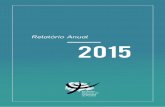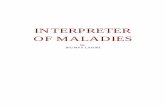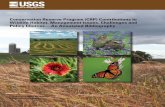CRP : Nouveau marqueur pour le pronostic des maladies cardiovasculaires
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of CRP : Nouveau marqueur pour le pronostic des maladies cardiovasculaires
Introduction
Dans la plupart des littératures récentes, il s'avère que la protéi-ne C-réactive n'est pas uniquement un indicateur sensible pourdes inflammations, mais peut également pronostiquer le risqued'un infarctus du myocarde. Les réactions inflammatoires jouentun rôle important dans l'athérosclérose. Dans le cas d'athérosclérose, il y a une activité augmentée desglobules blancs (cellules actives de la défense). Un stimulus constant des globules blancs cause une réactionchronique d'inflammation qui finalement peut mener aux consé-quences redoutées de l'athérosclérose. Les maladies vasculaires entraînent donc des inflammationschroniques et de ce fait on peut mesurer, dans le sang, desconcentrations légèrement augmentées de la protéine inflam-matoire, CRP. Il s'agit de très faibles augmentations qu'on peutuniquement détecter au moyen de la CRP ultrasensible. Ridker etses collaborateurs(1), ont récemment publié un algorithme per-mettant de pronostiquer le risque de troubles cardiovasculairesau moyen des mesures de la CRP et du cholestérol.
CRP : Nouveau marqueur pour le pronosticdes maladies cardiovasculaires
Les facteurs de risque dans le dévelop-pement de l'athérosclérose
Suivant l'Organisation Mondiale de la Santé, 4 millions de gensmeurent annuellement en Europe suite à des maladies cardio-vasculaires. A mesure que la population vieillit, ce problème croî-tra plutôt que de diminuer. Les facteurs de risque cardiovasculai-re sont très bien connus et les facteurs classiques sont : fumer,
Tension sanguine ≤140/90 mm HgIndice de masse corporelle 21-25 kg/m2
Taille < 102 cm<88 cm
FumerLipides (NCEP)
Cholesterol total <200 mg/dLCholesterol LDL <100 mg/dL
Cholesterol HDL >40 mg/dLTriglycérides <150 mg/dL
Age (hommes ≥ 45 ans; femmes ≥ 55 ans)DiabèteHomocystéïne < 124 µmol/L = valeur à atteindreLp(a) > 30 mg/dL
Facteurs de risque non-influençables Le génotype Apo-E: l'allèle Apo ∈ 4 est plus fréquemment présentchez des individus atteints d'athérosclérose, d'athérosclérose coro-naire vérifiée angiographiquement et chez des survivants d'un infarc-tus du myocarde.
Tableau 1: aperçu des valeurs cibles des facteurs de risque pour l'athé-rosclérose.
l'hypertension, l'excédent de poids, le diabète mellitus, unehaute teneur en cholestérol, une ménopause prématurée, peud'activité physique et l'historique familiale. Les hommes ont unrisque plus élevé d'athérosclérose que les femmes. Après laménopause ce risque augmente chez les femmes, de sortequ'avec la vieillesse, les hommes et les femmes ont à peu prèsle même risque. Les maladies cardiovasculaires sont des affections appelées mul-tifactorielles. La littérature récente révèle que les inflammationsjouent un rôle central dans l'apparition de maladies vasculaires.
Inflammation et risque cardiovasculaire
Les constatations suivantes indiquent une relation possible entreles symptômes inflammatoires et le développement de maladiescardiovasculaires.
Les plaques athérosclérotiques sont fortement infiltrées par desmonocytes et des cellules T activées qui sont attirés par les LDLoxydés dans la paroi vasculaire. Les monocytes se transforment en macrophages qui absorbent etstockent du cholestérol et se retransforment en cellules spu-meuses. Les monocytes et cellules T activées sécrètent des cyto-kines et des facteurs de croissance, comme l'interleukine 1 et 2,le facteur de nécrose tumorale (TNFα), l'interféron (IFNγ) et lefacteur stimulant les colonies (CSF). La concentration sérique des protéines de phase aiguë comme laCRP, l’amyloïde A sérique (SAA), le fibrinogène et l'interleukine 6,est augmentée chez des patients athérosclérotiques. La numéra-tion leucocytaire totale corrèle avec la gravité de la maladie car-diaque(2). Dans la littérature, il y a pas mal d'indications que laCRP est impliquée dans le développement des affections cardio-vasculaires. Pourtant, il n’est pas certain que la CRP soit la consé-quence ou la cause de l'athérosclérose. Il s'avère de plus en plusque les inflammations, et par conséquent également la CRP, sontimpliquées de façon active dans la pathogenèse des affectionscardiovasculaires(3).
Libby & Ridker(4) illustraient le rapport entre l'athérosclérose etdes marqueurs sériques élevés selon le pathway suivant.L'inflammation, générale ou locale, dans le vaisseau sanguin ousur un autre endroit, déclenche la production de cytokines pro-inflammatoires multipotentes, à savoir IL-1β ou TNF-α. Ces cyto-kines primaires stimulent les cellules endothéliales et d'autrescellules jusqu'à la production de molécules d'adhésion, de pro-coagulants et d'autres médiateurs qui sont libérés sous formesoluble dans le sang circulant. Les cytokines primaires stimulentaussi la production de la cytokine "messager", l'IL-6, qui assurel'expression de gènes hépatiques qui codent pour des réactantsde la phase aiguë présents dans le sang, comme la CRP et l’amy-loïde A sérique. La source des cytokines inflammatoires qui appa-raissent en cascade, n'est pas encore connue. Pourtant, des études prospectives épidémiologiques montrent
Guido Vranken Technical Marketing ManagerTél. 09 243 77 16 • [email protected] • Analis NV/SA • Leeuwerikstraat 28 • 9000 Gent
que les mesures des marqueurs d'inflammation sérique à chaqueniveau de ce modèle, sont associées à un risque coronaire élevé.
La fonction de la CRP dans l'athéro-sclérose
Récemment, il a été démontré expérimentalement(5) que la CRPa des effets directs pro-inflammatoires et pro-athérosclérotiques.Des cellules endothéliales de la veine saphène humaine incubéesavec la CRP recombinante humaine sécrètent plus d'endothéline-1 (ET-1, hormone vasoconstrictrice) et d'IL-6. La CRP simplifiel'expression des molécules endothéliales d'adhésion cellulaire,stimule la production de MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein-1, qui joue un rôle important dans le recrutement des monocytesdans les vaisseaux sanguins) et de la phagocytose du LDL par desmacrophages. De plus, ces effets semblent dépendants de l'ET-1et l'IL-6 et sont affaiblis par du bosentan, un antagoniste desrécepteurs de l’endothéline et des anticorps anti-IL-6. Ces don-nées(5) suggèrent des rapports pathophysiologiques entre la CRP,l'ET-1 et l'IL-6 et confirment le modèle de Libby & Ridker(3).
Vous trouverez ci-dessous, et ce de manière non exhaustive desindications prouvant qu'il existe un rapport entre la CRP et lapathogénèse de l'athérosclérose. La CRP agrégée se lie au LDL etaux VLDL du sérum frais(2). La CRP native se lie aussi bien au LDLoxydé(6) qu'au LDL partiellement décomposé par des enzymes, quiest présent dans les plaques athéromateuses et qui active le com-plément. La CRP renforce de façon significative cette activation(7)
et elle est présente dans la plupart des plaques étudiées ex-vivo(8).Cette CRP active le système complément et est donc pro-inflam-matoire. L'addition de la CRP au LDL dans des systèmes de cultu-re cellulaire, stimule la production des cellules spumeuses qui sonttypiques des plaques athérosclérotiques(9). On ne sait pas si celaindique une opsonisation des particules LDL par la CRP ou s'il s'agitd'un effet de la CRP sur des cellules phagocytantes. La CRP stimu-le in-vitro la production du facteur tissulaire (c-à-d la thrombo-plastine, un activateur important du système de coagulation) pardes monocytes sanguins périphériques, ce qui signifie que la CRPpeut jouer un rôle important lors de l’activation de la coagula-tion(10). La CRP stimule la production de MCP-1(11).
La CRP réduit de façon active l'expression et la bioactivité de l'en-zyme eNOS (oxyde nitrique synthase endothéliale) dans les cel-lules épithéliales humaines de l'aorte(12). L'oxyde nitrique, prove-nant de l'eNOS, stimule la vasodilatation artérielle, inhibe la pro-lifération de cellules musculaires lisses, l'oxydation des LDL, l'ad-hésion de plaques, l'agrégation et l'adhésion des monocytes àl'endothélium. On suppose que le dysfonctionnement endothélialavec une activité eNOS diminuée, se produit tout au début del'athérogénèse.
Une étude récente(13) établit de façon convaincante le rapportentre la CRP et la formation de caillots de sang, l'une des causesles plus importantes d'un infarctus du myocarde ou d'une apo-plexie. La CRP incite les cellules endothéliales de l'aorte à pro-duire de plus grandes concentrations de l’Inhibiteur ActivateurPlasminogène 1. Des hautes concentrations de l’InhibiteurActivateur Plasminogène 1 (PAI-1) dans le sang empêchent unebonne dégradation d'un caillot sanguin. Ensuite, ce caillot san-guin obstrue le vaisseau et abîme le tissu sous-jacent, ce quimène à la formation de plaque. La CRP est donc étroitementimpliquée dans l'athérosclérose. La protéine cause des inflam-mations dans les vaisseaux ce qui provoque des caillots et laplaque, pouvant mener à un infarctus du myocarde et une apo-plexie. Cela signifie que le médecin, en se basant seulement surle cholestérol, peut sérieusement sous-estimer le risque de pos-sibles cardiopathies.
La CRP comme facteur de risque car-diovasculaire
Dans le " Physicians Health Study ", Ridker et ses collaborateurs(14)
ont étudié l'effet d'une inflammation sur le risque cardiovascu-laire ainsi que l’intérêt de l’'aspirine pour prévenir un infarctus etune attaque. 543 hommes ayant eu dans les 8 ans un infarctusdu myocarde, un infarctus cérébral ou une thrombose, ont étécomparés avec 543 hommes sans complications.Cette étude a montré que lorsque le taux sanguin de la protéineC-réactive inflammatoire augmentait, le risque de complicationsvasculaires augmentait également. Sur base de leurs résultats hs-CRP, les sujets ont été répartis en quartiles. Les chercheurs ontcalculé le risque relatif des affections cardiovasculaires par quar-tile. Le risque d'un infarctus du myocarde augmente de 1 à 2,9lors d'une augmentation de la concentration sanguine en CRP de0,5 mg/L à 2 mg/L. Le risque relatif d'un infarctus cérébral aug-mente d'un facteur 2 lors d'une augmentation identique en CRP.En ce qui concerne la thrombose veineuse, il n'y a pas de diffé-rence entre les quartiles (Figure 1). L'aspirine baisse de 56 % lerisque relatif des personnes ayant la plus haute concentration deCRP (P = 0,02).
Figure 2: Physicians Health Study. Risque relatif d'un premier infarctus du myocarde,associé avec les concentrations de ligne de base de la CRP. La réduction de risquerelatif associée à l'aspirine, dépend fortement du niveau de CRP (voir texte). (Modifiéselon Ridker et al. N Eng J Med. 1997; 336:973-979).
CRP : NOUVEAU MARQUEUR POUR LE PRONOSTIC DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 2 ANALIS NV/SA
Figure 1: CRP et le risque cardiovasculaire; Physicians’ Health Study. Le graphiquemontre la relation entre la CRPH et le risque d'un infarctus du myocarde, d'une attaqueischémique et d'une thrombose chez des hommes apparemment sains. Le risque d'uninfarctus du myocarde et d'une attaque augmente significativement en cas d'augmenta-tion de la concentration de CRPH.Ces données sont très intéressantes car les teneurs lipidiques, et en particulier le cho-lestérol LDL, sont des prédicteurs très modérés d’apoplexie. (Modifiées selon Ridker etal. N Eng J Med. 1997; 336:973-979). Concentrations de CRP: Q1 ≤ 0,55 mg/L; Q2 =0,56 – 1,14 mg/L; Q3 = 1,15 – 2,1 mg/L; Q4 ≥ 2,11 mg/L.
Dans les deuxième et troisième quartiles, la réduction de risquerelatif induite par l'aspirine est assez significative, respective-ment de 33,4 et 46,3 %. Dans le groupe ayant la concentrationde CRP la plus faible, la réduction de risque relative existe, maisest limitée (13,9 %; P = 0,77). Cela signifie qu'on ne peut pasattendre des bénéfices de l'aspirine chez des personnes sainesavec de faibles concentrations en CRP (Figure 2).
Ridker(15) a utilisé les données de la cohorte PHS pour comparerl'efficacité relative d'un certain nombre de marqueurs quant aupronostic d'un infarctus du myocarde futur chez des hommesapparemment sains d'âge moyen. Cette étude prospectivemontre que la hs-CRP est un pronostiqueur simple, le plus puis-sant du risque de MI, mais que le meilleur marqueur est la com-binaison hs-CRP et le ratio cholestérol total/cholestérol HDL. Ceschercheurs(16) ont constaté également que la CRP améliore lavaleur prédictive du ratio cholestérol total/cholestérol HDL pourla détermination du risque d'un premier infarctus du myocarde.Toutefois, il s'avère que les hommes ayant de faibles etmoyennes valeurs de cholestérol peuvent avoir un risque élevéet sont uniquement identifiés moyennant un screening combinéde CRP et cholestérol. Cela signifie que les mesures de CRP ini-tiales ont une valeur ajoutée quant à l'évaluation du risque d'unpremier infarctus du myocarde.
D'autres études ont confirmé la valeur de la hs-CRP en tant quefacteur de risque indépendant pour les maladies cardiovascu-laires(17). Dans une 'étude prospective' 28 263 femmes sainespostménopausées ont été suivies pendant 3 ans. La valeur dutest de CRP comme facteur de risque pour des incidents cardio-vasculaires a été comparée avec d'autres facteurs de risque(Figure 3). La hs-CRP, l’amyloïde A sérique, l'interleukine-6, lamolécule 1 d'adhésion intercellulaire soluble (sICAM-1), l'homo-cystéïne et un nombre de paramètres lipidiques et lipoprotéiquesont été dosés comme marqueurs. Les points finaux cardiovascu-laires suivants ont été étudiés : décès par maladie coronarienne,attaque et infarctus du myocarde non fatal ou la nécessité d'exé-cuter une procédure de revascularisation coronaire. Des quartilesont été déterminés et pour chaque marqueur, le risque relatifd'individus dans le quartile le plus élevé a été calculé par rapportà ceux du quartile le plus bas. La CRP et le rapport du cholestérol total sur le cholestérol HDL(TC/HDLC) sont les meilleurs marqueurs pour les incidents car-diovasculaires. De plus, la CRP et le ratio TC/HDLC sont indépen-dants l'un de l'autre, de sorte qu'ils peuvent être utilisésensemble pour calculer un risque cumulé. Il est aussi intéressantque l’amyloïde A sérique (un marqueur non spécifique d'inflam-mation) et les valeurs plasmatiques du sICAM-1 (un marqueurmoléculaire associé à l'adhésion et à la transmigration des leu-cocytes à travers la paroi endothéliale), sont de meilleurs mar-queurs que le Cholestérol LDL et le Cholestérol total, qui se trou-vent seulement au milieu du range d'efficacité des marqueurs.Rifai et Ridker(1) ont calculé les risques cumulés avec la CRP et leratio TC/HDLC. Les personnes chez lesquelles les deux marqueurssont très élevés, ont un risque relatif d'avoir une maladie car-diaque coronarienne (CHD – coronary heart disease), qui est 9 xplus élevé que celui des personnes ayant des valeurs dans lequintile le plus bas pour ces deux paramètres (Figure 4).
Dans une méta-analyse de 14 études de population prospectivesde longue durée et comprenant 2 557 patients ayant une CHD, lerisque relatif de CHD a été déterminé au moyen des mesures deCRP(18). Le risque relatif de CHD a été calculé pour les individus dutiers le plus haut de la population par rapport à ceux du tiers leplus bas de la distribution de la CRP. Il y a une bonne concordan-ce entre les études (P > 0,1). Les personnes du groupe de CRP leplus haut, ont un risque de CHD deux fois plus haut que les per-sonnes du groupe de CRP le plus bas (RR = 1,9; 95%CI = 1,5 – 2,3).
Figure 3: Risque futur: un ratio élevé en cholestérol total/HDL-cholestérol (TC/HDLC),combiné à une valeur élevée en CRP, donne un risque relativement élevé d’avoir unproblème cardiovasculaire dans le futur. Données provenant du Women’s Health Study(WHS), modifiées par Ridker PM et al. N Eng J Med 2000; 342:836-834. Le risquerelatif est le rapport Q4/Q1 ; les lignes horizontales représentent un intervalle deconfiance de 95% (95%CI) pour l’effet. La ligne de 95%CI de Lp(a) coupe l'axe verticalavec un risque relatif de 1. Du point de vue statistique, cela signifie que ce paramètreest un moins bon marqueur de risque pour des événements cardiovasculaires futurs.
Figure 4: Risque cardiovasculaire relatif basé sur le quintile de CRPH, combiné avec lequintile du ratio TC/HDLC. Des personnes chez lesquelles les deux marqueurs sont for-tement élevés, ont un risque relatif 9x plus grand que chez des personnes ayant desvaleurs provenant du quintile le plus bas.Pour des personnes issues du quintile TC/HDL le plus bas, le risque relatif peut aug-menter plus de 2x quand les teneurs en CRPH augmentent.
Le risque obtenu a été corrigé en tenant compte du fait de fumeret des autres facteurs de risque vasculaire classiques. Les concen-trations de CRP moyennes estimées dans le tiers le plus haut et leplus bas de la population, sont respectivement de 2,4 et de 1,0mg/L. Dans une cohorte partielle (506 cas et 1 025 contrôles)l’odds ratio basé sur la CRP, diminue significativement (d'un fac-teur 1,6) après correction pour les facteurs de risque traditionnels.Sans fournir directement la preuve d'une relation causale entrel'inflammation et la CHD, les auteurs concluent que leurs donnéesmontrent que les processus d'inflammation sont importants pourla CHD.
Le cholestérol LDL est considéré comme l'un des plus grands mal-faiteurs dans le processus athérosclérotique. Ridker et ses colla-borateurs(19) ont étudié le cholestérol LDL et la hs-CRP comme fac-teurs de risque et ont comparé leur capacité à pronostiquer unemaladie cardiovasculaire chez les femmes. Environ 28 000femmes saines ont été suivies pendant 8 ans. Lors d'une aug-mentation de la hs-CRP de 0,5 à 4,2 mg/L, le risque d'avoir un
CRP : NOUVEAU MARQUEUR POUR LE PRONOSTIC DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 3 ANALIS NV/SA
premier incident cardiovasculaire augmente de 1 à 2,3 (P < 0,001). De femmes ayant une concentration en cholestérolLDL supérieure à 154 mg/dL (le quintile le plus haut) ont unrisque relatif accru de 1,5 de développer un premier incident car-diovasculaire. Les deux marqueurs ont une haute valeur pronos-tique pour des incidents cardiovasculaires futurs. Des femmesayant un haut taux plasmatique de ces deux marqueurs, ont unrisque élevé et vice versa. Une autre constatation intéressante, est que les femmes ayantdes faibles concentrations de LDL et des hautes concentrations deCRP, ont un plus grand risque que celles ayant des hautes valeursde LDL et des faibles valeurs de CRP. La corrélation entre les deuxparamètres est très petite (r = 0,08), ce qui signifie que chaquemarqueur individuel identifie un autre groupe de risque. Celasignifie que la valeur pronostique de la combinaison est plusgrande que celle des marqueurs individuels. Dans la cohorte étu-diée, 77 % des premiers incidents cardiovasculaires se présen-tent chez des femmes ayant des concentrations de cholestérolLDL inférieures à 160 mg/dL et 46 % chez des femmes ayant desvaleurs inférieures à 130 mg/dL. Selon les directives du NCEP(National Cholesterol Education Program) des valeurs de choles-térol LDL inférieures à 100 mg/dL sont optimales, des valeursentre 100 et 129 presque optimales, des valeurs entre 130 et 159mg/dL légèrement élevées, des valeurs entre 160 et 189 éle-vées et des concentrations supérieures à 190 très élevées. Celasignifie que trois quarts de tous les incidents surviennent chezdes patients ayant une concentration en cholestérol LDL légère-ment élevée. Presque la moitié des incidents se présente chezdes femmes ayant des concentrations presque optimales. Laconclusion des auteurs(19) est que la CRP est un marqueur plusperformant pour les incidents cardiovasculaires que le cholestérolLDL et que la CRP ajoute une information pronostique à celleobtenue avec le Score de Risque de Framingham. Suivant certainsauteurs cela signifie que la CRP a gagné définitivement sa posi-tion entre le LDLC, l'HDLC, la tension sanguine et d'autres facteursde risque en tant qu'indicateur important de l'état de santé(20).
Chez les patients ayant un angor instable, la CRP est associée àun risque élevé d'incidents récurrents(21). Chez 53 patients avec unangor instable, la hs-CRP a été déterminée à des moments diffé-rents pendant l'hospitalisation. Les patients ont été divisés endeux groupes suivant leur valeur de hs-CRP, c.à.d. ceux ayant uneCRP > 3 mg/L et ceux ayant une CRP < 3 mg/L. Les patients ontété suivis pendant un an. Les décès ainsi que les réhospitalisa-tions suite à un infarctus du myocarde ou un angor instable ontété notées. Les résultats sont représentés dans la figure 5. Lespatients ayant une faible concentration en CRP, ont un bienmeilleur pronostic. De plus, dans les deux groupes de CRP il n'y apas de différence entre les patients sans ou avec revascularisa-tion. Cela signifie qu'à la sortie de l'hôpital, des hautes valeurs deCRP pourraient identifier des patients à risque pouvant bénéficierd'un éventuel traitement anti-inflammatoire, même après une
revascularisation réussie. Vu l'ampleur de la cohorte étudiée, cesrésultats doivent être considérés comme une hypothèse.
Récemment(22), la CRP a été comparée avec le FCRS (FraminghamCoronary Heart Disease Risk Score) calculé sur 10 ans dans uneétude représentative, portant sur 1666 individus sans maladiecardiovasculaire. La CRP corrèle de façon significative avec le FCRScalculé sur 10 ans pour des hommes et des femmes sans théra-pie hormonale (HRT). Chez les femmes ayant une thérapie hor-monale, la CRP ne corrèle pas avec le FCRS. Dans l'étude, lesfemmes ayant une HRT ont une CRP initiale plus haute que desfemmes sans HRT. Selon les auteurs, cette différence et l’absencede corrélation entre la CRP et le FCRS chez des femmes avec HRP,seraient dues aux effets 'first-pass' d'oestrogènes oraux sur lasynthèse hépatique de la CRP. Il y a une corrélation minimaleentre la CRP et les composantes individuelles du FCRS. De plus, laCRP a une valeur pronostique ajoutée dans tous les groupes derisque du score de risque de Framingham sur 10 ans(23). Celaconfirme l'hypothèse que la CRP est un marqueur potentielvalable pour une stratégie globale de la stratification du risquecardiovasculaire.
Pour examiner la relation entre la CRP et le risque d'une apo-plexie ischémique et d'une attaque ischémique intermittente(TIA), 591 hommes et 871 femmes de la cohorte originale deFramingham d'âge moyen de 70 ans et sans apoplexie/TIA ontété suivis pendant 12 à 14 ans. Pendant cette période, il y a eu196 cas d'apoplexie ischémique et de TIA. La CRP a été diviséedans des quartiles de CRP dépendants du sexe. Le risque relatifcorrigé multivariant pour les hommes (RR = 1,248; P = 0,0365) etles femmes (RR = 1,288; P = 0,0084) à travers les quartiles deCRP est statistiquement significatif. Le risque relatif a été corrigéen tenant compte de l'âge, du fait de fumer, du rapport choles-térol total/HDL, de la pression artérielle systolique et du diabète.Au moyen de cette étude, le groupe de Framingham a démontréque la CRP peut pronostiquer de façon significative et indépen-dante d'autres facteurs de risque, le risque d'une apoplexie isché-mique future et de TIA chez des personnes plus âgées(24).
D'autres études(25), montrent que la CRP peut pronostiquer desévénements récurrents et/ou une mortalité augmentée chez despatients ayant une apoplexie ischémique, des syndromes coro-naires aigus, une angine de poitrine chronique stable et des
Figure 5: Survie de patients ayant une angine de poitrine instable pendant un an.Pendant la période de suivi, les décès et réhospitalisations suite à un infarctus dumyocarde ou un angor instable ont été enregistrés. Des patients ayant une teneuren CRP inférieure à 3 mg/L ont un meilleur pronostic que le groupe ayant uneconcentration de CRP supérieure à 3 mg/L. Il n'y a pas de différence de survieentre les patients avec ou sans revascularisation dans les deux groupes de CRP.
CRP : NOUVEAU MARQUEUR POUR LE PRONOSTIC DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 4 ANALIS NV/SA
affections vasculaires périphériques. Une augmentation de la CRPpour une intervention coronarienne percutanée et un pontagecoronarien donne un moins bon pronostic. La CRP est corréléeavec la corpulence abdominale et des valeurs augmentées pro-nostiquent le risque de développer un diabète de type 2.
Effet des médicaments sur la CRP
On peut prévoir que les médicaments anti-inflammatoires ont uneffet sur la concentration de CRP. Les médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens, commel'aspirine et l'ibuprofène, réduisent le stress oxydatif(26). Les effetsde l'aspirine sur la CRP ne sont pas tout à fait clairs. Il s'est avéréque l'aspirine n'a pas d'effet sur la CRP de volontaires sains (27, 28).Par contre, une dose d'aspirine de 300 mg/jour diminue consi-dérablement la teneur en CRP de patients ayant une angine depoitrine stable (SAP)(29). Toutefois, la concentration en CRP dugroupe SAP est plus élevée que celle des volontaires sains. La CRPest un indicateur de risque d'un infarctus du myocarde futur chezdes hommes affectés d'une maladie artérielle du membre infé-rieur ((Lower extremity arterial disease) (LEAD)) qui ne prennentpas d'aspirine. Ce n'est pas le cas chez des hommes atteints deLEAD qui ont bien pris de l'aspirine(30). Une petite dose d'ibupro-fène chez des fumeurs diminue la teneur en CRP(31). Les statines ou inhibiteurs de l’hydroxy-3-méthyl-3-glutaryl-coen-zyme A réductase (HMG-CoA-réductase) réduisent le LDL-choles-térol et le risque cardiovasculaire. Une méta-analyse de treizeétudes avec contrôle placebo, a montré que les statines rédui-saient les concentrations médianes de CRP de 13 à 50 %(32). Aucours de ces études, une diminution moyenne de – 0,5 mg/L aété constatée. La diminution de CRP a varié, à l'exception d’unoutlier, de 0 à –3,1 mg/L. Aussi bien l'atorvastatine, la lovastati-ne que la pravastatine, réduisent la CRP. Jusqu'à présent, il n'y aqu'une étude qui démontre l'avantage de l’utilisation de statinespour des personnes ayant une CRP augmentée(33). Récemment,lors d'une analyse rétrospective post hoc des données del’AFCAPS/TexCAPS, une étude clinique randomisée en doubleaveugle avec un contrôle placebo (RCT) a été réalisée pour savoirsi un traitement à la lovastatine serait efficace chez des per-sonnes ayant des niveaux de CRP normalement hauts. Les parti-cipants ont été divisés en 4 groupes selon leur teneur en LDL-C etCRP (tableau 2). Les patients avec un niveau de LDL-C au-dessusde la médiane de 149 mg/dl, bénéficient nettement du traite-ment à la lovastatine quelle que soit leur valeur en CRP. Lenombre de personnes nécessitant d’être traitées (The numbers
Points finauxGroupe d’étude N Lovastatin Placebo NNT sur
5 ans
LDL-C bas/CRP basse 726 0,025 0,022 -LDL-C bas/CRP élevée 718 0,029 0,051 48
LDL-C élevé/CRP basse 709 0,020 0,050 33LDL-C élevé/CRP élevé 741 0,038 0,055 58
Médiane LDL-C = 149 mg/dLMédiane CRP = 1,6 mg/L
Modifié suivant Ridker PM et al. N Engl J Med 2001; 344:1959-1965.
Tableau 2: Combinaison de la CRP avec le LDL-C comme méthode pourorienter la thérapie à la statine lors d’une prévention primaire:AFCAPS/TexCAPS.
NNT= Number Needed to Treat : Ce nombre détermine combien de per-sonnes doivent être traitées en vue de prévenir un futur problème supplé-mentaire d’une maladie déterminée.
needed to treat : NNT) dans ces deux groupes, est de 33 et 58.Cependant, il y a des différences marquées entre les 2 autresgroupes, c-à-d les groupes ayant des faibles valeurs de LDL-C (<149 mg/dl). Le nombre de points finaux dans le sous-groupe duplacebo du groupe de LDL-C bas/CRP élevée est aussi importantque dans les groupes de LDL-C élevé. Il est intéressant de noterque les personnes dans le groupe de LDL-C bas/CRP élevée,bénéficient autant du traitement à la lovastatine que ceux dugroupe avec des lipides élevés. Le NNT dans ce groupe est de 48.Les individus du groupe LDL-C bas/CRP basse ont peu de pointsfinaux et la lovastatine n'a pas d'effet dans ce groupe. Selon lesauteurs, ces résultats sont hypothétiques et ils suggèrent que laCRP peut être utilisée pour la prévention primaire d'affectionscardiovasculaires et pour commencer le traitement aux statineschez des personnes sans hyperlipidémie.De plus, selon la littérature(34), il s’avère que les avantages de lathérapie à la statine sont plus importants que ce qu’on peutattendre des modifications uniquement liées au profil lipidique.Ainsi, les statines ont de multiples effets positifs, indépendam-ment du cholestérol, sur les cellules de la paroi vasculaire. Ilsaméliorent la fonction endothéliale, inhibent la prolifération etl'hypertrophie des cellules musculaires lisses, augmentent la sta-bilité des plaques athérosclérotiques et réduisent le stress oxy-datif et l'inflammation vasculaire.
Biochimie de la CRP
La fonction physiologique de CRP est principalement de déclen-cher des mécanismes de défense non-spécifiques contre desinfections et d'aider les macrophages à éliminer la lipoprotéinemodifiée. La CRP initialise l'opsonisation, la phagocytose et lalyse d'organismes étrangers au corps, comme les bactéries et lesvirus. Elle est chimiotactique pour les granulocytes neutrophileset elle active le complément(35).Dans le passé, la CRP a surtout été utilisée comme protéine de laphase aiguë. Mais ce terme est quelque peu trompeur, car la CRP,tout comme les autres protéines de la phase aiguë, peut aussiêtre augmentée par des affections chroniques. Le test de CRP estsurtout utilisé pour des infections aiguës, pour suivre les inflam-mations et ainsi évaluer l'effet du traitement, mais aussi commepremière orientation lors de plaintes générales du patient.L'utilisation de la CRP comme protéine de la phase aiguë estreprésentée en bref dans le tableau 3:
Des valeurs de CRP élevées ont été constatées pour des infectionsbactériennes. Dans ce cas, les concentrations peuvent augmentertrès rapidement d'un facteur 500 à 1000. Lors des infectionsvirales, la CRP augmente dans une moindre mesure. La CRP estdécelable dans le sérum de patients ayant une destruction tissu-laire, une arthrite rhumatoïde, la Maladie de Crohn et assimilées.On constate une très légère augmentation et/ou des valeurs nor-males chez des patients atteints de lupus érythémateux systé-
CRP : NOUVEAU MARQUEUR POUR LE PRONOSTIC DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 5 ANALIS NV/SA
Augmentation en cas de:• Infection bactérienne• Infection à champignons• Inflammation : phase active d'arthrite rhumatoïde et de Maladie de
Crohn • Des tumeurs malignes•Des interventions médicales et blessures graves
Cut-off entre 5 et 10 mg/LAugmentation détectable après 6-8 heuresAugmentation maximale dans les 48 heuresBaisse rapide lors de guérisons
Tableau 3: importance clinique de la CRP en tant que protéine de laphase aiguë (adapté suivant 36)
mique (SLE), du syndrome de Sjögren, de colite ulcéreuse, dedermatomyosite et de leucémie. La CRP est détectable après 6 ou8 heures et atteint des valeurs maximales après 48 heures. Dansla plupart des infections inflammatoires, il y a une bonne corré-lation entre l'activité de l'inflammation et le niveau de CRP. Desdosages sériels sont alors utilisés pour suivre l'activité de la mala-die. A la guérison, la concentration en CRP diminue plus rapide-ment que la vitesse de sédimentation(37). Du fait que la CRP estrapidement produite et éliminée, il s'agit d'un bon marqueurpour la manifestation et la disparition d'une infection (ou blessu-re) aiguë (ou non).
Quand la CRP est utilisée en tant que marqueur d'inflammation,le cutoff se situe entre 5 mg/L et 10 mg/L. Au moyen desméthodes de routine traditionnelles et des techniques néphélo-métriques classiques, on peut mesurer avec une précision accep-table jusqu'à environ 1 mg/L. Cependant, les méthodes de rou-tine ne sont pas assez sensibles pour pouvoir mesurer la concen-tration en CRP de la plus grande partie de la population saine. Lestechniques sensibles ELISA ont permis de démontrer que lesteneurs en CRP de personnes saines, sont considérablement plusfaibles que les cutoff utilisés et que les valeurs de CRP hautementnormales, qui sont aussi considérablement plus bas que lescutoff, sont corrélées avec un risque élevé de maladies cardio-vasculaires.
Aujourd'hui, il est possible de déterminer au moyen de tests sen-sibles, le spectre complet de valeurs de CRP chez une populationsaine. Ces tests appelés 'hautement sensibles' utilisent le plussouvent des méthodes renforcées de particules et ont une sensi-bilité jusqu'à environ 0,1 – 0,2mg/L. Récemment, BeckmanCoulter Inc. a développé des tests de CRPH 'ultrasensibles' pour lenéphélomètre Immage et l’analyseur de chimie clinique SynchronLX 20 PRO. Ci-après (tableau 4) est représenté un aperçu de lasensibilité analytique et fonctionnelle des tests CRPH de BeckmanCoulter. Ces valeurs ont été comparées avec les performances dunouveau test de C-RP pour les systèmes Synchron LX-CX(38). Selonune étude récente, il s'avère que le nouveau test C-RP de routineest approprié pour des dosages de 1 à 3 mg/L. Cela signifie quele nouveau test C-RP de routine peut être utilisé comme une pre-mière approche rudimentaire pour évaluer le risque cardiovascu-laire. Cette proposition sera approfondie plus loin.
La plupart des méthodes CRP sont standardisées suivant la normeCRM 470. Par conséquent, les différentes méthodes corrèlent très
Test Appareil Méthode Sensibilité Sensibilité fonctionnelle analytique
CRPH Immage NIPIA 0,11 mg/L 0,2 mg/LCRPH LX20PRO NIPIA 0,18 mg /L 0,2 mg/LC-RP LX systemen Turbidimétrie ≤ 0,8 mg/L 1 mg/LC-RP CX systemen Turbidimétrie ≤ 1,3 mg/L 2 mg/L
Tableau 4 : Sensibilité fonctionnelle et analytique des tests CRPH deBeckman Coulter et des nouveaux tests de routine C-RP pour les sys-tèmes Synchron
Test CRP Système BCInc Test de référence Gamme de mesure (mg/L) N R Intercepte (SE) Pente (SE)
CRPH LX20 PRO BNA N high sensitivity reagent 0,3 – 9,6 62 0,988 0,007 (± 0,087) 1,1236 (± 0,0223)CRPH Immage BNA N high sensitivity reagent < 10 62 0,991 0,02 0,967CRPH LX20 PRO Immage CRPH 0,2 – 60,0 143 0,996 -0,19 0,983CRPH LX20 PRO BNA N high sensitivity reagent 0,3 – 80,0 141 0,994 -0,36 (± 0,297) 1,011 (± 0,0093)C-RP LX20 BNA II high sensitivity reagent 0,6 – 9,9 43 0,994 -0,029 (± 0,087) 0,955 (± 0,017)
Tableau 5: Analyse de corrélation et de régression de Deming entre les tests CRP (mg/L) de Beckman Coulter et le test à haute sensibilité BNA N;N= nombre d'échantillons; R = coefficient de corrélation; SE = erreur standard
CRP : NOUVEAU MARQUEUR POUR LE PRONOSTIC DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 6 ANALIS NV/SA
bien les unes avec les autres. Ceci est représenté dans le tableau 5qui reprend pour les valeurs < 100 mg/L, la corrélation entre lestests de Beckman Coulter et les tests de BNII –BNA haute sensibi-lité. Tous les coefficients de corrélation® sont environ égaux à0,99 ce qui veut dire que les résultats corrèlent bien les uns avecles autres. Les interceptes sont pratiquement égaux à zéro. Parcontre, les pentes diffèrent bien de 1, ce qui indique une faiblemais significative hétérogénéité proportionnelle entre les tests. La concordance entre un certain nombre de méthodes sélection-nées (Synchron LX20 PRO CRPH, Synchron C-RP et BNA hs-CRP) estanalysée au moyen des graphes de Bland & Altman (Fig.7A, B, C).Vu que le SD des tests de CRP dépend du niveau de CRP, la diffé-rence entre les 2 méthodes est exprimée comme un pourcentagede la moyenne des deux méthodes. Le graphe 7A (CRPH entre 0et 80 mg/L; N = 141) montre des différences entres les méthodes(LX20PRO versus BNA) pour des concentrations inférieures à 10mg/L. Le graphe 7B montre un détail des concentrations entre 0et 10 mg/L (groupes 1 et 2 de la figure 8). A partir de 1 mg/L ily a une assez bonne concordance entre les deux méthodes (dif-férence moyenne en pourcentage de -12,5%, SD = 9,8%). Pour cegroupe (groupe 2 avec une CRP entre 1 et 10 mg/L), la différen-ce moyenne absolue est de 0,5 mg/L (95% CI: 0,34 à 0,64 mg/L)et les résultats de CRPH du LX20PRO sont plus élevés que ceux duBNA (Fig. 8A; P< 0,001). Pour les concentrations très faibles enCRPH (groupe 1: CRP inférieure à 1 mg/L), les différences peuventmonter jusqu'à 80 %. Cependant, la différence moyenne absolueentre les méthodes est seulement de 0,14 mg/L (95% CI: 0,09 à0,2 mg/L). Il n'y a pas de grande différence entre les moyennesde ce groupe (ts=1,6; df=20; P=0,1321)( voir aussi le graphe deBox-and-whisker (Fig. 8B)). Le graphe 7C représente une bonneconcordance entre le test Synchron C-RP et le test BNA high sen-sitivity. Le test C-RP a une sensibilité jusqu'à 1 mg/L. Les résultatsdiffèrent seulement de 3,6 % (SD = 12,1 %), ce qui correspond àune différence absolue de 0,2 mg/L (95% CI: 0,13 à 0,32 mg/L).Il n'y a pas de différence significative entre les deux méthodes (C-RP et BNA) (H = 0,269; P = 0,604).Pour des concentrations inférieures à 5 mg/L, les CV totaux pourles méthodes CRP de BCInc, sont à 5%. Ces données indiquent unebonne qualité analytique des méthodes CRPH et une variabilitéinter série tout à fait satisfaisante.
Test Appareil CRP CV Variation maximaleen mg/L total (%) du résutat
(x ± 3SD)
CRPH Immage 0,8 5,2 0,67 – 0,92CRPH Immage 13,4 3,8 -CRPH LX20PRO 0,7 5,1 0,59 – 0,81CRPH LX20PRO 15,3 4,1 -C-RP LX20 4,9 3,45 4,39 – 5,41C-RP (1) LX20 15,4 1,86C-RP (2) LX20 15,2 1,56
Tableau 6 : Variabilité analytique des tests de CRPH et C-RP deBeckman Coulter
(1): University of Rostock, Germany (39)(2): Cliniques Universitaires Saint-Luc Bruxelles (38)
Figure 7a. CRPH (mg/L) PlotA: comparaison LX20PRO et BNA
Figure 7c. C-RP (mg/L) PlotC : comparaison LX20 et BNAFiguur 7b. CRPH (mg/L) Plot B : comparaison LX20PRO et BNA
Figure 8a. Graphe de Box-and-whisker CRPH (mg/L): comparaison de la distribu-tion des données entre BNA et LX20PRO (1 mg/L<CRPH < 10 mg/L)
Figuur 8b. Graphe de Box-and-whisker CRPH (mg/L): comparaison de la distribu-tion des données entre BNA et LX20PRO (CRPH < 1 mg/L)
CRP : NOUVEAU MARQUEUR POUR LE PRONOSTIC DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 7 ANALIS NV/SA
Figure 6. comparaison entre les valeurs (mg/L) obtenues avec le BNA (Hs-CRP, latex,Dade) et le LX20PRO (CRPH, Beckman Coulter); R = 0,988 (P < 0,001); moyenne X= 3,1 mg/L (95%CI: 2,6 –3,7) et moyenne Y = 3,5 mg/L (95%CI: 2,9 –4,2).
Pour classer les individus dans les 3 groupes de risque présentéspar le CDC et l'AHA, le test LX20PRO CRPH, le test LX/CX C-RP etle test " Dade Behring high sensitivity " sont utilisés. Les tableaux7 et 8 donnent un aperçu des résultats. Conformément à la direc-tive AHA/CDC, les données de plus de 10 mg/L n'ont pas été uti-lisées. Il y a une concordance de 87 % entre le test LX20PRO CRPHet le test Dade Behring Hs-CRP, ce qui indique une bonne concor-dance dans le classement (Kappa = 0,795; SE = 0,068). Entre letest BCInc C-RP et le test BNII high sensitivity, la concordance estde 98,3 % et la statistique Kappa est égale à 0,975 (SE=0,025),ce qui montre une classification presque identique des individusdans les classes de risque préétablies.
Dade Behring Hs-CRP
<1 1 – 3 > 3 ∑< 1 11 0 0 111 –3 0 17 0 17> 3 0 8 26 34∑ 11 25 26 62
Tableau 7: Concordance entre le test LX20PRO CRPH et le kit BNA HSCRP par rapport aux limites de risque présentés par le CDC et l'AHA.
Dade Behring BNII Hs CRP
<1 1 – 3 > 3 ∑< 1 18 0 0 181 –3 1 17 0 18> 3 0 0 24 24∑ 19 17 24 60
Tableau 8: Concordance entre le test LX20 C-RP et le Dade BehringBNII HS CRP.
LX20
PRO
- HC
RPLX
20 C
-RP
Valeurs normales
Avec les nouvelles techniques de CRP ultrasensible, des nouvellesvaleurs de référence pour les personnes saines ont été établies.Chenillot et ses collaborateurs ont publié des statistiques trèsdétaillées pour 3 605 individus de la cohorte de Stanislas(40). La dis-tribution des valeurs de CRP est non-gaussienne et plus précisé-ment "squewness". Le pic de distribution se situe en dessous de0,4 mg/L. La valeur moyenne augmente avec l'âge de 1 à 2mg/L. La CRP moyenne augmente avec l'âge et la différenceentre les hommes et les femmes est petite. Des limites de réfé-rence ont été établies pour 1853 individus ou 51,4 % du panel,après élimination des facteurs qui corrèlent positivement avec laCRP, comme le nombre de leucocytes, le BMI, le fait de fumer, laprise de médicaments ou de contraceptifs oraux et une Hb < 120g/L. Les valeurs de référence sont représentées dans le tableau 9.
Limites de référence issues de 1853 sujets après exclusion de 48,6 % des sujets ayant des facteurs influençant la CRP (mg/L)
Sexe Hommes FemmesAge (ans) 5 – 13 14 - 18 19 – 39 40 – 49 5 -18 19 - 49
N 388 255 150 156 566 33850ème percentile 0,21 0,28 0,54 0,66 0,21 0,5775ème percentile 0,47 0,61 0,85 1,42 0,54 1,0490ème percentile 0,86 1,4 1,68 2,76 1,1 2,2995ème percentile 1,45 2,13 2,68 4,8 1,9 3,3397.5ème percentile 2,4 3,55 4,08 6,4 3,23 4,31
Tableau 9: Valeurs de référence CRP de la cohorte de Stanislas(40).
Hutchinson et al.(41) ont publié des résultats de CRP de 2 popula-tions adultes d'Augsburg (N = 4494) et Glasgow (N = 1254), quisont comparables à la cohorte de Stanislas. La concentrationmédiane de CRP est d'environ 1 mg/L dans la décade la plusjeune et double jusqu'à environ 2 mg/L dans le groupe le plusvieux. L'effet de facteurs biologiques qui corrèlent positivementavec la CRP n'a pas été corrigé. Par conséquent, des valeurs plusélevées par rapport à la cohorte de Stanislas ont été observées.De plus, la CRP n’a pas de variations diurnes(42) et saisonnières(43)
ce qui n’est pas le cas d'autres protéines de la phase aiguë.
Variabilité biologique, valeurs decutoff et de décision clinique
Pour une réponse à la phase aiguë, une valeur de cutoff biendéfinie à savoir la limite de référence supérieure ‘upper referen-ce limit' (URL) ou le percentile 95 de la population est utilisée.Pour les tests de Beckman Coulter, le URL est de 7,4 mg/L. UnURL de 7,7 mg/L pour une population néerlandaise a été obte-nu; les hommes ont des valeurs légèrement plus basses que lesfemmes, respectivement de 6,4 et 8,1 mg/L(44). Dans la pratique,on utilise régulièrement une valeur de 10 mg/L, ce qui donneune zone grise d'environ 3 mg/L. En travaillant avec une zonegrise, le risque de faux positifs diminue sensiblement.
Pour les algorithmes de risque cardiovasculaires, l'école de Ridkerutilise des quintiles, des quartiles et ensuite des tertiles.Récemment, l'AHA/CDC(45) a présenté trois catégories de risquerelatif, avec un risque bas, moyen et haut, qui , grosso modo, cor-respondent avec les tertiles de la distribution de CRP chez despersonnes saines. Le problème, avec l'interprétation des donnéesd'une analyse de risque, basée sur des tertiles (ou d'autres per-centiles), est que la variation biologique n'est pas prise en comp-
CRP : NOUVEAU MARQUEUR POUR LE PRONOSTIC DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 8 ANALIS NV/SA
Etude
Statistique Macy et al. 1997 Valeurs De Maat et al 96 De Maat et al 96 Ockene et al.(47) acceptées (48) (population 2001 (49)
généralement d’angor) (48)
CVA (%) 5,2 10 5 5 5CVI (%) 42,2 30 14 9 22CVG (%) 92,5 84 86 81 78II: Index of Individuality 0,46 0,38 0,17 0,13 0,29Critical difference % 118 88 41 29 63(at P ≤ 0.05)N (14 % desirable 35 20 4 2 10precision, suivant Campbell et al., 2002) (50)
Tableau 10: Analyse de variabilité et performance de test de CRP (mg/L) suivant Fraser.
te. Or, l'un des composants de la variation biologique de CRP, lavariation biologique intra-individuelle, est considérable(46). La variabilité intra-individuelle de la CRP varie grandement selonl'étude, mais est estimée en général à environ 30 %. Les coeffi-cients de variation analytiques totaux des tests de CRPH sontenviron de 5 %. Le tableau 10 donne, pour les valeurs publiéesde la variabilité biologique et analytique, un certain nombre destatistiques liées à la performance du test de CRP. Le nombred'échantillons (N) nécessaires permettant de dire, avec une cer-titude de 95 %, que l'estimation dévie au maximum de 10 ou 14% de la valeur réelle, a également été calculé.
La différence critique entre deux valeurs successives varie sérieu-sement selon l'étude. Si on prend p.ex. le CVi intra-individuel leplus petit c-à-d de 9 %, la concentration en CRP devra alors êtremodifiée de 29 % pour être statistiquement importante. Pour leCVi le plus grand, elle est de 118 %. Le tableau 11 représente les modifications des concentrations cli-niquement significatives pour un certain nombre de concentra-tions en CRP ainsi que le nombre d'échantillons nécessaires pourpouvoir confirmer ceci avec une certitude de 95 %. Dans les cal-culs, une précision souhaitée de 10 % (AHA/CDC) et de 14 %(50)
a été utilisée. Le biais maximal admissible pour obtenir une clas-sification fiable avec les quintiles de Ridker(50) est de 14 %.De ces calculs, il ressort qu'il n'est pas toujours simple de faire desclassifications univoques moyennant 2 prises d'échantillons.Contrairement à l'argumentation statistique, on constate dans lapratique, et plus particulièrement lors du suivi de personnessaines, qu'il y a relativement peu d'outliers(47, 51). La littératuremontre que la concentration en CRP chez des personnes stables,est relativement constante et basse avec seulement un petit
CVA: coefficient analytique de variation CVI: coefficient biologique de variation du sujetCVG: coefficient biologique de variation entre sujetsII= index of individuality ª CVI/CVGCritical difference = 21/2*Z*(CVA2+ CVI2)1/2
N = [Z*(CVA2 + CVI2)1/2 /D]2; N= nombre d'échantillons nécessaires permettantavec une certitude de 95 % d’approximer la moyenne réelle.D = % de déviation de la moyenne réelle Z = score Z bidirectionnel pour une probabilité de 95 %.
Référence Valeur cible Différence Nbre d’échantillons Nbre d’échantillons(mg/L) critique (mg/L) nécessaires nécessaires
(précision = 10 %) (précision = 14 %)
AHA/CDC 1 0,4 8 4AHA/CDC 2 0,8 8 4AHA/CDC 3 1,2 8 4PHS hommes sains 1,13 0,5 8 4PHS apoplexie ischémique 1,38 0,6 8 4PHS MI 1,51 0,6 8 4
pourcentage d'outliers (< 5 %). La variation intra-individuelle dela CRP est surtout élevée pour des concentrations plus élevées(mais encore normales). Le CVi de la CRP est relativement grand(~30 %). Cependant, cette variation longitudinale des individusest petite par rapport à la variation biologique totale (CVc), desorte que le CVi < 0,5*CVc. Par conséquent, il est possible seloncertains, de situer le résultat dans la grande distribution biolo-gique(52) avec 1 échantillon de sang. Toutefois, à cause de cegrand CVi, le risque de mal classifier les individus est assez élevépar rapport aux valeurs de cutoff multiples. Afin de limiter cesmauvaises classifications, l'AHA/CDC propose d'utiliser des ter-tiles approximatifs au lieu des quintiles. Westgard va encore plusloin, et il suggère, en concordance avec le cholestérol total, detravailler uniquement avec un groupe à risque élevé, un groupeà bas risque, et une zone grise entre les deux. La zone grise peutêtre considérée comme une marge de sécurité pouvant compen-ser la variation analytique et préanalytique et pouvant prévenirune mauvaise classification. Kluft & de Maat(51) proposent de tra-vailler avec 2 classes de risque et une valeur de cutoff de 3 mg/L.La corrélation intra-classes pour les 2 groupes a une valeurmoyenne de r = ~0,5, ce qui implique que 20-25 % des individusont changé de classe. Ce nombre est réduit en travaillant avecdeux échantillons.
Pour justifier les algorithmes de l'analyse de risque et une classi-fication basée sur des valeurs de cutoff médicaux, Ockene et al(49, 53) ont analysé la concordance entre le premier et seconddosage de CRP chez 113 individus. 63 % des individus ont étéclassés dans la même classe de CRP et 90 % dans un quartile(kappa = 0,479; 95%CI = 0,39-0,60). La concordance entre laclassification d'individus dans des quartiles au moyen de mesures
Tableau 11: Différence critique(mg/L) pour un certain nombrede concentrations en CRP dansle cas d’une approximation durisque cardiovasculaire ainsique le nombre d'échantillonsnécessaires pour pouvoirprendre des décisions avecune certitude de 95 %. (La pré-cision souhaitée est de 10 % etde 14 %, voir texte; CVA = 5 %et CVI =4 %; CVG = 86 %).
CRP : NOUVEAU MARQUEUR POUR LE PRONOSTIC DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 9 ANALIS NV/SA
successives est de 59,3 % avec une statistique kappa de 0,452(95% CI: 0,34 –0,56). Pour le cholestérol p.ex., la concordanceentre le premier et le deuxième dosage est également de59,3 % (Kappa = 0,456; 95% CI = 0,35-0,56). Ils ont argumentéqu'il est utile d'utiliser pour la CRP des valeurs de cutoff cliniques,car celles-ci sont basées sur le risque relatif. L'utilisation degroupes de risque ayant des concentrations différentes estlogique, vu que les paramètres avec une distribution non-gaus-sienne squewness sont une donnée biologique normale. Ainsi,les concentrations plasmatiques des triglycérides sont métaboli-quement et pathophysiologiquement importantes, malgré leurdistribution non-gaussienne et leur variabilité biologique intra-individuelle considérable.
Chez qui devrait-on mesurer la protéi-ne C-réactive ?
L'utilisation de la CRPH est recommandée en particulier dans lecas de prévention primaire (voir plus loin: la directive AHA/CDC).Dans la prévention primaire, l'estimation du risque se fait aumoyen des tableaux de risque. Les calculs qui sont à la base deces tableaux de risque sont issus d'une recherche épidémiolo-gique prospective à grande échelle, à savoir le Framingham HeartStudy. Il s'agit d’une étude de cohorte où 5345 habitants deFramingham ont été suivis pendant 12 années, pour la manifes-tation d'un point final comme un décès suite à une infection coro-naire, un infarctus du myocarde, une angine de poitrine ou uneinsuffisance coronarienne(54). L'algorithme de Framingham calcu-le un score de risque cardiovasculaire global individuel (FCRS)pour les 10 années suivantes. Dans le FCRS, des valeurs sont attri-buées aux facteurs de risque suivants : l’âge, le LDL-C ou le cho-lestérol total, l’HDL-C, la tension artérielle systolique, le fait defumer et le diabète. En totalisant les valeurs, on obtient un scorede risque global. Au moyen de ce score, les individus asympto-matiques sont divisés en trois groupes de risque : bas (<10 %),moyen ou intermédiaire (10 à 20 %) et haut (>20 %)(55). EnBelgique(56), on opte pour l'utilisation du "Joint British Societiescoronary prediction chart"(57), permettant de faire une différenceentre un risque bas (<15%), moyen (15-20%), élevé (20-30%) ettrès élevé (>30%) sur dix ans(56). Selon l'AHA/CDC, l'utilisationoptimale de la CRP permet l'identification de patients asympto-matiques ayant un FCRS intermédiaire de 10 à 20 % sur dix ans,et qui ont en fait un risque cardiovasculaire plus élevé qu'estimé.La valeur de la CRP peut alors être utilisée pour décider si oncommence un traitement (voir la directive AHA/CDC). Des direc-tives et recommandations sur le traitement et l'hygiène de viesont décrites en détail ailleurs (58, 59, 60), mais ne sont pas traitéesdans cet article.
Recommandations pour l'utilisation dela CRP hautement sensible
Récemment, l'American Heart Association et le Center of DiseaseControl ont publié dans la revue Circulation (2003:17: 499-511),des directives sur l'utilisation de hs-CRP. Ces recommandationsont été établies pour pronostiquer avec plus de certitude le risquepotentiel de maladies cardiovasculaires, au moyen des mar-queurs d'inflammation et des lipides.
Points les plus importants des directives AHA/CDCLes dosages de hs-CRP sont recommandés pour détecter unrisque élevé absolu chez des personnes ayant un score de risqueFramingham, indiquant le développement d'une maladie car-diaque coronaire pendant les 10 années suivantes, qui est situéentre 10 et 20 %. Aux Etats-Unis, cette catégorie représente envi-
ron 40 % des adultes. Par conséquent, le dépistage de hs-CRPchez la population adulte totale n'est pas conseillé. La hs-CRP estajoutée aux facteurs de risque classiques afin d'obtenir plus d'in-dications sur le risque absolu de maladies cardiovasculaires etpour réaliser une meilleure prévention primaire. Pour l'analyse de risque cardiovasculaire, trois catégories ont étédéfinies :Les personnes du groupe le plus élevé ont un risque relatif deuxfois plus grand que ceux du groupe le plus bas. Les trois groupesont été établis au moyen de la distribution des données de hs-CRP de plus de 15 populations comprenant plus de 40 000 personnes, ce qui garantit une évaluation fiable de la dis-tribution de population.
La hs-CRP est dosée deux fois, avec un intervalle de deuxsemaines, chez des patients métaboliquement stables. Lamoyenne est calculée et exprimée en mg/L.Des concentrations de hs-CRP persistantes de plus de 10 mg/Lindiquent une affection non-cardiovasculaire. Chez les patients avec un risque global intermédiaire (10-20% sur10 ans), la hs-CRP peut aider à l'évaluation directe et à la théra-pie de prévention primaire.
Un niveau de hs-CRP de plus de 3 mg/L (jusqu'à 10 mg/L) peut: a) mener à l'intensification de la thérapie pour réduire le
risque, b) motiver les patients à améliorer leur style de vie, c) inciter les patients à prendre rigoureusement leurs
médicaments.
Chez les patients avec une maladie coronaire stable ou des syn-dromes coronaires aigus, la hs-CRP peut être utile en tant quemarqueur indépendant pour estimer le risque d'incidents récur-rents (comme l'infarctus du myocarde, la resténose après uneintervention coronaire percutanée ou même la mort).
Les directives définissent un sous-groupe de patients pouvantbénéficier des tests de CRP. Pour la plupart des patients, l'accentreste sur la détection, le traitement et le contrôle des marqueursde risque classiques, comme la tension artérielle élevée, un hautniveau de cholestérol de sang, le fait de fumer et le diabète. Laprévention secondaire ne peut pas être dépendante de la hs-CRP.
Conclusion
La hs-CRP est un marqueur additionnel qui, outre le dépistage delipides, s'utilise pour la détection d'individus ayant un risqueélevé de MCC. Elle peut être utilisée pour mieux orienter la thé-rapie à la statine lors de prévention primaire. La hs-CRP a unevaleur pronostique pour les syndromes coronaires aigus. Un nou-vel objectif dans le traitement et la prévention d’un infarctus dumyocarde est la détection d’inflammation.
CRPH (mg/L) Risque de MCC
< 1 bas1 – 3 moyen> 3 (tot 10) haut
CRP : NOUVEAU MARQUEUR POUR LE PRONOSTIC DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 10 ANALIS NV/SA
CRP : NOUVEAU MARQUEUR POUR LE PRONOSTIC DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 11 ANALIS NV/SA
References1. Rifai N, Ridker PM. Proposed cardiovascular risk assessment algorithmusing high-sensitivity C-reactive protein and lipid screening. Clin Chem. 2001Jan;47(1):28-30.2. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J ClinInvest. 2003 Jun;111(12):1805-12. Review. Erratum in: J Clin Invest. 2003Jul;112(2):299.3. Calabro P, Willerson JT, Yeh ET. Inflammatory cytokines stimulated C-reac-tive protein production by human coronary artery smooth muscle cells.Circulation. 2003 Oct 21;108(16):1930-2.4. Libby P, Ridker PM. Novel inflammatory markers of coronary risk: theoryversus practice. Circulation. 1999 Sep 14;100(11):1148-50.5. Verma S, Li SH, Badiwala MV, Weisel RD, Fedak PW, Li RK, Dhillon B,Mickle DA. Endothelin antagonism and interleukin-6 inhibition attenuate theproatherogenic effects of C-reactive protein. Circulation. 2002 Apr23;105(16):1890-6.6. Chang MK, Binder CJ, Torzewski M, Witztum JL. C-reactive protein bindsto both oxidized LDL and apoptotic cells through recognition of a commonligand: Phosphorylcholine of oxidized phospholipids. Proc Natl Acad Sci U SA. 2002 Oct 1;99(20):13043-8.7. Bhakdi S, Torzewski M, Klouche M, Hemmes M. Complement and athero-genesis: binding of CRP to degraded, nonoxidized LDL enhances comple-ment activation. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1999 Oct;19(10):2348-54.8. Torzewski J, Torzewski M, Bowyer DE, Frohlich M, Koenig W, WaltenbergerJ, Fitzsimmons C, Hombach V. C-reactive protein frequently colocalizes withthe terminal complement complex in the intima of early atheroscleroticlesions of human coronary arteries. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1998Sep;18(9):1386-92.9. Zwaka TP, Hombach V, Torzewski J. C-reactive protein-mediated low den-sity lipoprotein uptake by macrophages: implications for atherosclerosis.Circulation. 2001 Mar 6;103(9):1194-7.10. Cermak J, Key NS, Bach RR, Balla J, Jacob HS, Vercellotti GM. C-reactiveprotein induces human peripheral blood monocytes to synthesize tissue fac-tor. Blood. 1993 Jul 15;82(2):513-20.11. Pasceri V, Cheng JS, Willerson JT, Yeh ET, Chang J. Modulation of C-reac-tive protein-mediated monocyte chemoattractant protein-1 induction inhuman endothelial cells by anti-atherosclerosis drugs. Circulation. 2001 May29;103(21):2531-4. Erratum in: Circulation 2001 Oct 16;104(16):1992.Chang J [corrected to Cheng JS].12. Venugopal SK, Devaraj S, Yuhanna I, Shaul P, Jialal I. Demonstration thatC-reactive protein decreases eNOS expression and bioactivity in human aor-tic endothelial cells. Circulation. 2002 Sep 17;106(12):1439-41.13. Devaraj S, Xu DY, Jialal I. C-reactive protein increases plasminogen acti-vator inhibitor-1 expression and activity in human aortic endothelial cells:implications for the metabolic syndrome and atherothrombosis. Circulation.2003 Jan 28;107(3):398-404.14. Ridker PM, Cushman M, Stampfer MJ, Tracy RP, Hennekens CH.Inflammation, aspirin, and the risk of cardiovascular disease in apparentlyhealthy men. N Engl J Med. 1997 Apr 3;336(14):973-9.15. Ridker PM. Evaluating novel cardiovascular risk factors: can we betterpredict heart attacks?Ann Intern Med. 1999 Jun 1;130(11):933-7.16. 1: Ridker PM, Glynn RJ, Hennekens CH. C-reactive protein adds to thepredictive value of total and HDL cholesterol in determining risk of first myo-cardial infarction. Circulation. 1998 May 26;97(20):2007-11.17. Ridker PM, Hennekens CH, Buring JE, Rifai N. C-reactive protein andother markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease inwomen. N Engl J Med. 2000 Mar 23;342(12):836-43.18. Danesh J, Whincup P, Walker M, Lennon L, Thomson A, Appleby P,Gallimore JR, Pepys MB. Low grade inflammation and coronary heart disea-se: prospective study and updated meta-analyses. BMJ. 2000 Jul22;321(7255):199-204.19. Ridker PM, Rifai N, Rose L, Buring JE, Cook NR. Comparison of C-reacti-ve protein and low-density lipoprotein cholesterol levels in the prediction offirst cardiovascular events. N Engl J Med. 2002 Nov 14;347(20):1557-65.20. Ross Jessica. C-Reactive Protein Surpasses LDL in Predicting
Cardiovascular Disease. November 21, 2002 http://www.heart1.com/news/mainstory_pf.cfm?newsarticle=66.21. Biasucci LM, Liuzzo G, Grillo RL, Caligiuri G, Rebuzzi AG, Buffon A,Summaria F, Ginnetti F, Fadda G, Maseri A. Elevated levels of C-reactive pro-tein at discharge in patients with unstable angina predict recurrent instabili-ty. Circulation. 1999 Feb 23;99(7):855-60.22. Michelle A. Albert, Robert J. Glynn, and Paul M Ridker. PlasmaConcentration of C-Reactive Protein and the Calculated FraminghamCoronary Heart Disease Risk Score. Circulation, Jul 2003; 108: 161 - 165.23. Ridker PM, Buring JE, Cook NR. C-Reactive Protein in the Prediction ofCardiovascular Events. N Engl J Med 2003; 348: 1060-61.24. Rost NS, Wolf PA, Kase CS, et al. Plasma concentration of C-reactive pro-tein and risk of ischemic stroke and transient ischemic attack: theFramingham Study. Stroke 2001;32:2575-9.25. Hackam DG, Anand SS. Emerging risk factors for atherosclerotic vasculardisease: a critical review of the evidence. JAMA. 2003 Aug 20;290(7):932-40.26. Zapolska-Downar D, Naruszewicz M, Zapolski-Downar A, Markiewski M,Bukowska H, Millo B. Ibuprofen inhibits adhesiveness of monocytes to endo-thelium and reduces cellular oxidative stress in smokers and non-smokers.Eur J Clin Invest. 2000 Nov;30(11):1002-10.27. Feng D, Tracy RP, Lipinska I, Murillo J, McKenna C, Tofler GH. Effect ofshort-term aspirin use on C-reactive protein. J Thromb Thrombolysis. 2000Jan;9(1):37-41.28. Feldman M, Jialal I, Devaraj S, Cryer B. Effects of low-dose aspirin onserum C-reactive protein and thromboxane B2 concentrations: a placebo-controlled study using a highly sensitive C-reactive protein assay. J Am CollCardiol. 2001 Jun 15;37(8):2036-41.29. Ikonomidis I, Andreotti F, Economou E, Stefanadis C, Toutouzas P,Nihoyannopoulos P. Increased proinflammatory cytokines in patients withchronic stable angina and their reduction by aspirin.Circulation. 1999 Aug24;100(8):793-8.30. MacCallum PK, Cooper JA, Price C, Meade TW. The predictive value of C-reactive protein (CRP) for myocardial infarction may be affected by aspirintherapy in men with lower extremity arterial disease. J Thromb Haemost.2003; 1Supplement 1 July: Abstract number OC038.31. Mainous AG 3rd, Pearson WS. Aspirin and ibuprofen: potential mediatorsof the cardiovascular risk due to smoking? Fam Med. 2003 Feb;35(2):112-8.32. Balk EM, Lau J, Goudas LC, Jordan HS, Kupelnick B, Kim LU, Karas RH.Effects of statins on nonlipid serum markers associated with cardiovasculardisease: a systematic review. Ann Intern Med. 2003 Oct 21;139(8):670-82.Review.33. Ridker PM, Rifai N, Clearfield M, Downs JR, Weis SE, Miles JS, Gotto AMJr; Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study Investigators.Measurement of C-reactive protein for the targeting of statin therapy in theprimary prevention of acute coronary events. N Engl J Med. 2001 Jun28;344(26):1959-65.34. Takemoto M, Liao JK. Pleiotropic effects of 3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme a reductase inhibitors. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2001Nov;21(11):1712-9. Review.35. Whicher J, Biasucci L, Rifai N: Inflammation, the acute phase responseand atherosclerosis. Clin Chem Lab Med 1999; 37: 495-50336. Hinzmann RD, New indications for C-Reactive protein. From acute phaseprotein to cardiovascular risk marker. Diagnostic Today;4: 4-6.37. http://memoboek.de-san.nl/inhoud/klinchem/crp.asp38. Wawrzyniak J, De Nayer P, Philippe M. Evaluation of the performances ofthe new Synchron® C-RP reagent in the determination of the atheroscleroticrisk in apparently healthy patients. Clin Chem , 2003; 49(6), A113, AbstractD-85.39. Bastian M, Kohlschein P, Bartels P, Schneider KP, Schuff-Werner P. 2003.Evaluation of a new turbidimetric CRP test for the Beckman Coulter SynchronLX 20 systems. Poster K38XU Euromed Lab (IFCC) 2003 Barcelona.40. Chenillot O, Henny H, Steinmetz J, Herberth B et al.: High sensitivity C-reactive protein: biological variations and reference limits. Clin Chem LabMed 2000; 38: 1003-1011.41. Hutchinson WL, Koenig W, Frohlich M, Sund M, Lowe GD, Pepys MB.
Immunoradiometric assay of circulating C-reactive protein: age-relatedvalues in the adult general population. Clin Chem. 2000 Jul;46(7):934-8.42. Meier-Ewert HK, Ridker PM, Rifai N, et al. Absence of diurnal variation ofC-reactive protein concentrations in healthy human subjects. Clin Chem.2001;47:426–430.43. Frohlich M, Sund M, Thorand B, Hutchinson WL, Pepys MB, Koenig W.Lack of seasonal variation in C-reactive protein. Clin Chem. 2002Mar;48(3):575-7.44. Rothkrantz-Kos S, Schmitz MP, Bekers O, Menheere PP, van Dieijen-Visser MP. High-sensitivity C-reactive protein methods examined. Clin Chem.2002 Feb;48(2):359-62.45. Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, Anderson JL, Cannon RO 3rd,Criqui M, Fadl YY, Fortmann SP, Hong Y, Myers GL, Rifai N, Smith SC Jr,Taubert K, Tracy RP, Vinicor F; Centers for Disease Control and Prevention;American Heart Association. Markers of inflammation and cardiovasculardisease: application to clinical and public health practice: A statement forhealthcare professionals from the Centers for Disease Control and Preventionand the American Heart Association. Circulation. 2003 Jan 28;107(3):499-511.46. Fraser CG. Biological Variation: From Principles to Practice. Washington,DC. AACC Press, 2001.47. Macy EM, Hayes TE, Tracy RP. Variability in the measurement of C-reacti-ve protein in healthy subjects: implications for reference intervals and epide-miological applications. Clin Chem. 1997 Jan;43(1):52-8.48. de Maat MP, de Bart AC, Hennis BC, Meijer P, Havelaar AC, Mulder PG,Kluft C. Interindividual and intraindividual variability in plasma fibrinogen, TPAantigen, PAI activity, and CRP in healthy, young volunteers and patients withangina pectoris. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1996 Sep;16(9):1156-62.49. Ockene IS, Matthews CE, Rifai N, Ridker PM, Reed G, Stanek E. Variabilityand classification accuracy of serial high-sensitivity C-reactive protein mea-surements in healthy adults.Clin Chem. 2001 Mar;47(3):444-50.50. Campbell B, Badrick T, Flatman R, Kanowski D. Limited clinical utility ofhigh-sensitivity plasma C-reactive protein assays. Ann Clin Biochem. 2002Mar;39(Pt 2):85-8.51. Kluft C, de Maat MP. Determination of the habitual low blood level of C-reactive protein in individuals. Ital Heart J. 2001 Mar;2(3):172-80. Review.52. Cotlove E, Harris EK, Williams GZ. Biological and analytic components ofvariation in long-term studies of serum constituents in normal subjects. 3.Physiological and medical implications. Clin Chem. 1970 Dec;16(12):1028-32. No abstract available.53. Ockene IS, Matthews CE, Rifai N, Ridker PM, Reed G, Stanek E. Letter tothe editor. Problems with high-sensitivity C-reactive protein. Clin Chem. 2003Jan;49(1):201; author reply 201-2.54. Wilson PW, D'Agostino RB, Levy D, Belanger AM, Silbershatz H, KannelWB. Prediction of coronary heart disease using risk factor categories.Circulation. 1998 May 12;97(18):1837-47.55. Mosca L, Appel LJ, Benjamin EJ, Berra K, Chandra-Strobos N, FabunmiRP, Grady D, Haan CK, Hayes SN, Judelson DR, Keenan NL, McBride P, OparilS, Ouyang P, Oz MC, Mendelsohn ME, Pasternak RC, Pinn VW, Robertson RM,Schenck-Gustafsson K, Sila CA, Smith SC Jr, Sopko G, Taylor AL, Walsh BW,Wenger NK, Williams CL; American Heart Association; American College ofCardiology; American College of Nurse Practitioners; Amercian College ofObstetricians and Gynecologists; American College of Physicians; AmericanMedical Women's Association; Association of Black Cardiologists; Centers forDisease Control and Prevention; National Heart, Lung and Blood Institute,National Institutes of Health; Office of Research on Women's Health; Socieyof Thoracic Surgeons; World Heart Federation. Evidence-based guidelines forcardiovascular disease prevention in women. J Am Coll Cardiol. 2004 Mar3;43(5):900-21.56. http://inami.fgov.be/other/nl/drug/farmanet/consensus/2002%2D05%2D28/lv%2Dnl.pdf57. Education and debate: British Cardiac Society, British HyperlipidaemiaAssociation, British Hypertension Society, and British Diabetic AssociationJoint British recommendations on prevention of coronary heart disease in cli-nical practice: summary BMJ, Mar 2000; 320: 705 - 708.
58. Pearson TA, Blair SN, Daniels SR, Eckel RH, Fair JM, Fortmann SP,Franklin BA, Goldstein LB, Greenland P, Grundy SM, Hong Y, Miller NH, LauerRM, Ockene IS, Sacco RL, Sallis JF Jr, Smith SC Jr, Stone NJ, Taubert KA.AHA Guidelines for Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Stroke:2002 Update: Consensus Panel Guide to Comprehensive Risk Reduction forAdult Patients Without Coronary or Other Atherosclerotic Vascular Diseases.American Heart Association Science Advisory and Coordinating Committee.Circulation. 2002 Jul 16;106(3):388-91. Review.59. http://www.nzgg.org.nz/guidelines/0035/CVD_Risk_Summary.pdf60. http://www.americanheart.org/downloadable/heart/1076443898227AHA%20CVD%20Guidelines%20(lay%20version)%202-2-0411.doc
Guido VrankenTél. 09 243 77 16
[email protected] NV/SA
Leeuwerikstraat 289000 Gent
© ANALIS 2004
CRP : NOUVEAU MARQUEUR POUR LE PRONOSTIC DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 12 ANALIS NV/SA
—Remerciements
Nous tenons à remercier le Prof. Dr X. Bossuyt (KUL) et le Dr J. Van Cleemput (KUL) pour leurs remarques et adaptationsainsi que pour la relecture approfondie de la première versiondu texte.