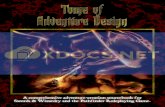Bhairava et les Mères au Bengale septentrional, Arts Asiatiques, Paris, tome XLV, 1990, pp. 61-66
Transcript of Bhairava et les Mères au Bengale septentrional, Arts Asiatiques, Paris, tome XLV, 1990, pp. 61-66
Claudine Bautze-Picron
Bhairava et les Mères
au Bengale septentrional
Lors d'un récent passage à Calcutta, nous avons eu l'occasion d'étudier et de photographier la collection d'images bengalies et biharies conservée dans les réserves de l'Indian Museum1. Une stèle2 a, parmi de nombreuses autres, retenu notre attention. Outre son iconographie particulière, c'est aussi son état de conservation (seuls le nez et la main gauche devant la poitrine
sont ébréchés) ainsi que les qualités plastiques évidentes dont cette image témoigne, qui nous ont convaincu de la publier.
Le lieu de découverte de cette stèle se situe dans le district occidental de Dinajpur (West Dinajpur district)3, plus précisément à Bhairâttâ comme le mentionne Enamul Haque4, le seul, à notre connaissance, à avoir cité et même décrit sommairement l'image avant qu'elle n'entre dans les collections de l'Indian Museum : «One 10-armed pot-bellied dancing image from Bairhatta (Dinajpur) resembles almost exactly Type-2 above except that it shows the god with fives heads, all with jatâ. Flames are coming out of the body. The right hands hold the khadga, bâna, parasu, varada and kapdla, and the left khetaka, dhanu, abhaya, nâgapâsa and trisûla. On the lower prabhâvalî and the pedestal eight 4-armed pot-bellied males and females are dancing holding various weapons in their hands. We do not know any dhyâna which identifies this deity5». Cet auteur n'eut probablement à sa disposition que la photographie de petites dimensions qu'il reproduit6, ce qui expliquerait qu'il ne reconnaît pas les Mâtrkà dans les danseurs masculins (sic!) et féminins de la partie inférieure et qu'il relève le parasu à la place du trisûla et le trisûla à celle du khatyânga.
Plusieurs images ont été découvertes à Bhairâttâ et ses environs, le plus souvent réduites à l'état de fragments7. Une représentation de Sùrya assis retient notre attention, son iconographie étant particulière. Bien préservée, cette stèle est sensiblement contemporaine de l'image considérée ici8. Les deux images offrent néanmoins plusieurs points de divergence en ayant les mêmes motifs (colliers, vidyâdhara...) traités différemment ou en intégrant des motifs variés au même endroit (kïrtimukha ou ornement floral...). En revanche, la stèle de l'Indian Museum que nous étudions présentement, partage plusieurs éléments avec des stèles découvertes en d'autres lieux du Bengale. Nous sommes confrontés ici à une situation généralisée dans l'histoire de la statuaire du Bengale, à savoir que la production y a été des plus abondantes du IX' au XIIe siècle, mais que le développement n'est appréhendé que dans ses grandes lignes. Les lieux précis de trouvaille des œuvres, bien que souvent connus, ne sont pas considérés9.
Le dieu se trouve, en position de danse, debout sur la pointe du pied gauche, la jambe droite repliée à hauteur de la cuisse gauche. Il a cinq faces visibles : deux sont profilées de chaque côté du visage principal. Il a cinq paires de bras armés
différemment, le ventre pansu et les faces grimaçantes. 3iva10 porte la jatâ composée de bandes verticales de mèches épaisses superposées; de part et d'autre du chignon central, on relève quatre coques latérales, surmontées comme la jatâ médiane, d'un bouton de lotus. Le croissant lunaire est glissé sous les mèches verticales qui constituent l'axe du chignon devant lequel est posé un fleuron. Un diadème plat ceint cette coiffe; deux anses perlées encadrant trois courts pendants se rattachent à une grosse fleur épanouie; deux fleurons triangulaires sont profilés au-dessus des tempes. Sous ces fleurons, sont accrochés au diadème des médaillons circulaires derrière lesquels s'échappent deux petits serpents. Un rang de disques plats cerne la base du chignon, identique à la guirlande qui tombe sur les cuisses. Une ligne de bouclettes marque la ligne supérieure du front, parallèle au diadème. De plus larges bouclettes, combinées à ces incisions parallèles, indiquent la barbe du dieu. La moustache aux pointes remontantes souligne la lèvre supérieure. La bouche est entrouverte, laissant apparaître une rangée de dents. Les yeux sont exorbités et un troisième oeil est incisé au milieu du front. Le nez est brisé mais il présentait probablement la silhouette offerte par les nez latéraux, busqués et pointus. Des larges médaillons qui ornent les oreilles s'échappent deux serpents.
Un serpent s'enroule autour de chaque poignet tandis qu'un brassard composé d'un ornement triangulaire auquel s'accrochent de petites anses orne le haut des bras. Un upavita composé d'un serpent, traverse la poitrine. Un large collier composé de fleurs fermées qui tombent de part et d'autre d'un joyau élaboré et bordé d'un rang perlé ceint le cou. Des lignes incisées indiquent les plis du cou. Sous le ventre, est accrochée la ceinture composée de anses perlées alternant avec des pendeloques. Un pendant plus long tombe entre les jambes (fig. 3 : partie supérieure du pendant ; fig. 1 : fleuron terminal). Une guirlande de disques aplatis pend sur les cuisses; elle correspond peut-être à la guirlande de calottes crâniennes. Deux anneaux auxquels sont accrochées des clochettes ornent les chevilles. Une peau de tigre ceint les hanches de la divinité.
De haut en bas, le dieu présente dans ses mains droites : l'épée (khadga), la flèche (bâna), le trident (trisûla), la paume de la main ouverte vers le bas, ornée d'un disque et la calotte crânienne (kapâla) tenue devant la poitrine (fig. 2). Et dans ses mains gauches : le bouclier (khetaka), l'arc (dhanu), la paume de la main ouverte, les doigts relevés, le serpent (nâgapâsa) et le khatyânga redressé (fig. 3).
Le dieu se tient sur un homme couché sur le dos, la tête appuyée sur la main gauche, le bras droit ramené sur la poitrine et la jambe droite repliée par-dessus la jambe gauche étendue. Il porte le chignon ceint du diadème et une jupe resserrée par une
61
'* ' >.-••;-, "•- * '^-vA'.i 7f'/y^/n -^^w Aw-i«Ps ..^---* -
g. 7. Bhairava, Indian Museum (photo J. Bautze).
ceinture. Cet homme est étendu sur un lotus à double corolle, chacune composée de plusieurs rangs de pétales superposés. La tige épaisse de ce lotus coupe le socle en deux parties égales. De part et d'autre de cette tige qui s'enfonce dans une base composée de deux corolles symétriques de pétales aux bords déchirés, se déroulent deux volutes florales achevées par deux grosses fleurs aux pétales également découpés.
Le dieu se détache devant une large mandorle marquée de deux rangs concentriques de flammes. La clef de la dalle est ornée d'un élément floral dont il est difficile de préciser la nature. Sur un rang épanoui de pétales, un bouton encore fermé domine le motif tandis que deux anses sont accrochées à ce rang, partiellement dissimulées par la mandorle flammée.
A un niveau inférieur, deux vidyddhara sont figurés en position de vol, sur fond de nuage. Ils portent une guirlande. Bottés, ils sont revêtus d'une courte dhotï et d'un châle au travers de la poitrine. Leur tiare est composée de rouleaux superposés dont le diamètre se réduit progressivement.
Dans la partie inférieure de la dalle, quatre déesses, chacune nantie de quatre bras, sont représentées en position dansante. Quatre autres déesses sont introduites dans le décor du piédestal et c'est ensemble qu'il convient de les étudier.
La partie inférieure du socle est composée d'une suite de trois bandeaux parallèles interrompus au milieu par un élément triangulaire inscrit. La longue inscription dédicatoire court sur le large bandeau inférieur à la droite de l'homme agenouillé qui offre une guirlande et qui est probablement le donateur cité par l'inscription (fig. 4 et 5).
Enamul Haque a relevé quarante-trois exemples de représentations du dieu qui entrent dans la catégorie des ugramûr- tiu. En revanche, il a comptabilisé cent quatre-vingt-quatre images illustrant différentes saumyamûrti12. Est-ce à dire que les ugramûrti sont minoritaires? Non, si l'on se rappelle que sous la dénomination saumyamûrti, entrent des sous-types fort variés, comme î>ivaparinaya, Natarâja, Sadâsiva, voire des représentations du dieu seul debout.
Dans la catégorie des ugramûrti, les variations sont plus réduites : elles se marquent principalement à l'attitude du dieu (debout, dansant ou non, en âlïdha- ou pratyâlîdhâsana), secondairement au nombre de bras. D'une manière générale, les dénominations saumya et ugra reposent sur l'expression du visage, paisible ou terrifiante13.
Certains types ou sous-types iconographiques14 sont aisément identifiables en étant identiques à des formes décrites par les textes. Or, dans la plupart des cas, ces mêmes textes demeurent silencieux. Certains éléments d'une image peuvent être cités, d'autres ne sont pas évoqués et relèvent exclusivement de l'iconographie plastique (par exemple, la fleur et les guirlandes en clef de stèle)15. Dans ces conditions, l'identification (c'est-à-dire le fait de donner un nom) pourrait paraître abusive si nommer n'était impératif. L'image a reçu un nom particulier lorsqu'elle était vénérée, nom que nous ignorons le plus souvent mais qui peut apparaître dans l'inscription, si l'image en comporte une, comme c'est le cas ici où le dieu est fort à propos nommé Bhairava16. Dans l'absence d'inscription et lorsque l'iconographie de l'image ne coïncide parfaitement avec aucune description littéraire, on ne peut se contenter de la mention « non identifié ». Aussi retenir un nom générique est à ce moment requis17. Ce nom nous semble aussi devoir être retenu si l'inscription révèle un nom local donné à la divinité18.
C'est un fait qu'en matière d'iconographie indienne, les auteurs se sont souvent arrêtés à un travail d'équivalence entre l'image sculptée et la description littéraire. Cette approche, pour nécessaire qu'elle soit, élimine néanmoins de la compré-
62
Vat-fa- ^V- -wr tfn^W ~: -
.^.- Li'" :&}' - -./ / J!B4 'V"TV^ê
O>.s*'-
Fig. 2. Détail (photo J. Bautze). Fig. 3. Détail (photo J. Bautze)
Fig. 4. Inscription (photo J. Bautze). Fj£. 5. Inscription (photo J. Bautze).
63
hension de l'image iconographique un certain nombre de motifs qui s'intègrent cependant à l'iconographie de l'œuvre19. Un élargissement de la compréhension du terme «iconographie» s'impose. Des éléments que certains jugent décoratifs20 comme le motif en clef de stèle, comme le lotus sous le dieu, la mandorle derrière la divinité ou encore les vidyâdhara sont iconographiques dans la mesure où ils aident à différencier le dieu des autres divinités figurées sur la stèle et à le distinguer par rapport à d'autres types iconographiques. Le lotus à double corolle comme la mandorle sont réservés dans le cas présent au seul dieu. Le motif floral à la clef de la stèle est relevé sur certains types ou sous-types iconographiques21, non sur d'autres. D'une façon générale, ce motif marque héraldique- ment les stèles çivaïtes du Bengale septentrional22. Il équivaut donc au kïrtimukha généralisé sur les images de Sûrya, Visnu ou Sadàsiva, entre autres.
coiffe à bourrelets superposés et que Càmundà ainsi que la huitième déesse ont les cheveux hérissés40. La disposition particulière des Mères permet de suggérer qu'elles forment avec Bhairava un mandata dont le dieu serait le centre41. On sait que l'ordre de ces divinités dans les panneaux qui les montrent en position assise ou dansante suit une séquence particulière qui se retrouve ici (celle-ci débutant avec Bràhmanï et s'achevant avec Câmundâ, de gauche à droite). La liste des Mâtrkâ varie selon les textes42. Dans certains cas, une huitième déesse est intégrée au groupe, nommée Mahâlaksmï par YAgni Purâna43. Les mêmes déesses sont aussi nommées Yoginï par le Garuda Purâna qui les distribuent aux huit orients44. La relation des Mâtrkâ et des Yogini apparaît aussi dans YAgni Purâna où à chaque Mâtrkâ correspondent huit Yogini45. Et les Yoginï ou les Mâtrkâ sont normalement associées à Bhairava ou à une autre hypostase de S"iva46.
La mandorle flammée est également réservée à certains types, tout en n'apparaissant qu'à époque tardive, les xie et XIIe siècles. Ces types sont hindous : Sûrya23, Bhairava24, Narasimha25, Agni26 ou bouddhiques : Hevajra27, Samvara28, Mârïcï29, Avalokitesvara30, Manjuvajra31 ou Mahâkâla32. Cette mandorle se silhouette ici parfaitement derrière Bhairava, en se rétrécissant vers le bas où elle semble prendre appui sinon sur le corps étendu, du moins sur le lotus épanoui et en se refermant en pointe sous l'ornement floral, au-dessus de la tête de la divinité. Les flammes en rangs concentriques recouvrent généralement toute la surface de la dalle de fond alors qu'ici, un espace libre est laissé dans la partie supérieure et de part et d'autre des jambes du dieu. La silhouette ovale de la gloire accentue le mouvement dansant du dieu, qui semble susciter cette mandorle. Les Mâtrkâ sont exclues de l'auréole flammée (à ne pas confondre avec le bandeau uni et plat qui longe le bord de la dalle et qui constitue une seconde auréole, généralisée à l'époque) alors que sur d'autres stèles couvertes des flammes, les divinités secondaires éventuellement représentées y sont comme incluses. Un rapprochement s'impose en revanche avec une autre représentation de Bhairava provenant de Deul- Talada, district de Rajshahi, ainsi qu'avec une de Hevajra découverte dans le district de Murshidabad33. Dans ces deux cas, le double rang flammé se déroule derrière les divinités en ne se confondant pas avec les bandes posées en bord de dalle. Le motif est aussi en bas relief (alors qu'il est le plus souvent incisé).
La position de danse est rarement accordée à Bhairava34. Elle est bien sûr celle définissant le sous-type Nataràja35 et est souvent adoptée par Câmundâ dont de nombreuses représentations sont connues au Bengale septentrional36. Elle peut aussi être observée en art bouddhique37.
Les huit Mâtrkâ sont représentées dans l'ordre suivant38 : Bràhmanï (trois faces); Mahesvarï (damaru, kapâla, trisûla notamment); Kaumàrï (lance, kapâla); Vaisnavï (massue, conque notamment); Vâràhï (épée, bouclier notamment); Indrànï (foudre, kapâla notamment); Câmundâ (couteau, kapa- 1a, khatvânga notamment) ainsi qu'une huitième déesse non identifiée (kapâla, damaru, khatvânga notamment). La petitesse des attributs rend parfois leur identification malaisée. Il est ainsi possible que l'objet allongé tenu par Vârâhï dans la main inférieure gauche, posée sur la hanche, soit le poisson39. Certaines déesses, Bràhmanï, Vârâhi ou encore la huitième, sont obèses. Dans l'ensemble, ces divinités portent divers ornements incisés (brassards, bracelets, collier, upavïta, jupe, anneaux de cheville). Leur coiffes varient : Bràhmanï, Mahesvarï et Indrànï peut-être aussi, portent la jatâ analogue à celle de Bhairava. Vaisnavï et Vârâhï portent la tiare alors que Kaumârï porte la
Plusieurs représentations de l'heptade des Mères nous sont parvenues du Bihar : elles sont dans l'ensemble datables des IXe et Xe siècles et illustrent toutes les Mères assises et accompagnées de âiva/Tumburu47. Comme le révèle aussi l'étude détaillée d'Enamul Haque, c'est en revanche un thème rarement illustré au Bengale, puisque cet auteur n'a catalogué que deux panneaux reproduisant l'heptade (alors qu'il réunit quelque quatre-vingts représentations isolées ou non, groupées en heptade, de Mères)48. Sur ces panneaux, les Mères sont représentées assises, accompagnées ou non de leurs vâhana respectifs alors qu'elles sont le plus souvent en position de danse sur les panneaux découverts en d'autres régions de l'Inde septentrionale49. Leur présence ici est donc remarquable à plus d'un point de vue : elles sont rarement observées en groupe au Bengale et elles n'y sont alors jamais représentées en position de danse. Cette attitude est en revanche fort souvent celle de Câmundâ représenté seule50 alors qu'au Bihar, on s'est davantage soucié de la représenter assise51.
On doit d'une façon générale souligner que les sources littéraires ne comportent aucune description qui conviendrait parfaitement à l'image ici considérée, observation qu'avait déjà faite Enamul Haque à propos des images de Bhairava dans leur ensemble52. Le Kàlikâ Purâna attribue cinq faces et dix bras au dieu, retient son aspect féroce et le serpent autour du cou53. Le Devî Purâna mentionne une guirlande de calottes crâniennes dans la coiffure ; or la suite de disques plats relevée ici à la base de la jatâ est identique à celle qui tombe sur les hanches du dieu et qui représente fort vraisemblablement cette même guirlande54. Le Visnudharmottara Purâna mentionne les yeux exorbités, les crocs, les narines ouvertes, le ventre rond, la guirlande de calottes crâniennes, les serpents servant d'ornements55. L'Agni Purâna présente Bhairava comme maître des Yoginï, le dieu y a douze bras et si l'on excepte la dépouille de l'éléphant tenue par la paire supplémentaire, huit attributs sont communs à la description du Purâna et à l'image de l'Indian Museum (épée, flèche, trident, arc, serpent ou corde, khatvânga, gestes de sauvegarde et de don56). Le même passage mentionne la peau de tigre, les serpents ornant le dieu, le croissant lunaire décorant la jatâ ainsi que les crocs. On peut donc, dans une certaine mesure, rapprocher la description de l'Agni Purâna de la stèle illustrée ici.
Une inscription en caractères gaudïya de la seconde moitié du xr s. court sur le bandeau inférieur du socle. La datation nous est confirmée par G. Bhattacharya auquel nous sommes reconnaissante pour l'aide apportée à la lecture de l'inscription. Nous lisons donc : siddhi / (première ligne sur le tenon) siddham (exprimé par un symbole) bhairava bhattârakasya / sthâpitam mitih (pour sthâpitam-itih) mâtâ pitâh tmanan-c-eva (pour :
64
mâtâ pitror âtmanas-c-aiva) dânapati jonimahyeyasah// (traduction : Hommage ! Jonimahyeyas, seigneur du don, a offert cette image du dieu Bhairava pour lui-même et ses père et mère).
L'intérêt de cette inscription n'est pas seulement de nommer le donateur, Jonimahyeyas, mais surtout d'appeler le dieu Bhairava. C'est sous ce nom qu'il figure comme maître des Mères qui l'accompagnent dans sa danse selon le Kathâsaritsâ- gara57 et c'est aussi sous cette dénomination qu'il apparaît dans l'Agni Purâna entouré des Yoginï58.
Une comparaison sommaire avec le Sadâsiva de Rajibur (district de Dinajpur) daté de l'an 14 du règne de Gopâla III59 révèle que certains motifs présentent ici un état moins avancé que sur le Sadâsiva : la fleur de lotus dominant le chignon, les bouclettes s'échappant de la partie supérieure du chignon (alors qu'ici quelques mèches verticales sont entrevues), les hauts brassards, le socle plus complexe (multiplication des bandeaux horizontaux avec redoublement de la zone inférieure). La stèle publiée ici est donc assurément antérieure à celle représentant Sadâsiva.
Nous relevons, par ailleurs, une série d'œuvres, déjà évoquées, dont les thèmes iconographiques s'inscrivent au même registre de l'horreur qui s'est surtout développé aux xr et XIIe siècles. Ces images sont essentiellement notées dans une région qui s'étend depuis le district de Monghyr (Bihar) jusqu'aux districts bengalis de Dinajpur (West Dinajpur en Inde et district du même nom au Bangladesh), Murshidabad (Bengale occidental, Inde) et Rajshahi (Bangladesh). Ces images, bouddhiques ou hindoues, sont relativement rares dans
l'ensemble de la production, mais elles eurent un impact certain puisque le motif des flammes irradiant sur la dalle de fond qui leur est initialement réservé sera au xir siècle intégré par des représentations d'Avalokitesvara60. Ces œuvres se partagent plusieurs éléments, comme la structure du décor sur la dalle de fond ou la manière de traiter le lotus sur lequel se tient la divinité. La fleur est de fait directement rattachée à son pied épais encadré de larges volutes au milieu du socle61, alors qu'elle est généralement séparée de son pied et des rhizomes par un bandeau horizontal sur les images du Bengale septentrional.
Cette stèle s'insère donc dans un ensemble stylistique cohérent qui s'est développé aux XIe et XIIe siècles du Bihar oriental au Bengale septentrional. Bien qu'illustrant une iconographie à ce jour unique, elle s'apparente par ce fait à d'autres stèles dont l'iconographie est également rare. On peut penser qu'elle participe à un large mouvement de renouveau iconographique où, à côté des sous-types communs (en iconographie sivaïte seule : Umà-Mahesvara, Sadâsiva, Bhairava non dansant...), de nouveaux modèles sont introduits (la remarque s'appliquant aussi aux iconographies visnuïte et bouddhique). Il est aussi possible que cette image de Bhairava s'inscrive dans un courant sivaïte particulier, peut-être celui des Kâpàlika dont Bhairava est le dieu suprême62. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons que relever l'existence du culte de cette hypostase sivaïte aux xie et XIIe siècles et dans la région orientale du Bihar ainsi que dans les régions septentrionale et occidentale du Bengale63.
1. Nous sommes extrêmement reconnaissante au Dr R. C. Sharma, Directeur du Musée, qui nous a autorisée à accomplir ce travail qui ne nous avait jamais été rendu possible lors de nos précédents séjours à Calcutta. Nos remerciements s'adressent aussi à Mesdames D. Mukherjee et Anasua Sengupta pour leur assistance ainsi qu'à Joachim Bautze qui a réalisé les photographies publiées ici.
2. Numéro d'inventaire : 72/2. Hauteur : 99 cm (114 cm avec le tenon de base), largeur : 46 cm.
3. Information recueillie auprès des autorités du Musée. La stèle est aussi reproduite dans Indian Archaeology 1975-76, A Review, pi. LXVI- B et p. 90.
4. Enamul Haque, The Iconography of the Hindu Sculpture of Bengal (up to c. 1250 A.D.), Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the University of Oxford, 1973 (non publiée) : image n° 1766 et pi. 215.
5. Ibidem, p. 266-267. 6. Ibidem, pi. 215. 7. Bhairâttâ est situé au sud-est de Patiràj-
pur, localisé approximativement à 25*30' (latitude N.) et 88"I5' (longitude E.). H. E. Stapleton, «Note on the Historical and Archaeological results of Tour in the Districts of Mâldah and Dinajpur, December 24th-31st, 1932», Journal of the Asiatic Society of Bengal, N.S., XXVIII, 1932, p. 151-171 : en particulier, p. 155-164, consulter aussi les pi. 3 et 4 de cet article qui donnent deux cartes de la région. S. K. Saraswati, « Notes on Two Tours in the Districts of Mâldah and Dinajpur», Journal of the Asiatic Society of Bengal, N.S., XXVIII, 1932, p. 173-183 : pi. 6, fig. 1 et 2, pi. 7, fig. 1 qui illustrent des images relevées au Kâkadighi et p. 178-179. M. Rahman, «The So-called Vâgïsvarï Images», Journal of the Varendra Research Museum, vol. 5, 1976-77,
p. 111-117 reproduit à la pi. II, fig. 1 de son article la Vâgïsvarï mentionnée par Stapleton, art. cit., p. 163.
8. N. Chakravarti and S.K. Saraswati, «Note on a seated and inscribed image of Sûryya from Qasbah (Ekdâlâ), District Dinajpur», Journal of the Asiatic Society of Bengal, N.S., XXVIII, 1932, p. 146-150 et pi. 2; Haque, op. cit., p. 304 et pi. 124 ; R. C. Majumdar, éd.. The History of Bengal, vol. I. Hindu Period, Dacca, 1943, pi. XV, fig. 39 et p. 457 ; Annual Report of the Archaeological Survey of India for the years 1930-34, pi. CXXVII-(c) et p. 256-257. Numéro d'inventaire : 860 I/A 16241.
9. Les grandes lignes de l'évolution sont développées par Stella Kramrisch, «Pala and Sena Sculpture», Rûpam, 40, 1929, p. 107-126 et Susan L. Huntington, The «Pâla-Sena» Schools of Sculpture, Leiden, 1984.
10. Le terme est générique et s'applique à n'importe quel aspect de la divinité.
11. Op. cit., p. 192-257. 12. Ibidem, p. 192. Il recense aussi 44 liriga. 13. Les formes ugra sont généralement ven
trues bien que cet aspect ne constitue pas un critère décisif quant à l'appartenance d'une image à la catégorie terrible ou non. Brahmâ ou Kubera, pour ne citer qu'eux, sont aussi pansus sans pour autant se rattacher à cette catégorie. Un second élément est la chevelure hérissée, un troisième le rictus et éventuellement la barbe, facteurs plus caractéristiques.
14. Le terme «type» est emprunté à Klaus Bruhn («The identification of Jina images», Berliner Indologische Studien, 1, 1985, p. 149-175, en particulier p. 150). A un type, peuvent correspondre plusieurs sous-types, par exemple si Avalokitesvara constitue un type particulier, il est figuré sous des aspects parfois fort variés qui constituent autant de sous-types. Dans son
travail déjà cité (supra note 4), Enamul Haque définit aussi des types et sous-types (encore qu'il ne soit pas fort clair à ce niveau) qu'il étudie en constituant des «groupes», caractérisés par la position de la divinité, chaque groupe recouvrant des « types » définis par le nombre de bras notamment.
15. Précisons que ce type de motif n'est généralement pas introduit par les auteurs s'occupant d'iconographie or s'il ne permet pas d'identifier le type figuré, il n'est cependant observé qu'avec certains types. Comme ce motif (ainsi que d'autres portés par la dalle de fond ou le piédestal) n'est pas mentionné par les sources littéraires, on le considérera comme participant à un vocabulaire iconographique exclusivement figuré. Il permet de caractériser un ensemble de types et donc de le différencier d'un ou de plusieurs autres ensembles (sur les termes «identification», « caractérisation » et «differentiation», voir K. Bruhn, article cité, p. 149). Lors d'une communication précédente, nous avions déjà eu l'occasion d'observer combien la littérature s'écartait de l'art dans le cas des représentations d'Avalokitesvara à six bras («'Identification' or 'classification' in Buddhist iconography : the case of the six-handed Avalokitesvara images in Bihar and Bengal, 8th to 12th c. », The Sastnc Tradition in the Indian Arts, Heidelberg, juillet 1986, éd. A. L. Dallapiccola et S. Zingel-Ave Lallemant, Stuttgart, 1989, p. 35- 50).
16. Ainsi une déesse aux serpents, généralement connue sous le nom de Manasâ, est nommée Svamgàï dans l'inscription de l'auréole (G. Bhattacharya, «Nâgendravâhinï Devï : The Snake-goddess with an elephant mount», Maka- randa. Essays in honour of Dr. James C. Harle, éd. Cl. Bautze-Picron, Delhi - sous presse).
17. Ce que reconnaît aussi Enamul Haque
65
quand, à propos d'une autre représentation d'une ugramûrti de Siva, il écrit que le nom Bhairava « may be accepted ... if only the term ... indicates a generic division of ugra images » (op. cit., p. 265).
18. Nous ne partageons donc pas les appréhensions de G. Bhattacharya, dans son article déjà cité (supra, note 16) qui hésite à nommer Manasâ la déesse aux serpents. Même si ce nom apparaît à époque tardive, il permet, par sa seule mention, de reconnaître immédiatement le type iconographique considéré alors que le nom Svamgâï, même s'il semble s'être appliqué à cette déesse (il est attesté par une source littéraire), n'a pas la même portée. Cet auteur mentionne aussi une représentation de Durgâ tuant le buffle du Chamba et qui est inscrite du nom de Laksanâde- vï, mais il est certain qu'évoquer cette image sous ce nom ne permet absolument pas de savoir de quelle iconographie il est question.
19. Ainsi, la dalle de fond derrière certains Natarâja comporte divers motifs, dont la représentation miniaturisée de plusieurs divinités. Or ces dernières sont systématiquement ignorées par Enamul Haque (op. cit., p. 229 par exemple).
20. Et pour cette raison n'en font pas mention dans leurs études.
21. Voir note 14. 22. Le motif apparaît sous deux formes :
avec ou sans anses. Avec anses, on l'observe notamment sur les stèles suivantes : Bhairava (Haque, op. cit., pi. 188, R. D. Banerji, Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture, Delhi, 1933, pi. LV-(c)), Bhairava (Haque, op. cit., pi. 191), Bhairava (Stella Kramrisch, Manifestations of Shiva, Philadelphia Museum of Art, 1981, cat. 30. Dans la description qu'elle donne de cette image, Stella Kramrisch a mal identifié les deux têtes d'animaux silhouettées de part et d'autre de la tête. En aucun cas, il ne s'agit de faces de lion ou de sanglier, mais bien de têtes de serpents profilées similaires à celles observées ici); Umà-Mahesvara (Inde, cinq mille ans d'art, Petit Palais, Paris, 1978, cat. 76), Umâ-Mahesvara (Mahasthangarh Museum 20, négatif Department of Archaeology and Museums, Dhaka, 79/140) ; Durgâmahisâsurâmardinî (Haque, op. cit., pi. 150), Durgâmahisâsurâmardinî (Haque, op. cit., pi. 154), Durgâmahisâsurâmardinî (Haque, op. cit., pi. 154), Durgâmahisâsuramardini (Mahasthangarh Museum 30, négatif Department of Archaeology and Museums, Dhaka, 79/185), Durgâmahisâsurâmardinî (State Archaeological Museum of West Bengal, négatif ASI 631/70); Vâràhï (Asutosh Museum T3586, négatif ASI 1412/62); Sarasvati (M. Bhattacharyya, Art in Stone : A Catalogue of Sculptures in Malda Museum, Malda, 1982, pi. XI. 1); Devi (sivaïte) (Haque, op. cit., pi. 134), Devi (Haque, op. cit., pi. 135); Skanda (Haque, op. cit., pi. 236); Brahmâ (Haque, op. cit., pi. 223) ...Sans anses : Manasâ (Haque, op. cit., pi. 208); Manasâ (R.D. Banerji, op. cit., pi. LXIV-(b)); Ganesa (ibidem, pi. LX-(d))...
23. R. C. Majumdar, op. cit., pi. XVI, fig. 40, Haque, op. cit., pi. 126; Akshaya Kumar Mai- treya Museum Catalogue, Part I, Darjeeling, 1981, pi. I; Sûrya d'Ekdàlâ/Bhairatta : voir supra, note 8. Sur ces différents exemples, la mandorle suit la silhouette ovale observée ici.
24. R.D. Banerji, op. cit., pi. LV-(c), Haque, op. cit., pi. 188; Bharat Kala Bhavan 22123.
25. R. D. Banerji, op. cit., pi. XLVI-(d). 26. Ibidem, pi. LXI-(b). 27. R. C. Majumbar, op. cit., pi. XXI, fig. 54,
S. K. Chatterji, « The Pala Art of Gauda and Magadha », The Modem Review, n° 47, janvier 1937, p. 82-90, fig. 5, Sherman E. Lee, Asian Art, Selections from the Collection of Mr. and Mrs. John D. Rockefeller 3rd, Part II, cat. 6.
28. R. C. Majumdar, op. cit., pi. XXI, fig. 55,
Annual Report of the ASI for the Year 1934-35, pi. XXIV-(c).
29. R. D. Banerji, op. cit., pi. XLII-(d), Kramrisch, art. cit., fig. 30.
30. Huntington, op. cit., fig. 155. 31. Janice Leoshko, «Buddhist Art of Nor
thern India», Orientations, volume 19, juillet 1988, p. 30-43, fig. 17.
32. Claudine Bautze-Picron, «The Lost(?) Pedestal from Madanapàla's Reign, Year 14», South Asian Studies, 4, 1988, p. 75-81, fig. 3.
33. Haque, op. cit., pi. 194 et p. 268 (Bhairava) et ci-dessus note 27 (Hevajra).
34. Outre l'image considérée ici, E. Haque n'a relevé que deux autres exemples de Bhairava dansant (8 bras, 3 visages) (op. cit., p. 266).
35. Haque, op. cit., pi. 31, 32, R.D. Banerji, op. cit., pi. LII-(a) et (c).
36. Haque, op. cit., pi. 169, 170. 37. R. C. Majumdar, op. cit., pi. XXIII,
fig. 59. 38. A la droite du dieu, de haut en bas, sur
le socle, de gauche à droite et à la gauche- de Bhairava, de bas en haut.
39. Attribut cité par la Nispannayogavalî. A ce propos, voir B.N. Sharma, «Châmundâ with fish — a rare trait in the Paramàra art», Art of the Paramâras of Mâlwâ, éd. R. K. Sharma, Delhi, 1979, p. 25-28, en particulier p. 26 et notes 8 et 9.
40. Les Mères portent les coiffes des dieux auxquels elles correspondent : Brahmà la jatâ comme Siva ; Visnu porte le kiritamukuta ; Skanda la coiffe à bourrelets superposés et Bhairava a généralement la chevelure hérissée.
41. Les Mât rcakra connus sont architecturaux et illustrent le cercle des 64 Yoginî autour de Siva. A ce propos, voir Marie-Thérèse de Mallmann, Les enseignements iconographiques de l'Agni-Purana, Paris, 1963, p. 172-176, et Mar- grit Thomsen, Kult und Ikonographie der 64 Yogi- nis, thèse de Doctorat, Berlin, 1976, p. 32-35.
42. Haque, op. cit., p. 413-414 donne les listes lues dans différents textes.
43. Mallmann, op. cit., p. 150. 44. Thomsen, op. cit., p. 16-17. Comme l'ob
serve cet auteur, les Mâtrkâ peuvent réapparaître dans les différentes listes de Yoginî (p. 18 et notes 1 à 3), certaines d'entre elles sont représentées parmi les groupes de Yogini de Bheràghàt, Naresar ou Satna (idem). Comme l'écrit justement cet auteur, «dies zeigt eine enge Verflechtung und teilweise Identitat von Mâtrkâs und Yoginîs. Damit hôrt das Eigenleben der Gruppe der Astamâtrkâs jedoch nicht auf. Von einem gene- rellen Aufgehen der Mâtrkâs in den 64 Yoginîs kann also nicht gesprochen werden. » (p. 18).
45. Mallmann, op. cit., p. 170, Thomsen, op. cit., p. 15, 18-19.
46. Mallmann, op. cit., p. 62-65, 169-170, 172-182.
47. Ibidem, p. 62-65. Les panneaux suivants proviennent du Bihar : R. D. Banerji, op. cit., pi. LXIII-(a) ; Annual Report of the ASI for the Year 1903-04, pi. LXIII-1, H. Sastri, The Origin and Cult of Tard, Memoirs of the ASI, 20, Calcutta, 1925, pi. I.B ; P. Pal, Indian Sculpture, volume 2, 700-1800, A catalogue of the Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, 1988, cat. 74 (avec références supplémentaires); un panneau photographié dans les réserves du Patna Museum et deux panneaux observés et photographiés in situ à Gayâ; Sotheby's, London, 5 juin 1989, lot 166 (avec pour particularité de remplacer Mahesvarï par Durgâ).
48. Op. cit., p. 417-418. 49. Kramrisch, op. cit., cat. 56; Pal, op. cit.,
cat. 38. 50. Câmundâ dansant entre deux Bhairava
est le sujet d'un large panneau sculpté reproduit par C. Sivaramamurti, Natarâja in Art, Thought,
and Literature, New Delhi, 1974, fig. 206. Elle est de loin, la plus vénérée des Mères : Haque en dénombre 46 représentations dans sa liste des 82 stèles consacrées à l'iconographie des Mères (op. cit., p. 435-448). Voir aussi note 36 (Càmun- dâ dansant).
51. R.D. Banerji, op. cit., pi. LVIII-(b). 52. «The extant specimens hardly agree in
full with the available iconographie texts. » (op. cit., p. 255).
53. R. C. Hazra, Studies in the Upapurdnas, vol. II, Calcutta, 1979, p. 253, 264.
54. Ibidem, p. 83. 55. Visnudharmottara-Purâna, Third Khanda,
vol. 1, éd. Priyabala Shah, Baroda, 1958, p. i82. 56. Mallmann, op. cit., p. 169, 176 (et no
te 5). On peut interpréter le geste de la main gauche (aux doigts relevés) comme étant le geste de sauvegarde évoqué par le texte (ibidem, p. 176 note 5 et p. 292) et reconnaître le geste de faveur, identifié avec hésitation par M.-Th. de Mallmann, présenté par une des mains droites. Manquent donc le croc et la hache du texte, remplacé par le kapâla et le bouclier.
57. N. M. Penzer, The Ocean of Story being C. H. Tawney's Translation of Somadeva's Kathà Sant Sâgara (or Ocean of Streams of Story), Delhi ..., 1968, vol. IV, p. 69 et 227 (cité par Mallmann, op. cit., p. 172).
58. Cf. supra, note 56. 59. Claudine Picron, «Gopâla II ou Gopâla
III, x' ou xir siècle. Datation d'une image de S"iva», Arts Asiatiques, XXXIV, 1978, p. 105-120, fig. 6.
60. Cf. supra, note 30. 61. Claudine Bautze-Picron, article cité,
fig. 2. P. 76, sont citées plusieurs images dont certaines sont ici d'intérêt : Buddha faisant la bhûmisparsamudrâ, déesse à l'enfant du règne de Palapâla notamment.
62. Les Kâpâlika sont notamment cités par le Kâhkâ Purâna (R. C. Hazra, op. cit., p. 253). Voir aussi Mark S. G. Dyczkowski, The Canon of the Saivâgama and the Kubjikâ Tantras of the Western Kaula Tradition, New York, 1988, p. 26- 31.
63. Sur Bhairava, on pourra également consulter l'article de H. von Stientencron, «Bhairava», XVII. Deutscher Orientalistentag vom 21. bis 27. Juli 1968 in Wûrzburg, Vortrâge, Teil 3, éd. W. Voigt, Wiesbaden, 1969, p. 863- 871. Jusqu'à présent, peu d'attention a été prêtée aux circonstances culturelles dans lesquelles s'articule l'iconographie. Il est donc impossible de cerner avec quelque précision, les lieux de culte des diverses divinités représentées. Ainsi, l'ouvrage, au demeurant fondamental, d'Enamul Haque recense les formes iconographiques et tente d'établir des corrélations avec les sources littéraires mais ne dessine pas la carte des iconographies présentes au Bengale, pas plus qu'il ne présente le développement de ces iconographies.
66