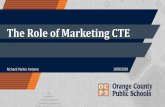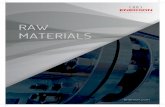Antoine Volodine : portrait de l’artiste en Stalker (2008)
-
Upload
univ-poitiers -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Antoine Volodine : portrait de l’artiste en Stalker (2008)
Frédérik Detue
PORTRAIT DE L’ARTISTE EN STALKER
Le rythme est lent. Dans Sola ris, dans Le miroir,dans Stal ker, et d’ailleurs dans tous les filmsd’Andreï Tar kovski, l’écou le ment du temps est unmotif qui compte. L’eau paraît immo bile, mais elleremue dou ce ment une che ve lure d’al gues ; desobjets oscillent sur la table où ils ont été posés, unverre, une lampe à pétrole, un livre – ils oscillent,glis sent vers le vide, ils tom bent au ralenti ; lesvisa ges met tent un moment avant de se tour nervers la caméra, ou ils font face à la caméra commeon fait face au ciel ou au des tin, sans se pré oc cu pervrai ment d’être à l’heure. Sou vent, on se tait.
Antoine Volo di ne
Le nom de Volo di ne
La ques tion tombe, sans tar der, en géné ral : «Mais Volo dine,c’est russe, non? C’est bien un écri vain russe, n’est-ce pas ? »Puis, quand la réponse tran che, néga tive : « Mais, tout demême, il a des ori gi nes rus ses, j’ima gine ?... » Là, je dis que jene sais pas bien, qu’on allè gue cer tes une grand-mère, maissur tout, je parle de pseu do nyme1 ; la pas sion enquê teuse ne
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 35
36 Défense et illustration du post-exotisme
rend pas les armes, cepen dant : « Et son vrai nom, vous le con -nais sez, non, si vous tra vaillez sur son œuvre ? » Que je puisseencore répon dre non, vrai ment, cons terne.
Il est amu sant d’ob ser ver comme le nom d’un écri vain con -duit déjà en ter rain miné, en terre d’in cer ti tude, alors mêmequ’on ne s’est pas encore aven turé dans son œuvre. Et quand, acon tra rio, on s’est soi-même engagé dans cette lec ture, ça faitsens, évi dem ment. Il suf fit d’avoir passé une fois le cap de la cou -ver ture dans un livre de Volo dine (par fois, ça se com pli que dèsla page de garde) pour ne plus igno rer que l’au teur aime l’am bi -guïté, et la signa ture fonc tionne à cet égard comme un aver tis -se ment à l’en trée (un vec teur de l’in cer ti tude).
« Vous qui allez ouvrir ce livre, sachez que son auteur pra -ti que la lit té ra ture à la manière d’un art mar tial, que les iden -ti tés sont des dif fé ren ces, que la ligne droite n’est jamais le pluscourt che min2 », pré vient le nom de Volo dine. Et il con vient,donc, de péné trer dans cet espace lit té raire avec la même pru -dence que dans la Zone mys té rieuse de Stal ker – en n’ou bliantpas, d’ailleurs, que les piè ges mor tels qui abon dent dans laZone dépen dent de ceux qui se ris quent à l’ex plo rer3.
Ancrage russe 1 : du syn thé tis me
Je ne fais pas ici réfé rence au cinéma de Tar kovski par esprit decon tra dic tion. Ce n’est pas parce que le nom de Volo dine n’estpas le signe d’une iden tité lin guis ti que ou natio nale d’ori ginecon trô lée qu’il ne cons truit pas néan moins une figure d’écri -vain atta chée de quel que manière à la Rus sie. En l’oc cur rence,il y a une cul ture russe – dont le cinéma de Tar kovski serait lapierre de tou che – qui est réel le ment chère à Volo dine ; et s’ils’en fait le pas seur en France par des tra duc tions (notam mentde la poé sie de sa « sœur d’écri ture » Maria Sou daïeva4), par sesadap ta tions en prose des byli nes (sous l’hé té ro nyme d’ElliKro nauer5), il peut être éclai rant de déter mi ner dans quellemesure l’édi fice « post-exo ti que » cons truit par son œuvre de
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 36
Portrait de l’artiste... 37
fic tion est tri bu taire de cette cul ture – dans quelle mesurecette cul ture cons ti tue une matrice du post-exo tisme, aumême titre que « le prin temps 1917 à Petro grad, ce prin tempsen attente d’oc to bre qui est, n’ayons pas peur des mots, à lasource de tou tes [les] émo tions poli ti ques [de l’écri vain et deses per son na ges]6 ».
Volo dine sou li gne dans un entre tien que « [sa] vision del’his toire a été con for tée par des points de vue situés […] dansle monde sovié ti que (non dans la vision occi den tale du mondesovié ti que, mais dans l’es pace à la fois grillagé et uto pi que del’ex-URSS)7 », et, si l’on con si dère en par ti cu lier Des angesmineurs, dont la fic tion se fonde pré ci sé ment dans cet espacesovié ti que russe, il appa raît en effet que le post-exo tisme,entendu aussi bien comme « lit té ra ture étran gère en fran çais »que comme « lit té ra ture poli ti que d’en ga gés écri vains », dia lo -gue avec toute une tra di tion issue de là-bas et son écri ture del’his toire.
« L’es pace lui-même et le temps [ont été] arra chés de leurancre par Eins tein, écri vait Evgueni Zamia tine. Et l’art, issu decette réalité-là, de celle d’au jourd’ hui – peut-il n’être pas fan -tas ti que, ne pas res sem bler à un rêve8 ? » Or l’art post-exo ti quede Volo dine est encore issu de cette réalité-là, et on peut lequa li fier de syn thé ti que au sens où l’en ten dait essen tiel le mentZamia tine : au sens où il fait la syn thèse du fan tas ti que et duquo ti dien. C’est cela même qui fait de lui un art de l’am bi -guïté ; comme pro jet d’« écrire en fran çais une lit té ra tureétran gère », il vise à bous cu ler, chez les lec teurs, tou tes leurshabi tu des de per cep tion du monde, leurs visions fami liè res, encons trui sant un monde dont « la rela tion avec le monde géo -gra phi que et his to ri que con tem po rain [soit] tou jours trèsdéfor mée, un peu comme dans un rêve9 ».
« [Eins tein] a réussi à se sou ve nir que lui, […] qui obs ervele mou ve ment avec une mon tre dans les mains, il bouge aussi,il a réussi à regar der les mou ve ments ter res tres du dehors10 »,
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 37
38 Défense et illustration du post-exotisme
écri vait encore Zamia tine, et c’est comme si Volo dine s’ac cor daitavec lui pour assi gner à la lit té ra ture la tâche de regar der lesmou ve ments ter res tres à la manière d’Eins tein, du dehors. Danscha que « ins tan tané roma nes que », nous pré vient Volo dineavant Des anges mineurs, « comme sur une pho to gra phie légè -re ment tru quée, on pourra per ce voir la trace lais sée par unange11 » ; et cette trace de l’ange, qui est comme sa signa ture,per met de com pren dre que, sui vant la grande uto pie angé li quedu baro que, l’écri vain se trans porte sur les bords du mondepour pro duire son œuvre. De cette façon, comme chez Veli mirKhleb ni kov – où le ka « s’ins talle con for ta ble ment dans les siè -cles comme dans un fau teuil à bas cule12 » –, ou dans Le maî treet Mar gue rite de Mikhaïl Boul ga kov – quand Woland, auterme d’un long sur vol de la terre sur de noirs cour siers magi -ques, amène le maî tre devant le héros de son roman, là où ildort depuis « pres que deux mille ans13 » –, il peut embras ser lemonde dans un regard qui syn thé tise les espa ces et les temps.
Ainsi, le bord du monde où tout com mence, dans Des angesmineurs, ne se trouve pas sim ple ment dans une con trée recu -lée de la Sibé rie orien tale ; sui vant l’en tre prise post-exo ti que quidéréa lise toute réfé rence natio nale, la Sibé rie est ici arra chée deson ancre russe con tem po raine, et prend un tour fan tas ti que. Ledéca lage opéré par Volo dine est moins spa tial, d’ailleurs, quetem po rel. D’un côté, il est pos si ble de « pas ser par la mémoirecol lec tive et l’incon scient col lec tif pour retro uver de la fami lia -rité14 » dans la réalité qui nous est pré sen tée ; dans la mai son deretraite du Blé Mou cheté, « à des milliers de kilo mè tres detout», au fin fond de la taïga, « on […] res pire, par exem ple,l’odeur des men suels illus trés dont les cou ver tu res célè brent labeauté des mois son neu ses-bat teu ses et des trac teurs à che nillet -tes, […] ou encore ont pour sujet des grou pes de jeu nes ouvriè -res, bien en chair devant des pêche ries ou des puits de pétrole, ouhila res devant des cen tra les nucléai res, ou devant des abat toirs,char meu ses, enthou sias tes15 », et, par méto ny mie ou non, c’est
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 38
Portrait de l’artiste... 39
un par fum d’Union sovié ti que qui émane de cet espace de fic -tion. Ce par fum est un sou ve nir, cepen dant : on com prend quel’his toire des géné ra tions qui ont mis leur héroïsme au ser viced’une société allant vers un idéal éga li taire, « et qui l’ont héroï -que ment cons truite jus qu’à ce qu’elle ne fonc tionne plus16 »,est du passé ; mais, d’un autre côté, la réalité pré sente ne sem -ble plus cor res pon dre à rien de connu, quant à elle, non seu le -ment dans le monde russe post so vié ti que, mais par toutailleurs.
Et pour cause. Dans Des anges mineurs, « [tout] se dérouledes siè cles après Tcher no byl17 », comme sous le signe de cettecata strophe nucléaire : c’est un temps de fin du monde où« l’hu ma nité [a] entamé la phase quasi finale de son cré pus -cule », où « [pres que] plus aucun enfant ne [naît] », où lesespè ces ani ma les et végé ta les mutent et devien nent indis tinc -tes, où, « [les] ima ges diur nes et noc tur nes se [suc cé dant]comme des dia po si ti ves dans un passe-vues déré glé », c’esttout le pay sage qui, pro gres si ve ment, « se méta mor phos[e] enboue noc turne », où « les dunes [ont] rampé hors de leurs litstor ri des pour par cou rir des régions jadis pro spè res et pour lesétouf fer jus qu’à ce qu’el les accep tent la domi na tion sans par -tage du rien18 ».
« Il y a une for mule ter ri ble, venue je ne sais plus d’où :“L’en tro pie de l’Uni vers tend vers un maxi mum”19 », notaitVic tor Sega len en marge de son Essai sur l’exo tisme ; et c’estcomme si la ver sion du monde pro po sée par Des angesmineurs mon trait la fin du pro ces sus dont rend compte cette« for mule ter ri ble ». À cette épo que de l’his toire humaine,«même la signi fi ca tion des mots [est] en passe de dis pa raî -tre20 » ; l’ex ten sion de l’in dif fé ren cia tion est telle qu’on estcomme au-delà de tou tes les anti no mies du lan gage. De mêmequ’on ne peut plus guère dif fé ren cier les espè ces entre elles oudis tin guer le jour de la nuit, cela ne rime plus à rien d’op po serla civi li sa tion à la bar ba rie, puis que l’at mos phère de déso la tion
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 39
40 Défense et illustration du post-exotisme
qui règne par tout vient « après la fin de la civi li sa tion et mêmeaprès la fin de la bar ba rie21 » ; et cela n’a plus guère de sens nonplus d’op po ser la vie à la mort : les quel ques êtres humains quierrent encore à la sur face de ce monde inha bi ta ble se main tien -nent tous dans un état inter mé diaire entre la vie et la mort,dans un état extrême de sur vie – comme le peu ple djann chezAndreï Pla to nov, de plus en plus « impro pres à la pro lon ga tionde leur vie mais ne sachant pas com ment mou rir22 ».
Au bord du monde, donc, on assiste ici à sa mort lente. Etsi l’éten due du dés as tre syn thé tise les espa ces et les temps,c’est que le monde en ruine con serve la trace du passé.«Comme dans le passé le futur mûrit, // Ainsi dans le futur lepassé couve encore23 », écri vait Anna Akh ma tova dans lePoème sans héros ; et ce passé qui ne passe pas, qui amon cellerui nes sur rui nes aux pieds des anges mineurs volo di niens etdont ils ne par vien nent pas, mélan co li ques, à faire le deuil,pro cède irré duc ti ble ment de l’his toire sovié ti que : car il n’estautre, ce passé, que « l’ob scène cata strophe que repré sentel’échec du pro jet révo lu tion naire au XXe siè cle24 ».
De livre en livre, les anges mineurs de Volo dine vien nentde cette réalité-là. Ce sont tou jours des révo lu tion nai res quiont été entraî nés dans cet effon dre ment, et qui sont plus oumoins écra sés, des sous. Et si on les retro uve à la der nièremarge du monde, alors c’est qu’ils n’y ont plus leur place,qu’on ne leur y donne plus droit de cité, qu’ils sont des parias,pri vés de monde. C’est pour quoi ils sont relé gués en pri son, encamp ou en exil, le plus sou vent ; dans Des anges mineurs,encore, la mai son de retraite au milieu des mélè zes noirs et dessapins est un labo ra toire « où l’on expé ri mente des muta tionsde la nature humaine25 », comme les camps dont on nous ditpour tant qu’ils appar tien nent à des temps pas sés.
Zamia tine, encore lui, oppo sait, à l’échelle cos mi que, uni -ver selle, la loi de l’en tro pie à la loi de la révo lu tion26 ; or voilàencore une oppo si tion qui ne sem ble plus per ti nente, quand
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 40
Portrait de l’artiste... 41
l’en tro pie de l’Uni vers sem ble avoir atteint un maxi mum : dansDes anges mineurs, la loi de la révo lu tion – décré tée hors-la-loivers la fin du XXe siè cle, pré ci sé ment – n’agit plus, ou pres que,comme vain cue par la loi adverse, et, mal gré Zamia tine, il neparaît plus pos si ble de « bou ter le feu » dans la pla nète, de « lafaire dévier de la route bal sa mi que de l’évo lu tion».
Les anges mineurs volo di niens sont de la même trempe queces « rêveurs de l’ab solu » qui ont ter ro risé les puis sants per son -na ges de la Rus sie tsa riste tout au long du XIXe siè cle, pour tant.Bien qu’ils mesu rent leur défaite com plète, ces héré ti ques com -pren nent qu’ils « sont l’uni que remède (amer) con tre l’en tro piede la [vie] humaine27 », et jamais ils ne renon cent à l’idée de « radi -ca le ment revi go rer le para dis éga li ta riste perdu »; la preuve enest que tout com mence, à la mai son de retraite du Blé Mou cheté,avec l’ac tion de « con fec tion ner col lec ti ve ment le ven geur néces -saire28 », par les vieilles révo lu tion nai res qui sont enfer mées là.
Cepen dant, s’il reste bien quel que chose de l’ac ti visme révo -lu tion naire dans Des anges mineurs, dans cet enfan te ment duven geur Will Scheid mann, par exem ple, ou encore dans l’in sur -rec tion de la mai son de retraite, s’il est vrai que les vieillesmis ent sur « l’épo pée rec ti fi ca trice de Var va lia Lodenko» et«son pro gramme d’ex tir pa tion des raci nes humai nes du mal -heur » pour que « jaill[isse] l’étin celle qui remettr[a] le feu à laplaine29 », on aurait tort de croire que là gît l’es sen tiel. Que l’oncon si dère la façon dont Will Scheid mann tra hit la cause révo lu -tion naire qu’il était censé régé né rer, la façon dont la libé ra tiondes vieilles ne change rien à leur situa tion d’exil, ou la façondont le ter ro risme de Var va lia Lodenko pré ci pite un peu plusl’ex tinc tion de l’es pèce humaine, tout laisse pen ser que cettepraxis révo lu tion naire, somme toute assez déri soire, a cer tes lafonc tion non négli ge a ble de réac ti ver la mémoire de l’his toirerévo lu tion naire, mais que, si la loi de la révo lu tion a une chancede s’ac com plir encore, c’est ailleurs que dans cette praxis à l’étatde trace.
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 41
42 Défense et illustration du post-exotisme
Pour com pren dre ce qu’il en est vrai ment, la réflexion quefait Volo dine sur le rythme lent des films de Tar kovski est par -ti cu liè re ment éclai rante. Les per son na ges, chez ce sculp teur detemps, parais sent « [ne pas] se pré oc cu per vrai ment d’être àl’heure », dit-il, or si l’on songe au retar de ment inces sant puis àl’aban don de l’exé cu tion (pour haute tra hi son) de Scheid mann,on peut en dire autant de ses pro pres per son na ges. Pour lesvieilles révo lu tion nai res, qui « [savent] dés or mais qu’el les ne[vont] jamais mou rir30 », tout se passe, exac te ment, comme sion avait tiré sur les hor lo ges mura les au grand soir de la révo -lu tion31, et qu’el les vivaient depuis lors dans ce temps inter -rompu – dans une sorte d’éter nité.
Jean-Chris to phe Bailly a magni fi que ment mon tré com -ment « toute l’œuvre de Pla to nov ou pres que se déroule dansun tel temps inter rompu, […] dans l’au-delà d’un évé ne mentqui a inter rompu l’His toire ou qui, à sa manière, l’inau gure32 »,et dans ce sens, c’est peut-être l’œuvre de lit té ra ture à laquellecelle de Volo dine est le plus rede va ble. Volo dine invente, avecle nar rat, une forme laco ni que prô née par Zamia tine, où cha -que mot pos sède « une haute ten sion », où il s’agit d’« enser reren une seconde autant qu’au tre fois dans les soixante secon desd’une minute33 », et comme le sou tient Volo dine après Zamia -tine et Cha la mov, cet irré su ma ble impromptu appelle les lec -teurs « à ima gi ner un roman34 », à se lais ser pren dre à unerêve rie qui leur fera « retro uver immé dia te ment quel que chosequi est enfoui en eux, des sou ve nirs, des fan tas mes qui appar -tien nent à la mémoire col lec tive35 ». Mais un inté rêt de cetteforme qu’il importe alors de sou li gner, c’est sa voca tion à deve -nir une ère de repos : un lieu où le temps s’ar rête, et où leshom mes « peu vent se repo ser un ins tant36 ».
C’est ainsi en ce que cha que nar rat qui com pose Des angesmineurs brise le con ti nuum du temps et « accorde aux hom mesaussi bien le séjour exta ti que dans une dimen sion plus ori gi -nelle que la chute dans la fuite du temps mesu ra ble37 » que
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 42
Portrait de l’artiste... 43
Volo dine attise l’étin celle qui pour rait remet tre le feu à laplaine. En renouant avec le rythme comme struc ture ori gi nellede l’œuvre d’art38, il met en som meil le pro ces sus entro pi quedu temps his to ri que, et il fait enten dre que l’évé ne ment révo -lu tion naire qui a eu lieu autre fois résonne encore.
Ancrage russe 2 : la steppe et le sacri fice
[…] je défends l’art qui porte en lui une nos tal gie d’idéal, etqui en exprime la quête. […] Et plus le monde que décritl’ar tiste paraît sans espoir, plus clai re ment doit être encoreres senti l’idéal qu’il lui oppose. Sans quoi la vie serait insup -por ta ble !
Andreï Tar kovs ki Sui vant la fic tion de Volo dine, c’est dans la steppe, « là où surla terre ne sub sis tent plus que des abstrac tions écra san tes, duciel écra sant et des pâtu ra ges ava res39 », qu’au cours de saremise de peine à la Shé hé ra zade, Will Scheid mann four nit unnar rat par vingt-qua tre heu res aux vieilles, et cela fait de ses«brè ves piè ces musi ca les dont la musi que est la prin ci pale rai sond’être » un vrai Chant de la terre40. Si la steppe est «une desrares régions du globe où l’exil [a] encore un sens41 » pour lesvieilles, c’est en effet que, chez Volo dine comme chez Pla to nov,« l’ho ri zon [que la révo lu tion] a ouvert se con fond à celui de lasteppe, ou du désert42 ». C’est parce que la steppe qui s’étend àl’in fini « [trans met] à cha cun un for mi da ble goût épi que devivre et de con ti nuer per pé tuel le ment à vivre », qu’elle ins -pire les nar rats ; c’est en se met tant à l’écoute « des sif fle -ments, des souf fles de grande flûte asiate, des orgues rau -ques43 » dont la steppe est balayée jour et nuit, en étant péné -tré par la « vieille âme du monde », que Scheid mann peutpren dre la parole, et faire rayon ner l’an ti que loi de la révo lu -tion dans l’ab sence et l’ou bli.
Retro uver le temps sus pendu de la révo lu tion dans unepoie sis comme le fait Scheid mann passe par une remon tée dans
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 43
44 Défense et illustration du post-exotisme
le temps très ancien de l’être. Mais, si les nar rats pro dui sentalors des har mo nies apai san tes, c’est que le « goût épi que devivre » qui les hante n’est pas oppo sa ble au goût de repo serpour l’éter nité ; dans cette stase, on atteint des tré fonds où lescon trai res s’unis sent, et il n’y a pas d’iro nie dans l’an ti thèsequi lie, dans le même nar rat 17, la vertu qu’a la steppe de per -pé tuer la vie et la reven di ca tion d’un droit à la mort parScheid mann.
Bien que con tra dic toi res, ce sont deux aspi ra tions qui secon fon dent, dans l’at ti tude de Scheid mann qui con siste en unsacri fice, un don, un aban don. Devant la mort, « éprouv[ant] àl’égard [des vieilles] et de [leurs] con vic tions une ten dresse querien jamais n’[a] pu ébré cher », il se met à com po ser des nar -rats pour elles, « [les] met tant en scène pour que [leur]mémoire soit pré ser vée mal gré l’usure des siè cles et pour que[leur] règne arrive44 ». Pour elles, il désire « per dre sans espritde retour, sans cal cul et sans sau ve garde jus qu’à son être quidonne45 », et c’est comme si, alors, le vide se fai sait en lui :comme si, dans « la steppe vide, jon chée d’ab sence », il se sen -tait gagné peu à peu par « l’apai se ment du vide » – de cetteinexis tence noire de « vingt milliards d’an nées » qui a pré cédésa nais sance et dont la nos tal gie l’ac com pa gne et ne le lâche pasdepuis cet évé ne ment péni ble46.
Dans Le retour du Boud dha de Vse vo lod Iva nov, la sta tuede Boud dha que le pro fes seur Safo nov trans porte dans ledésert du Kazakhs tan « est une coque vide, mieux, elle est levide ; tout natu rel le ment, elle se con fond avec ce désert danslequel elle se dés agrège [et avec la béance ouverte par la révo -lu tion d’Oc to bre]47 ». Dans Des anges mineurs, Scheid mannn’est pas une sta tue ; conçu magi que ment par les vieilles àpar tir de « tom bées de tissu et [de] bou les de char pie48 », il aplu tôt l’air d’une pou pée mal fago tée. Mais il se réfu gie avecles vieilles au sein du dénue ment et, par com pas sion, ilaccom pa gne la dégra da tion qui les fait se con fon dre avec la
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 44
Portrait de l’artiste... 45
steppe ; tan dis que les vieilles se rata ti nent, se déman tè lent,se dis sol vent sous elles, le corps de Scheid mann n’en finit pasde croî tre et de se rami fier dans l’iner tie jus qu’à se méta mor -pho ser en « un répu gnant buis son de chair » et à « ne plus[répon dre] aux nor mes ani ma les49 ».
Le sacri fice trans forme Scheid mann « en une espèce d’ac -cor déon à nar rats50 » ; sa sub stance ani male se déverse hors delui de façon igno ble comme dans la repré sen ta tion du Christ encroix par Mat thias Grü ne wald, et, évidé, il devient un théâ tre :le monde arrive entiè re ment à l’in té rieur de lui, dont il se faitl’écho. Le ser vice qu’il rend aux vieilles jus que dans la mort, lafaçon dont il prend sur lui leur mort inter mi na ble comme laseule mort qui le con cerne – voilà qui l’ou vre à l’Ou vert d’unecom mu nauté ; et, comme dans le com mu nisme pla to no vien,c’est une com mu nauté qui englobe dans sa sphère la tota lité del’exis tence mal heu reuse, humaine et autre. Au moment de sanais sance, déjà, Scheid mann a eu l’im pres sion que « la fron -tière phy si que entre [lui] et [les vieilles] n’était pas éta blie etne le serait jamais51 », mais, dés or mais, c’est toute dicho to mieentre son Moi et le Monde qui est abo lie. Quand il dit « je »,on ne sait jamais très bien qui parle en lui : ce peut être lavieille Marina Kou bal ghaï, qui fait vivre elle-même lamémoire d’Ar tiom Ves sioly depuis plus de deux siè cles, parexem ple, puis, outre ses aïeu les, ce peu vent être des écri vainscomme Fred Zenfl ou Maria Cle menti, une alouette des step -pes comme Armanda Ich kouat, et, le plus sou vent, ce sont« [des] popu la tions ano ny mes et des mar tyrs incon nus52 ».
« La liberté est dans le sacri fice au nom de l’amour53 »,écri vait Tar kovski, et, en ce sens, Will Scheid mann est la libertéincar née. Par un phé no mène de métemp sy cose, de sub sti tu tioncha ma ni que, il accueille en lui toute l’hu ma nité mou rante,« au der nier stade de la dis per sion et de l’inexis tence54 », et,avec fra ter nité, avec amour, il sup porte son âme dou lou reusedans la steppe – comme Nazar Tcha ga taïev sup porte l’âme du
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 45
46 Défense et illustration du post-exotisme
peu ple djann qu’il guide dans le désert55, comme le Stal kersup porte l’âme de tous les dés es pé rés qu’il guide dans laZone56. Et, même si l’athéisme est un des prin ci pes de base dupost-exo tisme, toute la ques tion est alors de savoir s’il fautrecon naî tre en lui un sau veur. Grâce à son écoute des voix quilui par lent, grâce à la magie de sa parole, il peut faire de lamasse de dou leur qu’il endosse la matière de ses nar rats, etcom po ser ainsi une sorte de monu ment à la mémoire de l’hu -ma nité per due ; mais est-ce à dire que son œuvre de lan gageremé die à l’ex tinc tion de l’es pèce humaine et à la fin du mondetou tes pro ches ?
Sui vant l’or bite russe dans laquelle j’ai pris le parti desituer cette œuvre (soit, spé cia le ment, une lec ture à la foistar kovs kienne et pla to no vienne), il est per mis d’es pé rer. Lamis sion que les vieilles con fient à Scheid mann d’« expli queraux sur vi vants ce [qu’el les font encore là] au lieu d’être mor -tes57 » initie une quête, dans le passé, de l’évé ne ment révo lu -tion naire à l’ori gine de leur immor ta lité, or il s’ac quitte decette tâche de façon à recueillir la pro messe d’un nou veaucom men ce ment.
Bien que la mémoire des vieilles immor tel les à pétrir danssa prose soit de plus en plus trouée et déchi rée, il sait cons -truire ses nar rats « sur ce qui reste quand il ne reste rien » enremuant des rêves ou des cau che mars qu’el les ont faits, et des -ti ner ses ima ges « à s’in crus ter dans leur incon scient et à resur -gir bien plus tard dans leurs médi ta tions et dans leursrêves58 » ; pour que la matière du rêve ou du sou ve nir cir cule,comme en bou cle, de l’in con scient vers l’in con scient, il con çoitdis crè te ment une struc ture en miroir de qua rante-neuf nar ratsaussi com plexe que le mon tage men tal du Miroir par Tar kovski59.Or, si cette matière qui défile dans la steppe vide comme sur unécran demeure alors tou jours fuyante, insai sis sa ble, le ver tigespé cu laire dans lequel Scheid mann entraîne les vieilles – etdans lequel Volo dine nous entraîne – lui donne vie d’une
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 46
Portrait de l’artiste... 47
façon inou blia ble, qui ne peut que sus ci ter la dou leur salu tairede la nos tal gie, comme chez Bash kim Kortch maz60.
C’est en accé dant, dans Des anges mineurs, « à l’ou blicomme patrie de la con science61 », que la parole de Scheid mannaccom plit la loi de la révo lu tion, con çoit une vie nou velle, unastre. Le temps qu’elle sus pend en qua rante-neuf nar ratsmime les qua rante-neuf jours de tra ver sée qu’ef fec tuent lesmorts dans l’es pace noir du Bardo (sui vant la tra di tion duboud dhisme tibé tain) ; et on com prend que ces « nar rats avecdes inabou tis se ments bizar res », au cours des quels « [onrevient] incoer ci ble ment à [son] point de départ62 », sont unepas se relle vers une renais sance.
Comme l’illus tre l’ef fet de miroir qui ren voie le der niernar rat au pre mier, le mou ve ment du texte dou ble cons tam -ment la pro gres sion vers la fin, d’une régres sion vers l’ori gine,et c’est ainsi toute l’œuvre qui est prise dans une oscilla tion,comme chez Tar kovski – et comme dans cet « état de latencequi si agréa ble ment pro longe le rien [et pré cède la nais -sance]63 ». La parole qui se loge dans le vide creusé en Scheid -mann forme une matrice dans laquelle il plonge en apnée,s’en glou tit lui-même, en un sens pour y accom pa gner la mortlente de ses dix-sept ou vingt-neuf ou qua rante-neuf grands-mères de l’in té rieur (« Heu reux ceux qui sont morts dans lesein de leur mère, dit Guioult cha taï [à son fils Tcha ga -taïev]64 »), mais aussi – con join te ment – pour libé rer, sans sediri ger vers lui, le futur ense veli dans leur passé immé mo rial :pour incar ner éter nel le ment, dans le ciel loin tain du lan gage,leurs rêves et leurs désirs inac com plis ; comme un mem brepatient de la résur rec tion, « tou jours sur le point de se réveillerdans la lumière du juge ment der nier65 ».
Une com mu nauté d’ébran lés
À pro pos de Maria Sou daïeva, Volo dine écrit que, « même si ellepor tait des juge ments très néga tifs sur l’Oc ci dent, son obs es sion
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 47
48 Défense et illustration du post-exotisme
res tait le monde ex-sovié ti que, et plus par ti cu liè re ment le sous-con ti nent sibé rien66 », or Des anges mineurs attes te rait sibesoin était que lui-même par tage avec elle cette obs es sion,car, comme les « slo gans » de la poé tesse russe, ses « nar rats »décri vent « les [noi res] per spec ti ves ouver tes par la chute del’URSS […] le chaos à venir67 ». Un pre mier tra vers con sis te -rait alors à ne rete nir que la dimen sion apo ca lyp ti que de l’œu-vre post-exo ti que (comme de Slo gans) ; l’an crage russe ici pro -posé fait appa raî tre qu’au con traire la nos tal gie d’un idéal estoppo sée à cette vision, et que, loin de gros sir le nom bre despro phè tes de mal heur, Volo dine et ses nar ra teurs font par tiede ces « apo ca ly ti ciens pro phy lac ti ques » dont Gün ther Anderssignait l’acte de nais sance après Hiros hima et dont « [la] pas -sion apo ca lyp ti que n’a pas d’au tre objec tif que celui d’em pê -cher l’apo ca lypse68 ». Mais un second tra vers con sis te rait, dansun autre sens, à sur in ves tir l’an crage russe, sous pré texte quecette nos tal gie d’idéal a par tie liée avec l’his toire sovié ti que dela Rus sie. Au demeu rant, dès le début de mon inves ti ga tion,l’hé si ta tion entre les ter mes de russe et de sovié ti que, puis ledou ble mou ve ment simul tané de ter ri to ria li sa tion (en terrerusse) et de déter ri to ria li sa tion (sur le bord du monde) ontsigni fié que cet ancrage est fon da men ta le ment pro blé ma ti que,et que, si le post-exo tisme fait écho aux œuvres de Pla to nov,Tar kovski ou Zamia tine (entre autres), c’est jus te ment parceque ces œuvres rus ses ont elles-mêmes une pro pen sion à lar -guer tou tes les amar res, et qu’el les don nent ce fai sant l’exem -ple d’un art abso lu ment étran ger tel que le con çoit Volo dine.Il serait juste, dès lors, de ne pas con si dé rer au terme de cetteétude que le post-exo tisme fan tasme une terre d’ac cueil russe ;ce serait un con tre sens com plet, non seu le ment au regard de laRus sie post so vié ti que et eu égard aux pro fes sions de foi inter -na tio na lis tes des nar ra teurs post-exo ti ques, mais même, dansle passé, au regard de la Rus sie sovié ti que. Volo dine parled’« une réflexion sans com plai sance [de Maria Sou daïeva] sur
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 48
Portrait de l’artiste... 49
le socia lisme réel dans lequel elle a été éle vée69 », et il suf fit dese repor ter, dans Des anges mineurs, au nar rat 10, tom beaupour l’écri vain Artiom Ves sioly aussi édi fiant sur le tota li ta -risme bol che vi que que le « Tom beau pour Boris Davi do vitch »de Danilo Kis, pour se con vain cre que cette réflexion sans com -plai sance a cours éga le ment dans l’œuvre post-exo ti que. Orl’hom mage rendu à Ves sioly est exem plaire en ceci qu’il donneà per ce voir quel genre de com mu nauté Volo dine et ses nar ra -teurs post-exo ti ques for ment avec les artis tes rus ses que j’aimen tion nés. Tar kovski sou tient l’idée, dans Andreï Rou blev,« qu’un artiste ne peut expri mer l’idéal moral de son temps,s’il ne tou che pas à ses plaies les plus san glan tes, s’il ne les vitet ne les endure pas en lui-même70 », et tel est le des tin de tousces artis tes ; « pri va tions cruel les et mort dans des souf fran cesinhu mai nes de Khleb ni kov71 », notait Jakob son dans son énu -mé ra tion des poè tes rus ses « gas pillés » au cours des années1920, et on pour rait en pro po ser une varia tion : morts en exilde Zamia tine et de Tar kovski, inter ne ment en hôpi tal psy -chia tri que et sui cide en exil de Sou daïeva, mort en dépor ta -tion de Ves sioly, per sé cu tions, sous Sta line, d’Akh ma tova, deBoul ga kov, con dam na tion à la mis ère et à l’ou bli de Pla to nov,dépor ta tion en Kolyma, dix-sept ans durant, de Cha la mov…Ce n’est pas parce qu’ils sont rus ses que le post-exo tisme dia -lo gue avec ces morts, mais parce qu’ils sont des ébran lés, desvain cus, parce que, « si l’en nemi tri om phe, même les mortsne seront pas en sûreté72 », et qu’en sem ble, de façon sou ter -raine, trans na tio nale, il s’agit donc de faire front com mun.
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 49
50 Défense et illustration du post-exotisme
1. Voir Phi lippe Savary, « Antoine Volo dine : la parole des insur -gés ad vitam æter nam », dans Le matri cule des anges, juillet-août 1997, no 20, s. p. Dis po ni ble sur : http://www.oike.com/lmda/mat/MAT02030.html (con sulté le 31 juillet 2005). «Decet amour pour la lan gue russe et en hom mage à une grand-mère, il adop tera plus tard Volo dine, comme nom d’écri vain »,écrit Savary. Volo dine rend hom mage en effet à une grand-mèredans le prière d’in sé rer à Des anges mineurs : « J’ap pelle ici nar -rats qua rante-neuf ima ges orga ni sées sur quoi dans leur errances’ar rê tent mes gueux et mes ani maux pré fé rés, ainsi que quel -ques vieilles immor tel les. Parmi cel les-ci, une au moins a été magrand-mère » (Des anges mineurs, Paris, Seuil, 1999, coll. « Fic -tion & Cie », p. 7).
2. C’est ce qui était pré cisé en qua trième de cou ver ture de son pre -mier livre. (Antoine Volo dine, Bio gra phie com pa rée de JorianMur grave, Paris, Denoël, coll. « Pré sence du futur », 1985). Quela qua trième de cou ver ture con coure à brouiller les car tes auseuil de la fic tion (spé cia le ment chez Denoël), c’est ce dont attesteencore celle du Navire de nulle part, un an plus tard : « AntoineVolo dine a pour véri ta ble pseu do nyme Volup Gol piez », était-ilpré cisé (Un navire de nulle part, Paris, Denoël, coll. « Pré sencedu futur », 1986).
3. Voir Andreï Tar kovski, Stal ker [scé na rio], dans Œuvres ciné ma -to gra phi ques com plè tes, tome II, trad. de Luc Aubry et alii,Paris, Exils Édi teur, 2001, p. 240-241 : « LE STAL KER […] : laZone, c’est un sys tème très com plexe… de piè ges, si on veut, quitous sont mor tels. J’ignore ce qui se passe ici en dehors de notrepré sence… mais il suf fit qu’on se mon tre pour que tout entre enmou ve ment. Nos humeurs, nos pen sées, nos sen ti ments, tou tesnos émo tions, pro vo quent ici des chan ge ments que nous ne som -mes pas en mesure de con ce voir. Les anciens piè ges dis pa rais senttan dis qu’en sur gis sent de nou veaux, les endroits sûrs devien -nent impra ti ca bles, et le che min tan tôt se fait plus sim ple et aisé,tan tôt se com pli que de manière impos si ble. C’est cela, la Zone.[…] elle est à cha que ins tant telle que nous la mode lons avecnotre con science… […] tout ce qui se pro duit ici ne dépend pasde la Zone, mais de nous. »
4. Maria Sou daïeva, Slo gans, trad. d’An toine Volo dine (pre mièreédi tion en fran çais), Paris, Édi tions de l’Oli vier, 2004.
5. Cinq recueils ont paru de 1999 à 2001. Sur ce pro jet, voir
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 50
Portrait de l’artiste... 51
« Quel ques mots sur l’in ten tion d’Elli Kro nauer », dans ElliKro nauer, Ilya Mou ro mietz et le ros si gnol bri gand : Byli nes,Paris, L’école des loi sirs, coll. « Médium », 1999, p. 11-12 : « PourElli Kro nauer, il s’agis sait de gagner un pari : faire con naî tre à unpublic occi den tal ces his toi res et ces héros, mais sans don nerl’im pres sion qu’il mani pu lait des docu ments morts, pous sié reux,appar te nant seu le ment au monde des musées. Il fal lait trans met -tre des voix d’au tre fois en leur don nant la force d’une voixvivante. / Afin de ne pas tra hir ce qui cons ti tue une des plus bel -les matiè res ora les dans l’his toire de l’hu ma nité, Elli Kro nauer adonc à son tour endossé les habits d’un chan teur de byli nes, et ila choisi de réin ven ter le monde épi que comme seul un barded’au jourd’ hui aurait su l’ima gi ner, si la tra di tion des byli nesavait con ti nué jus qu’à la fin du XXe siè cle. »
6. Antoine Volo dine, « Let tre hèle-néant », dans Cor biè res matin.In vino veri tas, 14 août 1998, no 44, s. p. Dis po ni ble sur :http://www.editions-verdier.fr/banquet/n44/inedits1.htm (con -sulté le 3 octo bre 2004).
7. Roma ric San gars, « Antoine Volo dine. Con si dé ra tions post-exo ti ques [entre tien] », dans Chro ni c’art, no 16, sep tem bre-octo bre 2004, s. p. Dis po ni ble sur http://www.chronicart.com/mag/mag_article.php3?id=1249 (con sulté le 19 novem bre 2005).
8. Evgueni Zamia tine, « À pro pos du syn thé tisme », dans Le métierlit té raire. Por traits, étu des et mani fes tes, trad. de Fran çoisMonat, Lau sanne, l’Âge d’Homme, coll. « Sla vica », 1990, p. 145.
9. Antoine Volo dine, « Écrire en fran çais une lit té ra ture étran -gère », dans Chaoïd, no 6, automne-hiver 2002, « Inter natio -nal », p. 53 [for mat PDF]. Dis po ni ble sur : http://www.chaoid.com/pdf/chaoid_6.zip (con sulté le 5 août 2004).
10. Evgueni Zamia tine, « Lit té ra ture, révo lu tion et entro pie », dansLe métier lit té raire, op. cit., p. 153.
11. Des anges mineurs, op. cit., p. 7.12. Veli mir Khleb ni kov, « Ka », dans Nou vel les du je et du monde,
trad. de Jean-Claude Lanne, Paris, Impri me rie Natio nale Édi -tions, coll. « La sala man dre », 1994, p. 218. Dans une let tre à safamille datée d’août 1915, Khleb ni kov décla rait déjà : « C’estcomme ceci que je par ti rai dans les siè cles, comme celui qui auradécou vert les lois du temps » [« Takim ja ujdu v veka, otkry simzakony vre mini »] (Sobr. Proiz ve de nij, L. 1933, tome V, p. 304).
13. Mikhaïl Boul ga kov, Le maî tre et Mar gue rite, trad. de Fran çoise
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 51
52 Défense et illustration du post-exotisme
Fla mant, dans Œuvres, tome II, Paris, Gal li mard, coll. « Biblio -thè que de la Pléiade », 2004, p. 798.
14. Antoine Volo dine, « Écrire en fran çais une lit té ra ture étran -gère», dans Chaoïd, op. cit., p. 53.
15. Des anges mineurs, op. cit., p. 100.16. Ibid., p. 101.17 Jean-Didier Wagneur, « Tout se déroule des siè cles après Tcher -
no byl (entre tien avec A. Volo dine) », Libé ra tion, « CahierLivres» du 2 sep tem bre 1999, p. II-III. (C’est Volo dine qui parle.)
18. Des anges mineurs, op. cit., res pec ti ve ment p. 23, p. 190, p. 155,p. 219 et p. 144.
19. Vic tor Sega len, Essai sur l’exo tisme. Une esthé ti que du divers,dans Œuvres com plè tes, tome I, Paris, Robert Laf font, coll. «Bou -quins », 1995, p. 766. Sega len pour sui vait : « L’en tro pie : c’est lasomme de tou tes les for ces inter nes, non dif fé ren ciées, tou tes lesfor ces sta ti ques, tou tes les for ces bas ses de l’éner gie. […] je merepré sente l’En tro pie comme un plus ter ri ble mons tre que leNéant. Le néant est de glace et de froid. L’En tro pie est tiède. Lenéant est peut-être dia man tin. L’En tro pie est pâteuse. Une pâtetiède.»
20. Des anges mineurs, op. cit., p. 175.21. Ibid., p. 54.22. Ibid., p. 202. Voir Andreï Pla to nov, Djann, suivi de Makar pris de
doute, trad. de Lucile Nivat, Lau sanne, l’Âge d’homme, coll.«Clas si ques sla ves », 1972. La repré sen ta tion par Pla to nov de ces« êtres pres que sans exis tence » (ibid., p. 72) que sont les Djannest bou le ver sante, comme en témoi gne le pas sage sui vant : « Toutle peu ple était vivant, mais la vie rési dait en lui sans que savolonté y eût part, et elle était qua si ment à la limite de ses for -ces. Hom mes et fem mes regar daient devant eux, mais ilsn’avaient pas clai re ment con science de la manière dont il leurfau drait se ser vir de leur pro pre exis tence ; même leurs yeuxsom bres étaient main te nant déla vés par l’in dif fé rence, ils n’ex -pri maient plus d’in té rêt, on n’y voyait même pas la force de leurpro pre regard, ils étaient comme aveu gles, usés de part en part »(ibid., p. 98).
23. Je pri vi lé gie ici la tra duc tion que pro pose Marc Weins tein dansun arti cle, moins som bre que celle-ci, de Jean-Louis Bac kès :«Comme dans le passé l’ave nir devient mûr, // Ainsi dans l’ave -nir le passé se cor rompt » (Anna Akh ma tova, Poème sans héros,
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 52
Portrait de l’artiste... 53
dans Requiem, Poème sans héros, et autres poè mes, trad. deJean-Louis Bac kès, Paris, Gal li mard, coll. « Poé sie », 2007,p.241). Pour la tra duc tion de Marc Weins tein : voir « Étudeintro duc tive : l’écri ture lit té raire de l’his toire au ving tième siè cleou Le sens de la lit té ra ture russe moderne », dans Marc Weins -tein (dir.), La geste russe : Com ment les Rus ses écri vent-ils l’his -toire au XXe siè cle, Aix-en-Pro vence, Publi ca tions de l’uni ver sitéde Pro vence, 2002, p. 34-35.
24. Jean-Chris to phe Millois, « Entre tien [écrit] avec Antoine Volo -dine », dans Pré texte, no 16, hiver 1998, p. 42. (C’est Volo dinequi écrit.)
25. Han nah Arendt, Les ori gi nes du tota li ta risme : 3. Le sys tèmetota li taire, trad. de Jean-Louis Bour get, Robert Davreu et PatrickLévy, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1972, p. 200. Sui vantArendt, « [le] des sein des idéo lo gies tota li tai res n’est […] pas detrans for mer le monde exté rieur, ni d’opé rer une trans mu ta tionrévo lu tion naire de la société, mais de trans for mer la naturehumaine elle-même » (ibid.) ; et c’est ce qui expli que que le camp,dont cette trans for ma tion est la fonc tion, soit l’ins ti tu tion cen -trale du régime tota li taire.
26. Voir Evgueni Zamia tine, « Lit té ra ture, révo lu tion et entro pie »,dans Le métier lit té raire, op. cit., p. 150-151 : « la loi de la révo lu -tion n’est pas sociale, elle est infi ni ment plus que cela – c’est uneloi cos mi que, uni ver selle – exac te ment comme la loi de la con ser -va tion de l’éner gie, de la dégé né res cence de l’éner gie (l’en tro pie).[…] / Pour pre, ardente, mor telle est la loi de la révo lu tion ; maiscette mort est des ti née à con ce voir une vie nou velle, un astre. Etfroide, bleue comme la glace, comme les infi nis inter pla né tai resgla cés, est la loi de l’en tro pie. »
27. Ibid., p. 151.28. Des anges mineurs, op. cit., p. 24.29. Ibid., res pec ti ve ment p. 188, p. 190 et p. 50.30. Ibid., p. 23.31. C’est une anec dote à pro pos des jour nées insur rec tion nel les de
juillet 1830 à Paris que rap porte Wal ter Ben ja min : « Au soir dupre mier jour de com bat, on vit en plu sieurs endroits de Paris, aumême moment et sans con cer ta tion, des gens tirer sur les hor lo -ges » (« Sur le con cept d’his toire », dans Œuvres, tome III, trad.de Mau rice de Gan dillac, Rai ner Rochlitz et Pierre Rusch, Paris,Gal li mard, coll. « Folio/Essais », 2000, p. 440).
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 53
54 Défense et illustration du post-exotisme
32. Jean-Chris to phe Bailly, « L’évé ne ment sus pendu : Sur AndreïPla to nov », dans Pan ora mi ques, Paris, Chris tian Bour gois, coll.«Détroits », 2000, p. 156.
33. Evgueni Zamia tine, « Lit té ra ture, révo lu tion et entro pie », dansLe métier lit té raire, op. cit., p. 154.
34. Jean-Didier Wagneur, « Tout se déroule des siè cles après Tcher -no byl », dans op. cit., p. II-III. Zamia tine écri vait en 1922 : « Lelec teur et spec ta teur d’au jourd’ hui saura finir de racon ter letableau, de des si ner les mots, et ce qu’il aura achevé lui-mêmesera gravé en lui d’une manière infi ni ment plus frap pante, sedéve lop pera orga ni que ment et plus soli de ment en lui » (« Àpro pos du syn thé tisme », dans Le métier lit té raire, op. cit.,p. 147). Quant à Var lam Cha la mov, il note pareille ment que« [le] lec teur con tem po rain com prend en deux mots de quoi ils’agit et n’a nul besoin qu’on lui fasse un por trait détaillé, niqu’on déve loppe le sujet. […] il est inutile de s’ob sti ner àtour ner en rond sur des voies que le lec teur con naît par cœurdepuis l’école » (« De la prose », dans Tout ou rien. Cahier 1 :L’écri ture, trad. de Chris tiane Loré, Lagrasse, Ver dier, coll.« Slovo », 1993, p. 27).
35. Jean-Didier Wagneur, « Tout se déroule des siè cles après Tcher -no byl », dans op. cit., p. II-III. (C’est Volo dine qui parle.)
36. Des anges mineurs, op. cit., p. 7.37. Gior gio Agam ben, L’homme sans con tenu, trad. de Caro line
Wal ter, Saul xu res, Circé, 1996, p. 163.38. Pour les Grecs anciens, le rythme est un « prin cipe qui donne
ori gine et main tient toute chose dans la pré sence » (ibid.,p. 157-158).
39. Des anges mineurs, op. cit., p. 109.40. Ibid., p. 7. Si l’on songe cepen dant à une rémi nis cence musi cale,
Antoine Volo dine m’a con fié qu’il n’avait pas en tête Das Liedvon der Erde, de Gus tav Mal her, en écri vant Des anges mineurs,mais Vier Letztze Lie der de Richard Strauss, aux quels ren voientDie Sie ben Letzte Lie der, de Fred Zenfl (dans le nar rat 2).
41. Ibid., p. 25.42. Jean-Chris to phe Bailly, « L’évé ne ment sus pendu. Sur Andreï
Pla to nov », dans Pan ora mi ques, op. cit., p. 157.43. Des anges mineurs, op. cit., res pec ti ve ment p. 71 et p. 25.44. Ibid., p. 96.45. Mau rice Blan chot, « La com mu nauté néga tive (sur Geor ges
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 54
Portrait de l’artiste... 55
Bataille) », dans La com mu nauté inavoua ble, Paris, Minuit,1983, p. 30.
46. Voir Des anges mineurs, op. cit., res pec ti ve ment p. 201, p. 112 etp. 120.
47. Dany Savelli, « Une lec ture du Retour du Boud dha de Vse vo lodIva nov », dans Sla vica Occi ta nia, no 21, 2005, « Pré sence duboud dhisme en Rus sie », p. 309.
48. Des anges mineurs, op. cit., p. 24.49. Ibid., res pec ti ve ment p. 180 et p. 201.50. Ibid., p. 150.51. Ibid., p. 113.52. Ibid., p. 73.53. Andreï Tar kovski, Le temps scellé : de L’en fance d’Ivan au Sacri -
fice, trad. d’Anne Kichi lov et de Char les H. de Bran tes, Paris,Cahiers du cinéma, coll. « Petite biblio thè que des Cahiers ducinéma », 2004, p. 214.
54. Des anges mineurs, op. cit., p. 97.55. Voir Andreï Pla to nov, Djann, op. cit., p. 108 : « Qu’at ten daient-
ils de lui, ces êtres ? […] leur lan gueur pour rait se trans for mer enjoie si cha cun d’en tre eux rece vait en par tage un petit mor ceau dechair d’oi seau. Cela ser vi rait non à les ras sa sier, mais à les met -tre en com mu nion avec la vie glo bale et les uns avec les autres.Cela leur ren drait le sen ti ment du réel, et ils se sou vien draientd’exis ter. L’ali ment ser vi rait de nour ri ture à l’âme et per met traitéga le ment que des yeux rési gnés et deve nus vides étin cel lent ànou veau et aper çoi vent la lumière dif fuse du soleil sur la terre. Ilsem blait à Tcha ga taïev que si toute l’hu ma nité s’était trou vée ence moment devant lui, elle l’au rait elle aussi regardé de la mêmefaçon, avec le même sen ti ment d’at tente, prête à se leur rer d’es -poirs, à accep ter ce leurre et à se replon ger dans la vie mul ti formeet inéluc ta ble. »
56. Voir Andreï Tar kovski, Stal ker, op. cit., p. 263 : « J’y amène desgens qui sont aussi mal heu reux que moi, qui ont autant souf fert.Ils n’ont plus rien en quoi espé rer ! Mais moi, je peux ! Je peuxleur venir en aide ! J’en pleu re rais de bon heur, de pou voir lesaider ! Tout ce monde immense en est inca pa ble. Mais moi, toutever mine que je suis, je le peux ! Et je ne désire rien de plus. Etquand vien dra pour moi l’heure de mou rir, je ram pe rai jus qu’ici,dans cette cham bre, et ma der nière pen sée sera : le bon heur pourtous ! »
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 55
56 Défense et illustration du post-exotisme
57. Des anges mineurs, op. cit., p. 79.58. Ibid., res pec ti ve ment p. 219 et p. 97.59. Les nar rats se répon dent deux à deux autour du nar rat 25 : « ils se
répon dent tous d’une manière sim ple, pré cise Volo dine : le pre -mier nar rat con tient un motif qu’on va retro uver dans le der niernar rat ; le deuxième nar rat lance quel que chose, une mélo die ouune note, dont on per ce vra l’écho dans l’avant-der nier nar rat ;etc. En somme, cha que nar rat pos sède son dou ble » (Jean-DidierWagneur, « Tout se déroule des siè cles après Tcher no byl », dansop. cit., p. II-III). Cepen dant, la sim pli cité n’est qu’ap pa rente, car,sui vant le modèle extraor di naire du voyage cha ma ni que, laparole ins pi rée de Scheid mann che vau che libre ment tou tes lesfron tiè res, et les cas ne man quent pas, par exem ple, d’êtres ou demotifs qui pas sent aussi d’un nar rat dans le sui vant. Ce carac tèrefai ble ment con trai gnant de la struc ture en miroir, qui pro cède duprin cipe d’in cer ti tude à l’œuvre dans tous les livres de Volo dine,en fait toute la valeur, en démul ti pliant ses effets. L’ana lo gie avecla struc ture du Miroir, fon dée sur un « croi se ment incer tain dumon tage et de la mémoire », est frap pante. La com po si tion enfrag ments du film de Tar kovski mime la mémoire diva gante d’unhomme qui meurt ; or, fonc tion nant par ana lo gie sui vant unelogi que de la sen sa tion, cette mémoire saute d’un sou ve nir à unautre en ména geant des pas sa ges de l’un à l’au tre, en asso ciantmémoire per son nelle et mémoire col lec tive, et crée ainsi desreflets mul ti ples. Puis l’en sem ble est cons truit « à par tir de deuxmiroirs. Un pre mier, placé en fin de course (dans l’hô pi tal oùmeurt le héros) reflète la vie pas sée. Un second, situé à l’ori ginede l’his toire, ren voie au pré sent du nar ra teur. Un œil entredeux miroirs : en opti que, ce phé no mène […] pro duit un dédou -ble ment infini des reflets » (Antoine de Baec que, « La mémoireinfi nie (Le miroir) », dans Andreï Tar kovski, Paris, Édi tions del’Étoile/Cahiers du cinéma, coll. « Auteurs », 1989, p. 79-80).
60. Voir Des anges mineurs, op. cit., p. 82 : « Le sou ve nir du rêve avecSolange Bud se défai sait en lam beaux qu’il ne réus sis sait plus àrete nir. Il s’ar rêta de bou ger, mais déjà pres que tout s’était enfui,à l’ex cep tion de la nos tal gie. »
61. Gior gio Agam ben, « Idée de l’im mé mo rial », dans Idée de laprose, trad. de Gérard Macé, Paris, Chris tian Bour gois, coll.«Titres », 2006, p. 49.
62. Des anges mineurs, op. cit., res pec ti ve ment p. 97 et p. 173.
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 56
Portrait de l’artiste... 57
63. Ibid., p. 109.64. Andreï Pla to nov, Djann, op. cit., p. 44.65. Gior gio Agam ben, « Idée du com mu nisme », dans Idée de la
prose, op. cit., p. 58.66. Antoine Volo dine, « Maria Sou daïeva (pré face) », dans Maria
Sou daïeva, Slo gans, op. cit., p. 14.67. Ibid.68. Gün ther Anders, Le temps de la fin, Paris, Édi tions de L’Herne,
2007, p. 29-30.69. Antoine Volo dine, « Maria Sou daïeva (pré face) », dans Maria
Sou daïeva, Slo gans, op. cit., p. 9-10.70. Andreï Tar kovski, Le temps scellé, op. cit., p. 198-199.71. Roman Jakob son, La géné ra tion qui a gas pillé ses poè tes, trad. de
Mar gue rite Der rida, Paris, Allia, 2001, p. 10.72. Wal ter Ben ja min, « Sur le con cept d’his toire », dans Œuvres, op.
cit., p. 431.
Int_Défense-illustration_Avec Antoine Volodine 12-01-03 11:26 AM Page 57