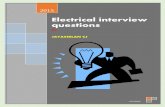Alaric et ses Goths: une question d’habitus?
Transcript of Alaric et ses Goths: une question d’habitus?
TABLES DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE ............................................................................ 1
SURVOL HISTORIOGRAPHIQUE ..................................................................... 1
PROBLEMATIQUE ............................................................................................... 3
CHAMP ANALYTIQUE ET THEORIES .................................................................................... 3
Champ analytique .......................................................................................................... 3
Habitus : explications et justifications .................................................................. 3
Habitus et « théorie de la pratique » ..................................................................... 5
Un habitus goth? ............................................................................................................ 6
• Alaric ...................................................................................................................... 6
• Les Goths d'Alaric ............................................................................................. 8
BOURDIEU ET SCIENCES SOCIALES CHEZ D’AUTRES ANTIQUISTES ............................... 11
CONCLUSION ...................................................................................................................... 12
Limites du champ analytique ................................................................................. 12
1 1
Introduction générale
L'étude que je propose dans le cadre de ma thèse saura exploiter une avenue encore peu explorée pour la période de l’Antiquité tardive. Mon objectif, comme je le présente aujourd’hui, est d’établir une nouvelle approche au thème sur des bases différentes. C'est-à-dire que, dans sa forme la plus simple, mon étude s'efforcera de dresser le portrait, non des Goths, Visigoths ou Ostrogoths, mais bien des Goths d'Alaric. Cette nuance devrait faire la force de mon étude. Contrairement à la tendance actuelle, je ne propose pas de retracer l'identité gothe; je propose plutôt de la remettre en question. Tous les chercheurs ont étudié ce groupe en l'inscrivant dans une étude plus large qui avait souvent comme but de faire l'histoire des Visigoths ou des barbares d'Europe. On n'a jamais vraiment considéré Alaric et son groupe autrement qu'en tant qu'entité gothe; l'identitéi ethnique du groupe est rarement soulevée comme problématique dans les études et lorsqu'elle l'est, on en fait peu de cas puisqu'on croit que les Goths étaient le peuple moteur du groupe de toute façon et qu'Alaric était un membre à part entière de ces Goths. La question que je cherche à résoudre est donc la suivante : Alaric et son groupe étaient-ils Goths?
Survol historiographique
La première analyse du monde barbare fut faite avec comme point de mire la chute de l’Empire de l’ouest. On croyait alors que les barbares nouvellement admis dans le girond de l’Empire étaient à la base de la dislocation de la partie occidentale. Le sac de Rome figurait d’ailleurs comme le point crucial qui signalait à la fois la faiblesse des Romaines et la force des Barbares. Les pionniers ici sont, bien sûr, Montesquieuiiet Edward Gibboniii. Plus encore, l’historiographie de cette époque montre qu’il s’agissait de faire l’histoire romaine en inscrivant les différents peuples de l’Europe moderne aux côtés de ceux de l’Antiquitéiv. C’est également à partir de ce temps que la figure du barbarev prit un sens exclusivement négatif. Gibbon fut vraiment celui qui mit la dégénérescence de l'Empire à l’avant-scène, même s’il ne fut pas le premier : Nicolas Vignier et Montesquieu avaient déjà su exploiter ce filonvi. Mais chez Gibbon, bien que les Goths jouèrent un rôle majeur dans les troubles de l’Empire, Alaric n'occupe que deux chapitresvii de son étude monumentale. Gibbon fit de l’histoire évènementielle et suivit à la lettre les récits de Claudien, Jordanès, et Zosime, ce qui le conduisit à voir les Romains et les barbares comme deux entités non conciliables. Il montra les Goths comme une bande de sauvages imprévisibles et destructeursviii qui étaient tout simplement hostilesix (quoi qu’il prît la peine de dépeindre Alaric sous des traits beaucoup plus humainsx). On peut aussi classer J. B. Bury, un érudit du 20e siècle, dans la tradition gibbonnienne simplement pour montrer la longévité de cette thèse. Ce dernier publia en 1928 The Invasion of Europe by the Barbarians où il concentra 36 pages à Alaricxi. Son ton est peut-être plus ambigu; on sent que Bury juge défavorablement les actions d'Alaric qui menèrent au sacxii, mais il renonce à voir les Goths comme conduit par un désir d'anéantir l'Empire romainxiii. C’est là une nuance importante. Qui plus est, Alaric aurait été mené par des ambitions personnellesxiv.
2 2
Enfin, entre Gibbon et Bury (avec Eugène Saint-Hilaire ou Thomas Hodgkin p. ex.) ou encore plus tard avec O’Flynn, Heather, Liebeschuetz et Ward-Perkins, pour n’en nommer que quelques-uns, la trame de fond et les résultats ont été les mêmes: c’est-à-dire que l’on s’est efforcé d’expliquer la chute de l’Empire en mettant les barbares (et surtout les Goths) à l’avant-scène. Et bien que la plupart admettent que certains barbares de renom étaient romanisés, il semble que leur nature non civilisée finissait toujours par avoir le dessus. Si on désire s’éloigner de Gibbon, il faut d’abord mentionner Amédée Thierry qui fut l’un des premiers à cultiver une thèse révisionnistexv. Thierry montra un Alaric moins barbare, qui avait « hâte d'arriver à Athènes »xvi, et à partir du moment où il est nommé maître des milicesxvii, Thierry parle du roi goth comme d'un général romainxviii et je suis d'avis qu'il est l'un des premiers à avoir été sensible à son ambiguïté ethniquexix. On peut encore nommer quelques autres érudits de marque aux côtés de Thierry, dont Numa Denis Fustel de Coulanges et surtout Marcel Brion. Son œuvre, La vie d'Alaricxx se rapproche beaucoup de l’approche de Fustel, mais elle va un peu plus loin encorexxi.
Brion vit lui aussi Alaric comme un Romain, mais il le présenta comme un Romain de façon constante tout au long de son récit et malgré tout ce que fit le Goth entre 395 et 410xxii. L'auteur montra plutôt les Goths qui suivaient Alaric comme les vrais barbares et il faut admettre que ce rendu très positif du roi goth n'avait jamais été fait à ce niveau avant luixxiii. Puis dans un ordre d'idées complètement différent de ce qui s'était fait jusque-là, Herwig Wolfram contribua à donner une nouvelle vie à l'étude des Gothsxxiv. Ce dernier exploita le premier la notion d'ethnogenèsexxv pour étudier la dynamique tribale gothe qui existait à l'époquexxvi. Du point de vue de l’Autrichien, Alaric menait une campagne pour établir son peuple à l'intérieur des frontières romainesxxvii. Dans cette étude, Alaric est un Goth agissant comme un roi goth pour des sujets goths ou devenus Goths par la force des chosesxxviii. L'auteur soulève en effet peu de questions quant à l'ethnicité des Gothsxxix. Il faut dire aussi que cette question d’ethnogenèse souleva bien des débats dans le milieu. Parmi les critiques les plus souvent citées, on trouve le livre éditer par Andrew Gillet, On Barbarian Identity (2002), où les contributions les plus significatives sont celles de Walter Goffart, Michael Kulikowski et Alexander Murray. Tous s’efforcent de démontrer que l’ethnogenèse tient trop d’éléments incertains pour acquis (dont surtout le noyau de traditions à travers les siècles) pour être un concept utile aux chercheurs. Enfin, ce qui est important de noter sur l’historiographie, lorsqu’on prend un certain recul et que l’on cherche la similitude entre les études depuis Gibbon, est que la quasi-totalité s’est concentrée à montrer la trame évènementielle et qu'elle a laissé de côté les questions d'ordres structurelles. La priorité a été de montrer comment Alaric et son groupe se sont inscrits dans la grande narration de l'Histoire romaine; on a rarement essayé de comprendre comment Alaric et son groupe divergeaient des autres barbares et pourquoi ils en vinrent à faire office de prototype chez les érudits. En vérité, aussitôt qu'on parle de royaume barbare ou de chef barbare notoire, Alaric fait office de modèle. Or, ce dernier n'est pas le roi barbare par excellence, et son groupe n'est pas la nation visigothe, comme l’annonçait déjà Fustel de Coulanges.
3 3
Problématique
Champ analytique et théories
Champ analytique
Il s’agit de structurer une méthode qui servira de base à l'étude. Mon sujet me demande une sensibilité au fait social d'un groupe qui est lui-même muet dans les sources historiques. C'est là une infraction à l’une des plus importantes règles de la méthode des sciences sociales : tant la sociologie que l'anthropologie mettent le travail empirique à l'avant-scène, suivie de l'examen des données recueillies et de la déduction qui clôt le travailxxx. La plupart des concepts et des théories se basent sur ce travail empirique. Bien entendu, il s'agit d'un élément épineux pour tout antiquiste qui veut se livrer à une étude multidisciplinaire comme je tente de le faire. Comment, en vérité, étudier un groupe qui n'a laissé aucune source primaire et qui est presque toujours perçu comme l'ennemi ou l'agresseur? On sait bien qu’aucun de nos auteurs romains n'a mené d'enquêtes ethnographiques comme on l'entend en ce moment; ce n'était simplement pas nécessaire. Mis à part l'aspect physique des barbares qui frappait par sa différence semble-t-il, ce que nous apprennent ces auteurs doit être pris au second, voire même au troisième degré dépendant de la distance temporelle et spatiale qui séparait l'auteur de son sujetxxxi. Une partie de la solution semble donc se trouver du côté des sciences sociales où certains concepts se présentent plus aptes à expliquer la formation d’un groupe d’une façon plus conforme à la réalitéxxxii. Je présente donc ici les balbutiements d'une réflexion qui se veut centrée sur l'agent, comme dirait Bourdieu, et non sur le groupe, dans une tentative de déplacer la mire des études précédentes. Simplement dit, en supplantant le groupe par l'agent, cela devrait me donner une certaine marge afin de mettre l'accent sur la complexité du groupe pour pouvoir faire ressortir ainsi pleinement le non-sens à décrire le groupe d'Alaric en termes simplistes.
Habitus : explications et justifications
Je rappelle que la méthodologie que je compte développer se concentre sur une approche microscopique du sujet d'étude, contrairement à l'approche macroscopique que l'on rencontre à l'habitude. L'ethnogenèse de Wolfram, par exemple, est réellement un concept qui vise à expliquer le long terme, le macromonde des Goths; c'est ce que certains nomment l'approche primordialistexxxiii. Bentley en dresse d'ailleurs un résumé exemplaire où il met l’accent sur la perturbation qui force la formation d’une ethnicité collectivexxxiv. Contrairement à cette approche, je propose de restreindre l’objectif : je vise à étudier un seul groupe sans assumer cette continuité. Je crois que les différents groupes goths n'avaient que ce nom de commun qui leur était donné par des auteurs romains loin de se soucier d'effectuer un travail juste. Les Goths d'Alaric ne sont pas à rapprocher de ceux d'Athanaric et de Radagaise. C'est aussi un point de vue que l'on pourrait dire plus instrumentalistexxxv, surtout en ce qui a trait au côté fictif de ces collectivitésxxxvi. Par contre, ce que les approches primordialistes et instrumentalistes ont en commun, comme l'a
4 4
bien indiqué Bentleyxxxvii, est qu'elles généralisent trop et ne prennent jamais en compte l'individu qui est pourtant le centre de la construction identitaire de tout groupe. C'est ce qui me mène à introduire le concept qui vient corriger ce défaut : l'habitusxxxviii. L'habitusxxxix tel que mis de l'avant par Bourdieu permet une plus grande ouverture d'esprit sur l'agent, d'un côté, et sur le champxl qui influence l'action, de l'autre. Ici, il faut souligner que l'habitus n'est pas l'équivalent de l'ethnicité; ce n'est qu'une composante identitaire crucialexli. Bourdieu a popularisé l'idée que l'agent agit en fonction de stimuli qui lui viennent d'un milieu où agir (champ) et entraine une réponse qui est en règle avec son bagage personnel d'idéaux (habitus). Ce bagage personnel est acquis en majeure partie dès l'enfancexlii et s’amplifie pour prendre une forme aux contours plus ou moins définis au cours de la vie; ce bagage ne sera jamais complet, on pourra toujours y ajouter des éléments, mais il devrait demeurer reconnaissable malgré toutxliii. C'est cela qui donne à l'agent le « sens of the game »xliv de la société dans laquelle il évolue. Le concept d'habitus a donc ce net avantage de mettre l'agent au premier plan. Non pas que l'agent y soit vu comme libre de contraintes : Bourdieu n'est jamais arrivé à se défaire complètement d'une approche structuralisantexlv. D'ailleurs, sa théorie est élitiste (tout comme l’est l’ethnogenèse) et, si elle est appliquée à la lettre, restreint considérablement le « libre arbitre » de l'agentxlvi. L'agent sera, à dire vrai, porté à agir comme il le fera par la force de la structure objective (c.-à-d. le champ)xlvii à laquelle il sera confronté, en règle avec sa doxaxlviii. De ce fait, aux yeux de Bourdieu, ses concepts n'existent pas séparémentxlix; l'habitus est donc directement relié au capital, au champ et à la doxa. C'est l'addition de tous ces concepts qui donne parfois à l'habitus une allure programmée. Il faut dire que Bourdieu s'est basé sur ses propres recherches pour construire sa méthode; la « théorie de la pratique » est donc bien ancrée dans la réalité d’aujourd’hui. Ce sont là deux limites importantes à ce champ analytique sur lesquelles je reviendrai plus en détail : pour l’instant, notez simplement que la théorie de Bourdieu assume que les espaces sociaux dominés aspirent à atteindre l’état des espaces sociaux dominants, et cela est dû aux structures qu’il a lui-même étudiées durant sa carrière. Comme l’a noté N. Zeiner, la théorie de Bourdieu ne fonctionne que selon « a vertical axis »l et ne considère jamais l’élément horizontal de la société. Malgré ce bémol, la solution est assez simple. Par exemple, en laissant de côté les concepts de champli et de capital pour ne pas donner une allure trop forcée à l'étude, on pourra tout de même avancer l'hypothèse sensée que chaque agent du groupe goth d'Alaric possédait son propre habitus (puisque tout groupe est cadencé par une structure intrinsèque de classe) et cela ne pourra faire autrement que de nous ramener à cette « théorie de la pratique » puisque l'on permettra justement à chaque agent un rayon considérable d'actions possibles (et non dépendantes du groupe) et alors, un certain relativisme sociétal malgré tout (c'est-à-dire, des actions de groupes impossibles à prédire puisqu'elles découleront de l'ensemble des actions structurées de chaque agent)lii. D'ailleurs, on doit réaliser que c'est la somme d'agents qui forme le groupe, d'abord, et que le groupe influence l'action de ses différents agents, ensuite; c'est absolument crucial à l'étude qui m'attend. On ne le dira jamais assez : tous les groupes goths n'étaient certainement pas identiques et ne sont pas équivalents l'un de l'autreliii. Ajoutons que le milieu influence fortement l’agent (et le créé même parfois), et que dans bien des cas le groupe sera la résultante d'une somme d'agents de provenances diversesliv. Cela en vient à créer un véritable complexe d'habitus et c'est ce complexe
5 5
d'habitus d'agents qui doit devenir le centre d'attention lorsqu’on parle des actions d'un groupe, et non l'habitus du groupe lui-même qui n'est rien d'autre à la fin qu'une médiation d'habitus d'agents d’espaces sociaux différents. L'habitus est donc à la fois individuel et social, constant et instable, unificateur et fractionnel.
Habitus et « théorie de la pratique »
Bourdieu a mis au point une « théorie de la pratique » qui me sera très utile et qui découle de ce concept d’habitus; on la résume à l'aide de la formule suivante : [(habitus)(classe)] + champ = pratiquelv. Pour Bourdieu, l'action (pratique) de tout individu (agent) est directement reliée et dépendante du milieu sociologique d'action (champ), du bagage personnel et social de l'agent (habitus) et de la classe (c.-à-d. sociale) de l'agent en question. À chaque homme son habitus, pourrait-on dire sur ces bases, et à chaque homme correspondra une pratique différente d'un autre dans une situation donnée. Toutefois, Bourdieu rappelle souvent que les agents d'une société s'influencent réciproquement et agissent de manière semblable dépendamment de leurs espaces sociaux. En regroupant ces multiples habitus qui forment la réalité de tout groupe, il devient impossible d'affirmer que la distance spatiale entre deux groupes est sans grande importance. De ce fait, il devient beaucoup plus difficile d'accepter une version réductrice qui voit l'ajout d'éléments nouveaux à tout groupe comme une banalité sans conséquences majeures. Au contraire, chaque nouvel individu apporte un nouvel habitus, de nouveaux conflits, etc. Bien sûr, il faut garder à l’esprit que le groupe à l'étude, les Goths d'Alaric, n'ont pas évolué dans le monde de Bourdieu, et n'ont peut-être pas partagé la structure sociale rigide qu'étudia le sociologuelvi. Aussi, la modernité d'aujourd'hui fait en sorte qu'il est beaucoup plus facile de garder en vie un sens identitaire collectif spatialement vastelvii puisqu'on est en mesure de maintenir les contacts, peu importe la distance. Et la distance spatiale entre bel et bien en jeux pour Bourdieu : selon lui, plus les agents sont près les uns des autres, plus ils auront d'éléments en communlviii. Cela me mène à postuler que les Goths, bien que différents de certains Romains à certains endroits de l'Empire, pouvaient néanmoins ressembler beaucoup à ceux qui vivaient à proximité. Il n'y a là rien d'inconcevable. Cela implique du même coup que deux groupes goths (p. ex. Alaric et Radagaise) évoluant à des endroits spatialement espacés, étaient sans doute bien plus différents qu’on ne veuille encore l’admettre suivant le témoignage de nos sourceslix. De là aussi, je crois que toute l'effervescence qu'a créée le courant de l'ethnogenèse, en nous faisant croire que la mémoirelx des dominants agissait comme le ciment du groupe, a obscurci les autres voies d’interprétations possibles. Qu'on le veuille ou non, l'ethnogenèse, même si à la base on y reconnait la diversité culturelle des groupes impliqués, passe comme un concept foncièrement unificateur et même homogénéisateur. Suivant les dernières études sur la question on se sent en effet obligé de partir avec l'idée que l'identité et l'ethnicité étaient importantes pour les Goths, ce qui est loin d'être certainlxi. Je répète que le point de départ est de reconnaitre que le groupe d'Alaric n'est pas à mettre au niveau des Goths précédents, ni peut-être même suivants d'ailleurs : on ne peut pas faire une histoire des Goths à la manière d'un Jordanèslxii. Je suis convaincu que les Goths d'Alaric et qu’Alaric lui-même possédait un complexe identitaire qui se nourrissait à partir de plusieurs sources de leur environnement et
6 6
formait alors un habitus unique. En parlant des Goths d'Alaric, de Gaïnas, etc., on ne peut éviter de les croire semblables sur la seule dénomination de leur nom Goth. Dans l’Empire, ce que ces groupes avaient de commun ne relevait pas de leur héritage goth, mais bien de leur adaptation à la vie romaine.
Un habitus goth?
On touche ici un problème épineux : on ne sait presque rien de la structure de l’espace social du groupe d’Alaric. On sait qui y était considéré le chef par les auteurs anciens : de là, on peut supposer qu’Alaric siégeait seul au sommet de la pyramide social et que, sous lui, s’étalait un nombre x d’espaces sociaux. On n’en sait pas beaucoup plus. Peu d’auteurs se sont d’ailleurs penchés sur la question, et jamais de façon satisfaisante. Il faudra s’adonner ici à une étude comparative. Cela fut fait auparavant entre les groupes barbares et l’Empire romain, mais très peu selon les groupes barbares entre eux. Par exemple, Wirth avance l’idée d’une dynastie royale pour les tribus germaniques et dépendante des ressources de l’Empire romainlxiii. C’est là une idée très répandue.
• Alaric Pareillement pour Alaric. On voit clairement, autant dans les sources que dans l’historiographie des 200 dernières années, que ce chef est vu autrement que son groupe. Avec quelles structures structurées Alaric évoluait-il donc? Certains des éruditslxiv les plus influents ont décrit Alaric comme un produit unique du monde romain, un général barbare à peine intégré qui essayait de se tailler une niche indépendante dans l’Empire pour ses Goths. Je suis plutôt d’avis qu’Alaric est la preuve que le monde romain était plus fluide qu’on ne veuille l’admettre.
Carrière, pouvoir et ébauche d’habitus
S'il n'est pas né dans l'Empirelxv, il y vécut sûrement durant une bonne partie de sa vie. En d’autres mots, bien que l’on ignore son lieu de naissance, ce que l’on sait avec un minimum de certitude nous en montre suffisamment pour tracer une première ébauche de l’habitus de cet homme. D’abord, au moment où Alaric combattait dans l’armée de Théodose, il était sans doute dans la jeune vingtainelxvi. Il était donc probablement dans la trentaine tout au plus à l'époque où il s'avança sur l'Italie avec son groupelxvii. Alaric présentait alors des caractéristiques que l’on retrouve chez la plupart des warlordslxviii subséquents : il avait servi à titre de soldat romain, reçut un haut titrelxix et fut un « faiseur d’empereurs ». De plus, son pouvoir lui venait de son armée qui lui témoignait une fidélité sans bornelxx, et on est porté à croire que son autorité passa à son successeur sans problème apparent. Une partie de son habitus était donc en règle avec ce que l’on sait des autres warlordslxxi. En cela, on est forcé d’admettre qu’Alaric présentait un habitus similaire à celui attendu de l’espace dominant du champ militaire romain. Personne ne dira que Richomer, Arbogast, Stilichon, Gaïnas, ou plus tard Aspar et Ricimer n’étaient pas Romains à la base (c.-à-d. selon leur habitus); je suis d’avis que c’est aussi le cas pour Alaric, du moins en partie. À première vue, Alaric semble se trouver dans un entre-deux, étant donné qu’il était forcé d’opérer selon les structures de l’Empire et celles de son propre groupelxxii. Cela implique que, si l’on désire étudier de près l’habitus d’Alaric, il faudra faire la part des choses selon les champs qui nous sont visibles dans les sources. Sans surprise, ce sont les champs militaire/politique et culturel qui sont les plus évidents. Ce qui est intéressant, c’est
7 7
qu’Alaric présentait une personnalité ambiguë aux auteurs de l’époque : on le voit parfois habillé de peaux, d’autres fois vêtu d’une togelxxiii. Ce dernier point amène à l’habitus culturel sur lequel on est moins renseigné. Quelques éléments en apparence banals méritent toutefois d’être mentionnés : Alaric était arienlxxiv, ses effets (habits, armes, etc.) provenaient de l’Empirelxxv, sa nourriture provenait de l’Empirelxxvi, et on peut aussi être porté à croire qu’il avait été initié à une forme d’éducation romainelxxvii. On peut donc penser que bien peu d’éléments extérieurs auraient permis de l’identifier comme un barbare. De plus, tout porte à croire qu’il savait comment se comporter avec la noblesse romaine dans laquelle il comptait au moins un amilxxviii. Il aurait peut-être même été un hôte exemplaire pour Galla Placidia à Ariminum (Rimini)lxxix. Il paraît également qu’il savait comment agir dans le Sénatlxxx ou du moins en présence des sénateurs. Ajoutons enfin que les demandes de paiement qu’il adressa à Stilichon et au Sénat semblent avoir été tout à fait réalistes pour l’époque, ce qui pourrait laisser transparaitre une compréhension du champ économiquelxxxi que l’on serait en droit d’attendre d’un homme qui avait occupé le poste de magister militum. Tous ces éléments peuvent aisément mener à des comparaisons afin d’établir un prototype d‘habitus aux warlords. Pour ne prendre qu’un exemple, le cas de Ricimer se prête bien à cette comparaisonlxxxii. Nous avons alors deux warlords barbares, de foi ariennelxxxiii, qui ont évolué dans le système romain dès un jeune âge, éventuellement fait magistri milites, puis des « faiseurs d’empereurs »lxxxiv. Ces éléments ont en fait causé bien des problèmes d’interprétation aux historiens sur le cas de Ricimer. Par exemple, Gillett se livre à une gymnastique intellectuelle assez poussée afin d’essayer de comprendre pourquoi Ricimer avait opté pour une carrière chez les Romains plutôt que chez son propre peuple.lxxxv Ce dernier avance l’hypothèse sensée que Vallialxxxvi, son grand-père, décéda alors que Ricimer était encore tout jeune et que cela poussa sa famille à l’exil. On peut aussi réinterpréter l’épisode en mettant à l’avant-scène l’habitus avec un résultat complètement différent. En effet, si Ricimer était membre du groupe goth de Vallialxxxvii, et qu’il naquit en 418 au plus tôtlxxxviii, il n’y a aucune raison pour que l’habitus culturel et militaire de ce groupe (éprouvé à l’habitus romain) ne l’ait pas modelélxxxix. Gillett voit ces groupes comme séparés des institutions romaines, alors qu’il faut plutôt apprécier leurs dépendances sur ces institutions. Qui plus est, le groupe de Vallia servait toujours l’Empire et on a toutes les raisons de croire qu’une éducation à la romaine ne posait aucun problème pour un membre de ce groupe; cela était peut-être même souhaité par le groupe ou l’Empire, ou les deux. Quoi qu’il en soit, Ricimer naquit dans une vieille province romaine et il n’avait pas besoin d’aller chercher bien loin cette éducation. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à l’exil pour expliquer ce phénomène curieux à priori; il s’agit peut-être simplement de l’évolution des relations et de l’adaptation évidente des groupes barbares (du moins, de leurs espaces dominants) à la vie romaine. Sa position dans son groupe, de même que son habitus en règle avec l’habitus romain, expliquerait en partie son ascension rapide dans la hiérarchie militaire romainexc. Cette comparaison n’explique pas cependant le curriculum militaire d’Alaric. À l'habitude, les généraux barbares finissaient par venir servir l'Empire (de leur gré ou forcé) et montaient graduellement en grade au fil des ansxci. Alaric passa de comeis rei militaris à magister militum per Illyricum en quelques mois seulement, si l’on suit Burnsxcii. Ensuite, ces généraux barbares étaient intégrés dans le système et n'agissaient pas, à l'habitude, selon leurs désirs; les empereurs pouvaient les appeler à leur service à tous moments et, bien qu'ils commandaient souvent des détachements barbares, on croit qu'il
8 8
n'y avait pas de lien fort entre euxxciii. Suivant la communis opinio, Alaric est un cas unique par ce caractère qu’il commandait son peuple et non pas un détachement barbare de l'armée romainexciv. Enfin, Wolframxcv est d’avis qu’il est le premier roi à avoir été élu dans l’Empire, ce qui constitue une particularité de plus. Quelques précisions semblent nécessaires pourtant sur cet habitus militaire/politique : Alaric n’a pas toujours joui d’une autorité inégalée chez les Goths et il semble qu’il ait dû faire ses classes. Le chef goth le plus puissant dans l'armée qui accompagnait Théodose en 394, c'était Gaïnasxcvi. Pareillement, Gaïnas et Fravitta (395-402) furent à la tête du commandement militaire d’Orient alors qu’Alaric était relégué à un poste subordonné. Il n’a réellement acquis un pouvoir romain équivalent à eux qu’en 409-410xcvii, soit quinze ans après, et grâce à l'usurpateur qu'il avait lui-même installé à Rome. Donc, bien qu’il ait acquis un titre prestigieux assez tôt dans sa carrière, il n’a pas atteint les sommets si rapidement. En cela, il se conforme tout de même à ce que l’on avait vu avant lui (et à l’habitus militaire romain). De plus, Alaric n’a jamais été fait consul au contraire d’autres barbares de renom comme Bauto ou Stilichon. Cela pourrait d’ailleurs surprendre qu’Attale ne l’ait pas nommé à ce titre après avoir été investi de la pourpre, mais il me semble que c’était assez en règle avec l’habitus militaire/politique attendu. Zosimexcviii montre d’ailleurs une dynamique surprenante entre Attale et Alaric dès le moment où il se voit investir du titre d’empereur : Alaric redevient son subordonné et n’a d’autre pouvoir que celui de conseiller jusqu’au moment où il décide de mettre un terme à l’expérience. Cette relation de pouvoir, curieuse à première vue, reprend tout son sens lorsqu’on la replace dans le champ analytique employé jusqu’ici : Alaric n’était pas l’empereur et n’agissait pas comme un empereur, ce qui, encore une fois, se conforme tout à fait à l’habitus militaire/politique romain attendu d’un homme intégré à l’espace social dominant. Alaric présente donc bien des éléments atypiques qui sont inattendus chez un général barbarexcix : quelques-uns sont certains (sa montée rapide dans la hiérarchie militaire), d’autres pourtant relèvent plus du romantisme et de la tradition littéraire à son sujet (sa royautéc, et son peupleci).
• Les Goths d'Alaric Il faut se livrer à deux études en réalité puisque, on l’a vu, presque tous les érudits ont réalisé qu’Alaric possédait un caractère différent de celui de son groupe qui est toujours vu comme plus barbare que son chef. Il faudra donc étudier le groupe d’Alaric en le comparant à d’autres groupes barbares de l’époque, comme les Maurescii, les Alamansciii, etc. Il faut essayer de faire une moyenne de la structure tribale de ces groupes barbares afin de se donner un point d’appui pour mener une étude comparative. Les travaux qui se sont penchés sur la société barbare l’ont fait, dans la majorité des cas, en comparant la tribu ou la confédération avec l’État romain, et souvent d’après la Germania de Tacite. Il faut plutôt s’efforcer de comparer des entités près l’une de l’autre temporellement et (de préférence) spatialement. Le but n’est pas d’arriver à la réalité de l’époque, mais bien de proposer un modèle plus représentatif des groupes barbares des 4e et 5e siècles afin de pouvoir comparer l’habitus du groupe d’Alaric à celui que l’on voit ailleurs et, du même coup, être mieux disposé à proposer une conclusion temporaire aux objectifs probables du groupe, de même que les raisons pour lesquelles il ne réussit pas à se sédentariser avant 418.
9 9
Avant tout, cependant, il vaut la peine de prendre pleinement conscience de la composition ethnique du groupe d’Alaric et du peu de fondement sur lequel s’appuie sa description comme une entité gothe (suivant l’interprétation d’Heather, entre autres)civ.
Composition ethnique
Très simplement, on peut s'en remettre à l'entrée dans l'Empire en 376. À ce moment, on lit chez Ammien que ces Goths sont en fait les Tervingi, soient les plus familiers avec l'Empirecv. Ils sont toutefois rejoints peu de temps après par un groupe de Greuthungi, de même qu'un groupe de soldats goths (commandé par Sueridas et Colias)cvi peu avant la bataille d'Andrinoplecvii. On sait aussi qu’un détachement de cavalerie alaine et hunnique s’ajouta aux alentours de cette bataillecviii. Enfin, on rapporte que des esclaves se seraient joints à ce groupe par la suite, de même que des déserteurs romainscix. C'est donc dire que, même en faisant fi des pérégrinations d'Alaric entre 401 et 410cx, on peut apprécier la complexité de ce groupecxi (ce qui n'est pas une percée en soi)cxii. Et même si on ne peut vraiment avancer de pourcentage tangible quant à la composition ethnique des Goths d'Alaric, il me semble clair que la majorité gothe n’est pas à tenir pour acquise.
Organisation et ébauche d’habitus.
Il faudrait d’abord s’entendre sur la division de l’espace socialcxiii du groupe. La tradition veut que l’on décrive tout groupe goth ou germanique selon une division s’apparentant à la tribu (gens)cxiv comme noyau de base de la société. Mais la description qu’on fait de l’organisation de l’espace social d’une telle société est superficielle : chaque tribu (hautement militarisée)cxv aurait été menée par un chef soit du champ militaire/juridique, peut-être du champ religieux, parfois les deux ou encore un seul en temps de crise qui regroupait probablement ces deux champs à la foiscxvi. Dans ce dernier cas, plusieurs tribus se groupaient ensemble pour former une confédération et le premier vrai chef goth d’une confédération (iudex)cxvii qui nous soit connu est Athanariccxviii, bien que son pouvoir relevait avant tout du champ militairecxix. Cette autorité n’était jamais absolue pourtant, et le chef tribal devait exciter son groupe à l’action sans pouvoir l’y forcercxx. C’est d’ailleurs là un élément qui joue en faveur du récit de Claudien, alors qu’il nous montre un Alaric en pleine discussion (enflammée) avec son conseil de guerrecxxi et l’assemblée des vieillardscxxii. Toutefois, Sivancxxiii remarque que l’épisode du sac de Rome tel que rapporté par Orose montre qu’Alaric avait acquis une autorité sans précédent sur ses Goths. Qui plus est, Sivancxxiv souligne également que l’on ne peut vraiment définir les bases de la royauté d’Alaric puisqu’il est un cas sans précédent; il n’évoluait pas dans un vase clos, mais dans le système romain et ce que l’on sait des Goths ante-376 ne s’applique pas nécessairement à son cas. Mis à part l’espace social dominant, qui implique d’ailleurs un espace dominé, on a cru longtemps que les Goths ou les sociétés germaniques avaient à leurs fondations une vaste base formée de paysanscxxv (libres/soldats) et sous eux se trouvaient encore des esclavescxxvi. C’est là l’héritage du nationalisme du 19e siècle, où on se félicitait à l’idée d’être des descendants d’hommes libres, etc. Heather met d’ailleurs en garde contre cette approchecxxvii. Ce dernier avance une théorie à mi-chemin entre cette vaste base paysanne et l’approche élitiste de Wolfram. Il argumente pour voir l’essentiel de l’espace dominant de la société gothe comme une oligarchie, menée par un groupe important d’hommes libres goths (paysans ou non) qui auraient constitué cette noblesse gothecxxviii, sans l’être au sens romaincxxix. Il croit que la période suivant la mort de Théodose poussa
10 10
à la création des Visigoths en forçant certains chefs (et nobles) d’autres tribus gothes à abandonner leurs places au profit de la collectivité gothe; c’est dire qu’ils auraient préféré s’unir à un grand rex ou iudex pour survivre et préservé leurs places dans la noblesse gothecxxx. Découlant de cela, on montre à l’habitude ces Goths très consciencieux de leur patrimoine, de l’importance de leur culture, etc., alors que l’on ignore totalement si le fait d’être Goth comptait réellementcxxxi. Par exemple, on sait que le groupe d’Alaric dénombrait un bon nombre de Romains à divers moments, et pas seulement de l’espace dominécxxxii. Attalecxxxiii est le plus fameux d’entre eux; peut-on croire qu’il ne faisait pas partie de l’espace dominant du groupe d’Alaric? Qu’en était-il d’Aetiuscxxxiv et Joviuscxxxv ou de Galla Placidiacxxxvi qui en firent partie à certains moments? C’est aussi là un indice qui vient s’ajouter au mystère de ce groupe : ils (les agents du groupe) devaient accepter de voir leur chef se soumettre à l’autorité des Romains. En instaurant Attale à titre d’empereur et en se contentant de recevoir le titre de magister utriusque militiae, Alaric laissait entendre qu’il était le second en importance dans la hiérarchiecxxxvii. Cela aurait pu avoir sonné sa fin si l’on s’en remet au schéma traditionnel de l’organisation tribale; que l'on n'ait jamais entendu dire que son autorité ait été vraiment défiée doit nous surprendre. On croit souvent que cela était d'usage entre les divers chefs des groupes goths réuniscxxxviii, ce qui était le cas de celui d’Alaric avec Athaulf et sans doute y en avait-il d’autres parmi les alliés de Stilichon… On voit clairement cette animosité en tout cas dans l'épisode fameux du banquet de 392, où Fravitta tua Eriulfcxxxix. Qui plus est, si l'on croit qu'Alaric était à la tête d'une confédération qui dénombrait plusieurs tribus (et donc un peuple)cxl, où chaque roi ou chef aurait surement eu leur mot à dire, le tout semble inconcevable. C'est là une indication que le groupe n'avait pas l’espace social goth attendu : le groupe d’Alaric opérait sous une autre structure que celle avancer dans la Germania. On ne perçoit pas un intérêt d’indépendance de leur côté, c’est plutôt un besoin urgent de se trouver une niche dans l’Empire. Ensuite, si l'on tient pour acquis qu'Alaric a vraiment conduit les Goths de 376 devant les portes de Rome, il ne faut pas se surprendre que certains auteurs romains les aient vus justement d'un meilleur œil que les Goths de Radagaise. Ces Goths de 376 avaient surement acquis au moins une fraction du « sens pratique » de l'Empire rendu à ce point. Qui plus est, on parle ici d'une période de 34 ans entre l'entrée de 376 et le siège de Rome, ce qui veut dire que les soldats goths qui avaient combattu à Andrinople étaient presque tous morts, et le reste n'était sans doute plus en mesure de combattre.cxli Ainsi, une partie des soldats qui accompagnèrent Alaric en Italie avaient fort probablement été élevés, et certains étaient même nés, dans l'Empire. On peut donc parler d'une armée en partie romainecxlii; c'est là un constat qui s'impose simplement avec l'approche de Bourdieu. En fait, on ne peut comprendre l’épisode d’Attale que si le groupe qui le suivait s’attendait justement à un tel comportement. C’est dire que les Goths d’Alaric étaient probablement assez familiers avec l’Empire, qu’ils avaient un habitus collectif assez romain, pour ne pas oser contester l’autorité romainecxliii. Ce groupe s’est en effet montré plus que patient alors que leur chef essayait de négocier avec Honorius… Pour qu’un tel épisode puisse avoir eu lieu, pour qu’Alaric ait eu, disons, le loisir de négocier et de quémander à l’empereur, il fallait que cette disposition vis-à-vis de l’Empire soit perçue comme normale ou soit du moins attendue et acceptée. C’est ici que l’habitus du chef et celui du groupe semblent se rejoindre, alors qu’ils acceptent tous deux l’autorité romaine.
11 11
L’usurpateur instauré par Alaric est bel et bien l’indice le plus probant que nous aillons qui prouve que ces Goths avaient acquis le « sens pratique » de l’Empire. Cet évènement trahit en effet une doxa tout à fait en accord avec la tradition romaine. Alaric ne se voyait pas occuper le rôle de l’empereur possiblement parce qu’il lui était mentalement impossible de se rendre à ce constat, tout comme bien des généraux avant et après lui qui étaient eux aussi parfaitement intégrés, dont le plus célèbre est sans aucun doute son rival le plus proche, Stilichoncxliv. En tout cas, cet épisode cadre bien dans l’habitus d’Alaric et de son groupe à une autre époque. Par exemple, Claudiencxlv mentionne qu'Alaric fut fait magister militum per Illyricum et qu'il dut alors agir en tant que juge pour des gens qu’il venait à peine de massacrercxlvi. En fait, ces mots cachent un élément que plusieurs ont ignoré : on est rapide à voir dans ce titre une solution aux problèmes logistiques d’Alariccxlvii, mais on ne reconnaît pas que cette fonction venait avec des responsabilités romaines. La grande majorité des chercheurscxlviii ont tenu pour acquis qu'Alaric n'a pas eu à remplir ses devoirs, mais c'est là une affirmation infondée. Qu'il ait reçu cette position prestigieuse (et au-delà des intrigues de cour que montre Claudien en toile de fond) milite en faveur de sa capacité à la remplir et de la place qu’il avait acquise dans la haute société romaine. En tout cas, il conserva ce titre pendant quatre ans (397-401), ce qui peut vouloir dire qu'il répondait aux attentes. Ce genre de détails montrent bien qu'Alaric avait la connaissance nécessaire de l'Empire romain et de ses institutions, le « sens pratique » requis pour y évoluercxlix. Notez qu’il y a encore bien d’autres difficultés rattachées à l’étude de ce groupe, comme lorsqu’on essaie de cerner son spectre social. Heathercl avance qu’Alaric menait un peuple, non seulement une armée comme le croit pourtant Liebeschuetzcli. L’indice le plus probant pour un peuple (avec femmes et enfants) nous vient de Claudienclii et Orosecliii, alors que l’armée est sous-entendue dans la majorité des autres sources comme Augustin, Zosime, Jordanès, Sozomène, etc.cliv Je crois de plus en plus que l’interprétation de Liebeschuetz soit la bonne. Tous les évènements connus, les batailles et les pérégrinations d’Alaric ne font de sens que si l’on croit qu’il menait une armée. Même ses demandes de territoires, qui sont habituellement perçues comme une volonté d’accommoder son peuple, sont sujettes à une tout autre interprétation : l'importance des terres pour les Goths de l'époque est en effet évidente dans la vie de St. Sabaclv; on y voit clairement que l’espace dominant goth prenait la propriété de terres comme un marqueur social important. Peut-être cela était-il toujours d'usage au temps d'Alaric, de sorte que ses revendications de territoires pourraient être redevables à un souci d'acquérir un capital économique en Occident afin de légitimer sa position au sein du groupe ou d’en faire profiter les plus méritants? Peut-être ces demandes cachaient-elles simplement un désir plus romainclvi, en règle avec l’habitus attendu? Une chose semble certaine (si l’on peut croire Zosime)clvii, les territoires qu’il demanda la première fois à Honorius étaient plus que suffisants à accueillir son peuple si c’est vraiment ce qu’il souhaitait. Mais encore, peut-être avait-il en tête un cantonnement selon l’habitus militaire, en éparpillant ses hommes dans plusieurs villes de ces provinces?
Bourdieu et sciences sociales chez d’autres antiquistes
C’est une approche encore peu explorée pour étudier l’époque des royaumes barbares (et
12 12
les barbares eux-mêmes)clviii et je suis certain qu’il s’agit d’une piste de recherche prometteuse. En ce qui a trait à l’Antiquité tardive, les concepts de Bourdieu sont le plus souvent utilisés pour expliquer le champ religieux, en montrant de quelle façon Chrysostome, par exemple, essayait de modifier l’habitus culturel romain de sa congrégationclix. Pour les autres périodes de l’Antiquité, c’est celle de la République qui concentre le plus d’études mettant à profit ce champ analytique. Notamment, le livre de Sara E. Phang, Roman Military Service, est une étude exemplaire en ce sens. Elle est l’une des rares à concentrer un chapitre entier aux méthodes et concepts qu’elle utilise dans son ouvrage. Bourdieu y figure aux côtés de Marx, Weber et Althusser. Contrairement à la majorité des érudits qui utilisent Bourdieu, Phang ne se limite pas seulement à l’habitus, mais emploie également les concepts de « violence symbolique » et « d’improvisation ». C’est là un signe qu’elle s’est investie à comprendre l’idée de Bourdieu. Essentiellement, on voit que sa réflexion sur ces concepts, bien esquissée dans le premier chapitre, reste en toile de fond d’un couvert à l’autreclx. Une partie de sa thèse est que l’habitus militaire (disciplina) du début de l’Empire était un état idéal auquel les soldats étaient encouragés, et même forcés, d’atteindre sans jamais y arriver. C’était donc une forme de répression politique qui faisait en sorte de légitimer la place des dominants tout en rendant l’état de soumission des soldats implicite. Puis, Clifford Ando est un autre chercheur à avoir utilisé Bourdieu avec succès dans : Imperial Ideology. Ce dernier s’en remet essentiellement au concept d’habitus pour expliquer en partie l’acculturation des provincesclxi. Il avance que Rome n’avait pas besoin de fournir un manuel de romanisation aux territoires nouvellement conquis, aussi longtemps qu’on y reconnaissait le langage officiel, la figure de l’empereur comme divinité et qu’on se réclamait de l’héritage historique de Romeclxii. Par le biais de la noblesse provinciale qui s’efforçait de modeler son habitus sur celui de l’espace dominant romain, les provinciaux se soumettaient alors à cette forme de « violence symbolique » par laquelle ils apprenaient à agir dans les limites imposées de façon subconsciente par l’habitus des dominants. Ando dresse donc un rendu beaucoup plus nuancé de la romanisation que ce que l’on voit à l’habitude ailleurs, et cela est redevable au travail de Bourdieuclxiii. Donc, ce champ analytique a déjà été utilisé auparavant pour l’Antiquité avec des résultats très intéressants. Dans la mesure où l’on reconnaît les limites de ces concepts et que les antiquistes se montrent assez froids devant la méthode, et que les résultats obtenus ne viendront que s’ajouter à ceux existants, je crois qu’il est possible d’effectuer une étude qui se concentrera sur un complexe de problèmes différents tout en offrant des réponses différentes. C’est en tout cas une approche très stimulante, une chose que la plupart des critiques reconnaissent. Ça nous permet de sortir un peu du canon établi et d’exploiter des avenues qui pourront se révéler éclairantes dans certains cas.
Conclusion
Limites du champ analytique
Le champ analytique que je propose entraine des questions quant aux limites de l’application des concepts de Bourdieu en histoire de l’Antiquité. On peut aisément
13 13
s’égarer si l’on se prend trop au sérieux, alors que la théorie engloutit l’objet d’étude, souvent au détriment de la réalité historique. La première limite de ce champ analytique est d’ailleurs sa subjectivité et son artificialité (pouvant s’apparenter à une sorte d’idéologieclxiv) qui est de surcroit ancrée dans la France élitiste du 20e siècle. L’analogie que j’opère entre le 20e siècle et le 5e siècle est une autre limite évidente et pourra choquer certains antiquistes moins familiers avec l’œuvre de Bourdieu. À ma défense, Bourdieu a construit une partie de sa théorie en étudiant les Kabyles, une société qui était alors considérée comme archaïque et que certains antiquistesclxv croient comparable à celles de l’époque romaine. Mais encore, en ce qui concerne les limites d’analyse propre à mon étude, elles restent à découvrir. Suivant ce que je viens de présenter dans ce texte, j’anticipe que le portrait que je tracerai d’Alaric et de son groupe ne répondra que différemment aux problèmes soulevés par tous les chercheurs, sans nécessairement les résoudre. Le concept d’habitus ne peut pas expliquer à lui seul pourquoi Alaric ne parvint pas à s’entendre avec Honorius, il peut seulement exposer les structures qui faisaient en sorte qu’Alaric négociait avec Honorius en premier lieu. Pareillement pour son groupe, l’habitus n’est pas l’explication miracle au mystère qui l’entoure; je n’arriverai sans doute qu’à déterminer si l’action collective se conformait à ce qu’on aurait pu s’attendre d’un tel groupe par le biais de comparaisons avec l’habitus d’autres groupes semblables ayant évolué à une époque temporellement rapprochée. C’est là une autre limite importante pour l’étude d’Alaric et de son groupe. Effectuer un travail comme je souhaite le faire, en puisant dans la sociologie d’aujourd’hui, demande de se conformer à certains prérequis. L’étude comparative en est un, et ça pose un problème majeur. L’idée est d’arriver à comparer plusieurs groupes pour en établir l’habitus prototype opérant qui servira d’étalon à la comparaison; l’exercice doit être tenté pour Alaric également. Le problème le plus apparent avec cette approche, qui est du même coup une limite de plus, est que je m’efforce pourtant de montrer que chaque groupe et chaque homme sont uniques en raison justement de cet habitus. C’est là un paradoxe bien gênant, mais je ne crois pas qu’il mitige sérieusement l’étude qui mérite d’être effectuée au-delà de ces limitations. On y gagnera peut-être même une meilleure compréhension des groupes barbares en les comparant entre eux, au lieu de s’en remettre aux structures de l’Empire romain en guise de prototype comparatif. i. « Si l’on comprend l'identité non comme une donnée quasi naturelle, mais comme un processus toujours inachevé, il est alors possible de considérer le concept d'identité (ou d'identification) comme le résultat d'une construction individuelle ou communautaire. Certes, l'usage de ce paradoxe inhérent au concept demeure extraordinairement diversifié au sein de chaque discipline et, plus encore, lorsque l’on passe de l’une à l’autre […] Le succès du concept s'explique d'ailleurs peut-être justement par la grande labilité de sa signification : l'identité peut se comprendre de manière statique ou comme un processus dynamique, être utilisée de manière pragmatique ou être fondée théoriquement – dans un sens moderne ou postmoderne –, être comprise comme un fait social ou un jeu de mots, aussi bien par des philosophes postmarxistes que par des politiciens conservateurs. C'est précisément ce qui rend son emploi scientifique si difficile. » (Pohl et Beaupré [2005], 184; voir aussi pp. 183-208). Voir aussi J. M. Hall ([1997], 19). ii. Voir surtout Grandeur et décadence des Romains (1842, Paris) et L'esprit des lois (1869, Paris). iii. Gibbon eut un impact déterminant et insistant quant à l’approche à adopter sur l’étude de l’Antiquité tardive; le titre de son œuvre est d'ailleurs notoire et annonce d'emblée son programme : The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776-1788). La liste des érudits qui le suivent sur cette voie est vaste. En effet, même aujourd'hui, on ne peut totalement se défaire de sa thèse.
14 14
iv. On se disait héritier de l’Empire romain et des différentes nations qui l’avaient peuplée. P. ex. on pourrait encore mentionner Chateaubriand (Œuvres de Chateaubriand : études historiques, tome 9, nouv. éd. [Paris, 1826]) et Voltaire (Œuvres complètes de Voltaire : essais sur les mœurs, tome 1, nouv. éd. [Paris, 1820]) où l’Empire romain côtoie les évènements contemporains de ces auteurs dans une foule de comparaisons. Cette position perdura longtemps, même si elle se raffina en chemin. Mentionnons à titre d’exemple, Ferdinand Lot, La Gaule : les fondements ethniques, sociaux et politiques de la nation française (Paris, 1947), qui concentre le premier chapitre à montrer de quelle manière les Gaulois d’autrefois sont les ancêtres directes des Français d’aujourd’hui. v. Cette question touche en fait au problème de la barbarisation de l’Empire, un phénomène que je préfère laisser de côté pour cette problématique. Voici néanmoins quelques études majeures : Goffart (1980), Liebeschuetz (1990), Vallet et Kazanski (1993), Elton (1996), Chauvot (1998; 2001), Nicasie (1998), Heather (1999a), Pohl (2006), Halsall (2007) et enfin, Aillagon (2008). vi. Gibbon n'est pas le seul à avoir attaqué l'Antiquité tardive sous cet angle. Déjà au 16e siècle, Nicolas Vignier (1530-1596), auteur de la Bibliothèque Historiale (1585), vit le sac de Rome comme le début du déclin de l'Empire romain. Plus près de Gibbon, le récit de Montesquieu (Grandeur et décadence…) est également notoire pour sa vision apocalyptique de l'histoire romaine. Montesquieu fut d'ailleurs une source importante pour Gibbon, selon Bowersock (et pour ce qui est de la longévité et de la notoriété de sa thèse aujourd'hui, voir Bowersock [1992; 1996]). Cela dit, je ne désire pas m’enliser dans une discussion sur les barbares et leur rôle dans les maux de l’Empire, la bibliographie est beaucoup trop vaste; le point de mire ici n’est que le groupe goth d’Alaric (et Alaric lui-même) et ce que les érudits en ont pensé jusqu’à présent. Je me limiterai à cet aspect pour ce survol historiographique. vii. 30 et 31, pp. 253-376 : L'édition utilisée (révision de celle de 1909-14) est celle de J. B. Bury, vol. 3 (1974). viii. Il vaut la peine de mentionner qu’Eugène Saint-Hilaire (1837; 141, note 2) critique Gibbon sur ce point et prône une plus grande ouverture d’esprit sur le point de vue barbare. Eugène préfère voir dans les barbares les géniteurs du nouveau monde post-romain, plutôt que les destructeurs de l’Empire, ce qui est notable en soi. ix. Gibbon 30.253; 31.341-342. x. Gibbon 30.254. Les Batli auraient été une lignée prestigieuse, seconde seulement aux Amali. Ailleurs, l'auteur parle d'Alaric comme d'un général compétent et zélé (Gibbon 30.267-271; 31.302-303, 329-330, 334. Gibbon [31.328, 340] le qualifie même de clément et modéré dans ses négociations avec Honorius et le sénat romain). Il le montre enfin quelques fois comme un « bon » chrétien (Gibbon 30.279; 31.340-341, 347) ce qui surprend considérant la propre position de Gibbon sur la religion. Il faudra se souvenir de ces traits de caractères propres à Alaric que nous permettent les sources plus tard dans la discussion. xi. pp. 62-98. xii. « [...] [Alaric] was to be a foe and not a defender of the Empire; first in the Balkans peninsula and aftewards in Italy » (Bury [1966], 64). xiii. Bury (1966), 66. L'auteur mentionne à quel point l'Empire, à ce moment, pouvait être attirant pour les barbares qui y occupaient souvent les plus hauts postes. Selon lui, Alaric était trop familier avec l'Empire pour vouloir sa perte. xiv. Bury ([1966], 116-122) reprend cette idée dans A History of the Later Roman Empire (395 A.D. to 800 A.D.). xv. Thierry est l'un des deux seuls érudits que j'ai pu trouver à avoir dédié une étude entière à Alaric avec son, Alaric : l'agonie de l'Empire (1826), l'autre étant Marcel Brion avec La vie d'Alaric (1930), infra. xvi. Thierry (1826), 98, 101. xvii. Thierry (1826), 109. Récemment, Kulikowski ([2007], 158) a émis une hypothèse similaire, voyant les ambitions d'Alaric évolué au fil du temps. xviii. Thierry (1826), 213. Cela ne dure pas, Alaric redevient barbare à la page 281 : l’auteur y rapporte les bouleversements de l'an 400 et croit qu'Alaric y aurait perdu son titre. Il s'en remet beaucoup (trop) à Claudien qu'il croit sans questionnement. Il s'agit pourtant d'une position très intéressante; je ne crois pas avoir lu un autre expert (avant cette époque) qui ait considéré Alaric comme un Romain une fois le titre de maître des milices acquis. xix. Thierry fait néanmoins de l’histoire évènementielle à la Gibbon. Il ne cherche pas à savoir ce qui différenciait Alaric des autres rois barbares de l'époque. Alaric y joue toujours le rôle du destructeur et Thierry se pose peu de questions quant à la justesse d’une telle position. En cela, il est l’héritier de l'ensemble de l'historiographie le précédant. Je note pourtant qu’un historien qui se rapproche beaucoup de Thierry par l’époque et l’approche, soit Numa Denis Fustel de Coulanges ([1904], 415-424), dresse un portrait pareillement très positif d’Alaric. Ce dernier fait le bilan de la carrière d’Alaric en le décrivant comme le général romain d’une armée bigarrée, gothe seulement pour un petit noyau (ce qui pourrait sembler annonciateur de l’approche de Wenskus/Wolfram). Il montre aussi une acuité d’esprit peu commune pour l’époque, et refuse de voir Alaric comme un envahisseur ou comme le chef de la nation gothe.
15 15
D’un autre côté, Eugène Saint-Hilaire s’en tient plus fidèlement à l’approche de Gibbon, bien qu’il le critique ouvertement (Saint-Hilaire [1837]; 141, note 2). Saint-Hilaire ([1837], 129-201) ne se montre certainement pas aussi ouvert d’esprit que Thierry et Fustel de Coulanges. En fait, il suit d’assez près le récit de Jordanès, ce qui pose bien des problèmes. En somme, il voit les Visigoths comme les mauvais, et les Ostrogoths comme les bons (Saint-Hilaire [1837], 144-146). Mentionnons enfin Thomas Hodgkin (1889), qui est bien ancré lui aussi dans la tradition de Gibbon. xx. Je n'ai eu accès qu'à la version anglaise, Alaric the Goth (1932). xxi. Cela ne veut pas dire pour autant qu’elle soit bonne. Brion imaginait Alaric comme un Romain du point de vue de la culture, si l’on veut. Il croyait qu’Alaric était inspiré par la Rome du temps de la République, une vision qui lui serait venue des textes anciens (Brion [1932], 221-222). Il croit qu’Alaric vivait dans un monde imaginaire, alors que Stilichon, par exemple, savait bel et bien qu’il vivait au temps d’Honorius. On voit ici l’espèce de romantisme qui afflige le récit de Brion malgré son acuité d’esprit. xxii. Brion va comparer Alaric à Stilichon dans une analyse excellente : pour lui, Stilichon était un « Romain au premier degré », alors qu'Alaric l'était « au second degré » (Brion [1932], 220-221). En d'autres mots, Alaric acquit sa romanité lors de son entrée dans l'Empire et en combattant dans son armée. Quant à Stilichon, on sait bien que la tendance est de voir en lui un semi-barbare. Il naquit toutefois dans l'Empire et c'est ce qui le place au premier degré, selon les critères de Brion. xxiii. Mis à part Fustel encore une fois, de même que le poème nationaliste de G. de Scudéry (Alaric ou Rome vaincue [1654]) où Alaric est présenté comme le défenseur de la chrétienté. Et il faudra attendre Wolfram (1988) pour retrouver un rendu si positif. Entre Brion et Wolfram, bien des études sont parues sur la question gothe et en dresser la liste ici serait fastidieux. Toutefois, on peut mentionner A. H. M. Jones (1904-1970) qui publia une étude influente, The Later Roman Empire (1964) et The Decline of the Ancient World (1966). Jones ne s'intéressa toutefois que très brièvement à Alaric dans son étude, mentionnant simplement qu'il exploita les faiblesses des deux parties de l'Empire suite à la mort de Théodose. L'auteur montre Alaric comme un outil des magistri milites qui se l'envoyèrent à quelques reprises (Jones [1966], 74-77; noter qu'Halsall [(2007), 203-217] le suit de près). Jones ([1966], 77) affirme aussi qu'Alaric avait été promu roi des Visigoths et qu'il désirait obtenir des terres pour y établir son peuple (voir Stein [(1968), 247-259] pour une opinion similaire). Enfin, la biographie la plus complète d’Alaric se trouve dans The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. II. (pp. 43-48); le commentaire le plus notable est qu'il n'était probablement pas un roi (Martindale [1971.2], 43. xxiv. Dans son, Die Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts (1980), paru en anglais sous le titre The History of the Goths (1988), soit l'utilisée. On consultera à ce sujet les nombreux comptes-rendus des livres de Wolfram qui se montrent assez critiques envers sa façon d'approcher la question (cf. Goffart 1982; Green 1990; Wood 1999). xxv. Geary ([2006], 75-84; 108-119) explique plus clairement cette notion, de même Heather ([2010], 19-28) et Pohl ([2002], 221). Voir infra (Exemples de concepts…) pour un examen plus détaillé du terme. xxvi. Wolfram s'est basé sur l'étude de Richard Wenskus (1961). Voir aussi l'étude de Liebeschuetz (1990) qui endosse cette approche. Il faut pourtant consulter maintenant l'article de Murray (2002) qui fait une critique exemplaire de la thèse mise de l'avant par Wenskus. xxvii. (Wolfram [1988], 151). C’est un point sur lequel Liebeschuetz (1990) et Heather (1991) sont en désaccord. xxviii. Wolfram ([1988], 160-161). Aussi, Wolfram ([1988], 153) chiffre à environ 100,000 le nombre de Goths avec Alaric en 408. Récemment, Kulikowski ([2007], 158) a avancé quelques hypothèses dans la même veine, selon lesquelles Alaric fonda les Goths, en quelque sorte, et établi les bases de l'identité gothique dans l'Empire romain. xxix. Et c'est là en fait l'importance de l'ethnogenèse; Wolfram fait des efforts considérables pour montrer comment les Goths se sont formés au contact des Romains en conservant un Traditionskerne autour duquel vinrent se greffer d'autres éléments (Wolfram [1988], 8). L'auteur mentionne que les Visigoths (résidus du groupe d'Alaric) étaient formés, en 418, de "[...] Tervingian-Vesian and Greuthungian-Ostrogothic tribal elements; non-Gothic groups [...] among them Alans, Bessi from Thrace, Galindi from the Baltic Sea, Varni, probably also Heruli, and maybe even Saxons from Loire and Garonne rivers [...] Sarmatian, Taifalian, and Suevian colonies [...] ». Dans la même ligne de pensées que Wolfram, on peut aussi inclure Walter Pohl (2006). En ce qui a trait au Traditionskerne, ce serait, croit-on, un noyau de traditions. L'idée est que l'élite gothe conservait un sentiment d'appartenance basé sur des mythes fondateurs commun (Wolfram [1988], 11-14; Murray [2002], 57). Wolfram reconnaît ainsi que l'identité ethnique du groupe n'a pas de caractère biologique; c'est quelque chose de construit (Wolfram 1988 : 5-6). xxx. cf. Bourdieu qui le répète partout. xxxi. infra, Quelques sources.
16 16
xxxii. Je suis conscient des frontières académiques placées entre l'anthropologie, la sociologie, l'ethnologie et l'histoire. Certains experts contestent toutefois ces divisions artificiellement imposées : voir Bourdieu (qui y fait toujours allusion) et Kertzer (2009). xxxiii. Bentley (1987), 25. xxxiv. « Primordialist models […] hol[d] that changing social contexts disrupt conventional ways of understanding and acting in the world. People disoriented by change seek refuge in those aspects of their shared lives that most fundamentally define for them who they are […] A deepseated need for rootedness gives rise to communal sentiments that generate ethnic groupings. Ethnic collectivities defend their members from material dislocations through collective action when threatened, but they continue to respond to emotional needs even in the absence of overt political and economic threats. » (Bentley [1987], 26). xxxv. Dans les mots de Bentley ([1987], 25) : « Instrumentalist models generally hold that changing political and economic contexts disrupt traditional material orders and create novel constellations of shared material interests. People with common interests coalesce into groups in pursuit of those interests […] Ethnic groups, resurgent or newly created, exist 'essentially as a weapon in pursuit of collective advantage'. » xxxvi. Bentley (1987), 26. xxxvii. Bentley (1987), 26. xxxviii. Concept inventé par Pierre Bourdieu. Pour l'avantage d'une perspective microscopique rattachée aux théories de Bourdieu, Swartz ([2008], 48) a déjà fait la remarque. Notez que Bourdieu est rarement mentionné dans les études sur les barbares. Les seuls que j'ai lus sont W. Pohl (2006) et S. Brather (2002). Notons encore que sa théorie de l'habitus a séduit plusieurs chercheurs qui s'intéressent à la religion romaine durant l'Antiquité tardive (cf. Maxwell [2006], 146-148 et Krueger [2010], 224, note 2). xxxix. « Principe générateur durablement monté d’improvisations réglées […], l’habitus produit des pratiques qui, dans la mesure où elles tendent à reproduire les régularités immanentes aux conditions objectives de la production de leur principe générateur, mais en s’ajustant aux exigences inscrites au titre de potentialités objectives dans la situation directement affrontée […] [l’habitus] est histoire faite nature, c’est-à-dire niée en tant que telle parce que réalisée dans une seconde nature […] » (Bourdieu [2000], 262-263). Voir aussi Hillier et Rooksby ([2005], 21), Maton (2008) et Wacquant ([1989], 40 et pp. 42-43; [1993], 31 et 34). On constate rapidement qu'il existe plusieurs définitions de ce concept parmi les spécialistes (cf. d'Agostino et coll. [2003], 39; Maxwell [2006], 147; Williams [2006], 19; voir toutefois les mises en garde de Wacquant [1989] au sujet des nombreux chercheurs qui ont effectué une mauvaise lecture de l'œuvre de Bourdieu). Et, bien sûr, Bourdieu a été critiqué; voir surtout J. Verdès-Leroux (2001) qui se montre virulent, et Ostrow (1981) qui est plus mesuré. xl. Sur le concept de champ, voir Wacquant (1989), 39 et Bourdieu (1994). xli. Vladiv-Glover et Frederic (2004), 33. xlii. Bentley (1987), 28. xliii. Waterson (2005), 338-339; Hillier et Rooksby (2005), 22; Swartz (2008), 48. xliv. Bourdieu (1986), 113-114 (la traduction anglaise [du « sens pratique »] renvoie mieux l'idée, je trouve). Bourdieu n'a pas été le seul à voir l'agent comme soumis à un ensemble de lois sociales que l'on pourrait presque croire innées. Voir, par exemple, Sidnell ([2003], 431) qui résume bien l'idée. xlv. Voir Vladiv-Glover et Frederic (2004) à ce sujet. xlvi. « We can always say that individuals make choices, as long as we do not forget that they do not choose the principle of these choices. » (Wacquant [1989], 43). Ailleurs (Bourdieu et Eagleton [1992]), Bourdieu mentionne qu'il est conscient de sa tendance à mettre parfois trop l'accent sur les limites de l'agent. Pourtant, il se montre plus ouvert d’esprit à certaines occasions et va jusqu’à dire que l’habitus peut générer des improvisations, mais qu’il est limité (Bourdieu [2005], 46). Vladiv-Glover et Frederic ([2004], 32-33) croient pourtant ce concept fermé. xlvii. « The habitus, which is determined by the social conditions in which an individual lives, imposes certain forms of practice and conduct on the bodies of individuals, who in the end unknowingly embody the "structuring structure" of the habitus. » (King [2000], 424). Voir aussi Vladiv-Glover et Frederic ([2004], 31-38). xlviii. « La doxa est un point de vue particulier, le point de vue des dominants, qui se présente et s’impose comme point de vue universel […] » (Bourdieu [1994], 129), ou encore : « […] état implicite et indiscuté […] » (Bourdieu [2000], 411, note 142). Voir aussi Arnal (2008), 56-57. xlix. Wacquant (1989); Swartz (2008), 47. l. Zeiner (2005), 25. li. Bourdieu ([2005], 47) s’y oppose, et j'hésite moi-même à laisser ces concepts de côté puisqu'ils étaient présents à l'époque romaine, bien que d'un autre ordre d'importance que sous-entendu dans l'étude de
17 17
Bourdieu. Zeiner ([2005], ch. 1) est de mon avis là-dessus et même qu’il argumente pour appliquer la théorie de Bourdieu assez étroitement. lii. Bourdieu fait une remarque similaire dans l'un de ses articles (cf. [1996], 14-15); il y dit, entre autres, que les habitus des agents d'un groupe sont à la fois « […] differentiated, but they are also differenciating », ce qui veut dire que l'habitus sert autant à unir qu'à diviser. liii. « Overlaps in the behavioral repertoire of peoples having characteristically different experiences (and habitus) are likely to give rise to invalid assumptions of mutual understanding. » (Bentley [1987], 34). liv. King ([2000], 421-422 et 424-425) en admet autant lui-même plus loin dans son article. Voir aussi Ostrow ([1981], 279). lv. d’Agostino et coll. (2003), 41. lvi. D'ailleurs, ce groupe de Goths ne possédait pas de structure sociale fixée, je crois, et donc, la théorie de Bourdieu aura ses limites à certains endroits, j'anticipe. lvii. P. ex. les Québécois de n'importe quelle région du Québec se disent Québécois même si la localité y compte pour beaucoup dans leur sens identitaire. La chose est aussi vraie pour les francophones du Nouveau-Brunswick, tant Acadiens que Chiacs que Brayons. On se sait membre de tel ou tel groupe, tout en reconnaissant une certaine affinité envers les autres groupes francophones malgré tout. La difficulté est de savoir jusqu'à quel point la modernité y joue un rôle : avec la technologie, il est beaucoup plus facile de développer une affinité avec des groupes qu'on n’aurait peut-être jamais entendu parler auparavant. Ensuite, si l'on prend les Québécois, il m'apparaît que cette identité est devenue forte depuis l'époque de René Lévesque (surtout); pour les Acadiens, c'est depuis la prise de conscience qui fut faite autour de la déportation de 1755, etc. À mon sens, la modernité joue un grand rôle dans ce sens identitaire fort. lviii. « Spatial distances on paper are equivalent to social distances. » (Bourdieu [1996], 13-14). Cette ressemblance est toute suggestive cependant; Bourdieu dit lui-même que la différence est partout présente dans les sociétés d'aujourd'hui, malgré la volonté d'homogénéisation et de démocratisation mise de l'avant par plusieurs entités politiques (Bourdieu [1996], 20-21). lix. On peut comparer ce phénomène avec un exemple beaucoup plus étudier, le monde grec de l'époque classique, où plusieurs ont montré que « Grec » ne voulait pas dire la même chose pour chaque Grec et que certains d'entre eux se croyaient plus Grecs que d'autres (voir J. M. Hall [1997]). lx. Cette question de mémoire est extrêmement problématique à l'étude. Goffart (2002) a déjà dit que la mémoire à ses limites (environ 50 ans). Il ne suffit que de jeter un œil à quelques études sociologiques avec point de mire cette mémoire collective (lieux de mémoire, mémoire de la violence, mémoire mnémonique, artificielle, etc.) pour se rendre compte assez rapidement qu'il s'agit d'un concept que la société doit s'efforcer cultiver : « Recall will remains active only if narrating remains restless. » (Sennett [1998], 20). Ce n'est pas inné chez un groupe d'avoir une mémoire. Et lorsqu'un groupe arrive à s'en forger une, on se remémore rarement des évènements très anciens; on se concentre plutôt sur le passé d'hier, compris et souvent vécu par la majorité du groupe (p. ex. Sennett [1998], 18-20). Goody ([1998], 78) explique bien que dans les sociétés illettrées (où il a investigué), la mémoire est construite sur la mnémonique et d'après un passé-présent; c'est-à-dire un passé construit selon ce que l'individu connait de sa situation actuelle. Bloch ([1998], 108-110) va même jusqu'à affirmer que certains groupes, comme les Zafimaniry on en fait plusieurs récits narratifs d'un même évènement historique marquant, sans que cela ne pose de problèmes. Maintenant, cette mémoire collective, en se rappelant le concept d'habitus, est difficilement réductible à un dénominateur commun; la mémoire de la classe dominante n'est pas nécessairement celle des classes inférieures. Il ne s'agit là, pour l'instant, que de constat qui nécessiterait une lecture plus approfondie des études sociologiques. J'anticipe que les études montreront, non pas un patron sociologique des collectivités, mais bien un modèle propre à chaque classe de chaque groupe... Il s’agit donc d’un point négatif de plus au concept de l'ethnogenèse (voir toutefois Pohl [2002] qui avance des arguments opposés). Quant au concept d'habitus, Bourdieu fait allusion non pas à une mémoire collective, mais à une mémoire génétique (ou de classe), je crois, apprise et transmise inconsciemment à l'agent par ses prédécesseurs (parents, proches, etc.), de sorte qu'il apprend à se conduire selon sa classe et selon les contraintes de la société où il vit, mais en y ajoutant sa touche personnelle (contra Goody [(1998), 90]). Voir aussi Bloch ([1998], 36-37 et 44-47) pour un point similaire. lxi. Gillett ([2002b], 121) fait une remarque similaire, de même que Pohl ([2002], 237). Il serait en effet extrêmement curieux que les anciens aient partagé notre obsession vis-à-vis de leur identité et de leur ethnicité, et ici je n'entends pas simplement les agents de la classe dominante, mais bien de toutes les classes. Rien ne nous dit que cet élément comportait une quelconque importance pour eux. Voir à ce sujet la conclusion de Theuws ([2009], 314-315). lxii. Il faut plutôt faire une étude sur chaque groupe particulier qui trouve des sorts différents dans l’histoire de l’Antiquité tardive, mais qui sont vus par des observateurs extérieurs comme faisant partie d’une même collectivité, alors qu’on ne sait pas s’ils se sentaient membres de cette collectivité.
18 18
lxiii. Wirth (1997), 24; voir aussi Murray (1983) et Goetz (2003). lxiv. Kulikowski ([2007], 157ff.) et Potter ([2004], 528). lxv. Claud. (Cons. Hon. 6.105) nous apprend qu’il était originaire de Peuce, ce qu’il faut bien sûr ne pas croire. Wolfram ([1988], 144) y croit parfois, parfois non (Wolfram [1988], 431, note 128; [1997], 90). lxvi. Martindale (PLRE) croit que la date de naissance d'Alaric se situait entre 365-370. Wolfram ([1997], 89) opte arbitrairement pour 370, sans justification. C'est de la pure conjecture, mais c'est le mieux que l'on puisse faire pour l'instant. L'hypothèse n'est pas mal avisée : on croit qu'en 391, Alaric participa à un raid sur le camp de l'empereur Théodose; il devait donc être en âge de porter les armes. Puis, en 401, le poète Claudien le qualifiait encore de calidae rapuit te flamma iuventae = ... tu fus emporté par le feu de l'ardente jeunesse guerrière... (PLRE 2.43 [tr. de l'auteur]). Voir pourtant Gillett ([1995], 383) qui avance que dans le style de la poésie classique, quelqu’un était qualifié de iuvenis s’il était âgée entre 30 et 45 ans, ce qui donnerait entre 355-370 comme date de naissance. lxvii. Même si cela demeure une hypothèse fragile. D'autres éléments de la vie d'Alaric sont encore moins certains que son lieu de naissance et son âge. Pour commencer, on ignore qui étaient ses parents et c'est la raison pour laquelle plusieurs chercheurs hésitent à suivre Jordanès sur l'origine noble d'Alaric (famille des Balti). L'exception notable est Wolfram ([1988], 144; [1997], 90) qui lance tout bonnement qu'Alaviv était peut-être le père d'Alaric sans en donner les preuves nécessaires (puisqu'elles n'existent tout simplement pas; cf. Kulikowski [2002], 79 et Collins [2004], 20), puis Heather ([1991], 196-199) qui semble convaincu de cette origine noble (pas nécessairement un Batlhi, cependant). lxviii. Terme emprunté de MacGeorge (2002) qui ne définit jamais clairement ce qui est sous-entendu dans ce concept. Goltz ([2008], 301) souligne le caractère le plus notable de ces warlords : « Emperor Makers ». Et dans la majorité des cas, leur pouvoir était hérité par leurs descendants (Goltz [2008], 301). Mathisen et Sivan ([1999], 3) sont parmi les seuls érudits à parler d’Alaric comme l’un de ces warlords (voir aussi Sivan [2003], 116). lxix. Il faut dire que son ascension a été plus rapide qu’à l’habitude, s’il reçut vraiment pour la première fois le titre de magister militum en 395 comme le croit Burns ([1994], 166). lxx. On se souviendra toutefois des paroles de Claudien (Cons. Hon. 6.2250-255) qui dit qu’une bonne partie de son armée le déserta suite à la défaite de Verona. lxxi. MacGeorge (2002). lxxii. Cela en tenant pour acquis que ce groupe était bel et bien l’ombre de celui de 382, ce qui me paraît de plus en plus problématique (cf. Kulikowski [2007]). lxxiii. Toge, chez Syn. (De Regno) 20.1; peaux, chez Claud. (Ruf.) 2.80-85 et Syn. (De Regno) 20.1. Voir p. ex. Edmondson (2008) sur l’importance de l’habit pour l’élite romaine. Le vêtement semble en effet de première importance aux auteurs. En vérité, le pantalon était devenu un accoutrement de l’armée romaine depuis longtemps. C’est là l’un des éléments qui font croire à cette barbarisation de l’armée. D’ailleurs, Stilichon, le patron de Claudien, en porte fièrement un modèle sur son diptyque. lxxiv. Oros. (Ad. Cont. Pag.) 7.37; Heather ([1999], 66) ne croit pas que l’arianisme était vraiment la religion des Goths. Quoi qu’il en soit, du point de vue de son habitus religieux, Alaric était très près d’une très grande partie de la population romaine. lxxv. On peut mentionner les 4,000 tuniques de soie et les 3,000 peaux teintées rouges (Zos. 5.41.4). Mis à part Claudien et Zosime (ici), aucun auteur que j’ai lu ne mentionne ces vêtements de peaux. On peut aussi se demander ce que 3,000 peaux teintées rouges faisaient à Rome si les Romains n’en portaient pas... lxxvi. Zosime (5.41.4; 48.3) mentionne le poivre et le blé ; Sozomène mentionne le maïs ([Hist. eccl.] 9.7). lxxvii. P. ex. Zosime (5.31.6; 5.48.2) fait référence à des lettres qu’Honorius lui aurait adressées. Ailleurs, Jovius en lui lit une à haute voix (Zos. 5.49.1), ce qui pourrait impliqué qu’il comprenait le latin (et sûrement le grec pour avoir occupé le poste de magister militum en Orient). Il n’est d’ailleurs jamais question d’interprètes dans les sources quand on voit Alaric parlementer. lxxviii. P. ex. Zos. 5.48.3 et 6.12 (s’il est permis de compter Attale déchu au nombre de ses amis). Il eut à négocier avec plusieurs, dont Rufin, Stilichon, Aetius, Jovius, Jean, les sénateurs de Rome et la noblesse d’Athènes, pour ne mentionner que ceux-là. lxxix. Zos. 6.12. Qu’Alaric ait choisi de loger si loin de Rome peut aussi aller dans le sens d’un habitus culturel en règle avec ce que l’on sait de l’élite romaine, bien que la proximité (50 km) de Ravenne en soit une autre explication logique. lxxx. Syn. (De Regno) 21; peut-être aussi Sozom. (Hist. eccl.) 9.8. lxxxi. Voir Lee ([2007], 119-121) qui montre clairement que les demandes d’Alaric n’étaient pas insensées dans les limites de l’économie de l’époque, alors qu’un seul sénateur empochait annuellement presque la totalité de la somme demandée. lxxxii. Tout comme le serait celui d’Aetius, bien que dans le sens opposé. En effet, les années qu’il passa chez
19 19
les Goths et les Huns modelèrent profondément son habitus, comme le montre bien son curriculum. Tout comme Alaric, il pouvait fonctionner parmi les Romains ou les barbares selon le besoin. Une autre possibilité serait le cas d’Aspar, suivant MacGeorge ([2002], 266), ou Richomer, Arbogast et Baudo qui, bien que d’origines différentes d’Alaric, ont vécu avant lui et serait donc peut-être encore plus représentatif de ce qu’Alaric était, comparativement à Ricimer ici qui était déjà bien établi dans l’Empire avant de s’en remettre aux Romains. lxxxiii. PLRE 2.48; 945. lxxxiv. Bien que Ricimer le fut à un autre niveau, exerçant un pouvoir proche de celui de l’empereur à certaines occasions où il n’y avait pas d’empereur en place (Goltz [2008], 301). lxxxv. MacGeorge ([2002], 182) émet aussi quelques hypothèses semblables à Gillett. lxxxvi. Le successeur d’Athaulf. C’est qu’on croit Ricimer descendant des familles royales gothes et suèves, ce qui aurait dû lui avoir permis d’occuper une place importante chez l’un ou l’autre (cf. Gillett [1995], 380-382; MacGeorge [2002], 178). lxxxvii. Les auteurs anciens lui attribuent le plus souvent ce lien (MacGeorge [2002], 179). lxxxviii. Gillett (1995); contra MacGeorge (2002), 180. lxxxix. MacGeorge ([2002], 191) admet que Ricimer se croyait sans doute Romain, tout en revenant sur ses mots ensuite (MacGeorge [2002], 264-265). xc. Un autre explication, suivant MacGeorge ([2002], 182), viendrait de son capital économique. En somme, Ricimer présente vraiment tous les éléments propres à un noble romain. Et l’apparent détachement de Ricimer face à ses Goths ne doit pas non plus nous surprendre; rien ne nous dit que ces hommes attachaient une quelconque importance à leurs groupes d’origines, ni si ces groupes demandaient qu’on leur reste fidèle, ni si Ricimer croyait trahir son groupe en servant les Romains (alors que son groupe faisait d’ailleurs la même chose !). xci. Heather (1996), 139. xcii. Burns (1994), 166. xciii. Heather (1991), 197. Le cas de Sarus peut toutefois montrer l'inverse (Elton [1996], 35-36). xciv. Potter (2004), 528; Pohl (2005), 189 ; Kulikowski (2007), 155. La distinction n'est pas aisément faite entre armée et peuple toutefois, et dépend encore de la nature du groupe d'Alaric. Si Alaric n'était que le commandant de mercenaires goths, et bien, peuple et armée deviennent synonymes dans ce cas. xcv. Wolfram ([1997], 91) croit qu'Alaric commença sa rébellion dès 391; il avance même qu'Alaric établit un royaume dans l'empire à cette date précise, ce qui est plutôt audacieux comme affirmation. xcvi. Fravitta était aussi plus important à l'époque (Heather [1991], 196). Cela en dit déjà long sur les origines, soi-disant, très nobles d'Alaric. xcvii. PLRE 2.48. xcviii. Zos. 6.9-12. xcix. Voir par exemple les commentaires classiques de Williams et Friell ([1994], 40) à son sujet. c. PLRE 2.43; Collins (2004), 23. Cette question de royauté pose encore un problème à certains chercheurs. Cela est dû en partie à cause de la royauté d'Athaulf qui n'est jamais remise en cause; il semble alors naturel que son prédécesseur dût avoir été lui aussi un roi. Évidemment, l'un n'entraîne pas l'autre (Halsall [2007], 190). ci. « Alaric was a typical product of the late-Roman world […] in which his aims were extremely unclear […] Alaric led a people, the Goths, whose origins are much disputed. » (Philip [2009], 157). cii. Suivant les études de Modéran. ciii. D’après les études de Drinkwater. civ. Heather (1999). cv. Amm. 31.4.1. cvi. Amm. 31.6.1. Et demandons-nous si ces soldats goths étaient vraiment tous Goths… cvii. Heather (1991), 138-139 et 142; Goldsworthy (2010), 253. cviii. Amm. 31.16.1-6; Goldsworthy (2010), 253. Voir toutefois Heather [(1991), 144-145) qui refuse d'y voir une composante du groupe ; il croit plutôt que ces nouveaux venus n’avaient été recrutés que pour combattre; il revint sur sa position en 1996 (p. 176). cix. Amm. 31.15.5-9, 16.1; Goldsworthy (2010), 253. On s'entend à l’habitude pour dire que le groupe d'Alaric était en fait ces Tervingi (qui ne le sont déjà plus vraiment) établis dans l'Empire par Théodose en 382 (Heather [1991], 194; contra Liebeschuetz [(1990), 51] et surtout Kulikowski [2002]). La raison de cette hypothèse vient à la fois du fait qu'Alaric avait sous son commandement un détachement qui provenait de ces Goths en 394 (Kulikowski [2002], 79-80; Liebeschuetz [1990], 55-56.). cx. Où, par exemple, on apprend que les auxiliaires de l'armée de Stilichon se joignirent à lui en grand nombre, soit plus de 30,000 hommes selon Zosime. Heather ([1991], 213) se montre toutefois sceptique. Selon lui, ce serait environ 10,000 soldats (goths!) qui se seraient joints à Alaric, ce qui représente néanmoins un nombre considérable.
20 20
cxi. Il faudrait inclure à ce mélange les esclaves et les prisonniers faits à Rome, et considérer que plusieurs Romains ont dû avoir subi le même sort à partir de 378. Il ne serait pas surprenant qu'Alaric ait eu à sa disposition des Romains qui connaissaient les territoires et les routes, les endroits les plus prometteurs où obtenir de la nourriture, etc. (p. ex. Amm. 31.16.2; Heather [(1991), 212-213 et 326] sur l'addition d'esclaves [goths!]). C'était le cas déjà en 378 (Amm. 31.16.1). Enfin, n'oublions pas d'inclure le groupe goth d'Athaulf qui vint se joindre à lui dès 408; loin d'y voir un avantage, j'y vois plutôt un inconvénient assez sérieux. cxii. « It is not news now; in fact the composite nature of early Germanic peoples has been recognized since the beginnings of modern scholarship. » (Murray [2002], 50). Voir encore Mathisen et Sivan ([1999], 3) : « Nearly a century and a half of exposure to Romanitas, both along the frontier zones and inside the imperial frontiers culminated in the emergence of a new Gothic society in Aquitania. » cxiii. Concept préféré à celui de classe sociale par Bourdieu. cxiv. Notons que la gens implique implicitement un héritage composé d’éléments récurrents et que l’on croit fixes, suivant nos sources : lois (écrites), mythes, coutumes, territoire et religion (cf. Goetz [2003], 44-50). Cela ressemble beaucoup à la formule d’Hérodote. Enfin, voir aussi le résumé qu’en donne Liebeschuetz (2003) de même que ses réserves devant les implications que sous-entend la gens (tribu). cxv. La tribu est aussi rapprochée des warbands par certains : « Modern scholars argue that in the comitatus as described by Tacitus, the warriors voluntarily attached themselves to the leader, who provided them with arms and armament, food, and a share in the bootytaken in warfare. In return for this maintenance., the members of the retinue were expected to fight for their leader […] » (Fanning [2001], 18; il s’oppose à cette interprétation tout au long de son article). Sur le passage de Tacite (Germ. 13-14) en question, voir Spiedel (2006); il mentionne que Tacite s’est inspiré de la relation principes/comitatus pour décrire ce qu’il croyait être les relations entre les rois barbares et leurs armées. Fanning ([2001], 17) va même jusqu’à avancer que les médiévistes s’en sont remis longtemps à la Germania pour expliquer la féodalité; voir à titre d’exemple Yorke ([1990], ch. 1) et surtout Wirth ([1997], 24, note 46). Je note que Thompson ([2008], 43-63) a aussi reconstruit l’organisation sociale des Visigoths à partir de la Germania. cxvi. Thompson (2008), 45-46. Heather ([1996], 57) s’avance pourtant pour dire que les Tervingi avaient un iudex, alors que les Greunthungi avaient un rex. cxvii. Thompson (2008), 44-45. cxviii. Thompson (2008), 43. cxix. Thompson (2008), 46. cxx. Thompson (2008), 47. Tacite y faisait déjà mention (Germ. 7.1). cxxi. […] consultare … bellis annisque uerendos […] (Claud. 26[Bell. Get.].480). Jordanès (Get. 3) fait aussi allusion à des délibérations. cxxii. […] sedere patres … Getarum curia […] (Claud. 26[Bell. Get.].481-482). Ailleurs, Claudien montre les soldats d’Alaric qui le critiquent ouvertement (Claud. Cons. Hon. 6.242). cxxiii. Sivan (2003), 111. cxxiv. Sivan (2003), 111-113. cxxv. L’image du Goth comme fermier ou cultivateur se trouve chez la plupart des auteurs; on voit cela chez Pacatus (Pan. Lat. 2.22.3) et Them. (Or. 16.211a), chez Claud. (Contr. Eutr. 2.195-202), Syn. (De Regno 21) et Jord. (Get. 9.1). cxxvi. Heather (1999b), 61-62. Les esclaves (ou captifs) sont mentionnés chez Jordanès (Get. 10.1). cxxvii. Heather (1999b), 59-63. cxxviii. Il faut noter que Zosime (5.36.1) et Jordanès (10.1) font allusion aux nobles (goths?) dans le groupe d’Alaric. Olympiodore (fr. 9 cité dans Paschoud [1986], 341) parle d’optimates (ὀπτίµατοι) pour qualifier les chefs goths qui formaient l’entourage de Radagaise. cxxix. Il faut comprendre d’où vient Heather pour apprécier l’improbabilité d’une telle hypothèse. Heather répète à plusieurs reprises qu’il croit que les Visigoths ont été créés à partir essentiellement d’autres groupes goths, et pas seulement avec des soldats, mais aussi avec femmes, enfants et vieillards. Cette union était essentielle, selon Heather ([1999b], 63-64), pour leur permettre de conserver leur autonomie et de survivre face à la menace romaine (et hunnique). Heather croit en effet que les Goths étaient constamment menacés, et c’est ce qui contribua à former un supergroupe où la grande majorité était consciemment gothe. C’est une vision fataliste des évènements. Les sources montrent pourtant, en tout cas pour Alaric, que l’Empire s’accordait assez bien en général avec ces groupes. Gaïnas, Sarus et Alaric sont tous des chefs qui évoluèrent dans le girond romain sans toujours combattre pour leur survie. Qui plus est, ces groupes goths n’étaient pas formés que de Goths, si même cela comptait en tout pour les membres du groupe. Heather tient ici pour acquis des éléments pourtant très problématiques. D’ailleurs, si Gaïnas et Alaric ont dû combattre l’Empire, ce n’est pas parce qu’ils étaient Goths, c’est plutôt parce qu’ils ont agi à titre d’agresseurs à un certains moments. C’est de là que leur viennent leurs statuts
21 21
d’ennemis, l’ethnicité n’a rien à y voir. Par exemple, est-ce que Gaïnas se serait fait tuer s’il n’avait pas tenté de prendre Constantinople? Est-ce qu’Alaric aurait été perçu autrement s’il ne s’était pas opposé à Stilichon et n’avait jamais pillé Rome? Qui plus est, le fait que ces deux hommes aient tenté leur chance après avoir vu une brèche dans le système romain montre hors de tout doute leur confort dans ce système. Il fallait bien connaître l’Empire pour frapper là où ça faisait mal : Constantinople et Rome. Plus encore peut-être, il fallait très bien connaître l’Empire pour savoir oser poser de tels gestes. Par exemple, Alaric aurait pu assiéger Ravenne et essayer d’y piéger Honorius (des murailles restaient des murailles après tout), mais il décida plutôt de concentrer ses efforts sur Rome. Rome présentait d’ailleurs des éléments qui ne pouvaient échapper à quelqu’un qui connaissait bien les airs : le port assurait un ravitaillement plus facile, la Cité avait conservé une renommée inégalée, et le Sénat s’y trouvait toujours. Et à voir la réaction de certains contemporains, Alaric n’avait pas si mal visé, c’est simplement Honorius qui ne voulut pas plier; l’idée était bonne. cxxx. Heather (1999b), 64 et 67; le récit de Zosime (5.35.5-6) permet peut-être une telle interprétation, bien que la raison ici semble être davantage la revanche qu’un quelconque souci de survie. cxxxi. Heather (1999b) verbalise son embêtement devant l’intégration d’une variété d’individus dans le groupe d’Alaric, à savoir selon quels critères tel ou tel individu était classé dans l’espace dominant ou dominé. cxxxii. Sozom. ([Hist. eccl.] 9.6) mentionne ces esclaves romains. cxxxiii. Olymp. fr. 3 (cité dans Paschoud [1986], 339) ; Oros. (Ad. Cont. Pag.) 2.3.4; Sozom. (Hist. eccl.) 9.8; Philotorg. (Hist. eccl.) 12.3. cxxxiv. PLRE 2.21; Paschoud ([1986], 247, note 82). cxxxv. Zos. 5.48.2; on peut aussi le déduire de Sozomène (9.4.3 [cité dans Paschoud (1986), 342]); Paschoud ([1986],196, note 54). cxxxvi. Olymp. fr. 3 (cité dans Paschoud [1986], 339); Jord. Get. 10.1. Placidia soulève d’ailleurs le problème du genre rarement mentionné dans les études sur les Goths. On peut certainement avancer, selon quelques sources, que certaines femmes occupèrent une place importante dans le groupe d’Alaric et de son successeur : Athaulf légitima d’ailleurs son pouvoir, en partie, par l'entremise de femmes : sa sœur mariée à Alaric, puis son propre mariage avec celle d’Honorius. Alaric, suivant le récit fictif de Claudien (26[Bell. Get.]. 626-629), aurait été mené à la première invasion de l’Italie sous les encouragements de la sœur d’Athaulf, et Zosime (5.38.1) avance que Séréna l’aurait attirée en Italie la seconde fois. Le meurtre des femmes et enfants des alliés de Stilichon les auraient poussés à supporter la cause d’Alaric (Zos. [5.35.6]. Il est important de noter que Zosime ne dit pas clairement que ces 30,000 soldats se joignirent à Alaric; il dit simplement qu’ils se tenaient à sa disposition. C’est plutôt Philistorge [Hist. eccl. 12.3] qui y fait mention), tout comme les otages (femmes et enfants) faits par Stilichon lors de Verona et Pollentia auraient poussé beaucoup de soldats à déserter le Goth. On peut également lancer l’hypothèse que ce groupe goth était organisé selon le modèle agnatique (cf. Murray [(1983), 16-17]), mais avec le matrilignage comme point d’appui, du moins à partir de Théodéric. Pour autant que l’on sache, la légitimation du pouvoir post-410 passa assez souvent par les femmes. En effet, Athaulf avait des liens avec Alaric par alliance, mais non par sang. Le seul roi qui put se réclamer vraiment de liens directs (bien que cela demeure très incertain) est Théoderic Ier qui maria la fille d’Alaric (PLRE 2.1070; Mathisen et Sivan [1999], 8). Certes, les fils de Théodéric Ier (soit Thorismund, Théodéric II, Euric, etc.) pouvaient aussi se réclamer de cet héritage, mais ce prestige leur venait de leur mère, non de Théodéric. Ce n’est qu’à partir d’Euric et de ses descendants (dont Alaric II) qu’on pourrait parler de modèle agnatique traditionnel. Tout cela, bien sûr, si Alaric était vraiment une figure importante pour le groupe, ce qui n’est pas certain à ce point. Par exemple, Athaulf nomma son fils Théodose, non Alaric, comme le note Livermore ([2006], 35), et entre 410 et 711, seulement un autre roi visigoth porta le nom d’Alaric (484-507). cxxxvii. MacGeorge ([2002], 266) touche en passant cet aspect curieux, aussi présent chez Ricimer et Aspar et avance des raisons psychologiques qui auraient pu pousser ces généraux à agir ainsi. cxxxviii. Heather (1991), 198. cxxxix. Heather (1996), 143. cxl. Suivant ce que semble avancer Heather (1999b). cxli. cf. Burns (1994), cxlii. Encore une fois, Fustel de Coulanges avait déjà fait une remarque similaire. cxliii. Ou encore, Alaric exerçait sur eux un pouvoir assez important pour que le groupe accepte de suivre son habitus. Et, comme je l’ai dit, on voit la chose se répéter avec Athaulf quelques années plus tard, sans que l’on apprenne que ses actions aient été impopulaires auprès de son groupe. cxliv. cf. MacGeorge ([2002], 7-8) pour un point similaire. cxlv. Venant d’Arcadius, voir Claud. (Cont. Eutr.) 2.214-216; allusions en (26[Bell. Get.]. 516-517) et (Cont. Ruf. 2.170-250); venant d’Honorius, voir Sozomène (8.25.5 [cité dans Paschoud (1986), 342] et [Hist. eccl.] 9.4). cxlvi. Notons que certains érudits ne croient pas Claudien et croient plutôt que les ravages de la Grèce auraient été causés par Stilichon; c’est le cas de Burns ([1994], 158).
22 22
cxlvii. cf. Heather (1999b), 49. cxlviii. p. ex. Wolfram (1997), 95. L’exception notable est Burns ([1994], 161). cxlix. Peut-on comprendre le propos d’Orose ([Ad. Cont. Pag.] 7.37.9) en ce sens lorsqu’il dit qu’Alaric ressemblait plus aux Romains que Radagaise ? D’ailleurs, un épisode antérieur montre encore une fois qu’Alaric savait très bien ce qu’il faisait. Sa révolte de 395 est souvent rattachée à la mort de Théodose et à l’annulation automatique du traité de 382 (cf. Wolfram [1997], 92.). Cela demeure débattu puisqu’on peut penser à Athanaric qui envoya des soldats à l'usurpateur Procope sous réserve qu'il dût honorer le traité de 332 conclu avec Constantin (Amm. Marc. 27.5.1-3). En supposant néanmoins que la renégociation du traité était le stimulant de toute l’affaire (cf. Liebeschuetz [1990], 56-57; Wolfram [1997], 89-91), il faut admettre que cette revendication n'est pas banale et qu’elle rend visible une compréhension du monde romain de la part du Goth. S’il avait vraiment été en mesure de reconnaître que ses services valaient plus que ce que Théodose avait octroyé en 382, cela montrerait qu’il avait acquis les moyens de faire un tel constat, ce qui ne pouvait arriver qu'au long de l'expérience. Pareillement, le fait qu'il tenait comme fer à obtenir une haute fonction romaine laisse entendre que ses Goths croyaient une telle position nécessaire. En tout cas, obtenir des titres romains n'était pas mal vu de leur part. Mais encore : si vraiment Alaric mobilisa ses Goths dès 395 (toujours en supposant qu’il s’agissait des Goths établis en 382), cela démontrerait qu’il était bien établi à ce moment (en tout cas, c’était une entreprise risquée; les soldats pouvaient en effet se montrer sensibles à ce genre de situation et l’on se souviendra de l'épisode où Julien avait été témoin de la révolte de ses barbares [Amm. 20.4-5]). Cependant, rien n’est moins sûr; la mort de Théodose n’impliquait aucunement que les Goths allaient se voir amputer de leurs territoires et ces Goths n'étaient pas le souci premier des nouveaux empereurs, on peut en être sur. Arcadius n’aurait rien gagné à provoquer ce bouleversement. Cela amène à se demander si le groupe d’Alaric était vraiment composé des Goths de 382. L’action d’Alaric pourrait très bien être en règle avec les responsabilités d’un général romain. Si Alaric reçut tant d’attention immédiatement après la mort de Théodose, c’est sûrement en raison du pouvoir qu’il détenait dans le monde oriental romain. Son armée (barbare ou non, peu importe) était sans doute précieuse à Arcadius et Rufin qui étaient alors en bien mauvaise posture puisque la majorité des troupes de l’Orient se trouvaient toujours à l’ouest avec Stilichon… On est très mal renseigné sur ces évènements en raison de notre source principale extrêmement biaisée (Claudien), mais il semble que l’on gagnerait à comprendre les évènements qui se produisirent en Grèce peu après selon l’approche de Burns (1994), soit de voir Stilichon comme l’envahisseur et Alaric comme le général d’une armée orientale. cl. Heather (1991; 1996; 1999b) cli. Liebeschuetz ([1990], 51). Ce dernier reprend cette idée pour expliquer d’autres groupes barbares, comme les Vandales (cf. Liebeschuetz [2003], 64-65). Ceux qui croient qu'il s'agissait simplement d'une armée voient les actions d'Alaric comme un moyen d'acquérir plus de prestige et le pouvoir nécessaire pour se maintenir à ce rang. Le titre de maitre des milices lui permettait aussi d'équiper ces hommes en armes et de leur assurer une ration de nourriture, croit-on (voir Liebeschuetz [1990], 55 et Goldsworthy [2010], 293-294). Synésios ([Corr.] 78.20-25) laisse entendre pourtant que c'était toujours l'empereur qui donnait ces bénéfices aux soldats, non le gouverneur militaire. clii. Claud. Cons. Hon. 6.243; 297-299; peut-être aussi Zosime (5.37.1). cliii. Oros. Ad. Cont. Pag. 7.38. cliv. Cette question demanderait un examen approfondi de la logistique, afin de voir si vraiment l’itinéraire connu (bien résumé dans Paschoud [1986], 250, note 84) était possible avec des femmes et enfants. Il s’agit d’un thème trop peu souvent abordé et une manière pourtant simple de remettre les choses en perspectives. On mentionne rarement cet aspect ou trop brièvement : Heather ([1991], 217-218) mentionne en passant que la distribution de blé aux Goths devait avoir été problématique (je note que Roth [(1999), 7-13] a montré qu'il est possible d'établir de manière réaliste la quantité nécessaire d'apports caloriques à un Romain de l'époque), Elton ([1996], 74-76) y fait allusion et Drinkwater ([2007], 288) mentionne que l'armée romaine se déplaçait en moyenne 20 km par jour et parfois plus lentement. Ainsi, pour ne donner qu’un exemple, le déplacement d’Alaric (en supposant que son armée était similaire à une armée impériale sur la base qu'il a su tenir tête à Stilichon, et en tenant pour acquis que tout ce serait bien déroulé – que le ravitaillement n'aurait pas été un problème et qu'ils auraient su tenir le cap des 20 km par jour sans embûches) lui aurait demandé 100 jours de marche pour atteindre Rome à partir de la Bulgarie actuelle. Ces Goths avaient pourtant des chariots avec eux et s'en servaient souvent comme d'une barricade défensive (Liebeschuetz [1990], 58; Kulikowski [2002], 80). On pourrait donc faire une comparaison avec le cas de Théodéric l'Amal (cf. Heather [1996], 170-171); en effet, Heather compare le train de bagages de Théodéric à celui des Boers et dit que dans le cas des Boers, il y avait un chariot pour six personnes (Heather [1996], 171, n. 9). Dans le cas des 40,000 Goths d'Alaric, cela donnerait plus de 6,500 chariots! Curieusement, Zosime (4.25.3) corrobore presque ces nombres incroyables lorsqu'il nous dit que
23 23
Modarès avait capturé 4,000 chariots goths et autant d'esclaves dans un seul affrontement. Si ces nombres sont vraiment réalistes, l'entreprise gothe était ambitieuse, pour dire le moindre. Heather estime encore que 460 chariots s'étiraient sur plus de trois miles : 6,000 chariots s'étireraient sur plus de 39 miles (soit environ 63 km)! Qui plus est, ces chariots étaient sans doute tirés par des bœufs, et non des chevaux, ce qui devait ralentir considérablement la vitesse du déplacement et il faut aussi compter, dans les rations, le fourrage pour les animaux de train, chevaux, etc. Pour ne donner qu'une idée de l'ampleur de l'organisation nécessaire, Roth ([1999], 62-66) a établi qu'un bœuf de taille moyenne (plus ou moins 800 lb) avait besoin d'environ 40 lb de nourriture par jour, en plus de 30 L d'eau. En estimant deux bœufs par chariots, sur plus de 6,000 chariots, on commence à apprécier l’ampleur du problème ! En somme, il apparaît évident que les estimations du groupe d'Alaric sont excessives si l'on considère, même rapidement, cette question de logistique. clv. cf. Thompson (2008). clvi. On sait que les nobles romains portaient aussi une attention particulière aux terres, comme on le voit bien dans les Correspondances de Synésios; cette interprétation n’est donc peut-être pas insensée. clvii. Zos. 5.48.3. clviii. Walter Pohl mentionne souvent Bourdieu par contre, sans vraiment exploiter ses concepts; c’est surtout son travail sur la distinction qui semble l’avoir eu intéressé (cf. Pohl [2006]). clix. Maxwell [2006], 146-148 et Krueger [2010], 224, note 2. clx. Je note la critique de Levithan (2008) : « I found that the use of Bourdieu's terminology left the facts no better organized than they are when presented in ordinary language […] "total habitus" does not have much meaning in this more specific discussion of masculinity. In other contexts it can end up as a mere placeholder […] » clxi. Pour ne pas donner de fausses impressions, il faut noter que Bourdieu n’est mentionné directement que dix fois dans cette œuvre monumentale; on trouve l’essentiel du propos entre les pages 21 et 27, surtout 23. clxii. Ando (2000), 23. clxiii. Par manque d’espace, je ne peux pas parler du livre de Corbeill, Nature Embodied, mais il s’agit d’une autre étude à exploiter le concept d’habitus pour montrer que les dominants justifiaient leur place par leur langage corporel transmis de manière subconsciente et qui se reproduisait chez ces dominants par la pratique (pp. 109-110, 135; voir son chapitre 4). clxiv. D’après la critique très dure de Barnes (2001) à l’endroit D’Ando. Voir d’ailleurs sa réponse : Ando (2002) où il définit l’idéologie (p. 248). clxv. Corbeill (2004), 70-71; Phang (2008), 98.