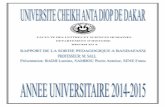BULLET"@BULLET**« MÉTHODES PRATIQUES DE CONSERVATION DES PRODUITS
Acheminement adaptatif dans les réseaux téléphoniques : méthodes et évaluation de performances
Transcript of Acheminement adaptatif dans les réseaux téléphoniques : méthodes et évaluation de performances
pp. 53-75 53
Acheminement adaptatif dans les r6.seaux t616phoniques i
m6thodes et 6valuat,on de performances Prosper C H E M O U I L **
Paul G A U T H I E R **
Jacques B E R N U S S O U ***
Jean-Mar ie G A R C I A ***
Frangoise LE G A L L ***
G6ra rd BEL ****
Charles C A S T E L ****
Analyse
Cet article est consacrd d l'analyse d'algorithmes d'acheminement adaptatif dans les r~seaux tdldpho- niques. Une premiOre partie concerne la description de diverses mdthodes, proposdes en fonction de la politique d'acheminement, des mesures et de leur fr~quence ainsi que de la structure de commande qui en rdsulte. La seconde partie est ddvolue ~ l'dva- luation des algorithmes ddveloppds sur un r~seau-test, ddfini ~ partir de donndes r~elles de la zone urbaine du r~seau d'lle-de-France.
Mots el~s : R6seau t~l~phonique, Acheminement, T61&rafic, Algorithme adaptatif, Evaluation performance, Gestion r6seau, Simulation num6rique.
ADAPTIVE TRAFFIC R O U T I N G IN T E L E P H O N E NETWORKS : M E T H O D S
A N D P E R F O R M A N C E EVALUATION
proposed algorithms on a testbed network obtained from real data of the Paris network.
Key words : Telephone network, Routing, Teletraffic, Adapta- tive algorithm, Performance evaluation, Networking, Digital simulation.
Sommaire
I. Introduction.
II . L'acheminement ~< intelligent>> dans le monde.
III . Description des algorithmes d' acheminement adaptatif .
IV. Description du rdseau-test et des conditions de fonctionnement.
V. Evaluation de performances des algorithmes d'acheminement adaptatif.
VI. Conclusion.
Bibliographie (22 rdf ).
Abstract
This paper is concerned with the analysis of adaptive traffic routing policies in telephone networks. A first part is devoted to the description of various approaches designed according to parameters such as the local routing policy, the available measurements as well as the update cycle length. The second part of the paper is dedicated to the performance evaluation of the
I. I N T R O D U C T I O N
Les m6thodes de c o m m a n d e du trafic dans les r6seaux t616phoniques ont connu un regain d ' int6r~t ces derni6res ann6es. Elles sont la cons6quence des nouvelles possibil i t6s technologiques qui permet ten t de reconsid6rer la s t ructure de gest ion du trafic et
* Cet article repr6sente une synth~se des recherches entreprises au sein du collectif A*T regroupant des ing6nieurs et des chercheurs impliqu6s dans des 6tudes sur la gestion en temps r6el des acheminements dans les r6seaux t616phoniques (AStARtE : Acheminement Souple pour le Traitement d'Appels dans un R6seau TEl6phonique). Ces 6tudes ont 6t6 d6velopp6es dans les centres de recherche suivants :
** Centre national d'6tudes des t616communications (CNET) 92131 Issy-les-Moulineaux (Equipe ~ Acheminement adaptatif >> du d6par- tement ArR/SST coordonn~e par P. Chemouil et P. Gauthier).
*** Laboratoire d'automatique et d'analyse des syst~mes (LAAS-CNRS), 7, avenue Colonel Roche, 31077 Toulouse (Equipe tmol, dirig6e par J. Bernussou).
**** D6partement d'6tudes et de recherche en automatique (CERT-DERA), 2, avenue Eugene Belin, 31055 Toulouse (Projet par G. Bel et C. Castel).
1/23 ANN. T~LECOMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987
54 P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RI~SEAUX TI~LI~PHONIQUES
de pr6voir l 'automatisation des proc6dures de com- mande du r6seau [1]. Ces proc6dures ont pour but d'assurer le bon fonctionnement du r6seau et de lui apporter une grande robustesse, n6cessaire pour garantir une qualit6 d'6coulement satisfaisante du trafic.
Les actions engag6es pour 6viter la saturation d 'un r6seau d6pendent 6videmment des 6v6nements susceptibles de produire une telle saturation et sont prises h des 6chelles de temps diff6rentes en fonction du fonctionnement pr6visible ou estim6 du r6seau :
�9 L'&ape de planification annuelle permet de dimensionner le r6seau ~. partir d'une (ou des) valeur(s) de r6f6rence du trafic offert ; on d6termine 6galement les matrices d'acheminement des appels. Le trafic 6tant une variable probabiliste, connait des varia- tions normales autour de sa valeur moyenne et celles-ci sont absorb6es par le surdimensionnement des faisceaux hi6rarchiques. On trouve ici la premiere action de s6curisation du trafic par la prise en compte d'6v6nements pr6visibles.
Parall~lement, des actions sont entreprises au niveau du r6seau de transmission pour pallier les effets n6fastes des pannes. I1 s'agit d'abord d'actions de multiroutage qui permettent de sauvegarder une pattie des moyens de communication en cas de pannes d'art6res. Ensuite, l'existence d 'un r6seau de transmission de r6serve est congu pour pallier les d6faillances graves du r6seau de transmission.
�9 La gestion pr6ventive, sur un horizon de quelques mois, permet la prise en compte des variations saisonni~res et le r6ajustement des pr6visions h partir de mesures plus fines. Elle conduit b. un redimension- nement partiel de certains faisceaux et h des modi- fications d'acheminement. Cet affinement constitue la seconde action, 6galement pr6ventive, de s6curi- sation du r6seau. Au niveau transmission, on peut imaginer des actions de transit lent qui consistent 5. cr6er des liaisons semi-permanentes dans les centres de transit (et donc grossir la taille de certains fais- ceaux directs) pour tenir compte des variations saisonni6res.
�9 La gestion corrective, de l'ordre du mois, est comme son nom l'indique, le premier jalon de remise en cause de la programmation par la prise en compte de mesures fra~ches. On a un effet de boucle dans le processus, du type action-mesure-correction. Cette 6tape permet de corriger l'errenr constat6e entre le trafic r&l et la pr6vision de trafic. Elle aboutit h une extension de certains faisceaux et h la modification de quelques acheminements.
�9 La gestion dynamique du r6seau sur un horizon de quelques secondes ~t plusieurs heures, est carac- t6ris6e par unc action de supervision et de contr61e du trafic, et une action de commande :
* la supervision et le contr61e permettent de g~rer les pointes importantes de trafic (pr6vues ou non) par des m6thodes de restriction d'appels et de faire
face ~t des pannes d'6quipements par le basculement sur des capacit& de r6serve.
* La commande de trafic consiste b, g6rer la non- coincidence des pointes de trafic (macroscopiques ou fines) et les surcharges de trafic, et ~t faire face une r6duction des capacit6s du r6seau en cas de pannes.
- - D u point de vue macroscopique, la non- coincidence des heures charg6es sur les faisceaux (trafic r6sidentiel et professionnel ou, dans le cas de vastes pays, la prise en compte des zones horaires) conduit 5. la modification des tables d'acheminement, pr6calcul6es ou d6terminfes en fonction d'estimation de trafic offert, pour profiter des capacit6s libres dans le r6seau. Sur une 6chelle de temps tr~s fine, on consid~re les variations en temps r6el du trafic, dues ~ la nature probabiliste du trafic et aux erreurs r6siduelles de pr6vision. Les actions ad6quates passent alors par l'application de r6gles d'acheminement adaptatif.
- - L e s surcharges de trafic locales ou globales sont absorb6es par d6clenchement d'actions de protection du r&eau pour 6viter son engorgement. Elles consistent ~t r6server des circuits pour le trafic frais de fagon ~ interdire des debordements successifs avides de ressources et ~. des actions de restriction d'appels ~t la source lorsque la raison de la surcharge est identifi6e.
- - Les pannes d'6quipements sont prises en compte par des actions de r6acheminement permettant d'absorber au mieux la d6gradation des performances en attendant le basculement 6ventuel sur des 6qui- pements de r6serve. Cette r6affectation a pour but d'assurer un service 6quitable pour les flux affect6s par la panne.
Les niveaux d6crits interagissent entre eux de fagon ~. simplifier le probl~me global de la gestion du r6seau. 11 s'agit de d6terminer 5. chaque niveau les actions les mieux adapt6es aux 6v6nements que l 'on consid6re. Toutes ces actions sont 6videmment indispensables pour assurer le fonctionnement ad6- quat et robuste du r6seau. Los trois niveaux sup6- rieurs de la gestion du r6seau (planification, gestions pr6ventive et corrective) sont g6n6ralement bien d6finis par les services qui programment les r6seaux de t616communications, et ont fair l'objet de nom- breuses recherches dans les ann6es pass6es. Par contre, la gestion dynamique n 'a pas b6n6fici6 de toute l'attention n6cessaire. Le contr61e et la supervision ont 6t6 assur6s de mani~re non automatique sans ~tre r6ellement pris en compte dans le processus global de la gestion. Pourtant, on con~oit facilement que le r6seau ne r6agit pas de mani~re id6ale et que la pr6vision de son fonctionnement h partir de valeurs de r~f6rence agr~g6es ne refl~te pas la r~alit6. Des actions sont donc n6cessaires pour tenir compte du fonctionnement au jour le jour du r6seau et des al6as qui l'affectent en temps r6el.
ANN. TI~Lt~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987 2/23
P. CHEMOUIL. - ACttEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RI~SEAUX TI~LI~PHONIQUES 55
Aujourd'hui l'61ectronisation du r6seau t616pho- nique permet d'envisager l 'automatisation partielle de la surveillance et du contr61e du r6seau, et l'intro- duction de proc6dures en temps r6el char#es d'assurer le bon fonctionnement du r6seau.
Dans cet article nous nous int6ressons h ce dernier point qui fait l'objet d 'un int6r& grandissant depuis une dizaine d'ann6es. Plus sp6cifiquement nous analysons les m6thodes d'acheminement intelligent dont le principe est de modifier en temps quasi r6el les tables d'acheminement des appels en fonction de l'6tat du r6seau, c'est-/t-dire en fonction de la demande des usagers et de la charge du r6seau, connues ~t partir de mesures effectu6es sur le r6seau.
Le principe de cette gestion adaptative des appels peut 6tre r6sum6 par le diagramme suivant la figure 1.
Apr6s avoir d6crit les principales m6thodes d6ve- lopp6es dans le monde, nous d6crivons les algorithmes d'acheminement adaptatif 6tudi6s en France. Puis nous 6valuons les performances des algorithmes propos6s sur un r6seau-test pr6alablement d6crit.
Traflc offert
~ atlons
RESEAU ~~s~l---
Commande ~ - ~ .....
FIG. 1. - - Principe de l ' acheminement adaptatif .
Principle of adaptive traffic routbtg.
II. L 'ACHEMINEMENT << INTELLIGENT >> DANS LE MONDE...
BNR (Bell Northern Research) au Canada [10], [11] ont 6t6 les principaux centres de recherche des t616com- munications /l consid6rer ce probl6me. Aujourd'hui de nombreuses administrations ou organisations ont per~;u le b6n6fice que pourraient apporter ces nouvelles m6thodes de gestion du trafic et ont initialis6 des &udes sur ce sujet (Su6de, Espagne, Gr6ce, Italie, Grande-Bretagne, ...).
Avant d'analyser en d&ail les recherches d6ve- lopp6es en France, nous pr6sentons les deux approches 6tudi6es aux Bell Laboratories et aux BNg qui sont bas6es sur des concepts initialement tr6s diff6rents.
II.1. Acheminement dynamique non hi6rarchique (DNHR).
L'61ectronisation du r6seau t616phonique d 'ATT,
/~ partir des ann6es 70, a entrain6 une r6duction importante du nombre de commutateurs et a donc remis en cause la structure hi6rarchique /t cinq niveaux. Prenant acte des possibilit6s offertes par ces nouveaux syst6mes ainsi que de l'introduction du r6seau de signalisation par canal s6maphore n ~ 6 (cos), les ing6nieurs des Bell Labs en ont profit6 pour r6nover le syst6me de gestion du r6seau et ont propos6 une nouvelle mgthode de gestion du trafic : l 'acheminement dynamique non hi6rarchique soit en anglais le dynamic non-hierarchical routing et plus commun6ment connu sous ses initiales DHNR [12].
Les principes de base sont les suivants/t l'int6rieur d 'un r6seau DNHR (Fig. 2) :
�9 l'acheminement est limit6 h un t ransit ;
�9 utilisation du retour ~ crankback >) (de la signa- lisation ~t l'origine) : ainsi lorsqu'un appel se trouve bloqu6 le long d 'un chemin, il est rapatri6 au nceud origine du r6seau DNHR et envoy6 sur un nouveau chemin. Notons que dans la plupart des pays le type de signalisation utilis6 est la signalisation pas /t pas (link by link control ou progressive control) et l'acheminement est dit s6quentiel ;
�9 d6bordement multiple par chemin sans notion de hidrarchie ;
Les perspectives d'introduction de commutateurs 61ectroniques et le d6veloppement des r6seaux s6ma- phores permettant de construire des r6seaux de t616- communications intelligents, ont incit6 les diff6rentes administrations de t616communications ~t envisager de nouvelles m6thodes de gestion du trafic t616phonique. J u s q u ' ~ . ce s derni~res ann6es, ce domaine 6tait du ressort universitaire et des p61es de recherches se sont cr66s en France (LAAS-CNRS et DERA-CERT de Toulouse) [2], [3], aux USA (Universit6 de Yale) [4], au Canada 0yRs de Montr6al) [5], en Pologne (Ins- tituts des t616communications de Varsovie et de Cracovie) [6], [7]. Simultan6ment, outre le CNET en France [8], les Bell Laboratories aux USA [9] et les
':+,' ,, /
+
\, x ,
' , /
t~
' '"x, / / '
\ \ /
tz
FIG. 2. ~ Principes du DNrm.
Principles of DNHR.
3/23 ANN. T~LI~COMMLrN., 42, n ~ 1-2, 1987
56 P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RI~SEAUX TI~LI~PHONIQUES
�9 sdquences de ddbordement variables avec le temps.
Le DNHR est non hidrarchique car il n 'y a ni supdrieur hidrarchique ni chemin normal. Evidemment la sdquence de ddbordement est diffdrente selon les flux.
Cependant, bien que les acheminements soient variables, il ne s'agit pas d'acheminement adaptatif modifid en fonction de l'dtat du rdseau mais d'ache- minement variant dans le temps selon des plans pr~calculds en fonction de tranches horaires, ce qui explique le qualificatif << dynamique ~ pour le DNHR.
La journde est ainsi divisde en une dizaine de plages horaires. Pour chacune d'entre elles, une suite de chemins ~ utiliser dans l'ordre pour le premier choix et les ddbordements successifs, est pr6program- mde pour chaque flux de trafic, en fonction de la prdvision de la demande. Cette prdvision est ddter- minde en tenant compte des variations journali6res et saisonni6res ainsi que de la non-coincidence des pointes de trafic dues ~t l'dtalement des USA sur plusieurs zones horaires.
En plus de ces chemins prdcalculds, il est prdvu une gestion en temps r6el des chemins dits de r6serve utilisds lorsque des ressources suffisantes existent dans le rdseau. Ces chemins de rdserve sont en fait des chemins programmds pour d'autres flux de trafic. Ils sont utilisables lorsque leur capacitd ins- tantande ddpasse un seuil de rdservation, ddtermind pour protdger le trafic pour qui le chemin est pro- grammd.
Un exemple d 'un tel acheminement est le suivant (d'apr6s [9]) : on consid6re le rdseau suivant o~ quatre tranches horaires principales ont dtd dis- tingudes (Fig. 3).
L'acheminement d 'un appel du centre 1 vers le centre 5 se fera selon les sdquences de ddbordement suivantes en fonction de la tranche horaire considdrde (Tabl. I) :
TABL. I. - - Sdquences de ddbordement dans un rdseau DNHR.
Routing sequences in DNHR networks.
Flux 1 --~ 5
Tranche horaire Sdquence de d6bordements
5 4 6 2 7 3 4 5 3 6 2 7 5 6 4 7 3 2 7 4 5 3 2 6
Nota : la pattie en gras reprdsente la sdquence programmde et le reste les chemins de rdserve.
Une gestion en temps rdel oil les actions sont manuelles est pr6vue en cas de panne ou d'dvdnements imprdvus [9]. Ces actions consistent principalement
restreindre le trafic h la source. Elles sont dgalement mises en oeuvre pour faire face h des dvdnements
Fro. 3. -- Exemple de r6seau DNHR.
Example of a DNHR network.
prdvus mais tr6s perturbateurs tels que la F&e des m6res, NoEl ou le Jour de l'an. Mais le DNHg ne prdvoyait pas ~ l'origine d'adaptation en temps rdel des tables d'acheminement. La multiplicitd des routes dans le rdseau DNHR fortement mailld allid au ddbor- dement par chemin rendu possible par le << crank- back>) semblait la rendre inutile ; cependant, non- obstant les avantages apportds par le << crankback )~ (dlimination des bouclages lors de l'dtablissement d'appel, contr61e du blocage des chemins) et malgrd la rapiditd des temps d'dtablissement des appels (rdduits par la sigrtalisation par canal sdmaphore), la multiplicitd des chemins pouvait rdduire l'effi- cacitd du rdseau DNHR. En effet, une tentative d'dta- blissement qui dchoue sur un faisceau bloqu6 sor- tant d 'un centre de transit rdsulte en la rdservation br6ve mais inutile d 'un circuit (du noeud origine au centre du transit). Comme l'appel n'est pas perdu mais rdachemind, ce ph6nom6ne peut se reproduire plusieurs fois par la politique figde de ddbordement et donc utiliser inefficacement lcs ressources du rdseau. Un effet de boule de neige apparait et les performances du rdseau s'effondrent.
Pour pallier ces effets ndfastes du crankback, un ren- forcement du DNHR par l'adjonction d'un algorithme temps rdel qui conduit ~ l'acheminement adaptatif, est en cours d'dtude. En fait la sdquence de ddbor- dement n'est plus figde mais mise h jour pdriodique- ment en fonction de mesures faites en temps rdel darts le r6seau [13].
La politique d'acheminement proposde par les Bell Labs serait la suivante :
�9 Le premier choix reste celui fixd par l'algo- rithme initial de DNHR (approche unifide) [12].
�9 Les ddbordements successifs sont classds selon leur disponibilitd parmi lcs choix programmds d&er- minds par l'approche unifide. La disponibilitd d 'un chemin est ddfinie par sa capacitd rdsiduelle, telle qu'elle a dtd proposde par BNR [10]. En faisant ddborder les appels sur les chemins les moins satur6s, on esp6re diminuer les risques de blocage et donc de nouveau ddbordement. Les rdsultats en simulation ont montrd que l'adjonction d'une gestion automatique en temps rdel conduit h des pertes quasiment nulles dans le rdseau en charge normale. Pour cette gestion, la pdriode de reconfiguration des sdquences de ddbor- dement est prdvue dgale h 5 s.
ANN. T~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987 4/23
P. CHEMOUIL. - ACttEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES Rt~SEAUX TI~LI~PItONIQUES 57
= F (~( f.~f ~\. t blesure s
i ~._]. gestion en temps ree~ ]. , ,~
[ a c ~ l ~ cjestion corrective I~ semaine
6 moi.~
FIG. 4. - - Gestion du r6seau DHNR.
DNHR network operations.
Pour mettre en oeuvre le DNHR, une gestion cen- tralis6e rigoureuse et automatis6e est mise en oeuvre selon la d6composition fonctionnelle suivante (voir Fig. 4) :
�9 planification semi-annuelle tenant compte de l'6volution des commutateurs et de pr6visions de la charge de trafic ;
�9 gestion pr6ventive trimestrielle prenant en compte l'6volution pr6visible du trafic ; elle permet de dimensionner les faisceaux et d'adapter les ache- minements en consfquence ;
�9 gestion corrective hebdomadaire qui permet de corriger les erreurs de pr6vision; elle aboutit /~ modifier la taille des faisceaux e t / t op6rer des modi- fications des tables d'acheminement ;
�9 supervision active et gestion en temps r6el charg6e de g6rer le r6seau en fonction de mesures op6r6es en ligne sur le r6seau ; elle conduit ~, des actiolls manuelles en cas de panne ou de surcharges graves et des actions automatiques de r6acheminement en ce qui concerne les variations al6atoires de trafic ou certaines configurations de trafic et de pannes mineures. I1 faut noter que le superviseur surveille 6galement le r6seau s6maphore cos .
Les trois premi6rcs fonctions sont r6alis6es hors- ligne et ont pour but de minimiser les coots du r6seau. La derni6re fonction est r6alis6e en ligne e t a pour r61e de veiller au bon fonctionnement du r6seau mais n'est pas prise en compte dans le dimensionnement.
Outre l'am61ioration de la qualit6 d'6coulement du trafic apport6e par lages t ion en temps r6el et la robustesse accrue par le maillage du r6seau per- mettant une multiplicit6 de chemins, le DNHR aboutit selon les 6valuations ~ une 6conomie de circuits de l 'ordre de 14 ~ .
La gestion DNrIR est aujourd'hui implant6e dans
le r6seau ATT et actuellement le r6seau DNHR comporte 25 nceuds assurant une grande partie du trafic lon- gue distance. A terme (vers 1990), le r6seau DNHR comportera une centaine de neeuds et englobera quasiment les trois niveaux sup&ieurs du r6seau hi6rarchique actuel. Le maillage de ce r6seau sera de l'ordre de 60 ~ . Tr6s adapt6 au r6seau interurbain, il a 6t6 montr6 que le DNHR &ait int6ressant 6galemertt dans le cas des grandes m6tropoles [14]. Dans ce cas, on prend avantage de la non-coincidence entre trafic r6sidentiel et trafic professionnel et entre trafic urbain et trafic p6riph6rique pour d6terminer les acheminements dynamiques.
II.2. Acheminement ~ haute performance (HPR).
Bell Northern Research (BNR) a lanc6 des 6tudes sur l ages t ion en temps r6el dans les ann6es 70. L'aboutissement des recherches en a 6t6 l'achemi- nement /t haute performance ou << high performance routing ~) (HER), bilinguisme oblige. Au fil des ann6es cet acheminement a 6t6 baptis6 en anglais << advanced routing)) ou << adaptive routing)), puis << dynamic routing)> avant de devenir HPR. Le principe de la politique d'acheminement est le suivant :
A partir de mesures effectu6es en temps r6el sur le r6seau, il s'agit de reconfigurer p6riodiquement la table de d6bordement en fonction de la dispo- nibilit6 des chemins.
8NR n'a pas consid6r6 une politique de d6bordement g6n6ralis6 et ainsi il s'agit de d6terminer le chemin de d6bordement. Dans cette approche 6galement, la notion de hi6rarchie n'existe plus et un chemin est limit6 /t la succession de deux faisceaux (un seul transit est permis) ; voir figure 5.
to + A
FIG. 5. I Prirtcipe de HPR.
Principle of HPR.
Le r6seau canadien utilise la technique de signa- lisation pas h pas. Dans ce cas, lors de l'6tablissement d 'un appel, un bouclage peut se produire 6tant donn6 l'inexistence de chemin hi6rarchique de dernier choix. Pour 6viter ce probl~me et pour satisfaire la contrainte de transit unique, les commutateurs doivent analyser l'origine de chaque appel et prendre la d6cision de bloquer un appel ayant d6j~ transit& Selon BNR, cette technique est moins contraignante que le crankback.
5/23 ANN. TI~L~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987
58 P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RESEAUX TELEPHONIQUES
La disponibilit6 des chemins est d6finie selon le crit6re de capacit6 r6siduelle [10] c'est-/t-dire le nom- bre de circuits/t l'6tat libre d 'un faisceau. Par exemple, un faisceau IJ de capacit6 N~j qui a S , circuits occup6s a une capacit6 r6siduelle Cis = N1s - - Sxs.
Pour un chemin IKJ compos6 de deux faisceaux successifs IK et K J, la capacit6 r6siduelle est d6finie par :
Ctrs = min {NjK - - S j r , Nxs - - Sxs}
= min { G r , CKj}.
Parmi t o u s l e s chemins possibles ILJ entre un nceud I et un noeud J, la table de d6bordement visera le centre de transit K d6termin6 en fonction de leur capacit6 r6siduelle par tirage al6atoire avec la pro- babilit6 :
P,, = C , , , ~ l ~ C , ~ . L
Ce tirage al6atoire a pour but de r6partir le trafic sur tous les centres de transit pour 6viter une concen- tration des trafics sur le faisceau le moins charg6. C'est un moyen de r6aliser du partage de charge lorsque la p6riode de reconfiguration est tr~s courte.
A cette notion de capacit6 r6siduelle, BNR a ajout6 le principe de protection de trafic. 11 s'agit de r6server une partie des ressources pour le trafic frais. Ainsi si un faisceau IJ est affect6 d 'un param6tre de r6ser- vation R~s, sa capacit6 r6siduelle devient :
G s = M s - - Sis - - Ris .
Un flux de d6bordement aura donc moins de chances d'&re achemin6 lorsque le faisceau IJ appro- che de la saturation.
Cette m6thode a 6t6 appliqu6e avec succ~s dans le r6seau urbain de Toronto en 1979 sous les noms advanced routing et adaptive routing. Cette exp6- rience en vraie grandeur limit6e ~ un r6seau de 9 nceuds est la seule exp6rimentation r6alis6e ~ ce jour darts le monde [11].
Un calculateur central connect6 aux neuf commu- tateurs recevait p6riodiquement (toutes les 16 s) l'6tat d'occupation des faisceaux sortant de chaque centre du r6seau et d6terminait la table de second choix pour chaque flux. L'algorithme implant6 est celui d6crit mais renforc6 par l 'adjonction d 'un filtre pr6dicteur du trafic offert. Ce r6sultat 6tait ensuite fourni /l chaque central qui mettait ~t jour ses tables de d6bordement, fig6es jusqu'h la recon- figuration suivante (16 s plus tard).
Bien que les r6sultats de l'exp6rience aient 6t6 tr6s positifs, BNR n 'a pas envisag6 une g6n6ralisation de cette gestion aux r6seaux urbains. Cependant l'id6e n 'a pas 6t6 abandonn6e et les 6tudes ont con- cern6 l'application au r6seau interurbain canadien. Pour celui-ci, l'6talement sur plusieurs zones horaires n6cessite de plus la d6termination de plusieurs matrices de trafic prenant en compte les heures charg6es dans les diff6rentes zones. Le dimensionnement du r6seau interurbain canadien consid6re les deux carac- t6ristiques suivantes [15] :
�9 prise en compte de plusieurs matrices nomi- nales de trafic statiques ;
�9 prise en compte d'un acheminement adaptatif 1i6 aux variations en temps r6el du trafic.
Les 6tudes ont montr6 que par rapport '~ l'ache- minement hi6rarchique actuel, HPR ne permet pas un gain substantiel en circuits. Par contre sa robus- tesse vis-/~-vis des perturbations graves est tr6s impor- tante et cet argument a justifi6 amplement son exis- tence aux yeux de BNR.
L'introduction de l 'acheminement adaptatif dans le r6seau interurbain canadien a donc 6t6 d6cid6e et cette m6thode de gestion de trafic doit ~tre mise en place h partir de d6but 1987.
11.3. L'acheminement adaptatif en France.
11.3.1. Objectifs de l'6tude.
Au milieu des ann6es 70, il est apparu souhai- table d'&udier en France les possibilit6s offertes par le r6seau de commutation associ6 /t de nouvelles m6thodes de gestion du trafic dans le but avou6 d'assurer une meilleure s6curisation au r6seau t616- phonique. A cet effet, en collaboration avec deux laboratoires de recherche de Toulouse, - - le labo- ratoire d'automatique et d'analyse des syst6mes du CNRS (LAAS-CNRS) et le d6partement d'&udes et recherches en automatique du CERT (DERA-CERT) - - , le CNET a engag6 des recherches sur de nouvelles m6thodes d'acheminement du trafic d6pendant de l'6tat de la demande et du r6seau, c'est-~-dire l'ache- minement adaptatif.
Ces recherches, de type prospectif, avaient pour objectif de d6velopper plusieurs m6thodes de mise en application de l 'acheminement adaptatif compte tenu de diff6rentes alternatives pour la gestion du r6seau [16]. Ces alternatives se rapportent aux pos- sibilit6s de mesures dans le r6seau et h leur fr6quence, aux diff6rents moyens d'acheminer les appels, aux moyens de v6hiculer les informations de gestion ainsi qu'aux capacit6s de calcul des organes de commande.
11.3.2. Caract6ristiques g6n6rales de 1'6tude.
Les r6seaux concern6s par l'6tude sont les r6seaux / t u n niveau de transit o/a les commutateurs sont reli6s par des faisceaux h un seul sens (Fig. 6). De plus on consid~re que les centres de transit sont affect6s h la fonction transit uniquement. Aucun trafic n 'a donc pour origine ou destination un centre de transit. De m~me seuls les centres de transit sont habilit6s /t faire transiter des appels. Cette r6gle est diff6rente de celle utilis6e dans les r6seaux am6- ricains o/a les n0euds des r6seaux DNHR et HPR ne sont pas sp6cialis6s mais sont utilis6s autant comme nceud origine et destination que comme n~eud de transit.
ANN. T~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987 6/23
P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RI~SEAUX TELEPHONIQUES 59
FIG. 6. - - R6seau it 1 niveau de transit.
One-level transit network.
Lorsqu'un faisceau direct existe entre deux commu- tateurs, il est syst6matiquement utilis6 en 1 er choix pour les appels concern6s. S i c e faisceau direct est bloqu6, alors les appels d6bordent sur le r6seau de transit. Par ailleurs on ne consid6re pas pour des raisons de simplicit6 les liaisons inter-transit et on limite la longueur d 'un chemin /l deux faisceaux successifs, c'est-~-dire qu'un seul transit est autoris6.
De fagon g6n6rale la politique d'acheminement que l 'on d6termine est une politique it deux choix, done un appel sera achemin6 selon un premier et 6ventuellement un seul d6bordement.
Evidemment le trafic offert au r6seau n'est pas connu directement mais estim6 si n6cessaire h partir des mesures effectu6es sur le r6seau. Finalement les hypotheses classiques sont prises pour la mod6- lisation du r6seau :
�9 les flux de trafic offerts au r6seau sont poisson- niens ;
�9 la dur6e de communication suit une loi expo- nentielle n6gative de moyenne 6gale pour tous les flux ;
�9 les temps d'6tablissement des appels sont n6glig6s ainsi que les temps de commutation.
I1.3.3. Param~tres de choix de la commande.
Les algorithmes d'acheminement d6velopp6s ont pour but de reconfigurer pour chaque flux de trafic les tables d'acheminement en fonction de l'6tat du r6seau et de la charge offerte au r6seau t616phonique. Les diff6rents param6tres qui nous ont guid6s pour l'61aboration de ces algorithmes sont les suivants :
�9 l'achemim,ment des appels entre deux reconfi- gurations
A l'heure actuelle, l 'acheminement des appels est bas6 sur la politique du d6bordement c'est-lt-dire qu'un appel arrivant dans un commutateur sera dirig6 premi6rement sur un faisceau d6termin6 (fais- ceau de premier choix). Si celui-ci est satur6, l'appel est dirig6 vers un faisceau de d6bordement fix6 (faisceau normal). Finalement si celui-ci est 6galement satur6, l'appel est alors rejet6 (Fig. 7).
I1 serait 6galement envisageable d'utiliser le multi- d6bordement comme dans le r6seau des USA o/~ l 'on d6crit une s6quence de d6bordement utilis6e
FIG. 7. - - Acheminement actuel.
Present call routing.
dans un ordre pr6d6termin6. Une politique de d6bordement adaptatif consiste
it r6actualiser la s6quenee de d6bordement qui est utilis6e entre deux reconfigurations et la notion de faisceau normal disparait (Fig. 8a).
L'acheminement adaptatif suppose une multi- plicit6 de chemins entre un centre origine et un centre destination, et une alternative ~ la politique de d6bor- dement qui a 6t6 consid6r6e est le partage de charge. Cela consiste ~t r6partir le trafie vers une destination donn6e sur plusieurs chemins sans notion d'ordre (premier ou second ehoix). Le principe est done de diriger une fraction ~1 du trafic sur un chemin, une fraction ~2 de ce trafic sur un second chemin et ainsi de suite jusqu'au dernier chemin possible (Fig. 8b).
Les proportions ~ sont d6termin6es par l'algo- rithme de mani6re /~ optimiser l'efficacit6 des appels [8].
FI~. 8a. - - Acheminement par d6bordelnent multiple.
Mtdtiple ovelflow policy.
FIG. 8b. - - Acheminement par partage de charge.
Load sharing policy.
7/23 ANN. TI~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987
60 1,. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RESEAUX TI~LI~PHONIQUES
/ Niveau de transit \
~ / / /
a
b
FJG. 9. - - Acheminement mixte.
Mixed call routing policy.
* mesures instantan6es : elles consistent en des blocages qui permettent d'ex6cuter un d6bordement ou de rejeter un appel, ou en des mesures d'6tat de faisceaux. Ces derni6res sont par exemple n6ces- saires pour d6terminer la capacit6 r6siduelle desdits faisceaux.
�9 la structure de commande de rr des acheminements
La structure de commande d6pend des mesures effectu6es, de leur niveau d'agr6gation et surtout des possibilit6s de transfert de l 'information dans le r6seau. L'algorithme d'acheminement adaptatif sera donc du type :
* d6centralis6 : dans cette structure chaque centre r6actualise localement ses tables d'acheminement en fonction d'informations locales et partielles sur l'6tat du r6seau (Fig. 10a);
Cette proc6dure d'acheminement n 'a jamais 6t6 mise en application dons un r6seau /~ ce jour mais pr6sente un int6r~t dons les situations de surcharge et de pannes. En effet la r6partition de trafic permet de prot6ger le flux lors de ces 6v6nements. Cependant telle quelle, cette politique n'autorise qu'un seul choix et a des performances moins bonnes que le d6bordement. II convient doric d'adjoindre ~ cette r6partition des premiers choix une politique de d6bordement. Celle-ci consiste ~ faire d6border les appels ayant 6t6 bloqu6s en premier choix soit sur un faisceau unique soit sur les autres chemins par une nouvelle r6partition (Fig. 9). Dons ce dernier cos, la strat6gie est la suivante :
* r6partir en premier choix le trafic sur les chemins avec une proportion 0c~;
* si le chemin i est satur6, les appels concern6s d6bordent sur les autres chemins et sont r6partis avec une probabilit6 ~.~, j :# i.
�9 les mesures effectudes sur le rdseau
Les mesures op6r6es sur le r6seau sont n6cessaires pour connaitre l'6tat du r6seau et la charge offerte, et peuvent ~tre du type :
* comptage : par exemple des comptages d'appels par flux qui permettent d'estimer la matrice de trafic offert ;
* valeurs moyennes : ce sont en pratique les mesures de trafic 6cou16 sur les faisceaux ou bien des mesures d'efficacit6 par flux ;
/ // / / ~ \ \
FIG. 10a. - - Structure d ' i n fo rma t ion d6centralis6e.
Decentralized information pattern.
FiG. 10b. - - Structure d ' i n fo rma t ion distribu6e.
Distributed information pattern.
F~G. 10c. - - Structure d ' i n fo rma t ion centralis6e.
Centralized information pattern.
ANN. T~L~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987 8/23
P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RESEAUX TI~LI~PHONIQUES 61
* distribu6 : les tables d'acheminement sont reconfigur6es aussi localement mais en fonction d'informations 6chang6es avec les centres adjacents (Fig. 10b) ;
* centralis6 : les informations sur l'6tat du r6seau sont centralis6es dans un coordinateur; celui-ci ayant la connaissance de tout le r6seau prend en compte les corr61ations et se charge de d&erminer globa- lement les meilleurs acheminements pour chaque flux. Cette information est rapatri6e vers tous les commutateurs qui modifient en corts6quence leurs tables d'acheminement (Fig. 10c).
�9 la fr~quence de r~actualisation des tables d'ache- minement
La r6actualisation des tables d'acheminement d6pend fortement du type de mesures effectu6es sur le r6seau ainsi que de leur fr6quence. Elle est fonction 6galement de la structure de commande choisie et de l'algorithme 6labor&
III. DESCRIPTION DES ALGORITHMES D'ACHEMINEMENT ADAPTATIF
llI.1. Notations.
Dans la description des diff6rents algorithmes, les notations suivantes sont utilis6es :
Nt./ : capacit6 du faisceau Q
Zt./ : taux d'arriv6e du flux offert poissonnien ij
"r : dur6e moyenne de communication distribu6e exponentiellement
At . /= )~t./v : 616ment de la matrice de trafic offert A
Xt./ : trafic 6cou16 sur le faisceau ij
Si./ : 6 t a t instantan6 du faisceau ij c'est-~.-dire nombre de circuits /t l '&at occup6 du fais- ceau ij
Ct./---- Nt . / - - Stj : capacit6 r6siduelle du faisceau (j
r~t./ : probabilit6 de blocage du faisceau
0q~./ : param&re de partage de charge c'est-h-dire pourcentage du flux de trafie ij qui est achemin6 via le centre de transit k.
111.2. Politiqne centralis6e de partage de charge.
Cette approche centralis6e est bas6e sur un fonc- tionnement quasi statique du r6seau. Cela suppose que le trafic offert est stationnaire pendant un inter- valle de temps assez long pour estimer les param6tres du syst6me. On peut alors imaginer une commande
deux niveaux :
�9 un niveau de coordination qui, h partir de l'estimation de la matrice de trafic offert, d&ermine
p6riodiquement (toutes les 15 min environ), les coefficients optimaux de partage de charge [2].
�9 Un niveau local oh ces param&res de partage sont appliqu6s en fonction des informations locales
chaque central. Ce sont surtout les informations de blocage sur les faisceaux sortants qui sont utilis6es.
Au niveau coordinateur, la m6thode consiste r6soudre un probl6me de multiflot non lin6aire.
Premi6rement, la matrice de trafic offert est estim6e, partir de comptage d'appels par flux, par une
m6thode de lissage exponentiel. Soit Wt./(n) le nombre d'appels du flux ij pendant un intervalle de temps AT, alors la matrice de trafic offert At./ pour l'inter- valle (n § I)AT peut ~tre estim6e selon l'algorithme r6cursif suivant [10] :
At.~ ~"+1~ = OAi./~") + (1 - - O){Wt . / (n) /AT-- Au(n)}. Pour cette estimation on consid~re des intervalles
de temps AT compris entre 1 et 3 rain. Ensuite les coefficients de partage de charge opti-
maux 0C*k./ /t appliquer durant la p6riode de r6ac- tualisation suivante sont solutions du probl~me d'optimisation :
J ----- min ~ (At . / - - X U ) , Ol, tk j l ~J
avec Cqk./---- 1, Vi, j et cqk./ ~ 0 .
k
Le crit6re J exprime que l 'on cherche b. minimiser les pertes dans le r6seau. Les trafics 6coul6s Xt./ sont solutions des syst6mes d'6quations dynamiques implicites suivants [17] :
S t k = - - . V t k l ' r + ~ ~tk./~'t./( 1 - - 7Ctk)(l - - 7~kj), J
Xk./= - - Xkj/~ + ~ ~/k./Z,./(l - - r:,~)(1 - - rckj), i
o~t -~'ik et Xkj sont d6termin6s selort les relations :
Xtk --- Ark(1 - - r q k ) et r~ik = E[Atk, Ntk],
Xg./ = A~./(1 - -~kj ) et 7Zk./ ---- E[Ak./, Nkj].
Dans cette expression Ark et Ak./ sont des trafics fictifs qui prennent en compte les corr61ations entre les flux de trafic sur les faisceaux. E[.,.] repr6sente la formule d'Erlang avec perte.
Le probl6me d6crit ci-dessus peut &re r6solu par des m6thodes de relaxation combin6es ~. des m6thodes de directions admissibles. On trouvera des d6tails du probl6me d'optimisation dans [8].
Dans la formulation du probl6me, il n 'a pas 6t6 tenu compte, pour des raisons de simplicit6, de coefficients de partage de charge pour le d6bordement. En fait ceux-ci peuvent 6tre 6galement d6termin6s dans l'algorithme d'optimisation mais il faut inclure leur effet dans la moddlisation du r6seau. On adjoint des param~tres ~,k./ avec l ~ k qui sont optimis6s simultan6ment avec les coefficients gtk./. Les r6sultats num6riques du probl~me ont montr6 que l 'optimum est tr6s plat. On peut done all6ger le probl~me de
9/23 ANN. TI~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987
62 P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATiF DANS LES RI~SEAUX TI~LI~PHONIQUES
minimisation en d6terminant uniquement les para- mStres ~, les coefficients ~ 6tant alors calcul6s de mani6re heuristique. Une bonne approximation des param6tres ~3 est la suivante :
~,kj = ~,,j/(1 - - ~ ) avec 1 :~ k.
III.3. Une approche d~centralis~e : les automates apprentissage.
L'application de la th6orie des automates h appren- tissage ~t la commande des r6seaux t616phoniques n'est pas r6cente et a 6t6 motiv6e par le peu d'infor- mations qu'elle n6cessite pour sa mise en application [4]. Les automates h apprentissage sont des organes de prise de d6cision dont le principe est tr~s simple : la d6cision (le choix d 'un chemin) sera motiv6e par la r6ponse de l'environnement ~t ses prises de d6cision ant6rieures (qui se traduit par l'aboutissement ou le rejet de l'appel). En r6sum6, plus une d6cision a 6t6 bonne plus on la renouvellera et plus un choix s'est r6v616 mauvais moins on le r6pStera.
La d6cision r6sulte doric en un partage de charge r6alis6 en chaque n~eud origine de trafic, le partage 6tant mis ~ jour h chaque appel en fonction des performances des prises de d6cision (c'est4t-dire l'appel a abouti ou l'appel a 6t6 rejet6). Le dispo- sitif de l 'automate h apprentissage qui va affecter les probabilit6s de choix d'une d6cision est le sch6ma de renforcement qui est de la forme g6n6rale :
~(n + 1) = T[P(n), ~(n), x(n)],
oh Tes t un op6rateur, ~(n) et x(n) sont respectivement l'action choisie et l'6tat du r6seau ~t l'6tape n, et P(n) repr6sente le vecteur des probabilit6s d'actions qui commandent le choix d 'un chemin au temps n.
Bien que l'oparateur T puisse ~tre quelconque, seuls les automates lin6aires, plus simples, ont 6t6 6tudi6s pour la gestion des appels t616phoniques. Les deux principaux sch6mas analys6s sont :
�9 L'automate LRp (c'est-~t-dire lin6raire, de type r~compense-p6nalit6) met h jour ses probabilit6s d'actions h chaque appel scion la m6thode du b~ton et de la carotte. Si une d6cision s'est rav616e bonne, on a tendance h la rait6rer ; sinon cela signifie que le chemin choisi n'est pas stir et on l'empruntera d'autant moins.
�9 L'automate LR~ (lin6aire de type r6compense- inaction) ne consid6re que les d6cisions agr6ables (aboutissement de l'appel). I1 aura tendance b. favo- riser le renouvellement de ces d6cisions. 11 a 6t6 montr6 que cet automate converge vers la solution 7q = ~zj oh rq repr~sente la probabilit6 de blocage associ6e ~t l'action ~q(n) [19]. Par ailleurs dans le cas oh la probabilit6 de blocage =~ est une fonction lin6aire de la probabilit~ d'action P~, alors l'auto- mate LR~ est optimal dans le sens oh il minimise globablement les pertes dans le r6seau.
Etant donn6 ces qualit6s nous nous int6resserons /t cette derni6re cat6gorie d'automates. De plus, l 'automate traditionnel n'offre en fait qu'un seul choix et sa d6termination a 6t6 am61ior6e pour prendre en compte la possibilit6 de d6bordement lorsque le faisceau sortant du centre origine et choisi en premier choix se r6v61e satur& On obtient alors un automate ~t deux actions qui est d6crit comme suit :
A l'6tape n, l'action i est choisie selon la proba- bilit6 P~(n) :
- - si l'action i est positive, c'est-5.-dire si l'appel a abouti, alors les probabilit6s d'actions pour l'6tape n + 1 sont r6actualis6es selon :
P,(n + 1) = P,(n) + a(1 - - P,(n)),
Pj(n + 1) = Pj(n) - - aPj(n), j :/: i.
- - si l'action i est n6gative par suite du blocage du faisceau sortant, l'appel d6borde sur un faisceau d6termin6 selon la probabilit6 Pj(n), j :/: i.
- - si l'action j choisie en d~bordement est posi- tive alors on met ~t jour les probabilit6s d'actions suivant le sch6ma :
Pj(n -~- 1) = Pj(n) + a(l - -Pj(n)) ,
Pk(n + 1) = Pk(n) - - aPk(n) k @ j.
- - si l 'act ionj est n6gative, les probabilit6s d'action ne sont pas r6actualis6es.
Des am61iorations peuvent 8tre encore apport6es pour cet automate de base :
�9 PremiSrement, l'6volution des probabilit6s repose sur le param6tre de renforcement a. Celui-ci peut 8tre adapt6 en ligne en fonction de l'importance de chaque flux de trafic.
�9 DeuxiSmement, il est 6vident que pour un grand r6seau oh le hombre de chemins devient gigantesque, une politique de gestion appel par appel devient irr6aliste, m~me si elle requiert peu d'informations et si elle d6termine l'acheminement selon un sch6ma trSs simple tel que l 'automate d6crit. Dans cette optique, des sch6mas de renforcement p6riodiques ont 6t6 d6velopp6s pour l 'automate LRI . 11 ne s'agit plus de r6actualiser les probabilit6s d'actions ~t chaque appel, mais soit ~t p6riode fixe soit en fonction de l'intensit6 de trafic ; c'est-h-dire que les perfor- mances de l 'automate sont 6valu6es soit toutes les 2 h 3 min environ, soit tous les N appels (N ~ 10). Cela repr6sente en fair une adaptation du sch6ma de renforcement scion un fonctionnement moyen de l'automate.
III.4. Algorithmes distribu6s.
Contrairement aux deux approches pr6c6demment d6crites qui 6taient bas6es sur une politique de par- tage de charge, nous nous int6ressons darts ce para-
ANN. TI~L~COMMUN., 42, n ~ I-2, 1987 10/23
P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RESEAUX TI~LI~PHONIQUES 63
graphe au d~bordement simple adaptatif. 11 s'agit de r6actualiser p6riodiquement pour chaque flux, le chemin de d6bordement utilis6 lorsque le faisceau de premier choix est satur6. La reconfiguratiort des tables de d6bordement cst op6r6e localement en fonction d'informations sur l'~tat du r&eau fournies par chaque centre adjacent. Airtsi le choix du chemin de d6bordement est-il r6alis6 en tenant compte de l'encombrement de chaque chemin pour minimiser le nombre d'appels perdus entre deux reconfigurations.
La disponibilit~ des cbemins peut 8tre ~valu6e selon plusieurs crit6res :
�9 un crit6re d6terministe bas6 sur des informations instantan6es, ce qui signifie une p6riode de recon- figuration relativement courte;
�9 un crit~re probabiliste bas~ sur le fonctionnement du r6seau suppos6 el1 6tat stationnaire, induisant donc une r6actualisation des tables d'acheminement plus lente.
IH.4.1. Une approche d~terministe : la capacit6 r~siduelle.
Cette approche utilise Ie m~me concept que les BNR pour leur m6thode d'acheminement adaptatif [10]. Cependant la structure de commande envisag6e est diff6rente. Dans leur approche les canadiens ont initialement pr6vu une estimation du trafic offert pour affiner le calcul des capacit6s r~siduelles ; pour cette raison la n6cessit6 d 'un calculateur central est justifide. En fait nous n'avorts pas inclus l'estimation de trafic pour la d&ermination des capacit6s r6si- duelles. Celles-ci sont calcul6es sans tenir compte des interactions entre les diff6rertts flux et les diff6- rentes affectations de trafic. Puisque les operations sont alors d6corr616es pour chaque flux, un calcu- lateur central n'est plus n6cessaire et nous proposons une mise en oeuvre de cette politique selon une struc- ture de commande distribu6e.
Ainsi chaque centre de transit transmet l'infor- mation de capacit6 r6siduelle de ses faisceaux sor- tants b. chaque centre origine.
Rappelons bri~vement le concept de capacit6 r6si- duelle ; pour un faisceau U, elle est d6finie comme le nombre de circuits libres :
Cu = Nu - - Su,
oh S u repr6sente le nombre de circuits occup6s /~ l'instant de mesure.
Cet indice indique que ee faisceau peut encore aeheminer C u appels. Pour un chemin ikj, l'extension de cet indice est le suivant :
C~kj = min (Cik, C~j).
Le chemin de second choix choisi est celui de plus grande capacit6 r6siduelle, c'est-~-dire viser le centre de transit k*(i, j ) tel que :
k*(i, j ) = arg [max(C~)]. k
Evidemment ce critare de choix ne prend en compte ni l'importance du trafic offert aux faisceaux, ni
les corr61ations qui existent par le biais des affec- tations des d6bordements ; pour le premier point une solution possible est de normaliser le crit~re de capacit6 r6siduelle par le trafic offert sur chaque faisceau (c'est-~-dire C,k/Z~k), mats il est alors n~ces- saire d'estimer [e trafic offert & chaquc faisceau. Pour le second point 6galement, une estimation des trafics serait n6cessaire ; ainsi l'affectation du d6bor- dement pour le flux ij serait r6alis6e en fonctiort des affectations d6j& op6r6es au noeud i pour d'autres flux.
L'estimation de trafic nous ram~ne au caract~re probabiliste du probl~me, et dans cette optique d'autres crit~res ont 6t6 propos6s.
IIL4.2. Une approche stochastique : probabilit6 du temps de d(~bordement.
Le crit~re utilise une mod~lisation dynamique du trafic et fournit airtsi une irtformation sur l'6volution du r6seau entre deux p6riodes de reconfiguration. Cet indice est la probabilit6 qu'aucurt appel de premier choix ne d6borde entre les deux r6actuali- satiorts des tables de d6bordement. II s'agit dortc de d6terminer la probabilit6 ~(to ~> T) oh to est le temps o~ le premier appel d6borde du faisceau cortsid6r6 et Tes t la p6riode de reconfiguration [20].
Plus la probabilit6 est grande, plus les pertes seront done faibles. Les calculs sont d6velopp6s ~ partir d 'un module de chaine de Markov qui comporte un 6tat putts (repr6sentant le ph6rtom+ne de d6bor- dement). Le diagramme de trartsitiort du syst6me consid6r6 est donn6 par la figure 11.
) dt ;' dt ;' dt ?,dt
1 - ?dr 1 dt N dt 7
FIG. 11. -- Diagramme de transition des 6tats.
State transition diagram.
Pour ce module, le syst6me d'6quations dynamiques est le suivant :
1 Xo = - - ~Tto Jr- - lx~ ,
"17
"7
77N = XT~N- 1 - - X Jr- 7~ N ,
7I:N+ 1 = XT~N,
o/i ni est la probabilit6 d'avoir St circuits enga#s dans le faisceau.
La probabilit6 que nous consid~rons est la suivante :
7Z(to < T) ----- rcN+a(T ).
11/23 ANN. TI~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987
64 P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RI~SEAUX TI~LI~PHONIQUES
La solution du syst6me d'6quations difl'~rentielles peut ~tre obtenue ais6ment par des m6thodes appro- ch6es. En supposant l'ind6pendance des faisceaux en tandem, la probabilit6 de non-d6bordement pour un chemin ikj entre deux reconfigurations s'dcrit :
rc,kj(to ~ T) : 7~ik(t 0 ~ T)nkj(to ~ T).
La d6termination de la solution fait directement intervenir le trafic offert aux faisceaux et son esti- mation est n6cessaire. Notons que dans ce cas, le trafic n'est pas poissonnien car il fait intervenir les flux de d6bordement. Comme nous l'avons d6jh mentionn6, l'affectation des d6bordements pour chaque flux est r6alis6e en chaque nceud, en tenant compte des affectations d6jh faites.
Par exemple, si au noeud i, les affectations des chemins de d6bordement pour les destinations j~ , J2 . . . . . j , ont 6t6 ex6cut6es, le flux ij consid6r6 pour l'affectation suivante sera tel que le chemin ik*j est de disponibilit6 maximale, donc :
(k*, j ) ---- arg[ min {max(z:,kj)}]. J~Jt ,J2, . . ,Jn k
Dans le m~me esprit, il est possible de consid6rer des p6riodes de reconfigurations encore plus lon- gues et un crit6re de s61ection pourrait ~tre le temps moyen avant d6bordement [3].
Dans ce paragraphe, quelques m6thodes ont 6t6 bri6vement d6crites dans le but d'introduire les concepts math6matiques qui ont 6t6 d6velopp6s pour la d6termination d'algorithmes d'acheminement adap- tatif. La suite de l'article est consacr6e h l'6valuation des diff6rentes approches qui ont 6t6 pr6sent6es.
IV. D E S C R I P T I O N D U RI~SEAU-TEST ET D E S C O N D I T I O N S
D E F O N C T I O N N E M E N T
conditions, la taille du r6seau choisi est forc6ment limit6e et le r6seau-test finalement consid6r6 comporte 8 nceuds sources de trafic et 3 noeuds de transit.
IV.1. Description du r~seau-test.
Le r6seau-test a 6t6 d6fini en fonction de doan6es r6elles qui ont 6t6 fournies par la direction des t61~- communications de l'Ile-de-France (oa'w - service r6seau). Les centres s61ectionn6s sont des centres 61ectroniques de la zone urbaine du r6seau d'Ile- de-France.
Le sous-r6seau ainsi d6fini comporte :
�9 8 centres origine-destination not6s S ;
�9 3 centres de transit temporels not6s T.
Le dimensionnement de ce r6seau a 6t6 r6alis6 en fonction de la matrice nominale de trafic point 5. point projet6e pour 1985 (Tabl. II). Le trafic total du r6seau est de 407,5 erlangs.
TABL. IL - - Matrice de trafic nominal. Nominal traffic matrix.
destination
Sx S ~ ] &
$1 -- 1,85 2,91
$2 2,00 -- 5,42
Sz 2,28 6 , 9 5 . - �9
$4 2,90 9,46 4,96
$5 2,12 21,481 4,36
$6 3,41 5,25 9,88
S 1 29,27 2,19 3,82
$8 4,05 5,00 5,86
&
6,46
4,54
6,45
-- 7,53
& & & I S 7
1,99 2,69 5,24 25,52
7,42 24,74 6,91 2,25
5,7o 5,21 11,72 3,o8
13,23 8,81 4,00
- - 6,55 2,00
5,35 -- 3,97
2,30 6,12 --
6,04 27,13 4,28
9,86
5,82
4,61
- - 19,13
3,93 4,71
6,76
Le but des recherches sur l'acheminement adap- tatif ne concernait pas seulement l'aspect descriptif des m6thodes mais 6galement une 6valuation des diff6rentes propositions. Evidemment, il n'est pas possible d'envisager une application des m6thodes sur un site r6el en raison des risques de perturbations du r6seau qui existent mais 6galement en raison des limitations techniques du r6seau actuel. Pour cette raison, l'6valuation des algorithmes a 6t6 effectu6e en simulation. Dans le souci de se rapprocher du fonctionnement le plus r6aliste possible, un rfseau- test, image d 'un r6seau r6el, s'est r6v616 n6cessaire e t a 6t6 d6velopp~ [20]. Comme il s'agit de gestion en temps r~el, seule une simulation ~v6nement par 6v~nement est utilisable pour l'~valuation des per- formances de chaque m6thode. Ce type de simulateur, tr~s lourd, n6cessite une taille m6moire importante et conduit h des temps de calcul, rapidement pro- hibitifs d~s que la taille du r6seau croit. Dans ces
Pour disposer d'un r6seau de r6f6rence, un r6seau a 6t6 programm6 avec les r~gles actuelles de dimen- sionnement pour une politique d'acheminement hi6rarchique fixe :
�9 les faisceaux directs sont cr66s lorsque le seuil de trafic de 5 erlangs est d6pass6.
�9 Chaque centre origine n'est li6 au niveau de transit que par son sup6rieur hi6rarchique.
Le r6seau de r6f6rence ainsi construit comporte 61 faisceaux dont 31 sont directs repr6sentant 866 cir- cuits (456 directs et 410 vers/du transit). La capacit6 des diff6rents faisceaux est donrt6e darts le tableau III.
Un tel r6seau n'est pas adapt6 h une gestion adap- tative des appels t616phoniques. En effet, il n'existe pas plusieurs chemins permettant de r6partir les flux de trafic. Pour cette raison, il est n6cessaire de redimensionner le r~seau en imposant une con-
ANN. T~L~COMMUN., 42, n ~ 1-2. 1987 12/23
P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RI~SEAUX TI~LEPHONIQUES 65
trainte suppl6mentaire : chaque noeud origine est connect6 /t chaque centre de transit pour avoir une multiplicit6 des chemins permettant une possibilit6 de choix pour l'affectation des acheminements. Evidemment les faisceaux directs ne sont pas tr6s affect6s par cette contrainte et le r6seau avec ache- minement adaptatif comporte toujours 31 faisceaux directs repr6sentant 424 circuits.
En fait le dimensionnement des faisceaux entre les commutateurs d'abonn6s et les centres de transit doit 8tre effectu6 en tenant compte de la politique locale d'acheminement (partage de charge ou d6bor-
dement). Ainsi deux options tr6s diff6rentes ont 6t6 choisies pour effectuer le dimensionnement du r6seau avec acheminement adaptatif :
�9 une option 6galitaire, compatible avec une politique de partage de charge. A priori une r6par- tition 6gale des flux de premier choix et de d6bor- dement sur les faisceaux est optimale et entraiue des tailles de faisceaux vers les centres de transit de mSme ordre. A partir d'une solution simple, une m&hode d'optimisation heuristique a conduit au r6seau suivant (Tabl. IV) :
TABL. I I I . - - Taille des faisceaux du r6seau hi&archique.
Trunk group size of the hierarchical network.
a
b 0
n n
e
s
&
abonn6s
destination
s~ s~ & s, & s~ s7
10 31
/'3
$2 - - 7 9 30 9 ~ - -
S3 - - 9 9 7 18 - - - -
- - 1 2 - - 16 16 - - 24
26 12 - - 9
7 15 12 7
&
&
s~
18
3 6 9 - - - -
$8 ~ 7 10 14 8 39 - - 18
T1 5 10 14 13 11 4 6
13 8 12 8 7 7 14
transit
10 21 - -
- - - - 23
10 - - 16
13 - - - -
- - - - 27
29 - -
- - 2 9 - -
11 - - - -
17 ~
4 - - - -
transit T2
T3 18 8 13 9 21
TABL. IV. - - Taille des faisceaux du r6seau avec partage de charge.
Trunk group size of the network with load sharing.
t r a n s i t
$1
S,
&
S,
S5
S.
S?
&
r~
T~
/'3
S l
36
12
12
12
Is2 I
u
9
12
26
7
7
7
destination
s~
7
15
10
13
12
12
abonn6s
[ & &
9 30
9 7
- - 16
12
12 7
1 0 8
8 9
8 8
8 8
[
8
9
18
12
9
9
30
5
7
6
$ 7 S s
31 9
- - 10
- - 11
- - 22
13 12
13 11
13 13
/'1
8
7
6
8
8
6
12
7
transit
T~
7
8
6
8
10
7
9
7
r3
6
6
5
10
9
8
9
8
13/23 ANN. T~LI~COMMUN.) 42, n ~ I-2, 1987
66 P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RI~SEAUX TI~LI~PHONIQUES
TABL. V. - - Taille des faisceaux du r&eau avec d6bordement adaptatif.
Trunk group size of the network with adaptive overflow.
o
r
i g i n
e
a
b O
n n
e
s
$1 &
&
&
S5
Se
$7
destination
abonn6s transit
& & S~ & &
7 9 30
9 9 7
12 16
26 12
36
7 15 12 7
& S7 & T1 T~ /'3
8 31 9 15 4 4
9 - - - - 5 15 5
18
12
10 4 10 4
11 4 4 20
9 - - 5 20 4
22 5 6 13
9 23 4 - - - - 4
Ss - - 7 10 10 8 30 6 5 15
T 1 5 10 13 12 12 6 5 10 - - - -
transit T~ 12 5 9 5 6 6 13 16
17 5 10 5 6 6 18 6
�9 une option d6s6quilibr6e ~t l ' instar du r6seau hi~rarchique et qui est compatible avec une politique de d6bordement. Dans cette option, t o u s l e s flux de traflc offert non achemin6s sur des faisceaux directs sont dirig6s en chaque noeud origine, sur le m~me faisceau montant vers le niveau de transit. I1 en r6sulte qu 'un de ces trois faisceaux sera de taille nettement sup6rieure aux deux autres. Bien stir, il est possible de r6partir les flux de premier choix sur les trois faisceaux montants mais nous voulions tester les performances des algorithmes sur des r&eaux bien adapt& h chacune des politiques d'acheminement. L 'opt ion choisie a abouti au r6seau suivant (Tabl. V) :
Pour ces deux r6seaux la taille des faisceaux directs est identique et seule la r6partition des circuits vers/ du niveau de transit est diff6rente. Les deux r6seaux avec acheminement adaptatif comportent 846 circuits soit 20 circuits de moins que celui avec acheminement fixe, soit environ 2 ~ de la capacit6 totale.
I V . 2 . D e s c r i p t i o n d e s e x p e r i m e n t a t i o n s .
L'int6r& de la gestion adaptative des appels r&ide dans la possibilit6 de r6action imm6diate face /l des 6v6nements perturbateurs tels que pannes de mat6riels ou surcharges de trafic. En fait oll souhaite que de tels 6v6nements soient sans cons6quences sur la qualit6 d'6coulement du trafic, ou au moins de limiter les << dSgats >>. Nous nous sommes done int6ress& /t l '6valuation de performances du r6seau dans des conditions anormales de fonctionnement, permettant de juger la robustesse du r&eau par une
gestion en temps r6el. Les perturbations caract6ris- tiques qui ont 6t6 prises en compte sont des d6s6qui- librcs de trafic, des surcharges locales de trafic vers une destination et des pannes d'art6res et de nceud de transit. Le d6tail de ces perturbations est d6crit ci-apr& :
IV.2.1. D~s&luilibre de traflc (PI).
Le r&eau t616phonique est dimensionn6 pour une matrice nominale de trafic hypoth6tique qui tient compte des variations al6atoires du trafic par le surdimensionnement des faisceaux hi6rarchiques; mais elle ne prend actuellement en compte ni les variations journali6res ni les variations saisonni6res de trafic qui conduisent h des matrices de trafic significativement diff6rentes de la matrice nominale. Comment r6agit le r6seau en face d 'une matrice de trafic pour laquelle il n ' a pas 6t6 dimensionn6 ? Nous avons donc d&ermin6 une nouvelle matrice de trafic <t chamboul6e >> off la masse totale de trafic reste la m~me (407 erlangs), mais off les flux de trafic offert sont fortement perturb&. Cette nouvelle matrice de trafic est repr6sent& dans le tableau VI.
IV.2.2. Surcharges de trafic (Pe et P3).
Dans le cas de surcharge globale du r&eau, il sera difficile d'6couler le trafic avec la mdme qualit& Un algorithme d'acheminement adaptatif ne r&oudra pas le probl6me, &ant donn6 que tous les chemins sont surcharg& ; en fait les performances risquent de se d6grader et la seule solution pour 6viter l 'effon- drement du r6seau consiste h rejeter les appeis l 'origine.
ANN. T~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987 14/23
P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RESEAUX TI~LI~PHONIQUES 67
TABL. VI. ~ Matrice de trafic perturbd.
Distorted traffic matrix.
destination
O
r
i g i n
e
41 & --
s~ 1,o
s3 4,o!
& 1,o
$5 4,0
S, 1,0
$7 33,0
s~ 1,o
0,5 6,0
- - 2,0
3,0 - -
15,0 2,0
15,0 10,0
10,0 6,0
1,0 8,0
8,0 4,0
&
0,5
12,0
2,0
5,0
10,0
1,0
12,0
& &
6,0 2,0
20,0 12,0
10,0 8,0
10,0 13,0
- - 3,0
2,0. - - .
8,0 0,5
4,0 35,0
32,0 1,0
0,5 7,0
6,0 3,0
1,0 12,0
4,0 1,0
1,5 25,0
- - 1,0
2 , 0 - -
On s'est donc int6ress6 ~ des surcharges localis6es vers une destination : tousles flux vers le centre S~ sont uniform6ment augment6s sans que les autres flux ne soient modifi6s. Cette surcharge est tr6s perturbatrice parce que d'une part la masse totale de trafic croit donc les performances seront moins bonnes, et que d'autre part, tous les faisceaux vers le niveau de transit vont supporter la surcharge.
Les performances du r6seau d6croissent tr6s vite avec le niveau de surcharge et nous avons consid6r6 deux surcharges : l 'une de 20 % (P2) et l'autre de 50 % (P3).
Par ailleurs pour prendre en compte l'effet 6vo- lutif de l'apparition et de la disparition de la surcharge, ainsi que du ph6nom6ne transitoire du fonctionne- ment, le trafic pour cette perturbation est g6n6r6 selon le profil repr6sent6 sur la figure 12.
Trafic
surcharge i~y ert
noamleUrle I~ / ~ /
Temps min 0 1~5 75 105 165
FIG. 12. - - Variations de trafic vers St .
Traffic variations towards $1.
lement du trafic. Les actions manuelles de reroutage demandent des d61ais et il est int6ressant d'6valuer le comportement d 'un acheminement adaptatif en face de ces pannes. Nous avons donc consid6r6 plusieurs types de ruptures d'art&es, en tenant compte d'une s6eurisation par bi-routage des fais- ceaux ; ainsi dans tous les cas, seule la moiti6 des faisceaux est hors-service :
* ruptures simples : nous avons consid6r6 la rupture de gros faisceaux :
- - l e faisceau direct Sa- $6 (P4),
- - l e faisceau montant vers le niveau de transit $7- Tt (es),
- - l e faisceau descendant du niveau de transit 7"3" S7 (P6),
* ruptures d6corr616es : c'est le cas de deux rup- tures simples simultan6es ; elles concernent les faisceaux $4- T3 et TI - $5 (e7),
* rupture multiple : en fait une panne d'art~res affecte plusieurs faisceaux qui supportent les m~mes flux de trafic offert ; la rupture des deux faisceaux Sa- $6 et Ss- 7'3 (P8) a donc 6t6 g6n6r6e.
IV.2.4. Panne d'6quipements terminaux (Pg.Plo).
Des pannes d'~quipements terminaux de centres de transit ont 6t6 consid6r6es qui affectent la moiti6 du trafic d~part ou arriv6e du n0eud. Les deux pertur- bations concernent le centre de transit T2 :
* panne d'6quipements terminaux arri%e (P9)
* panne d'6quipements terminaux d6part (Plo).
IV.2.5. Panne de centre de transit (Plx).
Une panne de centre est relativement rare et des dispositions sont prises pour r6agir le plus rapidement possible ~t un tel 6v6nement. La s6curisation du r6seau doit n6anmoins consid6rer ces pannes peu probables mais tr6s perturbatrices. Nous avons donc analys6 les cons6quences de cette panne s6v&e sur les per- formances du r6seau avec acheminement adaptatif. Le centre de transit T2 a 6t6 mis hors-service (Pll).
V. I~VALUATION DE PERFORMANCES DES ALGORITHMES
D'ACHEMINEMENT ADAPTATIF
IV.2.3. Rupture d'art~res (PcPs"PcPT"Ps).
La s~curisation du r6seau vis-&-vis des pannes de transmission est assur6e g6n6ralement par le biais du multi-routage des faisceaux et par la mise en place d 'un r6seau de r6serve. L'acheminement adaptatif n 'a donc pas de vocation & rem6dier /t ees perturbations. Cependant, un r6seau de r6serve ne s6curise pas enti6rement un r6seau et des actions sont n6cessaires pour sauvegarder la qualit6 d'6cou-
V.1. Conditions de simulation.
Les r6sultats d'6valuation des m6thodes ont 6t6 obtenus & l'aide de logiciels de simulation 6%nement par 6v6nement d6velopp6s dans les trois centres de recherche impliqu6s darts le projet.
Les diff6rentes configurations de fonctionnement ont 6t6 simul6es pendant 10 h pour les surcharges de trafic et de 5 h darts les autres cas.
15/23 ANN. TI~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987
68 1,. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RI~SEAUX TELI~PHONIQUES
Les r6sultats obtenus avec le r6seau dimensionn6 avec les r6gles de gestion actuelles sont donn6es comme valeur de r6f6rence pour juger les perfor- mances des m6thodes. On indique 6galement pour chaque cas le gain (ou 6ventuellement la perte) en pourcentage par rapport & la m6thode actuelle.
V.2. Algorithme de r~f~rence.
Tousles algorithmes n 'ont pas 6t6 6valu6s, 6tant donn6 le nombre d'exp6rimentations pr6vu. Par ailleurs, pour certains algorithmes, seules quelques perturbations types ont 6t6 simul6es. N6anmoins, nous avons analys6 certaines m6thodes en d6tails.
Ces algorithmes de r6f6rence sont :
# Partage de charge centralisd : le coordinateur optimise toutes les 15 min les param6tres de partage de charge de premier choix, en fonction de l'esti- mation de trafic offert & partir de comptage d'appels. Les coefficients de partage de choix de d6bordement sont calcul6s selon la formule heuristique donn6e lors de la description de la m6thode. I1 n 'y a pas d'adaptation de ces param6tres entre deux recon- figurations en fonction d'informations de blocage avec lesquelles le r6seau a 6t6 dimensionn6.
�9 Capacitd rdsiduelle : c'est l'algorithme distribu6 d6crit pr6c6demment avec une p6riode de recon- figuration de 60 s sans tenir compte des informations ap6riodiques de blocage des faisceaux descendants utilis6es pour dimensionner le r6seau.
Comme les aigorithmes de r6f6rence n'utilisent pas les informations ap6riodiques de blocage, leurs performances ne sont donc pas optimales. Elles sont 6valu6es & titre indicatif uniquement pour montrer l'importance de telles informations. Par ailleurs ces deux m6thodes de r6f6rence sont les plus simples & mettre en oeuvre.
Les performances des deux m6thodes de r6f6rence sont donn6es par les figures 13a et 13b.
Premi6rement on constate que, bien que le dimen- sionnement soit effectu6 sur la base d'informations en temps r6el sur les blocages de faisceau, les deux m6thodes de r6f6rence satisfont la contrainte de perte globale inf6rieure & 1 % . En fait le r6seau & acheminement fixe fournit de tr6s faibles pertes (0,5 %) alors que la contrainte & respecter est 1 % . Cela laisse & ce r6seau des capacit6s pour absorber les surcharges (20 %). Par contre, pour l'acheminement centralis6 les performances requises sont juste satis- faites (0 ,91%) et la surcharge de 20 % n'est pas support6e. Ce ph6nom6ne est 6galement reproduit pour l'algorithme de capacit6 r6siduelle, mais darts des proportions moindres. Pour la surcharge de 50 %, les performances des 3 r6seaux commencent & s'effon- drer et on perqoit que les pertes ont tendance s'6galiser.
Rappelons toutefois que les deux r6seaux avec
12
10
0:
Penes (%)
�9 Achem E3Cornm~ rqCapaci
P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Perturbations
P8 P9 P10 Pl l
Fie. 13a. -- Performances des m6thodes de r6f6rence.
Performances of reference methods.
80TGain
Ik 2
- 2 0 f ~ [ J n - L-I ii Commande centra,ise e -40
-60 - 80 -~ [] Capacite residuelFe
/ - 1 0 0 ~
b
Fie. 13b. - - B6n6fice des algorithmes adaptatifs de r6f6rence.
Benefit with adaptive reference methods.
acheminement adaptatif comportent 20 circuits de moins que le r6seau d'origine. Pour cette raison, on ne peut pas conclure que l'acheminement hi6- rarchique permet de mieux absorber les surcharges, bien au contraire.
Darts le cas de d6s6quilibre de trafic P1, on remarque que les performances sont fortement d6grad6es et que l'algorithme distribu6 se comporte bien mieux que l'acheminement fixe.
Deuxi6mement, les algorithmes adaptatifs am6- liorent nettement les performances du r6seau en cas de panne de structure par rapport ~t l'acheminement fixe. Cela est dO d'une part au fait qu'une panne affecte plus de circuits sur le r6seau hi6rarchique que sur les deux autres r6seaux, et d'autre part aux possibilit6s de r6allocation des trafics pour les m6thodes en temps r6el. On peut n6anmoins noter des diff6- rences sensibles entre ces deux algorithmes :
Le r6seau avec partage de charge est dimensionn6 en tenant compte de l'information en temps r6el de blocage des faisceaux montant vers le niveau de transit. Le blocage au d6part sera moindre /l
ANN. TI~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987 16/23
P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES Ri~SEAUX TI~LI~PHONIQUES 69
cause de la politique locale qui 6vitera d'emprunter les faisceaux satur6s et le blocage est plus important sur les faisceaux descendants.
Le r6seau avec d6bordement adaptatif tient compte de l 'information de saturation des faisceaux descen- dants du niveau de transit vers les noeuds de destina- tion. Par suite le blocage intervient surtout au d6part.
Pour ces raisons, le r6seau avec partage de charge comporte moins de circuits vers le niveau de transit que le r6seau avec d6bordement adaptatif (et donc plus de circuits descendant du niveau de transit).
Dans le cas de rupture d'art6res et de la panne P~o, l'aigorithme de capacit6 r6siduelle n'utilise pas l'infor- mation de saturation des faisceaux descendants; comme, en plus, il n 'y a pas de connaissance de la panne, la capacit6 r~siduelle est calcul6e avec pour capacit6 du faisceau kj Nk~ alors qu'elle est en fait N~J2. Le calcul des capacit6s r6siduelles est donc erron6 et conduit b. de mauvaises affectations des d6bordements. Comme ces faisceaux descendants sont de plus de petite taille, les pertes sont d 'autant plus importantes. Les performances sont donc moins bonnes qu'avec l'acheminement fixe.
V.3. Heuristiques pour le partage de charge.
Le partage de charge est r6alis6 apr6s r6solution d 'un probl6me d'optimisation non lin6aire qui peut se r6v61er lourd dans le cas d'un grand r6seau. Puisque l 'optimum est relativement plat autour d'une grande plage de coefficients de partage de charge, la recherche d'heuristiques ais6es & mettre en oeuvre a 6t6 effectu6e e t a abouti tt deux solutions :
�9 la premi6re heuristique ne tient compte que du nombre de circuits en service et le caract6re dyna- mique ou adaptatif de la commande intervient uni- quement en fonction des perturbations structurelles. Les param6tres de partage de charge sont simplement d6termin~s par :
min(Nik, Nkj)
~ik~ = ~ min(Ntk,, Nk,j)" k '
Cette solution est d6not6e ~(N).
�9 Une deuxi~me heuristique prenant 6galement en compte l'estimation du trafic offert a 6t6 propos6e e t e s t not6e ~(N, ;~). Elle consiste h pond6rer la capacit6 des faisceaux par rapport au trafic offert. Elle requiert, en plus de la connaissance des capacit6s en service la d6termination des flux de trafic par le biais d'une 6tape d'estimation. Les coefficients de partage de charge sont calcul6s ~t partir de la relation :
min[N~ (2~ ;q~.)-~, N~j (~ Xu) -~] j i
~ = Y~ min[N~v (~ ;~u)- l, Nv~ (2~ ~.u)- ~]"
L'ana[yse des r6sultats (Fig. 14a et 14b) con- firme la robustesse de la politique de partage de
4,0"
3,5 3,0. 2,5- 2,0: 1,5: 1,o: 0,5-
0,0
Pertes (%)
P0
~ C::::~dd: :~tN)ale ~
17 Commande •(N,Z) ~ H
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PlO Pll Perturbations
a
FIG. 14a. - - Performances des m6thodes centralis6es heurist iques.
Performances of heuristic centralized methods.
80 T Gain 6o t (%) 4C+ 2O 0
- 20! - 4 0
- 6 0
- 8 0
- 1 0 0
- 1 2 (
!Wt �9 Commande optimale.
[] Commande ~(N)
E C o m m a n d e ~(N,?.)
b
FIG. 14b. - - B6n6fice des approches centralis6es.
Benefit with centralized approaches.
charge. Les r6sultats sont tr6s comparables /t la m6thode optimale ce qui montre bien que l 'optimum est plat sur un grand domaine.
En fait la conclusion importante de ces figures est que la commande est surtout sensible aux chan- gements de structure. En effet la commande ~(N), d6pendant uniquement des param6tres de struc- ture, donne des performances 6quivalentes aux deux autres commandes, m~me dans les cas de surcharges. Celles-ci ne modifient pas vraiment le profil g6n6ral du trafic et Ia perturbation ne remet pas en cause l'allocation de trafic par les param~tres de partage de charge. Dans le cas du d6s6quilibre de trafic oh les profils de trafics sont tr6s diff6rents de ceux pour lesquels le r6seau a 6t6 dimensionn6, l'int~r& de l'heuristique ~(N, Z) pourrait &re montr6. Une commande tr6s simple tel[e que l'heuristique ~(N) est finalement suffisamment efficace au regard des autres r6sultats.
V.4. Influence des informations en temps r6ei.
Les r6seaux avec acheminement adaptatif ont 6t6 dimensionn6s en fonction d'informations disponibles
17/23 ANN. TI~Lf~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987
70 I,. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RI~SEAUX TI~LI~PHONIQUES
en temps r6el sur le blocage des faisceaux. Quel est l'apport de cette information darts la qualit6 des m&hodes ?
Nous avons repris les simulations du partage de charge en tenant compte de l'information de blocage sur les faisceaux montant vers les centres de transit. Lorsqu'un faisceau se trouve bloqu6, il n'est plus utilis6 et les coefficients de partage sont renormalis6s localement de mani~re & r6partir le trafic sur les autres faisceaux non bloqu6s. Ainsi les coefficients de partage sont modifi6s comme suit :
~ikj ~k O~kJ - - ~ ~ik ' j ~k' '
k'
off :
( l si le fa i sceau ik est l ibre 8~
0 si le faisceau ik est bloqu6.
Dans ce cas-l&, il n'est pas utile de d6finir des coefficients de partage pour le d6bordement car on achemine les appels sur les faisceaux non bloqu6s montant vers le niveau hi6rarchique. Ainsi, un appel sera dirig6 syst6matiquement sur un faisceau non satur6 s'il existe fi ce moment, et ne pourra ~tre
4 , 0 "
3,5- 3,0 , 2,5- 2,0 . 1,5 ] 1,0" 0,5 0,0
Pertes I I Commande optimale
P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pll Perturbations
Fl6. 15a. - - Influence des informations de blocage m6thodes centralis6es.
lt~fluettce of blocking informations on the performances : centralized methods.
perdu que sur un faisceau descendant ou lorsque tous les faisceaux montants sont bloqu6s. Les r6sul- tats sont r6sum6s dans les figures 15a et 15b.
De mSme les algorithmes distribu6s (capacit6 r6si- duelle et probabilit6 du temps de d6bordement) ont 6t6 test6s en tenant compte de l'information de saturation des faisceaux descendant du niveau de transit. Dans un tel cas cette information est rapatri6e ap6riodiquement (/~ l'instant d'occurrence) fi chaque centre d'origine. Cette information est quasiment identique fi celle obtenue en utilisant la signalisation par <( cranckback ~. Ainsi un appel de premier choix sera-t-il syst6matiquement d~bord6 (cela revient /t du d6bordement par chemin) et un appel de second choix sera rejet6 et non envoy6 (on aboutit h une sorte de r6servation de circuits). On 6vite ainsi l'utilisation des faisceaux montants pour des appels qui seront perdus plus tard et on favorise les autres flux de trafic. I1 faut noter qu'on ne remet pas en cause les acheminements calcul6s. Les performances des deux algorithmes sont donn6es dans les figures 16a et 16b.
Pertes
"~t (~176 II Capacit~ r6siduelle ~1~ 4,01 ~ ] []Temps de debordement
3,5 3,0I ~
PO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO Pll Perturbations
FIG. 16a. - - Influence des informations de blocage : m6thodes distribu6es.
Influence of blocking informations on the performances : distributed algorithms.
30 20 10 0
-10 -20. -30
70 Gain 60-(%) 50. 40
7OTGain
~ q~ ~ ~ :11 (%) ~ Ca Pma;st~ereds~dbo redem e nt "
Commande ~(N),)
b
FIG. 15b. - - Gain avec les approches centralis6es.
Benefit with centralized methods.
FI~. 16b. - - Gain avec les algorithmes distribu6s.
Benefit with distributed methods.
ANN. TI~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987 18/23
P. CHEMOUIL, - - ACHEMINEMENT ADAP/ATIF DANS LES Ri~SEAUX TELI~PHONIQUES 71
L'analyse de ces deux figures montre clairement l'importance des informations en temps r6el sur les performances d 'un acheminement adaptatif.
�9 Du point de vue des perturbations du trafic, le partage de charge centralis6 reste en deq& des performances de l'acheminement fixe, mais toujours pour les m~mes raisons que pour l'algorithme de r6f6rence. N6anmoins les performances sont nettement amdlior6es (de 20 it 40 %). Les algorithmes distribu6s quant it eux, 6quivalents & l'acheminement fixe en r6gime nominal, montrent leur int6r~t dans le cas de surcharges et de d6s6quilibre de trafic.
�9 Dans le cas des perturbations de structure, toutes les approches sont tr6s performantes. On note 6galement le bon fonctionnement des heuristiques. Par ailleurs, pour l'algorithme de capacit6 r6siduelle, l 'information de saturation des faisceaux descendants pallie la non-connaissance du nombre r6el de cir- cuits en service. L'algorithme d6termine des tables d'acheminement relativement m6diocres (e l figure 13 pour les m6thodes de r6f6rence), mais l 'information de saturation corrige ce d6faut en interdisant les chemins non disponibles. L'algorithme << probabilit6 du temps de d6bordement>> a des caract6ristiques semblables & celles de la capacit6 r6siduelle. La prise en compte de la nature probabiliste du trafic t616- phonique est done insignifiante & cette p6riode de reconfiguration. II est vraisemblable que cette approche est plus int6ressante pour des p6riodes de reconfi- guration plus grandes, lorsque l'information instan- tan6e de capacit6 r6siduelle n 'a plus grande valeur.
En conclusion on remarque que l'information sur l'6tat du chemin est plus riche que l 'information sur les faisceaux de d6part et donc les performances des algorithmes distribu6s sont g6n6ralement meil- leures que pour la m6thode centralis6e.
Un 616ment important dans l'6valuation des perfor- mances est la qualit6 d'6coulement par flux. En effet, les pertes globales permettent de juger le fonction- nement g6n6ral du r6seau alors que les pertes peuvent &re disproportionn6es entre les diff6rents flux. Le r6seau dolt assurer en m~me temps qu'un service global satisfaisant, une qualit6 d'6coulement du trafic acceptable pour tous les flux. Nous avons voulu v6rifier si l'acheminement adaptatif r@ondait
ce crit~re. Pour cette raison nous avons fait figurer dans les figures 17a et 17b la perte maximale parmi les flux pour le r6seau & acheminement fixe et le r6seau avec d6bordement adaptatif. On peut remarquer que l'acheminement adaptatif r6pond de mani~re tr~s satisfaisante h l'objectif d'6quit6 d'6coulement des appels par eomparaison ~t l'acheminement fixe dans le r6seau hi6rarchique (gain de 20 & 50 %). Celui-ci pr6sente dans plusieurs cas de mauvaises performances pour certains flux.
ioo%~,,.,, 6o I~ Pertes �9 Acheminement fixe I / ~
! maximales ~ ~ 141 50{ ('/o)~ r.4 t~apacit6, r6siduelle, ~1:i!;1
4O
3O
2O
10
0 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P l l
Perturbations
8
FiG. 17a. - - Pertes maximales avec diff6rents a lgor i thmes.
Maximal losses with different methods.
�9 Capacite residuelle 90 T Gain 13 Temps de debordement i 80 4- (%) ~L, 70 i
60-20.40.30.5,0.10. ~~ ~ ~ [ ~~ ~ 0 - . . . . . . . . . . .
b
FIG. 17b. -- Gain maximal avec les algorithmes distribu6s.
Maximal benefit with distributed approaches.
V.5. Influence de la cadence de reconfiguration.
I1 est intuitif que plus une information est fraiche, plus les actions seront pertinentes. Dans le cas de la commande centralis6e, il est difficile de r6duire la p6riode de r6actualisation des coefficients. Le module d'estimation du trafic requiert d'enregistrer Ies mesures pendant un temps assez long pour assurer la convergence. Par ailleurs, le probl6me d'opti- misation au niveau coordinateur peut n6cessiter des temps de calcul relativement grands dans le cas d 'un grand r6seau. Nous nous sommes donc int6ress6s & l'influence de la cadence de reconfiguration dans le cas de la capacit6 r6siduelle, qui est simple et rapide. La p6riode de r6actualisation de r6f6rence est de 60 s e t nous avons simul6 le m~me algorithme avec des p6riodes de 30 et 200 s pour montrer l'am61io- ration ou la d6gradation des performances. L'infor- mation ap6riodique de saturation des faisceaux des- cendants est 6galement utilis6e. Les r6sultats sont rassembl6s dans les figures 18a et 18b.
19/23 ANN. T/~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987
72 P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RESEAUX TELI~PHONIQUES
8 �84
7
6
5
4
3
2
1
0
Pertes �9 T = 30s
T = 200s
P 0 P I ' P 2 P 3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pl
Perturbations
8
FIG. 18a. - - Influence de la p6riode de reconfiguration.
Influence of the updating time interval.
8OlGain
:::I t 0 . . . . ~ '
[ ] T = 60s
[ ] T = 200s _60 j. -300%
b
FIG. 18b. - - Gain de la capacit6 r6siduelle selon la p6riode de reconfiguration.
Benefit of the residual capacity according the updating time interval.
�9 En consid6rant les perturbations de trafic, on constate que les performances sont tr6s nettement am61ior6es en cas de reconfiguration rapide et vrai- ment mauvaises pour une r6actualisation lente. Par ailleurs en r6gime nominal avec une p6riode de 200 s, le crit6re global de pertes n'est m~me plus res- pect6.
�9 Dans le cas des perturbations de structure, on a la m~me tendance except6 que la capacit6 r6siduelle recalcul6e toutes les 200 s reste toujours int6ressante du point de vue performances. Dans le cas de la panne du centre de transit, r6duire la cadence de reconfiguration n'est pas tr6s int6ressant. En effet, les chemias sont satur6s en permanence et une mise h jour rapide n 'y peut rien changer. Par contre ral- longer la p6riode de reconfiguration d6croit l'effi- cacit6 de la m6thode mais am61iore encore les perfor- mances par rapport h l 'acheminement fixe (rdallo- cation des ressources). L'algorithme a alors tendance ~t concentrer les trafics sur les chemins les moins cha r#s pendant une p6riode assez longue et il n 'y a plus de partage de trafic entre les diff6rentes routes.
V.6. Influence de multid6bordement.
Dans toutes les approches nous avons consid6r6 qu'un seul d6bordement 6tait possible; or il est d6jh possible de faire d6border les appels deux fois dans le r6seau franqais. Cette facilit6 n'est pas exploit6e actuellement et nous avons test6 le multid6bordement pour juger de son efficacit& Celui-ci peut ~tre d6ter- min6 de mani~re centralis6 par un algorithme simi- laire h celui utilis6 pour le partage de charge, en tenant compte des efficacit6s des flux entre deux reconfi- gurations [21]. Dans le cas de la capacit6 r6siduelle les d6bordements successifs sont class6s en fonction des capacit6s r6siduelles de chaque chemin. Nous avons limit6 les simulations "3. trois configurations pour la capacit6 r6siduelle :
�9 Trafic nominal ;
�9 Trafic d6s6quilibr6 ;
�9 Panne totale de centre.
De plus nous avons consid6re les cas oh l'infor- mation de saturation des faisceaux descendants est disponible ou non. Les r6sultats des simulations sont r6sum6s dans les tableaux VIIa et VIIb. De l'analyse de ces tableaux, on peut appr6cier l ' impor- tance d 'une politique de multid6bordement dans les
TABL. VHa. - - Impact du multid6bordement sur les performances (signalisation pas h pas).
Impact of multiple overflow on the performances (link-by-link signalling).
capacit6 r6siduelle
un d6bordement
deux d6bordements
trois d6bordements
Trafic 0,7 0,32 0,32 nominal - - 4 0 % + 36 % + 36 %
D6s6quilibre 5,0 3,84 3,83 e~ + 16 ~ + 36 ~ + 36
Panne totale 5,0 4,65 - - Pll -[- 53 % + 55 %
TABL. Vllb. - - Impact du multid6bordement sur les d6bordements (signalisation h l'origine).
Impact of multiple overflow on the performances (crankback).
Trafic nominal
D6s6quilibre Px
Panne totale Pax
capacit6 r6siduelle
un d6bordement
0,48 + 3 %
4,63 + 2 2 %
4,79 + 5 4 %
deux d6bordements
0,11 +78 %
2,80 + 5 3
4,34 + 5 9 %
: trois d6bordements
0,06 +88 %
2,52 +58 %
ANN. TI~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987 20/23
P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RESEAUX TELEPHONIQUES 73
performances du r6seau. Darts le cas du trafic nomi- nal et du trafic d6sdquilibr6, l'am61ioration est grande d6s le second d6bordement et se ralentit ensuite car il y a moins de trafic h 6couler et moins de ressources disponibles. Dans le cas de la panne du centre de transit le gain est moins significatif car le r6seau est bien surcharg6. On v6rifie aussi la pr66minence de l'information sur le chemin qui permet de grapiller quelques pour cent m~me avec le 3 ~ d6bordement.
Ces r6sultats ont 6t6 obtenus avec une p6riode de reconfiguration de 60 s. Des r6sultats plus complets faisant intervenir la cadence de scrutation, le multi- d6bordement et l 'information ap6riodique ont 6t6 obtenus de mani6re syst6matique [22]. Ils mettent en 6vidence les conclusions qui ont 6t6 tir6es des brefs r6sultats expos6s.
En fait ces r6sultats peuvent s'expliquer par la nature m~me de l'automate. Celui-ci n'utilise que des informations binaires (bon ou mauvais) pour mettre h jour son plan d'acheminement. Cette infor- mation est de faible valeur en comparaison de l'infor- mation sur le chemin des algorithmes distribu6s ou de l 'information sur les faisceaux montants du par- tage de charge centralis6. Elle n'indique ni o/~ l'appel s'est trouv6 bloqu6, ni une mesure d'intensit6 qui permettrait une r6allocation des capacit6s.
Cette pauvret6 de l'information utilis6e daas les approches d'automates h apprentissage implique des performances relativement mod6r6es.
VI. CONCLUSION
V.7. Automates ~ apprentissage.
Parmi toutes les vari6t6s d'automates qui ont 6t6 test6es, nous nous sommes restreints h l'analyse des performances de l 'automate appel par appel, de type LKt avec d6bordement. Le param6tre de renforcement a 6t6 choisi identique pour tous les automates. Pour analyser leur comportement, nous avons s61ectionn6 les perturbations les plus fortes, c'est-h-dire les perturbations P3 , P7, P s , P9 , P~o et P~ .
Les r6sultats obtenus figurent dans le tableau VIII.
TABL. V I I I . - - Performances des automates h apprentissage. Performances of learning automata.
surcharge /'3
rupture P,
rupture P,
panne arriv6e /'9
panne d6part Plo
panne transit Pll
automate /l apprentissage
2,32 - - 4 1 %
1,35 + 2 2 %
3,14 + 5 %
2,57 + 9 %
1,37 + 5 2 %
4,40 +58 %
Les performances de l 'automate vis-h-vis de la surcharge de trafic sont tr6s m6diocres. Vis-h-vis des perturbations de structure, ses performances sont correctes au regard de celles de l'acheminement fixe mais relativement moins bonnes que pour les autres m6thodes propos6es, exceptions faites de la panne d'6quipements terminaux d6part et de la panne de centre de transit o/a son comportement est quasi- optimal.
A partir des r6sultats de simulation des pr6c6dents paragraphes ainsi que de leur analyse partielle, nous pouvons mettre en exergue quelques conclusions quant aux performances de l'acheminement adaptatif :
�9 En cas de partnes de structure, les m6thodes propos6es ont montr6 leur capacit6 h bien mieux absorber les r6ductions de capacit6 que l'acheminement fixe. Cela est dfi aux possibilit6s de r6allocation de trafic par l'algorithme, qui grace h une reconfiguration p6riodique, permet de prendre en compte ces pertur- bations. Ainsi, bien que ce ne soit pas son objet, l 'acheminement adaptatif a tendance h mieux g6rer ia baisse de qualit6 d'6coulement du trafic en cas de panne. Par ailleurs, les exp6rimentations r6alis6es montrent l'importance de la structure sur la robus- tesse du r6seau et sur la s6curisation du trafic. Cela implique le d6veloppement de nouvelles m6thodes de planification, en particulier de dimensionnement.
�9 L'importance des informations ap6riodiques sur l'6tat du r6seau est primordiale dans l'am61ioration des performances des m6thodes analys6es. Elles 6vitent d'acheminer les appels sur les chemins sur- charg6s. Par ailleurs, on peut noter que les infor- mations de type par chemin sont bien plus int6res- santes que les informations sur les faisceaux sortants uniquement. On a une illustration de l'int6r~t du crankback.
�9 La p6riode de reconfiguration est 6galement un 616ment indissociable de la d6finition d 'un ache- minement adaptatif. En se restreignant h des p6riodes de r6actualisation des tables de d6bordement rela- tivement longues (30 h 200 s), aous avons mis en 6vidence que ce param6tre permet de passer de performances tr~s bonnes h tr~s m6diocres (c'est- h-dire bien pires que pour un acheminement fixe). Dans le cas off l 'on consid6rerait des fr6quences de mise h jour des tables plus rapides comme les BNR (10 S) OU ATT (5 S), ces performances seraient encore bien meilleures. Dans ce cas l'importance des infor-
ANN. T~L~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987
74 P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RI~SEAUX TI~LI~PI-tONIQUES
mations ap6riodiques diminue car la reconfiguration des tables se fait en fonctiort de mesures tr~s fraiches qui permettent d'estimer l'6tat r6el des chemins.
�9 Le multid6bordement, ~16ment qui n 'a 6t6 pris en compte que r6cemment, peut se r6v61er tr6s efficace. D6s le second d6bordement autoris6, la qualit6 d'6coulement des appels a &6 substantiel- lement am61ior~e. I1 r6duit l'int6r& de l'information ap6riodique et de la r6duction de la p6riode de recort- figuration par le test de plusieurs chemirts qui accroit les chances de trouver des capacit6s libres darts le r6seau. Finalement un compromis erttre ces trois param~tres doit pouvoir ~tre d6fini de fagon & sp6ci- tier des contraintes de commandes qui ne soient pas trop fortes.
En ce qui concerne l'int6r& propre de chacune des m&hodes propos6es, on peut note[ les points suivants :
�9 Le partage de charge centralis6 permet de d&er- miner les actions moyennes sur une 6chelle de temps de l'ordre de 1/2 & 1 h. En effet les caract6ristiques moyennes de trafic peuvent changer de mani~re significative dans ce laps de temps et la r6allocation de trafic se r6v~le rt6cessaire. Un coordinateur peut &re charg6 de r~soudre ce probl6me en fonction de l'estimatiort de ces variations moyennes des profils de trafic. Lorsque l 'on consid&e un 6tat stationnaire du r6seau ce type de commande garantit un fonc- tionnement moyen qu'il est possible d'am61iorer par des actions encore plus en temps r6el tel que les algorithmes distribu6s ou des informations ap6rio- diques de blocage. Par ailleurs, 6tant donn6 que les performances requises sont tr~s fortes (quelques de perte), une optimisation globale peut ~tre lourde b. mettre en oeuvre alors que des heuristiques simples permettent d'atteindre tr~s facilement un 6tat quasi optimal.
�9 Les algorithmes distribu6s propos6s tiennent compte des variations en temps r6el de faqon satis- faisante. N6anmoins, l'importance de la cadence de reconfiguration est tr~s importante ; si celle-ci est faible, les actions & prendre doivent tenir compte d 'un 6tat moyen qu'il faut estimer. Des actions suppl6mentaires en fonctions d'informations ap6rio- diques sur les blocages permettent de compl6ter le processus de r6acheminement .Si la pfriode de recon- figuration est courte (quelques secondes), alors ces algorithmes prennent err compte les variations quasi instantan6es du trafic et la connaissance pr6cise de l'&at du rdseau. Par suite les performances obtenues sont faiblement am61ior6es par des informations instantan6es sur l'6tat de blocage des chemins.
�9 Les automates 5 apprentissage agissent appel par appel et suivent au plus pr+s l'6volution irtstan- tan6e du r6seau. Cependant, ils utilisent des infor- mations tr~s pauvres sur l'aboutissement ou non d 'un appel. En fair, des informations plus compl&es
sur l'6tat du r6seau peuvent &re d'ores et d6j& obtenues (par exemple par le ~ crankback )) ou l'6tat des faisceaux) et il serait peu judicieux de ne pas les utiliser. Dans ce cas, il devient possible d'61aborer des algorithmes plus efficaces comme les capacit6s r6siduelles. Ces consid6rations font que les automates
apprentissage ont peu d'avenir pour l'acheminement adaptatif dans les r6seaux t61@honiques.
Ces conclusions sur les algorithmes peuvent &re r6sum6es par le diagramme (Fig. 19) qui repr6sente un exemple de gestion adaptative.
Achemmel'nent dynamlque
1,2 - 1 heure
Achemlnement adaptahf
5s - 2 rl31n
multdiot des profils centrahsee de ttaflc
- - q reslduelle 1~ I
I I I
I . . . . ~1. . . . . . . I I Iqformat~ctl I
. . . . - 4 - - - - ~ aperlod~que ] . . . . . " ~ - - - - - I . . . . . . . . J
Tables [ - ~ d ~lchemlnemenI - ' \
/ /
I M e , i r e s
Tlafic offert
FIG. 19. -- Exemple de gestion adaptative des acheminements.
Example of adaptive traffic routing.
Ce diagramme traduit 6galemertt les conclusions des m6thodes propos6es par les Bell Labs et BNR, mentionn6es dans le deuxi~me paragraphe de cet article. Les Bell Labs ont dans une premi&e &ape, consid6r6 les acheminemertts dynamiques (d6pendant du temps et pr6-calcul6s) qui ont un impact sur le dimensionnement (aspect 6conomique). Dans une seconde &ape, ils ont propos6 une m6thode d'ache- minement adaptatif (d@endant de l'6tat du r6seau) qui permette une gestion efficace et robuste du r6seau (aspect qualit6 d'6coulement du trafic). BNR a par contre consid6r6 le probl~me en sens inverse en justifiant d'abord l'int&& de l'acheminement adap- tatif. Par la suite l'aspect multimatrice (dynamique) a 6t6 pris en compte pour optimiser la structure du r6seau.
Nous nous sommes principalement int6ress6s dans cet article ~t analyser en simulatiort les performances de m6thodes d'acheminement intelligent. A l'heure actuelle, une premiere exp6rimentation est & l'&ude dans la zone urbaine de Paris en collaboratiort avec les services de la Direction des T616communications d'Ile-de-France. Elle est pr6vue pour 1987 avec une
ANN. TI~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987 22/23
P. CHEMOUIL. - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DANS LES RI~SEAUX TI~LI~PHONIQUES 75
&ape restreinte h la fin 86. l l s ' ag i t 6videmment de tester les per formances de la gestion adap ta t ive avec les moyens actuels. Ces essais pe rme t t ron t de mieux appr6hender l ' i n t roduc t ion de l ' a cheminemen t adap - ta t i f dans le r6seau futur. Les 6tudes se poursu iven t p o u r analyser les consequences des m&hodes que nous venons de pr6senter sur la s t ructure du r & e a u en 1995, car on peut est imer qu '~ cette da te le r6seau p o u r r a techniquement &re g6r6 ainsi et que leur sup6riori t6 (pour une gest ion 6conomique) au ra l a rgement 6t6 d6montr6e dans le monde.
R E M E R C I E M E N T S .
Les auteurs tiennent ~ remercier Janusz Filipiak de la Chaire des Tdldcommunications de Cracovie, Pologne, pour ses remarques fructueuses lors de la prdparation de cet article, ainsi que pour eertains de ses rdsultats utilisds pour analyser l'impact de diff~rents param&res dans les performances d'une gestion adaptative des appels.
Manuscrit regu le 13 mai 1986, aeeeptd le 23 septembre 1986.
BIBLIOGRAPHIE
[1] HAENSCHKE (D.G.), KETTLER (D.A.), OBERER (E.). Network management and congestion in the U.S. Tele- communications Network, 1EEL Trans. COM, USA (1981), 29, n ~ 4, pp. 376-385.
[2] BERNUSSOU (J.), GARCIA (J. M.), BONATTI (I. S.), LE GALL (F.). Modelling and control of large scale tele- communications networks, Prec. of 8th IFAC Conf. Kyoto (1981), pp. 1471-1477.
[3] I.OTTIN (J.), FORESTIER (J. P.). A decentralized control scheme for large telephone networks, Prec. of IFAC symp. on Large Scale Syst., Toulouse (1980), pp. 497-502.
[4] NARENDRA (K. S.), WRIGHT (E. A.), MASON (L. G.). Applications of learning automata to telephone traffic routing and control, IEEE Trans. SMC, USA (1977), 7, n ~ l l, pp. 785-792.
[5] MASON (L. G.), GIRARD (A.). Control techniques and performance models for circuit-switcbed networks, Prec. of Conf. on Decision and Control CDC'82, Orlando (1982), pp. 1374-1383.
[6] WINNICKI (A.), PACZYNSKI (J.). An approach to design three layer controlled telephone networks, Large Scale Syst., NL (1980), 1, n ~ 4, pp. 245-256.
[7] FILIPIAK (J.). Optimal adaptation of telephone traffic to changing load conditions, Large Scale Syst., NL (1985), 8, n ~ 3, pp. 237-255.
[8] HENNION (B.). Le pattage de cha/ge dans la tGl~phonie adaptative, L'Echo des Rech. (1978), n ~ 2, pp. 74-77.
[9] ASH (G. R.), KAFKER (A. H.), KRISHNAN (K. R.). Ser- vicing and real-time control of networks with dynamic routing, Bell. System Tech. J., USA (1981), 69, n ~ 8, pp. 1821-1845.
[10] SzvmcKI (E.), BEAN (A. E.). Advanced traffic routing in local telephone networks : performance of proposed call routing algorithms, Prec. of Int. Teletraf. Conf. ITC'9, Torremolinos (1979), paper 612.
[Ill CAMERON (W. H.), GALLOY (P.), GRAHAM (W. J.). Report on the Toronto advanced routing concept trial, Prec. NETWORKS'80 Conf., Paris (1980), pp. 228-236.
[12] ASH (G. R.), CARDWELL (R. H.), MURRAY (R. P.). Design and optimisation of networks with dynamic routing, Bell Syst. Tech. J., USA (1981), 60, n ~ 8, pp. 1787-182.
[13] ASH (G. R.). Use of a ttunk status map for real-time DHNR, Prec. of Int. Teletraf. Conf. ITC'11, Kyoto (1985), paper 4-4A-4.
[14] FIELD (F. A.). The benefits of dynamic non-hierarchical routing in metropolitan networks, Prec. of Int. Teletraf. Conf. ITC'IO, MontrGal (1983), paper 32-1.
[15] HUBERMAN(R.), HURTUBISE(S.), LE NIR (A.),DRWlEGA (T.). Multihour dimensioning for a dynamically routed net- work, Prec. of Int. Teletraf. Conf. ITC'll, Kyoto (1985), paper 4-3a5.
[16] BEL (G.), CHEMOUIL (P.), BERNUSSOU (J.), GARCIA (J. M.), LE GALL (F.). Adaptive traffic routing in telephone net- works: Large Scale Syst. J., NL (1985), 8, n ~ 3, pp. 267- 282.
[17] LE GALL (F.). One moment model for telephone traffic, Applied Math. Mod., NL (1982), 6, pp. 415-423.
[18] LE GALL (F.), GARCIA (J. M.), BERNUSSOU (J.). A one moment for telephone traffic application to blocking estimation and resource allocation, Prec. of Syrup. on Perf. of Comp.-Comp. Syst., ZOrich (1984), pp. 159-171.
[19] SRIKANTAKUMAR (P. R.), NARENDRA (K. S.). A learning model for routing in telephone networks, SIAM J., (1982), 20, n ~ 1, pp. 34-57.
[20] GARCIA (J. M.), LE GALL (F.), CASTLE (C.), CHEMOU1L (P.), GAUTHIER (P.), LECHERMEER (G.). Comparative evalua- tion of centralized/decentralized traffic routing policies in telephone networks, Proc. Int. Teletraf. Conf., ITC'll, Kyoto (1985), paper 5-1A-4.
[21] GARCIA (J. M.), HENNET (J. C.), TITLI (A.). Optimization of routing in interurban telephone networks, Large Scale Syst. J., NL (1981), 2, n ~ 3, pp. 257-267.
[22] CHEMOUIL (P.), FILIPIAK (J.), GAUTmER (P.). Analysis and control of traffic routing in circuit-switched net- works, Computer networks and 1SDN systems J., (1986), 11, n ~ 3, pp. 203-217.
23,/23 ANN. TI~LI~COMMUN., 42, n ~ 1-2, 1987