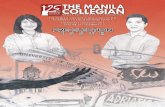AAC015 - URBAN UTOPIA 02
Transcript of AAC015 - URBAN UTOPIA 02
AAC
015-
0573
- EN
SAM
- S5
- 20
09/2
010
- ATE
LIER
AAC
- H
AYET
St
ud
io.A
rt
.Ar
ch
ite
ct
ur
e.&
.Co
ns
tr
uc
tio
n-S
5-E
NS
AM
-20
09
-20
10
-HA
YE
T
2711
2009
URBAN UTOPIA II
27112009
SOMMAIRE AAC015-0574
L’ART ET LA VILLE MARITIME AAC015-0576SAINT GERMAIN LouisMontpellier, port de MerL’Art et la Ville maritime - recueil de textes sur la littérature, l’Art contemporain, la philosophie politique, l’ethnologie, l’histoire de l’art, la sociologie
LE JARDINIER, L’ARTISTE ET L’INGÉNIEUR AAC015-0577SEVRE JulieBRISSON, Jean-Luc, 2000 : Le jardinier, l’artiste et l’ingénieur,Article de MICHEL COURAJOUD - Editions de l'Imprimeur - Collection JARDINS ET PAYSAGES.
DIGITAL GEHRY AAC015-0578PUIGSEGUR ErwanLINDSEY, Bruce, 2001 : Digital Gehry, Material Resistance and Digital Construction, Turin, BIRKHÄUSER.
ARCHITECTURE DANS LE PAYSAGE ? AAC015-0580OUGIER CamilleCERVER, Francisco Asensio, 1998 : Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, ARCO EDITORIAL, BARCELONA.
CONSOMMATION D’ESPACE AAC015-0582MAZILLE Matthieu"Rethinking Mobility"MERLIN, Pierre, 1994 : La croissance urbaine, Editions Presses Universi-taires de France PUF, Collection QUE SAIS-JE ?.MVRDV, 1998 : FARmax, Editions 010 Uitgeverij.
CULTURE URBAINE AAC015-0584BERGERET MaximePAQUOT, Thierry, 2000 : La ville et l’urbain, l’état des savoirs, Éditions LA DÉCOUVERTE, Collection TEXTES À L'APPUI .
SAVOIR URBAIN AAC015-0584BERGERET MaximeCLEMENT, Pierre et RUTH, Sabine, 1995 : De la densité qui tue à la densité qui paye. La densité comme règle et médiateur entre politique et projet, in Les Annales de la Recherche Urbaine n°67 - juin 1995.
CHRONOMOBILITÉ AAC015-0585MAZARI Malek
MARZLOFF, Bruno, 2005 : Mobilités, trajectoires fluides, Bibliothèque des Territoires.
MOBILITÉ AAC015-0586MAZARI MalekRAMPERT, Francis et APPEL-MULLER, Mireille, 2003 : Bouge l'architec-ture, Villes et Mobilités, Catalogue d'exposition publié par ACTAR et l’Institut pour la Ville en Mouvement .
TOPOS-LOGOS-AISTHÈSIS AAC015-0586GARDAIR MarieMANGEMATIN, Michel , NYS, Philippe et YOUNES Chris, 1996 : Le sens du lieu, Editions Ousia, BRUXELLES , articles respectifs : "Le sens du lieu" de PASCAL AMPHOUX , et "Topos-Logos-Aisthèsis" de HENRI MALDINEY.
BOITES AAC015-0587COQUART JordanePERON, René, 2004 : Les boites, Editions ATALANTE, Collection Comme un Accordéon.
MATIÈRE D’ART AAC015-0587FEUGERE PierreSTEINMANN, Martin, 2001 : Matière d’Art : Architecture contemporaine en Suisse, Centre Culturel Suisse à Paris / ITHA Institut de Théorie et d’Histoire de l’Architecture de LAUSANNE , BIRKHÄUSER.
TISSU URBAIN AAC015-0588PALLOT CamillePANERAI, Philippe et MANGIN, David, 2006 : Projet urbain, Éditions Parenthèses - Collection EUPALINOS, Marseille.
INSTINCT ANIMAL AAC015-0588PALLOT CamilleHAUMONT, Nicole, 2001 : L'habitat pavillonnaire, Edition L’HARMAT-TAN, Collection HABITAT ET SOCIÉTÉS, 115p.
APPROCHES URBAINES AAC015-0589PONCON ChloéGROSJEAN, Michèle et THIBAUD, Jean-Paul, 2001 : L’espace urbain en méthodes, Éditions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE.
TRAME URBAINE AAC015-0590MOL StephaneSITTE, Camillo, 1996 : L’art de bâtir les villes, Éditions du SEUIL, Collec-tion POINTS ESSAIS.
BEAUTÉ AAC015-0590
SOMMAIRE
S t u d i o . A r t . A r c h i t e c t u r e . & . C o n s t r u c t i o n - S 5 - E N S A M - 2 0 0 9 - 2 0 1 0 - H A Y E T
Travaux pédagogiques à l'intention des étudiants, et de l'équipe de recherche AAC. Diffusion res-treinte au cadre pédagogique et de la recherche, diffusion interdite sans autorisation expresse, contact: [email protected] .Se référer au " Bulletin officiel n° 34 du 17 septembre 2009 - Propriété intellectuelle -Protocole d'accord transitoire sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications pério-diques et des oeuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche . NOR : MENJ0900756X RLR : 180-1 . protocole du 15-6-2009. MEN - DAJ A1"
AAC015-0574 AAC015-0575
MOL StephaneDIDEROT, Denis et D’ALEMBERT, Jean Le Rond, 1779 : Encyclopédie, dictionnaire raisonné des sciences des arts et métiers".
--- AAC015-0591PASQUIER JordanALBERTI, Léon Battista, 2004 : De re aedificatoria (L’art d’édifier) , tra-duction du latin par PIERRE CAYE et FRANÇOISE CHOAY, Éditions SEUIL, Collection SOURCES DU SAVOIR.CHOAY, Françoise, 1997 : in Mémoire et Projet, Direction de l’Architec-ture , Paris.
PUZZLE=VILLE AAC015-0591BORDEAU AnaisDEVILLERS, Christian, 1994 : Le projet urbain, Éditions du PAVILLON DE L’ARSENAL, Collection LES MINI PA, Paris.
PROJET URBAIN AAC015-0592BORDEAU AnaisRONCAYOLO, Marcel, 2002 : Lectures de villes : formes et temps , Édi-tions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE.
EXO SOMATIQUE AAC015-0592MIECAZE LaurineROJAS, Rodrigo Vidal, 2002 : Fragmentation de la ville et nouveaux modes de composition urbaine, Editions L’Harmattan.
ÉLÉMENTS DU TISSUS URBAIN AAC015-0593FONTANA LaurePANERAI, Philippe, 2002 : Analyse urbaine, Éditions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE.
WALTER BENJAMIN AAC015-0593FOCK AH CHUEN EmilieBENJAMIN, Walter, 2000 : Sens unique, précédé d’une enfance berli-noise, Editions 10/18.
DENSITÉS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE AAC015-0594FONT MarineFOUCHIER, Vincent, 1998 : Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l’Ile de France et des villes nouvelles, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GROUPE CENTRAL DES VILLES NOUVELLES, 211p.
ÉLÉMENTS DU TISSUS URBAIN AAC015-0595BONIFACE Marine
RIBOULET, Pierre, 1998 : Onze leçons sur la composition urbaine, Édi-tions Presses de l’école nationale des ponts et chaussées.
ANTI - OEDIPE AAC015-0596GRIGONE LasmaDELEUZE, Gilles et GUATTARI, Felix, 1972 : L'Anti-Oedipe: Capitalisme et Schizophrénie, Nouvelle édition augmentée, Éditions de MINUIT.
BIBLIOGRAPHIE AAC015-0598
EXPOSITIONS AAC015-0599
FILMOGRAPHIE AAC015-0599
LIENS INTERNET AAC015-0600
ILLUSTRATIONS AAC015-0600
INDEX AAC015-0601
URBAN UTOPIA II
Synthèse des travaux pédagogiques de l'ATELIER AAC, École Nationale Supérieure d'Architecture LANGUEDOC-ROUSSILLON, sous la direction de William HAYET, Daniel ANDERSCH, Michel GVISTGAARD et Pascal MEGIAS.
AAC015-0574 AAC015-0575
L’ART ET LA VILLE MARITIME
SAINT GERMAIN LouisMontpellier, port de MerL’Art et la Ville maritime - recueil de textes sur la littérature, l’Art contemporain, la philosophie politique, l’ethnologie, l’histoire de l’art, la sociologie
La ville de MONTPELLIER à depuis plusieurs années entamé dans sa forme d’urbanisme un développement tendant à la relier à la mer. Elle peut de par cette démarche être considéré comme une future "ville ma-ritime", notion faisant appel a l’étude de quatre critères que sont la ville, la mer, le littoral et l’horizon.L’éminence symbolique maritime est ainsi amenée à faire partie inté-grante de la ville par le truchement de procédés divers. La déclaration de Barcelone en 1995 a permis de définir une sorte de code méditer-ranéen des relations maritimes. Le bassin de la méditerranée est ainsi envisagé comme zone de dialogue, d’échange et de coopération, faisant "abstraction" des forces historiques pour mieux penser une nouvelle re-présentation urbaine, celle de ville comme MONTPELLIER. Ces entités urbaine ne se réorientent pas seulement, elles se déplacent vers la mer amenant parfois à la refonte de leur fonctionnement interne. La limite maritime avec la ville crée ainsi un point de vue, un regard. La proliféra-tion d’espaces et de formes urbaines s’affronte à ce paysage minimal et symbolique. Ce dernier peut être décomposé en trois points :
La mer, riche en significations et évocations ; c’est un lieu d’échange, un lieu commun faisant preuve d’une communauté d’histoires a travers des partages, des mélanges et des circulations diverses. Elle véhicule un cor-pus d’images variant avec l’époque, pouvant être aujourd’hui matérielle-ment associé à de nouveaux enjeux écologiques, économiques,…(la mer est considéré comme un des challenges du futur en terme d’exploitation énergétique). Le littoral crée lui la liaison, l’interface entre deux espaces ; l’un terrestre, l’autre maritime. C’est un lieu en permanente stabilisa-tion sans contours définis. Au delà se situe l’horizon, troisième élément qui est a la fois clôture et ouverture. Son interprétation dépend selon le contexte historique et politique. Il peut être considéré que aujourd’hui nous vivons dans un monde où l’horizon est devenu vertical avec la per-manente recherche de hauteur (planètes, constructions,).Il s’agit pour la création d’une ville maritime de participer à l’invention d’images interprétant différent rapports ville/mer. Un des procédés est l’emploie de l’art comme modeleur d’espace commun. Les œuvres d’art issues de commandes publiques sont des éléments essentiels pour ac-compagner les mutations urbaines. Elles balisent des parcours, commé-morent, interprètes, tentent de représenter ce qui est en cours… « La lecture de la ville, de l’organisation de ses parties, du rapport entre ville et mer, entre l’habitat et l’horizon, le rivage, le littoral et l’ailleurs, pas-sera par ces œuvres parce quelles créent du sens, en ajoutant des images à d’autre images, des histoires à d’autres histoires.Dans le cadre de l’utopie urbaine relative à "Montpellier port de mer", il est nécessaire de prendre en compte la mission Racine de 1963, mis-sion ministérielle pour l ‘aménagement touristique du littoral qui a influé sur l’orientation urbanistique de MONTPELLIER. Plusieurs procédés sont pour cela mis en place. D’une part il fut nécessaire dans le cadre d’une réorganisation de la ville de redéfinir sa centralité urbaine et politique. Ce travail passera par l’intermédiaire de rites, emblèmes, signes et symboles qui légitimeront ANTIGONE et PORT MARIANNE en tant que nouveau centre de gravité du pouvoir. De plus les multiples commandes publiques permettront de diffuser par l’intermédiaire de différente œuvres d’art la notion de "maritimité" en ville. Des aménagements tel que le rond point ERNST GRANIER ainsi que d’autres permettent de rendre lisible au public les choix d’aménagements urbains. En complément est véhiculé l’image de Montpellier étant naquis de la mer et y retournant irrésistiblement. Le travail de justification des actes urbains va même jusque à la création d’un nouveau design pour les emblèmes et logos de la ville.Mais l’image de maritimité produite par le pouvoir local s’établi essen-tiellement à partir d’une approche ludique et estivale de la mer, à tra-vers ses fonctions de loisir et non a travers les champs du travail et de l’échange. Les œuvres et procédés semblent dans tous les domaines s’arrêter au niveau du sens premier de compréhension qui malheureu-sement est le plus souvent d’une trop grande légèreté. Ainsi PORT MA-RIANNE est défini comme un quartier a l’architecture méditerranéenne faite de jeux d’ombres et de lumières, ce qui relève de l’ordre du stéréo-type (ceci ne laisse pas place a une recherche "réfléchie" sur l’agence-ment des espaces). De même pour le tramway qui est sensé évoquer par le bleu la mer et par les hirondelles la migration. Quand à l’histoire, elle incorpore une pensée mythique, qui tord le fait historique pour le mettre au service du projet.Cette mer, réduite à n’être qu’une bande de littoral consacré aux pra-tiques ludiques, manque alors singulièrement de profondeur symbo-lique. Le rayonnement de son développement urbain ne peut se limiter aux stéréotypes de loisir estival, celui de la mer "claire et bleu". Ceci tra-duit dans le projet d’extension de la ville une incapacité à donner un véritable contenu à la maritimité de Montpellier.
MALGOR, Didier , 2005 : L’art et la ville maritime, Montpellier, Éditions ACTULAB, LABORATOIRE DE RECHERCHE DE L’ESBAMA, École supérieure d’Art de Montpellier Agglomération.RACINE, Pierre, 1980 : Mission impossible ? L’aménagement touristique
du littoral du Languedoc-Roussillon, Éditions Midi-Libre, collection Té-moignages, Montpellier293 p.
AAC015-0576 AAC015-0577
LE JARDINIER, L’ARTISTE ET L’INGÉNIEUR
SEVRE JulieBRISSON, Jean-Luc, 2000 : Le jardinier, l’artiste et l’ingénieur,Article de MICHEL COURAJOUD - Editions de l'Imprimeur - Collection JARDINS ET PAYSAGES.
Le livre est composé de différentes parties qui participent à cette même idée qu’a eu JEAN-LUC BRISSON de présenter la notion de paysage, le travail de paysagisme et le personnage du paysagiste dans lequel coexistent les savoirs de l’artiste, du jardinier et de l’ingénieur. Dans un premier temps, JEAN-LUC BRISSON nous explique donc sa démarche visant à prouver la nécessité du travail de terrain et l’effort que le paysagiste doit faire pour être relié à son site d’étude tout en gardant une certaine distance. Ensuite, commence le parcours entre le Potager du roi à VERSAILLES et le square Récamier à PARIS d’un artiste, d’un jardinier et d’un ingénieur. Les trois personnages vont explorer à pied une vingtaine de lieux tels que des cimetières, des parcs, des autoroutes, ou des forêts et débattre de ce qu’ils voient et de leurs sentiments selon leurs propres points de vue, leurs propres domaines de pratique. Ce voyage est entrecoupé de trois textes de trois auteurs différents, présentant trois approches diffé-rentes du paysage. Le premier est du philosophe GILLES A. TIBERGHIEN et pré-sente l’aéronaute brésilien ALBERTO SANTOS-DUMONT, pionnier de l’aviation ayant construit de nombreux ballons dont le premier dirigeable et pour qui la navigation aérienne permettait de voir et de comprendre la ville et le paysage sous un nouvel angle, « une perspective modifiée », un horizon déplacé, « un point de vue vertical ». Un autre texte du philosophe et géographe JEAN-MARC BESSE « s’attache à éclaircir le concept de paysage et ce qu’il recouvre » car c’est un domaine bien difficile à cerner tant il recoupe différent es disciplines, et est enseigné dans différentes institutions comme l’architecture, l’urbanisme ou encore l’écologie et la littérature. Dans ce sens, JEAN-MARC BESSE va pré-senter différentes facettes du paysage que sont « le paysage comme représen-tation, le paysage comme réalité objective et le paysage comme expérience ». Enfin, le troisième texte est du paysagiste MICHEL CORAJOUD qui dans « une lettre aux étudiants », expose les postures à adopter pour répondre à un projet de paysage dont le programme nous a été donné. C’est à cette lettre et surtout à un des neufs points qu’est « ouvrir son projet en cours » que nous nous intéresserons particulièrement.
La première posture à adopter à l’annonce d’un projet est de « se mettre en état d’effervescence ». Pour pallier rapidement à un manque de connaissances sur le site donné, il faut formuler de très nombreuses questions dont les ré-ponses peuvent rester évasives dans ce premier temps de l’étude, l’important étant de s’interroger le plus possible pour s’imprégner au mieux du site. Dans le même temps, il faut commencer à dessiner ses premières intuitions de tra-vail sans attendre, car ce sont ces premières perceptions qui vont permettre la « genèse du projet ». Ensuite, le site doit être « parcouru en tous sens » pour observer les caractéristiques, développer son « regard analytique », dé-gager des données objectives, formelles et sensibles du lieu, « distinguer les influences, les signes, les références et surtout les pratiques » qui le font vivre. Dans un deuxième temps, sur le site, il est nécessaire d’« explorer les limites, les outrepasser » car aucune limite donnée dans un sujet de projet n’est légi-time, le paysage ne peut se fragmenter, il est continu, et les espaces mitoyens permettront peut être de comprendre ou même de justifier le lieu choisi, ses caractéristiques, son histoire. De même que l’horizon est une limite glissante suivant notre place dans le site, les limites se déforment, évoluent, sont mou-vantes. Arrive le temps du travail en atelier. Grâce à des outils permettant de travailler le site sans y être concrètement tels que les photographies, les vi-déos ou les croquis par exemple, on pourra analyser les données et formuler les premières pistes du projet sans se trouver « enlisé dans la complexité de la situation paysagère ». Mais plusieurs allers-retours avec le site sont alors nécessaires pour vérifier l’adaptabilité du projet dans le lieu, pour l’ajuster au mieux : « quitter pour revenir ». « Traverser les échelles » et comprendre ce qui fait que le paysage forme un tout sable et durable, tant dans ses détails que sa globalité permet de tenter la transposition dans le projet. Nourrir ses connais-sances du site par l’histoire de son passé historique, les formes et images pas-sées pour en arriver jusqu’au lieu d’aujourd’hui vont ensuite permettre, par un travail rétrospectif et prospectif, d’« anticiper » et de dégager des tendances et même « entrapercevoir des images ». Le projet ne devrait pas être forcément un acharnement à la construction, il faut avoir des actions modérées et adé-quates et « défendre l’espace ouvert». MICHEL CORAJOUD pense qu’un aspect primordial de la présentation du projet est d’« ouvrir son projet en cours ». Elle ne doit pas seulement rendre compte du résultat du travail mais doit expliciter toutes les démarches, les hésitations, les choix, les évolutions, l’histoire ou encore les tâtonnements car ce n’est que grâce à l’enchaînement de ces dif-férentes postures que le projet trouvera sa légitimité et s’adaptera au mieux à d’éventuels utilisateurs. Enfin et surtout, il faut « rester le gardien de son projet » ; ne pas se laisser dérouter ou envahir par les interlocuteurs car nous sommes les seuls à connaître parfaitement le fil conducteur de notre idée ! MICHEL CORAJOUD étant paysagiste, son idée se portait plutôt sur un projet paysagé mais il s’adapte aussi bien aux projets d’architecture.
BRISSON, Jean-Luc, 2000 : Le jardinier, l’artiste et l’ingénieur,Article de CORAJOUD, Michel , Editions de l’Imprimeur , Collection JARDINS ET PAY-SAGES.
Autoroute A13, 1937
Aéroport Velizy Villa Coublay
Maison modulaire, Jean Prouvé.
Pièces d'eau des Suisses, Versailles.
AAC015-0576 AAC015-0577
DIGITAL GEHRY
PUIGSEGUR ErwanLINDSEY, Bruce, 2001 : Digital Gehry, Material Resistance and Digital Construction, Turin, BIRKHÄUSER.
« Assembler » les cultures de son époque et ses idées personnelles…Créer des « espaces » intermédiaires de qualités…Séparer les volumes pour créer des scénographies particulières… « Transcender » l’architec-ture pour lui apporter sa part d’abstraction… « Liquéfier » pour rendre en perpétuel mouvement… Autant d’image et/ou mot clef construis sur la base de verbes qui définiraient le « doing » de GEHRY ; sa façon d’être, de faire, de concevoir dans le projet et pour le projet. Mais son attitude/démarche dans la conception est plus complexe que cela et à la fois aussi simple… Elle s’inscrit clairement dans une démarche de "Moderniste" puisque les espaces sont mis en place dans l’optique d’obtenir «une forme suivant la fonction » (SULLIVAN, École de Chicago / ADOLF LOOS, "Décors et Crimes") malgré son « skin in » qui est un pro-cessus de conception qui part de la surface extérieure pour aller vers l’intérieur à l’instar des maîtres du mouvement moderne (MIES VAN DER ROHE, LE CORBUSIER, FRANCK LLOYD WRIGHT, PHILIP JOHNSON,…) qui commençaient d’une grille intérieur structurelle pour aller vers l’exté-rieur.
De plus, l’objet architectural « construit » est vu comme un tout toujours changeant fabriquant une sorte de machine architecture (LE CORBUSIER) au moyen de pièce préfabriquées et/ou standardisées ainsi qu’avec une réflexion sur l’enveloppe qui définirait la structure puis les espaces in-térieurs. Ces espaces intérieurs fluides et dynamiques poussés par une pensée provocante et courageuse qui viennent créer dés articulations avec l’espace publique dans un jeu avec les espaces extérieurs ( « Glass house » de PHILIP JOHNSON, Ecole du BAUHAUS).Ces derniers sont aidés des outils informatiques qui permettent de créer une cohérence dans la conception, une sorte de lien entre les surfaces extérieures, les géométries singulières, la grille structurelle ( si chère aux modernistes), et les connections intérieures. Cette conception « di-gitale » permet aussi de résoudre l’approche urbaine d’un édifice dans son contexte, à l’image du musée de BILBAO qui dans sa formalisation sculpturale et dynamique, n’est « rien d’autre » que la matérialisation de l’ entrée de la ville dans le musée.Mais ces outils informatiques sont aidés par la construction de séries de maquettes modélisées à différentes échelles (« Sketches », SIDNEY POLLACK) pour ne pas tomber sous le charme d’objets/sculptures. Ces maquettes sont ensuite numérisée pour permettre d’avoir un outil de dialogue avec les différents intervenants du projet architectural. L’outil informatique est donc l’interprète d’une pensée et non un objet permet-tant la création de fantasme … Il permet de passer de la maquette (3D) à la pensée bidimensionnelle (plans, coupes, élévations), et ainsi de « recentrer l’architecte dans un rôle de maître constructeur » (maîtrise du concept, de la structure et des coûts).Tous ces éléments forment des sortent de « vagues électroniques » tendues qui misent bouts à bouts nous ramène aux théories Futuristes (voir « Vers une Architecture » et son éloge de la vitesse), notamment en rapport à la vitesse des flux d’électrons dans l’atmosphère (aurores boréales). Finalement, le « doing » de GEHRY est bien toutes ces images/mots clefs citées plus haut inscris dans une conception informatique aux multiples allers-retours entre esquisses et modélisation 3D, et inscrites dans une pensée aux influences modernistes non négligeables. Il est à noter que l’influence du modernisme sur GEHRY semble à priori inscrite dans une relative normalité au vu de l’époque à laquelle il a commencé à exercer et par conséquent, il me vient une série de question évidentes à mon sens. Quelles influences doivent avoir un mouvement de pensée artis-tique dans la pensée d’un créateur, dans sa façon de créer, dans son « doing » ? Et par conséquent, quelles influences à le modernisme sur la pensée des jeunes étudiants en architectures que nous sommes; issus d’une culture de flux perpétuels mixtes et de masses (TV ; internet,…) ? L’architecture n’est elle pas finalement qu’un média catalyseur de pensée (celles du créateurs) et d’une vision de notre espace environnent ?
LINDSEY, Bruce, 2001 : Digital Gehry, Material Resistance and Digital Construction, Turin, BIRKHÄUSER.LE CORBUSIER, 1923 : Vers une architecture, Paris.POLLACK, Sydney, 2006 : Sketches of Frank Gehry, film, ALLEMAGNE et USA, 83’.MASSU, Claude, 1993 : L’architecture de l’école de Chicago, Dunod, Paris.SULLIVAN, Louis , 1918 : Kindergarten Chats and Other Writings, New York, DOVER PUBLICATIONS, 1979.SULLIVAN, Louis , 1924 : The Autobiography of an Idea, New York, DOVER PUBLICATIONS, 1956.LOOS, Adolf, 1908 : Ornament und Verbrechen.
Digital Gehry, Material Resistance and Digital Construction,BRUCE LIND-SEY , Turin, Birkhäuser, 2001.
AAC015-0578 AAC015-0579
Digital Gehry, Material Resistance and Digital Construction,BRUCE LIND-SEY , Turin, Birkhäuser, 2001.
Digital Gehry, Material Resistance and Digital Construction,BRUCE LIND-SEY , Turin, Birkhäuser, 2001.
AAC015-0578 AAC015-0579
ARCHITECTURE DANS LE PAYSAGE ?
OUGIER CamilleCERVER, Francisco Asensio, 1998 : Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, ARCO EDITORIAL, BARCELONA.
Dans l'ouvrage "Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura", nous sommes confrontés à cinq projets qui ont tous une inquiétude paysa-gère, ils tentent de résoudre le problème : comment intégrer l'architec-ture dans le paysage ? Ces cinq exemples apportent tous une solution différente à cette ques-tion : • STEVEN LOMBARDI à HONG KONG : situé entre une autoroute et
des voies ferrées, il génère un espace végétal qui suggère à la fois la transparence et abri. De plus, il marque une direction et introduit le bambou combiné à la lumière pour délimiter un espace.
• CARME PINOS : "el parque dunar" : situé sur une dune, le projet consiste à créer des bars afin de rendre la zone plus attractive. Pour ceci, l'architecte emploie trois types de structure reprenant les formes dunaires : des formes très souples, pour ne pas déna-turaliser le site.
• ENRIC MIRALLES : "el parque urbano en Mollet" à BARCELONE : construction d'un parc dans le nouveau quartier de BARCELONE POBLE NOU. S'agissant d'un parc urbain, l'architecte a souhaité concevoir un paysage artificiel : murs délimitant le parc (gros graffi-tis), espace de jeux, espace d'eau, trottoirs colorés, …
• FRANÇOIS ROCHE : "casa en el bosque à St Sauveur" : un véritable exemple d'intégrer l'architecture dans le paysage. Il s'agit d'une cabane décomposée en trois parties reliées par des passerelles, située au milieu des arbres. Le paysage devient donc structure l' édifice.
• PAULA SANTOS : "biblioteca infantil" à OPORTO : construction d'une bibliothèque et d'une ludothèque au milieu d'un magnifique jardin. Cet édifice paraît comme déposé sans avoir touché au ter-rain aux arbres, … en effet, l'architecte s'est implanté au milieu des arbres.
Dans cet ouvrage, il convient de remarquer que les projets sont expli-quées grâce aux images, à la représentation graphique et aux maquettes. En effet, chaque projet exposé est accompagné d'un texte expliquant la démarche du projet, les photos de maquette, les plans, les coupes, les détails montrent, expliquent les projet en détail : implantation dans le site, rapport avec l'existant, structure, approche réaliste, approche volu-métrique, conception du projet, …Nous pouvons trouver différents types de représentation. Tout d'abord en ce qui concerne les maquettes, il existe différents types de maquettes:• Maquette concept : il s'agit de décrire à l'aide d'une maquette le
concept du projet, la maquette n'exprime pas forcement le volume de l'édifice mais permet de montrer les lignes principales. (1)
• Maquette volume : il convient d'étudier le(s) volume(s) de l'édifice en maquette afin de se rendre compte de l'échelle, de l'emprise du bâtiment sur le site, …
• Maquette réaliste (la plus utilisée dans cet ouvrage) : elle nous per-met d'avoir une approche réelle du projet, il s'agit d'une maquette détaillée. Le site, la structure apparente, les ouvertures, l'enve-loppe, … sont représentés. Nous pouvons comparer ce type de maquette à des perspectives, ces deux moyens de représentation permettent de ressentir le projet, de vivre dans le projet. Il ne s'agit pas de faire une maquette extra-réaliste, celle-ci peut être entière-ment blanche, la lecture du projet sera aussi intense. (2)
• Maquette détail : elle permet d'expliquer la structure de l'édifice. Cependant il est plus fréquent de voir des détails tracés que des maquettes détails.
Ensuite, il convient d'analyser les plans, en allant du plan masse au plan structure :• Plan masse : il permet de visualiser le projet dans son contexte. On
peut ainsi savoir s'il s'agit d'un lieu densifié, d'un lieu rural, d'un désert, d'une friche ferroviaire, … Généralement accompagné de photos aériennes. (3)
• Plan : coupé à 1 m, il met en évidence l'organisation spatiale de l'édifice. (4)
• Plan structure, il montre l'aspect structurel du bâtiment. (5)Les élévations, permettent une lecture rapide des façades : enveloppe, ouverture, type de toit, … (6)Les croquis sont eux aussi très important pour expliquer la conception du projet. (7)Enfin, les photos permettent une lecture de l'existant (caractéristiques du lieu d'implantation), mais aussi elle sont utilisées pour expliquer la conception du projet (image concept) et elles apportent la visualisation du projet pendant et après sa construction. (8,9)Dans cet ouvrage, l'utilisation de maquettes et autres moyens de repré-sentation donnent aux lecteurs une échelle, une situation dans le site et une approche réaliste : une certaine ambiance créée par les ombres, les jeux d'ouvertures, l'enveloppe, … Elles nous permettent de visualiser le projet du site d'implantation aux détails.
CERVER, Francisco Asensio, 1998 : Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, ARCO EDITORIAL, BARCELONA.
Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASENSIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 01
Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASENSIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 04
Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASENSIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 07
AAC015-0580 AAC015-0581
Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASENSIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 02
Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASENSIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 05
Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASENSIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 08
Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASENSIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 03
Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASENSIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 06
Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASENSIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 09
AAC015-0580 AAC015-0581
CONSOMMATION D’ESPACE
MAZILLE Matthieu"Rethinking Mobility"MERLIN, Pierre, 1994 : La croissance urbaine, Editions Presses Universi-taires de France PUF, Collection QUE SAIS-JE ?.MVRDV, 1998 : FARmax, Editions 010 Uitgeverij.
Le calcul de la consommation d’espace de PIERRE MERLIN.Avant toute chose il semble important de définir un cadre historique et culturel a ce calcul de consommation d’espace. Les phases d’urbanisation de la FRANCE et de tous les pays urbanisé de notre époque commence a la révolution industriel, ou la ville a du être remanier pour faire face a toute les avancés technologiques, notamment en matière de transport. La séparation entre l’habitat et le travail a été rendue possible par les transports, ainsi sont apparue les banlieues industrielles et les habitats ouvriers du style des salines royales d’ARC ET SENANT ou des usines Michelin. Les villes se sont peu a peu consti-tuées de la manière suivante, les bureaux de prestige au centre ville et les usines en périphérie. Au niveau du logement, l’organisation se fait de manière beaucoup plus complexe et est fonction des pays. Soit il est constitué d’un espace vaste en périphérie (modèle anglo-saxon) soit il est formé par un espace beaucoup plus réduit au centre ville mais beau-coup plus valorisé par la proximité des services (modèle latin).Comme dit précédemment, c’est les transports qui régissent l’organisa-tion de la ville car ils règlent les temps de déplacement. Il est défini que Le rayon d’une ville ne peut pas déplacer 1h de trajet. C’est pourquoi il est primordial que le réseau de transport de la ville soit correctement géré. Il n’est pas possible de privilégier et de rendre unique un type de moyen de transport. Chaque type a ses qualités et touche un type de personnes, a des heures spécifiques et des lieux spécifiques. Les transports en com-muns sont utiles car ils ont une grande capacité de transport aux heures de pointes, qu’ils permettent un accès facile au centre ville et qu’ils don-nent une mobilité aux personnes n’ayant pas accès à la voiture (50% de la population). La voiture quant à elle est utile quand on sort du centre ville, elle permet des déplacements de façon beaucoup plus confortable et sont utilisation en heures creuses est privilégiée par les utilisateurs. On peut ainsi faire une comparaison entre les transports en communs et la voiture : Individuel CommunsAccès au type de transport 60% de la pop 100% de la popCapacité en pers/sens/heure 8000 (2X3 voies) 60000 (RER)Cout d’utilisation >Consommation d’énergie X3 Cout de nuisance X10 Espace consommé X30
On s’intéressera d’avantage à la consommation d’espace qu’utilise la voi-ture. Dans le modèle anglo-saxon, avec la prédominance de la maison individuelle, la consommation d’espace y est exponentielle. Elle grandi avec le niveau de vie et l’automobile y est une grande consommatrice d’espace. Dans le modèle latin, prédomine beaucoup plus les grands axes radiaux autour du centre et les transports en communs.
La consommation d’espace par habitant peut être définie par le quotient de la superficie totale d’une région sur la superficie urbanisée de cette même région, le tout divisé par le nombre d’habitant. Mais comme pré-cisé précédemment, elle ne dépend pas que des éléments qui partici-pent a son calcul. Elle dépend aussi de la façon de vivre des habitant de la région, elle dépend du niveau de vie et aussi de la grandeur de la ville elle même. Une ville de moindre taille à une valeur foncière plus basse qu’une ville de grande taille, ainsi chaque habitant consommera facile-ment plus d’espace. Cette donnée est donc peu significative et n’a au-cune valeur relative. Il est impératif de ne jamais considères la consom-mation d’espace par habitant comme valeur référence et surtout unique. Elle dépend de tellement de chose qu’il est aussi complexe de l’utiliser pour faire des modèles d’évolution de l’urbanisation future. Il faudrait alors considérer toutes les autres variables en même temps. Mais elle a l’avantage de donner une proportion, une échelle de grandeur de l’es-pace utilisé par chacun, qui comprend non seulement le logement mais aussi les zones de travail, de loisir, de consommation etc.
MERLIN, Pierre, 1994 : La croissance urbaine, Editions Presses Universi-taires de France PUF, Collection QUE SAIS-JE ?.MVRDV, 1998 : FARmax, Editions 010 Uitgeverij.
AAC015-0582 AAC015-0583
BERGERET MaximePAQUOT, Thierry, 2000 : La ville et l’urbain, l’état des savoirs, Éditions LA DÉCOUVERTE, Collection TEXTES À L'APPUI .
« L’influence d’une rencontre pour un individu n’est pas la même que pour une collectivité » THIERRY PAQUOT
La ville, non en son sens général mais plutôt dans son sens propre, est riche de ses cultures urbaines. Elles sont des pratiques, artistiques ou architecturales par exemple, qui sont propres à plusieurs individus et permettent ainsi une proximité des idées. Ainsi provoque t’elle un res-senti commun à ceux qui la vivent. Mais comment ces cultures sont elles perçus par les reste des populations car ces perceptions peuvent ne pas avoir le même effet sur les individus ou même sur une autre culture ur-baine. La culture urbaine aurait alors pour nécessité son impact sur les individus ou encore les collectivités et est mis en place à travers diffé-rentes étapes : sa naissance, sa diffusion, sa réception, sa mutation… Il faut aussi faire le décryptage de l’impact d’une culture urbaine au niveau de son échelle d’action que cela soit local ou singulier par exemple. C’est pourquoi il peut être intéressant faire un tri entre les cultures afin de mieux comprendre leur impact et leur effet.
"La ville et l’urbain, l’état des savoirs" est ainsi un rassemblement de ré-flexions « à la française » organisées autour de différents approches diverses et variés grâce à la contribution de nombreux intervenants s’attachant respectivement à leur propre domaine, aussi bien géogra-phique ou philosophique en passant par le cinéma ou l’anthropologie. Ces études vont ainsi permettent de se poser les bonnes questions sur la ville, ses acteurs, ses politiques ou encore ses cultures urbaines. Ceci afin de dégager les bonnes réponses sur les principes même de la ville et de son fonctionnement. Cette approche de la ville affirme son aspect syn-thétique des différentes disciplines exposées et qu’elle ne se limite donc pas à une simple définition et n’est pas l’objet d’un savoir spécifique. Une œuvre qui débouche sur des perspectives futures et les enjeux du rôle de la ville, de son développement, de son expansion à travers diffé-rentes échelles.
PAQUOT, Thierry, 2000 : La ville et l’urbain, l’état des savoirs, Éditions LA DÉCOUVERTE, Collection TEXTES À L’APPUI .
CULTURE URBAINE SAVOIR URBAIN
BERGERET MaximeCLEMENT, Pierre et RUTH, Sabine, 1995 : De la densité qui tue à la densité qui paye. La densité comme règle et médiateur entre politique et projet, in Les Annales de la Recherche Urbaine n°67 - juin 1995.
La densité urbaine est l’un des principaux outils au sein des processus de conception de la ville. Depuis la fin du XIXème siècle, elle est deve-nue un des facteurs de la création de la ville moderne. Avec l’augmen-tation de la population urbaine, les différents acteurs de la ville ont du trouver des solutions afin de répondre à ces nouvelles attentes. Dès lors, on va commencer à parler d’agglomération, dans le but de résoudre les problèmes de la densification des villes. Après des premiers projets de cités utopiques, on va peu à peu distinguer l’émergence de réponses au concept de densité.
Les premiers travaux de grande ampleur, notamment de HAUSSMAN, mais surtout de CERDA ("Théorie générale de l’urbanisation"), propo-sent la création d’une trame urbaine extensive et infinie permettant la création d’une ville gérée et homogène. Une fois la trame mise en place, l’habitat ne peut plus évoluer de par son plan d’occupation des sols em-pêchant ainsi les spéculations. Dans son ouvrage, CERDA distingue alors trois points distincts constituants la ville. Tout d’abord « le contenant » ou l’espace physique de la ville, puis le « contenu », soit les membres ou or-ganismes qui l’habitent, et enfin le « fonctionnement » qui correspond au rapport entre le contenant et le contenu. Ceci a pour but de réfléchir sur les besoins propres à chacun dans le cadre de regroupement d’habitats.
La seconde grande idée tentant de répondre à la problématique de la densité comme contrainte urbaine est la cité-jardin. La cité-jardin est « une alternative face au double phénomène de densification et d’exten-sion démesurée de la ville ». Elle correspond donc à une réponse stan-dardisée et prédéfinie de la densité urbaine. La densité devient alors un des éléments du programme car c’est celui qui met en forme le projet. Le principe de la cité-jardin est de travailler sur des habitats détachés les uns les autres par de la végétation ou une autre forme de vide. Le travail sur les cités-jardins aboutit à une réponse débouchant sur une densité moins importante en valorisant les jardins et les espaces publics pour davantage de bien être. Cette réponse ne pouvant s’utiliser dans n’importe quel type de situation, elle doit s’adapter à un travail préalable sur la densité.
La planification ou « zoning » correspond à la mise en place de différents secteurs pour des fonctions spécifiques et plus ou moins précises comme par exemple les pôles d’affaire, de logements, de commerces ou encore d’industrie ; tout cela dans le but de sectoriser la ville et de l’organiser avec, encore une fois, une densité maîtrisée. C’est le cas par exemple de villes comme DUBLIN ou encore de nombreuses villes américaines. Une des réponses à la densité fut ainsi la densification verticale permettant, en plan, une densification très élevée sans être pour autant remise en cause pour ce qui est de la qualité de vie. On peut même aller vers des exemples de tours entourées d’espaces libres amenant à une double ré-ponse.
Ces différentes idées ont su répondre au problème de la densité urbaine mais ont aussi dispersé la ville au sens d’un desserrement du tissu ur-bain. En effet les villes, afin de limiter la densité, se sont étendues jusqu'à perdre leur dimension humaine. C’est le cas par exemple de Paris qui a subi le phénomène de « cosification ». Ce problème est en partie résolu par les transports permettant d’accéder facilement d’un point à d’un autre. On peut réfléchir sur la médiation du traitement de la densité ur-baine car cet étalement de la ville peut augmenter des coûts de dysfonc-tionnements ou de problèmes d’environnement.
On ne doit alors pas se limiter à la densité du bâtit mais à la limite de la ville dans sa globalité et son ensemble urbain car la densité « n’est pas le seul instrument » de la planification de la ville.
CLEMENT, Pierre et RUTH, Sabine, 1995 : De la densité qui tue à la densité qui paye. La densité comme règle et médiateur entre politique et projet, in Les Annales de la Recherche Urbaine n°67 - juin 1995.
CERDA, Ildefons, 1867 : Teoría General de la Urbanización.
La ville et l’urbain, l’état des savoirs - Article de THIERRY PAQUOT - Edi-tions La Découverte - Collection Textes à l'appui - 2000
AAC015-0584 AAC015-0585
"De la densité qui tue à la densité qui paye. La densité comme règle et médiateur entre politique et projet" - PIERRE CLÉMENT et SABINE RUTH
MAZARI MalekMARZLOFF, Bruno, 2005 : Mobilités, trajectoires fluides, Bibliothèque des Territoires.
De nos jours, la mobilité ne se limite plus aux déplacements tels que nous les connaissons, c’est-à-dire, aux flux automobiles, maritimes, et aéronautiques. Ces flux se définissent par leur vitesse, la chronomobilité, et par leurs tempo, c’est-à-dire les interactions, les concordances entres eux (schéma avion, navette, train par exemple…).
Dans son ouvrage, BRUNO MARZLOFF, apporte une nouvelle vision de la mobilité, qui se définit dans le monde moderne, par l’échange d’in-formations. Il parle d’infomobilité, qui est une conséquence direct des nouvelles technologies, et qui nous rend à la fois indépendants dans nos modes de déplacements en créant une mobilité individualisée, et dépen-dants d’une nouvelle manière de consommer.
L’infomobilité est le passage d’une information statique (presse), à une information dynamique (borne), d’une information collective (panneau d’affichage) à une information personnalisée (site internet mobile), d’une information générale à une information géolocalisée (en fonction des heures et des déplacements des individus).
Cette infomobilité est présente au travers des objets-gadgets de la so-ciété de consommation, comme les webcams, les téléphones portables avec accès à internet, les écrans plasmas qui inondent les lieux publics, les codes-barres 2D, etc… Tous ces relais d’informations deviennent indispensables, et prennent le pas sur les mobilités traditionnelles. La mobilité de l’information devient un enjeu capital pour les sociétés de transits tels que la SNCF, la RATP, ou FED-EX. L’information doit aller vite, « ce n’est plus l’information qui circule entre deux lieux, mais un lieu qui ère entre deux réseaux d’infor-mations ».Cette fluidité d’informations nécessite un mixage dans un ensemble plus large de services, comme on peut le constater notamment avec l’IPHONE, où sa multiplicité d’applications permet de se mettre en ré-seaux avec tous les services tels que taxis, trains, avions, voyages…
L’analyse de BRUNO MARZLOFF semble somme toute en parfait accord avec les enjeux actuels des nouvelles technologies d’information, qui paraissent devenir l’élément clef d’un réseau dense d’échanges de flux (matériels et immatériels), où l’homme en est le centre.
MARZLOFF, Bruno, 2005 : Mobilités, trajectoires fluides, Bibliothèque des Territoires.
CHRONOMOBILITÉ
AAC015-0584 AAC015-0585
GARDAIR MarieMANGEMATIN, Michel , NYS, Philippe et YOUNES Chris, 1996 : Le sens du lieu, Editions Ousia, BRUXELLES , articles respectifs : "Le sens du lieu" de PASCAL AMPHOUX , et "Topos-Logos-Aisthèsis" de HENRI MALDINEY.
Topos, Logos, et Aisthèsis, ces trois notions sont la base d’un projet.Topos , c’est le lieu, le « où » du projet, appelé pôle intelligible. Logos c’est le discours, la logique d’un projet, sa partie rationnelle. Et aisthèsis c’est ce qui fait appel aux sens. Ces trois mots se marient, c’est leurs conjugaisons qui mènent jusqu’au projet.Le discours du sensible devient « concept ». Le discours mythique ou logos des formes sensibles devient « muthos ». La sensation que procure un lieu n’est rien d’autre qu’un « ressenti » .Et le programme dans tout ça ? C’est pourtant lui qui doit guider le projet. Il s’appuie également sur le topos, le logos, mais pas sur l’aisthèsis qui reste personnel puisqu’elle est liée à une intuition. En effet, je pense que le programme constitue la partie visible d’un projet, alors que le projet est fait de la partie visible et de la partie invisible.Si le projet répond au programme en s’appuyant sur ces trois notions, il constituera une tension motrice, tension inscrit dans le monde du vivant, alors que le programme reste un objet. Cependant, les frontières de ces trois notions ne sont pas si nettes... et leurs proportions pas forcément égales. Où est la limite entre le significatif et le rationnel ? Cette ques-tion rejoint le débat de l’architecture comme art ou comme science de la construction.Il faut trouver l’équilibre de ces pôles selon le projet.
MANGEMATIN, Michel , NYS, Philippe et YOUNES, Chris, 1996 : Le sens du lieu, Editions Ousia, BRUXELLES.AMPHOUX, Pascal, 1996 : Le sens du lieu, in Le sens du lieu, Editions Ou-sia, BRUXELLES .MALDINEY, Henri, 1996 : Topos-Logos-Aisthèsis, in Le sens du lieu, Edi-tions Ousia, BRUXELLES
MAZARI MalekRAMPERT, Francis et APPEL-MULLER, Mireille, 2003 : Bouge l'architec-ture, Villes et Mobilités, Catalogue d'exposition publié par ACTAR et l’Institut pour la Ville en Mouvement .
Bouge l'architecture, Villes et Mobilités est une exposition créée par « l’Institut pour la ville en mouvement ». Cette institut, à l’initiative de PSA PEUGEOT CITROËN, a pour but de contribuer « aux dynamiques d’inno-vation sociale, scientifique et culturelle », ceci afin de permettre l’amélio-ration des moyens de déplacement liés aux divers besoins de nos temps. Cet institut fait une critique des lieux de la mobilité, et regrette des en-droits « indignes » avec des infrastructures conçues en fonction de lo-giques fonctionnelles et techniques, qui segmentent la vie quotidienne, au détriment des aspects esthétiques et ergonomiques de ces lieux. Face à cela, l’Institut pour la ville en mouvement, créa l’exposition "Bouge l'architecture, Villes et Mobilités", afin de mettre en valeur les ar-chitectes, les aménageurs, les transporteurs ou les urbanistes, qui pren-nent en compte dans leurs projets, l’espace, le site, le contexte, comme condition et facteur de l’aménagement du territoire et de l’espace public, afin qu’ils soient adaptés à une multitude d’usages, facilitant les flux de personnes, de voitures et de transports en commun.Cet ouvrage présente de nombreux projets, classés par thèmes, avec des descriptions simples et efficaces, de leurs intégrations dans le contexte urbain, des relations avec la ville, des accès aux transports en communs, aux axes de circulation…
Ce livre se lit comme un dictionnaire, où l’on peut facilement trouver des projets correspondant aux caractéristiques de mobilité que l’on cherche (parcourir, desservir, stationner, résider, franchir, accéder…).
RAMPERT, Francis et APPEL-MULLER, Mireille, 2003 : Bouge l’architec-ture, Villes et Mobilités, Catalogue d’exposition publié par ACTAR et l’Ins-titut pour la Ville en Mouvement .
MOBILITÉ TOPOS-LOGOS-AISTHÈSIS
Topos-Logos-Aisthèsis de H. MALDINEY
Exposition - Bouge l'architecture, Villes et Mobilités
"Topos-Logos-Aisthèsis" de H. MALDINEY
AAC015-0586 AAC015-0587
COQUART JordanePERON, René, 2004 : Les boites, Editions ATALANTE, Collection Comme un Accordéon.
La grande distribution est la "mal aimée" de la société de consommation. Dans la pratique, tout le monde s'approvisionne dans ces grands han-gars à marchandises. Nous sommes, que nous le reconnaissions ou pas, des consommateurs, des cibles, des segments de marchés fichés dans des études marketing. Irrité par la non-architecture des hangars à mar-chandises qui se pressent aux portes des villes, RENÉ PÉRON, Chercheur au CNRS et sociologue de son état nous met dans son livre face a nos comportements quotidiens. En toile de fonds de sa réflexion, le constat qu’avait formulé GUY DEBORD quant à la marchandisation du monde ; repris ici en ces termes : « les marchandises investissent nos vies et nos villes sur un mode de plus en plus intime et totalitaire ».
Le livre se divise en quatre parties. La première propose un historique de l’évolution du commerce en FRANCE à partir de la seconde guerre mondiale. La deuxième partie, « Représentation », illustre le propos par des œuvres littéraires diverses : ÉMILE ZOLA avec Au Bonheur des dames, ANNIE ERNAUX La Place, FRANÇOIS BON Paysage fer, Parking et L’En-terrement" … Le troisième chapitre s’attache plus à établir une histoire de formes urbaines du commerce. En conclusion, l’auteur pose alors les questions essentielles de la dégénérescence des espaces publics et de la privatisation de l’espace.Sous le terme de boîtes RENÉ PÉRON qualifie ces architectures engen-drée par la volonté du public d’acheter le moins cher possible, volonté qui a défini un standard architectural (volumes simples, matériaux stan-dards, décoration minimum) mais également urbain: desserte par l’au-tomobile, disposition de plain-pied, acquisition de réserves foncières en vue des futures extensions… C’est « la consécration du Shopping Cen-ter, un mail de boutiques climatisées animé à chacune de ses extrémités par un grand magasin ». Gaspilleur de foncier, pollueur (par la densité des flux), standardisées dans leurs formes et leurs couleurs, ces boîtes relèvent d’une architecture fonctionnelle incitant à la consommation rapide et efficace. C’est de ça que les populations doivent aujourd’hui se contenter. En parallèle, on assiste dans les centres-villes à une émer-gence massive de boutiques luxueuses …
Ce livre, en traitant du commerce, pose la question fondamentale de notre relation au monde, relation de plus en plus déterminée par notre comportement de consommation. Là aussi, on pense à DEBORD, et à son « au-delà de la marchandise » se substituant à celui du paradis chrétien. Le vécu citoyen tendrait-il à se limiter à un vécu de consommateur ?
PERON, René, 2004 : Les boites, Éditions ATALANTE, Collection Comme un Accordéon.BON, François, 1991 : L’Enterrement, Éditions VERDIER.BON, François, 1996 : Parking, Éditions MINUIT.BON, François, 2000 : Paysage fer, Éditions VERDIER.ZOLA, Emile, 1883 : Au bonheur des dames.ERNAUX, Annie, 1983 : La Place, PARIS, GALLIMARD.
BOITES
FEUGERE PierreSTEINMANN, Martin, 2001 : Matière d’Art : Architecture contemporaine en Suisse, Centre Culturel Suisse à Paris / ITHA Institut de Théorie et d’Histoire de l’Architecture de LAUSANNE , BIRKHÄUSER.
Ce livre traite des fondements, de l’approche théorique ainsi que des caractéristiques physiques de l’architecture contemporaine SUISSE. Il dé-bute par une conversation avec le critique MARTIN STEINMANN, et nous propose ensuite un échantillon de la production des grandes figures de cette architecture, accompagné de réflexions sur les thèmes qu’elle aborde.
On comprend que l’architecture SUISSE actuelle est une héritière de l’architecture moderne, le pays ayant été épargné par la guerre, il n’a pas connu de rupture profonde. La théorisation devient la base de la conception architecturale, quand dans d’autres pays elle est rejetée. STEINMANN aborde d’abord l’importance du contexte chez les archi-tectes suisses, qui ne se contentent pas de reprendre la morphologie du terrain où d’en « citer » des éléments, mais de créer un dialogue entre le bâtiment et son contexte, parfois même par la rupture, le bâtiment s’impose alors comme entité et crée un nouveau rapport au paysage. La conversation se poursuit sur la place de l’image dans l’architecture contemporaine suisse, on voit que l’on s’intéresse plus ici à la « struc-ture de l’image » qu’à la référence elle-même, les suisses sont dans une démarche analytique du projet, où chaque élément construit doit être intelligible, on doit comprendre « comment c’est fait ». Mais cette archi-tecture ne se réduit pas à la simple expression des éléments construits, elle cherche l’unité par la mise en place d’une « forme forte » qui vient créer un événement et qui porte le sens de ce que les éléments de la construction ne pourraient véhiculer d’eux même.
On comprend alors qu’un bâtiment « bien construit » ne se suffit pas à lui-même et qu’il doit être porteur de sens. Inversement, la présence physique concrète due à l’intelligibilité des matériaux empêche que les formes ne disparaissent dans leurs significations. C’est grâce à cela que l’architecture peut être considérée comme un ART. Les architectes suisses sont très attachés à l’utilisation de matériaux banals car ils ai-dent à l’appropriation du bâtiment, ils tentent de trouver de nouvelles manière de les utiliser, non-pas pour rechercher l’originalité mais pour provoquer des expériences sensorielles qui viennent alors accrocher l’imaginaire du passant où de l’usager. La dimension physique est donc plus que jamais présente dans les constructions suisses, on cherche une vibration qui porterait des « significations transcendantales ».
STEINMANN, Martin, 2001 : Matière d’Art : Architecture contemporaine en Suisse, Centre Culturel Suisse à Paris / ITHA Institut de Théorie et d’Histoire de l’Architecture de LAUSANNE , BIRKHÄUSER.
MATIÈRE D’ART
AAC015-0586 AAC015-0587
PALLOT CamilleHAUMONT, Nicole, 2001 : L'habitat pavillonnaire, Edition L’HARMAT-TAN, Collection HABITAT ET SOCIÉTÉS, 115p.
Dans le livre de NICOLE HAUMONT, L’habitat pavillonnaire, une analogie avec les autres espèces vivantes peut être faite car l’homme pavillon-naire met en avant son instinct animal. En effet, l’homme cherche à marquer et à fermer son territoire tout comme l’animal. Les trois faits suivants déterminent cet instinct animal : fermer l’espace, défendre sa propriété et projeter dans cet espace des rapports sociaux. Les contacts entre individus sont fondés sur le fait que chaque sujet maintient au-tour de lui un espace de sécurité dans lequel aucune intrusion d’un quel-conque voisin n’est tolérée. L’affirmation de cet instinct de propriété d’un territoire, d’être chez soi peut se manifester de manière « agressive » par une haie obstruant toute vue ou de manière plus défensive par une simple clôture.
Dans la territorialité, l’individu est dominant chez lui. Il est familiarisé avec cet environnement dont il connaît les repères. Il en connaît mieux que quiconque les opportunités et les ressources. Inversement dès qu’il s’éloigne de son domaine et pénètre chez son voisin, il perd sa domi-nance.
Cette réflexion sur l’instinct animal est clairement identifiée dans le monde actuel dans ce qu’il y a de plus trivial, par exemple dans la série télévisée américaine "Desperate housewives", où les relations voisin/voi-sine, propriété et chez soi sont caricaturées et rejoignent bien souvent le vocabulaire de l’instinct animal.
HAUMONT, Nicole, 2001 : L’habitat pavillonnaire, Edition L’HARMATTAN, Collection HABITAT ET SOCIÉTÉS, 115p.CHERRY, Marc, 2004 : Desperate housewives, ABC.
PALLOT CamillePANERAI, Philippe et MANGIN, David, 2006 : Projet urbain, Éditions Parenthèses - Collection EUPALINOS, Marseille.
D’après PANERAI et MANGIN, le tissu urbain procède de l’imbrication de deux logiques : découpage du sol en lots à bâtir d’une part et tracés de la voirie qui les dessert d’autre part. Si ce découpage n’est pas pertinent, si les relations constructions/ espaces publics ne sont pas correctement gérées, il n’y a pas de tissu urbain car il y a absence totale de possibilité de favoriser dans le temps le développement d’activités et d’usages ca-ractéristiques de la ville.
Le tissu urbain se constitue par superposition de deux grilles régulières décalées : dans la première, chaque maille est formée par une section de rue avec rangées de parcelles bâties qui la bordent, dans la seconde, l’ensemble des quatre rues qui isole l’îlot. Le tissu urbain devient alors une suite organisée et réfléchie de surfaces géométriques, phénomènes géographiques faciles à délimiter créant réseaux et étalement organisés.
Le tissu urbain se constitue par emboîtement d’échelles croissantes : la maison dans la parcelle, la rangée, l’îlot, le groupe d’îlots, la maille se-condaire, la maille primaire. Deux grosses parcelles deviennent alors un équipement, l’îlot entier une école, un marché ou un square ; jusqu’à plusieurs mailles qui deviennent une forêt, un aéroport ou une zone agri-cole. Le tissu urbain résulte également de la présence et l’influence des pouvoirs politiques, religieux et économiques de la ville.
PANERAI, Philippe et MANGIN, David, 2006 : Projet urbain, Éditions Pa-renthèses - Collection EUPALINOS, Marseille.
TISSU URBAIN INSTINCT ANIMAL
PANERAI, Philippe et MANGIN, David, 2006 : Projet urbain, Éditions Parenthèses - Collection EUPALINOS, Marseille.
HAUMONT, Nicole, 2001 : L’habitat pavillonnaire, Edition L’HARMATTAN, Collection HABITAT ET SOCIÉTÉS, 115p.
AAC015-0588 AAC015-0589
PONCON ChloéGROSJEAN, Michèle et THIBAUD, Jean-Paul, 2001 : L’espace urbain en méthodes, Éditions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE.
L’espace urbain en méthodes présente différente façon d’analyser la ville, on s’aperçoit que le territoire fait l’objet d’interrogation interdiscipli-naire. En effet l’ouvrage passe de l’étude architecturale à la sociologie en passant par l’urbanisme, l’ethnologie, la linguistique…Le point commun à toutes ces démarches est que l’on se détache des approches globales habituelles pour privilégier une analyse in situ. Il y a quatre catégories de méthode : observer, accompagner, évoquer et s’entretenir, elles re-joignent toutes l’idée que le support matériel de la ville est indissociable des activités et des pratiques qui la forme.
Observer les comportements in situ des habitants c’est étudier leur vie quotidienne dans leurs déplacements et leurs comportements d’un point de vue qualitative (type de population : jeune, pauvre, active…) et quantitative (étude des flux). L’analyse de ces parcours est ensuite mise en relation avec l’environnement urbain pour en tirer des conclusions sur l’influence de la morphologie de la ville sur l’homme et leurs activités. Accompagner les descriptions en marche est la méthode la plus appliqué dans ce livre, c’est la description instantanée d’un itinéraire dans la ville. Cette démarche doit remettre en cause les hypothèses des sociologues, elle donne la dimension du vécu, de l’émotion urbaine. On met en rela-tion les expériences de plusieurs personnes (les difficultés rencontrées, leurs descriptions sensibles : ambiance, son, visuelle, lumière…), la syn-thèse final donne les configurations sensibles du lieu. L’espace public n’est pas homogène, on distingue différente forme qui sont associées à des usages et des sensations différentes.
Evoquer : il s’agit d’analyser un lieu par des réactivations sensorielles, ici le son décrit les lieux, il évoque une ambiance connue. En effet dans chaque espace il y a des ambiances sonores différentes qui sont liées à l’architecture (acoustique), des activités des hommes (commerce, mar-ché, habitation…), des voitures…Chaque bande-son est associé à une description urbaine. Cette méthode fait également appelle au vécue et à l’observation de la récurrence des gestes d’une population.
L’entretient est la méthode qui consiste à analyser linguistiquement ce que dit une personne et d’en tirer des conclusions sur ce qu’elle pense et ressent sur le sujet en question. Cette démarche contrairement aux autres, fait appelle à la mémoire, au vécu personnel et à la sensibilité personnel ce n’est pas une description instantanée du lieu, il y a beau-coup plus de subjectivité qui rentre en compte.
Dans les différentes démarches décrites ici le plus important c’est la pro-blématique de la perception in situ, le but est de se détacher des mé-thodes habituelles et théoriques d’analyses sociologiques et urbaines pour analyser ce qui se passe réellement sur le terrain afin de com-prendre l'impact de l’environnement (la ville, l’architecture) sur l’homme au quotidien.
GROSJEAN, Michèle et THIBAUD, Jean-Paul, 2001 : L’espace urbain en méthodes, Éditions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE.
APPROCHES URBAINES
L’espace urbain en méthodes - Gard du Nord : Accompagner
L’espace urbain en méthodes - Rue de la République, Lyon : Observer
AAC015-0588 AAC015-0589
MOL StephaneSITTE, Camillo, 1996 : L’art de bâtir les villes, Éditions du SEUIL, Collec-tion POINTS ESSAIS.
L’art de bâtir les villes de son vrai nom : L’urbanisme selon les fondements artistiques est un passage obligé pour tous étudiants d’architecture, d’ur-banisme ou de paysagisme, en effet que le sujet porte sur une ville tradi-tionnelle, sur notre patrimoine urbain ou sur une quelconque agglomé-ration, l'oeuvre de CAMILLO SITTE est d’actualité bien qu’écrit il y a plus d’un siècle. Cette œuvre fut la base et le guide pour la fondation de pas mal de villes que se soit en 1893 qu’après la Seconde Guerre Mondiale. Ce livre fut décrié par les partisans du MODERNISME avant de renaître de ces cendres à la fin de ce mouvements.
CAMILLO SITTE aborde dans L’art de bâtir les villes non pas une approche global de l’urbanisme comme pourrait le laisser croire le titre mais il aborde la dimension esthétique de l’urbanisme. SITTE recherche et veut mettre en valeur la beauté dans la ville. Pour cela dans son livre, il met en place des règles d’urbanisme sur la façon de traiter ou d’aménager la place publique. Il nous livre ici une vision sur les relations qu’il y a entre la place et ses alentours, sur ses dimensions ou encore sur sa forme.
CAMILLO SITTE relativise néanmoins ses règles en émettant des réserves sur la viabilité de ses règles, la faute a deux ou trois raisons qu’il met en avant…Il mettait demandé de lister les 5 déterminants de la trame urbaine, ce listing fut pour moi impossible car SITTE met en avant dans son livre une volonté de trouver la beauté dans la ville par des règles régissant l’espace public. Et si l’on prend quelques une de ses règles comme déterminants de la trame urbaines, cela serait une erreur étant donné les réserves et les doutes qu’il met en lumière quant à la viabilité de celle-ci.
SITTE, Camillo, 1996 : L’art de bâtir les villes, Éditions du SEUIL, Collection POINTS ESSAIS.
MOL StephaneDIDEROT, Denis et D’ALEMBERT, Jean Le Rond, 1779 : Encyclopédie, dictionnaire raisonné des sciences des arts et métiers".
Cette encyclopédie est séparée en plusieurs parties, la première nous présente une déclinaison de mots en rapport avec le vocabulaire du temple grec ou romain accompagnés de leurs représentations, cela va des modules en passant par les bases, les entablements et autres cha-piteaux ou balustrades. Une importance particulière est apportée à la proportion entre la taille et la grosseur. Cette proportion est à la base de la différence entre les ordres. En effet, le TOSCAN connu sous le nom de RUSTIQUE est plus grand proportionnellement au DORIQUE connu sous le nom solide qui est lui même plus grand que le Ionique, qui lui est connu sous le nom de moyen. Les derniers ordres existants, le CO-RINTHIEN et le COMPOSITE, sont eux les plus petits et sont connus sous le nom de délicat. Selon VITRUVE le COMPOSITE ne serait justement pas un véritable ordre en raison de l’égalité de rapport qu’il y a avec le CO-RINTHIEN.
La seconde partie, elle, nous présente une observation générale sur les trois ordres grecs appliqués en particulier à plusieurs monuments érigés pour la magnificence par exemple la fontaine de Grenelle. Il faut un or-donnancement correct entre le DORIQUE et le Ionique car en effet, un ordre met plus en valeur une œuvre qu’un autre ordre. Chaque ordre a une vraie expression que l’on ignore parfois.
Avec cette encyclopédie on apprend que l’expression de la beauté re-pose dans la proportionnalité qu’il y a entre la taille et la grosseur entre les ordres, mais aussi dans la symétrie. On peut finalement dire que la beauté réside dans l’ordonnancement.
DIDEROT, Denis et D’ALEMBERT, Jean Le Rond, 1779 : Encyclopédie, dic-tionnaire raisonné des sciences des arts et métiers».
TRAME URBAINE BEAUTÉ
SITTE, Camillo, 1996 : L’art de bâtir les villes, Éditions du SEUIL, Collec-tion POINTS ESSAIS.
DIDEROT, Denis et D’ALEMBERT, Jean Le Rond, 1779 : Encyclopédie, dictionnaire raisonné des sciences des arts et métiers».
AAC015-0590 AAC015-0591
PASQUIER JordanALBERTI, Léon Battista, 2004 : De re aedificatoria (L’art d’édifier) , tra-duction du latin par PIERRE CAYE et FRANÇOISE CHOAY, Éditions SEUIL, Collection SOURCES DU SAVOIR.CHOAY, Françoise, 1997 : in Mémoire et Projet, Direction de l’Architec-ture , Paris.
ALBERTI, Léon Battista, 2004 : De re aedificatoria (L’art d’édifier) , traduc-tion du latin par CAYE, Pierre et CHOAY, Françoise, Éditions SEUIL, Collec-tion SOURCES DU SAVOIR.CHOAY, Françoise, 1997 : in Mémoire et Projet, Direction de l’Architecture , Paris.
BORDEAU AnaisDEVILLERS, Christian, 1994 : Le projet urbain, Éditions du PAVILLON DE L’ARSENAL, Collection LES MINI PA, Paris.
CHRISTIAN DEVILLERS (1946) à fait l’école des Beaux-Arts, une licence et maîtrise d’urbanisme, sa culture est à la fois théorique et artistique…
« Le projet urbain est une pédagogie, un travail sue la conscience col-lective, en même temps qu’un travail sur la forme. » (Forme dans le sens sa capacité d’usage). Il est basé sur la pensée de la reconnaissance de ce qui est là, des traces, il prend en compte le mouvement et les flux dans lesquels on se situe et instaure des fondations pour les suivants. Il y a autant de relation dans le temps que dans l’espace. Le projet urbain est pluridisciplinaire un architecte ne peut aboutir seul un projet urbain. La ville est un grand ensemble, soit un monolithe. Pour l’organiser la solu-tion serait de la découper c'est-à-dire identifier des lieux publics et de créer des parcellaires. C’est à ce moment qu’on peut penser qu’il peut y avoir une autonomie possible des unités de substitution.
Un îlot serait donc une pièce urbaine. Son échelle permet à l’architecte de faire le lien entre projet urbain et projet architectural. C’est un petit projet urbain contrairement à un gros de 2000 hectares où l’on ne peut pas tout aborder, où il faut désigner des lieux de projet et identifier ce qui peut être projeté (c'est-à-dire ce qui peut être représenté comme lieu).Le projet d’îlot se base sur trois concepts : le travail architectural ; qua-lifier l’espace urbain ; le rapport aux autres architectures. C’est comme une pièce d’un puzzle (le puzzle = la ville) qui permet une articulation entre parcelles et formes urbaines.
Mais il faut faire attention au fait de ne pas gaspiller de l’espace qui serait causé par une forme directionnelle ce qui donnerait à la voie une géo-métrie hétérogène. L’îlot se définit surtout par son centre puis par sa pé-riphérie. Son travail est architectural parce qu’il faut penser son rapport au voisin, travailler la mitoyenneté, le vis-à-vis, la continuité, la disconti-nuité, les vues… L’îlot est à la fois espace public, espace collectif, espace intermédiaire et espace privé, par conséquent pour chaque bâtiments il faut définir son rapport à l’espace public, travailler sur ouvertures, fer-metures, alignements, gabarit… Le projet est porté sur une étendue limi-tée qui est contrôlée contrairement à la ville. L’îlot devient alors projet d’architecture car il est fondé sur une pensée de l’unité, l’unité de lieu, de temps et de concept.
DEVILLERS, Christian, 1994 : Le projet urbain, Éditions du PAVILLON DE L’ARSENAL, Collection LES MINI PA, Paris.
PUZZLE=VILLE---
ALBERTI, Léon Battista, 2004 : De re aedificatoria (L’art d’édifier)
AAC015-0590 AAC015-0591
BORDEAU AnaisRONCAYOLO, Marcel, 2002 : Lectures de villes : formes et temps , Édi-tions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE.
Cet ouvrage de MARCEL RONCAYOLO est constitué de 24 textes à propos de la morphologie de la ville où il fait de la « géographie critique et non critiques de la géographie ». Il témoigne des influences et des démarches qui ont conduit le géographe à faire des études urbaines, une rencontre de toutes les sciences sociales qui sont avec l’étude de la morphologie ses principales objectifs.
Il présente le « projet urbain » comme un univers qui ne se construit pas seul, au contraire il a besoin des sciences sociales, de l’histoire, de l’économie, de l’architecture et de l’urbanisme pour exister. Sa morpho-logie est une étude de l’organisation de peuplement, de groupes sociaux, associée avec les mouvements et les structures d’où sociale. Par consé-quent le temps est aussi plus qu’important dans sa démarche puisque le « projet urbain » ne peut se faire d’un seul coup dans sa globalité. Il évolue à travers le temps. La ville BAROQUE, CLASSIQUE, haussmannienne ou bien Industrielle, sont toutes différentes puisque le temps fait changer les politiques, les comportements, l’économie etc. Ce qui amène des conflits, des distances sociales, c’est à ce moment que la remise en question du projet arrive. Alors la ville et sa morphologie vont subir une évolution. Une évolution qui arrive assez rapidement ou au contraire la vision patrimoniale entre en jeu et là l’évolution sera plus longue puisque les sentiments de mé-moire collective, d’identité, de sens, de valeur vont se développer. « La résistance des tracés et celles des ensembles cohérents (voies, parcel-laires, bâtis) sont indéniables sauf que ces derniers peuvent supporter plus ou moins aisément la dissociation. » Même si les lieux changent, l’enjeu sur l’identité reste grâce à une valorisation patrimoniale ou par une autre exploitation du lieu avec une nouvelle fonction. Par exemple la gare CHAPTAL que l’on étudie a marqué la nouvelle organisation d’au-jourd’hui car ses tracés de rail représentent aujourd’hui l’AVENUE DE LA LIBERTÉ.
MARCEL RONCAYOLO dit « Ce qui compte, c’est la démarche, l’essai éventuellement contradictoire - de chemins variés. N’oublions pas que l’analyse statistique la plus sophistiquée ne peut qu’amener au rejet de certaines hypothèses et non l’affirmation d’une vérité. » Il parlait de l’ab-sence de conclusion dans son livre mais je trouve que cette citation dé-voile une des principales démarches du « projet urbain ».
RONCAYOLO, Marcel, 2002 : Lectures de villes : formes et temps , Éditions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE.
MIECAZE LaurineROJAS, Rodrigo Vidal, 2002 : Fragmentation de la ville et nouveaux modes de composition urbaine, Editions L’Harmattan.
Aujourd’hui, différentes analyses de la réalité spatiale de la ville font re-cours à la notion de fragmentation pour définir un processus de transfor-mation de l’espace urbain contemporain.Initialement, la notion de fragmentation est utilisée pour décrire un nou-veau type d’organisation spatiale de la ville. La notion de fragmentation s’aborde par une analyse globale de la ville et d’études sur l’habitat, des nouveaux modes d’urbanisation, des transports… Actuellement, la notion de fragmentation prend un sens plus large, vue comme un phénomène global qui concerne la fragmentation de la socié-té urbaine et suggère qu’à une ville unitaire, organique, solidaire succède un ensemble hétérogène composé de plusieurs parties plus ou moins reliés et en interaction les uns avec les autres.Cette idée de fragmentation est fréquemment utilisée pour transposer des problèmes socio-économiques au schéma de fonctionnement de la ville. Ce phénomène s’inscrit dans la question urbaine mondiale et concerne les pays développés et ceux en voie de développement, dans les espaces urbains comme dans celui de la ceinture bien des facteurs tendent à fragmenter la ville.
Ce livre met la lumière sur l’analyse moderne de la ville comme assem-blage de fragments en donnant son sens, sa mesure, ses espaces in-terstitiels, sa dimension comme idées contemporaines d’un renouveau urbain.Le phénomène de fragmentation de la ville s’explique comme le produit de causes physiologiques relatives aux modalités de croissance, aux dif-férenciations socio-économiques et à la rapidité des processus d’urbani-sation. La réflexion autour de la fragmentation renferme trois aspects :La fragmentation sociale exprime certainement une tendance de la so-ciété à l’éclatement ; et celle des lieux à perdre leur cohérence et leur cohésion .
Le deuxième aspect est fonctionnel afférent au modernisme et la volonté de répartir la ville en zoneLa fragmentation visuelle provoquant un désordre visuel du à des contraintes économiques rigides pour un type de construction tout à fait standard, mais poussés à réaliser quelques choses de distinctif mais aussi à la diversité des architectes.Ainsi, la fragmentation urbaine est axé sur la dilution et l’étalement du développement urbain par une hétérogénéité typo-morphologique, une multiplication des frontières urbaines et la privatisation des espaces publics. Cette segmentation est donc le produit d’un exosomatisme d’une société moderne basé sur l’individualisme. La ville moderne se dé-veloppe comme un morcellement dans lequel se pose la question des liaisons et des espaces interfragmentaires.
En fait, « l’espace interfragmentaire apparait comme une reconnaissance matérielle de la limite, laquelle exprime concrètement une relation/dif-férenciation entres les sphères d’identité, d’action et de domination que sont les fragments ». Cette question de la cohabitation des segments pose le problème de la qualité des espaces interstitiels : ces espaces n’ont pas d’identité propre, elle se construit à partir du croisement des identités prépondérantes de chacun des fragments.Ils sont vus comme un facteur de rapprochement, de continuité, espace de dilution de deux segments et créent une échelle intermédiaire, lieu de communication, de rapprochement des différences et d’éloignement des similitudes.
En conclusion, la fragmentation est un processus de compositions ur-baines modernes issus d’une évolution socio-économique d’individua-lisme est créant un morcellement d’espaces reliés entre eux par des es-paces inter fragmentaires qui servent de convergence et de cohabitation entre les deux fragments.
ROJAS, Rodrigo Vidal, 2002 : Fragmentation de la ville et nouveaux modes de composition urbaine, Editions L’Harmattan.
PROJET URBAIN EXO SOMATIQUE
RONCAYOLO, Marcel, 2002 : Lectures de villes : formes et temps , Édi-tions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE.
AAC015-0592 AAC015-0593
FONTANA LaurePANERAI, Philippe, 2002 : Analyse urbaine, Éditions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE.
Dans son livre, PHILIPPE PANERAI nous donne une piste pour comprendre la complexité d’une ville, en particulier moderne, enclin à une urbanisation crois-sante et sans cesse rattrapée par son passé. Outils indispensables donc que sont l’approche historique, la géographie, le travail cartographique, l’analyse architecturale, l’observation constructive et celle des modes de vie. Une manière de percevoir une ville est de l’envisager sous son évolution. Com-ment les grandes lignes du territoire ont pu générer la création urbaine ? La question du tissu urbain, aussi complexe soit-elle permet cette compréhen-sion. « Appliqué à la ville, le terme de tissu évoque la continuité et le renouvel-lement, la permanence et la variation ». En effet il demeure un lien mouvant et changeant entre le territoire d’hier et celui d’aujourd’hui, mais reste perçut comme un ensemble qui regrouperait tout, le banal comme l’exceptionnel. Chez PANERAI, le tissu urbain se constitue de trois ensembles qui inter-agis-sent, se complètent et créent une logique urbaine : le réseau des voies, les découpages fonciers et les constructions. C’est ce qui permet à la ville d’évo-luer en gardant sa structure initiale et « sa cohésion ». En effet, par exemple, la permanence d’un parcellaire dans certains quartiers leur permet de garder leurs identités en y limitant les nouvelles constructions. On voit aussi souvent la relation entre les édifices et les voies surtout quand il s’agit d’axes majeurs et d’édifices publics. Dans un premier temps, on peut s’attacher aux voies qui s’organisent de ma-nière hiérarchique. Ces dernières, relevant de l’espace public, desservent des espaces et génèrent donc « distribution et circulation ». Elles organisent donc le tissu aussi bien à l’échelle de la ville qu’à l’échelle du quartier (voiries secon-daires). Arriver à les recenser et les classer ensuite de manière hiérarchique permet de comprendre les axes forts d’une ville autour desquelles elle se dé-veloppe mais aussi ses sous-ensembles témoins d’un passé, ou d’un futur plus prometteur. On associe généralement les voies aux parcelles et c’est cette relation qui « fonde le tissu urbain véritablement et structure le bâti ». En effet, les construc-tions se définissent vis-à-vis de leur rapport avec la rue : alignement, retrait… On se retrouve ainsi avec des bâtiments solidarisés grâce à la rue, mais qui n’ont aucun rapport évident. L’unité est donc conservée, quoi qu’il arrive tout en laissant une marge aux changements. Cependant il ne faut pas oublier que quand on parle de découpage foncier et de constructions on parle non seulement du domaine construit mais aussi des dents creuses de la ville, ses parkings, ses parcs, ses jardins de particuliers, ses zones de non lieux … S’il existe une certaine cohérence dans nos villes portées par une urbanisation sans précédent c’est bien qu’une trame les régit, les structure laissant une marche à suivre, une grille préétablit.
PANERAI, Philippe, 2002 : Analyse urbaine, Éditions PARENTHÈSES, Col-lection EUPALINOS, MARSEILLE.
FOCK AH CHUEN EmilieBENJAMIN, Walter, 2000 : Sens unique, précédé d’une enfance berli-noise, Editions 10/18.
Ce bouquin est écrit dans un style particulier revendiqué par l’auteur. Il regroupe, à partir de textes très courts, les analyses sociologiques de l’auteur. On passe ainsi de ses rêves d’enfant, à ses expériences au cours de sa vie. Ces textes très courts n’ont cependant pas toujours vocation de morale ou d’analyse, mais reflètent parfois simplement le besoin de ra-conter, d’énoncer, d’archiver ou de constater différentes choses de la vie.Benjamin justifie ce procédé d’écriture en expliquant que la construction de la vie relève bien plus d’expériences que de convictions. Il lui paraît donc prétentieux d’énoncer des analyses sociologiques sans raconter préalablement l’expérience qui l’y a mené. Il explique aussi que pour cha-cun, les expériences sont personnelles et n’ont, en général jamais, encore servies à établir des convictions. L’activité littéraire ne peut donc pour lui se dérouler dans un cadre strictement littéraire. Elle doit au contraire être le reflet de la vie, de sa diversité et de sa multitude au travers de tracts, de journaux, d’affiches ou encore de rêves. En effet, ces formes un peu plus modestes de l’écriture représentent sûrement un peu mieux l’influence de l’écriture sur une communauté plutôt qu’un livre.
Le travail de mémoire et de la mémoire doit donc s’opérer au travers d’un aller-retour constant entre actions ou expériences et écriture. Pour l’auteur, « seul le langage instantané se révèle efficace et apte à faire face au moment présent ». On ne peut donc pas écrire en avance, au même titre qu’on ne peut pas prévoir le futur. On doit écrire au fur et à mesure. Les opinions ne peuvent s’affiner qu’au fil des expériences. D’ailleurs, on ne peut avoir d’opinions véritables que sur ce que nous connaissons bien. L’auteur précise : « les opinions sont à l’appareil géant de la vie so-ciale ce qu’est l’huile aux machines ; on ne se met pas devant une turbine pour l’inonder d’huile à machine. On en verse quelques gouttes sur des rivets et des joints cachés qu’il faut connaître ». La pensée pour le mé-moire peut donc être un grand répertoire d’expériences et de constats, plutôt que des énoncés de convictions.
BENJAMIN, Walter, 2000 : Sens unique, précédé d’une enfance berlinoise, Editions 10/18.
ÉLÉMENTS DU TISSUS URBAIN WALTER BENJAMIN
PANERAI, Philippe, 2002 : Analyse urbaine, Éditions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE.
BENJAMIN, Walter, 2000 : Sens unique, précédé d’une enfance berli-noise, Editions 10/18.
AAC015-0592 AAC015-0593
FONT MarineFOUCHIER, Vincent, 1998 : Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l’Ile de France et des villes nouvelles, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GROUPE CENTRAL DES VILLES NOUVELLES, 211p.
« Les hommes occupent très peu de place sur terre. Si les deux milliards d’habitants qui peuplent la terre se tenaient debout et un peu serrés, (…) ils logeraient aisément sur une place publique de vingt milles de long sur vingt mille de large. On pourrait entasser l’humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. »ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, "Le Petit Prince"
VINCENT FOUCHIER utilise comme référence plusieurs études menées précédemment sur la densité, le développement durable et la mobilité.Par exemple l’étude menée par P. NEWMAN et J. KENWORTHY, « Cities and automobile dependance : an international sourcebook ».
Cette étude montre que plus les villes sont denses, moins elles consom-ment de l’énergie.
Cette étude se base sur 31 villes. Il en ressort par exemple que les villes européennes ont une densité 3 à 4 fois plus élevée que les villes améri-caines ou australiennes, quand aux villes asiatiques, leur densité est 10 fois plus élevée que ces dernières. Ou encore que les densités ont un lien avec les déplacements, plus la densité est faible, plus la consommation d’énergie est élevée.
Ils en déduisent donc que, si une ville se densifie elle va limiter sa consommation d’énergie voire la diminuer.
Ils définissent même une forme de "future ville" qui pourrait limiter la dépendance a l’automobile ; une ville avec des densités variées. Densités fortes dans le centre, comme des "villages urbains", moyennes autour, dans des centres secondaires avec des stations de transport en commun, et faibles dans un rayon d'accessibilité en vélo autour des stations, ce qui correspond à la banlieue dont on souhaite limiter l'étendue et augmen-ter la densité.
VINCENT FOUCHIER se demande dans cet ouvrage si l’on peut se suffire de leur étude pour réduire la nuisance de l’automobile par la densifica-tion urbaine.Ce livre étudie le cas de l’ILE-DE-FRANCE en répondant à la question sui-vante: "Peut-on confirmer les avantages supposés des fortes densités à l'égard des principes du développement durable ?"
Il développe son étude en trois parties, la densité et la consommation d’espace en ILE-DE-FRANCE, les fortes densités et la mobilité, et l’impact écologique et les fortes densités.
• DENSITÉ ET CONSOMMATION D’ESPACE EN ILE-DE-FRANCEDense: qui rassemble beaucoup d'éléments en peu d'espace. Le terme densité ne possède pas de réelle définition en urbanisme. Il n’est pas vraiment possible de la qualifier de forte ou faible car il n’existe aucun référent. Beaucoup de termes se rapportent à la notion de densité et pour tous il en est de même que pour le terme de densité, il n’existe aucun référent, tout change selon l’échelle utilisée. VINCENT FOUCHIER définit dans cette première partie tous les termes nécessaires à la com-préhension de son étude.
• FORTES DENSITÉS ET MOBILITÉLes densité plus ou moins élevées se traduisent sur le fonctionnement des transports et la longueur des déplacements. Plus on s'éloigne du centre, plus la voiture devient un choix "nécessaire", ou plus avantageux, car il y plus de stationnement (et il est moins coûteux), et moins de trans-ports en commun.Le taux de motorisation augmente au fur et à mesure des années, ce qui a amené à une automobile individuelle plus que familiale.La taille des villes est historiquement liée à la capacité de déplacement, le mode de déplacement, les moyens de communication et l’organisation socio-économique.
Les systèmes de transport de plus en plus performants ainsi que les contacts et échanges devenus possible à distance par les moyens de communications permettent un éloignement croissant des centres ville.Avant, la proximité n’était possible que part la densité et la mixité, au-jourd’hui elle est plus temporelle, voir psychologique, et beaucoup moins spatiale.
Chacun cherche a tirer parti au maximum des opportunités spatiales sous deux contraintes : budget et temps. La contrainte saturée en pre-mier selon les gens amène un degré de mobilité. Pour PAUL VIRILIO, le temps l’emporte maintenant sur l’espace.
La géographie est bouleversée, ville et densité ne sont plus les seules réponses spatiales à la demande sociale d'interaction.
DENSITÉS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• IMPACT ÉCOLOGIQUE DES FORTES DENSITÉS Une chose est évidente, la densité de développement urbain réduit son étalement. Cependant cela ne signifie pas que la densification suffit pour réduire l’usage de l’automobile. Les surfaces commerciales ou les équipements sportifs, scolaire et culturels ont une importance non né-gligeable, leur localisation par rapport aux transports en commun et aux autres quartiers est très importante. L’éclatement des fonctions dans la ville, plus que son étalement spatial ou son intensification a de lourdes conséquences sur les déplacements. Il faut s’intéresser aux caractéris-tiques qualitatives de l’urbanisme plus qu’à son étendue géographique du point de vue quantitatif. Créer des centralités commerciales ou ré-créatives sans cohérence avec les centralités de transport en commun accru la dépendance à l’automobile. La densité et la mixité sont donc les deux éléments qui doivent être combinés pour permettre le développe-ment des transports en commun ainsi que la marche à pied ou le vélo.
On peut observer plusieurs paradoxes :
• Les habitantes des communes de faibles densités parcourent des distances plus longues que ceux des fortes densités mais ont un temps de transport globalement plus court. L’éloignement est géo-graphique mais pas temporel.
• • Les habitants des communes de faibles densités sont plus dépen-
dants de la voiture et consomment plus d’énergie et produisent plus de pollution, mais ce ne sont pas eux qui en subissent le plus les conséquences.
• • Le taux de motorisation par habitant ou par ménage est plus faible
dans les fortes densité, cependant la densité urbaine fait que la densité d’automobiles est supérieure dans les communes a fortes densités que dans celles à faibles densités.
De nos jours cependant la situation continue de s’aggraver, la consom-mation d’espace se poursuit et la longueur des distances augmente tou-jours.
Au final, VINCENT FOUCHIER constate que les densités ont de réelles im-plications en terme de développement durable dans les deux domaines, consommation d’espace et conséquences environnementale de la mo-bilité.
Mais cette conclusion ne peut pas amener à une solution parfaite, d'autres éléments devant être pris en compte.
La demande croissante de nature dans la ville amène une urbanisation plus étendue, en même temps, densifier les espaces urbains pour sauver les espaces naturels périphériques risque d’amener la suppression d'es-paces libres, ce qui est critère de départ des individus des fortes densités pour aller vers faibles densités.
Le progrès des vitesses de déplacement modifie la notion de proximité, elle n’est plus mesurée en distance mais en temps. La vitesse permet de maintenir la proximité en s'affranchissant de la densité.
Densifier pour réduire la pollution peut avoir pour conséquence une concentration supplémentaire des pollutions dans les fortes densités.
La densité n’est donc pas une solution unique et parfaite mais un point important auquel il faut ajouter de nombreux autres éléments.
FOUCHIER, Vincent, 1998 : Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l’Ile de France et des villes nouvelles, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GROUPE CENTRAL DES VILLES NOUVELLES, 211p.SAINT-EXUPERY, Antoine de, 1943 (1999) : Le Petit Prince, Editions GAL-LIMARD/Folio, 93p.KENWORTHY, Jeffrey; LAUBE, Felix; RAAD, Tamim ; POBOON, Chamlong ; GUIA, Benedicto, 2000 : An international sourcebook of automobile dependence in cities, 1960-1990, BOULDER, USA, Editions UNIVERSITY PRESS OF COLORADO. NEWMAN, Peter, et KENWORTHY, Jeffrey,1989 : Cities and Automobile Dependence. An international Sourcebook, Editions GOWER TECHNICAL, SIDNEY. SOULAS, Claude, et PAPON, Francis, 2003 : Les conditions d’une mobi-lité alternative à l’automobile individuelle, in RÉALITÉS INDUSTRIELLES novembre 2003. WIEL, Marc,1999 : La transition urbaine ou le passage de la ville pédestre à la ville motorisée, Editions PIERRE MARDAGA, 149 p.
AAC015-0594 AAC015-0595
BONIFACE MarineRIBOULET, Pierre, 1998 : Onze leçons sur la composition urbaine, Édi-tions Presses de l’école nationale des ponts et chaussées.
L’architecte français PIERRE RIBOULET né à SÈVRES en 1928, nous offre, ici, sa vision sur la composition urbaine. Il met en lumière dans son livre "Onze leçons sur la composition urbaine" la nécessitée d’une composi-tion des formes et l’impact qu’elle produit. Pour lui, deux mots clés guide notre lecture :• Une composition qui connote un attribue esthétique. L’action d’une
seule personne.• Une ville générée par des pratiques sociales. L’action induite pour
une collectivité. C est le contenant de rapports sociaux dans une enveloppe matérielle, elle est issue d’accumulation de traces. L’es-pace est appropriable à souhait.
En perpétuel mouvement, elle se transforme, se renouvelle, s’agrandit... Elle est vivante on y rentre, on en sort, on la traverse. Il existe plusieurs modes de représentations de la ville-objet ; elle peut être ouverte sur les alentours, fermée et autonome ou tenue, régis par l’état.
En fonction d’un besoin, d’une demande elle peut donc s’apparenter à différentes formes.
La morphologie urbaine prend alors tout sons sens.
L’accumulation, la superposition, la recomposition urbaine crée une image redoutée. La population reste craintive quant à ‘l’idée d’agrandis-sement urbain, qui engendrerai multiples nuisances (bruit...).
La question d’une taxe financière unique est lancé permettant de dissua-der les futurs projets. Selon l’INSEE, celle-ci existerai déjà sous le nom de, taxe professionnelle unique et permettrai de ralentir l’accroissement urbain.
En résumer la ville n’est qu’une projection d’une demande à satisfaire, il s’agit de la théorie du reflet.
RIBOULET, Pierre, 1998 : Onze leçons sur la composition urbaine, Éditions Presses de l’école nationale des ponts et chaussées.
ÉLÉMENTS DU TISSUS URBAIN
RIBOULET, Pierre, 1998 : Onze leçons sur la composition urbaine, Édi-tions Presses de l’école nationale des ponts et chaussées.
AAC015-0594 AAC015-0595
GRIGONE LasmaDELEUZE, Gilles et GUATTARI, Felix, 1972 : L'Anti-Oedipe: Capitalisme et Schizophrénie, Nouvelle édition augmentée, Éditions de MINUIT.
It presents an analysis of human psychology, economics, society, and his-tory, showing how "primitive", "despotic", and "capitalist regimes" differ in their organization of production, inscription, and consumption. It de-scribes how capitalism channels all desires through an axiomatic money-based economy, a form of organization that is abstract, rather than local or material.
KEY CONCEPTS1 - THE FAMILY AS THE FIRST CELL OF THE FASCIST SOCIETYAnd not only historical fascism, the fascism of HITLER and MUSSOLINI [...] but also the fascism in us all, in our heads and in our everyday behavior, the fascism that causes us to love power, to desire the very thing that dominates and exploit us.In the family, the young develop in a perverse relationship, wherein they learn to love the same person that beats and oppresses them. The family therefore constitutes the first cell of the fascist society, as they will carry this love for oppressive figures in their adult life. DELEUZE and GUAT-TARI's book, in its analysis of the dynamics at work within a family, con-sist in the "tracking down of all varieties of fascism, from the enormous ones that surround and crush us to the petty ones that constitute the tyrannical bitterness of our everyday lives".2 - DESIRING MACHINES & SOCIAL PRODUCTIONMICHEL FOUCAULT writes in the introduction, "...Anti-Œdipus is an in-troduction to the nonfascist life."[3] Where capitalist society trains us to believe that desire equals lack and that the only way to meet our desires is to consume, Anti-Œdipus has a different take: desire does not come from lack, as in the freudian understanding. On the contrary, desire is a productive force. "It is not a theater, but a factory". The opposition to the notion of lack is one of the main criticisms DELEUZE and GUATTARI make both to FREUD and MARXISM. Desire is a productive, real force — whereas psychoanalysis limits desire to imaginary fantasies.They oppose an "inhumane molecular sexuality" to "molar" binary sexu-ality: "making love is not just becoming as one, or even two, but becom-ing as a hundred thousand." DELEUZE and GUATTARI's concept of sexual-ity is not limited to the connectivity of just male and female gender roles, but by the multi-gendered flows that a "hundred thousand" .3 - BODY WITHOUT ORGANSIn "L'Anti-Oedipe: Capitalisme et Schizophrénie ", DELEUZE and GUAT-TARI begin to develop their concept of the BwO - body without organs, their term for the changing social body of desire. Since desire can take on as many forms as there are persons to implement it, it must seek new channels and different combinations to realize itself, forming a BwO for every instance. Desire is not limited to the affections of a subject.4 - TERRITORIALIZATION/DETERRITORIALIZATIONAlthough (like most Deleuzo-Guattarian terms) deterritorialization has a purposeful variance in meaning throughout their oeuvre, it can be roughly described as a move away from a rigidly imposed hierarchical, arborescent context, which seeks to package things (concepts, objects, etc.) into discrete categorised units with singular coded meanings or identities, towards a zone, where meanings and operations flow freely between said things, resulting in a dynamic, constantly changing set of interconnected entities with fuzzy individual boundaries.
Importantly, the concept implies a continuum, not a simple binary - every actual assemblage (a flexible term alluding to the heterogeneous com-position of any complex system, individual, social, geological) - is marked by simultaneous movements of territorialization (maintenance) and of deterritorialization (dissipation).
SOURCES UTILIZE:DELEUZE, Gilles et GUATTARI, Felix, 1972 : L’Anti-Oedipe: Capitalisme et Schizophrénie, Nouvelle édition augmentée, Éditions de MINUIT.http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Anti-%C5%92dipe - Françaishttp://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Anti-%C5%92dipe – Englishhttp://www.madinin-art.net/freud/index.html
ANTI - OEDIPE
AAC015-0596 AAC015-0597
BIBLIOGRAPHIE
• ALBERTI, Léon Battista, 2004 : De re aedificatoria (L’art d’édifier) , traduction du latin par CAYE, Pierre et CHOAY, Françoise, Éditions SEUIL, Collection SOURCES DU SAVOIR. ### AAC015-0591• AMPHOUX, Pascal, 1996 : Le sens du lieu, in Le sens du lieu, Editions Ousia, BRUXELLES . ### AAC015-0586• BENJAMIN, Walter, 2000 : Sens unique, précédé d’une enfance berli-noise, Editions 10/18. ### AAC015-0593• BON, François, 1991 : L’Enterrement, Éditions VERDIER. ### AAC015-0587• BON, François, 1996 : Parking, Éditions MINUIT. ### AAC015-0587• BON, François, 2000 : Paysage fer, Éditions VERDIER. ### AAC015-0587• BRISSON, Jean-Luc, 2000 : Le jardinier, l’artiste et l’ingénieur,Article de CORAJOUD, Michel , Editions de l’Imprimeur , Collection JARDINS ET PAYSAGES. ### AAC015-0577• CERDA, Ildefons, 1867 : Teoría General de la Urbaniza-ción. ### AAC015-0584• CERVER, Francisco Asensio, 1998 : Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, ARCO EDITORIAL, BARCELONA. ### AAC015-0580• CHERRY, Marc, 2004 : Desperate housewives, ABC. ### AAC015-0588• CHOAY, Françoise, 1997 : in Mémoire et Projet, Direction de l’Archi-tecture , Paris. ### AAC015-0591• CLEMENT, Pierre et RUTH, Sabine, 1995 : De la densité qui tue à la densité qui paye. La densité comme règle et médiateur entre po-litique et projet, in Les Annales de la Recherche Urbaine n°67 - juin 1995. ### AAC015-0584• DELEUZE, Gilles et GUATTARI, Felix, 1972 : L’Anti-Oedipe: Capita-lisme et Schizophrénie, Nouvelle édition augmentée, Éditions de MI-NUIT. ### AAC015-0596• DEVILLERS, Christian, 1994 : Le projet urbain, Éditions du PAVILLON DE L’ARSENAL, Collection LES MINI PA, Paris. ### AAC015-0591• DIDEROT, Denis et D’ALEMBERT, Jean Le Rond, 1779 : Encyclopédie, dictionnaire raisonné des sciences des arts et métiers». ### AAC015-0590• ERNAUX, Annie, 1983 : La Place, PARIS, GALLIMARD. ### AAC015-0587• FOUCHIER, Vincent, 1998 : Les densités urbaines et le dévelop-pement durable : le cas de l’Ile de France et des villes nouvelles, SE-CRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GROUPE CENTRAL DES VILLES NOUVELLES, 211p. ### AAC015-0594• GROSJEAN, Michèle et THIBAUD, Jean-Paul, 2001 : L’espace urbain en méthodes, Éditions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MAR-SEILLE. ### AAC015-0589• HAUMONT, Nicole, 2001 : L’habitat pavillonnaire, Edition L’HARMAT-TAN, Collection HABITAT ET SOCIÉTÉS, 115p. ### AAC015-0588• KENWORTHY, Jeffrey; LAUBE, Felix; RAAD, Tamim ; POBOON, Chamlong ; GUIA, Benedicto, 2000 : An international sourcebook of au-tomobile dependence in cities, 1960-1990, BOULDER, USA, Editions UNI-VERSITY PRESS OF COLORADO. ### AAC015-0594• LE CORBUSIER, 1923 : Vers une architecture, Paris. ### AAC015-0578• LINDSEY, Bruce, 2001 : Digital Gehry, Material Resistance and Digital Construction, Turin, BIRKHÄUSER. ### AAC015-0578• LOOS, Adolf, 1908 : Ornament und Verbrechen. ### AAC015-0578• MALDINEY, Henri, 1996 : Topos-Logos-Aisthèsis, in Le sens du lieu, Editions Ousia, BRUXELLES ### AAC015-0586• MALGOR, Didier , 2005 : L’art et la ville maritime, Montpellier, Édi-tions ACTULAB, LABORATOIRE DE RECHERCHE DE L’ESBAMA, École supé-rieure d’Art de Montpellier Agglomération. ### AAC015-0576• MANGEMATIN, Michel , NYS, Philippe et YOUNES, Chris, 1996 : Le sens du lieu, Editions Ousia, BRUXELLES. ### AAC015-0586• MARZLOFF, Bruno, 2005 : Mobilités, trajectoires fluides, Biblio-thèque des Territoires. ### AAC015-0585• MASSU, Claude, 1993 : L’architecture de l’école de Chicago, Dunod, Paris. ### AAC015-0578• MERLIN, Pierre, 1994 : La croissance urbaine, Editions Presses Uni-versitaires de France PUF, Collection QUE SAIS-JE ?. ### AAC015-0582• MVRDV, 1998 : FARmax, Editions 010 Uitgeverij. ### AAC015-0582• NEWMAN, Peter, et KENWORTHY, Jeffrey,1989 : Cities and Automo-bile Dependence. An international Sourcebook, Editions GOWER TECHNI-CAL, SIDNEY. ### AAC015-0594
• PANERAI, Philippe, 2002 : Analyse urbaine, Éditions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE. ### AAC015-0593• PANERAI, Philippe et MANGIN, David, 2006 : Projet urbain, Éditions Parenthèses - Collection EUPALINOS, Marseille. ### AAC015-0588• PAQUOT, Thierry, 2000 : La ville et l’urbain, l’état des savoirs, Édi-tions LA DÉCOUVERTE, Collection TEXTES À L’APPUI . ### AAC015-0584• PERON, René, 2004 : Les boites, Éditions ATALANTE, Collection Comme un Accordéon. ### AAC015-0587• RACINE, Pierre, 1980 : Mission impossible ? L’aménagement touris-tique du littoral du Languedoc-Roussillon, Éditions Midi-Libre, collection Témoignages, Montpellier293 p. ### AAC015-0576• RIBOULET, Pierre, 1998 : Onze leçons sur la composition urbaine, Édi-tions Presses de l’école nationale des ponts et chaussées. ### AAC015-0595• ROJAS, Rodrigo Vidal, 2002 : Fragmentation de la ville et nouveaux modes de composition urbaine, Editions L’Harmattan. ### AAC015-0592• RONCAYOLO, Marcel, 2002 : Lectures de villes : formes et temps , Édi-tions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE. ### AAC015-0592• SAINT-EXUPERY, Antoine de, 1943 (1999) : Le Petit Prince, Editions GALLIMARD/Folio, 93p. ### AAC015-0594• SITTE, Camillo, 1996 : L’art de bâtir les villes, Éditions du SEUIL, Col-lection POINTS ESSAIS. ### AAC015-0590• SOULAS, Claude, et PAPON, Francis, 2003 : Les conditions d’une mo-bilité alternative à l’automobile individuelle, in RÉALITÉS INDUSTRIELLES novembre 2003. ### AAC015-0594• STEINMANN, Martin, 2001 : Matière d’Art : Architecture contempo-raine en Suisse, Centre Culturel Suisse à Paris / ITHA Institut de Théorie et d’Histoire de l’Architecture de LAUSANNE , BIRKHÄUSER. ### AAC015-0587• SULLIVAN, Louis , 1918 : Kindergarten Chats and Other Writings, New York, DOVER PUBLICATIONS, 1979. ### AAC015-0578• SULLIVAN, Louis , 1924 : The Autobiography of an Idea, New York, DOVER PUBLICATIONS, 1956. ### AAC015-0578• WIEL, Marc,1999 : La transition urbaine ou le passage de la ville pédestre à la ville motorisée, Editions PIERRE MARDAGA, 149 p. ### AAC015-0594• ZOLA, Emile, 1883 : Au bonheur des dames. ### AAC015-0587
AAC015-0598 AAC015-0599
EXPOSITIONS
• RAMPERT, Francis et APPEL-MULLER, Mireille, 2003 : Bouge l’archi-tecture, Villes et Mobilités, Catalogue d’exposition publié par ACTAR et l’Institut pour la Ville en Mouvement . ### AAC015-0586
FILMOGRAPHIE
• POLLACK, Sydney, 2006 : Sketches of Frank Gehry, film, ALLEMAGNE et USA, 83’. ### AAC015-0578
AAC015-0598 AAC015-0599
ILLUSTRATIONSLIENS INTERNET
• http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Anti-%C5%92dipe – En-glish ### AAC015-0596• http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Anti-%C5%92dipe - Fran-çais ### AAC015-0596• http://www.madinin-art.net/freud/index.html ### AAC015-0596
• Aéroport Velizy Villa Coublay ### AAC015-0577• ALBERTI, Léon Battista, 2004 : De re aedificatoria (L’art d’édi-fier) ### AAC015-0591• Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASEN-SIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 01 ### AAC015-0580• Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASEN-SIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 02 ### AAC015-0581• Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASEN-SIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 03 ### AAC015-0581• Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASEN-SIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 04 ### AAC015-0580• Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASEN-SIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 05 ### AAC015-0581• Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASEN-SIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 06 ### AAC015-0581• Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASEN-SIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 07 ### AAC015-0580• Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASEN-SIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 08 ### AAC015-0581• Arquitectura del paisaje / Planos de Arquitectura, FRANCISCO ASEN-SIO CERVER, ARCO EDITORIAL, BARCELONA, 1998, 09 ### AAC015-0581• Autoroute A13, 1937 ### AAC015-0577• BENJAMIN, Walter, 2000 : Sens unique, précédé d’une enfance berli-noise, Editions 10/18. ### AAC015-0593• "De la densité qui tue à la densité qui paye. La densité comme règle et médiateur entre politique et projet" - PIERRE CLÉMENT et SABINE RUTH ### AAC015-0585• DIDEROT, Denis et D’ALEMBERT, Jean Le Rond, 1779 : Encyclopédie, dictionnaire raisonné des sciences des arts et métiers». ### AAC015-0590• Digital Gehry, Material Resistance and Digital Construction,BRUCE LINDSEY , Turin, Birkhäuser, 2001. ### AAC015-0578• Digital Gehry, Material Resistance and Digital Construction,BRUCE LINDSEY , Turin, Birkhäuser, 2001. ### AAC015-0579• Digital Gehry, Material Resistance and Digital Construction,BRUCE LINDSEY , Turin, Birkhäuser, 2001. ### AAC015-0579• Exposition - Bouge l'architecture, Villes et Mobilités ### AAC015-0586• HAUMONT, Nicole, 2001 : L’habitat pavillonnaire, Edition L’HARMAT-TAN, Collection HABITAT ET SOCIÉTÉS, 115p. ### AAC015-0588• La ville et l’urbain, l’état des savoirs - Article de THIERRY PAQUOT - Editions La Découverte - Collection Textes à l'appui - 2000 ### AAC015-0584• L’espace urbain en méthodes - Gard du Nord : Accompa-gner ### AAC015-0589• L’espace urbain en méthodes - Rue de la République, Lyon : Obser-ver ### AAC015-0589• Maison modulaire, Jean Prouvé. ### AAC015-0577• PANERAI, Philippe, 2002 : Analyse urbaine, Éditions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE. ### AAC015-0593• PANERAI, Philippe et MANGIN, David, 2006 : Projet urbain, Éditions Parenthèses - Collection EUPALINOS, Marseille. ### AAC015-0588• Pièces d'eau des Suisses, Versailles. ### AAC015-0577• RIBOULET, Pierre, 1998 : Onze leçons sur la composition urbaine, Édi-tions Presses de l’école nationale des ponts et chaussées. ### AAC015-0595• RONCAYOLO, Marcel, 2002 : Lectures de villes : formes et temps , Édi-tions PARENTHÈSES, Collection EUPALINOS, MARSEILLE. ### AAC015-0592• SITTE, Camillo, 1996 : L’art de bâtir les villes, Éditions du SEUIL, Col-lection POINTS ESSAIS. ### AAC015-0590• Topos-Logos-Aisthèsis de H. MALDINEY ### AAC015-0586• "Topos-Logos-Aisthèsis" de H. MALDINEY ### AAC015-0586
AAC015-0600 AAC015-0601
INDEX
AACTAR — AAC015-0586 ACTULAB, LABORATOIRE DE RECHERCHE DE L’ESBAMA — AAC015-
0576 aisthèsis — AAC015-0586 ALBERTI, Léon Battista — AAC015-0591 AMPHOUX, Pascal — AAC015-0586 ANTIGONE — AAC015-0576 anti-Oedipe — AAC015-0596 APPEL-MULLER, Mireille — AAC015-0586 aspect structurel — AAC015-0580 BBARCELONE — AAC015-0576, AAC015-0580 baroque — AAC015-0592 BAUHAUS — AAC015-0578 BENJAMIN, Walter — AAC015-0593 BERGERET, Maxime — AAC015-0584 BESSE, Jean-Marc — AAC015-0577 bien construit — AAC015-0587 BILBAO — AAC015-0578 BON, François — AAC015-0587 BONIFACE, Marine — AAC015-0595 BORDEAU, Anais — AAC015-0591, AAC015-0592 BRISSON, Jean-Luc — AAC015-0577 BwO, body without organs. — AAC015-0596 CCAYE, Pierre — AAC015-0591 CERDA, Ildefons — AAC015-0584 CERVER, Francisco Asensio — AAC015-0580, AAC015-0581 CHERRY, Marc — AAC015-0588, AAC015-0592 CHOAY, Françoise — AAC015-0591 chronomobilité — AAC015-0585 classique — AAC015-0592 CLEMENT, Pierre — AAC015-0584, AAC015-0585 CNRS — AAC015-0587 composite — AAC015-0590 COQUART, Jordane — AAC015-0587 CORAJOUD, Michel — AAC015-0577, AAC015-0586 corinthien — AAC015-0590 DD’ALEMBERT, Jean Le Rond — AAC015-0590 DEBORD, Guy — AAC015-0587 DELEUZE, Gilles — AAC015-0596 démarches — AAC015-0577 DEVILLERS, Christian — AAC015-0591 DIDEROT, Denis — AAC015-0590 doing — AAC015-0578 dorique — AAC015-0590 DUBLIN — AAC015-0584 Eéchelles — AAC015-0577 école de CHICAGO — AAC015-0578 ERNAUX, Annie — AAC015-0587 espaces mitoyens — AAC015-0577 évolution — AAC015-0592 explorer — AAC015-0577 FFed-Ex — AAC015-0585 FEUGERE, Pierre — AAC015-0587 FOCK AH CHUEN, Emilie — AAC015-0593
FONTANA, Laure — AAC015-0593 FONT, Marine — AAC015-0594 FOUCAULT, Michel — AAC015-0596 FOUCHIER, Vincent — AAC015-0594 FRANCE — AAC015-0582, AAC015-0587 FREUD, Sigmund — AAC015-0596 futurisme
futuristes — AAC015-0578 GGARDAIR, Marie — AAC015-0586 GEHRY, Frank Owen — AAC015-0578, AAC015-0579 genèse du projet — AAC015-0577 GRIGONE, Lasma — AAC015-0596 grille — AAC015-0593 GROSJEAN, Michèle — AAC015-0589 GUATTARI, Felix — AAC015-0596 GUIA, Benedicto — AAC015-0594 HHAUMONT, Nicole — AAC015-0588 HAUSSMAN, Georges Eugène — AAC015-0584 HITLER, Adolf — AAC015-0596 HONG KONG — AAC015-0580 IILE DE FRANCE — AAC015-0594 îlot — AAC015-0591 infomobilité — AAC015-0585 in situ — AAC015-0589 instinct animal — AAC015-0588 Institut pour la Ville en Mouvement — AAC015-0586 Iphone — AAC015-0585 ITHA, Institut de Théorie et d’Histoire de l’Architecture de Lau-
sanne — AAC015-0587 JJOHNSON, Philip Cortelyou — AAC015-0578 KKENWORTHY, Jeffrey — AAC015-0594 Lla fontaine de Grenelle — AAC015-0590 LAUBE, Felix — AAC015-0594 LAUSANNE — AAC015-0587 LE CORBUSIER — AAC015-0578 le Potager du roi — AAC015-0577 le square Récamier — AAC015-0577 les salines d’Arc et Senant — AAC015-0582 limites — AAC015-0577 LINDSEY, Bruce — AAC015-0578, AAC015-0579 liquéfier — AAC015-0578 logos — AAC015-0586 LOMBARDI, Steven — AAC015-0580 LOOS, Adolf — AAC015-0578 MMALDINEY, Henri — AAC015-0586 MALGOR, Didier — AAC015-0576 MANGEMATIN, Michel — AAC015-0586 MANGIN, David — AAC015-0588 maquette concept — AAC015-0580 maquettes — AAC015-0580 marxisme — AAC015-0596 MARZLOFF, Bruno — AAC015-0585 MASSU, Claude — AAC015-0578
AAC015-0600 AAC015-0601
MAZARI, Malek — AAC015-0585, AAC015-0586 MAZILLE, Matthieu — AAC015-0582 MERLIN, Pierre — AAC015-0582 MIECAZE, Laurine — AAC015-0592 MIRALLES, Enrique — AAC015-0580 mission Racine — AAC015-0576 modernisme — AAC015-0590 MOLLET — AAC015-0580 MOL, Stephane — AAC015-0590 monolithe — AAC015-0591 MONTPELLIER — AAC015-0576
Port Marianne — AAC015-0576 MUSSOLINI, Benito — AAC015-0596 muthos — AAC015-0586 MVRDV — AAC015-0582 NNEWMAN, Peter — AAC015-0594 NYS, Philippe — AAC015-0586 OOPORTO — AAC015-0580 OUGIER, Camille — AAC015-0580 PPALLOT, Camille — AAC015-0588 PANERAI, Philippe — AAC015-0586, AAC015-0588, AAC015-0593 PAPON, Francis — AAC015-0594 PAQUOT, Thierry — AAC015-0584 PARIS — AAC015-0577 PASQUIER, Jordan — AAC015-0591 paysagisme — AAC015-0577 PERON, René — AAC015-0587 photos — AAC015-0580 pièce urbaine — AAC015-0591 PINOS, Carme — AAC015-0580 POBOON, Chamlong — AAC015-0594 POLLACK, Sydney — AAC015-0578 PONCON, Chloé — AAC015-0589 projet urbain — AAC015-0591 PSA Peugeot Citroën — AAC015-0586 PUIGSEGUR, Erwan — AAC015-0578 puzzle — AAC015-0591 RRAAD, Tamim — AAC015-0594 RACINE, Pierre — AAC015-0576 RAMPERT, Francis — AAC015-0586 RATP — AAC015-0585 réalité spatiale de la ville — AAC015-0592 regard analytique — AAC015-0577 revue
Presses de l’école nationale des ponts et chaussées — AAC015-0595 Réalités Industrielles — AAC015-0594
RIBOULET, Pierre — AAC015-0595 ROCHE, François — AAC015-0580, AAC015-0587 ROJAS, Rodrigo Vidal — AAC015-0592 RONCAYOLO, Marcel — AAC015-0592 RUTH, Sabine — AAC015-0584, AAC015-0585 SSAINT-EXUPERY, Antoine de — AAC015-0594 SAINT GERMAIN, Louis — AAC015-0576 SANTOS-DUMONT, Alberto — AAC015-0577 SANTOS, Paula — AAC015-0580
Seconde Guerre Mondiale — AAC015-0590 Secrétariat général du groupe central des villes nouvelles — AAC015-
0594 SEVRE, Julie — AAC015-0577 Shopping Center — AAC015-0587 SITTE, Camillo — AAC015-0590 skin in — AAC015-0578 SNCF — AAC015-0585 SOULAS, Claude — AAC015-0594 stade Poble Nou — AAC015-0580 STEINMANN, Martin — AAC015-0587 SUISSE — AAC015-0587 SULLIVAN, Louis — AAC015-0578 TTHIBAUD, Jean-Paul — AAC015-0589 TIBERGHIEN, Gilles — AAC015-0577, AAC015-0596 tissu urbain — AAC015-0588 topos — AAC015-0586 toscan — AAC015-0590 transcender — AAC015-0578 Uunité de lieu — AAC015-0591 usines Michelin — AAC015-0582 VVAN DER ROHE, Mies — AAC015-0578 VERSAILLES — AAC015-0577 villages urbains — AAC015-0594 ville — AAC015-0591 ville baroque — AAC015-0592 ville maritime — AAC015-0576 VIRILIO, Paul — AAC015-0594 vision patrimoniale — AAC015-0592 VITRUVE, Marcus Vitruvius Pollio dit — AAC015-0590 WWIEL, Marc — AAC015-0594 WRIGHT, Frank Lloyd — AAC015-0578 YYOUNES, Chris — AAC015-0586 ZZOLA, Emile — AAC015-0587
AAC015-0602 AAC015-0603