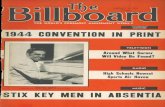3. « La reconstruction de l’hôtel d’Escoville après 1944 : histoire d’un conflit...
Transcript of 3. « La reconstruction de l’hôtel d’Escoville après 1944 : histoire d’un conflit...
Patrice Gourbin
La reconstruction de l'Hôtel d'Escoville après 1944 : histoire d'unconflitIn: Annales de Normandie, 51e année n°1, 2001. pp. 71-95.
Citer ce document / Cite this document :
Gourbin Patrice. La reconstruction de l'Hôtel d'Escoville après 1944 : histoire d'un conflit. In: Annales de Normandie, 51e annéen°1, 2001. pp. 71-95.
doi : 10.3406/annor.2001.1300
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/annor_0003-4134_2001_num_51_1_1300
LA RECONSTRUCTION DE L'HOTEL D'ESCOVILLE
À CAEN : HISTOIRE D'UN CONFLIT (1948-1963)
Avant la Seconde Guerre mondiale, Caen est une ville d'art reconnue et célébrée. Les bombardements alliés de l'été 1944 transforment la ville en champ de ruines et anéantissent, en même temps que la moitié des logements, une grande partie des trésors architecturaux de la ville. Églises, hôtels particuliers, palais, maisons anciennes : tous sont touchés à des degrés divers, certains ont même totalement disparu. La ville mettra quinze ans à se relever des ses ruines, de 1947 à 1963.
Pilotée depuis Paris par le tout-puissant ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU), la reconstruction de la France ne peut se réduire à une simple question comptable de reconstitution des logements détruits. Il est question de modernisation et d'adaptation à la vie moderne, mais aussi de composition urbaine et d'esthétique architecturale. Dans ce programme, les monuments historiques, précieux témoignages de la ville ancienne, ont naturellement une place. La pénurie économique et la volonté de modernisation du ministère de la Reconstruction sont des contraintes incontournables. L'administration des Monuments historiques qui gère ces bâtiments si particuliers et d'un poids symbolique si important devra donc faire des choix : quels bâtiments restaurer ? Comment les restaurer ? Et comment traiter ce qui se construit à proximité ?
À Caen, il existe un monument dont l'histoire de la reconstruction illustre bien la façon dont ces problèmes se sont posés et les réponses qu'on leur a trouvé. C'est l'hôtel d'Escoville, l'un des monuments les plus connus de la ville avant la guerre. Ce palais de la Renaissance construit vers 1530 par un riche négociant caennais comporte quatre corps de bâtiment organisés autour d'une cour somptueusement ornée de bas-reliefs, statues et loggias dans le goût italien (fig. 1). Après les bombardements, le bâtiment est dans un état catastrophique. Les murs extérieurs ont été totalement pulvérisés par les bombes ou sont très endommagés. La façade sur la place Saint-Pierre n'existe plus à l'exception de la travée du porche d'entrée. Seuls les murs intérieurs de la cour semblent intacts (fig. 3). À partir de 1953, l'hôtel d'Escoville est intégré dans un projet de reconstruction moderne. La construction neuve et la restauration « Monument historique » y sont menées conjointement, dans le même temps et le même espace : la confrontation entre patrimoine et modernité est alors inévitable.
Ann. Normandie, 51, 2001, 1
72 P. GOURBIN
<. tr-^i^i^rf^ < ■•.-
Fig. 1 : La cour de l'hôtel d'Escoville avant la guerre. À droite, le portail d'entrée qui ouvre sur la place Saint-Pierre.
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 73
COMPRENDRE LE CONTEXTE : LE GRAND ENSEMBLE « LES QUATRANS »
À ses débuts, le langage architectural de la reconstruction de Caen est « traditionnel » par les formes ( toitures à forte pente , baies verticales ) et par l'alignement des immeubles le long des voies. On évite les îlots totalement fermés pour des raisons d'hygiène, mais l'implantation régulière des bâtiments « en ordre continu » recrée l'espace fermé de la rue traditionnelle.
Sur ces principes l'architecte Henry Delacroix1 propose en 1950 un projet d'immeuble à côté de la maison des Quatrans2. Le volume est traditionnel par les toits d'ardoises mais le service des Monuments historiques refuse le projet car les façades sont trop modernes (vitrages continus par exemple). Deux projets supplémentaires tentent sans succès de répondre aux exigences de la commission3.
Le projet moderne pour l'ensemble des Quatrans, tel qu'il a été réalisé, est en cours d'élaboration à la fin de l'année 1951. Il n'est plus question d'immeubles de type traditionnel mais de barres parallèles organisées sur un ensemble de cinq îlots (fig. 2). Le tout est mis au point sous la responsabilité de l'architecte Henry Delacroix qui devient « chef d'îlot » pour l'ensemble de la zone. Le projet est officiellement présenté le 16 avril 1953.
Un certain nombre de bâtiments classés, et non des moindres, entourent la zone : le château, l'église Saint-Pierre, l'hôtel de Than. D'autres sont directement inclus dans le projet : maison des Quatrans, maisons à pans de bois de la rue Saint-Pierre, hôtel d'Escoville, hôtel de Mondrainville. Le service des Monuments historiques est donc directement concerné. Pour des raisons diverses le traitement des monuments historiques et leur rapport aux bâtiments neufs lui paraît inacceptable. Mais il considère aussi la totalité du projet (l'architecture comme l'urbanisme) comme inacceptable. Le service obtient quelques concessions comme la construction de murs en pierre de taille sur les parties des barres de logement visibles en même temps que les monuments historiques. Mais ce n'est pas suffisant et on va jusqu'à envoyer une délégation chez le ministre de la Reconstruction Maurice Lemaire en
1 Henry Delacroix (1901-1974). Il réalise de nombreux ensembles HLM (ex. 18 à 28 bd Saint-Jacques à Paris, 1954), travaille à la reconstruction de Caen (Ilot I.C. dans le quartier Saint-Jean, ensemble des Quatrans). Il collabore à la construction de la cité des 4 000 à la Courneuve avec Tambuté (1964).
2 La maison des Quatrans est un ancien hôtel particulier du XIVe siècle dont la façade sur rue est à pans de bois. Elle a pris le nom de son constructeur et propriétaire, Jean Quatrans. C'est elle qui donne son nom à l'ensemble d'immeubles « les Quatrans » lors de la reconstruction.
3 Pour une étude détaillée des projets successifs et de l'ensemble de logement Les Quatrans, voir : P. Gourbin, « Le grand ensemble Les Quatrans à Caen : un exemple de l'application de la loi sur les abords des monuments historiques », à paraître dans : Histoire de l'art.
74 P. GOURBIN
château
EU immeubles de commerces (un ou deux niveaux) ES3 monuments historiques
bâtiments première tranche bâtiments deuxième tranche
j constructions existantes
Fig. 2 : Plan masse de l'ensemble de la « zone Quatrans ».
janvier 1954 pour faire modifier le projet en profondeur. En vain. Le chantier des premiers immeubles est ouvert en juin. Malgré tout, le service continue ses protestations, contre l'immeuble de boutiques de la rue Saint- Pierre ou contre la tour de dix étages. Le projet des Quatrans est probablement, pour le service des Monuments historiques, l'affaire la plus conflictuelle des années de Reconstruction. C'est dans ce contexte tendu que prend place le débat autour de la reconstruction de l'hôtel d'Escoville.
La "zone Quatrans" : l'ambition de la modernité
La modernité de l'ensemble d'immeubles « les Quatrans » est inédite dans la reconstruction caennaise. Outre l'aspect des immeubles proprement dit (trame apparente, préfabrication, toits plats), la principale rupture con-
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 75
cerne l'organisation d'ensemble du projet. Jusqu'alors, on dessine des îlots délimités par des rues, puis on construit un à un les immeubles le long des voies. L'ensemble des Quatrans au contraire est constitué de la réunion de cinq îlots dans un seul projet.
L'architecte Henry Delacroix peut alors élaborer un projet global dans lequel il ne se contente pas de la seule construction des bâtiments. Les rues par exemple sont pensées en fonction de la logique d'ensemble. Elles serpentent sous les immeuble et ne sont plus des frontières. Les bâtiments peuvent être à cheval sur plusieurs îlots. Le traitement du sol est un autre exemple : tous les espaces sont publics et accessibles et leur aménagement est intégré dans le plan d'ensemble.
La zone regroupe des bâtiments de nature très différente : des immeubles appelés « IRP » réservés à des petits propriétaires ; des bâtiments construits sur dommages directs pour des propriétaires plus aisés ; des petits commerces, un grand magasin, des hôtels, des administrations et bien sûr des monuments historiques. Mais les différences sociales ou fonctionnelles sont gommées par la logique du projet de Delacroix qui privilégie au contraire l'homogénéisation formelle de toute la zone et l'affirmation de son unité. C'est ainsi qu'à l'intérieur de l'îlot KG, il est prévu une sorte de phagocytose de l'hôtel d'Escoville qui brouille la perception des limites entre l'hôtel et les immeubles qui l'environnent. L'implantation des murs, les formes, le programme, les circulations, le mode de propriété, sont pensés à l'échelle de l'îlot et même de l'ensemble de la zone. Cette volonté de subordonner le monument au projet d'ensemble heurte de plein fouet les souhaits de l'administration des Monuments historiques. Autour de l'hôtel d'Escoville, armés de leurs convictions, de leurs droits et de leur volonté, vont s'affronter les différents acteurs de la reconstruction.
LES HOMMES ET LES LOIS
Deux architectes pour un chantier
II est fréquent que la protection des bâtiments classés ne soit prononcée que pour une partie de l'édifice. Le plus souvent, il s'agit de la façade ou de la façade et des toitures correspondantes. Cette conception fragmentée du bâtiment est systématisée par la loi de la reconstruction : seules les façades sont prises en charge automatiquement par les Monuments historiques même si le bâtiment est classé en totalité4. Les intérieurs ne sont pris en charge que s'ils ont un intérêt artistique ; ils doivent normalement être négociés par le propriétaire avec les services de la reconstruction. Ceux-ci s'occupent des travaux et du financement et appliquent les critères habituels de la recons-
4 Loi du 28 octobre 1946, article 30. Cette loi reprend pour les monuments historiques les principales dispositions de la loi du 12 juillet 1941.
76 P. GOURBIN
truction : modernisation, abattements pour vétusté, non-reconstitution des éléments somptuaires. Deux architectes peuvent donc intervenir dans les travaux de reconstruction des édifices classés. L'architecte en chef des Monuments historiques s'occupe des façades et des couvertures classées, prises en charge par son service. L'autre est choisi librement par le propriétaire et s'occupe des planchers, des charpentes et de l'aménagement intérieur.
À l'hôtel d'Escoville la répartition des travaux entre les deux architectes suit ce schéma à l'origine puis évolue en fonction des rapports de force entre la municipalité propriétaire et les Monuments historiques. En 1944, Marcel Poutaraud est architecte des Monuments historiques pour le Calvados. Étant donnée l'ampleur de la tâche, il est déchargé de plusieurs zones du département au profit d'architectes plus jeunes. En 1949, Charles Dorian lui succède pour la restauration d'Escoville. De son côté, la municipalité, propriétaire de l'hôtel, fait appel pour les parties qui restent à sa charge à l'architecte Paul Binet. Celui-ci est placé sous l'autorité de l'architecte en chef de l'ensemble des Quatrans, Henry Delacroix, qui vérifie la conformité de ses projets avec le plan global de la zone. Henry Delacroix est lui-même placé sous l'autorité de Marc Brillaud de Laujardière, architecte en chef de la ville de Caen.
Les commerçants, les sinistrés, les archéologues
Les emplacements constructibles sont limités du fait du desserrement des constructions et de la plus grande emprise de la voirie. Le nombre des logements possibles en centre-ville est insuffisant et il en est de même pour les commerces. Si les logements peuvent être déplacés en périphérie, dans les « quartiers de compensation », il n'en est pas de même avec les commerces : l'emplacement a une grande importance et ils ne peuvent être transférés sans risques. La restitution du plus grand linéaire commercial possible sera une donnée constante dans l'élaboration du projet. De plus ou moins bon gré, les services de la reconstruction, la municipalité et les Monuments historiques l'intègrent dans leurs calculs. Dans tous les projets pour l'îlot, on prévoit donc des immeubles commerciaux le long des rues, parfois composés d'un simple rez-de-chaussée, parfois surmontés d'étages de logements.
Commerçants ou propriétaires, on ne peut oublier les sinistrés : les baraquements parsèment la ville, et les administrations sont assaillies de demandes d'autorisation pour en construire de nouveaux ou pour occuper des locaux vides. L'urgence de la reconstruction est une toile de fond qui, pour être diffuse, n'en n'est pas moins très forte.
La société savante « les Antiquaires de Normandie », généralement suivie par les autres sociétés savantes de la ville, entretient une autre sorte de pression. Elle réclame à Escoville comme pour tous les monuments de la ville, la reconstitution de l'état originel. La façade sur la place était très
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 11
transformée avant-guerre : les Antiquaires de Normandie demandent malgré tout la construction d'une façade Renaissance. Leur action consiste essentiellement en envois de lettres de protestation aux différentes autorités : municipalité, préfet, ministre, etc. Il est difficile de connaître l'impact des protestations des sociétés savantes et leur poids réel sur l'opinion locale. L'intransigeance des Antiquaires de Normandie entraîne des rapports tendus avec le représentant à Caen du service des Monuments historiques Louis Bourdil, qui tente pourtant d'associer la société aux projets de reconstruction.
Les Monuments historiques : un pouvoir ambigu
L'hôtel d'Escoville est classé. En tant qu'autorité de tutelle, le service des Monuments historiques considère qu'il peut imposer sa conception de la reconstruction du bâtiment. Mais la loi limite son action à la reconstitution ou à la réparation des façades anciennes. Une fois décidée la construction d'une façade moderne, la maîtrise des travaux sur cette partie ne lui appartient plus. La loi de 1943 sur les abords (la façade de l'hôtel d'Escoville fait face à l'église Saint-Pierre, classée) l'autorise bien sûr à refuser un projet pour des raisons esthétiques, mais pas à l'élaborer lui-même5. Les choses se présentent différemment quand le service accepte de payer : à partir d'avril 1951, le directeur de l'architecture René Perchet tente de couper court aux prétentions de la ville en prenant en charge la totalité de la restauration. À partir de ce moment, l'architecte des Monuments historiques fait officiellement des propositions pour la façade sur la place. Dans ce jeu à trois (services de la reconstruction, mairie, Monuments historiques) celui qui paie peut imposer sa volonté. Les crédits étant limités, chaque administration essaie de se décharger du financement tout en gardant la maîtrise de la décision.
Le service des Monuments historiques a deux ambitions pour l'hôtel d'Escoville. La première est de reconstituer approximativement comme le recommande le conservateur Louis Bourdil, les volumes d'avant-guerre. Le service est très réticent à accepter les agrandissements du bâtiment que réclame la municipalité pour y installer de nouveaux services (fig.3). On n'hésite pas cependant à corriger « la compression à laquelle Escoville a dû se soumettre lors de sa construction ». C'est ainsi que la façade sur la place Saint-Pierre est finalement reconstruite à un nouvel alignement, un mètre en avant de l'ancien. L'aile sur la place, très étroite avant-guerre, atteint maintenant une largeur qui permet une utilisation raisonnable des salles qui s'y trouvent. Le nouvel alignement de la façade est parallèle au mur sur la cour et régularise ainsi le plan de cette aile, trapézoïdal avant guerre (fig. 5 et 6).
5 Loi du 25 février 1943. Le service des Monuments historiques étudie les permis de construire dans un rayon de 500 mètres autour des bâtiments classés. Si les projets se trouvent dans le périmètre de visibilité de ceux-ci, les avis émis par le service doivent obligatoirement être pris en compte.
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 79
Fig. 4 : Plan de l'îlot KG et de l'hôtel d'Escoville. En haut, avant la guerre. En bas, proposition en 1953 (non réalisé).
80 P. GOURBIN
La deuxième ambition est de maîtriser la façade de la place Saint-Pierre : non seulement celle de l'hôtel proprement dit, mais aussi tout le front bâti de l'îlot. La façade est conçue comme un élément dans une composition linéaire qui s'étend de la rue Saint-Pierre au boulevard du maréchal Leclerc (fig. 10, 11, 20). De part et d'autre, les immeubles de logement 42 ter et 320 bis doivent idéalement être traités comme des « pavillons » dont l'architecture est semblable à celle, ultra-simplifïée, de l'hôtel. C'est un ensemble aligné et ordonnancé qui forme la façade d'un palais unique. Cette composition symétrique est très loin de l'alignement d'immeubles particuliers qui existait avant-guerre (fig. 3).
LE JAQDIM PUBLIC
PLACE 5- PltBRE
Fig. 5 : Plan au niveau du rez-de-chaussée, Paul Binet, mai 1953. Le trait oblique en arrière de la façade marque l'ancien alignement.
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 81
Un propriétaire jaloux de ses droits : la municipalité
La municipalité, qui est aussi propriétaire, veut maîtriser la reconstruction de son bâtiment, pour décider aussi du programme. Pour cela elle tente d'imposer son architecte, Paul Binet, pour les parties neuves à reconstruire et s'oppose à leur prise en charge par le service des Monuments historiques. La municipalité soutient par contre sans réserves le projet de Delacroix qui intègre l'hôtel d'Escoville dans un grand ensemble d'immeubles modernes.
La Ville veut installer un certain nombre d'administrations dans l'hôtel. Mais l'entassement qu'elle prévoit paraît peu réaliste par rapport au volume de l'édifice. Les administrations prévues sont pour partie celles qui existaient avant-guerre (tribunal des prud'hommes), mais d'autres sont nouvelles et leur choix est inexplicable (mutualité familiale, musée) (fig. 5).
Fig. 6 : Plan du premier étage, Charles Dorian, décembre 1954. Projet en partie réalisé.
82 P. GOURBIN
Une partie du programme au moins est parfaitement claire : de 1949 à 1964, la valeur touristique attribuée à l'hôtel par la municipalité est constante. Le syndicat d'initiative y est prévu dès les premiers projets. Mais l'emplacement prévu est aussi un emplacement commercial. Le local du syndicat d'initiative est donc très étroit pour laisser place à l'installation de commerces dans l'aile sur la place Saint-Pierre. La partie ancienne et intéressante est la cour qu'on ne peut deviner depuis la rue ; on va donc chercher à y remédier. La municipalité, tout au long de l'élaboration du projet, reste très attachée à la solution qui consiste à déboucher les deux arcades murées de l'aile est dans la cour pour faire voir depuis la place les qualités architecturales intérieures (fig. 1, 14 et 16).
Enfin, la volonté d'exercer son droit de propriété n'est peut-être pas étrangère au conflit. Le maire est une forte personnalité, autoritaire et obstiné. Mais l'organisation générale de la reconstruction en France ne donne que peu de place au pouvoir municipal. Le maire, qui s'exprime souvent et parfois avec brutalité sur le remodelage de la ville, n'a pas toujours le rôle central qu'il désire. L'hôtel d'Escoville est propriété de la ville et cela lui donne des droits dont le maire entend user. Le conflit de l'hôtel d'Escoville est donc peut-être aussi un conflit pour le pouvoir.
L'arbitre : le ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme MRU
Le ministère de la Reconstruction est l'organisateur. C'est lui qui répartit les enveloppes financières, y compris celle des monuments historiques : il est l'arbitre des conflits. Les grands principes de construction et de modernisation qu'il impose et met en œuvre sont relativement incontournables
L'hôtel d'Escoville est situé dans un petit îlot entouré de trois rues (fig. 7). L'insertion du bâtiment au cœur d'un îlot pose problème selon les critères de la reconstruction. En effet les règles du prospect rendent impossible la construction d'immeubles hauts à la fois en périphérie et en cœur d'îlot, surtout quand il est de taille réduite comme celui-ci. Reconstruire l'hôtel interdit donc théoriquement la construction d'immeubles le long des rues. Pour les services de la Reconstruction, la meilleure solution serait de laisser les ruines en l'état ce qui permettrait de construire des immeubles alignés sur les voies. Une fois prise la décision de reconstruire l'hôtel, on imagine un compromis pour les « pavillons » 42 ter et 320 bis. Le service Monuments historiques les veut aussi élevés que l'hôtel lui-même. Dérogeant à ses propres règles, le service de la Reconstruction autorise la construction des bâtiments, mais d'un seul étage sur rez-de-chaussée. Il accepte aussi de construire en pierre des immeubles situés à proximité des monuments historiques, y compris au détriment du confort. La réalisation de murs en pierre présente un surcoût non négligeable : le service de la Recons-
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 83
Fig. 7 : L'hôtel d'Escoville dans son contexte urbain d'aujourd'hui vu de la tour de saint-Pierre. A : hôtel de Than ; B : boulevard Maréchal Leclerc ; C : bâtiment 41/320 (grand magasin et logements) ; D et D' : " pavillons " (bâtiments 42 ter et 320 bis) ;
E : hôtel d'Escoville ; F : cour de l'îlot KG ; G : galerie marchande couverte
truction accepte pourtant de prendre en charge ceux des immeubles latéraux de l'hôtel d'Escoville, ainsi que leurs toitures d'ardoises, éléments purement esthétiques sans aucune utilité.
La compétence esthétique du service des Monuments historiques est donc admise, et dans une certaine limite ses exigences sont prises en compte avec une relative bienveillance. Il n'en va pas de même avec la municipalité. Pour elle, Escoville est un échec. Ses exigences de visibilité touristique n'ont pas été retenues. Son programme n'a pas été réalisé. Il est abandonné dès 1953 ; en 1956 le maire se plaint de n'avoir pas été mis au courant du changement de programme6. Même s'il est peu vraisemblable que la Ville n'ait rien su des travaux en cours pendant trois ans, l'épisode est significatif : les décisions sont prises entre le MRU et les Monuments historiques. La municipalité, pourtant propriétaire, est tenue à l'écart.
6 Lettre du maire de Caen, 8 décembre 1956, et réponse de L. Bourdil, 28 décembre 1956, DRAC de Basse-Normandie, dossier hôtel d'Escoville.
84 P. GOURBIN
QUINZE ANNÉES DE CONFLIT
Après les bombardements de 1944, la question de la reconstitution de l'hôtel d'Escoville ou de son maintien à l'état de ruine se pose. En 1948, le comité consultatif des Monuments historiques se décide en faveur de la reconstruction7. Mais pas à l'identique : on cherchera simplement à respecter les grandes lignes de l'état ancien et on évitera le pastiche. Or le premier projet de restitution de la façade que présente l'architecte en chef Poutaraud (fig. 9), est précisément un pastiche. Il est manifestement inspiré de la restitution fantaisiste de Claude Sauvageot de 18678 (fig. 8). La commission supérieure des monuments historiques décide alors de décharger Marcel Poutaraud de l'hôtel d'Escoville pour le confier à un architecte plus jeune, Charles Dorian9.
La décision de reconstruire une « façade moderne de style neutre10 » ne fait pas l'unanimité à Caen. Les sociétés savantes émettent des protestations énergiques. La chambre de commerce, locataire du bâtiment avant la guerre, renonce même à s'y installer pour cette raison en novembre 1949. L'hôtel d'Escoville est en train de devenir un sujet polémique.
En avril 1951 René Perchet est le directeur de l'Architecture, dont dépend le service des Monuments historiques. Il décide la prise en charge financière de toutes les façades : cela donne au service le pouvoir d'imposer son architecte et de décider la forme de la reconstruction11. En décembre Charles Dorian présente un premier projet de façade, toujours très inspiré par la restitution de Sauvageot12 (fig. 10). On lui demande de le simplifier, mais la commission des Monuments historiques trouve très intéressante la proposition de traiter les immeubles latéraux (qualifiés de « pavillons ») dans le même esprit que l'hôtel. Ces deux immeubles de logements doivent être construits et financés par la Reconstruction et ne sont pas du ressort de l'architecte des Monuments historiques.
Du côté de la ville, on n'a pas renoncé à maîtriser la reconstruction de l'hôtel d'Escoville. L'architecte Paul Binet est engagé en août 1949 à cette fin ; la répartition des travaux entre les deux architectes va rester incertaine jusque décembre 1954.
7 Comité consultatif, 8 novembre 1948, M.P. 81/14/140/78. 8 Publiée dans : Claude Sauvageot, Palais, châteaux, hôtels et maisons de France
du XVe au XVIIIe siècle, Paris, A. Morel, 1867. 9 Commission supérieure 25 février 1949, M.P. 80/16/7. 10 Bulletin de la. Société des Antiquaires de Normandie, tome LI, séance du 5
novembre 1949. 11 Réunion du 5 avril 1951, DRAC, dossier hôtel d'Escoville. 12 Projet présenté lors de la visite sur place de la commission le 10 décembre 51. Le
projet date de janvier 1951 ; celui daté de mars (fig. 1 1) correspond aux désirs de la commission mais ne semble pas lui avoir été présenté.
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 85
Fig. 8 : Proposition de restitution par Claude Sauvageot.
MOTEL D'ËiCOVILLE CAEM .(ALVAaos. fA(AD£ $UR la PLACE STPORE.
Fig. 9 : Projet pour la façade est, Marcel poutaraud, décembre 1948.
86 P. GOURBIN
Fin 1951, la ville fixe un nouveau programme. Depuis la défection de la chambre de commerce en effet rien n'a été décidé à propos de la future utilisation du bâtiment. L'hôtel doit désormais contenir la justice de paix, le conseil des prud'hommes, quatre commerçants, le syndicat d'initiative, la mutualité familiale du Calvados et trois logements pour les gardiens. Ce programme ne peut plus être contenu dans le volume des bâtiments tels qu'ils se présentaient avant-guerre. Jusque 1954, les projets prévoient donc un hôtel considérablement agrandi en hauteur et en largeur pour gagner la place nécessaire (fig. 4,5).
Des confrontations des projets des deux architectes ont lieu au cours de l'année 1953, en mars et avril chez le préfet13. Tous les acteurs sont présents : des représentants de la Reconstruction, l'architecte en chef de la ville, les architectes des Monuments historiques et des représentants du service, le maire ainsi que Bahrman, inspecteur général du MRU. Les deux projets présentés en mars se conforment au projet de Delacroix pour l'ensemble de la zone (fig. 12 et 13). Ils tentent chacun à sa manière une sorte de dialectique entre l'ancien et le moderne. Binet organise une séquence spatiale fortement bipolarisée, entre la façade triomphalement moderne et le somptueux décor renaissance de la cour. Au contraire Dorian incruste dans des volumes modernes un hôtel partiellement reconstitué qui semble émerger d'une gangue de verre et de béton. Lors de la seconde réunion en avril , le projet de Binet est dans le même esprit que ceux de mars (fig. 14). C'est celui de Dorian qui est retenu14, et on lui demande de poursuivre les études.
En mai, Paul Binet envoie tout de même de nouvelles études au service des Monuments historiques (fig. 15 et 16). Coiffé de lourdes toitures, le bâtiment tente une impossible conciliation entre modernité et régionalisme L'architecte semble penser que c'est ce qu'attendent les membres de la commission. Mais ce compromis grotesque est rejeté et c'est de nouveau le projet de Dorian qui est accepté (fig. 17). Il reprend en l'adaptant aux exigences du programme imposé par la mairie les grandes lignes du projet de mars 1951. La façade est en pierre de taille, les percements reprennent le rythme et les proportions de celles d'avant-guerre tout en refusant le pastiche. Le seul décor est constitué par l'encadrement saillant des baies. Il existe aussi une variante avec la réutilisation des vestiges du porche d'entrée. Il n'y a plus de propositions de Paul Binet pour l'extérieur après cette date.
En octobre 1953, Charles Dorian produit une série d'esquisses qui sont comme une récapitulation de toutes les options acceptables par le service des Monuments historiques depuis le maintien à l'état de ruine au milieu d'un jardin jusqu'à l'intégration dans un bloc d'habitation (fig. 18 et 19)15. Quatre
13 6 mars et 16 avril 1953. Comptes rendus : L. Bourdil, lettre du 7 mars, E. Herpe, rapport du 8 juillet , DRAC B.N., dossier hôtel d'Escoville.
14 Je n'ai pu retrouver les dessins de ce projet dans les différents dépôts d'archives. 15 Sur une série de neuf projets au moins, seuls trois sont conservés à la DRAC de
Basse-Normandie (dossier hôtel d'Escoville).
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 87
études de façade par Dorian sont confiées à Binet pour parvenir à un accord. En décembre 1954 l'administration des Monuments historiques réduit autoritairement le programme, en accord avec le préfet. Cela permettra de reconstruire un hôtel d'Escoville dont les volumes seront semblables à ceux d'avant-guerre. On n'y prévoit plus que l'installation de la justice de paix et du syndicat d'initiative (fig. 6). À cette date, la répartition des architectes est définitivement arrêtée : Dorian s'occupe de la façade et Binet des intérieurs. Les projets suivants ne concernent plus que des détails : vitrines du rez-de- chaussée et pavillons latéraux, dont la commission obtient enfin des services de la Reconstruction qu'il soient couverts par des toitures et non des terrasses.
En avril 1956, le devis pour la reconstruction de la façade est approuvé et le démarrage du chantier est prévu pour le mois d'août (fig. 20). Le pavillon de droite, est mis en chantier en novembre 1959, le gros-œuvre de l'ensemble de l'hôtel est achevé en 1960 et on pose les vitres du syndicat d'initiative en mai 1960.
En 1961, la réforme de la justice rend impossible l'installation du tribunal d'instance dans les locaux reconstruits. Le programme est totalement remis en cause. Le contrat de Paul Binet est alors résilié et la ville confie à l'architecte Manson l'aménagement de quatre salles d'exposition et d'un logement de gardien16. En 1962, une cheminée Renaissance provenant du musée des Antiquaires de Normandie est installée dans la grande salle de l'aile aux statues.
En 1963 a lieu à Caen le congrès national des villes reconstruites qui est habituellement considéré comme la fin de la reconstruction caennaise. À cette date, 98% des logements sont reconstruits. Témoignages de la renaissance de la ville meurtrie, les principaux monuments historiques le sont aussi17. C'est ainsi qu'en 1963, l'installation dans ses locaux du syndicat d'initiative marque la fin définitive de la reconstruction de l'hôtel d'Escoville.
LE NOUVEL HÔTEL D'ESCOVILLE : UN MONUMENT HISTORIQUE MODERNE
L 'hôtel d'Escoville qui est ouvert au public en 1963 n'est pas la copie de celui qui existait sur le même emplacement avant la guerre. C'est évident pour la façade sur la place Saint-Pierre. D'autres choix sont moins immédiatement perceptibles, comme le fait que le bâtiment n'occupe pas exactement le même emplacement qu'avant-guerre.
16 Conseil municipal du 26 novembre 1962, A.M. Caen, S.T.T. 195. 17 Des crédits supplémentaires sont accordés à cette occasion par le ministère pour
achever les travaux en cours au château, à Saint-Jean et à l'Abbaye-aux-Hommes. Lettre J.M. Louvel, 18 juillet 1962, DRAC B.N., dossier château.
P. GOURBIN
VILLE EE CAEN
Fig. 10 : Projet pour la façade est, Charles Dorian, janvier 1951.
Fig. 1 1 : Projet pour la façade est, Charles Dorian, mars 1951
X
Fig. 12 : Projet pour la façade est, Paul Binet, mars 1953. Le projet reprend le vocabulaire architectural des immeubles de Henry Delacroix : passages à couvert,
pilotis, porte-à-faux, toit-terrasse, dernier étage en retrait.
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 89
fl ^^^re=^>^^^^^
Fig. 13 : Projet pour la façade est, Charles Dorian, février 1953.
Fig. 14 : Projet pour la façade est, Paul Binet, avril 1953. Les trois arcades de la cour sont démurées : on peut voir la cour intérieure depuis la place.
Fig. 15 : Vue perspective de la façade est, Paul Binet, mai 1953. Le bâtiment porté par des piliers est en saillie sur la place.
90 P. GOURBIN
iesai- basai- ten*- tea?
Fig. 16 : Projet pour la façade est, Paul Binet, mai 1953 (variante). Les arcades de la cour sont démurées et on aperçoit la cour au travers des portes vitrées.
Fig. 17 : Projet pour la façade est, Charles Dorian, juin 1953.
En 1 944 si les murs extérieurs nord et sud ont disparu, la cour intérieure semble intacte. Mais l'hôtel a aussi subi l'incendie et les murs calcinés sont fragilisés. Ils seraient incapables de supporter le poids des planchers et des toitures. On va donc construire une ossature porteuse en béton armé à l'intérieur de la carcasse du bâtiment. Les poteaux sont encastrés dans l'épaisseur des murs anciens et recouverts de plaquettes de pierre qui les rendent indécelables. Cette structure assure la stabilité des parties anciennes conservées et supporte les nouveaux planchers en béton armé et la charpente, elle aussi en béton armé. Cette technique est fréquente dans les années d'après-guerre pour la stabilisation des édifices endommagés.
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 91
Fig. 18 : Plan et perspective de la partie est de l'îlot KG (n° 3), Charles Dorian, sd.
La restauration n'empêche pas l'adaptation à de nouvelles fonctions. C'est ainsi que la grande salle de l'aile nord est dotée de grandes croisées du côté nord qui font face à celles qui existent déjà du côté sud : elle est en effet destinée à abriter la salle d'audiences de la justice de paix. L'alignement nouveau de la façade de la place Saint-Pierre un mètre environ en avant de l'ancien, permet d'obtenir une largeur de l'aile est qui rend possible son utilisation.
92 P. GOURBIN
Fig. 19 : Plan et perspective de la partie est de l'îlot KG (n° 5), Charles Dorian, sd. On a supprimé deux travées de l'aile sur la place pour laisser voir depuis celle-ci
la façade sculptée de "l'aile aux statues".
Après avoir réussi à obtenir l'entière responsabilité de la reconstruction du bâtiment, le service des Monuments historiques cherche à tout prix à faire des économies sur la restauration. Les financements accordés par le MRU sont très insuffisants pour couvrir tous les besoins, qui sont immenses. C'est ainsi qu'en janvier 1956, l'inspecteur général des Monuments historiques Ernest Herpe examine le devis de Charles Dorian. Il lui demande la suppression de certains poteaux en béton armé qui lui semblent inutiles. Il regrette que les murs latéraux soient construits en pierre de taille avec des fenêtres à meneaux. Il s'étonne aussi du nouvel alignement de la façade qui oblige au déplacement de la porte d'entrée. L'architecte doit négocier. Il
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 93
accepte de réduire l'épaisseur des murs mais réussit à maintenir tout le reste. Le deuxième étage de la lucarne à deux niveaux du gros pavillon qui éclaire une pièce pratiquement inaccessible n'est pas restitué dans sa fonction originelle : c'est une source d'économie dans la reconstitution d'une toiture aux volumes assez complexes. Cet esprit d'économie imprègne toute la restauration du bâtiment. Les travaux « à l'ancienne » sont strictement réservés à la restauration des parties d'origine. Les menuiseries en chêne avec vitrages losanges à petit plomb ne garnissent par exemple que les baies anciennes et celles de la salle d'audience tandis que celles des murs modernes sont fermées par des menuiseries ordinaires à grandes vitres. Le dessin des vitraux losanges n'a plus rien à voir avec les vitraux au dessin complexe installés au début du siècle.
Sur la cour, les abondantes superstructures (lanternons, clochetons, lucarnes) avaient été remplacées au XIXe siècle par des copies en pierre plus dure, d'une couleur assez différente de celle de la pierre de Caen. Les restitutions d'après-guerre sont en pierre de Caen18. C'est ainsi que la lucarne de droite de l'aile nord est plus récente que celle de gauche bien qu'elle soit construite avec le matériau d'origine. La statue de génie de droite au-dessus de la statue de David a aussi été restituée. Par contre les murs reconstruits à neuf le sont avec une pierre différente de la pierre de Caen, d'un coût très élevé. Sur la cour, le mur de l'aile sud a été presque entièrement reconstruit et la différence de couleur et de grain de la pierre est assez visible. La couture entre les deux sortes de pierre est aussi très visible à l'intérieur du passage d'entrée. Cette même pierre grisâtre a été utilisée pour la façade sur la place Saint- Pierre. Quelques fragments du porche d'entrée ont été réutilisés dans cette façade ,mais ils sont limités à l'entablement du premier niveau et à quelques fragments sculptés. Tout le reste a été reconstitué.
Fig. 20 : Projet pour la façade est, Charles Dorian, octobre 1955. Projet réalisé.
18 Les devis prévoyaient pourtant de la pierre de Saint-Maximin, plus dure et plus blanche. Devis de remise en état 28 août 58, M.P. 81/14/140/77.
94 P. GOURBIN
La restauration peut aussi être une occasion de restitution archéologique des dispositions anciennes, le plus souvent par la suppression des transformations modernes. Elle est limitée à Escoville à la non-reconstruction de la toiture du petit escalier nord-est (fig. 1). La décision est prise dès 1948 par Marcel Poutaraud qui a trouvé les traces d'une toiture en terrasse. C'est aussi bien sûr une économie supplémentaire.
CONCLUSION
Dans toute la France, la Reconstruction a beaucoup investi dans la restauration des monuments historiques. Ils sont indispensables à la construction mentale, symbolique et esthétique des villes reconstruites. L'ampleur du conflit sur l'hôtel d'Escoville en porte témoignage. Ce passé de pierre reconstruit affirme malgré les destructions la permanence de la ville et sa renaissance.
Les grands principes de reconstruction imposés par le MRU ont aussi été ceux de la restauration des monuments historiques : modernisation, adaptation à la vie moderne, mais aussi pénurie et manque de moyens financiers. Néanmoins, la médiocrité lisse et aride de la façade actuelle de l'hôtel d'Escoville sur la place Saint-Pierre n'était pas une fatalité. Le projet pour l'hôtel d'Escoville préparé par Charles Dorian en mars 1951 est le même, à quelques détails près, que celui d'octobre 1955 qui a été retenu pour la reconstruction définitive. Entre-temps, l'intrusion déjà modernité voulue par Henry Delacroix sur l'ensemble de la zone Quatrans a fait surgir des réponses originales. Mais l'état des rapports de forces n'a pas permis aux projets de mûrir et l'hôtel d'Escoville n'a finalement jamais été qu'un objet conflictuel et polémique. Arbitre des conflits, le MRU a négocié avec le service des Monuments historiques un compromis qui écarte aussi bien les demandes extravagantes de la municipalité que les audaces formelles des architectes. Mais la recherche du consensus a aussi provoqué l'abandon de toute ambition. L'hôtel d'Escoville, la ville de Caen méritaient mieux.
Patrice GOURBIN*
SOURCES
MÉDIATHÈQUE DU PATRIMOINE Dans la série Travaux sont réunies diverses pièces ayant trait aux travaux de restauration ddes bâtiments classés : devis, correspndances, plans. ..Dans cette série ont été consultés les cartons : - 81/14/140/77 et 78 (hôtel d'Escoville)
Cet article est issu d'un mémoire universitaire soutenu en 1999.
La reconstruction de l'hôtel d'Escoville 95
- 81/14/25 (reconstruction ) Procès-verbaux des organes consultatifs : commission (supérieure) des Monuments historiques (1942-1956), délégation permanente (1950-1960) , comité consultatif (1941-1963)
CENTRE DES ARCHIVES CONTEMPORAINES DE FONTAINEBLEAU Plans, devis, correspondances sur le projet Quatrans : - dans la série 81.0690 : articles 69 à 72 et 87 à 91 - dans la série 77.1069 : article 1 107
ARCHIVES MUNICIPALES DE CAEN Série des services techniques: - carton 5 1 8 (quartier des Quatrans) - cartons 195 et 196 (hôtel d'Escoville)
CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BASSE-NORMANDIE - dossier hôtel d'Escoville, dossier îlot des Quatrans.
BIBLIOGRAPHIE BERTAUX Jean- Jacques, Renaissance d'une ville. La reconstruction de Caen,
1944-1963, catalogue d'exposition, Musée de Normandie, Paris, Delpha, 1994, 106 p.
COLL. : « Procès-verbaux des séances mensuelles », Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, tome XLIX au tome LVI, du 3 juin 1944 (!) au 5 mai 1961.
FORDERER Andreas, Deux exemples de l'architecture civile à Caen au XVF siècle: la demeure d'Etienne Duval, la demeure de Nicolas Valois, mémoire de maîtrise de l'université de Paris IV sous la direction de Jean Guillaume, 1996, 83 p. et un volume de documents.
GOURBIN Patrice, Construire des monuments historiques ? La confrontation des monuments historiques et de la modernité dans la reconstruction de Caen après 1944, mémoire de maîtrise de l'université de Paris I sous la direction de Gérard Monnier, 1999, 155 p.
LÉON Paul, La vie des monuments français. Destruction, restauration, Paris, Picard, 1951,584 p.
PERCHET René : « 1939-55: aspects financiers de la conservation des Monuments historiques », Monuments historiques, janvier-mars 1956, n° 1, p. 1-11.
VERDIER Paul : « 1939-55: la législation et l'organisation du service », Monuments historiques, avril-juin 1955 n°2, p.49-56, et octobre-décembre 1955 n°4,p. 145-154.
VOLDMAN Danièle, La reconstruction des villes françaises. Histoire d'une politique, Paris, l'Harmattan, 1997, 487 p.