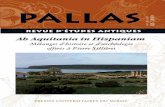2011b. “Sur les reconstructions berbères et afro-asiatiques”, in Parcours berbères, Mélanges...
Transcript of 2011b. “Sur les reconstructions berbères et afro-asiatiques”, in Parcours berbères, Mélanges...
SUR LES RECONSTRUCTIONS BERBERES ET AFRO-ASIATIQUES
Abdelaziz ALLATI Université Abdelmalek Essaadi Maroc
Les traces des structures linguistiques fossilisées dans les couches toponymiques berbères anciennes et leurs vestiges conservés dans les variétés modernes de cette langue permettent d’accéder à un ensemble de traits caractéristiques du proto-berbère et de déterminer les différents stades évolutifs de cette langue et le type d’évolution qu’elle a subi (cf. Allati, 2002, 2006, 2008, 2009). Ces reconstructions berbères ne sont sans doute pas sans influence sur la façon d’appréhender les éléments vestigiels des stades anciens conservés dans les autres branches afro-asiatiques et, d’une façon générale, les traits structurels supposés proto-afro-asiatiques ainsi que le type d’évolution que cette famille aurait subie. Comment le proto-afro-asiatique et son évolution apparaissent à partir du point où en sont les reconstructions berbères ? Pour des raisons de clarté et pour poser quelques jalons facilitant des discussions fructueuses, je voudrais y répondre sous forme d’un ensemble de points présentés de façon succincte.
I. L’afro-asiatique I.1. Les reconstructions afro-asiatiques accusent un grand retard. La phonologie proto-afro-asiatique a fait l’objet de plusieurs propositions de reconstruction qui sont non seulement différentes les unes des autres, mais également très divergentes (cf. Greenberg, 1958 ; Cohen, 1968 ; Diakonoff, 1965, 1988, 1992 ; Orel et Stolbova, 1995 entre autres). Les désaccords sont tels dans ce domaine qu’on a autant de propositions que de chercheurs (cf. idem.). Si bien que l’on ne peut que souscrire à cette conclusion d’Orel et Stolbova : « historical and comparative phonology of Hamito-Semitic is terra incognita no more » (Orel et Stolbova, 1995 : XV).
Le tableau est encore plus sombre quant à la morphologie et la syntaxe proto-afro-asiatiques. On postule que la morphologie proto-afro-asiatique est flexionnelle, mais on n’est pas encore en mesure, dans l’état actuel de la recherche, d’en reconstruire les traits généraux et, encore moins, les particularités. Tout au plus postule-t-on quelques éléments supposés proto-afro-asiatiques tels que les marques du genre, les deux types de conjugaison, le système verbal, etc. (cf. Diakonoff, 1965, 1988 ; Cohen, 1984, 1989 entre autres).
66 Abdelaziz ALLATI
On postule de même que la syntaxe proto-afro-asiatique est de type ergatif (cf. Diakonoff, 1988 : 111), mais nous n’en savons rien de plus, ni sur les caractéristiques de cette ergativité syntaxique originelle, ni sur ses liens avec celle qui lui a succédé, i.e. la construction accusative qui est prédominante dans les autres membres de cette famille. On ne va généralement pas au delà du constat de l’ordre des mots dans les différents groupes de cette famille : VSO dans le sémitique (dont notamment les langues anciennes et classiques), dans l’égyptien et le berbère ; SOV dans les langues couchitiques ; SVO dans la plupart des langues tchadiques.
On attribue habituellement le retard qu’accusent les études diachroniques afro-asiatiques au fait que quatre branches sur six (le berbère, les langues couchitiques, les langues tchadiques, l’omotique) ne sont connues que par leurs formes modernes − relatant un état ancien du berbère, les inscriptions libyques ne sont pas encore déchiffrées et ne sont donc pas exploitables d’un point de vue historique. Plusieurs millénaires séparent ces branches des langues sémitiques anciennes (dont l’akkadien) et de l’égyptien, ce qui rend les comparaisons infructueuses – on compare des états de langues séparés par plusieurs millénaires. Mais bien des faits montrent que cet élément n’est pas, à l’encontre de ce l’on croit, le seul responsable de la situation des recherches dans ce domaine (cf. Allati, idem). I.2. La « sémitisation » des reconstructions afro-asiatiques est le principal responsable du retard que celles-ci accusent. En raison, d’une part, de la situation des quatre autres branches susmentionnées qui ne sont connues que par leurs formes modernes et, d’autre part, de l’état des documents égyptiens dont l’exploitation historique est plus difficile, le sémitique dont on dispose des documents anciens permettant d’accéder à une profondeur historique notable (les données anciennes sur l’akkadien remontent au troisième millénaire avant J. C. et s’étalent sur près de trois millénaires) est très tôt devenu le joyau de cette famille dont les traits structurels ont constitué la base des reconstructions afro-asiatiques.
A cause de ces documents qui ont permis aux études historiques sémitiques de réaliser un progrès notable (comparable à celui des branches indo-européennes les mieux connues), ce groupe linguistique ou plutôt son état le plus ancien se présentait, au début des reconstructions afro-asiatiques, non seulement comme la branche où serait/pourrait être conservé le proto-afro-asiatique, mais comme le proto-afro-asiatique lui-même. Les traits structurels sémitiques sont ainsi extrapolés au proto-afro-asiatique: « l’état connu par le sémitique est aussi l’état chamito-sémitique. » (Cohen, 1947 :
Sur les reconstructions berbères et afro-asiatiques 67
59). En dépit des importantes contributions émanant de divers horizons et des connaissances accumulées depuis dans ce domaine (cf. Diakonoff, 1965, 1988, entre autres), cette position y reste prédominante ou, du moins, elle n’a pas été remise en question.
En outre, les traits structurels prédominants du stade le plus ancien du sémitique sont non seulement transférés au proto-afro-asiatique, mais ils servent également de base pour interpréter les résidus des stades antérieurs conservés dans l’état le plus ancien de ce groupe, dans ses stades ultérieurs et dans les autres branches (cf. Allati, 2002, 2006, 2008). Erigés au stade originaire ou proto-afro-asiatique, ces traits ou leurs formes évoluées (éléments phonologiques, morphologiques, syntaxiques, lexicaux …) devraient/doivent être attestés dans les autres membres de cette famille. C’est pourquoi l’objectif des études diachroniques afro-asiatiques se limite à la recherche des moyens et des mécanismes pour y ramener les différences structurelles − très nombreuses! − attestées dans les autres branches de cette famille. Les reconstructions du proto-afro-asiatique passeraient par le fait de ramener ces différences attestées dans les autres branches aux traits dominants caractérisant le stade le plus ancien et connu du sémitique. Si, par exemple, le berbère n’a pas les mêmes consonnes − celles de l’arrière de la gorge notamment − que le sémitique, s’il n’a pas le même type d’unité de classement lexical (la racine trilitère), le même procédé de formation du lexique (les schèmes), le même type de conjugaison, la même structure aspectuelle … que ce groupe linguistique, c’est qu’il aurait connu une réorganisation profonde où les actions conjuguées notamment de l’usure phonétique et des innovations spécifiques et locales lui auraient fait perdre ses traits structurels originaires (perte des pharyngales et des laryngales, réduction des trilitères aux bi- et monolitères, système de schèmes délabré, etc.) correspondant à ceux du sémitique.
Encouragée par les correspondances – tout à fait prévisibles! − entre les différents membres afro-asiatiques et le sémitique, la recherche des moyens pour étendre les traits structurels de ce groupe linguistique aux autres branches a donné lieu à un type d’évolution où le sémitique est le point de départ et d’arrivée. Les variations que renferment les correspondances entre les différentes branches de cette famille sont replacées sur l’axe temporel et interprétées d’un angle historique dont le point de départ est constitué par les traits structurels caractérisant le sémitique, ce qui rend plausible et justifierait ce type de reconstruction – qu’on ne peut facilement démystifier! Constituant des éléments à comparer et qui devraient, de ce fait, être considérés sur le même niveau, ces correspondances sont ordonnées sur un
68 Abdelaziz ALLATI
axe évolutif (cf. Bomhard et Kerns, 1994 : 110) allant du sémitique aux autres branches de cette famille qui sont considérées comme des formes détériorées, altérées … de ce groupe linguistique. Cette évolution et l’axe historique sur lequel sont placées les langues afro-asiatiques ont conduit les études diachroniques à une véritable impasse de laquelle elles ne sont pas encore revenues.
II. Le berbère II.1. De quelques traits linguistiques proto-berbères La morphologie proto-berbère diffère totalement de la morphologie flexionnelle postulée proto-afro-asiatique (cf. plus haut). La base de la formation du mot en proto-berbère est une unité lexicale monosyllabique (vc et cvc) dont les unités constitutives (les consonnes et les voyelles) sont radicales. Diakonoff a postulé deux unités similaires pour le proto-afro-asiatiques (*cv, *cvc) qui ne diffèrent des formes proto-berbères que par le premier élément (*cv) qui est pourtant attesté, dans cette langue, comme forme élidée de *cvc (cf. Allati, idem). La composition et la réduplication constituent les procédés de base de la formation du mot dans ce stade linguistique (cf. idem. § II). L’agglutination y est le mode d’adjonction des affixes grammaticaux aux unités lexicales. Les places des bases lexicales dans la formation des mots et celle des affixes grammaticaux n’y sont pas fixes (cf. idem).
Etant de type ergatif, la construction syntaxique proto-berbère, quant à elle, correspond à celle qui est postulée proto-afro-asiatique. Dans le proto-berbère, le prédicat d’existence (PE), le noyau de l’énoncé, pose l’existence d’un fait, d’une situation … c’est-à-dire exprime un état, une qualité, etc. (cf. idem et Allati, 2008). Il ne contient pas, en lui-même, d’éléments qui l’orientent par rapport à ses déterminants (sujet/agent, patient/non agent) et est obligatoirement attesté avec son actualisateur ou prédicateur (*ak) dont la place n’est pas fixe:
*ak (actualisateur/prédicateur) + PE / PE+ *ak La relation entre le prédicat d’existence et son déterminant privilégié qui
est un patient non agent se fait par la reprise et l’affixation, à ce dernier, de l’actualisateur *ak. Cette structure est conservée dans les verbes dont le premier déterminant est un patient non agent (cf. idem). Le déterminant agent/sujet y est utilisé uniquement en cas de besoin et est indiqué par un affixe spécifique. Les relations entre le prédicat d’existence et ses
Sur les reconstructions berbères et afro-asiatiques 69
déterminants qui sont ordonnés autour de lui sans ordre préétabli sont indiquées au moyen des affixes.
Etant non orienté par rapport à ses déterminants et exprimant un état, une qualité …, le PE a la valeur du statif qui est l’axe principal (et donc l’unité de base) du système aspectuel proto-berbère, duquel sont dérivées les autres valeurs aspectuelles. Des affixes aspectuels *il (état qui dure), *ad (proximité dans le temps) et *ek (accompli) se combinent entre eux et avec le prédicat d’existence et en modifient la valeur initiale, le statif, ce qui produit un ensemble d’oppositions aspectuelles indiquant les valeurs attribuées à l’état, à la qualité … exprimés par l’énoncé (cf. idem). À ces relations établies entre le prédicat d’existence et ses déterminants privilégiés, s’ajoutent d’autres qui sont nécessaires au fonctionnement de l’énoncé (affixes du genre, du nombre, de négation, affixes casuels, …). Plusieurs traits structurels qui sont prédominants dans le berbère moderne dont les oppositions verbo-nominale, de rection, de diathèse, de personne … sont inexistants dans ce système (cf. idem). II.2. Le sémitique et les autres groupes afro-asiatiques conservent des éléments vestigiels des structures linguistiques similaires à celles qui caractérisent le proto-berbère. Prenons un exemple précis : l’opposition verbo-nominale et le système verbal sémitiques. La situation du système verbal akkadien relate une de ses phases évolutives où il possède encore deux unités de base, le verbe et le nom, mais où ce dernier est en train de céder la place au premier − l’évolution du statif « nominal » a abouti à l’accompli dans les autres langues sémitiques (cf. Cohen, 1984, 1989, Allati, 2008). Ce qui montre que le système verbal y est en formation et, surtout, relate un stade évolutif de cette langue où la formation de l’opposition verbo-nominale est à sa dernière phase (Allati, 2002, 2006, 2008). Les éléments qui y opposent le nom et le verbe l’emportent sur ceux qui leur sont communs (d’où l’existence de cette opposition dans ce stade), mais ces derniers constituent les traces d’un stade antérieur où l’opposition verbo-nominale n’existait pas encore, un stade où il n’y avait que des bases lexicales qui peuvent se conjuguer toutes et qui pourraient avoir la fonction de ce qui correspond, dans les langues où cette opposition existe, à des noms dans certains cas, et à des verbes dans d’autres (cf. idem). C’est un fait que révèlent aussi bien les données appartenant à chacun des membres de cette famille que celles provenant de leur confrontation. La façon suivant laquelle cette opposition s’est formée et s’est progressivement établie recèle des renseignements sur
70 Abdelaziz ALLATI
l’élément auquel le nom et le verbe ont succédé, et sur la place qu’il détenait dans la phrase, dans le système aspectuel …
La partie récessive du système verbal akkadien, ce qui est convenu d’appeler la conjugaison « nominale », conserve un type de conjugaison antérieur − et donc des types antérieurs de morphologie et de syntaxe − où l’élément conjugué n’est ni un nom, ni un verbe, mais un prédicat d’existence (base lexicale et affixe de prédication qui a évolué en base lexicale renfermant l’élément prédicatif dans ce stade de l’akkadien) dont ont évolué, entre autres, ces deux catégories grammaticales.
La base lexicale qui fonctionne comme prédicat en akkadien (Cohen, 1989 : 175) conserve quelques aspects de la forme et de la fonction du prédicat d’existence, le noyau de la phrase dans le stade antérieur, qui pose d’existence d’un fait, d’une qualité, d’une situation … et dont la valeur aspectuelle ne peut être que le statif ou l’état, l’unité de base et l’axe principal du système aspectuel (cf. plus bas) : « à partir d’un radical verbal quel qu’il soit, un statif peut être construit de la même façon, sur une base verbo-nominale (…). Il ne semble avoir pour fonction ni de mettre l’état en relation avec le procès ni d’en évoquer le déroulement antérieur, mais plutôt de constater l’existence de l’état nommé par le radical verbal (souligné par nous) » (idem : 109). A quelque stade de l’akkadien qu’on se place et quelle que soit la forme que le statif y prenne (verbe, nom …), celui-ci pose l’existence d’un état, d’un fait … et a la fonction du prédicat : « le statif se présente comme un syntagme di-morphématique constitué par une base lexématique fonctionnant comme prédicat » (Cohen, 1989 : 175). Le stade où en est le système verbal akkadien où le statif correspond à des formes nominales et verbales (des bases lexicales ayant la fonction du prédicat et subissant des flexions morphologiques différentes) montre que celles-ci ont évolué du prédicat d’existence – l’antériorité historique du statif par rapport au processif apparaît dans tous les membres de cette famille. Le verbe au statif ou le statif « verbal » en est une forme recomposée, intégrée dans les oppositions thématiques (schème spécial) et est ainsi plus évoluée par rapport au nom au statif ou au statif « nominal. » Les valeurs aspectuelles des autres thèmes : le prétérit (= état accompli), le parfait (= état accompli duratif) et le présent (= état accompli duratif/à venir …) montrent qu’ils sont tous des formes déclinées de l’état (= statif) que pose le prédicat d’existence (cf., Allati, idem).
Les nuances des différentes valeurs de ces thèmes verbaux (cf. Cohen, 1989 : 172-176), les résidus des affixes aspectuels conservés, à des degrés divers, dans les autres langues sémitiques (araméen, arabe, guèze, tigré,
Sur les reconstructions berbères et afro-asiatiques 71
tigrina …) et dans les autre branches de cette famille dont le berbère laissent apparaître comment s’y était accomplie cette déclinaison du statif ou de l’état en plusieurs valeurs aspectuelles dérivées. Des affixes aspectuels (exprimant la durée, la proximité dans le temps …) se combinaient entre eux et avec le prédicat d’existence dont ils faisaient varier la valeur aspectuelle correspondante, le statif, et donnaient lieu à une gamme de valeurs aspectuelles dérivées (état accompli, état duratif, état accompli duratif, état à venir …), dont on relève des traces dans les valeurs des thèmes du système verbal akkadien (cf. Cohen. 1989 : 172-176, Allati, 2008). D’autant plus que des vestiges en sont conservés, sous des formes recomposées et/ou dotées de nouvelles fonctions, dans d’autres langues sémitiques dont l’arabe classique où l’accompli et l’inaccompli, les éléments de l’unique opposition de son système verbal, y prennent, par le moyen des préverbes, des nuances particulières (cf. Allati, 2008).
De même, les affixes personnels, les pronoms personnels affixes … des différentes branches afro-asiatiques renferment des vestiges de plusieurs éléments (dont les affixes du genre et du nombre) qui étaient combinés avec le prédicat d’existence (et la façon suivant laquelle ils l’étaient) pour attribuer l’état, la situation … qu’il posait à moi, à toi, à lui, à nous …Ce qui nous renseigne sur un type de paradigme de conjugaison sans opposition de personne (cf. Allati, 2002, §III) et, surtout, sur une morphologie foncièrement agglutinante.
De plus, les types de constituants de la phrase, les traces du prédicat d’existence et de ses déterminants, l’absence de l’opposition verbo-nominale, de personne et de diathèse, l’attestation des conjugaisons transitives et intransitives …, autant de vestiges de la construction ergative postulée proto-sémitique et proto-afro-asiatique : « In semitic (…) there is raison to believe that the original verbal construction was ergative » (cf. Diakonoff, 1965 : 58). II.3. Les mêmes mécanismes sont utilisés dans la réorganisation du système linguistique proto-berbère et dans celles des autres membres de cette famille. Une forte usure morphologique due à des changements phonétiques a affecté les relations reliant le prédicat d’existence avec ses déterminants et, par là, les structures morphologiques et syntaxiques proto-berbères qui ont été ainsi réorganisées (cf. Allati, 2002, 2006, 2008). Les caractéristiques du système morphologique proto-berbère, d’un côté, et celles des systèmes qui lui ont succédés, de l’autre, recèlent la stratégie que celui-ci a utilisée pour se recomposer. Celle-ci apparaît dans les résidus des structures anciennes
72 Abdelaziz ALLATI
qui y sont conservées, mais encore plus clairement dans les résultats de la confrontation des traits caractéristiques des systèmes morphologiques des stades anciens et actuels des différentes langues des autres branches afro-asiatiques.
Pour éviter de s’exposer aux changements qui ont provoqué son dysfonctionnement – dus essentiellement au fait que tout se forme par adjonction, les uns aux autres, des éléments dont les fonctions ne sont pas préalablement déterminées (une base lexicale pouvant être utilisée comme affixe) et dont les places ne sont pas fixes (cf. idem) −, le système a œuvré dans le sens de « fixer » une partie de sa morphologie, la base de la formation du mot, où sera intégrée l’autre partie, les procédés de dérivation et de flexion. Est ainsi créé un nouveau procédé morphologique (les flexions internes) qui consiste à intégrer les éléments morphologiques dans les catégories grammaticales qui se sont développées du prédicat d’existence (cf. idem.), et ce pour suppléer progressivement à l’ancien type de formation du mot et aux relations que les affixes grammaticaux agglutinés assuraient et aux fonctions qu’ils y remplissaient (relation du prédicat d’existence avec ses déterminants, affixes du genre, du nombre, etc.).
Les niveaux lexical et morphologique se sont ainsi progressivement recomposés dans une nouvelle structure où la base et le type de formation du mot ainsi que le type d’adjonction des morphèmes aux unités lexicales sont très différents de ceux qui les ont précédés (cf. plus bas). La comparaison des différentes branches afro-asiatiques montre que les conditions de ces changements étaient inégalement remplies dans les différentes branches de cette famille, ce qui s’est traduit par des rythmes évolutifs différents et, en conséquence, par de très grands décalages dans leur évolution (cf. plus bas).
Cette restructuration a nécessité un changement radical aussi bien de la base de la formation du mot que des procédés de dérivation. Dans le nouveau système, les consonnes sont dotées d’une fonction lexicale ou radicale alors que les voyelles y ont un rôle morphologique, non radical (cf. Allati, 2009).
La fixation, la stabilisation, la « radicalisation » ou la lexicalisation des consonnes ont pour répondant l’alternance, la « non radicalisation » ou la morphologisation des voyelles. Les deux niveaux se sont formés l’un en fonction de l’autre de telle façon qu’ils constituent deux parties d’une même pièce. Les données berbères et celles appartenant aux différentes branches afro-asiatiques mettent en relief l’interdépendance des deux niveaux lexical et morphologique qui se sont structurés mutuellement (cf. idem).
Sur les reconstructions berbères et afro-asiatiques 73
L’intégration des marques morphologiques dans les bases lexicales a engendré la constitution d’un type particulier de base de mot (la racine trilitère) et de nouveaux procédés de dérivation et de flexion (les flexions internes). Les comparaisons des éléments attestés dans les langues afro-asiatiques (dont notamment ceux appartenant au sémitique, au tchadique et à l’omitique, couplés avec les données berbères) montrent que la relation entre ces deux niveaux et le processus que celle-ci a engendré caractérisent l’évolution de toute cette famille, et que la racine trilitère et la morphologie flexionnelles sont le produit de la réorganisation d’un type morphologique antérieur qui se fonde sur des types particuliers de base de formation du mot et de procédés de dérivation et de flexion.
La forme la plus pertinente et la plus économique fonctionnellement pour mener ensemble ce jeu de fixation et de variation (alternances vocaliques) afin de structurer le lexique et permettre les différentes flexions, est d’utiliser une forme ternaire des deux côtés − les racines trilitères et les structures vocaliques discontinues (les affixations y sont secondaires). Les bases lexicales mono- et bi-consonantiques, les quadrilitères … sont, parce qu’elles sont soit trop courtes, soit très longues et fonctionnement plus lourdes, inadaptées pour assurer, d’une part, toutes les distinctions lexicales sous formes de noyaux consonantiques et, d’autre part, le fonctionnement des structures vocaliques qui systématisent les différentes dérivations et flexions. La forme la plus adaptée est la racine trilitère qui permet un très grand nombre de distinctions lexicales en se fondant sur des squelettes consonantiques (racines) et plusieurs alternances sous forme de structures vocaliques discontinues qui se définissent par leurs relations réciproques. Ce processus évolutif va dans le sens de constituer les squelettes consonantiques, des racines trilitères, bases communes à des groupes dérivatifs supportant les flexions internes, et ce en étoffant les formes lexicales constituées de moins de trois consonnes (une ou deux), et en réduisant celles qui sont plus longues (quatre, cinq consonnes …).
Les mécanismes qui sont mis en oeuvre dans cette adaptation du matériel lexical ainsi que le type et le mode d’évolution qui la caractérisent apparaissent dans chaque branche prise isolément, mais encore plus et d’une manière plus claire dans les stades évolutifs où en sont les différents groupes de cette famille. Les deux procédés principaux qui y sont utilisés soit séparément, soit de façon combinée (fixation et figement des composés et des unités formées par réduplication, d’une côté, lexicalisation des affixes qui s’agglutinaient aux unités lexicales, de l’autre) ont été relevés dans
74 Abdelaziz ALLATI
toutes les branches afro-asiatiques dont le sémitique (cf. Cohen, 1947 ; Moscati, 1964 ; Diakonoff, 1965, 1984, 1988; Ehret, 1989, et autres).
La racine trilitère est ainsi une forme de fixation du lexique qui est générée par l’évolution de ce groupe linguistique et de l’afro-asiatique, évolution qui est à des stades différents dans ses différentes branches (cf. Allati, 2002, 2008). Aussi les caractéristiques de la formation et de l’évolution de la base de formation du mot et du procédé dérivationnel apparaissent-elles dans les différents stades évolutifs où en sont les branches de cette famille. Le sémitique dont notamment l’arabe classique y a atteint le niveau le plus élevé de systématisation et les autres sont aux différents stades intermédiaires.
Les flexions internes qui constituent le moyen de l’intégration des marques morphologiques (les affixations y sont secondaires) dans les classes et catégories morphologiques et syntaxiques (nom, verbe …) ont affecté et altéré – et cela est tout à fait normal – les attestations radicales des voyelles, et ce à des degrés divers en fonction des stades évolutifs où en sont les différentes branches de cette famille dont le sémitique (cf. Diakonoff : 29, 57-58).
La comparaison des branches afro-asiatiques montre que plus le passage à la morphologie flexionnelle est un stade avancé, plus les réalisations radicales des voyelles reculent. La conservation des attestations radicales des voyelles apparaît dans les groupes les plus conservateurs (dont, par exemple, les langues tchadiques) où les flexions internes sont à peine introduites et où prédominent les racines mono- et bi-consonantiques: « Still, it can be supposed that the structure of the Tchad verbal root, biconsonantal with a root-vowel, is presumably an ancient feature » (Diakonoff, 1965 : 38). Le sémitique est à un stade évolué de son état ancien où la voyelle faisait partie également du radical : « The words in this group (Semitic) have a constant vocalism, and there is no doubt that their vowel is part oh the root » (idem : 30).
Ce qui explique, entre autres, les grandes difficultés que rencontrent les reconstructions des voyelles proto-afro-asiatiques. Celles-ci se fondent essentiellement sur les données sémitiques où les attestations stables des voyelles pouvant faire l’objet de comparaisons sont rares ou n’apparaissent que dans certaines zones du système. C’est pourquoi l’on délimite le corpus des comparaisons et des reconstructions aux données où il n’y a pas eu ou, le moins possible, de flexions : les radicaux nominaux non-dérivés (cf. Diakonoff, 1970 : 453-480 ; 1975 : 133-151; 1992 : 65-97 ; Orel et Stolbova, 1995 : XXI- XXIV et autres). Plus on va du sémitique aux autres
Sur les reconstructions berbères et afro-asiatiques 75
branches où le processus de la mise en place des flexions internes est encore moins avancé, plus on relève de réalisations radicales des voyelles. C’est le cas du berbère (cf. Cohen : 1993, Allati : 2009) et des autres groupes dont notamment le tchadique, l’omotique et le couchitique. II.4. L’évolution des différents groupes afro-asiatiques se caractérise par de grands décalages. Les différents membres de cette famille sont à des étapes différentes dans la recomposition de leurs anciens systèmes en une morphologie flexionnelle et une syntaxe accusative. Chacune d’entre elles a organisé de façon spécifique et selon un rythme propre le proto-système commun, et est à un stade particulier de son évolution. Les différents stades qu’elles ont atteints dans la recomposition de leurs systèmes morphologiques agglutinants en d’autres de type flexionnel (flexions internes) et de leurs constructions ergatives montrent que l’évolution de cette famille est caractérisée par de grands décalages (cf. Allati : 2002, 2006, 2008).
Ceux-ci apparaissent très nettement quand on confronte, par exemple, le système verbal akkadien (et du sémitique) et celui du berbère. Le stade où en est, en berbère, la recomposition des suffixes aspectuels en marques thématiques verbales nous renseigne sur celui où en était l’évolution du système verbal akkadien qui avait déjà, à cette étape, subi une profonde recomposition, si bien qu’il est très difficile de discerner les traits structurels du système dont il provient et le type de relations qu’ils y entretenaient.
Les systèmes verbaux de l’akkadien et des autres langues sémitiques ont réussi, lors de leur formation ou de la recomposition du système aspectuel antérieur, à intégrer les marques thématiques dans le verbe tout en réutilisant, à des degrés divers, les formes recomposées des affixes pour exprimer les nuances des thèmes aspectuels. Ils ont également exploité les positions des affixes qui étaient libres dans leur état antérieur pour renforcer la distinction, qui se fonde désormais sur les flexions internes, entre les deux pôles aspectuels (cf. Allati, 2002 : 199): statif/accompli (conjugaison préfixale) ~ processif/inaccompli (conjugaison suffixale). Un état fluctuant de cette distribution des positions des affixes personnelles (avant ou après le verbe) et de leur fixation est attesté en ougaritique où : « les deux conjugaisons, la préfixale et la suffixale, paraissent souvent interchangeables » (Cohen, 1989 : 176).
Le berbère a cependant opté pour une stratégie différente. Les positions des affixes (avant ou après le verbe) n’y ont pas été exploitées d’une façon ou d’une autre (les mêmes types de conjugaison sont utilisés dans l’accompli et l’inaccompli), ce qui explique en partie pourquoi le même
76 Abdelaziz ALLATI
type d’outils d’opposition (affixes agglutinés) y a été réutilisé et pourquoi la recomposition de ces derniers en marques flexionnelles intégrées dans le verbe est encore à des stades différents dans ses variétés modernes (cf. Allati, 2002, 2008).
Cette évolution a nécessité, à en juger par le stade où en sont les autres membres de cette famille (berbère, tchadique, couchitique … cf. Allati, idem), une longue période et des conditions internes et externes spéciales pour être menée à bout, ce qui explique les stades où en sont les différentes branches de cette famille. Entre les deux points extrêmes de l’évolution de cette famille, que constituent, d’un côté, les langues tchadiques et l’omitique dont le rythme évolutif semble lent ou, du moins, particulier, et, de l’autre, les langues sémitiques, la branche la plus évoluée de cette famille se trouvent les autres branches restantes qui en sont à des stades plus ou moins plus avancés.
Ces décalages forment – quand on confronte les systèmes des différents groupes de cette famille – une étape vivante de l’évolution de cette famille, qui recèle des renseignements sur le type d’évolution qu’elle a subi et le rythme qui l’a caractérisé dans chaque branche. Le rythme des changements qui ont affecté, par exemple, le sémitique (l’unique branche asiatique de cette famille) pendant la période antérieur au stade que relate les documents anciens (III et IV millénaires avant J.-C.) est accéléré ou, pour le moins, très particulier.
Ces éléments permettent de comprendre comment le fonds commun afro-asiatique a évolué dans chaque membre pris isolément et dans la famille toute entière. II.5. Ce renversement de perspective permet la réhabilitation d’une longue phase de l’histoire de l’afro-asiatique que les approches existantes ont, dans les meilleurs des cas, à peine effleurée. Les stades les plus anciens des langues sémitiques (dont notamment celui de l’akkadien) qui sont extrapolés au proto-afro-asiatique renferment des résidus (voyelles radicales, agglutination, traces d’ergativité, relation nom/verbe, système casuel …, dont la plupart sont mis en relief par Diakonoff, cf. Diakonoff : 1965, 1988) d’un système dont la phonologie, la morphologie et la syntaxe sont très proches de celles qui caractérisent le proto-berbère. Ce système correspond à un stade évolutif de cette branche qui est antérieur à celui postulé proto-sémitique et/ou proto-afro-asiatique.
Eclairées par les éléments diachroniques berbères, les données sémitiques apparaissent sous un autre jour et peuvent être exploitées d’une toute autre manière. Elles se débarrassent du « trait » proto-afro-asiatique
Sur les reconstructions berbères et afro-asiatiques 77
qu’on leur a attribué en prenant l’état le plus ancien du sémitique (les traits structurels akkadiens, ougaritiques …) pour le proto-afro-asiatique (cf. plus haut), et ce en confondant les traits structurels anciens d’une des branches de cette famille avec ceux caractérisant son proto-système.
Le stade le plus ancien connu du sémitique − qu’on prend pour le proto-afro-asiatique − est ainsi remis à la place qu’il occupe réellement, dans l’évolution de cette famille, à un de ses stades les plus avancés. Celle-ci est ainsi replacée sur son véritable axe historique, ce qui permet ainsi de déterminer la chronologie des différentes branches et leur type de ramification ainsi que les particularités de leur l’évolution.
Ce renversement de perspective ouvre de nouvelles voies de recherche qui réhabiliteraient une longue phase de l’histoire cette famille que l’on conçoit généralement comme un passé lointain, obscur … où l’on relègue les traits linguistiques archaïques relevés dans ses différentes branches.
Références bibliographiques
ALLATI, A., 2002. Diachronie tamazight ou berbère, Tanger : Publications
de l’Université Abdelmalek Essaâdi. ALLATI, A., 2006, La langue tamazight et les reconstructions afro-
asiatiques, in: IBRISZIMOW, D., VOSSEN, R. , STROOMER, H. (eds.), Etudes berbères III, Le nom, le pronom et autres articles: 29-38. Köln : Rüdiger Köppe Verlag.
ALLATI, A., 2006. Diachronie afro-asiatique et amazighe : problèmes et perspectives, in: Allati, A. (ed.), Linguistique amazighe : les nouveaux horizons : 12-27. Tétouan : Publications de la faculté des lettres, Université Abdelmalek Essaâdi.
ALLATI, A., 2008. Proto-berbère et proto-afro-asiatique : l’aspect, in: Takács, G. (éd.), Semito-Hamitic (Afroasiatic) Festschrift for A.B. Dolgopolsky and H. Jungraithmayr: 19-26. Berlin : Dietrich Reimer Verlag.
ALLATI, A., 2009. Sur le classement du lexique berbère, in: VOSSEN, R. IBRISZIMOW, D., STROOMER, H. (éds.), Etudes berbères IV, Essais lexicologiques et lexicographiques et autres articles: 9-24. Köln : Rüdiger Köppe Verlag.
BOMHARD, A., R & KERNS, J. C., 1994. The Nostratic Macrofamily. A study in Distant Linguistic Relationship, Berlin - New-York : Mouton.
78 Abdelaziz ALLATI
BROCKELMANN, C., 1908/1913. Grundriss der vergleichenden Grammatik der Semitischen Sprachen, I & II, Berlin.
COHEN, D., 1970. Études de linguistiques sémitiques et arabes, La Haye : Mouton.
COHEN, D., 1984. La phrase nominale et l’évolution du système verbal en sémitique. Étude de syntaxe historique, Paris-Leuven : Peeters.
COHEN, D., 1989. L’aspect verbal, Paris : PUF. COHEN, M., 1947. Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique
chamito-sémitique, Paris : Champion. DIAKONOFF, I.M., 1965. Semito-hamitic languages, an essay in
classification, Moscou : Nauka. DIAKONOFF, I.M., 1988. Afrasian languages, Moscou: Nauka EHRET, C., 1989. ‛The Origin of Third Consonants in Semitic Roots: An
Internal Reconstruction (Applied to Arabic)’, Journal of Afroasiatic Languages 2/2 : 109-202.
GALAND, L., 1955. ‘État et procès : les verbes de qualité en berbère’, Hesperis, 42 : 245- 251.
GALAND, L., 1977. ‘Continuité et renouvellement d’un système verbal : le cas du berbère’, BSLP, 72/1 : 275-303.
GALAND, L., 1980. ‘Une intégration laborieuse : les « verbes de qualité» du berbère’, BSLP, LXXV/1: 347-362.
GALAND, L., 1990. Du nom au verbe d’état : le témoignage du berbère. in: H.G. Mukarovsky (ed.), Proceedings of the 5th International Hamito-Semitic Congress, 1987, vol. I: Hamito-Semitic, Berber, Chadic:123- 137. Wien.
GREENBERG, J., H. 1955. Studies in African Linguistic Classification, The Compass Publishing Company : New Haven.
GREENBERG, J., H., 1966, The languages of Africa, The Hague : Mouton. OREL, V., E & STOLBOVA, Olga.-V. 1995. Hamito-Semitic Etymological
Dictionary. Materials for Reconstruction, Leiden-New York-Köln : E.J. Brill.