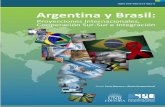« Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique,...
Transcript of « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique,...
Un livre intitulé Enquête sur les modes d’existence, mais sous-titré Une anthropologie des Modernes, pose immédia-tement la question : s’agit-il d’un ouvrage de métaphysique, comme le suggère le titre (décalqué de l’œuvre de 1943 du philosophe Étienne Souriau 1), ou d’un travail d’anthropolo-gie, comme l’indique le sous-titre ? Une chose est sûre : il ne s’agit pas d’étudier la manière dont certains groupes humains, en l’occurrence les « Modernes », s’accordent pour attribuer une « existence véritable » à telle chose plutôt qu’à telle autre, aux bactéries par exemple plutôt qu’aux licornes. Latour avertit d’emblée son lecteur : il se propose d’étudier non pas « des façons de parler comme dans la théorie des “actes de langage”, mais des modes de l’être », reprenant « la vieille question “qu’est-ce que ?” (qu’est-ce que la science ? quelle est l’essence de la technique ? etc.), mais en découvrant des êtres aux propriétés chaque fois différentes » (p. 32-33). Certains s’en inquièteront. Le grand combat des sciences sociales pour conquérir leur autonomie par rapport à la métaphysique, en mettant au point des procédures raffinées d’objectivation – statistiques, questionnaires, « terrain » ethno graphique, etc. –, doit-il finir en restauration de Platon et Aristote ? N’y a-t-il pas plutôt ici un choix à faire : parler « des modes d’exis-tence en général », ou bien des modes d’existence pour les Modernes ? Métaphysique ou anthropologie ?
Latour est loin d’être le seul dans le contexte actuel à accomplir ce qu’on pourrait appeler un tournant métaphy-
1. É. Souriau, Les Différents Modes d’existence [1943], préface de B. Latour et d’I. Stengers, Paris, PUF, 2009.
Un tournant métaphysique ?
Bruno LatourEnquête sur
les modes d’existenceUne anthropologie des Modernes
Paris, 2012,La Découverte, 504 p.}
Novembre n°786_EP1.indd 916 17/09/2012 11:14:55
917
sique dans les sciences humaines 2, à réactiver la métaphy-sique dans le contexte tant « analytique » que « continen-tal 3 ». Mais il est peut-être le plus surprenant. Ne passe-t-il pas souvent pour ce sociologue relativiste qui a voulu traiter les sciences comme Lévi-Strauss et Greimas les mythes et les contes 4 ? S’agirait-il donc d’un reniement ? Non, plutôt d’une redéfinition de la métaphysique elle-même. Celle-ci apparaît en effet, non plus comme entreprise pour dire une vérité uni-voque quant à l’Être en général, mais comme une « diplo-matie » d’un genre tout à fait singulier qui nous permet de redonner à toutes nos « institutions » (aussi bien la science que la religion, la politique que le management, la littérature que la psychologie, l’habitude que la subsistance) le poids de réalité qui est le leur et que la réduction à l’une d’entre elles exclusivement (« la science ») a tendance à leur dénier.
De la sémiologie des textes scientifiques à la métaphysique plate
Il y a longtemps que les sciences sociales touchent à la métaphysique : qu’on pense à Durkheim inventant ce qu’il appelait l’hyperspiritualité de la conscience collective 5.
2. Mentionnons les œuvres d’Eduardo Viveiros de Castro (Métaphysiques cannibales, PUF, 2009), de Philippe Descola (Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005), de Tim Ingold (voir notamment Une brève histoire des lignes, Zones sensibles, 2011) ou de Marylin Strathern (en particulier The Gender of the Gift, University of California Press, 1988). Dans un autre style, voir la réflexion sur l’ontologie des objets sociaux menée par P. Livet et R. Ogien (éd.), « L’ Enquête ontologique. Du mode d’existence des objets sociaux », Raisons pratiques, n° 11, 2000.
3. Pour le contexte « analytique », voir E. Garcia et F. Nef (éd.), Métaphysique contemporaine, Paris, Vrin, 2007 et pour le contexte « continental », les ouvrages de Quentin Meillassoux (Après la finitude, Éd. du Seuil, 2006) et T. Garcia (Forme et Objet, PUF, 2011), pour ne citer que les plus remarqués.
4. Voir B. Latour et S. Woolgar, La Vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, Paris, La Découverte, 1988 [1979]. C’est la raison pour laquelle Latour est la cible privilégiée de ceux qui ont mené au nom du « rationalisme » ce que l’on a appelé les « Science Wars », et plus particulièrement de Sokal et Bricmont (Impostures intellectuelles, Odile Jacob, 1997).
5. Voir Les Règles de la méthode sociologique, Paris, PUF,
UN TOURNANT MÉTAPHYSIQUE ?
Novembre n°786_EP1.indd 917 17/09/2012 11:14:55
CRITIQUE918
Latour cependant ne prétend pas évaluer les conséquences de la sociologie sur la métaphysique, mais rendre les deux disciplines indiscernables. Dès son petit ouvrage de 1984 sur Pasteur 6, il faisait suivre un travail empirique d’histoire des sciences d’une sorte de petit traité métaphysico-sociolo-gique intitulé Irréductions, numéroté à la manière du Tracta-tus logico-philosophicus de Wittgenstein et émaillé de scho-lies évoquant l’Éthique de Spinoza. Comment comprendre ce double régime qu’on retrouve peu ou prou dans tous les ouvrages de Latour ?
Pour répondre à cette question, repartons du début, pourtant peu propice à la métaphysique. L’ œuvre de Latour commence avec La Vie de laboratoire, écrit avec Steve Wool-gar. Il s’agissait pour Latour d’étudier la science en ethno-logue, afin de comprendre ce que ses hôtes lui disaient, ce à quoi ils accordaient de l’importance. Non pas cependant pour apprendre leur science – l’anthropologue des sciences deviendrait alors son objet comme d’autres décident de deve-nir Guayaki (going native) – mais pour utiliser son ignorance même à des fins de connaissance. L’ anthropologie se caracté-rise en effet comme une manière de faire de la différence cultu-relle – et donc de l’incompréhension où nous sommes d’abord des raisons et des usages de l’autre – l’instrument d’un savoir. Elle n’est pas une connaissance comme les autres, car elle ne suppose pas un cadre théorique prédéfini (des hypothèses à vérifier en fonction de « faits » et de « régularités »), mais vise à mettre en variation ce cadre théorique lui-même : l’anthro-pologue n’acceptera pour vrai de toute culture en général que ce qui permet de traiter également comme des variantes les unes des autres sa « culture » de départ et celle d’arrivée 7. Quoi de plus éloigné, en apparence, de la métaphysique ?
1937 [1894]. Voir aussi P. Maniglier, « Institution symbolique et vie sémiologique. La réalité sociale des signes chez Saussure et Durkheim », Revue de métaphysique et de morale, vol. 2, n° 54, 2007, p. 179-204.
6. B. Latour, Pasteur : guerre et paix des microbes, suivi de Irréductions, Paris, La Découverte, 2001 [1984].
7. Pour une élaboration de cette définition de l’anthropologie, voir R. Wagner, The Invention of Culture, Chicago, University of Chicago Press, 1981 ; E. Viveiros de Castro, op. cit., et P. Maniglier, « Le tournant anthropologique d’Alain Badiou », dans I. Vodoz et F. Tarby (éd.), Autour d’Alain Badiou, Paris, Germina, 2011.
Novembre n°786_EP1.indd 918 17/09/2012 11:14:55
919
Et pourtant. L’ anthropologie aura été le véritable cheval de Troie de la métaphysique dans les sciences humaines – et cela par un autre tour de relativisme. De fait, les « autres » se caractérisent rarement eux-mêmes comme des êtres culturels. Ils professent au contraire souvent une forme de « multinaturalisme », comme l’a appelé Viveiros de Castro. Au lieu d’avoir d’un côté une « nature » unique, à laquelle seule les sciences (occidentales) auraient accès, et de l’autre une pluralité de « cultures », faites de « représentations », de « symboles » ou de « constructions sociales », l’anthropo-logue devrait soutenir qu’il y a une pluralité de natures, les sciences n’étant jamais que des manières parmi d’autres de faire nature. Il n’y aurait donc pas d’un côté l’esprit (ou la culture ou le langage), et de l’autre l’être (ou la réalité ou le monde), mais plusieurs manières d’être. L’ ontologie devient le discours de l’anthropologie, parce que la notion d’être apparaît comme le comparant le plus puissant. Cela ne signi-fie pas qu’il est le plus indéterminé, mais au contraire qu’il est le plus intense, celui qui nous oblige au déplacement et au dépaysement le plus grand. L’ idée de culture n’est qu’une conséquence d’une certaine « ontologie ». Il faut ici être radi-cal : par « ontologie » nous n’entendons pas une « théorie » quant à l’Être, ni même des idées ou une « entente » de l’Être ; nous entendons bien des manières de déterminer quelque chose comme étant. L’ informateur d’Evans-Pritchard avait bien raison de dire que peut-être les sorciers n’existent pas chez nous, mais qu’ils existent chez eux 8. Un tel énoncé ne doit pas être compris comme une simple neutralisation de la question (« à chacun ses croyances ») ; il invite plutôt à nous redéfinir nous-mêmes (et à redéfinir les Zandés) par l’ensemble des opérations qu’il faut faire sur l’ontologie pour comprendre pourquoi il y a des sorciers chez eux, et point chez nous. La question n’est donc pas d’accepter comme étant tout ce qui est déclaré tel par les uns ou les autres, mais plutôt de mieux comprendre ce qui est effectivement dans notre monde par différence avec ce qui est dans les autres.
Bruno Latour s’est toujours défini comme anthropologue et sa polémique contre la « sociologie critique » de Pierre
8. E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, Oxford, Oxford University Press, 1937, p. 540.
UN TOURNANT MÉTAPHYSIQUE ?
Novembre n°786_EP1.indd 919 17/09/2012 11:14:55
CRITIQUE920
Bourdieu 9 pourrait être relue comme une version de la polé-mique entre la sociologie (savoir plus « classique » quant à son épistémologie) et l’anthropologie (« docte ignorance » moderne). Mais le « tournant métaphysique » prend chez lui une figure particulière, qui tient à la discipline à laquelle fina-lement il s’est identifié : la sociologie des sciences. La socio-logie des sciences, comme l’anthropologie, semblait a priori éloignée de la métaphysique. De fait, l’œuvre de Latour a été interprétée comme la mise en œuvre de l’idée que ce sont les actions des hommes qui produisent les « faits scientifiques » comme le dispositif cinématographique produit l’illusion optique du mouvement. Les savants qui croient s’intéresser aux éléments du monde extérieur, particules ou microbes, ne s’intéresseraient réellement qu’à leur position de prestige. Latour a toujours récusé cette interprétation réductionniste de sa démarche. Il ne s’agit pas pour lui de remplacer le réalisme spontané par un idéalisme sociologique, mais de dépasser l’opposition elle-même 10. Au lieu d’une disjonction entre l’esprit et la réalité, le savoir et l’être, le sujet et l’objet, le langage et le monde, il faut admettre que l’être lui-même est en train de se faire, et qu’il se fait précisément à tra-vers l’activité scientifique. Au lieu de supposer une réalité « toute faite », comme disait Bergson, une réalité qui atten-drait d’être connue, le réalisme ne doit-il pas plutôt accep-ter que c’est bien l’Être même qui se donne dans ce travail d’« établissement des faits », un Être en construction, in the making ? Telle est l’intuition qui guide l’œuvre de Latour depuis le début : remplacer la théorie de la correspondance entre un sujet et un objet par la théorie de la transformation- traduction d’une inscription dans une autre – ce que l’En-quête désigne comme les « chaînes de référence » (p. 86). Il ne s’agit donc pas de neutraliser l’ontologie par la sémiologie, mais de prendre position pour une autre ontologie, une onto-logie processuelle (d’où la référence constante à Whitehead et
9. B. Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, 2005.
10. Voir sur ce point le début de Nous n’avons jamais été modernes (La Découverte, 1991) : « Je parle bien des peptides eux-mêmes et non pas simplement de leur représentation au laboratoire du professeur Guillemin » (p. 13).
Novembre n°786_EP1.indd 920 17/09/2012 11:14:55
921
à James, mais ce pourrait être à Bergson et même à Althusser ou Spinoza), une ontologie où la réécriture essentielle à tout signe se confond avec l’Être même comme médiation.
Notons que cette idée qu’il n’y a pas de contradiction entre la réécriture des signes et la révélation même d’un Être est venue à Latour de son engagement religieux et théolo-gique. Dans sa thèse inspirée de Péguy et Bultmann et sou-tenue en 1985 11, il soutenait que Dieu n’est pas ce transcen-dant absolu retiré de l’autre côté du discours des hommes, mais que son être même se révèle dans la reprise d’une exégèse par une autre. On sent Dieu quand on reprend la Parole. L’ effort et la difficulté même que nous sentons – nos « embarras de parole » – constituent l’expérience que nous faisons de Dieu, et il n’est nul besoin de quoi que ce soit au-delà 12. Cette épreuve à laquelle nous sommes soumis suffit à rendre compte de l’expérience 13. Latour aura donc appliqué aux sciences une idée venue de la théologie. On la voit partout à l’œuvre dans l’Enquête sur les modes d’existence : au lieu d’une grande Transcendance obscurantiste, apparaissent une multitude de « mini-transcendances » (p. 216-218) bien définies qui permettent à une chaîne de réécriture (à une ligne sémiotique, donc) de se poursuivre, en sautant par- dessus le « hiatus » caractéristique qui menace sans cesse de l’interrompre.
Mais il y a une raison plus spécifique au virage méta-physique de la sociologie latourienne des sciences, qui tient à l’usage du concept d’acteur-réseau, élaboré avec Michel
11. De cette thèse il reste un article : « Pourquoi Péguy se répète-t-il ? Péguy est-il illisible ? », Péguy écrivain, Paris, Klincksieck, 1977, commenté et développé par M. Gil, Péguy au pied de la lettre, Paris, Cerf, 2011.
12. Sur tout cela, on pourra se reporter à B. Latour, Jubiler ou les Tourments de la parole religieuse (Éd. du Seuil, 2002), ainsi qu’au chapitre xi de l’Enquête, consacré précisément à la religion. Latour s’est lui-même expliqué sur l’importance de cette découverte théologique : voir en particulier B. Latour, « Biographie d’une enquête – à propos d’un livre sur les modes d’existence », à paraître dans les Archives de Philosophie, disponible sur le site internet www.bruno-latour.fr.
13. Le concept d’épreuve est celui que Latour utilise pour caractériser finalement l’expérience ontologique. Voir B. Latour, « Irréductions », dans Pasteur, op. cit., p. 242 et passim.
UN TOURNANT MÉTAPHYSIQUE ?
Novembre n°786_EP1.indd 921 17/09/2012 11:14:55
CRITIQUE922
Callon 14. Les textes scientifiques captureraient ou révéle-raient (partiellement, provisoirement, processuellement) certains étants, qui ne se contentent pas d’être ce dont on parle, mais qui agissent effectivement dans le texte. Ainsi les microbes de Pasteur ne sont-ils pas seulement des effets de discours, mais bien ces agents tout à fait réels, quoique leur existence tienne tout entière dans les épreuves aux-quelles ils soumettent non seulement l’écriture de Pasteur et des pastoriens, mais encore les dispositifs architecturaux et politiques qu’ils tentent de mettre en place ou de réaffecter. Une nouvelle thèse ontologique s’ensuit. Ce qu’il y a, ce sont non pas d’un côté des êtres parlants – ou des esprits tâchant de se représenter le monde –, et de l’autre des êtres parlés – des choses qui attendent d’être « découvertes » –, mais un ensemble d’acteurs également en train d’agir les uns sur les autres, et que l’on distribue à un moment donné entre ce qui relève des moyens du savoir (Pasteur, ses pipettes, ses feuilles de papier, etc.) et ce qui relève des choses sues (les microbes). En place du dualisme de la connaissance, nous trouvons un réseau d’acteurs.
Il en résulte une mise à plat de toutes les entités : par-tout, donc, des acteurs, distribués sur un plan unique où ils n’ont d’existence que relationnelle, et molécularisés, en ce sens que l’acteur n’est pas l’individu global mais un petit élé-ment opératoire dont la détermination exacte dépend de son opération locale dans le réseau scientifique (ou technique, religieux, etc.). Humains et non-humains, grands et petits, artefacts ou organismes, tous sont à égalité. Manuel de Landa a inventé l’expression « ontologie plate » pour caracté-riser une telle position métaphysique, expression désormais reprise un peu partout 15. La version qu’en donne Latour a des traits bien spécifiques. Elle attribue une forme de subjec-tivité aux non-humains : l’objet n’est pas muet, il parle, agit. Inversement le sujet n’est pas un extra-être : il « connaît »
14. Voir M. Callon, « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », L’ Année Sociologique, n° 36, 1986, p. 169-208.
15. Voir M. de Landa, . Voir M. de Landa, Intensive Science and Virtual Philo-sophy, New York, Continuum, 2002, p. 47.
Novembre n°786_EP1.indd 922 17/09/2012 11:14:55
923
dans la mesure où il arrive à « enrôler » d’autres actants – au sens de Greimas –, dans sa propre action, à traduire l’intérêt des autres. Ainsi Pasteur devient-il le « sujet » apparent de la « révolution » qu’on lui attribue parce qu’il arrive à traduire en même temps des intérêts incompatibles, ceux des microbes, des hygiénistes, etc. Le texte scientifique doit être considéré non pas comme une description mais comme une formule de compromis entre plusieurs exigences 16. D’où une nouvelle définition de la science, plus proche d’ailleurs de la compré-hension que les savants ont d’eux-mêmes : elle consiste non pas à représenter dans le tissu des symbolismes humains la réalité telle qu’elle est, mais à créer des dispositifs de traduc-tion qui permettent de faire parler les non-humains. Enfin, cet Être à la fois relationnel, actif – et même toujours déjà ré-actif, impliquant des actions sur des actions – et « traductif », n’est jamais entièrement donné : il est aussi processuel. Il faudrait de nombreuses pages pour déployer toutes les sub-tilités et les difficultés de cette métaphysique. Nous ne nous y attarderons pas : non seulement Latour s’y est employé dans plusieurs ouvrages, mais une figure importante du renou-veau contemporain de la métaphysique, Graham Harman, a consacré un ouvrage tout entier à sa reconstitution et à sa discussion critique 17. Il nous importait seulement de mon-trer ici comment Latour est allé d’une sémiologie des textes scientifiques à une métaphysique originale, à la fois relation-nelle, actantielle, processuelle et plate.
La force de cette proposition dans le contexte actuel de développement des métaphysiques « plates », qui lui donne d’ailleurs une capacité tout à fait singulière de traduction de la position des autres, tient à ce qu’il ne s’agit pas pour Latour d’un système métaphysique a priori, mais de la conséquence et de l’instrument d’un travail empirique mené sur les sciences, les techniques, la politique, la religion, les organisations – le tout sur fond de proposition écologique 18.
16. Sur tout cela, il faut une fois de plus renvoyer l’article fondateur de M. Callon, op. cit.
17. G. Harman, . G. Harman, Prince of Networks. Bruno Latour and Meta-physics, Melbourne, Re.press, 2009.
18. Sur ce dernier point, voir en particulier B. Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris,
UN TOURNANT MÉTAPHYSIQUE ?
Novembre n°786_EP1.indd 923 17/09/2012 11:14:55
CRITIQUE924
L’ ampleur de cette entreprise, sa cohérence, sa capacité aussi à fédérer et à renouveler une diversité de champs empiriques tout en jetant un pont vers les développements les plus poin-tus de la métaphysique, en font une chose rare, à vrai dire unique, dans le paysage contemporain.
Portrait du métaphysicien en diplomate.
Il faut relever cependant une ambiguïté quant au statut de cette métaphysique. Elle se veut résolument « non critique » ou, pour reprendre un terme introduit par le philosophe analytique Strawson, « non révisionniste » : elle ne prétend pas contester nos ontologies, mais les décrire. Cependant, ne finit-elle pas par construire malgré tout une ontologie parti-culière contre les autres, celle de l’acteur-réseau ? Cette ten-sion est évidente dans le livre de Graham Harman. Latour y apparaît comme un métaphysicien au même titre que Leib-niz, Spinoza ou Avicenne. Les concepts méthodologiques d’actants, de réseaux, de rapports de force, etc., sont réa-lisés par le commentateur dans quelque chose comme une conception du monde ou, plus techniquement, une ontologie formelle. Harman est conscient du caractère inexact de cette présentation, puisqu’il avoue ne pas couvrir ce qu’il appelle la deuxième période de l’œuvre latourienne, dont il précise qu’elle s’est élaborée à travers un ouvrage majeur composé en même temps que les livres de la première période, bien qu’il demeure encore inédit au moment où paraît le commen-taire 19. Cette œuvre, c’est bien sûr l’Enquête sur les modes d’existence que Latour publie aujourd’hui. Y aurait-il donc là un tournant dans le tournant ?
Plutôt une mise au point. En effet, le « réseau » n’est pas l’Être comme tel, mais seulement un mode d’existence parmi d’autres. C’est qu’il ne saurait être question pour Latour de formuler une ontologie générale, fût-elle « expérimentale » comme celle de Whitehead ou Bergson (c’est-à-dire aussi hypothétique, provisoire, progressive et révisable que les sciences) et « plate » comme celle de Meinong, Harman ou Garcia (c’est-à-dire minimale et non exclusive). S’y oppose
La Découverte, 1999. 19. Voir G. Harman, op. cit., p. 6.
Novembre n°786_EP1.indd 924 17/09/2012 11:14:55
925
le « principe d’irréduction » : « Aucune chose n’est par elle-même réductible ou irréductible à aucune autre 20. » Il est possible que Latour n’ait pas pris dès 1984 toute la mesure du genre de pluralisme qu’exigeait pareil principe. Parce qu’il ne déploie qu’un seul appareil conceptuel, Irréductions donnait en effet le sentiment de formuler l’ontologie de la « matière » dont, selon Latour, les phénomènes qu’il étudie seraient faits. Mais il ne suffit pas d’avancer une ontologie plate, si on continue par ailleurs à vouloir dire la vérité quant à l’être de tout étant. C’est précisément une telle monotonie que Latour reproche à son propre concept de réseau, qui le conduit à dire de tous les domaines (religion, droit, écono-mie, science, etc.) « presque la même chose, à savoir qu’ils sont “composés de façon hétérogène d’éléments imprévus révélés par l’enquête”. Certes [l’on] va bien […] de surprise en surprise, mais ces surprises […] cessent en quelque sorte d’être surprenantes puisqu’elles le deviennent toutes de la même façon » (p. 47). Cette citation montre que la différence entre Latour et ses prédécesseurs n’est pas dans le contenu de sa métaphysique, mais dans le sens même qu’il donne à l’exercice. Ce sens est diplomatique : il s’agit de négocier la rencontre et la confusion des ontologies. La métaphysique est donc de part en part anthropologique si l’on veut bien définir l’anthropologie comme ce savoir qui ne s’appuie que sur l’expérience des différences de nos évidences les mieux assises pour produire non pas un savoir sur quelque chose, mais une redescription de nous-mêmes à la lumière de l’alté-rité.
L’ Enquête commence par ce que Latour considère comme l’échec de la théorie de l’acteur-réseau en tant qu’an-thropologie : « les versions alternatives que nous avons pro-posées pour rendre compte de la fabrique de l’objectivité ont été violemment combattues par certains des chercheurs mêmes auxquels nous nous efforcions de rendre leurs valeur enfin compréhensibles aux autres » (p. 24). L’ allusion à la « guerre des sciences » est transparente, et Latour s’attribue magnanimement la responsabilité des malentendus dont son travail a été victime de la part des « rationalistes ». Car c’était bien la « Raison » qu’il s’agissait de redécrire, et l’anthropo-
20. B. Latour, Pasteur, op. cit., p. 243.
UN TOURNANT MÉTAPHYSIQUE ?
Novembre n°786_EP1.indd 925 17/09/2012 11:14:55
CRITIQUE926
logue ne saurait avoir raison contre ceux qu’il représente. Si Bartolomeo de las Casas n’avait pas su traduire pour les juges scolastiques de son temps les formes de vie et de pensée de ceux qu’il souhaitait préserver de l’extermination, afin qu’ils acceptent de considérer les « Indiens » comme des semblables, nous aurions été fondés à dire qu’il a échoué. De la même manière, si les « rationalistes » n’acceptent pas la redescription d’eux-mêmes que Latour leur propose à la lumière de leur altérité interne, c’est qu’il a mal fait son tra-vail. L’ anthropologue est un diplomate et n’a pas d’autre rai-son d’être : la guerre est sa défaite. Il tente de dissiper des malentendus en forçant tout le monde à se penser soi-même autrement afin de se rendre équivalent à l’autre moyennant quelques transformations. « Bien parler à quelque chose de ce qui lui importe », et le faire « debout dans l’agora », c’est-à-dire de telle sorte qu’on s’expose à la critique de tous : telle est l’ultime norme que Latour donne à son propre discours (p. 71 et 76), et l’on n’a peut-être jamais trouvé de formule à la fois plus simple et plus juste pour caractériser l’épistémo-logie des sciences sociales en général.
En quoi tout cela concerne-t-il encore la métaphysique ? C’est que les conflits qu’il s’agit de régler en diplomate portent précisément sur l’Être. Le problème vient de ce que non seu-lement l’on a mal compris les sciences, mais on leur a confié – et même, à en croire Latour, imposé – le monopole de la vérité quant à l’Être : rien n’« existe vraiment » que ce qui a été « établi scientifiquement ». Tout le reste relèverait d’autre chose : de la croyance (par exemple religieuse), de l’intérêt (par exemple politique ou économique), de l’obéissance (par exemple aux lois), etc. Or ce que Latour propose dans son Enquête, c’est une manière de rendre à la fois comparables et différenciables les sciences et les autres « pratiques de vérité », pour reprendre une expression de Foucault. Toutes ont en commun d’impliquer un « hiatus » (une discontinuité, un écart à franchir – par exemple pour l’individu la possi-bilité de la destruction, pour un raisonnement scientifique le risque d’une affirmation gratuite, pour le droit le soup-çon d’un vice de procédure, etc.), une « passe » (une conti-nuité – par exemple pour la science l’identité de structure, comme celle entre les inscriptions sur la carte et les repères optiques, pour la religion la fidélité dans la réinterprétation
Novembre n°786_EP1.indd 926 17/09/2012 11:14:55
927
des textes, etc.), et des « conditions de félicité ou d’infélicité » qui définissent si une « passe » a réussi ou non à franchir le « hiatus ». Avec ces trois concepts, Latour re-décrit effecti-vement presque tout ce qui nous importe vraiment – y com-pris la persistance des choses et la lourdeur des habitudes –, dans des termes communs : tous les « modes d’existence » sont redéfinis comme différents types de discontinuités per-mettant différents types de continuité en fonction de critères de vérité eux-mêmes variables. Par exemple, la continuité des sciences doit aller dans les deux sens : on doit pouvoir aller de la vache dans la ferme au laboratoire de Pasteur et y reve-nir ; en revanche, la continuité qui caractérise la persistance des choses est unidirectionnelle.
Latour resitue ainsi les différentes sphères de l’expé-rience les unes par rapport aux autres dans un tableau aux termes très abstraits qui n’est pas sans évoquer Hegel captu-rant toute la diversité du monde dans les différentes moda-lités du jeu contradictoire de l’identité et de la différence. Un Hegel, cependant, non pas dialectique et linéaire, mais tabu-laire et disjonctif (et plus lisible aussi !). Au passage, Latour accomplit ce à quoi se reconnaît selon Deleuze tout grand philosophe : il redécoupe le monde autrement. Ainsi la psy-chologie devient une partie de la sorcellerie, le langage une sorte de fiction (et non l’inverse), la technique quelque chose qui précède de très loin l’humain, etc. L’ Enquête est à la fois une somme et un chef-d’œuvre : Latour y rassemble le fruit de ses recherches précédentes, en même temps qu’il donne à voir un projet dans toute sa force et toute sa cohérence 21.
Tout cela pourrait-il se faire en s’épargnant le détour par les « modes d’existence », en se contentant de parler de « pra-tiques de vérité », par exemple ? Non, car toute réticence à l’égard du vocabulaire ontologique laisserait entendre que
21. Chaque mode d’existence renvoie silencieusement à au moins un livre antérieur de Latour ou d’un de ses proches : ses nombreux ouvrages de sociologie des sciences pour ce qu’il appelle REF (référence) ; Politiques de la nature pour la politique (POL), les œuvres de Tobie Nathan pour la psychologie (qu’il appelle MET, pour métamorphose), ses ouvrages de sociologie des techniques (en particulier Aramis ou l’Amour des techniques) pour TEC ; Jubiler pour la religion (REL) ; La Petite Fabrique du droit pour DRO ; ses travaux de sociologie des organisations pour ORG, etc.
UN TOURNANT MÉTAPHYSIQUE ?
Novembre n°786_EP1.indd 927 17/09/2012 11:14:55
CRITIQUE928
l’anthropologue ne se prononce pas sur l’Être même, mais seulement sur les manières de s’y « rapporter », d’y « accé-der », d’y « renvoyer », etc., comme si l’Être restait toujours en retrait. Nous n’avons rien à gagner à éviter le vocabulaire de la métaphysique, puisqu’il s’agit de faire pièce au privi-lège exceptionnel (et autodestructeur) des sciences, et que ce privilège est justement de nature métaphysique, puisqu’il se fonde sur l’idée d’un accès réservé à l’être comme objec-tivité 22. Latour ne fait que retourner le privilège contre lui-même : il n’y a pas d’un côté des praxis qui se contentent d’être des activités (la religion par exemple, ou la psycholo-gie) et de l’autre des poiêsis ayant réellement affaire à des êtres (les sciences, les techniques, éventuellement l’écono-mie, etc.) ; il y a différentes manières de faire être (d’ins-taurer) des objets (en entendant ce terme au sens que lui donne Simondon dans son livre, Du mode d’existence des objets techniques, à qui Latour confie d’ailleurs avoir repris le terme de mode d’existence). Le but de la métaphysique n’est donc plus de proposer une ontologie, mais au contraire de mettre en évidence la singularité ontologique tantôt des objets techniques, tantôt des valeurs économiques, tantôt des choses ordinaires, etc. À chacun de ces domaines corres-pond une table des catégories différente (p. 71). « Être » ne veut pas dire la même chose pour un boson de Higgs et pour un peso argentin, mais l’un et l’autre également sont, et la tâche du métaphysicien est de mettre en évidence cette égalité et cette diversité.
À nouvel enjeu, nouvelle méthode. La métaphysique ne passe pas par l’anticipation spéculative à la Whitehead, mais par ce que l’on pourrait appeler la recatégorisation contras-tive. Il s’agit d’apprendre à ne plus confondre deux modes d’existence afin d’affiner notre compréhension catégorielle de nous-mêmes. La méthode est, là encore, anthropologique. Elle consiste à partir de malentendus, tout comme l’anthro-pologue qui s’intéresse à ces équivoques sans lesquelles la communication « interculturelle » ne serait guère possible, par exemple celle qui lui fait prendre le don cérémoniel
22. C’est cela que veut dire Latour lorsqu’il explique que la métaphysique est le métalangage des Modernes (p. 33-34), ce par quoi ils évaluent ultimement la valeur d’une pratique.
Novembre n°786_EP1.indd 928 17/09/2012 11:14:55
929
pour une forme d’échange intéressé ou de générosité mys-térieuse. Les malentendus métaphysiques tiennent à ce que Latour appelle des « erreurs de catégorie », par exemple celle que commettent les « victimes » d’un procès pénal quand elles attendent d’un jugement qu’il obéisse à la logique de leur indignation et de leur peine. Ou, typiquement, celle qui conduit les sceptiques à exiger de ceux qui prétendent que les fantômes existent qu’on puisse les faire passer dans les « chaînes de référence » de la science. Ces erreurs ne sont pas pour Latour des accidents contingents qu’il faudrait corriger. Elles sont le véritable terrain de l’enquête, sa condition expé-rimentale et son instrument de pensée. De même que l’an-thropologue ne peut entrer dans la pensée de l’autre qu’en la faisant exister comme ensemble des variations à accomplir pour corriger les malentendus immédiats, le métaphysicien définira toujours un mode d’existence par contraste avec un autre mode avec lequel il a été confondu. L’ Enquête ne pro-pose donc pas une ontologie, mais un protocole expérimen-tal qui permettra à d’autres, éventuellement, de reprendre l’enquête. Métaphysique expérimentale, donc, en un sens dif-férent de Bergson ou Whitehead : il ne s’agit pas de prendre conscience du caractère révisable et hypothétique des thèses ontologiques, mais de définir en métaphysique une véritable méthode anthropologique, ou comparatiste.
On pourra bien encore, si l’on y tient, parler de l’Être en général. Mais pour en dire ceci : l’Être n’est pas le Séparé (ce qui doit être rejoint) mais le Confondu (ce qui doit être désin-triqué, contrasté). L’ ontologie n’a pas à résoudre des pro-blèmes d’accès, mais des problèmes d’équivoque. Sa valeur suprême n’est pas l’adéquation, mais, comme le disait d’ail-leurs Bergson, la précision. Il ne s’agit pas seulement de dire qu’il y a plusieurs sens de « être » – ce que fait toute doctrine des catégories –, mais de montrer que « être » n’a de sens que dans la disjonction même de ses sens. Rien n’est que ce qui a été confondu. Encore une fois, cela n’exige pas de supposer derrière cette confusion quelque réalité distincte à rétablir dans ses droits ; c’est dans ce qu’on pourrait appeler (d’un horrible néologisme calqué de l’anglais) la désambiguation, ou, pour être plus technique, la recatégorisation contrastive, qu’il faut chercher la phénoménalité même de l’Être en tant qu’Être, pour parler comme Heidegger, et non pas, comme le
UN TOURNANT MÉTAPHYSIQUE ?
Novembre n°786_EP1.indd 929 17/09/2012 11:14:56
CRITIQUE930
voulait la tradition existentialiste, dans l’angoisse et dans la mort… Latour a donc défini les conditions d’une relance de la question de l’Être ajustée à notre époque. Ontologie dou-blement paradoxale, certes, puisqu’elle fait non seulement de la médiation mais encore de l’équivoque son élément propre. Mais ontologie peut-être plus cohérente et surtout plus pertinente pour le contexte contemporain, plus insépa-rable de nos vies et de nos savoirs, que peut-être aucune de celles proposées par les grands métaphysiciens du xxe siècle, de Heidegger à Badiou. C’est d’ailleurs à ce dernier qu’on est tenté de comparer et d’opposer Latour aujourd’hui : sur la question de l’universel et d’autres sujets, il y aurait là une de ces alternatives sur lesquelles notre époque devra trancher.
Il n’y a pas de diplomate du Tout en soi
Une œuvre d’une telle ampleur ne peut pas ne pas s’ex-poser à toutes sortes d’objections, tant de gros que de détail. Mais de telles objections n’auront de sens que dans la mesure où elles permettent soit de contribuer au projet de Latour, soit d’en proposer des versions alternatives. Contentons-nous d’une seule, qui touche au statut de sa métaphysique. La comparaison avec la diplomatie est admirable, mais elle laisse une question en souffrance. Qui Latour veut-il finale-ment représenter ? Tout diplomate est un représentant, et il a pour ce qu’il représente un intérêt passionné. Le diplo-mate ne saurait être un mercenaire. Il n’est pas celui qui, au-dessus de la mêlée, tente de construire un monde habi-table pour tous parce qu’il nous aime tous, mais celui qui, pour défendre un mode d’existence auquel il tient tout par-ticulièrement, décide d’engager des représentations de ce mode dans d’autres, et inversement, de permettre à ce mode de représenter les autres. Son intérêt pour le Tout ne peut être que second. C’est la différence excessive (quoique jamais absolue) de ce qu’on pourrait appeler une singularité avec ce qu’elle détermine rétroactivement comme particularités (subdivisions d’un genre commun donc neutre, non singu-lier) qui donne au Tout un intérêt « théorique » (quelque chose dont on peut parler, qui a un sens) ou « pratique » (une valeur à protéger, quelque chose qui compte et qui importe dans le calcul de nos décisions).
Novembre n°786_EP1.indd 930 17/09/2012 11:14:56
931
De quoi ou de qui Latour est-il donc le représentant ? Des réseaux ? Certainement, mais l’on pourrait dire qu’il l’est tout autant désormais des « prépositions » (c’est-à-dire de ce qui permet de lire chaque mode d’existence dans sa clef), et de proche en proche de chacun des modes d’existence, qu’il défend avec passion… Mais ne fait-il pas alors figure d’agent double et tripe et quadruple, etc. ? Dira-t-on qu’il représente les « Modernes » en général ? Dans ce cas, la diplomatie s’exercerait non pas directement entre les modes d’existence eux-mêmes, mais entre différentes manières de faire coexis-ter ces modes d’existence, et nous aurions affaire à un travail d’anthropologie d’orientation plus classique. À moins qu’il ne s’agisse de Gaïa, cette entité-valeur dont Latour se réclame 23 ? Mais celle-ci ne constitue pas un « mode d’existence » en tant que telle et ne fait pas partie de cette négociation.
Faut-il dire alors que Latour est le diplomate de la reli-gion ? Biographiquement, cela ne fait aucun doute. Latour a lui-même raconté que c’est l’engagement catholique qui l’a conduit à l’idée que l’Être même est médiation 24. Et de fait, on ne peut manquer de noter que sa définition de la reli-gion est très restrictive, puisqu’elle fait de l’Amour le concept essentiel du religieux, d’une manière qu’on pourra trouver excessivement christiano-centrée… Il y aurait là peut-être un symptôme de ce que l’anthropologue, qui montre tant de talent à nous recatégoriser tous, n’a pas su complètement se rendre étranger à lui-même. Or c’est à cela, ultimement, qu’il doit se juger lui-même. Il n’a cessé d’œuvrer pour un monde « moderne », autrement dit sécularisé, capable de faire une place à la religion qui ne soit pas une place seconde, qui ne la relègue pas dans l’espace inoffensif des « convictions per-sonnelles » ou des « valeurs morales », mais c’est au prix d’une redéfinition complète de la religion. Il y a chez Latour quelque chose de Pascal, mais d’un Pascal joyeux, quand Bourdieu figurait le Pascal triste – ce n’est pas un hasard si les méditations pascaliennes de Latour s’intitulent Jubiler.
23. « C’est désormais devant Gaïa que nous sommes appelés à comparaitre » (p. 15). Voir aussi B. Latour, « Steps Toward the Writing of a Compositionist Manifesto », New Literary History, vol. 41, 2010, p. 471-490, ainsi que l’entretien publié dans ce même numéro.
24. B. Latour, « Biographie d’une enquête », op. cit.,, p. 126.
UN TOURNANT MÉTAPHYSIQUE ?
Novembre n°786_EP1.indd 931 17/09/2012 11:14:56
CRITIQUE932
Un Pascal qui s’adresserait aux libertins pour les convaincre de le rejoindre par un autre tour de libertinage. Ou, plus vrai-semblablement, un Leibniz qui, obstiné à trouver entre les sciences et la religion les voies d’un compromis, aura décou-vert que ce compromis impliquait une diversité d’êtres qui va bien au-delà du maigre dualisme offert par la « première modernité », celle de Descartes et de Galilée.
Au passage, Latour aura formulé la version à la fois la plus convaincante et la plus accueillante du tournant méta-physique contemporain : celle qui permet de satisfaire en même temps la conscience de l’importance de la métaphy-sique pour ne pas suturer à l’Être quelque positivité que ce soit, et la passion pour la diversité des savoirs empiriques, qu’il s’agisse des sciences sociales ou des sciences natu-relles ; celle qui allie le plus sûrement l’exigence de systéma-ticité, sans quoi il ne saurait y avoir de métaphysique digne de ce nom, et la méfiance à l’égard d’un discours ontologique unique et homogène, fût-il « plat » ; celle qui dépasse à la fois le relativisme hypercritique de la déconstruction et le dogmatisme un peu ostentatoire où se complaisent les nou-velles métaphysiques (dites « spéculatives »). Il n’y a guère de doute : l’Enquête sur les modes d’existence a ouvert une voie. Latour constitue clairement désormais une des grandes propositions de notre temps.
Patrice Maniglier
Novembre n°786_EP1.indd 932 17/09/2012 11:14:56
![Page 1: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: « Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012303/631985a577252cbc1a0ebc28/html5/thumbnails/17.jpg)