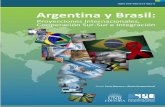Crédibilité de l'information sur Internet
Transcript of Crédibilité de l'information sur Internet
Crédibilité de l’information sur le web 2.0Adel Labidi
Bibliothécaire de référence
Bibliothèque Champlain
Université de Moncton
Résumé:
Avec l’avènement d’Internet et le développement de latechnologie numérique qui a créé le web 2.0, l’usager du21ème siècle est devenu de plus en plus autonome etindépendant aussi bien dans la recherche et la récupérationde l’information que dans l’évaluation des résultats.Toutefois, l’implication de l’usager dans tout le processusinformationnel a suscité le débat autour de la crédibilitéde l’information sur Internet. Comment les outils utiliséssur la toile ont affecté la crédibilité de l’information?Est-ce que l’usager est capable lui-même de déterminercette crédibilité ? Est-ce que les médiateurs del’information sont conscients de ce changement? La présentecommunication essaiera de répondre à ces questions tout enanalysant le comportement de l’usager 2.0 et en sefocalisant sur la nécessité d’établir un nouveau modèle deprestation du service informationnel.
Mots clés : Crédibilité, web 2.0, autorité, fiabilité
Introduction
Le développement accru des applications du web 2.0 et les
différents services proposés ont rendu les internautes
autonomes aussi bien dans le processus de recherche de
1
l’information que dans leurs interprétations de la
crédibilité du contenu. Les opportunités qu’offre le web
2.0 permettent à l’internaute de s’impliquer davantage dans
toutes les étapes de la production, de la diffusion et de
la récupération de l’information sur Internet. Néanmoins,
un débat a été ouvert autour de l’habileté de l’internaute
et de sa capacité à repérer l’information pertinente et à
valider son contenu. Ainsi, le présent article se propose,
d’abord, d’analyser le comportement de l’internaute 2.0 et
son aptitude à déterminer la crédibilité du contenu sur
Internet, surtout dans la présence de « l’infoabondance »,
de « l’infopollution » ainsi que de la « désinformation ».
Ensuite de préciser la notion de crédibilité de
l’information sur Internet en expliquant l’effet de
différents paramètres sur le jugement et le choix de
l’internaute. Enfin, d’expliquer la mutation du concept
« autorité » vers le concept « fiabilité » et son impact
sur le changement de l’attitude de l’utilisateur et bien
évidemment sur le rôle des anciens médiateurs de
l’information.
Contexte socioculturel et technique
Une panoplie de pratiques et d'outils a accompagné et
expliqué la transition de la société industrielle à la
société informationnelle. Avec son essor phénoménal,
Internet se place au premier rang de ces nouveaux outils.
2
Il est à la société informationnelle ce que les machines et
les dispositifs mécaniques étaient à la société
industrielle.
Les dispositifs numériques ont été le moteur de ces
transformations accentuées par l'usage du web 2.0 qui a
replacé l'internaute au centre de la Toile. L'internaute
est désormais participant à la création de l'information,
« capable d’émission en plus de la réception » (Quoniam et
Boutet, 2008), un usager qui est passé d'un comportement
passif à un comportement actif et créatif. Qu’est-ce que
alors le web 2.0 et quelles en sont les nouvelles pratiques
informationnelles ?
Le web 2.0 est un terme proposé par Tim O’Reilly qui
« désigne l'ensemble des techniques, des fonctionnalités et des usages du World
Wide Web qui ont suivi la forme initiale du web » (2005). En fait, après
le web statique qui a infligé à l’internaute une position
de récepteur passif, le web 2.0 a offert de plus amples
opportunités à l’internaute pour non seulement recevoir
l’information, mais aussi pour la créer et la partager en
favorisant une possibilité d’interaction avec d’autres
internautes.
En général, la technologie du web 2.0 repose sur deux
principes :
1. Le web 2.0 représente une plateforme informatique à
l’encontre du web statique qui était sous forme d’une
3
collection de sites disjoints. À ce stade,
l’internaute utilise le web en tant que service et
non en tant qu’application installée dans son
ordinateur.
2. Le web a favorisé l'émergence de nouveaux outils
conceptuels comme « l’intelligence collective », « le
partage des savoirs » et « l’interopérabilité ». Selon
P. Lévy, l’intelligence collective est « une intelligence
partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui
aboutit à une mobilisation effective des compétences » (Lévy, 2006).
Ce partage d’expertise et cet échange d’idées,
d’expériences et de compétences favorisent une
interaction et une interconnexion entre les
internautes, ce qui peut amener à profiter de cette
« intelligence » et de ce savoir-faire existant sur la
Toile. L’encyclopédie Wikipédia semble être l’exemple
phare de ce phénomène parce que son alimentation est
la responsabilité partagée entre les internautes.
Avec ces deux principes, le web a fourni aux internautes
une possibilité de rencontre, de communication, de partage
et d’interaction. Il importe alors d'appréhender le web 2.0
comme un outil « participatif » ou « collaboratif » (Stephens,
2007).
L’aspect social du web ainsi que sa facilité technique ont
renforcé la position de l’usager dans la chaîne de la
4
production de l’information lui rendant désormais capable
non seulement d’accéder aisément à l’information mais aussi
de partager et de produire de la même manière que les
auteurs et les producteurs de l’information sur le Net.
D’ailleurs, les internautes sont désormais capables de
configurer des outils d’agrégation en ligne comme Google
reader, My yahoo…etc. et de créer des portails personnalisés
afin de les partager avec d’autres utilisateurs. Le
développement des logiciels libres et leur abondance sur
Internet a aussi aidé l’usager à passer de la position de
réception passive de l’information vers la position d’un
usager contributif et producteur. En somme, en ayant cette
« autosuffisance informationnelle » et avec les services et
les nouvelles fonctionnalités du web 2.0, l’internaute est
devenu « l’auteur et le gestionnaire d’un point de concentration et
éventuellement de diffusion de l’information » (Piroll, 2010).
Cette responsabilité a ouvert le débat autour de la
capacité et l’habilité de l’utilisateur à exercer cette
fonction vu qu’il se trouve face à une source
informationnelle gigantesque qui dispose d’un contenu
ambivalent permettant à l’utilisateur d’accéder à des
informations de deux sortes : fiables, crédibles et
pertinentes mais aussi erronées, incertaines et non
crédibles.
5
Cela étant dit, il convient de poser les questions
suivantes: Comment les internautes auront la capacité de
bien cibler leurs sources pour accéder à l’information ?
Est-ce que l’utilisateur est capable d’évaluer le contenu
informationnel pour déterminer la crédibilité de
l’information? Ya-t-il d’autres acteurs qui entrent en jeux
lors du processus de la recherche de l’information? Et
quelles seront les solutions pour sauvegarder la
« crédibilité de l’information » sur Internet?
1. Crédibilité de l’information sur Internet
Plusieurs études statistiques (Lankes, R. David, 2008) ont
démontré l’accroissement du taux de connectivité sur
Internet notamment chez les jeunes. C’est ce qui explique
le développement actuel du « numérique » contrairement au
« physique ». D’ailleurs, les pressions économiques pour
diminuer le coût et réduire le taux d’impression confirment
ce penchant vers le numérique. De plus, la nouvelle
tendance chez les éditeurs et les fournisseurs des journaux
qui ont supporté l’édition des journaux en ligne et les
périodiques électroniques à la place des périodiques
papiers, les maisons et les firmes d’édition des livres qui
ont aussi multiplié l’édition des livres électroniques,
tout cela a encouragé l’utilisateur à consulter davantage
les ressources numériques. Toutefois, Il est important de
s’interroger sur la crédibilité du contenu de ces
6
ressources et sur l’habilité de l’usager à atteindre
l’information satisfaisante.
1.1 Définition de la crédibilité
D’après le petit Robert, la crédibilité c’est « ce qui fait
qu’une personne, une chose mérite d’être crue ». Flannigan et Metzger
(2007) pensent que la crédibilité repose sur deux
dimensions : la confiance et l’expertise. La crédibilité
est donc liée d’abord à la source du message ou de
l’information qui devrait être digne de confiance et
ensuite au contenu qui devrait satisfaire l’utilisateur et
répondre à son besoin. Sur Internet la crédibilité devient
un concept clé ayant une importance majeure. Des études ont
précisé certains critères pour évaluer la crédibilité de
l’information (Metzger, 2007 :
Exactitude : qui reflète la pertinence de l’information
qui devrait être authentique, fiable et sans erreur
Autorité : est reliée à la source de l’information
(site Internet) qui devrait être digne de confiance et
recommandée par d’autres utilisateurs
Objectivité : identifie l’objectif et les tendances du
site et si l’information est un fait ou juste une
opinion, si elle est d’ordre commercial ou si elle est
sujet de conflit d’intérêt, etc.
Instantanéité : reliée à l’actualité de l’information
des sites
7
Couverture : reflète l’efficacité et la profondeur de
l’information des sites
1.2 Crédibilité : une dimension d’Internet
L’importance du concept vient de la « surabondance
informationnelle » sur Internet et de l’accès direct
offert à l’usager qui devrait valider le contenu de ce
qu’il a trouvé.
Des études ont démontré que seulement 23% parmi 60% qui
accèdent eux-mêmes aux services web trouvent ce qu’ils
cherchent (Miteko, 2006). Cette défaillance dans la
récupération de l’information est due probablement à
l’incompétence des usagers mais aussi à d’autres paramètres
qui affectent la crédibilité de l’information sur Internet
comme les outils utilisés pour accéder aux réseaux,
notamment logiciel et matériel. Des recherches confirment
que l’environnement numérique peut affecter la crédibilité
de l’information (Lankes, 2008) surtout que les usagers
doivent utiliser ces outils d’Internet pour y accéder. Par
exemple, au moment où l’étudiant lance une requête sur le
moteur de recherche Google et lorsqu’il y aura le résultat
et lira son texte sur la page du site, il croira qu’il est
en train de prendre sa décision vis-à-vis la crédibilité du
contenu de ce texte dépendamment du site web et n’imaginera
guère que le moteur de recherche Google pourrait de même
affecter la crédibilité de son texte. Mais ceci est un
jugement superflu et non fondé. D’abord, parce que l’usager
8
concentrera son attention uniquement sur le facteur
technique et évaluera la crédibilité du contenu de son
document en fonction du temps de chargement de la page ou
bien de la capacité de l’outil à afficher les documents
images ou vidéos alors que les concepteurs de moteur de
recherche peuvent installer des filtres ou n’importe quel
outil qui pourrait affecter la crédibilité et induirait
l’étudiant en erreur. L’important est que ces outils soient
invisibles aux yeux de l’étudiant et le jugement de la
crédibilité de la part des usagers est généralement
unidimensionnel lié à ce qui est visible (condition du
site, temps de chargement, qualité de l’affichage…etc.).
Des recherches récentes ont présenté des explications plus
profondes concernant les paramètres qui peuvent affecter la
crédibilité (Lankes, 2008). Selon ces recherches, il est
évident que tous les maillons de l’architecture d’Internet
(Infrastructure, Application, Service d’information,
Utilisation) affectent de près ou de loin la crédibilité
sur Internet.
A. Infrastructure
L’infrastructure d’Internet est composée de hardware
surtout des routeurs, des protocoles (exemple Transmission
Control Protocol/ Internet Protocol) et des organisations
comme le cas des fournisseurs de service Internet. Cette
infrastructure est complètement écartée par les usagers
lors de l’évaluation de la crédibilité de l’information
9
alors que les fournisseurs peuvent bloquer la connexion
d’un point émetteur à un point récepteur avec une
discrétion totale du côté des usagers qui ne peuvent pas
découvrir l’opération. Par exemple quand un étudiant veut
accéder à un site quelconque, le fournisseur bloque ce
site, l’étudiant ne voit que l’indication « site non
trouvé » et il jugera que c’est le serveur qui a causé
cette inaccessibilité et non le fournisseur.
B. Application
L’application représente les programmes qui assurent la
communication entre différents acteurs sur Internet surtout
les moteurs de recherche, le protocole http et le protocole
SMTP. La crainte d’une évaluation erronée de la crédibilité
de l’information vient de l’effet que peut causer ces
programmes. Les filtres de la messagerie à l’instar des
« Spams » est un exemple qui illustre l’implication de ces
applications dans le processus d’évaluation.
C. Service d’information
Le service d’information sur Internet reflète les
organisations et les acteurs qui emploient
l’infrastructure et les applications pour fournir l’accès
informationnel à l’usager, citons Google, Facebook,
Twitter, site web d’une bibliothèque. L’implication de ces
acteurs dans l’évaluation de la crédibilité est importante.
L’affichage des résultats de recherche que ce soit sur les
moteurs de recherche ou sur le catalogue de la bibliothèque
10
et le classement de ces résultats n’innocentent pas ces
acteurs et leur pression sur l’avis de l’usager et sur la
crédibilité de l’information retrouvée.
11
D. Usage
L’usage se rapporte aux utilisateurs (étudiants,
enseignants, clients) qui sont en quête de l’information.
Ils utilisent entre autres Internet pour rechercher et
récupérer l’information désirée. Des statistiques
témoignent la participation des usagers dans la
circulation des informations sur le web 2.0 ((Lankes, 2008,
p.671). 26% des usagers partagent et communiquent avec les
créateurs, 30% d’entre eux utilisent couramment les
services sur le web 2.0 et 34% d’entre eux produisent de
l’information et l’incorporent sur Internet. Mais une
telle participation ne peut en aucun cas garantir une
évaluation raisonnable de la crédibilité, car la plupart
des usagers ne possèdent pas les habilités nécessaires pour
présenter un jugement crédible sur le contenu de
l’information.
En somme, la question de la crédibilité de l’information
sur le Net ne se résume pas dans la pertinence du contenu
mais elle concerne aussi les outils utilisés sur Internet.
L’effet de ces outils sur l’évaluation de la crédibilité
est majeur et important. Devant cette situation, la
position de l’usager par rapport à la crédibilité est
ambivalente : elle est dépendante de ces outils car il
s’avère qu’ils jouent un rôle central dans la détermination
de la crédibilité. Mais elle est aussi indépendante car
12
l’usager est amplement impliqué et est devenu créatif avec
ce que offre le web 2.0.
2. Crédibilité : Quel rôle pour l’usager
Comme indiqué ci-dessus, l’avènement d’Internet et surtout
du web 2.0 a permis à l’usager de contribuer à
l’enrichissement du contenu sur le Net non seulement par
la consommation passive de l’information mais aussi par la
production de cette information. L’usager est désormais un
« consomm-acteur » (Quoniam ; Boutet, 2008). De nombreux
producteurs ajustent leurs sites ou interfaces et bien
évidemment leurs services en fonction des commentaires et
des critiques des clients (exemple Amazon).
Toutefois, la situation du « consomm-acteur » indique la
complexité de sa position vis-à-vis la crédibilité de
l’information sur Internet. Son implication et son
indépendance dans la recherche de l’information mais aussi
sa dépendance aux outils utilisés sur Internet ont créé une
sorte de frustration chez les usagers qui se situent entre
deux situations : un « vécu » et un « voulu » :
Le « vécu » est caractérisé principalement par une
technologie de réseaux non participative et une absence
quasi-totale de la transparence. Les critères de la
crédibilité des documents eux-mêmes sont prédéterminés
par les producteurs, les fournisseurs du service
Internet ou bien par les organisations et acteurs du
service de l’information sur le Net. Certaines
13
bibliothèques collégiales et universitaires par exemple
imposent des filtres pour limiter l’accès des étudiants
aux sites Internet de crainte qu’ils accèdent à des
sites prohibés par exemple. Cette façon de borner
l’accès est une forme « autoritaire » et ne donne
aucune responsabilité aux étudiants qui sont le maillon
central du processus de recherche de l’information.
Le « voulu » est caractérisé par une implication
avantageuse de l’usager dans le processus de
circulation de l’information sur Internet. Les produits
« Open Source » et les mouvements qui défendent
l’intérêt de l’usager ont proposé une nouvelle voie de
communication et de « conversation » avec l’usager pour
rendre public par exemple le code source de l’outil ce
qui permet aux usagers techniquement chevronnés de
tester le produit. Cette conception transparente a
permet de redéfinir la crédibilité des outils utilisés
sur Internet qui désormais désigne la transparence au
moment du développement du produit. L’usager aura ainsi
confiance en ce produit et pourra déterminer les
caractéristiques confiantes de l’outil et l’expertise
du créateur qui sont des concepts clés pour définir la
crédibilité.
L’usager en fait est à la croisé des chemins : d’un côté il
est guidé et exclut de toutes les étapes de la production
des outils et n’ayant que le rôle d’un récepteur. De
14
l’autre côté, il est devenu partenaire, producteur et
parfois concepteur non seulement par la production du
contenu sur le web 2.0 mais aussi par son rôle dans la
conception des outils notamment ceux d’ « Open Source ».
Quoi qu’il en soit, le développement de la technologie du
web 2.0 notamment sa facilité d’utilisation et sa
flexibilité technique ont engendré une immense potentialité
aux usagers pour communiquer (émettre des commentaires, des
critiques…etc.), collaborer et enrichir le contenu sur
Internet.
3. De l’autorité à la fiabilité
Le degré de l’implication de l’usager 2.0 en tant que
maillon principal dans la chaine informationnelle a
certainement introduit des changements multidimensionnels :
technologiques, communicationnels, sociaux et même
conceptuels ce qui a imposé un transfert du concept
"autorité" qui était auparavant le concept central dans le
processus de recherche de l'information vers le concept
"fiabilité" qui règne présentement en tant que critère
primordial lors de la validité des résultats de recherche.
3.1 Définition de l’autorité
Historiquement, la notion d'autorité est attachée à
l'obéissance et à la soumission et implique un ordre
15
hiérarchique entre ceux qui détiennent l'autorité et ceux
qui obéissent à cette autorité (ARENDT, 1954). Mais au
moment de l'apparition du web, la notion d'autorité est
devenue un indice clé pour les internautes puisqu'elle sert
à mesurer la pertinence des résultats de recherche obtenus.
Elle est souvent connue sous l'appellation "autorité
informationnelle" (BROUDOUX, 2007) et elle est subdivisée
en quatre sous concepts :
a. Autorité énonciative détenue par l'auteur
(individuel ou collectif) du document sur le web
b. Autorité institutionnelle où le rôle de l'éditeur
est important pour l'usager pour repérer le contenu
pertinent.
c. Autorité du contenu du document lorsque le repère
de l'internaute devient le contenu : genre
(scientifique, littéraire. etc), qualité (restreint
ou détaillé), sources (auteur, programme, etc.) et
publication (wiki, blogs, site officiel, etc), qui
peut influencer le choix des internautes
d. Autorité du support qui est reliée au type du
support publié (type de document électronique,
caractère de la publication, etc).
Bien que la notion de "l'autorité informationnelle"
élargisse le sens traditionnel de l'autorité surtout par la
multiplication des acteurs de l'autorité, elle ne reflète
pas le statu quo du web 2.0 car elle exerce une orientation
16
autoritaire sur l'internaute. De plus, ces différents types
d'autorités ont perturbé l'internaute qui demeure incapable
de choisir et de repérer le contenu jugé pertinent.
3.2 Définition de la fiabilité
La fiabilité est la cohérence de mesure. Une mesure est
considérée fiable si la personne qui a effectué la mesure
aura le même score dans deux reprises consécutives (Hernon,
P; Schwartz, C, 2009). La fiabilité n'est pas un objet de
mesure mais d'estimation. Dans le contexte de la recherche
de l'information, la fiabilité désigne la cohérence du
contenu qui se manifeste dans son exactitude et dans sa
pertinence.
Quoi qu'il en soit, le concept de "fiabilité" se généralise
et s'enracine au moment de la recherche de l'information
sur le web comme un critère indispensable de la crédibilité
du contenu de l'information sur Internet. À contrario, celui
de l'autorité est en voie de disparition. Sa diminution est
due aux raisons suivantes :
- La participation des usagers du web 2.0 dans la
conception de certaines applications et parfois de
l'infrastructure sur le Net a permis de repositionner
l'internaute qui a cessé d'être un utilisateur réceptif
pour devenir un "consom-acteur",
17
- La transformation dans la notion de l'autorité lui même
qui était auparavant une seule et unique autorité
désignant la soumission au détenteur de la connaissance.
Mais avec le web 2.0, elle a connu une décentralisation
et une multiplication des autorités (multi-auteurs,
nouveaux intermédiaires comme les bloggers, lecteurs-
auteurs, etc).
- Le renforcement du rôle de l'internaute qui fait partie
de ceux qui détiennent l'autorité.
Cette nouvelle tendance exige une redistribution des rôles
entre les acteurs qui produisent ou diffusent de
l'information. De facto, le lecteur est devenu un lecteur-
auteur, un concepteur d'une application informatique, d'une
infrastructure, etc. Comment les "anciens acteurs" du
domaine de l'information parviennent-ils alors à
poursuivre leur rôle en tant que médiateurs qui offrent une
information pertinente et "fiable" à l'usager en respectant
ses nouvelles qualités? C’est l’objet des sections
suivantes.
4. L’adaptation sinon la disparition
Malgré le changement technique et social qu'a imposé le web
2.0, plusieurs médiateurs de l'information défendent encore
la notion de l'autorité sous sa forme traditionnelle. En
18
début des années 90, avec l’avènement d’Internet, les
bibliothécaires ont amoindri l’importance du phénomène en
prétendant qu’Internet ne dispose point d’une information
pertinente et fiable et jusqu’à l’heure actuelle, certaines
bibliothèques, surtout celles universitaires, ont continué
à rendre leurs services aux usagers sans s’adapter aux
changements de l’époque informationnelle 2.0. Les
institutions d’enseignement et le corps professoral,
notamment ceux du secteur universitaires continuent à
suivre les méthodes traditionnelles d’enseignement, alors
que l’étudiant 2.0 pourrait trouver en ligne des cours,
des manuels et des présentations qui couvrent toutes les
disciplines. Les médecins prétendent, dans la plupart du
temps que c’est eux seules qui détiennent le monopole de la
connaissance en médecine, alors qu’une simple recherche via
Google peut offrir au moins un aperçu global sur la maladie
ou le traitement. Il est devenu inévitable de s’adapter et
de prendre en considération les possibilités de
personnalisation offertes actuellement à l’internaute 2.0.
Autrement, avec l’accès direct à une vaste sources de
données diversifiées, l’usager apprendra au fur et à
mesure, d’une façon formelle ou informelle à chercher, à
repérer et à récupérer l’information car à force de
manipuler ces nouveaux outils sur le web, il sera conscient
de son habilité à trouver ce qu’il cherche et il finira par
développer une expertise et une auto-confiance vis-à-vis
19
la crédibilité de contenu. À ce stade, l’usager ne sentira
plus le besoin d’une autorité parce qu’il sera lui-même
une autorité.
5. Vers un nouveau modèle du service rendu
Afin que les médiateurs de l’information préservent leurs
positions comme auparavant et que les lieux qui abritent
les sources informationnelles comme les bibliothèques
restent au diapason des exigences et des attentes de leurs
utilisateurs, il demeure nécessaire de :
Offrir plus d’opportunités aux usagers pour participer
à « la personnalisation des services qu’ils désirent recevoir et leur donner
les moyens pour y arriver » (Houda Bachisse, Christine Dufour,
2011) en plus de créer des espaces de conversation pour
les usagers comme le cas d’Amazon et de Facebook.
Renforcer l’expertise des médiateurs (bibliothécaires
par exemple) au niveau des technologies de
l’information pour leur permettre de livrer des
services instantanément à jour et de se perfectionner
dans les techniques existantes sur le web 2.0
Enrichir les formations documentaires destinées aux
utilisateurs des bibliothèques en intégrant la notion
de crédibilité de l’information sur Internet, les
éléments qui peuvent l’affecter (Infrastructure
d’Internet, les applications, fonctionnement des
moteurs de recherche, etc.) afin de perfectionner les
20
usagers dans la validation du contenu de l’information
sur le web.
Adapter les services en fonction des besoins
particuliers des usagers.
Somme toute, l’adaptation des services informationnels au
diapason de ce qu’offre la technologie du web 2.0, la
démocratisation de l’autorité qui amène le médiateur à
transformer son mode traditionnel de médiation et de
diction vers un espace de communication, de discussion et
de participation avec l’utilisateur et le renforcement de
l’expertise que ce soit du côté des formateurs ou du côté
de l’utilisateur sont les éléments nécessaires qui
conserveront la confiance des utilisateurs du web 2.0 dans
les institutions sources d’informations et de savoir.
Conclusion
Dans cet article, nous avons essayé de démontrer le
bouleversement qu’a causé le web 2.0, entre autres sur le
comportement de l’usager qui est devenu « autosuffisant »
au niveau informationnel compte tenu de son accès direct
aux sources de l’information à travers Internet. Mais aussi
la dépendance de cet usager aux fournisseurs de
l’information et des outils existants sur Internet a
renforcé la position de l’usager par rapport à la chaine
de production, de diffusion et de récupération de
l’information. Il est devenu apte à trouver de
21
l’information et à choisir ce qui l’intéresse. Les
médiateurs de l’information (bibliothèques, institutions
d’enseignement, bibliothécaires, professeurs, etc.) sont
appelés à faire face à ces nouvelles tendances et ce par :
Reconnaitre les habiletés que possèdent les usagers du
web 2.0 qui sont devenus de plus en plus autonomes et
capables de récupérer l’information parfois sans
recourir au médiateur,
« s’ouvrir au client » (Bachisse et Dufour, 2011)
tout en établissant des espaces physiques ou virtuels
de conversation, de communication et de participation
des usagers,
Renforcer l’expertise, surtout ce qui a trait aux
technologies sur Internet et former l’usager pour
qu’il soit apte à valider lui-même le contenu de
l’information.
Bibliographie
1. Arendt, A. (1954). La crise de la culture. Folio/Essais
(1989).
2. Bachisse, Houda, et Christine Dufour. 2011. Le Web 2.0 dans les bibliothèques : vers un nouveau modèle de service. Documentation et bibliothèques 57 (1):5-18.
3. Bell, Suzanne.” Wikis as Legitimate Research Sources”.
Online. Medford, Nov/Dec 2008.
22
4. Broudoux E. Construction de l’autorité
informationnelle sur le web (dir. Skare R., Windfield
Lund N., Varheim A.) « A Document (re)turn » (contributions from
a research field in transition). Peter Lang/Europäischer Verlag
der Wissenschaften, pp.265-278, mars 2007.
5. Flannigan, A. and Metzger, M., “Introduction, in
MacArthur 2007”, Digital Media, Youth, and Credibility, MacArthur
Foundation Series on Digital Media and Learning, Chicago, IL,
2007
6. Hernon, P.; Schwartz, C. “Reliability and validity”.
Library & Information Science Research, Volume 31, Issue 2,
April 2009, Pages 73-74.
7. Metzger, M.J. “Making sense of credibility on the
web: Models for Evaluating Online Information and
Recommendations for Future Research”, American society for
information science and technology, Vol 58 (13): 2078-2091,
2007.
8. Miteko, T. « Driving value from every online customer
interaction : the power of intent-driven
personalization », Customer Inter@ction olutions.,Vol.24 No.
8, pp.38-41, 2006
9. O'Reilly, T. « What is Web 2.0: Design Patterns and
Business Models for the Next Generation of Software”.
Communications & Strategies, No. 1, p. 17, First Quarter 2007
23
10. Piroll, Fabrice. « Web 2.0 et pratiques
documentaires : évolutions, tendances et
perspectives », Lavoisier, N.1, Vol 6, pp81-95, 2010.
11. Quoniam, Luc et Boutet, Charles-Victor. « Web
2.0 : La révolution connectique », Lavoisier, Vol. 11, N.
1; pp. 133-143, 2008
12. R. David Lankes, (2008) "Credibility on the
internet: shifting from authority to reliability",
Journal of Documentation, Vol. 64 Iss: 5, pp.667 – 686
13. Stephens, M.”Participation in a 2.0”. World library
Technology Reports, 2007.
24