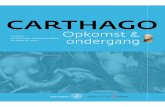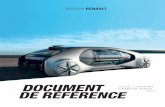Carthago in de 20e- en 21e-eeuwse verbeelding: Films, stripverhalen en gezelschapsspelen
« Les territoires mouvants de la production de montres japonaises : le groupe Seiko au cours du 20e...
Transcript of « Les territoires mouvants de la production de montres japonaises : le groupe Seiko au cours du 20e...
ENTREPRISES ET HISTOIRE, 2014, N° 74, pages 71 à 87 71
© Éditions ESKA, 2014
LES TERRITOIRES MOUVANTS DE LA PRODUCTION
DE MONTRES JAPONAISES : LE GROUPE SEIKO AU COURS
DU XXe SIÈCLEpar Pierre-Yves DONZÉ
Professeur associé d’histoire économique Université de Kyoto
Le groupe Seiko, la plus grande entreprise horlogère japonaise, a connu au cours du XXe siècle trois grands modes d’organisation territoriale de son système de production. La fabrication de montres a été successivement réalisée au sein du cluster urbain de la petite mécanique, à Tokyo (1895-1940), du district industriel de Nagano (1940-1985) et d’un système transnational de production en Asie de l’Est et du Sud-est (depuis 1985). Cet article présente les caractéris-tiques de ces divers types organisationnels, ainsi que les facteurs qui ont rendu nécessaire le passage à de nouvelles formes d’organisation industrielle.
INTRODUCTION
La localisation des firmes dans des territoires particuliers a donné lieu à une vaste littérature. De nombreux travaux se situant dans la continuité de Marshall1 et de Beccatini2 mettent l’accent sur les exter-
nalités dont bénéficient les entreprises au sein d’agglomérations tels que les districts industriels. La proximité géographique de firmes actives dans un même secteur industriel leur permet notamment de béné-ficier d’une main-d’œuvre qualifiée et de savoir-faire communs3. D’autres travaux,
ENTREPRISES ET TERRITOIRES
1 A. Marshall, Principes d’économie politique, rééd., Paris-Londres, Gordon and Breach, 1971.2 G. Beccatini, “Dal settore industriale al distretto industriale: alcune considerazioni sull’unita’ di indagine dell’economica industriale”, Rivista di economia e politica industriale, vol. 1, n° 5, 1979, p. 7-21.3 Voir la synthèse de J.-C. Daumas, « Dans la «boîte noire» des districts industriels », in J.-C. Daumas, P. La-mard et alii (dir.), Les territoires de l’industrie en Europe (1750-2000). Entreprises, régulations et trajectoires, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2007, p. 9-34.
72 ENTREPRISES ET HISTOIRE
PIERRE-YVES DONZÉ
portant sur l’organisation des entreprises multinationales, montrent que les choix de localisation de certaines de leurs filiales répondent à une nécessité d’accéder à des ressources spécifiques – parfois elles-mêmes établies dans des agglomérations particu-lières4 – et dépendent de la capacité de ces firmes à gérer et à intégrer un ensemble de ressources géographiquement dispersées afin de rester compétitives5. Cependant la plupart de ces modèles théoriques présentent une vision relativement statique de la question de l’ancrage territorial des firmes. Les raisons pour lesquelles des entreprises s’établissent dans des territoires particuliers, s’y déve-loppent, puis décident ou non de redéployer leur implantation varient au cours du temps et nécessitent une approche analytique qui mette l’accent sur l’évolution de l’en-vironnement technique, institutionnel et concurrentiel.
La frontière des modèles organisation-nels entre le district industriel et l’entreprise globale est toutefois poreuse6. Aussi convient-il d’analyser les enjeux que repré-
sente la mutation d’un modèle vers l’autre en termes d’organisation du territoire de la production. C’est cette approche qui fait l’objet de cet article. Elle est appliquée au cas du groupe horloger japonais Seiko, devenu l’un des plus grands fabricants d’horlogerie du monde au cours des années 1930 et la première entreprise du monde à lancer sur le marché une montre à quartz en 19697.
L’industrie horlogère mondiale comprend elle-même des entreprises dont la localisa-tion répond aux deux grands types présentés dans la littérature théorique. D’une part, il y a le modèle classique du district indus-triel, représenté par le cas suisse jusqu’aux années 19808. Un système de production similaire, dans lequel la compétitivité des firmes repose sur la flexibilité du système de production, peut également être observé dans le cas de Hong Kong depuis la fin des années 19509. D’autre part, il faut citer le cas de la grande entreprise industrielle ayant adopté le système de production de masse, comme c’est le cas aux États-Unis depuis les années 186010. Les entreprises améri-
4 A. Markusen, “Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts”, Economic Geography, vol. 72, n° 3, 1996, p. 293-313.5 J. H. Dunning et S. M. Lundan, Multinational enterprises and the global economy, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2008, p. 593-603.6 A. Colli, “‘Pocket Multinationals’: Some Reflections on ‘New’ Actors in Italian Industrial Capitalism”, in H. Bonin et alii (eds.), Transnational Companies 19th-20th Centuries, Paris, Plage, 2002, p. 155-178 et J. Catalan et R. Ra-mon-Muñoz, “Marshall in Iberia. Industrial Districts and Leading Firms in the Creation of Competitive Advantage in Fashion Products”, Enterprise & Society, vol. 14, n° 2, 2012, p. 327-359.7 Sur Seiko, voir M. Hirano, Seikosha shiwa, Tokyo, Seiko, 1968, Seiko tokei no sengoshi, Tokyo, Seiko, 1996 et P.-Y. Donzé, “Rattraper et dépasser la Suisse”. Histoire de l’industrie horlogère japonaise de 1850 à nos jours, Neuchâtel, Alphil-Presses universitaires suisses, 2014.8 O. Crevoisier, La transformation de l’industrie horlogère dans l’Arc jurassien suisse de 1960 à 1990, Neuchâtel, IRER, 1990 et B. Veyrassat, “Manufacturing flexibility in nineteenth-century Switzerland: social and institutional foundations of decline and revival in calico-printing and watchmaking”, in C. F. Sabel et J. Zeitlin (eds.), World of Possibilities. Flexibility and Mass Production in Western Industrialization, New York, Cambridge University Press, 1997, p. 188-237.9 P.-Y. Donzé, “The changing comparative advantages of the Hong Kong watch industry (1950-2010)”, Kyoto Eco-nomic Review, n° 170, 2012, p. 28-47.10 D. R. Hoke, Ingenious Yankees. The Rise of the American System of Manufacturers in the Private Sector, New York, Columbia University Press, 1990.
AVRIL 2014 − N° 74 73
LES TERRITOIRES MOUVANTS DE LA PRODUCTION DE MONTRES JAPONAISES
caines sont d’ailleurs les premières dans cette industrie à prendre la forme d’entreprises multinationales, avec par exemple l’ouverture de filiales en Suisse par les sociétés Gruen Watch (1903), Bulova Watch (1911) et Benrus Watch (1927)11.
Le cas de Seiko permet non seulement de contribuer à une meilleure connaissance du fonctionnement territorial de ces divers types d’organisation industrielle, mais aussi de discuter des raisons qui font passer la firme d’un modèle à l’autre. Depuis son engage-ment dans la fabrication de montres en 1895 jusqu’à la période actuelle, cette entreprise a en effet connu plusieurs types successifs d’organisation territoriale, qui répondent tous à une évolution des marchés de la firme, des technologies de production et de l’environne-ment compétitif. L’article est divisé en trois parties, qui correspondent chacune à un terri-toire productif particulier.
L’USINE INTÉGRÉE ET LES PREMIERS ESSAIS DE PRODUCTION DE MASSE (1895-1940)
L’implantation territoriale de la société Hattori & Co. (ci-dessous : Seiko) reste relativement stable et homogène jusqu’au déclenchement de la Seconde Guer re mondiale. L’entreprise, spécialisée dans la production d’horloges et de montres, est la principale firme de l’industrie horlogère japonaise. En 1920, elle représente 64,2 % de la production nationale d’horloges et 88,1 % pour les montres. Elle connaît une très forte croissance, avec une production annuelle qui passe de 200 000 pièces en 1906
à 1,3 millions en 1935 pour les horloges, et de 25 000 à 708 000 pièces pour les montres12. Cet essor repose pour l’essentiel sur le marché domestique, pour lequel Seiko bénéficie d’un protectionnisme douanier grandissant, ainsi que sur les marchés asiatiques pour les horloges. Cependant aucune délocalisation de la production dans les principaux marchés de la firme n’est envisagée. Son modèle organi-sationnel est celui du système de production de masse dans une entreprise intégrée.
Ainsi, durant près de quatre décennies, cette entreprise concentre l’ensemble de ses activités managériales et productives dans la ville de Tokyo. Le grand séisme de Kanto (1923) n’a pas d’influence sur l’implantation de l’entreprise et la reconstruction après le tremblement de terre renforce l’usine intégrée dans le quartier de Honjo.
La mise en place et les débuts de l’entreprise
Fils d’un négociant de Tokyo, Hattori Kintaro (1860-1930), le fondateur du groupe Seiko, a une formation à la fois commer-ciale et technique13. Hattori ouvre en 1877 un commerce d’horlogerie d’occasion, dont le bénéfice est investi quatre ans plus tard dans la création d’une société possédant un centre de vente dans le quartier de Ginza, dans l’arrondissement de Kyobashi (1881). L’établissement de son commerce dans ce quartier n’est pas un hasard. Après la restau-ration Meiji, le quartier de Ginza, situé au cœur de la capitale impériale, devient le principal quartier où les biens de consom-mation de luxe, généralement importés, sont vendus. Reconstruit et réaménagé à deux reprises après les incendies de 1869 et 1872, Ginza devient le symbole de la
11 M. Richon, Omega Saga, Bienne, Fondation Adrien Brandt en faveur du patrimoine Omega, 1998, p. 422-468.12 M. Hirano, Seikosha…, op. cit., annexes statistiques.13 S. Wakayama, Tokeio : Seiko okoku wo waraita otoko, Tokyo, Seiko Institute of Horology, 2002.
74 ENTREPRISES ET HISTOIRE
PIERRE-YVES DONZÉ
modernité à Tokyo et dans l’ensemble du Japon. Parmi les nombreux commerces à s’établir dans ce quartier, il faut souligner la présence de plusieurs grands négociants en horlogerie, comme Kobayashi Denjiro (1876) ou Tenshodo (1879)14. Hattori s’établit ainsi au cœur du marché horloger japonais. Son commerce devient l’un des principaux symboles de Ginza, sous le nom de Wako, et l’est resté jusqu’à aujourd’hui.
Une dizaine d’années plus tard, Hattori décide de s’engager dans la production de pendules (1892). Il rachète une ancienne fabrique de verre située dans l’arrondisse-ment de Honjo. Cet atelier comprend une dizaine d’employés et produit des pendules commercialisées sous la marque Seikosha. Hattori diversifie rapidement sa production, avec la fabrication de boîtes de montre (1893), de montres de poche (1895) et de réveils (1899). Sa volonté d’expansion l’amène aussi à envisager la construction d’une fabrique neuve. En octobre 1893, il achète du terrain, toujours dans l’arrondissement de Honjo, où il construit un bâtiment plus grand dans lequel il déplace son atelier le mois suivant15. Il s’agit d’une usine moderne, équipée de moteurs électriques, et comprenant 90 ouvriers, tandis que le siège de l’entreprise, resté à Ginza, ne compte que vingt personnes16.
L’arrondissement de Honjo est l’un des plus actifs districts industriels de la mécanique et des machines du Japon de la période Meiji. Il réunit 166 fabriques
actives dans la mécanique en 1909, prin-cipalement des petites entreprises (92 ont moins de 10 employés). Il s’agit d’un véri-table district industriel urbain, dans lequel s’observe la circulation des savoir-faire d’une usine à l’autre, grâce à un marché du travail fluide et à la constitution de réseaux de sous-traitance, soit autant d’éléments qui profitent à un essor général de ces entre-prises au niveau technique17. Hattori recourt lui-même à certaines de ces entreprises, avec par exemple la commande de pignons d’hor-loges à une fabrique de parapluies dans les années 190018. Parmi ses rares sous-traitants, il faut également citer le cas de l’atelier de machines-outils Wachigai, fondé en 1887 dans l’arrondissement de Honjo19. Cette entre-prises produit des pièces pour les horloges de Hattori dès les années 1890 et collabore ensuite à la production de machines20. Mais le modèle de manufacture intégrée adopté par Hattori dans sa fabrique d’horloges est plutôt celui d’une production en interne de l’ensemble des pièces du mouvement et de leur assemblage. Il ne dépend en principe de sous-traitants que pour les boîtiers et acces-soires de l’habillage, dont il s’approvisionne auprès d’artisans établis pour l’essentiel dans le quartier de Honjo21.
En outre, il faut mentionner le rachat par Hattori Kintaro vers 1899 d’une ancienne fabrique de machines établie dans l’arron-dissement de Furukawa-ku, environ trois kilomètres au sud-ouest de la fabrique
14 Kokoku de kataru tenshodo to ginza no 100 nen, Tokyo, Tenshodo, 1979.15 M. Hirano, Tokeio: Hattori Kintaro, Tokyo, Jiji tsushin, 1972, p. 208. 16 Seiko tokei…, op. cit., p. 4.17 A. Imaizumi, “Sangyo shuseki no koteiteki kouka to shusekinai kojo no tokucho. Meiji goki no tokyofu ni okeru kikai kanren kogyo wo taisho ni”, Rekishi to keizai, vol. 201, 2008, p. 19-33.18 H. Uchida, Tokei kogyo no hattatsu, Tokyo, Seiko Institute of Horology, 1985, p. 323.19 Daini Seikosha, vol. 29, 1958, p. 13.20 Daini Seikosha, vol. 89, 1963, p. 16.21 H. Uchida, Tokei kogyo…, op. cit., p. 328.
AVRIL 2014 − N° 74 75
LES TERRITOIRES MOUVANTS DE LA PRODUCTION DE MONTRES JAPONAISES
Seikosha. Renommée Furukawa Ironworks, cette entreprise devient un atelier de fabri-cation de machines pour Seikosha et est placée sous la responsabilité du directeur de la fabrique d’horloges22.
Ainsi, durant la période de mise en place de l’entreprise, l’usage du territoire tokyoïte que fait Hattori illustre la volonté de recourir aux avantages spécifiques de certains quartiers, pour ses activités aussi bien commerciales que productives. En ce qui concerne plus particulièrement la production, le territoire de l’entreprise se limite à l’arron-dissement de Honjo.
La reconstruction après le grand séisme de Kanto
Le grand séisme de Kanto, qui fait plus de 140 000 morts et détruit la ville de Tokyo – dont la fabrique Seikosha –, a des effets marqués sur le district industriel de Honjo et la présence des entreprises de mécanique dans la ville de Tokyo. Asuka Imaizumi a bien mis en évidence que, si les effets à court terme sont désastreux en raison des nombreuses pertes matérielles et humaines, les effets à moyen terme sont bénéfiques en ce sens que la reconstruction est l’occasion de bâtir des entreprises rationnellement organi-sées et équipées de matériel moderne23. Bien qu’on observe à cette occasion le départ de plusieurs entreprises des arrondissements industriels comme Honjo vers la banlieue de la ville, où elles trouvent plus de place pour
redéployer leurs activités, Tokyo n’en reste pas moins une ville industrielle et renforce même son importance nationale dans l’in-dustrie mécanique.
Seiko est une excellente illustration de cette dynamique. Dans un premier temps, les effets du séisme débouchent sur une grave crise. L’ensemble des bâtiments sont détruits dans des incendies, pour une perte totale estimée à 8,5 millions de yens, soit environ le double de la valeur de sa production annuelle au début des années 192024. De surcroît, le fait que la production de Seikosha est quasi nulle en 1924 et 1925 crée des conditions favorables à la concurrence, surtout pour l’horlogerie de gros volume, dont les entre-prises rivales sont basées principalement dans la ville de Nagoya et donc ne sont pas touchées par le séisme25. Cependant, à moyen terme, cet événement tragique apparaît comme une crise salutaire qui permet de reconstruire une usine plus moderne, mieux équipée et rationnellement organisée. La production est successivement reprise en 1924 pour les horloges (mars), les montres de poche (avril) et les réveils (septembre). En décembre, Hattori lance même un nouveau type de montre-bracelet, sous la marque Seiko26.
La seconde partie des années 1920 est une période de relance de la production et de réorganisation du travail27. Hattori cherche à se lancer dans la production de masse de montres et rationalise son système de production, avec l’emploi grandissant de
22 M. Hirano, Tokeio..., op. cit., p. 102-105.23 A. Imaizumi, “Tokyofu kikai kanren kogyo shuseki ni okeru kanto daishinsai no eikyo: sangyo shuseki to ichijiteki shokku”, Shakai-keizaishi gaku, vol. 74, n° 4, 2008, p. 23-45.24 M. Hirano, Seikosha…, op. cit., p. 185.25 Sur les fabricants d’horloges de Nagoya, voir H. Uchida, Wall Clocks of Nagoya, 1885-1925, Tokyo, Hattori Seiko, 1987.26 M. Hirano, Seikosha…, op. cit., p. 191.27 P.-Y. Donzé, “The hybrid production system and the birth of the Japanese specialized industry: Watch production at Hattori & Co. (1900-1960)”, Enterprise & Society, vol. 12, n° 2, 2011, p. 356-397.
76 ENTREPRISES ET HISTOIRE
PIERRE-YVES DONZÉ
jeunes filles non qualifiées dans les ateliers, la part des femmes parmi les salariés passant de 14,3 % en 1922 à 23,2 % en 1930, puis 42,2 % en 193528. Le site de production est également agrandi et transformé à plusieurs reprises, mais reste concentré à Honjo. Une seconde usine, spécialisée dans la fabrica-tion de montres, est ouverte en 1928 à côté du bâtiment principal. Enfin, une seconde usine de montres est ouverte (1934), suivie quelques années plus tard de la transfor-mation du bâtiment central, qui devient le centre de production de machines-outils pour l’entreprise (1937)29. Quant à la production de montres, elle est déplacée au sein d’une nouvelle entreprise, Daini Seikosha (litté-
ralement « Seikosha n° 2 »), dont le siège est établi dans une ancienne filature du quartier de Kameido (arrondissement de Honjo), à proximité de Seikosha30. Malgré la création de cette nouvelle entreprise, aucune société holding n’est créée pour assurer la gestion de l’ensemble des activités. Chaque entreprise est juridiquement indépendante mais leurs activités sont interdépendantes. Daini Seikosha vend ainsi l’ensemble de sa production à Hattori & Co. qui se charge de la commercialisation. Dans la pratique, c’est le conseil d’administration de Hattori & Co. qui forme le cœur du pouvoir de décision de ce groupe.
28 M. Hirano, Seikosha…, op. cit, annexes, p. 18-25.29 Seiko tokei…, op. cit., p. 9.30 Seiko tokei…, op. cit., p. 13.
Figure 1 : L’implantation territoriale de Hattori & Co. dans la ville de Tokyo, 1881-1940
Carte réalisée par l’auteur
AVRIL 2014 − N° 74 77
LES TERRITOIRES MOUVANTS DE LA PRODUCTION DE MONTRES JAPONAISES
Cependant les développements successifs de la production rendent nécessaire le recours à quelques sous-traitants, notamment pour la production de pièces d’habillage des montres, ainsi que pour leur assemblage. Or, contraire-ment à ce qui s’observe dans les années 1900, cette nouvelle génération de sous-traitants n’est pas forcément établie dans l’arrondisse-ment de Honjo. Il n’y en a guère qu’un seul qui y soit installé : la fabrique de boîtes de montre Hayashi Seiki Manufacturing, fondée par un ancien employé de Seikosha devenu indépendant au cours des années 1910 et avec qui Hattori entre en relations d’affaires en 192131. Quant aux autres, ils sont notam-ment établis dans l’arrondissement de Kita (fabrique de cadrans Shokosha, entrée en relations d’affaires en 1929) et la ville d’Ichi-kawa (préfecture de Chiba, à une dizaine de kilomètres de Honjo, atelier d’assemblage de montres Kojima Watch, 1917)32. Le nombre et l’inf luence de ces sous-traitants sont cependant trop faibles pour que l’on puisse évoquer une extension territoriale du système de production. Ils ne constituent qu’un apport de faible importance pour une entreprise qui reste très largement concentrée et qui vise à l’achèvement d’un système intégré de produc-tion de masse.
Ainsi, en installant sa fabrique d’hor-logerie dans le quartier de Honjo, Hattori mobilise aussi bien des ressources spécifiques à ce territoire que d’autres d’origine externe afin de mettre sur pied un système de produc-tion de masse pour la fabrication d’horloges et de montres. Les ressources spécifiques au quartier de Honjo sont relatives à la présence ancienne d’une main-d’œuvre qualifiée dans le domaine de la petite mécanique. Durant la période Edo (1603-1868), ce quartier proche du centre-ville de Tokyo connaît déjà
la présence d’un artisanat vaste et diver-sifié, qui devient à la fin du XIXe siècle un réservoir important de main-d’œuvre pour la petite industrie. Toutefois il convient de ne pas surinterpréter le rôle de ce territoire dans l’essor de la fabrique Hattori, dont l’or-ganisation et la direction interne dépendent d’ingénieurs et de techniciens issus d’univer-sités et d’écoles supérieures créées par l’État afin d’introduire de nouvelles technologies au Japon – soit de ressources humaines qui ne sont pas spécifiques à une région33.
DES TERRITOIRES DE PRODUCTION DIVERSIFIÉS (1940-1985)
Les années 1940 sont l’occasion d’une profonde réorganisation de l’implantation territoriale du groupe Hattori. Toutefois ces changements ne découlent ni d’un choix stratégique visant à redéployer le système de production ni d’une mutation en termes de produits ou de marchés. Bien que les usines du groupe se convertissent à la production de guerre en 1938, cela n’implique pas une réorganisation fondamentale du système de production, dans le sens où la plupart des munitions produites par Hattori, notamment les détonateurs pour obus, présentent une grande convergence technologique avec les montres.
L’expérience de la guerreC’est pourtant bien la guerre qui est
à l’origine de la réorganisation territoriale du système de production du groupe Seiko, pour des raisons de transferts des usines
31 Daini Seikosha, vol. 11, 1957, p. 12.32 Daini Seikosha, vol. 12, 1957, p. 14, vol. 26, 1958, p. 17 et vol. 87, 1963, p. 16.33 P.-Y. Donzé, “The hybrid production system ..”, art. cit.
78 ENTREPRISES ET HISTOIRE
PIERRE-YVES DONZÉ
de munitions en-dehors des grandes villes afin de les mettre à l’abri des bombarde-ments américains, qui débutent en avril 194234. De nombreux ateliers de production sont établis dans les préfectures voisines de Tokyo, poursuivant et intensifiant un mouve-ment de réindustrialisation de ces régions qui avait débuté au cours des années 1930. Plusieurs de ces préfectures, en particulier celle de Nagano, comprennent en effet d’an-ciens districts industriels de la soie, pour lesquels l’essor des fibres artificielles dans l’entre-deux-guerres est un choc technolo-gique qui entraîne de nombreuses difficultés économiques. La relative proximité de Tokyo et la présence d’une main-d’œuvre ouvrière bon marché sont autant de facteurs qui soutiennent l’établissement de fabriques industrielles dans ces préfectures35. Ainsi, avant même les bombardements américains, en 1940, Daini Seikosha entre en relations d’affaires avec Yamazaki Watch, un petit négociant en horlogerie de Suwa (préfecture de Nagano), auquel est sous-traité l’assem-blage de certains modèles de montres et de détonateurs36. Lorsque les bombardements sur Tokyo commenceront, c’est dans cette ville que Daini Seikosha mettra sur pied un nouveau site de production dans lequel elle déplace machines et ingénieurs. De même, en 1942, le dirigeant de Yamazaki Watch fonde une nouvelle société à Suwa sous le nom de Yamato Works, afin de développer ses travaux de sous-traitance pour Daini Seikosha. Quant à l’usine de production
d’horloges (Seikosha), elle commence le transfert de ses activités en-dehors de Tokyo en 1943. Six succursales sont ainsi ouvertes, à Kiryu (1943), à Saitama (1943), à Gunma (1943), à Toyama (1944), à Sendai (1944) et à Suwa (1945)37.
Le déplacement des usines du groupe Seiko hors de Tokyo permettra de conserver intacte une grande partie de l’équipement industriel jusqu’à la fin de la guerre et de fournir ainsi une base essentielle à la reprise des activités horlogères après 1945. Par exemple, Daini Seikosha déplace à Suwa en 1942 environ 300 machines-outils horlogères en raison de la baisse de la production de montres, pour les mettre à l’abri des bombar-dements, si bien que la destruction du siège de l’entreprise, à Tokyo, lors des raids améri-cains mars 1945, n’a pas d’effets sur son équipement horloger38.
Les réseaux de sous-traitance après 1945
Après la guerre, la plupart des centres de production établis en-dehors de Tokyo sont fermés et les activités manufacturières rapa-triées dans la capitale, où de nouvelles usines sont reconstruites. Dès le début des années 1950, les ingénieurs de production engagés par le groupe Seiko travaillent à la mise sur pied d’un système de production de masse intégré, ce qui mène à une certaine centra-lisation des opérations manufacturières39. Toutefois d’autres activités sont difficilement
34 A. D. Coox, “The Pacific War”, in P. Duus (ed.), The Cambridge History of Japan, Volume 6: The Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 350.35 H. Cumeno, “Chiho toshigata sangyo shuseki no henka”, in H. Konaka et K. Maeda (dir.), Sangyo shuseki no saisei to chusho kigyo, Kyoto, Sekai shiso, 2003, p. 115-138.36 M. Hirano, Seikosha…, op. cit., p. 308.37 Seiko tokei…, op. cit., p. 15-16.38 Seiko tokei…, op. cit., p. 20 et M. Hirano, Seikosha..., op. cit., p. 339.39 P.-Y. Donzé, “The hybrid production system...”, art. cit.
AVRIL 2014 − N° 74 79
LES TERRITOIRES MOUVANTS DE LA PRODUCTION DE MONTRES JAPONAISES
rationalisables et automatisables, notamment la fabrication de pièces d’habillage (boîte, cadran) et l’assemblage final des produits. Aussi, ce sont pour l’essentiel ces activités qui sont sous-traitées depuis les années 1950 à des sociétés indépendantes et des filiales établies pour l’essentiel hors de la capitale. La recherche d’une main-d’œuvre en nombre croissant mène les entreprises manufacturières à quitter Tokyo pour assurer le développement de leur production. Cette stratégie mène chaque entreprise du groupe Seiko à constituer son propre système de sous-traitance à plusieurs niveaux, typique de l’industrie manufacturière japonaise40.
La fabrique d’horloges et de pendules Seikosha prend le chemin d’une organi-sation sous forme de groupe au cours des années 1960. Elle comprend une dizaine de filiales, spécialisées dans la production de certains modèles d’horloges (Okatani Optical Machines, 1960, préfecture de Nagano), de produits pour l’exportation, notamment des horloges de cuisine (Ishioka, 1961, préfec-ture d’Ibaraki), le contrôle-qualité de la production dans l’ensemble des usines du groupe (Seiko Clock Service, 1963, Tokyo), de pièces pour appareils photographiques (Seiko Optical Machines, 1963, préfecture de Chiba), l’assemblage de mouvements d’horloges (Tochigi Clocks, 1967, préfecture de Tochigi), l’assemblage de réveils (Azusa Precision, 1967, préfecture de Nagano), l’as-semblage d’horloges (Mino Clocks, 1967, préfecture de Gifu) et la fabrication de boîtes en plastique (Gifu Precision, 1971, préfec-ture de Gifu)41. Chacune de ces entreprises
possède généralement son propre réseau de sous-traitants, le plus souvent établis à proximité.
La fabrique de montres Daini Seikosha suit une trajectoire similaire, caractérisée par l’ouverture de trois succursales et de cinq filiales spécialisées dans une partie de la production qui recourent elles-mêmes à des sous-traitants indépendants. Pour l’essentiel, elles sont spécialisées dans la production de pièces de montres particulières, comme les pierres et les ressorts42. Bien que toutes soient établies hors de Tokyo, elles présentent une certaines concentration géographique, avec les trois succursales et deux filiales dans la préfecture voisine de Chiba, tandis que les trois autres filiales sont dans les préfectures de Miyazaki, d’Ibaraki et de Tokyo. En 1964, ces sociétés emploient 48,6 % du personnel de Daini Seikosha43. Elles possèdent par ailleurs leur propre réseau de sous-traitants.
Enfin, le groupe Seiko fonde en 1959 une troisième entreprise dans la préfecture de Nagano, Suwa Seikosha, née de la fusion entre le site de production de Suwa de Daini Seikosha, d’une part, et un sous-traitant de Daini Seikosha, Daiwa Industry, d’autre part (1959). Suwa Seikosha possède ses propres filiales, au nombre de sept, toutes établies dans la préfecture de Nagano : Hamazawa, spécialisée dans l’assemblage de montres (1953) et les cadrans (1954), les fabriques de pièces Takaki (1957), de pierres d’horlogerie Matsushima (1959), de boîtes Tentatsu (1959), les usines d’assemblage Enko (1961) et Shimauchi (1961) et enfin la société spécialisée dans les instruments de
40 S. Matsushima, “Industrial District and the Multi-Tiered Supplier System – With Particular Reference to Secondary Suppliers of Metal Pressings in the Automobile Industry”, Japanese Research in Business History, vol. 24, 2007, p. 11-34.41 Seiko tokei…, op. cit., p. 73-78.42 Seiko tokei…, op. cit., p. 111.43 T. Chokki, Gendai shakai to kigyo kodo, Tokyo, Bunshindo, 1996, p. 132.
80 ENTREPRISES ET HISTOIRE
PIERRE-YVES DONZÉ
précision Shinshu Precision (1961, renommée Epson en 1982)44. À la fin des années 1970, ces sept entreprises entretiennent des rela-tions de sous-traitance avec une cinquantaine
d’entreprises indépendantes. En 1980, l’en-semble du groupe Suwa emploie environ 8 000 personnes45.
44 K. Katsuta, Suisu wo kutta otokotachi, Tokyo, Keiei bijon senta, 1981, p. 83-100 et Seiko tokei…, op. cit., p. 107.45 K. Katsuta, Suisu…, op. cit., p. 99.
Figure 2 : L’implantation territoriale du groupe Seiko au Japon en 1980
Carte réalisée par l’auteur
Note : en grisé, les préfectures qui comprennent des filiales et des succursales du groupe Seiko en 1980.
AVRIL 2014 − N° 74 81
LES TERRITOIRES MOUVANTS DE LA PRODUCTION DE MONTRES JAPONAISES
Ainsi, le groupe Seiko étend le territoire de sa production en-dehors de la seule ville de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale. L’enjeu majeur est de recourir à une main-d’œuvre qualifiée en suffisance sans remettre en cause le principe d’une production de masse intégrée, essentiel pour s’affirmer comme une entreprise compétitive sur le marché mondial. Toutefois cette nécessité d’étendre le bassin de recrutement et le terri-toire de production est relativement limitée. Les territoires de production des sociétés du groupe Seiko restent géographiquement concentrés. C’est particulièrement vrai pour les deux sociétés de fabrication de montres, qui ont chacune leur espace de production particulier : Daini Seikosha à Tokyo et dans les préfectures voisines, Suwa Seikosha dans la préfecture de Nagano. Le système de production mis sur pied durant cette période par le groupe Seiko présente ainsi deux caractéristiques en termes d’organisa-tion et d’usage des territoires. Premièrement, celui-ci dispose d’usines intégrées pour la fabrication des mouvements, dans lesquelles est organisé un système de production de masse, sous la direction d’ingénieurs univer-sitaires, dans la continuité de ce qui existait durant l’entre-deux-guerres. Ces centres de production n’ont qu’un rapport relativement faible avec leur territoire, dans le sens qu’ils font appel pour l’essentiel à des technologies et des savoir-faire issus des diverses facultés d’ingénierie du Japon, qui ne sont pas propres à une ville ou une région46. Deuxièmement, pour les activités d’habillage (boîtes, cadrans, bracelets) et d’assemblage final, soit des processus difficilement rationalisables, Seiko recourt à des sous-traitants et des ressources territorialisées. La période de forte industria-lisation, et de quasi plein emploi, que connaît
le Japon durant cette période mène en effet les entreprises manufacturières à déplacer leurs activités les moins rationalisées vers les bassins de main-d’œuvre hors des grandes villes.
Internationalisation et transfert de la production
Il faut également prendre en considéra-tion l’expansion internationale du groupe Seiko. Deux types de relations peuvent être envisagées en rapport avec le transfert de la production dans des territoires étrangers : premièrement, la délocalisation d’usines d’assemblage pour accéder à des marchés spécifiques ; deuxièmement, l’importation de pièces produites dans des pays à main-d’œuvre bon marché. Les deux stratégies ont été suivies par le groupe Seiko au cours des années 1960 et 1970, mais leur ampleur reste limitée.
Tout d’abord, le transfert de centres de production dans des pays est à replacer dans la continuité de l’essor des exportations, comme cela s’observe dans l’ensemble de l’industrie manufacturière nippone47. Seiko connaît une forte expansion de ses exporta-tions de montres durant ces deux décennies (9,9 % de la production en 1963 ; 52,8 % en 1970 ; 60,2 % en 1979)48. Accéder aux marchés étrangers devient une nécessité. Il convient donc de s’adapter aux conditions particulières de certains pays et d’accepter la création de joint ventures avec des parte-naires domestiques afin d’accéder à ces marchés, ce qui se réalise en Corée du Sud (1963), au Brésil (1963) et en Iran (1973)49. Les entreprises ouvertes dans ces pays sont toutefois essentiellement des fabriques d’as-
46 P.-Y. Donzé, “The hybrid production system...”, art. cit.47 S. Nakamura, Sengo nihon no gijutsu kakushin, Tokyo, Otsuki shoten, 1979, p. 203-215.48 Seiko tokei…, op. cit., p. 204.49 Seiko tokei…, op. cit., p. 290.
82 ENTREPRISES ET HISTOIRE
PIERRE-YVES DONZÉ
semblages de pièces exportées du Japon et leurs débouchés sont limités au marché domestique. Il s’agit ainsi d’exceptions qui ne mettent pas en cause l’organisation terri-toriale d’un système de production centralisé au Japon.
Quant au transfert de certaines activités productrices à faible valeur ajoutée, il porte pour l’essentiel sur la fabrication de pièces d’habillage (boîtes, cadrans) et l’assemblage final de la montre. Il s’agit d’activités plus difficilement rationalisables que la fabrica-tion du mouvement, pour lesquelles le coût de la main-d’œuvre est relativement élevé et justifie le transfert de ces activités dans des territoires où celle-ci est bon marché. Seiko ouvre ainsi en 1968 une première filiale pour l’assemblage de montres à Hong Kong, la société Precision Engineering Ltd., puis,
l’année suivante, une fabrique de pièces à Taiwan50. Toujours en 1969, Seiko ouvre à Singapour une fabrique de boîtes de montre en collaboration avec son importateur dans la ville, Thong Sia, la société Tenryu Singa-pore, qui exporte sa production au Japon et à Hong Kong. Quatre ans plus tard, c’est au tour de Daini Seikosha de fonder une filiale à Singapour, la société Singapore Time Pte, qui ouvre effectivement ses portes en 1975, après avoir formé une centaine d’ouvriers malais dans les usines japonaises du groupe. En 1975, elle emploie 300 personnes, dont 23 techniciens japonais, et a une capacité de production annuelle de 500 000 pièces (soit 2,9 % seulement du total de la production du groupe Seiko)51. Enfin, en 1980, Seiko ouvre dans cette ville une nouvelle entre-prise, Asian Precision Pte, pour le placage d’or sur les boîtes52.
50 M. Sato et Y. Mori, Seimitsu kikai gyokai, Tokyo, Kyoikusha, 1976, p. 266.51 Daini Seikosha, vol. 236, 1975, p. 6.52 Essai sur le groupe Seiko, Bienne, Fédération horlogère suisse, 1980, p. 112.
Tableau 1 : Importations japonaises de mouvements et de pièces de montres en provenance d’Asie du Sud-Est, 1960-1980
1960 1970 1980
Mvts, nombre
Pièces, 1 000 yens
Mvts, nombre
Pièces, 1 000 yens
Mvts, nombre
Pièces, 1 000 yens
Hong Kong - 141 - 34 798 1 537 571 1 306 026
Singapour - - - 90 079 847 553 850 667
Corée du Sud - - - - 852 158 887 527
Taïwan - - - - 953 250 1 685 819
Philippines - - - - 1 222 987 44 754
Source : Nihon gaikoku boeki nenpyo, Tokyo, Ministry of Finance, 1960-1980.
AVRIL 2014 − N° 74 83
LES TERRITOIRES MOUVANTS DE LA PRODUCTION DE MONTRES JAPONAISES
Malgré l’importance du mouvement de délocalisation, il est difficile de quantifier son étendue. Les statistiques du commerce extérieur japonais permettent de mesurer le développement du phénomène (cf. tableau 1). En 1960, les importations japonaises en provenance d’Asie du Sud-est se limitent à de faibles quantités de pièces importées de Hong Kong. Il s’agit alors de pièces qui ne sont pas fabriquées dans la colonie britan-nique mais qui ne font que transiter par Hong Kong à destination du Japon. Dix ans plus tard, la situation n’a pas fondamentale-ment évolué, malgré la hausse des volumes importés, mais on observe l’émergence de Singapour comme centre de production de pièces. Les années 1970 apparaissent comme la décennie au cours de laquelle les horlogers japonais organisent la sous-traitance à large échelle en Asie du Sud-est. On assiste à une très forte hausse des importations de pièces, qui se montent en 1980 à une valeur totale de 4,8 milliards de yens. De plus, le trait marquant de cette délocalisation est l’impor-tation de mouvements terminés – notamment à quartz –, un phénomène inexistant en 1960 et en 1970. Le nombre de mouvements fabriqués à l’étranger en 1980 s’élève à un total de 5,4 millions de pièces, soit 6,3 % de la production japonaise de montres. Les volumes délocalisés restent relativement faibles et ne mettent pas en cause l’organisa-tion territoriale de la production.
LA RÉGIONALISATION DU SYSTÈME DE PRODUCTION EN ASIE ORIENTALE (DEPUIS 1985)
Au milieu des années 1980, un ensemble de facteurs institutionnels et économiques débouchent sur une concurrence renforcée sur le marché mondial de la montre, qui amène les fabricants japonais, Seiko en particulier, à réorganiser leur système de production et à renforcer la délocalisation en Asie de l’Est et du Sud-est. Le premier de ces facteurs est monétaire. Il s’agit des accords du Plaza, qui ont notamment pour effet un renforcement du yen. Alors que les horlogers japonais bénéficiaient d’une monnaie rela-tivement faible par rapport au franc suisse depuis le début des années 1970, le facteur monétaire cesse de leur être favorable53. Pour l’ensemble de l’industrie manufacturière nippone, la seconde partie des années 1980 est marquée par le transfert d’une partie de la production dans des pays à main-d’œuvre bon marché en Asie du Sud-est.
Dans le même temps, il faut aussi tenir compte d’une concurrence renforcée sur le marché de la montre. D’une part, l’indus-trie horlogère suisse opère un formidable retour après la création en 1983 de la Société suisse de microélectronique et d’horlogerie (SMH, Swatch Group depuis 1998) et la restructuration industrielle qui s’ensuit54. Les exportations horlogères suisses passent de 1,5 milliard USD en 1985 à 4,3 milliards en 199055. D’autre part, l’essor des montres électroniques soutient la forte croissance des fabricants de montres de Hong Kong.
53 P.-Y. Donzé, Histoire de l’industrie horlogère suisse de Jacques David à Nicolas Hayek, Neuchâtel, Alphil-Presses universitaires suisses, 2009, p. 163-164.54 P.-Y. Donzé, Histoire du Swatch Group, Neuchâtel, Alphil-Presses universitaires suisses, 2012. G. Garel et E. Mock, La fabrique de l’innovation, Paris, Dunod, 2012.55 Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, Berne, Administration fédérale des douanes, 1985-1990.
84 ENTREPRISES ET HISTOIRE
PIERRE-YVES DONZÉ
Les exportations horlogères de la colonie britannique passent ainsi d’un peu plus de 1,5 milliard USD en 1985 à 2,6 milliards en 199056. Les entreprises horlogères japonaises sont donc soumises à une forte pression. Tandis que leurs exportations occupent encore le premier rang mondial en 1985, avec 1,6 milliard USD, elles ne parviennent pas à maintenir cet avantage et leurs exportations ne se montent qu’à 2,2 milliards USD en 199057. En conséquence, la rationalisation de la production et la baisse des coûts de fabri-cation sont des impératifs majeurs pour rester concurrentiel.
Le groupe Seiko adopte après 1985 tout un ensemble de mesures visant à assurer une meilleure compétitivité. Tout d’abord, la société se réorganise en profondeur, avec la transformation de l’ancienne société de vente, Hattori & Co., en société holding en 1997, l’année même où les autorités japo-naises autorisent à nouveau cette forme de société58. Depuis cette date, Seiko Holdings contrôle directement et juridiquement l’en-semble des sociétés de production et de distribution appartenant à la famille Hattori. Ensuite, le groupe horloger japonais entre-prend un mouvement de diversification dans les technologies de l’électronique, afin d’être moins dépendant des ventes de montres. La part de l’horlogerie dans le chiffre d’af-faires du groupe passe ainsi de 90 % en 1980 à 48 % en 2000 et à 33 % en 201059. Enfin, cette diversification s’accompagne d’une restructuration en termes d’organisa-tion, avec principalement le rachat de Suwa Seikosha par sa propre filiale Epson (1985) et sa spécialisation dans les périphériques pour
ordinateurs et pièces électroniques. Cette dernière abandonne la production de montres terminées, mais elle poursuit celle de quartz synthétique et de modules électroniques. La production de montres tend ainsi à disparaître de la préfecture de Nagano où elle avait été implantée au cours des années 1940. Quant à Daini Seikosha, rebaptisée Seiko Instruments Inc. (SII) en 1997, elle reste le producteur de montres du groupe mais se lance également dans d’autres domaines de l’électronique. Seules les filiales d’Ibaraki et d’Iwate restent spécialisées dans l’horlogerie.
Le transfert de la production dans d’autres pays asiatiques qui s’observe depuis la fin des années 1980 n’est cependant pas un simple renforcement des premières délocalisations observées au cours des années 1970, mais s’accompagne d’une véritable réorganisation du système de production. Auparavant, Seiko avait essentiellement délocalisé la produc-tion de pièces d’habillage, qu’elle importait ensuite au Japon pour les assembler avec les mouvements de montres produits sur place et exporter depuis l’archipel nippon des produits terminés. Or le système mis en place depuis les années 1980 aboutit à une intégration régionale et une véritable mise en réseau du système de production. Les activités de R&D et de conception, de même que la production de pièces et de mouvements à haute valeur ajoutée restent localisés au Japon, tandis que l’ensemble des autres pièces et l’assem-blage final de la montre sont des activités réalisées dans diverses usines réparties dans l’ensemble de l’Asie de l’Est et du Sud-Est (cf. figure 3).
56 Hong Kong Trade Statistics Export & Re-Export, Hong Kong, Census Department, 1985-1990.57 Nihon gaikoku bokei nenpyo, Tokyo, Ministry of Finance, 1985-1990.58 Les sociétés holdings avaient été interdites après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la démocratisation de l’économie et de la lutte contre la concentration du capital. M. Shimotani, “Japanese Holding Companies: Past and Present”, Japanese Research in Business History, vol. 29, 2012, p. 11-28.59 Kaisha nenkan, Tokyo, Nikkei, 1980-2010.
AVRIL 2014 − N° 74 85
LES TERRITOIRES MOUVANTS DE LA PRODUCTION DE MONTRES JAPONAISES
60 http://www.sii.co.jp (site consulté le 22 novembre 2012).
Figure 3 : L’implantation territoriale des fabriques de montres de Seiko Instruments Inc. (SII) en Asie orientale, 2012
Carte réalisée par l’auteur
Le transfert de la production de montres en-dehors du Japon par SII prend deux formes. Premièrement, la filiale de Hong Kong, Precision Engineering Ltd. (fondée en 1968), sous-traite depuis 1988 l’assemblage de montres électroniques à une nouvelle société qu’elle fonde à Guangzhou, Seiko Instruments (Whampoa) Factory. En 1996, elle ouvre une seconde société à Shenzhen (Sai Lai Factory), avant que l’ensemble de la production de SII sur le territoire chinois soit réorganisé à la fin des années 2000 et centra-lisé au sein d’une nouvelle usine à Guangzhou
(2012). On a donc affaire ici à un transfert qui se fait par l’intermédiaire de Hong Kong, la filiale de SII dans cette cité restant maîtresse des activités productrices en Chine voisine. Deuxièmement, le siège japonais de SII intervient aussi de manière directe et ouvre diverses filiales de production, en Thaï-lande (1988), en Chine (Dailan SII, 1989) et en Malaisie (1990)60. La Thaïlande sert en particulier de base pour l’assemblage final de produits destinés au marché mondial. En 1994, cette filiale emploie 770 personnes et produit 2,3 millions de pièces, soit près de
86 ENTREPRISES ET HISTOIRE
PIERRE-YVES DONZÉ
10 % de la production du groupe. La produc-tion de cette usine est exportée vers 60 pays en 199461. La recherche d’une main-d’œuvre bon marché pour l’assemblage de produits finaux explique également l’ouverture des usines en Chine et en Malaisie. Ces divers centres de production s’approvisionnent en pièces d’habillage (boîte, cadran, bracelet) auprès de nombreux partenaires, notam-ment des sous-traitants de Chine et d’Asie du Sud-est.
En conséquence de cette réorganisation du système de production, de moins en moins de montres terminées sont exportées direc-tement du Japon. Les chiffres relatifs au seul groupe Seiko ne sont pas publics, mais des données agrégées concernant l’ensemble de l’industrie horlogère japonaise, qui a adopté dans son ensemble une stratégie similaire à celle de Seiko, sont connues et permettent de mesurer cette importante mutation. Dans un premier temps, ce transfert de la production a soutenu une forte croissance du volume de la production, passé de 483 millions de pièces en 1995 à 747 millions en 1998. Ensuite, bien que le volume soit resté assez stable, malgré la crise financière mondiale de 2009, et oscille aux alentours de 700 millions de pièces, on observe un renforcement constant de la fabrication des produits terminés à l’étranger : celle-ci se monte à 45,8 % en 2010 contre seulement 17,8 % en 199562.
CONCLUSION
L’analyse de l’évolution des territoires de la production de montres du groupe Seiko au cours du XXe siècle a permis de mettre en lumière l’existence de trois grands modèles successifs d’organisation territo-riale et productive : l’usine concentrée dans
la ville de Tokyo (1895-1940), le réseau de districts industriels au Japon (1940-1985) et la régionalisation du système de production en Asie (depuis 1985). Chaque type d’orga-nisation spatiale correspond à un système de production spécifique et illustre la capacité de la firme à intégrer un certain de nombre de ressources afin de rester compétitive. Dans cette perspective, l’espace n’est pas un simple support aux activités de l’entreprise mais en devient l’une des ressources.
Le cas de Seiko met particulièrement en évidence la volonté de bénéficier d’externa-lités en termes de savoir-faire et d’accès au marché du travail. Durant les deux premières périodes, l’établissement de l’entreprise au cœur du cluster urbain de la petite méca-nique, dans la ville de Tokyo, ou dans l’un des principaux districts industriels de la mécanique de précision, dans la préfecture de Nagano, répond à une stratégie d’accès à des ressources spécifiques présentes dans ces espaces, notamment en termes de recru-tement d’une main-d’œuvre bon marché, à travers des filiales ou des réseaux de sous-traitance, pour les activités difficile-ment rationalisables comme l’habillage et l’assemblage. Quant à la mise en place d’un nouveau système de production à l’échelle de l’Asie de l’Est et du Sud-est depuis le milieu des années 1980, elle correspond à la volonté de renforcer la compétitivité de la firme en abaissant les coûts de production grâce à une main-d’œuvre meilleur marché, mais aussi d’accéder à certains savoir-faire localisés, comme la fabrication de composants électro-niques en Thaïlande et en Malaisie.
Le passage d’un modèle à un autre n’est cependant pas le fruit d’une évolution « naturelle ». Il résulte de choix stratégiques en matière de gestion de l’entreprise et il convient de s’interroger sur les raisons qui
61 Seiko tokei…, op. cit., p. 340-341.62 Nihon no tokei sangyo tokei, Tokyo, Nihon tokei kyokai, 1995-2010.
AVRIL 2014 − N° 74 87
LES TERRITOIRES MOUVANTS DE LA PRODUCTION DE MONTRES JAPONAISES
63 J. Watanabe, Sangyo hatten suitai no keizaishi, Kyoto, Kyoto University Press, 2010. Sur la désindustrialisation en général, voir P. Lamard et N. Stoskopf (dir.), 1974-1984 : une décennie de désindustrialisation ?, Paris, Éditions A. et J. Picard, 2009.64 Théorie développée dans les années 1930 et réactualisée récemment par T. Ozawa, Institutions, Industrial Upgrad-ing, and Economic Performance in Japan: The ‘Flying Geese’ Paradigm of Catch-Up Growth, Cheltenham-Nor-thampton, Edward Elgar, 2005.65 R. Vernon, “International Investment and International Trade in the Product Cycle”, Quarterly Journal of Eco-nomics, vol. 80, n° 2, May 1966, p. 190–207.66 T. Kikkawa, “Beyond product life cycle and flying geese: international competitiveness of East Asian region and the Japanese position within”, Hitotsubashi Journal of Commerce and Management, vol. 45, n° 1, 2011, p. 89-97 et H. Shioji (dir.), Higashi ajia yui sangyo no kyoso ryoku, Kyoto, Minerva, 2008.
ont mené les dirigeants de Seiko à redéployer leur système de production à deux reprises au cours du XXe siècle. Les facteurs politiques (mise à l’abri des fabriques d’armement dans les années 1940) et institutionnels (accords du Plaza en 1985) apparaissent comme les plus importants parmi les éléments externes à l’entreprise qui mènent cette dernière à devoir s’adapter à un nouvel environnement.
Enfin, la régionalisation du système de production à l’échelle asiatique et le trans-fert progressif de la production de montres terminées (production des composants de l’habillage et assemblage final) en-dehors de l’archipel nippon qui s’observent depuis 1985 apparaissent comme un phénomène
majeur, qui s’apparente à une forme de désin-dustrialisation du Japon63. À première vue, Seiko et l’industrie horlogère japonaise sont d’excellentes illustrations des théories de Kaname Akamatsu (le vol d’oies sauvages)64 et de Raymond Vernon (le cycle de vie du produit)65 selon lesquelles les industries ayant atteint le stade de la maturité disparaissent des économies les plus avancées au profit de pays dont le niveau de développement est moins élevé. Cependant l’horlogerie repré-sente plutôt un exemple typique de l’industrie manufacturière japonaise, qui ne quitte pas l’archipel, mais se redéploie à une échelle régionale plus large où elle prend la forme d’un réseau transnational de production66.