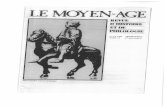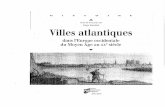Gaulle méridionale pendant l'Antiquité Tardive et le Haut Moyen Age, La
« La civette au Moyen Age et à la Renaissance : parfum prophylactique, curatif et aphrodisiaque...
-
Upload
univ-paris13 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of « La civette au Moyen Age et à la Renaissance : parfum prophylactique, curatif et aphrodisiaque...
Virginie Mézan-Muxart
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE:PARFUM PROPHYLACTIQUE, CURATIF
ET APHRODISIAQUE
ASPHODÈLEVotre nom, monsieur, s’il vous plaît?
CIVETTEJe m’appelle Civette.
ASPHODÈLEUn nom qui a bonne odeur! Dieu soit avec vous,
bon monsieur Civette!Shakespeare, Le prodigue de Londres, Acte I, Scène II
L’introduction de la civette fut tardive en Europe: il fallutattendre Alexandre le Grand qui, après sa conquête de l’Orientet de l’Empire perse, introduisit en Grèce non seulement lesnouvelles épices mais aussi les matières odorantes animalescomme l’ambre gris, le musc et la civette. Plus tard ce furent lesCroisés qui ramenèrent en Europe, dès le XIe siècle, ces matièresanimales d’Orient. La Chanson à la civette de Laurent le Magni-fique1 ainsi que les fréquentes allusions de Shakespeare à ce puis-sant parfum ne purent voir le jour que grâce aux échanges com-merciaux Orient-Occident et aux apports des médecines persaneet arabe véhiculées notamment par la civilisation al-Andalus. Selon les traditions musulmanes, l’action du parfum ne se
limite pas à la mise en valeur du corps mais s’étend aux fonc-tions de l’organisme. Chaque individu possède un tempéramentdominant et doit maintenir sans cesse l’équilibre entre quatre
131
1. A. F. Grazzini, R. M. Bracci, Tutti i trionfi carri, mascherate o canti carna-scialeschi, andati per Firenze dal tempo del magnifico Lorenzo de’ Medici finoall’anno 1559, Pel Benedini 1750, 67-69: Canzona dello zibetto.
«Micrologus’ Library» 67, SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2015
humeurs corporelles. Quand l’individu est malade, l’une deshumeurs est déséquilibrée; il faut donc soigner la maladie grâceà des médicaments composés sur l’humeur opposée. «Influant à lafois sur la santé physique et morale», les parfums sont des stimu-lants, «capable de vivifier l’esprit et de restaurer l’équilibre cor-porel»2. Ainsi écrivait déjà au XIe siècle Ibn Butlan3 dans sonTaqwım al-S. ih. h. a:
Les flagrances agréables sont des aliments pour l’esprit qui est le sup-port des facultés qui les transmettent, comme l’air a la disposition decapter la lumière. Elles sont divisées en simples [et composées]: lessimples proviennent soit des arbres et des fleurs, comme l’agalloche, lescondiments, le santal, le camphre, soit d’un animal comme le musc et lacivette odorante, soit des sources jaillissantes comme l’ambre.
La civette est un parfum qui, depuis au moins Dioscoride (Ier
siècle après J.-C.), fut décrite comme possédant son humeurpropre et qui, comme les autres matières animales, fut privilé-giée pour sa senteur tenace et sensuelle ainsi que pour son pou-voir thérapeutique et aphrodisiaque.
Nature et extraction
La civette est un mammifère carnivore, de la famille des viver-ridés (Viverridae), de la sous-famille des Viverrinae qui compteplusieurs espèces dont la Viverricula indica, la civette indienne quine pèse que deux à quatre kilos et la Civettictis civetta, la civette
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
132
2. E. Flat, «Le parfum de l’insolite», dans 100 000 ans de beauté. Âge clas-sique/confrontations, dir. G. Vigarello, avec le soutien et la participation deL’Oréal Fondation, Paris 2009, 181-82.
3. H. Elkadem, Le Taqwım al-S. ih.h.a (Tacuini Sanitatis) d’Ibn Butlan: untraité médical du XIe siècle, Histoire du texte, édition critique, traduction,commentaire, Louvain 1990, 277. Texte original: XXXVII, 133:
africaine 4, qui pèse entre quatorze à quinze kilos 5 et qui a inté-ressé particulièrement le parfumeur 6 depuis toujours. Certains Viverrinae dont la Civettictis civetta et la Viverricula
indica portent un double appareil glandulaire comprenant lesglandes «à parfum» et les glandes anales. Les glandes à parfumsont situées entre le scrotum et le prépuce chez le mâle et entrel’anus et la vulve chez la femelle 7. Elles s’ouvrent au-dehors parune fente 8. Le principal composant de la sécrétion de cesglandes, appelé viverreum, plus connu sous le nom de ‘civette’ estla civettone qui favorise la fixation des odeurs. Le viverreum dela femelle possède une odeur plus intense mais moins fine que lemâle et constitue avant tout ‘un rôle d’attractif sexuel’; sa quan-tité augmente par conséquent en période de rut. Il a «la consis-tance du beurre, est de couleur blanche et de texture mousseuse,il est riche en corps gras et exhale une odeur musquée, extrê-mement forte et tenace, voire sensuelle» 9. Cette substance
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
133
4. Même si le ‘musc’ des deux civettes est utilisé dans la parfumerie, ilsemble qu’aux époques étudiées dans ce présent article, celui de la civetteafricaine ait été le plus exploité, peut-être de par la proximité géographiqueavec le continent africain. En effet, quand les provenances de ces animauxsont spécifiées, il s’agit toujours de la civette africaine. Quant à l’iconogra-phie, les quelques tableaux où est représentée la civette confirment cettehypothèse (cf. tableau de «L’odorat», de Jan I Brueghel, dit de Velours (1568-1625) et de Rubens, vers 1617, dans le présent article; dessins et peinture dePieter Boel (1622-1674) qui fut chargé par Charles Le Brun de peindre lesanimaux de la ménagerie de Louis XIV: «Etudes d’une civette et patte d’oi-seau», Pieter Boel, INV 19395 recto, 1668-1674, «Etudes de civette, corps,tête et pattes», Pieter Boel, INV 19397 recto, 1668-1674, Musée du Louvre,Département des Arts graphiques et peinture à huile sur toile, «Blaireaux etcivettes», Pieter Boel, INV 3974 du dépôt du Musée du Louvre, Musée desBeaux-Arts de Limoges; tapisserie «Les Maisons royales. Octobre, signe duScorpion: promenade de Louis XIV en vue du château des Tuileries»,Manufacture des Gobelins, INV P. 340, Musée National du château de Pau).
5. J. C. Ray, «Mammalian Species: Civettictis Civetta», The AmericanSociety of Mammalogists, (1995), 1-7.
6. V. Perier, Les matières odorantes animales, la civette, l’ambre gris: mise aupoint de procédés d’accélération de vieillissement des teintures animales. Universitéde droit, d’économie et de sciences d’Aix-Marseille. Faculté des sciences ettechniques de Saint-Jérôme, 1996, 23.
7. Ray, «Mammalian Species», 3.8. Perier, Les matières odorantes animales, 24.9. Toutes ces données proviennent de la thèse de Perier, Les matières odo-
rantes animales, 24.
d’‘écume, mousse’ se disant zabad10 en arabe, a donné ‘zibetto’ enitalien puis ‘civette’ en français. Jadis, la prononciation zabad,variant en zebet, zibet ou zibeth conduisit le naturaliste Buffon àcaractériser ainsi la civette et à latiniser le terme en Viverra zibe-tha11. L’animal se dit en arabe sinawr al-zabad, c’est-à-dire ‘chatportant l’écume’12 et a été connu dès le XIIIe siècle en Occidentsous la forme de zabadec13.Depuis quand exactement l’homme sait-il que la civette pro-
duit cette substance odorante? Depuis quand sait-il qu’il n’estpas obligé de tuer l’animal pour lui extraire son ‘musc’14? Il fau-drait davantage de recherches pour répondre à ces questions.Dans l’Antiquité, Dioscoride (Ie siècle après J.-C.) mentionnedéjà la civette dans son De materia medica et connaissait ses vertusprophylactiques et aphrodisiaques15. Au XIe siècle16, le persan Al-Biruni, l’un des plus grands savants de l’Islam médiéval et qui fut«le premier de l’Islam et probablement de toutes les autres cul-tures, à tracer l’histoire de l’art apothicaire» 17 écrivit un articlesur la civette. A Zuhm 18 (synonyme de zabad), après avoir donnéles traductions de l’animal et de son musc en hindi, il écrivitque, d’après Khushkı, «la civette est obtenue de Sind, Dibal et
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
134
10. S. Guemriche, Dictionnaire des mots français d’origine arabe (et turque etpersane), accompagné d’une anthologie littéraire, préf. A. Djebar, Paris 2007, 296.
11. C. Radimilahy, N. Rajaonarimanana (dir.), Civilisations des mondesinsulaires. Mélanges en l’honneur du Pr. Claude Allibert, Pari 2011, 406.
12. Le français utilise souvent la traduction de ‘chat musqué’ mais il fautfaire attention car le musc est la substance qui se trouve dans le cerf porte-musc, de la famille des moschidés. Il ne s’agit donc pas du tout du mêmeanimal.
13. Guemriche, Dictionnaire des mots français d’origine arabe, 296.14. Les autres substances nécessitent la mort de l’animal qui les sécrète
(même s’il arrive que les cachalots expulsent spontanément leur ambregris): castor (castoreum), cerf porte-musc (musc) et cachalot (ambre gris).
15. P. A. Mattioli (P. A. Matthiole), Les commentaires de M.P. André Mat-thiole, sur les six livres de la matière médicinale de Pedacius Dioscoride, traduits delatin en françois par M. Antoine Du Pinet, augmentez d’un Traité de chymie enabrégé par un docteur en médecine, Lyon 1680, 143.
16. Nous n’avons pas trouvé avant Al-Biruni d’articles ou d’informationsconsacrés à l’extraction de la civette.
17. Al-Biruni’s Book on Pharmacy and materia medica, ed. with englishtransl. by H. Mohammed Said, Karachi 1973, 35.
18. Ibid., 171 n° 32.
Ceylon» 19 et que «le peuple d’Arabie ne le sait pas» 20. Croyantque la civette était présente dans les testicules du mâle et dans lesglandes mammaires de la femelle, il poursuivit ainsi: «L’animal estchassé, écorché, et finalement, la portion désirée est excisée» 21.Il fut un temps pourtant où l’homme se rendit compte qu’il
pouvait garder l’animal en vie après extraction ce qui, et peut-être dès le XIIe siècle 22, coûta à l’animal sa liberté. Enfermée dansune cage et parfois enchaînée, la civette subissait régulièrementdes curetages. Les récits de voyage des occidentaux en Orient ouen Espagne témoignent de plusieurs exemples. Félix Fabri, dansson Voyage en Égypte 23 de 1483 nous rapporte que l’extraction sefaisait selon un cérémonial précis du début à la fin:
Nous priâmes donc l’homme de nous montrer comment il faisait. Ilse saisit d’un bâton avec lequel il se mit à piquer et à énerver la bête; illa fit ainsi courir et crier à travers la cage, tout en guettant attentive-ment, s’efforçant de la saisir par la queue tandis qu’elle courait en toussens dans la cage. Lorsqu’il l’eut saisie, il attira la bête par la queue versla paroi de la cage et donna l’ordre à ses serviteurs de saisir fortementla bête, la queue en l’air, par les pattes arrière qu’ils tenaient égalementhors de la cage, de façon à découvrir complètement les parties géni-tales. Elle possédait en fait, près de sa matrice naturelle, une autre fente,comme une seconde matrice, qui n’était pas destinée ni à recueillir ni àémettre quoi que ce soit, si ce n’est ce qui va être décrit: tandis qu’ontenait ainsi la bête, elle sifflait, criait et crachait de rage. Quand elle futbien en furie, Tanguardin avança une petite cuillère d’argent et l’intro-
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
135
19. Ceylon: actuel Sri Lanka où l’on trouve la civette palmiste com-mune, connue pour être à l’origine d’un des cafés les plus chers du monde,le café indonésien ‘Kopi Luwak’.
20. Ibid., 172 n° 32.21. Ibid., 172. n° 32: «It comprises the testicles of zabad. The mammary
glands of the female civet are cut out and brought to Iraq: they do not getspoilt on their way. Zuhm is present therein in the manner of animals eyesor congealed oil. […] It is hunted, flayed, and finally the desired portion isexcised».
22. K. H. Dannenfeld, «Europe Discovers Civet cat and Civet», Journal ofthe History of Biology, 18,3 (1985), 403-31 (410) écrit qu’Idrisi rapporte queles civettes étaient gardées en Chine dans de grandes cages et nourries deviande.
23. F. Fabri, Voyage en Égypte, traduit du latin, présenté et annoté par leR. P. J. Masson, II, Le Caire 1975, 409-10.
duisit dans la seconde matrice de la bête. A ce contact, la bête agita samatrice et en fit jaillir à l’extérieur la chair interne d’où découlait unematière trouble de couleur cendrée. Tanguardin recueillit cette matièreà la surface de la chair, avec la cuillère. Il retira la cuillère pleine et relâ-cha la bête.
Cette technique d’extraction était déjà connue en Occident àcette période comme l’atteste un passage de Jerónimo Münt-zer 24, écrit en 1494-1495, dans son Voyage en Espagne et au Portu-gal. Le voyageur décrit Barcelone et sa visite chez l’Infante DonEnrique, qui avait construit «une maison d’une telle richessequ’il ne peut se concevoir de supérieure» 25. Ses compagnons devoyage et lui-même y virent un ‘porte-musc’ (almizclero) qu’ildécrit ainsi: «animal plus grand que le renard; tête, bouche etoreilles ressemblant à celles de l’hermine; couleur grise avec destaches blanches et obscures; queue et pieds de chien». Force estde constater que la description qu’il fait de l’animal qu’il voit necorrespond en rien avec celle du cerf porte-musc de la familledes Moschidés mais relève plutôt de l’espèce civette 26, de lafamille des Viverridés. L’extraction en elle-même se déroule de lamême manière mais la façon de ramener la bête vers l’opérateurse fait de façon plus brutale et sûrement plus douloureuse encorepour la bête. La civette, dans ce passage, un mâle, est présentécomme «une bête colérique et furieuse» et ce, dès qu’il voit lesvisiteurs approcher de la cage dans laquelle il est attaché par unechaîne (alors que dans le passage de Fabri, la femelle, qui n’estpas attachée dans la cage, est «énervée et piquée» afin qu’après,l’extraction se fasse). S’ensuit alors le curetage:
Celui qui s’en occupait demanda à ce qu’avec la chaîne, la civettesoit ligotée par la tête à la cage et, en la tirant par les pattes arrière, illui a levé la queue, nous a montré son membre (parce que c’était un
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
136
24. J. Müntzer, Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 1495, versióndel latín por J. Puyol, Boletín de la Real Academia de la Historia, 84 (1924),32-119.
25. Müntzer, Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 1495, 47.26. Voir note 8. Nous rejoignons sur ce point l’avis de DC. Morales
Muñiz, «La fauna exótica en la Península Ibérica: apuntes para el estudio delcoleccionismo animal en el Medievo hispánico», Espacio, tiempo y forma.Serie III, Historia medieval, 13 (2000), 233-70 (258).
mâle), et lui prenant les parties génitales, il les a inversées comme quel-qu’un qui retourne une bourse, laissant à vue deux cavités, une àchaque testicule; dans l’une d’entre elles, il a introduit une petitecuillère en verre lisse, et par trois fois, il a extrait deux drachmes desubstance odorifère, avec laquelle il m’a enduit la main qui gardal’odeur du musc pendant plusieurs jours 27.
Dans les deux cas, la bête paraît devoir être mise en colèrepour que l’extraction se fasse; peut-être était-ce dû à cescroyances trouvées notamment encore chez Scaliger et Matthioleselon lesquelles «le parfum de la civette n’est rien autre choseque sa sueur» 28 ou chez d’autres, «que cet animal ne rendaitpoint de civette qu’après avoir été bien battu; et que plus il étaiten colère, et plus il rendait de civette sous son ventre et entre lesjambes» 29. Léon l’Africain (XVIe siècle) rapporte une méthode 30
éthiopienne qui s’apparente aux croyances susdites:
On en reçoit la civette deux ou trois fois le jour, qui n’est autre choseque la sueur de cet animal, lequel on bat avec une petite baguette, le fai-sant sauter deçà et delà parmi la cage, jusqu’à ce qu’il vient à jeter lasueur qu’on lui ôte de dessus les bras, cuisses et queue […].
Ce sont sûrement les échanges commerciaux, les cadeauxdiplomatiques notamment entre les princes d’Occident et
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
137
27. Müntzer, Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 1495, 47:«bicho colérico y furioso […] El que lo cuidaba mandó que con la cadenalo amarrasen por la cabeza a la jaula y, tirándole de sus patas traseras, lelevantó la cola, nos enseñó su miembro (porque era macho), y cogiendo losgenitales, los invirtió como quien vuelve una bolsa del revés, dejando a lavista dos cavidades, una en cada testículo; en una de ellas introdujo unacucharilla de vidrio liso, y en tres veces extrajo como dos dracmas de subs-tancia odorífera, con la que me untó la mano, que estuvo oliendo a almiz-cle durante varios días».
28. A. Furetière, �Dictionnaire universel, contenant généralement tous les motsfrançois, tant vieux que modernes et les termes des sciences des arts […], I, Paris1727: article «Civette».
29. P. Pomet, �Histoire générale des drogues: �traitant des plantes, des animaux,& des minéraux: ouvrage enrichy de plus de quatre cent figures en taille-douce IILivre Premier des animaux, Paris 1694, 18: l’auteur réfute ces croyances.������������������������������������������������������������������������
30. Léon l’Africain, De l’Afrique contenant la description de ce pays, trad.J. Temporal, II, Paris 1830, 296.
d’Orient 31 qui firent connaître l’animal et sa matière odorante.Citons pour exemple notamment ces onze cornes contenant dela civette, qui faisaient partie de produits de luxe offerts en 1486par une ambassade de Qaït-Bey sultan d’Égypte à Laurent leMagnifique 32 et qui facilitèrent l’élaboration d’un traité avec lesFlorentins. L’animal faisait aussi partie des cadeaux exotiques queles princes occidentaux pouvaient intégrer dans leurs ménageriesroyales: entre autres, la civette offerte par Abul Faris, sultan deTunis entre 1394 et 1434 à Jean II de Castille 33 et les deuxcivettes offertes par le roi du Portugal au roi René d’Anjou 34.Les princes comprirent alors qu’il était dans leur intérêt de
garder la bête et de bien la soigner afin qu’elle ne manque de rienet fournisse la meilleure civette qui soit. Les exemples de civettesqui jouissent d’une situation privilégiée se multiplient aux XVe etXVIe siècles: sa matière odorante était très recherchée et trèschère. Aussi lit-on par exemple que la civette du roi René, roid’Anjou et de Sicile était «élevée à part». Sa nourriture était oné-reuse: chaque mois de l’année 1452 étaient dépensés quarante souscontre cent douze sous six deniers vingt ans plus tard. Un soi-gneur particulier lui fut attribué: le tapissier Jean Bidet nommépour l’occasion «Garde de la civette du roi de Sicile». Les dépensesen viande, bois pour rôtir cette viande et chauffer la civette étécomme hiver étaient scrupuleusement comptabilisées 35.Le 20 septembre 1505, René II, le petit-fils du roi d’Anjou, fit
venir à la Cour de Lorraine un couple de civettes qui mobilisa
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
138
31. La civette et son ‘musc’ font partie de cadeaux entre princesd’Orient. Exemple: ces quelques civettes en 991 données en cadeau de lapart du roi des Zénètes (tribu berbère) Ziri ibn ‘Atiyyah al-Maghribi, à al-Mansur dit Amenzor, homme d’état d’al-Andalus (S. M. Imamuddin, MuslimSpain 711-1492 A.D.: a Sociological Study, Leiden 1981, 98) et ces seizecivettes offertes et «one pound of civet» entre autres cadeaux au roi de Fezpar le Prince de Tensita que rapporte Léon l’Africain (J. Barclay Lloyd, Afri-can Animals in Renaissance Literature, Oxford 1971, 54).
32. I. Cloulas, «Un caprice d’Anne de Beaujeu: la girafe de Laurent leMagnifique», dans Anne de Beaujeu et ses énigmes. Actes du colloque nationaldu 28 mai 1983, Villefranche-sur-Saône 1983, 73-82 (77).
33. Morales Muñiz, «La fauna exótica en la Península Ibérica», 258 note 29.34. J. �de Bourdigné, Chroniques d’Anjou et du Maine. Avec un avant propos
de Mr. le Comte de Quatrebarbes et des notes, II, Paris 1842, 241.35. J. Favier, Le roi René, �Paris �2008.
beaucoup de soins. Il fallait entretenir le feu jour et nuit dansune pièce de la demeure ducale restaurée où séjournait lecouple, veillé par Grand Jehan, concierge de l’hôtel. Afin que lescivettes puissent dormir confortablement, d’amples coffres étaientcapitonnés de draps gris et garnis de coussins (changés l’annéesuivante «à cause que les autres estoient desja tout pourry»)36. Lesdépenses en bois, en mobilier et en textile étaient assez consé-quentes pour ces bêtes pour lesquelles rien n’était trop beau outrop délicat 37. Pouvaient-ils savoir que la nature de la civettedépend de la nourriture qu’on donne à l’animal 38? Léon l’Afri-cain (XVe-XVIe siècle) rapporta que les éthiopiens – qui élèventdes civettes depuis l’Antiquité, voire même du temps de la reinede Saba 39 – prenaient les civettes petites, les mettaient dans descages puis les nourrissaient avec «du lait, du potage de son et dela chair» 40. Certains Princes d’Occident comprirent aussi queleurs colonies pouvaient leur procurer ce parfum si cher et siconvoité comme par exemple le roi du Portugal qui, le 19octobre 1470, déclara un monopole royal sur certains produits deGuinée, dont la civette 41.
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
139
36. P. Boyé, «Animaux d’Afrique à la cour des ducs de Lorraine aux XVe
et XVIe siècles», Bulletin historique et philologique, (1905), 3-12 10 note 3:exemples de dépenses tirés d’Archives de Meurthe-et-Moselle dont «ADidier de Germiney, serrurier, pour avoir ferré le grant coffre que l’on afait tout neuf à mectre lesdites bestes et y faire une tenaille […]».
37. Il nous semble que René II ne pouvait pas ignorer ce que l’animalpourvoyait d’autant plus que son grand-père avait aussi des civettes. P. Boyése demande pourtant si le prélèvement avait lieu: «Grand Jehan vidait-ilpériodiquement cet organe avec une cuiller, et, pétri dans de l’huile, leurzibeth entrait-il comme antipasmodique dans la pharmacopée ducale?» inBoyé, «Animaux d’Afrique à la Cour des Ducs de Lorraine», 11.
38. E. Charton, «Civettes et genettes», Le magasin pittoresque, 28 (1860),363: «La quantité de l’humeur odorante dépend de la nourriture donnée àl’animal et de ses dispositions particulières». En 1995, P. Chardonnet, inFaune sauvage africaine: la ressource oubliée, P. Chardonnet (dir.), I, Luxem-bourg, 269-71, écrit: «La production du musc (de la civette) dépend de laqualité de l’alimentation […]».
39. Chardonnet, Faune sauvage africaine, 269.40. Léon l’Africain, De l’Afrique, 296.41. Dannenfeldt, «Europe Discovers Civet cat and Civet», 407.
Parfum prophylactique et curatif
Si la civette était, aux XVe et XVIe siècles, un animal exotiquequi faisait l’objet de toutes les attentions dans les Cours euro-péennes, c’est que sa substance odorante avait des vertus déjàconnues, réputées et diffusées depuis plusieurs siècles par les lit-tératures persane et arabe notamment, puis par les savants d’Al-Andalus.A la mort de Mahomet, et à partir du VIIIe siècle, l’Islam par-
vint à dominer la Palestine, la Syrie, l’Irak, l’Iran et l’Egypte,tous, ‘pays de grande culture’42. Le monde musulman découvritet acclimata la médecine, l’astronomie et la philosophie grecques,la littérature persane et l’astronomie indienne. Les bibliothèquescalifales furent alors «des lieux décisifs dans la collecte, la diffu-sion, la copie et la traduction des ouvrages» et contribuèrent «àforger l’unité de la culture musulmane autour de la littératured’adab» 43. Cette littérature se constitua à la naissance de l’Islamen Arabie au VIIe siècle et se diffusa de la Perse à l’Espagne ausiècle suivant, permettant ainsi son entrée définitive dans la cul-ture occidentale. Les Arabes furent donc de précieux intermé-diaires dans la transmission du savoir médical et pharmaceutiqueà l’Occident.Médecine et pharmacie furent étroitement liées. Grâce aux
contacts entre musulmans et persans, les califes de Bagdad établi-rent des pharmacies dans leurs hôpitaux et ce, à partir du IXesiècle 44. C’est aussi durant ce même siècle que la science anda-louse s’élabora, grâce à Abderrahamn II qui sut créer un climatpacifique dans lequel des groupes de savants allaient fortementinfluencer cette culture hispano-musulmane 45. Au Xe siècle se créa à Cordoue, «par ordre du Calife Alhakam
II, une pharmacie de Medina Azahara, située dans une salle du
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
140
42. C. Alvarez de Morales y Ruiz-Matas, El libro de la Almohada, Toledo1980 (Instituto provincial de investigaciones y estudios Toledanos, s. II, «ves-tigios del pasado», 7), 11.
43. A ce sujet, voir le dossier de la BnF: http://classes.bnf.fr/dossitsm/islam.htm
44 Alvarez de Morales y Ruiz-Matas, El libro de la Almohada, 14.45. Ibid., 17.
palais» 46, même si les pharmaciens subissaient encore la rudeconcurrence des droguistes et parfumeurs. Au XIIIe siècle, Abu-L-Muna Kuhin al-Attar écrivait en son Minhaj al-dukkan wa-dustur al-ayan: «La pharmacie est, après la médecine, une des plusrespectueuses professions […] elle est véritablement un ustensilepour l’art de la fabrication des parfums, médicaments aroma-tiques et sirops» 47. Il n’est donc pas étonnant de découvrir lacivette dans la composition de médicaments 48, fait qui remonteau moins aux IXe-Xe siècles lorsque Rhazès (865-925), éminentmédecin de Bagdad, fut le premier qui nota dans son Livre duSecret des secrets que les matières d’origine animale pouvaient êtretraitées comme celles d’origine végétale 49.Au XIe siècle, Ibn Wafid (1008-1074), né à Tolède, fut médecin
et philosophe même s’il occupa une place dans la politique deson époque. Il connaissait admirablement Dioscoride 50 etGalien 51. Il écrivit trois œuvres dont le Kitab al-wisad. Cetteœuvre 52 traite de la guérison des maladies de la tête aux pieds,ne présente pas de chapitres mais des groupes de recettes précé-dés de la région du corps à laquelle ils correspondent 53. Véritablepharmacopée, elle s’adresse au médecin qui doit traiter chaque
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
141
46. Ibid., 19: «se creó en Córdoba, por orden del califa Alhakam II, unafarmacia de medina Azahara, situada en una sala del palacio».
47. Définition donnée par Alvarez de Morales y Ruiz-Matas, ibid., 14:«La farmacia es, después de la medicina, una de las más honradas entre lasprofesiones […] y es verdaderamente un utensilio para el arte de la fabrica-ción de los perfumes, medicamentos aromáticos y jarabes».
48. Nous n’avons trouvé de civette dans la pharmacopée qu’à partir duXIe siècle. Des recherches plus approfondies permettraient sûrement deremonter plus avant.
49. G. Pillivuyt, Histoire du parfum de l’Egypte au XIX e siècle, préf. J. Kris-teva, Paris 1988 (Collection de la parfumerie Fragonard),100.
50. Dioscoride est considéré comme le père de la pharmacognosie,autrement dit de la connaissance des drogues.
51. Galien est considéré aujourd’hui comme le père de la pharmacie: ilpréparait lui-même des médicaments avec les drogues qu’il collectionnait,de retour de ses voyages.
52. Il s’agit ici d’une traduction espagnole d’un manuscrit arabe 883 dela Bibliothèque de El Escorial, non daté (1265?): Ibn Wafid, Kitab al-wisad«El libro de la almohada» por Camilo Alvarez de Morales y Ruiz-Matas,Instituto Provincial de investigaciones y estudios toledanos, Serie segunda«vestigios del pasado», Toledo, 1980.
53. Alvarez de Morales y Ruiz-Matas, El libro de la almohada, 26.
jour des malades. Dans la traduction espagnole de cette œuvre, ilest aisé de faire la différence entre le musc du chevrotain et celuide la civette car l’espagnol utilise deux mots bien différents:‘almizcle’ (musc du chevrotain) et «algalia» (qui correspond à lacivette extraite de l’animal). Dans ces recettes, la civette, commeles trois autres matières odorantes animales essentielles – musc,ambre et castoreum – servait à fixer les autres composants.Dans la partie II («El cerebro»), la civette rentre dans la com-
position de deux recettes dont un nadd 54:
On prend un demi dirham de civette, trois de santal, un de boisd’Agar ou bois de Thchampa et huit de camphre. On pétrit le tout avecde l’eau de rose et on l’utilise.
et dans un «remède contre le vertige et les états psychiques res-semblant à l’épilepsie et à la terreur» 55 dans lequel sont mélangésdu bois d’Agar, de la cannelle de Chine, de la noix de muscade,un peu de confiture de rose sucrée, de la civette ou du musc etde l’ambre. Dans la partie III («El ojo»), la civette rentre dans lacomposition d’un électuaire à prendre «contre l’insomnie pro-duite par la bile noire ardente, accompagnée d’un état fébrile etd’une faiblesse du cœur et du foie» 56:
On prend une once de confiture de rose sucrée, un mithqal d’épine-vinette, un quart de dirham de sucre et un huitième de dirham decivette. Avec tout cela, on prépare un électuaire à prendre après lesrepas. En plus on s’injecte dans la narine de l’huile de graine decitrouille tiède.
Enfin, dans la partie XXIV consacrée notamment aux «chawa-rish» (pâtes pharmaceutiques) et aux sirops, la civette rentre dansla composition du «chawarish simple à base de pomme et demusc» où il est conseillé d’utiliser dans un récipient en verrepropre de l’eau de rose dans laquelle on aura dissous soit du
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
142
54. Ibid., 41, folio 18: «Se toma medio dirham de algalia, tres de sándalo,uno de agáloco o madera de Tchampa y ocho de alcanfor. Se amasa elconjunto con agua de rosa y se usa». Voir aussi p. 57, folio 66.
55. Ibid., 62, folio 89. 56. Ibid., 66, folio 11.
musc ou de la civette. D’autres arômes seront vaporisés ensuitesur le récipient afin qu’il en soit imprégné, avant d’y placer lechawarish encore tiède 57. Au XIIe siècle, Al-Idrissi écrivit un véritable article sur la
civette 58 – repris plus tard par Ibn Baytar 59 (XIIIe siècle) – luireconnaissant déjà des vertus notamment pour l’accouchement etle cœur:
La civette est une espèce de parfum que l’on recueille entre lescuisses d’une sorte de chat bien connu. […] puis on le nourrit de mor-ceaux de viande, ce qui le met en sueur, et c’est de cette sueur que pro-vient entre ses cuisses, le parfum en question. Cet animal est plus grandque le chat domestique, et il est bien connu. La civette est chaude autroisième degré et tient le milieu entre l’humidité et la sécheresse. Ellea la propriété, employée en frictions, de dessécher les abcès et d’encalmer la souffrance. Ses émanations aspirées sont utiles contre lecoryza. On l’administre à la dose d’une drachme, avec partie égale desafran, dans le bouillon de poule grasse, aux femmes en couches, pouraider à l’accouchement et c’est un remède efficace. Si l’on en fait dis-soudre la valeur d’un quirath dans deux oques de bon vin, on dissipe lespalpitations. C’est un remède excellent contre la faiblesse du cœur.
Au XIVe siècle, Zeinoddin Ali ibn Hossein Ansari, dit Ansari,né à Chiraz en Iran (1329-1404) fut un médecin et pharmaciencélèbre. Son livre le plus fameux, Ekhtiârât-e Badiei (Les optionsinnovantes), traité de pharmacopée de médecine de tradition per-sane, fut terminé en 1368-1369, sur la base de son premier livreMiftah ol Kahazain (Clé des Trésors) écrit trois ans auparavant 60.Son livre, Ekhtiârât-e Badiei, dédié à la reine Bado o Jamal, étaitdivisé en trois chapitres: les avantages des médicaments simples(chapitre qui offre des similitudes avec Dioscoride et Ibn al-
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
143
57. Ibid., 361, folio 2.58. Les relations de voyages et textes géographiques arabes, persans et turcs rela-
tifs à l’Extrême-Orient du VIIIème au XVIIIème siècles, traduits, revus et annotéspar Gabriel Ferrand, Tome I, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1913, 199.
59. Ibn al-Baytar, Traité des simples, traduction de Lucien Leclerc, 3 vols,vol. II, Paris: Institut du Monde Arabe, [1987], 198-99.
60. F. Ramezany et MR. Ardakani, «Ali ibn Hosein Ansari (1330-1404): aPersian Pharmacist and his Pharmacopoeia, Ekhtiyarat i Badi i», Journal ofMedical Biografy, 19 (mai 2011), 80-83.
Baytar) 61, la méthode de filtration des médicaments et les médi-caments composés. Il a écrit un paragraphe consacré à la civette62
dans lequel l’influence de Al-Idrissi est manifeste:
La civette est une humidité qu’on prend de l’entre-jambes d’unanimal qui ressemble à un chat, mais qui a une petite figure et qu’onl’appelle «le chat civette». La nature de la civette est chaude et la civetteéquilibre l’humidité et la sècheresse. Sentir et frotter la civette sontutiles pour le mal de tête froid intense, la migraine et le catarrhe. Si ondissout un carat de civette dans dix dirhams de vin réjouissant et qu’onle boit, la suffocation disparaît et c’est parfait pour les affres. Et si unefemme, ayant un accouchement difficile, ajoute un dirham de civette etun dirham de safran au bouillon d’un poulet gras et qu’elle le boit, elleaura un accouchement facile.
Au XIVe siècle, l’Europe est ravagée par la grande peste qui sepropage en suivant les itinéraires commerciaux de l’Asie centrale(d’où elle avait surgi en 1334) à la Méditerranée 63. Deux méde-cins de Grenade écrivirent des traités sur la peste: Ibn Jatima etIbn al-Jatib. Ce dernier, de son vrai nom Muhammad ibn AbdAllah (1313-1375), médecin hispano-arabe, était né dans la villede Lonja, en Andalousie, d’une famille d’origine arabe yéménitequi s’installa en Espagne au VIIIe siècle 64 et fut l’un des derniersgrands médecins de l’Occident 65. Il décrivit dans son traité l’ob-
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
144
61. Ibid., 82.62. Nous remercions très chaleureusement Peiman Hosseini, de l’Univer-
sité d’Ispahan (Iran), de nous avoir traduit le fol. 168 du manuscrit Paris,BnF, Supplément persan 1534. Au fol. 168v, une civette est dessinée à l’inté-rieur d’une cage dorée, une cuillère dirigée vers la partie de l’animal conte-nant la substance si convoitée:
63. C. de la Puente, Avenzoar, Averroes, Ibn al-Jatib: médicos de al-Andalus:perfumes, ungüentes y jarabes, s.l. 2003, 87.
64. Ibid., 89.65. Al-Jatib, Libro del cuidado de la salud durante les estaciones del año o
Libro del higiene, edición, estudio y traducción de M. de la Concepción Váz-quez de Benito, Salamanca 1981, 26.
servation et la propagation de l’épidémie de 1348: il découvrit eténonça le concept de contagiosité, préconisa l’isolement desmalades et la destruction des sources contacts de contamina-tions 66, notamment les habits. Il écrivit aussi le Traité de patholo-gie générale et spéciale, un grand traité de médecine 67 et le Livre del’entretien de la santé selon les saisons de l’année, écrit entre 1362 et1371 68 et qui nous intéresse ici. Ce livre est divisé en deux sec-tions indépendantes; l’une théorique, l’autre pratique. La secondesection de ce livre se divise en trois parties 69: traitement desquatre humeurs existantes (sang, phlegme, bile jaune et bilenoire); traitement du corps selon les quatre saisons de l’année entenant compte à nouveau des quatre humeurs; thérapeutiqueadéquate selon les «situations spéciales» de l’être humain (lesenfants, les personnes âgées, les marins, les soldats, etc.).
La civette 70 est préconisée surtout en hiver, comme parfumassocié avec des inhalations et d’autres senteurs car elle donnaitune note ‘chaude’ (en hiver, il faut se fortifier et tous les moyenssont bons). Employée en tant que fumigation, la civette renvoie àl’étymologie même du mot ‘parfum’. Elle est préconisée pourl’humeur équilibrée, pour le régime d’hiver, avec «des fleurs etdes parfums chauds en une juste proportion» 71; pour l’humeurphlegmatique, pour le régime d’hiver «où tous les parfums […]de forte chaleur, comme le castoreum, le musc tibétain, la civette
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
145
66. N. E. Boutammina, Les fondateurs de la médecine, Œuvres universellesde l’Islam, Edit. BoD, Paris 2011, 199-200.
67. C. de la Puente, Avenzoar, Averroes, Ibn al-Jatib, 113. Nous n’avons paspu vérifier si dans ces deux œuvres, la civette était préconisée dans le trai-tement d’une pathologie.
68. Il n’y a que trois manuscrits de cette œuvre; l’un, à Berlin (ms. 6401),celui qui a servi de base à l’auteur et les deux autres, à Rabat (mss. 2672 et2673); cf. ibid., 22.
69. Ibid., 116-17.70. Ibid., 204 note 35: «La ‘algalia’ según Ibn al-Jatıb, es un perfume que
tiene entre sus ingredientes: amizcle y ámbar, amalgamados con óleo conbeleño. Pero, además, y según el autor, es el perfume llamado ‘al-Zabada’,tomado de los animales y que es el conocido en Occidente». ‘Algalía’ peutdonc être soit un composé de parfums, soit celui de la civette.
71. Al-Jatib, Libro del cuidado de la salud durante les estaciones del año oLibro del higiene, 204: «con flores y perfumes cálidos en justa proporción».
aromatique et les médicaments indiens par exemple, clou degirofle, noix de muscade» 72; pour la bile noire, pour les régimesde printemps, d’automne et d’hiver 73. La civette est donc large-ment conseillée pour les mélancoliques et ce, à presque toutes lessaisons sauf l’été. Elle n’est préconisée ensuite ni pour les enfants,ni les personnes âgées. En étant conseillée ainsi surtout l’hiver,elle se voit officialisée comme traitement ‘chaud’ qui fortifie.Ces propriétés prophylactique et curative de la civette allaient
être utilisées au même siècle en Europe pendant l’épisode depeste notamment. En cette période épidémique, le bain et lavapeur furent considérés comme dangereux pour la peau car ilsouvraient les pores; l’air malsain et la chaleur pouvaient alorspénétrer le corps 74. Les ouvertures jouant dans les deux sens, lessubstances internes pouvaient aussi s’enfuir 75. Au XVe siècle sub-sistent encore ces croyances: «Bains et étuves et leurs séquelles,qui échauffent le corps et les humeurs, qui débilitent nature etouvrent les pores, sont cause de mort et de maladie» 76. Ce n’estqu’au XVIe siècle que les étuves fermèrent officiellement et sys-tématiquement en période d’épidémie 77. Les pommes de senteurfirent alors leur apparition: pour se préserver de l’épidémienotamment, les hommes et les femmes plaçaient dans une boule
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
146
72. Ibid., 241: «todos los perfumes […] de fuerte calidez, como castóreo,almizcle tibetano, algalia aromática y los medicamentos indios por ejemplo,clavo, nuez moscada […].
73. Ibid.: printemps, 245: «perfumes e inhalaciones: ámbar con beleño,óleo de almendras y algalias; entre las segundas, agua de rosas mezclada conagua de flor de toronja, almizcle disuelto en agua de rosas y flores equili-bradas, las de almendro […]», automne, 253: «Perfumes y inhalaciones:ámbar, almizcle, algalias atemperadas con óleos aromáticos y húmedos, einhalaciones, con flores, por ejemplo, jazmín, rosa blanca almizclada, flor denaranjo ácido […]»); hiver: 250: «Inhalaciones y perfumes: jazmín, rosablanca almizclada, flor de naranjo amargo, alhelí, narciso, todas las albhacas,almizcle, ámbar y las algalias».
74. G. Vigarello, Le propre et le sale: l’hygiène du corps depuis le Moyen Age,Paris 1985, 17: «Au-delà du seul refus des contiguïtés, s’impose une imagetrès spécifique du corps: la chaleur et l’eau ne feraient qu’engendrer des fis-sures; la peste, enfin, n’aurait qu’à s’y glisser».
75. Ibid., 20.76. T. Le Forestier, Régime contre épidémie et pestilence, Paris 1495, 102; cité
dans Vigarello, Le propre et le sale, 19.77. Ibid., 16.
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
147
Pomander du XVIesiècle fermé © DROM janvier 2
013.
Le même pomander, ouvert, avec la partie haute du centre,
nommée «zibeth» © DROM janvier 2
013.
de senteur dont ils ne se séparaient jamais « des matières aroma-tiques végétales et animales extrêmement chères» 78 et les inha-laient 79. Ces boules de senteur appelées aussi ‘boules à parfum’,‘pommes d’ambre’ se nommèrent ensuite ‘pomanders’, «évocationà la fois du réceptacle se rapprochant d’une pomme et ducontenu constitué très souvent d’ambre» 80. La civette, à l’odeur puissante, à la nature chaude, fait partie
des moyens prophylactiques pour se prémunir de la peste. AuXVe siècle, Rozmital rapporte que le roi du Portugal hume àjeun de la civette tous les jours car celle-ci est «un produit déli-cieusement parfumé qui entre dans la confection de baumesactifs contre la peste» 81. Il était aisé pour lui de s’en procurerpuisqu’il détenait un couple de civettes qui provenaient d’Alca-cer. Au XVIe siècle, l’eau de Damas, «composée d’une douzained’aromates additionnés de musc et de civette» 82 fut vite réputéecontre le fléau.La civette, substance qui exhale une odeur musquée extrême-
ment forte et tenace, fit partie des matières animales utilisées enpharmacopée et ce, depuis de nombreux siècles. Pourtant, uneautre facette de cette flagrance se profila en même temps: lafonction d’attractif sexuel que joue ce parfum entre les civettesmâle et femelle retentit au plus profond de l’être humain. C’estainsi que la civette, depuis fort longtemps, fut caractériséecomme un parfum entêtant, sensuel et aphrodisiaque.
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
148
78. Pillivuyt, Histoire du parfum de l’Egypte au XIX e siècle, 114.79. Ibid., 129: «Les plus pauvres en possédaient en métal non précieux
(parfois en bois) ou tenaient même directement dans leur main la bouleparfumée».
80. Ibid., 114: «La forme ronde symbolisait la vie éternelle, la puissance etla force; sur le plan profane, la pomme possédait des qualités guérissantesimportantes pour la digestion, les organes féminins et l’impuissance mascu-line».
81. L. de Rozmital, 1465-67, trad. D. Péricard-Mea, De la Bohême jusqu’àCompostelle. Aux sources de l’idée d’union européenne. Projet de Georges de Pode-brady (1464). Récit du voyage en Europe du seigneur Léon de Rozmital (1465-1467), Biarritz 2008, 277.
82. Ibid., 124.
Parfum et aphrodisiaque
Acquérir ses lettres de noblesse dans le monde musulman nefut pourtant pas aisé pour la civette. C’est ce qu’explique Al-Suyuti, au XVe siècle, dans Al-Maqama al Miskiyya (La Maq�madu musc). Dans cette œuvre, «quatre Princes des Parfums compa-raissent devant un juge, qui proclame leurs qualités et qui lesclasse selon leurs mérites» 83. La civette n’est pas aussi ‘noble’ queles trois premiers Princes qui sont dans l’ordre décroissant desuprématie: le musc 84, l’ambre et le safran. Elle n’est pas évoquéedans le Coran et Al-Djahiz rapporte même qu’un marchand deparfum lui aurait dit que si le prophète ne se parfumait pas avecdu musc, il ne s’en parfumerait pas lui-même. Quant à la civette,il ne songeait même pas à s’en mettre sur les habits 85. Pourquoiun tel rejet? Al-Suyuti l’explique lui-même: la civette n’est citéeni dans le Coran, ni par Adnan l’ancêtre. Elle est de plus la sueurd’un chat sauvage 86 ou le lait d’un chat des mers 87. Malgré tout, la civette finira par rejoindre les trois autres par-
fums élus et à acquérir de l’honneur grâce à l’une des femmesdu prophète, Umm Habbiba. Une tradition raconte que le pro-phète, ayant appris qu’Umm Habbiba était veuve (d’un roimusulman qui s’était fait chrétien et qui vivait en Abyssinie),envoya une lettre au Negus, lui demandant d’arranger un mariage
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
149
83. G. J. van Gelder, «Four perfumes of Arabia: A translation of al-Suyutı’sAl-Maqama al Miskiyya», in Parfums d’Orient, éd. R. Gyselen, Leuven 1998, 212.
84. Dans le Coran, il est dit que le musc est le meilleur parfum qui soit;le Prophète a été embaumé avec du musc; enfin, la terre du paradis est celledu musc in van Gelder, «Four perfumes of Arabia», 208. Pour plus d’infor-mations à ce sujet, voir notamment le livre de A. H. King, The Musk Tradeand the Near East in the Early Medieval Period, Indiana University 2007.
85. Al-Jahiz, al-Hayawan, ed. Aʿbd al-Salam Muhammad Harun, Cairo1965-1969, V, 304.
86. Au XIe siècle, Al-Biruni écrit dans l’article «Zuhm» que «Certainespersonnes ont en horreur la civette car elle provient d’un carnivore quiressemble à un chat», in Al-Biruni’s Book on Pharmacy and materia medica,172: «Some people hold in abhorrence because it comes from a carnivorelike a cat».
87. Au XIVe siècle, Al-Damiri a cette croyance. In Al-Damiri, Hayat al-Hayawan. A Zoological Lexicon, transl. from the Arabic by Lt.-Colonel A. S.G. Jayakar, II, I, London 1908, 90.
entre cette femme et lui. Le Negus missionna alors sa servante(ou concubine) Abraha chez Umm Habbiba afin de lui donnercomme présent des parfums dont la civette. Umm Habbibaapporta tous ces présents ‘sur elle et avec elle’ et le Prophète nefit aucune objection 88. Aussitôt après, la partie consacrée à lacivette se conclut par cette phrase: «La civette acquit ainsi del’honneur et atteint une haute position, devenant magnifiqueparmi les autres sortes de parfums et le quatrième, avec les troisautres Princes» 89.
La civette fut aussi utilisée dans la société médiévale arabedans le rituel d’hospitalité 90. Dans sa description de cette société,basée sur les études des Mille et une nuits, E.W. Lane rapporte qu’«il était habituel pour les hôtes et invités dans les parties de vin[…] de se parfumer les barbes et moustaches de civette» 91.Le retour des croisés contribua aux XIe, XIIe et XIIIe siècles à
faire connaître les essences, les parfums et les épices aux Euro-péens qui «avaient un retard culturel considérable sur les peuplesdu Moyen-Orient et de l’Asie» et qui «ignoraient le tout-à-l’égout, disposaient de peu de savon et éprouvaient une aversionmarquée pour les bains» 92. Ils rentrèrent notamment avec duChypre rouge – «mélange de substances résineuses et d’huilescomprenant de la rose de Damas, du bois de santal rouge, del’aloès, du girofle, du musc, de l’ambre gris et de la civette» 93 –qui détrôna l’eau de rose d’Avicenne.
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
150
88. Nous remercions chaleureusement M. van Gelder, de l’Oriental Ins-titute d’Oxford, de nous avoir donné cette référence: in Ibn Saʿ d, TheWomen of Madina, Aisha Bewley’s translation of part of al-Tabaqat al-kubra,London 1995, 96: «She [Umm Habiba] said, ‘On the following day, she[Abraha] brought me aloes, wars, and amber and much civet. I brought allthat to the Prophet. He saw it on me and with me and did not object’».
89. van Gelder, «Four perfumes of Arabia», 211: «Thus civet acquiredhonour and rose to an exalted position, becoming splendid amongst thekinds of perfume and the fourth together with the three other Princes».
90. M. Marín, «The Perfumed Kitchen: Arab Cookbooks from the Isla-mic Easted», in Parfums d’Orient, Leuven 1998 (Res Orientales, 11), 159-66.
91. E. W. Lane, Arabian Society in the Middle Ages, London 1883, 157: «Itwas usual with the host and guests at wine parties […] to perfume theirbeards and mustaches with civet».
92. R. Winter, Le livre des odeurs, trad. M.-F. de Palomera, Paris 1978, 22.93. Ibid., 23.
La civette rentra ensuite dans la composition de savons, d’eauxou de pastilles. Au XIIIe siècle, dans les Secrets merveilleux de lamagie naturelle du Petit Albert 94, dans la partie Secrets récréatifs tantde fantaisie que de grande utilité, la civette est mentionnée dans lacomposition de pastilles de rose 95, de l’eau d’Ange 96, de Pomos«comme ceux qui se font en Espagne» 97, de balles odorifé-rantes 98, du parfum de tabac 99 et du parfum à brûler 100. Dans lapartie Secrets curieux touchant la beauté des femmes, la civette rentredans la composition de «pastille d’une odeur fort agréable» 101; dela poudre pour conserver les cheveux 102 et des savonnettes duSérail 103. La civette, souvent rajoutée à la fin pour lier tous lesingrédients, est souvent associée au musc. Voici pour exemple larecette de «la poudre pour conserver les cheveux»:
Prenez racines de souchet long, calamus aromatique, Roses rouges, dechacun une once et demie; Benjoin, une once, bois d’aloës, six gros,corail rouge et succin, de chaque une demi-once, farine de fèves, quatreonces, racines d’iris de Florence, huit onces; mêlez le tout ensemble;faites-en une poudre très-fine, et ajoutez-y grain de musc et autant decivette. Cette poudre dont on se parfume la tête, facilite la régénérationdes cheveux et fortifie leur racine. On lui donne encore la propriétéd’égayer l’imagination et de fortifier la mémoire.
Nous ne pouvons ici reprendre toutes les recettes des savons,poudres, eaux et huiles dans lesquelles la civette est ingrédient.Notons par exemple que dans le célèbre livre de la parfumerie
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
151
94. Secrets merveilleux de la magie naturelle du Petit Albert, tirés de l’ouvragelatin intitulé Alberti Parvi Lucii Libellus de mirabilibus naturae Arcanis, etd’autres écrivains philosophes enrichis de figures mystérieuses, d’astrologie, physiono-mie ... nouvelle édition corrigée et augmentée, Lyon 1867.
95. Ibid., 144.96. Ibid., 144-45; en «grains de civette».97. Ibid., 145-46.98. Ibid., 146.99. Ibid., 147-48: «Cecy est fort bon contre le mauvais air, s’en frottant
sous le nez et aux tempes. Si on en met gros comme une lentille dans uneboëte à moitié pleine de tabac pardessus, il fera perdre le goust du tabac».
100. Ibid., 148: sous forme de tablettes.101. Ibid., 162: «vingt grains de bonne civette».102. Ibid., 164-65.103. Ibid., 166-67.
de la Renaissance italienne, Notandissimi secreti de l’arte profumato-ria 104, la civette se retrouve dans au moins une trentaine derecettes. Voici la recette du savon dit ‘Parfum de Damas’ de l’al-chimiste italien Girolamo Ruscelli 105:
Pulvériser: musc, civette, ambre, sucre, benjoin, storax et aloès. Mettrele tout dans une petite poêle ou parfumoir. Verser eau de rose ou eaude naphe. Faire un petit feu dessous, rajouter de l’eau dès qu’elle estconsumée, au bout de quelques jours, on obtiendra un excellent savon.
et celle de l’‘Huile impériale’, que Ruscelli utilisait pour parfu-mer ses cheveux et sa barbe et s’en frotter les mains et les gants106:
Mettre à bouillir dans un vaisseau plombé: ambre, styrax, gommes,eau de rose, huile de rose damasquée, clou de girofle et cannelle. Aprèsrefroidissement, amasser avec une cuillère d’or ou d’argent l’huile quinage par-dessus. Y additionner musc et civette. Garder cette huile dansune fiole bien bouchée avec cire et parchemin.
La civette, substance très chère que seuls les nobles pouvaientacquérir, était généralement renfermée dans des petites boîtes enmatières ou métaux précieux: en argent, chez les Ducs de Bour-gogne 107 ou en ivoire, par exemple, chez Catherine de Médi-cis 108. La civette de Catherine de Médicis provenait peut-être duseul animal de l’espèce qu’elle possédait dans sa ménagerie crééeà Chenonceau 109. Notons aussi que la belle-fille de Catherine de
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
152
104. R. Giovanventura, Notandissimi secreti de l’arte profumatoria, a c. di F.Brunello, F. Facchetti, Vicenza 1992. Nous remercions Paola Goretti, Profes-seur d’Histoire du Costume, Académie des Beaux-Arts, Bologne, pour cetteréférence.
105. Les deux recettes sont données dans G. Pillivuyt, Histoire du parfumde l’Égypte au XIXe siècle, 231-32, in A. Piémontois dit Girolmao Ruscelli,Les secrets du seigneur, Paris 1573.
106. Pillivuyt, Histoire du parfum de l’Égypte au XIXe siècle, 126.107. «Une petite boictelette d’argent à mettre cyvecte» in P. Blaizot, Par-
fums et parfumeurs, Cavalière: Éditions du Layet 1982, 41.108. «Une petite boeste d’yvoire, en laquelle y a de la civette», in E.
Bonnaffé, Inventaire des meubles de Catherine de Médicis en 1589: mobilier,tableaux, objets d’art, manuscrits, Paris 1874, 163.
109. C. Chevalier, Histoire de Chenonceau: ses artistes, ses fêtes, ses vicissi-tudes, XXV, Paris 1868, 339-40.
Médicis, Louise de Lorraine, lorsqu’elle vint s’installer au châteaude Chenonceau après la mort de son époux Henri III, vécutonze années dans le plus simple appareil dont la civette faisaitpartie: «De tout l’ancien attirail de la coquetterie féminine, ellene garda que […] quelques boîtes de civette, ambre et pas-tilles»110. Quant à Henri IV, il se fournissait chez le marchandapothicaire Pierre Chauche notamment en civette, musc, ambregris, poudre de violette et de Chypre et s’achetait aussi des pots,des vases et des sachets de senteur pour les garder111. La civette connut aussi son siècle de gloire en Occident car à
la Renaissance, «l’apparence extérieure commença à jouer unrôle plus important que la propreté en soi et la peur des bainsentraîna des notions de propreté tout à fait nouvelles» 112. Lessubstances animales furent alors utilisées pour cacher la saleté etvaincre les mauvaises odeurs. Les courtisanes étaient souvent lesseules à se laver les parties intimes, «les autres (comme une damede la Cour d’Henri II décrite par Brantôme) portaient entre lescuisses et sous les aisselles des éponges imprégnées de musc,d’ambre et de civette, pour ne pas sentir l’épaule de moutonaigre»113. Nicolas de Montaud qui fit, en 1582, imprimer Le miroirdes Français y reprochait aux dames et demoiselles de la Cour«d’employer tous les parfums, eaux cordiales, civette, musc, ambregris et autres précieux aromates, pour parfumer leurs habits etlinges, et, parlant par honneur, jusqu’aux parties les plus hon-teuses d’icelui, lesquelles sont les plus parfumées et aromatiséesque nulle autre chose»114. Une frénésie s’empara alors des Cours et courtisans pour ces
odeurs animales et certains accessoires furent parfumés commeles chaînes et les gants. Citons pour exemple en 1591 une chaîne
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
153
110. Ibid., 390.111. G. Bascle de Lagrèze, Henri IV, vie privée, détails inédits, Paris 1885, 128.112. Pillivuyt, Histoire du parfum de l’Égypte au XIXe siècle, 126.113. Ibid., 126 in Brantôme, Vie des dames galantes, Paris 1883. Cette
remarque de Brantôme rejoint cette autre: «Pour ne pas subir des reprochesde ce type au moment des règles, elles portaient des tampons parfumés oudes éponges mouillées de musc, d’ambre et de civette» in R. Muchembled,Une histoire du diable: XIIe-XXe siècle, Paris 2002, 136.
114. L. Sallentin, L’improvisateur français, XIV, Paris1805, 391.
pour laquelle on dut utiliser «cinq onces de civette à 14 escus» 115
et en 1595, «une grande cottoire à mectre au col composée desenteurs, musc, ambre et cyvette, le tout couvert de fil d’or»116.Catherine de Médicis introduisit en France le gant parfumé
qui était devenu une spécialité espagnole. En effet, à la Renais-sance, les parfumeurs arabes restèrent en Espagne alors que leurscompatriotes en furent chassés. Les parfumeurs espagnols devin-rent bientôt maîtres en parfumerie. Le musc, l’ambre gris et lacivette étaient utilisés pour imprégner les peaux tannées qui ser-vaient ensuite, après un intervalle assez long, à la confection desgants et de ceintures. Ce cuir parfumé, si renommé, fut baptisé‘peau d’Espagne’ et «se faisait avec une peau de chamois trempéedans de l’essence de fleur d’oranger, de rose, de santal, delavande, de verveine, de bergamote, de girofle et de cannelle, puisenduite de civette et de musc»117. On disait que la peau d’Es-pagne «était, de tous les parfums, celui qui se rapprochait le plusde la peau humaine». D’après Brantôme, les galants se plaignaient«des odeurs empestantes imprégnant gants, linge et vêtements deleurs dames»118. Enfin, Henri III, ses mignons et les femmes por-taient, pour avoir les mains douces, «des gants de nuit préalable-ment trempés dans une mixture de malvoisie, de musc, de civetteet de benjoin»119. On remarqua que le tabac égyptien avait une odeur d’ambre
très fine, ce qui amena les fabricants à lui ajouter de la civettepuisqu’elle s’associe admirablement à celle du tabac. Ce fut pour-quoi les marchands les plus célèbres prirent comme raison socialele nom «A la civette»120.
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
154
115. Article «Parfums» in V. Gay, Glossaire archéologique du Moyen Âge et dela Renaissance, II (repr. Paris 1887), 205 (Paris, Archives nationales, KK 147,fol. 177 et 182: «Pour une grande chesne de muscq de Levant, ambre griz etcivette, faisant trois tours, dont les grains sont fort groz»).
116. G. Le Breton, Inventaire des bijoux et de l’orfèvrerie appartenant à Mmela comtesse de Sault, confiés à l’amiral de Villars et trouvés après sa mort en 1595,Paris 1882, 6-7 note 5: «sorte de collier formé de boules contenant des par-fums qui étaient fort en vogue au XVIe siècle».
117. Blaizot, Parfums et parfumeurs, 48-49.118. Ibid, 48.119. C. d’Harcourt, Les habits, Paris 2001, 137.120. Blaizot, Parfums et parfumeurs, 48.
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
155
Détail du tableau «L’odorat», de Jan I Brueghel, dit
de Velours (
1568-1
625) et de Rubens, vers 1
617
@ Madrid, Musée du Prado
La civette regarde en direction de la boîte et de la
pomme de senteur qui contiennent son «musc».
Près de l’animal, d’autres objets qui pourraient être
imprégnés de civette: gants et collier de senteur.
Enfin, porté en pendentif, le pomander – utilisé notammentcontre la peste – devint un objet de séduction auquel lui furentattribués des pouvoirs aphrodisiaques car s’en dégageaient deseffluves animales (dont musc, ambre, civette). Il devint un véri-table objet d’art (auquel on rajouta un pied à la base) qui s’ou-vrait par quartiers (ou loculi). Chaque quartier (il y en avait aumoins six) «était muni d’une tirette où le nom de la substanceodoriférante était quelquefois gravé»121. La civette fut considérée depuis toujours comme un aphrodi-
siaque entrant dans de nombreuses compositions et de nos joursencore, les femmes éthiopiennes se lissent les cheveux avec cettesubstance lorsqu’elles veulent séduire un homme les jours defête 122. Dans l’Antiquité, Dioscoride «vantait d’ailleurs moins la
civette pour son parfum que pour ses pouvoirs aphrodi-siaques» 123. Au XIe siècle, Ibn Wafid en fait même son ingrédientpremier dans des recettes pour qu’une personne tombe amou-reuse d’une autre jusqu’à n’en plus dormir. Citons pour exemplecette recette qui eut pour conséquence qu’«un homme tombeamoureux d’une femme jusqu’à lui dédier toute son attention ettoutes ses pensées et à souffrir d’insomnie pour elle» 124. L’ingré-dient principal est la civette (2, 61 grammes) «de la meilleure quisoit» à laquelle on rajoute de l’épine-vinette, du sucre, de l’huilede rose, de l’eau chaude. Ce mélange doit être pris deux heuresavant le repas pour fortifier le cœur. En plus, il fallait s’injecterdans le nez de l’huile de graine de citrouille tiède. Dans un autrechapitre consacré aux organes génitaux (XVII: Los organos geni-tales) sont recommandés notamment plusieurs médicaments quirenforcent «le désir sexuel lorsqu’il s’est affaibli à cause de la
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
156
121. Pillivuyt, Histoire du parfum de l’Égypte au XIXe siècle, 129.122. Perier, Les matières odorantes animales, 15.123. E. G. Gobert, Parfums et tatouages, Paris 2003, 33.124. Ibn Wafid, Kitab al-wisad «El libro de la almohada», 64, III, 6 «Le
indiqué tomar tres tomines de algalia de la mejor clase, tres dirhames deagracejo, media uqiyya de azúcar, un mithqal de aceite de rosa y tres uqiyyasde agua tibia, todo lo cual debía usarse dos horas antes de la comida, porquele era necesario para fotalecer el corazón. Además debía inyectarse por lanariz aceite de simiente de calabaza tierna».
chaleur»: soit l’eau de rose avec du musc dissous ou du myrtearrosé de civette et vaporisé avec du bois d’Agalloche125.Du XIVe au milieu du XVe siècle, Venise eut «le monopole du
trafic des épices et des aromates entre l’Orient et les pays d’Eu-rope» et allait connaître «un essor important dans le domaine ducommerce des senteurs et des arômes»126. Lors du carnaval, lesfiltres d’amour au musc et à la civette dont les Vénitiens étaientfriands opéraient127 et des œufs parfumés (ovi odoriferi), «emplisde poudre de Chypre 128, pour les plus recherchés, ou simplementd’eau, parfois nauséabonde» 129, étaient envoyés sur le public. Al’origine, des marchands vendaient différents types d’œufs et lesjeunes hommes masqués jetaient des œufs parfumés devant lesmaisons des femmes qu’ils voulaient courtiser 130. Mais cela dégé-nérait souvent car les œufs s’écrasaient sur le public, sur lesépoux des femmes voire les femmes convoitées elles-mêmes.Etait réservé aux mégères, aux vieilles nourrices ou aux mèrespeu complaisantes «un autre type de projectile à l’odeur intense,mais beaucoup plus méphitique» 131. Ce jeu des œufs faisait fureuret complétait le déguisement du Mattacino, toujours entouré devendeurs d’œufs qui portaient de drôles d’accoutrements ressem-blant à de petits diables tentateurs 132.Pendant ce temps-là en France, Agnès Sorel, favorite du roi
Charles VII, connue pour l’extravagance de ses tenues et ses four-rures imprégnées de senteurs animales, utilisait aussi pour se par-fumer le ‘Chypre rouge’ composé ‘de roses de Damas, de bois desantal, d’aloès, de girofle, de musc, d’ambregris et de civette’133.
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
157
125. Ibn Wafid, Kitab al-wisad «El libro de la almohada», XVII, II, 253:«También es recomendable el uso de productos aromáticos, tales como elagua de rosacon almizcle disuelto o el arrayánrociado con algalía y vapori-zado con madera de agáloco».
126. Perier, Les Matières odorantes animales, 13.127. A. Le Guérer, Le parfum: des origines à nos jours, Paris 2005, 99.128. La poudre de Chypre contient de la civette. 129. M. Boiteux, «Chasse aux taureaux et jeux romains de la Renais-
sance» in Les Jeux à la Renaissance. Actes du XXIII Colloque internationald’études humanistes, Tours, juillet 1980, études réunies par Ph. Ariès et J.-Cl.Margolin, Paris 1982, 41.
130. http://www.delpiano.com/carnival/html/eggs.html131. D. Reato, Les masques de Venise, trad. D.-A. Canal, Paris 1991, 40.132. Ibid., 40.133. Pillivuyt, Histoire du parfum de l’Égypte au XIXe siècle, 108.
Enfin, en Angleterre, au XVIe siècle, le musc et la civetteconstituaient l’élément de base de presque tous les parfums. Sha-kespeare reconnaissait que pour séduire et conquérir sa damoi-selle, le soupirant devait se parfumer le corps à la civette 134: «Il sefrotte de civette, ne sentez-vous pas ce que cela signifie? C’estque le jeune homme est amoureux».Ces quelques pages ne suffisent pas à retracer toute l’histoire
de la relation entre l’homme et la civette qui semble avoir com-mencé très tôt, en atteste l’Avesta, qui, dès le VIe siècle av. J.-C.,décrit la civette comme «animal fabuleux qui a du musc sous laqueue». Une recherche plus approfondie, avec un corpus plusexhaustif, pourrait répondre aux questions soulevées.
Ayant acquis ses lettres de noblesse très tôt en Orient, la civettea poursuivi son enivrante ascension en Occident tout au long duMoyen Âge, à la Renaissance et à l’ère classique, en remplissantplusieurs fonctions: ingrédient fixatif en pharmacopée aux vertusreconnues, effluve enivrante pour masquer les mauvaises odeursou en exalter d’autres. Forte et puissante quand elle est pure, elledevient suave lorsqu’elle est mêlée aux autres essences. Utiliséesous forme de poudre, de pâte dans des pomanders, elle contribuaà lutter contre la peste, créant ainsi une véritable barrière entrel’air malsain et la peau. Véritable phéromone jouant un rôle dansle comportement sexuel entre civettes mâle et femelle, elle sembleavoir séduit l’humain et l’avoir invité à suivre ses pulsionssexuelles. Elle est présente dans des recettes aphrodisiaques orien-tales, au Carnaval de Venise dès le Moyen Âge ou sur les vête-ments des courtisanes et favorites dans les Cours européennes. Essentielle sur la palette des senteurs, la civette est encore uti-
lisée aujourd’hui 135 en dose infime pour fixer d’autres essences.Á notre époque où tout n’est que stérilisation et désinfection, lacivette demeure une note animale capiteuse de grande ampleur,une note de caractère qui «adoucit l’imagination» 136 et qui fut
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
158
134. Winter, Le livre des odeurs, 29: dans «Les joyeuses commères deWindsor» (1601).
135. De façon confidentielle par les parfumeurs car la civette de synthèsene donne pas les mêmes résultats.
136. «Give me an ounce of civet, good apothecary, to sweeten my ima-gination» dit le Roi Lear dans la Scène 6 de l’Acte 4.
classée au XIXe siècle comme la note la plus aiguë du clavier dessenteurs, dominant ainsi la gamme «de l’odorat et des odeurs» 137.
ABSTRACT
This article is a sample of the relationship between the human andthe civet for the production of perfume which comes from the perinealsecretion of this animal named «civette» in french and whose namecomes from the italian word «zibetto» which comes itself from thearabic word «zabad».Playing a role in the sexual behavior between male and female civets,
this substance of sparkling texture rich in fat with extremely strong andfirm muskyness is an absolute perfume which has been used very earlyin Persian and Indian pharmacopoeia. Then, it continued its intoxica-ting rise in the West throughout the Middle Ages, in the Renaissanceand in the Classic era, by being alternately a fixative component inpharmacopoeia with recognized virtues or a scent to mask the stenchesor an aphrodisiac in the East and in the West.
LA CIVETTE AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE
159
137. Dans les gammes selon S. Piesse, Des odeurs, des parfums et des cosmé-tiques, Paris 1865, 20-21, la civette est le «fa», la dernière et la plus élevée dela gamme. – Remerciements sincères pour l’aide apportée à la constitutionde la bibliographie: Elisabeth Belmas (Histoire moderne) et Juliette Vion-Dury (Littérature générale et comparée), Responsables de l’Axe 5 “Individu,corps, santé, société” du laboratoire PLEIADE (Université Paris 13 - Sor-bonne Paris Cité), Patricia de Nicolaï Michau (parfumeur créateur et prési-dente de l’Osmothèque, Versailles), Expiración García-Sánchez (Escuela deEstudios Árabes, CSIC), Paola Goretti (Storia del costume, Università diBologna), Nadine Guesdon (Bibliothèque de l’ISIPCA, Versailles), RifatKhalid et Stéphanie Lamy (Bibliothèque Droit-Lettres de Paris 13-SorbonneParis Cité), Dolores Carmen Morales Muñiz (Historia medieval, Universi-dad Autónoma de Madrid), Baudouin Van den Abeele (Histoire médiévale,Université catholique de Louvain) et Geert Jan Van Gelder (Oriental Insti-tute, Pusey Lane, Oxford); aux biologistes: Miguel Delibes (CSIC, Sevilla),François Moutou (SFEPM, Paris) et Géraldine Véron (Muséum nationald’histoire naturelle, Paris); pour leurs traductions: Expiración García-Sán-chez (CSIC), Peiman Hosseini (Littérature générale et comparée, Universitéd’Ispahan, Iran), Llúcia Mártin (Literatura medieval, Universidad de Ali-cante), Philippe Mézan et Hassan Sadi (BFM de Limoges); pour leur relec-ture: Corinne Beck (Histoire et archéologie médiévale, CALHISTE, Valen-ciennes) et Hamdi Mlika (Philosophie, Université de Kairouan, Tunisie); àl’entreprise DROM Fragrances international KG (München) pour les cli-chés envoyés gracieusement.
Indubitably we may say that the European use of civet has beeninherited from Arab and Persian Medicine and especially through Al-Andalus culture.
Virginie Mézan-MuxartLaboratoire PLEIADE
Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité[email protected]
VIRGINIE MÉZAN-MUXART
160