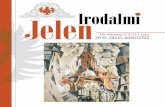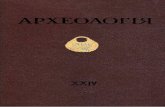« De l’efficacité de manger une souris cuite », Memnonia XXIV, pp. 209-214.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
Transcript of « De l’efficacité de manger une souris cuite », Memnonia XXIV, pp. 209-214.
Le Bulletin MEMNONIA traite, en priorité, des études et recherches effectuées sur le temple de Ramsès II longtemps désigné sous l’appellation de Memnonium. Périodique annuel d’archéologie et d’histoire régionales, il contient également des études spécifiquement consacrées à Thèbes-Ouest, aire géographique connue sous le nom de Memnonia à l’époque gréco-romaine. Financé et édité par l’Association pour la Sauvegarde du Ramesseum, il est adressé gratuitement aux Membres d’honneur, aux Membres donateurs, bienfaiteurs et titulaires.
Fondateur et directeur de la publication : Christian LEBLANC
Comité de Lecture : Christophe Barbotin (égyptologue, conservateur en chef, Musée du Louvre) ; Jean-Claude Goyon (égyptologue, professeur émérite à l’Université de Lyon II) ; Hélène Guichard (égyptologue, conservateur en chef, Musée du Louvre) ; Christian Leblanc (égyptologue, directeur de recherche CNRS) ; Guy Lecuyot (architecte-archéologue, ingénieur de recherche CNRS) ; André Macke (médecin-radiologue et anthropologue, Université de Lille) ; Monique Nelson (égyptologue, CNRS) ; Angelo Sesana (égyptologue, directeur de la mission archéologique du temple d’Amenhotep II à Thèbes-Ouest, CFE) ; Gihane Zaki (égyptologue, professeur à l’Université de Helouan, Le Caire).
Les manuscrits des contributions au Bulletin doivent être envoyés directement au siège social de l’Association, avant le 1er mars de l’année en cours. Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
Adresse du site web du Ministère de la Culture [Les monuments d’éternité de Ramsès II] :http://www.culture.fr/culture/arcnat/thebes/fr/index.htmlAdresse du site web de l’Association pour la Sauvegarde du Ramesseum : http://www.asrweb.orgAdresse du site web de la MAFTO : http://www.mafto.fr
Le volume XXIV des Memnonia [2013] a été imprimé au Caire par PRINTOGRAPH29 Al-Moarekh Mohamed Refaat – El-Nozha el Gedida, Le Caire.
ISSN 1110-4910. Dépôt légal no 796/1994Dar El-Kûtub. Le Caire. République Arabe d’Égypte.
© Toute reproduction intégrale ou partielle destinée à une utilisation collective et faite par quelque procédé que ce soit, est interdite. Elle constituerait une contre-façon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
DE L’EFFICACITÉ DE MANGER UNE SOURIS CUITE…
Amandine MARSHALL *
Des yeux rieurs reflétant une grande simplicité et bonté, c’est le souvenir que je conserverai de Fathy Hassanein que j’ai eu la chance et l’honneur de connaître.
Le papyrus Berlin 3027, également connu sous le nom de Livre de protection de la mère et de l’enfant, constitue un recueil de prescriptions destiné à protéger ces deux catégories de personnes particulièrement fragiles de toutes sortes de menaces (maladies, mauvais esprits ou revenants malintentionnés). Dans le cadre de cet article, nous nous intéresserons plus particulièrement à la formule livrée au chapitre L du pBerlin 3027 en donnant ici la traduction de N. Yamazaki qui fait référence en la matière :
Repousser la maladie sesemy
«O toi qui es dans l’eau, va et dis à ce qnbtj (1)-là qui est dans sa chapelle, à Sekhmet lorsqu’elle est venue derrière (?) la Résidence (?) [à cause] de
* Amandine MARSHALL est docteur en égyptologie (EHESS, Toulouse) et collabore aux travaux archéologiques de la MAFTO (UMR 8220 CNRS/LAMS).
(1) N. Yamazaki indique que qnb.tj pourrait désigner une divinité ou en être l’épithète : cf. N. Yamazaki, Zaubersprüche für Mutter und Kind : Papyrus Berlin 3027, Achet 2, Berlin, 2003, p. 30.
210 MEMNONIA XXIV
l’occasion, et qui est apparue [en tant que (?)] Ouadjyt, dame de Bouto, que pour elles-deux est apporté le lait de cette souris adulte, éveillée (?), qui est dans son trou, lorsque pour elles-deux sont célébrées les fêtes snw.t et dnj.t à Héliopolis : le fait de donner son œil par le Grand à l’autre Beau, pour que Seth voie <cela>».«On doit réciter cette formule pendant que l’on fait manger une souris cuite à cet enfant ou à sa mère. Ses ossements doivent être attachés à son cou (au moyen d’) une bande de lin fin et 7 nœuds doivent être noués» (2).
La formule comporte une première partie incantatoire et une seconde livrant un rituel à accomplir. Bien que la première partie soit lacunaire, le texte conservé indique un recours à deux puissantes déesses : Sekhmet et Ouadjyt. La première, particulièrement crainte des Égyptiens, pouvait toutefois mettre son savoir magique au service de la médecine et consentir à guérir les malades. La seconde, en revanche, est rarement évoquée dans les papyrus magiques.
Le rituel consiste à réciter l’incantation en même temps que l’enfant ou sa mère mange une souris cuite. Toutefois, cet aliment un peu particulier relève de la pratique magique et non d’un traitement médical. Le passage précise bien que la souris doit être mangée pendant la récitation de la formule magique, ce qui n’est jamais le cas pour les prescriptions médicales lorsqu’elles sont associées à des charmes à prononcer. En outre, l’animal entier cuisiné n’est jamais mentionné dans les autres posologies thérapeutiques. Seule la graisse (ou huile) de souris peut être éventuellement utilisée comme ingrédient dans le cadre de certaines prescriptions (4). Enfin, les ossements du rongeur devaient être précautionneusement prélevés et glissés dans un morceau de lin, lequel devait ensuite présenter sept nœuds. Cette dernière procédure n’est jamais appliquée dans le cas d’un traitement médical où l’on préconise l’ingestion d’aliments divers. On ne peut donc pas parler ici de médicament, comme certains l’ont fait4. Cette erreur d’interprétation est cependant aisée à comprendre : en effet, au Ier siècle de notre ère, Dioscoride, médecin et pharmacologue grec, rédige une œuvre en cinq livres, Περὶ Ὕλης Ἰατρικῆς («À propos des plantes médicinales»), dans laquelle il fait allusion à des problèmes de dentition soignés par l’ingestion d’une souris : «On affirme en général que […] les souris rôties sèchent la salive
(2) Traduction d’après N. Yamazaki : cf. N. Yamazaki, op. cit., 2003, p. 30.(3) Th. Bardinet, Les papyrus médicaux de l’Égypte pharaonique, Paris, 1995, p. 344 (pEbers 658 (82, 13-16) et 473 (pRamesseum V, n° III).(4) W. Dawson, JEA 10, 1924, pp. 83-86 ou B. Ebbell, ZÄS 59 (1924), p. 144.
DE L’EFFICACITÉ DE MANGER UNE SOURIS CUITE… 211
dans la bouche des enfants qui les mangent» (5). Dioscoride note également qu’en cas de salivation abondante, il est recommandé de mettre dans la bouche de l’enfant une souris vivante (6). On peut supposer que le traumatisme jouait efficacement son rôle sur la salivation du jeune patient…
D’après les propos de Dioscoride, il est clair que la souris cuite a acquis un nouveau statut à la période romaine : elle est désormais l’unique médicament à utiliser dans un traitement en rapport avec des problèmes de dentition clairement exprimés. C’est le rapprochement de l’utilisation de cette souris cuite dans la prescription de Dioscoride et du recours au rongeur cuit pour soigner le ssmy, dont le nom est déterminé par l’homme portant la main à la bouche, qui a permis à W. Dawson de rapprocher les deux affections et de suggérer que le terme ssmy signifiait «salivation excessive». Si son raisonnement semble fondé, en revanche, faire de la souris cuite un ingrédient thérapeutique à l’époque pharaonique est incorrect. Si tel avait été réellement le cas, la prescription aurait débuté, comme les autres traitements connus, par l’évocation de la posologie médicale et se serait terminée par l’incantation magique à réciter (7). À l’inverse, chaque fois qu’un charme est évoqué pour une affection déterminée, l’énoncé débute toujours par la récitation de la formule magique, laquelle est éventuellement complétée par un rituel à accomplir. Et c’est bien ainsi qu’il faut comprendre l’ingestion de cette souris cuite, à tout le moins, à l’époque pharaonique : comme relevant d’un rituel et non d’un traitement médical. Par contre, ce qui était, à l’origine, constitutif d’un rituel est devenu, au fil du temps, une simple recommandation médicale dont l’aspect magique et ritualiste s’est progressivement perdu au cours du temps.
Nous sommes également en désaccord avec W. Dawson sur un autre point qu’il évoque pour étayer son argumentation visant à établir que la souris était utilisée comme médicament par les Égyptiens dès l’époque prédynastique. L’égyptologue appuie sa théorie par une découverte de Gr. Elliot Smith sur certains corps desséchés d’enfants inhumés dans la nécropole prédynastique de Naga el-Deir. L’anatomiste relève en effet «la présence occasionnelle de restes de souris dans les canaux alimentaires des enfants dans des circonstances qui prouvent que le petit rongeur a été mangé après avoir été écorché» (8). Malheureusement, il ne donne aucune autre
(5) Dioscoride, De materia medica, Livre II (69).(6) Dioscoride, De Simplicibus, Livre I (71).(7) Th. Bardinet, op. cit., 1995.(8) Gr. Elliot Smith, The Ancient Egyptians of the Origin of Civilization, London-New York,1923, p. 50.
212 MEMNONIA XXIV
précision. Nous ne savons donc pas combien d’enfants étaient concernés ni comment l’identification de la souris fut établie avec une telle certitude. Les corps des enfants n’ayant pas été momifiés mais desséchés naturellement, on peut exclure l’insertion de souris à l’occasion du procédé de momification. En outre, Gr. Elliot Smith paraît certain que les rongeurs n’étaient pas présents dans les corps suite à une intrusion post-mortem. Ce qui est assuré, en revanche, c’est que l’ingestion de ces souris a été suivie rapidement par la mort de l’enfant. Or si des jeunes individus ont réellement ingéré un rongeur, ils n’ont pu avaler l’animal entier en une seule fois, même écorché.
L’égyptologue A. Lythgoe mentionne également dans le cimetière prédynastique de Naga el-Deir une découverte similaire, cette fois en rapport avec un homme adulte : «À l’intérieur du pelvis était une masse de matière intestinale contenant des petits os semblables à ceux d’une souris (?). Ces os, agglutinés à l’intérieur de cette matière, n’étaient pas endommagés, et les vertèbres et les dents de souris étaient certaines» (9). Il est curieux que la mention de souris dans la première phrase soit suivie d’un point d’interrogation sous-entendant que son identification n’est pas assurée alors que la seconde phrase certifie la présence de vertèbres et de dents du rongeur. Dans cette publication au moins, il est clair que l’animal n’a pas été désossé avant d’être mangé. Ce sont peut-être les mêmes éléments qui ont amené à l’identification des souris dans les corps de quelques enfants de Naga el-Deir.
Quoiqu’il en soit, si l’hypothèse d’un traitement médical faisant intervenir une souris doit effectivement être prise en considération (ne serait-ce que parce que les individus sont morts peu après), on ne peut en aucun cas affirmer, comme P. Podzorski le fait, qu’il s’agisse d’une pratique médicale certifiée (10), ni même qu’elle soit la «preuve attestée de l’usage médical de la souris en Égypte à une période qui, au calcul le plus bas possible, date de 6.000 ans» ainsi que l’avance W. Dawson (11). En outre, la découverte de restes de vertèbres et de dents de souris agglutinés dans le corps d’un homme adulte affaiblit quelque peu la théorie de l’utilisation ancestrale de souris dans le cas d’une affection infantile.
En revanche, l’usage médical du rongeur pour traiter la salivation excessive des enfants est mentionné, à la suite de Dioscoride, par un médecin
(9) A. Lythgoe, The Predynastic Cemetery N 7000, Naga-Ed-Dêr, Berkeley, 1965, p. 17 (tombe n° N 70 30).(10) P. Podzorski, Their Bones Shall not Perish, New Malden, 1990, p. 89.(11) W. Dawson, op. cit., p. 83.
DE L’EFFICACITÉ DE MANGER UNE SOURIS CUITE… 213
algérien du nom d'aAbd er-Razzak à la fin du XVIIe siècle (12). Des témoignages de cette pratique pour le moins inhabituelle sont également signalés, dans les campagnes du Royaume-Uni, au début du XXe siècle (13), où l’on donne aux enfants une souris écorchée, frite, bouillie ou intégrée à une tarte pour traiter l’incontinence de la vessie, la salivation excessive et la coqueluche.
Étant donné l’ampleur chronologique et géographique de cette prescription médicale, il convenait de s’interroger sur l’efficacité éventuelle d’un tel traitement et sur les raisons expliquant sa longévité si elle était inefficace. Qu’elle ait perduré depuis le Nouvel Empire jusqu’à l’époque romaine peut déjà sembler moins insolite, étant donné que l’ingestion de la souris faisait initialement partie d’un rituel magique. Son impact sur les problèmes de santé de l’enfant n’était pas remis directement en question dans les cas (probables) où le jeune sujet présentait toujours les mêmes douleurs puisque, déjà en Égypte ancienne, les voies des divinités étaient impénétrables… Les raisons de cette pratique ont dû se perdre au fil des siècles, ce qui expliquerait que l’ingestion du rongeur ait ensuite été considérée – et plus particulièrement par un étranger comme Dioscoride, peu familier des coutumes et rituels égyptiens – comme l’ingrédient essentiel pour venir à bout de soucis de salivation excessive chez les enfants. Que cette pratique ait été ensuite évoquée par un médecin arabe du XVIIe siècle ne présente, en réalité, rien d’étonnant : en effet, le Περὶ Ὕλης Ἰατρικῆς de Dioscoride connût une postérité incroyable qui traversa les siècles. Son œuvre fut traduite en latin (De materia medica) et en arabe. Sa traduction française remonte également au XVIIe siècle. On la doit à Jean de la Ruelle, médecin de François Ier. Qu’un praticien arabe la mentionne à cette époque ne doit donc pas nous étonner. La seule différence avec la version de Dioscoride (adaptation arabe ? question de goût ?) est le fait que l’on préconise de faire manger aux enfants une souris non plus bouillie mais grillée. On pourrait déjà être plus étonné de la persistance de cette pratique en Angleterre et au Pays de Galles mais là aussi, lorsque l’on considère les maux à traiter – salivation excessive, incontinence urinaire et coqueluche – et le remède proposé, on se rend compte que le premier mal est celui évoqué dans la prescription égyptienne et le deuxième, indiqué dans une recommandation latine de Pline l’Ancien qui, dans son Histoire Naturelle, préconise de faire manger des rats bouillis aux enfants souffrant d’incontinence urinaire (14). Quant au troisième mal, il s’agit probablement d’une variante anglaise ajoutée postérieurement
(12) ‘Abd er-Razzak indique en effet que «grillée et mangée, elle [= la souris] arrête la bave de la salive des enfants…» : cf. W. Dawson, ibid., p. 84.(13) W. Dawson, ibid.(14) Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Livre XXX (47).
214 MEMNONIA XXIV
aux deux autres, de même que les façons de préparer la souris varient quelque peu : la souris peut être servie écorchée, frite, bouillie ou en tarte.
Nous retiendrons de cette formule extraite du pBerlin 3027 qu’elle indiquait, à l’origine, un traitement destiné à lutter contre une maladie infantile (15), a priori en rapport avec la bouche. S’agissait-il de la salivation excessive évoquée par Dioscoride ? C’est possible mais non assuré. En effet, chez les enfants, l’hypersalivation accompagne très souvent l’éruption des premières dents, une période particulièrement douloureuse pour les nourrissons. Peut-être le terme ssmy est-il plutôt à mettre en relation avec la douleur provoquée par l’apparition des premières dents qu’avec l’étiologie de cette affection ?
Résumé en français :
Une formule du pBerlin 3027 livre un procédé assez déroutant consistant à faire manger à un enfant souffrant de l’affection-sesemy une souris cuite. Quelle était cette affection ? Comment expliquer que cette méthode, compilée dans un papyrus du Nouvel Empire, ait traversé les siècles et les continents et qu’elle ait été toujours préconisée dans les campagnes anglaises et galloises du début du XXe siècle ? C’est ce que propose de voir cet article.
English abstract :
A formula from the pBerlin 3027 calls for a rather upsetting process consisting in making a child, who is suffering from the sesemy-disease, eat a cooked mouse. What was this disease ? How to explain that this method, described in a papyrus of the New Kingdom, crossed the centuries and the continents, and was still recommended in the English and Welsh countrysides of the beginning of the XXth century ? The article proposes to elaborate on this.
(15) L’affection ssmy ne se retrouve en effet pas dans les maladies en relation avec les adultes.
TABLE DES MATIÈRES
Nouvelles et Activitésde l’Association pour la Sauvegarde du Ramesseum
— Composition du Conseil d’Administration et du Bureau de l’Association pour la Sauvegarde du Ramesseum. ........................................... 5
— Liste des nouveaux membres de l’ASR. ........................................................... 6-14
— Compte-rendu de l’Assemblée Générale Élective et de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association pour la Sauvegarde du Ramesseum du 5 avril 2013. Nouvelles et activités, par Christian Leblanc. ........................ 15-22
Recherches et Travaux
— Christian Leblanc. Recherches et travaux réalisés au Ramesseum et dans la Vallée des Rois, durant la mission d’octobre 2012 à janvier 2013 [Pl. I-XII]. ................................................................................. 25-56
Rapport financier
— Jean-Claude Blondeau. Rapport financier de l’exercice 2012. ......................... 57-62
Hommages à la mémoire de Fathy Hassanein Mohamed
— Christian Leblanc. Fathy Hassanein Mohamed (1935-2013) Biographie et bibliographie. ............................................................................. 63-69
Études
— Christophe Barbotin. Les ostraca hiératiques de l’école du Ramesseum [Pl. XIII-XVII]. ............................................................................. 73-79
— Thierry De Putter, Christina Karlshausen et Christian Dupuis. Les blocs en calcaire remployés au Ramesseum et l’utilisation du calcaire sur la rive ouest de Thèbes au Nouvel Empire ................................................................................................ 81-90
— Monique Nelson. Une sépulture de la Deuxième Période intermédiaire (XVIIe dynastie) et ses ramifications [Pl. XXVIII-XXV]. ............................................................................................ 91-103
226 MEMNONIA XXIII
Varia thebaïca
— Hisham Elleithy. Five XXVIth dynasty wooden Funerary Stelae from Thebes [PL. XXVI-XXIX]. ...................................................................... 107-128
— Christian Leblanc. De la dispersion au récolement des vestiges de l’équipement d’éternité de Ramsès II [Pl. XXX]. ............................................. 129-146
— Alban-Brice Pimpaud et Guy Lecuyot. Cartes pour l’étude de la rive gauche de Thèbes aux époques romaine et byzantine [Pl. XXXI-XXXII]. ........................................................................................... 147-154
— Susan Redford. The Tomb of Amenmose (AT-2). A Small Ramesside Tomb in the Assasif [Pl. XXXIII-XXXVI]. ....................................................... 155-183
— Angelo Sesana et Anna Consonni. Une sépulture de nouveau-né dans l’aire du temple de millions d’années d’Amenhotep II à Thèbes-Ouest [Pl. XXXVII-XXXVIII]. ........................................................ 187-198
Varia aegyptiaca
— Jean-Claude Goyon. Les vautours, la matrice et les «humains remetj». ........... 201-208
— Amandine Marshall. De l’efficacité de manger une souris cuite…. ................. 209-214
— Gihane Zaki. L’île de Philae : un lieu enchanté et une mémoire transposée dans l’universel recueil des Mille et Une Nuits [Pl. XXXIX-XLIII]. ........................................................................................... 215-224
Table des Matières. ................................................................................... 225-226
Planches photographiques I-XLIII.