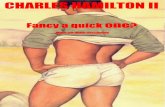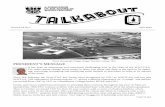« Charles Péguy à la croisée des âges », in Camille Riquier dir., Charles Péguy, Cahier...
-
Upload
univ-lyon2 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of « Charles Péguy à la croisée des âges », in Camille Riquier dir., Charles Péguy, Cahier...
Charles Péguy à la croisée des âges Sarah Al-Matary (Université Lyon 2, EA 4160
Passages XX-XXI)
Deux ans après avoir recensé Les Générations sociales (1920) de
François Mentré pour la Nouvelle Revue Française1, le critique
Albert Thibaudet constate que cette catégorie s’est imposée au
point de remplacer celle de « classes », empruntée au lexique
militaire2. Sans relever le rôle des écrits de Charles Péguy
(1873-1914) dans la banalisation de l’étiquette
générationnelle, Thibaudet suggère qu’en tombant au champ
d’honneur en pleine force de l’âge, ce dernier s’est fait
l’incarnation de ses contemporains. Péguy, disparu depuis
presque une décennie, alors qu’il était à peine plus âgé que
Thibaudet, avait partagé avec lui le destin de ceux qui
« eurent vingt ans en 1894 […], l’année-même où fut dégradé sur
le front des troupes le capitaine Alfred Dreyfus », des
« hommes nés au lendemain de Sedan », auxquels l’Histoire
1 Albert Thibaudet recense Les Générations sociales (Paris, Bossard, 1920, 472p.) de François Mentré dans la Nouvelle Revue Française du 1er mars 1921 (cecompte rendu, intitulé « L’idée de génération », figure dans les Réflexions surla littérature, édition établie et annotée par Antoine Compagnon et ChristophePradeau, préface d’Antoine Compagnon, Paris, Gallimard, « Quarto », 2007,1754 p., p. 506 sq.). Thibaudet poursuit sa réflexion dans différents textes,parmi lesquels « Procès littéraires » (Nouvelle Revue Française, 1er août 1923,ibid., p. 813 sq.) ; « Le roman de l’énergie » (Nouvelle Revue Française, 1er mars1924, ibid., p. 866 sq.) ; Le Liseur de romans, Paris, G. Grès et Cie, 1925, XXXIV-239 p., p. 200 ; La République des Professeurs, préface de Michel Leymarie, Paris,Hachette Littératures, « Pluriel », 2006, [1927], 284 p., p. 54 sq. etsurtout Histoire de la littérature française, paru de façon posthume en 1936. Sur lesusages de la « génération » chez Thibaudet, voir Michel Leymarie, AlbertThibaudet : l’outsider du dedans, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires duSeptentrion, 2006, 367 p., p. 158 sq. 2 La « classe » désignait l’ensemble des jeunes gens appelés sous lesdrapeaux une même année.
1
« réservait encore de devoir battre ensemble le rassemblement,
un rassemblement cette fois-ci général, puisque l’âge où l’on
commence à prendre le pouvoir politique, l’âge de quarante ans,
[cette] génération l’eut en 1914 ».
À la date où écrit Thibaudet, seules quelques centaines de
lecteurs peuvent prétendre que l’œuvre de Péguy leur est
véritablement familière. Le témoignage du critique reflète
d’ailleurs moins la reconnaissance posthume de la production
péguyste que l’espoir d’associer sa figure à l’élaboration
d’une conscience collective. Ce n’est donc pas sans calcul que
Thibaudet fait d’un auteur méconnu « l’étoile littéraire de sa
génération3 », d’un réprouvé une figure identificatoire. Le
contexte est propice à la réhabilitation : en mourant au feu,
Péguy s’est fait héros. Il apparaît par ailleurs comme un
« homme-époque » ayant été, de près ou de loin, le témoin d’une
série d’événements historiques : né d’un brave type miné par
les privations du siège de 1870, il grandit dans la France de
la Revanche ; le dreyfusisme galvanise son entrée sur la scène
politique et littéraire ; il disparaît à l’aube de la Grande
Guerre, qui emporte tout un monde. Ces circonstances ne
suffisent pourtant pas à désigner en Péguy, isolé dans le champ
politique et littéraire, le symbole d’une génération. Comment
faire de cet écrivain inclassable, qui refusait les
rapprochements qu’affectionnait l’histoire littéraire
3 Cet article, destiné à être publié en 1923 dans La Nouvelle Revue Littéraire,figurait dans un exemplaire de La République des Professeurs dédicacé par l’auteurà Daniel Halévy. Voir Roland Thévenet, « Hommage (retrouvé) de Péguy parThibaudet », 22 février 2010, Solko. Littérature, histoire, théâtre,polémiques à Lyon &ailleurs, http://solko.hautetfort.com/archive/2010/02/22/ommage-retrouve-de-peguy-par-thibaudet.html, blog consulté le 3 janvier 2014.
2
universitaire, le représentant d’une « génération
littéraire » ? Comment l’ériger en représentant d’une
« génération politique », alors que son socialisme – ni
radical, ni guesdiste, ni jaurésien – s’inscrit à la marge ?
Une annexion fondée sur l’imbrication de récits générationnels
De Péguy, la postérité a fait le centre d’un récit
générationnel élaboré au prix de déplacements et d’omissions :
le combattant marchant sur les pas de son père, l’esprit libre
rallié au catholicisme relèguent souvent dans l’ombre le
révolutionnaire, l’athée devenu chrétien hors de l’Église. Mais
ce grand récit n’aurait pu voir le jour si Péguy n’en avait
lui-même posé les jalons à travers la série de scènes où il
s’est peint en chef de file : au lycée d’Orléans, il patrone
les plus sportifs4 ; gérant des Cahiers de la quinzaine, il devient
l’un des principaux animateurs culturels du Quartier Latin ; au
front enfin, il conduit les cent-vingt mobilisés de son
peloton. L’usage récurrent que Péguy fait du paradigme
générationnel a ainsi pu conditionner sa sacralisation.
Doublement capté, ce paradigme soutient à la fois la rhétorique
d’un auteur qui se singularise, et celle de ses zélateurs
(Daniel Halévy, les frères Tharaud, Albert Thibaudet, les
4 Il jouera les capitaines jusqu’à la fin de sa vie, à la tête de la fineéquipe réunissant, entre autres, Alain-Fournier, Jacques Rivière, JeanGiraudoux et Pierre Mac Orlan. Cette équipe devait donner naissance à unesociété ‒ La Jeunesse Sportive et Littéraire ‒, ouverte aux « sportsmen,débutants ou vétérans, littérateurs ou artistes » (Excelsior, 4 février 1914),mais la guerre contrecarra le projet. Sur le sujet, voir Pierre Charreton,Les Fêtes du corps : histoire et tendances de la littérature à thème sportif en France 1870-1970,Saint-Étienne, CIEREC, « Travaux », 1985, 172 p., p. 63.
3
hussards), qui calquent leur représentation du « grand homme »
sur l’autoportrait que ce dernier a brossé.
Cruciale dans la pensée péguyste de l’Histoire, tous
genres littéraires confondus, la « génération » rend compte de
la manière dont s’entrelacent des temporalités (biologiques,
historico-politiques, intellectuelles et institutionnelles) et
des modes de catégorisation sociale hétérogènes (la famille, la
classe, la nation). Contre « l’histoire des intellectuels5 »
fondée sur une chronologie linéaire, Péguy envisage la
temporalité dans une perspective à la fois diachronique et
synchronique, croisant l’acception verticale de la
génération (engendrement biologique, filiation spirituelle) et
son acception horizontale (solidarité de formation, amitié).
Relier le contemporain à l’origine, penser le collectif (le
peuple, la famille, la camaraderie d’étude et de lutte, la
communauté des croyants) en des termes personnels lui permet de
rendre son épaisseur à l’Histoire. En un mot, de l’incarner.
Vivant dans l’entre-deux des siècles et des guerres,
Péguy n’appartient entièrement ni à la « génération du feu » ‒
quand bien même cette dernière serait constituée de différentes
classes d’âges6) ‒, ni à celle qui connut l’Empire. Il est tout
au plus, comme l’avançait Thibaudet, un enfant de Sedan ; la
5 Charles Péguy, « Deuxième suite de Notre patrie », in Par ce demi-clair matin,Paris, Gallimard, « NRF », 1952 [1905], 293 p., p. 113. 6 Les conscrits ont une vingtaine d’années ; Alain-Fournier, avec lequelPéguy a noué amitié, trépasse comme lui en septembre 1914, peu avant sonvingt-huitième anniversaire ; Péguy, quarantenaire, a tenu à rester dansl’armée active, alors qu’il relevait de l’infanterie territoriale (ceuxqu’on appelait les « Pépères », parce qu’âgés de plus de trente-quatre ans,il ne pouvaient occuper les premières lignes). Péguy est de la même classeque Barbusse, né lui aussi en 1873. Sur le sujet, voir notamment BrunoCabanès, « Génération du feu : aux origines d’une notion », Revue historique,n°641, 2007, p. 139-150.
4
mémoire du confli franco-prussien lui a été transmise sous la
forme d’un quignon de mauvais pain que son père aurait rapporté
du siège de Paris. Cette transmission médiatisée par le récit
de sa mère, Péguy la présente comme organique, plutôt
qu’intellectuelle. L’étoffent un faisceau d’attestations
impalpables :
[…] les hommes de ma génération, nés immédiatement après la
guerre, ont été élevés dans ce témoignage même ; nous n’avons
pas même eu à le recevoir ; c’est lui qui nous a élevés, qui
nous a bercés, qui nous a nourris, qui nous a fomentés sur
ses genoux ; c’est lui qui a fait toute notre vie,
sentimentale, mentale, passionnelle […].
Donné avec la vie, cet héritage qui relève d’« une connaissance
incorporée7 » se sédimente dans l’enfance et l’adolescence.
Néanmoins, malgré d’apparentes similitudes, tout sépare la
France contemporaine de celle de 1870 : Péguy est bien
conscient, par exemple, que la question de l’Alsace-Lorraine ne
se pose plus dans les mêmes termes8.
L’Affaire Dreyfus ancre-t-elle Péguy dans une génération ?
Nul mieux que ce dernier n’a montré quels clivages condamnaient
la prétendue « génération de l’Affaire ». L’expérience de
l’événement s’est construite au prisme des appartenances
individuelles, mais aussi à la lumière de son évaluation
rétrospective. Charles Péguy et Daniel Halévy, confrontant
leurs souvenirs, ne peuvent lire l’Affaire de manière
identique. Si, lorsqu’il répond à son compagnon en dreyfusisme7 Charles Péguy, « Deuxième suite de Notre Patrie », op. cit., p. 87, p. 90. 8 Ibid., p. 46. Voir aussi Charles Péguy, Victor-Marie, Comte Hugo, Paris,Gallimard, « NRF », 1934 [1910], 241 p., p. 145.
5
dans Notre Jeunesse (1911), Péguy rattache certes l’Affaire au
« besoin d’héroïsme qui saisit toute une génération9 »,
l’emploi est ici normatif : il désigne une communauté
idéologique (ce qui exclut un antidreyfusard comme Barrès),
regroupant différentes classes d’âges (Jean Jaurès est né en
1859, Lucien Herr et Bernard Lazare en 1864 et 1865, Péguy en
1873). Élevé par une grand-mère ayant elle-même été recueillie
par son propre grand-père, Péguy envisage toujours la
« génération » en termes de coexistence des âges. Aussi
corrige-t-il, dans L’Argent suite, un singulier employé à la
légère : parce que dans un même « temps », les « cadets et les
aînés » cohabitent, il faut parler de « générations10 » au
pluriel.
Toutefois, c’est moins le rôle des aînés que celui des
étudiants dont l’Affaire aiguisa la conscience politique que
valorisent les textes du début des années 1910, minorant en
somme les interventions d’un Jaurès au profit de celles d’un
Péguy. Ce dernier peut ainsi se faire le porte-parole du
groupe, et écrire : « Nous ne voulons pas être traités comme
des suspects par des anciens qui sans nous n’existeraient pas
dans une maison qui sans nous était emportée il y a quinze ans
dans la tourmente antisémitique11 ». Qu’on se le dise : ceux
qui ont sacrifié la jeune génération en sacrifiant la mystique
à la politique n’ont pas le monopole du dreyfusisme, quoiqu’ils
soient les plus introduits, les plus visibles. Ce partage entre9 Péguy, Notre Jeunesse, Paris, Gallimard, « Folio », 1993 [1910], 345 p., p.287. 10 Charles Péguy, L’Argent suite, in Œuvres en prose 1909-1914, Paris, Gallimard,« Bibliothèque de la Pléiade », 1961, 1648 p., p. 1178.11 Charles Péguy, Un nouveau théologien. Monsieur Laudet, Paris, Gallimard,« NRF », 1936 [1911], 226 p., p. 108.
6
aînés et cadets demeure néanmoins relatif : un « grand aîné »
se distingue – le maître Bernard Lazare, que Péguy campe en
père spirituel, quoique huit ans le séparent à peine de lui.
Revenant sur son dreyfusisme, Péguy se trouve isolé, raillé par
les « vieux républicains » et les « jeunes gens » : il se dit
« extrêmement mal situ[é]. Dans la chronologie. Dans la
succession des générations », et s’assimile à « une arrière-
garde mal liée, non liée au gros de la troupe, aux générations
antiques ». Cette position intersticielle confère finalement
toute sa valeur à son témoignage : le présent ne scelle pas une
rupture totale ; il est un simple moment de relais. L’avenir
complètera la physionomie de l’Affaire Dreyfus. Voilà pourquoi
Péguy espère que la « génération suivante12 » renoue avec la
mystique, et mette un terme à la crise.
Le paradigme générationnel sature les pages de Notre
Jeunesse, comme si Péguy souhaitait en remotiver l’emploi pour
le détacher de la rhétorique jaurésienne, Jaurès représentant
désormais pour lui la dégradation de la démocratie en
démagogie. Les usages jaurésiens du terme génération étaient
connus de Péguy, qui avait édité les Études socialistes dans les
Cahiers de la quinzaine (quatrième cahier de la troisième série,
décembre 1901) ‒ non sans y joindre un « avertissement »
invitant les anciens dreyfusards à ne pas céder aux attraits de
la politique politicienne. Or ces Études comptaient une vingtaine
de références à la génération. Jaurès y évoquait les
« générations nouvelles13 » ; dans son avertissement, Péguy
leur préfère les « générations neuves », et déclare :
12 Charles Péguy, Notre Jeunesse, op. cit., p. 104.13 Jean Jaurès, Études socialistes, 1901, p. XXIV, p. 137, p. 214.
7
c’est un insupportable abus de l’autorité paternelle que de
vouloir imposer aux générations neuves les radotages des
générations fatiguées, vieilles, que nous sommes. […] Ne
faisons pas au nom de la raison des vœux perpétuels pour
nous-mêmes. Et n’en faisons pas pour les perpétuelles
générations.
À la faveur de ce déplacement, Péguy développe une contre-
pensée de l’héritage. Pour lui, le legs révolutionnaire même
doit être perpétuellement réinterrogé, passé au crible de la
conscience individuelle ; car la Révolution suppose une
constante actualisation :
Imiter bien les anciens révolutionnaires, c’est nous placer
librement en face du monde comme ils se plaçaient librement
en face du monde. […] Pas plus que nous ne devons attacher à
la révolution sociale et imposer aux humanités futures nos
systèmes, nous ne devons pas plus leur imposer des systèmes
hérités, fussent-ils hérités de révolutionnaires14.
Qu’est la Révolution, sinon cette perpétuelle régénération
qu’avaient souhaitée les premiers révolutionnaires français ?
Vivre, c’est toujours recommencer. On ne vit qu’au présent.
L’écrivain le suggère encore dans un texte rédigé en 1905. De
manière quelque peu provocatrice, il y érige en
« révolutionnaires » plusieurs personnalités de l’Ancien
Régime, parmi lesquelles Richelieu et Colbert :
14 L’avertissement en question est aujourd’hui connu sous le titre De laraison, et joint à Notre jeunesse, op. cit., ici p. 74-75, p. 85.
8
un homme comme Richelieu ne représentait évidemment pas les
hommes de sa génération ; un homme comme Colbert non plus ;
[…] au contraire ils agissaient par opposition, par
anticipation éminente ; leur valeur, leur action, le résultat
qu’ils obtinrent venait au contraire de ce qu’ils ne
représentaient pas leurs contemporains, de ce qu’ils
n’étaient pas de leurs contemporains ; ils étaient des hommes
de notre temps […].
C’est bien ce qui sépare ces chefs « modernes » des
« anciens » :
les anciens rois, [qui] représentaient leurs bandes et leurs
peuples, […] pouvaient donc nous donner des indications
éminentes sur la mentalité de leurs âges ; au contraire, […]
les nouveaux rois, les nouveaux ministres […] étaient des
révolutionnaires, c’est-à-dire qu’ils annonçaient dans leurs
âges les âges qui allaient venir ; ils ne représentaient donc
pas éminemment leurs âges dans leurs âges pour nous, mais ils
représentaient initialement nos âges dans leurs âges pour
eux ; ils étaient nos anciennes extrêmes pointes d’avant-
garde ; nous ne savons que trop quelle armée s’avançait
derrière eux15.
Se dessine ici une lecture de l’Histoire faite d’aller-retour,
que travailleront les textes postérieurs. L’événement ne s’y
détache pas en tant que tel ; il prend sens à la lumière de ce
qui l’a préparé, et de sa perception rétrospective. Raison pour
laquelle il doit être envisagé dans la durée. Gilles Deleuze,
relisant Péguy en mai 1968, sera sensible au fait que « c’est
généralement dans les périodes où rien n’arrive que se font les15 Charles Péguy, « Deuxième Suite de Notre Patrie », op. cit., p. 111, p. 116.
9
changements », que l’avenir peut amener à modifier radicalement
l’expérience et la vision d’un événement, parce que tout
événement comporte une « part » qui « ne se laisse pas
accomplir par son actualisation16 ».
Péguy envisage les suites de l’Affaire rétrospectivement,
en homme de quarante ans parvenu à une forme de maturité. Ce
chiffre, hautement symbolique, a une valeur particulière dans
la Bible, où il désigne à la fois des périodes de mise à
l’épreuve (la traversée du désert par les Hébreux, tout comme
leur domination par les Philistins durent quarante ans) et de
maturation profitable (Moïse a quarante ans lorsqu’il quitte
l’Égypte, les règnes des rois David et Salomon s’étendent sur
quarante ans). Au mitan d’une vie humaine (comment Péguy
aurait-il pu savoir que la sienne touchait en fait à son
terme ?), cet âge représente l’expérience acquise : c’est le
moment où « nous devenons ce que nous sommes17 », écrit Péguy.
Il forme en outre, chez l’intéressé, ce point où la conscience
du vieillir rencontre le sentiment d’une déchéance historique.
À l’heure où il écrit L’Argent (1913), Péguy estime en effet que
« les hommes de soixante ans sont jeunes et que les hommes de
quarante ans ne le sont plus18 », parce que ces derniers ont
traversé des crises politiques et sociales inédites (l’Affaire
16 Cours de Gilles Deleuze en ligne, 7 décembre 1982, transcrits par JulieAlfonsi, consultés le 3 janvier 2014 sur La voix de Gilles Deleuze enligne, http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=163 Voiraussi Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 1993 [1968].17 Charles Péguy, Victor-Marie…, op. cit., p. 20. La quarantaine, telle que Péguy ladéfinit, acquiert un attrait particulier pour les générations suivantesd’écrivains. Jean Guéhenno, né en 1890, consacre par exemple tout un volumeà cet âge « où la probité [devient] de plus en plus difficile » (Journal d’unhomme de quarante ans, Paris, Grasset, 1934, 259 p., p. 16).18 Charles Péguy, L’Argent, op. cit., p. 1132.
10
Dreyfus, le ministère Combes, l’Affaire de la « Nouvelle
Sorbonne », etc.). Il y a ce relativisme une constante du
discours polémique, constamment mobilisée entre le second XIXe
siècle et les années 1940. Le procédé, mis en œuvre par les
satiristes à l’époque de l’affrontement entre romantiques et
réalistes, est immortalisé, dans le roman fin-de-siècle, par
les héros de Joris-Karl Huysmans ou de Jean Lorrain (Des
Esseintes, Fréneuse, Noronsoff), qui mêlent de façon grotesque
la jeunesse et la décrépitude, et diffusé par la tradition
pamphlétaire19. Les auteurs catholiques, pour lesquels la
jeunesse représente un état spirituel conforme à l’esprit
d’enfance prêché dans les Évangiles20, jouent particulièrement de
cette conception relativiste, qui leur permet de représenter
des personnages que le vice a vieilli. Georges Bernanos suit
ainsi les traces du Péguy d’Un nouveau théologien. Monsieur Naudet
lorsqu’en 1929 il peint une Jeanne d’Arc méjugée par les
docteurs ‒ des « vieillards, dont beaucoup n’ont pas dépassé la
19 Dans les Lettres satiriques et critiques d’Hippolyte Babou (Paris, Poulet-Malassiset de Broise, 1860, 386 p., p. 207), les disciples de Champfleury fontfigure de « vieux jeunes gens qui font depuis dix ans l’écolebuissonnière ». Ce type de caractérisation est porté par les pamphlets(qu’on songe au Coups de mèche d’un vieux jeune aux jeunes vieux, par Alexandre Weill,Paris, E. Dentu et chez l’auteur, 1889, 32 p.), au moins jusqu’à la fin dela IIIe République. Louis-Ferdinand Céline imagine la France futureentièrement peuplée de « vieillards », sous l’effet du système académique,qui transforme les jeunes gens en barbons, les condamnant au « gâtismemoral ou [au] commerce » (voir Céline, Bagatelles pour un massacre, Paris,Denoël, 1937, 379 p., p. 174 ; Les Beaux draps, Paris, Nouvelles ÉditionsFrançaises, 1941, 223 p., p. 178 et « L’art nous est hostile », interviewpar Georges Cazal (1958), in L’Argot est né de la haine !, proposé par RaphaëlSorin, notice biographique de Bernadette Dubois, Bruxelles, AndréVersailles éditeur, 2010, 93 p., p. 28).20 « Je vous le dis, en vérité, si vous ne changez et ne devenez comme lesenfants, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux » (Évangile selonsaint Matthieu, XVIII, 3).
11
trentaine21 ». L’originalité de Péguy tient au fait qu’il
revalorise la référence au vieillissement, si fréquemment
sollicitée par les auteurs clamant la décadence de la nation à
des fins polémiques, en soulignant la sagesse et la dignité des
« jeunes vieux ». L’Argent suite précise que si « l’homme de
quarante ans qui secoue l’homme de soixante-dix ans a l’air de
se rebeller contre son père », « [prendre] le parti de ses pères contre
son père » « est le programme et la dure destinée de notre
génération ». Péguy ajoute :
[…] c’est aussi ce qui nous justifie, et ce qui nous
authentique [sic], et ce qui nous fait rentrer dans la
nature, et dans l’ordre et la loi. C’est nous ainsi qui
sommes l’autorité la plus ancienne et la plus légitime, c’est
nous qui sommes la tradition, c’est nous qui sommes la
continuité, c’est nous qui sommes les pères, véritablement,
puisque c’est nous qui sommes la race, puisque c’est nous qui
sommes les grands-pères et les aïeux22.
Une double ligne
Si l’Affaire Dreyfus constitue, dans la trajectoire de
Péguy, une rupture mise en scène par l’auteur lui-même, il est
des déchirements moins tapageurs, quoique d’égale importance. La
crise qui mène à la conversion s’enracine ainsi dans les années
1902-1905, riches en bouleversements. Alors que les tensions
s’accroissent sur tous les fronts (la seule année 1905 est
troublée par la séparation des Églises et de l’État, les grandes21 Georges Bernanos, Jeanne, relapse et sainte, Essais et écrits de combat I, Essais et écrits decombat I, textes présentés et annotés par Yves Bridel, Jacques Chabot etJoseph Jurt sous la direction de Michel Estève, Paris, Gallimard,« Bibliothèque de la Pléiade », 1971, LI-1712 p., p. 22. 22 Péguy, L’Argent suite, op. cit., p. 1214.
12
grèves, la guerre russo-japonaise, la révolution russe, les
massacres arméno-tatars, la crise « marocaine » entre la France
et l’Allemagne, l’unification du socialisme dans la SFIO ‒
autant dire, pour Péguy, sa dégénération définitive ‒, le
rassemblement d’une partie des nationalistes dans la Ligue
d’Action Française), Péguy voit s’intensifier sa passion
impossible pour Blanche Raphaël. Il s’écarte de Jean Jaurès,
d’Anatole France, des camarades de la Ligue des Droits de
l’Homme et des Universités Populaires. Le parcours de Péguy est
jonché d’amitiés brisées. C’est que, de politique, l’amitié
revêt un sens mystique chez le penseur, sens qui s’affirme à
partir de 1905.
C’est sur les bancs de l’école que se nouent ses premiers
attachements. Péguy entre en primaire peu avant les lois laïques
de Jules Ferry, cette réforme qu’il accusera d’avoir enterré
l’ère républicaine. Passé au collège Sainte-Barbe, en 1893, il y
rencontre Marcel Baudoin, Joseph Lotte et les frères Tharaud.
L’année suivante, il intègre l’École Normale Supérieure. Le
Loiret, la grand-mère qui amenait les vaches à l’étang sont
désormais bien loin. Et, si ses sociabilités ne se limitent pas
aux normaliens de sa promotion, ce que Péguy nomme sa
« génération » se compose d’une élite intellectuelle ayant accès
aux études supérieures. Lui-même le souligne dans Un nouveau
théologien. Monsieur Laudet : lorsqu’il parle de « génération », «
([il] ne parle pas naturellement, [il] ne parle jamais des
pauvres gens), ([il] ne parle que des grands seigneurs de la
Politique et de l’Université […]23 ». La Revue Blanche, puis les
23 Péguy, Un nouveau théologien…, p. 110.13
Cahiers de la quinzaine offrent aux « amis » politiques de Péguy un
espace d’indépendance, contre les menaces des socialistes
« autoritaires ». Conçus comme un vivier générationnel au sens
large, les Cahiers soudent autour de leur gérant une communauté de
contributeurs et de lecteurs. Cela n’interdit évidemment pas les
fâcheries. Près d’une décennie après sa création, la revue se
trouve fragilisée lorsque Péguy tombe malade. Il sollicite alors
l’aide de la communauté qu’il a réunie sans promesse
d’« engagement » ni « aliénation » ‒ cette « société d’un mode
incontestablement nouveau, [cette] sorte de foyer, […] [cette]
sorte de famille d’esprits, sans l’avoir fait exprès,
justement ; nullement un groupe, comme ils disent ; cette
horreur ; mais littéralement ce qu’il y a jamais eu de plus beau
dans le monde : une amitié ; et une cité24 ».
Aux Cahiers, l’amitié qui unissait Charles Péguy et son
contemporain Daniel Halévy s’affermit : « On ne forme, on ne lie
d’amitiés de cette sorte qu’entre hommes du même âge, de la même
génération, de la même promotion25 ». Mais l’appartenance à une
même classe d’âge (Halévy est né en décembre 1872, Péguy en
janvier 1873) n’efface pas la différence sociale. Halévy est le
riche héritier d’une famille en vue dans le Paris mondain et
intellectuel depuis au moins trois générations ; Péguy, lui,
mythifie son ascendance populaire : fils d’un menuisier et d’une
rempailleuse, tôt orphelin de père, il s’enorgueillit d’avoir
élevé par une grand-mère « paysanne », ne sachant « pas
lire26 ». Péguy se plaît à rapporter l’interprétation
24 Péguy, « A nos amis, à nos abonnés », juin 1909, édition de la Pléiade,1988, t. II, XLI-1604 p., p. 1276. 25 Charles Péguy, Victor Marie…, op. cit., p. 16.
14
discordante qu’Halévy et lui donnent de l’Affaire Dreyfus à
cette altérité originelle, assez tangible pour provoquer une
brouille, mais pas une rupture définitive ; car, même si cela
les mène à la croisée des chemins, les deux amis continuent
d’avancer sur ce plateau des Yvelines qu’ils aiment tant :
« tout ce que nous avions de différence, d’écart entre nous »,
affirme Péguy, « donnait précisément, était précisément ce qui
donnait une valeur, peut-être unique, à cette perpétuelle
référence mutuelle […]27 ».
Sans jamais négliger cette définition horizontale de la
« génération », Péguy l’articule à une réflexion sur la
généalogie, qui en constitue la définition verticale. L’intérêt
que porte Péguy à la génération, sous la double forme de la
filiation et de la transmission, s’explique en outre par le fait
qu’il a grandi sans père. La disparition de son géniteur, mort
le 18 novembre 1873, hante d’autant plus Péguy qu’on l’a élevé
dans l’idée qu’il remplaçait un père dont le décès coïncide, à
dix mois près, avec sa propre naissance28. Dans une page
supprimée de Victor Marie, comte Hugo, Péguy, partant d’une
confession que lui aurait faite Halévy, dénonce un non-dit, un
secret, un défaut de « communication », une rupture qui creuse
le fossé entre les générations : les adultes dissimulent à ceux
qui les suivent que l’existence ne peut être heureuse. Le «
26 C’est à sa mémoire qu’écrivant sous le pseudonyme de Pierre Baudoin, ildédie La Chanson du roi Dagobert (1903).27 Charles Péguy, Victor Marie…, op. cit., p. 16-17.28 Sur cet aspect, voir Romain Vaissermann, « La mort du père chez Péguy,analyse d’un récit autobiographique », in Romain Vaissermann dir., CharlesPéguy, l’écrivain et le politique, Paris, Éditions de la Rue d’Ulm, 2003, 332p., p. 25-76. En ligne sur romain.vaissermann.free.fr/12/pere.htm#_ftn93.Consulté le 3 janvier 2014.
15
[c]omplot des pères et des mères, cette conspiration tacite,
jamais trahie » est pourtant la condition de l’Espérance,
puisque chaque génération croit de nouveau en un bonheur
possible. Ce constat dessine un nouveau point de rupture : non
seulement la solidarité des individus d’une même génération peut
être troublée par les inégalités sociales, mais la communication
intergénérationnelle a été rompue29 . Péguy choisit finalement
de ne pas conserver cette page, comme s’il superposait son
silence à celui des pères. C’est sur le devoir de transmission
intergénérationnelle, plus que sur les failles de ce dernier,
qu’il insistera. Non sans rappeler l’existence de « mauvais
maîtres » qui ont failli à leur tâche.
Parmi ces « mauvais maîtres », indignes de leur charge, les
historiens professionnels tiennent la première place, parce
qu’ils refusent d’intégrer à leur réflexion les données qui
contredisent l’écriture linéaire de l’Histoire. Malgré la
fascination qu’il continue d’exercer sur Péguy30 et une bonne
part des contemporains venus au monde autour de 1870, Ernest
Renan est tenu reponsable de l’entrée dans une modernité
« incurablement bourgeois[e] », asservie à « un dogme infiniment
plus autoritaire » que le dogme catholique qu’elle a chassé :
l’« histoire » et la « sociologie31 ». Double inversé de Péguy ‒
venu au christianisme dont Renan s’est écarté ‒, l’auteur de
29 Ces relations ont inspiré à Françoise Gerbod un schéma qui rend compte dela condition « tragique » de l’homme péguyste (Françoise Gerbod, Écriture ethistoire dans l’œuvre de Péguy, Lille, Atelier de reproduction des thèses del’université de Lille 3, 1981, 2 t., 914 p., p. 593). 30 Sur ce point, voir Simone Fraisse, « Péguy et Renan », Revue d’histoire littérairede la France, mars-juin 1973, n°2-3, p. 264 sq. 31 Charles Péguy, « De la situation faite à l’histoire et à la sociologiedans les temps modernes », 3e cahier de la 8e série, 4 novembre 1906,édition de la Pléiade, 1986, t. I, CXXXI-1934 p., p. 1028-1029.
16
L’Avenir de la science aurait ouvert la voie aux intellectuels
républicains qui mettent la discipline historique au service de
la constitution de leur propre autorité. Du fait même de ce
qu’il doit à Renan (il lui emprunte peut-être la distinction
entre « époque » et « période », si centrale dans Notre jeunesse),
Péguy semble vouloir remotiver les usages renaniens de la
« génération ». Usages hautement représentatifs, puisque Renan
est l’un des auteurs du second XIXe siècle français qui a le
plus volontiers recours au terme32.
Péguy affirme d’abord que la génération positiviste l’« a
immédiatement précéd[é]33 » ; pour donner une pleine efficacité
à son discours, il rapproche en fait de lui des individus qui
n’appartiennent pas à la même classe d’âge, créant une catégorie
homogène qui s’avère un pur artefact. À la génération de Renan,
né en 1823, succède sous sa plume celle d’Ernest Lavisse,
Ferdinand Brunetière, Gustave Lanson, Charles-Victor Langlois et
Charles Andler, nés respectivement en 1842, 1849, 1857, 1863 et
186634. Or, si sept petites années séparent de Péguy le cadet
des universitaires incriminés, Renan et Lavisse appartiennent à
la génération de son grand-père et de son père. Péguy précise :
je ne dis pas [qu’Andler et Langlois] étaient de notre
génération. Ils étaient dans notre génération, en ce sens que
32 La recherche, certes partielle, des occurrences de « génération » sur labase Frantext (98 occurrences dans seulement cinq titres : la Vie de Jésus,Marc Aurèle et la fin du monde antique, Souvenirs d’enfance et de jeunesse, Dramesphilosophiques, L’Avenir de la science) place Renan en tête, devant Michelet etHugo. 33 Charles Péguy, « De la situation faite à l’histoire et à la sociologiedans les temps modernes », op. cit., p. 1014. 34 Ce qui ne l’empêche pas, dans L’Argent suite (op. cit., p. 1179), de prétendreque Brunetière a formé la génération de Lanson !
17
[sic] ils étaient juste assez au-dessus de notre génération
pour agir immédiatement dans notre génération35.
C’est leur empreinte qu’on détermine, leur ascendant qu’on
évalue. Or ces derniers se manifestent hors de toute
transmission véritable :
Ce que cette génération précédente avait reçu de sa
précédente, elle ne (nous) l’a point transmis, elle ne l’a
point traduit. Et ce que nous la génération suivante nous
transmettons déjà à la génération suivante, à la génération
qui nous suit, nous ne l’avons point reçu36.
Ces professeurs sont bien de mauvais maîtres, au plein sens du
terme. Dans le texte qui deviendra L’Argent suite, Péguy éreinte
Gustave Lanson, incarnation à ses yeux des intellectuels
arrivistes qui méprisent les lois de la génération :
Il faut croire qu’il y a des hommes pour qui les âges
n’existent pas, qui n’entendent pas couler le temps, succéder
le jour, et pour qui ces nobles reposoirs d’une longue
existence ne sont jamais que les marches d’un escalier37.
L’histoire littéraire que Lanson contribuera à imposer à
l’Université ne peut, de ce point de vue, prétendre être
historique car elle est obstinément linéaire, et arase les
obstacles : « l’événement [y a] les deux bras attachés le long
du corps et les jambes en long et les deux poignets bien liés et
les deux chevilles bien ligotées38 ». Ainsi, l’histoire35 Charles Péguy, L’Argent suite, op. cit., p. 1171.36 Charles Péguy, Un nouveau théologien…, op. cit., p. 110.37 Charles Péguy, L’Argent suite, op. cit., p. 1176.
18
lansonienne aurait dû buter contre Corneille, qui rompt la
linéarité comme Péguy écrivain espère la rompre. Corneille se
dérobe en effet à l’interprétation méthodique ; il requiert un
autre type d’expérience ; une lecture intégrale, terre à terre,
primaire, pourrait-on dire en jouant sur les mots.
Mais ramener les usages péguystes de la génération à une
volonté de resémantisation ne suffit pas. On ne peut évidemment
ignorer les résonances religieuses du terme, exploitées par
Joseph de Maistre, Lamennais, et bien des écrivains catholiques
fin-de-siècle tels que Léon Bloy. Or c’est surtout après sa
conversion, du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (1910) à Ève (1913) -
cet hymne à la mère des générations -, de Clio (1909) à L’Argent
(1913), que Péguy a de plus en plus fréquemment recours au
lexique de la génération. Tourmenté par la réflexion sur ses
origines, mythifiait-il sa propre création jusqu’à se rêver
divin enfant, lui le fils d’un menuisier et d’une humble
femme39 ? Reste que le dénombrement biblique des générations
sert de matrice à un passage de Victor Marie comte Hugo, faussement
motivé par le commentaire de « Booz endormi » ‒ poème qui
déploie d’ailleurs une conception relativiste de l’âge40 .
Dans ces pages apparemment apparemment dédiées à Hugo sont
en fait confrontées les généalogies de Jésus que détaillent, au
38 Ibid., p. 1177. 39 C’est ce que suggère André Mabille de Poncheville dans sa Vie de Péguy,Paris, Bonne presse, 1943, 236 p., p. 9 : « Charles Péguy vient au mondele lendemain du Jour des Rois, sous l’égide de l’épiphanie. Qui sont cesparents ? Un menuisier, une rempailleuse de chaises ».40 « Le vieillard qui revient vers la source première, / Entre aux jourséternels et sort des jours changeants ; / Et l’on voit de la flamme auxyeux des jeunes gens, / Mais dans l’œil du vieillard on voit de lalumière » (Victor Hugo, « Booz endormi », La Légende des siècles, première série,Paris, Hachette, 1862, 395 p., p. 26, v. 21-24).
19
sein du Nouveau Testament, saint Matthieu et saint Luc. Le Livre
de la génération de Jésus-Christ ‒ qui ouvre le premier des Évangiles ‒,
comme le chapitre trois de l’Évangile de Luc articulent
l’histoire charnelle et l’histoire spirituelle. Matthieu retrace
l’ascendance humaine du Christ sur quatorze générations, en
partant d’Abraham. Luc procède autrement : du Christ, il remonte
jusqu’à Adam, en soixante-dix-sept générations. Ces deux récits
affirment certes qu’à n’importe quelle époque, l’individu est
immédiatement lié à l’origine ‒ au Christ, à Adam, à Dieu. Mais
chaque version a une finalité propre. Partant de « Jésus âgé »,
Luc réalise ce que Péguy nomme « une extraction », « une
remontée verticale » jusqu’à l’origine. Il ne hiérarchise pas
les acteurs, qui s’effacent tandis qu’est valorisé le processus
de filiation. Confrontant ce modèle au précédent, Péguy note que
Luc « est plus pressé » que Matthieu, qui cite deux fois les
acteurs, comme père et comme fils. Au contraire, « la génération
de Matthieu est comme posée. […] D’une pesanteur matérielle,
d’une pesanteur charnelle. D’une pesanteur naturelle. Elle est
historique. Elle suit le fil de l’événement, le sens de
l’événement, le fil de la race ». Et c’est bien cette durée que
valorise Péguy, qui peint saint Matthieu en « honnête »
« paysan ». La préférence de Péguy ne va donc pas à la version
de Luc, où le Christ éclaire rétrospectivement tout ce qui l’a
précédé, où le Nouveau Testament explique l’Ancien, mais à celle
de Matthieu, dont il retient moins le respect de la chronologie
qu’un déclassement, une commutation : Matthieu « prend non point
la généalogie mais la génération même de Jésus pour ainsi dire
par le pied », liant le Christ à Abraham, « deuxième Adam », non
20
plus « chassé » mais « élu » par Dieu. Même si aucun des
évangélistes ne cache que l’ascendance de Jésus-Christ est
marquée par des « crimes de chair », c’est là relativiser la
Faute, mais surtout signifier que l’élection définitive a pris
du temps (Caïn, Noé n’en étaient pas dignes), comme a pris du
temps l’avènement du Sauveur. L’événément n’acquiert tout son
sens qu’à la lumière de cette maturation.
Le processus d’« extraction41 » que Péguy relève dans
l’Evangile de Matthieu, il l’évoque encore dans les textes où il
revient sur sa propre expérience de père :
Un homme est de son extraction, un homme est de ce qu’il est.
[...] Le père n’est pas de lui-même, il est de son
extraction ; et ce sont ses enfants peut-être qui seront de
lui42.
L’autoritarisme parental n’est pas de mise, car la
transmission s’opère d’une autre manière : songeant à Marcel et
Pierre, ses deux garçons, Péguy regrette que les pères veuillent
invariablement « faire compter [leur] compte aussi pour [leurs]
enfants, pour les générations suivantes » ‒
un compte qui ne devrait pas même nous servir à nous-mêmes,
qui ne devrait même pas compter pour nous-mêmes, si nous
savions vieillir, si nous consentions à vieillir. […] On croit
que c’est de l’amour et de la paternité, on croit que c’est de
l’amour paternel que de vouloir, que de leur [sic] faire que
leur vie soit la prolongation de la nôtre. Que notre
41 Charles Péguy, Victor Marie…, op. cit., p. 105-108.42 Charles Péguy, L’Argent, p. 1122. Voir aussi Guy Lecomte, « Charles Péguy,départ dans la paternité et départ dans l’action socialiste », Feuillets del’Amitié Charles Péguy, n° 209, avril 1976, p. 19-23.
21
installation compte pour eux. Serve pour eux. Que notre compte
compte pour eux. Laissons nos enfants s’installer pour eux,
compter pour eux, commencer pour eux. […]. Laissons-les faire
leurs comptes, qui nous chassent43.
Si Péguy colore la rhétorique générationnelle, il ne se
contente pas de remotiver des usages antérieurs. Il étaye ainsi
son refus de la linéarité chronologique par une critique du
positivisime universitaire et des dérives du dreyfusisme. Pour
rendre à l’Histoire son épaisseur – et ainsi l’incarner ‒, Péguy
replace l’événement au cœur d’un feuilletage temporel où
l’acception verticale de la génération et son acception
horizontale s’articulent, liant le public et le privé. Dans
cette entreprise, l’homme se donne pleinement à voir : car cette
philosophie du temps que Péguy bâtit sur le souvenir d’un père
disparu ou l’évocation de différends amicaux est aussi une
philosophie de l’expérience dont l’originalité mérite plus que
jamais d’être signalée.
43 Charles Péguy, Victor Marie…, op. cit., p. 147.22