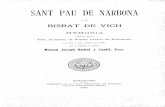« Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres...
Transcript of « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres...
1
Baudelaire et la prostitution « fraternitaire » À propos de La Solitude
Andrea Schellino [Paris-Sorbonne]
(paru dans Méthode ! Revue de littérature [Université de Pau], sous la direction de Caroline Fischer et de Dominique
Vaugeois, no 24, automne 2014, p. 183-194)
La Solitude est au cœur de l’édition de 1869 des Petits poèmes en prose, juste avant Les Projets et après Le
Crépuscule du soir. Le poème occupe le vingt-troisième rang dans la liste dressée par Baudelaire. Sa genèse éditoriale, ses réécritures et sa nature de projet littéraire in fieri en font un cas particulier dans le traitement du poème en prose par Baudelaire. Publié quatre fois en volume et en revue du vivant du poète, il est, avec Le Crépuscule du soir, Les Projets et Les Bons Chiens, le poème en prose le plus édité et le plus remanié. Nous disposons en outre de trois épreuves du texte, dont deux corrigées par Baudelaire : une épreuve de la première version pour Fontainebleau, laquelle, selon Claude Pichois, ne fut pas transmise à l’imprimeur1 ; une épreuve d’octobre 1862 non corrigée et restée inédite, en vue d’une quatrième livraison de Petits poëmes en prose destiné au journal dirigé par Arsène Houssaye, La Presse ; une épreuve corrigée de novembre ou décembre 1864 du texte qui fut publié dans la nouvelle Revue de Paris. Au total, donc, huit versions qui présentent de nombreuses différences et qui poussent les éditeurs à s’interroger sur le statut du texte publié en 1869, et dont Baudelaire n’a pas contrôlé l’édition2. Robert Kopp envisage deux branches dans la généalogie du texte, la seconde correspondant au tournant éditorial de 18623. Le concept de « variante » ne suffit pas en effet à décrire le déroulement de la composition du poème. Si parfois les corrections de Baudelaire sont attribuables aux procédés de révision et d’écriture qui lui sont propres, le texte du poème évolue aussi au gré du contexte éditorial. Il s’adapte à sa finalité et reflète, en même temps, tout au long d’une dizaine d’années, l’évolution de la conception baudelairienne du « poème en prose ».
La première version connue de La Solitude précède de deux ans la publication des Fleurs du Mal en
juin 1857. Avec Le Crépuscule du soir, La Solitude est le premier poème en prose publié par Baudelaire, en juin 1855. Baudelaire avait répondu à l’appel de Fernand Desnoyers de rendre hommage à Claude-François Denecourt, vétéran de l’armée napoléonienne amoureux de la forêt de Fontainebleau et auteur de célèbres guides. Desnoyers avait sollicité d’importants écrivains de l’époque, dont Banville, Béranger, Champfleury, Gautier, Hugo, Lamartine, Musset, Nerval ou George Sand, pour constituer ce volume portant un titre : Fontainebleau, un surtitre : Hommage à C.F. Denecourt, et un sous-titre : Paysages – Légendes – Souvenirs – Fantaisies.
Entre la fin de 1853 et le début de 1854 Baudelaire, peu sensible à la « religion nouvelle4 » de la nature, envoie à Desnoyers une lettre avec un petit ensemble de textes, comprenant deux poèmes en vers, sous le titre Les Deux Crépuscules : Le Soir, qui deviendra Le Crépuscule du soir, et Le Matin, qui deviendra Le Crépuscule du matin, auxquels il ajoute, en prose, Le Crépuscule du soir et La Solitude. La lettre à Desnoyers, imprimée en tête de ces quatre textes, n’est pas dépourvue d’intention polémique et provocatrice, ironisant sur le culte de la nature et déclarant la foi du poète dans l’espace poétique de la grande ville et la fécondité de la rêverie urbaine : « Dans le fond des bois, enfermé sous ces voûtes semblables à celle des sacristies et des cathédrales, je pense à nos étonnantes villes, et la prodigieuse musique qui roule sur les sommets me semble la traduction des lamentations humaines5. » Le mot nature n’apparaît ni dans Le Crépuscule du soir ni dans Le Crépuscule du matin, qui illustrent deux moments de
1 Charles Baudelaire, Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1975, p. 1328.
2 Nous donnons en annexe le texte de ces huit versions. 3 Ch. Baudelaire, Petits Poèmes en prose, édition critique par Robert Kopp, Paris, José Corti, 1969, p. 67. 4 Ch. Baudelaire, Correspondance, texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois avec la collaboration de Jean Ziegler,
Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1973, p. 248. 5 Ibid.
2
cette poésie de Paris, et détournent un lieu commun du romantisme : le « crépuscule ». Ces deux poèmes n’étaient pas inédits, puisque Baudelaire les avait déjà publiés dans la Semaine théâtrale du 1er février 1852, et leur composition est probablement plus ancienne6.
Aux Deux Crépuscules s’ajoutent donc deux poèmes en prose qui, dans leur premier état, sont étroitement reliés : Le Crépuscule du soir et La Solitude. La mention « poèmes en prose » n’apparaît pas dans l’envoi à Desnoyers. Elle n’est d’ailleurs pas encore apparue sous la plume de Baudelaire à cette date. Les deux textes forment un ensemble, le second prolongeant le premier par l’opposition que Baudelaire établit entre ses « deux amis » et lui. Dans Le Crépuscule du soir la tombée de la nuit est pour le poète une « fête intérieure », une lumière intime ; au contraire, le soir déclenche chez ses deux amis une « manie crépusculaire », une maladie mystérieuse qui bouleverse les règles : « L’ombre qui fait la lumière dans mon esprit fait la nuit dans le leur7. » Cette constatation permet à Baudelaire une généralisation des causes susceptibles d’engendrer « deux effets contraires8 » sur des personnes différentes, affirmation qui prépare la transition vers La Solitude. C’est ainsi que le second poème s’ouvre ex abrupto par la condamnation de la solitude par le second ami, lequel est en proie à une « insatisfaction perpétuelle9 ». Baudelaire montre ainsi l’effet bénéfique de la solitude sur l’homme actif. À l’appui de sa thèse, et en opposition aux « paroles des Pères de l’Église », il invoque Robinson Crusoé et La Bruyère. Ce trajet de la pensée le conduit à assimiler « crépuscule » et « solitude », et à énoncer la réversibilité de leurs effets sur le tempérament de l’individu : « Il en serait donc de la solitude comme du crépuscule ; elle est bonne et elle est mauvaise, criminelle et salutaire, incendiaire et calmante, selon qu’on en use, et selon qu’on a usé de la vie. » Quant au paragraphe conclusif, qui peut apparaître comme une concession à Desnoyers dans le goût de Jean-Jacques, il prépare la relation paradoxale et convertible qui sera développée plus tard, notamment dans Les Foules, entre la jouissance de la solitude et le plaisir du « bain de multitude10 ».
Recevant l’épreuve corrigée par Baudelaire, l’imprimeur du volume de 1855 a respecté la correction des conjonctions au troisième paragraphe : « elle est bonne et elle est mauvaise, criminelle ou [corrigé en et] salutaire, incendiaire ou [corrigé en et] calmante », mais il n’a pas corrigé « Quant à la jouissance » en « Quant à la question de jouissance », qui sera la forme adoptée dans l’édition de 1857. Dans la même version de 1857, Baudelaire revient du reste à la conjonction ou, simplifiant la première partie de la phrase : « elle est bonne ou mauvaise, criminelle ou salutaire, incendiaire ou calmante ».
On connaît l’importance de Gaspard de la Nuit dans la genèse du Spleen de Paris. Baudelaire y fait
allusion à trois reprises : Poèmes nocturnes (essais de poésie lyrique en prose, dans le genre de Gaspard de la Nuit)11. [Lettre à Armand du Mesnil, 9 février 1861.]
Mon point de départ a été Gaspard de la Nuit d’Aloysius Bertrand, que vous connaissez sans aucun doute ; mais j’ai bien vite senti que je ne pouvais pas persévérer dans ce pastiche et que l’œuvre était inimitable. Je me suis résigné à être moi-même12. [Lettre à Arsène Houssaye, 25 décembre 1861.]
C’est en feuilletant, pour la vingtième fois au moins, le fameux Gaspard de la Nuit, d’Aloysius Bertrand (un livre connu de vous, de moi et de quelques-uns de nos amis, n’a-t-il pas tous les droits à être appelé fameux ?) que l’idée m’est venue de tenter quelque chose d’analogue, et d’appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d’une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu’il avait appliqué à la peinture
6 Selon Ernest Prarond, Le Crépuscule du matin serait antérieur à la fin de 1843. Baudelaire a envoyé entre septembre 1851
et le début de janvier 1852 les deux pièces (dans une série de Douze poèmes) à Gautier pour la Revue de Paris, qui ne les inséra pas (Claude Pichois, Baudelaire. Études et témoignages, Neuchâtel, À la Baconnière, 1967 ; nouvelle édition revue et augmentée, 1976, p. 25. Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, éd. cit., p. 1024, 1043-1044).
7 Hommage à C.F. Denecourt. Fontainebleau. Paysages – Légendes – Souvenirs – Fantaisies, Paris, Hachette, 1855, p. 78-79. 8 Ibid., p. 79. 9 Ibid., p. 78. 10 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, éd. cit., t. I, p. 291. 11 Ch. Baudelaire, Correspondance, éd. cit., t. II., p. 128. 12 Ibid., p. 208.
3
de la vie ancienne, si étrangement pittoresque13. [Lettre-dédicace « À Arsène Houssaye », La Presse, 26 août 1862.]
Les premières tentatives de Baudelaire, en 1855, témoignent d’une poétique et d’une méthode qui
semblent déjà bien distinctes des fantaisies gothiques de Bertrand. Baudelaire admet d’ailleurs qu’il s’est vite résigné à abandonner son « mystérieux et brillant modèle ». Des traces de « pastiche » de Gaspard de la Nuit restent cependant perceptibles. Le premier titre des poèmes en prose, Poèmes nocturnes, à la tête du petit ensemble publié le 24 août 185714, est un hommage aux Contes nocturnes de Hoffmann, mais aussi à Bertrand, dont l’œuvre entière baigne dans une atmosphère nocturne. Même si Le Spleen de Paris représente l’expression accomplie de la modernité baudelairienne, celle-ci garde un reflet du romantisme fantastique, comme si le poète avait voulu préserver une continuité entre les fantasmagories surnaturelles et sa représentation de Paris : des Poèmes nocturnes à la manière de Bertrand, de Hoffmann ou de Nodier, en passant par le titre Petits poèmes lycanthropes en juin 1866, qui fait allusion à Pétrus Borel. Les deux poèmes en prose publiés en 1855 puisent dans la folie lunaire, dans le satanisme et dans les stratégies de dédoublement de Gaspard de la Nuit. Leur disposition typographique, à travers des blanchissements entre les paragraphes qui découpent les textes, rappelle les suites de « couplets ou de versets » dont Jean-Luc Steinmetz parle à propos de l’ouvrage de Bertrand15. Cette organisation textuelle, qui propose une sorte de mimétisme du poème en vers et de sa division en strophes, sera abandonnée dans les livraisons de La Presse, en août et septembre 1862.
Une intertextualité précise intervient au début de La Solitude. Baudelaire invoque l’avis du second ami qui, dans Le Crépuscule du soir, à mesure que le jour baisse, est atteint d’une « manie crépusculaire16 », redoutant la solitude et citant « des paroles des Pères de l’Église ». Baudelaire, qui y voit une empreinte satanique, précise : « Il est vrai que l’esprit de meurtre et de lubricité s’enflamme merveilleusement dans les solitudes ; le démon fréquente les lieux arides. » L’allusion aux « Pères de l’Église » est singulière, parce que la tradition patristique est plutôt hétérogène sur ce point, et Baudelaire connaissait probablement les exhortations de saint Augustin à se réfugier dans l’intériorité et la solitude : « Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiori homine habitas veritas17. » Or le troisième livre de Gaspard de la Nuit, « La Nuit et ses prestiges », s’ouvre sur une pièce cauchemardesque, « La Chambre gothique », où les figures et les profils de la chambre paraissent s’animer, à minuit, avant qu’un fantasque Scarbo se révèle, cautérisant sa blessure d’un « doigt de fer18 ». Bertrand fait précéder son texte d’une épigraphe qu’il a, de toute évidence, composée lui-même :
Nox et solitudo plenae sunt diabolo. Les Pères de l’église La nuit, ma chambre est pleine de diables19.
Le rapprochement entre ces deux mentions des « Pères de l’Église », chez Bertrand et chez
Baudelaire, est signalé dans l’édition de Jean-Luc Steinmetz20. La traduction française est éloignée de l’original latin, qui donnerait plutôt : « La nuit et la solitude
sont pleines du diable. » Baudelaire, trouvant le germe de ses deux poèmes en prose dans la séduisante invention de son devancier – nox et solitudo –, attribue l’avertissement à son interlocuteur, sans en nier le
13 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, éd. cit., t. I, p. 275. 14 Le même titre se trouve dans la lettre à Poulet-Malassis du 25 avril 1857 ; Correspondance, éd. cit., t. I, p. 395. 15 Les Spleen de Paris. Petits Poèmes en prose, édition présentée, établie et annotée par Jean-Luc Steinmetz, Paris, Le Livre de
Poche, 2003, p. 22. 16 Hommage à C.F. Denecourt. Fontainebleau […], op. cit., p. 78. 17 De vera religione, XXXIX, 72. 18 Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot, édition établie sur le manuscrit
original, publiée selon les vœux de l’auteur, présentée et annotée par Jacques Bony, Paris, Flammarion, 2005, p. 185. 19 Ibid., p. 184. 20 Les Spleen de Paris. Petits Poèmes en prose, éd. cit., p. 184.
4
danger implicite : meurtre et lubricité peuvent se nourrir dans la solitude, par l’entremise du démon. Mais le deuxième paragraphe, s’ouvrant à une proposition adversative, éloigne la tentation d’une solitude propice à l’envoûtement diabolique.
Jean Pommier a rapproché ces considérations d’une épigramme de l’Histoire des flagellants de Boileau, où le mot lubricité apparaît21. Il faut les rapprocher aussi de la contribution, dans le même volume d’hommage à Denecourt, d’Hippolyte Castille, intitulée Sur la solitude, où l’on peut lire : « quiconque ne sait pas dompter le mauvais esprit de la solitude, les bois voudront toujours dire : assassinat, viol ou suicide22 ». Mais pour Castille l’alternative à ce péril n’est pas la jouissance du « Solitaire » – même si celui-ci est encore ravi par un simple « paysage », dans la première version du texte de Baudelaire. Elle est la satisfaction des « âmes robustes et saines », pour lesquelles « les grands aspects de la nature sont un perpétuel memento qui ramène l’homme au profond, au social sentiment de l’égalité23 ». Sept ans plus tard, l’appel aux « plus belles agapes fraternelles » deviendra une féroce ironie contre la prostitution « fraternitaire ».
Ces deux poèmes en prose, Le Crépuscule du soir et La Solitude, restent jumelés dans les deux
publications suivantes de poèmes en prose par Baudelaire, dans le Présent, le 24 août 1857, et dans la Revue fantaisiste, le 1er novembre 1861. Dans ces deux éditions le corpus des textes s’enrichit :
1855 Hommage à C.-F. Denecourt [Sans titre collectif] Le Crépuscule du soir La Solitude 24 août 1857 Le Présent « Poëmes nocturnes » Le Crépuscule du soir La Solitude Les Projets L’Horloge La Chevelure L’Invitation au voyage 1er novembre 1861 Revue fantaisiste « Poëmes en prose » I. Le Crépuscule du soir II. La Solitude III. Les Projets IV. L’Horloge V. La Chevelure VI. L’Invitation au voyage VII. Les Foules VIII. Les Veuves IX. Le Vieux Saltimbanque
Dans l’édition des Petits poèmes en prose, les trois poèmes en prose Le Crépuscule du soir, La Solitude et
Les Projets conserveront cette même disposition, mais au centre du recueil.
21 Jean Pommier, Dans les chemins de Baudelaire, Paris, José Corti, [1945], p. 169. Suggestion reprise par Robert Kopp dans
son édition critique du Spleen de Paris (éd. cit., p. 274). 22 Hommage à C.F. Denecourt. Fontainebleau […], op. cit., p. 88. Voir Jean Borie, Une forêt pour les dimanches. Les romantiques à
Fontainebleau, Paris, Bernard Grasset, coll. G.F., 2003, p. 167-172. 23 Ibid., p. 89.
5
Les trois premières versions publiées de La Solitude présentent plusieurs variantes. Le texte de 1857 intègre notamment la variante de l’épreuve de 1855 que nous venons de signaler : « Quant à la question de jouissance ». Concernant le texte de 1861, les modifications sont plus nombreuses et visent à une simplification de la ponctuation originelle (suppression de tirets et d’un point-virgule). La capitale de « Solitaire » disparaît. La révision la plus importante, au deuxième paragraphe, introduit une ambivalence au moment où Baudelaire propose un écart entre la solitude sensible aux attraits diaboliques et une solitude positive, celle de la volonté : « qui ne sont pas gouvernées par une importante pensée active » devient « , qu’une idée despotique ne tient pas en lisière ». Mais ce n’est qu’un choix provisoire : en 1862 Baudelaire fait économie de la litote, met au conditionnel la première partie de la phrase et développe la séduction de la solitude et de ses risques : « Mais il serait possible que cette solitude ne fût dangereuse que pour ceux dont l’âme oisive et divagante la peuple de leurs passions et de leurs chimères. »
Le texte resté inédit de l’épreuve d’octobre 1862 est un tournant décisif dans la genèse de ce poème,
en accord avec la nouvelle configuration du projet de publier des poèmes en prose tel qu’il apparaît dans les trois livraisons de La Presse et dans la correspondance de Baudelaire à cette époque. Le poète, qui prévoit désormais un véritable ouvrage, a multiplié les plans et les titres du recueil, en les communiquant au directeur de L’Artiste et de La Presse, Arsène Houssaye, les 20 et 25 décembre 1861 (La Lueur et la Fumée, Le Promeneur solitaire, Le Rôdeur parisien). Il choisira finalement Petits poèmes en prose et fera précéder la première livraison (parue le 26 août 1862) d’une préface-dédicace à Arsène Houssaye. Les vingt poèmes en prose, publiés en trois tranches, numérotés, s’ouvrent sur un texte inédit, L’Étranger. Le quatrième feuilleton, comprenant six poèmes dont Le Crépuscule du soir et La Solitude, fut refusé et resta à l’état d’épreuve. Les deux textes, malgré leur contiguïté, deviennent pleinement indépendants. Baudelaire projette un ouvrage qui n’aurait « ni queue ni tête », un « serpent » librement découpé selon les humeurs du lecteur : « Enlevez une vertèbre, et les deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en nombreux fragments, et vous verrez que chacun peut exister à part24. »
Le travail accompli avec Le Crépuscule du soir et La Solitude est peut-être la meilleure application de ce projet. La nouvelle version de La Solitude sera publiée, avec des variantes, le 25 décembre 1864 dans la Revue de Paris, précédée cette fois du Miroir et donc entièrement émancipée du Crépuscule du soir. Déjà dans le quatrième ensemble des Petits poëmes en prose pour La Presse resté inédit, d’ailleurs, La Solitude est précédée des Projets. La version de 1864, dont il existe une épreuve corrigée par le poète, est presque équivalente à celle qui figurera dans l’édition posthume de 1869. Le remaniement de l’épreuve de 1864 pour la Revue de Paris a été étudié par Jacques Crépet25, qui rappelle notamment la lettre du 3 novembre 1864 à Henry de La Madelène, nouveau directeur de la Revue de Paris, auquel Baudelaire propose de remettre ses « élucubrations » du Spleen de Paris. Comme il résulte de deux billets de La Madelène, qui avait accepté la proposition avec enthousiasme (« envoyez-nous le plus que vous pourrez et le plus tôt possible »), le poète dut insister pour avoir un jeu d’épreuves26. Selon Crépet l’écart entre la première lettre de Baudelaire, le 3 novembre, et la publication des six poèmes, le 25 décembre, est dû à son insistance pour avoir une, voire plusieurs épreuves.
Le texte d’octobre 1862 oriente le poème vers une signification plus polémique et plus ironique. Le cible est la société et ses idoles. Le « second ami » devient un « grand politique de gazette » – en décembre 1864, il deviendra un « gazetier philanthrope » –, rappelant les attaques du dernier Baudelaire contre la presse progressiste de son temps et contre Le Siècle.
La seconde partie du poème est développée et prend un sens plus engagé. Claude Pichois a identifié l’allusion aux « tambours de Santerre », brasseur devenu commandant de la Garde nationale, célèbre
24 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, éd. cit., t. I, p. 275. 25 Jacques Crépet, « Documents baudelairiens. Une version inconnue de La Solitude. Une lettre inédite de Baudelaire »,
Mercure de France, no 977, 1er mars 1939, p. 460-465 ; repris dans Propos sur Baudelaire, rassemblés et annotés par Claude Pichois, préface de Jean Pommier, Paris, Mercure de France, 1957, p. 136-139.
26 Lettres à Baudelaire, publiées par Claude Pichois avec la collaboration de Vincenette Pichois, Neuchâtel, À la Baconnière, coll. Langages, 1973, p. 204-206. Les lettres de Baudelaire n’ont pas été retrouvées.
6
pour avoir fait couvrir d’un roulement de tambours la voix de Louis XVI devant la guillotine. Baudelaire aurait taquiné la verbosité de Philoxène Boyer, en lui disant, selon Charles Asselineau : « “Philoxène, à la prochaine révolution, vous monterez sur l’échafaud. – Oui, mais aussi je parlerai, dit Philoxène en extase. – Non ! on ne vous laissera pas parler. Il y aura les tambours de Santerre.” Et Philoxène baissait la tête d’un air atterré27. » Le gazetier, sorte d’antagoniste du narrateur, revient un peu plus loin s’insinuer dans les jouissances du solitaire. Assimilé à un missionnaire de la société – d’où son « nez très apostolique » dans la version de 1864 –, avec ses convoitises indiscrètes, il passe pour un « subtil égoïste » (sur les épreuves de 1862, devenu un « subtil envieux » sur les épreuves de 1864) et un « insidieux usurpateur » (sur les épreuves de 1862, devenu un « hideux trouble-fête » sur les épreuves de 1864). Dans la version de 1864, Baudelaire supprime aussi un emprunt à l’anglais, le mot speech – attesté dès 1829 et utilisé souvent dans un contexte railleur –, pour lui préférer un vieux mot français, « harangue ».
Il faut aussi remarquer une curieuse note de bas de page, consacrée à La Bruyère, dans l’avant-dernier paragraphe, ajoutée à l’occasion de la publication dans la Revue de Paris en décembre 1864, et absente de l’édition posthume de 1869. Baudelaire, alors établi à Bruxelles, fait allusion à la supposée haine des Belges pour la littérature : « Auteur français, très-méprisé en Belgique. » Un fragment semblable, également laconique, apparaît sur un feuillet de La Belgique déshabillée : « Haine de la Belgique contre toute littérature, et surtout contre La Bruyère28. » La présence de La Bruyère est un indice important car, comme le signale Jacques Crépet29, cette citation tirée des Caractères (« De l’homme ») est l’épigraphe de L’Homme des foules de Poe, récit traduit par Baudelaire et publié le 27 janvier 1855 dans Le Pays, à l’époque de la première rédaction du poème en prose. La Bruyère est défini comme un « pur moraliste pittoresque30 » dans un passage du Peintre de la vie moderne.
Mais c’est la conclusion du poème, entièrement inédite à l’exception de la citation de La Bruyère, qui
pose les principales questions herméneutiques. Les stigmates de la différence baudelairienne, ce sceau qui éloigne le poète de « tous les êtres qui ont consenti à leur finitude31 », comme l’écrit Yves Bonnefoy, se révèlent d’une façon inattendue : cette conclusion entre dans une résonnance ambiguë avec les thèses de Baudelaire sur les habitudes du poète-flâneur, telles qu’elles sont décrites dans Le Peintre de la vie moderne. Baudelaire, qui suit l’avis de La Bruyère sur la solitude, blâme « ceux qui courent s’oublier dans la foule ». En l’occurrence, le propos, tiré des Pensées de Pascal, renforce cette idée et la joint à la méditation baudelairienne sur le « mouvement », sur la « prostitution », condamnée et définie comme « fraternitaire ». La position originale du poète face aux jouissances que la foule peut fournir est bien connue32. Le « flot mouvant des multitudes33 » n’est pas seulement un élément de l’ivresse inspirée par le nombre dans l’espace de la ville ; il est aussi une condition de la conscience du nouveau moi poétique dans le tourbillon de l’existence moderne.
La morale de La Solitude, avec ses échos ironiques, s’oppose à plusieurs égards à la théorie exposée dans un autre poème en prose, Les Foules, publié la première fois dans la Revue fantaisiste le 1er novembre 1861. Dans Les Foules, Baudelaire fait état de ses intuitions sur la passion orgiaque de l’ « universelle
27 Baudelaire et Asselineau, textes recueillis et commentés par Jacques Crépet et Claude Pichois, Paris, Nizet, 1953, p. 194.
(Voir aussi Petits Poèmes en prose, édition critique par Robert Kopp, éd. cit., p. 275 et Œuvres complètes, éd. cit., t. I, p. 1330). 28 Ch. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, suivi de Amœnitates Belgicae, édition d’André Guyaux,
Paris, Gallimard, coll. Folio, 1986, p. 203. 29 Œuvres complètes de Charles Baudelaire, t. IV : Petits Poëmes en prose (Le Spleen de Paris). Le Jeune Enchanteur, notice, notes et
éclaircissements de M. Jacques Crépet, Paris, Louis Conard, 1926, p. 306. 30 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, éd. cit., t. II, p. 691. Steven Monte s’est penché sur le caractère polyphonique de La
Solitude, où plusieurs voix « seem to be engaged in a debate over the advantages and disadvantages of solitude » (Steven Monte, Invisible Fences. Prose Poetry as a Genre in French and American Literature, Lincoln, University of Nebraska Press, 2000, p. 80-84).
31 Yves Bonnefoy, Le Poète et « le flot mouvant des multitudes ». Paris pour Nerval et pour Baudelaire, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2003, p. 93.
32 Elle a été étudiée, notamment, par Walter Benjamin (Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, traduit de l’allemand et préfacé par Jean Lacoste d’après l’édition originale établie par Rolf Tiedemann, Paris, Payot, 2002) et par Yves Bonnefoy (Le Poète et « le flot mouvant des multitudes ». Paris pour Nerval et pour Baudelaire, op. cit.).
33 Dédicace des Paradis artificiels à J.G.F. (Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, éd. cit., t. I, p. 400).
7
communion » au sein de la multitude, sur les jouissances du flâneur plongé dans la foule. C’est la même ivresse que le poète décrit dans Le Peintre de la vie moderne à propos de Constantin Guys, censé élire « domicile dans le nombre » et « épouser la foule »34. Celui qui sait à loisir se perdre dans la vie ondoyante de la ville est, selon Baudelaire, le seul être capable d’accroître sans limites sa propre conscience, comme un kaléidoscope. Des considérations semblables, alimentées par les théories de Poe et de Maistre, se retrouvent dans les « Tableaux parisiens » des Fleurs du Mal, dans Les Paradis artificiels et dans ses derniers fragments autobiographiques35. Dans Les Foules, le poète théorise la convertibilité et la consonance des jouissances dans la multitude et dans la solitude : « qui ne sait pas peupler sa solitude ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée36 ». Le vrai poète maîtrise cet art, puisque « tout est vacant37 » à sa guise, et le promeneur solitaire de Rousseau se métamorphose en un rôdeur fiévreux et passionné. Cet art suprême du nombre est universel. Un fragment de Mon cœur mis à nu le rappelle : « Tout est nombre. Le nombre est dans tout. Le nombre est dans l’individu. L’ivresse est un nombre38 ».
Baudelaire assimile cette dynamique à une « ineffable orgie », à une « sainte prostitution de l’âme »39. Il ne veut pas simplement la créditer d’une charge érotique, il veut l’ancrer dans la métaphysique ou dans une théologie de la prostitution qu’il ébauche dans plusieurs fragments autobiographiques. Cette « sainte prostitution » est bien différente de la prostitution « fraternitaire » de La Solitude. La seule forme de prostitution légitime est selon lui celle qui se forme dans la tension avec les agapes du solitaire : la jouissance est la même, sans cesse réversible et à réinventer, « poésie et charité40 ». La duplicité est au cœur de cette forme de prostitution. Elle est l’une des incarnations de la théorie de la dualité, que Baudelaire dissémine dans les fragments de Mon cœur mis à nu et de Fusées. Cette constante postulation duelle n’est pas un champ d’oppositions irréductibles, mais une échelle modulable, perpétuellement en tension, apte à traduire le paradoxe du cœur humain et de l’existant. D’une part il y a le penchant de l’homme à sortir de lui-même, l’ « horreur de la solitude41 », le désir d’ « être deux42 » ; de l’autre la nécessité du dandy de conquérir la solitude, le culte de la différence, l’adoration de son image dans un miroir. D’une part « l’extase de la vie » ; de l’autre « l’horreur de la vie »43. D’une part la « vaporisation » du moi et Satan ; de l’autre la « centralisation » du moi, la concentration, et Dieu44. Selon Baudelaire on ne peut jamais choisir une fois pour toutes ; il faut se résoudre à habiter l’irréductibilité et, selon la circonstance, contrôler la transition pour ne pas en devenir la victime. Chaque terme peut être une condition de jouissance ou de corruption : à la « haine du domicile » des Foules, postulat d’une vacance jouissive, fait face la « Grande Maladie de l’horreur du Domicile45 » d’un feuillet de Mon cœur mis à nu ; semblablement, l’homme de génie ou le poète qui peut « à sa guise, être lui-même et autrui », dans Les Foules, « veut être un, donc solitaire46 », dans Mon cœur mis à nu. Dans le même fragment, Baudelaire propose une analyse de la prostitution semblable à celle de La Solitude : ce « goût invincible » est la matrice de son « horreur de la solitude ». Pour résumer alors l’équilibre mouvant que le poète doit assumer sur la prostitution, il recourt à une formule : « La gloire, c’est rester un, et se prostituer d’une manière particulière47. » Cette « manière particulière » exclut la prostitution « fraternitaire » de La Solitude, qui n’est qu’une corruption irréfléchie et qui exclut le recueillement, la concentration. Elle s’apparente au slogan républicain « liberté, égalité, fraternité » et fait peut-être allusion à l’utopie « fraternitaire » de
34 Ibid., p. 691. 35 Au-delà de Poe, Baudelaire avait pu trouver des réflexions semblables dans ses auteurs de prédilection, comme De
Quincey, Hoffmann ou Balzac (le conte Facino Cane). 36 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, éd. cit., t. I, p. 291. 37 Ibid. Sur l’importance de du concept de « vacance » dans le domaine poétique du XIXe siècle, voir Henri Scepi, Poésie
vacante. Nerval, Mallarmé, Laforgue, Lyon, ENS Éditions, 2008. 38 Ch. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, éd. cit., p. 65. 39 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, éd. cit., t. I, p. 291. 40 Ibid. 41 Mon cœur mis à nu, ft. XXXVI, dans Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, éd. cit., p. 114. 42 Mon cœur mis à nu, ft. XXXVI (ibid.). 43 Mon cœur mis à nu, ft. XL (ibid., p. 116). 44 Mon cœur mis à nu, ft. I (ibid., p. 89). 45 Mon cœur mis à nu, ft. XXI (ibid., p. 103). 46 Mon cœur mis à nu, ft. XXXVI (ibid., p. 114). 47 Mon cœur mis à nu, ft. XXXVI (ibid.).
8
Proudhon, comme le suggère Patrick Labarthe à propos d’Assommons les pauvres !48. L’adjectif fraternitaire, souligné par Baudelaire, est à l’époque un néologisme, qui vient nourrir le lexique quarante-huitard ou socialiste49.
L’idée de prostitution dont se réclame Baudelaire et qu’il charge d’une atmosphère théologique, représente une dynamique qui règle la constitution duelle de l’homme et ses rapports avec la réalité. Elle est « sainte » dans Les Foules et « sacrée50 » dans un fragment de Mon cœur mis à nu qu’André Guyaux a rapproché de la pensée de Benjamin Constant et de la théorie du sacrifice de Joseph de Maistre51 : la prostitution serait un « dérivé du concept maistrien de substitution52 ». Il n’est guère possible de comprendre l’expérience de La Solitude et des Foules sans prendre en compte cette dimension religieuse et jouissive : « Ivresse religieuse des grandes villes. – Panthéisme. Moi, c’est tout ; Tous, c’est moi53. » Elle n’est pas pour Baudelaire une simple métaphore de la plongée du poète dans la multitude urbaine. Pour lui, toute identité est dualité, celle du moi qui rencontre (et parfois produit) l’autre, qui fait sa jouissance et son deuil de ce qui n’est pas lui-même. Ainsi, l’art est prostitution54 : l’artiste qui enfante l’œuvre, s’affranchissant de sa propre essence poétique pour l’offrir à un public inconnu, est prisonnier de ce paradoxe. Selon Baudelaire, l’amour, dans ses différentes formes, est également prostitution, et Dieu, « réservoir commun, inépuisable de l’amour » est l’ « être le plus prostitué »55. N’hésitant pas à transposer cette conception à un niveau cosmique, Baudelaire reprend dans Mon cœur mis à nu une idée gnostique, et se demande si la chute de ce Dieu « prostitué » n’est pas la création elle-même :
La Théologie. Qu’est-ce que la chute ? Si c’est l’unité devenue dualité, c’est Dieu qui a chuté. En d’autres termes, la création ne serait-elle pas la chute de Dieu56 ?
Ainsi, La Solitude, dès la réécriture de 1862, se trouve pleinement intégrée aux moteurs de la pensée
du Baudelaire et aux thèmes qui lentement s’imposent dans le projet des Petits poèmes en prose puis du Spleen de Paris. Le point de départ de Gaspard de la Nuit est entièrement absorbé dans l’épaisseur de réflexions sur le rapport de l’artiste avec la société et la grande ville. La polémique s’insinue dans le texte, et plusieurs reflets du projet d’un pamphlet sur la Belgique s’y attachent. Au topos des « belles agapes fraternelles », Baudelaire substitue l’appel ambivalent à une prostitution « fraternitaire », qui trahit son souci de restituer à la vie humaine ses paradoxes profonds et ses mystérieuses tensions.
48 L’adjectif est employé par Proudhon dans le deuxième volume de La Guerre et la paix. Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens (Paris, Michel Lévy, 1861, p. 217) et, en 1862, dans sa Théorie de la propriété (Paris, Librairie Internationale, 1871, p. 49), où le philosophe critique son ancienne « sensiblerie fraternitaire, communautaire ». Voir Patrick Labarthe commente « Petits Poèmes en prose. Le Spleen de Paris » de Charles Baudelaire, Paris, Gallimard, coll. Foliothèque, 2000, p. 92-99.
49 Voir Ch. Baudelaire, Petits Poèmes en prose, édition critique par Robert Kopp, éd. cit., p. 278. 50 Ch. Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée, éd. cit., p. 91. 51 Ibid., p. 585. 52 Ibid., p. 561. 53 Ibid., p. 67. 54 Ibid., p. 65, 106. 55 Ibid., p. 106. 56 Ibid., p. 102.
9
Les huit versions de La Solitude
I
Épreuve de l’Hommage à C.F. Denecourt. Fontainebleau. Paysages – Légendes – Souvenirs – Fantaisies, 1855, où les corrections de Baudelaire n’ont pas été intégrées dans le texte imprimé :
La Solitude Il me disait aussi, – le second, – que la solitude était mauvaise pour l’homme, et il me citait, je crois, des
paroles des Pères de l’Église. Il est vrai que l’esprit de meurtre et de lubricité s’enflamme merveilleusement dans les solitudes ; le démon fréquente les lieux arides.
Mais cette séduisante solitude n’est dangereuse que pour ces âmes oisives et divagantes qui ne sont pas
gouvernées par une importante pensée active. Elle ne fut pas mauvaise pour Robinson Crusoë [corrigé en Crusoe] ; elle le rendit religieux, brave, industrieux ; elle le purifia, elle lui enseigna jusqu’où peut aller la force de l’individu.
N’est-ce pas la Bruyère qui a dit : « Ce grand malheur de ne pouvoir être seul ..... ? » [corrigé en ..... » ?] Il en
serait donc de la solitude comme du crépuscule ; elle est bonne et elle est mauvaise, criminelle ou [corrigé en et] salutaire, incendiaire ou [corrigé en et] calmante, selon qu’on en use, et selon qu’on a usé de la vie.
Quant à la [question de ajouté] jouissance, – les plus belles agapes fraternelles, les plus magnifiques réunions
d’hommes électrisés par un plaisir commun n’en donneront jamais de comparable à celle qu’éprouve le Solitaire, qui, d’un coup d’œil, a embrassé et compris toute la sublimité d’un paysage. Ce coup d’œil lui a conquis une propriété individuelle inaliénable.
II Hommage à C.F. Denecourt. Fontainebleau. Paysages – Légendes – Souvenirs – Fantaisies, Paris, Hachette, [juin] 1855, p. 79-80. Précédé d’une lettre « à Fernand Desnoyers », Les Deux Crépuscules : Le Soir (ensuite Le Crépuscule du soir, poème en vers), Le Matin (ensuite Le Crépuscule du matin) et Le Crépuscule du soir (poème en prose) ; signé « Charles Baudelaire » :
La Solitude
Il me disait aussi, – le second, – que la solitude était mauvaise pour l’homme, et il me citait, je crois, des paroles des Pères de l’Église. Il est vrai que l’esprit de meurtre et de lubricité s’enflamme merveilleusement dans les solitudes ; le démon fréquente les lieux arides.
Mais cette séduisante solitude n’est dangereuse que pour ces âmes oisives et divagantes qui ne sont pas
gouvernées par une importante pensée active. Elle ne fut pas mauvaise pour Robinson Crusoë ; elle le rendit religieux, brave, industrieux ; elle le purifia, elle lui enseigna jusqu’où peut aller la force de l’individu.
N’est-ce pas la Bruyère qui a dit : « Ce grand malheur de ne pouvoir être seul ?..... » Il en serait donc de la
solitude comme du crépuscule ; elle est bonne et elle est mauvaise, criminelle et salutaire, incendiaire et calmante, selon qu’on en use, et selon qu’on a usé de la vie.
Quant à la jouissance, – les plus belles agapes fraternelles, les plus magnifiques réunions d’hommes électrisés
par un plaisir commun n’en donneront jamais de comparable à celle qu’éprouve le Solitaire, qui, d’un coup d’œil, a embrassé et compris toute la sublimité d’un paysage. Ce coup d’œil lui a conquis une propriété individuelle inaliénable.
10
III « Poëmes nocturnes », Le Présent, 24 août 1857, p. 284-285. Précédé par Le Crépuscule du soir, suivi par Les Projets, L’Horloge, La Chevelure, L’Invitation au voyage :
La Solitude Il me disait aussi, – le second, – que la solitude était mauvaise pour l’homme, et il me citait, je crois, à l’appui
de sa thèse, des paroles des Pères de l’Église. Il est vrai que l’esprit de meurtre et de lubricité s’enflamme merveilleusement dans les solitudes. Le Démon fréquente les lieux arides.
Mais cette séduisante solitude n’est dangereuse que pour ces âmes oisives et divagantes qui ne sont pas
gouvernées par une importante pensée active. Elle ne fut pas mauvaise pour Robinson Crusoe. Elle le rendit religieux, brave, industrieux ; elle le purifia, elle lui enseigna jusqu’où peut aller la force de l’individu.
N’est-ce pas La Bruyère qui a dit : « Ce grand malheur de ne pouvoir être seul..... ? » Il en serait donc de la
solitude comme du crépuscule ; elle est bonne ou mauvaise, criminelle ou salutaire, incendiaire ou calmante, selon qu’on en use, et selon qu’on a usé de la vie.
Quant à la question de jouissance, les plus belles agapes fraternelles, les plus magnifiques réunions d’hommes
électrisés par un plaisir commun, n’en donneront jamais de comparable à celle qu’éprouve le solitaire, qui d’un coup d’œil a embrassé et compris toute la sublimité d’un paysage. Ce coup d’œil lui a conquis une propriété individuelle inaliénable.
IV « Poëmes en prose », Revue fantaisiste, [18e livraison], 1er novembre 1861, p. 324. Précédé par Le Crépuscule du soir, suivi par Les Projets, L’Horloge, La Chevelure, L’Invitation au voyage, Les Foules, Les Veuves, Le Vieux Saltimbanque :
La Solitude
Il me disait aussi, le second ami, que la solitude était mauvaise pour l’homme, et il me citait, je crois, à l’appui de sa thèse, des paroles des Pères de l’Église. Il est vrai que l’esprit de meurtre et de lubricité s’enflamme merveilleusement dans les solitudes. On sait que le Démon fréquente les lieux arides.
Mais cette séduisante solitude n’est dangereuse que pour les âmes oisives et divagantes, qu’une idée
despotique ne tient pas en lisière. Elle ne fut pas mauvaise pour Robinson Crusoe ; elle le rendit religieux, brave, industrieux ; elle le purifia, elle lui enseigna jusqu’où peut aller la force de l’individu.
N’est-ce pas La Bruyère qui a dit : « Ce grand malheur de ne pouvoir être seul.... » ? Il en serait donc de la
solitude comme du crépuscule ; elle est bonne ou mauvaise, criminelle ou salutaire, incendiaire ou calmante, selon qu’on en use, et selon qu’on a usé de la vie.
Quant à la pure jouissance, je crois que les plus belles agapes fraternelles, les plus magnifiques réunions
d’hommes électrisés par un plaisir commun, n’en donneront jamais de comparable à celle qu’éprouve le solitaire qui, d’un coup d’œil, a embrassé et compris toute la sublimité d’un paysage. Ce coup d’œil lui a conquis une propriété individuelle inaliénable.
V
11
Épreuve non corrigée de La Presse, [début octobre 1862] ; restée inédite après le refus d’Arsène Houssaye, le texte aurait dû être précédé par Les Tentations, Le Crépuscule du soir, Les Projets, et suivi par La Belle Dorothée et Les Yeux des pauvres57 :
La Solitude
Un grand politique de gazette me dit que la solitude est mauvaise pour l’homme, et, à l’appui de sa thèse, il cite, comme tous les incrédules, des paroles des Pères de l’Église.
Je sais que le Démon fréquente volontiers les lieux arides, et que l’esprit de meurtre et de lubricité s’enflamme merveilleusement dans les solitudes. Mais il serait possible que cette solitude ne fût dangereuse que pour ceux dont l’âme oisive et divagante la peuple de leurs passions et de leurs chimères.
Il est certain qu’un homme dont le suprême plaisir consiste à parler du haut d’une chaire ou d’une tribune, risquerait fort de devenir fou furieux dans l’île de Robinson. Je n’exige pas de mon gazetier les courageuses vertus de Crusoe, mais je demande qu’il ne décrète pas d’accusation les amateurs de la solitude et du mystère.
Il y a, dans nos races bavardes, des individus qui accepteraient volontiers le supplice suprême, pourvu qu’ils pussent faire de haut un interminable speech, et que les tambours de Santerre ne leur coupassent pas intempestivement la parole.
Je ne les plains pas, parce que je devine que leurs effusions oratoires leur procurent des voluptés égales à celles que d’autres tirent du silence et du recueillement.
Mais je désire que mon gazetier me laisse m’amuser à ma guise. « Vous n’éprouvez donc jamais, me dit-il le besoin de partager vos jouissances ? » Voyez-vous le subtil égoïste ! Il sait que je ne veux pas des siennes, et il réclame sa part des miennes, l’insidieux usurpateur !
« Ce grand malheur de ne pouvoir être seul... » dit Labruyère, donnant ainsi une belle semonce à tous ceux qui courent s’oublier dans la foule, craignant sans doute de ne pouvoir se supporter eux-mêmes.
« Presque tous nos malheurs nous viennent de n’avoir pas su rester dans notre chambre, » dit un autre sage, Pascal, je crois, rappelant ainsi dans la cellule du recueillement tous ces affolés qui cherchent le bonheur dans le mouvement et dans une prostitution que je pourrais appeler fraternitaire, pour parler la belle langue du dix-neuvième siècle.
VI Épreuve corrigée de la Revue de Paris [novembre ou décembre 1864] :
La Solitude Un grand politique de gazette [corrigé en Un gazetier philanthrope] me dit que la solitude est mauvaise pour
l’homme, et, à l’appui de sa thèse, il cite, comme tous les incrédules, des paroles des Pères de l’Église. Je sais que le Démon fréquente volontiers les lieux arides, et que l’Esprit de meurtre et de lubricité
s’enflamme merveilleusement dans les solitudes. Mais il serait possible que cette solitude ne fût dangereuse que pour ceux dont l’âme oisive et divagante la peuple de leurs passions et de leurs chimères.
Il est certain qu’un homme dont le suprême plaisir consiste à parler du haut d’une chaire ou d’une tribune, risquerait fort de devenir fou furieux dans l’île de Robinson. Je n’exige pas de mon gazetier les courageuses vertus de Crusoï [corrigé en Crusoé], mais je demande qu’il ne décrète pas d’accusation les amateurs de la solitude et du mystère.
Il y a, dans nos races bavardes, des individus qui accepteraient volontiers le supplice suprême, pourvu qu’ils pussent faire de haut un interminable « speech », et que les tambours de Santerre ne leur coupassent pas intempestivement la parole.
57 Claude Pichois se trompe sur l’ordre proposé par Baudelaire pour cette livraison de La Presse, donnant Les Tentations, Le Crépuscule du soir, La Solitude, La Belle Dorothée, Les Projets, Les Yeux des pauvres. Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, éd. cit., t. I, p. 1306.
12
Je ne les plains pas, parce que je devine que leurs effusions oratoires leur procurent des voluptés égales à celles que d’autres tirent du silence et du recueillement.
Mais je désire que mon gazetier me laisse m’amuser à ma guise. « Vous n’éprouvez donc jamais, me dit-il le besoin de partager vos jouissances ? » Voyez-vous le subtil égoïste [corrigé en envieux] ? Il sait que je ne veux pas des siennes, et il réclame sa part des [corrigé en veut entrer dans les] miennes, le l’insidieux usurpateur [corrigé en hideux trouble fête] !
« Ce grand malheur de ne pouvoir être seul !... » dit quelque part Labruyère, donnant [corrigé en faisant] ainsi une belle semonce à tous ceux qui courent s’oublier dans la foule, craignant [hésitation avec et qui craignent] sans doute de ne pouvoir se supporter eux-mêmes.
« Presque tous nos malheurs nous viennent de n’avoir pas su rester dans notre chambre, » dit un autre sage, Pascal, je crois, rappelant ainsi dans la cellule du recueillement tous ces affolés qui cherchent le bonheur dans le mouvement et dans une prostitution que je pourrais appeler fraternitaire, si je voulais parler la belle langue du dix-neuvième siècle.
VII « Le Spleen de Paris. Poèmes en prose », Revue de Paris, 25 décembre 1864, p. 52-53. Précédé par Les Yeux des pauvres, Les Projets, Le Port, Le Miroir, suivi par La Fausse Monnaie :
La Solitude. Un gazetier philanthrope me dit que la solitude est mauvaise pour l’homme, et, à l’appui de sa thèse, il cite,
comme tous les incrédules, des paroles des Pères de l’Église. Je sais que le Démon fréquente volontiers les lieux arides, et que l’Esprit de meurtre et de lubricité
s’enflamme merveilleusement dans les solitudes. Mais il serait possible que cette solitude ne fût dangereuse que pour l’âme oisive et divagante qui la peuple de ses passions et de ses chimères.
Il est certain qu’un bavard, dont le suprême plaisir consiste à parler du haut d’une chaire ou d’une tribune, risquerait fort de devenir fou furieux dans l’île de Robinson. Je n’exige pas de mon gazetier les courageuses vertus de Crusoé, mais je demande qu’il ne décrète pas d’accusation les amoureux de la solitude et du mystère.
Il y a dans nos races jacassières des individus qui accepteraient avec moins de répugnance le supplice suprême, s’il leur était permis de faire du haut de l’échafaud une copieuse harangue, sans craindre que les tambours de Santerre ne leur coupassent intempestivement la parole.
Je ne les plains pas, parce que je devine que leurs effusions oratoires leur procurent des voluptés égales à celles que d’autres tirent du silence et du recueillement ; mais je les méprise.
Je désire surtout que mon maudit gazetier me laisse m’amuser à ma guise. « Vous n’éprouvez donc jamais, – me dit-il, avec un ton de nez très-apostolique, – le besoin de partager vos jouissances ? » Voyez-vous le subtil envieux ! Il sait que je dédaigne les siennes, et il vient s’insinuer dans les miennes, le hideux trouble-fête !
« Ce grand malheur de ne pouvoir être seul !..... » dit quelque part La Bruyère58, comme pour faire honte à tous ceux qui courent s’oublier dans la foule, craignant sans doute de ne pouvoir se supporter eux-mêmes.
« Presque tous nos malheurs nous viennent de n’avoir pas su rester dans notre chambre, » dit un autre sage, Pascal, je crois, rappelant ainsi dans la cellule du recueillement tous ces affolés qui cherchent le bonheur dans le mouvement et dans une prostitution que je pourrais appeler fraternitaire, si je voulais parler la belle langue de mon siècle.
VIII
Œuvres complètes de Charles Baudelaire, Paris, Michel Lévy, t. IV : Petits poèmes en prose. Les Paradis artificiels, 1869, p. 67-68. Précédé par Le Crépuscule du soir, suivi par Les Projets :
58 Auteur français, très-méprisé en Belgique.
13
La Solitude Un gazetier philanthrope me dit que la solitude est mauvaise pour l’homme ; et, à l’appui de sa thèse, il cite,
comme tous les incrédules, des paroles des Pères de l’Église. Je sais que le Démon fréquente volontiers les lieux arides, et que l’Esprit du meurtre et de lubricité
s’enflamme merveilleusement dans les solitudes. Mais il serait possible que cette solitude ne fût dangereuse que pour l’âme oisive et divagante qui la peuple de ses passions et de ses chimères.
Il est certain qu’un bavard, dont le suprême plaisir consiste à parler du haut d’une chaire ou d’une tribune, risquerait fort de devenir fou furieux dans l’île de Robinson. Je n’exige pas de mon gazetier les courageuses vertus de Crusoé, mais je demande qu’il ne décrète pas d’accusation les amoureux de la solitude et du mystère.
Il y a dans nos races jacassières des individus qui accepteraient avec moins de répugnance le supplice suprême, s’il leur était permis de faire du haut de l’échafaud une copieuse harangue, sans craindre que les tambours de Santerre ne leur coupassent intempestivement la parole.
Je ne les plains pas, parce que je devine que leurs effusions oratoires leur procurent des voluptés égales à celles que d’autres tirent du silence et du recueillement ; mais je les méprise.
Je désire surtout que mon maudit gazetier me laisse m’amuser à ma guise. « Vous n’éprouvez donc jamais, – me dit-il, avec un ton de nez très-apostolique, – le besoin de partager vos jouissances ? » Voyez-vous le subtil envieux ! Il sait que je dédaigne les siennes, et il vient s’insinuer dans les miennes, le hideux trouble-fête !
« Ce grand malheur de ne pouvoir être seul !..... » dit quelque part La Bruyère, comme pour faire honte à tous ceux qui courent s’oublier dans la foule, craignant sans doute de ne pouvoir se supporter eux-mêmes.
« Presque tous nos malheurs nous viennent de n’avoir pas su rester dans notre chambre, » dit un autre sage, Pascal, je crois, rappelant ainsi dans la cellule du recueillement tous ces affolés qui cherchent le bonheur dans le mouvement et dans une prostitution que je pourrais appeler fraternitaire, si je voulais parler la belle langue de mon siècle.
![Page 1: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: « Baudelaire et la prostitution fraternitaire. À propos de La Solitude », Agrégation de lettres 2015, Méthode ! [Pau], no 24, 2014, p. 191-202 [Peer review].](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042403/63345fec76a7ca221d08a9e7/html5/thumbnails/13.jpg)