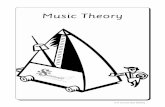Name: _______________________ Music Theory Worksheet Music Theory
world music - musique du monde
-
Upload
galatasaray -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of world music - musique du monde
World Music (Musique du Monde)
• Réalités contradictoires• 1) Dominante, productrice des inégalités, impose l’économie du marché, la démocratie libérale comme seul système politique légitime.
• 2) D’autre part elle propose et devient diversification: société multiculturelle, sophistication des technologies, popularisation des cultures.
1
World music• La World Music est un label
commercial qui sert à classer un produit. Elle intéresse à ce titre les producteurs, les diffuseurs, des publics, des musiciens et certains journalistes.
• C'est aussi un mouvement qui entend s'approprier ou s'affilier à toutes les musiques du monde, traditionnelles, populaires, exotiques.
• À ce titre elle intéresse les musiciens, les sociologues et interpelle les ethnomusicologues.
2
World music
• La World Music se veut une musique contemporaine, qui a vocation à être largement diffusée au niveau mondial.
• Elle prétend exprimer la diversité des musiques populaires par les moyens techniques les plus modernes ou s'en inspirer en les mixant.
• Elle est destinée principalement à un public censé défier les frontières, être curieux des choses du monde, ouvert aux autres, en quête d'exotisme, de dépaysement au sens strict du terme, bref un public contemporain d'une mondialisation sans contraintes.
• Terme ambigu, il désigne tantôt des musiques « ethniques » tantôt un métissage planétaire. C'est grâce à cette ambiguïté que se retrouvent et se perdent, autour de la World, les différents partenaires, producteurs, distributeurs, chercheurs, publics... La chaîne est complexe, les interactions et leurs enjeux différents selon les acteurs considérés. 3
World music
• La World Music, c'est une part de marché qui représente, en 1996, plus de 12 % des ventes en magasin pour l'Europe.
• Ce sont près de 250 000 titres disponibles, dont environ 10 000 nouveautés chaque année.
4
Comment classer?
• A la FNAC, un panneau indicatif « Musiques du monde » désigne un espace où chacun pourrait trouver ce qui n'est pas classique, jazz, rock, pop... ou ce qui est du monde, des mondes ? d'un monde lointain, dans le temps, dans son espace géographique, par ses pratiques. A l'intérieur de ce monde des musiques, des panneaux plus petits guident le voyageur : chasseur ? découvreur ? consommateur ? 5
Comment classer?• Ils affichent un classement par continents
ou zones géographiques : « Afrique », « Afrique Est et Sud », «Zaïre-Congo », par style : « Afrique traditionnelle », « Actualité Afrique », « Amérique latine », « Salsa »... et, encore une fois, « Musiques du monde », doublure des termes du premier panneau, nécessité de multiplier les balises d'un monde trop grand ?
• L'observation rigoureuse des disques révèle la nature du classement des cultures : des « Voix du monde » à «Musics of the nile, from the desert to the sea », en passant par « La légende de la flûte de pan », il s'agit de compilations. De « Ketama » à « l'Orchestre national de Barbès », en passant par « Mozart l'Égyptien », il s'agit de nouveauté De Khaled à la musique du film La vérité si je mens, il s'agit de succès.
6
catégorisation• Comme chez les distributeurs, en France, on parle généralement
des « Musiques du monde » et non de « World Music ». • Le pluriel n'en désigne pas moins une même réalité. En effet,
littéralement «Musiques du monde » inclut toutes les musiques y compris la musique classique, de fait, et ce n'est pas innocent, il faut l'entendre en référence au terme anglais et à ce qu'il vise et exclut.
• Les rubriques de certains journaux sont de vraies mines d'informations ! Véritables nourritures, les musiques du monde sont sous la plume des critiques : « savoureuses », « un régal » ; nourritures spirituelles elles sont : « méditatives », « mystiques », « magiques », « des féeries », «comme un soupir venu des limbes », « timbre d'outre-tombe ». Elles agissent : « charment », « électrisent », «ensorcellent », « envoûtent », «hypnotisent », « invitent (à la danse, à festoyer...) », « souhaitent la bienvenue », « sont contagieuses » ou « caressantes », « apaisent », «enivrent », « offrent », «baladent ».
7
catégorisation• Quant à leurs caractéristiques musicales, le vocabulaire employé témoigne d'une rigueur remarquable ! : «Les percussions s'affolent», « les trémolos s'envolent », « les vielles et les luths dansent », elles sont des « danses facétieuses », ou « pimentées », des «effluves de danses orientales ». Les musiques ont toutes les vertus du métissage : elles sont « entrecroisement », « se mêlent savamment », « côtoiement », « rencontre », « dialogue », «synthèse », « incursion », « inspirées par », « concentré d'influence», « imprégnées de », « emprunt », « héritage », «adopté par », « revisité », « renouveau », « réinvente », « sur fond de », «sur un tapis », « foisonnement ».
• Cette sélection du vocabulaire utilisé dans la presse résulte d'une analyse faite à partir de 25 rubriques « musiques du monde » de Télérama, de la revue World- Music, la planète musicale et de Libération.
8
Un exemple d’exotisme !
• La musique classique indienne semble suggérer les accords marécageux…
• Les cessions de transes arabes ont un écho dans les arpèges des guitaristes flamenco, les percussionnistes coréens suggèrent les chansons de prières West africaines [...]
9
Musiciens I• Une jeune musicienne malgache interviewée sur France
Culture dans l'émission Musiques du monde, se revendique d'abord de la modernité et de son appartenance à la jeunesse, comme s'il s'agissait d'une catégorie mondiale univoque : «Moi je joue ma musique, surtout d'une façon professionnelle, parce que à Madagascar, la musique traditionnelle c'est fait à la maison, c'est intime [...] Quand on me dit que ce n'est plus de la musique traditionnelle ça dépend, parce que qu'est-ce que c'est la musique traditionnelle? A Madagascar il y a beaucoup de musiques traditionnelles, nous on prend les instruments traditionnels, les techniques de voix traditionnelles, les danses traditionnelles, on mélange tout, mais on a une approche très moderne parce que voilà, on vit au XXE siècle, on est jeune donc on veut faire des choses à nous. »
• Cette musicienne reconnaît s'appuyer sur un patrimoine hérité des anciens, mais en même temps elle fait une distinction entre une musique professionnelle et une musique intime, faite à la maison, ce qui indique l'intériorisation occidentale de la séparation entre le privé et le public. 10
Musiciens II
• Plus critique par rapport aux liens qu'elle devrait avoir à la tradition, revendiquant le droit à la création, une musicienne libanaise met en cause le regard occidental qui assignerait un rôle aux pays du Tiers-monde, celui de préserver le passé, leur refusant ainsi d'être dans l'histoire. «C'est de l'Occident que les peuples orientaux attendent [...] la consécration. Mais l'Occident a autorité sur les musiques orientales. Il dicte ses lois [...] refusant systématiquement certaines musiques, en encourageant d'autres [...]. L'Oriental, du xxe siècle n'a pas le droit de créer, mais il doit perpétuer les créations de ses ancêtres » (During 1996).
• Peter Gabriel répond aux accusations de vampirisme dont il a été l'objet. « Tous les artistes sont des vampires, c'est un signe de santé et il faut l'encourager» .
• Il rappelle que les pratiques d'emprunts on toujours eu lieu dans un sens ou dans l'autre. Et il précise enfin qu'aujourd'hui, les musiques à partir desquelles il travaille sont ainsi connues dans le monde entier, le seul problème étant d'assortir les emprunts d'une protection juridique. 11
Effets de lacommercialisatio
n?
• L'opération marchande décrite plus haut déploie des moyens économiques considérables, qui ne sont pas sans répercussions sur les pratiques musicales. Qui ignore aujourd'hui que les musiques exotiques peuvent être lucratives ?
• Le débat porte aussi sur les effets de la World sur des pratiques musicales complexes, la grande distribution permet-elle réellement un accès à ces musiques, ne risque-t-elle pas d'en annuler le sens ?
• Enfin, le débat porte sur l'intérêt théorique de la World dans la mesure où elle amène à se réinterroger sur des concepts fondamentaux de la discipline : identité, acculturation, tradition, métissage, authenticité, formes de l'échange
12
Urgence? • « Je prétends qu'il y a urgence à s'occuper de ces musiques profondément intégrées à la vie, à la génétique même de ces groupes ethniques encore protégés de la modernité, avant de s'intéresser aux métissages de la World Music, par ailleurs fort intéressants.
• Il y a quelque chose de fondamentalement différent entre le métissage contemporain et celui qui s'est effectué tout au long des millénaires.
• De tout temps les gens ont voyagé. Si la musique traditionnelle a survécu au choc du métissage pendant si longtemps, c'est parce que d'abord il n'existait pas de diffusion massive comme aujourd'hui et ensuite parce que les peuples étaient très attachés à leur identité musicale, à leurs différences, ce qui est aux antipodes de la World Music ». Entretien réalisé par Véronique MORTAİGNE, Le Monde, 30 septembre 1997, p. 15.
13
Construire et saisir l’objet• De manière quasi systématique, les différents auteurs qui tentent de
donner une définition du terme en question commencent par faire la genèse de ce phénomène. Pour les uns (Martin 1996a) il naît avec le premier festival Womad (World of Music Arts and Dance) en 1982. François Picard (1997) l'attribue à trois personnes dont Peter Gabriel. Steven Feld (1995) le fait surgir aux États-Unis en 1985.
• Alors que des musiques les plus diverses étaient classées sous ce label, des tentatives de définitions sont apparues comme nécessaires pour essayer de clarifier ce qui était devenu un « fourre- tout».
• Du côté français, le sociologue Denis-Constant Martin (1996a : 5), décrit le phénomène comme un « mouvement caractérisé à la fois par son extension mondiale, le mélange des musiques qui sont associées et une préoccupation marquée à l'égard de certains problèmes sociaux et politiques.» Pour lui, ces musiques constituent un champ de recherche en. tant qu'elles sont l'expression d'un phénomène social.
• Laurent Aubert (1997), quant à lui, fait une tentative de classement à partir des sous-divisions existantes : « roots », « world beat », « world mix », « transmusic» Plus que d'une définition, il s'agit d'une description minutieuse et empirique des genres inclus sous ce label. Il conclut qu'il n'y a pas de définition satisfaisante de cette « sono mondiale »…Il s'appuie sur les «méga-concerts» et l'importance des ventes pour en souligner la dimension sociale. Valeur marchande, il lui reconnaît aussi une valeur humaine. 14
Construire et saisir l’objet• Par World Music nous n'entendons évidemment pas toutes les musiques du monde. Ne sont pas inclues dans cette typologie les musiques dites « traditionnelles », les œuvres de composition qui s'inscrivent dans l'histoire des musiques classiques occidentales ou encore les expériences acousmatiques de musique contemporaine.
• Nous n'avons retenu que les différentes formes utilisées dans la fabrication d'un produit revendiquant le label World, le niveau objectif d'implication des musiciens dans ce processus, l'adhésion des publics à ce qui voudrait représenter l'idéologie actuelle de refus des frontières culturelles…
15
Construire et saisir l’objet• …Professionnalisation des musiciens, intervention de technologies modernes, une dose plus ou moins importante d'exotisme, en l'occurrence le rapport avec des répertoires venus d'ailleurs ; d'autre part des différences qui indiquent le degré d'appropriation et de dissolution de l'Autre dans le processus.
• Ce tableau doit se lire de manière dynamique. On constatera que plus on se rapproche d'une « création » World plus il s'agit d'un phénomène largement dominé par les technologies, les circuits occidentaux, destiné à un public postmoderne.
• À une extrémité la cohérence du système musical est conservée, à l'autre on a l'explosion des systèmes. On va du plus local au plus global. Ce tableau représente le degré de manipulation, d'appropriation d'un matériau musical.
• C'est à fin de le rendre moins abstrait que nous avons indiqué quelques genres ou noms de musiciens.
16
Construire et saisir l’objet• Si le projet de l'ethnomusicologue a pour vocation de
montrer comment un système musical est cohérent avec l'ensemble des institutions et des modes de vie d'une société, alors il lui faut recomposer une totalité inscrite dans un espace défini.
• Théoriquement cette recomposition n'est pas impossible. La complexité de ce travail s'accroît avec le degré de fusion des matériaux musicaux hétérogènes utilisés, l'individualisation du public, la professionnalisation et l'internationalisation des musiciens.
• Pratiquement, lorsqu'il s'agira de délimiter les frontières du terrain des difficultés surgiront, quels producteurs, quels musiciens, quels publics peuvent-ils être appréhendés comme une totalité sociale ? A vouloir tout englober la World peut-elle constituer une totalité ou en est-elle la négation ? Peut-on empiriquement dépasser le fait que la World Music se donne comme un monde éclaté : division du travail, disparition des styles, diversité infinie des musiques, professionnels isolés, atomisation du public ?
17
Construire et saisir l’objet• …on peut se demander s'il lui est tout simplement possible de reconstituer un groupe social significatif à partir de pratiques musicales englobant l'ensemble des acteurs mis en relation dans la réalisation d'un produit World, chacun de ces acteurs relevant d'appartenances hétérogènes.
• La question des publics n'étant pas la moins redoutable. Quelle que soit son approche, il lui faudra, là encore, détourner la vocation globalisante de la World en l'abordant à partir d'objets singuliers.
18
Mahmoud Ahmed
• Le jazz est né en Amérique mais plonge ses racines en Afrique. Les musiciens africains ne sont donc pas les plus mal placés pour jouer du jazz à partir de leurs musiques locales.
• MULATU ASTATQE, le père de l'éthio-jazz
20
Addis-Abeba
• Il y a un paradoxe éthiopien et une capitale. Addis-Abeba, à 2 000 mètres d'altitude, folle clé musique. Qu'il s'agisse de celle des tadjbets, ces bars où l'on boit le tedj (hydromel national), des lieux de clause, des mariages, des fêtes communautaires ou des stades pris d'assaut lorsque, d'aventure, une star locale s'y produit.
21
• Comme dans la plupart des pays sous-développés, c'est l'arrivée des instruments occidentaux (cuivres, guitares) des fanfares qui modifie la donne musicale. Après la brève occupation mussolinienne (octobre 1935- avril 1941) naissent de grands orchestres sous l'égide d'institutions militaires ou culturelles 22
• De nombreux groupes indépendants s'en inspirent aussi, à l'instar des Ail Star Band, Girmas Band, Soûl Echo, Wallias, Venus, Ethio Stars, Black Lion...
• Et, jusqu'au milieu des années soixante-dix, ce sont ces formations officielles, à l'instar de l'Impérial Body Guard Band (l'orchestre de la garde impériale), de l'Army Band, du Police Orchestra, qui accompagnent la plupart des figures de proue de la chanson autochtone, sur scène ou sur disque.
23
Hailé Selassié – monarque réformiste
• Hailé Selassié, deux cent vingt-cinquième descendant de Salomon, dont le droit divin esi garanti par l'ancien Livre des Rois.
• Un monarque devant lequel on se prosterne lorsqu'il traverse la capitale dans sa Rolls-Royce verte, mais qui contribue, en "1963, à la naissance de I'OUA (Organisation de l'unité africaine) et, après un coup d'Etat manqué, comprend l'urgence d'engager son pays dans une mue progressiste.
24
Les années folles ?
• Addis-Abeba, capitale des non-alignés, va s'afficher au diapason du monde. Les jeunes hommes déambulent en pantalons à pattes d'éléphant. Les jeunes filles affichent minijupes, coupes afro et choucroutes.
• La soul music et la guitare électrique font des dizaines d'émulés. Témoignage de cette effervescence, l'essentiel de la production discographique éthiopienne (cinq cents disques quarante-cinq tours, trente albums trente-trois tours) est publié entre 1969 et 1978.
• Le seul label Ahma Records enregistrant en six ans deux cent cinquante titres.
25
Dans ce processus chaotique, Mahmoud Ahmed. par sa longévité, représente l'archétype du grand chanteur "classique". Né en 1942 au cœur du labyrinthe du Mercato, le grouillant et permanent marché d'Addis-Abeba, il est d'origine fort modeste et, ses études écourtées, entre dans la vie active comme cireur de chaussures.
• Au fil des petits boulots, il se retrouve, à vingt ans, homme à tout faire à l'Arizona, un de ces clubs où les stars des orchestres officiels viennent faire des extras, nonobstant l'interdiction militaire et les arrêts de rigueur. Jusqu'à ce qu'il fasse un remplacement au pied levé et se retrouve invité, grâce à ses remarquables aptitudes, à intégrer l'Impérial Body Guard, où il demeurera jusqu'en 1974.
• Source: TENAILLE Frank, Le Swing du Caméléon – Musiques et chansons africains 1950-2000, Eds. Actes Sud, 2000, p. 187-193.
• Voir aussi: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmed 26
• Quand il peut se produire devant un public populaire, Mahmoud Ahmed est aussi apprécié pour ses talents de showman. Car il n'a pas son pareil pour déclencher la fameuse eskista, frémissement haletant du torse et des épaules, dont sont friands les Ethiopiens. Eskita qui tout à la fois est "la" danse des amhariques, relève de la parade amoureuse et exprime la jubilation collective.
• http://www.youtube.com/watch?v=84AcXQp3VEY
• Ses origines gouragué, populations réputées pour l'extraversion de leur danse, expliquant ses qualités d'ambianceur.
• http://www.youtube.com/watch?v=sml_YDo3d_I
27
• Avec la chute du régime de Mengitsu, de pair avec une frénésie économique qui est aussi celle des businessmen de la musique, la vie culturelle retrouve des couleurs en Ethiopie. En témoigne l'ouverture de dizaines d'azmaribéts (maisons d'azmaris), où des azmaris new-look, anticonformistes et bouffons, n'ayant que faire des castes, ont inventé le bolel (traduire : gaz d'échappement d'automobile), un genre entre tchatche et absurde qui se nourrit des images satellitaires comme de la tradition, jouant des répertoires et des allusions avec l'évidente envie d'assumer pleinement leur rôle de mauvaise conscience de l'Ethiopie. 28
• Et c'est dans ce contexte bouleversé, avec sa voix puissante, rauque, ondoyante que Mahmoud Ahmed est devenu au niveau international le révélateur de l'iceberg musical éthiopien.
• Pour preuve, en 1986, les huit brillantes minutes d'Ere mêla mêla, un de ses morceaux (publié en 1975 en Ethiopie) qui va faire un tabac sur les radios spécialisées d'Europe et des Etats- Unis.
• Sa musique ouvrant la porte à celle d'une nouvelle génération, plus pop, moins cuivrée, plus électrique, qui affiche un nombre respectable de femmes, comme Aster Aweké. 29
Nusrat Fateh Ali Khan (1948-1997)
• Par sa voix et son charisme, le qawwali, traditionnellement destiné à un noyau de dévots et de mystiques musulmans du sous-continent indien, conquérant des publics fort bigarrés en Europe, aux Etats-Unis, dans le monde arabe, au Japon, en Australie, au Brésil.
• Ses enregistrements se comptent par dizaines, ses concerts aux quatre coins du monde par centaines, ses ventes de cassettes par millions. Consacré star au hit-parade des musiques du monde, il joue régulièrement à guichets fermés au Théâtre de la Ville de Paris ou au Town Hall de Broadway, enregistre avec le chanteur de rock Peter Gabriel, interprète la Passion dans le fort polémique film de Martin Scorsese, «La dernière Tentation du Christ», intègre des instruments électriques dans certains de ses concerts...
31
Nusrat Fateh Ali Khan • Sur les cinq continents, il bouleverse
une diaspora pakistanaise à l'âme ravivée, éblouit les fans de World Music, trouble les curieux, ébranle les spiritualistes, fascine les branchés... Prodigieuse multiplicité du personnage, trait d'union déjà mythique entre tradition et modernité, Orient et Occident, sacré et profane.
• «On n'échappe pas à la ferveur de Nusrat» prévient Alain Swietlik: «Comment résister à une telle force de certitude, comment faire face à un tel déferlement de passion ? Comment ne pas croire à un amour aussi fou, comment ne pas se laisser emporter par une joie aussi outrée ? ... Nusrat n'a pas appris à chanter pour louer Dieu, il est né pour chanter Dieu... Nusrat, c'est la ferveur religieuse poussée à la plus élevée des folies musicales.32
Nusrat Fateh Ali Khan
• Se laisser pénétrer du feu flamboyant du chant nusratien, expérience personnelle fabuleuse, n'empêche néanmoins pas une interrogation essentielle: qu'induit ce glissement radical d'une pratique lourde de sens dans son contexte originel, vers sa présentation en spectacle payant - et payé - dans des lieux pour le moins profanes de notre Occident ?
Un rituel extatique pour initiés, transformé en concert artistique à l'occidentale doté d'une audience le plus souvent fort peu dévote et généralement guère instruite du sens des paroles et du sens originel?
•33
• Le qawwali de Nusrat Fateh Ali Khan s'inscrit dans le tourbillon mondialisé qui traverse désormais une tradition soufie présente dans le sous-continent depuis des siècles. Voici plus de sept cents ans, en effet, que le lignage de et «chanteur élu» projette aux foules embrasées sa poésie d'amour fou au divin. Ses ancêtres arrivèrent d'Afghanistan. A l'opposé des armées arabes, turques et mongoles qui conquirent la région au fil du sabre avec leur vision orthodoxe d'un Islam rigoriste, ces moines errants souhaitaient diffuser le message d'une foi toute imprégnée de la Voie soufie (tariqa) fondée sur l'amour mystique.
• «le mystique se sent l'être le plus libre du monde et, dans son détachement matériel, le plus résolu à le transformer» 34
Qawwali national
• Ce fut cependant l'émergence du Pakistan qui semble avoir véritablement happé le qawwali dans le tourbillon qui le projette actuellement aux quatre coins du monde.
• Le nouvel État pakistanais souhaitait en effet forger une identité nationale qui rassemblerait l'immense diversité des populations composant le pays. L'appartenance majoritaire à l'Islam étant le seul dénominateur commun face à l'Inde rivale, les expressions issues de la sphère musulmane furent dès lors utilisées à des fins éminemment nationalistes par le nouvel État.
• Ainsi, alors que le qawwali était essentiellement resté au cours des siècles une musique rituelle jouée dans les sanctuaires soufis au cours des sama', on l'intégra désormais comme élément distinctif d'une culture nationale pakistanaise en formation. 35
• La renommée planétaire du chanteur Nusrat Fateh Ali Khan permet désormais d'entendre son chant qawwali aux quatre coins du monde, que ce soit en concert, par la voie de ses innombrables enregistrements vidéo, CD et K7, ou des musiques de film à succès qu'il compose et interprète.
• Ce faisant, il s'éloigne du cadre originel du qawwali, forme musicale chantée depuis le xne siècle dans les sanctuaires soufis de l'Inde du Nord et du Pakistan. Dans ces mausolées, le sama', ou concert spirituel se développant autour du qawwali, est traditionnellement conçu comme une opportunité permettant de guider le dévot vers l'extase, expérience vécue de la divinité dans une alliance d'amour mystique. 36
• La pratique séculière de ce chanteur qawwal n'est néanmoins pas nouvelle, puisqu'outre les concerts privés proposés depuis très longtemps par la plupart des musiciens de ce genre musical, le qawwali a été érigé depuis l'émergence du Pakistan indépendant en élément distinctif de la culture nationale pakistanaise, et à ce titre fortement appuyé par les appareils d'Etat comme Radio Pakistan.
• Devenu maintenant pour la diaspora pakistanaise un flambloyant symbole identitaire, enraciné dans ia tradition mais aussi projeté dans - et reconnu par - la modernité occidentale, Nusrat Fateh Ah Khan s'est mué en fer de lance de la diffusion internationale d'un qawwali aujourd'hui happé par le tourbillon de la World Music, cette mouvance musicale globalisante de notre village planétaire.
37
À l’épreuve
• Face à l'essor accéléré des échanges musicaux mondiaux, et au risque induit de nivellement sous bannière occidentale des multiples sensibilités musicales, il incarne avec faste les ambiguïtés d'une musique rituelle projetée dorénavant auprès des audiences modernes des cinq continents, nous renvoyant, médiateur inspiré, à la nature et la qualité fondamentales de notre propre écoute.
38
Sources• MALLET Julien, “World Music, Une question
d’ethnomusicologie”, in Cahiers d’Etudes africains, 168, XLII-4, 2002, pp. 831-851.
• TENAILLE Frank, Le Swing du Caméléon – Musiques et chansons africains 1950-2000, Eds. Actes Sud, 2000, pp. 187-193.
• BAUD Pierre-Alain, “Nusrat Fateh Ali Khan le qawwali au risque de la modernité”, in Cahiers de Musiques Traditionnelles, no:9, 1996, pp. 259-273.
• http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_%C3%A9thiopienne
39