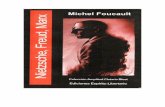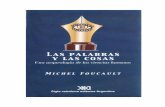VERBE / VERBUM (Michel Arouimi)
Transcript of VERBE / VERBUM (Michel Arouimi)
1 Verbe /Verbum /Word; Verb
VERBE / VERBUM / Word ; Verb
ÉTYMOLOGIEVerbe, verbe, subst. Masc. Français, 1050, du latin verbum : « parole, mot » (cf.
verve). En latin ce terme est parfois impliqué dans certaines expressions, où il
désigne le sujet de l'énonciation (par ex.: « de ma part, en mon nom »). En moyen
anglais verb est emprunté au vieux français au sens grammatical. Verbe au sens
théologique de « Logos» est traduit par The Word.
Michel Arouimiédité et appareillé par Jean-Marie Grassin
Modifié 21 juin 2005
par MD
ÉTUDE SÉMANTIQUE1. En français, ce terme qui désigne principalement une classe grammaticale, a gardé
son sens latin de « parole», avec les connotations laudatives que réclame la “parole”
des poètes ou des écrivains. (Le terme verbelet en ancien français a d'ailleurs le sens
de « petit mot ».)
2. Il peut désigner aussi, par une dérivation du sens, l'amplitude du ton de la voix.
L'expression verbe haut est courante, mais il n'est pas habituel de parler d'un verbe
bas, peut-être en raison de la grandeur qui s'attache au sens théologique de ce mot.
3. Assimilé au Logos, il désigne la parole (plutôt que les paroles) de Dieu, une Parole
qui constitue, selon la tradition, le processus même de la Création. C'est pourquoi,
dans la théologie chrétienne, le Christ, homme et Fils de Dieu, deuxième personne
de la Trinité, est nommé le Verbe incarné, puisqu'il représente aux yeux des hommes
cette volonté créatrice qui, selon la tradition, nous a engendrés.
4. Le sens grammatical de ce terme présente des traits singuliers, qui peuvent
expliquer le sens théologique qu'il prend en français. Le terme néerlandais
werkwoord associe justement l'idée d'une puissance productrice au mot désignant
cette classe grammaticale: le verbe, le nœud ou le pivot de la phrase, a pour vocation
de signifier les phénomènes dynamiques. Le verbe intéresse des modalités variée :
l'être, l'avoir... Associé au temps, le verbe n'est pas le seul moyen de signifier une
action, un état. (Des noms propres et des adjectifs remplissent cette fonction.)
Le verbe, dont il faut rappeler l'indépendance vis-à-vis du genre, présente un grand
nombre de catégories morphologiques (les conjugaisons entraînent maintes variations
du radical). Ces catégories sont : la personne (exceptés les verbes à l'infinitif, les
participes et les gérondifs, qui transforment le verbe en des formes moins complexes)
— le nombre, conféré au verbe par le sujet — le temps, auquel s'ajoutent le mode et
l'aspect (exprimé par des auxiliaires) — enfin la voix (passage de l'actif au passif).
Liens hypertextesABÎME; ABYME; MISE EN ABYME/Abyss ; Mirror text ,
APOCALYPSE/Apocalypsis, ANDROGYNIE/Androgyny, ARCHÉTYPE,
COSMOGONIE/Cosmogony, CRÉATION/Creation,
DISCOURS/Discourse; Speech,
ÉMERGENCE/Emergence, ÉSOTÉRISME/Esotericism,
2 Verbe/Verbum/Word; Verb
HARMONIE/Harmony, HÉBRAÏSME/Hebraism,
KABBALE/KABBALAH,
LANGUE; LANGAGE/Language, LEXIE/Lexia, LOGOS,
MANTRA, MÉTAPHYSIQUE/Metaphysics, MOT/Word, MUSIQUE/Music,
MYTHE/Myth,
NOMBRE/Number, NON, NUMÉROLOGIE,
ORDRE/Order, ORIGINE/Origin,
PALINGÉNÉSIE/Palingenesis, PAROLE/Speech; Word, POÉSIE/Poetry,
PRÉSENCE/Presence,
SACRÉ/Sacred , SOUFFLE/B reath , SYMBOLISME/Symbol ism ,
SYMÉTRIE/Symmetry,
TON; TONALITÉ/Tone; Pitch, TRANSGRESSION/Transgression,
ORDRE, ORIGINE/Origin,
UNITÉ/Unit; Unity; Oneness,
VERBE/VERBUM/Word, VOIX/Voice.
NOMENCLATURESCRÉATION/Creative process, CHRISTIANISME/Christian lore,
ÉSOTÉRISME/Esoterism,
GÉNÉTIQUE/Text production, GRAMMAIRE/Grammar, GREC/Greek studies,
HEBREU/Jewish studies,
LATIN/Rome, LINGUISTIQUE/Language,
MYTHE/Myth criticism,
PHILOSOPHIE/Philosophy, POÉSIE/Poetry, POÉTIQUE/Poetics,
RELIGION/Spirituality.
KeywordsBreath,
Creative process,
Esoterism,
God,
Incarnation,
Language, Lexia, Light,
Pitch,
Speech, Spirituality, Symmetry,
Tone,Trinity,
Violence.
ÉQUIVALENTS / CorrespondencesAllemand / German : Wort.
Anglais / English : (gram.) verb; (religion) The Word : «le Verbe»; (poétique)
language; word (ex: the magic of language, – of the word : «la magie du verbe»);
(général) tone (of voice); to sound high and mighty : «avoir le verbe haut».
Arabe / Arabic :
3 Verbe /Verbum /Word; Verb
Chinois / Chinese : Coréen / Korean : Danois / Danish : Espagnol / Spanish : Français / French : verbe; le Verbe.
Grec / Greek : : ëüãïò logos : «parole, ton de voix»; ñìá rêma (gram.) ; Ëüãïò
Logos : «le Verbe divin». V. l’article LOGOS.
Hongrois / Hungarian :Italien / Italian : Hébreu / Hebrew : Japonais / Japanese : Latin : Néerlandais / Dutch : Persan / Farsi :Polonais / Polish : Portugais / Portuguese : verbo (gram.); Verbo (religião); palavra. Roumain / Romanian : Russe / Russian : Viêtnamien / Vietnamese :
COMMENTAIREDe tous les mythes dits premiers, celui du Verbe qui les contient tous en germe, peut
paraître facile à définir. Mais cette notion du «Verbe», qui désigne la parole de Dieu
(du latin verbum, dans la Vulgate: «le mot, la parole»), pose maints problèmes.
D'abord à cause des deux sens, littéral (les propos rapportés de Dieu dans la Bible)
et ésotérique du «Verbe» divin, qui nomme la volonté créatrice de la divinité
(certains passages de l'Ancien Testament, où les interventions orales de Dieu
s'accompagnent de symboles visuels renvoyant à la puissance du Verbe créateur,
suggèrent le rapport de ces deux sens...). Cette notion du Verbe se retrouve dans
différentes traditions qui ne lui accordent pas le même rang dans leurs cosmogonies.
Certains mythes polynésiens étudiés par Mircea Eliade mettent en avant la parole
créatrice des dieux, qui modèle l'univers. Mais si le Logos grec recouvre la notion du
Verbe, l'idée d'une parole originelle n'est pas évidente en Grèce, même si le langage
humain, comme en Inde, est œuvre divine.
Ces différences s'estompent, eu égard à la «métaphysique intégrale» qui serait
interprétée par toutes les cosmogonies, avec le vocabulaire symbolique particulier à
chaque tradition. Quoi qu'il en soit, il faut encore noter la diversité réelle, parfois au
sein d'une même tradition, des expressions symboliques du Verbe, où la lumière le
dispute au son, le serpent au cheval... Enfin certains mythes, comme celui de
l'Androgyne, coïncident sous certains aspects avec le mythe du Verbe, auxquels ils
peuvent être rattachés.
Ce mythe du Verbe divin proprement dit, émerge comme tel dans la Génèse, dès ses
premiers versets qui évoquent le rôle créateur du souffle et de la parole divine. Mais
c'est dans le Nouveau Testament, avec le Prologue de l'Évangile de saint Jean et dans
l'Apocalypse, que le Verbe s'impose comme un thème majeur (ou comme dans le
thème clé) du texte biblique. En fait, les gloses juives du récit inaugural de l'Ancien
Testament ont mis en place une métaphysique du Verbe, où se fait sentir l'influence
des théories pythagoriciennes.– Notamment la réflexion sur le Nombre, et sur les
principes mathématiques qui, d'après les anciens philosophes grecs, régissent
l'univers. Cette mathématicité – celle d'une «architecture du divin» – intéresse
d'ailleurs le «Logos» qui implique, outre les notions de mot, de discours (comme le
Verbum du Nouveau Testament, traduit en anglais par Word), celle de réunion, de
collection de choses dans un certain ordre.
La tradition hébraïque – celle de la Bible, analysée par la mystique juive – a donc
joué un rôle majeur dans l'impact, notamment souligné par Robert Aron, de la
4 Verbe/Verbum/Word; Verb
notion du Verbe dans notre culture. Mais le raffinement conceptuel de la kabbale
s'apparente à celui qui, dans les traditions islamique ou hindoue, rend compte du
mystère de ce que nous nommons «creatio per verbum». Dans toutes ces traditions,
le Verbe doit d’abord (comme l'observe F. Schuon dans son Résumé de métaphysique
intégrale) s'entendre comme l'Intellect divin qui conçoit les possibilités de sa
manifestation, avant de s'affirmer comme le Verbe manifesté et agissant, au niveau
de l'Existence dont nous faisons partie.
L'article présent n'a pas l'ambition de mesurer le rapport de ces visions convergentes
de la «creatio per verbum», que nous envisagerons sous les traits fixés par la
tradition judéo-chrétienne, telle qu'elle se voit interprétée dans notre littérature.
(Cette «interprétation» n'a pas toujours l'assurance d'une annexion consciente du
mythe en question, dont les traits semblent parfois revivre au gré d'une spontanéité
de l'inspiration, comme en retrait de la conscience de l'écrivain.) L'étroitesse de ce
champ culturel judéo-chrétien est elle-même très relative, quand des écrivains comme
Rimbaud, Conrad ou Kafka, pénétrés de la lumière de ce mythe du Verbe,
convoquent dans leurs œuvres, avec une sorte de ludisme ambigu, des symboles qui
dans d'autres traditions expriment un mystère équivalant à celui du Verbe, défini
comme la parole créatrice du Dieu de la Bible. Le motif de l'œuf, sous la plume de
Ronsard, de Rimbaud ou d'Eichendorff, peut s'apprécier comme un reflet plus ou
moins conscient de l'Œuf cosmique des cosmogonies orphiques, qui ne sont pas très
éloignées de notre tradition. Mais la présence thématique de la Chine ou (et) de
l'Inde, chez Rimbaud, Eichendorff, Conrad ou Kafka, permet d'estimer le symbolisme
(probable) de certains motifs de leurs textes, qui pourraient se mettre en rapport avec
les conceptions orientales équivalant à celle du Verbe.
Dans toutes les traditions, les thèmes associés de la parole, du son et de la lumière
expriment, adaptée à l'entendement humain, la vibration primordiale où se manifeste
le pouvoir créateur de la volonté divine. (Peut-être les nomenclatures et les
énumérations de dieux dans la Théogonie d'Hésiode ont-elles la même nécessité
«poétique» que celles de la Bible, entendues comme des variations lyriques sur le
thème de l'Un.) La création du monde (ou des mondes) est en effet envisagée comme
un écho matériel de cette parole. (Dans maints textes sacrés, les manifestations
terrestres de la divinité s'accompagnent d'échos ou de reflets de cette vibration...). Le
mystère de cette propagation sonore ou lumineuse recouvre celui de la «Creatio in
Deo», puisqu'en effet la Création dont nous sommes un infime, mais appréciable
constituant reste liée au Verbe (et à la volonté qui s'y énonce) dans un rapport de
non-séparation.
Léo Schaya rappelle (dans Naissance à l'Esprit) que l'acte éternel de l'Être divin est
son Verbe, «qu'il prononce en lui-même, qui est son Logos ou discours intérieur»...
Sous son aspect créateur, le Verbe peut encore se définir comme la scission de l'Un
(le point suprême des traditions orientales), à partir de laquelle s'étagent les différents
aspects de la Création, définis par Leo Schaya comme la cristallisation des
possibilités manifestables de l'Un, qui commencent par ses vibrations cosmiques. (Le
panorama synchrétique esquissé dans cet article est fidèle à l'identité des principes
des grandes traditions, chacune pourvue de son vocabulaire symbolique.)
Cette scission semble interprétée dans les premiers mots du Prologue de l'Évangile
de saint Jean: «Au commencement était le Verbe [Logos]/ et le Verbe était avec Dieu/
et le Verbe était Dieu». L'identification du Verbe à Dieu, après leur distinction
(«avec»), exprime le mystère de la scission de l'Un, dont résulte la Création où
s'emploie la volonté divine. Et bientôt le Verbe «fait chair», c'est-à-dire «le Fils
unique» qui tient sa gloire «de son Père» et qui se tourne «vers le sein du Père»,
donne l'aspect d'un rapport parental au mythe de l'Un auquel retournent les
«vibrations» engendrées à partir de sa scission. Il n'existe donc pas de coupure entre
la notion du Verbe et celle du «Verbe incarné», qui implique la personne du Christ.
Autour du «Fils unique», les fils de Dieu que nous sommes sont émanés de la
5 Verbe /Verbum /Word; Verb
«lumière» du Verbe, comme le multiple est produit par l'irradiation de l'Un. Les
métaphores sonores et / ou lumineuses de cette irradiation ont laissé des traces – ou
simplement revivent, sous des formes altérées, dans les chefs-d'œuvre profanes de la
littérature universelle. Mais dans ces derniers, le symbolisme des détails suggérant
cette transposition semble parfois perdre ses couleurs religieuses...
Rappelons, avant de spécifier l'impact du mythe du Verbe dans la littérature profane,
que ce rayonnement actif de l'Un, dans la tradition juive, est dépeint comme la mise
en jeu des «lettres fondamentales», où se particularise la vibration de la parole divine.
La tradition orientale est plus elliptique, avec le monosyllabe «AUM», censé
reproduire le processus même de la manifestation, qui se voit encore représenté par
certaines associations de couleurs dans les peintures d'inspiration sacrée. Cette
croyance évoque les prières impliquant le nom divin qui dans diverses traditions sont
supposées adapter pour les sensibilités humaines la vibration de la parole divine,
interprétée dans des rythmes dont la perception s'accompagne d'une élévation
spirituelle, vécue comme une participation au mystère divin.
Le mythe du Verbe ne porte pas vainement son nom. Peut-être le Word anglais ou le
Wort allemand expriment-ils plus simplement les implications langagières de ce
mythe. Pourtant la notion du «Verbe» vaut par le sens grammatical du verbe,
principe vital du discours. Cette catégorie syntaxique intéresse des modalités aussi
diversifiées que celles de l'être, de l'avoir, du vouloir – toutes confondues dans l'agir
divin, sous son aspect créateur.
Il faut souligner l'impact de ce mythe dans la conception du langage humain, entendu
par les théologiens et par les poètes comme un écho amoindri du Verbe divin. C'est
d'abord la justification essentielle, même si elle n'est pas clairement avouée, de la
littérature sacrée.
Quoi qu'il en soit l'image du Verbe, telle que l'imposent les textes sacrés, les grands
mystiques ou certains philosophes, déborde donc l'idée d'une parole divine qui, ne
serait-ce qu'à travers le langage humain, surtout traité par les écrivains, résonnerait
simplement dans nos mémoires. Nous sommes pétris par et dans cette parole qui
éprouve sa grandeur dans une sorte d'écho lui revenant, un écho dont nous serions
un constituant privilégié. L'actualité de ce mythe sans âge pour nos consciences
modernes se vérifie à l'écoute des écrivains chez qui le modèle du Verbe, en question
dans leurs œuvres, trouve un relief particulier. On songe à la «Réponse à une mise
en accusation» de Victor Hugo dans Les Contemplations, même si l'éloge du Verbe,
comparant laudatif du «mot» hugolien, accompagne une condamnation de la
versification classique, fustigée par les «douze plumes en rond» qui restent une image
quasi religieuse de la perfection. Les aspirations unitaires de ces écrivains (qui
intéressent, outre leur vision du monde, les aspects formels de leur production),
peuvent d'abord s'apprécier comme un effort pour transposer, sur le plan de l'écriture,
les aspects divers d'un mythe dont l'existence même est questionnée dans des œuvres
dont le Verbe est, implicitement ou explicitement, le thème majeur.
Mais chez certains d'entre eux (les plus représentatifs de la pensée occidentale
moderne), le Verbe devenu thème du poème ou du récit, s'il reste le modèle hors
d'atteinte de la parole poétique, semble être parfois l'objet d'une critique qui n'est pas
toujours consciente. – Quand l'adhésion spirituelle de l'écrivain aux vérités
fondamentales du dogme semble démentie par les détails du texte suggérant une
remise en question de ces vérités. Cette critique, consciente ou non, s'autorise par le
rapport d'analogie entre les aspects du mythe en question et les moyens spontanément
mis en œuvre par cette parole, encline à tourner en dérision (ou pire à condamner)
ses propres élans démiurgiques, et surtout les moyens qui les servent.
Ces écrivains, majeurs de la littérature profane, semblent avoir ressenti leur pouvoir,
fondé sur les sonorités de la langue et sur les rythmes de la syntaxe, mais encore sur
le mouvement général qui conduit l'œuvre en cours (quel qu'en soit le genre) comme
un équivalent profane de l'agir du Verbe. Victor Hugo est un exemple fameux de
6 Verbe/Verbum/Word; Verb
cette tendance, avec sa Réponse à un acte d'accusation. On peut citer encore, dans
Les Orientales, les vers des Tronçons du serpent où ces tronçons, comme «deux
bouches frémissantes» sont l'image mythique, peu engageante, du «génie» du poète.
Cette identification du verbe poétique au Verbe divin se nuance parfois, notamment
à l'époque moderne, par une méfiance déclarée à l'égard du dogme, une méfiance
dont certaines œuvres portent la trace.
Cette condamnation paradoxale prend la forme des images ou des situations décrites:
autant d'aspects du dualisme violent, qui marquent la limite de l'Harmonie idéale,
rendue à la tension (plutôt qu'à l'équilibre) des contraires. Et cette visée critique
rejaillit sur le mythe de la scission de l'Un (autrement dit du Verbe) qui domine
l'horizon thématique de ces œuvres littéraires.
Les vertus du rythme et la fluctuance de ses principes élémentaires, qui s'apparentent
au rapport (métaphysique) de l'Un et du Deux, reçoivent les couleurs de la violence
dualiste, à travers les motifs de l'action dominée par le thème de l'unité rompue.
Cette violence en effet caractérise les détails de l'action (ou du texte) qui peuvent se
lire comme des allusions, ou du moins des reflets spontanés de ce rapport de l'Un et
du Deux.
Dans les textes sacrés eux-mêmes, la mythologie déployée autour de la métaphysique
du Verbe confirme cette violence: qu'il s'agisse des mythes orientaux de la Création,
ou des métaphores cernant l'agir divin, par exemple dans le Zohar... Mircea Eliade
s'est intéressé aux mythes de création par sacrifice, qui imprègnent notre conception
de la création artistique. Mais chez Kafka par exemple, le sacrifice de soi–même,
pratiqué dans l'écriture, est une expérience à partir de laquelle semble jugé le mythe
qui ne fournirait plus à cette expérience une quelconque justification spirituelle.
Ces remarques risquées, qu'il reste à illustrer par des exemples, soulèvent un
problème spécifiquement littéraire. L'idée même de cette «critique» qui implique
chez certains écrivains profanes tous les plans du texte, est sans doute l'aspect le plus
fascinant de la tendance à la «mise en abyme «– c'est-à-dire les tendances introspecti-
ves dont résulte ce questionnement de l'Harmonie, doublé d'un verdict intéressant le
mythe du Verbe. Or la principale définition de l'action du Verbe: son «reflux en Lui-
même», pourrait s'appliquer à ce phénomène. Quoi qu'il en soit, les contours du
mythe du Verbe reçoivent un éclairage particulier lorsqu'il est jaugé avec une
suspicion d'ailleurs fort inégale par la plume de certains écrivains, dont les noms
seront cités dans cet article. Le lecteur excusera la partialité de ces références
littéraires, qui restent exemplaires d'une problématique intéressant des auteurs
d'époques et de cultures diverses, dont il serait téméraire de vouloir dresser la liste.
Le Verbe comme thème de réflexion
«Dieu est le Verbe de son Père; Dieu est à la fois Père et Fils», écrit Wolfram von
Eschenbach dans son Parzival où le conflit des doubles rivaux, résolu dans la
violence, jette une ombre sur cette définition où s'exorcisent les fantasmes de
parricide, pressentis dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes par Wolfram, qui
les accentue dans son Parzival.
Cette ambiguïté trouve des accents cruciaux chez Maître Eckhart, porte-parole
éminent de la métaphysique chrétienne. Les déclarations concernant l'identité du
Père, du sujet croyant et du Verbe, tous «un dans la lumière» (sermon 49) et la
nécessité de «devenir fils, dans le cœur du Père» recouvrent le souci de maîtriser
l'impact des «images» extérieures, autrement dit les pulsions mimétiques qui
corrompent le genre humain, réorientées dans une introspection «mystique» justifiée
comme une quête de (ou du) «soi». (Voir Maître Eckhart, Sermons I à III,
Paris : Seuil, 1974–1979.) Outre le thème filé de cette corruption, la véhémence de
certains sermons trahit la pression de la violence, surmontée dans des pratiques
spirituelles (et textuelles?) que ce souci de la violence semblerait dicter.
7 Verbe /Verbum /Word; Verb
La mise en œuvre du Verbe est l'objet, dans la Genèse, d'une imagerie à laquelle n'est
pas étrangère celle qui, par exemple dans le Livre des Rois, s'applique au rapport
d'Élie et d'Élisée – jusqu'au décor de leur séparation. Melville, dans certains chapitres
de Billy Budd, se montre conscient de cette valeur symbolique, lorsqu'il évoque le
drame des deux prophètes à propos de celui de Billy Budd qui s'impose comme une
incarnation (christique) du verbe poétique de Melville (voir M. Arouimi, «Billy Budd
ou La Beauté chiffrée», R.S.H., 243, 1996, p.93-111). Les réflexions du narra-
teur–auteur sur la perfection formelle (suspecte à ses yeux) de son récit sont d'ailleurs
finement rattachées au conflit de doubles, qui sera fatal à Billy Budd. Ce dernier,
jusque dans son agonie, incarne les aspects majeurs du mythe du Verbe. Cette visée
allégorique se confirme dans les trois usages du mot tongue, qui scellent le rapport
des deux personnages antagonistes et de leur arbitre, le capitaine Vere. Le cœur de
Budd, autour duquel s'unissent dans un écho sonore tous les cœurs de l'équipage,
évoque le «Cœur mystique» qui nomme le mystère de l'auto-connaissance divine, et
partant le reflux en Lui-même du Verbe divin.
La beauté féminine de Budd évoque plus nettement le mythe de l'Androgyne. Même
si le personnage de Melville emprunte ses traits aux figures de traditions très
diverses, on songe à l'ésotérisme chrétien, où le symbolisme unitaire du Verbe est
«interprété» dans la vision de Marie épouse du Verbe (principe actif). Au dernier
chapitre de l'Apocalypse de Jean, l'union de l'Époux et de la Fiancée céleste
(assimilée à la Cité où se matérialise le Verbe divin) relaie le symbolisme de
l'apparition, au premier chapitre, du Verbe–Seigneur. Et cet effet de symétrie suggère
la conformité de l'espace textuel du récit sacré avec la conception du Verbe. L’union
de la Fiancée et de l’Époux illustre celle de la Rigueur et de la Douceur qui, dans la
tradition juive, nomme un aspect majeur de la «shekhina» (c'est le nom donné au
concert des émanations de l'Un dont résulte l'existence du cosmos. Et c'est encore
l'attribut le plus préoccupant de Billy Budd, dont le corps est éclairé par les rayons
de l'aube, préférés par Melville à la «shekhina de l'aube», raturée dans le manuscrit.).
Cette rature traduit un désengagement du sacré, qui se précise lors de l'agonie de
Budd, avec les détails du décor (objets doubles, lignes parallèles) qui dans leur
horreur, semblent interpréter les aspects fondamentaux de la conception du Verbe.
Cette critique impliquant les mythes parents du Verbe et de l'Androgyne se
renouvelle chez Kafka, dans le relais qui associe le personnage de Rosa et, dans Ein
Landartz, la plaie rose et grouillante de vers du malade visité par le «médecin de
campagne» dont le drame nocturne est une représentation du drame artistique de
Kafka, touché par le démon de l'inspiration. Certains détails de l'action concernant
la famille du malade rappellent les visées religieuses de ce récit. Le prêtre qui reste
chez lui et qui «transforme en charpie les ornements sacerdotaux» précise en effet la
valeur symbolique de la plaie, évoquée quelques lignes plus tôt. (O.C.II, Pléiade,
1980, p. 444).
On peut encore songer ici à l'Arlequin de Heart of Darkness, autre androgyne et fils
d'un archiprêtre, que ses attitudes et ses attributs vestimentaires désignent comme
une représentation du Verbe. – Surtout si l'on exploite, plus profondément que ne
l'ont fait certains commentateurs de ce récit, les ouvrages concernant les doctrines
orientales, vraisemblablement connus de Conrad. Mais ce personnage dont
l'apparence et les propos conjuguent les données des savoirs oriental et chrétien
s'impose en même temps comme une incarnation du désir mimétique, éprouvé par
tous les personnages pour un trafiquant poète, mythique personnage dont le dernier
cri: «The horror, the horror!» nomme l'essence de son verbe, autrement dit celui de
Conrad, dont ce fameux Kurtz incarne le talent.
Les liens qui rattachent ce Kurtz aux grandes figures de l'Apocalypse précisent les
enjeux d'une critique qui vise, à travers les principes auxquels on doit chez Conrad
une esthétique des contraires, les fondements d'un dogme dont Conrad dans certaines
de ses lettres méprise âprement tous les mystères. Cette liberté d'esprit s'expliquerait
par les «pulsions contradictoires» dont Conrad observait le rôle dans l'émergence de
8 Verbe/Verbum/Word; Verb
son propre verbe, comparé au «Fiat Lux». L'esthétique pluriforme engendrée par
cette contradiction coïncide avec celle qui, dans les textes sacrés, se justifie comme
le reflet textuel de Verbe en action.
Cette ambiguïté n'est pas si moderne: chez Shakespeare, la célébration du Verbe, par
exemple dans Henry V, prend d'abord la forme de celle du cheval, figure du Verbe
dans les traditions ésotériques si prisées au temps de Shakespeare. Mais cette
célébration du Verbe dans l’acte III, nuancée par l'évocation symétrique de chevaux
fourbus dans l’acte IV, n’est pas moins parlante que la floraison de détails qualifiés
par les numéraux “un” et “deux”, répartis sur l’ensemble du drame, et dans lesquels
semble projetée la violence (dualiste) surmontée dans le mystère du Verbe. (Voir M.
Arouimi: «Du Verbe de Moïse à celui de Shakespeare», Analyses et réflexions sur
'Henry V', Ellipses, 2000, p. 129-136). Les phrases lapidaires du Zohar affirmant le
rapport réversible de l'Un et du Deux ne sont pas moins suspectes quand elles
s’accompagnent d’une imagerie (dualiste) complexe, caractérisée par la violence.
Mieux que les dramaturges de l'Angleterre élisabéthaine, les philosophes de
l'Allemagne romantique se sont inquiétés, pour l'assumer à tout prix, de la violence
inhérente à cette rupture de l'Un, confirmé dans son unité par le déploiement de la
dualité. Or les poètes, prosateurs ou dramaturges de cette époque ont laissé des
œuvres où ce mystère semble interprété sur le plan des relations humaines,
déterminées par une conflictualité qui peut prendre des formes larvées. Ainsi chez
certains d'entre eux, la célébration du Verbe (sous-jacente aux justifications
d'Eichendorff concernant la finalité de son travail littéraire) semble reniée dans la
mise à jour d'une violence interhumaine, dont il est difficile de dire si elle résulte de
la dérive de l'humanité, éloignée de son principe divin, ou si elle exprime le tourment
originel qui serait à l'origine de ces conceptions mythiques.
Le rapport fluctuant du Double et de l'Un ne peut définir le Verbe qu'en raison du
rayonnement de ce rapport, dont l'expansion créatrice est mesurée par des nombres
auxquels la tradition attribue des valeurs symboliques. – C'est la «science des
nombres», dont nous verrons bientôt l'intérêt eu égard au Verbe. Le «moteur
immobile qui meut toute chose», repris par Maître Eckhart à Aristote, est une image
de l'agir de l'Un, principe des harmonies de la Création. La pensée juive et la pensée
orientale se rejoignent dans la conception des neuf Sephiroth et des neuf triangles
qui représentent le déploiement du Verbe, autrement dit, comme l'écrivait Schelling
dans Les Âges du Monde: la «connaissance de soi du centre invisible à partir duquel
tout se déploie.» Dans la tradition chrétienne, le dogme de la trinité divine, opposé
à celui de la trinité infernale dans l'Apocalypse par le philosophe romantique
Bengler, illustre cet intérêt pour le nombre 3, identifié par F. Schuon comme le
«Principe de la Création», même s'«(il n'y a) pas que le nombre trois qui régit la
structure de l'univers; le principe suprême (ayant) aussi un aspect de dualité et un
aspect de quaternité, et même des aspects plus complexes.» (Résumé de métaphysique
intégrale, p. 39-40).
La tradition chinoise n'est pas en reste, avec les «graphiques de Dieu» dont les lignes
sont une mise en scène graphique de tous les êtres du cosmos en devenir. Les
digrammes et les trigrammes du Yi–king sont rapprochés du mythe du Verbe par
Matgioi. Les références fugitives à la Chine dans Aurélia de Nerval, ou chez Conrad,
Kafka, trouveraient leur sens dans leur curiosité (avouée ou probable) pour le mythe
du Verbe.
On peut interpréter dans le même sens l'intérêt amusé de Nerval (La Main
enchantée), Kafka (Dans notre synagogue), Conrad (Au cœur des ténèbres), pour le
symbolisme du triangle. On ne saurait dresser la liste des écrivains qui ont été
fascinés par la conception du Point central, avili dans les visions de certains
fragments de Kafka où les souvenirs de la littérature hassidique s'entrecroisent avec
ceux de grands textes philosophiques ou poétiques de la Chine ancienne. Et la
9 Verbe /Verbum /Word; Verb
Correspondance de Conrad recèle des passages qui, dans l'extase quasi mystique que
lui inspire une vision concentrique du paysage, rachètent le questionnement
inquisitoire du Verbe, pratiqué dans ses œuvres romanesques.
Le mouvement du Verbe
La conception musicale du Verbe, notamment dans l'Allemagne romantique, a certes
servi de modèle à une certaine vision de l'activité littéraire. Mais évoquons d'abord
le mouvement du Verbe dont se rapprochent, envisagés dans leurs grandes lignes et
dans leur esprit, les chefs-d'œuvre littéraires.
Le Verbe ne fait qu'un avec son agir, caractérisé comme un mouvement de flux et de
relux (en Lui–même), si bien décrit par Léo Schaya. Le Verbe divin, écrit Maître
Eckhart, «flue au–dehors et demeure cependant dans la volonté qui l'a produit» (s.9).
Or, la métaphysique envisage sous un jour positif la contradiction suggérée par ce
mouvement, assumée par Schelling dans son relief le plus dualiste.
Ce déploiement du Verbe impliquant son repli, se transpose (comme l'ont remarqué
certains commentateurs) dans l'architecture textuelle de l'Apocalypse dont les
premiers versets (un peu comme dans la Bhagavat Gîta, rapprochée de l'Apocalypse
par H. P. Blavatsky), nous proposent une personnification du Verbe, sous les traits
du «Vivant». La symétrie qui associe les évocations (explicites ou symboliques) du
Verbe semble adaptée au mythe de la résorption du multiple dans l'Un, que
l'Apocalypse représente dans l'entrée des purs dans la Jérusalem céleste.
Sous la plume d'écrivains de diverses époques, le thème de la Jérusalem céleste
(thème déclaré ou altéré par leur imagination) éclaire l'architecture de certaines
œuvres (poèmes, récits) qui, par des effets de symétrie intéressant les situations
décrites et par la récurrence de détails–clés, définit un cadre approprié pour la quête
(amoureuse, intérieure) du narrateur ou des personnages principaux. Le lecteur peut
ainsi revivre le cheminement quasi mystique qui les conduit à la vérité enfouie dans
leur propre cœur. Le rapport entre la mystique du Verbe – associée à celle du Cœur
–, le bâti du récit et l'expérience du personnage principal; ce rapport a inspiré les
passages les plus denses de Billy Budd.
Le thème du retour, associé à la structure en boucle (ou en cercle) de ces œuvres,
comporte un sens hautement spirituel, que l'on peut qualifier de métaphysique. Les
vibrations cosmiques émanées de l'Un jaillissent «dans un mouvement centrifuge de
leur source divine, la recherchant aussitôt par un mouvement contraire, centripète:
elles gravitent autour de l'Un immanent, qui est leur Axe central», écrit Léo Schaya
dans Naissance à l'Esprit, (p. 38.)
La littérature orientale (le Genji Monogatari) est exemplaire de cette tendance
intéressant la thématique et la forme textuelle, qui accède à une évidence (peu étudiée
par les spécialistes) dans les premiers poèmes de Claudel, ou, dans certaines
répliques de L'échange, dont la structure en boucle est soulignée par des détails
similaires : certains de ces détails disposés en symétrie, illustrent justement le thème
du retour.
Les épisodes des récits du Graal ne sont pas moins parlants. Et dans ces récits, sous
la plume de Chrétien de Troyes ou de Wolfram von Eschenbach, les traits de la
Jérusalem céleste semblent avoir été empruntés pour le décor de certaines situations.
Mais à l'époque moderne un écrivain comme Conrad, s'il ressent sans doute la
grandeur spirituelle de ce thème du retour, n'en fait pas moins une parodie
outrancière dans plusieurs de ses romans. Et Jérusalem et Babylone confondent leurs
traits, dans le cadre urbanistique des deux épisodes marquant dans Heart of Darkness
les extrémités de l'aventure du narrateur Marlow.
Des traces mémorielles similaires de l'Apocalypse peuvent se remarquer dans le
Taugenichts d'Eichendorff qui n'éprouve pas, à l'heure où il écrit, la suspicion
sacrilège d'un Conrad. Aux deux extrémités du Taugenichts, la même vision de
l'étang où des cygnes décrivent un cercle génère d'abord un sentiment d'angoisse dans
le cœur de celui qui guette sa belle, divinisée par ses attributs. Les données
10 Verbe/Verbum/Word; Verb
fondamentales de la métaphysique juive ou chrétienne (voir Robert Mühler, «Der
Pœtenmantel», in Eichendorff heute, 1960, p.180-195) inspirent maints détails de
l'action rapportée, et le mouvement des cygnes qui «passent et repassent», en même
temps qu'il se propose comme une image de la structure du récit dont il marque les
deux pôles, peut s'apprécier comme un symbole du Verbe dont l'écrivain semble
pénétrer le mystère, dans un décryptage du monde observable, préalable à l'activité
littéraire.
La file des cercles qui ponctuent Aurélia n'est pas moins expressive chez Nerval, avec
les valeurs dualistes et funèbres qui singularisent la première et la dernière des huit
occurrences de ce motif. Il en va de même dans le Cristo si è fermato a Eboli de
Carlo Levi, dont la structure en boucle, balisée par deux références à la Jérusalem
céleste, est rythmée elle aussi par huit occurrences du même motif du cercle (une
série que referment les «yeux cerclés de la mort»). Dans Billy Budd, la série
harmonisée des huit mentions d'oiseaux se referme par les cercles que décrivent de
funèbres oiseaux de mer, lors des funérailles de Billy. (Les détails temporels de sa
mort, annoncée par huit coups de cloche, livrent la clé de ce rythme d'écriture qui
s'étend à bien d'autres motifs....) Rimbaud est plus elliptique, avec les motifs
circulaires qui mesurent la structure en diptyque de Mystique, une Illumination
inspirée par une peinture du Jugement dernier, dans laquelle Rimbaud questionne
l'aura surnaturelle de son propre génie lyrique.
Dans ses grandes lignes, la conception du Verbe implique un renversement de nos
repères spatio–temporels, qui rejoint l'optique imposée par la philosophie et la
littérature orientales. Notre époque moderne semble redécouvrir la vérité, cernée par
ces mots de Jacob Bœhme: «rien n'est près et rien n'est loin» pour la volonté divine.
Mais cette redécouverte, notamment chez Kafka, s'effectue au prix de la mise à jour
de l'antagonisme violent, surmonté dans ce type de définition. L'équivalence du
proche et du lointain, dans certaine phrase de Chacals et Arabes, dessine le cadre
spirituel adapté à la rivalité mimétique des chacals et des Arabes, dans une situation
où Kafka remodèle un rituel sacrificiel dont les justifications métaphysiques
succombent sous sa plume. (L'Islam n'ignore pas le concept de création perpétuelle,
et F.Schuon dans son Résumé de métaphysique intégrale rappelle les équivalences
islamique et hindoue de la «creatio per verbum».) Le rapprochement de certains
énoncés de ce récit et des passages du Journal où Kafka s'interroge sur le mystère de
son désir créateur suggère les aspects autocritiques d'un verdict qui embrasse verbe
poétique et Verbe créateur. Ce dernier est notamment impliqué dans la ronde unie
des chacals, animée par le même or de leurs yeux...
L'antagonisme en question inspirait à Schelling (dans Les Âges du Monde) des
remarques qui font le sel de sa philosophie naturaliste. L'«intolérance réciproque de
principes cœxistant» est ressentie comme le fondement d'un ordre (naturel) auquel
on peut assimiler l'agir du Verbe. Et pour ce philosophe romantique, cette intolérance
trouve son chiffre dans l'«équipolence» du Oui et du Non, définie comme l'«opposi-
tion originelle» qui s'exprime dans les formes de la Création. Or, sous la plume de
Shakespeare, Marivaux, Eichendorff, Melville, Conrad et Claudel, l'inscription des
adverbes «oui» et «non» aurait sa place dans le champ métaphorique impliquant la
notion du Verbe, thème sous-jacent de leurs œuvres.
Ainsi chez Marivaux l'inscription de ces adverbes, dans les répliques de maintes
scènes de La seconde surprise de l'amour, souligne la construction symétrique de ces
scènes, adaptée au conflit de doubles qui s'y déroule. L'intérêt d'Eichendorff pour
Marivaux est peut-être fondé sur ce phénomène, qui se renouvelle avec éclat dans les
chapitres III et X du Taugenichts. Et dans Le Pain dur, une allusion aux «marivauda-
ges» incite à apprécier la gamme définie par la répétition des adverbes «Non» et
«Oui», dans la bouche du père et du sacrificateur qui accomplit un parricide. En
11 Verbe /Verbum /Word; Verb
même temps la contradiction qui caractérise l'agir et le comportement de ce père
trouve un écho spontané dans la litanie de ces deux adverbes...
La conjonction des contraires, signifiée par la tension du Oui et du Non ou par
l'esthétique du contraste (ou de l'oxymore) – encore un point commun de ces
écrivains – trouverait sa plus remarquable expression dans la modulation sonore du
Verbe (le Son causal des traditions orientales, associé à des symboles chromatiques),
restituée par le talent des poètes. C'est dans ce sens qu'il faudrait comprendre
l'expression de Rimbaud «alchimie du verbe», qui couvre les deux aspects, sonore et
sémantique, d'un même jeu sur les contraires. («Les rythmes instinctifs» en question
dans Alchimie du Verbe caractérisent les poèmes où s’opère une véritable «alchimie»
des valeurs.)
La voix du Seigneur dans l'Apocalypse clame «comme une trompette.» (Bible de
Jérusalem, Ap. 1: 10). Le souvenir de cette voix, comparée à «la voix des grandes
eaux» (Ap. 1: 15) a laissé des traces dans certains poèmes de Rimbaud et dans maints
romans de Conrad, qui entraîne dans la dérision de ses propres pouvoirs langagiers
(éprouvés comme l'émergence du «Fiat Lux») l'idéal que le dogme désigne par ces
symboles sonores. Cette dérision (moins explicite que les aveux du locuteur de Une
Saison en Enfer) concerne avant tout l'exercice «musical» des rythmes auxquels
s'adonne l'écrivain. – Rythmes si proches de ceux que la tradition attribue à la
propagation du Verbe, connus surtout par les litanies oratoires qui les traduisent pour
nos sensibilités, susceptibles de «vibrer dans le Verbe» par de tels moyens. Certains
écrivains profanes, en retrouvant spontanément ces rythmes, s'amusent de cette
analogie que leur irréligiosité déclarée rend préoccupante.
Cette ambiguïté, encore une fois, recoupe une énigme peu apparente de l'Apocalypse,
dont les rythmes internes sont supposés médiatiser l'agir du Verbe. Ce livre biblique
rassemble en effet six allusions à la bouche du Seigneur ou des témoins (cet exemple
parmi tant d'autres vient à point dans notre enquête sur le Verbe): 1: 16, 2: 16, 3: 16,
puis 11: 5, 19: 15 et 21. (Soulignons le choix du verset 16 des trois premiers
chapitres pour les trois premières allusions.) De même, on dénombre six énoncés
dans lesquels sont évoquées les gueules infernales, ou celles qui châtient l'humanité
dont elles incarnent peut–être l'orgueil: 9: 17, 18, 19 – les chevaux cracheurs de feu
– et 12: 15, 16; 16: 13 – le serpent, le Dragon, la Bête associée au faux prophète –.
(Certains de ces versets comportent plusieurs mentions de la «gueule», et le verset
16 du ch.12 associe curieusement la gueule du Dragon et la bouche de la Terre qui
en vient à bout.)
Le rapport 6 / 6 est donc animé par un dynamisme sur lequel on pourrait longuement
s'interroger. Le chiasme des valeurs célestes et infernales dessiné par la succession
de ces douze versets donne une forme graphique au «mouvement» du Verbe, qui
implique la production du multiple à partir de l'Un. La multiplication des allusions
néfastes dans les versets des chapitres 12 et 16 participerait à cet effet d'harmonie
imitative, où l'essor du Mal, associé au multiple, est nuancé par les deux allusions
divines du chapitre 19, elles–mêmes précédées au verset 13 par l'inscription du
«Verbe de Dieu». Ces bouches et ces gueules sont un symbole contrasté du Verbe et
de la volonté maligne qui en jalouse les pouvoirs. Or le Verbe a d'autres symboles fort
connus, que l'on peut évoquer avant d'estimer les moyens spontanément mis en œuvre
par certains écrivains pour concurrencer (ou transposer) les magies du «Verbe divin».
Les symboles du Verbe
Dans l'Apocalypse, l'épée à double tranchant qui sort de la bouche du Vivant
matérialise le rapport de l'Un et du Deux, et donc le Verbe jaillissant. Cette épée
mythique, qui semble avoir hanté l'imagination de Chrétien de Troyes et de ses
continuateurs, est l'objet d'une dérision insurpassée dans un des nombreux romans
de Conrad où s'entrecroisent les souvenirs de l'Apocalypse, objet d'une allusion
explicite dans Under Western Eyes. Dans The Shadow Line (où l'usage du mot
«revelation» révèle cet intertexte majeur), le narrateur lance six mots («six words»)
12 Verbe/Verbum/Word; Verb
à un personnage (son double négatif) qui semble se plonger dans la gorge une paire
de ciseaux («scissors»). La parenté phonique des mots scissors et six words inspire
l'énigme tendue par la série de six termes qui rassemble les cinq répétitions du mot
scissors et l'unique emploi de l'expression «six words». (Voir M. Arouimi:
«L’Apocalypse, entre Baudelaire et Conrad», Mythes, Croyances, Religions, 19;
2002, p. 69-80.)
Comme chez Edgard Pœ et surtout Shakespeare (chez qui le thème des gorges
tranchées revêt un symbolisme intéressant l'unité rompue), le mot word s'auréole d'un
sens religieux, confirmé par d'autres détails du texte. Et ce rythme en six temps,
souligné par l'indice des «six words», coïncide avec les mesures attribuées par la
tradition au principe qui régit la structure de l'univers.
Le Verbe, associé à l'idée d'une «lumière véritable» dans le Prologue de Jean, peut
prendre l'aspect d'une fumée – dans les traditions orientales ou dans l'Ancien
Testament. Les thèmes associés de la lumière et de la fumée, dans les chefs–d'œuvre
littéraires comportant des allusions aux grandes traditions religieuses, ravivent–ils
ce symbolisme ? Quel que soit le poids de l'Apocalypse dans la mémoire de Rimbaud,
le fleuve de vie qui traverse la Jérusalem céleste – autre image du Verbe – peut se
voir comme le modèle idéal de la rivière chanteuse qui, dans Le Dormeur du val,
donne une forme visible à l'élan lyrique, célébré de diverses manières dans les
poèmes de Rimbaud. Mais dans le premier et le dernier vers de ce sonnet, le «trou
de verdure où chante une rivière» et les «deux trous rouges au côté droit» du soldat
défunt, s'ils rappellent le rapport mythique de l'Un et du Deux, expriment en fait la
violence qui se domestiquerait dans les harmonies charriées par cette «rivière», reflet
profane de celles que génère le déploiement du Verbe.
Le Verbe, défini comme la vibration originelle, trouve son symbole animal le plus
connu dans le serpent. L'Ouroboros grec est le principe de l'ordonnancement du
cosmos. Le serpent reçoit un symbolisme analogue chez les Celtes et surtout chez les
Égyptiens, qui voient dans le serpent (Atoum) l'origine de la Création. De même en
Inde, où le serpent est assimilé au Chaos premier, c'est–à–dire au non–manifesté.
Dans les traditions orientales, le serpent représente encore la continuité des choses
et la renaissance des êtres.
Or, ce symbolisme se renouvelle sous la plume de Rimbaud, qui lui associe
insidieusement l'idée d'une filiation... littéraire, envenimée par une violence que l'on
peut qualifier de parricide, dans le fameux poème adressé à Théodore de Banville:
Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs. Le motif du serpent y voisine avec celui de
l'Œuf qui évoque, comme le serpent, une cosmogonie orphique selon laquelle un
Dieu–serpent engendra l'Œuf qui représente l'origine de la Création proprement dite.
Mais dans ce poème, la symétrie des «Tas d'œufs frits dans de vieux chapeaux» et des
«Calices pleins d'Œufs de feu» (II, 9 – IV, 8) fustige l'idéal «cosmique», encore
mieux visé par le relais sinueux qui implique les occurrences du motif du serpent.
Au cœur de ce long poème articulé en plusieurs sections, les «constrictors d'un
hexamètre» partagent le symbolisme de la rivière chanteuse du Dormeur du val et
celui des bavures florales qui, dans Ce qu'on dit, sont l'image de pouvoir de celui qui
signe «Alcide Bava». Le déroulement graphique du poème, avec toutes les harmonies
textuelles qui le tendent (les ressources lyriques de la répétition), restitue d'ailleurs
pour les yeux du lecteur l'image du serpent.
Une allusion aux «crotales», située après les douze premières strophes du poème,
précède ces constrictors, avec lesquels elle délimite une suite de six strophes. Et ces
constrictors sont encore relayés, à six strophes de distance, par les «hydres» qui
préfigurent l'«Hydre intime sans gueules» qui dans Comédie de la soif incarne, pour
le rendre à la violence, le rapport de l'Un et du multiple. De même dans Ce qu'on dit,
le fondement des harmonies qui se raidissent dans la succession de ces reptiles,
apparaît comme une violence meurtrière, dont les enjeux du poème précisent la
nature dualiste. (De multiples allusions suggèrent d'ailleurs les retombées de cette
13 Verbe /Verbum /Word; Verb
critique sur le dogme de différentes traditions, et l'identification très complexe de
Rimbaud à Banville – une forme vécue du conflit du Père et du Fils mythiques – est
le support d'une remise en cause du mouvement giratoire du Verbe, qui est l'objet
occulte, vaguement conscient de cette performance littéraire.)
Dans l'Apocalypse, le cheval blanc monté par le cavalier fidèle dont le nom est «le
Verbe de Dieu» (19: 13) s'auréole du symbolisme qui, dans l'ésotérisme juif, associe
le Verbe et le cheval. Ce symbolisme, perpétué par les doctrines occultistes, reçoit son
plus fameux éclat dans certains hymnes du Véda, notamment Le Cheval du Sacrifice
(RV. I.163), ou Indra (RV. III. 38) dont les premiers vers associent métaphorique-
ment le «poème» et le «cheval de course».
Le même symbolisme trouve une flamboyante expression sous la plume de
Shakespeare dans Henry V: le cheval d'un prince français est célébré comme
l'incarnation des ressources du langage (pas seulement poétique). Mais cette
célébration comporte un revers, suggéré par la vision morbide de chevaux expirants
(IV, 2) qui sont le pendant symétrique de l'évocation laudative (III, 8). (Cette
symétrie est un modeste exemple de la perfection formelle qui satisfait aux
aspirations unitaires que Shakespeare partage avec les artistes et les penseurs de son
temps.)
L'association du cheval et du lyrisme en III, 8 (le sabot, plus «musical» que la flûte
d'Hermès) se renouvelle dans l'imagination de Rimbaud, mais avec des valeurs
macabres qui accentuent, indépendamment de tout rapport d'influence (malgré
l'intérêt de Rimbaud pour Shakespeare), la visée critique du dramaturge. Dans
l'Illumination Jeunesse en effet, le «cheval percé par la peste carbonique» où le
«voyant» fustige l'idéal unitaire, indissociable de la violence qui le fonde, ce cheval
fait suite à une allusion à la «séance des rhythmes», dont il complète le sens.
(L'horreur du bubon contamine le mythe unitaire dont l'imagination de Rimbaud
multiplie les symboles dans ses poèmes.) Et dans cette première section de Jeunesse,
intitulée Dimanche, s'enchaînent des symboles dualistes – autant de reflets tragiques
du drame de l'unité rompue. Mais Shakespeare poursuit la même enquête expose la
même énigme, dans le conflit verbal des deux princes français qui surenchérissent
mimétiquement lors du dilemme engendré par le cheval du Dauphin, pourtant
dépeint comme l’incarnation du mariage alchimique des quatre éléments.
Le rapport symbolique du cheval et du Double – dans leur relation mutuelle au Verbe
– est plus apparent dans l'Illumination Ornières, où Rimbaud dispose en symétrie les
«chevaux de cirque tachetés» et les «juments bleues et noires» d'un convoi funèbre,
rassemblés dans un «défilé de féeries» où l'on doit reconnaître une image des
procédés de l'inventeur des «Illuminations». Kafka sera moins sophistiqué, en
projetant dans les deux chevaux de son «Médecin de campagne» sa conception de
l'art. Ce dernier est éprouvé par Kafka comme un sacerdoce infernal et comme
l'exorcisme d'une violence qui se chiffre dans la plaie du malade visité, le double de
ce médecin égaré.
Le symbolisme de la plaie (la division de l'unité) est d'ailleurs accentué par les vers
roses («rosig») dont elle est remplie. Ces vers sont l'image de l'Un «confondu avec
le multiple» (Je cite André Siganos, auteur de l'article «Bestiaire mythique» du
Dictionnaire des mythes littéraires, rubrique «Ver»). Dans ce récit de Kafka, la
première étape de cette dégradation de l'Un – sa division violente, plutôt que sa
scission – trouve un reflet dramatique dans le relais qui unit cette plaie et la joue de
«Rosa», mordue par les «deux rangées de dents» du terrible palefrenier, dans la
première moitié du récit. – Sans rien dire des détails violents qualifiés par le numéral
«deux» qui rythment le texte articulé en deux volets, dont ils soulignent l'unité.
Cette «Rosa serait donc l'équivalent de la rose peu mystique qui marque le cœur du
chapitre III du Taugenichts, un chapitre dont la construction symétrique mérite bien
le symbole de cette rose. Et ce «cœur» du chapitre est un cœur divisé par le «Oui» et
par le «Non» qui opposent les deux partenaires de cet épisode, un jeune violoniste et
14 Verbe/Verbum/Word; Verb
une jeune fille, simultanément prédateur et victime dans leur attraction réciproque.
Leur rencontre est d'ailleurs ombragée par la figure du Père absent (de la demoiselle)
dont sont évoquées la convoitise musicale et la table garnie, sur laquelle des dindons
et des oies farcies se substituent, avec les valeurs sacrificielles qui les auréolent, à
l'idéal quasi religieux nommé dans la rose que la fille offre au propre–à–rien.
On pourrait sans fin rassembler des exemples de l'imagerie amoureuse qui, sous la
plume de certains écrivains, honore une certaine idée du Verbe, sanctifiée dans
l'époux et la jeune mariée de l'avant–dernier chapitre de l'Apocalypse. Un peu comme
Rimbaud dans Royauté, Julien Gracq dans Au château d'Argol a exploité avec un art
rarement égalé ce mythe, dont les formes les plus diverses sont l'objet d'une synthèse
qui dans ce bref roman fait la part belle à la violence dualiste.
Henry V de Shakespeare vaut d'être encore cité ici, d'abord pour le couple formé par
Henry V, le roi «boucher» et Catherine, la princesse française sacrifiée dans le
dernier acte. Il s'agit bien d'une vision profane du mariage mystique, associée à des
problèmes de communications langagières qui précisent son rapport avec le mythe
du Verbe. Dans cet acte le contraste entre cette scène II (la dernière du drame) et la
scène I, dans laquelle s'affrontent deux soldats anglais, nous vaut une résurgence du
mythe de l'Androgyne, redoublée par l'érotisme latent du conflit des deux hommes
venus de contrées différentes, et qui ne parlent donc pas tout à fait la même langue.
Ce symbolisme, et les intentions critiques qui s'y attachent, se resserrent dans deux
énoncés similaires qui tendent un relais énigmatique à travers tout le drame de
Shakespeare, dont ils expriment les enjeux les plus secrets (Gallimard Folio, 1999).
C'est d'abord l'expression de Pistol qui s'exprime dans un français défaillant en II, 1:
«Couple a gorge (sic), that is the word» (96). Le mot word, comme le confirment
certains détails de cette courte réplique, renvoie au mythe du Verbe, contaminé par
la violence de cette image – et par le lapsus «Couple» qui exprime le rapport
mythique de l'Un et du Deux, questionné par le dramaturge dans d'autres œuvres,
drames ou poèmes. À présent ce rapport est stigmatisé par cette idée d'égorgement
dont Shakespeare fait un usage récurrent. L’harmonie de la série lexicale rassemblée
par ce thème atroce, révèle au moins la violence dont ne peut s’affranchir le principe
de l'Harmonie. Mieux encore: dans la réplique qui recèle la première occurrence du
mot «throat», cette image: «some say knives have edges» (90) peut se lire comme une
anamorphose de l'épée à double tranchant qui matérialise le Verbe jaillissant de la
bouche du Seigneur dans l'Apocalypse. (Et du Livre de Jean de Patmos, Shakespeare,
plus consciemment, évoque seulement la «putain de Babylone», en II, 3.)
Or Pistol parle de même, dans un meilleur français, en IV, 4 : «Oui, coupe la gorge,
par ma foi, peasant»... Mais le mot «foi» entraîne dans la vulgarité de son
énonciation, les justifications ésotériques de la technique littéraire qui se résume dans
la symétrie des deux énoncés impliquant le mot «gorge», ou dans la tension des deux
langues, aggravée par leur mélange explosif dans le premier énoncé.
La métaphysique chrétienne ignore le symbolisme du beurre baratté qui dans la
tradition hindoue (cf. Le Beurre rituel, RV. IV. 58) représente le mouvement du
Verbe (ou de la Cause première, nommée dans le «Son causal») et sa force
productrice (sans doute la brillance du beurre, son inconstante densité
participent–elles à ce symbolisme...). Pourtant les tartines beurrées proposées par un
ecclésiastique (et d'abord par un jeune joueur de cor de chasse) au propre-à-rien
d'Eichendorff apparaissent comme un équivalent occidental de cette imagerie. Et
d'autant mieux que l'ecclésiastique et le joueur de cor de chasse apparaissent comme
des doubles inversés dans ce chapitre IX du Taugenichts.
L'idéal unitaire si cher aux romantiques s'incarne encore dans le couple mieux visible
formé par l'ecclésiastique vêtu de gris et plongé dans son bréviaire et le jockey en
rouge armé d'une cravache. Cette cravache traduit, dans un aspect trop négatif, la
«Rigueur» associée à la «Douceur» pour exprimer la volonté divine, qui se prononce
15 Verbe /Verbum /Word; Verb
dans le «Verbe». Le sens de cette dérision s'accuse chez Conrad, avec le pain beurré
autour duquel s'unissent, pour aussitôt se séparer, les deux jeunes gens du récit
To–morrow. Cette union manquée fustige la conception du Logos, défini comme une
collection ou une union ordonnée de choses. – Une union dont le beurre, du moins
dans la Tradition orientale, est encore l'expression symbolique. L'échec de cette
rencontre trouve sa clé dans l'attitude contradictoire des pères des deux jeunes gens.
Le «double-bind» dont parle René Girard est-il pressenti par Conrad (et ses pairs
spirituels) comme le fondement du sacré, et plus particulièrement de la métaphysique
(du Verbe), à laquelle l'écrivain se sent lié par tant d'affinités?
Dans maints récits de Conrad, le thème des tissus (souvent frangés) s'impose comme
le signe du dualisme violent de l'action, malgré les allusions religieuses qui ne
permettent pas de voir dans ces tissus frangés ou rayés le reflet du «Soi principiel»,
autrement dit du Verbe qui dans les traditions orientales est encore symbolisé par le
tissage, comme le montre René Guénon dans Le Symbolisme de la Croix. Cette
dérive symbolique, justifiable comme une mise à jour de la violence fondatrice, se
prépare chez Nerval. Les visions de lignes parallèles dans La main enchantée
définissent une esthétique dont relève aussi bien le thème du tissu, associé dans
certain passage de Aurélia au motif de la toile d'araignée, dont R. Guénon a souligné
le symbolisme métaphysique. On peut encore songer au symbolisme analogue du
treillage, dont Nerval fait un emploi savamment mesuré dans Aurélia. La mimésis,
thème discret de ces passages, est d'ailleurs cernée dans ses aspects les plus violents
dans d'autres endroits du récit.
Cette interprétation déviante du mythe du Verbe, conduite avec différents moyens par
ces écrivains, pourrait trouver un appui paradoxal dans l'Apocalypse, où les
évocations de la Bête, aux chapitres 11 et 13, suggèrent un double axe de symétrie,
dans ce livre qui compte 22 chapitres. Le privilège de cette position dans le texte
validerait les revendications jalouses de la Bête à l'égard du Verbe. Ainsi Rimbaud
dans Mystique exprime toute la magie de son «alchimie du verbe» : («La douceur ...
des étoiles et du ciel... descend en face du talus,... contre notre face») en déformant
le contenu du verset qui rappelle les prodiges de la Bête, capable de «faire
descendre... le feu du ciel sur la terre devant les hommes.» (Je cite la Bible de
Lemaistre de Sacy, pratiquée par le jeune Rimbaud: Ap. 13: 13).
La Bête de la mer aux prises avec son double (la Bête de la terre) et avec son «image»
(que la seconde Bête a le pouvoir d'animer) incarne certes le culte de l'ego, opposé
à la lumière du Soi que l'épée du Vivant (une représentation de l'alternance des
grands courants cosmiques) symbolise un peu durement. Faut–il voir dans la symétrie
des allusions présentant la Bête le reflet du dualisme violent, autrement dit du Mal,
inscrit dans notre univers par la volonté divine, identifiée comme l'Équité suprême
dont l'épée à double tranchant est encore l'image?
Verbe poétique et Verbe divin
Schelling considérait la musique comme une «pâle imitation de la force du Verbe.»
D'où sans doute la valeur de modèle que certains écrivains reconnaissent à la
musique, devenue le comparant obligé de leurs efforts poétiques. Qu'il s'agisse de
poésie ou de prose, la littérature aurait le pouvoir de faire éprouver au lecteur les lois
qui gouvernent l'équilibre apparent de l'univers. Cette vocation de la littérature
rejoint celle de la prière, et d'autant mieux que la fonction sociale de la prière,
indiquée par saint Augustin, Maïmonide ou Maître Eckhart, équivaut aux vertus que
Kafka reconnaissait à la littérature, pratiquée comme un moyen d'abolir les frontières
qui séparent les hommes. – Serait-ce au prix d'une activation, dans l'espace textuel,
d'une violence qui est le dénominateur commun de nos sensibilités. Mais par quels
moyens la parole poétique, qu'il s'agisse de prose ou de vers, se constitue–t–elle
comme un écho du Verbe ?
16 Verbe/Verbum/Word; Verb
Il faut rapprocher ici le Verbe de la notion du Nombre, définie par Plotin comme la
puissance du déploiement de l'être, qui s'effectue dans une hiérarchie gouvernée par
l'Unité première. La structuration mathématique de ce déploiement, mesurée par les
nombres (communs), a fasciné les écrivains de diverses époques. Le Livre de Jean de
Patmos, la Divine comédie de Dante, les drames de Shakespeare et les œuvres de
certains romantiques allemands sont représentatifs de cette tendance à laquelle on ne
saurait assigner un cadre temporel bien défini. Mais c'est en suivant leur instinct
(éprouvé comme une sorte d'aptitude musicale par certains d'entre eux) qu'ils
retrouvent, dans leur travail d'écriture, la grandeur agissante du Nombre.
La verve de Victor Hugo, déchaînée (dans Les contemplations) sur les «raquettes»
de la versification traditionnelle, a un remarquable antécédent chez Scarron, en
particulier dans le Roman comique, où l'image des «raquettes» semble désigner
l'usage lyrique, remarqué par de récentes critiques, de la répétition dont Scarron
éprouve l'attirance et l'horreur dans les rythmes qui guident sa plume. Par exemple
au chapitre XV, le verbe de Scarron s'illustre dans des séries lexicales aux mesures
identiques, parmi lesquelles la litanie des 12 emplois du verbe 'chanter', comporte
cette occurrence, entourée de détails qui font tout son prix: «ils chantaient
(dévotement) toujours la même chose."
Les allures métaphysiques de cette harmonie qui se renouvelle avec des termes
impliquant de près ou de loin la notion de dualité, sont condamnées par le contexte
de cet épisode où un organiste castré, équipé de deux tréteaux et payé de «deux
testons» (!) incarne la débâcle du sacré. Ce dernier se voit en effet fustigé par le «bel
Exaudiat» poussé par deux voix, piteuses dans leur illusoire différence, tandis que
«dix ou douze chiens» perturbent ce concert, image dévalorisante de celui du texte
dont ces cabots sont le chiffre répugnant. Cette évocation est justement située après
les dix premières occurrences du verbe 'chanter', parmi lesquelles se glissent les deux
substantifs «chant» et «chanson»! (Voir M. Arouimi, «La Machine harmonieuse de
Scarron», XVIIème siècle, 191, 1996, 2, p. 365-380).
Au rapport mythique de l'Un et du Deux, Scarron substitue, au début de cet épisode,
l'attitude du père du Destin qui «promèn(e) dans deux ou trois rues» son fils, le
«caress(e) puis (le) quitte tout à coup, (lui) défendant de le revenir voir.» Il s'agit là
d'un reflet dramatique de la double sollicitation contradictoire dont parle Girard, à
laquelle ne serait pas étrangère l'approximation numérique où se conjuguent le pair
et l'impair.
Nerval, grand admirateur de Scarron, ne sera pas plus doux, avec le relais des «deux
yeux caves» du sosie d'Aurélia et des portes de deux caves, dans la cour carcérale où
se referme (avant les Mémorables) un questionnement du Verbe divin et de toutes les
traditions qui s'y rapportent, filé dans les deux parties de Aurélia. Et dans ce récit la
«combinaison des nombres» et les «calculs» dont elle est le prétexte révèlent parmi
d'autres détails l'exercice de certains nombres dans le tissage harmonisé du texte
(séries lexicales, ou simples accumulations), qui coïncident avec ceux de la «divine
cabale»... Mais la violence dualiste, jointe à la figure du Père, oriente dans un sens
négatif cette prise de conscience, maintenue jusque dans l'élévation apparente des
Mémorables.
L'allusion à l'Apocalypse de Jean dans Aurélia, trouve son sens dans la coïncidence
entre les nombres clés du récit de Jean et le mètre adopté dans une semi-inconscience
par Nerval pour les harmonies secrètes de son récit. À commencer par les sept
répétitions du chiffre 7, si l'on tient compte d'une note de la première partie. La
septième concerne justement le prêtre qui «recommenc(e) sept fois» l'oraison (II, 4).
L'Apocalypse une fois de plus s'impose comme un exemple majeur de ce phénomène,
que je me permettrai d'illustrer par les résultats d'un arpentage inédit, pratiqué sur
le livre biblique comme sur les chefs-d'œuvre profanes, connus pour la perfection
«mathématique» de leur espace textuel.
Le mot «livre» est ainsi prononcé 14 fois par la bouche de Jean dans l'Apocalypse:
17 Verbe /Verbum /Word; Verb
8 fois dans la première moitié du récit, et 6 fois dans la seconde. Or ce rapport
s'inverse avec les emplois du même mot par le Seigneur, les Vieillards, l'Ange ou
Jésus lui–même: 6 fois dans la première, moitié et 8 fois dans la seconde. (1: 11, 3:
5, 5: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; 6: 14; 10: 2, 8, 9, 10; 13: 8; 17: 8, 20: 12, 12, 12, 15; 21: 27;
22: 7, 9, 10, 18, 18, 19, 19. Les occurrences dans le discours de Jean sont
soulignées.)
Cette harmonie se renouvelle dans le Cristo de Carlo Levi, balisé par deux allusions
à la Jérusalem céleste, avec une infinité de motifs parmi lesquels on peut au moins
souligner celui des «voiles», distribués dans une symétrie que respectent les deux
emplois du participe «velato», sur les deux versants du récit. Plus parlante, la série
sophistiquée des yeux noirs (11 occurrences dans chaque moitié du récit) ou bleus (3
occurrences dans chaque moitié) s'étage sur les deux moitiés du récit (de 24
chapitres). Elle est encore centrée (au chapitre 12) sur les yeux noisette du chien
Barone, le chien mage, alter ego du mystique narrateur. (Une combinatoire se
dessine, qui favorise les nombres clés de la mystique juive...)
Or, dans ce récit les activités picturales du narrateur, associées à ses travaux
d'écriture et à sa pratique de la médecine, sont tendues vers un idéal que servent plus
concrètement, pour le lecteur du récit, les harmonies internes du texte, régi par une
loi dont la mathématicité est l'objet d'une métaphore éclatée, impliquant aussi bien
le mystère d'un code chiffré («cifrario segreto») relatif à la production scripturale
d'un personnage, double de Levi narrateur, que les computations mercantiles
auxquelles se livre une sorte de guérisseur. Et la violence mimétique revendique ses
droits, dans cette allégorie plurielle où la concurrence jalouse des enfants autour du
peintre divinisé jette une ombre sur la magie picturale, si proche de celle des séries
lexicales. (Voir M. Arouimi, «Les Harmonies de la peur», Strumenti Critici, 76,
1994-3, p. 363-386.)
La «combinatoire» dont Nerval pressentait l'exercice dans sa propre écriture
résulterait, comme le suggèrent les thèmes liés de l'imitation et de la jalousie dans
Aurélia (comme dans le Cristo), de la contradiction «fondatrice», entendue comme
le principe des harmonies (pas seulement textuelles) où elle se domestiquerait.
Schelling ne croyait donc pas si bien dire, en affirmant dans Le Génie et ses œuvres
(Textes esthétiques, Klincksieck, 1978) que l'instinct artistique résulte d'un
«sentiment de contradiction interne».
Une allusion au «Jugement dernier» dans le Taugenichts d'Eichendorff incite à
rapprocher les sept emplois du sémantème «Mitte», répartis dans six chapitres du
récit et les six notations du «milieu» dans l'Apocalypse. (1: 13, 2: 1, 4: 6, 6: 6, 7: 17
et 22: 1.) Et si la construction en dyptique du chapitre VII du Taugenichts est
soulignée par deux notations du «milieu», la deuxième: «in der Mitte der Stube» peut
se rapprocher du verset 17 du chapitre 7 de Ap. (Denn das Lamm mitten im Stuhl
wird sie weiden» trad. Martin Luther) puisqu' Eichendorff, dans le passage suivant,
écrit les mots: «Darauf ergriff er einen alten Stuhl.» Mais de cette vieille chaise sur
laquelle le narrateur pose pour la peinture d'une Vierge à l'enfant, le dossier à
«moitié» cassé rappelle l'usure du Mythe clairement visé dans cette représentation.
Une analyse quantitative du vocabulaire du Taugenichts,proposée par Knut Rybka
(Eichendorffs italienische Reise. Textarbeit zum 'Taugenichts', 1993) donne un relief
concret aux appréciations générales de Dietmar Köhler sur cet aspect de la technique
d'Eichendorff («Wiederholung und Variationen...» Aurora, 27, 1967, p. 26–43.)
Mais cette analyse gagnerait à être appréciée en fonction de la succession des
chapitres. Treize emplois du mot «Gott» s'étagent dans chaque moitié du récit, dans
un rapport nuancé par les rares emplois de la forme «Gottes» (comprise dans cette
série).
Cette harmonie renouvelle celle qui, dans l'Apocalypse, intéresse les 36 mentions du
nom de la Bête: un redoublement de son «nombre», relu par certains commentateurs
18 Verbe/Verbum/Word; Verb
comme la somme de trois 6. L'harmonie des douze mentions du Dragon (si l'on
excepte la comparaison de la Bête en 13: 11: «elle avait des cornes comme un
dragon»), cette harmonie concurrence, dans l'espace graphique, les mesures de la
Cité céleste, dont cet espace serait le reflet textuel. Il arrive d'ailleurs que la Bête et
le Dragon soient nommés dans les mêmes chapitres (13, 16 et 20) qui regroupent 24
évocations mêlées de la Bête et du Dragon.
La Bête est en effet nommée dans les versets suivants: Ap.11 (7), 13 (1, 2, 3, 4, 4, 4,
11, 12, 12, 14, 14, 15, 15, 17, 18), 14 (11), 15 (2), 16 (2, 10, 13), 17 (3, 7, 8, 8, 11,
12, 13, 16, 17), 19 (19, 20, 20, 20), 2O (4, 10).
Le Dragon est mentionné dans Ap. 12 (3, 4, 7, 7, 9, 13, 16, 17), Ap.13 (2, 4), 16
(13), 20 (2).
Les chapitres 13, 16 et 20 dans lesquels alternent 20 mentions de la Bête et 4
mentions du Dragon regroupent donc 24 mentions. Il reste alors 16 mentions de la
Bête... et 8 mentions du Dragon (la moitié de 16) rassemblées dans Ap.12.
Le nombre 24, associé aux figurations et à l'agir du Verbe, n'a donc pas toujours le
symbolisme positif que lui confèrent les motifs de l'Apocalypse auxquels il s'applique.
Mallarmé devait se montrer sensible au potentiel symbolique du nombre 24, dans la
présentation graphique originale du Coup de dés. L'Ancien Testament a pu être
considéré comme une suite de 24 livres, et les 22 chapitres de l'Apocalypse
s'augmentent par le «Prologue» et l'«Épilogue», isolés dans les traductions modernes.
Ce nombre 24, lorsqu'il concerne la Bête ou le Dragon dans l'Apocalypse, revêt le
sens diabolique dont les vingt-quatre jambes des chevaux de Méphistophélès , sous
la plume de Gœthe, sont un exemple fameux, d'ailleurs parodié au chapitre IV du
Taugenichts.
Les 24 tableaux différemment titrés du Premier Faust illustrent d'ailleurs un aspect
mathématique du Verbe, ce Verbe dont parle saint Jean dans son Prologue, justement
déformé dans la bouche de Faust. Mais ni le souvenir de l'Apocalypse ni celui du
Faust ne peuvent «expliquer» les harmonies textuelles du Taugenichts, dont le plus
pur exemple est fourni par les trois mentions du mot «Flügel» qui ponctuent chaque
moitié de ce récit de dix chapitres. Et cette harmonie est soulignée par les deux seuls
emplois du mot «Flügeltür(en)», disposés en symétrie: chapitres II et VIII.
La perfection «musicale» de ces dispositions accède à une surprenante amplitude
avec le thème des oiseaux, du violon ou du «cœur». Autant de motifs que l'on peut
rattacher, en vertu de leur symbolisme, à la métaphysique du Verbe. Mais ce
symbolisme n'explique pas cette faveur dont il est difficile de fixer les limites, et qui
intéresse encore le rythme phrastique (découpage en phrases ou rythme interne de
certaines phrases) de maints passages. La tentation est grande, encore une fois, de
recourir aux thèmes croisés de la jalousie et de la violence sacrificielle, attachés à des
motifs qui forment l'axe de ces séries, pour cerner l'origine de ce phénomène, dont
il n'est pas sûr qu'il trouve sa garantie dans la Vierge à l'Enfant (le Verbe incarné)
du chapitre VII.
Il en va de même dans Heart of Darkness, où le souvenir de la Bête et de son
«image» revit dans le portrait de l'aventurier trafiquant d'ivoire, dont l'«image»
participe à une série de six occurrences de ce mot. La disposition de cette série sur
les deux moitiés du récit (1+ 5) est le reflet inversé de celle que regroupe le mot
«pretence», qui partage le sens le plus négatif du mot «image». L'unique mention du
mot «image» dans la première moitié du récit et l'unique mention du mot «pretence»
dans la seconde, encadrent d'ailleurs une suite de six mentions dans cette série de
douze termes.
La Concordance Bender permet de vérifier l'existence de ces harmonies textuelles,
dont la clé nous est livrée par l'emploi récurrent des numéraux «six» et «sixty»,
employés chacun six fois par Conrad dans ce récit où ils inscrivent, dans un
hommage d'autant plus ambigu qu'il est sans doute inconscient, le «chiffre» de la
Bête. Les séries de six termes regroupées par les mots «violence» ou «confounded»
19 Verbe /Verbum /Word; Verb
manifestent la raison probable de l'attrait de Conrad pour l'Apocalypse – et donc pour
le mythique agir du Verbe. Mais le rythme d'écriture spontanément mis en œuvre par
l'écrivain coïncide avec le nombre qui, du moins dans l'Apocalypse, exprime le
dualisme violent qui, sur les degrés inférieurs de l'échelle des êtres, parodie le
rayonnement de l'Un. Et la figure de Kurtz, le trafiquant poète, est là pour rappeler
la dimension autocritique du travail poétique de Conrad, orienté sur la violence
originelle qui détermine nos attirances esthétiques, notre rapport à l'Harmonie, et
bien sûr notre conception du sacré.
L'auteur de The Shadow Line a trouvé en Baudelaire (dont quelques vers sont cités
en exergue de ce récit) un frère de plume, soucieux de de son verbe – et de
l'ambiguïté foncière de la musique, dont les résonances métaphysiques s'annulent
dans le rapport des expressions «vaste éther» et «grand miroir/ De mon désespoir»
qui balisent ce poème La Musique.
Moins bien connu, l'intérêt de Conrad pour Rimbaud a peut-être sa raison dans
l'existence des «rythmes instinctifs» auxquels les écrits de Rimbaud, lui-même si
attiré par l'Apocalypse, doivent leur taille diamantée. Certains critiques ont reconnu
les aspects mathématiques de la technique du «voyant» qui se donnait pour but de
découvrir le secret du «Nombre et (de) l'Harmonie». Cette technique s'exerce sur tous
les niveaux du texte, en vers ou en prose. Les aptitudes «musicales» d'Eichendorff
ou de Conrad s'aiguisent avec une vigueur surprenante sous la plume de Rimbaud,
avec le jeu des mêmes nombres...
Revenons par exemple au poème Ce qu'on dit au poète..., signé par un «Alcide
Bava» dont le verbe se fait «bavures de pipeaux», après les 14 premières strophes,
et «pommades d'or» que «bavent» des Fleurs, 14 strophes plus loin (II, 9 et IV, 7).
La position des «constrictors d'un hexamètre», dans la strophe 18, n'est pas moins
fascinante, eu égard au symbolisme de ces constrictors. Il serait trop long de montrer
ici que cette position constitue la clef (visuelle) des «rythmes instinctifs» mis en
œuvre dans ce poème. (Un peu comme dans le poème Michel et Christine: voir M.
Arouimi, «Le rosaire syntaxique de Rimbaud», Champs du Signe, 3, 1992, 233–257.)
Le conflit spirituel qui inspire le poème se chiffre dans les 18 vers comprenant les
marques du «Tu» (19 marques, avec le vers «Ne peux-tu pas, ne dois-tu pas» : III,1)
et dans les 18 vers comprenant les autres indicateurs de personnes (19 marques, avec
le vers si expressif eu égard au «Verbe»: « – Et j'ai dit ce que je voulais!» (III, 6).
(Ces deux vers, on ne s'en étonne pas, délimitent une section de six strophes.)
L'usage de certains verbes: «dire» et «trouve» (avec le sens spirituel que ce dernier
revêt dans la Lettre du voyant: «trouver une langue») est le prétexte de séries de six
termes, qui donnent leur vrai sens aux «hexamètres» comparés à des «constrictors».
L'espace graphique n'est pas en reste dans ce jeu régi par le nombre de la Bête, avec
les 18 vers dans lesquels est employé le tiret. (On compte 19 tirets, avec un vers de
la 18ème strophe – position révélatrice – qui en comprend deux: « (l'Art n'est plus,
maintenant,) / – C'est la vérité, – de permettre /(...) Des constrictors d'un
hexamètre».)
Le caprice qui nous vaut ce glissement des valeurs 18 et 19 permet en fait d'inscrire,
dans les vers cités, la marque du Double (les deux «tu», les deux «je», les deux tirets)
qui nomme en fait le principe de ces harmonies, rendu à la violence mimétique dont
ces répétitions immédiates sont le chiffre. Et le prétexte du poème: un règlement de
compte fort ambigu avec Banville (en fait un alter ego de Rimbaud?) fournit le cadre
spirituel idéal pour cette démonstration dont la clef la mieux forgée nous est offerte
dans le mensonge de Rimbaud qui prétend avoir «dix–huit ans» dans la lettre
accompagnant ce poème.
Dans la strophe 6 de la section II, «L'Ode Açoka» permet de songer ici, comme dans
l'Illumination Vies, à la tradition hindoue, qui n'est pas étrangère à certaine
cosmogonie tibétaine rapportée par M. Eliade, selon laquelle dix-huit œufs seraient
sortis d'un Œuf primordial, pour permettre la naissance d'un roi mythique, dans l'œuf
20 Verbe/Verbum/Word; Verb
au milieu d'entre les dix-huit. Cette ambiguïté (le milieu de 18?) recoupe d'autant
mieux le glissement numérique suggéré par la plume de Rimbaud que ce dernier,
dans Ce qu'on dit, exerce sa malice sur le mythe de l'Œuf cosmique.
Ces analogies témoignent d'une parenté spirituelle, obscurément pressentie par le
poète. Quelle qu'ait été la connaissance de ce dernier en matière d'ésotérisme, on est
en droit d'hésiter sur le sens de ces analogies, qui plaident autant pour le mythe du
Verbe, fondement de l'Existence, qu'en sa défaveur. – Même si les écrivains cités
jusque–là ont suivi l'inspiration négative, dont les aspects les plus curieux restent à
noter.
Le phénomène évoqué dans les lignes précédentes peut se rapprocher du mythe des
22 lettres par lesquelles Dieu, selon la mystique juive, aurait formé «toutes les
créatures et tout ce qui sera créé» (Séfer Yesira). Rappelons d'abord le lien, établi par
Schelling dans ses Œuvres métaphysiques (Gallimard, 1980) entre le Verbe divin et
l'unité de la lumière et de l'obscurité, littéralement réfléchie dans le jeu des voyelles
et des consonnes, associées par la tradition à la formation de l'univers. Ernst Cassirer
observait d'ailleurs (dans Langage et Mythe: À propos des noms de Dieu) que les
religions qui honorent dans les mots du langage la force originelle dont résulte la
production du monde à partir du chaos, sont celles dont la cosmogonie est fondée sur
le dualisme entre le Bien et le Mal.
On peut d'abord songer au Cristo de Carlo Levi, où le mythe des 22 lettres revit dans
des séries lexicales harmonisées dont l'esprit même (sinon la mesure) se matérialise
dans une comptine de deux fois huit vers, et mieux encore dans la reproduction
graphique d'un triangle magique, à valeur thérapeutique, constitué par les lettres du
mot ABRACADABRA, multipliées dans une pyramide de 66 lettres. Il s'agit en fait
du «triangle de la cabbale», inspiré des recherches mathématiques des
pythagoriciens, auxquelles nous devrions le symbolisme numérique qui s'attache à
la Jérusalem céleste (Le souvenir des Bucoliques dans le Cristo et dans le
Taugenichts autorise ici la mention d'un article de Paul Maury, consacré à la
structure mathématique des Bucoliques, régie par des lois dont l'inspiration coïncide
avec celle qui dictait à Jean de Patmos le nombre de la Bête : «Le Secret de Virgile
et l'architecture des Bucoliques», Lettres d'Humanité, 1944, p. 44–147.)
Dans Aurélia de Nerval, un lien se tisse, entre le thème de la Cité céleste et le
mystère du rapport des 66 occurrences du mot «esprit» et des 33 mentions du mot
«âme», soulignées par M. Brix dans l'édition Pléiade (1993 : (Pour un élargissement
de cette incursion quantitative: M. Arouimi, «L'escalier de Nerval», Analyses et
Réflexions sur 'Les Filles du Feu', Ellipses, 1997, 97-109.)
Ce triangle qui représente «deux fois Dieu et son temple», comme le note Georges
Jouven (dans Les Nombres cachés) trouve un équivalent plus intéressant pour notre
propos dans les «soixante-six intervalles inégaux» qui divisent l'octave dans la
musique indienne, inspirée dit-on par la théorie métaphysique du Verbe (v. A.
Daniélou, La Musique de l'Inde du Nord, Fata Morgana, 1995, p. 36.) Sans doute les
préoccupations musicales de Nerval dans les Mémorables qui clôturent Aurélia
rejoignent–elles et le raffinement et le sens métaphysique de cette octave divisée:
«deux notes ont résonné, l'une grave, l'autre aiguë, – (...) Sois bénie, ô première
octave qui commença l'hymne divin!» Mais ne perdons pas de vue que ces deux notes
exorcisent le dualisme violent qui assure au récit sa continuité thématique, si peu
apparente.)
A. Daniélou précise d'ailleurs que vingt-deux intervalles, parmi les soixante-six,
«forment l'échelle sur laquelle se déplacent les sept notes de la gamme». On retrouve
ici, dans le domaine musical, associé au mythe du Verbe pour nos sensibilités, des
mesures que la tradition juive rattache à la formation du monde.
La technique poétique de Rimbaud, envisagée sous un certain angle, permet de mieux
sentir le rapport entre cet aspect du mythe du Verbe et le dualisme. Les 22
21 Verbe /Verbum /Word; Verb
inscriptions de la lettre «R», réparties en deux suites de 11 sur les deux versants de
l'Illumination À une raison manifestent un aspect secret de l'art auquel font allusion
les premiers mots du poème: «Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les
sons et commence la nouvelle harmonie.» Cette expérience musicale, accompagnée
d'allusions sacrificielles, redonne vie aux thèmes clés de l'Apocalypse («nouveaux
hommes», «fléaux» ) et surtout le mouvement: «Ta tête se détourne (...)! Ta tête se
retourne,» semble transposer celui de Jean, lors de la manifestation sonore et visuelle
du Verbe incarné: «je me tournai pour voir de qui étoit la voix qui me parloit; et
m'étant tourné je vis sept chandeliers d'or» (traduction Lemaistre de Sacy).
La substitution du «nouvel amour» à ces chandeliers d'or est un hommage illusoire,
si l'on reconnaît dans ce «nouvel amour» l'effet des comportements cyclothymiques,
dictés par une contradiction violente que le dogme, dans ses images, ses formes, et
dans les rythmes des prières qu'il nous propose, ne ferait que domestiquer. Quoi qu'il
en soit, l'expérience de Rimbaud écrivant À une raison ou Comédie de la soif peut
se voir (et a sans doute été vécue par Arthur) comme un équivalent profane de
l'introspection mystique, dramatisée dans le rapport de Jean et du Seigneur.
Cette visée critique annonce bien la méfiance contemporaine, dans l'univers de la
science et celui de la philosophie, à l'égard des formes canoniques de l'harmonie.
Mais il n'est pas sûr que l'on puisse rendre si simplement à la violence dualiste les
fondements de notre esthétique. Certains passages de Billy Budd, du Taugenichts –
ou les seules «violettes humides» qui referment, comme un sceau portant les couleurs
de la dualité résolue, la Comédie de la soif de Rimbaud, nous parlent d'une
aspiration à la libre contemplation de l'Harmonie universelle, affranchie des grilles
de lecture que la violence dispose dans nos consciences, et qui sont, paradoxalement,
notre seul moyen d'apprécier cette Harmonie. (Ces «violettes» de Rimbaud ne sont
pas ou ne sont plus le reflet de «l'affreuse crème» qui, dans la section 3 du poème,
convient à l'"Hydre intime sans gueules» de la section 2: la violence faite verbe, et
d'autant mieux que le pluriel de «gueules», après l'Hydre au singulier, suggère une
incarnation diabolique de l'irradiation de l'Un).
Il existe certes un rapport entre la doctrine du Soi dont la définition coïncide, en
l'englobant, avec celle du Verbe, et le repli introspectif de toutes les œuvres profanes
évoquées jusque–là. Dans ces dernières le thème musical – ou sonore – est d'ailleurs
le premier indice de ce repli. Rimbaud notamment éprouva l'attrait de cette parenté,
pour la questionner sévèrement à l'intérieur même des «Illuminations» où elle
s'affirme. Mais dans ces œuvres, quelle valeur allégorique accorder à la violence
dualiste, thème déclaré de l'action rapportée?
Les mystiques de leur côté prennent pour modèle de leur quête la «réflexion sur
lui–même du Verbe autoconnaissant», mais leurs justifications ne sont pas toujours
hautement spirituelles. La mise en échec de la violence dualiste semble déterminer
leur démarche, appuyée sur des pratiques imitées de ce «reflux en lui–même» du
Verbe... Les limites (pas seulement spatiales) de cet article de permettent pas de
poursuivre cette enquête, qui a le défaut d'esquiver toute tentative de réhabiliter le
sacré, certes mis à mal dans l'expérience poétique de ces écrivains qui semblent avoir
exploré les zones ultimes de la vocation littéraire.
Le lecteur appréciera peut-être, au lieu d'une conclusion, une rapide analyse d'une
œuvre cinématographique récente: Lost Highway, dont le réalisateur David Lynch,
en s'efforçant consciemment de mettre à jour les secrets de la psyché humaine, se
livre un questionnement critique du Verbe. Tous les aspects de ce mythe premier, ses
expressions symboliques, paraissent en effet transposés dans le scénario et dans la
plastique du film, qui prolonge ainsi, adaptées au regard des spectateurs modernes,
les intuitions des écrivains cités plus haut. (Scénario original publié chez Faber and
Faber, trad. dans la Petite Bibliothèque du Cinéma, 1997).
Quelques références picturales ou textuelles à la passion du Christ ponctuent le
scénario dédoublé de ce film, tendu par des effets de miroir au gré desquels se donne
22 Verbe/Verbum/Word; Verb
en spectacle la violence fratricide – et parricide – d'une crise de doubles. (Voir
M.Arouimi, «L'opus 666 de David Lynch, un Graal pornographique», dans
L’Apocalypse sur scène, Paris : L’Harmattan, 2002, p. 135-177.) Le récit filmé se
justifie comme une critique de l'esthétique des contraires, poussée à sa limite. Et cette
critique s'étend au mythe du Verbe divin avec lequel coïncide, dans une certaine
mesure, l'idéal esthétique de Lynch. Passons sur les jeux nominaux et numériques
dans lesquels se voient associés les notions de l'harmonie et du diabolisme. (Les noms
de tous les personnages ont été choisis en fonction de leur valeur allusive, parfois très
claire, eu égard au Double et/ou au démoniaque. Et les données chiffrées du scénario:
âge des personnages, détails horaires, matricules, etc. sont autant d'énigmes
renvoyant aux nombres clés de l'ésotérisme universel, appréhendés dans leur sens le
plus négatif.)
Dans une scène purement musicale, le déchaînement du saxo fait revivre (comme le
confirme le script) les anciens rituels sacrificiels, dont la passion du Christ interroge
le sens. Plus généralement les indications de divers bourdonnements évoquent le Son
originel, autrement dit l'état premier de la parole divine, incarnée par le Christ. Dans
une séquence qui nous fait partager l'angoisse hallucinée d'un jeune assassin, le
bombinement des phalènes et la vision d'une araignée près d'une lustre solaire, nous
parlent du mythe unitaire, dont le destin de ce personnage est une transposition
négative. Cette séquence est d'ailleurs le pendant symétrique de celle qui met en
scène le prisonnier dont ce jeune assassin est le double, bras en croix sous le cercle
lunaire d'un plafonnier: un symbole complété par le parallélisme des barreaux de la
cellule.
Toute l'action du film converge sur l'inversion infernale d'un mariage mystique, au
son de la «mer de parasites» émise par la radio d'une voiture, tandis que la lueur
aveuglante d'une «incandescence primitive» (celle des deux phares allumés?) baigne
l'étreinte très vite rompue du couple maudit.
Et cette symbolique (adaptée à la scission de l'Un) éclaire le bâti en deux volets
contrastifs du film, mais encore la poétique du double, résumée dans les deux balles
qui percent le vieil Eddy, sous les yeux de son jeune rival et de l'«homme–mystère»
qui incarne, avec sa caméra portative, la pugnacité introspective du regard de Lynch.
Ces deux balles signifient encore, parmi bien d'autres motifs, la violence où seraient
pétris les fondements d'une métaphysique dont le scénario constate le recul à l'époque
moderne. Et ce constat s'empare des autres arts, jusqu'à la littérature, balayée par la
question soupçonneuse du personnage principal à son épouse infidèle, et peu lettrée,
significativement prénommée Renee: «Read... read what, Renee?»
La répétition du verbe, et la signification de ce prénom (re–naissance), jointes à la
tension psychologique des partenaires, ne condamnent rien moins que le mythe du
Verbe. Le rapport de l'Un et du Deux est en effet mimé par la chaîne graphique et
sonore de cet énoncé qui se fait l'expression d'une insupportable contradiction.
Celle–ci n'est d'ailleurs qu'un reflet parmi bien d'autres de celle qui s'attache, en
différentes séquences, aux avatars de la figure du Père. Comme dans les
chefs–d'œuvre littéraires cités plus haut, la contradiction émanant du Père est
pressentie comme le fondement de la violence interhumaine dont le scénario
rassemble toutes les formes. Et cette contradiction s'impose encore comme le principe
méconnu de notre métaphysique, mise à l'épreuve dans ce film dont l'esthétique
générale, si bien adaptée à cette métaphysique, se dénonce comme un effet et comme
un reflet de la violence mimétique, elle–même objet d'une dérision qui s'accuse dans
divers passages du film.
Michel Arouimi
Université du Littoral
Bibliographie
Ambacher, Michel. – Cosmologie et philosophie.– Paris: Aubier–Montaigne, 1967.
Aron, Robert.– Histoire de Dieu. – Paris: Librairie Académique Perrin, 1964.
23 Verbe /Verbum /Word; Verb
Benz, Ernst.– Les sources mystiques de la philosophie romantique allemande.– Paris: Vrin, 1968.
Blavatsky, H.P. – Isis unveiled. – London, 1877. (Isis dévoilée. – Paris: Adyar, 1990).
Bormann, Alexander (von).– Natura loquitur. Naturpœsie und emblematische Formen bei Joseph von
Eichendorff.– Tübingen: Max Nieyemer, 1968.
Burckhart, Titus.– Alchimie: sa signfication et son image dans le monde.– Milano: Arché, 1979.
Cassirer, Ernst.– Langage et mythe: à propos des noms de Dieu. – Paris: éd. de Minuit, 1973.
Charles – Saget, Annie.– L'architecture du divin: mathématique et philosophie chez Plotin et Proclus.–
Paris: Les Belles Lettres, 1982.
Crump, Thomas.– The antropology of numbers.– Cambridge University Press, 1990.
Dauphiné, James.– «Des mythes cosmogoniques,» in Dictionnaire des mythes littéraires.– Paris: Éd. du
Rocher, 1988, p.374–383.
Darriulat, Jacques.– L'arithmétique de la grâce: Pascal et les carrés magiques.– Paris: Les Belles Lettres,
1994.
Dieckmann, Liselotte. – «The metaphor of hieroglyphics in german romanticism» in Comparative Literature.–
VII, 1995, 306–312.
Eliade, Mircea.– Aspects du mythe. – Paris: Gallimard (Folio), 1989.
Eliade, Mircea.– Briser le toit de la maison. – Paris: Gallimard, 1986.
Eliade, Mircea. – Méphistophélès et l'Androgyne.– Gallimard (Folio), 1995.
Gaon, Saadya.– Commentaire sur le Séfer Yesira. – s.l.: Bibliophane, 1986.
Girard, René. – Des choses cachées depuis la fondation du monde.– Paris: Grasset, 1984.
Girard, René.– Je vois Satan tomber comme l'éclair.– Paris: Grasset, 1999.
Granet, Marcel.– La pensée chinoise.– Paris: Albin Michel, 1980.
Guénon, René.– Le symbolisme de la croix.– Paris: Véga, 1984.
Hillach, Ansgar.– «Dramatische Theologie und christlische Romantik», in : Germanische romantische
Monatschrift (67) 1977, 144–165.
Izutsu, Toshihiko.– Unicité de l'existence et création perpétuelle en mystique islamique.– Paris: Les deux
Océans, 1981.
James, Jamie. – La musique des sphères. – Paris: Éd. du Rocher, 1997.
Jouven, Georges. – Les nombres cachés: ésotérisme arithmologique. – Paris: Dervy–Livres, 1990.
Köhnke, Klaus.– Hieroglyphenschrift: Untersuchung zu Eichendorff Prosastil.– Sigmaringen, 1986.
Krabiel, Klaus Dieter.– Tradition und Bewegung.– Stuttgardt: W.Kohlhammer.
Lillie, Arthur.– The influence of buddhism in primitive christianity.– London, 1893.
Lindemann, Klaus.– «Von der Naturphilosophie zur christlischen Kunst», in Literaturwissenschaftlisches
Jahrbuch, 15, 1974, 101–121.
Liu, James. – Chinese theories of literature.– University of Chicago Press, 1975.
Matgioi. – La voie métaphysique.– Paris: Éditions traditionnelles, 1991.
Marchal, Jean.– L'apocalypse de Jean: un message pour notre temps.– Paris: Albin Michel (Question de,
68), 1987.
Neveux, Gérard de. – Le nombre d'or: radiographie d'un mythe. – Paris: Points, 1995.
Reik, Theodor. – Le rituel: psychanalyse des rituels religieux.– Paris: Denoèl, 1974.
Schaya, Léo.– La création en Dieu.– Paris: Dervy–Livres, 1983.
Schaya, Léo.– L'homme et l'absolu selon la kabbale.– Paris: Dervy–Livres, 1988.
Schaya, Léo.– La doctrine soufique de l’Unité.– Paris : A. Maisonneuve, 1981.
Schaya, Léo.– Naissance à l'esprit.– Paris: Dervy–Livres, 1987.
Schmidt, Albert-Marie.– La poésie scientifique au XVIème siècle.– Lausanne: Éditions Rencontre, 1970.
Scholem, Gershom.– La mystique juive.– Paris: Cerf, 1985.
Scholem, Gershom.– Le nom et les symboles de Dieu.– Paris: Cerf, 1988.
Schuon, Frithjof.– Du divin à l'humain.– Paris: Le Courrier du Livre, 1981.
Schuon, Frithjof.– L'œil du cœur.– Paris: L'Âge d'Homme, 1985.
Schuon, Frithjof.– Résumé de métaphysique intégrale.– Paris: Le Courrier du Livre, 1985.
Le serpent et ses symboles.– Méolans–Revel: DésIris, 1994.
Temple Bell, Eric.– The magic of numbers.– New York, London : Whittelesey House, 1946.
Tuzet, Hélène.– Le cosmos et l'imagination. – Paris: José Corti, 1988.
Zum Brunn, Emilie; Libera, Alain.– Maître Eckhart: métaphysique du verbe et théologie négative.– Paris:
B.A.P. (42), 1984.
24 Verbe/Verbum/Word; Verb
Note complémentaire (auteur?)
Verbe, du latin verbum : « parole, mot ».
En français, ce terme qui désigne principalement une classe grammaticale, a gardé
son sens latin de parole, avec les connotations laudatives que réclame la “parole” des
poètes ou des écrivains. (Le terme verbelet en ancien français a d'ailleurs le sens de
« petit mot ».) Il peut désigner aussi, par une dérivation du sens, l'amplitude du ton
de la voix. L'expression “verbe haut” est courante, mais il n'est pas habituel de parler
d'un “verbe bas”. — Peut-être en raison de la grandeur qui s'attache au sens
théologique de ce mot. Assimilé au Logos, il désigne la parole (plutôt que les paroles)
de Dieu, une Parole qui constitue, selon la tradition, le processus même de la
Création. C'est pourquoi, dans la théologie chrétienne, le Christ, homme et Fils de
Dieu, deuxième personne de la Trinité, est nommé le “Verbe incarné”, puisqu'il
représente aux yeux des hommes cette volonté créatrice qui, selon la tradition, nous
a engendrés.
Le sens grammatical de ce terme présente des traits singuliers, qui peuvent
expliquer le sens théologique qu'il a pris en français. Le terme néerlandais
werkwoord associe justement l'idée d'une puissance productrice au mot désignant
cette classe grammaticale : le verbe (français), le nœud ou le pivot de la phrase, a
pour vocation de signifier les phénomènes dynamiques. Le verbe intéresse des
modalités variée : l'être, l'avoir... Associé au temps, le verbe n'est pas le seul moyen
de signifier une action, un état. (Des noms propres et des adjectifs remplissent cette
fonction.)
Le verbe, dont il faut rappeler l'indépendance vis-à-vis du genre, présente un grand
nombre de catégories morphologiques (les conjugaisons entraînent maintes variations
du radical). Ces catégories sont : la personne (exceptés les verbes à l'infinitif, les
participes et les gérondifs, qui transforment le verbe en des formes moins complexes)
— le nombre, conféré au verbe par le sujet — le temps, auquel s'ajoutent le mode et
l'aspect (exprimé par des auxiliaires) — enfin la voix (passage de l'actif au passif).