“Une revue ‘sans rédacteurs’ : Avalanche, New York, 1970-1976”
-
Upload
univ-rennes2 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of “Une revue ‘sans rédacteurs’ : Avalanche, New York, 1970-1976”
levue des revues Avalanche
New York
La Revue théâtrale
Jean Paulhan et la résurrection de
La Nouvelle Revue française
revue franco-marocaine Maghreb
GustaveLe Bon et l'usage des
N ° 2 9
Sylvie Mokhtari
Une revue « sans rédacteurs » : Avalanche New York, 1970-1976
« Avalanche n'emploie pas de rédacteurs ^ » Cette phrase, certes laconique et quelque peu surprenante,
répond néanmoins avec exactitude à une des questions de l'enquête sur les revues d'art contemporain
dirigée en 1976 par Richard Cork pour Studio International^. Le résultat de cette enquête publiée
dans le magazine londonien reste aujourd'hui encore une source de première main pour qui
s'intéresse aux revues des années 1960 et 1970. Elle pose les jalons d'une étude d'envergure
internationale sur les revues d'art à un moment, en 1976, où beaucoup de revues d'avant-garde
déposent leur bilan, et où le débat critique stagne.
Ce numéro de Studio International sur les revues d'art accompagne l'actualité d'une exposition
importante The Art Press : Two Centuries ofArt Magazines (Londres : Albert & Victoria Muséum,
8 avril-26 septembre 1976). Historique par son envergure, cette manifestation trouve un
prolongement plus contemporain et prospectif dans les pages de Studio International. A l'époque de
cette enquête et au moment de l'exposition, la revue américaine Avalanche publie son treizième et
dernier numéro.
1. « A Survey of Contemporary Art Magazines : Avalanche », Studio International {LonAKs), vol. 192, n° 983, septembre-octobre 1976, pp. 157-158 [trad. de l'auteur].
2. « A Survey of Contemporary Art Magazines », Studio International (Londres), vol. 192, n° 983, septembre-octobre 1976, pp. 145-186.
Les prédécesseurs
Si la revue Avalanche avait publié des éditoriaux et ainsi
décrit ses objectifs, elle aurait énoncé le programme d'une
information diffusée avec mais aussi par les artistes, contre les
notions conventionnelles de l'art, contre les classifications et
contre l'écriture sur l'art produite par les seules instances de la
critique. L'époque, celle des années 1969-1975, est à la prise de
parole spontanée, à une responsabilité intellectuelle et à une liberté
LA REVUE DES REVUES N° 29 3
d'action que les artistes américains soutenus p^i Avalanche ont su retenir de l'expérience des avant-gardes
précédentes (autour de Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt ou encore Ad Reinhardt). Comment ne
pas citer à ce titre le nom déterminant pour Avalanche de Robert Morris dont les œuvres et les textes (voir
ceux publiés de 1966 à 1968 dans le magazine américain Artforum) ont influencé les débuts de la revue.
N'ayant rien à voir avec la forme avant-gardiste du « manifeste », ces écrits d'artistes véhiculent une
approche de l'information et de la réflexion sur l'art qui ne laissent par indifférentes les revues américaines
des années i960, qu'il s'agisse des revues de petite diffusion comme Aspen (New York, 1965-1971), Art
Now (New York, 1969-1972), ou des magazines de plus grande diffusion comme Artforum (San
Francisco, 1962-...). Parallèlement aux magazines les plus influents de l'époque - Studio International
(Londres, 1893-1988 Art in America i^mYoïk, m?,-..), Arts Magazine (New York, 1926-1992 ?),
Arts Review (Londres, 1949-...) et Art International (Zurich, 1956-1984 ?) - , Artforum s'intéresse aux
tendances de l'actualité la plus novatrice, et suit l'émergence des nouvelles générations d'artistes (Warhol,
Stella, Judd, Hesse, Nauman, Heizer, Kosuth...). Le magazine sait aussi se montrer proche des artistes
dont il parle, en les invitant à collaborer ponctuellement à la réalisation de certains numéros. On
comprend l'influence qu'il put avoir sur la jeune génération des critiques et des artistes des années 1970.
Artforum a ouvert la voie à Avalanche mais aussi à Flash Art (Rome, 1967-...) ou à Artpress (Paris,
1972-...). Willoughby Sharp, fondateur et directeur (^Avalanche, y fera entre autres ses premières armes.
AvdïmchQ : Une revue « faite [d']art »
Dans le premier numéro (ïAvalanche\y Sharp publie un ensemble de notes : « Body
Works : A Pre-critical, non Définitive Survey of Very Récent Works Using Body or Parts Thereof ». Ce
texte, préparatoire et porteur d'un travail à poursuivre, est la seule véritable contribution écrite, sous
une forme rédigée par l'auteur dans sa revue.
Conjointement à ce texte, W Sharp réalise une vidéo réunissant Terry Fox, Vito Acconci, Keith
Sonnier, Bruce Nauman, Dennis Oppenheim et William Wegman. La vidéo Body Works est diffusée le
18 octobre 1970 dans un bar (le Breen's Bar) parallèlement à une exposition montée en collaboration
avec le musée d'art contemporain de San Francisco. W Sharp y inscrit les artistes qui retiennent son
adhésion dans la lignée de Marcel Duchamp ou d'Yves Klein plus que dans une histoire du geste
héroïque initié par Jackson Pollock. Ce texte, mis en forme dans
, . , „ Avalanche autour des œuvres reproduites en vis-à-vis, traduit la 1. Périodicité trimestrielle. ^ Tirage moyen de 4 000 exemplaires. position critique de W. Sharp qui, à partir d'un bilan descriptif et
4 LA R E V U E DES REVUES N° 29
ARiromiM
Artforum, volume V, n° 8,
avril 1967.
sélectif d'actions ayant trait au corps de l'artiste, transmet une information diversement exploitable,
issue d'une observation pragmatique et de la connaissance précise du contenu des œuvres.
Plus qu'une appréciation critique sur l'art dont elle se fait le porte-parole. Avalanche est de facto
pensée comme une revue « faite [d'jart ». Elle entreprend un travail d'information sur les artistes et avec
eux. Le choix d'une telle position éditoriale, point de vue très ouvert quant au traitement de
r« information sur l'art », prend tout son sens au regard d'expositions contemporaines comme
Information réalisée par Kynaston L. McShine et présentée au Muséum of Modem Art de New York
pendant l'été 1970, quelques mois seulement avant le lancement ôi Avalanche. L'exposition réunit un
ensemble d'artistes minimalistes et conceptuels proches des choix de la jeune revue américaine. La
publication qui l'accompagne est conçue comme un objet complémentaire à l'exposition, et non
comme un catalogue classique. Des pages confiées aux artistes de l'exposition donnent au catalogue le
caractère d'un support original et non redondant à la manifestation. Des documents extraits de la presse
assurent un lien avec l'actualité et inscrivent les œuvres dans le présent qui est le leur.
LA REVUE DES REVUES N° 29 5
Le degré zéro de la critique
Si Information précise le sens des œuvres choisies dans l'exposition en les resituant dans leur
environnement immédiat (culturel, philosophique mais aussi médiatique), la manifestation et le
catalogue qui l'accompagne prolongent une réflexion très contemporaine, elle aussi, sur les médias et
les premiers temps forts d'une théorie de l'information illustrée par de nombreuses citations ou
références aux écrits de Marshall McLuhan. Déjà en 1967, la revue d'artistes new-yorkaise Aspen
consacra un numéro aux recherches déterminantes de McLuhan sur les médias et publia la traduction
américaine d'un texte de Roland Barthes sur la disparition de l'auteur \
Ces initiatives caractérisent une pensée dominante des années 1960, de plus en plus réceptive
à la place occupée par les médias dans l'environnement social et artistique, mais aussi de plus en plus
consciente du dépassement des notions traditionnelles d'« auteur » et d'« originalité » par une
« nouvelle critique » (incarnée ici par R. Barthes et Susan Sontag) plus subjective et ouverte à d'autres
champs du savoir. Sensible à de tels changements, Aspen a laissé la possibilité à des artistes pop (dont
Andy Warhol), fluxus (dont John Cage ou La Monte Young) et conceptuels (dont Mel Bochner et
Dan Graham) d'intervenir directement dans la revue, sans intermédiaire.
A titre d'exemples et parmi les artistes proches ^Avalanche, Sol LeWitt y publia Sériai Project
N°l (1966), Dan Graham y proposa entre autres la pièce Schéma for a Set of Pages, et Robert Morris
y difflisa la copie d'un extrait de son film From Site^. Ces pièces écrites (articles, œuvres multiples,
planches, cahiers...), visuelles (films) et parfois sonores (disques) constituent autant de matériaux
laissés à la libre consultation des lecteurs, réunis dans des boîtes 1. Roland Barthes, « The Death of the Author»,yli/)e« (New York), n° 5-6, de fotmats différents. Il est intéressant de noter qu'en 1967 automne-hiverl967,np [texte paru en ^J^^-^-^ COUSacrer UU UUmérO doublc à Stéphane français sous le titre : « La Mort de l'auteur », Mîwfeitf (Paris), n°V, 1968, Mallarmé. Qui mieux que Mallarmé incarne l'hypertrophie du p.l4]. Ce texte est le premier de trois essais ^-^^^^^^ modeme que ressentent de nombreux acteurs de la reunis dans la « Section 3 » a Aspen. Les ^ deux autres auteurs invités à compléter le scèue artistique des années 1960 ? Son approche critique des arts dossier sont respectivement George Kubler i i i - / - • \ • j ' / H T f c I j n • f et de la littérature reioint la ronction d un art reriexil et critique, (avec « Style and Représentation or ^ ' HistoricalTime ») et Susan Sontag (pour celui des années 1960-1970 (voit par exemple les écrits de Dan « The Aesthetics of Silence »). \ \
Graham a ce sujet). 2. Ces trois exemples sont extraits du numéro r» • • • i • • A double confié à Brian O'Doherty (« guest « VvemicT magazine en ttois dimcusious », Aspen, aussi sous-editor-designer »), David Dulton et Lynn ^[^^^ « tevue mise en boîte » (« The Magazine in a Box ») Letterman (« guest art direaors ») en 1967, i D et consacré à Stéphane Mallarmé. V o i r c e s s c r a ses activités pendant 1 été 1971 (au numéro 10), un an (New York), n° 5-6, automne-hiver 1967. ^près les débuts (ïAvalanche.
6 L A R E V U E DES REVUES N° 29
Un « artiste en résidence »
En ces années post-soixante-huitardes où la hiérarchie généralement admise entre les tenants
d'une pensée écrite sur l'art (les critiques) et ceux de la pratique de l'art (les artistes) est remise en cause,
artistes-écrivains ou critiques-« performers »..., chacun trace un itinéraire personnel et donne forme à
un engagement qui bien évidemment évolue dans le temps. Dans Avalanche, Willoughby Sharp « se
met en scène », s'attribue un rôle (celui de « grand manitou de la scène artistique ' ») et montre sa
préférence pour l'entretien comme mode de communication et comme introduction immédiate aux
artistes qu'il suivra. Les nombreux entretiens retranscrits dms Avalanche, les expositions et les rencontres
publiques organisées autour de la revue, l'impHcation progressive
de W. Sharp comme « vidéo-performer » aux côtés des artistes, se
présentent comme autant de casquettes possibles à la fonction du
critique d'art qui, dans ce cas, ne se veut absolument pas distancié
ni « passif » face aux œuvres. Les expériences de W. Sharp visant
une non-différenciation de ses fonctions sont une réponse à un
contexte intellectuel et artistique américain et européen ouvert à
ce type d'expériences. D'autres revues en auront fourni des
exemples différents, à chaque fois en lien avec un contexte
1. De 1970 à 1973, des portraits de W. Sharp trouvaient leur place parmi les pages publicitaires des premiers numéros
de la revue. Il se définit alors comme le « grand manitou de la scène artistique » [ The mighty Mogul ofthe Art Scène, cf. le n° 7 Avalanche, hiver-décembre 1973].
A cette époque, W. Sharp réalise lui-même des vidéos-performances diffusées en public, dont The Famous Dog Show
présentée à Minneapolis au Collège of Art and Design en 1973 n'est qu'un exemple.
LA REVUE DES REVUES N° 29 7
spécifique et avec la création d'un regroupement d'individus à l'origine de formulations différentes. En
quatre ans, W. Sharp élargit sa position de directeur de la publication à celle plus ouverte « d'artiste en
résidence » dans les pages di Avalanche. A partir du numéro 9 (mai 1974), la revue quitte parallèlement
son format emprunté au magazine pour une formule comparable à celle du newspaper
L'entretien avec les artistes
Plus que n'importe quelle autre revue d'avant-garde de l'époque, et quoiqu'il en soit avec brio.
Avalanche privilégie le mode de l'entretien avec les artistes. Les premières années, entre 1970 et 1973,
sont les plus radicales. Les enthousiasmes y sont sans nuance, et les initiatives multiples. Le travail
critique de W. Sharp dans d'autres revues américaines, avant le lancement ^Avalanche et
simultanément, exprime cette adhésion sans retenue pour la parole de l'artiste que l'on peut lire dans
les entretiens qu'il a réalisés avec Joseph Beuys, Bruce Nauman ou Terry Fox..., John Coplans ou Keith
Sonnier... publiés en 1970-71 àms Arts Magazine tt Artforum.
Aucune contribution strictement rédactionnelle n'est donc à signaler pour la réalisation
Avalanche. A sa place, les noms des artistes côtoient ceux du responsable de la revue et de sa rédactrice
en chef, Eisa Béar. Le programme de la revue n'en est que plus explicite : Avalanche livrera un matériel
inédit issu de documents sonores et/ou visuels en lien avec une exposition importante, ou une rencontre
dans un contexte choisi. Faire de l'information sur l'art, sous toutes ses formes possibles, et notamment
sous la forme de l'entretien, devient par ailleurs un modèle qui se généralise dès la fin des années 1960.
Toutes publications, quelque soit leur aspect, deviennent la possibilité (pour les artistes en particulier)
de communiquer, d'exprimer leurs idées sur l'art et de préciser la destination de leur travail. La pratique
conceptuelle d'un art critique et de la performance encourage plus généralement la production de
discours annexes aux œuvres. Avalanche n'en est qu'un des supports de diffiision.
Avalanche obéit au traitement concentrique d'une information abordée sous différents angles
d'attaque dans un même numéro ou d'une livraison à l'autre. Chaque nouvel entretien, chaque
documentation visuelle proposée apportent ainsi dans l'un ou l'autre numéro un éclairage nouveau,
enrichi par la confrontation avec d'autres œuvres et d'autres artistes. Inviter Robert Smithson, Dennis
Oppenheim ou Vito Acconci dans un sommaire orienté vers l'Earth Art, puis vers le Body Art, facilite un
décloisonnement entre toutes ces pratiques, et encourage une 1. Cinq numéros paraissent réflcxion coutinuc sur l'actuaUté. Lorientatiou thématique sous ce format, entre mai 1974 (n° 9) et l'été 1976 (n° 13). suggérée dans chacun des numéros donne ainsi l'illusion d'une
8 L A R E V U E DES REVUES N° 29
approche éphémère, mais néanmoins cohérente de l'actualité. Contrairement à de nombreuses autres
revues de l'époque, qui comme VH101 (Paris-Zurich, 1970-1972), Kunsforum (Mainz, 1973-...) ou
Der Ldwe (Berne, 1974-1976) marquent une préférence pour une organisation thématique de leur
sommaire, les responsables d'Avalanche n'ont jamais explicitement énoncé en couverture ou dans les
sommaires le dième fédérateur de chacun des numéros. Celui-ci se déduit de la place réservée à Cari
André, Jan Dibbets, Richard Long, Robert Morris, Michael Heizer, Dennis Oppenheim et Robert
Smithson dans le premier nimiéro (automne 1970) principalement consacré à la pratique de l'Earth Art ;
de celle laissée à Jackie Winsor, Sol LeWitt, Stanley Brouwn, Hanne Darboven ou Lawrence Weiner dans
le numéro quatre (printemps 1972) sur r7\rt conceptuel ; ou enfin de celle laissée à General Idea, Lowell
Darling, Edward Ruscha et William Wegman dans le numéro sept (hiver 1972-printemps 1973) autour
de l'humour. La souplesse offerte par une thématique non explicitement définie permet, à chaque nouvelle
livraison dAvalanche, une lecture plurielle et non figée de l'ensemble de ces pratiques. Laissant
volontairement la parole aux artistes, avec les écarts que permet la discussion et avec l'énergie qui s'en
dégage, les entretiens représentent un espace de réflexion ouvert aux remarques spontanées, à l'anecdote
et aux commentaires les plus directs. Les entretiens dévoilent le contenu de l'œuvre et de la pensée des
artistes interrogés ; ils donnent des clefs de compréhension parfois contredites par l'un et l'autre
interlocuteur dans un même numéro dAvalanche. Libre au lecteur de bâtir sa propre interprétation des
démarches ainsi livrées !
Dans un même élan, l'entretien individualise l'artiste et son travail. Il l'accompagne et aide à la
présentation de son œuvre. Il lui donne une voix et, dans Avalanche, souvent un visage. L'entretien
donne l'illusion d'une proximité avec l'artiste et d'une communication plus spontanée quAvaknche
tente de rendre toujours plus authentique à chaque numéro. On connaît par ailleurs l'importance de la
parole, de l'enseignement oral dans la pratique de nombreux artistes des années 1960-1970, dont
Joseph Beuys reste un exemple marquant'.
La figure de Tartiste
Parallèlement et contrairement airx revues d'art qui choisissent couramment la reproduction d'une
œuvre en couverture, Avalanche préfère la formule du portrait d'artiste pour « donner corps » au
contenu qu'elle propose. Tel un magazine culturel de grande diffusion, Avaknche affiche des artistes « vedettes » dont les l . Beuys a publié près d'une trentaine
a entretiens et de prises de paroles visages prêtent leurs traits au contenu des numéros qu'ils publiques, entre 1961 et 1970.
LA REVUE DES REVUES N° 29 9
incarnent'. Dans une revue attachée aux pratiques d'un art de l'action, ces portraits sont l'occasion de
valoriser la « figure de l'artiste » et de rendre hommage aux artistes. C'est ainsi que Joseph Beuys
bénéficie d'une première couverture dans une revue d'art américaine grâce 2i Avalanche en 1972. Ces
portraits procèdent à une mise en avant symbolique de la personnalité de l'artiste, qui trouve sa
réalisation la plus aboutie dans le numéro monographique consacré à Vito Acconci à l'automne 1972
(n° 6). Avec ce sixième numéro. Avalanche joue à nouveau avec les limites éditoriales d'une revue d'art
classique. Elle s'aventure dans la conception d'un numéro réunissant les avantages d'un authentique
catalogue monographique (pourvu d'un catalogue raisonné des œuvres, d'un index, d'une bio
bibliographie, etc.). Faut-il y lire une réaction à un contexte institutionnel qui n'a pas encore reconnu
la richesse d'un travail pourtant déjà sanctionné par plus de soixante-dix pièces (sous la forme
d'activities, de performances, de films, de vidéos et d'enregistrements sonores) ? Difficile de ne pas
répondre par l'affirmative. Il reste que ce numéro, qui demeure encore aujourd'hui une source de
première main sur le travail de V. Acconci, est à lui seul une entreprise éditoriale très réussie.
Impact de Image
L'idée d'une proximité avec l'artiste et d'un accès immédiat à l'œuvre est complétée par un très
grand nombre d'illustrations que la revue, grâce au concours de photographes qu'elle sollicite
régulièrement, soumet, tel un reportage documentaire, en complément des entretiens publiés. W. Sharp
réussit en vrai « communicateur » à importer dans la revue des techniques inhabituelles pour les revues
d'art traditionnelles, qui s'avèrent très efficaces dans un tel contexte éditorial. Aucune revue d'art au
même moment ne s'est montrée capable de reproduire un reportage aussi direct, aussi pertinent, et aussi
complet sur l'art le plus novateur. Ces images « muettes » et leur composition quasi-cinématographique
soulignent les moments clés des œuvres et de leur déroulement
dans le temps. Le montage visuel essaye de rendre « l'énergie en
acte », le processus mis en œuvre, à partir d'une image ou d'une
série de prises de vue qui suggèrent un avant et un après. Quoi de
plus direct que la composition d'images sur Joseph Beuys
installant Fettecke (n° 1) pour inscrire une action dans le temps,
pour rendre l'immédiateté de cette action que l'artiste nous invite
à lire dans l'observation de ses gestes, dans la symbolique des
matériaux qu'il choisit et dans leur occupation de l'espace ?
1. Voir surtout les couvertures des numéros 1 à 8 Avalanche diffusant les visages de Joseph Beuys (n° 1, automne 1970), de Bruce Nauman (n° 2, hiver 1971), de Barry Le Va (n° 3, automne 1971), Lawrence Weiner (n° 4, printemps 1972), de Yvonne Rainer (n° 5, été 1972), de Vito Acconci (n° 6, automne 1972), de Man Ray / William Wegman (n° 7, hiver 1972-printemps 1973) et de Robert Smithson (n° 8, été-automne 1973).
ans rédacteurs » : Avalanche, New York, 1970-1976
définition, méthode, usage
par Sylvie Mokhtari^
par Yves Chevrefils Desbioiies
par Gérard-Den
t la résurrection de La Nouvelle Revue française, 1953 par Martyn Cornick i par Gilles ^ ^ JBj
e franco-marocaine contre le protectorat, 1932-1936
et le monde des revues au tournant du siècle par Benoît Marpeau
C H R O N I Q U E S Parcours de Théodor Balmoral— Le site revues.org : une fédération de revues de sciences humaines et sociales sur internet — Autour de XAnnuaire de TAfrique du Nord : le Maghreb en revues — Deux colloques sur les revues
L E C T U R E — N O U V E L L E S R E V U E S
Prix: 100 F (15,24 € ) ISSN : 0980-2797 ISBN : 2-907702-25-4
782907 llllllllllll
702256












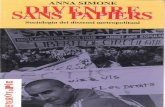








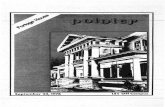


![Elektor[nonlinear.ir] 1976-03.pdf](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63255337cedd78c2b50c8927/elektornonlinearir-1976-03pdf.jpg)







