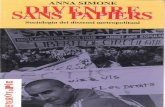Les Copiaus sans Copeau
Transcript of Les Copiaus sans Copeau
94
Les Copiaus sans Copeau
Miloš Mistrík
Une confrérie théâtrale
Jacques Copeau, accompagné de sa famille, d’ acteurs, d’ élèves et de collaborateurs, quitte Paris pour la Bourgogne en 1924. Léon Chancerel l’ aide à trouver un endroit propice à l’ installation. Après deux mois de vaines investigations et de négociations avortées, Copeau décide d’ opter pour une location et de limiter les recherches à la seule région bourgui-gnonne. L’ existence du Vieux-Colombier a épuisé ses ressources. Aussi, ne cherche-t-il pas seulement une région appropriée mais également un prix modéré. Malgré cela, il est surprenant qu’ il opte finalement pour une maison à l’ abandon total, appartenant à des gens qui vivent alors dans le Midi, engageant la bonne santé de sa compagnie, située dans une petite commune bourguignonne au nom funèbre1 – Morteuil.
Il s’ agit bien d’ une ferme, vu de l’ extérieur le bâtiment donne cependant l’ impression d’ un château fortifié. Même de nos jours, on peut observer sur la façade, à côté de la porte d’ entrée, les vestiges du mécanisme d’ un pont-levis. Comme nous l’ apprennent les souvenirs des participants à l’ entre-prise, ils trouvent « La maison dans un état de saleté incroyable. Les poêles et fourneaux fonctionnent mal2. » Une maison sans éléctricité, froide, aux murs suintants. Son emplacement est un des plus humides des environs de Beaune. Les champs alternent avec les étangs, les flaques d’ eau stagnent sous les arbres, sur les routes et dans les prés. Des plantes hydrophiles sont cultivées dans les champs, le bétail paît dans les prairies arrosées, les pois-sons abondent dans les étangs, dans les ruisseaux et dans les petites rivières.
1 Expression de Jean VILLARD-GILLES, in Mon demi-siècle et demi, Lausanne, Éditions Ren-contre, 1970, p. 121.
2 In Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929. Édition commentée par Denis Gontard, Paris, Seghers, 1974, p. 42.
Les Copiaus sans Copeau 95
La Bourgogne a la réputation d’ être une région de vignobles, ensoleillée, vallonnée ; mais Morteuil, situé dans une vaste plaine, aux confins de la Saône-et-Loire et de la Côte-d’ Or, ne l’ est pas. Jacques Copeau, après avoir visité la maison, consent à ce que tout le monde y emmenage, y compris lui-même et sa famille. Léon Chancerel, qui avait aussi vu cette habitation, s’ est installé, avec sa femme et Suzanne Maistre, dans le petit village de Demi-gny, distant de deux kilomètres. Plus peuplé que Morteuil et possédant les locaux appropriés pour la présentation de pièces de théâtre.
La plupart des acteurs de la première heure du Vieux-Colombier restent à Paris ; Seuls Auguste Boverio, François Vibert, Jean Villard et Suzanne Bing suivent le Patron. Les autres membres de la troupe ne sont alors qu’ élèves de l’ École du Vieux-Colombier. Alexandre Janvier, machi-niste, et Georges Chennevière, poète, les accompagnent. Si l’ on compte aussi tous les membres des familles, car quelques-uns ont déjà une femme et des enfants, ils sont trente-cinq au total.
L’ ambiance dans le groupe est excellente. Partir pour la campagne, c’ est pour tous tendre en quelque sorte vers un but désiré. Ils s’ éloignent du cabotinisme de Paris pour s’ approcher du théâtre populaire. Ils peuvent continuer à étudier, à expérimenter et à préparer une comédie nouvelle qui devait être une version moderne de la commedia dell’ arte. Les premiers s’ installent en septembre et en octobre 1924, la troupe est complète en dé-cembre. Un ciel haut et un air frais les enchantent mais aussi l’ excitation de pouvoir continuer à servir le théâtre. Jeunes, très jeunes, ils découvrent un monde nouveau, celui des petites villes et des villages environnants, consta-tant qu’ il y a des salles adaptées à présenter des pièces de théâtre, que la région, loin d’ être pauvre, a une vie sociale à laquelle ils participent.
Cependant, le Patron ne partage pas cet engouement. Plus tard, en 1931, il se souviendra de l’ état d’ âme dans lequel il se trouvait à son arrivée :
Mélange de fatigue, d’ inquiétude, de désespoir, d’ illuminations... déper-dition dans l’ insomnie, dans l’ absence totale de ménagements... attachement frénétique à des idées, à des choses, à des usages qui n’ étaient pas jugés par ceux qui m’ entouraient aussi importants que je les faisais, avec une passion qui peut-être me rendait ridicule à leurs yeux... et cette colère qui grondait en moi sans répit... Je n’ étais plus aimable. On ne pouvait plus m’ aimer.3
3 Jacques COPEAU, Souvenirs du Vieux-Colombier, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1931,
96 Miloš Mistrík
Le manque de ressources financières serait une raison du choix de cet endroit morne, tout comme un désir presque fanatique d’ ascétisme, d’ une vie quasi érémitique, d’ abandon de soi que Copeau aime tellement à offrir à ceux qui l’ entourent. Il critique et opprime toutes les tentatives du luxe, si petit soit-il. Au moment où il emménage en Bourgogne avec sa troupe, il écrit à Aman Maistre : « Nous allons retrouver les conditions nouvelles d’ un art dramatique et nous allons servir Dieu4. » Il « traversait une crise religieuse. Il était rentré dans le sein de l’ Église et manifestait la ferveur un peu envahissante propre aux nouveaux convertis. Il faisait du prosélytisme et avait imaginé de porter chaque jour au billet de service traditionnel le nom du saint du jour et, le cas échéant, de la fête religieuse. Cela nous exas-pérait d’ autant plus que nous y sentions la volonté de nous tirer derrière lui. [...] Il semblait qu’ il eût le diable à ses trousses, et cette conversion, loin de lui apporter la paix, augmentait encore ses tourments.5 »
Dès le début de la période bourguignonne, il réagit d’ un air de re-proche aux petites scènes accompagnées de chansons anciennes fran-çaises, grivoises et frivoles jouées pour lui à son arrivée à Morteuil, le 3 novembre 1924. Le lendemain, il convoque les membres de sa troupe pour leur faire un discours essentiel sur les objectifs du séjour en Bour-gogne et sur ses intentions. Il dit avoir tout abandonné pour ce projet commun. Il leur demande de rester fidèles à « la personne morale de l’ École », de respecter une discipline sévère, de s’ adonner au travail comme si c’ était une « religion ». Malgré la promesse qu’ il a faite de leur payer les salaires, il parle de la vie en pauvreté, de la dévotion au travail et de l’ intérêt collectif. C’ est lui-même qui détermine sa propre posi-tion. Il est là « pour filtrer, choisir, expliquer, équilibrer, harmoniser6 ». Comme les membres de la troupe sont vraiment attachés à l’ œuvre, incarnée à leurs yeux notamment par les idées théâtrales de Jacques Copeau, quelques visions différentes de la vie ne conduisent pas encore aux divergences essentielles. Cependant, les problèmes et les conflits qui opposent la vision du monde professée par le Patron et la façon dont voulaient vivre les jeunes, se sont posés aussi par le passé. Parmi tous les
pp. 104-105.4 Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929, op. cit., p. 165.5 J. VILLARD-GILLES, Mon demi-siècle et demi, op.cit., pp. 130-131.6 In Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929, op. cit., pp. 44-46.
Les Copiaus sans Copeau 97
exemples, on peut citer au moins une rupture dramatique avec Charles Dullin aux États-Unis, en 1919.
L’ année 1925 commence le 24 janvier par une prestation totalement manquée de la troupe à Lille qui essuie un échec global, rentre bredouille, alors qu’ elle souhaitait obtenir des subventions auprès des industriels du nord de la France pour subsister. Un différend survient entre le maître et ses disciples. Copeau, qui se fait un devoir de nourrir sa troupe, se trouve quelques mois après son ancrage provincial dans une crise financière dé-finitive. Complètement désespéré et ne voyant pas d’ autre issue, il dissout sa petite compagnie théâtrale. Mais certains membres refusent et déci-dent de rester en Bourgogne, à leurs risques et périls, sans son soutien financier. Ils veulent continuer à exister indépendamment. Une volonté forte, l’ enthousiasme et le talent les aident à acquérir vite un nouveau public et à faire revivre ce qui semblait être en ruines, au printemps 19257. Les voyant prospérer sans son soutien, Copeau déclare vouloir reprendre la direction, le 8 juin 1925. La réaction à cette reprise de pouvoir est né-gative. Elle émane autant des membres anciens que des nouveaux de la troupe. Le plus indigné par cette décision du Patron est Léon Chancerel, légèrement plus âgé que les autres. Copeau voit en lui un élément suscep-tible de mettre en danger sa posture. Mais la compagnie finit par accepter la position dirigeante que le Patron détermine lui-même. Léon Chancerel s’ en va à Paris, suivi par Auguste Boverio. Jean Villard rappelle ainsi cette période douloureuse :
Nous n’ arrivions pas à comprendre pourquoi il ne saisissait pas cette chance de pouvoir méditer seul, préparer l’ avenir en toute liberté d’ esprit, en ayant à ses côtés une petite troupe attachée à lui et prête à vivre par ses propres moyens ; et, bien entendu, prête aussi à le servir, lui le premier, s’ il avait quelque chose à nous apporter. Mais il ne pouvait supporter cette idée que nous fussions indépendants de lui.8
7 Le noyau de ce groupe est constitué de Michel Saint-Denis avec Léon Chancerel, Jean Villard, Aman Maistre et Auguste Boverio, vite rejoints par Suzanne Bing, Marie-Hélène Copeau – la fille du Patron, appelée par tous Maïène, Marie-Madeleine Gautier, il y a encore Marguerite Cavadaski et Jean Dasté qui les suivent. Le technicien Alexandre Janvier, lui aussi, refuse de les quitter.
8 Ibidem, p. 119.
98 Miloš Mistrík
Demigny. Carte postale.
La maison à Morteuil en 2013. Les vestiges du pont-levis visibles sur la façade. (Photo Miloš Mistrík).
Les Copiaus sans Copeau 99
Copeau, lui non plus, ne se sent pas à l’ aise. Les jeunes membres ne sont plus ce qu’ ils étaient au temps du Vieux-Colombier à Paris. Il était une personnalité centrale, ayant le dernier mot sur le choix du réper-toire, tant sur les œuvres classiques que sur les scénarios et prologues dont il était l’ auteur. Mais suite au fiasco de Lille, pour lequel il avait écrit L’ Objet ou les Contretemps ainsi que L’ Impôt, il voit son autorité s’ affaiblir. Les spectacles suivants se préparent avec le concours des membres de la troupe. Les classiques restent au répertoire, les spectacles de soirée sont composés d’ une série de scènes dans lequelles certains acteurs insèrent leurs propres contributions, improvisations, chants choraux des chan-sons anciennes, du mime…
La compagnie adopte pour la première fois le nom des Copiaus que lui ont attribué spontanément les spectateurs locaux9, lors de la représen-tation qu’ elle donne à Demigny, le 17 mai 1925. Ce nom rappelle à la fois Jacques Copeau, le fait que les comédiens sont ses disciples et en même temps il y a une référence au copis qui désigne le cep en patois, c’ est-à-dire ce que les gens ont ici de plus précieux. Composé de plusieurs parties, le spectacle de Demigny commence par un cortège dans les rues. C’ est ici qu’ apparaît le personnage de Jean Bourguignon, créé par Michel Saint-Denis. « C’ est un personnage haut en couleur, fortement ancré dans le terroir10. » Jean Villard se souvient :
Chancerel avait écrit un divertissement poétique, Boverio préparait en grand secret un mime burlesque, Maistre un prologue, moi la musique et des chansons (mes premières chansons), et je montais une farce de Thomas Gueulette dans lequel j’ incarnais le masque enfariné, ce personnage que Watteau a rendu célèbre11 et qui, plus tard, me fournit un pseudonyme :
9 « Les gens du pays, patoisant le nom du Patron, nous appellent ‘Les Copiaus’ . La troupe adopte ce titre. », in Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929, op. cit., p. 75.
10 Denis GONTARD, ibidem, pp. 179-180. Dans le Prologue de Mersault, Michel Saint-De-nis interprétant Jean Bourguignon se décrit comme suit : « Penché sur la côte, au flanc du coteau, / À remonter ou à descendre dans la raie / Sous le soleil qui s’ enforce droit dans la terre / Je me fais l’ effet, malgré la peine, / Malgré la peau cuite et la gorge pelée, / D’ un roi toujours en lutte, toujours en guerre, / Qui connaît victoire et revers, / Mais dont le renom / Depuis maints siècles / Domine une partie de la terre / Car je produis Vin de Bourgogne / Et je me nomme Jean Bourguignon. »
11 Il s’ agit du célèbre tableau de Watteau Pierrot de 1718, connu également sous le nom de Gilles.
100 Miloš Mistrík
Gilles. [...] Pour ce spectacle, il nous manquait une demi-heure. Copeau, pour nous aider, nous avait promis un petit acte qu’ il jouerait lui-même. [...] Quand il vint, la veille de la représentation, nous jouer sa pièce, nous fûmes consternés. [...] C’ était l’ histoire – tirée d’ un authentique drame qui s’ était déroulé dans le village de Demigny – d’ un vieux paysan neurasthé-nique qui s’ était suicidé en avalant presque d’ un trait un litre de marc de Bourgogne. [...] Copeau, pour comble de malheur, jouait ça avec un réa-lisme effrayant. Il y était abominable. Il semblait qu’ il eût rassemblé, dans sa pièce et dans son jeu, tous les moyens, toutes les facilités qu’ il avait com-battus pendant dix ans...12
Ce petit acte est tellement inapproprié pour être présenté de nouveau que Copeau lui-même le remplace, quelques jours plus tard (le 24 mai 1925), par un court scénario, Mirandolina, qu’ il a écrit en toute hâte d’ après La Locandiera de Goldoni.
Les premiers mois en Bourgogne sont difficiles. En plus de leur situa-tion précaire, les Copiaus recherchent intensément leur voie. Le public parisien est différent du bourguignon, même si nous devons nous abste-nir de penser qu’ ils jouent uniquement pour les spectateurs non scola-risés et pour les paysans. Ils ne jouent pas seulement dans les auberges, sur les marchés, sur les places pendant les fêtes publiques. Ils chantent en chœur, à plusieurs reprises, dans les églises. Dès le début, ils se produisent aussi dans les villes de Beaune, Dijon, Chalon-sur-Saône, dans les salles de théâtre. Ils se font accepter non seulement par le public populaire mais aussi par les notables et les entrepreneurs locaux. Pendant les dernières années de la période bourguignonne, ils ne jouent même plus du tout dans les villages. Par contre, ils font des tournées en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Grande-Bretagne et en Italie.
Le Patron choisit des auteurs anciens, français, espagnols et italiens, ou bien ils rédigent eux-mêmes leurs propres scénarios. Ils s’ inspirent plu-sieurs fois de la vie locale bourguignonne et de ses traditions. Pour Copeau, la commedia dell’ arte est une pure source de culture et d’ humanisme, pour les Copiaus, c’ est aussi une impulsion pour leurs propres improvisations et compositions. Ils montent, entre autres, Arlequin Magicien, Le Médecin malgré lui (15 août 1925), L’ École des maris (25 octobre 1925) de Molière, Les
12 J. VILLARD-GILLES, op. cit., pp. 117-118. Le petit acte est intitulé Le Veuf.
Les Copiaus sans Copeau 101
Cassis (24 août 1925) de Lope de Rueda, L’ Illusion (3 octobre 1926) adaptée de La Célestine de Rojas et de Corneille, L’ An-conitaine ou les Amoureux de Padoue (8 novembre 1927) de Ruzzante. Jean Villard, Michel Saint-Denis et Aman Maistre contribuent de plus en plus au choix du répertoire.
Dès sa première année en Bourgogne, la troupe se rend compte que tout ce qui a un rapport à la viticulture et à la production du vin, est inspi-rant du point de vue drama-tique, et de surcroît rentable. Pour remédier à leurs pro-blèmes financiers, les jeunes acteurs participent aux travaux viticoles, ils acquièrent ainsi des connaissances pratiques. Les producteurs locaux paient même les acteurs comme présentateurs et propagateurs de leurs vins sur les marchés et les expositions. Les vignerons invitent les Copiaus à participer à leurs fêtes traditionnelles en tant que comédiens ou en tant qu’ invités et amis. Plus tard, Copeau prête aux entrepreneurs locaux la cuverie de Pernand qu’ il a aménagé en salle de spectacles ; des réunions sociales et des bals s’ y déroulent aussi13, les Copiaus y font leurs répéti-tions et des excercices d’ école.
La Célebration du vin, de la vigne et des vignerons, présentée le 14 novembre 1925 à Nuits-Saint-Georges, puis le 23 novembre 1925 à Mer-sault, devient le premier manifeste de la compagnie déclarant son adhé-sion à cette composante importante de la Bourgogne. Un travail collectif effectif en est l’ aboutissement14 bien que Copeau soit cité comme auteur
13 Cf. Vincent CHAMBARLHAC, « Les Copiaus, Jacques Copeau, au village – 1925-1929 », In Annales de Bourgogne, Dijon, 2012.
14 Le rassemblement collectif de la documentation nécessaire, l’ étude de l’ histoire et de la pré-sence du métier viticole en Bourgogne. On trouve dans les archives les documents écrits
La Fanfare à Demigny. A la tête Michel Saint-Denis porte la bannière des Copiaus, 1925.
102 Miloš Mistrík
du scénario. Seul, il n’ aurait pu réaliser cela ! Il s’ agit du spectacle des Copiaus préparé vraiment collectivement.
Dans les Souvenirs du Vieux-Colombier, Jacques Copeau nous donne des éléments permettant de reconstituer le spectacle sur La Célebration du vin, de la vigne et des vignerons. Il présente l’ espace ouvert d’ un tré-teau, situé devant une grande salle, où dominent les acteurs en vêtements clairs, éclairés par les projeteurs. Il esquisse à grands traits le sujet, une composition kaléidoscopique des petites scènes dialoguées, des chants choraux et des danses. Il décrit les histoires humoristiques des person-nages – y compris celles de Jean Bourguignon – qui déclarent leur amour de la bouteille, histoires dans lesquelles la sympathie mutuelle entre les deux sexes est sous-entendue :
Il faudrait surtout vous décrire ces fêtes de Dijon, de Beaune ou de Nuits, ces Célébrations de la vigne et du vin qui répandirent dans toute la province la réputation de mes compagnons...
Face à des centaines, à des milliers de vignerons accourus de tous les points de la côte, quatre à droite quatre à gauche, et le chef au milieu, bien établis dans leur formation chorale, fermes sur jambes, les fronts haut levés, les voix claires et fortes, mes Copiaus pindarisaient en l’ honneur des petites reines hâlées que le suffrage de leurs communes avaient désignées, en cette fête des vendanges, pour conduire les cortèges et présider à la Paulée.
Puis, cette première partie de la cérémonie achevée, la nuit venue, les compagnons quittaient la salle, avec leurs habits clairs, la fleur au chapeau, se mêlant au peuple dans les rues, reconnus, interpellés, fêtés, hébergés jusqu’ à l’ heure où la salle de nouveau s’ emplissait, plus frémissante, plus houleuse, où nous reparaissions sous les lampes pour un nouveau divertis-semenet dont le héros est Jean Bourguignon. Voici Jean Bourguignon :
JEAN BOURGUIGNON : Salut la Louise, la Berthe, la Rose et la Suzon.LES QUATRE FILLES : Salut, salut, salut, Jean Bourguignon. Salut, roi de la côte !BERTHE : Vous êtes-vous levé du bon pied, ce matin, et point trop besin ?
que les Copiaus ont rassemblés : noms des grands crus de Bourgogne, descriptions des faits historiques divers, des légendes, des coutumes locales et des historiettes. Ensuite la liste des maladies du cep de vigne mais aussi un petit vocabulaire d’ expressions locales et des di-zaines d’ autres petites notes et remarques.
Les Copiaus sans Copeau 103
ROSE : C’ est à ce coup qu’ on va voir ce que vous savez faire.LOUISE : Si vous avez deux bras aussi bien pendus que la langue.SUZON : Et si vous entendez aussi bien à détacher la grape qu’ à faire gan-doise et pousser la chanson.JEAN BOURGUIGNON : Laissez, laissez, filles d’ en bas, qui venez aux vendinges sans outils ni charpaigne. Si c’ est des bras qu’ il vous faut, il n’ en manque pas dans le finage. Si la grape est grosse, j’ ai la main large, et quand il y en a deux, j’ y mets les deux mains...
Conteste des vignobles, dialogues d’ amour, chœurs bachiques, proverbes et chansons, danses des travaux de la vigne et du vin. Le père Noé venait les interrompre. Voici le père Noé :
J’ ai bu, je bois et je boirai. On dit que ça ne vaut rien ? Ça console de tout. Si tu as des soucis dans tes affaires, bois un verre de blanc. Si ta femme te trompe, bois un verre de rouge. Si elle recommence, recommence aussi. Ça guérit de tout. Si tu as des maux de dents, bois de la Romanée, si tu as des rhumatismes, bois du Nuits-Saint-Georges. Les hommes aiment voir les femmes boire du Bordeaux qui est langoureux, mais les femmes aiment voir les hommes boire du Bourgogne, qui est héroïque. Il a guéri Louis XIV et donné des conseils à Napoléon. Il faut en faire boire à la République...
Ainsi nos jeux, presque improvisés, s’ accordaient à la circonstance, à la saison, au terroir, au public. Ils étaient sains, vigoureux, à peu près complè-tement décrassés de la poussière du théâtre. Ils ébauchaient hardiment mais incomplètement, pauvrement mais sincèrement des formes plus libres, plus aérées. Ils ont souvent obtenu, naturellement, cette adhésion du public, ces instants de communion parfaite entre la scène et la salle qui sont les som-mets du théâtre, et que tant d’ esthètes et théoriciens cherchent à atteindre par des moyens sophistiqués15.
Les premières années hors de Paris (1924-1926), le Patron est fécond : il écrit, met en scène, joue, anime la troupe. Pour améliorer la situation économique, il prononce sur invitation des conférences, en France et à l’ étranger, il prépare une mise en scène aux États-Unis (The Brothers Ka-ramazov, New York, 2 janvier 1927). Comme il est occupé plus qu’ avant,
15 Jacques COPEAU, Souvenirs du Vieux-Colombier, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1931, pp. 114-118.
104 Miloš Mistrík
depuis 1926, les pauses commencent à se prolonger entre les différents scénarios qu’ il écrit pour ses acteurs.
Les Copiaus intensifient leur travail collectif. « Michel achète à Beaune des masques de Carnaval. L’ idée de la Comédie à personnages fixes, que le Patron a confié à plusieurs depuis longtemps, et à d’ autres dès le début du travail ici, se développe et fait sujet de presque toutes les conversations entre Michel, Boverio, Villard, Chancerel, de leurs re-cherches et de leurs improvisations16. » Chaque comédien forge un ar-chétype en faisant le masque et le costume en écrivant les sketchs et les petites scènes qui s’ y rattachent. « Michel Saint-Denis crée Jean Bour-guignon, qui incarne l’ esprit du vignoble, Jean Dasté campe un Capitan bourgeois nommé César, Aman Maistre est le premier Amoureux, bap-tisé Julien (qui demeura son nom d’ artiste), Jean Villard, sous le nom de Plombin, puis de Gilles, qu’ il a conservé au cabaret, rejoint la tradition du second zanni en incarnant un valet ‘gourmand, naïf, paresseux, un peu porté sur la chose’ .17 » « Dans la lignée des Polichinelles, l’ éton-nant Bitouille de Marcel Boverio, est une parfaite illustration du type du Représentant tel que l’ imaginait Copeau. [...] De son côté Léon Chan-cerel donne vie à (Jean-)Sébastien Congre [...]. Archiviste-paléographe, collectionneur de fiches, membre de l’ Institut, Sébastien Congre se rat-tache à la famille des Vecchi et des pédants traditionnels18 ». Les enfants de Copeau, eux aussi, essaient leurs personnages : « Maïène une prin-cesse de conte [...]. Le jeune homme présenté par Pascal [le fils] devient le M. Valentin...19 ». En août 1925, un divertissement, Les Vacances, fait partie d’ un spectacle composé de plusieurs parties dans lequel appa-raissent aussi Jean Bourguignon et Gilles. Dans les mois et les années qui suivent, les divertissements20 s’ unissent peu à peu avec les autres
16 In Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929, op. cit., pp. 66-67.17 Jean VILLARD-GILLES, « Léon Chancerel, le Vieux-Colombier et les Copiaus », in Revue
d’ histoire du théâtre, Paris, 1968-2, p. 158.18 Maryline ROMAIN, Léon Chancerel. Portrait d’ un réformateur du théâtre français (1886-
1965), Lausanne, L’ Age d’ Homme, 2005, pp. 90-91.19 In Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929, op. cit., p. 67.20 Denis GONTARD, ibidem, p. 28 : « Les Cassis (fin octobre 1925). Cette courte pièce évoque
par la chanson, le geste et la parole, la culture et la récolte des cassis, chers aux Bouguignons. En octobre de la même année, c’ est Le Lavoir, divertissement mimé sur le thème des femmes en train de laver leur linge au lavoir communal. »
Les Copiaus sans Copeau 105
scènes pour aboutir naturellement à des spectacles plus importants, composés collectivement.
Après y avoir passé une année, ils quittent Morteuil pour se trou-ver ensemble sur la pente ensoleillée, fertile, dominée par la colline de Corton, entourée de parcelles de vignes. Jacques Copeau achète la mai-son de Pernand-Vergelesses. Les Copiaus le rejoignent le 11 décembre 192521 :
L’ installation des Copiaus à Pernand marque un moment essentiel dans la vie de Jacques Copeau en Bourgogne et dans celle de la troupe réunie au-tour de lui. Un peu plus d’ un an après l’ arrivée dans cette région, après les difficiles premiers mois dans la maison de Morteuil, la dissolution partielle de la communauté et la fondation de la troupe de campagne, Copeau pos-
21 Ibid., p. 97.
Jean-Sébastien Congre (dessin de Léon Chancerel pour Les Copiaus, 1924).
106 Miloš Mistrík
sède, enfin, dans ce village de la Côte, un lieu de travail calme et reposant. Il dispose aussi d’ un groupe de comédiens et d’ élèves qui lui permettront de poursuivre les recherches théâtrales qu’ il avait interrompues à la fermeture du Vieux-Colombier. Les Copiaus, de leur côté, trouveront à Pernand un pu-blic encore plus ouvert, encore plus réceptif que celui de Demigny. Quarante ans après le séjour de la jeune troupe, le souvenir des Copiaus est resté encore très vivant chez les habitants de Pernand qui nous ont dit combien ils avaient apprécié l’ implantation d’ une troupe de comédiens dans leur village22.
Les orphelins de Copeau
Malgré une installation décente et des occupations prometteuses pour tous, Copeau semble délaisser sa compagnie, ralentit son activité d’ au-teur et de metteur en scène. Il espace même les rencontres directes avec les jeunes. En 1926, on renouvelle les exercices d’ École et Pernand voit venir de nouveaux élèves, de France comme de l’ étranger23, Suzanne Bing et des Copiaus assurent l’ enseignement. Copeau ne visite pas la cuverie. La tension entre lui et ses acteurs augmente. Jean Villard relate le climat de tension : « Imaginez alors, ce qui se passe dans nos têtes : l’ ennui, la pauvreté, la médiocrité, un travail stérile et la solitude campagnarde qui commence à nous peser lourdement, et par-dessus le marché, comble de l’ abandon, le maître, le Patron, réfugié, en fuite plutôt, dans son silence et qui, non seulement ne prépare rien, mais encore ne s’ ouvre pas, ne nous parle pas, montre un visage dur, morose.24 »
Le Patron écrit et met en scène néanmoins deux pièces pour eux : L’ Illusion et L’ Anconitaine, les spectacles reçoivent un accueil favorable du public et de la critique et qui représentent le summum du travail sur la comédie nouvelle de Copeau en Bourgogne. Mais ils ont cependant besoin de renouveler leur répertoire pour gagner décemment leur vie. Au début de 1927, Jean Villard présente un canevas de scénario. Dans
22 Ibid., p. 192.23 « Je viens de remettre en mouvement cette jeunesse qui m’ entoure. Il s’ agit de ne la plus
décevoir », note-t-il le 5 mai 1926, in Jacques COPEAU, Journal 1901-1948. Deuxième par-tie : 1916-1948. Paris : Seghers, 1991, p. 233.
24 J. VILLARD-GILLES, Mon demi-siècle et demi, op. cit. , p. 127.
Les Copiaus sans Copeau 107
ses commentaires du Journal de Bord des Copiaus, Denis Gontard écrit : « Les Copiaus, pendant l’ absence du Patron, donnent, avec le scénario de la Guerre, apporté par Marie-Hé-lène Copeau, et avec Le Prin-temps, apporté par Jean Villard, deux exemples de leur travail de création25. Dans les deux cas, il s’ agit d’ un travail d’ ensemble pour lequel sont mis en pra-tique les exercices d’ improvi-sation, de mime et d’ utilisation des masques, tels qu’ ils étaient enseignés à l’ École du Vieux-Colombier.26 » Jean Villard confirme :
Il s’ agissait, partant du chœur et du masque, de dérouler comme en une fresque vivante la montée de la sève dans les plantes et dans les arbres, de faire jaillir la fleur, le vent, le bond de l’ animal dans la forêt, d’ y mêler l’ homme, ses travaux et ses amours, et de couronner ce geste du printemps par des noces et leur cortège de chants et de danses. [...] Nos doigts, nos mains, nos bras, successivement, devenaient comme les signes de la vie sou-terraine qui, peu à peu, envahit la plante. Nos trois groupes, dont les mou-vements se composaient ensemble, différents mais synchronisés, s’ élevaient lentement, s’ épanouissaient comme des arbres, en branches, en fleurs, et même, sur un coup de vent dont nous imitions le bruit de nos bouches fer-mées, nos mains soudain frémissantes suggéraient le brusque envol des oi-seaux. Ce n’ était pas de la danse mais une sorte de pantomime, exprimant, sans la copier, la nature dans son réveil printanier27.
25 Rappelons qu’ à ce moment les hommes de la compagnie préparent aussi une courte scène comique Les Musiciens, qu’ ils représentent occasionnellement. In Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929, op. cit., p. 117.
26 Denis GONTARD, ibidem, p. 202.27 J. VILLARD-GILLES, Mon demi-siècle et demi, op. cit., pp. 136 et 138.
Les Copiaus avec Jacques Copeau à la cuverie, 1925.
108 Miloš Mistrík
Pendant les préparations de La Guerre et du Printemps, les Copiaus poussent leurs expérimentations sur le développement du langage drama-tique. Le 26 février 1927, Copeau apprécie leur implication : « Mes Copiaus me montrent la série de leurs exercices qui presque tous sont dans la bonne voie. » Le 1er mars, il écrit à sa femme : « Leur travail me donne un grand es-poir. Je vois peu à peu se dessiner cette forme nouvelle que j’ attends depuis si longtemps.28 » Au cours de l’ été 1927, il s’ engage à peaufiner la forme définitive de ces petites scènes improvisées mais il y renonce car le projet de L’ Anconitaine l’ accapare. Seul un public restreint a pu voir La Guerre et Le Printemps. Les descriptions et témoignages brefs présentent une similarité avec les recherches pantomimiques réalisées par Étienne Decroux29.
Copeau n’ offrant pas de nouveau texte, les Copiaus décident, quelques mois plus tard, de monter et représenter leur propre spectacle : La Danse de la Ville et des Champs (première à Mersault, le 4 mars 1928)30 , en reve-nant à ce qu’ ils ont développé auparavant. Sous forme de thèses à la façon du sogetto italien, on trouve, dans le bulletin, une table des matières dé-montrant que les exercices du Printemps en sont à l’ origine.
Prologue : Présentation de la troupePartie I : Hiver Réveil du printemps Végétation, Vents, Oiseaux Danse des travaux printaniers Jeanne et François Appel de la Ville Arrivée du chœur de la Ville François part pour la ville
28 Jacques COPEAU, Journal 1901-1948. Deuxième partie : 1916-1948, op. cit., p. 253.29 Étienne Decroux, élève de l’ École du Vieux-Colombier, lui aussi, depuis 1923, et, jusqu’ en 1925,
également participant à l’ aventure bourguignonne. Son mime pure a des racines communes.30 La Danse de la Ville et des Champs. Mise en scène : les Copiaus, création collective, sans
Jacques Copeau. Texte de Jean Villard-Gilles, Michel Saint-Denis, Aman Maistre ; costumes de Marie-Hélène Dasté. Première : France, Meursault, 4 mars 1928. Autres représentations : Belgique, Bruxelles, 15 mars 1928 ; France – 5 mai 1928, Beaune, 19 mai 1928, Chalon-sur-Saône, 29 mai 1928, Dijon – ; Suisse – 5 juin 1928, Lausanne, 6 juin 1928, Genève, 7 juin 1928, La Chaux de Fonds, 8 juin 1928, Neuchâtel, 9 juin 1928, Avenches, 11 juin 1928, Fri-bourg, 12 juin 1928, Yverdon, 13 juin 1928, Monthey.
Les Copiaus sans Copeau 109
Partie II : Ville Camelot Arrivée de François Réveil de la ville François dans la ville le matin Ville des ouvriers Bourse François quitte la ville Mendiants Oscar Knie part pour la campagne Champs Machines agricoles Aventures d’ Oscar Knie dans les champsPartie III : François sur la route dans son pays Menace d’ un orage Village chasse François Jeanne refuse François Orage Oscar Knie après l’ orage Oscar devient riche Amusement Chœur final
L’ ébauche de scénario montre que les Copiaus complètent, avec les histoires des gens, les scènes de la nature, détaillées déjà dans Le Prin-temps. À notre connaissance, le texte de la pièce n’ a pas été conservé, on ne peut le reconstituer qu’ à partir de cette ébauche et de descriptions partielles laissées par certains critiques, surtout suisses31. L’ action com-mence au moment où l’ hiver finit. Les acteurs représentent l’ arrivée du
31 Vincent VINCENT, « La Danse de la Ville et des Champs jouée, dansée, chantée, mimée par les Copiaus du Vieux-Colombier », in Comœdia, Paris, 18 juin 1928 ; Henri MUGNIER, « La Danse de la ville et des champs », in Comœdia, Paris, 9 juin 1928 ; Eugène FABRE, « Un spectacle des Copiaus », in La Suisse, Genève, 7 juin 1928 ; A. COMTESSE, « La Danse de la ville et des champs », in Feuille d’ Avis du District de Monthey, le 19 juin 1928.
110 Miloš Mistrík
printemps par leurs corps, par la danse, par la gestuelle, vêtus légèrement. Ils imitent le chant des oiseaux, la nature qui bourgeonne, les nou-velles amours ; les fleurs sont fixées sur leurs costumes : les hommes en bleu, les femmes en plusieurs couleurs. Les arbres sont figurés par « trois ou quatres jeunes gens aux bras harmonieusement noués. Le vent ? Tout son secret ré-side au coin de leurs lèvres. Et l’ envol des oiseaux au bout de leurs doigts32. » Des vignerons apparaissent. Un des person-nages, François, désire quit-ter la campagne pour aller
vivre en ville. C’ est la raison pour laquelle il rompt avec son amoureuse Jeanne qui reste fidèle au terroir bourguignon. François est absorbé par le rythme étranger de la ville : les boniments des camelots, les bruits des rues, le vacarme industriel. Avec leurs corps, les acteurs créent une chaîne de production, l’ avancée mécanique et rythmique. François « verra des masques de fer, des hommes sombres couleur d’ huile grasse, des dac-tylos hiératiques, dont le simple tic-tac d’ un crayon sur une planchette donnera l’ illusion de l’ enfer qu’ est bourse. Quand il voudra participer au travail mécanique d’ un atelier, il retrouvera encore des hommes de métal, des hommes qui, sur un coup de sifflet, deviennent tour à tour des pistons, des turbines ou des marteaux-pilons. Tout cela vrombit, tourne, marche, halète, écrase dans un bruit de tonnerre. Il y a juste cinq acteurs en scène, pas un accessoire, nul orchestre.33 » Ces passages montrent la beauté de l’ expression corporelle plastique. Imprudent, François n’ a pas
32 Jean de BROSSES, « La Danse de la ville et des champs », in Le Courrier de Saône et Loire, Chalon-sur-Saône, 18 mars 1928.
33 Ibidem.
Jean Dasté modelant un masque.
Les Copiaus sans Copeau 111
de chance : il perd son argent. Sous le pont, où il doit passer la nuit, il ren-contre un bohème déclassé Oscar Knie (interprété par Michel Saint-De-nis ; lorsque ce spectacle est joué en Suisse, le personnage devient Oscar Trique en considération pour une famille locale respectable). Par contre, ce citadin est tenté par la vie campagnarde. Leur scène commune prend la forme de bouffonnerie. En retournant chez lui, François ne trouve pas son bonheur. Jeanne ne le veut plus, les anciens camarades le chassent, c’ est seulement Jean Bourguignon qui le sauve d’ une échauffourée. Mais tout d’ un coup, un orage violent éclate (lui aussi exprimé par les corps et les voix des acteurs) et c’ est François qui, au péril de sa vie, sauve le village du déluge, ce qui le réconcilie avec les gens du cru. En outre, Oscar Knie hérite inopinément d’ un gros montant d’ argent ; il offre un bon dîner à François et Jeanne qui se rabibochent.
La Danse de la Ville et des Champs se déroule sur un tréteau dont l’ ar-rière-plan ne change pas, le jeu dynamique des acteurs domine. Même s’ ils sont seulement neuf à paraître sur scène (Michel-Saint Denis, Jean Villard, Aman Maistre, Paul Paulet, Jean Dasté, Maïène, Marie-Madeleine Gautier, Marguerite Cavadaski, Trinidat Japp), ils donnent l’ impression d’ être plus nombreux. Un mouvement soutenu, la représentation des phénomènes naturels, des objets et des machines alternent avec les rondes populaires, et aussi avec une danse stylisée, un ballet abstrait. Ils changent de costume dix fois au cours du spectacle : « [La] vérité avec laquelle furent mimés, soit les travaux champêtres du printemps, soit l’ atmosphère en-fiévrée de l’ usine ou de la bourse ; jamais encore nous n’ avions vu réaliser des scènes aussi vivantes avec des éléments aussi simples.34 » « Le tableau des Machines rythmé à merveille. Celui de la Bourse évoqué avec perspi-cacité. Celui de Retour de François, vraie bande de film, avec sa bataille d’ hommes et son opposition d’ une foule à un individu.35 » L’ accent n’ est pas mis exclusivement sur le mouvement corporel. Les acteurs créent l’ aspect musical et sonore par le chant choral. Ils confient aux moyens expressifs de leurs corps, à leurs bouches et à leurs bras l’ imitation des sons et des bruits de la nature et de la ville. Avant les représentations, ils se sont procuré à Paris un grand gong chinois. Plusieurs acteurs maî-trisent un instrument de musique : Jean Villard est un excellent pianiste,
34 A. COMTESSE, loc. cit.35 V. VINCENT, loc. cit.
112 Miloš Mistrík
l’ étudiant Paul Paulet joue remarqua-blement de la flûte et ils disposent même d’ un phonographe – mais les descriptions de son application ne se sont pas conservées. Léon Chance-rel dit qu’ ils étaient « animés par la batterie et la flûte36 ». Eugène Fabre rappelle qu’ il y avait aussi « quelques scènes où le dialogue nous rappellera que ‘sire le mot’ tout de même, c’ est encore le théâtre français et où, venus de la farce, des accents comiques ten-teront d’ alléger ce spectacle un peu laborieux.37 » Un critique genevois, Henri Mugnier, écrit qu’ il « n’ y a rien de transcendant, mais en cet instant où s’ épanouit l’ été, en cet instant où l’ enfant prodigue revient, et aux
siens, et à l’ amour, il prend un accent particulier et touchant [...] qui nous émeuvent au plus profond de la poitrine. […] Il y a de la santé dans leur spectacle.38 »
Les Copiaus, conformément à la formation reçue par le Patron, dépa-thétisent l’ art dramatique, refusant le geste statique et la déclamation tra-ditionnelle. Les critiques prisent la fraîcheur, la jeunesse et la pureté de l’ esprit de cette mise en scène. Ils apprécient l’ orientation générale de la troupe : « Au moment où le théâtre s’ industrialise de plus en plus, au mo-ment où l’ abominable opérette graveleuse, le vaudeville pornographique à caleçons, le music-hall inepte, avec ses défilés de filles nues, s’ impatro-nisent de tous côtés, sans vergogne aucune, il est réconfortant de consi-dérer les Copiaus. Troupe dans laquelle le souci d’ un art vraiment pur, noble et fort, prévaut sur toutes les satisfactions matérielles.39 »
36 Léon CHANCEREL, « Les Copiaus », in Jeux, tréteaux et personnages, Paris le 15 octobre 1930.
37 E. FABRE, loc. cit.38 H. MUGNIER, loc. cit.39 V. VINCENT, loc. cit.
Les arbres. Le mime pur d’Étienne Decroux. (Photo don Wilder).
Les Copiaus sans Copeau 113
Les Copiaus essuyent néanmoins de mauvaises critiques pour La Danse de la Ville et des Champs, y compris de la part de Copeau qui, absent à Pernand pendant les répétitions, assiste seulement à la première. La salle de Meursault est complète, de Paris sont venus Léon Chancerel et sa femme, Auguste Boverio, leurs anciens collègues. Le public accueille favorablement le spectacle, le Patron s’ amuse bien. Mais le lendemain, il les rassemble. Jean Villard rapporte :
Le soir de la première, Copeau entra tout entier dans notre jeu. Au milieu de ce public délirant, il riait, s’ attendrissait, applaudissait comme un enfant. Vous pensez si nous l’ avions à l’ œil ! On le sentait heureux et fier de ses en-fants. Notre joie était complète. Nous avions gagné la partie. Le lendemain, il nous réunit pour la critique. Nous l’ attendions avec quelle impatience ! Tout prêts à corriger nos erreurs, à rendre notre spectacle, sur les conseils du maître, encore plus efficace. Mais son visage, tout de suite, nous glaça. Nous attendions des critiques constructives. Hélas, ce fut une démolition totale, absolue. Copeau se montra féroce. De tous nos efforts, de toute notre pas-sion, de toute notre joie, il ne resta rien. Rien ne trouva grâce à ses yeux. Son dernier mot, digne de l’ Ecclésiaste, plein d’ une amère dérision fut : poussière [...] C’ était trop méchant, trop injuste. Tout cela sonnait faux40.
La blessure ne cicatrisera jamais ! Même si Copeau fut souvent sé-vère avec eux, cette fois, ils sont indignés parce qu’ il s’ est bien amusé pendant toute la soirée mais le lendemain, il les critique avec virulence. Serait-il hypocrite ? Lui qui symbolise en quelque sorte la vérité ? Non, il y a quelque chose qui entraîne la perte de sa respectabilité à leurs yeux plus que n’ importe quoi : il est jaloux ! C’ est ainsi qu’ il confirme indi-rectement ne plus les égaler, qu’ ils l’ ont déjà devancé, qu’ ils ont encore plus de puissance créatrice que cet homme fatigué, n’ ayant pas encore 50 ans. Il y a un mot émanant de lui qu’ ils ne peuvent oublier. « Poussière ». C’ est ainsi qu’ il a apprécié leur travail. Il était tourmenté par une crise religieuse profonde, répétant sans cesse se sentir épuisé, doutant d’ être toujours capable de bien faire les choses – et les Copiaus le savaient bien.
Certains critiques, notamment suisses, égratignèrent sans indulgence La Danse de la Ville et des Champs. Eugène Fabre écrit que les Copiaus
40 J. VILLARD-GILLES, Mon demi-siècle et demi, op. cit., pp. 142-143.
114 Miloš Mistrík
« forçaient leurs moyens » et à son avis : « La présentation de la troupe, tout comme le prologue, ont de l’ esprit et de la verve, et l’ évocation de la Bourse est pleine de force. Dans l’ interprétation des machines des champs et de la ville, il y a d’ expressives réussites rythmiques. Je vois bien toutes les inten-tions qui animent la traduction des mouvements de la nature, mais j’ y vois aussi des affèteries, des manières de ‘concetti’ plastiques, qui les dénaturent et compromettent leur force et leur évidence. » Le chroniqueur n’ oublie pas de leur rappeler au passage qu’ ils ne devraient pas s’ éloigner trop de l’ œil critique de Jacques Copeau. « C’ est [...] le choix, qui manque le plus. Il y a tout au long de ces trois parties, malgré l’ abondance, une uniformité qui n’ est pas sans lasser et qu’ on souhaiterait voir plus souvent rompue41. » Même Vincent Vincent, qui leur est favorable, ne manque pas de faire une remarque au sujet de la scène où François et Oscar Knie se rencontrent en la qualifiant « d’ une grosse bouffonnerie amusante de verdeur, quoique un peu longue42. » Ils en étaient offensés, ce que reproduit Jean Villard :
Le critique d’ un important journal genevois43, d’ une plume douce-reusement paternaliste, nous renvoyait à l’ école. Nous étions des enfants prodigues en train de renier leur maître, au lieu de nous appliquer bien sagement à jouer sous sa direction les classiques, ce pourquoi nous étions faits, et, malheureusement égarés, nous allions déchirer nos vêtements aux buissons épineux de l’ aventure. Ce papier, je n’ hésite pas à le dire, tua les Copiaus. Le Patron s’ en servit pour nous montrer que nous n’ étions pas mûrs, que nous avions encore tout à apprendre. Il sema le doute dans l’ esprit de quelques-uns d’ entre nous et servit au mieux la politique de certains autres44.
Le Patron s’ en délectait. Même si on peut lui reprocher une insensi-bilité à l’ égard des jeunes, on ne saurait nier la finesse de son goût ni la perfection de sa pensée analytique. Ni sa prudence adulte. Lorsque les Copiaus se produisent en Suisse, dans le bulletin destiné aux spectateurs locaux, il les recommande tout en gardant ses distances réalistes :
41 E. FABRE, loc. cit.42 V. VINCENT, loc. cit.43 Jean Villard ne donne pas le nom de ce critique mais il s’ agit très probablement d’ Eugène
Fabre.44 J. VILLARD-GILLES, Mon demi-siècle et demi. Lausanne, op. cit., pp. 143-144.
Les Copiaus sans Copeau 115
Il est le temps que les Copiaus soient connus pour ce qu’ ils sont par eux-mêmes, jugés sur ce qu’ ils autorisent d’ espoirs. Il est le temps que le public devienne leur maître. [...] Cette Danse de la Ville et des Champs, qu’ ils vont représenter devant vous, est strictement leur ouvrage. [...] Et si deux ou trois instants de leur jeu vous procurent le sentiment d’ une qualité exceptionnelle, ne cherchez pas plus loin : tout sortira de là. Je vous les livre. C’ est bien plus que moi-même. Soyez justes pour eux. Si vous avez à les louer, ne dites pas : « Ils exécutent bien ce qu’ un autre a réglé pour eux ». Dites : « L’ instruction qu’ ils ont reçue est devenue source de création ; leur discipline est en eux-mêmes »45.
La Danse de la Ville et des Champs, première création vraiment auto-nome des Copiaus, est cependant fidèle aux idées tracées par Copeau. Elle est d’ abord le prolongement de la recherche sur la comédie nouvelle. Les masques et les personnages comme Oscar Knie, Jean Bourguignon, ainsi que les autres présents sur scène, dynamiques et remuants, dansant, chantant et parlant, le prouvent. Cela ressort aussi du scénario qui décrit une action simple, linéaire. En outre, le message de cette pièce est mar-qué par l’ héritage de Copeau parce que c’ est en fait une moralité. Le ton moralisateur est présent dans beaucoup de pièces que Jacques Copeau a montées. Chez les Copiaus, la vision chrétienne du monde ne se mani-feste pas, mais il y a une éthique enracinée dans les fondements de la civilisation européenne, ce qui est en fait pareil.
La parole scénique, créée par le corps, la voix, le mouvement, le geste, dans La Danse de la Ville et des Champs, est celle qui est la plus éloignée des mises en scène précédentes de Copeau plus réalistes, voire plus tradi-tionnelles. Exceptés ses versions scéniques de Scapin empreintes du sceau de la recherche sur la comédie nouvelle, les masques des élèves dans Saül de Gide, le dernier spectacle de l’ École du Vieux-Colombier que Suzanne Bing, s’ inspirant du nô, a préparé avec ses propres élèves, enfin L’ Illusion et l’ Anconitaine. Ces exemples prouvent que dans La Danse de la Ville et des Champs les Copiaus ont progressé sans le Patron en ne reniant pas leurs acquis. Ils ont en quelque sorte devancé Copeau en parvenant à créer un spectacle original de la comédie nouvelle. Aman Maistre le confirme : « C’ était très beau. Avec le recul, je compare cela, toutes proportions gar-
45 Jacques COPEAU, in Bulletin destiné aux représentations suisses de La Danse de la Ville et des Champs, juin 1928.
116 Miloš Mistrík
Monsieur César de Jean Dasté.
dées, aux Noces de Stravinski. Pour la première fois nous avons imposé aux spectateurs le mime à l’ état pur.46 » Denis Gontard ajoute : « La Danse de la Ville et des Champs se présente, mieux encore que l’ Illusion ou les diver-tissements assez simples [...] comme le premier exemple, encore imparfait mais plein de promesses, de ce que pourrait être cette ‘Comédie Nouvelle’ à laquelle Copeau a tout sacrifié. Il aurait fallu que de tels essais soient mul-tipliés pendant l’ expérience bourguignonne. Mais Copeau voyait, avec crainte et un cer-tain chagrin, les Copiaus li-vrer au public des choses qui n’ étaient pas mûres et, de ce fait, les figer. Par ailleurs, il n’ était pas peut-être plus en mesure, à ce moment-là, de donner lui-même l’ impulsion necéssaire à un tel travail.47 »
Le plus important pour les Copiaus fut l’ accueil extra-ordinaire du public à chaque
représentation de La Danse de la Ville et des Champs. Même Elisabeth, reine de Belgique, fut enchantée de leur prestation à Bruxelles et les félicita. Ils n’ avaient jamais connu un succès aussi spontané auparavant, qui devait donc douter à un tel moment ?
46 Aman MAISTRE, in Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929, op. cit., p. 31. 47 Denis GONTARD, ibidem, pp. 31-32.
Les Copiaus sans Copeau 117
Mais le silence du Patron perdure. Son attention est absorbée ailleurs, par les évé-nements à Paris car, depuis la capitale, des voix suggèrent qu’ on lui confie les rênes de la Comédie-Française. En Bourgogne, il aurait pu re-nouer avec le succès remporté auprès du public de La Danse de la Ville et des Champs, rédiger un nouveau scénario dans lequel il aurait introduit ses propositions, mais cela ne s’ est pas produit. Alors, les Copiaus s’ organisent seuls.
En janvier 1929, Michel Saint-Denis et Jean Villard terminent une nouvelle pièce intitulée Les Jeunes Gens et l’ Araignée ou la Tragédie ima-ginaire. Le scénario reste ou-vert car Jean Dasté doit ache-ver le personnage de Monsieur César. Les auteurs écrivent dans la hâte sachant que des modifications et des compléments seront apportés par les improvisations au cours des répétitions. Jean Villard se souvient : « On a essayé une deu-xième création où il y avait une partie de mime qui était un grand jeu de jeunes gens qui passaient leurs vacances à la campagne. C’ était une chose assez facile, mais il y avait une partie (au milieu de la pièce), qui durait vingt minutes, de mime pur, avec des masques. C’ était assez impressionnant.48 »
L’ hiver rude de 1929 leur complique la vie : des maladies successives les affaiblissent, ils se sentent dépressifs, épuisés… la première est repor-
48 Jean VILLARD cité par Denis GONTARD, in Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929, op. cit., p. 212.
Oscar Knie de Michel Saint-Denis.
118 Miloš Mistrík
tée plusieurs fois. Ils font beaucoup de répétitions, en sacrifiant même les exercices de l’ École. Jacques Copeau voyage en France et l’ étranger pour donner une série de conférences sur le théâtre et sur son travail. Il aide à parachever les masques le peu de temps qu’ il passe à Pernand, mais ne se considère plus comme le co-metteur en scène de ce spectacle. Le 9 mars 1929, ses acteurs lui présentent pour la première fois, en continu, une version incomplète, car Marie-Madeleine Gautier est souffrante. Dans le Journal de Bord, il est noté qu’ « après hésitations, on décide qu’ on repren-dra le travail49 » – ce qui laisse à penser que le Patron a été encore critique. La première des Jeunes Gens et l’ Araignée ou la Tragédie imaginaire 50 se tient, le 27 avril 1929, à Beaune et, deux jours plus tard, les Copiaus partent en tournée en Suisse. Ils rentrent en France à la mi-mai, puis jouent à Lyon, Dijon et Chalon.
Les Jeunes Gens et l’ Araignée ou la Tragédie imaginaire souscrit, elle aussi, à l’ idée de la comédie nouvelle ; elle contient des pantomimes, des danses, des sketchs comiques et surtout deux personnages fixes (Oscar Knie de Michel Saint-Denis et Monsieur César de Jean Dasté) présents sur scène. Mais les Copiaus ont tiré une leçon du spectacle précédent. Une préparation littéraire insuffisante leur avait été reprochée pour La Danse de la Ville et des Champs, ils rédigent un scénario. Aman Maistre pense qu’ ils se sont détournés du théâtre : « Là, on est entré dans la litté-rature. C’ est que, à ce moment-là, et ce n’ est pas pour […] critiquer [les Copiaus], il y avait déjà une idée philosophique, un désir de littérature, un désir d’ écriture51. » Le chroniqueur Vincent Vincent a expliqué, après les représentations en Suisse, le déroulement du spectacle ; ce qui aide
49 Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929, op. cit., p. 155.50 Les Jeunes Gens et l’ Araignée ou la Tragédie imaginaire. Tragi-comédie en 4 actes. Mise en
scène : les Copiaus, texte de Jean Villard-Gilles et Michel Saint-Denis, musique de Jean Vil-lard-Gilles, décors de Marie-Madeleine Gautier, costumes de Marie-Hélène Dasté. Date de la première : France, Beaune, 27 avril 1929 . Autres représentations : Suisse – 29 avril 1929, Zurich, 30 avril 1929, Bienne, 2 mai 1929, Fribourg, 3 mai 1929, Neuchâtel, 6 mai 1929, Lau-sanne, 7 mai 1929, Genève – ; France – 15 mai 1929, Dijon, 16 mai 1929, Chalon. Distribution : Francis – Aman Maistre, Paul – Paul Paulet, Gilles – Gilles Margaritis, Irène – Marie-Hélène Dasté, Juliette – Marguerite Cavadaski, Lucienne – Marie-Madeleine Gautier, Jeannette – Tri-nita Japp, Alexandre Byd – Jean Villard, Miss Dot – Dorothy Jane Imbrie, Le paysan – François Guenot, Oscar Knie – Michel Saint-Denis, Monsieur César – Jean Dasté.
51 Aman MAISTRE cité par Denis Gontard in Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929, op.cit., p. 212.
Les Copiaus sans Copeau 119
à s’ en faire une idée complète, étant donné le manque de documentation en images, de photographies, de descriptions et de registre de mise en scène. Cette critique complète notre idée sur les scènes de mouvement, de mime et de rêves qui sont, pour des raisons évidentes, assez faiblement développées dans le scénario initial, conservé aux archives de la Biblio-thèque nationale de France52. Cela montre aussi la façon dont les Copiaus parachevaient le texte pendant les répétitions.
Dans un pays de gaîté et de tendresse jeune, les vacances rassemblent de jeunes garçons et de jeunes filles. Ils jouent entre eux. D’ un motif futile naît une querelle qui sépare les joueurs : d’ un côté le clan des garçons, conduit par Francis ; de l’ autre celui des filles, dont la fière Irène devient le chef. C’ est la guerre ! Une guerre qui ne dépassera pas les limites d’ une bouderie de collégiens en liberté. Mais voici qu’ arrive un jeune naturaliste se prome-nant à quatre pattes, à la poursuite d’ un couple d’ araignées qu’ il observe. C’ est Byd, qui nous conte les mœurs de ces insectes, lesquelles mœurs ne sont certes pas sans analogie avec celles des humains... Il y a ici une scène fort plaisamment dialoguée, d’ une gentille cocasserie sentimentale, que l’ on pourrait – toutes proportions gardées – rapprocher d’ une scène d’ opé-rette parlée. Elle est tout à fait délicieuse. Byd prend parti dans la lutte des sexes. Les filles, malgré l’ heure tardive, décident de s’ aller cacher dans les
52 Bibliothèque nationale de France, Paris. Fonds Jacques Copeau 4-COL-1 ; FOL-COL-1 (52). Texte.
Jacques Copeau et Les Copiaus près de sa maison à Pernand-Vergelesses, 1927.
120 Miloš Mistrík
ruines d’ un vieux château croulant, afin de faire pièce aux garçons. Byd [...] y entraîne le petit Gilles, afin d’ y jouer les filles à leur tour. L’ aventure resterait une bonne farce plaisante si deux personnages : Oscar Trique53 et son maître César, n’ avaient jeté leur dévolu sur le même château afin d’ y installer leur quartier général et y réaliser de merveilleux projets utopistes hurluberlus, voulant fonder une nouvelle société, créer tout un village. César est chimérique, innocent, un brin mégalomane, et Trique est faible et peureux. Ce savoureux personnage d’ Oscar Trique, d’ ailleurs, est une de nos vieilles connaissances. Il figurait déjà dans La Danse de la Ville et des Champs, et devient une manière de mythe, un personnage créé de toutes pièces par les Copiaus, tout comme les Italiens créèrent Arlequin, Pantalon ou Scaramouche. Inspiré de la Commedia dell’ arte, il improvise son texte sur un canevas liminaire, et sa verdeur bouffonne est d’ un attrait irrésistible.
Le château est sombre et tragique ; les paysans le tiennent pour un lieu hanté. Comment personnages et jeunes gens voisinent au château et se font peur mutuellement en s’ ignorant, comment Byd se déguise en vieux sorcier pour donner une leçon à l’ orgueilleuse Irène, comment César et Trique se croient en péril et lèvent les ponts-levis, c’ est ce que conte le deuxième acte. Les jeunes gens, affolés de peur, sont enfermés. Ils s’ endorment de fatigue.
Alors, sous la forme d’ un rêve, éclate la tragédie : tous les incidents mar-quants de la journée y prennent place. Quatre vieux tiennent les filles pri-sonnières. Mais Irène est portée par son orgueil à répondre aux hommages qui lui sont rendus. Ses compagnes se séparent d’ elle, l’ implorent, elle les repousse et, sur l’ invitation du maître des vieux, se transforme en princesse. Elle règne.
Francis la cherche dans la campagne, tombe épuisé. Ses compagnons le rejoignent. Ils attaquent le château, en tentant l’ escalade. Une puissance invisible les rejette. Francis seul parvient au sommet, il repousse les autres filles, même celle qu’ il aimait ; quand il veut s’ élancer vers Irène, Byd lui barre la route. Ils se battent. Francis vaincu se jette au bas des murs. Mais Irène dessine, avec une compagne, la figure de l’ araignée qui tue et dévore son mâle. Byd fasciné est étranglé, mais le rêve finit et le sommeil recouvre le drame.
Toute cette scène est admirablement mimée et dansée. La souplesse des corps à moitié vêtus donnent à l’ impression plastique une beauté étrange-
53 Dans Les Jeunes Gens et l’ Araignée Oscar Knie se voit également rebaptisé en Oscar Trique pour les représentations suisses.
Les Copiaus sans Copeau 121
ment mystérieuse. Des masques adroitement sculptés changent à vue les mille et unes ressources des visages fertiles en actions multiples des Protées agissants. Les rythmes s’ enchaînent en se multipliant, comme dans cette vision de l’ araignée au travail de sa toile ; les éléments s’ accordent en de larges arabesques d’ un dessin schématique d’ une vie nouvelle, que l’ on croit découvrir au travers d’ un verre tout nouveau, braqué sur un monde de rêve et d’ hallucination, jusqu’ à la fin du songe. Alors, les personnages réappa-raîssent. Trique a bu dans la cave ; il est ivre. César est momentanément fou. Byd et Trique finissent par se rencontrer, ils trinquent de compagnie à l’ orgueil, au rêve, à la folie. Le jour paraît. Comme une fanfare, le so-leil éclate, en chassant les fantômes, et les deux compères lui adressent une petite prière en phrases alternées, qui est un des charmants morceaux du spectacle. Après quoi, Trique s’ en va dormir et Byd sort du château après avoir abaissé les ponts-levis.
Au dernier acte, tout le monde se retrouve hors des murs, mal délivré du rêve. [...] Trique, en excellent deus ex machina dénoue l’ imbroglio ; le jeu reprend. Irène a plié. Les garçons et les filles reforment des couples. L’ amour et l’ accord remplacent la guerre et tout finit par une délicieuse chanson, qui noue sa ronde joyeuse au centre de l’ harmonie ressuscitée54.
À l’ époque où le surréalisme culmine, le jeu des Copiaus n’ est pas obligé de se borner au réalisme des images. Dans les visions oniriques, propres au Songe d’ une nuit d’ été de Shakespeare, Les Jeunes Gens et l’ Araignée intègrent au troisième acte un jeu de théâtre dans le théâtre. Les Copiaus, tout comme le dramaturge élizabéthain, jouent une pièce d’ amour, une pièce qui veut montrer la capacité des personnages domi-nants à abuser de leur position pour jouer avec les jeunes amoureux et pour leur donner, avant le happy-end, une leçon de fidélité, d’ amour et d’ humilité.
Une seule photo de ce spectacle reste, à notre connaissance, publiée dans un journal, celle des acteurs sur la scène : douze personnages costu-més. L’ arrière-plan est constitué d’ un rideau de couleurs claires. La pé-nombre est réservée aux scènes qui se passent dans le château. Il y a une petite butte sur le plateau – un podium faisant penser à une version basse du tréteau nu. Dans le prologue, le texte indique que deux paniers étaient
54 Vincent VINCENT, « Les jeunes Gens et l’ Araignée » ou « La Tragédie imaginaire », in Comœdia, Paris, 12 mai 1929.
122 Miloš Mistrík
pendus sur la scène, sous lesquels une équipe de garçons et une de filles faisaient une partie de basket. Hormis les objets cités, l’ espace est nu. Les filles sont vêtues en robes d’ été, claires et légères. Les hommes se tiennent derrière elles, il n’ y en a qu’ un seul devant, portant un pan-talon et une chemise foncés – ce serait Byd. Selon Vincent Vincent, les costumes « sont comme autant de belles fleurs écloses au jardin de la fantaisie si rafraîchissante de la compagnie des charmants Copiaus55. » Ils sont conçus, comme d’ habitude, par Marie-Hélène Dasté, cette fois-ci en coopération avec Marie-Madeleine Gautier. La scénographie est éga-lement attribuée à ces deux femmes. Il y a aussi Monsieur César et Oscar Knie, dans leurs fameux masques et habits, debout, se tenant de part et d’ autre du petit groupe sur la photographie conservée. César avec un masque foncé couvrant tout son visage à l’ exception de la bouche et vêtu d’ un long pardessus retombant ; Knie avec une tête de hérisson, en veston foncé et en pantalon clair. Il faut les imaginer dynamiques, jouant seule-ment avec quelques accessoires.
La musique utilise des procédés simples. Les Copiaus n’ ont pas d’ or-chestre, les acteurs jouent des instruments dans les coulisses. Derrière la scène, ils font aussi tout le bruitage. « Des préludes musicaux et une ronde de Jean Villard aident à créer une atmosphère et à préparer le spectateur à l’ ambiance du jeu.56 » On lit dans le scénario conservé que l’ accessoiriste Jean Mercier a dû prévoir pour le prologue : « piano, clari-nette, flûtes, bloc de bois, tambour chinois, tambour arabe, grosse caisse (pédale), deux petites mailloches et gong ». Pour les actes suivants il y en a davantage « tambour marocain, sifflet, saxophone ». Jean Villard a com-posé des mélodies simples, en tenant compte, d’ une part, de l’ harmonie du piano et de la flûte et, d’ autre part, du rythme accentué de la batterie réservée aux scènes de mouvement des comédiens.
Les Jeunes Gens et l’ Araignée ou la Tragédie imaginaire est un spectacle d’ acteurs confirmés. Les cinq années de la vie des Copiaus en Bourgogne ont transformé les élèves en professionnels. Certains ont sculpté leur masque définitif. D’ autres ont mûri et prouvent leur capacité à représen-ter des états d’ âmes complexes tout en préservant le travail collectif. Ils maîtrisent le langage du corps pour être performants dans les scènes pan-
55 Ibidem.56 Ibid.
Les Copiaus sans Copeau 123
tomimiques, acrobatiques et dansantes. Et sans perdre le contact avec le public. L’ art qu’ ils montrent a une forte inspiration métaphorique. C’ est à la fois un art vivant et comique, nouveau et magique.
Chacun des personnages a retenu l’ attention de Vincent Vincent. Il écrit que Michel Saint-Denis, dans le rôle de Knie, a réussi à faire une caricature « de grand style et de l’ humanité sincère » ; que César de Jean Dasté était l’ « incarnation vivante du bravache illuminé à la silhouette excellemment composée » ; que Jean Villard a parfaitement interprété le personnage d’ Alexandre Byd – « Il y fait preuve de beaucoup de finesse, de jovialité, d’ entrain et a un sens très aigü, mais bien naturel du comique [...] Cela sans aucun truc de maquillage, de gestes répétés, de tics ou de facéties clownesques. » – ; qu’ Aman Maistre a créé le rôle du responsable des garçons, Francis, « avec beaucoup d’ autorité, une excellente diction et un naturel parfait. Il danse à ravir, avec souplesse et fermeté, sans finas-series ou mièvreries d’ exécution faciles. » Il ajoute que le chef du clan des filles, Irène, incarnée par Maïène, a enchanté « par un jeu naturel fait de spontanéité et de vérité. Sa voix claire, bien timbrée, donne un accent de sincérité remarquable à son texte » 57.
L’ origine des personnages est variée, comme dans La Danse de la Ville et des Champs ainsi que dans les spectacles précédents auxquels Jacques Copeau a participé en tant que metteur en scène. Il y avait des prototypes de la comédie nouvelle (Monsieur César et Oscar Knie) cotoyant des per-sonnages du théâtre dramatique. Byd, interprété par Jean Villard, n’ est apparu que dans Les Jeunes Gens et l’ Araignée, sans être envisagé comme un autre archétype de la comédie nouvelle, mais il en avait les attraits pour le devenir dans l’ avenir au cas où les Copiaus continueraient. Jean Villard a aussi façonné son personnage de Gilles en s’ inspirant du Pier-rot. Il deviendra ensuite célèbre comme chansonnier sous le nom de Jean Villard-Gilles. Son Byd est un nouveau personnage comique, celui d’ un entomologiste peu pratique, qui ne se rend pas compte de son ridicule lorsqu’ il observe les araignées mais qui sait se venger sévèrement sur ceux qui se moquent de lui. Dans la commedia dell’ arte, cet attribut est lié aux personnages des zannis et Villard avec son Byd ne savait peut-être pas à ce moment-là combien il était proche d’ un nouveau masque.
57 Ibid.
124 Miloš Mistrík
Le scénario des Jeunes Gens et l’ Araignée ou la Tragédie imaginaire, écrit par Jean Villard et Michel Saint-Denis, original par son contenu, ne s’ inspire pas des pièces du répertoire classique, ce que faisait avant parfois Copeau. Le duo a inventé seul l’ intrigue, ainsi que le nœud dra-matique, les scènes muettes de pantomime-danse. Les personnages de Monsieur César et d’ Oscar Knie sont aussi le résultat de leur propre in-vention, ils figurent dans plusieurs spectacles précédents et voient leur accomplissement dans celui-ci. Le nouveau personnage de Byd apparaît comme une promesse d’ autres masques pour la comédie nouvelle. Les Jeunes Gens et l’ Araignée restera, hélas, le dernier spectacle des Copiaus.
Le texte de la pièce relate, pour ainsi dire, l’ expérience autobiogra-phique des Copiaus. Les jeunes gens qui vont à la campagne, leurs re-lations mutuelles, leurs amours et amitiés, les disputes entre les deux sexes… Certains personnages portent des noms identiques aux réels – Paul pour Paul Paulet, Gilles pour Gilles Margaritis, Miss Dot pour Doro-thy Jane Imbrie – ou présentent des traits de caractère similaires – Irène la déterminée pour Maïène, l’ animateur joyeux Byd pour Jean Villard, Francis l’ amoureux pour Aman Maistre. Écrits naturellement, leurs dia-logues sont certainement faciles à déclamer, comme s’ ils sortaient direc-tement de leur bouche. Vincent Vincent remarque : « Il y a ici une scène fort plaisamment dialoguée, d’ une gentille cocasserie sentimentale [...]. Elle est tout à fait délicieuse. » Il mentionne sans doute le dialogue du premier acte entre Irène et Francis, dans lequel Byd intervient avec ses commentaires. Les deux jeunes gens se taquinant prend la force d’ une conversation vivante avec un déroulement dynamique, l’ un ayant alter-nativement le dessus sur l’ autre. Et Byd se réfère simultanément à l’ ana-logie de la lutte mortelle de l’ amour et du sexe chez les araignées où la femelle, après avoir copulé, dévore le mâle.
BYD : Ah ! voilà mes bêtes. Quelle alerte !FRANCIS : Vous vous conduisez mal, Irène.BYD : Voilà le mâle...IRÈNE : Vous m’ ennuyez, Francis...BYD : La femelle.FRANCIS : La vérité vous blesse, Irène.IRÈNE : Vous m’ ennuyez, Francis.FRANCIS : Alors, c’ est la guerre ?
Les Copiaus sans Copeau 125
BYD : Le mâle est agité.IRÈNE : Quoi ? La guerre ? Il n’ y a pas de guerre..FRANCIS : Si, il y a une guerre. Vous nous provoquez. Vous êtes véxée. Alors vous cherchez à vous venger, sur moi évidemment, parce que je suis plus carré que les autres, pluc franc, plus mûr !IRÈNE. Mais, qu’ est-ce que vous me voulez ?FRANCIS : Je veux ! je veux ! je veux que ça change ![...]FRANCIS : Eh bien, Irène, vous êtes dure.IRÈNE : Vous ne m’ adoucirez pas.FRANCIS : Si ! ....Non... ne m’ interrompez pas tout le temps. Qu’ est-ce que je disais ? Ah ! oui. Malgré tout, malgré vos grands airs, vous n’ êtes qu’ une femme !BYD : Chez les araignées, le mâle est maladroit.IRÈNE : Mais qu’ est-ce que tout cela veut dire ?FRANCIS : Ça veut dire que vous n’ avez pas d’ autres lois que vos caprices ... et que vous vous faites un piédestal de nos malheurs.BYD : Le mâle monte à l’ assaut.IRÈNE : Et un trône de vos misères. Bravo ! Vous souffrez donc. J’ en suis ravie !
De deux groupes, celui des garçons et des filles, le dernier est le plus fort : plus hardi, plus déterminé, plus actif, c’ est lui qui décide comment leurs joutes verbales vont se développer. Incapables de s’ imposer, les gar-çons les suivent avec peine et perdent même le contrôle des dialogues. L’ esprit de liberté et d’ indépendance des filles se fait sentir. De nos jours, on dirait qu’ on voit ici poindre le féminisme ; un féminisme non agressif mais spontané et authentique.
Le monde des jeunes personnages réels des Jeunes Gens et l’ Araignée converge avec celui des personnages fixes de la comédie nouvelle. Jean Dasté et Michel Saint-Denis incarnent respectivement Monsieur César et Oscar Knie. Ces personnages ont aussi – hormis les traits caractéristiques qui leur sont attribués par le masque – des répliques, des actions, qui se réfèrent à la réalité qu’ ils sont en train de vivre. Rappelons que les rela-tions entre Copeau et ses comédiens étaient alors tendues, cela n’ a rien de surprenant de les voir se projeter dans l’ action dramatique. Jean Dasté est le gendre du Patron et Michel Saint-Denis son neveu. Ces deux hommes souffrent de cette position ambiguë et délicate à l’ égard des autres Copiaus.
Le motif principal de l’ action de ces deux personnages reflète des faits réels vécus par les Copiaus en Bourgogne. Tout comme Jacques Copeau,
126 Miloš Mistrík
en quête de la « nouvelle comédie », Monsieur César cherche un endroit propice pour pouvoir y fonder la nouvelle société des rêves.
CÉSAR : Parce que tout est gâté, mon ami. C’ est pourquoi je vous ai dit : « Réfugions-nous dans la solitude, retrouvons cette liberté humaine où dans l’ aisance des muscles et des sentiments peut refleurir la beauté. Nous chasserons, nous nagerons, nous aurons faim, nous aurons soif. Moi, je sortirai à cheval et ma noblesse, ma prestance, mon grand air de bonté me vaudront la confiance et l’ estime de la population. Nous accueillerons ceux qui viendront à nous : un petit peuple de travailleurs se groupera ainsi ; l’ un cuira le pain, l’ autre sarclera la vigne. Nous édicterons nos réglements et rendrons notre justice. Une petite société pure et vraie se dressera en face du monstre actuel. »
Il finit par trouver la ruine d’ un château. Un lieu inapproprié pour vivre, borgne, éloigné, dont les conditions insalubres rappellent la maison de Morteuil. Cette lutte pour un avenir nouveau, César la mène assisté d’ Oscar Knie, une sorte de Sancho Panza, valet toujours mécontent, naïf et insidieux qui est mal payé, peureux, mais qui, néanmoins, fait preuve de réalisme et d’ esprit critique à l’ égard de la mégalomanie de son maître.
La nuit, les jeunes gens se trouvent dans ce château. Ce refuge pour tous se transforme en un lieu de peur et de bagarres. Byd, qui est aussi présent, veut leur faire peur et, déguisé en vieux magicien, tient un dis-cours dans lequel il prononce les phrases suivantes :
VIEUX : [...] je suis là pour vous accueillir, pour vous conseiller, pour vous réconforter. Moi aussi dans mon temps je me suis retiré du monde, comme vous aujourd’ hui et j’ ai vécu tout seul depuis lors. J’ espérais tou-jours que de grandes âmes se joindraient à moi. Et enfin vous voilà. Ne pleurez pas. Levez la tête – Là – Regardez-moi.
Cela ne fait-il pas penser à une personne concrète ? Comme si les Copiaus projetaient dans ces scènes leurs tracas générés par le Patron. Comme s’ ils voulaient, dans leur comédie, remédier à ce qui pèse sur eux ! Toute la faute incombe à Monsieur César et toute la fureur retombe finalement sur lui, Monsieur César interprété par Jean Dasté parodiant Copeau ! À la fin du spectacle, Knie évoque « un spectre », « une halluci-
Les Copiaus sans Copeau 127
nation » en parlant de lui et le tourne en dérision. Monsieur César, luttant toujours contre des ennemis imaginaires, devient finalement fou.
Dans l’ acte final, les jeunes gens sortent du château le lendemain ma-tin, retrouvant leur liberté : le cauchemar terminé, ils deviennent amis et rient ensemble du passé. De nouvelles amours et des ruptures naissent. Ils entonnent, joyeux, les chansons de Villard.
Les allusions au Patron ne sont pas appuyées dans Les Jeunes Gens et l’ Araignée. Les Copiaus ne lui donnent pas de nom. La critique n’ a rien re-marqué. Il est possible que les acteurs, réagissant inconsciemment à leurs tracas à travers la pièce, n’ aient pas fait cela avec l’ intention de ridiculiser qui que ce soit. Ce n’ est qu’ au fil des années, en prenant connaissance des circonstances de leur séjour bourguignon, des propos des participants, de leur Journal de bord, de leur correspondance et de leurs souvenirs que les éléments, concrets, véridiques, de cette pièce, émergent.
Leur tournée terminée, les Copiaus retournent le 17 mai 1929 à Per-nand pour préparer leurs vacances. Fatigués mais ravis de leur réussite, ainsi que le confirme leur Journal de bord : « Grand succès, très grand intérêt, sympathie marquée58. » Bref, Jacques Copeau les gratule : « bon, mes enfants, c’ est bien59 », mais ses pensées convergent vers sa nomina-tion au poste d’ administrateur général de la Comédie-Française. Le 25 mai 1929, il dissout subitement la troupe. Sa décision ne serait pas ca-ractérisée par l’ impulsivité qui serait en opposition avec la rationalité de son caractère. Il perdait progressivement de l’ intérêt pour les Copiaus ces dernières années. Sa future nomination à la Comédie-Française ne devait pas être l’ unique raison. Nous pourrions invoquer qu’ il souffrait d’ une dépression due au fait que pendant ces cinq dernières années rien d’ important ne s’ était produit pour lui. Il n’ avait pas réussi à concré-tiser pleinement ses idées, clairement exposées dans ses conférences et dans ses écrits. Il voulait être l’ initiateur d’ un nouveau courant dra-matique, de la comédie nouvelle qui devait, tout comme la commedia dell’ arte, se propager pour toucher tout le pays, devenir un mouvement d’ épigones nombreux. On constate chez Copeau la volonté de devenir inspirateur, non seulement pour ses Copiaus, mais aussi l’ ambition de contribuer au renouveau du théâtre français en général. Mais pendant
58 In Le Journal de Bord des Copiaus 1924-1929, op. cit., p. 157.59 Propos de Jean VILLARD cité par Denis GONTARD, ibidem, p. 212.
128 Miloš Mistrík
son séjour en Bourgogne, il n’ a réussi qu’ à réaliser quelques spectacles plus ou moins réussis, interprétés devant un public provincial et étran-ger, hors de Paris. Des spectacles laissant à désirer à son avis. Il désirait l’ absolu – et cet absolu était momentanément hors de vue. Les derniers acteurs partis, il note le 12 octobre 1929 dans son journal : « Réduit à ce point, à ce point dégagé, vais-je de nouveau m’ engager ? N’ est-il pas souhaitable que je montre ce que je puis faire seul, et peut-être ne puis-je faire que seul60 ? »
Les Copiaus acceptent la dissolution. Ils quittent successivement la Bourgogne et retournent à Paris, regrettant de n’ avoir pu s’ affranchir du Patron, bien qu’ ils aient montré leur propre créativité ainsi que leur capa-cité à vivre en tant que troupe autonome. Nombreux étaient ceux qui leur rappelaient Copeau en leur recommandant de ne pas le lâcher.
Les Copiaus ne se séparent pas pour autant ; ils s’ installent en 1930 dans l’ ancienne salle du Vieux-Colombier que leur propose Jean Tedes-co. Mais ils ne portaient plus cette désignation polysémique, riche en significations très bien trouvée – : les Copiaus. Leur nouvelle appellation, la Compagnie des Quinze, corroborant leur nombre, suggère plutôt le ré-sultat d’ un acte administratif. En 1934, cette troupe disparaît également. Ses membres maintiendront des contacts étroits et auront une grande in-fluence sur le développement du théâtre français en s’ inspirant toujours des idées et des principes de Copeau.
Miloš MistríkTraduction de Martin Brtko
60 J. COPEAU, Journal 1901-1948. Deuxième partie : 1916-1948, op. cit., p. 280.