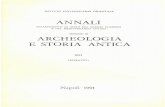Un philosophe engagé au Palais Farnese: Léopold Mabilleau (1853-1941)
Transcript of Un philosophe engagé au Palais Farnese: Léopold Mabilleau (1853-1941)
AURÉLIEN ROBERT
UN PHILOSOPHE ENGAGÉ AU PALAIS FARNÈSE : LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941)
Il suffit1 de parcourir l’annuaire des anciens membres de l’École française de Rome2 pour s’apercevoir que peu de philosophes de formation ont séjourné au Palais Farnèse. Pourtant, dès sa création, l’École de Rome se montre plus ouverte à des parcours atypiques que sa sœur aînée d’Athènes. Non seulement l’École pratique des hautes études et l’École des chartes peuvent proposer des candi-dats à Rome – et non à Athènes – mais « un jeune savant » peut y entrer sur travaux uniquement, ainsi qu’un jeune docteur, s’il s’est brillamment illustré lors de sa soutenance de thèse3. Par ailleurs, les normaliens présentés à Rome peuvent être agrégés de lettres, de grammaire ou de philosophie4. C’est ainsi que, grâce au décret inaugural du 20 novembre 1875, un jeune agrégé de philosophie fait son entrée au Palais Farnèse en 1876 : Léopold Mabilleau.
Personnage tombé dans l’oubli aujourd’hui, Mabilleau connut pourtant un destin peu commun au sortir de l’École de Rome. Historien de la philosophie, spécialiste de la Renaissance italienne, mais aussi versé dans les études médiévales, Mabilleau entama une carrière fulgurante à son retour en France, universitaire d’abord,
1 Une première version de ces recherches a été présentée lors d’une soirée de lecture à la Bibliothèque des amis de l’instruction publique le 21 janvier 2010 sous le titre « Léopold Mabilleau et le solidarisme ». Je remercie Nicolas Petit de m’avoir convié à cette soirée, ainsi que tous ceux qui ont assisté à cette présentation. Je remercie aussi les conservateurs du Musée social, du Conservatoire national des arts et métiers, des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale de France qui m’ont beaucoup aidé dans mes recherches.
2 École française de Rome, Annuaire des membres (1873-1986), Rome, 1987 ; Liste des membres et anciens membres, Rome, 1999.
3 Voir le décret du 20 novembre 1875. Cf. aussi A. Geffroy, La nouvelle École française de Rome. Ses origines, son objet, ses premiers travaux, dans Revue des Deux-Mondes, 16, 1876, p. 800-827, à la p. 812.
4 R. Müller, Les chemins qui mènent à Rome. Entrer à l’École française entre 1876 et 1914, dans MEFRIM, 120-1, 2008, p. 259-279.
AURÉLIEN ROBERT174
mais aussi et surtout politique par la suite. Ce n’est pas dans la lumière des chambres législatives, mais dans l’ombre de quelques cénacles où se discutaient les questions sociales les plus brûlantes de la IIIe République qu’il joua un rôle de premier plan. Si ce parcours politique – qui fit de Mabilleau le directeur du Musée social et le président de la Fédération nationale de la mutualité française – justifierait à lui seul qu’on lui consacre une étude, il nous a semblé plus intéressant d’éclairer son action politique et sociale par ses travaux universitaires et, réciproquement, de mettre en rapport ses études historiques, philosophiques et littéraires avec son engagement dans le mouvement que l’on a appelé, dès la fin du XIXe siècle, « le solidarisme »5. En effet, hormis quelques courtes notices biographiques, toujours focalisées sur son rôle dans le mouvement mutualiste, on recense très peu de travaux sur le Léopold Mabilleau historien de la philosophie6. Or, comme nous tenterons de le montrer ici, il est difficile de traiter séparément ces deux aspects de sa vie si l’on entend comprendre les raisons qui guidèrent cet intellectuel de la philosophie vers le monde de l’économie sociale. Par ailleurs, ses travaux de philosophe ne sont pas dénués d’intérêt en eux-mêmes, pour qui étudie la philoso-phie italienne du Moyen Âge et de la Renaissance. Il vaut donc la peine de s’y arrêter et de mettre en lumière ces recherches laissées jusqu’ici dans l’ombre.
5 Sur l’histoire du solidarisme comme position philosophique et comme mouvement politique, voir la récente étude de M.-C. Blais, La solidarité : histoire d’une idée, Paris, 2007 (Bibliothèque des idées).
6 Mentionnons les travaux que Michel Dreyfus a consacrés à Mabilleau : M. Dreyfus, Le mutualisme de Léopold Mabilleau. Fondateurs et militants du mouve-ment mutualiste sous la IIIe République, dans La Mutualité et la protection sociale. Colloque national d’Albi, 24-25-26 septembre 1987, Paris, 1988, p. 29-44 ; Id., Léopold Mabilleau, dans Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, dir. J. Maitron, C. Pennet et al., Paris, 1989, tome 35, p. 128-130 ; Id., L. Mabilleau. Professeur d’assurances et de prévoyance sociales (1900-1926), dans Les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers. Dictionnaire biographique, 1794-1955, dir. C. Fontanon et A. Grelon, 2 vol., Paris, 1994 (Histoire biographique de l’ensei-gnement), t. 2, p. 160-168 ; Id., Léopold Mabilleau et le mouvement mutualiste fran-çais et international, dans Le Musée social en son temps, éd. C. Chambelland, Paris, 1998, p. 103-118. Voir aussi J. Bennet, Léopold Mabilleau, dans Biographies de personnalités mutualistes (XIXe-XXe siècles), Paris, 1987, p. 293-308 et A. Hirschfeld, Léopold Mabilleau (1853-1941). Une figure du Musée social, dans Vie sociale, 3, 1989, p. 91-96.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 175
Les années romaines
Fils d’Auguste Mabilleau, professeur au lycée de Beaulieu dans l’Indre-et-Loire, et d’Amélie Léopoldine Roos, Léopold naît le 10 octobre 1853 dans la ville où enseigne son père. Il poursuit des études au lycée de Niort7 avant d’entrer à l’École normale supé-rieure, section des Lettres, en 1873. Reçu premier au concours de l’agrégation de philosophie en 18768, Mabilleau entre immédiate-ment à l’École française de Rome9, où il resta jusqu’en 1878, aux côtés d’Élie Berger, Émile Chatelain, Georges Duruy et Emmanuel Fernique pour l’année 1876-1877. Il fut rejoint par Maurice Albert et François Delaborde l’année suivante.
La personnalité de Mabilleau, son originalité parmi les Farnésiens, ne manqua pas de susciter l’étonnement, voire l’aga-cement, de certains de ses collègues. Dans ses Souvenirs romains, Jérôme Carcopino, membre de l’École française de Rome entre 1904 et 1907, puis directeur entre 1937 et 1940, se souvient d’une rencontre avec Mabilleau lors d’une réception organisée par Mgr Duchesne au Palais Farnèse au tournant du vingtième siècle. Il s’agissait, écrit Carcopino, du « plus pittoresque des repas qu’avec mes camarades convoqués en totalité, j’aie pris dans la salle à manger de Mgr Duchesne ». Le pittoresque de la scène tenait essen-tiellement à la présence du philosophe :
Avec notre directeur et nous, n’y assistait qu’un seul invité du dehors : l’archicube et farnésien Léopold Mabilleau. Ah ! Le curieux personnage ! Nous nous figurions voir un ancêtre en ce normalien de la promotion de 1873, qui avait vécu à l’École française de 1876 à 1878. Son apparition fut,
7 Une source unique le mentionne au lycée Henri IV ; cf. Léopold Mabilleau, dans Dictionnaire national des contemporains, dir. C.-E. Curinier, 6 vol., Paris, 1899-1919, t. 2, p. 160.
8 Léopold Mabilleau obtient l’agrégation de philosophie en 1876. Sont aussi reçus cette année : Paul Souriau, Arsène Monty, Louis Ricardou et Émile Chatelain (il semble qu’il ne s’agisse pas d’Émile Louis Chatelain, qui entre à l’École fran-çaise de Rome en même temps que Mabilleau, mais nous n’avons pas pu vérifier ce point). Cf. Les lauréats des concours d’agrégation de l’enseignement secondaire (1821-1950), Paris, 1993, disponible en ligne à l’adresse suivante URL = http://www.inrp.fr/she/chervel_laureats.htm.
9 Dans une lettre adressée à Auguste Geffroy du 27 août 1877 (Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 12925, fol. 3721-3724), Mabilleau se plaint de ne pas avoir reçu son traitement alors que sa nomination date du mois de janvier. Il faudrait conclure de cette précision que la promotion 1876-1877 a pris ses fonctions en 1877 seulement. Il ne peut en effet s’agir de sa nomination en qualité de membre de deuxième année, puisqu’il écrit : « Il me paraît impossible qu’on nous laisse ainsi sans ressources pendant des mois, obligés de vivre à l’étranger, et d’y vivre honorablement ».
AURÉLIEN ROBERT176
pour nous, une première surprise. Ce vétéran, la cinquantaine dépassée, portait beau sans avoir l’air du vieux beau. Il soulevait le poids des ans sur ses robustes épaules avec une sorte d’alacrité provocante. La stature haute et large, le cheveu abondant et noir sur un visage plein et coloré, les yeux fureteurs, la démarche souple et aisée, la faconde sonore, il débordait d’une vitalité juvénile. Jadis, il s’était singularisé au Palais Farnèse en s’affirmant philosophe au milieu des archéologues et d’historiens et en soumettant, au verdict de l’Académie des inscriptions, un mémoire insolite qu’il avait affublé d’un titre dont la longueur respirait une odeur de canular : Recueil de documents relatifs à la philosophie de Cesare Cremonini. Depuis, il avait, en la transformant au gré des circonstances, maintenu son originalité à travers les avatars de sa carrière accidentée. Il avait d’abord tiré sa révé-rence à l’université pour faire, comme on dit, de la politique. Puis, il avait délaissé la politique malgré les succès qu’il avait remportés à Toulouse et il se mua en économiste. Maintenant, il se carrait dans une confortable et substantielle sinécure : l’administration du Musée social.10
Voici résumé en peu de mots ce que beaucoup répètent : Mabilleau fut un original dans toutes les institutions académiques où il passa. Jamais véritablement à sa place, tiraillé entre le monde des universitaires et celui de l’action politique, il fut toujours trop engagé dans le monde politique pour les uns, pas assez pour les autres11.
Si sa compagnie était jugée agréable, ses recherches en revanche ne trouvèrent pas aisément leur place parmi les orientations intel-lectuelles de l’École française de Rome à cette époque. C’est que Mabilleau est philosophe et qu’il s’intéresse de surcroît aux confins de la Renaissance italienne et, qui plus est, à un courant que l’on avait coutume de qualifier de libertin avant l’heure, à travers la figure sulfureuse de Cesare Cremonini, parfois taxé d’athéisme et condamné par l’Église12. Rien de classique donc, ni dans la disci-pline, ni dans le thème choisi, ni même dans la période étudiée : tout cela était peu ou pas du tout représenté au Palais Farnèse. Aussi peut-on y voir la raison pour laquelle Auguste Geffroy – direc-teur de l’École quand Mabilleau y était membre – ne parvint pas à inclure de plein droit notre philosophe dans sa publication sur les
10 J. Carcopino, Souvenirs romains, Paris, 1968, p. 255.11 Bien entendu, ce trait prend une couleur particulière sous la plume de
Carcopino qui, rappelons-le, occupa plusieurs positions importantes, dont la direc-tion de l’École normale supérieure, sous le gouvernement de Vichy.
12 Sur le rôle de Cremonini dans la libre-pensée, cf. D. Bosco, Cesare Cremonini e le origini del libertinismo, dans Cesare Cremonini 1550-1631 : il suo pensiero e il suo tempo, Convegno di studi, 7 aprile 1984, Cento, 1990, p. 249-289 ; F. Charles-Daubert, La fortune de Cremonini chez les libertins érudits du XVIIe siècle, dans Cesare Cremonini. Aspetti del pensiero e scritti, éd. A. Poppi, E. Riondato, Padoue, 2000, p. 169-191.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 177
premiers travaux de l’École, tant ses sujets de prédilection étaient étrangers aux productions intellectuelles des autres membres. Geffroy le mentionne tout de même en fin de présentation, tel un hapax inclassable :
En résumé, le cadre des études que conseille à l’École française de Rome la grande variété des ressources offertes par l’Italie est singulièrement vaste. On a essayé de le restreindre en se fixant une limite chronologique, la fin du XVe siècle environ. Toutefois, deux membres de l’École, MM. Mabilleau et Georges Duruy, ont publié de très utiles études sur le XVIe siècle, avec beaucoup d’informations inédites. (…) M. Mabilleau, outre un mémoire sur la philosophie italienne de la Renaissance qui a été couronné par l’Institut, a le premier fait connaître le philosophe Cremonini, de l’école de Padoue.13
Si Auguste Geffroy se fend de quelques lignes, ce ne fut pas le cas de Pierre de Nolhac, membre de l’École de 1882 à 1885, en charge de la rédaction du chapitre « Humanisme et Renaissance » dans l’ouvrage consacré à L’histoire et l’œuvre de l’École française de Rome paru en 1931, qui ne fait pas même mention du nom de Mabilleau14. Cette publication salue l’historien de l’art Eugène Müntz, de la promotion qui précéda Mabilleau, puis Léon Dorez, membre de 1890 à 1893, pour leurs rôles respectifs dans l’amorce des études renaissantes à l’École, mais rien sur le philosophe. Pour quelles raisons le nom de Mabilleau a-t-il disparu ? Une remarque de Pierre de Nolhac permet peut-être d’esquisser une réponse. Selon lui, l’un des premiers directeurs, Albert Dumont, se plai-gnait auprès de l’Académie des inscriptions et belles-lettres que les membres délaissassent l’Antiquité pour ses premiers découvreurs à la Renaissance. Rien d’étonnant dans cette plainte, si l’on s’en tient aux déclarations programmatiques d’Auguste Geffroy dans l’article qu’il fit paraître dans la Revue des deux mondes dès 1876 pour expliquer la nature des travaux de l’École française de Rome tout juste créée :
Les sujets et travaux sont difficiles à choisir selon la vocation et le gré de chacun ; mais, à vrai dire, ils abondent ; voici de quelle nature nous les souhaitons. Nous devons éviter les desseins ambitieux ou trop vastes. Notre affaire n’est pas d’écrire des dissertations de philosophie ou de morale, ni des pages d’esthétique ; la critique littéraire n’est pas non plus de notre domaine, ni les impressions de voyage, ni la politique contemporaine.15
13 A. Geffroy, L’École française de Rome, ses premiers travaux, Antiquité-Moyen Âge, Rome, 1884, p. 103.
14 P. de Nolhac, Humanisme et Renaissance, dans L’histoire et l’œuvre de l’École française de Rome, Paris, 1931, p. 305-312.
15 A. Geffroy, La nouvelle École française de Rome..., cit., p. 814-815.
AURÉLIEN ROBERT178
Mabilleau, lui, s’adonna à tout ce que l’École écarte dès le départ de son domaine de compétence. Non seulement il écrivit des textes purement philosophiques – dont deux mémoires à Rome qui représentent quelques milliers de pages – mais il rédigea aussi des manuels de morale pour le compte de Jules Ferry et de ses collaborateurs, se plut à décrire le fonds de peinture française du Musée de Madrid, tout en enseignant l’esthétique à la Faculté des lettres de Caen, et fut l’auteur d’un livre très remarqué sur Victor Hugo ainsi que de quelques études sur Lamartine. Quant à « la politique contemporaine », il y consacra toute sa vie dès son retour en France comme nous allons tenter de le montrer.
Si son passage par l’École normale supérieure a certainement contribué à cet éclectisme, les années romaines ont peut-être aussi joué un rôle dans certains de ses choix intellectuels et même politiques, bien que cela soit difficile à déterminer. Mabilleau ne manque pas d’affirmer en divers endroits sa reconnaissance, voire sa dette, envers l’École française et envers les personnes qu’il a fréquentées à Rome16. Dans la préface de la version publiée en 1881 de ses recherches menées à Rome, intitulée Étude historique sur la philosophie de la Renaissance en Italie (Cesare Cremonini), Mabilleau remercie ses maîtres, ainsi que tous ceux qui l’ont aidé durant son séjour à Rome : des intellectuels, des bibliothécaires, mais aussi le sénateur Mamiami et le député Berti17. À la suite de
16 Dans le rapport sur l’état des travaux des membres que le directeur (Auguste Geffroy) fait parvenir au ministre le 16 janvier 1877 (Arch. nat., F17 4130), on trouve la description suivante des travaux de Mabilleau : « M. Mabilleau entreprend une histoire des doctrines de l’École de Padoue. Pour lui aussi, les documents inédits abondent. Les professeurs de l’université de Rome, M. le Comte Mamiami de la Rovère, M. Berti, M. Luigi Ferri, lui ont prodigué à ce propos avec une rare libéra-lité les documents utiles. M. Luigi Ferri, ancien élève de l’École normale de Paris, a été jusqu’à mettre à sa disposition la copie d’un manuscrit inédit de Pomponace (...). M. Mabilleau compte s’occuper spécialement pendant cet hiver de la première période de son sujet, c’est-à-dire des origines de l’École de Padoue, depuis 1300 environ jusqu’à Pomponace (1462-1525). Il est parti le 10 janvier de Rome pour Venise, où il doit copier d’utiles documents ».
17 L. Mabilleau, Étude historique sur la philosophie de la Renaissance en Italie (Cesare Cremonini), Paris, 1881, p. X-XI : « En Italie aussi, la liste [des remercie-ments] est longue : M. le sénateur Mamiami, le grand écrivain dont nous suivions les travaux avec la plus respectueuse admiration ; M. le député Berti, dont la bien-veillance nous a ouvert plus d’une bibliothèque et procuré plus d’un document ; M. Fiorentino, l’éminent historien et philosophe, à la suite de qui doit se mettre tout d’abord quiconque veut étudier la Renaissance ; plusieurs autres sans qui nos efforts fussent demeurés infructueux : M. le commandeur Niccolò Barozzi, conser-vateur du Musée Correr à Venise, chevalier de notre Légion d’honneur, l’ami et l’appui de tous les Français qui séjournent dans cette ville qu’il connaît si bien ;
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 179
quoi Mabilleau remercie poliment le directeur de l’École française de Rome, qui lui a permis de mener à bien ses recherches en Italie18, non seulement à Rome, mais surtout dans le nord de l’Italie, prin-cipalement à Padoue, Ferrare et Venise19. S’il est difficile d’évaluer la sincérité de l’attachement de Mabilleau pour l’École française de Rome, notons cependant qu’il assista au cinquantenaire de l’École20. Mais plutôt que d’évaluer, sans véritable fondement, ses rapports personnels avec l’institution et ses membres, tentons de présenter les travaux que Mabilleau a menés en Italie sur la philo-sophie de la Renaissance dans l’Italie du Nord et à Padoue en parti-culier.
La philosophie rebelle en Italie du Moyen Âge à la Renaissance : Cesare Cremonini et l’École de Padoue
Pendant son séjour en Italie, Mabilleau rédige un premier mémoire intitulé Recueil de documents relatifs à la philosophie de Cesare Cremonini, professeur à l’université de Padoue (1591 à 1631), qui fut présenté à l’Académie des inscriptions et belles-
M. le commandeur Veludo, bibliothécaire de Saint Marc ; M. le professeur Zeni, bibliothécaire de Ferrare ; M. le chanoine De Fabris, bibliothécaire de Padoue ; et M. Marco Gerardi, l’actif et intelligent sous-bibliothécaire ; M. Favaro, professeur à l’université de Padoue, dont les études historiques sont connues et appréciées en France ; et, avant tout, M. le commandeur Louis Ferri, ancien élève de notre École normale supérieure, auteur d’un beau livre que l’on connaît sur la Philosophie italienne au XIXe siècle, et de nombreux travaux que nous avons mis à profit. Notre gratitude pour M. Ferri est aussi grande que l’affection qui nous lie à lui ».
18 Ibid., p. XI : « Enfin nous obéissons à un penchant de cœur autant qu’à un sentiment de justice en rapportant le mérite de ce travail à notre cher et respecté maître, M. A. Geffroy, directeur de l’École française de Rome, sous le patronage de qui nous l’avons écrit. Comme tous ses élèves, nous conservons un profond souvenir des années que nous avons passées près de lui, au milieu des sympathies qu’il avait su nous conquérir. »
19 Dans la correspondance entre Léopold Mabilleau et Auguste Geffroy, conservée à la Bibliothèque nationale de France, on constate qu’en 1877 Mabilleau se trouve le plus souvent à Padoue. Dans une lettre du 27 août 1877 adressée à Geffroy, Mabilleau dit qu’il retournera à Venise le 5 septembre (Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 12925, fol. 3721-3724). Le 17 septembre de la même année, Geffroy reçoit une lettre de Mabilleau postée de l’hôtel « Al sole d’oro » de Padoue (ibid., fol. 3731-3732), puis le 26 décembre, toujours de Padoue. Dans une lettre du 1er février 1893 adressée au ministre de l’Instruction publique (Arch. nat., F17 2986A), dans laquelle il demande une bourse pour une mission à l’étranger, Mabilleau rappelle les éléments principaux de sa carrière et précise qu’il était préparé aux recherches qu’il veut entreprendre à présent « par un séjour de deux années à Venise ».
20 Le cinquantenaire de l’École française de Rome, dans MEFR, 49, 1932, p. 308.
AURÉLIEN ROBERT180
lettres le 10 août 187721. Étonné par le mémoire reçu, le rappor-teur se contente d’un court texte plutôt formel, dans lequel il note surtout l’important travail philologique effectué sur des manuscrits inédits22.
L’année suivante, lors de la séance du 8 décembre 1878, l’Aca-démie des inscriptions et belles-lettres se plaint de ne pas avoir reçu un autre mémoire de Mabilleau :
MM. Mabilleau et Élie Berger ne nous ont rien adressé ; mais nous savons qu’ils s’occupent de recherches étendues, et nous ne leur marchan-dons pas le temps exigé pour fouiller les bibliothèques et réunir les maté-riaux. M. Mabilleau veut faire l’histoire de la philosophie péripatéticienne en Italie du XIVe au XVIe siècle.23
Ayant achevé assez rapidement son travail sur Cesare Cremonini, Mabilleau entreprend un travail considérable sur ce qu’il est coutume d’appeler « l’École de Padoue », école aristotélicienne qui débuterait au Moyen Âge avec la figure emblématique de Pietro d’Abano et qui s’achèverait approximativement avec Cremonini et Galilée au début du XVIIe siècle. Un an plus tard, le 10 janvier 1879, alors que Mabilleau n’est déjà plus à Rome, les membres de l’Institut se plaignent encore du retard dans le dépôt de certains mémoires, dont celui de Mabilleau sur l’École de Padoue, et disent regretter de ne l’avoir pas lu, au regard de ce qu’il les avait habitués à lire avec ses précédents travaux sur Cremonini :
21 CRAI, 1877, séance du vendredi 10 août, p. 255. Nous n’avons trouvé aucune trace de la lettre adressée par le directeur de l’École française de Rome au secré-taire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. L’année 1877 est partiellement manquante dans le carton F17 4130 des Archives nationales. Dans une lettre adressée à Auguste Geffroy le 26 décembre 1877, de Padoue (Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 12925, fol. 3723-3726), Mabilleau dit la chose suivante : « Je ne suis pas certain d’avoir absolument terminé mon mémoire pour le 1er mars, mais en tout cas, il offrira un ensemble et sera présentable. »
22 Rapport de la commission des écoles d’Athènes et de Rome sur les travaux de ces deux écoles pendant l’année 1876, lu par M. Perrot le 30 novembre 1877, dans CRAI, 4e série, t. V, 1877, p. 478-515, aux p. 512-513 : « Le sujet choisi par M. Mabilleau, agrégé de philosophie, s’écarte plus encore des études ordinaires de l’Académie, c’est un Recueil de documents relatifs à la philosophie de Cesare Cremonini (...). Guidé par les indications que lui ont fournies les éminents profes-seurs de philosophie dont s’honore l’université romaine, M. le Comte de Mamiani, M. Berti, M. Ferri, M. Mabilleau a retrouvé beaucoup de manuscrits inédits de Cremonini, il s’en sert habilement pour faire revivre une figure qui mérite de n’être point oubliée et de reprendre sa place dans l’histoire du mouvement philosophique, vers le commencement du XVIIe siècle ».
23 CRAI, 1878, séance publique annuelle du 8 décembre 1878, discours d’ou-verture de M. Laboulaye, p. 234-251, à la p. 249.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 181
Nous regrettons aussi, écrivent-ils, de ne pas avoir encore entre les mains le résultat des études que M. Mabilleau poursuit sur la philosophie péripatéticienne en Italie pendant les XIVe, XVe et XVIe siècles. On nous dit avec quel soin il en a réuni les matériaux dans les bibliothèques de Venise, de Bologne, de Vicence, de Ferrare, de Vérone ; et, d’après la valeur des recherches qu’il a présentées à l’Académie l’année dernière sur Cremonini, nous avons tout lieu de croire que son travail comblera une lacune impor-tante, en complétant le tableau des transformations de l’esprit philoso-phique en Italie depuis saint Thomas jusqu’à Galilée.24
On peut présumer que les retards dans le dépôt des mémoires étaient – déjà – fréquents en ces premières années de l’École fran-çaise de Rome, car le rapporteur devait les justifier par la nature singulière du travail des membres :
Si nous n’avons pas encore la rédaction complète du mémoire de M. Fernique, écrit M. Girard, si les noms de deux de ses collègues, MM. Élie Berger et Mabilleau, ne figurent pas dans les envois qui nous sont adressés, cela tient en grande partie aux conditions particulières du travail à l’École de Rome. En Italie comme en Grèce, les jeunes gens doivent s’occuper d’amasser pour l’avenir, et l’intérêt général de l’École leur crée le double devoir de suivre attentivement les découvertes partout où elles se font, en se hâtant de les mettre à profit, et de fournir leur part à des œuvres communes qui se continuent d’année en année.25
En fait, le mémoire était presque achevé bien avant ces délais. Dans une lettre adressée au directeur de l’École le 8 février 1878, dans laquelle Mabilleau se plaint d’être une fois de plus malade des bronches26, il annonce qu’il enverra très prochainement son mémoire, qui contient déjà 1 300 pages. Mais, dans une lettre du mois de juillet suivant, Mabilleau décrit son désespoir de voir son mémoire – et avec lui 400 ou 500 pages de transcriptions inédites de manuscrits – égaré par les postes italiennes ou par le personnel du Palais Farnèse, car il dit l’avoir envoyé un mois plus tôt et croyait
24 Rapport de la commission des Écoles d’Athènes et de Rome sur les travaux de deux Écoles pendant l’année 1877-1878, par M. J. Girard, lu dans la séance du 10 janvier 1878, dans CRAI, 1879, p. 349-371, à la p. 249
25 Ibid., p. 370.26 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 12925, fol. 3733-3734. La lettre n’indique que
le jour et le mois, mais Mabilleau évoque la mort du pape (Pie IX est décédé le 7 février 1878). Dans sa lettre, Mabilleau parle même d’un accès de malaria. Il rappelle que trois ans auparavant il avait dû resté alité pendant cinq mois (fol. 3733). Le 31 décembre 1877, Auguste Geffroy recevait une lettre du père de Mabilleau, postée de Niort, le remerciant de tout ce qu’il a fait pour son fils quand celui-ci était malade (ibid., fol. 3727-3728).
AURÉLIEN ROBERT182
donc que son mémoire était déjà arrivé à l’Institut27. Il annonce alors au directeur qu’il devra renoncer à concourir aux Sciences morales et politiques si jamais son mémoire n’était pas retrouvé.
Car ce n’est pas à l’Académie des inscriptions et belles-lettres que Mabilleau désire envoyer son mémoire, intitulé simplement Histoire de l’école de Padoue, mais bien à l’Académie des sciences morales et politiques afin de répondre à l’annonce d’un concours on ne peut plus ciblé, puisque son intitulé n’est autre que « La philo-sophie de l’École de Padoue »28. Il s’agit d’un travail colossal, qui décrit les origines de l’université de Padoue – tant institutionnelles qu’intellectuelles – et qui s’intéresse à plusieurs types de savoir (notamment la logique, la théologie, la médecine et l’astrologie). Sans surprise, seul mémoire présenté à ce concours, le texte de Mabilleau remporte le prix du budget attribué au lauréat. Malgré la facilité avec laquelle il obtient ce prix, le président de l’Académie loua cependant ce mémoire dans un discours du 21 juin 187929.
Après son premier travail sur Cesare Cremonini et son contexte padouan, Mabilleau a hésité quant au sujet de thèse qu’il pourrait choisir. Dans une lettre adressée le 26 décembre 1877 à Auguste
27 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 12925, fol. 3740-3741, Fribourg-en-Brisgau, [s.d.]. Mabilleau dit qu’il a quitté Venise la première semaine de juin pour Fribourg-en-Brisgau, d’où est postée la lettre. Dans cette lettre, il demande à ce que le Palais Farnèse soit fouillé entièrement pour retrouver le paquet, il demande aussi que M. Ferri soit avisé de cette perte et que l’on fasse appel à Mme de Noailles « pour qu’une recherche soit faite à la juste ».
28 L’Académie des inscriptions et belles-lettres n’a pas commenté ce choix. En novembre 1879, lorsque M. Miller lit son rapport sur les travaux de l’École fran-çaise de Rome, le nom de Mabilleau n’apparaît plus.
29 Discours du président de l’Académie, M. Vacherot, le 21 juin 1879, dans Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 39e année, nouvelle série, t. 12, 1879, p. 46-63, à la p. 49 : « Sans offrir le puissant attrait d’une grande doctrine, La philosophie de l’École de Padoue avait de quoi tenter la curiosité d’un érudit philosophe. Le sujet était à peu près neuf, et c’est dans des manuscrits inédits qu’il fallait chercher la matière d’une histoire complète. Un seul mémoire nous a été remis. C’est la première grande étude qui a été faite en France sur ce sujet. L’œuvre est très étendue, riche de recherches, d’analyses, d’explications qui montrent une érudition sûre et variée, unie à une intelligence large et profonde des doctrines de cette philosophie plus traditionnelle qu’originale, où l’on retrouve partout la pensée d’Aristote et l’interprétation de ses plus célèbres commentateurs, avec des développements que le génie du maître n’eut pas toujours désavoués. » M. Vacherot vante au passage les mérites de la jeune École française de Rome (ibid., p. 50) : « L’auteur de ce mémoire, auquel l’Académie décerne le prix, est M. Mabilleau, élève de l’École française de Rome. C’est grâce à cette institution, heureux complément de l’École d’Athènes, qu’il a pu trouver dans les bibliothèques romaines jusqu’alors fermées à l’érudition française les meilleurs matériaux de son travail ».
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 183
Geffroy depuis Padoue, Mabilleau confesse qu’il a « songé à une thèse sur Cardan, un des plus originaux et des plus modernes esprits de la Renaissance, ou sur la philosophie platonicienne à Florence »30. Plus loin, il explique un peu plus avant ce dilemme :
La philosophie de la Renaissance, vous le savez, Monsieur le Directeur, se divise en deux courants, péripatéticienne à Padoue, platonicienne à Florence. Cette année et l’année dernière j’ai étudié la première. En y joignant la seconde, l’histoire des idées pendant la Renaissance se trouve-rait complète. Mais je recule un peu devant cette grande tâche, et je l’aban-donnerai en tout cas certainement si mon mémoire de cette année n’obtient pas une mention. Sur tout cela d’ailleurs, mes projets et mes intentions sont très flottants (...).
Finalement, fort de ces deux mémoires, Mabilleau présente sa thèse sur Cremonini et l’École de Padoue pour le grade de docteur ès lettres de l’université de Paris en 1881 et, comme la réglementation de l’université de Paris l’exigeait à l’époque, rédige aussi une courte thèse complémentaire en latin sur l’idée de perfection chez Leibniz31.
Il n’existe pas, à notre connaissance, de compte rendu officiel de la soutenance de thèse de Léopold Mabilleau ; mais, par chance, dans La vie à Paris, l’académicien Jules Claretie en raconte les prin-cipaux moments32. Grâce à ce récit, on apprend notamment une partie de la composition du jury qui, outre Ernest Bersot, directeur de thèse33, comptait au moins Elme-Marie Caro34, Ernest Lavisse35
30 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 12925, fol. 3723-3726, Léopold Mabilleau à Auguste Geffroy, Padoue, 26 décembre 1877.
31 De perfectione apud Leibnitium, thesim Facultati litteratum Parisiensis propo-nebat L. Mabilleau (68 p.). Nous y reviendrons un peu plus loin.
32 J. Claretie, La vie à Paris, 1880-1885, t. 2 (année 1881), Paris, 1881, p. 422 : « J’ai pourtant – avec beaucoup d’agrément esthétique – assisté, l’autre jour, à la Sorbonne, à la soutenance de la thèse de M. Léopold Mabilleau sur La philosophie de la Renaissance en Italie et César Cremonini, un philosophe assez obscur de l’uni-versité de Padoue qui trouva le moyen de vivre bien renté en se donnant à ses élèves pour libre-penseur, comme on dirait aujourd’hui, et qui se tint à égale distance de la messe et du fagot. »
33 L. Mabilleau, Étude historique..., cit., p. X. On y apprend que son directeur était Ernest Bersot, philosophe, directeur de l’École normale supérieure de 1871 à 1880 et ancien secrétaire de Victor Cousin.
34 Elme-Marie Caro fut professeur de philosophie à la Faculté des lettres de Paris et occupa le fauteuil 27 de l’Académie française.
35 Historien plus que philosophe, Ernest Lavisse est considéré comme un personnage important de la IIIe République. Ancien suppléant de Fustel de Coulanges à la Sorbonne, il entra ensuite à l’Académie française et fut directeur de l’École normale supérieure à partir de 1904. Il est surtout connu pour son rôle actif dans les réformes du système éducatif français, auxquelles Mabilleau participe lui aussi, comme nous le verrons plus loin.
AURÉLIEN ROBERT184
et Paul Janet36. On apprend aussi quelques éléments sur le déroule-ment de cette soutenance :
M. Mabilleau, qui vient d’être proclamé docteur, est un des esprits les plus distingués de la jeune génération universitaire. (…). Ses juges l’ont parfois critiqué, mais l’ont surtout loué. Il a révélé à plusieurs un person-nage, quasi ignoré, Cremonini, que sa très brillante thèse fait revivre d’une manière inattendue. (…) M. Caro, si attendu et si écouté, a, le plus finement du monde, avec un rare talent de parole et une bonne grâce peu commune, interrogé le candidat, et le résumé de la thèse même de M. Mabilleau, présenté par M. Ernest Lavisse dans un langage entraînant et ferme, m’a plu infiniment. (…) Quelque part, M. Mabilleau avait légèrement raillé Victor Cousin, ce qui était son droit ; mais, quelque timide que fût son irrévérence, elle a semblé audacieuse à M. Paul Janet, qui en a pris texte pour tracer rapidement, avec une éloquence émouvante, le tableau des luttes soutenues par l’Université, il y a cinquante ou soixante ans.37
Si la réception de ses travaux sur la philosophie italienne fut globalement bonne chez les philosophes, certains y apportèrent cependant quelques bémols. Le premier à émettre quelques réserves n’est autre que Francisque Bouiller, rapporteur de son mémoire devant l’Académie des sciences morales et politiques. Il lui reproche d’abord de n’avoir pas limité son travail sur Padoue aux XIVe-XVIe siècle et d’avoir inclus le XIIIe siècle38. Plus géné-ralement, à la lecture du rapport de Bouiller on sent l’agacement du spécialiste de Descartes face à l’érudition de Mabilleau, qui lui semble être à bien des égards éloignée de toute préoccupation philosophique. Dans la préface du livre publié en 1881 et qui est issu de cette thèse, Mabilleau se défend contre ces attaques39 et affirme n’avoir jamais renoncé au souci historique, tout en jugeant, il est vrai, Cremonini bien supérieur à nombre des auteurs les plus célébrés de la Renaissance italienne d’un point de vue philoso-phique :
36 Paul Janet fut professeur de philosophie au lycée Louis-le-Grand de 1857 à 1863, puis professeur à la Faculté des lettres de Paris et membre de l’Académie des sciences morales et politiques à partir de 1864. Dans la préface de son livre sur Cremonini (Étude historique..., cit., p. VIII), Mabilleau dit avoir suivi les cours de Paul Janet à la Faculté des lettres de Paris sur la philosophie pré-cartésienne en 1875-1876.
37 J. Claretie, La vie à Paris..., t. 2 (année 1881), p. 422.38 Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 39e année,
nouv. s., t. 11, 1879, p. 449-542, à la p. 450.39 L. Mabilleau, Étude historique..., cit., p. VII : « Le savant et bienveillant
rapporteur de l’Académie, M. Francisque Bouiller, nous avait reproché d’avoir eu là “plus de souci de l’histoire que de la philosophie”. Nous croyons que le présent ouvrage échappera à cette chance de blâme. »
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 185
Nous n’avons point tenté de grandir notre auteur, écrit Mabilleau ; nous avons même une fois prononcé le mot « médiocrité » ; nous nous en sommes repentis. Il y a peut-être autant de force réelle et disponible dans l’activité mesurée et maîtresse d’elle-même d’un esprit qui borne volontairement son horizon, que dans les écarts violents de l’imagination déréglée. Pris en lui-même, le système de Cremonini est très supérieur aux palingénésies fantaisistes de ses contemporains. Il y a quelque chose de séduisant à coup sûr dans ces essais de révolution intellectuelle, nés du mépris de la tradition et de l’amour immodéré du mieux ; mais il faut se garder d’en être dupe.40
Mabilleau voit en Cremonini un rationaliste assoiffé de progrès, pratiquant la philosophie de manière autonome, indépendamment des discours des théologiens, à l’image de ses propres maîtres posi-tivistes de l’École normale supérieure formés à l’école d’Auguste Comte.
Alors que le rapporteur de l’Institut lui reprochait d’être trop historien, Georges Lyon, philosophe spécialiste de la philosophie empiriste britannique, ancien condisciple de Mabilleau à la rue d’Ulm, reproche au livre de Mabilleau sur Cremonini son trop grand engagement philosophique par rapport à son objet historique41. Après avoir rappelé que l’ouvrage était le résultat d’une recherche beaucoup plus large menée à l’École française de Rome, Georges Lyon entend montrer que même si Mabilleau n’hésite pas à criti-quer Cremonini, à montrer les limites de sa philosophie, il s’efforce néanmoins constamment de compléter certaines lacunes philoso-phiques afin de montrer que les pistes suivies par Cremonini pour-raient produire une philosophie plus systématique, avec laquelle l’auteur montrerait quelques signes de connivence :
Aussi m’a-t-il, en maint endroit, semblé que la pensée de M. Mabilleau se sentait mal à l’aise dans l’étroite imitation aristotélicienne où son héros s’est complu. Volontiers il se distrait de son auteur pour se livrer à des incursions soit dans le domaine de la philosophie classique, soit parmi les doctrines antérieurement professées par les maîtres padouans. Quand telle théorie de Cremonini est trop insuffisante, M. Mabilleau l’étage d’un emprunt fait à Pomponace ou à Pietro d’Abano. Telle lacune est-elle à combler, un souvenir d’Averroès ou d’Alexandre d’Aphrodise réparera le défaut.
De sorte que l’on entrevoit sans peine vers quelle doctrine à lui penche le choix de l’historien. Il serait sans nul doute pour Aristote contre Platon, avec Leibnitz, malgré Descartes. Et la conception des choses, qu’il adopte-
40 Ibid., p. IX.41 Revue philosophique de France et de l’étranger, 1882, t. XIII, p. 77-81. Georges
Lyon est un spécialiste de philosophie anglaise, du Moyen Âge à l’époque moderne. Il entre à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm en 1874. Il enseigna ensuite au lycée Henri IV, puis à l’École normale supérieure.
AURÉLIEN ROBERT186
rait serait sans doute, celle d’un dynamisme transcendantal, suspendant les êtres aux intelligences, les intelligences aux âmes, et les âmes aux volontés. Que cette forte doctrine ressorte brutalement de ce savant livre, ce n’est nullement ce que j’entends dire. Mais un œil attentif la démêle de l’amas des rapprochements, tout comme dans une mosaïque l’on reconnaît le dessin réfléchi que l’ouvrier créa librement avec des couleurs faites et des nuances empruntées.42
Pour marquer un peu plus son aversion pour toute hagiogra-phie de philosophes prémodernes, Georges Lyon va jusqu’à consi-dérer qu’un des chapitres du livre ressemble fort à une réhabilita-tion de l’astrologie43. Certes, Mabilleau évoque à plusieurs reprises les travaux d’Albert le Grand et de Pietro d’Abano dans lesquels l’astrologie occupe une place importante. Mais au Moyen Âge et à la Renaissance, surtout à Padoue, exclure l’astrologie des savoirs universitaires, y compris philosophiques, n’avait aucun sens.
Mabilleau se défendit d’une telle accusation dans un court article paru dans les Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux en 188244. Mabilleau tente d’y montrer qu’il est tout à fait possible et même souhaitable d’étudier les sciences occultes d’un point de vue philosophique, puisque l’on ne peut opérer des distinctions entre les disciplines sur le modèle du XIXe siècle et les appliquer au passé. D’ailleurs, contrairement à Georges Lyon, Francisque Bouiller faisait remarquer l’intérêt philosophique des analyses que Mabilleau proposait de certains textes astrologiques45. C’était là en effet une nouveauté méthodologique que de ne pas limiter l’analyse aux seuls textes reconnus comme philosophiques (commentaires à Aristote ou traités indépendants), mais d’élargir le champ d’inves-tigation à l’ensemble des savoirs où peut s’exprimer un discours philosophique.
Dans ce court article, Mabilleau défend une autre idée centrale, qui transpire ici comme dans son livre sur Cremonini : l’idée d’un long Moyen Âge – même s’il faut tout de même attendre Jacques Le Goff pour que l’expression soit forgée. Ce que Georges Lyon consi-
42 Ibid., p. 81.43 Ibid., p. 80.44 L. Mabilleau, Notes pour servir une histoire critique des sciences occultes,
dans Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, t. 4, 1882, p. 185-191.45 Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 39e année,
nouv. s., t. 11, 1879, p. 454 : « Mettant de côté tout ce qui a déshonoré l’astrologie, comme la magie, l’horoscopie, les incantations, les prédictions, les sortilèges, il en dégage cette idée fondamentale et vraiment philosophique, que dans l’univers tout se tient, qu’il y a, sous l’influence des astres, corrélation des existences, des mouve-ments, une solidarité de tous les êtres » (nous soulignons).
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 187
dère comme une lecture infidèle constitue plutôt un lot de thèses historiques fortes pour l’époque : la frontière entre le Moyen Âge et la Renaissance n’est pas si nette que ce que la facilité univer-sitaire nous amène à répéter encore aujourd’hui ; les innovations philosophiques les plus fortes ne sont pas toujours à chercher dans la tradition de l’humanisme philologique, mais parfois aussi dans la poursuite, certes critique, de la philosophie scolastique, notam-ment lorsqu’elle a tenté d’interpréter les pensées rebelles d’un Alexandre d’Aphrodise ou d’un Averroès dans leur contradiction avec les dogmes de l’Église ; enfin, l’étude de la philosophie médié-vale et renaissante ne saurait se restreindre aux seuls textes stric-tement philosophiques46. La relative nouveauté de cette approche place Mabilleau en porte-à-faux par rapport à une partie de la communauté scientifique de l’époque. Non seulement ses travaux remettent la scolastique sur le devant de la scène philosophique, mais ils en font l’une des sources incontournables du tournant de la modernité. Cela devait paraître inacceptable aux cartésiens et aux empiristes habitués à répéter que la pensée ne s’est véritable-ment libérée de l’aristotélisme qu’avec les travaux de Locke ou de Descartes au XVIIe siècle47.
Quoi qu’il en soit, ces deux critiques – l’excès d’histoire au détri-ment de la philosophie ou l’engagement parfois anachronique de l’auteur dans son objet – paraissent aujourd’hui démesurées à la lecture des travaux de Mabilleau et ne semblent pas rendre justice à sa préoccupation constante pour les problèmes d’historiogra-phie. Non seulement son travail paraît bien ménager les diverses exigences qui font le travail de l’historien de la philosophie – un travail sur des archives inédites48, un souci des filiations intellec-tuelles et des sources disponibles à l’époque et une interprétation philosophique dont la pertinence peut encore trouver quelque écho chez les philosophes du présent –, mais il fait aussi montre d’une conscience aiguë des débats historiographiques qui font rage chez les historiens de la philosophie de la fin du XIXe siècle.
46 Dans les sections suivantes, le lecteur pourra trouver quelques illustrations de cette attitude historiographique, certainement inspirée, négativement, par les travaux de son maître Ernest Renan.
47 Mentionnons tout de même E. Krakowski, Les sources médiévales de la philo-sophie de Locke, Paris, 1915. Krakowski cite d’ailleurs les travaux de Mabilleau pour étayer sa propre thèse historique sur les liens entre philosophie moderne et philosophie scolastique.
48 Le mémoire sur Padoue contient 200 feuillets de textes inédits.
AURÉLIEN ROBERT188
Dès 1877, dans un article consacré à Pietro Pomponazzi49, autre figure sulfureuse de l’histoire intellectuelle de la Renaissance, bien connue pour son traité sur l’immortalité de l’âme et condamné à maintes reprises par les autorités ecclésiastiques50, Mabilleau s’inter-roge sur l’historiographie italienne concernant cet auteur. En effet, deux historiens de la philosophie que Mabilleau fréquenta à Rome, Francesco Fiorentino et Luigi Ferri, ont publié l’un après l’autre des livres sur celui qu’on appelait en France le Pomponace51. Il constate que Fiorentino est très influencé par la pensée de Hegel, notam-ment lorsqu’il fait de la pensée de Pomponazzi une grande étape du génie italien de la Renaissance, dans le sillage des travaux de l’his-torien allemand Jacob Burckhardt. Mabilleau, quant à lui, consi-dère que non seulement la Renaissance n’évolue pas dans une direc-tion unique, mais aussi que le génie italien doit être nuancé : alors que l’Italie remet à l’ordre du jour les beaux textes classiques, elle continue de brûler les philosophes indépendants, comme Giordano Bruno en 1600 sur le Campo dei Fiori à Rome. Mabilleau montre donc clairement sa préférence pour la méthode de son ami Ferri52 :
La méthode de M. Ferri est vraiment historique et ne connaît point les impatiences familières à M. Fiorentino ; voici comment il la caractérise lui-même dans la préface de son histoire : « Il est avant tout nécessaire que les doctrines philosophiques soient exposées exactement et connue d’une manière précise en elles-mêmes et dans leurs rapports, afin que la pensée guidée par l’histoire puisse s’élever à un point de vue vraiment général et supérieur aux points de vue spéciaux. Nous nous garderons généralement de mêler la critique à l’exposition (…) ».53
49 L. Mabilleau, Les interprètes italiens de Pietro Pomponazzi, dans Revue philo-sophique de France et de l’étranger, t. 4, 1877, p. 513-523.
50 Sur les débats suscités par Pomponazzi en Italie, cf. É. Gilson, Autour de Pomponazzi : problématique de l’immortalité de l’âme en Italie au début du XVIe siècle, dans Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 36, 1961, p. 163-279.
51 F. Fiorentino, Pietro Pomponazzi, studi storici sulla scuola Padovana et Bolognese nel secolo XVI, Firenze, 1868 ; L. Ferri, Psicologia di Pietro Pomponazzi, secondo un manoscritto inedito dell’Angelica di Roma, Rome, 1877, tiré-à-part de Intorno alle dottrine psicologiche di Pietro Pomponazzi (…), dans Atti dell’Academia dei Lincei, t. 3, sér. 2, 1877, p. 333-548.
52 Notons que Fiorentino a dû écrire un compte rendu assez mauvais des travaux de Mabilleau, car le directeur de l’École française de Rome lui demande de répondre à ces attaques. Cf. Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 12925, fol. 3736, Léopold Mabilleau à Auguste Geffroy, s. l. n. d. Dans cette lettre, Mabilleau dit qu’il n’a pas le temps de lui répondre, mais qu’il en a déjà parlé à son ami Ferri. Il ajoute : « Il me sera d’ailleurs facile de répondre car il n’y a pas une seule critique fondée sur toutes celles qu’il m’a lancées. » Nous n’avons pas retrouvé la trace de ce compte rendu de Fiorentino.
53 L. Mabilleau, Les interprètes italiens..., cit., p. 520-521.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 189
Cette séparation méthodologique entre la critique textuelle et l’interprétation se retrouve dans le travail d’archives qu’a mené Mabilleau lors de son séjour en Italie, comme en témoigne le cata-logue des manuscrits publié en annexe de son livre sur Cremonini54. On ne saurait donc le blâmer pour son manque de considération historique, ni même pour une lecture téléologique de l’histoire. Son étude sur Cremonini était la première en France et elle souffre surtout de cette primauté.
D’un point de vue philosophique, le choix de Cremonini provient certainement de l’un de ses maîtres, à qui il dédie son livre lors de sa publication : Ernest Renan55. Dans son fameux Averroès et l’aver-roïsme, publié en 1852, Ernest Renan écrivait que « Cremonini a été jusqu’ici apprécié d’une manière fort incomplète par les histo-riens de la philosophie. On ne l’a jugé que par ses écrits imprimés, qui ne sont que des dissertations de peu d’importance et ne peuvent en aucune manière faire comprendre la renommée colos-sale à laquelle il parvint »56. C’est certainement pour remédier à ce manque que Mabilleau décida de lui consacrer sa thèse de doctorat et de mener des recherches sur des matériaux inédits. Mais il se pourrait que la réputation de Cremonini ait aussi suscité l’intérêt du jeune normalien. En effet, selon Renan, « le dernier représentant de la scolastique averroïste est César Cremonini (...) »57. Pourtant, dans les quelques pages qu’il consacre à ce personnage, Renan ne parvient ni à le classer dans le camp des averroïstes véritables, partisans de la séparation de l’intellect humain – thèse condamnée, rappelons-le, par l’Église aux conciles de Vienne de 1311-1312 et de Latran V de 1512-1517 parce qu’elle ne permet pas de penser la résurrection et qu’elle pose nombre d’autres problèmes théolo-giques – ni de le situer dans le camp des matérialistes, disciples loin-tains d’Alexandre d’Aphrodise58, qui réduisent l’âme à la matière,
54 Ils sont principalement contenus dans trois bibliothèques : la Bibliothèque Saint-Marc de Venise, la Bibliothèque universitaire de Padoue et la Bibliothèque nationale de Paris. Mais comme l’indique le rapport de l’Institut cité plus haut, Mabilleau a aussi effectué des recherches dans les bibliothèques de Venise, de Bologne, de Vicence, de Ferrare et de Vérone.
55 L. Mabilleau, Étude historique..., dédicace placée avant les pages foliotées : « Aux deux maîtres, à qui je dois d’avoir pu écrire ce livre, trop peu digne de leur être offert, MM. Ernest Renan et Félix Ravaisson. Hommage de respectueuse et reconnaissante affection. »
56 E. Renan, Averroès et l’averroïsme, Paris, 2002 (première édition 1852), p. 283.57 Ibid.58 Notons que la thèse matérialiste ne se trouve pas chez Alexandre d’Aphro-
dise, mais il était fréquent à l’époque de la lui attribuer.
AURÉLIEN ROBERT190
ce qui peut conduire, dans ses versions les plus radicales, à une forme d’athéisme ou de panthéisme. D’un côté comme de l’autre, Cremonini, dont les démêlés avec l’Inquisition sont bien connus, apparaissait donc comme une figure singulière dans l’histoire de la philosophie. Mort l’année de la publication des Discours de Galilée et peu avant la publication du Discours de la méthode de Descartes, Cremonini se situe à la charnière de la modernité et marquerait l’avènement de la méthode scientifique et rationnelle si chère aux disciples d’Auguste Comte à la fin du XIXe siècle. Aussi l’étude de Mabilleau entend-elle à la fois situer Cremonini dans le contexte de l’École de Padoue – et donc de son héritage médiéval – et exhiber la singularité de sa pensée à ce moment charnière de l’histoire des idées philosophiques.
Contre Renan, Mabilleau montre notamment que Cremonini n’a jamais accepté la thèse de la double vérité, selon laquelle il y aurait une vérité philosophique et une vérité de la foi, lesquelles pourraient se contredire le cas échéant. C’est pourtant le point de doctrine le plus connu de ce qu’on a appelé « l’affaire Cremonini ». L’Inquisition, jugeant qu’il exposait sans critiques le système des philosophes, lui a demandé de réfuter les thèses contraires à la foi chrétienne. Cremonini refusa cette injonction, renvoyant les inqui-siteurs à leurs théologiens spécialistes, se gardant le droit de philo-sopher librement59, d’où les étiquettes durables d’athée et de libre penseur qu’on a accolées à son nom. Mabilleau semble convaincu pour sa part qu’il n’y a qu’une seule vérité selon Cremonini, celle de la philosophie.
Le grand historien Paul Oskar Kristeller relevait à juste titre la différence d’approche entre Renan et Mabilleau, en faisant remar-quer que ce dernier ne s’intéressait pas seulement à l’arrière-fond théologique des débats de la Renaissance italienne autour de la libre-pensée et de l’athéisme, mais élargissait considérablement les perspectives de l’époque en poussant son enquête jusque dans les textes les plus rébarbatifs, traitant de physique et de philosophie naturelle, pour tenter de comprendre les présupposés des positions radicales de Cremonini60.
En effet, rappelant la prière de Victor Cousin, qui souhaitait voir quelqu’un travailler enfin sur le prétendu panthéisme de l’École de
59 Voir la récente étude de L. Bianchi, Pour une histoire de la « double vérité », Paris, 2008, en particulier p. 141-143.
60 Cf. P. O. Kristeller, The myth of Renaissance atheism and the French tradition of free thought, dans Journal of the history of philosophy, 6-3, 1968, p. 233-243 (en particulier p. 236).
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 191
Padoue, Mabilleau tente de montrer à quel point il était nécessaire d’interpréter cette doctrine d’une manière très différente de celle qui était en vogue depuis Renan. À vrai dire, Mabilleau pense même que le terme de « panthéisme » est « inexact »61. Dans son style habi-tuel, Mabilleau synthétise ainsi son interprétation de Cremonini :
Plus on pénètre avant dans l’intelligence de sa pensée, plus aussi l’on voit croître le rôle qu’il accorde à la matière, plus aussi l’on voit s’atténuer, se subtiliser, s’idéaliser la part qui est réservée à la fin dans la génération. En somme, la fin n’agit jamais que par sa représentation, par son idée ; la réalité véritable, c’est la matière qui fait effort pour la réaliser. L’histoire du monde n’est pas la fable des voyages divins en dehors de l’empyrée, mais l’épopée de la nature luttant pour sortir d’elle-même et se rapprocher de Dieu62.
Contrairement au diagnostic de Renan, le philosophe italien ne serait pas le dernier des averroïstes, mais pencherait plutôt vers une forme de matérialisme, où tout prend son origine dans la matière et tend à s’idéaliser dans les esprits singuliers des hommes qui, par réflexion, peuvent prendre conscience de l’existence d’un Dieu à l’origine de l’organisation de la matière. Ce matérialisme ne fait donc pas de Cremonini un véritable panthéiste, ni même un véritable athée, puisque la matière est laissée au monde, extérieure à Dieu, dont l’esprit qui meut la matière entend se rapprocher. Dans son mémoire sur l’École de Padoue, Mabilleau tentait déjà de montrer qu’au XIVe siècle la philosophie naturelle et la physique dominaient la scène philosophique padouane et non l’averroïsme, comme le pensait Renan. Au XVe siècle, ce sont la logique et la métaphysique qui deviennent prépondérantes ; au XVIe siècle, l’averroïsme est bien au cœur des débats, mais Mabilleau consi-dère que ce sont les tendances matérialistes qui prennent le pas sur celles des sectateurs du philosophe de Cordoue.
Les analyses de Mabilleau, tant sur le milieu padouan en général que sur Cremonini en particulier, étaient donc très origi-nales pour l’époque. La conclusion de son parcours dans l’œuvre de Cremonini est très claire : « Au fond, le doute est impossible : il a cru tout simplement à la mortalité de l’âme. C’était une conséquence de son système »63. Ni véritable panthéisme, ni athéisme assumé, Cremonini proposerait une philosophie éclectique et rebelle qui devait griser notre archicube, comme le montrent certaines de ses
61 L. Mabilleau, Étude historique..., cit., p. 270.62 Ibid.63 Ibid., p. 323.
AURÉLIEN ROBERT192
envolées. Si l’on peut considérer que Mabilleau était trop engagé dans son objet d’étude, ce n’est pas peut-être pas tant du point de vue de son orientation philosophique, que des implications possibles d’une telle philosophie dans la réalité sociale et politique. C’est en tout cas la conclusion que l’on pourrait tirer rétrospecti-vement, à la lecture de ses travaux ultérieurs, tant en philosophie qu’en littérature ou en économie sociale.
Une fois le doctorat obtenu, Mabilleau entama une carrière universitaire qui l’amena à travailler sur des sujets de plus en plus éloignés du Moyen Âge et de la Renaissance italienne. Ses inté-rêts se transformèrent progressivement, passant de la philosophie naturelle à la philosophie politique, avec un détour par la morale et l’esthétique. L’unité de ce parcours peut cependant être résumée en un seul mot : le solidarisme.
Mabilleau professeur de philosophie
À la fin de l’année 1877, Mabilleau fait part au directeur de son souhait de rentrer en France et, si possible, avec un poste à Paris, puisque certains de ses aînés, bien placés dans l’institution, comme Bersot, Janet, Ravaisson ou Lachelier, l’auraient encouragé dans cette voie64. Si cette démarche ne devait pas aboutir, Mabilleau demanderait au directeur de bien vouloir le garder une année supplémentaire à Rome65. Finalement, Bersot ne le soutient plus
64 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 12925, fol. 3723-3726, Léopold Mabilleau à Auguste Geffroy, Padoue, 26 décembre 1877 : « Mais je dois avant tout vous faire part du désir – du vœu, si le mot désir vous paraît trop ambitieux – qui me trotte en tête : ce serait de rester à Paris, à la rentrée prochaine, soit comme suppléant, soit comme professeur adjoint quelque part. J’attacherai un grand prix à l’obtention d’une place à Paris et je vous en expliquerai en long les raisons quand j’aurai le plaisir de vous voir au mois d’avril. M. Dumesnil, à qui j’avais parlé de cela en l’air, il y a dix ou huit mois, pensait que la chose ne serait pas du tout impossible, si, une place se trouvant vacante, j’étais appuyé par votre bon témoignage, Monsieur le Directeur, et si mon mémoire réussissait. M. Bersot m’avait parlé dans le même sens, et ceux qui ont été mes maîtres, M. Janet, Ravaisson, Franck, Lachelier m’y encourageaient. Je voulais vous parler de cela à un passage à Paris, mais j’ai eu la mauvaise chance de ne pas vous rencontrer, et j’attendais toujours une occasion pour vous demander conseil et appui, au cas où vous croiriez ce désir raisonnable et réalisable. Je le fais aujourd’hui et serais heureux, Monsieur le Directeur, si vous vouliez bien me donner votre avis. »
65 Ibid. : « Nos prédécesseurs ont été nommés dans les Facultés, comme le sont tous les membres de l’École d’Athènes : à qui devons-nous viser, nous ? L’exemple de Chatelain me tente beaucoup, et je ne sais pas s’il ne vaudrait pas mieux demander une place, même momentanément, inférieure à Paris, qu’une suppléance dans une faculté de province. Pour être complet dans cette confession, j’ajouterai, Monsieur
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 193
dans sa demande de retour à Paris et lui offre un poste au lycée d’Alger66. Mabilleau s’insurge contre cette éventualité, arguant des postes que d’autres ont réussi à obtenir sans les succès qui sont les siens. Il fait donc une demande de conférence dans une Faculté67 et supplie Geffroy d’intervenir personnellement68. Si cette nouvelle demande n’aboutit pas, Mabilleau affirme qu’il préfère se mettre en congé69.
Finalement, à son retour en France, Mabilleau enseignera la philosophie à la Faculté des lettres de Toulouse de 1878 à 188770, puis à l’École normale d’Auteuil et au Musée pédagogique71 de 1887 à 1890, et obtint enfin un poste de professeur titulaire à la Faculté des lettres de Caen où il enseignera la philosophie de 1890 à 189772. En 1897-1898, il enseignera quelque temps à la Faculté de droit de Paris, où il donnera des conférences sur le mouvement coopé-ratif73. Du 1er décembre 1898 au 30 novembre 1899, il remplacera
le Directeur, que si je ne pouvais pas obtenir un poste à Paris, je vous prierais encore de vouloir bien m’accepter comme élève pour l’année qui s’ensuivrait. Je l’emploierai alors à faire ma thèse, ou à achever l’étude commencée. » Plus loin, il insiste encore sur ce point : « Si cette demande n’aboutissait pas, j’espère qu’on voudrait bien me reprendre pour un an à l’École de Rome, et j’emploierai alors cette année peut-être plutôt à l’étude du platonisme florentin, qu’à une monogra-phie de Cardan ».
66 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 12925, fol. 3742-3743, Léopold Mabilleau à Auguste Geffroy,s.l.n.d., postée à Niort.
67 Ibid., fol. 3744-3745, Léopold Mabilleau à Auguste Geffroy, s.l.n.d.68 Ibid., fol. 3750-3753, Léopold Mabilleau à Auguste Geffroy, s.l.n.d., postée
à Niort : « Demain samedi vous serez à Paris pour l’Institut ; oserais-je vous prier de voir M. Du Mesnil et de lui demander formellement s’il compte me donner la conférence de Faculté que je lui ai demandée. La chose presse, car M. Bersot m’a prévenu que si je laissais passer l’époque du placement dans les lycées, je courrais le risque de perdre les bonnes chances que j’aurais sur ce terrain, sans être sûr pour cela d’en réserver de bonnes pour la conférence. » Il rappelle dans cette lettre qu’il est soutenu par Félix Ravaisson et Jules Simon.
69 Ibid. : « demande donc ou une conférence de Faculté ou une suppléance à Paris; ou un lycée de première ou de seconde catégorie; autrement je préfère un congé et le repos ».
70 Nous avons pu consulter le programme des enseignements de l’université de Toulouse de l’année 1886-1887 (Arch. nat., F17 13138), Léopold Mabilleau y apparaît comme conférencier pour l’agrégation et son cours s’intitule simplement « philosophie ».
71 Le Musée pédagogique est fondé par Jules Ferry en 1879 dans le but de promouvoir l’instruction populaire.
72 Les programmes imprimés des cours de la Faculté des lettres de l’université de Caen sont conservés aux Arch. nat., carton F17 13138.
73 Arrêté du 13 octobre 1897 (Arch. nat. AJ16 1245) : « M. Mabilleau est chargé, à la Faculté de droit de l’université de Paris, d’une conférence sur le mouvement
AURÉLIEN ROBERT194
Charles Lévêque au Collège de France à la chaire de philosophie gréco-latine74.
À partir de 1900, il cesse d’enseigner la philosophie75 et se consacre essentiellement à l’économie sociale et solidaire au Conservatoire national des arts et métiers où il occupera la chaire de prévoyance et de mutualité jusqu’en 192676. Il s’agit d’une chaire financée par la chambre du commerce de Paris, sur laquelle Mabilleau est nommé par Millerand sur avis du ministre Émile Loubet et sur proposition de Léon Bourgeois, alors président du Conservatoire77. Il donne alors deux cours hebdomadaires très
coopératif dans les pays latins. » Notons que dans l’Annuaire de l’université de Caen 1897-1898, Caen, 1898, p. 84, Mabilleau apparaît comme professeur titulaire, correspondant de l’Institut, en congé. Il est remplacé par le célèbre philosophe et mathématicien Louis Couturat.
74 Une lettre de Mabilleau datée du 20 novembre 1898 et envoyée à Gaston Paris, alors administrateur du Collège de France, témoigne de cette courte période. Des proches de Mabilleau ont dû dire haut et fort que ce dernier entrait comme suppléant au Collège de France et on a rapidement rappelé à notre philosophe qu’il n’était que remplaçant. Cf. Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 24447, fol. 234-235 : « Monsieur Charles Lévêque a dû vous écrire que j’ai été profondément ému des reproches qui me sont venus par son entremise. J’espère que les explications qu’il vous a transmises de ma part ont un peu modifié le jugement dont vous l’aviez chargé de me faire part. Je ne suis pas l’auteur du bruit qui s’est fait autour de la très récente désignation dont j’ai été l’objet – et surtout je n’ai nullement songé à m’arroger un titre qui ne m’appartient point. Un excès de zèle de la part de mes jeunes auxiliaires a été le point de départ et le service de presse organisé autour du Musée social par Monsieur de Chambrun a fait tout le reste. Je ne suis intervenu qu’une fois et précisément pour limiter le dommage déjà fait, en rétablissant la vérité. Je l’aurais fait plus tôt et plus expressément si je m’étais rendu compte de l’importance qu’avait, en la circonstance, la substitution du titre de “suppléant” à celui de “remplaçant”. Je croyais que le “remplaçant” était un “demi-suppléant”, un suppléant de six mois. (...) Mon excellent maître, Monsieur Lévêque, m’a appris la valeur des termes et de leur différence. Je ne l’oublierai pas et je n’aurai d’ailleurs qu’un désir, pendant les quatre mois qui vont suivre, celui de remplir modestement et silencieusement la tâche qu’on a bien voulu m’offrir. Le choix des sujets que j’ai indiqués vous montre, Monsieur l’administrateur, que je m’efforcerai de faire œuvre scientifique et utile. L’histoire de la philosophie grecque n’est pas achevée, n’est pas entrée, en bien des points, dans la “phase pédagogique” : sur les deux points que j’ai choisis, il y a, depuis vingt ans, des acquisitions nouvelles à formuler et à coordonner. Je m’y emploierai sans aucun souci de publicité. »
75 Par décret du 4 juillet 1901, Mabilleau est remplacé à son poste de Caen et est nommé professeur honoraire à la Faculté des lettres de Caen. Cf. Rapport présenté à M. le ministre de l’Instruction publique par le conseil de l’université de Caen. Année scolaire 1900-1901, Caen, 1901, p. 13.
76 M. Dreyfus, Léopold Mabilleau. Professeur d’assurances..., cit., p. 160-168.77 Dans une lettre du 24 octobre 1911 à Maurice Couyba, ministre du Commerce
(Archives du Conservatoire national des arts et métiers, dossier personnel de L. Mabilleau), Mabilleau s’inquiète de la possible disparition de sa chaire et, le cas
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 195
techniques sur l’histoire des sociétés de secours mutuel et de crédits ou sur les différents modèles d’assistance, de prévoyance et d’assu-rance dans le domaine de la santé ou du travail78.
Quant à ses recherches en philosophie, elles s’orientent pendant un temps vers le Moyen Âge, qui occupait déjà une place très importante dans ses recherches sur Padoue. En 1893, Mabilleau demande à partir en mission en Espagne pour, dit-il, y étudier des manuscrits byzantins79. Dans une lettre du 1er février 1893 adressée au ministre de l’Instruction publique, Mabilleau explique qu’il veut s’adonner entièrement à l’étude de la culture byzantine et de son influence sur la pensée européenne. Il explique notamment que l’importance de la pensée de Byzance au Moyen Âge lui est apparue lorsqu’il faisait ses recherches en Italie sur Pietro d’Abano, qui aurait lui-même enseigné à Constantinople. Mabilleau veut donc écrire « une histoire de la culture byzantine »80. Il revint finalement
échéant, de sa réintégration comme professeur de philosophie. Il rappelle alors comment lui a été proposé ce poste en 1900 par Léon Bourgeois et pourquoi il a décidé d’abandonner la Faculté de Caen et le Collège de France avec l’assurance de la pérennité du poste.
78 Dans le dossier personnel de Léopold Mabilleau, ainsi que dans les dossiers de cours, tous conservés dans les archives du Conservatoire à Paris, on trouve la liste des cours (Cf. Archives du Conservatoire national des arts et métiers, 1CC/20 pour les années 1900-1909 ; 1CC/21 pour les années 1909-1924 ; 1CC/22 pour les années suivantes). En 1900-1901, Mabilleau enseigne « les retraites ouvrières ». En 1901-1902, Mabilleau divise son cours sur l’assurance sociale en trois sections : l’assurance contre la maladie (avec une comparaison entre les modèles français, anglais, allemands et autrichiens) ; l’assurance contre les accidents du travail ; l’as-surance contre le chômage (pour le détail, cf. Annales du Conservatoire national des arts et métiers, 3e série, t. 3, 1901, p. 279). En 1902-1903, il consacra son cours à l’épargne (ibid., 3e série, t. 4, 1902, p. 221). Dans une lettre adressée au direc-teur du Conservatoire datée du 2 mai 1902 (conservée dans le dossier personnel de Mabilleau dans les archives du CNAM), Mabilleau explique qu’il entend faire fonctionner son cours selon un cycle de trois ans, en s’appliquant chaque année à l’un des trois thèmes principaux : l’assistance sociale, la prévoyance sociale et l’as-surance sociale. Durant les dernières années, Mabilleau changea de perspective et proposa des cours beaucoup plus généraux sur « la démocratie et le travail » ou sur « le problème des grandes villes », dans lesquels il va jusqu’à aborder la question de la solidarité mondiale.
79 Un arrêté du 3 mars 1893 (Arch. nat., F17 2986A) signé de la main de Charles Dupuy, Ministre de l’Instruction Publique, déclare que « M. Mabilleau, professeur à la Faculté des lettres de Caen est chargé d’une mission en Espagne à l’effet d’y étudier les manuscrits grecs d’origine byzantine conservés dans les grandes biblio-thèques de ce pays et d’y poursuivre des recherches relatives à la culture byzan-tine ».
80 Une lettre du 1er février 1893 adressée au ministre (ibid.) explique encore un peu plus les motifs de cette recherche. « Je me suis engagé, depuis l’an dernier, dans
AURÉLIEN ROBERT196
de cette mission avec un inventaire du fonds de peinture fran-çaise du Musée du Prado...81 L’année suivante, il demande à partir à Constantinople et en Asie Mineure pour les mêmes raisons82. Ce projet d’écrire une somme sur la culture byzantine « en dix volumes » ne verra jamais le jour, pas plus que la monographie sur Pietro d’Abano qu’il avait annoncé comme déjà rédigée lorsqu’il s’adressait au ministre pour justifier ces missions.
L’intérêt pour le Moyen Âge et la Renaissance ne sera dès lors plus au cœur de ses préoccupations et de son enseignement. Mabilleau se concentre plutôt sur ce qui lui servit ensuite de fonde-ment pour penser, aux côtés de son grand ami Léon Bourgeois, le système philosophique et politique de la solidarité. Dès 1881, quand paraît sa thèse sur l’idée de perfection sur Leibniz83 que Mabilleau dédicace – cela mérite d’être noté – à Alfred Fouillée, un de ses maîtres en philosophie quand il était rue d’Ulm84 et surtout l’un des grands penseurs du mouvement solidariste, on sent déjà que sa philosophie sera désormais au service d’idéaux sociaux. L’idée défendue dans cette thèse latine n’a rien de très original : il s’agit de présenter l’idée de perfection naturelle du monde dans le système leibnizien de la sympathie universelle entre les monades, entités individuelles au principe de la métaphysique de Leibniz. Mais ce qui intéresse Mabilleau, c’est la situation métaphysique inédite que décrit Leibniz à l’époque : le monde est composé exclusivement
la voie des recherches byzantines. J’y étais préparé et amené par un séjour de deux années à Venise, par un long mémoire (de 1 200 pages) sur l’école de Padoue, que l’Académie a couronné, par ma thèse de doctorat, qui a suivi, par une monographie sur Pierre d’Abano, qui, à la fin du XIIIe siècle, <est> professeur de philosophie à Constantinople, à Paris et à Padoue. Mon intention est de me donner tout entier maintenant à la grosse tâche d’écrire (en dix ans et en dix volumes) une ’histoire de la culture byzantine’. J’ai passé un an à étudier ce qu’ont fait les autres, et je suis prêt à continuer, pour mon compte, un travail à peine ébauché en Allemagne et en France ». Une autre lettre, adressée le 21 février de la même année au ministre (ibid.), précise qu’il entend communiquer les premiers résultats de ces recherches au Congrès des sociétés savantes de 1893, sous le titre « Rapport de l’Université de Paris avec les écoles byzantines au Moyen Âge ».
81 L. Mabilleau, La peinture française au Musée de Madrid, dans Gazette des Beaux-Arts, avril 1895, p. 299-313, et mai 1895, p. 411-429. On trouvera des éléments relatifs à cette mission en Espagne dans le carton F17 2986A des Archives nationales.
82 Par arrêté du 17 novembre 1894, la mission en Asie Mineure est acceptée, mais sans allocation (Arch. nat., F17 2986A).
83 L. Mabilleau, De perfectione apud Leibnitium, Paris, 1881.84 Voir la notice de P. Janet, Notice sur la vie et les œuvres de M. Alfred Fouillée,
Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 185, 1916, p. 225-253.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 197
d’individus, irréductibles à autre chose qu’eux-mêmes, si ce n’est à Dieu. La monadologie leibnizienne servit de principe au libéra-lisme social de Mabilleau, mais reste très en deçà des fondements métaphysiques qu’il cherche pour fonder la solidarité naturelle.
Dans un texte plus tardif, présenté lors du Congrès d’éducation sociale de l’exposition universelle de 1900 à Paris, Mabilleau fera explicitement de la pensée leibnizienne un moment dans l’histoire du concept de solidarité sociale en philosophie, mais qu’il faut, selon lui, absolument dépasser85. En effet, après avoir critiqué la morale chrétienne, dont le principe de charité n’est pas encore, selon lui, une solidarité véritable, Mabilleau écrit : « Ne parlons donc pas de solidarité, au sens social de ce mot, qui implique une dépendance réciproque de personnes, inconciliable avec les prin-cipes du christianisme. Là toutes les âmes sont rattachées à Dieu, mais sans se toucher, ni se pénétrer, comme les rayons émanés d’un foyer. Le seul système qui convienne à l’illustration de cette morale est la monadologie de Leibniz où chaque être ne connaît que soi et Dieu, n’agit que sur soi et sur Dieu, et ne tient compte de l’univers que dans la mesure de l’image que Dieu a place en lui »86. Il faut donc dépasser la morale chrétienne et son fondement métaphy-sique tel qu’il est mis en place chez Leibniz, pour retrouver ce qui amène les individus à s’associer entre eux, comme si chacun éprou-vait une dette envers tous. C’est donc dans la philosophie politique que pourra être compris le concept de solidarité.
Quant à l’idée de perfection, Mabilleau n’hésite pas à la déplacer dans le domaine de la philosophie pratique. En 1890, Léopold Mabilleau reçoit le Prix Stassart de l’Académie des sciences morales et politiques, pour une étude sur « Le rôle du sentiment ou de l’ins-tinct moral dans les théories contemporaines ». Son mémoire, intitulé L’idée de perfection devant la morale, arrive ex aequo avec celui d’Adolphe Hatzfeld, professeur au lycée Louis-le-Grand87. Quelques années plus tard, en 1896, il reçoit le prix Saintour, de la même Académie, pour son mémoire sur L’idée de perfection, pour lequel Mabilleau semble avoir repris des éléments déjà développés ailleurs, notamment dans sa thèse latine. Jules Lachelier, rappor-teur pour son mémoire, juge d’ailleurs qu’aucun des trois mémoires
85 L. Mabilleau, L’idée de solidarité sociale dans la philosophie, dans Exposition universelle de 1900. Congrès de l’éducation sociale, 26-30 septembre 1900, Paris, 1901, p. 62-78.
86 Ibid., p. 68.87 Cf. Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 134,
1890, p. 494.
AURÉLIEN ROBERT198
remis n’est véritablement à la hauteur du sujet, mais l’attribue tout de même au mémoire n° 3 qui est celui de Mabilleau88.
Ce déplacement dans les recherches de Mabilleau, des théories complexes de la scolastique vers des problèmes plus pratiques de philosophie morale, esthétique ou politique, apparaît clairement dans l’intitulé de ses cours. On ne sait rien de précis sur son ensei-gnement à Toulouse, mais en revanche on connaît en détail son enseignement à Caen à partir de 1890. En effet, outre ses confé-rences d’agrégation et ses cours de licence, Mabilleau donne chaque année un cours public. En 1890-1891, ce cours public s’intitule « Le problème moral de notre temps », l’année suivante « Le conflit de la science et de la morale » et enfin, en 1892-1893, Mabilleau donne le cours « Esquisse d’une morale fondée sur la science »89. Ces cours font écho aux manuels de morale et d’instruction civique qu’il rédigea pour les collaborateurs de Jules Ferry à partir de 188590.
À partir de 1893, son intérêt philosophique se porte vers l’esthé-tique. En 1893-1894, Mabilleau donne un cours intitulé « Théorie de l’imagination. Essai de psychologie sur quelques poètes du XIXe siècle », puis, en 1894-1895, il présente un cours très général sur les « Principes d’esthétique ». C’est précisément en 1893 que paraît son livre sur Victor Hugo, qui fit date dans les études hugoliennes de cette fin de siècle et c’est aussi à cette époque que Mabilleau fait paraître plusieurs études sur Lamartine.
À partir de 1895, on perçoit un tournant dans la carrière de Mabilleau. Pour l’année 1895-1896, le cours de Mabilleau s’intitule « Principes de philosophie sociale », et entend étudier « les fonde-ments de la société humaine ; d’abord, en ce qu’elle a de commun avec les diverses organisations vivantes, ensuite, en ce qu’elle a de particulier à notre espèce, où la raison et la liberté introduisent un élément nouveau qui transforme l’idée de loi naturelle en l’idée de droit »91. L’année suivante, il précise son titre en « Principes de philosophie sociale : l’État et l’individu »92. On reconnaît là un des
88 Cf. le rapport de Jules Lachelier, dans Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, nouvelle série t. 46 (=146), 1898, p. 742-747 (et p. 765 pour la proclamation du nom du vainqueur du prix Saintour).
89 Le détail de ces cours est donné dans l’Annuaire de l’université de Caen, dont les exemplaires sont conservés aux Archives nationales, F17 13145.
90 Nous y reviendrons un peu plus loin.91 Annuaire des établissements d’enseignement supérieur 1895-1896. Université
de France Académie de Caen, Caen, 1895, p. 71. Nous avons consulté l’exemplaire conservé aux Archives nationales, F17 13145.
92 Programme de l’année 1896-1897 (Arch. nat., F17 13138) et Annuaire de l’uni-versité de Caen1896-1897, Caen, 1896, p. 51 : « Le professeur étudiera les origines
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 199
thèmes favoris de Mabilleau : garantir métaphysiquement l’indivi-dualisme et la liberté, sans abandonner l’idée d’un ordre moral et social, fondé à la fois sur des principes naturels et sur l’association volontaire des individus. Ce tournant coïncide précisément avec son engagement croissant dans le mouvement mutualiste et surtout avec son abandon progressif du milieu universitaire. À partir de 1897, Mabilleau cherche en effet à échapper à ses charges d’ensei-gnement à l’université de Caen et entend aménager son temps pour se consacrer plus pleinement au Musée social dont il est désormais le directeur. En 1900, il abandonne définitivement l’enseignement de la philosophie à Caen.
Avant de détailler plus avant son parcours politique, il faut s’arrêter sur les quelques moments que nous venons de distin-guer dans son parcours universitaire pour comprendre comment Mabilleau parvient à articuler ses recherches à la pensée solida-riste. Nous avons vu comment les recherches sur Cremonini indi-quaient déjà le penchant de Mabilleau pour une pensée rationaliste et critique, qui n’avait pas peur d’assumer certains principes de la raison contre l’autorité de l’Église. L’exemple du système leibni-zien pouvait aussi entrer dans ce parcours intellectuel consistant à penser l’individu comme fondement rationnel unique du social ; mais un autre pan de l’histoire des conceptions de la solidarité mérite que l’on s’y arrête quelque peu : l’histoire des conceptions atomistes. En effet, non seulement Mabilleau a écrit la première monographie en français sur Cremonini, mais il est aussi l’auteur de la première histoire des théories atomistes, de la philosophie hindoue à celle du XIXe siècle.
L’histoire de l’atomisme
Dans le texte que nous avons déjà mentionné plus haut, « L’idée de solidarité dans la philosophie », lu en 1900 lors de l’exposition universelle de Paris, Mabilleau commençait son étude historique par le système stoïcien, pour rapidement passer à l’épicurisme. Si les stoïciens donnaient déjà de bonnes raisons pour penser la solidarité comme fondement de tout lien social, en pensant l’unité de l’homme et de la rationalité, l’égalité des individus et la néces-sité d’une doctrine du droit individuel – qui, selon Mabilleau, anti-
psychologiques, historiques, économiques de l’État, considéré dans ses rapports avec l’individu et avec le but commun de l’organisation sociale. » Il est précisé ensuite la progression du cours, qui commence avec les auteurs antiques pour parvenir jusqu’à Emmanuel Kant.
AURÉLIEN ROBERT200
cipe celle de la Révolution française – l’épicurisme va plus loin en fondant l’individualisme dans une physique et une métaphysique de l’atome. Mabilleau reproche cependant à Épicure son côté anar-chiste, ainsi que l’absence, dans ce système, d’une véritable pensée de l’égalité des hommes et de la dignité humaine ; Mabilleau lui reprend cependant l’idée d’un fondement scientifique à l’individua-lisme qui impose de concevoir le monde social grâce au concept de solidarité93 plutôt que grâce aux concepts issus des lectures que Marx a faites de l’atomisme grec.
Cet intérêt pour les conceptions atomistes dans l’histoire de la philosophie était ancien, puisqu’en 1890, Mabilleau répondait à un concours lancé par l’Académie des sciences morales et politiques, dont le programme est intitulé « Histoire et examen critique de la philosophie atomistique ». La définition précise du programme de recherche souhaité par l’Institut a de quoi surprendre un lecteur contemporain. Articulé en quatre grands axes, le texte demande au candidat de (1) « remonter aux premières origines de la philoso-phie atomistique », (2) « indiquer les changements introduits dans la philosophie atomistique par Épicure, Lucrèce, les scolastiques arabes ou motécalémin et Gassendi » ; (3) « comparer la philoso-phie des atomes à la monadologie de Leibniz » ; (4) « rechercher ce qu’il y a de vrai ou de faux dans la philosophie des atomes tant au point de vue métaphysique qu’au point de vue scientifique »94. Les directions indiquées sont si vastes, les périodes et les person-nages à considérer si éloignés, qu’aucun chercheur aujourd’hui ne s’y essaierait, d’autant que le mémoire est à déposer à l’Ins-titut avant le 31 décembre 1892. Mabilleau, qui est alors profes-seur à Caen, remet pourtant à l’Institut un manuscrit de 900 pages in-folio. Le mémoire semble répondre aux demandes du concours, puisque son rapporteur, Félix Ravaisson, qui fut jadis le maître de Mabilleau, écrit que « toutes les parties de la question, telles que le programme les avait énumérées, y sont traitées avec ampleur (…) »95. Ravaisson ne cache d’ailleurs guère son enthousiasme96 et
93 L. Mabilleau, L’idée de solidarité sociale..., cit., p. 65-67.94 Le programme est publié dans les Séances et travaux de l’Académie des
sciences morales et politiques, 133, 1890, p. 290 (séance du 7 décembre 1889).95 F. Ravaisson, Rapport sur le concours pour le Prix Cousin 1893, dans Séances
et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 1894, p. 545-558, à la p. 545. Un autre mémoire a été rendu à l’Institut, mais Ravaisson n’en fait pas grand cas, consacrant l’essentiel des quatorze pages de son rapport au travail de Mabilleau qu’il propose comme lauréat du prix.
96 Ibid., p. 558 : « Malgré les réserves qu’il y a lieu de faire sur certaines parties du mémoire n° 1, il a paru à la section Philosophie que, par l’étendue des recherches
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 201
Mabilleau emporta aisément le prestigieux prix Victor Cousin de l’année 1893.
Le choix d’un tel sujet de la part de Mabilleau repose sur des raisons historiques et philosophiques évidentes et qui sont dans une certaine mesure comparables à celles qui l’avaient amené à travailler sur Cesare Cremonini dans sa thèse de doctorat. Il s’agissait d’abord d’une carence historiographique importante à la fin du XIXe siècle (qui n’a d’ailleurs pas encore été comblée aujourd’hui). Si l’on dispo-sait à l’époque de quelques travaux sur l’atomisme antique et sur l’atomisme moderne, très peu de choses avaient été écrites sur la période qui précède la philosophie grecque et sur les siècles qui séparent Lucrèce des premiers chimistes, même si, à peu près à la même époque, l’allemand Kurd Lasswitz publia lui aussi une longue étude sur l’histoire de l’atomisme du Moyen Âge à Newton, mais qui tient plus du catalogue d’opinions que de l’histoire raisonnée97.
Fait rare, Mabilleau consacre un chapitre entier à la philoso-phie indienne, encore assez mal connue aujourd’hui, et un autre à la philosophie médiévale arabe, ce qui, pour l’époque, constituait une avancée considérable dans la recherche sur la philosophie atomiste. Si l’information scientifique est abondante, elle est la plupart du temps de seconde main. Le but de l’ouvrage, qui répond d’abord à une demande expresse de l’Institut, est de fournir un état des lieux des connaissances tout en montrant les raisons philoso-phiques profondes de l’idée récurrente d’atome dans l’histoire de la philosophie. Cependant, d’un point de vue plus général, il semble que l’intention qui préside à cette œuvre n’est pas totalement étran-gère – une fois de plus – à ses idées politiques et sociales. On se souvient qu’à l’époque deux camps s’opposent déjà chez les intel-lectuels français, entre ceux qui, comme Émile Durkheim, tentent de s’opposer à une vision purement atomiste de la société, et ceux qui, comme Gabriel Tarde, pensent le social sur le modèle de la foule et de l’association d’irréductibles individus. Mabilleau tente bien, lui aussi, de penser un individualisme irréductible, métaphy-sique pourrait-on dire, avec la nécessité du lien social, puisque l’homme isolé n’est rien selon lui. Mais dans son opposition systé-matique au socialisme collectiviste, Mabilleau avait peut-être en tête de récupérer une partie de la tradition atomiste dans le camp
et l’intelligence des questions, comme aussi par les qualités du style généralement correct et clair, et souvent élégant, l’auteur de ce travail avait mérité le prix mis au concours, et elle vous propose de le lui décerner ».
97 K. Lasswitz, Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton, Hambourg, 1890.
AURÉLIEN ROBERT202
des républicains et ne pas la laisser à ceux qui puisaient chez Marx (qui avait défendu sa thèse de doctorat sur l’atomisme antique en 1841) le modèle pour penser le social. Quoi qu’il en soit, le lien entre ses recherches en histoire de la philosophie et son engage-ment progressif dans le solidarisme ne fait aucun doute.
De l’esthétique à la littérature engagée
Durant ses années d’enseignement à Caen, on l’a vu, Léopold Mabilleau s’autorise un détour par les études littéraires, notam-ment dans ses cours sur l’esthétique. Grand admirateur de Lamartine, Mabilleau prépare entre 1888 et 1899 l’édition de plusieurs poèmes, qu’il accompagne à chaque fois de notes et d’une introduction détaillées98. Toutefois, ce sont incontestablement ses travaux sur Victor Hugo qui ont connu le plus grand succès. Après un court article sur « Le sens de la vue chez Victor Hugo » paru dans La Revue des Deux Mondes en 189099, Mabilleau rédigea en 1893 un livre très remarqué simplement intitulé Victor Hugo100, réédité plusieurs fois101, et dont la particularité est d’orienter la lecture de l’œuvre romanesque et poétique de Hugo dans un sens philosophique et politique.
Comme l’a bien montré Marie-Claude Blais, la solidarité, comprise comme concept philosophique et politique, est origi-nellement une idée romantique, que l’on trouve sous la plume de nombreux auteurs du XIXe siècle, dont Lamartine, Sand ou Hugo102. George Sand peut ainsi écrire que « la source la plus vivante et la plus religieuse du progrès de l’esprit humain, c’est, pour parler la langue de mon temps, la notion de solidarité »103. Mais, bien
98 A. de Lamartine, Le chêne, l’immortalité, Paris, 1888 ; Le poète mourant, la mort de Socrate, l’immortalité ; Paris, 1893 ; Le vallon, Milly, Paris, 1896 ; L’isolement, le soir, le désespoir, l’automne, Paris, 1899. Toutes ces éditions sont annotées et introduites par Mabilleau.
99 L. Mabilleau, Le sens de la vue chez Victor Hugo, dans Revue des deux mondes, 101-3, 1890, p. 834-859.
100 L. Mabilleau, Victor Hugo, Paris, 1893.101 Sa nécrologie parue dans le Ouest-Éclair daté du 9 février 1941 prétend
même que ce livre aurait été tiré en deux cent mille exemplaires. Nous citons cette nécrologie à la fin de l’article.
102 M.-C. Blais, La solidarité..., cit., p. 49-73. Il est vrai qu’un texte comme L’État, l’Église et l’enseignement de Lamartine (Mâcon, 1843), contient des éléments d’une réflexion politique qui anticipe à certains égards celles des solidaristes de la fin du siècle.
103 G. Sand, Histoire de ma vie, Paris, 2004, p. 47 (cité par M.-C. Blais, La soli-darité..., cit., p. 52).
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 203
entendu, c’est chez Victor Hugo que les idées de solidarité, de fraternité et d’humanitarisme sont les plus présentes, notamment dans Les misérables mais aussi dans de nombreux autres romans. Plus généralement, Lamartine et Hugo sont associés au républica-nisme et tous deux y sont venus par une sorte de conversion. Dans sa brochure intitulée La politique rationnelle, Lamartine, pourtant fils d’aristocrate, défendit la liberté et l’égalité et prit explicitement le parti de la République. Plus tard, lorsqu’il fut député, il s’op-posa souvent au régime et défendit ardemment l’instruction pour tous comme noyau de la République. Quant à Victor Hugo, on sait comment la révolution de 1848 l’engagea définitivement en poli-tique aux côtés des républicains.
Dans son Victor Hugo, Mabilleau tente de montrer le lien qui unit l’esthétique et la politique104. Toujours sensible à la théorie de la connaissance et au rôle de l’expérience, qu’il avait tant travaillés dans ses premiers travaux sur l’aristotélisme de Padoue, Mabilleau insiste à plusieurs reprises, comme dans son article sur la vue chez Hugo, sur l’importance de la sensation et de la philosophie de la connaissance implicite qui infuse l’œuvre hugolienne. Cette théorie de la connaissance pourrait être qualifiée d’empirisme ou de phénoménologie : dans les images sensibles que le monde offre à notre point de vue apparaîtraient les traces d’un ordre idéal que l’esprit du lecteur devrait reconstruire. On reconnaît ici les raisons qui poussaient déjà Mabilleau à apprécier les aristotéliciens de la Renaissance italienne de Padoue plutôt que les Platoniciens de la cour des Médicis à Florence. L’expérience des réalités singulières doit amener l’homme à construire un système idéal et non l’inverse. On serait aussi tenté d’y voir un essai de réconciliation entre les deux mouvements qui ont façonné le XIXe siècle philosophique : le
104 Dans une lettre du 8 mars 1891, postée à Caen (Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 25044, fol. 1), Mabilleau adresse ses remerciements à Ferdinand Brunetière de l’accueil qu’il a réservé à son livre (sans doute lui a-t-on demandé un avis avant publication). Quelques mois plus tard, dans une seconde lettre, toujours adressée à Ferdinand Brunetière (ibid., fol. 2-3, Castelnaudary, 14 août [sans année]), Mabilleau tente d’expliquer un peu ses intentions : « J’espère que mon petit volume sur Victor Hugo vous aura été remis (...). C’est un de vos articles qui m’a donné l’idée d’écrire le livre, et c’est sous vos auspices et par votre bienveillant appui que le premier fragment a paru dans la revue. Ce serait pour moi un grand bonheur si vous jugiez que l’ouvrage, si imparfait qu’il soit, mérite un examen de votre part. » Ensuite, Mabilleau affirme avoir voulu insister sur la sensibilité et la plasticité chez Hugo et écrit qu’il « n’en a point fait le porte-parole de l’esprit français de 1830 ». En tout cas, l’aspect politique de la pensée d’Hugo est très présent malgré tout dans le livre.
AURÉLIEN ROBERT204
positivisme d’Auguste Comte d’un côté et le spiritualisme de Victor Cousin de l’autre. Certes, on sent surtout ici l’influence du positi-visme des disciples d’Auguste Comte, pour qui il n’y a de science que des phénomènes. Mais, plus encore, un tel souci de la descrip-tion de ce qui se donne à voir fait écho aux principales préoccu-pations des sciences sociales naissantes : il faut décrire la société, comme si elle était un phénomène naturel parmi d’autres. C’était là en effet la devise de l’un des pères de la sociologie descriptive et quantitative, Frédéric Le Play, sous les auspices duquel Mabilleau travailla au Musée social, mais aussi d’Émile Durkheim avec qui Mabilleau a été en contact à plusieurs reprises.
Passé ce prodrome théorique, ce qui intéresse notre philosophe, c’est le Victor Hugo « de l’âge mûr », celui qui a quelque peu aban-donné le romantisme pour se tourner vers ce que nous appellerions aujourd’hui une « littérature engagée », lorsqu’il devient l’écrivain de la République. Mais la thèse de Mabilleau est plus ambitieuse encore, puisqu’il entend montrer que dès 1846 Victor Hugo donnait de nombreux discours montrant « le plus ardent libéralisme ». Il s’agit non pas du libéralisme d’un Adam Smith, mais d’une libé-ration de la pensée, comparable à la libération des hommes après 1789. L’interprétation de Mabilleau va encore plus loin, puisqu’il fonde une large part de son interprétation sur quelques vers tirés de sa fameuse « réponse à un acte d’accusation », contenu dans Les contemplations, écrites en 1834 :
Et je n’ignorais pas que la main courroucée Qui délivre le mot, délivre la pensée … Tous les mots, à présent, planent dans la clarté. Les écrivains ont mis la langue en liberté… La liberté dans l’homme entre par tous les pores Les préjugés formés, comme les madrépores, Du sombre entassement des abus sous les temps, Se dissolvent au choc de tous les mots flottants, Pleins de sa volonté, de son but, de son âme… … Le mouvement complète ainsi son action. Grâce à toi, Progrès saint, la Révolution vibre aujourd’hui dans l’air, dans la voix, dans le livre Dans le mot palpitant, le lecteur se sent vivre…105
Selon Mabilleau, à bien y regarder, on trouve là le signe que « toutes les théories politiques et sociales de V. Hugo sont une conséquence de son système littéraire »106. Il s’agit certes là d’une
105 Cité dans L. Mabilleau, Victor Hugo..., cit., p. 78.106 Ibid.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 205
affirmation à double tranchant, car si elle fait de Victor Hugo un écrivain engagé, Mabilleau ne le considère pas pour autant comme un théoricien de la politique, mais comme un rêveur, dont la pensée n’eut pas les effets concrets sur l’orientation de la politique fran-çaise qu’elle aurait pu avoir étant donné les rôles politiques que Victor Hugo a occupés :
Il vota contre la peine de mort et la déportation pour toutes les lois de clémence et de réparation sociale qui furent proposées ; mais il les vota en rêveur plutôt qu’en homme d’État, sans présenter aucun projet efficace. Il prétendit toujours être, et il était vraiment, de ceux qui veulent supprimer la misère ; mais il ne fut d’aucun secours aux socialistes et aux économistes qui cherchaient le moyen d’en alléger le fardeau, trop lourd aux épaules du peuple.107
Aux yeux de Mabilleau, ce n’est donc qu’à la toute fin de sa vie que l’auteur de Quatre-vingt-treize se montra véritablement engagé, moment d’une ultime révolution chez le poète qui devient enfin plus réaliste politiquement, œuvrant pour le retour de la République. Mais y a-t-il véritablement une philosophie politique chez Hugo ? Mabilleau sous-entend qu’il délaissa les économistes et les socia-listes. Il s’agit sans aucun doute d’une tentative de récupération d’Hugo dans le camp des libéraux modérés ou des radicaux, qui veulent privilégier la liberté individuelle à la contrainte du collec-tivisme des Fourier et Saint-Simon, sans jamais refuser l’impor-tance de la solidarité sociale. En d’autres termes, Hugo nous ferait voir la situation sociale de la France et nous montrerait la voie à suivre pour conserver la liberté individuelle en refusant l’égoïsme des libéraux orthodoxes : la solidarité.
Les cours d’esthétique que donnait Mabilleau à la Faculté des lettres de Caen devaient certainement exposer certains éléments contenus dans ces publications. Plus généralement, Mabilleau utilisa sans cesse la littérature comme un moyen pour l’éduca-tion sociale à laquelle il se consacra plus intensément quand il fut au Musée social. Auteurs encore en vogue en cette fin de siècle, Lamartine et Hugo sont convoqués par Mabilleau en diverses circonstances. En 1903, par exemple, alors qu’il parcourt les États-Unis pour vanter le modèle social qu’il défend, à savoir celui de la mutualité et du secours mutuel en général, un journaliste raconte l’une de ses conférences sur « les idées politiques françaises » données à l’Athénée de la Nouvelle-Orléans. Celui-ci nous dit que Mabilleau aurait cité les poètes, mais aussi des œuvres d’Émile
107 L. Mabilleau, Victor Hugo..., cit., p. 82.
AURÉLIEN ROBERT206
Zola et, plus étonnant, Les déracinés de Maurice Barrès, pour offrir à son public « des réflexions de haute portée sur la dépopulation des campagnes et le fonctionnarisme »108. Il est certes difficile d’imaginer aujourd’hui le maniement de sources littéraires aussi variées – Zola et Barrès ! – dans un but politique unique. Mais cela ne fait que souligner, malgré son goût véritable pour la littérature et pour l’éloquence, sa vision utilitariste de la littérature pour l’édu-cation sociale. Il faut montrer la situation sociale de la France pour redonner au peuple le sentiment naturel et nécessaire de solidarité.
Lors d’une conférence prononcée au Palais des Champs-Élysées le 31 janvier 1905, Mabilleau revient sur l’expérience de l’exposi-tion d’économie sociale organisée lors de l’exposition universelle de 1900. Il défend, une fois de plus, l’idée de solidarité comme le seul fondement véritable pour une économie sociale et plus géné-ralement, pour toutes les activités humaines. Mabilleau ne déve-loppe qu’un seul exemple, celui de la poésie de Sully Prudhomme, dont il écrit qu’il a proclamé « la solidarité universelle parmi les hommes »109.
En 1906, Jules Arboux, secrétaire général de la Ligue nationale de la prévoyance et de la mutualité et ami de Mabilleau, raconte que lorsque ce dernier assura l’intérim de Charles Lévêque au Collège de France à la chaire de philosophie gréco-latine en 1898-1899, il commença son cours en citant quelques vers de Lamartine :
À sa première leçon au Collège de France, parlant de la philosophie grecque, il dit avec un art remarquable les beaux vers de Lamartine sur la mort de Socrate. Dans les théâtres où il expose les questions de mutualité, il a maintenant une voix forte dont il tire de puissants effets. Il improvise trop pour que son élocution ait toute la perfection de ses cours. Mais qu’il est coulant, abondant, facile ! C’est le style qui convient à son genre de talent, net, rapide, sans bavure, avec quelque chose d’enveloppant qui fait qu’on se tient sur ses gardes et qu’on se défend parce qu’on craint dans la rapidité du débit, soit de se laisser trop charmer, soit d’être ébloui par quelque brillant paradoxe.110
Une telle description montre bien ce qui plut aux acteurs de l’économie sociale en la personne de Mabilleau : un érudit, qui puise sa matière dans des ressources variées, notamment dans la littérature du siècle. Mais on comprend aussi le défaut que pouvait représenter ce genre de personnalité : Mabilleau n’a jamais été un
108 Cf. L’abeille de la Nouvelle-Orléans, 6 mai 1903.109 Conférence de M. Léopold Mabilleau, Palais des Champs-Élysées, 31 janvier
1905 (Archives du Musée social-CEDIAS, carton Léopold Mabilleau).110 Cité par J. Bennet, Léopold Mabilleau..., cit., p. 305.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 207
pur politicien, pas plus qu’un universitaire totalement immergé dans son objet, bien qu’il se donnât pour ambition de réconcilier ces deux aspects, comme en témoigne son œuvre. Malgré son inten-tion de mener une double vie en quelque sorte, en alliant enseigne-ment et engagement dans ce qu’on appelait à l’époque « la question sociale », la tension entre ceux deux mondes finit par devenir de plus en plus difficile à soutenir et de là vint sans doute son abandon progressif du monde des idées pour celui de l’action.
Le chemin vers l’engagement politique : l’éducation sociale et la philosophie solidariste
De son parcours politique, on retient surtout son poste de direc-teur du Musée social, qu’il occupa de 1895 à 1921, et plus encore son rôle dans la Fédération nationale de la Mutualité française, qu’il a lui-même créée dès 1902 et qu’il préside jusqu’en 1921. D’ailleurs, d’aucuns se souviennent du Mabilleau mutualiste, comme le romancier Gustave Guiches (1860-1935) qui, dans ses souvenirs littéraires publiés sous le titre Au banquet de la vie, raconte une anecdote à propos d’une rencontre fugace avec le père fondateur de la Mutualité française. Alors qu’il déjeunait avec son ami l’écri-vain Albert Delpit, une silhouette apparaît à la porte : « La porte s’est ouverte. Delpit se lève et, s’écriant ainsi que dans La Juive : « Léopold ! », s’élance dans les bras d’un géant à crinière de lion noir, au regard flamboyant et au verbe solennel. ». Mabilleau dit ne pas pouvoir rester et une fois parti, continue Guiches, son ami Delpit lui dit : « Vous l’avez reconnu ? Non ? Vous ne savez pas qui c’est ? Formidable, mon cher ! Une force ! Une puissance ! Un apôtre ! Avant cinq ans, il aura groupé plus de trois millions d’hommes, de femmes et d’enfants ! Le Pierre l’Ermite de la Mutualité ! Retiens ce nom : Mabilleau ! Léopold Mabilleau ! »111. Devenu un person-
111 G. Guiches, Au banquet de la vie, Paris, 1925, p. 39-40. On retrouve cette association inévitable entre Mabilleau et le mutualisme sous la plume de plusieurs de ses collaborateurs. André Hirschfeld cite le témoignage de Jean Hébrard, secré-taire de la Fédération nationale de la Mutualité française quand Mabilleau en était le président, qui écrivait dans un article de 1913 publié dans l’Almanach de la Mutualité, que « Léopold Mabilleau portait la mutualité avec cette belle humeur qui est le propre des esprits courageux et s’il est vrai de dire que dans les institutions les hommes sont tout, on peut affirmer que Léopold Mabilleau a été tout dans la mutualité. » (cité dans A. Hirschfeld, Léopold Mabilleau..., cit., p. 94.). Hirschfeld a lui aussi connu personnellement Mabilleau, et, comme la plupart de ceux qui l’ont fréquenté, il en garde un souvenir ému. Aussi écrit-il : « Pour ma part, je préfère me souvenir seulement de l’homme à la voix chaude qui, pendant des années, par
AURÉLIEN ROBERT208
nage connu sur la scène publique, Mabilleau incarnait désormais le mutualisme français. Mais y a-t-il un quelconque rapport entre l’universitaire et l’homme engagé ?
Selon Jules Arboux, grâce à ses multiples compétences, tant philosophiques que politiques, Mabilleau ne pouvait manquer de réussir à fédérer les mutualistes112. Paul Strauss, sénateur de la Seine de 1897 à 1936 et président du groupe radical au Sénat avant de devenir ministre de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociales de 1922 à 1924, écrivait dans le journal Les prévoyants de l’avenir en décembre 1912 :
Léopold Mabilleau pourrait, par auto-psychologie, marquer avec exac-titude le point de départ précis de sa vocation mutualiste. Il suffit toutefois de le voir physiquement et de le connaître intellectuellement pour se rendre compte que, doué comme il l’est pour l’action extérieure, pour la propa-gande, voire même pour la bataille, il pouvait difficilement se maintenir dans les régions abstraites de l’idée et de l’art, qu’il lui fallait à tout prix se dépenser au dehors face à face avec la foule, tête à tête avec le peuple.113
Selon Paul Strauss, Mabilleau était fait pour l’économie sociale et solidaire, pour en défendre les principes devant la société civile et dans les milieux professionnels, et non pour les travaux univer-sitaires. Le sénateur vante d’ailleurs ce qu’il croit être un choix délibéré de Mabilleau de n’entrer dans aucun cabinet de gouverne-ment, pas plus qu’au Parlement où il connaissait pourtant certaines personnalités parmi les plus influentes des dernières décennies du XIXe siècle :
la parole et par la plume, a été l’un des meilleurs artisans de l’évolution de nos modestes sociétés de secours mutuel vers un puissant mouvement mutualiste. » (ibid., p. 96).
112 J. Arboux, Les orateurs mutualistes, Paris, 1914, p. 19-20 : « Normalien, professeur, ancien membre d’une municipalité, ayant les pouvoirs du directeur dans un centre important d’études sociales, auteur déjà connu d’ouvrages divers, écrivain très particulièrement informé de la coopération, favorisé de précieuses relations dans les milieux politiques, littéraires, scientifiques, philosophiques, artistiques, entouré d’auxiliaires immédiats qui sont eux-mêmes des hommes distingués et déchargé par eux de ces occupations secondaires où s’épuisent sans gloire les forces des meilleurs, prêt à la lutte aussitôt qu’elle paraît s’imposer, mais commençant toujours les relations par des paroles bienveillantes où l’on sent la sympathie, ingénieux, plein de ressources, connu déjà de nombreuses sociétés que le comte de Chambrun hébergeait et secourait, M. Léopold Mabilleau ne pouvait manquer de réussir et de briller, s’il le voulait, dans ce milieu d’artisans honnêtes qu’est en somme la Mutualité. Il le voulut ».
113 Cité dans J. Bennet, Léopold Mabilleau..., cit., p. 294.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 209
Un homme de cet âge, de cette valeur, naturellement destiné à la poli-tique, s’est jusqu’à ce jour refusé à entrer au Parlement ; il a voulu et veut obstinément, sans relâche, sur un champ d’action qui s’agrandit chaque jour, avec une autorité croissante, être et rester suivant le mot de Millerand « un des personnages les plus représentatifs de la Mutualité française » et par surcroît, le pionnier infatigable et bon, l’avocat chaleureux et persuasif de la solidarité républicaine.114
Pourtant, comme l’indique le rapport du préfet de police demandé à l’occasion de sa candidature au titre de commandeur de la Légion d’honneur en 1912, Mabilleau a bien été candidat – sans succès – aux élections législatives de 1885115. La raison d’un tel éloignement apparent du pouvoir tient plutôt à ses fonctions au Musée social à partir de 1897 puisque, comme le remarque Janet Horne, « le personnel administratif se voyait formellement conseiller de n’accepter aucun rôle politique pouvant compromettre la neutralité de l’institution que le musée souhaitait préserver » ; et, ajoute-t-elle, « quand le nom de Mabilleau fut rendu public en 1898 comme membre du comité d’organisation du Grand Cercle républicain, il demanda immédiatement à ce qu’il en fût retiré » et « lors d’une autre occasion, en 1901, lorsque le nom de Mabilleau circula comme celui d’un candidat possible au siège de député de la circonscription de Castelnaudary, le Comité exécutif l’informa que toute participation active à la vie politique serait considérée comme incompatible avec la direction du musée »116. Une lettre du 9 décembre 1901 du directeur du Conservatoire national des arts et métiers au ministre du Commerce atteste de l’intérêt que Mabilleau portait à l’éventualité de ce poste de député, puisqu’il demande au ministre s’il est possible de cumuler le salaire de professeur au Conservatoire avec celui de député117.
Contrairement au jugement de Paul Strauss donc, il ne faut pas trouver si forte la rupture entre l’universitaire et l’homme public, malgré l’obligation qu’il a eue de se tenir à l’écart des responsa-bilités politiques pour un parti donné. Lors du banquet offert à Mabilleau le vendredi 20 décembre 1901 au Palais d’Orsay sous les auspices de Paul Deschanel et de Léon Bourgeois, un certain nombre de politiciens et de mutualistes portent des toasts en son honneur. Émile Cheysson, l’un des fondateurs du Musée social, se
114 Cité ibid., p. 304-305115 Arch. nat., F12 6657.116 J. Horne, Le Musée social. À l’origine de l’État providence, Paris, 2004, p. 172.117 Archives du Conservatoire national des arts et métiers, 5AA/24, correspon-
dance officielle, minutes.
AURÉLIEN ROBERT210
félicite que Mabilleau ait quitté le monde universitaire pour s’en-gager pleinement dans l’économie sociale118. Dans son discours, Léon Bourgeois revient sur ce jugement pour montrer combien les années passées à l’Université s’inscrivent au contraire dans ce parcours politique :
M. Cheysson a tout à l’heure félicité M. Mabilleau, en termes excel-lents, de son dévouement à l’idée mutualiste. Mais il semble avoir surtout fait dater ce dévouement de l’époque où Mabilleau, renonçant à l’enseigne-ment de la philosophie, a pris possession d’une chaire au Conservatoire des arts et métiers. Or les titres de Mabilleau aux éloges et aux remerciements qui lui sont adressés, les services rendus par lui et qui justifient la grande manifestation qui nous rassemble ce soir autour de lui, remontent à une époque bien antérieure. Quand Mabilleau professait au Collège de France et y enseignait la philosophie atomistique, quand il cherchait, comme l’a fort bien dit M. Cheysson, dans les lois de la formation des êtres, les lois de la formation des sociétés, il avait si bien la préoccupation des choses sociales qu’il était déjà un mutualiste convaincu et pratiquant. Certes il a été heureux de trouver, dans cette chaire du Conservatoire, l’occasion d’études sociales plus directes et plus vivantes ; au lieu des philosophies abstraites et purement théoriques, il savait qu’il pourrait y aborder la philosophie pratique et appliquée, celle des choses de la vie réelle qui est le propre de l’enseignement de cette École des hautes études économiques et sociales qu’est vraiment le Conservatoire des arts et métiers.119
Léon Bourgeois a raison d’insister sur cette continuité que nous avons tenté d’illustrer dans les pages précédentes, d’autant plus qu’un
118 Banquet offert à Léopold Mabilleau, sous la présidence de Léon Bourgeois, le vendredi 20 décembre 1901, au Palais d’Orsay, Paris, 1902, p. 18 : « Sorti brillam-ment de l’École normale avec le grand prix de Rome (sic), M. Mabilleau a séjourné quelques années dans la Ville éternelle, et – je vous le dénonce – au lieu de se plonger, comme il n’aurait pas manqué de le faire s’il avait pressenti ses destinées futures de mutualiste, dans l’étude des collèges romains qui ont été l’origine et peut-être les modèles de notre mutualité moderne, il a fouillé les archives : exploité une veine que son maître, Renan, avait déjà entrevue dans son beau livre sur Averroès, mis en évidence avec une extrême sagacité, les infiltrations par lesquelles la philosophie byzantine avait pu pénétrer jusque dans la philosophie du Moyen Âge. S’enfonçant de plus en plus dans ces recherches d’érudition philosophique, il a publié un beau livre sur la philosophie atomistique, étudié Aristote, le stoïcisme, l’école de Padoue et s’est fait ainsi, de succès en succès, dans le monde spécial de ces études, une réputation sans cesse grandissante. Heureusement pour nous, il a été saisi par l’engrenage des questions sociales, dont on ne peut se déprendre une fois qu’il vous tient. » (...) « Je dois dire cependant – il ne me démentira certaine-ment pas – que les années qu’il a consacrées à la philosophie n’ont pas été perdues pour son action sociale. Ce n’est pas impunément que l’on fréquente pendant long-temps les grands penseurs et qu’on étudie ces nobles problèmes qui sont à la fois l’angoisse et l’honneur de l’humanité. »
119 Banquet offert à Léopold Mabilleau..., cit., p. 26.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 211
tel jugement se confirme aussi par les charges politiques qu’il accepte très tôt, alors qu’il enseigne encore à l’Université. En effet, lorsqu’il enseignait à Faculté des lettres de Toulouse, Léopold Mabilleau fut adjoint au maire responsable de l’instruction publique de 1884 à 1888, soit quelques années avant que Jean Jaurès, son ancien condis-ciple de la rue d’Ulm, soit lui-même promu conseiller municipal de cette ville en 1890. Jaurès et Mabilleau se connaissaient d’ailleurs très bien et se côtoyaient à Toulouse, comme le montre la correspon-dance du chef de file socialiste récemment publiée120. Plus tard, les deux hommes seront souvent opposés, notamment sur la question des retraites121. C’est aussi à cette époque que Mabilleau a rencontré son ami Léon Bourgeois, qui était préfet du Tarn en 1882, puis préfet de Haute-Garonne à partir de 1885. En tout cas, Mabilleau démontre déjà son engagement politique à travers les diverses missions qu’il accepte pour servir le ministère de l’Instruction publique. Comme nous l’avons déjà souligné, dès 1883, Mabilleau est chargé de rédiger un cours complet d’enseignement primaire en conformité avec le programme du 27 juillet 1882 décidé par Jules Ferry et inscrit au programme des toutes les écoles françaises par une circulaire du 17 novembre 1883 adressée aux instituteurs122.
À partir d’octobre 1887, on demande à Mabilleau de remplacer M. Izoulet à la chaire d’enseignement de la psychologie et de la morale à l’École normale d’instituteurs de la Seine123. En 1889, Mabilleau le remplace à nouveau à l’École normale d’Auteuil et enseigne l’instruction morale et civique. Jean Izoulet était élève à l’École normale supérieure en même temps que Mabilleau et avait obtenu l’agrégation de philosophie en 1877. Il occupa la chaire de « philosophie sociale » au Collège de France à partir de 1897, chaire qui a été demandée par Léon Bourgeois. Celui que Mabilleau
120 J. Jaurès, Œuvres complètes, t.1, Les années de jeunesse. 1859-1899, Paris, 2009, p. 103 et 105 par exemple.
121 Jules Arboux, grand mutualiste, écrit à ce propos : « Je ne sais où j’ai lu – c’est sans doute dans Une vie à Paris de Jules Clarétie – qu’on ne peut manquer d’entendre au milieu de l’agitation qu’entretiennent autour de nous, depuis vingt ans, les lois sociales, le hautbois infatigable de Jaurès et le clairon de Mabilleau. » (J. Arboux, Les orateurs mutualistes..., cit., p. 22).
122 Il rédigea ensuite plusieurs manuels de ce genre, ainsi qu’un manuel d’examen pour les futurs instituteurs. Cf. L. Mabilleau (et al.), Manuel d’examen pour le brevet de capacité de l’enseignement primaire, Paris, 1892 (5e édition).
123 Arch. nat., AJ16 1245. Le carton contient une partie du dossier de Mabilleau auprès du ministère de l’Instruction publique, concernant le personnel de l’ins-truction primaire pour l’année 1889. Le document contient un curriculum vitae détaillé. L’arrêté du 18 octobre 1887 contenu dans ce carton dit que « M. Mabilleau est chargé des cours d’instruction morale et civique à l’École normale d’Auteuil ».
AURÉLIEN ROBERT212
remplace est en effet l’un des grands penseurs du solidarisme, dont l’œuvre maîtresse, La cité moderne, fut l’une des références principales de La solidarité de Léon Bourgeois124. Le choix de ces deux philosophes, Izoulet et Mabilleau, s’explique notamment par le rôle qu’ont joué Ferdinand Buisson, agrégé de philosophie, lui aussi grand ami de Léon Bourgeois et farouche défenseur du solidarisme et de l’école républicaine laïque, nommé directeur de l’Enseignement primaire par Jules Ferry en 1879 et maintenu à ce poste jusqu’en 1896125, et Henri Marion, normalien et philosophe, proche des solidaristes et initiateur à la Sorbonne de la chaire de « science de l’éducation »126. Il est donc clair que Mabilleau se situe dans la lignée de ses prédécesseurs philosophes Henri Marion et Ferdinand Buisson et qu’il bénéficie du même réseau d’influence au sein du ministère de l’Instruction publique.
Revenons maintenant sur le contenu des manuels rédigés par Mabilleau, car ils montrent une fois de plus combien il mettait son savoir au profit d’un idéal éducatif, dont les fondements théoriques étaient partagés par une large frange des politiques, des républi-cains les plus libéraux jusqu’aux socialistes : l’école doit être laïque et enseigner les principes de la République. L’idée de solidarité, elle aussi partagée par différents courants de pensée à l’époque, même si elle fut surtout théorisée par les radicaux, est au cœur de l’éducation civique et morale. C’était déjà le cas dans le Petit traité de morale à l’usage des écoles primaires laïques que rédige Charles Renouvier en 1879, ce fut encore le cas plus tard dans le Petit traité de morale sociale de Félix Pécaut127, mais surtout dans le grand Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire de Ferdinand Buisson. Dans le cours de morale que Mabilleau publie en 1885 et destiné au cours supérieur128, on s’aperçoit que la pensée de la soli-darité y est déjà constituée et enseignée. La première partie du livre constitue un cours de philosophie morale simplifié, dans lequel Mabilleau s’attache à définir les concepts de liberté, de conscience, de responsabilité, de dignité, de droit et de devoir, ou encore le concept de loi, à partir de situations concrètes, mises en scènes sous
124 Cf. M.-C. Blais, La solidarité..., cit., p. 217-231.125 Sur ce personnage très important, prix Nobel de la paix en 1927 et pourtant
resté dans l’oubli, lire le livre récent de V. Peillon, Une religion pour la République. La foi laïque de Ferdinand Buisson, Paris, 2010.
126 À la mort d’Henri Marion en 1896, c’est d’ailleurs Ferdinand Buisson qui lui succède à la Sorbonne.
127 Cf. M.-C. Blais, La solidarité..., cit., p. 292.128 L. Mabilleau, Cours de morale, Paris, 1885 (Cours supérieur).
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 213
forme de dialogues destinés à illustrer ces idées abstraites en vue d’une application pédagogique chez les instituteurs. Sur le fond, ce premier moment du cours a l’apparence d’un traité de philosophie kantienne, en tout cas d’une pensée héritière des Lumières, même si elle semble parfois mâtinée de considérations plus anciennes sur la vertu et la justice par exemple. La morale consisterait avant tout à se plier à des impératifs catégoriques, à obéir à la loi morale, dont les contenus seraient fournis par des principes purement rationnels et universels, détachés de tout appel à une religion singulière ou à des croyances culturelles particulières. Ces principes sont, selon Mabilleau, ceux d’une justice désintéressée. L’ensemble s’organise donc autour de deux maximes kantiennes simplifiées : « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il te fût fait » ; « agis envers toi et les autres en respectant toujours la dignité humaine ».
Les parties suivantes viennent détailler cette vision par ce que Mabilleau développe ailleurs dans sa pensée du solidarisme. Le livre III tente de montrer la nécessité de la société contre l’in-dividualisme et défend l’idée d’une division du travail, dans une veine presque durkheimienne, mais fait en même temps l’éloge du progrès qui doit gouverner le corps social, notion chère à la tradi-tion positiviste à laquelle il a été formé en Sorbonne et à la rue d’Ulm. Les chapitres 3 et 4 s’intéressent plus particulièrement à la notion de charité. Mabilleau fait varier les différents sens de la charité, de la bienveillance à l’amitié en passant par le dévouement ou le sacrifice. La forme la plus haute est selon lui la fraternité républicaine. S’effectue alors la synthèse entre les deux premières parties : la morale, au départ, est fondée sur des principes ration-nels et individuels (comme chez Kant), mais l’homme, en plus d’être un individu rationnel, a besoin de la société pour exercer sa liberté. Comme l’explique Mabilleau, si la justice est d’abord un devoir de l’individu, il faut expliquer comment la justice se met en œuvre dans la société. Tout cela, écrit-il, « change de forme et de nom en passant dans le domaine social : le désintéressement devient la solidarité, et le dévouement devient la fraternité »129.
On voit donc à quel point la formation du philosophe est mise au service de la pensée républicaine et laïque et s’inscrit dans le projet général des solidaristes qui militent pour une éducation sociale pour tous, destinée à rendre la solidarité naturelle, c’est-à-dire à retrouver par l’éducation l’état naturel de l’association des hommes entre eux. Dès 1884, Léon Bourgeois défendait l’idée de
129 Ibid., p. 149.
AURÉLIEN ROBERT214
la création d’une société d’éducation sociale devant les membres de la Ligue de l’enseignement aux côtés de Jean Macé. Le projet d’une « Société d’éducation sociale » voit finalement le jour en 1899, lorsque Léon Bourgeois s’entoure de plusieurs intellectuels dont Mabilleau, Buisson, Durkheim et Seignobos, pour réfléchir sur l’éducation sociale dans le cadre de la préparation de l’un des congrès de l’exposition universelle qui doit avoir lieu un an plus tard à Paris. Au sein de ce groupe, Mabilleau est désigné rappor-teur du futur Congrès d’éducation sociale de l’exposition universelle de 1900. Lors de ce Congrès, Léon Bourgeois affirme très explicite-ment les principes de l’éducation sociale :
L’éducation sociale enseignera les lois de la solidarité naturelle ; elle montrera comment ces lois ont constitué à la charge de chacun des hommes une obligation née de tous les travaux et de tous les efforts des autres hommes, obligation qui doit être acquittée par chacun, dans la mesure de ses forces et de l’usage qu’il fait du fonds commun, dans chacun des actes de sa vie sociale. Elle se donnera pour objet d’amener la volonté de chacun à contracter toujours, en tenant compte de ces faits de solida-rité, c’est-à-dire à réaliser en somme la solidarité contractuelle, liquidation, pourrions-nous dire, des injustices de fait qui ont résulté de la méconnais-sance de la solidarité naturelle.130
À n’en pas douter, les manuels de Léopold Mabilleau se situaient déjà dans la lignée de cette pensée. D’ailleurs, Léopold Mabilleau est à ce point convaincu par la doctrine solidariste qu’il considère que le monde se souviendra du tournant du XXe siècle grâce à la philosophie de la solidarité131.
Les résultats de ce Congrès de l’éducation sociale montrent la volonté de fonder scientifiquement la doctrine solidariste. Par exemple, le docteur Paillault, biologiste, tente dans une première communication de montrer que la solidarité est une condition pour le développement biologique de l’homme ; Charles Seignobos présente « la solidarité dans l’histoire » ; Arthur Fontaine « la solida-rité dans les faits économiques ». Mabilleau, lui, s’intéresse à « l’idée
130 Programme proposé au Congrès international de l’éducation sociale, p. 92, cité par M.-C. Blais, La solidarité..., cit., p. 285-286.
131 Palais des Champs-Élysées, 31 janvier 1905, Conférence sans titre de M. Léopold Mabilleau (Archives du Musée social-CEDIAS, carton Léopold Mabilleau) : « S’il y a une caractéristique de notre époque, c’est précisément ce sentiment d’hu-manité, de pitié et de compassion, disons le mot de solidarité, et c’est par là que la fin du XIXe siècle et le commencement du XXe siècle seront connus dans l’histoire. Et laissez-moi vous dire que ce n’est pas seulement dans l’ordre de l’industrie, du commerce, des arts et des sciences, que les sentiments se font jour par tant d’œuvres et d’institutions, c’est dans toutes les formes de la pensée et de l’activité humaines ».
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 215
de solidarité sociale dans la philosophie »132. Un second chapitre s’intéresse plus précisément à la manière d’enseigner cela, avec des communications de Jules Payot ou d’Émile Durkheim, puis un troi-sième chapitre s’intéresse aux applications pratiques de la solida-rité, dans lequel Mabilleau présente une seconde communication sur la Mutualité, quand d’autres s’intéressent aux coopératives, aux syndicats, bourses du travail et autres formes d’association de travailleurs. Le plan même de ce livre montre très clairement comment s’imbriquent la doctrine solidariste, la question éduca-tive et ses débouchés dans la société, et illustre aussi à quel point Mabilleau est concerné par chacun de ces aspects.
La première communication de Mabilleau – que nous avons déjà évoquée plus haut – semble résumer son propre parcours intel-lectuel. Il nous livre en effet une succession de théories de la solida-rité qui, dans l’histoire, se dépassent successivement. Les stoïciens d’abord, dont le principal défaut est de ne pas avoir assez pensé les débouchés politiques de la solidarité ; l’épicurisme, dont l’indivi-dualisme anarchique demande à être dépassé par la solidarité orga-nisée par des lois ; puis le christianisme, qui fait un pas en avant avec ses notions de charité et de fraternité, mais qui ne conçoit pas encore la relation de « dépendance réciproque » qui unit les indi-vidus entre eux. Pis encore, le christianisme ne peut avoir aucun débouché politique qui garantisse la liberté, l’égalité et la solidarité :
Sans doute, le christianisme a dû se plier aux nécessités des temps ; il s’est accommodé à l’Empire romain, auquel il a même emprunté son orga-nisation, merveilleux instrument de despotisme administratif ; aux royautés postérieures dont le principe monarchique convenait à sa conception sociale fondée sur l’obéissance ; il s’accommodait même d’une république où, dans la ruine des hiérarchies humaines, subsisterait l’autorité morale du prêtre, représentant le seul pouvoir qu’on ne renverse point ; mais, à travers l’opportunisme de ces variations, un seul système politique est dans l’esprit du christianisme, c’est la théocratie, qui est la négation même de la solidarité humaine133.
Léopold Mabilleau n’est pas Ferdinand Buisson134 : la laïcité s’accompagne chez lui d’un fort anticléricalisme, qui est peut-être même un athéisme déguisé.
132 Congrès international de l’éducation sociale, Paris, 1901, p. 62-78.133 L. Mabilleau, L’idée de solidarité sociale..., cit., p. 68.134 Dans son livre sur Ferdinand Buisson, Vincent Peillon tente de montrer
combien la « foi laïque » veut instituer la laïcité comme une nouvelle religion et combien le protestantisme de Buisson n’est jamais absent de sa réflexion sociale et politique. Cf. V. Peillon, Une religion pour la République...
AURÉLIEN ROBERT216
Jean-Jacques Rousseau a bien tenté de donner un débouché politique à la solidarité avec son contrat social. Les individus doivent s’associer entre eux par un contrat social qui, selon la formule célèbre, les forcerait à être libres. Mais Mabilleau reproche à cette forme de contractualisme d’aliéner totalement les individus, lesquels n’existent plus que dans et par un contrat social, dont l’es-sence et l’objet précis ne sont pas très clairs. Toujours dans une veine libérale mais sociale, Mabilleau préfère affirmer que le droit public doit toujours être une extension du droit privé.
Emmanuel Kant marque une avancée supplémentaire selon Mabilleau, car ses maximes morales impliquent, au moins néga-tivement, la nécessité de la solidarité (notamment sa critique de l’égoïsme). Mais Kant reste un penseur trop individualiste. Dans toutes ces théories il manquait donc ce que seul le positivisme d’Auguste Comte a compris selon Mabilleau : la société est un fait naturel et la solidarité en est le ferment. Il ne s’agit pas seule-ment d’une obligation morale ou juridique, ni même d’un effet qui suivrait quelque contrat passé entre les hommes : la solidarité décrit « la société humaine raisonnable »135. Mabilleau reproche tout de même à Comte de ne pas avoir assez envisagé le rôle de la coopération, qu’il restreignait au domaine de l’économie, alors que Mabilleau entend l’étendre à l’ensemble du corps social. Mais, malgré cette naturalité de la société et de l’association des indi-vidus entre eux, l’État doit jouer un rôle régulateur, il doit « empê-cher que l’individu, le coopérateur, absorbé dans sa tâche séparée, ne s’isole du milieu social »136. Le seul artifice nécessaire est donc celui de la loi, qui doit garantir le plein exercice des libertés indi-viduelles tout en maintenant la solidarité comme fondement du contrat social.
Qu’est-ce qui distingue alors cette vision philosophique de la solidarité des théories de l’économie libérale d’un côté et du socia-lisme de l’autre. Selon Mabilleau, deux hommes ont bien montré en quoi il y a une pensée solidariste qui échappe à ces deux qualifi-catifs : Alfred Fouillée, son maître d’antan, et Léon Bourgeois, son ami de toujours. « M. Fouillée s’attache d’abord à montrer que ni les économistes, ni les socialistes n’ont résolu le problème qu’ils ont eu l’honneur de poser clairement »137. Aux premiers il reproche leur excès de libéralisme, puisqu’ils ne s’en remettent qu’au libre jeu de la concurrence. Aux seconds il reproche de ne pas laisser assez
135 L. Mabilleau, L’idée de solidarité sociale..., cit., p. 76.136 Ibid., p. 77.137 Ibid., p. 78.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 217
de place à la liberté individuelle, mais aussi de ne pas avoir placé la justice au premier rang de leur système, subordonnant ainsi la justice et la liberté au simple bonheur. « C’est de ce dernier principe [la justice] que se réclament les collectivistes, mais ils n’en veulent tirer que des applications matérielles. Pour eux, la société n’a pas d’autre but que le bonheur, ou plutôt le bien-être des individus. Il est facile de leur objecter qu’un tel résultat ne dépend point de la société seule, et que chacun de nous trouve en soi-même plusieurs moyens de le réaliser »138. On reconnaît là le principe de toute théorie libérale, selon laquelle le bonheur reste une affaire privée, raison pour laquelle on ne saurait fonder aucune philosophie morale et politique sur l’idéal d’une vie bonne. Plus positivement cette fois, Mabilleau considère que le seul système qui permette de répondre à la question sociale est celui esquissé par le radical Léon Bourgeois. Qu’il nous soit donc permis d’exposer les axes princi-paux du solidarisme de Léon Bourgeois afin que le point de vue de Mabilleau apparaisse plus clairement.
Dès 1895, Léon Bourgeois avait fait paraître dans La nouvelle revue ses « Lettres sur le mouvement social », qui deviendront ensuite son célèbre livre intitulé La solidarité publié en 1896. Radical et franc-maçon, Léon Bourgeois développe une théorie laïque et rationaliste de la solidarité sociale, sans aucune référence à la religion, découlant uniquement de la description et de l’analyse du phénomène social. Le point de départ est clairement individua-liste : le monde est fait d’individus, qui s’associent librement et sont naturellement solidaires s’ils suivent leur nature. Car, c’est un fait, les individus sont dans un lien de dépendance réciproque, ils sont donc débiteurs envers les hommes qui les ont précédés et envers ceux avec lesquels ils s’associent. Pour rendre obligatoire pour tous de rendre à chacun son dû, il faut que les individus contractent une sorte de promesse qui les rende obligés vis-à-vis de cette dette sociale. Léon Bourgeois propose donc, contrairement à la thèse de Rousseau, de penser l’existence d’un quasi-contrat qui, comme le rappelle Marie-Claude Blais139, est un terme juridique emprunté au Code civil. S’il s’agit d’un quasi-contrat, c’est que nous n’avons pas nous-mêmes consenti à ce contrat au départ, puisque nous nais-sons débiteurs. Il s’agit, écrit Bourgeois, « d’un contrat rétroacti-vement consenti ». Mais puisque nous ne pouvons pas rendre aux ancêtres leur dû, nous le rendons aux contemporains et devenons
138 Ibid.139 Voir son introduction à L. Bourgeois, Solidarité, Paris, 2008, p. 29.
AURÉLIEN ROBERT218
créanciers pour les générations futures. Quel est le contenu de cette dette ? Progresser dans tous les domaines, accroître notre liberté et réduire les inégalités sociales. La loi aura donc pour charge que tous les contrats réels s’élaborent dans le respect de ce quasi-contrat originel et sans cesse perpétué et amélioré. Le principe du droit reviendrait en gros à celui qui gouverne un système mutua-liste140. Le contrat consenti volontairement entre les individus n’est donc pas à l’origine de la société, il en est le résultat, qui se fonde sur le quasi-contrat, qui est lui-même le fruit de la solidarité naturelle. En quelque sorte, l’État aura donc pour but de légiférer pour permettre la perpétuation de ce quasi-contrat, c’est-à-dire de permettre et de garantir la solidarité naturelle141.
Les résultats politiques et juridiques de cette doctrine furent nombreux : les solidaristes firent partie des défenseurs de la loi de 1884 sur la liberté syndicale ; ils firent voter la loi du 1er avril 1898 sur la Mutualité, aussi appelée « charte de la Mutualité » ; ils œuvrèrent pour que la loi de 1901 sur les associations soit acceptée au Sénat, comme celle de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État ; ils participèrent aussi au vote de la loi du 29 décembre 1906 autorisant le crédit agricole à prêter de l’argent aux coopératives de production ; enfin, leur dernière réussite législative fut la loi sur l’impôt sur le revenu de juillet 1914.
140 L. Bourgeois, La dette sociale et le quasi-contrat social, conférence du 20 novembre 1901, publié en annexe de L. Bourgeois, Solidarité..., cit., p. 184-211, à la p. 184 : « Une organisation qui mutualiserait, pour ainsi dire, entre tous les hommes, les avantages et les risques de la solidarité naturelle, nous a paru, à première vue, le seul procédé capable de donner le résultat que nous attendons. »
141 On trouve une assez bonne description des solidaristes et de leur doctrine dans B. Dumons et G. Pollet, La naissance d’une politique sociale: les retraites en France (1900-1914), dans Revue française de science politique, vol. 41, n° 5, 1991, p. 627-648, à la p. 635 : « Influencés par la doctrine positiviste d’Auguste Comte et les découvertes pasteuriennes, mais également sensibles aux discours des philo-sophes Alfred Fouillée et Charles Renouvier, du sociologue Émile Durkheim, du catholique libéral Célestin Bouglé ou du protestant Charles Gide, et aux avancées du droit social, illustrées par les travaux de Léon Duguit, ils tentent une adapta-tion pragmatique de ces théorisations de la cohésion sociale, basée sur le droit et l’intervention de l’État, souhaitant les développer dans un esprit laïc et rationaliste. Avec l’aide de la doctrine solidariste de Léon Bourgeois, peut alors se fonder une politique sociale désireuse « d’éviter le double écueil de l’individualisme absolu et du socialisme collectiviste ». Il s’agit de légitimer l’intervention du législateur en matière sociale, sans remettre en cause les fondements libéraux de la République. D’où la création d’un nouveau droit social, d’un quasi-contrat reconnaissant une double dette de l’individu envers l’espèce humaine (et la société) et la succession des générations. »
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 219
Mabilleau a collaboré à chaque étape du programme solida-riste : philosophe et penseur de la doctrine dès ses premiers travaux, il a participé à l’éducation sociale en formant les instituteurs et en rédigeant les manuels d’instruction civique et morale, pour enfin incarner sa pensée dans l’action concrète au sein du mouvement mutualiste, mais aussi et surtout au Musée social, où nombre de lois étaient discutées avant de passer devant les députés.
Mabilleau à la tête du Musée social et de la Fédération nationale de la Mutualité française
Léopold Mabilleau est devenu très tôt proche du comte de Chambrun, l’homme qui fonda le Musée social en 1894 à Paris au 5 rue Las Cases. L’inauguration officielle eut lieu en 1895, en présence de Jules Simon, alors président du Conseil142. Mabilleau devient alors le secrétaire du comte de Chambrun avant de devenir direc-teur du Musée social. L’idée d’un Musée social avait véritablement vu le jour lors de l’Exposition universelle de 1889, notamment grâce aux travaux de la section d’économie sociale, qui avait fait fleurir l’idée d’un espace pédagogique permanent à Paris où l’on pourrait mener à bien des études sociologiques sur la France moderne, et dont les résultats serviraient de fondement aux réformes sociales. Cette idée était au départ celle de Frédéric Le Play, précurseur des sciences sociales en France143, mais l’idée du comte de Chambrun, lorsqu’il décida de financer la fondation du Musée social, était plus large puisqu’il disait lui-même que « le socialisme, dont le véritable nom est la charité, [était] devenu son tout premier objet d’étude »144. Tiraillés entre un musée public – et donc nécessairement dépendant du pouvoir en place – et une institution totalement privée, Émile Cheysson et Jules Siegfried choisirent une solution de compromis : une fondation privée ayant le statut d’utilité publique. Comme l’a bien montré Janet Horne, cette institution est tout à fait singu-lière, puisqu’il s’agit d’un lieu qui se veut neutre politiquement. Y cohabitent donc les disciples de Le Play (comme Émile Cheysson), des partisans du catholicisme social (comme Georges Blondel), du protestantisme social (comme Jules Siegfried et Charles Gide), des solidaristes (comme Léon Bourgeois et Léopold Mabilleau) et
142 La plupart des informations qui suivent sont documentées et exposées en détail dans J. Horne, Le Musée social...., cit., p. 71-116.
143 Cf. B. Kalaora et A. Savoye, Les inventeurs oubliés. Le Play et ses continua-teurs aux origines des sciences sociales, Paris, 1989.
144 Cité par J. Horne, Le Musée social..., cit., p. 106-107.
AURÉLIEN ROBERT220
même quelques socialistes (comme Alexandre Millerand et l’ancien communard Jean-Baptiste Dumay, qui participaient cependant assez peu aux activités du Musée). Ces réformateurs de tous hori-zons étaient liés par un même projet : remettre en question le libé-ralisme orthodoxe tel qu’il était théorisé à l’époque. Il s’agissait de conserver et de garantir l’initiative privée tout en accordant un rôle assez important à l’État, ce que refusaient les libéraux orthodoxes.
Avant de devenir directeur de ce Musée social, Mabilleau était déjà membre du comité français d’organisation du 2e Congrès de l’Alliance coopérative internationale organisé à Paris par le Musée social en 1896. Fort de son expérience italienne, cette même année Mabilleau est envoyé en Italie pour le compte du Musée social où il doit effectuer un travail de recherches sur le système italien de prévoyance sociale. La publication de ses travaux eut un impact assez important sur le Musée social lui-même145, suffisant en tout cas pour que Mabilleau en devienne le directeur l’année suivante, lorsque Robert Pinot démissionna brutalement à la suite d’un désaccord avec le Comité exécutif. Selon Janet Horne « ses réfé-rences universitaires pesèrent en sa faveur, de même que sa répu-tation d’orateur exceptionnel. Convaincus que le Musée social avait besoin de faire entendre sa voix d’une façon plus active dans le débat public sur la réforme sociale, les membres du Comité furent de toute évidence sensibles aux talents de Mabilleau, plus appré-ciables que ceux d’un spécialiste de science sociale au langage tech-nique »146. Il s’agissait d’un poste prestigieux, puisque l’on appelait le Musée social « l’antichambre de la Chambre »147 et que son Grand Conseil a vu passer beaucoup de grands noms de la politique (Émile Loubet, Léon Bourgeois, Paul Deschanel, Jules Méline ou Raymond Poincaré). Ce poste lui permettait donc d’influer sur certaines décisions politiques.
Au départ, le Musée social apportait son soutien à différentes formes d’associations, mais il se concentra progressivement sur les associations de secours mutuel, certainement sous l’influence
145 En 1901, Léon Bourgeois cite encore l’exemple du voyage de Mabilleau en Italie, dans le Piémont et en Lombardie, où il a pu trouver plusieurs exemples de fonctionnement mutualistes ou coopératifs qui pourraient être importés en France. Cf. L. Bourgeois, Discours prononcé au banquet offert à L. Mabilleau le 20 décembre 1901, réédité dans L. Bourgeois, La politique de la prévoyance sociale, t. I, La doctrine et la méthode, Paris, 1914, p. 153-154.
146 J. Horne, Le Musée social..., cit., p. 171.147 Cf. J. Horne, L’antichambre de la Chambre : le Musée social et ses réseaux
réformateurs, 1894-1914, dans Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réfor-matrice et ses réseaux en France (1880-1914), éd. C. Topalov, Paris, 1999, p. 121-140.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 221
de Mabilleau. Dans ce contexte, écrit Janet Horne, « les réforma-teurs rattachés au Musée social, en particulier Léopold Mabilleau, devinrent les interlocuteurs clés à la fois pour le mouvement mutua-liste et pour le gouvernement »148. L’année de l’adoption de la « Charte de la Mutualité », en 1898, Mabilleau prononce une conférence sur « l’avenir de la Mutualité » au Musée social, aux côtés de Charles Dupuy, président du Conseil. En 1899, c’est lui qui fut chargé de représenter les mutualistes français au grand Congrès coopératif italien tenu à Côme. Au tournant du siècle, Mabilleau est en outre appelé à participer à de nombreuses institutions qui s’occupent des questions sociales, comme le Collège libre des sciences sociales149.
1900 est une année cruciale, car, comme nous l’avons montré plus haut, Mabilleau est très engagé dans l’organisation de l’expo-sition universelle à Paris. Conformément à ses engagements dans le mouvement coopératif, il est nommé rapporteur de la classe 107, intitulée « Sociétés coopératives de consommation ». Non seule-ment il rédige le rapport sur les coopératives pour le ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes150, mais il participe aussi à la plupart des congrès qui touchent de près ou de loin à l’économie sociale : il est notamment actif dans l’organisa-tion du Congrès international pour la protection légale des travail-leurs, aux côtés de Paul Cauwès et d’Arthur Fontaine ; on le trouve aussi aux côtés d’autres intellectuels, comme Charles Seignobos et Émile Durkheim, parmi les organisateurs du Congrès international de l’enseignement des sciences sociales, tenu à Paris du 30 juillet au 3 août 1900151. Mais nous retiendrons surtout ici sa contribution au Congrès international de l’éducation sociale dont il fut le rappor-teur et pour lequel il rédigea le texte sur la philosophie solidariste évoqué plus haut. C’est alors que Mabilleau s’engage pleinement dans le mutualisme, puisque c’est en 1900 qu’il arrête définitive-ment d’enseigner la philosophie à l’université de Caen pour occuper la chaire de prévoyance sociale au Conservatoire national des arts et métiers ; et c’est aussi à cette date qu’il succède à Charles Robert pour présider la société de secours mutuel de la Maison Leclaire. Certes, devenu correspondant de l’Académie des sciences morales
148 J. Horne, Le Musée social..., cit., p. 232.149 J. Bergeron, Le Collège libre de sciences sociales. Ses origines, son fonction-
nement, Paris, 1910, p. 35.150 L. Mabilleau, Rapports du jury international. Classe 107. Sociétés coopéra-
tives de consommation, Paris, 1902 (84 p.).151 H. Hauser, Congrès international de l’enseignement des sciences sociales tenu
à Paris du 30 juillet au 3 août. Procès verbaux sommaires, Paris, 1900, p. 3-4.
AURÉLIEN ROBERT222
et politiques en 1895152, il fait encore de très nombreuses confé-rences pour l’Institut, au moins jusqu’en 1904153 ; mais ce n’est plus qu’une activité périphérique pour lui.
En 1901, lors du banquet qui lui est offert au Palais d’Orsay, Mabilleau reçoit la médaille d’or de la Mutualité avant de partir en mission aux États-Unis. Il demande en effet une mission au minis-tère de l’Instruction publique « à l’effet d’y étudier l’organisation de l’enseignement social dans les Universités de ce pays »154. Dans une lettre du 23 décembre 1901, Mabilleau explique qu’il « traversera les principales universités de l’Union et fera même un cours suivi de quatre conférences dans trois d’entre elles : Harvard, Columbia, Chicago »155. Il fit en effet ces cours sur le système politique français et écrivit un article à son retour sur le socialisme aux États-Unis156. Il repartit en 1903 pour une mission similaire – mais cette fois il fut aussi missionné par le Musée social157 – lors de laquelle il visita un nombre considérable de villes et d’universités158. Il fut même l’un des premiers professeurs à bénéficier des échanges universitaires entre la France et les États-Unis, grâce à l’invitation de l’univer-sité d’Harvard en 1903-1904, université où il donna un cours sur « les idées fondamentales de la politique française depuis 1870 »159. À force de voyages et de rencontres internationales, Léopold Mabilleau connaît son heure de gloire au tournant du siècle.
Mabilleau cumule alors les décorations160 et parvient difficile-ment à mener de front ses activités d’enseignement et son engage-
152 Cf. C.-E. Curinier dir., Dictionnaire national des contemporains..., cit., t. 2, p. 160, col. 2.
153 Mabilleau aurait fait 115 conférences ! Information que nous n’avons pas pu vérifier. Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, t. 62, 1904, p. 542.
154 Arrêté du 24 décembre 1901 (Arch. nat., F17 2986A)155 Ibid.156 L. Mabilleau, Les États-Unis et le socialisme, dans Musée social, Annales,
décembre 1902, p. 413-421.157 Voir la liste des missions et enquêtes du Musée social jusqu’en 1908 publiée
en annexe dans Le Musée social en son temps..., à la p. 394.158 La liste des villes qu’il visita aux États-Unis est impressionnante. On la
trouve dans un article du journal L’Abeille de la Nouvelle-Orléans, du vendredi 13 février 1903.
159 Cf. Y. H. Nouailhat, France et États-Unis, Paris, 1979, p. 62.160 Chevalier de la Légion d’honneur en 1896, il est fait officier en 1900 puis
commandeur en 1912. Mabilleau est aussi officier de l’Instruction publique, et commandeur de la couronne d’Italie, comme l’indique un document de la main de Mabilleau, adressé au ministère de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, daté du 9 juillet 1900, relatif au jury de l’exposition universelle de 1900 (Arch. nat., F12 6657).
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 223
ment politique et militant. Sa carrière politique prend un nouveau tournant en 1902 quand, après des années de travail pour fédérer les mutualités régionales, il parvient, avec plusieurs mutualistes, à fonder la Fédération nationale de la Mutualité française, dont il devient le premier président et le porte-parole, position qu’il occupa jusqu’en 1921161. Comme le rappelle Michel Dreyfus, c’est en 1900, à l’occasion de l’exposition universelle que la Mutualité française connaît un nouvel essor162. La multiplication des conférences après 1900 atteste de cette dynamique163 et on ne peut mentionner ici tous les congrès auxquels Mabilleau participe entre 1900 et 1914, tant ils sont nombreux164.
Le mutualisme de Léopold Mabilleau
Mabilleau a toujours essayé de faire coïncider son enseigne-ment au Conservatoire national des arts et métiers avec son acti-vité de mutualiste. Il demande même au Conservatoire de faire certains cours in situ, au Musée social ou dans les sociétés mutua-listes Jean Leclaire165. Des conférences publiques sont organi-sées au Conservatoire sur différents thèmes, tels que « l’organisa-
161 Cf. B. Gibaud, Fédérer autrement. Histoire de la Fédération nationale de la mutualité française (1902-2002), Paris, 2003.
162 M. Dreyfus, Léopold Mabilleau et le mouvement mutualiste français, dans Le Musée social en son temps..., cit., p. 111.
163 De 1902 à 1903, Mabilleau est membre du Comité central de l’Union coopé-rative des sociétés françaises de consommation ; en 1904, il représente le Musée social à l’exposition internationale de Saint Louis ; en 1905, il le représente au Congrès de la Mutualité coloniale et des pays du protectorat à Alger et Tunis puis au Congrès international des assurances sociales à Vienne et en 1906, au Congrès du Crédit populaire à Oran. Cf. Liste des missions et enquêtes du Musée social..., cit., p. 393-396. Toujours en 1906, il représente aussi la France au Congrès inter-national pour la lutte contre le chômage, organisé à Milan. Cf. É. Lecerf, Les conférences internationales pour la lutte contre le chômage au début du siècle, dans Cahiers Georges Sorel, 7, 1989, p. 99-126, à la p. 103. En 1914, aux côtés de Pierre Loti qui en assume la présidence d’honneur, Léopold Mabilleau dirige le comité franco-musulman fraîchement créé pour rapprocher la France de certaines de ses colonies. Cf. P. Le Pautremat et C. R. Ageron, La politique musulmane de la France au XXe siècle, de l’Hexagone aux terres d’islam : espoirs, réussites, échecs, Paris, 2003, p. 156.
164 Cf. M. Dreyfus, Léopold Mabilleau. Professeur d’assurances..., cit., p. 161. Dans le dossier de Mabilleau pour devenir commandeur de la Légion d’honneur (Arch. nat., F12 6657), sont aussi évoqués, sans plus de précision, des congrès à Londres, Bruxelles, Liège, etc.
165 Archives du Conservatoire national des arts et métiers, dossier personnel de Léopold Mabilleau, Léopold Mabilleau au directeur du Conservatoire, [sans lieu], [sans précision de jour] octobre 1921.
AURÉLIEN ROBERT224
tion sociale de l’Allemagne » (7 février 1916) ou « les réformes de demain » (23 mars 1916). Dans cette dernière conférence, Mabilleau tente de montrer à quel point son modèle social sera utile après la guerre, tant sur les questions de prévoyance et que sur celle, plus précise, de l’hygiène publique. Il faudra selon lui « surexciter » les naissances, faire appel à des travailleurs de l’étranger et proposer un impôt plus juste (c’est-à-dire soulagé par l’association volon-taire des citoyens). Ainsi, écrit-il, « le jeu de la solidarité travail-lera à remplir les cadres de la société, qui, si elle se vidait, rendrait bien inutiles tous les principes de solidarité, de fraternité, que nous professons si haut »166. En ces temps de guerre, la solidarité doit jouer sur plusieurs plans : dans l’impôt, dans la production (les coopératives) et dans ce qu’il appelle « l’entraide nationale », c’est-à-dire la mutualité.
Malgré sa vision générale et optimiste de la mutualité, sur plusieurs thèmes cruciaux, il doit ménager la susceptibilité de ceux qu’il représente et mettre de côté ses propres convictions libérales167. Par exemple, en 1898 il défendait encore le rôle de la Mutualité dans le système des retraites, pensant qu’elle pouvait se substi-tuer au rôle de l’État. Mais, quelques années plus tard, en 1902, devant le consensus autour de l’idée de pensions de retraite obliga-toires et gérées par l’État, Mabilleau doit défendre un modèle plus étatiste devant le Congrès national sur les pensions et les retraites qu’il présidait au Musée social. Alors que Mabilleau défendait un modèle libéral, il eut à user de toute sa rhétorique pour convaincre les mutualistes réunis en Congrès à Nantes de 1904 d’accepter le caractère obligatoire du projet de loi sur les pensions168. En 1910, Mabilleau reconnut que le devoir de solidarité obligeait à passer par la loi et devait donc revêtir un caractère obligatoire pour tous. Quelque temps après fut votée la loi du 5 avril 1910 sur les retraites obligatoires.
Quelques années plus tard, Mabilleau devait encore changer quelque peu d’optique sur la question de l’assurance sociale obli-gatoire. Au Congrès de la Mutualité d’Angers en 1920, Mabilleau tente de limiter la portée de l’obligation et ne conçoit pas que l’on
166 L. Mabilleau, « Les réformes de demain », conférence prononcée au Conservatoire national des arts et métiers le 27 mars 1916. Un exemplaire dacty-lographié est conservé dans le dossier personnel de Mabilleau dans les Archives du Conservatoire et une copie est disponible à la Bibliothèque du Conservatoire national des arts et métiers sous la cote Br. 968.
167 Cf. M. Dreyfus, Léopold Mabilleau et le mouvement mutualiste...168 Cf. B. Dumons et G. Pollet, La naissance d’une politique sociale...
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 225
passe par la loi pour obliger les citoyens à souscrire à une assu-rance sociale. Le 30 juin 1920, Mabilleau fait partie d’une commis-sion chargée de réfléchir sur un projet de loi sur l’assurance sociale obligatoire, laquelle devrait pouvoir prendre en charge la maladie, l’invalidité et la vieillesse169. Si les discussions politiques conti-nuèrent sur la réforme de l’assurance sociale, Mabilleau n’y parti-cipa plus à partir de 1921.
La fin de la gloire
Le 29 avril 1921, Mabilleau se voit contraint de démissionner de la Fédération nationale de la Mutualité française, suite à une affaire financière dans laquelle il est directement impliqué. Deux personnes, les dénommés Machal et Martin, auraient vendu 5 000 lits récupérés dans les camps américains de la Première Guerre mondiale à un certain Dabilly dans le but de fournir des lits aux régions de l’Est de la France. Ils auraient prétendu agir sous mandat de Léopold Mabilleau, pour le compte de la Fédération nationale de la Mutualité française170. Le journal Le Matin s’acharne sur le cas Mabilleau, ce qui oblige ce dernier à publier une lettre dans ce même quotidien pour démentir la plupart des informations qu’il diffuse et qui ont porté gravement atteinte à sa carrière et à sa vie personnelle171. Malgré sa défense, Mabilleau est démis de ses fonc-tions de directeur du Musée social. La Fédération nationale de la Mutualité française étant hébergée dans l’immeuble de la rue Las Cases, il n’était pas possible, pour l’image de l’institution, de lui laisser ce poste.
Dans une lettre du 27 mai 1921 adressée à Jules Siegfried, alors président du Musée social, Léopold Mabilleau reconnaît ses fautes, et les juge même inexcusables, s’évertue à rappeler l’intention géné-reuse qui présidait à son choix, mais propose tout de même sa démission au conseil de direction. Il tente cependant de montrer au président que cette affaire n’a absolument rien à voir avec le Musée social et qu’elle tient plus de la calomnie que du scandale. Mabilleau voudrait obtenir un délai pour pouvoir se retourner et préparer son avenir et celui de sa famille :
169 Cf. M. Dreyfus, Léopold Mabilleau. Professeur d’assurances...170 Le Matin, 28 mai 1921 : « La démission de M. Mabilleau » : « Le comité de la
Fédération nationale de la mutualité déclare avoir mis son président dans l’obliga-tion de démissionner en raison de certains actes commerciaux faits au nom de la Fédération et sur lesquels la justice a ouvert une enquête. »
171 Cf. Le Matin du 2 juin 1921.
AURÉLIEN ROBERT226
Mais il me permettra, vous me permettrez vous-même, après m’avoir entendu, après avoir constaté le désastre moral et matériel entraîné par cette mesure qui me tue, – oui, vous me permettrez de solliciter une atténuation momentanée où je pourrais peut-être me relever de mon désespoir. Si mon départ du Musée Social est annoncé et réalisé immédiatement, c’est une exécution certainement excessive, car elle ne serait pas autre si j’avais péché contre l’honneur (...).172
La lettre dans son ensemble montre le désarroi profond dans lequel se trouve Mabilleau, lui qui a consacré la majeure partie de sa vie à la Mutualité, au détriment de l’enseignement de la philo-sophie et de la littérature. En post-scriptum, Mabilleau inscrit la phrase latine Res sacra miser et ajoute : « Le malheur (surtout excessif, comme ici) a quelque chose de sacré pour les grands cœurs. Telle fut la fin d’une des dernières conférences d’Émile Cheysson, qui, s’il était là, voudrait m’épargner, comme Léon Bourgeois ». Ses principaux amis sont en effet décédés et ne peuvent plus rien pour lui : le 31 mai 1921, le procès-verbal de la réunion du comité de direction du Musée social annonce la démission de Mabilleau et son remplacement par André Lichtenberger173.
Le Conservatoire national des arts et Métiers a été plus prudent et a attendu le jugement de l’affaire avant de démettre Mabilleau de ses fonctions. Or, le 20 mai 1922, Mabilleau est jugé innocent et la cour d’appel de Paris rejette tous les griefs de Dabilly, lequel doit verser des dommages et intérêts à l’accusé174. Mabilleau peut donc continuer son enseignement au Conservatoire, jusqu’à ce qu’un second scandale éclate en 1926, lié, cette fois encore, à une affaire commerciale frauduleuse. Malgré une dernière tenta-tive de défense dans une lettre du 2 mai 1926 adressée au direc-teur du Conservatoire175, Mabilleau doit demander un congé pour atteindre l’âge légal auquel il pourrait partir en retraite176. Pourtant, si Mabilleau fut condamné en première instance à quatre mois de prison, sa peine fut abaissée à mille francs d’amende lors d’un
172 Archives du Musée social-CEDIAS, carton Léopold Mabilleau, Léopold Mabilleau à Jules Siegfried, Paris, 21 mai 1921.
173 Archives du Musée social-CEDIAS, carton Léopold Mabilleau.174 Le Matin, 3 juin 1922: « Conclusion de l’affaire Mabilleau-Dabilly ».175 Archives du Conservatoire national des arts et métiers, dossier personnel de
Léopold Mabilleau, Léopold Mabilleau au directeur du Conservatoire, Paris, 2 mai 1926 : « Si cruelle que soit, dans sa forme extérieure, l’invraisemblable aventure dont je suis victime, je vous supplie de ne pas trop vous en émouvoir ; au fond, je ne suis, à aucun degré, coupable de complicité dans une ’escroquerie’, et n’ai nulle crainte d’être effectivement condamné pour cela. »
176 Cf. M. Dreyfus, Léopold Mabilleau et le mouvement mutualiste..., cit., p. 118.
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 227
second jugement. Les détails publiés dans la presse (notamment dans Le Matin) montrent que les plaignants ont reconnu « la bonne foi » de Mabilleau.
À partir de 1926, il donne des cours au collège Sainte-Barbe à Paris. André Hirschfeld raconte qu’il a suivi ces cours, durant lesquels il dit avoir été initié « aux idées généreuses de mutualité et de coopération dont il était resté l’ardent défenseur »177. Selon la plupart des notices biographiques consacrées à Mabilleau, celui-ci serait mort à Niort le 8 février 1941, oublié de tous après une retraite à Villeloin-Coulangé en Indre-et-Loire178. Une nécrologie parue dans le journal Ouest-Éclair affirme cependant qu’il serait mort à La Baule, où, malgré son grand âge, il enseignait encore les lettres et la philosophie179.
Conclusion
L’importance des travaux de Léopold Mabilleau en histoire de la philosophie ne fait aucun doute, plus particulièrement ceux sur l’Italie. En effet, les historiens de la philosophie du Moyen Âge et de la Renaissance – dont je fais partie – s’interrogent aujourd’hui encore sur les moyens de dépasser la vision d’Ernest Renan, mouve-ment que Mabilleau avait esquissé concernant la place de l’aver-roïsme par exemple. Plus généralement, sa proposition d’un long Moyen Âge, qui en philosophie du moins, durerait jusqu’à l’époque
177 A. Hirschfeld, Léopold Mabilleau...178 La lettre dans laquelle Mabilleau demande un congé avant la retraite précise
en effet qu’il compte se retirer à Villeloin-Coulangé (Archives du Conservatoire national des arts et métiers, dossier personnel de Léopold Mabilleau, Léopold Mabilleau au directeur du Conservatoire, s.l.n.d.)
179 Ouest-Éclair, 9 février 1941 « Le Professeur Mabilleau de l’Institut est mort à La Baule » : « La Baule 8 février. À 9 heures vendredi soir s’éteignait à La Baule où, bien qu’il fut âgé de 88 ans, il enseignait les lettres et la philosophie avec une étonnante fraîcheur d’esprit, le professeur Léopold Mabilleau, membre de l’Institut et du Collège de France, commandeur de la Légion d’honneur. Cet économiste aux dons prodigieux, qui fut agrégé de philosophie à 21 ans et entra à 37 ans sous la coupole, laisse une dizaine d’ouvrages d’histoire et de philosophie qui font autorité. L’œuvre maîtresse de sa vie semble toutefois être ce Victor Hugo de la collection des grands écrivains de chez Hachette, dont le tirage atteint le 200e mille. Notons encore que ce magnifique vieillard à l’âme si jeune fut, voici quelques années déjà, notamment avec Bergson et Joseph Barthélemy, notre actuel ministre de la Justice, l’un des promoteurs d’un mouvement tendant au recrutement d’hommes jeunes, à la rénovation des méthodes éducatives. Les obsèques du professeur Mabilleau auront lieu lundi à 10 heures à La Baule. » Les informations de cette nécrologie sont très mal renseignées, voire fausses.
AURÉLIEN ROBERT228
moderne malgré la Renaissance et ses philologues, est une hypo-thèse qui refait surface depuis peu, mais qui n’a jamais su s’imposer et remplacer les vieilles catégories historiographiques. L’attention particulière portée à l’Italie du Nord et à l’école de Padoue jusqu’à l’époque de Galilée est au cœur des recherches actuelles en histoire de la philosophie médiévale et renaissante en Italie. Ses recherches sur Padoue sont malheureusement restées dans l’ombre – au moins la partie inédite contenue dans son mémoire de l’École française de Rome – et Mabilleau n’a jamais publié sa monographie sur Pietro d’Abano, auteur qui reste énigmatique aujourd’hui aux yeux des historiens. De telles publications auraient pourtant permis d’avancer plus vite et de ne pas attendre la fin du XXe siècle pour que paraissent quelques monographies sur le sujet. Quant à Cesare Cremonini, les textes qu’avait mis au jour Mabilleau sont, pour la plupart, toujours inédits à ce jour. Il fallut attendre 1968 pour qu’une nouvelle monographie soit consacrée à ce personnage important dans l’histoire des idées180, puis un ou deux colloques dans les années 1980 pour renouveler en profondeur certaines analyses de Mabilleau, qui continuent malgré tout d’être citées181. La situation est la même pour l’histoire de l’atomisme, pour laquelle Mabilleau tentait de prendre en compte les traditions grecques, indiennes, arabes et latines, ce que personne n’a su refaire après lui, malgré un fort renouvellement des études sur cette question.
Tant dans le domaine de la philosophie qu’en littérature – notamment avec ses travaux sur Hugo – Mabilleau a été un pion-nier enthousiaste, animé par une même volonté de rationalisme laïc, orienté à la fois vers l’érudition et vers la société. Certes, on a montré que ce qui l’animait au premier chef était la volonté de fonder une ontologie que nous qualifierions aujourd’hui de nomina-liste, dans laquelle seuls les individus existent. Mais à partir de cela, il entendait défendre la nécessité de la solidarité entre les hommes et cette orientation politique ne l’a pas empêché de mener à bien des recherches qui, pour l’époque, étaient en avance sur leur temps.
Passé au monde de la politique, mettant sa rhétorique philoso-phique au service de son idéal social, son passage au Musée social et à la Mutualité française a participé à des transformations impor-tantes du système social français, comme l’a montré Janet Horne, puisque selon elle le Musée social est, au moins en partie, à l’ori-gine du modèle de l’État providence à la française.
180 M. A. del Torre, Studi su Cesare Cremonini, Padoue, 1968.181 Dans sa synthèse sur l’aristotélisme à la Renaissance, Charles B. Schmidt le
cite encore (C. B. Schmidt, Aristote à la Renaissance, Paris, 1992, p. 15).
LÉOPOLD MABILLEAU (1853-1941) 229
Si Mabilleau a été oublié des philosophes et du monde acadé-mique en général, c’est peut-être à cause de son abandon de l’Uni-versité pour la Mutualité, puisqu’il laissait de côté toutes les insti-tutions prestigieuses qu’il avait fréquentées et qui l’avaient porté pendant près de trente ans. S’il a été oublié de l’histoire politique, comme tant d’autres, c’est parce qu’il n’a jamais été élu à des postes importants et qu’il a plutôt œuvré à l’écart des chambres législa-tives, comme initiateur d’institutions comme le Musée social ou la Mutualité française, en participant à l’élaboration des lois, mais non à leur promulgation. Plus généralement, les circonstances de la fin de sa vie et la discrétion avec laquelle il enseignait encore ici ou là quelques-unes de ces idées qui lui étaient si chères, ont certainement contribué à cet oubli. Ce malaise face à Mabilleau, ressenti sans doute des deux côtés, chez les universitaires et chez les politiciens, Jérôme Carcopino, pour des raisons qui proviennent probablement de ses propres orientations politiques, l’exprime très explicitement. Décrivant la fin du repas qu’il avait partagé avec Mabilleau au Palais Farnèse en compagnie de Mgr Duschesne, il achevait ainsi son récit : « Quand Léopold Mabilleau se tut et nous quitta, il nous laissait sous le charme. Il nous avait désopilés par son espièglerie, étourdis par son esprit. Toutefois, nous ne pouvions nous défendre d’un certain malaise. Dans notre cage d’érudits, il avait introduit un merle blanc dont nous nous demandions si le plumage était immaculé »182. Nous n’avons point cherché ici à blan-chir son plumage, mais seulement à réveiller la mémoire collective de l’oubli dans lequel elle s’était complu depuis près d’un siècle au sujet de Mabilleau. En effet, un parcours aussi singulier que celui de Mabilleau, ainsi que l’originalité de ses travaux philosophiques et littéraires, méritaient qu’on y consacrât un exposé détaillé.
Aurélien Robert Maître de conférences à l’Université de Tours
182 J. Carcopino, Souvenirs romains..., cit., p. 257.