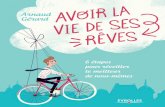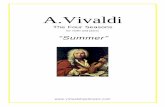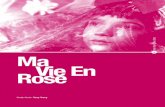Un four de potier du VIe s. av.J.-C. à Bezouce, Gard
Transcript of Un four de potier du VIe s. av.J.-C. à Bezouce, Gard
Un four de potier du Vlème siècle avant J.-C
à Bezouce (Gard)
par Michel PY*
1. Durant l'été 1977, M. F. Gaud, en défonçant une terre lui appartenant à Bezouce, remarqua la présence de cendres et de tessons de vases dans un secteur très limité de la parcelle. Pensant avoir affaire à des vestiges d'époque très ancienne, il prévint le Directeur régional des Antiquités Préhistoriques, qui se rendit peu après sur place. Ayant constaté qu'il s'agissait de témoins de l'Age du Fer, ce dernier laissa à l'inventeur et à son fils toute latitude pour explorer le gisement. Après avoir assuré le sauvetage des vestiges antiques et recueilli quelques informations, M. Gaud nous confia le mobilier et les divers documents de fouille pour étude. La présente note est le résultat de cette collaboration.
2. Conditions de gisement ; structures observées
Le gisement prend place dans' le quartier des Fours à Chaux (fig. 1), au nord de la commune de Bezouce (1), sur les premières hauteurs des Garrigues dominant la plaine littorale. La trouvaille se situe dans un léger creux où l'érosion a accumulé un dépôt épais de terre rougeâtre de décalcification. Le défonçage du terrain, poussé jusqu'à 0,65 m, a fait apparaître au milieu du tenement un amas de cendres unique et très localisé, aucun témoin humain n'ayant été relevé sur le reste de la parcelle. La fouille a pris la forme d'un carré d'environ 2 m de côté, et a permis d'observer sous la couche remuée par la charrue, les restes d'une strate de cendre pure, contenant des charbons de bois et quelques tessons de vases dispersés. A la base de cette couche, dont il est difficile de préciser la puissance originelle (0,20 à 0,30 m ?), on a rencontré un pavage de pierres plates - ou lames - en calcaire local (fig. 2), disposé sur le fond d'une légère fosse creusée dans le terrain naturel, dont la nature ne diffère pas de celle des dépôts supérieurs (terre brun -rouge avec cailloutis calcaire).
Les pierres qui pavaient le fond de la fosse ont fait l'objet d'un relevé précis de M. Gaud et son équipe, relevé que nous reproduisons ici (fig. 3). On voit que les
pierres, qui couvraient environ les deux tiers de la fosse, avaient un léger pendage régulier vers le centre de cette dernière, sauf une dalle au milieu du secteur fouillé, qui a été, selon les fouilleurs, déplacée par la charrue. Un grand fragment d'urne en céramique non tournée (fig. 4) se tenait au centre de la zone dallée, recassé sur place. D'autres tessons de vases et des fragments d'argile cuite ont été recueillis dans les cendres qui recouvraient les pierres plates. A noter enfin que plusieurs des dalles retrouvées en place au fond de la fosse étaient rubéfiées à leur partie supérieure, certaines même ayant éclaté au feu.
3. Le mobilier recueilli
Le mobilier recueilli dans les cendres, au fond de la fosse et dans les terres remuées par le labour, est homogène : une cinquantaine de tessons de vases non tournés, à l'exclusion de toute pièce modelée au tour, et deux blocs d'argile durcie au feu.
3.1. VASES CERAMIQUES Après recollage, douze fragments de vases
présentent une forme reconnaissable. En voici la description.
Kg. 4 et fig. 5, n" 1 : partie supérieure d'urne, de forme probable 221 A/E (2), si on lui restitue le fond plat que l'on attend avec ce type de profil. Bord de forme D0 1/ C01, sur col légèrement concave dont la direction générale se rapproche de la verticale. Panse arrondie- convexe à profil surhaussé. Argile brun-rouge sombre en épaisseur, présentant en surface des couleurs diverses dues aux coups de feu pendant la cuisson (du rouge-orange au brun foncé). Abondant dégraissant assez fin, mais mal calibré, à base de calcaire et de calcite broyés (fig. 7, C). Aménagement des surfaces extérieures : lissage fini sur le col et l'épaule, lissage ébauché sur la panse.
Kg. 5, n" 2 : fragment d'épaulement d'urne orné d'un cordon digité. Pâte gris-beige en épaisseur, brun-beige en surface, farcie d'un abondant dégraissant de calcaire et de calcite broyés, mal calibré, d'assez gros module. Lissage fini à l'extérieur du vase, lissage ébauché à l'intérieur.
Rue Basse - 30980 LANGLADE. 1 - Coordonnées Lambert : X 772, 75 ; Y 178,7, altitude 110 m. parcelle cadastrale 43-44. 2 - La forme des vases non tournés, de leurs bords et de leurs fonds, est donnée ici selon le système de B. Dedet et M. Py, Classification de la céramique non tournée
tohistorique du Languedoc méditerranéen, suppl. 4 à la Rev. Arch. Narb., Paris, 1975.
Documents d'Archéologie Méridionale, 2, 1979.
Illustration non autorisée à la diffusion
Fig. 1 - Situation du four de potier et des gisements protohistoriques environnants : n' Bronze final ; n° 4 : oppidum de Roquecourbe (carte I.G.N. 1 /25000e).
1 : four de Bezouce ; n ° 2 et 3 : gisements de plaine du
Fig. 5, n° 3 : épaulement de petite urne portant un bouton allongé verticalement, perforé à sa partie supérieure. Argile noire en épaisseur, gris-brun en surface, à fin dégraissant de calcaire broyé. Lissage ébauché à l'extérieur, tandis que l'intérieur du vase n'est pas aménagé.
Fig. 5, n° 4 : col évasé de grande urne portant un bord de forme Cil. Argile brun-beige en épaisseur et beige en surface, à fin dégraissant de calcaire et de calcite broyés, auxquels s'ajoutent des éléments de couleur noire, probablement végétaux (brindilles de bois ou de paille carbonisées). Surfaces lissées sans soin à l'intérieur et à l'extérieur du vase.
Fig. 5, n ° 5 : Epaule d'urne ornée de trois méplats peu anguleux. Paroi zonée, grise en épaisseur, beige clair en surface. Argile à dégraissant très mal calibré de calcaire et de calcite broyés. Surface extérieure soigneusement lissée, surface intérieure dégradée.
Fig. 5, n ° 6 : bord d'urne de forme D09 sur col rectiligne et divergent. Pâte brun -rouge sombre en épaisseur, brun-noir à noir en surface, contenant un fin dégraissant de calcaire et de calcite broyés, auxquels se mêlent des brindilles végétales carbonisées. Lissage fini à l'intérieur et à l'extérieur.
Fig. 5, »° 7 ; fond plat d'urne ou de coupe, de forme 13 A. Lissage soigné à l'extérieur et à l'intérieur du vase. Argile brun -rouge en épaisseur, beige en surface à l'extérieur, brun-noir à l'intérieur. Abondant dégraissant mal calibré de calcaire et de calcite broyés.
Fig. 3, n° 8 : fond annulaire de grande coupe ; forme 42C. Pâte gris-beige à très fin et abondant dégraissant de calcaire broyé ; quelques particules végétales carbonisées.
Fig. 5, n° 9 : bord de vase à embouchure rétrécie de forme 102 , portant sur l'épaule à l'extérieur un décor impressionné. Le motif est une rangée de coups répétés, faits à l'aide d'un instrument bifide donnant un dessin en V. Pâte très noire en épaisseur, nuances brunes en surface à l'extérieur du vase.
Fig. 5, » " 10 : fragment de coupelle hémisphérique, munie d'un bord E09. Aigile brun-gris à brun-rouge, à fin dégraissant de calcaire et de calcite broyés, bien calibré et bien réparti. Lissage fini à l'extérieur comme à l'intérieur du vase.
Fig. 5, »° 11 : coupelle hémisphérique portant un bord E01, paroi particulièrement fine. Pâte brune, à dégraissant très fin de calcaire broyé. Les surfaces portent un lissage très soigné, prenant par endroit l'aspect d'un polissage.
Fig. 5, n° 12 : grande coupe évasée à bord E09 et paroi assez fine. L'argile est brune à brun-noir et comprend un dégraissant mal calibré de calcaire et de calcite broyés. Lissage très soigné à l'intérieur du vase, polissage de l'épiderme extérieur.
Cet ensemble de vases présente un certain nombre de caractères communs : l'argile employée contient un très fin mica blanc, qui ne constitue pas un dégraissant ajouté, mais correspond à l'une de ses composantes naturelles. Rien n'empêche de croire que toutes ces pièces ont été fabriquées à partir de la même terre.
Le dégraissant ajouté (calcaire et calcite broyés) est le même pour tous les vases, si ce n'est :
- que sa taille et son calibrage varient entre les pièces fines (dégraissant bien calibré de petit module) et les pièces de grande taille (calibrage et répartition moins réguliers) ;
- que s'y ajoutent parfois des éléments végétaux (brindilles) qui se retrouvent calcinés dans la paroi ou bien y laissent des vacuoles allongées.
55
'.'".* ôlCËL ■_ ..M- v— : . >- •
Fig. 2 - Le pavage de dalles calcaires, au fond de la fosse de cuisson ; vue prise de l'ouest, échelle en dm (photo Gaud).
r
L
~l
J
2m
1m
CM
Fig. 3 - Relevé du pavage de la fosse de cuisson. On remarquera l'orientation convergente du pendage de la plupart des dalles calcaires.
Fig. 4 - Grande urne en céramique non tournée trouvée dans le four de Bezouce.
56
Fig. 5 - Profils des vases en céramique non tournée recueillis dans les cendres au fond de la fosse de cuisson.
57
L'aménagement des surfaces ne présente pas d'unité : il est variable d'une pièce à l'autre et dépend surtout de la forme du vase. Le lissage fini est le plus courant. Quelques coupes portent à l'extérieur un aménagement particulièrement soigné de l'épiderme.
Enfin, les traces de coups de feu nombreuses, les couleurs diverses de l'argile en surface et en épaisseur, variant entre chaque pièce, mais aussi entre différentes zones d'une même pièce, témoignent d'une cuisson peu maîtrisée, où les poteries étaient en connexion avec le combustible et où les réactions au feu purent être très variées selon la place de chaque vase dans le four.
3.2. MOTTES D 'ARGILE CUITE
Plusieurs mottes d'argile cuite ont été rencontrées dans les cendres. Deux d'entre elles ont été recueillies (fig. 6, A et B). Ces documents sont intéressants, car outre les précisions techniques qu'ils apportent, ils prouvent à eux seuls que l'on est en présence d'un four de potier.
En effet, trois observations peuvent être faites à leur propos : a) II ne s'agit pas d'argile native : à la terre est en effet mêlé un abondant dégraissant à base de calcaire et de calcite broyés, mal réparti et mal calibré (fig. 7, A et B). Ce dégraissant est de surcroît très semblable à celui que contiennent les tessons de vases associés, notamment les pièces de grande taille. On pourra en juger par la comparaison des photographies (agrandissement x 5) que nous donnons de l'aspect de l'argile et du dégraissant de la motte de notre fig. 6 A( = fig. 7 A), de la motte de notre fig. 6 B ( = fig. 7 B) et de l'urne de notre fig. 4 ( = fig. 7 C). Il est probable que les mottes d'argile cuite et les tessons de vases recueillis dans les cendres comblant la fosse ont été faits à partir des mêmes matériaux. b) Les mottes d'argile ont été pétries de main d'homme peu avant leur cuisson : c'est ce qu'indiquent les traces de doigts visibles un peu partout à leur surface. c) L'empreinte d'un fond de vase annulaire (du type de notre fig. 5, n° 8) dans l'une des mottes d'argile (fig. 6, A) prouve enfin qu'elles ont été utilisées comme cales pour la cuisson de vases dans un four. Il s'agit évidemment de cales très rudimentaires, utilisant des rebuts de pâte à poterie pour le même usage que celui qui est assuré, dans les fours plus récents, par les cales en forme de parallélépipède, de cylindre ou de disque (3).
4. Interprétation
Plusieurs éléments permettent d'identifier les découvertes de Bezouce comme les restes d'un four de potier. Outre les cales de cuisson décrites ci-dessus, on tiendra compte des observations suivantes : la couche de cendres et de charbons de bois ne contenait aucun reste de faune, comme c'est le cas pour les foyers culinaires rencontrés dans les habitats. Il ne saurait donc s'agir du
B
Fig. 6 - Cales en argile, contenant un abondant dégraissant de calcaire et de calcite broyés, trouvées dans les cendres au fond de la fosse de cuisson. Remarquer l'empreinte d'un fond annulaire de vase dans la motte d'argile A.
reliquat d'un fond de cabane protohistorique. Par ailleurs ,noute la poterie est ici du même type - céramique non tournée - à une époque qui connaît d'autres catégories de vases (amphores, céramiques fines tournées). Le pavage observé au fond de la fosse n'est pas plan, comme celui d'un sol (4), mais dessine une légère cuvette. Les pierres sont aussi brûlées en plusieurs endroits, et non pas seulement en un point donné, comme c'est le cas lorsqu'un foyer s'est installé sur un pavement. Enfin, le volume de cendre et de charbons de bois est important pour la surface concernée, et répond plus à la production d'un four qu'à celle d'un foyer domestique. On regrettera à ce propos qu'aucun charbon de bois n'ait été prélevé, et que l'on ne puisse donc pas avoir idée de l'espèce ou des espèces utilisées comme combustible.
Reste à déterminer le type du four de potier dont témoignent ces documents. L'aire de cuisson aménagée en plein air dans une légère fosse, sans aucune trace de structure en élévation, correspond à un mode de cuisson
3 - Voir par exemple G. Rancoule, Ateliers de potiers et céramique indigène du 1er s. av. J.-C, Rev. Arch. Narb., 3, 1970, p. 64, fïg. 25. 4 - Des sols pavés de lauses sont en effet connus dans certains fonds de cabane du let Age du Fer de la région, par exemple à La Iiquière (Calvisson).
58
défini comme primitif par M. Picon (5). En principe, ce type de cuisson procédait comme suit : les vases, préalablement séchés, étaient disposés sur une aire de cuisson ou dans une fosse ; on entassait ensuite par dessus le combustible (branchages) que l'on faisait brûler. Le contact des vases avec le combustible est visible sur les pièces de Bezouce : il est responsable des coups de feu et des différences de teinte observés sur l'épiderme extérieur de presque tous les fragments (voir ci-dessus).
Deux modes de cuisson primitive ont été distingués par M. Picon, selon que la cuisson {stricto sensu), qui est réductrice du fait de la richesse de l'atmosphère du four en produits volatils, est suivie d'une post-cuisson oxydante lorsque le feu diminue puis s'éteint (mode A) ; ou bien que la cuisson réductrice est suivie d'une postcuisson également réductrice, obtenue en couvrant le four de mottes de terre dans la phase finale de l'opération (mode B). Ici encore, l'examen des vases produits par le four montre clairement que la cuisson employée est du mode A : en effet, on observe assez régulièrement dans l'épaisseur des parois une texture plus ou moins zonée, de couleur différente en épaisseur et en surface. Ce trait caractérise les cuissons réductrices à post-cuisson oxydante. Seul un vase (fig. 5, n° 9) et intégralement très noir : mais il semble s'agir d'un spécimen accidentellement recuit.
5. Datation et comparaison
Le four de Bezouce n'est daté que par la typologie des vases qu'il a produits. L'ensemble appartient clairement au faciès du Vlème s. av. J.-C.. Quelques comparaisons de détail permettent de préciser un peu cette chronologie.
L'urne (fig. 5, n° 1) est semblable à des exemplaires recueillis à Calvisson , sur les oppida de La Liquière et de La Font du Coucou. Cette forme de vase, à col diver
gent légèrement concave, existe dans les niveaux de La Liquière I récent vers 600-580 av. J.-C. (6), de La Liquière II vers 580-540 (7) et de La Font du Coucou II ancien, vers 550-525 (8). Les coupes et les coupelles hémisphériques (fig. 5, n° 11 et 12) sont bien attestées dans les mêmes niveaux (9).
Les vases à embouchure rétrécie (fig. 5, n° 9), d'apparition ancienne au 1er Age du Fer, se retrouvent surtout dans les gisements de la fin du Vllème s. et du début du Vlème s., et ne semblent guère perdurer au- delà de 550 av. J.-C. (10).
Les bords d'urne présentant un méplat à l'intérieur sous la lèvre (fig. 5, n° 4), bien connus à la fin du Vllème s. (11), sont encore quelques fois attestés au début du Vlème s. (12), mais disparaissent peu après. Il en va de même des épaules d'urne ornées de méplats ou de cannelures larges, caractéristiques du Bronze final III B (13), qui subsistent à la fin du Vllème s. et au début du Vlème s. comme archaïsme (14).
Enfin, les boutons de préhension ovales percés d'un trou ne sont guère attestés dans la région à l'Age du Fer qu'au début de cette période (15).
Cet ensemble de remarques accrédite une datation dans la première moitié du Vlème s. av. J.-C, voire même dans les premières décennies de ce siècle, si l'on en juge par l'abondance relative des traits archaïsants dans les formes de la céramique.
On connaît très peu de fours du 1er Age du Fer dans le Midi de la France, si l'on élimine du moins les fours de petite dimension à sole en matière légère, du type d'Achenheim (Bas-Rhin) (16) ou de Sévrier (Haute- Savoie) (17). Des soles et des calottes en matière légère sont en effet connus dans les habitats des VII -Vlème s. du Languedoc (18) et de Provence (19), mais il n'est pas du tout prouvé que de tels fours servaient à la cuisson de poteries plutôt qu'à celle d'aliments. La présence de ces restes de fours à sole à l'intérieur même des cabanes semble au contraire favoriser la seconde hypothèse,
5 - M. Picon, Introduction à l'étude des techniques des céramiques sigillées de Lezoux, Centre de Recherches sur les Techniques Gréco-Romaines, n° 2, Dijon, 1973, p. 68-70.
6 - Par exemple M. Py, L'oppidum des Castels à Nages, Gard, fouilles 1958-1974, 35ème suppl. à Gallia, Paris, 1978, p. 37, fig. 9, n° 15. 7 - Ibid, p. 39, fig. 10, n" 17. 8 - Par exemple M. Py et C. Tendille, Fouille d'une habitation de la deuxième moitié du Vlème s. sur l'oppidum de la Font du Coucou, Rev. Arch. Narb., VIII, 1975,
p. 36 fig. 4 n° 1, p. 53 fig. 14 et p. 54 fig. 15 9 - M. Py, L'oppidum des Castels..., o.c, p. 37 fig. 9 n° 10 et 11 ; p. 39 fig. 10 n° 16 ; p. 41 fig. 11 n° 15.
10 - Par exemple au Vllème s. à La Redoute (B. Dedet, A. Michelozzi, M. Py, C. Tendille et C. Raynaud, Ugernum, Protohistoire de Beaucaire, cahier n° 6 de l'A.R.A.L.O., Caveirac, 1978, p. 66, fig. 44, n" 10 et 11) ; vers 600 dans la Grotte Suspendue à Collias( A. Coste, B. Dedet, X. GutherzetM. Py, L'occupation protohistorique de la Grotte Suspendue de Collias, Gard, Gallia, 34, 1976, 1, p. 146, fig. 17) ; à La Liquière à la fin du Vllème s. (M. Py, L'oppidum des Castels..., o.c, p. 34, fig. 8, n° 14) et au début du Vlème s. (M. Py et C. Tendille, Fouille d'une habitation..., I.e., p. 38, fig. 5, n° 2).
11 - Par exemple B. Dedet et alii, Ugernum..., o.c, p. 64, fig. 43, n° 2 et 3. 12 - M. Py, L'oppidum des Castels..., o.c, p. 37, fig. 9, n° 12, vers 600-580 av. J.-C. 13 - Voir B. Dedet et M. Py, Introduction à l'étude de la Protohistoire en Languedoc oriental, cahier n° 5 de l'A.R.A.L.O., Caveirac, 1976, p. 51, pi. III, n" 6 et p. 53, pi. IV, n° 10. 14- Ibid., p. 54, pi. VI, n" 14 (fin du Vllème s.) ; B. Dedet et alii, Ugernum..., o.c, p. 64, fig. 43, n° 2 (fin du Vllème s.) ; p. 63, fig. 42, n" 21 (début du Vlème s.). 15 - Cf. M. Py, Les oppida de Vaunage, fouilles 1958-1968, Thèse de Illème cycle, dact. , Montpellier, 1972, fig. 220, n° 176 et 177 (fin du Vllème s.) ; fig. 226, n' 254
(début du Vlème s.) ; fig. 232, n" 318 (milieu du Vlème s.). 16 - J.J. Hatt, Découverte à Achenheim d'un four de potier de la période des Champs-d'Urnes, Cah. Arch, et Hist. d'Alsace, 1952, p. 43-53. 17 - A. Boquet et J.P. Couren, Le four de potier de Sévrier, Haute-Savoie, Age du Bronze Final, Etudes Préhistoriques, 9, 1974, p. 1-6. Les auteurs prouvent la
tion du four en lui associant des tores d'argile rubéfiés sur une face. Or de tels tores existent à l'entour de tous les foyers culinaires de l'époque, et leur destination, la plupart du temps domestique, ne saurait indiquer sûrement la cuisson de poteries.
59
A
Fig. 7 - Macrophotographies de la pâte des mottes d'argile (A et B) et d'une urne du four de Bezouce (C) (A C = fig. 4 et fig. 5, n" 1). Grossissement x 5.
figure 6 A ;, B = fig. 6 B
60
de même que la comparaison possible avec les fours en calotte de la fin de l'Age du Fer fouillés dans la même région et interprétés comme des « fours à pain » (20). De toutes façons, la faible contenance des fours à sole percée du Bronze final et du 1er Age du Fer interdirait d'y voir le seul mode de cuisson utilisé pour la céramique, puisque près de 50 % des vases de fabrication indigène contemporaine auraient été trop grands pour y entrer. Est-il bien logique de supposer un instrument de cuisson différent pour les petits vases et pour les grands ? Cet usage, jamais attesté par la suite, ne semble pas compatible avec les coutumes artisanales en ce domaine, ni avec la présence, dans le cas de Bezouce, de vases petits et grands dans la même fournée (21).
Une aire de cuisson de poteries selon le mode primitif défini par M. Picon, assez semblable à celle de Bezouce, a été découverte dans le tenement de Saint - Jean-de-Cas à Mailhac (22). Ce gisement appartient à la troisième période du 1er Age du Fer de M. Louis, O. et J. Taffanel, soit à la deuxième moitié du Vllème s. av. J.- C. Le foyer (aire de cuisson A) s'étendait sur 1,20 m de diamètre. Les cendres, en dôme, atteignaient une épaisseur de 0,25 m. La sole n'était pas pavée, mais directement sur la marne naturelle, qui était rougie profondément. Des morceaux de torchis mêlés de paille, retrouvés sur les vases écrasés dans les cendres, ont été interprétés par les auteurs comme une preuve que la meule de branchages était recouverte d'argile pendant la cuisson. Ce dernier point n'est pas assuré, car la texture zonée des parois des vases de Saint-Jean-de-Cas semble, comme à Bezouce, être l'effet d'une post-cuisson oxydante.
On a signalé des fosses de cuisson de Provence, mais ces découvertes anciennes sont peu utilisables (23).
En tout état de cause, la rareté de tels témoins s'explique avant tout par le fait que les fours de potier devaient se trouver souvent, de même qu'à Bezouce, en dehors des habitats. En effet, on n'a jamais signalé de restes clairement identifiables à des fours de potier dans les agglomérations du 1er Age du Fer du Midi, contrairement à la période suivante (24).
A Bezouce du moins, aucune trace d'habitat contemporain n'a été relevée à proximité. Les gisements les plus proches dans l'espace et dans le temps (fig. 1) appartiennent au Bronze final II et III (cabanes des environs de la source d'Arnon, à Cabrières) (25), ou aux VI- Illème s. av. J.-C. {oppidum de Roquecourbe, à Marguerittes) (26). Un niveau d'habitation (sondage 3, zone 3c, couche 4) et quelques tessons recueillis en surface sur ce dernier site (fragment de bucchero new étrusque, épaule d'urne à méplats) (27) pourraient être éventuellement contemporains.
Reste à se demander pour quelle raison le four de potier de Bezouce a été établi dans le Quartier des Fours à Chaux, à un endroit éloigné de tout point d'eau et de tout banc d'argile évident (28). Des sources existaient- elles alors non loin de là ? Le montage des vases se faisait-il ailleurs que leur cuisson, elle-même située en un endroit boisé où le combustible était à portée de main ? Nous ne savons pas répondre à ces questions.
6. Conclusion
La découverte de Bezouce présente donc un intérêt certain : bien que toutes les observations souhaitables n'aient pu être faites sur les conditions de gisement, les données recueillies permettent d'affirmer que l'on est en présence d'un four de potier, ayant fonctionné durant la première moitié du Vlème s. Les caractères techniques de ce four (aire de cuisson dallée), des instruments (cales de cuisson) et des rebuts (céramiques non tournées) qui lui étaient associés, ont permis de supposer un type de cuisson primitive à post-cuisson oxydante .
Il est remarquable que ce four ait été isolé en dehors du village correspondant. Même si une telle situation reste peu justifiable dans l'état actuel des données, on pourrait par hypothèse y trouver l'explication de la rareté des découvertes de fours de potier du 1er Age du Fer dans le Midi de la France, bien qu'on y connaisse de nombreux habitats.
Michel PY
18 - A Mailhac (M. Louis, O. et J. Taffanel, Le Premier Age du Fer languedocien, I, 1955, p. 86, fig. 56 : tores et fragment de sole percée) ; à La Liquière (tores et soles percées inédits) ; à La Redoute (Ugernum.. . , o.c. ) ; à Comps (sole percée, inédite) ; à La Roque de Fabrègues (P. Larderet, L 'oppidum préromain de La Roque, commune de Fabrègues, Hérault, Gallia, XV, 1957, 1, p. 17, fig. 12 : tore et sole percée) ; etc..
19 - A Saint-Biaise (P. Arcelin, La céramique indigène modelée de Saint-Biaise, Paris, Ophrys, 1971, p. 64-65 : tores et soles percées) ; à La Couronne (Ch. Lagrand, Un habitat côtier de l'Age du Fer à l'Arquet, à La Couronne, Bouches-du-Rhône, Gallia, XVII, 1959, 1, p. 198 et pi. IX, n° 1 : sole percée).
20 - M. Py, L'oppidum des Castels..., o.c, p. 136, fig. 69 à 71 ; P. Arcelin, La céramique indigène..., o.c, p. 64 ; L. Chabot, Découverte de fours à pain en pisé dans les oppida de la Tène III de la périphérie de l'étang de Berre, cahier n° 6 du Centre de coordination des Sociétés Archéologiques de Provence, 1978, p. 1-17.
21 - La plupart des auteurs méridionaux s'accordent avec nous pour exclure l'usage artisanal des petits fours à sole percée comme fours de potier ; ainsi O. et J. Taffanel, o.c, infra, p. 11 ; Ch. Lagrand, I.e., p. 195-196 ; et P. Arcelin, o.c, p. 65.
22 - 0. etj. Taffanel, La céramique du 1er Age du Fer à Mailhac, Aude, Bull. Soc. Et. Scient, de l'Aude, LVI, 1956, p. 9-19. 23 - P. Arcelin, o.c, p. 20, note 10. 24 - Fours du Ilème s. à Nages (M. Py, L'oppidum des Castels..., o.c, p. 122-123 et p. 321-322) ; fours du 1er s. de La Lagaste (G. Rancoule, I.e.). 25 - Gisements récemment identifiés, inédits. 26 - M. Py, Première exploration de l'oppidum proto historique de Roquecourbe, commune de Marguerittes, Gard, Bull, de l'Ecole Antique de Nîmes, n° 11-13, 1976-
1978, p. 31-35. 27 - Ibid., p. 34 et p. 50, fig. 11, n° 16 à 24. 28 - Le point d'eau actuellement le plus proche est la source de la Bastille, à près de 2 km du gisement.