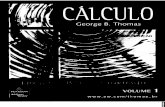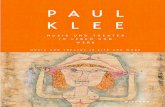Thomas Unger
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Thomas Unger
Thomas Unger
LE DUEL DANS LE JOURNAL DES TRIBUNAUX À LA BELLE-EPOQUE (1881-
1900).
Quand juristes et journalistes se rendaient sur le
pré.
Travail réalisé dans le cadre du séminaire d’approchescritiques d’histoire du droit
Correcteur : Jérôme de BrouwerMaster 1 Droit – Finalité civil et pénal
Université Libre de BruxellesAnnée académique : 2014-2015
1
L’illustration de la page de garde est tirée de L'Illustration n°2205 du 30 mai1885, et représente le duel de MM. Chapuis et Dekeirel (gravure).
INTRODUCTION
« Les journalistes ne se sont pas toujours uniquement envoyés despiques sur Twitter »1
Au cours des siècles, le duel a subi des alternancesd’expansion et de relâchement. Mais il semble que son apogéeait été atteinte au cours des XVIIe et XIXe siècles2. Autrefois3
privilège de la noblesse4, le duel, fréquemment conséquenced’une certaine pratique de l’« esprit » 5, acquit ses lettresde noblesse en France au XIXe siècle6. En effet, à la Belle-
1 X., « Quand les journalistes allaient sur le pré », Le Postillon,octobre/novembre 2014, n°27. 2 X. DE GRANIER DE CASSAGNAC, « Le duel », Conférence en août 1988 à Soulan(Ariège), La Réveillée, pp. 81 à 90. Voy. not. sur le duel aux XVIe et XVIIe
siècles : F. BILLACOIS, Le duel dans la société française des XVIe-XVIIe siècles. Essai depsychosociologie historique, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes enSciences sociales, 1986. 3 Notamment au XVIIe siècle. 4 L’aristocratie, ayant le privilège de l’épée, sortait la lame du fourreautantôt pour des motifs graves (querelles de famille), tantôt des motifsplus futiles (questions de préséance), parfois même gratuitement pour fairedémonstration de son courage personnel. Voy. X. DE GRANIER DE CASSAGNAC, op.cit., p. 81.5 Saint-Simon, le premier dans l’histoire, a pu montrer que l’on pouvaitfaire de la grande littérature avec de très mauvais sentiments. Voy. ensens le florilège de citations contextualisées recueillies par FrançoisXavier Testu (Le bouquin des méchancetés et autres traits d’esprit, Paris, EditionsRobert Laffont, 2014). 6 Sans qu’elle puisse se targuer d’en avoir le monopole. F. X. TESTU (Lebouquin des méchancetés et autres traits d’esprit, Paris, Editions Robert Laffont, 2014)cite de très nombreux auteurs et beaux esprits étrangers.
2
Epoque, la politique conduisait journalistes et bourgeois à serendre sur le terrain pour en découdre.
Afin de comprendre notre démarche, commençons par lacontextualiser. Dans le cadre du master en droit del’Université Libre de Bruxelles, nous choisissons un coursd’approche critique, en l’occurrence celui traitant des« Questions approfondies d’histoire du droit », lequels’intéresse spécifiquement au Journal des Tribunaux vers la fin duXIXe siècle. Deuxièmement, afin de déterminer lespréoccupations des rédacteurs de l’époque, nous avons comptélors de nos lectures le nombre de lignes dévolues à chaquethématique récurrente (chaque groupe d’étudiants analysant uneannée de J.T.). Tenant compte de la place éditoriale limitée,nous sommes partis du postulat que les rédacteurs de l’époque,dont Edmond Picard, ont du faire des choix, en fonction deleurs intérêts et des préoccupations de leurs contemporains.
Personnalité d’envergure assez exceptionnelle7 quoiquecontroversée8, Edmond Picard (1836-1924) est un juriste9 auquelil est encore fait référence de nos jours10. En 1881, il fondale Journal des Tribunaux qui parait encore de nos jours. Il en futle rédacteur en chef jusqu’au tournant du siècle11. Encollaboration avec Napoléon d’Hoffschmidt et Jules De Le
7 Pierre Henri le classe parmi les trente-six « grands avocats de Belgique » ets’interroge comment, « sans trahir, dépeindre en quelques pages celui qui fut le colosse dubarreau belge ? » P. HENRI, Les grands avocats de Belgique, Bruxelles, J.M. Collet,1984, p. 154). Un an après sa mort, le 19 février 1925, on installa aupalais de justice son buste, occasion pour laquelle « les plus hautesautorités lui rendirent un hommage solennel » (P. HENRI, Les grands avocats deBelgique, Bruxelles, J.M. Collet, 1984, p. 164). 8 Il était un antisémite notoire. Voy. not. la « mise en accusation »posthume de F. RINGELHEIM (Edmond Picard, jurisconsulte de la race, Bruxelles, Larcier,1999) que B. Coppein n’hésite pas à qualifier de « pamphlet » (B. COPPEIN,« Edmond Picard (1836-1824), avocat bruxellois et belge par excellence dela deuxième moitié du XIXe siècle », sous la direction de V. Bernaudeau etal., Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 225). 9 Jurisconsulte, avocat à la cour d’appel de Bruxelles, bâtonnier,professeur de droit, écrivain, dramaturge, sénateur, etc.10 Voy. en ce sens : J. DE BROUWER, « Des bougies pour le palais de justicede Bruxelles – Le symposium Edmond Picard », J.T., 2013, p. 707. 11 D. STERCKX, « Un siècle de J.T. : 1881 – 1900 », J.T., 1982, p. 262.
3
Court, il se lança également dans la titanesque entreprise derédaction des encyclopédiques Pandectes belges12 13, encollaboration avec Ferdinand Larcier14.
Nous avons constaté avec surprise la récurrence des articlesportant sur le duel, qui, par ailleurs, se révèlent parfoistrès longs ! Partant, nous avons établi des graphiques (voy.annexes) qui témoignent de l’évolution de l’intérêt desrédacteurs : le premier détaillant l’évolution annuelle dunombre d’articles (annexe 1) ; les suivants l’évolutionannuelle du nombre de lignes qui y sont consacrées (annexes 2et 3).
Divers articles biographiques publiés dans le Journal des Tribunauxdepuis la mort de l’éminent Picard ont évoqué la figure de cerédacteur à travers différents sujets (son antisémitisme, sonengagement social, etc.). Cependant, aucun ne l’a abordée sousl’angle du duel. D’aucuns seraient dès lors tentés d’affirmerque cette porte d’entrée est inadéquate car trop superficielle
12 Les Pandectes belges est une encyclopédie juridique monumentale qui futlancée par Edmond Picard en 1878. Il y resta attelé jusqu’à la fin de savie en surveillant méticuleusement les apports de ses collaborateurs. LéonHennebicq (1971-1940), « héritier intellectuel » de Picard, donna suite à cemonument avec les Novelles. Voy. en ce sens : B. COPPEIN et J. DE BROUWER,Histoire du barreau de Bruxelles, 1811-2011 / Geschiedenis van de balie van Brussel,Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 153 et 154 et P. HENRI, Les grands avocats deBelgique, Bruxelles, J.M. Collet, 1984, p. 157. 13 Picard peut être classé parmi les industriels littéraires du XIXe siècle[terme déjà utilisé pour qualifier Honoré de Balzac (C. A. SAINTE BEUVE, « Lalittérature industrielle », Revue des deux mondes, t. 19, 1839, p. 684)]. Eneffet, quand n’utilisait pas sa plume pour ces publications sur l’art (cf.pour une énumération de celles-ci, voy. l’appendice littéraire de F.VERMEULEN, Edmond Picard et le réveil des lettres belges (1881-1888), Bruxelles, Palais desAcadémies, 1935, pp. 89 à 95), il s’attelait à la rédaction d’articles dansdes revues juridiques qui se succédaient à un rythme effréné. Les jeudisétaient consacrés au conseil d’administration des Pandectes et les lundis aucomité de rédaction du Journal des Tribunaux. Un bureau fut même aménagéspécialement pour lui aux imprimeries Larcier. Voy. en ce sens A. PASQUIER,Edmond Picard, Collection Nationale, Bruxelles, Office de publicité, 1945, pp.12 et 13 (ouvrage souffrant d’une approche hagiographique d’après BartCoppein, op. cit., p. 225).14 Sur la maison Larcier, voy. : P. JANSSENS (réd.), Fiscaal Recht Geboekstaafd.Geschiedenis van het Belastingrecht van Perkament tot Databank, Bruxelles, FiscaleHogeschool, 1995, pp. 49 à 50 cité par B. COPPEIN, op. cit., p. 229.
4
et ne mettant pas en lumière les grands évènements ou traitsde l’époque. Dans cette optique, ce travail ne pourrait, parconséquent, rendre compte de l’esprit de Picard, du Journal desTribunaux et, a fortiori, de l’époque.
Toutefois, nous soutenons que le duel est une pratique typiquede la Belle Epoque qui souligne le côté « romantisme social »et donne « son panache au journal [et qui] dispar[u] avec la guerre, lebouleversement des mœurs et l’effacement d’Edmond Picard »15.
En réalité, la question posée est très simple : « pourquoi etcomment le Journal des Tribunaux évoque-t-il itérativement leduel ? ». Pour ce faire, nous procéderons en deux temps : dugénéral (chapitre I – L’honneur est dans le pré) auparticulier (chapitre II – Quand Picard allait sur le pré) ;du global à la personne d’Edmond Picard.
CHAPITRE I – L’HONNEUR EST DANS LE PRÉ
Après quelques brèves précisions, historiques (section I) etjuridiques (section II), nous entrerons pleinement dans lecorps du sujet, le duel au siècle du fer et de la vapeur16.Pour ce faire, deux questions retiendront notre attention :d’une part, qu’est-ce qui peut pousser un individu, à unmoment donné, à risquer sa vie en défiant ou en accepter unduel ? (section III) ; et d’autre part, quels sont lesfacteurs menèrent à ce que le duel soit accaparé par denouvelles catégories sociales ? (section IV). Enfin, de façonplus générale, nous clôturerons ce chapitre par une sectionconsacrée à « l’honneur », concept au coeur de notrethématique (mais pas seulement) (section V).
§1. - Un vieux jouet acquis par droit de conquête
Si le choix du duel comme sujet en histoire du droit ne doitpas surprendre, la période qui constitue le champ de notre
15 A. GUISLAIN, « Le “Journal des Tribunaux”, reflet de son temps », J.T.,1960, n°4271, p. 229. 16 F. GUILLET, La Mort en face. Histoire du duel en France de la Révolution à nos jours, Paris,Aubier, 2008, p. 431.
5
étude peut étonner. En effet, cette pratique a une forteconnotation aristocratique et l’on peut s’étonner de sapersistance au XIXe siècle, siècle de domination bourgeoise17.La prophétie de François Gorguereau (selon laquelle « Le duel,invention des gentilshommes, ne peut leur survivre ») ne s’est pasréalisée18, car « [e]n pénétrant dans le vieil arsenal de la féodalité, le tiersétat y a trouvé, parmi les dépouilles des vaincus, l’épée du duel, saisie par droit deconquête, et l’on conçoit que, dans les premiers temps de son triomphe, il ait éprouvéune joie d’enfant à manier cette arme dont il lui avait été interdit jusque-là de seservir »19.
Bien que le Journal des Tribunaux cessa prématurément d’y accorderde l’importance (bien que le phénomène se poursuive20), n’yfaisant plus, dès 189821, mention ; il constata lui-même lapersistance du « duel, [qui], contrairement à la guerre, n’a peut-être jamaisautant sévi avec plus d’intensité que dans le temps présent (...). La questionn’est pas localisée dans les journaux politiques ; de graves Revues croient devoir luioffrir asile dans leurs colonnes (...) »22.
Le phénomène a encore pu être observé jusqu’il y a peu. Ledernier duel opposa en 1967 le député-maire socialiste deMarseille, Gaston Deffere, à un collègue gaulliste de larégion parisienne, René Ribière. Celui-ci avait été traité17 A.-J. ARNAUD, Essai d’analyse structurale du Code civil français. La règle du jeu dans la paixbourgeoise, Paris, L.G.D.J., 1974.18 F. GORGUEREAU, Le duel considéré dans tous les rapports historiques, moraux et constitutionnel,et moyens de l’anéantir radicalement, Paris, Imprimerie de J. Gorsas, 1791, p. 199cité par F. Guillet, « L’honneur en partage. Le duel et les classesbourgeoises en France au XIXe siècle », Revue d'histoire du XIXe siècle, 34, 2007,p. 55. 19 E. CAUCHY, Du duel, considéré dans ses origines et dans l’état actuel des mœurs, Paris,Charles Hingray, 1846, p. 15 cité par F. GUILLET, « L’honneur en partage(...) », op. cit., p. 55. 20 Voy. chapitre I, section I. 21 Nous avons consulté les tables des matières jusqu’en 1918. Par ailleurs,la publication du J.T. cessa à partir de juillet 1914 car « [d]epuis les vacancesjudiciaires de 1914, la justice belge a subi le joug de l’occupation. Le Journal des Tribunaux,organe libre d’un barreau libre, ne pouvait plus paraître, car son premier mot devait être uneprotestation indignée contre la plus monstrueuse atteinte au Droit et la plus flagrante violation de laparole donnée et de la Foi jurée (...) » (X., « 1914-1918 », J.T., 1918, n°2740, col.937). 22 C. A. CROABBON, « Comment peut-on remédier au duel », J.T., 1896, n°1213,col. 369.
6
d’ « abruti » en pleine séance. Mai 68, avec sa « joyeuse lessive deprintemps », mit fin à de tels « archaïsmes » et les méchancetés,épigrammes, piques, traits, mots d’esprits, jugés intolérablesfurent désormais soumis à l’arbitrage des magistrats23.
§2. - Quelques précisions juridiques
Nous survolerons successivement les régimes juridiquesapplicables en la matière en France (§1) et en Belgique (§2).Cette analyse, qui n’a point l’ambition d’être une étude dedroit comparé, a pour but de faciliter au lecteur lacompréhension des nombreuses affaires auxquelles nous nousintéresserons lors de nos développements ultérieurs. En effet,la plupart des duels (en tout cas ceux pour lesquels le Journaldes Tribunaux consacre plusieurs articles) ont soit lieu enFrance, soit en Belgique mais presque toujours entre Français.
§3. - En France
En France, contrairement à la Belgique, le duel ne figuraitplus parmi la liste des infractions réprimées par le Codepénal français. Dans le Code pénal de 1791, la suppression deslois édictées par la monarchie fut interprétée comme lareconnaissance d’un droit naturel, appartenant à chaquecitoyen, de porter les armes et de se défendre. Il s’agit peuou prou du raisonnement qu’invoquent, encore de nos jours, les(fervents) partisans du port d’arme aux Etats-Unis.
La Cour de cassation entérina, en 1819, cette interprétationen jugeant que le combat loyal, conduit selon des règles quigarantissent l’égalité et la réciprocité des chances, sortaitdu champ juridique couvert par le Code pénal. En effet, leditcode ne prévoyait aucune disposition expresse concernant cecas de figure. Par conséquent, la personne ayant donné la mortou infligé des blessures dans de telles conditions ne pouvaitêtre poursuivie24.
23 F. X. TESTU, op. cit., p. 7. 24 Affaire Brutus, Cass. fr. 8 avril 1819, Journal des audiences de la cour deCassation ou Recueil des arrêts de cette cour en matière civile et criminelle, publié par M. deSéligny, greffier en chef de ladite cour, Paris, Imprimerie J. Smith, 1819,
7
Confirmée par onze arrêts successifs, cette interprétationgarantissait une impunité quasi totale jusqu’en 1837, dated’un revirement de jurisprudence25, sans que cetteinterprétation nouvelle (appliquant aux conséquences du duel,homicide ou blessures, les dispositions générales du Codepénal) n’ait cependant de conséquence pratique, les jurysd’assises continuant à acquitter de manière systématique lesduellistes homicides jusqu’à la fin du siècle26.
§4. - En Belgique
Pour la Belgique, nous verrons d’une part comment étaitréprimée la pratique du duel (A.), et, d’autre part, nousenvisagerons une question spécifique : la Belgique était-ellele paradis des duellistes (B.) ?
§5. - L’état du droit Dès 1817, la cour supérieure de Bruxelles27 trancha la questionen stipulant que les dispositions relatives aux attentats surles personnes s’appliquaient28. Après la Révolution belge, la
pp. 209 à 220 cité par F. GUILLET, « L’honneur en partage (...) », op. cit., p.58.25 Cité par A.-M.-J.-J. DUPIN, Réquisitoires, plaidoyers et discours de rentrée prononcéespar M. Dupin, depuis le mois d’août 1830 jusqu’à ce jour, Paris, Joubert, tome 5, 1842, p.46. 26 F. GUILLET, « L’honneur en partage (...) », op. cit., p. 58.27 Cette cour de justice fut créée en 1814. M. Spruyt, avocat général, enrédigeait le « recueil des arrêts remarquables » (deux volumes par an) jusqu’en1833 (M. DUPIN, Manuel des étudiants en droit et des jeunes avocats. Recueil d’opuscules dejurisprudence, Bruxelles, Tarlier, 1835, p. 698), date à laquelle ce recueilde jurisprudence prit le titre de Jurisprudence de la cour de cassation et des coursd’appel du royaume (A. G. CAMUS et A.-M.-J.-J. DUPIN, Lettres sur la profession d’avocatpar Camus, Bruxelles, Tarlier, 1833, p. 162). Il y avait dans les Provincesméridionales de Belgique « deux Cours supérieures de justice, l’une à Bruxelles, l’autre àLiège » (X., « Chapitre II – Organisation judiciaire », Almanach de la cour desProvinces méridionales et de la ville de Bruxelles pour l’An 1828 à Bruxelles, vol. 12,Bruxelles, A. D. Stapleux, 1828, p. 119. Sur l’organisation judiciairebelge à cette époque, voy. : J.-P. NANDRIN, Hommes et normes : le pouvoir judiciaire enBelgique aux premiers temps de l'indépendance (1832-1848), 4 vol., thèse de doctorat enPhilosophie et Lettres, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain,1995. 28 Bruxelles, ch. de cass., 3 juillet 1817, Pas., p. 446 cité in Pand.,v° « Duel », t. 33, Bruxelles, Veuve Larcier, 1890, col. 1378.
8
nouvelle Cour de cassation29 se prononça en s’alignant sur lajurisprudence antérieure30. Cependant, plusieurs tribunauxcorrectionnels (sans parler de la témérité des tribunauxmilitaires) persistaient dans le système contraire. De sorteque la loi du 8 janvier 184131 fut votée (principale source desarticles du futur code pénal). Outre la loi sur le duelprécitée, les articles 423 à 433 du Code pénal belgerégissaient la matière32.
A la différence d’autres régimes, le Code pénal de 1867 nedéfinissait pas le duel. Dès lors, le duel était une purequestion de fait ressortissant du pouvoir d’appréciation destribunaux. Toutefois, il y avait tout de même certainesexigences : il était requis qu’il fut question : 1) d’un combatentre deux personnes ; 2) selon les règles arrêtées par l’usageet la loyauté (cela avait une incidence en cas d’emploi de lamain gauche, voy. infra) ; et 3) sous la présence etsurveillance de témoins33.
Sans doute le duel était-il réprimé, mais de façon peu sévèrecar « des peines trop sévères n’auraient pas manqué de froisser l’opinion publiqueet de provoquer une réaction en faveur des duellistes »34. Le système entierreposait en réalité sur ce que Croabbon appelait la « science dupoint d’honneur »35 et certains duellistes étaient reconnus commeexperts en la matière (voy. infra, les interventions de MM. de
29 Sous la présidence du baron Etienne-Constantin de Gerlache (1832-1867),fraîchement nommé le 4 octobre 1832. Voy. en sens : R. DEMOULIN, Biographienationale de Belgique, t. XXXIII, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1963-1964, col. 217 à 245. 30 Cass., 12 février 1835, Pas., p. 30 ; Cass., 6 mars 1835, inéd. ;Cass.,11 juin 1835, inéd. ; Cass., 12 novembre 1835, inéd., ; Cass., 22juin 1837, Pas., p. 108 cités in Pand., v° « Duel », t. 33, Bruxelles, VeuveLarcier, 1890, col. 1378. 31 Loi précitée, M.B., 8 janvier 1841, art. 9, 10 et 13, abrogée par la loidu 13 février 2005, art. 4. 32 Pand., v° « Duel », t. 33, Bruxelles, Veuve Larcier, 1890, col. 1375 et1376. 33 Ibidem, col. 1380 et 1388. 34 Ibidem, col. 1379 et 1380. 35 C. A. CROABBON, « Bibliographie », J.T., 1895, n°1107, col. 15. C’est nousqui soulignons.
9
Cassagnac, de la Forge, de Châteauvillard et du Hallay-Coetquen lors du duel Chapuis-Dekeirel).
Toujours selon le même auteur, le duel était « une des raresmatières du droit contemporain qui ne subsist[a] que par l’usage et la coutume. Lesquestions d’honneur cré[aient] vis-à-vis de ceux qui y figur[aient], desobligations et des droits. Et mêmes s’ils [n’étaient] point légalement reconnus, ils[n’étaient] point laissés à l’arbitraire des adversaires et des témoins. Unensemble de règles traditionnelles y form[ait] une véritable coutume presqueaussi impérieuse qu’une loi et dont il [était] souvent question dans les procès deduel pour l’appréciation de la conduite et de la responsabilité des adversaires et destémoins »36.
§6. - Honneur et préjugé Nous allons évoquer l’article intitulé « Duel », publié en1890 qui a pour intention de contredire le préjugé de l’époqueselon lequel la Belgique serait la « terre bénie des duellistes ». PourEdouard Clunet, « [c]ette idée, entretenue par le théâtre et le roman, est d’uneinexactitude absolue ».
Fort de quatre cent quarante-sept lignes, cet article deClunet37 traite de l’affaire du marquis de Morès et de CamilleDreyfus, ainsi que de l’affaire Decourcelle et Bauer38 ;celles-ci ayant pour cause la « question juive »39. Par36 C. A. CROABBON, ibidem, col. 14 et 15. 37 Avocat à la Cour d’appel de Paris. 38 E. CLUNET, « Duel », J.T., 1890, n°717, col. 641 à 652. . 39 Camille Dreyfus, député de Paris et directeur du journal La Nation, aurait,selon M. de Morès, été offensé celui-ci dans un article publié sur laquestion juive. La rencontre eut lieu à Commines, en Belgique. A l’échangedes deux premières balles, Dreyfus est touché au bras droit. Ce duel ne futpas recensé dans l’Annuaire du duel qui avait pour ambition d’être le« répertoire des affaires d'honneur » (J. FÉRRÉUS, Annuaire du duel, 1880-1889, Paris,Perrin & Cie, 1891, p. IV). En revanche, d’autres duels impliquant M.Dreyfus furent longuement traités par cet annuaire. On dénombre ceuxl’ayant opposé à Ernest Judet (le 13 juillet 1883), à Georges Martin (le 25janvier 1885 ; le motif était une dispute lors d’une réunion électorale), àAlbert Goullé (le 3 septembre 1885), Henri Rochefort (le 27 avril 1886),Ferdinand Duval (19 février 1888), Georges de Labruyère (le 17 octobre1888). Ces opposants étaient respectivement rédacteur à La France (Judet),rédacteur au Cri du peuple (Goullé), directeur de l’Intransigeant (Rochefort),ancien préfet de la Seine, conseiller municipal et directeur de la PetitePresse (Duval) et directeur de La Cocarde (Labruyère). Voy. J. FÉRRÉUS, ibidem,
10
ailleurs, il s’est avéré par la suite que la seconde affairen’eut même pas lieu en Belgique.
« A aller se battre en Belgique les étrangers risquent non seulement les ennuis et lespetites misères d’un déplacement, (...) mais encore les sévérités très réelles de laloi locale ». En effet, « le duel est puni par le Code pénal belge (...) quellequ’en soit l’issue. (...) alors que les duellistes jouissent en France, à l’heureactuelle, de la plus complète impunité (...). On se bat à Paris en toutquiétude »40.
Qu’en serait-il maintenant si les autorités belges arrêtaientces Français, allant se battre en Belgique, et une fois leduel terminé, repassant la frontière ? De l’avis du juriste,la chose n’est point concevable. Certes, « [l]e droit de poursuivrepar contumace des nationaux ou des étrangers qui ont violé la loi pénale belgeappartient incontestablement au parquet belge (...). Néanmoins, « si lesdélinquants sont français, la Belgique ne pourrait en obtenir la remise de la France,puisque cette puissance n’extrade pas ses nationaux. Si les délinquants sontétrangers, la France ne les délivrerait pas davantage, car le duel ne figure par parmiles délits mentionnés dans le traité franco-belge d’extradition du 15 août 1874 »41.
En outre, puisque le duel n’était pas réprimé en France, leprocureur de la République ne pouvait rien faire. En effet,l’article 5 du Code d’instruction criminel français, prévoyantle cas où un Français commettait un délit à l’étranger,disposait :
« Si le Français a été jugé définitivement à l’étranger, il ne peut plus être jugé enFrance. Si, au contraire, le Français n’a pas été jugé définitivement, le juge françaisest compétent, si et seulement si : le fait incriminé est puni par la législation françaiseet si le fait incriminé et puni par la législation du pays où il a été commis »42.
Toutefois, les choses pouvaient-elles se compliquer s’ils’avérait que l’un de ces duels s’était terminé par lablessure de l’un des adversaires (mort ou blessure grave ;auquel cas ce duel était puni conformément aux articlesrelatifs à l’homicide et aux blessures involontaires) ? Nonpp. 62, 119, 131, 152, 214 et 236. 40 E. CLUNET, « Duel », J.T., 1890, n°717, col. 644. C’est nous quisoulignons. 41 E. CLUNET, ibidem, col. 649 et 550. 42 E. CLUNET, ibidem, col. 650 et 551.
11
pas... force est de constater que le juge belge était, en cecas, dessaisi au profit du juge français.
En définitive, aucune autre démarche qu’une simpledénonciation au ministère des affaires étrangères n’étaitpossible pour le ministère public belge43.
§7. - Mais pourquoi risquer sa vie ?
Le duel n’ayant peut-être jamais autant sévi qu’à cetteépoque, nous allons tenter de lister les causes pouvantpousser un individu à risquer sa vie, soit en proposant derégler un litige sur le pré, soit en acceptant laditeproposition. Outre la lecture par les protagonistes de romanshéroïques (§1), divers facteurs menèrent à une croissance dunombre de duels : nous relevons non exhaustivementl’apparition des salles d’escrime dans les clubs (§2) ; laprise de conscience de l’économie d’un procès (§3) ; maisaussi et surtout la teneur que prend la conception de lagloire tirée d’un duel (§4).
§1. - La littérature
Le lecteur ne devra pas s’étonner que nous mobilisions diversromans du XIXe siècle44. Dans le cadre de ce travail, il nes’agit non pas d’une pédanterie stérile mais nous estimons queceux-ci étaient à l’esprit des spectateurs de la Belle-Epoque,témoins des perturbations sociales, littéraires et artistiquesde ce siècle des révolutions. Les rédacteurs du Journal desTribunaux, ainsi que les divers acteurs qui participent au« rituel duelliste » sont issus de la bourgeoisie45.
43 E. CLUNET, ibidem, col. 551 et 552.44 Voy. en sens : P. HAMON et A. VIDOUD, « Duel », Dictionnaire thématique du romande mœurs en France, 1814 – 1914, A.-I, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2008, pp.292 à 296. Voy. infra, en particulier le §4 de la présente section.45 Pendant la seconde moitié du siècle, la société belge subit unetransformation profonde. La révolution industrielle atteignit son apogée etla bourgeoisie (libérale ou catholique) possédait le pouvoir politique etla majorité des ressources matérielles. « La famille de Picard appartenait clairement àla bourgeoisie bruxelloise » selon Bart Coppein (op. cit., pp. 225 à 237).
12
François Vermeulen souligne cette inquiétude bourgeoise(« [celle-ci] étant presque tout entière composée d’hommes nouveaux ») dene pas rester des parvenus et, pour ce faire, de « s’inquiéter »de littérature et de poésie. Cette classe sociale ne voulaitplus laisser la Belgique à l’arrière-plan des nations, dans ledomaine des arts et des lettres46.
Ses membres, éduqués47, avaient sûrement en tête48 les figuresde Julien Sorel, Ryno de Marigny, Georges Duroy, PhilippeBridau et tant d’autres quand ils allaient sur le pré49.
§2. - Les clubs et les cercles
Les clubs et les cercles (ayant auparavant concurrencé lessalons dont la renaissance fut encouragée pendant le SecondEmpire) étaient fréquentés par de nombreux journalistes ethommes politiques. Ces lieux de sociabilité spécifiquementmasculine offraient souvent à leurs membres, sous la TroisièmeRépublique, une salle d’escrime50. En 1880, Bruxelles comptaittrois salles d’escrime (celles des maîtres Verheugen, Hennaertet Selderslagh). En décembre 1885, une école normale d’escrimeouvrit ses portes comme école militaire. Le Fencing-club fut le
46 F. VERMEULEN, op. cit., p. 23. 47 Le père Picard, François-David, également avocat, aimait s’entourerd’œuvres d’art et se faire réciter des scènes de Corneille et de Racine (E.PICARD, Confiteor, Bruxelles, Larcier, 1901, p. 159). Son fils, Edmond Picard,fut, plus tard, « tout aussi passionné de littérature que de droit » (P. HENRI, Les grandsavocats de Belgique, Bruxelles, J.M. Collet, 1984, p. 155). 48 Bien qu’Edmond Picard regrettait « la redoutable et pernicieuse influence qu’exerce surnous la littérature française » (Lettre de Picard à l’Evénement, 13 mars 1886 citéepar A. PASQUIER, op. cit., p. 19). 49 Respectivement héros du Rouge et le Noir de Stendhal, d’Une vieille maîtresse deJules Barbey d’Aurevilly, de Bel-Ami de Guy de Maupassant et de La Rabouilleused’Honoré de Balzac. En atteste la façon dont Picard se servi de cettelittérature dans sa querelle avec la Jeune Belgique à propos de l’Art socialqu’il défendait au détriment de l’Art pour l’Art : [« Edmond Picard aligneMolière, Balzac, Daudet, Cladel, Conscience ; Molière fustige les vices sociaux de son temps, Balzacdépeint la puissance grandissante de l’argent, Zola montre la déchéance de la bourgeoisie, etc. » (F.VERMEULEN, op. cit., p. 70). Ses opposants estimaient qu’ « une œuvre est belle ou nel’est pas ; le sujet et la matière ne sont d’aucune importance » (Jeune Belgique, 1er septembre1883, A. Giraud : l’Art social cité par F. VERMEULEN, op. cit., p. 70)].50 A. DE SAINT-ALBAN, A travers les salles d’armes, Paris, Librairie illustrée, s. d.,cité par F. GUILLET, « L’honneur en partage (...) », op. cit., p. 66.
13
premier des clubs à s’ouvrir à un « autre milieu social ».Installé dans la Galerie du Roi, sous la présidence du comtede Sauvage51 et la vice-présidence d’Eugène Anspach52, ce cerclefut à l’origine du rapide développement des cerclesbruxellois. En France, le journal Le Figaro avait sa propre salled’armes ! Des proches du rédacteur en chef du Journal des Tribunauxtémoignèrent d’un vif intérêt pour ce « noble art ». Parexemple, Albert Fierlants reconstitua à travers les âges desduels et organisait des expositions sur l’escrime. FrédéricRégamey devint le peintre attitré de ce petit monde (dontEdmond Deman53 et Emile Verhaeren54) et effectua des aquarellesdes membres du club nouvellement ouvert par Fierlants 55.
Perpétuellement en quête de reconnaissance56, Edmond Picardlança avec ses fils son propre club en 1892 : le cercle Arte etMarte qui eut pour maître d’armes M. Delhaise. Son siège futélu au Bain royal, rue de l’Enseignement. En juin 1895, leconseil d’administration de ce club était formé par Picard,son président, et Jacques des Cressonnières57, son secrétaire51 Nous n’avons pas été en mesure d’en savoir plus sur cette personne. 52 Eugène Anspach (1833-1890) était un avocat belge et ancien gouverneur deBanque nationale de Belgique. Voy. en ce sens : P. KAUCH, Biographie Nationale,t. XXIX, Bruxelles, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des BeauxArts, 1957, col. 123 à 126.53 Edmond Deman (1857-1918) est un libraire et éditeur d’art (A.RAITT, Edmond Deman éditeur (1857-1918) : Art et édition au tournant du siècle,coll. Archives du Futur, Bruxelles, Labor, 1997). 54 Pour plus d’informations sur la figure d’Emile Verhaeren, voy. : R. VANNUFFEL, « Verhaeren, Emile Adolphe Gustave », Nationaal biografisch woordenboek,part. 6, Bruxelles, Palais des Académies, 1974, col. 965 à 980 cité par B.COPPEIN et J. DE BROUWER, op. cit., p. 112. 55 P. ARON et C. VANDERPELEN-DIAGRE, Edmond Picard : un bourgeois socialiste belge à la fin dudix-neuvième siècle : essai d'histoire culturelle, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Artsde Belgique, 2013, p. 288. 56 En témoigne sa devise : « Je dérange ! » (M. LUCIEN, Eeckout le rauque,Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 1999, p. 59) ;forme courte de la maxime qu’adoptera plus tard Zitrone : «Qu'on parle de moi enbien ou en mal, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi ! ». A. Pelzer arrive à lamême conclusion que nous (« Edmond Picard ador[ait] que l’on parle de lui ! » (A.GUISLAIN, « Le “Journal des Tribunaux”, reflet de son temps », J.T., 1960,n°4271, p. 230).57 Jacques des Cressonnières fut en outre, avocat, président de laConférence du Jeune Barreau et exerça deux mandats de bâtonnier, voy.
14
et « main la plus légère du cercle »58. La formule privilégiée futcelle d’un « club où les gens de qualité sont mêlés à des professionnelsexigeants, et où il fait bon bavarder et se détendre après l’exercice »59. Choseencore inédite à Bruxelles, on opta pour un cercle à la foisculturel et sportif (des ateliers de sculpture et desconférences y furent tenus)60.
§3. - L’économie d’un procès
Le duel permettait parfois, dans certaines affairesfinancières, de faire l’économie d’un procès. Au sein de la «société », surtout parisienne, où se retrouvaient des groupes,souvent rivaux, issus de la politique, de l’argent ou desarts, l’opinion publique revêtait une importance primordiale61.
Investi du mandat de député (ou d’une fonction judiciaire) etassumant la direction d’un journal (souvent les deux à lafois62), les leaders s’affrontaient par la parole et par laplume. Les méchancetés les plus acerbes étaient mises parécrit. La pression était à ce point élevée qu’il ne subsistaitqu’une alternative : l’action en justice ou le duel63. Lapremière s’avérait extrêmement lente, onéreuse et, le plussouvent, inefficace, d’autant plus que les tribunaux,interprètes du Droit et chargés d’appliquer la loi, neprotègent, en fait, que « l’intérêt » ; l’honneur l’étaituniquement dans la mesure où il était lié à l’intérêt. Si bienque la réputation ne pouvant être rétablie par la justice, on
not. : B. COPPEIN et J. DE BROUWER, op. cit., pp. 151 à 153. 58 P. ARON et C. VANDERPELEN-DIAGRE, op. cit., p. 289. 59 P. ARON et C. VANDERPELEN-DIAGRE, ibidem, p. 289. 60 P. ARON et C. VANDERPELEN-DIAGRE, ibidem, p. 289. Le nom du cercle nous lerappelle également. 61 F. GUILLET, « L’honneur en partage (...) », op. cit.,p. 66.62 Edmond Picard est cité comme l’archétype de l’écrivain-journaliste ; ilavait d’ailleurs coutume de dire que s’il « n’avait pas exercé la profession d’avocat,[il] se serait fait journaliste » (A. GUISLAIN, « Edmond Picard, journaliste. Lecturefaite par M. Albert Guislain à la séance mensuelle du 9 octobre 1954 »,Bulletin de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, tome XXXII,n°3, 1954, p. 116 cité par C. VANDERPELEN-DIAGRE, « Ambivalent journaliste.Edmond Picard et la presse », Textyles, n°39, 2010, p. 27).63 X. DE GRANIER DE CASSAGNAC, op. cit., pp. 81 à 90.
15
en revenait à la réparation par les armes pour défendre sonhonneur64.
§4. - « A nous deux maintenant, Paris ! » 65 (tremplin social)
« Le duel constitue dans ces conditions un véritable tremplin pour tous lesambitieux, en particulier les journalistes, désireux de réussir dans ce monde »66. Lalecture du roman Bel-Ami de Guy de Maupassant atteste de cetteidée. Il y est dit de Georges Duroy (qui se battit contreLouis Langremont, journaliste pour La Plume) que « [s]on duel[l’]avait fait passer au nombre des chroniqueurs de tête de la VieFrançaise »67.
Le duel était à la fois une modalité d’affirmation desoi68 (« il faut entrer dans la vie avec un duel » est unemaxime qui a marqué les esprits69) et un signe de distinction,les nouvelles classes dirigeantes imitant les précédentes(« Est-ce que vous vous battriez, Messieurs, avec le premier venu ? »interrogeait d’ailleurs un plaideur dans l’affaire Chapuis-Dekeirel70).
Dans Le Rouge et le Noir (dont la vocation est d’être une Chronique duXIXe siècle), c’est le duel avec le chevalier de Beauvoisis quifait reconnaître socialement Julien Sorel. : en risquant savie et en affrontant la mort, il fait ses preuves71.64 X. DE GRANIER DE CASSAGNAC, ibidem, pp. 81 à 90. 65 Cette antonomase est une référence au personnage balzacien Eugène deRastignac, symbole littéraire de l’ascension sociale fulgurante (H. DEBALZAC, Le Père Goriot, Œuvres complètes de H. de Balzac, Paris, Calmann-Lévy, 1910, p.343). Aujourd'hui, le terme « Rastignac » est passé dans le langage pourqualifier quelqu’un d’arriviste, de « jeune loup aux dents longues ».66 F. GUILLET, « L’honneur en partage (...) », op. cit., p. 66. 67 G. DE MAUPASSANT, Bel-Ami, Ollendorf, Rencontre, 1901, p. 196. 68 F. GUILLET, « L’honneur en partage (...) », op. cit., p. 68. 69 Nietzsche, par exemple, écrit « J’entre dans la société avec un duel ; Stendhal a donnéce conseil » (D. FERNANDEZ, Dictionnaire amoureux de Stendhal, Paris, Plon-Grasset,2013, p. 123). 70 A. TAVERNIER, « Duel Chapuis-Dekeirel », J.T., 1885, n°246, col. 801 à 812.Sur ce duel, voy. infra, section V, §2. Adolphe Tavernier fut lui-mêmetémoin de Catulle Mendès le 11 juillet 1887, celui-ci ayant eu une« altercation violente » avec le baron René Toussaint (J. FÉRRÉUS, op. cit., p. 196).71 M. CROUZET, « Introduction », Le Rouge et le Noir de Stendhal. Préface,commentaires et notes de M. Crouzet, Paris, Librairie Générale française,
16
« Julien se bat pour un regard, il se bat contre n’importe quoi ; le duel qui mûritdepuis Besançon éclate à Paris. C’est un tournant dans sa carrière. Le baptême dufeu, le risque de la mort sont la vraie entrée dans la vie morale, la preuve qu’onexiste. Mais le duel dans le roman est partout : comme évènement, désiré, trouvé ;comme métaphore : tout danger, la guillotine, sont des duels, des combatssinguliers, les chances varient en probabilité, mais l’enjeu est toujours le même : Moi.Toujours armé, moralement ou physiquement, Julien est un duelliste permanent(...) »72.
§5. - Une récupération par les bourgeois, journalistes et politiques
Le propos de la présente section sera non pas comme à lasection précédente de se placer du point de vue de l’individumais d’appréhender le concept de façon sociologique. Il estsurprenant de constater qu’à l’époque, l’épée n’est plusl’attribut exclusif des aristocrates (§1). Elle fut récupéréepar les journalistes et politiques ; et c’est ce que nousmontrerons à travers certains faits divers particulièrementdéveloppés dans les pages désormais jaunies du Journal desTribunaux (§§2 et 3).
§1. - Généralités
Depuis la première moitié du siècle, le phénomène avaitpénétré toutes les couches de la société. Les milieuxd’affaires, les négociants, les commerçants, les artisans etjusqu’aux boutiquiers furent également concernés. Une affaireau retentissement considérable du début des années 1840 futcelle de la mort d’un marchand boucher tué dans un duel aupistolet par un premier garçon boucher73 !
Toutefois, durant la deuxième moitié du siècle, notamment enraison de la disparition des vétérans de l’Empire, ce qui fitperdre au duel sa dimension populaire, l’usage du duel fut peuà peu confiné au sein de quelques groupes sociaux parisiens.La Troisième République mit un terme à l’hégémonie de lanoblesse. C’est surtout à cette époque chez les journalistes
coll. « Le livre de poche classique », 1997, p. X. 72 M. CROUZET, ibidem, p. X. C’est nous qui soulignons. 73 Gazette des tribunaux, 30 janvier, 1er, 2, 3, 4 février, 14 et 15 août 184,cité par F. GUILLET, « L’honneur en partage (...) », op. cit., p. 62.
17
et les hommes politiques que cette forme de règlement desconflits acquit un caractère distinctif74.
De par son pouvoir, la presse représentait dorénavant un enjeuessentiel pour les groupes sociaux qui sont les plus exposés àses investigations. En effet, son contenu pouvant être connude tous, elle était capable d’humilier la victime du moindreincident (une mauvaise place dans un dîner officiel parexemple ou être l’objet de la moindre assertion calomnieuse).Elle rendit aussi plus ténue la frontière entre vie privée etvie publique75. Le récit du duel et parfois sa représentationsous forme d’image (comme c’est le cas pendant la très célèbreaffaire Dreyfus pour le duel opposant, le 5 mars 1898, lecolonel Henry au colonel Picquart, qui fait la couverture dusupplément illustré du Petit Journal ou celui opposant MM. Chapuiset Dekeirel76) prend le pas sur sa réalité et devient l’élémentprincipal du rituel ; d’où les accusations de mascaradesouvent proférées à l’encontre de cette coutume.
Alors que pour la première moitié du XIXe siècle les archivesjudiciaires et les comptes rendus de la Gazette destribunaux fournissaient l’essentiel des sources de l’histoire duduel, ce sont les journaux, surtout après la loi de 1881, quien devinrent les principaux éléments d’information pendant laseconde moitié du siècle. Cette mise en scène de l’honneur estaussi une mise en abîme puisque beaucoup de ces combats sontle fait de journalistes qui se battent en raison d’articlesparus dans leurs journaux respectifs77.
§2. - Le duel Drumont-Meyer (1886)
Notre premier exemple est développé dans deux des nombreuxarticles des éditions de 1886. Ils relatent le duel opposantMM. Drumont et Meyer et ses suites judiciaires.
74 F. GUILLET, ibidem, p. 64. 75 F. GUILLET, ibidem, p. 69. 76 Voy. page de garde. 77 F. GUILLET, ibidem, p. 65.
18
La chronique judiciaire du numéro 330 du journal (nonante etune lignes) annonça une conférence, donnée par Alexandre deBurlet78, portant de manière générale sur le duel, et enparticulier celui opposant Drumont et Mayer, le premier étantun antisémite notoire, auteur d’un livre dont l’ambition étaitde se poser « contre les Juifs »79. Comme le relève l’article« Duel » du Dictionnaire thématique du roman de mœurs en France,l’affaire Dreyfus démultiplia les duels qui défrayèrent lachronique littéraire et politique80.
Cette affaire81 occupe, peu ou prou, le même nombre de lignesque l’affaire Chapuis-Dekeirel (précisément mille trois centquatre-vingt-six lignes, réparties en trois articles82) Celle-ci fit l’objet d’un procès devant la 10e ch. du Tribunalcorrectionnel de Paris. L’Annuaire du duel83 nous apprend que laraison de ce duel fut la publication de La France juive, livreécrit par le directeur du Monde, Drumont, (ce sera égalementla raison du duel daté 19 avril avec Charles Laurent,directeur du journal Paris84) visant nommément M. Meyer,directeur du Gaulois. Comme Dekeirel, Meyer écarta par deux foisl’épée de son adversaire par la main gauche et blessa sonadversaire.
Meyer invoqua deux moyens pour échapper à la qualification de« blessures et coups volontaires » (article 309 du Code pénalfrançais) ; si cette qualification est confirmée par le juge,
78 Avocat (au département des chemins de fer) et frère de Jules de Burlet,ministre de l’intérieur, chef de cabinet et sénateur provincial. Voy. ensens : X., « Jules de Burlet », Hommes du jour, Revue biographique de la politique, dessciences, des arts, de la littérature, etc. (1883-1896), n°5, 1895-1896. 79 X., « Le duel Meyer-Drumont », J.T., 1886, n°330, col. 591 et 592. 80 P. HAMON et A. VIDOUD, op. cit., p. 292. 81 Datée du 24 avril 1886. Edouard Drumont eut également affaire à CharlesLaurent, directeur du Paris, le 19 février de la même année (cf. J. FÉRRÉUS,op. cit., pp. 150 et 151). 82 X., « Le duel Meyer-Drumont », J.T. 1886, n°345, col. 817 à 832 ; n°346,col. 833 à 844 ; et n°357, col. 849 à 862. 83 J. FÉRRÉUS, op. cit., p. 151.84 J. FÉRRÉUS, ibidem, p. 150.
19
elle entraine pour l’auteur de l’infraction la réclusion85.Selon l’accusé, il ne fut pas établi qu’il y ait eusimultanéité de la blessure et du coup porté quand il écartal’épée avec la main gauche qui, de toute façon, relevait dumouvement instinctif, et non d’une intention délibérée86. Aufinal, il fut condamné à 200 francs.
§3. - Le duel Naquet-Menvielle (1888)
En 1887, les deux cent septante-cinq lignes de l’uniquearticle de l’année consacré au duel évoquèrent le même pointde droit : « l’emploi de la main gauche dans les duels »87. Ils’agit de l’affaire Naquet rendue par le tribunal de Grenobleopposant Naquet, rédacteur en chef du journal le Petit Dauphinois,et Menvielle, rédacteur en chef du Réveil du Dauphiné. Ce duel futégalement indiqué dans l’Annuaire du duel88 qui indique qu’il s’estdéroulé en juillet 1887. Leurs différends apparurent pour lapremière fois à l’occasion d’une élection locale.
Le Petit Dauphinois du 3 mai 1887 tira le premier coup :« M. Menvielle raconte que l’ayant rencontré au café Cartier, je lui ai offert unepoignée de main, comme d’habitude, et qu’il l’a refusée. Qu’est-ce que cela prouve ?Rien, si ce n’est qu’un burgrave (vieillard dont les idées paraissent démodées) peutavoir un meilleur caractère qu’un bébé, voilà tout. D’ailleurs l’impertinence n’a jamaissauvé personne du ridicule et M. Menvielle aura peut-être l’occasion de s’enapercevoir »89.
Le Réveil du Dauphiné, le 7 mai 1887, répondit :
85 « Sera puni de la réclusion, tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups, s’il estrésulté de ces actes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingtjour ». 86 X., « Le duel Meyer-Drumont », J.T., 1886, n°437, col. 862. ==> bonneréférence ?87 X., « Chronique judiciaire. L’emploi de la main gauche dans les duels »,J.T., 1887, n°455, col. 1077 à 1080. 88 J. FÉRRÉUS, op. cit., p. 197. A la lecture de cet annuaire, aucun autre duelne semble avoir impliqué l’un de ces journalistes, même si Naquet futquelques fois témoins (not. celui de MM. Jacob et Devries, les 22 et 26avril 1882). 89 Cité in X., « Quand les journalistes allaient sur le pré », Le Postillon,octobre/novembre 2014, n°27.
20
« Le sort du Petit Dauphinois ne nous touche que médiocrement, mais nousplaignons le public qui pourrait chercher dans ses colonnes une orientationpolitique »90.
Le 2 juillet 1887, la querelle se poursuivit : « Un petit bonhomme sans importance, mais non sans jactances, s’avise de reprendrepour son compte une allusion plus bête que méchante (…) Il s’agit toujours de cesfameux fonds secrets où sont parfois obligés de puiser les journaux sans clientèle etsans acheteurs, tels, par exemple, que celui qui achève sa malheureuse existencedans le cloaque de la rue Servan. On ne répond à de telles choses et à de tels gensque par le mépris et le dédain. C’est ce que je fais »91.
Dans Le Réveil du Dauphiné du 13 juillet 1887, on pouvait lire que :« L’étonnant bonhomme qui passe sa vie à falsifier l’histoire dans son arrière-boutique de la rue du Quai publie ce matin une facture d’une si abracadabrantefantaisie que je suis bien forcé de m’occuper une fois encore de sa triste personnalité.(…) Si M. Naquet, cependant habitué au rasoir, n’a pas compris que c’était laréponse au “jeune homme” dont il m’avait agacé dans la conversation, c’est quedécidément l’ossification est complète chez lui »92.
Ces échanges menèrent à un duel dont les faits sont semblablesà ceux décrits dans l’affaire Chapuis-Dekeirel. Naquet fit une« parade » de la main gauche (il a même saisi l’arme à pleinemain pour la maintenir) afin d’utiliser la main droite. Laquestion de savoir si la manœuvre constitua un « coupd’assassin »93 se posa à nouveau. L’absence de simultanéitétrahirait la volonté de l’auteur et semblerait exclure enl’espèce un réflexe. En l’espèce, l’absence de corps à corpsexclut l’invocation par Naquet de la légitime défense.
« Attendu que, au surplus, le tribunal n’a pas à se préoccuper des discussionsrelatives à l’usage de la main gauche dans le duel ; car il est aujourd’hui bien établique Naquet ne s’est pas borné à parer de la main gauche, ce qui d’après son propreaveu, aurait été blâmé sévèrement par le jury, mais qu’il a réellement saisi l’épée etparalysé ainsi la défense de son adversaire qu’il blessait en même temps. (...)ainsi s’est-il rendu coupable du délit puni par l’art. 311 du code pénal » 94.
90 Cité in X., ibidem, n°27.91 Cité in X., ibidem, n°27.92 Cité in X., ibidem, n°27.93 X., « Chronique judiciaire. L’emploi de la main gauche dans les duels »,J.T., 1887, n°455, col. 1078. 94 X., ibidem, n°455, col. 1079.
21
En premier degré, la juridiction prononça une « condamn[ation]à deux mois d’emprisonnement et à 200 francs d’amende envers l’Etat, ainsi qu’entous les dépens, et fix[a] au minimum la durée de contrainte par corps ; Et statuantsur la demande de la partie civile, le condamn[a] à payer à Menvielle un franc àtitre de dommage-intérêts »95.
En 1888, les soixante-cinq lignes du seul article de l’annéedédié au duel furent encore consacrées au duel Naquet-Menvielle96. En effet, M. Naquet interjeta appel de la décisionet en déférant l’affaire à la Cour d’appel de Grenoble quiréduisit la peine d’emprisonnement à six jours en raison dupeu de gravité des blessures occasionnées, bien qu’il s’agissed’un acte déloyal, et de la position d’inégalité de Naquetface à Menvielle (âge, lourdeur des épées et fatigue). L’arrêtrappela l’état du droit : le fait, dans un duel à l’épée, deporter volontairement et sciemment des blessures occasionnantune maladie de plus de vingt jours à la victime tombe sous lecoup de l’art. 311 du code pénal français. Or, en l’espèceMenvielle, fut blessé pendant moins de vingt jours.
§4. - La « nationalisation de l’honneur »
Le propos de cette dernière section sera d’illustrerl’omniprésence de l’utilisation du terme « honneur » dans lesconversations et écrits de l’époque. En tout état de cause,des sociologues en déduisent que l’honneur, en France, àl’époque, fit l’objet d’une « nationalisation » 97.
Après avoir relevé de façon générale le concept dans le Journaldes Tribunaux (§1), nous verrons le duel Chapuis-Dekeirel et lesplaidoiries qui y furent échangées (§2).
95 X., « Le duel Naquet-Menvielle », J.T., 1888, n°495, col. 158.96 X., ibidem, col. 157 et 158. 97 N. HAMPSON, « The french society Revolution and the Nationalisation ofHonour », sous la direction de M. R. D. Foot, War and Society, Londres, PaulElock, 1973, pp. 199 à 212 ; G. BEST, War and Society in Revolutionary Europe, 1770-1870, Leicester, Leicester University Press with Fontana Paperbacks, 1982.
22
§1. - Généralités
La fusion des élites reposait sur des valeurs et un mode devie communs liés notamment à la possession de la terre,condition nécessaire pour l’accès aux fonctions politiques ;elle s’accompagna indubitablement d’une prééminence culturellemaintenue de la noblesse, qui conserva sa capacité àreprésenter, pour les élites plus récentes, l’idéal d’uneclasse dirigeante éternelle, et jouissait d’un véritablemonopole dans la définition des bonnes manières. Durant unepartie du XIXe siècle, la bourgeoisie, pourtant créatrice decomportements et des signes distinctifs nouveaux (le grandrestaurant, la ville et l’habit noir) demeurait à la recherched’un véritable capital symbolique sur lequel elle pourraitasseoir son honneur98.
Dans les reconstructions du pays qui s’opérèrentsuccessivement, l’honneur agit comme un signe de ralliement etpermit de conjurer, pour les élites, l’ampleur dubouleversement social qui a touché la France (passage desdifférents régimes)99, et par mimétisme, la société belge.
L’Annuaire du duel (1880-1889) parut en France précisément dès ledébut de la première décennie faisant l’objet de notre étude.Il y était d’emblée souligné dans l’Avertissement que« [l]’Annuaire du duel est le répertoire des affaires d'honneur » etque « [l]'intérêt de cette publication nous a paru être de constituer, pour ainsidire, le dossier d'honneur des contemporains »100. En 1895, un article duJournal des Tribunaux évoqua un important ouvrage du à C. A.Croabbon, intitulé La science du point d’honneur101, qui attesta duphénomène. 98 Voy. Ch. CHARLE, « Noblesse et élites en France au début du XXe siècle »,Les noblesses européennes au XIXe siècle. Actes du colloque de Rome, 21-23 novembre 1985,Collection de l’Ecole française de Rome, Rome, Ecole française de Rome etMilan, Université de Milan, 1988, p. 432 ; E. MENSION-RIGAU, Aristocrates et grandsbourgeois. Education, traditions, valeurs, Paris, Plon, 1990 ; E. MENSION-RIGAU, L’enfanceau château. L’éducation familiale des élites françaises au XXe siècle, Paris, Rivages, 1990, p.158 cités par F. GUILLET, « L’honneur en partage (...) », op. cit., p. 61. 99 F. GUILLET, ibidem, p. 60. 100 J. FÉRRÉUS, op. cit., p. IV. C’est nous qui soulignons. 101 C. A. CROABBON, « Bibliographie », op. cit., col. 14 et 15.
23
§2. - Le duel Chapuis-Dekeirel
Pour illustrer ce phénomène, nous allons nous attarder sur uneaffaire qui défraya la chronique du Journal des Tribunaux et dont ilest fait mention dans l’Annuaire du duel102. En effet, dans lesnuméros 246 à 248, ce n’est pas moins de mille deux centslignes qui sont consacrées au duel du 19 février, opposant MM.Chapuis et Dekeirel.
L’objet du présent paragraphe n’est pas comme l’article de A.Tavernier103 qui étudia la délicate question de savoir sil’emploi de la main gauche pour parer un coup était conforme,ou non, aux exigences de l’honneur, propres au duel. Enrevanche, nous aurons pour objectif d’étonner le lecteur parl’argumentation développée lors des plaidoiries des parties àla cause.
Notre affaire débuta sur une question d’honneur, un des futursadversaires ayant traité l’autre de « lâche » dans un café àDunkerque (France).
Le plaidoyer de l’avocat de la partie civile s’inscrivit dansla même veine, son argumentation reposant sur l’honneur,concept clef de notre étude, et sur le témoignage despécialistes en la matière tels qu’Anatole de la Forge et Paulde Cassagnac, ainsi que les écrits du comte deChâteauvillard et du marquis du Hallay-Coetquen104. Dans cestrois articles, la référence à l’honneur fut incessante. Pourillustrer cette affirmation, voici quelques extraits, parmiune pléthore, de ce qu’on appellerait de nos jours des« punchlines » :
« L’accuserez-vous de ne pas savoir ce que c’est que l’honneur ? »105.
102 J. FÉRRÉUS, op. cit., p. 122. 103 A. TAVERNIER, « Duel Chapuis-Dekeirel », J.T., 1885, n°246, col. 801 à812 ; n°247, col. 817 à 827 ; et n°248, col. 833 à 841. 104 Cf. Ces noms confirment ce que nous disions à propos du monopole del’ancienne élite dans la définition des bonnes manières et, par extension,de l’honneur. 105 A. TAVERNIER, ibidem, col. 806. C’est nous qui soulignons.
24
« On est venu me dire que, sans une convention préalable, vous aurez le droit devous battre sur le terrain comme deux crocheteurs se battent dans la rue, je protestede toutes mes forces ; j’ai toujours entendu dire que le dire était un combat entredeux galants hommes ; qu’une fois sur le terrain vous étiez des être idéaux »106. « Le duel est une affaire de pure convention, rigoureusement limitée par desconditions expresses et réglée par des usages inviolables, qui en font la valeur etl’honneur »107. « (...) honorables officiers ».
Tentant de provoquer un émoi dans la salle, l’avocat desparties civiles conclut : « Le lieutenant Chapuis, au moment de mourir, adit en parlant de son adversaire : “ah le traître !”, c’était son dernier mot. C’est aussile mien. J’ai la ferme confiance que ça sera le vôtre ». Par ailleurs, l’avocatgénéral Dumas rejoignit également ces analyses. Pour rappel,en France, le duelliste qui se rendait coupable de déshonneurou de déloyauté tombait à nouveau sous le coup du droitcommun. D’ailleurs quand Dekeirel touche avec son épéeChapuis, lui disant « Vous êtes touché ! », la « victime » répondit« Oui, mais c’est presque un assassinat »108.
Le respect de l’honneur et des usages effaçant en quelquesorte l’infraction, la partie défenderesse plaida uniquementsur ce moyen là.
« Ce n’est pas, soyez-en convaincus, pour disputer la justice les cinq, dix ou vingt ansde travaux forcés que votre verdict peut octroyer à mon client, que je prends la paroleen ce moment. Le débat est plus élevé. Le dernier mot de M. l’avocat général, motcruel, vous indique bien que c’est une question d’honneur, plus qu’une question deliberté que nous plaidons »109.
La plaidoirie de la partie défenderesse n’a pas seulementsuscité l’enthousiasme, elle a convaincu : l’acquittement futfinalement prononcé par le président.
« En vain vous feriez des lois pour réprimer le duel, les hommes d’honneur s’enmoqueraient. C’est uniquement une question de loyauté, et puisqu’il n’y a pas eu dedéloyauté, je le répète c’est l’acquittement (...). Messieurs les jurés, l’honneur decet homme est entre vos mains (...) » 110.
106 A. TAVERNIER, ibidem, col. 808. C’est nous qui soulignons.107 A. TAVERNIER, ibidem, col. 823. C’est nous qui soulignons.108 A. TAVERNIER, ibidem, col. 821. 109 A. TAVERNIER, ibidem, col. 833. C’est nous qui soulignons. 110 A. TAVERNIER, ibidem, col. 840.
25
CHAPITRE II – QUAND EDMOND PICARD ALLAIT SUR LE PRÉ
Les causes énumérées aux sections III à V du précédentchapitre doivent être analysées comme une poupée russe, EdmondPicard se trouvant au cœur de celle-ci111. Par conséquent, nouspouvons émettre l’hypothèse qu’il condense en lui tous lestraits développés supra pour en faire une synthèse tout à faitoriginale. C’est autour de la figure de cet « avocat parexcellence »112 que nous allons nous diriger dans ce secondchapitre.
Section I. Une coïncidence ?
§1. - La tentation
Comme nous l’avons annoncé en introduction, le point de départde ce travail fut la réalisation de graphiques (voy. annexes 1et 4). Signalons que la liste exhaustive des articles utilisésà cette fin se trouve en annexe, au point 2 de labibliographique.
Nous remarquons d’emblée que la pente de la courbe du premiergraphique monte en flèche vers le milieu de la décennie de1880. En effet, sur un total de cinq mille quatre centcinquante-deux lignes (5442), les années 1885 et 1886 encomptent trois mille quatre cent septante et une (3471), soitprès de 65% (voy. annexe 5).
Or, il s’avère qu’en 1885, Edmond Picard défia un autrejournaliste. En effet, il attribua à tort à Albert Giraud unarticle, publié dans la Jeune Belgique, dans lequel Edmond Picardétait indirectement traité d’imbécile113. Ce dernier, lelendemain (17 octobre 1885), se munit d’un gourdin et
111 Pour rappel, les deux premières répondaient à certaines questions. Toutd’abord, dans la section III, nous nous sommes demandés quelles étaient lescauses qui poussaient un individu à accepter un duel ou à en provoquer un ?Ensuite, la section IV a répondu à la question « pourquoi le phénomène est-il davantage marqué dans les milieux bourgeois, politiques etartistiques ? ». Enfin, la section V a constaté que l’honneur est «nationalisé » dans la France de la Belle-Epoque. 112 R. WARLOMONT, « Picard, Edmond-Désiré », Biographie Nationale, t. 34,Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 656 cité par B. COPPEIN, op. cit., p. 225.
26
encouragé par Léon Cladel114, attendit Giraud au coin d’une rue,l’interpella et le rua de coups. Giraud envoie ses témoinspour provoquer le rédacteur du Journal des Tribunaux en duel. Leduel eut lieu le 21 octobre 1885, selon les règles, dans unpré à Uccle, près du Fort Jaco, avenue de Lorraine.
Deux balles furent échangées, sans dommage. Du chef de coupsavec préméditation, Picard fut condamné à 200 francs d’amende,du chef de provocation en duel à 100 francs et du chef de duelà 50 francs. M. Giraud s’en tire pour 160 francs115.
Nous l’avons étudié au premier chapitre, Picard est une figureemblématique de l’esprit de son siècle (presque un « idéal-type » wébérien), « un avocat qui condense en lui des traits épars chez sesconfrères pour en faire une synthèse d’une totale originalité »116. Nous avonségalement rappelé que la bourgeoisie gagna avec la Révolutionla possibilité de revendiquer un honneur propre ; prérogativedont elle usa et abusa. Elle et Picard s’approprièrent cerituel en en faisant un de leurs signes distinctifs, au prixd’un réaménagement. Le prix de la crédibilité fut toutefois deconserver l’éventualité de la mort tout en réduisant ladangerosité du combat d’honneur117.
Fougueux mais pas fous, au fait des bonnes manières, les deuxadversaires eurent la courtoisie, l’intelligence, l’habileté118
voire même la maladresse sinon le ridicule119 de se ratermutuellement. On aurait pu penser, vu le nombre impressionnant
113 Il était en réalité écrit par Max Waller. Voy. En ce sens : G.-H. DUMONT,« Quand le Coq rouge plantait ses ergots sur la Jeune Belgique (1895-1897) », LeCoq rouge, Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature françaisesde Belgique, 1991. 114 Romancier et nouvelliste français (voy. en ce sens : J. CLADEL, La Vie de Léon Cladel, suivie de Léon Cladel en Belgique, par Edmond Picard, Paris, A. Lemerre, 1905).115 P. CLAUDES et M.-C. HUET-BRICHARD, Léon Cladel, Toulouse, PressesUniversitaires du Mirail, 2003, p. 293.116 P. HENRI, Les grands avocats de Belgique, Bruxelles, J.M. Collet, 1984, p. 154. 117 F. GUILLET, « L’honneur en partage (...) », op. cit., p. 70. 118 F. RINGELHEIM, op. cit., p. 43 119 G.-H. DUMONT, La vie quotidienne en Belgique sous le règne de Léopold II, Paris,Hachette, 1974, p. 158.
27
d’articles consacrés à l’utilisation de la main gauche dans leduel, que Picard ait subi un tel coup bas d’Albert Giraud.Cette hypothèse est vaine, dans la mesure où le pistolet futchoisi. On fit toutefois attention à compter des « pas degéants »120.
De surcroît, il n’était pas étonnant que la plupart des duelsci-avant évoqués furent exécutés à l’épée. Alexandre Dumas nedisait-il pas qu’ « à l'épée, on défend sa vie ; au pistolet, on la livre »121 ?Stendhal relevait déjà dans Le Rouge et le Noir cet aspect spectacledu duel.
« Le duel fut fini en un instant : Julien eut une balle dans le bras ; on le lui serra avecdes mouchoirs ; on les mouilla avec de l’eau-de-vie, et le chevalier de Beauvoisis priaJulien très poliment de lui permettre de le reconduire chez lui, dans la même voiturequi l’avait amené (...) Mon Dieu ! un duel, n’est-ce que ça ! pensait Julien »122. «Mais le duel n’est plus qu’une cérémonie. Tout en est su d’avance, même ce que l’ondoit dire en tombant. Étendu sur le gazon, et la main sur le cœur, il faut un pardongénéreux pour l’adversaire, et un mot pour une belle souvent imaginaire, ou bien quiva au bal le jour de votre mort, de peur d’exciter les soupçons »123.
Cette appropriation et ce réaménagement ne sont pas cependantsans susciter des sarcasmes. La littérature se moque dubourgeois maniant l’épée depuis Le Bourgeois gentilhomme124, enpassant par Pot-Bouille. Tout au long du XIXe siècle, lalittérature ne manque pas de mettre en scène le ridicule deces combats bourgeois125. Hélas pour Picard, son duel fit lebonheur des plaisantins et n’échappa pas aux quolibets deceux-ci. Relevés par Mario Villès126, un petit poème minimalisteintitulé « Tableau des mœurs »127 et une parodie publiée dans le120 D’après le témoignage du témoin de Picard, Iwan Gilkin, venu en habit desoirée (V. GILLE, La Jeune Belgique, Collection Nationale, p. 33 cité par A.PASQUIER, op. cit., p. 18. 121 A. DUMAS, Mes Mémoires. Quid d’Alexandre Dumas, t. II, Paris, Robert Laffont,2002, p. 1029. 122 STENDHAL, Le Rouge et le Noir, Chronique du XIXe siècle, Paris, Michel Lévy frères,1854, pp. 267 et 268.123 STENDHAL, ibidem, p. 325. 124 François Vermeulen nomme ainsi Picard (op. cit., p. 57). 125 F. GUILLET, « L’honneur en partage (...) », op. cit., », p. 70.126 M. VILLÈS, Bruxelles-satire, Bruxelles, Félix Callawaert, 1886, p. 10. 127 « - L’art est social non divin- Voulez vous-vous taire, imbécile.
28
journal Les Matinées littéraires en témoignent. Cet article avait pourtitre « Le duel. Comédie en trois actes » et avait pourpersonnages : Amer Picon et Doux Jésus128. Le duel y étaittourné en dérision par l’entente des témoins sur le fait detirer en l’air ; par la séparation des adversaires en comptant« trente enjambées pour un total d’un hectomètre environ » ; et par lesnombreuses insultes échangées (« arétin de bouges ! tabaton déchu !triboulet ramolli ! moutard venimeux ! (...) »)129.
Cet épisode grotesque souligne combien l’opinion publiquecommençait à s’intéresser aux faits et gestes des hommes delettres et à quel diapason étaient montées les rivalités entreceux-ci130.
§2. - Attention aux conclusions hâtives
L’hypothèse que nous avons annoncée en filigrane estséduisante : selon celle-ci, Picard, inquiété par la justice,réhabiliterait son honneur à travers le journal juridique dontil est rédacteur en chef. En effet, il paraît clair que lapente de la courbe du graphique devient vertigineusementabrupte dans les années 1885-1886 (voy. graphiques ci-dessus) ; précisément à l’époque où l’avocat est inquiété parses propres affaires de duelliste du dimanche.
Toutefois, il ne s’agit bien là que d’une hypothèse. Nous nepouvons pas aller jusqu’à affirmer que l’importance donnée àla pratique du duel au cours de ces deux années n’a pourunique cause que le duel du Fort Jaco.
La presse « ordinaire » (destinée à des non-juristes),française et européenne (voire mondiale), fit également état
- Au coin de la rue, une pile. - Un coup de feu, dans le ravin »128 X., Les Matinées littéraires, n°3, 20 novembre 1885, pp. 108 à 112. 129 X., ibidem, p. 110. 130 Voy. chapitre I, section III et F. VERMEULEN, op. cit., p. 47.
29
des principaux duels évoqués dans ce travail131 132 133 ; ce quisemble prouver qu’ils ne s’agissait non pas d’escarmouchespurement anecdotiques repêchées par le périodique belge. LaBelgique judiciaire, recueil de jurisprudence, donna au duel uneimportance marquée pour le duel pendant ces mêmes années(principalement les années 1885-1886), quoique dans unemoindre mesure (cf. les deux graphiques ci-dessous).
Outre une relative concordance que nous pouvons observer dansles graphiques ci-dessus, force est de constater que les duelsdont nous faisons l’énumération ne sont pas les mêmes dansl’un et l’autre périodique. En effet, aucun nom cité dans leJournal des Tribunaux ne revient dans la Belgique judiciaire. Signalonsles tout de même. Tout d’abord, première occurrence du sujetpendant les deux décennies qui font l’objet de nos recherches,en 1881, la Cour d’appel de Bruxelles (chambrecorrectionnelle. Présidence de M. H. Casier) jugea le duelopposant MM. du Val de Beaulieu et de Schiervel134. Ensuite, en1885, la Cour d’appel de Gand (chambre correctionnelle.
131 Concernant le duel Chapuis-Dekeirel, des journaux d’origines diversesl’évoquent. Not. le néo-zélandais Oamaru Mail (X., « Trial of a duellist »,Oamaru Mail, vol. X, n° 2996, 21 juillet 1885, p. 3) ; le kentukhian (X.,« Duel », Courier-Journal from Louisville, 29 juin 1885, p. 2) ou encore des revuesrégionales françaises comme La Revue de l’Anjou (« Duel en France et enEspagne », Revue de l’Anjou, pp. 171 et 172), Le Journal du Loiret (X., « Faitsdivers », dimanche 9 septembre 1894, n°211) ou le Journal de Senlis (X.,« Faits divers. Cour d’assises du Nord. Le duel d’Audinkerque », Journal deSenlis, 4 juin 1885). 132 Les échos du duel Drumont-Meyer furent encore plus retentissants. MarcelProust en parla dans une lettre à Reynaldo Hahn (lettre IV-133, 9 septembre1904). Une lettre d’Alphonse Daudet à Edmond de Goncourt le mentionnaégalement (lettre datée du mois d’avril 1886). Cf. P. DUFIEF, Edmond deGoncourt et Alphonse Daudet. Correspondances, Genève, Droz, 1996, pp. 196 et 197. 133 Venons en au troisième et dernier duel important de notre exposé :Naquet contre Menvielle. Le Journal du Loiret titra le 13 janvier 1888 « Faitsdivers. Duel » (X., n°11). Un quotidien suisse (de La Chaux-de-Fonds)consacra également quelques lignes à celui-ci (X., « Un duel irrégulier »,L’Impartial, n°2021, 21 juillet 1887). Même le journal espagnol El Popularinforma ses lecteurs de la teneur de l’affaire dans ses « Noticiasgenerales » (X., « Noticias generales », El Popular, n°8932, 27 juillet1887). 134 Bruxelles, 19 juillet 1881, Belgique judiciaire, 1881, t. XXXIX, deuxièmesérie, tome 14, n°70, col. 1105 à 1118.
30
Présidence de M. De Meren), traita d’une affaire relative à laprovocation en duel. (éléments constitutifs. Diffamation) dansun combat entre MM. Van Wayenbergh et Van Beckhoven135. Enfin,en 1886, la Cour d’appel de Bruxelles (6e ch. Présidence de M.Fauquel conseiller), condamna MM. Van Bellighen et de Heusch136.
§3. - Analyse – Le duel, c’est mal, mais quand même
L’énoncé de la présente section annonce déjà la conclusion quenous en tirerons. Elle était par ailleurs prévisible, EdmondPicard incarnant l’esprit de son époque. La section II a doncpour tâche de développer, articles à l’appui, les argumentsqui germaient dans les esprits de l’époque, tant à charge (§1)qu’à décharge du duel (§2).
§1. - Le duel, c’est mal
Dans l’affaire Chapuis-Dekeirel137, l’avocat de la défensesoutenait que le duel était mal : « “Il n’y a plus de duel possible” disaitencore Me Danet. eh bien ! tant mieux ! Et si ce lamentable procès devait marquer ledernier duel, ce serait pour l’humanité un véritable progrès ! »138.
En effet, même si à l’époque le fait de « tailler sonadversaire en marbre »139 tendait à disparaître, l’éventualité
135 Gand, 21 avril 1885, Belgique judiciaire, 1885, t. XLIII, deuxième série,tome 18, n°37, col. 589 à 591136 Bruxelles, 5 août 1885, Belgique judiciaire, 1886, t. XLIV, deuxième série,tome 19, n°42, col. 666. 137 Voy. supra, chapitre I, section V, §2138 A. TAVERNIER, op. cit., col. 840. 139 Cette expression date du règne d’Henri III de France. Un duel avait eulieu au Marché aux chevaux (actuelle place des Vosges) à propos d’uneinsolence prononcée au Louvre envers une dame « douée de plus de beauté quede chasteté » entre des mignons du roi (notamment Jacques de Levis, comtede Quelus et Charles de Balsac d’Entragues) au petit matin du 27 avril1578. Le roi fit élever à la mémoire de ses favoris de magnifiquestombeaux ornés de leurs statues en marbre, dans l’église Saint-Paul (celle-ci étant devenu pour le peuple le « sérail des mignons »). Après que le roieut tant fait pour ensevelir sous des mausolées de marbre ses mignons, unadversaire de ceux-ci, venant de tuer celui avec lequel il s’était battu enduel, dit pour exprimer sa prouesse : « Je viens de le tailler en marbre ».Le mot fit fortune et pendant longtemps, « taillé en marbre » fut synonymede « tué en duel ». Cf. F. X. TESTU, op. cit., pp. 474 et 475.
31
d’une mort restait toujours possible ! C’est pourquoi le Journaldes Tribunaux soutint que le duel n’est pas une composante de lasociété dont celle-ci doit veiller à la persistance.
A. Le duel ne fera pas long feu ! Premièrement, le mensuel juridique expose un devenir nettementdéfavorable pour la pratique. En 1897, le Journal des Tribunauxpublia un article d’une soixantaine de lignes faisant uneanalogie entre l’évolution juridique du duel et de la guerre :« [l]e Duel est la guerre d’homme à homme ; la Guerre est le duel de nation ànation ; dans les deux cas le combat a lieu pour un conflit de Droit oud’Honneur »140.
Les deux subissent un même processus qui débute par l’absencede règles (pour le duel : une époque où régnait le « défaut dejustice sociale organisée » ; et mutatis mutandis pour la guerre qui afranchi cette période « primitive d’attaques sauvages et sans règles ») etaboutit à l’arbitrage.
D’ailleurs, il est indiqué que la guerre essuie « un certainretard ». Ces affirmations nous informent que celui qui a écritce billet voit l’histoire de façon téléologique ; estimant, ausurplus, que la direction de l’Histoire va vers un futurmeilleur, où ni les questions qui intéressent le duel, nicelles se rapportant à la guerre, ne seront soustraites à unejuridiction compétente en la matière141.
Si, à l’époque d’Edmond Picard, le duel tend à être remplacépar l’arbitrage des questions d’honneur, « ce qu’on nomme le droitde la Guerre n’est qu’un code officieux de règles humanitaires rudimentairesauxquelles se soumettent volontairement les nations civilisées sans autre sanctionque celle de la conscience et de l’opinion publique »142. Prophétiquement, lejournal conclue que « la guerre subira sans doute, mutatis mutandis,le surplis de la même évolution (...) avec un des règes analogues au Code du
140 X., « Le Duel et la Guerre. Analogie de leur évolution juridique », J.T.,1897, n°1290, col. 253. 141 X., ibidem, col. 254. 142 X., ibidem, col. 253 et 254.
32
Duel, (...) et finalement, l’idée d’un arbitrage universel, résolvant tous lesdifférends sans effusion de sang, triomphera »143.
§2. - Comment remédier au duel ? Deuxièmement, le Journal des Tribunaux propose activement dessolutions pour remédier au phénomène. C’est bien un texteévoquant une perspective de lege feranda que propose l’article« Comment peut-on remédier au duel ? »144, long de trois centseptante-sept lignes.
Croabbon réfuta tout d’abord l’argument récurrent du malnécessaire avancé par les partisans du duel. En effet, « [l]eduel est un mal et un mal plus grand que ne le croient généralement ceux qui, debonne foi, le jugent nécessaire »145.
« On peut dire, sans crainte d’être démenti par le statisticien consciencieux, qu’àl’heure présente, 9/10 des affaires qu’il enregistre, n’ont d’autre but que de servir depiédestal au coquin, à l’impudent ou au fou » 146. « Etant donné un tel état dechoses, qui est à peu près l’état général, le code de l’honneur devient la pluscommode des armes offensives et défensives pour les gens sans honneur »147.
Toutefois, même s’il souhaitait ardemment que le fait cessât,il se retint de sous-estimer l’attachement à l’honneur decertaines catégories sociales en osant croire « qu’il suffirait dedécréter purement et simplement ex abrupto et ex cathedra la suppressionimmédiate et entière du combat singulier »148 pour que ces gens, soucieuxde leur image, cessent de se battre et se réfèrent aux
143 X., ibidem, col. 254. 144 C. A. CROABBON, « Comment peut-on remédier au duel ? », op. cit., col. 369 à380. Celui-ci mentionnait que ces notes étaient « communiquées par C. A.Croabbon, le spécialiste français en matière de Législation du Point d’Honneur, qui feront l’objetd’une conférence au Cercle Arte et Marte de Bruxelles » (C. A. CROABBON, ibidem, col.369). 145 C. A. CROABBON, ibidem, col. 370. 146 C. A. CROABBON, ibidem, col. 370. 147 P. FAMBRI, Giurisprudenza del Duello, cité par C. A. CROABBON, « Comment peut-onremédier au duel ? », op. cit., col. 371. 148 C. A. CROABBON, ibidem, col. 371.
33
tribunaux civils149. Partant de ce diagnostic, il envisageaplusieurs voies pour y remédier.
« A qui donc, encore une fois, demander le remède ? Nous répondrons : “au pointd’honneur lui-même”. Le point d’honneur cause la blessure dont souffre la sociétéactuelle. C’est lui qui la guérira (...) »150. C’est un remède guérissantle mal par le mal que conseilla l’auteur : en s’appuyant surles mœurs, la société allait faire peu à peu disparaître unede ses plaies actuelles, « un mal invétéré que ces mêmes mœurs nous ontlégué comme un héritage du passé et que jusqu’à présent elles ont non seulementmaintenu, mais encore renforcé »151.
Son premier conseil fut de faire promulguer un code disposantque seul l’échec d’un traitement approfondi de l’affaire et deses dessous pouvait donner lieu à un duel, c’est-à-dire aprèsle bilan des responsabilités dressé. Et l’auteur de préciserque lui-même préparait un tel code (« projet de Codechevaleresque international ») en vue d’essayer de rapprocherles différentes législations. Le deuxième conseil futd’établir un système de juridiction consistant en des« personnes ayant l’expérience, le sens, l’autorité et l’impartialité qui manquent(...) aux traditionnels témoins, c’est-à-dire des gens choisis souvent à la hâte,généralement ignorants de la loi qu’ils doivent appliquer et toujours plus ou moinspartiaux »152. Mais « [e]st-ce à dire, cependant, que nous fassions absolumentet obstinément fi de l’intervention des pouvoirs publics, de l’influence de la loiproprement dite ? Non pas (...). [L]es lois peuvent, à notre avis, devenir unjour dans l’avenir, les auxiliaires utiles des mœurs »153. Partant, « [l]e duel,entouré de si sages précautions, deviendrait un fait tout à fait exceptionnel(...) »154.
149 « Les uns l’ont demandé à la morale pure ou à la religion seule. Les autres aux lois, d’autres àl’alliance de la morale, de la religion et des lois. Les uns ont édicté des lois draconiennes, d’autres, deslois plus en harmonie avec les idées et les sentiments modernes. Les uns ont fait du duel un délitspécial, les autres l’ont considéré comme un délit de droit commun (...). La place me manquepour expliquer cette impuissance des sanctions légales, morales, religieuses (...) » (C. A.CROABBON, ibidem, col. 372). 150 C. A. CROABBON, ibidem, col. 372. 151 C. A. CROABBON, ibidem, col. 377. 152 C. A. CROABBON, ibidem, col. 374. 153 C. A. CROABBON, ibidem, col. 379 et 380. 154 C. A. CROABBON, ibidem, col. 379.
34
§3. - Mais quand même
Nous avons vu que pour Edmond Picard, passionné d’escrime(l’une de ses nombreuses activités155), le combat de corps àcorps était perçu comme un prolongement de son salon et de sesautres activités mondaines.
Toutefois, le Journal des Tribunaux ne poussa pas l’hypocrisiejusqu’à affirmer que le duel fut bénéfique en soi. Néanmoins,il justifia celui-ci ; donnant des excuses et descirconstances atténuantes à ses praticiens. Contrairement auxautres infractions, considérées comme apanage du peuple nonéduqué, les magistrats et politiques admettaient que si leduel fut répréhensible, il s’agissait de « tout autre chose »,d’une infraction « d’un autre genre » (...).
A. « Hercule » Picard En 1897, Edmond Picard donna une conférence au Palais deJustice de Bruxelles sur l’ « Evolution juridique du duel dansle droit français » dont le plan détaillé nous est donné dansle Journal des Tribunaux (cent trente et une lignes)156.
Il commença par y définir le duel comme un « combat singulier pourvider un conflit sur une question de Droit ou d’Honneur »157. A l’instar desanciens propriétaires du château de Modave qui avaient faitfigurer Hercule dans leur arbre généalogique, Edmond Picardpoursuivit en s’intégrant dans une « filiation ». Les exemplesqu’il énuméra pouvaient étonner : « Ménélas contre Paris, David contreGoliath, les Horaces contre les Curiaces, Achille contre Hector, Enée contre Tucnus ouencore Tancrède contre Clorinde »158.
155 P. ARON et C. VANDERPELEN-DIAGRE, op. cit., p. 286. 156 E. PICARD, « Evolution juridique du duel dans le droit français », J.T.,1897, n°1288, col. 219 à 222. 157 E. PICARD, ibidem, col. 219. C’est nous qui soulignons.158 E. PICARD, ibidem, col. 219.
35
§2. - Circonstances atténuantes En 1898, un journaliste159 estima (dans un article du Journaldes Tribunaux long de cent quarante-cinq lignes) que lapratique du duel méritait néanmoins des « Circonstancesatténuantes ».
« Il est impossible de contester que, dans l’état actuel des mœurs, le duel ne soit,dans certains cas, une obligation à laquelle on ne peut se soustraire ». « Aprèsavoir été l’objet d’autant de lois, d’édits et de décrets que la Presse, le duel a survécucomme elle à toutes les législations (...). Le duel et la Presse, d’ailleurs, sont tousdeux de même nature ; insaisissables tous deux et échappant aux réglementations lesmieux combinées, ils représentant l’un et l’autre cette puissance indéfinissable etvague qui s’appelle l’Opinion. Dans son article d’aujourd’hui, Cassagnac sembleattribuer la permanence du duel à ce fait que notre législation répare insuffisammentles plus mortelles offenses160 ».
L’auteur de ce billet, après avoir soutenu l’inutilité de lajustice en la matière (« que voulez-vous que les tribunaux fassent contrecette loi sociale, qui est en dehors de toutes les lois du Code »161), défendit lapratique du duel.
En effet, selon lui,
« [i]l convient de reconnaître, d’ailleurs, que l’indulgence des lois actuelles pourle duel correspond à une évolution générale de la société française ». Si leduel était fort sanglant à l’époque des Henri IV et LouisXIII où l’on comptait « les victimes du sang le plus pur du royaume parmilliers », « nous n’en sommes plus là aujourd’hui (...) car les jeunesgénérations n’ont plus ces ardeurs martiales, [étant] de plus en plus éprises debien-être »162.
Ensuite, l’auteur poursuivit : « le duel, quand il est justifié, est la manifestation dernière de cet état d’esprit quifaisait jadis passer l’honneur avant toutes les richesses ; il représente, de nobles etgénéreux sentiments ; c’est la parodie d’un magnifique idéal »163.
159 X., « Le duel. Circonstances atténuantes », J.T., 1898, n°1379, col. 340à 342. 160 X., ibidem, col. 340. 161 X., ibidem, col. 341. 162 X., ibidem, col. 341. C’est nous qui soulignons.163X., ibidem, col. 341. Ce texte est une reproduction ad integrum del’ouvrage de Ch.-M. DE VAUX (Les duels célèbres, Paris, Rouveyre et G. Blond,
36
« Le duel a conservé son prestige [car], en dépit de tant de changementsaccomplis dans les usages, quiconque se bat en duel expose sa vie, risque cette vie siprécieuse, si chère entourée maintenant de tant de confortable, embellie par tant deplaisirs (...) »164.
« L’acte par lequel un homme se rend sur le terrain, quittant donc volontairement unintérieur où il est bien d’ordinaire pour courir la chance de n’y plus revenir vivant,s’accomplit sans être forcé, pour l’honneur, c’est-à-dire pour cette chose abstraite quin’est pas cotée comme une valeur, qui ne se traduit pas par des chiffres. En seconduisant ainsi, il sort de la vulgarité des jours actuels ; il s’élève au-dessus desconsidérations terre à terre, il témoigne qu’il a une âme élevée et accessible à despensées d’un ordre supérieur (...). L’écrivain qui, entrainé au delà de ladiscussion permise par son ardeur à défendre ses convictions et ses idées, abandonneun matin son cabinet d’études plein de livres pour répondre à un défi, me semblepersonnifier un des côtés sympathiques de l’existence moderne »165.
CONCLUSION
Nous avons vu qu’à la Belle Epoque, la tradition voulait, enquelque sorte, qu’une polémique entre deux hommes importants,par exemples des politiques, des avocats, ou journalistes(certains combinant plusieurs de ces fonctions) aboutisse à unduel à l’épée ou au pistolet. C’est pourquoi, à l’instard’Alphonse de Lamartine, nous en venons à nous demander s’iln’aurait pas été plus courageux de refuser un duel que d’enaccepter un 166 ?
A l’époque, on estimait que les « mœurs »167 ne laissaient àcelui qui était provoqué en duel qu’une option : accepter leduel (et risquer sa vie) ou le refuser (et êtreirrémédiablement considéré comme lâche). Cependant, nousestimons que cette aporie pouvait être résolue. En effet,certains fins esprits purent refuser un duel tout enridiculisant l’adversaire (le « beurre et l’argent du
1884). 164 X., « Le duel. Circonstances atténuantes », op. cit., col. 342.165 X., ibidem, col. 342.166 Alphonse de Lamartine s’écria du haut de la tribune nationale que « dansun pays où l’honneur est plus cher que la vie, il y a plus de courage à refuser un duel qu’à en accepterdix » (X., Congrès scientifique de France, 5e session, Metz, Lamort, 1837, p. 499). 167 Au sens du dictionnaire de P. HAMON et A. VIDOUD (op. cit.).
37
beurre »). Ainsi, Dugazon168, acteur de la Comédie-Française,tourna en ridicule son rival Desessarts169. Celui-ci exaspérépar les moqueries du premier, le provoqua en duel. Dugazonrefusa : « Mon ami, tu es si gros que j’aurais trop d’avantage sur toi »170. Maisnous avons vu que l’humour et la taquinerie ne servaient querarement à décliner un duel. Ils en étaient en général lacause.
Arrivé au terme de ce travail, que rajouter ? Son apport àl’étude du duel n’aura pas été d’en découvrir unerecrudescence à la fin du XIXe siècle du duel ; sujet déjàmainte fois exploré. Tout au plus aurons-nous d’abord mis enexergue dans la première partie de notre exposé son importancedans le Journal des Tribunaux. En effet, nous avons vu que le duelfut accaparé par la bourgeoisie, qui tout en condamnantl’aristocratie, en adopta les usages171. Les différents articlesdont nous avons retracé les grandes lignes ont montré quemilitaires, parlementaires, journalistes, écrivains etartistes n’ont eu de cesse de s'affronter, pour un regard detravers ou une phrase jugée, à tort ou à raison, offensante.Ces conflits picrocholins, fondamentalement ordaliques,perdurèrent jusqu’jusqu'à la Grande Guerre, voire même jusqu’àMai 68172.
Ensuite, ce travail aura également permis de revenir sur lafigure d’Edmond Picard, « colosse du barreau belge »173 dont « l’ombre
168 Nom de scène de Jean-Henri Gourgaud. 169 De son vrai nom, Denis Dechanel. 170 F. X. TESTU, op. cit., p. 342. 171 « Proposition de loi relative au duel, présentée par l’abbé Lemire »,dans Journal officiel, n° 1230, Chambre des députés, session de 1895, annexe auprocès-verbal de la séance du 14 mars 1895, p. 5 cité par F. GUILLET,« L’honneur en partage (...) », op. cit., p. 56. 172 Voy. not. : J.-N. JEANNENEY, Le duel : une passion française (1789-1914), Paris,Tempus, 2011. 173 L’expression est de Pierre Henri (Grands avocats de Belgique, Bruxelles,Éditions J.M. Collet, 1984, p. 154).
38
singulière »174 plane encore dans la salle des pas-perdus du Palaisde justice de Bruxelles175.
Enfin, en introduction, nous nous étions donné pour but derépondre à une question simple : « pourquoi et comment leJournal des Tribunaux évoque-t-il itérativement le duel ? ». Ladeuxième partie de notre exposé aura eu pour mission de mettreen lumière la difficulté de la réponse. Les rédacteurs étaientdans une position délicate : tâche difficile pour eux que decondamner une pratique dont ils sont assidus. Le deux-poids-deux-mesures (le duel n’étant pas une infraction en soi enFrance et n’étant pas réprimé de façon effective en Belgique)évident à l’époque impliquait qu’ils considéraient que le duelrelevait d’un « autre genre », jusqu’à légitimer, ou à tout lemoins excuser la pratique des bretteurs et tireurs176.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages mobilisés autres que le Journal des Tribunaux (1881-1900)
174 C’est en ces termes qu’Albert Guislain évoque celui pour lequel il fitune biographie manuscrite que l’on peut trouver aux Archives Générales duRoyaume à Bruxelles (Archives Albert Guislain (AAG), n° 2413, p. 1 cité parB. COPPEIN, op. cit., p. 225). 175 Foulek Ringelheim s’offusque d’ailleurs que la statue d’un homme – «ayant passé sa vie à bafouer les principes de justice et à instiller dans les esprits une idéologie qui fitles malheurs de l’Europe » – se trouve toujours au Palais de justice, parmi lesbustes des anciens bâtonnier du barreau (op. cit., p. 110). A titre indicatif,signalons que le buste fut volontairement renversé par un avocat en signede protestation envers l’antisémitisme de Picard qui n’aurait plus droit decité (Ch. LAPORTE, « Le buste d'Edmond Picard projeté à terre au palais deJustice de Bruxelles. Me Graindorge revendique un "attentat" », Le Soir, 18février 1994). 176 Ce paradoxe est perceptible à la lecture d’un passage des Pandectes belgesdont les lignes relèvent normalement davantage de la description juridique(de lege lata). « La nécessité de punir le duel nous paraît incontestable. Non seulement il constitueun attentat contre les personnes, mais il est, en outre, la violation fragrante de cette maxime d’ordrepublic : que nul ne peut se rendre justice à soi-même. A ce double titre, le législateur ne pouvait lelaisser impuni. Mais d’un autre côté, nous pensons que c’est avec raison qu’il en a fait un délit d’unenature spéciale ; car il est de toute impossibilité de le faire rentrer dans le droit commun et de leplacer sur la même ligne que l’assassinat ou le meurtre. Ce sont évidemment là d’ordre absolumentdifférent et qui n’ont ni le même ni la même cause » (Pand., v° « Duel », t. 33,Bruxelles, Veuve Larcier, 1890, col. 1379. Nous soulignons).
39
– ARNAUD (A.-J.), Essai d’analyse structurale du Code civil français. La règle
du jeu dans la paix bourgeoise, Paris, L.G.D.G., 1974.
– ARON (P.) et VANDERPELEN-DIAGRE (C.), Edmond Picard : un bourgeois
socialiste belge à la fin du dix-neuvième siècle : essai d'histoire culturelle,
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique,
2013.
– BEST (G.), War and Society in Revolutionary Europe, 1770-1870,
Leicester, Leicester University Press with Fontana
Paperbacks, 1982.
– BILLACOIS (F.), Le duel dans la société française des XVIe-XVIIe siècles.
Essai de psychosociologie historique, Paris, Editions de l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences sociales, 1986.
– CAMUS (A. G.) et DUPIN (A.-M.-J.-J.), Lettres sur la profession
d’avocat par Camus, Bruxelles, Tarlier, 1833.
– CLADEL (J.), La Vie de Léon Cladel, suivie de Léon Cladel en Belgique,
par Edmond Picard, Paris, A. Lemerre, 1905.
– CLAUDES (P.) et HUET-BRICHARD (M.-C.), Léon Cladel, Toulouse,
Presses Universitaires du Mirail, 2003.
– COPPEIN (B.) et DE BROUWER (J.), Histoire du barreau de Bruxelles,
1811-2011 / Geschiedenis van de balie van Brussel, Bruxelles,
Bruylant, 2012.
– COPPEIN (B.), « Edmond Picard (1836-1824), avocat
bruxellois et belge par excellence de la deuxième moitié
du XIXe siècle », sous la direction de V. Bernaudeau et al.,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, pp. 225 à
237.
– DE BALZAC (H.), Le Père Goriot, Œuvres complètes de H. de Balzac,
Paris, Calmann-Lévy, 1910.
40
– DE BROUWER (J.), « Des bougies pour le palais de justice de
Bruxelles – Le symposium Edmond Picard », J.T., 2013, p.
707.
– DE GRANIER DE CASSAGNAC (X.), « Le duel », Conférence en août
1988 à Soulan (Ariège), La Réveillée, pp. 81 à 90.
– DE MAUPASSANT (G.), Bel-Ami, Ollendorf, Rencontre, 1901.
– DE VAUX (Ch.-M.), Les duels célèbres, Paris, Rouveyre et G.
Blond, 1884.
– DEMOULIN (R.), Biographie nationale de Belgique, t. XXXIII,
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1963-1964, col.
217 à 245.
– DUFIEF (P.), Edmond de Goncourt et Alphonse Daudet. Correspondances,
Genève, Droz, 1996.
– DUMAS (A.), Mes Mémoires. Quid d’Alexandre Dumas, t. II, Paris,
Robert Laffont, 2002.
– DUMONT (G.-H.), « Quand le Coq rouge plantait ses ergots sur
la Jeune Belgique (1895-1897) », Le Coq rouge, Bruxelles,
Académie royale de langue et de littérature françaises de
Belgique, 1991, pp. 1 à 19.
– DUMONT (G.-H.), La vie quotidienne en Belgique sous le règne de Léopold
II, Paris, Hachette, 1974.
– DUPIN (M.), Réquisitoires, plaidoyers et discours de rentrée prononcées par
M. Dupin, depuis le mois d’août 1830 jusqu’à ce jour, Paris, Joubert,
tome 5, 1842.
– DUPIN (M.), Manuel des étudiants en droit et des jeunes avocats. Recueil
d’opuscules de jurisprudence, Bruxelles, Tarlier, 1835.
– FERNANDEZ (D.), Dictionnaire amoureux de Stendhal, Paris, Plon-
Grasset, 2013.
41
– FÉRRÉUS (J.), Annuaire du duel (1880-1889), Paris, Perrin & Cie,
1891.
– GUILLET (F.), « L’honneur en partage. Le duel et les
classes bourgeoises en France au XIXe siècle », Revue
d'histoire du XIXe siècle, 34, 2007, pp. 55 à 70.
– GUILLET (F.), La Mort en face. Histoire du duel en France de la Révolution
à nos jours, Paris, Aubier, 2008.
– HAMON (P.) et VIDOUD (A.), Dictionnaire thématique du roman de
mœurs en France, 1814 – 1914, A.-I, Paris, Presses Sorbonne
Nouvelle, 2008.
– HAMPSON (N.), « The french society Revolution and the
Nationalisation of Honour », sous la direction de M. R. D.
Foot, War and Society, Londres, Paul Elock, 1973, pp. 199 à
212.
– JEANNENEY (J.-N.), Le duel : une passion française (1789-1914), Paris,
Tempus, 2011
– KAUCH (P.), Biographie Nationale, t. XXIX, Bruxelles, Académie
Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1957.
– LAPORTE (Ch.), « Le buste d'Edmond Picard projeté à terre
au palais de Justice de Bruxelles. Me Graindorge
revendique un "attentat" », Le Soir, 18 février 1994.
– LUCIEN (M.), Eeckout le rauque, Villeneuve d'Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, 1999.
– NANDRIN (J.-P.), Hommes et normes : le pouvoir judiciaire en Belgique
aux premiers temps de l'indépendance (1832-1848), 4 vol., thèse de
doctorat en Philosophie et Lettres, Louvain-la-Neuve,
Université catholique de Louvain, 1995.
42
– Pand., v° « Duel », t. 33, Bruxelles, Veuve Larcier, 1890,
col. 1380 à 1388.
– PASQUIER (A.), Edmond Picard, Collection Nationale, Bruxelles,
Office de publicité, 1945.
– PICARD (E.), Confiteor, Bruxelles, Larcier, 1901.
– RAITT (A.), Edmond Deman éditeur (1857-1918) : Art et édition au
tournant du siècle, coll. Archives du Futur, Bruxelles, Labor,
1997.
– RINGELHEIM (F.), Edmond Picard, jurisconsulte de la race, Bruxelles,
Larcier, 1999.
– SAINTE BEUVE (C. A.), « La littérature industrielle », Revue
des deux mondes, t. 19, 1839, pp 675 à 691.
– STENDHAL, Le Rouge et le Noir, Chronique du XIXe siècle, Paris, Michel
Lévy frères, 1854.
– STENDHAL, Le Rouge et le Noir. Chronique du XIXe siècle, Préface,
commentaires et notes de M. Crouzet, Paris, Librairie
Générale française, coll. « Le livre de poche
classique », 1997.
– STERCKX (D.), « Un siècle de J.T. : 1881 – 1900 », J.T.,
1982, pp. 262 à 264.
– TESTU (F. X.), Le bouquin des méchancetés et autres traits d’esprit,
Paris, Robert Laffont, 2014.
– VANDERPELEN-DIAGRE (C.), « Ambivalent journaliste. Edmond
Picard et la presse », Textyles, n°39, 2010, pp. 27 à 38.
– VERMEULEN (F.), Edmond Picard et le réveil des lettres belges (1881-1888),
Bruxelles, Palais des Académies, 1935.
– VIAU (R.), Vingt ans d'antisémitisme 1889-1909, Paris, Fasquelle,
1910.
43
– VILLÈS (M.), Bruxelles-satire, Bruxelles, Félix Callawaert,
1886.
– X., « 1914-1918 », J.T., 1918, n°2740, col. 937.
– X., « Chapitre II – Organisation judiciaire », Almanach de
la cour des Provinces méridionales et de la ville de Bruxelles pour l’An 1828 à
Bruxelles, vol. 12, Bruxelles, A. D. Stapleaux, 1828, pp.
119 à 220.
– X., Almanach de la cour des Provinces méridionales et de la ville de
Bruxelles pour l’An 1828 à Bruxelles, vol. 12, Bruxelles, A. D.
Stapleux, 1828.
– X., Congrès scientifique de France, 5e session, Metz, Lamort,
1837.
– X., Hommes du jour, Revue biographique de la politique, des sciences, des
arts, de la littérature, etc. (1883-1896), n°5, 1895-1896.
Articles et jurisprudences du Journal des Tribunaux et de la Belgique judiciaire (classement chronologique : de 1881 à 1900)
1881
– Bruxelles, 19 juillet 1881, Belgique judiciaire, 1881, t.
XXXIX, deuxième série, tome 14, n°70, col. 1105 à 1118.
1885
– TAVERNIER (A.), « Duel Chapuis-Dekeirel », J.T., 1885,
o n°246, col. 801 à 812 ;
o n°247, col. 817 à 827 ;
o et n°248, col. 833 à 841.
– Bruxelles (6e ch.), audience du 5 août 1885, J.T., 1885,
n°263, colonnes 1073 et 1074.
44
– Corr. Termonde, 12 février 1885, J.T., 1885, n°275, col.
1267 à 1269.
– Gand, 21 avril 1885, J.T., 1885, n°278, col. 1313 à 1316.
– Gand, 21 avril 1885, Belgique judiciaire, 1885, t. XLIII,
deuxième série, tome 18, n°37, col. 589 à 591
1886
– X., « Chronique judiciaire », J.T., 1886, n° 330, col. 591
et 592.
– X., « Le duel Meyer-Drumont », J.T. 1886,
o n°345, col. 817 à 832 ;
o n°346, col. 833 à 844 ;
o et n°357, col. 849 à 862.
– Cour militaire, 4 mars 1886, J.T., 1886, n°318, col. 396.
– (Gazette des Tribunaux), « Le duel à l’épée devant la justice »,
J.T., 1886, n°359, col. 1041 à 1046.
– Bruxelles, 5 août 1885, Belgique judiciaire, 1886, t. XLIV,
deuxième série, tome 19, n°42, col. 666.
1887
– X., « Chronique judiciaire. L’emploi de la main gauche
dans les duels », J.T., 1887, n°455, col. 1077 à 1080.
1888
– X., « Le duel Naquet-Menvielle », J.T., 1888, n°495, col.
157 et 158.
1889
45
– Cass. (2e ch.), 18 décembre 1888, J.T. 1889, col. 101 et
102.
– Corr. Bruxelles (6e ch.), 23 janvier 1889, J.T., 1889,
n°592, col. 168 à 170.
– Corr. Bruxelles (6e ch.), 10 mars 1889, J.T. 1889, n°617,
col. 603 et 604.
1890
– CLUNET (E.), « Duel », J.T., 1890, n°717, col. 641 à 652.
1891
– Corr. Louvain, 20 avril 1891, J.T., 1891, n°800, col. 595.
1895
– CROABBON (C. A.), « Bibliographie », J.T., 1895, n°1107,
col. 14 et 15.
1896
– CROABBON (C. A.), « Comment peut-on remédier au duel ? »,
J.T., 1896, n°1213, col. 369 à 380.
1897
– PICARD (E.), « Evolution juridique du duel dans le droit
français », J.T., 1897, n°1288, col. 219 à 222.
– (La Libre Parole), « La procédure du duel judiciaire en
Belgique », J.T., 1897, n°1291, col. 269 à 271177.
177 La Libre Parole était un journal politique français (1892-1924), parmi lesprincipaux supports antidreyfusards, qui fut lancé par Edouard Drumont,auteur de la France juive et duelliste (voy. supra, chapitre I, section IV, §2,le duel Drumont-Meyer). Voy. en ce sens : R. VIAU, Vingt ans d'antisémitisme 1889-1909, Paris, Fasquelle, 1910.
46
– X., « Le Duel et la Guerre. Analogie de leur évolution
juridique », J.T., 1897, n°1290, col. 253 et 254.
1898
– X. « Le duel. Circonstances atténuantes », J.T., 1898,
n°1379, col. 340 à 342.
47
ANNEXES
Annexe 1 :
1881
1883
1885
1887
1889
1891
1893
1895
1897
1899
01234567
Nombre articles consacrés au duel par année
Annexe 2 :
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Belgique judiciaireJournal des Tribunaux
Annexe 3 :
48
Annexe 4 :
1881
1883
1885
1887
1889
1891
1893
1895
1897
1899
0200400600800100012001400160018002000
Lignes consacrées au duel par année
Annexe 5 :
49
TABLE DES MATIÈRES
Introduction.................................................2Chapitre I – L’honneur est dans le pré.......................4Section I.........Un vieux jouet acquis par droit de conquête
4Section II.....................Quelques précisions juridiques
5§1. -.............................................En France
5§2. -...........................................En Belgique
5A. L’état du droit......................................6B. Honneur et préjugé...................................7
Section III....................Mais pourquoi risquer sa vie ?8
§1. -........................................La littérature8
§2. -..............................Les clubs et les cercles9
§3. -................................L’économie d’un procès10
§4. -.........« A nous deux maintenant, Paris ! » (tremplin social)10
Section IV...Une récupération par les bourgeois, journalisteset politiques..............................................11§1. -...........................................Généralités
11§2. -..........................Le duel Drumont-Meyer (1886)
12§3. -.......................Le duel Naquet-Menvielle (1888)
13Section V.................La « nationalisation de l’honneur »
14§1. -...........................................Généralités
15§2. -..............................Le duel Chapuis-Dekeirel
15Chapitre II – Quand Edmond Picard allait sur le pré.........17Section I...................................Une coïncidence ?
17
51
§1. -..........................................La tentation17
§2. -.....................Attention aux conclusions hâtives19
Section II......Analyse – Le duel, c’est mal, mais quand même20
§1. -....................................Le duel, c’est mal20
A. Le duel ne fera pas long feu !......................21B. Comment remédier au duel ?..........................21
§2. -.......................................Mais quand même23
A. « Hercule » Picard..................................23B. Circonstances atténuantes...........................23
Conclusion..................................................24Bibliographie...............................................26Annexes.....................................................32Table des matières..........................................35
52