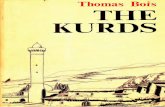Thomas d'Aquin pense-t-il?
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Thomas d'Aquin pense-t-il?
Rev. Sc. ph. th. 93 (2009) 229-250
THOMAS D’AQUIN PENSE-T-IL =?
RETOURS SUR HIC HOMO INTELLIGIT
par Jean-Baptiste BRENET=∗
INTRODUCTION
Il y a différentes manières d’envisager la très célèbre proposition deThomas d’Aquin : Hic homo intelligit (cet homme pense). On pourraitconsidérer ses sources (y en a-t-il ? Sont-elles exclusivement latines ?),son statut dans les textes de Thomas (est-ce une sorte d’axiome, unedonnée de la conscience, une exigence métaphysique, morale, politi-que ?), son efficacité dans la réfutation du « monopsychisme » (et lalecture de la noétique averroïste qu’elle suppose), ou encore sa circula-tion, pour ne pas dire son destin, dans la scolastique. Notre objet, cepen-dant, est ici réduit et ciblé sur autre chose. Admettons que l’hommepense (et qu’on sache ce que penser veut dire). Nous voudrions examinersi Thomas est lui-même en mesure, d’un point de vue théorique, et sansaccroc, de le justifier. Quelle que soit l’entrée qu’on choisisse dans sonsystème, peut-on vérifier cette proposition : hic homo intelligit ? Autre-ment dit : Thomas peut-il lui-même relever le défi qu’il croit légitime delancer à Averroès : celui, par sa théorie de l’homme, de l’âme, del’intellect, de rendre raison de l’expérience de la pensée personnelle ?Rappelons brièvement comment il formule ce challenge. Si l’on pose,
∗ Cet article n’existerait pas sans B. C. Bazán, que je remercie très chaleureusementpour ses conseils et son soutien. Son livre sur Thomas, à paraître chez Vrin, est indispen-sable ; outre des points techniques de détail, que je signalerai, je lui dois une grande partde la perspective adoptée. Grâce à lui, ce qui suit me paraît dénouer certaines difficultésprésentées dans J.-B. BRENET, « “…set hominem anima”. Thomas d’Aquin et la penséehumaine comme acte du “composé” », Mélanges de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth,59 (2006), p. 69-96.
230 JEAN-BAPTISTE BRENET
ainsi que le fait Averroès, que l’intellect est une substance ontologique-ment séparée de l’individu, comment expliquer que l’acte de cet intellectséparé, c’est-à-dire la pensée, puisse être l’acte de l’individu ?=1 Précisé-ment, comme on le sait, Thomas jugera que c’est impossible. Chez Aver-roès, selon lui, ce n’est jamais que l’intellect qui pense, et non pasl’homme, et toutes les tentatives de suture échouent à faire de ce dernierun être effectivement intelligent. Mais qu’en est-il chez Thomas ? Netrouve-t-on pas chez lui, chez lui aussi, une sorte de tension, voire dedivorce, entre deux énoncés : « l’âme (intellective) pense » d’un côté,« l’homme pense » de l’autre ? C’est notre question. Nous voudrionsdonc sur ce point précis relever certaines difficultés chez Thomas (encroisant des textes généralement archi-lus) et tâcher de voir s’il s’agit dedifficultés réelles, c’est-à-dire de vraies impasses, de contradictions (unrefoulé thomasien des « deux sujets » de la pensée ?), ou si l’on peut, parquelques éclaircissements lexicaux et conceptuels, les résoudre de ma-nière satisfaisante.
I. L’INTELLIGER COMME ACTE PROPRE DE L’ÂME
Pour ce qui nous importe, la difficulté majeure tient dans cette idée,répétée maintes fois par Thomas, que la pensée (ou l’intelliger, si l’onveut coller au latin) est un acte propre de l’âme humaine, et que celle-ci,donc, en pensant, opère par soi. On le trouve énoncé partout, et c’estbien connu : la pensée se fait, nécessairement, sans organe ; le corps n’yentre pas à titre de sujet ou d’instrument direct. Pourquoi cela ? Parceque, ainsi que l’enseigne Aristote, penser consiste à pâtir en quelquefaçon de l’intelligible, pour le saisir comme tel, dans son universalité ; ilfaut donc que n’intervienne aucune organe corporel qui, par sa détermi-
1. Deux exemples, parmi des dizaines d’autres : (1) « Si quis autem velit dicere ani-mam intellectivam non esse corporis formam, oportet quod inveniat modum quo istaactio quae est intelligere sit huius hominis actio (Mais si l’on voulait soutenir que l’âmeintellective n’est pas la forme du corps, il faudrait montrer comment cette action qu’est lapensée est l’action de cet homme) » (THOMAS D’AQUIN, Summa theologiae, Ia [q. 50-119],Romae, Ex Typographia Polyglotta [Sancti Thomae Aquinatis Opera omnia, t. V], 1889,q. 76, art. 1, resp., p. 209). (2) « Si autem dicas quod principium huius actus qui est intelli-gere, quod nominamus intellectum, non sit forma, oportet te inuenire modum quo actioillius principii sit actio huius hominis » (THOMAS D’AQUIN, De unitate intellectus, dansOpuscula, Santa Sabina [Aventino], Roma, Editori di San Tommaso [Sancti Thomae deAquino Opera omnia, t. XLIII], 1976, p. 303, 41-44) ; voir THOMAS D’AQUIN, L’Unité del’intellect contre les averroïstes, suivi des Textes contre Averroès antérieurs à 1270, textelatin, traduction, introduction, bibliographie, chronologie, notes et index par A. DE
LIBERA, Paris, GF-Flammarion, 1994 p. 137 ; traduction légèrement modifiée : « Mais si tudis que le principe de cet acte qu’est la pensée, principe que nous appelons intellect, n’estpas forme <du corps>, il va te falloir trouver la manière dont l’action de ce principe peut-être l’action de cet homme-ci <ou de cet homme-là>. »
THOMAS D’AQUIN PENSE-T-IL ? 231
nation, sa matérialité, viendrait altérer l’universel et rendrait impossiblela pure réception que doit être l’acte de conception ; c’est ce que Thomastirait du De anima, livre III, chapitre 4 (429a13-29). Mais on sait aussiqu’au fondement épistémologique de la thèse s’ajoute une dimensionthéologique, dans la mesure où, en vertu d’une homogénéité de l’être etde l’agir, la « perséité » de l’acte intellectif vaut comme le signe de la« perséité » ontologique de l’âme qui l’accomplit. Le principe, là encore,est omniprésent : puisqu’il revient à chaque chose d’agir sur le modemême où il lui revient d’être (unumquodque operatur in quantum estens), ce qui agit par soi possède nécessairement l’être par soi. Si l’âme,donc, en pensant, agit par soi (et il ne peut en être autrement, si l’on veutque la pensée ait lieu), c’est qu’elle possède un être par soi ; or si ellepossède un être par soi, cela signifie qu’elle est subsistante ; et si elle estsubsistante, cela implique – et tel est l’enjeu – qu’elle ne disparaît paslorsque le corps se corrompt. Aristote, au premier chapitre de son traitéDe l’âme (I, 1, 403a10-11), déclarait que s’il existait un acte ou une affec-tion de l’âme lui appartenant en propre, celle-ci pourrait se séparer=2. Celane fait aucun doute pour Thomas : cet acte propre de l’âme, c’est la pen-sée ; et c’est l’indice de son immortalité.
Voici par exemple ce qu’il écrit dans la question une de ses Quaestio-nes de anima de Thomas=3 :
non solum absque materia et conditionibus materie species intelligibiles[anima rationalis] recipit, set nec etiam in eius propria operatione possibileest communicare aliquod organum corporale, ut sic aliquid corporeum sit or-ganum intelligendi, sicut oculus est organum uidendi, ut probatur in III Deanima. Et sic oportet quod anima intellectiua per se agat, utpote propriamoperationem habens absque corporis communione. Et quia unumquodqueagit secundum quod est in actu, oportet quod anima intellectiua habeat esseper se absolutum, non dependens a corpore=4.
2. Voir ARISTOTE, De l’âme, traduction inédite, présentation, notes et bibliographiepar R. BODÉÜS, Paris, GF-Flammarion, 1993, p. 83 : « donc, s’il est une des opérations oudes affections de l’âme qui lui soit propre, on peut admettre que l’âme se sépare, maisdans le cas où aucune ne lui est propre, elle ne peut être séparée ».
3. La question demande si l’âme humaine peut être à la fois forme et hoc aliquid ;Thomas va répondre que oui, en un certain sens ; mais il s’oppose d’abord à ceux qui,comme Empédocle ou Galien, font de l’âme une « harmonie » ou un « mélange » (unecomplexion) et qui, ce faisant, la réduisent au simple statut de forme matérielle incapablede transcender les qualités élémentaires. Thomas le conteste : ce n’est déjà pas le cas del’âme végétative ; a fortiori, ça l’est encore moins pour l’âme sensitive, puis pour l’âmeintellective. Il écrit alors le texte cité.
4. THOMAS D’AQUIN, Quaestiones de anima, edidit B.-C. BAZÁN, Roma-Paris, Commis-sio Leonina-Éd. du Cerf (Sancti Thomae de Aquino opera omnia, t. XXIV, 1), 1996, q. 1,sol., p. 8, 234-247.
232 JEAN-BAPTISTE BRENET
L’importance de cette double thèse est telle que dans sa Sentencia duDe anima Thomas reconnaît au début du livre I qu’il doit anticiper surles développements du livre III pour qu’on n’aille pas croire, comme lalettre paraît le suggérer en 403a7-10, que l’intelliger ne serait pas propre àl’âme mais commun « à l’âme et au corps ». Dans ce passage célèbre,Aristote écrit en effet que l’intelliger semble être une passion éminem-ment propre à l’âme mais que, « si elle constitue […] une sorte de repré-sentation ou ne va pas sans représentation, il ne saurait être questiond’admettre non plus qu’elle se passe du corps=5 ». Thomas intervient surle champ. Qu’on ne se méprenne pas, en effet, en jugeant sur les appa-rences : si l’on a besoin du corps pour penser, ce ne sera jamais commeinstrument d’effectuation de la pensée ; il ne saurait y avoir pour la pen-sée l’équivalent de ce qu’est l’œil pour la vue. Et l’on retrouve les deuxconclusions du texte des Quaestiones cité plus haut : d’une part (a),l’intelliger est bien une opération propre de l’âme ; d’autre part (b), si telest le cas, c’est que l’âme possède un être par soi et partant qu’elleéchappe à la corruption.
La chose est donc exprimée de manière nette et récurrente : l’âmepense par soi, l’intelliger est l’opération propre de l’âme. Pourtant, cen’est pas si clair. D’autant plus que cela, comme on l’annonçait, heurte laproposition principale qu’est « cet homme pense ». Aussi faut-il revenirsur ces formules afin d’essayer d’en élucider le sens exact. Pour ce faire,il est nécessaire de rappeler en bref quelques points de doctrine bienconnus.
Premier point : l’âme humaine n’agit pas par son essence=6. En effet, sil’âme est un principe premier et immédiat de l’être (en tant que formesubstantielle unique, elle confère l’être au corps sans que rien nes’interpose), elle n’est pas un principe immédiat d’opération ; elle ne peutpas l’être ; pour différentes raisons, qu’on ne détaillera pas, mais notam-ment parce que, s’il est vrai que tout agent produit quelque chose qui luiest semblable (omne agens agit sibi simile), et que ce qu’opère l’âme estd’ordre accidentel, le principe immédiat d’un accident ne peut être uneessence, mais un accident lui-même=7. De fait, que sont ces principes im-médiats des opérations de l’âme ? Ce sont ses « puissances », que l’ondoit comprendre, si l’on se place dans l’ordre catégorial, comme des ac-
5. ARISTOTE, De l’âme, I, 1, 403a8-10 ; trad. R. Bodéüs, p. 83 ; texte latin de la nova (inTHOMAS D’AQUIN, Sentencia libri De anima, Roma-Paris, Commissio Leonina-Vrin(Sancti Thomae de Aquino Opera omnia, t. XLV,1), 1984, p. 8) : « maxime autem uideturproprium intelligere. Si autem est et hoc fantasia quedam aut non sine fantasia, noncontinget utique neque hoc sine corpore esse. »
6. Voir par exemple ST Ia, q. 77, art. 1 ; Quaestions de anima, q. 12 ; Quaestio de spi-ritualibus creaturis, art. 11.
7. Voir par exemple Quaestiones de anima, q. 12, resp., p. 109, 152 sqq.
THOMAS D’AQUIN PENSE-T-IL ? 233
cidents (des qualités de la deuxième espèce) ; ou bien, si l’on se placedans l’ordre des prédicables, comme des propres ou des propriétés natu-relles de l’âme=8. Quand l’âme agit, par conséquent, elle agit par ses puis-sances, lesquelles sont nécessairement requises à titre de principes im-médiats des opérations=9.
Deuxième point : ces puissances sont de divers types=10. En effet, diffé-rentes puissances émanent de l’essence de l’âme humaine en tant qu’elleest en acte, les unes, comme les puissances du sens, actualisant des orga-nes du corps, d’autres, en revanche, comme l’intellect et la volonté – etcela dans la mesure où l’âme humaine n’est pas une forme totalementimmergée dans la matière – n’en informant aucun=11. De l’âme émane lapuissance de voir, par exemple, formellement solidaire de cet organequ’est l’œil ; mais de l’âme émane aussi, en tant qu’elle transcende lacapacité de la matière, l’intellect, qui n’est associé à aucune partie ducorps. Cela permet déjà de préciser les propositions qui nous importent.Lorsqu’on dit que l’âme pense par soi, ou que l’intelliger est une opéra-tion propre de l’âme humaine, on se place au niveau des principes immé-diats de l’agir, et l’on entend que la pensée est un acte de cette puissancen’informant aucun organe qu’est l’intellect.
Pour affiner cette première approche, il faut lire un texte de Thomasrelatifs à la question du « sujet » (subiectum) des puissances. Il s’agit dela Somme de théologie Ia, q. 77, art. 5, qui demande « si toutes les puis-sances de l’âme sont dans l’âme comme dans un sujet ». Thomas base saréponse sur un adage fameux extrait du De somno et vigilia d’Aristote,selon lequel, en latin, « eius sit potentia cuius est operatio », c’est-à-dire,presque littéralement : « la puissance appartient à ce à quoi appartientaussi l’opération » ; ou encore, un peu plus clairement : « ce qui possèdela puissance (et Thomas précise : à titre de « sujet »-substrat), c’est celamême qui opère ». En d’autres termes, ce qui sert de sujet-substrat à une
8. Voir par exemple THOMAS D’AQUIN, Quaestio disputata de spiritualibus creaturis,edidit J. COS o.p., Roma-Paris, Commissio Leonina-Éd. du Cerf (Sancti Thomae de Aqui-no opera omnia, t. XXIV, 2), 2000, art. 11, resp., p. 119, 239-120, 290.
9. Voir par exemple THOMAS D’AQUIN, Scriptum super libros Sententiarum, éd. R. P.MANDONNET, Paris, Lethielleux, 1929, lib. I, dist. 3, q. 4, art. 2, p. 116 : « ab anima, cum sitsubstantia, nulla operatio egreditur, nisi mediante potentia » ; voir Quaestiones De Ani-ma, q. 12, resp., p. 110, 204-209 : « manifestum est igitur quod ipsa essentia anime non estprincipium immediatum suarum operationum, set operatur mediantibus principiis acci-dentalibus. Unde potentiae anime non sunt ipsa essentia anime, set proprietates ipsius. »
10. On peut renvoyer à ST Ia, q. 77 dans son ensemble.11. Par exemple, voir THOMAS D’AQUIN, Scriptum super libros Sententiarum, lib. I,
dist. 3, q. 4, art. 2, p. 116 : « Hae autem potentiae fluunt ab essentia ipsius animae, quae-dam ut perfectiones partium corporis, quarum operatio fit mediante corpore, ut sensus,imaginatio, et huiusmodi ; et quaedam, ut existentes in ipsa anima, quarum operatio nonindiget corpore, ut intellectus, voluntas, et alia hujusmodi. »
234 JEAN-BAPTISTE BRENET
puissance d’opération, c’est cela même qui accomplit cette opération ;pour désigner, donc, quel est le substrat d’une puissance, il suffit de dé-terminer ce qui opère son acte. Or, dit Thomas :
manifestum est […] quod quaedam operationes sunt animae, quae exercentursine organo corporali, ut intelligere et velle. Unde potentiae quae sunt harumoperationum principia, sunt in anima sicut in subiecto. Quaedam vero ope-rationes sunt animae, quae exercentur per organa corporalia ; sicut visio peroculum, et auditus per aurem. Et simile est de omnibus aliis operationibussensitivae et nutritivae partis. Et ideo potentiae quae sunt talium operatio-num principia, sunt in coniuncto sicut in subiecto, et non in anima sola=12.
Ainsi : il y a d’un côté des opérations de l’âme qui ne sont que del’âme ; c’est-à-dire des opérations accomplies par une puissance, principeimmédiat de l’agir qui n’est lié à aucun organe corporel ; et en ce cas, sic’est l’âme, seule, via sa puissance, qui agit, c’est l’âme qui sert de sujet àcette puissance ; mais on trouve aussi, d’un autre côté, des opérations del’âme qui ne s’exercent que par le biais d’organes corporels (comme lavision) ; en ce cas, ce qui agit, c’est l’organe (joint à la puissance), et c’esten lui, donc, qu’elle trouve son sujet. Cela veut dire, par conséquent, quel’âme est certes le principe de toutes ses puissances (le principe actif, lacause efficiente), mais qu’elle n’est le sujet-substrat (le principe récep-teur) que de celles qui s’exercent sans organe, les autres, précisément, etconformément au principe d’Aristote, se subjectant dans l’organequ’elles utilisent pour agir.
Citons deux textes pour confirmer ce qui vient d’être dit. Le premierest extrait du Compendium theologiae I, 89 :
Omnes enim huiusmodi potentie quodam modo in anima radicantur : que-dam quidem, sicut potentie uegetatiue et sensitiue partis, in anima sicut inprincipio, in coniuncto autem sicut in subiecto, quia earum operationes con-iuncti sunt et non solum anime : cuius enim est actio, eius est potentia ; que-dam uero in anima sicut in principio et in subiecto, quia earum operationessunt anime absque organo corporali, et hiusmodi sunt potentie intellectiuepartis=13.
Le second est extrait de la Question sur les créatures spirituelles :
Secundum Philosophum in libro de sompno et uigilia « Cuius est potentiaeius est actio ». Unde potentie ille quarum operationes non sunt solius animeset coniuncti, sunt in organo sicut in subiecto, in anima autem sicut in ra-dice ; solum autem ille potentie sunt in anima sicut in subiecto, quarum ope-
12. THOMAS D’AQUIN, ST Ia, q. 77, art. 5, resp., p. 245.13. THOMAS D’AQUIN, Compendium theologiae, dans Opuscula, Roma, Editori di San
Tommaso (Sancti Thomae de Aquino Opera omnia, t. XLII), 1979, I, 89, p. 112, 4-14.
THOMAS D’AQUIN PENSE-T-IL ? 235
rationes anima non per organum corporis exequetur, que tamen sunt animesecundum quod excedit corpus=14.
On peut rassembler les différents éléments qui sont apparus. Quel’âme pense par soi signifie que l’intelliger est l’acte d’une puissancesupérieure, l’intellect, qui, s’exerçant sans instrument corporel, n’estreçue que dans l’âme, et non pas, à l’instar d’une puissance végétative ousensitive, dans quelque organe. L’intelliger est l’acte propre de l’âmedans la mesure où, si l’on se place – comme on le doit pour commencer –au niveau du principe prochain de l’agir, ce qui l’exerce n’est pas unconiunctum, c’est-à-dire l’unité conjointe d’une puissance et d’un or-gane, mais une puissance « séparée », c’est-à-dire sans assise corporelle,sans inscription dans la matière.
II. LE SENS DE CONIUNCTUM
Le terme de coniunctum est capital pour notre analyse, mais chezThomas il est équivoque=15. Le plus souvent, pour ne pas dire toujours, lestraducteurs en font un simple synonyme de compositum, le « composé »,qui, selon eux, ne peut désigner autre chose que le composé de l’âme etdu corps (c’est-à-dire ce tout hylémorphique qu’est l’homme). Il est vraique c’est parfois le cas. Dans certains passages, Thomas paraît user in-distinctement de l’un ou l’autre terme, en se référant au composé del’âme et du corps qui constitue l’être complet=16. Mais ce n’est pas tou-jours le cas, et la nuance, pour le problème qui nous occupe, n’est pasmineure. Le coniunctum, en son sens plus restreint, technique, en usagedès lors qu’il est question des puissances de l’âme (et donc des principesimmédiats des opérations du vivant), c’est, si l’on peut dire, le« conjoint », l’associé de la puissance immédiate qui ne peut s’exercersans le corps, c’est-à-dire l’organe qui lui sert de substrat et forme avecelle une unité (une unité hylémorphique, du reste : ce qui explique queThomas use certaines fois du terme de compositum pour la désigner)=17.Pris en ce sens, le coniunctum dont parle Thomas intervient au niveaud’un principe immédiat de l’agir : il s’agit de l’organe corporel que telleou telle puissance inférieure (la vue, par exemple, principe prochain del’opération consistant à voir) requiert pour son exercice.
14. THOMAS D’AQUIN, Quaestio disputata de spiritualibus creaturis, art. 4, ad 3, p. 53,263-272.
15. Sur ce point, voir le livre de B. C. Bazán.16. Par exemple, voir Quaestio disputata de spiritualibus creaturis, art. 2, ad 2, p. 30,
330-331.17. Voir par exemple la Sentencia libri de anima I, 2 (403a3-403a10), p. 9, 57-58 ; I, 10
(408b18-29), p. 51, 281 ; III, 1 (429a20-429b5), p. 204, 207-214 (où l’on voit clairement quele conjoint peut être le « composé » d’une puissance et d’un organe corporel).
236 JEAN-BAPTISTE BRENET
Ainsi, lorsque Thomas répète que l’intelliger est un acte propre del’âme humaine, il faut tenir en tête, fermement, méthodiquement, quecela consiste à dire que la pensée est l’acte d’une puissance, principeimmédiat de l’action, qui n’utilise, pour s’exercer, aucun organe corporel« conjoint », et qui, pour cette raison, ne se subjecte que dans l’âme.Pourquoi cette mise au point est-elle ici importante ? Parce que nous nesommes encore qu’au niveau des principes immédiats de l’agir et que cen’est en rien celui du composé hylémorphique humain. Confondre lesdeux plans conduirait à des affirmations problématiques=18. LorsqueThomas dit que la pensée est l’acte propre de l’âme et non d’un con-iunctum, il faudrait comprendre, si l’on fait du coniunctum un synonymedu composé hylémorphique d’âme et de corps qu’est l’homme, qu’ellen’est pas l’acte du composé humain – ce qui, bel et bien, ne va pas.
À l’inverse, prenons deux difficultés qui, si l’on se tient à ce que l’ona vu pour l’instant, semblent disparaître. (1) Premièrement, dans un il-lustre passage du De anima d’Aristote (I, 4, 408b14-15), il est écrit :
dire que l’âme est en colère, c’est comme si l’on disait – sous-entendu : « etcela ne va pas » – que l’âme est en train de tisser ou de bâtir. Il vaudraitmieux, en effet, ne pas dire que c’est l’âme qui a pitié, apprend ou réfléchit(en latin : intelligere), mais que c’est l’homme qui le fait, par l’âme=19.
Phrase remarquable, puisqu’Aristote paraît dire lui-même, offrantune autorité rêvée : « ne disons pas que c’est l’âme qui pense ; mieuxvaut dire que c’est l’homme, par son âme ». Or force est de constater,après enquête, que Thomas, étonnamment, ne reprend quasiment jamaisce passage pour son propre compte, et notamment qu’il ne s’y réfère pascontre Averroès pour appuyer sa proposition hic homo intelligit. Aucontraire, même. Lorsqu’il apparaît chez lui, le texte se présente systé-matiquement sous la forme d’une objection qu’on lui adresse. Pourquoicela ? Pourquoi Thomas ne fait pas de ce texte son autorité phare ? Laréponse nous paraît claire : ce n’est évidemment pas parce qu’il récuse laconclusion du passage, à savoir que c’est l’homme qui pense plutôt quel’âme, et qu’il le fait par son âme. Cela – on y revient –, c’est aussi sathèse, mot pour mot. Ce qui le gêne, c’est la justification que l’on sup-pose ici de cette conclusion, laquelle justification voudrait que, sil’homme pense, c’est dans la mesure où l’intelliger, comme le fait detisser, comme le fait de bâtir, est l’acte d’un organe. Voilà ce que Thomas
18. Voir le livre de B. C. Bazán, où l’auteur souligne bien les risques de ce qu’il ap-pelle « la micro-analyse ».
19. ARISTOTE, De l’âme, 408b14-15 ; trad. R. Bodéüs, p. 118. Pour la Nova (Thomasd’Aquin, Sentencia libri de anima, p. 47) : « dicere autem irasci animam, simile est et sialiquis dicat eam texere uel edificare. Melius enim fortassis est non dicere animam mise-reri aut addiscere aut intelligere, set hominem anima ».
THOMAS D’AQUIN PENSE-T-IL ? 237
ne peut admettre. Non pas que l’homme pense – certainement pas ; maisque c’est lui qui pense parce que sa pensée serait opérée par un instru-ment corporel, ou encore, pour reprendre le terme sur lequel on a misl’accent, parce que sa pensée serait l’acte d’un coniunctum, c’est-à-direde l’unité conjointe de la puissance intellective et d’un organe. C’est celaqu’il ne peut valider et qui, si c’est ce qu’on risque d’entendre, rend letexte d’Aristote délicat.
Dans les dernières œuvres de Thomas qui font référence à ce texted’Aristote, l’Aquinate bénéficie de la Paraphrase du texte de Thémistiuset trouve en elle de quoi dénoncer ce passage du De anima paraissantsuspendre le fait (indéniable) que l’homme pense à l’effectuation de lapensée comme acte d’un organe corporel. Thomas dit clairement ceci,désormais : Aristote, en ce passage du texte, ne parle pas en son nom. Ilne formule pas sa thèse personnelle, determinando, mais s’exprime sup-ponendo, c’est-à-dire dans un cadre (platonicien), qu’il n’assumera nul-lement par la suite, où l’on associe le sens et l’intellect en attribuant àchacun d’eux des organes=20. Et c’est dans ce cadre, où il prête seulementsa voix, qu’Aristote explique « que ces opérations, à savoir sentir, seréjouir, et d’autres de ce genre, ne sont pas des mouvements de l’âme,mais du “conjoint” (quod huiusmodi operationes, scilicet sentire, gaudereet huiusmodi non […] esse anime motus, set coniuncti)==21 ». On comprendbien, par conséquent, la réserve ou la critique de Thomas. S’il ne nie pasque ce soit bien l’homme qui pense, il récuse le fait qu’il pense parce quela pensée serait l’acte d’un « conjoint » ; il nie le fait que l’homme penseparce que la pensée serait un acte « commun », en ce sens que ce seraitl’acte d’un « conjoint » : si l’homme pense, la pensée est « commune »,assurément, mais en un autre sens ; et cela, jamais, ne doit consister ànier que c’est un acte propre de l’âme, c’est-à-dire un acte exercé par unepuissance sans organe.
Deuxième exemple : celui de la chaleur. C’est bien connu : Thomasoppose souvent la chaleur à l’âme humaine ; la chaleur sert en effet demodèle pour caractériser une forme matérielle, tandis que l’âme humaineest subsistante. La chaleur n’est pas subsistante ; elle n’opère donc paspar soi. Et Thomas de répéter : « ce n’est pas la chaleur, d’ailleurs, quiagit, c’est le chaud », le composé hylémorphique qu’est le corps chaud.Autrement dit, la chaleur étant une forme strictement matérielle, ce n’estpas elle qui agit mais le composé dont elle est la forme. Or c’est bien cequi pourrait poser problème, puisqu’il semblerait qu’on dût en déduire,par contraste, que si l’âme humaine, elle, est subsistante, cela implique
20. Voir par exemple THOMAS D’AQUIN, ST Ia, q. 75, art. 2, ad 2 ; ou Sentencia libri deanima, I, 10 (408b5-18), p. 48, 32-63 ; p. 51, 262-269.
21. THOMAS D’AQUIN, Sentencia libri de anima, p. 48, 64-65.
238 JEAN-BAPTISTE BRENET
que c’est elle qui agit, et non pas le composé hylémorphique humain. Ence cas, effectivement, « l’âme pense » rivaliserait avec « l’hommepense ». Mais ce n’est pas cela. Que l’âme agisse, cela veut dire, si l’onapplique ce qui précède, qu’au niveau des principes immédiats de l’agir,c’est une puissance séparée qui opère, et non pas un coniunctum, c’est-à-dire, comme dans le cas des puissances sensitives ou végétatives, l’unitéconjointe d’une puissance et d’un organe. Ce qui ne préjuge en rien de lapensée comme acte du composé hylémorphique d’âme et de corps.
Jusqu’à présent, nous avons montré ce que signifiait cette proposi-tion : l’âme pense par soi ; ou cette autre : l’intelliger est l’acte propre del’âme humaine. Et pour cela nous nous sommes placé au niveau desprincipes immédiats de l’agir en distinguant, parmi les puissances éma-nées de l’âme, celle, comme l’intellect, n’actualisant aucun organe, decelles informant au contraire un coniunctum, qu’il fallait prendre soin dene pas confondre (au prix d’une malheureuse confusion des niveaux del’agir) avec le « composé » hylémorphique humain. Soit. Mais expliquerque la puissance intellective opère sans organe ne dit rien encore du faitque l’homme pense. S’il faut donc partir du niveau des puissances, prin-cipes immédiats de l’agir du vivant, il est essentiel de ne pas s’y tenir etde remonter à la source dont ce niveau dépend.
III. DU PRINCIPE IMMÉDIAT DE L’AGIR À SON PRINCIPE PREMIER
De fait, si l’intellect est en tant qu’accident propre émanée del’essence de l’âme le principe immédiat de l’opération intellective, l’âme,en qui il est enraciné, en est le principe premier. Plus largement, du reste,elle est le principe premier (quoique jamais immédiat) de toutes les ac-tions du vivant. Cela tient au fait qu’elle est, en tant que forme substan-tielle, principe (premier et) immédiat de l’être du vivant. Car, commeThomas le répète systématiquement : « nihil agit nisi secundum quod estactu : unde quo aliquid est actu, eo agit=22. » Il écrit dans ses Quaestionesde anima :
Set quia eadem forma que dat esse materie est etiam operationis principium,eo quod unumquodque agit secundum quod est actu, necesse est quod ani-ma, sicut et quelibet alia forma, sit etiam operationis principium=23.
Il ne suffit donc pas de dégager le niveau du principe prochain del’agir puisque ce dernier ne s’effectue qu’en rapport au niveau premierqui l’explique, l’oriente, le commande. Que l’âme soit le principe premierde l’agir, en effet, cela signifie qu’elle agit par le biais de ces puissances
22. En l’occurrence, THOMAS D’AQUIN, ST Ia, q. 76, art. 1, resp.23. THOMAS D’AQUIN, Quaestiones de anima, q. 9, resp., p. 81, 246 sqq.
THOMAS D’AQUIN PENSE-T-IL ? 239
propres (lesquelles n’ont donc pas d’indépendance), ou encore, pour re-prendre des formules du texte, que ces puissances, tels de simples ins-truments, n’opèrent qu’en vertu du principe actif que l’âme est pourelle=24. En guise d’illustration, lisons à nouveau un extrait des Quaestionesde anima. Il s’agit de savoir si l’âme est identique à ses puissances.L’argument dix, qui soutient que oui, explique que l’âme, dans la mesureoù elle est principe de l’être, est aussi principe de l’opération. Or unepuissance n’est rien d’autre qu’un principe d’opération. Donc, etc. MaisThomas répond d’une nuance. L’âme est principe d’opération, certes ;mais principe premier, pas prochain. Voici l’objection :
idem est principium essendi et operandi. Set anima secundum se ipsam estprincipium essendi, quia secundum suam esentiam est forma. Ergo secun-dum suam essentiam est principium operandi. Set potentia nichil aliud estquam principium operandi. Essentia igitur anime est eius potentia=25.
Et la réponse :
anima est principium operandi, set primum, non proximum. Operantur enimpotentie in uirtute anime, sicut et qualitates elementorum in uirtute forma-rum substantialium=26.
Thomas formule d’une autre manière remarquable la conséquencequi suit l’idée de l’âme comme principe premier d’un agir dont les puis-sances émanées sont les principes immédiats : si ces puissances agissenten vertu de l’âme, cela signifie que là où se trouve une puissance del’âme se trouve chaque fois l’essence de l’âme :
ad decimum dicendum quod potentia anime radicatur in essentia ; et ideoubicumque est aliqua potentia anime, ibi est essentia anime=27.
L’âme est en quelque sorte présente « aux » puissances, qu’elle faitêtre et dont elle alimente, par sa virtus, l’efficacité. Le principe premierde l’agir est dans chacun de ses principes immédiats. L’âme humaine, quin’opère pas par essence, est toujours là où ça agit, parce que ce qui agiten bout de chaîne (et qu’on doit se garder d’autonomiser), n’existe et
24. Plus largement, sur cette question de l’action in virtute…, voir J.-B. BRENET, « Lefeu agit-il en tant que feu ? Causalité et synonymie dans les Quaestiones sur le De sensuet sensato de Jean de Jandun », à paraître en 2009 dans les Actes du collo-que international La réception des Parva naturalia d’Aristote (Antiquité, Moyen Âge),organisé en Sorbonne les 4-5 novembre 2005 par Ch. Grellard et P.-M. Morel.
25. THOMAS D’AQUIN, Quaestiones de anima, q. 12, arg. 10, p. 106, 61-67.26. THOMAS D’AQUIN, Quaestiones de anima, q. 12, ad 10, p. 111, 295-299 ; q. 12, resp.,
p. 110, 204 sqq. : « Manifestum est igitur quod ipsa essentia anime non est principiumimmediatum suarum operationum, set operatur mediantibus principiis accidentalibus. »
27. THOMAS D’AQUIN, Quaestiones de anima, q. 10, ad 10, p. 93, 335-337. C’est un pointmis en valeur par B. C. Bazán dans son livre.
240 JEAN-BAPTISTE BRENET
n’est efficace que par (et pour) elle. Et cela, encore une fois, vaut pourtoutes les actions, qu’elles procèdent en dernier ressort d’une puissanceémanée n’actualisant aucun organe ou d’une puissance émanée inscritedans un organe. Ce qui ne revient pas à nier toute différence entre, parexemple, le fait de penser et le fait de voir. Mais ce ne sont que des diffé-rences dans le mode d’effectuation d’actes qui, nonobstant, se rapportentà l’âme comme à leur source commune. Penser ne se fait certes pascomme voir : d’un côté, un intellect sans organe ; de l’autre, un œil ;mais c’est à une seule et même âme que les deux doivent d’intervenir ; etc’est jusqu’à cette racine, quels que soient les modes opératoires, qu’ilfaut reconduire l’action=28.
IV. LE SUJET-AGENT DE L’AGIR
Ce n’est pourtant pas fini. Qu’il faille remonter à l’âme comme auprincipe premier de l’agir est une chose ; mais trouver le sujet-agentproprement dit de l’agir (c’est-à-dire cela même, en rigueur de termes,qui agit) en est une autre. Car l’âme, d’où sourdent les puissances, etdont la virtus les porte, n’est pas ce sujet-agent. Et pas plus qu’il ne fal-lait hypostasier les principes immédiats de l’agir (en les coupant de leurbase), il ne faut isoler son principe premier. Même si cela mobilise plu-sieurs règles conceptuellement denses, la raison générale en est simple etconnue des lecteurs de Thomas : c’est que l’âme n’est pas, au sens pleindu mot, un hoc aliquid, puisque, quoique subsistante, elle ne constituepas d’elle seule une nature d’espèce complète=29 ; elle n’est pas, donc, ausens plein du mot, hoc aliquid ; elle n’est pas une substance première,une hypostase, une personne, ou encore, un « suppôt ». Or, et c’est la cléde tout, actiones sunt suppositorum, c’est-à-dire : les actions sont le faitdes suppôts ; les actions ne sont le fait que des suppôts ; ce sont les sup-pôts qui agissent, ce sont eux les sujets de l’agir : les êtres qui constituentvéritablement, intégralement, un hoc aliquid, les substances premières,les personnes (dans le cas de l’homme), les hypostases, mais pas l’une oul’autre de leurs parties, fût-elle, comme c’est le cas de l’âme humaine,subsistante=30. Il ne suffit donc pas de relier les principes immédiats auprincipe premier de l’agir qu’est l’âme ; il faut associer cette âme à ce qui
28. THOMAS D’AQUIN, ST Ia, q. 77, art. 5, ad 1, p. 245 : « omnes potentiae dicuntur esseanimae, non sicut subjecti, sed sicut principii : quia per animam conjunctum habet quodtales operationes operari possit. »
29. Voir par exemple ST Ia, q. 75, art. 2, ad 1m.30. Sur cet adage, voir A. DE LIBERA, « Les actions appartiennent aux sujets. Petite ar-
chéologie d’un principe leibnizien », dans « Ad Ingenii Acuitionem ». Studies in Honourof Alfonso Maierù, edited by S. CAROTI, R. IMBACH, Z. KALUZA, G. STABILE andL. STURLESE, Louvain-la-Neuve, Brepols, 2006, p. 199-219.
THOMAS D’AQUIN PENSE-T-IL ? 241
ontologiquement, en tant qu’elle est forme substantielle, constitue soncorrélat, à savoir le corps, puisque c’est l’être total qu’ils forment,l’homme, qui seul, dans la mesure où il est complet et subsiste vérita-blement par soi, agit.
L’intellect opère par soi, sans organe ; mais c’est par l’âme qu’ilopère ; une âme supérieure, dont émane, en tant qu’elle excède la capa-cité de la matière, une puissance séparée ; cependant c’est avec le corps,seulement (ce corps qu’elle fait communier à son acte d’être) que cetteâme, à son tour, constitue un être susceptible d’agir. Le trajet est le sui-vant : de l’intellect, qui n’est qu’une puissance émanée, principe immé-diat de l’agir, à l’âme, qui en est le principe premier ; et de cette âme,certes subsistante, au tout, le composé humain, dont elle n’est jamais, àtitre de forme substantielle, qu’une partie. C’est là qu’est la solution,comme le résume cette phrase limpide de Thomas, extraite de sesQuaestiones de anima :
intellectus possibilis non est aliqua potentia fundata in aliquo organo corpo-rali, et tamen eo intelligit homo formaliter in quantum fundatur in essentiaanime humane, que est hominis forma=31.
Ou encore celle-ci, tirée de la Question sur les créatures spirituelles, etformulée un peu autrement :
intelligere est operatio anime humane secundum quod superexcedit propor-tionem materia corporalis, et ideo non fit per aliquod organum corporale.Potest tamen dici quod ipsum coniunctum, id est homo, intelligit in quantumanima, que est pars eius formalis, habet hanc operationem propriam, sicutoperatio cuiuslibet partis attribuitur toti : homo enim uidet oculo, ambulatpede, et similiter intelligit per animam=32.
L’âme accomplit l’intelliger par le biais de l’intellect, sans organepropre. Mais on peut dire, pourtant, que c’est l’homme qui pense, parceque l’âme est une partie de l’homme (sa partie formelle), et que l’acte dela partie s’attribue au tout.
Ces formules, cependant, pourraient troubler. Thomas soutient-il quec’est l’âme, en vérité, qui pense, mais qu’on peut tout de même « dire »– si l’on y tient – que l’homme pense, en lui « attribuant » (et rien quecela) ce que l’âme opère mais qu’il n’aurait pas réalisé lui-même ? Rai-sonner ainsi serait en réalité faire fausse route. Que la pensée soit« attribuée » à l’homme, cela veut dire, sans équivoque, qu’il l’accomplitlui-même, qu’elle est son acte (et cela, comme on l’a dit, parce qu’il n’y a
31. THOMAS D’AQUIN, Quaestiones de anima, q. 2, resp., p. 19, 310-327.32. THOMAS D’AQUIN, Quaestio disputata de spiritualibus creaturis, art. 2, ad 2m,
p. 30, 326-335.
242 JEAN-BAPTISTE BRENET
d’acte que d’un suppôt véritable)=33. Que l’homme pense, par conséquent,n’est pas une manière de parler. Et d’ailleurs, c’est plutôt l’inverse : c’estle fait de dire que « l’âme pense » qui manque de rigueur. Thomas lereconnaît dans un texte insolite de la Somme de théologie Ia, q. 75, art. 2,qui demande « si l’âme humaine est quelque chose de subsistant ». Ilsemble que non, lit-on d’abord. L’objection 2 fait valoir le texted’Aristote (De an. 408b 12-13) qu’on a relevé plus haut. On lit ceci :
omne quod est subsistens potest dici operari. Sed anima non dicitur operari :quia, ut dicitur in I de Anima, “dicere animam sentire aut intelligere, simileest ac si dicat eam aliquis texere aut aedificare”. Ergo anima non est aliquidsubsistens.
Autrement dit : l’âme ne serait pas subsistante, puisque, comme le Deanima paraît l’indiquer, si l’on ne dit pas que l’âme tisse ou bâtit, on n’apas à dire non plus qu’elle sent ou qu’elle pense ; mais si ce n’est pas ellequi pense, cela signifie qu’elle n’a pas d’opération par soi ; et si elle n’apas d’opération par soi, cela implique qu’elle n’est pas subsistante.
La réponse de Thomas est particulièrement notable. Dans un premiertemps, il récuse le texte. C’est ce qu’on a déjà vu. Aristote, ici, ne donne-rait pas sa thèse personnelle, mais raisonnerait supponendo dans un ca-dre associant un organe à l’intellect. Rien ne peut donc en être extrait quiserve d’autorité ; et de fait, comme on l’a dit, l’intellect pour Thomas n’apas d’organe et ne s’actualise pas comme par exemple le puissance detisser ou de bâtir qui mobilise instrumentalement le corps. Mais dans undeuxième temps, Thomas sauve le texte. Non pas, bien sûr, l’hypothèse,selon lui sous-jacente, que l’intellect serait la forme d’un organe corpo-rel ; mais, décrochée de cette base fautive, l’idée que ce n’est pas l’âmequi pense mais l’homme par son âme. Pourquoi, en effet – à condition,on le redit, de ne pas y voir la conséquence du caractère organique del’intellect –, cela est-il sensé ? Pour les raisons mêmes qu’on a donnéesplus haut : parce que l’âme, à proprement parler, n’est pas subsistante, etque, donc, puisque seul ce qui est proprement subsistant agit proprementpar soi, elle n’agit pas, à proprement parler, par soi, mais n’est rien quece par quoi le composé humain opère=34. Il l’écrit comme suit :
33. Voir par exemple THOMAS D’AQUIN, Sentencia libri de anima III, 4 (430a18-20),p. 220, 101 sqq. Cette question de l’attribution (de la pensée) constitue peut-être unedifférence significative de plus avec Averroès ; pour ce dernier, voir J.-B. BRENET,« Acquisition de la pensée et acquisition de l’acte chez Averroès. Une lecture croisée duGrand Commentaire au De anima et du Kitāb al-Kašf ̔an manāhij al-adilla », à paraîtredans les Actes du colloque Philosophical Psychology in Medieval Arabic and Latin Aris-totelianism, Mexico, Universidad Panamericana, 29-30 mai 2008.
34. Ce qui pose un problème de taille : si l’âme agit par soi dans la mesure où elle estpar soi, qu’implique cette remise en cause de l’idée même qu’elle agisse ? Comme leremarque justement A. KENNY (Aquinas on mind, London and New York, Routledge,
THOMAS D’AQUIN PENSE-T-IL ? 243
Vel dicendum quod per se agere convenit per se existenti. Sed per se existensquandoque potest dici aliquid si non sit inhaerens ut accidens vel ut formamaterialis, etiam si sit pars. Sed proprie et per se subsistens dicitur quod ne-que est praedicto modo inhaerens, neque est pars. Secundum quem modumoculus aut manus non posset dici per se subsistens; et per consequens nec perse operans. Unde et operationes partium attribuuntur toti per partes. Dicimusenim quod homo videt per oculum, et palpat per manum, aliter quam cali-dum calefacit per calorem, quia calor nullo modo calefacit, proprie loquendo.Potest igitur dici quod anima intelligit, sicut oculus videt, sed magis propriedicitur quod homo intelligat per animam=35.
Ainsi, en tant qu’elle n’est qu’une partie, l’âme ne subsiste pas par soiet n’opère pas par soi. Certes, il faut distinguer entre le cas de l’âme hu-maine et celui de la chaleur : jamais, en aucune façon, la chaleur ne sedissociera du corps qu’elle informe, tandis que l’âme, comme partie, aumême titre que l’œil ou la main, dispose d’une indépendance relative ; età cet égard, « on peut dire que l’âme intellige (potest […] dici quod ani-ma intelligit)=36 ». Mais en vérité, « il est plus propre de dire que l’hommeintellige par l’âme (magis proprie dicitur quod homo intelligat per ani-mam) ». A proprement parler, donc, ce n’est pas l’âme qui pense :comme on le disait, elle n’est que le principe premier d’une opérationsans organe dont le sujet véritable est l’homme concret qui l’a pourforme substantielle.
La thèse est large, du reste ; elle ne vaut pas seulement, comme on l’avu plus haut, pour la pensée : si tout ce qui se passe, quelle qu’en soit lamodalité, doit être reconduit à l’âme, et que, de l’âme, on est nécessaire-ment ramené au composé humain complet dont elle fait partie, cela veutdire que toutes les opérations, quelles qu’elles soient, seront, pour cetteraison que lui seul subsiste vraiment par soi, les opérations de l’homme.Penser n’est pas chauffer, certes ; penser n’est pas voir, n’est pas toucher,n’est pas imaginer – car ces actes ne se rapportent pas au corps de lamême manière. Mais ce ne sont là que différents déploiements de surfaced’une même virtus de l’âme, forme substantielle du corps ; si bien que,par-dessous ces différences, non seulement l’homme pense ; non seule-
1993, p. 135) : « the final sentence, echoing Aristotle, seems to cut the ground from underthe argument for independent existence of any kind ». Il faut réserver cela, qui menace lacohérence globale de la position thomasienne, pour un autre travail.
35. THOMAS D’AQUIN, Summa theologica, Ia, q. 75, art. 2, resp., p. 197.36. THOMAS D’AQUIN, Summa theologica, IIaIIae, q. 58, art. 2, resp., Rome, Ex Typogra-
phia Polyglotta, (Sancti Thomae de Aquino Opera omnia, t. IX), 1897, p. 10-11 :« Actiones autem sunt suppositorum et totorum, non autem, proprie loquendo, partiumet formarum, seu potentiarum, non enim proprie dicitur quod manus percutiat, sed homoper manum ; neque proprie dicitur quod calor calefaciat, sed ignis per calorem. Secun-dum tamen similitudinem quandam haec dicuntur. »
244 JEAN-BAPTISTE BRENET
ment, il sent ; non seulement il imagine ; mais c’est le même homme quipense, qui sent, qui imagine.
V. LE RAPPORT À L’IMAGE
Cette unité se manifeste d’ailleurs dans l’acte intellectif ; et c’est undernier point essentiel. Lorsque Thomas analyse les textes du De animaqui paraissent suggérer l’idée de la pensée comme d’un acte« commun », et non pas « propre » à l’âme, il ne transige jamais sur cequi selon lui constitue le caractère majeur de la connaissance intellec-tuelle, à savoir l’immatérialité, dont il fait dépendre la possibilité d’uneséparation de l’âme à la mort du corps ; et ainsi, comme on l’a noté, ilétablit toujours d’abord que l’intelliger est propre à l’âme en ce sens que,au niveau du principe immédiat de l’agir qu’est l’intellect, il n’entre au-cun organe corporel et que sous ce rapport la pensée n’est jamais l’acted’un coniunctum. Mais il ajoute une chose dont on n’a rien dit jusqu’àprésent : c’est que si le corps n’est pas mobilisé comme instrument, sousla forme d’un coniunctum, il est tout de même nécessairement requis àtitre d’objet, puisqu’il n’y a d’intelligible pour l’homme que sur la based’une abstraction des images et que ces images, elles, sont évidemmentinscrites dans des organes corporels. En effet :
Sciendum est igitur quod aliqua operatio anime est aut passio que indigetcorpore sicut instrumento et sicut obiecto ; sicut uidere indiget corpore sicutobiecto quia color, qui est obiectum uisus, est corpus, item sicut instrumentoquia uisio, etsi sit ab anima, non est tamen nisi per organum uisus, scilicetper pupillam que est ut instrumentum ; et sic uidere non est anime tantum,set etiam organi. Aliqua autem operatio est que indiget corpore, non tamensicut instrumento, set sicut obiecto tantum ; intelligere enim non est per or-ganum corporale, set indiget obiecto corporali=37.
La conclusion est que « l’intelliger est en quelque façon propre àl’âme », mais aussi qu’« il relève en quelque façon du conjoint (intelli-gere quodam modo est proprium anime, quodam modo est coniuncti)=38 ».
37. THOMAS D’AQUIN, Sentencia libri de anima, I, 2 (403a3-403a10), p. 9, 50-62. Surcette question du corps-objet, corps-sujet, voir J.-B. BRENET, « Sujet, objet, pensée person-nelle : l’Anonyme de Giele contre Thomas d’Aquin », à paraître dans les Actes du Collo-que Averroès, averroïsme, anti-averroïsme, organisé à Genève, 15-18 octobre 2006, sous ladirection d’A. de Libera ; et Id., « Corps-sujet, corps-objet. Notes sur Averroès et Thomasd’Aquin dans le De immortalitate animae de P. Pomponazzi », à paraître dans les Actesdu Colloque Pomponazzi : autour du De immortalitate animae, organisé à Tours, 12-13octobre 2006, par le Centre d’Études supérieures de la Renaissance (UMR 6576, universitéFrançois Rabelais, Tours / CNRS) et le GDR 2522 du CNRS, sous la responsabilité deJ. Biard et Th. Gontier.
38. THOMAS D’AQUIN, Sentencia libri de anima, I, 2 (403a3-403a10), p. 9, 48-50.
THOMAS D’AQUIN PENSE-T-IL ? 245
La pensée en effet n’est pas l’acte d’un coniunctum, si l’on entend par làqu’elle n’use pas d’un instrument corporel ; mais elle est d’une certainemanière, dit Thomas, l’acte d’un coniunctum, si l’on entend cette foisqu’elle requiert pour son exercice un objet présent dans le corps etqu’elle mobilise, donc, des facultés inférieures, le sens et l’imagination,actuant des organes. Or on aurait tort de négliger ce point. On aurait tortde le négliger en croyant que l’essentiel, pour Thomas, consiste à dé-montrer que la pensée est l’acte de l’intellect sans l’usage d’un organecorporel, et que, du coup, si le corps intervient, ce n’est jamais quecomme objet. C’est mal juger. Il est vrai que le corps est seulement objetdans l’acte d’intellection=39 ; mais il est tout à fait capital et significatifqu’il le soit. Capital à deux niveaux, au moins : non seulement par sondynamisme, au niveau des puissances sensitives, dans l’élaboration et lafourniture de l’image qui constitue l’objet pensable ; mais aussi, et sur-tout, par sa nécessaire co-opération dans l’acte même d’intellection, puis-que penser ne consiste pas seulement à concevoir de l’universel abstraitd’images singulières, mais à penser cet universel rapporté à la chosemême dont il est tiré.
C’est le sens de la conversio ad phantasmata dont parle Thomas=40. Ilest impossible à notre intellect dans son état présent de penser quoi quece soit sans être tourné vers les images. Cela tient au fait que l’opérationd’une puissance est proportionnée à cette puissance, ou encore que leconnaissable est proportionné au connaissant=41. Si l’intellect humain estla puissance d’une âme forme substantielle du corps, son objet propre nepeut donc être qu’« une quiddité ou une nature existant dans une ma-tière corporelle (quidditas sive natura in materia corporali existens)= =42 ».Mais cela ne signifie pas que les formes senties et imaginées soient seu-lement le point de départ obligé de notre connaissance, son amorce. Elles
39. Voir par exemple Sentencia libri de anima, I, 2 (403a10-403b7), p. 10, 71-72 :« [anima] non indiget corpore nisi ut obiecto tantum. » Nous soulignons.
40. Sur ce point, voir notamment R. PASNAU, Thomas Aquinas on human nature. Aphilosophical studies of Summa Theologiae Ia 75-89, Cambridge, Cambridge UniversityPress, 2002, p. 284-295 ; J. MOREAU, De la connaissance selon Thomas d’Aquin, Paris,Beauchesne, 1976, p. 51, n. 10 ; p. 89, n. 7 ; p. 106 ; N. KRETZMANN, « Philosophy ofmind », dans N. KRETZMANN et E. STUMP (éd.), The Cambridge Companion to Aquinas,Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 141-142 ; A. KENNY, Aquinas on mind,op. cit., p. 89-99.
41. Voir par exemple THOMAS D’AQUIN, ST Ia, q. 84, art. 7, resp., p. 325 : « potentia co-gnoscitiva proportionatur cognoscibili » ; ou De memoria reminiscentia, dans THOMAS
D’AQUIN, Sentencia libri De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria etreminiscentia, Rome-Paris, Commission Léonine-Vrin, 1985 (Sancti Thomae De AquinoOpera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. XLV, 2), 2 (450a5-14), p. 109, 104-104 :« operatio proportionatur uirtuti et essencie. »
42. THOMAS D’AQUIN, ST Ia, q. 84, art. 7, resp., p. 325.
246 JEAN-BAPTISTE BRENET
doivent en constituer la constante référence, le point d’appui. Il ne suffitpas d’en partir, autrement dit, il faut s’y tenir. C’est ainsi que Thomascomprend Aristote, lorsqu’il écrit dans le De anima (III, 6, 431b2) que« c’est dans les images que l’intellectif intellige les espèces (species […]in fantasmatibus intellectiuum intelligit)=43 ». L’intellect pensel’intelligible dans l’image, non pas seulement parce qu’il doit puiser dansle senti de quoi penser, faute de disposer d’espèces co-naturelles oud’idées innées, mais parce que l’intelligible qu’il pense ne peut être conçucorrectement que comme une forme existant dans une nature corporelle.Sans être considéré selon les caractères particuliers dont le revêt la ma-tière, il doit donc être pensé en rapport simultané aux particuliers danslesquels il existe. C’est ce que veut dire « voir » (speculari) la natureuniverselle existant dans le singulier sensible=44. C’est bien la nature de lapierre que je pense ; mais celle-ci n’existant que dans telle et telle pierreréelles, je ne la pense « complètement et vraiment qu’en tant qu’elle estconnue comme existant dans le particulier (complete et vere nisi secun-dum quod cognoscitur ut in particulari existens)=45 » ; ou bien : je nepense de manière satisfaisante, quand bien même j’aurais déjà acquiscertaines espèces intelligibles, qu’en usant de ces espèces « selon que celaconvient aux choses dont elles sont les espèces, lesquelles choses sont desnatures existant dans les particuliers (oportet quod eis utamur secundumquod convenit rebus quarum sunt species, quae sunt naturae in particu-laribus existentes)=46 ».
Thomas l’explicite encore autrement. Si penser dans l’image consisteà intelliger, non pas simplement à partir des images, mais encore, aussibien pour l’acquisition que pour l’actualisation des espèces en habitus,avec elles, comme en un vis-à-vis, c’est pour s’assurer que les conceptsproduits rejoignent « le sol de la réalité=47 ». Les images servent de cri-tère. Tels les principes pour la démonstration, elles constituent le« fondement permanent » par rapport auquel le jugement intellectueldoit s’évaluer=48 ; elle en sont le « terme » et la « fin »=49. Ou bien encore,
43. THOMAS D’AQUIN, De memoria et reminiscentia, 2, p. 108, 100-109, 103.44. Voir THOMAS D’AQUIN, ST Ia, q. 84, art. 7, resp., p. 325 : « Necesse est ad hoc quod
intellectus actu intelligat suum obiectum proprium, quod conuertat se ad phantasmata, utspeculetur naturam uniuersalem in particulari existentem. » C’est le terme qu’on re-trouve dans cette autre autorité majeure du De anima III, 8, 432a7-9 : « Et ob hoc nequenon senciens nichil, nichil utique addiscet neque intelliget, set cum speculetur, necessesimul fantasma aliquod speculari » ; voir le commentaire, Sentencia libri de anima, III, 7(431b28-432a14), p. 236, 72-89.
45. THOMAS D’AQUIN, ST Ia, q. 84, art. 7, resp., p. 325.46. THOMAS D’AQUIN, ST Ia, q. 84, art. 7, ad 1, p. 325.47. La formule est de J. MOREAU, De la connaissance selon Thomas d’Aquin, p. 106.48. THOMAS D’AQUIN, Super Boetium De Trinitate, Roma-Paris, Commissio Leonina-
Ed. du Cerf (Sancti Thomae de Aquino Opera omnia, t. L), 1992, q. 6, art. 2, ad 5, p. 166,
THOMAS D’AQUIN PENSE-T-IL ? 247
de même que l’artisan ne peut pas bien fabriquer un couteau s’il enignore la fonction, l’intellect ne peut parfaitement juger s’il ne rapportepas sa production mentale à son pendant sensible. C’est ce qu’écrit Tho-mas dans le De veritate :
iudicium non dependet tantum a receptione speciei, sed ex hoc quod ea dequibus iudicatur examinantur ad aliquod principium cognitionis, sicut deconclusionibus iudicamus eas in principia resolvendo. […] Sed quia primumprincipium nostrae cognitionis est sensus, oportet ad sensum quodammodoresolvere omnia de quibus iudicamus ; unde Philosophus dicit in III Caeli etmundi, quod complementum artis et naturae est res sensibilis visibilis, exqua debemus de aliis iudicare ; et similiter dicit in VI Ethic. Quod sensus suntextremi sicut intellectus principiorum ; extrema appellans illa in quae fit re-solutio iudicantis=50.
Il est clair par conséquent qu’on ne saurait minorer le rôle du corpsdans l’intellection. Comme tel, l’acte de penser se fait sans instrumentcorporel, mais il requiert ici-bas le corps pour son déclenchement et sacorrecte effectuation. Comme nous le disions, l’acte intellectif est à cetégard significatif : issu d’une principe séparé, puissance supérieure d’uneforme substantielle du corps, il est la manifestation de l’identité del’homme sentant, imaginant, et pensant. Si l’homme, cet homme, fait dechair et d’os, pense, ce n’est pas seulement parce que l’acte propre de
171-180 : « phantasma est principium nostre cognitionis ut ex quod incipit intellectusoperatio, non sicut transiens, set sicut permanens ut quoddam fundamentum intellectua-lis operationis ; sicut principia demonstrationis oportet manere in omni processus scien-tie, cum phantasmata comparentur ad intellectum ut obiecta in quibus inspicit omnequod inspicit, uel secundum perfectam representationem, uel per negationem. » VoirST IIa IIae, q. 173, a. 3, p. 388 ; voir aussi Summa contra Gentiles (Sancti Thomae Aquina-tis Opera omnia iussu edita Leonis XIII P. M., t. XIII), Romae, Riccardi Garroni, 1918, II,73, p. 462 ; trad. franç., Somme contre les Gentils. Livre sur la vérité de la foi catholiquecontre les erreurs des infidèles, traduction inédite par V. AUBIN, C. MICHON et D. MOREAU,4 volumes, Paris, GF-Flammarion, 1999, livre II, chap. 73, § 38, p. 290-291.
49. THOMAS D’AQUIN, ST Ia, q. 84, art. 8, resp., p. 328.50. THOMAS D’AQUIN, Quaestiones disputatae de veritate, Romae, Ad Sanctae Sabinae
(Sancti Thomae de Aquino Opera omnia, t. XXII), 1970, q. XII, art. 3, ad 2, p. 377, 366-378,387 ; voir ST Ia, q. 84, art. 8, resp., p. 328 : « Proprium obiectum intellectui nostro propor-tionatum est natura rei sensibilis. Iudicium autem perfectum de re aliqua dari non potest,nisi ea omnia quae ad rem pertinent cognoscantur ; et praecipue si ignoretur id quod estterminus et finis iudicii. Dicit autem Philosophus, in III De caelo, quod sicut finis factivaescientiae est opus, ita naturalis scientiae finis est quod videtur principaliter secundumsensum : faber enim non quaerit cognitionem cultelli nisi propter opus, ut operetur huncparticularem cultellum ; et similiter naturalis non quaerit cognocere naturam lapidis etequi, nisi ut sciat rationes eorum quae videntur secundum sensum. Manifestum est au-tem quod non posset esse perfectum iudicium fabri de cultello, si opus ignoraret : etsimiliter non potest esse perfectum iudicium scientiae naturalis de rebus naturalibus, sisensibilia ignorentur. Omnia autem quae in praesenti statu intelligimus, cognoscuntur anobis per comparationem ad res sensibiles naturales. »
248 JEAN-BAPTISTE BRENET
l’âme, en vérité, lui revient comme l’acte de la partie revient au tout,mais aussi parce que, dans la pensée, solidairement, fût-ce à des titresdivers, ce sont toutes ses puissances qui s’accordent.
CONCLUSION
Concluons rapidement en trois points.(1) Premièrement, il ne nous semble pas y avoir chez Thomas de vraie
concurrence entre ces deux énoncés : « l’âme pense », d’un côté ;« l’homme pense », de l’autre. Nous ne sommes pas sur le même plan. Sil’on distingue principe immédiat de l’agir, principe premier-forme sub-stantielle, et suppôt, les trois niveaux de l’intellect, de l’âme et del’homme s’articulent et débouchent sur l’idée qu’à proprement parler,seul l’homme intellige. Il en irait certes tout autrement si Thomas avaitfait de l’âme humaine une substance première ; mais tel n’est pas le cas.Et s’il y a deux sujets de la pensée chez lui (chez lui aussi), l’un, l’âme,n’est que le sujet-substrat de l’intellect, tandis que l’autre, l’homme, estproprement le sujet-suppôt de l’agir. Reste ce problème majeur, rapide-ment noté plus haut : si l’âme ne pense pas vraiment par soi, parce que,simple partie, elle n’agit pas vraiment, que faire de tout ce qui suspend àson action par soi la démonstration de son être par soi, et donc de sonimmortalité ?
(2) Deuxièmement, l’analyse qu’on propose permet d’harmoniserdivers énoncés aristotéliciens notoirement délicats. N’en retenons quedeux. Au livre III, chapitre 4 (429a23), l’intellect est défini comme « cepar quoi l’âme intellige » ; au livre II, chapitre 2 (414a12-13), en revan-che, on lit que l’âme est « ce par quoi nous pensons ». Là encore,l’articulation s’impose : l’intellect, comme puissance émanée, est ce parquoi, n’usant pas d’organe, l’âme, son principe premier, pense (c’est sonacte propre en ce sens) : premier énoncé ; mais cette âme n’est qu’unepartie de l’humain, seul véritable suppôt : c’est lui, donc, qui, à propre-ment parler, pense, et il le fait par cette âme qui, en tant que formesubstantielle, est principe premier de toute opération : second énoncé.
(3) Troisièmement, d’un point de vue conceptuel, les développementsde Thomas nous semblent enrichir l’une des questions clés de la psy-chologie d’Aristote, ou mieux : de sa biologie, à savoir celle qui concernece qui est « commun » à l’âme et au corps=51. Au début de son De anima(I, 1, 403a3 sqq.), Aristote demande – et c’est un axe du texte – si toutes
51. Sur ce point – qu’on tâchera d’étudier ailleurs – voir notamment P.-M. MOREL, Dela matière à l’action. Aristote et le problème du vivant, Paris, Vrin, 2007 ; S. MENN,« Aristotle’s definition of the soul and the programme of the De anima », Oxford Studiesin Ancient Philosophy 22 (2002), p. 83-139.
THOMAS D’AQUIN PENSE-T-IL ? 249
les affections de l’âme sont « communes » ou s’il en est quelqu’une quilui soit absolument propre. L’analyse de Thomas dépasse cette alterna-tive. Comme on l’a répété, la pensée est un acte propre de l’âme, c’est-à-dire un acte de la puissance intellective qui s’effectue sans organe corpo-rel : en ce sens, elle n’est pas « commune », c’est-à-dire qu’elle n’est pascommune à une puissance et un organe ; elle n’est pas l’acte d’un con-iunctum. Mais un coniunctum est tout de même requis : non pas à titred’instrument, mais à titre d’objet, puisqu’il faut des images pour penser,et même, en pensant : de ce point de vue, la pensée est de l’âme et ducorps. Du reste, l’âme n’étant pas à proprement parler une substancepremière, ce n’est pas elle qui agit mais le suppôt dont elle est la forme.En ce sens aussi, par conséquent, la pensée est « commune » : sans êtrel’acte d’un coniunctum, compris comme organe récepteur d’une puis-sance, elle est bien l’acte du compositum hylémorphique qu’estl’humain : aussi la « propriété » de l’acte intellectif n’est-elle pas anti-nomique sous tous rapports avec sa « communauté » : la pensée est pro-pre au niveau de sa puissance immédiate ; commune au niveau de sadépendance à l’objet ; commune, enfin, de la manière la plus radicale, auniveau de son sujet-suppôt.
Cela n’enlève pas toutes les difficultés, certes non. Mais on y trouvepeut-être de quoi ne pas dénoncer trop vite chez Thomas l’impossibilitéde s’excepter du coup qu’il porte à la noétique d’Averroès. Voyait-il justeen menant cette attaque ? Nous croyons que non=52. Mais c’est une autreaffaire.
6, rue Deguerry75011 Paris
52. Sur ce point, voir notamment D. L. BLACK, « Consciousness and Self-Knowledgein Aquinas’s Critique of Averroes’ Psychology », Journal of the History of Philosophy 31(1993), p. 349-393 ; id., « Models of the Mind : Metaphysical Presuppositions of the Aver-roist and Thomistic Accounts of Intellection », Documenti e Studi sulla tradizione filoso-fica medievale, 15 (2004), p. 319-352 ; J.-B. BRENET, « Averroès a-t-il inventé une théoriedes deux sujets de la pensée ? », Tópicos. Revista de filosofía 29 (2005), p. 53-86 ; Id.,« Habitus de science et subjectité. Thomas d’Aquin, Averroès – I* », dans Ch. ERISMANN
et A. SCHNIEWIND (éd.), Compléments de substance. Études sur les propriétés accidentellesoffertes à Alain de Libera, Paris, Vrin, 2008, p. 325-344.
250 JEAN-BAPTISTE BRENET
RÉSUMÉ. — Thomas d’Aquin pense-t-il ? Retours sur Hic homo intelligit. Par Jean-Baptiste BRENET.
L’article examine si Thomas est en mesure de relever lui-même le défi qu’il lance à lanoétique d’Averroès, celui de justifier théoriquement la proposition hic homo intelligit. Ils’agit d’étudier l’éventuelle concurrence entre deux énoncés : « l’âme pense par soi » d’uncôté ; « l’homme pense » de l’autre. Pour cela, on revient sur la distinction entre les diffé-rents niveaux de l’agir, sur le statut de l’âme humaine comme partie formelle du composéhylémorphique humain, sur l’idée que actiones sunt suppositorum et sur la portée, enfin,de la dépendance au corps.
MOTS CLEFS : agir – âme – Averroès – image – intellect – objet – puissance – sujet.
ABSTRACT. — Does Thomas Aquinas think ? Reconsiderations of Hic homo intelligit.By Jean-Baptiste BRENET.
This article examines whether Thomas himself is capable of responding to the chal-lenge he poses to Averroès’ noetics : to provide a theoretical justification for the proposi-tion hic homo intelligit. We shall examine two statements which may well be in competi-tion: on the one hand, ‘the soul thinks in and of itself’ ; on the other, ‘the human beingthinks’. In doing so, we reconsider the distinction between the different levels of action,the status of the human soul as the formal component in the hylomorphic make-up of thehuman being, the notion that actiones sunt suppositorum, and finally the significance ofthe soul’s dependence on body.
KEY WORDS : action – Averroès – image – intellect – object – power – soul – subject.