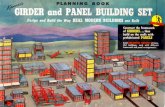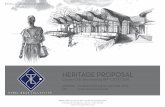The myth of Sophiatown and the Post-Apartheid urban reconstruction in Johannesburg
Transcript of The myth of Sophiatown and the Post-Apartheid urban reconstruction in Johannesburg
1
Table des matières
Remerciements ................................................................................................................................ 4 Introduction .................................................................................................................................. 5 Première Partie Sophiatown, modèle de l’urbanité sud-africaine ............................................................. 9
I. Le décor ............................................................................................................................... 9 A. Sophiatown, le drame parfait ............................................................................................ 9
1. Un quartier en kaléidoscope ......................................................................................... 10 a. Genèse et paysage ...................................................................................................... 10 b. Mémoire et reconstitution .......................................................................................... 13
2. Une journée ordinaire à Sophiatown ............................................................................ 16 a. La rue : espace public ................................................................................................. 16 b. La maison : espace partagé ........................................................................................ 18
B. Les acteurs ......................................................................................................................... 20
1. En haut de l’affiche : stars et bandits ........................................................................... 21 a. Les nouveaux FarWest ............................................................................................... 21 b. Bouillon de cultures ................................................................................................... 23 c. La fièvre du samedi soir ............................................................................................. 24
2. Les figurants : trajectoires de vies dans l’Afrique du sud des années 1950 ................. 25 a. Claudiah ..................................................................................................................... 25 b. Le petit peuple de Sophiatown ................................................................................... 26
3. Le chœur : Drum magazine ........................................................................................... 27
2
C. Le dénouement tragique ................................................................................................... 29 1. Mots et maux de Sophiatown ....................................................................................... 29
a. Destruction et déplacement de population ................................................................. 29 b. L’arrivée à Orlando .................................................................................................... 30
2. La naissance d’un mythe ............................................................................................... 31 a. Mort prématurée de l’urbanité ................................................................................... 31 b. Sophiatown, Fietas, District Six : plusieurs quartiers, une seule histoire .................. 32
II. Sophiatown du mythe au modèle ...................................................................................... 34 A. Qu’est ce qui fait le mythe ? ............................................................................................. 34
1. Les multi facettes du mythe géographique .................................................................... 34 a. Le mythe : éléments de définition .............................................................................. 34 b. Les arché-paysages : le mythe à l’échelle géographique ........................................... 36 c. Nostalgie et territoire .................................................................................................. 38
2. La mobilisation d’un imaginaire .................................................................................. 39 a. Les représentations du mythe ..................................................................................... 40 b. Les utilisations du mythe ........................................................................................... 41
B. Le mythe : un pont dans l’histoire ? ................................................................................ 42
1. Un lien entre l’avant et l’après apartheid .................................................................... 42 a. Négation de urbanité, négation de l’identité .............................................................. 43 b. La ville dans la reconstruction identitaire à l’échelle nationale ................................. 44
2. Le mythe, manifeste pour un retour à l’urbain ? .......................................................... 46 a. Ville et urbanité .......................................................................................................... 46 b. Des résurgences épisodiques ...................................................................................... 47
C. Le modèle de Sophiatown ................................................................................................. 49
1. Johannesburg versus Amsterdam ................................................................................. 49 2. Le modèle de Sophiatown ............................................................................................. 51
Deuxième partie Sophiatown, un modèle d’urbanité pour la ville post apartheid ? .......................... 54
I. A la recherche de nouveaux mondes urbains ............................................................ 54 A. Sophiatown : des thématiques d’études pour la ville contemporaine .......................... 54
1.Un modèle à part ........................................................................................................... 54 2. Méthodologie ................................................................................................................ 55
a. La démarche ............................................................................................................... 55 b. Discours ..................................................................................................................... 56
3. la matrice Sophiatown .................................................................................................. 58 a. Topographie .............................................................................................................. 58 b. Mixité. ........................................................................................................................ 59
B. Mayfair, Brixton : deux quartiers pour une nation arc-en-ciel? .................................. 59
1. L’approche .................................................................................................................... 59 a. Johannesburg, vue d’ensemble ................................................................................... 60 b.Les quartiers mixtes .................................................................................................... 60
2. Typographie des quartiers : présentation de l’espace .................................................. 61
3
a. Mayfair ....................................................................................................................... 61 b. Bixton ......................................................................................................................... 62 c. Au fil des rues……………………………….……………………………………….81
3. Passants et habitants ..................................................................................................... 64 a. Profils ......................................................................................................................... 65 b. Le quartier : un espace inventé ? ................................................................................ 66
C. Tranches de vie, tranches d’espaces ................................................................................ 69
1. Un espace, des territoires : une coprésence assurée .................................................... 69 a. Mayfair ....................................................................................................................... 69 b. Brixton ....................................................................................................................... 73
2. Le quartier dans la ville ................................................................................................ 76 a. Déplacements et mouvement ..................................................................................... 76 b. Urbanisme vs communautarisme ? ............................................................................ 78 c. Urbanité alternative ou alternative d’urbanité?...........................................................78
II. L’échec de l’intégration urbaine? ............................................................................... 80 A. Coprésence sans interaction : la création de non-lieux ? .............................................. 80
1.Où sont les non lieux ? ................................................................................................... 80 2. Mayfair, Brixton : lieux ou non-lieux ? ........................................................................ 81 3. Les écoles : enclaves d’interaction sociale dans la ville ? ........................................... 83
B. Une urbanité protéiforme ................................................................................................. 84
1. Identités urbaines .......................................................................................................... 84 a. De la réalité au modèle ............................................................................................... 84 b. Mayfair Brixton, quartiers urbains ? .......................................................................... 85
2. La mémoire de la ville ................................................................................................... 86 a. Mayfair ou le retour aux sources ................................................................................ 86 b. Les musées : la création de lieux symboliques .......................................................... 88
Conclusion Mythe, mémoire et urbanité .................................................................................................. 90
• Changement d’échelle : la ville, l’urbain et l’héritage ................................................... 90 • Les projets ...................................................................................................................... 92 • Ville-villes ...................................................................................................................... 94 • Quel modèle pour les villes du sud?................................................................................95
Bibliographie ..................................................................................................................... 97
4
Remerciements
Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Marcel Bazin, directeur de l’Ecole
doctorale de l’Université de Reims ; Monsieur Charles Vulliez et Madame Nicault directeurs
du DEA Espaces, Cultures et Civilisations ; Messieurs Jacques Lévy, professeur des
Universités et rapporteur de ce travail et Philippe Gervais-Lambony, professeur de l’Université
Paris X-Nanterre et membre du jury ; Messieurs Philippe Guillaume, vice-directeur de
l’Institut Français d’Afrique du Sud, Alan Mabin, professeur de l’Université du Witwatersrand
à Johannesburg, Benoît Antheaume, représentant de l’IRD en Afrique du Sud, Olivier Vilaça,
doctorant et chargé de cours à l’Institut d’Etude Politique de Paris, Nicolas Péjout, doctorant à
l’IFAS, ainsi que Mesdames Pernette Grandjean et Claire Bénit, professeurs à Reims et
Marseille, et Madame Bénédicte Alliot, directrice de L’IFAS, qui ont guidé mes premiers pas
dans la recherche.
5
Introduction
« Une ville est une portion de territoire surchargée d’interactions. »
Ulf Hannerz
« Nous nous sommes engagés à construire la société
dans laquelle tous les sud-africains, qu’ils soient blancs ou noirs
pourront marcher la tête haute sans peur dans le cœur,
sûrs de leur droit inaliénable à la dignité humaine
– une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et dans le monde »
(Nelson Mandela, 1994, cité par S.Smith, 2003 : 196)
L’étude de la ville sud-africaine contemporaine s’inscrit dans le
contexte particulier de la chute du régime de l’apartheid qui divise le pays au nom du
«développement séparé» jusqu’en 1994 et régit de manière plus ou moins marquée les rapports
entre les groupes raciaux depuis le début de XXème siècle.
C’est au tournant du siècle que l’Afrique du Sud élabore et applique une ségrégation spatiale et
raciale systématique censée éradiquer la présence d’espaces mixtes dans le paysage urbain. En
1901, en vertu de principes hygiénistes, il est décidé que les non-Blancs des villes du Cap et de
Johannesburg doivent résider dans des quartiers spécifiques. En 1923, le Général Smut
entérine le Native Urban Area Act, première action généralisée de planification urbaine qui
limite la liberté de circulation et de résidence des populations noires dans les villes. Héritières
des modèles de planification américains (P.Guillaume, 2001), ces lois sont régies par le
principe de zonage, mis en place au Etats-Unis dans les années 1910, et repris au Cap dès 1920.
Comme le souligne P.Guillaume, certains planificateurs urbains cherchent alors à promouvoir
un idéal communautaire pour concevoir ce qui deviendra les townships, ces immenses ghettos
déshumanisés. Un pas de plus est franchi en 1950, deux ans après l’arrivée au pouvoir du Parti
National et la mise en place du « grand apartheid » qui marque une radicalisation du système.
L’application du Group Area Act étend alors la ségrégation à toutes les races et l’établi de
façon légale la division de espaces publics et une gestion raciste du logement.
6
La multiplication de ces Acts tente de s’opposer à ce que fut la primo urbanisation de
Johannesburg, ville minière fondée en 1886. Dès 1890 les premiers camps de travailleurs
(compounds) s’installent, abritant chercheurs d’or, aventuriers et travailleurs de toutes origines
attirés par l’appât du gain ou plus modestement la possibilité de gagner quelques pennies.
Comme le rappelle P.Gervais-Lambony : « jusqu’à la fin du XIXème siècle Johannesburg fut
une ville minière assez typique. On y trouvait une écrasante proportion d’hommes, des
mineurs anglophones venus du Royaume-Uni, d’Australie ou d’autres régions de l’Empire
Britannique, une minorité d’Afrikaners venus des zones rurales pour travailler dans les
briqueteries ou les sociétés de transport, des mineurs africains venus du Mozambique, du
Transvaal, ou du Cap, des Africains du Natal employés comme domestiques ou
blanchisseurs.» A l’opposé de la ville racialement uniforme que le régime de l’apartheid tente
de mettre en place Egoli (la ville d’or en Zoulou) était «la ville des aventuriers patrons de bars,
bistroquiers, joueurs blancs et métis d’ailleurs, comme les prostituées elles-mêmes.» Charles
van Onselen, historien sud-africain, affirme lui aussi qu’en 1896 le « quartier indigène »,
(Coolie Location), était composé de « 7000 personnes de toutes races, dont 1500 employés à
la construction des briques, 1200 chevaux et mules et 450 attelages. » (cité par Guillaume,
2001, 57). Quelques années plus tard, dans un article du 5 février 1915, le Transvaal Leader,
rapporte les conditions de vie dans ces quartiers : «Ces courts ressemblent à des terriers à
lapins, d’où part un labyrinthe de passages, de repaires du criminel, de l’indigène sans pass,
du tire au flanc. Il y a des cours où Indiens, Malais, Blancs, Métis et Kaffirs s’entassent dans
la promiscuité. Il y a des maisons, jadis demeures des Blancs de la classe supérieure, qui sont
aujourd’hui abandonnées à la lie d’une population mélangée. Je me vois encore monter les
escaliers d’une maison de Marshall Street et trouver un Blanc, une Noire, un mouton et une
chèvre vivant ensemble dans la chambre du haut. Je n’oublierais pas non plus cette cour dans
le quartier de choix qu’on appelle le Camps Malais, où j’ai trouvé un matin, un groupe de
jeunes filles indigènes ivres mortes après l’orgie d’alcool méthylique et d’opium qu’elles
avaient acheté dans une boutique chinoise. » (cité par P.Guillaume, ibid).
C’est donc pour palier à ce qu’elle estime être un problème de santé publique que
l’administration détruit la Coolie Location en 1904 et se lance dans la construction 1917 du
premier township : le Western Native Township. En 1932, Orlando Township, destiné aux
Africains est mis en construction, bientôt suivi de Javabu et Moroka en 1948, prémices du
futur Soweto. En 1940, il ne reste à Johannesburg plus qu’un seul quartier rescapé de cette
ségrégation spatiale planifiée : Sophiatown qui sera détruit en 1956.
7
Dans cette histoire urbaine faite de ruptures et d’exclusion, je me suis demandée comment peut
naître et se développer un sentiment urbain, celui d’appartenir à cet univers social spécifique et
cette manière d’être en ville qui crée ce que l’on appelle « l’urbanité » ?
Réflexion en plusieurs étapes sur la notion d’urbanité et son évolution dans le temps, ce travail
s’appuie sur deux études. La première concerne Sophiatown, devenu aujourd’hui la référence
incontournable de l’histoire urbaine de l’Afrique du Sud post-apartheid, symbole d’une
urbanité déchue mais toujours vivace. La seconde concerne les quartiers de Mayfair et Brixton,
deux espaces mixtes émergeants de la ville sud-africaine et - peut-être ? - porteurs d’une
nouvelle façon de pratiquer la ville.
Lors du travail préparatoire à cette recherche, Sophiatown est apparue comme un espace
complexe : à la fois social, culturel, politique et religieux, lieu d’intégration, de renouvellement
et de mixité, mais aussi lieu de création de citoyenneté et d’urbanité. Je me suis donc
interrogée sur les réminiscences de cette urbanité spontanée dans la ville sud-africaine
contemporaine et l’existence d’une mémoire urbaine, capable ou non, de régénérer et de
récréer un espace urbain.
Cette première recherche a amené d’autres questionnements sur la ville contemporaine et sur la
construction de nouveaux espaces d’échanges et d’interaction entre des populations et des
cultures séparées depuis des décennies. Ces questionnements nécessitaient une étude de terrain
qui permette d’inscrire le mythe dans une perspective historique. J’ai donc choisi de mener une
étude dans deux quartiers de Johannesburg, Mayfair et Brixton, dont les caractéristiques
topographiques et sociales semblaient pouvoir être mises en perspectives avec le modèle de
Sophiatown précédemment définit.
Dans un souci de lisibilité, j’ai choisi de présenter la démarche méthodologique des enquêtes
au début des premières et seconde parties de ce travail. Mais, que ce soit lors des entretiens
avec les anciens habitants de Sophiatown ou les habitants de Mayfair et Brixton, j’ai d’abord
cherché à mettre en place une méthode d’analyse des représentations et des faits de la ville.
Cette « démarche cohérente » (J.Lévy), s’appuie sur le principe «d’invention du quotidien »
développé par Michel de Certeau et Pierre Mayol, dont les travaux m’ont donné les premières
pistes de compréhension du territoire urbain : son inscription dans le temps, l’espace et
l’imagination.
Il ne s’agit donc pas ici de proposer une étude exhaustive d’une question qui, par ailleurs,
occupe de nombreux géographes et anthropologues urbains. L’objet de ce travail est de
8
replacer la question de l’urbanité dans une perspective historique, à l’échelle d’une ville, ou
plutôt de quelques quartiers de celle-ci.
Comme le rappelle Pierre Nora « Ce que nous cherchons dans l’accumulation religieuse des
témoignages, des documents, des images, de tout les « signe visible de ce qui fut » (...) c’est
notre différence, et « dans le spectacle de cette différence l’éclat soudain d’une introuvable
identité. Non plus une genèse mais le déchiffrement de ce que nous sommes à la lumière de ce
que nous ne sommes plus » (P. Nora cité par Augé, 1992 : 37).
***
9
Première Partie
Sophiatown, modèle de l’urbanité sud-africaine
I. Le décor
A. Sophiatown, le drame parfait
« Sophiatown, Softown, Kofifi, Kasbah, Sophia…place of Freedom Square, and the back of the
Moon. Place of Can Themba House of Truth. Place of the G-men and father Huddleston’s
mission. (…)And let’s not forget Kort Boy and Jazz Boy, and the Manhattan Brothers and
Dolly Rathebe singing her heart out – her in Sophia….
The American, the Berliners, the Gestapo, the Vultures – they fought here and blood ran in the
street of Sophia. (…) Tambo and Mandela walked here.
Luthuli stood, and the city’s people walked past, here in Sophia. »
Jack, in Sophiatown (1988 : 1)
«Live fast, die young», à l’image James Dean, telle aurait pu être la
devise de Sophiatown. Sorti de terre en quelques mois, le quartier tombe quelques dizaines
d’années plus tard sous les coups des bulldozers qui ne laissent comme trace de cette intense
vie urbaine que l’Eglise Anglicane (Christ The King) et la maison du Docteur Xuma dans
Toby Street, que l’on dit trop belle pour être rasée.
En l’espace de quelques années, Sophiatown avait pourtant réussi à transformer le paysage
urbain sud africain et les aspirations des populations Noires. Quartier mixte socialement,
culturellement et surtout racialement, il connaît une évolution en marge de la planification
urbaine gouvernementale de l’époque.
Au tournant des années 1950, la plupart des grandes villes sud-africaines laissent se
développer des «zones franches urbaines» oubliées par l’administration de l’apartheid : District
Six au Cap, Cato Manor à Durban et, dans une moindre mesure Marabastad à Pretoria ou
10
Fietas à Johannesburg, en sont les principales figures. Quartiers populaires où s’entassent pêle-
mêle populations Noires et Métis en provenance de campagnes et d’autres townships,
commerçants asiatiques et indiens, jeunes urbains, intellectuels et artistes en quête d’argent et
de reconnaissance, ces nouveaux territoires urbains auraient pu ressembler à n’importe quel
autre quartier d’immigration des années 1950, en France ou aux Etats-Unis, si le Parti National
n’en avait décidé autrement.
Sophiatown n’est donc pas un cas unique dans l’histoire urbaine, mais aucun autre quartier
n’évoque de manière aussi symbolique la question de l’urbanité en Afrique du Sud.
1. Un quartier en kaléidoscope
a. Genèse et paysage
« Sophiatown c’était un peu comme Harlem aux Etats-Unis,
je me demande quand même ce que ça aurait donné aujourd’hui. »
Maurice, 24/10/2002
• L’histoire
L’histoire commence en 1899. M. Tobiansky signe un bail avec le gouvernement pour que le
terrain qu’il vient d’acquérir à sept kilomètres du centre ville de Johannesburg serve à la
construction de «colored location». Ce bail est annulé en 1905 et le spéculateur baptise son
terrain du nom de sa femme, Sophia, et les rues aux noms de ses cinq enfants : Edith, Bertha,
Gerty, Toby et Sol. Le lot est ensuite divisé en 1694 parcelles proposées à la vente. La distance
du centre ville est perçue comme un inconvénient par les populations Blanches. Le quartier se
peuple donc lentement : 88 familles majoritairement Blanches y vivent en 1910 (Hart et Piri,
1984 : 39, cité par P.Guillaume, 2001 : 65). C’est l’augmentation exponentielle de la
population de Johannesburg dans les premières années du XXème siècle qui va donner un
véritable essor au quartier.
• Les habitants
« Sophiatown is a city of many faces: Kind, cruel, pagan,
Christian, Islamic, Buddhist and Hindu »
(D.Mattera, 1987 : 50).
11
Quartier aux multiples visages, Sophiatown abrite une population cosmopolite et hétérogène.
Rien d’uniforme, rien qui n’ait été planifié, juste une urbanisation spontanée qui se déploie
dans les moindres interstices. Comme le fait remarquer Don Mattera, gamin des rues de
Sophiatown, gangster puis poète, figure emblématique et mémoire médiatique du quartier :
« Every conceivable space was occupied by a living thing – man or animal» (D.Mattera, 1987 :
50).
Les estimations de population dans les années 1950 sont très variables. P.Guillaume (ibid.)
rappelle qu’en 1953 les autorités l’évaluaient à 39 186 personnes. D’autres estimations varient
entre 70 000 habitants (Hart et Piri, ibid.) et 130 000 habitants (Junction Avenue Theatre
Compagny, 1993 : ibid).
Année Nombre de familles
1913 700
1923 10 000
1933 20 000
(Cité par P.Guillaume, 2001 :65)
La population est, à cette époque, majoritairement noire. Certains viennent du centre ville d’où
ils sont été chassés par les premières lois de ségrégation spatiale en 1921 ; d’autres fuient les
campagnes attirés le miracle d’Egoli - la Ville de l’or en Zoulou - à la recherche d’un emploi
dans les mines ou les industries lourdes. Les Indiens, les Coloured, les Asiatiques sont aussi
nombreux à venir s’installer dans ce nouveau centre urbain ; certains témoignages attestent
également de la présence de quelques résidents Blancs. Cette répartition de la population
s’explique facilement : avec Alexandra, Sophiatown est le seul quartier de Johannesburg où,
dans les années 1950, les non-Blancs peuvent accéder à la propriété. Cela fera son succès.
Il n’existe pas de données très fiables pour quantifier l’importance relative de ces populations.
Par exemple, aucun document ne fait état d’un recensement précis du nombre d’Indiens et
d’Asiatiques (majoritairement Chinois), qui détenaient pourtant la plupart des commerces du
quartier (D.Mattera, 1987 : 54). On sait que la population métisse était relativement nombreuse,
P.Guillaume (ibid.) l’estime à 2000 personnes. L’historien Tom Lodge, avance lui les chiffres
de 54000 africains, 3000 Coloured, 1500 indiens et 686 chinois. (T.Lodge, Black policy in
South Africa, 1999).
En revanche, il est certain que peu de Blancs habitent Sophiatown, même si une partie de la
jeunesse engagée et quelques intellectuels fréquentent régulièrement le quartier. Mike Nicol
12
(1991 : 232) cite cependant le cas de Jean Hart et de son mari, originaires de Grande-Bretagne
établis comme antiquaires à Sophiatown pendant plusieurs années.
• Bâti, voirie
Les nombreuses photos prises dans les années 1950 permettent d’imaginer ce qu’était ce
quartier « extra-ordinaire » : bâti, voirie, occupation et surtout son atmosphère unique.
En feuilletant les ouvrages de photographie, on découvre ces rues goudronnées bordées de
belles maisons d’architecture hollandaise, avec frontons et terrasses. Construites par les
premiers arrivants, elles correspondent aux standards de la petite bourgeoisie et sont pour leurs
habitants symbole d’ascension sociale. Dans les grandes artères, les nombreuses échoppes et
boutiques sont surmontées d’un appartement où habite la famille du commerçant. Le linge
pend aux fenêtres, les femmes font leurs commissions. Sur certains clichés, la circulation
semble dense et de grosses voitures américaines se partagent l’asphalte. Le soir, dans les rues
toujours animées, des couples en tenue de soirée se dirigent vers les cinémas aux enseignes de
néons. Images d’insouciance raffinée et de rêve américain.
Mais l’autre visage de Sophiatown se cache derrière ces clichés de carte postale. Dans les
cours et les jardins, on construit des baraques de fortunes (shacks ou backyards
accommodations) dans lesquels s’entasse la plupart des habitants de Sophiatown. «The yards
were small and stinking wherever people lived in this crowded communal way. And you would
find a man or a woman lying drunk in the grime and slime and debris, breathing the foul air of
a dispossessed and forsaken life» (D.Mattera, 1987 : 50).
Dans ces conditions précaires, la rue devient très vite l’espace public privilégié. Filmée par les
services de propagande de l’administration de l’apartheid (cf. Musée de l’Apartheid, Gold
Reef City), elle est bariolée et bruyante : les hommes discutent à l’ombre des maisons, les
femmes y font la lessive, les gamins et les chiens crapahutent à qui mieux mieux. Comme le
décrit Ramoshidi, fils de commerçant indien rencontré à l’Oriental Plaza : «Sophiatown was a
multicultural society of rich and poor. There was no distinction between people. But I think
because it was created with multicultural society it was a slum. Because were some public
services for roads and variety, the area became a town of its own.»
Au croisement de ces univers urbains on trouve les shebeens – les bars informels et illégaux -
et leurs tenancières fortes en gueule et respectées, les « shebeens queens ». Dans ces arrières
cours, à l’abri des regards indiscrets se crée la culture de Sophiatown. Musiciens, chanteurs,
écrivains, journalistes, hommes politiques, gangsters ou amateurs de jazz et de vapeurs
d’alcool se retrouvent là, comme en témoignent les photos glamour de Jürgen Schadeberg –
13
photographe du magazine Drum. Dans cette ambiance de music-hall, les couples qui dansent
au son des orchestres ne sont pas sans évoquer le Saint-germain des années 1950.
b. Mémoire et reconstitution
« Memory is a weapon.»
Don Mattera
Dans ce travail j’ai voulu retrouver une image plus précise de Sophiatown et de ses habitants.
En effet, si les photographies permettent une reconstitution relativement objective de
l’environnement, il n’en est pas de même avec les témoignages écrits ou oraux qui ne peuvent
pas être objectifs et ont souvent été utilisés à des fins politiques.
Je suis donc allée à la rencontre des anciens habitants pour tenter de reconstituer leur vie
quotidienne.
• Méthodologie
Pour aborder ces questions liées à la vie sociale et à l’urbanité avec les anciens habitants de
Sophiatown, l’entretien non directif m’a semblé être le meilleur outil. Je me suis donc rendue
chez eux, à Soweto - le grand township de Johannesburg, dans les petites maisons
(matchboxes) qu’ils habitent depuis la destruction de leur quartier. Lors des ces rencontres
j’étais accompagnée par Todd, assistant de recherche à l’Université de Witwatersrand,
informateur, traducteur et médiateur indispensable. L’entrevue se déroulait en général chez les
interviewés que nous allions trouver à l’heure du thé, dans des conditions que je m’efforçais de
rendre cordiales en leur faisant raconter «le bon vieux temps». Ce « good old time » qui
semble si bien partagé...
• Analyse du discours
L’entretien s’articulait autour du récit de l’enfance et de l’adolescence à Sophiatown et la
reconstruction de l’environnement social et géographique. La plupart des personnes
interrogées sont nées entre 1924 et 1948. Le quartier ayant été détruit en 1955, leur souvenirs
reflétaient bien souvent l’état d’esprit des gamins de (presque) partout : découverte,
insouciance et joie de vivre.
Les thèmes abordés lors de ces conversations furent différents selon des les individus et
reflètent la diversité des expériences. Ainsi, les hommes concentrent leur récit sur les activités
14
sportives, la vie sociale et l’univers de la rue ; les femmes, elles, racontent l’histoire
domestique du quartier, l’éducation, le mariage et les conditions de vie.
• Des mots
Malgré la diversité de ces regards, les adjectifs employés par les uns et les autres reflètent plus
un souvenir sensible qu’un état des lieux objectif. Ainsi Sophiatown était « joli », « agréable »,
« chaleureux », « vibrant », « mixte », « sophistiqué » etc. Les conditions de vie y étaient
toujours « meilleures », les relations avec les autres « solidaires », « plus chaleureuses »,
« familiales » en un mot la vie y était toujours « plus facile », « plus agréable ».
Cette description très générale peut-être liée à un déficit de vocabulaire anglais des interviewés,
mais pas à des défaillances mémoire. Beaucoup de ces personnes se souvenaient encore de
leurs listes de courses, du prix de chaque article et mettait un point d’honneur à m’en faire
l’inventaire. Ces détails qui m’ont permis de collecter des informations précieuses sur la mode,
les habitudes alimentaires, les relations familiales ou les questions d’économie domestique
nécessaires à brosser le tableau de la microsociété de Sophiatown. Dans bien des cas, ces
descriptions «sensibles» résultent d’une distanciation historique et géographique, qui amène à
une représentation magnifiée de la réalité.
A cette évocation romancée du passé, il faut ajouter l’appropriation d’une histoire collective au
travers des récits de parents et amis, des médias et des interventions des grandes figures de
l’époque : écrivains, chanteurs, prêtres, etc., qui ont scellé leur « histoire officielle » de
Sophiatown. Dans ce contexte de construction d’une mémoire collective, il faut également
souligner l’importance capitale du traumatisme causé par la destruction du quartier et le
déplacement de ces protagonistes vers les townships. Comme le souligne avec force l’une des
personnes rencontrée, Claudiah (cf. entretien) : «When we were from Sophiatown coming to
Soweto the spirit went down completely. The government did the most hateful thing that one
could really think of. That killed the people’s spirits. »
• Sophiatown : un conte moral ?
Si l’évocation de Sophiatown est conditionnée par un champ lexical déterminé, l’histoire qui y
est racontée est aussi cantonnée à un registre bien précis : l’évocation d’un temps meilleur,
entre conte et légende. Lorsqu’on leur demande ce qui leur plaisait à Sophiatown, beaucoup
des anciens habitants répondent en effet en évoquant un monde et des valeurs pour eux
disparus.
15
Certains, comme Dorine, évoquent la famille : « Everybody’s child was everybody’s mother
and every mother was everybody’s child, which was very explicit. We were just one big family,
we new each other as we grew up and attended school. » (entretien, 2002)
D’autres la liberté, comme Myriam : « Sophiatown was a beautiful place because we all lived
a free life - except being pressurized by the government at that time - but otherwise the people
living in Sophiatown had rights. » (entretien, 2002)
Quelques-uns évoquent, le caractère extrêmement moderne de l’espace, comme Jack :
« Sophiatown was a small township, very well organised, very advanced with all the
facilities»; ou Claudiah : « People in Sophiatown were very clever. » (entretien, 2002).
Beaucoup, enfin, expliquent comme Gally que leur qualité de vie était lié à leur pouvoir
d’achat : « It was called a happy place at that time because things were cheap. You could get
meat for two shillings in the butchery and potatoes for two pennies. It was not as bad as now.
We were having Pounds, not Rands. » (entretien, 2002).
On retrouve dans ce discours un attachement aux valeurs fondamentales de la société
traditionnelle et hiérarchisée bafouées par le régime de l’apartheid.
• Il était une fois…Sophiatown
De leur coté, auteurs, journalistes, artistes ou hommes politiques ont façonné une vision
romancée du quartier, sans toujours beaucoup de respect pour la réalité historique, mais
aujourd’hui sous jacente dans tous les discours.
Le père Huddleston, à la tête de l’Eglise anglicane de Sophiatown pendant de nombreuses
années et très engagé auprès des plus défavorisés, écrit par exemple dans ses mémoires :
«Sophiatown is not and never has been a slum. There are no tenements: there is nothing really
old: there are no dark cellars. Something looking up at Sophiatown from Western Native
Township, across the main road, I have felt I was looking at an Italian village somewhere in
Umbria. For you do « look up » at Sophiatown, and in the evening light, across the blue grey
haze of smoke from braziers and chimney against a saffron sky, you see closed packed, red
roofed little houses. You see, on the farthest skylight, the tall and sharply blue-gum trees…you
see, moving up and down the hilly streets, people in groups, people with colorful clothes:
people who, when you come up to them, are children playing, dancing and standing round the
braziers…In the evening, towards the early south African sun-set, there is very little of a slum
about Sophiatown. » (Huddleston, 1956 : 121)
Il y a peu de chance pour que la réalité n’ait jamais correspondu à cette description pittoresque,
pourtant représentative des images couramment véhiculées sur Sophiatown. Au moment où il
écrit ces lignes, le père Huddleston est sans doute porté par la volonté de sauver le quartier de
16
la destruction en amenant le lecteur Blanc à considérer Sophiatown comme l’image d’Epinal
d’un sympathique village européen auxquels les élites blanches vouent un véritable culte.
Le journaliste et romancier à succès Can Themba, exilé en Europe après l’arrivée au pouvoir
du Parti National, s’essaye à plus d’objectivité dans Requiem for Sophiatown :
«Long ago I decided to concede, to surrender to the argument that Sophiatown was a slum,
after all. I am witchingly nagged by the thought that a Slum – clearance should have nothing
to do with the theft of free –hold right » (in Lebelo, 1988 : 95)
Le témoignage de Jean Hart, antiquaire d’origine londonienne donne tout de même quelques
clés de compréhension et de comparaison : « I come from Whitechapel, London, and even
though I’ve been to university I was still very working-class. (…)In Sophiatown, which was
after all a working class black area, I felt like home. (…) Ma-Bloke was like someone I knew.
(…) Her making liquor and doing a bit round the back. (…) Her pride, her self reliance, her
vicious, cutting tongue. All of it was exactly the same as what I’d come from. I felt absolutely
at home. » (Nicol, 1991 : 232)
La diversité de ces témoignages montre, s’il en est besoin, à quel point l’objectivité dans la
reconstitution d’un lieu est difficile. Les expériences individuelles créent un tableau
kaléidoscopique, changeant et souvent contradictoire. Ici, le conte, le récit ou le mythe semble
souvent masquer un monde complexe et riche.
2. Une journée ordinaire à Sophiatown
En croisant les témoignages, les récits et les différentes sources d’information disponibles sur
Sophiatown, j’ai tenté d’en brosser un tableau qui laisse entrevoir la diversité des habitants et
des situations.
a. La rue : espace public
« Bruyantes et spectaculaires, ses rues non goudronnées, pleines d’ornières, couraient le long
des fontaines, des latrines communes, de rectangles enchevêtrés de cours que délimitait des
murs de brique, de bois ou de tôle »
(D.Coplan, 1992 : 221)
17
Pièce centrale du décor, la rue est ici investie de valeurs positives de convivialité et de
connivence sociale. Espace public par excellence, elle change de visage tout au long de la
journée.
Aux premières lueurs du jour, une foule bigarrée envahie les rues de Sophiatown : petits
employés, ouvriers et travailleurs domestiques commencent leur journée. La grande majorité
d’entre eux se dirige, à pied ou en vélo, vers les usines et les ateliers qui entourent Sophiatown
et Alexandra. Ils sont manœuvres, ouvriers à la chaîne ou livreurs pour deux ou trois pounds
par semaine. D’autres s’entassent dans les trains et les bus qui relient Sophiatown aux quartiers
blancs du centre de Johannesburg. Les femmes y occupent des emplois de domestiques.
Cuisinières, repasseuses, bonnes à tout faire, Nanis : elles font tourner ces maisons bourgeoises
et élèvent les enfants de leurs patrons. Les hommes se chargent eux de la maintenance des
habitations, du jardin, des voitures. Parmi ces voyageurs se trouvent aussi privilégiés issus de
la nouvelle bourgeoisie noire. Journalistes, avocats ou infirmières, ils partent vers le centre
ville où ils exercent des professions libérales, travaillent chez des artisans ou pour
l’administration. Dans ces trains vétustes, ce petit monde se reconnaît et se salue.
Ensuite, les enfants en uniforme prennent le relais et investissent l’espace. Sophiatown compte
17 écoles (T.Lodge, 1999), toutes confessions et niveaux confondus. La plupart des enfants
sont scolarisés et l’éducation est un sujet particulièrement sensible pour cette nouvelle
génération d’urbains, qui compte bien rattraper les processus d’ascension sociale mis en œuvre
pour les Blancs.
Une fois les maisons vidées de leurs habitants, les femmes se consacrent au ménage : très peu
de maisons ont l’eau courante et il n’y a, en général, qu’un seul robinet pour quarante
personnes (T.Lodge, 1999). Les femmes font donc la queue aux points d’eau avec leurs
bassines et leurs bidons. C’est le moment où elles se retrouvent entre elles et échangent les
nouvelles et informations. Leur communauté, forte et dynamique, est investie des pleins
pouvoirs dans la sphère domestique. Organisées en associations, elle ont mis en place des
systèmes d’entraide : les Stokvelds – groupe mutualiste de collecte de fonds - qui leur
permettent de surmonter les coups durs ou les fortes dépenses (mariages, enterrements). Elles
font aussi du petit commerce, vendent des beignets ou brassent et vendent illégalement de la
bière traditionnelle. Comme le rappelle Jack, avec un sourire amusé : « Les femmes de
Sophiatown, c’était pas tout le monde ! Elles étaient indépendantes et savaient vous faire filler
doux ! »
Boutiques et magasins ouvrent enfin vers neuf heures. Le plus souvent tenus par des Indiens et
des Asiatiques, ils sont nombreux et bien pourvus. On y trouve de tout : les meilleures pains et
les meilleurs steaks de la ville, mais aussi des quincailleries et détaillants de tissus et d’articles
18
de mode dont raffolent les jeunes filles. Les produits, souvent moins chers que dans les
quartiers blancs, se vendent bien et les magasins ne désemplissent pas.
Plus tard dans la journée, on peut voir déambuler des jeunes gens à la mise soignée qui
arborent des airs conquérants. Ce sont des membres des gangs, admirateurs de l’American Way
of Life et de ces dérivés culturels (jazz et cinéma) dont les noms s’inspirent de la deuxième
guerre mondiale : les Americans, les Berliners, la Gestapo, etc. Ils vivent – et souvent bien -
une vie de petits délits et de plaisirs. S’ils sont parfois craints, ils sont le plus souvent regardés
avec envie : belles voitures, beaux vêtements, belles filles...tout semble leur réussir.
Provocants, hors système, ils servent aussi d’exécutants des basses œuvres de certains partis
politiques. Connus pour ne voler qu’aux riches et à l’Etat, ils bénéficient d’une certaine
indulgence de la population qui les voit comme de nouveaux justiciers.
Au retour de l’école, la rue se transforme en terrain de jeu parfois violent. Chaque rue a son
gang d’enfants - les Vultures, dirigés par Don Mattera ou les Kangos Kids -, outils de
socialisation et d’apprentissage des règles de la communauté. Car il ne suffit pas de le vouloir
pour faire partie d’un gang, encore faut-il faire preuve de prédispositions : taper fort, courir
vite et dégainer à bon escient. Résultat : les cours de boxe sont très populaires et on dit qu’il
existe une école de Pickpockets (cf. entretien Maurice). Cette petite délinquance juvénile plus
où moins sous contrôle est le fruit d’une société globalement violente, même là encore, si la
régulation sociale semble jouer son rôle.
Le soir, trains et bus déversent sur Sophiatown le flot des travailleurs. Après des journées
souvent pénibles, tous et toutes se retrouvent sur les porches afin de profiter des dernières
heures de soleil, discuter, jouer aux cartes ou aux osselets. Vu l’exiguïté des logis, le dîner se
prépare souvent dehors, entre voisins. Les hommes, les gangsters et leurs amies vont ensuite
dans les shebeens boire un verre de bière brassé où de whisky (interdit à la consommation pour
les non-blancs) en écoutant du jazz sur un vieux gramophone.
b. La maison : espace partagé
« 65 Gerty Street, that’s were I found myself,
in a shack at a back of a Softown cottage.
Live-in at Mamariti’s Diamond Shebeen. One pound a month !
I say an exorbitant price to pay for a room hardly big enough to hold a bed.
Tap in the yard, toilet in the corner – but it was great because it was Softown. »
19
Jack in Sophiatown (1988 : 2)
Comme des vases communicants la maison et la rue se partagent une sociabilité bien différente.
Espace privé, la maison est aussi un espace de cohabitation entre les générations et les milieux
sociaux. Pour répondre à la « crise du logement » des années 1940, les propriétaires ont en
effet aménagé leurs jardins et leurs cours en backyards accommodations. Faites de bric et de
broc, ces cabanes de tôle abritent en général une famille entière. Cité par P.Guillaume (2001 :
68), Paul Gready affirme qu’il n’était pas rare de trouver huit familles vivant sur une parcelle
de 450 mètres carrés. Il ajoute, en outre, que 70% de ces habitations pouvaient être considérées
comme des taudis.
Les plus chanceux, et les plus riches, pouvaient se partager une chambre dans une maison.
Comme le montre le témoignage d’Elisabeth, la maison est un élément considérable dans la
représentation de soi et la construction d’une identité (Lévy, cité par P.Guillaume, 2001 : 31).
Je suis née le 7 avril 1927. Je suis venue à Johannesburg avec d’autres filles de mon village
pour travailler. Nous habitions toutes ensemble. La propriétaire de la maison était une femme
de mon village. Je travaillais comme cuisinière chez des Blancs. Ensuite, j’ai épousé un métis
dont la famille habitait à Sophiatown. On habitait une jolie maison à Gold Street. Il y avait 4
chambres que nous nous partagions entre deux familles. Moi j’avais deux filles. C’était une vie
agréable. La maison n’était pas facile à cambrioler. Mon mari travaillait dans l’usine de balais.
Nous vivions bien, la vie était peu chère et il y avait beaucoup de commerces autours de nous.
C’était un endroit très agréable à vivre, tout était jute comme il faut.
(Elisabeth, 24/03/2002)
Parmi les personnes interrogées, beaucoup font part de la même expérience. Claudiah explique
ainsi l’aménagement de la maison où elle vivait avec ses parents. « 5 or 8 persons were staying
in a room. In the night time you take the chairs, put them on the table and make the children
sleep underneath. My father and my mother used to settle on the other side and that is how
people were living ».
Pour les familles aisées, la maison est toujours le symbole de la réussite sociale. Elle est
considérée comme un bien précieux dont la perte est extrêmement douloureuse, comme en
témoigne Gally : « It was a beautiful house. It was a 4 roomed house as it was called, beautiful
very large and comfortable. It was very much unlike this house (elle montre sa maison d’un
geste de la main). The big difference is the quality of the brick, and…just everything: the
plastering, everything. Here you could see the way the building was poor, you see.»
20
Ramishidi, le fils de commerçant, a aussi connu les belles demeures de Sophiatown : «The
main roads, all the shifts of front rows, were reserved for traders basically. It was a proper
big built all the front sides of Sophiatown. »
Pour tous, les loyers étaient relativement élevés et, tout le monde, y compris les locataires des
misérables cabanes, devait s’en acquitter. Maurice se souvient : « Everybody was paying a rent.
Our was 1,10 pound per month. The toilets were outside and ten or twelve persons were
sleeping in the same room. »
Le logement, et le souvenir qu’il laisse dans la mémoire des habitants a donc une importance
considérable dans leur processus de construction sociale. Comme le rappelle Jacques Levy, « Il
ne fait pas de doute que le logement représente (…) un noyau dur de l’identité contemporaine
en tant que structuration de ses éléments les plus intimes c'est-à-dire les plus chargés
affectivement » (1994 : 345).
Dans le cas de Sophiatown, on peut alors poser l’hypothèse que cette cohabitation forcée a
développé un puissant esprit communautaire, dans un environnement où la frontière entre
l’intérieur et l’extérieur, entre le privé et le public est floue et parfois inexistante.
B. Les acteurs
« Tu n’a pas à trouver ta place ici, tu la fais et tu te débrouilles. C’est ce qui fait le piquant de
cet endroit. Tu pourrais maintenant et d’autres doivent partir faire leur vie selon des méthodes
qui ne sont pas dans les livres, mais ça ne te pose pas de problème. Tu as le droit d’écouter les
derniers enregistrements de jazz chez Ah Sing’s de l’autre coté de la route. Tu peux emmener
une métisse un soir au cinéma Odin sans que l’on te pose de question. Tu peux essayer le curry
de Rhugubar avec tes doigts sans être gêné.
Il n’y a jamais d’hérésie. En effet j’ai vu peu de Blancs dans le «Petit Paris du Transvaal» et
encore moins d’afrikaners. »
(C.Themba in U.Hannerez, 1992 : 190)
21
1. En haut de l’affiche : stars et bandits
a. Les nouveaux FarWest
« Enfants nous étions tous des gangsters, des pickpockets. Nous allions sur les golfs voler les Blancs.
Nous étions toujours très bien habillés, nos marques préférées étaient : Jaman Shoes, Woodway
Heads, Stadson, Borsalino. »
Maurice 24/03/02
Pourtant omniprésente dans la vie des populations noires, l’histoire des gangs a été longtemps
ignorée dans celle de la résistance noire en Afrique du Sud. Tom Lodge suggère que cet
oublie est du à leur caractère apolitique et rappelle qu’ils «donnaient à ses membres qui
travaillaient dans des conditions coloniales aliénantes un sens et un but à leur dignité.»
(Charles van Onselen in T.Lodge, 1999)
Le témoignage de Maurice va dans ce sens. Crâne rasé et vêtements de marque, ce grand
amateur de jazz, le verbe haut, retrouve l’énergie et l’humour de ses années Sophiatown au
cours de l’entretien. Ses « old mates », occuper à siroter une bière dans le jardin, intervenaient
parfois pour montrer un pas de danse ou raconter une anecdote. L’histoire de Maurice est celle
de beaucoup de gamins de Sophiatown fasciné par le glamour de film américains et qui se
lance dans le petit banditisme, moins par vocation que par besoin.
Je suis né en 1932 et j’ai grandi à Sophiatown, c’est là que je suis allé à l’école. Le Père
Huddleston qui m’a appris à nager.
Quand nous étions adolescents, nous emmenions nos amies au cinéma. Nous étions très chics.
Pour être dans le coup il fallait avoir un corps sain et des vêtements chers et à la mode. Les
garçons avaient de larges ceintures en tissu, des chemises à jabot, des montres Roma, Sima ou
Rothari. Ceux qui étaient vraiment bien habillés, c’étaient les Américains (célèbre gang de
Sophiatown).
Nous, on montait des stratagèmes pour détourner l'attention des commerçants. On arrivait à
plusieurs en vélo près d’une boutique. L’un d’entre nous se plantait devant la vitrine et
descendait son pantalon. Le commerçant était évidement furieux et poursuivait notre copain
dans la rue. Pendant ce temps, les autres prenaient tout ce qu’ils pouvaient, le mettaient dans
des boites et s’enfuyait en pédalant comme des fous! ! !
22
Quand on avait de la marchandise, on allait chez les indiens, les chinois ou les syriens du
centre ville. Ils ne négociaient jamais et achetaient au prix qu’on leur demandait. Dans une
bonne journée on pouvait se faire 300 Pounds qu’on partageait ensuite.
Tout le monde faisait ça, il y avait une école des pickpockets à Sophiatown.
Comme je m’appelle Maurice, les copains m’appelaient Maurice Chevalier. On faisait
beaucoup de soirées ensemble, entre gentlemen. Tous les soirs, on allait dépenser l’argent
qu’on avait gagné la journée. D’abord, on allait dans le Camp Malais pour chercher de
l’alcool, ensuite on allait écouter du jazz ou faire des compétitions de danse. Nous avions
l’habitude de suivre les musiciens partout où ils allaient. Nous avions toujours des amies très
jolies et bien habillées pour nous accompagner. Nous étions des gens sophistiqués et bien
élevés, des gentlemen!!
Nous étions aussi très sociaux : tout le monde se parlait dans les shebeens! Il y avait des
Blancs, des Noirs, de tout ! Beaucoup de Blancs qui avaient des amis Noirs aimaient passer du
temps avec nous. Nous faisions vraiment la pluie et le beau temps là-bas…
Les samedi et dimanche il y avait des mariages et des fêtes. Il y avait toujours un groupe de
jazz, on appelait ça les Brass Wedding. Les percussionnistes, les musiciens s’installaient dans
la rue et on dansait. En général quelqu’un tuait une chèvre et tout le monde venait manger.
Etre un gangster était aussi un rôle politique. A cette époque tout Sophiatown faisait partie de
l’ANC.
On lisait les journaux aussi. Je me souviens de quelques journalistes vedettes : Angry Klostery
ou Don Mattera, Peter Magumane, Can Themba…. Leur travail était incendiaire, ils ne
cessaient jamais de dénoncer l’apartheid
Ensuite il a fallu aller travailler. A cette époque, je gagnais 2 pound 10 par semaine (5 rands)
comme chauffeur dans une entreprise de commerce. Puis j’ai été arrêté pour vagabondage
(effraction à la très stricte loi des pass, ces documents justifiaient la présence des non-blancs
dans les quartiers blancs) et emprisonné à la section 17 pendant 3 ans et a la section 29 pendant
2 ans pour vagabondage.
(Maurice, 24/03/02)
L’histoire de Maurice est représentative de celle des classes populaires de Sophiatown. Peu
éduqués mais aspirant à un style de vie raffiné, ces jeunes gens ont largement contribué à la
diffusion de l’American way of life, à l’explosion d’une culture urbaine et dans une certaine
mesure, à une certaine libéralisation des mœurs qui ont rendu la quartier célèbre. Mais cette
apparente insouciance a aussi un prix. L’historien Philip Bonner estime ainsi qu’en 1953, les
Russians (rivaux des Americans, guerre froide oblige) furent responsables de 12 morts et 341
23
blessés, sans compter les innombrables, vols, les attaques au couteau et les violences verbales
et physique. (cité par P.Guillaume, 2001 : 73)
b. Bouillon de cultures
Dans son recueil de photos et de texte consacré à Sophiatown et à la culture noire des années
1950, le photographe Jürgen Schadebreg s’amuse à faire un « Who’s Who » des célébrités du
monde des arts, du spectacle et de la politiques de Sophiatown. L’inventaire est éloquent.
D’abord la musique. Tous les grands jazzmen sud-africains ont fait leurs classes dans les
shebeens de Sophiatown. La chanteuse Myriam Makeba, bien sur, qui commença sa carrière
avec les Manhattan Brothers. Le trompettiste et chanteur Hugh Masekela, la chanteuse de
blues Dolly Rathebe, le saxophoniste Kippy Moekesti - célébrité du jazz sud africain des
années 1950 - ou encore Todd Matshikiza, compositeur de la première comédie musicale sud
africaine King-Kong. Tous voisins, tous partageant leur amour de la musique et leur
fascination du jazz américain ; ils ont été les catalyseurs de cette nouvelle culture urbaine
syncrétique et farouchement ouverte au monde. Chefs de file, ils ont entraîné derrière aux des
kyrielles de musiciens amateurs, chanteurs du dimanche, chorales solaires et religieuses, etc.
Ensuite, les hommes politiques. Le docteurs Xuma, refondateur de l’ANC dans les années
1940, habitait Toby Street. Albert Luthuli, Nelson Mandela, son associé Olivier Tambo et
Walter Sisulu ont passé beaucoup de temps à arpenter les rues et les salles de meeting de
Sophiatown. Sans doute moins politisée que sa voisine Alexandra – grand township noir au
nord de Johannesburg, Sophiatown n’en a pas moins été le foyer des grandes manifestations
des années 1950. Ici, tout le monde parlait politique et, dans ses revendications d’égalité de
droits entre les groupes raciaux, l’ANC (African National Congress) mobilisait sans distinction
hommes, femmes, enfants, gangsters, artistes ou hommes d’Eglise.
Enfin, les intellectuels. Ecrivains, journalistes, poètes ou professeurs, ils sont nombreux à se
côtoyer dans «The house of Truth» de l’écrivain et journaliste Can Temba ; sorte de salon
littéraire farouchement anticonformiste. Henry Nuxmalo, Peter Magubane, Lewis Nkosi, Bloke
Modisane, Don Mattera : tous participent de près ou de loin à la rédaction du magazine Drum
et font connaître Sophiatown au monde. Parmi les visiteurs nocturnes des shebeens et des clubs,
on trouve aussi des auteurs blancs comme Nadine Gordimer, Prix Nobel de Littérature.
Engagés dans la lutte contre l’apartheid, beaucoup d’entre eux meurent ou partent en exil après
la destruction de Sophiatown.
24
Ces élites ont joué un rôle moteur dans la dynamique sociale et urbaine de Sophiatown et lui
ont donné ce cachet si particulier que l’on ne retrouve ni à District Six, ni dans aucun des
autres quartiers mixtes de cette période.
c. La fièvre du samedi soir
La littérature concernant le monde de la nuit à Sophiatown - aussi diverse qu’abondante (cf.
bibliographie) - témoigne de son rôle considérable dans la construction d’une identité locale.
Dans cet espace urbain hétérogène et grouillant, dans les shebeens et les concerts hall
s’épanouit une nouvelle forme de culture urbaine. « The shebeens were one of the main forms
of social entertainment. In old Sophiatown the shebeens were not simply made up of gathering
or drunkards. People came to the shebeens to discuss matters, to talk about things, theirs daily
worries, their political ideas, their fears, and theirs hopes.» (J.C.Ridder in U.Hannerz, 1992 :
187) L’anthropologue Ulf Hannerz avance l’idée que les shebeens de Sophiatown furent pour
la création d’une culture urbaine noire en Afrique du Sud, ce qu’avaient été le Vesuvio Bar et
le Café Trieste de San Fransico dans l’émergence de la culture Beat aux Etats-Unis, ou le
Griensteidl et le Café Central de Vienne dans l’Europe du début du XXème siècle. Cette
inscription des bars illégaux dans la grande lignée des lieux de création culturelle d’avant-
garde est reprise par un autre anthropologue, le sud-africain David Coplan. «La société du
shebeen, à l’origine innovation de la classe ouvrière, s’épanouit dans les divers milieux de la
population de Sophiatown. Certains débits de boisson – Aunt Babe’s, the House, the Télégraph
hill, the Back of the moon – devinrent de véritables boites de nuit ou l’élite africaine, des
affaires, du sport, du spectacle et de la pègre venait bavarder, écouter des disques ou danser
au son des dernières nouveautés de jazz. » (D.Coplan, 1992 : 222) Dans son ouvrage In
Township Tonight, D. Coplan également s’attache à souligner l’importance de cette vie
nocturne dans la création d’une unité sociale et d’une identité géographique. Il rappelle que :
«les arts du spectacle ont joué un rôle important dans la tentative faite par les africains de
trouver des lieux et des communautés où l’interaction sociale puisse exister » (1992 : 278).
Can Themba confirme cette hypothèse : «We were not « cats » either ; that sophisticated
group of urban Africans who play jazz, and speak the township transmigrations of American
slang.» (in Hannerz, 1992 : 188).
Sous les projecteurs, on trouve ceux qui ont fait la gloire de Sophiatown et qui ont fédéré
autour d’eux une dynamique culturelle et sociale. Star d’un jour ou d’un demi siècle, ils ont été
les moteurs de cette société urbaine naissante suivis par la grande majorité des anonymes, qui
disent pourtant, avoir partagé la même expérience.
25
2. Les figurants : trajectoires de vies dans l’Afrique du sud des années 1950
a. Claudiah
Claudiah vit aujourd’hui à coté de Kliptown, un des nombreux camps de squatteur qui borde le
township de Soweto. Je l’ai rencontrée dans sa maison, entourée de ses enfants et petits enfants.
Le Sophiatown de son enfance est celui de la petite bourgeoisie intellectuelle fasciné par
l’éclosion de ce nouveau monde, dans lequel elle pressent l’opportunité unique d’une
ascension sociale. Sa vie de petite fille rangée se concentre entre l’Eglise et l’école, deux
institutions fondamentales dans la structure de la société du quartier.
Je suis née en avril 1948 dans le West Native Township. Mes parents venaient du Lesotho.
Mon père travaillait pour l’entreprise Codex film et nous vivions à 8 dans la maison, six
enfants, quatre garçons et deux filles. Nous habitions numéro 100, Gold Street. Je suis allée à
l’école à Sophiatown dans des classes où nous étions très mélangés. Il y a avait des chinois,
des indiens. Je faisais partie de l’Eglise Anglicane du Père Huddleston. Elle existe toujours :
aujourd’hui, c’est mon frère qui en est le prêtre.
Les gens de Sophiatown étaient très sophistiqués et intelligents. Les enfants de trois ans
parlaient plusieurs langues : leur langue maternelle, l’anglais, l’afrikaner et le Fly Taal, notre
langue, un mélange de toutes les autres. Don Mattera et moi étions dans la même classe. Mon
grand-père avait été directeur de l’école primaire où nous étions élèves, il fut le premier
homme noir à enseigner la littérature. C’était un grand homme trop méconnu : je l’ai toujours
vu comme un héros. Il m’a appris l’éloquence, la force et la sagesse, je lui dois beaucoup.
Il y a avait beaucoup d’intellectuels et de professeurs à Sophiatown. Dès 1948, certains
instituteurs ont quitté l’école parce qu’ils refusaient l’éducation bantoue que l’apartheid
réservait aux Noirs. Ils ont préféré démissionner plutôt que d’inculquer ce poison aux enfants.
Je me souviens de Mr Bonhighabamn, qui était mathématicien et professeur d’anglais, lui aussi
il a démissionné.
Ma tante Florence était chanteuse dans les cabarets, c’était une très belle femme. Tout le
monde l’admirait. A cette époque, les femmes lisaient Vogue et s’habillaient comme les
mannequins. Elles étaient libres. Les hommes ne les contraignaient jamais.
(Claudiah 12/01/2002)
26
Egalement issu d’une famille bourgeoise, Jack raconte son expérience de la rue, réservée aux
garçons. Il habite aujourd’hui une matchbox aux confins de Soweto et, hors entretien, parle
avec fierté de sa fille comme d’une revanche contre le système qui l’a brisé.
Je suis né en 1943 à Sophiatown, j’y ai été à l’école avant de passer mon Matric (équivalent du
baccalauréat) et aller à l’université. Il y en avait deux réservées aux Noirs, dont une université
de médecine d’où est sorti le docteur Xuma.
Mes parents avaient un peu d’argent, c’est pour cela que j’ai pu suivre ces études. Mon père
était contremaître dans l’usine de balais qui se trouvait à côté de Sophiatown.
A Sophiatown, les garçons faisaient de la boxe, se battaient beaucoup. On était tous un peu
gangster, on avaient pas le choix…On se battait tous les jours : je faisait parti des KK (Kangos
Kids). C’est pour cela qu’on faisait de la gym et qu’on apprenait à se battre et à se servir d’un
couteau. On était violents, mais on nous avait appris à être violents. D’autres enfants jouaient à
la marelle, à la corde à sauter ou chantaient dans la rue. Il y avait aussi une école de musique
près du cinéma Odin…A la maison nous avions un piano qui faisaient beaucoup d’envieux.
Beaucoup de pianistes venaient y jouer. Plus ils jouaient plus ils buvaient ! ! ! C’est pour ça
que j’ai arrêté la musique : je ne voulais pas devenir alcoolique comme eux.
(Jack 23/02/2002)
b. Le petit peuple de Sophiatown
Hétérogène dans sa forme et sa construction, la présence d’une élite commerciale et
intellectuelle ne doit pas faire oublier que Sophiatown était aussi un quartier de primo arrivants,
pauvres et peu éduqués, à la recherche d’un emploi.
Comme le souligne Can Themba « After the war, many people came in Johannesburg to seek
work and some hole to right in it. As they increased, they become a housing problem. As
nobody seemed to care, they made Sophiatown a shame. » (cité par Lebelo)
Lors des entretiens, peu de personnes ont déclaré avoir vécu dans des conditions véritablement
précaires. Seule Dorine fait part des difficultés économiques dans lesquelles se trouvait sa
famille. Elle est née dans la Province du Cap Ouest en 1920. « Sophiatown….We were here
because there were no jobs there… that why life was so tough... It is terrible, when you are
home with your children only one is working. So we only came to look for work. We had no
houses. We were living in shaks. Where there was an open space we put one. There would be
ten of them the next day in the same place. »
27
L’historien Tom Lodge (1999) rappelle en effet que la sophistication urbaine de Sophiatown
n’était qu’un de ses nombreux attraits aux yeux de groupes économiquement défavorisés,
comme les parents de Dorine, qui cherchaient avant tout à gagner l’argent nécessaire à leur
subsistance. Selon son étude, seulement 2% des familles étaient propriétaires de leur maison,
contre 82% de locataires et 16% de sous-locataires. Il estime également qu’en 1951, 82% de la
population était issue du prolétariat et un tiers d’entre eux gagnait moins de cinq Livres par
mois. Les chômeurs, nombreux, représentaient entre 10 et 15% de la population totale. Enfin,
on estime que 80% des familles africaines vivaient en dessous du seuil de pauvreté (Gready
cité par P.Guillaume, 2001 : 68).
3. Le chœur : Drum magazine
« Drum was (…) an entertainment-exposé-picture periodical crammed
with fiction and muckraking, busty broads and huckster advertising.
The curious thing about Drum (…) was that its appeared to
function as a political instrument, (…) as an articulator of
the black experience and black aspiration. »
Addison in Champan
Journal emblématique de la culture urbaine noire qui émerge à Sophiatown dans les années
1950, l’histoire de Drum est considérée comme une épopée héroïque sur fond de mise en place
de l’apartheid.
L’aventure commence en 1951 quand le journal est lancé par Jim Bailey, jeune héritier d’un
magnat des mines. Dans sa première version the African Drum, destiné à lectorat défini en
ethnies, adopte un ton moralisateur et paternaliste. Le bilan est rapidement catastrophique et
J.Bailey engage Anthony Sampson, journaliste londonien, fasciné par la vie urbaine et
amoureux de Sophiatown. C’est lui qui donne au journal sa véritable identité en inventant une
approche qui correspond aux attentes des lecteurs. « Give us jazz and film star, man ! We want
Duke, Satchmo and hot dames ! Yes brother anything American. You can cut out this junk
about kraal and folk-tales and Basutos in blankets – forget it ! (…) Tel us what happening
right here, on the Reef ! » note Sampson dans son journal de bord (Chapman, 2001 : 187).
Dirigé et financé par des Blancs, écrit par des journalistes noirs aussi talentueux qu’alcooliques,
Drum devient rapidement une référence, tant il est difficile de rivaliser avec le charisme de ses
plumes. Parmi elles, on retrouve ceux qui font la vie culturelle de l’Afrique du Sud d’après
guerre. L’incontournable Henry Nxumalo, Mr. Drum - grand reporter et âme du journal,
28
mystérieusement assassiné en 1957 alors qu’il enquête sur une affaire d’avortements - les
journalistes Can Themba, Bloke Modisane, Casey Motisi, Nat Nakasa, Lewis Nkosi, Arthur
Maimane, Ezekiel Mphahlele, G.R.Naidoo, les photographes Jürgen Schadeberg et Peter
Magubane ou encore le musicien Todd Matshikisa. Sous l’impulsion de J.Schadeberg, jeune
exilé allemand, le journal s’oriente vers une formule de photojournalisme jusque là inconnue
en Afrique du Sud.
Avec une telle équipe, rédaction peut s’enorgueillir de quelques jolis «coups», comme ces
enquêtes dans les fermes de pomme de terre de Bethal, en 1952 et dans prisons en 1953.
Véritables prouesses journalistiques, elles amènent Mr. Drum à se faire engager comme
manœuvre ou arrêter par la police. On imagine aisément les retentissements de ce type
d’articles aussi engagés que culottés, d’autant que si le style toujours caustique, les risques
sont bien réels…
Reportages, papiers d’opinions, attention particulière portée aux sports, aux spectacles, et last
but not least, l’apparition de pin-up en couverture firent rapidement la renommée du journal.
Formidable outil de mise en abîme des habitudes et des modes de vie de la population noire de
l’époque, il mélange les genres, les goûts et les couleurs.
Dans ses pages, les célébrités de l’époque, les agitateurs de tendances - artistes, hommes
politiques ou gangsters - donnent le ton. Sophiatown devient le lieu d’investigation privilégié
de la rédaction qui fait de Drum le miroir de cette société en ébullition. Ce creuset d’une
nouvelle culture urbaine syncrétique, qui selon le mot de David Coplan « exigeait à grand cris
qu’on la reconnut » (1992 : 221) acquiert une dimension mythique grâce au talent romanesque
des journalistes amoureux de leur quartier.
Véritablement subversifs sans être révolutionnaires - passer entre les fourches caudines de la
censure relevait d’un véritable exploit – les journalistes de Drum ont maintenu jusqu’au début
des années 1960 une véritable liberté de ton, de pensée et de parole inédite. Plaidoyer en
faveur de l’égalité des races, de la reconnaissance d’une classe moyenne, urbaine noire et de sa
culture le journal ne survivra pas dans sa forme initiale au durcissement du régime.
Aujourd’hui encore, on trouve Drum en kiosque : pâle copie de tabloïde, sans reliefs, ni
saveurs…
29
C. Le dénouement tragique
1. Mots et maux de Sophiatown
« You think Sophiatown is just jazz and clubs and the bright light ! It’s war man »
Mingus, in Sophiatown, 1988
Haut lieu de la culture urbaine, Sophiatown n’en était pas moins un bidonville souffrant des
maux inhérents à ces types d’habitats, qui narguait l’administration de l’apartheid soucieuse de
se débraser au plus vite des zones racialement «impropres» et ne cadrant pas aux principes de
«développement séparé».
a. Destruction et déplacement de population
«They bulldozed the kaffir-nests, here in Sophiatown (…) Some house were just pushed down
with everything still inside, so all you herd was glass breaking and wood cracking. Then the
community development started building,
here, right on the top of kaffir’s rubbish. Decent house for white people.»
(M.van Niekerk, 2001)
Les témoignages sur la destruction de Sophiatown concordent tous. Moment traumatique qui
cristallise toute la violence et la souffrance engendrée par les méthodes inhumaines des agents
de l’apartheid, il est resté vivace dans les mémoire et très présent dans les récits.
Quelques semaines avant l’arrivée des militaires dans les rues de Sophiatown, cent cinquante
deux familles reçoivent une lettre les informant qu’elles sont tenues de quitter les lieux, le 12
février 1955 au matin. La police et l’armée, suivis de camions, arrivèrent trois jours plus tôt, le
9 février 1955 à 4h00 du matin, alors que des pluies torrentielles s’abattent sur Johannesburg.
Leur objectif est simple, prendre de court et neutraliser les mouvements de résistance et
embarquer vite et discrètement les locataires (les propriétaires seront délogés plus tard) vers
leur nouveau lieu de résidence, Soweto.
Claudiah raconte ce qui représente pour de nombreux habitants la rupture définitive avec le
monde urbain et libre et la violence physique et morale qu’ils ont générés.
« When came 1955 the government said: “These people are going to be removed forcefully”.
So they had to bring an army. The soldiers came with machine guns and they just bulldozed
30
houses. Most of people were taken to Meadowlands, others to Dube. An because they didn’t
want to come to this mess area of Soweto, some of them had heart attacks. I can name them:
Ban Makanye, Mr Ratebe, Mr Pooe the father, Mrs. Dakile they had heart attacks because
they couldn’t imagine being taken out of their bonded houses. After that most of the people
who left Sophiatown to Soweto were demotivated and stressed, it was painful to see. They
never thought that the government was going to do what he has done. And they never
motivated themselves again..»
Ramashidi analyse la situation de façon plus critique. «As I said, Sophiatown was used as
example for the rest of the country. People had no choice. Because there were slums and the
area was feared of poor people problems hiding place for movement so they (the government)
had to get rid of this area quickly. And they removing them away from here, they didn’t want
them to have their own homes, and not realizing the consequences that was the start of
smuggling.»
C’est ainsi que plusieurs milliers de personnes se retrouvent déracinées et parquée dans ce qui
deviendra bientôt le plus grand township d’Afrique du Sud : le Southern Western Township,
SOWETO.
b. L’arrivée à Orlando
L’arrivée dans ces petites baraques à peine finies se fait dans les larmes. Lors d’un entretien
informel avec Betty qui habite aujourd’hui à Meadowlands, un des quartiers de Soweto, elle
raconte son arrivée. « It was terrible. We had just the wall of the house, no electricity, no water,
the floor was mud. We had to do everything ourselves. The school was very far away and to go
there the children had to go through the forest. I was not safe at all. There were no shop, no
crèches, nothing.»
Les photos de l’époque montrent des maisons, les matchboxes (boites d’allumettes), alignées à
perte de vue sur des parcelles identiques, le long de pistes sablonneuses. Dans cet univers, les
rues n’ont pas de nom et les maisons ne sont que des numéros. Les jardins, les arbres, les parcs,
les espaces publics, les transports en communs, les commerces, les écoles, les lieux de culte,
les administrations publique, enfin tout ce qui fait qu’une ville est ville : tout cela est inexistant.
31
2. La naissance d’un mythe
« Sophiatown était un taudis de rêves, un champ de bataille du cœur »
D.Coplan (1992 : 221)
a. Mort prématurée de l’urbanité
Lors ce rapide tour d’horizon de Sophiatown, je me suis efforcée de porter un regard objectif
sur une réalité de cinquante ans. Sophiatown, qui n’était sans doute pas le nouvel Eden urbain
que certains ont décrit, fut néanmoins à l’origine d’un des plus important mouvement social
dans l’Afrique du Sud du XXème siècle : celui de l’urbanisation des populations noires.
D.Coplan qui s’est intéressé aux problématique d’urbanisation et de création de cultures
urbaines en Afrique du Sud analyse ce processus de la façon suivante : « le processus
d’urbanisation à proprement parler est multiple : il comprend les aspects culturels autant que
les aspects sociaux et spatiaux. Pour les africains, s’urbaniser implique de s’engager à résider
en ville de façon permanente à participer aux rapports qui tournent autour du système social
urbain. Sur le plan culturel, s’urbaniser, signifie adopter des modes d’interaction et
d’expression qui sont créés dans – mais ne se limitent pas – des situations propres à la ville. »
(1992 : 351)
Il ajoute qu’« on peut considérer l’urbanisation comme un processus social au cours duquel
les gens acquièrent des models de perception, de communication et d’action qui sont
caractéristiques de la ville. » Cette définition élaborée à partir de l’étude des mouvements
culturels africains depuis le début du siècle jusque dans les années quatre vingt, semble décrire
le Sophiatown du début des années 1950. « Quartier polymorphe » générateur d’une « culture
syncrétique » et de « processus interactifs de créolisation » établissant des normes sociales
relative au partage d’un espace urbain, Sophiatown a posé les bases de ce qu’aurait pu être le
modèle urbain d’une société non raciale tournée vers l’amélioration des conditions de vie de sa
population. Comme le rappelle U.Hannerz ; « There is indeed a sense of a global ecumene
here, of a simultaneous presence within one’s field of experience of ancestral gods, western
philosophy, and the Jazz of Black America ; and it is all being worked on right there, in the
township. Distinctive cultural currents are coming together, having been separated by ocean
and continents, working there way of shaping human beings. » (Hannerz, 1994, 189)
32
b. Sophiatown, Fietas, District Six : plusieurs quartiers, une seule histoire
Lors des entretiens, une seule et même histoire semblait être répétée et reprise par toutes les
personnes interrogées : celle du paradis perdu ou de la rupture initiale à l’origine de toute
société. Sophiatown, District Six ou Fietas, seraient devenu des mythes selon la définition de
Mircea Eliade : c’est «le récit d’une création» qui «ne parle que de ce qui est arrivé réellement,
de ce qui c’est pleinement manifesté» (Eliade, 2002 : 16). L’histoire parallèle de ces quartiers
mérite que l’on s’y attarde pour mieux comprendre les processus en œuvre dans la création
d’une mémoire urbaine, d’un récit et finalement d’un mythe urbain.
• Fietas
Peu connu du grand public, Fietas était un quartier très commerçant, mixte à dominante
indienne, situé entre Fordsburg au Sud, Braamfontein à l’Est et Mayfair à l’Ouest et
progressivement détruit au nom du Group Area Act entre 1964 et 1970. Le promeneur avisé
peut encore retrouver quelques maisons de cette époque autour de 14th Street, mais dans le
quartier aujourd’hui éteint, on peine à imaginer ce qu’était l’effervescence et la vitalité de ce
petit espace d’urbanité spontanée. Communauté intégrée socialement et spatialement, sans
doute plus tournée vers le commerce que vers la culture, Fietas est pourtant le pendant de
Sophiatown. Nat Nakasa (1975, cité par F.Mamdoo) en rappelle le cosmopolitisme : “14th
Street in Vrededorp is long overdue for recognition as one of Johannesburg’s most famous
streets. This street does business with people of all races, all walks of life, from Soweto to
Mayfair, from Houghton to Japan, India, Europe and the United States”. La description de
Peter Abrahams dans Tell Freedom (cité par F.Mamdoo) renoue, elle, avec l’enthousiasme et
la nostalgie des plus belle pages écrites sur Sophiatown : “And from the streets and houses of
Vrededorp, from the backyards and muddy alleys, a loud babble of shouting, laughing, cursing,
voices rise, are swallowed by the limitless sky, and rise again in unending tumult. And through,
and above, and under, all this is the deep throbbing hum of the city. It is everywhere at once.
Without beginning, without end.”
Diversité, centralité mais aussi pauvreté, promiscuité : les ingrédients de la recette Sophiatown
sont ici réunis et le discours reproduit les éléments d’un bon temps oublié, d’une urbanité
mouvante et la nostalgie d’une vie de bohème.
33
• District Six
District Six a, en Afrique du Sud, la même notoriété que Sophiatown. Détruit plus tardivement,
cette partie de la ville n’a jamais été reconstruite : un terrain vague devenu symbolique
témoigne de cette histoire douloureuse.
Ici aussi, la catharsis collective est passée par la publication de nombreux ouvrages, recueils de
mémoires et de photographies. Dans la préface de son livre Linda Fortune, ancienne habitante
du quartier, revient sur ce qui l’a poussée à écrire ses mémoires. « I did not want to leave the
way my family were forced to do in December 1971. At the time I wanted to plant my one foot
on the Devil’s Peak and the other on Table Mountain and shout: « Let us stay, don’t force us
to go. You are destroying our families and our lives ! ». But who would have listened ?
Nothing could be done. It was hopeless. We were helpless. I must finally do something to ease
my aching heart, I decided then and there. I must bury the past and get this feeling of
hopelessness out of my system once and for all. The best way to do it, I thought, would be to
record what I remember and so preserve the once daily loved place, a place which has ceased
to exist but which will forever live in our hearts and our minds. » (1999: 3)
Dans le discours des anciens habitants - de District six comme de Sophiatown, on retrouve des
termes récurrents : perte de paradis, nostalgie, transmission d’un savoir et tentative de
pansement de plaies toujours vives par l’évocation des souvenirs.
Mais ici, cette demande de mémoire a été entendue par les responsables politiques de la ville.
Non loin des vestiges du quartier un musée à thème a été érigé en mémoire au quartier disparu.
L’implication des anciens habitants dans la réalisation de ce projet fut un point fort de
l’opération. En plus du recueil de témoignages ou d’objets et la reconstitution des éléments de
la vie quotidienne, les témoins ont été invités à faire figurer leur nom à l’emplacement de leur
ancienne résidence sur une carte du quartier dessinée à même le sol. Ce projet muséographique,
unique en son genre, a bien sur connu un grand succès. En 2003, la municipalité a également
entreprise de reloger les anciens habitants, ou leurs descendants, dans des lotissements dont la
construction est prévue sur les ruines de District Six.
Sophiatown, Fietas ou District Six, ces quartiers ont en commun une histoire douloureuse et
leurs habitants partagent toujours le souvenir de l’injustice dont ils ont été victimes. Traitée de
façon institutionnelle, cette mémoire collective tient lieu de catharsis et s’enracine dans des
projets de réconciliation nationale voulus par les gouvernements depuis 1994.
34
II. Sophiatown du mythe au modèle
A. Qu’est ce qui fait le mythe ?
« Récit fabuleux, le plus souvent d'origine populaire,
qui met en scène des êtres incarnant sous une forme symbolique
des forces de la nature, des aspects du génie ou de la condition de l'humanité. »
Dictionnaire Robert
Aujourd’hui, s’interroger sur l’impact de l’histoire de ces quartiers dans la population, c’est
s’interroger sur le passage de l’histoire à la mythologie. Comme le rappelle Mircea Eliade «Le
mythe est une réalité culturelle extrêmement complexe, qui peut être observée et interprétée
dans des perspectives multiples et complémentaires.» (2002 : 16)
Serait-il alors possible de concevoir l’existence d’un mythe géographique dont Sophiatown
serait l’illustration ?
1. Les multi facettes du mythe géographique
a. Le mythe : éléments de définition
Pour Roland Barthes « le mythe est une parole » (1970 : 193). L’histoire qui nous est parvient
aujourd’hui de Sophiatown, de Fietas ou de District Six sous forme de paroles ou de récit
contribue à donc l’élaboration progressive d’un mythe urbain.
Cette définition du mythe comme signifiant d’un discours ne s’oppose pas à celle de Mircea
Elias, citée plus haut. Barthes rappelle en effet que si l’«on peut concevoir des mythes très
anciens, il n’en est pas d’éternels ; car c’est l’histoire humaine qui fait passer le réel à l’état
de parole, c’est elle seule qui règle la vie et la mort du langage mythique. » (1970 : 193).
Barthes rappelle également que la parole ou le récit ne sont pas les seuls vecteurs du mythe :
«Cette parole est un message, elle peut donc bien autre chose qu’orale ; elle peut être formée
d’écritures et de représentations : le discours écrit mais aussi la photographie, le cinéma, le
reportage, le sport, les spectacles, la publicité tout cela peut servir de support à la parole
mythique.» (1970 :194). Cette définition, en parfaite adéquation avec les média d’informations
du monde contemporain, souligne l’importance de chacun des vecteurs du mythe que l’on
retrouve dans le cas de Sophiatown, Fietas ou District Six : l’importance des images dans la
35
transmission du sens et, comme souligné plus haut, la possible manipulation induite par ces
mêmes images. Rien de ce qui est rapporté ne peut donc être considéré comme neutre.
Quelle interprétation donner à cette profusion d’images et de récits ? Barthes affirme que : «La
fonction du mythe c’est d’évacuer le réel : il est, à la lettre, un écoulement incessant, une
hémorragie, ou si l’on préfère, une évaporation, bref une absence de sensible. » (1970 :230)
Dans le monde urbain sud africain cette fonction d’évacuation semble pertinente. Le « mythe
de Sophiatown » serait alors comme l’opium de l’habitant du township : une substance
anesthésiante autorisée pour supporter la violence d’un monde urbain stérile et déshumanisant.
Le mythe est aussi histoire, et, comme le rappelle P.Guillaume (2001), l’histoire sert à
légitimer un état social présent. « Le mythe a pour charge de fonder, une intention historique
en nature, une contingence en éternité. » confirme Barthes (1970 : 229).
L’idée de nature est ici intéressante tant elle s’applique à son contraire : le construit, l’acquis,
l’urbain. Ainsi, cette représentation du mythe qui donnerait aux habitants l’image d’une
chronologie séparant une urbanité «avant apartheid» qui suivant une «ère tribale» assez vaste
et qui précédant celle de « la reconstruction » d’une urbanité et d’une identité perdue montre
l’importance du processus historique dans la définition de soi et des lieux.
Le constat d’une uniformité de discours dans les descriptions de Sophiatown, s’explique donc
par la transformation de la réalité en discours mythique. Car, selon R.Barthes, le mythe se
nourrit du réel qui, lui, «ne nie pas les choses, sa fonction est au contraire d’en parler ;
simplement, il les purifie, les innocente, les fonde en nature et éternité, il leur donne une clarté
qui n’est pas celle de l’explication, mais celle du constat. (…) En passant de l’histoire à la
nature, le mythe fait une économie : il abolit la complexité des actes humains, leur donne la
simplicité des essences, il supprime toute dialectique, toute remontée au-delà du visible
immédiat, il organise un monde sans contradiction parce que sans profondeur, un monde étalé
dans l’évidence, il fonde une clarté heureuse : les choses ont l’air de signifier toutes seules. »
(1992 : 230-231).
C’est pourquoi : « Les hommes ne sont pas avec le mythe dans un rapport de vérité, mais
d’usage : ils le dépolitisent selon leurs besoins. » (1992 : 232) Dans le cas particulier de
Sophiatown, le mythe a, au contraire, acquis une dimension politique extrêmement forte,
devenant une des icônes de la lutte contre l’apartheid. Cette situation particulière, transforme le
mythe pour les populations qui l’ont construit, car comme le rappellent nombre des
interviewés : « Ici tout est politique».
L’importance de l’espace comme référent ou comme catalyseur est également relevée par
R.Barthes : «chaque mythe peut ainsi comporter son histoire et sa géographie : l’une est
d’ailleurs le signe de l’autre ; un mythe mûrit parce qu’il s’étend.» (1992 : 237)
36
Si R.Barthes donne une interprétation du mythe dans la société contemporaine, sa conclusion
sur son objectif en tant qu’outil de contrôle social est questionnable au regard de la réalité Sud
Africaine. « Ainsi, chaque jour et partout, l’homme est arrêté par les mythes, renvoyé par eux
à ce prototype immobile qui vit à sa place, l’étouffe à la façon d’un immense parasite interne
et trace à son activité les limites étroites où il lui est permis de souffrir sans bouger le monde :
la pseudo-physis bourgeoise est pleinement une interdiction à l’homme de s’inventer. » (1992 :
244).
Dans le cas de Sophiatown, modèle d’invention humaine s’il en est, la construction et
l’évocation du mythe semblent avoir eu comme fonction la reconstruction de l’environnement
et du système social plus que la destruction du libre arbitre décrit par Barthes. Le contexte est
ici inversé : le mythe est l’élément libérateur de la société quand l’interdiction de l’homme à
s’inventer a été le fait de l’administration de l’apartheid.
b. Les arché-paysages : le mythe à l’échelle géographique
« Les mythes sont loin de n’être qu’une fuite dans l’illusion :
motivant les hommes à imaginer et à agir,
ils ne cessent de nourrir et de transformer la réalité. »
A. Berque
Si Barthes donne une définition sociale et historique du mythe, Berque lui donne sa dimension
géographique et sa dynamique dans le système social.
Dans son travail sur la ville japonaise, A.Berque utilise la forme poétique et romanesque pour
emmener le lecteur à la découverte de ces nouveaux territoires. « L’on ouvrirait les villes
comme on ouvre les livres. Les banlieues, les portes et les octrois se diraient préambules,
prologues ou introduction ; l’inverse également : des pages voudraient dire des rues, des
chapitres des arrondissements, et les titres des livres seraient les noms des villes. Ainsi les
auteurs composeraient l’espace et le temps des livres comme les villes ont composés les
leurs. » (1993 : 9) A.Berque raconte la ville, comme on raconte une histoire, en dévoilant les
uns après les autres les personnages et les éléments de l’intrigue pour finalement poser avec
nous les questions : qu’est ce qui fait l’urbanité. Qu’est ce qui fait le sens de la ville ?
« Le sens de la ville passe en nous-mêmes, à travers notre corps où l’active et l’élabore nos
expériences antérieures, les symboles que nous avons appris, les noms que nous avons en
mémoire. Noms communs des choses que nous percevons, noms propres des choses et des
lieux que nous reconnaissons : tout cela s’anime, dans un perpétuel manège où l’on serait bien
37
en peine de dire ce qui, des symboles ou des choses, des images ou des idées, précède le reste
et gouverne notre perception de la réalité. C’est selon vraisemblablement : selon les cas les
lieux, les cultures, les trajets individuels et les moments de l’histoire. Si des hiérarchies stables,
des causalités claires étaient seules en cause parmi ces facteurs, le monde se figerait dans une
définitive identité, ce qu’il ne fait manifestement pas. Mais, non moins manifestement, un
incessant travail d’identification tend à maintenir des relations stables entre les symboles, les
choses, les images, les idées ; relation que toute culture tend à unifier dans un équilibre
original. » (1993 : 101)
Manifestement, la mémoire fait sens dans la ville d’ A.Berque et cette mémoire est l’une des
clés de la dynamique de la cité et de la création de son urbanité.
Dans Du geste à la cité, A.Berque s’attache donc à faire le tour des noms, des symboles, des
objets de mémoire qui créent le monde urbain de Tokyo.
Cette description est intéressante comme élément de comparaison avec Sophiatown. Il y a là, à
Tokyo, les mêmes images et les mêmes mécanismes de la mémoire à l’œuvre pour faire exister
une ville dans toute sa complexité et son historicité.
«En menant diverses enquêtes sur les goûts paysagers des citadins d’Osaka, en particulier sur
leur attachement aux paysages de leur enfance, l’architecte Narumi Kunihiro est parvenu aux
conclusions suivantes : les citadins sont particulièrement sensibles aux éléments paysagers qui
évoquent des relations humaines ; tels la ruelle où l’on jouait entre petits voisins, le terrain
vague où l’on partait à l’aventure, la petite boutique où l’on allait acheter des sucreries à
deux sous, etc. » (1993 : 31) L’utilisation de ce patrimoine commun par les artistes japonais est
également proche de celle que l’on retrouve en Afrique du Sud. L’image symbolique devient
porteuse d’un tout : une époque, un style vestimentaire, une musique, une certaine forme
urbaine et une socialisation particulière. Réducteur en même temps que porteuse d’une
multitude de sens, ces images ont la fonction d’un logo : elle renvoie à un imaginaire collectif
acquis par l’ensemble du publique à qui elle s’adresse.
A partir de ce logo, ce tout symbolisé, A.Berque crée le concept d’arché-paysage, une image
géographique disparue mais partagée par tous que l’on retrouve dans différents types de
support. Dans le cadre de son étude, il cite : « Deux bandes dessinées célèbres, qui jouent sur
cette fibre nostalgique (et) ont à merveille schématisés les traits caractéristiques de ces arché-
paysages (gen-fûkei), que les japonais portent gravés dans leur cœur. » (1993 :31) On
retrouve la notion de mythe en tant que création sociale, vecteur d’identité. Par exemple, le
dessinateur « Haruki, lui, donnant délibérément dans le mythe, a fixé un fois pour toutes
l’image d’une gamine d’Osaka chaussée de geta (socques en bois) comme on n’en voit plus
guère. Qu’a cela ne tienne ; c’est le propre des arché-payasges que d’échapper au temps
38
historique ! » (1993 :31) Ainsi, le mythe et son corollaire géographique se servent des
changements morphologiques de la ville pour faire vivre leur intrigue : Le paysage urbain, au
demeurant fort présent et que les personnages apprécient comme tel (…) est pris dans d’infime
intrigues humaines. Peut-être en effet doit-il toujours se passer quelque chose dans le paysage
nippon ? Après tout, les meisho (sites fameux) valent souvent par une évocation historique ou
mythique, plus souvent que par leur morphologie. » (1993 :31)
Ce que A.Berque évoque ici, c’est la production sociale des espaces symboliques qui associés
à « l’environnement, (au) paysage et (au) commerce des hommes forment un tout, qui est
l’urbanité de cette ville. » (1993 : 31)
Protéiforme, le mythe se niche dans les interstices de la ville et lui donne, une mémoire, un
sens et une dynamique que Philippe Gervais-Lambony retrouve dans la nostalgie.
c. Nostalgie et territoire
« Les rues sont tristes et vides, la vieille Sophia est partie »
Myriam Makeba
« La prégnance de Sophiatown est nostalgie,
et même peut-on dire le modèle de la nostalgie sud africaine.»
Philippe Gervais-Lambony
Philippe Gervais-Lambony, géographe de l’Afrique du Sud, définit la nostalgie comme une
valeur proprement géographique. Dans son travail sur Johannesburg – dont une partie s’appuie
sur celui d’A.Berque – il évoque, le New York de C.Lévi-Strauss et Sophiatown, deux
exemples de la nostalgie urbaine.
La condition sine qua none à la création d’un sentiment nostalgique est l’unicité d’un lieu.
«L’existence de territoires complets tels que nous les définissons n’est possible que dans
l’unicité : un territoire, construction sociale et inscription des hommes dans le monde ne peut
être identique à aucun autre car il est fait d’une relation singulière dans le temps et l’espace.
On peut traduire cette idée par l’expression de « génie du lieu ». Il y aurait des lieux sans
génie, d’autres avec, ou bien un espace ne serait lieu que si habité par un génie. Le territoire
est cela : un lieu habité par un génie ou un lieu « ayant une âme ». Cette « âme » n’est pas
extérieure ou préexistante à l’homme, elle est le lien entre le territoire et l’homme et créée par
ce dernier. En effet il ne s’agit pas d’une divinité locale ou d’un esprit maléfique, mais d’une
transcendance. » (2001)
39
Autre ingrédient indispensable à la création d’un sentiment nostalgique : la présence humaine
autrement dit, l’habitat, sans lequel le lieu se peut se doter d’une âme. Seul le lieu n’est rien, et
devient ce que Marc Augé appelle des « non lieux, par opposition à la notion sociologique de
lieu, associée par Mauss et toute une tradition ethnologique à celle de culture localisée dans le
temps et l’espace. » (1992 : 48). C’est donc par un processus de « construction du territoire »
que l’homme transforme le lieu et lui donne une identité, définie comme « une double
inscription humaine dans le social et le spirituel ».
Pour traiter du mythe en géographie urbaine il ne suffit pas de s’intéresser au seul territoire. Il
faut aussi traiter l’ensemble des échelons de la pyramide qui transforme le lieu en territoire, le
territoire en représentation, la représentation en mémoire et cette dernière en mythe.
Ainsi, « La nostalgie est une notion géographique car elle est spatiale. Le mot nous vient de
deux termes grecs : nostos, retour et algos, souffrance. Il s’agit donc d’un mal, voire d’une
maladie (…), causé par l’absence d’un lieu. » Et comme R.Barthes et A.Berque, P.Gervais-
Lambony rappelle que : « dans la nostalgie du passé, on ne cherche pas le retour en arrière,
mais au contraire notre identité actuelle. »
C’est aussi ce que souligne M.Augé lorsqu’il se réfère à la préface du premier tome de Lieux
de mémoire de Pierre Nora : « Ce que nous cherchons dans l’accumulation religieuse des
témoignages, des documents, des images de « tous les signes visibles de ce qui fut », (…) c’est
notre différence et « dans le spectacle de cette différence l’éclat soudain d’une introuvable
identité. Non plus une genèse mais le déchiffrement de ce que nous sommes à la lumière de ce
que nous ne sommes plus.» (1992 : 37)
Sophiatown, tellement regrettée et érigée en symbole par ses anciens habitants, devenue
mythique pour les nouvelles générations serait donc l’exemple parfait de la nostalgie comme
concept géographique, recherche de l’identité omniprésent dans le paysage contemporain
comme en témoigne Can Temba « Même détruits ces vieux quartiers et surtout Sophiatown
sont encore très présents aujourd’hui dans la ville car ils représentent toute une culture
urbaine fondée sur le mélange racial (…), la liberté, la musique (…), la consommation
d’alcool dans les bars clandestins (…), la culture alternative Noire qui se manifestait dans les
pages du magasine Drum. » (cité par P. Gervais-Lambony, 2001)
2. La mobilisation d’un imaginaire
Dans le contexte sud-africain, le mythe est un vecteur d’identité largement partagé
(M.Houssay-Holzshuch, 1995). Conséquence des luttes incessantes entre les populations pour
gagner le contrôle du pays et l’asservissement des autres groupes, ces mythes périphériques ou
40
fondateurs d’une communauté, sont extrêmement présents. M.Houssay-Holzshuch (1995 : 28)
fait référence dans sa recherche à celui des Afrikaners qui mélange des données bibliques
(peuple élu), des évènements historiques (Grand Treck), des valeurs (darwinisme, religion,
races) et des symboles (monument Voortrekkers). On peut également citer l’histoire du roi
Chakazulu qui fonde en 1807 la nation zouloue assurant ainsi la suprématie de son peuple,
l’expansion de son territoire et qui combat également férocement les Boers et les Anglais. (Son
personnage –mythifié – est repris par L.S.Senghor dans les Ethiopiques)
Comme ailleurs, la réalité sud-africaine est donc formée des mythes. Pauvreté, migration,
espoirs : ces histoires familiales et collectives sont le socle de la société sud africaine.
a. Les représentations du mythe
Depuis une dizaine d’année, on ne compte plus les ouvrages consacrés à Sophiatown, ses
personnages célèbres et sa vie trépidante. Difficile à compter aussi les évocation d’un
Sophiatown aux allures de quartier latin local. Dans African Foot Print, comédie musicale à
succès retraçant l’histoire de l’Afrique du Sud, Sophiatown apparaissait ainsi comme un décors
d’opérette entre un tableau évoquant la puissance des rois Zoulous et un autre sur la passion du
football. Pour le public Blanc venu voir un divertissement célébré par la presse, l’évocation de
Sophiatown n’avait, selon la définition de R.Barthes, aucune dimension politique ni historique.
Seule comptait ici la mise en scène de la nation arc-en-ciel et des valeurs fondatrices de la
« nouvelle Afrique du Sud ».
Le thème de Sophiatown a été également repris par plusieurs spectacles « engagés ». Lors de
l’édition 2002 du Dance Umbrella Festival à Johannesburg, The Suit, chorégraphie de Boyzie
Cekwena, inspiré de l’ouvrage éponyme de Can Themba publié en 1967, mettait en
perspective l’héritage de Sophiatown dans la vie artistique contemporaine de l’Afrique du Sud.
Cette mise en scène du mythe par un artiste Noir et destiné au public d’un festival de grande
qualité et cosmopolite prenait un sens politique évident : celui de la lutte pour la liberté des
populations non-Blanches et la mise en abîme de leur formidable énergie créatrice, hier
comme aujourd’hui. Dans la même veine, les étudiants de l’université du Witwatersrand ont
mis en scène, toujours en 2002, un spectacle dédié à la mémoire des artistes Noirs des années
1950. Spectacle didactique à l’attention d’un public de curieux et d’amoureux du jazz.
Si le mythe se met en scène, il s’illustre aussi et s’imprime aussi sur papier glacé. En 2002
encore, J.Schadeberg ancien photographe de Drum, sortait son deuxième ouvrage de
photographies consacré à Sophiatown. Lors du lancement, l’artiste présentait également une
série de nouveaux clichés sur Soweto, sensés mettre en perspective la vitalité des nouveaux
41
quartiers africains avec les clichés, désormais célèbres, du Sophiatown des années 1950.
Quelques anciennes célébrités avait été réunies pour l’occasion : Dolly Rathebe, toujours en
verve, et les Manhattan Brothers étaient de la fête. Largement annoncé, l’évènement n’a
pourtant trouvé dans le public qu’un accueil mitigé…
b. Les utilisations du mythe
« Ce qui faisait de Sophiatown une merveille, c’était ses habitants (…).
Ce qui faisait de cette ville une merveille c’était la vie qui y était vécue,
la musique qu’on y jouait, les histoires qu’on y racontait…(…)
La pensée et le talent poussaient comme des plantes tropicales dans la jungle ! »
Can Themba cité par Gervais-Lambony
Pour plusieurs générations de Sud-africains, artistes ou simples quidam, Sophiatown est une
balise, un repère historico-géographique primordial. C’est aussi le tremplin sur lequel «un
certain nombre d’artistes et d’organisateurs africains sont en train de renouveler la quête
pour l’autonomie artistique et professionnelle dont Sophiatown était l’incarnation.» (D.Coplan,
1992 : 277)
S’il est vrai que l’évocation de Sophiatown joue un rôle indispensable dans la culture urbaine
contemporaine, il est néanmoins difficile de ne pas penser que le mythe est aussi très profitable
à ceux qui en exploitent les retombées. Sous le couvert d’un «devoir de mémoire» certains
n’hésitent ainsi pas à faire rétribuer grassement leur participation aux meetings et célébrations
tandis que d’autres exploitent leurs royalties en publiant régulièrement textes, photos où
mémoires. A tel point que déjà, le 19 mai 1995, Hazel Friedman, se demandait dans le Mail
and Guardian si les trois ouvrages justes publiés sur Sophiatown par J.Bailey, J.Schadeberg et
G.Narasamy, devaient être considérés comme des «leçons intéressantes sur l’histoire récente
du pays» ou comme «les relents d’une nostalgie commerciale très lucrative».
Le profit à tirer n’est pas qu’économique, il peut-être aussi politique. Depuis un an, les équipes
municipales ont pris en charge la célébration de Sophiatown, dont l’emplacement se trouve sur
la circonscription de la Région 4. Suite à quelques campagnes d’animation dans des quartier
longtemps oubliés (un enfant = un arbre, dans l’ancien quartier colored en 2001), les
responsables, soucieux d’améliorer leur image auprès des électeurs défavorisés, ont cherché
d’autres thèmes porteurs. L’idée de célébrer Sophiatown revient à July Tim, chargée de
l’animation, qui a pressenti l’impact positif d’une telle initiative. Elaboré en collaboration avec
d’anciens habitants, le Projet Sophiatown a donc plusieurs objectifs : reconnaître de façon
42
institutionnelle les aspects d’une culture aujourd’hui mondialement partagée, dynamiser une
vie de quartier quasiment inexistante et renouer avec un électorat noir largement
abstentionniste, les déçu de la «Nouvelle Afrique du Sud».
Le projet fut lancé le 9 février 2002, date anniversaire des premiers déplacements, par une
messe donnée à l’Eglise Jesus Christ the King en présence de nombreuses personnalités
politiques. Celle-ci fut suivie d’une exposition de photographies au Museum Africa, reprenant
les clichés célèbres publiés dans Drum. En février 2003, la célébration commémorative a eu
lieu de nouveau. Mais Julie Tim et son équipe trouvent que «l’esprit n’était plus là. Il faut
créer des évènements plus divertissants. »
C’est dans cette optique qu’a eu lieu la « Soirée shebeens», en mars dernier toujours à
l’initiative de la Région 4. Cette soirée à thème – code vestimentaire : « années 1950 » -
accueillait aussi bien les anciens habitants de Sophiatown que de nombreuses personnalités du
monde social et politique; les premiers dînant dans la salle et les seconds sur l’estrade. Dans le
Centre social de Westdeen, recouvert pour l’occasion de photos noir et blanc, plusieurs
personnalités de Sophiatown ont été très applaudies. Des célébrités, dont les Manhattan
Brothers et Emily Koeane, et des inconnus venus partager leurs souvenirs. La fête était belle,
la musique entraînante et l’atmosphère portait à la réconciliation des peuples.
Mouvement du cœur, cette soirée fut pour les anciens habitants un grand moment de bonheur.
Elle permit en outre Claudiah et son amie Eva de retrouver des anciennes connaissances et de
raconter leur histoire à quelques journalistes. La position entre-deux de la municipalité aura eu
ce mérite, même si elle ne semble pas avoir cerné la fonction de cet évènement, confidentiel et
sans grande portée médiatique.
B. Le mythe : un pont dans l’histoire ?
1. Un lien entre l’avant et l’après apartheid
« La réalité du quartier n’a plus d’importance, ce qui compte
c’est le mythe et la nostalgie vécue aujourd’hui »
P.Gervais-Lambony
A quoi sert le mythe ? Si comme le suggère P.Guillaume « L’histoire sert à légitimer », ici,
l’histoire devenue mythe, sert à légitimer la place des populations non-Blanches dans une
nouvelle Afrique du Sud.
43
a. Négation de urbanité, négation de l’identité
Meschack Khosas (in P.Gervais-Lambony, 1999 : 290) rappelle que le temps de l’apartheid est
celui de « l’urbanisation injuste ». A cet époque, l’état utilise l’espace pour asseoir « le
contrôle indigène » avec une ambition claire : contrôler l’homme, comme l’explique
H.F.Verwoerd, alors premier ministre sud-africain : « L’apartheid comprend une multitude de
phénomènes. Il comprend la sphère politique ; il est nécessaire dans la sphère sociale ; c’est
un but dans le domaine religieux ; il est pertinent dans tous les aspects de la vie. Même dans la
sphère économique, il n’est pas un simple problème arithmétique. Ce qui importe c’est de
savoir si l’on maintient la colour bar ou non. » (H.F.Verwoerd, Senate debates, 1954, cité par
M. Houssay-Holzshuch, 1999 : 23). Cette réflexion amène le premier ministre à la position
suivante : «Les chaos du squatting, le surpeuplement des quartiers indigènes, le logement
illégal sur des propriétés Blanches, l’expulsion de tous ceux qui refusent de travailler et donc
n’ont pas leur place en ville, ces problèmes ne pourront être résolus que quand de grands
townships indigènes seront construits près des villes. » (H.F.Verwoerd, 1952, cité par
P.Gervais-Lambony)
Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement définit ce qui, à ses yeux, devra être une
politique urbaine satisfaisant les critères de développement séparé. C’est ainsi que le townships
idéal est défini comme suit :
« 1. le site doit être à une distance adéquate de la ville européenne.
2. Il doit de préférence être contigu au ghetto (location) d’une ville voisine, de manière à
diminuer plutôt que de multiplier le nombre de zones indigènes.
3. Il doit de préférence être séparé de la zone européenne par une zone tampon industrielle
existant ou à développer.
4. Il doit comprendre un Hinterland adéquat pour son développement futur à éloigner de la
zone européenne.
5. Il doit être à une distance raisonnable de la ville, pour permettre un transport facile par
voix ferrée plutôt que par route.
6. Il doit avoir sa propre route reliant le township à la ville, si possible en passant par les
zones industrielles.
7. Il doit être entouré de zones tampons vacantes cerclant la zone de lotissement, dont la
largeur optimal dépend de la densité d’occupation de la zone européenne la plus proche.
8. Il doit être à une bonne distance des routes principales, nationales en particulier, dont
l’usage local par les habitants du township doit être complètement découragé. »
(H.F.Verwoerd, 1952, cité par C.Bénit, 2001 : 19)
44
En résulte ce que Philippe Gervais-Lambony qualifie de « blitzkrieg urbain » et Jacques Lévy
de « crime contre l’urbanité » : le township.
Afin de segmenter encore cet univers urbain carcéral, le gouvernement de l’apartheid joue la
carte du tribalisme. «Ceux qui ont la même appartenance veulent naturellement vivre ensemble,
et la politique de regroupement ethnique conduira au développement d’un sens renouvelé de la
communauté.» (H.F.Verwoerd, cité par C.Bénit, 2001 : 53).
b. La ville dans la reconstruction identitaire à l’échelle nationale
Dans ce contexte de rupture, le mythe a donc une fonction de création identitaire. Longtemps,
il a servi de référent à une population spoliée de sa liberté et son droit à la ville. Aujourd’hui il
est aussi l’outil de reconstruction d’une nouvelle identité urbaine sud-africaine.
C’est en tout cas ce qu’espère, Feizel Mamdoo directeur du Fietas Festival qui souhaite
comprendre comment et en quoi l’apartheid a changé sa manière de voir le monde.
Originaire de Fietas, délogé avec sa famille vers Lenasia, le township Indien au Sud de
Johannesburg, il reconquiert depuis dix ans son « droit à la ville ». Membre actif de l’ANC,
aujourd’hui réalisateur de films documentaires, il marié à une femme d’origine anglaise et vit
dans une banlieue blanche de Johannesburg. «Je suis parti de Lens (Lenasia) pour les
quartiers Blancs, mais combien on réussit à faire cela ?», s’interroge-t-il. « L’apartheid a
réussi à nous séparer de nos voisins, de nos amis. Combien de temps faudra-t-il pour retrouver
la capacité à vivre ensemble ? » Plus libre que beaucoup dans ses choix culturels et religieux,
il s’interroge sur la question de l’identité sud-africaine en général et indienne en particulier.
Il y a quelques temps, je me suis demandé pourquoi et comment l’apartheid m’avait changé. A
Fietas on vivait tous ensemble. Evidement la vie n’était pas facile, il y avait beaucoup
d’alcoolisme parmi les populations Noires. Je me souviens de voir des femmes portant le voile
ramasser des hommes soûls qui dormaient dans la rue. Je crois qu’à l’époque nous avions tous
conscience d’appartenir à la même humanité. Comme Sophiatown, Fietas était un quartier un
quartier populaire et vivant. Apres nous avons été déplacés et séparés les uns des autres. A
chaque tribu Noire a été affectée une partie de Soweto, les métis ont eu leur township et nous
sommes partis à Lenasia. Comme j’ai été très jeune dans les mouvements ANC j’avais
beaucoup d’amis à Soweto, à l’époque je connaissais très bien les townships, Johannesburg :
j’allais partout. Mais mon cas n’est pas celui de tout le monde. Pendant toutes ses années
d’apartheid, les gens ont été coupés les uns des autres. Ils ont désappris à se connaître. C’est
pour ça que j’ai voulu monter le Fietas Festival. Pour que l’on ré-apprenne à vivre ensemble,
45
pour que chacun se réhabitue à la culture de l’autre. Il n’y a rien qui me met plus en colère que
quand quelqu’un ne sait pas ce qu’est l’Aïd ou le Ramadan. Nous vivons tous dans la même
ville, nous sommes voisins. Moi je connais les fêtes religieuses des autres communautés, je les
respecte, ça me semble être la base de la vie en communauté, non ?
Ce festival est une réponse au Group Area Act et à ce que nous a fait subir l’apartheid. A
travers cet évènement nous réclamons le droit de vivre ensemble. La réalité de Johannesburg
aujourd’hui, c’est une société polarisée entre les townships éclatés qui sont des ghettos ou
vivent la plupart de la population et les quartiers Blancs ou vit la minorité Blanche et riche du
pays. Cela ne me semble pas être les conditions idéales pour construire une société, intégrée,
non raciale et une identité forgée par les expériences passées de la majorité de la population.
La majorité reste confinée dans les ghettos et ce n’est pas les centres commerciaux qui vont
nous donner ou nous montrer notre âme celle des humains ni celle de la ville. Ce que je
cherche à mettre en place c’est une relation entre l’homme et l’espace. L’énorme polarisation
de Johannesburg en fait un challenge très important. A Fietas, les ruelles étroites, les petits
cottages, les chemins qui s’entrecroisent et les backyards tout ça donnait de la vie, de la mixité
au quartier. Ce que nous essayons de recréer dans ce festival c’est cette dynamique urbaine au
travers des activités pour retrouver l’esprit de cette époque. Il reste encore quelques beaux
bâtiments : des vieilles maisons, des mosquées qui sont des symboles très forts de la
destruction matérielle et spirituelle du Group Area Act et forment un cadre idéal pour un
festival qui veut travailler sur la mémoire. L’objectif de l’apartheid était de créer une rupture
dans la construction et le développement d’une identité nationale qui transcendait les races. En
vivant côte à côte et partageant l’espace comme c’était le cas à Fietas, les Chrétiens auraient pu
comprendre les Hindous, personne n’aurait pu ignorer ce que faisaient les sangomas, les
pratiquants des églises et des shebeens se seraient peut-être mieux compris. A moyen terme, le
Fietas festival, outre de réclamer un espace commun de célébration historique et de mémoire
indispensable à tous ceux qui ont été abandonnés dans les townships, veut contribuer à la
création d’une identité nationale.
F.Mamdoo (2003)
Le mythe a donc une fonction transitoire permettant le passage d’un état - social ou urbain - à
un autre. Il a aussi une fonction didactique développée par Mircea Eliade – tout ce qui peut-
être fait par l’homme le fut par le passé par des surhommes – et pourrait donc être un
facilitateur de recréation de l’esprit urbain. Clairvoyant, F.Mamdoo envisage le mythe comme
le médium entre l’individu et son espace, facteur de dynamique urbaine, et pourquoi pas,
première étape vers une société non raciale.
46
2. Le mythe, manifeste pour un retour à l’urbain ?
a. Ville et urbanité
« Urbanité : savoir vivre ensemble »
Jean-Pierre Simon
L.Wirth (1938, cité par A.Raulin, 2001 : 48), fut le premier à étudier les interactions entre
l’espace et ses habitants dans le contexte urbain. Il en déduit la première définition de
l’urbanité : l’hétérogénéité des population et leur proximité sont les caractéristiques essentielle
de la ville. La ville est «une configuration particulière fondée sur la coprésence et permettant
de limiter, au même titre que les transports et les communications, les obstacles opposés par la
distance à l’interaction sociale » (D.Dabrowsky-Sangodeyi, 2002 : 51). Marie-Christine
Jaillet (citée par Bénit, 2001 : 129) donne une autre définition de la ville dans laquelle
s’articulent des éléments de définition du sens urbain : «La ville donnant à voir dans un même
espace restreint la société dans sa complexité, ses différences et ses déchirements, obligerait à
construire, par nécessité de cohabitation, un «être-ensemble» ou un «vivre-ensemble»,
enrayant la violence originelle des rapports sociaux. Sans nier la dimension mythique de cette
vision la ville comme fait civilisateur, celle-ci s’alimente cependant d’un certains nombre
d’expériences concrètes (…). A cette ville « civilisatrice », « émancipatrice », il faut des
attribut physiques : la densité, l’espace public où se côtoient, se mettent en scène, s’observent,
et se défient groupes et classe dans un jeu complexe de représentation et de confrontation. »
Coprésence, interaction, civilisation, émancipation : plusieurs concepts pour définir le sens
urbain, cette urbanité que Jean-Pierre Simon (www.cafe-geo.com), définit de la façon suivante.
« La famille, l'immeuble, la rue, la quartier, la commune, l'agglomération, la nation, la
religion, etc… Au niveau individuel, l'urbanité, c'est la capacité d'articuler ensemble le plus
grand nombre de ces échelles. » D.Coplan donne, lui, une définition plus large et considère
l’urbanité comme l’ensemble des interactions économique, sociales et culturelle ayant pour
cadre un milieu urbain.
A.Berque avance ce qui semble être la définition la plus sensible de l’urbanité conditionnée par
l’acquisition de trois des sens de la ville:
« • le sens de la ville comme façon d'être dans sa tête
(l'idée ou la signification des choses de la ville) ;
• le sens de la ville comme façon de la ressentir
(la sensation / perception / représentation de l'environnement urbain) ;
47
• le sens de la ville comme tendance évolutive de ses formes propres
(formes architecturales et formes comportementales). » (A.Berque,
www.urbanisme.equipement.gouv.fr)
Ces sens de la ville correspondent à «l’état d’urbanité» véhiculé par le mythe de Sophiatown.
Une définition à paliers pour comprendre la ville dans sa complexité. C’est d’ailleurs cette
même complexité que l’on retrouve chez Jacques Lévy dans ses « Sept propositions » pour
mesurer l’urbanité, « ce qui fait qu’une ville est une ville » (1999, 200).
A Johannesburg, ce sens urbain a rejailli plusieurs fois et dans plusieurs lieux différents après
la disparition de Sophiatown. Est-ce à dire que l’urbanité en Afrique du Sud est un gène
récessif de la ville planifiée ? Claire Bénit avance l’hypothèse que ces re-créations d’urbanité
furent possibles grâce à certaine intégration économique et sociale des villes de l’apartheid.
«La notion de fragmentation sociale s’inscrit en réalité dans cette lignée moderniste, prenant
la séparation physique des quartiers pour le signe de leur séparation sociale et
fonctionnelle. On verra qu’il n’en est rien : la ville hyper –ségrégée de l’apartheid se marque
au contraire par une forte intégration économique, et un certain degré de centralisation
politique au service de l’interdépendance des groupes.» (Bénit, 2001 : 54) L’apartheid a donc
échoué dans sa tentative d’uniformisation des villes pour des raisons essentiellement politiques
(P.Gervais-Lambony, 1999 ; P.Guillaume, 2001). Comme le rappelle C.Bénit, la stratégie
d’urbanisation du gouvernement fut confuse jusqu’au début des années 1960 – date où elle
s’arrête brutalement- et la crise du logement qui en résulte a favorisé largement le
développement de l’habitat informel, obstacle de taille à une fragmentation urbaine planifiée.
Pendant la seconde moitié du XXème siècle, quelques quartiers échappent donc aux contrôles
du Group Area Act, pour suivre un modèle d’urbanisation proche de Sophiatown.
b. Des résurgences épisodiques
«Sophiatown se reconstitue sans cesse dans divers lieux de l’espace jobourgeois :
émergeant toujours des quartiers qui sont marqués par une véritable urbanité
et qui sont des espaces de contacte entre les différentes communautés.»
P.Gervais-Lambony
En guise de préambule on peut ici remarquer que «l'urbanité ne se transfère pas. Certains de
ses constituants, ainsi les formes architecturales, peuvent bien voyager ; de même les figures
comportementales de l'urbanité, par exemple les manières polies de se tenir à table ; voire les
48
façons urbaines de regarder et de penser, comme les goûts littéraires ou paysagers ; mais
l'urbanité comme telle, qui intègre tous ces constituants pour en faire le sens d'une ville, ne
peut pas être déplacée. En cas d'emprunt, le milieu d'accueil réintègre les éléments adoptés en
d'autres compositions que celles du milieu d'origine ; ce qui a pour résultat de subvertir leur
sens et de l'assimiler à l'urbanité de ce milieu d'accueil : une ville singulière.» (Berque,
www.urbanisme.equipement.gouv.fr).
• Hillbrow et Yeoville : résurgences du mythe
Au cours des années 1970-1980, le centre de Johannesburg, et plus particulièrement l’ancien
quartier de la bourgeoisie blanche, Hillbrow, a subit une désagrégation progressive qui
l’emmène a être considéré comme zone «grise», par opposition aux zones «Noires» ou
«Blanches» définies par l’administration (P.Guillaume, 2001 ; A.Morris, 1999 ; Crankshaw et
White, 1995). Le processus d’évolution est complexe. Les premières familles d’origine
indienne, poussées vers le centre par la crise du logement, sont en général plus jeunes, plus
qualifiées et plus riches que les familles Blanches qu’elles remplacent. Mais «selon la
perception populaire, la déségrégation raciale des districts à haute densité du centre de
Johannesburg s’est accompagné d’un déclin général des standards de civilité.» (P.Guillaume,
2001 : 275). Les années 1980 marquent l’intensification de la migration des populations non-
Blanches vers le centre et le mouvement des Blancs vers les banlieues nord, leurs grandes
maisons, nouveau standing de la classe moyenne. Le quartier se transforme alors rapidement.
La population, principalement composée «d’universitaires et d’immigrants européens ainsi
que de jeunes Blancs libéraux et spatialement très mobiles.» (Bähr, Bock& Jügens, cité par
P.Guillaume, 2001 : 279) adopte les comportements d’«un des plus cosmopolites quartiers du
pays, avec un caractère continental distinctif dû à une vie nocturne animée, des restaurants
élégants, des salons de thé et des cafés fréquentés par un grand nombre de groupes
d’immigrants tels que les italiens, allemands, portugais ou grecs qui y vivent.» (de Coning,
Kick & Olivier, 1987, cité par P.Guillaume, 2001 : 295) Comme les shebeens de l’époque de
Sof’town, les cafés y sont nombreux forment, comme le U.Hannerz dans le cas de Sophiatown,
le ciment de l’urbanité : le Café de Paris, le Café Zurich, le Bella Napoli sont des lieux de
rencontre et d’interaction. Les librairies, les disquaires et les boutiques de mode drainent une
population et des modes de consommation différents de ceux du reste de l’Afrique du Sud.
Cette ville européanisée devient emblématique de l’évolution de la société et de l’espace
urbain, certains veulent y voir un modèle qui se caractérise par le dynamisme des espaces
publiques, la diversité sociale et raciale et la vie culturelle et nocturne. Cette description est
confirmée par les enquêtes de terrain réalisées par Alan Morris au début des années 1990. « It
49
was a very cosmopolitan place, and at Christmas time everybody used to come here. It was a
lovely and clean place. There was life. There was always music. People used to go out to
restaurants. We often used to go for a walk(…). But ever since, you know, it has been taken
over by everybody and it’s become a little bit of a second Soweto as far as I am concern.»,
témoigne une ancienne habitante, Mrs Fisher. Une autre femme Blanche résidente du quartier
depuis longtemps, Mrs Lee, ajoute : « I loved the vibrancy of it. I loved the feeling that I could
get anything at anytime of the day or night. I was just in my fingertips. And I am actually in a
dilemma now because I don’t like living in the suburbs but the neighbourhood has deteriorated
terribly since the blacks moved in.» (Morris, 1999 : 192) Ces témoignages, que Morris qualifie
de nostalgiques et romantiques, annoncent la dégradation du quartier, aujourd’hui considéré
infréquentable et dangereux par une large partie de la population Jobourgeoise.
A la suite d’Hillbrow, le quartier de Yeoville a connu les mêmes transformations : le passage
d’une zone «blanche» à «grise» puis «noire». J’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup
d’anciens habitants du quartier. On retrouve dans leur témoignages la même nostalgie de leur
quartier, des relations hétéroclites qu’il y ont nouées, du rythme de la vie, des rues, des bars,
etc…Là aussi l’augmentation de la criminalité, la dégradation du bâti, la fermeture des lieux à
la mode : en un mot la paupérisation du lieu a eu raison des plus farouches défenseurs d’une
«autre modèle urbain sud-africain ».
Les quartiers Hillbrow puis Yeoville ont donc été des « villes singulières », ou plutôt des
quartiers singuliers, reproduisant certains aspects de Sophiatown et se créant une identité
particulière.
B. Le modèle de Sophiatown
la principale caractéristique serait la spontanéité et une courte durée de vie. La réapparition
d’une forme d’urbanité connue dans une histoire récente amène à s’interroger sur la validité
d’un modèle urbain récurant dont
1. Johannesburg versus Amsterdam
Dans Le tournant géographique, Penser l’espace pour lire le monde (1999), Jacques Lévy
avance l’idée suivante : «Il n’existe, au fond, que deux modèles de ville dans le monde
contemporain, qu’on peut appeler l’un, le modèle d’Amsterdam, l’autre le modèle de
Johannesburg. » (1999 : 242)
50
Ces deux modèles sont définis par le tableau suivant :
Amsterdam Johannesburg Densité + - Compacité + _ Inter accessibilité des lieux urbains
+ _
Présence d’espaces publics + _ Importance des métriques pédestres
+ _
Coprésence habitat/emploi + _ Diversité des activités + _ Mixité sociologique + _ Fortes polarités intra urbaines
+ _
Productivité marchande par habitant
+ _
Auto évaluation positive de l’ensemble des lieux urbains
+ _
Auto visibilité et auto identification de la société urbaine
+ _
Société politique d’échelle urbaine
+ _
(Extrait de Lévy, 1999 : 243)
«Cette typologie élémentaire constitue l’une des retombées d’une démarche visant à
réintégrer de l’urbanité (ce qui fait qu’une ville est un objet social spécifique) dans le
mouvement théorique de la géographie en repartant d’une définition simple : la ville est une
association de densité et de diversité.» (J.Lévy, 1999 : 243) Ces deux descriptions
idéaltypiques de la ville ont donc été conçues comme des aides à la définition de l’urbanité. Le
modèle de Johannesburg synthétise les caractéristiques des villes américaines et de certains
nouveaux quartiers aisés des pays en voie de développement.
Même si Denton et Massey considèrent «la ségrégation (en Afrique du Sud) comme une
séquelle malheureuse d’un passé raciste qui s’estompe progressivement avec le temps»
(1995 :14), la comparaison Etats-Unis/Afrique du Sud a été établie par de nombreux
chercheurs. Dans son travail consacré aux formes de la ségrégation spatiale à
Johannesburg, P.Guillaume explique ainsi que «l’exclusion sud-africaine possède des
caractéristiques socio-économiques valides dans d’autres systèmes d’exclusion » (2000 : 159).
C.Bénit précise que : «les formes de ségrégation urbaine à Johannesburg sont moins
exceptionnelles qu’elles ne sont la caricature de dynamique ségrégatives présentes plus
51
implicitement dans d’autres métropoles mondiales. Ségrégation raciale et ethnique, absence
d’espace publics de la mixité et du brassage, ghetto, …pourraient tout aussi bien caractériser
une ville comme Los Angeles.» (2001 : 53). Dans sa thèse consacrée à Salvador de Bahia,
D.Dabrowski-Sangodeyi, fait, elle, le rapprochement entre le modèle de Johannesburg et
certains quartiers de condominium de Salvador de Bahia. «Si la séparation sociale ou ethnique
n’est pas soutenue légalement par les institutions brésiliennes, certaines composantes du
modèle de Johannesburg (…) apparaissent dans les représentations de certains habitants et
dans leur appréhension de la spatialité.» (2002 : 193)
Cette comparaison avec des quartiers de villes dans des pays en développement est importante
dans la mesure où elle semble pouvoir s’appliquer à de autres nombreux espaces urbains,
notamment dans les pays en voie de développement. Ne serait-on pas en présence d’une
nouvelle forme d’urbanité qui, le souligne J.Lévy, pourrait être compensée par «la production
d’autres capitaux sociaux » parmi lesquels la ville européenne serait «devenue un luxe pour le
‘Sud’ » ? (1999 : 244-145)
Dans cette nomenclature, la ville européenne se définie en effet par une importante
concentration c'est-à-dire une forte dose de «coprésence et d’interaction du plus grand
nombres d’opérateurs sociaux » (1999 : 243). Ville de référence dans l’imaginaire urbain, elle
est «l’image-mère» de toutes les villes. A.Berque rappelle, par exemple, que les architectes de
l’ère Meiji se sont inspirés d’une représentation de Paris «capitale du XIXème siècle» pour la
reconstruction de Tokyo en 1923. La ville européenne est vécue comme une utopie, un modèle
(2001 : 62), une image de ville plus que la ville elle-même. La ville européenne serait alors par
essence mythique et porteuse d’utopies. Le modèle d’Amsterdam a donc des accointances avec
la ville asiatique, mais on retrouve certaines caractéristiques de ce modèle de «ville-quartier»
en Amérique Latine ou dans le monde arabe. Jacques Lévy rappelle en effet que, malgré de
nombreuses hésitations entre les deux orientations –Johannesburg ou Amsterdam ?, ces villes,
ces quartiers « partagent la même tendance à une appropriation spécialisée et communautaire
de l’espace.» (1999 : 247). C’est ce qui les rapproche du modèle de Sophiatown.
2. Le modèle de Sophiatown
Pour mieux comprendre quels sont les points communs entre les quartiers de Sophiatown,
Hillbrow et Yeoville, j’ai tenté de définir ce que pourrait être un « modèle de Sophiatown »,
hybride entre Johannesburg et Amsterdam. Ni ville fragmentée, ni lieu privilégié de l’urbanité :
il décrit une ville mouvante, en construction dont l’avenir reste incertain.
52
Amsterdam Sophiatown Johannesburg Densité + + - Compacité + + - Interaccessibilité des lieux urbains
+ + _
Présence d’espaces publics
+ + _
Importance des métriques pédestres
+ - _
Coprésence habitat/emploi
+ - _
Diversité des activités + - - Mixité sociologique + + - Fortes polarités intra urbaines
+ - _
Productivité marchande par habitant
+ - _
Auto évaluation positive de l’ensemble des lieux urbains
+ + _
Auto visibilité et auto identification de la société urbaine
+ + _
Société politique d’échelle urbaine
+ + _
Ce modèle rappelle le Harlem des années 1930 (P.Guillaume & M.Houssay-Holzschuch, 2001 :
68), les ambiances du Paris d’après-guerre capturées par la caméra de Cartier-Bresson, du
Quartier Latin ou de Montmartre, Soho, Greenwich village (U.Hannerz, 1994 : 184) et certains
quartiers populaires de Salvador de Bahia (D.Dabrowski-Sangodeyi, 2002 : 207). Modèle de
transition, il s’inscrit dans u contexte historique – après-guerre, exode rural, changements
démographiques – ; géographique – par sa dimension locale, régionale, nationale et finalement
globale - et se caractérise par une dynamique sociale et culturelle exceptionnelle.
Dans le cas de l’Afrique du Sud, le modèle de Sophiatown peut donc s’appliquer aux exemples
d’Hillbrow et de Yeoville développés plus haut. Alan Morris (1999 : 39) rappelle la théorie de
F.Tönnies qui, en 1887, fait état du passage de la communauté (Gemeinschaft), modèle
traditionnel des sociétés rurales et villageoises, à la société (Gesellschaft) : «all praise of rural
life has pointed out that Gemeinschaft among people is stronger there and more alive : it is the
lasting and genuine from living together…In contrast Gesellschaft is transitory and
superficial». Pour F.Tönnies, qui pose un regard critique sur les grandes agglomérations, la
ville développe des comportements individualistes qui isolent les citadins les uns des autres.
53
S’il reprend les même termes de Gemeinschaft et Gesellschaft, Jacques Lévy insiste lui sur le
fait «que la recherche permanente de l’écart suppose une attente négative vis-à-vis de la
collectivité, tandis que la densité et la diversité permettent à la fois le développement de
l’individu (grâce à l’économie de moyens sur le logement et les services quotidiens) et la
société.» (1999 : 245)
Entre la société éclaté où l’on cherche à donner un sens aux espaces publics (L.Lofland cité par
J.Lévy, 1999 : 245) et une société villageoise privées des ressources du monde urbain, il
existerait donc un modèle intermédiaire, celui d’une société urbaine dense et diverse dans
laquelle deux modèles se rejoignent et cohabitent pour un temps.
* * *
54
Deuxième partie
Sophiatown, un modèle d’urbanité pour la ville post apartheid ?
I. A la recherche de nouveaux mondes urbains
A. Sophiatown : des thématiques d’études pour la ville contemporaine
1. Un modèle à part
L’étude de Sophiatown, - à cause de son urbanisation spontanée
représentative de nombreux quartiers populaires et grâce à la qualité et la diversité des
phénomènes culturels et sociaux que celle-ci a engendré dans le temps - invite à s’interroger
sur les conditions d’émergence de l’urbanité et plus généralement à se poser la question de ce
qui fait la ville.
Selon U. Hannerz «Accepting New-York could be a way to rejecting Pretoria» (1994 : 192), il
s’agit là de reconnaître les processus de créolisation culturelle à l’œuvre dans l’espace urbain
dont Sophiatown a été l’un des modèles «If cultural traffic is now less of a one-way thing, that
is to say, it from place like Sophiatown, the focal point of creolization, that the centre of the
global ecumene (…) are mostly reach ».
La notion d’écoumène, est un autre concept fort dans cette vision de la ville. L’écoumène est
ainsi définie par A.Berque : «L'écoumène, entendue comme l'ensemble des milieux humains, se
définit ici comme la relation de l'humanité à l'étendue terrestre. Cette relation établit
concrètement dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire dans un milieu et dans une histoire,
le moment structurel de l'existence humaine. (…) L'étude de l'écoumène (…) exige
l'interprétation herméneutique du sens que lui donne l'histoire humaine. Ce sens diffère
toujours selon les sociétés, qui l'établissent de leur point de vue, subjectivement, tout en
l'inscrivant objectivement dans l'étendue par leur action. Cette relation ambivalente, mi-
55
objective mi-subjective, est la réalité humaine, celle de l'écoumène. »
(http://www.ehess.fr/centres/crj/pages/berque.html).
A partir de cette définition et du modèle de Sophiatown définit plus haut, il est intéressant de
se questionner sur la ville contemporaine. Dans quelle mesure celle-ci est-elle héritière de la
créolisation évoquée par Hannerz et porteuse de cette notion d’écoumène chère à A. Berque ?
Cette première question incite ensuite à se poser celle de l’urbanité fantasmée ou niée de
Johannesburg et, par ricochets, à interroger une nouvelle fois les concepts de mixité, centralité
et densité.
Ces réflexions qui ont aboutit à l’étude de deux quartiers de Johannesburg, Mayfair et Brixton,
ont été largement alimentées par les rencontres avec d’autres chercheurs. C’est à partir de leurs
questionnements – sur des problématiques contemporaines et parfois techniques – que je me
suis posée la question de l’héritage de Sophiatown dans ces quartiers apparemment mixtes et
présentant des signes d’urbanité. Près de dix ans après la chute de l’apartheid, l’institution
d’une démocratie et l’abolition des lois ségrégationnistes, on peu effectivement s’interroger sur
la reconstruction d’un espace urbain commun et partagé par tous...
2. Méthodologie
a. La démarche
Ce travail à Johannesburg a donc été réalisé à partir d’une étude de terrain de 2 mois, à
Mayfair et Brixton, et de nombreuses observations participantes et entretiens, réalisés dans
toute l’agglomération pendant les deux années de mon séjour sur place.
Pour reprendre le mot de Guy di Méo, je me suis donc attachée à décrire «l’espace vécu» qui
exprime la réalité des comportements individuels et que rejoint le concept «d’habitus»
développé par Pierre Bourdieu et la notion d’acteur social et spatial analysée par Fanny
Letissier dans son travail sur Saint-Denis. «Le territoire entre dans la combinaison identitaire
du groupe social spatialisé qui la façonne. Il la rend plus tangible, plus intelligible, semé
d’objets patrimoniaux, de hauts lieux emblématiques, de mémoire collective. Comme l’écrit
Bernard Debrabieux, le territoire «imbrique un espace géographique structuré par les
principes de contiguïté et de connexité et un monde symbolique construit à l’aide de
synecdoques et de métaphores.» Dès lors le territoire devient un attribut majeur de la
construction du rapport à l’extériorité, à l’altérité, à ceux qui n’appartiennent pas au groupe.»
( G.Di Méo, 2001 : 9)
56
Dans cette définition de territoire il est question du rapport à l’autre développé par Emile
Durkheim : «L’homme est double. En lui il y a deux êtres : un être individuel qui a sa base
dans l’organisme et dont le cercle d’action se trouve, par cela même, étroitement limité, et un
être social qui représente en nous la plus haute réalité, dans l’ordre intellectuel et moral, que
nous puissions connaître par l’observation, j’entends la société.» (E.Durkheim, cité par
D.Dabrowski-Sangodeyi.) En m’inscrivant dans cette perspective, j’ai tenté de distinguer ce
qui, dans le discours et les représentations, relevait de la construction individuelle,
communautaire ou sociétale. A partir de cette courte analyse il est possible de se faire une idée
du processus de construction sociale/spatiale de ces quartiers et de leur représentations qui
« passe par des formes créées, idéalisées, théorisées dont on aura du mal à saisir la raison si
on oublie qu’elles sont nées tout autant du mythe, de l’inconscient, et du religieux que des
déterminants fonctionnels.» (A.Bailly, C.Baumont, J.-M.Huriot, A.Sallez cités par
D.Dabrowski-Sangodeyi.)
Lors des entretiens qui ont servi de base à l’élaboration de ce travail, j’ai également essayé de
déterminer quelle était la place du mythe urbain contemporain, ici Sophiatown, dans la ville.
En retrouve-t-on «les fragments à travers les notes des journalistes et des rédacteurs
éditoriaux, idéologues sociaux et candidats politiques » comme le suggère E. Whitmont, (cité
par D.Dabrowski-Sangodeyi.) ou bien, dans une certaine manière d’envisager l’espace et de
parcourir la ville comme l’avance M.de Certeau ? Ou encore, finalement ce «good old time» se
cantonne-t-il à un espace de parole délimité dans le temps ?
b. Discours
En choisissant deux quartiers mixtes et populaires j’ai ainsi voulu m’inscrire dans la nouvelle
dynamique de l’Afrique du Sud : un mouvement économique, social et spatial d’intégration
des populations au cœur du pays. Les problématiques des quartiers ségrégués ayant déjà été
largement traitées par ailleurs (P.Guillaume, 2001), il me semblait plus pertinents de me
pencher sur la compréhension de systèmes urbains mouvants ces lieux en/de transition -
« Lieu : là ou quelque chose se trouve/se passe » (Dictionnaire de la Géographie, 2003 : 555).
Cette recherche empirique à Mayfair et Brixton est un donc point de départ pour une réflexion
sur l’articulation entre la mémoire urbaine, l’évolution des configurations urbaines et les
représentation de l’espace. Reprenant l’hypothèses de Jacques Lévy selon laquelle «la relation
entre identité spatiale et la conception de la vie sociale est consistante», D.Dabrowski-
Sangodeyi rappelle, qu’ «il convient de d’admettre que même les acteurs du pouvoir sont
«dominés» par certains «mythes» et par leur représentation de la ville et de la société. Ils
57
entreprennent d’autant plus une relation particulière avec toute la dimension idéelle de la ville
que les projets qu’ils mettent en place s’appuient sur certaines idées de ville présentes dans
l’inconscient social. Dans le discours de légitimation de ces projets auprès de la société, ils
dont souvent appel à ces mythes.» (34 : 2003)
D.Dabrowski-Sangodeyi souligne également que la vision de la ville dépend pour beaucoup de
la place occupée par l’acteur. Reprenant une classification utilisée par A.Bailly, C.Baumont,
J.-M.Huriot et A.Sallez, elle la complète de la manière suivante : «l’action du chercheur sur la
ville relève du discours, de la lecture de la ville perçue comme objet d’étude. (…) Il influence
les représentations de l’aménageur et de l’homme politique et il a un rôle critique par rapport
à l’action de ces derniers. (…) Le citadin agit sur la ville dans sa pratique quotidienne de
l’espace par ses stratégies spatiales. Ses représentations sont influencées par la configuration
de la ville, les idéologies et les idées de la ville. Il participe à l’élaboration des idées de la ville
et à leur reproduction dans l’inconscient collectif par un « accord tacite » de l’ensemble de la
société. La ville est l’espace essentiel de dialogue entre le citadin, l’homme politique et
l’aménageur car le premier a rarement l’occasion d’échanger ses opinons. C’est pourquoi la
lecture de l’espace permet de décrypter sa forme de discours.» (2003 : 35)
Cette nomenclature souligne l’importance du discours sur la ville dans la démarche recherche
en géographie urbaine en bref : qui sont les émetteurs, les récepteurs et quel est le message ?
Etudier la ville, c’est donc tenter de mettre en perspective la diversité et la complexité des
différents discours. Acteur et nouvellement citoyen (dans le cas des populations non blanches),
le citadin/citoyen de Johannesburg fait depuis dix ans ce parcours de compréhension et
d’appropriation de la ville, d’abord à l’encontre des planificateurs et des hommes politiques, et
depuis peu, avec eux. Cette situation extraordinaire de fin de l’apartheid, crée donc les
conditions particulières et spontanées d’accès à l’urbanité. Comment se construit au jour le
jour cette nouvelle urbanité sud africaine ? De quel modèle cette nouvelle ville sud-africaine
va-t-elle être porteuse ? Il me semblait donc important de recueillir leur discours sur la ville
pour mieux comprendre leur manière d’aborder cette question.
• Entretiens
Lors de mes rencontres avec les habitants, je me suis appuyée sur un entretien semi-directif
dont l’objectif était double : connaître l’utilisation de l’espace urbain et y chercher des clés de
compréhension de l’importance du mythe - ici Sophiatown - dans la construction d’un « être-
en-ville».
L’échantillon des personnes interrogées a été établi selon des critères spatiaux et raciaux. En
voulant dépasser les catégories de l’apartheid, il m’a pourtant fallu les reprendre et les utiliser
58
pour mesurer la mixité de ces quartiers. C’est aussi pour avoir un panel aussi représentatif que
possible que je me suis attachée à sélectionner des individus des deux sexes et de différentes
tranches d’âge.
La plupart des entretiens on été réalisés sur le lieu de travail des interviewés, parfois dans les
magasins, quelques fois dans la rue mais rarement chez eux. L’entretien, qui durait en général
trois quart d’heure/ une heure, se faisait sans traducteur et de préférence de face à face.
Les thèmes abordés ont été les suivants :
- l’utilisation de la ville : type d’habitat, utilisation des infrastructures, lieux fréquentés,
itinéraires habituels, transports, etc.,
- la vie sociale : participation à des activités familiales, communautaires ou sociales, évaluation
des relations sociales dans le quartier, évaluation des problèmes de sécurité,
- les stratégies spatiales, référents spatiaux d’évaluation de l’environnement et de son évolution.
- référents urbains et appréciation de la ville,
- les représentations et les perceptions de la ville, du quartier.
Ces entretiens ont permis d’approcher la réalité vécue par des populations peu étudiées dans la
ville sud-africaine. Indiens, musulmans ou hindous, Asiatiques, Métis, immigrés d’Afrique
anglophone ou d’autres continents et la nouvelle bourgeoisie noire urbaine, tous se partagent
un espace commun, fait géographique et social qui révolutionne les préceptes de l’ancienne
Afrique du Sud et correspond à l’émergence d’une petite classe moyenne, mixte et
fondamentalement urbaine.
Cette courte étude donne ainsi des pistes de ce qui pourrait être la démarche d’une recherche
plus approfondie sur la mutation des villes et la création de nouveaux modèles urbains sur le
schéma du « modèle de Sophiatown » évoqué plus haut.
3. La matrice Sophiatown
Dans le cadre de cette recherche, je me suis plutôt tournée vers des zones d’habitations plus
structurées répondant aux trois impératifs de l’urbanité telle que définit précédemment :
centralité, densité et hétérogénéité. L’objectif de cette enquête étant de retrouver quelques
réminiscences Sophiatowniennes dans la ville de Johannesburg du XXIème siècle : une certaine
façon d’être en ville, un esprit, une forme d’urbanité.
a. Topographie
59
Mon terrain d’investigation se devait donc d’être un lieu dans lequel les métriques pédestres
soient, sinon dominantes, au moins évidentes (ce qui implique la présence de trottoirs, de
passage piétons, de parc ou de square, ect.), où l’on trouve une coprésence d’habitat et
d’activité (présence de commerces) et où une forme d’espace publique soit identifiable (rue
commerçante, parcs, terrasses, etc..)
b. Mixité
Grâce aux travaux réalisés sur Johannesburg et d’autres banlieues américaines ségréguées
(P.Guillaume, D.Dabrowsky-Sangodeyi), on connaît aujourd’hui le mode de fonctionnement
de ces espaces clos. La primauté donnée à l’hétérogénéité sociale et raciale dans ce travail a
permis de l’ancrer dans une autre perspective : celle de la fin de l’apartheid, de la
déségrégation spatiale et de la création de nouveaux modèles urbains. Sophiatown était un
quartier en perpétuelle mutation, doté d’une population mouvante et principalement composée
de primo arrivants. Sans qu’il soit complètement possible de transposer cette composante
sociologique dans la recherche d’un terrain dans le Johannesburg contemporain, il semblait
important rechercher ces critères. La mixité était aussi importante dans une approche plus
économique : le dynamisme de la société de Sophiatown était en effet fortement lié à la mixité
économique et culturelle.
Les quartiers déjà largement étudiés par des chercheurs français et sud-africains ont également
été exclus de ce travail. L’histoire particulière et les phénomènes sociaux qui y sont analysés
serviront plutôt de trame de comparaison. Il m’a, en effet, semblé plus pertinent de me pencher
sur des quartiers jamais étudiés auparavant.
Ce travail est donc focalisé sur des quartiers proches du centre ville, composés de populations
mixtes culturellement, socialement et racialement : Mayfair et Brixton qui, lors des repérages
ont semblé correspondre aux critères de recherche.
B. Mayfair, Brixton : deux quartiers pour une nation arc-en-ciel?
1. L’approche
60
a. Johannesburg, vue d’ensemble
En abordant Johannesburg en 2003, on ne peut qu’être frappé par cette ville tentaculaire et si
éloignée des représentations urbaines européennes. Une fois passé le centre ville hérissé de
tours et d’immeubles, les banlieues résidentielles semblent se succéder les unes aux autres. Le
plan des rues perpendiculaires, si symbolique de l’espace américain, est ici appliqué à la lettre.
Seuls les centres commerciaux (malls) jouent le rôle d’espace public, piéton, commerçant et de
divertissement. Ils sont légion : à chaque quartier le sien, grand ou petit, à l’image de son
environnement. Celui de Rosbank est urbain et branché, ceux de Sandton ou d’East-Gate,
immenses et ostentatoires, ceux des petits quartiers résidentiels, pratiques et bon marché.
Ces temples de la consommation apparaissent comme les seuls lieux d’urbanité dans le
paysage monotone de la ville sud-africaine. C’est là que familles et amis viennent se divertir et
sortir puisqu’on y trouve de tout : des cinémas, des salles de jeux, des restaurants, des bars et
des cafés qui jouxtent, en effet, les supermarchés et les grandes enseignes nationales et
internationales.
Pourrait-on qualifier ces centres de nouveaux pôles urbains ? Leur vocation commerciale
première semble être obstacle à une définition qui se vérifie pourtant dans la pratique.
b. Les quartiers mixtes
En dépit des apparences, il existe à Johannesburg des quartiers ou des zones véritablement
urbains. On en trouve par exemple dans ce que l’on pourrait appeler la «petite couronne» des
banlieues résidentielles : zones d’habitat relativement anciennes dans lesquelles se sont
développés des petits centres urbains regroupant sur une ou deux rues commerces et
restaurants souvent très fréquentés. L’un des plus fameux est Melville, rare lieu où l’activité
commerciale dépasse le cadre d’une seule rue. C’est là que se retrouve une population plutôt
jeune, souvent branchée et très mixte.
Dans le Sud de l’agglomération on trouve une autre forme d’urbanité plus populaire et
« africaine ». Très animés, ces anciens quartiers de «petits Blancs» ont été investis par les
populations noires dont beaucoup d’immigrés d’Afrique francophone comme Rosentenville.
Ces nouveaux citadins ont, dans la plupart des cas, maintenu les structures urbaines existantes
(infrastructures, commerces) et en ont développées d’autres (espaces public et des structures
informelles).
61
On pourrait également parler du centre ville, des quartiers réputés dangereux voir
infréquentables comme Yoeville, Hillbrow ou encore du grand township de Johannesburg,
Soweto, où une urbanité farouche, parfois exubérante prend des formes insolites pour
l’observateur non initié. Il existe bien dans la ville de Johannesburg plusieurs quartiers qui
répondent de façons plus ou moins précises aux critères d’urbanité définis plus haut.
2. Typographie des quartiers : présentation de l’espace
Situés à l’Est du centre ville, ces deux quartiers appartiennent à la même aire géographique et,
comme Sophiatown, sont rattachés administrativement à la Région 4 de Johannesburg.
a. Mayfair
«This suburb, to the west of Fodsburg, was a part of the portion of Langlaagte acquired by J.B.
Robinson. The first plots were sold in august 1896. The area was originally intended for upper
class residences. Robinson built his headquarters there, one of the first double-storeyed
official building in the area. A few elegant houses were erected, one of the most distinctive
being Villa Mayfair, built in 1898 for Mr Busat, a Market Street businessman, The old fired
station and Jewish Synagogue were also noteworthy buildings. A row of original corrugated
iron houses in Church Street Extension, Mayfair, is a relic of the early miners’ houses.»
(Musiker, 2000 : 181)
C’est de ces débuts prestigieux que le quartier tient son nom, hommage au célèbre quartier
londonien. Au cours du XXème siècle le quartier subit une mutation démographique importante
et se transforme rapidement en lieu de résidence de la petite classe moyenne Blanche :
beaucoup des habitants étaient par ailleurs employés de la société de transport ferroviaire
nationale qui les logeait dans des maisons bon marché.
Aujourd’hui très mixte, le quartier a gardé des traces de ces époques successives dans
l’architecture. On trouve encore quelques unes des belles maisons du début du siècle et
beaucoup des ces petites maisons mitoyennes qui ne sont pas sans rappeler les paysages
urbains des banlieues ouvrières des Pays -Bas ou du Royaume-Uni.
Au cours des vingt dernières années, le paysage a encore une fois évolué avec l’arrivée de
nouveaux résidents. Venus des townships, les populations spoliées de leur droit à la propriété
investissent alors ce quartier proche du centre ville et disposant d’infrastructures de qualité.
Ces nouveaux propriétaires, très souvent indiens, ont alors fait construire des maisons dont la
62
démesure est souvent proportionnelle à leur réussite sociale et économique. Le mélange des
styles est ici à l’image de ce que l’on retrouve dans certaines banlieues du nord de la ville :
l’hacienda mexicaine côtoie la villa hollywoodienne, elle-même encadrée par un bunker aux
murs hérissés de barbelés et d’un authentique mas provençal. Dans cet imbroglio architectural
on trouve aussi quelques petites maisons de style hollandais délabrées et de vieilles maisons
qui abritent aujourd’hui une population de « pauvres Blancs ».
b. Brixton
Brixton a, à l’origine, plus ou moins la même configuration. « This Suburb adjoining Mayfair
and Auckland Park, was originally part of the farm Braamfontein and was surveyed by W.H.
Auret Pritchard in December 1902 for the Auckland Park Real Estate. H.Collins secretary of
the company named the streets, many of them have a London names. Already at this period,
Brixton contained many commercial sites in the vicinity of Mayfair. » (Musiker, 2000 : 181)
Quartier pour Blancs plus aisés, il est recherché par une partie de l’élite intellectuelle et
artistique qui s’y installe dans les années 1970-1980. La qualité du bâti et des infrastructures
témoigne encore aujourd’hui de cette présence. Au cours des deux décennies suivantes, le
quartier connaît le même phénomène de déségrégation que les quartiers adjacents.
Contrairement à Mayfair qui voit alors arriver une population largement d’origine indienne, la
population qui s’installe à Brixton apparaît très diverse, réunissant dans la même rue des
anciens habitants des townships, des primo arrivants, des cadres moyens, etc.
Le quartier vivant et prospère attire également de nombreux immigrés d’Afrique centrale et
beaucoup de sans-logis qui, ici comme ailleurs, tentent de survivre et de s’intégrer.
Hors de la rue centrale qui regroupe la majorité des commerces, Brixton dispose d’un petit
réseau d’infrastructures qui témoigne de la richesse culturelle et sociale du quartier et de la
diversité des cultures et des religions qui s’y côtoient. La plupart des Eglises confessionnelles
et plusieurs centres laïcs y sont représentés. Cette diversité, bien rare à Johannesburg, permet
de se faire une idée de l’évolution sociale et culturelle du quartier où se côtoient des mondes
pourtant antagonistes. Autre particularité de l’endroit : le nombre important des shebeens.
Essentiellement fréquentés par les populations noires, on y retrouve les shebeens queens de
Sophiatown et la clientèle hétéroclite et bouillonnante des bistrots populaires. Pour le visiteur
européen, la présence de ces shebeens en face de l’un des commissariats plus importants de
Johannesburg peut sembler surprenante. Mary, tenancière d’un de ces débits de boisson
illégaux explique que les policiers - en fonction - ne viennent chez elle qu’à la fin des mauvais
mois, quand les contraventions n’ont pas suffit à renflouer les caisses…
63
Ces deux quartiers, différents dans leur structure sociale n’en fonctionnent pas moins en
binôme. La proximité géographique, la diversité des commerces, la présence d’école et de
centres de loisirs favorisent les échanges entre les deux. L’étude parallèle de ces quartiers
permet en outre d’aborder une population plus diverse et tenter d’entrevoir la complexité des
interactions entre ces groupes.
c. Au fil des rues
Le promeneur qui s’aventure dans les rues de Mayfair ne peut être que surpris par l’activité
intense qui y règne. La rue principale, Church Street, est bordée de commerces : alimentations,
restaurants, concessions automobiles, cabinets médicaux, coiffeurs, pour n’en citer que
quelque uns. L’ambiance est bon enfant et populaire: les femmes – voilées ou non - font leur
marché sur les étalages des boutiques où aucune attention particulière ne semble avoir été
portée à la mise en valeur des produits qui s’entassent en vrac, ni des lieux dont
l’aménagement est réduit au strict minimum.
Pendant la journée, des gamins des rues aux allures de Tstosis (gangsters de Sophiatown) bob
légèrement relevé sur le coté - signe distinctif des caïds de Soweto - et pantalon de jogging
négligemment relevé sur une jambe - signe de reconnaissance des gangs américains, sifflent et
interpellent les automobilistes simulant faim et détresse. En tête à tête, commerçants et
badauds se plaignent de ces adolescents livrés à eux-mêmes qui terrorisent la population.
Construite sur le versant d’une colline, Church Street descend en pente douce vers la voie
ferrée qui relie Johannesburg à Soweto. De l’autre coté du pont qui la surplombe, le quartier a
un autre visage. Moins bien entretenu –voir complètement délabré à certains endroits, il
accueille une population économiquement fragile qui s’entasse dans des appartements bon
marché. On retrouve ici une ambiance plus typiquement africaine. Les marchands informels
étalent leur marchandise sur le trottoir, des groupes de jeunes gens et de femmes discutent sur
un pas de porte, l’atmosphère y est un peu traînante et nonchalante. Les shebeens et les débits
de boissons, invisibles de l’autre coté du pont sont ici nombreux et drainent une population de
marginaux et de laissés pour compte. C’est aussi ici que se trouve le plus grand camp de
squatteur du quartier, objet des soins attentifs de plusieurs association caritatives.
En amont, Church Street débouche sur un grand parc vallonné équipé de jeux pour les enfants
où les dormeurs s’allongent à toute heure à l’ombre d’un arbre. Trois jours par semaine, une
distribution de nourriture crée un peu d’agitation autour de midi. Le calme revient ensuite
jusqu’à la sortie des écoles vers 16h00. Coté Sud, le parc est bordé d’autres commerces
spécialisés relativement animés. Coté Nord, il longe Main Road, grande artère qui traverse la
64
ville d’Est en Ouest. Hofmeyer, quartier très populaire de « petits Blancs » construit sur les
ruines Fietas se trouve de l’autre coté : on y voit souvent des mères de familles qui profitent de
la sortie des écoles pour se promener et faire quelques achats.
Brixton se trouve à moins d’un kilomètre à l’Est. Fait relativement rare dans l’espace urbain de
Johannesburg, le réseau de social et commercial reste dense entre les deux quartiers. Une fois à
Brixton, Main Road se transforme en rue extrêmement commerçante, aux larges trottoirs
bordés de palmiers. Dans cette zone dense et active, la circulation est systématiquement
entravée par des camions, des taxis collectifs ou des voitures individuelles qui chargent ou
déchargent ou marchandises et passagers. Cette impression d’agitation est renforcée par
l’activité sur les trottoirs. La mixité est là aussi est de mise : Noirs, Indiens, Blancs et
Asiatiques semblent se partager l’espace en bonne intelligence. Ici aussi les gens vont à pied,
et les trottoirs occupés par les étalages des vendeurs informels sont bruyants et colorés. A la
différence de Mayfair, Brixton dispose d’un centre commercial flambant neuf : le Protea. Dans
la catégorie centre commercial de quartier, celui-ci est plutôt de haut standing. On y trouve des
petits commerces spécifiques et très recherchés, comme la pâtisserie faite maison du Coffe
shop, un bouquiniste et plusieurs bijouteries à coté des traditionnelles grande surface bon
marché, pizzerias, boutiques de vêtements et de services. Il est intéressant de constater que là
aussi, la fréquentation du mall est résolument mixte. Comme dans le reste de la rue, son
activité connaît des pics de fréquentation vers 9h00 heures, 12h00 heures et 16h00 heures, la
plupart des magasins fermant vers 17h00 heures. Les rues autours de Main Road sont
également animées puisqu’on y trouve des écoles, quelques boutiques ou encore le casino qui
semble être l’une des principales sources de distraction du quartier. Si la voirie est en très bon
état, le bâti est lui inégal. Les maisons proprettes, quelques belles propriétés et les taudis se
succèdent sans ordre apparent.
Que ce soit à Mayfair ou Brixton, les soirs et week-ends sont très peu animés. Beaucoup
préfèrent se retrouver en famille à la maison et les sorties sont le fait d’une minorité de jeunes
gens qui préfèrent souvent fréquenter les lieux à la mode des quartiers Nord. Cette relative
tranquillité n’est troublée que par quelques shebeens surtout présents dans les rues de Brixton,
où, renouant avec une vieille tradition de cafés, les habitants se retrouvent pour boire un (et
souvent plusieurs) verres, regarder un événement sportif à la télévision, écouter de la musique
et le plus souvent les trois en même temps.
3. Passants et habitants
65
a. Profils
Population de Mayfair Population de Brixton
Africain 2228 572
Metis 912 130
Indien 4684 94
Blancs 465 1490
Autres 400 36
Age des résidents
Population de Mayfair Population de Brixton
0-4 671 139
5-19 1938 364
20-29 2037 540
30-49 2506 742
50-64 780 225
Plus de 65 386 298
Age inconnu 373 22
Total 8691 2330
(Tiré du Demarcation board, Johannesburg, 2003)
Les deux quartiers ont une pyramide des âges comparable, marquée par une forte majorité de
jeunes actifs. Cela s’explique facilement : la plupart des habitants n’habitaient pas le quartier il
y dix ans et s’y installent espérant améliorer leur niveau de vie. Parmi eux, tous ne travaillent
pas. Nombreux sont ceux qui partagent une maison, souvent en pauvre condition, avec des
parents ou relations de leur village ou de leur communauté, et qui vendent leurs services sur le
bord de la route. C’est le cas de Tshidiso, James et Kashia qui habitent dans une petite maison
d’aspect misérable avec femmes et enfants ou de Tandy, jeune fille hébergée par une tante
éloignée qui cherche du travail, chante dans la chorale de l’Eglise et tente de survivre dans cet
univers violent. Ces primo arrivants autant démunis culturellement qu’économiquement, ne
sont pas sans rappeler ceux de Sophiatown. Les plus chanceux réussissent parfois à se placer
dans les petits commerces des environs ou tentent de profiter des opportunités qu’offre la
grande ville.
66
La population indienne, qui donne au quartier son atmosphère, est souvent plus éduquée et
nombreux sont ses membres qui travaillent hors du quartier sans vouloir le quitter. Cet
attachement s’explique par l’importance des structures religieuses et sociales indispensable au
fonctionnement de la communauté musulmane pratiquante. Dans cette population cosmopolite
on trouve aussi les localement célèbres coiffeurs pakistanais, des étudiants et commerçants
africains ou asiatiques et une nouvelle bourgeoisie Noire et métisse qui, comme Euphémia,
aime fréquenter les cafés à la mode et fait fructifier ses affaires. Ces young professional
(jeunes cadres) tendent, lentement, à faire évoluer le mode de fonctionnement du quartier par
une fréquentation plus transversale de la société. On trouve aussi quelques pauvres Blancs dont
les conditions de vie sont parfois très rudes. C‘est le cas de Nicole, rencontrée au moment de
son installation devant une maison en piteux état, sans eau ni électricité qu’elle se préparait à
habiter avec son mari et ses quatre enfants. Dans la rue ses garçons se faisaient glisser sur un
vieux cadi tandis qu’une petite fille au visage sale se tenait accrochée à ses jupes : vision d’un
autre monde. Ces «pauvres Blancs» sont aussi largement représentés dans la classe d’âge des
plus de cinquante ans : anciens habitants, ils n’ont pas pu, ou pas voulu, suivre le mouvement
migratoire vers les banlieues nord. Isolées, ces vieilles personnes ne semblent plus guère se
soucier des évolutions de leur quartier.
Cosmopolites, Mayfair et Brixton regroupent donc des populations aux histoires, aux cultures,
aux religions et aux fonctionnements extrêmement différents, pour ne pas dire antagonistes.
Cette co-présence semble pourtant apaisée des conflits communautaires et des violences
raciales dont l’Afrique du Sud fut, un certain temps, coutumière. Comment les habitants ont-ils
réussit à créer, au sein du quartier, les espaces de liberté indispensables à cette cohabitation
pacifiste ?
b. Le quartier : un espace inventé ?
« Les jeux de pas sont des façonnages d’espace. Ils trament les lieux. A cet égard les motricités
piétonnières forment l’un des «système réel dont
l’existence fait effectivement la cité» mais qui n’ont aucun réceptacle physique.
Elle ne se localisent pas, ce sont-elles qui spatialisent. »
M.de Certeau, 1990
• Qu’est ce que le quartier ?
67
«Comme le remarque J.L. Borges à propos du quartier nord de Buenos-Aires (Cuaderno San
Martin) (J.L. Borges, 1929), «la plus part du temps, le quartier nous échappe». Mais le poète
ajoute aussitôt que «sans bruit, toujours, dans des choses isolées, (…) persiste ce fait amical et
dévoué, cette loyauté obscure (…) : le quartier. » Si le quartier disparaît sous les formes les
plus visibles et les plus évidentes, J.L. Borges nous dit que sa structure, sa trace profonde,
existentielle et même sociale, ne s’efface pas pour autant. (…) Médiateur spatial des rapports
sociaux, territorialité, schème structurel quasi invariant débordant en quelque sorte de la
maison, le quartier figure en bonne place dans l’abondante littérature que les sciences
sociales consacrent à la question du territoire.» (G.Di Méo, 2001, 106)
G.Di Méo insiste ici sur l’importance du quartier en tant que créateur d’identité. On est de
Mayfair ou Brixton comme on est du 6ème arrondissement de Paris ou de la Croix Rousse à
Lyon. L’information identitaire donnée par la situation spatiale est, dans bien des cas,
parfaitement assimilée par le locuteur. Pour «Henri Lefebvre, le quartier est «une porte
d’entrée et de sortie entre les espaces qualifiés et l’espace quantifié». (Il) apparaît donc comme
le domaine dans lequel le rapport espace/temps est le plus favorable pour un usager qui s’y
déplace à pied, à partir de son habitat. Partant il est aussi ce morceau de ville que traverse
une limite distinguant l’espace privé et l’espace publique : il est ce qui résulte d’une marche,
de la succession de pas sur une chaussée peu à peu signifiée par son lien organique avec le
logement.» (G.Di Méo, 2001, 106)
Pierre Mayol, co-auteur du 2ème tome de L’invention du quotidien développé par M.de Certeau,
propose la définition suivante : «Le quartier est une notion dynamique, nécessitant un
apprentissage progressif qui s’accroît par la répétition de l’engagement du corps de l’usager
dans l’espace public jusqu’à y exercer une appropriation. La banalité quotidienne de ce
processus, partagé par tous les citadins, rend inapparente sa complexité en tant que pratique
culturelle et son urgence pour satisfaire le désir urbain des usagers de la ville. Du fait de son
usage habituel, le quartier peut être considéré comme une privation progressive de l’espace
public. C’est un dispositif pratique dont la fonction est d’assurer une solution de continuité
entre ce qui est le plus intime (l’espace privé du logement) et ce qui est le plus inconnu
(l’ensemble de la ville ou même par extension, le reste du monde.» (1994 : 22)
Cette appropriation de l’espace est sans doute un point central de la définition du quartier et le
rouage indispensable à la création d’une coprésence. Dans cette conception l’espace
géographique est comparable à une toile, dont les fils sont les parcours individuels ou collectifs
des habitants. Cet espace parcouru, façonné, apprivoisé est finalement symboliquement
privatisé par le(s) passant(s) comme le suggère P.Mayol qui compare l’espace et l’habitat.
«Chacun d’eux a, avec les limites qui lui sont propres, le plus haut taux d’aménagement
68
personnel possible, car l’un et l’autre sont les seuls « lieux » vides où de manière différente,
on puisse faire ce que l’on veut. (…) de fait l’acte d’aménager son intérieur rejoint celui de
s’aménager des trajectoires dans l’espace urbain du quartier, et ces deux actes sont
fondateurs au même degrés de la vie quotidienne en milieu urbain : ôter l’un ou l’autre, c’est
détruire les conditions de possibilité de cette vie.» (1994 : 22) Il considère également le
quartier comme l’espace d’un rapport à l’autre. Sortir de chez soi et marcher dans sa rue est un
acte social, le quartier étant le sas dont la pratique en tant qu’espace sociétal fait partie des
acquis voir des signatures des individus. Le quartier est donc un territoire intermédiaire entre
soi et l’autre, l’ici et l’ailleurs qui peut être le reste du monde, le reste de la ville, le lieu de
travail.
• L’invention de l’espace
«La ville est au sens fort « poétisée » par le sujet :
il l’a re-fabriqué pour son usage propre
en déjouant les contraintes de l’appareil urbain ;
il impose à l’ordre externe de la ville sa loi de consommateur d’espace.»
(P.Mayol, 1994 : 24)
Objet malléable, objet de consommation, l’usager s’approprie donc la ville sous le mode de la
privatisation invisible de l’espace public. «Toutes les conditions sont réunies pour favoriser cet
exercice : connaissance des lieux, trajets quotidiens, rapports de voisinages (politique),
rapport avec les commerçants (économie), sentiment diffus de son territoire (ethnologie),
autant d’indices dont l’accumulation et la combinaison produisent, puis organisent le
dispositif social et culturel selon lequel l’espace urbain devient non seulement l’objet d’une
connaissance, mais le lieu d’une reconnaissance. A ce titre pour reprendre une distinction clé
de Michel de Certeau, la pratique relève d’une tactique qui n’a pour lieu « que celui de
l’autre ». Ce que gagne l’usager à bien «posséder» son quartier n’est pas comptable ni
jouable dans un échange nécessitant un rapport de force : l’acquis apport, l’accoutumance
n’est que l’amélioration de la «manière de faire», de se promener, de faire son marché, par
quoi l’usager peut vérifier sans cesse l’intensité de son insertion dans l’environnement social.»
(1994 : 23)
Toujours dans son étude sur la Croix-Rousse, P.Mayol a également souligné l’importance de la
«convenance», concept qui sert de point de départ son analyse. « Le quartier se définit comme
une organisation collective de trajectoire individuelle ; il est la mise à disposition, pour ses
usagers, de lieux « à proximité » dans lesquels ceux-ci se rencontrent nécessairement pour
69
subvenir à leurs besoins quotidiens. Mais le contact interpersonnel qui s’effectue pendant ces
rencontres est aléatoire, non calculé à l’avance (…).Ce rapport entre la nécessité formelle de
la rencontre et l’aspect aléatoire de son contenu conduit l’usager à se tenir comme « sur ses
gardes », à l’intérieur de codes sociaux précis, tous centrés autour du fait de la
reconnaissance, dans cette sorte de collectivité indécise – donc indécidée et indécidable –
qu’est le quartier. » (1994 : 25) Dans ce contexte le quartier impose donc «un savoir faire de
la coexistence indécidable et inévitable tout à la fois. (…) Celui-ci traduit le caractère
homogène et normatif («cela se fait »/ «cela ne se fait pas») du quartier où émergent les règles
de régulations sociales qui lui sont propre. (…) Le corps, dans la rue, est toujours
accompagné d’une science de la représentation du corps dont le code est plus ou moins, mais
suffisamment, connu de tous les usagers que je désignerai du mot qui lui est le plus adéquat :
la convenance. » (1994 : 27)
Dans le cas de l’étude des quartiers de Mayfair et Brixton cette convenance prend d’autant plus
d’importance qu’elle stigmatise l’appartenance à l’une ou l’autre des communauté en présence.
Le quartier est donc un espace multiple qui forge la relation dans son interaction avec les
individus la trame d’un espace social.
C. Tranches de vie, tranches d’espaces
1. Un espace, des territoires : une coprésence assurée
«La ville comme réalité géographique, c’est la rue. (Elle est le) centre et cadran de la vie
journalière où l’homme est passant, habitant, artisan.»
E. Darel, in G.Di Méo, 2001 : 102
a. Mayfair
Dans le Mayfair Indien, cette régulation interne, autrement dit «convenance», semble d’autant
plus forte qu’elle est aussi portée par un discours religieux qui tend à se radicaliser. Ces
éléments culturels et religieux contribuent à ce que Pierre Mayol définit comme «la
transparence sociale du quartier» : nous sommes ici dans une enclave musulmane en territoire
majoritairement chrétien. Le statut quo qui préside à la possession des espaces individuels est
donc bien en place, et l’on retrouve l’invention politique, économique et éthologique de
l’espace décrite par P.Mayol. Cette division, ethnique comme religieuse, marque des territoires
bien séparés entre les différentes communautés et l’on ne peut qu’être frappé par la force avec
70
laquelle la communauté Indienne a réussi à imposer un modèle dominant. Comme nous
l’avons vu plus haut, la population indienne n’est pourtant pas la communauté la plus
importante d’un quartier où tout semble avoir été pensé et réalisé par et pour elle. Commerces,
écoles, lieux de cultes : les repères marquent une inscription forte dans l’univers musulman
que confirme les piétons en habits traditionnels et les femmes vêtues de longues burkas noires.
Fortement ancré dans le cercle communautaire, cet espace urbain transformé est donc, pour
cette population indienne et musulmane, le lieu d’une reconnaissance sociale, culturelle et
religieuse dont ne bénéficient pas les autres populations. Comme le souligne Mrs Ismaël, qui
porte la burka : «Cet endroit est très agréable, centré sur la communauté. Tout le monde ce
connaît, on se sent chez soi.» Ce «chez soi» implique la reconnaissance des pratiques
religieuses vécues comme base de la vie communautaire. Dans le discours de Mrs Ismaël
transparaît également l’importance d’être dans un lieu qui accepte, reconnaît et valorise le port
de la burka. Burka qu’elle arbore dans le magasin de son mari, et qui semble être un outil de
distinction autant sociale, raciale que religieuse entre elle, les employés et les clients non-
musulmans et non-indiens et le reste de la rue.
La hiérarchie sociale est, en effet, très nettement établie entre les différents groupes religieux
et raciaux : les musulmans et les Indiens y tiennent, comme on s’en doute, le haut du pavé. Au
sein de chaque groupe, les hiérarchies sociale et religieuses sont profondément respectées : les
hommes âgés passent avant les hommes jeunes qui eux-mêmes passent avant les femmes et les
enfants. Dans cette société qui se voudrait totalement homogène, les autres groupes sont
victimes d’une discrimination importante. A chacun des entretiens menés avec des non-indiens
et non-musulmans, les interviewés ont avoué se sentir exclus, mis à l’écart, voir d’être victimes
de propos et de violence racistes.
Ahmed, étudiant somalien à l’université de RAU, Johannesburg, explique ainsi qu’il côtoie
surtout la communauté Somalie. Il se plaint des nuisances induites par la proximité des
populations démunies et du manque de contacts avec la population indienne. « Le crime est
important ici, il est favorisé par les vendeurs d’alcool illégaux qui attirent des consommateurs
à n’importe quel heure du jour et de nuit. Je ne connais pas très bien mes voisins, ce sont des
indiens. Cela fait maintenant 5 ans que je suis à Mayfair mais ils ne m’adressent toujours pas
la parole, il y a un gros problème d’intégration dans le quartier. C’est d’abord un problème
de race. » Ahmed est membre de l’association des Somalis d’Afrique du Sud. Petite
communauté, ils ne sont que 50 000 dans toute l’Afrique du Sud et environ 500 à
Johannesburg où ils se retrouvent pour la plupart à Mayfair qui leur offre des facilités de cultes.
Plus intégré dans les communautés minoritaires, Ahmed cite aisément les différentes
71
communautés d’immigrés : Bangladais, Tanzaniens, Rwandais, etc. Il les décrit comme
repliées sur elles-mêmes sans contacts les unes avec les autres.
Amina, d’origine marocaine, habite Johannesburg depuis plus de dix ans où elle a suivi son
frère et épousé un homme d’origine égyptienne. Tous deux s’occupent d’une boutique de
vêtements spécialisée dans la mode orientale. Dans cette boutique, bien placée sur Church
Street, les clientes se succèdent, fouillent, commentent, négocient et souvent achètent. Amina
qui, outre la boutique, s’occupe aussi de sa maison et de ses deux enfants porte un voile Noir
qui ne laisse apparaître que les yeux. « Ici il n’y a pas de communication entre les gens. Ils ont
peur de tout. C’est parfois difficile. Heureusement, j’ai réussi à me faire des amies dans le
quartier : grâce à la mosquée ou à l’école, on rencontre du monde et on s’aide aussi un peu
entre voisins. Malgré tout, en tant qu’étranger on n’est pas très bien accueilli par les sud-
africains. Très peu de mes amies sont sud-africaines. Avec eux on se connaît, on sait qui on est,
mais on ne se parle pas beaucoup...»
Cette méfiance systématique est confirmée par quatre jeunes hommes qui vivent dans une
maison qu’ils partagent avec femmes et enfants. Leur rue aux limites du quartier est bordée de
petites maisons mitoyennes dans un état de délabrement plus ou moins avancé, toutes occupées
par ces jeunes migrants qui quittent leurs campagnes à la recherche d’un emploi. «Il n’y a pas
une bonne ambiance ici, les gens ne se font pas confiance. Les problèmes raciaux sont
fréquents. Pour nous c’est difficile de faire confiance à quelqu’un qui n’est pas Tswana. Ici on
est toujours suspect. Quand un Blanc ou un Indien marche dans la rue le soir, personne ne
s’inquiète, mais quand c’est un Noir, il est forcement suspect. On ne connaît pas nos voisins :
c’est difficile, on ne se sent pas en sécurité. »
Ces affirmations, reprise par la plupart des personnes interrogées dans la communauté Noire et
non musulmane vont à l’encontre du discours des musulmans qui semblent avoir à peine
conscience de «l’Autre». Atif, l’égyptien, avance: «le quartier n’est pas un endroit mixte
racialement, il y a environ 80% d’indiens, 10% d’étrangers et 10% de Noirs. » de la même
manière Yassen et Zubair, deux jeunes hommes qui tiennent un magasin de vêtements dans le
centre commercial de Brixton et habitent Mayfair affirment, après réflexion, que très peu
d’étrangers vivent dans le quartier. Ils ajoutent qu’ils ne voudraient quitter le quartier pour rien
au monde : aucun autre endroit de Johannesburg ne pouvant leur offrir une vie communautaire
aussi concentrée.
Cette vision limitée de l’environnement n’est heureusement pas partagée par toute la
communauté indienne de Mayfair qui compte également de nombreux intellectuels, hommes
politiques et artistes engagés dans la vie sociale, politique et culturelle du quartier. C’est le cas
de Réhanna, élue ANC de la ville, installée à Mayfair en 1995 pour fuir promiscuité du
72
township. Aujourd’hui elle constate, un peu amère : «Mon mari et moi nous sommes installés
ici parce que nous souhaitions évoluer dans un milieu plus cosmopolite et plus ouvert que
celui du township. Mais depuis quelques années, le quartier est devenu majoritairement indien
et l’on retrouve les dérives que l’on connaissait avant : la pression de la communauté se fait
de plus en plus forte et paradoxalement les gens deviennent plus passifs ». Cette expérience de
vie est aussi celle de Norgehan journaliste du Star – premier quotidien national, Philippine
d’origine catholique, qui subit les pressions de son entourage depuis son mariage avec un
indien musulman.
«J’ai fait mes études au Zimbabwe, puis en Afrique du Sud où j’ai rencontré mon mari. Il est
d’origine malaise et indienne. Quand je me suis mariée, j’ai dû changer de nom et devenir
musulmane. Au début, je pensais qu’il ne s’agirait que d’une formalité. Ce n’est pas
exactement le cas. La famille indienne de mon mari voudrait que je sois plus religieuse, que je
porte un voile. Parmi eux, il y a beaucoup de gens qui suivent des principes religieux très
stricts. C’est difficile pour moi : j’ai du renoncer à mon nom, à ma culture, à toute mon
éducation pour pouvoir me marier. C’est déjà beaucoup. Heureusement la famille malaise est
plus tolérante. Ils pratiquent un Islam progressif et, finalement, ils se réunissent surtout pour
les grandes cérémonies religieuses du calendrier et les évènements familiaux. Leur approche
est plus festive, plus culturelle…Les Malais sont en général plus chaleureux et plus
accueillants que les Indiens. De façon générale l’intégration des étrangers et des non
musulmans est encore un problème ici. Beaucoup d’indiens sont toujours très virulents contre
les Noirs. Ce sont des gens qui sortent très peu de leur communauté : leurs amis sont indiens et
leur femme/mari le sera aussi. Leur fort sentiment religieux et communautaire leur fait
considérer tous les non musulmans comme impurs. Pourtant, même entre eux ils n’ont pas une
vie sociale très importante. En tout cas la plupart d’entre eux sortent rarement du cercle
familial. Globalement je dirais qu’il n’y a pas beaucoup d’intégration sociale ou raciale dans le
quartier. C’est très rare que des Blancs assistent à des événements culturels ou sociaux qui ont
lieu ici. Il faut dire que beaucoup de Blancs ont du mal à évoluer : ils ne font pas d’efforts pour
aller vers les autres cultures. J’habite le quartier depuis maintenant cinq ans. J’y suis bien parce
que ce n’est pas l’occident comme à Santon, ni le tiers monde, comme dans certains endroits
du centre ville : on est un peu entre les deux. Mais après cinq années passées ici, certains de
mes voisins ne me disent toujours pas bonjour. Voilà un des mauvais cotés du quartier : les
gens se referment dans une forme de libéralisme indifférent. »
Norgehan 23/02/03
73
On observe donc une grande variation de discours entre les différents habitants, liée à leurs
appartenances communautaires et religieuses.
Tous se retrouvent néanmoins sur plusieurs valeurs et comportements, ciment du
développement urbain qui garantissent un équilibre social basé sur l’acceptation du partage de
l’espace.
1. La centralité. La proximité du centre ville et de certains quartiers très fréquentés (Auckland
Park, Melville) est un atout très souvent relevé par les interviewés. Qu’ils soient sans emploi,
ou au contraire qu’ils aient à gérer des contraintes professionnelles et familiales, tous se disent
très satisfaits de cette situation spatiale. «A partir d’ici, il est très facile de se déplacer dans
toute la ville. Les minibus sont très pratiques et plutôt surs.» explique Réhanna. Même si
beaucoup d’habitants se plaignent du manque de transport en commun (ce qui est valable dans
toute la ville), sa centralité est un des atout majeur du quartier.
2. Les commerces. L’offre commerciale du quartier est également très appréciée. Mrs Ismaël
commente : «On peut faire toutes les courses dont on a besoin sans sortir du quartier. Il faut
parfois aller à Brixton et très rarement à Eastgate pour les achats très spéciaux. Sinon ici c’est
très pratique, il a les petits magasins et les supermarchés ».
3. Les infrastructures. Le quartier dispose de nombreuses infrastructures en très bon état. Les
écoles publiques, la bibliothèque, le centre aéré, les parcs, la piscine : tout cela contribue au
sentiment de bien être et de considération de leur quartier par les habitants.
4. Les services publics. Là aussi les habitants du quartier semblent satisfaits des services de
leur municipalité.
Il est également intéressant de noter que toutes les personnes interviewés insistent sur
l’importance de la structure communautaire, que celle-ci soit considérée comme facteur
d’intégration ou comme excluante.
b. Brixton
L’ambiance de Brixton est très différente de celle de Mayfair. L’appropriation du quartier par
une communauté dominante y est moins visible, ce qui semble permettre une meilleure
intégration des groupes dans l’espace.
Pour reprendre les termes du proposés par P.Mayol, la «convenance» sociale s’exprime donc
ici de manière moins évidente qu’à Mayfair et l’apparente confusion qui règne dans la rue rend
l’interprétation complexe. La juxtaposition des enseignes et des populations est, en effet, très
surprenante. On trouve pêle-mêle : une pharmacie et ses pharmaciennes afrikaners habitant en
périphérie de la ville, plusieurs shebeens et leur shebeen queen, un piscine municipale d’où
74
proviennent des cris d’enfants, des drugstores chinois, une église oecuménique ouverte vingt
quatre heures sur vingt quatre, une pizzeria portugaise, un shopping-mall rutilant, une
antiquaire afrikaner, un marchand de voitures, un magasin d’objet d’inspiration Rastafaraï, un
commissariat de police, des tavernes sombres et enfumées, un centre de karaté, des
marchandes de fruits et légumes ou de vêtements d’occasion installées sur les trottoirs, une
boulangerie de quartier, un casino, etc... Dans la rue parallèle, les hasards de l’aménagement
créent encore quelques surprises : le centre musulman, aujourd’hui fermé, se trouve en face de
l’Eglise Afrikaner, elle-même adjacente d’un temple Protestant, non loin d’un instrumentiste
fameux, du centre aéré de quartier et d’une immense discothèque (elle aussi fermée), etc…
Dans cet imbroglio, la diversité des populations est aussi frappante : Métis, Asiatiques, Blancs,
Noirs, Indiens, se croisent sur les trottoirs et vaquent à leurs activités. Ancien quartier Blanc,
devenu zone «grise» selon la terminologie de P.Guillaume, Brixton serait-il donc un des rares
cas de réel partage de l’espace ?
Il ne semble pas que la «convenance» soit ici imposée par un groupe au dépend des autres mais
plutôt sous la forme d’une « co-tutelle » sur l’espace publique. Parce que les communautés y
sont plus mélangées, le discours des personnes interrogées ne reflète pas une séparation aussi
forte entre «nous» et les «autres».
Comme le rappelle Euphémia, une jeune femme métis qui a monté une micro entreprise
spécialisée dans la formation d’adultes : «L’ambiance du quartier est globalement bonne et
détendue. J’habite dans un bloc d’immeubles très mixte, il y a des sud-africains d’origine
grecque ou italienne, un Indien, un couple Noir, et moi. On s’arrange tous très bien, on est
même devenus amis. Evidement, tous les habitants de Brixton, n’entretiennent pas de relations
aussi proches avec leur voisinage, mais on ne peut pas dire qu’il y ait réellement de conflits
visibles entre les communautés. Chacun s’occupe de ses affaires. ». De même Welma,
d’origine Afrikaner qui vit dans une grande maison dont le jardin (ou ce qu’il en reste) sert
d’atelier de mécanique à son mari, affirme avec conviction : «Nous entretenons de bons
rapports avec nos voisins qui sont pour la plupart des familles Noires. Ce sont des gens très
gentils qui vous aident s’ils le peuvent. Quand nous nous sommes fait agresser, ce sont eux qui
ont protégés mon mari. Je crois qu’il est important d’entretenir de bonnes relations avec ses
voisins. Ici, c’est vrai, les Noirs se battent beaucoup entre eux mais l’ambiance reste
agréable». Cette impression est confirmée par Siphiwe, jeune ministre du culte qui officie à
l’Eglise œcuménique ouverte 24h/24h: «Les gens de toutes catégories sociales assistent aux
offices. C’est un quartier où il y a beaucoup de personnes différentes qui viennent d’un peu
partout, d’Afrique du Sud ou des pays voisins. Les gens se serrent les coudes. »
75
Cette relative bonne entente entre les habitants et cette solidarité nouvelle devant le crime n’est
cependant pas idyllique. Sydney tente depuis un an de monter le premier projet de
« Communauty Dialogue » à Brixton. L’idée est simple : aider les membres de chaque
communauté à se rencontrent pour échanger leurs point de vue et trouver des solutions aux
problèmes du quartier. Sur le panneau affiché dans son salon, on peut lire le programme de
séances à venir : drogue, sida, xénophobie, insalubrité de certaines parties du quartier, violence.
Malgré ses efforts, le succès de l’association reste mitigé. «Les gens ne s’intéressent pas à ces
problèmes, tout ce qu’ils veulent c’est être bien chez eux et que rien ne leur arrivent. J’arrive
parfois à en convaincre de venir en faisant du porte à porte, en distribuant les annonces, et
surtout en expliquant pourquoi on essaie de monter un projet comme ça. Ceux que ça
n’intéresse jamais, ce sont les Blancs. Ils n’écoutent pas, ils s’enferment. Les gens ne
s’intéressent pas vraiment les uns aux autres. J’espère que ça va changer…»
Bongo Wattu, le tanzanien qui tient la boutique d’articles Rastafaraï, raconte aussi les mauvais
cotés du quartier : «Je ne comprend pas pourquoi, mais j’ai l’impression que la sécurité se
dégrade, je ne suis pas toujours rassuré, je ne me sens pas toujours à l’aise. Pourtant la vie
sociale est plutôt bonne, chacun garde un œil sur la maison ou l’appartement de son voisin.
Mais beaucoup de gens ne se respectent pas les uns les autres. Je dirais qu’ici il y en
seulement à 50% qui respectent leurs voisins. Heureusement il y a une forte communauté
Rasta à Johannesburg et des endroits où on peut se rencontrer, comme ici. La vie est parfois
difficile : il y encore beaucoup de discrimination envers les Noirs énormément de méfiance
envers les étrangers. »
Brixton est donc un exemple de coprésence plus ou moins sereine et assumée en fonction des
individus, de leur situation économique et sociale et de leur intégration ou non dans une
communauté.
Comme à Mayfair, les habitants de Brixton insistent sur la qualité de vie que procure l’endroit.
La proximité du poste de police a visiblement un impact positif sur la sécurité, un hôpital
public, une clinique et d’un centre de loisir rendent sans doute cette localisation attrayante. Il
mettent également en valeur les points cités par les habitants de Mayfair : centralité et
proximité des autres centres urbains et commerciaux, la densité et la diversité commerciale et
la présence de services publiques et d’infrastructures en bon état.
76
2. Le quartier dans la ville
a. Déplacements et mouvement
«La vie résidentielle, le travail, les achats, les loisirs et l’activité associative s’effectuent
désormais en des lieux séparés aux sein d’agglomérations toujours plus vastes.
Le quartier d’antan éclate en tout sens.
Comment le citadin étend-il autour de son logis, sa territorialité élémentaire ?
Se réfère-t-il toujours au quartier dont l’image est devenue si floue ?»
G.Di Méo, 2001
Au cours de ces entretiens, j’ai tenté de définir les trajets hors du quartier des personnes
interrogées afin de mieux comprendre leur perception de la ville et leur positionnement dans le
système urbain. Selon la description de P.Mayol, le quartier est vécu comme un sas entre soi et
les autres, entre l’espace privatisé et la ville d’abord puis finalement le reste du monde. En
d’autres termes c’est «une localité vécue», c'est-à-dire la différenciation entre un «intérieur»
ou «dedans» et un «extérieur» ou «dehors» (G.Di Méo, ibid.).
Pour la plupart des personnes interrogées, la majorité des déplacements ne dépassent pas les
frontières de l’aire « Mayfair-Brixton » où les parents travaillent et habitent et où sont
scolarisés les enfants. Dans une certaine mesure, les autres déplacements peuvent être
considérés comme exceptionnels (achats, visite d’ami ou de famille) et se concentrent vers le
centre ville - considéré comme un endroit agréable pour faire ses courses, Santon et les
townships de Lenasia et de Soweto.
«On trouve tout ce que l’on veut ici. On n’a pas vraiment besoin de sortir du quartier. Je vais
de temps en temps au centre ville pour voir un film, c’est tout.» explique Siphiwe. Amina
ajoute : «j’ai une voiture, ce qui me permet de me déplacer comme je l’entends. Je fais mes
courses au Checkers (chaîne de supermarchés) qui est très pratique. De temps en temps je vais
à Cresta pour les articles spécifiques. Mes enfants vont dans une école coranique dans le
quartier. Je les accompagne tous les matins avant d’aller à la boutique et je vais les chercher
le soir. Nous sortons souvent le dimanche, mais plutôt chez des amis qui habitent dans le coin.
C’est plus pratique, certains ont des piscines où les enfants peuvent s’amuser. Il nous arrive
parfois d’aller au cinéma à Rosbank, mais c’est rare.»
Comme beaucoup d’indiens Mrs.Ismaël va régulièrement à Lenasia dont est originaire sa
famille. «On peut tout faire dans le quartier, il est très bien desservit. Mon mari et moi
77
préférons rester à la maison, nous ne sortons pas beaucoup, si ce n’est pour aller voir nos
familles qui habitent dans le sud de Lenasia. Le soir nous restons en famille. Mes deux
garçons font des activités, il faut les emmener et les ramener. Le plus jeune, 9 ans, va à la
piscine et l’aîné, 11ans, a arrêté le football pour pouvoir suivre l’école coranique.»
Welma, dit aller quelques fois au casino du quartier. «La plupart du temps, nous passons nos
soirées à la maison. Le week-end je vais souvent voir ma mère à Germiston et nous allons à
l’église ensemble. Quand il nous arrive de sortir, nous allons à Westgate, au Burgerbox
(restauration rapide), par exemple.»
Pour Welma, comme pour beaucoup de familles sud-africaines, l’essentiel du temps libre se
passe en famille et si possible à la maison. «Le soir je reste chez moi, je lis, je regarde la
télévision, je fais du sport, je vais à l’église - eh, mais pas trop souvent hein !! - ou je vais voir
des amis. Il m’arrive aussi de rester seul ou avec ma petite amie.» raconte Sydney qui passe
aussi beaucoup de temps à mettre en place ses projets associatifs et à aider sa sœur qui tient un
shebeen.
Les seuls à avoir une pratique plus active la ville sont, en majorités, les actifs dont le pouvoir
d’achat est suffisamment élevé pour accéder aux plaisirs de la ville. Euphémia sort aussi bien
en centre ville qu’à Melville ou à Auckland Park, et si possible, dans des lieux branchés.
«J’aime la diversité de cet endroit, je ne voudrais jamais vivre dans une société uniforme, où
je serait la seule de mon espèce. J’ai besoin d’un environnement mixte. Brixton est un quartier
très central. D’ici je peux facilement aller au restaurant à Rosbank, Cresta, Midrand ou
Killarny, comme je peux aller faire le marché en centre ville. Je vais aussi souvent à Sandton
ou à Pretoria, plus pour raisons professionnelles. J’aime me promener, sortir et découvrir de
nouveaux coins. Le seul endroit où je ne mets jamais les pieds c’est Hillbrow, c’est trop sale et
dangereux.»
Yaseen et Zubair, eux ne sortent que dans les quartiers Nord qui correspondent plus à leur
mode de consommation. «Le week-end on va souvent au restaurant puis dans les discothèques
de Rivonia et de Sandton. Ce sont les mieux, la musique, l’ambiance, c’est là-bas que ça se
passe.»
Rehanna et Nahem, plus âgés et tous deux parents de deux jeunes enfants, tentent de concilier
pratique de la ville et vie de famille avec de petits revenus. Très engagé dans la vie
communautaire et associative, Nahem parcours la ville du matin au soir: « J’aime Mayfair
parce que c’est mon chez moi, mais je n’y suis pas très souvent. Je sors beaucoup pour des
réunions associatives ou des conférences, ce qui m’amène à parcourir la ville en long en large
et en travers. J’aime beaucoup cette ville, sa diversité, ce mélange de premier et de troisième
78
monde. Quand je ne travaille pas je m’occupe de mes enfants et j’essaye de les amener partout
où ils peuvent se divertir ou avoir des activités : les parcs, les cinémas, les restaurants.»
Si elle fréquente beaucoup les commerces de la zone, qui explique-elle «sont très pratique et
suffisants», Rehanna met également un point d’honneur à diversifier ses activités. «Mon mari
et moi essayons de participer à un maximum de manifestations politiques, associatives et
culturelle. Cela me semble important de bien connaître sa ville et ses habitants. C’est vrai que
nous n’allons pas très souvent au restaurant ou au cinéma, nous préférons aller dîner chez des
amis, ou rencontrer de nouvelles personnes.»
Une majorité des personnes interrogées a donc une pratique peu importante de la ville et leurs
déplacements sont circonscrits dans un périmètre qui englobe à l’air de résidence et le lieu de
travail. Par contre à l’intérieur de ce périmètre, apprivoisé et connu, les déplacements
quotidiens ou occasionnels sont nombreux et fréquents.
b. Urbanisme vs communautarisme ?
A partir de ces quelques entretiens, on remarque la présence de deux types de populations bien
différenciées. Ceux que l’on pourrait appeler les «urbains», qui s’inscrivent dans une
dynamique globale de la ville et les «communautaristes» qui s’en tiennent à une vision plus
réduite de l’espace, essentiellement articulée autours des quelques repères indispensables de la
vie quotidienne.
Dans l’échantillon de personnes interrogés, les «urbains» sont ceux qui par leur éducation, leur
profession où leur expériences antérieures ont été en contact avec d’autres communautés, et
d’autres cultures. Leur vision du monde dépasse le cadre de la famille, de la communauté, du
quartier pour aller à la rencontre de l’Autre. Ils ont également les ressources financières
nécessaires à la consommation de «produits urbains» diurnes ou nocturnes.
Sous le terme Communauté, le Dictionnaire de la Géographie propose l’énoncé suivant :
«Dans l’ensemble on constate dans le monde actuel un double débat sur la part de la
communauté souhaitable dans l’organisation de la société et, s’il y a lieu, sur le type de
principe communautaire qui doit y être privilégié par rapport aux autres. On peut faire
l’hypothèse que la persistance d’une organisation communautaire, dans le Monde où
l’individu est de plus en plus forcement présent, engendre auprès de ceux qui estiment avoir à
perdre à ses changements, des protestations et des résistances, (…)auxquelles les structures
communautaires offrent des ressources de mobilisation, potentiellement violente.» (2003 : 177)
Les «communautaires», sont, de façon général, issus de milieux plus conservateurs et/ou
économiquement fragilisés. Dans certaines communautés, le modèle, la convenance, est induit
79
par la force du «clan» qui met en valeur ses particularismes par rapport au reste de la
population. Ce retrait de la vie urbaine peut aussi être une conséquence de l’ostracisme dont
sont victimes les individus. C’est par exemple le cas de certains immigrés, rejetés par les
communautés dominantes hors de l’espace urbain.
Cette rapide distinction est, bien sur, à prendre avec précautions. Le fait communautaire en
Afrique du Sud est extrêmement répandu et rares sont ceux qui ne se sentent pas, peu ou prou,
membres d’une communauté raciale, culturelle et religieuse. Il serait donc abusif de
stigmatiser le seul sentiment d’appartenance communautaire comme frein à l’inscription
urbaine de l’individu. Dans ce cadre les facteurs économique et culturels semblent jouer un
rôle bien plus important.
c. Urbanité alternative ou alternative d’urbanité
«Nous craignons les espaces anonymes. Nous redoutons ces étendues où l’on ne communique
plus de personne à personne. (…)
Le quartier, comme le «pays» (…) est un médium fort subtil de l’interaction sociale.
A défaut d’enracinements structurels et territoriaux plus profonds,
il sert de creuset aux manifestations les plus anodines de la sociabilité,
cette expression rassurante des tribalismes contemporains.»
G.Di Méo, 2001
Espaces habités, les quartiers de Mayfair et Brixton sont donc chargés d’une valeur affective et
symbolique qui les attachent à leurs habitants en dépit des problèmes de fonctionnement que la
cohabitation de différentes communautés peut poser. Pour cette population de néo-urbains – la
plupart n’habitent à Johannesburg que depuis une dizaine d’année – l’accès à la ville
représente un bénéfice social et culturel que l’expression des «tribalismes contemporains» ne
réussit pas à émousser. La co-habitation ou coprésence de ces populations est, en elle-même,
un phénomène nouveau dans l’histoire urbaine sud-africaine. Mayfair et Brixton peuvent-ils
donc être considérés comme représentatifs d’une nouvelle forme d’urbanité dans le paysage
urbain sud-africain ? Dans quelle mesure le manque d’interactions et d’inscriptions dans un
espace urbain dynamique peuvent –elles être considérées comme les premières marques d’une
désertification de l’espace urbain, première étape à la création des non-lieux.
80
II. L’échec de l’intégration urbaine?
A. Coprésence sans interaction : la création de non-lieux ?
«Le lieu constitue la plus petite unité spatiale complexe»
M. Lussault cité par G.Di Méo, 2001
1. Où sont les non lieux ?
En s’inscrivant dans une perspective aussi anthropologique que géographique et littéraire,
M.Augé a introduit le concept de «non-lieux».
«Si un lieu peut se définir comme identitaire, relationnel et historique, un espace qui ne peut se
définir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique définira un non-lieu.
L’hypothèse ici défendue est que la sur modernité est productrice de non-lieux, c'est-à-dire
d’espaces, qui ne sont pas eux-mêmes des lieux anthropologiques et qui contrairement à la
modernité baudelairienne, n’intègrent pas les lieux anciens : ceux-ci répertoriés, classés et
promus «lieux de mémoire», y occupent une place circonscrite et spécifique. Un monde où
l’on naît en clinique et où l’on meurt à l’hôpital, où se multiplient, en des modalités luxueuses
ou inhumaines, les points de transit et les occupations provisoires (les chaînes d’hôtel et les
squats, les clubs de vacances, les camps de réfugiés, les bidonvilles promis à la casse où à la
pérennité pourrissante), où se développe un réseau serré de moyens de transport qui sont aussi
des espaces habités, où l’habitué des grandes surfaces, des distributeurs automatiques et des
cartes de crédit renoue avec les gestes du commerce «à la muette», un monde ainsi promis à
l’individualité solitaire, au passage, au provisoire et à l’éphémère, propose à l’anthropologue
comme aux autres, un objet nouveau dont il convient de mesurer les dimensions inédites avant
de se demander quel regard est justiciable. Ajoutons qu’il en est évidement du non-lieu comme
du lieu : il n’existe jamais sous une forme pure ; des lieux s’y recomposent ; des relations s’y
reconstituent ; les «ruses millénaires» de «l’invention du quotidien» et des «arts de faire» dont
Michel de Certeau a proposé des analyses si subtiles, peuvent s’y frayer un chemin et y
déployer leurs stratégies. Le lieu et le non-lieu sont plutôt des polarités fuyantes : le premier
n’est jamais complètement effacé et le second ne s’accomplit jamais totalement – palimpseste
où se réinscrit sans cesse le jeu brouillé de l’identité et de la relation. Les non-lieux pourtant
sont la mesure de l’époque ; mesure quantifiable et que l’on pourrait prendre en additionnant,
81
au prix de quelques conversion entre superficie, volume et distance, les voies aériennes,
ferroviaires, autoroutières et les habitacles mobiles dits « moyens de transport » (avions, trains,
cars), les aéroports, les gares et les stations aérospatiales, les grandes chaînes hôtelières, les
parcs de loisir, et les grandes surfaces de distribution, l’écheveau complexe, enfin, des réseau
câblés ou ans fil qui mobilisent l’espace extra-terrestre aux fins d’une communication si
étrange qu’elle ne met souvent en contact l’individu qu’avec une autre image de lui-même. La
distinction entre lieux et non lieux passe par l’opposition des lieux à l’espace. Or Michel de
Certeau a proposé, des notions de lieu et d’espace, une analyse qui constitue ici un préalable
obligé. Il n’oppose pas pour sa part les «lieux» et les «espaces» comme les «lieux» aux «non-
lieux». L’espace pour lui est un «lieu pratiqué», «un croisement de mobiles» : ce sont les
marcheurs qui transforment en espace la rue géométriquement définie comme lieu par
l’urbanisme. A cette mise en parallèle du lieu comme ensemble d’éléments coexistants dans un
certain ordre et de l’espace comme animation de ces lieux par le déplacement d’un mobile,
correspondent plusieurs références qui en précisent les termes.»
M.Augé (1992 : 101-103)
L’espace devient lieu lorsqu’il est habité, parcouru, vu et décrit. C’est ce que Marc Augé
appelle le «lieu anthropologique» ou espace symbolisé. (1992 : 104), par opposition au non-
lieu définit comme sa qualité négative : «une absence du lieu à lui-même» (1992 : 105). Dans
cette typologie, on peut se demander où placer la ville sud-africaine et plus particulièrement les
quartiers de Mayfair et Brixton.
2. Mayfair, Brixton : lieux ou non-lieux ?
Le lieu « (…) est une idée essentiellement géographique, celle d’un milieu doué d’une
puissance capable de regrouper et de maintenir ensemble
des êtres hétérogènes en cohabitation et corrélation réciproque.»
D. Retaillé cité par G. Di Méo
M. Houssay-Holzshuch affirme que : «la ville sud africaine n’a donc rien d’une polis. Elle est
atomisée en une multitude de communautés différentes, n’ayant que peu de contacts les uns
avec les autres » (1995 : 71). Dans le cas des deux quartiers de Mayfair et Brixton on retrouve
ce bien sur le découpage de l’espace et le cloisonnement communautaire, décrit par M.
Houssay-Holzshuch. Mais est-ce à dire que cette atomisation, rend caduque toute tentative de
82
cohabitation et de corrélation réciproque ? Ce qui amène à se poser la question de l’évaluation
de l’interaction spatiale et sociale en vigueur dans ces deux quartiers.
« Interaction spatiale : l’idée d’interaction spatiale procède des forces sociales susceptibles
de faire émerger des rapports entre les lieux. Ceux-ci peuvent être perçus comme positifs
(synergie, coopération), ou négatifs (concurrence, conflit…). Leur nature peut-être formelle ou
informelle, matérielle (échange de bien) ou immatérielle (échange d’information) (…). Les
modalités d’interactions font émerger des ensembles cohérents définis par le caractère,
l’intensité, la nature des lieux ou par la distance qui les sépare. L’interaction spatiale est donc
davantage une interaction sociale dans l’espace. (…) L’interaction sociale dans l’espace est un
des concepts fondamentaux de la géographie. C’est le moteur indispensable à la fondation de
toute catégorie d’espace. » (Dictionnaire de la géographie 2003 : 518)
« Interaction sociale : l’attention pour l’interaction sociale permet de penser le lien et l’ordre
sociaux comme étant quotidiennement accomplies dans les pratiques interactives des acteurs.
Deux constats sembles néanmoins possible. Dans le cadre de la géographie, de la sociologie
urbaine ou de l’anthropologie de l’espace, l’attention, de plus en plus soutenue, pour
l’interaction sociale permet de concevoir l’espace comme une ressource qui, à la fois, structure
les pratiques sociales et est structurée par elles – par exemple dans l’usage que font les
passants de l’espace public ; dans la façon dont les interlocuteurs se disposent spatialement en
conversant entre eux, dans les modes d’organisation et de conduite entre clients et
professionnels d’une administration, une école, un hôpital, une prison…. » (Dictionnaire de la
géographie 2003 :517)
Au travers de lieux publics décrits plus haut (rue, boutique, parcs, écoles, lieux de cultes) les
interactions spatiales existent. Les habitants de Mayfair et Brixton, échangent quotidiennement
des bien, des informations, sur un mode que l’on qualifie sans mal de positif, puisque ces
échangent ne suscitent pas de conflits ouverts et, à un degré moindre, que tensions localisées
entre les habitants (enfants des rues). Ces deux quartiers sont donc porteurs d’une interaction
sociale notable dans la mesure où chaque communauté conçoit l’espace comme une ressource
sociale et économique à partager avec les autres. La diversité de celles-ci représente même des
opportunités économiques importantes, grâce un élargissement de la demande dont profitent
les commerçants.
83
3. Les écoles : enclaves d’interaction sociale dans la ville ?
La situation des écoles primaires est complexe et souvent difficile. Enseignants et directeurs
d’établissements se plaignent de maux récurrents : programmes trop denses, manque de
moyens, indiscipline des élèves et, dans le contexte particulier de l’Afrique du Sud, intégration
des élèves des townships au niveau parfois très faible. Fuyant les écoles surpeuplées de ces
zones, les parents plus fortunés scolarisent leurs enfants dans l’ancienne ville blanche. Jeu des
chaises musicales, la plupart des élèves Blancs se retrouvent dans des établissements privés
aux frais de scolarités discriminants.
A Mayfair, les deux écoles primaires n’en restent pas moins mixtes, reflétant la diversité de la
population du quartier et les flux de population à l’œuvre depuis la fin de l’apartheid. Dans le
cadre scolaire, l’interaction entre les enfants est largement favorisée par les initiatives du corps
enseignant. Impliqués et responsabilisés, ils sont invités à travailler, réfléchir et agir ensemble
en dépassant leurs appartenances communautaires et religieuses pourtant affichées : de
nombreuses élèves ont les cheveux couverts d’un voile, et on ne compte plus les kippa ou les
croix. Apprendre aux enfants à vivre et à travailler ensemble, tel est l’objectif de ces écoles au
travers d’initiatives comme la « school patrol » - groupe d’enfants de 7à 10 ans chargés de
régler la circulation – ou des séminaires de développement personnel organisés très
régulièrement pour les élèves et les professeurs.
Ce constat pourrait porter à considérer l’école publique comme un ferment d’interaction
sociale apte à répandre dans le reste de la société. Alan Mabin, géographe sud-africain et
ancien résidant de Brixton, tempère cette hypothèse. : «Le problème, c’est qu’une fois sortie de
l’enceinte de l’école il est très difficile à un enfant de Soweto d’entretenir des contacts avec
des enfants d’un autre quartier. Pour des questions géographiques d’abord, mais surtout
culturelles et psychologiques : comment rapprocher des parents que tout séparent ? Comment
aller voir un copain qui habite à Orlando quand on habite Brixton, où inversement ?» Agent
d’interaction sociale et spatiale, l’école permet donc un brassage de population : pas en avant
considérable, bien souvent limité à l’enceinte de l’établissement quand les adultes ne font pas
le choix de la mixité et de la découverte de l’autre. Il faut cependant noter que ces derniers ne
sont pas rares et soutiennent activement les initiatives des écoles publiques.
84
B. Une urbanité protéiforme
1. Identités urbaines
L’étude de ces deux quartiers révèle une forme d’urbanité différente de celle présentée par les
modèles de Johannesburg ou d’Amsterdam. Plus proches du modèle de Sophiatown, Brixton et
Mayfair n’en présentent pas non plus toutes les particularités.
a. De la réalité au modèle
Amsterdam Sophiatown Johannesburg Mayfair Brixton Densité + + - + + Compacité + + _ + + Inter accessibilité des lieux urbains
+ + _ + +
Présence d’espaces publics
+ + _ + +
Importance des métriques pédestres
+ - _ + +
Coprésence habitat/emploi
+ - _ + -
Diversité des activités
+ + _ + +
Mixité sociologique
+ + _ + +
Fortes polarités intra urbaines
+ - _ - -
Productivité marchande par habitant
+ - _ + -
Auto évaluation positive de l’ensemble des lieux urbains
+ + _ + +
Auto visibilité et auto identification de la société urbaine
+ + _ + +
Société politique d’échelle urbaine
+ + _ - -
Sociétés en mouvement, Mayfair et Brixton s’opposent à l’apparente rigidité du système
urbain de Johannesburg. Comme dans le modèle de Sophiatown, on trouve une forte densité et
85
une co-présence de populations très différentes. Sa centralité et l’importance des transports en
commun les accessible au reste de la ville. Différence notable avec le reste de l’agglomération
de Johannesburg, les rues sont parcourues à pieds et sont de lieux de rencontre, de socialisation
et d’échange humain ou économique.
La coprésence habitat/emploi, qui existe seulement pour une petite partie de la population, est
très visible dans l’espace public. Les activités, peu diversifiées, se résument souvent au
commerce de proximité qui joue un rôle primordial dans la dynamique sociale des quartiers.
On ne trouve pas d’industries et très d’entreprises du secteur tertiaire dans la zone; une grande
partie de ces activités restant concentrées au centre ville ou à Santon. La productivité
marchande par habitants est par conséquent assez faible en raison des fortes différences de
revenus entre les individus.
Contrairement au reste de la ville, la mixité sociologique est ici très importante. Ce phénomène
s’explique de plusieurs manières. D’abord parce que les brassage de population successifs de
ces quartiers ont mis en présence des populations très diverses : petits Blancs et riches
commerçants Indiens, immigrés clandestins et nouvelle bourgeoisie non-Blanche, sans parler
du mélange des religions. Ensuite, parce que le regroupement de populations sur des bases
communautaires et religieuses exclu les critères de sélection sociologiques.
Il est enfin intéressant de constater les habitants ont une perception positive de leur
environnement qu’ils comparent au reste de la ville, jugée froide et hostile. Malgré cette
identification forte, la donnée «habitant de Mayfair» ou «habitant de Brixton» n’est pas
reconnue par les autres habitants au même titre qu’«habitant de Soweto», par exemple.
Autre fait marquant dans ces deux quartiers, l’économique a pris largement le pas sur les
considérations politique dont se désintéressent la plus grande partie de la population.
b. Mayfair Brixton, quartiers urbains ?
Quartiers en transition, entre deux mondes (le premier et le troisième), Mayfair et Brixton
présentent les caractéristiques du modèle d’Amsterdam dans un contexte qui n’est pas celui des
villes européenne. On y trouve également une notion de mouvement qui n’existe pas, en tout
cas à cette échelle, dans les métropoles d’Europe. Dans un environnement urbain très
américanisé, certains quartiers semblent donc en mesure de résister un moment à la
désertification qui les guette. Pour des raisons culturelles, religieuses et économiques, les
habitants y reproduisent et entretiennent une urbanité ailleurs peu visible. Celle-ci, vécue
comme un élément positif par l’ensemble de la population, ne correspond pourtant pas à l’idéal
urbain partagé la majorité. Interrogés sur leur ville idéale ou leur maison idéale, la plupart des
86
interviewés déclarent vouloir vivre dans les grandes et belles maisons avec piscines des
banlieues résidentielles huppées, ou dans des «gated communities», quartiers résidentiels, clos
et sous perpétuelle surveillance. Ce détournement de l’urbanité au profit de la sécurité, en vertu
d’un nouvel idéal urbain, a été également décrit par D.Dabrowsky-Sangodeyi et semble se
répandre dans les grandes métropoles du tiers monde n’ont pas su juguler des inégalités
économiques, sociale et spatiales endémiques.
Dans bien des cas, le mode de vie urbain de Mayfair et Brixton est donc considérée comme une
étape entre le township et l’accès aux sphères privilégiées. Urbanité choisie, mais aussi subie,
creuset d’une nouvelle bourgeoisie d’affaire mais aussi refuge communautaire, cette urbanité
paradoxale rejoint la définition de M.C. Jaillet : «la ville donnant à voir dans un même espace
restreint la société dans sa complexité, ses différences et ses déchirements, obligerais à
construire, par nécessité de cohabitation, un «être ensemble» ou un «vivre ensemble» enrayant
la violence originelle des rapports sociaux. Sans nier la dimension mythique de cette vision de
la ville comme fait civilisateur, celle-ci s’alimente cependant d’un certain nombre
d’expériences concrètes (…). A cette ville «civilisatrice», « émancipatrice», il faut des attribut
physiques : la densité, l’espace public où se côtoient, se mettent en scène, s’observent et se
défient groupes et classes dans un jeu complexe de représentations et de confrontation.» (cité
par C.Bénit, 2001 : 129)
1. La mémoire de la ville
Dans cette ville en perpétuelle évolution, l’héritage, la culture et la religion des individus sont
à la base de la subtile composition des rapports sociaux et de la perception de l’espace. La ville
a un sens et une histoire qui définit les mouvements de ses habitants.
a. Mayfair ou le retour aux sources
«Sophiatown en se reconstitue sans cesse dans divers lieux de l’espace jobourgeois :
émergeant toujours des quartiers qui sont marqués par une véritable urbanité et qui sont des
espaces de contact entre les différentes communautés.»
Philippe Gervais-Lambony, 2001
Après la transformation de Fietas en quartier d’habitation pour pauvres Blancs, les très
nombreux commerçants indiens de la 14ème rue furent re-localisés à l’Oriental Plaza - énorme
centre commercial de 17 hectares qui compte aujourd’hui plus de 360 boutiques. Déplacés
87
avec leur famille à Lenasia ou Eldorado Park, la plupart de ces anciens habitants se sont
réinstallés à Mayfair- quartier voisin - dès le début des années 1980. Ce parcours en boucle
pose la question du rôle et de l’importance de la mémoire des lieux dans la construction – ici la
reconstruction- d’une identité urbaine et d’une urbanité.
Ce «retour aux sources», prend une importance considérable dans le récit de vie de vie des
habitants.
Hussein est médecin. Il est fier d’avoir fait partie de la dernière promotion de l’université du
Witwatersrand à accepter quelques (cinq) étudiants non-Blancs sur ses bancs. Enfant de Fietas,
il a vécut à Lenasia, à Londres, et à Roodeport avant de s’installer à Mayfair dans les années
1990.
Il y a quelques années, l’élite de la population indienne a commencé à s’installer à Mayfair.
La raison principale est que les gens ne voulaient plus vivre dans les townships et que Mayfair
est près du centre ville et de l’Oriental Plaza où de nombreux commerçants ont leur boutique.
Ce quartier là a toujours été plus où moins indiens. Avant il y avait Fietas ; les gens étaient
heureux. Par conséquent quand ils ont pu revenir, ils se sont installés dans le secteur et le
prix des maisons a considérablement augmenté en dix ans. Mon voisin à acheté sa maison en
1990 environ 80 000 rands. Un an après j’ai acheté la mienne 120 000 ! Les premières
maisons étaient à vendre à un prix dérisoire. J’ai entendu parler de maisons que certains
avaient acheté 20 000 rands. Les Blancs qui habitaient ici ont vite compris où était leur
intérêt. Comme la plupart n’étaient pas riches, ils ont vendu leur maison à des Indiens au prix
fort et sont allés s’installer ailleurs! Aujourd’hui le quartier change toujours, il y a de plus en
plus d’immigrés. Tenez là, le coiffeur pakistanais, il est arrivé il y a peine deux ans. Il a
commencé son business en proposant des coupes de cheveux à 20 rands. Maintenant les élites
indiennes partent. Les gens vendent leurs maisons pour plus d’un million de rands et vont
s’installer à Northcliff ou à Hougton. Mayfair est une sorte d’air de transition on s’y installe,
on fait un peu d’argent et ensuite, on s’en va.
Pour la communauté indienne, la mémoire de Fietas est donc un élément de reconstruction
d’une vie urbaine après la ségrégation de l’apartheid. La mémoire comme outil de
reconstruction de soi et de l’espace urbain : tel est aussi l’objectif des organisateurs du Fietas
festival. «The people of Fietas reclaim their heritage, to restore themselves and the vital
legacy of a community, through a festival that celebrates the ways and values of a time and
place that still resides in memories and hearts and, which people yearn to collectively
reconnect with and grow from again. »
88
Comme le rappelle G.H. Mead : «Le soi, en tant qu’il est à lui-même son propre objet, est
essentiellement uns structure sociale et il prend naissance dans l’expérience sociale.» (cité par
Hannerz, 1983 : 278) C’est sans doute dans cette expérience sociale première s’enracine la
conscience d’un « sens » urbain commun à l’origine de la création des quartiers de Mayfair et
Brixton.
Cette reconstruction de l’individu et de son « être en ville » passe par une reconnaissance de
l’histoire. C’est en tout cas ce qu’on souhaité les concepteurs du musée de l’apartheid et ceux
du futur musée de Constitutional Hill.
b. Les musées : la création de lieux symboliques
«Les relations entre l´espace, le pouvoir et l´identité sont nécessairement médiatisées par des
symboles. Un symbole étant une réalité matérielle (un bâtiment, une statue,
une pièce de monnaie, etc.) qui communique quelque chose d´immatériel (une idée, une valeur,
un sentiment). (…) Un lieu peut être considéré comme "symbolique" dans la mesure où il
signifie quelque chose pour un ensemble d´individus ; ce faisant, il contribue à donner son
identité à ce groupe.»
A.Berque, in Driant
Dans la ville post-apartheid, «l’héritage» et le devoir de mémoire ont pris une importance
considérable. Dans une lettre ouverte au Sunday Time du 27 Avril 2003 intitulée «Helping
learners to understand apartheid», Emilia Potenza, «Consultante en éducation» posait la
question suivante : «How do we help children to understand what apartheid was like? How
will they understand the greatness of our victory over the system, and the importance of our
current freedom? How will they appreciate the struggles that they are spared?» et donnait la
réponse «Simply talking about "those days" is not enough. We need something to bring it all
alive, especially at this time of the year when we celebrate our liberation. Well, there are now
places out there to help us bring our history to life. These are the museums and heritage sites
that are beginning to spring up all over South Africa. A good museum can allow learners to
enter the world of the past. They can see and experience things that make history real.»
C’est l’objectif des différents lieux de mémoire crées ces dernières années. L’apartheid
Muséum, ou le musée Hector Peterson en ont été les premiers exemples. Le Constitution Hill
Heritage Precinct est le dernier projet en date mené par la ville. Projet d’envergure, il a donné
lieux à de nombreux débat sur la question de la mémoire dans la ville comme en témoigne la
89
série de conférence de l’institut de recherche en science social et économique (WISER) de
l’université du Witwatersrand intitulé «Making sense of the past, desining the futur :
international lesson for Constitution Hill ». A cette occasion, Ralph Appelbaum, architecte,
entre autres, du Holocaust Memorial Museum de Washington est revenu sur l’importance des
lieux de mémoire et dans la ville. «Quel message veut-on faire passer au travers d’un mise en
scène muséographique? Je crois que ces musées doivent poser la question des valeurs que
nous voulons transmettre aux générations futures. Dans le cas du projet de Constitution Hill, il
s’agit d’un retour aux sources puisque nombreux sont ceux qui y ont séjourné à l’époque de
l’apartheid. Ces musée sont à la base de la création d’une mémoire urbaine, ils doivent être
intégrés dans l’espace et la société de manière à être considérés par tous comme des lieux de
référence, des lieux symboliques.»
***
90
Conclusion
Mythe, mémoire et urbanité
Ce travail a tenté de répondre à plusieurs questions articulées autour
des problématiques posées par l’urbanité et le mythe urbain. A partir de ce constat on peut se
demander quelles sont les conditions nécessaires à la création d’une nouvelle urbanité dans un
environnement fortement marqué par la contrainte et les ruptures.
• Changement d’échelle : la ville, l’urbain et l’héritage
Si l’urbanité peut-être spontanée, elle est aussi conditionnée par la volonté politique des
municipalités de favoriser, ou non, les conditions de son éclosion.
Dans son travail sur Johannesburg, C.Bénit revient sur «l’intégration » devenu le maître mot
des politiques urbaines post-apartheid (2001 : 122). Caractérisées par la notion de «ville
compacte», développée par David Dewar en 1994, l’objectif de ces politiques urbaines est de
corriger les maux induits par la politique d’apartheid en s’attaquant entre autre à la
déségrégation des quartiers résidentiels et au rapprochement des zones d’habitat et d’emploi.
La mise en place de cette «ville compacte» demande donc des actions politiques à l’échelle
locale comme à l’échelle métropolitaine et pose les base d’un modèle de développement urbain.
Les problèmes spatiaux de la ville de l’apartheid
Les solutions apportées par la ville compacte
Autre solutions envisageables, peu
envisagées 1. absence d’espace public 1. créer des espaces publics
aménagement urbain / approche architecturale
2. mono fonctionnalité des quartiers/ ségrégation raciale
2. Favoriser la mixité fonctionnelle des quartiers racialement mixtes (jeu sur le POS, politique de logement)
3. Localisation périphérique de l’habitat des populations défavorisées
3. densifier la ville pour développer les logements à proximité des emplois, des équipements, des réseaux existants (politique du logement
3bis. (conséquence de 3) 3bis
91
mauvais accès de ces populations aux équipements aux services, aux emplois
a. rattraper le retard d’équipement (services urbains, sociaux, commerce) et encourager le développement des emplois dans les townships (politique économique / investissement dans les réseaux) b. favoriser la mobilité des résidents des townships (politique de transport)
(Cité par C.Bénit, 2001 : 124)
A l’échelle locale, il s’agit de favoriser l’intégration urbaine et de mettre en place les processus
de déségrégation résidentielle générés par des modèles d’action publique occidentale qui
permettent la création d’espaces mixtes et intégrés. A l’échelle métropolitaine, le
rapprochement entre l’habitat et l’emploi par une politique d’investissements massifs,
condition préalable indispensable au développement des investissements privés.
Ce sont les axes énoncés par le plan d’urbanisation de la ville de Johannesburg, «Joburg 2030»,
rendu public par la municipalité en février 2002. Cette projection urbaine à trente ans permet
de mettre en place un «plan» dont l’objectif est de tracer les grands axes développement
économique, industriel et urbain dont voici quelques extraits :
The City of Johannesburg will be concentrated around a key north-south and east-west axis,
delineated by the Gautrain route and other key economic infrastructure ensuring increased
total factor productivity and the harnessing of issues of proximity and economies of scale.
Increased concentration and densification will replace urban sprawl. Sectoral clustering will
inform economic activity locations and historically black townships will be redeveloped and
upgraded to form traditional suburbs of the City along the same lines as historically white
suburbs. Residential housing will be driven by proximity to business opportunities, public
transport and higher disposable income. All households will be able to access the formal
commuter transport system within 60 minutes of leaving their homes.
Commercial activity location will be driven by access to markets and access to sector specific
economic infrastructure. The former CBD, now termed the inner city, will be regenerated to its
previous standing as a prime business location, but on a far smaller geographic scale.
Commercial activity nodes will be well connected by public transport. Financial and support
business activities will centre around the key nodes of Sandton, Randburg and the CBD. With
the reduction of urban sprawl, increased densification, better public transport and increased
disposable income, a greater demand for green lungs, open spaces, leisure, recreational and
cultural facilities will arise. The City will have redeveloped and reclaimed the numerous sprits,
92
rivers and dams in its environs, as well as expanded its City parks with the result that it will
offer world-class outdoor relaxation facilities.These facilities will reflect the cosmopolitan
nature of the City and access will be available to all.
(http://www.joburg.org.za/feb_2002/2030-vision.pdf)
• Les projets
Si l’on en croit les récents projets mis en place par la ville de Johannesburg par l’intermédiaire
de la Johannesburg Devloppement Agency (JDA), la rénovation urbaine fait partie des priorités
politique de la municipalité. Créée à l’initiative de la Ville de Johannesburg, la JDA a ouvert
ses portes en 2001. Structurée en agence économique de développement, sa mission est de
favoriser l’implantation d’activités favorisant le développement économique de la ville. Ses
objectifs peuvent donc se résumer en trois points :
- créer des emplois favoriser le développement et la création de nouveaux habitats,
- attirer les investisseurs,
- améliorer l’image de Johannesburg comme place à vivre.
Nombres de ces projets s’appuient sur les éléments historiques de l’environnement urbain.
Ainsi le projet de développement de Newtown, qui fut l’un des plus important mené ces
dernières années s’appuie sur les éléments architecturaux de la première moitié du XXème
siècle. Les anciennes halles commerciales, ont été transformée en salle de spectacle et abritent
aujourd’hui un théâtre, le Market Theater, et un des restaurants les plus en vogue de la ville, le
Moyo dont la carte évoque le renouveau de la culture africaine. Depuis l’impulsion donnée par
la ville avec la remise a neuf de la place Mary Fitzgerald et surtout la construction du Pont
Mandela inauguré en 2003, le quartier - pourtant considéré comme endroit à risques - semble
avoir pris son envol. C’est en tout cas ce que laisse penser l’augmentation de la fréquentation
du Newtown Cultural Precinct et surtout l’installation dans le quartier d’une autre institution
de la nuit Jobourgeoise : le Bassline, club de jazz incontournable. Comme le souligne le
propriétaire des lieux, Paige Dawtrey : "(We decided to move) to affirm it as the cultural hub of
the nation. We want to be involved in turning the precinct around." Avec l’arrivée des clubs et
des restaurants, Newtown est en passe de devenir un des endroits les plus branché et des plus
cosmopolite de la métropole. On voit bien ici le rôle joué par les agences de développement
urbain. L’investissement et la rénovation des quartiers ont été moteurs dans la création d’un
centre urbain attractif et dynamique. La JDA a d’autres projets en cours :
93
The Braamfontein Corridor
Braamfontein is a satellite economic node of the Johannesburg city centre. It is home to the
University of Witwatersrand, four of South Africa’s major corporates, the Civic Theatre (home
of the Nelson Mandela Theatre) and Johannesburg’s local government. It is the fourth largest
node for office space in Johannesburg, offering 428 000 sq metres of A and B grade
commercial space. Braamfontein forms the major corridor link (known as the Cultural Arc)
between the Newtown and Constitution Hill developments. The project will establish
Braamfontein as an area that is well-managed, vibrant, physically attractive and well-lit with a
growing evening economy.
The Fashion District
The Fashion District is located in the eastern sector of the Johannesburg city centre.
Approximately 1,000 SMMEs involved in the garment industry have clustered in this area. The
project will develop the area as a viable, distinctive and sustainable Fashion District. The
project also promotes local, national and international tourism and the growth of existing
cross-border trade and investment in the area.
The Jeppestown Regeneration Project
Located in the eastern sector of the city centre, and centred on the Jeppe Station and its
surrounds, the development will provide a multi-modal transport facility for rail, bus and taxi;
market trading facilities; and, housing opportunities for 100 new in-fill housing units.
The Faraday Precinct Development
Located in the south-east sector of the city centre, and centred on the Faraday Station, market
and taxi ranking area, the development will provide a multi-modal transport facility for rail,
bus and taxi; market trading facilities, a traditional health centre; formal retail facilities; and, a
major taxi service centre.
The Greater Kliptown Development (Soweto)
Greater Kliptown originally formed a primarily residential apartheid buffer between Soweto to
the west and Johannesburg to the east. At its heart lies Freedom Square on which the historic
Congress of the People was held on June 26th, 1955. Anchored by the development of
Freedom Square, the project will develop Kliptown as a prosperous, desirable, well-managed
residential and commercial area and a major national and international heritage and tourism
site.
94
• Ville-villes
«De la Grèce, nous avons non seulement retenu la polis (…), mais encore l’image de l’agora
où les citoyens parlaient entre eux des choses de la cité. De là, nous pensons au forum et à la
Ville entre les villes, qui du fond des siècles nous à légué notre idéal d’urbanité : une
« civilisation», où des «civils» peuvent et savent discuter avec «civilité» de la « chose
publique» (la « république») parce qu’il y ont part. Les dictionnaires nous rappellent que tout
cela vient des mots latins urbs, civis, res publica ; et bien qu’ils nous surprennent parfois, ils
font sens. Un sens bien vivant, et qui ne cesse d’organiser pour nous selon notre propre vision,
le monde présent et passé.
Le sens de notre paysage mental, qui est aussi celui de nos villes.»
A.Berque, 1993
Dans un article, Colin Hossack se posait la question «Next génération Jo’burg – Africa San
Fransisco ?» (http://www.joburg.org.za/feb_2002/2030.stm). «In 2030, the quality of life of a
citizen in Johannesburg will have more in common with the quality of life of a citizen in San
Francisco, London or Tokyo than that of a developing country's capital city. The quality of life
in Johannesburg will be such that it will be a positive factor in locational decisions made by
international firms and individuals. (…)In the space of a generation, the vision goes, HIV-Aids
will no longer be a run-away pandemic in the city. Life expectancy will have increased. All
citizens will be literate and numerate. Public transport will be quick, safe and efficient. There
will be acceptable pollution levels and a generally good quality of air, and waste production
and litter will have decreased. Recreational facilities and areas will exist in every suburb, and
outdoor activities will be readily available. International cultural arts events will reflect the
cosmopolitan nature of Johannesburg's population, and animal and plant biodiversity will be
actively supported. »
Johannesburg, grande métropole de l’Afrique Australe se rêve donc à l’image de ces grandes
sœurs américaines. Cette vision urbaine, reprise dans l’introduction du plan Joburg 2030, a
aussi été soulignée par C.Benit «Les formes de ségrégation urbaine à Johannesburg sont
moins exceptionnelles qu’elles ne sont la caricature de dynamique ségrégatives présentes plus
implicitement dans d’autres métropoles mondiales. Ségrégation raciale et ethnique, absence
d’espace publics de la mixité et du brassage, ghetto, (….) pourraient tout aussi bien
caractériser une ville comme Los Angeles» (Benit, 1998a :53). Aujourd’hui la ville tente de
95
réconcilier ces racines africaines et sa volonté de devenir demain, la rivale des grande capitales
européenne, américaines ou japonaises. « We believe this view to be ill-conceived.
Johannesburg will strive to become a world-class city that will operate in line with the highest
internationally benchmarked norms and standards, competent to compete on a worldwide
scale and ensure economic growth. As such it will offer the same services, at the same
standards and with the same efficiency as New York, London or Tokyo. Simultaneously, the
City will be an African city – not simply as a happenstance of its geography and the citizenship
of its people, but as a positive statement of what is different, special and unique about our
people, their lifestyles, their history, their endeavours and dreams and the environment in
which they work and live.» (http://www.joburg.org.za/feb_2002/2030-vision.pdf)
Comme nombre de ces consœurs des pays en voie de développement, Johannesburg tente donc
le grand écart entre le premier et troisième monde. Car si la vision est belle, il ne faut pas
oublier l’envers du décors : les conditions de vie de la majeur partie des habitants. «For many,
however, this is cold comfort. 120 000 households in Johannesburg live below the World
Bank's minimum living level. In a recent comparative study of the education systems of 12
African countries, South Africa came last. 286 000 Johannesburg residents are reported to be
HIV-positive, and current projections are that there will be 26 000 new infections a year and
that life expectancy in Johannesburg will decrease from 61 years to 48 years by 2012 - let
alone by 2030.» (http://www.joburg.org.za/feb_2002/2030.stm).
• Quel modèle pour les villes du sud?
Au delà de cette vision idyllique du Johannesburg de demain, la question du développement
des villes du sud reste entière. Dans un article (Le monde urbain à travers le prisme Sud
Africain, 1999 : 62 – 74) Alan Mabin, géographe sud africain, plaide pour une nouvelle
conception de la ville du Sud. «Les villes du Sud ne peuvent pas être conceptualisées de façon
adéquate comme des entités sociales sans les situer fermement dans le contexte d'un mouvement
massif continu, à long terme, de population dans et en dehors des villes. Les significations de
l'urbanisme dans ce genre d'économie politique doivent être explorées, et les villes d'Afrique du
Sud apportent un éclairage sur ces processus.(…) Si nous évitons de penser qu’un modèle urbain
particulier (Chicago, Los Angeles ...) est celui du futur, nous pouvons enrichir nos concepts
urbains pour digérer l'allure étourdissante et les myriades de lieux de la vie urbaine.» La ville du
sud ne peut donc pas être lue comme sa cousine du nord et nécessite une redéfinition des mondes
urbains en développement : «dans toutes les grandes villes, la vieille prédominance d'une
centralité unique cède la place à une diversité d'activités et de fonctions, ou au moins à une multi
96
centralité, ce qui modifie les relations que les gens créent avec les activités urbaines, ainsi que
leurs types de déplacements, et leur expérience de la vie urbaine. Les formes de ségrégation de
ceux qui ont un accès différencié aux bonnes choses de la vie urbaine se modifient. La manière
dont les gens utilisent l’espace public - et la signification de l'espace urbain lui-même - se
transforment. (…) De la même manière que les groupes dont sont originaires les chauffeurs de
taxis de New York (indien, russe, nigérian) changent à un rythme accéléré, les villes d'Afrique du
Sud montrent une incroyable diversité sociale qui recompose leurs divisions du travail et leurs
intégrations de cultures. Vues globalement, toutes les villes semblent se diriger vers le
cosmopolite (…). La vitalité des liens sociaux et leur importance dans les négociations de
positionnement, de droits, et de revenu dans la ville sont apparents, bien que de façon opaque
pour le moment, du fait que les villes d'Afrique du Sud attendent le type de recherches qui a
alimenté la compréhension des formes de l'urbanisme d'Afrique occidentale. Il semble y avoir un
étroit parallélisme avec les images de populations urbanisées dans cette région, qui continuent à
opérer dans des lieux à la marge du système urbain et des économies urbaines, créant la haute
densité de mondes urbains parallèles (…).» (1999, 62-74)
La ville sud-africaine se trouve donc aux confluences de plusieurs modèles et références. Ville
à plusieurs vitesses, elle se régénère sans cesse, créant de nouvelles formes « d’être en ville »,
plus ou moins intégrées dans le champs urbain. Depuis une décennie, c’est de ce décalage
entre les cultures que vient le dynamisme de nouveaux centres urbains, lieux ou se croisent,
sans toujours se parler, les héritiers de mondes qui furent antagonistes.
S’il semble clair qu’une nouvelle forme d’urbanité est en marche, cette courte étude de la ville
contemporaine laisse la porte ouverte sur de nombreuses questions. Dans des villes
polymorphes et éclatées, l’urbanité syncrétique se construit en réseaux, utilisant les lieux
comme un symbole d’une identité qui, elle aussi, est mouvante. La question de la mémoire
urbaine y est donc toujours présente puisque les lieux utilisés comme marqueurs d’une époque,
sont détournés ou au contraire mythifiés. On pourrait donc s’interroger sur la construction
d’une urbanité dans les lieux urbains où les conditions de sa réalisation ont été détruites ou
jamais établies. Les villes des pays en voie de développement, les villes reconstruites, ou les
nouveaux centres urbains des capitales occidentales seraient, dans ce cadre, particulièrement
intéressantes en ce qu’elles génèrent sans cesse de nouveaux modèles urbains dans lesquels
mémoire, identité et urbanité cimentent une société en perpétuelle évolution.
***
97
Bibliographie
OUVRAGES GÉNÉRAUX THÉORIQUES
AUGE (M.), Non lieux, Introduction une anthropologie de la surmodernité, La librairie du
XXIème, Seuil, 1992, 150 pages.
BERQUE (A.), Du geste à la cite, Formes urbaines et lien social au Japon, Bibliothèque des
Sciences Humaines, NRF, Editions Gallimard, 1993, 247 pages.
DI MEO (G.), Géographie Sociale et Territoires, Collection Géographie fac, Nathan
Université, 2001, 317 pages.
DRIANT (J.-C.), Habitat et villes, l’avenir en jeu, L'Harmattan,
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/datas/docs/ouvr8/sommaire.htm
GRAFMEYER (Y.), Sociologie urbaine, Nathan Université, 2002, 127 pages.
LEVY (J.), Le tournant géographique, penser l’espace pour lire le monde, Paris, Ed. Belin,
Coll. Mappemonde, 1999, 400 pages.
LEZY (E.), Guyane, Guyanes, une géographie sauvage de l’Orénoque à l’Amazone,
Collection Mappemonde, Belin, 2000, 347 pages.
RHEIN (C.), Intégration sociale, intégration spatiale, L’espace géographique, n°3 2002, p193 –
207.
SMITH (S.), Négrologie, Pourquoi l’Afrique se meurt, Paris, Calmann-Lévy, 2003, 248 pages.
98
Nouvelles géographies, Le débat, Gallimard, numéro 92, novembre décembre 1996, pages 44-
125.
OUVRAGES SUR LA VILLE
AGIER (M.), De nouvelles villes : les camps de réfugiés, éléments d’une ethnographie urbaine,
Les annales de la recherche urbaine, 91 p 129 – 136.
BRUN (J.), RHEIN (C.) (eds), La ségrégation dans la ville, Habitat et Société, L’Harmattan,
2001, 258 pages.
DABROWSKI-SANGODEYI (D.), Le modèle brésilien de la ville, Configuration et
représentation de l’espace à Salvador de Bahia, Université de Reims, Thèse de doctorat sous
la direction de Jacques Lévy, 2002.
DERYCKE (P.H.), HORIOT (J.M.), PUMAIN (D.), Penser la ville : Théories et modèles,
Collection Villes, Editions Anthropos, 1996, Paris, 335 pages.
GERVAIS-LAMBONY (P.), Géographie et nostalgie, mémoire d'habilitation, 2001,
Université de Paris X.
MASSEY (D.S.), DENTON (N.), American apartheid, segregation and the making of the
underclass, Harvard College, third printing 1993, 292 pages.
POCHE (B.), L’espace Fragmenté, Eléments pour une analyse sociologique de la territorialité,
Villes et entreprises, L’Harmattan, 1996, 275 pages.
RENNES (J.M.), La recherche sur la ville en Afrique du Sud, Collection Villes, Editions
Anthropos, Paris, 1999, 252 pages.
The Urbanized Black, Thinkers Forum, Daan, Retief Publishers, Pretoria, 1981.
99
SUR LA SOCIETE
BARTHES (R.), Mythologies, Essais, Point Seuil, 1970, Paris, 247 pages.
ELIADE (M.), Aspects du mythe, Essais, Folio, 2002, 250 pages.
LEVI-STRAUSS (C.), La pensée sauvage, Agora, Pocket, Paris, 1990, 347 pages.
MICHAUD (Y.), Qu’est ce que la société ?, Université de tous les savoirs, Volume 3, Editions
Odile Jacob, 2001, 887 pages.
POCHE (B.), L’espace fragmenté, Eléments pour une analyse sociologique de la territorialité,
Collection Ville et Entreprises, L’Harmattan, 1996, 275 pages.
VANSINA (J.), Une recension imparfaite : un cas de parti pris débats et controverses, Cahiers
d’Etudes Africaines, 66-67, 1977, p 369-373.
SUR LA CULTURE URBAINE
de CERTEAU (M.), L’invention du quotidien, Tome I., Arts de faire, Essais, Folio, Paris, 1994,
449 pages.
de CERTEAU (M.), Giard (L.), Mayol (P.), L’invention du quotidien, Tome II, Habiter,
Cuisiner, Essais, Folio, Paris, 1994, 415 pages.
CHIVALON (C.), La diaspora antillaise au Royaume-Uni et le religieux : appropriation d’un
espace symbolique et reformulation des identités urbaines, L’espace Géographique numéro 2,
2000, p315 -328.
DOLBY (N.), Constructing Race, Youth, Identity, and popular culture in South Africa, State
University of New York Press, 2001, 156 pages.
MASSEY (D.S.) and DENTON (N.A.), American Apartheid, segregation and the making of
the underclass, Harvard University Press, London, 1993, 292 pages.
100
MAERTENS (D.), Populations déplacées en Colombie et insertion urbaine, Annales de la
recherche urbaine, Numero 92, p 118-127.
HANNERZ (U.), Exploring the city, Inquiries toward an urban anthropology, New York,
Colombia University Press, 1980, 378 pages.
LEBLOND (D.), L’imaginaire habitant, codes et rituels dans l’espace des camps de la WRA,
Les Annales de la recherche urbaine, numéro 91, P137-143.
RAULIN, (A), Anthropologie urbaine, Collection cursus Sociologie, Armand Colin, 2001, 187
pages.
WHYTE (W.F.), Street Corner Society, The Social Structure of the Italian Slum, The
University of Chicago Press, 1943, 366 pages.
SUR L’AFRIQUE DU SUD
MABIN A., Le monde urbain a travers le prisme Sud Africain, in Thérèse Spector et Jacques
Theys (eds.), Villes du XXIe siecle: Entre villes et metropoles: rupture ou continuite”
Synthèse du colloque de La Rochelle 19 – 20 – 21 octobre 1998, Paris, Certe, 1999, pages 62 –
74
GERVAIS-LAMBONY (P.), Nouvelle Afrique du Sud, nouveaux territoires, nouvelles
identités, l’espace Géographique, tome 28, n°2 1999, p 99.
GERVAIS-LAMBONY (P.), La question urbaine en Afrique Australe, éditions Karthala et
Ifas, 1999, Paris, 332 pages.
GUILLAUME (P.) et HOUSSAY-HOLZSCHUCH (M.), L’Amérique entre rêve et dignité.
Essai sur la réécriture d’une mémoire urbaine en Afrique du Sud, Espaces et Sociétés, Les
Etats-Unis : un modèle urbain ?, n°107, 2001, pp 65-81.
101
HOUSSAY-HOLZSCHUCH (M.), Mythologies territoriales en Afrique du Sud, Espaces et
Milieux, CNRS Editions, Paris, 1995, 104 pages.
HOUSSAY-HOLZSCHUCH (M.), Le Cap : ville Sud Africaine, ville blanche, vies noires,
Collection Géographie et cultures, l’Harmattan, Paris, 1999.
MONTCLOS de (M.-A.), Violence et Sécurités Urbaines en Afrique du Sud et au Nigeria, Un
essai de Privatisation, Tome 1, Collection Logiques Politiques, L’Harmattan, 1997, 303 pages.
NUTTAL (S.), COETZEE (C.) edited by, Negotiating the past, The making of memory in
South Africa, Oxford University Press, Cape Town, 1998, 300 pages.
POSEL (D.), The making of Apartheid 1948-1961, Conflict and compromise, Oxford studies in
African affairs, Clarendon papebook, Oxford, 1991.
ZEGEYE (A.), (ed) Social Identities in the new South Africa, Kwela Books and SA, History
Online, 2001, 360 pages.
L’Afrique du Sud recomposée, Géographies et Cultures, Numéro 28, Hiver 1998, 142 pages.
Afrique du Sud : Espace et Littérature, Travaux de l’Institut Géographique de Reims, Reims,
1998.
Nouvelle Afrique du Sud, nouveaux territoires, nouvelle identité ?, L’espace Géographique,
tome 28, numéro 2, 1999.
HISTOIRE DE L’AFRIQUE DU SUD
COQUEREL (P), La nouvelle Afrique du Sud, Gallimard, 1992.
DAVENPORT (T.R.H.), South Africa: a modern history, MacMilliam éditions, 1993.
LODGE (T.), Black policy in South Africa, 1999.
102
MUSIKER (N.& R.), A Concise Historical Dictionary of Greater Johannesburg, Francolin
Publishers, Cape Town, 2000.
SUR JOHANNESBURG
BENIT (C.), La fragmentation urbaine à Johannesburg. Recomposition des pouvoirs locaux,
mobilité de travail et dynamiques résidentielles dans le ville post-apartheid, thèse de doctorat,
Université de Poitiers, sous la direction de Michelle Guillon et Sylvy Jaglin, 2001, 512 pages.
CHIPKIN (C.), Johannesburg, Style architecture and society, David Philip, Cape Town, 1993,
335 pages.
GUILLAUME (P.), Johannesburg, géographies de l’exclusion, IFAS Karthala, Paris, 2001,
388 pages.
GUILLAUME (P.), Du blanc au noir…Essais sur une nouvelle ségrégation dans le centre de
Johannesburg, L’espace Géographique, Numéro 1, 1997, pp 21-34.
MERVELEC de (P.), The Joburger’s, Protea Book House, Menloparck, 2001, 125 pages.
MORRIS (A.), Bleakness and light, Inner-city transition in Hillbrow, Johannesburg,
Witwatersrand University Press, 1999, 411 pages.
MUSIKER (N.) & (R.), A concise Historical Dictionary of Greater Johannesburg, Francolin
Publishers, Cape Town, 2000, 303 pages.
Junction Avenue Theatre Company, Love, Crime and Johannesburg, Witwatersrand
University Press, 2000, 55 pages.
SUR SOPHIATOWN
COPLAN (D.B.), In township Tonight! Musique et théâtre dans les villes noires d’Afrique du
Sud, Karthala /CREDU, Paris-Nairobi, 1992, 450 pages.
103
DENNISTON (R.), Trevor Huddleston, A life, Macmillan Publishers Ltd, London, 1999, 295
pages.
HANNEREZ (U.), Sophiatown, the view form afar, Journal of the Southern African Studies,
Volume 20, number 2, June 1994, pp.181-193.
HUDDLESTON (T.), Father Huddleston’s pictures book, Kliptown books, 1990, 144 pages.
HUDDLESTON (T.), Naught for your Comfort, Collins, London, 1956.
LEBELO (M.), Sophiatown removals, relocation and political quiescence in the rand townships, 1950 -
1965, BA University of the Witwatersrand, November 1988, 150 pages.
MAIMANE (A.), Hate no more, Kwela Books, Cape Town, 2001, 296 pages.
MATSHIKIZA, (T.), Chocolate for my wife, AfricaSouth Paperbacks, David Philip, Cape
Town and Johannesburg, 1985, 128 pages.
MATTERA (D.), Gone with the Twilight, A story of Sophiatown, Zed Books Ltd, London and
New Jersey, 1987, 151 pages.
NICOL (M.), A Good Looking Corpse, Martin Secker and Warburg Limited, London, 1999,
401 pages.
NKOSI (L.), Home and Exile, Longmans, London, 1965, 136 pages.
SCHADEBERG (J.), The finest Photos from the Old ‘Drum’, Bailey’s African Photo Archives,
1987.
SCHADEBERG (J.), Sof’town Blues, Images from the black’ 50’, Jürgen Schadeberg, 1994,
160 pages.
THEMA (D.), Kortboy : a Sophiatown Legend, Kwela Books, Cape Town, 1999.
104
Junction Avenue Theatre Company, Sophiatown, David Philip & Junction Avenue Press, 1988,
75 pages.
SUR DRUM
CHAPMAN (M.), Drum and its significances in Black south African writing in The Drum
decade, University of Natal Press, 2001.
FENWICK (M.) Though Guy eh ? the gangster figure in Drum, Queen’s university, Kingston,
Canada Journal of South African Studies, volume 22, November December 1996.
STEIN (S.), Who killed Mr drum ?, Mayibuye Book-UWC, University of the Western Cape,
1999.
SUR DISTRICT SIX
FIELD (S.), Lost communities, Living memories, remembering the forced removals in Cape
Town, David Philip, Cape Town, 2001, 142 pages.
FORTUNE (L.), The House in Tyne Street, Childhood memories of District Six, Kwela Books,
Cape Town, 1996, 132 pages.
NGCELWANE (N.), Sala Kahle District Six, An African Woman perspective, Kwela Books,
Cape Town, 1998, 135 pages.
METHODOLOGIE
BEAUD (S.), Weber (F.), Guide de l’enquête de terrain, Collection Guides Repères, La
Découverte, Paris, 1998.
AUTRES
CALVINO (I.), Les villes invisibles, Point Seuil, 1999.
105
NIEKERK van (M.), Triomf, Jonathan Ball Publishers, Johannesburg, 1988, 474 pages.
FILMOGRAPHIE
Dolly and the Inkspots, directed by Jürgen Schadeberg, The Schadeberg Movie Company,
colour and b/w, 35 minutes, 1997.
Have you seen Drum recently?, The black fifties in South Africa, directed by Jürgen
Schadeberg, The Schadeberg Movie Company, colour and b/w, 77 minutes, 1997.