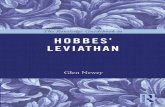Springborg, Hobbes Calviniste? 2013 (in French)
Transcript of Springborg, Hobbes Calviniste? 2013 (in French)
~ ! i i ~ ! ! I !
I
I I !1 1 I ! 1) l
. 111
'i I I 'I 11 ~
·1~ ; ! i
'! l ~
I ..
I Ii
.
I i.fil
I
HISTOIRE ET SOCIETE
Erasme, Les Prefaces au Novum Testamentum Marc Lienhard, Martin Luther Jean-Paul Willaime, La precarite protestante Jean-Pierre Bastian, Le protestantisme en Amerique latine Jeanine Horowitz et Sophia Menache, L 'humour en chaire Hubert Guicharousse, Les musiques de Luther Grace Davie, La religion des Britanniques Frans:oise Lautman ed., Ni Eve ni Marie. Luttes et incertitudes des heri-
tieres de la Bible Collectif, Coexister dans !'intolerance. L 'edit de Nantes (1598) Peter Stephens, Zwingli le theologien Sebastien Fath, Une autre maniere d'etre chretien en France Andre Encreve, L 'experience et la Joi. Pensee et vie religieuse des
huguenots au XIX' siec!e Frank Fregosi et Jean-Paul Willaime ed., Le religieux dans la commune Erasme, La Langue Martin Rose ed., Histoire et Hermeneutique William Bradford, Histoire de la colonie de Plymouth. Chroniques du
Nouveau Monde (1620-1647) Sebastien Fath, Du ghetto au reseau. Le protestantisme evangelique en
France (1800-2005) Lukas Zurcher, L 'Eglise compromise? La Federation des Eglises pro
testantes de Suisse et !'apartheid (1970-1990) Liliane Crete, John Cotton 1585-1652. Au cl£ur de! 'emotion puritaine Liliane Crete, Ou va-t-on apres la mart? Le discours protestant sur
l'au-dela: xvr-xvIIr siecles Michel Grandjean et Sarah Scholl ed., L 'Etat sans confession. La !a;c
cite a Geneve (1907) et dans !es contextes suisse etfran9ais Remy Bethmont, L 'anglicanisme. Un modele pour le christianisme a
venir? Yannick Fer, L'offensive evangelique. Voyage au Cl£Ur des reseaux
militants de Jeunesse en Mission Pierre Viret, Dialogue du desordre qui est a present au monde Bernard Reymond, Auguste Sabatier. Un theologien a !'air fibre (1839-
1901) Olivier Abel, Pierre-Frans:ois Moreau et Dominique Weber (ed.), Jean
Calvin et Thomas Hobbes. Naissance de la modernite politique
HISTOIRE ET SOCIETE N° 56
Olivier ABEL, Isabelle BOUVIGNIES, Marianne CARBONNIER-BURKARD, Philippe CRJGNON, Edwin M. CURLEY, Fran9ois DERMANGE,
Bernard FORTHOMME, Aloysius P. MARTINICH, Pierre-Fran9ois MOREAU, Nicolas PIQUE, Patricia SPRINGBORG,
Gilbert VINCENT, Dominique WEBER, George WRIGHT
JEAN CALVIN ET THOMAS HOBBES
Naissance de la rnodemite politique
Edite par Olivier ABEL, Pierre-Fran9ois MOREAU
et Dominique WEBER
LABOR ET FIDES
I I I
Ouvrage publie avec le soutien du Centre national du livre (Paris), cle l'lnstitut protestant de tbeologie, du Centre d'etudes en rhetorique, philosophie et histoire des idees (CERPHI-ENS Lyon) et du College
de theologie protestante des Universites de Geneve, Lausanne et Neuchatel
Avec le soutien de la Ville de Geneve.
ISBN 978-2-8309-1455-9 ISSN 1662-0046
© 2013 by Editions Labor et Fides I, rue Beauregard, CH - 1204 Geneve
Tel. +41 (0)22 311 32 69 Fax +41 (0)22 781 30 51
e-mail : [email protected] Site internet: www.laboretfides.com
Diffusion en Suisse : OLF, Fribourg Diffusion en France et en Belgique : Presses Universitaires de France, Paris
Diffusion au Canada : Dim6dia, Montreal
AVANT-PROPOS
Tout semble opposer Calvin et Hobbes. Et ii peut paraltre iucongru de s'interroger sur !es rapports entre la pensee du Reforrnateur fran9ais du XVI' siecle (1509-1564), et celle du philosophe anglais du XVII' siecle (1588-1679). Leurs horizons intellectuels divergent; leurs visees theoriques, pratiques, theologiques et politiques sont differentes; leurs contextes et leurs epoques historiques aussi sont incomparables : rien n'invite ii ouvrir un dossier qui semble sans consistance. En dehors de I' association creee par le dessinateur americain Bill Watterson pour sa serie humoristique Calvin & Hobbes (1985-1995, 24 vol. dans !'edition fran9aise), l'idee meme de refiechir aux rapports entre Calvin et Hobbes peut sembler denuee de toute pertinence. Ils ne repondent pas aux memes questions, et Jes rapprocher ne peut susciter que des malentendus.
A bien des egards pourtant, c'est avec Calvin que Hobbes est en debat, et avec !'interpretation de Calvin par !es puritains de la Revolution anglaise. Dans le cadre de sa longue controverse avec I' eveque arrninien John Bramhall, et notamment dans Jes Questions concerning liberty, necessity, and chance de 1656, Hobbes compte Calvin au nombre des « docteurs de l'Eglise » qu'il admire et respecte, estimant qu'il a ete ma! interprete par la plupart de ses disciples. On sait en effet que, dans son Behemoth ( ecrit vers 1666-1668), le philosophe anglais a fait de I' eclatement du protestantisme anglais en de multiples « sectes dissidentes », notamment calvinistes, l'une des causes majeures de la guerre civile des aunees 1640-1660 : « Voilil quels etaient Jes ennemis qui se dresserent
TABLE DES MATIBRES
AVANT-PROPOS.............................................................................. 7
TABLE DES ABREVIATIONS ............................................................ 11
I. LA PREDESTINATION, LE PECHE ET LE MAL :
PROBLEMES THEOLOGIQUES, PROBLEMES POLJTIQUES
La predestination est-elle une aventure? .......... ....... ................ 17 Bernard Forthornrne, of.rn.
I. Providence, predestination et possibles................................ 17 2. La supposition impossible et l' oubli amoureux de la pre-
destination............................................................................. 23 3. La predestination, le zele et la mer....................................... 28 4. Le cri du prisonnier et la priere de l'aventurier ................... 35 5. L'aventure et le dechiffrement de sa vie quotidienne .......... 38
L'auteur du peche et !es demoniaques : deux problemes calvinistes chez Hobbes et certains de ses contemporains ......... 43 Aloysius P. Martinich
I. Le calvinisme anglais et Hobbes.......................................... 43 2. L'auteur du peche ................................................................. 46 3. Le debat entre Thomas Pierce et William Barlee................. 55 4. Le de bat entre William Twisse et Thomas Jackson............. 63
360 JEAN CAL VIN ET THOMAS HOBBES
5. Les demoniaques .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 65 6. Conclusion .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 71
II. LE CORPS POLITIQUE ET LE CONCEPT DE SOUVERAINETE
Calvin contre la puissance souveraine...................................... 75 Fran9ois Dermange
1. Calvin et .Gardiner : deux conceptions opposees de Ia puis-sance pohtlque .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 5
2. La puissance au service d'un ordre legitime ........................ 84 3. De Calvin it Hobbes.............................................................. 91 4. Conclusion .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 92 Annexe: extrait des« Le9ons sur Amos», 7, 13 de 1558 ...... 95
Union mystique et union politique dans le cou~ant calviniste jusqu'a Hobbes............................................................................ 97 Philippe Grignon
1. Union mystique et union sacramentelle : la vertu du Saint-Esprit..................................................................................... 98
2. La communion des saints et le corps mystique de I 'Eglise . 102 3. L'institution humaine chez Calvin et Jes calvinistes............ 104
La juridicisation de l 'Etat................................................. 104 La conception organique de la societe humaine .............. 106 La theorie calvinienne de la representation..................... 110
4. Conclusion : la reaction hobbesienne ............ ...... ........ ......... 113
Hobbes sans calvin? ................................................................... 115 Isabelle Bouvignies
I. Naissance du contractualisme moderne................................ 119 2. Une souverainete exclusive de tout contra!.......................... 127 3. Une Republique fondee sur un contra!................................. 130 4. De la Joi naturelle au contra!................................................ 131
III. LE TEMPS DES HOMMES, LES INSTITUTIONS JURIDICO-POLITIQUES HUMAINES
ET LE PROBLEME THEOLOGICO-POLITIQUE
Calvin, Hobbes et le probleme tbeologico-politique................ 139 Edwin M Curley
1. Les theses de Calvin............................................................. 141
TABLE DES MATIERES 361
2. Les theses de Hobbes............................................................ 147 3. Un probleme theologique et ses incidences politiques......... 155
« Obeir a Dieu plutot qn'aux hommes » : Jeu d'echos entre Calvin et Hobbes sur la sentence de Pierre (Actes 5,29)......... 161 Marianne Carbonnier-Burkard
1. Actes 5,29 dans la doctrine politique de Calvin................... 162 Le cadre de !'Institution....................................................... 163 Une possible evolution.......................................................... 167
2. La critique de Hobbes........................................................... 170 Les premisses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. 171 L 'argumentaire topique ........................................................ 172
3. Re tour it Calvin..................................................................... 1 79 L 'horreur de la « puissance ecclesiastique » ....................... 179 Fascination pour Naaman et/ou pour !es martyrs............... 184
Le Christ-Roi : Les enjeux de la reecriture par Hobbes de la doctrine calviniste des trois offices du Christ...................... 190 Dominique Weber
1. L' Ascension et le Regne du Christ selon Calvin................. 193 2. L'interpretation Mterodoxe de Hobbes de !'Ascension du
Christ et de !'Esprit saint...................................................... 197 3. Une commune sobriete apocalyptique? ............................... 201
IV. HOBBES CALVINISTE? CE QUE NOUS APPRENNENT LES CONTEXTES
Hobbes calviniste? Hobbes, l'epicurisme et !es enjeux de la difference anthropologique ........................................................ 207 Patricia Springborg
I. Hobbes, !es calvinistes et !es presbyteriens.......................... 207 2. Le calvinisme, l'epicurisme et !es principes metaphysiques
de Hobbes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 211 3. Dieu comme cause premiere et la religion naturelle............ 219 4. L'arbitraire de l'orthodoxie religieuse: !es notions d' huposta-
sis et d'homoousion comme cas paradigmatiques................ 223
Ce qui est lutherien dans le« calvinisme » de Hobbes........... 232 George Wright
1. Perspective catholique romaine ............. '............................... 232 2. Perspective lutherienne .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .... .. .... .. .... . . .... .. .. .. 23 9
362 JEAN CAL VIN ET THOMAS HOBBES
3. Perspective reformee ........................................................... . 4. Perspective hobbesienne ...................................................... .
V. HERITAGES, USAGES, RECOMPOSITIONS :
CALVIN, HOBBES ET LA NAISSANCE
DE LA MODERNITE POLITIQUE
L'equivocite des signes: Eglise, eucharistie et election chez c~~ .......................................................................................... . Nicolas Pique
I. Logique rhetorique ............................................................... . 2. Logique theologique ............................................................ . 3. Logique semiologique ......................................................... .
Calvin selon Hobbes et selon Milton ........................................ . Olivier Abel
I. La cite de Calvin .................................................................. . Calvin et /'action ................................................................. . Calvin !egislateur ................................................................. . Le statut des Ecritures ..........................................................
2. La rupture theologico-politique, cote Hobbes ..................... . L 'articulation des dew: regimes .......................................... . De Machiavel a Hobbes ...................................................... . ({ Une exception, OU plutot une regle » ................................ .
3. Le droit de partir, cote Milton ............................................. . La desobeissance et l 'exil .................................................... . Le libre-lien .................................................. ........................ . Une epopee oceanique ......................................................... .
249 252
265
267 270 274
277
278 278 279 280 282 282 283 285 286 286 288 290
Guizot, lecteur de Calvin, critique dn concept de souverainete 293 Gilbert Vincent
I. Pourquoi Guizot? Enjeux de l'etude et obstacles liminaires 293 2. Guizot, biographe de Calvin, !'artisan de l'institutionnalisa-
tion de la Reforme .............. ............................................. ..... 297 3. L'action des grands hornrnes et celle de la Providence :
his to ire et progres ................................................ ........ ......... 302 4. La question de la legitimite. Qui juge? ................................ 308 5. L'absolutisation du pouvoir, expression du besoin d'idole.. 312
1·1·:·· f ;; n
~· II l• 1§
I!
II I\ 1;
I' 1: l'i [\!
TABLE DES MATIERES
6. De Guizot it Calvin : Jes enjeux politiques de !'affirmation de la souverainete de Dien, ou le demembrement du theolo-gico-politique ....................................................................... .
ANNEXE: Jean Calvin : La division tripartite des lois et leur usage ..... .
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES .................................................... .
I. - CEuvres de Jean Calvin ....................................................... . II. - CEuvres de Thomas Hobbes ................................................ .
III. - Instruments bibliographiques ............................................. . IV. - Etudes et cornrnentaires ...................................................... . V. - Les calvinismes, notarnrnent anglais et ecossais : doctrines
et contextes historiques ....................................................... .
INDEX NOMINUM ........................................................................... .
LES AUTEURS ................................................................................ .
363
318
325
331 331 332 334 335
345
349
353
HOBBES CAL VINISTE?
HOBBES, L'EPICURISME ET LES ENJEUX DE LA DIFFERENCE ANTHROPOLOGIQUE
Patricia Springborg
1. Hobbes, Jes caJvinistes et Jes presbyteriens
II paralt aujourd'hui opportun, maintenant que l'reuvre tardive de Hobbes est rendue accessible pour la premiere fois dans des editions critiques veritablement scientifiques 1, de reprendre a nouveaux frais Jes termes du «Calvin and Hobbes debate» qui opposa en 1996 Al Martini ch et Ed Curley dans le Journal for the History of Philosophy 2•
Six ans plus tard, George Wright s 'engagea dans le debat en argumentant dans le sens de Martinich 3, lequel, rappelons-le, soutient que Hobbes fut un penseur authentiquement calviniste. Quant a Curley, ii
1. C'est desormais en particulier le cas pour le poeme latin tardif (c. 1659-1671) Historia Ecclesiastica : Historia Ecclesiastica. Critical edition, including text, translation, introduction, commentary and notes, Patricia SPRINGBORG, Patricia STABLEIN et Paul WILSON (6d.), Paris, Honore Champion, 2008.
2. Rappelons le d6roulement du d6bat: 1) Martinich a tout d'abord critique Curley dans I'« Appendix A : Curley on Hobbes » de son livre The Two Gods of Leviathan. Thomas Hobbes on religion and politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 339-353; 2) Curley a ensuite critique le livre de Martinich dans une etude intitu16e « Calvin and Hobbes, or, Hobbes as an Orthodox Christian», Journal of the History of Philosophy, vol. 34, n° 2, avril 1996, pp. 257-271; 3) Martinich a alors lui-meme r6pondu a cette 6tude, dans le meme numero de la meme revue : « On the proper interpretation of Hobbes's philosophy», Journal of the History of Philosophy, vol. 34, n° 2, avril 1996, pp. 273-283; 4) en:fin, toujours dans le meme numero de la meme revue, Curley r6pondit a la r6ponse de Martinich : «Reply to Professor Martinich »,Journal of the History of Philosophy, vol. 34, n° 2, avril 1996, pp. 285-287.
3. George Herbert WRIGHT, « Curley and Martinich in dubious battle», Journal of the History of Philosophy, vol. 40, 2002. pp. 461-476.
208 PATRICIA SPRINGBORO
est reste fermement persuade du scepticisme de Hobbes : un scepticisme teinte d'une ironie veritablement systematique, estime-t-il.
Cette idee que toute interpretation de Hobbes se doit d'etre extremem~nt .attenti".~ aux differents r~gistres, rhetoriques que le philosophe a u!Jhses (et I 1rome d01t assurement etre comptee au nombre de ces registres) montre en taus Jes cas !'importance cruciale de la contextualisation et rend necessaire de lire l'reuvre de Hobbes comme une contribution it certains debats specifiques de son temps. De nombreuses eludes recentes ant du reste de plus en plus impose !'image d'un « Hobbes situe », participant it sa maniere propre au projet transnat10nal d'elaboration d'une science nouvelle capable, d'un cote, de defier !'heritage use de l'aristotelisme et de l'autre d'affronter le . , , nsque de neant engendre par un scepticisme endemique. Hobbes fut forme it la science nouvelle it la fois dans Jes laboratoires de la celebre famille Cavendish et dans Jes reseaux de Marin Mersenne en France. C'est d'ailleurs la France qui abrita Jes critiques Jes plus radicaux de l'orthodoxie aristote!icienne, Jes libertins erudits, a qui Hobbes fut associe, du mains a certains d'entre eux. C'est egalement la France qui fut l'une des terres de predilection du mouvement de defense de l'aristotelisme, mais aussi du mouvement qui opera un grand retour a la ~ensee patristique et du mouvement qui tenta de preserver la moderation rehg1euse contre Jes extremites du calvinisme, d 'une part, et du scep!!c1sme, d'autre part.
. C?mme Richard Tuck l'a bien montre ii ya quelques annees, ce qui reumt Jes membres du cercle de Mersenne, auquel Hobbes, Gassendi et Descartes ant appartenu, ce fut le projet de retablir face a la menace du scepticisme un realisme minimal 4 . Assurement, le degre de serieux theologique n' etait pas le meme chez taus Jes membres de ce cercle reuni autour du Frere Minime, cercle comprenant en outre plus d'un me1,llbre du cl~rge. Mais je suis it present persuade que Hobbes a partage Jes obJec!Jfs fondamentaux de ce programme; je pense meme que, au ~oms dans une certame mesure, Hobbes parvint a le remplir avec succes. Hobbes emprunta certes un chemin different de celui de Descartes et meme un chemin oppose a Jui; mais ii fut, Jui aussi en mesure d~ mettr~ itjour.un noyau de certitude, dans le cadre d'une ~hysique et d une metaphys1que mm1mahstes dont Jes consequences sur I' etude du comportement humain furent essentielles. D'un temperament pugnace, semble-t-Jl, Hobbes forgea sa philosophie premiere en parallele it celle
4,- .Richard TucK, «Optics and Sceptics : The Philosophical Foundations of Hobbes's Pohhcal Thou~t »,in: Edmund LEITES (ed.), Conscience and Casuistry in Early Modern Europe, Cambndge, Cambridge University Press, 1988, pp. 235-263.
HOBBES CAL VINISTE? 209
du Frere fran9ais Gassendi et en opposition a celle du grand laic fran-9ais catholique Descartes. Au nombre de ses ennemis jures, ii faut compter Jes presbyteriens calvinistes fran9ais. II semble en revanche avoir frequente Jes catholiques de la faction secrete du Louvre, reun1e autour de la reine Stuart fran9aise Henriette Marie. Kenelm Digby (1603-1665), un alchimiste et.diplomate catholique'.et Thomas Whi'.e (1593-1676), un pretre cathohque, furent alors des mterlocuteurs tres importants de Hobbes. Comme Jeffrey R. Collins l'a parfa1tement etabli Hobbes fut, de toutes Jes sectes religieuses, le plus hostile it celle des p;esbyteriens, de la meme fa9on que ces demiers constituerent la secte religieuse qui Jui fut le plus hostile, un groupe ~'1mpnm~urs presbyteriens ayant meme forme tres !Ot, avec le sou!Jen de theolog1ens puritains infiuents, un reseau en vue de« reduire Leviathan ~u silence».
La reception hostile a I' reuvre de Hobbes se fit en plus1eurs vagues successives. La premiere, etudiee seulement depuis tres peu de temps, fut menee par Jes presbyteriens par l'intermediaire de membres de la Stationer's Company, cette guilde de libraires et d'imprimeurs anglais autorisee a dormer une licence aux livres '. En 1652, cinq libraires et imprimeurs furent ainsi Jes signataires du texte A beacon set on fire qui repertoriait vingt-trois « livres papistes et blasphemateurs » : Ii est remarquable de constater qu'ils estimerent que le Leviathan de Hobbes devait sans conteste figurer dans cette liste. Mais le texte n'entenda1t pas seuJement protester contre Jes livres en question : plus fondamentalement, ii s'agissait de protester contre le laxisme du regime de licence qui avait pennis it ces livres d'etre imprimes 6• Le fait ~' assoder am,s1 Hobbes a des auteurs catholiques dans une commune reprobat10n n est pas s1
5. Pour !'analyse de cette campagne, je renvoie a l'6tude de Jeffr~)'." R. COLLINS, << Silencing Thomas Hobbes : The Presbyterians and Leviathan »,.in : Patnc1a. SPRING~ORG (6d.), The Cambridge Companion to Hobbes's Leviathan, Cambndge, Cambndge Univer-sity Press, 2007, pp. 478-500. Ma dette est grande a l'egard de cett.e etud~. . .
6. A beacon set on fire : or, The humble infonnation of certain stationers, clt1Zens of London, to the Parliament and Commonwealth of England. Concerning the vigilancy of Jesuits, papists, and apostates, (taking advantage of the divisions among our selves and the states great employment,) to corrupt the pure doctrine of the Scriptures. Introduce the whole body of popish doctrine & worship. Seduce the subjects of this Commonweal!~ unto the popish religion, or that which is worse. By writing and publishing many pop1s? b~of:s, (printed in England in the English tongue within these three last years, therein ma1ntain1n¥ all the gross points ofpopery, ... And blasphemous books of another nature: all mad~ ev1-dent by the catalogue and contents of many of the aforesaid books added hereunto. Pubbshed for the service of the Parliament and commonwealth. Hoping that the P~rliament by s~fficient laws, ... will set themselves ... to maintain the faith that was once delivered to the saints against all the enemies thereof, Londres, Printed for the subscribers hereof, 165~, in-4°, 16 p., ici pp. 3-4 et pp. 7-8. Les signataires du texte 6taient Luke Fawne, Samuel Gelhbrand, Joshua Kirton, John Rothwell, Thomas Underhill et Nathaniel Webb. Voir Jeffrey R. COLLINS, art. cit., p. 483.
............... ------------~----,-..•. ~ ;~
210 PATRICIA SPRINGBORO
etrange qu'il parait au premier abord, car le texte denon9ait egalement !es partisans de la moderation comme Thomas White, dont on peut rappeler que le traite De mundo fut pour Hobbes !'occasion d'exposer une premiere fois !es principes de sa philosophia prima 7
• Le texte prenait en outre pour cible The Christian Moderator, un livre catholique tres interessant ecrit par le pretre John Austin (1613-1669) : ii faut rappel er que c'est dans eel ouvrage que peut se lire la premiere reference imprimee connue au Leviathan. De maniere significative et precise, Austin empruntait au Leviathan tous ces arguments erastiens qui rendirent Hobbes si detestable aux yeux des presbyteriens et des eveques 8•
Comme Hobbes, ces catholiques moderes commencerent it regarder favorablement Oliver Cromwell comme un nouveau prince erastien, capable d'autoriser une certaine tolerance religieuse 9•
Austin appartenait en fait a un cercle de catholiques erastiens connus sous le nom de « Blackloistes ». II s'agissait de partisans de Thomas White, ce pretre philosophe it qui Hobbes fut associe et qui ecrivit sous le pseudonyme de « Blacklo » 10
• Les Blackloistes etaient presque aussi profondemcnt attaches a la condamnation des Jesuites et de la
7. Thomas WHJTE, De mundo dialogi Ires: quibus materia, hoc est, quantitas, numerus, figura, partes, partium qualitas & genera : forma, hoc est, 1nagnorum corporum motus, & motuum intentata hactenus philosophis origo : caussae, hoc est, mouens, ejjicfens, gubernans, caussa Jina/is, duration is quoque principium & terminus : et tandem definitio, rationihus puree naturd depromptis aperiuntur, concluduntur, Paris, Apud Dionysium Moreaum, via Iacobaeft, sub Salamandra, 1642; Thomas HOHBES, Critique du De Mundo de Thomas White (1642), Jean JACQUOT et llarold WHITMORE JONES (6d.), Paris, Vrin-CNRS, 1973.
8. John AusnN, The Christian moderator, in two parts : or, Persecution for religion condemned; by the light of nature. Law of God. Evidence of' our own principles. With an explanation of the Roman Cathofick belie},' concerning these .four points : their church, worship, iusttftcation, and civill government, Landres, Printed for H. J., 1652, [2]-86-15-52-[ l] p. (4" ed.). Publie sous le pseudonyme de William Birchley, l'ouvrage rejette le pouvoir de destitution du pape. Voir Jeffrey R. COLLINS,« Silencing Thomas Hobbes: The Presbyterians and Leviathan)), pp. 492-494.
9. Jeffrey R. CotLINS analyse tous ces points a la lun1iere de l'eccl6siologie de Hobbes dans «Thomas I-Iobbcs and the Blackloist Conspiracy of 1649 »,The Historical Journal, vol. 45, n° 2, 2002, pp. 305-331.
10. FonnC a Douai et prCsident du College anglais de Lisbonnc entrc 1630 et 1633, date a laquelle ii revint en Angleterre, White a 6crit environ une quarantaine de trait6s th6ologiques, dont plusieurs ont 6t6 censures par !'Inquisition (dCcrets du 14 mai 1655 et du 7 septembre 1657) a cause de leurs id6es h6t6rodoxes au sujet du Purgatoire, de l'Enfer et de l'infaillibilite du pape. Ses principaux adversaires furent George Leybum, le president du College de Douai, et Robert Pugh, qui 6crivit une vie de White (dont nous n'avons plus aucune trace) et une cruvrc intitul6e Black/o's Cabal (dans laquclle il accusait White de fouler aux pieds l'autorite Cpiscopale et de se montrcr d6ioyal envers le papc). Sur White et les Blackloistes, voir Beverley C. SOUTHGATE,« Covetous of truth». The Life and Work of Thomas White. 1593-1676, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1993, pp. 35-39; Robert I. BRADLEY,« Blacklo and the Counter-Reformation : An Enquiry into the Strange Death of Catholic England)), in: Charles Howard CARTER (Cd.), From the Renaissance to the Counter-R€[/(1rmation : essays in honour of Garrell Mattingly, New York, Rando1n
HOBBES CAL VINISTE?
papaute tridentine que Jes erastiens. Ils s'appuyaient, comme ce_s_derniers, sur la science nouvelle, tout en se fondant sur un anstotehsme ec!ectique 11 • Apres la fuite _de White a Paris, en_ 1643, cert~ms B_lackloistes rejoignirent la fact10n du Louvre reume autour d Hem1ette Marie faction a laquelle appartenaient egalement Edmund Waller (1606'.1687) et Kenelm Digby (1603-1665), l'emissaire de la reme a Rome que Hobbes rencontra a_Paris 12
• Il ~'a~issait d'un cercle large ~t instable, qui comprenait plus1eurs des ecnvams que Hobbes a frequentes durant Jes annees 1640, comme Abraham Cowley (_1618-1667) et William Davenant ( 1606-1668); ii etait compose de pmssants courants catholiques. Les parlementaires et !es presbyteriens surent jouer durant plusieurs decennies de la menace represe_nte~ par cette sorte de cour secrete, exemplaire a leurs yeux de 1 host!hte fran9a1se et de la papaute ultramontaine.
2. Le calvinisme, l' epicurisme et les principes metaphysiques de Hobbes
II est Jargement admis que la metaphysique de Hobbes est deflationniste Hobbes est materialiste et deterministe. Son determinisme est le resultat d'un minimalisme caracteristique et se traduit par une certaine neutralite morale. Ce determinisme a pu etre considere comme un signe d'adhesion de la part de Hobbes aux doctrines calvinistes de la p_re_destination B. J' en doute. Son determinisme est simplement un m1mmalisme au sujet de la volonte, egalement compatible av~c sa noti~n (tres etroite) de la liberte 14 • II est fonde sur une psycholog1e sensuahste qm distingue a peine !es hommes des autres animaux. La controverse avec
House, 1965, pp. 348-370, ici pp. 355-358. V?ir 6~alement Jeffrey R. COLLINS, The Allegiance o/Thomas Hobbes, Oxford, Oxford Un1vers1ty Press, 2005, PP- 9~-91.
11. Beverley C. SOUTHGATE, «"A medley of both" : old and n~"". 1n th~ ~ought of Thomas White »,History of European Ideas, vol. 18, 1994, pp. 53-59, 1c1 P- 53, « To speak the truth" : blackloism, scepticism, and language», Seventeenth Century, vol. 10, 1995,
pp. 237-254. 12. Kenelm DIGBY, A Thomas Hobbes, Paris, }«[/11] octobre 1636, Corr., Lettre 20, t. I,
p. 36; A Thomas Hobbes, Paris, 17[/27] janvier 1637, Corr., Lettre 25, t. I, pp. 42-49; A Thomas Hobbes, Landres, 11[/21] septembre 1637, Corr., L~ttre 26, t I, PP· 50-51.
13. Vair Aloysius Patrick MARTINICH, The Two Gods ofLev1ath.an.. . . 14. Vair Quentin SKINNER,« Thomas Hobbes and the Proper S1gn1ficat1on ?fL1berty »,
Transactions of the Royal Historical ~ocie.ty, vol. 40, 1990, PP: 121,-151; Lzb~rtr b~fore Liberalism, Cambridge, Cambridge Un1vers1ty Press, 1998 /La Li~erte ai:ant le llberali~me, trad. fr. Muriel Zagha, Paris, Seuil, 2000; Hobbes and Republlcan Liberty, Cam~ndge, Cambridge University Press, 2008 I Hobbes et la conception republicaine de la liberte, trad. fr. Sylvie Taussig, Paris, Albin Michel, 2009.
212 PATRICIA SPRINGBORG
Bramhall portant sur Jes questions de la liberte et de la necessite, datant de 1646 mais publiee seulement une decennie plus tard, peut suggerer la presence de problematiques calvinistes. Mais le traitement hobbesien des problemes est en realite epicurien. II n'y a pas de contradiction entre la liberte et le determinisme. Le concept de liberte forge par Hobbes est simplement si restrictif qu'il commence la ou le determinisme cesse, ne portant principalement que sur Jes sujets qui autorisent !'indifference. Vue sous un angle different, la liberte represente !'insertion du soi dans un systeme detenniniste, systeme dans lequel, a travers Jes operations de la sensation, de la deliberation et de la volonte (laquelle est le dernier appetit dans le processus deliberatif), le sujet sentant, qu'il soit humain ou animal, choisit la direction estimee favorable a sa survie que Jui dictent Jes deux forces jumelles de la repulsion de !'aversion et de !'attraction du plaisir. Par exemple, lorsque Hobbes concede aux etres humains le pouvoir de la parole, comme chez un Ciceron ou chez un Augustin, ce n' est pas pour differencier Jes hommes des animaux a partir d'une capacite en faveur de la pensee rationnelle. Les an:imaux aussi sont capables de faire des calculs quant aux moyens et aux fins. Pour Hobbes, la rationalite est minimaliste : elle est precisement la capacite de faire des calculs quant aux moyens et aux fins, rien de plus.
Ce qui differencie Jes etres humains est plut6t leur faiblesse instinctive qui Jes accable sans cesse de la peur de l'inconnu. La peur opere sur !'imagination (fancy), un element encore trop souvent sous-estime dans la pensee de Hobbes. C'est sur la peur que !'edifice entier de la civilisation est construit, son pilier etant la religion naturelle. Hobbes a du reste en commun une analyse proprement anthropologique de la religion naturelle avec Jes historiens de I' Antiquite de son temps, analyse ne pouvant susciter qu 'une tres forte hostilite de la part des calvinistes et des chretiens Jes plus orthodoxes. Qui sont ces historiens de I' Antiquite dont Jes travaux possedent un air de ressemblance frappant avec ceux de Hobbes? II faut mentionner le De religione gentilium de son arni Edward Herbert de Cher bury 1', le Remaines of gentilisme and judaisme de son biographe John Aubrey 16,
ainsi que Jes histoires universelles composees par Walter Ralegh 17,
15. Edward Herbert DE CHERBURY, De religione gentilium, errorumque apud eos causis, Isaac Voss (6d.), Amsterdam, typis Blaeviorum, 1663, 231 p. +index. Traduction anglaise: The antient religion of the gentiles, and causes of their errors consider 'd, trad. angl. William Lewis, Landres, Printed for John Nutt, 1705, XIII- [3]-336-353-388-[12] p.
16. John AUBREY, Remaines ofgentilisme andjudaisme (Londres, 1666), in: In., Three Prose Works, John BUCHANAN-BROWN (6d.), Fontwell, Centaur Press, 1972, pp. 130-304.
17. L'History of the World de Sir Walter Ralegh est inscrite dans le Stationers' Register en 1611 et chez William Camden; l'ouvrage fut publie anonymement pour la premiere fois en 1614; entre 1614 et 1678, il connut dix editions separees.
HOBBES CAL VINISTE? 213
Alexander Ross 18 ou encore Gerard Joannes Vossius, en particulier son grand traite De theologia gentili, et physiologia Christiana 19
• Ce n'est certainement pas une comcidence si !es dates de redaction et de publication des histoires de Herbert, Aubrey et Vossius sont contemporaines de I' ecriture par Hobbes de son Historia Ecclesiastica : le De religione gentilium a ete publie a Amsterdam en 1663 et le Remaines of gentilisme and judaisme de Aubrey a Londres en 1666; quant au De theologia gentili, et physiologia Christiana de Vossius, ii l'a ete a Amsterdam une premiere fois en 1641 puis a nouveau en 1668. Ce sont la des reuvres d'auteurs deistes, dont Jes travaux en histoire de I' Antiquite en font Jes Mritiers des historiens anciens, Herodote et Diodore de Sicile, au sujet des origines du gentilisme ou du paganisme. L'ouvrage de Walter Ralegh audacieusement intitule History of the World a ete compose un peu plus tot, entre 1607 et 1614, durant son emprisonnement a la Tour de Londres. La Hardwick Hall Library en conserve une edition in-folio sous la cote P.2.3. (MS El A). Les deux premiers livres de I' History de Ralegh, qui comprend vingt-huit chapitres, dressent un parallele entre l'histoire de la Creation et des Juifs, d'une part, et des evenements contemporains a cette histoire empruntes a la mythologie grecque et a l'histoire egyptienne, d'autre part: une perspective que !'on retrouve semblablement dans I' Historia Ecclesiastica de Hobbes.
L'analyse de Hobbes concemant la religion difrere toutefois de celle des autres historiens de I' Antiquite en ce sens qu'elle est a la fois une histoire et une anthropologie - une anthropologie fondee sur certains postulats universellement applicables au sujet d'une nature humaine permanente, en particulier le postulat epicurien de la« peur de la mort » et de la demande de securite qu'elle implique. C'est notamment !'imagination qui differencie !es etres humains des animaux. L'imagination
18. Alexander Ross, Pansebeia : or, A view of all religions in the world : with the several church-governments, from the Creation, to these times. Together with a discovery of all known heresies, in all ages and places, throughout Asia, Africa, America_, and Europe, Landres, Printed by James Young, for John Saywell, and are to be sold at his shop, at the sign of the Grey-hound in Little Britain, without Aldersgate, 1653, [40]-578-[24] p. Traduction franyaise : Les religions de monde, ou Demonstration de toutes /es religions & heresies de /'Asie, Afrique, & Amerique, & de /'Europe, depuis le commencement du mondejusqu'G present. Escrites par le Sr. Alexandre Ross, et traduites par le Sr. Thomas La Grue, trad. fr. Thomas La Grue, Amsterdam, Chez Jean Schipper, 1666, 3 parties en I vol., in-12°; 2° ed. : 1669.
19. Gerard Joannes Vossrus, De theologia genti/i, et physiologia Christiana; sive, De origine ac progressu idololatriae, : ad veterum gesta, ac rerum naturam, reductae; deque naturae mirandis, quibus homo adducitur ad Deum [texte precede par R. Mosis Maimonidae de idololatria liber, cum interpretatione Lat. &. no tis D. Vossii, en hebreu et en la tin], Amsterdam, apud Ioh. & ComeliumBlaeu, 1641,4 parties en 2 vol. (1653 p.), in-4°; 2• ed.: 1668.
1 !
214 PATRICIA SPRINGBORG
est une capacite qui a la fois engendre la grande culture et pousse les hollllileS a fabriquer des dieux, a implorer en vue de leur defense des interventions (( divines )) et des puissances invisibles, OU encore a multiplier des « entites incorporelles » superflues. Le demier livre du Leviathan, le livre IV, Of the Kingdome of Darknesse, qui est le plus long du traite, est une sorte de parodie virgilienne du monde des « fan!Omes »(shades) et des« ombres »(shadows, umbrae), des« spectres » (ghosts) et des« fees» (fairies) invoques par les pretres: ii s'agit selon Hobbes d'un pur effet de I 'imagination, mais institutionnalise al' echelle du monde entier dans le but de satisfaire une aspiration a gouvemer dans ce monde et dans l' autre monde, effet vossedant par consequent un grand pouvoir de destabilisation des Etats. Hobbes cherche a identifier Jes causes fondamentales de ce vaste edifice, l'Eglise (qui comprend aussi bi en les catholiques que Jes calvinistes ), afin de pouvoir en demasquer et en denoncer !es pretentious reelles illegitimes. II y a la de la part de Hobbes un rejet en bloc des doctrines Jes plus centrales de Calvin, celles qui concement la predestination, le monde a venir, l'fune ou encore le Dieu personnel. S'agissant du monde a venir, Hobbes estime ainsi que nous solllliles en presence d'une inference erronee qui a ete tiree des Ecritures dans le but de faire du royaume a venir de Dieu un royaume celeste et non pas terrestre, ce qui a pour effet d'accroitre la puissance des « pouvoirs jumeaux » - le pouvoir spirituel et le pouvmr temporel - de l'ecclesiologie lutberienne et calviniste. Si l'Eglise est un royaume fantomatique qui mime le « defunt Empire romain », le pape, en tan! que souverain pontife, en est le « spectre » qui est « assis couronne sur [!]a tombe » de eel Empire'°- Quant a la notion d' « rune » elle incame !'essence meme de l'idee fallacieuse de« substance incor~ porelle ». Et tous ces «agents invisibles» que l'Eglise invoque pour defendre I'« iime », ce sont simplement Jes ceuvres de !'imagination et ]es reves d'hollllileS en proie a ]a peur :
Touchant la matiere ou substance des agents invisibles qu'ils imaginent de la sorte, !es hommes ne pnrent par la reflexion naturelle rencontrer aucune autre conception que celle-ci: elle est la meme que celle de l'§.me humaine, et l' §.me humaine est faite de la me me substance que ce qui apparalt au dormeur dans ses r€:ves, ou dans un miroir a celui qui est eveille, apparitions qu'ils prennent, faute de savoir qu'elles ne sont que des creations de !'imagination [Fancy], pour des substances ext6rieures r6elles, et qu'en consequence ils appellent des spectres; ainsi, les Latins les noll11!1aient imagines et umbrae, et les prenaient pour des esprits, c'est-it-d!fe des corps etheres et subtils; et ils pensaient que ces agents
20.Lev., XLVll, § 21 (p. 712/p. 707).
HOBBES CAL VINISTE? 215
invisibles qu'ils redoutaient leur 6taient semblables, a ceci pres qu'ils apparaissaient et disparaissaient a leur gr6 21
•
Comment est-il alors possible de demasquer !es pretentious de c.e royaume fantomatique? Collllile les epicuriens, Hobbes se montre oplimiste et pense que la science, bien conduite, est en mesure de comger Jes erreurs de la religion. La propension humaine pour la recherche n'a pas qu'une face sombre; bien qu'elle ne soil pas une garantie de verite, elle produit des reflexions systematiques fondees sur l' experience, ou de la prudence :
Alors que la sensation et le souvenir ne sont qu'une connaissa~ce du fait, qui est une chose pass6e et irr6vocable, la science est la conna1ssance des cons6cutions, de la d6pendance d'un fait a regard d'un autre; c'est par elle qu'a partir de ce que nous pouvons produire pr6sentement, nous savons comment produire quelque chose d' autre si nous le voulons, ou une chose semblable une autre fois : car en voyant comment une chose arrive, par quelles causes et de quelle manii::re, nous voyo~1s, sides ~auses semblables viennent en notre pouvoir, comment leur fatre produtre des effets semblables 22
•
Toute minimaliste et circonspecte que soil sa definition de la science, il faut prendre Hobbes au serieux lorsqu'il revendique ouverten;ent pour le Leviathan le statut d'ceuvre scientifique con9ue ~our com~~~ Jes abus des Ecoles 23 • Une telle revendicat10n se trouve d a11leurs deja dans Jes Elements of Law, dont Hobbes pretend qu'ils son! la premiere ceuvre de ce genre 24 et elle est encore repetee dans le Behemoth, dans lequel le philosophe: deplorant que son Leviathan ail ete tres c~lomnie, Se refore a ]ui en ]e caracterisant COllllile Uil essa1 dans le domame de la science civile 25
•
Que! est des !ors le gain, en termes scientifiques, de !'analyse corporelle et materialiste de la nature humaine developpee par Hobbes? Dans le Leviathan, recapitulant des materiaux deja presents dans Jes Elements et dans les esquisses preparatoires au De Corpore, Hobbes presente une serie de theoremes qui derivent tous de son postulat (gahleen) originaire au sujet de la matiere en mouvement. II s'agit d'un axiome qui s'applique aussi bien au monde anime qu'au .monde inanime. Dans Jes chapitres V a VIII du Leviathan, l'aboulissement de
21. Lev., XII,§ 7 (pp. 170-171 / p. l06). 22. Lev .• V, § 17 (p. 115 / p. 43). 23. Lev., I,§ 5 (pp. 86-87 Ip. 13). 24. EL, Ep. ded. (pp. XV-XVI I pp. 77-79). 25. B, I (EW, VI, pp. 213-214 /pp. 78-79).
I ! I'
216 PATRICIA SPRINGBORG
!'analyse reside dans !'elaboration d'une theorie psychologique sensualiste deflationniste, semblable a une boite noire, qui postule que le comportement humain, tout comme le comportement animal, est la consequence de I' abrasion causee par la rencontre entre les organes des sens et le monde materiel 26 • Souscrivant a la doctrine epicurienne selon laquelle le comportement humain est une reponse a l' attraction du plaisir et a !'aversion de la peine, Hobbes, au chapitre VI trap souvent neglige du Leviathan intitule Of the Interiour Beginnings of Voluntary Motions; commonly called the Passions. And the Speeches by which they are expressed, pent alors redecrire les vertus et les vices comme des expressions correspondantes d'approbation et de desapprobation, en montrant que le probleme de l' esprit et du cerveau est une illusion, n'etant a l'origine qu'une question de nom.
Prenant clairement pour cible Descartes, qui est d' ordinaire rendu responsable de nos erreurs au sujet de !'intelligence des animaux, Hobbes pretend que Jes animaux, tout comme Jes hommes, pensent, sentent, de!iberent et peuvent faire des calculs quant aux moyens et aux fins, ce qui constitue le tout de la raison : « En somme, si I' addition et la soustraction ant leur place en quelque domaine, quel qu'il soit, la raison y a aussi sa place. Et la ou elles n'ont pas leur place, la raison n' a rien a faire. » 27 Les animaux jouissent egalement de liberte et manifestent de la volonte, qui n'est que le demier appetit dans la deliberation:« Cette succession altemee d'appetits, d'aversions, d'espoirs et de craintes n'existe pas moins chez les autres creatures vivantes que dans l'homme : les betes deliberent done, elles aussi. » 28 Critiquant la doctrine scolastique de la volonte comme appetit rationnel, Hobbes soutient que, a supposer qu'une telle caracterisation soit exacte, elle ne perrnet en rien de distinguer l'homme des autres betes : « Dans la deliberation, le demier appetit ou la demiere aversion, qui se trouve en contact ill1lJlediat avec l' action ou son omission, est ce qu' on appelle la VOLONTE: c'est l'acte (non la faculte) de vouloir. Les betes, qui ant la deliberation, doivent necessairement avoir aussi la volonte. » 29 Cette capacite a deliberer, que les hommes ant en commun avec Jes animaux, « se termine quand ce dont on delibere est, soit accompli, soit considere comme impossible : car jusque-la nous gardons la liberte d'accomplir ou d' omettre selon notre appetit ou notre aversion. » 30
26. Lev., I, § 4 (pp. 85-86 /pp. 11-12). 27. Lev., V, § 1 (pp. 110-111 / p. 37). 28. Lev., VI,§ 51 (p. 127 Ip. 55). 29. Lev., VI,§ 53 (p. I27 Ip. 56). 30. Lev., VI, § 52 (p. 127 I pp. 55-56).
HOBBES CAL VINJSTE? 217
Ni la sensation, ni les passions, ni la deliberation, ni la volonte, ni la raison ne permettent de differencier !es hommes des autres animaux : qu'est-ce qui perrnet alors d'operer la differenciation? La reponse de Hobbes est tres claire : Jes hommes possedent la rehg10n alors que les animaux ne la possi:dent pas. Comme la science, la religion est une consequence de la recherche des causes : « Attendu que les signes et \es fruits de la religion ne se font voir que chez l'homme, 11 n'y a pas de raison de douter que le gerrne de la religion ne se trouve aussi que dans l'homme, et consiste en quelque caractere qui lui soit propre, ou qui du mains soit porte chez lui a un degre remarquable, et qu'on chercherait en vain chez Jes autres creatures vivantes. » 31 Premierement, parce qu' « ii est prop re a la nature des hommes de s' enquerir des ca;ises des evenements qu'ils voient [ ... ],tons assez pour se montrer cur1eux de la recherche des causes de leur bonne et de leur mauvaise fortune » "- « Deuxiemement, a la vue d'une chose qui a un commencement, de penser qu'elle a eu aussi une cause, qui l'a determinee a commencer au moment ou elle !'a fail et non pas plus ti\t ou plus tard. » 33 Et, troisiemement, parce que, « alors que les betes ne connaissent pas d' autre felicite que les jouissances attachees a leur nourriture quotidienne, a leurs commodites et a leur concupiscence », Jesdites betes « n'ont que peu ou pas de prevision de l'avenir, faute d'observer et de se rappeler l'ordre, la consecution et la dependance des choses qu'elles aper9oivent »34
• •
I1 est remarquable que Hobbes differencie aussi systemallquement le comportement animal du comportement humain sur le fondement de I' absence chez !es animaux de la peur du futur, qm est le ressort chez Jes hommes de la religion naturelle. A cet egard, son analyse semble en accord avec la science biologique moderne, qui souligne la relative faiblesse des instincts humains, qui doivent etre compenses par des defenses culturelles. En consequence, l' economie politique des animaux ne produit pas Jes competences cognitives que l'homme doit acquerir pour faire face a sa peur. Ainsi, « l'homme observe comment un evenement a ete produit par un autre, se rappelle ce qui Jes a precedes et ce qui !es a suivis ; et meme, quand ii ne pent etre assure des vraies causes des choses (en effet, !es causes de la bonne et de la mauvaise fortune sont invisibles pour la plus grande part), ii leur suppose des causes, soil telles que son imagination les lui suggere, soil en se
31. Lev., XII,§ 1 (p. 168 / p. 104). 32. Lev., XII,§ 2 (p. 168 / p. 104). 33. Lev., XII,§ 3 (p. 169 / p. 104). 34. Lev., XII,§ 4 (p. 169 / p. 104).
218 PATRICIA SPRINGBORG
fiant ii l'autorite d'autres hommes qu'il juge bien disposes ii son egard et plus sages que lui-meme. » '' '
L'imagination et la capacite d'eriger des defenses artificielles contre la peur du futur - parmi ces defenses, la principale est bien stir cette construction artificielle qu'est le Leviathan- differencient Jes hommes ~es autres cre~tures .. C~la produit un developpement cognitif en I homme qm fa1t auss1 defaut chez Jes autres animaux, avec toutes Jes consequences sociales que ce developpement engendre. Mais precise?1ent ii cause de cette <leficience intiale, ii savoir le fait d'etre en proie a la peur, la percept10n n'est pas infaillible, produisant des distorsions systematiques qui son! comportementalement aggravees. Ainsi Hobbes ecrit-il :
Auss~ tous les h?rnmes, et specialement ceux qui voient le plus loin, sont-1~s ~ans un etat semblable .ii celui .de Promethee : car de meme que Prome~hee ( dont le nom, une fms tradmt, donoe : / 'homme prudent) etait attache sur le mont Caucase, endro1t d'oU la vue s'6tend fort loin et oU un aigle qui se nourrissait de son foie d6vorait le jour ce qui en ren~issait dans la nuit, ainsi l 'homme qui regarde trap loin devant lui par souci de l'avenir, a le cceur range tout le jour par crainte de la mort, de la pauvrete ou de quelque autre malheur : et son anxi6t6 ne connait ni apaisement ni tr@ve, si ce n' est dans le sommeil 36•
. Dan~ le s01::1meil, la securite dont nous pouvons alors disposer est b1en s~r. le reconfort d'un monde entierement imaginaire ! Dans ce grand edifice de peur exteriorisee qu'est la religion toutes sortes d'entites incorporelles imaginees - Jes « imagines » et' !es «umbrae»" -?Ill un role il~ouer d~s.la pose des pieux. de la peur, peuplantunmonde 1m~grna!fe d « espnts mcorporels », qm demeurent « inintelligibles » ma1s sont compns « dogmatiquement » ou « pieusement » 38, ce qui, pour Hobbe~, est la ~eme chose. Tel qu'il est utilise par Jes epicuriens, le mot rehgzo, qm v1ent de religare, « lier etroitement », sert ii designer auss1 b1en la rehg10n que la superstition. Suivant Jes le9ons de Lucrece 39
, Hobbes pretend du reste des !es premieres pages du Leviathan que le pouv~fr des pretres est d6liberement fonde sur I' exploital!on de la supersl!l!on : « Pour ce qui est des sylphes et des spectres errants, Je pense que c'est a dessein que la croyance a leur existence a
35. Lev., XII,§ 4 {p. 169 Ip. 104). 36. Lev., XII,§ 5 {p. 169 Ip. 105). 37. Lev., XII,§ 7 {p. 171 Ip. 106). 38. Lev., XII,§ 7 {p. 171 I pp. 106-107). 3.9. LucRECE, D~ rerum natura, I, 101-103 et I, 127-135, trad. fr. Jose Kany-Turpin,
Parts, GF-Flammanon, 1997, p. 58 et p. 60.
HOBBES CAL VINISTE? 219
ete enseignee ou du mains n'a pas ete refutee, afin de maintenfr le credit de I 'usage des exorcismes, des signes de croix, de I' eau benite et des autres inventions semblables des Hammes spirituels. » 40
Mais si la religion ne peut pas etre distinguee de la superstition, Hobbes ne privilegie pas pour autant purement et simplement la science. Si, « quand on raisonne, on ne fait rien d'autre que de concevofr une somme totale a partfr de !'addition des parties; ou concevoir un reste, a partir de la soustraction par laquelle une somme est retranchee d'une autre »41 , operations auxquelles on attache des noms, la science n'est rien de plus que « la connaissance de toutes !es consecutions de denominations qui concement le sujet dont on s'occupe »42• II n'y a pas de refuge ou se mettre ii I' abri. Les hommes n' ont pas un ace es ii la verite plus grand que Jes autres animaux : la « counaissance du fait » releve de la « sensation » et du « souvenir » 43 , et Jes animaux y ont un egal acces.
3. Dieu comme cause premiere et la religion naturelle
Dans le Leviathan, Hobbes examine en detail l'argmnent faisant de Dieu une cause premiere en tant que eel argmnent constirue un trait caracteristique de la « religion naturelle », trait don! ii estime, comme !es epicuriens, qu'il est ne de la peur de l'inconnu. Dans l'Historia Ecclesiastica, Hobbes suit Diodore de Sicile lorsqu'il decrit sur pres d'une quarantaine de lignes l'etiologie de la religion naturelle et la fa9on don! ]es premiers hommes, (( en s, emerveillant des etoiles et du ciel », furent incites ii chercher des explications aux eclipses ou aux phases de la lune, ce qui renfor9a le pouvoir des astrologues en tan! que savants et prophetes 44• Dans le Leviathan, Hobbes se contente d'une analyse plus concise de l'histoire de la religion naturelle : « L'anxiete de l'avenir dispose ii s'enquerir des causes des choses : en effet, cette connaissance rend l'homme d' autant plus apte a ordouner le present en vue de son plus grand avantage. » 45 Mais, comme nous I' avons vu, Jes strategies humaines destinees a reduire la peur ne font qu'engendrer davantage de peur. Le fail de postuler des <lieux en tan! que causes finales - des <lieux qui gouvement par la peur - appartient completement au sympt6me de ce fait que la defense contre la peur engendre
40. Lev., II,§ 8 {p. 92 Ip. 19). 41.Lev., V, § 1{p.110/p. 37). 42. Lev., V, § 17 {p. 115 Ip. 42). 43. Lev., V, § 17 {p. 115 I pp. 42-43). 44. HE, vv. 121-160 (OL, V, pp. 352-353 /pp. 316-321). 45. Lev., XI,§ 24 {p. 167 Ip. 102).
220 PATRICIA SPRINGBORG
encore davantage de peur. Bien plus, e'en est meme en realite !'element explicatif fondamental :
Cette crainte perpetuelle qui accompagne sans cesse l'humanite plongee dans !'ignorance des causes et, pour ainsi dire, dans les tenebres, doit necessairement prendre quelque chose pour objet. Et la done oil il n'y a rien 8. VOir, il n'y a rien fl quoi l'on puisse imputer la bonne OU la mauvaise fortune, en dehors de quelque pouvoir, ou agent, invisible. C'est peutetre en ce sens que quelqu 'un des anciens poetes a <lit que les <lieux ont d'abord ete crees par la crainte humaine : ce qui, applique aux dieux (c'est-a-dire aux multiples dieux paYens) est tout a fait vrai 46•
Hobbes semble cependant faire une exception pour le Dien createur monotheiste (Dien pour lequel ii n'y a de toute maniere aucune place dans sa metaphysique ), cette cause premiere opposee aux dieux des pa!ens. Mais c'est lit en realite un tres maigre reconfort. Un tel Dien pent certes paraitre « plus scientifique » : « Le fait de reconnaitre un Dien etemel infini et tout-puissant pent decouler plus facilement du desir qu'ont Jes hommes de connaitre Jes causes des corps naturels, leurs differentes proprietes et leur action, que de la crainte de ce qui leur arriverait dans l'avenir. » 47 En ce sens, ii semble justifie de conclure comme George Wright qu'un tel Dien appartient it« une analogie naturelle de l'reuvre de Dien dans le monde »". Mais en fait, « ainsi que Jes philosophes pa!ens eux-memes l'ont admis »", ce Dien appartient au meme symp!Ome de la regression it l'infini, qui multiplie simplement Jes puissances invisibles maintenant Jes hommes dans I' esclavage:
En effet, celui qui, de quelque effet qu'il voit se produire, passerait par le raisonnement a la cause prochaine et immediate de celui-ci, et de la a la cause de cette cause, et se plongerait ensuite a fond dans la poursuite des causes; celui-Ia arriverait enfin a ceci : qu'il doit y avoir (ainsi que !es philosophes paYens eux-memes I' ont admis) un premier moteur
46. Lev., XII, § 6 (pp. 169-170 I p. 105). Dans sa traduction fram;aise du Leviathan, Franyois Tricaud souligne, pour la mention aux «old Poets», la reference a STACE, Thibarde, III, 657-661 ; dans son edition, Ed Curley ajoute une reference ii. LucRECE, De rerum natura, I, 50-135 (ed. cit., pp. 54-60).
47. Lev., XII, § 6 (p. 170 Ip. 105). 48. George H. WRIGHT, art. cit., p. 475. 49. Lev., XII, § 6 (p. 170 Ip. 105). Le Leviathan latin (OL, III, p. 86 Ip. 96) dit :
«[ ... ]cum veterum philosophorum sanioribus >>,«[ ... ]en accord avec Ies plus senses des anciens philosophes ». Curley note dans son edition du Leviathan qu'il s'agit Iii. peut-8tre d'une reference a Aristote, « une (rare) reference positive», «a (rare) approving reference».
HOBBES CAL VINISTE? 221
unique, c'est-:l-dire une cause premiere et 6temelle de toutes .chose~, ~u~ est ce que l' on entend par le mot Dieu ; et tout cela, sans avorr cons1dere son propre sort, dont le souci, parce qu'il incline a la crainte et d6toume de la recherche des causes des autres choses donne occasion de forger autant de dieux qu' il y a d 'hommes a les forger so.
Hobbes ne fait pas non plus un appel a la conscience ou it la raison naturelle comme garantie contre !es distorsions psychiques auxquelles sont en proie !es hommes, qu'ils dorrnent ou qu'ils soi~nt eveilles. La conscience, it laquelle un homme a recours pour pnv1leg1er sa propre opinion, n'est rien de plus qu'un~ inferen~e ~rronee tfrfr du mot latm conscius : « [ ... ] des hommes v!Vement epns des opm10ns nouvelles qui etaient !es leurs (quelque absurdes qu'elles fussent), entet.es, a, Jes soutenir ont aussi donne it ces opinions personnelles ce nom revere de conscie~ce » 51 . Comme le souligne Curley dans !es notes de son edition du Leviathan, au chapitre VII, la notion de conscience chez Hobbes est tres e!oignee de celle que I' on trouve chez Calvin'', « pour qm la conscience est un sens de la Joi morale implantee en l 'homme par D1eu, de sorte que l'homme ne pent pas echapper a la connaissance du fait qu'il est en train de ma! agir quand ii est en train de :naI agfr ». II_s'.ensuit que, si la conscience privilegie la croyance subJecl!ve, la rehg10fo', qui est nee de la peur, fait exactement de meme mais sur un phn msl!tutionnel. Hobbes ecrit ainsi : « Cette cramte des choses mv!S!bles est le gerrne nature! de ce que chacun nomme religion chez lu~-meme, et superstition chez ceux qui montrent it I' egard de cette pmssance un genre de culte ou de crainte different des s_i~ns. » 53
•
Le postulat de Dien comme cause premiere est done s1mplement un reflexe de religion naturelle, une reponse a la crainte de la mort. II est autant scientifique que la decouverte du fen par un aveugle :
La curiosit6 ou amour de la connaissance des causes, d6tourne de la consid6ratio~ de l' effet vers la recherche de la cause, puis de la cause d~ la cause, jusqu'A ce qu'enfin on arrive n6ces~~irement a I.a pe~see qu'1l existe quelque cause qui n'a pas de cause anter1eure, et qui est ~ternelle: c'est cette cause qu'on appelle Dieu; de sorte qu'il est impossible d<; se livrer a aucune investigation approfondie des causes naturelles sans etre par la incline a croire qu'il existe un Dieu 6ternel, quoiqu'on ne puisse
50. Lev., XII, § 6 (p. 170 I pp. 105-106). Voir les commentaires ~e Pierre-Fra~_yois MOREAU, «La crainte a engendre les <lieux», Libertinage et philosophw au XVJfe siecle, Publications de I'Universit6 de Saint-Etienne, n° 4, 2000, pp. 147-153.
51. Lev., VII,§ 4 (p. 132 / p. 61). 52. Voir !RC, Ill, XIX, 15-16 (00, t. 4, pp. 358-361); reference a Rm 2,14-16. 53. Lev., XI,§ 26 (p. 168 / p. 103).
222 PATRICIA SPRINGBORG
avoir dans l'esprit aucune idee de lui qui corresponde a sa nature. Car de meme qu'un aveugle-ne, s'il entend des gens qui parlent de se chauffer aupres du feu et que ceux-ci le conduisent se chauffer lui aussi, peut aisement concevoir, et etre assure, qu'il y a la quelque chose que les ho mm es nomment feu, et qui est la cause de la chaleur qu' il sent, ma is ne peut pas imaginer a quoi cela ressemble, ni en avoir l'idee dans son esprit, telle que l'ont ceux qui le voient: de merne aussi, par les choses visibles de ce monde et leur ordre admirable, un homme pent concevoir qu'elles ont une cause, laquelle est appelee Dieu: et pourtant n'avoir de celui-ci aucune id6e ou image dans son esprit 54 •
La these de l'ineffabilite, bien qu' « indecise » et « fluctuante », conduit-elle des !ors, selon !es termes de Wright, vers « une analogie nature Ile de I' reuvre de Dieu dans le monde »? Je ne le pense pas. La curiosite, qui est I'« amour de la connaissance des causes », peut avoir des effets salutaires ou des effets pernicieux, et, comrne nous l'avons vu, Hobbes peut tres clairement differencier, selon ce point de vue, la religion de la science 55
• La religion ne peut etre distinguee de la superstition. Mais la science, comrne prudence fondee sur I' experience, possecte precisement la capacite de « defaire !es nreuds dont la religion nous entrave », selon une formule de Lucrece qui resume de maniere frappante le projet de Hobbes 56 • La science ne delivrera pas necessairement une verite definitive. Mais, demeurant aussi pres qu'il est possible des faits tels que nous !es connaissons, elle peut servir, comrne la philosophie naturelle, de palliatif a la peur. Desserrer !es nreuds de la peur et de la superstition, c'est precisement la l'idiome qu'utilise Hobbes au chapitre XL VII du Leviathan, lorsqu'il resume l'histoire de la religion a l'histoire d'une (( toile )) tissee par !es pretres et !es presbytres en vue d'acquerir et de renforcer leur pouvoir 57, une « toile » qu'il faut savoir demeler de la meme maniere qu'elle a ete construite, des nreuds liant la liberte des homrnes qu'il faut savoir denouer de la meme maniere qu'ils ont ete noues. C'est la le sujet des derniers livres du Leviathan (!es plus longs), de I' Historia Ecclesiastica et de I' Historical Narration Concerning Heresy, and the Punishment thereof Pour Hobbes, !es principes fondamentaux de la doctrine chretienne sont
54. Lev., XI,§ 25 (p. 167 Ip. 102). 55. Lev., XI,§ 26 (p. 168 / p. !03). 56. LUCRECE, De rerum natura, I, 932, ed. cit., p. 102 : « [ ... } religionum animum nodis
exsoluere pergo ». Sur la philosophie 6picurienne comme palliatif a la crainte de Ia mort, voir Jean-Marie GUYAU, La Morale d'Epicure et ses rapports avec !es doctrines contemporaines, Paris, Germer Bailliere, 1878, reed. Paris, F61ix Alcan (Collection historique des grands philosophes), 19277
, II, 3, pp. 103-126; Jean SALEM, Tel un dieu parmi !es hommes : l'ethique d'Epicure, Paris, Vrin, 1989.
57. Lev., XLV!l, § 19 (p. 710 I pp. 705-706).
HOBBES CAL VINISTE?
aussi invraisemblables et incroyables que !es vestiges du gentilisme qui se son! conserves !ors du passage du monde pafen au monde chretien, comrne l'ont montre ses amis historiens de I' Antiquite Edward Herbert ou John Aubrey.
4. L'arbitraire de l'orthodoxie religieuse : !es notions d'hupostasis et d'homoousion comme cas paradigmatiques
Examinons deux cas que Hobbes traite avec un sens caracteristique du sarcasme et de la derision, deux cas qui mettent en cause !es dogmes religieux orthodoxes !es plus centraux auxquels adherent !es chretiens, qu'ils soient calvinistes ou catholiques. Ils concernent tous !es deux la doctrine de la Trinite. Hobbes montre qu 'ils forment a chaque fois la solution la moins plausible au probleme philosophique qui etait pose. Aussi bien dans le Leviathan latin que dans I' Historia Ecclesiastica, !'analyse de Hobbes des circonstances et des deliberations du concile de Nicee, au cours duquel furent promulguees !es doctrines, suggere une sorte d'imprevu frolant l'arbitraire dans un processus dont !'issue fut l'etablissement d'une orthodoxie, laquelle n'etait ni ordonnee de toute eternite, ni aisement justifiee OU justifiable d 'un point de vue phi)osophique. A l'epoque de l'Eglise primitive, beaucoup de Grecs n'hesiterent pas a introduire dans la foi chretienne « la philosophie grecque, surtout aristotelicienne » : « Parmi !es convertis, ii se trouvait meme des philosophes, mais ces derniers ( chretiens trop peu endurcis) embrasserent la foi de fa9on a ne pas repudier pour autant !es dogmes de leurs maltres, mais a conserver au contraire ce qui pouvait se concilier en quelque maniere avec la doctrine chretienne. » 58 C'est de ce melange que naquit le symbole de Nicee :
Ce fut lit l'origine premiere des sectes (le grec dirait des heresies) dans l'Eglise du Christ, ces pasteurs proselytes n'etant evidemment pas d'accord entre eux au sujet de la nature du Christ. Les apotres avaient prouve par des miracles que le Christ etait Dieu; n6anmoins, ils ne crurent pas que ce filt vra~ parce qu'il paraissait impossible de le demontrer it partir des principes de leur philosophie. Aussi Jes uns, disciples d'un denomme Valentin, transformerent-ils l'histoire tout entiere de la generation du Christ en une allegorie; Irenee, du parti des orthodoxes, le combattit. Apres lui, Apelle et d'autres nierent que le
58. Lev., version iatine, XL VI, § 9 (OL, III, p. 492 Ip. 483). Le developpement le plus complet sur le concile de Nic6e, qui approfondit simplement cette ligne d'argumentation, se trouve dans l'Historia l!cclesiastica: HE, vv. 545-776 (OL, V, pp. 364- 370 I pp. 364-394).
,,,.-------------------~-------~-··-·-·~----
224 PATRICIA SPRINGBORG
Christ fill un homme reel, affinnant qu'il n'etait qu'un phantasme sans corps; Tertullien polemiqua contre eux, en se servant au premier chef de !'argument selon lequel ce qui est incorporel, n'est rien. D'autres, que I' on appelait Jes Anthropomorphites, attribuerent it Dieu un corps pourvu d'organes. D'autres encore voulurent que le Christ fill, non pas Dieu tout entier, mais une partie de Dieu. Pendant ce temps, les eveques et les pretres examinerent dans leurs synodes ces doctrines nouvelles, appelant heresies celles qu'ils condamnaient, et foi catholique celles qu'ils approuvaient : on distingua alors, pour la premiere fois, entre les catholiques et Jes heretiques. Ensuite apparut l'heresie d'Arius, qui niait que le Christ flit Dieu ; c' est elle qui fut la raison pour laquelle le concile de Nic6e se r6unit 59
.
Hobbes recourt it une ironie caracteristique lorsqu'il explique comment l'orthodoxie fut distinguee de l'Mresie par un simple.fiat. Mais, apres tout, c'est aussi la tout ce qui est requis, puisque le concile fut convoque par Constantin, dans le pouvoir souverain duquel, selon Hobbes, reside le pouvoir de determiner la doctrine religieuse. De plus, ces « chretiens trop peu endurcis » ne faisaient que deliberer sur I 'ineffable, comme Hobbes ne cesse de le rappeler. Le philosophe conclut que le concile, vu !es circonstances, fit plut6t un bon travail, raison pour laquelle, peut-etre, ii minimise le fait que le symbole de Nicee fut contamine par la philosophie grecque. II insiste egalement sur le fait qu'il n'est pas le premier a avoir exprime des doutes ace sujet: ii n'Msite pas a faire appel a l'autorite de saint Jerome et a souligner Jes difficultes insurmontables auxquelles Jes Peres furent confrontes dans leur tache impossible de faire « trois it partir de un » et « un a partir de trois », comme nous allons le voir. C'est dans ce contexte que Hobbes defend son interpretation du concept de « personne » : dans le cadre d'une demonstration subtile et erudite, a la fois classique et patristique, ii revendique l'excellente autorite de Ciceron (De oratore, II, 24), tout en suggerant en meme temps qu'il est capable, lui, de foumir une solution au probleme de la Trinite meilleure que celle qui fut avancee par !es Peres :
Nous utilisons le mot [= celui de « personne »] dans le rneme sens en noire langue [= l'anglais], lorsque nous disons que celui qui agit de sa propre autorite agit «en personne », et que, quand c'est par l'autorite d'un autre, il est la « personne » de ce demier. Ainsi avons-nous la signification exacte du mot « personne ». La langue grecque ne peut la rend.re, car np6crwn:ov est, a proprement parler, un visage et,
59. Lev., version latine, XLVI, § 9 (OL, III, pp. 492-493 Ip. 483).
HOBBES CAL VINISTE? 225
metaphoriquement, le masque de l' acteur a la scene. Comment les Peres grecs exprimerent-ils done le mot « personne », tel qu' employe dans la sainte Trinite? Ils s'y prirent rnal. A la place du mot « personne », ils mirent hupostasis, qui signifie substance; d'oU l'onpourrait deduire que les trois personnes de la Trinite sont trois substances divines, c'est-i-dire trois <lieux. Ils ne pouvaient utiliser le mot np6crwnov, parce que ni le visage ni le masque ne sont des attributs honorables pour Dieu, pas plus qu'ils n'expriment ]'intention de l'Eglise grecque. Aussi l'Eglise latine (et l'anglaise, par consequent) rend-elle hupostasis, tout au long du symbole d'Athanase, par« personne »60
•
Le terme hupostasis, qui signifie en grec « fondation » ou «travail preparatoire », bien qu'il soil de fa9on generale un synonyme de « substance », est un terme theologique technique, utilise dans le contexte du neoplatonisme et du christianisme primitif pour designer une personne de la Trinite 61
. Et au concile de Ferrare et de Florence en 1438-1439, reuni un millier d'annees apres Nicee afin d'exarniner !es conditions d'une possible unite entre l'Eglise grecque et l'Eglise latine, !es positions adverses du parti des Orthodox.es et du parti des Latins quant aux personnes de la Trinite furent a nouveau resumees it partir des expressions « un en trois » et « trois en un » 62 . Hobbes passe !es positions catholiques et !es positions orthodoxes au crible, en montrant comment ii etait possible, en rendant hupostasis par « personne » it partir de sa propre interpretation de la representation, d'etre en conformite avec le symboled' Athanase. II demontre, avec un serieux quelque peu sarcastique, que !es theologiens utiliserent !es termes « hypostase » et «union hypostatique » d'une fa9on certes coherente, mais erronee, produisant trois natures du Christ au lieu de deux :
Mais l'expression «union hypostatique » est conservee et employee a juste titre par Jes theologiens, pour designer !'union de deux hypostases, c'est-it-dire, de deux substances ou natures en la personne du Christ. Attendu, cependant, qu'ils tiennent egalement que l'iime de notre Sauveur est une substance qui, bien que separee de son corps, subsistait neanmoins en elle-meme et, consequemment, avant d'etre separee de son
60.AB(EW, IV, p. 311/pp.187-188). 61. Voir Charles-Joseph HEFELE, Histoire des conciles d'apres Jes documents originaux,
trad. fr. Henri Leclerq, Hildesheim, Georg Olms, 1973 (fac-sim. de l'ed. de Paris : Letouzey et An6, 1907-1949), I, I, 2, p. 368, n. I, la citation de saint Athanase d' Alexandrie, Gratia I contra arianos, chap. 6, PG, t. 26, col. 24.
62. Voir Deno John GEANAKOPLOS, Byzantine East and Latin West : two worlds of Christendom in Middle Ages and Renaissance. Studies in ecclesiastical and cultural history, Oxford, Blackwell, 1966, chap. 3 («The Council of Florence [1438-1439] and the Problem of Union between the Byzantine and Latin Churches»), p. 99 sqq.
226 PATRICIA SPRINGBORG
corps sur la Croix, 6tait une nature distincte de son corps, comment echapperont-ils a cette objection que le Christ possedait alors trois natures, trois hypostases [ ... ] ? "
Lorsqu'il doute ainsi de la doctrine de !'union hypostatique, Hobbes sait qu'il n'est aucunement une figure isolee. Dans un passage celebre (Ep. 57 ad Damasum), saint Jerome avail deja exprime de serieuses reserves au sujet de !'expression (( trois hypostases pour trois personnes » : ii ne fail aucun doute que Hobbes connaissait Jes doutes de Jerome, comme en temoigne la source dont ii est admis qu'elle fut la sienne, a savoir Denis Petau 64. Et dans I' Appendice I du Leviathan latin 65
, Hobbes cite longuement Jes vains efforts consignes par Pierre Lombard dans le premier livre de ses Sentences pour donner un sens aux trois hypostases. Commentant saint Augustin 66, le Lombard, comme le note Hobbes, declarait :
Les Grecs entendent la substance autrement que Jes Latins. Les Latins distinguent une seule essence, ou substance, et trois personnes. En effet, dans notre langue, on ne doit pas comprendre essence autrement que substance. Pour faire comprendre cela, au mains dans une a116gorie obscure, on s'est plu a parler de maniere a avoir quelque chose a dire lorsqu'on demandait ce qu'6taient ces trois. Aussi, quand on demande ce que sont ces trois termes, ou ces trois etres, nous entreprenons de trouver quelque nom qui embrasse les trois termes, mais nous ne trouvons rien, parce que la supereminence de la divinite excede Jes possibilites du langage courant 67.
63. AB (EW, IV, pp. 3 l!-312 Ip. 188). 64. Denis PETAU, s.j. (1583-1652), Opus de theologicis dogmatibus, Amsterdam, apud
G. Galet, 1700, 2 vol., ici Livre IV, p. 187 b, texte cite par Gianni PAGANINI,« Hobbes, Valla and the Trinity>~, British Journal for the History of Philosophy, vol. 11, n° 2, mai 2003, pp. 183-218, ici p. I99.
65. Lev., version latine, Append.ice I (OL, III, pp. 535-536 Ip. 522) =George H. WRIGHT, «Thomas Hobbes' 1668 Appendix to Leviathan, translated with an Introduction and Notes», Interpretation, vol. 18, n° 3, printemps 1991, pp. 323-413, ici § 88, p. 365.
66. SAINT AUGUSTIN, De Trinitate (399-422/426), VII, 4, 7, BA, t. 15, p. 526 ~PL, t. 42, col. 939 : « ltaque loquendi causa de ineffabilibus, ut fart aliquo modo possemus, quad effari nullo modo possumus, dictum est a nostris Graecis una essentia, tres substantiae, a Latinis autem, una essentia vel substantia, tres personae; quia, sicut jam diximus, non aliter in sermone nostro, id est, latino, essentia quam substantia so/et intelligi. Et dum intelligatur saltem in aenigmate quad dicitur, placuit ita dici, ut diceretur aliquid cum quaereretur quid tria sint, quae tria esse fides vera pronuntiat, cum et Patrem non dicit esse Filium, et Spiritum sanctum quad est donum Dei nee Patrem dicit esse nee Filium ».
67. Pierre LOMBARD, Sententiae in IV Libris Distinctae (ca. 1155-1158), I, dist. 23, cap. 2 (96), Grottaferrata, Ed. Collegii S. Bonaventurae Ad Claras Aquas, 1971, pp. 182-183 : « Qua necessitate non so/um latinus sermo, sed etiam graecus eadem pene super hac re laborans nominum penuria coarctatur. Unde Augustinus, quid a Graecis vela Latinis necessitate de ineffabili Trinitate dictum sit aperiens, in VII libro De Trinitate ait: "Loquendi
HOBBES CAL VINISTE? 227
Rapportant dans I' Historia Ecclesiastica Jes deliberations du concile de Nicee, au cours duquel la doctrine de la Trinite fut definitivement formuJee, Hobbes, invoquant le principe de la sola scriptura 68 , s'exclame:
0 Docteurs grecs, pourquoi pretendez-vous qu'il ya Trois personnes en un seul Dieu unique? Comment le savez-vous? Si vous ne le savez pas, ne parlez pas en vain. Que les pures paroles des Livres saints soient pour vous suffisantes 69.
Dans le poeme latin, ii apparait tres clairement que Hobbes ne retracte en rien la doctrine heretique de la Trinite qu'il enonce dans le Leviathan anglais 70, ce qui suggere que la retractation apparente de son heterodoxie dans I' Appendice III du Leviathan latin 71 n' est que de pure forme et que sa version de la doctrine trinitaire est toujours autant susceptible d'etre accusee d'arianisme. II affirme ainsi sans menagement que « le mot grec pour designer la substance est le mot hupostasis; quiconque <lit qu'il y a trois hypostases <lit qu'il y a trois <lieux » n Dans I' Appendice I du Leviathan latin, Hobbes <lit exactement la meme chose : « Mais si, au lieu de personne, nous nous servons, comme !es Peres grecs, du mot hypostase (etant donne qu'hypostase et substance ont meme signification), nous avons, au lieu de
causa de ineffabilibus, ut fari aliquo modo possemus, dictum est a Graecis : una essentia, tres substantiae" (id est una usia, tres hypostases: aliter enim Graeci accipiunt substantiam quam Latini). "A Latinis autem dictum est: una essentia vel substantia, tres personae, quia non aliter in sermone nostro, id est latino, essentia quam substantia so/et intelligi. Et ut intelligatur saltem in aenigmate, placuit ita dicit : ut cum quaereretur quid tria sint, a/iquid diceretur; quae tria esse fides vera pronuntiat, cum et Pat rem non di cit esse Filium; et Spiritum Sanctum, scilicet Donum Dei, nee Patrem dicit esse nee Filium" [. .. ]. "Cum ergo quaeritur quid tria vel quid tres, conferimus nos ad inveniendum aliquod nomen quo complectamur haec tria; neque occurrit animo, quia supereminentia divinitatis usitati eloquii Jacultatem excedit" ».
68. Dans l'Answer to[. . .] Bramhall, Hobbes reaffirme sa position constante: « Lorsque la nature de la chose est incomprehensible, je puis donner mon assentiment a l'Ecriture; mais lorsque c'est le sens des mots qui est incomprehensible, je ne puis donner man assentiment a l'autorite d'un disciple de l'Ecole »-AB (EW, IV, p. 314 Ip. 190). De meme, dans I' Appendice I du Leviathan latin, Hobbes redit brutalement les principes de la so/a scriptura : « [. . .] sanctam Trinitatem ex so/a Scriptura Sacra ostendere »-Lev., Appendice I (OL, III, p. 536 Ip. 522). VoirGianni PAGANINI,« Hobbes, Valla e i problemi filosofici della teologia umanistica : la riforma "dialettica" della Triniti\ »,in : Luisa SIMONUTTI (ed.), Dal necessario al possibile. Critica al determinismo e luogo de/le liberta nel pensiero anglo-olandese de/ XVII secolo, Milan, Franco Angeli, 2001, pp. 11-45, ici p. 42, n.
69. HE, vv. 1081-1084 (OL, V, p. 378 I pp. 434-436). 70. Lev., XVI (p. 220 I pp. 165-I66); Lev., XXXJI! (p. 425 Ip. 414) ; Lev., XL!
(pp. 520-521 Ip. 5I6); Lev., XL!! (pp. 522-524 I pp. 518-520). 71. Lev., version latine, Appendice III (OL, III, pp. 563-564 Ip. 550). 72. HE, vv. 75I-752 (OL, V, p. 369 Ip. 392).
228 PATRICIA SPRINGBORG
trois personnes, trois substances divines, c 'est-a-dire trois dieux. » 73
lei, a nouveau, ecrivant en latin, Hobbes juge plus durement le symbole de Nicee que dans \'Historical Narration Concerning Heresy ecrite en anglais, oil Hobbes affirme plus prudemment : « C'est ainsi que les choses sont expliquees dans le symbole d' Athanase, qui prit part it ce concile [= celui de Nicee], avec les mots : "sans confondre les personnes, ni diviser la substance"; ce qui signifie que Dieu ne se divise pas en trois personnes comme l'homme se divise en Pierre, Jacques et Jean, tandis que les trois personnes ne sont pas une seule et meme personne. » 74 Cette phraseologie fail echo a celle de \'Answer to [. . .} Bramhall, comme nous l'avons vu. Hobbes observe en effet dans \'Historical Narration que, « dans cette confession de foi generale que contient le symbole appele symbole de Nicee, on ne rencontre nulle mention d'hupostasis, ni d'union hypostastique, ni de ce qui serait corporel ou incorporel, ni de parties» 75
• Cette fa9on d'argumenter est en accord avec celle du personnage «A» dans l' Appendice I du Leviathan latin, personnage qui trouve a son grand etonnement (peut-etre un etonnement quelque peu sarcastique) que le symbole de Nicee n'est pas contamine par la langue et la pensee grecques 76 . Mais, dans l'Historia Ecclesiastica, Hobbes affirme categoriquement qu' a cause de cette contamination par la langue et la pensee grecques les hommes pieux « s'egarerent » : « Comme des hommes aveugles, ils ne pouvaient trouver !es doctrines du concile dans l'Ecriture sainte. » 77 Je crois que toutes ces nuances, dans le ton et dans !'accentuation, refietent des contextes differents ainsi que des audiences differentes auxquelles Hobbes s' adresse, plut6t que des contradictions dans la coherence de la pensee, meme s' il faut aussi reconnaitre parfois certain es ruptures dans I' argumentation.
73. Lev., version latine, Appendice I (OL, III, pp. 533-534 I pp. 520-521) = George H. WRIGHT,« Thomas Hobbes' 1668 Appendix to Leviathan, translated with an Introduction and Notes», art. cit., § 82, p. 364.
74. HNH (EW, IV, p. 398 / p. 41). 75. HNH (JJW, IV, p. 401 / p. 46); voir AB (EW, IV, p. 311 / p. 188). 76. Lev., version latine, Appendice I (OL, III, p. 536 I pp. 522-523). Cette position est
coh6rente avec celle que defend Hobbes dans le Leviathan latin, XL VI, § 10 (OL, III, p. 493 Ip. 483), oU il affirme que « ce synode ne condamna pas seulement l'h6r6sie arienne, mais aussi toutes les h6r6sies du temps pass6, depuis la naissance du Christ. Le symbole dit de Nicee servit a renfermer un abrege de la foi orthodoxe, tire des Ecritures elles-memes sans aucunement tenir compte de la philosophie grecque ». Comme !'observe Curley, a la fois clans son edition du Leviathan et dans sa «Reply to Professor Martinich », p. 287 (oU il cite ce meme passage du chapitre XLVI), !'affirmation de Hobbes n'est pas completement exacte, puisque le mot homoousios fut incorpor6 dans le symbole nic6en, meme si, ainsi que le montre Martinich dans Sa r6ponse a Curley, ce fut a cause de l'insistance de l'empereur Constantin.
77. HE, vv. 739-740 (OL, V, p. 369 / p. 388).
HOBBES CAL VINISTE? 229
Parallelement au probleme souleve par le terme hupostasis, sans toutefois lui etre identique, s'est pose le probleme de l'emploi du terme homoousion 18, emploi qui fut aussi debattu par !es Peres de Nicee comme autre consequence de la doctrine selon laquelle Dieu « n'a pas de parties». En proclarnant contre les ariens !'unite et l'homogeneite de la Divinite, le concile fut force de conclure que les personnes de la Trinite etaient de meme (homoousion) substance et non pas de substance semblable (homoiousion). Ce la conduisit les Peres dans une impasse lorsqu'il fallut montrer comment Dieu pouvait etre dans le Christ, lui qui avail manifestement part it la nature mortelle. La question est pour Hobbes d'un grand interet. Elle est parallele a celle de la transsubstantiation : comment le corps et le sang du Christ peuvent-ils etre dans le pain et le vin de la communion 79, ou, pluti\t, comme le dit Hobbes de fa9on irreverencieuse, comment !es proprietes du pain et du vin de la communion peuvent-elles se repandre dans le corps et le sang du Christ? 80 S'il traite le probleme cree par les termes homoousion et homoiousion dans les ceuvres latines tardives - les Appendices du Leviathan latin 81 et I' Historia Ecclesiastica 82 -, ce n' est pas le cas dans le Leviathan anglais et dans \'Answer to [. .. ] Bramhall, sa position etant peut-etre trop clairement Mretique pour son audience anglaise. Sa fa9on d' aborder le probleme est tres instructive : elle demontre a nouveau une excellente comprehension des materiaux et des sources, ainsi qu'un certain serieux theologique. Dans l'Historia Ecclesiastica, le philosophe fait une allusion quelque peu cryptee au fait que « !es actes du concile de Nicee ne resterent pas en vigueur longtemps » parce que le symbole niceen, creant de tres nombreux Mretiques, ne produisit pas la paix qu'escomptait Constantin; Hobbes note meme que le successeur de Constantin, son fils Constance II (317-361), « un partisan d' Arius », (( ne voulut pas que la clause relative a l' homoousion rut ratifiee »,pour la meme raison 83• Or, nous savons par l'historien arien Philostorgius (v. 368-v. 433) que plusieurs des signataires des decrets de Nicee substituerent deliberement le terme homoiousios au terme homoousios (des termes qui sont en grec presque indiscernables ),
78. HE, v. 673 (OL, V, p. 367 / p. 381+n.191); Lev., version latine, Appendice II (OL, III, p. 544 Ip. 530) =George H. WRIGHT,« Thomas Hobbes' 1668 Appendix to Leviathan, translated with an Introduction and Notes», art. cit., § 127, p. 370.
79. Lev., version latine, XLVJ, § 19 (OL, III, p. 499 / p. 488). 80. Lev., VIII,§ 27 (p. 147 Ip. 77). 81. Lev., version latin, Appendice 1 (OL, III, p. 516 / p. 506); Appendice II (OL, II~
p. 544 Ip. 530); Appendice II (OL, III, p. 554/ p. 540); voir les notes de Curley dans son edition du Leviathan.
82. HE, vv. 660-676 (OL, V, p. 367 I pp. 378-380). 83. HE, vv. 671-676 (OL, V, p. 367 Ip. 380 + n. 190-192).
230 PATRICIA SPRINGBORO
demontrant ainsi qu'ils etaient des Mretiques 84• Dans l'Appendice II
du Leviathan latin, Hobbes reprend et prolonge cette maniere d'argumenter. II note qu'Eusebe, eveque de Cesaree et historien ecclesiastique de premiere importance, ecrivit au clerge de tous ses dioceses une epitre encyclique dans laquelle ii expliquait « la raison pour laquelle Jui, et d'autres, qui avaient d'abord refuse de souscrire [~au symbole de Nicee, a cause de la clause relative a l'homoousion], le faisaient maintenant » :
11 donnait de sa souscription la raison suivante: qu'une formule avait ete prescrite par les Peres qui garantissait qu'on ne tomberait pas en dehors des conceptions de la droite foi, et que pour cette raison il ne rejetait pas le mot 6 CboUmo q parce que la paix etait devant nos yeux cornme notre point de mire[~ PG, t. 20, col. 1541 et t. 67, col. 73]. On comprend par IA que toutes les fois qu'on incrimine des paroles au nom des conceptions du concile de Nicee, ces paroles doivent Stre couch6es en une formule qui permette a chacun de s'assurer, sans plus de syllogismes, des paroles qui supportent cette incrimination et de celles qui ne la supportent pas : de la meme maniere, exactement, que ce qui est incrimine dans des actions est distingue de ce qui ne !'est pas par la formule de la loi 85
•
En d'autres termes, le concile de Nicee, reuni par la personne de Constantin, a observe une pratique normale, celle observee par « tous Jes papes » et meme plus tard par Elisabeth rre, une pratique qui consiste, « des qu' ils condanment quelque doctrine comme Mretique dans Jes conciles generaux )) a « inscrire toutes Jes consequences de cette doctrine dont ils prevoient la naissance possible dans autant de formules exprimees dans le decret lui-meme » 86• En assimilant ainsi la pratique des conciles de l'Eglise a celle des rois et a celle des papes, en tant qu'instances souveraines de codification de la loi, Hobbes laisse ouverte la possibilite que Jes sujets puissentjouir du« silence de la Joi» et libre l'espace pour la difference d'opinion dans le« tribunal interieur » que permet la distinction entre le for interne et le for externe 87
- dans la
84. Voir Charles-Joseph HEFELE, Histoire des conciles d'apres !es documents originaux, op. cit., I, 1, 2, pp. 446-448 + n., les r6f6rences a l'Historia Ecclesiastica de Philost<;>rgius, reuvre qui n'est plus disponible qu'au travers du monumental Epitome de Photius r••, patriarche de Constantinople (v. 820-v. 891). Voir SozoMEN, The ecclesiastical history of Sozomen : comprising a history of the church from A.D. 324 to A.D. 440 translated from the Greek : with a memoir of the author. Also, the Ecclesiastical history of Philostorgius as epitomized by Photius, Patriarch of Constantinople, trad. angl. Edward Walford, Landres, Henry G. Bohn, 1855, pp. 433-434.
85. Lev., version latine, Appendice II (OL, III, p. 554/ p. 540). 86. Lev., version latine, Appendice II (OL, III, pp. 554-555 /pp. 540-541). 87. Lev., XV,§ 36 (p. 215 / p. 158).
HOBBES CAL VINISTE? 231
mesure ou la Joi permet cette distinction. Ainsi les hommes accuses d'Mresie - comme ce fut le cas pour Hobbes - ont-ils toujours le recours, pour autant qu'ils ne clament pas leurs opinions sur tous les toits et qu'ils s'efforcent de montrer qu'ils se conforment a la doctrine orthodoxe, de pouvoir jouir de la protection de la loi. D'ou toutes Jes manreuvres sophistiquees de Hobbes dans ses reuvres tardives pour s'exonerer de !'accusation d'etre un Mretique.
Texte traduit de l'anglais par Dominique Weber