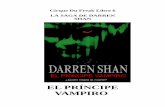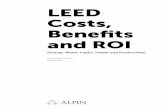Sopdou et le roi - Principe de composition axiale dans la pyramide d'Ounas
Transcript of Sopdou et le roi - Principe de composition axiale dans la pyramide d'Ounas
Spécim
en au
teur
INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE
bIbLIOTHèqUE D’ÉTUDE 162 – 2015
Ouvrage édité parR é m i L e g R o s
Cinquante ans d’éternitéJubilé de la Mission archéologique française de Saqqâra
MAFS V
Sommaire V
Spécim
en au
teur
Sommaire
M. EldamatyForeword .......................................................................................................................................... ix
Remerciements ........................................................................................................................................ xi
A. LabrousseHéritiers de Mariette ...................................................................................................................... 1
pREMièRE pARtiE
les Textes des PyramidesN. Beaux
Sopdou et le roi. Principe de composition axiale dans la pyramide d’Ounas ................................................ 11
É. Bène – B. MathieuTradition et innovation dans les Textes des Pyramides. La paroi ouest de l'antichambre de Téti (T/A/W) : un cas exemplaire .......................... 23
C. Berger-el Naggar – M.-N. FraisseLa paroi est de la chambre funéraire de Béhénou : le dernier voyage de la reine .......... 41
S. FeneuilleDe la pyramide de Pépy Ier à Paroles d’éternité ....................................................................... 53
N. GuillhouLe linceul d’étoffe idémi d’après le TP 453, le TS 608 et le rituel d’Abydos ................................................................ 57
B. MathieuLa paroi est de la chambre funéraire de la reine Ânkhesenpépy II (AII/F/E). Contribution à l’étude de la spatialisation des Textes des Pyramides ............................... 69
VI Cinquanteansd’éternité.JubilédelaMissionarchéologiquefrançaisedeSaqqâra
Spécim
en au
teur
B. Mathieu – i. pierre-CroisiauUne nouvelle formule des Textes des Pyramides : TP 1002.Édition synoptique et traduction commentée ....................................................................... 77
i. pierre-CroisiauLes signes en relation avec les vêtements et l’action de vêtir dans les Textes des Pyramides.Enquête paléographique .............................................................................................................. 97
dEuxièME pARtiE
la nécropole de pépy ier
G. ClercAmulettes, parures et sceaux recueillis dans le complexe funéraire de Pépy Ier .......... 139
ph. CollombertUne nouvelle version de l’autobiographie d’Ouni ............................................................... 145
Fr. Janot – S. MathieuLa momie d’Ânkhnespépy/Ânkhsen, prêtresse d’Hathor ................................................ 159
A. LabrousseLes reines de la salle aux offrandes de Pépy Ier ..................................................................... 167
R. LegrosUne inhumation factice au complexe de Ânkhnespépy II ? .............................................. 181
A. Minault-GoutLes tamis ẖnmt-wr des reines de la fin de la VIe dynastie .................................................. 195
Fr. payraudeauConsidérations sur quelques titres des reines de l’Ancien Empire à l’époque ptolémaïque ............................................................................................................. 209
p. péroUne stèle-maison au nom de Mémy ....................................................................................... 227
Sommaire VII
Spécim
en au
teur
tRoiSièME pARtiE
variaH. el tayeb
The False-Door of Rashepses from Saqqara LS 16 (QS 902) ........................................... 239
Y. GourdonRois vivants et rois défunts dans les inscriptions événementielles de la fin de l’Ancien Empire ..................................................................................................... 249
A. Hélal-GiretSarwat Okacha et Jean-Philippe Lauer : une rencontre .................................................... 265
E. Kormysheva – Sv. MalykhAnalyse comparative de certains ensembles céramiques des nécropoles de Giza et de Saqqâra des Ve et VIe dynasties ..................................................................... 271
L. pantalacciFamille royale et pouvoir oasite. Une fille royale à Balat à la fin de l’Ancien Empire .............................................................. 301
p. VernusAutobiographie et scènes dites « de la vie quotidienne ». De la parodie à la fiction du paysan prototypique .............................................................. 309
M. WissaTradition and Continuity. Sekhemkhet Search for Eternal Casing from Helwan ..................................................... 323
M. YoussefReport on the Excavation to the North of the Tomb of Nakht-Min (North Saqqara-Abusir). Dec. 10th 2002-January 31st 2003 ............................................ 327
A. ZivieÀ propos de la « tombe à la vache » de Saqqâra ................................................................... 339
Résumés .................................................................................................................................................... 345
Sopdouetleroi 11
Spécim
en au
teur
Sopdou et le roi
Principe de composition axiale dans la pyramide d’Ounas
Nathalie Beaux *
Le principe axial selon lequel la décoration des portes est conçue est bien connu, en particulier pour ce qui concerne la face extérieure 1. Les signes des inscriptions sur les linteaux sont le plus souvent orientés de façon à converger vers un même signe central.
L’idée est de souligner l’axe du passage autour duquel tout s’ordonne.
Dans la pyramide d’Ounas 2, il existe deux passages : le premier permet d’aller de la chambre funéraire à l’antichambre, le second de l’antichambre au couloir de sortie du monument. Le roi, appelé à ressusciter, part de l’ouest, dans la chambre funéraire où se trouve son sarcophage, et son cheminement se fait d’abord d’ouest en est, puis, une fois arrivé dans l’antichambre, du sud au nord. Il pénètre donc dans le premier passage en passant sous la face est de la chambre funéraire, puis dans le second passage en passant sous la face nord de l’antichambre.
Un premier regard sur ces deux faces ne révèle d’abord rien d’autre qu’un déroulement de colonnes de signes, du sud au nord dans le premier cas, d’est en ouest, du moins en apparence, dans le second. Cependant, un examen attentif permet de voir qu’en réalité l’axe central est signalé sur ces deux faces, mais de façon différente.
Les textes gravés sur la face est de la chambre funéraire forment deux ensembles séparés par une ligne horizontale (fig. 1). L’ensemble supérieur forme un triangle composé d’une succession de colonnes s’allongeant de plus en plus pour culminer au faîte de la face, et se réduisant ensuite progressivement, suivant ainsi la voûte composée de deux larges dalles posées en chevrons. Deux colonnes centrales de même longueur partent du faîte de la face, sous la pointe des chevrons. Dans l’ensemble inférieur, des colonnes se succèdent, débutant toutes à même hauteur que les textes gravés sur les faces nord et sud de la chambre funéraire. C’est dans cette partie inférieure de la face que s’ouvre la baie du passage vers l’antichambre.
* Collège de France/Ifao.1. Je suis reconnaissante à J.-P. Corteggiani et N. Grimal pour leurs remarques sur une première version de cet article.2. Ces remarques ont été faites lors de missions d’étude des textes et de la paléographie de la pyramide d’Ounas, avec l’aimable autorisation du Conseil suprême des antiquités. Je suis reconnaissante à la MafS pour les informations qu’elle a bien voulu me communiquer concernant l’emplacement, dans les diverses pyramides, des textes en référence à Sopdou étudiés et cités dans cet article. Les photographies sont de G. Pollin, que je remercie pour la qualité de son travail.
Spécim
en au
teur
Fig. 1. Vue de la face est de la chambre funéraire de la pyramide d’Ounas, les deux colonnes axiales sont encadrées (cliché G. Pollin).
Fig. 2. Vue de la face nord de l’antichambre de la pyramide d’Ounas, la colonne axiale est encadrée (cliché G. Pollin).
Sopdouetleroi 13
Spécim
en au
teur
D’emblée, l’œil est attiré par les deux colonnes médianes de cette partie inférieure, les colonnes 20 et 21, situées dans le prolongement des deux colonnes centrales de la partie supérieure. Elles présentent, en effet, dès leur sommet et sur un tiers de leur hauteur, le même texte, les signes étant parfaitement juxtaposés d’une colonne à l’autre, fait unique sur cette paroi. L’axe est ainsi visuellement souligné. Le texte, quant à lui, mentionne sur chaque colonne, le nom de Sopdou inscrit juste au-dessus du passage pour la colonne 20 et presque à mi-hauteur pour la colonne 21.
Pour la face nord de l’antichambre (fig. 2), la lecture des textes se fait de façon rétrograde, soit d’ouest en est. Pourquoi cette face est-elle la seule dans la pyramide à être inscrite en écriture rétrograde ? Il s’agit de la dernière grande face de l’intérieur de la pyramide avant la sortie du monument : l’ultime passage, dont la baie s’ouvre au centre de la face, et son axe même, sont mis en valeur par l’orientation contraire des signes et de la lecture. Ce procédé ne rend pas visible de façon immédiate l’axe du passage ; il faut lire les textes pour s’en rendre compte, alors que sur la face est de la chambre funéraire, les deux colonnes parallèles en soulignent d’emblée l’axe.
Si l’axe est signalé par l’écriture rétrograde, quelle est la colonne de texte figurant au centre de la face, dans l’axe du passage ? Au milieu de quarante-trois colonnes, la colonne 22 porte un texte avec, à nouveau, une mention du dieu Sopdou, inscrite juste au-dessus de l’axe du passage.
Les deux faces inscrites au-dessus des passages importants de la pyramide (chambre funéraire/antichambre et antichambre/couloir) présentent donc toutes les deux une référence au dieu Sopdou inscrite dans leur axe médian, axe souligné graphiquement par une « mise en page » de la face. Ce ne peut être un hasard.
I. Axe du pASSAge de lA chAmBre fuNérAire à l’ANtichAmBre : chAmBre fuNérAire, pAroi eSt [fig. 3a-b]
Il s’agit, dans ce texte, du Spr. 222, § 201c-d (col. 281-2), col. 20-21 3 (fig. 3a). Différents dieux sont invoqués, à propos de la venue du roi, avec une même phrase répétée pour chaque divinité (§ 200-201). Cette série d’invocations commence par Rê : « Il est venu à toi, son père, il est venu à toi, ô Rê ! » Elle s’achève avec Sopdou. L’incantation à Sopdou est, de surcroît, reprise deux fois, ce qui souligne l’importance du dieu (§ 201c-d) :
jw-n=f ḫr=k, jt=f, jw-n=f ḫr=k, Spdwjw-n=f ḫr=k, jt=f, jw-n=f ḫr=k, Spd jbḥ.w, Spdw
Il est venu à toi, son père, il est venu à toi, ô Sopdou !Il est venu à toi, son père, il est venu à toi, ô toi dont les dents sont pointues, ô Sopdou !
3. Les références aux TextesdesPyramides se font selon l’édition de K. Sethe, DiealtägyptischenPyramidentexte, à laquelle on ajoute, pour la pyramide d’Ounas, celle d’A. Piankoff, ThePyramidofUnas,BollSerXL – 5, 1969. Pour ce texte, cf. A. Piankoff, op.cit.,pl. 51-2 ; R. Faulkner, TheAncientEgyptianPyramidTexts, Oxford, 1969, p. 49-50 ; J.P. Allen, TheAncientEgyptianPyramidTexts, SocietyofBiblicalLiterature23, 2005, p. 39. Ce texte est également gravé dans la chambre funéraire, face sud, chez Pépy II et Neith.
14 NathalieBeaux
Spécim
en au
teur
Fig. 3. Texte des colonnes axiales sur la face est de la chambre funéraire de la pyramide d’Ounas (cliché G. Pollin) : a. Chapitre 222, § 201c-d (col. 281-2), col. 20-21 ; b. Correction au bas de la colonne 20.
ba
Sopdouetleroi 15
Spécim
en au
teur
Il faut noter que le bas de la colonne 20 porte une correction (fig. 3b). Dans un premier temps, le scribe avait gravé le nom du dieu Sopdou suivi du début de la deuxième incantation (« jw-n=f »), qui terminait la colonne. Dans un second temps, il a écrit phonétiquement le nom du dieu, ce qui a allongé la mention de Sopdou (au lieu de la limiter à un seul cadrat) et repoussé le début de l’incantation au sommet de la colonne 21. Pourtant, il n’y avait pas de faute dans ce qu’il avait d’abord gravé. Pourquoi alors l’avoir corrigé ? Il s’agit en fait d’une modification de la disposition du texte et non d’une correction de son contenu. Ce changement est important car il montre la volonté du scribe de faire commencer les colonnes 20 et 21 par le même texte et les mêmes signes, de façon à souligner visuellement, par cette « mise en page », l’axe médian de la face. De plus, le nom du dieu figure ainsi en bas de la colonne, juste au-dessus du passage.
La raison de cette litanie est donnée ensuite (§ 202a-c) :
d=k nḏr Wnjs pn qbḥw šsp=f ȝḫ.td=k jȝq Wnjs pn psḏ.t ḥtm=f Psḏ.td=k ʿw.t m-ʿ Wnjs pn wȝḥ(w).t-tp Mḥw ḥnʿ Šmʿw
Fais qu’Ounas que voici saisisse les Eaux fraîches célestes et prenne l’Horizon,Fais qu’Ounas que voici gouverne les Neuf et pourvoie l’Énnéade,Place dans la main d’Ounas que voici la férule qui incline la tête de la Vallée et du Delta du Nil !
L’invocation du dieu Sopdou se fait donc au point culminant de la litanie, à deux reprises, et sous le nom puissant de Spd jbḥ.w, Spdw, martelant le mot « spd » que l’on retrouve comme épithète et dans le nom du dieu. Il s’agit de la nature littéralement « pointue, acérée » et, par là même, « efficace » du dieu, dont les « dents pointues » sont l’emblème le plus explicite. Cette image se retrouve dans le § 148d, Spr. 215, gravé également dans la chambre funéraire d’Ounas, mais sur la paroi sud. Dans un texte d’ascension du roi, différentes parties de son corps sont associées chacune à un dieu, dont Sopdou :
jbḥ.w=k Spdw Jḫm(w)-sk !
Tes dents sont Sopdou, ô Immortel 4 !
Le Spr. 222 indique clairement qu’il s’agit de donner au roi Ounas le pouvoir céleste et terrestre, un pouvoir universel. Une série d’invocations divines est lancée, commençant par une adresse à Rê, soulignant ainsi le contexte solaire de cette litanie. La double invocation à Sopdou en est
4. A. Piankoff, op.cit.,pl. 41. Il faut noter que dans une première version du texte, le § 148d a été omis, et qu’ensuite une partie de la colonne 14 a été regravée en plus petits signes pour rajouter ce paragraphe et inclure la mention, qui s’avérait donc indispensable, de Sopdou (observation que j’ai faite sur le monument). Ce texte est également gravé dans la chambre funéraire, face sud, chez Pépy II, Neit et Oudjebten.
16 NathalieBeaux
Spécim
en au
teur
le point culminant et se situe précisément dans l’axe du passage. En raison de l’efficacité qu’il incarne, l’appel à Sopdou apparaît, plus que tout autre, vital pour l’établissement du pouvoir royal universel.
II. Axe du pASSAge de l’ANtichAmBre Au couloir de Sortie : ANtichAmBre, pAroi Nord [fig. 4]
Il s’agit ici du Spr. 306, § 480d (col. 588), col. 22. Le texte décrit l’ascension au ciel du roi. Les paroles de Geb sont ainsi rapportées (§ 480b-d) (fig. 2, 4) :
jȝ.wt jȝ.t(=j) jȝ.t Ḥr jȝ.t Stšsḫ.wt jȝrw dwȝ=sn ṯwm rn=k pw n Dwȝw Spdw js ẖr ksb.t=f
Les buttes de (mon) domaine, la butte d’Horus et celle de Seth,Et les champs de roseaux t’adorent,En ce tien nom de Douaou, comme Sopdou sous ses acacias.
Ce texte se trouve développé dans d’autres pyramides au § 994a-e (Spr. 480) (Pépy Ier et Pépy II) 5 :
Les buttes d’Horus, les buttes de Seth et les champs de roseauxAdorent Pépy comme Douaou,Comme Iahes à la tête du pays du Sud,Comme Dedoun à la tête du pays nubien,Comme Sopdou sous ses acacias.
Les § 1476a-c (Spr. 572) chez Pépy et Mérenrê 6 reprennent enfin le même texte ; mais, au lieu de seulement comparer le roi aux divinités, ils l’identifient à elles et, en dernier lieu, à Sopdou (§ 1476c) :
(…) Pépy est Sopdou sous ses acacias (Pépy Ier).(…) Tu es Sopdou sous ses acacias (Mérenrê).
5. A. Piankoff, op.cit.,pl. 5-6 ; R. Faulkner, op.cit., p. 168 ; J.P. Allen, op.cit.,p. 281. Ce texte est gravé sur la face ouest de l’antichambre, dans les deux pyramides.6. A. Piankoff, loc.cit. ; R. Faulkner, op.cit., p. 227 ; J.P. Allen, op.cit.,p. 180. Ce texte est gravé dans le vestibule des deux pyramides, sur la face ouest chez Pépy, sur la face est chez Mérenrê.
Sopdouetleroi 17
Spécim
en au
teur
Fig. 5. Gravure du nom de Sopdou dans la pyramide d’Ounas (clichés G. Pollin) :a. § 148d (chapitre 215), chambre funéraire, face sud, col. 14 ; b. § 201c-d (chapitre 222), chambre funéraire, face est, col. 20 ; c. § 201c-d (chapitre 222), chambre funéraire, face est, col. 21 ; d. § 480d (chapitre 306), antichambre, face nord, col.22.
a b
d
c
Fig. 4. Texte de la colonne axiale sur la face nord de l’antichambre de la pyramide d’Ounas (cliché G. Pollin) : chapitre 306, § 480d (col. 588), col. 22.
18 NathalieBeaux
Spécim
en au
teur
La différence entre ces deux passages (§ 994a-e et § 1476a-c) correspond à leur emplacement dans la pyramide : la comparaison du roi avec les divinités (dans les pyramides de Pépy Ier et Pépy II) se fait dans l’antichambre (face ouest), alors que son identification (dans les pyramides de Pépy Ier et Mérenrê) se trouve dans le vestibule, ce qui souligne, pour la pyramide de Pépy Ier, où l’on trouve les deux textes, une progression qui suit celle du roi vers la sortie et son ascension finale.
Dans la pyramide d’Ounas, le § 480b-d (Spr. 306) est inscrit sur la paroi nord de l’antichambre ; on le trouve aussi gravé chez Merenrê et Pépy II, mais dans le vestibule.
L’emplacement de ce passage (et de ses variantes) dans les pyramides royales est significatif : celui-ci est gravé dans l’axe de la paroi nord de l’antichambre chez Ounas, en deux endroits et avec une progression de l’antichambre au vestibule de Pépy Ier, par deux fois, dans l’antichambre et le vestibule de Pépy II, ainsi que par deux fois dans le vestibule de Merenrê. Cela souligne assez son importance comme texte d’émergence. Il associe le roi à Sopdou, parfois avec d’autres divinités. Mais en ce dernier cas, Sopdou est alors celle que l’on nomme ultimement, point d’orgue magique indispensable à l’ascension royale.
Que signifie cette association ? Qui est Sopdou ?
III. ANAlySe deS meNtioNS de Sopdou dANS leS TexTes des Pyramides
Deux études ont été consacrées à Sopdou 7. Le culte du dieu Sopdou est très ancien puisqu’il est attesté dès la seconde dynastie. Dieu de la frontière orientale de l’Égypte, « maître des pays étrangers », il fait figure de protecteur de l’Égypte ; il bat les Asiatiques et les amène, soumis, au roi. Dans le temple de Sahourê, le roi est représenté en créature composite, lion aux ailes de faucon piétinant ses ennemis 8, et est identifié, dans la légende, à Sopdou (cf. infra), ce qui indique assez la nature guerrière du dieu et sa puissance. Ailleurs, il apparaît sous forme humaine, une barbe naturelle en pointe et parfois même fournie, soulignant son côté « oriental », la tête surmontée de deux hautes plumes droites 9. Sur les enseignes du dieu, il apparaît, enfin, sous forme de statue de faucon, la tête surmontée de hautes plumes. C’est son aspect horien qu’évoque en outre l’épithète « Horus de l’Orient ».
Dans les Textes des Pyramides, le nom de Sopdou s’écrit presque toujours au moyen du signe G 13 figurant une statue (reconnaissable au socle sur lequel l’oiseau est posé et à la forme massive du signe) (fig. 5). Il s’agit d’un faucon en posture de veille, légèrement penché en avant, dominant son territoire d’un poste d’observation tel que le bord d’une falaise, à l’affût d’une proie ou d’un danger potentiel. Sa posture serait plus dressée s’il était perché sur un arbre
7. J. Yoyotte, « Le roi Mer-djefa-rê et le dieu Sopdou – un monument de la XIVe dynastie », BSFE 114, 1989, p. 17-63 ; I.W. Schumacher, DerGottSopdu,derHerrderFremdländer, OBO79, 1988. Voir aussi Chr. Leitz, LexikonderÄgyptischenGötterundGötterbezeichnungen, VI, OLA 115, 2002, p. 289-291.8. L. Borchardt, DasGrabdenkmaldesKönigsS’aȝḥu-Reʿ, II, DieWandbilder, Leipzig, 1913, pl. VIII. Comme la tête manque, il est difficile d’affirmer s’il s’agit d’un sphinx ou d’un griffon (cf. LÄV, 1984, col. 1143, s.v. « Sphinx »).9. L. Borchardt, op.cit., pl. V.
Sopdouetleroi 19
Spécim
en au
teur
ou un mât 10. Il est coiffé de longues plumes droites dressées sur la tête. Des quatre exemples de la pyramide d’Ounas, trois indiquent une coiffe tripartite et un seul une coiffe avec seule-ment deux plumes. La coiffe est par deux fois accompagnée d’un ruban retombant sur le dos, ruban intégré à la silhouette de l’oiseau. On retrouve cette graphie de la couronne tripartite 11 chez Pépy Ier. Plusieurs attestations témoignent, dès l’origine, d’une coiffe à plusieurs plumes (trois ou quatre) 12 sur ce signe 13.
Il serait possible de voir en cette couronne de plumes des trophées que le dieu vainqueur, « maître des pays étrangers » et en particulier de l’Orient, arborerait sur sa tête. Cette idée découle de l’observation d’un fragment du temple de Niouserrê 14. Sur celui-ci, le roi massacre des ennemis et l’on peut voir que chacun d’eux tient un poignard dans la main gauche et une plume dans la main droite. Cette plume ne pouvant être une arme, il s’agit d’un emblème. Elle est droite comme celle que le dieu a sur la tête 15. On pourrait alors concevoir que les trois plumes sur la tête de Sopdou soient une évocation du pluriel symbolisant tous les peuples soumis par le dieu. Les quatre plumes pourraient pareillement introduire une variante, avec une référence aux quatre points cardinaux. La couronne de plumes de notre signe serait donc une sorte de tiare composée de trophées pris à l’ennemi.
On a mentionné l’assimilation au dieu Sopdou du roi sous sa forme la plus guerrière, en sphinx/griffon dans le temple de Sahourê 16 : si la tête n’est, hélas, plus visible aujourd’hui, on voit cependant clairement un corps de lion à ailes de faucon repliées, soumettant les peuples étrangers. La légende inscrite au-dessus de la créature présente le cartouche royal suivi d’une mention de Thoth et de Sopdou : Spdw nb ḫȝs.wt ptpt(w) znṯ.w, « Sopdou, maître des pays étrangers, qui piétine les rebelles ». Cette représentation souligne assez le lien du roi avec le dieu, sa dimension agressive de conquérant universel, cela d’autant plus que la mention de Sopdou s’inscrit dans la boucle de la queue du lion, laquelle est relevée comme dans le signe pḥ, évoquant ainsi « les confins (de la terre) » (pḥ(w.w)) jusques auxquels s’étend sa domination 17.
Le signe G 13 de la statue de faucon est le plus souvent accompagné du signe spd (M 14), un triangle isocèle très pointu, et parfois du complément phonétique s. Dans deux cas seulement le nom est écrit phonétiquement 18.
10. Le signe G 13 a été diversement qualifié de « faucon couché » ou « accroupi », « assis », ou encore « momifié ».11. I. Pierre-Croisiau, LestextesdelapyramidedePépyIer.Fac-similés, MIFAO 118/2, 2001, pl. VII, col. 41 (P/A/W) ; pl. XX, col. 40 (P/V/W).12. I. Regulski, APalaeographicStudyofEarlyWritinginEgypt, OLA195, 2010, p. 433 ; I.W. Schumacher, op.cit., p. 14, n. 1 et p. 29, n. 33.13. Pour l’Ancien Empire, voir par exemple L. Borchardt, op.cit., pl. V, avec l’écriture du signe de Sopdou avec trois plumes.14. Berlin nº 16110/11/15 (L. Borchardt, DasGrabdenkmaldesKönigsNe-user-Reʿ, Leipzig, 1907, fig. 64, p. 86).15. L. Borchardt, DasGrabdenkmaldesKönigsS’aȝḥu-Reʿ,II, Leipzig, 1913, pl. V.16. L. Borchardt, op.cit., pl. VIII.17. Je suis redevable à N. Grimal de la lecture de cette image de la queue de lion comme signe pḥévoquant les « confins » du domaine sur lequel s’exerce le pouvoir du roi/dieu.18. Sur les dix-huit mentions du dieu dans les TextesdesPyramides, seules deux sont écrites de façon strictement phonétique (Ounas, § 201c : A. Piankoff, op.cit., pl. 52, col. 20 ; Pépy Ier, § 1534c : I. Pierre-Croisiau, op.cit., pl. XX, col. 72 [P/V/W]). Toutes les autres comprennent le signe du faucon G 13, et parfois un complément phonétique.
20 NathalieBeaux
Spécim
en au
teur
Le dieu est qualifié de spd jbḥ.w, c’est-à-dire qu’il a les « dents pointues, acérées ». Il est clair que son nom évoque à la fois un dieu spd, « efficace », et redoutable justement par ses dents. Son autre caractéristique est qu’il est dépeint « sous ses arbres-ksb.t », l’Acacia tortilis 19, de même que le dieu crocodile Sobek qui, lui, les parcourt 20. Le lien entre l’acacia, le faucon et le crocodile se situe peut-être dans le caractère pointu (et redoutable) des épines de l’arbre, du bec de l’oiseau ou des dents du saurien 21. Pour chaque prédateur, crocodile 22 et faucon 23, l’attitude décrite, en relation avec les acacias, est différente. L’immobilité du faucon « sous ses arbres-ksb.t » est souli-gnée, en accord avec sa représentation figée dans le signe G 13, renvoyant à une posture d’animal aux aguets, lui qui a une vue perçante et est extrêmement rapide et redoutable lorsqu’il voit une proie. L’oiseau utilise l’acacia et d’autres espèces d’arbres comme poste d’affût, reposoir diurne ou nocturne, plus que comme site d’aménagement de son nid. Il montre ce comportement plutôt lors de son vagabondage internuptial dans les plaines colonisées par une végétation arborée clair-semée/discontinue (type savane), loin de l’escarpement rocheux où il s’est reproduit 24. On peut penser que le dieu faucon Sopdou se place ainsi symboliquement sous l’auspice de ce végétal très répandu autrefois 25, ce qui serait une façon supplémentaire d’expliquer son lien avec les acacias.
Figure belliqueuse et souverainement efficace, comme on vient de le montrer, le dieu possède en outre dans les Textes des Pyramides une dimension astrale qui n’apparaît pas dans d’autres contextes. Dans un article écrit en hommage à Jean Leclant 26, j’avais mis en évidence la façon dont les anciens Égyptiens évoquaient le lever héliaque de l’étoile Sirius, Spd, dans les Textes des Pyramides, son apparition après une période d’invisibilité, épiphanie vitale car ce lever était annonciateur du début de la crue. Il était apparu que la figure divine de Spdw était une des fa-çons d’évoquer l’astre, sous l’angle de son éclat incomparable (il s’agit de l’étoile la plus brillante du ciel nocturne) précisément au moment de ce lever, lorsqu’il apparaît à l’aube et demeure seul visible dans l’éclat grandissant du soleil levant. Revenons sur les éléments étayant cette dimension astrale de Sopdou. Le § 1863b (Spr. 659) permet d’affirmer que le dieu Sopdou était une évocation de l’astre Spd, l’étoile Sirius 27. Ce texte substitue en effet, chez Pépy II, le nom de Spdw à celui de Spd inscrit chez Pépy Ier avec le simple triangle effilé :
Jnk sn=k Spd (var. : Spdw) js
Je suis ton frère et Sirius-Spd (var. : Sopdou).
19. Il s’agit plus précisément de l’Acaciatortilis(Forsk.) Hayne (N. Baum, « Essai d’identification de l’arbre ou arbuste ksbt des anciens Égyptiens », VarAeg 3, 1987, p. 195-205).20. § 456a-b (Spr. 301), antichambre, paroi est.21. Je remercie J.-P. Corteggiani pour cette suggestion.22. J. Yoyotte, « Crocodile », dans P. Vernus, J. Yoyotte, Bestiairedespharaons, Paris, 2005, p. 209-240.23. P. Vernus, « Faucon », dans P. Vernus, J. Yoyotte, op.cit., p. 369-377.24. Je suis reconnaissante, pour ces informations sur les liens entre faucon et acacia, à A. Czajkowski, biologiste, directeur d’Oiseaux migrateurs du paléarctique occidental. Voir aussi V. Salewski, V. Martignoli, « A Ground Nest of the Lanner Falcon Falco biarmicus in Mauritania », Malimbus 27, 2005, p. 113-116.25. Cf.N. Baum, op.cit., p. 201.26. N. Beaux, « Sirius, étoile et jeune Horus », dans C. Berger, G. Clerc, N. Grimal (éd.), HommagesàJeanLeclant, BdE 106/1, 1994, p. 61-72.27. N. Beaux, op.cit., p. 69-70.
Sopdouetleroi 21
Spécim
en au
teur
Comme on l’a mentionné, le nom de Spdw n’est jamais écrit avec ce seul signe du triangle dans les Textes des Pyramides. Il s’agit donc bien chez Pépy Ier de Spd et non de Spdw. D’autre part, Spd, au § 458a (Spr. 302), apparaît chez Ounas avec le déterminatif de l’étoile. Il est donc clair que « Spd » est une étoile et que dans le § 1863b l’astre Spd et le dieu Spdw sont équivalents. Spdw est donc également vu comme l’astre Spd, mais dans quelle perspective ?
Les mentions de Spdw se font dans un contexte résolument solaire, on l’a vu en particulier dans la litanie inscrite dans l’axe du passage de la chambre funéraire vers l’antichambre, litanie commençant par une invocation à Rê et culminant par une double invocation axiale à Sopdou. Le roi est assimilé 28 ou associé à Sopdou, qui est son père 29 ou son frère 30. Ce contexte solaire, lié à des textes d’ascension, fait surgir l’image de l’éclat salvateur de l’étoile, seul astre visible dans la lumière répandue à l’aube par le soleil, et tisse une métaphore stellaire évoquant l’apparition radieuse, puissante, efficace, du souverain, métaphore nouée autour du radical spd, « efficace, acéré, pointu » que l’on retrouve dans le nom de l’astre Spd et celui du dieu Spdw :
Pr=k r=sn ȝḫ=tj spd=tj m ms t(w)t, m ms t(w)t m rn=k pw n Spdw
Tu t’élèveras vers eux puissant, efficace, comme un parfait enfant, comme un parfait enfant,En ce tien nom de Sopdou (§ 1534bc – Spr. 578) 31.
Mais revenons à la face nord de l’antichambre, celle sous laquelle doit passer le roi pour atteindre, par le couloir, la sortie de la pyramide. Cette face débute avec le § 458a (Spr. 302) :
Sbš p.t ʿnḫ Spd n Wnjs js ʿnḫ sȝ Spd.t
Que le ciel s’éclaircisse, que Sirius-Spd vive, car Ounas est le vivant, le fils de Canis major-Spd.t !
Gravé sur la première colonne de la face nord de l’antichambre, ce texte indique donc, dès le début, que le thème de Sirius est fondamental pour la résurrection du roi. L’aube naissante et l’assimilation du roi à l’étoile sont évoquées, invocation nouant Ounas et l’astre en une même incantation de vie, appelant le souverain à apparaître en son lever héliaque au sein de la constellation Canis major (Spd.t). Or, c’est justement ce thème qui est repris au milieu de la face, au-dessus du passage vers la sortie, dans le texte que nous avons déjà mentionné, § 480d (Spr. 306) : il s’agit de son ascension au ciel, le roi est adoré comme Sopdou, et nous ne sommes plus dans l’invocation mais dans l’acclamation de l’astre rayonnant et ascendant.
28. § 1534b-c (Spr. 578) (Pépy Ier, vestibule, paroi ouest).29. § 201c-d (Spr. 222) (Ounas, chambre funéraire, paroi est ; Pépy II, chambre funéraire, paroi sud ; Neith, chambre funéraire, paroi sud).30. § 1863b (Spr. 659) (Pépy Ier, chambre funéraire, paroi est ; Pépy II, chambre funéraire, paroi est).31. Pépy Ier, vestibule, paroi ouest. Il faut comprendre le terme de t(w)tcomme à la fois, « plaisant, agréable » et surtout « complet, achevé », donc « parfait ».
22 NathalieBeaux
Spécim
en au
teur
Au terme de son destin funéraire, que peut souhaiter le roi sinon renaître comme cette étoile, le jour de son lever héliaque, seul point lumineux à l’horizon annonciateur du soleil, porteur de promesses de vie pour les hommes par son apparition, et garant d’un monde har-monieux soumis à la Maât sous les traits de Sopdou, le dieu terrible qui écrase les ennemis jusqu’aux confins de la terre ? Voilà sans doute pourquoi la mention de Sopdou, combinant la puissance de l’évocation astrale lors de son lever à l’est du ciel et celle de la divinité redoutable, « Seigneur de l’Orient », apparaît de façon primordiale, dans la pyramide d’Ounas, puisqu’elle est inscrite dans l’axe médian des passages, au-dessus de celui menant de la chambre funéraire à l’antichambre, et de celui conduisant de l’antichambre au vestibule de sortie de la pyramide 32.
32. Nous reviendrons dans un autre article sur l’application de ce principe axial dans les autres pyramides.