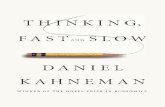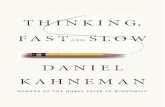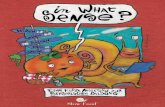Consumer Satisfaction and Dis-satisfaction with Long-haul ...
Slow food / Slow freight. Is river transport suitable for urban short-haul food supply chains ?...
Transcript of Slow food / Slow freight. Is river transport suitable for urban short-haul food supply chains ?...
1
BEYER A., LECUYER M. , “Slow food/ Slow Freight. Quel transport fluvial pour les circuits courts alimentaires ?” Colloque : Les Circuits Courts de Proximité. Renouer les liens entre les territoires et la consommation alimentaire. Colloque SFER CCP 2013 – AgroParisTech – Paris 4 et 5 juin 2013. Actes en cours de publication.
SLOW FOOD/SLOW FREIGHT.
LE TRANSPORT URBAIN PAR VOIE D’EAU, VITRINE OU FENETRE DE TIR POUR LES
CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES ?
SLOW FOOD/SLOW FREIGHT. IS RIVER TRANSPORT SUITABLE FOR URBAN SHORT-
HAUL FOOD SUPPLY CHAINS ?
Résumé
La voie d’eau apparaît aujourd’hui comme un vecteur logistique opérationnel dans
l’approvisionnement alimentaire des centres urbains. En témoigne le service fluvial développé à
l’automne 2012 pour la desserte des magasins Franprix du centre de Paris. Cette actualité met aussi en
lumière des initiatives, qui, bien qu’encore encore rares, intéressent pleinement les circuits courts
alimentaires qui souffrent d’une moindre efficacité logistique. Sur un système de valeurs communes,
leurs promoteurs ont en effet privilégié le mode fluvial pour des raisons environnementales ainsi que
pour la qualité des relations humaines qu’il offre. Si leur démarche s’inscrit dans le champ de
l’économie sociale et solidaire, leur modèle économique reste encore très fragile . Au-delà de l’analyse
détaillée des exemples que propose l’article, l’intérêt des circuits alimentaires courts « mouillés »
révèle le potentiel polyfonctionnel des voies d’eau urbaines et ouvre des perspectives plus larges sur la
cohérence urbaine et sociale de la ville durable.
Mots – clés : circuits-courts alimentaires, transport fluvial, économie fluviale, report modal, marché,
logistique urbaine
Summary
The recent development of containerized river transport in French urban logistics (i.e. the Franprix
experience in Paris in 2012) shed light on a still marginal offer which combines short-hauls for food
supply chains with river transport. Only very rare cases could be identified in France that are
thoroughly analyzed. Their promoters clearly prioritize environmental and social benefits instead of
financial profitability, so that the various models are still experimental and economically uncertain.
They strongly rely on a social and solidarity economy. In a broader perspective, emerging services
reveal the richness and versatility of urban waterways and their capacity to be used within new
logistical schemes. They also can be regarded as an interesting attempt to question the urban and
social coherence of the sustainable city.
Keywords : short-haul food supply chains, river transport, river economy, urban freight, modal shift
JEL : R410 L260
2
La question de l’usage des voies d’eau comme support à des circuits-courts alimentaires est à la
croisée des réflexions actuelles sur la logistique urbaine et sur la « réappropriation de la
question alimentaire » (Amemiya, 2011), sur fond de crise écologique. A bien des égards, les
quais ou la voie fluviale peuvent apparaître comme des lieux de vente originaux, qu’ils soient
permanents (les bouquinistes à Paris) ou temporaires (marché flottant « Little Venice » à
Londres avec vente de livres, vêtements et bibelots ; marchés des produits du Sud-Ouest à Paris
sur les quais près de Notre-Dame), voire très ponctuels (animation marketing nocturne d’Ikea
sur le canal Régent à Londres). Il faut cependant aller en Asie du Sud-Est (Inde, Thaïlande,
Indonésie, Vietnam) pour trouver de véritables marchés flottants avec un usage des voies d’eau
comme support à des circuits-courts alimentaires, bien que le sens premier de certains de ces
marchés flottants soit désormais oblitéré par le tourisme de masse, comme à Damnoen Saduak
(à une cinquantaine de km de Bangkok) en Thaïlande. Il ne faut pourtant pas nécessairement
aller aussi loin pour goûter à ce tableau pittoresque. En Europe, Venise semble être restée la
seule ville à offrir le spectacle de maraîchers venus du continent vendre leur production. Cette
pratique tient surtout au coût prohibitif des locaux commerciaux que préemptent les
commerces tournés sur le tourisme. Si le marché sur l’eau du quartier de Saint-Leu à Amiens
accueille bien chaque semaine les productions des hortillonnages locaux, les maraîchers ne
prennent plus qu’une fois par an leur barque pour approvisionner la ville dont ils sont devenus
l’emblème. Les circuits alimentaires des villes étaient jusqu’il y a deux siècle largement assurés
par voie fluviale (Bakouche, 2000). Le long des quais, de nombreux marchés, souvent spécialisés
s’y succédaient. Ils se sont effacés avec l’avènement du chemin de fer, ne laissant dans la
mémoire urbaine que des noms et des images qui rappellent mal l’intense activité des berges.
De manière encore très timide, mais très prometteuse, l’intérêt grandissant des consommateurs
français pour les circuits alimentaires courts - 6 à 7% achats alimentaires en France (ADEME,
2012) - et l’intérêt croissant des villes pour leurs berges assure une conjonction favorable à la
redécouverte de l’approvisionnement fluvial des villes (Fluide, 2013). Car si les circuits courts
valorisent l’origine des produits, ils accordent souvent une trop faible place à l’efficacité
logistique (Blanquart et al., 2009) (Messmer, 2013). Aussi les coûts environnementaux de
transport peuvent-il obérer l’avantage écologique de leur production (CGDD, 2013). Certaines
expériences, surtout parisiennes il est vrai, ont été très médiatisées car elles renforcent l’image
de circuits résolument alternatifs. Au-delà de ce succès d’estime qu’en est-il vraiment ? Le
fleuve offre-t-il une alternative économiquement et écologiquement pertinente pour
l’approvisionnement alimentaire des villes ? Quelle est la réalité de cette offre existante en
France, quels en sont les acteurs et les ressources mobilisées ?
Bien qu’encore marginales, le renouveau de telles pratiques commerciales contribue à réanimer
les quais fluviaux et ainsi à ré-urbaniser le fleuve et l’usage de la voie d’eau, ce que Bernard Le
Sueur synthétise avec le mot-valise de flurbanisme (Le Sueur, 2012). Notre échantillon compte
en effet à peine cinq entreprises qui croisent l’offre de circuits courts alimentaire et le recours
au transport fluvial. Parmi elles, une est encore à l’état de projet, bien que son lancement soit
3
imminent. Nous avons en revanche écarté les manifestations qui ont pour cadre les quais
fluviaux mais qui ne recourent pas au transport fluvial (comme par exemple à Paris, le Marché
du Sud-ouest sur le quai de la Tournelle, ou les péniches amarrées au port de Suffren au pied de
la Tour Eiffel). En revanche, des mentions complémentaires pourront être faites des projets
urbains sur les quais, soutenus par les autorités portuaires comme la Maison du quai des
Célestins à Paris. L’analyse proposée ici portera dans un premier temps des pratiques et des
projets de natures très différentes dans l’organisation des circuits, la nature des produits et les
acteurs qui en sont à l’initiative. Un second point entrera plus en détail dans les éléments
techniques qui caractérisent cette offre avec une attention particulière sur le modèle
économique et partenarial mobilisé. La troisième partie assure une lecture territoriale de
l’usage polyvalent accordé au bateau dans la structuration de l’offre. Une quatrième et dernière
partie envisagera les conditions d’un développement viable de cette activité. La recherche
s’inscrit dans une démarche plus vaste menée dans le cadre de l’ANR Fluide (FLeuve Urbain
Intermodal DurablE) réalisée à l’IFSTTAR qui porte sur l’évolution de la fonction portuaire et
fluviale dans les logistiques métropolitaines (http://www.inrets.fr/les-partenariats/sites-web-
projets-de-recherche/fluide/accueil.htm).
1. Les acteurs
L’idée de reconnecter les territoires urbains à leur voie d’eau pour la distribution de produits
alimentaires cultivés à proximité est partagée par différentes catégories d’acteurs, allant de
l’architecte visionnaire au transporteur fluvial pragmatique, en passant par des groupes de
consommateurs inscrits dans des réseaux alternatifs. Chacun définit un type d’approche
spécifique mais complémentaires que nous pouvons désigner sous l’angle de la prospective, de
l’expérimentation ou de pratiques émergentes, entrée que nous privilégierons.
Les réflexions d’architectes et de designers autour de la ville de demain peuvent alimenter notre
imaginaire sur l’importance que pourrait éventuellement prendre les circuits-courts fluviaux
dans une « ville-nature ». Sous l’appellation « d’Ekovores » deux designers (cabinet Faltazis, cf.
Fig.1) ont conçu un système d’économie circulaire pour l’agglomération nantaise : fermes
ramenées plus près de la ville, voire en ville avec installations de serres tunnels sur les berges de
la Loire et de jardins familiaux flottants pour impliquer les riverains du fleuve dans la culture
maraichère, développement de « barges marchés » qui se déplaceraient de point de vente en
point de vente, entre ces jardins, les fermes périurbaines et les consommateurs. De
nombreuses écoles d’architecture font réfléchir leurs élèves sur la ville de demain. A Paris c’est
notamment le cas dans le cadre des projets pour « Paris 2030 ». Des marchés flottants y
apparaissent, comme en témoigne par exemple le « MarchéO » de l’Ecole nationale Supérieure
4
de Création Industrielle « proposant aux maraîchers de vendre sur les barges leurs produits qui
seront acheminés dans différents lieux de la ville ».
Figure 1. Les barges-marchés (source Agence Faltazis)
La réalité rappelle cependant qu’il y a très peu de projets en fonctionnement aujourd’hui
mettant en lien circuits-courts et voie d’eau. Les seuls projets existants sont marginaux en
termes de tonnages. Pourtant ils ne sont pas dénués de succès auprès des consommateurs,
voire de succès médiatique comme en témoigne les nombreuses apparitions dans les médias du
Marché sur l’Eau à Paris. Les initiatives existantes ou en phase de démarrage sont toutes
privées, à la différence de la Thaïlande où ce sont les autorités publiques qui ont par exemple
décidé de la création du marché flottant de Klonghae en 2008 avec un double objectif
économique et environnemental (Buakwan et Visuthisamajarn, 2012). Mais l’intérêt des
collectivités, notamment parisiennes pourrait rapidement faire évoluer cette donnée et donner
suite aux expérimentations déjà réalisées ponctuellement (cf. Marché flottant quai Henri IV en
2011).
Le nombre très réduit d’entrepreneurs à s’être effectivement lancé dans une offre de transport
fluvial pour les circuits courts alimentaires rend possible une présentation détaillée des acteurs.
Il fragilise toutefois les généralités avec cinq micro-entreprises qui n’occupent cette activité
parfois qu’à temps partiel (2 cas) et des projets encore non encore réalisés (1 cas) (cf. Tableau
1). A notre grande surprise, le champ d’étude reste donc confidentiel alors même que l’intérêt
pour la voie fluviale en milieu urbain gagne en reconnaissance et que les circuits courts sont de
leur côté en plein essor. Lors de nos entretiens nous avons pu ressentir une certaine retenue de
la part de nos interlocuteurs, à la fois pour des raisons de confidentialité concernant une activité
commerciale mais peut-être plus encore par crainte d’une « récupération » liée à la diffusion de
pratiques acquises au bout de plusieurs années d’expérience et qui pourraient être utilisée à
l’encontre des valeurs défendues par leurs promoteurs, à savoir l’importance accordée au
contact personnel direct et à l’échelle humaine des échanges. Cette attitude résulte aussi de
l’incompréhension des grandes administrations publiques trop peu attentives à ces pratiques
5
émergentes et dont le potentiel a sans doute été sous-estimé, que ce soit VNF, les autorités
portuaires ou municipales amenant à composer avec des cadres réglementaires rigides, des
aménagements fluviaux et portuaires souvent inadaptés. On peut à titre d’exemple citer
l’autorisation très encadrée des transactions commerciales sur les quais. Le statut de
transporteur fluvial est nécessaire pour assurer cette prestation et constitue en retour un garde-
fou à des pratiques plus commerciales. L’intérêt et la bienveillance des autorités portuaires
semblent donc indispensables dans une phase de développement ultérieur.
Les entretiens menés soulignent la dimension souvent plus militante qu’entrepreneuriale des
projets portés, parfois de fort longue date. Toutefois si un des acteurs a souhaité que le nom de
son entreprise ne soit cité (il sera désigné par CC1 dans le texte), la majorité dispose d’une
couverture médiatique non négligeable et leurs porteurs se sont montrés plus enclins à révéler
les divers aspects de leur activité. Leur développement repose toujours sur des convictions
fortes qui impliquent un choix de vie exigeant, en accord avec la défense de valeurs sociales et
existentielles, souvent critiques vis-à-vis des modes de vie et de productions industrialisées. La
plupart des projets sont en lien direct avec des logiques agricoles qui se veulent durables, soit
peu intensives, soit bio. Pour Marché sur l’Eau, il y a eu cependant une grande difficulté à
trouver des producteurs bio (du coup les produits vendus ne sont pas forcément bio et
l’association a poussé les producteurs choisis vers une agriculture raisonnée sur la base d’une
«charte des producteurs»). Le lien avec une agriculture durable est donc fortement ancré dans
la démarche effectuée et il est intéressant de voir à ce titre l’inflexion que souhaite donner
Marché sur l’eau aux méthodes productives de ses fournisseurs. Tous ces projets mettent en
avant les avantages écologiques du transport fluvial (qui devient ainsi « labellisé » de manière
concrète comme souhaite le faire Alizarine par une étiquette qui serait apposée sur chaque
produit).
Le transport fluvial qui est un autre lien avec la nature est ainsi un étendard pour démontrer
qu’une alternative d’une production et d’une distribution respectueuse des hommes et de la
terre est possible. Elle est fondée sur des valeurs en rupture avec les références courantes du
monde de l’entreprise contemporaine, celui de la vitesse et de la rentabilité. La multiplicité des
tâches à accomplir (transport, commerce, communication, gestion) est lourde d’autant que les
faibles marges ne permettent guère de déléguer des fonctions à des tiers. Elles sont alors
assurées par un nombre réduit de personnes, et souvent par une seule. Plus qu’à un métier, ce
type d’activité économique correspond donc à un engagement personnel fort. Les
entrepreneurs enquêtés sont très proches des mouvements productifs alternatifs qui entendent
se réapproprier les traditions que les acteurs du secteur de la batellerie et de l’agriculture
paysanne, poussés par l’environnement socio-économique global concurrentiel, ont eu
tendance à délaisser. Mais c’est avant tout des trajectoires et des motivations personnelles qui
les ont conduits à inventer un service inédit, dont ils sont conscients d’être les précurseurs. Tous
ne sont pas issus du transport fluvial, comme Claire-Marie Hue formée au design industriel,
présidente fondatrice du Marché sur l’eau qui approvisionne le nord de Paris en produits de
maraîchage, Philippe Testut viticulteur à Chablis et Elio Achache, graphiste (La Cave vagabonde)
6
ou Jean-Marc Samuel (Vivre le canal) ancien menuisier, puis animateur culturel du canal du
Midi, amoureux des bateaux et de la batellerie de ce réseau. Dans leur parcours, le recours à la
voie d’eau est avant tout un élément qui fait sens dans un système de valeur plus large, à la fois
sur le plan personnel et sociétal.
Le statut juridique oscille entre formule associative et pette entreprise mais toutes ces
initiatives partagent un « esprit » commun qui s’apparente de près ou de loin à l’économie
sociale et solidaire. Le degré associatif fait par exemple intervenir le bénévolat de manière
importante, tant pour des raisons financières que comme valeur recherchée pour elle-même
(convivialité). La dimension humaine se manifeste aussi par le dialogue entre les acteurs de la
chaine, par la qualité de la relation souhaitée avec les producteurs et par l’engagement
commun des consommateurs. Cet engagement est d’ordre opérationnel, avec une dimension
d’ailleurs Marché sur l’Eau a repris aux Amap le principe d’abonnement des consommateurs à
un certain nombre de paniers. Mais il est aussi militant. Les prix de vente, qui peuvent être
légèrement supérieurs à ceux d’un marché classique, sont aussi l’expression de la
reconnaissance par les consommateurs de « l’utilité sociale » des achats (Chiffoleau et Prévost,
2012). Cette vocation sociale s’exprime aussi chez Marché sur l’Eau par la revente des invendus
de l’étal à prix coûtant à des associations caritatives (Messmer, 2013). De manière générale et
quel que soit le statut juridique, l’enjeu n’est pas seulement l’adhésion à une agriculture sans
chimie ou à un mode de transport alternatif à la route, mais aussi le retour à une échelle
humaine et agréable. L’importance des données interpersonnelles se retrouve aussi dans le
financement, puisqu’il s’agit de composer avec des moyens limités et pour ce faire associer des
partenaires (producteurs ou consommateurs) dans l’entreprise en recourant notamment au
crowdfunding dans la mesure où il s’agit d’un financement participatif sans intermédiation
financières ou bancaires avec pour objectif plus de souplesse et d’indépendance. Le
recoupement et l’interconnaissance des acteurs structure ainsi un véritable territoire (cf. Fig.2).
2. Les produits, les échelles
Les déplacements du bateau varient entre circuits géographique longs/livraison annuelle (la
notion de circuit-court prévalant toujours au niveau économique par la suppression
d’intermédiaires marchands – cas des Amap), et circuits géographique courts (intrarégionaux
voire interrégionaux proches), associés avec des principes de vente « à la volée » en n’importe
quel lieu de la voie d’eau, ou plus généralement pour la Cave Vagabonde et Marché sur l’Eau, en
des lieux multiples mais prédéfinis à Paris, avec des horaires dédiés publiés sur internet. Les
produits transportés varient entre produits secs ou conditionnés (jus de fruit, vin, miel, etc) pour
les trajets longs et produits frais (légumes) pour les trajets plus courts. Pour ces derniers,
l’existence d’un circuit-court géographique évite les éventuelles cueillettes de produits non
matures qui seraient ensuite transportés réfrigérés puis gazé à l’ethylène. Le possible gain
d’énergie par rapport à un transport long se double donc de celui du problème de la
conservation requise pendant un transport long, sans compter les économies d’emballages qui
deviennent superflus. Le système de transport repose fondamentalement sur le principe d’une
boucle fluviale qui relie un bassin de production à un bassin de consommation généralement
7
urbain pour y approvisionner les consommateurs en produits qualitatifs, majoritairement issus
de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Ce qui change entre les opérateurs
c’est l’échelle, celle du temps de parcours, la longueur de l’itinéraire et le nombre de haltes. Les
fournisseurs sont sélectionnés par connaissance interpersonnelle sur la base de l’orientation
productive. Même dans un échantillon aussi restreint, on a tenté de distinguer plusieurs sous-
systèmes qui mettent en jeu plusieurs orientations :
- Le circuit local est illustré par le Marché flottant dans le nord de Paris qui emprunte 30 km du
canal de l’Ourcq parcourus en 6h. Il s’agit d’un transport de légumes sur des barges de très
faible capacité. Les livraisons ont lieu le mardi et le samedi et les paniers de légumes peuvent
être retirés à Pantin ou Bassin de La Villette deux fois par semaine. L’engagement des adhérents
porte sur la livraison de 10 paniers pour 15 semaines. Aujourd’hui, les 200 membres de
l’association réceptionnent chaque semaine environ 140 paniers. Depuis 2012, la gamme de
produits végétaux s’est enrichie d’une offre de bière produite artisanalement sur les rives de
l’Ourcq.
- Les circuits régionaux (Vivre le canal sur le canal des Deux Mers de Bordeaux à Sète, avec
quelques voyages à Marseille, Lyon et jusqu’à Bordeaux – La Cave vagabonde active sur le
réseau de l’Yonne et de la Seine et de plus en souvent présente à Paris dans le bassin de La
Villette suivant des boucles initialement prévues pour un mois). Les embarcations sont ici
adaptées à des parcours plus longs et d’emport moyen, capacité de navigation contraintes par
le gabarit (Vivre le Canal) ou choix, multiplication de haltes intermédiaires, ventes directe et
animation. Les acteurs privilégient ici la promotion et l’animation. Le choix régional peut être
imposé par la gamme des produits, notamment le vin, indéniablement le produit caractérisant
le mieux l’ancrage local et qui véhicule en outre l’image de qualité. C’est assurément celui qui
offre le moins de risques commerciaux et pratiques. Son offre peut être complétée par d’autres
produits caractérisés par une bonne conservation.
- Le circuit interbassins concerne là encore les produits de plus longue conservation permettant
d’envisager des transports de plusieurs semaines, à l’échelle nationale. Tel est le cas de CC1
dont l’itinéraire fluvial relie Béziers à Paris par des canaux secondaires. Le voyage annuel prend
trois semaines et dessert divers points de livraison le long de l’itinéraire pour desservir les
AMAP partenaires. Celle-ci offre une palette variée : huile d’olive, vins, cassoulet, riz et sel de
Camargue, jus de fruits, anchois de Collioure, conserves artisanales, fromages, miel, riz, savon
de Marseille, produits d’entretien labellisés écocert, cosmétiques. Les produits sont récupérés
lors du passage programmé du bateau. Pour suppléer l’espacement entre deux livraisons et
pour atteindre les volumes minimaux requis, les AMAP peuvent être amenés à établir des stocks
collectifs temporaires. Dans ce modèle, le batelier se positionne bien comme transporteur et
non comme un revendeur comme dans le cas précédent. Cela ne l’empêche d’ailleurs pas de
soutenir des actions culturelles ou de prendre et d’être accompagné dans son périple par un
bateau hôtel qui prend à son bord des passagers pour des courts séjours sur une partie du
trajet.
8
La géographie de l’offre souligne l’importance du pôle parisien dans les initiatives et comme
pour le marché. L’absence du Nord peut étonner où existaient un lien historique à la fois des
marchés d’approvisionnement urbains de proximité en produits frais et le recours à la voie
d’eau est contrebalancé par la présence du Sud. Les marchés urbains (cf. Fig.2) ne sont pas
forcément les seuls porteurs et souvent les haltes intermédiaires dans des communes rurales du
parcours s’avèrent intéressantes.
Figure 2. La Caroline (Cave Vagabonde) à quai, bassin de La Villette (juin 2013)
9
Figure 3. Les composants techniques et économiques des circuits courts fluviaux
Entreprise
(date de création)
Statut Nombre
d’actifs
Partenariat avec
les collectivités/
associations
Composante
économique
Bateau et capacité
Alizarine
(en projet) SCOP (Société Coopérative Ouvrière de Production)
Sans objet Région Rhône-Alpes, Départements de l’Ardèche et de la Drôme, Cigale
1
Transport et stockage de vin – animation
380 t Grue de levage à bord et pour assurer l’autonomie sur les sites de livraison
Cave
vagabonde
(2011)
SARL 70 particuliers associés
2 salariés Principe d’un caviste avec des remises qui permettent d’offrir des prix proches de ceux proposés au domaine.
Poids de 20 t pour 10 t charge utile 14,9 m x 3,5 m tirant d'eau de 80 cm et un tirant d'air de 3 m.
Marché sur
l’eau
(2011)
SCIC (Sociétés coopératives d'intérêt collectif) – siège Paris 20ème
3 salariés Divers partenaires (voir Figure 1, infra)
Equilibre avec 350 paniers (pas atteint en 2012). Accord de production avec trois agriculteurs de la Seine et Marne (Claye-Souilly)
Barge ostréicole adaptée, charge utile max. 5 t. Tirant d’eau 80 cm.
CC1
(NC) NC NC NC Les prix sont ceux
des producteurs, augmentés uniquement du prix du transport. Les commandes sont gérées par les AMAP partenaires.
Usage à la morte-saison d’un bateau de croisière qui accueille des scolaires sur le canal des deux mers le reste de l’année.
Vivre le canal
(2011) Société Fret Sud (Jean-Marc Samuel) - 2011, La SAS l'Équipage rachète 49% du Tourmente et en devient le copropriétaire. L’acquisition de parts est ouverte au public
1 personne Fédération des Mouvements Ruraux de l'Hérault
Multi-activités (actions culturelles et économiques dans le but de développer la vie sur le canal du Midi).
3. Des fonctions fluviales qui dépassent le transport
De manière générale, la cale des bateaux est largement surdimensionnée pour l’usage de
transport assuré. Marché sur l’eau qui a acquis un chaland ostréicole d’une capacité d’emport
de 5 t prend à son bord 2 t de légumes à la densité bien moindre que les casiers à huîtres. La
Caroline charge à son bord 3,5 à 4 t de vin (soit environ 3000 bouteilles) à chaque voyage pour
un potentiel de 10 t que permettrait la péniche. Le constat est similaire pour Le Tourmente
(Vivre le canal) qui est loin de saturer un potentiel de 140 t (180 t sur le canal latéral à la
1 Club d’investisseurs pour la gestion alternative et locale d’épargne solidaire
10
Garonne) pour 250 m3. Sa cale est ainsi valorisée par une exposition sur la mémoire des
mariniers du Canal des deux Mers. Sur son itinéraire entre Béziers et la capitale, le bateau de
CC1 exige un chargement de 20 t pour entrer dans ses frais, tonnage semblerait avoir atteint
les 30 t, ce qui reste loin de son emport maximal. Enfin l’Alizarine, une unité Freycinet permet
un chargement de 380 t aura peu de chance d’être atteint une fois le projet lancé. Bien que la
densité des marchandises soit plus faible que les vracs pour lesquels ils ont été conçus, ces
bateaux sont loin d’atteindre leur chargement optimal. Dans ces conditions, le bilan
énergétique est lui aussi loin d’être aussi flatteur qu’il peut y paraître à première analyse.
L’absence de chargement de retour et une motorisation souvent ancienne assombrit encore le
bilan. Dans son projet, l’Alizarine annonce l’adoption d’un système qui réponde aux normes
environnementales actuelles de même que l’embarcation des Marché sur l’eau devrait
bénéficier d’une remotorisation au biogaz.
Même limitées, les aires de ramassage et de distribution des marchandises supposent des
acheminements. Toutefois, en milieu urbain mouillé, l’avantage du bateau est de permettre
une desserte multi-points (exemple de Marché sur l’eau avec deux points de livraison
réguliers), ce qui en théorie, doit permettre de s’approcher au plus près de différentes aires
de marché, comme c’est le cas dans les arrondissements du nord-est parisien desservis par les
canaux. Le soucis d’atténuer le lien routier est aussi présent en amont, comme en témoigne
l’exemple de CC1 une AMAP partenaire précise que « pour transporter les produits d’entretien
de Marseille au point de chargement de la péniche, près d’Arles, il a été choisi de faire appel à
l’association "Roulemafrite" qui fait rouler des véhicules avec de l’huile de friture récoltée
auprès des particuliers et des restaurants Marseillais et filtrée des impuretés.» 2
. Au final, seul
un bilan environnemental systématique permettrait de fournir des conclusions plus
prononcées. Une démarche de bilan carbone est d’ailleurs en cours chez Marché sur l’eau. En
attendant, retenons que l’intérêt majeur de ces initiatives est au minimum de poser la
question du transport dans le cadre de circuits courts.
Le potentiel d’emport du bateau offre assurément bien d’autres avantages. D’abord celui du
stockage à moindre coût dans des espaces urbains centraux. Ensuite, les conditions du
transport et de l’entreposage peuvent eux-mêmes être un argument en soi. Le transport par
voie d’eau garantit un plus grand respect pour des marchandises fragiles en évitant les chocs
et les vibrations. Pour les légumes des Marché sur l’eau, la livraison directe évite le
conditionnement et le transport sous température dirigée qui peut porter atteinte au goût des
aliments. De son côté, Alizarine entend investir dans une « cale isolée, étanchée, climatisée
afin de garantir une maitrise de la température et de l’hygrométrie tout au long du voyage ».
Si l’entreposage qui n’est pas possible à bord, il peut être improvisé à terre, comme c’est le
cas de Marché sur l’eau qui compte sur le soutien de certains partenaires. La cale de la Cave
vagabonde, qui plonge dans l’eau atténue les amplitudes thermiques et permet de conserver
le vin dans de très bonnes conditions.
2 Les Lapereaux des Thermopyles, http://amap-lapereaux.org/content/blogcategory/33/39/ (consulté le
21/5/2013)
11
La fonction de transport n’est donc exclusive que dans deux cas. Comme fonction intégrée à
l’offre pour les Marché sur l’eau. En tant que prestation par un batelier indépendant pour CC1.
Le bateau s’avère être un support à d’autres services. Il y a d’abord la fonction commerciale
où la cabine est aménagée en point de promotion et de vente. S’y effectuent la réception de
la clientèle et la dégustation des produits dans une cabine aménagée à cet effet. Au-delà du
seul lieu de vente, la Cave vagabonde assure à bord des dégustations de produits du terroir en
soirée, sur la base de réservation. On n’est plus très loin du bateau un débit de boissons,
comme il en existe fréquemment dans les villes fluviales qui alignent des bateaux-cafés.
Pontés, les bateaux permettent enfin de recevoir du public dans le cadre d'événementiels à
quais.
L’arrivée du bateau est ainsi l’occasion de créer l’évènement. Il y a d’abord la dégustation et la
vente de produits locaux. Dans les cales du Tourmente, l’association Vivre le canal a installé
une exposition permanente sur la mémoire des bateliers du Canal du Midi qu’elle ouvre
régulièrement au public lors des haltes. L’animation peut se prolonger par de la musique ou la
projection d’un film en plein air, si possible sur un thème fluvial. D’août à octobre, différentes
étapes ponctuent l’itinéraire et peuvent compter sur le bon accueil des municipalités et le
soutien local du Mouvement Rural de l’Hérault et l’Aude. L’activité de transport est
partiellement équilibrée par des activités annexes. Cela passe par l’animation de vente et de
promotion avec l’appui des producteurs agricoles locaux et surtout depuis une dizaine
d’années, avec l’accompagnement estival du Festival Convivencia « passerelle de culture » le
long du canal du Midi (Fig.4). Dans cadre d’ « un festival naviguant », le bateau constitue pour
quelques soirées une scène itinérante ouverte à divers groupes de musique du monde avec le
soutien de divers partenaires économiques et institutionnels. Le bateau accueille enfin des
rencontres-débats sur les thèmes de la culture locale et de la production alternative.
Figure 4. Les animations estivales sur le Canal du Midi (source Convivencia)
Dans le projet de l’Alizarine, le transport fluvial doit offrir l'occasion à des producteurs ou à
des acteurs de la filière viticole de disposer d’une vitrine remarquable au cœur de grandes
villes, notamment lors d’événements festifs importants : Fête des lumières à Lyon, Festival
international de théâtre à Avignon, 14 juillet à Paris, les opérations « Paris Plage » en bords de
Seine, le festival international de spectacles de rue « Chalon dans la rue ». Le prestataire
souligne bien l’intégration de l’offre et le cadre attractif et accessible que constitue l’ambiance
fluviale, à la fois au cœur des villes comme une invitation au voyage et au dépaysement. La
12
difficulté demeure d’informer l’acheteur éventuel de la présence à quai sur une base de
régularité. L’information en ligne rend bien sûr la circulation de l’information plus aisée.
Les projets portés par ces différentes entreprises ont bien en commun de mobiliser
directement les territoires locaux par la production qu’ils sollicitent et parfois même suscitent,
et par l’investissement des consommateurs à l’autre bout de la chaîne qui en sont les soutiens
sinon les promoteurs directs. Le marché sur l’eau en sont un bon exemple puisqu’issus d’une
demande locale ; ils peuvent compter sur un réseau d’entraide de bon voisinage, des
commerces et cafés qui leur apportent un soutien (stockage temporaire, reprise des invendus
pour l’élaboration de repas par des restaurants proches). Les paniers non retirés par les
adhérents sont données à des associations de quartier. Il y a donc bien des liens territoriaux
qui se tissent autour de cette prestation. La transaction elle-même devient un lieu
d’animation des quais, souvent élargie à une dimension culturelle effective (dégustation des
produits, théâtre, spectacle, concert), où le bateau joue véritablement le rôle de scène. C’est
d’ailleurs souvent la nécessité d’équilibrer son budget qui pousse le marinier à tirer
pleinement parti de l’offre événementielle. Il y a alors de fait une situation où le bateau est en
quelque sorte urbanisé dans la mesure où sa fonction première doit s’accommoder des codes
et des attentes propres aux populations urbaines. Comme le cadre des quais il tend à devenir
un espace récréatif.
On voit bien que ce qui caractérise le bateau est sa polyvalence fonctionnelle ( à laquelle il
faut bien sûr ajouter la fonction de logement !) où le transport n’est plus forcément l’élément
majeur, même s’il reste indispensable car donnant du sens et de la crédibilité au schéma
d’ensemble. Les ports, du moins dans les lieux centraux, pourraient endosser le rôle
d’organisateurs de marchés paysans et ainsi cristalliser l’émergence d’un lieu qui peine à
s’inscrire clairement dans l’espace urbain. Cette localisation fluviale fait sens et devrait donc
être considérée avec attention dans les réaménagements actuels et futurs des quais centraux.
Elles permettraient de conserver, ou de promouvoir un usage de la voie d’eau. L’activité elle-
même reste très légère sans occuper à plein temps le domaine. Demeure la question de
l’adaptation d’accueil du public et les conditions d’accès. Cet effet de vitrine qui s’applique au
port comme aux produits est aujourd’hui à peine esquissée et pose la question de la
possibilité même de pérenniser et de développer cette option.
4. A quelles conditions un modèle alternatif d’un marché « flottant » est-il envisageable ?
Les exemples analysés soulignent bien que le recours au bateau pour le transport de circuit
court n’est pas pour le moment à envisager tant qu’activité exclusive. L’intérêt réside en fait
largement dans la polyvalence qu’offre le bateau en milieu urbain et l’image qu’il véhicule. On
peut considérer deux grands types de circuits logistiques. L’avantage du transport fluvial est
plus marqué pour des distances courtes et les produits frais dans la mesure où la capacité du
bateau correspond aux besoins d’emport comme c’est le cas pour Marché sur l’eau. En
13
revanche, dans les échanges interbassins, le faible taux de remplissage alourdit de fait le bilan
carbone souvent affecté par une motorisation ancienne. Cette évaluation ne résulte que d’un
constat actuel qui est appelé à évoluer de manière positive dès lors que le système se
stabilisera et pourra accroître les volumes concernés.
La lenteur du transport impose le choix d’aliments bénéficiant d’une bonne conservation et
souvent à forte valeur ajoutée (vin, fromages et les salaisons, miels etc.). Ils peuvent être
accompagnés le cas échéant d’autres produits de consommation qui viennent diversifier
l’offre. La lenteur du transport en renchérit le coût du fait de la main d’œuvre. Aussi ce type
de prestation est-il souvent peu compatible avec un main d’œuvre salariée et intervient en
complément d’autres activités, notamment dans les temps morts de la saison touristique.
L’intérêt du bateau repose alors sur la polyvalence de sa fonction dans l’espace urbain, où il va
servir tout à la fois de vitrine, de lieu de stockage et d’accueil de la clientèle et de logement, à
un coût nettement inférieur à celui pratiqué dans ces espaces urbains centraux. Les ressources
culturelles associées au bateau viennent renforcer son rôle d’animation et son attrait
commercial.
Pour tirer pleinement du potentiel d’emport qu’offre le transport fluvial, le principe d’une
structuration combinée des demandes s’impose. D’abord par rapport à la demande des
chargeurs, commerces, consommateurs et leurs regroupements. D’une part, on pourrait
reprendre le principe de la Ruche qui dit oui à une échelle plus large avec le déclenchement
d’une livraison groupée sur la base d’engagement quantitatif dès qu’un volume (en tonnage
ou en valeur est atteint (principe retenu par CC1). Toutefois, cette démarche n’est pas
forcément compatible avec la régularité que suppose une transaction de type de marché.
Peut-être convient-il alors d’envisager des lieux d’entreposage intermédiaires bord à voie
d’eau, vers lesquels pourraient alors converger différents types de circuits et offrir une
pérennisation de l’offre tout en favorisant l’interconnexion des circuits et l’éventuel échange
entre transporteurs dans la mesure. Ces différents types de circuits, par la diversité des
produits qu’ils offrent sont de fait complémentaires et pris ensemble sont en mesure de
structurer l’attractivité d’un lieu en bord à voie d’eau. Il s’agit en quelque sorte d’un potentiel
d’agglomération qui permettrait de dépasser son caractère d’hyper-niche. On pourrait dès lors
imaginer dans un contexte fluvial dynamique la structuration d’un véritable marché des
« producteurs des terroirs » (qu’ils soient locaux ou plus éloignés). Regroupant en un lieu des
produits de qualité, éventuellement écolabellisés et approvisionnés par voie d’eau (cf.
Alizarine), le site pourrait fonctionner sur la base de la régularité, voire de la pérennité des
implantations (fluviales ou terrestres). Il offre des capacités d’accueil à moindre coût pour les
bateaux (avec la fonction diversifiée d’accueil, de stockage temporaire, d’exposition et de
vente). La diversité de l’offre permet de justifier des équipements spécifiques et permet de
répondre aux différentes clientèles : particuliers avec des achats ponctuels, base de remise de
commande aux membres des AMAP, relais à une distribution urbaine élargie. C’est aussi le
moyen d’articuler le modèle d’une offre itinérante avec des bateaux dévolus au seul transport
(modèle CC1) et d’autres pour lesquels la fonction est plus diversifiée (transport et lieu de
14
vente, type Cave vagabonde), voire de bateau ou de structures pérennes à quai pour
l’entreposage et la vente. Le regroupement de la demande est par ailleurs le meilleur garant
de la massification et permettrait de tirer pleinement parti du recours au fluvial. Pourquoi dès
lors ne pas imaginer à l’échelle des régions françaises mouillées et de leurs ports urbains un
échange de produits complémentaires ? Associés à des activités d’animation, cette fonction
permettrait enfin de donner vie et de valoriser les quais tout au long de la journée et de la
semaine, y associant d’autres activités, de dégustation, de restauration et d’animation
culturelle ? Cette orientation n’est au fond pas loin de celle qu’envisageait Ports de Paris avec
son projet de Maison du quai des Célestins associant un conservatoire des pratiques et des
productions régionales, un marché flottant paysan, une épicerie alimentée en circuit court, un
restaurant participatif et un potager urbain. Les autorités portuaires, gestionnaire du foncier
avec une assise économique suffisante pourraient bien sûr des éléments moteurs de cette
dynamique et les garants de sa cohérence, sans pour autant se substituer à l’initiative
associative ou privée. Reste à voir si cette approche plus étroitement coordonnée peut retenir
l’intérêt des associations et des bateliers souvent réputés pour leur indépendance ?
Conclusion
Ces quelques innovations soulignent tout le potentiel de la voie d’eau dans l’alimentation des
villes. Leur modèle économique reste encore très fragile. Bien qu’encore marginaux en
nombre et insignifiants quant aux volumes, ces développements sont riches d’enseignements
et porteurs de renouvellements potentiels. Ce sont d’abord des solutions alternatives, aussi
bien dans le choix modal que pour l’organisation commerciale et productive qu’ils engagent.
Elles intègrent explicitement le transport à d’autres fonctions dans un système global de
production et de distribution soucieux des équilibres environnementaux. Elles impliquent
encore souvent le consommateur de manière plus active (consom’acteur) et parfois même
bénévole. A travers les cas évoqués, on voit que le quai fluvial (ou son prolongement le
bateau) devient un lieu de rencontre économique où les consommateurs se rendent, à
l’inverse d’une simple fonction de transit et de stockage temporaire que revêt le port fluvial
traditionnel. Cet échange marchand revendique une dimension de socialisation explicite non
dénué d’un caractère convivial voire festif qui est un des leviers des circuits alternatifs. Le
croisement des fonctions récréatives et fonctionnelles se « nourrissent » l’une l’autre au
travers des circuits-courts par voie d’eau. Il n’est pas sans rappeler le discours émergent sur
les usages et les aménagements mixtes de la voie d’eau en ville. Il y a bien une convergence
des formes et des attentes des citadins qui ouvrent au transport fluvial de belles perspectives
d’invention et de développement. Les quais sont ainsi devenus les laboratoires sinon les
modèles d’une nouvelle urbanité. Plus qu’une coupure spatiale (qui tend au demeurant à
s’estomper), les quais marquent un rythme urbain différencié et ouvrent en quelque sorte
entre deux rives une parenthèse dans l’espace contraints de nos villes. Avec une autre valeur
15
du temps social, la mixité des fonctions revendiquée des fonctions productives et récréatives,
la voie d’eau revendique une troisième rupture, celle de renvoyer l’image concrète de circuits
lisibles (du local au local), une transparence des circulations et des origines que le chaos du
mode routier n’offre plus. Il y a bien là une montée en puissance symbolique qui fait système
et qui est peut-être le capital immatériel le plus précieux de la voie d’eau. Ainsi pour répondre
au titre de la communication, le recours à la voie d’eau est à la fois une fenêtre de tir et une
vitrine pour les circuits courts alimentaires. Pour pouvoir prétendre à l’équilibre économique,
la coordination des acteurs, au premier rang desquels l’autorité portuaire semble
indispensable, gage d’une meilleure visibilité et d’une optimisation logistique (par les volumes,
la complémentarité des flux et par la garantie de régulation que peut apporter le port). Reste
à voir si le modèle des circuits courts et la philosophie de ceux qui le portent est compatible
avec une organisation élargie. Tel est sans doute la condition d’insertion durable de la voie
d’eau dans l’approvisionnement alimentaire des villes.
Les initiatives rappellent enfin la réinvention nécessaire de la polyvalence des usages urbains
autour des voies d’eau. Alors que les ports industriels ont globalement été rejetés en dehors
de la ville et que les ports urbains subissent des pressions foncières multiples, les circuits-
courts étudiés montrent que la fonction logistique des quais ne s’oppose pas forcément à une
fonction sociale de loisir ou de détente qui est souvent mise en avant dans les politiques de
renouveau urbain autour du fleuve. Au contraire, l’usage de quais légers dans le cadre des
circuits-courts alimentaires permet cette synthèse fonctionnelle et cette rencontre urbain-
rural, ville-nature, au delà d’un simple effet de site et de paysage, par une reconnexion
spatiale au territoire urbain ouvert à ses espaces d’approvisionnement.
Références
ADEME, « Les circuits courts alimentaires de proximité », Les Avis de l’ADEME, 2012, 4 p.
Amemiya H., « Du teikei aux AMAP, le renouveau de la vente directe de produits fermiers locaux »,
Rennes, PUR, 2011, 350 p.
BESTUFS, Guide de bonnes pratiques pour le transport de marchandises en ville,
http://www.bestufs.net/gp_guide.html,
Blanquart C., Gonçalves A., La diversité de l’inscription spatiale des circuits courts, 48ème colloque de
l’ASRDLF, 6-7-8 juillet 2011, http://asrdlf2011.com.
Blanquart C., Kebir L.-Y.,Petit C., Traversac J.-B., Les enjeux logistiques des circuits courts, Rapport pour
le PIPAME, Projet INRA – INRETS, Note bibliographique, 2009, 24 p. et Rapport, 2009, 68 p.
Buakwan N., Visuthisamajarn P., « Activities Guideline of Cultural Tourism : A case study of Khonghae
Floating Market, Hatyai District, Songkhla », 4th International Conference on Humanities and
Social Sciences , April 21st , 2012 Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University.
CGED, « Consommer local, les avantages ne sont pas toujours ceux que l’on croit », Le Point Sur, mars
2013, 4 p., en ligne.
16
Chiffoleau Y., Prévost B., “Les circuits courts, des innovations sociales pour une alimentation durable
dans les territoires », Norois, n°224, 2012/13, pp. 7-20.
Fluide (Au service d'une mobilité durable : les grandes villes fluviales françaises et leur port. Étude des
ports métropolitains de Paris-Lyon-Lille-Strasbourg et perspectives internationales),
http://www.inrets.fr/les-partenariats/projet-fluide, 2013, en ligne.
Le Sueur B., Navigations intérieures. Histoire de la batellerie de la Préhistoire à demain, Chasse-
marée/Glénat, Grenoble, 2012, 239 p.
Lechner G., « Le fleuve de la ville, la valorisation des berges en milieu urbain », in Les dossiers de la
direction générale de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction, Paris, 2006, 120 p., en ligne.
Messmer J.- G., Les circuits courts multi-acteurs : Emergence d'organisations innovantes dans les
filières courtes alimentaires, Rapport INRA-MaR/S, 2013, 69p.
SUGAR, City Logistics Best Practices: a Handbook for Authorities, 2012, 276 p., en ligne.
Sites internet consultés
http://blog.appli-jardin.com/public/LOCALBIOBAG/projet_public.pdf (Maison Rouge)
www.hortillonnages-amiens.fr/evenements/marche-sur-eau.html
www.lacavevagabonde.com/
www.lesekovores.com/
www.marchesflottants.fr/
www.marchesurleau.com/
www.vivre-le-canal.fr/
www.convivencia.eu