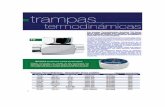Résumé des 6 TD de Psychologie clinique Licence 1
Transcript of Résumé des 6 TD de Psychologie clinique Licence 1
Résumé des 6 TD de Psychologie clinique Licence
1
TD 1
1 la psychologie cliniqueLa psychologie se décompose en racines : âme, discours, lit, on
peut donc traduire le terme par : « la science du psychisme
faite au chevet du patient ».
La démarche et la théorie s’intéressent à des sujets pris
un à uns, au cas par cas. Le sujet n’est appréhendé qu’à partir
des significations qu’il donne à sa propre histoire. La
personne est considérée comme singulière, unique et originale.
Lagache donne en 1949 la définition suivante de la
psychologie clinique : L’étude de la personne totale en
situation, c'est-à-dire l’étude de la condition humaine
individuelle et des conditions susceptibles de déterminer cette
conduite, comme l’hérédité, l’histoire de vie du sujet.
Autrement dit, elle s’intéresse à tous les secteurs de la
conduite humaine, normale et pathologique.
Il existe un clivage entre la psychologie centrée sur
l’objet (la pathologie, la maladie) ce qui tend à déshumaniser
le sujet, qui n’est plus pris dans sa globalité ; et une
psychologie centrée sur le sujet : on s’intéresse au sens qu’a
la maladie dans la vie du sujet. Il est pris dans sa globalité
et on ne s’intéresse pas qu’au côté pathologique de sa
conduite.
On a d’un côté, la méthode clinique à tendance naturaliste
il s’agit d’une clinique « armée », instrumentale utilisant les
outils tels que les tests de personnalité, de performance,
projectifs, les échelles d’évaluation, les questionnaires, la
classification nosographique, même si cette dernière est
utilisée à moindre mesure, à titre indicatif. (la nosographie
est une méthode de classification des maladies mentales, par
exemple, le DSM4, le CIM10 ou encore INSERM)
Cette méthode s’oppose à la méthode clinique à tendance
humaniste, qui renvoie à une clinique « à mains nues ». Elle
n’utilise aucun outil prédéfini, autre que l’entretient pour
appréhender le fonctionnement de la personne (l’entretient peut
être semi directif ou d’inspiration psychanalytique).
Il existe différentes méthodes, différentes façons d’effectuer
un travail eu cas par cas, chacune reposant sur des fondements
épistémologiques et éthiques différents. On peut les comparer à
la clinique de l’observation opposée à la clinique de la
parole. L’enjeu principal pour le psychologue clinicien est de
ne jamais perdre de vue le parcours du sujet dans sa
singularité.
2 La psychopathologieLa psychopathologie est la science fondamentale ayant pour
objet d’étude les dysfonctionnements des processus psychique
c'est-à-dire l’étude des difficultés ou échecs des mécanismes
psychiques directement perceptibles, et non directement
perceptibles.
La psychopathologie a une visée étiologique (recherche des
causes de maladie). Elle cherche à mettre en évidence les
causes de ces dysfonctionnements. Samacher en 1998 indique que
« la psychopathologie tente de décrire les phénomènes de
l’activité psychique, pathologique, de les classifier,
identifier leurs mécanismes et leurs évolutions.
Ces buts sont donc la description, la connaissance, la
compréhension de ces pathologies. Les moyens qu’elle met en
place sont les entretiens, échelles d’évaluation, tests, et
surtout les classifications nosographiques.
3 Différences entre psychologie clinique et
psychopathologieLes démarches de ces deux disciplines sont différentes. La
clinique a une volonté de mettre en avant la dimension de
singularité et d’unicité du sujet. La dimension de singularité
peut être davantage occultée en psychopathologie, car la
psychopathologie utilise souvent la méthode nosographique basée
sur le recensement des signes cliniques pour établir un
diagnostic. Il s’agit de déchiffrer un système de signes et de
les classer dans une catégorie préétablie. Le sujet est découpé
en catégories ou unités de comportement. La dimension de
singularité est d’unicité du sujet disparait alors.
Au niveau des buts, la différence est aussi frappante : la
dimension de traitement, de soin est totalement absente de la
psychopathologie, qui ne s’intéresse qu’à l’étude seule.
4 La psychanalyse
Fondée par Freud 1896, ce dernier la décrit comme le procédé
d’investigation des processus inconscients et un mode de
traitement des troubles névrotiques. Le travail psychanalytique
se centre sur l’analyse du transfert et de la libre association
(association libre).
Le transfert désigne l’ensemble des réactions de l’analysant
envers la personne de l’analyste dans le processus de la cure
psychanalytique. Le transfert vient actualiser dans la relation
entre la psychanalyste et le patient toutes sortes de
situations conflictuelles refoulées. Il implique le déplacement
et la projection sur l’analyste d’images du passé du patient.
Il s’agit souvent de la répétition des prototypes infantiles
(objet fortement investi dans l’enfance). Les réactions de
transfert peuvent aller de l’amour à l’hostilité déclarée, sur
ce transfert prend appui le déroulement de la cure.
L’association libre permet de déchiffrer le savoir inconscient
et désigne un dispositif particulier de parole et de
traitement, une méthode curative fondée sur la verbalisation
aussi complète que possible des pensées, des associations
d’idées qui se présentent au sujet. Cela consiste pour le
patient à exprimer à haute vois tout ce qui lui passe par
l’esprit sans censure. C’est l’analyse de la structure même du
discours ainsi que l’analyse des productions inconscientes,
comme le lapsus, le rêve, l’acte manqué, les oublis, les
symptômes, qui permet d’accéder au message inconscient caché
derrière par exemple le symptôme. Les dispositifs de
l’association libre et du transfert permettent de mettre à
jour, faire remonter à la surface ce qui a été refoulé.
Le refoulement est un mécanisme de défense inconscient et
involontaire par lequel les souvenirs, sentiments,
représentations pénibles liées à une pulsion inaccessible sont
maintenus hors du champ de la conscience.
La psychanalyse a donc introduit un tournant décisif car on
laisse la parole au sujet au lieu de répertorier les signes
d’un diagnostic comme c’était le cas avant la naissance de la
psychanalyse.
5 Différences entre psychopathologie et psychanalyse.Le positionnement du savoir est opposé, dans le cas de la
psychanalyse, c’est le sujet qui détient la clé de la
compréhension de ses comportements, alors qu’en psychologie,
cette connaissance se trouve du côté du praticien.
La méthode en psychanalyse repose seulement sur l’association
libre, alors que la psychologie dispose d’outils multiples.
L’approche des deux disciplines est aussi différente. La
psychanalyse se centre sur le subjectif, le sujet, dans le but
de voir comment le sujet vit ses symptômes et ce qu’il en dit.
Pour Freud, le symptôme ne peut pas être dissocié de la parole
du sujet. Au contraire, la psychopathologie prône davantage une
science dite objective, centrée sur l’observation, les
symptômes, les processus sous jacents aux symptômes et moins
sur le discours. La psychopathologie énonce des lois
universelles applicables à tous à la différence de la
psychanalyse qui prône les essais de généralité avec extrême
précaution.
Enfin, les buts de la psychanalyse et de la psychopathologie
sont différents, la psychanalyse comme la clinique, vise au
traitement, alors que la psychopathologie ne vise que la
recherche.
Texte sur l’oubli d’un nom propre dans « Psychopathologie de la vie
quotidienne » :
Freud est en vacances et discute avec un compagnon de
voyage, il lui parle d’une ville orientale : il y a une église
où il y a des peintures murales à l’intérieur portant sur le
thème de la fin du monde. C’est alors que Freud veut dire le
nom du célèbre peintre mais n’y parvint pas, c’est alors que
lui viennent d’autres noms tels que Botticelli mais ce n’est
jamais le bon. Freud rencontre donc un symptôme, il avait en
fait oublier le nom Signorelli. Il se demandera alors pourquoi il
avait oublié ce nom :
- Juste avant de parler des fresques,
Freud parlait d’un autre thème avec son compagnon
qui aurait perturbé la conversation suivante : Ils
parlaient de turc et de gens qui étaient
« monsieur », soit Herr en allemand, ceci se
passait en Bosnie Herzégovine (on y retrouve le mot
Herr (association).
- Ensuite Freud se rend compte qu'il a
« cassé » en deux le mot Signorelli : d’un coté
«elli » (comme Botticelli) de l’autre Signor (Soit
Monsieur en Italien qui se traduit par Herr en
allemand). Il pense qu'il s’est produit quelque
chose dans son inconscient.
- Puis Freud se souvient qu'il y avait
quelque chose qu'il ne voulait pas dire à son
interlocuteur (pour garder son image de médecin
devant un inconnu) : « Les Turcs mettent de la
jouissance sexuelle au début de tout ». Il a même
fait en sorte de détourné la conversation des
thèmes de la mort et de la sexualité pour qu'ils
n’en viennent pas à se débat.
- Il se rend compte qu'il y avait encore
une autre pensée qu'il avait refoulée, cela depuis
quelques semaines : Durant un bref séjour à Trafoï
(s’associe à un autre peintre Boltraffio) toujours
en Bosnie Herzégovine, « un patient venait de
mettre fin à ses jours à cause d’un incurable
trouble sexuel ».
La conversation lui a donc fait rappeler ce séjour refoulé qui
lui fait oublier ce mot Signorelli. Freud va donc parler d’un
nom de substitution : oubli déterminé par un conflit
inconscient.
Dans l’inconscient règne l’économie des processus
primaires : grouillement, désordre (association anarchique) où
les mots se décomposent et se recomposent entre eux à travers
des jeux de mots (plus ou moins marrant). Cela obéit tout de
même à une structure élémentaire du langage dont on n’a pas
conscience.
Dans la conscience règne ce processus secondaire qui va
produire un discours cohérent.
Il y a toujours un conflit entre l’envie de transmettre des
informations à un public et l’inconscient, qui va venir
perturber cette volonté d’avoir un discours cohérent.
L’inconscient trouble notre discours qui veut préserver le moi.
Ce discours est perturbé par un processus de révélation. Il y a
trahison de la conscience (du moi) par l’inconscience et donc
révélation du sujet à l’autre.
On est obligé d’être le maintien, au niveau du moi, d’un
discours cohérent. Cette partie du moi est aveugle à une
certaine partie d’elle-même.
Le principe de la libre association de Freud sert à inviter la
personne à ne pas être perturbé par son propre discours.
TD 2 et 3 sur Le Reve
Le rêve, selon Freud, est la « voie royale » pour accéder à
l’inconscient.
Le rêve est apparemment absurde, dénué de sens. Il se présente
comme un enchaînement d’événements sans liens apparents.
Pour interpréter un rêve, trouver son sens, il faut distinguer
le contenu manifeste et le contenu latent.
Contenu manifeste :
Scénario du rêve tel qu'il apparaît dans le souvenir que
le rêveur en garde. Le contenu manifeste des rêves des
adultes est souvent confus et absurde. Le sens du contenu
manifeste n'apparaît que par sa mise en relation avec un
contenu latent caché dont il est la manifestation
symbolique.
Contenu latent :
Ensemble des pensées refoulées qui sont à l'origine du
rêve mais dont le rêveur n'a pas immédiatement conscience.
Le contenu latent est restitué à partir du contenu
manifeste grâce à l'association libre des idées. Le
contenu latent est le sens du contenu manifeste.
Ainsi, le contenu manifeste est ce dont parle explicitement le
rêve; le contenu latent est l’ensemble des pensées, désirs,
etc. qui cherchent à devenir conscients mais qui subissent la
censure du refoulement et sont donc transformés pour apparaître
sous la forme du contenu manifeste.
-> Le travail d'élaboration du rêve est le processus par lequel
le contenu latent est transformé en contenu manifeste. C'est le
travail de construction du rêve. Le travail du rêve est rendu
nécessaire par la censure et le refoulement. Les images
constituant le contenu manifeste du rêve présentent les pensées
constituant le contenu latent de façon voilée : le travail du
rêve est donc une forme codage pour contourner la censure.
Contenu latent --------- Travail d'élaboration ----------> Contenu
manifeste
Le contenu manifeste est le résultat d’une élaboration qui
mobilise une « logique » propre à l’inconscient :
• La condensation est le fait que plusieurs éléments du contenu
latent peuvent être concentrés sur un même élément du contenu
manifeste qui est par conséquent "polysémique" (il a plusieurs
sens). Ainsi, plusieurs pensées sont figurées par la même
image. Le contenu manifeste du rêve est donc beaucoup plus
court que son contenu latent. Cependant, l'inverse est aussi
possible: il peut arriver que plusieurs éléments du contenu
manifeste renvoient au même élément du contenu latent. On parle
alors de dispersion.
• Le déplacement : les détails anodins du contenu manifeste
sont liés aux pensées latentes importantes (qui donnent
l’essentiel du sens latent). Déplacement de l’intensité
affective.
-> Le travail d'analyse est l'inverse du travail du rêve. C'est
le travail d'interprétation du rêve. Interpréter le rêve, c’est
« remonter » du contenu manifeste au contenu latent. Mais
comment faire ?
- Principe du déterminisme psychique : ce qui vient spontanément à
l’esprit a un rapport avec les idées refoulées ; la résistance
du patient à dire ce qui lui vient à l’esprit est une marque
qu’on se rapproche de ces idées.
- Technique de l’association libre des idées: dire le plus librement
possible ce à quoi le contenu manifeste du rêve fait penser
devrait permettre, de proche en proche, de remonter du contenu
manifeste au contenu latent.
Par association libre des idées, le travail d'analyse restitue
le contenu latent du rêve à partir de son contenu manifeste. Le
rêveur est invité à dire sans auto-censure toutes les pensées
évoquées par le contenu manifeste du rêve.
Contenu manifeste --------- Travail d'analyse ---------->
Contenu latent
TD 4 « L’Homme aux rats »
Les deux topiques
Conçue par Freud, la topique est l'étude de la structure
mentale, dans une théorie des lieux.
C'est la différenciation des parties de l'appareil psychique,
en systèmes doués de caractère et de fonction différents, et
disposés dans un certain ordre. Dans la théorie
psychanalytique, la topique révèle les rapports entre les 3
instances psychiques du ça, du Moi et du Surmoi, ainsi que
l'ensemble des phénomènes qui s'y passent.
C'est une métaphore qui permet de spatialiser les lieux
psychiques.
-> 1ère topique :
Trois systèmes : l'Inconscient, le Préconscient et le
Conscient.
Entre ces 3 systèmes se situent des sas, des censures, dont la
fonction est de contrôler le passage d'un système à l'autre.
L'ordre de passage est toujours le même. La direction est soit
"progrédiante" (Inconscient, Préconscient, Conscient), soit
"régressive" (Conscient, Préconscient, Inconscient). Une
représentation ne peut donc jamais passer directement du
Conscient à l'Inconscient, ni inversement de l'Inconscient au
Conscient.
Le "noyau pathogène" est un noyau qui peut donner naissance à la
pathologie. Il est formé par le refoulement.
-> 2ème topique :
Elle est élaborée à partir de 1920. Elle comporte 3 systèmes,
le ça (pôle pulsionnel), le Moi (intérêt de la totalité de la
personne, raison + narcissisme) et le Surmoi (agent critique,
intériorisation des interdits et des exigences).
Sexualité infantile
Freud dit que l’enfant a une sexualité, existence de la
sexualité infantile. La sexualité infantile se caractérise par
sa dimension partielle. En effet Freud distingue trois stades :
-stade oral : (bouche) la tété, succion du pouce
-stade sadique anal (région rectal) stade expulsion/stade
rétention. Freud relie le sadisme à ce stade. Ce stade est
important socialement, l'enfant acquiert une autonomie à ce
stade car dans ce stade l'enfant peut s'opposer à la mère par
la rétention (pulsion d’emprise) ou exprimer son agressivité à
l'expulsion.
-Stade phallique : (zone génitale) exhibition, voyeurisme
concernant les organes génitaux. Donc période de différence des
sexes du complexe d'Œdipe. Fin du complexe d'Œdipe avec le
complexe de castration est entrée dans la latence.
-Période de latence : calme au niveau des pulsions sexuelles.
-Stade génital : entrée dans l'adolescence : les pulsions
partielles sont rassemblées, ici primat de la zone génitale et
accès à une sexualité adulte.
Nevrose obsessionnelle
Il s’agit là d’une régression au stade sadique-anal, soit le
second sous stade du stade anal. L’influence sur les défenses
de cette fixation est que le refoulement est suppléé par
d’autres défenses dont notamment les formations
réactionnelles : rituels, pensée magique, annulation (chercher
à annuler une mauvaise action que l’on a fait par une bonne par
exemple).
Cette névrose s’exprime par des ruminations en une
obsessionnalisation de la pensée. On parle d’ailleurs de pensée
obsédante. Les rituels servent à s’apaiser pour ne pas se
laisser envahir par une pensée. Ainsi le sujet en vient à se
dire que s’il ne croise qu’un seul feu rouge lors de son trajet
vers le travail sa journée se passera bien. Il peut ainsi en
venir à rentrer chez lui et refaire le trajet jusqu’à ce qu’il
ne croise qu’un seul feu rouge. C’est une contrainte psychique
interne qui s’exerce et la personne lutte contre elle en se
raisonnant, tente de se retenir. Elle y cède en fin de compte,
mais contre son grès, il y a donc une lutte intérieure face à
ça ; on est loin de la belle indifférence hystérique. Plus on y
résiste, plus elle devient importante. On considère la pensée
obsédante comme pathologique lorsqu’elle occupe plus de 3 ou 4
heures par jour.
Au niveau de l’expression de la personnalité, elles sont
caractérisées par le doute à tout sujet, ce qui entraîne des
scrupules, quel que soit le choix effectué. Sur le long terme
cela amène à ne plus faire de choix du tout, et entraîne une
inhibition de l’action. Le conflit psychique ici est
caractérisé par des actes ou idées que le sujet ne veut pas
avoir, mais ne peut pas empêcher.
Symptomatologie
Il n’y a pas deux obsessionnels identiques. Mais très
souvent, on a une isolation qui consiste à isoler une pensée ou
un comportement doté d’une signification inconsciente, de façon
à ce que leur connexion avec d’autres pensées et comportements
soit rompue.
On a aussi le contrôle obsédant : vérifications,
rangements, collections, accumulations, méticulosité… Le rite
obsessionnel est un ensemble d’obsessions compulsives à
caractère conjuratoire mis en place pour canaliser l’angoisse.
Bien sur, la conjuration ne marche pas, ce qui conduit à devoir
recommencer le rituel chaque jour de nouveau. Il s’agit d’une
défense inopérante. C’est bien parce que ce type de défense
échoue que le sujet, petit à petit, s’enferme dans la seule
mentalisation. C’est ce qu’on appelle de la pensée aux actes.
Il ne sont plus utilisés parce qu’ils ne marchent pas. Ce type
de défense a en fait l’effet inverse de celui qui est escompté.
Origine
Pour qu’il puisse y avoir régression, il faut qu’il y ait
fixation de l’enfant au stade sadique anal. L’enfant
expérimente le plaisir de l’expulsion, de rétention et la
puissance de l’agressivité. Le conflit joue entre les pulsions
refoulées et les prémices d’un surmoi particulièrement
interdicteur et rigide. Il y a alors une bonne ou mauvaise
image : ce qui prévaut est une inversion de la pulsion « j’ai
envie de » en la renversant en « je n’ai pas le droit de ». Le
déplacement se met aussi en place à ce moment là. La
personnalité obsessionnelle est extrêmement liée à ces
mécanismes.
L’enfant du stade sadique anal est par essence
obsessionnelle. C’est le moment où l’enfant a besoin de rituels
pour traverser ses journées. C’est par exemple la grande époque
de collections, du rituel du repas et du coucher. Si quelque
chose accroche à ce stade là (maladie, peur, angoisses).
TD 5 « La paranoïa »
Freud part du principe que la paranoïa s'est ici
construite en défense face à un désir homosexuel, avec
construction d’un délire de persécution. La base du conflit
serait: "j'aime un homme" (éprouvé d'un désir homosexuel)
transformé en "je le hais" (mécanisme de contre-investissement),
et aboutissant à "il me hait" (mécanisme de projection). De ce
fait, le sujet paranoïaque n'est "haï" que par les gens
auxquels il voudrait ressembler (vis à vis desquels il
ressentirait plutôt de l'attirance, un désir d'identification).
Il ne choisit l'Objet aimé/haïssant qu'en fonction de critères
narcissiques.
Le sujet paranoïaque se focalise sur un être narcissiquement
intéressant auquel il prête des sentiments de haine à son
égard.
Le sujet paranoïaque a une relation à l'Autre de type
psychotique dans le sens où il ne fait pas de différence entre
ce qu'il pense et ce que les autres pensent ou font. De fait,
il lui sera extrêmement difficile de prendre du recul, de la
distance par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il dit, car cela
signifierait se mettre à la place de l'Autre.
Dans la paranoïa, la relation d'Objet n'est pas totale. Elle
est de type narcissique: l'Autre n'est reconnu que dans la
mesure où le sujet lui-même s'y retrouve. Du stade anal
renaissent des projections d'agressivité et de l'ambivalence.
L'Autre est le support de projection de la partie de lui-même
que le sujet paranoïaque expulse.
Les délires paranoïaques
Il y a trois délires paranoïaques :
1. Délire de persécution : "je l'aime" ... ... "il me
hait";
2. Délire de jalousie. Dans un exemple de paranoïa
masculine : "ma femme me trompe avec un homme" (si
possible haut placé socialement). On voit alors qu'il
est question d'une relation sexuelle, avec présence
d'une personne de même sexe, en l'occurrence un homme
mais c'est la femme (l'Autre) qui en supporte
l'interdit!
3. Délire érotomaniaque : "cette femme m'aime mais on
l'empêche de me le dire". Le persécuteur est toujours
quelqu'un de même sexe, et donc ici un homme. Il est
bien encore question de deux hommes et d'une relation
amoureuse, mais la présence dans la construction
délirante de cette femme providentielle a escamoté
les désirs profonds intolérables. Dans le délire
érotomaniaque, il y a une phase d'espoir, une phase
de dépit et une phase de rancune.
Dans ces trois délires, il y a toujours la présence d'un homme
(dans le cas d'une paranoïa masculine) ou d'une femme (dans le
cas d'une paranoïa féminine) plus haut placé(e), socialement ou
non. Ce sera le "persécuteur", rôle nécessaire à la construction
délirante. Les mécanismes de contre investissement et de
projection ont maquillé une pulsion sexuelle intolérable en
pseudo-réalité beaucoup plus acceptable pour le sujet délirant.
C'est un délire systématisé, ne laissant aucune prise au doute
et se construisant au fur et à mesure que la personne
paranoïaque a besoin de se protéger de ses propres pulsions. On
notera le travail d'un "refoulement premier", contemporain de la
fixation, et qui permet de ne pas voir en l'homme aimé (ou en
la femme aimée) un Objet sexuel.
TD 6 «Petit bilan Névrose et Psychose »
Dans les névroses, le Moi, arbitre, prend le parti du Surmoi
pour combattre les pulsions du Ç a , en contrôlant ou interdisant
tout plaisir. Le névrosé a conscience de sa maladie. Les
processus psychiques sont de type secondaire.
La névrose se différencie de la psychose sur ces trois
notions :
1. il y a la conscience de la morbidité des
troubles,
2. il n'y a pas la perte du sens de la
réalité,
3. il n'y a pas de confusion entre réalité
extérieure et réalité intérieure.
Dans l'expression d'une névrose adulte, les symptômes peuvent
être vus comme des compromis entre la pulsion et l'interdit. Ce
n'est qu'après coup, et sous l'effet de la poussée pulsionnelle
de la puberté, que la valeur traumatique se réveille. On parle
ici d'un retour du refoulé. La valeur traumatique concerne des
traumatismes réels ou imaginaires. Pour se mettre à distance de
l'angoisse, le Moi utilisera plusieurs mécanismes de défense.
Le refoulement est le fondateur de l'inconscient. La névrose
apparaît parce que les défenses utilisées sont inadaptées. Mais
en créant par exemple un Objet de la situation phobogène (la
phobie des chiens, des araignées, ou des espaces clos...),
l'angoisse est actualisée, extériorisée, alors que jusque-là
elle était cachée. De plus elle est nommée et circonscrite,
permettant au sujet de la contourner (sens réel et symbolique).
Dans les psychoses, le Moi prend le parti du Ç a pour détruire
la réalité du Surmoi. Il la remplacera par une néo-réalité qui
est le délire. Ce délire sera bâti sur les exigences du ça.
La personne psychotique n'a pas conscience de sa maladie.
Les processus psychiques sont de type primaire.
Ainsi apparaissent dans les pathologies psychotiques de
l'adulte : la schizophrénie, la paranoïa d'apparition plus
tardive, la manie (état d'exaltation) et la mélancolie, avec
son délire de culpabilité.
On classe aussi dans la psychose les bouffées délirantes,
éclosion brusque d'un délire, souvent sans suites pour
l'avenir.
Chez l'enfant, on évoquera plutôt une organisation de type
psychotique, en gardant toujours à l'esprit le caractère
extrêmement évolutif de la pathologie infantile.
La psychose est une perturbation primaire de la réalité
affective. Elle se traduit par un désinvestissement de la
réalité extérieure (mécanisme de déni), et un surinvestissement
de soi-même.
Le délire est une tentative de reconstruction de la réalité
perdue. Il y a toujours un aspect négatif que sont le déni et
la dissociation, et un aspect positif qui est le délire.
Il faut savoir que dans la psychose, l'angoisse est majeure,
envahissante. Elle est de l'ordre du morcellement, de
l'intrusion, de la dévoration. Il est possible de s'en faire
une idée en se remémorant l'angoisse oppressante vécue lors
d'un cauchemar. Mais l'angoisse dans un cauchemar ne dure que
quelques secondes, alors que l'angoisse psychotique, subie à
l'état de veille, peut durer plusieurs heures.
Un mécanisme de défense est un processus de défense élaboré par
le Moi sous la pression du Surmoi et de la réalité extérieure,
et permettant de lutter contre l'angoisse. Il en existe
plusieurs.
Ces mécanismes psychiques préservent le Moi et le protègent
aussi des exigences pulsionnelles du ça. Mais ce dont le Moi se
protège en priorité, c'est de l'angoisse.
Par exemple, une représentation inconsciente va être
incompatible avec les exigences du Surmoi. Cette représentation
inconsciente du ça apporte du plaisir mais provoque aussi du
déplaisir. Le Moi, pour se défendre contre cette
représentation, va utiliser divers procédés que l'on réunit
sous le terme de “mécanismes de défense du Moi”.
































![iGalerie.cz: [Literatura] Psychologie (Rita L. Atkinson a kol](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63367c2be8daaa60da0fec2d/igaleriecz-literatura-psychologie-rita-l-atkinson-a-kol.jpg)