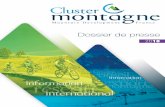représentations de soi et des autres dans la presse coloniale ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of représentations de soi et des autres dans la presse coloniale ...
Identités et exotisme : représentations de soi et des autres dans la presse coloniale française au XIXe siècle
(1830-1880)
Thèse en cotutelle Doctorat en études littéraires
Laure Demougin
Université Laval Québec, Canada
Philosophiae Doctor (Ph. D.)
et
Université Paul-Valéry Montpellier III Montpellier, France
Doctorat en littérature française
© Laure Demougin, 2018
Identités et exotisme : représentations de soi et des autres dans la presse coloniale française au XIXe siècle
(1830-1880)
Thèse en cotutelle Doctorat en études littéraires
Laure Demougin
Sous la direction de :
Guillaume Pinson, directeur de recherche
Marie-Ève Thérenty, directrice de cotutelle
I
Résumé
Identités et exotisme : représentations de soi et des autres dans la presse coloniale française au XIXe siècle (1830-1880)
Sur les territoires colonisés par la France paraissent des journaux locaux qui suivent le développement national de la presse : entre 1830 et 1880, l’époque est médiatique et le journal est un support important des publications littéraires. Dans les colonies, les périodiques contiennent ainsi des textes adaptés à leurs territoires respectifs, mais publiés toujours selon la même structure, ce qui permet une comparaison entre les différentes stratégies conduisant à l’élaboration d’identités coloniales. Ces textes, par leur diversité et leurs évolutions, représentent une sorte de chaînon manquant entre la littérature des récits de voyage et la littérature coloniale qui se définit au tournant du XXe siècle : interrogés et étudiés sous cet angle, ils prennent valeur de corpus signifiant. Ils montrent en effet le rôle identitaire de cette littérature médiatique adaptée aux colonies : en adaptant l’exotisme aux conditions coloniale, en faisant varier le critère d’altérité et par bien d’autres moyens encore, la presse locale fonde en partie une attitude coloniale qui se retrouve, mutatis mutandis, dans l’empire colonial français. C’est également la raison pour laquelle le corpus médiatique colonial du XIXe siècle se trouve être au centre de connexions avec les textes de la littérature coloniale ainsi qu’avec les problématiques de l’écriture postcoloniale : lieu de publication, de nouveauté, de tentatives identitaires et d’essais génériques, le journal colonial a produit entre 1830 et 1880 des mécanismes d’écriture appelés à se développer par la suite.
Mots-clefs : littérature médiatique, colonies, postcolonial, exotisme.
II
Abstract
Identities and exoticism : representations of self and others in the french colonial press in the 19th century (1830-1880)
Local newspapers were published in French colonial areas following the same evolution as the national newspapers: between 1830 and 1880, media-rich times, the press represents a significant publishing-platform for literary texts. Colonial newspapers contain texts adjusted to their respective geographic areas, but keep the same structure regardless, thereby allowing the comparison between the strategies leading to the building of colonial identities. The diversity and the different evolution pathways of these texts may then be considered as the missing link between the travel narratives and the early-20th century defined colonial literature. As such, they can undoubtedly be considered as a significant corpus of colonial times. These texts reflect the identity role this colonial-area adjusted media literature had: by adapting exoticism to the colonial conditions, by varying the criterion of alterity and by many other ways, local press founds, partially, a colonial attitude that can further be found, mutatis mutandis, in the French colonial empire. This is also the reason the 19th-century colonial-media corpus is at the crossroads of both colonial literature and postcolonial writing problematics: as a place for publication, novelty, identity essays, and literary genre essays, the colonial newspaper witnessed the creation, between 1830 and 1880, of writing mechanisms that would eventually develop later on.
Keywords : press, colonialism, postcolonial, exoticism
III
Table des matières
RESUME ...............................................................................................................................................I
TABLE DES MATIERES .........................................................................................................................III
REMERCIEMENTS ............................................................................................................................... X
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 1
PREMIERE PARTIE – LE JOURNAL COLONIAL ...................................................................................... 17
1 UNE MOSAÏQUE DE JOURNAUX COLONIAUX ........................................................................... 20
1.1 TITRES ET PROJETS : QUAND LES JOURNAUX PARLENT D’EUX-MEMES ................................................. 23 De quelques titres : modèle national, appartenance locale .................................................................. 23 Une presse « littéraire, politique, commerciale et d’annonces » ? ........................................................ 29 Le premier numéro : ne pas être « le simple avènement d'une feuille périodique » .............................. 33
1.2 LA FABRICATION DU JOURNAL COLONIAL..................................................................................... 37 Les arcanes du journal : coûts, abonnements, retards et traductions à la une ...................................... 37 Les liens avec les lecteurs locaux : un marqueur identitaire ................................................................. 41 Les liens matériels avec la métropole .................................................................................................. 46 Le journal parodié : la reconnaissance d’une familiarité ....................................................................... 51
1.3 PERIODISER LA PRODUCTION MEDIATIQUE COLONIALE ................................................................... 55 Législation et presse coloniale ............................................................................................................ 55 Journal et développement colonial ..................................................................................................... 61 Les années 1860, un pic de production médiatique ? ........................................................................... 66
2 AUTEURS ET SIGNATURES ........................................................................................................ 69
2.1 SIGNATURES ET COLLABORATEURS : PROFILS DE JOURNALISTES ......................................................... 69 Signer par périphrase : cristallisation de certains enjeux de la presse coloniale .................................... 70 Le colon, l’interprète : silhouettes de la société coloniale et auteurs médiatiques ................................ 73 Le régime du pseudonyme colonial ..................................................................................................... 76 Écritures indigènes : une absence remarquable ? ................................................................................ 79
2.2 « L’ECRIVAIN BANAL » ET LE JOURNAL COLONIAL .......................................................................... 85 La presse coloniale algérienne : historiens et interprètes, deux images de savants ............................... 86 Hommes de lettres réunionnais et antillais : colonies anciennes et question créole .............................. 91 La Nouvelle-Calédonie : de la transition à l’installation ........................................................................ 93
2.3 LE JOURNALISTE COLONIAL COMME CATEGORIE ............................................................................ 97 Les journalistes représentés par eux-mêmes ....................................................................................... 98 L’auteur de presse coloniale, un journaliste ? Une question de scénographie ..................................... 102 Le journaliste, l’imprimeur, l’éditeur : un réseau entre colonie et métropole ..................................... 104
IV
3 « TU T’IMAGINES, MON CHER AMI » : LA RECEPTION DU JOURNAL COLONIAL ...................... 107
3.1 LA REALITE – VISEE – DU LECTEUR COLONIAL ............................................................................. 108 Représenter les lecteurs de la presse coloniale .................................................................................. 110 Faire entendre la parole des lecteurs : le rôle du courrier .................................................................. 114 Sermonner les lecteurs : les lecteurs présents au cœur du fonctionnement colonial .......................... 118
3.2 LE LECTEUR METROPOLITAIN, PENDANT DU LECTEUR COLONIAL ...................................................... 122 La métropole au centre du journal colonial ....................................................................................... 123 Rectifier la vérité auprès d’un lectorat métropolitain ? L’ambiguïté des rectifications......................... 126 La presse racontée par des témoins métropolitains : une histoire immédiate ..................................... 131 Transition : du journal colonial au territoire colonial .......................................................................... 133
DEUXIEME PARTIE – LA PRESSE ET LE TERRITOIRE ........................................................................... 135
1 L’ELOIGNEMENT COLONIAL MIS EN LUMIERE ........................................................................ 137
1.1 BATEAU, COURRIER, PACKET : L’ELOIGNEMENT PAR LES TEXTES ...................................................... 139 Le « packet » colonial : la malle, le courrier, les nouvelles .................................................................. 140 Le bateau, objet littéraire symbolique ............................................................................................... 145 L’auteur embarqué : une posture littéraire coloniale ......................................................................... 150
1.2 INTERCOLONIALITE, INTRACOLONIALITE : LE RESEAU PAR LES TEXTES ................................................ 158 Les colonies d’un journal à l’autre : intercolonialité médiatique ? ...................................................... 159 Les journaux coloniaux entre eux : une presse avant tout locale ?...................................................... 166
1.3 DE CERTAINS LIEUX : LA CRISTALLISATION DE L’IDEOLOGIE COLONIALE .............................................. 169 Le Tombeau de la chrétienne et le Fort des Vingt-Quatre-Heures en Algérie ...................................... 169 Les cimetières coloniaux, symboles idéologiques et littéraires ? ........................................................ 174 Écrire les rues et les villes des colonies .............................................................................................. 180
2 (D)ECRIRE EN MOUVEMENT : PROMENADES, EXCURSIONS, DECOUVERTES .......................... 183
2.1 L’EXCURSION OU LA CONQUETE MISE EN MOTS .......................................................................... 185 Des descriptions dynamiques ............................................................................................................ 186 Explorations, expéditions, voyages : une première approche ............................................................. 188 Les excursions ou comment décrire une colonie pacifiée ................................................................... 193
2.2 LA PROMENADE OU UNE FLANERIE COLONIALE ........................................................................... 200 Une typologie des promenades......................................................................................................... 201 Voir la ville : les mœurs coloniales au cœur des descriptions ............................................................. 204 Scénographies auctoriales de promeneurs ........................................................................................ 208
2.3 LA DECOUVERTE « EUROPEENNE » ......................................................................................... 213 « L’Européen qui découvre » : envisager le territoire colonial par détour ........................................... 213 Le touriste, avatar de l’Européen ...................................................................................................... 218 D’autres découvertes : un journalisme de l’enthousiasme ? ............................................................... 224
3 DE L’IDENTITE DES TERRITOIRES COLONIAUX......................................................................... 229
V
3.1 UNE NATURE BIENVEILLANTE ET EDENIQUE................................................................................ 232 Les îles : de la beauté naturelle à la tentation allégorique .................................................................. 233 L’opposition à la métropole : paysages édéniques et civilisation ........................................................ 235 Répondre aux stéréotypes : une signature coloniale ? ....................................................................... 238
3.2 ENTRE METONYMIE ET JUSTIFICATION : UNE NATURE SAUVAGE, A DOMPTER ...................................... 241 L’Algérie : la domestication, « ense et aratro » .................................................................................. 242 Les naufrages : du fait divers au microrécit........................................................................................ 247
3.3 TOPONYMES ET DESCRIPTION : L’ABOUTISSEMENT DU TERRITOIRE................................................... 253 De plusieurs noms : une polyphonie géographique ? ......................................................................... 254 Une approche visuelle de la distance : cartes et plans........................................................................ 260 Transition : la colonisation, du territoire au peuple ............................................................................ 262
TROISIEME PARTIE – LE COLONIAL ET SES AUTRES .......................................................................... 264
1 LE MYTHE DE LA RENCONTRE COLONIALE .............................................................................. 267
1.1 LA RENCONTRE PAR LA LANGUE : L’IDENTITE DES AUTRES PAR LES TEXTES .......................................... 269 Le créole et les fables ....................................................................................................................... 271 Contes arabes et style oriental .......................................................................................................... 274 Tahiti ou les chants ........................................................................................................................... 278
1.2 DE LA DIVISION A LA FUSION : ECRIRE LE RAPPORT AUX AUTRES ...................................................... 284 Diviser pour mieux régner : classer les colonisés................................................................................ 284 « Une maison dont la façade est française et l’intérieur mauresque » ................................................ 287 L’esclavage ou le contact impossible ................................................................................................. 291
1.3 PRISONNIER OU CHASSEUR : UN COLONIAL RENFERME SUR LUI-MEME .............................................. 297 Les prisonniers en Algérie ou la survivance de l’épée ......................................................................... 297 Les chasseurs : le récit cynégétique rejoue la guerre coloniale ........................................................... 300
2 UNE ECRITURE DE LA DIFFRACTION : S’INSCRIRE DANS LE FLUX HISTORIQUE ........................ 305
2.1 LES CONFLITS COLONIAUX OU LES MOMENTS DE COMPARAISON ..................................................... 307 Une galerie de héros coloniaux ......................................................................................................... 308 Un héros anticolonial : Abd el-Kader ................................................................................................. 311 La disparition du héros : le cas d’Ataï ................................................................................................ 316
2.2 RACONTER L’HISTOIRE : PRISE DE POUVOIR ET AFFIRMATION DE SOI ................................................. 322 Histoire antécoloniale : le poète, le missionnaire, le conservateur ..................................................... 323 Histoire coloniale.............................................................................................................................. 327 L’actualité coloniale .......................................................................................................................... 333
2.3 UNE ECRITURE ETHNOGRAPHIQUE .......................................................................................... 340 Les mœurs coloniales : décrire une société à plusieurs niveaux .......................................................... 341 Le métadiscours et le discours : deux strates de composition ethnographique ................................... 345 L’interprète ou un avatar de l’ethnographe ? ................................................................................... 347
3 GROSSIR LE TRAIT : UNE ESTHETIQUE COLONIALE ? ............................................................... 351
VI
3.1 LE ROLE DES STEREOTYPES : DE L’INSTALLATION A L’UTILISATION ..................................................... 352 L’anthropophagie ............................................................................................................................. 352 Barbarie et violence .......................................................................................................................... 358 Décivilisation et décadence............................................................................................................... 363
3.2 LES TRAITS DEFORMES : SATIRE ET IRONIE ................................................................................. 367 L’indigène dévalorisé : entre caricature et ironie ............................................................................... 368 La saynète satirique, une manière de traiter de l’actualité ................................................................. 370 Déconstruire les stéréotypes par l’ironie ........................................................................................... 374
3.3 ENJEUX ET FONCTIONNEMENTS DE LA FICTIONNALISATION ............................................................ 379 Les influences orientalistes en Algérie ............................................................................................... 379 La circulation d’un fait divers : construire une héroïne ....................................................................... 382 Transition : vers d’autres corpus ....................................................................................................... 387
QUATRIEME PARTIE – DE LA PRESSE COLONIALE AU ROMAN POSTCOLONIAL ................................ 389
1 LE TEXTE MEDIATIQUE COLONIAL DANS SON ENVIRONNEMENT ........................................... 392
1.1 LE TEXTE ET SON ENTOURAGE : CONTAMINATION ET ECHOS ........................................................... 394 Le journal colonial et les frontières des textes ................................................................................... 395 Le contexte, le cotexte : l’importance de l’environnement en littérature ........................................... 402 La lettre : l’expérience comme modèle esthétique ............................................................................ 406
1.2 UN PACTE DE LECTURE : MODELE DE NARRATION ET LECTORAT ....................................................... 411 D’où vient l’auteur, de la presse au livre............................................................................................ 412 De la presse coloniale au récit de voyage : une transformation du pacte ............................................ 415 Alexandre Dumas lecteur de la presse coloniale ................................................................................ 418
1.3 UNE TERATOLOGIE MEDIATIQUE ? .......................................................................................... 421 Le contexte, une source d’originalité ................................................................................................. 422 Les illustrations des périodiques : quand l’image parle ...................................................................... 424
2 HISTOIRE DE CONNEXIONS : D’UN CORPUS A UN AUTRE ....................................................... 429
2.1 LA PRESSE ET LE LIVRE FACE AUX COLONIES AU XIXE SIECLE ............................................................ 433 Le socle de l’écriture coloniale : les références aux livres canoniques ................................................. 433 La créole, entre colonie et métropole, entre journal et livre .............................................................. 438 Publications métropolitaines et cadre colonial : des interactions ....................................................... 443
2.2 LITTERATURE COLONIALE ET PRESSE COLONIALE : DES CORPUS GEMELLAIRES ? ................................... 451 Feuilletons locaux et littérature coloniale : quand les corpus se confondent ...................................... 452 Le refus de la littérarité, un programme impossible ........................................................................... 458 Motifs et personnages récurrents : du feuilleton au livre ................................................................... 460
2.3 LA LITTERATURE POSTCOLONIALE OU L’ECRITURE COMME REPONSE ................................................. 463 Le territoire au centre des corpus ..................................................................................................... 465 De la littérature coloniale à la littérature postcoloniale : la question de la temporalité ....................... 469 Le retour de la créole........................................................................................................................ 471
VII
Le document et la parole : une représentation de la situation coloniale ............................................. 472
3 LA PRESSE COLONIALE COMME CLEF HEURISTIQUE ............................................................... 477
3.1 UNE PRODUCTION LITTERAIRE PRISONNIERE DE SON EPOQUE ......................................................... 478 Des horizons d’attente : répondre aux lecteurs ................................................................................. 479 L’écrivain introuvable ....................................................................................................................... 481
3.2 LA LITTERATURE POSTCOLONIALE ET LA PRESSE COLONIALE : UNE QUESTION D’ECHELLE ........................ 483 Le local : une négociation quant à la valeur littéraire des textes ......................................................... 484 Le national : un but........................................................................................................................... 489 Le mondial : deux fonctionnements .................................................................................................. 494
3.3 IDEOLOGIE ET ESTHETIQUE : LE DILEMME DES CORPUS DEVALORISES ................................................ 497 Des œuvres en défaut de beauté ? .................................................................................................... 500 La décentralisation et le décentrement : mots-clefs colonial et postcolonial ? .................................... 503 La recherche de l’origine : une idéologie première ? .......................................................................... 507 Transition : vers la conclusion des recherches ................................................................................... 509
CONCLUSION ................................................................................................................................... 511
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................... 520
INDEX DES PRINCIPAUX JOURNAUX CITES ....................................................................................... 541
ANNEXES ......................................................................................................................................... 543
1 ANNEXE 1 : BIBLIOGRAPHIE DES PRINCIPAUX ARTICLES CITES ............................................... 543
Algérie ............................................................................................................................................. 543 Cochinchine ..................................................................................................................................... 550 Guadeloupe et Martinique................................................................................................................ 551 Guyane ............................................................................................................................................ 553 La Réunion ....................................................................................................................................... 554 Nouvelle-Calédonie .......................................................................................................................... 556 Tahiti ............................................................................................................................................... 557
2 ANNEXE 2 : TABLEAU DE DEPOUILLEMENT DES PERIODIQUES ............................................... 559
3 ANNEXE 3 : ANTHOLOGIE DE TEXTES MEDIATIQUES COLONIAUX .......................................... 566
« Esquisses de la Guyane », La Feuille de la Guyane française, 9 janvier 1830, deuxième page ............ 566 « Excursion dans l’Atlas. Le prince Pukler Muslaw », Le Moniteur algérien, 13 mars 1834, deuxième page
....................................................................................................................................................................... 568 « Les Nouvellistes algériens, comédie en deux actes et en prose », Le Moniteur algérien, 27 mai 1836,
feuilleton ........................................................................................................................................................ 571 « Le Tombeau de la chrétienne », Le Moniteur algérien, 17 juin 1836, feuilleton (extrait)................... 573 Le Moniteur algérien, 7 janvier 1837, première page ......................................................................... 575
VIII
« Cinq mois de captivité dans l’intérieur de la province d’Oran », Le Moniteur algérien, 13 janvier 1837,
troisième page (extrait) ................................................................................................................................... 576 « Traduction libre de quelques poésies orientales », Le Moniteur algérien, 8 février 1840, troisième page
....................................................................................................................................................................... 578 R. de B., « Type. – Un nouveau débarqué », Le moniteur algérien, 4 juillet 1840, troisième page ........ 578 « Un chasseur changé en cerf, ou le nouvel Actéon », L’Akhbar, 10 et 13 février 1842 ........................ 580 B., Le Moniteur algérien, 10 novembre 1843, troisième page ............................................................ 583 H. Vignerte, « Revue et chronique de Saint-Pierre », Les Antilles, 18 et 22 novembre 1843 (extraits) .. 585 Le Moniteur algérien, 5 février 1844, deuxième page ........................................................................ 589 Eugène X., « Le sultan et la mouche », L’Akhbar, 19 mai 1846 ............................................................ 593 « Une Mauresque », La France algérienne, du 23 juillet au 11 août 1846, feuilleton ........................... 594 L’Écho d’Oran, « Un miracle d’Aïssa. Légende arabe », 22 juillet 1848, feuilleton ............................... 616 Un campagnard, « L’actualité, comédie en un acte et en prose », Le Commercial de la Guadeloupe, 23
août 1848 ....................................................................................................................................................... 617 Rousseau St-Val, « Le Jugement de Dieu », Le Commercial, 26 septembre 1849, feuilleton................. 619 « Dernière lamentinoise », Le Commercial, 17 octobre 1849, deuxième page .................................... 621 Chandellier, « Les petites misères de la vie algérienne », L’Akhbar, 16 août 1851 ............................... 622 C. Chanel, « Martinique. Eruption volcanique de la Montagne-Pelée. Première visite aux cratères », La
Feuille de la Guyane française, 13 et 20 septembre 1851, troisième page. ........................................................ 626 J., « Les îles du Salut », La Feuille de la Guyane française, 3 juillet 1852, troisième page ..................... 628 Le Messager de Tahiti, « Mœurs tahitiennes », 22 mai 1853 .............................................................. 629 « Le martyr du fort des Vingt-Quatre-Heures », Le Moniteur algérien, 30 décembre 1853, première page
....................................................................................................................................................................... 631 Le Messager de Tahiti, 14 mai 1854 .................................................................................................. 635 Le Messager de Tahiti, 16 juillet 1854 ............................................................................................... 637 Celtibère, « Voyage autour du monde », Le Messager de Tahiti, 28 janvier, 4 et 11 février 1855,
feuilleton (extraits) .......................................................................................................................................... 637 Le Messager de Tahiti, 13 juillet 1855, première page ....................................................................... 641 Marie-Lefebvre, « Le cimetière Bab-el-Oued, à Alger », L’Akhbar, 29 juin 1858, feuilleton (extrait) ..... 643 « Tournée d’exploration dans les Ksours et dans le Sahara de la province d’Oran, par le commandant de
Colomb », Le Moniteur algérien, 5 et 10 juin 1858, troisième page (extraits) .................................................... 644 L’Avenir, 23 mars 1859, troisième page ............................................................................................. 651 « Chronique locale : petit avant-propos pour tenir lieu de préface », L’Avenir, 18 juin 1859, troisième
page ............................................................................................................................................................... 653 Bou Achra, « Souvenirs d’un vieil Algérien. Une chasse au lion à Philippeville en 1844 », 25 septembre
1863, feuilleton ............................................................................................................................................... 654 Armand Closquinet, « Hommage et Adieu », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 17 avril 1864,
deuxième page................................................................................................................................................ 655 Augustin Marquand, « Les Poètes du Sa’hara », 13 novembre 1864, deuxième page .......................... 657 E.-J. Sartor, « Hassen le chaouch. Nouvelle algérienne », Le Moniteur de l’Algérie, du 29 novembre 1865
au 2 décembre, feuilleton ................................................................................................................................ 660 E.F., « Boghari ou une ville arabe », 12 août 1865, troisième page ..................................................... 669 Walt’her, « Le Marabout. Esquisse algérienne », Le Chitann, 26 avril 1866, feuilleton ........................ 670
IX
Walt’her, « Le chant du Reïs », Le Chitann, 19 août 1866, feuilleton .................................................. 671 « Monologue du dernier des Arabes », L’Est algérien, 4 décembre 1868, première page .................... 674 Dr. E. Bertherand, « À propos d’un conte arabe », Le Moniteur algérien, 3 juillet 1869, troisième page
....................................................................................................................................................................... 676 Tric-Trac, « Origine des scorpions (légende arabe) », Le Moniteur algérien, 10 septembre 1869,
feuilleton ........................................................................................................................................................ 681 C. l’une, « Alger, la nuit », La Vie algérienne, 23 et 29 janvier 1870, deuxième page ........................... 683 Trabaud, « De Paris à Tahiti, par Londres et New-York. Souvenirs et impressions de voyage », Le
Messager de Tahiti, du 14 mai au 25 juin 1870 (extraits) .................................................................................. 685 Somebody, « La machine ne fonctionne plus », Le Moniteur de l’Algérie, 2 août 1871, troisième page 687 Tinterio, « Les Dix plaies d’Alger. Les arabolâtres », Le Moqueur, 22 avril 1866, feuilleton .................. 688 « Chronique locale », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 20 septembre 1871, première page ...... 689 La Feuille de la Guyane française, « Mme Gillain », 11 et 18 novembre 1876, feuilleton ..................... 689 A. Ralu fils, « Les Fastes de l’histoire des Antilles », Les Antilles, 16 février 1876, troisième page ........ 696 F. Ratte, « Sentiers canaques. De Gomen à la côte Est (Nord de la Nouvelle-Calédonie) », Le Moniteur de
la Nouvelle-Calédonie, 13 novembre 1878, deuxième page (extraits) ............................................................... 698 X., « À Papoa (communiqué) », Le Messager de Tahiti, 27 décembre 1878, deuxième page ................ 700 Alexandre Dumas et La France algérienne : comparaison................................................................... 701
X
Remerciements
Mes premiers remerciements vont d’abord à Marie-Ève Thérenty et Guillaume
Pinson : il y a tant de raisons de les remercier que je ne pourrais pas les énumérer… Je les
remercie cependant, et avec un peu plus de précision, pour ces si belles années passées à
Montpellier et à Québec : pour les réunions menées par Skype d’un continent à l’autre, pour les
projets auxquels j’ai pu participer, pour les rencontres que j’ai pu faire, pour toutes les
discussions partagées et pour tout ce que ce travail de thèse m’a apporté, de colloques en cafés.
Merci aussi, plus spécifiquement, à Marie-Astrid Charlier, Claire Ducournau et Mélodie
Simard-Houde pour leurs encouragements et conseils ; à Yvan Daniel et son équipe rochelaise
pour leur accueil et pour l’année passée avec eux ; aux archivistes des ANOM à Aix-en-
Provence pour leur travail. J’ai une pensée pour Anne-Marie Houdebine, dont les réflexions ont
constitué une étape dans mes recherches.
Sur un plan plus personnel, je profite de cette page pour remercier également mes
parents : il y a longtemps que j’ai appris qu’ils étaient extraordinaires, et ils l’ont été
particulièrement pendant cette thèse. Claire et Charlotte savent bien tout ce que ce travail leur
doit, mais qu’elles soient remerciées ici un peu plus encore que ce que j’ai pu leur dire. Merci
aux amis nîmois (même au plus récent d’entre eux), montpelliérains, parisiens ou québécois ; en
particulier aux sœurs Claire et Laure, à Sophie et Anaïs, à Laurent, qui ont tous dû m’écouter
parler de presse coloniale plus qu’il n’est raisonnable.
Merci à Pauline pour ses relectures attentives (Madeleine a été nourrie de cette thèse,
j’en suis sûre) et à Benjamin, pour tout. Je crois même que je remercie mes lycéens de Pézenas
pour leur enthousiasme en classe qui m’a permis de terminer cette thèse avec un regain
d’énergie.
Merci enfin, parce que je crois que cette thèse a commencé avec elles, à Marie-Rose
Dumont et à Aziza Sadki.
1
Introduction
Cette thèse se donne pour but d’étudier la presse coloniale française entre 1830 et 1880,
et plus précisément l’une des problématiques qui explique cette presse à cette période
donnée : l’émergence, par les textes, d’une identité coloniale qui réévalue la distance entre
l’exotisme et l’identité. La colonisation française est un pan de l’histoire nationale – et mondiale
– qui s’est développée sous différentes formes, avec différents résultats et sur différents
territoires : mais à cette hétérogénéité problématique répond l’unité d’un corpus littéraire, celui
de la presse. Bien plus encore que le livre, le journal est soumis à une matrice médiatique
première, à un modèle que les différents périodiques réalisent : cette forte contrainte, assortie
d’autres impératifs annexes (la répercussion des nouvelles, la circulation des textes, les voyages
des journalistes) fait du journal colonial un objet particulièrement propre à révéler les
ressemblances et les divergences des écritures coloniales. Les textes de la presse coloniale
appartiennent tous en effet, quel que soit le statut de la colonie et quel que soit son avenir, à un
modèle médiatique national que l’on adapte au cadre territorial. À l’échelle de l’empire français,
chaque colonie a son histoire médiatique particulière, conditionnée par ses problématiques
propres, qu’elles soient historiques, sociologiques, littéraires ou médiatiques. Au loin apparaît
également l’histoire médiatique nationale qui égrène les étapes de la naissance du journal à la
française et ses transformations matérielles et poétiques. Justement, la présente thèse trouve son
unité et sa justification dans le corpus traité : c’est le journal français, sa structure et ses
orientations, qui sont au centre d’une réflexion sur l’adaptation d’une matrice médiatique aux
divers cadres coloniaux. Ce corpus présente un organisme semblable quel que soit le territoire
sur lequel il est produit : c’est le premier invariant sur lequel nous faisons reposer les fondations
de notre étude d’une littérature (pré)coloniale, précédant la littérature coloniale instituée et
succédant à la littérature des découvertes et des voyages si l’on adopte un schéma dans lequel
l’histoire littéraire serait linéaire et régulière. Plus que sur des aires géographiques limitées,
c’est sur les variations de la présence coloniale française que nous allons centrer cette étude, et
plus précisément encore sur le produit médiatique d’une appropriation territoriale. Le corpus
de la presse produite dans les territoires coloniaux, pour et par les colonisateurs, permet de
problématiser un des aspects de l’identité des sociétés coloniales françaises en respectant leur
2
hétérogénéité fondamentale par une étude comparative1. Puisque c’est un mécanisme général
que nous voulons interroger, la comparaison de territoires coloniaux très différents sur une
durée suffisamment longue pour permettre de voir de grandes évolutions semble la meilleure
méthode. C’est en effet le principe de « société coloniale2 » que nous visons, et ici de société
coloniale française dans ses variations sur différents continents, face à différentes
cultures : l’inflexion particulière que prend notre étude est que nous interrogeons le corpus sous
un angle littéraire, que nous faisons ressortir cet aspect de son identité. Les textes de la presse
coloniale ressortissent tous en effet à cette littérature médiatique qui ne se résume pas à des
bulletins d’information, mais constitue au contraire l’un des plus formidables laboratoires
littéraires du XIXe siècle. Or les responsables coloniaux ont attribué à la presse une mission
première de toute importance : créer la colonie au plan culturel, l’ancrer comme une identité à
part, la développer littérairement. Cette ambition se réalise pleinement dans les décennies qui
suivent 1880 par la production d’une littérature coloniale reconnue et publiée sous la forme de
livres : mais avant cette date, c’est par le journal que passe la littérature coloniale, par un « hors
livre » qui s’écrit dans les colonnes des périodiques.
D’un point de vue matériel, l’on peut se demander ce qu’est devenue la presse coloniale
française : un onglet présentant les périodiques de la Bibliothèque Nationale de France ; des
séries de cartons dans des archives nationales ou départementales ; l’expression apparaît
également dans quelques études ciblées présentant les journaux de telle ou telle colonie sous un
angle le plus souvent historique… Cet éparpillement des collections ne rend pas apparente
l’unité du corpus – car c’est bien d’un corpus qu’il s’agit –, de la même manière qu’il ne permet
pas d’envisager au premier regard son aspect littéraire. Et pourtant, cette voisine de la littérature
coloniale qu’est la littérature médiatique coloniale peut comme elle réunir des auteurs, des
conditions, des territoires différents sous une même étiquette : celle d’une presse particulière,
pas seulement locale, mais déclinant des identités coloniales selon une même matrice. De la
même manière que la littérature coloniale est une forme de littérature réaliste, la presse
coloniale est avant tout une forme de littérature médiatique. L’ensemble des périodiques qui
répondent à cette catégorie n’est pas numérisé ; mais quelques titres le sont, et la Bibliothèque
1 Il sera donc question ici, exclusivement, de la presse francophone, bien que les colonies françaises aient également produit des journaux en d’autres langues : langues dites indigènes, mais aussi langues européennes (par exemple les journaux en italien ou espagnol parus en Algérie). 2 L’objet complexe que désigne une expression comme « société coloniale » est à comprendre au croisement de l’histoire, de la sociologie et de la littérature. Voir l’article de Georges Balandier, « La situation coloniale. Approche théorique », Cahiers internationaux de Sociologie, XI, 1951, p. 44-79. L’historienne Isabelle Merle en a fait une analyse récemment, eu égard au caractère fondateur de l’article : Isabelle Merle, « ʺLa situation colonialeʺ chez Georges Balandier. Relecture historienne », Monde(s), 2013/2, n° 4, p. 211-232.
3
Nationale de France les présente en voisins d’autres corpus médiatiques, « presse culinaire »,
« presse d’annonces » et « presse de cinéma » entre autres :
À la fin du XIXe siècle, l’expression « Presse coloniale » recouvre un ensemble de périodiques facilement identifiables. Elle décrit en effet les journaux édités dans les colonies et les organes qui, depuis la métropole, s’intéressent aux questions coloniales. À la lumière de l’histoire de la colonisation au XXe siècle et de la presse qu’elle a engendrée, il est nécessaire d’ajouter une autre dimension à cette définition. La presse coloniale, qu’il ne faut pas confondre avec la presse colonialiste, représente un éventail de tendances : des journaux qui assurent la promotion et la mise en valeur des colonies jusqu’aux publications anticolonialistes qui apparaissent dans l’entre-deux-guerres, en passant par ceux qui, sans nécessairement relever de la presse anticolonialiste, ont critiqué les politiques coloniales3.
La présentation est large, et ne précise pas un point important : les journaux numérisés
ressortissent plutôt à des publications du XXe siècle, ou à des publications métropolitaines ; il
n’y a sous ce même onglet que très peu de périodiques parus avant 1880 dans les territoires
coloniaux. Cette première remarque montre les manques qui entourent le corpus que nous allons
étudier.
En outre, cette presse coloniale locale qui nous intéresse, « non métropolitaine », est
importante par les chiffres comme par le poids symbolique qui est le sien : et l’on peut s’étonner
de devoir préciser que « presse coloniale » ne désigne pas forcément et premièrement les
organes métropolitains destinés à promouvoir l’action coloniale. Mais le fait est que la
définition même de la presse coloniale est problématique : il faut souvent redoubler
« coloniale » par la précision « non métropolitaine ». Ce que ces précautions et cette répétition
signalent, c’est à quel point la métropole est première dans la constitution de la colonie, dans
l’imaginaire actuel que l’on en a. Quand l’on envisage ce corpus, et passée cette première étape
de définition par le local, il apparaît que la presse coloniale locale pourrait n’être qu’un avatar
exotisant de la presse provinciale. Il est vrai qu’elle présente plusieurs points communs avec
son équivalent régional : retards de publications, textes dont la valeur esthétique peut être
problématique, positionnement par rapport au centre que constitue Paris… Mais la spécificité
de la presse dans le contexte colonial tient à sa valeur symbolique (elle signale l’appartenance
à la culture française) et pragmatique (elle tient lieu de littérature locale). Ces deux axes se
retrouvent d’ailleurs, avec les variations nationales auxquelles l’on peut s’attendre, dans les
colonies anglaises. La presse coloniale est ainsi fondatrice aux États-Unis où elle désigne les
journaux parus avant l’indépendance, mais elle est également importante en Australie ou en
Afrique du Sud : le rôle des publications médiatiques est suffisamment reconnu dans ces pays
3 Voir http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/presse-coloniale. Consulté le 7 août 2017.
4
pour que l’on s’interroge sur l’absence de reconnaissance qui caractérise la presse coloniale
issue de l’empire français. Sans doute cela tient-il à l’idée du corpus canonique français, qui
s’accommode mal de littératures moins légitimes, moins reconnues.
Au cours du XIXe siècle pourtant, lorsque les puissances coloniales s’emparent d’un
territoire pour le coloniser, elles mettent en place les structures administratives propres à la
constitution d’une communauté coloniale : bureaux du gouverneur, tribunaux, casernes,
commerces et entrepôts apparaissent assez rapidement. L’on pourrait donc penser, à l’instar de
Gabriel Audisio, écrivain de l’école d’Alger et chantre de la littérature coloniale, que les
premières décennies des colonies ne sont faites que de préoccupations économiques, qu’elles
ne comptent aucun écrivain, et que les accompagne une presse administrative, orientée vers la
conquête, l’agriculture, le commerce :
Pendant plus de cinquante ans, l’Algérie n’a pour ainsi dire pas eu d’écrivains à elle, et c’était bien normal : les soldats, les pionniers, les colons de l’âge héroïque avaient autre chose à faire que d’écrire ; ils ne racontaient pas l’Algérie, ils la faisaient avec leur sueur et leur sang4.
Ce serait oublier qu’à côté des soldats et des fonctionnaires, des pionniers et des colons,
les puissances coloniales commencent aussi par mettre en place d’autres lieux symboliques, par
construire d’autres bâtiments : théâtres, imprimeries, écoles sont également au premier plan de
l’implantation coloniale. Plus précisément, l’argument de l’écrivain algérianiste est contredit
d’abord, et pour rester sur son propre territoire, par l’existence même de journaux variés qui se
répondent durant ces cinquante premières années de la colonisation de l’Algérie : L’Estafette
d’Alger paraît brièvement mais dès 18305 ; Le Moniteur algérien est lancé en 1832, et
L’Akhbar, premier titre privé, sort son premier numéro le 12 juillet 1839. De ces premières
étapes à la multiplication des titres dans les années 1880, en passant par les éclosions éphémères
de 1848 ou 1870, la presse algérienne locale témoigne d’une belle vitalité qui ne se résume pas
à des annonces de ventes de biens et de départs de bateaux. Dans les autres territoires coloniaux
s’accomplit le même phénomène : la conquête est souvent suivie de près par une feuille
officielle qui intègre dès qu’elle le peut une littérature – embryonnaire peut-être, mais littérature
tout de même – à côté des chiffres qui rythment la vie coloniale : arrivées et départs, naissances
et morts, faillites et mises aux enchères. Ainsi, outre les bulletins administratifs, une perspective
chronologique montre que les journaux officiels paraissent dans la décennie suivant la conquête
4 Gabriel Audisio, « Les écrivains algériens », Documents algériens, n° 67, 1952, p. 113. Cité par Alain Calmes, Le Roman colonial avant 1914, Paris, L’Harmattan, 1984, p. 62. 5 Cette temporalité de l’urgence est illustrée, par exemple, dans le « roman historique » Ali le renard d’Eusèbe de Salle : récit de la conquête, il paraît en 1832 chez Gosselin à Paris et met en scène dans son chapitre VII (« Le Conseil de censure ») la création, sur le vif, de L’Estafette d’Alger. Nous reviendrons sur cet épisode du livre.
5
française : Le Moniteur Impérial de la Nouvelle-Calédonie et dépendances paraît en 1859 alors
que le territoire est sous contrôle français depuis 1853 ; Tahiti possède son Messager dès 1847
alors que la prise de possession française date de 1842 ; Le Courrier de Saïgon, journal officiel
de la Cochinchine, paraît en 1864, deux ans après la prise de possession du territoire6. En ce
qui concerne les territoires issus de la première colonisation, les Antilles, l’île de la Réunion et
la Guyane ont des journaux dès le XVIIIe siècle, appartenant ainsi à l’histoire ancienne du
journalisme français qui suivra les évolutions du XIXe siècle7. À la fin du siècle, chaque colonie
compte une belle floraison de titres privés, et pas seulement des titres officiels. Un cas qui se
situe à la limite de l’histoire coloniale fait ressortir encore l’importance du journal dans la
colonie : lorsque le marquis de Rays se lance dans la fondation de la colonie de Port-Breton en
1879, un journal colonial accompagne l’aventure ; publié à Marseille puisque la colonisation
n’est pas encore faite, il est cependant le témoin et le pendant textuel de cette tentative coloniale
avortée, qui est rapidement qualifiée d’escroquerie8. C’est dire à quel point, dans ce siècle
médiatique qu’est le XIXe siècle, les colonies sont loin de rester à l’écart du grand mouvement
médiatique qui anime la métropole : elles aussi vivent une ère médiatique, mais avec des
caractéristiques propres. La presse coloniale devient donc consubstantielle à cette deuxième
période de colonisation française : c’est à partir de ce constat que l’on peut progresser vers
l’idée d’une constitution médiatique et littéraire de l’identité coloniale au cours du siècle.
Le moment est propice, justement, à une telle étude de la presse coloniale. La vague de
numérisation de la presse qui a cours dans plusieurs institutions de conservation est le signe
d’un intérêt croissant pour les corpus médiatiques : même si la presse coloniale française datant
d’avant 1880 n’est majoritairement pas numérisée, son exploration dans différents domaines
gagne en puissance9. Nous avons pu comprendre, grâce à la numérisation des corpus du XXe
siècle, comment le réseau médiatique allait évoluer ; nous avons pu alors avoir une idée de
l’identité des périodiques coloniaux parus plus tard – ne serait-ce que dans les années
1880 – dans les territoires qui nous intéressaient. En outre, et puisque notre approche tend à
subsumer les différentes aires de l’empire colonial français pour aboutir à une vision globale de
6 Actuellement, sud du Viêt Nam. Saïgon est l’actuelle Hô-Chi-Minh-Ville. 7 Le site http://dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/ permet de retrouver les traces de ces publications. Consulté le 7 août 2017. 8 Sur la fausse colonie du marquis de Rays, voir : Anne-Gabrielle Thompson, « Une escroquerie à la colonisation : l’entreprise du marquis de Rays à ʺPort-Bretonʺ », Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 238, 1er trimestre 1978, p. 21-39 ; Bill Metcalf, « Utopian Fraud : The Marquis de Rays and La Nouvelle-France », Utopian studies, vol. 22, n° 1, 2011, p. 104-124. Le journal relatif à l’entreprise est disponible sur Gallica. 9 Et ce au moment même où nous écrivons : pour preuve, la consultation de L’Océanie française, journal de Tahiti paru entre 1844 et 1845, en mai 2017 à la Bibliothèque Nationale de France a été suivie par la numérisation du journal le 22 juin 2017.
6
la presse coloniale française, s’inscrire dans un réseau de titres en cours de numérisation a
confirmé notre appréhension d’une bibliothèque médiatique dépassant les frontières nationales
et s’épanouissant dans un réseau francophone10. Mieux encore, les périodiques coloniaux au
sens large, francophones ou non, peuvent offrir une possibilité de comparaisons intéressantes
avec notre corpus, à partir d’études déjà réalisées11. Pour les journaux non numérisés, les fonds
des Archives Nationales d’Outre-Mer et de la Bibliothèque Nationale de France constituent le
point de départ de nos dépouillements12. Nous avons pu y ajouter un dépouillement aux
Archives Départementales de la Réunion, et des échanges avec le conservateur des Archives de
Nouvelle-Calédonie. Il a fallu également, à partir de ces consultations, exclure du corpus
certains périodiques. Après quelques dépouillements, certains territoires ne se sont pas avérés
posséder une presse assez riche pour donner prise à une étude littéraire : ainsi des comptoirs du
Sénégal, représentés par le Moniteur du Sénégal et dépendances, qui reste malheureusement un
journal purement administratif et qui n’offre donc pas assez d’aspects saillants pour une étude
littéraire ; ainsi de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui avant 1880 ne possède qu’une feuille officielle
très administrative, elle aussi. La structure du comptoir et le trop petit nombre de Français
présents sur place expliquent sans doute ce défaut de matière. Il ressortit aussi à une autre
particularité de notre corpus quand il est envisagé sous un angle historique : il existe des écarts
flagrants de bibliographie critique et historique selon les territoires. Ce n’est pas une surprise,
et ce constat est même intuitif : la Nouvelle-Calédonie a suscité moins d’études que l’Algérie
en ce qui a trait à la société ou à la culture coloniale, alors même que les deux territoires
connaissent théoriquement une colonisation qui repose sur le principe du peuplement.
Quant aux bornes chronologiques de notre étude, elles se sont imposées à partir d’une
lecture croisée du projet : l’histoire coloniale et l’histoire médiatique ont été prises en compte.
L’année 1830 marque le début de la présence française en Algérie ; médiatiquement, c’est de
1836 que l’on peut dater le début d’une nouvelle « ère médiatique13 ». Entre 1830 et 1880, l’on
peut estimer que vont se développer dans l’empire colonial français plusieurs centainesde
périodiques : parutions officielles, parutions éphémères, titres n’ayant produit qu’un numéro ou
10 La plateforme Medias19 offre ainsi une liste de ressources pour trouver des périodiques du XIXe siècle numérisés : http://www.medias19.org/index.php?id=80. Elle offre aussi une carte permettant de les situer ; cette carte permet de se représenter les aires francophones et d’établir des liens entre la presse coloniale et la presse étrangère francophone : http://www.medias19.org/index.php?id=10575. Consultés le 14 avril 2015. 11 Ainsi de la presse francophone égyptienne, dont on peut trouver une liste et certains exemplaires numérisés à l’adresse suivante : http://www.cealex.org/pfe/presentation/liste_200ansPFE.php#haut. La presse belge est elle aussi en cours de numérisation ; or elle était une source d’informations pour la presse coloniale française, notamment par le biais de l’Indépendance Belge : http://belgica.kbr.be/fr/coll/jour/jour_fr.html. Consultés le 14 avril 2015. 12 À partir de maintenant, respectivement ANOM et BNF. 13 Marie-Eve Thérenty et Alain Vaillant, 1836, l’an I de l’ère médiatique, Paris, Nouveau Monde, 2001.
7
au contraire entreprises florissantes, ces journaux n’ont pas tous été conservés, et parfois même
n’ont laissé que très peu de traces. Ce qui est certain, c’est que le nombre de périodiques explose
dans les années 1880, développement concomitant d’un changement de stratégie coloniale : la
Troisième République amplifie l’expansion de l’empire (protectorat sur la Tunisie en 1881,
annexion du Tonkin en 1884, de Madagascar en 1896, constitution aussi d’un parti colonial
plus organisé et plus influent qu’auparavant14). Ces premières indications ont orienté le choix
des bornes de notre étude : médiatiquement et historiquement, 1830 et 1880 apparaissent
comme des jalons importants. Les périodisations adoptées par la plupart des chercheurs en
littérature et en histoire montrent que la période qui commence avec la IIIème République amène
une rupture consommée en 1880 : les périodisations adoptées hésitent entre 1870 et 1880
lorsqu’il s’agit de grands découpages chronologiques permettant une vue large du phénomène
colonial15. L’année 1880 nous semble davantage adaptée à notre projet, et nous suivons en cela
l’idée qu’il s’agit alors d’un « moment idéologique spécifique du colonialisme européen : celui
au cours duquel, dans les années 1880-1930, la justification morale de la colonisation s’impose
aux dépens de, mais ne se substitue pas complètement à, sa justification économique16 ». Nous
nous arrêtons donc avant cette entreprise de « justification morale » de la colonisation qui ira
de pair avec la naissance de la littérature coloniale comme genre de (para)littérature bien
identifié. En outre, si nous n’avons pas choisi 1870 comme borne finale, alors que c’est une
date parfois adoptée dans les chronologies coloniales, c’est parce qu’elle ne rendait pas compte
d’une évolution propre à l’histoire de la presse, à commencer par la promulgation des lois sur
la liberté de la presse du 29 juillet 1881, promulgation qui marque un tournant important dans
l’historiographie médiatique. S’arrêter en 1870 serait le signe d’un calque politique qui ne rend
pas compte d’une cohérence médiatique ; poursuivre après 1880 modifierait profondément la
cohérence de notre corpus, en l’augmentant de manière vertigineuse, et y compris pour des
titres éphémères.
14 Voir notamment l’ouvrage de Raoul Girardet, L’Idée coloniale en France de 1871 à 1962, Paris, Hachette, 1990. 15 Raoul Girardet présente ainsi les dix premières années de la Troisième République comme « une sorte de parenthèse dans l’histoire de l’expansion coloniale française » (p. 24) ; pour ce qui est de la littérature, Bernard Mouralis étudie « un corpus qui correspond à la période 1880 – 1960 et qui […] montre que ce grand ensemble est lié à la mise en place de la colonisation territoriale ». Référence : « Pourquoi étudier les littératures coloniales », Cahiers de la Sielec, 2003, n° 1, Paris-Pondichéry, Kailash, p. 17. Martine Astier-Loutfi, dans Littérature et colonialisme : l’expansion coloniale vue dans la littérature coloniale française, 1871 – 1914, donne comme bornes à son étude 1871 – 1914 ; c’est ce que font aussi Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire dans leur ouvrage La Culture coloniale. La France conquise par son empire en faisant porter leurs études sur la période 1871 – 1931. David Spurr dans The Rhetoric of empire étudie aussi la période 1870 – 1960 ; Hans-Jürgen Lüsebrink étudie La Conquête de l’espace public colonial. Prises de parole et formes de participation d’écrivains et d’intellectuels dans la presse coloniale entre 1884 et 1960. 16 Romain Bertrand, « Les sciences sociales et le ʺmoment colonialʺ : de la problématique de la domination coloniale à celle de l’hégémonie impériale », Questions de recherche / Research in Question, n° 18, juin 2006, p. 14. URL : https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01065637/document. Consulté le 7 décembre 2015.
8
Choisir 1830 et 1880 comme bornes, c’est se situer dans le premier développement de
la presse coloniale, avant sa fulgurante croissance de la fin de siècle. Il s’agit enfin pour nous
de trouver, grâce à l’étude de cette période antérieure, une sorte de « chaînon manquant » entre
le récit de voyage et le roman colonial : l’on postule que le XIXe siècle médiatique prend en
charge la transition entre ces deux types de littérature qui sont liées à un espace d’abord perçu
comme exotique, puis comme colonial17. La période d’étude choisie se joue au cœur de ce
moment où s’accélère la mondialisation de l’information, où le bateau à voile est remplacé par
le bateau à vapeur, où le télégraphe fait son entrée dans le monde de la communication, où les
colonies françaises inscrivent leurs identités territoriales face à la métropole autant que dans un
système régional qui ne se résume pas à la nation. Un exemple de ces identités territoriales en
cours d’affirmation se trouve dans la langue et ses emplois : la parution de fables en créole se
fait dans les Antilles, en Guyane et à la Réunion dans les années 1860. Une identité linguistique
qui tend à revendiquer une langue autre émerge donc sur ces territoires, cependant qu’en
Algérie les nouvelles et chroniques deviennent « algériennes » par leurs sous-titres ; la
Nouvelle-Calédonie développe aussi ses chroniques dans les années 1860, en les disant
« calédoniennes » et en traitant de la vie coloniale. Une évolution coloniale est donc en marche,
qui est coordonnée sur des territoires différents ; pourtant, ces trois exemples tirés de trois
territoires différents laissent entrevoir un risque : celui de céder à une analyse téléologique de
la situation, et, en miroir, celui de se borner à remarquer des faits en ne pariant que sur leur
coïncidence. Il nous faut donc adopter un juste milieu, et tirer de ces cas particuliers une
inscription dans un système colonial plus global. Tout en reconnaissant la justesse des
observations historiographiques récentes qui postulent que « l’idée de modèle national de
colonisation ne résiste pas à la diversité des situations et des pratiques coloniales au sein de
chaque formation impériale18 » et qu’« une situation coloniale relève rarement d’une seule
logique impériale19 », c’est cependant les liens très spécifiques entre une presse au modèle
français et sa réalisation effective sur des territoires ultramarins que nous visons.
Outre ces problématiques, nous avons axé notre titre autour d’une opposition qui n’est
pas nouvelle entre l’exotisme et les identités ; elle nous a semblé rendre compte des tensions
qui existent a priori dans la presse coloniale. La référence qui fonde notre réflexion en la
17 Grégoire Holtz et Vincent Massé, « Étudier les récits de voyage : bilan, questionnements, enjeux », Arborescences : revue d’études françaises, n° 2, 2012. URL : http://id.erudit.org/iderudit/1009267ar. Consulté le 6 février 2015 ; Roland Le Huenen, « Le récit de voyage : l’entrée en littérature », Études littéraires, vol. 20, n° 1, 1987, p. 45-61. URL : http://id.erudit.org/iderudit/500787ar. Consulté le 31 janvier 2015 ; Jean Sevry, Un Voyage dans la littérature des voyages. La première rencontre, Paris, L’Harmattan, 2012. 18 Pierre Singaravélou, « Introduction », Pierre Singaravélou (dir.), Les Empires coloniaux. XIXe – XXe siècle, Paris, Points, 2013, p. 24. 19 Ibid., p. 25.
9
matière reste celle des ouvrages d’Edward Said, principalement L’Orientalisme et Culture et
impérialisme, ainsi que les critiques qui ont pu lui être faites et les débats suscités par son
modèle d’analyse : c’est dans un dialogue avec ce type de projets que nous ancrons les
prémisses de l’étude20. L’analyse de Said a été nuancée depuis sa publication, et la constitution
de son corpus a pu être critiquée ; mais il n’en reste pas moins que ces ouvrages ont représenté
la possibilité d’une nouvelle étude de la colonisation. Les questionnements sur la nation et la
presse font également partie de ces nouvelles approches dans lesquelles nous nous inscrivons21.
En effet, les périodiques officiels, premiers nés de la presse coloniale non-métropolitaine, ont
une mission d’éducation : pour garder le lien avec la patrie lointaine autant que pour accéder à
la formation d’une nouvelle entité, ils forment en effet leur lectorat à un nouvel
environnement ; et même dans les titres privés, des particularismes se retrouvent qui laissent à
penser que cette mission d’éducation des colonisateurs est un pilier définitoire de la presse
coloniale, qu’elle soit explicitement placée sous l’autorité officielle ou non.
Dans cette perspective, nous nous limitons aux colonies françaises, et en ce sens nous
n’entrons pas dans les problématiques actuelles des historiens, davantage orientées vers la prise
de parole indigène ou une réévaluation des territoires coloniaux. Il y a quelques années, Jean-
Frédéric Schaub posait ainsi la question de la pertinence des études coloniales qui, se limitant
au cadre impérial français, ne rendent compte ni de l’intégration de l’histoire coloniale dans
une histoire nationale, ni de la spécificité régionale des aires colonisées22. Il y aurait donc
perpétuation de l’idée coloniale dans le mouvement même qui veut les étudier en tenant compte
de leur histoire. Mais l’approche que nous avons choisie ici est justifiée par les études littéraires
médiatiques et non par les écoles historiques actuelles, sujets elles-mêmes de débats que Patrick
Boucheron et Nicolas Delalande ont résumé dans l’ouvrage qu’ils ont dirigé en 2013, Pour une
histoire-monde23. La présente thèse ne peut se livrer à une étude « à parts égales24 » de la
littérature médiatique coloniale, et pour cause : l’objet même du journal est l’un des outils
20 Edward Said, L'Orientalisme : L'Orient créé par l'Occident, trad. Catherine Malamoud, Paris, Seuil, [1978], 1980 ; Culture et impérialisme, trad. Paul Chemla, Paris, Fayard, [1993], 2000. 21 Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), Presse, nations et mondialisation au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2010. 22 Jean-Frédéric Schaub, « La catégorie "études coloniales" est-elle indispensable ? », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2008/3, p. 625-646. 23 Patrick Boucheron et Nicolas Delalande (dir.), Pour une histoire-monde, Paris, Presses Universitaires de France, 2013. 24 Selon le titre de l’ouvrage de l’historien Romain Bertrand, L’histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècles), Paris, Seuil, 2011. L’expression « à parts égales » est analysée comme un slogan par Patrick Boucheron, « L’entretien du monde », Patrick Boucheron et Nicolas Delalande (dir.), Pour une histoire-monde, Paris, Presses Universitaires de France, 2013, p. 12-13. Voir aussi p. 14 son analyse de l’injonction faite aux jeunes historiens : « Aussi doit-on prendre garde à ce que […] l’histoire connectée n’apparaisse pas désormais comme une obligation morale à des chercheurs qui devraient s’excuser de ne pas pratiquer l’histoire à parts égales, par manque de sources ou de compétences ».
10
majeurs de la domination coloniale, et ne laisse pas s’exprimer les indigènes25. Nous n’adoptons
pas non plus une perspective inter-impériale : parce que le journal présente des écritures et des
différences nationales, se cantonner à l’empire français apparaît comme le choix le plus
cohérent lorsqu’il est question des liens entre l’identité et la littérature26. Si elle n’apparaît pas
au premier plan, l’armature impériale est cependant sous-jacente à notre étude27.
Il faut ensuite considérer ce corpus comme littéraire, et pour cela dépasser son statut
actuel d’archive historique, sa littérarité problématique. Ce statut ambigu n’est pas spécifique
à la presse coloniale ; il ressortit à l’ensemble des écrits médiatiques. La presse coloniale a cette
spécificité cependant qu’elle fait office d’archives à bien des niveaux : elle contient les
annonces d’arrivées et de départs, elle renseigne sur les décrets officiels, elle fournit les avis de
ventes d’esclaves et de propriétés ; et les textes historiques que nous venons d’évoquer
contiennent des éléments eux aussi riches dans une perspective historiographique… Outre ces
éléments qui relèvent d’une histoire matérielle ou politique, les textes qu’elle contient peuvent
intéresser les historiens en ce qui concerne les mentalités. Rien d’étonnant alors à ce que
plusieurs thèses aient montré l’intérêt que l’étude de la presse coloniale pouvait avoir d’un point
de vue historique : ainsi, par ordre chronologique, on trouve d’abord une étude sur La Presse
dans le département de Constantine28 ; puis, en 1984, sur la Presse de la Nouvelle-Calédonie
au XIXe siècle (1859 – 1900)29 ; en 1986, mais effectuée et publiée à Alger, ce qui est intéressant
quant à la portée de ces études dans le monde post-colonial, une thèse sur La Presse musulmane
algérienne de 1830 à 193030 ; enfin, dans le cadre des études plus récentes sur la presse, une
thèse sur Feuilletons et Histoire. Idées et opinions des élites de Bourbon et de Maurice dans la
presse de 1817 à 184831 a été soutenue à la Réunion ; en études françaises et histoire, une thèse
intitulée Imagining the Peuple Nouveau : Medicine and the Press in French Algeria32 a été
25 La première attestation au sens d’un groupe opposé à celui des colonisateurs est donnée en 1770 selon le TLF : « personne faisant partie d'une population qui était implantée dans un pays antérieurement à la colonisation ». Nous utiliserons ce terme sans utiliser de guillemets et dans ce sens, bien que son utilisation dans le contexte colonial l’ait chargé de connotations négatives. 26 Voir Hélène Blais, Claire Fredj, Sylvie Thénault, « Introduction », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2/2016 (n° 63-2), p. 7-13 pour la justification, d’un point de vue historique, d’une telle approche. 27 Voir Pierre Singaravélou (dir.), Les Empires coloniaux. XIXe – XXe siècle, Paris, Points, 2013. 28 Louis-Pierre Montoy, La Presse dans le département de Constantine, thèse de doctorat en histoire sous la direction de M. le Professeur Jean-Louis Miège, Université de Provence, 1982. 29 Georges Coquilhat, La Presse de la Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle (1859 – 1900), thèse de doctorat en histoire sous la direction de M. le Professeur Jean Chesneau, EHESS, 1984. 30 Zahir Ihaddaden, La Presse musulmane algérienne de 1830 à 1930, Alger, ENAL, 1986. 31 Fabienne Jean-Baptiste, Feuilletons et Histoire. Idées et opinions des élites de Bourbon et de Maurice dans la presse de 1817 à 1848, thèse de doctorat en histoire contemporaine sous la direction de M. le Professeur Prosper Ève, Saint-Denis de la Réunion, 2010. 32 Charlotte Legg-Chopin, Imagining the Peuple Nouveau : Medicine and the Press in French Algeria, 1870-1914, thèse de doctorat en études françaises et histoire sous la direction de M. le Professeur Edward Berenson, soutenue à New-York University, 2013.
11
soutenue en 2013 à New-York University. Ces thèses étudient la presse comme un support
particulier pour le développement d’idéologies nouvelles liées au mouvement colonial. Si elles
ont été d’une grande aide pour comprendre les conditions de production de la presse, pour
vérifier certaines de nos hypothèses et pour établir un arrière-plan historique de notre étude, il
est à remarquer qu’il n’existe pas de thèses et de mémoires en littérature portant sur le corpus
colonial français en général, dans une perspective de comparaison. Ce qui ressort en effet de
ces titres que nous avons cités, c’est l’idée que la presse coloniale doit être étudiée selon les
aires coloniales et leurs problématiques spécifiques : on ne trouve pas de vue générale de la
presse coloniale en tant que telle. Loin de nous pourtant l’idée de postuler que la colonisation
fut un bloc, et que l’on peut ainsi réduire ce phénomène ; mais c’est précisément par le jeu des
comparaisons que nous voulons penser la colonisation française dans ses nuances. Notre
interrogation rejoint ainsi des préoccupations qui dépassent le cadre national français, comme
en témoigne une thèse soutenue récemment en études germaniques et portant sur la construction
identitaire des colons dans la presse des colonies allemandes en Afrique, plus précisément dans
ses rapports à l’Allemagne33. Si les débats mêmes qui animent les études historiques coloniales
constituent, pour nous, un bon point de départ, notre approche est résolument littéraire et donc
axée sur des problématiques littéraires, au premier rang desquelles la constitution du corpus.
La constitution d’un tel corpus en effet n’est pas sans questionner différents aspects des
études littéraires. Le geste premier de notre thèse a été celui d’une collecte de grande
ampleur : les collections des périodiques coloniaux sont lacunaires, et les textes qu’ils
contiennent sont courts, fragmentés du fait même de la parution médiatique. Le critère de
l’auteur n’est pas pertinent dans la plupart des cas : les journalistes utilisent des pseudonymes,
des initiales, ils disparaissent parfois, et parfois sont les prête-noms d’une manœuvre de plagiat.
L’on se trouve donc face à un corpus à première vue décousu, constitué de fragments de textes
qu’il faut assembler pour faire advenir l’image de l’identité coloniale construite : plus que
jamais le terme de « mosaïque » semble alors adapté. Ces textes dispersés, liés aux
circonstances de leur publication, ne permettent pas non plus l’émergence d’un texte majeur
qui les surplomberait avec autorité : au contraire, souvent dans notre exposé il nous faudra
résumer, replacer, raconter les textes pour mieux amener à leur compréhension. De la même
manière, la plupart des textes que nous avons sélectionnés pour ce qu’ils apportaient à la
constitution de l’identité coloniale appartiennent au genre narratif ; mais il se trouve aussi des
33 Elisabeth Schmidt, La Presse dans les colonies allemandes en Afrique 1898 – 1916. Rapports à l’Allemagne et construction identitaire des colons, thèse de doctorat en études germaniques sous la direction de Mme la Professeure Anne Saint-Sauveur-Henn, Université de la Sorbonne Nouvelle, 2008.
12
textes poétiques, des textes de « variétés » qui correspondent bien à la rubrique dont ils
émanent34, des textes informatifs… Il se trouve dans cette recherche quelque chose qui tient au
risque de l’éparpillement ; mais ce risque appelle également à réfléchir aux gains que peut
apporter une forme de kaléidoscope. Tous les éléments de notre corpus se combinent de manière
à former une image que l’on peut faire varier. Grâce à la dispersion de l’image, grâce à la
répétition de certains motifs, c’est une identité coloniale complète et complexe qui finit par se
former.
C’est aussi dans une perspective développée par Marc Angenot35, celle de l’analyse du
discours social, que notre thèse se place plus largement, afin de lier les discours médiatiques
coloniaux aux ensembles discursifs globaux auxquels ils appartiennent. Les discours
médiatiques que nous avons retrouvés apparaissent en effet comme les traces d’un discours
social plus large qui a enveloppé les colonies françaises à un moment où elles entrent dans ce
qui est ressenti et compris alors comme une modernité. La remise en question du terme de
« discours colonial » s’est alors révélée comme un axe centrifuge de notre recherche : autant
que l’« imaginaire » ou l’« inconscient » colonial, et suivant en cela l’analyse développée par
Emmanuelle Sibeud, nous employons le terme de discours pour mettre en avant une forme de
dynamisme de la presse coloniale, qui assume sa fonction de force coloniale motrice36. Notre
hypothèse de travail repose sur l’idée que ce corpus a priori éclaté et fragmenté peut être
« unifié » grâce au regard littéraire et médiatique : l’on y retrouve des procédés d’écriture, des
poétiques, et plus généralement un discours social colonial qui les réunit.
La presse coloniale représente clairement l’instantané d’une vie coloniale, et l’on a donc
aisément compris son intérêt historique, comme on l’a vu plus haut. Mais cette écriture
momentanée a pourtant une valeur littéraire. La presse coloniale du XIXe siècle est un corpus à
part, nous l’avons dit, et peu étudié littérairement : nous nous servirons donc des outils et
pensées propres à l’étude des littératures francophones et postcoloniales pour réfléchir, à
rebours, sur la situation coloniale37. De la même manière, le champ de la littérature exotique,
34 Cette rubrique du journal permet de publier de courtes fictions, des textes humoristiques, des notices scientifiques… Elle contient donc des articles variés. Nous emploierons à partir de maintenant le terme sans guillemets. 35 Marc Angenot, 1889, un état du discours social. Consultable en ligne sur le site Médias 19 : http://www.medias19.org/index.php?id=11003. Consulté le 22 septembre 2014. 36 Emmanuelle Sibeud, « Cultures coloniales et impériales », Les Empires coloniaux. XIXe – XXe siècle, Pierre Singaravélou (dir.), Paris, Points, 2013, p. 335-376. Sur le « discours colonial », voir également : Norbert Dodille, Introduction au discours colonial, Paris, PUPS, 2011. Sous un angle plus spécifique : Oissilia Saaïdia et Laurick Zerbini (dir.), La Construction du discours colonial. L’empire français au XIXe et XXe siècles, Paris, Karthala, 2009. 37 Les ouvrages de Jean-Marc Moura, notamment : « Postcolonialisme et comparatisme », Vox Poetica, 2006 ; « Littérature coloniale et exotisme : Examen d’une opposition de la théorie littéraire coloniale », Regards
13
par ses problématiques, apporte à l’édifice théorique des bases profondes, qui peuvent entrer
directement en écho avec le corpus étudié. À considérer les périodiques coloniaux comme une
forme de littérature en situation, le regard actuel gagne en acuité sur une forme de réalité
coloniale. Les textes issus du corpus médiatique colonial se prêtent particulièrement à une étude
littéraire, et ce pour des raisons structurelles qui tiennent au journal en tant que production
culturelle. Il faut d’abord reconnaître que
la majeure partie du journal est, dès la monarchie de Juillet, faite de récits, même si les rubriques les plus nobles sont oratoires et si le lecteur, immergé dans une masse composite de textes hétérogènes, n’a sans doute pas la pleine conscience de cette prédominance du narratif38.
Parce que le narratif est le genre prédominant de la presse à la période considérée – il
reste à étudier ce qui précède la monarchie de Juillet –, les outils littéraires peuvent rendre
compte d’écritures médiatiques. C’est pour cette raison qu’il ne nous semble pas possible de
renoncer aux microlectures, aux approches précises de textes choisis pour leur exemplarité, en
précisant leur ancrage culturel et temporel. Quant à la citation d’extraits, inévitable ici, elle est
contrebalancée par une annexe contenant certains des textes importants en intégralité : certains
articles demandent une publication in extenso pour révéler leur teneur. Mais plus largement,
pourquoi donc s’accrocher aux commentaires précis des textes, puisque le corpus est large et
que la perspective adoptée pourrait être celle que développe Franco Moretti lorsqu’il indique
que la microlecture tient d’un « exercice de nature théologique39 ». Ce point de vue témoigne
d’une perspective que nous reconnaissons et acceptons ; seulement la notion même de
« genres », par exemple, en contexte médiatique, est problématique et ne peut se régler d’aussi
loin40. Pour le reste, les entrées que nous utilisons sont thématiques, analysent les tropes,
sur les littératures coloniales : Afrique francophone, Paris, La Découverte, 1999, p. 21-39 ; et son ouvrage Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, PUF [1999], 2013. 38 Alain Vaillant, « Écrire pour raconter », La Civilisation du journal : Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), Paris, Nouveau Monde, 2011, p. 779. 39 Franco Moretti, « Hypothèses sur la littérature mondiale », trad. Raphaël Micheli, Études de lettres, Lausanne, 2001, n° 7, p. 13. Citation in extenso : « on n’investit autant de temps sur des textes singuliers que si l’on estime que très peu d’entre eux valent la peine d’être étudiés. Sinon, la démarche n’a aucun sens. Si l’on porte son regard au-delà du canon (et bien sûr, le point de vue de la littérature mondiale y incitera de lui-même : il serait absurde d’en restreindre la portée), la microlecture ne fera pas l’affaire. Elle n’est pas faite pour cela, bien au contraire : il s’agit d’un exercice de nature théologique – un traitement très solennel de très peu de textes pris très au sérieux – alors que ce dont nous avons besoin, c’est d’un petit pacte avec le diable : nous savons comment lire des textes, apprenons maintenant comment nous pourrions ne pas les lire. La distance aux textes : où la distance, je le répète, est une condition du savoir. Elle permet de se concentrer sur des unités qui sont bien plus petites ou bien plus grandes que des textes : des procédés, des thèmes, des tropes – ou des genres et des systèmes ». 40 Corinne Saminadayar-Perrin, « Stratégies génériques dans l’écriture journalistique du XIXe siècle », Romantisme, 2010/1, n° 147, p. 121-134.
14
trouvent des points communs à des textes disséminés par la colonisation dans des aires
géographiques éloignées et différentes.
Ces questionnements orientent aussi notre étude, en amont, vers une réflexion plus large
et empruntée aux débats historiographiques sur la place du document historique : les notions de
traces, notamment, font écho à notre étude. Dans une perspective littéraire, cela revient à ne pas
refuser les études micro-stylistiques au motif que le corpus serait trop dispersé pour pouvoir
préciser la place exacte du texte traité. L’étude de cas, en littérature, reste en effet un bon moyen
d’accéder à une forme de vérité sur les textes qui constituent la presse coloniale – partant, une
partie de la colonie à proprement parler. Autour du cas se nouent en effet des problématiques
habituellement associées à la médecine, à la science : et le rôle de l’étude de cas n’est pas de
permettre l’affirmation d’une règle, puisque le cas est et reste bien un fragment. L’étude de cas
« donne plutôt l’occasion de mettre en relation les éléments disjoints d’une configuration qui
est au départ indéchiffrable et même impossible à repérer, et qui pour cela fait problème41 ».
Mais le choix est difficile ; et face à l’instabilité promise par les études de cas, la tentation est
grande de se réfugier derrière des statistiques, chiffres, présentations fermes d’un corpus
envisagé comme un ensemble réductible à un modèle mathématique. L’aspect fragmenté du
corpus interdit toute étude statistique signifiante, et il nous semble au contraire que les micro-
études de textes sont un moyen signifiant d’accéder à une forme de vérité sur la production
médiatique des colonies, quand bien même les textes ne peuvent prétendre à une forme de
représentativité. Dans une pensée de la littérature mondiale passant par la relation entre les
textes, dans cette pensée dynamique de la littérature comme grand œuvre total et pas seulement
collection de canons bien connus et reconnus par la postérité, l’on retrouve les notions de
cultures périphériques et de cultures centrales, de corpus valorisé ou délaissé : autant de
perspectives auxquelles nous souscrivons. Savoir ce qui était dicible ou non dans les presses
des colonies, s’interroger sur ce que chaque texte apporte à l’énonciation coloniale, formuler
des hypothèses sur la réception des textes et le positionnement des auteurs, voilà plusieurs axes
d’analyse stimulants, et qui se réalisent à travers une variation de la focale d’étude, entre une
vue large de la production médiatique ou des parcours journalistiques, et une vue recentrée sur
les textes se développe une appréhension du fait colonial dans les textes. Nous retrouvons ainsi
ce que Jacques Revel a écrit à propos de la micro-histoire :
Il s’agit, en premier lieu, de prendre le parti de la complexité là où l’histoire sociale dominante procédait par abstraction et stylisation : la micro-histoire s’assigne pour tâche d’intégrer, c’est-à-dire de prendre en compte et d’articuler le plus grand nombre possible de
41 Jean-Claude Passeron et Jacques Revel (dir.), Penser par cas, Paris, EHESS, 2005, p. 19.
15
données ; d’« enrichir » en quelque sorte le matériel de l’historien. Ce qui est recherché, en second lieu, c’est la modulation individuelle d’une histoire plus large, que l’individu soit une personne ou un groupe relationnel42.
Le « parti de la complexité » est ce qui, en premier lieu, motive l’étude de la presse
coloniale dans son rôle littéraire et identitaire : ces différents journaux, tous participant d’une
presse française au sens large, éclairent un point aveugle de la colonisation vue comme un
phénomène social et historique, partant comme un matériau pour la littérature.
Pour saisir la manière dont la presse locale a fondé en partie l’identité coloniale, il faut
partir de l’aspect matériel des journaux mêmes. Le premier temps de l’étude est donc consacré
au journal colonial en tant qu’objet signifiant, qui construit une première strate de l’identité
coloniale. Titres, auteurs, lecteurs sont trois pôles de cette identité, trois étapes qui permettent
de saisir l’unité du corpus en adoptant une vue d’ensemble, et en s’appuyant autant sur les traces
réelles laissées par les auteurs et lecteurs que sur leur représentation dans les textes médiatiques.
Le corpus présente donc une unité structurée par ces trois piliers qui ressortissent aux
particularités des publications médiatiques ; une deuxième partie analyse alors, dans les textes,
la construction du territoire. Dans l’idéologie coloniale, le territoire est en effet premier : dans
la presse, cette position prédominante est mise en lumière par le traitement de la distance à la
métropole, par certains lieux traités en abondance ; le journal colonial se caractérise également
par une écriture qui adapte les descriptions au discours colonial environnant et au phénomène
qui vise à construire un territoire familier là où les récits de voyage donnaient à lire un paysage
nouveau et une découverte. Cette appropriation textuelle du territoire colonisé aboutit à
l’attribution d’identités territoriales et littéraires : à certains espaces correspondent certains
textes, certains types de publications, sans compter la manière dont le journal propage la
nouvelle toponymie coloniale et la compréhension du territoire qui va de pair avec cette
toponymie. La représentation du territoire apparaît en fait comme la trame sur laquelle va se
développer ensuite la construction des identités diverses qui fondent la société coloniale : du
mythe de la rencontre à la représentation d’une société fragmentée, le journal participe aux
variations entre identité et altérité, aux phénomènes infimes qui vont structurer une mentalité
coloniale prise entre le local et le national. Le rapport aux indigènes, le rapport aux
métropolitains, aux voyageurs, aux figures héroïques de la colonisation – ou de la résistance à
la colonisation – est écrit dans la presse. Différents points rendent ainsi compte de cet ancrage
extrêmement local du journal en tant que structure de publication et de rayonnement de
42 Jacques Revel, « L’émergence de la micro-histoire », Sciences humaines. Hors-série, septembre octobre 1997, p. 26.
16
l’idéologie coloniale. Cette capacité à tenir un discours sur les autres et à construire en creux
une identité coloniale se signale jusque dans une esthétique qui doit beaucoup à une déformation
des traits à plusieurs niveaux : stéréotypes, satire, ironie mais aussi fictionnalisation sont des
points particuliers de l’écriture médiatique aux colonies. Ces problématiques d’écriture
aboutissent alors à un dernier mouvement qui vise à replacer la littérature médiatique coloniale
au sein d’une chronologie littéraire au long cours : le rapport aux identités de cette presse locale
et revendiquée comme telle est le pivot à partir duquel l’on peut reconsidérer d’autres
publications issues d’autres périodes, mais qui ont un lien avec la colonisation. La littérature
coloniale du XXe siècle et la littérature postcoloniale représentent deux corpus liés au nôtre par
des problématiques et des questionnements semblables : les réponses apportées ne sont pas les
mêmes, mais la perception de ces liens seule suffit à replacer la littérature médiatique dans une
dynamique d’écriture moderne.
17
Première partie – Le journal colonial
Les périodiques coloniaux du XIXe siècle ont eu à traiter de sociétés, d’événements, de
périodes mêmes qui sont différents, dans l’empire anglais comme dans l’empire français : c’est
un fait établi par de nombreuses études, et c’est la première remarque que l’on peut faire43. Quoi
de commun entre un titre réunionnais ancré dans le début du XIXe siècle et Le Courrier de
Saïgon qui paraît en 1864, dans ce qui est alors une phase de conquête de la Cochinchine44 ? Le
point commun n’est pas historique, c’est évident ; il est à rechercher dans la structure d’un
journal français organisé en rubriques qui reviennent d’un périodique à un autre, présentant une
ambition littéraire d’appréhension du monde selon la grille médiatique française. Même quand
les territoires étudiés sont soumis à d’autres influences – anglaises au premier chef – le modèle
médiatique reste français : ainsi, la Nouvelle-Calédonie, si elle est proche de l’Australie et cite
régulièrement les journaux australiens, ne cède pas à la tentation de reproduire leur format. La
première raison, dans ce cas précis, en est que le principal titre néo-calédonien est officiel ; mais
plus largement, la colonisation française est bien vécue et racontée comme l’extension de la
France à l’étranger : il s’agit donc d’exporter un modèle médiatique bien français – quitte à
l’acclimater ensuite, mais en restant dans les limites de la culture française ; c’est tout l’enjeu
des publications coloniales que nous allons étudier. En effet, le journal colonial se caractérise
d’abord par une structure, qu’il soit officiel ou privé, imprimé par le gouvernement ou par un
entrepreneur. Le plus souvent hebdomadaire, il offre une partie officielle – ou politique dans le
cas des périodiques privés –, une partie non officielle, et une dernière page de réclames et
d’annonces. Dans la première partie, le journal contient les informations coloniales (décrets,
promotions, annonces officielles, débats politiques) ainsi que les informations nationales
d’importance ; dans la deuxième partie paraissent les textes de fiction, les notices diverses, les
informations au long cours qui font du journal un objet textuel riche45. Enfin, les réclames
locales et les annonces constituent une dernière partie du journal, et rappellent le rôle
commercial et économique de la colonisation. L’on voit bien alors que le journal colonial est le
43 Clem Loyd, « British Press Traditions, Colonial Governors, and the Struggle for a ‘Free’ Press », Journalism. Prints, Politics and Popular Culture, Ann Curthoys, Julianne Schultz (dir.), Queensland, University of Queensland Press, 1999, p. 10-19. On y trouve : « Differencies between the colonies in governance and geography ensured that the reception of British press traditions varied in detail from colony to colony » (p. 10). Nous traduisons : « Les différences entre les colonies en matière de gouvernement et de géographie ont permis que l’adaptation des traditions de la presse britannique varie précisément d’une colonie à une autre ». 44 Actuellement Hô-Chi-Minh-Ville, et souvent écrit sans le tréma, que nous gardons par fidélité au titre. 45 Les feuilletons ne sont pas toujours présents dans les périodiques coloniaux : ils disparaissent parfois, puis réapparaissent sans que la raison de ces variations soit expliquée.
18
reflet de la colonie autant que son ossature : par lui passent tous les textes officiels, toutes les
annonces d’arrivées de passagers et de marchandises, mais également les articles inclassables,
les variétés qui participent de la construction de l’identité coloniale.
Les journaux que nous étudions sont définis, outre par ce modèle médiatique français
dont ils sont une réalisation, par l’endroit où ils paraissent : ils sont issus des imprimeries
coloniales, qui comptent parmi les premières structures mises en place dans les territoires
colonisés, et dont la portée symbolique est tout aussi importante que l’efficacité pratique.
L’imprimerie arrivant sur le territoire colonial signale l’appropriation culturelle du pays
conquis : les contemporains en sont conscients. Charles Desprez, arrivé en Algérie en 1860,
peintre et homme de lettres, décrit ainsi l’arrivée de l’imprimerie en Algérie, reconstituant les
temps glorieux de la conquête pour le besoin d’un ouvrage de souvenirs :
Notre presse algérienne est aussi vieille que la conquête. Elle en a même devancé le fait d’armes décisif. Dès le 25 juin 1840, dix jours avant la capitulation d’Alger, le formidable engin de Guttemberg [sic] débarquait à Sidi-Ferruch en compagnie des canons, mortiers, affûts, bombes et boulets destinés aux travaux du siège. Et le lendemain, 26 juin, les quatre ouvriers attachés à son service l’inauguraient sous une tente, en présence d’un grand nombre d’officiers de terre et de mer, de soldats et de marins accourus pour jouir du spectacle nouveau d’une imprimerie fonctionnant dans le pays des Bédouins. Elle fut baptisée du nom de l’Africaine […]46.
L’imprimerie fait donc partie d’un arsenal de guerre, et presque au sens premier du
terme : elle participe de l’effort de conquête. Cette installation de l’imprimerie qui marque la
prise de possession du territoire autant que le siège militaire, Eusèbe de Salles, autre
collaborateur de la presse algérienne, en avait parlé dès 1832, évoquant la création de
L’Estafette d’Alger dans son roman historique Ali le renard ou la conquête d’Alger47. Si De
Salles ne précise pas d’où vient l’idée de la publication, il se plaît à décrire le mécanisme qui
aboutit au premier numéro, et particulièrement les auteurs concernés :
Pour ce journal, les rédacteurs ne manquaient pas. Il y avait d’abord tous les officiers d’état-major, y compris leur chef, artisans nés de littérature militaire, puis les correspondants des trois journaux ultra de Paris, auxquels le gouvernement avait donné des sinécures à l’armée d’Afrique. Ceux-là, en prélevant la dîme sur leur correspondance avec la métropole, pouvaient donner de la politique et de l’administration. Pour l’histoire naturelle, on avait le corps des ingénieurs géographes ; pour les lettres orientales, le corps des interprètes ; pour le pittoresque, on avait des artistes ; pour les quolibets, les calembours, les bons mots, les petites scènes militaires, on avait des vaudevillistes48.
46 Charles Desprez, Alger naguère et maintenant, Alger, Imprimerie du Courrier de l’Algérie, F. Maréchal, 1868. 47 Eusèbe de Salles, Ali le Renard ou la conquête d’Alger, Paris, Gosselin, 1832. 48 Ibid., tome I, p. 148.
19
Cette variété d’hommes sollicités pour le journal correspond à la variété des visées de
la presse et signale la portée totale de la colonisation : alors même que le projet d’occupation
n’est pas bien défini, le journal, lui, apparaît le plus complet possible. Il appartient bien au
moment fondateur de la colonisation, à la marque que la France imprime sur le territoire.
D’autres types de célébrations du journal en tant que force de colonisation existent. En
Nouvelle-Calédonie, l’arrivée de l’imprimerie est rappelée à la mémoire publique quand meurt
celui qui l’avait mise en place : au cours d’une notice biographique surgit cette mention de
l’installation de l’imprimerie. Le 17 avril 1864, la partie non-officielle commence sur le texte
suivant :
On lit dans L’Opinion nationale : On annonce de Tampico la mort du lieutenant d’Infanterie de la marine Poincignon. C’était un enfant de Paris. À vingt ans, le sort le faisait soldat ; à trente, il était lieutenant et décoré. Il avait, à la première attaque de Puebla, sauvé le drapeau du régiment. […]
C’est à lui que revient l’honneur d’avoir fondé la première imprimerie (lithographique) à la Nouvelle-Calédonie49.
Une brève nécrologie lie ainsi le destin exemplaire d’un officier colonial et la première
imprimerie de Nouvelle-Calédonie ; c’est tout ce dont pourra bénéficier l’imprimerie locale en
termes d’histoire et de reconnaissance, mais c’est déjà l’indice du rôle de l’imprimerie. Ce court
texte nous informe autant sur l’importance de l’imprimerie, vue comme un symbole de la
« civilisation » française, que sur celui qui a participé à la mise en place des infrastructures de
la presse coloniale : la figure de l’« enfant de Paris », métonymie du peuple, soldat héroïque
qui parcourt le monde, met en lumière les liens entre l’imprimerie et le peuple français tel que
les colonisateurs le vantent.
Pour les sociétés issues du premier empire colonial, le problème est autre : l’imprimerie
s’est installée au cours du développement global de la colonie ; à la Réunion, la première
imprimerie est installée en 1792 pour « diffuser les actes de la Révolution à Bourbon50 ».
L’enjeu n’est pas alors celui de la conquête ou de l’appropriation, mais celui de la persévérance
de la colonie, de son amélioration – de ce « progrès » aux résonances si idéologiques. Le
journal, comme métonymie de l’imprimerie, est donc important dans la société coloniale : dans
ses pages se cristallisent certains traits de l’imaginaire colonial, et les textes qui le composent
49 Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 17 avril 1864. Le journal passe sous silence, à cette occasion, le rôle des missionnaires maristes dans l’histoire littéraire de la Nouvelle-Calédonie : « Éditer, c'était d'abord afficher l'ubiquité de l'Écriture. De la presse (à bras), que les maristes amenèrent, sortit donc en 1855 le premier ouvrage calédonien : Ba comuli hristiano nom nielaïu, à Balade et dans cette langue ». Référence : François Bogliolo, « Nouvelle-Calédonie, vieille terre d’édition », Mots, n° 53, décembre 1997, p. 103 50 Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, Vanves, Edicef, 1991, p. 201. Voir aussi Auguste Toussaint, « Les Débuts de l'imprimerie aux Iles Mascareignes », Revue d'histoire des colonies, tome 35, n°122, 1948, p. 1-26.
20
nourrissent en retour la colonie. Or le nœud majeur de notre étude réside, précisément, dans ce
lien entre le journal colonial et le territoire où il prend naissance : d’où une « mosaïque51 » de
journaux coloniaux si on observe de loin cette activité médiatique française mais non
métropolitaine. Pour s’en rapprocher, on peut donc commencer par s’intéresser au journal en
tant que publication au sein de la société coloniale, puis considérer ensuite les deux pôles qui
en font un instrument de communication : les auteurs de la presse coloniale et ses lecteurs,
qu’ils soient supposés, avérés ou évoqués. Accéder à la matérialité du journal est une première
étape nécessaire pour développer ensuite une étude plus précise des problématiques proprement
coloniales qui s’en dégagent : il faut comprendre ce qu’est réellement le journal colonial, et si
l’on peut en parler au singulier sans gommer les particularités de chaque publication.
1 Une mosaïque de journaux coloniaux
Au XIXe siècle – de nombreuses recherches, anglophones comme francophones, le
signalent – le journal est essentiel au monde colonial52. Même à Tahiti, protectorat français
éloigné de la métropole et que les images d’Épinal identifient plutôt à un imaginaire édénique
qu’à la production d’un titre de presse, le journal est important. Quand Patrick O’Reilly,
spécialiste de l’histoire des sociétés océaniques, s’intéresse à la vie culturelle tahitienne sous le
règne de Pomaré IV53, il commence son article par ces quelques lignes :
C’était le samedi qu’était distribué à domicile par des porteurs, ou remis à la poste, à 2 h du soir, l’unique périodique local, Le Messager de Tahiti. Hormis les correspondances privées, il était le seul truchement qui apportât à la colonie les nouvelles du monde extérieur54.
Suit une description du journal, et particulièrement de l’année 1855 ; mais ce qui ressort
de cette présentation, c’est la place fondamentale que Le Messager de Tahiti a tenue dans la
51 Voir Marie-Ève Thérenty, Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (1829-1836), Paris, Champion, 2003, p. 13 pour une définition plus précise et plus historique du terme. Nous nous en tenons à une acception plus générale. 52 Entre autres : Julie Codell (dir.), Imperial Co-Histories. National Identities and the British and Colonial Press, Madison, Fairleigh Dickinson Univ Press, 2003 ; Ann Curthoys et Julianne Schultz (dir.), Journalism. Prints, Politics and Popular Culture, Queensland, University of Queensland Press, 1999 ; Richard L. Merritt, « Public opinion in colonial America : content-analyzing the colonial press », Public Opinion Quarterly, 1963, n° 27, p. 356-371 ; Hans-Jürgen Lüsebrink, La Conquête de l’espace public colonial. Prises de parole et formes de participation d’écrivains et d’intellectuels dans la presse coloniale (1884 – 1960), Québec/Frankfurt am Main/London, Éd. Nota bene/IKO-Verlag, coll. Studien zu den frankophonen Literaturen ausserhalb Europas, Bd. 7, 2003 ; Elisabeth Schmidt, La Presse dans les colonies allemandes en Afrique 1898 – 1916. Rapports à l’Allemagne et construction identitaire des colons, thèse de doctorat en études germaniques sous la direction de Mme Anne Saint-Sauveur Henn, soutenue à l’Université de la Sorbonne Nouvelle, 2008. 53 Reine tahitienne (1813-1877). 54 Patrick O’Reilly, La Vie à Tahiti au temps de la reine Pomaré, Paris, Publications de la Société des Océanistes, Éditions du Pacifique, 1975, p. 201-207. Disponible sur http://books.openedition.org.
21
société tahitienne, et la manière dont il a été le seul lien avec l’extérieur de l’île. Le constat est
vrai pour bien des colonies : c’est par les périodiques que se font entendre toutes les voix du
monde extérieur. L’angle choisi par Patrick O’Reilly est celui d’une immersion dans la société
tahitienne du XIXe siècle : il faut savoir « ce que les 350 ou 400 lecteurs de ce journal à Papeete
pouvaient apprendre chaque samedi55 » : il est vrai que le journal se prête à ces reconstitutions.
Mais il se prête également à une recherche plus culturelle et littéraire : Patrick O’Reilly lui-
même inscrit le journal au sein d’une gradation qui le place en tant que bien culturel. Sont en
effet mentionnés la bibliothèque, l’écrivain public, la musique, le théâtre, tout ce qui contribue
à créer une vie culturelle dans le protectorat tahitien. Le premier point de la vie intellectuelle
tahitienne envisagée au sein d’un monde plus vaste reste bien le journal : permettant aux échos
du monde extérieur d’arriver jusqu’à l’île, il est également le lieu où s’élabore la colonie sur le
plan pratique et symbolique. Le journal est donc, à Tahiti, fondamental pour la vie coloniale :
mais qu’en est-il des autres territoires, des autres périodiques, d’un corpus médiatique envisagé
au long cours ?
Les journaux coloniaux sont tributaires de leurs territoires, on l’a dit : cela se traduit
également par la disparité du nombre de titres disponibles selon les colonies. L’Algérie en
possède un très grand nombre, alors que Saint-Pierre-et-Miquelon ne voit paraître qu’un journal
officiel exclusivement informatif qui ne se prête pas à une étude littéraire. Pour l’Algérie
encore, donc, les périodiques sont déjà nombreux si l’on se penche sur les cinquante ans que
nous prenons comme empan chronologique ; et l’on aura une idée de l’éventail des titres qui
constituent la presse coloniale non-métropolitaine, en lisant Le Chitann, journal satirique
algérien. La satire permet en effet une entrée directe dans le monde médiatique : Le Chitann
peint à grands traits le tableau au sein duquel il va prendre place, et l’on est alors au milieu des
années 1870.
AKHBAR, dont l’origine remonte aux temps mythologiques. C’est, dit-on, Protée qui fut son premier rédacteur-gérant. Il se ressentira toujours de cette origine fabuleuse. MOBACHER, journal intermittent, écrit en arabe et en français, pour la commodité des deux races, mais que jamais Français ni Arabe n’a lu de sa vie. LE MONITEUR, journal paraissant tous les jours et, pour cette raison, précieux… aux épiciers et aux marchands de tabac. LE COURRIER, journal des tempêtes ; qui a essuyé maintes bourrasques depuis qu’il est au monde et n’a jamais pu entrer dans aucun port, aborder une crique, sans que tout craque. E. Lourdau l’abandonne, après avoir fait de son chargement un inventaire qui vous
55 Id. Nous citons ces chiffres avec précaution ; car d’après Michel Panoff, on ne dénombre que 210 résidents français et 231 résidents étrangers, sans tenir compte des soldats, sur l’île en 1863. Le règne de Pomaré IV qu’évoque Patrick O’Reilly va de 1827 à 1877. Source : Michel Panoff, « Farani Taioro. La première génération de colons français à Tahiti », Journal de la Société des océanistes, tome 37, n° 70-71, 1981, p. 3-26.
22
arrache des larmes : pas une goutte d’encre à boire ! Le [fiol ?] va l’entraîner… LE JOURNAL DES COTONS, des choux, des poireaux, des carottes et du sorgho. Qui se bat les flancs pour conquérir sa place au soleil ; il mériterait de percer, car il ressemble énormément à mon palais : il est pavé de bonnes intentions56.
Cet article permet d’évoquer la variété des titres et des préoccupations coloniales
médiatiques. Apparaissent ici : par L’Akhbar l’importance de l’origine de la conquête dans une
communauté qui célèbre son identité récente, par Le Mobacher le problème fondamental de la
cohabitation entre les colonisés et les colonisateurs ; outre cela, les questions économiques
propres aux journaux, les sujets traités, les lecteurs volages… Le Chitann plaisante, mais il
informe en même temps sur ce qu’une colonie pouvait produire en termes de périodiques. Sans
doute n’en est-on pas encore à ce qu’Hans-Jürgen Lüsebrinck affirme pour la presse coloniale
du XXe siècle : « 95 % de la production littéraire africaine publiée entre 1913 et 1960 parut non
pas sous forme de livres, mais essentiellement dans la presse57 ». Mais dès ce milieu de siècle,
la presse affiche son ambition littéraire et son rôle culturel. Toute perspective gardée, et en
tenant compte de ce que la « production littéraire africaine » a de fondamentalement différent
d’une production littéraire coloniale, il faut donc reconnaître que, dans les colonies, la presse a
constitué pendant longtemps le seul média littéraire d’importance – les livres, plus chers et
vendus en librairie après une traversée longue, ne relevaient pas de la même implication du
littéraire dans la société. À propos de l’Algérie, Alain Calmes écrit d’ailleurs que
si la colonie souffre d’un grand isolement culturel, sa presse –relativement florissante – peut donner l’illusion d’une belle activité. Le journal est un support bien adapté à cette société dans l’ensemble peu instruite et peu enthousiasmée par la forme livresque, mais qui apprécie une information condensée et prédigérée58.
Nous pouvons interroger cette idée récurrente – le journal est une forme littéraire, ou au
moins culturelle, qui correspond bien au fonctionnement du monde colonial – en repartant des
journaux et de ce qu’ils affirment d’eux-mêmes quant à leur mission et le rôle qu’ils entendaient
jouer.
56 Chitann, 18 octobre 1866, « Aux populations algériennes et attentives ». Nous rappelons que « chitann » signifie diable, ou démon : c’est donc lui qui s’exprime et évoque son « palais ». En 1868, Bordeaux voit paraître des Lunettes de Satan et un Satan, tous deux illustrés et satiriques (source : http://presselocaleancienne.bnf.fr/) : preuve que le diable est un bon satiriste. 57 Hans-Jürgen Lüsebrinck, La Conquête de l’espace public colonial. Prises de parole et formes de participation d’écrivains et d’intellectuels dans la presse coloniale (1884 – 1960), Québec/Frankfurt am Main/London, Éd. Nota bene/IKO-Verlag, coll. Studien zu den frankophonen Literaturen ausserhalb Europas, Bd. 7, 2003, p. 12. 58 Alain Calmes, Le Roman colonial en Algérie avant 1914, Paris, L’Harmattan, 1984, p. 33.
23
1.1 Titres et projets : quand les journaux parlent d’eux-mêmes
Le premier lien formel qui réunit tous ces périodiques, publics ou privés, réside d’abord
dans les titres et les sous-titres choisis : c’est la première apparition d’une identité médiatique
particulière, qui ressemble sur quelques points à la presse provinciale, ou même à la presse
métropolitaine en général. Si l’on tente de dresser une typologie, on remarque la récurrence des
termes attendus pour des titres de presse : au premier chef les moniteurs officiels, puis, pour la
presse privée, le courrier et l’écho ; apparaissent ensuite des titres plus particuliers, liés aux
territoires et qui en marquent l’appropriation59. Les périodiques coloniaux se plient également
à la publication de prospectus qui constituent un discours inaugural et surplombant intéressant
à plus d’un titre. La ligne directrice que s’impose le rédacteur n’est pas toujours suivie, mais
elle témoigne du point de départ de la publication.
De quelques titres : modèle national, appartenance locale
Les titres des périodiques apparaissent comme autant d’indices forts de leur ancrage
dans le monde colonial. Les différentes échelles symboliques d’identités se jouent en effet dans
les titres, puisque l’ancrage national y côtoie l’appartenance locale. La variation la plus
marquante de ces échelles réside d’abord dans les emprunts visibles aux langues locales : le Te
Vea no Tahiti, publié en langue tahitienne, qui fusionne avec Le Messager de Tahiti pour en
former le sous-titre en 1859, après sept ans de publication, témoigne d’une attention particulière
accordée à la population autochtone dans le cadre du protectorat60. Ce journal devient à cette
date bilingue, publiant arrêtés officiels tout autant que feuilletons tirés de la littérature française
avec leur traduction. Souvent en vis-à-vis, parfois avec le décalage d’un numéro, Le Messager
affiche, par le lien entre son titre et son sous-titre, la correspondance forte entre la langue
tahitienne et la langue française. En ce qui concerne l’Algérie, la situation est plus complexe,
du fait sans doute de l’attirance orientaliste pour la culture arabe et de l’évolution du statut de
cette colonie de peuplement habitée par des Européens variés : des Français certes, mais aussi
des Espagnols, des Maltais et des Italiens. Le mélange des langues, outre les langues indigènes,
aboutira à des publications médiatiques en italien, en espagnol, en maltais ; dans un premier
temps, Le Moniteur algérien fait aussi l’expérience temporaire de la parution d’une édition dont
59 Dans ce cadre, on peut s’appuyer sur différentes sources, quand bien même les périodiques ne présenteraient finalement qu’un seul numéro conservé ou seraient incommunicables : les catalogues de la BNF et des ANOM, mais aussi le site de la BNF consacré à la presse locale et ancienne (http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil). Par ce dernier, nous avons accès, en comparaison, aux titres de la presse régionale : d’où la possibilité de réfléchir à la presse coloniale dans son rapport à une autre presse locale, métropolitaine celle-ci. 60 Il est conservé (1850-1859) à la BNF, mais pas aux ANOM.
24
le titre est écrit en arabe avant le titre français ; mais l’expérience n’a qu’un temps, celui des
années 1830. Plus largement, d’autres journaux paraissent, qui, contrairement au Moniteur,
n’abandonnent pas la langue arabe. Les stratégies d’appropriation de la langue dont témoignent
les titres de presse sont même variées, et répondent à une évolution historique de l’appréhension
de la présence française. Outre Le Mobacher (« qui annonce de bonnes nouvelles »), journal
bilingue impulsé par le gouvernement le 17 septembre 1847, L’Akhbar (l’actualité, si l’on s’en
tient à une traduction moderne ; le journal précise s’appeler « les annonces ») paru en 1839 et
Le Chitann (le démon) paru en 1865 témoignent de liens différents avec la langue. L’Akhbar,
journal sérieux et lié aux débuts de la colonisation, n’explique pas le pourquoi de son titre dans
son premier numéro et ne donne même sa traduction que dans son deuxième numéro, alors qu’il
n’est encore qu’une feuille simple :
Plusieurs de nos abonnés nous ayant demandé la signification du mot AKHBAR que nous avons donné pour titre à notre feuille, nous croyons devoir informer les personnes étrangères à la langue arabe que ce mot, dans l'idiome d'Alger, signifie annonces61.
Il présente, quelques années après, et en regard de la date française, la date en
arabe : l’intention de l’équipe de rédaction, explicitée à ce moment-là, est de l’ordre d’une
colonisation pragmatique, assimilant la culture locale dans un but principalement commercial.
Rien d’étonnant, donc, en contexte colonial :
À partir de ce numéro, nous mettrons en tête du journal la date de l’hégire à côté de la date de l’ère chrétienne. Nous espérons que cette addition ne sera pas inutile aux nombreuses personnes qui ont fréquemment besoin de connaître la correspondance du calendrier arabe avec le nôtre62.
Le Mobacher, parce qu’il s’adresse aux arabophones comme aux francophones, justifie
son titre par le lectorat visé : le projet idéologique est alors explicite, et il s’agit d’importer le
journal occidental dans la langue du pays colonisé. Reste alors le cas du Chitann, qui, bien des
années après, semble témoigner d’un emprunt ponctuel à la langue arabe qui ressortit plutôt à
une forme de « glottophagie63 » humoristique : commence à se dessiner ainsi, par la langue, une
évolution entre les années de conquête et celles de la « pacification », pour reprendre les termes
de l’époque et du discours colonial. Cette glottophagie se marquera aussi dans l’utilisation des
toponymes locaux comme titres de périodiques.
61 L’Akhbar, 19 juillet 1839. 62 L’Akhbar, 12 janvier 1843. 63 Nous empruntons ce terme à l’étude de Louis-Jean Calvet, Linguistique et colonialisme, Paris, Payot, 1974 ; et nous y reviendrons à propos du thème de l’anthropophagie (troisième partie).
25
Un autre changement indique à quel point Le Moniteur colonial est bien une sorte de
laboratoire se prêtant à la redéfinition d’une identité coloniale en passant d’abord par les
variations de titres64. Le Moniteur algérien s’interrompt en 1858 et devient en 1861 Le Moniteur
de l’Algérie : c’est le seul changement de ce type, ce passage de l’adjectif au substantif, que
connaîtra un journal colonial officiel. Or qu’est-ce que le nom « Algérie », si ce n’est une des
premières marques de la conquête française ? L’adjectif sans doute ne laisse pas assez entendre
que le territoire qui s’appelle « Algérie » depuis 1830 est bien une création française, qui
recoupe un découpage précis. Mettre l’accent sur le toponyme plutôt que sur son adjectif, c’est
bien insister sur le territoire que constitue l’Algérie, c’est aussi rappeler l’anecdote qui veut que
ce soit Adrien Berbrugger, personnalité du monde savant et médiatique algérien, qui ait
« inventé » cette dénomination pour les Français, dans le cadre même du journal65. Les années
1860 marquent l’époque où Napoléon III pense encore à la création d’un grand royaume arabe
en Algérie : le titre du journal officiel peut aussi s’en ressentir, préparant ainsi l’éventuelle mise
en place du royaume66.
Considérons les autres espaces de notre corpus : en ce qui concerne les Antilles, la
Réunion, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie ou la Cochinchine, les titres de presse n’incluent
pas d’appropriation linguistique. Cela s’explique pour la Réunion par l’absence de population
autochtone antérieure à la colonisation et le statut particulier du créole, qui mettra du temps
pour entrer dans le journal colonial et n’y sera présent que dans des genres textuels
particuliers ; pour les Antilles et la Guyane par la disparition ou le déni de la population
autochtone, avec toujours ce statut à part du créole – là aussi, l’on pourra le retrouver dans les
pages du journal, mais pas en faire une identité revendiquée. Dans ces colonies héritées du
premier empire colonial, la question de titres bilingues est donc dépassée par l’occupation
historique du territoire. Enfin, pour la Nouvelle-Calédonie ou la Cochinchine, c’est la
64 Nous reprenons ici les termes d’Anne-Marie Thiesse : « La presse, bien sûr, n’est pas seulement un laboratoire philologique et un support de diffusion de la langue nationale, elle est aussi un instrument majeur dans la création d’une conscience nationale ». Voir Anne-Marie Thiesse, « Rôles de la presse dans la formation des identités nationales », Presse, nations et mondialisation au XIXe siècle, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), Paris, Nouveau Monde, 2010, p. 130. 65 Charles Desprez, op. cit., p. 289. Voici le passage précis : « En 1836, par exemple, M. Berbrugger, fatigué de la périphrase officielle "possessions françaises dans le Nord de l’Afrique" qu’il lui fallait employer chaque fois qu’il avait à désigner la colonie, se rappela fort à propos avoir lu, dans je ne sais trop quel bouquin, le mot "Algérie". Ce mot avait le triple avantage d’être court, harmonieux, et de bien rendre la pensée. Algérie dès lors remplaça dans tous ses articles les huit mots consacrés dont il s’était servi jusqu’alors faute de mieux ». 66 Histoire de l’Algérie à la période coloniale, 1830-1962, Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Paris, La Découverte, [2012], 2014, p. 38. Voir aussi Michel Levallois, Ismaÿl Urbain. Une autre conquête de l’Algérie, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001, p. 16-17. L’idée de Napoléon III consistait à développer une domination plus discrète sur l’Algérie que la colonisation : le « royaume arabe » aurait été une entité politique dans laquelle Abd el-Kader aurait pu jouer un rôle, et qui aurait été soumise à la France sans en être une colonie.
26
représentation de la population autochtone ainsi que le statut de la colonie qui semble expliquer
cette absence d’une langue autre : outre le fait que le nombre des langues locales a pu
déstabiliser les colonisateurs, les Kanaks sont dépeints comme un peuple sauvage dont les
idiomes n’ont que peu de valeur67. En Cochinchine, c’est une dynamique semblable qui
s’observe, accentuée par le fait que la colonie n’est pas destinée au peuplement, et que la
grammaire annamite, pourtant étudiée dans les pages du journal, n’est pas destinée à être
pratiquée par tous les colonisateurs.
La langue est donc une première entrée dans le journal colonial ; mais d’autres éléments
peuvent également être attendus : ainsi, les journaux coloniaux affichent souvent dès leur titre
une appartenance locale forte. Les titres officiels prennent habituellement la forme, d’abord
d’une « feuille officielle » (quand la création remonte à une période antérieure à 1830) ou d’un
« moniteur » sur le modèle du Moniteur universel de Panckouke. Outre ces deux formes de
titres adoptés pour les journaux officiels, il reste, plus originalement, Le Messager de Tahiti
(1847), Le Courrier de Saïgon (1864) qui est le journal officiel de la Cochinchine alors
récemment française (1862), et enfin l’expérience avortée du Messager, journal officiel de la
Martinique (1863)68. Un même titre peut aussi subir quelques modifications : ainsi Le Moniteur
impérial de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (1859-1862) devient Le Moniteur de la
Nouvelle-Calédonie. Journal officiel de la colonie (1862-1886)69 sans pourtant que le régime
ait changé. Plusieurs formes de titres correspondent donc à la publication d’un journal
officiel : l’important étant bien que soit signalé le territoire. Quand les territoires sont
suffisamment étendus pour pouvoir abriter des titres de presse privés – et pas seulement d’un
journal officiel –, l’on trouve beaucoup de titres adoptant la syntaxe « courrier de – toponyme »
ou « écho de – toponyme ». L’Algérie se distingue à ce propos par la multiplicité de ses
titres : Le Saf-Saf70 de Philippeville (1844), La Seybouse71 (1848), Le Zéramna72 (1850), La
67 Nous adopterons cette orthographe pour l’ancien « canaque », en l’accordant au pluriel le cas échéant. Sur la situation linguistique en Nouvelle-Calédonie, voir l’article de Benoît Trépied, « Langues et pouvoir en Nouvelle-Calédonie coloniale. Les Kanaks locuteurs du français dans la région de Koné », Cultures d’empires. Échanges et affrontements culturels en situation coloniale, Romain Bertrand, Hélène Blais et Emmanuelle Sibeud (dir.), Paris, Karthala, 2015, p. 145-170. L’auteur résume ainsi la situation : la Nouvelle-Calédonie compte 28 langues ; une lingua franca s’est développée dans les premiers temps de la colonisation, mais, contrairement aux autres îles mélanésiennes, a été « perdue » rapidement. Il n’y a donc pas eu de pidgin, ce qui place la Nouvelle-Calédonie à l’écart des dynamiques régionales linguistiques, et rend explicite la politique de séparation entre les Kanaks et la « société "néo-française" en gestation » (p. 148). 68 Le caractère officiel de ces titres apparaît dans les sous-titres ; d’où l’absence ici de L’Océanie française, journal paru à Tahiti du 5 mai 1844 au 28 juin 1845, sorti de l’imprimerie du gouvernement, mais qui ne possède pas ce caractère officiel pour des raisons politiques – le gouverneur étant alors dans une situation instable. 69 Georges Coquilhat, op. cit., p. 31. Dans la suite de la thèse, on notera le titre simplement comme suit : Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie. 70 Safsaf est aujourd’hui une commune de Mostaganem qui tire son nom d’un cours d’eau. 71 La Seybouse est un cours d’eau, là encore ; le journal paraît à Bône (aujourd’hui Annaba). 72 Même chose pour le Zéramna, un cours d’eau de la région de Philippeville (aujourd’hui Skikda).
27
Mahouna73 (1867), L’Atlas (1872), désignent ainsi des lieux connus des colons, cours d’eau ou
montagne pour lesquels on conserve la langue arabe translittérée. Le paysage algérien entre
ainsi dans les habitudes des colons : il s’inscrit dans les publications médiatiques et dans les
discussions. Plus rarement, la référence aux toponymes peut se faire antique, comme c’est le
cas avec la parution de La Numidie (1875), marquant ainsi les efforts coloniaux pour faire
émerger un territoire antique en vue de justifier la colonisation française.
Les cours d’eau et les montagnes ne sont pas les seuls mobilisés : c’est parfois une
référence régionale qui apparaît, comme pour un Salazien74 (1833) à la Réunion, bien isolé
cependant. D’autres formes encore, moins précises, indiquent ainsi le lien de l’habitant à son
territoire, et particulièrement dans le contexte insulaire, qui fait identité à lui seul : ainsi du
Martiniquais (1854), plus précis que Les Antilles (1843) ou que La France d’Outre-Mer (1852).
Ce dernier titre semble plus proche du modèle des Colonies (1878), car il choisit d’affirmer
plutôt le statut du territoire et son rapport à la France qu’une identité proprement locale. Ces
variations d’échelle offrent une entrée intéressante dans la mentalité coloniale et son
positionnement géographique et identitaire : le lecteur du journal colonial peut ainsi être lié au
paysage qui l’entoure, au statut de son territoire, à la situation régionale de la colonie qu’il
habite. C’est dans cette perspective d’une identité géographique forte que le terme de « colon »
est lui aussi utilisé pour créer des titres : il permet en effet de lier une forme de mythologie
coloniale avec un ancrage géographique précis, faisant tenir ensemble le particulier du territoire
et l’universel de la condition coloniale. Citons ainsi Le Colon de la Nouvelle-Calédonie, Le
Petit colon algérien, Le Journal des colons (cité dans Le Chitann, mais introuvable dans les
catalogues des bibliothèques), Le Colonial (1833) et Le Colon (1853) à la Réunion, titres qui
évoquent une silhouette renvoyant au lecteur ou bien ce qu’il est ou bien ce qu’il doit être. Il
est à noter, dans ce cadre, les titres qui font apparaître l’identité créole plutôt que l’identité
coloniale : Le Créole de l’île Bourbon (1840) et Le Créole républicain (1849) marquent ainsi
une autre appartenance que celle, peut-être trop temporaire, du colon. Le créole est celui qui est
natif de l’île et qui la revendique comme origine : le statut de colon, lui, renouvelé par la
conquête de l’Algérie qui met à l’honneur l’image du colon soldat, semble connoter davantage
le travail de la terre.
L’Éclaireur de Cayenne (1849) quant à lui, est représentatif de ces quelques titres qui
font le lien entre le lieu de publication et les ambitions politiques de la rédaction ; plus
simplement, on aura de nombreux journaux affichant les mêmes titres qu’en métropole,
73 La Mahouna est une montagne au-dessus de Guelma. 74 Les Salazes sont des pics rocheux de l’île de la Réunion.
28
l’affiliation géographique ne venant qu’en sous-titre : un Propagateur (1853) martiniquais
affiche ses ambitions républicaines75, tout comme un Réveil (1849) réunionnais et
éphémère76 ; un Bien-Public (1849) réunionnais rappelle fortement la création du Bien public
(sans trait d’union, cette fois), journal éphémère paru du 24 mai 1848 au 12 décembre 1848,
fondé par Eugène Pelletan et Arthur de la Guéronnière77. La parution réunionnaise durera, elle,
jusqu’en 1861, preuve de la longévité possible des titres réunionnais, quand bien même leur
parution a été occasionnée par un contexte politique spécifique. Les parutions de 1849 se
détachent ainsi des autres titres de corpus par leur résonance nationale et non locale : leurs titres
témoignent de l’activité républicaine qui survient y compris dans les colonies. Ce qui semble
primer alors dans l’identité du journal, c’est sa fonction de médiation, d’espace public transposé
à l’écrit ; la composante locale n’est pas la plus importante. La volonté de mettre en avant cette
capacité du journal à représenter l’espace public peut aboutir à des changements de titre : c’est
le cas du dernier journal que nous avons cité, Le Bien-Public réunionnais. Il s’inscrit dans une
lignée de périodiques dont le titre va changer, mais pas le contenu, puisqu’il n’est autre qu’une
forme nouvelle du Glaneur (1832) qui deviendra ensuite Le Courrier de Saint-Paul (1843-
1848) ; le courrier restera, mais l’ancrage local sera adapté à une perspective plus large et plus
politique, puisque le titre devient Le Courrier républicain de l'île de la Réunion (1848-1849),
et très rapidement Le Créole républicain entre juillet et novembre 1849. Après l’étape du Bien-
Public, en 1862, le titre devient Le Courrier de Saint-Pierre jusqu’en 1872, et enfin Le Courrier
de la Réunion. Ces variations prouvent la portée du choix d’un titre : hésitant entre la
perspective locale (les toponymes plus ou moins précis) et l’ancrage politique (l’adjectif
« républicain » en 1849 ou le plus englobant Bien-Public), réunissant parfois les deux (Le
Créole républicain), le journal subit les choix de la rédaction et le contexte politique dans lequel
il est remanié. Un titre au départ général se spécialise donc et en quelque sorte se
« territorialise » : du Glaneur initial qui rappelle, par exemple, le journal d’Eure-et-Loir du
même titre que Gilles Feyel a étudié jusqu’au Courrier de Saint-Paul, en passant par Le Créole,
75 Le titre est en effet républicain : on trouve un Propagateur du Pas-de-Calais de la même couleur politique dans les années 1830. Voir Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), La Civilisation du journal : Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2011, p. 608. 76 Le Réveil est républicain, comme le sera Le Réveil de Blida qui paraît à un autre moment politique clef. Voici comment il est présenté dans L’Indépendant de Constantine le 24 décembre 1880 : « On lit dans le Petit Colon : Nous apprenons avec plaisir la création d’un nouveau journal républicain à Blida. Il portera le nom de Réveil de Blida. Ce titre est à lui seul un programme. […] Nous saluons de nos vœux les plus sincères ce nouveau confrère indépendant, honnête et républicain ». 77 Le titre est là encore récurrent dans d’autres régions : à la publication réunionnaise de Saint-Paul répond la publication d’un Bien Public dijonnais, paru lui aussi en 1849.
29
le même périodique montre des variantes entre perspective politique et perspective locale, et
finit par s’ancrer sous une forme politiquement neutre mais géographiquement signifiante78.
Restent enfin des titres plus précis encore, peu fréquents dans le corpus mais qui se
signalent alors par une longévité assez remarquable : La Malle (1860) réunionnaise, journal
catholique, affiche ce titre comme le rappel de ce courrier qui fait le lien entre l’île et le reste
du monde, ancrant de fait sa publication dans une connivence avec son lecteur ; Le Commercial
(1860) de la Guadeloupe affiche son projet éditorial dès son titre. Quelques Avenir enfin entrent
dans la définition d’une temporalité nouvelle : de L’Avenir de Pointe-à-Pitre (1843) à L’Avenir
de la Nouvelle-Calédonie (1883, en marge de notre corpus) en passant par L’Avenir algérien
(1865), cette pensée du progrès réunit les territoires et les époques, dans une perspective qui
apparaît tout autant en métropole : on trouve dans les archives des Avenir à Hyères, Caen, Nice,
Lodève, en Corse, dans le Loir-et-Cher, dans le Béarn79… La presse coloniale choisit donc
soigneusement ses titres, qui révèlent une partie de ses projets pour la société coloniale.
Une presse « littéraire, politique, commerciale et d’annonces » ?
La titraille est l’un des premiers éléments de l’identité que développe le journal, un
premier indice : outre le titre à proprement parler et ses connotations que nous venons de voir,
chaque journal colonial redéfinit sa silhouette par le biais de sous-titres à la forme adjectivale
ou substantive. Les sous-titres précisent ainsi le contenu du journal ou son statut : ils affichent
les prétentions des publications et permettent de les situer dans un paysage médiatique plus
large. Souvent « littéraire, politique, commercial et d’annonce », le journal colonial vise tous
les aspects de la colonie et s’applique à les faire rentrer dans les quatre pages dont il
dispose ; mais il y a des cas plus révélateurs que d’autres. Ainsi, Le Messager de Tahiti,
puisqu’il a « absorbé » le périodique en langue tahitienne Te Vea No Tahiti, en garde la trace et
la transforme en sous-titre à partir de 1860, affichant du même coup son caractère bilingue. Une
autre précision complète le titre du périodique : on lit ainsi « Journal officiel des Établissements
Français de l’Océanie Orientale » – jusqu’en 1880, date à laquelle la séparation administrative
entre la Nouvelle-Calédonie et Tahiti fait disparaître l’adjectif « orientale80 ». Le sous-titre peut
ainsi être l’occasion de préciser d’emblée une ligne éditoriale par le biais d’une citation ; ainsi
78 Gilles Feyel, « Un journal départemental et son budget, Le Glaneur, journal d’Eure-et-Loir (1830-1851) », Presse, radio et histoire, actes du 113e Congrès national des sociétés savantes, Strasbourg, 1988, Paris, éd. Du CTHS, 1989, p. 59-84. 79 On peut consulter une liste plus complète sur le site http://presselocaleancienne.bnf.fr/. 80 Voir Raoul Teissier, Messager de Tahiti (1852-1883) : Te Vea no Tahiti (1851-1859) : Edition sur microfilm : Index des articles, Paris, Service international du microfilm, 1978. Les deux journaux ont paru en parallèle pendant six ans.
30
du Conservateur de l’île Bourbon, à la présentation simple, et qui affiche : « Feuille politique,
commerciale, industrielle et littéraire (Toutes les propriétés sont inviolables) » ; ou encore, pour
L’Avenir algérien, le sous-titre « Le sol, c’est la patrie ». La tonalité conservatrice s’affiche
immédiatement, ne laissant aucun doute sur la ligne politique du journal : mais ce n’est pas le
seul rôle des sous-titres. Un titre clandestin, toujours sur l’île de la Réunion, pourra être encore
plus précis, puisque c’est l’article 7 de la Charte de 1830 qui s’affiche en devise : « Les Français
ont le droit de publier et faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois. La censure ne
pourra jamais être établie » ; or précisément, ce point n’a pas été appliqué par le gouverneur en
place81.
La presse satirique des années 1870, souvent intéressante pour le grossissement de traits
qu’elle produit, incline à penser que le sous-titre, même si le lecteur ne l’envisage même plus
quand il se livre à la lecture, est bien l’un des traits identitaires de la feuille. Ainsi, outre Le
Chitann (1866) qui se décrit sobrement comme « artistique, impolitique et peu littéraire », le
journal La Pipe en bois (1867) se présente comme « journal à peu près littéraire. Organe des
électeurs susceptibles. Impolitique, satirique, hilarique [sic], colérique, sympathique » ; La
Goguette (1867) s’annonce comme un « journal lunatique, satyrique [sic], lyrique, bachique,
humoristique, drolatique, comique et surtout impolitique ». L’énumération des adjectifs mime
en effet les sous-titres à rallonge d’une presse qui affiche l’ambition d’être à elle seule l’image
de la colonie tout entière ; la mention « impolitique », si elle est surtout une garantie de
publication, rappelle aussi les orientations politiques présentées sur les premières pages. On
peut ajouter encore La Caricature (1872) réunionnaise, « Journal charivarique, satirique et
littéraire de l’île de la Réunion » et L’Enfant terrible (1871), lui aussi réunionnais, « Journal
critique, charivarique et littéraire, paraissant à des époques indéterminées » : chacun de ces
titres précise l’importance de l’ancrage spatial ou de la périodicité du titre, rendant plus lisibles
les éléments définitoires de l’identité des autres journaux coloniaux.
Certains périodiques s’avèrent plus riches, littérairement parlant, que ce que le sous-titre
pourrait laisser penser : ainsi L’Écho d’Oran (1848), sous-titré « journal d’annonces légales,
judiciaires, administratives et commerciales de la province d’Oran », fait pourtant paraître bien
d’autres textes que de simples annonces. Pour donner une idée de cette production, l’on peut
citer certains articles parus dans les premières années, et d’abord l’exemple d’un certain
Mahmoud Cusson et de ses « Premières amours d’un renégat82 » du 9 août 1851 au 27 août
81 Fabienne Jean-Baptiste, Feuilletons et Histoire. Idées et opinions des élites de Bourbon et de Maurice dans la presse de 1817 à 1848, thèse de doctorat en histoire contemporaine sous la direction de M. le Professeur Prosper Ève, soutenue à l’Université de la Réunion, 2010, p. 167. 82 Mahmoud Cusson, « Les Premières amours d’un renégat », L’Écho d’Oran, du 9 août 1851 au 27 août 1851.
31
1851. Cusson bénéficie d’une certaine célébrité, en tant que soldat belge passé un temps dans
le camp d’Abd el-Kader, et qui s’est converti à l’Islam : ses « premières amours » ont dû valoir
une certaine renommée au journal d’Oran, contredisant son ambition un peu trop commerciale
ou légale83. Plus généralement, L’Écho d’Oran explore son environnement sans se cantonner
aux annonces ou à l’administration : le lecteur y trouve, dans la rubrique des variétés et au fil
des numéros, « Les Babouches d’Abd-el-Kassem84 », « Un Miracle d’Aïssa. Légende arabe85 »
ou des « Variétés sur la poésie86 », articles non signés mais qui rendent compte d’une volonté
de « littérariser » le contenu. Cependant, et même dans ce cas, la mention des annonces
officielles est importante, car elle signifie un plus grand lectorat possible : le journal tient alors
son rôle de moyen de publicité officielle. Quelques sous-titres sont aussi plus explicitement
« coloniaux », au sens où ils utilisent des termes du lexique de la colonisation. Le Brûlot de la
Méditerranée (1848) choisit un sous-titre qui permet de souligner la formule des « intérêts »
algériens puisqu’il est composé ainsi : « journal des intérêts algériens. Politique, commerce,
industrie, agriculture et annonces ». Cette formule souligne l’appartenance des périodiques au
contexte idéologique colonial, et l’on retrouve ce lexique dans d’autres périodiques et sur
d’autres territoires : La Réunion (1862) est ainsi le « journal des intérêts coloniaux » ; Le
Courrier de Bône (1870), « organe des intérêts de l’Est de l’Algérie » ; Le Courrier de la
Réunion (1872), « organe des intérêts agricoles, maritimes et commerciaux » ; L’Écho de la
Guadeloupe (1872), « journal des intérêts coloniaux » ; La Numidie (1875), « journal des
intérêts de la colonisation et des communes du département de Constantine ». Les « intérêts »,
quand ils sont formulés dans la presse métropolitaine régionale, se contentent d’être « locaux »
ou « communaux » ; dans le domaine colonial, ils semblent prendre une autre ampleur. Si l’on
considère que « colonial » n’est pas seulement un adjectif géographique, mais qu’il est chargé
d’une idéologie qui est celle du processus colonial, les « intérêts coloniaux » deviennent en
effet un peu plus qu’une simple mention à vocation géographique. Là encore, la prétention
littéraire n’apparaît pas dans le sous-titre : est-ce dire, en fait, que les textes de variétés visant à
rendre compte de la colonie dans une perspective littéraire sont si évidents dans un journal qu’il
ne faut pas les mentionner ? Est-ce dire, aussi, que ces mêmes textes sont d’une moindre valeur
et amènent moins de sérieux, moins de légitimité, à l’identité du journal ? Dans Le Brûlot de la
Méditerranée l’on trouvera pourtant plus d’un texte qui ne correspond pas au sous-titre
83 On trouve ses traces par exemple dans l’ouvrage de Jules Duval, Réflexions sur la politique de l’Empereur en Algérie, 1866. Mahmoud Cusson jouera en effet un rôle politique dans les débats sur l’Algérie. 84 « Les Babouches d’Abd-el-Kassem », L’Écho d’Oran, 13 janvier 1848. 85 « Un Miracle d’Aïssa. Légende arabe », L’Écho d’Oran, 22 juillet 1848. 86 « Variétés sur la poésie », L’Écho d’Oran, 23 septembre 1848.
32
donné : « Une histoire contemporaine bien que tirée d’un vieux livre87 », qui prend la forme
d’un conte ancien, une poésie parodique intitulée « Vue de la tente88 », un feuilleton intitulé
« Les lamentations du vieux de la Montagne89 »… Énumérer ces titres constitue un moyen
d’enrichir la compréhension du titre périodique, et de voir comment le sous-titre annonce un
projet qui n’est pas fixe. Ces textes qui ne rentrent pas toujours exactement dans le projet du
journal sont ceux qui constituent notre corpus : ils sont publiés parce qu’ils font ressortir une
part d’identité profonde de la colonie, parce qu’ils attirent les lecteurs et dépassent la simple
publicité.
D’autres sous-titres sont plus clairs et précisent d’emblée leur volonté de publier de la
littérature : Le Commercial (1864), « journal politique, littéraire et agricole » ; Le Courrier de
Mostaganem (1860), « journal politique, littéraire, commercial, agricole et d’annonces », et
bien d’autres encore se donnent comme ligne éditoriale une intention littéraire. Certains
périodiques font évoluer leurs sous-titres, preuve de l’attention qu’on leur porte : Le Bien-
Public réunionnais, étudié plus haut, portant d’abord le sous-titre « politique, commerce,
littérature. Annonces officielles, judiciaires et volontaires », devient ensuite « politique,
industrie, agriculture, littérature. Annonces officielles, judiciaires et volontaires de la partie
sous-le-vent ». Ici la littérature a reculé devant l’agriculture, et l’ancrage territorial s’est fait
plus visible par la mention « de la partie sous-le-vent ». Le Courrier de Tlemcen, créé en 1860
et d’abord sous-titré « journal politique, littéraire, commercial et agricole », devient « journal
politique, satirique, commercial et agricole » en 1870, puis en 1881 « journal politique,
industriel, commercial et agricole » : d’abord « complet » au sens où il informe autant qu’il
cultive à sa création, il a ensuite suivi la vogue satirique des années 1870, puis s’est spécialisé
dans les années 1880. Cette évolution n’est pas insignifiante, et encore moins pour nous : elle
signale une ambition initiale qui disparaît au moment où, justement, la littérature coloniale tend
à se mettre en place. En outre, la lecture attentive aux sous-titres n’est pas une projection
contemporaine sur des objets dénués de sens : La Caricature attaque ainsi Victor Grenier, le
gérant de L’Enfant terrible, pour avoir appelé sa feuille « critique charivaresque et littéraire »
mais avoir en fait produit un journal politique, preuve que les journalistes et les lecteurs de
l’époque sont attentifs aux promesses des sous-titres90. Et plus généralement, on lit dans les
sous-titres que le journal colonial reste, sur ce point, semblable au journal métropolitain : il se
veut d’abord un moyen d’information avant de développer ensuite une identité, par les textes,
87 « Une histoire contemporaine bien que tirée d’un vieux livre », Le Brûlot de la Méditerranée, 25 mai 1848. 88 A. Loubignac, « Vue de la tente », Le Brûlot de la Méditerranée, 31 août 1848. 89 « Les lamentations du vieux de la Montagne », Le Brûlot de la Méditerranée, 3 septembre 1848. 90 La Caricature, 22 juin 1872.
33
plus locale et plus littéraire. La presse coloniale prouve également, par ce jeu des sous-titres,
qu’elle est bien une presse locale : elle en présente les caractéristiques de titraille, les tensions
entre modèle national et ancrage régional. Pourtant, dès cette titraille se fait jour un exotisme
premier, lié à la notion même de colonisation et aux toponymes présents ; cet exotisme va se
confirmer à un autre niveau.
Le premier numéro : ne pas être « le simple avènement d'une feuille périodique »
Outre ces caractéristiques qui se présentent au lecteur dès le premier abord, la presse
coloniale élabore aussi un discours important pour qui veut comprendre son organisation. Un
discours d’autodescription se forme en fait, qui concerne spécifiquement le journal : par les
textes qui entourent sa publication à proprement parler autant que par l’ethos développé dans
les textes médiatiques, l’objet même du journal accède à une identité particulière, construite par
les commentaires. Dans un fonctionnement liminaire, les premiers articles des journaux
coloniaux donnent aux lecteurs les projets de publication des rédacteurs et l’impulsion de
départ. Les collections conservées ne permettent pas de rassembler tous ces premiers textes, ces
faire-parts médiatiques pourtant si fondamentaux, parfois publiés sur de simples feuillets ; mais
il en reste suffisamment pour dresser une première image de ce que la presse coloniale pense
d’elle-même. Quelques microlectures suffiront à cerner ce discours médiatique réflexif : quand
La France algérienne paraît en 1845, les premières lignes du prospectus sont très claires. Le
rédacteur commence ainsi : « Une Revue générale de l’Algérie, rédigée et imprimée sur les
lieux mêmes, nous a toujours paru être une œuvre essentiellement patriotique et d’une utilité
incontestable91 ». L’accent mis sur l’atout de la publication, à savoir une parution « sur les lieux
mêmes », est en effet à la base de la presse coloniale en général : exprimée ici, cette ambition
cristallise aussi la période de conquête qui dure encore sur le territoire algérien. Et lorsque ce
titre est repris en 1871 pour un autre périodique, à l’identité différente, le programme a
évolué : les deux « France algérienne » ne signifient pas la même chose, et le programme de
1871 s’appuie davantage sur le titre choisi, sur le poids de l’adjectif accolé à la France.
Notre titre seul suffit pour indiquer notre but : nous fondons la France algérienne pour défendre les intérêts de notre grande colonie, faire connaître ses besoins et ses aspirations, la révéler à la métropole qui l’ignore presque complètement, éclairer, autant qu’il nous sera possible, sa marche dans la voie des améliorations, en un mot, contribuer, dans les limites de notre pouvoir, à faire que cette terre si longtemps arrosée de notre sang porte des fruits glorieux, qu’elle devienne le grenier de la France comme elle a été autrefois le grenier de Rome, et que, par degrés, elle arrive à une assimilation complète avec la métropole, ou
91 « Prospectus », La France algérienne.
34
plutôt qu’elle finisse par n’être qu’une extension, une continuation de la France au-delà de la Méditerranée92.
La différence principale tient au contexte de la publication : le journal de 1871 paraît au
milieu d’un paysage médiatique déjà fourni, et l’ambition est plus clairement politique qu’en
1845. Le rappel du passé et l’ambition d’une assimilation totale vont dans ce sens, précisant ce
qui n’était qu’une ambition « patriotique » en 1845. Cette comparaison entre deux journaux
jumeaux par leurs titres, mais différents par leurs parutions met en lumière toute l’importance
de ces premiers numéros qui expliquent les titres. L’évolution de la presse coloniale s’y lit en
effet de manière générale, et à ce titre Le Courrier de Saïgon peut prendre valeur d’étape. Quand
il paraît en 1864, il témoigne d’une presse coloniale déjà bien constituée et consciente de sa
« mission », vantant également l’avènement de la « publicité » sur le territoire colonial : ayant
bien compris le mécanisme de parution des périodiques coloniaux, il met en mots la mission
complexe d’un journal officiel sur des terres colonisées :
Ce numéro ne signale pas le simple avènement d'une feuille périodique ; il est en même temps le début de la presse européenne dans un pays qui n'a encore connu aucune sorte de publicité, et à ce titre quelques explications sont nécessaires. Bien que le caractère officiel du journal le dispense de tout programme dans le sens que l'on attache ordinairement à ce mot, on conçoit pourtant que sa création eût été superflue, s'il ne se fût agi que d'enregistrer une succession d'arrêtés administratifs ; aussi, le but que l'on s'est proposé est-il autre. Faire connaître à la France un pays qu'elle ignore, et qu'elle semble en quelque sorte ne vouloir accepter que sous bénéfice d'inventaire ; le faire connaître, qui plus est, aux colons eux-mêmes, et pour cela étudier les ressources d'un sol qui n'a jamais donné la mesure réelle de sa fécondité ; combattre une réputation d'insalubrité fâcheusement exagérée ; éclairer franchement les populations sur ce qu'a de définitif notre présence dans l'extrême Orient, en faisant ressortir à cet égard les vues bien arrêtées du gouvernement de l'Empereur ; rassurer ainsi les capitalistes métropolitains, et rechercher leur coopération, en leur montrant ce qu'est appelée à devenir une prospérité commerciale dont le passé offre de sûrs garants ; tel est en peu de mots le programme futur du Journal officiel de la Cochinchine française93.
Le caractère officiel de la publication n’est donc pas synonyme de bulletin administratif,
c’est le point sur lequel insiste le rédacteur : il s’agit de faire circuler une connaissance du
territoire alors conquis pour développer la colonie, et d’élargir aussi l’horizon du lectorat
métropolitain destiné à recevoir des nouvelles émanant des colons. Cet aller-retour entre la
colonie et la métropole est l’un des lieux communs de ces discours inauguraux : le journal
colonial est réellement envisagé comme un trait d’union entre la métropole et la colonie.
Présenté comme la métonymie brillante de la civilisation française, Le Courrier de Saïgon est
92 La France algérienne, 29 octobre 1871. 93 « Ce numéro ne signale pas… », Le Courrier de Saïgon, 1er janvier 1864.
35
cette raison caractéristique des premières années d’une colonisation : la découverte est le
maître-mot de cet appel à la colonisation. La colonie prend ici naissance sous les yeux du
lecteur, par le biais du périodique, et la création de la presse européenne devient elle-même un
acte performatif. Le Courrier de Saïgon appartient à ces périodiques dont la naissance est à peu
près concomitante de la colonisation, au sens où il fait partie des premières infrastructures mises
en place après la conquête ; il est représentatif à ce titre d’un mécanisme général qu’on peut
retrouver dans d’autres territoires soumis à des conditions semblables de colonisation. Quand
la colonie a eu quelques décennies pour se développer, certains de ces numéros inauguraux en
reviennent à la mission idéologique de la colonisation : en célébrant la fondation de la colonie,
le journal se fait voix de l’autorité au sens premier du terme, rappelant l’accroissement du
premier noyau colonial. C’est une telle idée que développe par exemple Le Courrier d’Oran
qui paraît en 1861, à une période qui n’est plus celle de la conquête et pas encore celle du régime
civil en Algérie. Dans cet entre-deux de la colonisation, le journal se donne pour but une
célébration de la colonisation par le rappel de son origine ainsi que de ses réalisations :
Il y a trente ans, l'armée française débarquait sur la côte africaine, et, arborant son drapeau victorieux sur la Casbah d'Alger, vengeait du même coup l'insulte faite à l'honneur national, et délivrait l'Europe du honteux tribut que lui imposait la piraterie barbaresque. […]
La presse, en Algérie, n'a pas, à vrai dire, à rechercher un rôle politique. Sa véritable mission consiste à étudier les besoins du pays, à les faire connaître, et à provoquer toutes les mesures qui peuvent favoriser le développement de la colonisation94.
Mais dans les colonies du premier empire colonial, la presse se développe alors même
que la colonie est bien établie et la société créole bien implantée. Il est alors intéressant de noter
que l’on retrouve pourtant dans ces feuilles guyanaises, antillaises ou réunionnaises le même
souci de l’image qui doit être transmise à la métropole ; ainsi, un « journal politique,
commercial, littéraire, d’agriculture et d’annonces maritimes et volontaires » réunionnais, Le
Colonial, annonce qu’il se montre « à visage découvert » et expose la manière dont il entrevoit
sa mission :
Nous crayonnerons avec vérité, sinon avec talent, le tableau de notre intéressante Colonie ; nous la montrerons avec ses imperfections originelles, et son désir sincère de perfectionnement ; avec son état actuel de civilisation et ses progrès rapides ; avec ses sentiments généreux, élevés, auxquels rien de grand, rien de noble ne saurait être antipathique. Plus cette image sera fidèle, plus, si nos feuilles traversent les mers, elle dissipera avec succès les funestes préventions, et réfutera les calomnies dont on nous flétrit95.
94 « Il y a trente ans… », Le Courrier d’Oran, 25 février 1861. 95 « Une règle consacrée par l’usage… », Le Colon, 7 mai 1833.
36
La circulation du journal vers la métropole est, comme à Saïgon, l’une des raisons
données à la publication ; seulement, contrairement au Courrier de Saïgon, il s’agit ici non pas
de faire découvrir la colonie, mais de corriger une image déjà formée. Le « nous » final clôt
l’extrait dans ce sens : l’on remarque alors à quel point il était absent dans le prospectus du
Courrier de Saïgon, qui ne pouvait pas s’appuyer sur une communauté coloniale bien formée.
Plus largement, dans ces morceaux rhétoriques qui signalent la naissance d’un nouveau titre,
c’est tout de même la notion d’image, quelle que soit l’ancienneté de la colonie, qui est au cœur
du projet affiché par le rédacteur. La métaphore somme toute attendue de la « peinture » dans
un projet médiatique est confirmée d’abord par l’idée de l’esquisse (le journaliste est un homme
dans son temps, le journal est l’écrit de l’actualité, de la rapidité), et précisée ensuite par
l’ambition de corriger un tableau préexistant qui serait celui de la métropole. Se lit bien la
volonté d’un autoportrait : la presse coloniale se veut être un instantané colonial, le vecteur
d’une autoreprésentation qui s’offrirait ensuite aux regards extérieurs ; c’est sur ce postulat
aussi que repose notre projet d’étude de cette presse. L’autoportrait annoncé se développera,
selon la fortune des périodiques, sur quelques numéros ou sur des années : mais il a été le
prétexte de la première parution.
Enfin, ces déclarations réelles de journaux coloniaux sont complétées par la perception
qu’en donnent les textes parodiques ou satiriques. Ainsi, une main anonyme, un « abonné » – à
en croire sa signature – du journal Les Antilles fait paraître en 1864 une variété mettant en scène
la création d’un journal colonial. Le rédacteur et fondateur en est Greluchon, ami d’enfance du
narrateur :
Chacun [estimait Greluchon] pour sa probité, son caractère franc et sans prétention ; chacun l’aimait, parce qu’il y avait dans son air de bonheur quelque chose de contagieux qui vous gagnait au cœur d’un charme indéfinissable.
Un jour, il entra chez moi soucieux et préoccupé ; il avait à me consulter : - Mon ami, me dit-il, la satiété du farniente et la philanthropie m’aiguillonnent ; sauf mon logis, je vends tout pour établir sur des bases solides une entreprise indispensable à mon pays, sollicité par les besoins de l’époque, et…
L’habitude que j’ai du pathos moderne me fit deviner sur l’heure qu’il voulait fonder un journal. […]
Quelques temps après, surgit au monde Le Levier d’Archimède, feuille politique, scientifique, littéraire, agricole et commerciale96.
L’on retrouve ici, déformé par le prisme satirique, l’ambition du rédacteur de journal
colonial. Le discours – plein de « pathos moderne » – du futur gérant reprend en effet les
grandes lignes des publications médiatiques ; le sous-titre est tout aussi prométhéen que les
96 Un abonné, « Le journal des colonies », Les Antilles, 17 septembre 1864.
37
intentions ; enfin, le titre même, ce « Levier d’Archimède », participe de l’image d’une presse
coloniale ambitieuse et imagée, prétentieuse sans doute, et refusant la stricte perspective
commerciale. La satire et la parodie se révèlent ici de très bons moyens pour toucher au cœur
des représentations du journal colonial comme objet primordial de la colonisation, comme
vecteur d’une communauté coloniale.
1.2 La fabrication du journal colonial
Les chiffres manquent pour bien percevoir la réalité de la presse coloniale : les archives
des imprimeries ont été mal ou non conservées, et il ne reste que la lecture des périodiques eux-
mêmes pour apprendre quelles étaient les chiffres de diffusion ou les coûts de l’abonnement –
quand les rédacteurs se livrent à une sorte de mise en abyme de leur production. Les périodiques
imprimés par le gouvernement ont, quant à eux, laissé quelques traces dans les journaux
officiels : on y trouve par exemple les rémunérations des employés de l’imprimerie, ce qui
permet une vision générale du monde de l’écrit officiel dans les colonies. Enfin, de cette étude
à venir nous amorçons déjà une première idée : le terme d’« arcanes » employé ci-dessous n’est
pas seulement dû à la réminiscence d’un chapitre des Illusions perdues97. Le journal colonial
s’affiche en effet, dans ses colonnes mêmes, comme un objet dont la fabrication est importante,
car elle correspond déjà à une définition de la colonie : un territoire soumis à des conditions
plus dures qu’en métropole, où le colonisateur doit faire face à un environnement hostile98.
Insister sur la matérialité du journal, sur les secrets de sa fabrication et les problèmes rencontrés,
c’est mettre le journal sur le même plan que la terre que le colonial est censé défricher : dans
l’idéologie coloniale, affirmer le travail, les efforts et les difficultés, c’est se montrer comme
membre de plein droit de la société coloniale. Par ce biais-là, le journal devient en quelque sorte
une partie du territoire à coloniser.
Les arcanes du journal : coûts, abonnements, retards et traductions à la une
Le 27 juillet 1864, Le Messager, journal officiel de la Martinique, annonce qu’il met
fin, après vingt mois d’existence, à sa parution. Le discours tenu sur cette fin programmée est
intéressant, parce qu’il explicite l’idée que Le Messager était le « premier essai aux colonies
d’une presse à bon marché », et qu’« ainsi aura passé le premier journal colonial à vingt
97 Chapitre XXIIII de la deuxième partie de l’œuvre, Un Grand homme de province à Paris : « Les arcanes du journal ». 98 Pour la Sydney Gazette, Clem Loyd a été attentif à ces conditions de production, et il montre que les vicissitudes de production se retrouvent dans l’impression même du titre (colonnes inégales, utilisations de caractères inappropriés, comme un V inversé pour noter un A majuscule). Voir Clem Loyd, art. cit., p. 15.
38
francs99 » : même s’il ne prend pas en compte toutes les publications coloniales, l’on peut faire
le lien ici avec la parution en 1836 du Siècle et de La Presse100, premiers titres d’une presse à
bon marché, que le territoire colonial suit avec son décalage habituel. Quand les titres
métropolitains proposent de faire passer l’abonnement de quatre-vingts à quarante francs, le
journal martiniquais ne divise pas un prix existant de moitié : il rejoint, en fait, les abonnements
de certains territoires (voir tableau infra, et surtout les journaux officiels à dix-huit francs).
Cette tentative, ainsi que sa mention dans le journal même, orientent les recherches vers la
question du financement des périodiques coloniaux : publics et sortis des imprimeries
gouvernementales, ou privés et émanant d’imprimeurs particuliers, les journaux coloniaux ont
une histoire économique qu’ils affichent et dont ils jouent. Quelques sources permettent de
remonter jusqu’au financement de ces feuilles, qu’elles soient gouvernementales ou privées.
Les bulletins officiels complètent ainsi les indices que constituent le nombre de réclames, les
prix d’abonnement, les annonces de tirages – très rares – faites par les journaux.
Prix des abonnements annuels locaux à quelques périodiques coloniaux, par décennie et en francs. Titre du périodique Jours de parution Prix
1830 Prix 1840
Prix 1850
Prix 1860 Prix 1870
Le Moniteur algérien (1832)
Mercredi ; le 5, 10, 15, 20, 25 et 30 entre 1847 et 1861. À partir de 1861, mardi, jeudi et samedi ; ajout du dimanche en 1863 ; tous les jours excepté le lundi à partir de 1865
25 25 25 10 (1857) 20 (1862) 30 (1865) 40 (1867) 25 (1868) 30 (1869)
30
L’Akhbar (1842) Mardi, jeudi et dimanche 15 15 30 L’Écho d’Oran (1844) Samedi 20 La Seybouse (1848) Samedi 18 Le Zeramna (1850) Mercredi 18 La Feuille de la Guyane française (1819) puis Moniteur de la Guyane française (1871)
Samedi 25 25 25 16 (1862) 16
99 Le Messager, journal officiel de la Martinique, 27 juillet 1864. 100 Voir l’article de Gilles Feyel, « L’Économie de la presse au XIXe siècle », Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), La Civilisation du journal : Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2011, p. 142-180.
39
Le Propagateur (1853) Mardi et vendredi, puis mercredi et samedi à partir du mercredi 27 juin 1855
54 54 54
L’Avenir (1842) Mercredi et samedi ; mardi et vendredi à partir de 1862
30 40 (1860) 40
Les Antilles (1843) Mercredi et samedi 50 50 Le Messager de Tahiti (1852)
Dimanche ; samedi à partir de 1863
12 18 (1860) 18
Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie (1859)
Dimanche ; mercredi à partir de 1873.
18 12 (1863)
12
La Malle (1860) Jeudi ; à partir de 1864, jeudi et dimanche
35 50 (1864)
50
Le Courrier de Saïgon (1864)
Le 10 et le 25 de chaque mois
18 18
Construit autour d’une sélection de quelques titres dont les collections étaient
relativement bien conservées, ce tableau laisse apparaître les grandes lignes d’une presse qui
connaît des variations de prix et de parution : les quelques titres cités ici connaissent des
périodicités qui évoluent avec le siècle, allant du côté de parutions plus rapprochées. En
comparant avec les prix de la presse provinciale à la même époque, on obtient une idée du type
de lectorat que peut induire le coût d’un abonnement. Ainsi, Le Courrier du Havre propose en
1848 un abonnement coûte 48 francs par an, mais 72 francs « pour l’étranger et les colonies par
voie ordinaire », et 86 francs « par les paquebots transatlantiques d’Angleterre » ; en 1872,
l’abonnement coûte 42 francs par an, 50 francs pour les départements limitrophes, 57 pour les
autres départements – dont les colonies ou l’étranger. C’est pourtant un journal au lectorat
élargi : comme il paraît au Havre, il est régulièrement embarqué dans les navires en partance
pour les colonies, et il est souvent cité dans la presse coloniale pour la fraîcheur de ses nouvelles.
En considérant uniquement les prix des abonnements locaux, il semble donc que la presse
coloniale officielle était peu chère (d’autant plus qu’en 1869, et toujours à titre de comparaison,
Le Journal officiel de l’Empire français coûte 40 francs à l’année), et que la presse privée elle-
même affichait des abonnements sensiblement inférieurs à ceux de la presse provinciale.
En ce qui concerne la production des journaux, les meilleures traces laissées à notre
curiosité sont celles des journaux officiels qui contiennent les budgets des colonies comme
autant de sources intéressantes, bien que souvent incomplètes ou tardives. L’on peut ainsi suivre
les évolutions de dépenses de la Guyane : en 1861, le coût total de l’imprimerie est de 37 550
francs ; il atteindra 60 103 francs en 1880, sans que cette évolution ait entraîné une
augmentation de l’abonnement au périodique. En 1861, si l’on consulte les détails des chiffres,
40
l’imprimerie emploie dix-neuf personnes : on trouve un chef comptable, un sous-chef
correcteur, huit compositeurs, quatre imprimeurs pressiers, un imprimeur lithographe et quatre
relieurs. Cette équipe, déjà conséquente, est augmentée durant la décennie, puisque dans le
budget de 1872, sous la rubrique imprimerie, on trouve les dépenses suivantes, établies par
postes – nous en donnons le détail eu égard au nombre de rubriques concernées :
1 chef comptable : 5000 francs de traitement, 1000 francs de remise et 720 francs d’indemnité de logement. 1 sous-chef correcteur : 3500 francs 1 maître entretenu : 3000 francs 7 ouvriers compositeurs : 1 à 2500, 2 à 2200, 1 à 2100, 1 à 1800, 1 à 1700 et 1 à 1000 francs 3 apprentis compositeurs : 1 à 650, 1 à 400 et 1 à 200 francs 2 apprentis compositeurs surnuméraires 1 imprimeur lithographe : 3000 francs 4 ouvriers imprimeurs typographes : 1 à 2400, 1 à 1000, 1 à 900 et 1 à 800 francs 1 apprenti imprimeur typographe : 400 francs 1 apprenti surnuméraire 3 ouvriers relieurs : 1 à 1800, 1 à 1250 et 1 à 1200 francs 1 apprenti relieur : 400 francs 1 apprenti surnuméraire 1 ouvrière couseuse et plieuse : 640 francs 1 garçon de bureau : 600 francs Supplément à l’apprenti et au garçon de bureau chargés de la distribution de la Feuille, du Bulletin officiel, etc. : 200 francs101
Apparaît ici tout un monde dévoué à l’imprimerie, et qui a singulièrement étoffé ses
rangs en une dizaine d’années – les effectifs évoluent au cours de la décennie suivante, dans les
années 1870. En 1878, le coût est porté à 45 130 francs, et l’équipe de l’imprimerie est
composée comme suit : un chef comptable de première classe, un chef de deuxième classe, sept
compositeurs, quatre apprentis compositeurs, cinq ouvriers imprimeurs typographes, un
apprenti imprimeur typographe, deux ouvriers relieurs, deux apprentis relieurs, une ouvrière
couseuse et plieuse de septième classe, un garçon de bureau. Apparaissent aussi le supplément
à l’apprenti et au garçon de bureau chargés de la distribution du Moniteur, du Bulletin officiel,
etc., ainsi que l’« indemnité à un militaire employé comme lithographe », s’établissant à 620
francs. Si on ajoute à cela les rubriques « matériel et frais divers », « entretien du matériel et
menus achats dans la colonie », ainsi qu’« achats en France de caractères, papiers, cartons, etc.
», le coût total atteint 55 130 francs. L’année suivante, le chiffre est à peu près le même : 54
086 francs ; et, comme mentionné plus haut, 60 103 francs en 1880. Le monde de l’écrit n’a
donc pas cessé de progresser, en Guyane, au cours des décennies qui vont de 1860 à 1880,
décennies pour lesquelles nous possédons une documentation : le personnel employé aux
impressions officielles constitue une petite communauté fournie. Certes, l’imprimerie officielle
101 Guyane française. Service local. Budget des recettes et dépenses de l’exercice 1872, Cayenne, Imprimerie du gouvernement, 1871, p. 20-21.
41
ne sert pas qu’à la publication de la Feuille : le Bulletin officiel y est imprimé, et l’imprimerie
sert aussi à la publication d’avis et de documents divers qui font l’essence même de la colonie.
Mais il n’en reste pas moins qu’elle représente un poste de dépenses important pour la colonie,
et qu’elle fait vivre un nombre conséquent de coloniaux, outre la portée symbolique qu’elle
revêt.
Ces chiffres font également apparaître la manière dont chaque territoire colonial dispose
de son matériel et de ses employés : chaque colonie a son propre fonctionnement (et ses propres
frais) en ce qui concerne l’imprimerie. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie et pour la même année
1872, l’imprimerie coûte 33000 francs à la colonie, sans que les différents employés soient
énumérés aussi précisément qu’en Guyane102. Plus généralement, les budgets des autres
territoires coloniaux n’apparaissent pas aussi clairement dans les documents produits à cet effet,
et certains exercices ne sont pas disponibles : les quelques chiffres que nous donnons ici n’ont
donc qu’une valeur d’aperçu. Le budget de Guyane n’indique pas les recettes de
l’imprimerie ; le budget de Nouvelle-Calédonie, en revanche, a prévu une rubrique pour ces
rentrées d’argent. Pour garder l’exemple de 1872, les recettes sont de 12 000
francs : l’imprimerie est donc clairement une entreprise déficitaire, mais bien nécessaire à la
colonie ; l’on peut supposer que le calcul est assez proche en Guyane, et ce d’autant plus que
l’on retrouve ces déficits dans d’autres territoires coloniaux, pour la même période. En
Martinique, toujours en 1872, les recettes de l’imprimerie sont ainsi de 18 000 francs pour des
dépenses de 39 500 francs103. Les chiffres sont donc, pour ces territoires dont les budgets sont
disponibles, sensiblement les mêmes, et donnent l’idée d’une activité importante de
l’imprimerie : le journal fait partie intégrante de cette effervescence de l’écriture dans les
territoires coloniaux.
Les liens avec les lecteurs locaux : un marqueur identitaire Les journaux officiels n’ont pas à se préoccuper du nombre de leurs lecteurs ; mais les
titres privés, quant à eux, vivent des abonnements et de missions annexes : ils font ainsi paraître
des annonces privées et de la réclame en quatrième page. Ils peuvent aussi publier certains
décrets et avis officiels sous réserve d’être agréés par l’autorité coloniale. Les rédacteurs
peuvent, à l’occasion, rendre publique leur stratégie d’utilisation des annonces : c’est ce que
fait le rédacteur réunionnais de La Malle en 1860, inscrivant ainsi sa feuille dans une
102 Nouvelle-Calédonie. Service local. Budget des recettes et dépenses de l’exercice 1872, Nouméa, Imprimerie du gouvernement, 1872, p. 24-25. 103 Martinique. Service local. Budget des recettes et des dépenses pour l’exercice 1872, Fort-de-France, Imprimerie du gouvernement, 1872, p. 4 et p. 26.
42
perspective dynamique. Il compare les pratiques réunionnaises à « l’usage des avis et annonces
si répandu en France et à Maurice pour le commerce et l’industrie104», et en conclut qu’il faut
baisser le prix des insertions. Le discours commercial tenu ici signale un ancrage territorial et
une stratégie commerciale qui font de La Malle un journal accessible et réfléchi : il connaîtra –
est-ce un succès dû à cette stratégie ? – une durée de vie respectable, sa publication se terminant
en 1886. Cette annonce d’un changement dans la politique commerciale du périodique indique
que les titres coloniaux aiment à laisser paraître les « coutures » de leur production : et c’est à
partir de ces textes que nous pouvons remonter jusqu’aux conditions de publication des
périodiques privés. Leurs archives n’ont généralement pas connu une aussi belle postérité que
les budgets officiels ; elles ont souffert des conditions de conservation, et il est difficile de
trouver les traces du nombre d’abonnements. Pour combler ce manque d’informations, il
apparaît qu’au titre des « coutures » que le journal fait apparaître figure la question des
abonnements. Ces derniers ne coïncident pas forcément avec le nombre réel de lecteurs, qui
reste incalculable et inimaginable (faut-il considérer que la lecture d’un article suffit à compter
un lecteur dilettante comme un vrai lecteur du journal ?). Les pratiques de lecture, c’est certain,
dépassent de loin le cadre strict de l’abonnement : mais dans quelle mesure, on ne peut le savoir.
L’on repère néanmoins quelques données concernant au moins les abonnements payés : en
1845, L’Océanie française de Papeete, précise qu’il distribue 98 feuilles dans la ville même de
sa parution, mais qu’il reçoit des demandes d’abonnement qu’il ne peut satisfaire par manque
de moyens, devant en outre échanger le journal avec d’autres périodiques105. Sur un autre
territoire, avec une population plus nombreuse et un développement de la presse déjà bien
amorcé, L’Écho d’Oran est censé être distribué en 1846 à 300 abonnés, alors qu’il compte deux
ans de parution106. En 1870, à un moment où les journaux continuent leur progression, une
étude nous apprend que L’Akhbar, titre privé, tire à autant d’exemplaires que Le Moniteur :
Le vieil Akhbar, 47ème année, journal du soir, tirait à 2000. Son propriétaire et rédacteur en chef, Arthur de Fonvielle, soutint la politique de Ferry, le gouvernement de Tirman, se montrant hostile à toute violence antisémite. Ses annonces et son tirage lui permettaient de vivre. Il restait attaché à sa formule ancienne, assez littéraire, étoffée de nombreux articles de "Variétés", chroniques théâtrales, feuilletons choisis, comme "Les Diaboliques" de Barbey d'Aurevilly. Dans le combat électoral, L’Akhbar défendait Letellier. Sa diffusion était importante dans les trois départements, et assurait même quelques numéros dans les kiosques parisiens […]. Le Moniteur, tirage 2000,
104 La Malle, 9 février 1860. 105 L’Océanie française, 2 février 1845. Le journal a été créé le 5 mai 1844 et est autographié : il est donc récent et d’une production difficile ; il disparaît en juin 1845. 106 Source : Centre de Documentation Historique sur l’Algérie, article d’Yves Marthot. URL : http://www.cdha.fr/histoire-de-la-presse-en-algerie-lecho-doran. Consulté le 30 mars 2016.
43
quotidien du soir, donnait des signes d'essoufflement. Le préfet Firbach attribuait son insuccès aux faiblesses de la rédaction 107.
Ce portrait du « vieil Akhbar » littéraire, autant lu que le journal officiel et arrivant
jusqu’à Paris, témoigne de la bonne santé de la presse coloniale à ce moment de son histoire.
Cette information cependant ne se trouve pas dans les pages du périodique, qui ne présente pas
les chiffres des abonnements ; mais de nombreux titres affichent, quant à eux, les difficultés
liées aux abonnements et créent aussi une représentation sous-jacente du lectorat et de la place
de l’imprimé dans le monde colonial. Le Commercial guadeloupéen, qui en 1861 annonce qu’il
en est à sa quarante-huitième année d’existence, formule ainsi clairement les enjeux de sa
publication : il précise qu’à partir du 1er juillet 1861, les journaux ne seront plus délivrés aux
lecteurs qui ne paient pas les abonnements. Cette pratique est somme toutes courante dans la
presse ; mais Le Commercial insiste, et l’abonnement devient un thème crucial de la
publication. Au cours de ce mois de juillet 1861, et après avoir publié la lettre d’un lecteur qui
demandait la publication d’articles d’économie politique, la rédaction répond par la négative,
arguant que le journal n’a plus que 63 abonnés et que cela ne suffit pas pour justifier de
nouveaux types d’articles108. En octobre, la qualité du papier baisse : on peut supposer que les
difficultés financières sont réelles pour le périodique. C’est dire à quel point cette presse
manque de fonds ; c’est aussi estimer qu’elle circule en-dehors des abonnements, car le
rédacteur précise qu’il n’y a que peu de journaux sur l’île. Le 2 mars 1861, il avait déjà publié
l’article suivant :
Découragement L’article que nous allons reproduire et qui est extrait de La Revue du monde colonial est vrai dans tous ses termes : les colonies ont tort de reprocher aux écrivains de la métropole de les négliger quand elles-mêmes se préoccupent si peu d’encourager leur zèle et leur bon vouloir. Mais que dirait la presse métropolitaine si nous lui assurions que le sort des journalistes aux colonies n’est pas plus favorablement traité par ceux-là mêmes qui réclament leurs services ? C’est pourtant ainsi ! Nous sommes ici deux journaux et sur une population de 140 à 150 mille âmes, nous ne réunissons pas à nous deux 700 abonnés ! Encore sur ce nombre 400 à peu près ne paient pas leur abonnement ou ne le paient qu’en se désabonnant, froissés qu’ils sont de réclamations réitérées qui les fatiguent et leur paraissent souverainement ridicules. L’Avenir n’a-t-il pas été dans l’obligation il y a quelques jours de supprimer d’un seul coup quatre-vingt souscripteurs en retard ? Notez toutefois qu’il n’avait choisi que parmi ceux qui lui devaient de 18 mois à 2 ans109.
107 Georgette Sers-Gal, « La Presse algérienne de 1870 à 1900 », La Revue africaine, 1959, p. 100. 108 Le Commercial, 24 juillet 1861. 109 Céloron de Blainville, « Découragement », Le Commercial, 2 mars 1861.
44
Le même Céloron de Blainville, toujours rédacteur du Commercial, se sert durant la
même année de ces chiffres d’abonnement au cours d’une querelle avec L’Avenir. Les chiffres
deviennent les enjeux des manipulations et des querelles : on apprend ainsi qu’« à la campagne
[Le Commercial] n’en a plus 33 comme auparavant, mais, ainsi que le prouve son bulletin à la
poste, 97 sans compter 60 qu’il a supprimés pour défaut de paiement », alors que son concurrent
« qui devrait, suivant son dire, posséder 12 fois 33 abonnés, soit 396, n’en compte réellement
que 173110 ». Le journal colonial revendique sa dignité dans le nombre de ses lecteurs : c’est
par ces échanges que l’on perçoit le combat que peut représenter la publication médiatique dans
un milieu aussi restreint que les colonies ; et c’est aussi dire à quel point le journalisme colonial
se situe sur le même plan symbolique que les activités diverses de la colonie, qu’elles soient
commerciales ou agricoles.
Dans la même perspective de revendication – mais revendication alors d’une spécificité
et non d’une dignité –, la presse coloniale affiche aussi ses éventuels retards de publication, et
les causes de ces retards. Là encore, ces discours de présentation semblent relever du même
geste : identifier les conditions de production du journal et les conditions de vie dans la colonie.
Ainsi, Le Messager de Tahiti peut publier des explications comme celle-ci :
Dans un de nos précédents numéros, nous avons annoncé à nos lecteurs le récit détaillé de la promenade militaire faite autour de l’île Taïti au mois de juillet 1861, nous tenons maintenant notre promesse, que des retards dans la traduction nous avaient forcé d’ajourner111.
Le rédacteur du Messager de Tahiti expose ici un problème lié au caractère bilingue de
son titre, mais tous les retards ne sont pas liés à des traductions, et le problème que l’on retrouve
le plus généralement dans le journal lui-même, autrement dit le retard qui est affiché avec le
moins de vergogne, c’est celui qui tient à la circulation des textes en provenance de la
métropole. Le « retard colonial », si l’on peut le qualifier ainsi, est un thème récurrent de la
publication médiatique, jusqu’à devenir une marque d’identité, une manière de se revendiquer
en tant que presse coloniale112. L’un des meilleurs exemples de ce « retard colonial », c’est Le
Courrier de la Martinique qui le présente en 1848, lorsqu’il fait paraître des extraits des
Mémoires d’outre-tombe, avec décontraction et insolence :
Cette reproduction est interdite à la vérité, mais il est évident que cette interdiction n’a été faite que pour la France. De tout temps, nous avons eu, aux colonies, le privilège de glaner sans obstacle dans les champs
110 Céloron de Blainville, Le Commercial, 5 janvier 1862. 111 Le Messager de Tahiti, 16 février 1862. 112 Il s’affiche par exemple dans la publication d’extraits des Misérables, paru le 30 mars 1862 à Bruxelles et le 3 avril 1862 à Paris : à la Réunion, La Malle publie quelques lignes du roman de Victor Hugo dans son numéro du 3 juillet ; l’Avenir, en Guadeloupe, en a publié un extrait dès le 9 mai.
45
moissonnés par les éditeurs métropolitains. Qui songerait à nous reprocher une reproduction aussi tardive que sera nécessairement la nôtre ? Nous la commençons un mois et demi après la publication européenne, et chacun de nos numéros laissera fermement en arrière un certain nombre de lignes du feuilleton de la Presse. Nos abonnés qui ne reçoivent pas les journaux de la Métropole nous sauront gré de les avoir conviés à la lecture de ces magnifiques pages. Et puisque nous sommes en train de piller, prenons aussi sans scrupule l’étude biographique que M. Ch. Monselet a mise comme introduction en tête des Mémoires d’outre-tombe113.
Un « piratage » médiatique se donne à lire ici sur le mode plaisant, grâce à une voix
éditoriale mise en avant : à temporalité décalée, lois différentes, semble-t-elle affirmer – et ce
piratage est plutôt courant, en effet, d’un pays à l’autre. Et cette idée d’une particularité de la
presse coloniale se retrouve tout au long du siècle, quelle que soit la période et quel que soit le
territoire concerné114 : ainsi, un journaliste de la Seybouse algérienne fait plaisamment
remarquer, en 1866, les emprunts auxquels il va se livrer, puisqu’on lit dans le feuilleton, pour
introduire un extrait de la Comédie contemporaine d’Auguste Villemot :
Mon cher Directeur, Vous voulez absolument des feuilletons ? Soit ! On vous en donnera ; mais non pas de mon cru. Je n’ai pas le temps, à cette heure, de vous en composer moi-même. Je prendrai n’importe où ce qui me semblera bien rencontré pour la Seybouse. Des feuilletonnistes de Barbarie ont bien le droit d’être un peu corsaire115.
Le contexte algérien permet en effet ce trait d’humour métadiscursif ; mais il confirme
un fonctionnement plus large, qui est celui d’une adéquation entre le principe de publication et
l’identité du territoire sur lequel le journal est produit. Les Antilles ou la Réunion sont les plus
rompues à ce type d’exercice de piratage, sans doute à cause de leur éloignement de la
métropole, mais également parce le motif même de l’éloignement ou du piratage fait partie de
l’identité de ces colonies. En outre, l’actualité coloniale est à part de l’actualité métropolitaine :
il s’agit de les faire tenir ensemble, et de ce décrochement temporel inévitable naît une tonalité
particulière, une inflexion médiatique coloniale jouant sur la double temporalité du journal. Le
journal colonial, sur la période que nous étudions, n’est pas encore relié au reste du monde par
des moyens efficaces : il n’est pas entré dans ce que les années 1880 inaugurent, c’est-à-dire
une nouvelle forme d’écriture de l’actualité liée à la transmission rapide de l’information116.
113 Le Courrier de la Martinique, 6 décembre 1848. 114 Ainsi, par exemple, de L’Indépendant de Constantine du 23 juin 1865, où on lit dans le feuilleton, en introduction : « nous empruntons à l’Opinion nationale, sans trop savoir si nous en avons le droit et à tous risques, une des plus originales de ses causeries, pleines de bon sens d’esprit et de science, que M. Edmond About écrit tous les samedis dans ce journal ». 115 La Seybouse, 30 juin 1866. 116 Marie-Ève Thérenty, « Pour une histoire littéraire de la presse au XIXe siècle », Revue d’histoire littéraire de la France, 2003/3, vol. 103, p. 631.
46
C’est l’une des raisons pour lesquelles l’on trouve même des professions de foi revendiquant le
plagiat comme mode de publication117. La presse coloniale est une presse faite de discours
réflexif, une presse régie par le principe du miroir, comme beaucoup d’autres journaux de son
siècle ; mais elle y ajoute cette mise en scène de soi comme entreprise soumise aux mêmes
problèmes que les autres coloniaux vivant sur le même territoire118. Elle parle d’elle-même,
désigne son fonctionnement, évoque son personnel – un article du Propagateur laisse apprendre
que le rédacteur du journal est notaire, indication du statut social de certains rédacteurs
antillais119. Mais la presse coloniale semble se différencier de la presse métropolitaine parce
qu’elle transforme des contraintes matérielles en autoportrait, et joue de son importance
symbolique au sein du territoire colonial.
Les liens matériels avec la métropole Tout ce qui constitue le cadre contraint dans lequel se développe le journal est donc
mobilisé au sein même de son écriture. Autre principe se rattachant à la fabrication du titre et
mis en avant pour le lectorat, au fil de ses pages se dessine ainsi un réseau complexe tissé de
titres étrangers ou métropolitains cités et repris selon le principe des échanges hérités du dix-
huitième siècle : le journal colonial vit des informations qu’il reçoit120. La presse
départementale française a bien assimilé ce fonctionnement quand commence la monarchie de
Juillet, puisque sous Charles X déjà se met en place, en 1828, la Correspondance politique et
agence de journaux des départements et de l’étranger du journaliste Justin121. Ce modèle n’est
pas utilisé dans les colonies : les échanges entre les périodiques officiels locaux et les
périodiques métropolitains sont réglés par l’administration en place, autrement dit par le
gouverneur ; les échanges entre les titres privés s’établissent d’un journal à l’autre, et l’on utilise
également le principe de la correspondance particulière. Dans le journal colonial se retrouvent
ces deux fonctionnements : d’un côté, les nouvelles sont données sous la forme de paragraphes
117 Ainsi de la Semaine illustrée de la Réunion, le 27 février 1862. Un débat y est lancé autour du plagiat, revendiqué clairement : « nous avons pris et prenons encore l’engagement formel de faire du PLAGIAT, comme il était précisé dans le premier n° du journal La Semaine, colonne 2 ». 118 Voir les travaux de Guillaume Pinson, notamment « L’imaginaire médiatique. Réflexions sur les représentations du journalisme au XIXe siècle », COnTEXTES, 2012, n° 1. URL : http://contextes.revues.org/5306. Consulté le 11 août 2015. Et aussi l’ouvrage L'Imaginaire médiatique. Histoire et fiction du journal au XIXe siècle, Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », 2013. 119 « La conversion », Le Propagateur, 6 mai 1862. 120 Will Slauter, « Le Paragraphe mobile. Circulation et transformation des informations dans le monde atlantique du XVIIIe siècle », Annales. Histoire, sciences sociales, 2012¬/2, p.363-389. 121 Gilles Feyel, La Presse en France. Des origines à 1944, Paris, Ellipses, 2007, p. 139.
47
empruntés à des périodiques ; de l’autre, des « correspondances particulières » produisent une
analyse politique de la situation française ou européenne122.
Les abonnements aux périodiques sont réglementés, pour les périodiques officiels, par
le gouvernement. En Nouvelle-Calédonie par exemple, le Bulletin officiel donne un bon aperçu
de la manière dont s’organise ce réseau d’information officiel. On lit ainsi :
Port-de-France, le 20 février 1862. Nous, commandant de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, Vu la décision du 8 janvier dernier limitant le nombre
d’exemplaires du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie que le Chef de l’Imprimerie peut expédier en échange aux journaux de France, des colonies françaises et des pays étrangers ;
Attendu que, depuis lors, des journaux non compris dans le nombre fixé sont parvenus au Moniteur de la colonie, et qu’il y a lieu de répondre à ces envois par la réciprocité ;
Attendu que la direction du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie peut se trouver éventuellement dans des cas analogues ;
Sur la proposition de l’Ordonnateur, AVONS DÉCIDÉ ET DÉCIDONS : Art. 1er. Il sera ajouté à la liste des journaux auxquels le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie est envoyé à titre d’échange : 1° L’Économiste français, à M. Jules Duval, directeur, rue de Parme, 7, à Paris. 2° La Revue du Monde colonial, à M. A. Noirot, directeur, rue Christine, 3, à Paris ; 3° La Patrie, au bureau du journal, rue du Croissant, 12, à Paris ; Art. 2. Il sera satisfait aux demandes d’échange ultérieures sur l’autorisation de l’Ordonnateur de la colonie. Art. 3. Il sera pourvu aux envois que nécessiteront les échanges autorisés, sur la réserve restant en dépôt à l’Imprimerie du Gouvernement123.
Interrogeons ces choix d’abonnement : Jules Duval est un colonial, et son Économiste
français oriente donc l’abonnement vers les questions économiques dont dépend la colonie. La
Revue du Monde colonial va aussi en ce sens. Le journal La Patrie est quelque peu différent,
puisque connu pour être un partisan de l’Empire : c’est une affiliation politique qui se lit ici.
C’est ainsi que Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, au fil de ses publications, dessine un
autoportrait par les échanges souscrits auprès des périodiques métropolitains : ils font partie de
sa ligne éditoriale. Ces abonnements sont plus généralement une source fondamentale de la
production médiatique ; un journal officiel comme La Feuille de la Guyane française cite avec
une remarquable fidélité les journaux du Havre – Le Courrier du Havre particulièrement –
pendant toute la période étudiée. L’importance de la presse portuaire pour les colonies est une
122 Les journaux locaux sont censés recevoir le journal officiel national : L’Avenir souligne dans son numéro du 14 décembre 1863 qu’il est le seul journal de la presse coloniale qui ne le reçoive pas. 123 Bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie, 1861, arrêté n° 20 – Décision du Commandant portant modification à la distribution du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne les échanges avec les autres journaux.
48
constante de l’empire français : au Havre, Le Journal du Havre et Le Courrier du Havre sont
en effet les deux titres majeurs distribués dans les colonies, entre autres car ils se sont affirmés
pour leur portée politique, et pas seulement commerciale. Contrairement à la presse d’autres
ports – Bordeaux, par exemple – Le Journal du Havre est l’un des plus anciens en France, et il
a développé tôt sa propension politique à parler pour les coloniaux. Ses rédacteurs et
collaborateurs défendent l’esclavage jusqu’à son abolition ; ils jouent le rôle d’intermédiaire
entre la métropole et les colonies, par le système des correspondances ; le journal enfin est
subventionné par des fonds coloniaux pour défendre la cause coloniale en métropole. L’autre
périodique havrais, Le Courrier du Havre, est une preuve supplémentaire de cette imbrication
entre colonie et métropole : il est dirigé, dans les années 1840, par un créole de la Martinique,
Théodore Lechevalier124. Des journaux havrais, la presse coloniale reprend surtout les
nouvelles ; pour les feuilletons, pour une « nourriture » moins axée sur l’actualité, d’autres
titres sont sollicités. Un exemple permettra de rendre compte de cette origine des feuilletons : Le
Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, en 1862, va chercher ses feuilletons dans La Revue
coloniale et maritime (il publie un « Aperçu sur la basse-Cochinchine par Reunier, lieutenant
de vaisseau »), puis reprend, dans l’ordre de leur parution et de manière beaucoup plus
étonnante, les textes fictionnels du Journal des familles de l’année 1856. Les lecteurs de
Nouvelle-Calédonie ont donc à leur disposition deux feuilletons flamands : Un roi dans la
campine et Le président Breugels, puis La Calomnie, histoire racontée par un maître d’école,
traduit de l’italien par le comte Balbo. Autant dire que la publication n’a que peu de rapport
avec le territoire, et que les attentes du lectorat ne semblent pas particulièrement prises en
compte. Quand la colonie n’a en effet pas d’hommes de lettres, la presse comble les attentes
littéraires des lecteurs par les journaux auxquels elle est abonnée. L’exemple du Moniteur de la
Nouvelle-Calédonie est en quelque sorte exagéré, et tient sans doute à sa position extrême, bien
loin de la métropole : reprendre des fictions datées de six ans et issues d’un corpus qui ne
concerne en rien la colonie n’est pas le lot commun de tous les périodiques. La plupart du temps,
les feuilletons sont repris dans les grands titres parisiens auxquels le périodique colonial est
abonné, et l’écart semble moins grand ; l’on publie les auteurs en vogue.
Les périodiques privés mettent en place leurs correspondances selon un principe
d’efficacité ou d’affinité. Efficacité quand les journaux du Havre ou de Nantes sont cités comme
source de nouvelles la plus fraîche, probablement parmi les derniers journaux embarqués à bord
des navires ; affinité quand un périodique comme Le Sport colonial raconte à ses abonnés la
124 Lawrence Charles Jennings, « La Presse havraise et l’esclavage », Revue Historique, 272, n° 1, 1984, p. 45-71.
49
manière dont s’est mise en place sa correspondance particulière. La première perspective
présentée est celle des premières décennies du siècle, quand le bateau est le seul moyen de
communiquer : « Par le Créole, parti de Nantes le 16 juin, arrivé sur notre rade le 14 courant,
nous recevons des journaux de cette ville jusqu’au 12 juin, et de Paris jusqu’au 10
inclusivement125 », précise ainsi L’Indicateur colonial réunionnais en 1841 à ses lecteurs. Le
journal portuaire est distribué pour les deux jours qu’il permet de gagner, comme un sursis sur
l’absence de nouvelles métropolitaines. La deuxième perspective, celle d’une affinité
intellectuelle, peut s’illustrer par l’exemple de L’Avenir guadeloupéen, qui donne à lire un autre
fonctionnement de la mise en réseau. Le 19 juin 1860, le rédacteur fait paraître le texte suivant
:
L’Avenir vient de faire une excellente acquisition dans la collaboration d’un écrivain connu et aimé de tous ceux qui apprécient et aiment la bonne littérature.
À partir du mois prochain, M. Pierre Maurel, ancien rédacteur et ancien correspondant de l’Avenir en 1849 et 1850, et aujourd’hui résidant à Paris, enverra, par tous les packets, des correspondances résumant les principaux événements de la quinzaine, et donnant des nouvelles, toujours plus fraîches de vingt-quatre heures, que celles annoncées par les journaux.
Outre cette correspondance, M. Maurel, qui possède à un haut degré toutes les questions coloniales écrira pour l’Avenir des articles qui seront reproduits par la presse parisienne, dans laquelle le talent de M. Maurel lui a fait une place distinguée126.
Le rédacteur reconnaît ensuite qu’
il ne suffit pas que les questions qui intéressent les colonies soient discutées et publiées dans nos petits journaux, qui n’ont guère de lecteurs que nous-mêmes : la chose essentielle c’est que les articles qui sont consacrés à ces matières soient répétés, sinon en totalité, du moins en partie, par les organes de la presse parisienne qui sont lus de tout le monde127.
Cette représentation des liens tissés par la correspondance tient à une facette nécessaire
de l’identité du journal, partant de l’identité coloniale : il faut affirmer la circulation des textes,
il faut montrer qu’il n’y a de communication que si elle va dans les deux sens. Lorsqu’en 1866
Anténor Vallée, le rédacteur de L’Avenir, doit se rendre en métropole, c’est lui-même qui assure
la correspondance parisienne de son journal, laissé aux mains de Paul Rous, un collaborateur.
Différents types de collaboration apparaissent donc dans la presse non-métropolitaine, chaque
périodique y puisant, selon les époques, les correspondances dont il a besoin128. Quand il s’agit
125 L’Indicateur colonial, 18 septembre 1841. 126 L’Avenir, 19 juin 1860. 127 Id. 128 On a pu avoir des doutes sur l’authenticité des correspondances publiées dans la presse, par exemple en Belgique : il apparaît que certaines de ces « correspondances », données comme authentiques, étaient plutôt
50
des correspondances, ces textes destinés à rendre compte de la vie métropolitaine et adressés
au rédacteur du journal sous la forme de lettre, un autre ton s’impose, et partant un autre type
de relations :
Nous avons eu la satisfaction de voir notre petit journal signalé à l’attention publique par plusieurs journaux de la Mère-Patrie, qui lui ont fait même l’honneur de reproduire quelques-uns de ses articles. De toutes les marques de sympathie et d’encouragement que nous avons reçues, aucune n’était de nature à nous toucher plus profondément. Mais voici qui nous confond : nous tenons à donner dans toute sa gracieuse spontanéité la lettre que nous recevons d’un jeune journaliste de talent. Perpignan, 29 mai 1879.
Monsieur et honoré confrère, Mon cousin, chargé de vous remettre le présent billet, m’a envoyé le n° 2 de votre Revue. Je vous félicite cordialement d’avoir fondé une publication qui me paraît devoir rendre de grands services à votre chère Colonie de Bourbon. J’ai lu avec un bien grand intérêt les articles de ce numéro, articles dus à des talents originaux et distingués. Je viens vous demander si vous désirez que je sois votre collaborateur correspondant en France. Je me ferais un plaisir de vous adresser, à titre sympathique seulement, par chaque malle, une chronique mondaine, moitié sérieuse, moitié légère. Ayant déjà dirigé plusieurs revues littéraires, notamment la Muse Orientale, publiée avec Lacaussade, Leconte Delisle et Dierx, mes amis particuliers, je ne crois pas trop présumer de moi en vous priant d’agréer mon humble concours. S’il est nécessaire que je m’abonne pour collaborer au Sport, inscrivez-moi et je vous ferai tenir le montant par le plus prochain courrier, sur votre réponse. En attendant un mot de réponse de votre bienveillance confraternelle, croyez-moi, monsieur et honoré confrère, Votre bien dévoué, Victor PUJO, Rédacteur de l’Indépendant. On n’est pas plus aimable. Nous avons accepté avec reconnaissance la collaboration de notre distingué confrère, dont nous donnons plus loin une poésie, que nous cueillons au hasard, dans un charmant recueil qui s’appelle Rêves Bleus129.
Ce passage est long, mais nous le citons intégralement car il révèle pleinement la
manière dont un journal colonial peut se placer par rapport à la métropole à la fin des années
1870, dans un mélange d’admiration et d’échange de bons procédés, de camaraderie littéraire
(la publication du poème, en fin d’article, en est un signe). La lettre reproduite, qui mêle un
rapide curriculum vitae du journaliste à des considérations plus pragmatiques, est reproduite
constituées à partir de coupes dans les périodiques parisiens reçus. Source : Georges Braive, « Les groupes de presse belge en 1858 », Revue belge de philologie et d’histoire, tome 45, fascicule 2, 1967, p. 414-415. Mais rien de semblable dans les colonies, a priori : l’effort que fournissent les rédactions pour mettre en avant leurs correspondants, la nécessité de présenter une attache précise en métropole semblent sauvegarder les titres coloniaux de cette tentation. 129 « Le Sport colonial en France », Le Sport colonial, 30 août 1879. Nous reprendrons à partir de maintenant l’expression « mère-patrie » sans lui accoler de guillemets, bien qu’elle appartienne à l’idéologie coloniale, pour fluidifier la lecture.
51
pour l’image qu’elle donne du Sport colonial, périodique réunionnais qui est distribué jusqu’à
Perpignan et y gagne, comme le précise le chapeau, des lettres de noblesse. La circulation des
périodiques dans le sens colonie-métropole s’avère donc être un moyen de gagner une forme
de reconnaissance : elle est moins marquante que l’aboutissement d’une presse métropolitaine
dans les colonies, moins conforme à l’idéologie coloniale du rayonnement métropolitain, mais
elle reste fondamentale dans l’imaginaire colonial130.
Enfin, il faut noter que ces correspondances ne relèvent pas toutes du champ
politique : au tournant du siècle particulièrement, les périodiques coloniaux apprécient une
certaine tournure parisienne, au sens d’un discours divertissant, d’une causerie spirituelle. Si
l’on se penche encore sur les textes liminaires qui introduisent une nouvelle signature, l’on
remarque ainsi comment la « chronique parisienne » devient une rubrique propre à garder le
lien avec la métropole imaginée. Dans Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, ainsi, une
chronique parisienne est présentée ainsi : « un simple bavardage, écho des nouvelles, des
cancans de Paris, une causerie intime131 » qui se refuse au politique. Le contexte de publication
est bien évidemment lié à ce refus du politique ; mais l’on y lit aussi une affirmation du modèle
de la conversation dans le périodique colonial, une manière de faire passer l’esprit parisien dans
les colonnes calédoniennes. Cette migration de la chronique parisienne, partant de l’esprit
parisien, dans le monde colonial se retrouve plus largement dans le monde
francophone : l’identité culturelle est l’un des facteurs d’explication, mais la connivence qui
s’établit avec le lecteur colonial peut être un autre facteur d’explication.
Le journal parodié : la reconnaissance d’une familiarité
« La Goguette fera l’échange avec tous les journaux algériens, européens, américains,
asiatiques, océaniques ou autres, même quand ces journaux seraient quotidiens, voire même
quand ils auraient une vingtaine d’éditions par jour132 » : dans son cinquième numéro, La
Goguette algérienne, journal satirique, attire l’attention du lecteur sur ce phénomène particulier
des échanges de journaux que nous venons d’évoquer. Ne peuvent être livrés à la parodie que
des éléments suffisamment visibles pour être déformés : c’est ce qui se produit pour le journal
130 Cet envoi des périodiques privés est moins attendu que l’envoi des périodiques officiels : c’est ce que l’on remarque concernant par exemple le journal officiel de l’Algérie dans les premières décennies de la conquête : « le ʺJournal officiel de la colonieʺ compte peu d’abonnés, sa principale destination étant les envois d’office – et sa diffusion reste aussi importante en Métropole qu’en Algérie ». Extrait de « Le Moniteur algérien de 1841 à 1848, son rôle et sa tendance par Mlle Granfort », Institut d’histoire des pays d’Outre-Mer : bulletin n° 6, 1970-1971, p. 5-18. L’article présente des extraits d’un mémoire de maîtrise. 131 M.H., « Chronique parisienne », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 17 janvier 1864. Notons au passage que la chronique qui paraît est, elle, datée du 26 octobre 1863. 132 La Goguette, 4 mai 1867.
52
colonial, et pour certains éléments saillants qui font son identité. Les petits journaux de
caricature fleurissent à la fin des années 1860, au moment de la libéralisation de l’Empire : les
exemples que nous pouvons traiter se cantonnent donc principalement à cette période. Il ne
s’agit pas ici des représentations satiriques visuelles des journaux ou de leur lectorat, mais bien
du mécanisme qui fait que de petits journaux reprennent la structure du journal colonial et ses
attendus pour faire rire : et ce fonctionnement relève d’un modèle d’écriture médiatique lié à la
littérature médiatique proprement française, celui de la « petite presse133 ». Le Chitann algérois
n’hésite ainsi pas à reproduire une fausse page du Moniteur, journal essentiel à la colonie,
reconnaissable facilement et facilement pris pour cible – la censure ne s’attaque pas à une
critique convenue sur le journal officiel, tant que la critique ne porte pas sur un aspect
proprement politique. Nous reproduisons ici la page pour donner à voir la manière dont la
parodie fonctionne, portant sur la forme autant que sur le fond :
133 Voir la base d’Alain Vaillant et Jean-Didier Wagneur : http://petitepresse.medias19.org/. Consultée le 1er mars 2017.
53
Sur cette page, l’on retrouve les rubriques primordiales du périodique, à savoir la partie
officielle et la partie non officielle. Dans la partie non officielle, le bulletin est commenté en
italique par la voix satirique :
(Voilà) vous pouvez crier si vous voulez, mais pour quelqu’un qui n’en a pas l’habitude, ces petits bulletins ne sont pas trop mal. Que voulez-vous, M. Bouyer n’est pas un rédacteur : il faut être juste134 !
Viennent ensuite les « premières nouvelles », qui moquent le fonctionnement par lecture
des périodiques européens sans avis tranché de la part de la rédaction algérienne à la fin : « La
Gazette de Vienne dit que… » ; puis des « deuxièmes dépêches » internationales (Pologne,
Jamaïque) ; une « revue de la presse algérienne », « l’observatoire d’Alger » et enfin des « faits
divers ». Les « annonces légales » complètent ce tour d’horizon sur une page d’un Moniteur
que Le Chitann donne à voir comme vide, à la limite de l’écholalie en ce qui concerne le
remplissage de ses colonnes. Dans cette charge parodique, le feuilleton n’est pas oublié ; il est
vide, sauf un commentaire entre parenthèses :
(Ma foi ! les compositeurs m’affirment que ce n’est pas drôle du tout à composer cette palabre-là. Si vous tenez à la lire, passez au bureau de la rédaction, avant le 8 septembre, le secrétaire vous remettra 13 sous pour que vous puissiez vous offrir le roman tout entier.)135
En fait, l’état d’esprit du journal satirique face à son confrère officiel peut être résumé
comme suit : « le Moniteur est comme le soleil, il ne change pas136 ». C’est d’ailleurs ce qui en
fait une proie aussi facile : dans tous les territoires coloniaux paraît un journal officiel dont
l’administration a besoin, et qui se place de fait dans une sorte de hiérarchie médiatique. Mais
le journal officiel n’est pas la seule cible possible ; à sa critique facile se joignent des parodies
plus politiques, qui ressortissent à la vie médiatique du territoire colonial. Ainsi, La Semaine
illustrée de la Réunion moque le concept du journal colonial en reproduisant, en quatrième page
d’un de ses numéros, la une d’un journal qu’il baptise L’Île Bourbon137. Cette Île Bourbon cache
en fait très peu la critique faite du périodique La Réunion, qui vient alors d’être créé – ou plutôt
repris du Colon, comme le fait remarquer l’introduction de la fausse page dans La Semaine.
Visiblement républicain et sans doute pas assez littéraire au goût de la Semaine qui a fait de la
134 Le Chitann, 9 septembre 1866. 135 Id. 136 Id. 137 Ce périodique, La Semaine illustrée, est à part dans notre corpus, ne serait-ce que pour la grande qualité de ses illustrations. On lit à son propos, dans Histoire de la presse à la Réunion que ce « premier hebdomadaire illustré de La Réunion » est publié par Antoine Roussin, Avignonnais installé à Bourbon depuis 1842, « peintre, dessinateur, lithographe, imprimeur et journaliste [qui] imprimera les journaux des autres, notamment La Malle catholique » (Karine Técher et Mario Serviable, Histoire de la presse à la Réunion, Sainte-Clotilde, Ars terres créoles, 1991, p. 33).
54
défense de la littérature l’une de ses lignes directrices, le nouveau titre n’est pas le bienvenu
dans une île où les abonnés ne sont pas légion. Le premier texte de la fausse page s’appuie sur
la structure médiatique pour se livrer à la parodie : là encore, la parodie passe d’abord par la
forme médiatique, avant d’en venir au fond. Après avoir annoncé que le spécimen ne sera pas
« aussi chonosof138 » que désiré, le texte continue ainsi : « Dorénavant, nos numéros
contiendront en outre de la partie réservée aux affaires locales, une revue commerciale délayée
commentée et considérablement embrouillée et des renseignements inintelligibles sur le prix
des songes bouillies, de la colle de natte et des gâteaux bananes139 ». On trouve ensuite des
« nouvelles de l’étranger » dans lesquelles « les caïmans se sont réunis hier à deux heures et ont
pris l’engagement solennel de ne plus imiter le cri des enfants » ; une rubrique de « télégraphie
privée », des « dernières nouvelles » et des « nouvelles à la patte ». Dans les « Dernières
nouvelles », on lit : « La nuit dernière, quelques nègres qui sont encore noirs, bravant la défense
qui leur avait été faite, ont profité de l’obscurité pour aller cultiver les terres des blancs140 ». En
pleine guerre de Sécession, ce trait d’humour interroge la perception de l’esclavage dans cette
colonie anciennement esclavagiste qu’est la Réunion ; et l’on voit ici que l’intention parodique,
si elle est politique, s’affiche d’abord comme un simple jeu avec l’objet familier qu’est le
journal. Il y a une forme de dérision gratuite reposant sur le détournement qui témoigne, par
reflet, de l’importance du texte colonial que représente le journal. Ce que nous signalent ces
appropriations parodiques qui ont lieu dans la presse coloniale, c’est une cohérence à la fois
ressentie et réelle : ressentie puisque d’autres périodiques coloniaux sont pris pour sujet de
parodie, et réelle puisque la forme des journaux permet l’insertion parodique de feuilles (Le
Moniteur algérien et l’Île Bourbon se fondant dans les pages des périodiques satiristes sans que
l’insertion soit particulièrement remarquable). Les journaux coloniaux parlent donc d’eux-
mêmes, et aussi de leurs voisins, à différents niveaux, mais avec ce sentiment d’un microcosme
médiatique – sentiment justifié par les limites de la société coloniale – qui nous permet de mettre
en parallèle les publications médiatiques coloniales d’un espace à un autre, d’une aire culturelle
à une autre. Il ne reste que deux appropriations de ce genre dans la presse que nous avons
dépouillée ; mais nous pouvons faire l’hypothèse, puisque le Chitann et La Semaine illustrée
sont publiés dans des lieux et avec des buts différents, que d’autres périodiques, non conservés,
ont pu utiliser ce procédé parodique à l’efficacité étonnante.
138 Terme d’argot. D’après l’ARTFL, « Chocnosof : beau, remarquable, exceptionnel, plantureux, brillant, formidable ; fou, imbécile ». URL : http://dvlf.uchicago.edu/mot/chocnosof. Consulté le 18 octobre 2016. 139 La Semaine illustrée de la Réunion, 6 novembre 1862. 140 Id.
55
1.3 Périodiser la production médiatique coloniale
« L’exactitude véritable consiste à se régler, chaque fois, sur la nature du phénomène
considéré. Car chaque type de phénomène a son épaisseur de mesure particulière, et, pour ainsi
dire, sa décimale spécifique141 ». Or le journal tel que nous l’envisageons, ou plutôt le corpus
médiatique que nous étudions, est à la croisée de plusieurs phénomènes et ne se résout
complètement dans aucun. L’étude du corpus de la presse coloniale nécessite donc de croiser
plusieurs chronologies qui ne se recoupent pas forcément. Dans cette première partie, dont
l’objet est bien le journal colonial, la périodisation est considérée dans une perspective
strictement médiatique : quelles lois, quelles conditions de production, quelles contraintes
proprement liées au journal expliquent les variations de parution ? Viendront ensuite une
chronologie technique, une chronologie coloniale, et enfin la mise en perspective d’une
chronologie littéraire – chacune se rattachant à l’objet de la partie traitée. Ici, les différentes
rubriques par lesquelles nous avons abordé notre corpus nous amènent, naturellement, à tenter
de périodiser les grandes étapes de sa production. Les lois sur la presse ne s’appliquent pas
toutes au domaine colonial : à part les éclosions de 1848 et 1870, il est difficile de reprendre
exactement les scansions de la presse nationale pour rendre compte de la presse coloniale. La
temporalité coloniale est à elle seule un sujet de discussion : le « second souffle » de la
colonisation française au XIXe siècle peut se décomposer en différentes étapes, et les territoires
colonisés ne vivent pas selon les mêmes évolutions, ne produisent pas les mêmes discours au
même rythme142. De la même manière, tous les territoires ne suscitent pas la même production
littéraire ou médiatique, comme la lecture des périodiques coloniaux nous l’a montré : il faut
notamment séparer les colonies issues du premier empire colonial, les colonies récentes
conquises au cours de la période, et l’Algérie, que l’on a pris l’habitude de mettre à part – ce
que sa production médiatique particulièrement prolixe confirme. Enfin, la presse coloniale
relève d’une législation qui n’est pas celle de la métropole : moins connue et peu étudiée que la
législation nationale, elle est pourtant nécessaire à la compréhension du corpus.
Législation et presse coloniale Les titres coloniaux laissent parfois paraître les blancs laissés par la censure, et ces
blancs constituent un indice précieux pour mettre au jour une étude de la législation propre à la
141 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, Colin, [1949], 1993, p. 183. Cité par Dominique Kalifa, « L’entrée de la France en régime "médiatique" : l’étape des années 1860 », De l’écrit à l’écran, Jacques Migozzi (dir.), Limoges, Pulim, 2000, p. 39. 142 Oissilia Saaïdia et Laurick Zerbini (dir.), La Construction du discours colonial. L’empire français au XIXe et XXe siècles, Paris, Karthala, 2009, p. 11 et suivantes.
56
presse coloniale et de ses particularités. Ainsi, en 1830, lorsque la Charte instaure la liberté de
la presse, rien n’indique quel doit être le traitement réservé à la presse des colonies : le
gouverneur de Bourbon peut alors en profiter pour maintenir la censure, qui sera
particulièrement sévère sur l’île143. Cet épisode n’est pas la seule preuve du fonctionnement
décalé de la législation sur la presse dans les colonies : quand le ministre de la Marine et des
Colonies Chasseloup-Laubat144 fait publier des Notices sur les colonies françaises en 1866, il
y admet un passage portant spécifiquement sur la presse.
Aux termes des ordonnances organiques de 1825 et de 1827, la surveillance de la presse et la police de la librairie sont remises au pouvoir discrétionnaire des gouverneurs.
Cette législation avait été modifiée par un décret du 2 mai 1848 et une loi du 7 août 1850, qui avaient été abrogés eux-mêmes par un décret du 20 février 1852 ; mais un décret du 30 avril 1852 a remis en vigueur ces deux derniers actes en tant qu’ils ne seraient pas contraires aux ordonnances organiques, et a substitué, pour la connaissance des délits politiques ou autres commis par la voie des journaux ou par la parole, la juridiction des tribunaux correctionnels à celle des cours d’assises145.
La presse coloniale est surtout caractérisée par un manque de liberté flagrant : pour
l’empan chronologique que nous étudions, elle est soumise à une censure sévère. Le gouverneur
de la colonie possède en effet une autorité plus marquée – « discrétionnaire », dit le texte – que
celle du préfet, son équivalent métropolitain. Sous la monarchie de Juillet, la presse coloniale
est donc soumise à la seule autorité du gouverneur. Ensuite, et pour reprendre les étapes
signalées par Chasseloup-Laubat, la liberté de la presse aux colonies est bien décrétée le 2 mai
1848. En 1849 pourtant, pendant l’un de ces moments où une certaine liberté est permise à la
presse coloniale, Le Brûlot de la Méditerranée évoque ses concurrents par le biais de la
censure : au cours d’une rubrique d’esprit intitulée « Obus », L’Akhbar et L’Afrique
française sont caractérisés par leurs rapports à la censure146.
143 Fabienne Jean-Baptiste, op. cit., p. 165-166. 144 Ministre de 1860 à 1869. 145 Notices Sur Les Colonies Françaises : Accompagnées D’un Atlas de 14 Cartes / Publ. Par Ordre de S. Exc. Le Marquis de Chasseloup-Laubat, Ministre Secrétaire d’Etat de La Marine et Des Colonies, Paris, Challamel ainé, 1866. URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5833387n. Consulté le 24 mars 2016. 146 « Obus », Le Brûlot de la Méditerranée, 13 août 1848.
57
Ce fonctionnement ironique n’est pas fréquent dans le reste de notre corpus : il signale
ce moment de liberté dont bénéficient les périodiques coloniaux. Si l’on développe les dates
données par l’ancien ministre, l’on se rend compte que la législation se renforce : le 7 août 1850
est créée la police de la presse aux colonies, qui sera renforcée au cours de l’année 1852 (le 28
mars 1852 en Algérie, le 30 avril 1852 dans les autres territoires coloniaux). Si se sont produits
dans les colonies de véritables moments d’éclosion de la presse, dont 1848 est un exemple
remarquable, le retour de la coercition ne leur permet pas de durer, et à ce titre l’année 1852
marque fortement la presse coloniale – ainsi que tout l’environnement colonial. L’on note ainsi
que
dès l’annonce du coup d’État, le gouverneur [peut] agir en toute connaissance, frappant principalement les journaux, objets du rétablissement de la censure préventive. Le premier titre à subir les foudres est le Courrier d’Oran, saisi pour avoir imprimé des extraits de la Constitution. Puis c’est le tour de L’Atlas, le 12. […] Enfin, à la fin du mois de décembre, le Saf-Saf, journal de Philippeville, est lui aussi suspendu et de nombreux journaux étrangers sont interdits, brûlés à la poste. La suspension de L’Atlas, malgré un acquittement le 24 décembre, s’avère définitive147.
Le Second Empire est central dans la période que nous traitons ; et surtout, plusieurs
titres de notre corpus prennent naissance sous l’Empire : Le Messager de Tahiti, Le Moniteur
de la Nouvelle-Calédonie et Le Courrier de Saïgon sont ainsi les trois titres officiels dont la
création même ressortit à une politique impériale. Ce régime va aussi marquer certaines
évolutions, d’abord concernant le statut des territoires coloniaux, ensuite et plus précisément
concernant la législation de la presse. En premier lieu, la Martinique, la Guadeloupe et la
147 Betrand Jalla, « Les colons d’Algérie à la lumière du coup d’État de 1851 », Afrique & histoire, 2003, vol. 1, p. 131-132.
58
Réunion sont administrées par décrets de l’empereur à partir du sénatus-consulte de 1854.
D’autres changements vont se répercuter dans la législation médiatique : dans le premier
numéro du Messager, Journal officiel de la Martinique, le rédacteur – expliquant pourquoi son
périodique paraît – précise à ses lecteurs que le décret du 5 juillet 1863 « a étendu au régime de
la presse dans les colonies le droit commun dans la métropole148 ». Autrement dit, le même
rédacteur devient responsable du journal ; mais, suivant ce que 1854 avait amorcé comme
différenciation des territoires, le décret du 5 juillet 1863 ne s’applique qu’à la Martinique, à la
Guadeloupe et à la Réunion – c’est cependant assez pour susciter dans notre bibliographie un
sommet de publications à interroger. La censure continue de s’exercer cependant : à la Réunion,
justement, un exemple parmi d’autres laisse voir les traces matérielles de la censure. La Malle
du 3 décembre 1868 publie ainsi une page largement amputée de son premier article, manière
d’exhiber le pouvoir du gouverneur.
148 Le Messager de la Martinique, 2 mars 1864.
59
La représentation de la censure dans la presse peut également emprunter d’autres voies,
moins imagées et plus narratives : certains rédacteurs racontent leurs mésaventures, se
définissant ainsi une posture d’homme de lettres désemparé face à la complexité des conditions
de publication dans les colonies. C’est ce que fait par exemple Anténor Vallée, le rédacteur de
L’Avenir, en préface au récit historique qu’il publie dans son périodique. Il écrit :
Je m’étais arrêté pour deux causes : j’avais de la peine et n’avais pas de profit, cela m’allait peu et même pas du tout ; ne pouvant, à cause de la censure, qui florissait alors, imprimer ici, j’imprimais ailleurs, j’envoyais à New-York mon histoire et quand elle revenait, il fallait pour la vendre, l’annoncer par la presse, et dame censure me guettait au passage…
Et puis il y avait la douane qui est la censure des choses, comme la censure est la douane des idées :
Il y avait le consignataire du navire importateur, qui avait peur de la saisie ou de l’amende pour fait de contrebande et qui me disait, la larme à l’œil : j’avais à bord un ballot de votre histoire, j’ai vu venir la douane, je l’ai jeté à l’eau ;
Et moi je répondais : c’est bien fait, périsse mon histoire plutôt que votre navire.
Depuis lors, les choses ont changé de face, je change ma préface et reprends le fil de mon histoire : on nous a donné la liberté de parler, je n’ai plus le droit de me taire ; je continue ou plutôt je recommence ; quelques pages seulement avaient paru, elles paraîtront dans L’Avenir, à partir du premier juillet prochain, afin que tous les abonnés aient l’œuvre complète149.
Superposer ces deux représentations de la censure montre bien comment elle fait partie
des contraintes fondatrices de l’écriture coloniale : ici, la législation devient l’élément
perturbateur d’une histoire de publication, et elle permet d’exprimer ainsi l’une des facettes de
l’identité coloniale. Plus habituellement, et dans une perspective quelque peu différente, les
titres de presse se font, à l’occasion, l’écho des procès les concernant. Ces procès sont
révélateurs de tensions propres au déroulement de la colonisation sur le territoire
concerné : ainsi, quand l’Algérie est encore sous un régime militaire de plus en plus contesté,
la presse cristallise certains points de ce débat. C’est en tout cas ce qui apparaît en 1865 dans
L’Indépendant de Constantine, en une :
En juillet 1864, le ministère public avait vu dans deux articles de notre étude sur la conquête morale des Arabes une triple infraction aux lois de la police de la presse, à savoir : 1° trouble à la paix publique en excitant les citoyens à la haine et au mépris les uns contre les autres ; 2° Apologie de faits qualifiés crimes ; 3° diffamation envers les chefs arabes150…
149 A. Vallée, « Petit avant-propos, pour tenir lieu de préface », L’Avenir, 18 juin 1859. On remarque le détournement de la phrase « Périssent les colonies plutôt qu’un principe » prononcée par Robespierre : cela ancre le texte dans une écriture coloniale fondée sur la connivence. 150 L’Indépendant de Constantine, 30 juin 1865.
60
L’Indépendant de Constantine est un journal particulièrement revendicatif : distribué en
fait sur l’ensemble du territoire colonisé, et pas seulement à Constantine, cet organe républicain
cherche à accélérer le passage de la colonie au régime civil, et veut donc accélérer également
les expropriations151. D’autres journaux, concernés par des procès – sous le Second Empire
comme sous la Troisième République – connaissent des déboires qu’il serait trop long de
préciser ici152. Mais plus généralement, l’on peut donc dire que la presse commente ce qui la
concerne, y compris les évolutions de la législation. Il est vrai que les lois qui portent sur la
presse coloniale changent au cours du siècle, et aboutissent à un système beaucoup plus
complexe que ce qui avait pu exister auparavant. Vers la fin du Second Empire, la loi du 11 mai
1868 vaut surtout parce qu’elle remplace l'autorisation préalable par une déclaration préalable,
impose le dépôt préalable de chaque numéro au siège de l'autorité et au tribunal, interdit la
publication d'articles émanant de personnes privées de leurs droits civiques, pose le principe de
la suspension ou de la suppression d'un journal pour crime par voie de presse. Elle est complétée
ensuite par les lois de la République ; mais toutes ne s’appliquent pas dans les colonies. Ainsi,
le décret du 10 septembre 1870 rendait libres les professions d'imprimeur et de libraire, mais
ce décret ne fut point promulgué en Algérie. Pour suppléer à l'absence de législation, une circulaire en date du 9 juillet 1872, émanant du Gouvernement Général, fut adressée aux préfets. Elle maintint dans la colonie les règles en usage antérieurement : autorisation préalable, justification par les postulants de leurs droits civils, politiques, garantie de moralité, production d'un certificat de capacité professionnelle émanant d'au moins deux imprimeurs ou libraires établis dans le département où les postulants voulaient exercer153.
Les lois qui s’appliquent sont davantage coercitives : la loi du 15 avril 1871 relative
aux poursuites à exercer en matière de délits commis par voie de presse ; la loi du 6 juillet 1871
rétablissant le cautionnement pour tous les journaux et écrits périodiques ; la loi du 29 décembre
1875 sur la répression des délits qui pouvaient être commis par la voie de la presse ou par tout
autre moyen de publication. Enfin, à l’extrémité de la période étudiée, les lois sur la liberté de
la presse de 1881 ont un effet sur la presse coloniale : l’autorisation préalable du gouverneur
est supprimée, et le régime juridique colonial s’aligne alors sur le régime juridique
151 Voir Didier Guignard, « Des maîtres de paroles en Algérie coloniale. Le récit d’une mise en scène », Afrique & histoire, 2005/1 (vol. 3), p. 129-154. 152 Voir Georgette Sers-Gal, « La Presse algérienne de 1870 à 1900 », La Revue africaine, 1959. Elle écrit, p. 96-97 : « Un arrêté de mars 1874 proclama l'état de siège à Alger en raison des attaques, jugées injurieuses, de la presse contre la municipalité. Cette mesure provoqua une protestation des négociants de la ville, comme portant atteinte aux intérêts commerciaux. Elle n'en fut pas moins maintenue jusqu'en 1875, année de grande persécution contre les journalistes. En juin, des Ageux du Courrier de Tlemcen se voit traduit en police correctionnelle pour le délit bien élastique de fausse nouvelle visant un article inséré dans le numéro du 17 juin. Ceci inspire à un de ses rédacteurs, Olivier, un article amer intitule "De la liberté de la presse coloniale" (numéro du 2 juillet 1875) ». 153 Ibid., p. 95.
61
métropolitain. En tant que publications officielles, les journaux officiels coloniaux font l’objet
d’un dépôt légal auprès des ministères qui les régissent154.
Journal et développement colonial Parler de la presse coloniale nécessite de repenser sa parution en termes de conquête ou
d’installation de la colonie : si l’objet « journal » reste le même sur tous les territoires, sa
fonction varie selon les périodes de colonisation. Le périodique catalyse les étapes de la
colonisation : il en rend compte, mais il est aussi le support qui les modèle et leur donne forme
pour le lectorat. Sur le territoire algérien, les créations de journaux vont suivre le développement
de la colonisation et de la conquête : des titres locaux privés se créent dans les villes nouvelles
ou conquises. Cette diffusion spatiale du journal suit la même progression qu’en Australie ou
au Canada155, mais elle est assez différente des autres colonies françaises : en ce sens, elle rend
bien compte de la spécificité algérienne. En effet, les anciennes colonies ont déjà une presse
locale plurielle, on l’a dit, et qui paraît dans les différentes villes qui les constituent. La
Nouvelle-Calédonie et Tahiti ne verront se mettre en place des titres régionaux que plus tard,
dans les années 1880 – si l’on fait exception de la presse calédonienne publiée par et pour les
bagnards ; la Cochinchine, possession plus récente, se contente du Courrier de Saïgon jusqu’à
la décennie 1880. La progression politique des colonies peut également se voir dans les
évolutions médiatiques : en 1878 paraît en Martinique le premier journal fondé et dirigé par des
« hommes de couleur » républicains. Les Colonies de Marius Hurard, assisté de César Lainé et
Ernest Deproge, est un journal à part, qui marque l’évolution qui a été celle de la société
coloniale depuis l’abolition de l’esclavage. Hurard et Deproge deviendront députés : le journal
est leur première action publique, leur première inscription au centre de la vie coloniale
comprise sur le plan symbolique156.
Outre ces faits visibles, les périodiques coloniaux témoignent dans les feuilletons, les
faits divers ou les variétés, d’une évolution de la représentation du phénomène colonial en tant
154 Les collections consultées aux ANOM émanent de ces dépôts obligatoires. Un document de la BNF précise : « En 1877, Léopold Delisle, administrateur de la Bibliothèque Nationale, indique, dans son Rapport au Ministre de l’Instruction publique, que sur 45 300 articles rentrés en 1876, les périodiques représentent 5 100 entrées. Ce chiffre ne reflète pas les créations de titre qui s’élèvent à plusieurs centaines par an dans les années 1880. Plus loin, toujours dans le même rapport, les chiffres relatifs au dépôt légal font état de statistiques par départements ; il note, entre autres, 60 pour Constantine qui correspondent à un nombre probable de titres de presse, sachant que les publications de l’Algérie, pour laquelle le dépôt légal a été mis en place en 1871, portent en grande partie sur cette activité de presse ». Source : « Des sources pour l’histoire de la presse », Lise Devreux et Philippe Mezzasalma (dir.), avec la collaboration de Catherine Eloi, Denis Gasquez et Jean-Didier Wagneur, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2011, p. 32. 155 Clem Loyd, art. cit., p. 18-19. 156 Auguste Joyau, Panorama de la littérature à la Martinique, Fort-de-France, Édition des horizons caraïbes, 1977, p. 400.
62
que conquête d’un espace autre. La Nouvelle-Calédonie offre ici un bon exemple : l’on peut
s’attacher à lire les variations médiatiques comme les répercussions des changements de
gouverneurs, mais l’on peut aussi lire ces changements d’un point de vue plus textuel. Six ans
après la prise de possession de 1853, le journal fait encore paraître des annonces qui valent
avertissement auprès de la population. Le Moniteur est bien alors la voix officielle qui sermonne
ses lecteurs et tire des leçons des événements de la vie coloniale :
Jeudi dernier 27, le service annoncé pour le mardi précédent, pour le repos de l'âme de l'infortuné CAPRON Français âgé de 27 ans massacré et mangé par les chefs de Taw et Hyenouène, a eu lieu en l'église de Ste Eugénie. Le recueillement de nombreux assistants témoignait assez combien cet épouvantable forfait a jeté de tristesse dans tous les cœurs, et les regrets unanimes qu'a emportés la victime. L'autorité supérieure croit devoir rappeler de nouveau aux nombreux immigrants de cette belle colonie, qu'en dehors du quadrilatère de notre occupation, il n'y a aucune sécurité pour les Européens, surtout pour les Français qui continuent, poussés par l'appât du lucre, à s'aventurer au milieu des peuplades féroces du nord, malgré ses nombreux avertissements et rigoureux arrêtés dictés par la prudence la plus vulgaire157.
La « belle colonie », formule convenue des débuts d’une prise de possession, est donc
retravaillée par le journal au fur et à mesure. Ainsi, le 19 août 1860 paraît le premier épisode
d’un feuilleton écrit par le père Montrouzier, « Nouvelle-Calédonie. Fragments historiques158 »,
dans lequel il raconte les premières années de son arrivée sur le territoire. Mais il n’y développe
pas une vision idyllique de la conquête, bien au contraire : le journal fonctionne là encore selon
le principe de la prévention, de l’éducation. Le journal se fait également et plus largement l’écho
des difficultés de la vie coloniale : dans un autre type de texte, le premier numéro de 1861
propose de « mettre sous les yeux de [ses] lecteurs un résumé historique des faits qui se sont
passés en Nouvelle-Calédonie pendant l'année 1860159 », habitude médiatique qui n’appelle pas
à commentaires : il s’agit de combler le manque d’histoire des lecteurs coloniaux et
métropolitains. Mais le rédacteur continue :
Nous ne nous dissimulons pas que vers les premiers mois de l'année passée, une sorte de découragement et de manque de confiance dans l'avenir de notre Colonie s'est emparée de notre population. Plusieurs causes, nous l'avouons franchement, ont pu donner naissance à ces sentiments. Sans les discuter, nous nous bornerons aujourd'hui à exprimer l'espoir que ces inquiétudes au milieu desquelles il est impossible d'accomplir des progrès sérieux se dissiperont graduellement et que l'année dans laquelle nous venons d'entrer sera profitable aux intérêts généraux et particuliers du pays, aucune colonie
157 Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 1859. 158 Père Montrouzier, « Nouvelle-Calédonie. Fragments historiques », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 19 août 1860. 159 Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 6 janvier 1861.
63
naissante n'est exempte de moments de malaise, il faut savoir les surmonter160.
Le ton est ici moins prescriptif, et rend davantage compte de la perception d’une
colonisation difficile : cet aveu de franchise est quelque peu étonnant, et d’autant plus au sein
du journal officiel. Ces premiers textes, qui insistent sur les dangers que courent les coloniaux
ou leur découragement, ne font pas long feu. Le journal publie ensuite des explorations ; dans
le même temps, le lecteur du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie voit s’ouvrir le monde des
explorations, et se retrouve pris dans ce mouvement, puisque paraît une « Notice sur les îles
Loyalty161 » écrite par le lieutenant de vaisseau Jouan et tirée de La Revue maritime et coloniale.
L’ouverture sur le monde colonisé se fait par le biais des textes : l’on trouve en feuilleton un
« Aperçu sur la basse-Cochinchine, par Reunier, lieutenant de vaisseau162 » ; en deuxième page
et dans les faits divers, un « Voyage dans le pays des maures Brakna163 » pris dans la Revue
maritime et coloniale ; en première page et dans les variétés, un « Voyage d’exploration sur le
Yang-Tse-Kiang164 » repris du Times. La colonie vise donc l’extérieur et participe par ce biais
au mouvement colonial qui reconfigure la vision occidentale du monde ; les explorations
circulent dans le cadre du journal et ne sont pas limitées à une seule rubrique. Cette preuve de
leur plasticité montre leur importance : et le fait que ces publications aient été précédées par la
notice portant sur les Loyalty prouve que le lectorat du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie peut
replacer le développement de la colonie calédonienne au sein d’un mouvement plus vaste, qui
concerne une grande partie du globe. Cette évolution des publications médiatiques en Nouvelle-
Calédonie ne se limite pas à cette évolution : une « chronique néo-calédonienne165 » commence
à paraître en juin 1862, montrant l’utilisation que fait le journal d’un nouveau type de textes.
La colonisation devient force littéraire locale, précise, revendiquée : l’on est loin alors des
premières inquiétudes ou des explorations qui visaient à replacer la découverte des archipels
sur le même planisphère. Le journal adopte une écriture qui veut révéler une forme de
civilisation locale : c’est en ce sens que les explorations coloniales laissent place à la chronique
personnelle, fondée sur un modèle davantage lié à la conversation. Le changement de texte le
signale : la colonie est de plus en plus sûre. Le 10 août enfin paraît une « Exploration faite de
N’goé à Port-de-France166 par M. le lieutenant de vaisseau Chambeyron », qui réconcilie le récit
160 Id. 161 « Notice sur les Loyalty », Jouan, Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, du 10 novembre au 19 décembre 1861. 162 Aperçu sur la basse-Cochinchine, par Reunier, lieutenant de vaisseau », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, du 5 janvier au 26 janvier 1862. 163 « Voyage dans le pays des maures Brakna », 30 mars 1862. 164 « Voyage d’exploration sur le Yang-Tse-Kiang », 11 mai 1862. 165 Félix H. Béraud, « Chronique néo-calédonienne », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 29 juin 1862. 166 Port-de-France est le premier nom donné à Nouméa.
64
d’exploration et la dimension locale : le but reste la ville coloniale. Le 17 août, le périodique
continue en ce sens, avec un « Voyage par terre de Port-de-France à Kanala, exécuté par M.
Marchant, sous-lieutenant d’infanterie de Marine » ; le 14 septembre, c’est un « Voyage sur la
côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie » relatant un voyage fait en mai 1862 qui est publié. Les
explorations qui rayonnent à partir de la ville se succèdent et signalent la réussite coloniale dans
le journal.
Ce recentrement sur le territoire colonial est encore renforcé par un autre modèle
littéraire publié par le journal : les poèmes d’un certain Armand Closquinet paraissent à partir
du 5 octobre 1862. « En mer » est en effet une succession de textes peignant l’arrivée du poète
sur le territoire colonial : la forme s’accorde ici à peindre la réussite de la société coloniale,
puisqu’un poète peut y trouver sa place en plus des officiers ou des prêtres167. En 1867 paraît,
autre évolution des publications, un « Historique de la découverte de la Nouvelle-
Calédonie168 » très informatif, qui se déploie sur quatre numéros et donne l’image d’une
conquête achevée, devenue objet d’histoire. C’est une autre perspective que celle des premiers
écrits historiques du Père Montrouzier que le journal a fait paraître : l’histoire alors est publiée
sous une forme neutre, à la perspective élargie, et non comme des « fragments » liés à une
expérience. Dans le même esprit, en 1880, une variété contient une « Construction de la carte
de la Nouvelle-Calédonie169 » : l’ère des explorations est achevée, et le territoire colonial peut
bien être fixé par la carte – quand bien même le texte joue d’une narration à la première
personne qui littérarise l’entreprise. Le journal qui accompagne la conquête donne à lire, certes
rétrospectivement, mais avec une vue d’ensemble révélatrice, l’adaptation des textes
médiatiques à une situation précise : pour la Nouvelle-Calédonie, quelques décennies ont suffi
à modifier les parutions médiatiques.
Le Courrier de Saïgon, quant à lui, témoigne d’un autre type d’évolution qui tient là
encore au territoire et à sa conquête : la volonté de faire découvrir certains aspects de la culture
locale, puisqu’on lui reconnaît une ancienneté et une valeur intrinsèque. Dès son deuxième
numéro paraît une « chronique annamite » qui étudie plusieurs aspects de la société locale :
« Fragments d'histoire du royaume annamite – Ses rapports avec Siam – Son émancipation de
la Chine et son adoption du système d'exclusion des étrangers170 » sont ainsi les sous-titres qui
167 Nous reviendrons sur la manière dont Armand Closquinet participe à la production littéraire de l’île. 168 « Historique de la découverte de la Nouvelle-Calédonie », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 27 octobre 1867. 169 « Construction de la carte de la Nouvelle-Calédonie », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 24 mars 1880. 170 « Chronique annamite », Le Courrier de Saïgon, 10 janvier 1864.
65
précisent le propos. Suit, dans le même esprit, un « Aperçu sur la province de Mytho171 » qui
sera complété en mars et en juillet, preuve d’un projet sur le long cours qui vise à déchiffrer
l’environnement colonial. En 1865, pour sa deuxième année, Le Courrier de Saïgon fait paraître
un voyage « De Saïgon à Contior » par Pierre Le Faucheur ; des « Lettres sur le Cambodge »,
une « grammaire annamite172 » et des « notes historiques sur la nation annamite173 » dans le
même numéro de septembre… En 1866, le journal publie des « Observations sur le peuple
annamite » signées du Père Jourdain : l’on retrouve toujours cet objectif de connaissances,
décliné selon la langue, l’histoire et l’ethnographie. Le périodique ne s’arrête d’ailleurs pas là,
puisqu’en juillet 1866, on lit :
Nous recevons de M.G. Aubaret, consul de France à Ban-kok, la traduction d’un petit poëme en langue annamite vulgaire, où l’on trouve une fraîcheur et une énergie de sentiments digne des nations les mieux douées.
Nous croyons faire grand plaisir à nos lecteurs en leur faisant connaître cet ouvrage remarquable, qui peint fidèlement les mœurs et les idées d’une population intéressante à tous égards.
Quand on lit ces pages naïves et attrayantes qui sont si populaires en Cochinchine, on voit qu’en perdant les lisières de la phraséologie chinoise, les nouveaux sujets de la France pourront cultiver une littérature nationale, plus énergique et plus naturelle, capable de satisfaire les besoins de leur cœur et de leur imagination174.
La condescendance coloniale est ici évidente ; et cependant, cette traduction de Luc Van
Tien s’annonce comme un des morceaux de choix du journal officiel. Le texte, publié de
manière épisodique et sans grand ordre, ne prendra fin qu’en août 1867, ayant alors « servi » à
la publication coloniale pendant toute une année. L’intérêt ethnographique ne se dément pas
par la suite : en octobre et novembre 1868, Achille Sinet publie une « Étude sur le deuil et la
parenté chez les Annamites175 » ; en 1869, les « Mœurs et coutumes annamites » occupent le
périodique du 5 mai au 20 novembre, là encore avec des parutions irrégulières.
Ces différents enjeux – auxquels la presse coloniale doit répondre – se conjuguent à des
évolutions plus larges, que le journal cristallise et qui marquent dans le texte des changements
politiques importants. Il y a l’annonce des changements de régime, que les périodiques
coloniaux répercutent avec le retard inévitable mais qui provoquent une même écriture que dans
la presse métropolitaine (récits des événements, proclamations, appels au calme) ; il y a aussi
171 « Aperçu sur la province de Mytho », Le Courrier de Saïgon, 10 janvier 1864. 172 « Grammaire annamite », Le Courrier de Saïgon, 5 septembre 1865. 173 P. Le Grand de la Lyraie, « Notes historiques sur la nation annamite », Le Courrier de Saïgon, 5 septembre 1865. 174 Le Courrier de Saïgon, 20 juillet 1866. 175 Achille Sinet, « Étude sur le deuil et la parenté chez les Annamites », Le Courrier de Saïgon, 5 octobre et 20 novembre 1868.
66
des faits médiatiques qui se jouent sur un plus long terme. Pour un lecteur moderne, le plus
frappant reste les « annonces » relatives à l’esclavage dans la presse antillaise, réunionnaise et
guyanaise : ventes, héritages, déclarations de marronnages sont visibles dès la une des journaux
officiels. Il n’est même pas question encore des articles de fond portant sur l’esclavage, des
débats au moment de l’abolition ; mais bien, visuellement, des listes présentées en première
page et qui révèlent toute la violence du monde colonial. Sous la rubrique « Service intérieur »
de la Feuille de la Guyane française du 21 janvier 1848, on trouve ainsi trois rubriques : une
« déclaration de marronnage », des « marrons arrêtés » et un « marron rentré », avec sous
chacune de ces rubriques des prénoms et des dates. D’autres rubriques encore sont
possibles : ainsi des « rachats forcés » rendant publics des esclaves « se rachetant » pour des
sommes fixées par une commission. Dans Le Courrier de Saint-Paul, on trouve des demandes
d’affranchissement, publiées elles aussi à la une : le journal est certes « politique, commercial
et littéraire », mais il est aussi la « feuille d’annonces légales de l’arrondissement sous-le-
vent ». D’où ces publications officielles qui précisent le nom et l’âge du propriétaire, ainsi que
le prénom et l’âge de l’esclave ; s’y ajoute le patronyme que portera le futur affranchi. Le
journal garde donc, à plus d’un titre, la trace de la période de colonisation pendant laquelle il
paraît.
Les années 1860, un pic de production médiatique ?
« L’étape des années 1860 » qu’évoque Dominique Kalifa pour la presse métropolitaine
tient compte de nombreux facteurs sociaux et culturels favorisant l’apparition de « structures
inédites176 » sous le Second Empire et le début d’une culture de masse. Au cours de nos
recherches, il est également apparu – de manière empirique – que les années 1860 représentaient
une sorte de « pic de production » du corpus médiatique colonial : nous y avons trouvé des
articles nombreux, issus de journaux divers, portant sur l’identité dans les territoires colonisés
à travers différents thèmes. Pourquoi cette décennie se retrouve-t-elle si bien représentée dans
notre bibliographie ? Peut-être d’abord pour des raisons de conservation : les périodiques des
années 1860 sont plus récents, mieux conservés – la qualité du papier s’est visiblement
améliorée. Peut-être est-ce également dû à une période de production médiatique assez intense
en règle générale, et qui voit les journalistes français circuler à travers le monde : cette
hypothèse est confortée par la création, dans cette décennie, de journaux francophones ailleurs
que dans les colonies. Certains titres officiels prolixes voient aussi le jour à cette époque,
176 Dominique Kalifa, « L’entrée de la France en régime "médiatique" : l’étape des années 1860 », De l’écrit à l’écran, Jacques Migozzi (dir.), Limoges, Pulim, 2000, p. 51.
67
directement liés au développement colonial : la Nouvelle-Calédonie, la Cochinchine entrent
sous domination française et inaugurent la parution de titres qui connaîtront une longue vie.
Peut-être ces années 1860 constituent-elles, dans les textes de la presse coloniale, une forme
d’accélération de la problématique identitaire coloniale : ce point mérite une analyse qui
interviendra plus tard dans notre développement. Mais l’on peut d’abord se demander si le
régime politique a joué un rôle dans ces décennies fastes pour la production médiatique
coloniale. Il y a bien, en 1858, la création d’un éphémère Ministère de l’Algérie et des
Colonies : Napoléon III le supprime certes après quelques mois, et l’Algérie est à nouveau
rattachée au Ministère de l’Intérieur, pendant que le Ministère de la Marine retrouve les
colonies177. Cette création et ce retournement témoignent bien d’une nouvelle attention portée
aux colonies, tout comme l’idée du royaume arabe en est un indice : Napoléon III réfléchit à la
politique coloniale algérienne, en même temps que sur ce territoire les populations européennes
installées se revendiquent coloniales et refusent l’idée même du royaume arabe178.
En métropole, Le Moniteur universel, « sans cesser d’être le journal officiel de la France
et l’étant même superlativement, peut être qualifié d’"entreprise commerciale et littéraire" selon
la formule de Félix Ribeyre dans Les Grands Journaux de France179 » : il y a bien ici la trace
d’un changement dans la presse officielle au cours de cette décennie 1860, changement qui a
pu se répercuter jusque dans les publications officielles des territoires coloniaux. Le régime
impérial, par la censure, favorise une expression littéraire plus vive ; et les périodiques
coloniaux qui paraissent entre 1852 et 1868, ne pouvant traiter de questions politiques sensibles,
publient alors des textes divers portant sur ce qui fait consensus : une force coloniale montrée
comme triomphante. Enfin, la parution des petits journaux parodiques à la fin des années 1860
se fait en lien avec la libéralisation des dernières années de l’Empire : la loi du 11 mai 1868, en
supprimant les autorisations préalables et avertissements, permet l’émergence de plusieurs titres
satiriques et marque une étape supplémentaire dans un développement de la liberté médiatique.
Les années 1860 sont aussi les années d’une mondialisation qui s’accélère, et dont le
journal participe : le premier câble sous la Manche est posé en 1861, et en ce qui concerne notre
domaine, la France est reliée à sa colonie algérienne en 1863 ; le journal est l’un des enjeux de
177 Julie D’Andurain, « Entre velléité et opiniâtreté : la création du ministère des Colonies en France (1858-1894) », French Colonial History, 2013, vol. 14, p. 33-54. 178 Histoire de l’Algérie à la période coloniale, 1830-1962, Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Paris, La Découverte, [2012], 2014, p. 38. 179 Laurence Guellec, « Les Journaux officiels », Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), La Civilisation du journal : Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2011, p. 491.
68
ces relais de l’information180. Une revendication paraît dans L’Indépendant de Constantine en
1863, qui réclame un organe centralisé à Paris pour coordonner la presse coloniale, à l’image
de ce qui se passe en Australie : cet article même est la preuve d’une mondialisation qui monte
en puissance. La comparaison avec la colonie australienne en même temps que la demande d’un
rattachement plus fort à Paris vont dans le sens d’une prise de conscience de ces nouveaux
réseaux de l’information, ainsi que de la nécessité pour les colonies de se rapprocher encore de
la métropole181. Dans les territoires récemment conquis, la colonisation semble également
opérer un tournant dans les années 1860 : à Tahiti, Michel Panoff repère que les Français ayant
fait le choix de s’installer sur le territoire du protectorat révèlent une bourgeoisie en marche182.
L’exposé de la période médiatique de notre corpus ne serait pas complet si l’on n’évoquait pas,
en 1869, les événements de la Réunion, preuves de l’importance du monde médiatique dans les
colonies, et de son influence politique183. Depuis le 2 février 1852, les colonies n’ont plus de
représentants à l’Assemblée, et elles n’en retrouveront que le 8 septembre 1870. C’est en
décembre 1868, plus précisément, au milieu de discussions toujours renouvelées sur ce défaut
de représentation coloniale, que surviennent des débats animés184. Or la presse réunionnaise est
travaillée par des dissensions politiques fortes : la question religieuse, d’abord en arrière-plan,
gagne en vigueur et oppose La Malle cléricale au Journal du commerce de gauche185. La
discorde entre les deux périodiques est ancienne, mais prend alors une tournure inattendue,
puisqu’une manifestation contre un journaliste de La Malle aboutit à six morts et trente-quatre
blessés, faisant de cet épisode un symbole de la crise politique que traversent les colonies, et un
épisode inédit dans l’histoire de la presse coloniale.
180 Catherine Bertho, « Télégraphes et téléphones », Culture technique, mars 1982, n° 7, p. 243-249. Voir aussi plus largement Bruno Marnot, La Mondialisation au XIXe siècle (1850 – 1914), Paris, Armand Colin, 2012. 181 « La presse coloniale », L’Indépendant de Constantine, 3 avril 1863. 182 Michel Panoff, art. cit., p. 16. 183 Karine Técher et Mario Serviable, Histoire de la Presse à la Réunion, Sainte-Clotilde (La Réunion), Ars terres créoles, 1991, p. 35-37. On peut consulter aussi à ce propos l’article ancien d’André Masson, « L’opinion française et les problèmes coloniaux à la fin du Second Empire », Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 49, n° 176-177, 1962, p. 366-467. 184 Voir Jacques-W. Binoche-Guedra, « La Représentation parlementaire coloniale (1871-1940) », Revue historique, t. 280, fascicule 2, octobre-décembre 1988, p. 521-535. URL : http://www.jstor.org/stable/40954790. Consulté le 28 mars 2017. 185 Appelé également, sous une forme abrégée, Le Commerce.
69
2 Auteurs et signatures
Roland Lebel dans son Histoire de la littérature coloniale établit une distinction sur
laquelle nous pouvons nous appuyer pour définir les contours de nos journalistes et leur
inscription dans le champ social colonial. Il différencie ainsi trois périodes et donc trois types
d’auteurs : d’abord la « littérature de découverte », puis la « littérature technique et
documentaire », et enfin la « littérature touristique et littérature d’imagination186 ». Or il
apparaît que ces trois types de littérature se mêlent dès les débuts des périodiques coloniaux nés
au XIXe siècle : les biographies des auteurs vont en ce sens, qui révèlent des magistrats, des
militaires, des savants et des hommes de lettres investissant les différentes sections du journal
colonial. « Présentes dans les textes, les représentations collectives se traduisent aussi par des
pratiques matérielles et des stratégies qui ont une épaisseur sociale187 », écrit encore le
spécialiste de la littérature coloniale. L’épaisseur sociale se perçoit en effet dans les deux pôles
de la communication médiatique que sont les journalistes et leurs lecteurs. Ceux que l’on
qualifie de « journalistes » par facilité sont bien, davantage encore que les représentants de la
culture coloniale (expression problématique, vaste, et qui impliquerait en effet une étude
globale de la colonie), des écrivains en régime médiatique, dont la biographie peut éclairer
certains traits d’écriture. Leurs parcours, leurs postures, leurs publications ou leurs occupations
éclairent la place que tient le journal au sein de la société coloniale : plus encore que des
« journalistes » sans doute, ils sont des publicistes, des hommes de lettre, des plumitifs.
2.1 Signatures et collaborateurs : profils de journalistes
Le « journaliste » est au XIXe siècle un personnage marquant : il n’est que de voir les
pages que Jules Janin lui consacre dans Les Français peints par eux-mêmes, ou le succès des
Illusions perdues de Balzac pour avoir un aperçu de sa fortune en tant que personnage et
écrivain. Mais ce journaliste est parisien, ou au mieux provincial ; que dire alors du journaliste
colonial188 ? On peut s’en faire l’idée d’un homme de peu de qualités, réduit à écrire dans la
186 Roland Lebel, Histoire de la littérature coloniale, Paris, Larose, 1931, p.76. 187 Emmanuelle Sibeud, « Introduction », dans Cultures d’empires. Échanges et affrontements culturels en situation coloniale, Romain Bertrand, Hélène Blais et Emmanuelle Sibeud (dir.), Paris, Karthala, 2015, p. 10. 188 Voir par exemple l’introduction de Marc Martin sur le type du journaliste, La Presse régionale : des affiches aux grands quotidiens, Paris, Fayard, 2002.
70
presse coloniale par manque d’ambitions ou de talents, tant l’idéologie coloniale valorise plutôt
les hommes dits d’action, le soldat, le laboureur ou le commerçant. Oissilia Saaïdia et Laurick
Zerbini, en étudiant le discours colonial et ceux qui le produisent, isolent ainsi les
journalistes de trois autres catégories d’auteurs : les spécialistes, les spécialistes linguae et enfin
les historiens de l’art : « à ces trois catégories, qui cohabitent encore aujourd’hui, se sont greffés
d’autres spécialistes autoproclamés d’une autre nature qui occupent aussi le terrain : les
journalistes189 ». Ils sont donc partie prenante de la colonisation, et sont eux aussi déterminés
par les conditions dans lesquelles ils écrivent : le territoire et l’époque. « Autoproclamés »,
enfin, est le terme qui leur convient en effet : c’est pour cette raison qu’ils nous intéressent
également, parce qu’ils affirment dans leurs textes un rapport étroit à la terre coloniale et à
l’identité qui doit en émaner.
Signer par périphrase : cristallisation de certains enjeux de la presse coloniale Les signatures périphrastiques sont révélatrices d’un statut social, d’un rôle colonial.
Elles sont légion dans cette presse qui concerne un monde restreint, dans lequel les questions
de réputation sont au premier plan : c’est par sa place au sein de la communauté que l’on peut
se définir en tant que colonial. Un même individu peut faire évoluer ses signatures pour marquer
son appartenance au monde colonial, suivant en cela la conquête et l’installation : c’est
particulièrement palpable dans le cas algérien, où la volonté d’appropriation du territoire est
fortement symbolique. Le docteur Bodichon est un cas exemplaire de ces variations. Médecin,
auteur d’ouvrages tel qu’une Hygiène à suivre en Algérie, acclimatement des Européens190 et
de Considérations sur l’Algérie191, c’est une célébrité locale dans les années 1840, un de ces
hommes qui participent à la formation d’une vie coloniale, comme en témoigne cet extrait de
La France algérienne, où Bodichon est traité sur le mode de l’ironie : « en ce moment la
merveille, le héros, le lion, le "digito monstratus", le "dictus hic est" est un Européen, un
D.M.P., c’est M. Bodichon192 ». Pourtant, et malgré ces apparences légères, il est décrit dans
plusieurs ouvrages récents comme un partisan de l’extermination des indigènes : c’est dire si
l’homme prête à la controverse, et si sa manière d’écrire dans la presse coloniale peut enrichir
son portrait193. Or que lit-on dans sa manière de signer les articles qu’il donne à la presse ? Celui
189 Oissilia Saaïdia et Laurick Zerbini, op. cit., p. 11. 190 Bodichon, Hygiène à suivre en Algérie, acclimatement des Européens, Rey, Delavigne et Cie, 1851. 191 Eugène Bodichon, Considérations sur l’Algérie, Paris, Comptoir central de la librairie, 1845. 192 Ed. Bourgogne, « Lettre d’un Parisien à un Parisien », La France algérienne, 1er novembre 1845. 193 Patricia M. E. Lorcin, Kabyles, arabes, français : identités coloniales, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2005, p. 108 ; Benjamin Brower, « Les Violences de la conquête », dans Histoire de l’Algérie à la période coloniale, 1830-1962, Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Paris, La Découverte, [2012], 2014, p.61.
71
qui est présenté sur la page de garde de ses Considérations comme « Docteur-médecin, à
Alger », a commencé par signer sa collaboration à L’Akhbar, en 1839, par les termes
suivants : « Eugène BODICHON (de Nantes), Docteur-médecin à Alger », dans un article du
13 décembre 1839 ; mais il signera ensuite comme « Bodichon, docteur en médecine », et finit
enfin par la signature qui est celle de ses Considérations : « Docteur-médecin, à Alger194 ».
Nantes disparaît donc au profit d’Alger, et Bodichon se présente de plus en plus comme un
connaisseur de l’Algérie, signe d’une familiarisation affichée avec le territoire colonisé. Son
projet colonial, sa violence extrême sont loin d’être affichés par ses signatures : mais on y lit
pourtant les prémisses d’une telle pensée, au sens où sa prétention à l’expertise augmente
d’article en article. L’obsession hygiéniste, la scientificité affichée, l’origine géographique
affirmée font de Bodichon, par le jeu de ses signatures, un parangon du cadre de la colonisation ;
or les années 1840 sont celles des combats contre Abd el-Kader, et d’une maîtrise du territoire
qui se fait dans des violences extrêmes : Bodichon participe de ce cadre intellectuel. Dans la
même perspective, Eusèbe de Salles, romancier de la conquête d’Alger, joue de la même
inscription dans la société coloniale. Après une expérience déplorable comme interprète en
1830, il retourne en Algérie en 1843, car il y a hérité d’une ferme : dans les listes de passagers
arrivés de France du Moniteur algérien, l’on trouve le 30 juillet 1843 un « Eusèbe de Salle,
professeur de langue orientale » ; le 13 août, la liste des départs permet de voir un « Salles,
propriétaire », et pendant cet été algérien il a publié quelques textes. D’autres paraîtront à
l’automne, après son départ ; après deux textes signés seulement de son nom, on ajoute
« propriétaire à Bir mourad raïs » en octobre 1843 : la recherche d’une légitimité passe par le
statut de propriétaire195.
Une connivence peut se développer selon d’autres modèles, qui font davantage
intervenir le lectorat métropolitain : ainsi, dans les « nouvelles locales » du Messager de Tahiti,
une lettre apparaît, signée par celui qui se présente dans le texte introducteur comme un abonné
mais revendique en tant que scripteur le statut de « pionnier de la civilisation196 ». Un autre, se
faisant fort d’exprimer un point de vue général et éclairé sur la colonisation de l’Algérie, signe
« Un vieux voyageur197 » alors que la France est encore dans une phase de conquête : le
spécialiste n’est alors que celui qui peut se prévaloir de l’expérience de multiples territoires. Un
194 Eugène Bodichon (de Nantes), docteur-médecin à Alger, « Explications de quelques points de la mythologie qui ont trait à l’Afrique septentrionale », L’Akhbar, 13 décembre 1839 ; puis Bodichon, docteur-médecin, « Rapports et rapprochements entre la composition physique du sol et les hommes de l’Afrique », L’Akhbar, 18 septembre 1840. 195 Eusèbe de Salles, propriétaire à Bir mourad raïs, « Pérégrinations dans le Sahel », Le Moniteur algérien, 24 octobre 1843. 196 Le Messager de Tahiti, 3 novembre 1861. 197 Le Moniteur algérien, 5 juillet 1845.
72
« touriste » signe un article portant sur des « souvenirs de voyage. Une visite au Creusot198 »
dès 1841 dans Le Créole de l’île Bourbon ; dans le Moniteur algérien, c’est ainsi une
« Excursion sur la côte ouest » qui est signée « Un autre touriste199 ». Le terme de « touriste »
est en vogue dans la presse coloniale des années 1840, dans les titres et au fil des textes ; il se
perd ensuite et n’apparaît presque plus dans notre corpus. Il semble donc que le touriste soit la
signature en vogue des années 1840 : influence des Mémoires d’un touriste de Stendhal,
derniers feux des jeunes anglais du XVIIIe siècle200 ? Les signatures font apparaître, en tout cas,
cette attirance pour la figure du voyageur dans les colonies ; plus tard dans le siècle, quand les
coloniaux auront encore affirmé leur emprise sur le territoire et leurs connaissances, le touriste
sera le grand modèle contre lequel se construira la littérature coloniale.
D’autres manières permettent de revendiquer une « colonialité » dans les signatures de
la presse, une appartenance à la société coloniale autant qu’au territoire colonisé. L’un de ces
moyens par lequel apparaissent les coloniaux au sein de leur propre presse se révèle par exemple
dans le nombre d’« abonnés » qui interviennent, signant des lettres – de réclamations, de
propositions de nouvelles techniques agricoles, de demandes d’explications. L’abonné est celui
qui envoie un courrier parfois suffisamment développé pour avoir une vraie valeur politique : la
presse du début de notre corpus, celle des années 1830, présente ainsi plusieurs lettres
d’abonnés portant sur les cultures, les décisions politiques, le régime colonial. Mais cette
signature évolue, et finit par apparaître à la fin d’articles plus inattendues : l’abonné devient une
posture littéraire, et plus seulement une réalité médiatique. Sa signature apparaît au bas des
chroniques théâtrales dans Le Moniteur de l’île de La Réunion (en 1856 particulièrement), des
poèmes dans le journal Les Antilles en 1872 et 1873 ou d’autres textes encore, sous la rubrique
variétés201. Un « abonné » est même l’auteur d’une revue de presse illustrée, dans La Semaine
illustrée réunionnaise : une brève « correspondance » adressée à l’éditeur du journal propose
une esquisse, publiée juste en dessous202. Dans la même perspective, l’article intitulé « le
198 Un touriste, « Souvenirs de voyage. Une visite au Creusot », Le Créole de l’île Bourbon, 25 juillet 1841. 199 Un autre touriste, « Excursion sur la côte ouest », Le Moniteur algérien, 10 mars 1844. 200 Voir par exemple Valérie Berty, Un Essai de typologie narrative des récits de voyage français au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2001, p.53 : le mot « touriste » naîtrait dans les années 1800, repris de l’anglais « tourist ». Il est confirmé en 1816 dans le Voyage d’un Français en Angleterre de Louis Simond ; « ensuite, ce terme est utilisé de manière très sporadique jusqu’à la parution, en 1838, des Mémoires d’un touriste de Stendhal. Selon les commentateurs, il est l’un des premiers voyageurs à donner à ce mot droit de cité dans la langue française. Le lexicologue Boiste, dans la troisième édition de son dictionnaire parue en 1839, écrit que le mot touriste ʺs’est répandu en français avec Stendhalʺ ». 201 Un abonné, « Aux cultivateurs de la Martinique », Les Antilles, 10 avril 1872 ; puis 11 janvier et 16 juillet 1873. 202 Un abonné, « Correspondance », La Semaine illustrée, 6 février 1862. Un poème, publié le 13 mars, et signé encore par « un abonné », est peut-être du même auteur anonyme : le texte porte sur cette même querelle entre périodiques réunionnais.
73
journal des colonies » dans le journal Les Antilles est une fiction que la rédaction introduit dans
les termes suivants, en note de bas de page après le titre :
Nous prions la main inconnue qui nous adresse ce très spirituel article, qui est en même temps une étude pleine d’observations fines et variées, de vouloir bien songer à nous le plus souvent qu’elle pourra. Une telle collaboration est une fortune pour un journal203.
Ce type de signature quelque peu paradoxale – se qualifier d’abonné au moment où l’on
écrit plus qu’on ne lit – n’est pas très répandu avant les années 1860 ; il semble se renforcer
dans les années 1870, comme l’indice d’un changement dans la presse coloniale et dans son
écriture. L’abonné se transforme en un chroniqueur spirituel, proche de la vie coloniale, puisque
sa caractéristique première est d’en être un acteur. En deuxième page d’un numéro de L’Avenir,
périodique guadeloupéen, un article intitulé « Quousque tandem, Catilina », et signé par « un
abonné » commence ainsi par une scène coloniale :
… J’étais embourbé dans le morne de Cadou avec un compagnon grandfonnier quand je m’exclamais ainsi : - Eh ! vous aurez beau jurer en anglais, ça ne nous tirera pas de là, riposta mon ami. – Je m’emporte un peu contre le directeur des ponts et chaussées, lui dis-je. – Qu’il vous entende alors ce M. Catilina : c’est un nouveau directeur, n’est-ce pas204 ?
La précision locale et la portée comique de ce début de texte vont de pair : ils signent
une double appartenance, au monde colonial et au monde lettré. L’abonné serait-il alors une
sorte d’auteur « précolonial », la meilleure manifestation d’une culture coloniale s’exprimant
dans les colonnes des périodiques ? L’hypothèse n’est pas aberrante : on a vu que l’abonné peut
devenir un collaborateur ; que ce véritable « titre » colonial autorise et révèle une forme
d’écriture très locale, suffisamment libre pour décrire la vie coloniale avec précision (puisque
l’abonné n’est pas tenu aux mêmes exigences que le collaborateur régulier).
Le colon, l’interprète : silhouettes de la société coloniale et auteurs médiatiques
Outre les « abonnés » devenant auteurs le temps d’un – ou plusieurs – numéro, la presse
coloniale laisse passer des signatures influencées par le contexte, faisant apparaître ainsi un
dégradé des nuances idéologiques de la situation coloniale. Certaines signatures entraînent des
réponses et digressions : ainsi de La Tribune algérienne qui se moque d’un collaborateur de la
Zéramna qui a signé « Un colon de Rouffach ».
203 Un abonné, « Le journal des colonies », Les Antilles, 17 septembre 1864. 204 Un abonné, « Quousque tandem, Catilina », L’Avenir,1er septembre 1865.
74
Ce colon, nous allons vous le présenter de telle sorte qu’un abonné du journal des abrutis de Constantine ne saurait manquer de le reconnaître.
Ce colon, voulez-vous que nous l’appelions Gribouille ? Oui, vous le voulez bien, et nous allons le faire.
Or, Gribouille est un colon comme on en voit peu. Toujours de noir habillé, cravaté de blanc, ganté de violet, il est porteur d’une barbe agréablement grisonnante, et d’une tête majestueusement somnolente dont il croit l’effet irrésistible. […] Vous le savez, il y a des gens qui se disent espagnols et qui ne sont pas espagnols, de même certains se disent colons qui ne sauraient pas distinguer un plant de tabac, parce qu’ils n’ont jamais contemplé cette solanée que sous forme de cigarette. Gribouille appartient à cette sorte de colons en chambre. S’il ne manie pas la charrue, il a autrefois manié les ciseaux et la plume et il lui en reste quelque chose, puisqu’au mépris de ses graves fonctions, il vient de reprendre celle-ci sous la modeste signature d’un colon de Rouffach205.
Ce portrait du faux colon fait fonctionner des ressorts qui sont ceux de la littérature
panoramique : à l’esquisse physique se joignent quelques traits moraux qui constituent le
« colon en chambre », selon les mots de l’auteur ; mais il y a d’autres éléments encore qui font
surgir de ce portrait des clefs pour comprendre comment se développe le portrait du colon. La
référence aux Espagnols, tout d’abord, ancre le propos dans la société plurielle de l’Algérie
française, marquée en effet par la présence de nombreux Espagnols ; l’importance du tabac
marque aussi l’appartenance à un contexte économique précis. Enfin, opposer la charrue aux
ciseaux et à la plume reprend une opposition symbolique et marquante : le colon pris par le
travail physique n’est pas le journaliste, et il y a donc ici usurpation d’identité. La mention de
Gribouille achève enfin de donner à ce portrait sa dimension caricaturale, appuyée sur la
connivence avec le lecteur local.
Autre cas de signatures particulières, et qui construisent des images d’auteurs dont les
éléments rappellent la définition des auteurs coloniaux : les interprètes. On doit ici restreindre
au cas particulier de l’Algérie, car d’interprètes il n’y a que peu de traces dans la presse des
autres territoires coloniaux : soit que la conquête soit achevée depuis longtemps (colonies du
premier empire colonial), soit que les langues locales ne soient pas valorisées ou pas encore
étudiées, peu d’auteurs ressemblent aux interprètes de l’armée d’Algérie. Et, de la même
manière que le « touriste » est une signature plutôt antillaise des décennies 1840-1850, il
apparaît que l’interprète est une signature algérienne qui fait florès dans les années 1870.
Historiquement, le corps des interprètes militaires est extrêmement intéressant, parce qu’il
témoigne d’une forme de rencontre coloniale206. Littérairement, c’est aussi une mine de
205 X.X., « Un colon de Rouffach », La Tribune algérienne, 29 novembre 1879. Rouffach s’appelle aujourd’hui Ibn-Ziad. 206 On peut consulter à ce propos l’ouvrage et les articles d’Alain Messaoudi, plus particulièrement Les Arabisants et la France coloniale. 1780-1930 : savants, conseillers, médiateurs, Lyon, ENS Éditions, 2015.
75
découvertes sur la littérature médiatique coloniale. On peut s’arrêter plus particulièrement sur
le cas d’Arnaud, père de l’écrivain algérianiste Robert Randau (lui aussi interprète) qui publie
textes humoristiques autant que notices savantes dans le cadre du Mobacher, ce périodique
bilingue officiel paru en 1847 pour être lu par les indigènes. Arnaud y est l’auteur de textes
qu’on attendrait d’un interprète : un « Mécanisme de l’Administration française à l’usage des
indigènes musulmans », série d’articles publiés au début de l’année 1878 ; la critique d’un
manuel, sous le titre « Cours pratique de langue arabe à l’usage des lycées, collèges et écoles
de l’Algérie, par Belkassem Ben Sedira, professeur à l’école normale et à la medreça
d’Alger207 » ; un article sur « Les sciences et l’islamisme208 » ; une traduction, « Voyages
extraordinaires et nouvelles agréables par Mohammed Abou Ras ben Ahmed ben Abd El Kader
En Nasri209 »... La liste n’est pas exhaustive. Mais l’interprète n’est pas seulement traducteur :
il publie par exemple un « Colporteur indigène210 » puis « Quelques réflexions d’un âne
algérien211 » dont les titres mêmes signalent assez la direction que prend l’auteur, passant de
sérieux à spirituel. Dans ces variétés, Arnaud met en scène sa connaissance du territoire et de
la population algérienne autant que sa capacité littéraire : adoptant d’abord l’écriture
physiologique, il passe ensuite à la digression spirituelle par le monologue intérieur d’un âne
philosophe212.
Ces publications nous mettent sur la piste d’interprètes construisant leur image d’auteur
comme une forme de transition : leur rôle est important dans la constitution d’une culture
intermédiaire qui va se revendiquer coloniale213. Et cet « agent de renseignement, de science et
207 Arnaud, interprète militaire, « Cours pratique de langue arabe à l’usage des lycées, collèges et écoles de l’Algérie, par Belkassem Ben Sedira, professeur à l’école normale et à la medreça d’Alger », Le Mobacher, 5 janvier 1878. 208 Arnaud, interprète militaire, « Les sciences et l’islamisme », Le Mobacher, 23 juin 1877. 209 Arnaud, interprète militaire, « Voyages extraordinaires et nouvelles agréables par Mohammed Abou Ras ben Ahmed ben Abd El Kader En Nasri », Le Mobacher, 9 août 1879. 210 Arnaud, interprète militaire, « Colporteur indigène », Le Mobacher, 17 février 1877. 211 Arnaud, interprète militaire, « Quelques réflexions d’un âne algérien », Le Mobacher, 19 et 25 mai 1877. 212 L’âne permet une distance ironique par rapport aux éléments du débat colonial, avec toujours en arrière-plan idéologique « l’instruction » des lecteurs indigènes. Ainsi de ce passage : « Les blancs découvrirent un jour que ceux dont l’épiderme était noir, les cheveux crépus, le système pileux peu prononcé, devaient être rangés en dehors de l’humanité. De leur côté, les noirs soutenaient que la bêtise humaine est en raison directe de la longueur des moustaches et de la blancheur de la peau. Mais, moins nombreux que leurs ennemis, ils ne purent assez vigoureusement appuyer leur théorie ; ils eurent le dessous et devinrent une branche importante de commerce. Depuis, certains peuples blancs, craignant à juste titre le retour possible des choses d’ici-bas – cuivis potest accidere quod quicam potest – ont mis terme à ce trafic et ont posé en loi que la race noire a autant d’intelligence que la race blanche. Tout le monde ne s’est pas encore rallié à cette doctrine ; il reste encore pas mal de Musulmans qui ont, jusqu’ici, refusé de rengainer ce vieil aphorisme d’Aristote que les unes naissent pour l’esclavage et les autres pour la domination ». 213 Ruth Amossy, « La double nature de l’image d’auteur », Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 3 | 2009. URL : http://aad.revues.org/662. Consulté le 24 avril 2013.
76
de modernisation214 » qu’est l’interprète selon la formule d’Alain Messaoudi, est aussi un agent
de littérarisation de la colonisation : à ce titre, les textes que produit Arnaud sont un peu à part
– la littérarisation y est poussée à l’extrême – mais reflètent bien des textes multiples, où
l’auteur ne refuse ni la poétisation ni la scientificité apparente. En fait, et plus largement, les
signatures d’abonnés ou d’interprètes sont le signe d’une tentative de la presse coloniale pour
asseoir une forme d’autorité : et pour reprendre les mots de Dominique Maingueneau, si « pour
déterminer qui a le droit d’énoncer, chaque position littéraire définit à sa mesure ce qu’est un
auteur légitime215 », c’est en se fondant sur le statut de ses collaborateurs que la presse coloniale
affiche sa légitimité. En outre, la mention d’un statut – officiel (interprètes), relevant de la
sphère privée (abonné) ou encore d’une histoire commune (un pionnier de la
civilisation) – oriente aussi la lecture de ces signatures vers la pensée d’une scénographie au
sens large : on en déduit une posture d’auteur qui ne se limite pas à sa représentation dans le
texte, mais engage aussi l’image de la vie de l’auteur en-dehors du texte216. D’autres
problématiques, liées toujours à cette recherche de légitimité, apparaissent alors quand la
signature se fait sous pseudonyme.
Le régime du pseudonyme colonial Les journalistes de la presse coloniale, même quand ils signent par leur nom d’état-civil,
ne sont pas facilement étudiables, par manque de traces biographiques. Bien plus compliquée
encore est la situation où ils signent par des pseudonymes – comme cela se fait aussi dans la
presse métropolitaine – : mais dans ce cas, si l’on ne peut remonter jusqu’à l’auteur réel, il reste
le poids symbolique du choix du pseudonyme, qui se combine souvent avec l’éthos présent au
sein des textes. Le pseudonyme est révélateur des écritures coloniales, car il signale soit une
appartenance au territoire, soit une adaptation d’une problématique nationale à l’espace
colonial. Fondoc, pseudonyme d’un auteur antillais qui écrit en créole entre 1850 et 1860, est
un cas exemplaire de ces pseudonymes révélateurs. Comme l’écrit le rédacteur de L’Avenir en
introduction à l’un de ses poèmes, le présentant comme un « vieil ami » : « Fondoc n’est pas
un anonyme, c’est un Pseudonyme connu de tout le monde. Et puis Fondoc ne dit pas de
sottises217 ». En effet, Fondoc soutient dans ce poème en créole le rédacteur M. Vallée : il
214 Alain Messaoudi, « Renseigner, enseigner. Les interprètes militaires et la constitution d’un premier corpus savant "algérien" (1830-1870) », Revue d’histoire du XIXe siècle, 2010, p. 105. 215 Dominique Maingueneau, Le Contexte de l’œuvre littéraire. Énonciation, écrivain, société, Paris, Dunod, 1993, p. 77. 216 « J’ai défini la posture comme la présentation de soi d’un écrivain, tant dans sa gestion du discours que dans ses conduites littéraires publiques », comme l’écrit Jérôme Meizoz. Référence : Jérôme Meizoz, « Ce que l’on fait dire au silence : posture, ethos, image d’auteur », Argumentation et Analyse du discours, 2009, n° 3. URL : http://aad.revues.org/667. Consulté le 17 septembre 2014. 217 L’Avenir, 8 octobre 1869.
77
appartient donc au « parti » libéral de L’Avenir. On trouve sa signature dans L’Avenir et dans
Le Commercial, d’abord en 1856, et ensuite dans les années 1860. Il est critique théâtral avec
un « Portrait de Mme Roche, artiste » dans L’Avenir du 5 avril 1856, il signe la fable politique
en créole « Les deux cafiers » dans le numéro du 6 septembre 1862 du Commercial. Le grand
intérêt de ce pseudonyme, c’est qu’il a en fait surgi dans Le Commercial le 15 mars 1856, pour
un article de critique sur le Théâtre de la Basse-Terre ; et dans le numéro suivant, la pièce
Fondoc et Thérèse de M. Baudot sera critiquée par « Edmée ». On y mentionne Fondoc et
Dakoé, qui sera lui aussi un pseudonyme, ou en tout cas une signature, mais plus isolée218.
Fondoc ne reviendra pas dans les colonnes du Commercial avant le 15 août 1866, pour un récit
de variétés qui le met en position de personnage et non d’auteur : « Fondoc allant toucher un
mandat au trésor ».
La question se pose alors de savoir qui est ce Fondoc, personnage si important du monde
créole que le journal le traite en auteur et en personnage. C’est d’abord un personnage tiré de
la pièce de Paul Baudot, Fondoc et Thérèse, critiquée par « Edmée », comme nous l’avons dit :
cet opéra en un acte, écrit en créole de Guadeloupe, a été créé le 9 mars 1856. Il est probable
que Baudot se soit ensuite servi de Fondoc comme un pseudonyme pour ses activités de
journaliste : ce notaire guadeloupéen, né en 1801 et mort en 1870, a produit plusieurs textes,
notamment sous forme de brochures219 ; et il ne serait pas étonnant qu’il ait alors été un
collaborateur régulier de la presse locale. Le pseudonyme est donc ici témoin d’une certaine
popularité d’un personnage créole : il n’a pas pour fonction de cacher, mais au contraire de
mieux révéler l’identité de l’écrivain. Fondoc a été décrit, en tant que personnage fictionnel,
« sous la figure d’un jeune nègre que la fortune vient de favoriser ; il s’avance habillé en gros
monsieur, mais déjà très gêné des obligations que lui impose sa nouvelle position220 » dans une
anthologie de 1890 ; Armand Corre, l’auteur de cette anthologie, précise encore dans son
analyse d’une fable de Baudot, qu’il « vise très spirituellement un travers qui existe ailleurs
qu’aux colonies, la manie de la particule et la morgue de caste221 ». Si l’on met bout à bout ces
différentes informations, le pseudonyme de Fondoc commence à révéler sa richesse : Baudot
apparaît comme un auteur que l’on pourrait dire engagé, au sens où il n’était « pas très apprécié
218 Dakoé, ou Dakoè, est la signature d’une lettre parue le 11 juillet 1849 dans L’Avenir ; plus précisément encore, il signe « Dakoè, cultivateur ». 219 Marie-Christine Hazael-Massieux, Textes anciens en créole français de la Caraïbe - Histoire et analyse, Paris, Éditions Publibook, 2008, p. 163. On trouve aussi dans Armand Corre, Nos Créoles, Paris, A. Savine, 1890, la mention d’une fable intitulée « Les Animaux nobles (Baudot dit Fondoc, Guadeloupe) » : le pseudonyme semble avéré. 220 Armand Corre, Nos Créoles, Paris, A. Savine, 1890, p. 284. 221 Ibid., p. 266.
78
de l’administration222 ». Ses textes valent pour autant de prises de position, et le fait qu’il les
signe avec un pseudonyme clairement créole oriente la lecture du texte pour ses contemporains
autant que pour les éventuels lecteurs actuels : le nom porte une connivence culturelle forte.
Le pseudonyme colonial peut être aussi une manière de cacher une femme auteure. Ainsi
d’Anne-Caroline-Joséphine Husson, alias Pierre Cœur, que le Courrier d’Oran présente
ainsi dans une rubrique de bibliographie, citant d’abord le journal Le Peuple français :
L’auteur, qui cache un nom féminin sous le pseudonyme de Pierre Cœur, dépeint avec un rare talent dans ce volume la poésie et la mollesse de l’existence contemplative des Orientaux, existence qui s’écoule sous un ciel étoilé au milieu des nuits pleines du parfum des orangers, ou sous les purs rayons d’un soleil paradiséen que tempèrent les tièdes haleines des brises du soir. (Peuple français)
Nos lecteurs se souviennent que Pierre Cœur a bien voulu publier pour eux, dans le Courrier, l’une de ces charmantes nouvelles223.
Le pseudonyme peut enfin être intertextuel, et en appeler à une parenté médiatique plus
qu’à une civilisation coloniale : c’est le cas pour « L’hermite de la Case-Pilote », qui signe deux
articles sur la Martinique dans La France d’Outre-Mer en 1859. La « Case-Pilote » est un
toponyme qui associe à l’auteur un ancrage géographique précis, une commune martiniquaise
située au nord de Fort-de-France ; quant à « l’hermite », il n’est pas sans rappeler Etienne de
Jouy, connu sous le pseudonyme de « L’Hermitte de la Chaussée d’Antin224 ». Cet observateur
des mœurs parisiennes a publié dans La Gazette de France des articles que son disciple de la
Case-Pilote a pu lire : l’auteur martiniquais aurait alors réutilisé des éléments de la posture de
Jouy pour s’affirmer auteur. L’« hermite » martiniquais observe son entourage et en rend
compte dans des anecdotes à la première personne ; mais là ne se limitent pas ses talents. Dans
Le Propagateur, l’on trouve ainsi plusieurs poèmes signés « L’hermite » – probablement celui
de la Case-Pilote. Il fait paraître en feuilleton, le 19 mars 1862, « La Vieille et la jeune
Martinique. Dialogue » puis « Les serments d’autrefois. Légende coloniale » ; le 10 mai 1862,
en troisième page, se succèdent les poèmes « La prière », « L’honnête homme » et la saynète
« La rencontre imprévue de trois vieux colons » ; le 14 juin, « La circulation arrêtée »… La
liste n’est pas exhaustive, mais il apparaît que cet auteur prolifique comble les pages du
périodique par des textes affichant par la forme versifiée leur littérarité, par le fond leur
appartenance au monde colonial et à la description de ses mœurs. Dernier argument enfin en
faveur de cette intertextualité du pseudonyme : l’hermite signe le 30 août 1862 « le Jérôme
222 Marie-Christine Hazael-Massieux, op. cit., p. 262. 223 A.D., « Bibliographie », Le Courrier d’Oran, 13 décembre 1869. 224 Voir à ce propos Marie-Ève Thérenty, Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (1829-1836), Paris, Champion, 2003, p. 238-239 notamment.
79
Paturot de la Martinique », toujours dans Le Propagateur. La référence au texte de Louis
Reybaud confirme le réseau littéraire dans lequel s’insère le journaliste colonial à vocation
littéraire. Étienne de Jouy avait conditionné les changements de la chronique ; le journaliste
martiniquais anonyme adapte cette formule à son cadre ultramarin225.
Écritures indigènes : une absence remarquable226 ?
Mais qu’en est-il alors des écritures indigènes, et de la place qui leur est laissée dans ces
publications idéologiquement très marquées que sont les périodiques coloniaux ? Le code de
l’indigénat date de 1881, mais le terme d’indigène est attesté en contexte colonial bien avant ;
c’est lui que nous reprendrons dans ce développement pour plus de lisibilité dans notre propos.
En 1974, après les décolonisations, Louis-Jean Calvet évoque la définition que le Robert donne
de la colonisation et en tire la conclusion suivante : « cet article présente une absence
remarquable : celle du colonisé. Les colonies seraient donc des pays vides227 ». Cette image
serait nécessaire pour justifier la colonisation : il reste à vérifier si elle est en vigueur dans les
textes médiatiques. La question se pose de savoir si des journalistes indigènes, issus des
populations colonisées, ont pu émerger des périodiques coloniaux : les rédacteurs se sont-ils
appuyés sur des intellectuels locaux et francophones – les interprètes ne formant pas l’essentiel
des journalistes coloniaux – pour remplir leurs colonnes d’une prose qui ne soit pas que
française ? C’est un fonctionnement qui a pu être observé dans l’empire anglais, en Inde
particulièrement228. Il y a bien la publication du Mobacher, que nous avons déjà évoqué ; mais
l’impact réel du journal est difficile à déterminer – Le Chitann le moque justement pour son
manque de lecteurs. Zahir Ihaddaden estime cependant qu’il produisait une forte impression sur
les indigènes en tant que journal d’information tout autant que de culture, ayant ouvert ses
colonnes aux « intellectuels indigènes229 » pour sa partie arabe. Des tentatives semblables
s’observent à Tahiti, avec le Te Vea No Tahiti qui finit par se fondre dans Le Messager de
Tahiti, et en Cochinchine avec Gia Dinh Bao. L’on trouvera d’autres expériences linguistiques
liées à la presse, au fil du siècle :
225 Signer un texte comme un « hermite » semble bien être un moyen récurrent de contourner la question de l’identité : le 19 août 1860, dans Le Messager de Tahiti, l’on trouve un poème signé « l’hermite du lac » et qui porte sur la fête de l’Empereur ; dans le numéro suivant, il signe également une pièce lyrique intitulée « Rosa (souvenir) ». 226 Certaines parties de ce développement ont été remaniées à partir d’un article paru en anglais dans la revue Literary Journalism Studies. URL : http://ialjs.org/wp-content/uploads/2017/03/09-Demougin-Indiginous_90-101.pdf. Consulté le 1er juillet 2017. 227 Louis-Jean Calvet, Linguistique et colonialisme, Paris, Payot, 1974, p. 12. 228 Voir Julie F. Codell, « The Empire Writes Back : Native Informant Discourse in the Victorian Press », Imperial Co-Histories. National Identities and the British and Colonial Press, Julie F. Codell (dir.), Madison, Fairleigh Dickinson Univ Press, 2003, p. 188-218. 229 Zahir Ihaddaden, La Presse musulmane algérienne de 1830 à 1930, Alger, ENAL, 1986, p. 38-39.
80
Arthur de Fonvielle, toujours audacieux dans ses entreprises, désirait en 1877 donner un supplément en langue arabe à son journal Le Progrès de l'Est. Ayant convaincu ses coactionnaires, il ne lui restait plus qu'à défendre son point de vue auprès des autorités. Si le hardi journaliste s'attendait à des encouragements, il fut déçu, son initiative ayant été jugée inopportune par Chanzy. Trois ans plus tard, un officier de zouaves, qui avait été attaché au Gouvernement Général créa à peu près dans le même esprit L'Astre d'Orient. [...] Ayant des rédacteurs français et arabes, cet hebdomadaire du jeudi était imprimé et plié de telle façon, qu'il était susceptible d'être présenté sur une face entièrement comme un journal français ou sur l'autre entièrement comme un journal arabe. L'idée était ingénieuse mais elle se révèla peu commerciale et une faillite liquida cette expérience en 1883230.
Mais ces titres n’étant pas francophones ne répondent pas à notre projet – outre le fait
qu’ils nous sont, par leurs langues respectives, inaccessibles. Une fois ces journaux mis de côté,
la réponse, a priori, est plutôt négative en ce qui concerne des auteurs indigènes dans la presse
coloniale francophone. Mais c’est en partant de cette supposée absence que l’on peut amorcer
une réflexion sur ce que veut dire la prise de parole de l’indigène dans la presse coloniale, même
si elle est rare. Commençons par le cas algérien : les journaux n’y laissent pas la parole aux
autochtones, pour des raisons autant politiques et sociales que pratiques – les périodiques sont
en français, et il faudra attendre que le français soit répandu ou l’arabe reconnu pour qu’une
vraie prise de parole indigène émerge dans la presse : ce sera alors l’époque de la presse dite
« indigène » qu’étudie Zahir Ihaddaden231. En outre, la presse fait partie de la structure
coloniale, et il paraît donc peu probable que le point de vue de l’indigène puisse y être exprimé
ou pris en compte, puisqu’il n’est pas considéré comme un citoyen mais comme un sujet232.
Mais sans qu’il y ait forcément expression d’un point de vue, l’on peut se demander quels textes
sont signés par des indigènes. Quelques titres laissent à penser que l’on peut trouver une parole
indigène libre : ainsi de la piste d’une « chronique arabe » qui paraît dans La France algérienne
à partir du 4 avril 1846. Mais cette chronique n’est pas ce à quoi l’on pouvait s’attendre : elle
ne laisse pas la parole à un auteur arabe, se contentant de publier
tous les renseignements qu’il nous sera possible de recueillir sur la vie intérieure de nos tribus, sur leurs habitudes commerciales et agricoles, sur leurs rapports de bon ou mauvais voisinage, enfin sur les
230 Georgette Sers-Gal, « La Presse algérienne de 1870 à 1900 », La Revue africaine, 1959, p. 109. 231 Zahir Ihaddaden, op. cit. On y lit, en p. 8 : « La période de 1852 à 1881 qui est assez importante parce qu’elle renferme des événements déterminants ne livrera jamais la face cachée de ces événements parce que les "indigènes" de cette période n’ont laissé aucun témoignage écrit ». 232 Voir notamment les travaux de Laure Blévis : « La Citoyenneté française au miroir de la colonisation », Genèses, 2003, n° 4, p. 25-47 ; « Les Avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes d'une catégorisation », Droit et société, 2001, n° 2, p. 557-581 ; « Quelle citoyenneté pour les Algériens ? », Histoire de l’Algérie à la période coloniale, Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Paris, La Découverte, [2012], 2014, p. 352-358.
81
innombrables détails de leur politique locale, si ardente, si mobile et si peu soupçonnée, particulièrement en France233.
La chronique place donc la population colonisée sur le plan d’un objet d’étude, et
l’espoir d’une prise de parole indigène est déçu. Mais une autre « chronique » révèle, quelques
années plus tard, et dans un autre périodique à l’ancrage plus local, cette prise de parole que
l’on peut attendre : en août 1851, trois « chroniques indigènes » paraissent dans l’Akhbar,
d’abord dans les variétés, puis complétées par deux feuilletons et signées par Ismael ben
Mohammed Khodja234. Les textes sont présentés dans une note comme « diverses
communications qui nous sont faites par un musulman de cette ville235 » ; si le premier texte
met en mots les bonnes relations entre Français et indigènes, l’auteur interroge ensuite le
fonctionnement de la colonie française en affirmant cette identité indigène. On trouve ainsi ce
passage, en début de chronique :
Il y a environ trois ans, on écrivait partout à Alger, au-dessus des portes des maisons du beylik, une courte inscription, toujours la même. J’ai prié un Français de me l’expliquer ; et je crois la comprendre à peu près, sauf le deuxième mot sur lequel je crains de m’être mépris. Car, enfin, ces inscriptions, sur lesquelles on lit Egalité, entre Liberté et Fraternité, - sont, les unes peintes en détrempe noire et les autres gravées en lettres d’or sur des tablettes de marbre. […]
Mais passons du signe à la chose signifiée ; vous défendez d’inhumer nos morts dans le cimetière de Sidi Abd-er-Rahman-el-Tsaalebi, parce que, d’après vos lois, on ne doit pas enterrer dans l’intérieur des villes. Et cependant vous permettez d’y déposer un membre de la famille de Moustafa pacha, un parent de Ben-Mrabet et tout récemment le Bey Ahmed ; les pauvres seuls en sont sévèrement exclus. […] Est-ce que vos notions transcendantes et étendues sur toutes les sciences vous auraient fait reconnaître que les émanations du cadavre d’un indigent sont plus dangereuses que les autres pour la santé publique236 ?
La posture ironique de l’ignorant est ici utilisée pour montrer les erreurs de la
colonisation et la trahison de la maxime républicaine ; elle est l’amorce d’un discours à la
rhétorique affirmée et dont l’argumentation structurée fait la force. Cette utilisation d’une
posture rhétorique accusatrice s’explique par la ligne de L’Akbhar, alors journal concurrent du
Moniteur algérien officiel, et qui peut se permettre des audaces que le gouvernement n’ose pas,
précisément pour commenter des positions officielles. Las, après trois chroniques, deux
feuilletons sont nécessaires pour développer certains des thèmes qui auraient dû être abordés
233 La France algérienne, 4 avril 1846. 234 Ce nom n’a abouti dans aucune de nos recherches à une biographie, et l’auteur n’est pas particulièrement présenté dans le cadre du journal. « Khodja » est sans doute, non un patronyme, mais la fonction occupée par l’auteur, qui serait alors un imam ou un muezzin. 235 Ismael ben Mohammed Khodja, « Chronique indigène », L’Akhbar, 21 août 1851. 236 Ismael ben Mohammed Khodja, « Chronique indigène », L’Akhbar, 16 septembre 1851.
82
dans la chronique ; et ce bouleversement permet à Chandellier, rédacteur du journal, de
reprendre la parole avec le titre « un coup d’épaule » pour indiquer que
l’auteur de la Chronique indigène de ce journal ignore ou dédaigne nos habitudes littéraires : il ne s’occupe pas le moins du monde de conserver les proportions convenables entre une narration incidente et le sujet principal237.
La parole indigène est donc, finalement, commentée pour la forme et non pour le fond :
elle est traitée comme réfractaire à l’ordre littéraire, à l’organisation – donc à l’ordre colonial.
La violence du « coup d’épaule » montre aussi que c’est le paradigme de la violence qui permet
de réprimander le rebelle à l’ordre médiatique : la prise de parole n’a donc été que momentanée,
avant une reprise du discours d’escorte au premier plan. L’Akbhar n’a donc pas tenu ses
promesses plus libérales que la presse officielle.
Les années de conquête ont pu être l’occasion d’une prise de parole minimale des
indigènes ; mais dans les années 1860, la cause semble entendue, et la presse ne tente plus de
faire entendre une autre voix que celle des colonisateurs déjà installés. Pourtant, une autre prise
de parole indigène se trouve dans un numéro du 4 décembre 1868 de L’Est algérien, dans lequel
l’œil est attiré, dès la première page, par un titre inhabituel. On remarque en effet un
« Monologue du dernier des Arabes » sur une colonne, texte dont la structure immédiate
apparaît hachée, marquée par de nombreux retours à la ligne. Dans ce texte dont le titre et la
teneur semblent indiquer un hapax au sein des journaux coloniaux, on peut cependant trouver
dès le titre une référence au texte Les Aventures du dernier Abencérage de Chateaubriand ou
au Dernier des Mohicans de Fenimore Cooper : une posture romantique est adoptée ici, qui
mise sur l’individu pour faire valoir tout un peuple238. L’article, non signé, si ce n’est par un
énigmatique tiret, laisse donc se développer une litanie remarquable par sa force, à en juger par
les premières lignes :
…Voilà les ossements épars des derniers musulmans ! « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. » Et ne pas pouvoir mourir comme eux… La mort, c'est la fortune des vaincus. Ô race disparue, tribu éteinte, braves fils de l'Islam que la misère a fauchés, que Dieu vous prenne en miséricorde239 !
237 Chandellier, « Un coup d’épaule ! », L’Akhbar, 5 octobre 1851. 238 Les Aventures du dernier Abencérage paraît en 1826, tout comme Le Dernier des Mohicans de Fenimore Cooper, qui est lu et commenté par George Sand dans Le Journal pour tous en 1856, trente ans après sa parution. George Sand signe aussi (mais le texte s’avère être de Félicien Mallefille) dans le périodique L’Artiste une nouvelle, Le Dernier sauvage, qui met en scène, à l’île Maurice, la fin d’une civilisation précoloniale à travers le personnage d’un vieux guerrier. Dans la presse coloniale elle-même, on peut noter l’article « Le dernier des barbaresques », qu’Adrien Berbrugger fait paraître le 4 janvier 1852 dans L’Akhbar : la colonisation produit ce genre de textes fascinés par la fin des civilisations. 239 « Monologue du dernier des arabes », L’Est algérien, 4 décembre 1868.
83
Dans une esthétique du discours interrompu qui évoque les paroles d’un mourant, le
texte développe un rappel de l’arrivée des Français : c’est bien la voix d’un indigène qui est
censée émaner de ce texte, voix qui se signalera dans les lignes suivantes par un « nous », par
des apostrophes travaillées, par une dégradation aussi des expressions employées pour se
désigner. Le « goum de cavaliers » devient ainsi les « tribus effarées240 », les « bandes
affamées » ; les Ouled-Sliman, nom mentionné au début du texte, sont montrés dans leur déclin.
Le texte confronte également une image positive du peuple colonisé à une image très négative
des colonisateurs : les « chrétiens » sont ainsi mentionnés pour « la ruse et la dépravation de
leur race241 ». La colonisation est ensuite décrite en quelques mots : l’ébauche de description
des gens de loi est renforcée par un rythme ternaire montrant qu’ils ne connaissent ni « [leurs]
mœurs, ni [leur] religion, ni [leur] langue » et évoque aussi les « prisons sans soleil » dans
lesquelles est jeté le peuple colonisé. L’axiologie inversée qu’on trouve ici par rapport au
discours attendu est supportée par une rhétorique forte qui légitime la dénonciation et lui donne
une crédibilité pour le lecteur, comme dans la chronique indigène que nous avons citée
précédemment : reste alors la question de l’intention cachée derrière ce texte. Pourquoi le faire
paraître en première page ? Sur ce point nous en restons au stade des hypothèses : critique de
la colonisation, combat pour une prise en compte de la culture arabe, provocation ? Il apparaît
peu probable que ce texte ait été écrit véritablement par un indigène, pour des raisons pratiques
autant que symboliques. Le texte aurait alors été signé, et sans doute le style n’en aurait pas été
si romantique : il s’agit ici, probablement, d’un exercice littéraire signé par un des
collaborateurs de ce journal, dans une visée libérale. Cet article est publié dans les premiers
numéros du journal : parions qu’il s’agit de frapper fort, de marquer un lectorat qui a déjà des
périodiques à sa disposition, et d’orienter clairement la politique éditoriale de ce nouveau venu
dans le monde des « luttes de la grande presse algérienne242 » auquel il ne veut pas rester
étranger. La voix de l’indigène représente donc, ici aussi, un enjeu politique fort qui concerne
avant tout la ligne éditoriale d’un journal et l’image qu’il veut donner de sa position dans la vie
coloniale.
240 De manière étonnante, la même expression apparaît dans Tartarin de Tarascon (op. cit., p. 223-224): « Puis, tout autour, des plaines en friche, de l’herbe brûlée, des buissons chauves, des maquis de cactus et de lentisques, le grenier de la France !… Grenier vide de grains, hélas ! et riche seulement en chacals et en punaises. Des douars abandonnés, des tribus effarées qui s’en vont sans savoir où, fuyant la faim, et semant des cadavres le long de la route. De loin en loin, un village français, avec des maisons en ruine, des champs sans culture, des sauterelles enragées, qui mangent jusqu’aux rideaux des fenêtres, et tous les colons dans les cafés, en train de boire de l’absinthe en discutant des projets de réforme et de constitution ». 241 Id. 242 Carle, « Aux lecteurs », L’Est algérien, 13 novembre 1868.
84
Quelques textes enfin, pour rester dans le contexte algérien, relèvent du courrier de
lecteurs et font apparaître des signatures indigènes. À ce titre, l’un des textes les plus
intéressants, parce que l’auteur remet en cause une traduction, reste le texte signé « Kodja-ben-
Bougouffa, propriétaire243 », paru dans Le Progrès de l’Est. Le texte commence ainsi :
Lorsque j’ai lu le Mobacher du 12 courant, j’y ai vu une lettre de M. Arnaud interprète militaire à Alger, qui est consacrée à faire l’éloge d’Abd-el-Kadder-el-Medjaoui, et de son livre, que l’on désigne sous la qualification de « livre utile ».
Le texte développe ensuite une analyse des termes arabes employés par l’auteur, dans
une translittération qui prend tout un paragraphe, et dans le but avoué de démontrer que,
contrairement à ce qu’en dit Arnaud, l’ouvrage est bien injurieux et grossier. La lettre se termine
par une demande : il s’agit que l’interprète Arnaud retraduise le passage cité. La signature, parce
qu’elle insiste sur le statut de propriétaire, affirme ici l’identité qui apparaît dans le texte, celle
d’un homme instruit et lettré qui peut concurrencer un interprète officiel dans sa connaissance
de la langue arabe. On ne sait ce qui a été répondu dans les numéros suivants, la collection du
périodique étant trop lacunaire ; mais ce texte met en lumière l’adéquation forte entre les enjeux
de la signature et les enjeux du texte. L’identification de l’auteur est primordiale dans le
contexte médiatique – outre la loi qui oblige les auteurs à signer leurs articles depuis le 16 juillet
1850 – parce qu’elle permet d’orienter immédiatement la lecture du texte. Sur le très vaste
corpus que représente la presse coloniale en Algérie des débuts de la conquête aux années 1880,
les textes signés par des indigènes ou permettant d’entendre leurs voix sont rares, et l’on pouvait
s’y attendre : les exemples que nous avons choisis rendent compte de tendances qui travaillent
ce corpus. La parole du colonisé dans la presse coloniale est en effet à peine audible : quand
cette parole trouve un espace d’expression, il est de manière quasi-systématique repris et
encadré, voire déformé par la parole colonisatrice. Il ne reste ensuite que quelques textes à part,
remarquables précisément parce qu’ils sont autant d’exceptions à cette règle de la société
coloniale – à ce titre, ils cristallisent certains enjeux de cette prise de parole. Et encore peut-on
remarquer que ces textes à la rhétorique soignée, qui expriment des idées fortes, affichent un
style qui emprunte aux canons littéraires français de leur époque, preuve que le colonial ne peut
écouter le colonisé que si celui-ci emprunte son moule discursif.
Dans les autres territoires, il n’y a presque pas d’écritures indigènes, même encadrées.
Parmi les quelques exceptions, cependant, la plus notable serait celle du Courrier de Saïgon.
243 Kodja-ben-Bougouffa, « Correspondance », Le Progrès de l’Est, 22 décembre 1877.
85
Pendant les années où s’établit un protectorat sur le Cambodge, on y lit le texte suivant dans le
supplément :
Nous nous appelons Kmêr comme notre pays. Les Siamois nous connaissent sous le nom de Kam-men, les Annamites sous celui de Kaomen, les Chinois nous désignent par le nom de Tang-po-cha, enfin les Malais par celui de Cambodia ; c’est ce dernier nom qui a prévalu en Europe, puisque vous nous appelez Cambogiens ou Cambodgiens. Je voudrais vous dire notre histoire, mais comment démêler la vérité des mille légendes fabuleuses qui l’enveloppent et la dénaturent depuis des siècles ! Quant aux livres chinois, ils ne sauraient jeter beaucoup de jour dans ces ténèbres, car ils sont, comme nos traditions, tissus de superstitions et de mensonges244.
Or ce texte paraît dans un environnement médiatique qui favorise plutôt les récits
d’exploration et les descriptions à visée ethnographique. Il est évident ici que le texte supporte
une idéologie coloniale précise : on y retrouve l’obsession de l’histoire positiviste européenne,
l’image négative des Chinois contre lesquels les Français ont établi leur colonisation, et, dans
le cours du texte, un exposé ethnographique qui convient tout à fait aux classifications
européennes. L’origine du texte, elle, n’est pas établie ; et d’ailleurs seul le traducteur apparaît,
preuve de la valeur accordée à la voix de départ. Mais il n’en reste pas moins que la survenue
de cette voix peut surprendre, eu égard aux habituels récits d’exploration, et que c’est l’une des
rares manifestations d’une voix qui s’affirme comme n’étant pas colonisatrice.
2.2 « L’écrivain banal245 » et le journal colonial
Les missionnaires tiennent une place importante dans les écritures coloniales, et au sein
de la presse coloniale également : le père Jourdain en Cochinchine, le père Rougeyron en
Nouvelle-Calédonie signent des articles importants dans les premières années de colonisation.
Le père Rougeyron est même qualifié de « classique » dans une étude sur la Nouvelle-
Calédonie, au vu des rééditions modernes de ses œuvres, et au même titre que des auteurs
beaucoup plus récents, comme Jean Mariotti (1901-1975) ou Jean-Marie Tjibaou (1936-
1989)246. Mais les missionnaires représentent une page particulière de l’histoire médiatique des
territoires coloniaux, et ne rendent pas compte de tendances plus profondes que l’on peut
observer par les biographies des publicistes coloniaux : ils sont à part des flux qui font voyager
les hommes de lettres coloniaux. Les journalistes des colonies affichent des biographies qui
dépendent fortement – et forcément – de l’histoire de la conquête française sur le territoire. Pour
244 James (trad.), « Lettres sur le Cambodge », Le Courrier de Saïgon, 5 mars 1865. 245 Expression prise dans l’article « Le journal des colonies », Les Antilles, 17 septembre 1864. 246 François Bogliolo, « Nouvelle-Calédonie, vieille terre d’édition », Mots, n° 53, décembre 1997, p. 109.
86
bien comprendre le fonctionnement des titres coloniaux, il faut se pencher sur la trajectoire de
ces hommes, sur leur appartenance locale, leur éventuelle arrivée, l’ethos qu’ils développent247.
L’on peut commencer par distinguer trois territoires coloniaux particulièrement riches de ce
point de vue : l’Algérie d’abord, avec ses hommes de lettres arrivés de France et occupant le
plus souvent des fonctions officielles ; les hommes de lettres réunionnais ou antillais,
majoritairement créoles issus de vieilles familles coloniales ; enfin, les auteurs qui écrivent dans
la presse néo-calédonienne, emblématiques d’un territoire qui est un point de passage et de
rencontre entre différentes aires culturelles. Les journalistes de Cochinchine, de Guyane
s’ancrent plus difficilement dans cette pensée des trajectoires, par manque de documents les
concernant ou par manque d’écrits propres à la colonie. En ce qui concerne Tahiti, Patrick
O’Reilly est assez catégorique quant à la vie intellectuelle en général sur l’île :
Du côté des belles-lettres et de la littérature, le même vide ; le Tahitien trempe peu sa plume dans l’encre. Personne, localement, ne semble avoir tenu son « journal », courtisé la muse, échangé des correspondances de qualité, philosophé, romancé son existence, essayé de retracer l’histoire de son île248…
La question qui se pose en effet est celle de la qualité des journalistes : sont-ils de
mauvais journalistes métropolitains, exilés dans les colonies par manque de talent, relèvent-ils
de parcours trop individuels pour être significatifs, ou peut-on tirer de leurs parcours une vision
plus nette du monde médiatique colonial ? L’hypothèse qui apparaît la plus certaine est que ces
journalistes coloniaux sont souvent des hommes à double facette : historiens, interprètes,
professeurs, médecins ou planteurs, ils ont une première occupation qui leur permet de
s’exprimer dans la presse avec la légitimité donnée par leur métier initial.
La presse coloniale algérienne : historiens et interprètes, deux images de savants
La place à part de l’Algérie dans la cartographie et dans l’histoire des colonies françaises
ressortit en partie à la particularité des hommes de plume qui prennent en charge les articles de
sa presse. La langue et l’histoire constituent deux points d’achoppement dans le traitement du
territoire colonisé : historiens et interprètes sont deux types d’auteurs que l’on retrouve dans les
journaux, affirmant leur qualité à côté de leur patronyme, et transformant par là l’identité du
texte produit. L’histoire est le premier point sensible d’une écriture médiatique coloniale ; dans
247 Les femmes sont très peu présentes parmi les signatures : Lucie de P. dans Le Propagateur des années 1850, Anna Puéjac dans l’Algérie des années 1860 sont parmi les rares noms qui émergent, mais soit leur biographie est peu connue, soit leurs œuvres sont introuvables. Anna Puéjac par exemple, sage-femme à Montpellier, jouit d’une vraie célébrité à son époque ; elle devient aussi professeur d’accouchement à Alger ; mais le catalogue de la BNF ne conserve aucune de ses œuvres de fiction. On voit pourtant paraître ses œuvres fictionnelles dans des périodiques, mais peut-être n’y a-t-il pas eu de publication en recueil. 248 Patrick O’Reilly, op. cit., p. 210.
87
le journal officiel qu’est le Moniteur algérien, les articles historiques se trouvent le plus souvent
dans les pages deux ou trois, sous la rubrique variétés, dont l’intitulé est suffisamment large
pour se prêter à différents textes ; ils passent quelquefois en feuilleton. Qu’apprend-on des
auteurs de ces articles, par leurs signatures et par la manière dont les textes les présentent ? Ils
occupent une place prépondérante dans l’écriture de la colonie, et sont en fait en nombre
restreint : Henri Feuilleret, Auguste Cherbonneau et Albert Devoulx sont les trois principaux
représentants de plusieurs décennies de publications médiatiques algériennes portant sur
l’histoire.
Henri Feuilleret, professeur d’histoire au collège d’Alger, se charge, à la fin des années
1840, de présenter le tableau des invasions successives qui ont marqué le territoire algérien : en
focalisant sa lecture historique sur les vandales, les pirates, les Turcs, il dresse ainsi le portrait
d’une terre qui n’appartient plus à son peuple. Après avoir publié des « Études sur l’Afrique249 »
qui sont historiques et avec une focale large, il restreint en effet son propos aux pirates « anciens
et modernes » de la Méditerranée dans le numéro du 5 avril 1848 du Moniteur algérien. Deux
numéros sont consacrés plus particulièrement aux Vandales. On note qu’en 1845, alors en
pleine « pacification » et en pleine guerre contre l’émir Abd el-Kader250, la presse joue vraiment
son rôle pédagogique et idéologique auprès des lecteurs coloniaux – et métropolitains s’il y en
a : la piraterie a bien été l’un des prétextes aux premiers pas de la conquête algérienne. Feuilleret
introduit aussi une étude toute historique sur Jugurtha en 1844 par la comparaison avec Abd-
el-Kader : là encore, la France s’est placée en fille de l’Antiquité romaine pour justifier la
conquête, y accolant une résurrection de l’Afrique romaine jusque dans les textes des journaux.
Auguste Cherbonneau251 (1813-1882) est une autre de ces silhouettes d’auteurs qui
aident à comprendre la production médiatique en lien avec le passé algérien : prenons l’exemple
de sa série de « chroniques algériennes ». Il les publie à l’automne 1855, et ce professeur
d’arabe au collège d’Alger s’y focalise sur quelques personnages historiques. « Ahmed-
Chaouche surnommé le Kabyle, bey de Constantine252 » est donc étudié pour son rôle dans
l’année 1807 ; ensuite, c’est une « Expédition de Mourad-Bey, pacha de Tunis, contre
249 Henri Feuilleret, « Études sur l’Afrique », Le Moniteur algérien, publications épisodiques en 1844. 250 Vincent Joly, « Les Résistances à la conquête, 1830-1880 », Histoire de l’Algérie à la période coloniale, Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Paris, La Découverte, [2012], 2014, p. 95-102. 251 Dans la notice BNF, on trouve : « Orientaliste. - Fondateur puis secrétaire de la Société archéologique du département de Constantine, Algérie. - Directeur du Collège arabe français d'Alger puis inspecteur des écoles musulmanes d'enseignement supérieur. - Correspondant de l'Institut puis professeur d'arabe vulgaire à l'École des langues orientales vivantes. - Prénoms complets : Auguste, Jacques ». 252 Auguste Cherbonneau, « Chroniques algériennes. Ahmed-Chaouche surnommé le Kabyle, bey de Constantine. Année 1807 », Le Moniteur algérien, 30 septembre 1855.
88
Constantine et Alger253 » ayant eu lieu au XVIIe siècle, qui est donnée à lire aux colonisateurs,
comme un écho de leur propre conquête ; enfin, c’est « Mohammed-ben-bou-Diaf, muphti de
Constantine254 » qui complète en passant au XVIIIe siècle les sujets de cette chronique
algérienne dont le titre même affirme une identité coloniale locale et instruite. Le fait que
Cherbonneau soit professeur d’arabe ancre l’idée de cette connaissance précise des textes, à
défaut du territoire ou de la société.
Albert Devoulx255 (1826-1876), conservateur des archives arabes, arabisant né à
Marseille est un autre de ces auteurs éminemment prolixes dans la presse algérienne, dont la
signature se rencontre assez fréquemment et qui semble avoir pour mission de donner une assise
historique au journal officiel. Actif dans les années 1860, donc dans une phase qui est celle de
l’apaisement du point de vue des autorités coloniales256, il multiplie ainsi les articles où il se
met en scène en tant que savant dénouant les trames de l’histoire algérienne, faisant la part entre
oral et écrit, bonne et mauvaise tradition, plus simplement donc entre vrai et faux. Celui qui est
apparu sous le nom de De Voulx dans ses premiers articles a affiné un style très subjectif par la
suite, marqué par des interventions du narrateur et un commentaire du travail effectué :
Hassan Ara, l’heureux défenseur d’Alger contre Charles Quint en 1541, Hassan Ara, le gouverneur intérimaire de la régence, laissé par Kheir Eddin, le deuxième Barberousse, lorsqu’il alla remplir à Constantinople les hautes fonctions de capitan-pacha, l’eunuque Hassan Ara venait de mourir. Privé de chef par cette mort, la milice remit le commandement, entre les mains d’un Turc de distinction, connu sous l’épithète d’El Hadj, le pèlerin, d’après les assertions de l’historien espagnol Haedo, et sous celle d’El Hadj Pacha, d’après les résultats de mes recherches particulières dans des documents originaux. M. de Rotalies, qui rappelle succinctement ce fait, d’après Haedo257, dans son Histoire d’Alger, y voit un acte d’indépendance et une infraction au respect et à l’obéissance dus à la Sublime-Porte. Cette appréciation ne me semble pas inadmissible. […] Comme les chronologies arabes, - qui sont, d’ailleurs, toutes plus ou moins erronées, - ne parlent pas de cet intérimaire, et que les ouvrages européens en parlent peu, je crois devoir rappeler ce qu’en rapporte l’historien espagnol Haedo et publier divers renseignements que j’ai
253 Auguste Cherbonneau, « Chroniques algériennes. Expédition de Mourad-Bey, pacha de Tunis, contre Constantine et Alger. 1700 », Le Moniteur algérien, 10 novembre 1855. 254 Auguste Cherbonneau « Chroniques algériennes. Mohammed-ben-bou-Diaf, muphti de Constantine », Le Moniteur algérien, 15 octobre 1855. 255 Marié en 1852 à Alger, et mort en 1876 dans la même ville. Notice BNF : « A aussi traduit de l'arabe en français. Conservateur des archives arabes du service de l'Enregistrement et domaines à Alger. - Membre de la Société historique algérienne. - Auteur d'ouvrages historiques sur l'Algérie ». 256 De juin à décembre 1852 paraît dans Le Moniteur algérien un texte intitulé Tachrifat, recueil de notes historiques sur l’administration de l’ancienne régence d’Alger ; le texte est aussi publié en recueil sur l’imprimerie du Gouvernement. Mais c’est dans les années 1870 qu’il publie le plus. 257 L’auteur fait référence à Diego de Haedo, abbé bénédictin espagnol, captif à Alger de 1578 à 1581, auteur de Topographia e Historia general de Argel et Epitome de los Reyes de Argel.
89
recueillis dans des titres de propriété et autres documents authentiques d’origine indigène258.
Les passages que nous avons soulignés tendent à montrer comment Devoulx se présente
au centre de l’histoire qu’il raconte : distribuant les bons et les mauvais points, il se met en
scène en tant que savant français, arabophone, capable de se livrer à un véritable travail
d’historien, sérieux et reposant sur des documents avant tout – et ces préoccupations sont bien
celles qui règnent aussi en France à la fin du XIXe siècle : refusant de plus en plus la part de
littérarité qu’avaient pu avoir les grands historiens passés, l’idée émerge que « l’historien doit
être compilator ou commentator259 ». Cette inflexion générale que prennent les études
historiques se complique ici d’une situation coloniale où les documents dits indigènes sont
dévalorisés et récupérés par la « science » française : Devoulx va beaucoup jouer sur cet aspect
de son travail. Il introduit ainsi un article sur « La mort d’un Mezouar » par une réflexion sur
son activité, donc par une mise en scène de la méthode qu’il représente. Opposant la tradition
au travail qu’il mène (ce qui lui permet de mentionner qu’il tente alors de faire publier son
ouvrage à ce sujet), Devoulx met en équilibre son travail sur les sources écrites et les sources
orales qu’il a recueillies.
Je ne me suis donc pas attaché à recueillir les nombreux récits en circulation chez les indigènes qui, en matière historique, poussent l’ignorance et l’exagération jusqu’à leurs dernières limites. Il n’est pas rare d’entendre le même individu raconter le même fait de plusieurs manières différentes, à de courts intervalles, l’imagination, chez lui, remplaçant la mémoire infidèle. […] Cependant, je ne les repousse pas systématiquement, et j’ai pris exceptionnellement note de quelques rares récits où la vérité ne semble pas trop altérée, ou qui contiennent des détails caractéristiques.
Un vieux corsaire m’a narré un conte que je vais essayer de rapporter aussi fidèlement que possible, quant au fond seulement, car pour la forme, je n’ai pas essayé un seul instant de l’imiter. Cette tradition concerne un célèbre raïs algérien nommé El Hadj Embarek. Mon interlocuteur n’avait nulle idée de l’époque à laquelle vivait son héros, ni du nom des personnages intervenant dans son récit ; il paraissait même fort étonné que je pusse me préoccuper de semblables bagatelles. Cependant, j’ai pu m’assurer que ce Hadj Embarek n’était pas un corsaire imaginaire et trouver sur lui quelques renseignements d’une incontestable authenticité. […]
J’aborde maintenant la partie légendaire de mon récit, étant bien entendu qu’à partir de ce moment je décline toute responsabilité sous le rapport de la véracité260.
258 Albert Devoulx, « El Hadj Pacha », Le Moniteur algérien, 7 juillet 1864. Cette notice, parue dans les variétés, sera republiée la même année par la Revue africaine, tome VIII, p. 290-299. Nous avons souligné les passages qui nous semblaient intéressants. 259 Ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature contemporaine, Paris, Seuil, 2014, p. 91. L’auteur rappelle aussi qu’en 1876, donc dans la décennie suivant Devoulx, Gabriel Monod ouvre la Revue historique sur l’idée que l’histoire doit adopter « un point de vue strictement scientifique » (p. 75). 260 Albert Devoulx, « Mort d’un Mezouar », Le Moniteur algérien, 1er et 2 mars 1866.
90
La « vérité », la « véracité » sont au centre de la présentation de l’auteur, qui fait ici acte
de littérarisation de l’histoire, mais en prévenant son lecteur que cette littérarisation est le fait
des indigènes par lesquels il a dû passer. « Conte », « partie légendaire », « imagination »,
« tradition » s’opposent ici aux recherches historiques : et le « vieux corsaire » lui-même
introduit déjà l’apparence d’un récit dramatisé par l’historien. Apparaît dans ces quelques lignes
la montée en puissance d’une forme de folklorisme, d’une collecte des traditions orales, mais
mâtinée de représentations de l’Algérie passée.
Ces trois silhouettes d’auteurs, collaborateurs prolixes du journal officiel et presque
toujours affectés aux textes à sujet historique, montrent donc l’ébauche d’une typologie de
savants : Feuilleret l’historien suit les instructions officielles en donnant à lire une histoire
algérienne orientée vers la conquête française ; Cherbonneau l’arabophone travaille sur des
sources plus récentes et démontre une supériorité dans la connaissance des textes ; Devoulx,
arabophone lui aussi, mais surtout conservateur des archives arabes, plus libre dans ses sujets
et moins lié à l’enseignement, semble inaugurer une nouvelle appréhension du passé algérien.
Enfin, à côté de ces trois auteurs qui aident à saisir comment un journal officiel accompagne
l’évolution d’une colonisation du territoire, des signatures plus irrégulières mais révélatrices de
l’implication du corpus savant colonial complètent le tableau d’une vaste production
historique qui implique notamment les militaires et les interprètes261. Pour renforcer ce paysage
médiatique, l’on peut leur ajouter Adrien Berbrugger (1801-1869), né à Paris, arrivé en Algérie
en 1833 avec Clauzel – il y mourra après avoir été un des membres les plus actifs de la colonie.
Fouriériste, rédacteur du Moniteur algérien, il joue de son passé de chartiste pour mettre en
valeur les articles d’histoire et surtout d’archéologie autant que pour défendre l’idée même de
colonisation ; le gouvernement le charge dès 1835 « "de la formation et de la conservation
d’une bibliothèque à Alger", à laquelle allait s’adjoindre dès 1838 un musée dans lequel
s’entassèrent les pièces les plus hétéroclites262 ». D’Adrien Berbrugger l’on ne peut tout retenir ;
pourtant, dans ses publications, un Voyage au camp d’Abd-el-Kader à Hemzat et aux montagnes
de Wamoura (1837-1838) paraît dans la Revue des Deux Mondes le 15 août 1838, et est tiré à
part en 1839263.
261 Ainsi du numéro du 10 février 1847 du Moniteur algérien, qui fait paraître dans ses variétés une « Relation de l’expédition du bey Mohammed contre Chellella, en l’année 1786, faite par MM. Deligny261, capitaine au 13ème léger, et Theuma, interprète militaire de la même division », qui se poursuit sur plusieurs numéros. 262 X. Yacono, « Adrien Berbrugger », dans L’Académie des sciences d’outre-mer. Hommes et destins, 1975-1986. Cette notice biographique mentionne son entourage : De Slane, Neveu, Louis Bresnier et « Abel » Devoulx, Lacroix, Faidherbe, Charles Féraud. 263 Dans les premières pages de ce récit apparaît le médecin Bodichon, un autre habitué des premiers temps de la conquête ; et Berbrugger se désigne à la troisième personne comme le « conservateur de la bibliothèque et du musée d’Alger ».
91
Hommes de lettres réunionnais et antillais : colonies anciennes et question créole
L’île de la Réunion a développé une tout autre réputation : c’est une île poétique,
marquée par des poètes reconnus – Leconte de Lisle, Parny – et d’autres moins reconnus mais
davantage présents dans la presse locale : Ernest Cotterêt264, Eugène Dayot265, Edouard
Fontaine266, François Saint-Amand267 sont parmi ces noms récurrents que nous avons relevés.
Il y a à cette époque une circulation des poètes dans les périodiques : ils se répondent et
s’invitent, se commentent aussi, et de critique en critique apparaît un monde littéraire
particulièrement vivant. À travers certaines de ces destinées se lit aussi la particularité de
l’île : Eugène Dayot attire ainsi particulièrement les regards, tant par son surnom, « le mutilé »,
que par son Bourbon pittoresque, roman paru en feuilleton dans le Courrier de Saint-Paul,
inachevé mais à la forte teneur politique et esthétique – il y est notamment question des
« marrons », ces esclaves ayant fui les plantations et s’étant réfugiés au cœur de l’île. Dayot se
révèle dans ses textes comme un poète en lutte contre la peine de mort et contre l’esclavage, et
ce au cœur des années 1840, avant les bouleversements que provoque l’abolition de l’esclavage
au sein de l’île – et de sa presse268. Présenté comme « poète et journaliste », Eugène Dayot est
en effet un homme de presse : « il rachète l’ex-Glaneur et fonde le journal Le Créole en
1839269 » ; ses positions contre l’esclavage et la peine de mort
lui attirent de solides inimitiés de la part de l’establishment local. Le journal est boycotté. Après de graves revers financiers il est contraint de vendre son imprimerie en novembre 1843270.
On peut s’arrêter aussi sur la figure de Raffray, actif médiatiquement dans les décennies
1850 et 1860. Il est principalement l’auteur d’une série intitulée « De la presse à Bourbon depuis
264 Ernest Cotterêt (1833- ?), poète, auteur du recueil Les Sensitives. Jean-Claude Roda dans Bourbon littéraire, Saint-Denis, Bibliothèque interuniversitaire de la Réunion, 1974, donne 1854 comme date de sa mort ; mais Cotterêt publie son recueil en 1862, et en 1860 son poème « Le Vieux professeur de campagne » paraît dans le journal Le Colon, sans qu’il soit fait référence à son décès. Prosper Ève évoque Ernest Cotterêt dans son ouvrage Les Esclaves à Bourbon : la mer et la montagne, Karthala, 2003. 265 Eugène Dayot, (1810-1852), homme de lettres né à Saint-Paul, surnommé « le mutilé » à cause de la lèpre qui le défigure, est le fondateur du journal Le Créole, le rédacteur du Bien-Public (publié à Saint-Paul) dans les années 1850. 266 Édouard Fontaine, rédacteur du Phare de Saint-Paul (journal éphémère publié de janvier à décembre 1862 d’après Karine Técher et Mario Serviable, Histoire de la presse à la Réunion, Sainte-Clotilde, A.R.S Terres créoles, 1991) publie plusieurs poèmes dans la presse réunionnaise. Il n’apparaît pas dans les dictionnaires biographiques, mais semble assez proche des collaborateurs du Courrier de Saint-Paul. 267 François Saint-Amand, poète, publie entre autres : en 1857, Madagascar (Poème), en 1858 Les Bourbonnaises, puis La Navigation aérienne en 1878, et enfin Causeries historiques sur l’île de la Réunion en 1881 (source : Jean-Claude Roda, op.cit.). Ses éditeurs le présentent, sur la page de garde, comme un « créole de l’île Bourbon ». 268 Il faut penser que, jusqu’en 1848, la presse réunionnaise publie les avis de ventes d’esclaves ainsi que les déclarations de marronnage ou d’affranchissements : textes et gravures forment un environnement médiatique surprenant pour le lecteur moderne. Voir en annexe pour des extraits de ces publications. 269 Sabine Deglise (dir.), Le Dictionnaire biographique de La Réunion, Saint-Denis, Editions CLIP, 1993, p. 60-61. 270 Id.
92
quarante ans271 », publiée dans Le Bien-Public en 1851, et d’un feuilleton, « Un fils de Béranger
à l’île Bourbon272 », paru dans La Réunion en 1862 : deux textes très ancrés localement, témoins
de ces publications originales que la presse coloniale produit. Quant à retrouver les traces de
l’auteur, plusieurs pistes s’offrent à nous. On trouve un Raffray médecin à l’île Maurice en
1836, un Raffray que les procès-verbaux du conseil colonial réunionnais signalent en conflit
avec le curé de Saint-Paul en 1834 et un explorateur de l’Abyssinie dans les années 1870. Les
signatures incomplètes de la presse coloniale n’aident pas à identifier plus avant celui qui signe
J.-M. Raffray, mais le plus probable reste encore que ce Raffray ait été « secrétaire de la
banque », comme le présente le Bulletin de la société des sciences et arts de l’île de la Réunion
en 1862. L’on retrouve à ses côtés deux Vinson, dont l’un, Auguste, est un poète publié dans la
presse : preuve que la société des sciences et arts de l’île de la Réunion est liée aux publications
médiatiques. L’on trouve également un Raffray qui aurait, d’après la Revue de Lille (1899),
tenté d’achever le Bourbon pittoresque. Il est certain que Raffray sera le rapide biographe de
Dayot, faisant paraître une notice biographique dans la parution des œuvres complètes du poète
réunionnais, et qu’il apparaît comme son ami273.
Aux Antilles, Céloron de Blainville, que nous avons cité comme le rédacteur du
Commercial guadeloupéen, est un exemple intéressant du fonctionnement médiatique dans les
îles créoles. L’homme lui-même n’a pas laissé beaucoup de traces, si ce n’est le ton désabusé
de certains de ses articles274 ; mais sa famille, en revanche, possède une trajectoire plus
documentée, et l’on découvre tout un pan de l’histoire coloniale à travers leurs déplacements275.
L’État présent de la noblesse française précise ainsi que Claude de Céloron, secrétaire du roi
en 1637, est « passé au Canada, à Saint-Domingue et à la Guadeloupe » ; seigneurs du fief de
Blainville au Canada, les Céloron, devenus de Blainville, sont aussi présents à la Guadeloupe,
et appartiennent de fait à une des plus anciennes familles de l’île276. Autre silhouette
guadeloupéenne présente dans les textes médiatiques, Anténor Vallée (1809-1870) est le
rédacteur de L’Avenir, et son journal nous permet une première approche biographique : on y
271 14 mars 1851, 21 mars 1851, 28 mars 1851, 4 avril 1851, 11 avril 1851. 272 27 novembre 1862. Raffray publie aussi en recueil « Orère », Album de l’île de la Réunion, A.-L. Roussin, vol. 1, Saint-Denis, 1860 (cité par Prosper Ève, Les Esclaves de Bourbon : la mer et la montagne, Paris, Karthala, 2003, p. 130). 273 Eugène Dayot, Œuvres choisies. Avec une Notice biographique et littéraire par J.-M. Raffray et une préface par François Saint-Amand, Paris, Challamel aîné, 1878, p. 720. 274 Dont « Le cimetière à la Pointe-à-Pitre. Un chapitre de mœurs coloniales », Le Commercial, 31 octobre 1863. 275 Des sources généalogiques diverses font apparaître les biographies – presque toutes coloniales – des membres de la famille Céloron de Blainville : en ligne, on trouve ainsi un bulletin Généalogie et histoire des Caraïbes (URL : http://www.ghcaraibe.org/, consulté le 3 mars 2016) et un Dictionnaire biographique du Canada (URL : http://www.biographi.ca/fr, consulté le 3 mars 2016). 276 Antoine Bachelin-Deflorenne, État présent de la noblesse française, Paris, Librairie des bibliophiles, [1866] 1887, p. 700.
93
apprend la noyade accidentelle de son fils, son voyage en France (il en profite pour écrire la
correspondance parisienne du journal) ainsi que son propre décès, occasionnant la reprise du
journal par sa veuve, puis par son frère. Il publie dans son journal et en recueil une Histoire de
la Guadeloupe. Un site consacré à l’abolition nous donne quelques informations sur lui, le
dessinant bien comme un créole, mais précisant aussi qu’il a été, avant d’être journaliste,
instituteur et policier277 : il témoigne alors contre un nommé Rabou, suspecté d’avoir profité
des événements de 1848. Les trajectoires des hommes de lettres réunionnais et antillais, si l’on
les a traités ensemble, témoignent donc de la vitalité culturelle des créoles réunionnais d’un
côté, et des changements possibles dans les familles coloniales de l’autre.
La Nouvelle-Calédonie : de la transition à l’installation
La presse coloniale a ceci d’intéressant qu’elle favorise les auteurs de passage en mettant
en scène, justement, leur passage dans la colonie : et ce particulièrement dans les territoires où
il y a peu d’hommes de lettres en puissance, territoires éloignés ou considérés comme trop
rudes. Armand Closquinet est l’un de ces auteurs de passage : arrivé en Nouvelle-Calédonie sur
l’Isis et reparti sur la Sibylle, il publie dans Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie et toutes ces
informations que nous avons données émanent des textes eux-mêmes. Le poète est présent entre
1862 et 1864, publiant d’abord « En mer278 », long poème en plusieurs épisodes, à partir du 14
septembre 1862. Sa signature redouble encore le caractère inaugural que présente le poème,
puisqu’elle précise : « à bord de la frégate L’Isis ». Il finit par un « Hommage et adieu279 » le
17 avril 1864, et, outre de nombreux poèmes publiés très régulièrement dans les colonnes du
Moniteur de la Nouvelle-Calédonie280, il devient aussi chroniqueur théâtral à l’occasion. Pour
mieux comprendre comment Closquinet s’épanouit en tant que journaliste en Nouvelle-
Calédonie, l’on peut s’arrêter sur sa critique de l’opérette Vent du soir, opérette d’Offenbach
jouée à Nouméa – alors Port-de-France – qui met en scène des anthropophages281. Closquinet
y adopte l’écriture d’un métropolitain, d’un observateur de la colonie qui évoque des pages de
l’histoire antécoloniale telle qu’elle est racontée par les coloniaux. Évoquant les figurants
kanacks de la scène, c’est avec « horreur » qu’il reçoit le spectacle du faux banquet
anthropophage : « j’avais réellement devant les yeux d’anciens mangeurs d’hommes, de
277 URL : http://lesabolitions.culture.fr/medias/liberte/8campagnes/documents/cite-proces-senecal.pdf. Consulté le 11 avril 2016. 278 Armand Closquinet, « En mer », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 14 septembre 1862, 5 octobre 1862, 26 octobre 1862, 14 décembre 1862. 279 Armand Closquinet, « Hommage et adieu », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 17 avril 1864. 280 Quelques poèmes publiés dans Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie en 1863 : « La Nuit » (23 août 1863), « L’Enfant et le papillon » (6 septembre 1863), « Souvenirs et regrets » (27 septembre 1863), « La vie humaine » (25 octobre 1863), « Le Nid d’hirondelle » (24 mai 1863), etc. 281 Armand Closquinet, « Vent du soir et les Kanacks », Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 1er février 1863.
94
femmes, voire même d’enfants282 ». Ces premiers instantanés d’une production poétique et
critique construisent la posture d’un journaliste colonial caractérisé par son arrivée, donc par
son étonnement, par une écriture encore marquée par la surprise. Mais l’intéressant ici est que
l’image de l’auteur s’enrichit ensuite par les présentations dont il fait l’objet dans les colonnes
du journal. Un de ses derniers poèmes est introduit par une citation de L’Économiste français,
dans un jeu intéressant entre colonie et métropole, entre projection métropolitaine sur la colonie
et vrai discours tenu par Closquinet dans son poème.
On lit dans l’Economiste français du 7 janvier 1864 : « La poésie est en honneur à Port-de-France, si nous en jugeons par les odes
et idylles que publie fréquemment le Moniteur. M. Armand Closquinet a de la grâce, de l’élégance, une sensibilité toute féminine ; aux souvenirs et regrets qu’il aime à chanter, nous l’invitons à opposer les perspectives et espérances que ne peut manquer d’évoquer dans son âme de poëte le spectacle de la civilisation prenant possession d’un pays et d’un peuple aussi sauvages l’un que l’autre. »
En réponse à cette appréciation flatteuse, nous publions les adieux à la Nouvelle-Calédonie du poëte que nous a enlevé la Sibylle et dont nous aimons le talent non moins que l’Economiste283.
[…]
Je pars ! le sort le veut ! J’abandonne cette île Où, plein d’illusions, de loin j’étais venu ; Où le bonheur pour moi semblait chose facile ; Je pars ! le sort le veut ! triste et déconvenu. […] J’ai vu, j’ai vu de près tes cases, tes villages ! Je me suis même assis au foyer indien ; J’ai passé plusieurs nuits chez tes guerriers sauvages ; Leur hospitalité fut large ; ils la font bien. Ces hommes, qu’on nommait cannibales féroces, M’ont reçu franchement et m’ont tendu la main, Ces kanacks, dont on dit tant de choses atroces, Veillaient autour de moi, du jour au lendemain.
Car l’étonnant ici est la distorsion entre la présentation de L’Économiste et le poème qui
le suit : l’un parlant de sauvages, de spectacle de la civilisation et d’avenir à mettre en lumière,
l’autre reconnaissant l’hospitalité kanack et la manière dont il a été protégé. Certes une grande
partie du poème de Closquinet explique ensuite que la « transformation » des kanacks est due
précisément à l’œuvre accomplie par les colonisateurs ; mais son texte est plus ambigu que ce
que la présentation pouvait laisser attendre. La « civilisation » n’apparaît que tardivement, bien
après les images idylliques données d’une terre qui n’est pas exploitée, mais encore sauvage ;
terre « française », donc, mais surtout naturelle et peu transformée. Sans que cette distorsion
soit commentée, on lit pourtant une différence profonde entre l’image de l’auteur produite par
la critique métropolitaine et l’éthos qu’il construit. Cet éthos d’ailleurs a évolué, lui aussi : on
282 Id. 283 « On lit dans l’Économiste français », », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 17 avril 1864.
95
est loin alors de la critique de Vent du soir. Enfin, Closquinet est même cité par le journal en
1865 pour un poème « La Sybille », introduit par la lettre d’un certain Laurent, résident de
Papeete, qui envoie les vers au journal car Le Messager de Tahiti ne les a pas publiés. Là encore,
l’image s’enrichit : l’auteur colonial appartient au réseau, suit les mouvements coloniaux.
Nous nous empressons de communiquer à nos lecteurs la lettre suivante et la pièce de vers qui y était annexée.
Papeete, le 6 octobre 1864 Monsieur, Une appréciation très flatteuse des vers de M.A. Closquinet, émanant de la rédaction
de l’Économiste français et qui a été insérée dans le n° 238 du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie du 17 avril 1864, m’engage à vous prier de vouloir bien obtenir l’insertion, dans le Moniteur, de la pièce de vers dont original est ci-joint.
À son arrivée à Taïti, M. Closquinet, ayant désiré faire insérer ce morceau de poésies dans le Messager, le transmit à la rédaction ; mais ce manuscrit ayant été conservé sans que suite y soit donnée, je crois remplir un devoir en laissant au Moniteur calédonien le soin de reproduire les derniers vers de son poète, inspirés sous les rayons du soleil des tropiques.
C’est un de ses compatriotes qui vous prie de vouloir bien accueillir cette demande, persuadé d’avance qu’elle sera reçue avec bienveillance.
M. Closquinet ignore si ses vers ont été publiés par le Messager. En vous les envoyant, je crois rendre hommage et au talent du poète et à l’impartialité du journal qui a su si bien accueillir ses premières œuvres.
Je suis, etc. LAURENT, résidant à Papeete284.
Qu’apprend-on ensuite de ce Closquinet, si l’on élargit l’image à son état-civil ? On le
découvre « instituteur aux environs de Brest285 » dans les années 1870 : mais pourquoi est-il
parti en Nouvelle-Calédonie pendant seulement deux ans, et que fait-il ensuite à Tahiti ? Le
Bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie nous apprend qu’il a été attaché au secrétariat de
l’Ordonnateur286 ; puis « appelé à continuer ses services au bureau de la comptabilité centrale
des fonds287 » ; enfin, il est noté que « par décision du Gouverneur, en date du 6 novembre
1862, M. Closquinet (Armand) a été révoqué de son emploi d’écrivain de la marine288 », sans
que l’on sache pourquoi ou comment. Quelques traits d’un poète passé par les colonies
émergent donc, dont le texte constitue une très grande partie de l’identité – voire la majeure
partie.
Armand Closquinet n’est pas le seul collaborateur marquant du Moniteur de la
Nouvelle-Calédonie à cette période : un certain Béraud est lui aussi une plume du journal
officiel289. Ce publiciste a donné au périodique une série de « Chroniques néo-
284 Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 9 février 1865. 285 Il est cité ainsi dans le Bulletin de la société académique de Brest, Brest, Gadreau, 1873, p. X. Il y publie « Simple récit. Poésie » 286 Bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie, août 1862, p. 88. 287 Ibid., octobre 1862, p. 188. 288 Ibid., novembre 1862, p. 219. 289 Quand il interroge pour sa thèse les publications médiatiques de Félix Béraud et Armand Closquinet, tous deux collaborateurs du Moniteur de la Nouvelle Calédonie dans les années 1860, Eddy Banaré met en lumière une
96
calédoniennes290 » centrées sur la vie quotidienne de la colonie, ainsi qu’une critique théâtrale,
mais il n’a laissé aucune information qui permette de remonter à sa date d’arrivée dans la
colonie, son occupation ou sa carrière : il n’existe que par ses chroniques. Béraud est donc
inconnu, et Closquinet n’a laissé que quelques traces ; mais l’on peut tirer de ces deux auteurs
pourtant deux idées qui éclairent la vie de la société coloniale : « ce tandem formé par la
bleuette de Closquinet et la solennité de la chronique de Félix H. Béraud291 » montre la
multiplicité des tons possible dans le journal. La complémentarité des deux hommes se joue au
niveau de leurs écritures, et laisse voir une évolution possible des publications sur l’île prise
comme sujet de publications autant que comme lieu de publication. Cette évolution va se
matérialiser dans les années 1870 par un personnage important de la culture médiatique de la
Nouvelle-Calédonie. Alfred Laborde (1832-1890) est d’abord un nom qui possède une entrée
dans le dictionnaire en ligne du site Médias 19292. On y apprend qu’il est né à Nantes ; qu’il a
été rédacteur du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie jusqu’en 1873, puis le directeur du
Nouvelliste (1882), journal hebdomadaire paraissant le samedi sur son imprimerie ; qu’enfin il
a participé à la fondation du journal La France Australe vers 1889. En croisant ces informations
avec celles de Georges Coquilhat293, la silhouette de Laborde apparaît encore plus
précisément : passant d’abord par l’Australie où il a enseigné et s’est marié avec une Anglaise,
il est arrivé en 1870 dans la colonie française, et a fait entrer son fils Pierre (1860-1910) comme
apprenti typographe à l’imprimerie du Gouvernement en 1876. Georges Coquilhat cite encore
Le Moniteur comme source pour évoquer précisément la fin de l’activité de rédaction de
Laborde, suspendu le 17 mai 1879294. Mieux encore, la lecture du journal nous donne
l’information d’un A. Laborde traducteur assermenté du Sidney Morning Herald en 1871, donc
à ses débuts néo-calédoniens, lui donnant par là une envergure supplémentaire. Alfred Laborde
va passer d’un élément à l’autre dans le monde médiatique très restreint de la Nouvelle-
complémentarité entre les deux hommes de lettres. Voir : Eddy Banaré, La Littérature de la mine en Nouvelle-Calédonie (1853-1953), thèse de doctorat en littérature française, sous la direction de Mme la Professeure Dominique Jouve, soutenue à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, 2010. 290 Publiées en juin 1862 dans le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie. 291 Eddy Banaré, op. cit., p. 87. 292 URL : http://www.medias19.org/index.php?id=20175. Consulté le 17 février 2016. 293 Georges Coquilhat, La Presse de la Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle (1859 – 1900), thèse de doctorat en histoire sous la direction de M. le Professeur Jean Chesneaux, soutenue à l’EHESS, 1984. 294 Sur le site tiré de sa thèse, Georges Coquilhat cite ainsi Le Moniteur du 21 mai 1879, arrêté n° 374 : « Vu l'impossibilité de maintenir en fonction un agent à l'incapacité et à l'incurie duquel est dû le désordre constaté dans la comptabilité de ce service ; vu son égale insuffisance en matière de connaissances techniques de l'imprimerie ; vu les antécédents de cet agent auquel n'ont profité ni les avis, ni les blâmes de l'Administration qui a épuisé à son égard toute indulgence… ». URL : http://gnc.jimdo.com/biographies/laborde-a/. Consulté le 10 août 2016.
97
Calédonie, et va aussi participer à son extension. L’image du polygraphe qu’on attribue
habituellement au journaliste colonial est toujours valable ici, et se complexifie même avec
Laborde : il est l’exemple du journaliste étant en même temps traducteur, fondateur, directeur
de journaux, sans être forcément excellent dans toutes ses catégories ; il donne l’idée d’une
passion médiatique transmise à son fils – une situation qui peut rappeler celle de la Réunion,
fonctionnant aussi sur un principe de verticalité dynastique, et pas seulement de réseaux
horizontaux.
D’un point de vue sociologique, l’on peut trouver intéressant que les auteurs que nous
avons étudiés ici soient issus des côtes françaises, atlantiques ou méditerranéennes. Leurs
circulations entre les colonies et la métropole est un autre axe important, qui permet de nourrir
l’idée d’une circulation des hommes et des idées autour du pivot que constitue le journal
colonial. Le portrait-type du journaliste colonial n’est pas facile à dresser : mais quelques
dominantes apparaissent pourtant, d’un territoire à l’autre ; et c’est au journaliste colonial en
tant que type que l’on peut s’intéresser à présent.
2.3 Le journaliste colonial comme catégorie
Le journal colonial a visiblement perçu, au cours du siècle, la conscience profonde de
son importance. Certes, un discours médiatique existe en général, qui met en scène et commente
les réseaux de circulation (comme preuve de modernité, de présence au monde, d’informations
fiables). Mais en contexte colonial, ce procédé qui vise à rendre publiques les tractations du
journal est également un signe idéologique profond ; pour preuve encore, ce passage du tout
neuf alors Courrier de Saïgon : dans son dixième numéro paraît une annonce signée Émile
Brun, propriétaire-directeur du journal L'Égypte. Il y écrit que « le journal l'Égypte a fait la dure
expérience de l'apprentissage du journalisme colonial » et propose la mise en place d’un
échange entre sa « feuille quotidienne » et « l'estimable journal295 » : ce qui nous intéresse ici,
c’est l’affinité créée par le « journalisme colonial », affinité sur laquelle repose la collaboration
entre deux périodiques issus d’aires géographiques bien différentes. Si le journalisme colonial
est une entité avérée dans les années 1860, le journaliste colonial doit être un type d’auteur
familier. Mais accumuler les biographies des journalistes dont le nom a pu laisser quelques
traces ne suffit pas à penser la cohérence d’un corpus de journalistes. Les différents territoires
semblent en outre conditionner différents types de journalistes, comme on l’a vu : un territoire
à la conquête récente comme la Nouvelle-Calédonie ne peut être couvert par le même type de
295 Le Courrier de Saïgon, 10 mai 1864.
98
journalistes que les Antilles. Pourtant il nous faut donc questionner l’existence d’un
« journaliste colonial » qui fonctionnerait selon le principe du plus petit dénominateur
commun : une fois les cas particuliers envisagés, que reste-t-il pour justifier l’expression de
« journaliste colonial », ou d’« écrivain de la presse coloniale296 » ? C’est un type particulier
mais mal défini pour la période que nous étudions. Preuve en est que ses syndicats se constituent
à la fin du siècle, quand la presse coloniale a pu se développer et se multiplier. La presse
coloniale métropolitaine a alors, elle aussi, pris un poids fondamental, qui a joué sans doute
dans ces créations : le syndicat de la presse coloniale est créé en 1885, le syndicat des
journalistes coloniaux en 1899 – le premier syndicat de journalistes, sans autres restrictions, est
créé en 1918.
Quand il s’agit de la presse coloniale non métropolitaine, et avant les années 1880, il
semble être question davantage de collaborateurs occasionnels que de journalistes attitrés, de
plumes coloniales plus que de publicistes de métier. Les collaborateurs sont soumis aux
changements, et les dates de parution de leurs articles sont souvent très rapprochées, ce qui
empêche de les suivre sur le long cours : les colonies sont donc des terres où les écrivains,
même mineurs ou médiocres, ne font – la plupart du temps – que passer.
Les journalistes représentés par eux-mêmes
En 1898, Joseph Aumérat, ancien rédacteur en chef de la Dépêche algérienne (créée en
1885), publie ses Souvenirs algériens. Né à Marseille en 1818, Aumérat est arrivé en Algérie
en 1842, et à ce titre il revendique une authentique ancienneté aux yeux de la colonie : il raconte
donc les premières années de la colonisation, décrit les costumes, rappelle quelques faits divers
en citant Le Moniteur algérien, explique les noms des rues et narre les aventures des premiers
colons. L’un de ses chapitres s’intitule « Publicistes et journalistes algériens », et attire
l’attention par ses premières lignes :
Si l’Algérie n’est pas connue en France, on ne saurait l’attribuer aux Algériens. Depuis le lendemain de la conquête et jusqu’à nos jours nous avons publié des milliers de volumes de tout format ; de tout temps aussi nous avons vu ces écrivains répandre leurs idées dans la presse, bien que, sauf dans ces dernières années, la presse n’ait pu jouir en Algérie des mêmes libertés que dans la métropole297.
Il reconnaît ensuite que les premiers écrivains de la colonie n’étaient pas des publicistes
mais « des commerçants, des agronomes, des fonctionnaires298 » dont les écrits étaient publiés
296 A. Vallée, « Petit avant-propos, pour tenir lieu de préface », L’Avenir, 18 juin 1859. 297 Joseph-François Aumérat, Souvenirs algériens, Blidah, Imprimerie A. Mauguin, 1898, p. 365. 298 Ibid, p. 366.
99
en France : par cette précision apparaît l’importance du lieu de publication comme critère
qualifiant pour une littérature dite coloniale, ainsi que la polyvalence des premiers journalistes
coloniaux. Mais Aumérat précise surtout la présence dès 1831 de deux imprimeries à
Alger : celle de Luxarde (nous n’en avons pas trouvé trace dans les publications médiatiques)
et celle de Bastide et Bruchet. Un autre chapitre est même consacré plus explicitement encore
aux « débuts de la presse algérienne », incarnée par Roland de Bussy. Aumérat se fait alors
portraitiste, comme il le sera ensuite, avec plus d’enthousiasme, pour Adrien Berbrugger :
Le Moniteur algérien fut donc fondé ; un matériel d’imprimerie fut acheté à Paris et son rédacteur en chef fut en même temps nommé directeur de l’Imprimerie du Gouvernement.
M. Roland de Bussy était-il journaliste de profession ou compositeur typographe ?
Je crois qu’il n’était ni l’un ni l’autre. C’était le fils de son père, lequel avait occupé des fonctions importantes en France et était à Alger dans ces temps-là commissaire du Roi, Maire, Préfet, Chef de la justice, de la police, et je ne sais quoi encore299.
Il y a donc une presse algérienne reconnue dès ses débuts, mais qui ne trouve pas sa
légitimité dans le personnel de direction, dans les gérants. C’est plutôt le journaliste colonial
qui rend cette presse légitime, et peut-être justement parce qu’il est d’abord un amateur, au sens
où son activité médiatique est souvent le complément d’une autre activité : cela se voit
particulièrement dans les moments de liberté de la presse, quand le citoyen peut et veut écrire
dans la presse. L’Akhbar souligne à plusieurs reprises, par le biais de brefs récits humoristiques,
ces silhouettes de journalistes occasionnels qui trouvent à s’exprimer en 1848. Ainsi d’un
premier fait divers sans gravité, qui est introduit comme suit :
Pendant la nuit du 1er au 2 juin, un milicien se promenait silencieusement devant le poste de Bougie. Il était si bien absorbé par la rédaction mentale d’un article destiné au Gourayah, que les Kabyles auraient pu emporter le lit de camp et ses camarades qui ronflaient dessus sans qu’il s’en doutât le moins du monde. Hélas ! ce malheur fut bien près d’arriver ; mais n’anticipons pas sur les évènements300.
Ce milicien n’est pas encore un journaliste, tout comme Roland de Bussy ne l’est pas
non plus d’après Aumérat ; et l’auteur de l’article conclut d’ailleurs par le conseil
suivant : « Chacun son métier, publicistes Bougiotes, et votre ville sera bien gardée ». Dans le
même journal, deux mois après cette première histoire, une deuxième paraît qui joue sur les
mêmes ressorts : le journal ancien qu’est L’Akhbar s’amuse des tentatives de nouveaux
journalistes.
299 Ibid, p. 272. 300 L’Akhbar, 11 juin 1848.
100
Le Précurseur, un des petits journaux qui se donnent le plaisir de paraître… quelquefois, a disparu après la publication de son premier et unique numéro. Il se rattache à l’apparition ou plutôt à la disparition de cette feuille des faits assez curieux dont nous ne croyons pas devoir priver nos lecteurs. Son fondateur, le citoyen R…, s’est livré avec tant de vivacité à l’ardeur de l’intérêt patriotique et aux douceurs du premier-Alger, que la politique lui a monté à la tête et qu’il en est devenu fou ! Il y a quelques temps, il se présente chez M. le directeur-général, à une heure très avancée de la nuit et n’ayant pas été, bien entendu, reçu par ce fonctionnaire auquel il venait demander, tout simplement, la somme nécessaire pour son cautionnement, il monta à cheval, alla à Mustapha, revint à Saint-Eugène, voulut embrocher deux pauvres diables qu’il prenait pour des mouchards, et donna pendant toute la journée des preuves non équivoques d’aliénation mentale. La nuit venue, il se présenta de nouveau chez le directeur-général, armé d’un fusil chargé à balles, et comme il proférait des menaces assez exagérées, le fonctionnaire jugea prudent de l’arrêter.
Le citoyen R… fut immédiatement conduit à l’hôpital civil où il est encore ! Nous espérons qu’il en sera quitte pour la peur, et que dans quelques jours il sortira de l’hôpital tout-à-fait guéri. Du reste, la meilleure preuve qu’il puisse nous donner de sa complète guérison, c’est de renoncer bravement au Précurseur, dont le premier numéro a satisfait les exigences des hommes les plus difficiles en matière d’excentricité301.
Il faut donc du temps pour qu’apparaisse le journaliste colonial professionnel, ou du
moins pour qu’il soit présenté comme tel. Plus généralement, d’après Marc Martin, le
« journaliste » en tant que catégorie d’écrivain n’existe pas avant les années 1870, puisque « la
profession de journaliste commence d’exister sémantiquement autour de 1870 – 1880. C’est le
moment, précisément, où elle prend sa consistance sociale302 ». Le journaliste colonial suit-il
ce développement, ou la société coloniale modifie-t-elle cette apparition ? Il existe en effet, ce
« journaliste colonial » dont la presse locale a conscience, mais en pointillé et selon quelques
textes, dans les (auto)représentations que le journal produit. Dès les premières décennies de la
conquête algérienne, l’on peut trouver dans les textes la conscience nette d’une écriture locale
qui passe par le journal, et donc par des auteurs particuliers – les journalistes coloniaux :
J'ai lu dans L'Écho de l'Atlas quelques articles de mon excellent ami Bache, le spirituel auteur de Kamara, articles qui feraient une mine très convenable dans tous les journaux du monde, et qui sont passés ici presque inaperçus. Je lis tous les jours, dans L'Akhbar, des feuilletons de Chancel que Théophile Gautier ne désavouerait pas. Je ne parle pas de ses vers, qui valent encore mieux que ses feuilletons. Le poète d'Alger a le défaut, comme Figaro, d'être paresseux avec délices et de ne pas faire dix rimes par mois. Eh bien ! Combien y a-t-il à Blida de personnes qui n'ont jamais lu de leur vie un seul vers de Chancel ? Combien y en a-t-il qui ne se doutent seulement pas de son existence ? Et cependant, s'il était à Paris au lieu d'être à Alger, soyez sûr qu'il serait digne en tous points de faire partie de cette poétique pléiade dont Lamartine et Victor Hugo sont les
301 « Faits divers d’Alger », L’Akhbar, 29 août 1848. 302 Marc Martin, Médias et journalistes de la République, p.120. Cité par Michel Mathien, Les journalistes. Histoire, pratiques et enjeux, p. 57, dans son étude de l’évolution sémantique de « journaliste ».
101
chefs et qui comptent pour soldats Alfred de Musset, Méry, Théophile Gautier, Emile et Anthony Deschamps, Brizeux, Barbier, et tant d'autres dont le nom m'a échappé303.
Que l’on trouve cette dénonciation dans un journal local, L’Écho de l’Atlas, est l’indice
de la formation d’une catégorie d’hommes de lettres liés au territoire, et qui préfigurent l’un
des critères de la littérature coloniale à venir : il faut être né sur place, y avoir vécu, ne pas faire
qu’y passer. Cette perspective va plus loin que celle de Marc Martin : elle ressortit à la naissance
d’une conscience littéraire aux accents romantiques, qui valorise les « jeunes » littératures et
affirme une identité culturelle nouvelle. En 1846 déjà, la presse revendique donc une classe
d’auteurs coloniaux qui se démarquent de la production littéraire métropolitaine ; et ces auteurs
sont publiés dans la presse, qui gagne bien ici ses lettres de noblesse. La reconnaissance des
journalistes coloniaux en tant que plumes locales va aller de pair avec une reconnaissance – plus
tardive – du journal des colonies : c’est le titre que prend l’article, déjà cité, que signe un abonné
des Antilles, en 1864. Le journal des colonies se définit cependant toujours par son auteur, et
l’article, humoristique, se conclut ainsi :
Oh ! si d’un criminel, atteint par la justice, Le ciel même à mes soins remettait le supplice, Oui ! j’en atteste ici ce qui se passe en moi, Pour frapper ses pareils d’un salutaire effroi, Jetant au malheureux, d’une main vengeresse, Quelques cent abonnés, un prote et une presse, Je lui dirais soudain : D’un journal colonial, Monstre ! pour châtiment, sois l’écrivain banal304 !
La reconnaissance d’une catégorie de journalistes n’est pas signe ici de
valorisation : « l’écrivain banal », c’est la formule qui permet de rabattre les prétentions des
auteurs de presse, c’est aussi l’expression d’une reconnaissance de la réalité du journal colonial.
Le journal colonial devient un châtiment exemplaire : c’est peindre le monde colonial par l’un
de ses éléments les plus évidents, et le tourner en dérision.
Le journaliste peut être également représenté par les siens au moment de son décès, et
dans les colonnes du journal : nous voulons parler ici des nécrologies qui rendent compte de
carrières journalistiques coloniales. En 1872, quand meurt François Coquille, un collaborateur
du Moniteur de l’Algérie, la une du journal lui est ainsi consacrée. Le « principal rédacteur »
du quotidien officiel, né en 1805, est présenté sur le long cours : ancien élève du lycée Louis-
le-Grand, on mentionne de lui sa participation au feuilleton du Constitutionnel au début de sa
carrière. L’auteur de la nécrologie précise ensuite que Coquille « publia des causeries, des
303 « Courrier de Blidah », L’Écho de l’Atlas, 24 avril 1846. 304 Un abonné, « Le journal des colonies », Les Antilles, 17 septembre 1864.
102
Nouvelles – le roman-feuilleton ne s’était pas encore emparé du rez-de-chaussée des journaux
politiques ». On le signale ensuite collaborant au Moniteur de l’armée, traducteur pour la Revue
britannique, et enfin entrant dans une carrière administrative en Algérie : « Il y débuta, à
quarante ans, dans le modeste emploi de commis-rédacteur à 1800 francs, lui écrivain déjà coté
dans la presse de la métropole ! ». La nécrologie s’appesantit ensuite sur sa carrière médiatique
dans la colonie :
A la même époque, l’imprimeur Besancenez fondait la France Algérienne, en concurrence à L’Akhbar, le seul organe de publicité – sauf le Moniteur algérien – qui existât alors dans la Colonie. C’était un journal indépendant, libéral, mais conservateur. […] Cette collaboration d’une plume alerte et exercée fut bien vite remarquée et très goûtée des lecteurs de la France algérienne ; mais elle faillit porter malheur au novice bureaucrate305.
En effet, Coquille doit changer de service suite à un article « indiscret » concernant les
questions administratives. Le texte se termine sur l’idée que le journaliste bureaucrate « a droit
aux meilleurs souvenirs des algériens ». On voit donc ici une carrière représentative de
l’évolution de la colonie, et qui se confond avec sa vie médiatique. Entre la métropole et la
colonie, entre différents périodiques, François Coquille permet de mettre en place les éléments
d’un portrait plus large de la presse coloniale, qui s’intègre à un corpus médiatique national.
Car le rédacteur de la nécrologie ne mentionne pas ce qui apparaît sur l’avis de décès : son statut
de chevalier de la légion d’honneur, de conseiller de préfecture à la retraite, de veuf aussi. Il se
focalise sur les points qui identifient le journaliste et la presse algérienne, qui font du parcours
de l’homme un reflet de la position de la presse. Un mois plus tard, Le Moniteur de l’Algérie
doit encore se livrer à cet exercice, quand décède M. A. de Bellecote, l’un des rédacteurs de
L’Est algérien « que nous avons eu souvent occasion de citer dans notre Revue de la presse
algérienne306 » : est repris alors le texte de La Seybouse, autre périodique de la région de Bône.
Le texte est moins significatif que pour François Coquille ; mais la reprise d’un périodique
colonial à l’autre montre bien une forme de solidarité de la presse algérienne autour de ses
journalistes.
L’auteur de presse coloniale, un journaliste ? Une question de scénographie L’auteur de la presse coloniale n’est souvent qu’un journaliste occasionnel : le
rédacteur, souvent gérant, signe la plupart des articles, et il s’adjoint la collaboration d’hommes
qui peuvent signer des textes sans que cela soit leur activité principale. Le lexique même du
305 Le Moniteur de l’Algérie, 1er novembre 1872. 306 Le Moniteur de l’Algérie, 3 décembre 1872.
103
journalisme peut constituer un premier obstacle à la compréhension du statut des auteurs, en
même temps que le choix des termes signale en fait l’adoption d’une certaine posture d’écriture.
C’est très clairement en tout cas au début de la Monarchie de Juillet que s’imposent dans l’usage les mots de Presse, journal et journaliste pour recouvrir l’ensemble du secteur des périodiques et des professionnels s’occupant à livrer le récit de l’actualité dans les registres les plus divers et singulièrement dans celui de l’actualité politique307.
Il s’agit donc de pouvoir relire l’époque en tenant compte de la manière dont le
« journaliste » n’est pas un auteur bien défini : ce « flou » permet en fait une certaine liberté
dont nous pouvons profiter. En outre, la situation particulière de la colonie et des journaux qui
s’y impriment peuvent inviter à penser que le « récit de l’actualité » qui se fait sur ces territoires
est différent de celui qui se fait en métropole ; partant, que les journalistes qui écrivent ce récit
bénéficient d’une identité à part, qui devrait être interrogée. L’on peut ainsi reprendre et faire
varier les catégories littéraires attendues : éthos, posture, styles trouvent à enrichir la définition
du journaliste colonial. Au sein de la mosaïque d’auteurs qui composent un corpus aussi vaste
que le nôtre, il s’agit aussi de trouver des points communs : outre le support médiatique en
situation coloniale, que peut-on retrouver ?
Nous avons étudié quelques biographies d’auteurs ; en franchissant un niveau
supplémentaire, l’on peut interroger la construction du journaliste dans le texte, les noms
d’auteurs qui apparaissent en fin d’articles, les voix qui émanent du journal : et c’est bien une
interrogation d’époque que celle du journaliste comme personnage308. La restriction du lectorat
à la communauté coloniale, les échos que provoquent les articles inclinent à penser que l’auteur
en régime médiatique pourrait presque tenir davantage du locuteur que de l’auteur tout-puissant
que peut représenter le journaliste309. Une forme de connivence s’instaure entre le lecteur du
journal et l’auteur qui en signe certains passages : le lecteur sait qu’il le retrouvera de jour en
jour, de semaine en semaine. Cette connivence invite même à penser que le lecteur et le
journaliste découvrent en même temps et construisent en même temps leur connaissance de la
colonie : l’on peut esquisser ici un rapprochement entre le statut problématique de l’auteur
médiatique et ce que Paul Zumthor dit de l’auteur médiéval, précisant justement qu’il est
davantage locuteur qu’auteur : on ne sait quand il « signe » s’il est auteur, récitant ou copiste310.
Nous avons, à l’inverse, hérité et retravaillé une définition de la littérature toute romantique,
307 Pascal Durand, « Presse ou médias, littérature ou culture médiatique ? Question de concepts », COnTEXTES, n° 11, mai 2012. URL : http://contextes.revues.org/5392. Consulté le 2 septembre 2014. 308 Voir notamment Guillaume Pinson, L’Imaginaire médiatique. Histoire et fiction du journal au XIXe siècle, Paris, Garnier, 2012. 309 Jules Janin, « Le Journaliste », Les Français peints par eux-mêmes, Paris, Curmer, 1840-1842. 310 Paul Zumthor, Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, 1972.
104
qui passe par la sacralisation de l’auteur, de l’originalité, du génie créateur – quand bien même
on le déclare mort, ce qui est une manière comme une autre d’en faire un point majeur de la
réflexion. Le journaliste colonial est auteur, mais pas écrivain : il n’a pas pour lui ce « style »
individualisant, cet idiolecte qui marque la présence d’un grand écrivain ; il a les contraintes de
la ligne éditoriale de son journal, la surveillance de son rédacteur, la censure planant au-dessus
de la publication ; il n’a pas, enfin, le temps de relire ou de retravailler à l’excès ses textes, qui
sont courts. On pourrait continuer ainsi la liste des critères qui rendent problématiques
l’appartenance du journaliste colonial à la catégorie des « écrivains » : pourtant, c’est bien à la
même période, en parallèle et en opposition, que se construisent les deux catégories du
journaliste et de l’écrivain. Mais les journalistes coloniaux revendiquent une dignité plus
élevée : le rédacteur de L’Écho d’Oran introduit la publication d’un texte poétique en précisant
ainsi que « la poésie est comme l’hirondelle, elle va où le ciel est bleu, écrivait, il y a quelques
années M. Victor Hugo à l’un de nos collaborateurs311 ». Le lien est fait alors entre la
« littérature industrielle » dont l’expression remonte à Sainte-Beuve et la littérature
« vocationnelle312 » : c’est en passant par les auteurs que le journal tisse ce lien. Le journaliste
colonial n’obéit donc pas au schéma que l’on pourrait attendre, aux étapes de « l’apprentissage
de l’homme de lettres » que le XIXe siècle développe. Le journaliste colonial n’est pas
forcément jeune ; il a souvent une carrière administrative derrière – ou devant – lui ; il ne vise
pas à une reconnaissance littéraire, mais plutôt à un épanouissement politique sur le territoire
colonial. De là une portée plus idéologique qu’esthétique, et la mauvaise réputation, voire
l’absence de réputation, des écrits médiatiques coloniaux : ils sont destinés à ne pas être séparés
de l’entreprise coloniale, à n’en être qu’un rouage, au même titre que leur lecteur.
Le journaliste, l’imprimeur, l’éditeur : un réseau entre colonie et métropole Le journaliste colonial, en tant que type social, est un homme intégré à un réseau culturel
qui le dépasse, mais dont souvent l’activité tourne aussi autour de la colonie, de sa
reconnaissance et de son rayonnement. Un extrait de L’Indépendant de Constantine donne
l’idée de cet entourage et du but affiché par les auteurs qui gravitent autour du journal colonial :
l’on y lit des noms connus, ainsi que le projet de faire connaître la colonie ailleurs. L’on y
trouve aussi la mention des « Algériens » en tant que groupe colonial constitué.
Nous recevons le premier numéro de l’Algérie illustrée. Nos lecteurs comprendront en le lisant pourquoi il nous est interdit de faire l’éloge du texte ; nous sommes un des collaborateurs de l’œuvre. Il nous sera bien permis, cependant, d’appeler l’attention du public sur les articles
311 L’Écho d’Oran, 23 septembre 1848. 312 Voir Pascal Durand, art. cit.
105
signés E. Thuillier, de la Tréhonnais, Berbrugger, Achille Huré, Charles Brosselard, etc. Les dessins sont faits avec une perfection extrême par M David de Noter, bien connu dans le monde artistique. L’éditeur est Ch. Lahure dont la réputation n’est plus à faire et dont les ateliers de gravure sont les premiers de la capitale. En résumé, cet ouvrage qui formera tous les six mois un magnifique volume a pour but d’attirer vers l’Algérie le flot de l’immigration européenne, de faire connaître cette magnifique terre à peine explorée dont les richesses sont inépuisables. Il embrassera, comme une encyclopédie, tous les sujets, tous les intérêts : les sciences, la littérature, l’agriculture, le commerce et l’industrie, au point de vue de la colonisation. C’est plus qu’il n’en faut pour lui valoir le concours sympathique de tous les Algériens313.
Tous les journaux sont défendus en effet par un imprimeur ou un libraire sur lequel il
serait possible d’effectuer une étude approfondie afin de faire apparaître le réseau culturel de
l’écrit dans les colonies – le cadre serait ici trop large. Quand Le Brûlot de la Méditerranée
lance en 1849 un appel à la souscription pour payer son cautionnement, les fonds sont à adresser
au bureau du journal, au libraire Hartmann à Blida et chez les correspondants du périodique314.
Mais un réseau plus large que ces trois ancrages se dessine si l’on lit, en une, le bandeau qui
rappelle les possibilités d’abonnement : M. Espa à Médéah, le libraire Châtelain à Mostaganem,
l’imprimeur Perrier à Oran315, le libraire Moulte à Philippeville, M. Ameline à Constantine, le
libraire Chaix à Marseille, et enfin Lejollivet et Cie à Paris. Se dessinent également des
coopérations entre les éditeurs métropolitains et les productions littéraires coloniales. L’éditeur
Challamel, spécialisé dans les récits exotiques et coloniaux, commissionnaire pour la marine et
les colonies, offre des abonnements au Moniteur de la Nouvelle-Calédonie ; il collabore aussi
avec des éditeurs de Constantine ou Alger pour la publication de certains auteurs connus dans
le monde médiatique algérien. La liste des titres publiés chez Challamel comprend des textes
poétiques : Ausone de Chancel y fait paraître sa Première algérienne316 et M. Marie-Lefebvre
Les Angoisses317, deux recueils évoqués dans Le Moniteur de l’Algérie. Sur un autre thème et
sous une autre forme, Adrien Berbrugger publie une sérieuse étude sur Les puits artésiens des
oasis méridionales de l’Algérie318. Ces trois auteurs sont connus des lecteurs de la presse
algérienne, notamment du Moniteur ; mais Challamel ne se limite pas à ces textes : l’on trouve
aussi, dans les coopérations qu’il entretient avec l’autre rive de la Méditerranée, des Dialogues
français-arabes : avec le mot à mot et la figuration en caractères français319 écrit par Tahar
313 C. Allan, « Nous recevons le premier numéro », L’Indépendant de Constantine, 11 février 1872. 314 Le Brûlot de la Méditerranée, 31 août 1849. 315 C’est cet Adolphe Perrier qui a fondé L’Écho d’Oran en 1844 et qui a aussi fait paraître Les Oranaises, poésies de Paul-Eugène Bache, en 1850. 316 Publication chez Bastide (Alger), Arnolet (Constantine) et Challamel (Paris) en 1860. 317 Publication chez Dubos frères (Alger) et Challamel (Paris), en 1859 318 Publication chez Bastide, Alessi et Arnolet (Constantine) et Challamel (Paris) en 1862. 319 Publication par Alessi et Arnolet (Constantine) et Challamel aîné (Paris), en 1863.
106
ben Neggad, et le cas intéressant de Hanina, la vierge de Constantine, roman algérien320, par
Eugène Vayssettes. Tahar ben Neggad et Eugène Vayssettes (1826-1899) sont interprètes ; le
premier est appelé ainsi sur la page de garde de ses Dialogues321 ; le second par son emploi de
professeur au collège d’Alger. Il a été interprète pourtant, « disciple d’Auguste
Cherbonneau322 », auteur d’un manuel et d’un récit de voyage ; son roman incarne bien la
conscience d’une forme littéraire propre au territoire algérien, et c’est en ce sens que la double
publication est intéressante. Ces quelques titres montrent aussi que le journal colonial rejoint
chez Challamel son corollaire littéraire, si l’on peut qualifier ainsi les titres que fait paraître la
maison d’édition323. Le dernier titre cité, le « roman algérien » d’Eugène Vayssettes, permet de
s’arrêter un instant sur Louis Marle, imprimeur à Constantine. Ancien déporté politique de
1851, né à Mâcon mais exerçant à Paris avant le coup d’état, c’est sur ses presses qu’est tiré
L’Indépendant de Constantine, journal républicain fondé en 1858. Sa fiche politique, mise en
ligne par des chercheurs de l’Université de Bourgogne, le décrit avec les mots suivants :
« Antécédents détestables. Homme dangereux. Affilié aux sociétés secrètes. Socialiste très
exalté324 ». Ce profil particulier qu’est celui de Marle modifie la perception du paysage
médiatique algérien : non seulement il s’y trouve des titres républicains, mais encore les
déportés politiques y exercent des activités intellectuelles qui ne sont pas réprimées outre-
mesure, et qui peuvent trouver des répercussions jusqu’à Paris par échange de journaux ou par
collaborations éditoriales.
Sur l’île de la Réunion, l’imprimeur Lahuppe (Pierre-Marie) chez qui on imprime La
Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon en 1830 ou L’Indicateur colonial dans les années 1840
porte le même nom que Gabriel et Gaston Lahuppe, chez qui Rougier fait imprimer La Semaine
illustrée en 1879 : une famille d’imprimeurs se devine ainsi, fondant une continuité médiatique.
Mais la famille ne s’arrête pas là : Ernest Lahuppe, alias Sylvien, est un journaliste accompli
de la presse réunionnaise, feuilletoniste et critique de la Feuille éditée par son père, actif dans
les années 1840325. Enfin, en Guyane, le Feuille officielle sort de l’imprimerie du
Gouvernement, ce qui limite les études sur le rôle de l’imprimeur. Mais l’on peut repérer
320 Publication chez L. Marle (Constantine) et Challamel (Paris), 1873. 321 Voir Jean Déjeux, Dictionnaire des auteurs maghrébins de langue française, Paris, Karthala, 1984, p. 66. Il précise à son sujet qu’il devient interprète en 1855, et décède en 1863. Son nom n’est pas apparu ailleurs au cours de nos recherches. 322 Alain Messaoudi, Les Arabisants et la France coloniale. 1780-1930 : savants, conseillers, médiateurs, Lyon, ENS Éditions, 2015, p. 249. 323 Les titres cités sont principalement issus du catalogue de la BNF. 324 Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d'État de décembre 1851. URL : http://tristan.u-bourgogne.fr/1851.html. Consulté le 7 décembre 2016. 325 Fabienne Jean-Baptiste, op. cit., p. 1145-1147.
107
certains phénomènes de publication : ainsi, du 27 mai au 17 juin 1871, un « Voyage chez les
Indiens de la Guyane » paraît en feuilleton, sous la signature d’Arthur Delteil, pharmacien de
1e classe de la Marine et chevalier de la Légion d'honneur (1835-1905). L’ouvrage sera republié
en 1886 sous forme de recueil, chez un L. Mellinet, éditeur nantais ; sans surprise, ses autres
ouvrages paraîtront surtout chez Challamel.
Cette étude sur le « journaliste colonial » peut se clore sur une ultime variation, trouvée
dans Le Commercial de 1861 : présentant la reproduction abrégée d’un « excellent, un
remarquable article sur la législation de la presse aux Colonies » pris dans Les Antilles, le
rédacteur souligne que l’étude émane d’un « écrivain dont les destinées ont été liées très
longtemps à celles du journalisme créole326 ». Le « journalisme créole » est bien à entendre ici
comme une déclinaison particulière du « journalisme colonial » trouvé ailleurs, et il en apparaît
comme un avatar territorial, plus précis et plus ancré. La mémoire nationale n’a pas conservé
la trace de ces journalismes extrêmement territoriaux, alors que l’époque que nous étudions
mettait en avant cette facette de l’écriture médiatique.
3 « Tu t’imagines, mon cher ami » : la réception du journal colonial
La représentation du lecteur est-elle la même selon que le journal est métropolitain ou
réunionnais, qu’il est distribué à Paris ou à Oran ? On sait l’importance de la presse dans la
constitution de ce que Benedict Anderson a appelé les « communautés imaginées » :
Le sens de cette cérémonie de masse – la lecture du journal est pour l’homme moderne un substitut de la prière matinale, observait Hegel – est paradoxal. Elle s’accomplit silencieusement, en privé, dans les méandres du cerveau. Pourtant, chaque communiant sait pertinemment que la cérémonie qu’il accomplit est répétée simultanément par des milliers (ou des millions d’autres), dont il connaît parfaitement l’existence même s’il n’a pas la moindre idée de leur identité. De surcroît, cette cérémonie se répète sans cesse, à intervalles quotidiens ou semi-quotidiens, au rythme du calendrier. Peut-on envisager figure plus vivante de la communauté imaginée séculière, historiquement chronométrée327 ?
Cette remarque est-elle applicable au contexte colonial ? La lecture coloniale n’est pas
la lecture métropolitaine, et c’est même là que réside toute l’ambiguïté initiale de la
communauté coloniale : le rapport à la temporalité n’est pas le même. Le lecteur de la presse
coloniale, s’il veut lire un journal adapté à son environnement, aux nouvelles relativement
326 Le Commercial, 2 février 1861. 327 Benedict Anderson, L’Imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, La Découverte et Syros, [1983], 2002, p. 46.
108
fraîches, aux référents qui le concernent directement, n’a accès qu’à quelques titres, souvent
tirés à peu d’exemplaires. Il est à l’écart de la « cérémonie » métropolitaine : les journaux ne
lui parviennent qu’avec retard, et il ne peut « communier » si facilement avec le reste de sa
communauté nationale – cette difficulté constitue l’un des repères de l’identité coloniale. D’où
l’intérêt d’étudier ici les figures du lectorat colonial, en tenant compte de la particularité de ces
lecteurs. C’est bien ce que fait Charles-André Julien, dans son Histoire de l’Algérie
contemporaine, quand il consacre un passage de ses annexes à la presse. Il y affirme notamment
que « la presse française d’Algérie présente un grand intérêt car elle révèle, à plein, les passions
des colons328 » : la presse coloniale algérienne est bien celle d’un petit groupe qui se replie sur
lui-même. Le lecteur du journal colonial, disons le colon pour une portée plus générale, a existé,
qu’il soit abonné, acheteur occasionnel ou auditeur d’une lecture publique ou familiale : mais
nous n’avons pas accès à lui. Il reste donc à construire l’image du lecteur colonial par plusieurs
rubriques et par plusieurs approches : en commençant par les textes du journal qui tendent à
faire le portrait du lecteur empirique, l’on peut ensuite passer à la question du lecteur idéal que
le journal dessine dans sa vocation pédagogique ; enfin, la question du lecteur métropolitain se
pose aussi, eu égard au réseau d’échanges et de distribution des périodiques coloniaux.
3.1 La réalité – visée – du lecteur colonial
La réclame présente dans la quatrième page des périodiques montre que ce sont
véritablement des coloniaux qui sont visés au premier abord : c’est à eux que l’on vend les
marchandises venues de métropole, c’est pour eux que les libraires annoncent leurs livres en
vente. Cela mis à part, il reste peu de traces des lecteurs de journaux : pour un Aumérat, déjà
cité, qui raconte son arrivée en Algérie en mentionnant sa lecture du journal colonial, combien
d’expériences quotidiennes de la presse sont coupées de notre connaissance ? Pourtant cette
scène inaugurale, le premier matin que passe Charles Aumérat à Alger, fait entrer en scène la
presse comme élément essentiel :
Quand j’arrivai à Alger, le 26 janvier 1842, le journalisme n’avait pas fait de grands progrès, je pus le constater le lendemain matin en prenant une tasse de chocolat au café d’Apollon qui était alors le plus grand café d’Alger. Sur ma demande on m’apporta le seul journal paraissant en Algérie : il était d’un petit format et paraissait deux fois par semaine ; il portait un nom arabe, L’Akhbar329.
328 Charles-André Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, PUF, 1979, p.510. 329 Joseph-François Aumérat, op. cit., p. 365.
109
Aumérat ici nous apporte, dans son rôle de lecteur, une précision intéressante : pour lui,
ou pour le garçon de café à qui il demande un journal, Le Moniteur algérien, qui existe pourtant
à cette date, n’est pas un journal digne de lecture, parce qu’il est un titre officiel, un journal de
fonctionnaire et non un périodique privé. L’on retrouve la mention du « nom arabe » étudié plus
haut : c’est en effet un des traits de la colonie que cet ancrage linguistique qui doit marquer le
lecteur quand il se procure son journal. D’autres ouvrages nous signalent encore des lecteurs
occasionnels de la presse coloniale – entendue comme presse locale publiée dans les colonies.
Si l’on sort un peu des bornes de notre corpus, on rencontre ainsi un juge lisant Le Messager de
Tahiti pour mieux faire – injustement – condamner un marin jugé pour plusieurs meurtres dans
les eaux tahitiennes. Le journal colonial apparaît comme une preuve silencieuse mais
irrévocable entre les mains du juge : plus encore que la parole de l’accusé, il a valeur de
témoignage, puisqu’il provient de la région où a été commis le crime.
Je fus outré du sans-gêne de ce juge et m’arrêtai de parler, pour le regarder fixement, croyant ainsi, par mon brusque silence, appeler son attention.
Je pouvais lire, quoique voyant les lettres à l’envers, le nom du journal, « le Messager de Taïti », et en-dessous, en grands caractères : « Scènes de piraterie dans le Pacifique. Horrible assassinat. Sept victimes. »
Ce que j’avais prévu arriva. Le juge baissa le journal, me jeta un coup d’œil, distrait, vague, mort, et, flegmatiquement, continua à lire330.
Ce que révèle cette scène glissée dans le récit, c’est la foi que le lectorat – métropolitain
particulièrement – peut avoir dans ces publications médiatiques qui sont considérées comme
l’écho véridique de ce qui se passe dans les colonies, comme des témoignages dont la légitimité
et l’authenticité ne sont pas mises en doute. Le juge ici préfère lire le journal local plutôt que
d’écouter la parole vive de l’accusé : le poids symbolique de la presse en est clairement établi.
En-dehors de ces furtives apparitions de lecteurs de la presse coloniale, impossible de dresser
un tableau complet des habitudes de lecture ou du lecteur empirique. Par détour, cependant, et
en variant les approches, on peut se livrer à une forme de reconstitution : c’est ce que nous
ferons, en commençant par un aspect visuel particulièrement utilisé dans la presse coloniale
dans un but de mise en abyme, autrement dit la caricature. Nous pourrons ensuite étudier les
appels aux lecteurs contenus dans la presse, et enfin les courriers tels qu’ils sont présentés dans
les périodiques.
330 Eugène Degrave, Le Bagne : Affaire Rorique, Paris, Stock, 1901, p. 125.
110
Représenter les lecteurs de la presse coloniale
En règle générale, la presse satirique coloniale excelle à représenter les querelles entre
journaux, partant les différences entre lecteurs visés par ces journaux. C’est de ces premières
représentations, caricaturales et extrêmement locales, que l’on peut partir pour développer
ensuite de l’image des lecteurs de la presse coloniale. Le Chitann, par exemple, prend une pleine
page pour peindre les lecteurs de la presse locale algérienne, sous le titre « Dis-moi ce que tu
lis, je te dirai qui tu es331 ». Placés au centre, les lecteurs du Chitann sont entourés (entre autres)
par un colporteur lecteur du Moniteur algérien, un douanier lecteur du Courrier de l’Algérie,
un convalescent qui tient L’Akhbar, un indigène assis sur Le Mobacher (qui signale ainsi
l’échec de la politique des bureaux arabes), un militaire en train de lire Le Journal des colons…
Est aussi représenté, comme déchet, l’un des concurrents du Chitann, Le Moqueur. Tous ces
personnages sont constitutifs de l’identité coloniale algérienne, même s’ils ne lui sont pas
spécifiques : la rédaction du Chitann ne fait que leur attribuer un journal comme attribut
supplémentaire de leur identité coloniale, et décline ainsi un principe plus général de
représentation des lecteurs de journaux. Ce type de représentations illustrées qui visent les
lecteurs des journaux n’est en effet pas propre seulement aux colonies : le lecteur du journal est
un sujet intéressant pour la presse en général. Mais la particularité coloniale tient à la
représentation des éléments humains de la colonie, et au nombre restreint de journaux : il faut
peindre l’administrateur, le soldat, l’indigène pour rendre compte de la vie coloniale et faire
advenir le sourire de connivence du lecteur colonial.
331 « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es », Le Chitann, 19 avril 1866.
111
Dans la presse réunionnaise, l’on trouve ce même type de représentations de lecteurs
coloniaux – qui sont plongés dans la lecture de périodiques tout aussi coloniaux. Au cours du
« Voyage de Monsieur Chose dans la mer des Indes332 », le héros découvre ainsi un lecteur de
La Malle qui correspond aux stéréotypes racistes répandus dans les autres vignettes de
l’histoire, et dans le reste du journal : la paresse coloniale est traitée ici avec le détail du journal.
332 « Le Voyage de Monsieur Chose dans la mer des Indes », La Semaine illustrée, 31 août 1862. D’autres titres réunionnais préfèrent personnifier les journaux plutôt que de représenter leurs lecteurs.
112
Il est vrai que, dans les représentations coloniales, le temps de la lecture du journal s’apparente
à une oisiveté que l’on condamne : faire le portrait d’un lecteur paresseux, c’est prendre le
risque de dénoncer l’objet même du journal.
Si l’on quitte la presse satirique, l’on peut remonter un peu en amont des années 1860
et trouver d’autres représentations de lecteur, textuelles cette fois-ci, qui investissent des formes
d’écritures différentes. Un poème humoristique paru dans Le Brûlot de la Méditerranée en août
1848 mêle ainsi l’obsession coloniale pour le journal et une mention assassine concernant les
abonnés de L’Akhbar : transposé à une représentation textuelle et non à une vignette, c’est le
même fonctionnement que la publication de la Semaine illustrée que nous avons reproduite ci-
dessus. D’un côté l’on désigne le journal colonial comme un élément essentiel de la colonie ; de
l’autre, l’on en profite pour citer et moquer un périodique ennemi. Le Brûlot de la Méditerranée
complique seulement le portrait du colonial par quelques points :
Dans le courrier dernier j’avais mes espérances, J’attendais un emploi. L’inspecteur des finances M’aura fort mal noté. Comprends-tu ce faquin, Un homme comme moi ?... Fougueux Républicain, Que ne suis-je resté fidèle philippiste ? J’aurais fait un journal intitulé Canard. On ne t’aurait pas lu. – Pourquoi pas ? Mais L’Akhbar Qui bredouille toujours et ment comme un dentiste,
113
A-t-il des abonnés ? Quinze-cent cinquante-un. Ceci ne prouve rien. Ce journal est cyclique ; - Oui. Mais il ne dit mot de la chose publique, Et tous ses abonnés n’ont pas le sens commun333.
Le poème est ici le vecteur de représentation de différents lecteurs de la presse
coloniale : écrit d’une plume rapide et sans grande portée, il brocarde rapidement les (autres)
lecteurs de la presse. Le lecteur que l’on apprend à connaître dans ce texte est l’un des piliers
de la société coloniale : l’employé du gouvernement, qui vit pour les nouvelles reçues de la
métropole. L’on retrouve également dans ce poème humoristique tous les éléments de la vie
coloniale régie par l’administration : le courrier qui apporte les nouvelles, la présence fortement
marquée de la hiérarchie, les retournements politiques, et enfin le journal apolitique.
Plus largement, le lecteur que vise la presse coloniale peut posséder différentes facettes :
c’est l’employé du gouvernement, mais c’est aussi et surtout l’habitant, le colon. C’est de
l’habitant en effet que la colonisation tire sa justification et son assise, puisqu’il s’agit de
« mettre en valeur », selon le vocabulaire d’époque, des terres. D’où des textes à vocation
pédagogique, qui dessinent en creux ce que ce type de lectorat doit faire : la presse coloniale a
une portée pragmatique que l’on ne comprend que si l’on s’intéresse à ce que ses lecteurs
recherchent. L’on touche ici à un autre degré encore d’images du lectorat. L’Avenir
guadeloupéen publie le 27 juin 1854 « Le bon Habitant », texte signé Serpette – il précise qu’il
est membre correspondant de plusieurs sociétés d’agriculture. Suit un sous-titre : « Ses
connaissances, ses qualités ; comme pédagogue, il civilise le naturel affranchi et combat
l’isolement du cultivateur ». Vient ensuite le texte à proprement parler :
Il ne s’agit plus maintenant de parcourir plus ou moins lentement la route frayée par ses ancêtres ; la routine a fait son temps. Les circonstances sont changées ; les procédés de l’esclavage ne peuvent convenir à un temps de liberté334.
Sous le couvert d’une typologie à laquelle sont habitués, stylistiquement au moins, les
lecteurs des années 1840 – l’on peut penser à la littérature des physiologies à la lecture du titre
« Le bon habitant » – Serpette donne ici des conseils précis à un lectorat que l’on devine encore
peu habitué à l’abolition de l’esclavage, qui n’a pas encore fêté ses dix ans. La communication
s’établit de fait entre le savant qui s’exprime dans le journal et le lecteur colonial modèle qu’il
vise.
333 A. Loubignac, « Vue de la tente », Le Brûlot de la Méditerranée, 31 août 1848. 334 Serpette, « Le Bon habitant », L’Avenir, 27 juin 1854.
114
De l’image au sens strict à la représentation par mention, jusqu’au portrait en creux que
l’on fait de lui, le lecteur de la presse coloniale n’est pas seulement l’un des pôles de la
communication médiatique : il est aussi l’un des constituants du texte médiatique, et ce d’autant
plus que le contexte colonial crée une égalité apparente entre les colonisateurs, égalité bien plus
forte que sur le sol métropolitain. L’« aventure » coloniale telle qu’elle est présentée aux
colonisateurs ou aux candidats pour le départ témoigne bien de ces nouveaux rapports de force
que le territoire colonial permet : la presse en garde les traces.
Faire entendre la parole des lecteurs : le rôle du courrier Il n’y a pas, dans les journaux coloniaux de notre corpus, de rubrique spécialement
dédiée au courrier des lecteurs : sans doute la régularité de publication n’aurait-elle pas permis
de remplir une telle rubrique. Pourtant, les lecteurs peuvent s’exprimer s’ils le souhaitent, et le
journal publie alors leurs récriminations, plaintes sur l’état des routes, autres menues
affaires : venues de différents endroits de la colonie, souvent éloignés des villes principales, ces
lettres témoignent de l’étendue du territoire colonisé. Elles témoignent également, par leurs
appels à l’autorité administrative, du lien avec le gouvernement colonial, et donc du lien avec
l’autorité nationale au sens large. Le lectorat se trouve face à la tension qu’il connaît : un
ancrage local fort, matérialisé par les lettres, et un lien à la mère-patrie également fort, signalé
par la publication même des lettres dans des périodiques qui rappellent la nation et en appellent
au gouvernement. La référence à la nation, à la patrie, est l’une des constantes de la presse
coloniale ; en conséquence de quoi la distance à cette patrie devient pour le lecteur l’occasion
d’exprimer ses sentiments face à la patrie lointaine. Un exemple de cette expression peut se lire
dans un extrait du Commercial, journal guadeloupéen qui fait paraître en première page de son
numéro du 13 août 1862 une lettre de réclamation adressée au directeur du Constitutionnel :
Un de nos amis, abonné au Constitutionnel, vient d’adresser la lettre suivante au directeur de cette feuille :
Pointe-à-Pitre, le 10 août 1862 (Guadeloupe) Monsieur,
Je suis un de vos plus anciens abonnés de la Guadeloupe et pendant plusieurs années j’ai reçu votre journal sous une bande qui n’outrageait pas la géographie de nos Antilles.
Mais voilà que depuis le dernier renouvellement de mon abonnement votre compositeur de bandes et votre prote ont eu la fantaisie de placer la Pointe-à-Pitre à la Martinique, ce qui fait qu’à chaque packet mes journaux vont visiter cette dernière île, que le steamer n’atteint que dix heures après avoir touché la nôtre, pour me revenir quelques jours après. C’est un retard fort désagréable.
Pauvre Guadeloupe ! jusqu’à présent on n’avait pris que son café pour en faire une production de la Martinique, qui n’en fournit même pas au besoin de ses habitants ; et voilà qu’on lui prend sa Pointe-à-Pitre, cette reine des Antilles, comme on disait autrefois.
115
Je crois, au train des choses, qu’il faudra bientôt qu’un nouveau Christophe vienne nous découvrir pour que la France nous rapprenne. Je vous en prie, Monsieur, rendez la Pointe-à-Pitre à la Guadeloupe, au moins sur les bords de votre journal335.
Tout humoristique qu’il soit, ce texte oppose clairement un « nous » à la figure de
l’explorateur européen, et les Antilles à la France : l’abonné du Constitutionnel est surtout un
habitant colonial dont la réclamation plaisante est suffisamment répandue pour qu’elle trouve
sa place dans Le Commercial. En outre, d’après nos vérifications, la lettre n’a pas été publiée
dans Le Constitutionnel : la réclamation, si elle a effectivement été envoyée, n’aura pas franchi
les bureaux du journal. Cela confirme qu’elle vaut davantage pour les lecteurs coloniaux que
pour les lecteurs métropolitains ; par cette protestation humoristique, le rédacteur donne à voir
un lieu commun de l’identité coloniale : les métropolitains ne connaissent pas les colonies, la
mère-patrie ne s’occupe pas de son outre-mer. Le même Commercial est justement visé par son
confrère L’Avenir à de nombreuses reprises, mais particulièrement par un texte qui prend
justement les apparences de la lettre. Les lettres de lecteurs peuvent aussi être le matériau d’une
espèce de mise en abyme, comme celle que produit un auteur anonyme, désigné par sa
commune d’origine en Guadeloupe : les « Lettres d’un Grandfonnier » qui paraissent dans
L’Avenir en 1867 donnent à lire un auteur spirituel qui finit par se montrer en collaborateur du
journal. Dans l’une de ses lettres d’août, on lit ainsi :
Monsieur le Rédacteur, Le Grandfonnier est très en colère ce matin. Voici pourquoi :
Arrivé hier soir, après une assez longue journée, je trouve sur votre bureau une douzaine de lettres et je me mets à les ouvrir, conformément à vos ordres.
La première venait de la Basse-Terre et contenait ces quelques lignes : « Monsieur, depuis quelques temps, votre journal n’arrivant plus qu’après un jour de retard, je vous prie de bien vouloir arrêter mon abonnement ».
Je mets la lettre de côté, avec un peu d’humeur, naturellement, et passe à la seconde, datée du Port-Louis et contenant ce qui suit : « Monsieur, depuis quelques temps, votre journal nous arrive assez irrégulièrement et si cela continue, je prendrai un abonnement au Commercial ».
Pour le coup je fis une boulette de la lettre et la lançai dans le panier.
Fendez-vous donc la tête, Monsieur le Rédacteur, cassez-vous le cou, faites dont des tournées générales, sans vacations, pour signaler à l’administration le mauvais état des ponts, des chaussées, des chemins et recevoir à votre retour et pour prix de vos peines et fatigues, un désabonnement et une menace de passer au Commercial336 !
335 Le Commercial, 13 août 1862. 336 « Lettres d’un Grandfonnier », L’Avenir, 16 et 20 août 1867.
116
C’est une manifestation originale de la concurrence entre les titres que l’on peut lire ici :
sous le couvert de la lettre au rédacteur, forme d’une chronique régulière que le Grandfonnier
envoie, le lecteur découvre un épisode de la vie du journal. La citation des deux prétendues
lettres reçues permet à la fois de montrer l’importance du lectorat dans la vie du journal (et du
journaliste) en même temps qu’elle donne une impulsion à l’article. Grâce aux supposés
courriers des lecteurs, le Grandfonnier change de ton, devient polémique, se décrit en action :
dans cette mise en scène du fonctionnement médiatique, le traitement épistolaire autorise donc
une animation qui signale la proximité entre le journaliste et son lecteur.
Enfin, quelques lettres émanent d’instances reconnues, et transforment encore la relation
entre le lecteur et le journaliste, comme dans cet extrait du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie,
où le discours du rédacteur introduit et commente la lettre qui lui a été adressée :
Nous recevons de Monsieur le R.P. Rougeyron, provicaire apostolique, une lettre qu’il nous prie de faire insérer au journal ; elle a pour but de rectifier le passage suivant des nouvelles locales données au numéro du 1er mai :
« Au même moment, le second chef de Monéo fut tué sur ordre de celui de Pounérihouen, appelé aussi chef des Attinens, pour avoir mangé de la chair humaine. Ce soi-disant catholique avait donc, de sa propre autorité, infligé à son subordonné la peine du talion ». Nous nous empressons de satisfaire Monsieur le provicaire apostolique : Conception, le 13 mai 1864, Monsieur,
On vient de me faire remarquer que, dans le numéro du 1er mai du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, vous donnez au chef des Attinens ou de Pounérihouen, le titre de soi-disant catholique. J’en ignore les raisons ; mais je puis affirmer d’une manière positive qu’il n’est ni catholique, ni chrétien. Non-seulement il n’est pas baptisé, mais il n’est jamais fait instruire sérieusement de la doctrine chrétienne, il n’a jamais renoncé à la polygamie, non plus qu’aux superstitions qui constituent le culte des indigènes néo-calédoniens. Toute sa bienveillance s’est bornée à tolérer, sur le territoire de sa tribu, les visites et le séjour momentané d’un missionnaire qu’il traitait assez bien. […] Je suis, avec respect, Monsieur, etc. Signé : ROUGEYRON, prov. » La lettre ci-dessus confirme les détails que nous possédions sur certains actes des tribus d’Attinens et de Monéo. Quant au titre donné au chef de Pounérihouen, elle infirme purement et simplement la prétention de ce chef, comme nous avions cru le faire nous-même : « SOI-DISANT, adjectif invariable que l’on emploie quand on ne veut pas reconnaître la qualité que prend un individu (Dictionnaire général de Bescherelle aîné, éditions de 1853 et 1861) SOI-DISANT, prétendant être, se disant être (Dictionnaire universel de la langue française de Boiste, 12ème édition (1847), revue et corrigée par Charles Nodier, de l’Académie française, et Louis Barré, professeur de philosophie). »
117
Le Rédacteur de l’article « Nouvelles locales » du journal du 1er mai, A. MATHIEU337
Ce long échange que le journal reconstitue résonne comme la démonstration d’une
facette du fonctionnement médiatique : le rédacteur signe son article une fois la contestation
effectuée, et ne publie la lettre que pour mieux montrer son inanité. À la longueur de la lettre –
que nous avons coupée, mais que le journal reproduisait intégralement – répond la brièveté des
citations du dictionnaire ; à la parole du père Rougeyron, qui se peint en témoin et expert de la
société kanak, répond la parole d’un journaliste qui se borne à reprendre les mots utilisés. Le
lecteur quand il écrit à la rédaction de son journal peut aussi, et ce sera notre dernier point,
apparaître de manière détournée : ainsi de ces réponses que publie L’Avenir guadeloupéen pour
quelques numéros, en 1847, et que nous reproduisons ici. Sous la rubrique « petite
correspondance », on trouve en effet des réponses sibyllines aux courriers reçus, comme ici le
26 juillet 1848 :
Pendant plusieurs numéros, cette rubrique permet les réponses de la rédaction aux
auteurs de certaines lettres que le lecteur du journal peut deviner par retour. De manière
intéressante, l’on y lit aussi la constitution progressive d’un auteur, ce fameux « voyant », qui
finira par signer la rubrique des « Lettres d’un Zombien », chroniques politiques écrites avec
facilité et esprit. Le 2 août, on lit en effet dans la « Petite correspondance » le paragraphe
suivant : « A M. L. V. – Nous commençons. Le sérieux est nécessaire dans les questions
sérieuses, et le bon sens public les accepte d’autant mieux qu’elles sont plus sévèrement
traitées338 » ; et en effet, dans le même numéro, « Le Voyant » publie ses « Lettres d’un
zombien », qui dureront sur plusieurs numéros. Sans doute ces publications sont-elles liées à
l’atmosphère révolutionnaire et à la liberté occasionnée par 1848 ; mais elles témoignent aussi
337 Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 22 mai 1864. 338 « Petite correspondance », L’Avenir, 2 août 1848.
118
d’une volonté d’interaction et d’échange qui se comprend eu égard aux limites de la société
coloniale. Enfin, cette habitude des incursions de lecteurs brouille la frontière déjà mince entre
les lettres émanant de lecteurs réels et les lettres factices, qui tiennent davantage d’un genre
littéraire et participent à la visée esthétique du journal. Les lettres en créole qui paraissent dans
La Semaine illustrée réunionnaise le 20 mars et le 10 avril 1862, bien que signées, pourraient
susciter le doute : mais, parues entre des textes politiques et littéraires, ces « correspondances »
semblent donc devoir être traitées sous un autre angle que celui de l’inscription des lecteurs au
sein du périodique339.
Sermonner les lecteurs : les lecteurs présents au cœur du fonctionnement colonial
Dans les premières années de la colonisation en Nouvelle-Calédonie, un missionnaire,
le père Montrouzier, se charge de publier quelques informations sur l’histoire du territoire.
Alors qu’il a déjà commencé son récit au fil de plusieurs numéros, le père interrompt son
discours et en appelle à son lectorat pour expliciter son texte : « Le lecteur ne sera peut-être pas
fâché de savoir un fait qui lui fera juger des mœurs des Nouveaux-Calédoniens, dont quelques
philanthropes exagérés et maladroits ont voulu faire un peuple doux, inoffensif et presque
supérieur à nos nations civilisées340 ». À ce lecteur qu’il s’agit de convaincre n’est accordée
aucune particularité : on ne lui demande que de suivre la voix experte du missionnaire qui a
déjà affirmé, dans les livraisons précédentes, sa connaissance du milieu et des habitants. Il y a
donc ici argument d’autorité, et le lecteur est prié de s’y rendre. Ce fonctionnement n’est pas le
plus courant, mais il dessine en tout cas une figure de narrataire particulièrement intéressante.
Narrataire en effet, car les textes médiatiques prévoient leur lectorat plus encore que les
publications en recueil : ils en dessinent la silhouette, en creusent les ressemblances avec le
narrateur et en font une figure du monde colonial à part entière. Pourtant ce lecteur peut être
métropolitain par le biais des échanges, et l’on a vu que c’est l’un des points importants de la
presse coloniale que de viser une publication métropolitaine, ne serait-ce que par citations. Pour
mieux connaître le lecteur de la presse coloniale, l’on peut donc d’abord passer par ce qui lui
est directement et explicitement adressé. Le père Montrouzier nous a fourni un premier exemple
assez neutre : il en est d’autres plus précis. Toujours en Nouvelle-Calédonie, Armand
Closquinet, le poète, écrit aussi des critiques théâtrales ; et celle qu’il fait en 1863 le porte à
s’adresser à un lectorat qui n’est pas local, mais métropolitain. Il y écrit :
339 Pour la question plus générale des interventions des lecteurs dans la presse, voir l’ouvrage à paraître : Les voix du lecteur dans la presse française au XIXe siècle (dir. Elina Absalyamova et Valérie Stiénon). 340 P. Montrouzier, curé de Napoléonville, « Nouvelle-Calédonie. Fragments historiques », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 16 septembre 1860.
119
Sachez-le tout d’abord, habitants européens de la Nouvelle-Calédonie en général, et de Port-de-France en particulier, ce n’est pas à vous que s’adresse cet humble, mais très-véridique article. Non, ce n’est point à vous, colons, qui connaissez les Néo-Calédoniens ; qui les employez ou les voyez aller, venir autour de vous, pour leurs affaires ou pour les vôtres, que j’offrirai ce court aperçu d’une soirée que MM. Ph. Gille, le poète, et J. Offenbach, le maestro, ne prévoyaient sans doute point lors de la première représentation de leur œuvre aux Bouffes Parisiens, le 16 mai 1857. […] Mais oyez ! oyez ! gens de France ; et vous surtout, gens de Paris qui avez assisté aux premières exhibitions de Vent du soir ! Oyez ! car c’est à vous que sont dédiées ces lignes que je vous prie de communiquer à vos voisins, parents, amis, etc341.
Pourtant ce texte est bien publié dans la presse néo-calédonienne, et s’adresse donc,
avant tout échange, à un lectorat local. Mais l’on y retrouve cette obsession de la lecture
métropolitaine et de ce qu’elle insuffle comme obligations à la presse coloniale ; Closquinet
étant, en outre, destiné à repartir, cette attention portée au lectorat métropolitain peut se lire
sous différents angles. L’écriture plaisante et légère de l’article permet de voir que le lecteur
visé reste colonial, et que c’est par détour que l’on s’adresse à lui en flattant sa connaissance de
la population kanak. La chronique est donc le lieu où l’on interpelle le lecteur colonial,
directement ou non. Fondés sur le même modèle de la conversation, les articles tenant des
« lettres » font également apparaître des adresses aux lecteurs : ainsi des « Lettres parisiennes »
que La France algérienne fait paraître en 1845. Dans l’une de ces lettres, avant d’en venir au
compte-rendu du Salon de cette année-là, l’auteur anonyme écrit : « Ne soyez plus si fiers, chers
Algériens, de votre printemps, de votre beau ciel, des verdoyantes splendeurs de votre sol342 ».
S’ensuit une description du printemps parisien et de la vie parisienne, avant d’en venir à la
description du tableau d’Horace Vernet représentant la « prise de la Smala », épisode de la
conquête algérienne qui concerne donc au premier chef les lecteurs coloniaux. Mais l’intérêt ici
réside bien dans ce que le modèle de la « lettre » insérée dans le journal permet comme mise en
valeur du lectorat colonial. Il est, dans cette correspondance qui n’en porte pas le nom, pluriel
et indistinct : mais d’autres textes tiennent le genre épistolaire de manière plus serrée encore, et
affichent un seul lecteur.
La lettre permet un jeu avec la représentation du lectorat : dans le miroir déformé que
lui tend la lettre, le lecteur colonial trouve une identité médiatisée par un autre. Ce
fonctionnement, sérieux ou léger, peut aboutir à une vraie forme humoristique, comme le fait
L’Avenir lorsqu’il publie les « Lettres d’un Zéphir à Flore » : l’épistolier, soldat en Algérie, a
dû partir pour Pointe-à-Pitre après s’être battu déguisé en femme pour les besoins d’une pièce
341 Armand Closquinet, « Vent du soir et les Kanacks », 1er février 1861. Les dernières lignes sont citées par Eddy Banaré dans sa thèse de doctorat, op. cit., p. 87. 342 « Lettres parisiennes », La France algérienne, 30 avril 1845.
120
de théâtre. Sa compagne et la destinataire des lettres, Flore, est une « mauresque » que le soldat
a sauvée pendant la prise de Constantine. La lettre est écrite par un auteur qui introduit le tout
à la première personne : le zéphir veut décrire à Flore la vie à Saint-Pierre. Toutes ces notations
qui visent à compléter l’énonciation de la lettre lui donnent un ancrage qui ne fait qu’accentuer
la portée comique du texte dans lequel le lectorat guadeloupéen se retrouve : « Enfin me voici
rendu à la Pointe-à-Pitre ma nouvelle garnison, c’est une ville propre jusqu’à un certain point,
bien bâtie jusqu’à un certain point et salubre jusqu’à un certain point » ; ou encore, de manière
plus précise : « Les naturels du pays ont une religion très poétique. Ils connaissent et adorent
trois dieux, la déesse Morue… le dieu Sucre… et le dieu Tafia343 ». La caricature de la vie
coloniale passe donc par un énonciateur particulier, représentatif de la circulation dans le monde
colonial et permettant de mettre en scène la naïveté de celui qui découvre. Utiliser un
truchement pour décrire une société est un procédé déjà bien éprouvé : réutilisé dans la presse
coloniale, il révèle une forme de critique locale qui correspond à l’esprit du journal. Cette
perspective qui permet à l’auteur médiatique de jouer avec son lectorat et sa représentation se
retrouve à différentes périodes et dans différents endroits. Les « Lettres d’un voyageur » que le
Propagateur martiniquais publie en 1873 vont dans ce sens : la représentation progresse par
détour là aussi, mais sans l’affirmation d’une portée comique dès le début. « Paul », qui signe
ces lettres, développe en fait une manière originale de faire la critique théâtrale : sous couvert
d’étudier les mœurs coloniales pour un de ses amis resté en France, l’auteur signe une
description des créoles qui ne manque pas de piquant. La fausse destination de la lettre est un
moyen efficace de jouer sur ce que le lecteur colonial sait être lui : dans l’exemple précédent,
un écrivain public était censé présenter les lettres de Zéphir Mazagran ; ici, la lettre adressée à
un ami est publiée sans fausse introduction. La présentation a tout de la lettre : une adresse
tronquée (« Mon cher … »), une date qui précède de deux jours la date de parution du journal,
un récit à la première personne et des détails qui entrent dans le modèle épistolaire.
Je vais aujourd’hui t’entretenir du théâtre de Saint-Pierre que je suis assez assidûment depuis environ dix semaines. Tu t’attends probablement à ce que je t’en conte des merveilles, car tu n’as pas oublié, n’est-ce pas, les tableaux enchanteurs qui nous étaient faits par ces braves créoles que nous rencontrions à notre cercle ; pour eux, l’Opéra et les Italiens n’avaient été que désillusion ; la Patti n’était rien à côté des cantatrices martiniquaises, et nous nous demandions comment le Directeur de l’Opéra pouvait s’arrêter à ne recruter ses sujets qu’au Conservatoire, quand il était si facile de recourir aux colonies françaises pour se procurer des étoiles de première grandeur. Je dois dire, mon ami, qu’il y a passablement à rabattre de ces prétentions ; mais le plus plaisant de l’affaire, c’est que nos excellents intertropicaux sont plus difficiles pour leurs artistes qu’ils ne l’étaient
343 Zéphir Mazagran, « Lettres d’un zéphir à Flore », L’Avenir, 2 avril 1859.
121
pour les nôtres ; ils parlent ici de Paris comme ils nous parlaient là-bas de Saint-Pierre ; rien n’est supportable, tout marche de travers ; ils critiquent, sifflent, interpellent, gesticulent, se démènent, et la vérité est que, si le théâtre local n’est pas précisément l’Opéra, il est à coup sûr supérieur, comme ensemble de troupe, à ceux des villes de province d’une égale population344.
Dans cet exemple, le lecteur du journal n’est pas prévu par ce fonctionnement : une
forme de voyeurisme tourné vers soi s’installe, qui témoigne d’une avidité coloniale à saisir sa
propre identité. De ces descriptions peuvent également ressortir une forme de sermon sur cette
identité coloniale : l’une des finalités qui apparaît alors tient à ce qu’il faut faire ou pas en tant
que colonial. Ces lettres fictives qui tournent le regard du colonial vers lui-même constituent
donc une partie non négligeable du tissu médiatique colonial : la preuve en est que La Vie
algérienne, « journal amusant illustré » publie, certifiées copie conforme par « C. Lui », les
lettres de l’imaginaire Isidore Cascaret, à son ami « Bétinet, Cretigny-les-oies (Creuse) » selon
ce même principe. « Je vais te narrer mes aventures et mes aperçus de touriste amateur ; tu
garderas mes écrits, car je compte, à mon retour, les publier pour l’édification de tout un chacun
et de la postérité345 », commence ainsi l’une des lettres copiées sur celle des périodiques. Plus
simplement encore, Le Siroco s’amuse en publiant les « lettres d’un Vent étésien à une Jolie-
Brise346 », certifiées conformes par « El-Guebli », nom arabe du sirocco : là encore, la
description de la colonie passe par la correspondance.
L’interpellation du lecteur, souvent plaisante et tenant d’un jeu dont la communication
médiatique est le ressort principal, peut cependant se faire plus sérieuse et plus à charge. Ainsi,
Le Commercial guadeloupéen fait paraître en 1865 un article signé « Cur », intitulé « Mes
pourquoi », et qui sonne comme un réquisitoire contre certaines habitudes créoles347. On y lit
une charge sur les créoles qui n’attendent que d’avoir fait fortune avant de rentrer en France ;
une déploration des conditions économiques de la Guadeloupe ; le tout mêlé à un appel au
lecteur. Cette rhétorique qui prend à parti le lecteur colonial en lui présentant une typologie de
ses habitants donne une nouvelle couleur à l’adresse : le ton est léger, le contenu ne l’est pas.
344 Paul, « Lettres d’un voyageur », Le Propagateur, 17 décembre 1873. 345 C. Lui, « Lettre d’Isidore Cascaret à son ami Bétinet, Cretigny-les-oies (Creuse) », La Vie algérienne, 7 novembre 1869, puis 27 novembre et 19 décembre. 346 El Guebli, « Lettre d’un vent étésien à une Jolie-Brise », Le Siroco, 6 octobre 1866, puis 13 octobre, 21 octobre, 28 octobre et 4 novembre. 347 Cur, « Mes Pourquoi », Le Commercial, 14 octobre 1865.
122
3.2 Le lecteur métropolitain, pendant du lecteur colonial
La plupart des journaux coloniaux sont envoyés en France pour être lus par des lecteurs
métropolitains, ou au moins dans le cadre des échanges de périodiques. La conscience de cette
double destination des articles du journal n’est pas toujours exprimée ; mais quand elle l’est,
elle peut tenir du numéro d’équilibriste. Une note de bas de page du journal La France
algérienne formule ainsi clairement cet enjeu, et ce dès 1846 :
Cette nouvelle de l’un de nos collaborateurs formera sept ou huit feuilletons. Nous la publierons sans interruption, persuadé que nous serons en cela agréable à nos abonnés et surtout à ceux d’Afrique. Plusieurs de ces derniers nous ont fait cette observation fort juste : « Habitant l’Algérie, nous connaissons ce pays et serions fort désireux de voir varier le feuilleton de la France algérienne, qui pour nous est un peu trop souvent algérien ». Nous ferons droit à cette réclamation sans pourtant mécontenter trop nos lecteurs de France, qui, de leur côté, se montrent avides de renseignements sur l’Afrique348.
Ce périodique, nous l’avons dit dans une présentation précédente, est particulier : son
titre même précise sa vocation à être lu en France, et à ce titre il peut apparaître comme l’un
des cas limite de notre corpus. Mais il est bien publié à Alger ; et c’est donc l’affichage de sa
dimension « mixte », de sa double destination, qui nous pousse à le mettre en ouverture de ce
passage consacré aux lecteurs métropolitains dans la presse coloniale. Dans cette même
perspective, l’on peut s’interroger sur les éditions spéciales pour l’extérieur : le catalogue de la
BNF précise ainsi, pour Le Messager de Tahiti, que le journal « a publié une éd. pour l'extérieur
de nov. 1866 au 31 déc. 1880 (n° 1-157) » ; c’est a priori celle que l’on peut consulter aux
ANOM. Ces précisions sont encore mal connues, et les conservateurs commencent à se pencher
sur la presse coloniale et à en décrire le fonctionnement ; mais l’idée même d’une édition pour
l’extérieur permet d’entrevoir un dessein double dans la presse coloniale, qui se matérialise
dans une double réception. Cette double réception est bien un enjeu fondamental du journal
colonial si l’on élargit la perspective aux autres empires coloniaux : elle constitue même un
nœud de réflexions, puisque dans tous les empires il s’agit d’abord d’informer les lecteurs
locaux, mais sans jamais perdre de vue les éventuels lecteurs métropolitains. C’est en partie ce
dont témoigne Benedict Anderson lorsqu’il écrit que les premiers journaux du continent
américain ne sont que le reflet de la structure administrative de la colonie : en ce sens en effet
c’est la première forme d’une communauté imaginée. Mais ce reflet, avec ses particularités
locales, implique aussi pour Anderson une réception qui n’est que locale : il conclut ainsi que
348 François Coquille, « Le mandarin et la modiste », La France algérienne, 11 février 1846.
123
l’Espagnol ne lira pas le journal du Créole, alors que le Créole lira un journal madrilène349. Le
constat est majoritairement vrai : cependant, le lectorat métropolitain reste prévu par le texte,
ne serait-ce que parce que les échanges entre journaux font du journaliste métropolitain le
premier lecteur d’articles qu’il pourra éventuellement reproduire. Si les pratiques de lecture
nous sont en grande partie cachées, on peut donc cependant partir de l’écriture du journal
colonial pour voir quelle place il réserve au lectorat métropolitain.
La métropole au centre du journal colonial S’appuyant sur l’idée selon laquelle il existe une « relation métonymique entre presse
et nation », Anne-Marie Thiesse évoque « l’articulation entre unité nationale et diversité du
territoire350 » au sein de laquelle la presse a joué un rôle. En adaptant ce propos à la situation
coloniale, il est possible d’ajouter une excroissance à cette articulation : il ne s’agit pas
seulement de diversité du territoire, mais également d’un sentiment contrasté à l’égard de la
métropole, souvent lointaine et pourtant au centre du journal colonial. Pour autant, il est évident
que la métropole n’est pas non plus le seul aboutissement de la colonie, son modèle et sa source
à la fois, son seul interlocuteur ; seulement, dans les textes, le recours à la métropole est un
recours obligé, et notamment dans la presse officielle. Mieux encore, la métropole est un
concept que les textes médiatiques plient à leur idéologie : repoussoir parfois, point de
comparaison souvent, la métropole passe par son lecteur pour être traitée dans la presse
coloniale. Il n’est donc pas question ici d’affirmer le schéma dépassé de colonies prises dans le
piège d’un face-à-face exclusif avec leur métropole ; mais plutôt de voir comment,
textuellement, la métropole reste un point de repère qui se réalise avec des orientations
différentes, à travers la figure de son lecteur.
« Comme Français et comme colons » : le 10 mars 1841, La Feuille hebdomadaire de
l’île Bourbon fait paraître cette expression au fil de son éditorial à propos de la question d’Orient
– à l’époque, les guerres entre l’Égypte et l’Empire ottoman. Pourtant, la colonisation est
ancienne à la Réunion, et la mention des deux identités, donnée comme évidente, nous invite à
interroger les liens entre la colonie et la métropole, entre la France et ce que le journal colonial
retient et présente du territoire sur lequel il paraît. Le journal colonial est, on l’a dit, un reflet
de la colonie et de sa structure ; il est local, soumis à la censure du gouverneur, contraint par
les conditions coloniales : pourquoi alors ne reproduirait-il pas un schéma opposant le centre et
la périphérie, partant une fascination pour la métropole ? C’est un mécanisme qui peut sembler
349 Benedict Anderson, op. cit., p. 72. 350 Anne-Marie-Thiesse, art. cit., p. 136.
124
normal et dont l’on trouve plusieurs traces, y compris sur le plan littéraire. De nombreux
journaux publient ainsi des textes parce qu’ils ont été bien reçus en métropole, et ce quelle que
soit la période, quel que soit le territoire : Le Colon réunionnais du 9 décembre 1858 publie
ainsi dans son feuilleton l’auteur créole, local, Auguste Lacaussade, en justifiant la publication
par le succès qu’a connu le poète dans la presse officielle nationale. Dans le feuilleton de La
France algérienne, un poème intitulé « La Guerre » et signé par Ausone de Chancel paraît ainsi
avec l’introduction suivante :
Plusieurs journaux et notamment la Presse, ont publié la première Algérienne de M. A. de Chancel, qui a obtenu un grand et légitime succès. La seconde Algérienne du même poète est achevée et sur le point d’être mise sous presse. M. A. de Chancel a bien voulu nous autoriser à en publier, le fragment suivant, et qui prouvera à nos lecteurs que cette nouvelle production de notre poète algérien sera digne de son aînée351.
Chancel a été cité à de nombreuses reprises dans ce périodique alors jeune : mais il est
ici accompagné et justifié par sa réputation métropolitaine ; dans le même texte, il est cependant
revendiqué par la colonie, avec l’expression de « poète algérien » qui clôt la présentation. Dans
le même esprit encore, mais sur un troisième territoire, dans La France d’Outre-Mer, la
publication d’un récit de Paul Dhormoys est également expliquée par le succès que l’auteur a
eu en métropole, au cours d’une introduction relativement longue :
Une histoire de serpent ! Ce titre va sans nul doute allécher nos lecteurs et attirer l’attention de nos aimables lectrices. C’est bien pourquoi nous avons pensé qu’il en serait ainsi que nous nous sommes empressés de détacher du Monde Illustré ce charmant petit roman qui a notre colonie pour théâtre et qui est signé d’un nom qui n’est pas effacé à coup sûr de la mémoire de tous les habitants de Saint-Pierre et de Fort-de-France. M. Paul d’Hormoys auquel nous le devons a résidé assez longtemps à la Martinique en qualité de lieutenant d’artillerie de marine et ceux qui l’ont connu alors ont gardé le souvenir de son esprit et de ses aimables qualités. En passant des rangs de l’armée dans ceux des écrivains pittoresques, M. d’Hormoys est resté le même : nous n’en voulons pour preuve que ses impressions de voyage si pleines de verve et d’atticisme qu’il a publiées récemment dans le Figaro et l’histoire écrite avec une si gracieuse aisance que nous allons mettre sous les yeux de nos lecteurs. Il eût été seulement à désirer – que M. d’Hormoys nous permette cette légère critique – que la plume qui raconte si bien une histoire de l’autre monde ne se soit quelque peu attachée à exagérer la couleur locale. Cette exagération a malheureusement fait de ce souvenir de la Martinique une histoire presqu’aussi fabuleuse que celle de Laocoon ; mais à cela près, cette histoire est charmante et nos lecteurs, nous en sommes sûrs, se divertiront fort de sa lecture. – La voici :
351 La France algérienne, 20 juin 1846.
125
Prenez garde au serpent : Telle est la première recommandation que l’on adresse à l’étranger qui débarque à Saint-Pierre ou à Fort-de-France ; et l’on a raison352.
Le rédacteur présente son geste d’un point de vue matériel : il a « détaché » le récit du
Monde illustré, d’une publication métropolitaine donc, d’abord parce qu’il a connu ce succès
d’être publié en métropole, et ensuite parce que l’auteur est passé dans les Antilles, parce que
l’action a lieu dans la colonie même. La première étape de la justification passée, le rédacteur
peut alors critiquer, justement, cette vision trop métropolitaine de l’île ; mais c’est une
démarche progressive qui se lit, et elle doit commencer en métropole. C’est parce que le lectorat
métropolitain a apprécié le récit qu’il est ensuite publié en Martinique : un premier cercle de
lecteurs apparaît ainsi au sein du journal colonial. Cet extrait montre également la part de
critiques qui peut être réservée aux auteurs écrivant pour les lecteurs métropolitains. Car tout
en étant une force inscrite au centre du journal, la métropole est aussi un thème lié à l’expression
de l’amertume : le personnel médiatique colonial n’hésite pas à jouer du discours dénonçant les
stéréotypes venus de métropole pour toucher son lectorat. Il participe en ce sens à la définition
d’une identité en creux : le lectorat colonial doit opérer la lecture du stéréotype en même temps
qu’il construit l’image de lui-même orientée par le journal. Le propos est affirmé sur le territoire
algérien, mais pas uniquement, et surtout on remarque qu’il prend une tonalité générale, ne se
cantonnant pas à cette seule colonie. En témoigne L’Indépendant de Constantine, en 1865,
publié dans une époque de transformation des colonies et dont la ligne éditoriale vise le passage
à un régime civil et non plus militaire :
Bien des esprits, en France, considèrent encore les colonies comme des théâtres d’aventure, où ne peuvent se rendre que des gens plus ou moins déclassés et compromis ; où on ne s’exile volontairement que pour un temps, avec une intention arrêtée de retour au pays natal, une fois qu’on aura fait fortune353.
Cette stratégie qui passe par l’image amorce tout un discours de rectification de
l’information. Le « théâtre » convoqué dans l’expression convenue « théâtre des aventures »
trouve aussi, dans ce cas, une acception plus précise. Il met en lumière les illusions de la terre
coloniale vue par la métropole, et permet l’opposition du journal local, documenté et
authentique, à ces illusions. De manière générale, le journal colonial maîtrise en effet un
métadiscours clairement construit en opposition à certains aspects de la métropole : l’identité
coloniale se joue jusque dans les détails de ces textes qui affirment la domination du territoire
352 Paul Dhormoys, « Une histoire de serpents. Souvenirs de la Martinique », La France d’Outre-Mer 15 avril 1859. 353 Ferdinand Guillon, « Bien des esprits, en France », L’Indépendant de Constantine, 28 juillet 1865.
126
colonisé. En témoigne aussi cet extrait du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, plus explicite
encore quant à la réalité coloniale qu’il s’agit de dévoiler à la métropole :
On s’étonnera, sans doute, en France que nous en soyons encore, onze années après la prise de possession, à enregistrer des actes aussi horribles que celui rapporté ci-dessus, car nos lecteurs de la Métropole ne connaissent pas l’exiguïté des moyens dont dispose le Gouvernement local. Deux postes militaires en dehors de Port-de-France, et sans le moindre bateau à leur disposition, sont-ils en mesure d’étendre loin leur section354 ?
Dans cet extrait, le métadiscours sur les productions médiatiques présente un but
pratique : renforcer la présence de l’armée sur l’île. Si la métropole est au centre de la
production, c’est donc à la fois parce que le journal colonial vise une distribution
métropolitaine, mais aussi parce que cette publication doit faire agir le lectorat métropolitain.
Les textes littéraires et revendiqués comme tels n’échappent pas à l’obligatoire caisse de
résonance métropolitaine que le journal met en mots : le lecteur métropolitain finit toujours par
apparaître comme une sorte de double du lecteur local.
Rectifier la vérité auprès d’un lectorat métropolitain ? L’ambiguïté des rectifications Ce lecteur métropolitain inconnu, puisqu’idéalisé, représente l’horizon à partir duquel
écrivent les journalistes coloniaux ; les prospectus des journaux coloniaux présentent souvent
une mission double, on l’a vu plus haut : la peinture de la colonie est destinée aux coloniaux
bien sûr, mais aussi aux métropolitains. En fait, la presse coloniale semble avoir bien pris en
compte l’adage « A beau mentir qui vient de loin », au sens où elle se donne pour mission, dans
un système énonciatif plutôt complexe, de rendre compte de la vérité de la situation coloniale.
C’est un leitmotiv qui parcourt tout le siècle, et le journaliste colonial devient alors, suivant
cette représentation de la vérité et cette obsession de l’authenticité, un reporter immobile. Il vit,
raconte et dresse le portrait d’une situation exotique qui aspire à ne plus l’être : à travers ses
interventions, la presse coloniale met en place un rapport de connaissance et de familiarité avec
une situation qui passe progressivement d’exotique à coloniale. Il est reporter au sens où il
transmet une réalité lointaine à des lecteurs métropolitains ; il est cependant immobile, puisqu’il
tend à résider longtemps, voire à s’installer sur le territoire colonial – quand il n’y est pas tout
simplement né. Les textes produits par les journalistes coloniaux jouent alors de cette position
intermédiaire, comme c’est le cas dans les premières années de la conquête en Algérie : Le
Moniteur algérien joue de sa position de journal officiel par rapport à des correspondances
particulières.
354 « Anthropophagie (côte Ouest) », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 29 janvier 1865.
127
Nous engageons nos confrères les journalistes de Paris à se défier des correspondances particulières d’Afrique, surtout de celles d’Oran et de Bône. Déjà ils ont pu voir qu’on avait abusé de leur crédulité en leur racontant les hauts faits, en dénombrant les blessés et les morts d’une garde nationale qui n’était même pas créée. Ce qu’ils racontent tous les jours d’Oran et de Bône n’est guère plus fondé. Les actes officiels de ces pays sont promptement communiqués aux autorités centrales d’Alger, qui s’empressent toujours de leur donner publicité dans nos colonnes355.
Une première manifestation de ces phénomènes de correction concerne donc la situation
des coloniaux eux-mêmes. Il s’agit de prendre la plume pour décrire une situation authentique
et qui ne se réduise pas aux clichés exotiques : c’est par ce biais également que l’entreprise
idéologique coloniale prône la réussite de l’implantation française à l’étranger. Ainsi, le 24 avril
1846, le feuilleton de L’Écho de l'Atlas consiste en un « Courrier de Blidah » non signé mais
très adressé, puisqu’il prend la forme d’une lettre :
Je ne sais trop par où commencer, mon bon ami : tu t'imagines que Blidah est une masure, et que nous y vivons, à la façon des Bédouins, de couscousse, d'amour et de café sans sucre. Nous n'en sommes malheureusement pas réduits à ces originales excentricités ; l'Algérie est aujourd'hui une terre française où l'on trouve à peu près le confortable de la métropole. Le vieil Hussein, en partant pour l'exil, a emporté avec lui toute la poésie, toute l'originalité de ce pays356.
Or en 1846, la colonie algérienne n’est pas encore apaisée, ni même totalement
conquise : même si Abd el-Kader a subi des défaites (la « prise de la Smala » date de 1843), il
n’est pas encore exilé, et apparaît même très actif357. D’où l’importance de cette fausse
lettre – selon le modèle que nous avons vu – affirmant l’idée que la colonisation est en bonne
voie, que l’Algérie est « une terre française » et que ce changement est irréversible. Ce « bon
ami » imaginé qui ouvre la lettre est le meilleur prétexte que l’on peut trouver pour affirmer un
point de vue colonial sur la situation. La fausse déception exprimée – l’Algérie n’est plus
« poétique », n’est plus « couleur locale » – est ici intéressante parce qu’elle entre en dissonance
avec l’habitude des voyageurs à venir : la recherche de ce pittoresque censé caractériser cette
récente colonie française. Un Théophile Gautier envoyé en tant que journaliste pour couvrir
l’inauguration du chemin de fer de Blida, quelque vingt années après, se comportera tout à
l’inverse, remarquant pendant sa promenade dans Alger qu’il « [fait] rentrer derrière le grillage
355 Le Moniteur algérien, 13 octobre 1832. 356 « Courrier de Blidah », L’Écho de l’Atlas, 24 avril 1846. 357 Il se rend le 23 décembre 1847 ; mais en 1845-1846, la France entretient une armée nombreuse pour venir à bout de l’émir. Voir Jacques Frémeaux, « Abd el-Kader, chef de guerre (1832-1847) », Revue historique des armées, n° 250, 2008. URL : http://rha.revues.org/194. Consulté le 20 septembre 2015. On y trouve notamment la précision suivante : « C’est à tort, enfin, que les Français lui ont imputé le massacre de 300 prisonniers détenus dans son camp (avril 1846), perpétré en son absence par un de ses lieutenants ». On voit donc dans quel contexte est présentée l’image d’une Algérie française et tranquille.
128
des petites lucarnes arabes plus d’une tête curieuse et furtive ; puis, rassuré à l’endroit de la
couleur locale, [il redescend] vers la ville moderne », concluant alors qu’« Alger n’est pas
encore tout à fait une Marseille africaine358 ». Il y a bien chez Gautier le constat d’une modernité
de la capitale coloniale, mais elle se conjugue à l’image attendue d’une Algérie encore
orientaliste, bien loin de l’idéologie du journaliste anonyme de L’Écho de l’Atlas : en 1846, et
pour les lecteurs locaux comme pour les lecteurs métropolitains éventuels, il faut participer à
l’idée d’une colonisation bien entamée.
Tourner en ridicule le goût pour l’exotisme des métropolitains – nouveaux débarqués,
touristes, fonctionnaires – est un autre ressort majeur de la presse coloniale. C’est en dressant
le portrait de néophytes que l’on convainc le lecteur métropolitain de la francisation de la
colonie, et que du même coup l’on donne au lecteur colonial la conscience de sa particularité et
de son identité propre. Ces deux types de lecteurs, proches mais pourtant différents déjà, vont
avoir accès à ces journaux : là réside l’ambiguïté d’une « double énonciation », si l’on peut dire,
qui est le propre de la presse coloniale – quand elle est suffisamment connue pour circuler
ailleurs que dans son cadre de naissance. En 1848, la Seybouse du 16 décembre fait paraître en
feuilleton le récit de l’installation de « nouveaux frères » à Mondovi, sous la plume d’un
chroniqueur d’abord épique, puis léger dans la description de détails. Sous la signature
évocatrice d’« Un colon sérieux », il révèle une pleine connivence avec son lectorat colonial
constitué de lecteurs installés. L’anecdote est en effet le lieu d’une différenciation entre
l’Algérien aguerri et le « colon parisien », armé jusqu’aux dents sans raison nécessaire – la
colonie n’est-elle pas un endroit familier, habituel, pacifié ? –, dont le chroniqueur se moque en
instaurant une connivence forte avec son lecteur algérien :
Hic est locus, voici le moment, voici l’instant de mettre sous vos yeux la figure empreinte d’une véritable béatitude de cet honnête parisien mordant avec délices dans une superbe figue de Barbarie, encore revêtue de sa verte enveloppe359.
La rectification de la vérité peut aussi se réaliser dans le commentaire de la presse
métropolitaine, souvent considérée avec méfiance. Cela peut se matérialiser sous la forme du
simple relevé de fautes, comme dans le récent alors Courrier de Saïgon, en une : « On lit dans
la partie non officielle du Moniteur du 7 septembre, sous la rubrique Correspondance Havas,
une note contenant des appréciations inexactes sur notre situation en Cochinchine360 ». Cela
peut aussi se développer jusqu’à prendre des accents polémiques qui touchent à une définition
358 Théophile Gautier, Loin de Paris, Paris, Lévy, 1865, p. 129. 359 Un colon sérieux, « Les Colons de Mondovi », La Seybouse, 16 décembre 1848. 360 Le Courrier de Saïgon, 5 novembre 1864.
129
du « journalisme européen ». Ainsi de cet article qui paraît dans La Malle réunionnaise le 28
septembre 1865, à propos de la fin de l’esclavage aux États-Unis : le journaliste s’y révèle en
spécialiste d’une situation que les journalistes du Journal des débats ne peuvent comprendre.
Nous autres Français, nous sommes habitués à mourir pour la liberté ; mais les noirs n’ont pas encore cette habitude ; ils ressentent médiocrement « le bienfait de disparaître du sol », qui, pour être une conséquence des principes de 89, n’en est pas moins dur, du moins pour eux ; pour les journalistes européens vainqueurs de l’esclavage, c’est autre chose : leur gloire n’en sera pas altérée, et leur dévouement à l’idée en reluira davantage. Exterminer l’esclavage, c’est bien ; exterminer tous les ci-devant esclaves, c’est mieux. Ce bienfait de l’extermination, on l’entrevoyait au début de la guerre, on le signalait aux États fédéraux comme aux publicistes de l’Ancien-Monde. Si la pure négrophilie avait inspiré le gouvernement fédéral et les journaux, ils auraient sans doute reculé devant le résultat certain de l’entreprise. Rien ne les a arrêtés : périssent les noirs plutôt qu’un principe ! […] Mais ces malheurs sont plus que compensés par la gloire qui va rejaillir sur l’Ancien-Monde, sur les journalistes qui sont si vaillamment combattu pour la liberté361.
À de nombreuses reprises, les « journalistes européens », ceux de « l’Ancien Monde »,
sont désignés comme des philanthropes mal avisés, qui n’envisagent que les idées abstraites et
non les manifestations concrètes de leurs décisions. Cette ironie qui en vient à qualifier les
journalistes de « vainqueurs de l’esclavage » appelle, en creux, à interroger les journalistes
coloniaux et le monde colonial en général. À la distinction entre l’ancien et le nouveau monde
se superpose la distinction entre les États-Unis et la France, entre deux civilisations différentes :
l’on voit alors se dessiner, mais toujours par un système d’oppositions non explicite, un
journaliste colonial qui revendique une position intermédiaire. Le travail même du journaliste
est mis en scène pour satisfaire à ces exigences de réparation qui définissent la presse
coloniale :
La rivière des Galets et le ras-de-marée [sic] ayant depuis plusieurs jours intercepté toute communication avec Saint-Denis, nous sommes encore forcés de publier, sans pouvoir nous livrer aux réflexions qu’elles nous inspirent, les nouvelles que nous extrayons du Globe et du Courrier de la Gironde, dont les derniers numéros remontant au 15 novembre dernier renferment des faits sur Bourbon qui méritent, selon nous, d’être réfutés362.
En condensé ici, on retrouve le « retard » colonial, la difficulté de la vie coloniale
soumise à des phénomènes naturels qui ne sont pas ceux de métropole, et enfin, en dernier plan,
la métropole visible par les journaux reçus, journaux mensongers et dont la réfutation va apaiser
le lectorat. La réfutation coloniale peut également prendre des accents clairement racialisés,
361 La Malle, 28 septembre 1865. 362 Le Courrier de Saint-Paul, 8 mars 1844.
130
renvoyant à la situation coloniale réelle et à ses confrontations. Sous le titre « comme quoi les
blancs de la Guadeloupe font mourir leurs curés de chagrin et de misère », le rédacteur de
L’Avenir guadeloupéen fait paraître en 1864 un article qui commence ainsi : « Depuis quelques
temps, la Presse Métropolitaine accueille avec une bien grande légèreté des correspondances
anonymes dirigées contre la population blanche de notre pays363 ». Sont citées La Revue du
monde colonial et L’Opinion nationale à l’appui de ce réquisitoire contre les rumeurs
métropolitaines.
[M]ais si elle se cache dans nos deux colonies où elle ne peut produire aucun mal, elle se prodigue, elle s’étale, elle se multiplie par centaines d’exemplaires, en France, à Paris et dans tous les ports de mer ; elle peut abuser les personnes les plus loyales, mais qui ne seraient pas au courant des choses coloniales, qui ne connaîtraient pas la situation de notre agriculture, de notre haut commerce et de notre Banque.
C’est donc pour le lecteur métropolitain que nous nous humilions au point de reproduire dans nos colonnes les calomnies du libelliste Martiniquais ; c’est pour le lecteur métropolitain que nous prenons la peine de les combattre par les chiffres officiels, qu’on lira ci-dessous et qui nous sont donnés par les censeurs de notre banque ». …] P.S. Nous avions fait composer le libellé in extenso, l’arrivée du packet nous oblige à en supprimer la première partie qui est l’apologie de la situation de la Martinique364[…].
Suivant le même principe, mais visant cette fois une illustration plutôt qu’un texte,
L’Indépendant de Constantine du 26 mai 1865 fait paraître dans ses « correspondances
algériennes » la rectification suivante :
Vous verrez la protestation de tous les journaux d’Alger contre le dessin publié par le journal l’Illustration, et représentant la promenade de l’Empereur sur la place du Gouvernement, à Alger, dans la soirée du 3 mai, au milieu d’une foule exclusivement composée d’Arabes, sans le moindre costume d’Européen. Cela ne paraît rien, mais cela doit frapper les badauds de l’Europe qui croient aux journaux à images… Rien que des Arabes sur cette place du Gouvernement le soir à neuf heures ! où jamais on n’en voit un seul ! C’est trop fort365 !
Les « badauds de l’Europe » sont bien ici à l’opposé de la réalité vécue par les
coloniaux : ce que signale cette lettre, c’est le refus de l’exotisation d’un territoire qu’ils se sont
appropriés.
Si l’ambiguïté semble toujours se dessiner au bout d’une étude des lectorats visés, c’est
que sans doute la presse coloniale ne se résout ni à un lectorat strictement local, ni à un lectorat
strictement métropolitain : c’est une presse qui compte particulièrement sur les
363 A. Vallée, « Comme quoi les blancs de la Guadeloupe font mourir leurs curés de chagrin et de misère », L’Avenir, 9 septembre 1864. 364 L’Avenir, 22 avril 1862. 365 « Alger, le 22 mai 1865 », L’Indépendant de Constantine, 26 mai 1865.
131
correspondances, et qui peut être lue sur le territoire colonial comme à Paris. D’où cette
démarche hésitante que l’on observe ; d’où, aussi, la possibilité de faire de cette indétermination
de réception l’un des traits définitoires du journal colonial. L’on peut enfin trouver, en limite
de notre corpus, des cas révélateurs de fonctionnements médiatiques de l’époque, notamment
des « vols » que subissent les journaux coloniaux non officiels. Ainsi, en mai 1881 Le Courrier
de Bône dénonce l’utilisation de ses articles par un journal local pyrénéen : la figure du
« corsaire » est alors attribuée à la feuille métropolitaine ; est dénoncé ici un procédé de reprise
qui transforme la relation habituelle entre centre et périphérie.
Il faut convenir que nous avons, dans la presse de France, quelques confrères peu gênés. Il n’est pas de jour où ne lisions dans quelque feuille de Paris ou de province nos articles ornés d’une signature, de nous parfaitement inconnue. Celui de ces journaux qui nous paraît avoir mérité la palme est l’Écho des Pyrénées, organe de l’appel au peuple, paraissant à Pau. Cette aimable feuille bonapartiste raconte à ses lecteurs qu’elle a envoyé un reporter dans le pays des Kroumirs et, sous le titre de Lettres de son correspondant spécial, elle publie les articles du Courrier de Bône sans prendre la peine d’y changer même un iota. Le tout est suivi de la signature Jean Flingot.
Assurément, nous sommes très flattés que notre littérature ait le don de plaire aux journaux de l’appel au peuple et à l’Écho des Pyrénées en particulier ; mais le procédé qu’ils emploient pour se l’approprier nous paraît un peu cavalier366.
Apparaît aussi la figure du faux « reporter » : elle est intéressante pour nous, parce
qu’elle modifie l’identité du journaliste colonial, faisant de lui, en effet, un reporter paradoxal
car immobile et local. L’on note également que la posture qui consistait à se réjouir de la citation
dans une feuille nationale n’est plus valable en 1881 : c’est avec une distance ironique que le
journaliste utilise le lieu commun de la reprise flatteuse.
La presse racontée par des témoins métropolitains : une histoire immédiate
Enfin, si le lectorat visé par la presse coloniale est ambigu, à la fois métropolitain et
colonial, la presse coloniale locale a aussi tendance à se refermer sur elle-même et à se peindre
comme une entité particulière, propre à la colonie. Le dessein de ces autoportraits qui marquent
la spécificité d’une presse non métropolitaine peut se lire comme un effort destiné au double
lectorat que nous venons d’évoquer. La presse coloniale se révèle être, dès ses origines, un objet
d’études pour les savants ; elle signale ainsi comment elle a pu compter pour le développement
de la colonie. Nous tirons ce constat de quelques textes – ouvrages ou articles – qui nous sont
parvenus, et qui laissent autant de traces de ce que cette presse pouvait susciter comme avis et
débats. Charles Desprez, que nous avons déjà cité, consacre ainsi un chapitre très intéressant à
366 « Les Corsaires », Le Courrier de Bône, 11 mai 1881.
132
la presse algérienne dans son Alger naguère et maintenant367 : cet ancien collaborateur de
plusieurs périodiques décrit l’ascension de L’Akhbar, informe sur les différentes phases de
production de la presse, donne les noms des rédacteurs et leurs ambitions… Commençant par
l’installation de l’imprimerie, l’auteur développe ensuite une vision plus large de la presse
coloniale, qu’il appelle « presse africaine ». Il revient même sur l’invention du nom
d’« Algérie », et nous aimerions revenir sur ce passage déjà cité :
En 1836, par exemple, M. Berbrugger, fatigué de la périphrase officielle « possessions françaises dans le nord de l’Afrique » qu’il lui fallait employer chaque fois qu’il avait à désigner la colonie, se rappela fort à propos avoir lu, dans je ne sais trop quel bouquin, le mot « Algérie ». Ce mot avait le triple avantage d’être court, harmonieux, et de bien rendre la pensée. Algérie dès lors remplaça dans tous ses articles les huit mots consacrés dont il s’était servi jusqu’alors faute de mieux. À peine cette énormité fut-elle connue à Paris, que toutes les chevelures des affaires d’Afrique se hérissèrent. On fulmina séance tenante un blâme furibond à l’endroit du malheureux néologiste qui, dégoûté, poussé à bout, résigna, dix-huit mois après les avoir acceptées, ses épineuses fonctions de secrétaire-rédacteur368.
Pourtant, le Trésor de la Langue Française donne bien le mot répertorié dans le
dictionnaire du père Trévoux ; mais son application à la colonie n’est pas signalée369. Les
témoins de la presse naissante dans les colonies comprennent qu’ils sont en train de vivre un
moment historique : leur « pulsion autoscopique » s’accroît d’autant plus qu’ils ont déjà la
conscience de l’importance des journaux. D’où, sans doute, cette insistance à faire de l’Algérie
un mot inventé pour les besoins de la presse370. Autre territoire, même intérêt : à la Réunion,
Raffray – que nous avons déjà évoqué – publie dans Le Bien-Public une série d’articles intitulée
« De la presse à Bourbon depuis quarante ans371 ». Ce journaliste qui fait varier ses signatures
– d’abord R….Y pour ces articles, puis J-M Raffray dans La Réunion – adopte d’abord une vue
générale, qui ne se limite pas à l’île mais présente une opposition forte entre la gazette et le
journal, partant entre le gazetier et le journaliste. Dans cet article politique, il évoque aussi les
débuts de la presse dans l’île :
Ici, le journalisme ne fut encore qu’un faible écho des gloires de l’empire ; ce n’était pour ainsi dire qu’un rappel de tambour battu dans un petit coin isolé du globe, pour rassembler sur une plage lointaine quelques Français, quelques soldats et leur lire les proclamations, les
367 Charles Desprez, Alger naguère et maintenant, Alger, Imprimerie du Courrier de l’Algérie, 1868. 368 Ibid., p. 289. 369 Abrégé à partir de maintenant en TLF, disponible à l’adresse http://atilf.atilf.fr/tlf.htm. 370 Ce fantasme du rôle de la presse se retrouvera pour l’invention du mot « sabir », que nous traiterons dans la troisième partie plus précisément. 371 Raffray, « De la presse à Bourbon depuis quarante ans », Le Bien-Public, 14 mars, 21 mars, 28 mars, 4 avril, 11 avril 1851.
133
ordres du jour de leur chef, voyageant en conquérant de capitale en capitale.
L’insistance sur le territoire colonial, sur « ce petit coin du globe », fonde une rhétorique
d’opposition à la métropole. L’utilisation de l’« écho » va aussi dans le sens d’un
amoindrissement volontaire, mais pour mieux servir l’élan qui va définir positivement la
colonie – et plus particulièrement sa presse. On ne sait trop, alors, à qui s’adresse le
texte : coloniaux à qui il faut rappeler leur histoire, métropolitains qui aimeraient
apprendre ? Après ce rappel des temps passés, il développe aussi d’autres ambitions pour la
presse réunionnaise, et ce texte vaut programme :
Notre presse peut être littéraire aujourd’hui : n’avons-nous pas bien des tableaux pittoresques à exécuter en groupant tous ces types originaux de nos anciennes mœurs, types uniques, vieux débris qui s’en vont et disparaissent tous les jours ? N’avons-nous à peindre ces mœurs créoles qui, si elles n’ont pas leur côté grandiose, ne manquent pas que d’avoir une certaine fraîcheur, une certaine originalité, bien digne d’occuper le pinceau d’un artiste ? Que de vieilles légendes bien suaves, bien naïves, bien terribles même nous ont raconté nos pères !... […] Oui, notre presse peut être littéraire : notre jeunesse s’éclaire, elle est ardente, intelligente ; elle veut penser, elle veut connaître372.
C’est sur des assertions comme celles-ci que nous bâtissons notre projet d’étude : la
presse coloniale – ou du moins certains de ses auteurs – a eu conscience de son rôle littéraire et
d’une particularité littéraire propre à la colonie, avant que les romans se saisissent de ces
questions. Cette prétention à une littérarité médiatique et coloniale peut se comprendre en
envisageant deux types de lectorat, l’un colonial et l’autre métropolitain. L’affirmation d’une
littérature propre à l’île passe ainsi pour un manifeste dont il faut interroger les aboutissements.
La double destination des textes coloniaux médiatiques se retrouvera dans la théorisation de la
littérature coloniale : de cette première ambiguïté (à qui est destiné le texte exactement ?) naît
l’un des aspects de cette littérature pensée comme une excroissance au corpus littéraire national.
Transition : du journal colonial au territoire colonial
Le journal colonial constitue une structure de publication fixe à partir de laquelle les
hommes de lettres des différentes colonies peuvent faire paraître des textes locaux au milieu
d’autres publications témoignant de l’identité coloniale. Pris dans le flux de l’actualité, dans les
publications de feuilletons appartenant à la littérature nationale, dans les publications savantes
également, ces textes offrent aux coloniaux une facette textuelle de leur identité : c’est une
première étape de leur identité culturelle. Le journal révèle également la manière dont
fonctionne tout un pan de la société coloniale : le rôle des publicistes, la pensée d’un lectorat
372 Ibid.
134
double, l’absence d’écritures autres montrent, avec les autres axes que nous avons étudiés, la
perpétuation d’un modèle idéologique au sein des périodiques. Ces premiers éléments tiennent
à une culture coloniale française, et qui se revendique comme telle, avec des particularités
médiatiques et littéraires liées à une identité culturelle. Mais l’on retrouve également dans le
journal les éléments définitoires de l’identité coloniale au sens large, au premier rang desquels
le territoire et ses représentations. C’est en effet l’un des premiers marqueurs de l’identité
coloniale que le rapport à un territoire qui n’est pas celui de la nation historique : la mission du
journal – d’abord officiel, puis éventuellement privé – consiste à témoigner d’une appartenance
territoriale en même temps qu’à convaincre ses lecteurs (même locaux) de la réalité de cette
appartenance.
Différents moyens sont mis au service de cette mission idéologique, et ces moyens
reprennent ce que nous avons expliqué ici du modèle médiatique colonial : les éléments les plus
variés construisent le territoire, de la mention en sous-titre de l’espace concerné par la
publication jusqu’aux textes les plus descriptifs contenus dans le feuilleton. C’est tout un réseau
qui apparaît en fait entre les colonnes des journaux coloniaux, et un réseau dont l’on peut
retracer les évolutions – liées à l’évolution des techniques de communication – au cours du
siècle. Les écrits de la presse coloniale sont à ce titre éminemment modernes, au sens où ils
dépendent des évolutions technologiques et où ils les reflètent. Ce rapport à la mondialisation
en cours participe de l’identité coloniale en faisant varier les perceptions du territoire
colonisé : ces perceptions, constructions et descriptions qui spatialisent l’écriture sont au centre
de notre deuxième partie.
135
Deuxième partie – La presse et le territoire
« Le Territoire devint la gueule armée de l ’Unicité1 »
Les cités viennent après les empires dans les « lourds antécédents2 » comptant dans
l’appréhension actuelle des territoires par lesquels Bertrand Badie ouvre son étude des
territoires ; et le spécialiste en relations internationales d’affirmer que « le projet culturel qui
fonde la construction impériale est peu compatible avec le principe de territorialité3 »,
notamment parce qu’il est universaliste, et s’accommode d’une forme de multiculturalité, d’un
« dégradé territorial4 » ne donnant pas à tous les territoires les mêmes droits. Plus simplement,
« l’Empire se dévoile comme une construction politique originale, dotée de son propre usage
du territoire qui se distingue de l’Etat-nation pour opposer, aux vertus de l’unicité, de la fixité
et de la frontière, celles de la multiplicité, de la souplesse et des limes5 ». Ouvrir sur ce point de
vue politique, diachronique et général nous éloigne de notre perspective mais nous permet
pourtant de montrer à quel point la notion même de territoire est un enjeu fondamental de la
construction impériale, et donne lieu à une polyphonie régie par le domaine d’où s’exprime
l’auteur : le vieux guerrier de Patrick Chamoiseau, obsédé par le territoire colonial, et que nous
avons cité en épigraphe, évoque en effet le Centre comme obsession, l’Unicité comme
représentation du territoire colonial, bien loin de l’analyse géopolitique de Bertrand Badie. Aux
confins de ces deux pensées, l’une rétrospective et théorique, l’autre engagée et littéraire, le
territoire apparaît tout de même comme le point central d’où rayonne la pensée impériale,
partant la pensée coloniale : et c’est en équilibre entre ces deux perceptions que nous tenterons
de développer une étude littéraire et médiatique du territoire colonial. Il s’agit maintenant de
voir comment la presse coloniale a mis en place, en son temps et sans distance interprétative,
son imaginaire territorial. La colonisation reste bien une affaire d’expansion territoriale : c’est
également et surtout le point de départ de la presse coloniale, l’un des points cruciaux de ses
développements et de ses problématiques. Il faut montrer un attachement au territoire colonisé,
1 Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, Paris, Gallimard, 1997, p. 26. 2 Titre du premier chapitre de Bertrand Badie, La Fin des territoires, Paris, CNRS Éditions, coll. « Biblis », [1995], 2013, p. 17. 3 Ibid., p. 20. 4 Ibid., p. 28. 5 Ibid., p. 27.
136
une connaissance, un lien, tout ce qui pourra justifier le développement d’une population
coloniale même peu nombreuse. Et si l’on va plus avant dans la compréhension de cet
attachement et de ce lien au territoire, c’est par la construction intellectuelle, culturelle, voire
littéraire qu’il faut passer. Apparaît alors une sorte de théorie du point de vue dans la presse
coloniale, quelque chose comme un « antexotisme », pour reprendre le concept développé par
Pierre Halen lorsqu’il explique que :
Le colonial, qui ne voyage pas mais s’établit en un lieu qu’il a tout intérêt à connaître suffisamment pour y assurer sa survie, est obligé, à rebours de l’exotisme et de la logique viatique, d’adopter un antexotisme à même de stabiliser sa relation au lieu et d’en faire un rapport d’habitation et de production6.
Le point de vue colonial sur le territoire est donc la pierre angulaire des récits qui vont
se développer au sein de la communauté coloniale. Dans la même perspective, il n’est pas si
étonnant de commencer par évoquer la relation au lieu avant de se pencher sur les habitants, si
l’on considère comme le fait l’historienne Cécile Vidal que dès le premier empire colonial, la
fragilité des liens entre un souverain et ses « lointains sujets d’origine européenne » ainsi que
les rivalités impériales et les multiples changements de souveraineté qu’elles entraînèrent conduisirent à l’émergence d’une double préoccupation relative à l’identité ethnique des colons et au statut des territoires ultramarins7.
Ce point de vue correspond assez bien à ce que l’on peut observer pour les territoires
coloniaux qui bénéficient d’un journal ; elle s’applique particulièrement, cependant, aux
Antilles, à la Guyane et à la Réunion, colonies anciennes et éloignées ayant vécu ces
« changements de souveraineté » marquants : qu’on pense à l’indépendance haïtienne de 1804,
au traité de Paris qui sanctionne la perte de plusieurs territoires – Tobago, Saint-Domingue – et
le retour de quelques autres – la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion (alors Bourbon), la
Guyane, Saint-Pierre et Miquelon. Mais la « double préoccupation » reste valable pour tous les
territoires que nous envisageons, la Nouvelle-Calédonie, l’Algérie, Tahiti, la Cochinchine : le
territoire et l’identité vont de pair pour ces colonies nouvelles que l’empire français intègre au
cours du siècle et plie à ses exigences. À ces remarques sur les spécificités que la colonisation
introduit dans le rapport qu’entretiennent les coloniaux et le territoire sur lequel ils s’implantent,
faisant abstraction ou annihilant les premiers habitants, on peut ajouter des faits à la portée plus
6 Pierre Halen, « Pour en finir avec une phraséologie encombrante », Regards sur les littératures coloniales, tome I, dir. Jean-François Durand, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 55. 7 Cécile Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre colonies et métropole, XVIe-XIXe siècle, Paris, éditions de l’EHESS, 2014, p. 25.
137
générale. La période que nous traitons est en effet celle du développement de la mondialisation,
phénomène auxquels les textes participent. D’un point de vue technologique,
Si l’on combine lignes terrestres et câbles sous-marins, on assiste à la mise en place d’un réseau véritablement international de liaisons télégraphiques dans le dernier tiers du XIXe siècle. Selon Christophe Grataloup, l’adjectif « mondial » serait même apparu pour la première fois sous la plume du géographe Elysée Reclus dans sa Géographie universelle publiée en 1893, en évoquant précisément le « réseau mondial » des câbles télégraphiques8.
Le développement de l’empire colonial français participe de ce réseau qui se met alors
en place, et le journal sert volontiers de reflet à ce développement technologique ; mais il
catalyse aussi, il accélère la mise en réseau par ses impératifs. Enfin, il faut bien préciser que le
territoire ici est étudié selon notre projet initial, autrement dit sa construction par et pour les
colonisateurs, avec les œillères qui caractérisent leur perception de ce territoire. Il est évident
que ce qui ressortira de l’étude négligera la perception autochtone du territoire, son histoire
antécoloniale, ses logiques propres que la colonisation a bouleversées : il est bien question ici
d’une littérature quotidienne, triviale souvent, idéologique en tout cas. De la même manière, la
perspective de comparaison des territoires colonisés par la France peut donner l’impression
d’un aplanissement des particularités : d’où certains passages, centrés sur des territoires précis,
pour nuancer des constats trop généraux. Mais le point commun des études que nous
développerons dans cette deuxième partie réside dans le traitement textuel réservé aux
territoires colonisés : c’est par eux que se construit l’image première de la présence coloniale.
1 L’éloignement colonial mis en lumière
« Je vous serre la main par-dessus l’isthme de Lesseps9 », écrit en 1879 le correspondant
métropolitain d’un périodique réunionnais à ses lecteurs lointains ; et cette formule révèle la
complexité du lien entre la métropole et les colonies dans ces décennies marquées par les
progrès techniques. Elle pose aussi la question suivante : qu’évoquent alors pour les lecteurs
métropolitains du XIXe siècle les colonies ? L’éloignement, l’exotisme et l’étrangeté : c’est ce
qu’on peut tirer d’un ouvrage connu dans les études littéraires coloniales, Philoxène ou de la
littérature coloniale, paru en 1931. Eugène Pujarniscle, l’auteur, y écrit dans les premières
pages que « la littérature coloniale, à une époque comme la nôtre, où les moyens de
8 Bruno Marnot, La Mondialisation au XIXe siècle (1850 – 1914), Paris, Armand Colin, 2012, p. 226. 9 Victor Pujo, « Correspondance coloniale », Le Sport colonial, 18 octobre 1879.
138
communication sont rapides, nombreux, commodes, et où les colonies commencent à être
connues même du grand public, ne peut plus rester ce qu’elle était aux siècles précédents, un
genre fantaisiste10 ». Nous reviendrons sur le reproche de « fantaisie » fait à une littérature
donnée comme exotique ; mais apparaît bien ici l’idée que la connaissance des colonies est liée
au développement des moyens de communication. Les auteurs coloniaux du XXe siècle
entreprennent de montrer que leur siècle est celui de l’épanouissement de la littérature
coloniale parce que la distance était auparavant un frein trop important : l’intérêt des lecteurs
n’aurait crû qu’à mesure que le sentiment d’éloignement diminuait. Et il est vrai que, d’un point
de vue historique,
les empires coloniaux se distinguent […] des autres empires par au moins deux caractères déterminants. Leur dimension ultramarine implique une grande distance géographique entre le centre métropolitain de taille réduite et les périphéries colonisées recouvrant souvent d’immenses superficies peuplées de populations très diverses11
comme l’explique Pierre Singaravélou dans son introduction à l’étude des empires au XIXe et
XXe siècles. Cette hétérogénéité territoriale est cependant traitée et conditionnée par un même
dispositif textuel initial, à savoir le journal. C’est que le journal colonial est inextricablement
lié à la « condition coloniale », dont il tire sa spécificité ainsi que ses mécanismes d’expression,
sa forme, ses problématiques : éloignement du centre métropolitain, occupation problématique
d’un territoire étranger, prédominance des questions agricoles et industrielles, forte présence
administrative, inégalités profondes entre colonisés et colonisateurs. C’est en effet par son
traitement des aspects matériels que la presse coloniale se forge une identité textuelle à
part : elle exhibe son fonctionnement, son caractère périphérique par rapport au centre culturel
parisien, son décalage permanent avec l’actualité métropolitaine, sa capacité à traiter
l’information reçue le plus rapidement possible. Le journal colonial est bien le point névralgique
de la colonie : les formules qui annoncent les faits divers, par exemple, en font bien le centre
des informations. « On nous écrit de… », « on lit dans… », « nous recevons des nouvelles
de » : toutes ces informations parcellaires, ces petits récits de la vie coloniale (nouvelles
militaires, chasses, réussites agricoles, accidents) aboutissent tous au périodique produit dans
une ville suffisamment importante pour recueillir les échos locaux, mais aussi nationaux et
internationaux. Cette mise en écho de nouvelles provenant de points différents est l’un des
10 Eugène Pujarniscle, Philoxène ou de la littérature coloniale, Paris, Didot 1931 ; réédité chez L’Harmattan (Paris) en 2010, avec une présentation de Jean-Claude Blachère avec la collaboration de Roger Little, p. 17 pour la citation. 11 Pierre Singaravélou, « Introduction », Pierre Singaravélou (dir.), Les Empires coloniaux. XIXe – XXe siècle, Paris, Points, 2013, p. 14.
139
points de définition du périodique colonial ; mais il est vrai que le point majeur en reste la
distance à la métropole. On se focalisera ici sur quelques points particuliers de ces matérialités
que le régime médiatique laisse paraître : d’abord le bateau et ses corollaires (le courrier, le
packet), puis la mise en réseau des colonies qui s’observe dans les textes, et enfin le rôle de
certains lieux qui cristallisent l’éloignement colonial autant que la naissance du territoire
colonial comme terreau textuel. Ces rubriques sont apparues au fil des dépouillements par leur
omniprésence : sans a priori, elles permettent de préparer l’étude des descriptions qui feront le
cœur du deuxième chapitre. Et si l’on quitte ici le terrain proprement littéraire, c’est pour mieux
envisager une production médiatique complète : de fait, les périodiques coloniaux offrent de
larges pages aux textes permettant l’amélioration des productions agricoles ou industrielles,
autant qu’ils font voir à leurs lecteurs une inscription dans un monde qui complexifie ses
réseaux. Les publications de « voyages » divers dans la presse coloniale mettent en lumière
cette aspiration à la mise à distance : quand un certain Trabaud, qui n’est pas un collaborateur
régulier, publie dans Le Messager de Tahiti le récit de sa traversée jusqu’à l’île, il s’agit bien
de montrer la distance dans le périodique, de revendiquer cet exotisme par rapport à la
métropole12. En outre, l’une des particularités des textes médiatiques dans la colonie réside dans
leur capacité à être reliés aux grandes évolutions technologiques, et à faire émerger ainsi une
histoire littéraire du support, une histoire de l’écriture en contexte, traversée autant que régie
par des problématiques qui tiennent à l’origine des textes, cet éloignement premier et fondateur
de l’imaginaire colonial.
1.1 Bateau, courrier, packet : l’éloignement par les textes13
Le XIXe siècle est celui de l’évolution des technologies maritimes : les clippers anglais,
spécialement conçus pour traverser l’Atlantique, touchent à leur fin en 1856 ; la vapeur
remplace les voiles au fur et à mesure de l’avancée du siècle, et les empires coloniaux sont pour
beaucoup dans ces évolutions14. Les périodiques coloniaux offrent d’ailleurs un reflet
intéressant de ces évolutions du bateau, ne serait-ce qu’à travers les gravures qui agrémentent
les publicités pour les compagnies maritimes : il y a bien une conscience du lien avec le navire
12 Trabaud, « De Paris à Tahiti, par Londres et New-York », Le Messager de Tahiti, du 14 mai au 25 juin 1870. 13 Ce passage est issu en partie d’un article paru sur la plateforme Médias 19 : « Un pan de l’identité coloniale : la presse coloniale et la circulation de l’information au XIXe siècle », Les journalistes : identités et modernités, Actes du premier congrès Médias 19 (Paris, 8-12 juin 2015), Guillaume Pinson et Marie-Ève Thérenty (dir.), 2017. URL : http://www.medias19.org/index.php?id=22749. 14 Léonce Peillard, Sur les chemins de l’océan : paquebots, 1830 – 1972, Paris, Hachette, 1972.
140
qui se lit dans les textes, dans la minutie des détails, les silhouettes évocatrices. Mais ces bateaux
qui rendent visible l’éloignement colonial par quelques vignettes ne sont pas les seuls à
apparaître dans les périodiques coloniaux. Par métonymie, du bateau surgit le packet, et
l’étymologie confirme le lien entre ces deux éléments prédominants dans la colonie. Le
paquebot est bien l’héritier de l’anglais « packet-boat » dont on a perdu la trace ; et pourtant le
« packet » a subsisté dans le jargon colonial, mot-clef de la colonisation et de son rapport à
l’espace et au temps. Le packet, c’est donc l’ensemble du courrier que les bateaux apportent
aux colonies : on y trouve des correspondances privées, des décrets de métropole, des
journaux… Chacun attend l’arrivée du packet selon ses intérêts, et le journal vit selon ses
rythmes : c’est une constante de notre période, même après l’invention des télégraphes qui
permettent pourtant des communications plus rapides et efficaces. Le packet et le bateau sont
des éléments primordiaux des représentations coloniales ; mais le bateau n’est pas seulement
un objet de représentation, tout fécond que soit ce motif pour les journalistes coloniaux. Il fait
aussi partie du sujet : l’écriture de la traversée permet aux auteurs de la presse coloniale de
matérialiser la distance, d’en faire l’indice d’une posture d’auteur particulière, liée à la situation
coloniale et au périodique dans lequel ils écrivent. Une étude thématique permet d’entrer plus
précisément dans cette mise en texte de l’éloignement et dans la manière dont les textes
coloniaux quotidiens jouent de cette part de leur identité.
Le « packet » colonial : la malle, le courrier, les nouvelles
Il est un type de paragraphe auquel les lecteurs de la presse coloniale sont
habitués : celui qui les prévient du retard des nouvelles d’Europe, et des répercussions que ce
retard peut avoir sur la production médiatique – selon l’exemple que nous donnons ci-dessus15.
Ces rouages mis au jour par les périodiques coloniaux participent d’un des rythmes de la vie
15 Le Propagateur, 18 mars 1864. Le journal paraît en Martinique.
141
coloniale ; ils apparaissent souvent dans les toutes premières lignes du journal, et ressemblent
plus ou moins à celui que nous citons ici :
Nous devons au passage sur notre rade d’un bâtiment du commerce français, le Hambourg, allant de Karikal à la Martinique, quelques journaux dont le contenu ne supplée que très incomplètement à l’absence de la malle que l’Estafette nous fait si longtemps attendre16.
Ils se font parfois plus précis, apparaissent au cœur des correspondances ou pour signaler
un envoi vers la métropole, et pas seulement la réception du courrier : « la malle prochaine
portera nos doléances aux autorités compétentes de la Métropole17 », écrit ainsi un journaliste
de La Caricature réunionnaise en 1872, après une querelle au sujet de la représentation du
peuple colonial ; une correspondance des Antilles commence par une mise en scène de la
transmission : « Monsieur le rédacteur, j’apporte à ma lettre d’hier un complément
qu’emportera le packet anglais18 » ; un journaliste de L’Avenir l’évoque en post-
scriptum : « Nous avions fait composer le libellé in extenso, l’arrivée du packet nous oblige à
en supprimer la première partie qui est l’apologie de la situation de la Martinique19 ». Un cas
en-dehors de notre corpus peut enfin être convoqué ici pour sa valeur exemplaire : Le Messager
de l’Indochine, qui paraît pour la première fois le 19 février 1865, affiche comme but
l’information des comptoirs français (d’où son absence de notre corpus régulier). Il vaut ici
pour un bon exemple de l’influence des mouvements maritimes sur les publications
périodiques, puisque ce « courrier financier et commercial de l’Extrême-Orient » paraît une fois
par mois, « le jour du départ du paquebot des Messageries impériales desservant la ligne de
l’Indochine », comme le précise son sous-titre.
Ce packet, autrement dit la « malle » – on peut se rappeler ici que c’est le titre d’un
périodique réunionnais, preuve de son importance – désigne par métonymie, en passant par le
courrier d’Europe et d’ailleurs, les liens avec le monde extérieur. Emblématique car réservé
exclusivement au contexte colonial, contrairement à une « malle » aux usages plus souples, le
packet est pourtant mal aimé : il est anglais d’origine, nous l’avons rappelé ; les dictionnaires
français ignorent sa présence et lui préfèrent le terme de « paquet20 ». Le journal colonial,
16 Le Moniteur de l’île de la Réunion, 3 mars 1855. 17 La Caricature, 22 juin 1872. 18 D’Orville, « Correspondance », Les Antilles, 7 août 1869. 19 L’Avenir, 22 avril 1862. 20 On trouve dans le dictionnaire de l’Académie (1835), à « Paquet » : « PAQUET se prend quelquefois pour toutes les lettres et les dépêches que porte un courrier. Le paquet d'Angleterre. Le paquet d'Espagne ». Dans le Larousse de 1864, « packet » n’apparaît que pour expliquer l’étymologie de « paquebot », autrement dit packet-boat. Packet est alors défini comme « paquet de dépêches ».
142
lui, utilise abondamment le terme « packet21 » : faut-il y voir la preuve d’un fonctionnement
colonial si particulier qu’il ne trouve même pas droit de cité dans la langue normée de la
métropole ? Sans aller jusqu’à cette extrémité, il faut reconnaître que le packet est ignoré hors
des colonies dont il est un élément structurant. Hormis l’Algérie, qui est suffisamment proche
de la métropole pour ne pas exagérer l’importance du courrier, tous les périodiques présentent
à leurs lecteurs les aléas du packet pour justifier leurs publications. Un exemple parmi d’autres
sera donné par cet extrait de L’Indicateur colonial réunionnais, pris en 1841 :
Bien qu’il soit arrivé plusieurs navires de France pendant la semaine, nous n’en sommes pas plus riches en nouvelles que la semaine dernière, puisque les départs de ces bâtiments sont antérieurs à celui de l’Iris qui a quitté Marseille le 8 août, et qui nous a fourni les faits déjà anciens que nous avons publiés dans notre dernier numéro22.
Le packet est à ce point important que, même au cours d’une expédition, la scène de
réception du courrier est l’occasion d’une pause dans le récit, et d’un rappel de la situation
coloniale. C’est ce qu’on lit dans une « promenade militaire » publiée en 1862 dans Le
Messager de Tahiti, et au cours de laquelle le narrateur laisse une place pour une scène de
lecture improvisée :
Une surprise nous attendait au dessert : au moment où l’Amu-raa-maa s’achève, une baleinière de la direction du port accoste le rivage ; elle apporte au Commandant des dépêches d’Europe, qu’elle est allée chercher à bord d’un navire de commerce que nous apercevons au large. Un bureau de poste s’établit au bord de la mer, sous un Burao ; (1) les sacs sont ouverts par des mains impatientes, chacun reçoit ce qui lui est destiné et le poste-office se change en salon de lecture. C’est un beau souvenir du pays qui nous arrive au moment où nous allons nous éloigner pour quelques jours de notre petite capitale de Papeete23.
Le courrier devient « souvenir du pays », preuve de sa portée métonymique dans les
textes coloniaux ; et cette lecture inopinée, faite dans un paysage tahitien marqué par la langue
exotique, témoigne de son importance dans l’imaginaire colonial. Le détail même du sac et des
mains, focalisant l’attention sur l’impatience des coloniaux – ici, des soldats – fonctionne
comme un rappel de leur condition et de cet éloignement si important dans les périodiques. Le
courrier est à ce point important qu’il n’est pas limité aux entrefilets annonçant des arrivées et
des retards ; devenu l’objet de scènes chargées d’émotion et de sens, il permet de petits récits
plus développés, à part dans les colonnes. Si la préoccupation ne varie pas, la forme peut se
21 L’Avenir a ainsi une rubrique intitulée « Nouvelles du packet » dans les années 1860. 22 L’Indicateur colonial, 27 novembre 1841. 23 « Promenade militaire autour de Taïti », Le Messager de Tahiti, 16 février 1862. Le Burao est précisé en note de bas de page : hibiscus taliaceus ; et l’Amu-raa-maa a été traduit dans une note précédente par « festin ».
143
faire plus libre : ainsi, un extrait des Antilles du 2 janvier 1872 montre comment l’arrivée du
packet peut donner naissance à une forme de micro-récit. On lit dans le « bulletin » publié en
première colonne :
Lundi passé, entre six et sept heures du matin, le canon du sémaphore annonçait un steamer au large, et n’écoutant que la voix des probabilités, nous nous préparions à recevoir le courrier de Saint-Nazaire du 14 décembre, qui nous semblait quelque peu en retard et avait, d’ailleurs, été signalé à faux la veille, dans la soirée.
Ce second coup de canon devait être une nouvelle déception. En effet, le navire en vue ayant gagné la rade, nous acquérions la
certitude que ce n’était point l’intercolonial attendu de Saint-Thomas avec les malles françaises, mais bien le North-America, de la ligne des États-Unis au Brésil […].
Autre déception. Toute communication était immédiatement interrompue entre la
terre et le North-America qui, provenant d’un port soupçonné de contamination, était de droit soumis à une quarantaine ; et, de cette manière, s’élevait une barrière infranchissable entre nous et les passagers et s’évanouissait l’espoir d’être mis en possession des journaux de New-York et des télégrammes sous-marins jusqu’au 23 du mois passé24.
Pourquoi parler ici de micro-récit ? L’usage des temps verbaux nous y autorise, ainsi
que la scansion des paragraphes : il s’agit bien, pour le journaliste, de peindre une action – plus
que d’expliquer vraiment, ce qu’il fera à la fin, pourquoi le journal manque de nouvelles
fraîches. Il y a ici une explication purement pragmatique à ce développement : le journal
manque de nouvelles et a besoin de remplir ses colonnes – par n’importe quel moyen, semble
signaler ce texte. Mais on y lit aussi l’ancrage multiple des Antilles, entre la métropole française
et les voisins d’Amérique, ainsi qu’une forme d’angoisse mise en scène par la métaphore de la
« barrière infranchissable », qui dessine une insularité synonyme d’isolement. C’est donc par
le packet et ses apports que certains territoires peuvent être rapprochés des colonies, que ce soit
la métropole ou les terres voisines – cet ancrage multiple que nous venons d’évoquer. L’un des
exemples de cette proximité réside dans le traitement des faits divers : de petites séquences
narratives, prises dans les périodiques reçus, font du journal colonial le creuset d’un récit plus
vaste que ses simples limites géographiques. Deux exemples peuvent illustrer ce propos. Le
premier, le récit d’un « incident tragique à Charleston » dans Le Propagateur martiniquais du
3 mai 1864, sous la rubrique « Petite chronique », apparaît ainsi sans source précise si ce n’est
cette introduction :
Les Yankees jettent de temps en temps un obus dans la ville, et personne n’y fait attention. Mais le malheur a voulu qu’une bombe mit
24 Les Antilles, 2 janvier 1872.
144
en deuil toute la société. Voici comment le fait est raconté par un journal de Charleston25.
Le récit présente ensuite les deux personnages, la fille du gouverneur et son fiancé, et
leur cérémonie de mariage : « Au moment où le ministre épiscopalien demandait aux fiancés
s’ils étaient prêts à l’écouter, un obus tomba sur le toit de la maison, pénétra dans la pièce où
se trouvait l’assistance, éclata et blessa neuf personnes […] ». S’ensuit une scène pathétique
rendue par les discours directs des deux jeunes gens, qui se marient avant le décès de la jeune
fille.
Une légère rougeur colora un instant [le] pâle visage [de la jeune fille] ; on voyait que la douleur et la joie se partageaient son âme. Étendue sur un divan, sanglante dans ses vêtements de fête, les cheveux épars, elle n’avait jamais été plus belle26.
Le texte se développe ainsi, avec quelques intrusions d’un « nous » auctorial mal situé,
par exemple quand il faut conclure sur le personnage du fiancé : « Le lieutenant de Rochelle a
juré de périr en combattant les Yankees, et nous sommes certains qu’il tiendra parole ». Ce
texte, qui se présente comme une « petite chronique » à une période d’instabilité des rubriques,
témoigne aussi de l’hybridité que permet le packet dans la presse coloniale : hybridité des
genres d’abord, et hybridité géographique aussi. En ce qui concerne le genre, ce « journal de
Charleston » pose question : d’abord quant à son existence réelle (l’anecdote peut être l’écho
de correspondances privées) ; pourquoi ne pas avoir donné le titre de ce journal de Charleston,
probablement francophone27 ? Ensuite quant à son contenu : le texte est-il une invention à partir
d’une brève, ou la retranscription mot pour mot d’un article ? L’état de conservation des
périodiques ainsi que l’avancée des recherches actuelles en littérature médiatique font que la
« viralité28 » des textes n’est pas aisément démontrable : on ne peut, pour le moment, que se
cantonner au stade des hypothèses. La proximité entre les Antilles et leur voisin continental
permet, en tout cas, l’intrusion de tels faits divers dans le cœur du journal colonial, et permet
aussi une grande liberté dans le traitement : premier indice d’une identité coloniale par les
textes. L’effet de proximité et de distance se joue aussi à l’échelle de la page, par la
25 Le Propagateur, 3 mai 1864. 26 Id. 27 En ce qui concerne la vitalité de la presse francophone en Amérique du Nord, voir Guillaume Pinson, La Culture médiatique francophone en Europe et en Amérique du Nord, de 1760 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Québec, Presses de l’Université Laval, 2016. 28 L’expression de « viralité médiatique » est empruntée au chercheur Ryan Cordell, qui a travaillé sur les republications et circulations de textes dans la presse américaine. Voir plus largement le projet Numapress : http://numapresse.hypotheses.org/. Consulté le 23 mars 2017. Y est cité un article de Ryan Cordell : « Reprinting, Circulation, and the Network Author in Antebellum Newspapers », American Literay History, vol. 27, Issue 3 Fall 2015, p. 417-445.
145
confrontation entre les textes : Le Courrier d’Oran du 6 mars 1861 présente ainsi, au sein du
même numéro, une « Origine des cinq prières des musulmans29 » et un article présentant une
coutume auvergnate jugée originale. Pris dans Le Moniteur du Puy-de-Dôme, voici ce que
contient le texte : la coutume veut que quand deux mariages sont célébrés en même temps, la
première mariée à sortir de l'église aura un garçon ; d’où des pugilats à la sortie des noces, et la
solution trouvée : faire sortir les mariées en même temps. Le ton est ici anecdotique, et la portée
des faits limitée ; mais ce qui ressort du contraste entre les deux textes, c’est l’effet d’étrangeté
que peut produire l’écriture exotisante d’une particularité locale française pourtant : la coutume
provinciale semble mise sur le même plan d’étrangeté que la leçon sur l’origine des cinq prières
musulmanes, et le lecteur se trouve de fait dans une position intermédiaire, à équidistance des
deux articles et de leur appartenance géographique. Par un jeu d’éloignement et de proximité,
le journal colonial réajuste les récits de faits divers – entendus ici au sens large – au cadre dans
lequel il paraît ; et ce sont bien les journaux fournis par le packet qui se révèlent être la variable
d’ajustement.
Le bateau, objet littéraire symbolique « Un journal qui entre pour la première fois dans la publicité, c’est un peu comme le
navire qui lève l’ancre et quitte la rade pour un autre monde30 » : c’est par cette comparaison
que l’éphémère Messager de la Martinique annonce la fin de sa publication et revient sur sa
parution. Cette comparaison pourrait paraître anecdotique, mais elle signale la prégnance du
motif de la navigation dans le monde colonial. Un autre extrait confirme cette association entre
le journal et le bateau : La Semaine illustrée réunionnaise insère en première page de son
numéro du 13 mars 1862 une « épître au Journal LA SEMAINE », signée par un abonné
anonyme, et dont nous en citons les premiers vers :
Aimable et cher Journal, quand ton navire cingle Au souffle du zéphir, pourquoi de ton épingle Crèves-tu sans pitié ces ballons si gonflés, Dans le ciel de Bourbon fièrement envolés […]31 ?
Passons outre le caractère polémique de l’épigramme (les « ballons si gonflés »
désignent d’autres journaux, réputés « commerciaux ») ; l’association entre le journal et le
navire est ici explicite. Tous deux reflets de la vie coloniale et de sa modernité, ils constituent
en effet les fondations d’une entente entre les journalistes et leur lectorat. C’est d’ailleurs une
29 J.-L. Bresnier, « Origine des cinq prières des musulmans », Le Courrier d’Oran, 6 mars 1861. 30 Le Messager de la Martinique, 27 juillet 1864. 31 « Épître au Journal LA SEMAINE », La Semaine illustrée, 13 mars 1862.
146
même idée que développe, onze ans auparavant, Raffray dans son feuilleton « De la presse à
l’île Bourbon depuis quarante ans ». Il y défend le personnage de La Serve32 avec la même
métaphore du bateau, y ajoutant cette fois un nocher et jouant de la définition des coloniaux
comme « Français d’un autre monde », transformant alors la traversée en franchissement du
Styx. La parole est alors plus libre que sous l’Empire, mais l’emploi métaphorique reste le
même, et Raffray a le mérite de développer sa métaphore pour la rendre plus compréhensible.
Aujourd’hui que l’océan gronde Que la tourmente a commencé Qui doit, Français d’un autre monde, Sauver votre esquif menacé ? Sans guide, hélas ! sur l’onde il flotte ; Où dont est-il notre pilote ? Qu’il parle et que de sa voix haute Il commande aux flots révoltés ! Vaine attente ! leur lâche audace Du mérite usurpe la place ; Mais quand le péril est en face A quoi servent ces nullités ! La Serve, en nocher plus habile, Combattant le flot mutiné, Oh ! qu’avec éclat pour ton île Ta forte voix eût résonné33 !
Et plus précisément encore, le bateau, symbole de la colonisation, de la distance, de
l’aventure, est chargé d’un sens fort ; et c’est en tant que motif littéraire qu’il va être réinvesti
dans des textes à vocation mémorielle ou identitaire, avec un dessein esthétique autant
qu’idéologique. Bateau menacé par les flots, l’île de la Réunion n’est donc pas guidée par un
« publiciste », selon les mots de l’époque, qui pourrait être son nocher : c’est l’une des
utilisations faites du motif littéraire que nous traitons, mais ce n’est pas la seule. Le bateau est
à ce point important que l’on peut trouver sous la plume de « l’hermite » de la Case-Pilote une
« Ode sur l’établissement des nouveaux paquebots transatlantiques34 » dont les quatrains
déroulent une poésie de circonstances, peu marquée par l’humour ou la dérision – contrairement
à ce à quoi l’auteur avait pu habituer ses lecteurs. L’on connaît aussi l’importance du Mayflower
dans l’imaginaire américain ; or les colonies françaises dans leur ensemble n’ont pas un même
bateau, fondateur et symbolique, du fait même de leur éclatement et des différentes histoires
coloniales qui les définissent, mais plutôt une flotte de navires dont les noms témoignent d’un
32 Nicole Robinet de la Serve (1791-1842) : journaliste, avocat, homme politique. Collaborateur au Constitutionnel ; fondateur du Furet et du Salazien. Son fils Alexandre de la Serve (1821-1882) sera journaliste et député républicain, fondateur du journal Le Cri Public. 33 Raffray, « De la presse à Bourbon depuis quarante ans », Le Bien-Public, 14 mars 1851. 34 L’Hermite, « Ode sur l’établissement de nouveaux paquebots transatlantiques », Le Propagateur, 10 mai 1862.
147
événement important pour la vie coloniale. Dans le journal Les Antilles, une correspondance
des années 1860 mentionne l’un de ces navires :
Paris, le 1er juillet 1861. Vous souvenez-vous, Monsieur le Rédacteur, du Chaptal qui vous apporta dans les premiers jours de 1848 l’émancipation des esclaves et les décrets du gouvernement provisoire organisant la liberté aux colonies ? Je doute que le Packet qui emporte ma lettre, lorsqu’il s’arrêtera dans les eaux dormantes de votre rade, soit salué des bravos enthousiastes qui accueillirent le Chaptal, et cependant ce Packet est chargé d’un événement aussi important pour le moins que celui qui a illustré le Chaptal35.
Le bateau apportant les nouvelles est fondateur dans le discours médiatique
colonial : tout comme le Chaptal est ici nommé, un navire comme l’Isis est reconnu en
Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’en témoignent ses apparitions36. Plus largement, les noms des
vaisseaux sont cités dans les rubriques d’arrivées et de départs avec une régularité rassurante,
et la mythologie du navire se combine avec la portée pragmatique de journaux qui annoncent
l’arrivée de produits ou de personnalités attendues – on pense ici aux arrivées des gouverneurs,
comme dans ce passage de la Feuille de la Guyane française du 21 mai 1859 :
Dimanche dernier, 15 mai, à une heure après-midi, le sémaphore signalait le packet ; aussitôt la ville s’animait, la population affluait au rivage, les troupes étaient mises sous les armes. Le vapeur le Flambeau, ayant à son bord M. Tardy de Montravel, capitaine de vaisseau, gouverneur de la Guyane française, est bientôt entré, laissant tomber l’ancre en rade37.
Mais le traitement du bateau comme point de repère peut aussi se faire sous une tonalité
humoristique, qui révèle alors un peu plus le lien fort de la colonie – envisagée ici avant tout
comme territoire ultramarin – à la métropole. Ainsi d’un curieux texte anonyme, intitulé
« Adieux à l’Anacréon » et qui paraît dans le Courrier de la Martinique le samedi 3 mai 1851
afin de signaler la fin de service d’un navire.
Notre station navale s’en va peu à peu, pour se renouveler bientôt. […] Ils sont arrivés, ces fidèles zéphirs du mois de mai, qu’on attendait pour leur confier la voilure novice et timide de l’Anacréon, qui va entreprendre son dernier voyage ; un voyage, hélas ! comme il a depuis longtemps perdu l’habitude d’en faire.
Il est bien triste, l’Anacréon, transformé en gabare, en galiote, en coche d’eau, en tout ce qui peut se mouvoir lentement, sans feu et sans fumée.
35 « Correspondance coloniale », Les Antilles, 20 juillet 1861. 36 Voir notamment la « Chronique néo-calédonienne » de Félix H. Béraud datée du 7 septembre 1862, dont nous citons un extrait : « C’est par l’Isis que sont venus le premier groupe de colons de la mère-patrie ». 37 « Arrivée à Cayenne de M. le capitaine de vaisseau gouverneur Tardy de Montravel », La Feuille de la Guyane française, 21 mai 1859.
148
Privé de ses palettes agiles, c’est en vain qu’il agiterait sa voilure, c’est en vain qu’il battrait des ailes comme un oiseau pris dans la glu, sa traversée serait une nouvelle Odyssée, et il a plus loin de Fort-de-France à Brest que de Ténédos à Ithaque.
Mais l’Élan, marchant fièrement à pleine vapeur, donnera, au besoin, secours et protection à son compagnon paralytique qui, lui, marchera quand et comme il pourra. […]
Ce pauvre petit steam-boat qui a trouvé dans nos tièdes eaux un véritable océan de misère, a donc accompli sa dernière transformation. Il paraît qu’il était écrit là-haut, que l’Anacréon subirait dans son corps autant de métamorphoses qu’en faisait subir à son nom, la poésie locale : Arrivé aviso, devenu bouée, il s’en retourne à l’état de goélette, de brick, de brick-goélette ou de tout autre chose maritime dont nous ignorons la dénomination technique38.
Dans cet extrait, la tonalité hypocoristique et la complexité affichée du vocabulaire
maritime concourent à donner l’image d’un territoire qui vit par les arrivées et départs de bateau,
jusqu’à en développer une familiarité sentimentale. Autre exemple de cette familiarité qui fait
de la distance un élément de l’identité coloniale : le 11 février 1849, le tout jeune Éclaireur de
Cayenne publie dans ses variétés un texte centré sur « la boule39 » et qui laisse apparaître
plusieurs personnages du monde colonial dans leur rapport au navire et à ce qu’il apporte : le
négociant, les bureaux, les élégantes, la caserne, le colon ruiné sont mobilisés comme autant de
catégories sociales concernées. Mais à côté de ces intérêts personnels, la fin de l’article fait
apparaître l’importance de la nouvelle et de l’annonce :
Quel est l'homme qui n'aime point la boule ? Démocrate, elle vous annonça la République ; affranchis, elle a signalé votre émancipation ; colons, elle vous amènera cette réparation que vos frères de France ne peuvent tarder à vous envoyer.
Pour moi, je veux qu'on élève un autel à la boule dont le signaleur sera le grand prêtre40.
En Nouvelle-Calédonie, c’est en 1862, dans la « chronique néo-calédonienne » qu’on
trouve un texte équivalent, mais bien moins humoristique : l’auteur va chercher ici du côté de
l’épique, faisant du courrier d’Europe une sorte de Messie, un annonciateur de bonnes nouvelles
qui réunit le peuple colonial et lui donne une cohésion. Après deux parutions de cette chronique
seulement, c’est la première fois que le chroniqueur quitte la politique coloniale pour aller du
côté d’une scène de vie assumée comme telle, dans Port-de-France qui n’est pas encore appelée
Nouméa.
Chacun des habitants de Port-de-France dirige ses regards vers la montagne que le Sémaphore domine, debout comme une sentinelle vigilante, avec ses grands bras face à la mer. Tous les visages expriment
38 Le Courrier de la Martinique, 3 mai 1851, « Adieux à l’Anacréon ». 39 La boule hissée en haut des sémaphores donne des informations sur les conditions de navigation. 40 Lechartier, « Variété », L’Éclaireur de Cayenne, 11 février 1849.
149
un intérêt mélangé d’espérance et d’inquiétude ; de la main de l’un passe à la main de l’autre, le feuillet indicateur des signaux ; enfin, les poitrines, un instant comprimées, se dilatent en un grand soupir de satisfaction ; rapide comme l’électricité, une grande nouvelle circule en ville : un navire est en vue !
Il apporte sans doute le courrier d’Europe, et tous de chercher des yeux, pour y courir aussitôt, un point culminant d’où les regards puissent embrasser un vaste horizon. Encore quelques instants et, du sommet des collines […] vous verrez descendre vers le rivage des gens empressés, des officiers, des soldats, des marins et des colons ; bientôt on distinguera, à l’entrée de la baie, une blanche voile ; le navire s’avance, s’avance encore, il vient vers vous, il entre ; tous entendent le fracas de ses ancres qui vont mordre le fond ; oui, c’est le courrier d’Europe, ce sont les nouvelles de France que nous apporte ce navire qui, aujourd’hui, se balance mollement encore sur les eaux bleues de la rade41.
Le traitement de l’objet qu’est le bateau se retrouve donc pour lui-même, sa charge
symbolique étant suffisamment forte ; et l’arrivée du bateau rejouerait presque la scène
mythologique d’Égée guettant le retour de Thésée : les textes se focalisent sur l’attente des
nouvelles et l’attention portée à la voile qui apparaît à l’horizon42. Un ajout cependant constitue
pour nous un indice intéressant : la comparaison avec l’électricité, qui fait du bateau un élément
de modernité malgré cette intertextualité antique qui conduit les auteurs coloniaux à broder dans
leurs textes le motif de l’attente des bonnes ou mauvaises nouvelles. Le motif de l’attente,
cependant, est plus répandu que les connotations modernes : dans la première partie du siècle,
l’état d’avancement de la technologie encourage même les auteurs à jouer sur cet aspect de la
distance à la métropole. L’extrait suivant, pris dans un numéro paru en 1840 du Créole
réunionnais, témoigne encore plus clairement du motif égéen :
Éloignés comme nous le sommes de la mère-patrie, placés sur un rocher pour ainsi dire perdu au milieu de ce grand désert de l'océan, ayant tout à craindre ou tout à espérer des évènements politiques qui s'accomplissent là-bas, et dont les conséquences peuvent ébranler ou raffermir nos fragiles toits d'insulaires, ce n'est pas sans raison que nos regards s'attachent avec anxiété à l'horizon, ce n'est pas sans raison que le cœur nous bat, lorsqu'apparaît une voile, car c'est joie ou douleur qu'elle nous apporte43.
Ce texte n’est autre qu’une introduction aux nouvelles qui parviennent alors de la
Chambre : mais une introduction dramatisée, littérarisée, et qui modifie alors la portée même
des nouvelles politiques qui suivent. Le fait que les textes retrouvés sur ce thème soient
41 Félix H. Béraud, « Chronique néo-calédonienne », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 13 juillet 1862. 42 Dans une variante intéressante, une chronique locale de La Seybouse, le 1er août 1863, présente Bône ainsi : « Bône dormait la nuit, et faisait de longues siestes le jour ; en sorte qu’elle ressemblait beaucoup à la Belle-au-bois-dormant, quand le canon de la Casbah et celui de la Ville-de-Paris nous ont réveillés. Un grand événement se produisait ; notre cité algérienne, si délaissée d’ordinaire, était visitée par la flotte d’évolution qui venait de jeter l’ancre sur notre rade, et comme le prince Charmant avait tiré notre cité de sa somnolence ». 43 Le Créole, 1er mai 1840.
150
majoritairement issus des années 1850 amène à considérer une possible cristallisation des
enjeux de la modernité à ce moment du siècle. Le sentiment de modernité apparaît dans de
nombreux textes, y compris ceux que nous avons cités. Que ce soit par la comparaison avec
l’électricité, l’arrivée des nouvelles récentes ou l’évolution des techniques de navigation, le
bateau est le signe de la nouveauté. Or c’est précisément une temporalité moderne, liée à cette
nouveauté, qui constitue un soubassement de l’idéologie coloniale, habitée par l’idée d’un
temps linéaire soumis au progrès technologique. En somme, le thème littéraire du bateau est ici
une sorte de transfuge pour affirmer l’idée coloniale ; c’est l’hypothèse qu’on peut faire pour
expliquer la parution de ce type de textes, à la portée spéculaire, dans les territoires coloniaux.
Il n’est rien dans ces textes que les habitants ignorent : leur montrer ce qu’ils connaissent
devient ici un moyen d’affirmer leur identité, de créer une connivence en leur rappelant leur
statut au sein de la colonie. Il reste cependant d’autres textes qui jouent de ce motif marin : le
dépouillement fait apparaître dans les journaux coloniaux plusieurs articles qui se veulent écrits
en mer, ou pendant le débarquement, transformant la posture de l’écrivain et la rendant plus
« coloniale », dans les termes que nous allons voir.
L’auteur embarqué : une posture littéraire coloniale Si le bateau est donc un objet intéressant à traiter pour les auteurs de la presse coloniale,
il leur permet aussi de mettre au point leurs postures d’auteur, et ce quel que soit le genre
envisagé – pour autant qu’il autorise une représentation de soi. Utilisons ici le sens de posture
tel que l’on peut le trouver chez Jérôme Meizoz, qui définit « la posture comme la présentation
de soi d’un écrivain, tant dans sa gestion du discours que dans ses conduites littéraires
publiques44 » ; il ajoute encore que la posture « relève d’une ʺscénographie auctorialeʺ
d’ensemble. Par ce terme, Maingueneau décrit la dramaturgie inhérente à toute prise de parole,
centrant son attention sur l’énonciateur du discours. Parler de posture suppose de décrire ce
processus à plusieurs niveaux simultanément45 ». Pourquoi alors parler ici de posture et non de
scénographie auctoriale ? C’est que les textes que nous traitons affichent une prétention
autobiographique, et qu’ils sont les seules traces que nous ayons de la « conduite publique » de
leurs auteurs. L’une des ambiguïtés des textes que nous présentons, quand ils sont écrits à la
première personne, est de proposer une référentialité forte. Et dans ce cadre, se représenter
pendant la traversée apparaît comme un élément attendu des lettres ou récits qui signalent les
44 Jérôme Meizoz, « Ce que l’on fait dire au silence : posture, ethos, image d’auteur », Argumentation et Analyse du discours, 2009, n° 3. URL : http://aad.revues.org/667. Consulté le 17 septembre 2014. 45 Id.
151
auteurs de passage ou ceux qui cherchent un regard distancié sur la colonie. L’on peut ici
employer ce terme d’« attendu » eu égard à l’introduction que fait paraître La France d’Outre-
Mer au récit qu’elle publie :
Notre colonie a gardé un trop bon souvenir de M. A. Maurin, le successeur de M. Meynier, aux fonctions de Procureur général, pour que nous ne soyons pas assurés de faire plaisir à tous en recueillant dans nos colonnes un extrait d’un livre que vient de publier l’éminent magistrat sous le titre : Notes de voyageur. Le chapitre que nous allons mettre sous les yeux de nos lecteurs a évidemment été écrit par son auteur durant sa traversée pour se rendre à la Martinique46.
On peut souligner ici la portée de l’adverbe « évidemment » : la traversée apparaît bien
comme ce moment fondateur du récit de voyage, comme la transition nécessaire à la mise en
récit d’une découverte de la colonie, et ce trait est saillant dans de nombreux textes, qu’il soit
porteur d’extraordinaire ou non. Une traversée pour l’Algérie sera ainsi moins dramatisée
qu’une traversée pour les Antilles : on peut ainsi comparer une « lettre » qui paraît dans Le
Moniteur algérien à celle qui paraît dans Le Messager de la Martinique en 1864. En Algérie,
même si l’on n’est encore que dans les années 1840, on lit : « je montai sur le pont du navire
qui me portait en Afrique, et là sur le versant septentrional d’une des collines du Sahel, j’aperçus
une ville et cette ville était Alger47 ». L’anadiplose donne au texte un enchaînement qui est celui
de la simplicité : la vue inaugurale est simple, alors même que les années 1840 ne sont pas
celles de l’apaisement dans la colonie algérienne dont l’on discute alors les modalités
d’occupation. Un ton bien différent marque la lettre que le dénommé Sylvius48 fait paraître dans
un feuilleton intitulé « La Martinique pittoresque. Première lettre », dans Le Messager de la
Martinique, quelque vingt après le premier texte que nous avons cité. Pourtant des évolutions
technologiques ont eu lieu qui ont rendu les traversées, même transatlantiques, plus prévisibles
et moins risquées. Mais la lettre concerne alors un départ, et non une arrivée ; la distance n’est
pas la même, ni le choix d’ancrage générique ; dans l’Algérie de 1843, le texte se donnait à lire
comme une nouvelle, alors qu’il s’agit bien d’une vision « pittoresque » de la Martinique que
Sylvius met en mots :
La traversée. Je pars, mon cher ami, le navire m’a emporté, et je vous envoie
ces pages qui sont tombées de ma plume, au vent qui souffle des mornes martiniquais. Je ne les ai pas écrites sans plaisir, je l’avouerai, car je songeais, en les écrivant, au pays qu’elles allaient voir et que je ne dois pas revoir encore. Je n’ai pu m’empêcher de les regarder de cet œil
46 La France d’Outre-Mer, 1er septembre 1853. 47 B., Le Moniteur algérien, 10 novembre 1843. 48 Voir la première partie pour des précisions sur ce pseudonyme.
152
mouillé qu’on tourne vers ceux qui embrasseront bientôt les objets perdus de notre affection49.
L’auteur travaille ici sa posture d’écrivain en voyage ; il choisit pour cela l’épistolaire,
et le moment de la traversée comme temporalité intermédiaire. C’est que la traversée est en
effet un motif littéraire fort : moment d’aventure dans les œuvres romanesques, elle garde cet
attribut dans les textes coloniaux, mais y joint d’autres particularités, plus symboliques que
diégétiques. La traversée, quand elle est représentée dans la presse coloniale, est ainsi le lieu
d’une mise en valeur de l’auteur et de ses liens – de son déchirement souvent – entre l’espace
colonial et l’espace métropolitain. La lettre écrite sur le bateau redouble ce déchirement : elle
signale, elle aussi, l’éloignement et l’implication de l’auteur. Sylvius, pour le cas qui nous
intéresse, continue ainsi son récit :
Quand nous partîmes pour la Martinique, il faisait un beau soleil de juin. Le vent qui nous avait été contraire pendant plus de huit jours, s’était enfin lavé à souhait, et vingt navires, comme des oiseaux échappés de cage, se répandaient avec nous sur l’horizon du Havre. Chacun s’en allait dans un coin du monde. Combien de ces barques devaient périr ! Tel drapeau flottant orgueilleusement sur les flots, qui devait huit jours, quinze jours ensuite, le lendemain peut-être, s’abîmer avec tous ceux qu’il ombrageait ! Tout départ afflige, fut-ce d’une mauvaise terre. Il y a quelque chose de l’homme qui s’attache aux lieux indépendamment de leurs qualités, tel que les lianes créoles qui enveloppent aussi bien les mancenilliers que les arbres séculaires. Et je laissais dans cette France si chère de si nobles amitiés50 !
L’insistance sur le départ et le voyage modifie encore le rapport que le lecteur peut
entretenir avec le bateau, élément nécessaire et naturel de la vie coloniale, lien réel entre la
métropole et la colonie, métonymie d’un moment intermédiaire et dangereux qui représente
bien des aspects de l’entreprise coloniale. L’auteur du texte que nous venons de citer utilisera
aussi ce moment si particulier dans le cadre d’une entreprise plus romanesque : dans le même
Messager de la Martinique, et pour son dernier numéro du 31 août 1864, il fait paraître en
feuilleton « La Pomme d’une fille d’Ève51 ». L’action commence sur un bateau entrant au
Mexique, tout comme les lettres : la lumière est ainsi mise sur l’importance de cette scène dans
l’imaginaire de cet auteur de presse. C’est ainsi, plus largement, qu’on peut expliquer l’attirance
pour les titres qui mettent en avant la présence à bord : les « Fragments du journal d’un
passager52 » qui paraissent en décembre 1842 dans La Feuille hebdomadaire de l’île
49 Sylvius, « La Martinique pittoresque. Première lettre », Le Messager de la Martinique, 13 juillet 1864. 50 Id. 51 Sylvius, « La Pomme d’une fille d’Ève », Le Messager de la Martinique, 31 août 1864. 52 « Fragments du journal d’un passager », La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, décembre 1842. Le texte est trop fragmentaire pour pouvoir être soumis à une étude.
153
Bourbon ; l’un des poèmes d’Armand Closquinet, paru dans Le Moniteur de la Nouvelle-
Calédonie, « En mer », est conforté par la signature de l’auteur, qui précise : « à bord de la
frégate L’Isis53 » pour chaque livraison du texte ; et dans Le Messager de Tahiti, un auteur
nommé Celtibère signe en 1855, en feuilleton, un poème intitulé « Voyage autour du monde.
Taiti », qui commence ainsi :
Voilà donc Taïti, la perle de la mer, Ce port hospitalier, ce fortuné rivage ! Nous la touchons enfin. Favorable présage, Un iris merveilleux, dans les plaines de l’air, Le ciel libre partout et pur de tout nuage, Nous l’avait annoncée, avant qu’à l’horizon, Au milieu des vapeurs qui voilaient l’étendue, Elle sortît de l’onde et charmât notre vue. Maintenant à loisir foulant son doux gazon, Je tourne mes regards vers sa rade admirable Que des bancs de coraux, barrière inébranlable Défendent longuement des flots tumultueux54.
Le titre de « voyage » n’est pas aussi explicite que les précédents ; mais il est complété
par les premiers vers, et il ressort bien de ce poème la même tension que dans les autres textes
cités : le poète se met en scène au moment de toucher terre, quand sa présence sur le bateau lui
fait découvrir la terre colonisée ; par une ellipse marquée, une deuxième scène le montre déjà à
terre, regardant la rade où il est arrivé. Dans cette rapide succession de tableaux, on lit le récit
d’une arrivée centrée sur le port, véritable cœur de la colonie. Et, plus intéressant encore,
Celtibère publie le 11 février 1855, après la deuxième partie de son « Voyage autour du
monde », un texte poétique intitulé « En mer », qui revient sur la traversée qu’il a effectuée
pour arriver à Tahiti :
Mi-octobre 17° 21’ lat.S. – 63° 39’0. Dieu ! que ne sommes-nous plus près de la patrie, Ou du moins navigant vers la France chérie, Si nous songions enfin à l’instant du retour, Combien je jouirais, o ciel ! de ce beau jour. […] Cap Horn Ouragan. Novembre …5455
53 Armand Closquinet, « En mer », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 14 septembre 1862, 5 octobre 1862, 26 octobre 1862, 14 décembre 1862. 54 Celtibère, auteur des Poésies religieuses, « Voyage autour du monde. Taiti », Le Messager de Tahiti, 28 janvier 1855. L’auteur n’apparaît pas dans le dictionnaire des pseudonymes ; ses Poésies religieuses ont été publiées à Paris peu de temps avant son départ, chez les principaux libraires, en 1852. 55 Celtibère, auteur des Poésies religieuses, « Voyage autour du monde. Taiti », Le Messager de Tahiti, 11 février 1855.
154
Progressant encore dans la mise en scène d’un écrivain « sur le pont », Celtibère utilise
ici les coordonnées spatiales comme moyen supplémentaire de transformer sa poésie en journal
de voyage, en témoignage d’une traversée. La publication d’un texte déjà âgé de quelques mois,
à en juger par la date, et qui raconte le passage du cap Horn met Celtibère du côté de ses
lecteurs : il réactive par le texte une expérience inaugurale qui est celle de l’éloignement vécu,
et permet au poète une expression qui se veut lyrique. Et même quand un journaliste choisit
d’écrire des « souvenirs », on y retrouve la même importance du bateau et de la traversée : ainsi,
quand Alphonse Alizart publie ses « Souvenirs d’un voyage de l’île Bourbon en France56 » dans
Le Courrier de Saint-Pierre en 1871, il précise en sous-titre « à bord de la corvette l’Égérie »
et décrit en effet sa traversée. Peu présent dans la narration, l’auteur insiste sur les événements
du bord : bal, tempêtes, repas, accidents… On y lit même la rencontre entre deux navires,
venant tous deux de la Réunion et suivant la même route. Au dialogue entre les marins, d’un
bord à l’autre, on apprend certaines nouvelles récentes de l’île, et l’auteur précise : « A cette
réponse, un éclair de joie brille sur tous les visages, tant le souvenir de la patrie est
profondément enraciné dans les cœurs créoles57 ». Par cette remarque, Alizart fait du bateau un
élément déjà étranger, et réellement un lien entre l’espace métropolitain et l’espace colonial. Il
n’est pas seul à travailler en ce sens ses textes, à en faire ressortir le moment intermédiaire qui
sépare la « mère-patrie » de la colonie ; même en Algérie, pourtant peu éloignée des bords
métropolitains, on trouve un autre exemple de ces descriptions de voyage qui se focalisent sur
la traversée, sur le bateau : c’est ce qu’un certain Almire Gandonnière (1803-1863) fait paraître
dans L’Akhbar en 1848. L’auteur, homme de lettres ayant tenté sa fortune à Paris, s’est
embarqué pour l’Algérie en 1846 et tente de s’y faire une place dans la presse58. Il fait donc
paraître le récit d’une traversée vers la colonie – elle n’est pas donnée comme celle de son
arrivée, mais comme un des trajets effectués.
Il y a de tout dans ce voyage ; du drame et du plus sombre, de la comédie à faire pouffer de rire un misanthrope ; l’opéra même s’est mêlé de la partie, majestueusement accompagné par l’orchestre aux mille instruments de la Méditerranée.
Dumas ferait soixante volumes avec ces trois jours de traversée. Moins ambitieux et moins fécond, je ne demande à la Revue de la
province d’Oran que quelques pages d’hospitalité, pour résumer mes impressions personnelles. […]
56 Alphonse Alizart, « « Souvenirs d’un voyage de l’île Bourbon en France », Le Courrier de Saint-Pierre, mai 1871. L’auteur a laissé peu de traces ; le 1er novembre 1870, il signe dans le même périodique un feuilleton en tant que « Ancien élève du collège de Lorient » ; et on le trouve en effet dans les annales des boursiers, en tant que « fils d’un employé aux colonies ». 57 Id. 58 À propos de l’auteur, voir sa notice sur le site de la BNF : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130085137. Il a été librettiste pour Hector Berlioz, poète, journaliste.
155
De quatre à cinq heures, j’eus une lueur d’espérance. Un vieux colon d’Afrique, à qui j’avais confié mes goûts orageux, vint me tirer de ma cabine, où je m’étais mollement endormi, et me dit à l’oreille ces mémorables paroles : Vous aurez votre tempête59.
Le jeu avec les attendus du récit maritime continue, le narrateur développant une
distance plaisante face à l’événement qu’il raconte : « Décidément c’était la tempête. En effet
nous en eûmes toutes les horreurs moins le naufrage ». Enfin, la tempête étant passée, on
propose à l’auteur du texte de devenir le parrain du Pharamond, le navire en question ; il finit
par accepter, et alors réapparaît le journal, sous la forme d’un discours direct qui résume la
pensée générale : « L’histoire de la marine française enregistrera votre nom, mossieur, et l’Écho
d’Oran vous fera l’honneur d’un article60 ». Raconter la traversée et le faire avec une tonalité
burlesque est un fonctionnement qui se retrouve ainsi élevé au rang d’attendu de la presse
coloniale algérienne : expérience partagée par tous, la traversée de la Méditerranée est en effet
un point de connivence entre auteur et lecteur61. Contrairement aux voyages vers les Antilles,
la Guyane, la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie, elle est en effet relativement courte et
relativement tranquille62. Cela explique, non seulement Almire Gandonnière, mais aussi
l’énigmatique « Somebody » qui signe en 1871 dans Le Moniteur de l’Algérie un texte appelé
« La machine ne fonctionne plus ». Sa place en troisième page exhibe le caractère divertissant
du texte – une information importante aurait été publiée en première, peut-être en deuxième
page –, d’ailleurs confirmé dès les premières lignes :
Ceux de mes lecteurs qui se sont trouvés soudainement réveillés en pleine mer, par une violente secousse immédiatement suivie de l’arrêt complet du bateau, comprendront seuls ce qu’ont d’effrayant ces quelques mots sourdement répétés par chacun : « La machine ne fonctionne plus ! »
Le sang se glace dans les veines, on se voit sombrer, et, sans force, sans volonté on attend dans des angoisses horribles, une fin qu’on croit aussi rapprochée qu’inévitable. Combien plus terrible est l’effet de cette affreuse nouvelle lorsqu’elle menace la population de toute une ville
59 Almire Gandonnière, « Un passage de Marseille à Oran à bord du Pharamond », L’Akhbar, 21 décembre 1848. 60 Id. 61 La presse satirique s’en empare aussi : A. Sylva, « Aventures incroyables et ébouriffantes arrivées pendant une traversée de Bône à Alger. Nouvelle », La Goguette, 20 juillet 1867. Le journal n’étant conservé que par fragments, on ne peut juger complètement des « aventures incroyables » promises. Dans le même journal, et conservé tout aussi fragmentairement, on trouve : Farewell, « Une histoire », publié au courant du mois de mai. Le héros est un jeune homme venu de Californie pour rencontrer un des journalistes de L’Akhbar ; dans les numéros du 1er et du 8 mai est décrite l’arrivée à Alger. 62 Quand la traversée vers les Antilles se passe bien, cela produit d’ailleurs des textes déceptifs, comme en témoigne l’article « Impression de voyage », paru le 4 juin 1854 dans La France d’Outre-Mer et signé Duprey de la Ruffinière : « En quittant notre beau et bien aimé pays sur le Louis-le-Grand, mon cher ami, je vous ai promis un récit circonstancié de mes Impressions de voyage ; mais, hélas, je n’avais pas compté sur la vulgarité d’une traversée ordinaire, et je serais réellement très embarrassé, pour tenir à ma parole, si une circonstance, une seule, n’était venue par ses émotions briser la monotonie de nos quarante jours de mer ».
156
quand, comme à Alger, l’autre soir, les victimes, au lieu de se compter par centaines, se comptent par milliers63 !
La tonalité dramatique du début de l’article commence un jeu avec le lectorat, jeu
approfondi encore par le récit qui commence peu après, et cette fois non pas en mer mais sur
terre. Et si l’on peut parler de « jeu » ici, c’est que sont utilisés, comme dans l’extrait précédent,
tous les attendus d’un récit de naufrage ou de tempête, mais avec la mention d’Alger, de la terre
ferme, comme lieu du naufrage. Cette première discordance en annonce d’autres :
C’était le 29 juillet, à la tombée de la nuit. L’atmosphère était lourde, le ciel avait un aspect sinistre. Épuisé par la chaleur de la journée et de plus, poursuivi par un pressentiment que rien ne justifiait, je me proposais, au lieu de sortir, de vérifier l’exactitude du proverbe : « qui dort dîne », en demandant tout simplement à mon lit, pour ce soir-là, la table et le logement. Hélas, que j’eusse bien fait ! Mais le fatal destin ne le voulut pas. Une soif canine s’empara de moi. La perspective de boire frais me fit surmonter ma paresse et ma peur, et je me mis en route pour l’hôtel de *** où je prends pension64.
Car voilà où réside le nœud de l’histoire : la machine est, non pas le moteur du bateau,
mais celle qui permet de fabriquer des glaçons. L’article est long et joue sur la réaction
disproportionnée de l’auteur assoiffé ; dans notre perspective, nous en retirons toujours cette
idée de l’importance du bateau, motif si fréquent et si connu qu’il permet justement le
détournement et l’humour : formule oubliée aujourd’hui, « la machine ne fonctionne plus »
représentait pour les lecteurs des années 1870 une forme de menace récurrente.
Légitimité et connivence sont donc les deux desseins que semble recouvrir l’utilisation
de la traversée dans les textes à la première personne. Mais un usage métaphorique est possible
aussi, qui montre un dernier degré dans l’appropriation de cette scène coloniale première.
L’hermite de la Case-Pilote (nous conservons ici l’orthographe archaïsante du terme utilisée
par l’auteur) visant le récit plaisant d’une anecdote vécue sur un bateau, tourne ainsi un texte
intéressant. Protestant d’abord contre des gouverneurs appartenant au corps de la marine et ne
restant pas assez longtemps en place pour connaître la colonie, il écrit au cours de cette
introduction selon des termes qui nous intéressent : « Dans les trente dernières années qui
viennent de s’écouler, nous avons entendu, à satiété, répéter à nos oreilles, que la Martinique
ne devait plus être considérée comme quelque chose de territorial, mais plutôt comme un
vaisseau à l’ancre65 ». Cette introduction passée, l’auteur file sa métaphore (« Donc, autour de
ce vaisseau mouillé, qu’on nomme la Martinique, on a vu fonctionner, en tout temps, des
63 Somebody, « La machine ne fonctionne plus », Le Moniteur de l’Algérie, 2 août 1871. 64 Id. 65 L’hermite de la case-pilote, « Le Bateau à vapeur », La France d’Outre-Mer, 19 avril 1859.
157
embarcations plus ou moins légères, plus ou moins expéditives ») et examine la flotte qui a
servi à la Martinique, y compris le « canot gros-bois », qui sert aux circulations locales.
C’est une évidence, mais on peut le rappeler ici : le bateau provoque d’autres textes,
plus littéraires et plus intéressants, que ceux que l’on peut trouver pour le télégraphe ; Le
Moniteur de l’Algérie a bien son service spécial, grâce auquel il peut avoir de Marseille les
titres du Moniteur parisien paru le matin même, mais ce télégraphe est tout entier du côté de la
modernité, et n’appelle pas, comme le bateau, un héritage des récits de voyage ou d’exploration,
voire davantage66. Par « davantage », l’on entend notamment ce que Michel Foucault écrit de
l’importance du bateau dans l’imaginaire social et littéraire du XIXe siècle. Dans sa conférence
sur les hétérotopies, il conclut en effet par la mention du bateau, qu’il décrit ainsi :
Et si l’on songe que le bateau, le grand bateau du XIXe siècle, est un morceau d’espace flottant, un lieu sans lieu, vivant par lui-même, fermé sur soi, libre en un sens, mais livré fatalement à l’infini de la mer et qui, de port en port, de quartier à filles en quartier à filles, de bordée en bordée, va jusqu’aux colonies chercher ce qu’elles recèlent de plus précieux en ces jardins orientaux qu’on évoquait tout à l’heure, on comprend pourquoi le bateau a été, pour notre civilisation – et ceci depuis le XVIe siècle au moins – à la fois le plus grand instrument économique et notre plus grande réserve d’imagination. Le navire, c’est l’hétérotopie par excellence.67.
L’hétérotopie du bateau, en contexte colonial, se pare de valeurs supplémentaires : par
le packet, par l’apparition d’une modernité signalée par le délaissement progressif de la voile,
par la publicité aussi qui fait des navires les images prépondérantes de la presse coloniale, le
lectorat est habitué à ce motif et en comprend les enjeux. C’est précisément ce trait qui permet
la production de textes parodiques ou humoristiques : la connivence se fait ici sur ce que l’on
peut détourner. L’éloignement n’est donc pas seulement une donnée géographique : elle
s’épanouit en devenant un motif poétique signifiant, un peu à la manière dont l’imaginaire de
la frontière avait forgé une partie de la littérature des États-Unis.
66 Plus tard dans le siècle, voire au siècle suivant, le télégraphe connaît son heure de gloire, que ce soit par ses fonctionnaires devenus martyrs, ou par quelques lignes qui en font un objet poétique. Ainsi de Jean Ajalbert, qui écrit au cours de l’un de ses romans : « Pour l’installation du trait d’union prodigieux, du fantastique fil à couper l’espace, la voie escalade les sommets, plonge dans l’abîme, s’enfonce dans la sylve farouche ». Référence : Jean Ajalbert, Raffin Su-su, mœurs coloniales, Paris, Publications Littéraires et Politiques, 1911, p. 50. 67 Michel Foucault, « Les utopies réelles ou lieux et autres lieux », Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 2015, p. 1247.
158
1.2 Intercolonialité, intracolonialité : le réseau par les textes
Le journal colonial permet aussi, par ses packets, ses correspondances, ou plus
largement encore par les lignes maritimes dont il dépend, de repenser la configuration
symbolique des colonies françaises, que l’on peut avoir tendance à n’envisager que dans un lien
étroit avec la métropole. Les échanges se font avec les aires proches, francophones ou non : le
cas le plus évident reste à ce titre les échanges entre Maurice – l’ancienne île de France – et La
Réunion, les deux « îles sœurs » de l’Océan indien. La presse réunionnaise cite souvent Le
Cernéen mauricien – relevant donc du Commonwealth depuis 1810 – pour en tirer des
nouvelles. Plus précisément, Le Colon réunionnais des années 1860 échange régulièrement ses
numéros avec des journaux mauriciens, notamment pour annoncer le passage de troupes
d’artistes de l’une à l’autre des îles. Enfin on trouve la mention du passage des nouvelles
métropolitaines par Port-Louis :
C’est une chose digne de remarque que l’importance des nouvelles est presque toujours en sens inverse de la célérité du courrier d’Europe. Rarement, en effet, la malle nous est parvenue ainsi promptement que la dernière apportée par l’Annie à Maurice, et rarement aussi elle a été plus dénuée d’intérêt. Nous n’en devons pas moins regretter qu’elle ne nous soit parvenue que trois jours après son arrivée dans la Colonie voisine, car il est fâcheux qu’elle soit toujours subordonnée au départ du premier navire de Port-Louis pour la Réunion68.
Différents indices permettent de voir comment les périodiques coloniaux représentent
un espace en cours de mondialisation à leurs abonnés : dès les unes des journaux se lisent ainsi
de grands traits d’évolution qui ont accompagné les lectures coloniales et ont inscrit les
territoires coloniaux dans des aires qui ne correspondent pas uniquement à l’empire français.
Les « Nouvelles du monde » côtoient les « Nouvelles de France » ; les dépêches télégraphiques
à partir des années 1860 donnent une source géographique proche comme point de repère ; les
journaux cités appartiennent à une aire géographique bien plus large que la simple métropole,
et dans Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie paraît en 1877 le sous-titre « Nouvelles
intercoloniales69 » à propos des « Conférences relatives aux communications électriques avec
l’Europe » : l’article est issu du Sydney Morning Herald. Outre ces négociations géographiques
contenues en une, les périodiques coloniaux ont aussi participé aux discours sur les colonies : un
périodique algérien est cité en Nouvelle-Calédonie, on s’intéresse à la Cochinchine dans le
journal officiel tahitien… Le réseau colonial se voit aussi dans ces apparitions qui complètent
68 « Malle du 28 août », Journal du commerce, 14 octobre 1856. 69 « Nouvelles intercoloniales », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 14 mars 1877.
159
une perception spatiale dont on a aujourd’hui peine à cerner les contours. Enfin, dans cet
exercice de variation d’échelle, les querelles qu’on pourrait dire intracoloniales ne sont pas sans
importances : elles témoignent d’un rétrécissement du monde médiatique qui cohabite sans
difficultés avec l’ancrage dans une aire géographique et dans un réseau colonial plus large. Les
textes médiatiques des colonies se situent donc au croisement de ces problématiques spatiales
qui dessinent les prémisses d’une mondialisation : une forme de complexification de l’identité
narrative se lit alors. Le journal colonial est à la fois une parution locale, extrêmement attachée
au territoire dans laquelle elle est produite, et la production d’un empire qui ne peut se limiter
aux kilomètres carrés de la colonie dont il est question.
Les colonies d’un journal à l’autre : intercolonialité médiatique ?
Le 24 octobre 1863, La Feuille de la Guyane française salue, dès les premières lignes
de sa partie non officielle une nouvelle qui situe le territoire au centre d’un réseau intéressant :
le paquebot intercolonial qui permet à la Guyane de se rapprocher de « [ses] sœurs les Antilles »
est au premier plan – ainsi que l’Europe –, mais subsiste dans la deuxième partie de l’annonce
la volonté d’être aussi reliée au fleuve Amazone. Cet équilibre est assez représentatif des années
1860 et des liens qui se développent alors entre les colonies et leurs aires géographiques, ainsi
que de l’accélération technologique qui sous-tend ces changements.
Si l’on se sert de cet extrait pour inaugurer l’étude de l’intercolonialité médiatique, c’est
qu’il ne s’agit pas ici de dresser une carte de la viralité médiatique dans les colonies : l’on a
160
déjà dit que l’état des collections, leur absence de numérisation et leur caractère fragmentaire
ne pourraient permettre des résultats aussi éclatants que pour des corpus de presse mieux
conservés70. Mais on peut tout de même repérer quelques passages, quelques échanges entre
périodiques qui en viennent à tisser une cohérence coloniale : l’une des questions que l’on peut
en effet se poser, en tant que lecteur du vingt-et-unième siècle d’une collection de périodiques
si disparate, concerne la perception que les colonies ont les unes des autres. Les réponses
apparaissent donc d’un entrefilet à l’autre, à l’occasion d’événements dont le sens se construit
sur un espace colonial pensé au sens large. Les débuts des colonisations sont ainsi un objet
médiatique à traiter : dans Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie du 10 juillet 1878, juste après
le début de l’insurrection kanak, on lit le rapport de la prise de possession de l’île de Saint-
Barthélémy, pris dans L’Écho de la Guadeloupe et reproduit pendant deux numéros, en
parallèle aux récits de l’insurrection71 ; la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie et
l’installation française en Algérie avaient été également évoquées dans des périodiques
réunionnais. Dans La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, les « Strophes sur l’expédition
d’Alger72 » d’Auguste Vinson célèbrent la conquête d’Alger par la voix d’un poète local. Cette
projection d’une voix bourbonnaise sur la conquête qui se joue alors en Afrique du Nord
témoigne d’une solidarité textuelle entre les colonies. Il y est bien sûr question, selon les
directives de la presse officielle, des esclaves chrétiens, d’un « tyran sauvage » mais aussi du
« tigre britannique ». L’intéressant est ici qu’une note de bas de page précise, à propos de « la
foudre d’Albion [qui] sur lui fut impuissante », que « l’expédition de lord Exmonth qui se borna
à incendier quelques vaisseaux de la régence ne fit qu’ajouter à l’audace du dey ». En tout cas,
les divers journaux de l’île Bourbon suivent les développements coloniaux en Algérie : Le
Colonial décrit, en 1833, la mise en place de la colonisation en Algérie par un court article
intitulé « Colonie d’Algérie ». Le texte ressortit à ce qu’on peut trouver ailleurs dans la presse
métropolitaine : il témoigne d’un intérêt pour les possessions françaises à l’étranger, pour le
développement de l’influence française, visible ici par l’architecture.
70 Même sur des corpus numérisés, retracer le voyage d’un texte n’est pas toujours aisé, comme en témoigne l’article de Jean-Luc Buard, « Un feuilleton-nouvelle dans la médiasphère du XIXe siècle : ʺCour criminelle de l'île Mauriceʺ (1840), de L'Audience au Petit Journal, en passant par Le Canadien et le reste du monde », Médias 19, Guillaume Pinson et Marie-Ève Thérenty (dir.), Les journalistes : identités et modernités. URL : http://www.medias19.org/index.php?id=23685. Consulté le 16 mai 2017. 71 Ém. Le Dentu, Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 10 juillet 1878. Le texte débute par une adresse au rédacteur et par cette ligne : « J’arrive de Sant-Barthélémy où je viens d’assister à la prise de possession de cette île par la France ». 72 Auguste Vinson, « Strophes sur l’expédition d’Alger », La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, 6 octobre 1830.
161
Les établissements des colons à Kouba et Dély-Ibraïm, sont devenus le but des promenades à cheval : le village de Kouba, dont la route boisée est si pittoresque, et dont la situation domine la plaine de la Métidja, est depuis quelques temps le rendez-vous de brillantes cavalcades qui viennent y voir un village français au milieu des constructions mauresques, avec le bénéfice de la végétation extraordinaire du climat. Les petites maisons des colons, avec leurs portes, leurs fenêtres et leurs toits à l’européenne, forment avec les habitations à terrasse des maures, presque sans couvertures, un contraste remarquable, et semblent dessiner la différence de mœurs entre les deux nations73.
Ce qui peut sembler intéressant ici, c’est la manière dont Le Colonial reprend, avec
ciseaux et colle, le texte d’un périodique sans doute algérien (nous n’en avons pas trouvé la
trace), peut-être métropolitain. La précision des toponymes, par exemple, semble superflue pour
des lecteurs réunionnais ; la description du village français et des maisons « maures », en
revanche, signale une volonté descriptive qui s’accorde avec le lectorat insulaire. Ce texte
somme toute habituel dans la presse française – coloniale ou métropolitaine – permet, par ces
traits d’éloignement et de rapprochement, d’envisager les présences propres à une forme
d’intercolonialité dans les périodiques coloniaux locaux. Autre territoire, autre moyen de rendre
compte d’une actualité coloniale : au début de l’année 1854, Le Bien-Public réunionnais
informe ses lecteurs, avec quatre mois de délai, des événements qui ont fait de la Nouvelle-
Calédonie une possession française.
Le Gouvernement Français vient de prendre possession de la nouvelle Calédonie, dans le but est-il annoncé par un journal de Sydney, d’y établir une colonie pénitentiaire. Cette mesure a été effectuée le 24 septembre par le steamer le Phoque, à Balade, où le contre-amiral Febvrier Despointes, accompagné de plusieurs officiers de la marine et du civil, a fait hisser le pavillon français et dresse procès-verbal constatant qu’il prenait possession de l’Ile de la Nouvelle Calédonie et de ses dépendances par ordre de son gouvernement et qu’il les déclarait colonie française à partir du 24 septembre.
À cette occasion, un correspondant de Sydney fait remarquer à l’Argus de Melbourne que la France, possédant maintenant presque tous les groupes situés dans l’est de la Polynésie et venant de s’assurer un point dans l’ouest, il ne lui reste plus qu’à faire un établissement intermédiaire pour entourer les possessions britanniques de l’Australie et de la Nouvelle Zélande d’un cordon complet qui les isolerait de l’Océan Pacifique du Nord74.
Dans ce texte, l’origine de l’information apparaît parce qu’elle est
étrangère : s’informant à partir d’un packet visiblement australien, le journaliste donne l’origine
de son propos, et construit ainsi l’image d’une actualité véritablement internationale.
L’inquiétude du journal australien est reproduite sans commentaire, la suite de l’article se
73 « Colonie d’Alger », Le Colon, 18 juin 1833. 74 Le Bien-Public, 20 janvier 1854.
162
focalisant plutôt sur les îles Fidji pour illustrer le propos initial. Entre compte-rendu neutre
parce qu’inspiré de périodiques étrangers, et texte repris de périodiques nationaux, les
périodiques créoles ont rendu compte des actualités coloniales en général, des conquêtes en
cours ou d’actualités qui intéressaient l’empire français. Mais l’intercolonialité apparaît plus
prégnante dans les périodiques coloniaux à certains moments : expositions coloniales,
problématiques agricoles ou industrielles communes (la question du sucre dans les Antilles ou
à la Réunion, par exemple) sont ainsi des points de repères dans la production médiatique. Le
tout jusqu’à des articles qui font office de publicité et d’éditorial dans le même élan :
Nous avons reproduit quelquefois dans nos colonnes des extraits d’une revue bi-mensuelle, L’Algérie agricole, qui s’était donné pour mission l’étude des questions de colonisation, de commerce, d’industrie, se rattachant à l’Algérie et aux colonies. Cependant, comme son titre l’indiquait, ses préférences ou plutôt ses connaissances plus étendues sur l’Afrique l’amenaient à s’occuper plus spécialement de notre conquête que des établissements français d’outre-mer, à l’égard desquels, il faut bien le dire aussi, les éléments d’appréciation lui faisaient défaut. Mais à partir du 1er janvier 1861, L’Algérie agricole subit une transformation complète et prend le titre de : Revue du monde colonial, organe des intérêts agricoles, industriels, commerciaux, maritimes, scientifiques et littéraires des Deux-Mondes. Cette détermination est une bonne fortune pour les Antilles, car, nous le répéterons sans cesse, les Colonies ne sortiront de l’état de marasme où elles languissent, que quand, en France, on les connaîtra, quand on aura pu apprécier les ressources précieuses qu’elles renferment dans leur sein et qui n’ont besoin pour se développer que d’un peu d’aide et d’expansion75.
En filigrane, on lit dans ce texte une modification administrative importante : en 1861,
le ministère de l’Algérie et des Colonies est supprimé ; l’Algérie rejoint le ministère de
l’Intérieur, et les Colonies celui de la Marine76. Le titre de la revue est donc modifié sans doute
pour conserver une unité coloniale : et le commentaire que fait le collaborateur du Commercial
confirme cette volonté, latente dans les colonies françaises, de faire apparaître une unité – et de
ne pas être oublié au profit de l’Algérie. Dans tout le corpus médiatique, mais particulièrement
sous le Second Empire, cette association coloniale se signale par de petits passages qui révèlent
des circulations sous-jacentes en les affichant : ainsi de l’Avenir martiniquais, qui publie à sa
une la citation d’un article de La Malle, journal réunionnais. Pour reprendre une des formules
figées de la presse, « on lit » alors :
75 A. Noirot, « La Revue du monde colonial », Le Commercial, 16 janvier 1861. 76 Pour plus de précisions historiques, voir Lorraine Decléty, « Le ministère des colonies », Livraisons d'histoire de l'architecture, 2004, 2e semestre, n° 8, p. 23-39. URL : www.persee.fr/doc/lha_1627-4970_2004_num_8_1_978. Consulté le 22 janvier 2017.
163
Nous publions ci-après une lettre fort intéressante que nous avons trouvée dans La Malle de la Réunion, journal rédigé avec une grande verve et un grand talent.
Ce document est d’autant plus intéressant qu’il nous apprend que « le Délégué de la Guadeloupe a passé marché avec la Compagnie maritime pour le transport et l’introduction des travailleurs destinés à sa colonie ».
Ce qu’il y a de très curieux c’est que ce fait nous soit révélé par une feuille qui s’imprime à trois mille lieues de nous77.
L’ironie du propos met en lumière la distance géographique en même temps que la
proximité réelle des périodiques coloniaux, proximité idéologique, historique et industrielle.
C’est par éclats, au vu de la fragmentation du corpus, qu’apparaissent ainsi un pan assez
important des relations entre colonies. Le réseau peut même, quand la question est large et
concerne plusieurs colonies, s’élargir lui aussi. Les périodiques coloniaux peuvent s’entendre
sur des questions politiques, et exhibent alors cette entente et cette capacité à débattre, comme
c’est le cas quand se pose la question de la « constitution coloniale » :
En reproduisant, il y a peu de temps, les lettres de M. de Cordemoy, rédacteur du journal de la Réunion, à M. Léger, rédacteur en chef du Commercial, de la Guadeloupe, sur l’opportunité de modifications à apporter à la Constitution coloniale, nous disions que nous ferions suivre cette publication à notre honorable confrère de la Pointe-à-Pitre, si, toutefois, il voulait et pouvait nous répondre78.
Ces relations sont politiques ; et pourtant, elles influencent bien la représentation
coloniale, la manière dont le lectorat colonial définit l’influence de son environnement et son
insertion dans des aires géographiques ou politiques plus larges. Dans ces années 1860, la
circulation des textes se marque aussi par quelques fictions ou nouvelles reprises d’une feuille
à l’autre. Ainsi, Le Messager de Tahiti publie dans ses variétés du 22 juillet 1860 la « Mort d’un
dey d’Alger en 1754 », et un collaborateur anonyme présente le texte ainsi :
Sous ce titre, M. Paul-Eugène Bache vient de publier, dans l’Écho d’Oran, une curieuse étude qui fait bien connaître ce qu’était, il y a cent ans, cette Algérie où flotte glorieusement aujourd’hui le drapeau de la France, et d’où s’élançaient alors les redoutables pirates qui pillaient les navires européens et réduisaient les Chrétiens en esclavage. Nous empruntons à ce travail quelques passages qu’on lira peut-être avec intérêt79.
Le texte prend deux pages mais ne semble pas traduit en tahitien : preuve que le texte
s’adresse avant tout aux colonisateurs ? En tout cas, la justification coloniale de la conquête de
l’Algérie, répétée en introduction, est bel et bien ancrée dans la pensée médiatique. Dernière
77 L’Avenir, 9 décembre 1862. 78 Les Antilles, 9 janvier 1869. 79 « Mort d’un dey d’Alger en 1754 », Le Messager de Tahiti, 22 juillet 1860.
164
manifestation d’un système intercolonial enfin, les annonces des expositions coloniales, sous
forme de listes, confirment aux lecteurs ce que les textes leur montraient : les colonies sont bien
ces territoires reliés entre eux par leur statut ultramarin. Leur unité apparaît donc à plusieurs
reprises, et sous différentes formes.
Si les années 1860 amorcent un mouvement assez fort de liaisons entre les différentes
aires coloniales, pour des raisons à la fois politiques et technologiques, dans les années 1870,
la presse coloniale est bien constituée et est consciente de ses ramifications. On peut en donner
comme exemple la première colonne du Courrier de Saint-Pierre du 23 septembre 1872 : « Le
Courrier de Saint-Pierre s’associe aux sentiments de regrets que témoigne toute la presse
coloniale de la mort de M. Francis Channel, directeur du Commercial Gazette de Maurice80 ».
Et surtout, le journal de citer La Malle réunionnaise : on a ici deux espaces très différents,
associés par un événement et par la mention de la « presse coloniale ». Autre signe parmi ceux
que l’on peut prendre dans la presse et qui désignent des liens intercoloniaux : dans Les Antilles
martiniquaises de 1866, le rédacteur présente d’abord la publication de Souvenirs de Guyane
d’un officier, Armand Jusselain. Les extraits publiés trouvent un écho que le lecteur actuel
perçoit malgré la dizaine de mois d’écart entre cette publication et une autre nouvelle : l’avis
nécrologique d’un journaliste parisien mais créole, originaire de Guyane, justement. Le
rédacteur, Carles, introduit ainsi l’avis nécrologique : « Un jeune créole d’un esprit distingué,
M. Auguste Polo, qui, sous le pseudonyme de Polin, s’était fait une position dans le journalisme
[…] a succombé à Paris, le 9 octobre dernier81 ». Suit alors l’article du journal La France,
auquel le journaliste collaborait, et dans lequel on trouve :
Auguste Polo appartenait à une ancienne famille de Nantes, établie à la Guyane vers le commencement de ce siècle, mais dont l’origine première remonte à Venise. Un de ses ancêtres a été Marco Polo, l’illustre voyageur du treizième siècle. […] Il a habité l’Amérique, et pendant plusieurs années, il a été l’un des rédacteurs du Courrier des Etats-Unis82.
Le 1er décembre 1866, La Feuille de la Guyane française publie cette même notice, en
introduisant la nouvelle du décès par l’idée d’Auguste Polo comme « enfant de la Guyane ».
Autre lien enfin, que l’on peut trouver entre la Guyane et les Antilles : le voyage que raconte
C. Chanel entre la Martinique et Cayenne est publié dans La Feuille de la Guyane française au
80 Le Courrier de Saint-Pierre, 23 septembre 1872. 81 Les Antilles, 7 novembre 1866. 82 Id.
165
cours de l’été 185883, sans régularité mais prenant à chaque fois une part non négligeable du
journal – le plus souvent, la moitié de la deuxième page. Ce voyage est tiré de La France
d’Outre-Mer, périodique martiniquais : ainsi est fait le lien entre les deux territoires, et cette
double publication rejoue le voyage que Chanel a effectué. S’il y a bien quelques digressions
portant sur les systèmes coloniaux ou l’enseignement des langues, le récit reste avant tout centré
sur le voyage : les péripéties ne sont pas qu’un prétexte à des développements scientifiques ou
politiques. Dans le cas précis des Antilles et de la Guyane, la proximité géographique a bien été
l’occasion d’un rapprochement dans les textes périodiques.
En Nouvelle-Calédonie, l’on peut trouver un autre exemple de ces circulations entre
colonies ; exemple intéressant en ce qu’il montre une circulation entre des aires linguistiques et
des empires différents. Paraît en effet en 1864 une lettre adressée au rédacteur de l’Herald
australien, datée du 24 janvier de la même année à Tahiti, signée par « Un vieil Australien », et
publiée, donc en Nouvelle-Calédonie ; cédant à la demande d’amis et soulignant la capacité
d’entreprendre de tous les jeunes gens présents en Australie, l’épistolier précise sa
situation : « À la suite de divers évènements dont le récit n’intéresserait personne, je me suis
trouvé sans emploi dans les colonies australiennes, après les avoir habitées pendant dix-huit
années84 ». Le passage à Tahiti est présenté comme un hasard, mais suivi d’une invitation à
d’autres Australiens à faire comme lui ; puis se succèdent des conseils et descriptions. Une fois
la lettre terminée, c’est le rédacteur du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie qui reprend la parole
pour se livrer à une appropriation du propos de l’Australien :
Cet appel du vieil australien sera-t-il entendu ? nous le désirons pour notre sœur de l’Océan Pacifique ; mais, comme bien plus qu’elle nous avons besoin des Européens pour nous donner la vie active, nous ferons remarquer aux entreprenant colons anglais qui ne se trouvent plus assez riches pour rien tenter dans leurs colonies où déjà, disent-ils, les places sont disputées, que plus près d’eux encore existe une terre aussi belle, aussi fertile85.
Il faut alors supposer que cette publicité faite par le rédacteur pouvait constituer une
réponse, par le biais de l’échange de journaux, au texte paru dans la presse australienne ; et que
la démonstration des avantages de la Nouvelle-Calédonie face à Tahiti se faisait donc dans un
jeu de multiples destinations : les colons de Nouvelle-Calédonie y trouvaient une valorisation
de leur travail, les métropolitains une invitation à venir s’installer dans la colonie, les
83 C. Chanel, « Le long des Guyanes », La Feuille de la Guyane française, épisodiquement pendant l’été 1858. Pris dans La France d’Outre-Mer. 84 Un vieil Australien, « À M. le rédacteur de l’Herald », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 7 août 1864. 85 Ibid.
166
Australiens une réponse à un autre texte et une autre île. Dans une perspective encore plus
mondialisée, mais la mention ne peut être ici qu’anecdotique car elle nécessiterait une étude
complète à elle seule, on observe que les journaux coloniaux répercutent des journaux issus de
minorités francophones : le phénomène est particulièrement visible dans la deuxième moitié du
siècle, et il fait découvrir des titres et des espaces inattendus. Ainsi du Mobacher qui publie en
février 1875 un article intitulé « Violence sur un Français au Pérou86 » : l’article est repris de
L’Indépendant de Constantine, qui cite lui-même L’Étoile du sud, journal paraissant à Lima.
Pourquoi ce fait divers ? Pour insister sur l’inimitié qu’entretient le gouverneur de la province
contre la France : le journaliste clôt le récit sur le rappel de la « dignité nationale ».
Les journaux coloniaux entre eux : une presse avant tout locale ?
Les relations cordiales entre périodiques coloniaux émanant de différents territoires ne
masquent pas une situation plus contrastée à l’échelle locale. Pourtant, en voyant dans L’Avenir
de la Guadeloupe, paraître l’avis suivant en 1859 : « Par suite de la suspension de la
Guadeloupe, l’Avenir sera envoyé à tous les abonnés de son confrère », l’on est tenté de croire
à une solidarité médiatique. Mais ce geste de solidarité, précisément, est plutôt rare : sur un
même territoire, les abonnés ne sont pas légion, contrairement aux querelles. C’est une autre
forme de circulation et de dialogue que ce réseau d’auteurs s’interpellant et débattant autour de
textes poétiques, et le cas le plus marquant se trouve à la Réunion. Dès les années 1830 se lit
une effervescence dans la presse réunionnaise dont on n’a pas trouvé l’équivalent sur d’autres
territoires, malgré des querelles toujours nombreuses87, et qui révèlera une pleine vitalité. Ainsi
d’un premier texte, pris dans Le Colonial en juin 1833 :
Comme nous étions occupés dans un petit démêlé avec notre bonne voisine La Gazette, querelle dans laquelle l’hebdomadaire Feuille ne manquera pas, sans doute, de venir prêter main-forte à son aînée, voici qu’à travers monts et vaux nous arrive un nouvel antagoniste. Encore le Glaneur ! …. . Que deviendrions-nous contre une aussi formidable coalition ? Cette fois, le chevalier s’avance visière haute, et nous reproche fièrement d’être venus un peu tard dans notre dernière rencontre88.
Cette représentation héroï-comique de la situation médiatique est humoristique, quoique
marquée par une polémique que l’on devine violente : et si la tonalité ne variera guère au cours
du siècle, les périodiques impliqués, eux, ne sont pas les mêmes selon les époques ; souvent à
plusieurs termes, les débats de la presse coloniale occupent plusieurs colonnes. Le Phare de
86 « Violence sur un Français au Pérou », Le Mobacher, 24 février 1875. 87 Les autres territoires ne sont pas exempts de semblables querelles, cependant. 88 Le Colonial, 21 juin 1833.
167
Saint-Paul et La Semaine illustrée s’affrontent ainsi au cours de l’année 1862, avec critiques
assassines et lettres publiques paraissant dans les pages de l’un et de l’autre. L’un des rédacteurs
de La Semaine désigne ainsi la lutte entre les deux : « Me voici obligée d’entrer en lice avec
lui : Le Gamin de la Presse créole contre un de ses géants ! David contre Goliath ! et pas la plus
petite fronde ! Allons, et Dieu sauve la Semaine89 ». L’expression « le gamin de la presse
créole », reprise encore, est attribuée au Phare de Saint-Paul ; et cet article, signé simplement
par La Semaine, donne le ton d’une confrontation humoristique mais violente. Dans le cours de
cette dispute qui court de numéro en numéro, un article peut être intéressant, parce qu’il
témoigne d’une portée dialogique du journal. Les Hirondelles citées désignent un poème
d’Edouard Fontaine, le rédacteur du Phare de Saint-Paul, poète en effet et ayant été éreinté par
La Semaine illustrée :
Le Phare de St-Paul nous lance dans son dernier numéro une bordée de gros reproches à propos de l’analyse des hirondelles. Nous allons reprendre son entrefilet et le servir avec nos réflexions à ceux qui ne le connaissent pas : il en vaut bien la peine.
Un petit journal de la Colonie – Est-ce vous qui êtes l’autre ? – a publié contre un de nos collaborateurs – contre ses vers – un article où l’injure – je voudrais savoir laquelle – se substitue d’une façon déplorable aux saines appréciations de la logique et du bon goût. – que diable la Logique et le bon goût ont-ils à voir dans les hirondelles90 !
Le reste de l’article est à l’avenant : chaque partie de l’article du Phare est commentée
en italique par la voix de La Semaine. Apparaît alors une forme de dialogue étonnant, plutôt
inventif pour une presse locale qu’on pourrait croire uniquement préoccupée par des questions
industrielles ou agricoles : et de ces querelles émane aussi l’idée d’une vitalité littéraire plus
large, qui a sans doute contribué à forger l’identité de l’île de la Réunion comme île de poètes.
Si la Réunion se caractérise par cette vitalité des échanges médiatiques, elle n’est pas la seule
colonie à voir naître ce type d’échanges dans la presse. Ainsi, dans L’Écho d’Oran, en 1849,
un compte-rendu est fait du carnaval de l’année. Après une critique plutôt acerbe de
l’atmosphère délétère du carnaval oranais, on trouve la mention d’un « seul accident
gracieux » :
À propos d’un célèbre feuilleton de l’Écho, on a autographié puis affiché et distribué dans les bals, les cafés, les… etc. d’Oran (sans timbre, sans nom d’imprimeur et sans dépôt préalable à la préfecture), avec une profusion digne d’un meilleur sort, la pièce suivante – en vers et contre tous ! O pardon ! mille fois pardon – à tous ! ACROSTICHES Improvisé dans un bal, à propos d’un Écho plus ou moins murmurant
89 « À l’auteur des hirondelles », La Semaine illustrée, 17 avril 1862. 90 « Le Phare de Saint-Paul », La Semaine illustrée, 17 juillet 1862.
168
Esprit-saint, dictez-lui de meilleures réponses ; Comblez de vos bienfaits l’organe du canton. Homme d’argent, il peut rédiger ses annonces ; Oui ! mais c’est à Paris qu’il prend son feuilleton91.
Le journaliste répond ensuite en continuant l’acrostiche pour mieux critiquer son rival.
Cette écriture influencée par la petite presse constitue une part non négligeable des
périodiques – même les plus en vue – des colonies. Enfin, il est des cas où la querelle n’a pas
lieu, mais où pourtant se lit une relation entre deux périodiques. Prenons une « nouvelle
algérienne inédite » intitulée « Histoire d’un cheveu » : elle paraît en feuilleton le 9 juin 1863
dans Le Moniteur de l’Algérie, avec la mention « reproduction interdite », signée par un certain
Ernest de Chanzé. L’histoire est en effet « algérienne » :
Tout le monde, à Alger, connaît Mme X… Il n’est personne qui ne soit entré dans son magasin, pour faire quelques emplettes de papeterie, acheter des livres ou en louer, ou tout au moins pour orner d’un timbre-poste une lettre qu’attend, à trois pas de là, la boîte géante de la poste92.
Résumons : le narrateur discute avec Mme X… quand un Anglais, après lui avoir acheté
un livre, revient en tenant un cheveu trouvé dans le volume, et prétend qu’il appartient à son
épouse, qu’il cherche depuis deux ans. Après une introduction « algérienne » par les lieux et
personnages décrits, la nouvelle développe en fait une intrigue « anglaise » : le jeune lord a tué
le chien de son épouse dans un mouvement de colère, elle a fui ; ils finissent par se retrouver et
vivent heureux, gardant en souvenir le volume acheté chez Mme X… qui a permis leurs
retrouvailles. En feuilleton, la nouvelle se développe en trois numéros seulement, et elle peut
passer inaperçue. Mais, de manière étonnante, elle est republiée le 13 novembre 1871 dans
L’Indépendant de Constantine, avec les mêmes titre et sous-titre. Mais à Constantine, l’auteur,
Ernest de Chanzé, est devenu X… ; et la reproduction n’a donc pas été interdite longtemps.
Cette circulation entre deux journaux locaux est intéressante : elle témoigne d’un réservoir de
textes dans lesquels puisent les rédacteurs. D’autres cas encore peuvent se retrouver qui
présentent le même principe de republication : la mention « reproduction interdite » rend
l’« Histoire d’un cheveu » marquante, mais ce fonctionnement est plus général : on verra plus
loin l’exemple d’une publication intitulée « Dialogue. La France et Bourbon », qui paraît
d’abord dans La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon puis dans Le Colonial en 1819 puis en
183393. Dans les deux cas, on remarque cependant que ce sont des textes très locaux, portant
d’une manière ou d’une autre sur le territoire colonial. On pourrait en conclure que les territoires
91 L’Écho d’Oran, 24 février 1849. 92 Ernest de Chanzé, « Histoire d’un cheveu », Le Moniteur de l’Algérie, 9 juin 1863. 93 D., « Dialogue. La France et Bourbon », Le Colonial, [1819], 2 et 5 juillet 1833.
169
coloniaux tels qu’ils sont construits dans les périodiques locaux se révèlent au croisement entre
deux réseaux : si la presse apparaît consciente de son statut colonial et de son appartenance à
un empire qui dépasse l’environnement immédiat, elle montre aussi comment le caractère
restreint de ce même environnement occasionne une certaine effervescence médiatique. Pour
amplifier ce mouvement de reconnaissance territoriale, les périodiques – officiels, le plus
souvent – adoptent une autre stratégie. Visant le territoire et sa description, son appréhension
idéologique, certains articles cristallisent en effet l’attention du lecteur sur quelques lieux
particulièrement marquants : c’est ce que nous allons maintenant entreprendre de montrer.
1.3 De certains lieux : la cristallisation de l’idéologie coloniale
Le territoire colonial, cartographié, exploité, mis en cadastre, est un enjeu idéologique
autant qu’économique ; mais c’est encore un angle trop large pour la presse coloniale et son
approche culturelle. Passer par quelques lieux permet aux auteurs médiatiques locaux de mettre
en lumière et d’encourager un autre rapport aux lieux : ruines, mais aussi paysages
extraordinaires sont mis en valeur par des traitements textuels qui sortent de l’information pure.
Ils deviennent ainsi des « lieux » textuels, polyphoniques et centraux dans le cadre du journal
colonial, et autour d’eux se nouent différents discours et différentes pratiques : en Algérie
particulièrement, les ruines permettent de créer un lien avec l’Afrique antique et romaine, pour
relativiser la nouveauté de la conquête. Une perspective plus ouverte amène à considérer, dans
cette même étude, le cas particulier que représentent les cimetières français, lieux symboliques
de la présence coloniale : ils entérinent la présence française, rappellent les « dangers » de la
vie coloniale, exportent enfin un aspect fondamental de la culture française. Enfin, allant du
plus particulier au plus général, les rues des colonies semblent condenser elles aussi une
problématique particulière dans la littérature médiatique coloniale : elles sont, après tout,
restées fameuses comme métonymies coloniales qui réapparaissent aujourd’hui encore dans les
discours politiques.
Le Tombeau de la chrétienne et le Fort des Vingt-Quatre-Heures en Algérie Parmi ces lieux emblématiques, en Algérie, le Tombeau de la chrétienne et le Fort des
vingt-quatre heures comptent parmi les plus importants de la culture coloniale que les
périodiques développent. Nous désignons ces deux lieux avec des guillemets qui signalent, déjà,
une appropriation par la traduction. Ils se rejoignent aussi dans leur capacité à signaler une
présence chrétienne ancienne sur le territoire à coloniser. Après les publications dans la presse,
170
les deux lieux feront l’objet de publications plus étendues que dans la presse, par Adrien
Berbrugger. Paraît d’abord Géronimo : le martyr du fort des Vingt-Quatre-Heures à Alger,
édité chez Bastide en 1854 puis réédité chez Bastide et chez Challamel en 1859 ; Le Tombeau
de la chrétienne : mausolée des rois mauritaniens de la dernière dynastie est publié chez
Bastide et Challamel en 1867. Mais c’est en juin 1836, dans une perspective qui est bien celle
de l’actualité, que le tombeau de la chrétienne est étudié pour les lecteurs du Moniteur algérien,
en feuilleton.
À l’extrémité ouest de la plaine de la Métidja, sur un des points les plus élevés du Sahel est un monument que les Arabes nomment koubar roumiah, ce qui peut se traduire également par tombeau romain ou tombeau de la chrétienne. Ce dernier nom a prévalu, probablement à cause d’une croix, ou du moins d’une figure qui en présente la forme qu’on remarque sur une pierre droite, isolée du monument. Bien des traditions merveilleuses se rattachent à cet édifice, dont les musulmans évitent de s’approcher. La plus accréditée est que des trésors considérables sont renfermés dans son sein. C’est à cause de cela, sans doute, et aussi pour la forme qu’il présente que les Turcs le désignaient par le nom de Maltapasy, qui veut dire dans leur langue le trésor du pain de sucre. On pense généralement dans le pays que les chrétiens seuls peuvent impunément s’emparer des richesses qu’il contient ; ces croyances forment une légende locale assez curieuse pour que nous la rapportions telle que le capitaine Pelissier la raconte dans ses Annales algériennes. […]
Après avoir donné à nos lecteurs le côté merveilleux de l’histoire du tombeau de la Chrétienne, nous examinerons dans un dernier temps la partie réellement positive94.
La légende est encadrée par une voix narratrice plus informée, qui se livre d’abord à une
exploration des toponymes puis à un effort de renseignement : deux aspects d’un même lieu,
deux manières d’appréhender sa valeur dans le cadre colonial. Dans le même Moniteur
algérien, le tombeau réapparaît en 1856, sous une forme encore différente, liée à la publicité
d’une opération décidée par le gouvernement. En effet, le comte Randon, alors gouverneur-
général, a décidé que le tombeau serait fouillé. Le journal officiel rend alors compte des
premiers travaux en publiant le rapport écrit par Adrien Berbrugger, responsable des fouilles.
Le texte commence par des précisions sur « l’historique des opérations », mais le conservateur
(de la bibliothèque et du musée d’Alger) infléchit son propos assez rapidement sur « les diverses
traditions qui ont cours parmi les Indigènes sur le fameux Kobeur-Roumia » : Adrien
Berbrugger convoque alors « un vieillard musulman de Coléa » puis le peuple des Hadjoutes
en général, et enfin les Turcs pour rendre compte de ces légendes. Par cet élargissement des
paroles rapportées, Berbrugger laisse son rapport devenir récit et légende : sur le lieu se greffe
94 « Le tombeau de la chrétienne », Le Moniteur algérien, 17 juin 1836.
171
une représentation des différentes populations que les autorités coloniales ont entrepris
d’inventorier. Le tombeau est construit comme un lieu de mélanges : différentes légendes,
différentes traditions, différentes approches textuelles le constituent en enjeu de la colonisation
française en Algérie. Les fouilles occasionneront d’autres textes encore, certains parus aussi
dans La Revue africaine : ainsi de l’article du 25 décembre 1856 qui paraît en deuxième page
sous le titre « exploration du Tombeau de la Chrétienne », et signé encore par Berbrugger. Le
tombeau, considéré comme une trace de l’Algérie pré-islamique et à ce titre intéressant pour
l’idéologie coloniale, connaît une postérité littéraire qui court jusqu’à nos jours, preuve de sa
vitalité symbolique95. L’ancêtre de ces publications en recueil est à chercher du côté d’un
Tombeau de la chrétienne anonyme, recueil paru en 1845 : on y raconte un aspect de l’histoire
de Barberousse, amoureux d’une captive espagnole qui meurt après avoir vu son père tué par
les hommes de son amant. Barberousse lui édifie alors le tombeau dit de la chrétienne96. Le
récit est délégué à un vieil Arabe : si cette tradition n’apparaît pas dans les travaux de
Berbrugger ou dans la presse coloniale, l’on voit cependant que son onde de choc atteint les
publications parisiennes, et brasse plusieurs éléments constitutifs de l’image de l’Algérie : le
héros Barberousse, les captifs, la narration indigène et le récit d’amour.
Ajoutons enfin, sur un autre registre mais pour compléter l’importance de l’image du
lieu, que Le Chitann, journal satirique prompt à se saisir de l’actualité, rend compte en 1866 de
l’importance du tombeau en produisant plusieurs illustrations sous la rubrique « Des Nouvelles
du tombeau » : l’on y croise notamment une araignée monstrueuse. Transcrivons les légendes :
« La plus cordiale entente n’a cessé de régner entre les deux savants et les travaux ont été menés
avec activité et intelligence, bien qu’un certain Pharaon, soi-disant expert pyramidal, ait allégué
le contraire et élagué notre monument » ; puis « Après quelques tâtonnements, un trou s’étant
produit, l’un des chercheurs y descend intrépidement » ; « Arrivé au fond, le Savant découvre
une galerie mystérieuse dont l’entrée se trouve gardée par une affreuse araignée, aussi rouillée
que poilue… » ; et enfin « Service de voiture entre Coléah et le Tombeau de la Chrétienne. Les
Algériens s’empressent d’aller voir l’étrange araignée qu’un mauvais plaisant assure s’être
détachée du crâne de l’un des Savants97 ».
95 Voir les titres suivants : Gaston Servent, Le Tombeau de la chrétienne, Paris, Ergé, 1946 ; Anne Loesch, Le Tombeau de la chrétienne, Paris, Plon, 1965 ; Bruno Racine, Le Tombeau de la chrétienne, Paris, Grasset, 2002 ; Roger Baret, Le Tombeau de la chrétienne, Montpellier, Mémoire de notre temps, 2005. 96 Le Tombeau de la Chrétienne, Paris, Dentu, 1845. 97 Le Chitann, 27 mai 1866.
172
Le Fort des Vingt-Quatre-Heures relève d’un fonctionnement semblable – opérations
publiques dont les journaux coloniaux font la publicité – en même temps qu’il révèle d’autres
problématiques, symboliques et textuelles. C’est en lisant les textes périodiques que l’on peut
approcher sa portée symbolique, plus forte que celle du tombeau de la chrétienne, car liée au
martyr Géronimo, dans un passé relativement proche. On peut analyser ici trois apparitions du
fort dans la presse : le 5 octobre 1847 et le 13 mars 1849, L’Akhbar rend compte d’abord du
lieu, puis de sa destruction qui commence alors ; il republiera le premier texte en 1853, au
moment de la découverte du squelette. Le Moniteur algérien reprend en 1853 l’information, en
rappelant les articles précédents ; et c’est en première page qu’il présente « Le Martyr du fort
des Vingt-Quatre-Heures ». L’article, non signé, commence ainsi :
Une découverte bien émouvante vient d’être faite au fort des Vingt-Quatre-Heures. Mardi dernier, vers onze heures du matin, les artilleurs occupés à la démolition du rempart qui regarde la route, aperçurent, en enlevant les déblais produits par l’explosion d’une des mines, une excavation occupant le milieu d’un bloc de pisé dans le sens de sa longueur et renfermant un squelette humain visible depuis la région occipitale du crâne jusqu’à l’articulation du tibia avec le fémur : en un
173
mot, sauf le haut de la tête et la partie inférieure des jambes, tout le corps était très-apparent98.
Il y a mention du texte de L’Akhbar du 5 octobre 1847, qui présente sous la forme d’un
« simple récit » le martyre de Géronimo. Le premier texte – et le seul signé – raconte en effet
son martyre : au seizième siècle, cet enfant musulman, enlevé par des Espagnols et élevé dans
la foi catholique, retourne en Algérie à la faveur d’une évasion de ses compagnons d’infortune,
mais refuse alors de se convertir à l’islam et meurt étouffé, pris dans le pisé qui sert à la
construction du fort. Adrien Berbrugger est l’auteur du récit de 1847, qui sert alors seulement
à donner une mémoire locale aux colonisateurs français, à justifier une présence chrétienne en
Algérie et à s’approprier le lieu. Il en est l’auteur, ou plutôt le traducteur, puisqu’il transcrit ce
que le moine Haedo, source valorisée par les Français, en a écrit en 1612. Géronimo y est
présenté notamment par le biais de discours directs, et l’ensemble est fortement narrativisé et
dramatisé. Le lieu, ce fort que les Français détruisent dans les années 1840, est alors le décor et
l’arrière-plan de l’hagiographie. Le deuxième texte développe le partage du lieu avec la culture
musulmane, passant par la citation et l’utilisation du lieu sous la Régence ; le troisième enfin
récapitule et cite les textes précédents, faisant chorus avec la publication que refait L’Akhbar
du texte de Berbrugger. Au fur et à mesure se lit la confrontation entre la légende et sa
réalisation matérielle, qui se conclut par la venue de l’évêque : la récupération du fort est ainsi
complète, et les derniers textes oublient la dimension musulmane du lieu. Le premier texte, récit
du martyre, sera republié sous forme de recueil en 185499, et accepté par l’Église catholique
alors même que Géronimo n’en est pas un martyr reconnu. Berbrugger publiera donc d’abord
sa présentation de la découverte, puis le texte espagnol et sa traduction en vis-à-vis ; et enfin
des documents en annexes, procès-verbaux pièces justifiant de l’authenticité du corps et notices
historiques. Ils y jouent le rôle de preuves, d’appui, de charpente pour la démonstration de
l’historien ; et leur utilisation signale la polyphonie du recueil. Voix de l’Église, voix du passé,
voix d’un historien et voix médiatiques : autour du Fort se nouent des discours complexes, et
c’est le récit hagiographique d’Haedo qui surmonte ces différentes voix. Mais il manque une
voix par rapport aux publications médiatiques : celle qui précisait l’appropriation musulmane
du lieu, et que l’on trouve dans L’Akhbar du 13 mars 1849, texte que nous avons jusqu’ici laissé
de côté. En effet, ce numéro annonce ainsi, en troisième page, la démolition du Fort des Vingt-
Quatre-Heures :
98 « Le Martyr du fort des Vingt-Quatre-Heures », Le Moniteur algérien, 30 décembre 1853. 99 Adrien Berbrugger, Géronimo, le martyr du fort des vingt-quatre heures à Alger, Alger, Bastide et Paris, Challamel, 1854.
174
La démolition du fort des 24 Heures, qui s’effectue en ce moment, nous fournit l’occasion de rappeler qu’un martyr, l’Arabe chrétien Géronimo, a été pilé vif dans un des blocs de pisé de la muraille du nord, ainsi que nous l’avons raconté, jadis, dans notre numéro du 5 octobre 1847. Nous ajouterons que, dans cette même forteresse, une sainte musulmane est révérée : c’est la Kabyle Setti Takelit, qui a donné son nom à l’édifice (Borj setti Takelit). En entrant dans le fort, on trouve, à droite du vestibule, un banc en maçonnerie, qui s’étend sous un arceau, surmonté, sur un côté, d’une petite niche creusée dans la muraille. Selon la tradition locale, cette niche indique l’endroit où se trouve la tête de la maraboute, qui est enterrée sous ce banc. Du temps des Turcs, lorsque ce fort était gardé par un seul bache tobdji (chef des canonniers), qui y habitait avec sa famille, souvent une musulmane, portant un petit pot d’huile à la main, demandait à pénétrer dans le vestibule sacré. Là, elle déposait le pot d’huile sur le banc, ôtait sa benika (coiffe qui se met sous la chachïa), qu’elle jetait dans la niche, et disait à haute voix : Ya, Setti Takelit ! Amri bit, kheli bit ; Ou n’âtek betta bis-zit. C’est-à-dire : O notre dame Takelit ! Emplis une chambre, vide une chambre ; Et je te donnerai un pot d’huile100 […].
L’effacement de la tradition musulmane autour du Fort des Vingt-Quatre-Heures se fait
au profit de la tradition chrétienne et du personnage de Géronimo : le mouvement est ici évident
qui sélectionne ce que le lieu doit représenter, quels textes doivent le décrire. Enfin, il faut noter
que le Fort des Vingt-Quatre heures et sa légende ne sont pas restés sans postérité : non
seulement Aumérat évoque cet épisode dans ses Souvenirs algériens101, mais en 1866, Augustin
Marquand, quand il écrit son article « Alger Nouveau », le cite ainsi : « À quelques pas de la
construction dans le mur de laquelle le corps de Géronimo a été maçonné, Michel Cervantès
passera esclave et Abd el-Kader passera vaincu102 ». En outre, l’aspect macabre de la
découverte et l’image du mur contenant un squelette ont peut-être inspiré René Euloge lorsqu’il
publie, un siècle après ces articles, dans Les Derniers fils de l’ombre la nouvelle « Le Rempart
des morts103 ». Dans ce récit qu’Euloge dit inspiré des récits entendus dans les montagnes de
l’Atlas marocain, deux ouvriers participant à la construction d’un rempart y cachent les
cadavres des hommes assassinés et dépouillés pendant la nuit.
Les cimetières coloniaux, symboles idéologiques et littéraires ?
Outre les lieux précis que nous venons d’évoquer, il en est d’autres qui valent non pour
leur spécificité, mais bien pour leur généricité : ainsi des cimetières, symboles des territoires
100 L’Akhbar, 13 mars 1849. 101 Joseph Aumérat, Souvenirs algériens, Blida, A. Mauguin, 1898, p. 20. 102 Augustin Marquand, « Alger Nouveau », Le Moniteur de l’Algérie, 1er avril 1866. 103 René Euloge, Les Derniers fils de l’ombre, Casablanca, Éditions de la Tighermt, 1952.
175
coloniaux et catalyseurs de différents thèmes. Le cimetière est un espace particulier, pour lequel
nous pouvons à nouveau convoquer la conférence de Michel Foucault citée plus haut à propos
des « hétérotopies ». C’est en effet l’un des premiers exemples que donne le philosophe pour
appuyer sa démonstration, juste après le jardin104. Il revient à plusieurs reprises sur cet espace
qui évolue à partir de la fin du XVIIIe siècle, et se retrouve à la marge des sociétés : l’évolution
même de sa perception au cours du XIXe siècle le rend intéressant. En outre, le cimetière
colonial gagne encore en particularités quand il se constitue en tant qu’espace, puisqu’il
appartient au monde colonial que Foucault désigne déjà comme un espace hétérotopique.
Aucune surprise alors à ce qu’il soit un enjeu de l’espace colonial, enjeu autour duquel se
développent différents discours, là encore. Ainsi de la « chronique indigène » que L’Akhbar fait
paraître en 1848 à Alger, et que nous avons déjà citée en première partie : c’est sur le cimetière
que l’auteur développe son propos dans sa livraison du 16 septembre – il a commencé le 21
août, et c’est donc l’un des premiers thèmes qu’il traite.
Mais passons du signe à la chose signifiée ; vous défendez d’inhumer nos morts dans le cimetière de Sidi Abd-er-Rahman-el-Tsaalebi, parce que, d’après vos lois, on ne doit pas enterrer dans l’intérieur des villes. Et cependant vous permettez d’y déposer un membre de la famille de Moustafa pacha, un parent de Ben-Mrabet et tout récemment le Bey Ahmed ; les pauvres seuls en sont sévèrement exclus. […] Est-ce que vos notions transcendantes et étendues sur toutes les sciences vous auraient fait reconnaître que les émanations du cadavre d’un indigent sont plus dangereuses que les autres pour la santé publique105 ?
Le cimetière est ici l’enjeu du mouvement précis que signale Foucault dans sa
conférence : les cimetières occidentaux sont, au XIXe siècle, progressivement rejetés en-dehors
des villes ; or ce fonctionnement imposé à Alger, y compris aux cimetières indigènes, est une
violence coloniale que le journal permet de mettre au jour. Cet article, à la visée polémique et
à la dénonciation forte, n’est pourtant pas représentatif des textes produits sur les cimetières
dans la presse coloniale : d’autres voix ont à faire entendre d’autres discours, bien moins
polémiques, sur les cimetières ; autrement dit, les coloniaux ont une autre manière de rendre
compte de cet espace, particulièrement quand il s’agit des cimetières coloniaux. Dans le même
journal, et quelques années après, Marie-Lefebvre signe dans le feuilleton le onzième numéro
d’une « Revue algérienne » qui traite alors plus précisément du « Cimetière Bab-el-Oued, à
Alger ». L’auteur, poète, a déjà publié dans L’Akhbar un texte repris par Le Moniteur algérien
sur « La France en Kabylie » ; il publiera son recueil poétique Les Angoisses l’année suivante.
104 Michel Foucault, art. cit., p. 1239. 105 Ismael ben Mohammed Khodja, « Chronique indigène », L’Akhbar, 16 septembre 1851.
176
C’est un homme de lettres polygraphe, reconnu dans la colonie. Dans ce feuilleton de L’Akhbar,
il commence par déplorer la tristesse des cimetières – ce devrait être des endroits gais. Jusque-
là, il reste dans les limites du feuilleton et traite d’un thème général ; c’est ensuite qu’il restreint
à la colonie, évoquant « les pays de soleil » et les cimetières turcs qui « ressemblent plutôt à
des jardins qu’à des nécropoles ». Il traite enfin d’Alger dans le paragraphe suivant :
À ces points de vue, le cimetière d’Alger, à Bab-el-Oued, nous a toujours paru admirablement placé : si quelque chose peut consoler nos morts de ne pas reposer sur la vieille terre de France, c’est à coup sûr d’avoir trouvé dans les tombes africaines, une si douce et si gracieuse hospitalité !
Ils sont là, sous le ciel bleu, au pied des coteaux verts, en face de la baie : tout près d’eux, l’ancienne ville découpe, sur une pente rapide, les dentelures de ses hauts remparts, nettement tranchées sur un fond d’azur intense ; par derrière, s’enfoncent les ravins du Frais-Vallon, pleins d’ombre et de murmures, - mystérieux asiles où il semble qu’on sente la vie sourdre à chaque instant autour de soi ; au-dessus, enfin, la Bou-Zaria dresse ses contreforts d’un seul jet à une hauteur dont la mesure élève la pensée et fait rêver du ciel106.
De la « chronique indigène » montrant la violence coloniale à une « revue algérienne »
tenue par un poète en vue, le ton de L’Akhbar a changé, et la présentation du cimetière aussi.
On peut percevoir ici l’appropriation de la terre par les termes mêmes, par ces rubriques, et par
le traitement qui est fait du cimetière : d’enjeu politique à objet poétique, c’est un espace qui a
connu une transformation, et la parenté du texte de Marie-Lefebvre avec une écriture poétique
en prose souligne bien cette évolution. Elle ne sera pas la seule dans la vie médiatique
algérienne : dix ans après Marie-Lefebvre, on trouve encore une autre apparition du cimetière,
et un autre traitement de cet espace. C’est ainsi qu’on peut lire l’imbroglio que publie, en deux
articles, L’Indépendant de Constantine en 1868. L’affaire tourne autour de l’interdiction qui
aurait été faite à une femme « mauresque » d’entrer dans un cimetière français pour se recueillir
sur la tombe de son mari. Le problème apparaît dans la rubrique « Nouvelles locales et
algériennes », avec la justification apportée par le journal que le cimetière relève de l’autorité
communale. Le rédacteur de l’article joue alors de son rôle de protecteur de la société en
reconstituant l’anecdote.
Samedi dernier, une femme estimable, Mme C…, mauresque d’origine et de religion, mais épouse légitime d’un chrétien mort il y a trois mois, veuve ainsi d’un honnête citoyen français regretté de tous, d’un homme qui a de plus rendu de longs services à la cité comme premier adjoint au maire, Mme C…, disons-nous, entrait au cimetière et se dirigeait vers la tombe de son mari, lorsqu’un prêtre catholique qui se trouvait là de service, a voulu lui en interdire l’accès.
106 Marie-Lefebvre, « Cimetière Bab-el-Oued, à Alger », L’Akhbar, 29 juin 1858.
177
Contre cette étrange et grossière prétention, se sont hâtées de protester plusieurs personnes catholiques que le même sentiment avait amenées au cimetière… et Mme C… a pu se recueillir sur la tombe de son mari.
Nous devons la connaissance du fait à ces témoins indignés, et nous leur avons exprimé la confiance qu’il suffirait de le rendre public pour empêcher désormais sa reproduction107.
Deux numéros plus tard, le journal revient sur l’anecdote, sous forme de mea culpa : il
reconnaît avoir été « complètement induit en erreur », et donne une nouvelle version de
l’anecdote.
Au moment où Mme C…, vêtue à la mauresque et suivie d’une mauresque, entrait au cimetière, le gardien lui demanda où elle allait. Mme C…, s’adressant à M. l’abbé X… qui se trouvait auprès du gardien, demanda à son tour si l’entrée du cimetière n’était pas accessible à tout le monde. M. l’abbé X…, ignorant la situation de Mme C…, répondait poliment que les cimetières sont des lieux de recueillement où l’on n’est amené que pour rendre hommage aux morts. Mme C… fit alors ce qu’elle aurait dû faire d’abord : elle déclina son nom et mit ainsi fin à toute observation108.
Il est intéressant de voir comment la langue sert à mettre en lumière deux descriptions
différentes de la femme impliquée dans l’affaire du cimetière : « mauresque d’origine et de
religion, mais épouse légitime d’un chrétien » devient « vêtue à la mauresque et suivie d’une
mauresque ». L’apparence remplace l’origine, et dans cette tension se lit aussi une situation
discriminante que le cimetière a mise en lumière. C’est ainsi que le cimetière, comme catalyseur
d’une situation coloniale prompte à la violence, montre que les indigènes ont perdu sous
l’Empire le droit à la parole qu’ils pouvaient avoir au début des années 1850.
À la Réunion, le cimetière n’est pas porteur des mêmes problématiques sociales, ou en
tout cas elles n’apparaissent pas dans les textes médiatiques. On peut cependant trouver un texte
local portant sur un cimetière dans des circonstances particulières – ainsi de la Toussaint 1863,
où après un poème d’Henry Murger, « Le jour des morts. Ultima spes mortuorum », le texte
suivant paraît :
S’il est un lieu qui doive inspirer le respect et le recueillement, qui doive appeler l’active surveillance de l’autorité, c’est le champ de repos des morts, c’est le cimetière. Et cependant – nous regrettons d’avoir à le dire - il semble que le cimetière de la Pointe-à-Pitre, affranchi de toute police, est un terrain vague abandonné aux profanations des hommes et aux insultes des anomaux. C’est un point de joyeux rendez-vous ; c’est
107 L’Indépendant de Constantine, 8 octobre 1868. 108 L’Indépendant de Constantine, 13 octobre 1868.
178
un pâturage aimé des cabrits et nous y avons vu des chevaux et des mulets à l’attache paissant au milieu des tombeaux109.
L’indignation face à l’abandon du cimetière, la description qui en est faite par touches
et scènes, cela concourt à signaler l’importance du cimetière. Il est bien en effet la trace de
l’ancrage réel de la communauté française dans son nouvel environnement, et à ce titre il
compte dans l’imaginaire médiatique. On trouvera d’autres textes sur les cimetières, certains de
circonstance et demandant l’intervention du gouverneur en visite pour améliorer le lieu ; mais
même dans ce type de texte, une inscription dans le monde colonial et littéraire s’effectue :
Chacun connaît cette magnifique réponse du héros sauvage au conquérant civilisé : - « Dirons-nous aux os de nos pères : levez-vous et suivez-nous sur la terre étrangère ? ... » - Une vénération profonde pour les cendres des morts est donc un précepte écrit dans toutes les religions, dont l’immortalité de l’âme est le dogme fondamental110.
Le décalage entre cette publication coloniale et l’évocation voltairienne des
« sauvages » tels qu’on les concevait pendant les Lumières est une marque intéressante de
l’adaptation que peut connaître l’identité coloniale. Par l’intertextualité, le cimetière devient le
lieu où le colonisateur se fait « sauvage », exprimant par ce renversement un attachement à la
terre plutôt qu’à la nation imaginée. Se joue en arrière-plan un enjeu pragmatique, celui de
l’entretien du cimetière ; mais se revendiquer du sauvage sur une terre coloniale, par le biais de
Voltaire, reste une forme remarquable d’investissement dans les nuances de l’identité coloniale.
Quelques textes enfin mentionnent des cimetières – et coutumes – propres aux
populations locales. Dans Le Courrier de Saïgon, le 20 mai 1867, les « nouvelles locales » font
paraître un texte sur le « lieu l’enterrement de la fille du prince cambodgien Phra-keo-pha, frère
du roi Norodon111 ». L’entrefilet est bref, et porte plus sur le cortège que sur le cimetière ; mais
il signale tout de même une portée ethnographique que l’on ne retrouve pas dans les autres
territoires de notre corpus.
Dans l’après-midi du 5, a eu lieu l’enterrement de la fille du prince cambodgien Phra-keo-pha, frère du roi Norodon. Le cercueil était porté par quatre Cambodgiens, et accompagné par le prince avec ses femmes et toute sa suite ; plusieurs fonctionnaires et habitants s’étaient joints au cortège, qu’escortait un détachement de quarante hommes d’infanterie.
109 « Le cimetière à la Pointe-à-Pitre. Un chapitre des mœurs coloniales », Le Commercial, 31 octobre 1863. 110 Un habitant de Saint-Pierre, « Le Cimetière de Saint-Pierre », Le Bien-Public, 11 novembre 1854. L’auteur cite un extrait de l’Essai sur les mœurs de Voltaire, Introduction, chapitre VII, « Des Sauvages ». 111 Le Courrier de Saïgon, 20 mai 1867.
179
Pendant tout le trajet de la demeure du prince au cimetière, un officier cambodgien jetait, selon l’usage, à la foule qui suivait des citrons contenant chacun une pièce d’argent112.
On trouve des textes équivalents pour les cérémonies funéraires tahitiennes dans Le
Messager de Tahiti : les aristocraties et royautés étrangères sont ainsi décrites à des moments
particuliers de leurs vies, sous une lumière ethnographique qui insiste sur l’exotisme des
coutumes davantage que sur le lieu même de l’inhumation. Certaines personnalités issues du
peuple colonisé se voient reconnaître par les textes une grandeur dictée par la politique, et c’est
par le cimetière ou son équivalent que se marque cette grandeur :
Sous les cocotiers du rivage, non loin de la case royale, s’élève un petit monument sous lequel est exposée la dépouille mortelle de Tapoa Ier, petit fils et dernier descendant d’un conquérant illustre. Des plantes aromatiques, des résines odoriférantes, employées d’après certaines recettes indigènes, ont permis de soustraire aux horribles lois de la décomposition le corps du souverain. Il est là, couché sur un lit de parade, revêtu du manteau royal et le visage découvert. Chaque jour son peuple, qui bénit sa mémoire, peut contempler ce visage vénéré, qui, maintenant flétri, était, quand la vie l’animait, le reflet des heureuses qualités, des vertus qui distinguèrent Tapoa et firent de lui un prince chéri de ses sujets, redouté, mais estimé de ses rivaux, et de son pays, un des plus sagement administrés de tous ceux des Îles sous le vent113.
En l’absence de familles régnantes, le périodique colonial peut citer le cimetière au cours
de « promenades » : l’auteur y jette alors un regard qui correspond aux ambitions descriptives
des auteurs coloniaux. Ainsi, dans L’Akhbar, en 1851, on lit au cours d’une telle promenade :
Partons donc : gravissons la rue de la Casbah, et sortons d’Alger par la porte de la victoire. Nous voici devant le cimetière Musulman, que je vous recommande de visiter les vendredi matin. Une foule de femmes mauresques chargées de rameaux verts, viennent y pleurer, causer, rire et manger tour à tour. Elles animent et égaient ce lieu funèbre ; et au printemps surtout, lorsque les arbres dont il est parsemé se couvrent de bourgeons et de fleurs, et que le soleil sourit à la terre tout émaillée de marguerites, ces troupes de femmes et de jeunes filles, se montrant parmi les tombes avec leurs voiles blancs, produisent un effet fantastique qui n’a rien de lugubre. L’on est déjà loin que le bruit de leurs voix joyeuses vous poursuit encore114.
La coutume décrite pour l’enterrement cambodgien, l’atmosphère du cimetière
musulman sont donc les deux points sur lesquels achoppent les textes : mais le cimetière
indigène est loin d’avoir la même portée que le cimetière colonial. La description du printemps,
des fleurs et du soleil permet même une poétisation du lieu qui tend vers l’orientalisme : les
voiles blancs, les marguerites, les tombes et arbres évoquent une peinture riche de couleurs.
112 Id. 113 « Couronnement de la reine de Borabora », Le Messager de Tahiti, 20 janvier 1861. 114 François Coquille, « Environs d’Alger. Le Frais-Vallon (Aïoun-Schrakna) », L’Akhbar, 18 février 1851.
180
C’est que le cimetière indigène est exotique et charmant ; différent du cimetière colonial, il est
décrit dans les premières années de colonisation comme pour affirmer une coexistence
pacifique entre colonisateurs et colonisés. Mais on ne peut que remarquer les manques : à notre
connaissance, pas de description des cimetières d’esclaves dans les colonies de plantations ; et
grâce aux cimetières, pas d’images de massacres ou de morts violentes. Indigène ou colonial,
le cimetière a gagné sa place dans la presse par sa capacité à construire une image apaisée de la
colonie, et par signifier la nouvelle appartenance des coloniaux au territoire sur lequel ils se
sont installés.
Écrire les rues et les villes des colonies
Il est enfin un lieu que la presse coloniale prend plaisir à décrire, lieu encore plus
« général » – si l’on peut employer ce terme – en tout cas plus habituel et trivial que ne l’était
le cimetière : la rue, les villes, toutes deux symboles pour le journaliste colonial de la force de
la colonisation, de cette « civilisation » apportée au territoire colonisé. L’évocation peut se faire
sur le mode sérieux, voire poétique, comme on peut en juger avec cette description qui paraît
dans La France algérienne dans les strophes d’un auteur qui ne signe que de ses initiales : H.
R. décrit ainsi la ville à partir de sa terrasse.
Le jour, c’est le travail ; et la nuit, c’est la joie Qui, bruyante ou paisible, en tous lieux se déploie ; Chansons de tous pays s’élèvent dans les airs, Doux entretiens d’amour, concerts, Promenades, théâtre ; et les chiens qui dans l’ombre Hurlent. Pourquoi ? Je crois, - un khodja me l’a dit, - Que l’âme du vieux Dey revient de l’enfer sombre Parfois nous regarder la nuit115.
Le théâtre ici, ainsi que la promenade, sont les signes apparents de la colonisation : ils
se mêlent à la présence du dey dans une évocation intéressante du passé de la ville. La rue
devient bien, dans ce texte, l’occasion d’une description qui se veut hybride, et ce dès son titre,
cette terrasse qui apparaît comme un motif prédominant de la représentation de l’Orient pour
les Français. Mais la rue peut être « utilisée » différemment, et par exemple dans un contexte
explicitement publicitaire. C’est ce qui se produit dans un numéro de L’Akhbar qui paraît en
décembre 1841, sous le titre « La plinthotomie ». On y lit ceci dès les premières lignes :
Alger, au point de vue architectural, se transforme avec une rapidité désespérante pour les amateurs de la couleur locale. Bientôt, les touristes et les poètes qui viendront chercher ici des ruelles sombres,
115 H.R., « La nuit sur ma terrasse », La France algérienne, 9 mai 1846. Le khodja est l’instituteur dans une école coranique.
181
tortueuses, inégales ; ces maisons mystérieuses aux façades blanches percées de quelques rares et étroites ouvertures, ne trouveront plus que des habitations européennes aux couleurs variées, ouvrant leurs nombreuses baies à la lumière du jour, dans des rues larges et bien aérées116.
Le texte s’avère être une publicité pour une entreprise toulousaine qui permet d’acheter
les pierres peu chères et bien taillées des maisons récentes et européennes que l’on voit dans les
rues : la réclame explique cette attention portée aux détails de la rue algérienne. Mais cet effort
de description que l’on lit au début est fait pour attirer le lecteur, et c’est ce qui le rend
intéressant ; il signale les attendus des lecteurs, le goût pour certains thèmes, par exemple la
« couleur locale » évoquée dès le début. Or cette « couleur locale » s’explique ici par les
« ruelles sombres, tortueuses, inégales » devenant des « rues larges et bien aérées » : apparaît
alors toute la force de ce décor, tout le sens qu’il peut prendre. Ce point même est un sujet de
débat : dix ans après cette réclame, le rédacteur de L’Akhbar se plaint, dans la description des
« Petites misères de la vie algérienne », des « hautes maisons à la française, puantes et
malsaines, qui interceptent l’air et la vue, et qui, dressant leurs sombres murailles au-dessus des
blanches terrasses à la mauresque, attristent et détruisent la gracieuse symétrie du vieil
Alger117 ». Comme pour le poème cité précédemment, c’est d’ailleurs dans l’architecture et le
dédale urbain que prend réellement forme la colonisation, par la concurrence ici – ou le
mélange, plus haut – de deux architectures et de deux atmosphères. Un autre texte, paru dans le
journal satirique Le Chitann, le confirme, qui décrit le mélange architectural autant que le
mélange des populations118. Une preuve supplémentaire de cette force se trouve dans les
tonalités que prennent les textes qui portent explicitement sur ce décor urbain : l’évocation des
rues de la ville peut aussi se faire sous un jour plus parodique, comme c’est le cas dans un texte
jouant sur la mise en abyme qui paraît en 1869. On est bien alors dans une écriture
caractéristique de la fin des années 1860, médiatiquement parlant : la caricature, le
grossissement des traits, la mise en abyme se retrouvent dans les publications d’un second
Empire devenu plus libéral. Sous la forme d’un dialogue, on lit :
Mon ami N. N. vint un jour me relancer en ces termes : - On voit rarement de votre prose dans nos journaux.
Moi de répondre : - Personne ne m’en a fait de reproche. D’ailleurs il en est assez
d’autres pour me remplacer et à si bon titre. Je ne suis ni industriel, ni habitant, ni conseiller municipal, et n’écris pas qui veut : et puis, payer des frais pour qu’on vous lise !
116 « La plinthotomie », L’Akhbar, 5 décembre 1841. 117 Chandellier, « Les Petites misères de la vie algérienne », L’Akhbar, 16 août 1851. 118 Cornibus, « Alger dans la rue », Le Chitann, 19 avril 1866.
182
N. N. – Que cela ne vous embarrasse : le journaliste corrige des phrases, le prote les fautes d’orthographe, et par-dessus le marché, on vous imprime aux frais des abonnés, chose d’autant plus méritoire que les abonnés ne paient pas toujours d’avance. Je réponds – Tout cela est assez engageant, mais il manque le sujet et un peu d’esprit pour le traiter. N. N. – Il n’est pas question d’esprit. Pour le sujet, parlez de la Pointe-à-Pitre, votre résidence, ses maisons, sa rade, ses rues. Je réponds – Il faudrait une brochure et intéresser le lecteur. Cependant vous me donnez une idée qui rentre dans mes attributions de moraliste. Puisque c’est à qui nous ôtera le dogme, qu’il nous reste au moins la morale, jusqu’à temps meilleur. Lisez ces quelques journaux, et prêtez-moi la plume : LA RUE. Une rue est un canal que l’on a ménagé entre les habitations des hommes, pour laisser écouler le flot du peuple119.
Ensuite se développe une description généralisante de ce qu’est une rue, loin de l’aspect
personnel, pittoresque que semblait demander l’interlocuteur de l’auteur. D’où une deuxième
version du texte :
LES RUES. Rues de Pointe-à-Pitre Elles ne sont pas vieilles, elles datent de la reconstruction de la ville, après l’année 1843 de sinistre mémoire. Elles sont larges pour la plupart, droites, mais loin de former un ensemble régulier. On était, cependant, maître du terrain, et le niveau ne laissait rien à désirer. Les maisons ne sont que des cases en bois plus ou moins basses, de constructions plus ou moins simples. Dans certains quartiers, elles ont l’air de s’appuyer avec précaution sur leurs voisines, ou restent penchées en équilibre d’une manière assez gauche. Beaucoup d’entre elles sont en mauvais état. La Pointe-à-Pitre n’en est pas moins une des belles villes de notre archipel colonial120.
Cette tonalité plus sérieuse se tient ensuite plus longuement, vantant les mérites de la
colonie à travers sa population. On trouve, malgré les premières lignes humoristiques que nous
avons citées, un aspect extrêmement sérieux, et qui justement illustre notre propos : la
description des rues des colonies est d’une précision révélatrice. La mention du séisme de 1843,
rappel d’une histoire coloniale récente ; les « cases en bois » plutôt que les
maisons ; l’inscription des rues au sein d’un « archipel colonial » transforment bien cette
description en ébauche d’une spécificité coloniale. Mais on reste encore, dans ces textes que la
presse coloniale offre, dans une perspective statique : or le corpus que nous traitons est
caractérisé par sa capacité à publier des textes « en mouvement », et c’est sur ce point que nous
allons nous pencher à présent.
119 L. Frossard, Pr, « La Rue », Le Commercial, 11 décembre 1869. 120 Id.
183
2 (D)écrire en mouvement : promenades, excursions, découvertes
Outre les aspects matériels – bateau, transports, lieux symboliques – que le journal met
en avant et dont il joue pour situer ses lecteurs sur la carte d’un monde qui change et intensifie
ses échanges, une autre dynamique se développe : à l’échelle de la colonie, l’exploration et les
découvertes font partie du corpus de textes que les publications périodiques favorisent ; en
métropole, les explorations coloniales sont elles aussi publiées dans la presse121. Les touristes
du XIXe siècle ont été précédés par « les explorateurs, les aventuriers, les militaires, les
diplomates, les négociants, les missionnaires ou les savants qui produisaient les récits de
voyage122 » : en contexte colonial, cette remarque générale peut souffrir quelques
aménagements, ne serait-ce que parce que ces différents niveaux de textes et leurs différents
desseins se retrouvent simultanément dans certains journaux coloniaux. Les touristes publient
en même temps que les diplomates, marins, missionnaires : tous s’inspirent de la géographie
pour mettre au point des récits plus ou moins poétisés, plus ou moins attentifs à leur lectorat123.
Mais il est vrai qu’un souvenir imprègne ces textes de voyage : celui de l’expédition qui a
inauguré la colonisation, qu’elle soit représentée dans notre corpus pour l’Algérie et les colonies
du second empire colonial, plus lointaine pour les Antilles et la Réunion. La une du Moniteur
algérien du 25 février 1836, reproduite infra, signifie assez l’importance de ces expéditions
pour la presse qui en rend compte alors : le récit se déroule sur plusieurs colonnes encore.
121 Voir pour l’Algérie Slimane Aït Sidhoum, Les récits de voyage en Algérie dans la presse illustrée et les revues du XIXe siècle ou l'invention d'un orient de proximité, thèse de littérature française et comparée sous la direction de Mme la Professeure Marie-Ève Thérenty, soutenue à l’Université Montpellier III, 2013. 122 Valérie Berty, Un Essai de typologie narrative des récits de voyage français au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 53. 123 Pour problématiser les différents types de littérature coloniale, voir Jean-Marie Seillan, « La (para)littérature (pré)coloniale à la fin du XIXe siècle », Romantisme, 2008, n° 139, p. 33-45.
184
Les textes de la presse coloniale se livrent à une valorisation des textes descriptifs ; mais
aucune description statique ne peut convenir à l’idéologie coloniale, qui se gargarise
d’aventures et de dangers. Il ne peut s’agir que de descriptions dynamiques, en mouvement,
énergiques, censées révéler un lien colonial à l’espace qui ne se résout pas que dans l’habitation.
Les textes de la colonisation ont aussi comme ancêtre une certaine littérature de voyage, et ils
sont contemporains d’une vague de récits qui a maintenant été bien étudiée : ils vont s’en
inspirer et construire un nuancier pour compléter cette littérature de voyage originale. Les récits
de voyage anciens avaient pour but la découverte ; les récits de voyage qui voient le jour au
185
XIXe siècle sont pensés dès le départ pour produire le récit final. Une nouvelle catégorie de
voyageurs aurait alors vu le jour, et
les écrivains se mettent à parcourir le monde avec pour but d’écrire leur voyage. Cette hypothèse est cependant quelquefois nuancée par les critiques qui travaillent sur les voyages d’écrivains au XVIe siècle, comme Montaigne. Mais si la pratique du récit de voyage existe bien évidemment avant le XIXe siècle, elle reste comme aux marges de la littérature124.
Au XIXe siècle, les récits de voyage sont dictés par l’écriture même : autotéliques, en
quelque sorte, ils se démarquent de la masse des écrits antérieurs. Où situer alors les récits
coloniaux qui paraissent à la même époque dans la presse ? Ils ne sont pas des voyages
d’écrivains ; ils ne visent pas le récit pur, mais sont subordonnés à des finalités idéologiques ou
pratiques. Apparaît alors l’image de récits qui sont bien les héritiers en ligne directe de textes
plus anciens, mais que malgré tout travaille une nouvelle appréhension du voyage littéraire. De
l’excursion organisée jusqu’à la promenade légère, les premières nuances se font jour dans cette
étude que nous proposons de faire : ainsi, intituler un texte « promenade », c’est, au contraire
de l’exploration ou de l’excursion, refuser la démarche orientée, l’exotisme lointain.
2.1 L’excursion ou la conquête mise en mots
Commencer par traiter des excursions scientifiques ou militaires peut sembler
rébarbatif : mais ces textes sont pourtant fondamentaux dans la construction textuelle du
territoire qu’opèrent les périodiques. Partant, leur forme n’est pas celle de rapports
administratifs, quand bien même ils s’en réclament pour affirmer une autorité intellectuelle
autant qu’empirique sur le sujet traité. Descriptions et aventures à la fois, ces textes
d’excursions se réalisent sur tous les territoires sous des formes différentes, et avec des
perspectives différentes : et pourtant ils semblent constituer la colonne vertébrale de la presse
coloniale locale. Ils se ressemblent en effet par le récit qu’ils font à la première personne, et la
manière dont cette énonciation influence la perception qu’a le lecteur de la réalité : « la place
logique du récit à la première personne est donc établie par le seul concept d’énoncé de réalité
feint, qui le distingue d’une part de la fiction, d’autre part du genre lyrique125 ». Renforcée par
des précisions géographiques, scientifiques ou historiques, les excursions de la presse coloniale
affirment leur appartenance à la réalité coloniale ; et ces textes que nous traiterons ressortissent
124 Véronique Magri-Mourgues, Le Voyage à pas comptés. Pour une poétique du récit de voyage au XIXe siècle, Paris, Champion, 2009, p. 28-29. 125 Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, trad. Pierre Cadiot, Seuil, 1986, p. 277.
186
à un thème certes colonial bien connu : celui de l’aventure, qui incline à se poser la question de
« la colonisation et l’espace de l’aventure126 ». Car si en 1839 un journal comme L’Akhbar fait
paraître un « diorama de l’Algérie », sous-titré « Description de la rade d’Alger127 », ce type de
titres n’est pas le plus apprécié par les rédactions coloniales : la description simple, ici
envisagée par le prisme du « diorama » alors en vogue, va se compliquer d’autres références et
d’autres modèles au fil du siècle. Une problématique générique se dessine alors, qui concerne
bien l’écriture de l’exploration coloniale. Car ces textes participent aussi à un mouvement plus
large, qui est celui de la généralisation de la figure de l’explorateur au XIXe siècle, et des
tensions qui travaillent ce héros de la modernité128.
Des descriptions dynamiques
Avant de voir comment les termes d’« excursion » ou d’« exploration » sont utilisés dès
les titres pour baliser la lecture du journal et indiquer quelle va être la grille de lecture de la
description, on peut s’intéresser aux textes, sans titres ou indiquant simplement le lieu décrit,
qui rendent compte d’un lieu colonial et de ses enjeux. Or une des premières remarques que
l’on puisse faire concerne l’animation qui régit la description dans nos périodiques. Précisons
ce que nous entendons par « animation » par l’exemple suivant : Le Messager de Tahiti fait
paraître en 1854 une description de l’archipel des Pomotous qui commence par une
comparaison.
Quand on suit en bateau le cours d’un grand fleuve, l’œil est à chaque instant charmé de la diversité des aspects qu’offrent ses rives. Tantôt on se trouve resserré entre de hautes montagnes, tantôt on ne sait plus reconnaître où est le lit, où est la rive. C’est l’effet qu’on éprouve quand on va de Matea à Raïroa. Aux approches de cette dernière île on voit poindre çà et là des bouquets de verdure sur une bande de sable dorée par le soleil et frangé d’une écume étincelante ; on dirait un collier de turquoises enchâssées dans de l’or émaillé d’une bordure d’argent. Est-ce la terre ? Est-ce la mer ? est-ce une chaîne d’îlots capricieusement étalés sur l’azur de l’Océan ? Comme un grand lac qu’entourerait un mur, Raïroa n’est qu’un bassin de 43 milles de longueur, enveloppé d’une muraille calcaire de 100 à 200 mètres d’épaisseur, qui s’élevant presque verticalement du fond de la mer, tantôt vient affleurer la vague, tantôt la dépasse en petites dunes couvertes d’arbustes d’un vert éclatant, et s’entrouvre en deux endroits, comme par deux portes, pour donner passage aux flots et aux navires129.
126 Voir Sylvain Venayre, « Introduction », Les Cahiers de la SIELEC, « L’aventure coloniale », Jean-François Durand et Jean-Marie Seillan (dir.), Paris, Kailash, 2011, n° 7, p. 19 ; et l’ensemble du numéro. 127 Joanny Pharaon, « Diorama de l’Algérie. Description de la rade d’Alger », L’Akhbar, 20 décembre 1839. 128 Voir Isabelle Surun, « Les figures de l'explorateur dans la presse du XIXe siècle », Le Temps des médias, 2007, n° 8, p. 57-74. 129 « Archipel des Pomotous. L’île Rairoa », Le Messager de Tahiti, 30 avril 1854.
187
Viennent ensuite des précisions sur la population, puis des descriptions à visée
ethnographique, et la traduction d’un chant tahitien. Mais dans ces premières lignes, la volonté
de rendre dynamique – d’animer, en d’autres mots – la description de l’archipel est évidente : le
pronom personnel indéfini camoufle à peine un discours indirect libre qui donne à lire
l’étonnement du spectateur. Ce moyen rhétorique n’est pas extraordinaire – si l’on ne le
rapporte pas à la publication d’un périodique colonial dont le lecteur moderne n’attend pas
forcément tant de ressources, mais plutôt une visée commerciale, ou en tout cas technique. Le
texte aboutit d’ailleurs à la formulation des précisions géographiques attendues : 43 milles de
longueur, 100 à 200 mètres d’épaisseur… Mais les premières lignes ont été écrites de manière
à impressionner le lecteur par un « effet » : celui d’une découverte, d’une excursion. On peut
aussi trouver, support médiatique oblige, des textes où la description dynamique sert un but
clairement commercial, celui de la publicité. Dans La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon
de Noël 1839, un texte intitulé « feuilleton » – et pourtant bien situé dans les colonnes de la
deuxième page – déroule ainsi la liste des boutiques recommandées aux lecteurs. L’ensemble
du texte est à l’avenant de cet extrait :
Puis, traversez la rue, si tant est que vous ne soyez pas affriandés par l’énorme édifice de bonbons et de dragées qui s’élève au centre du magasin de madame Camoin, comme un démon tentateur. Entrez au Cogne-Petit : ceci est un vrai panorama composé des innombrables objets que Paris enfante sans cesse pour le plus grand ornement de nos salons et le plus grand plaisir de nos dames et de nos enfants. […] Enfin, pour terminer votre promenade, parcourez notre rue Richelieu et notre rue Vivienne, je veux dire notre rue du Barachois et notre rue de l’Eglise, vous arrêtant devant chaque étalage habilement disposé, et vous serez bien difficile si vous avez encore quelque envie que vous ne puissiez contenter130.
Cette description, outre sa portée commerciale évidente, montre aussi comment les
textes médiatiques jouent avec l’espace dans lequel ils prennent naissance. Elle montre aussi à
quel point le texte de promenade, de flânerie, a envahi les colonnes des journaux. En creux se
fait alors ressentir l’absence d’un élément qui va pourtant prendre de l’importance au cours du
siècle, en métropole tout du moins : le chemin de fer n’apparaît que pour l’Algérie, et n’est que
très peu présent dans les périodiques. On trouve bien, par exemple, en 1866 un « Parcours
rapide d’Alger à l’Oued-Guétard ou Ravin des voleurs, et de celui-ci à Milianah » non signé,
qui rend compte rapidement d’un voyage en train :
Quoique le train que nous avons pris marche à petite vitesse, on regrette cependant d’aller encore trop vite et de n’avoir pas le temps de considérer à loisir le paysage riche et varié qui se déroule à vos regards.
130 E. V., « Feuilleton », La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, 25 décembre 1839.
188
Les nombreuses haltes que nous avons faites aux diverses stations d’Hussein-Dey, de la Maison-Carrée, de Birtouta, du Gué-de-Constantine, de Boufarik, de Béni-Méred, soit pour déposer des voyageurs, soit pour prendre ou laisser des marchandises, ont essentiellement retardé notre marche, et nous ont fait arriver à Blidah vers trois heures et demi du soir, juste comme le cocher de la voiture de Marengo allait monter sur son siège131.
L’animation de la description est ici travaillée et voulue ; il est d’autres textes pour
lesquels elle est nécessaire : les récits d’expéditions ou d’explorations, de voyages au sens large,
qui occupent les pages des périodiques. Enfin, le territoire prend parfois le pas sur la présence
des habitants au sein du journal : l’insurrection kanak de 1878, par exemple, pour importante
qu’elle soit, n’arrête pas le fonctionnement habituel du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie,
puisqu’on peut y lire un texte intitulé « Sentiers canaques. De Gomen à la côte Est (Nord de la
Nouvelle-Calédonie132) ». Or cette description de sentiers suit immédiatement le compte-rendu
de l’insurrection, caractérisée par des engagements violents et des destructions de villages ou
de cultures ; elle apparaît décalée par rapport à l’actualité, traitant paisiblement des paysages
de l’île, l’auteur affirmant ne vouloir donner qu’« une simple esquisse d’une des parties les
moins explorées de la Nouvelle-Calédonie », dans laquelle les Kanaks ne sont que des guides
ou des interprètes, et non des guerriers.
Explorations, expéditions, voyages : une première approche Les textes qui revendiquent une « exploration » dans leurs titres sont souvent tirés de
publications plus prestigieuses que celles de la presse coloniale locale : La Revue africaine, Le
Journal officiel de la République française, L’Explorateur géographique et commercial… Les
articles peuvent aussi se révéler des prépublications d’ouvrages savants. Ils composent un
corpus récurrent dans la presse coloniale, même si les territoires du premier empire colonial y
sont moins propices que d’autres, pour lesquels la colonisation est encore en voie d’achèvement
au cours du XIXe siècle. Certains pics de publication s’observent empiriquement à la lecture
des périodiques, mis en lumière par l’assemblage des numéros en recueil : de tels pics n’étaient
sans doute pas perceptibles pour les lecteurs de l’époque. En Nouvelle-Calédonie, en août
1862, le périodique officiel publie deux récits d’explorations successifs : d’abord une
« Exploration faite de N’goé à Port-de-France par M. le lieutenant de vaisseau
131 « Parcours rapide d’Alger à l’Oued-Guétard ou Ravin des voleurs, et de celui-ci à Milianah », Le Moniteur de l’Algérie, 11 janvier 1866. 132 F. Ratte, « Sentiers canaques. De Gomen à la côte Est (Nord de la Nouvelle-Calédonie) », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 13 novembre 1878. L’auteur est a priori le même que celui que répertorie la BNF : un A-Félix Ratte publie une Note sur les roches et gisements métallifères de la Nouvelle-Calédonie et catalogue explicatif de la collection envoyée à Paris en 1878, Nouméa, J. Bouillaud, 1878.
189
Chambeyron133 », puis un « Voyage par terre de Port-de-France à Kanala, exécuté par M.
Marchant, sous-lieutenant d’infanterie de Marine134 » ; en septembre, c’est un « Voyage sur la
côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie (mai 1862135) » qui est publié et annoncé par le rédacteur
comme le voyage d’un commerçant de Port-de-France. Ces textes montrent bien comment
l’exploration du territoire rayonne à partir de la capitale, par mer et par terre ; et comment ce
même territoire n’est pas encore bien connu par les colons présents sur place, d’où des
explorations locales. Mais le mouvement qui pousse à publier des récits d’exploration peut
s’avérer plus général : en 1875, Le Moniteur de l’Algérie multiplie les « explorations »,
publiées dans la rubrique des variétés : on y trouve par exemple « Les dernières explorations
françaises sur la côte occidentale136 », pris dans Journal l’Explorateur géographique et
commercial ; « Exploration dans l’Afrique occidentale137 », pris dans le Journal officiel de la
République française. Les textes d’excursion paraissent aussi parfois dans les feuilletons, par
exemple un « Voyage d’exploration dans le Sahara, exécuté par V. Largeau, membre
correspondant de la Commission de géographie commerciale à Paris138 ». La liste n’est pas
exhaustive, mais on voit par ces exemples, pris sur une période relativement courte, la manière
dont les récits d’exploration peuvent se succéder, et modifier ainsi la perception qu’ont les
lecteurs des territoires étrangers. Se pose alors la question suivante : les explorations et
expéditions sont-elles dévolues aux spécialistes ? La presse coloniale consultée encourage à
répondre positivement : ainsi, La Feuille de la Guyane française fait la publicité de son
territoire par des publications disséminées au fil des années de publication. En février 1853 est
publié – avec un délai seulement d’un mois – une « Exploration dans la partie sous le vent de
la Guyane française, par ordre de l’administration supérieure, faite par M. J.-P. Lougarre,
habitant de Cayenne, pour la recherche des produits naturels du sol et notamment du
caoutchouc, du 24 septembre 1852 au 26 janvier 1853139 ». Le titre est très long, le récit en
deuxième page, et le prospecteur un « habitant » dont on précise ainsi la connaissance du
133 « Exploration faite de N’goé à Port-de-France par M. le lieutenant de vaisseau Chambeyron », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 10 août 1862. 134 « Voyage par terre de Port-de-France à Kanala, exécuté par M. Marchant, sous-lieutenant d’infanterie de Marine », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 17 août 1862. 135 F. Knoblauch, « Voyage sur la côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie (mai 1862) », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 14 septembre 1862. 136 « Les dernières explorations françaises sur la côte occidentale », 31 janvier et 2 février 1875. 137 « Exploration dans l’Afrique occidentale », 3 février 1875. 138 « Voyage d’exploration dans le Sahara, exécuté par V. Largeau, membre correspondant de la Commission de géographie commerciale à Paris », 15 juin 1875. 139 « Exploration dans la partie sous le vent de la Guyane française, par ordre de l’administration supérieure, faite par M. J.-P. Lougarre, habitant de Cayenne, pour la recherche des produits naturels du sol et notamment du caoutchouc, du 24 septembre 1852 au 26 janvier 1853 », La Feuille de la Guyane française, 19 et 26 février 1853.
190
territoire autant que le manque de talents particuliers : tout est réuni pour attirer de nouveaux
investisseurs, par le biais de l’échange de journaux pratiqués entre la métropole et les colonies.
Autre temps, autres mœurs ? En 1861, une « Excursion dans le haut Maroni140 » paraît, signée
par un lieutenant d’infanterie de marine et, surtout, prise dans La Revue maritime et coloniale,
ce qui garantit son succès métropolitain. Les lecteurs de la presse coloniale ne sont plus aussi
proches de l’auteur qu’ils l’étaient dans notre premier exemple. Et cette tendance va se
poursuivre, modifiant le statut des textes pour le lectorat colonial : en septembre, c’est un
« Voyage d’exploration dans le haut Maroni (Guyane française141) », ayant eu lieu l’année
précédente, qui paraît, mais sous la forme d’un rapport adressé au gouverneur et prépublié – là
encore –dans la Revue maritime et coloniale. Une impulsion officielle, à savoir l’exploration
du Haut Maroni, permet donc la publication de quelques textes que l’on peut penser destinés en
fait à la métropole. Mais l’évolution ne s’arrête pas ici : en 1866, un certain C.C. signe dans les
variétés un « À travers la Guyane. Fragment142 ». Ce feuilleton, relativement long, égrène les
étapes d’un voyage plaisamment raconté, avec insertions de dialogues. Après une interruption
de quelques mois, en janvier 1867, « À travers la Guyane143 » paraît avec un nouveau sous-
titre : « Deuxième fragment. Bois et rivières » ; et il se clôt même sur une adresse lyrique à une
allégorie de la Guyane. Enfin, en 1877, un certain docteur Jean Chevaux publie, là encore sous
forme de rapport, un « Voyage d’exploration à travers la Guyane144 ». Mais cette fois, le voyage
paraît dans une rubrique qui n’est plus seulement le lieu des « variétés », mais bien une
« chronique locale » dont la temporalité n’est pas trop éloignée de celle des lecteurs. Le même
Jean Chevaux est à nouveau publié en 1878 : « Nouveau voyage d’exploration du docteur
Chevaux dans la Haute Guyane145 », annonce le périodique à la date du 7 septembre 1878. Les
textes d’exploration et de découverte ont donc un rapport variable au lectorat : rapport publié
immédiatement dans la presse locale, publication envoyée d’abord à La Revue coloniale et
140 Ronmy, lieutenant d’infanterie de marine (Revue maritime et coloniale), « Excursion dans le haut Maroni », La Feuille de la Guyane française, 21 septembre, 19 et 26 octobre 1861. 141 G. Vidal, lieutenant de vaisseau, « Voyage d’exploration dans le haut Maroni (Guyane française) », La Feuille de la Guyane française, épisodiquement de septembre 1862 à avril 1863. 142 C.C., « À travers la Guyane. Fragment », La Feuille de la Guyane française, épisodiquement d’avril à mai 1866. 143 C.C., « À travers la Guyane. Deuxième fragment. Bois et rivières », La Feuille de la Guyane française, épisodiquement de janvier à mai 1867. 144 Jean Chevaux, « Voyage d’exploration. À travers la Guyane », La Feuille de la Guyane française, épisodiquement d’août à décembre 1877. Le catalogue de la BNF donne plutôt l’orthographe « Crevaux », mais nous gardons ici l’orthographe, même défaillante, du périodique. Enfin, on peut noter que le texte sera publié en 1883 avec des illustrations de Riou. Voir Isabelle Surun, « Les figures de l'explorateur dans la presse du XIXe siècle », Le Temps des médias, 2007, art. cit. 145 « Nouveau voyage d’exploration du docteur Chevaux dans la Haute Guyane », La Feuille de la Guyane française, 7 septembre 1878.
191
maritime, retour enfin à une description plus littéraire qu’officielle, et plus proche des habitants,
tels sont les trois cas que nous avons identifiés pour ces publications de longue durée, qui
remplissent les deuxième et troisième pages du périodique guyanais.
En Cochinchine, le constat n’est pas le même que pour la Guyane, et la différence entre
les récits d’exploration semble encore plus marquée. Le Courrier de Saïgon publie en 1870 le
rapport de « M. Richier, lieutenant de vaisseau, commandant la COULEUVRE, à l’occasion de
fêtes à Bang-kok146 ». La rédaction se fait au passé composé et à la première personne ; deux
mois plus tard, on trouve un « Voyage au Laos », sous-titré : « Note sur le voyage au Laos, fait
en 1869 du mois de janvier au mois de septembre, par M. d’Arfeuille, lieutenant de vaisseau et
M. Rheinart, capitaine d’infanterie de marine, inspecteurs des affaires indigènes147 ». Là encore,
on trouve du passé composé et une description « sérieuse », dépouillée et neutre, qui ressortit
au statut officiel des voyageurs. Il est vrai que la colonisation de la Cochinchine a donné lieu à
ce genre de publications, officielles, d’explorations coloniales. Mais d’autres textes sont
apparus, et ce avant même les rapports que nous avons cités ; et si l’exploration n’est pas
explicite dans le titre, elle peut cependant apparaître comme terme générique dans le texte.
Ainsi dans « De Saïgon à Contior148 », signé par P. Le Faucheur dans Le Courrier de Saïgon,
où les premières lignes précisent le propos, et qualifient le trajet qui va être accompli :
Le 10 avril 1864, par un beau dimanche, après le déjeuner où j’avais réuni des personnes qui voulaient bien me témoigner tout l’intérêt qu’elles prenaient au voyage d’exploration que j’allais entreprendre, et après les toasts convenus, je m’embarquai sur un des bateaux qui me conduisirent, en remontant la rivière de Saïgon, au village de Ben-kack149.
Le récit est ensuite dramatisé, y compris lorsqu’il s’agit d’une attaque de tigres, durant
laquelle l’auteur se décrit comme un héros. L’énallage des temps verbaux, avec le passage au
présent de narration, participe à la pertinence du terme « exploration » signalé plus haut : se
développe ici un véritable récit d’aventure.
La lune étant splendide, je voyageai la nuit ; je venais de monter dans une des charrettes qui portaient nos bagages, et j’allais, je crois, m’endormir malgré des cahots épouvantables, lorsque j’entendis un grand tumulte, et je finis par démêler au milieu de la confusion des langues les exclamations : éléphants ! éléphants ! Je ne me dérangeai pas. A trois ou quatre reprises différentes, on vint bien me crier qu’ils venaient sur nous, qu’ils étaient tout près, je refusai toujours
146 « Rapport de M. Richier, lieutenant de vaisseau, commandant la COULEUVRE, à l’occasion de fêtes à Bang-kok », Le Courrier de Saïgon, 5 avril 1870. 147 « Voyage au Laos », Le Courrier de Saïgon, 20 juin 1870. 148 P. Le Faucheur, « De Saïgon à Contior », Le Courrier de Saïgon, 5 janvier 1865. 149 Id.
192
énergiquement de croire à une pareille énormité. Selon moi, je n’étais pas encore rendu dans les pays où ces choses devaient m’arriver. Cependant il fallut bien se rendre à l’évidence, un cri strident vint me déchirer l’oreille ; en un bond je suis hors de ma charrette, ma carabine à la main ; je crie de faire feu et je tire aussi mes deux coups. Il n’était que temps : quatre ou cinq grands mâles n’étaient plus qu’à cinq ou six mètres et s’avançaient, nous chargeant la trompe haute, presque verticale. Les huit ou dix coups de fusil que nous tirâmes presque en même temps les effrayèrent tant, qu’ils s’enfuirent en déroute en poussant des cris. Ils se perdirent dans le bois, et longtemps nous entendîmes le brisement des branches et des arbres qu’ils broyaient sur leur route150.
Mais le texte ne refuse pas non plus sa mission pédagogique. Quelques lignes après ce
récit, l’auteur adopte un autre ton et une autre perspective, sans refuser pour autant de
s’impliquer par l’emploi de la première personne : « Ils se servent, pour [remplacer le sel], de
la cendre de racine de bambou. J’évalue la population stieng à 14.000 individus, ou 10 environ
par kilomètre carré ». Il apparaît en fait que Le Courrier de Saïgon remplit ses colonnes par des
explorations ou des expéditions locales : la raison en est-elle que la colonisation date de 1864,
ce qui fait de ce territoire colonial l’un des derniers à avoir son propre périodique ? De fait, Le
Moniteur algérien ou Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie ne semblent pas publier autant de
textes d’exploration dans leurs premières décennies de parution. En outre, les explorations que
publie Le Courrier de Saïgon concernent aussi les territoires voisins de la colonie : en adoptant
une perspective téléologique, force est de remarquer que l’expansion coloniale se poursuivra
en effet davantage sur ce territoire qu’en Nouvelle-Calédonie ou en Algérie. Les explorations
sont en effet des entreprises sérieuses, ethnographiques, industrielles ; mais leur récit semble
bien marqué par une hybridité première : dans Le Messager de Tahiti, c’est une « Exploration
géologique151 » signée par un ingénieur des mines qui permet d’expliciter une légende liée au
lieu décrit, avant que l’intérêt scientifique ne reprenne le premier plan de la narration. Nous
avons cité des titres officiels ; mais les titres privés peuvent aussi se livrer à la grande entreprise
de publication d’explorations qui accompagne la colonisation : on pourrait donner plusieurs
exemples, et on prendra ici L’Écho d’Oran, qui publie dans ses variétés, pendant tout l’été 1847,
une « Expédition du général Cavaignac dans le Sahara algérien152 », expédition qui ressortit en
effet au contexte militaire de la conquête alors en cours. Le volume de publications
d’explorations, cependant, est moins élevé dans les titres privés que dans les titres officiels : ce
type de textes reste étroitement lié à un projet officiel. Ces premiers voyages que nous venons
150 Id. 151 Garnier, ingénieur des mines, « Ile Tahiti. Exploration géologique », Le Messager de Tahiti, 6 et 20 octobre 1866. 152 « Expédition du général Cavaignac dans le Sahara algérien », L’Écho d’Oran, épisodiquement du 19 juin au 9 octobre 1847.
193
de citer, explorations ou expéditions, ont une prétention le plus souvent scientifique,
ethnographique ou commerciale : l’on pourrait s’attendre alors à lire des textes adoptant la
forme du rapport rendu public mais non destiné au public au départ ; il y aurait alors peu
d’attention prêtée à l’écriture du voyage. Pourtant toutes ces explorations ne sont pas présentées
comme de simples rapports dénués d’une présence narratrice ; dans les années 1850, même si
le terme n’est pas fixé littérairement, l’exploration est aussi valorisée par ce qu’elle permet de
subjectivité, comme on peut le voir dans la présentation d’une de ces explorations :
Ce récit est dû à M. le commandant de Colomb, commandant supérieur du cercle de Grévyville. A côté de renseignements très-utiles, de relations légendaires des plus attachantes, l’auteur a placé des descriptions empreintes d’un grand cachet de couleur locale et a fait de tout cela des pages pleines d’un véritable intérêt : nous les offrons à nos lecteurs, persuadés qu’elles seront accueillies avec faveur153.
Et en effet, le récit est émaillé d’anecdotes qui laissent place à une autre description que
celle, neutre et objective, attendue :
En 1853, lors de notre premier voyage à Ouargla, le général Durrieu, alors colonel, commandant la subdivision de Mascara, devait traverser, avec une colonne de cavalerie, les plateaux qui séparent El-Maïa de Mitlili. À mesure qu’il avançait dans ce morne désert, cette mélancolie, cette espèce de terreur que ces espaces inspirent, l’envahissaient sans doute, car il interrogea à diverses reprises et toujours avec une inquiétude croissante, le caïd des Ouled-Yagoub, Tahar-bel-Fathmi, qui le guidait, sur les ressources en eau, en bois et en fourrage qu’il avait devant lui. Le vieux caïd lui répondit : « Mais vous êtes sur l’Oued-Zergoun » de l’air à la fois étonné et narquois que pourrait prendre un Parisien pour dire : « Vous êtes à Paris ! » à un étranger qui semblerait craindre d’y manquer du nécessaire. Le Yagoubi ne pouvait pas admettre qu’on pût craindre la faim ou la soif dans cette vallée qui était pour lui le type de la fécondité154.
L’anecdote ici éclaire l’exploration en donnant à la confrontation entre le caïd et le
commandant une portée humoristique qui souligne la nouveauté du territoire pour un Français
saisi par « ces espaces » inconnus. Mais les explorations et expéditions ne sont pas les seules
modalités pour écrire la découverte du territoire : il reste encore les excursions.
Les excursions ou comment décrire une colonie pacifiée Le 17 janvier 1852, Le Courrier d’Oran fait paraître en feuilleton « De Tlemcen à
Rachgoun », texte signé par O. Mac Carthy et pris dans la Revue de l’Orient, comme le précise
la signature. Le 11 juillet de la même année, L’Akhbar fait paraître, en feuilleton aussi, une
153 « Tournée d’exploration dans les Ksours et dans le Sahara de la province d’Oran, par le commandant de Colomb », Le Moniteur algérien, 5 juin 1858. 154 Id.
194
« Excursion de Tlemcen à Rachgoun », signée par O. Mac Carthy et prise dans la Revue de
l’Orient, de l’Algérie et des colonies : un même texte, paru dans une revue métropolitaine, est
republié dans la presse coloniale locale, mais avec une variation de titre intéressante. Dans La
Revue de l’Orient, le texte est bien paru sous le titre « Excursion de Tlemcen à
Rachgoun155 » : pourquoi omettre cette précision dans Le Courrier d’Oran ? Cette question,
devenue point de départ, permet de rayonner autour de la notion d’excursion et de ses
réalisations textuelles dans la presse coloniale. Quand l’exploration joue clairement sur le
ressort de l’aventure, l’excursion en appelle à un autre type de voyage : si au départ elle désigne
une « irruption guerrière en territoire ennemi156 », le mot a rapidement servi à qualifier la visite
qu’on fait d’un territoire : contrairement à l’exploration, qui conserve l’inconnu comme but,
l’excursion est une sortie orientée, durant laquelle le voyageur sait où il va. D’ailleurs, en 1870,
la collection incomplète du Courrier de Tlemcen laisse voir par extraits la publication d’« Un
Voyage par terre de Tlemcen à Alger et retour par mer » qui montre bien comment l’excursion
a pu se stabiliser en voyage. Le feuilleton du 29 avril traite du trajet entre Orléansville et
Miliana :
La voiture quitte Orléansville, nous sommes, comme j’ai dit, huit dans l’intérieur.
Une conversation qui paraît interrompue se continue entre le débitant, sa femme et la chanteuse.
Cette dernière émet une théorie singulière sur sa profession, la longueur de mon feuilleton d’aujourd’hui, m’oblige à ajourner, au prochain numéro, la conversation de ces trois compagnons de route.
Peu à peu la conversation devient générale, je prends des notes sur mon calepin, j’écris toute la théorie de la chanteuse, dans une écriture inconnue à mes voisins157.
Cette scène de genre qui inaugure le texte laisse une place importante à la personnalité
du journaliste, rédacteur du journal et qui se met en avant en tant que personnage ; puis le texte,
la première page passée, développe plutôt une dimension polémique, rappelant ce qui oppose
Des Ageux et le maire de Tlemcen. La colonisation a permis aux journaux de passer des
expéditions aux excursions, et des excursions aux voyages qui sont autant de scènes de
diligence davantage portées sur les personnages que sur le territoire. C’est que l’excursion a
aussi conservé, dans ses connotations, l’idée du voyage court, contrairement à l’exploration ; et
elle semble convenir particulièrement à ce que Benedict Anderson, au cours d’un chapitre sur
« les pionniers créoles », explique. Son idée majeure est en effet que « ni les intérêts
155 Le texte est paru en deux parties, dans les livraisons de 1850. 156 Définition donnée par le TLF. 157 Émile des Ageux, « Un Voyage par terre de Tlemcen à Alger et retour par mer » durant le printemps 1870 », Le Courrier de Tlemcen, printemps 1870.
195
économiques, ni le libéralisme ou les Lumières ne purent créer ni ne créèrent d’eux-mêmes le
type, ou la forme, de la communauté imaginée158 » ; et il ajoute ensuite que « ce furent les
pèlerinages des fonctionnaires créoles et les presses des imprimeries créoles qui jouèrent un
rôle décisif dans l’accomplissement de cette tâche159 ». La mise sur le même plan des
« pèlerinages » de fonctionnaires – entendus au sens de ces tournées dans les différents
territoires coloniaux – et des presses nous intéresse ici particulièrement, car certains journaux
réunissent justement le rôle des presses créoles et celui des excursions officielles, militaires
autant que d’apparat. Les comptes rendus de ces sorties officielles sont réguliers dans la presse
coloniale locale ; le schéma en est toujours plus ou moins le même, et on peut prendre en
exemple le paragraphe suivant :
Nous ne sommes informés qu’aujourd’hui des circonstances du voyage que M. le Gouverneur vient de faire autour de l’île. Partout sur son passage, notre digne chef s’est informé, avec la plus vive et la plus tendre sollicitude, de la situation des divers quartiers : c’est surtout sous le chaume des cabanes que M. le contre-amiral allait chercher la triste vérité ; c’est assis sur la misérable escabelle du pauvre qu’il aimait à s’informer des malheurs, des besoins de ses administrés160.
La première phrase, il faut le reconnaître, n’est pas si habituelle : dans le fonctionnement
attendu, le journal est non seulement le vecteur, mais encore l’associé du fonctionnaire en
déplacement : il crée, en quelque sorte, le voyage officiel lorsqu’il en relate les étapes pour les
lecteurs de toute la colonie, et pour les éventuels lecteurs métropolitains. Mais à côté de ces
représentations officielles, un dépouillement rapide laisse apparaître plusieurs « excursions »,
quel que soit le territoire colonial concerné. Regardons quelques titres et quelques auteurs de
ces excursions : une « Excursion d’un touriste dans la province d’Oran161 » parue dans Le
Moniteur algérien en 1843 ; une « Excursion d’un médecin militaire dans le Kabylie de Collo,
pendant le dernier choléra162 » dans Le Moniteur algérien en 1855 ; une « Excursion aux îles
sous le vent163 » dans Le Messager de Tahiti en 1856 ; « Excursion dans la partie Sud-Ouest de
la Nouvelle-Calédonie, faite en mars 1866 par M. Garnier, ingénieur des
mines164 » ; une « Excursion faite à l’île de Phuquoc pendant le mois de septembre 1870, par
158 Benedict Anderson, op. cit., p. 75. 159 Id. 160 Le Colonial, 14 juin 1833. 161 « Excursion d’un touriste dans la province d’Oran », Le Moniteur algérien, 25 novembre 1843. 162 « Excursion d’un médecin militaire dans le Kabylie de Collo, pendant le dernier choléra », Le Moniteur algérien, 25 janvier 1855. 163 E. Hardy, « Excursion aux îles sous le vent », Le Messager de Tahiti, 30 novembre 1856. 164 « Excursion dans la partie Sud-Ouest de la Nouvelle-Calédonie, faite en mars 1866 par M. Garnier, ingénieur des mines », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, du 22 juillet au 5 août 1866.
196
M. de Chaunac-Lanzac, inspecteur stagiaire des affaires indigènes165 » dans Le Courrier de
Saïgon en 1870 ; « Une excursion dans la rivière des patates-à-Durand et sur le sommet du piton
Grayel, au bois de nèfles166 » dans Le Courrier de Saint-Pierre en 1870 ; « Excursion dans la
vallée du Chelif167 » dans Le Mobacher en 1876 : tels sont les textes à partir desquels nous
pouvons réfléchir à ces articles dont les titres signent la parenté, mais dont les auteurs sont très
différents. L’origine militaire de l’« excursion » n’apparaît que très peu dans cette liste ; tout
semble indiquer une exploration courte plutôt qu’une campagne militaire : c’est ce qu’on peut
lire dans les annonces qui précèdent certains de ces textes, quand le périodique justifie la
publication et l’inscrit dans une perspective. Ainsi, l’excursion aux îles sous le vent d’E. Hardy
est annoncée dans le numéro précédant sa parution par les lignes suivantes :
Mercredi dernier, l’aviso à vapeur le Styx est rentré en rade de Papeete, après une charmante excursion aux îles de Huahine, Raiatea et Borabora. L’un de nos amis, qui a pu, grâce à la bienveillante hospitalité et à l’obligeance de M. le lieutenant de vaisseau Grimoult, faire ce petit voyage, a promis pour dimanche prochain de nous communiquer quelques notes sur l’état actuel de ces îles qui, malgré leur proximité de Tahiti, sont presqu’inconnues à un grand nombre de nos lecteurs168.
En fait, l’excursion – charmante, ici – est l’occasion de donner au lecteur colonial un
aperçu de son territoire entendu au sens large : autres îles de l’archipel, parties du territoire peu
fréquentées ou sommets réputés difficiles sont les objets de ces textes. C’est ce qu’on voit par
exemple dans une « Excursion dans la partie Sud-Ouest de la Nouvelle-Calédonie, faite en mars
1866 par M. Garnier, ingénieur des mines », qui commence ainsi :
Le Mont d’Or est orienté N. 40° O et offre quatre faces principales qui regardent le S.-O., le N.-O., le N.-E., et le S.-E. Vu de l’Ouest, il présente un aspect saisissant : sa masse énorme est complètement détachée de toute chaîne et son flanc, sans courbure ni contour, descend verticalement, comme une vaste muraille169.
La précision géographique est mêlée à une comparaison rapide, certes, mais qui
complète la portée descriptive en accord avec le statut de l’auteur, ingénieur des mines. D’autres
textes feront de l’excursion un récit plus léger, comme c’est le cas pour le « touriste » qui écrit
dans Le Moniteur algérien, et qui décrit son excursion en impliquant sa personne, ses pensées
165 Chaunac-Lanzac, « Excursion faite à l’île de Phuquoc pendant le mois de septembre 1870, par M. de Chaunac-Lanzac, inspecteur stagiaire des affaires indigènes », Le Courrier de Saïgon, 5 décembre 1870. 166 Alphonse Alizart, « Excursion dans la rivière des patates-à-Durand et sur le sommet du piton Grayel, au bois de nèfles », Le Courrier de Saint-Pierre, 23 décembre 1870. 167 « Excursion dans la vallée du Chelif », Le Mobacher, 2 juillet 1876. 168 E. Hardy, « Excursion aux îles sous le vent », Le Messager de Tahiti, 30 novembre 1856. 169 « Excursion dans la partie Sud-Ouest de la Nouvelle-Calédonie, faite en mars 1866 par M. Garnier, ingénieur des mines », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 22 juillet 1866.
197
et réflexions sur le territoire qu’il parcourt. L’excursion parfois peut être aussi inattendue, au
sens où elle ne concerne pas le territoire colonial, mais un territoire voisin : parce que La Feuille
de la Guyane française est mieux conservée que Le Courrier de la Martinique, c’est dans le
périodique guyanais, qui précise son emprunt, que l’on peut aujourd’hui lire le texte que publie
C. Chanel, journaliste martiniquais déjà cité par La Feuille de la Guyane française, sur une
éruption de la Montagne-Pelée. À Cayenne, en effet, c’est le 13 septembre 1851 que paraît, en
troisième page, le récit de ce qui est qualifié de « visite » dans la titraille et d’« excursion » dans
le texte. L’éruption a eu lieu en août ; et ce récit d’actualité a donc plus d’un mois quand les
lecteurs guyanais en prennent connaissance. Après une description générale de l’éruption, le
journaliste décrit les mouvements de panique, et s’inclut enfin dans son récit : c’est alors que
va véritablement commencer l’excursion.
Leurs récits sur l’événement dont ils avaient été les témoins rapprochés furent bientôt rapportés, commentés, amplifiés ; les passants troublèrent la tranquillité des rues, les uns par curiosité, les autres par effroi, se rendirent sur les points de la ville d’où l’on pouvait apercevoir les colonnes de vapeur.
J’avoue que pour mon compte, profondément enseveli dans le sommeil du juste, je ne me doutais pas qu’un volcan eût passé si près de moi. À six heures, une voix amie me réveilla et m’annonça ce dont il s’agissait. Il y avait une éruption à la Montagne-Pelée ; il fallait aller voir cela de près. Aussitôt dit, aussitôt fait ; une demi-heure après, notre rédacteur en chef, M. de Maynard, M. Vidal, négociant, et moi, nous chevauchions dans les rues du Fort170.
La mise en scène du rédacteur en chef du journal participe aussi à la définition des
hommes de presse comme de nouveaux aventuriers : et leur troupe va grossissant au fur et à
mesure qu’ils progressent vers le volcan, s’arrêtent dans des habitations et croisent des
cultivateurs qui fuient la zone, un lieutenant de gendarmerie qui en revient... Au numéro
suivant, le récit de cette « visite » continue, selon un modèle léger, et qui fait la part belle aux
autres personnages présents :
Nous allons ; c’est entendu ; en marche. Par où passe-t-on ? Mais il y a cinq lieues à faire dans les bois. Jamais vous ne pourrez vous tenir avec vos souliers… ; nous ne reviendrons pas avant la nuit, etc., etc. Arguments jetés au vent. – Nous irons seuls, s’il le faut, mais nous irons, dit M. de Maynard, qui venait de se faire indiquer, tant bien que mal, la direction du chemin ; en avant. Et nous voilà prêts à emboiter le pas. Un grand gaillard, bien découplé, prend alors son coutelas, et dit : Si ces Messieurs y vont, j’y vais aussi ; un autre l’imite, Jean Élie, je
170 C. Chanel, « Martinique. Éruption volcanique de la Montagne-Pelée. Première visite aux cratères », La Feuille de la Guyane française, 13 septembre 1851. L’éruption a eu lieu le 5 août.
198
crois ; puis un autre. Le Rubicon était passé, chacun voulait être de la partie171.
Une fois le texte terminé et ses protagonistes revenus chez eux, le journaliste rajoute
sous forme de post-scriptum quelques faits à propos du volcan. Pour que le texte soit publié en
Guyane, il faut certes une proximité géographique qui intéresse les lecteurs ; mais surtout, il
faut un texte comme celui-ci, qui traite d’un événement non-métropolitain et en fait un récit
agréable. La Feuille de la Guyane française ne publie les récits d’explorations ou les excursions
uniquement quand le sujet se rapporte au territoire colonial guyanais ; ce texte est à plus d’un
titre original. Tous les territoires coloniaux sont cependant concernés, avec leurs nuances, par
les récits d’excursion ; à la Réunion, un bon exemple de ces nuances est donné par Le Courrier
de Saint-Pierre, dans son feuilleton du 24 octobre 1867. Le rédacteur prend le soin d’introduire
le propos :
Nous recevons la relation suivante d’une excursion dans l’intérieur de l’île. Nous la publions avec d’autant plus d’empressement qu’elle est écrite avec l’esprit qu’exigent de pareilles narrations.
Ce n’est pas la première fois, sans doute, que l’on fait dans le pays des relations de voyages dans les hautes régions de l’Île ; mais les premiers écrivains n’ont pas tant épuisé la matière qu’il n’en reste encore quelques jolies anecdotes que notre correspondant a inscrites sur son carnet et qu’il livre aujourd’hui à la publicité172.
Le texte se donne ensuite sous une forme épistolaire, décrivant en effet l’intérieur de
l’île et les efforts faits pour y parvenir. « L’esprit » ici diffère en effet du rapport officiel, de la
mise en danger ou de la promenade : la narration est conditionnée par le métadiscours qui est
tenu sur elle en premier lieu, et le lieu même de la publication (le feuilleton) signale bien que
l’excursion a ici une valeur de divertissement en même temps que l’affirmation de la beauté de
l’île – y compris de son « intérieur », ces terres habituellement moins fréquentées que les
rivages par les sociétés coloniales. Un autre texte attire notre attention, parce qu’il signale une
autre utilisation de l’excursion comme concept colonial et complète notre nuancier : un
collaborateur du Moniteur algérien dont on ne connaît que les initiales, Al. D., signe en mars
1834 un article intitulé « Excursion dans l’Atlas. Le prince Pukler Muskaw ». Le prince est en
fait Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871), touriste allemand connu dès 1828 pour ses
voyages à travers l’Europe. Le collaborateur algérien voit donc l’Algérie à travers le regard
d’un voyageur chevronné : mise en réflexion intéressante pour la description du territoire.
Le prince Pukler Muskaw que son voyage en Angleterre a placé au rang de nos littérateurs distingués, est depuis quelques temps à Alger où il
171 « Martinique. Éruption volcanique de la Montagne-Pelée », 20 septembre 1851. 172 « Relation de voyage », Le Courrier de Saint-Pierre, 24 octobre 1867.
199
s’occupe, dit-on du soin de recueillir des matériaux pour la publication d’un ouvrage sur notre colonie. Il vient de faire, dans l’Atlas, une excursion dont les détails remplis d’intérêt sont propres à répandre un nouveau jour sur les mœurs et le caractère des Arabes.
Personne depuis l’occupation n’avait encore pénétré aussi avant dans les terres, et l’on voit avec surprise trois Européens s’avancer, presque sans escorte, au milieu de tribus que l’on supposait plus ou moins hostiles, et en recevoir l’accueil le plus hospitalier. Cette excursion peut contribuer à rectifier nos idées sur un peuple que l’on est disposé à se représenter comme essentiellement vénal, sans aucun sentiment de moralité et de dignité individuelle : c’est sous ce rapport que nous nous sommes déterminés à en publier quelques circonstances qui nous ont été communiquées par M. Harbaïby, officier d’ordonnance de M. le comte d’Erlon, qui avait été autorisé par lui, à accompagner le prince173.
Suivent en effet plusieurs descriptions des étapes du voyage, de l’accueil reçu. Le
déroulement est bien chronologique, et le texte se conclut sur le retour à Alger du prince et de
ses compagnons de voyage. L’intermédiaire de ce personnage s’affiche comme le prétexte
d’une description de l’Algérie en tant que terre coloniale apaisée. La mention de l’excursion est
ici à prendre en opposition avec le caractère dangereux de l’exploration première, de la
découverte du territoire : si elle est mentionnée, c’est pour mieux mettre en valeur le manque
d’escorte du voyageur et l’hospitalité rencontrée. C’est en ce sens qu’on peut parler de concept
colonial autant que de sous-genre littéraire : il apparaît ici que le mot, le genre de textes qu’il
produit, et sa portée idéologique forment une sorte de chaîne : l’excursion, dans la presse
coloniale, vaudrait pour un texte « performatif », au sens où il affirme par sa seule mention que
le territoire colonial est conquis, pacifié, soumis. C’est ce que met très clairement en mots le
« touriste » du Moniteur algérien qui présente ainsi son excursion dans la province d’Oran :
Je dois regarder comme une bonne fortune d’être arrivé à Alger la veille du jour où M. le Maréchal Gouverneur-Général partait pour une promenade dans la province d’Oran, promenade non plus à main armée et en compagnie de bons bataillons ; mais simple excursion d’un bon propriétaire dans ses terres174.
La « promenade » apparaît ici comme une sorte d’hyperonyme : décalée quand elle
désigne la conquête militaire dans une périphrase – « à main armée et en compagnie de bons
bataillons » –, elle permet de mieux décrire l’excursion, et attire surtout l’attention du lecteur
sur la pacification en cours. Or ce terme de « promenade » apparaît à de nombreuses reprises
dans la presse coloniale, et témoigne de l’inscription des textes dans leur époque, dans une
problématique spatiale qui est celle du XIXe siècle. Toutes les excursions que nous avons citées
ne représentent qu’un échantillon de ce qui pouvait se lire au XIXe siècle dans la presse
173 Al. D., « Excursion dans l’Atlas. Le prince Pukler Muskaw », Le Moniteur algérien, 13 mars 1834. 174 « Excursion d’un touriste dans la province d’Oran », Le Moniteur algérien, 25 novembre 1843.
200
coloniale : pourtant elles témoignent d’appréhensions multiples du territoire sous une même
étiquette générique. L’excursion n’est pas seulement l’action racontée ; elle en vient, par
métonymie, à désigner un texte particulier, un petit genre colonial particulièrement prolifique.
Proto-reportage quand il s’agit d’aller voir le cratère de la Montagne Pelée, récit d’aventures
contrariées par la pacification coloniale en Algérie, rapport officiel qui ne renonce pas tout à
fait à une narration destinée à la publicité : les modalités de l’excursion littéraire sont
nombreuses, et chacune correspond à un projet idéologique précis. Mais il n’en reste pas moins
que c’est par elles, et par les périodiques qui les publient, que s’accomplit une création du
territoire colonial imaginé.
2.2 La promenade ou une flânerie coloniale
Le territoire colonial apparaît comme un objet mouvant, et le texte ici vaut l’équivalent
de la carte : attentif aux limites, aux reliefs, aux contours, il dessine une nouvelle appréhension
des villes et des campagnes, des côtes et des intérieurs. L’exploration se prête particulièrement
aux territoires encore sauvages, naturels, inconnus ; mais la colonisation, entendue dans son
acception la plus courante au XIXe siècle, entend démontrer les bienfaits de la
« civilisation » – les deux termes vont de pair dans le discours colonial. Or cette civilisation se
fonde sur l’idée de la ville, et sur son corollaire de la promenade : oisive, souvent urbaine, la
promenade coloniale constitue bien, rétrospectivement, l’un des attendus des appréhensions
textuelles du territoire. Plus largement, la promenade a pu constituer un thème des études
littéraires, et la démarche qui inaugure l’étude d’Alain Montandon est intéressante pour notre
propre progression dans l’étude des textes médiatiques :
Ce qui retient notre attention dans cette pratique solitaire ou partagée n’est pas la promenade comme trajet lyrique d’un sujet dans un paysage, mais la déambulation comme phénomène social. Ce sont les représentations de la promenade comme mode d’interaction sociale, comme type de rencontre avec l’autre, qui nous intéressent ici175.
Le seul bémol – ou plutôt la seule variation – que nous pouvons apporter à cette
définition, c’est en ce qui concerne le « type de rencontre avec l’autre » : dans les promenades
coloniales, si altérité il y a, elle concerne surtout le paysage, et non ses habitants. En fait, et plus
largement, si l’écriture de la promenade ressortit bien à une mentalité romantique176, la
175 Alain Montandon, Sociopoétique de la promenade, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2000, p. 7. 176 Philippe Antoine, Quand le Voyage devient Promenade. Écritures du voyage au temps du romantisme, Paris, PUPS, 2011.
201
promenade coloniale semble en être un avatar un peu particulier : elle néglige le caractère
gratuit ou personnel de ce nouveau type de récit de voyage, et convertit la promenade en
stratégie textuelle d’exploration du territoire – en avatar civilisé de l’excursion ?
Une typologie des promenades Partir des titres d’articles permet d’entrevoir la fertilité de la « promenade » comme
texte de variétés, étroitement lié au territoire colonial et à ses auteurs. On trouve les titres
suivants : une « Promenade dans la ville177 » de L’Est algérien est bien le seul titre à ne pas être
précis, car le corpus fait apparaître une « Promenade à Dellys178 », « Une promenade sur les
quais de Saïgon179 », « Une promenade au château de Gol180 » et une « Promenade au lac de
Tahiti181 ». Sur un corpus fragmentaire comme l’est le nôtre, ces quelques titres montrent que
ce genre de textes se retrouve d’un journal à l’autre : si l’on fait l’hypothèse d’une identité
générique promise par le titre, cette récurrence devient intéressante. La « Promenade à Dellys »
participe clairement d’un projet idéologique : le texte commence par un exposé portant sur
l’emplacement stratégique de la ville. « Dellys, ainsi que nous l’avons dit l’autre jour, est appelé
par sa position à devenir le grand entrepôt des denrées kabyles qui, de là, s’écouleront vers
Alger par deux voies faciles ; à dos de mulets d’un côté, sur des barques de l’autre », écrit
l’auteur, avant de décrire le développement de la ville et les différents travaux entrepris. Puis le
ton s’infléchit, et un paragraphe fait transition entre la description de la ville et celle de la
promenade à proprement parler.
M. le général de Bar, commandant en l’absence de M. le Gouverneur-Général est allé, mardi dernier visiter Dellys, accompagné de tous les chefs d’administration qui, chacun en ce qui le regarde, avaient à étudier le point nouveau où nous voulons nous asseoir. Ce voyage de 36 heures par un temps magnifique sur une mer sans ride, vers une ville à peu près inconnue, intéressante par ce qu’elle a été, par ce qu’elle doit être et par la richesse proverbiale de ses jardins maintenant pleins de fruits et de fleurs, avait tout l’attrait d’une promenade. Mme de Bar et Mlle Bugeaud se laissèrent tenter à la faire en touriste ; Mme la Maréchale encore souffrante de son voyage à Oran, n’avait pu entreprendre cette nouvelle excursion. Depuis 12 siècles peut-être, depuis que les dames romaines ont été chassées de leurs villes, aucune dame européenne n’avait été montrer à ces âpres habitants tout ce que la civilisation donne de grâces, et tout ce qu’ils perdent à ne pas mieux comprendre la dignité de la femme.
177 « Promenade dans la ville », L’Est algérien, 4 décembre 1868. 178 Henri Feuilleret, « Promenade à Dellys », Le Moniteur algérien, 14 juin 1844. 179 « Une promenade sur les quais de Saïgon », Le Courrier de Saïgon, 5 octobre 1865. 180 Alphonse Alizart, « Une promenade au château de Gol », Le Courrier de Saint-Pierre, 11 avril 1871. 181 A. Barion, « Une promenade au lac de Tahiti », Le Messager de Tahiti, 22-26 février 1860.
202
On retrouve encore dans ce texte les éléments idéologiques qui soutiennent l’entreprise
coloniale : le rappel du passé, les richesses du territoire, et quelques silhouettes féminines qui
témoignent de la pacification du territoire. C’est ensuite que le texte évolue vers un récit plus
poétique :
Nous nous embarquâmes à neuf heures du soir à bord du Météore. Le ciel était tout émaillé d’étoiles, Alger, tout semé de lumières. À mesure que nous gagnions au large, ces lampes du ciel et de la terre, confondues dans la perspective à travers les mâts des vaisseaux au mouillage, semblaient étinceler à travers une forêt. Ce spectacle était sans doute fort poétique ; mais les lits du Météore, dont la destination habituelle est de recevoir des blessés, sont excellents, si bien que beaucoup d’entre nous arrivèrent à Dellys sans s’en apercevoir ; il était 4 ou 5 heures du matin182.
La poéticité apparente, fonctionnant par métaphores et comparaison, est désamorcée
immédiatement par l’apparition même du terme « poétique », la mention du prosaïque et le
rappel d’un contexte militaire : les lits donnés habituellement aux blessés coupent la parole
descriptive pour revenir à la réalité du voyage effectué. Le texte se développe ensuite selon cet
équilibre entre passages descriptifs travaillés et comptes rendus d’entrevues avec les chefs ou
informations sur le passé romain de la ville.
Les titres sont parfois étonnants : ainsi d’une « promenade militaire » presque
oxymorique, en tout cas non signée, qui paraît dans le Messager de Tahiti en 1862, sous la
forme d’un récit de voyage où chaque jour est noté. La « promenade » a duré dix-huit jours et
entraîné le Commissaire Impérial, le narrateur et des troupes françaises le long de l’île : on nous
décrit les banquets, réceptions, marches des soldats ; et même, très rapidement, un assaut donné
contre des Tahitiens, conclu par une victoire française. Quelle est l’utilité de ce texte dans le
périodique tahitien ? Il est traduit : les Tahitiens peuvent en prendre connaissance. Il est
didactique : les notes de bas de page traduisent certains termes tahitiens que l’auteur met un
point d’honneur à utiliser. Il est idéologique : les descriptions mêmes peuvent servir à inscrire
l’histoire coloniale dans le paysage, comme nous le verrons. Il est enfin dramatisé : le récit
d’une marche dangereuse sous l’averse, par exemple, transforme le texte en récit tendant vers
l’épique.
Nous franchissons de cette façon des montagnes, des rivières, de longues plages de sable, des montagnes encore ; dans quelques endroits, par un faux-pas sur la pierre glissante et boueuse du sentier qui souvent n’a pas trois pieds de large, on serait lancé dans des précipices qui
182 Henri Feuilleret, « Promenade à Dellys », Le Moniteur algérien, 14 juin 1844.
203
donnent le vertige, quand la lueur d’une torche qu’on y secoue dissipe les ténèbres de leurs profondeurs183.
Parfois, la description de moments d’incompréhension entre les soldats et leurs hôtes
tahitiens prête à sourire : l’un de ces moments est introduit par un commentaire métadiscursif
de celui qui se dépeint comme un « narrateur fidèle184 ». Quant à l’auteur, il ne signe pas, mais
qualifie un médecin tahitien rencontré au cours de la promenade comme « notre honorable
collègue » : sans doute est-il, en effet, un médecin attaché au corps expéditionnaire. Le texte
est introduit par un paragraphe qui signale son importance : « Dans un de nos précédents
numéros, nous avons annoncé à nos lecteurs, le récit détaillé de la promenade militaire faite
autour de l’île Taïti, au mois de juillet 1861, nous tenons maintenant notre promesse, que des
retards dans la traduction nous avait forcé d’ajourner185 ». Le texte commence ensuite par la
description des préparatifs, la mention des soldats présents ; et au cours du texte, qui s’étire sur
plusieurs numéros, on lit plusieurs réceptions, repas, mais aussi des descriptions de paysages :
C’est du haut de cette première des nombreuses montagnes qu’il nous faudra franchir d’ici à Taravao que Amo et Berea, sa femme, qui régnaient en 1767, sur une grande partie de l’île, purent juger pour la première fois des effrayants effets de l’artillerie. Après avoir envoyé contre les navires de Wallis, dont ils voulaient s’emparer et qui étaient mouillés dans la baie de Matavai, de nombreuses pirogues de guerre, ils gravirent la montagne, pour assister en spectateurs à l’événement qui allait se passer. Mais les canons de cette proie qu’ils croyaient assurée foudroyèrent leur flotte qui fut détruite, et eux-mêmes échappèrent avec peine aux boulets qui venaient briser les arbres autour d’eux, en les couvrant de débris de pierres et d’éclats de bois186.
L’intérêt ici réside dans la manière dont le paysage devient prétexte à une évocation
historique : le territoire colonial apparaît ainsi hanté par la guerre, et par l’histoire des premiers
contacts lors de la colonisation. Cet extrait attire aussi l’attention du lecteur par le changement
de ton au sein du texte : le lecteur est ici plongé dans un récit rapide mais fort, illustré par des
détails marquants (les débris de pierres et les éclats de bois). Cette « promenade militaire »
refuse le nom d’exploration ou d’excursion, et son récit refuse le titre de « rapport » ou de
« compte-rendu » : pourtant, c’est bien le récit d’une excursion officielle, et qui vise à aller
reprendre une partie du territoire colonisé. La clef de ce titre réfractaire à la typologie habituelle
réside peut-être dans la posture du narrateur : extérieur à l’armée et pourtant inclus dans la
communauté, observateur et savant, il fait de son texte un récit complet, théoriquement destiné
183 « Promenade militaire autour de Taïti », Le Messager de Tahiti, 16 février 1862. 184 « Promenade militaire autour de Taïti », 23 février 1862. 185 « Promenade militaire autour de Taïti », 16 février 1862. 186 Id.
204
à un lectorat multiple (colonisateurs, colonisés, métropolitains curieux, journalistes de la presse
métropolitaine en quête d’articles).
Voir la ville : les mœurs coloniales au cœur des descriptions Si l’on a étudié jusqu’ici des textes dont le titre même les situe dans une parenté, voire
un sous-genre descriptif que serait particulièrement la promenade, il est évident que d’autres
textes utilisent la promenade comme moyen descriptif, comme manière d’impliquer le lecteur
dans la description de la ville coloniale. Ainsi de La Feuille de la Guyane française qui fait
paraître le 9 janvier 1830 des « Esquisses de la Guyane » ouvrant sa partie non-officielle.
« C’est, je l’avoue, avec une prévention défavorable que j’ai abordé les côtes de la Guyane française. J’avais quelquefois entendu parler de cette contrée, et toujours sous des dehors peu avantageux. Le hasard m’y a fait relâcher malgré moi. D’après ce que j’en ai vu depuis quelques jours, avec un aussi beau climat, des terres aussi fertiles, une végétation aussi riche, je m’étonne que la colonie soit restée si pauvre et si arriérée dans ses travaux ». Ainsi s’exprimait un étranger, M. James W…., récemment arrivé des Etats-Unis sur un navire qui avait fait escale à Surinam et qui, destiné pour un plus long voyage, avait été forcé par quelques avaries à s’arrêter dans notre port. Un ancien habitant auquel il adressait ces paroles lui fit observer que peut-être ses préventions s’effaceraient s’il connaissait mieux un pays intéressant sous beaucoup de rapports. Sur ce, pour mettre à profit le temps que le navire devait donner à ses réparations, on proposa une promenade dans les principaux quartiers de la colonie ; la partie fut acceptée ; l’exécution fixée au lendemain187.
Sous forme d’introduction, le discours direct du voyageur américain résume ce qui doit
sonner comme un lieu commun sur la Guyane : c’est une manière d’attirer le lecteur avant de
le lancer dans la description précise du territoire guyanais. Car le voyage à proprement parler
apparaît dès le paragraphe suivant, avec une rupture de ton remarquable : l’auteur n’est plus
dans la publicité, mais bien dans un récit qui doit illustrer la Guyane. D’où les lignes suivantes :
C’était par une de ces belles matinées du mois d’octobre, si calmes, si fraîches, si suaves sous les tropiques à cette époque. Quelques nuages plus légers que le souffle qui les dirige, épars çà et là dans le ciel, colorés de pourpre et d’opale, se détachaient dans le plus bel azur. Une vapeur plus légère encore flottait en glissant sur la surface des eaux qui, reposées dans le calme de la nuit, présentaient l’aspect d’un vaste miroir. À travers ce brouillard du matin apparaissaient de loin en loin les palétuviers de la rive opposée, la point Tanguy, celle de Macouria, le Mont Mathoury couronné de forêts et de nuages, et dans le lointain les montagnes de Tonnegrande, horizon qui, comme une ceinture verdoyante, entoure la rade de Cayenne et que doraient à peine les premiers rayons du soleil188.
187 « Esquisses de la Guyane », La Feuille de la Guyane française, 9 janvier 1830. 188 Id.
205
Le lexique poétique et la pause que constitue cette scène se mêlent avant le retour à la
description du voyage. La manière dont le texte joue de ces variations de ton met en lumière
l’aspect composite du genre même : à la fois publicité, récit de voyage et description poétique,
ces « esquisses de la Guyane » relèvent bien de la littérature médiatique.
Après quelques instants d’attente, nos voyageurs arrivent au rendez-vous sur le grand pont du débarcadère, où se trouvent réunis M. James W… en léger costume de campagne, deux Européens nouvellement arrivés de France, qui profitaient de l’occasion pour visiter notre pays, l’habitant qui leur en faisait les honneurs, et finalement votre serviteur qui, embarqué comme passager pour se rendre à Roura et entraîné dans la suite du voyage, se voit aujourd’hui l’écrivain de la compagnie, dont il se fait un plaisir de consigner ici les observations. Un canot muni d’un tendelet, armé d’un patron et de six noirs vigoureux nous attend au bas de l’escalier du pont. Chacun prend place ; l’équipage plonge les pagayes en mesure pressant l’eau qui jaillit de toutes parts, et le canot s’élance avec la rapidité du trait189.
Le texte développe ensuite une description des paysages qui apparaissent vus du
canot : Cayenne, ses arbres, ses bâtiments défilent ainsi, et le texte est alors à nouveau poétique,
jusqu’à faire entendre des chants. Réalité coloniale oblige, ces chants sont ceux d’esclaves en
train de pagayer, mais le narrateur ne limite pas pour autant le penchant poétique de ses
descriptions. Finalement, le narrateur apparaît aussi à la première personne, à la fin de la
livraison, quand il faut « arriver à Mondélice, où nous étions attendus pour nous mettre à
table » ; et la présence de l’auteur se fait de plus en plus précise, jusqu’à la précision
suivante : « je termine ici ce chapitre ». C’est que les textes de « promenade », quand bien
même ils ne portent pas ce titre, mettent en jeu la présence d’un auteur qui revendique son rôle.
Le siècle voit varier les manières de rendre compte de la ville coloniale : dans une « Revue et
chronique sur la ville de Saint-Pierre », en 1843, l’auteur choisit de mettre en scène le manque
de feuilletons parisiens pour justifier son écriture très locale. Le geste par lequel il introduit sa
chronique est intéressant ; dans une optique de discussion avec le lecteur, il écrit :
Mais avant de vous montrer Saint-Pierre, de vous mettre au courant de ses cancans, de son bavardage, des nouvelles du jour, enfin de tout ce qui constitue la vie publique et animée d’une ville, il est indispensable de choisir un endroit convenable, d’où, bien placés, nous pourrons promener nos regards sur le vaste et mouvant panorama qu’elle présente, et où les bruits de la populeuse cité ne viendront pas me troubler dans les petites narrations que je veux vous faire190.
189 Id. 190 H. Vignerte, « Revue et chronique de Saint-Pierre », L’Avenir de la Pointe-à-Pitre, 18 novembre 1843. Pris dans Le Courrier de la Martinique.
206
C’est donc par une mise à distance que va se faire la description de la ville et
l’intégration du lecteur au texte médiatique :
Votre vue se porte au loin sur le Morne-Pelé, qui vous apparaît comme un colossal géant couché, qui se repose de ses fatigues : ses flancs arides toujours couverts de nuages semblent une grève sur laquelle roulent incessamment des flots d’argent. À vos pieds, Saint-Pierre bruyant et livré à toutes les passions, à tous les vices des modernes Babylones, étend le vaste échiquier de ses maisons et de ses rues, qui se dessinent à vos regards comme les cases d’un immense damier ; un peu plus loin la rade avec ses navires immobiles comme des mouettes reposées, et qui ressemblent à des mouches collées sur une glace de Venise : pour faire cadre au tableau, la mer calme, unie, bleue, mais transparente, déroule devant vous les plaines scintillantes de son incommensurable horizon sur lequel se dessine vaguement la silhouette blanchâtre d’un bâtiment à voile, ou le noir panache de fumée d’un paquebot anglais que dorent les rayons étincelants du beau soleil des tropiques191.
Le texte joue de l’aspect spirituel de la chronique, sans éviter une certaine poéticité dans
la description : la ville est envisagée par un réseau de comparaisons qui met en valeur le regard
surplombant du promeneur. Des techniques narratives semblables se retrouvent en contrepoint
subjectif de descriptions : ainsi, la description des îles du Salut en 1852, par un chroniqueur qui
signe J., met en valeur l’activité qui règne sur ces territoires occupés par un bagne. L’auteur
décrit le paysage, et plus particulièrement la ville, avant de couper sa description par cette
intrusion à la première personne :
Suivons cette route que nous avons escaladée à la hâte : On nous montre l’hôpital, l’infirmerie, le logement des sœurs, celui des aumôniers, le corps-de-garde… que sais-je ? C’est à ne pas y croire, quand on songe que l’on est en pleine Guyane, sur la terre classique des impossibilités, des désillusions, des déceptions traditionnelles192
La promenade, quand elle est ainsi intégrée, est un indice de l’observation, et de la
possible inadéquation entre une représentation et sa réalité. Ce sont des textes qui peuvent aussi
faire la promotion des réalisations coloniales : « Il y a un an à peine le voyageur qui venait
visiter Tahiti se sentait saisi d'une secrète tristesse en entrant à Papeete », écrit ainsi un
publiciste en 1853 dans le journal officiel local. Mais il continue par une promenade qui
correspond à l’actualité du journal, qui inclut le lecteur et fait de la description dynamique une
réalisation de la propagande gouvernementale : « Entrons par la porte du sud-ouest, dont les
gens de Faa viennent de déblayer les abords par une belle et large route193 ». Il y a une utilité
purement politique à ces types de textes ; mais d’autres emplois encore justifient les
191 Id. 192 J., « Les îles du Salut », La Feuille de la Guyane française, 3 juillet 1852. 193 « Édilité tahitienne », Le Messager de Tahiti, 28 août 1853.
207
descriptions dynamiques, et notamment la peinture de mœurs. Le ton est alors davantage
comique, et la perspective plus « terre à terre », si l’on peut utiliser cette expression, dans les
« petites misères coloniales » – c’est bien le titre de l’article – dont se plaint un collaborateur
de la presse antillaise en 1869. La littérature médiatique a alors évolué ; les traces de la
littérature panoramique autant que celles de la petite presse permettent l’éclosion de textes
humoristiques, textes de mœurs qui jouent sur la connivence avec le lectorat. À partir d’un
élément urbain comme le trottoir, C. P. met en mots la trivialité de la vie coloniale ; en fait,
dans ce texte court et plaisant, il s’adresse au rédacteur pour porter une réclamation – pratique
courante dans les journaux coloniaux, puisque locaux, pour signaler une route mal entretenue,
un pont défaillant ou ce genre de défaut… La dénonciation tourne aux scènes de « mœurs
coloniales », et on peut alors en citer quelques extraits :
Le jour vient de s’ouvrir, une molle fraîcheur vous convie à une promenade hors ville. Vite, vous quittez votre demeure et cheminez joyeusement sur le trottoir en vous enivrant d’air pur et en vous répétant à vous-même : Qu’il fait donc bon ce matin ! – Paf ! Vous recevez tout à coup une terrine d’eau dans les jambes et votre douce quiétude se change en fureur lorsque vous vous apercevez que vous venez subitement d’être converti en triton : tête humaine, queue de poisson ! Votre blanc pantalon ruisselle de vase et de boue.
Que voulez-vous ? C’est une domestique qui lavait à grands courants le salon de ses
maîtres… Elle ne l’a pas fait par exprès, la pauvrette ; elle était toute à son affaire et la terrine a été vidée à distance sans qu’elle pût même, à pareille heure, soupçonner l’existence d’un passant.
Aye ! aye ! ya-ya ! moin bien fâché ! ça moin fai là !... Et vous recevez une seconde inondation d’excuses du même genre, excuses sincères assurément – mais qui n’en laissent pas moins subsister le bain de pieds non prévu par la faculté. – Pardon pas que gueri bosses…
Mais vous avez repris courage et vous continuez votre route en méditant sur le sans-façon par trop primitif des mœurs coloniales. – Vlan ! vous recevez en pleine figure un battant de porte ou un volet de fenêtre qui s’ouvre comme par magie et vous barre le passage après vous avoir brisé le nez ou avarié le menton194.
La description de la rue coloniale qui est faite est bien différente de celles, statiques,
qu’on a évoquées dans le chapitre précédent : c’est ici la promenade comme possibilité de
scènes comiques, de rencontres, autrement dit comme mise en scène de l’auteur dans le cadre
colonial, qui prévaut. La rue est un arrière-plan, le décor des « mœurs coloniales » que le
collaborateur du journal met par la suite au jour, paroles comprises. La meilleure preuve de
cette utilisation réside encore dans son détournement par la presse satirique : La Vie algérienne
s’en charge, qui publie « Alger, la nuit195 ». Le journaliste y fait une promenade nocturne en
194 C.P. « Petites misères coloniales », Les Antilles, 28 août 1869. 195 C. l’une, « Alger, la nuit », La Vie algérienne, 23 et 29 janvier 1870.
208
compagnie du lecteur, et n’oublie aucun des passages obligés de la description des rues : foule,
silhouettes, cafés et hauts lieux de la vie algérienne y défilent, et à l’occasion ressort le racisme
consubstantiel au phénomène colonial.
La plus vilaine race d’ivrognes de ces quartiers, c’est la race indigène ; l’européen, à quelques exceptions près, dans l’état le plus complet d’ivresse, garde cependant, sinon le raisonnement, du moins conscience de ses actes : l’indigène, point ; il est mahboul et réduit à l’état de bestialité qui ne fait même pas plaisir aux animaux auxquels je pourrais le comparer ; plus il boit, plus il veut boire, et, l’alcool agissant, il devient furieux. Ne vous montrez pas à lui, en ce moment, ou garnissez votre poitrine d’une bonne cotte de mailles ; malheur au premier qui lui tombera sous la main. Attention ! regardez bien : un de ses coreligionnaires, à peu près dans le même état, s’approche : ils causent ensemble, et le résultat de leur entretien est qu’il faut encore boire : nouvelle station au cabaret, nouvelles libations ; puis, il faut payer… vous allez voir196.
Voir, en effet, c’est là le but de ces textes qui affichent l’ambition de décrire l’habituel
autant que le caché : la nuit algérienne autant que les paysages et ruelles de Martinique ou de
Guadeloupe.
Scénographies auctoriales de promeneurs Si l’on se penche sur la production d’Alphonse Alizart, on remarque qu’il a écrit, avant
sa « Promenade au château de Gol », une « Excursion dans la rivière des patates-à-Durand et
sur le sommet du piton Grayel, au bois de nèfles197 », les deux étant publiées dans Le Courrier
de Saint-Pierre. Deux textes, deux descriptions, mais une « excursion » et une
« promenade » : on peut ici faire le pari que l’écriture n’est pas exactement la même dans les
deux articles, et que l’auteur y module sa présence. C’est dans le cadre de cette hypothèse, et
en l’étendant au corpus, que l’on se propose d’étudier les scénographies auctoriales à l’œuvre
dans les « promenades ». Plus largement, des textes remontons aux auteurs, aux collaborateurs
qui se définissent entre les pages du périodique et dont il ne nous reste que ces traces écrites.
Utilisons alors l’outil de « scénographie auctoriale198 » tel que Dominique Maingueneau le
développe dans le cadre de l’analyse du discours, comme « scène de parole qu’impose
196 Id. 197 Alphonse Alizart, « Excursion dans la rivière des patates-à-Durand et sur le sommet du piton Grayel, au bois de nèfles », Le Courrier de Saint-Pierre, 23 décembre 1870. 198 « Mais l’ethos n’est en aucun cas un phénomène que l’on peut autonomiser : c’est une dimension de la scène d’énonciation, plus particulièrement de la ʺscénographieʺ, c’est-à-dire de la scène de parole qu’impose l’énonciation », selon les mots qu’il emploie dans « L’ethos : un articulateur », COnTEXTES, 2013, n° 13. URL : http://contextes.revues.org/5772. Consulté le 20 septembre 2014.
209
l’énonciation », et qui comprend alors l’ethos ; comme une composante discursive du texte199.
Quel est donc, dans le cas particulier des « promenades » coloniales, l’ethos visé et développé
par les auteurs ; quel monde de valeurs sous-entend cet ethos ; et enfin, pour aboutir à
l’établissement d’une scénographie, quelle place est réservée aux lecteurs et au texte lui-même ?
En analysant quelques exemples, c’est bien une meilleure appréhension des textes que nous
visons. Dans sa « Promenade au château de Gol », Alizart commence par une description neutre
de Saint-Louis, « un des quartiers de l’île de la Réunion qui offrent aux touristes et aux
botanistes le plus de curiosités et d’agréables délassements200 ». Le texte progresse ensuite par
paragraphes délimités très nettement : apparition d’un « nous » auctorial au deuxième pour
continuer la description, implication du lecteur par un « vous » et apparition de l’auteur par un
« je » au troisième, avant le passage à la promenade à proprement parler, qui se fait au présent
dans le quatrième paragraphe :
Après avoir visité ce charmant petit quartier où vous admirez une église magnifique encore inachevée, véritable cathédrale par ses vastes proportions, son style simple et sévère, et les cinq belles cloches d’Amiens offertes à la communauté par la générosité d’un riche propriétaire de l’endroit, je voulus faire une promenade au château de Gol que l’on aperçoit dans l’Ouest, au milieu d’immenses plaines verdoyantes, et entouré par des arbres de haute futaie.
Un de mes bons amis, le jeune F…, qui partage mes goûts, mes sentiments, voulut bien m’accompagner dans cette excursion.
C’était le 8 mars 1871, au matin. Nous cheminons lentement sur la route nationale. Le temps est superbe, pas un nuage au firmament. Devant nous, les hauteurs des Avirons, les monticules de l’Étang-Salé se dessinent clairement sur un ciel azuré ; à notre droite, de hautes montagnes, sillonnées par des chemins carrossables, étalent par graduation leurs riches cultures dont l’aspect présente les nuances les plus bigarrées, et nous laissons sur notre gauche les vastes plateaux du Gol qui se prolongent indéfiniment jusque sur le littoral201.
Et l’auteur de remarquer, après avoir décrit la beauté des lieux visités : « Mais c’est en
vain que vous voulez me retenir, je ne suis qu’un étranger, tant de félicité et de bien-être ne sont
pas faits pour moi ». La portée publicitaire de l’article est assez évidente à la fin :
Disons au lecteur en terminant cette description : Ami, si vous voulez visiter un superbe château, parcourir, explorer la plus belle propriété de l’île de la Réunion, donnez-vous la peine de vous rendre au Gol et soyez
199 Voir pour plus de précision : Ruth Amossy et Dominique Maingueneau, « Autour des “scénographies auctoriales” : entretien avec José-Luis Diaz, auteur de L’écrivain imaginaire (2007) », Argumentation et Analyse du discours, 2009, n° 3. URL : http://aad.revues.org/678. Consulté le 17 septembre 2014. José-Luis Diaz y précise : « Bien sûr, à mes yeux, l’adoption d’une scénographie auctoriale a des conséquences tout à fait prévisibles et logiques en termes d’adoption d’une scénographie énonciative et discursive, au sens (plus restreint) de Dominique Maingueneau. Mais elle n’a pas une pure et simple fonction discursive ». 200 Alphonse Alizart, « Une promenade au château de Gol », Le Courrier de Saint-Pierre, 11 avril 1871. 201 Id.
210
persuadé que, comme nous, vous en reviendrez riche de souvenirs et d’impressions202.
L’apparition du « nous » est tardive, et la promenade prend d’abord à parti le lecteur, le
touriste, ce « vous » indifférencié qu’il s’agit d’emmener. On est loin alors de l’impression que
produisent les premières lignes de « l’excursion » faite un an auparavant :
En 1860, j’eus l’occasion de faire la connaissance de Valmire Boyer, ce créole énergique, fier et indomptable dans les dangers, que les touristes de la partie-du-Vent connaissent bien. J’aimais à entendre cet intrépide voyageur raconter ses exploits, ses courses à travers les plaines et les forêts de notre île. Il me parlait surtout du piton Grayel, (Lisez Grêle, du prénom de M. Deville qui, le premier, fit l’ascension de ce morne, au commencement de ce siècle) de la caverne de la Terre, du bassin Daniel et de toutes les beautés que renferme la zone des montagnes situées entre la rivière des pluies et la rive droite des patates-à-Durand, et m’engageait fortement à explorer ces hauteurs203.
La tonalité autobiographique du texte fait de l’excursion un texte littéraire à part ; et si
on n’a pas trouvé trace de ce Valmire Boyer, la mention d’un personnage que l’on suppose
connu (le déterminant démonstratif le prouve assez) ancre le texte dans une communauté de
lecteurs et ne vise pas à leur exposer une nouveauté. Si nouveauté il y a, elle réside plutôt dans
la précision toponymique sur le piton Grayel ; et ces exemples montrent que le promeneur est
polyvalent : ni voyageur à proprement parler, ni explorateur, il se tient sur une ligne qui lui
permet des incursions dans différentes tonalités et différentes scénographies.
La promenade au lac de Tahiti que nous avons déjà évoquée constitue une deuxième
étape intéressante. Elle est signée par A. Barion, collaborateur occasionnel du journal, et qui
fait état dans sa signature de sa fonction de pharmacien de marine : on a vu que la signature,
notamment quand elle complète le patronyme par la fonction, signifie beaucoup quant à la
scénographie que l’auteur va développer. Pharmacien de marine signifie d’abord une
appartenance au corps militaire colonial ; la fonction évoque à la fois l’aventure des traversées
maritimes et une connaissance scientifique poussée. Deuxième indice à analyser avant même
de se lancer dans le texte à proprement parler : sa « promenade au lac de Tahiti » paraît en
feuilleton ; or « en tant qu'espace culturel, le feuilleton est révélateur des tendances et attentes
culturelles du public visé par le journal, il montre ce qui fait partie de la culture à un moment
et pour un public donnés204 ». Le Messager de Tahiti publie habituellement dans son feuilleton
202 Id. 203 Alphonse Alizart, « Excursion dans la rivière des patates-à-Durand et sur le sommet du piton Grayel, au bois de nèfles », Le Courrier de Saint-Pierre, 23 décembre 1870. 204 Lise Dumasy-Quéffélec, « Le feuilleton », Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), La Civilisation du journal : Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2011, p. 925.
211
des fictions qui seront reprises en recueil en 1881, dans La Bibliothèque franco-tahitienne du
journal Le Messager. On y trouve des contes, des récits édifiants ; mais pourquoi alors faire
paraître la « promenade » de Barion dans cet espace ? Précisons, pour mieux saisir les enjeux
du feuilleton, que quelques semaines après la publication du texte qui nous intéresse, Le
Messager de Tahiti publie en feuilleton Les Aventures de Télémaque, avec l’introduction
suivante :
Cet ouvrage, publié il y a environ cent soixante ans, est resté un modèle de la langue française. Il a été traduit dans toutes les langues Européennes. Ce qu’on en fait aujourd’hui ne peut augmenter sa réputation ; mais son illustre auteur, l’archevêque de Cambrai (archevêque français), dont la charité et les vertus ont tant honoré l’épiscopat français, se serait sans aucun doute intéressé à voir ses pensées reproduites devant la population Taïtienne205
Le fait que le texte de Barion ait eu un tel successeur, avec une telle portée,
interroge : cela ne peut pas relever uniquement d’un « remplissage » du feuilleton par les textes
disponibles. Il y a bien ici la révélation d’une culture coloniale « tahitienne », au sens où elle
est orientée vers la connaissance et la description du territoire avant tout. Le pharmacien de
marine se livre dans ce feuilleton à une description emphatique dont voici le début :
Si l’Islande a ses geysers, dont les eaux tumultueuses après s’être élevées à de très-hautes distances retombent sur elles-mêmes pour se terminer par une superbe girandole ; si le Canada a pu attirer de nombreux curieux aux bords de ses Cataractes, dont la plus merveilleuse a été tant de fois chantée et décrite sous le nom de Cataracte, ou mieux de saut de Niagara, Tahiti, cette perle jetée comme par hasard au milieu d’un vaste Océan, renferme également une curiosité, moins connue peut-être, mais digne d’exciter le plus vif intérêt des voyageurs moins avides de connaître les phénomènes actuels que d’étudier les causes qui les ont produites. Ceux qui chaque année, consacrent leurs loisirs à visiter les nombreux prodiges que la nature a semés comme autant de leçons, pour qui sait les comprendre, forment une bien petite cohorte, comparée à la masse de ceux qui, réduits par les occupations journalières, ou leur appréhension pour des courses lointaines, souvent même par leur manque de ressources, n’en sont pas moins curieux d’apprendre d’autrui, ce qu’ils ne peuvent aller voir eux-mêmes. Pour ceux-là, je mets de côté toute vaine crainte de critique littéraire, pour transmettre mes impressions, et fournir également à ceux que la fortune ou tout autre mobile décideraient à visiter notre riante oasis, un moyen de passer d’agréables instants, dans un pays où l’on se croirait à l’avance privé de toute distraction206.
Cet exorde permet de situer le texte sur plusieurs plans : géographiquement d’abord, en
plaçant Tahiti au même niveau d’émerveillement que l’Islande ou le Canada, Barion opère un
205 « Les Aventures de Télémaque », Le Messager de Tahiti, 22 juillet 1860. 206 A. Barion, « Une promenade au lac de Tahiti », Le Messager de Tahiti, 22 février 1860.
212
aplanissement du monde qui est en même temps expansion. Sur un autre plan, celui de la
réception, Barion ouvre à plusieurs catégories son texte : touristes, visiteurs futurs ou lecteurs
qui chez eux attendent que le merveilleux vienne à eux. On peut d’ailleurs penser que les
lecteurs trop occupés chez eux peuvent aussi être ceux de l’île ; certes ils ne seraient pas soumis
aux « courses lointaines » évoquées, et pourtant ils peuvent se reconnaître dans l’impossibilité
qui leur est faite d’être des touristes. Le feuilleton paraît dans leur journal : ils sont clairement
concernés par le texte, et on peut interpréter en ce sens les signes de connivence que Barion
dissémine dans son récit. Ainsi de sa mention des « jeux de la nature, que les habitants d’un
autre hémisphère sont très souvent portés à considérer comme des élucubrations d’un cerveau
malade ou inspiré, d’un poète en un mot ». La périphrase des « habitants d’un autre
hémisphère » montre ici une connivence entre l’auteur et ses lecteurs coloniaux, connivence
qui se joue autour du territoire. Le promeneur est bien ici celui qui se situe par rapport à ses
lecteurs, et par rapport à une géographie qu’il sait mondiale : homme informé, il est le vecteur
de l’information des autres. Mieux encore, dans ce court extrait la promenade trouve une
ambiguïté générique : la description va passer pour poétique, alors même que l’auteur se place
sur le plan de la stricte réalité, sans embellissement. Le promeneur qu’est Barion annonce une
hybridité générique liée au territoire. Son texte mêle ensuite vues larges sur le paysage et
digressions ethnographiques, rencontres diverses et anecdotes, jusqu’à la rencontre de la reine
Pomaré. Alternant les temps du passé et un présent de narration qui ancre le lecteur dans les
méandres de la promenade, Barion utilise différents aspects de son ethos : voyageur, poète,
homme d’importance et aventurier, pharmacien par signature, il est un témoin avant tout.
Le journal se prête particulièrement à ces descriptions qui fantasment la communication
avec le lecteur : et dans le contexte colonial, ces promenades modifient aussi l’appartenance au
territoire et sa connaissance. C’est peut-être le genre le plus représentatif de la littérature
coloniale, pour ses enjeux esthétiques et idéologiques, pour cette apparente désinvolture qui
permet d’accéder d’une nouvelle manière au territoire colonial : dans une promenade, la liberté
du narrateur apparaît comme l’un des éléments majeurs de l’écriture, puisqu’elle reflète
l’essence même de la déambulation. Ce lien entre le fond et la forme n’est pas anecdotique : il
permet de remonter, plus largement, à une forme de communication. Quand Dominique
Maingueneau préconise de « rapporter les œuvres non seulement à des idées ou à des mentalités
mais à l’apparition d’aires de communication spécifiques207 », il donne l’exemple du genre
207 Dominique Maingueneau, Le Contexte de l’œuvre littéraire. Énonciation, écrivain, société, Paris, Dunod, 1993, p. 67.
213
épistolaire lié à la vie des salons. Adapter cette remarque à la promenade coloniale semble
pouvoir être bénéfique dans notre cadre d’analyse : l’aire de communication médiatique est ici
celle de la colonie et du journal. Mais en restant dans des explorations, des excursions ou des
promenades, on ignore tout un pan de la description du monde colonial telle que la met en place
la presse : la mise en scène des découvertes faites par d’autres, par ces autres européens qui
confirment l’identité particulière des coloniaux en affichant leur rapport au territoire.
L’« Européen » est une catégorie vaste, qui porte encore la marque de l’origine des
coloniaux ; il peut se préciser en touriste, il peut aussi s’incarner dans le rapport qu’entretient
le journaliste avec le territoire. Apparaît en tout cas une portée performative du texte médiatique
colonial, plus particulièrement dans la titraille employée : en classant les descriptions du
territoire, le journal réalise l’appréhension de ce dernier pour le lectorat, et guide sa perception
de l’environnement. Contrairement à la presse locale métropolitaine, la presse locale coloniale
a pour mission de baliser ainsi la connaissance du territoire : textuellement, cela passe par le
premier indice que représente le titre, puis s’étend jusqu’au déroulement du texte.
2.3 La découverte « européenne »
La dynamique des explorations coloniales trouve un pendant qu’on pourrait en premier
lieu penser parodique : la découverte faite par les touristes, les Européens, les autres construits
très vite comme altérité alors même qu’ils viennent d’Europe. Littérairement, on serait en effet
tenté de penser ces découvertes touristiques qui paraissent dans la presse coloniale comme un
simple fonctionnement de détournement : au danger de la première exploration, au courage des
premiers habitants répondraient les fausses aventures des touristes, le confort de leur visite
rapide. Mais les textes coloniaux affichent un jeu plus complexe avec l’altérité blanche, si l’on
peut utiliser cette expression pour rendre compte d’un phénomène médiatique, littéraire et
sociologique ; et l’enjeu de ces présentations et de ces descriptions tient bien à une manière
d’affirmer la connaissance du territoire colonial.
« L’Européen qui découvre » : envisager le territoire colonial par détour208 L’arrivée d’un étranger, d’un européen, d’un touriste ou d’un nouveau colon sur le
territoire colonial est une scène habituelle dans les écrits coloniaux, et la presse n’échappe pas
208 Ce passage est issu de la version remaniée d’un chapitre d’ouvrage collectif : « Le "nouveau débarqué" dans la presse coloniale ou le renversement de la perspective exotique », Les Ailleurs de l’Europe dans la presse et le reportage littéraires (XIXe-XXe siècles), Marie-Astrid Charlier et Yvan Daniel (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016.
214
à la tentation de représenter la colonie vue par un œil nouveau. C’est une manière de faire la
publicité de la colonie, de vanter sa beauté et sa capacité d’accueil, de la situer enfin par rapport
à l’Europe et à ses habitants. Il n’est pas anodin, ainsi, que dans l’article « La Patrie » qui paraît
dans Le Bien-Public réunionnais, l’on trouve le paragraphe suivant :
L’île Bourbon est, sans contredit, la première des Colonies françaises ; la beauté de son ciel, la salubrité de son climat, la fécondité de son sol si riche, en font la perle de l’Océan indien. L’étranger qui la visite aime à s’y arrêter longtemps ; il se complait au milieu de cette nature vivace et robuste qu’il ne soupçonnait pas, et quand il la compare à ce qu’il a quitté, il arrive souvent que, pour elle, il délaisse bientôt la patrie et oublie ses promesses de retour. C’est là, du reste, l’histoire de presque tous les Européens qui viennent s’asseoir au foyer de l’hospitalité créole209.
« Étranger » ici, « Européen » dans d’autres textes ; représentatif de « l’hospitalité
créole » ici ou témoignant de l’attrait de territoires neufs : les auteurs coloniaux aiment à jouer
de cet étonnement d’un « autre » qui n’est pas si différent du colonial. Littérairement,
l’Européen décrit comme un élément étranger arrivant sur une terre qu’il ne connaît pas est un
motif médiatique fréquent qui copie le mécanisme des grands récits de voyage et se constitue
en réponse moderne à ces derniers : c’est une matrice littéraire à partir de laquelle de nombreux
journalistes coloniaux vont travailler, substituant à l’autochtone la figure du colon ou de
l’habitant. Ils gardent cependant comme deuxième terme de la rencontre la silhouette de
l’Européen : celui-ci, plutôt que de « découvrir » un autochtone, va au XIXe siècle se trouver
face à un colonial. Le point de vue de l’Européen qui inaugure les textes descriptifs permet
alors de rejouer le récit de voyage dans une perspective adaptée au contexte colonial, et d’après
les traces d’un corpus médiatique en partie disparu, cette manière d’ordonner le texte colonial
est plutôt courante. Le lecteur actuel est ainsi frappé par des ressemblances imprévues, par
exemple celle qui réunit deux textes intitulés « coups d’œil » : l’un est issu de l’Écho de l’Atlas
et date de 1846 ; l’autre des Antilles de 1863, et dans les deux on trouve une syntaxe semblable.
Outre leurs titres respectifs, ils ont en effet leurs premières lignes en commun : « l’Européen
qui se trouve subitement transporté, par les hasards de sa destinée, sur le sol de la Martinique,
subit tous les genres d’étonnement210 » ou « L’Européen qui, pour la première fois, quitte la
ville d’Alger pour venir visiter Blidah, éprouve un sentiment de vive admiration lorsque, arrivé
sur le versant méridional du Massif, il découvre tout-à-coup la plaine de la Mitidja211 ». Ces
ressemblances nous renseignent sur les possibilités du discours ; et, plutôt que de les considérer
209 X., « La Patrie », Le Bien-Public, 31 juillet 1856. 210 « Coup d’œil sur la Martinique par un Européen », Les Antilles, 26 août 1863. 211 « Coup d’œil général sur la plaine », L’Écho de l’Atlas, 24 avril 1846.
215
comme des occurrences isolées, il vaut bien mieux les voir comme les vestiges d’un discours
généralisé, à une échelle locale qui est celle de la presse. Preuve en est que, dans une légère
variation, l’Akhbar fait paraître en 1859 un texte commençant ainsi : « Rien n'égale la surprise
d'un Européen, lorsqu'au détour d'une des rues sombres, étroites et tortueuses de la haute ville,
il se trouve pour la première fois face à face avec une Mauresque212 ». Au tournant du siècle, la
formule de l’Européen à la découverte du monde est donc un attendu médiatique : c’est un seuil
facilement utilisable pour aborder l’Ailleurs colonial, et une focalisation qui permet de jouer
avec les attendus et les naïvetés d’un étranger. Dans le cas de l’Écho de l’Atlas, il faut faire
connaître le territoire algérien aux lecteurs installés en 1846 encore sur la côte, et leur désigner
Bouffarik, à la réputation encore mauvaise, comme l’exemple d’une colonisation réussie et
apaisée. L’Européen, dans ce texte, s’identifie alors plus ou moins au lecteur colonial installé à
Alger. Dans l’Akhbar, le but visé est la description orientalisante des « types algériens » dont
raffolent les journaux dans les premières décennies de la colonisation : mais, puisque le journal
sort en 1859, l’« Européen » est alors déjà synonyme de touriste en quête de pittoresque, et se
détache de la population coloniale européenne. L’identification est bien alors le ressort de ces
textes, et c’est sur la figure de l’Européen qu’elle se cristallise. Dans l’article des Antilles,
l’auteur dénonce la méconnaissance des colonies en métropole, et le dispositif énonciatif est
plus intéressant encore que ce qui a pu apparaître dans les périodiques algériens :
L’Européen qui se trouve subitement transporté, par les hasards de sa destinée, sur le sol de la Martinique, subit tous les genres d’étonnement. Il s’attendait à trouver un rocher brûlant sous les ardeurs du soleil tropical ; […] des habitants tels qu’on nous les a dépeints, indolents, illettrés, farouches, cruels, ayant hérité de tous les vices des aventuriers qui vinrent se ruer sur les Indes occidentales […] puis une population noire, esclave malgré l’émancipation, malmenée, conspuée, parquée, demi-nue, misérable au point de justifier la locution proverbiale en Europe – malheureux comme un nègre. Cependant, et celui qui tient cette plume a hâte de le dire, cette prévention défavorable ne tarde pas à s’effacer. Même avant de mettre le pied sur le sol de l’île, il avait entrevu cette prodigieuse végétation qui recouvre les rochers les plus abrupts de ses côtes […]. Et qu’on ne dise pas que j’exagère : j’en appelle à tous les Européens que des relations antérieures ne liaient pas à la colonie213.
Le glissement de l’énonciation est particulièrement révélateur ici d’un bouillonnement
des discours au sein d’un même article : l’adoption d’un moule narratif à la troisième personne
semble être une étape obligée avant le retour au récit et à une subjectivité affichée. Le lecteur
colonial antillais, dans ce texte, trouve ce qui flatte la représentation qu’il se fait de lui-
212 « Mauresques », L’Akhbar, 22 novembre 1859. 213 « Coup d’œil sur la Martinique par un Européen », Les Antilles, 26 août 1863. Nous soulignons.
216
même : idéologiquement, cela lui confirme son identité à part. Ce jeu entre éloignement et
rapprochement caractérise encore mieux les colonies très éloignées de la métropole : l’auteur
de la « chronique néo-calédonienne » qui paraît le 20 juillet 1862 dans Le Moniteur de la
Nouvelle-Calédonie adopte lui aussi ce glissement, passant de la troisième personne à l’adresse,
avec des particularités propres à son territoire. Le lecteur trouve ainsi un « voyageur » plutôt
qu’un « Européen » parce que les colons ne sont encore que militaires et non civils, ce qui
change la définition en creux de l’opposé. Dans une Nouvelle-Calédonie alors largement
militaire, logiquement, cette syntaxe de la découverte est introduite par des nouvelles liées à
l’armée :
Nous venons de recevoir des nouvelles excellentes du poste militaire de Napoléonville et nous voulons consacrer quelques lignes à cette succursale de la Colonie calédonienne. Le voyageur qui arrive à Port-de-France et qui, parvenu au terme de sa longue et périlleuse excursion, s’arrête un instant sur le sommet du mont de l’Impératrice, ne peut détacher ses regards du panorama splendide qui se déroule à ses yeux. […] Descendez ensuite la colline, adressez un bienveillant sourire à tous ces travailleurs militaires214.
La définition de l’habitant se fait donc par rapport à cet étranger dont l’identité reste
modulable en partie, Européen dans le cas des colonies peuplées, voyageur dans le cas d’une
colonie récente et qui n’affiche pas encore une population coloniale conséquente. Cette
interprétation de l’emploi du terme « voyageur » peut souffrir cependant quelques
aménagements, puisque, par exemple, on trouve aussi dans un article intitulé « Sidi Aïssa », le
début suivant : « Le voyageur qui part d’Aumale215, allant à Bouçaada (sic), suit la route
nouvellement tracée par le génie militaire216 ». Quel est alors le voyageur « utilisé » ici dans la
narration ? Projection de l’auteur, qui a écrit pour La Revue africaine, le voyageur annonce
aussi ici la venue du touriste : c’est cette vision touristique, attentive, qui peut expliquer la
description. Et l’explication est d’autant plus séduisante que la description du paysage constitue
en fait une introduction à la « Tradition orale sur la vie de Sidi Aïssa ben Mo’hammed », comme
il est précisé en sous-titre : la description par le biais d’un « voyageur » permet d’immerger le
lecteur de La Revue africaine dans un environnement exotique.
En outre, comme on peut le voir dans la reproduction suivante du texte, le texte du
voyageur appartient à la rubrique des variétés. Les deux notes de bas de page le situent à la fois
214 Félix H. Béraud, « Chronique néo-calédonienne », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 20 juillet 1862. 215 Aujourd’hui Sour El Ghozlane. 216 Mercier (Revue africaine), « Sidi Aïssa », Le Moniteur de l’Algérie, 7 avril 1864. Le texte original est paru dans La Revue africaine en 1863. L’auteur, E. Mercier (1840-1907), deviendra maire de Constantine et en serait alors à l’une de ses premières publications.
217
comme un savant suffisamment versé en botanique pour préciser l’équivalent du driss arabe
dans la classification de Linné, comme un homme capable aussi de parler et lire l’arabe – même
si la deuxième note est étonnamment accompagnée d’un point d’interrogation, ce qui amène à
reconsidérer l’image de l’auteur produite dans le texte.
Ces quelques exemples, traces d’un corpus plus vaste, montrent dans un premier temps
comment s’opère une forme de substitution d’un étranger à un autre, et d’un autochtone à un
autre : le colonisateur prend la place du colonisé, substitue à son ancien statut d’étranger celui
d’habitant, et peut donc définir l’Européen, son ancien semblable, comme un nouvel étranger.
Défini par son origine géographique, l’Européen désigne, en fait, le Français, et on peut
s’interroger sur la raison pour laquelle les journalistes coloniaux font ce détour terminologique.
Cette restriction poserait sans doute une confrontation trop nette avec la « mère-patrie », et
mettrait à mal l’exercice d’équilibriste qui consiste à créer une identité de Français des colonies.
En faisant appel à l’« Européen », c’est bien la géographie, et non l’appartenance nationale, qui
est soulignée : cet Européen représente aussi, plus largement, la possibilité d’un regard
touristique ; il gomme les éventuelles distinctions entre voyageurs et pose l’horizon d’un monde
vaste qui se repère à ses continents et non à ses nations, entrant en résonance avec la constitution
d’une première mondialisation. Littérairement, il serait enfin une forme de juste milieu entre
218
les premiers récits de voyage et ceux que les romantiques inventent217 : l’Ailleurs décrit par les
coloniaux eux-mêmes prendrait donc comme moyen terme cette figure de l’Européen.
Le touriste, avatar de l’Européen Le colon face au touriste anglais : le face à face que Le Chitann met en scène en 1866
dans l’une de ses illustrations est caractéristique d’une autre opposition habituelle dans les
colonies. Le touriste n’est pas réductible au voyageur, à l’étranger, à l’Européen : il est plus
précis que cela, et son emploi correspond à d’autres stéréotypes218. La légende précise le
dialogue entre les deux personnages : « Mossé le colon, quelles été les prodouctions du sol en
Algérie ? – Nombreuses, Mylord : la garance est ici chez elle, la graine d’épinards s’y
développe, le tabac et l’absinthe s’y voient partout, mais ce qui pousse le mieux c’est la carotte,
elle y croît spontanément et sans culture219 ! »
On a évoqué dans la première partie les quelques signatures de « touristes » qui
apparaissent dans les années 1840 et leur aspect littéraire : il est temps maintenant de revenir
217 Voir l’article de Roland Le Huenen, « Le Récit de voyage : l’entrée en littérature », Études littéraires, vol.20, n° 1, 1987, p. 25-61. Il y résume ce passage entre les premiers récits de voyage, tendant à l’objectivité, et les récits de voyage romantiques, qui mettent en avant la personnalité de l’écrivain voyageur. 218 On peut consulter, sur le tourisme en Algérie, l’ouvrage récent de Colette Zytnicki, L’Algérie, terre de tourisme, Paris, Vendémiaire, 2016. Une recension qui en a été faite a choisi un titre intéressant dans notre perspective : Ewa Tartakowsky, « Le touriste, un ʺcolon en puissanceʺ ? », La Vie des idées, 25 mai 2017. URL : http://www.laviedesidees.fr/Le-touriste-un-colon-en-puissance.html. Consulté le 25 mai 2017. 219 « Colons et touristes », Le Chitann, 16 décembre 1866.
219
sur ces signatures et d’analyser l’éthos qui s’y attache. En opérant ainsi un lien entre l’auteur et
le texte, ce sont aussi les attentes du lecteur que l’on met au jour. Il est quelques articles
originaux qui utilisent la figure du touriste : ainsi d’un texte de circonstances, écrit par Adrien
Berbrugger à l’occasion d’une publication de la correspondance d’Henry Murger, en 1862.
L’auteur des Scènes de la vie de Bohème220 est en effet passé en Algérie, et certaines de ses
lettres en rendent compte : d’où une critique particulière de la part de Berbrugger, qui tourne
autour de l’image du voyageur – pour lequel il se montre indulgent. Dans les premières lignes,
Berbrugger mentionne les registres d’arrivées dans lesquels se trouve le nom de Murger ; et par
cette introduction même, il se place en colonial : notre première partie a déjà évoqué la place
fondamentale du bateau dans la vie coloniale. Le texte développe ensuite une description
plaisante du voyage de Murger en Algérie : cafés, excursions, etc., avant d’évoluer vers une
critique plus générale de la perception de la nouveauté par les Européens, touristes ou non.
Murger, en effet, est excusable car ses erreurs de touristes sont celles des premiers
colonisateurs.
De fait, il ne voyait le Désert qu’avec les yeux de l’imagination, car il en était encore assez loin. Mais n’est-ce pas chose convenue parmi les touristes que le Désert commence à l’endroit où ils cessent de marcher vers le Sud ? La première terre que nous ayons foulée ici, la presqu’île de Sidi Ferruch, n’est-elle pas qualifiée de Sahara, dans les relations de la conquête de 1830221 ?
Mais le texte permet aussi une description de l’Algérie comme terre exotique : elle
soumet le voyageur, quel qu’il soit, à un « état d’éblouissement physique et de trouble moral
où vous jette le passage subit de la régulière ordonnance d’Europe, au pêle-mêle et au tohu bohu
de la promiscuité algérienne222 ». Berbrugger construit donc son texte en faisant du touriste un
Européen comme un autre : par ses références générales, le touriste n’est pas un type totalement
à part. Mais cette indulgence première est cependant nuancée quand une dernière partie clôt le
texte avec légèreté, réutilisant les lieux communs de la critique du touriste par le
colonial : rapidité et hâte à décrire ou juger. Le touriste est un personnage que l’on retrouvera
surtout dans la presse algérienne : la proximité avec la métropole permet de rendre crédible et
d’exploiter au mieux ce ressort des narrations coloniales. Car Henry Murger, justement est ainsi
décrit comme un « touriste judicieux » plutôt qu’un « simple trottmann ». Adrien Berbrugger
ajoute même, après avoir chanté les louanges de l’auteur : « Nous l’aimons et l’estimons bien
davantage, depuis que nous avons la certitude qu’il a passé près d’une quinzaine de jours en
220 Henry Murger, Scènes de la vie de Bohème, Paris, Lévy, 1851. 221 Adrien Berbrugger, « Henri Murger en Algérie », L’Akhbar, 20 juin 1862. 222 Id.
220
Algérie, sans enfanter le plus petit système de gouvernement et de colonisation223 ». Ainsi se
conclut l’évocation de l’auteur touriste. Mais ce stéréotype du touriste qui produit un système
de colonisation après quelques jours se retrouve dans d’autres textes et apparaît plus
ancien : dans le type du « nouveau débarqué » que nous avons cité, la figure du touriste apparaît,
et c’est bien alors un stéréotype inspiré par la littérature panoramique qui se fait jour.
Pénétré de l’importance de ses investigations et de la profondeur de ses vues, notre touriste désintéressé se hâte d’en composer une relation qu’il enverra à ses amis pour la faire insérer dans le journal du lieu ; mais par bonheur pour son lecteur et par suite d’une bizarrerie naturelle à tous les nouveaux débarqués, il n’a pas confié sa lettre à la poste, c’est trop simple, elle parviendrait ; il a, dit-il, profité d’une occasion sûre et prochaine ; c’est dire qu’elle n’arrivera jamais224.
Le touriste n’est pas seulement l’occasion d’utiliser un stéréotype ; il a d’autres utilités.
La critique du touriste donne aux auteurs de la presse algérienne l’occasion de se décrire, par
un effet de miroir, en véritables connaisseurs du territoire autant que de la population : sans
accumuler les exemples, certains textes se révèlent particulièrement explicites sur ce point.
Ainsi de la critique que fait Henri Feuilleret du récit de voyage de l’abbé Poiret en 1846 :
Les voyageurs, quand ils vont en Afrique, s’embarquent ordinairement sous le poids de deux préventions qui ne tardent pas à se dissiper ici. La première est que la nature d’Afrique doit être aride et stérile tout à la fois ; la deuxième que les Arabes y sont toujours les Arabes des Mille et une Nuits : sanguinaires parfois, toujours beaux et poétiques. Le soleil d’Afrique a bientôt dissipé ces deux illusions, comme il fait des premières vapeurs du jour ; la nature paraît à nos touristes moins mesquine qu’ils ne le supposaient, et les indigènes un peu plus déguenillés qu’ils ne se l’imaginaient225.
Après cette introduction générale, le professeur d’histoire peut se livrer à la critique de
l’ouvrage qui l’intéresse – quoique cet ouvrage soit ancien, puisque publié en 1789. Que la
mention du comportement touristique serve d’introduction à un exercice de critique montre bien
que le touriste est un vecteur, un moyen, une possibilité offerte aux collaborateurs locaux de la
presse. C’est que le touriste permet de décrire rapidement ce qui fait l’intérêt du pays ; il est un
véritable embrayeur de description, comme on le voit dans cet extrait de 1866 du Moniteur de
l’Algérie :
À mesure que le vieil Alger s’efface, l’Alger nouveau apparaît. Le panorama offert au touriste, à l’émigrant ou au visiteur par la silhouette étincelante de notre capitale, n’est déjà plus ce monstrueux entassement de maisons blanches, escaladant les pentes raides de la Casbah, et
223 Id. 224 R. de B. [Roland de Bussy], « Type. – Un nouveau débarqué », Le Moniteur algérien, 4 juillet 1840. 225 H.F. [Henri Feuilleret], « Étude sur les voyageurs en Algérie », Le Moniteur algérien, 21 janvier 1846.
221
offrant au regard l’aspect désolé d’une carrière de gypse en exploitation, vaste, nue, béante, de teinte uniforme226 !
Touriste, émigrant, visiteur : ces trois catégories qui présupposent un regard nouveau
sur la ville sont là encore un moyen pour exprimer une prise de position sur l’aspect de la ville.
Ces descriptions peuvent également s’accommoder d’un récit à la première personne, qui
transforme le touriste en aventurier. Dans les années 1840, l’Algérie est véritablement donnée
aux lecteurs de la presse locale comme une terre de tourisme, y compris par le biais de récits de
voyage :
L’heure du départ avait sonné ; le panache blanc du Ténare s’élevait bruyamment au-dessus des bâtiments de la rade ; déjà les embarcations du port se pressaient autour de sa coque noire et luisante, il fallait quitter Alger, ses belles maisons, ses rues encombrées à toute heure d’un peuple de colons, travailleurs et industriels, qui se ruent sans cesse, du débarcadère aux villes et villages de l’intérieur. […]
Quelques instants après mon arrivée à bord on appareilla : le vent était à l’ouest, la mer assez belle ; on voulait arriver à Cherchell avant le jour. La machine fut mise en mouvement et trois quarts d’heure après, nous avions laissé bien loin derrière nous le môle et les énormes blocs qui le couvrent, le fanal, sa tour et cette multitude de jolies maisons qui ornent la Boudjaréah et qui, à cette heure de la nuit, disparaissaient blanches et détachées sur un fond noir comme les villas de Naples ou de Sorrento, alors qu’on part d’Italie par une belle nuit d’été227.
Cette « Excursion sur la côte ouest » réunit même plusieurs des critères que nous avons
cités jusqu’ici : « excursion » au sens propre, elle met en scène un auteur anonyme dont la
signature seule ne sert qu’à renforcer la situation du texte et sa définition par rapport au contexte
colonial ; le lecteur passe le seuil du récit par la mention de la traversée ; on y retrouve enfin ce
mélange d’information et de description qui montre la polyvalence du touriste. L’aspect
idéologique de cet extrait est suffisamment visible pour qu’on ne s’y attarde pas : les colons
« travailleurs et industriels » signalent assez dans quel but le « touriste » se livre à une
description précise et marquée par le souvenir de son passage dans la ville d’Alger. La mention
enfin de la ressemblance avec l’Italie ancre le texte dans une intertextualité stendhalienne qui
est alors récente ; le territoire colonisé ainsi décrit gagne en légitimité, en beauté, en poids
esthétique. Ressortent aussi de ce texte deux types de description : l’une, pour Alger, marquée
par le souvenir – les « belles maisons » et les « rues encombrées » relèvent d’une image figée
de la ville, non d’une observation faite depuis le bateau – ; l’autre, pour Cherchell, est certes
liée à la vue qu’offre le navire, mais se joue aussi sur le plan d’un imaginaire méditerranéen
général. Dans les deux cas cependant, c’est un projet politique qui peut se lire : Alger, ville
226 Augustin Marquand, « Alger Nouveau », Le Moniteur de l’Algérie, 18 mars 1866. 227 Un autre touriste, « Excursion sur la côte ouest », Le Moniteur algérien, 10 mars 1844.
222
industrieuse, et Cherchell, ville calme, semblable à l’Italie des voyageurs romantiques,
permettent de dresser le portrait d’une colonisation en bonne marche. Le touriste en effet, quand
il écrit à la première personne et revendique son identité de visiteur, se révèle une véritable
arme médiatique. En ce sens, ce récit touristique se rapproche fortement d’un autre récit, publié
un an auparavant dans le même périodique, et qui fait aussi du touriste le narrateur à la première
personne :
En mettant le pied sur la terre d’Afrique, je comprenais parfaitement que le nœud de la question n’était pas dans les villes de la côte ou dans leur banlieue […] ; j’étais décidé à ne pas faire comme certains Touristes qui, après avoir vu du haut de la Casbah, avec une lorgnette, les villes du Sahel, et ramassé quelques observations critiques sur l’administration municipale des établissements de la côte, s’en retournent à Paris déconcerter, abuser ou affliger les citoyens sincères, en leur portant les assertions tranchées que je viens de rappeler plus haut228.
Le bon touriste est celui qui porte une parole de vérité, un témoignage ; et il ressort bien
de cet extrait un stéréotype latent, présent depuis les années 1840 en effet, mais qui va se
développer jusqu’à donner naissance au Tartarin d’Alphonse Daudet en 1872229. Avant même
que la colonisation française en Algérie ne soit bien installée, le touriste représente un lieu
commun sur lequel auteur et lecteur doivent s’entendre. Pour dernière preuve, cet extrait d’un
article, constitué de deux lettres portant sur Abd el-Kader ; après la signature de la deuxième
lettre, les guillemets se ferment et l’auteur premier reprend la parole : « J’avoue qu’après avoir
lu ces deux lettres, je taxai mon touriste d’exagération ; je crus que son imagination
impressionnable avait à ses yeux grandi ce chef musulman et poétisé la tribu arabe230 ».
Touriste, donc, se retrouve ici avec le déterminant possessif hypocoristique que l’on a pu
observer dans le « type » de 1840 ou dans la critique littéraire de 1846, léger indice d’une
véritable connivence avec le lecteur autour de cette figure. Mais, malgré cette tournure qui
semble annoncer que le « touriste » a tort et s’est laissé jouer par son imagination, le texte se
conclut par un retournement : le touriste a bien eu raison, et il n’y a eu ni poétisation ni
exagération de sa part. Considérons que le touriste algérien est à part ; d’autres « touristes »
apparaissent sur d’autres territoires coloniaux. Ainsi du « grandfonnier » qui écrit dans
L’Avenir guadeloupéen et se sert lui aussi du touriste comme personnage pour démontrer une
théorie sur le territoire colonial. Après avoir récriminé contre l’état des routes et la production
de café qui serait transférée sur l’île de Nossibé, le narrateur met en place l’anecdote suivante,
228 « Excursion d’un touriste dans la province d’Oran », Le Moniteur algérien, 25 novembre 1843. 229 Alphonse Daudet, Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, Paris, Dentu, 1872. 230 Le Moniteur algérien, 5 février 1844.
223
pour montrer « ce que bien des personnes pensent de la canne et de ce qu’elle rapporte dans
notre pays » :
Ces jours passés un jeune Parisien qui possède cinquante mille francs de rente sur l’état et qui est venu se promener ici en touriste, disait : votre pays est magnifique, le climat me plaît, j’y achèterais volontiers une belle sucrerie si elle devait me rapporter quelque chose, mais ici la propriété ruine le propriétaire.
Qui donc vous a dit cela, lui demanda l’un de nous ? Mais ce sont vos journaux, répondit le Parisien. Leurs colonnes sont remplies de ces mots : vente par autorité de
justice, vente judiciaire, vente sur folle-enchère, et presque toujours ce sont des sucreries que l’on vend ; si elles rapportaient un produit net, elles ne seraient pas si souvent saisies et vendues à la barre du tribunal. Le sacristain qui était là, il est toujours là le sacristain, commença par mettre ses lunettes bleues, et fixa le Parisien231.
Suit alors le discours du sacristain qui explique pourquoi les habitations sont vendues,
principalement à cause de l’impéritie des propriétaires ; mais le discours est en quelque sorte
désamorcé par la conclusion que le Grandfonnier donne à l’anecdote : « Le Parisien, paraît-il,
n’a pas été converti par le sacristain, car il est parti par le dernier packet sans avoir fait la
moindre acquisition à la Guadeloupe232 ». Ici le touriste est avant tout Parisien : cette
considération enrichit un peu son portrait, mais il conserve surtout son utilité narrative. Naïf,
facilement trompé sur le territoire colonial qu’il visite, prompt aux jugements, le touriste, qu’il
soit à la première personne ou non, acteur ou agent de la description, visiteur de l’Algérie ou
des Antilles, apparaît en fait dans la littérature médiatique comme un embrayeur d’exotisme,
un élément qui va de pair avec le colonial et amorce déjà cette opposition entre littérature
coloniale et littérature exotique, vision naïve du territoire et perception modelée par une
connaissance que l’on met en avant. À la fin de notre période, un texte montre même quelle
utilité le touriste peut avoir comme axe de réflexion et point de connivence textuelle :
Un touriste, en Nouvelle-Calédonie, ne serait pas embarrassé pour noircir ses tablettes ; un peintre remplirait sans peine les pages de ses albums ; il trouverait en maints endroits ce caractère imposant et sauvage que les roches impriment aux sites montagneux ; ces oppositions de teintes qui animent le paysage, ces anfractuosités sombres et ces fouillis impénétrables qui font mieux ressortir les parties éclairées, mais s’il aime à varier ses sujets, il lui faudra souvent abandonner les gorges resserrées et les vallées étroites, les ruisseaux encaissés et leurs tumultueuses cascades et transporter son point de vue sur les flancs ou sur les hauteurs des montagnes233.
231 « Lettres d’un grandfonnier », L’Avenir, 12 juillet 1867. 232 Id. 233 F. Ratte, « Sentiers canaques. De Gomen à la côte Est (Nord de la Nouvelle-Calédonie) », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 13 novembre 1878.
224
Le touriste devient ici l’équivalent du peintre : avatar moderne de l’observateur et
contrepoint de l’artiste, il a pour fonction de permettre une description précise et subjective du
paysage. Il n’est pas forcément la cible du texte colonial, et peut aussi s’en révéler un
moyen : par sa labilité, le « touriste » se montre donc bien comme un élément nécessaire du
monde colonial, mais un élément dont la place varie, dont l’utilité se plie aux exigences de la
description. Silhouette ridicule pour les textes qui ont besoin d’affirmer la connaissance
coloniale du territoire, le touriste peut également signaler la valeur de ce territoire, comme le
montre ce dernier extrait, pris dans la presse réunionnaise et qui affirme clairement sa mission
de publicité :
Je finis en vous engageant, chères lectrices et chers lecteurs, à aller au Morne-Vert ; les malades et les convalescents y trouveront une température propice, les biens portants se réjouiront en contemplant les innombrables variétés de sites, les vrais chrétiens iront en pèlerinage demander quelques consolations à cette Vierge qui leur tend si gracieusement le scapulaire. Allez, allez tous à ce pays de résurrection et alors l’édilité de la commune se fera un devoir de faire une route facile aux voitures afin de vous rendre le voyage plus agréable et procurer aux visiteurs les jouissances de ce nouvel Eden que le grand artiste a enrichi de ses plus belles parures234.
Pas de mention d’un touriste dans cet extrait : c’est dans la signature qu’il faut aller le
chercher. L’auteur a auparavant décrit le paysage, interpellé son lecteur en utilisant la deuxième
personne : sa signature de « touriste » vaut ici pour ce qu’elle promet d’une expérience partagée
sur le territoire d’une île devenue, en effet, lieu de tourisme.
D’autres découvertes : un journalisme de l’enthousiasme ?
« Impressions de voyage ! – Comme nous sommes loin du temps où ces choses-là
étaient à la mode, où M. Alexandre Dumas s’impressionnait en Suisse, et découvrait la
Méditerranée235 ! » : le journaliste qui raisonne ainsi dans La Seybouse du 17 juillet 1869 rend
compte d’un changement dans l’écriture du voyage qui est d’autant plus intéressant que son
article commençait par une adresse au directeur (« C’est bien le moins, mon cher directeur, que
j’écrive à votre intention quelques impressions de mon voyage »). La question se pose en effet
du rapport que le collaborateur entretient avec le territoire qu’il décrit, et de la filiation littéraire
dans laquelle il inscrit son texte : va-t-il donner à lire une description d’expert, marquée par la
connaissance et l’explication, ou un texte fondé sur le sentiment de la beauté du territoire
234 Un touriste, « Le Morne vert », Les Antilles, 13 mars 1872. 235 Olivier, « Voyage à Alger », La Seybouse, 17 juillet 1869. L’auteur est un collaborateur régulier du journal ; il s’en dit « rédacteur en chef nominal » dans le numéro du 19 mars 1870.
225
colonial ? Plus le siècle avance, plus se font rares les occasions de lire une description
enthousiaste d’un territoire, d’une cérémonie, d’un paysage colonial : faire rentrer le territoire
colonial dans le cadre de la banalité rassurante fait partie des attributions du journal colonial, et
cela explique la mise en valeur de cette forme d’habitude que l’on trouve dans les périodiques.
Pourtant quelques descriptions se font encore enthousiastes et jouent, pour les lecteurs, sur le
ressort de la découverte. Dans ce jeu de mise à distance et d’autoportrait que le touriste ou
l’Européen permettent de mettre en place parce qu’ils sont, eux, des figures exotiques, un article
aussi banal que le compte-rendu d’une fête officielle peut devenir une source intéressante : ainsi
d’un article du Messager de Tahiti, non signé, qui en 1854 rend compte de l’inauguration par
le Commissaire impérial d’une « nouvelle maison construite par le vieux chef Tati236 ». Le ton
adopté est celui qu’on attend d’un texte officiel, neutre et bref : « La fête a été des plus
brillantes », annonce ainsi le journaliste, avant de préciser que « les étrangers qui y assistaient
ont été surtout frappés de la cérémonie antique de la présentation des pupérus. Les chants
nationaux et les danses de caractère ne les ont pas moins impressionnés237 ». L’étonnement est
donc du côté des visiteurs, et il n’y a rien d’exceptionnel à cela. Mais le texte prend ensuite une
autre direction, et après avoir mentionné la manière dont le Commissaire demande aux
Tahitiens « d’ôter à la joie bruyante des habitants tout ce qui aurait pu effaroucher des yeux ou
des oreilles façonnés aux plaisirs délicats de l’Europe238 », l’auteur développe une description
poétisante de la cérémonie :
C’était étrange, c’était éclatant de couleurs, de vivacité, d’animation ; le ciel, un instant obscurci et pluvieux, était devenu radieux et répandait sur toute la scène de lumineux reflets ; la verdure étincelait ; les vagues azurées, l’écume éblouissante des récifs, le grondement de la mer, les senteurs de la terre, le feuillage rafraîchi, la variété des costumes et des langues, tout contribuait à donner à cette fête un cachet de féerie. L’ordre le plus parfait a régné depuis l’instant où la santé de l’Empereur a été portée jusqu’à l’heure où le clairon a sonné la retraite pour tous les habitants239.
Le point de vue enthousiaste de l’auteur, qui le conduit à quitter le ton officiel pour
développer une syntaxe et un lexique plus souples, tend à montrer que l’étonnement des
voyageurs est contagieux. Et le passage est rapide, puisque l’on en revient ensuite à la précision
officielle : ordre, clairon, retraite. Mais entre les lignes se lit une attirance pour le spectacle vu,
et une manière d’en rendre compte qui dépasse le cadre idéologique de la colonie : on n’est pas
236 Le Messager de Tahiti, 28 mai 1854. 237 Id. 238 Id. 239 Id.
226
ici dans la description ethnographique d’une cérémonie maîtrisée par les colonisateurs, mais
dans une « féerie » qui suspend un instant le jugement axiologique pour mettre en avant le
caractère esthétique de la fête. Les êtres disparaissent au profit du paysage : l’enthousiasme
écrit se décale et ne porte que sur la scène, et non sur la population. La « joie bruyante »,
négative et soupçonnée de grossièreté, disparaît pendant quelques lignes. D’autres textes
expriment le saisissement produit par le territoire exotique :
Nous gravîmes ensuite les pentes du Piton des Sables, après avoir contourné la Rivière des Remparts, marchant sur des laves rougies par le feu et mêlées de sables de la même couleur. Toute trace de végétation avait presque disparu et les ambavilles que nous avions vus sur les autres pitons s’élever au-dessus de nos têtes, ne poussaient plus çà et là, entre les fissures de la lave, que des rejetons rares et semblables à des touffes d’herbe. Arrivés sur le Piton Fémozac, nous pûmes apercevoir la Rivière des Remparts et le Nez-de-bœuf, rocher ainsi appelé à cause de son aspect singulier : « Voici, me dit mon guide, l’endroit où M. X*** que je conduisais au Volcan, se jeta à genoux en joignant les mains ». Le spectacle que nous avions sous les yeux était sublime en effet. La rivière était bordée de deux remparts à pic, gouffre béant d’une largeur et d’une profondeur immense d’où sortaient comme la fumée d’une fournaise, des brouillards que le vent emportait aussitôt240.
L’ethnographie en germe ici laisse une place au territoire comme toile de fond, certes,
mais toile de fond splendide, prédominante même par rapport aux populations qui devraient
être au centre des descriptions. L’on retrouve ce même glissement dans Le Moniteur
algérien : avant même la reddition d’Abd el-Kader, la décennie 1840 voit paraître la chronique
d’un « Algérien », écrite pour un Parisien sous la forme épistolaire. De manière caractéristique,
cette chronique commence par décrire un territoire fascinant : « Je vous parlerai souvent du ciel
et de la mer, du climat si doux et des magnifiques horizons d’Alger. Je ne me lasserai pas plus
de louer ces beautés naturelles, que je ne me lasse de les admirer241 ». Quelque dix-neuf années
plus tard, le ton des chroniqueurs algériens n’a pas changé outre-mesure : l’on y trouve toujours
cette capacité à insister sur le paysage et sa description pour rendre compte d’une particularité
de la colonisation ; le propos est seulement devenu plus culturel, faisant porter l’admiration
autant sur les beautés naturelles que sur le spectacle des courses, et explicitant aussi l’habitude
que la colonisation a produite chez les coloniaux :
L’accoutumance ainsi nous rend tout familier. Mais qu’on se figure un correspondant étranger, quelque chroniqueur d’Epsom ou de Chantilly, transporté tout à coup dans la plaine de Mustapha ; quelle surprise et quel enthousiasme ! un panorama splendide, sans égal peut-être au monde, un ciel d’azur et de lumière ; à droite, au premier plan, les coquettes collines du Sahel encore semées malgré le soleil, de noirs
240 « Relation de voyage », Le Courrier de Saint-Pierre, 31 octobre 1867. 241 Un Algérien, « Lettres d’Alger et de Paris », Le Moniteur algérien, 25 octobre 1842.
227
massifs, d’où se détachent de blanches maisons ; plus loin, la Mitidja, bordée à l’horizon par les cimes majestueuses de l’Atlas ; à gauche, les tentes du camp vagabond, et la ville appuyée au flanc du coteau, baignant ses pieds dans son port, peuplé de mâts et de carènes ; en face, l’immensité, la mer dessinant nettement sa ligne bleue, au-delà de laquelle on sent la France ; voilà le cadre. – Et dans la plaine, au pied de longues tribunes pavoisées de mille drapeaux, la foule des cavaliers français ou arabes, les uns manœuvrant avec la régularité et la précision de la discipline européenne, les autres livrés à toute leur fougue désordonnée, s’élançant par groupes, par masses, enivrés de cris, de mouvement, de poudre, soulevant des nuages de poussière, à travers lesquels passent rapides comme l’éclair les manteaux blancs ou rouges, les bannières bariolées. Voilà le tableau. Et ce spectacle vivant, étourdissant, qui finit par donner le vertige et faire partager aux spectateurs l’ivresse des spectateurs, cela s’appelle les Courses d’Alger242 !
Cette tendance à associer finalement le territoire à une manifestation culturelle s’observe
donc sur plusieurs territoires, malgré des représentations différentes des populations décrites.
Le point commun réside dans la capacité à donner au paysage une force également marquante
à celle du peuple. Et on aurait tort de croire que ces types de description ne peuvent se trouver
que dans des textes en prose : la poésie peut aussi révéler ces émerveillements coloniaux. On a
déjà cité le poème suivant, écrit par un certain Celtibère et publié dans Le Messager de
Tahiti ; mais ici, il vaut pour la manière dont il met en place, lui aussi, une description
dynamique et émerveillée.
Maintenant à loisir foulant son doux gazon, Je tourne mes regards vers sa rade admirable Que des bancs de coraux, barrière inébranlable Défendent longuement des flots tumultueux. Vainement souffleraient des vents impétueux, Dans ces ondes mouillé, sur son ancre immobile Le nocher peut dormir dorénavant tranquille. […] Contemplons Taïti, sa plage et ses coteaux, Ses vallons odorants, ses rapides ruisseaux Qui charmant à l’envi ces lieux de leur murmure, Y maintiennent sans cesse une fraîche verdure, Que d’arbres inconnus, que de nouvelles fleurs, Quels parfums étrangers, quels fruits, quelles couleurs ! Ici s’offre à ma main la banane sucrée, Là, du mol hibiscus la corolle pourprée. La noix du cocotier parmi de longs rameaux, Sur les bords de la mer, s’incline vers les eaux. Je cueille la goyave à la chair rougissante, Tout près, de l’arbre à pain la pomme nourrissante : L’indigène naïf l’appelle maïoré243.
242 « Chronique », Le Moniteur de l’Algérie, 15 octobre 1861. 243 Celtibère, auteur des Poésies religieuses, « Voyage autour du monde. Taiti », Le Messager de Tahiti, 28 janvier 1855.
228
Le regard de celui qui découvre est offert ici sans médiatisation narrative : la forme
poétique donne accès à la subjectivité d’un auteur qui révèle ses sentiments face au paysage
nouveau. Ce texte paraît dans le journal local, et met en valeur la beauté naturelle de l’île ; certes
il peut être destiné, par le jeu des échanges médiatiques, aux lecteurs métropolitains, mais il est
aussi offert à la lecture des coloniaux. On y retrouve bien ce fonctionnement colonial qu’est
l’émerveillement, écran à une lecture plus sociale de la colonie ; on peut aussi percevoir la
plasticité des publications coloniales quand il s’agit de rendre compte du territoire. Des
excursions, voyages et promenades jusqu’à la description de touristes ou Européens découvrant
le territoire colonial, le corpus des périodiques coloniaux donne à lire de nombreuses
possibilités pour appréhender le territoire et pour lui donner corps à travers les textes. L’objet
que représente le territoire, bien sûr, est une première partie de cette construction ; mais il se
révèle par des moyens nombreux, au premier rang desquels se trouve l’énonciateur. En effet,
« les œuvres parlent effectivement du monde, mais leur énonciation est partie prenante du
monde qu’elles sont censées représenter244 » : et la typologie que nous venons de dresser rend
bien compte de la complexité du monde colonial par la complexité même des énonciations qui
en rendent compte. C’est que la description est révélatrice d’un mouvement plus large, et qui a
été particulièrement bien rendu dans l’anabase qu’effectue Patrick Chamoiseau. Son récit, dont
nous citons ici un passage, est révélateur en effet d’une histoire de la perception du territoire
qui s’appuie sur la littérature au sens large, sur l’attente des lecteurs et le réseau de
représentations qui se met en place pendant la colonisation :
Dans mon sillage [celui du premier colon antillais, d’Esnambuc], surgit une bibliothèque d’abbés savants, voyageurs et marins-chroniqueurs : Coppier, Pelleprat, Du Tertre, Rochefort, Breton, Labat, Saint-Méry… La première écriture a devancé ma prise de possession, puis l’a accompagnée, puis l’a observée, puis l’a célébrée, puis l’a justifiée. Les « Histoire naturelle », « Histoire nouvelle », « Histoire véritable », « Histoire générale », « Histoire morale », « Description », « Relations », « Chroniques », « Voyages », « Lettres », « Discours », « Registre », « Journal », « Mémoires »… vont remodeler terre, peuples, faune et flore, profilant ainsi ce regard exotique que les poètes-doudous reprendront à leur compte. Rien ne s’écrira pendant longtemps en face. J’engouffrais mes journées dans ces livres poussiéreux que mon moi-colons déchiffrait aisément. Les grands-bois tropicaux et les ruées volcaniques y apparaissent horribles face au paysage européen de la douce colline et du pré ondulant. Les rochers sont pelés. Les précipices, effroyables. La faune inspire d’affreuses chimères. La Caraïbe devient l’incarnation d’une diablerie cannibale. Puis, à mesure de l’implantation, du désir d’émerveiller ce « cher lecteur » européen et d’inciter au peuplement des îles, s’élèvera l’hymne paradisiaque qui jamais plus n’aura de fin. La colonie sera décrite, habillée, transformée,
244 Dominique Maingueneau, Le Contexte de l’œuvre littéraire. Enonciation, écrivain, société, Paris, Dunod, 1993, p. 29.
229
décomptée, domptée selon mes yeux de nouveau maître. Le pays sera expliqué, c’est-à-dire mis à plat, en évidences, sans plis aucun, et sans obscurité245.
C’est dans cette perspective que nous pouvons aborder la manière dont les colonies sont
en effet « habillées » selon les yeux des colonisateurs : des colonies anciennes jusqu’aux plus
récentes, un même regard conditionne la description, et attribue aux territoires une identité
dictée par les nécessités idéologiques de la colonisation. Le journal participe à ce mouvement,
et plus que tout autre type d’écrit colonial il exhibe son adresse aux lecteurs européens en même
temps que son lien avec le territoire : d’où l’intérêt de focaliser maintenant l’étude sur les
modalités de la transformation opérée par les textes sur le matériau brut que représente le
territoire. La médiatisation du territoire colonial se joue bien dans les lignes de périodiques dont
l’identité double – à la fois métropolitaine par le modèle et une partie du lectorat, ainsi que
coloniale par l’ancrage et l’autre partie du lectorat – produit un tissu descriptif particulier.
Marquée par l’idéologie coloniale, la description du territoire se plie à une forme de dynamisme,
à une exigence d’exotisme et en même temps de familiarité : de cette tension résultent quelques
grands traits que nous allons maintenant aborder, et qui attribuent aux territoires coloniaux des
identités spécifiques, des représentations qui vont tendre au figement par le discours
médiatique.
3 De l’identité des territoires coloniaux
Matérialités d’un réseau mondial qui se met en place, rôle particulier des textes qui
spatialisent le journal et en font le relais d’une connaissance textuelle de la colonie : ces deux
aspects amènent à se poser la question des représentations, plus largement, de la nature dans les
périodiques, des territoires envisagés en-dehors de la narration qui les prend en charge. La
colonisation se donne comme justification la « mise en valeur » de terres qu’on prétend
négligées : d’où une attirance soutenue pour les textes descriptifs, pour la manière dont ils
rendent compte d’une forme de nature non industrialisée ou exploitée246. Cette nature est bien
une construction, et une construction qui néglige, voire ignore complètement le territoire dans
son organisation antécoloniale. Aux Antilles ou en Guyane, les populations indigènes ont été
245 Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, Paris, Gallimard, 1997, p. 106. 246 En Australie, la « bush literature » apparaît ainsi comme une catégorie spécifique de récits populaires. Voir Monique Weisz-Bonnaud, « La littérature de Nouvelle-Calédonie et d’Australie : analogies et divergences d’une quête identitaire », Notre librairie. Revue des littératures du Sud, « Littératures de Nouvelle-Calédonie », n° 134, mai-août 1998, p. 108-123. Il est bien question d’une approche poétique de l’espace.
230
anéanties ou repoussées loin de leur territoire ; l’île de la Réunion est connue pour avoir été
déserte jusqu’à l’arrivée des Européens ; en ce qui concerne Tahiti ou la Nouvelle-Calédonie,
les textes du journal colonial ne portent aucune trace des systèmes existants de propriétés, que
le gouvernement comprendra d’ailleurs mal247 ; enfin le gouvernement colonial en Algérie
détruit aussi l’organisation territoriale. Il est donc normal que les périodiques accompagnent ce
refus de voir le territoire colonial comme un espace occupé : soutien idéologique et pilier de la
colonisation, ils construisent au contraire une nouvelle appréhension de l’espace, propre au
système colonial. Ainsi de l’extrait présenté ci-contre du Messager de Tahiti, qui publie des
listes d’enregistrement de terres marquant une conception coloniale de la propriété248.
Le territoire devient occidental ; c’est ce que la presse confirme, c’est ce qu’exprime le
rédacteur de la « chronique néo-calédonienne » dans les termes les plus idéologiques : « Et
colons et soldats sont venus et ce coin de terre doit changer d’aspect, car sur lui, désormais, se
247 Pour la Nouvelle-Calédonie, voir les travaux des historiens Alain Saussol et Isabelle Merle. 248 Le Messager de Tahiti, 26 octobre 1865.
231
projette un des rayons de l’œil de la France249 ! » Cette exigence de changement apparaît en
effet comme l’un des critères préexistant à la description des territoires coloniaux : la
colonisation doit être transformation. Mais elle ne se résout pas tout entière dans ce mot
d’ordre : l’admiration pour une nature exotique constitue également l’un des modèles selon
lequel les descriptions peuvent s’ébaucher. Dans une étude relativement récente sur l’île de la
Réunion apparaît l’idée que la littérature produite par les coloniaux est une littérature « tournée
vers un public occidental » qui « s’intéresse aux XVIIIe et XIXe siècles à l’île, espace de rêves,
de fantasmes européens, ou de nature sauvage, plus qu’à l’humain250 ». Il est vrai que,
particulièrement à la Réunion, le lecteur trouve pléthore de textes décrivant les
paysages : savanes, pitons, falaises, forêts apparaissent fréquemment, bien plus que dans les
textes médiatiques de la colonie algérienne ; et surtout, sous un angle différent. Peu de
silhouettes d’esclaves, mais plutôt la mention d’un formidable cadre et des plantations qui s’y
trouvent. En Algérie, si les indigènes n’apparaissent qu’à l’état de silhouettes, ils sont tout de
même partie prenante du tableau peint, de cette nature hostile que le colonisateur dompte : là
encore, l’utilisation même de la description signale une orientation idéologique coloniale. Alors
apparaît une colonisation bifrons : celle qui vante une nature sauvage mais nourricière, celle
qui peint les travaux des colonisateurs sur une terre inhospitalière. Les deux coexistent et ne
concernent pas les mêmes territoires : il est alors intéressant d’en rendre compte pour saisir la
multiplicité même des rapports entretenus entre les auteurs coloniaux et la nature, forcément
exotique, qu’ils décrivent pour leurs lecteurs. Car les journalistes coloniaux sont conscients de
cette dichotomie dans la représentation de leurs territoires : ainsi, à la Réunion, le rédacteur de
La Malle se plaint en 1872 des stéréotypes divergents attachés aux colonies.
Tantôt ces pays lointains sont représentés comme des terres incultes et sauvages où la civilisation européenne et les institutions qu’elle comporte ne sauraient ni s’implanter ni s’acclimater avec la moindre chance de succès ; tantôt, au contraire, ce sont de petits paradis terrestres habités par des populations exceptionnelles, que leur développement moral et leurs progrès intellectuels ont mises à la hauteur de toutes les situations251.
Entre ces deux excès, la représentation médiatique semble chercher sa voie ; les îles
édéniques, les marais algériens se construisent par différents moyens. Et, dans un dernier temps,
on pourra aussi s’interroger sur la formulation et l’usage des toponymes complètera cette étude
249 Félix H. Béraud, « Chronique néo-calédonienne », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 6 juillet 1862. 250 Rose-May Nicole, Noirs, cafres et créoles : étude de la représentation du non blanc réunionnais, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 45. 251 Chalvet de Souville, « Discernement et sagesse », La Malle, 23 mai 1872.
232
des natures exotiques : le journal, parce qu’il vaut aussi pour la publication qu’il fait de la vie
coloniale, annonce et précise les contours du territoire colonial, en fixe les noms, en discute les
sonorités. Ce n’est pas le moindre de ses effets que de peindre le territoire jusqu’à le transformer
en carte, et en une carte faite pour les coloniaux autant que pour les métropolitains destinés à
connaître les territoires appartenant à l’empire français.
3.1 Une nature bienveillante et édénique
La particularité de l’île de la Réunion tient sans doute, dans l’imaginaire colonial, à ce
qu’elle ait été inhabitée jusqu’au débarquement de marins français ; dans une perspective
voisine, l’île de Tahiti, découverte relativement tard et terre d’origine du « bon sauvage » que
Diderot a popularisé, bénéficie de la même vision édénique. Les îles sont donc, dans la presse
même qui est publiée sur leur territoire, marquées par ce discours positif qui vante les mérites
de la nature et permet, en creux, de décrire les conditions de vie métropolitaines, tout en passant
sous silence les réalités sociales de la colonie : tout se passe comme si la beauté des paysages
naturels masquait la réalité de l’esclavage, et plus tard celle de l’engagisme252 ; comme si la
poésie, genre noble et valorisé par les littérateurs coloniaux, était préférée à des fictions plus à
même de peindre la société contemporaine. À ces lectures anciennes et acceptées du territoire
comme paradis répond celle que fait Patrick Chamoiseau lorsqu’il met en lumière l’écriture de
ceux qu’il appelle les « poètes-doudous », autrement dit des poètes « mulâtres » marqués par la
perception dominante du paysage : il évoque ainsi les « rimes d’alizé, de soleil et de fleurs
odorantes253 », démontre comment cette « géographie-paradis » issue de l’émerveillement des
voyageurs européens – auteurs de « chroniques de passage254 » – a été reprise et reproduite par
des poètes issus de l’esclavage. Le terme de « géographie-paradis » et la lecture qui est faite du
territoire par un auteur antillais contemporain révèlent à quel point cette problématique de
l’appréhension du territoire est fondamentale dans l’écriture et l’identité antillaise, et ce depuis
longtemps. Patrick Chamoiseau critique un fonctionnement que la presse coloniale du XIXe
siècle a confirmé et répandu : c’est aussi par la voix du journal que s’est affirmée cette identité
forcée, conditionnée par une bibliothèque coloniale et enrichie par les textes médiatiques
quotidiens.
252 « L’engagisme » désigne le système de travail en usage dans les colonies de plantation après l’abolition de l’esclavage : étaient « engagés » des travailleurs souvent originaires de Chine ou d’Inde, sous des modalités qui rappelaient fortement l’esclavage. 253 Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, Paris, Gallimard, 1997, p. 47. 254 Ibid., p. 49.
233
Les îles : de la beauté naturelle à la tentation allégorique
Une nature bienfaisante, nourricière, majestueuse : bien des traits de la description de la
nature insulaire, qu’elle soit tahitienne ou réunionnaise, se prêtent à une écriture allégorique
imprécise mais enthousiaste. Peindre la Réunion par l’allégorie permet de donner aux coloniaux
une vision positive de leur île, et une perception positive de leur culture capable de se livrer au
jeu de l’allégorie : c’est en ce sens qu’est commentée une publication poétique parue en recueil.
Le critique y vante le rapport qu’entretient la poétesse créole avec le paysage de son
enfance : « Elle a pour ses mornes et ses savanes quelque chose des infinies tendresses des
Hébreux pour Jérusalem, des Grecs pour Argos et des Ecossais pour le Ben-Lothian. Ce
précieux amour a été son inspiration quotidienne et c’est non seulement la source de ses plus
beaux vers mais encore le fond et le corps même de sa poésie255 ». Sont ensuite cités quelques
vers :
Viens, ô viens avec moi dans ma terre lointaine, Viens voir son ciel brillant, ses mornes toujours verts, De rouges grenadiers et d’orangers couverts. Ah ! le soir est si beau dans nos vertes savanes Surtout lorsque la lune étend ses blancs rayons Sur la mer endorme et sur nos champs de cannes Où la brise, en passant, trace mille sillons256 !
Les textes cependant ne sont pas légion qui répondent à la tentation allégorique ; mais
ils se révèlent particulièrement intéressants pour nourrir l’étude d’un territoire médiatisé par la
presse. Ainsi, La Feuille hebdomadaire puis Le Colonial publient, en 1819 et 1833, un anonyme
« dialogue » versifié entre « la France et Bourbon » : deux personnages féminins s’y affrontent
autour de la valeur de chaque territoire. « Zoé, Créole de Bourbon, Élise, Parisienne,
Ariste257 » : les deux jeunes femmes sont ainsi présentées avant le début du dialogue à
proprement parler, avec Ariste leur arbitre, et le fonctionnement allégorique étant ainsi bien
installé, le texte peut déployer ses ressources argumentatives et descriptives. Zoé, la jeune
Réunionnaise, explique alors :
Mais, si l’on veut d’un riche paysage Se figurer l’aspect riant, C’est ici qu’on en prend l’image258.
À quoi Élise la Parisienne répond :
255 J. Elsey, « Une créole poète. Mme de Lafaye », Le Propagateur, 10 octobre 1863. 256 Id. 257 D., « Dialogue. La France et Bourbon », Le Colonial, [1819], 2 et 5 juillet 1833. 258 Id.
234
En peinture, en vers, c’est charmant ; Ce paysage est justement Ce qui me déplait davantage259.
Dans ce débat allégorique portant sur les mérites de Paris et de la Réunion, le décor est
mentionné comme enjeu majeur, prouvant bien là que l’utopie réunionnaise se joue au premier
chef dans la caractérisation d’une nature positive. Et dans le miroir que Paris tend à la Réunion
apparaît donc une nature nourricière, riche, apaisée, qui est le décor idéal de l’utopie.
L’allégorie aide à percevoir ce débat : ainsi, plusieurs décennies après la première publication
du dialogue cité ci-dessus, L’Hermite, évoqué en première partie pour son pseudonyme, verse
lui aussi dans l’allégorie versifiée pour évoquer la Martinique : il publie en 1862 dans Le
Propagateur un texte poétique intitulé « La Vieille et la jeune Martinique. Dialogue260 ». La
perspective est certes avant tout temporelle, et pas esthétique : il s’agit d’opposer le passé de la
colonie au présent des années 1860, sur le chapitre du mariage, de la mode vestimentaire, des
mœurs enfin. Le propos est socio-historique au sens large, et pas seulement colonial ; mais il
n’en reste pas moins que les deux Martinique, allégorisées, offrent quelques traits communs
avec notre texte précédent. Et pourtant rien de commun entre les deux périodiques, entre les
époques ou les auteurs : rien, si ce n’est la capacité à allégoriser les territoires insulaires pour
évoquer l’époque et les mœurs. Les textes peuvent aussi faire apparaître cette tendance au cœur
d’autres genres que celui de la poésie : dans La Feuille hebdomadaire de la Réunion, une
nouvelle intitulée « Esquisses morales. Alice, ou une destinée de femme » commence par une
description qui met en valeur le paysage réunionnais :
L’herbe a jauni sur les flancs de nos montagnes, elles ont revêtu leur parure d’hiver ; des siliques desséchées pendent seules et bruissent aux branches des bois-noirs, et sur le sable du rivage le filao funéraire, courbant au souffle la brise ses flexibles pyramides de feuillage chevelu, mêle au bruit des vagues son murmure plaintif.
La tête chenue de nos âpres Salazes s’est poudrée de frimas, leur front sourcilleux s’est couronné de glaçons, et, dans sa prédilection pour notre île bien-aimée, la nature offre à nos poitrines fatiguées des ardeurs de la canicule ce punch à la romaine que ne connut pas Lucullus, ces bienfaisants sorbets que Maurice nous envie, doux présent des cieux aux zones tempérées261.
S’ensuit une description d’un bal à Saint-Denis, mis sous le signe de la richesse et de la
profusion créole. Mais, ce bal mis à part, la description n’a pas d’intérêt diégétique : le récit va
se développer ensuite dans la ville de Saint-Denis et dans le quartier du Butor, les personnages
259 Id. 260 L’Hermite, « La Vieille et la jeune Martinique. Dialogue », Le Propagateur, 19 mars 1862. 261 *** D.M.P, « Esquisses morales. Alice, ou une destinée de femme », La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, 24 juillet 1839.
235
passant de la bonne société de Saint-Denis à la déchéance du Butor. L’intérêt de ce passage
réside dans la manière dont l’auteur opère un rétrécissement de la perspective géographique.
D’une vision de la planète qui situe l’île par rapport à la métropole, il passe ensuite à la
description des montagnes, puis particulièrement à la description des Salazes, pics rocheux au
toponyme précis. Le rétrécissement de la perspective s’accompagne aussi d’une
personnification : le « feuillage chevelu », le « murmure plaintif », la « tête chenue » des
Salazes dessinent à la fin de la description une île humanisée, qui sans aller jusqu’à l’allégorie
joue de la personnification. Cette toile de fond donnée au récit signale son caractère local, et
tend aussi à faire du paysage un personnage caché en même temps que le lieu d’une connivence
entre l’auteur et ses lecteurs réunionnais.
L’opposition à la métropole : paysages édéniques et civilisation Dans un texte qui paraît en feuilleton et s’intitule « Revue et chronique de Saint-Pierre »,
le journaliste chargé de décrire la ville commence par une opposition :
Le soleil a passé l’équateur, il est dans l’hémisphère nord ; les vents alizés, qui nous frappent d’orient en occident dans notre rapide rotation sur ces régions élevées du globe, nous font respirer l’air des climats plus doux, ils amènent sous notre tropique la délicieuse température du joli mois de mai dans notre belle France262.
Ce paragraphe montre une perspective essentielle dans la compréhension du territoire tel
qu’il apparaît dans le texte : c’est par une référence à la France, à la métropole, que s’ouvre la
description de l’île tropicale. Et ce fonctionnement est le même pour d’autres textes déjà cités.
On a lu dans le dialogue entre Élise et Zoé une trace de l’antagonisme entre les paysages
parisiens et les paysages réunionnais : sur ce point, la représentation textuelle des liens entre la
colonie et la métropole touche à un sujet plus large. Parce qu’ils rendent compte d’un point
précis de la presse coloniale, parce qu’ils cristallisent une particularité des écrits coloniaux au
sens large, quelques textes émergent particulièrement de notre corpus et rendent compte de cette
opposition. Dans le dialogue entre la France et Bourbon, donc, on trouve l’intervention d’Ariste,
un jeune homme qui joue le rôle d’arbitre, et dont à ce titre les paroles sont révélatrices d’une
position d’auteur :
Sur la pelouse du village Le paysan bondit joyeux : Le souvenir de l’esclavage
262 Id.
236
Ne le trouble point dans ses jeux263.
Le paysan français est plus heureux que l’esclave réunionnais, malgré les sèmes positifs
liés à la nature réunionnaise que l’on trouve auparavant, et malgré un lieu commun répandu
chez les planteurs et qui postulait l’inverse264 : l’utopie sociale est du côté de la métropole pour
ce texte. Publié deux fois, il est pourtant passé « incroyablement inaperçu265 » selon les mots
de Fabienne Jean-Baptiste, qui a étudié les feuilletons réunionnais de cette période. Preuve de
l’inefficacité de la poésie à éveiller les consciences à des sujets sérieux, dans cette presse
coloniale constituée de beaucoup d’autres morceaux représentatifs de la colonie et de son
système esclavagiste ? Les périodiques coloniaux avant 1848 intègrent en effet les demandes
d’affranchissement, les ventes comprenant des esclaves et les déclarations de marronnage ; ce
texte offre une dissonance trop infime pour être repérée. Plus largement, le thème de la
comparaison entre le territoire colonial et le territoire métropolitain est fécond : ainsi, en juillet
1856, Le Bien-Public réunionnais publie en feuilleton un texte intitulé « La Patrie », et signé X.
Sans doute il comble un manque de textes plus qu’un besoin d’actualité, puisque s’y développe
une description enthousiaste de la colonie qui n’est motivée par aucune explication et ne se
rattache à aucune nouvelle. C’est ce dont témoignent les premières lignes : « L’île Bourbon est,
sans contredit, la première des Colonies françaises ; la beauté de son ciel, la salubrité de son
climat, la fécondité de son sol si riche, en font la perle de l’Océan indien266 ». Si cette
introduction est somme toutes attendue, et relève d’une rhétorique qui ne déparerait pas dans
un discours officiel, l’auteur par la suite se décrit en poète, et en vient à développer une forme
de lyrisme inaugurée par une interjection :
Oh ! j’aime mon île natale avec son soleil de feu et ses brises tempérées ; je l’aime avec ses Salazes aux crêtes audacieuses et groupées dans les nues, avec sa ceinture de sables d’or et l’éloquence de son océan dont les lames étincelantes viennent lécher ses pieds de granit ! Ici, point de ces sombres misères si communes en Europe, et que la plume habile de l’historien ou du romancier est quelquefois impuissante à retracer ; notre bengali chante toujours et trouve, à l’abri d’un printemps perpétuel,
Du grain dans les sillons et des nids dans les fleurs267.
263 Id. 264 Idée évoquée par John D. Garrigus, « Des François qui gémissent sous le joug de l’oppression. Les libres de couleur et la question de l’identité au début de la Révolution française », Cécile Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre colonies et métropole, XVIe-XIXe siècle, Paris, éditions de l’EHESS, 2014, p. 165. 265 Fabienne Jean-Baptiste, Feuilletons et Histoire. Idées et opinions des élites de Bourbon et de Maurice dans la presse de 1817 à 1848, thèse de doctorat en histoire contemporaine sous la direction de M. Prosper Ève, soutenue à l’Université de la Réunion, 2010, p. 522. 266 X., « La Patrie », Le Bien-Public, 31 juillet 1856. 267 Id.
237
La citation finale, prise à Hégésippe Moreau268, confirme l’intention poétique et lyrique
de la description ; elle affirme aussi cette volonté de parenté avec un poète « maudit », connu
pour sa misère. On se trouve donc face à un entre-deux : la comparaison entre la nature
réunionnaise et la nature métropolitaine est un des lieux communs de la littérature coloniale ; la
tentative poétique de décrire l’île annonce une autre ascendance, et une autre posture. D’autres
passages décrivent l’île avec cet effort pour mettre en avant son caractère édénique : « J’aime
ses guirlandes de jardins aux sveltes cocotiers et ses parfums de citronniers et d’orangers. Ses
cascades cotonneuses qui s’éparpillent au souffle des montagnes, rafraîchissent mes sens
agités269 ». Le texte se clôt enfin sur le départ du poète ; il qualifie son texte de « chant d’adieu »
et justifie sa publication par ces termes : « je ne l’ai introduit [le chant d’adieu] que pour ceux-
là qui, en voyant des nuages s’amonceler au fond des cieux, se signent et prient pour le voyageur
qui s’aventure à travers les écueils de l’Océan, dans la prestigieuse fascination des rêves de
l’avenir270 ». La publication d’un tel texte pose question au lecteur moderne, et interroge les
habitudes de lecture médiatique : pourquoi ce texte hybride, qui hésite entre deux tonalités et
ne porte ni actualité, ni fiction, ni débat ? Il conforte l’image du poète réunionnais, malheureux
et forcé à l’exil ; il décrit positivement l’île habitée ; il faut alors conclure qu’il fait office de
miroir pour la colonie, et qu’il participe à la construction de son image : en 1856, ces éléments,
bien que divers, sont devenus habituels, puisque la génération des grands poètes réunionnais
(Lacaussade, Dayot) est passée. Plus tard encore, en 1879, l’image de l’île est bien ancrée dans
les représentations médiatiques : et quand Victor Pujo, correspondant métropolitain du Sport
colonial, envoie sa première collaboration au journal, c’est à une description de l’île vue par le
biais métropolitain qu’il se livre. Le texte est intéressant pour ce qu’il révèle de ce contraste
fort que l’on présente au lectorat réunionnais :
Heureux créoles ! Vous ne connaissez pas les ennuis glacés de l’hiver, les longues, longues veillées au coin du feu, un vieux bouquin sur les genoux. […] Vos varangues n’ont pas de ces nostalgies qui font passer dans le cœur une bise âpre : celle des regrets du soleil, de la verdure, des matinées ensoleillées, des ombrelles blanches, des sentiers papillotés de fleurs ; des soirées enamourées, parfumées par les brises chargées d’effluves douces ; des courses vagabondes à travers la campagne printanière !...
Vous avez vos jardins feuillus que l’hiver respecte, vos horizons vermeils que borne l’Océan dont les tempêtes mêmes sont des spectacles grandioses, vos montagnes poétiques, qui n’ont pas, comme les nôtres, au manteau éternel de neige et de glacier271.
268 Hégésippe Moreau, « L’Hiver », Le Myosotis, Paris, Desessart, 1838. 269 X., « La Patrie », Le Bien-Public, 31 juillet 1856. 270 Id. 271 Victor Pujo, « Correspondance particulière », Le Sport colonial, 15 novembre 1879.
238
La description des saisons métropolitaines permet une évocation des paysages
réunionnais fantasmés : dans ce jeu de miroir, les « spectacles grandioses » et les « montagnes
poétiques » appartiennent bien à la nature insulaire, et le caractère fantasmé de la description
apparaît d’autant plus que l’auteur, résidant à Perpignan, ne s’est jamais rendu jusqu’à La
Réunion. Même jeu de miroir, mais inversé, et présenté aux lecteurs de La France d’Outre-Mer
quand le chroniqueur qui signe Luis de Padilla raconte l’installation des créoles à Paris et leur
manière de se regrouper, de former à part un quartier en utilisant leur habitude coloniale :
Les Créoles furent donc les génies secrets qui frappèrent de la baguette magique le sol abandonné, pour en faire jaillir comme une ville élégante et riche. Le quartier de la Madelaine est une colonie fondée par eux au sein de la capitale de la Métropole272.
Les créoles forment une population à part, et dans cette deuxième moitié du XIXe siècle,
leur identité coloniale sert à les définir au sein même de la capitale. La transformation est alors
complète : les coloniaux ont transformé le lieu même d’où ils sont partis.
Répondre aux stéréotypes : une signature coloniale ?
De manière étonnante, alors même que les écrits coloniaux sont censés utiliser les
stéréotypes, voire les créer, on trouve dans la presse coloniale une forme de refus de ces
stéréotypes – en ce qui concerne le territoire, du moins. Ainsi, la nature insulaire est marquée
par des stéréotypes puissants : et le correspondant tout neuf du périodique réunionnais Le Sport
colonial, ce Victor Pujo que nous venons de citer, se présente ainsi à son lectorat colonial pour
sa première publication :
Vous n’êtes pas habitués à rencontrer des compatriotes de France, témoignant une affection pareille pour votre petit pays. Vous devez déjà vous dire in petto que celui qui vous parle ainsi est encore sous l’émotion de l’enthousiasme que lui a procuré la lecture de Paul et Virginie de l’Île de France, d’Indiana, l’héroïne du Bernica, de l’Album de la Réunion, aux pages colorées et brillantes, des poésies créoles de Lacaussade ou de l’auteur des Erinyes.
Détrompez-vous ; certes, j’ai une prédilection particulière pour les idylles tropicales de Bernardin de Saint-Pierre ; j’admire l’immense talent de George Sand (quoiqu’elle ait placé dans le beau site du Bernica une scène déplorable) ; je goûte très particulièrement les splendides lithographies de M. Roussin, les études remarquables de MM. Pajot, Raffray, Dr Vinson, et de tous les écrivains d’élite qui collaborent à ce qu’on pourrait appeler, au lieu d’Album, le Panthéon pittoresque à l’île de la Réunion. Enfin je professe un culte spécial pour le génie poétique des poètes créoles contemporains.
Mais je n’aime pas seulement votre île, chers lecteurs, pour toutes ces belles choses séduisantes. Votre caractère affable, sympathique, vos mœurs, l’esprit éminemment distingué qui vous distingue des habitants
272 Luis de Padilla, « Chronique de la quinzaine », La France d’Outre-Mer, 22 mai 1853.
239
des autres colonies, m’a toujours porté à vous vouer une affection constante273.
Dans cette captatio benevolentiae empreinte d’humour, la littérature apparaît comme le
premier moyen de connaître l’île : Paul et Virginie, Indiana, L’Album de la Réunion sont les
trois titres qui permettent cette connaissance première. L’œuvre de Bernardin de Saint-Pierre
est connue pour son exotisme tropical, et Pujo la cite tout en précisant bien qu’elle concerne
l’île de France, aujourd’hui Maurice. Cette première citation, presque obligatoire, est complétée
par l’œuvre de George Sand connue pour son épilogue réunionnais empreint d’utopie ; enfin,
L’Album de la Réunion montre une connaissance plus récente et plus précise de l’île : tous ces
textes montrent bien une image construite par des textes – et comment le lecteur métropolitain
aurait-il une autre idée de l’île ? Puiser dans ces références textuelles pour en extraire des
représentations figées revient, pour le correspondant, à avouer son ignorance des réalités de
l’île ; ce mécanisme ressortit à une perspective que l’on observe plus largement à l’échelle
coloniale. N’importe quelle forme textuelle peut en effet se prêter à la déconstruction des
stéréotypes exotiques : ainsi, dans La France d’Outre-Mer, un poème à la structure intéressante
met en balance l’apparence apaisée d’une anse et la scène de mort qui s’y déroule. C’est par la
parole du voyageur que le territoire est d’abord appréhendé, avant que cette parole soit
contredite par la voix du poète et par l’anecdote : deux chasseurs trouvent la mort au cours
d’une crue. Le texte est sans grande importance dans le fonctionnement du journal ; il ne trouve
pas d’écho dans les publications suivantes, et son auteur ne signe qu’avec des initiales. Mais sa
situation, sa parution en feuilleton et la capacité qu’a ce poème – anodin, donc, et de peu
d’importance –de jouer sur la vérité d’un fragment du territoire insulaire en font un indice
intéressant de l’écriture médiatique insulaire.
« Oh ! – dit le voyageur, - dans cette anse bénie Que l’on serait heureux de voir couler sa vie ! » Quand l’ouragan mugit Au sombre hivernage, Ah ! malheur à qui gît Sur ce beau rivage ! Malheur au chasseur, Malheur au pêcheur Séduit par l’asile Qu’offre la presqu’île !... L’anse aux ombreux monts, L’anse à la plage blonde, C’est l’anse immonde : L’anse aux démons274 !
273 Victor Pujo, « Correspondance coloniale », Le Sport colonial, 18 octobre 1879. 274 C. B., « L’Anse au diable », La France d’Outre-Mer, 15 février 1859.
240
Dans la même perspective, la beauté des îles de Tahiti, des Antilles et de la Réunion se
marque par la description de leur profusion : et ces récits entraînent donc une forme de réaction,
qu’on peut lire par exemple sous la plume de Celtibère, l’auteur qui publie des poèmes dans la
presse tahitienne en 1855. Après avoir énuméré certaines productions du territoire tahitien, le
poète interrompt un moment le flux de la description pour produire un commentaire
métadiscursif :
Vainement de sa voix la jalouse science Vient et m’importuner et troubler mes plaisirs, Loin de me tourmenter d’ambitieux désirs, Je poursuis, sans rougir de ma douce ignorance. Eh ! voudrais-je jamais barbare dans mes vers De cent étranges noms hérissant leur mesure, Savoir, amant naïf de l’aimable nature, Bizarrement parler de ses produits divers275 ?
La posture du poète refusant la terminologie scientifique est en accord avec l’image
édénique de l’île : le « barbare » ici représente cette inclination pour la science, et la « douce
ignorance », l’« aimable nature » s’y opposent en réactivant l’image du « bon sauvage ». Le
glissement opéré ainsi entre le poète et le bon sauvage modifie le statut de l’observateur, de
l’écrivain : il s’affirme du côté de la nature parce qu’il reprend un des stéréotypes qui ont servi
à la décrire.
Autre territoire, mais même tentation : dans Le Brûlot de la Méditerranée du 3
septembre 1848 paraît une critique littéraire assez violente contre un auteur non nommé,
probablement Désiré Léglise, dont l’œuvre « Les Djinns » n’a pas plu au journal. Après avoir
introduit ironiquement le poète comme auteur de « cet étroit espace qui s’étend de Bab-el-Oued
à la Rosa en passant par la Régence, dans ce terroir favorisé des Muses, auquel deux débits de
cigares servent de limites276 », le journaliste cite quelques passages qu’il incrimine. On voit dès
son introduction que la critique s’appuie sur la perception du territoire ; c’est encore plus vrai
à la lecture des reproches précis :
Le colon rebuté déserte sa charrue, Regagne son pays ou se laisse mourir Sur ce sillon ingrat qui ne peut le nourrir. Ne croyez point les poètes menteurs, ils ont vu ce pays dans le pays des songes ; ici, point de fleurs, de rayons, de parfums, de soleil ! N’écoutez pas ces diseurs de mensonges : partout le brouillard, le marais et la
275 Celtibère, auteur des Poésies religieuses, « Voyage autour du monde. Taiti », Le Messager de Tahiti, 5 février 1855. 276 « Les Djinns », Le Brûlot de la Méditerranée, 3 septembre 1848.
241
fièvre aux haleines fétides, et le colon pâle et nu qui meurt à l’hôpital277 !
Les premiers vers sont ceux de Désiré Léglise ; le journaliste du Brûlot les reprend
ensuite pour mieux les caricaturer, et ce qui apparaît alors est bien un stéréotype
anticolonial : fièvre, agriculture ingrate, hôpital sont les termes d’un discours auquel le
journaliste répond par la caricature. Il fait alors apparaître une nature qui, à défaut d’être
édénique, n’en est pas moins positive : fleurs, parfums, soleil sont les armes de cette opposition
entre deux stéréotypes, qui se joue dans les pages d’une critique littéraire anodine. La presse
satirique rend elle aussi particulièrement palpable cette usure de la description :
Ce [que le héros] venait d’apercevoir c’était Alger ! Alger la bien gardée, Alger la guerrière qui, pareille à… – A quoi diable pourrai-je bien comparer Alger ? La fameuse carrière de plâtre est bien commune et franchement elle commence à être usée – Ah ! j’y suis – … un vaste éventail d’un blanc mat dans lequel scintillaient mille paillettes d’or, formées par les feux du soleil levant se reflétant dans les croisées de la vieille cité mauresque. – Comment trouvez-vous la comparaison ? Elle est inédite au moins278 –
Voilà ce que publie La Goguette en 1867, et cette interruption du récit par la voix du
narrateur permet de développer les lieux communs de l’appréhension de la ville coloniale.
L’effort d’originalité est d’ailleurs contredit par la formulation même : l’éventail et le rappel de
la cité « mauresque » (alors même que le mouvement général de la presse est d’insister sur les
transformations dues à la colonisation) ancrent profondément le récit dans la tradition
orientaliste. Or c’est cette tradition que la presse locale veut dépasser, pour affirmer une prise
de parole à la fois nouvelle et pertinente sur le territoire colonial. Ces voix qui s’élèvent se
rapportent cependant à un même arrière-plan : celui de l’alibi premier de la colonisation, la mise
en valeur de la nature.
3.2 Entre métonymie et justification : une nature sauvage, à dompter
L’espace que la presse coloniale représente est orienté idéologiquement : chaque
description doit prouver que l’entreprise coloniale « met en valeur » le territoire étranger,
chaque rappel du passé doit affirmer qu’elle est en bonne voie. Le critère esthétique même est
subordonné à cette mission idéologique, qui se manifeste différemment selon les territoires. Le
277 Id. 278 Farewell, « Une histoire », La Goguette, 1er mai 1867.
242
plus frappant sur ce chapitre reste l’Algérie, car la colonisation y est agricole et repose sur des
mécanismes d’expropriation dont la presse même se fait l’écho, en publiant les listes de
territoire soumis à la séquestre. L’on trouve encore en 1879 des avis d’expropriation pour créer
de nouveaux villages, publiés en supplément du Moniteur de l’Algérie : ainsi, le 19 juillet, le
village de Cavaignac est créé au lieu-dit Beni-Madoun et entraîne des expropriations. On verra
donc ici deux cas précis que la presse traite particulièrement : pour l’Algérie, outre
l’appropriation du territoire, la mise en scène d’une colonisation qui se manifeste par la charrue
et par l’épée. Un deuxième cas concerne toutes les colonies : les naufrages, événements
construits dans les textes par des rubriques diverses, permettent de donner une image précise
des dangers de la vie coloniale. Car les territoires ultramarins, on l’a vu dans le premier chapitre,
développent un lien très fort avec le navire qui réunit la métropole et la colonie ; mais qui dit
navire au XIXe siècle entend « naufrage » en écho : et la presse ne peut pas ignorer ces faits
divers. Une étude rapide du traitement des naufrages dans les différents territoires coloniaux
sera l’occasion de donner une image de la colonisation par un axe particulier, qui vaut
métonymie : le naufrage est bien une partie de la dangereuse vie coloniale telle qu’on la
présente aux lecteurs de journaux, de cette confrontation à une nature autre.
L’Algérie : la domestication, « ense et aratro279 »
Le cas algérien est particulier : c’est vers l’Algérie qu’a convergé toute une population
qui a fait ensuite les beaux jours de la littérature coloniale et de ses titres : Les Colons algériens,
Vingt ans en Algérie ou Tribulations d’un colon raconté par lui-même, La Fille du colon, Je
deviens colon280… Le courageux colon, paysan autant que soldat, est incontournable dans ces
premiers titres qui évoquent l’Algérie coloniale en-dehors de considérations purement
techniques. Dans la presse coloniale, dès les premières années, l’effort des colons pour
« reprendre » le territoire est mis en mots et associé aux sentiments plus qu’à l’efficacité :
Je n’essaierai pas, Monsieur, de vous peindre ici les diverses sensations que nous éprouvâmes à ce spectacle inattendu. Cette espèce d’oasis, ou plutôt ce village européen au milieu du désert ; ces cultures à l’entour qui décelaient une main intelligente et qui contrastaient si fort avec la végétation sauvage de la partie de la plaine que nous venions de parcourir ; peut-être aussi, tant les souvenirs sont puissants, le son de la
279 Devise portée sur les armes du général Bugeaud, devenue celle de la colonisation et reprise dans la devise de La France algérienne : ense et aratro ; arte et ingenio. La formule se répand rapidement : on trouvera aussi une nouvelle de Florian Pharaon, dans ses Récits algériens, intitulée « Le Soc et l’épée ». Voir Florian Pharaon, Récits algériens, Paris, A. Panis, 1871. 280 Léon Beynet, Les Colons algériens, Alger, Molot, 1863 ; A. Villacrose, Vingt ans en Algérie, ou Tribulations d’un colon racontées par lui-même, Paris, Challamel 1875 ; Comtesse de la Rochère, La Fille du colon, Tours, Mame et fils, 1878 ; Hugues Le Roux, Je deviens colon. Mœurs algériennes, Paris, C. Lévy, 1895.
243
cloche que nous n’avions pas entendu depuis notre sortie d’Europe ; mais surtout cette croix, ce signe naguère abhorré des Musulmans, qui après douze siècles reparaissaient sur ces rivages d’Afrique comme un symbole de la civilisation européenne […]281.
La main du colon est citée, mais c’est bien le territoire qui est au centre du texte, et son
occupation. Par le détour de la description, la transformation du paysage signale la colonisation
réussie. Une certaine idée du peuple apparaît par le biais de ces personnages donnés comme des
paysans d’un type nouveau ; et à ces colons correspond un territoire décrit comme sauvage, en
effet, et dangereux. Le toponyme qui semble le plus évocateur de cette situation algérienne
compte trois syllabes : Bouffarick apparaît comme le symbole de la transformation coloniale la
plus aboutie, la plus réussie282. C’est à ce titre qu’en 1845, dans une nouvelle publiée dans La
France algérienne dont le rédacteur précise qu’elle a été publiée dans La Démocratie pacifique
(journal fouriériste), on lit :
Un de mes amis de France, désireux de juger par ses yeux de la véracité de mes correspondances cynégétiques, était venu me demander l’hospitalité à Bouffarick en 1842. À cette époque, la Mitidja n’était pas encore sûre aux alentours de cette place ; les cavaliers de Ben-Salem tenaient toujours la plaine, et chaque nuit de station des convois étaient signalés par quelques vols de bêtes de somme ou quelque assassinat. Ce n’était pas là une raison pour empêcher un chasseur de chasser, au contraire. La guerre allait finir d’ailleurs, et bientôt toute la population d’Alger, se répandant par la plaine, ferait main-basse sur tout le gibier qu’elle rencontrerait ; bientôt la Mitidja, abandonnée à la dévastation et à la concurrence anarchique des chasseurs, serait réduite, comme territoire de chasse, à la pauvreté déshonorante de la plaine Saint-Denis. Il fallait donc se hâter, pendant qu’il était encore temps, d’user des bénéfices de la guerre et de se donner le plaisir d’une chasse en Algérie dans son beau283.
La comparaison avec la plaine Saint-Denis présente la domestication comme un fait à
venir par le biais de la comparaison : l’assertion tranquille de cette transformation – négative,
d’ailleurs – montre bien les enjeux d’une description de Bouffarick comme symbole des phases
de colonisation. Un autre texte, à un an d’intervalle, témoigne aussi de ce changement, de cette
transformation rapide à mettre au crédit de l’action des colons :
Bouffarik ?... Mais ce nom réveille des idées sinistres, des souvenirs de destruction et de mort !... mais n'est-ce pas là le noyau de la peste et de l'infection, cette masse de marais putrides, ce séjour privilégié des miasmes délétères ? N'est-ce pas ce nom qui a jeté l'effroi dans les
281 « Extrait du Voyage à la Rassauta, publié par M. Ch. Solvet, juge au tribunal supérieur d’Alger », Le Moniteur algérien, 7 mai 1836. Une note précise : « cette brochure est adressée, sous forme de lettre, à un membre de la Chambre des députés ». 282 Actuellement, l’orthographe translittérée donne « Boufarik » ; nous avons conservé ici les orthographes en usage dans les textes. 283 A. Toussenel, « Une chasse au sanglier à l’allumette chimique – Souvenir d’Algérie », La France algérienne, 5 mai 1845.
244
admirateurs les plus enthousiastes de la plaine, qui a fait reculer tant de colons ? N'est-ce pas à ses habitants que l'Administration, par mesure d'humanité, a proposé plusieurs fois de fuir ? Oui, lecteur, c'est bien là ce Bouffarik gros de gros souvenirs : souvenirs de mortalité, souvenirs d'horreur, souvenirs de glorieux faits d'armes, souvenirs d'héroïques dévouements, souvenirs de constance, de patience et de résignation, souvenirs de massacres, souvenir enfin du triomphe de ses anciens colons sur tant de fléaux ! Beau triomphe, en effet, triomphe admirable, dont ils ont raison d'être fiers. Rassurez-vous, lecteur : un enchantement réel a métamorphosé Bouffarik en une ville déjà gracieuse, assise sur de larges proportions, peuplée d'habitants aussi gais et aussi robustes que ceux des autres villes de l'Algérie. Embellie par une demi-ceinture de vergers variés, animée par ses ruisseaux abondants, purifiée par les saignées des desséchements, enivrée de sa résurrection, confiante dans un avenir que tout annonce devoir être très-florissant, elle se livre, joyeuse, aux travaux du commerce, de l'éducation, des bestiaux et de la culture284.
Les aposiopèses qui interrompent le récit pour montrer l’émotion au début du texte,
comme si le rappel même tenait de l’indicible, les interrogations, le rythme ternaire (« le noyau
de la peste et de l'infection, cette masse de marais putrides, ce séjour privilégié des miasmes
délétères ») : tout est fait pour peindre, dans le texte, la frayeur du lecteur, et permettre au
journaliste de poser ensuite sa voix pour peindre avec éloquence le « souvenir ». Ce
fonctionnement dialogique piégé révèle un aspect du journalisme colonial autant qu’un aspect
du territoire colonial : il faut en écrire la transformation, en signifier l’entrée dans une
temporalité linéaire orientée vers le progrès. D’où l’insistance, dans les deux textes que nous
venons de citer, pour temporaliser la description. En 1845 et 1846, la colonisation est encore
vécue comme l’avancée des armées de la conquête ; évoquer des « souvenirs », dans le titre ou
dans les textes, revient à signifier l’appropriation du territoire par les coloniaux. Dans cette
même perspective du souvenir, un poème emprunté au Courrier d’Oran et reproduit dans Le
Moniteur de l’Algérie rappelle les combats de la colonisation, et se clôt sur l’idée que c’est par
l’agriculture que la paix va pouvoir se faire : rien d’étonnant alors, si ce n’est que le texte date
de 1865. Ce poème n’est pas sans rappeler d’autres textes, qui ont alors une vingtaine d’années :
tout se passe comme si, sous la menace du royaume arabe, ces thèmes des premières années de
colonisation se perpétuaient285. C’est un texte purement idéologique, et sa portée officielle ne
fait aucun doute, puisqu’il est clairement adressé au maréchal de Mac-Mahon et sobrement
intitulé « L’Algérie ». On y retrouve l’énergie que la presse coloniale met en exergue comme
284 L’Écho de l’Atlas, 24 avril 1846. 285 Le poème de 1865 est assez semblable à un autre poème, paru le 20 avril 1842 dans Le Moniteur algérien, et dont voici la première strophe : « Vainqueurs d’Alger ! Dieu vous destine / Des périls pour l’humanité / Et de Tlemcen à Constantine / Nos puissants drapeaux ont flotté ! / Ta lutte, ô France ! est grande et pure ; / Mais il est d’autres ennemis / Les peuples, tu les as soumis ; / Il faut soumettre la nature ! / Courage ! travailleurs ! tous soldats et colons, / Semons ! plantons ! / Croissez en paix ombrages et moissons ! ».
245
une caractéristique de la vie coloniale ; on y retrouve, surtout, le motif colonial de l’épée et de
la charrue, ense et aratro :
Desséchons les marais, fouillons jusqu’aux entrailles Le sol rebelle encore ; dirigeons dans leurs cours Les ondes des torrents – gigantesques batailles Où l’homme se grandit, plus près de Dieu toujours286.
Dans ce condensé d’idéologie coloniale, la rime « entrailles / batailles » n’est pas
innocente : elle mêle le vocabulaire guerrier, et une violence certaine, au travail agricole et aux
éléments naturels (marais, torrents, sol), le tout porté par l’énergie des impératifs qui forment
la communauté coloniale. Or la presse coloniale, algérienne particulièrement, regorge de tels
textes à la portée guerrière, et qui font de la nature un champ de bataille. Une mythologie de la
terre s’esquisse ainsi, qui aura des répercussions fortes sur l’identité coloniale. L’on peut aussi
reprendre l’exemple, déjà cité, de la description de la route qui va d’Aumale à Bousaada : c’est
par le changement de territoire que se fait la défense de la colonisation.
Oui, l’Afrique me plaît ! Et son ciel est si beau, Que le cœur se dilate, et le sang sous la peau Coule mieux aux rayons d’un soleil qui féconde. Tout y mûrit : les fruits, les filles et les fleurs ; Et la pensée aussi germe dans tous les cœurs,
Plus fière et plus profonde.
J’aime l’Atlas neigeux et j’aime les palmiers, Dans la plaine sans fin levant leurs fronts altiers, Jalons au voyageur, ombrage pour le pâtre. Et quand le simoun souffle et foudroie en passant, Je regarde, là-bas, s’approcher menaçant
Le nuage rougeâtre. […]
Et ces lieux, hier encore, étaient nus, dévastés, Sauvages et déserts, sanglants de tous côtés ; Les ronces avaient crû sur ces côtes stériles. - L’industrie a passé : maintenant l’on entend Cette terre en travail, qui frémit, enfantant
Des hommes et des villes287.
On a déjà évoqué le récit du voyage fait par le prince von Puckler Muskau dès
1834 ; mais il est important de noter qu’on y trouve, au cours du récit, la mention de l’activité
du colonisateur, par exemple quand est décrite « l’énergie d’une végétation libre, sauvage mais
vigoureuse, qui annonce tout ce que l’intelligence de l’homme laborieux peut attendre de ce sol
lorsqu’il l’aura fécondé par ses travaux288 ». La publication est récente, le ton clairement
286 J. Margéridun, « L’Algérie. Au maréchal de Mac-Mahon », Le Moniteur de l’Algérie, 13 janvier 1865. 287 H.R., « Africana », La France algérienne, 27 juin 1846. 288 Al. D., « Excursion dans l’Atlas. Le prince Pukler Muskaw », Le Moniteuralgérien, 13 mars 1834.
246
idéologique : d’où cette mise en relation de l’énergie de la nature et de l’intelligence de
l’homme, d’où cet oubli momentané du voyageur pour mettre en avant une forme de synergie
entre le territoire et le colon. Et les voyages, que nous avons étudiés plus haut, sont en effet le
vecteur idéal pour mettre en avant cette domestication du territoire colonisé. Henri Feuilleret se
sert ainsi de l’abbé Poiret pour glisser une remarque sur l’évolution du territoire : « Je ne veux
pour preuve de ce que j’avance que les premières lignes du voyage de Poiret en Barbarie,
comme on appelait autrefois, avec raison, cette côte aujourd’hui civilisée289 ». Dans les années
1860, alors que la colonisation est déjà bien avancée, le voyageur peut prendre lui-même la
parole pour mettre en valeur un panorama de civilisation :
Si j’ajoute que lorsque je gravis l’une de nos montagnes, ma vue peut embrasser une partie de l’immense plaine de la Mitidja, depuis Koléa jusqu’aux anfractuosité de Cherouan ; - ici, Marengo sortant d’une ceinture de verdure ; là, la Bourkika dont on distingue les blanches maisons ; de toutes parts des formes disséminées au milieu de terrains cultivés qu’elles vivifient ; enfin, plus loin, la mer apparaissant derrière les collines qui bordent ses rivages et dont l’azur tranche, tantôt avec la couleur grise plombée d’un ciel nuageux, tantôt avec une couleur céleste plus azurée et unie, que le bleu de ses eaux en repos, lorsque le ciel est pur et serein, et vous aurez une idée, incomplète, il est vrai, des lieux qui actuellement me retiennent290.
Évidemment ces textes sont tous issus, bien qu’à des époques différentes, du journal
officiel algérien, Moniteur dont le discours est représentatif de la pensée officielle tant sur le
territoire qu’en métropole : peindre ainsi une nature domestiquée, cultivée, « vivifiée » – pour
reprendre le terme de l’extrait ci-dessus – revient à faire la publicité du territoire. On peut
ajouter à cette promotion que les voix des voyageurs ou des colonisateurs (Henri Feuilleret en
est l’exemple) ne suffisent pas forcément ; le même Moniteur a aussi recours, en 1864, à un
récit présenté ainsi :
Nous empruntons au Mobacher du 12 juin des renseignements intéressants, dus à la plume d’un indigène, sur le Hodna, dans la subdivision de Batna.
Enfant du pays, l’auteur affirme que le Hodna était l’une des plus belles contrées de l’Afrique septentrionale, alors que des eaux abondantes portaient la vie et la richesse dans ses terres d’excellente qualité. Si ce beau pays a déchu de son ancienne splendeur, c’est uniquement parce que des bouleversements du sol ont fait disparaître sous terre une notable partie de ces eaux.
Faisant bon marché d’une légende superstitieuse qu’il raconte et à laquelle le vulgaire parmi les Arabes attribue le détournement aux eaux du Bou Sellam, il rend grâce au gouvernement français des travaux qu’il a entrepris dans le Hodna pour ramener partout les eaux à la surface du
289 H.F. [Henri Feuilleret], « Étude sur les voyageurs en Algérie », Le Moniteur algérien, 21 janvier 1846. 290 « Parcours rapide d’Alger à l’Oued-Guétard ou Ravin des voleurs, et de celui-ci à Milianah », Le Moniteur de l’Algérie, 11 janvier 1866.
247
sol et rendre ainsi à ce beau pays de plaines son ancienne splendeur, attestée par des ruines romaines imposantes291.
Le tour idéologique est ici accompli, au sens où toutes les voix sont convoquées pour
donner l’image d’une nature domestiquée : le « gouvernement français » est nommé, ce qui
n’était pas le cas dans les autres textes, et c’est par la voix d’un « enfant du pays », plutôt que
d’un « indigène » que la portée bénéfique de la colonisation est affirmée. L’expression que nous
soulignons, « enfant du pays », a toute son importance dans le discours qui est mis en
place : rare, elle signale assez que la parole de l’indigène est ici reconnue parce qu’elle porte
sur un point précis, le territoire, et qu’on lui laisse faire le lien entre le passé antique et le présent
colonial.
Les naufrages : du fait divers au microrécit Quittons la terre pour la mer, élément fondamental de l’empire colonial. En contexte
médiatique, le naufrage est un fait divers ; il appartient à ces formes brèves qui rendent compte
d’un événement, d’une nouvelle quelconque, comme on peut le voir dans l’extrait suivant, qui
nous a paru représentatif d’une trame minimale :
Encore un acte de dévouement et de courage de la part de Joseph Arriot, passeur de Macouria, décoré de la médaille de première classe pour ses nombreux sauvetages.
Le 15 octobre, à neuf heures du soir, des cris de détresse se font entendre au large de la pointe de Macouria. Prévenir la brigade de gendarmerie, sauter dans une embarcation, c’est le fait d’un instant. Accompagné du brigadier Orvain et des gendarmes Jungbluth (Charles) et Georges (Jean-Pierre), Joseph Arriot s’élance, au milieu de l’obscurité la plus profonde, sur cette partie si dangereuse de la rade, pour arracher à la mort le malheureux qui demande du secours.
Enfin, après bien des luttes et des dangers, ils ramènent à terre, avec son canot coulé, le sieur Joseph Sepho, propriétaire à Montsinéry, qui avait osé s’exposer seul dans un voyage à Cayenne292.
La particularité du naufrage en tant que fait divers, cependant, tient à ses possibilités
narratives, qui en orientent le récit vers un exotisme certain. C’est que l’attirance de la littérature
pour les naufrages est ancienne, et en a élevé le récit au rang de topos, voire de corpus
particulier, ayant ses règles propres et ses auteurs : presse locale, certes, mais également revues
spécialisées et recueils forment l’arrière-plan littéraire sur lequel se détache le corpus
médiatique colonial293. En outre, le souvenir de la Méduse, naufragée en 1816, est encore
291 Ali ben Abbadi, des Ouled Mdhi, « Note sur le Hodna (subdivision de Batna) », Le Moniteur de l’Algérie, 14 juin 1864. 292 La Feuille de la Guyane française, 24 octobre 1863. 293 Voir l’article de Monique Brosse, « Littérature marginale : les histoires de naufrage », Romantisme, 1972, n° 4, p. 112-120.
248
présent à bien des esprits, véritable contre-exemple face auquel se construisent les récits
héroïques de sauvetage et dévouement294. Le naufrage, cependant, est aussi un des événements
habituels de la vie coloniale, et il faut en rendre compte. Mais c’est justement là qu’intervient
le journal et sa capacité à mettre le monde en récit : tous les naufrages ne sont pas rendus de la
même manière. On trouve, bien sûr, des entrefilets rendant compte du nom du bâtiment et des
victimes éventuelles ; mais on trouve aussi des récits plus travaillés, et qui vont chercher du
côté d’une dramatisation de l’événement. Ces récits mettent en scène la nature et le territoire
dans une perspective qui diffère des entrefilets informatifs : souvent dans ces derniers, la
tempête ou le passage dangereux sont à peine mentionnés, et sûrement pas décrits. Mais en
allant du côté des récits de naufrage présents dans la presse, on voit surgir une appréhension
des éléments naturels qui vaut une étude rapide. L’un des cas intéressants offerts par notre
corpus est celui d’un sauveteur réunionnais célèbre, Moïse Bègue, dont la renommée va
permettre une diversité de textes concernant les naufrages. Moïse Bègue est donc un marin
réunionnais des années 1870 ; il accède à une forme de célébrité en étant décoré en 1877 pour
les nombreux sauvetages qu’il a effectués, comme en rend compte Le Moniteur de la flotte295.
Mais auparavant, celui qu’on surnomme « le sauveteur » a déjà été décrit dans Le Courrier de
Saint-Pierre. Son cas illustre la manière dont circulent les textes à l’intérieur du journal, le sujet
étant traité en feuilleton ou en variété ; il illustre aussi une circulation plus large, puisque Le
Moniteur de la Nouvelle-Calédonie reprend le texte du Moniteur de la flotte à l’occasion de la
décoration296 : or le Moniteur de la flotte renvoie… au texte du Courrier de Saint-Pierre. Mais
les détails comptent, et témoignent de l’identité que les journaux construisent par les textes, et
du statut qui est donné au sauveteur et à son île. C’est en ce sens que l’on peut se livrer ici à un
travail de comparaison des textes : leur inscription dans les périodiques témoigne d’une
appréhension différente du sauveteur, et partant des éléments naturels. Les introductions sont
évidemment différentes, mais surtout le récit des naufrages varie d’un périodique à l’autre. Le
tableau suivant présente, en vis-à-vis, le récit du premier naufrage où Moïse Bègue s’est
illustré : Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, puisqu’il reprend Le Moniteur de la flotte,
reconnaît avoir tiré le texte d’un périodique réunionnais.
294 En janvier 1865, dans les variétés du Moniteur de l’Algérie, on trouve ainsi « le dernier mot sur le naufrage de la Méduse » par Ab. Rolland ; le naufrage a eu lieu en 1816. 295 Il marque à ce point la mémoire réunionnaise qu’il a une rue à son nom, et surtout un bateau : la vedette de sauvetage SNS 232 Moïse Bègue. 296 Numéro du 22 août 1877.
249
Courrier de Saint-Pierre
26 juillet 1870
Moniteur de la Nouvelle-Calédonie
22 août 1877
Le 1er juillet 1857, Moïse Bègue fit son premier sauvetage. Il était minuit : la mer était calme et les lames venaient briser doucement sur les récifs. Le bateau de côte l’Anasthénie, commandé par le patron Ferréol et signalé depuis l’après-midi courait des cordées devant l’entrée du bassin et attendait le jour pour entrer dans la passe. Rien ne faisait prévoir un malheur et tout le monde dormait à la Terre-Sainte, lorsque tout à coup des cris lugubres se firent entendre au large du côté de la jetée Est qui n’était point encore terminée. Rien n’est sinistre comme l’appel désespéré de naufragés, retentissant au milieu du silence de la nuit. En un instant, tous les pêcheurs de la côte avertis par les douaniers de garde, étaient sur pied et mettaient à l’eau leurs pirogues. Moïse réveillé par son oncle David Bègue arriva avec lui le premier auprès de l’Anasthénie qui venait de couler à fond et put recueillir deux matelots qui se trouvaient très au large, soutenus par une barrique à la surface de l’eau. Les autres matelots furent sauvés par d’autres pirogues ou parvinrent à gagner la côte sur un panneau. Un petit noir, mousse à bord de l’Anasthénie et auquel personne ne songeait, fut aussi recueilli par le pêcheur Paul-Émile Hoarau, au moment où il était sur le point de se noyer.
Le 1er juillet 1857, il fit son premier sauvetage. C’était la nuit. La mer était calme. Le bateau de côte l’Anasthénie, commandé par le patron Ferriol, avait été signalé dans la soirée ; rien ne faisait présager un malheur et tout le monde dormait à la Terre-Sainte, lorsque tout à coup des cris lugubres se firent entendre du côté de la mer. En un instant tous les pêcheurs de la côte, avertis par les douaniers de garde, étaient sur pied et mettaient à l’eau leurs pirogues. Moïse, réveillé par un de ses parents, David Bègue, arriva le premier avec celui-ci auprès de l’Anasthénie, qui venait de sombrer. Ils purent recueillir deux matelots qui se trouvaient très au large, soutenus par une barrique à la surface de l’eau. Les autres matelots furent sauvés par d’autres pirogues ou parvinrent à gagner la côte sur un panneau.
L’extrait du Courrier de Saint-Pierre est plus développé que ce qu’en tire le Moniteur
de la Nouvelle-Calédonie ; surtout, il dramatise bien davantage le récit, et en fait réellement un
segment de narration dramatique. Les ciseaux du rédacteur ont coupé et retravaillé un
développement sur la description de la mer la nuit (« Il était minuit : la mer était calme et les
lames venaient briser doucement sur les récifs ») ; ils ont coupé un moment de pause au présent
de vérité générale : pas de réflexion sur le fait que « rien n’est sinistre comme l’appel désespéré
de naufragés, retentissant au milieu du silence de la nuit » ; pas non plus de détail final sur le
petit mousse qui manque de se noyer. Pourtant ces trois passages orientent le texte vers une
écriture romanesque caractérisée par une attention aux détails formant la scène, et une volonté
de mettre également en pause le récit pour viser à une forme de généralité. Plus largement, le
récit des naufrages permet de décrire à la fois une nature dangereuse et des héros de la société
250
coloniale, porteur des valeurs que la presse coloniale veut mettre en avant : courage et solidarité,
mais aussi prudence et adresse. D’où la mise en mots d’un suspense qui se joue dans la mise en
paragraphe : il est facile de faire de ces nouvelles un récit prenant. Dès 1835, dans Le Moniteur
algérien, on lit de telles mises en texte de l’angoisse :
Vingt-quatre hommes furent ainsi arrachés à la mort. Mais pour obtenir ce résultat, il avait fallu des efforts surhumains ; lutter contre la mer, rester exposé à la grêle et à un vent impétueux, avec des vêtements trempés. Force fut à tous de se traîner aux tentes des Bédouins, pour y prendre un peu de repos. Personne ne se sentait la force de courir au secours du troisième navire. Ce bâtiment était le brick autrichien el-Rio de 360 tonneaux297.
La mention tardive du nom du bateau participe à cet effet de suspense pour le lecteur.
Et, plus loin :
La violence des vagues, les débris de toute sorte qui se jetaient vers la plage, rendaient l’abord du navire impossible. Le soir arriva : on fut obligé de quitter la plage. La mer augmentait et avait gagné le haut du bâtiment ; les malheureux qui le montaient étaient dans l’eau jusqu’à la ceinture ; deux fois la jeune femme se laissa tomber dans l’eau par l’excès de la fatigue, deux fois l’un des matelots du bord put la sauver.
Pendant la nuit le bâtiment fut mis en pièces, et coula à fond. Six matelots morts furent portés sur la plage par les vagues ; cinq
autre, le capitaine et les deux femmes, furent ensevelis sous les débris du brick298.
Ici, l’isolement de la phrase qui rend en deux verbes la perte du navire signale la fin du
récit : le paragraphe suivant, redondant en quelque sorte, reprend une tonalité propre à la
nouvelle – le décompte macabre des victimes y participe. Cependant, l’Algérie n’est pas le
territoire le plus marqué par les textes de naufrages : les traversées y sont plus paisibles que
pour les îles ou la Guyane. Ainsi, dans La Feuille de la Guyane française, à la fin des années
1840, c’est une rubrique – « traits de courage » – qui rend compte des exploits accomplis lors
de naufrages : elle apparaît épisodiquement, quand elle peut être remplie par un court texte
précisant les circonstances du sauvetage des naufragés. Certains récits demandent plus de place,
et alors le titre de la rubrique ne convient plus. C’est ce qui se produit dans l’extrait suivant : si
le premier paragraphe correspond bien à la tonalité des « traits de courage », ce qui suit
développe un autre aspect textuel.
Un de ces accidents qui malheureusement se reproduisent trop souvent sur nos côtes, par suite de l’imprudence avec laquelle certaines classes de la population s’exposent dans de frêles embarcations, vient
297 Le Moniteur algérien, 17 avril 1835. 298 Id.
251
encore d’être l’occasion d’un de ces actes de courage si fréquents chez nos militaires et nos marins.
Dans la matinée du 23 de ce mois, une légère pirogue, montée par cinq noirs, partait de la côte de Remire pour aller à l’Ilet-la-Mère ; la vente de quelques fruits et l’attrait de donner un coup de filet étaient la cause du voyage. Mais bientôt, enveloppée par les vagues furieuses soulevées par le raz de marée qui règne sur la côte, la frêle embarcation chavira et tous ceux qui la montaient furent précipités dans les flots.
Leurs cris de détresse furent heureusement entendus de l’Ilet, et le patron Raimon de la goélette l’Aurore, n’écoutant que son courage, se précipita aussitôt dans sa chaloupe avec quelques rameurs et se dirigea rapidement vers le lieu du sinistre. Il aperçut bientôt quatre de ces malheureux accrochés à leur barque, et eut le bonheur, en les recueillant, de les sauver du danger qui les menaçait. Cependant un des naufragés avait disparu… sachant un peu nager, il s’était dirigé vers les Mamelles, rochers abrupts situés à une petite distance. Aussitôt le sapeur Reynier de la 21e compagnie qui, lui aussi, accourait dans une petite pirogue à leur secours, comprenant la dangereuse position de ce malheureux, force de rames pour lui venir en aide, s’il en est temps encore. Le succès couronne son courage, et bientôt il voit le pauvre noir accroché par les mains au rocher battu par une mer furieuse, et poussant des cris de détresse. Au risque de briser son frêle canot, Reynier le lance vers le rocher, et saisissant rapidement ce malheureux, il parvient à l’arracher à une mort certaine. Bientôt après les deux patrons ramenaient à l’Ilet les naufragés qui leur devaient la vie !
Mais ici, une autre scène non moins touchante les attendait. Ces pauvres gens avaient tout perdu. Ils étaient tout meurtris, accablés de fatigue. Aussitôt chacun s’empresse de les soulager ! Celui-ci leur apporte des provisions, celui-là leur offre des vêtements ; une collecte s’organise par les employés pour leur fournir de quoi réparer leur désastre. Mais, ce qu’il y a de mieux, les transportés demandent à être autorisés à prendre part à cet acte d’humanité, et bientôt le nommé Oudailler vient remettre au chef de l’établissement une somme de 30 fr. 15 cent. recueillie parmi ses camarades !... Que de réflexions fait naître une pareille action299 !
Le récit respecte certains attendus du naufrage : une mise en suspense accompagne le
jugement moral, et le présent de narration renforce encore cette impression. Quelques éléments
instaurent une forme de suspens dans l’action par le biais de la ponctuation : « Cependant un
des naufragés avait disparu… sachant un peu nager, il s’était dirigé vers les Mamelles, rochers
abrupts situés à une petite distance » ; le reste de cette anecdote enchâssée au sein du récit
conserve cette même tension jusqu’au sauvetage final. Une forme de métadiscours permet
d’ailleurs de voir à quel point le narrateur est conscient de son écriture, puisqu’il évoque la
« scène touchante » lors du retour à terre. C’est que le naufrage est aussi l’occasion de montrer
une colonie où les éléments vivent en harmonie : transportés, militaires, noirs s’entendent et
dressent le portrait d’une colonie apaisée, en contraste avec les éléments naturels, avec cette
« mer furieuse » qui joue contre eux.
299 La Feuille de la Guyane française, samedi 31 mars 1855.
252
Autre territoire, autre type de texte pour rendre compte du même type d’événement : Le
Messager de Tahiti en 1870 publie le récit du naufrage de la Clarissa en deuxième page ; le
texte ici a pour mission de remplir les pages, de dramatiser, non d’informer. C’est ce que l’on
voit dès le premier paragraphe : « Mercredi le trois-mâts guatémalien Clarissa appareillait de
Papeete pour se rendre à Papeari, où il devait prendre un chargement d’oranges pour la
Californie ; mais un fatal événement devait l’arrêter au début de ce voyage300 ». Le récit se fait
ensuite précis, donnant les heures auxquelles ont été effectuées les manœuvres ; puis, passant
au présent de narration, jouant des effets d’isolement que permettent les paragraphes, le récit
détaille les réactions de l’équipage. Est ainsi isolée la phrase suivante : « Le pavillon est mis en
berne à midi 55 minutes », qui signale le basculement du récit, et la destruction progressive du
navire. Ménageant la précision technique et la mise en suspense, le rédacteur du texte écrit en
effet : « Rien n’est encore absolument perdu, mais bientôt la Clarissa commence à talonner de
l’arrière ; la chaîne de bâbord casse, l’avant tombe sur le tribord, et le cap vient au S.S.E301 ».
Enfin, après avoir décrit les ultimes péripéties du naufrage, et le sauvetage des passagers, des
vivres et des bagages, le texte se conclut par un retour sur lui-même : « Telle est la relation
succincte de la perte de ce pauvre navire, qui est venu finir au point même où, il y a huit ans, a
péri le transport Infatigable302 ». « Relation succincte », certes, au sens où le récit a été bref et
circonstancié ; cependant, la mise en récit du naufrage ne s’est pas limitée aux détails
maritimes : s’y fait jour une manière de décrire l’événement qui dramatise le récit, le tend.
L’équilibre entre précision technique et mise en suspense témoigne d’une volonté : celle de
rendre lisible le texte pour le lecteur du Messager de Tahiti. Enfin, dernier élément du corpus
que nous présentons, le récit de naufrage peut aussi se faire à la première personne, et affirmer
ses liens avec le journal : ainsi du récit que fait paraître J. M. Mac-Auliffe, chirurgien de marine,
qui écrit à Trollé, rédacteur du Travail réunionnais, pour lui conter le naufrage du Dot303.
Pourquoi représenter des naufrages ? Pour donner aux lecteurs des journaux une
impression de sécurité face à la mer, pour édifier aussi les colonisateurs par la lecture d’actes
héroïques ? Un rapport à la terre se joue paradoxalement dans ces récits de naufrage : la côte
apparaît bien comme un refuge par rapport à l’océan, à l’élément liquide terrifiant. Le constat
peut sembler anodin ; mais peut-être ne l’est-il pas tant. C’est qu’il semble bien que la
300 « Naufrage de la Clarissa », Le Messager de Tahiti, 12 mars 1870. 301 Id. 302 Id. 303 J.M. Mac-Auliffe, D.M. Chirurgien de 1e classe de la marine, « Le Naufrage du Dot », Le Travail, 18, 21, 25 et 28 mars 1874. Le ton particulièrement amical de la lettre, ainsi que la publication elle-même, s’expliquerait par des liens de famille : Trollé serait le beau-père du chirurgien de marine.
253
représentation de la mer comme danger, et corollairement de l’île comme refuge, tient à une
conception occidentale des éléments, à une conception française même : la perception de
l’insularité se révèle en fait, d’après Patrick Chamoiseau, dominée par une vision occidentale
qui fait de la mer une barrière, là où les Caraïbes la voyaient comme un espace ouvert304. Si
l’on s’appuie sur ces représentations orientées d’un même espace, l’on perçoit en effet à quel
point le récit de naufrage participe d’une construction du territoire entendu au sens large.
3.3 Toponymes et description : l’aboutissement du territoire
On a vu dans une première partie que les titres mêmes des périodiques pouvaient faire
place à l’affirmation d’un lien avec le territoire sur lequel ils paraissaient. Mais la représentation
de l’espace – et son rôle au sein des constructions médiatiques – ne se limite pas au titre ou aux
textes liminaires : se développe une image du territoire qui passe par des moyens textuels plus
qu’iconographiques, qui textualise le territoire. C’est dans ce cadre qu’Alger devient par
périphrase « la deuxième capitale de la France305 » au hasard d’un feuilleton sur son
carnaval ; c’est dans ce cadre qu’on apprend que « Port-de-France n’est plus, Vive
Nouméa306 ! » : plusieurs occurrences semblables mettent en scène les enjeux d’une
désignation du territoire colonisé, entre attirance métropolitaine et revendication d’une langue
qui sait utiliser les mots indigènes. Cette problématique liée aux premiers temps d’occupation
se retrouve aussi dans L’Océanie française, où l’on lit dans le dixième numéro : « Comme il
convient de conserver l’orthographe indigène pour les noms propres et les noms de lieux, à
l’avenir, au lieu de Taïti et Papeïti, nous écrirons Tahiti et Papeete307 ». Nous sommes alors en
juillet 1844, et les tensions sont encore vives entre Anglais et Français au sujet du protectorat
récent que la France vient d’établir : préciser un respect de l’indigène, même par un point aussi
minime que l’orthographe en français, peut valoir comme l’affirmation d’une appropriation du
territoire308. C’est que le toponyme, loin d’être anodin dans le contexte colonial, est porteur au
contraire d’une force esthétique et idéologique forte : Fort-de-France, comme Philippeville,
comme Nouméa309, témoignent d’ancrages locaux différents et de perspectives différentes que
304 Patrick Chamoiseau, op. cit., p. 240. 305 A.B., « Le Carnaval à Alger », La France algérienne, 25 février 1846. 306 A. Le Boucher, ancien régent de sixième du collège d’Évreux, « Port-de-France n’est plus. Vive Nouméa ! », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 17 juin 1866. 307 L’Océanie française, 7 juillet 1844. 308 Le protectorat est établi le 6 novembre 1843. 309 Fort-de-France s’appelle ainsi depuis 1807 ; Philippeville, aujourd’hui Skikda, est nommée ainsi en 1838 ; Nouméa enfin prend ce nom en 1866.
254
la presse met en avant. C’est d’ailleurs ce dont traite Louis-Jean Calvet dans Linguistique et
colonialisme, quand il invente le concept de « glottophagie » ; il traite ainsi de l’importance de
la toponymie dans l’appropriation linguistique, donnant comme exemple Ferryville en Algérie,
devenue Menzel Bourguiba310. Ces appropriations toponymiques ne sont pas à négliger : elles
expliquent, par exemple, la longue publication dans Le Mobacher, au cours de l’année 1875,
d’une « Géographie ancienne de l’Algérie311 » qui se donne pour but de rechercher les
emplacements exacts décrits chez les auteurs latins.
De plusieurs noms : une polyphonie géographique ? L’attitude que les auteurs de la presse coloniale adoptent vis-à-vis des toponymes reflète
une problématique plus large, qui est celle de l’histoire du territoire colonial. Se dégagent
plusieurs perspectives ; et la première est celle de la tradition perdue ou malmenée. Prenons ici
deux exemples : le premier concerne le fort des Vingt-Quatre-Heures, que nous avons évoqué
plus haut. Dans le premier article concernant le martyre de Géronimo, Adrien Berbrugger
évoque « un fort [que le pacha] faisait élever hors la porte Bab-el-Oued, celui que nous appelons
aujourd’hui (on ne sait pourquoi) le fort des Vingt-Quatre-Heures312 ». L’ajout des parenthèses
permet le commentaire du toponyme et l’établissement d’un mystère lié au passé, le tout rendu
marquant par l’intervention d’une voix savante, frustrée par un manque d’explication. La
mention intervient en cours d’article, et pas au début : la réalité donnée, celle du fort, ne pose
pas question auparavant. D’autres savants se penchent, moins incidemment, sur la
toponymie : Berbrugger est le conservateur de la bibliothèque et du musée d’Alger ; mais
Albert Devoulx, que nous citons maintenant, est le conservateur des archives arabes, et se
prévaut d’une meilleure connaissance de la langue. On comprend mieux alors ce passage de
son « Enlèvement d’un pacha par les Kabyles » dans lequel il commente un manuscrit arabe :
Rappelons d’abord que Tamentefous est le cap Matifou, et que l’ancien royaume de Koukou – appelé Cudo par les auteurs espagnols et Cauque par les trafiquants marseillais – correspondait à peu près à la confédération naturelle des Zouawas. […] Ne serait-il pas préférable de supposer que l’auteur indigène a commis une erreur et que l’endroit indiqué par lui est en réalité Tamgout, aujourd’hui crique de Mers-el-Feham (port au charbon) qui servait autrefois de port au royaume de Koukou313 ?
310 Louis-Jean Calvet, Linguistique et colonialisme, Paris, Payot, 1974, p. 105. 311 L.R., « Géographie ancienne de l’Algérie », Le Mobacher, à partir du 31 janvier 1875. 312 A. Berbrugger, « Le martyr du 18 septembre 1569 », L’Akhbar, 5 octobre 1847. Republié : Le Moniteur algérien, 30 décembre 1853. 313 Albert Devoulx, « Enlèvement d’un pacha par les Kabyles », Le Moniteur de l’Algérie, 28 avril 1866.
255
Plus tard dans le texte, il commente cette fois du document français, un Précis historique
portant sur le même événement : « il est évident que Ténez figure par erreur dans le récit de M.
Rang au lieu de Tédelès, forme berbère du nom de Dellys ». Plusieurs assertions semblables
indiquent assez l’enjeu de la toponymie dans le récit que fait le savant d’une colonie qui se
revendique déjà bien enracinée sur le territoire algérien – puisqu’on est alors en 1866. La même
question se pose à propos du toponyme Alzéjaïr, quelle que soit la forme sous laquelle on
l’écrit : comment les journalistes coloniaux utilisent-ils ce toponyme, remplacé par Alger en
langue française ? Ce peut être dans la perspective de l’histoire antécoloniale, comme on le voit
dans un extrait des « Mystères de Constantine » qui paraissent en 1846, et qui malgré leur titre
alléchant n’ont rien à voir avec la vogue des mystères urbains : l’auteur s’en défend dans les
premières lignes, et développe ensuite une histoire de la ville de Constantine. Il y évoque alors
Tunis et Alger sous des orthographes arabisantes :
Constantine, sous la domination des rois de Thunes ou Tunis, maîtres audacieux et déprédateurs excessifs, qui pratiquèrent la piraterie longtemps avant que Al-Djezaïr, sous la domination arabe, y songeât ; Constantine, dis-je, sous ce gouvernement, fut toujours turbulente, et les Tunisiens se virent obligés de fortifier la citadelle et de s’y retirer, craignant les habitants314.
C’est dans cette perspective historique qu’Augustin Marquand utilise l’expression des
« pirates d’Al-Djézair » dans son article sur « Alger Nouveau » qui paraît en 1866 : il s’agit de
désigner la ville à une époque qui n’est pas celle de la colonisation française. Mais Alzéjaïr, ou
Al-Dejezaïr, permet d’autres jeux avec le territoire que la simple perspective historique, et son
emploi peut également signaler une approche être comique et parodique : ainsi du Brûlot de la
Méditerranée se moquant de la disparition de L’Afrique française.
Pleurez, filles d’Alzéjaïr la victorieuse, pleurez ! Ma fille la plus chère, le sang de mon sang, la chair de ma chair, mon espérance, mon avenir, tout est mort, tout est fini !
L’Afrique française a cessé de paraître, comme l’a dit triomphalement l’Akhbar, cet autre vieux qui n’a pas eu une seule larme à verser sur le désespoir d’un vieux315 !
Le registre épique ainsi détourné justifie l’utilisation du toponyme qui évoque le passé
de la ville ; et le ton hyperbolique de l’article s’accorde ici avec le burlesque : Alzéjaïr, c’est le
refus d’Alger la moderne et l’affirmation d’Alger « la victorieuse », la ville du passé. Le
Chitann, journal algérois satirique des années 1860, renforce cette analyse ; un feuilleton
portant sur le tombeau de la chrétienne commence ainsi : « Déjà El-Djézaïr aux blancs minarets,
314 E.N., « Les Mystères de Constantine », La France algérienne, 4 février 1846. 315 Le Brûlot de la Méditerranée, 3 septembre 1849.
256
comme l’appelait je ne sais quel verreux de ma connaissance, disparaissait dans le
lointain316… ». La publication d’un texte de 1874 intitulé La Déjézaïriade, et sous-titré
« Histoire analytique, comique, anecdotique et commerciale de l’Algérie depuis les temps les
plus reculés jusqu'au jour de la conquête d’Alger par les Français317 », par un ancien capitaine
de l’armée d’Afrique, ex-adjoint du bureau arabe de Mascara, confirme cette appropriation de
Djézaïr dans la littérature coloniale des premières décennies de colonisation. La veine comique
n’est pourtant pas la seule exploitée : la trace de la polyphonie linguistique originelle apparaît
dans ces textes et se mêle à une perspective historique qui fait du toponyme bien plus qu’une
simple indication. Ainsi, quand Le Chitann publie en vers la chanson supposée d’un Reïs,
chanson qui n’est pas humoristique, deux expressions se succèdent, qui rendent compte de la
dichotomie coloniale : d’abord « Connaissez-vous Alger la blanche ? » introduit une
description personnifiant Alger en belle orientale alanguie ; puis le ton change : « Le flot qui
vient mordre la grève / D’Aldjezaïr / Est déchiré par les carènes / De ces chrétiens / Qui
ployaient le cou sous nos chaînes, / Chiens, fils de chiens318 ! » Le jeu sur les toponymes est
intéressant, parce qu’il rend compte d’une autre tension encore que celle que l’on pouvait
observer dans les exemples donnés jusqu’ici : Alger la coloniale s’oppose à Aldjezaïr
l’orientale. Dernier aspect enfin des enjeux qui signalent Aldjézaïr, la question de l’étymologie
signale une mainmise sur le passé du territoire. En 1862, Le Moniteur de l’Algérie rend compte
de l’origine du nom d’Alger, et la tournure généralisante employée dénote une volonté
ethnographique et un racisme reposant sur l’absence de connaissances positives concernant
l’Algérie :
À défaut de connaissances en archéologie et en histoire, l’Arabe possède une imagination féconde, qui lui permet de broder des légendes merveilleuses sur la fondation, l’origine ou les ruines des cités qui s’élèvent sur le sol algérien ou jonchent la vieille Mauritanie. Presque toutes les villes arabes et les débris des monuments latins ont leur roman ou leur drame dans l’esprit crédule et borné de l’indigène.
Aucune légende, que je sache du moins, n’a cependant attribué à Alger une origine fantastique ou merveilleuse. Les chansons populaires du pays l’appellent simplement du premier nom qu’elle a porté du temps des naturels : El Djezaïr-Beni-Mazarhanna, ce qui signifie Les îlots des Enfants de Mazrhanna. À l’époque des Turcs, on l’avait surnommée la guerrière, la bien gardée, probablement à cause de ses janissaires, de sa position et de ses remparts crénelés et fortifiés. En effet, le dernier des Dey la croyait imprenable ; mais les soldats français
316 « Au tombeau », Le Chitann, 3 juin 1866. 317 Nicolas Legié-Provançal, La Déjézaïriade, Vichy, C. Bougarel, 1874. 318 Walt’her, « Le chant du Reïs », Le Chitann, 19 août 1866.
257
lui prouvèrent le contraire en s’en emparant en 1830, sans subir beaucoup de pertes ni surmonter de grands obstacles319.
Sur ce stéréotype d’un caractère indigène définissant en creux le caractère colonial, féru
d’archéologie et d’histoire, le journaliste peut développer en contrepoint la méthode rationnelle
d’étiologie : la voix coloniale qui se développe ici, assurée, est celle d’une explication
englobante qui ne décrit que pour ancrer l’idéologie coloniale. Cette volonté d’expliquer le
passé par la toponymie n’est pas nouvelle et ne concerne pas qu’Alger. On en lit quelques traces
dès les années 1840, par exemple entre les lignes d’un article qui rend compte de la
commémoration du débarquement de Sidi-Ferruch : dans L’Akhbar en 1849 paraît une
évocation de « la légende du marabout Sidi-Feredj. (Les Français en ont fait Sidi-Ferruch, sans
doute par euphonie320) ». Les parenthèses signalent bien un décrochement du discours,
décrochement renforcé par la mise à distance des « Français » : le journaliste se place ainsi dans
une position intermédiaire, entre la langue arabe et la langue française. Cette polyphonie peut
aussi, à l’occasion, devenir la trame d’un récit, l’origine d’une anecdote, et occuper la place du
feuilleton :
On voit près de Tlemcen, dans les plis du ravin qui serpente au pied du Mansourah, les ruines d’un vieux fort appelé Boedj el Kelb ou le Fort du Chien. Voici ce qu’on raconte à propos de l’origine de ce nom singulier.
C’était au commencement de l’année 998 de l’hégire (vers 1580 de notre ère321).
À l’exploration des origines du nom répond ici une adaptation à la temporalité locale,
comme le montre l’effort de dater à partir de l’hégire. L’effort étiologique que montre le
narrateur du récit exprime assez la connaissance du territoire, de la langue, de l’histoire de
l’Algérie : le toponyme est alors bien le vecteur d’une emprise coloniale, et c’est le cas dans
tous les extraits que nous avons cités ici.
Le toponyme en appelle aussi, dans l’utilisation coloniale, à la notion de
« trace » : quelques traces historiques subsistent dans les dénominations que conservent les
cadastres coloniaux. Mais le toponyme n’est pas qu’une affirmation par rapport à la langue
locale et au territoire colonial : c’est aussi une affirmation par rapport à Paris. On peut le voir à
travers quelques cas très précis : l’importance du toponyme est telle que, dans un article du
Brûlot de la Méditerranée que nous avons cité plus haut, le « premier-Paris » est remplacé par
319 « Arabesque. Les légendes arabes sur l’origine des villes », Le Moniteur de l’Algérie, 11 février 1862. 320 « Sidi-Ferruch, une légende et un procès-verbal », L’Akhbar, 24 juin 1849. 321 « Le Fort du chien (Bordj el Kelb) », L’Écho d’Oran, 30 septembre et 6 octobre 1848.
258
la mention de « premiers Alger322 ». L’auteur imaginant sa retraite continue sur le ton
humoristique qu’il avait commencé à employer : « Là, je ferai des premiers Alger, que personne
ne lira ; là, nous fonderons un papier-monnaie, qui servira à satisfaire nos besoins ; de là nous
contemplerons en paix l’affreux cataclysme qui va bientôt engloutir l’Algérie désolée323 ».
Cette invention toponymique n’est pas fréquente ; pour autant, elle ne constitue pas un hapax,
et n’est pas non plus limitée au cadre parodique. On trouve d’autres traces de ces appropriations
de la terminologie médiatique : ainsi du Commercial guadeloupéen, dans son numéro du 11
novembre 1848, à l’occasion d’une peinture de la presse martiniquaise réagissant aux premiers
temps de l’abolition de l’esclavage. On lit ainsi :
Le Courrier de la Martinique a reçu la nouvelle avec calme et dignité, chez Les Antilles il n’en a pas été de même. Ils ont perdu la tête, ils ont divagué. Ainsi, les rédacteurs dans leur premier St-Pierre commencent par nous déclarer que le rappel du commissaire général n’est dû qu’aux calomnies du Constitutionnel, des Débats, de la Presse et des journaux du Havre324.
On est ici dans un contexte explicitement resserré à une problématique médiatique : la
mention des autres titres va dans ce sens. Ces premières remarques visent à faire naître l’image
d’une presse très attentive aux toponymes qu’elle utilise : qu’ils soient empruntés à la langue
locale ou pas, qu’ils soient revendiqués ou utilisés pour afficher une tonalité comique, les lieux
coloniaux apparaissent comme des nœuds particuliers où se joue l’identité coloniale à travers
la presse. Mais si ces deux premiers toponymes sont bien ceux d’une colonisation francophone,
d’autres territoires peuvent poser des problématiques particulières : il en est ainsi de la
Nouvelle-Calédonie. Durant son « Aperçu historique sur la tribu des Houassios ou des
Manongôés325 », un collaborateur du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie précise en note
l’origine de quelques toponymes :
Connu aussi par les Européens sous le nom de Kodiétrokoi, contrefort assez escarpé qui sépare les vallées arrosées par la Siombeba et la Tamoa.
Cocétolo, casser ; coi, cou : montagne casse-cou, ainsi appelée parce qu’une femme surprise en flagrant délit d’adultère et voulant éviter la vengeance de l’homme trahi, se rendit au sommet de Cocétolocoi et se tua en se précipitant en bas. Cet exemple fut suivi, dit-on, par les canaques décidés au suicide326.
322 L’expression, sans être utilisée systématiquement, est cependant courante dans la presse algérienne. 323 Le Brûlot de la Méditerranée, 3 septembre 1849. 324 Le Commercial, 11 novembre 1848. 325 A. Mathieu, « Aperçu historique sur la tribu des Houassios ou des Manongôés », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 12 janvier 1868. 326 Ibid. Une note manuscrite, ancienne, précise dans la marge du recueil des Archives Nationales d’Outre-Mer : « interprétation imbécile ».
259
Dix années plus tard, le géologue qui décrit les sentiers parcourus se livre à une même
explication des toponymes, mais par un biais qui lui laisse plus de possibilités pour le
commentaire :
Lorsque du mouillage de Gomen on regarde sur la droite des Monts Kaala en suivant des yeux les crêtes qui forment un rideau dans le fond de Gomen, on aperçoit une montagne qui présente la silhouette d’un éléphant ; les canaques donnent à cette montagne le nom de Tchiongopau. Or, s’il est bon de conserver les noms indigènes lorsqu’ils sont harmonieux et faciles à retenir, celui-ci ne nous paraît pas dans ce cas327.
Le géologue qui se livre ainsi à la description du paysage apporte un soin particulier aux
toponymes, et avec une désinvolture concernant les noms indigènes qu’il conservera par la
suite : la condescendance du savant colonial, dictée par le sentiment de domination sur le
territoire, apparaît ici clairement. Plus loin dans son texte, mentionnant son guide kanak, il
précise que ce dernier lui fait noter tous les « endroits remarquables », et conclut : « un trou,
une roche, une place, tout avait son nom, mais je vous en fais grâce, car, de ces noms, il y en a
que je n’ai pu transcrire avec moins de dix-huit ou dix-neuf lettres ». Cette première attitude
face à la toponymie kanak est complétée par une autre manière de commenter l’explication
locale, comme en témoigne ce passage :
Toujours plein de zèle, mon guide m’arrêta dans la forêt, au milieu du col, et, me montrant une pierre, il me dit : « C’est Caourraouk, la pierre qui a crié ». Il y a des années Coungnha était en guerre avec Hyenghène à propos d’un enlèvement ; pendant le combat, un cri s’éleva dans la montagne, les canaques de Coungnha comprirent qu’ils n’étaient pas les plus forts et l’on cessa les hostilités ; c’était la pierre qui avait jeté ce cri, voilà ce que dit la légende. C’est là un procédé ingénieux pour sauvegarder devant l’histoire la responsabilité du chef qui a enterré la sagaie dans le sentier de la paix328.
Cette parole scientifique qui commente le discours kanak et l’évalue ne se retrouve pas
dans la presse des autres territoires coloniaux : en Cochinchine, les toponymes ne font pas
débat, et sont transcrits sans que le commentaire soit nécessaire. Face à un territoire dont il faut
s’approprier les toponymes, la presse coloniale envisagée comme un ensemble publie donc
différents textes, marqués par différentes postures : on retrouve bien ici la construction de
l’autre, de l’indigène, passant par une implication du « même », autrement dit de l’auteur de
presse valant pour symptôme de la colonisation.
327 F. Ratte, « Sentiers canaques. De Gomen à la côte Est (Nord de la Nouvelle-Calédonie) », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 13 novembre 1878. 328 Id.
260
Une approche visuelle de la distance : cartes et plans
Lorsque Sydney Daney est publié dans Le Courrier de la Martinique pour son histoire
des débuts de la colonisation en Martinique, il commence par décrire une carte :
Lorsqu’on jette les yeux sur la carte géographique du Nouveau-Monde, le regard est involontairement attiré par l’aspect de cette large échancrure qui sépare le continent du nord de celui du sud, unis seulement par l’isthme étroit de Panama, et la vue se porte avec curiosité sur cette traînée curviligne et obéissant à l’inclinaison de la Terre-Ferme, d’îles de toute grandeur qui commencent à l’extrémité des Florides et s’arrêtent aux bouches de l’Orénoque, comme pour relier ces parties disjointes de ce vaste et magnifique continent329.
La description de la carte constitue donc un moyen d’entrer dans l’histoire d’une partie
du monde bien éloignée de la métropole : cette remarque permet d’orienter le propos vers la
dernière partie de notre étude, à savoir le poids des cartes dans des périodiques coloniaux qui
jouent leur spécificité par ces publications annexes.
La question de l’espace, de sa représentation et de son organisation s’avérera déterminante autant pour penser les démarches de conquêtes ou de découvertes, que pour tenter de cerner le thème de l’altérité. La carte, instrument privilégié de la géographie, est le simulacre du lointain. Elle entretient avec l’exotisme un rapport paradigmatique. Elle en est à la fois le modèle et l’intouchable approche. Elle donne à voir mais non à saisir. Pour saisir, il faut partir. De ce fait, on peut avancer une étrange aporie : sans carte pas de découverte, mais sans découverte pas de carte330.
Quelques cartes surgissent parfois, en effet, dans les publications ; quelques documents
iconographiques apparaissent, mais ils sont loin d’être habituels : isolés, ils montrent cependant
les intérêts de la colonie où elles paraissent, et donnent un autre sens à la publication médiatique.
Ces cartes apparaissent, d’après nos dépouillements, dans les périodiques officiels : la
cartologie relève d’une science coloniale officielle, et les imprimeries gouvernementales sont
probablement mieux dotées que les imprimeries privées pour faire paraître de tels documents,
qui émanent en outre de commandes officielles. Ce sont bien ces titres subventionnés par le
gouverneur qui se chargent de la publicité d’une autre version de la colonie, non pas textuelle
mais iconographique. En Algérie, le 25 juin 1843, Le Moniteur algérien publie un plan de la
« zemala » d’Abd el-Kader, qui vient alors de tomber aux mains des Français. La capitale
volante de l’émir a suscité bien des fantasmes : le journal, en donnant à ses lecteurs la possibilité
d’en voir un plan, joue son rôle d’information, mais pas seulement. Cette première carte
329 Sydney Daney, « 15, 16, 17 juin 1502 ou La Martinique. Prologue », Le Courrier de la Martinique, 14 juin 1851. 330 Francis Affergan, Exotisme et altérité, Paris, Presses Universitaires de France, 1987, p. 33.
261
appartient bien à la phase de conquête que la presse coloniale peut accompagner et informer,
mais il s’y joue aussi une conquête symbolique qui n’est pas moins violente : donner le plan de
la ville, c’est affirmer la fin d’un mystère, et la réduction d’un terme fort à une réalité dénuée
de rêverie. Ce plan de la « zemala » explique une particularité algérienne ; dans d’autres
périodiques, d’autres problématiques spécifiques aux territoires colonisés apparaissent. Ainsi,
dans La Feuille de la Guyane française, le rédacteur publie, le 25 juin 1859, l’extrait d’une
carte dessinée par M. de Saint-Quantin, directeur des ponts et chaussées331, pour préciser ses
frontières avec le Brésil ; après cette carte, le lecteur trouve une « Cartologie de la Guyane
française » prise dans la France coloniale et maritime et signée G. Lejean. C’est que les
frontières de la Guyane française n’ont été que difficilement fixées : l’enjeu est ici moins
symbolique qu’en Algérie, mais il témoigne tout de même d’une volonté de réduire le territoire
aux portions d’une carte insérée dans un périodique. Derrière le tracé des frontières guyanaises
peut aussi se lire la présence des populations d’anciens esclaves marrons. On peut d’ailleurs
noter que dans la « Cartologie de la Guyane française332 », l’auteur commence par évoquer le
nom de la Guyane : c’est par le toponyme que le lecteur doit entrer dans la géographie coloniale,
mais c’est par la carte que se matérialise l’obsession coloniale pour les limites et les tracés du
territoire. Tracer les frontières du territoire livre aussi une vision économique du territoire : la
Guyane se révèle en territoire à exploiter.
Troisième exemple de ces publications iconographiques, Le Courrier de Saïgon publie
en 1864, dans son dixième numéro, un grand plan de la ville, et dont l’explication donnée est
la suivante : la ville de Saïgon est une « image en raccourci de toute la colonie333 ». Quelques
années plus tard, le journal publie aussi, la carte de la vallée du Mékong : le 5 août 1867, elle
participe de l’actualité coloniale autant que de la bonne saisie du territoire. Les relevés ont été
faits dans l’année précédente : il s’agit bien d’une mission d’information autant que de
représentation. Ce périodique publie enfin, le 20 juin 1870 et en première page, une carte
intitulée « plan de la baie de Sandakan levé par les officiers de la corvette italienne Princesse
Clotilde » : cela participe de ce même mouvement colonial d’exploration, mais qui a changé
331 Un certain Édouard de Saint-Quantin est l’auteur d’un poème intitulé « Imitation de Delille » et paru dans La Feuille du 20 septembre 1856. Le nom de famille, Saint Quentin ou Saint Quantin, est celui d’une famille implantée en Guyane depuis quelques générations alors. Sur la famille Saint-Quantin, ou Saint-Quentin : Catherine Le Pelletier, Littérature et société : la Guyane, Matoury, Ibis rouge éditions, 2014, p. 59-62 particulièrement. Elle précise aussi qu’Alfred et Auguste de Saint-Quentin ont publié une Introduction à l’histoire de Cayenne suivi d’une Etude sur la grammaire créole (p. 11). 332 G. Lejean, « Cartologie de la Guyane française », La Feuille de la Guyane française, 25 juin 1859. Pris dans La France coloniale et maritime. 333 10 mai 1864.
262
d’échelle et d’enjeu. Alors que le premier plan avait un intérêt immédiat et pratique pour le
lectorat, le deuxième joue sur d’autres ressorts et ressortit aux connaissances géographiques,
tout comme le troisième : le fait que cette dernière carte soit due à des officiers italiens donne
à percevoir une expansion européenne en mouvement. L’exploration coloniale se fait ici en lien
avec les autres puissances européennes. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, Le Moniteur publie le 8
mai 1864 dans son supplément une carte de la côte est, sur la partie portant entre Kanala et
Touho. Dans le même numéro paraît une « Expédition de Monéo, de Mou et de
Pounérihouen » : l’on en est encore au stade de la mise en carte de l’île, de sa découverte ; une
autre carte, là aussi d’occasion, est publiée l’année suivante, pour aider à la compréhension
d’une expédition militaire334. Mais ce ne sont que des fragments, et ce n’est que le 24 mars 1880
qu’est publiée une variété portant sur la « construction de la carte de la Nouvelle-Calédonie ».
C’est un texte narré à la première personne ; ce n’est que quatre mois plus tard, le 21 juillet,
qu’est publiée la carte à proprement parler. Le journal montre que la prise de possession du
territoire s’effectue sur le long terme : ce qui est offert au lectorat en termes de connaissance du
territoire est d’abord passé par les récits d’exploration, les faits divers, les nouvelles issues des
différentes communes de l’île, avant d’aboutir à un tracé offert à la publicité médiatique.
Transition : la colonisation, du territoire au peuple
Le territoire est bien l’un des enjeux majeurs de la presse coloniale locale, et un enjeu
qui construit l’identité coloniale : par ces textes quotidiens et divers se manifestent différentes
problématiques, qui toutes tendent à créer une relation entre le lectorat et son environnement.
La manifestation de la distance, les jeux de découverte et de description, l’importance de la
scénographie auctoriale participent à ce même mouvement général : inventer l’appropriation du
territoire par et pour les colonisateurs, trouver une manière d’écrire une territorialisation de
l’identité littéraire. L’étonnant ici est que cette appropriation ne se résout pas seulement dans
des décrets ou des textes officiels : elle se joue aussi dans la production poétique, dans les récits
non-fictionnels de promenades ou d’excursions travaillés par la matrice des grands récits de
voyage, dans les variétés enfin qui composent une grande partie des colonnes du journal
colonial. Et cette attention portée au territoire et à ses descriptions permet alors de faire
apparaître une autre composante essentielle de l’identité coloniale telle qu’elle se construit dans
les textes : les habitants du territoire, silhouettes qui se détachent au premier plan des
descriptions que nous avons évoquées et qui feront l’objet de notre troisième partie. Le constat
334 « Expédition de Gatope », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 1er octobre 1865.
263
selon lequel on trouverait dans la littérature exotique des « paysages schématisés destinés à
renvoyer de manière métonymique aux traits de caractère ethnique de ses habitants335 » est vrai
en contexte colonial ; seulement il se complique de l’ambition de créer des habitants propres au
territoire colonisé. Il faut que le territoire colonisé renvoie aux caractères des habitants
indigènes, mais aussi des habitants coloniaux : d’où l’importance première des textes
descriptifs dans la presse coloniale.
Car la question que pose en fait le lieu est celui du lien : reprenant cette idée à Carpanin
Marimoutou, nous ouvrons ainsi notre étude aux habitants, coloniaux ou indigènes, qui
participent à l’écriture de l’identité coloniale. Dans son article se trouve en effet l’idée que « la
littérature réunionnaise, quels que soient ses langues et ses espaces de production, revient sans
cesse sur cette dialectique du lieu et du lien ; du lieu qui fait lien, du lien qui autorise le
lieu336 » : en faisant de cette dynamique un trait définitoire de la littérature réunionnaise jusqu’à
aujourd’hui, il permet d’ouvrir plus largement sur la question du lien. De fait, et même si les
rythmes d’appropriation varient selon les types de colonisation mises en place, la
transformation du territoire et son appropriation par les coloniaux se fait assez rapidement, et
selon des modalités qui ne laissent pas d’étonner le lecteur actuel : ainsi, quand le rédacteur de
L’Indépendant de Constantine se sent menacé par l’idée d’un royaume arabe, c’est bien un
territoire français qu’il évoque, pour une génération qui a eu le temps de naître dans une Algérie
devenue colonie française :
Pour ne pas devenir sujets d’un royaume arabe, pour ne pas devenir des étrangers sur une terre française, les Algériens se lèvent comme un seul homme, et, des frontières de la Tunis [sic] à celle du Maroc, du Tell à la mer, se fait entendre une douloureuse, une unanime supplication au Sénat, à l’Empereur337
335 Hans-Jürgen Lüsebrink, « La perception de l’Autre. Jalons pour une critique littéraire interculturelle », Tangence, 1996, n° 51, p. 56. Le premier exemple donné est celui de Pierre Loti dans Le Roman d’un Spahi. 336 Jean-Claude Carpanin Marimoutou, « Le lieu et le lien : à propos de la littérature réunionnaise », Hermès, La Revue, 2002, n° 32-33, p. 131. URL : http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2002-1-page-131.htm. Consulté le 22 novembre 2014. 337 Marle, « Pétitionnez, pétitionnez », L’Indépendant de Constantine, 20 février 1864.
264
Troisième partie – Le colonial et ses autres
La presse coloniale traite très visiblement et très explicitement du territoire colonisé,
mais il est évident qu’elle aborde également la question des habitants de ce territoire : les
modalités en sont seulement plus variables, eu égard aux attitudes adoptées par les coloniaux.
Il subsiste cependant des traits communs dans l’écriture qui est faite des autres coloniaux, et ce
quel que soit le territoire envisagé. Une partie de ces convergences s’explique par la question
initiale posée aux coloniaux : comment écrire le « désir d’autochtonie1 » qui se développe chez
les colonisateurs, si ce n’est en passant par une forme d’oubli ou de réduction de l’autre ?
Pourtant, dans la construction de l’identité coloniale, le face-à-face inégalitaire n’est pas le seul
mode d’appréhension de cet autre qui est en fait multiple, nuancé, complexe : bien des éléments
sont mobilisés pour créer des tensions et des alliances, bien des textes négocient l’identité du
colonial par rapport à d’autres groupes, à d’autres logiques. Un des acquis relativement récents
de l’historiographie réside dans l’ouverture des perspectives sur l’identité coloniale entendue
au sens large ; et, de manière plus précise, on peut citer ici l’une des perspectives des études
coloniales :
Les travaux qui ont pris appui sur la notion de culture d’empire ont ainsi permis d’aller au-delà de l’idée, au fond assez banale, que les identités sociales se construisent par contraste. Ils ont fait apparaître les réseaux, les déplacements effectifs et les transactions qui reliaient les pratiques et les représentations d’acteurs vivant tout à la fois dans le même cadre impérial et dans des sociétés très différentes les unes des autres2.
La perspective textuelle qui est la nôtre, cependant, amende quelque peu cette
remarque : puisqu’on se limite ici au corpus de la presse coloniale, les textes sur lesquels nous
nous pencherons seront ethnocentrés. De la même manière, les identités dans la presse sont
discursives en premier lieu et se fondent sur des contrastes, voire sur des fonctionnements
manichéens : parce qu’il y a construction d’une identité, il y a aussi réduction de la réalité, et
l’ensemble de ces représentations est également gouvernée par une idéologie de la domination.
On n’étudie ici les sujets coloniaux que dans la mesure où ils apparaissent dans les textes : le
point de vue n’est pas restreint, mais se focalise davantage sur des thématiques et des
1 Jean-Claude Carpanin Marimoutou, « Le lieu et le lien : à propos de la littérature réunionnaise », Hermès, La Revue, 2002, n° 32-33, p. 131. URL : http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2002-1-page-131.htm. Consulté le 22 novembre 2014. 2 Romain Bertrand, Hélène Blais et Emmanuelle Sibeud (dir.), Cultures d’empires. Échanges et affrontements culturels en situation coloniale, Paris, Karthala, 2015, p. 17.
265
esthétiques que l’histoire, même culturelle, ne met pas au premier plan. Nous abordons donc
cette partie dans un troisième mouvement parce qu’elle nécessite un arrière-plan suffisamment
fort, mais aussi parce que cette distinction entre territoire et population se justifie par une forme
de mentalité coloniale. Plusieurs articles étudiant les colonisations en reviennent à ce constat
que le territoire est prédominant, et que les individus formant la société coloniale n’apparaissent
que dans un deuxième temps – là encore, ce fonctionnement textuel est une incarnation, si l’on
peut le dire ainsi, de la domination. En 1974, Louis-Jean Calvet évoque la définition que le
Robert donne de la colonisation et en tire la conclusion suivante :
Cet article présente une absence remarquable : celle du colonisé. Les colonies seraient donc des pays vides […]. Il n’y a pas là oubli, ou plutôt cet oubli n’est pas dû au hasard : pour justifier l’entreprise coloniale dans les termes de la « culture » occidentale, de l’humanisme dont on nous a tant rebattu les oreilles, il fallait oublier l’existence des autres3.
Rose-May Nicole abonde en ce sens lorsqu’elle écrit que l’écriture coloniale « s’intéresse aux
XVIIIe et XIXe siècles à l’île, espace de rêves, de fantasmes européens, ou de nature sauvage,
plus qu’à l’humain4 ». Dans cette perspective, nous avons d’abord étudié la construction du
territoire dans la presse avant de voir comment les différentes silhouettes de la société coloniale
sont, elles aussi, représentées et construites au sein du même espace médiatique. Étudier la
population coloniale dans la littérature a déjà été fait, et sous bien des angles ; la nouveauté
réside ici dans le support qui permet l’étude, et plus largement, dans ce que la littérature
médiatique apporte de neuf5. Le premier chapitre de cette troisième partie reprend donc la scène
inaugurale de la colonisation, celle de la rencontre, pour la décliner selon ses réalisations dans
les textes médiatiques : quelles traces subsistent de ce schéma fantasmé ? Le deuxième chapitre
approfondit cette rencontre en respectant une forme de chronologie de la colonisation : après
elle vient la tentation ethnologique, et la presse a eu un rôle à jouer dans ce qui se veut être une
étude de l’altérité. De l’ethnographie latente à la question particulière de l’esclavage, en passant
par la problématique d’une galerie de résistants anticoloniaux, ces problématiques affleurent
3 Louis-Jean Calvet, Linguistique et colonialisme, Paris, Payot, 1974, p. 12. 4 Rose-May Nicole, Noirs, cafres et créoles : étude de la représentation du non blanc réunionnais, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 45. 5 Voir l’anthologie d’Alain Ruscio, Le Credo de l’Homme blanc : regards coloniaux français, XIXe – XXe siècles, Paris, Complexe, 1995 ; Patricia Lorcin, Kabyles, Arabes, Français, identités coloniales, Limoges, Pulim, 2005 ; Julia Clancy-Smith, Rebel and Saint. Muslim Notables, Populist Protest, Colonial Encounters (Algeria and Tunisia, 1800 – 1904), Los Angeles, Université of California Press, 1994 ; les travaux de Gisèle Sapiro sur les représentations coloniales ; les travaux de Jennifer Yee sur la femme exotique ; les travaux de Sarga Moussa sur les interprètes ; la première partie de l’étude d’Alain Calmes sur Le Roman colonial en Algérie avant 1914 ; l’ouvrage célèbre de Léon-François Hoffmann sur Le Nègre romantique : personnage littéraire et obsession collective, Paris, Payot, 1973. Une thèse de doctorat est également en cours à l’université de Tétouan, avec comme intitulé : « L’image du Marocain dans la presse coloniale française éditée au Maroc. Approche imagologique », par Fatima Zohra Khari.
266
dans une presse qui vise le lectorat colonial avant tout et qui dresse donc les nuances d’une
confrontation locale. Un troisième chapitre vient compléter cette étude en passant par la
question d’une esthétique propre à la presse coloniale. Cette partie n’est donc pas organisée
selon des catégories précises d’« autres » indigènes : il n’y aura pas d’études particulières sur
les femmes, à l’image de ce que Jennifer Yee avait pu produire6. Pour autant, nous traitons bien
des autres coloniaux dans leur complexité, et non de l’Autre comme concept appliqué à la
situation coloniale. Cet « Autre » dont la majuscule rend compte du caractère problématique
autant que paradigmatique constitue un axe fondamental des études coloniales ; mais nous
avons adopté une forme plurielle et sans majuscule comme une première remise en question de
l’Autre en tant que type et référence abstraite : les journalistes coloniaux insistent davantage
sur la multiplicité du réel colonial. Dans la même perspective, le pluriel des « autres » permet
de voir le processus caché dans l’écriture :
La littérature de voyage, de même que le discours colonial qui lui est concomitant, est un processus de construction de l’altérité, d’« othering » (altérisation ; ce terme est employé notamment par Gayatri Spivak), à situer dans un réseau d’autres processus de domination, tel que celui des relations hommes/femmes7.
Cette hypothèse permet donc de replacer notre étude au sein d’un mouvement littéraire
plus vaste et plus ancien. En outre, les colonies qui voient paraître des journaux ne se résumant
pas à de l’information commerciale ne sont pas des comptoirs, et prennent en compte la
population européenne qui peut les lire : les Antilles en donnent un exemple ancien ; la Guyane
aurait dû donner le même type d’exemple, n’eussent été les déboires propres à sa colonisation
et la mauvaise réputation qui en est résultée8 ; Tahiti même est peuplée par quelques
colonisateurs européens, comme l’est la Cochinchine à la fin de notre période ; enfin la
Nouvelle-Calédonie et l’Algérie sont particulièrement envisagées, quoiqu’avec des nuances,
comme deux terres à peupler9. Le journal complet, avec ses pages littéraires, ses feuilletons et
ses notices, est donc l’apanage d’une colonisation qui parie sur le peuplement : s’y fait jour le
6 Jennifer Yee, Clichés de la femme exotique. Un regard sur la littérature coloniale française entre 1871 et 1914, Paris, L’Harmattan, 2000. 7 Grégoire Holtz et Vincent Massé, « Étudier les récits de voyage : bilan, questionnements, enjeux », Arborescences : revue d’études françaises, n° 2, 2012, p. 18. URL : http://id.erudit.org/iderudit/1009267ar. Consulté le 6 février 2015. 8 Catherine Le Pelletier, Littérature et société : la Guyane, Matoury, Ibis rouge éditions, 2014, p. 23 en particulier. 9 La Nouvelle-Calédonie a ainsi été envisagée sur le modèle australien de Botany Bay. Voir la première partie, intitulée « Aux origines d’un projet de peuplement », d’Isabelle Merle dans Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie (1853-1920), Paris, Belin, 1995.
267
besoin de préciser les frontières d’une identité complexe, sanctifiée comme possibilité de
revivifier le peuple français, et marquée dans le même temps par la crainte de l’ensauvagement.
1 Le mythe de la rencontre coloniale
Il peut paraître étonnant d’évoquer une « rencontre » quand notre projet nous prive
forcément de l’un des acteurs de cette rencontre : il n’y a pas, on l’a vu, de place pour une parole
indigène dans les périodiques que nous étudions10. Mais dans ces mêmes périodiques, il est bien
question d’une construction imaginaire, transmise par des récits successifs, plutôt que d’une
réalité dont les textes médiatiques rendraient compte ; et cet imaginaire s’appuie sur la
rencontre comme thème. La première rencontre en littérature n’est pas réservée au domaine
amoureux ; la littérature de voyage se prête aussi à ces études thématiques qui regroupent des
textes différents, tous portés ici par ce contact inaugural entre deux mondes. Et Jean Sévry, par
exemple, lorsqu’il écrit sur le thème de la première rencontre dans la littérature viatique, justifie
ainsi les changements de siècles et de territoires qui fondent son ouvrage :
Dans toute littérature de ce type, on voit un Européen débarquer chez l’Autre. Il n’est donc plus chez lui. Mais pour tenter de comprendre les comportements de cet étranger qu’il ne connaît guère, il ne peut faire autrement, par une sorte d’ethnocentrisme spontané, que de se fier à son propre système de représentations, à son code culturel, qui dans la plupart des cas sont inadéquats et incapables de décrypter correctement ce qui se passe réellement lors de ces premières rencontres11.
Qu’en est-il de l’arrivée des Européens sur les territoires qu’ils entreprennent de
coloniser ? Dans les Antilles, à la Réunion ou en Guyane, elle est ancienne, et appartient alors
aux textes historiques ; en Algérie, même si la conquête se fait en 1830, elle est contrebalancée
par l’histoire commune ancienne12 ; en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti ou en Cochinchine, les cas
de figure sont plus complexes, car il y a bien prise de possession pendant la période envisagée,
mais là encore sur un arrière-plan nourri par les récits de voyage ainsi que par tout un corpus
attenant, au premier rang duquel se trouvent la littérature du XVIIIe siècle. Dans les textes de la
presse coloniale, ces situations différentes semblent subsumées par des écritures connexes : il
10 Les modalités mêmes de la « rencontre coloniale », ses nuances et ses réalisations historiques, prêtent à débat : voir sur ce point, Isabelle Surun (dir.), Les Sociétés coloniales. Afrique, Antilles, Asie (1850-1950), Paris, Atlande, 2012, p. 49. 11 Jean Sévry, Un Voyage dans la littérature des voyages. La première rencontre, Paris, L’Harmattan, 2012. 12 Voir Jocelyne Dakhlia, « 1830, une rencontre ? », Histoire de l’Algérie à la période coloniale, Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Paris, La Découverte, [2012], 2014, p. 142-149.
268
s’agit bien d’une écriture coloniale en situation, idéologique et téléologique quand elle reprend
l’histoire des contacts précédents. Et ce n’est pas tant la « première rencontre » qui est
écrite – ou réécrite – pour être présentée aux lecteurs, mais plutôt la répétition de cette rencontre
dans la société coloniale : la cohabitation se lit en effet comme une rencontre réitérée sans cesse.
La fortune de l’expression « colonial encounters13 » dans la bibliographie anglophone témoigne
de l’attention portée à cette grille de lecture des textes coloniaux et, plus largement, de la culture
coloniale14. Il s’agit bien de donner à lire une communauté coloniale : or les lecteurs de la presse
appartiennent presque exclusivement au groupe des coloniaux. Il revient donc aux périodiques
d’exprimer ce qui est acceptable, ou seulement dicible, dans un contexte colonial : d’où
l’importance de tous les textes qui accordent une place aux silhouettes coloniales. L’un des
paradigmes de cette rencontre problématique dans les textes peut se trouver dans cette critique
que L’Indépendant de Constantine porte contre l’idée de royaume arabe développée par
Napoléon III :
Si, lors de son premier voyage à Alger, le Chef de l’État avait pu passer en revue la milice agricole, au lieu d’assister à ces somptueuses fantasias en l’honneur de l’Arabe et de son coursier – qu’on a tenu à Lui faire voir, – jamais l’idée de créer un royaume arabe sur une terre déclarée française depuis si longtemps ne Lui serait venue15.
Milice agricole contre fantasias : une image d’Épinal est dressée contre une autre, et
surtout cette confrontation de stéréotypes montre bien que, dans l’esprit colonial, les
représentations ont une influence directe sur les réalisations politiques, sur le développement
même de la colonie. Étudier les déclinaisons de ces représentations permet donc de comprendre
la manière dont s’est constituée une identité coloniale dans les textes médiatiques : identité que
l’on sait variable selon les territoires, mais aussi selon les époques et selon les publics visés par
les périodiques. En outre, il est évident que d’un point de vue strictement historique « il
importe […] de mesurer les logiques d’exclusion à l’œuvre dans bien des cultures d’empire
pour éviter de verser dans le vieux récit irénique de la colonisation comme “mise en
contact16” ». Mais que veulent dire alors les manifestations, les textualisations d’une mise en
contact que l’on peut trouver dans la presse coloniale ? Ne doit-on les interpréter qu’à l’aune
13 Julia Clancy-Smith, Rebel and Saint. Muslim Notables, Populist Protest, Colonial Encounters (Algeria and Tunisia, 1800 – 1904), Los Angeles, London, Université of California Press, Berkeley, 1994. 14 Et ce, même si Aimé Césaire dans son Discours sur le colonialisme notamment a suffisamment souligné que la colonisation était une des formes les plus appauvries de contact. Voir Discours sur le colonialisme, Paris, Présence Africaine, [1955], 2004, p. 20-23. 15 « On lit dans L’Écho d’Oran du 27 avril », L’Indépendant de Constantine, 5 mai 1865. 16 Romain Bertrand, Hélène Blais et Emmanuelle Sibeud (dir.), Cultures d’empires. Échanges et affrontements culturels en situation coloniale, Paris, Karthala, 2015, p. 25.
269
d’une hypocrisie intellectuelle flagrante ? Le journal démontre là encore sa force polyphonique,
sa dimension dialogique : les nuances qui en émergent sont à interroger, d’une situation à
l’autre, d’un territoire à l’autre. Une trame poétique semble se révéler sous les descriptions de
ces contacts coloniaux : c’est elle que nous voulons interroger ici.
1.1 La rencontre par la langue : l’identité des autres par les textes
« Un mata de la préfecture de Cho-len, en permission de 24 heures, n’y eut pas plus tôt
jeté les yeux [sur un spectacle naval], qu'il s'écria : toclam17 ! » : le lecteur du Courrier de
Saïgon qui portait les yeux sur ce texte durant l’été 1864 comprenait-il ces deux italiques ? La
rencontre coloniale, même si ses incarnations littéraires sont contrastées et plus égocentrées
qu’ouvertes, ménage quelques ouvertures linguistiques : le français est certes omniprésent et
omnipotent, mais quelques mots de créole, quelques termes tahitiens18, quelques traductions de
l’arabe permettent aux périodiques coloniaux d’afficher un dialogisme de façade
particulièrement intéressant. On peut en effet parler ici de « textualisation des contacts
linguistiques19 » pour comprendre la manière dont les textes médiatiques coloniaux construisent
un rapport à l’altérité linguistique. Le journal est particulièrement propre à être le « laboratoire
philologique20 » qu’évoque Anne-Marie Thiesse ; il tient cette place si l’on en juge par
l’histoire de l’invention du « sabir ». Plusieurs fois dans nos textes apparaît ce terme, comme
dans l’exemple suivant qui ébauche la silhouette d’un indigène selon le mécanisme du
« type » : « Le Biskri est causeur, narrateur, écrivain ; il a mille cordes à son arc ; en remplissant
nos fontaines, il puise à la source des petits cancans d’intérieur ; il jase avec les bonnes dans ce
langage impossible appelé petit sabir ; il les fait rire et rit avec elles21 ». La définition du sabir
permet de remonter à une étymologie médiatique ; mais l’on se rend compte, en reprenant les
17 « Spectacle naval », Le Courrier de Saïgon, 25 août 1864. 18 Un exemple entre mille de ces courts emprunts linguistiques souvent attribués, comme c’est le cas dans l’exemple qui inaugure la partie, à un indigène. Dans Le Messager de Tahiti, le fait divers « Suicide, par strangulation » du 17 mars 1861 contient ce passage : « Arrivé à destination, il parcourut quelques journaux anglais, puis profitant d’un moment où personne ne s’occupait de lui, il prit un morceau d’étoffe, le divisa en deux parties et en fit une espèce de corde qu’il installa à un bourao, de manière à se donner la mort. À l’instant où il fut suspendu, un jeune indien, sortant de l’école, le vit et cria : au secours, le tamouta s’est pendu ! ». L’arbre n’est pas en italique, puisqu’il s’agit d’une notion biologique ; le « tamouta », en revanche, est bien désigné comme étranger culturellement. 19 Selon l’expression empruntée à Rainer Grutman dans son article « Effets hétérolingues dans le roman québécois du XIXe siècle », Littérature, 1996, n° 101, p. 44. 20 Anne-Marie Thiesse, « « Rôles de la presse dans la formation des identités nationales », Presse, nations et mondialisation au XIXe siècle, Marie-Eve Thérenty et Alain Vaillant (dir.), Paris, Nouveau Monde, 2010, p. 130. 21 Un arabophone, « Un bruit de cruche arabe », L’Indépendant de Constantine, 20 mars 1864. Un « biskri » est un portefaix, et l’une des silhouettes habituelles des descriptions d’Alger.
270
publications disponibles, que le « sabir » a connu une première existence avant de se répandre
dans la presse coloniale. Son apparition est en effet datée par le TLF de 1852, avec la référence
suivante : « La langue Sabir, titre d'art. ds l'Algérien, journal des intérêts de l'Algérie, 11 mai
d'apr. H. Schuchardt ds Z. rom. Philol. t. 33, p. 45722 ». Mais l’utilisation des moyens actuels,
et donc de la plateforme Gallica, montre que le terme est attesté avant 1852, et surtout dans un
autre périodique que L’Algérien. La Revue du Midi en donne un extrait en 1844 : au cours d’une
chronique est évoquée cette langue d’Algérie qui remplace la lingua franca, autre langue de
« mélanges », utilisée auparavant.
Un de nos amis qui revient d’Afrique nous communique les observations suivantes sur un idiome récent, clair, bref, expressif, et surtout varié, né en Algérie, du contact des nations chrétiennes avec les états musulmans. Cet idiome, inconnu à nos lecteurs, comme aux professeurs du Collège de France et de la Faculté des lettres de Montpellier, nous ne désespérons pas de le voir adopter bientôt dans nos deux Chambres. Il facilitera singulièrement les discussions, en les abrégeant. Il se nomme la langue sabir. La langue sabir se compose d’espagnol et d’italien. Elle n’est ni difficile à prononcer, ni longue à apprendre23.
Le terme est en effet utilisé par la presse algérienne, mais sans cet effort d’explication
que se permet la revue montpelliéraine. Plus largement, ce que montre cette étymologie, ainsi
que les recherches faites sur l’utilisation du terme « sabir », c’est le lien qu’entretient la presse
coloniale locale et francophone avec les langues autres24. Du Moniteur de la Nouvelle-
Calédonie qui parfois traduit quelques textes25 au Messager de Tahiti bilingue en partie, en
passant par la mission bilingue du Mobacher algérien, plusieurs rapports se dessinent donc aux
langues indigènes26. Mais il est trois cas pour lesquels ces langues s’incarnent aussi dans des
textes particuliers, censés représenter l’âme du peuple dans une perspective romantique : les
fables créoles, les contes arabes et les chants tahitiens valent ainsi pour trois genres littéraires
22 URL : http://www.cnrtl.fr/definition/sabir. Consulté le 24 mars 2017. 23 « Chronique », Revue du Midi, 1844, p. 393. URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6562747h. Consulté le 24 mars 2017. 24 Sur les liens entre la lingua franca préexistante, et son rapport au sabir de la conquête, voir Jocelyne Dakhlia, art. cit., p. 107. 25 Dans le numéro du 4 décembre 1859 par exemple, en partie officielle, le R.P. Forestier traduit « dans le dialecte des tribus Ti-Uaka et Touo », puis « dans le dialecte des tribus de Balade » l'information donnée précédemment en français ; mais cette traduction ne relève pas du fonctionnement habituel du journal. 26 On rappelle ici que Le Mobacher vise à conquérir un lectorat très particulier : sont particulièrement visés les anciens fonctionnaires musulmans. La correspondance d’Ismaël Urbain, impliqué dans la fondation du journal, permet de compléter ce que les premiers numéros mettent en avant : une volonté d’opérer ainsi, dans les premiers temps de la conquête, une forme de rencontre qui est aussi, du point de vue français, une possibilité d’enseignement.
271
qui condensent, dans la presse coloniale, la représentation des indigènes ; qui précipitent, au
sens chimique, les caractéristiques exotiques que les coloniaux veulent faire reconnaître.
Le créole et les fables27 En 1849, L’Avenir publie plusieurs lettres en créole, attribuées à « Dakoè », censé être
cultivateur : c’est l’une des premières apparitions du créole dans la presse coloniale28. Après
cette première date, il faut attendre les années 1860 pour que se remarque la publication de
textes écrits en créole, principalement des fables ; et l’on aurait tort de négliger ces apparitions
linguistiques et ce qu’elles disent de l’identité coloniale qui se forge alors par les textes. Tout
un arrière-plan de publications créoles a préparé cette apparition médiatique, qui n’est pas
première chronologiquement. Les Essais d’un bobre africain29 sont publiés en 1820 puis en
1831 par François Chrestien, à l’île Maurice : ce premier élément n’apparaît pas dans notre
corpus, mais lance une « mode » qui va se répandre dans les aires créolophones. On trouvera
ensuite les textes de Marbot (Martinique), d’Héry (La Réunion) et des Saint-Quentin
(Guyane) : or ces publications sont toutes reprises ou précédées, selon les cas, par une
publication dans la presse locale. Les fables publiées sont le plus souvent des adaptations des
fables de La Fontaine, et l’on peut se demander pourquoi : l’auteur classique aurait été utilisé
pour l’instruction des esclaves, d’où sa fortune ensuite en créole ; mais la publication ensuite
dans une presse francophone et destinée à l’élite pose la question de la réutilisation des textes,
et de leur adaptation. Le « travestissement » signale la parodie, et le burlesque : il fallait donc
que les lecteurs aient une connaissance préalable des fables pour apprécier la réécriture. L’on
n’a pas ici la compétence linguistique pour discuter des créoles utilisés dans les fables : mais
l’on s’en tiendra à la thèse de Jean Bernabé selon laquelle ces fables, proches par leur forme
des chansons qui pouvaient circuler, s’ancrent dans la réalité linguistique de leurs territoires30.
L’on peut d’abord s’arrêter sur Louis Héry, qui publie l’une de ses fables dans Le
Moniteur de l’île de la Réunion du 7 juillet 1849, « Les animaux malades de la peste, fable
créole imitée de La Fontaine ». L’auteur est alors déjà connu, puisque, selon Jean Bernabé, il
serait l’auteur des premiers textes attestés en créole bourbonnais, avec l’utilisation de realia
propres à la Réunion : tout le désigne comme un auteur profondément local31. Un autre manuel
27 Sur les fables et le créole, on peut consulter les travaux de Jean Bernabé, notamment l’ouvrage publié pour le CAPES de créole : La Fable créole, Mantoury, Ibis Rouge, 2001 ; et un numéro de la revue Études créoles : Des Fables créoles, numéro coordonné par Jean-Claude Carpanin Marimoutou, Paris, L’Harmattan, 2002. 28 Lettres publiées dans les numéros du 11 juillet, 21 juillet et 22 décembre 1849. 29 Le bobre est un instrument de musique réunionnais, d’origine africaine. 30 Voir Jean Bernabé, op. cit., p. 20 et suivantes. 31 Ibid., p. 37 et p. 54.
272
sur la littérature réunionnaise ajoute que « le premier ouvrage littéraire imprimé dans l’île (en
1828) est remarquablement révélateur, dans son ambivalence, des contradictions à venir de la
littérature réunionnaise. Il s’agit des Fables créoles de Louis Héry32 ». L’on reconnaît
maintenant son rôle dans la naissance d’une littérature créole, comme l’explique Jean-Claude
Carpanin Marimoutou :
Il existe une tradition du texte poétique créole, remontant à 1828, année où Louis Héry publie ses Fables créoles. On a trop tendance à dénigrer ce siècle et demi de textes qui va de Héry à Cheynet, sous prétexte qu’il s’agit là trop souvent de futilités où la langue créole serait mise en scène et moquée par les maîtres. Ce point de vue sociolinguistique et glottopolitique, pour lequel un texte n’est créole que dans la mesure où il assure la promotion de l’écrit créole et récuse la diglossie en s’éloignant le plus possible des modèles français, est un point de vue a posteriori qui ne tient guère compte du travail réel de l’écriture, de la relation de connivence instaurée entre lecteurs créolophones et du regard que l’écrivain pose sur sa langue. Les textes de Héry sont – par le fait même du passage à l’écriture d’une langue orale – une contestation active de la diglossie ; le créole est là – en acte – utilisé comme langue pour la littérature, elle n’est pas considérée comme une variante mineure ou dialectale du français, et s’instaure déjà là une littérarité créole qui va se rejouer sans cesse jusqu’aux poètes contemporains33.
Aux Antilles, le constat est le même d’un engouement pour ces fables, au sens où les
tentatives ne sont pas isolées : dans Le Propagateur martiniquais, en 1862, l’on trouve des
« Fables de la Fontaine traduites en langue créole34 » à partir du 1er janvier, et qui courent sur
plusieurs numéros ; dans Le Commercial, toujours en 1862, Fondoc (évoqué dans la première
partie) publie « Les deux cafiers. Fable », qui prend comme toile de fond la rivalité entre la
Martinique et la Guadeloupe à propos de la production de café35. Il est intéressant de noter que
dès 1846, l’on trouve cet exercice de « travestissement » – plutôt que « traduction », marquant
donc la parodie, comme on l’a dit – des fables de La Fontaine en créole : ainsi paraissent Les
Bambous. Fables de La Fontaine travesties en patois créole par un vieux commandeur, sur
l’imprimerie du gouvernement36. Or que lit-on dans Le Propagateur du 7 juillet 1869, en
troisième page ? « Les bambous, fables de La Fontaine travesties en patois créoles par un vieux
commandeur ». Sept ans après la publication de quelques fables créoles, le journal a remis à
l’honneur, par republication, le volume de 1846 : faut-il y voir la preuve d’une dilatation du
32 Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, Vanves, Edicef, 1991, p. 201. 33 Jean-Claude Carpanin Marimoutou, art. cit. 34 M., « Fables de la Fontaine traduites en langue créole », Le Propagateur, 1er janvier 1862 et numéros suivants, épisodiquement. 35 Fondoc, « Les deux cafiers. Fable », Le Commercial, 6 septembre 1862. Le texte est accompagné d’une gravure qui prouve l’importance de la publication aux yeux du gérant du journal. 36 Les Bambous. Fables de La Fontaine travesties en patois créole par un vieux commandeur, Port-Royal-Martinique, E. Ruelle et Ch. Arnaud, imprimeurs du gouvernement, 1846.
273
temps colonial ? Le fonctionnement est habituel dans cette presse qui comble comme elle le
peut le manque d’actualité : le rédacteur publie des extraits d’un ouvrage déjà paru, ou d’une
revue reçue de métropole. Mais l’intérêt ici réside dans le choix fait, et dans la mention de la
« bonne réception » des fables créoles : on y lit la formation d’une identité culturelle qui
revendique une autre langue que le français. Et ce qui apparaît, c’est une montée progressive
du créole dans cette décennie 1860, et sur plusieurs territoires : la Guyane n’est pas en reste
dans ce mouvement qui donne au créole une plus grande visibilité et lisibilité au cours du siècle.
Ainsi paraît « Chien crabié qui pèdi so laquio » en 1869, fable anonyme mais qui est sans doute
l’œuvre de Saint-Quentin, nom de famille que nous avons rencontré dans la deuxième partie37.
Cette première publication n’est accompagnée d’aucun discours expliquant sa place ou donnant
le nom de son auteur ; c’est seulement dans le numéro du 12 juin, soit deux semaines après, que
l’on lit l’encart suivant :
L’accueil favorable fait à la fable en créole insérée dans la Feuille du 29 mai dernier, nous engage à en publier d’autres. Il ne faut pas oublier que ces imitations du fabuliste populaire datent de plusieurs années déjà, que beaucoup de locutions usitées alors ont été modifiées par le temps ou l’introduction d’éléments étrangers. Enfin, l’orthographe adoptée est toute de convention. Il n’existe pas de grammaire pour le créole guyanais38.
L’attention portée à la langue n’est pas anecdotique, puisque le rédacteur prend la peine
de donner ces précisions linguistiques, pariant sur des débats possibles à la publication.
Paraissent ensuite d’autres fables : à la suite de cet encart, « Tigu ké piti mouton » ; le 19 juin
« Chouguier’ ké canari » ; le 26 juin « Milé ké chouval » ; le 10 juillet 1869 « Chat’ ké
macaq39 ». L’ouvrage des Saint-Quentin qui reprend ces fables sera publié, d’après le catalogue
de la BNF, en 1872 : le journal aurait servi à prépublier ces fables, et aurait encouragé les
travaux des deux érudits guyanais. Si l’on s’arrête un instant sur ces publications, l’on se rend
compte de l’importance historique de La Feuille de la Guyane française, et de la manière dont
elle présente les travaux divers des Saint-Quentin avant que ceux-ci ne soient recueillis : le
périodique colonial joue bien alors son rôle de soutènement d’une identité créole en formation.
Mais le créole dans le journal ne se limite pas aux fables, même si elles en ont constitué un
« moment » médiatique important. Ainsi de la réponse qui est faite en 1865 à une lettre de Mme
37 « Chien crabié qui pèdi so laquio », Feuille de la Guyane française, 29 mai 1869. 38 La Feuille de la Guyane française, 12 juin 1869. 39 Toutes ces fables sont publiées dans Introduction à l'histoire de Cayenne ; suivie d'un Recueil de contes, fables et chansons en créole. Étude sur la grammaire créole, par Alfred et Auguste de St-Quentin, Antibes, J. Marchand, 1872. Il faut noter que Louis Héry publie aussi ses œuvres avec cette même ambition dédoublée, ne se limitant pas aux fables : en 1883 paraît Esquisses africaines. Fables créoles et explorations dans l’intérieur de l’île Bourbon, Paris, Rigal ; le volume reprend les publications de 1849 et 1856.
274
Nanteuil, cantatrice qui quitte Pointe-à-Pitre et envoie au Propagateur une lettre de
remerciement pour l’accueil qu’elle a reçu. À la lettre est jointe une pièce créole signée par
« les habitués du parterre » et qui débute ainsi :
Plus de chants, plus de plaisirs, Nou kalé vive de souvenirs ; En quittant sol nou man Nanteuil, Dans cœur a nou ou laissé deuil ; Lucie gagné ou tous les cœurs, Jeannette livré nou sou le chame, Friquet fait nou croire au bonheur, Toute l’amou nou pou ou madame40
Le créole n’est donc pas limité aux fables, puisqu’il apparaît dans des textes
humoristiques (Dakoè) ou de sociabilité (Mme Nanteuil) ; seulement les seules fables qui
paraissent sont en créole, et par là se marque bien une première image de la langue, qui est
renvoyée aux locuteurs comme un fragment de leur identité. À ce titre, la presse créole
commence bien à représenter le bilinguisme, davantage encore que la diglossie, constitutif des
anciennes colonies de plantation.
Contes arabes et style oriental Si les fables créoles visent à exhiber une forme de déclinaison d’une identité française
sur un territoire colonial ancien, il n’en est pas de même de l’arabe, langue étrangère dont les
coloniaux veulent donner une image avant tout, et face à laquelle même un auteur né en Algérie
maintient un rapport d’étrangeté41. Quelques expressions arabes sont translittérées et passent
dans les périodiques coloniaux : outre les toponymes ou quelques mots se rapportant à la culture
arabe, quelques expressions visent à donner la « couleur locale » aux textes médiatiques. Ainsi
d’une locution comme le fameux « in cha allah42 » que l’on retrouve de journal en journal, dès
1848 dans le commentaire d’une lettre fictionnelle : « Tout ce que nous parvenons encore à lire,
c’est un tendre adieu à Anastasie, et la promesse de lui écrire le plus tôt possible, In cha
allah43 » ; que l’on retrouve aussi, vingt ans après, dans des chroniques, comme le montre cette
phrase par laquelle Émile Thuillier conclut une chronique théâtrale : « Mais maintenant, il est
trop tard, ou ce sera pour l’année prochaine, in cha allah44 ! ». Les italiques signalent l’emprunt,
40 « Romance créole dédiée à Mme Nanteuil par le parterre de Pointe-à-Pitre », Le Propagateur, 2 mai 1865. 41 Dans les années 1860 paraissent bien des fables dans Le Moniteur de l’Algérie, mais elles sont traduites de l’arabe par Auguste Cherbonneau : la démarche est bien différente. 42 Expression que l’on traduit habituellement par « si Dieu veut ». 43 « Lettre d’un voyageur », L’Écho d’Oran, 21 novembre 1848. 44 Thuillier, L’Indépendant de Constantine, 13 décembre 1868.
275
et attirent par là le regard sur l’appropriation de cette expression religieuse45. Mais là n’est pas
le plus important dans l’appréhension que les coloniaux ont de la langue arabe. Par une
métonymie travaillée, la langue donne l’image des locuteurs : c’est sans doute pour cela qu’on
observe une extrême attention portée, en Algérie, aux légendes et aux contes qui dressent
l’image d’une tradition orale et merveilleuse, loin de toute attitude rationnelle – c’est ce que
soulignent les commentaires et introductions à ces textes. Une légende peut même devenir une
fable, le flottement linguistique aidant, à l’image de ce que L’Akhbar insère dans l’un de ses
numéros en 1846 en précisant que le texte vient d’être reçu :
Au rédacteur de l’Akhbar. Monsieur, La légende arabe de Sidi-Mohammed-Blidi dont j’ai lu dans le dernier numéro du Courrier d’Afrique la traduction que M. Bérard en a faite en vers si élégants, m’a donné l’idée de livrer aussi à la publicité une fable arabe que j’ai extraite d’un manuscrit assez curieux que l’un des caïds les plus influents de la province de Constantine m’a prié d’accepter un soir qu’assis sous sa tente, à quelques lieues de Biskara, notre conversation roulait sur les bucoliques orientales dont nous admirions le plus la fraîcheur et l’originalité. J’ai rimé en alexandrins, et le mieux que ma jeune muse m’a permis de le faire, cette suave production de l’imagination vagabonde du sublime El Said-Madoul, celui dont les chants et les idylles caressaient le plus agréablement la douce mélancolie du célèbre Hadj-Mohammed-Pacha, à la cour de Constantinople. […] Le sultan et la mouche. Fable. Le sultan Soliman fumait sur une natte ; Il avait le teint blême et le nez écarlate Près de lui son esclave armé d’un éventail Pourchassait gravement les mouches du sérail. Mais soudain l’une d’elles, à l’éventail rebelle, Sur le nez du Sultan se pose à tire d’aile. Orgueilleux, on eût dit, du lieu de sûreté Qu’il a choisi l’insecte, en sa sécurité, Se pavanait déjà en agitant sa trompe Quand tout-à-coup, plus prompt que l’éclair ou la bombe, De sa main, main de fer, sur son front pur et beau, Le sultan Soliman porte le large espace, (Il venait d’inventer quelque supplice nouveau !) Et soudain l’animal qu’il aplatit trépasse. Ce trait malin bientôt excita tous les ris, En exceptant celui d’une vieille houris Qui, voyant Soliman prendre un air calme et grave, Tel qu’un vieux cardinal présidant un conclave,
45 Au fil du siècle, d’autres expressions orales apparaissent non traduites, par exemple dans des chroniques écrites sous forme de dialogue entre le journaliste et un zouave : « Ne vous ai-je pas vu à Constantine ? lui demandais-je. – Possible, bourgeois, précisément que j’en débarque. – Alors, mon brave, Wach alek ? Wach inta ? – Chrer. – Que se passe-t-il sur le gros caillou ? – Hélas ! – Le choléra, peut-être ? ». Référence : Iblis, « Petit courrier de Constantine », L’Indépendant de Constantine, 15 décembre 1865.
276
Lui dit : réfléchissez, seigneur, réfléchissez, Votre peuple vous aime et vous, vous l’égorgez ! Cet insecte tué sans qu’on lui crie gare Est la victime, hélas ! d’une pensée barbare, Triste image de l’homme, cheminant à pieds nus Qui ne voit le serpent que quand il est mordu. ……….. Le soir du même jour on entendit un râle……. Celui de la houris expiant sa morale46.
Légendes et contes se retrouvent en effet dans nombre de périodiques, qu’ils soient
officiels ou privés : L’Écho d’Oran publie « Un Miracle d’Aïssa. Légende arabe47 » en
1848 ; L’Indépendant de Constantine « Légendes algériennes – Quatre marabouts et une
sorcière contre un empereur48 » en 1849 et « Le prince confiseur, conte arabe49 » en 1862 ; Le
Moniteur de l’Algérie, dans les années 1860, publie plusieurs titres semblables : « Une soirée
dans l’Atlas. Légende musulmane50 », « Origine des scorpions. Légende arabe51 », « L’Homme
qui ne rit plus (conte arabe52) », « À propos d’un conte arabe53 » ; enfin Le Mobacher
publie « Le moucheron (légende algérienne54) » en 1879. Ce relevé qui ne peut prétendre à
l’exhaustivité montre cependant que les légendes et contes sont publiés à partir des années 1840,
et identifiés par des sous-titres génériques. Cela montre aussi que les signatures sont variées, et
prouvent une forme d’appropriation commune : les érudits ou les savants ne sont pas les seuls
à pouvoir mobiliser ce genre de récits. De ces textes émerge le lien que font les coloniaux entre
le conte et la supposée âme arabe, à l’image du commandant Colomb que nous avons déjà cité :
Les Arabes sont si chaudement, si naïvement enthousiastes quand ils racontent ces traditions, ces fantastiques légendes, quand ils parlent de la végétation, des pâturages et des chasses des solitudes sahariennes ; ils ont des gestes et des mots si expressifs pour peindre leurs horizons infinis ; l’attrait qu’ils paraissent éprouver pour les solitudes est si vif, que leur enthousiasme a quelque chose de communicatif et qu’on se sent entraîné, malgré soi, à désirer l’immensité, le désert et la vie contemplative qu’ils y mènent55.
Enfin, la langue utilisée dans les contes arabes est parodiée ou moquée, dressant le
portrait de l’indigène selon les critères coloniaux. Ce portrait se fait parfois discrètement,
46 Eugène X., « Le sultan et la mouche », L’Akhbar, 19 mai 1846. 47 « Un Miracle d’Aïssa. Légende arabe », L’Écho d’Oran, 22 juillet 1848. 48 « Légendes algériennes – Quatre marabouts et une sorcière contre un empereur », L’Akhbar, 3 avril 1849. 49 X., « Le prince confiseur, conte arabe », L’Indépendant de Constantine, 1er avril 1862, 4 avril 1862, 15 avril 1862. 50 Abbé Bertrand, « Une soirée dans l’Atlas. Légende musulmane », Le Moniteur de l’Algérie, 4 mai 1867. 51 Tric-Trac, « Origine des scorpions. Légende arabe », Le Moniteur de l’Algérie, 10 septembre 1865. 52 A.C., « L’Homme qui ne rit plus (conte arabe) », Le Moniteur de l’Algérie, 15 juillet 1864. 53 Dr. E. Bertherand, « À propos d’un conte arabe », Le Moniteur de l’Algérie, 3 juillet 1869. 54 Albert Marie, « Le moucheron (légende algérienne) », Le Mobacher, 30 août 1879. 55 « Tournée d’exploration dans les Ksours et dans le Sahara de la province d’Oran, par le commandant de Colomb », Le Moniteur algérien, 5 juin 1858.
277
comme dans l’extrait suivant qui décrit un forgeron et sa fille, préalable au déroulement de
l’histoire : « Il vivait donc là, au milieu de l’estime de ses voisins, avec sa fille, la brune
Hourida, astre de jeunesse, trésor de grâce, fleur de beauté, etc.56 ». Dans ce récit de l’origine
d’un nom – qui est donc bien une légende, même si le terme n’apparaît pas dans le
titre – l’auteur copie rapidement les périphrases précieuses associées à la langue arabe, et les
dévalorise par l’énumération même que coupe un « etc. » péremptoire. D’autres apparitions de
ces calques apposés à la langue arabe apparaissent assez régulièrement dans les textes
fictionnels que fait paraître la presse algérienne. « Le cadi (que Dieu le rende illustre et nous
fasse profiter de ses mérites !), le cadi, homme savant et sage, promit de faire ce qu’on lui
demandait, d’autant plus que l’emploi dont il était revêtu lui imposait le devoir d’ordonner le
bien et de défendre le mal57 » : le style est censé imiter là aussi la langue arabe, et témoigner
ainsi de l’identité d’un narrateur indigène ; mais l’intérêt du texte réside aussi dans le fait que
cette légende est censée illustrer un épisode de la vie de Jésus, en effet envisagé comme un
prophète. Le prénom d’Aïssa est traduit entre parenthèses par Jésus à sa première apparition : le
lecteur n’est donc pas dupe de ce qui se joue dans les lignes suivantes. Le renversement de point
de vue qui se joue alors dans le journal est assez remarquable : l’on donne à lire aux Oranais de
1848 une perspective brouillée, quelque chose comme un reflet inversé de leur position
habituelle de lecteur. La présence des « chrétiens » dans les contes arabes opère cette même
transformation du récit : le « Tombeau de la chrétienne », par exemple, que nous avons traité
précédemment dans le cadre de l’écriture historique, autorise aussi la publication des légendes
s’y rattachant. Un texte emprunté aux Annales algériennes du commandant Pélissier, qui
commencent alors à être publiées, paraît ainsi dans Le Moniteur algérien : par cette signature
prestigieuse est remplie la condition tacite qui accorde la confiance du lecteur colonial à un
auteur connaissant la colonie ; reste alors à développer le récit qui met en scène la légende arabe
et peint les Chrétiens en esclavagistes.
Il existait, il y a fort longtemps, dans le pays des Hadjoutes, un homme nommé Jousuf ben Cassem, riche et fort heureux dans son intérieur. Sa femme était douce et belle, et ses enfants étaient robustes et soumis. Cependant comme il était très-vaillant, il voulut aller à la guerre ; mais malgré sa bravoure, il fut pris par les Chrétiens, qui le conduisirent dans leur pays, et le vendirent comme esclave. Quoique son maître le traitât avec assez douceur, son âme était pleine de tristesse, et il versait d’abondantes larmes lorsqu’il songeait à tout ce qu’il avait perdu. Un jour qu’il était employé aux travaux des champs, il se sentit plus abattu qu’à l’ordinaire, et, après avoir terminé sa tâche, il s’assit sous un arbre, et s’abandonna aux plus douloureuses réflexions. « Hélas, se disait-il,
56 « Le Fort du chien (Bordj el Kelb) », L’Écho d’Oran, 30 septembre et 6 octobre 1848. Nous soulignons. 57 « Un Miracle d’Aïssa. Légende arabe », L’Écho d’Oran, 22 juillet 1848.
278
pendant que je cultive ici le champ d’un maître, qui est-ce qui cultive les miens ? Que deviennent ma femme et mes enfants ? Suis-je donc condamné à ne plus les revoir, et à mourir dans le pays des infidèles58 ? »
Le fait même qu’il soit question du « pays » des Chrétiens montre l’effort fait par
l’auteur pour donner l’apparence d’une narration indigène : le conte sert ici d’alibi à un effet
d’étrangeté qui participe de la construction d’une identité coloniale fondée sur l’illusion de la
proximité avec la culture indigène. Ce n’est pas entièrement un hasard si le commandant
Pélissier est connu pour être un saint-simonien, favorable à la « fusion des races » : cet effort
d’écriture semble bien aller dans ce sens.
D’autres particularités encore confirment le statut particulier des contes indigènes dans
la presse coloniale, au rang desquelles figure l’utilisation occasionnelle de narrateurs enchâssés
dans la presse : par rapport à la légende du Tombeau de la chrétienne, c’est un pas
supplémentaire encore que de décrire le narrateur indigène du conte avant de le laisser parler.
Mais dans les deux cas, attribuer le conte à un narrateur indigène, c’est utiliser un relais narratif
qui modifie le statut même du texte raconté et donne l’illusion d’une connaissance directe
offerte au lecteur. Si des contes arabes sont publiés dans les périodiques, officiels ou non, de la
colonie algérienne, c’est selon une perspective de connaissance minimale qui essentialise la
littérature arabe en la considérant comme expression de l’identité des indigènes. Face à cette
essentialisation se dégage de ces contes une esthétique de la désinvolture qui est
intéressante : elle signe véritablement une forme de voie pour la narration, une alternative aux
contes européens. Le narrateur colonial se fait, dans ces textes, le transcripteur de textes qui ne
relèvent pas de sa culture : partant il affiche quant à eux une distance condescendante qui se
marque dans les interventions de ce narrateur premier. Une identité, toute littéraire, se
développe ainsi, qui contribue à forger dans la presse un rapport aux autres et à leurs cultures.
Tahiti ou les chants À Tahiti, c’est encore un autre genre de textes qui phagocyte la représentation que l’on
peut avoir des autres de la colonie. L’importance de la danse et des chants s’y voit
particulièrement au moment de la mise en place du protectorat, et y compris dans la presse
métropolitaine :
L’Illustration, revue dont les intérêts étaient plus commerciaux que politiques, offre un bon moyen de mesurer, dans un lectorat médiocrement politisé, l’écart entre l’intérêt très mesuré pour la prise
58 « Le Tombeau de la chrétienne », Le Moniteur algérien, 17 juin 1836.
279
planifiée des Marquises et l’excitation provoquée par le protectorat inattendu sur Tahiti, qui venait contester l’Angleterre dans un territoire travaillé par ses missionnaires. Pour le coup, l’imaginaire joua un rôle important : l’Océanie s’incarnait plus harmonieusement dans le mythe de la vahine tahitienne que dans celui du cannibale marquisien. Le samedi 25 mars 1843, l’Illustration fit du protectorat sur Tahiti la « nouvelle de la semaine ». […]
C’est après avoir expulsé de l’île les missionnaires anglicans et méthodistes qui voulaient les empêcher de danser et de jouer de la flûte, que ces pauvres sauvages se sont mis sous la protection du pavillon français59.
C’est donc sur un arrière-plan idéologique de confrontation avec l’Angleterre que se
développe l’image de Tahiti. D’autres travaux prouvent encore, prenant parfois la presse à
l’appui, l’importance du sport ou des fêtes dans l’imaginaire colonial tahitien60. Et ce n’est pas
le cas seulement en métropole : à Tahiti même, la publication de textes tahitiens traduits dure
peu – on lit plutôt des traductions de textes français –, mais révèle un élan coupé dans les
premiers temps de l’absorption par Le Messager de Tahiti du Te Vea no Tahiti. Au mois de mai
1853, Le Messager de Tahiti fait ainsi paraître deux textes donnés comme des
traductions : « Tiretire61 » et « La Houpahoupah (Ute no te Upaupa62) ». Pour « Tiretire », le
texte se présente dans une configuration intéressante : il suit le récit de l’ouverture d’une
boutique de mode à Papeete.
Il faut voir Tahitiennes et Tahitiens sortant de cette boutique d'un air joyeux, et déployant au vent et au soleil des robes de soie éclatantes, des jupes à franges, des mouchoirs brodés, des habits en étoffe légère, des poufs, des falbalas, des écharpes, mousselines, dentelles, gazes et blondes des plus riches couleurs ; et avec quels trépignements de joie enfantine ils admirent ces produits légers et charmants de nos manufactures, qu'ils n'avaient pu se procurer jusqu'ici qu'en les payant chèrement et dans de rares occasions63 !
Après cette première représentation du peuple tahitien, le texte de « Tiretire ou Le Chant
de l’Uriti (Peke no te Uriti) » est présenté comme une « ancienne ballade tahitienne », avec la
précision « air noté par M. Noc.... ». Plusieurs xénismes sont laissés dans le texte, qui est un
chant amoureux :
Dans l'antre où le Kanack s'oublie, Réveille le plus tendre écho ; Brise la chaîne qui me lie A mon époux, le chef Noho
59 Renaud Meltz, « "Ici, l'on danse" : Tahiti et l'opinion publique sous la Monarchie de Juillet », Hermès, La Revue, 2013, n° 65, p. 46. 60 Yves Leloup, « Festivités sportives populaires et presse coloniale (1844-1900) », Recherches en Communication, 2008, vol. 30, n° 30, p. 71-88. 61 « Tiretire », Le Messager de Tahiti, 1er mai 1853. 62 « Mœurs tahitiennes », Le Messager de Tahiti, 22 mai 1853. 63 Le Messager de Tahiti, 22 mai 1853.
280
La tapèna mêle son onde Et son murmure au flot grondeur ; Qu'importe époux, les flots, le monde, Dès que ta voix chante en mon cœur. Oui ! J'ai déserté mon asile ; Il me fallait ton chant des nuits ; Que Noho me chasse et m'exile, Avec toi je n'ai plus d'ennuis64.
L’emploi du terme « Kanack », la mention de la « tapèna » vont dans le sens d’un
exotisme intégré de force dans la métrique française : le premier terme est employé dans une
acception locale ; quant au deuxième, les traductions actuelles donnent « capitaine ». Plus tard
dans le mois, la publication d’un autre texte issu de la culture tahitienne montre à quels motifs
le rédacteur peut se plier : au sein de la rubrique « Nouvelles diverses », des « Mœurs
tahitiennes » commencent par un avertissement.
Nos lecteurs se rappellent l'arrêté par lequel le gouverneur a cru devoir défendre la upaupa, danse toujours accompagnée et suivie d'excès regrettables. La ronde que nous publions aujourd'hui en donnera l'idée, bien affaiblie toutefois par la décence du langage65.
L’intérêt est ici ethnographique plus qu’esthétique : on y lit une curiosité mêlée de
l’érotisme qui sert habituellement à représenter les mœurs tahitiennes, et la justification d’une
décision légale de la colonisation. Or la « houpahoupa » se présente comme le texte
précédent : l’air a été noté par le même homme, le texte est présenté avec ses strophes. Mais il
y a quelques changements : le journal accueille cette fois tout un appareil de notes de bas de
page qui expliquent le texte et ses mots. Ce discours d’escorte tenu par le journal est renforcé
par la conclusion :
Réveillez la mémoire des vieux chefs qui, dans leurs beaux jours, ont dansé cette houpahoupah échevelée, vous verrez leur visage s'épanouir, leurs lèvres se gonfler, le plaisir briller dans leurs yeux, et du fond du cœur ils vous diront : c'était bien amusant. Et pourtant ils en ont tous demandé et voté la suppression comme d'un symbole du paganisme66.
La connivence mise en place avec le lecteur le signale assez : il y a une utilité à cette
publication, une forme de démonstration coloniale du « progrès » en train de se faire, y compris
à travers les manifestations de ce qui a construit le mythe du « bon sauvage » auquel doivent
correspondre les Polynésiens. L’année suivante paraissent d’autres textes de même nature, qui
64 « Tiretire », Le Messager de Tahiti, 1er mai 1853. 65 « Mœurs tahitiennes », Le Messager de Tahiti, 22 mai 1853. 66 Id.
281
suivent là encore des stratégies éditoriales que l’on peut préciser. C’est d’abord la description
d’une scène de fête :
Quel charme indéfinissable que de les écouter le soir sous un ciel irradiant, argenté par la lune et tout semé d’éclatantes étoiles, assis sur le corail brisé, abrité par le panache des cocotiers où la brise se tamise en murmurant dans les franges du feuillage, ayant devant soi le lac paisible où semblent dormir les rayons reflétés des astres, derrière soi l’Océan qui gronde sur le récif ; quel charme d’écouter leurs chants choisis, et comme ils en ont d’une inspiration délicieuse, comme on peut en juger par ce refrain : Ia ha ! trarara, trarara rara ! Que je voudrais être un petit oiseau Qui vite vole Qui vole, vole Que je voudrais être un petit oiseau Qui vole vite et vole si haut !
Et toute la ronde mène de ce train charmant les plus riantes images ; et les femmes accroupies en ligne sur une natte mêlent leurs voix avec un accord d’une simplicité harmonieuse ; et mains de frapper en cadence et bras de s’agiter comme dans un doux battement d’ailes, et tambourin de résonner mollement sous les doigts, et chagrins de s’oublier dans cette poésie de toute la nature67.
Là encore, la voix du publiciste « territorialise » la poésie et fait montre de sa capacité
à concurrencer le texte initial en lui donnant un ancrage dans le paysage. C’est comme si
s’opérait ainsi un glissement : la langue tahitienne, inaccessible puisque traduite, s’incarne dans
le paysage et dans la danse. C’est par le regard du publiciste, gagné par une forme de répétition
lui aussi, que la coutume tahitienne décrite prend en quelque sorte son sens : l’anaphore de
« quel charme » dans le premier paragraphe, la polysyndète du dernier réitèrent le signe majeur
de la chanson donnée à lire, autrement dit la répétition simple. Deux numéros après la
publication de cette exploration, on lit : « On nous demande la suite de la chanson de Raïroa,
dont nous avons publié le refrain dans notre numéro du 30 avril. Voici la ronde toute entière68 ».
Plusieurs strophes se succèdent sous le titre « Le Petit oiseau. Ronde des Pomotous ». Quelques
mois plus tard, on trouve une autre publication liée à la culture tahitienne, toujours dans cette
série de description des Pomotous, mais cette fois pour l’île d’Ana : « Pitaferiro (ancienne
élégie69) ».
Parmi eux, comme dans presque toutes les îles Tuamotu, la danse est vite organisée. Un bâton qui bat la mesure sur une planche forme l’orchestre, des feuilles sèches et des branches d’arbres liées en torches éclairent la scène de lueurs fantastiquement reflétées sous les voûtes ondoyantes des cocotiers. Quelque rapsode improvise ou répète sur des motifs vraiment gracieux des lambeaux de ballade que le chœur redit
67 « Archipel des Pomotous. L’île Rairoa », Le Messager de Tahiti, 30 avril 1854. 68 « Le Petit oiseau », Le Messager de Tahiti, 14 mai 1854. 69 « Archipel des Pomotous. Île d’Ana », Le Messager de Tahiti, 24 septembre 1854.
282
avec un entrain irrésistible. Tantôt ce sont de légères peintures de mœurs comme celles-ci : Je voudrais bien monter sur un navire, Je voudrais bien voir de nouveaux pays ; Secret écho dans mon cœur qui soupire Me dépeint là nombreux objets chéris. Mais mon vieux père aux cendres de ma mère Reste enchaîné par mystérieux lacs ; Je resterai pour soigner mon vieux père, Tant qu’aux lieux froids il ne dormira pas ; Ou bien : Je ne veux pas d’un serment qui m’oblige Et me subjugue au son de même voix ; Même oreiller, même époux, ça m’afflige ; Mon goût se plaît à varier ses choix ; Ou encore : Sous le Tavana – a À la ronde, Tout le monde dansait la upaupa Sous le Tavana – a ; Ou quelque critique fine de l’autorité, des travers d’un chef ; ou un lambeau d’épopée70
Toutes ces manifestations textuelles de chansons tahitiennes tiennent en fait à une forme
de folklore que la colonisation invente et met en place : s’y lit un rapport problématique à
l’altérité tahitienne et à la temporalité qu’elle est censée incarner. On est loin alors de ce que
l’éphémère Océanie française avait publié en 1844 concernant les mœurs tahitiennes : le
journal publie des extraits du voyage de Dumont d’Urville plutôt que de produire, comme Le
Messager, des textes de circonstances, des descriptions liées à la vie de la colonie71. Nous avons
donc vu que la désinvolture semble le maître-mot pour qualifier le rapport du journaliste
colonial aux contes arabes ; le paternalisme serait alors un deuxième maître-mot, pour qualifier
cette fois le rapport du journaliste colonial aux chants tahitiens. Pourtant le corpus journalistique
traitant de ces deux types de textes n’est pas monolithique ; mais il laisse bien apparaître
quelques traits communs qui permettent d’établir une perspective semblable, celle d’une
textualisation presque maximale de la rencontre, parce qu’elle porte sur les mots mêmes. La
réalité des pratiques créoles, arabes ou tahitiennes est importante, mais elle prendrait ici une
place trop importante, et orienterait le propos davantage vers l’ethnographie que vers la
littérature : or la question ici n’est pas de savoir dans quelle mesure les coloniaux ont déformé
une réalité qu’ils voulaient observer, mais plutôt de quelle manière ils ont construit dans leurs
périodiques une identité passant par le genre pour représenter la langue, partant ses locuteurs.
70 « Archipel Tuamotu. L’île Faaite », Le Messager de Tahiti, 9 juillet 1864. 71 Dans les publications de cet éphémère hebdomadaire dactylographié sous-titré « Journal de Tahiti », le numéro du 10 novembre 1844 fait ainsi paraître, en deuxième page un article intitulé « Une Fête tahitienne » ; en troisième page « Variétés. Traditions, mœurs, coutumes des Tahitiens ». Ce dernier article est issu du récit de voyage de Dumont d’Urville, qui sera publié par extraits plus longuement.
283
Si l’on a mis sur le même plan, dans une perspective de comparaison, les différentes productions
ci-dessus, c’est qu’elles révèlent en effet une démarche semblable : la prise en compte, même
minimale, d’une langue qui n’est pas le français mais qui est nécessaire à qui revendique la
connaissance du territoire. D’où une question : qu’en est-il alors des langues manquant à l’appel
ici ? Elles ne sont pas apparues au cours des dépouillements, ou dans des documents qui leur
étaient exclusivement consacrés : pas d’utilisation de la réalité linguistique kanak dans le
journal, et pas de mention du « bichelamar », pidgin que pourtant Louise Michel mentionne dès
les premières pages de son ouvrage sur les Légendes et chants de geste canaques72. En
Cochinchine, le constat est plus mitigé, et en appelle à une autre représentation encore de la
langue : il y a la publication d’un périodique en langue annamite, le Gia-dihn-Bao, et dans le
Courrier de Saïgon la présence d’une grammaire annamite qui rappelle le statut des langues
orientales sous le Second Empire – bien loin alors des langues polynésiennes. Ce qui ressort de
ces études mêlant langue et genre littéraire, c’est une manière de considérer les langues qui
permet de voir comment l’identité coloniale médiatique a traité, par un fonctionnement
métonymique, les autres. Avec cette dernière étude sur la langue tahitienne, l’on retrouve l’idée
d’une distinction entre l’arabe, le créole et les autres langues dites exotiques : Daniel Baggioni,
en explorant la linguistique coloniale, expliquait déjà que les langues dites exotiques « sont
l’affaire des missionnaires, des voyageurs et bientôt des cadres coloniaux73 » contrairement aux
autres langues, liées aux Belles Lettres et aux professeurs de langue ancienne. Les langues
orientales ne pouvaient donc relever du même paradigme que les langues exotiques définies
ainsi : et cette identité première des langues exotiques a eu comme corollaire leur absence dans
les débats linguistiques du XIXe siècle ; le tahitien, dans la presse, ne trouve sa place que par
une vision positive de la civilisation qui l’accompagne. Dans les trois cas que nous avons cités,
l’implication de la langue autre dans le journal n’est pas massive ; il s’agit plutôt d’une forme
de facilité donnée au journal que d’une habitude linguistique. Pourtant, cette utilisation même
superficielle de la langue peut donner un substrat à la langue coloniale telle qu’elle se
développera dans la littérature coloniale.
72 Benoît Trépied, art. cit. Pour Louise Michel, voir Légendes et chants de geste canaques, Paris, Kéva et Cie, 1885, p. 4. 73 Daniel Baggioni, « Les linguistiques européennes et l’étude des langues ʺexotiquesʺ des Lumières à l’anthropologie moderne », Alain Buisine, Norbert Dodille et Claude Duchet (dir.), L’Exotisme, actes du colloque de Saint-Denis de la Réunion, Cahiers CRLH.CIRAIO, n° 5, 1988, Paris, Didier-Erudition, 1988, p. 23.
284
1.2 De la division à la fusion : écrire le rapport aux autres
Outre l’aspect linguistique du « contact », le terme même est au centre d’une polémique
liée à la matière historique : est-il adéquat, révèle-t-il suffisamment la logique coloniale ? Dans
notre perspective, littéraire et médiatique, il ne s’agit pas de savoir s’il y a eu contact ou pas,
mais de voir comment les textes ont traité de ce thème, et donc comment la description des
autres fait partie intégrante de la manière dont se forge l’identité coloniale chez les coloniaux.
Ainsi, Le Moniteur algérien fait paraître le récit de mises en contact qui ne peuvent pourtant
pas prétendre à la confrontation de deux mondes radicalement inconnus l’un de l’autre, puisque
sont signalées des sources premières ou des attendus : « Ma première rencontre en entrant à
Alger a été celle d’une multitude innombrable d’indigènes, et ce que la peinture et les relations
des voyageurs m’en avaient appris n’est que l’ombre de ce que j’ai vu »74. Cette réaction d’un
épistolier publié dans Le Moniteur algérien en 1843 respecte une formulation que l’on peut
trouver dans un certain nombre de descriptions. Il n’est plus temps de croire aux toutes
premières découvertes : la vision des autres coloniaux se fait forcément dans la continuité d’une
conformité (ou de son absence) à un modèle, peinture ou récit, et le premier contact algérien est
donc lourd d’antécédents historiques ou littéraires, comme le sont les premiers contacts dans
les colonies plus récentes. De la classification apparaissant dans les textes à l’écriture de
l’esclavage comme point particulier de l’altérité, en passant par la mise en scène d’une
possibilité de fusion, plusieurs réalisations textuelles laissent percevoir la manière dont se
raconte la mise en contact, ou du moins sa pensée.
Diviser pour mieux régner : classer les colonisés
Les réflexions à portée ethnographique ne sont pas rares dans la presse coloniale,
qu’elles soient insérées dans des récits de voyage ou qu’elles constituent des articles à part
entière : ces études morales, historiques – généralisantes – constituent un motif récurrent des
écritures coloniales. Mais leur objet et leur utilisation, tout comme le système narratif sur lequel
elles s’appuient, peuvent varier. L’Algérie n’est pas la seule colonie dans laquelle les
périodiques sont le relais d’une pensée coloniale ethnographique et classificatoire : si l’on sait
à quel point le colonisateur français fait ressortir les différences entre Arabes et Kabyles, par
exemple, il faut connaître aussi les distinctions faites entre les populations dans tous les
territoires coloniaux (les classifications raciales dans les colonies de plantation en sont un
74 B., Le Moniteur algérien, 10 novembre 1843.
285
exemple éclatant), et même sur le territoire métropolitain, comme en témoigne par exemple la
publication des Français peints par eux-mêmes en 184075. Au fil des descriptions que les
périodiques coloniaux produisent sur la population, l’on trouve à la fois des textes qui se
revendiquent d’une certaine scientificité, et d’autres qui jouent sans ambages sur un racisme
mondain qui caractérise une partie des productions de l’époque, et dont voici un extrait assez
représentatif :
Ajoutez enfin à une odeur de bouc des myriades de ces insectes que Dieu créa sans doute pour les loisirs toujours si longs des enfants du Prophète, et vous n’aurez encore, Madame, que des fashionnables près des Arabes du désert et des Kabyles des montagnes. Les jeunes ont des figures très peu différentes de celles des autres peuples ; mais celle des vieillards est infiniment plus expressive et plus caractérisée. Il est certain que l’on n’a pas fait poser les plus vilains pour peindre Abraham et Melchisédec ; j’en rencontre bien peu dont je n’aie vu le portrait dans les gravures de la Bible. Les Maures, ces descendants des vainqueurs de l’Espagne sont tous des hommes superbes76
Pas d’apparence scientifique ici, mais plutôt une conversation qui repose sur des
outrances de la parole. Arabes, Kabyles, Maures : la tripartition ici ébauchée se retrouve d’un
article à l’autre, parfois enrichie par d’autres catégories, au rang desquelles on compte les
« kouloughlis », issus des unions entre Arabes et Turcs, ou les Juifs77. Les tribus sont un autre
point de repère quand il s’agit de faire apparaître la population algérienne : les terribles
Hadjoutes, par exemple, gagnent rapidement en célébrité, et intègrent l’imaginaire colonial
comme on a pu le voir plus haut avec le récit de la chasse ratée78. Toutes ces remarques et
définitions, présentes dans des textes documentaires, se retrouvent ensuite dans les poèmes,
fictions, variétés du journal, formant le substrat des références culturelles obligées. On les lit
également dans la (mauvaise) poésie orientaliste : « J’aime, Mauresque ou Juive, ou fille du
désert / À baiser ses cheveux et voir à découvert / Son grand œil qui s’allume79 » ou dans la
littérature panoramique qui se moque du nouveau débarqué : « Pour lui une juive est une
mauresque ; celle-ci est à son tour une bédouine ; un juif est transformé en arabe80 ». Quelques
silhouettes apparaissent encore dans les flâneries des journalistes : ainsi des noirs présents en
Algérie, dont celui qui raconte au journaliste la légende arabe sur l’origine des scorpions. « Tour
à tour porteur d’eau, commissionnaire, interprète, messager d’amour intelligent et discret, se
75 Les Français peints par eux-mêmes, Paris, Curmer, 1840-1842. 76 B., Le Moniteur algérien, 10 novembre 1843. 77 Voir « Origine du nom des Kouloughlis », L’Écho d’Oran, 29 juillet 1848 ; D’Esgrigny d’Herville, « Études arabes et juives », L’Écho d’Oran, du 30 janvier 1850 au 1er janvier 1851. 78 On trouve alors des textes comme celui de Florian Pharaon, « Notes sur les tribus de la subdivision de Médéah », Le Moniteur algérien, 25 juin 1857. 79 H.R., « Africana », La France algérienne, 27 juin 1846. 80 Roland De Bussy, « Type. – Un nouveau débarqué », Le Moniteur algérien, 4 juillet 1840.
286
faisant tout à tous, enfin, Chocolat est un de ces êtres que le Darfour ou le Soudan semblent
avoir fait naître tout exprès pour les besoins de la civilisation créole81 » ; l’auteur l’appelle
ensuite « mon Soudanien », et c’est par lui que passe le récit, conservant au personnage son
caractère de rouage mécanique de la « civilisation créole ». La volonté classificatoire se lit donc
particulièrement en Algérie, et gagne aussi les populations européennes : Espagnols, Italiens,
Maltais sont ainsi présents dans les textes, même si leur « étude » n’est pas aussi poussée. Est-
ce donc un trait définitoire de l’écriture médiatique coloniale que cette manière de diviser le
peuple colonisé ? Un texte concernant la Guyane permet même de mettre en valeur le
fonctionnement particulier de cette esquisse d’ethnographie coloniale qui insiste sur le
fractionnement, et qui se prête ainsi, comme tout motif bien intégré, à une tentation parodique.
Une description des Amérindiens de Guyane est en effet écrite sur un ton plaisant et selon le
principe de la comparaison chez C. Chanel, le voyageur que publie La Feuille de la Guyane
française en 1858 :
On se figure aisément d’ailleurs que Galibis, Caraïbes, Arouagues, Oyampis, etc., tous ces braves sauvages sont, je ne puis dire ejusdem farinae, mais bien du même roucou82, et qu’il n’y a pas physiquement entre eux d’autres distinctions que celles qui existent entre Français, Belges, Anglais et Allemands. Ils portent des noms différents, parlent des langues un peu différentes, se parent de plumes de couleur opposées et, pour ce, se haïssent sans se connaître, se font la guerre ou plutôt la chasse et s’entre’égorgent absolument comme ont fait si longtemps les peuples européens susindiqués. Il faut ajouter en faveur des Indiens ou à leur honte – la circonstance est, comme à la correctionnelle, laissée à l’appréciation du juge – qu’ils se cassent la tête réciproquement à coups de boutou ou ne se transpercent de leurs flèches que quand ils sont ivres.
Et malheureusement leur goût pour l’alcool est tel que si ces lointaines tribus avaient un nom populaire, à l’égal d’un infortuné peuple du Nord, les Indiens détrôneraient, du droit du plus fort… buveur, les Polonais dans un proverbe connu83.
L’humour ici est le but principal du commentaire qui est fait au cours d’un voyage décrit
avec précision : quelques xénismes pour donner l’idée de la couleur locale (remplacer la farine
par le roucou), quelques comparaisons avec l’Europe pour illustrer un propos descriptif et léger
permettent d’insister sur l’éthos du voyageur bien davantage que sur les peuples qu’il ne
mentionne que pour l’exotisme des noms. Cette comparaison cependant entre des peuples
européens et des peuples indiens, pour humoristique qu’elle soit – et certes on ne saurait y lire
un programme politique – met en exergue une pensée analogique qui aplanit les différences. En
81 Tric-Trac, « Origine des scorpions. Légende arabe », Le Moniteur de l’Algérie, 10 septembre 1865. « Créole » s’entend ici au sens de « colonial ». 82 Le roucou est un arbre d’Amérique tropicale dont l’exploitation a enrichi les colons de Guyane. 83 C. Chanel, « Le long des Guyanes », La Feuille de la Guyane française, 31 juillet 1858.
287
ce qui concerne la Cochinchine, et par contraste, le propos ethnographique est plus affirmé et
se prête moins aux réécritures ou utilisations littéraires. Le deuxième numéro du Courrier de
Saïgon présente l’article suivant en tête de sa partie non officielle, preuve d’un matériau jugé
adéquat à la publication coloniale et à ses enjeux : « Populations asiatiques de la ville84 ». Il y
est question en effet de populations diverses, avec des religions diverses, mais dès les premières
lignes apparaît une population chrétienne. Dans le même numéro, une « Chronique annamite »
paraît en deuxième page qui présente le programme suivant : « Fragments d'histoire du
royaume annamite – Ses rapports avec Siam – Son émancipation de la Chine et son adoption
du système d'exclusion des étrangers85 ». Aucune trace ici d’humour ou d’esprit, pas le moindre
décalage ou jeu linguistique : on est bien dans l’exposé orientaliste d’une histoire envisagée au
prisme de la division. On trouvera dans les numéros suivants d’autres articles qui vont en ce
sens : ainsi d’un article sur une « Communauté de Juifs dans l’Empire chinois86 » ; d’un récit
d’expédition militaire au cours duquel on décrit les différentes populations
rencontrées87 ; d’une « tournée » plus apaisée, mais qui exploite ce même ressort d’une
description ethnographique en situation88. En seulement quinze numéros, le périodique colonial
a donné à lire, par plusieurs types de textes, la description de populations sur lesquelles le
colonial adopte un point de vue surplombant. Ces articles divers mettent en exergue dans les
colonies une division face à l’homogénéité du colonisateur : les titres que nous avons cités
indiquent assez qu’il n’y a là nul effort pour créer une distance entre ces notices informatives
et d’autres, plus agricoles ou techniques. Ce constat d’une mise sur le même plan de
l’information, qu’elle soit agricole ou ethnographique, est à nuancer : mais il interroge tout de
même la spécificité d’une presse coloniale qui crée entre ses objets d’étude des liens visibles
aussi par des ressemblances stylistiques ou médiatiques.
« Une maison dont la façade est française et l’intérieur mauresque89 » Les autres de la colonisation sont objets d’étude, puis matériau littéraire grâce auxquels
le journaliste colonial construit une altérité démultipliée et incohérente ; pour autant, cette
vision négative de l’altérité n’empêche pas, selon les territoires et les possibilités, une écriture
84 « Populations asiatiques de la ville », Le Courrier de Saïgon, 10 janvier 1864. 85 « Chronique annamite », Le Courrier de Saïgon, 10 janvier 1864. 86 « Communauté de Juifs dans l’Empire chinois », Le Courrier de Saïgon, 24 février 1864. 87 25 mai 1864. 88 « Nouvelles et faits divers. Une tournée chez les Moi », Le Courrier de Saïgon, 25 juillet 1864. On trouve dans l’article des déclarations comme celle-ci : « Les Stiengs sont la tribu la plus méridionale de ces peuplades dites sauvages ». 89 Un arabophone, « Un bruit de cruche arabe », L’Indépendant de Constantine, 20 mars 1863. Emprunt au Courrier de l’Algérie.
288
de la fusion, de l’assimilation. On a évoqué, en deuxième partie, la question architecturale, qui
métonymise un certain rapport au territoire étranger vécu par les colonisateurs : dans cette
citation qui fait en partie notre titre, elle incarne en effet un « fantasme irénique » qui est celui
de la cohabitation réussie90. Le fait que le texte d’origine soit signé par « un arabophone »
confirme bien ce que ces premières lignes laissent entendre : L’Indépendant de Constantine,
qui publie le texte, donne une image apaisée de la colonisation. En Algérie, l’idée d’une
« fusion » possible porte à débat, mais elle est ancrée dans les débuts de la colonisation, comme
peut en témoigner le texte suivant, qui mêle différents niveaux de représentation de cette fusion
entre les peuples et les cultures, dont les saint-simoniens sont les plus fervents défenseurs91.
En femme qui pense à tout et qui veut la fusion complète, Mme Allix fit préparer à ses visiteurs un déjeuner à la mode et les invita au repas de noces. Ils acceptèrent non sans avoir fait beaucoup de façons, et l’on se mit à la même table, tous confondus, chrétiens et musulmans, Maures et Français. […] Cette fête, vraiment pittoresque, que la plume orientale de Victor Hugo pourrait seule décrire convenablement, mais que je puis à peine esquisser, a produit sur tous les convives français une profonde impression. J’ai appris qu’elle avait fait aussi beaucoup de sensation dans la population indigène. On en a parlé sur les terrasses, dans les cafés maures, et les détails du dîner et de la cérémonie ont défrayé pendant huit jours toutes les conversations d’intérieur92.
Besancenez, connu pour être le rédacteur de La France algérienne, est l’auteur dans son
périodique de cette description qui prend place en 1846. Il y relate le mariage de la fille de Mme
Allix, qui tient une école franco-arabe : on est loin alors de la racialisation qu’amènera la fin du
siècle, et ce discours garde les traces d’un orientalisme encore concurrent de la pensée coloniale,
comme en témoigne la mention de Victor Hugo. Mais Besancenez est surtout, et cet article le
signale, saint-simonien : c’est en effet dans cette mouvance que les contemporains d’Ismaÿl
Urbain défendent, entre autres, l’existence d’écoles franco-arabes93. Deux modes de
représentation se conjuguent en effet : celui qui adopte le lexique de la conquête, et celui qui
vante une fusion passant par l’apparat. C’est l’une des manifestations textuelles de l’aspiration
à la transformation que l’on peut retrouver dans les textes coloniaux, et elle n’est pas visible
qu’en Algérie. Le principe de la comparaison entre la métropole et la colonie se retrouve en
90 Voir le passage sur « le vieux récit irénique » de la colonisation qui est évoqué dans l’introduction de Cultures d’empires. Échanges et affrontements culturels en situation coloniale, Romain Bertrand, Hélène Blais et Emmanuelle Sibeud (dir.), Paris, Karthala, 2015, p. 25. 91 Voir particulièrement Michel Levallois, Ismaÿl Urbain. Une autre conquête de l’Algérie, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001. 92 A. Besancenez, « Mariage français et fête mauresque », La France algérienne, 31 janvier 1846. 93 Voir Michel Levallois, « Ismaÿl Urbain, ou le combat perdu de l’apôtre d’une Algérie franco-musulmane », Histoire de l’Algérie à la période coloniale, Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Paris, La Découverte, [2012], 2014, p. 131-134.
289
effet d’un territoire à l’autre : les coloniaux utilisent avec l’identité des corsaires en Algérie ou
avec l’identité caraïbe dans les Antilles : c’est l’une des manières de coloniser un territoire que
de jouer sans cesse sur les rapprochements entre la culture du colonisateur et ce qui est mis en
lumière comme étant la culture du colonisé. Ainsi de la comparaison entre Paris et la
Guadeloupe dans La France d’Outre-Mer, à propos des bateaux : « Le gros-bois c’est le coche
d’eau allant jadis d’Auxerre à Paris ; c’est la vénérable galiote transportant, sur la Seine, le
badaud Parisien à St.-Cloud94 ». Cette description du « gros-bois » permet en fait d’avancer
dans le récit de l’anecdote et dans la description des personnages présents sur le bateau que le
narrateur emprunte ; il permet aussi une critique politique par la suite. Mais pour nous, se lit
dans ce passage tout un réseau de références qui correspondent à l’identité de la colonie : le
Parisien et le Caraïbe y sont présents aux deux extrémités du paragraphe, et entre eux se
développe toute une image de la colonie, par ses ressources comme par ses habitants.
Mais prenez garde à vous, voyageur, de broncher ; vous êtes horizontalement étendu sur le lit de Procuste ; si vous faites un mouvement brusque, crac, l’esquif tourne sens dessus dessous ; vous allez boire un coup dans la coupe de Neptune ; c’en est fait de vous, si vous ne savez nager, si vous n’avez la prestesse d’un Caraïbe consommé, pour retourner le canot, le désemplir et vous y rembarquer. Ce jeu-là ne pouvait toujours durer et plaire à tous les goûts, à tous les sexes, à tous les âges, n’est pas Caraïbe qui veut95.
D’autres écritures et d’autres procédés permettent encore, sur tous les territoires,
l’écriture d’une fusion ; dans les Antilles ou en Guyane, cette dynamique est peu observable,
mais il reste quelques exceptions. Ainsi de ce texte où apparaît le personnage de la nourrice du
narrateur :
La solitude [des] longues allées me ramène au temps où la négresse qui surveillait mes premiers pas dans la vie, déroulait à ma faible intelligence les contes fantastiques de son pays idolâtre. Il me semble la voir encore, la vieille africaine, à la peau d’ébène, aux dents d’ivoire, m’entretenant de sa patrie toute pleine de gnomes aux ailes de flamme et de sorciers implacables qui vous jettent un sort dont la puissance vous fait sécher comme la branche dont la sève est tarie96.
Le personnage de la nourrice devient ici, sans mauvais jeu de mots, la matrice d’une
imagination qui emprunte aux stéréotypes pour définir une identité narrative nourrie par les
récits africains. Tout comme le mariage fait à la mode indigène était une possibilité de montrer
une adaptation du colonisateur au cadre culturel antécolonial, la nourrice africaine est à la
94 L’hermite de la case-pilote, « Le Bateau à vapeur », La France d’Outre-Mer, 19 avril 1859. 95 Id. 96 X., « La Patrie », Le Bien-Public, 31 juillet 1856.
290
Réunion la possibilité de donner au colonisateur une tradition plus longue, plus ancrée
géographiquement que celle de la simple colonisation : un rapport au continent africain. Ces
textes dont nous citons des extraits témoignent d’un mouvement qui peut trouver une expression
plus directe et plus claire ; dans Le Courrier de Saïgon, deux ans seulement après la création
du journal, le père Jourdain écrit ses « Observations sur le peuple annamite » et décrit l’un des
fonctionnements de la colonisation française :
Aussi est-ce un plaisir pour le Français de voir l’Indien, par exemple, de Karikal, l’aborder sans grandes façons, dans des pays éloignés comme Singapour ou Saïgon, et lui dire avec une grosse joie toute naturelle : moi, aussi français Karikal. Que l’on me trouve un pauvre indien de Madras ou de Calcutta, qui aborde aussi un anglais à Singapour ou à Saïgon et lui dise gaiement : moi, aussi anglais ; aussitôt je cède la palme aux fils d’Albion : ils ont assez d’autres qualités, mais qu’ils nous laissent le bon cœur, nous aurons encore une belle part97.
Le journal enfin a ceci d’intéressant que sa polyphonie permet de donner aux textes un
écho qui n’est pas toujours orienté dans la même perspective : les annonces officielles par
exemple peuvent y contredire l’orientation des faits divers. Dans les exemples que nous avons
cités, la fusion fonctionne comme un élément du métadiscours colonial, qui se retrouve démenti
par tout un corpus fictionnel ou d’actualité : tout se passe comme si une dichotomie émergeait
entre des unités narratives différentes. Le discours officiel, documentaire, sérieux, peut
revendiquer la fusion comme idéal de civilisation – encore que cela soit soumis aux orientations
politiques des feuilles et aux événements politiques – alors que les textes qui font l’actualité du
journal et son inscription dans la colonie même semblent présenter un pas de côté.
Dans Le Chitann paraît un dessin dont la légende annonce une « fusio-blague » qui
jouant sur les vieilles peurs racistes de l’union entre un indigène et une (ou plusieurs) femme(s)
blanche(s). La parole de l’indigène est précisée et moquée dans la légende : « A prisent moi star
français voulir mouquère français tenir trois – moi voulir marier98 ». La contradiction entre ces
97 R. P. Jourdain, « Observations sur le peuple annamite », Le Courrier de Saïgon, 5 février 1866. 98 « Fusio-blague », Le Chitann, 19 avril 1866.
291
deux types de textes médiatiques est intéressante : elle constitue une piste pour comprendre la
production des textes coloniaux.
L’esclavage ou le contact impossible
Les colonies dites de plantation posent la question particulière de l’esclavage et de ses
représentations dans le journal colonial : Antilles, Réunion, Guyane laissent percevoir dans
leurs périodiques le système esclavagiste, que l’on peut considérer facilement comme une
absence radicale de contact. Un peu à la manière dont Patrick Chamoiseau écrivait, de sa
« sentimenthèque » : « Du Nègre marron : Le bruit de l’eau dans les arrières-ravines, et le vent
qui se tait dans les hauts99 », on peut alors s’interroger sur la présence des esclaves, des marrons,
des affranchis, des « libres de couleur », de toute cette population coloniale que les périodiques
font apparaître dans les colonnes par différents moyens, et sous différentes rubriques, et des
traces que ces silhouettes laissent.
99 Patrick Chamoiseau, op. cit., p.24.
292
Quelle est, pour ces cas précis, la manière dont le texte représente le contact, la rencontre
– si tant est qu’elle existe ? La forme de présence la plus marquante dans les périodiques
coloniaux réside dans les textes officiels : demandes d’affranchissement et déclarations de
marronage, ventes aussi sont une partie importante des colonnes du journal, et plus précisément
de la partie officielle des journaux concernés. Les demandes d’affranchissement, comme l’on
peut le voir dans l’exemple ci-dessous, se présentent comme des listes publiées à plusieurs
reprises dans le journal100 :
En 1830, dans La Feuille de la Guyane française, un texte donné comme traduit de
l’anglais présente une scène de plantation qui n’est qu’une introduction à un exposé plus
pragmatique : l’auteur conclut à la nécessité de ménager ses esclaves, mais uniquement dans
une perspective de production. Les premières lignes, qui présentent un voyageur arrivant dans
une plantation, dressent le portrait du planteur nonchalant :
Couché à demi dans son hamac de bâche, sous sa vaste galerie, il aspirait avec volupté dans une longue pipe turque l’odorante fumée du bon tabac de la Havane. Au milieu d’une salle voisine de la galerie, on voyait une table garnie des débris d’un repas abondant. Une troupe d’enfants vint se ranger autour du planteur ; chacun avait une calebasse vide à la main, qu’il eut bientôt remplie des restes du dîner. Tous paraissaient joyeux, tous se retiraient en folâtrant.
Le lendemain matin je vis de bonne heure l’atelier du planteur. Tous ses esclaves avaient l’air content et vigoureux. L’hôpital renfermait peu de malades. Je suivis les nègres à l’ouvrage. Ils travaillaient avec vigueur et me paraissaient faire le double du labeur
100 La Feuille hebdomadaire de l'île Bourbon, 24 juillet 1831.
293
que d’autres esclaves que j’avais vus la veille, et qui m’avaient paru faibles et mal soignés101.
Il y a donc bien une comparaison entre deux planteurs et leurs modes de vie ; elle ne se
fait pas, cependant, par le biais d’un texte désincarné : bien au contraire, c’est ici le témoignage,
et l’image figée d’un planteur paternaliste, que le lecteur guyanais est appelé à se représenter.
Le stéréotype individuel se conjugue bien ici avec la description économique ; et ce texte
complète le kaléidoscope de la représentation du système esclavagiste que l’on peut découvrir
dans la presse guyanaise. Qui dit esclave ne peut pas négliger, et cela participe du même
mouvement, la question des « marrons », ces esclaves ayant fui les plantations pour vivre en
liberté. En Guyane, les marrons sont présents à différents niveaux ; avant l’abolition, ils sont
l’objet de faits divers comme celui que retranscrit La Feuille de la Guyane française du 28
décembre 1833. L’introduction faite par le rédacteur donne le texte qui suit comme le récit d’un
« affreux événement suivi de circonstances tout à fait romanesques [qui] est depuis quelques
temps l’objet des conversations à Cayenne102 » ; il se présente comme un rapport fait au
gouverneur. Le crime commis par les trois marrons nommés John, Auguste et Antoine est
présenté avec force détails, notamment ce passage : « À peine levé, j’étais encore à m’expliquer
le bruit que j’entendais sur le pont, quand John et Antoine se présentent armés et dans le plus
grand désordre moral, à la porte de la chambre où je me trouvais, en disant en créole le voici,
le voici103 ». Le récit est suffisamment long pour prendre plus d’une page, débordant sur le
supplément du numéro : le héros, Gustave Franconie, est alors le témoin de la cruauté des
marrons et un représentant de la société coloniale policée face à la sauvagerie. Après l’abolition,
le marron n’a plus la même portée en tant que personnage ; il peut être utilisé en tant
qu’élément – pour ne pas dire décor, tant les silhouettes n’ont que peu de traits individuels –
d’histoires à rire. L’Avenir en 1859, après avoir publié deux numéros qui ne contiennent que
des annonces faute de cautionnement, publie une variété sans titre ni signature, et qui affirme
en préambule la nécessité, en temps de crise, du conte qui va suivre :
Il y avait, une fois, un maire… Ce maire apprit que 2 ou 3 congos marrons se cachaient dans un
certain grand bois et que de là ils sortaient la nuit pour faire main basse sur les patates et les maïs de ses administrés. Il leur arrivait parfois de vouloir y joindre un peu de viande et, alors, ils volaient des poules, même des cabrits.
101 « Les deux planteurs », La Feuille de la Guyane française, 17 avril 1830. 102 G. Franconie, « Affreux événement », La Feuille de la Guyane française, 28 décembre 1833. 103 Id.
294
Il se dit dans sa sagesse, c’était un lettré : il n’est pas bon (non bonum est) il n’est pas bon que ce désordre continue. Je m’en vais traquer ces congos et les arrêter… si je puis104.
La suite de l’histoire ridiculise le corps des Pompiers, qui a pour mission d’arrêter les
deux marrons :
Un de ces groupes eut le bonheur de tomber sur deux Congos assis et occupés à faire rôtir des patates.
Quant aux autres groupes, trouvant de l’ombrage, ils s’assirent au frais, lâchèrent leurs bretelles pour se remettre de leur fatigue.
Les deux Congos, troublés dans leur cuisine, se levèrent. C’était le moment de leur sauter dessus et de les appréhender au
corps. Les Pompiers en jugèrent autrement. Ils s’enfuirent en criant au
secours, sans penser à éteindre le feu, comme c’était leur spécialité. – il est vrai qu’ils n’avaient pas de pompe. Puis, aux cris poussés par eux, tous les groupes s’étant réunis, on décida qu’on en avait assez fait pour aujourd’hui, et qu’il était temps de rentrer dans ses foyers105.
Enfin, après avoir épilogué sur le même ton, l’auteur clôt son récit par un nota
bene : « Ceci se passait dans les Indes en 1759 ». La distance finale, introduite avec la brièveté
d’une chute travaillée, modifie la perception que l’on pouvait avoir du récit et dénonce une
forme de censure plaisamment exhibée : le marron appartient à un folklore général, qui dépasse
les frontières de l’île et sert de support à une critique des autorités. Les marrons, il est vrai, sont
souvent des personnages forts, à laquelle l’histoire coloniale a été réceptive, et qui apparaissent
dans des romans, des études historiques ou littéraires106. Le Bug-Jargal de Victor Hugo, œuvre
de jeunesse, témoigne bien de l’empreinte qu’a pu laisser le thème du marronnage dans la
première moitié du XIXe siècle, et le Georges d’Alexandre Dumas, dans les années 1840,
également107 ; or la Réunion est un lieu particulièrement important quand il s’agit de
marronnage, et ce d’autant plus que la parution du Bourbon pittoresque d’Eugène Dayot dans
Le Courrier de Saint-Paul a connu une destinée particulière. Dans ce roman inachevé, paru en
feuilleton et qui a fait en grande partie la réputation du « Mutilé », les marrons occupent une
place centrale : les premiers épisodes mentionnent une fête créole, mais qui débouche
rapidement sur une « chasse » aux marrons. On est loin ici des publications de nouvelles, faits
divers romancés ou variétés historiques : Bourbon pittoresque marque réellement une étape
104 « Variété », L’Avenir, 23 mars 1859. La mention des « congos » marrons fait référence à l’origine des esclaves : étaient ainsi désignés les esclaves nés en Afrique, et non sur le territoire colonial. 105 Id. 106 Voir par exemple : Richard D. E. Burton, Le Roman marron : études sur la littérature martiniquaise contemporaine, Paris, L’Harmattan, 1997 ; René Louise, Le marronisme moderne : traditions populaires et recherches artistiques à la Martinique, Paris, Éditions caribéennes, 1980 ; Raphaël Confiant, Nègre marron : récit, Paris, Écriture, 2006 ; Rachel Danon, Les Voix du marronnage dans la littérature française du XVIIIe siècle, Paris, Garnier, 2015. 107 Bug-Jargal est paru dans Le Conservateur littéraire en 1820 ; Georges chez Michel Lévy en 1848.
295
importante dans la production littéraire insulaire, et la parution en feuilleton va en ce sens
également.
Le Bourbon pittoresque d’Eugène Dayot amplifie à dessein la mémoire des violences issues du marronnage pour mieux justifier les préjugés de l’auteur. Il va jusqu’à évoquer une guerre civile, une lutte à armes égales qui aurait pour enjeu la conquête des hauts pouvant aller jusqu’à l’expulsion des colons hors de l’île108.
Si Bourbon pittoresque est donc à part, les périodiques réunionnais exploitent autrement
les personnages d’esclaves ou de marrons. Le marron, par exemple, peut après l’abolition de
l’esclavage s’inscrire dans le paysage, comme en témoigne un passage de l’excursion faite
par Alphonse Alizart et que nous avons citée en deuxième partie. Le narrateur écoute ainsi
Valmire Boyer raconter l’histoire du malgache Ranecaze, un marron mort en 1825, trouvé par
des créoles partis « pour une chasse aux cabris-marrons ». L’histoire est déclenchée par la vue
d’une tombe, « une petite proéminence de terre couverte par un amas de pierres d’une teinte
verdâtre ». Le récit du guide, enchâssé dans le récit d’Alizart, se déroule ainsi :
Le malgache Ranecaze, homme à la fois robuste et agile, était marron dans ces montagnes depuis une quinzaine d’années. Il s’y était établi dans un boucan, épiant les mouvements des chefs de détachements de Saint-Denis, et s’enfuyant à leur approche. Ces derniers découvraient toujours dans sa hutte quantité de filaments de fanjans bouillis, lorsque peu de temps après le coup de vent de 1852, nos infatigables créoles Loricourt, Nérac, Larenaudy et François Mamazé se mettant en campagne pour une chasse aux cabris-marrons, escaladèrent le piton Grayel et trouvèrent Ranecaze mort dans le boucan, ayant à côté de lui une marmite encore pleine de morceaux de fanjans. Ils l’enterrèrent dans cet endroit, et le surnommèrent Mangeur de fanjans109.
Les différents ouvrages que nous avons pu consulter ne nous ont pas permis d’arriver à
ce personnage, Ranecaze : l’ouvrage de Prosper Ève, notamment, n’en fait pas mention.
Trois ouvrages marquent l’accession de l’esclave à la littérature fictionnelle entre 1844 et 1848. Ce sont dans l’ordre chronologique : Les Marrons (1844) et les deux nouvelles de Charles Marie René Leconte de Lisle : Sacatove (1846) et Marcie (1847). Marrons ou couples proscrits Noir/Blanc, ils incarnent en quelque sorte des Noirs problématiques, exclus en quête de liberté et d’égalité et d’enracinement, ou esclaves sortis du troupeau110.
108 Françoise Sylvos, « Les marrons bourbonnais, héros du courant abolitionniste », Sarga Moussa (dir.), Littérature et esclavage. XVIIIème – XIXème siècles, Paris, Desjonquères, 2010, p. 287. 109 Alphonse Alizart, « Excursion dans la rivière des patates-à-Durand et sur le sommet du piton Grayel, au bois de nèfles », Le Courrier de Saint-Pierre, 23 décembre 1870. 110 Rose-May Nicole, Noirs, cafres et créoles : étude de la représentation du non blanc réunionnais, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 185.
296
Ces marrons personnages de récits en prose sont bien différents de ceux de la presse, où
se ressent davantage la pression sociale coloniale. Ils sont des individus forts, et à ce titre ils
posent problème à la société coloniale, peut-être justement parce qu’avec eux, la mise en scène
d’un contact devient nécessaire. Plus tard dans le siècle encore, les anciens esclaves continuent
à apparaître dans certains textes de presse, parce qu’ils appartiennent à l’histoire : ainsi de
l’épisode de « L’Histoire de Saint-Leu » que La Malle fait paraître le 25 avril 1861 et qui
concerne la « Révolte des noirs111 ». Dans ce feuilleton, l’épisode de la révolte est intégré à un
récit plus large ; mais il marque le cinquantième anniversaire de la révolte de 1811, restée
célèbre dans l’histoire de l’île ; et l’auteur est probablement un ancien propriétaire
d’esclaves ; il possède une sucrerie. Dans la même perspective, on note la parution dans le
périodique La Liberté, en 1850, de « L'Histoire des gens de couleur libres aux Antilles
françaises, publiée à partir du numéro 12 jusqu'au numéro 55. Écrite par Marlet, elle retrace
l'histoire des affranchis et de leurs descendants depuis leur origine jusqu'aux évènements de la
Grande-Anse112 », événements qui ont lieu en 1833. Enfin, les esclaves – ou ici, la question de
l’esclavage – apparaissent aussi en fonction du contexte politique environnant ; pendant la
guerre de Sécession, La Malle prend position par la plume de Coquille, collaborateur régulier
du périodique :
La philanthropie triomphe, et il y a de quoi. Quatre millions de nègres délivrés tout à coup de la servitude, c’est un beau succès ! La médaille, il est vrai, a son revers, car cent mille noirs sont déjà morts de faim, de misère, de fatigue ou à coups de fusil, et le reste est dans un état lamentable. Les sauveurs en prennent assez gaiement leur parti :
« A moins que les gouverneurs provisoires nommés dans les anciens Etats confédérés ne prennent des mesures qui soient à la fois énergiques et prévoyantes, tout le bienfait que la race nègre tirera de l’affranchissement, ce sera de disparaître à peu près complètement du sol qu’elle a, durant plus de deux siècles, fécondé de ses larmes autant que de ses sueurs. »
Ceux qui parlent ainsi sont les héroïques rédacteurs du Journal des Débats. Après tout, ils ont promis de délivrer les noirs de la servitude et non de la mort.
Plutôt la mort que l’esclavage, C’est la devise des Français113.
Le reste de l’article développe une ironie qui rend palpable la « connaissance » dont se
prévaut le journaliste face à ses collègues métropolitains : le contact colonial, ici avec
l’esclavage, sert d’arrière-plan à une posture ironique.
111 De Chateauvieux, « Histoire de Saint-Leu », La Malle, 25 avril 1861. 112 Stella Pamé, Contribution à l'étude de la presse martiniquaise 1850 – 1855, mémoire sous la direction de M. le Professeur Pierre Albert, Université Panthéon-Assas, Institut français de presse et de l'information, 1977, p. 119. 113 Coquille, « La philanthropie triomphe », La Malle, 28 septembre 1865.
297
1.3 Prisonnier ou chasseur : un colonial renfermé sur lui-même
S’il y a certes une écriture du contact et de la rencontre dans les périodiques coloniaux,
elle n’est pas cependant la plus importante : le colonial en lui-même est une pierre angulaire de
l’écriture médiatique coloniale, et à lui seul il mobilise des ressources littéraires poussées.
Davantage que le contact ou la rencontre, les textes de la presse périodiques se focalisent plutôt
sur le colonisateur et ses avatars. Si l’on s’en tenait à une opposition conceptuelle entre le Même
et l’Autre, il faudrait constater que le Même est lui aussi soumis à des stéréotypes : positifs et
idéologiquement marqués, ils permettent d’affirmer l’identité de la colonie autant que les
stéréotypes altérifiants appliqués aux colonisés. Au concept général de l’Européen arrivant sur
un territoire qu’il ne connaît pas pour le coloniser répondent des réalisations plus concrètes : le
prisonnier, l’aventurier, le chasseur ou encore le philanthrope sont ainsi des figures qui
permettent de saisir le polymorphisme des silhouettes européennes destinées à être lues par les
coloniaux et par les métropolitains. Le prisonnier ou le chasseur, l’un étant en position de
faiblesse par rapport au colonisé, et l’autre au contraire en position de force, constituent les
deux pôles de notre étude. Dans cet étrange jeu de miroir, le lecteur colonial aperçoit les piliers
de la colonisation, et l’ensemble relève d’un fonctionnement textuel bien défini, entre
intertextualité et balises narratives.
Les prisonniers en Algérie ou la survivance de l’épée114 La signature d’un certain « Mahmoud Cusson », qui est imprimée dans quelques
numéros de L’Écho d’Oran en 1851, peut laisser rêveur, puisqu’on y lit dans le nom même une
forme de mélange. Le personnage en lui-même, d’après ses traces biographiques, s’avère
encore plus intéressant, puisque c’est un renégat, un Belge passé dans le camp d’Abd el-Kader
et revenu ensuite vivre parmi les Européens. Quand paraît le feuilleton « Les premières amours
d’un renégat115 », on donne donc à lire aux coloniaux d’Oran le récit d’une trahison : pourquoi
ce choix éditorial ? Le titre oriente la lecture vers le romanesque, mais on peut parier que la
signature est alors connue : cette tension entre la réalité et la fiction met en lumière le rôle
fondateur de ces récits de prisonniers qui vont caractériser la production littéraire autour de la
conquête de l’Algérie. Les racines de cette fascination pour le personnage du prisonnier sont à
trouver dans le passé : les « Barbaresques » sont le lieu d’histoires d’enlèvements, d’évasions,
114 Pour les antécédents, voir François Moureau, Captifs en Méditerranée (XVIe – XVIIIe siècles). Histoires, récits et légendes, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2008. 115 Mahmoud Cusson, « Les premières amours d’un renégat », L’Écho d’Oran, du 9 au 27 août 1851.
298
de témoignages. Dans le même Écho d’Oran, c’est ainsi que l’on trouve, le 2 mars 1850, un
feuilleton intitulé « Le Captif116 », qui donne des indications historiques sur cette page de
l’histoire algérienne ; mais le terreau de ces récits de captivité va surtout se retrouver dans les
épisodes de la guerre contre Abd el-Kader. En effet, à la réalité de cette guerre répondent
plusieurs publications de récits de prisonniers, publiés dans la presse contemporaine : le
lieutenant de frégate Defrance, le trompette Escoffier, le civil Beauprète, le capitaine Blanc de
Loire et plus tard le capitaine Bruxel sont ainsi parmi les prisonniers devenus célèbres. Plus
tard, en 1871, on pourra joindre à ces noms celui de Louis Saint-Pierre. Pour le lieutenant
Defrance, Le Moniteur algérien se charge de présenter le texte comme suit : « Nous
emprunterons autant que possible les paroles de cet officier qui a écrit les faits principaux de sa
captivité, ainsi que les observations qu’il a pu recueillir, dans un mémoire qu’on a bien voulu
mettre à notre disposition117 ». Mais le journal officiel de la colonie n’est pas le seul à répercuter
les récits d’emprisonnement : en 1842, L’Akhbar rend compte du décès du capitaine Blanc de
Loire, « dans le camp de Cid Mohammed ben Allal, khalifah d’Abd-el-Kader, où il était du
reste fort bien traité » mais où il n’a pas survécu à l’hiver118. Cette nouvelle d’un décès tranche
quelque peu avec le reste du corpus de prisonnier que nous avons mis au jour ; on publie plutôt
le récit des captivités que l’annonce factuelle des décès ; on publie aussi les récits d’évasion, à
l’image de l’aventure du jeune Beauprète119. Le Saf-Saf publie ainsi en 1851, et en feuilleton,
« La captivité du trompette Escoffier120 », écrite par Ernest Alby – auteur qui se chargera de
reprendre et de publier tout un recueil de récits de prisonniers. Le texte est ici transformé par la
voix de ce narrateur qui réorganise la matière toute romanesque de l’enlèvement et de la
captivité. On comprend mieux le personnage d’Ernest Alby si l’on s’arrête sur la notice
biographique que lui consacre Gustave Vapereau dans son édition de 1865 : né à Marseille,
ayant étudié au lycée Louis-le-Grand, fervent saint-simonien, Alby a publié en 1837 Les
Prisonniers d’Abd-el-Kader, « puis sous le nom de A. de France, enseigne de vaisseau, une
série d’ouvrages à laquelle appartiennent La Captivité du trompette Escoffier (1848), les Vêpres
marocaines (1853). L’un des créateurs du roman-feuilleton historique, il a fourni des œuvres
de ce genre à la plupart des revues et des journaux121 ». La captivité du trompette Escoffier,
lorsque Le Saf-Saf reprend le texte, est donc déjà paru depuis trois ans. Ces parutions
116 « Le Captif », L’Écho d’Oran, du 2 au 16 mars 1850. 117 « Cinq mois de captivité dans l’intérieur de la province d’Oran », Le Moniteur algérien, 7, 13 et 20 janvier 1837. 118 L’Akhbar, 23 janvier 1842. 119 « Un nouvel échappé de la Deïra », La France algérienne, 20 juin 1846. Pris dans L’Écho d’Oran. 120 Ernest Alby, « La captivité du trompette Escoffier », Le Saf-Saf, 14 et 28 juin 1851. 121 Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, Paris, Hachette, 1865, t. I, p. 25.
299
médiatiques posent parfois la question du genre du texte : lorsque paraît « Le Prisonnier de
guerre (épisode de la guerre d’Afrique122) » dans La Seybouse en 1848, la narration a beau être
à la première personne, la signature de V. Bounoure ne correspond pas au nom du personnage
dans le texte, Juan. On trouve pourtant dans les premières lignes les éléments de véridicité que
demande un tel récit : « Notre petite colonne, sous les ordres du général Randon, était partie de
Bône dans les premiers jours du mois de mai 1846 ; nous longions la frontière de Tunis en nous
dirigeant vers le sud ». Mais il s’y mêle aussi une pointe de burlesque qui sème le doute :
Je fus l’objet d’un examen très-attentif, absolument comme d’une bête curieuse… ou plutôt comme un conscrit qui se présente au conseil de révision, car dans ce moment (je dois bien l’avouer en rougissant, à ma honte et confusion bien grande), je me trouvai dans un appareil plus simple encore Qu’une beauté qu’on vient d’arracher au sommeil
La citation de la réplique racinienne de Néron ici, alors que le personnage est présenté
à la tribu arabe dans laquelle il est arrivé, ancre le récit dans une écriture plus légère que celle
du simple témoignage. Dans la notice du Vapereau n’est pas cité un autre ouvrage d’Ernest
Alby, pourtant particulièrement riche pour nous : son Histoire des prisonniers français en
Afrique depuis la conquête, paru en 1847123. On y lit, mêlés de considérations sur le pays, les
habitants, la langue, le récit d’enlèvements de plusieurs personnages (De France, Meurice,
Moncel, des pêcheurs de corail italiens), y compris les Lanternier – l’auteur en tire même un
récit à part, car Jeanne (ou Virginie) Lanternier épousera ensuite le sultan du Maroc. Le Saf-Saf
publie en feuilleton un « Voyage à la cour du Maroc124 » écrit par Ernest Alby, et qui focalise
l’attention sur l’histoire de la jeune femme. En 1865, c’est La Seybouse qui fait paraître, dans
une chaîne d’emprunts conséquente (le texte est repris du Moniteur universel qui l’a lui-même
tiré de L’Abeille de Fontainebleau), le récit du retour du capitaine Bruxel après trente-trois ans
de captivité.
Un de nos compatriotes a voyagé, il y a quelques jours, avec un officier français qui rentre dans sa patrie, après une captivité de trente-trois ans.
Cet officier, M. Bruxel, capitaine au 20ème de ligne, aurait été fait prisonnier en 1831, en Algérie, dans une rencontre avec les Arabes. Porté comme disparu, il avait été ensuite remplacé : on le croyait mort. Le fait est qu’il avait été bien près d’avoir la tête tranchée ; mais, sur ordre du chef de la tribu, il aurait été emmené à trois cents lieues dans l’intérieur des terres, où, depuis le premier jour de sa captivité, il était employé à garder les troupeaux, et où il aurait été entièrement privé de nouvelles de sa famille et de sa patrie.
122 V. Bounoure, « Le Prisonnier de guerre (épisode de la guerre d’Afrique) », La Seybouse, 3 juin 1848. 123 Ernest Alby, Histoire des prisonniers français en Afrique depuis la conquête, Paris, Desessart, 1847. 124 Ernest Alby, « Voyage à la cour du Maroc », Le Saf-Saf, de novembre 1850 à février 1851.
300
Profitant de ce que, pendant la dernière insurrection arabe, la surveillance dont il était l’objet s’était un peu relâchée par suite du départ de tous les gens valides de sa tribu, M. Bruxel s’évada, et, après un long trajet accompli sur un chameau, il parvint à gagner la côte occidentale d’Afrique, d’où il prit enfin passage sur un navire maltais, qui le débarqua à Carthagène (Espagne).
Le premier soin du capitaine Bruxel a été de rejoindre son régiment, où il lui a été délivré une feuille de route pour se rendre à Paris et régulariser sa position125.
L’événement n’est pas tant alors la captivité elle-même que le retour de l’officier perdu
après un temps qui ramène la colonie algérienne à son origine. La survie de l’officier est aussi
une survivance du passé, et la démonstration d’une ténacité qui est érigée en valeur première
des colonisateurs. Au fur et à mesure que se développe la colonisation, les récits de prisonniers
ponctuent les moments de révoltes. Ainsi, en 1871, au moment de l’insurrection des Mokrani,
d’autres prisonniers sont faits, d’autres récits publiés : dans L’Indépendant de Constantine, on
lit ainsi en juin le récit de « Vingt-deux jours de captivité parmi les Arabes126 », signé par Canal,
adjoint du Borj-Menaïel ; en octobre, « Huit jours de captivité chez les Arabes127 », par Louis
Saint-Pierre. Le titre même devient habituel, et déroule la trame de ces captivités sanctionnées
par une évasion et un retour triomphal à la vie coloniale. Ces récits sont marquants, à tel point
qu’Alexandre Dumas dans Le Véloce rend lui aussi compte de la libération de prisonniers – à
laquelle il participe puisque le bateau sur lequel il voyage, le fameux Véloce, a pour mission
première d’aller les chercher, et notamment Courby de Cognord128.
Les chasseurs : le récit cynégétique rejoue la guerre coloniale Un autre modèle s’offre aux récits médiatiques algériens, tout comme il apparaît aussi
dans les récits de Cochinchine : celui du chasseur de lions, de tigres, de panthères. La réputation
d’une Algérie dangereuse car peuplée de bêtes féroces a été faite par Jules Gérard (1817-1864)
d’une part, dans la deuxième moitié du siècle, et plus tard par Alphonse Daudet quand il
s’inspire de ce dernier pour son Tartarin de Tarascon129 ; elle circule, dans les journaux, jusque
dans les autres colonies, comme en témoigne cet extrait de L’Avenir publié à Pointe-à-Pitre :
Les journaux d’Alger racontent le triste et émouvant drame que voici : samedi dernier, vers trois heures du soir, la femme D…, épouse d’un honnête et laborieux colon espagnol, était occupée dans un champ
125 La Seybouse, 28 janvier 1865. 126 Canal, adjoint du Borj-Menaiel, « Vingt-deux jours de captivité parmi les Arabes », L’Indépendant de Constantine, 27 juin 1871. 127 Louis Saint-Pierre, « Huit jours de captivité chez les Arabes. Récit de la captivité du jeune Saint-Pierre », L’Indépendant de Constantine, 21 octobre 1871. 128 Alexandre Dumas, Le Véloce, ou Tanger, Alger et Tunis, paru en livraison à Paris, 1848. Des nouvelles de l’officier sont publiées dans Le Courrier de Philippeville, 5 octobre 1846. 129 Alphonse Daudet, op. cit.
301
à moitié défriché, situé à quelque distance de Kouba, et à proximité des hautes broussailles qui vont aboutir à un ravin profondément encaissé. Elle avait avec elle sa petite fille, âgée de quatre ans, qu’elle avait déposée à l’ombre, sous une touffe de palmiers nains, et à laquelle, en ce moment, elle tournait le dos. Tout-à-coup, un cri perçant se fait entendre. La femme D… se redresse. Que voit-elle, grand Dieu ! Une panthère, une horrible panthère qui était sortie du fourré, et qui tenait entre ses dents sa petite fille, et la regardait elle-même avec ses yeux flamboyants. A cet aspect, la malheureuse mère demeure sans mouvement et sans voix, et comme pétrifiée. Le monstre, profitant de cet instant d’indécision, s’éloigne avec sa proie, et d’un bond s’enfonce dans les broussailles130.
Ces « drames » que la presse rend avec pathos mettent d’autant plus en lumière les
épisodes de chasse dans lesquels s’illustrent les coloniaux, souvent au détriment des populations
locales. Dans le schéma de fait divers qui se met ainsi en place, le colonial héroïque est appelé
à l’aide par une population dépassée et terrifiée ; grâce à une arme et à son courage, il tue la
bête sauvage. Tous ces discours de chasse sont donnés comme authentiques, et l’on précise
l’origine de l’information ainsi que les noms des chasseurs. Ainsi d’une chasse aux tigres que
l’on lit dans les « nouvelles locales » du Courrier de Saïgon :
Nous recevons de Trambang la nouvelle suivante : Un tigre, dont la présence remplissait d’effroi les populations voisines, sur lesquelles il avait levé un sanglant tribut, vient d’être tué, le 12 décembre, à deux heures de l’après-midi, par M. Gatte. Les Annamites l’avaient découvert dans un fourré, compris entre une haute palissade et une mare d’eau : ils le cernèrent et envoyèrent prévenir les résidents français. Le sieur Kassubeck, surveillant des lignes télégraphiques, arrivé le premier sur les lieux, a pris de suite la direction des traqueurs annamites et attaqué l’ennemi dans son repaire. Le tigre s’élance hors du fourré, en poussant des rugissements qui font reculer les Annamites ; il renverse le brave surveillant, resté ferme au poste qu’il s’était choisi. Le sieur Kassubeck conserve son sang-froid et blesse l’assaillant d’une balle en plein corps ; celui-ci, effrayé des cris des traqueurs, n’ose franchir leur cercle et se rue sur la palissade ; ses bonds sont impuissants. M. Farège profite du moment pour tirer à travers la palissade ; son feu ne parvient pas à renverser l’animal, qui se retourne alors de l’autre côté, et débouche de la broussaille par l’issue que gardaient MM. Gatte et Brun. Un premier coup de feu, tiré par ce dernier, n’arrête pas la course du tigre, qui bondit furieux et rugissant sur ses deux adversaires. Nulle retraite possible et part et d’autre ; les Français ne peuvent se mettre à l’abri des atteintes du monstre qui, lui, ne peut reculer : car le cercle des traqueurs se resserre derrière lui. Heureusement le coup d’œil et le sang-froid de M. Gatte ne lui firent pas défaut en cette heure solennelle : deux coups mortels frappent, au milieu de son élan, le tigre qui vient tomber expirant à ses pieds131.
Le lexique militaire est significatif ici : il transforme le fonctionnaire colonial
(surveillant des lignes télégraphiques, autrement dit garant d’un aspect essentiel du
130 « Nouvelles diverses », L’Avenir, 27 mars 1852. 131 Le Courrier de Saïgon, 5 janvier 1866.
302
fonctionnement de la société coloniale) en héros militaire ; se retrouve bien ici une opposition
entre l’action du côté des colonisateurs et la passivité du côté des colonisés. Ces moments de
tension, qui rejouent en fait les récits des guerres de conquête sur un autre terrain, les auteurs
médiatiques perçoivent toute leur portée, jusqu’à la signaler dans le titre, comme c’est le cas
pour un feuilleton de L’Écho d’Oran en 1852 : « Une chasse à la panthère et ses conséquences.
Esquisse de mœurs132 ». La chasse est l’occasion de peintures morales de la colonie ; mais elle
est plus que cela : dans les années 1840, elle est un matériau humoristique pour une histoire
d’adultère dans « Un chasseur changé en cerf, ou le nouvel Actéon133 » ; elle est un matériau
de faits divers dans « Un nouveau Gérard – histoire d’hier134 » ; elle est enfin, dans les années
1860, et selon une continuité chronologique remarquable, symbole de la transformation de
l’Algérie dans « Souvenirs d’un vieil algérien. Une chasse au lion à Philippeville en 1844135 ».
La veine humoristique des chasses se lit donc dès 1842, avec le personnage de « M. Duflos,
honnête épicier d’Alger » qui, partant à la recherche d’un lion, ne tue que son propre chien et
rentre pour trouver son épouse en plein adultère – d’où le jeu sur les « cornes » de ce nouvel
Actéon. Le récit est fait à la première personne, par un effet d’enchâssement : le narrateur
explique que l’épicier s’est « servi du papier où [le récit de la journée] se trouvait consigné pour
envelopper une livre de sucre [qu’il achetait] modestement dans son magasin136 ». L’aspect
burlesque de l’écriture tourne en dérision, à travers la chasse et le récit de l’épicier, plusieurs
figures importantes de la colonisation. Il critique d’abord les fermes, emblèmes de la « mise en
valeur » du territoire, en expliquant qu’il se trouve « auprès d’une ferme, qu’on appelle Modèle,
je ne sais trop pour quoi, vu qu’elle ne paraît pas un modèle à imiter » ; il donne aussi une image
dévalorisante de l’armée : « si je n’ai pas encore de gibier, en revanche je possède un
magnifique coup de soleil qui me donnera un aspect martial à ma première garde : j’aurai le
faux air d’un troupier qui revient d’expédition » ; enfin, il rejoue même les scènes de danger
que l’on peut trouver dans la littérature de l’époque quand il croit rencontrer des Hadjoutes.
Tandis que j’examine un lit de sable où il ne manque que de l’eau pour faire une rivière, j’aperçois sur le bord opposé deux cavaliers bédouins qui paraissent étudier mon signalement. Je ne doute pas que ce ne soit des Hadjoutes ; et n’ayant aucune espèce d’arme pour leur livrer combat, je me sauve dans un marais où j’entre jusqu’aux aisselles. Il ne me paraît pas encore assez profond et je crains que mon buste ne soit
132 E.V. Fenech, « Une chasse à la panthère et ses conséquences. Esquisse de mœurs », L’Écho d’Oran, du 21 février au 25 septembre 1852. 133 « Un chasseur changé en cerf, ou le nouvel Actéon », L’Akhbar, 10 février 1842. 134 A.D., « Un nouveau Gérard – histoire d’hier », La France algérienne,12 mai 1846. 135 Bou Achra, « Souvenirs d’un vieil algérien. Une chasse au lion à Philippeville en 1844 », Le Moniteur de l’Algérie, 25 septembre 1863. 136 « Un chasseur changé en cerf, ou le nouvel Actéon », L’Akhbar, 10 février 1842.
303
aperçu par l’ennemi. Pour diminuer cette chance fâcheuse, je jette ma casquette et me courbe de manière à avoir de l’eau jusqu’au niveau de la lèvre inférieure. J’attrape un affreux coup de soleil sur la tête. Les bédouins s’éloignent enfin, je sors du marais en y laissant toutefois les débris de mon fusil, ma casquette, ma carnassière et mes souliers, trop heureux de n’y pas laisser la vie137.
Ce texte humoristique coexiste avec d’autres récits bien plus sérieux ; outre les
entrefilets signalant tel acte de bravoure accompli par un Français, des textes plus longs
héroïsent véritablement les chasseurs de panthères ou de lions. C’est le cas du « nouveau
Gérard », un gendarme nommé Vermey, qui est décrit dans La France algérienne en 1846 :
Au lointain on entendait le glapissement criard des chacals, et les hurlements sinistres de la hyène ; mais le chasseur n’avait des oreilles et des yeux que pour la panthère, qu’il semblait flairer ce soir-là. Tout-à-coup, deux chacals passent en bondissant près de lui ; une hyène les suit ; ces animaux paraissent fuir un ennemi. Vermey a la prescience d’un grave évènement : il redouble d’attention ; à ce moment la brise lui amène un sourd frémissement ; il entend une respiration bruyante, précipitée ; sans doute l’ennemi approche. Vermey prépare son canon, il était temps. Une panthère énorme paraît à quinze pas de lui : elle est horriblement belle, ses yeux flamboient dans l’obscurité comme deux lucioles ; sa gueule ouverte présente une double rangée de dents aigues. Vermey ne sourcille pas ; la terrible bête s’arrête un instant et darde son brûlant regard dans la direction du gendarme ; elle l’a deviné… alors la redoute vomit sa mitraille, l’animal fait un saut prodigieux et retombe foudroyé138.
Cet extrait est à la mesure du reste du récit : après avoir été blessée, la panthère se relève
et bondit sur le gendarme qui la poignarde, non sans être marqué au visage par les derniers
efforts de l’animal. Le texte se clôt sur le constat suivant : « Quant au gendarme Vermey, il ne
se propose rien moins que l’extermination totale des bêtes féroces de la province d’Alger ».
Dans ce fait divers somme toute banal, le récit transforme le gendarme en héros animalisé,
preuve d’une force physique vantée par l’idéologie coloniale : aux aguets, il « flaire » la
présence de la panthère et lui fait face sans hésitation ; l’auteur se permet même un arrêt sur les
regards des deux protagonistes qui transforme la scène, présent de narration à l’appui, en face
à face extraordinaire. La phrase finale conforte un autre pan de cette idéologie, celle de la
domestication du territoire – dont il a été question dans notre précédente partie. En ce sens, ce
récit est davantage conforme à la légende coloniale de la chasse au lion ou à la panthère que
l’on retrouve dans les années 1860, quand il s’agit de raconter des « souvenirs » et de montrer
par là même l’évolution de la colonie, son implantation réussie. Rien d’étonnant alors à ce que
137 Id. 138 A.D., « Un nouveau Gérard – histoire d’hier », La France algérienne,12 mai 1846.
304
Le Moniteur de l’Algérie se charge de cette mise en valeur de la continuité historique qui a
conduit à la fin de la fascination pour le lion :
Jules Gérard a singulièrement dépoétisé le lion. Adroit tireur, doué à forte dose d’une impassibilité courageuse, qui lui fait braver froidement les plus grands dangers, il a détrôné l’ancien roi du désert. Le récit de ses exploits, - et Dieu sait s’il en est avare, - a fait descendre le lion au rang de simple bête de vénerie. Bonbounel et Chassaing, de leur côté, n’ont pas peu contribué à activer cette décadence. De sorte qu’aujourd’hui, il n’est pas de sanglier poltron de la Macta qui ne semble à nos modernes Nemrod, tueurs de cailles et de bécassines, aussi redoutables pour le moins que Sa Majesté le lion elle-même. Les Arabes seuls, - peut-être parce qu’ils n’ont pas lu les livres de Gérard, - ont conservé une crainte superstitieuse et probablement salutaire, de ce farouche animal, à la crinière noire, à la griffe cruelle.
En 1844, - époque à laquelle se passèrent les faits que je vais raconter, - on n’était pas aussi rassuré qu’à présent. Le lion avait conservé sa splendeur légendaire, et si sa présence était annoncée dans un quartier, c’était avec terreur que l’on parlait de ses farouches exploits.
Moi-même, j’étais arrivé depuis peu de temps en Algérie. Ma passion pour la chasse, peut-être aussi le vaniteux désir d’envoyer à mes amis de France le récit d’exploits peu communs me poussait vers les aventures. J’avais tué des chacals et tiré des hyènes. Un jour, même, l’on m’avait entraîné jusqu’à El-Arouch pour exterminer une panthère139.
Ce que l’on remarque ici, cependant, c’est la manière dont les indigènes sont exclus de
cette évolution historique : « Les Arabes seuls » ont encore peur de l’animal féroce, écrit
l’auteur, marquant par là le stéréotype déjà bien ancré dans les mentalités de la superstition
indigène. En Algérie ou en Cochinchine, donc, les récits de ces chasses sont un moyen discret
mais prégnant de marquer une supériorité coloniale : devenus lieux communs de la
colonisation, marqueurs d’exotisme et témoins de la force des coloniaux, les récits cynégétiques
donnent aux journaux de notre corpus un matériau premier à modeler en fonction des
personnages coloniaux rêvés. Ces deux personnages, le prisonnier et le chasseur, sont les plus
signifiants parmi d’autres. Ils apparaissent comme les moules discursifs dans lesquels le
colonial peut illustrer sa force agissante ; s’accordant presque avec le schéma actanciel d’un
Greimas, les textes périodiques sont ainsi au premier plan d’un autoportrait colonial qui
conditionne les portraits autres.
Plusieurs modalités de rapport aux autres se font jour dans la presse coloniale locale,
reflétant ainsi les différentes positions politiques qui accompagnent les débats de la colonisation
(abolition de l’esclavage, occupation restreinte ou totale, régime militaire, colonie
139 Bou Achra, « Souvenirs d’un vieil algérien. Une chasse au lion à Philippeville en 1844 », Le Moniteur de l’Algérie, 25 septembre 1863.
305
pénitentiaire…). C’est donc bien une littérature idéologique à laquelle les coloniaux avaient
accès, et qui pouvait se manifester sous différentes formes, par différents genres. L’une de ces
formes réside dans l’écriture de l’histoire, point central et foyer autour duquel s’établit l’identité
coloniale : dans les textes, l’utilisation de personnages issus des différents groupes qui
composent la société coloniale se fait selon une historicisation caractéristique de la pensée
coloniale.
2 Une écriture de la diffraction : s’inscrire dans le flux historique
Cette forme de « rencontre » que les textes médiatiques coloniaux mettent en place se
résout dans une tension qui n’est pas seulement ancrée dans le présent : il s’agit aussi d’une
représentation historicisée. La colonisation se construit selon le récit fait par le vainqueur, et
dans une pensée de l’histoire qui repose sur la rupture : même en Algérie, où les textes
soulignent une continuité avec le passé antique et latin du territoire, c’est bien ce motif de la
rupture historique qui permet de mettre en mots l’histoire. Mais justement : quand commence
l’histoire pour les colonisateurs d’un territoire ? À partir de quand peut-on faire la mise en récit
de l’histoire d’un peuple colonisé ? Dans Le Courrier de Saïgon, la réponse est clairement
apportée quand on lit les premières lignes des « Notes historiques sur la nation annamite »
publiées dans le supplément :
La nation annamite, lors de l’expédition de Tourane, aux mois d’août et septembre 1858, était certainement une des nations les plus inconnues du globe. En France, on savait alors que la Cochinchine et le Tông-King avaient des missionnaires depuis le premier quart du XVIIe siècle, et que dans ces deux contrées la religion chrétienne avait été et était encore cruellement persécutée. Mais, quels étaient les peuples qui habitaient ces deux pays ? Quels étaient leur origine et leur berceau ? Étaient-ils vraiment différents de nationalité ? N’étaient-ils pas au contraire un seul et même peuple, très-ancien, aussi ancien que la Chine, et ne se distinguant réellement l’un de l’autre que par la permanence de l’un dans le lieu d’origine et par l’émigration de l’autre dans les pays conquis ? Ces peuples étaient-ils encore tributaires de la Chine ou s’en étaient-ils complètement émancipés ? Quand avait eu lieu cet affranchissement et comment ? Le peuple habitant, il y a trois et quatre siècles, depuis Tourane jusqu’au fleuve de Saïgon et celui qui habitait il y a deux cents ans toute la basse Cochinchine actuelle, existaient-ils encore et n’étaient-ils pas aussi ce peuple annamite ? Toutes ces questions n’avaient aucune solution sérieuse et bien connue. On se contentait forcément de prendre dans des relations de voyages, plus ou moins intéressantes, et dans les Annales de la Propagation de la Foi, quelques idées des mœurs et des coutumes annamites, quelques notions vagues et confuses de la position géographique des produits et des ressources de pays compris in globo
306
dans l’Indo-Chine tout entière et que l’on confondait volontiers avec tout ce qui la compose140.
Le mouvement est ici intéressant, car l’on y retrouve les éléments de l’histoire entendue
par la colonisation : la date fondatrice de la conquête, à partir de laquelle se déroulent des
interrogations sur le passé de peuples dont on met en avant le mystère, mais en passant par des
sources occidentales ou acceptables pour des Occidentaux. « Une des nations les plus inconnues
du globe » avant la conquête française : l’expression même qui inaugure le texte fait percevoir
ce modèle de l’aventure coloniale, dont la fin de notre extrait montre aussi l’évolution et
l’aboutissement. C’est en effet la mise en texte d’une position d’autorité que l’on lit dans cet
article, et l’aboutissement textuel des premiers questionnements formulés. Sans que ce modèle
d’écriture soit répandu dans toute la presse coloniale, on observe cependant des problématiques
semblables quand il s’agit d’aborder les autres coloniaux : il faut les inscrire dans le récit de la
colonisation. Plus largement, la question problématique du traitement des autres a produit
quantité de textes théoriques visant à comprendre les liens entre le « même », occidental
conquérant, et « l’autre ». Tantôt individu représentatif d’un peuple, tantôt au contraire élément
isolé qui ne correspond pas aux valeurs indigènes, « l’autre » est un concept labile. Il s’incarne
cependant particulièrement dans les textes où s’écrit l’histoire : en constituant une galerie de
héros coloniaux, et parfois de héros anticoloniaux, la presse contribue à forger une identité qui
repose sur quelques individualités remarquables, facilement transmuables en personnages
romanesques ou épiques. C’est une problématique qui correspond d’ailleurs à ce qui peux
exister, au XIXe siècle, dans les études littéraires : le héros ou la foule ? Et qu’en est-il alors
d’une pensée du « peuple » ? Est-ce une notion qui ne s’applique qu’aux coloniaux, d’après
leur presse ? L’incarnation de valeurs ou de problématiques se fait en tout cas au sens premier
du terme dans la littérature médiatique : le personnage est souvent symbolique. D’un point de
vue médiatique, les textes consacrés à la connaissance des peuples colonisés n’ont pas de place
établie dans le journal, pas plus qu’une appartenance générique bien déterminée : notices,
variétés, feuilletons sont les rubriques de parution de textes pourtant signés parfois par les
mêmes auteurs, et portant sur des sujets voisins. Et pourtant, chacune de ces rubriques ne
produit pas le même écho sur la nature même du sujet que le texte construit : il y a bien, dans
le cadre très particulier du journal, une circulation du savoir et une inflexion particulière donnée
à ces textes historiques ou ethnographiques. Entre le « romantisme anthropologique141 » qui
140 P. Le Grand de la Lyraie, « Notes historiques sur la nation annamite », Le Courrier de Saïgon, 5 septembre 1865. 141 Douglas Bronwen, « L'histoire face à l'anthropologie : le passé colonial indigène revisité », Genèses, 1996, p. 127. URL : http://www.persee.fr/doc/genes_1155-3219_1996_num_23_1_1390. Consulté le 24 mars 2017.
307
veut que les sociétés dites traditionnelles soient anhistoriques, et le rappel obsédant de
l’Antiquité africaine, les différentes colonies n’ont pas le même rapport au temps, qui pourtant
peut subsumer la vision coloniale en général, mais sans rendre compte des spécificités propres
à chaque territoire, à chaque peuple et à chaque fonctionnement colonial. Voit-on dans les textes
coloniaux une évolution de l’écriture historique, qui accompagnerait la tendance générale à
séparer l’histoire de la littérature142 ? Le constat n’est pas si clair, et la vue peu dégagée a
priori : plusieurs points d’ancrage permettent donc d’étudier la manière dont la presse coloniale
participe à la transformation de l’écriture de l’histoire.
2.1 Les conflits coloniaux ou les moments de comparaison
La presse coloniale étant le point de départ et la raison profonde de toute notre étude,
nous n’avons pas orienté la présente thèse en fonction d’une chronologie historique, préférant
chercher une cohérence d’abord médiatique. Mais la presse est actualité ; et sur les territoires
coloniaux, elle est particulièrement soumise aux conflits qui naissent de l’occupation française.
En Algérie, ainsi, la conquête est considérée comme achevée en 1857 avec l’occupation de la
grande Kabylie, mais diverses révoltes, d’ampleur et de conséquences différentes, traverseront
tout le siècle ; en Nouvelle-Calédonie, l’insurrection de 1878 marque les esprits jusqu’à devenir
un moment fondateur de l’identité kanak ; dans les colonies esclavagistes, le marronnage
d’abord puis l’abolition sont l’occasion de conflits. La spécificité de l’écriture médiatique
coloniale tient alors à la « chaîne médiatique143 » qui se crée dans la représentation du héros, au
sens d’individu remarquable, et ce, qu’il soit colonial ou anticolonial : le personnage circule de
texte en texte, de place en place dans l’économie du journal. Les lignes éditoriales des
périodiques coloniaux peuvent varier selon les régimes ; mais la colonisation elle-même n’est
évidemment jamais remise en cause : quand il y a conflit, la presse se révèle donc unanime à
prendre le parti des armées coloniales, quelles que soient les conditions particulières des
affrontements. En ce qui concerne le camp « anticolonial », pour le dire vite, l’on se focalisera
sur les conflits restés les plus marquants dans l’histoire coloniale, et les individus qui y sont
liés. Abd el-Kader en Algérie, Ataï en Nouvelle-Calédonie représentent ainsi deux cas
142 Voir Ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature contemporaine, Paris, Seuil, 2014. La revendication d’une écriture historique « scientifique » se fait davantage à la fin du siècle, mais le mouvement amorcé est plus ancien. 143 Amélie Chabrier, Les genres du prétoire : chronique judiciaire et littérature au XIXe siècle, thèse de littérature française sous la direction de Mme la Professeure Marie-Ève Thérenty, soutenue à l’Université Montpellier III, 2013.
308
intéressants de héros anticoloniaux : l’un visible jusqu’à l’aveuglement dans la presse coloniale,
l’autre au contraire oublié, presque disparu dans les annales du colonisateur144.
Une galerie de héros coloniaux Sur le modèle de l’histoire exemplaire, les périodiques coloniaux traitent quelques
individus comme des modèles à suivre, qu’ils soient partie prenante de l’actualité ou
appartiennent déjà à un passé même proche. Les premiers héros individuels de la colonisation
sont les militaires : et la poésie officielle qui remplit les colonnes des périodiques laisse assez
entrevoir quelle place l’histoire coloniale leur accorde145. Mais l’anecdote tient aussi une place
particulière dans la reconnaissance des héros militaires, à l’image de celle consacrée à deux
blessés dans L’Akhbar du 9 juin 1840 :
Parmi plusieurs beaux traits qui ont signalé la prise du col de Teniah, on cite le suivant, que nous nous empressons de publier d'après l'autorité de témoins oculaires et authentiques. Un soldat zouave, atteint d'un coup de feu dans la poitrine, gravissait péniblement le sentier escarpé qui conduit au sommet de cette partie de l'Atlas. Un capitaine d'état-major, M. D'Abrantès, vint à passer auprès de lui ; et ému de compassion, lui proposa le cheval sur lequel il était monté. Merci, mon capitaine, répondit le zouave : Dieu merci les jambes sont bonnes encore et peuvent me porter jusque là-haut. Mais, ajouta-t-il, en lui montrant un malheureux étendu à quelques pas, voici un camarade qui a reçu une balle dans le pied et que sa blessure empêche de marcher. Votre cheval pourra lui sauver la vie. – M. D'Abrantès, pénétré d'admiration pour cet acte de dévouement exécuté avec la simplicité d'un homme qui ne paraissait pas même soupçonner qu'il y eût là quelque mérite, s'empressa de faire monter sur son cheval le blessé que le zouave lui avait signalé, et ne le quitta qu'après l'avoir remis entre les mains des employés de l'ambulance146.
Les indigènes de l’Armée d’Afrique se trouvent aussi rédimés par une stature de
héros – orientaux, certes, mais héros : dans La France algérienne, deux épisodes sont ainsi
racontés qui mettent en avant le courage des spahis147. Ces anecdotes de héros militaires
circulent dans la presse française : jusque dans Le Créole, feuille de l’île Bourbon on peut en
lire quelques traits. Le 21 août 1840, ce périodique réunionnais fait ainsi paraître le court récit
d'un combat en Algérie, qui se clôt sur la mention du mot reçu par un officier français après
avoir blessé un chef arabe.
« Je te reconnaîtrai, chrétien, disait le billet : à la première rencontre, je t'appellerai par ton nom, et si tu oses te mesurer seul avec moi, je te
144 Réhabilité récemment : voir Didier Daeninckx, Le Retour d’Ataï, Paris, Gallimard, 2006. 145 Par exemple J. Margéridun, « L’Algérie. Au maréchal de Mac-Mahon », Le Moniteur de l’Algérie, 13 janvier 1865. Emprunt au courrier d’Oran. 146 « Les Deux blessées » [sic], L’Akhbar, 9 juin 1840. 147 A.D., « Bou-Maza (l’homme à la chèvre) », La France algérienne, 10 septembre 1845.
309
défie. » Le chrétien, comme vous le pensez, a relevé le gant du musulman, et il ne manquera pas de camarades qui se feront ses hommes d'armes148.
D’autres cas font ressortir ainsi des paroles remarquables, qui dressent le portrait du
colonisateur idéal, qu’il soit soldat anonyme ou aristocrate : ces textes brefs mettent en avant
des actes et des paroles qui définissent la stature des héros coloniaux. Dans les îles issues du
premier empire colonial, l’histoire coloniale cependant ne met pas toujours en avant des
personnalités guerrières : la conquête est trop ancienne pour cela. Mais d’autres événements
peuvent servir à fournir des personnages héroïques : ainsi, ce n’est qu’en 1876 que l’on peut
trouver un bel exemple de l’incarnation des valeurs coloniales dans une héroïne, Marie
d’Orange. Le texte qui la présente commence par une réflexion sur le manque de reconnaissance
envers les héros dans les colonies, alors que « ces terres de feu au sein desquelles la lave
bouillonne, ont toujours produits les grands dévouements, les grands cœurs, et les actions
d’éclat ». Dans une rhétorique enflammée, le journaliste en appelle ensuite aux Annales et au
père Dutertre pour relire l’histoire de l’île à l’aune du courage créole, et il en vient à écrire
l’épopée qu’il demande149.
Qui donc est Marie d’Orange ? Une femme du peuple, la femme d’un canonnier. Était-elle esclave ou libre ? Noire ou de couleur ? Qu’importe ! L’héroïsme n’a pas de couleur, l’héroïsme est sacré ! Et qu’a-t-elle fait ? Ce qu’elle a fait… je vais vous l’apprendre : Le 29 juin 1667, le chevalier Harmant, commandant l’armée navale d’Angleterre, venait à la portée du canon reconnaître le mouillage de nos vaisseaux ; il avait appris par un certain Lombardon, corsaire, que la flotte française arrivée à la Martinique dans le plus grand désordre, manquait entièrement de poudre.
Le récit suit ensuite l’arrivée des Anglais et les péripéties du combat, jusqu’à l’irruption
du présent de narration qui va véritablement révéler la figure héroïque.
Encore quelques instants, et c’en est fait de nous. Les Anglais poussent des hurrahs frénétiques, déjà ils crient… Victoire ! La batterie est battue en brèche, l’assaut va se donner. Victoire ! … Non ? Car en ce moment apparaît une femme, les cheveux épars, la figure noire de poudre, criant : Vive la France ! Sus aux ennemis !!!! Cette femme, c’est Marie d’Orange ! Cette femme… c’est notre héroïne150 !
148 Le Créole feuille de l’île Bourbon, 21 août 1840. 149 Auteur de L'Histoire générale des Antilles habitées par les Français (1667-1671). 150 A. Ralu fils, « Les fastes de l’histoire des Antilles », Les Antilles, 16 février 1876. L’auteur précise en note que le texte est « extrait de [son] livre en voie d’achèvement La Martinique », mais nous n’avons pas trouvé trace dudit
310
Demandant en fait l’érection d’une statue à la gloire de cette héroïne martiniquaise, le
texte sert bien ici un propos d’actualité ; mais il a en outre cette maîtrise du récit historique, cet
enthousiasme qui signale la portée plus idéologique du texte. Un autre cas d’héroïsme est celui
de Juliette Dodu, héroïne réunionnaise de la guerre de 1870 en métropole, revendiquée par Le
Sport colonial par un poème d’Émile Bellier – mais il semble bien que ce soit l’une de ses
seules apparitions dans la presse réunionnaise. Il lui rend hommage dans la rubrique « La pêche
aux perles », qui publie des poèmes d’auteurs issus de l’île : saluant dans la pointe du sonnet la
« Sœur cadette de Jeanne, ô ma compatriote151 ! », le poète s’approprie un épisode
métropolitain, et rappelle ainsi la participation de l’île à la guerre contre les Prussiens.
Enfin, à défaut de héros militaires, les « célébrités » coloniales peuvent participer à la
création de l’identité coloniale. Ainsi d’une série de portraits : signés par un énigmatique
« J… », plusieurs « Célébrités créoles » paraissent en feuilleton dans Le Propagateur
martiniquais, à l’été 1873. On y trouve deux Guadeloupéens (Nicolas-Germain Léonard,
Guillaume Guillon Lethière), un Martiniquais (Moreau de Saint-Méry) et un Réunionnais
(Évariste de Parny). Ces courtes notices biographiques témoignent d’une forme d’historia
magistra vitae : le journal se fait ici le moyen d’une perception intercoloniale de la créolité,
avec des personnalités émanant de domaines différents. Le premier à être ainsi traité est Moreau
de Saint-Méry, en juin ; vient ensuite Guillaume Guillon Lethière, en juillet, puis Évariste de
Parny en août ; enfin, en octobre, Nicolas-Germain Léonard clôt la série152. Ces profils révèlent
quel but est visé par l’énigmatique auteur de la série : Moreau de Saint-Méry (1750-1819) est
un historien rendu célèbre par son anti-abolitionnisme et la manière dont il a défendu la
classification raciale ; Guillaume Guillon Lethière (1760-1832) un peintre ; Évariste de Parny
(1753-1814) est le fameux poète réunionnais auteur des Chansons madécasses ; Nicolas-
Germain Léonard (1744-1793) est poète lui aussi, mais né en Guadeloupe. Historien, peintre,
poètes, issus de différentes aires : cette série plaide pour une reconnaissance intellectuelle des
créoles, revendication ancienne et que la presse réitère régulièrement, mais par touches et sans
prendre cet aspect plus massif.
ouvrage. Une publicité nous apprend que M. Ralu fils possède un magasin à Fort-de-France, où il vend notamment du tissu. 151 Ém. Bellier, « À Mademoiselle Juliette Dodu », Le Sport colonial, 31 mai 1879. 152 Dates précises : J…, « Célébrités créoles (Martinique). Moreau de Saint-Méry », Le Propagateur, 14 juin 1873, 19 juin 1873, 26 juin 1873 ; « Célébrités créoles (Guadeloupe). Lethière Guillaume Guillon », 19 juillet 1873 ; « Célébrités créoles (île Bourbon, aujourd’hui la Réunion) », 16 août 1873, 27 août 1873 ; « Célébrités créoles (Guadeloupe). Léonard (Nicolas-Germain) », 4 octobre 1873.
311
Un héros anticolonial : Abd el-Kader153
À propos des romans coloniaux, Martine Astier-Loutfi écrit : « Particulièrement
remarquable dans tous les portraits des colonisés est le fait que chacun de ses gestes est choisi,
interprété, comme une manifestation de sa ʺrace154ʺ » ; ce constat s’applique certes aux romans,
mais pas forcément au traitement d’un héros comme Abd el-Kader, que les coloniaux vont
parfois mettre à part pour pouvoir exalter ses qualités. La stature du héros se voit notamment
quand on le compare à son contemporain Bou-Maza, son contemporain et lui aussi héros
anticolonial, et pourtant bien moins prisé par la presse : il est vrai que Bou-Maza,
historiquement, n’a pas eu autant de poids qu’Abd el-Kader, mais la presse a encore accentué
ce fait. Il apparaît ainsi dans La France algérienne en 1846 davantage pour introduire des
épisodes glorieux de la geste des spahis que pour faire le portrait d’un ennemi inquiétant. S’il
est qualifié au départ de « chériff infatigable », et si le publiciste relève sa beauté et son
influence (liant l’une à l’autre), c’est pour mieux constater que « Bou-Maza est un Abd-el-
Kader au petit pied, et il attend que les évènements l’élèvent aussi haut que son modèle155 »,
sans que l’armée française doivent s’en inquiéter. Pour l’Émir, le traitement médiatique a été
tout autre sur le territoire algérien : la presse coloniale suit d’abord au jour le jour ses épisodes
guerriers ; il devient ensuite une silhouette récurrente des récits consacrés à l’Algérie, puis un
personnage déjà « historique », éloigné dans le temps, que l’on réhabilite après son parcours en
France et en Syrie : car, et ce sera en partie le problème de son traitement par la nation
algérienne après l’indépendance, Abd el-Kader n’est pas mort en résistant à l’occupation
française : il a survécu, et il a même obtenu la Légion d’honneur. Mais de son vivant, trois types
de textes médiatiques lui constituent une image qu’on pourrait dire bifrons pour le mélange
d’admiration et de répulsion qu’elle suscite156. Au départ, donc, dans les années 1830-1840,
Abd el-Kader est présent dans les bulletins d’information, mais aussi dans des rapports
d’excursions ou de combats. Le Moniteur algérien développe une véritable obsession pour
l’émir : les articles aux accents informatifs se succèdent qui visent à éclairer cet ennemi pour
les lecteurs coloniaux, et ce particulièrement après l’éclat de la prise de la Smala. On trouve
ainsi, le 20 novembre 1843, le fragment d’un ouvrage intitulé Deux ans chez Abd-el-
153 Quelques passages de ce développement sont issus d’un article en cours de publication sous le titre « Abd-el-Kader, de la presse coloniale du XIXe siècle à La Dernière nuit de l’Émir d’Abdelkader Djemaï », issu d’une communication effectuée le 25 septembre 2015 pendant la journée d’études « Figures historiques et mémoire(s) collective(s). De l’usage des héros en contexte colonial et postcolonial », à l’Université Paris VII – Denis Diderot. 154 Martine Astier-Loutfi, Littérature et colonialisme : l’expansion coloniale vue dans la littérature coloniale française, 1871 – 1914, Paris, Mouton & C°, 1971, p. 63. 155 A.D., « Bou-Maza (l’homme à la chèvre) », La France algérienne, 10 septembre 1845. 156 Karima Aït Dahmane, « Catégorisations et stéréotypisations de l’altérité dans le discours de conquête (1830-1847) », Insaniyat, 2007, n° 37. URL : http://insaniyat.revues.org/4134. , Consulté le 10 septembre 2015.
312
Kader157 ; puis au début de l’année 1844, le règlement de l’armée d’Abd el-Kader, par l’officier
Eugène Daumas158 ; le 5 février 1844, une variété donne à lire des lettres d’un supposé Parisien
qui a rencontré Abd el-Kader et décrit sa politique, sa vie, son physique aussi159 ; le 10 juillet
1844, c’est justement la « Zemala » de l’émir qui est décrite après sa capture – l’article court
sur plusieurs numéros – avec le plan que nous avons mentionné dans la partie précédente160.
Cette littérature documentaire et assumée comme telle se double d’une littérature de témoignage
qui joue sur la personnalité de l’émir : il est présenté comme un être plein de contradictions,
suffisamment complexe pour susciter le commentaire. Quelques récits de prisonniers, étudiés
plus haut, apparaissent dans les colonnes du Moniteur algérien. Ainsi, dans le récit de De
France, Abd el-Kader est décrit comme un homme qui traite bien ses prisonniers, mais dont les
forces politiques s’affaiblissent, d’où une forme de cruauté. Là réside d’ailleurs l’intérêt
principal de l’article : permettre aux lecteurs algériens de se renseigner sur la défaite prochaine
du chef arabe, qui par exemple « ne put réussir à réduire […] deux tribus et à en obtenir l’impôt
: il lui fallut se retirer et se dédommager d’un échec par un acte d’une atroce cruauté161 ». Dans
ce que nous pourrions qualifier de « propagande » par anachronisme, la cruauté du chef de
guerre est mise en avant autant que son bon traitement des prisonniers français : par cet équilibre
axiologique, l’ennemi devient à la fois un adversaire difficile à combattre parce que noble, et
un chef terrible dont il faut débarrasser les indigènes eux-mêmes162. Dès 1847 et l’édition des
Prisonniers français d’Afrique cependant, qu’Ernest Alby publie en remaniant le récit de De
France, Abd el-Kader, parce qu’il a été vaincu, bénéficie d’une image cette fois clairement
valorisée : « le premier [De France] il a vu, il a entretenu l’émir, et il a su apprécier
physiquement et moralement la valeur de notre compétiteur163 », écrit Alby dans l’introduction
de son premier volume. Mais il nous faut ajouter que cette image positive est contrebalancée à
plusieurs reprises par la mention des mauvais traitements que subissent les prisonniers français
(femmes violées, hommes battus : le tout décrit avec force détails et indignations de
l’auteur) ; et surtout, par la mention, à plusieurs reprises du caractère extraordinaire de l’émir,
157 Léon Roches, « Notice sur les Coulouglis des Ouèd Zeïtoun. Combat soutenu par eux contre Abd-el-Kader », Le Moniteur algérien, 20 novembre 1843. 158 Eugène Daumas, « Règlement de l’armée d’Abd-el-Kader », Le Moniteur algérien, 20 décembre 1843. Ce général aux ouvrages nombreux finira même par collaborer avec l’émir, en 1851, pour l’écriture d’un livre sur les chevaux. 159 Le Moniteur algérien, 5 février 1844. 160 Eugène Daumas, « Renseignements historiques sur la Zemala de l’Emir Abd-el-Kader, fournis par des chefs attachés à sa personne et pris dans la razia de S.A.R. Mgr le duc d’Aumale », Le Moniteur algérien, 10 juillet – 10 août 1843. 161 « Cinq mois de captivité dans l’intérieur de la province d’Oran », Le Moniteur algérien, 13 janvier 1837. 162 Ce thème de l’impôt difficile à lever sera ainsi l’un des aspects que traitera un autre texte de la conquête. 163 Ernest Alby, Histoire des prisonniers français en Afrique depuis la conquête, Paris, Desessart, 1847, p. II.
313
qui le met à part de la population arabe. Dans une perspective idéologique coloniale, le héros
du camp adverse ne peut être gratifié de valeurs positives et héroïques que s’il n’est pas
représentatif de son peuple. S’amorce donc l’ancrage littéraire de la figure d’un émir que la
France sait reconnaître à sa juste valeur : quelle meilleure manière de justifier la colonisation
qu’en montrant comment le colonisateur sait apprécier, à travers ses héros, le peuple qu’elle
colonise ?
L’émir apparaît aussi dans de nombreux récits publiés dans la presse coloniale en tant
que silhouette dont le nom connote tout un imaginaire clairement négatif, parce qu’il ressortit
à la description du peuple et non de l’individu. Dès 1845, c’est au fil d’un récit pourtant
humoristique sur une chasse au lion que le narrateur fait intervenir son nom, avec la rhétorique
coloniale attendue (la mention des « barbares » va particulièrement en ce sens) qui joue sur la
charge négative que cristallise Abd el-Kader en tant que guerrier. Le paysage est lui aussi
marqué du souvenir des combats, et témoigne de la constante attention que la presse porte à
l’émir, dans une perspective de revanche, et avec le thème tout colonial de l’imitation.
Les combats meurtriers de Coléah et d’Oued-Lalleg, glorieux pour les armes d’Abd-el-Kader, et où l’on a vu pour la première fois les barbares essayer une contrefaçon de tactique européenne, ont consacré l’illustration de ces lieux dans les fastes militaires du pays164.
On trouve d’autres mentions éparses dans la presse d’un Abd el-Kader devenu symbole
culturel, signe symbolique de la colonisation. Dans L’Écho d’Oran du 6 novembre 1847 paraît
en feuilleton un étonnant « Épisode du temps de Hassan Bey », à une époque donc où Abd el-
Kader ne s’est pas encore rendu. Étonnant car ici, Abd el-Kader est un personnage orientalisé
à l’extrême, secondaire et ne se révélant complètement que dans la chute de ce bref feuilleton165.
L’intrigue est sommaire et sentimentale : Quaddour, l’amant de la favorite d’Hassan Bey doit
être exécuté ; or le jeune Abd el-Kader, ami d’enfance de la belle jeune femme, va aider à sauver
le condamné à mort. Après ces premières scènes topiques de l’orientalisme (femmes sur un
balcon au clair de lune, prison obscure de l’amant, exécution capitale et fuite), une ellipse
narrative d’une vingtaine d’années amène le lecteur au moment des combats de 1845. Le texte
se clôt ainsi :
Le soir, en avant d’une des faces du camp, il y avait cent têtes ennemies apportées par le goum, elles étaient couvertes de terre et de poussière ; l’une d’elle avait une barbe grisâtre, c’était celle de Quaddour qui préféra mourir que de fuir, après avoir proposé un
164 A. Toussenel, « Une chasse au sanglier à l’allumette chimique – Souvenir d’Algérie », La France algérienne, 5 mai 1845. 165 J. Pichon, « Épisode du temps de Hassan Bey », L’Écho d’Oran, 6 novembre 1847.
314
combat. C’était ce même Quaddour qui avait promis de donner son bras et sa vie au jeune Abd-el-Kader qui fut le voir à la prison, qui lui parlait encore quand il marchait au supplice, et pour le sauver. L’heure du dévouement était venue, et la reconnaissance paya son tribut, car Abd-el-Kader fut depuis reconnu sultan par nos arabes insoumis.
Le journal a été fondé en 1844 par le républicain Adolphe Perrier, et affiche une ligne
qu’on peut qualifier, par métonymie, de républicaine ; pour autant, cette vision positive et
romanesque du jeune Abd el-Kader ne s’explique pas uniquement par la distance qu’aurait le
propriétaire vis-à-vis de la Monarchie de Juillet. Il y a dans cette esthétisation, dans cette
orientalisation du personnage historique la trace d’un changement d’attitude. L’ennemi est aussi
un héros d’intrigues sentimentales qui, certes, ne le concernent pas, mais le montrent néanmoins
sous un jour léger – ainsi de ce passage qui précise que la favorite « fôlatrait » avec lui et ses
« compagnons du douar » dans leur jeune âge. Abd el-Kader commence à faire partie d’une
galerie de personnages orientaux ; à son nom s’attachent des connotations qui dépassent celles
d’un simple ennemi. En avril 1849, dans le Zeramna, le feuilleton « Un bal et une représentation
théâtrale chez les Kabyles », signé E.V.F., met ainsi en scène plusieurs Européens invités à une
fête « indigène ».
L’improvisateur parut se recueillir, et d’une voix qu’il s’efforçait en vain de défendre d’une certaine émotion, il s’écria : Al ras tal émir Abd-el-Kader ! Puis il fit succéder un brillant éloge du héros de la guerre sainte, du vainqueur des Français, de l’exterminateur prochain de la race chrétienne… Il s’enthousiasmait de ses propres paroles que sa fureur rendait incompréhensible et se rapprochait de nous en gesticulant avec véhémence, toujours suivi par le groupe hostile… […] Nous avons dit que l’acte de vigueur hasardé par G…lorsqu’il avait durement reproché au cheick la tiédeur dont il faisait preuve à notre égard, en avait imposé au plus grand nombre de ceux qui nous poursuivaient de leurs démonstrations hostiles, et que notre ami avait, en saisissant notre hôte par la barbe, vengé impunément par un outrage l’outrage que l’improvisateur nous avait adressé en faisant devant nous l’éloge de l’émir Abd-el-Kader166.
C’est l’un des rares moments de tension du récit : la valeur guerrière du nom même
d’Abd el-Kader montre bien comment une vertu quasi-magique s’attache au nom de l’émir pour
les Français – et dans la manière dont ils envisagent les « Kabyles » présentés dans le titre de
la nouvelle. Le nom est ici mobilisé dans la description d’un des thèmes récurrents, voire d’un
stéréotype, quand il s’agit de décrire la population « indigène » : le fanatisme. On en retrouve
tous les ingrédients, mais avec comme déclencheur le nom et la personne d’Abd el-Kader : c’est
en ce sens que l’on peut parler ici d’un « imaginaire négatif », d’un nœud profond de tension
dans lequel les lecteurs coloniaux peuvent se reconnaître. Après ces deux phases, cependant,
166 E.V.F., « Un bal et une représentation théâtrale chez les Kabyles », Le Zeramna, 21 avril 1849.
315
les années 1860 ancrent clairement la figure de l’émir dans le positif pour les lecteurs
français : il n’est plus le guerrier redoutable, mais plutôt l’homme de Damas, qui a protégé les
chrétiens167, le détenteur de la Légion d’honneur, le visiteur de l’exposition universelle… Le 3
septembre 1861, le Moniteur de l’Algérie traite de lui en feuilleton, publiant des extraits d’un
ouvrage intitulé Abd-el-Kader, sa vie politique et militaire, 1838 – 1860, par M. Bellemare, le
présentant comme « une des personnalités les plus remarquables de l’époque168 ». Les années
1860 semblent en effet une période propice au changement de perception de l’émir dans la
presse coloniale française : il n’y a plus trace de l’ambiguïté que la guerre exigeait, et l’émir est
même devenu une sorte de preuve exhibée par la France du bon fonctionnement de son
entreprise coloniale169. Enfin, en 1875, le personnage est si bien intégré à la presse qu’un
feuilleton de la société climatologique d’Alger commence ainsi : « En voyant le soleil darder
ses rayons embrasés sur les troupes françaises, Abd-el-Kader s’écriait : ʺVoilà le plus fatal
ennemi des Chrétiens !ʺ ». Abd el-Kader est devenu un signe, une portion figée du discours
colonial ; cette première phrase ne sert véritablement qu’à introduire un propos savant, puisque
le publiciste continue ainsi : « L’Émir, sans doute peu familiarisé avec l’étude de la
climatologie algérienne, attribuait à la chaleur solaire une action des plus nuisibles qui revient
à meilleur droit à l’humidité170 ». Au cours de ces trois phases, l’émir est donc traité selon trois
angles par la presse coloniale : le document, le témoignage et la fictionnalisation – cette
capacité à combler l’aspect informatif par l’identification de la personne réelle à un modèle de
personnage historique ou fictionnel. Nœud de la représentation de la colonisation, le personnage
historique est ainsi modelé par l’usage colonial, et les textes qui le présentent feront office de
sources pour les textes à venir : la représentation d’Abd el-Kader par les Français de l’époque
coloniale est l’un des jalons de la construction complexe du personnage, qui se jouera également
à la période post-coloniale.
167 Voir par exemple le texte de Benjamin Stora, qui en fait mention : « L’Émir Abd El-Kader. Guerrier Lucide, Savant Mélancolique. Conférence Musée Du Quay Branly Avril 2011 ». URL : http://www.univ-paris13.fr/benjaminstora/articlesrecents/251-lemir-abd-el-kader-guerrier-lucide-savant-melancolique. Consulté le 14 septembre 2015. 168 Le Moniteur de l’Algérie, 3 septembre 1861. 169 L’Indépendant de Constantine fait même paraître, le 20 mars 1863, une lettre de Si Elkhoudir ben Abd el Kader, « Bachadel et assesseur musulman près les tribunaux de Sétif », qui a écrit en tant que membre de la famille de l’Émir à L’Écho de Sétif pour réfuter l’information selon laquelle un neveu d’Abd el-Kader se serait converti au christianisme. On peut lire cette publication comme le reflet des rumeurs qui circulent alors. 170 « Société climatologique d’Alger », Le Mobacher, 21 mars 1875.
316
La disparition du héros : le cas d’Ataï
À l’aune de ce qu’un héros comme Abd el-Kader a pu provoquer comme écrits chez les
colonisateurs français, l’on peut se demander ce qu’ont donné d’autres héros dans d’autres
territoires coloniaux. La Nouvelle-Calédonie a été le terrain, comme les autres territoires
colonisés par la France, d’affrontements sur le long terme entre les populations locales et les
colonisateurs français, et un soulèvement en particulier a marqué l’histoire faite par le
vainqueur, celui de 1878. Mais avant même 1878, et pour rendre compte de ces conflits, la
presse n’hésite pas à recourir à une dramatisation de l’action, usant de termes axiologiques forts,
de mise en suspens (par un imparfait d’imminence contrecarrée, par exemple). Ces textes
circulent d’une colonie à l’autre, comme on le voit dans ce que publie La Feuille de la Guyane
française à propos de la Nouvelle-Calédonie :
Une sourde trahison, un complot horrible se tramaient depuis longtemps dans la tribu de Wagap.
La plupart des conjurés appartenaient à la famille du grand chef ; leurs criminels desseins avaient pour but la destruction et la ruine des missions catholiques de la Nouvelle-Calédonie.
Tant que vécut le grand chef Emmanuel, homme énergique, d’un esprit droit et éclairé, d’un dévouement inébranlable, rien ne vint altérer la bonne harmonie entre les révérends pères maristes et leurs catéchumènes. La confiance, la sécurité semblaient régner de toute part. Mais, à la mort de ce vaillant guerrier, les haines, les passions se réveillèrent.
Ses trois frères, à l’instigation d’un oncle aussi lâche que dangereux, au mépris du serment qu’ils avaient fait de respecter les dernières volontés d’un mourant, ne tardèrent pas à se liguer entre eux ; et appelant à leur aide le chef Kahoua, notre plus grand ennemi, jurèrent la perte de nos vénérables missionnaires.
Le 16 janvier, toute la tribu de Wagap, conduite par les principaux chefs de village, se rua en masse sur la tribu de Tuho entièrement dévouée à la mission. L’établissement des révérends pères fut incendié, les troupeaux furent égorgés, les plantations dévastées. Plusieurs cadavres d’indigènes chrétiens, arrachés de leur tombeau, furent foulés aux pieds et mis en pièces. La fureur de ces féroces cannibales était à son comble.
La mission de Wagap allait subir le même sort, lorsqu’un détachement expédié en toute hâte de Kanala, dans une frêle embarcation, arriva sur les lieux où ce nouveau drame était près de s’accomplir171.
La presse coloniale préfère montrer les insurgés comme une foule
sauvage ; conséquemment, les héros anticoloniaux ne peuvent être mis au premier plan, et les
conflits peuvent être traités sans que ressorte l’image au premier plan d’un héros : c’est ce qui
arrive à Ataï. En 1878 donc, « les spoliations foncières et l’attitude du colonat, en particulier,
171« On lit dans le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie du 23 février 1862 », La Feuille de la Guyane française, 14 juin 1862.
317
les éleveurs172 » expliquent l’origine d’un conflit par lequel, pendant plusieurs mois, Ataï va
tenir tête aux colonisateurs français. Plusieurs textes parus hors du Moniteur de la Nouvelle-
Calédonie racontent les événements : le récit presque joyeux du commandant Rivière, glaçant
par le récit badin des cruautés françaises, le reportage d’un journaliste du Sydney Morning
Herald, le récit d’un appelé bourguignon, Michel Millet ; plusieurs articles de l’Illustration
aussi sont consacrés à ces épisodes néo-calédoniens, et on pourrait citer d’autres textes encore
qui rendent compte de cet épisode connu de la colonisation française en Nouvelle-Calédonie173.
Qu’en est-il alors de la presse coloniale ? Quelle silhouette dessine-t-elle à Ataï ? L’important
ici est que, justement, Ataï apparaît très peu dans les articles d’un Moniteur de la Nouvelle-
Calédonie qui est pourtant au cœur des événements et de l’inquiétude suscitée par les combats.
En 1878, c’est Charles Lemire (1839-1912) qui écrit sur l’insurrection, puisque tel est le mot
employé dans le journal174. Il a commencé son activité de publiciste dans le journal officiel de
la colonie en publiant des variétés, par exemple une description de la baie de Prony : le texte
est descriptif, centré sur les cultures, la géologie, bref d’un intérêt pratique et immédiat175. Il
s’agit bien alors dans un écrit habituel de la colonisation, visant à donner à connaître le territoire
d’un point de vue agricole, dans le cadre d’une exploitation économique. Il publie ensuite,
durant le mois de juin, des variétés sur les télégraphes, qui sont sa spécialité : là encore, rien
d’inattendu, et l’objet traité correspond à une idéologie coloniale affichant le progrès technique
comme but principal. Mais c’est dans le numéro du 10 juillet 1878 que survient la nouvelle de
l’insurrection, en ouverture de la partie non officielle ; et c’est le même Lemire qui se charge
du récit, lequel dure de numéro en numéro jusqu’en janvier 1879, date de la bataille de Mouéara,
difficulté majeure pour l’armée française. Les premiers textes sont relativement longs ; les
derniers ne seront plus que des entrefilets rendant compte des derniers feux d’une insurrection
qui aura duré de juin 1878 – la première attaque a lieu le 25 juin – jusqu’en avril 1879.
Le premier compte-rendu de l’insurrection commence ainsi : « Le 25 juin dernier a
éclaté subitement en Nouvelle-Calédonie une révolte kanak, qui a déjà fait une centaine de
victimes176 ». Ce premier paragraphe, qui correspondrait aujourd’hui au « chapeau » d’un
172 Isabelle Merle, Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie (1853-1920), Paris, Belin, 1995, p. 110. 173 Henri Rivière, Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. Insurrection canaque, Paris, Calmann Lévy, 1881 ; John Stanley James, Le Vagabond. La guerre en Nouvelle-Calédonie (1878), traduit et édité par Géraldine Pons-Ribot, Paris, La Petite Maison, 1989 ; Michel Millet, 1878. Carnets de campagne en Nouvelle-Calédonie, présenté par Alban Bensa, Toulouse, Anacharsis, 2004. On peut trouver les articles de l’Illustration dans l’édition du reportage de John Stanley James par Géraldine Pons-Ribot. 174 Charles Lemire est administrateur des Postes et télégraphes en France, en Nouvelle-Calédonie et en Indochine, administrateur colonial en Indochine (1886-1894), géographe. 175 Charles Lemire, « Notice sur la baie de Prony », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 15 mai 1878. 176 Charles Lemire, « L’insurrection canaque », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 10 juillet 1878.
318
article accrocheur, attire l’attention sur la circulation du texte : il est prévu qu’un tel article soit
repris et recopié par les périodiques métropolitains, et c’est ce qui explique la précision
géographique large ; plus loin dans le texte, les communes touchées sont précisées, et l’article
peut alors s’adresser au lecteur local. Malgré les événements, le journal n’arrête pas ses
publications habituelles : on apprend la prise de possession d’un îlot au nom de la France, une
nécrologie concerne un officier décédé d’une maladie à l’hôpital… Les nouvelles de
l’insurrection commencent en fait à s’intégrer au cadre régulier du journal : le titre
« Insurrection canaque » devient une rubrique que l’on retrouve de numéro en numéro. Les
nouvelles prennent l’apparence de dépêches télégraphiques : paragraphes très courts,
événements donnés au présent et peu détaillés, succession de nouvelles ; mais quelques
variations surviennent. Après les colonnes plutôt développées de l’été, le 2 octobre, le texte
prend la forme suivante, non signée :
Les nouvelles suivantes ont été affichées au chef-lieu depuis la publication du dernier numéro : 25 septembre 1878 – Hier au soir, les canaques de Nekou en grand nombre ont attaqué le poste de Gouaro, occupé par les marins du Lamothe-Piquet. Ils ont été repoussés avec de grandes pertes. Nous avons eu le libéré Redoua tué, sa femme blessée ; le surveillant Meyer, un de ses enfants, ainsi que deux condamnés ont été également blessés. 1er octobre – Les tribus de Wagap, de Gondou et Konè ont tué dix hommes aux révoltés de la Poya. Le chef Poo du grand Nekou a été tué. Le canaque Willi a été reconnu coupable de trahison et d’assassinat et passé par les armes à Bourail177.
Dans cette même perspective de variation formelle, dans le numéro suivant du 9 octobre,
un sous-titre précise qu’on va lire le « Résumé du 24 septembre au 9 octobre178 ». Jusqu’à la
fin de l’insurrection, le récit sera donc purement informatif. En comparaison, il est intéressant
de voir ici comment les périodiques métropolitains traitent de l’insurrection, et par quels
intermédiaires. Ainsi, Le Petit Journal du 5 septembre 1878 présente en deuxième page des
nouvelles de l’insurrection : « Le journal la Nouvelle-Calédonie du 4 juillet vient d’arriver à
Paris ; ce journal paraît à Nouméa ; il nous apporte le premier récit détaillé de l’insurrection des
Canaques ». Le Rappel du même jour se sert de la même source, et publie donc le même
texte ; c’est ainsi que la nouvelle se répand en France… sans passer par le Moniteur de la
Nouvelle-Calédonie pourtant officiel. Et en effet, La Nouvelle-Calédonie est un journal qui sera
177 « Insurrection canaque », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 2 octobre 1878. 178 Charles Lemire, « Insurrection canaque », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 9 octobre 1878.
319
souvent cité comme source ; il est facile de comprendre pourquoi si l’on compare les textes qui
en sont issus à ceux du Moniteur. Voici un extrait de ce qui est recopié dans la presse :
Mardi matin (2 juillet), on avait appris l’assassinat de la brigade de gendarmerie de la Foa ; tout le monde avait considéré ce crime comme isolé, et quelques-uns pensaient que l’arrestation des chefs des tribus voisines de la propriété du Chêne et sa famille avaient été quelques jours auparavant assassinés n’était pas étrangère à ce nouveau malheur. Personne n’émettait la possibilité d’une révolte organisée.
Dans la soirée de mardi, des télégrammes faisaient connaître que vingt et unes victimes avaient succombé à la Foa ; il y avait des colons, des condamnés, des libérés, des noirs. Tout ce qui touchait à la colonisation semblait désigné aux coups des assassins. On croyait encore à un soulèvement tout à fait local. On supposait que les Canaques des tribus qui reconnaissent Ataï pour chef, après ce massacre, gagneraient la montagne pour essayer de se soustraire aux troupes envoyées dans la journée du mardi179.
Le numéro du 30 septembre 1878 du Gaulois ajoute deux paragraphes qui montrent à
quel point la Nouvelle-Calédonie a pu circuler : le journal précise que le numéro ne leur est
parvenu que la veille, alors que deux autres titres parisiens ont publié le même texte, quoique
coupé, quinze jours auparavant.
De quoi pouvons-nous parler aujourd’hui, si ce n’est de la catastrophe qui s’est subitement abattue sur notre pauvre colonie : toute autre préoccupation disparaît devant les terribles effets de la révolte des tribus d’Ouarail et de Bouloupari.
Nous pensions être en pleine sécurité, nous appelions les Canaques de grands enfants, nous vivions au milieu d’eux sans crainte aucune ; quel réveil et quelle leçon pour l’avenir180 !
Or qu’a publié le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie pour décrire le même événement ?
Le 19 juin, sur une habitation européenne, à vingt-cinq kilomètres de Bouloupari, un assassinat fut commis par des canaques sur la personne d’un français transporté libéré, d’une femme indigène et de leur enfant ; les assassins étaient, paraît-il, de la tribu de Dogny. La gendarmerie de la Foa, à proximité de ces villages, et la gendarmerie de Bouloupari, à proximité du lieu du crime, mirent en état d’arrestation plusieurs chefs des tribus voisines jusqu’à ce que les coupables fussent livrés. Les recherches judiciaires continuaient lorsque, dans la nuit du 24 au 25 juin, la brigade de gendarmerie de la Foa, comprenant quatre gendarmes et un brigadier, fut assassinée par les canaques révoltés181.
Mais notre problème réside ici dans la disparition des numéros dont sont issues les
citations de la presse métropolitaine : introuvable aux ANOM et à la BNF, le journal est
179 « La Nouvelle-Calédonie », Le Petit journal, 5 septembre 1878. 180 « L’insurrection de la Nouvelle-Calédonie », Le Gaulois, 30 septembre 1878. 181 Charles Lemire, « L’insurrection canaque », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 10 juillet 1878.
320
manquant pour toute l’année 1878 aux archives départementales de Nouvelle-Calédonie182.
Plus tardivement, dans Le Petit Parisien du 19 décembre 1878, l’insurrection est traitée
aussi ; mais sous un angle intéressant pour nous, car apparaît alors le Moniteur:
Nous recevons, en même temps que le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, une lettre partie de Nouméa par le courrier du 27 septembre et renfermant de nouveaux détails, sur l’insurrection canaque. Les opérations simultanées qui avaient été combinées entre le commandant supérieur de l’arrondissement de Uaraï et le chef de Canala ont eu lieu le 1er septembre avec le plus grand succès183.
Enfin, le journal L’Univers suit pendant tout l’été les événements, avant de publier trois
lettres dans son feuilleton pour traiter de l’insurrection kanak : elles ne sont pas signées184. Les
sources sont donc multiples : lettres, rapports, articles du Journal officiel, dépêches de l’agence
Havas, et, en ce qui concerne les journaux locaux, davantage la Nouvelle-Calédonie que Le
Moniteur de la Nouvelle-Calédonie. Ataï trouve une plus grande popularité en métropole que
ce à quoi on pourrait s’attendre eu égard à son absence dans la presse officielle de Nouvelle-
Calédonie ; La Nouvelle-Calédonie l’évoque régulièrement, mais pas Lemire, qui se borne à
annoncer sa mort dans le numéro du 4 septembre 1878, sans qu’il ait été particulièrement
mentionné auparavant185. Il en est tout autrement à Paris : les textes citent Ataï, et il est à ce
point connu qu’on en trouve un étonnant portrait dans Le Voleur, en une du 4 octobre 1878, et
que nous reproduisons ici.
182 Georges Coquilhat en traite ainsi dans son site consacré à la presse de la Nouvelle-Calédonie : « La Nouvelle-Calédonie, ce n'est rien d'autre que les Petites Affiches affectées d'un nouveau titre : même sous-titre, même imprimerie, même gérant, même format, même prix... Une seule différence apparente au premier coup d'œil : alors que les Petites Affiches paraissaient imprimées sur trois colonnes, La Nouvelle-Calédonie, est imprimée sur quatre colonnes, un détail ; encore cette différence n'est-elle certaine que pour les numéros parus en 1879, on ne possède aucun exemplaire des trente-trois numéros publiés en 1878 ». URL : https://gnc.jimdo.com/la-presse-de-nouvelle-cal%C3%A9donie-au-siecle-19-these/i-2-premiers-journaux-independants/. Consulté le 20 mars 2017. Voir aussi, sur le même site, le lien spécifique : https://gnc.jimdo.com/journaux-de-noumea/la-nouvelle-caledonie-1878-1879/, consulté le même jour, qui présente plus précisément le journal. 183 « L’insurrection canaque », Le Petit Parisien, 19 décembre 1878. 184 12 janvier 1879, 20 janvier 1879, 7 février 1879. 185 Il est en effet mort le 1er septembre 1878.
321
Dans Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, dans l’été, la place est prise par les
mémoires adressés par les colons qui ont subi des pertes par le fait de l’insurrection : nom des
personnes, liste des biens et estimations se succèdent et donnent à l’insurrection de 1878 son
aspect final. La différence de traitement du héros anticolonial dans la presse métropolitaine et
dans la presse officielle locale laisse percevoir dans quelle mesure l’écriture médiatique en
situation est nourrie d’impératifs propres : Ataï ne peut gagner en publicité sur le territoire
colonial, pas par la voix officielle qui met en place le récit de la colonisation. Cette disparition
du héros est également le signe du mépris dans lequel sont tenus les Kanaks, puisqu’ils
n’accèdent pas aux rôles d’ennemis organisés et égaux aux Français.
La guerre marque l’origine de toute colonisation, et plus encore elle accompagne toute
colonisation : c’est donc l’un des points de repère de la littérature médiatique coloniale. Les
individus pris dans ces conflits cristallisent l’une des possibilités qu’utilisent les coloniaux dans
les textes pour construire une image d’eux-mêmes et des autres : le héros individuel est plutôt
Français qu’indigène ; quand émerge une personnalité forte, soit le colonisateur se l’approprie
et en marque le caractère exceptionnel, soit le héros disparaît des récits. L’actualité n’est pas
seule à expliquer ces traitements différents : l’écriture de ce qui apparaît comme une geste
coloniale se construit sur un plus long terme que le seul moment de l’affrontement. Dans le
même esprit de construction de l’altérité au sein d’une pensée historique, les conflits ne sont
pas les seuls à être écrits : le récit du passé est un enjeu fondamental de l’écriture médiatique
coloniale.
322
2.2 Raconter l’histoire : prise de pouvoir et affirmation de soi
L’établissement de l’histoire coloniale en France a déjà été étudié186 ; mais il faut
remarquer que la question de l’écriture de l’histoire se pose avec une acuité particulière dans
les colonies de peuplement, constat souligné par le sous-titre d’un article de Frédéric Angleviel
pour la Nouvelle-Calédonie187. Dans la construction textuelle médiatique de la colonie, en effet,
et particulièrement d’une colonie destinée à être peuplée par les colons français, l’histoire est
partie prenante, et ce sous différentes formes. Les textes historiques donnent en quelque sorte
leurs fondations aux autres textes des périodiques ; s’ils diffèrent en fonction des types de
territoires coloniaux, l’on y retrouve des traits propres à l’écriture de l’histoire occidentale,
selon ce qu’en souligne Michel de Certeau :
Une structure propre à la culture occidentale moderne s’indique sans doute dans cette historiographie : l’intelligibilité s’instaure dans un rapport à l’autre ; elle se déplace (ou « progresse ») en modifiant ce dont elle a fait son « autre » - le sauvage, le passé, le peuple, le fou, l’enfant, le tiers monde188.
La pensée par périodes, la compréhension de l’histoire par ruptures vont dans le sens de
ce qui sera écrit dans la presse coloniale, et déformé par cette nécessité de l’écriture
coloniale : là plus qu’en métropole se fait ressentir le besoin d’une écriture de l’histoire qui soit
menée par des Français, capables de faire le récit téléologique d’une arrivée bénéfique de la
France. En outre, il est facile de trouver dans la presse des colonies la certitude que l’histoire
coloniale ne peut être écrite que dans les colonies et par les coloniaux : dans La Malle du 23
mai 1872, le rédacteur Chalvet de Souville souligne cet aspect quand il écrit que « l’histoire des
colonies, même leur histoire la plus contemporaine, s’écrit en France d’une façon bien étrange,
et il ne semble guère que la présence des députés envoyés par elles au sein de la métropole pour
les mieux faire connaître ait en rien modifié les erreurs qui ont cours à leur sujet189 ». Les
colonies ont en effet à nouveau des députés ; mais surtout, ce que le rédacteur de La Malle
souligne ici, c’est le refus d’une mainmise métropolitaine sur un matériau colonial par
186 Voir Sophie Dulucq, Écrire l’histoire de l’Afrique à l’époque coloniale (XIXe – XXe), Paris, Karthala, 2009 ; Sophie Dulucq et Colette Zytnicki (dir.), Décoloniser l’histoire ? De l’« l’histoire coloniale » aux histoires nationales en Amérique latine et en Afrique, (XIXe – XXe siècles), Paris, Publication de la Société Française d’Histoire d’Outre-Mer, 2003 ; Pierre Singaravélou, « Des historiens sans histoire ? La construction de l'historiographie coloniale en France sous la Troisième République », Actes de la recherche en sciences sociales, 2010/5, n° 185, p. 30-43. 187 Frédéric Angleviel, « La littérature coloniale à vocation historique et la Nouvelle-Calédonie – 1853-1945, ou comment une colonie de peuplement génère des écrits historiographiques », Jacques Weber (dir.), Littérature et histoire coloniale, Paris, Les Indes savantes, 2005, p. 155-174. 188 Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Gallimard, 1975, p. 15. 189 Chalvet de Souville, « Discernement et sagesse », La Malle, 23 mai 1872.
323
excellence, la revendication d’une connaissance locale. Qu’il s’agisse de raconter le territoire
avant la colonisation ou les débuts de la prise de possession, l’histoire faite par les coloniaux et
publiée dans leurs journaux est le signe de l’importance du texte comme structure de l’identité
coloniale : écrire l’histoire coloniale revient aussi à affirmer page par page la prise de
possession. Rien d’étonnant alors à ce que les récits historiques représentent en quelque sorte
la quintessence de l’écriture médiatique coloniale : beaucoup d’éléments conduisent à ce
constat. L’écriture médiatique utilise le matériau historique dans le cadre de la construction
coloniale : et si l’on parle d’une écriture de la diffraction, c’est pour rendre compte de la
manière dont le sujet colonial est projeté sur l’arrière-plan historique. Le territoire colonisé n’est
envisagé que comme le lieu de l’appropriation de l’histoire : à partir de cet invariant se
construisent des cas particuliers.
Histoire antécoloniale : le poète, le missionnaire, le conservateur En Algérie, l’histoire antécoloniale est particulière, puisqu’elle relève d’une série de
contacts documentés et travaillés par des auteurs divers190. Le mouvement qui porte à
s’intéresser au passé algérien n’est pas neuf, et la description de cette part d’histoire peut se
faire par allusions, dans différents textes. La focalisation sur la piraterie algérienne est
fréquente, parce qu’elle permet de justifier la conquête de 1830 ; elle peut aller jusqu’à servir
de trame onirique à un poème, comme on le voit dans La France algérienne en 1846 :
Va, flotte. À toi le champ sans bornes de l’espace Et du temps infini. Remonte sur la trace Du passé ; montre-moi les farouches forbans, Dormant accroupis sur les bancs De leurs chebecks, de leurs galères assassines. Montre-moi les cachots des esclaves chrétiens, Les yatagans de feu, les longues carabines, L’air inquiet de leurs gardiens. Mais permets qu’en passant je salue et console D’un regard d’amitié, d’une douce parole, Ces fiers captifs courbant humiliés leurs fronts Devant leurs stupides patrons ; Que je donne à leurs cœurs l’espoir de la vengeance, Et qu’au lieu du croissant je leur montre qu’un jour Flottera glorieux le drapeau de la France Sur le repaire du vautour191.
Cette relecture du passé antécolonial déformé par l’histoire des captifs européens est un
thème majeur des écritures de l’histoire, et il se réalise dans des textes différents. Deux numéros
190 Nous employons le terme « antécolonial » plutôt que « précolonial » dans le souci d’éviter une terminologie trop téléologique. 191 H. R., « La nuit sur ma terrasse », La France algérienne, 9 mai 1846.
324
après, le même périodique publie également une « Histoire d’Alger et de la piraterie des
Turcs192 » qui est présentée ainsi :
Le libraire-éditeur Paulin a publié, en 1841, un livre très remarquable de M. Ch. De Rotalier, où les événements et les hommes d’Afrique, depuis le 16e siècle jusqu’à la conquête, sont appréciés avec talent et impartialité. C’est cet ouvrage, dont nous commençons aujourd’hui la reproduction (après en avoir demandé l’autorisation à l’éditeur et à l’auteur), et que nous publierons en entier. Nos lecteurs nous sauront gré, sans doute, de leur faire connaître ce livre d’une haute portée, écrit consciencieusement, d’un style pur, correct, élégant, et qui a coûté à son auteur de nombreuses recherches indiquées dans une multitude de notes et de pièces justificatives que nous retrancherons afin de rendre plus facile la lecture de l’Histoire d’Alger.
Nous suspendrons cette publication de longue haleine chaque fois que nous aurons un feuilleton local inédit et dont l’impression ne pourrait souffrir de retard193.
La hiérarchie qui est exprimée ici entre deux types de textes confirme l’idée que
l’histoire, si elle est importante, apparaît cependant comme un réservoir, un à-côté des
publications que l’on veut locales. Mais les périodiques algériens vont aussi faire la part belle
aux travaux des bibliothécaires, savants, conservateurs qui se fondent sur les documents
auxquels la conquête leur a donné accès. Albert Devoulx, le conservateur des archives arabes,
écrit clairement dans son deuxième article publié dans Le Moniteur de l’Algérie une
justification de la conquête : « la France, obligée plusieurs fois, à bout de patience, d’avoir
recours aux armes et finalement amenée à couper le mal dans sa racine, avait sa part d’insultes
comme les nations secondaires et ne se défendait qu’avec peine des excès et des vexations d’une
populace grossière, ignorante, fanatique et pillarde194 ». Par ces lignes, il nous révèle aussi
comment se joue la question prédominante de l’identité française face aux indigènes. Devoulx
est en fait représentatif d’un mouvement plus général dans la presse colonial : il s’agit de refuser
aux indigènes la capacité même à écrire l’histoire, de situer la France dans le continuum de
l’Antiquité romaine, et de ne construire l’image de l’Algérie que comme un territoire sur lequel
se sont succédées différentes dominations. Chaque morceau d’histoire tiré des archives arabes
est l’occasion d’un rappel méthodologique qui construit en creux l’éthos du conservateur :
Ces pièces, écrites dans le style pompeux, laudatif et boursouflé ordinaire aux Orientaux, ne renferment pas les détails précis, les renseignements techniques et les aperçus et considérations d’un ordre élevé que nous sommes habitués à rencontrer dans les rapports de nos officiers. Mais telles qu’elles sont, elles ont un grand intérêt historique et elles doivent partager le vif intérêt qu’excitent les rares documents
192 « Histoire d’Alger et de la piraterie des Turcs », La France algérienne, 14 mai 1846. 193 Id. 194 Albert Devoulx, « Le Capitaine Prépaud », Le Moniteur de l’Algérie, 20 juillet 1862.
325
indigènes qui concernent les derniers moments de la Régence d’Alger195.
L’appropriation du passé permet donc de dresser un autoportrait du colonial. En
Cochinchine, cette écriture du passé antécolonial se fait selon des modalités quelque peu
différentes : il y a là aussi les traces d’un passé commun, mais avec la reconnaissance d’une
civilisation qui est autre sans être dévalorisée. En publiant les notes historiques du Père La
Lyraie en 1865, Le Courrier de Saïgon se situe dans une approche du passé qui reste donc
habituelle, rentrant dans le cadre d’une écriture missionnaire se présentant comme neutre196.
Les textes relevant de l’histoire antécoloniale ne seront pas aussi variés qu’en
Algérie : l’orientalisme, la fascination pour l’histoire des captifs européens, la proximité
géographique conditionnent des écrits plus libres en Algérie que dans la mystérieuse
Cochinchine. Au plus trouve-t-on un texte censé avoir été traduit du cambodgien, et qui présente
ainsi le peuple khmer :
Je voudrais vous dire notre histoire, mais comment démêler la vérité des mille légendes fabuleuses qui l’enveloppent et la dénaturent depuis des siècles ! Quant aux livres chinois, ils ne sauraient jeter beaucoup de jour dans ces ténèbres, car ils sont, comme nos traditions, tissus de superstitions et de mensonges197.
L’élargissement aux « livres chinois » n’est pas anodine, puisque c’est contre la Chine
que la France s’est installée en Cochinchine ; et le rappel des traditions, dont on remarque le
pluriel, peint là encore une histoire qui n’est pas acceptable par les plumitifs français – et par
les lecteurs du périodique colonial. La prise de parole, émergeant censément d’un indigène, est
une manière intéressante de contourner le jugement du colonisateur, et ce d’autant plus que le
texte est entièrement consacré à la description d’un peuple.
195 Albert Devoulx, « Documents indigènes sur l’expédition française en 1830 », Le Moniteur de l’Algérie, 14 juin 1863. 196 Père Le Grand de la Lyraie, « Notes historiques sur la nation annamite », Le Courrier de Saïgon, 5 septembre 1865. 197 James (trad.), « Lettres sur le Cambodge », Le Courrier de Saïgon, 5 mars 1865.
326
Tout autre est l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, autre territoire occupé sous le Second
Empire : là aussi écrite par un missionnaire, le père Montrouzier, elle ne se comprend que sous
la forme de « fragments », d’après le titre, et adopte une description bien plus dure de la
population indigène198. Un « Historique de la découverte de la Nouvelle-Calédonie199 » paraît
en 1867, sous une forme moins subjective. Un an après, le missionnaire n’est plus l’auteur des
notices historiques : c’est A. Mathieu, un collaborateur régulier du journal, qui publie un
« Aperçu historique sur la tribu des Houassios ou des Manongôés200 ». On y trouve un récit
historique, mais aussi un schéma généalogique intéressant, parce qu’il transpose par écrit la
volonté historique des publicistes : avoir une connaissance de la population qui soit aussi
précise et occidentalisée que la connaissance qui a été établie du territoire. À la carte du
territoire colonial répond en effet l’arbre généalogique du peuple colonisé : l’on peut expliquer
ainsi les tentatives faites par la presse pour produire une histoire locale.
Ce traitement réservé à la Nouvelle-Calédonie se retrouve-t-il à Tahiti ? L’histoire
antécoloniale n’est pas traitée dans le protectorat comme dans la colonie. Il n’en est presque
pas fait mention, et quand il en est question, c’est au fil de textes qui traitent d’autres choses,
comme la « promenade » que fait A. Barion :
Notre guide nous apprit qu’à une époque fort ancienne, lors des guerres fréquentes entre les différents chefs de l’île, cette caverne servait aux vainqueurs pour y précipiter les vaincus, après leur avoir préalablement coupé les oreilles201.
198 P. Montrouzier, curé de Napoléonville, « Nouvelle-Calédonie, fragments historiques », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, du 19 août 1860 au 17 mars 1861. 199 « Historique de la découverte de la Nouvelle-Calédonie », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, du 27 octobre au 17 novembre 1867. 200 A. Mathieu, « Aperçu historique sur la tribu des Houassios ou des Manongôés », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 12 janvier 1868. 201 A. Barion, « Une promenade au lac de Tahiti », Le Messager de Tahiti, 19 février 1860.
327
La parole rapportée ici est celle de la tradition orale, transmise par le guide, et qui
souligne seulement la violence du peuple indigène sans la situer dans une période précise. C’est
dire à quel point l’histoire est malléable dans les pages du périodique et selon les populations
concernées. Rien d’étonnant alors à ce que l’histoire devienne le sujet d’un article satirique, et
ce particulièrement en Algérie. En témoigne l’exemple du Chitann, qui se sert du Tombeau de
la chrétienne pour mettre en place la prosopopée de Juba, roi historique de Numidie, face à un
jeune Français, plus exactement défini comme l’un des diablotins qui rédige le journal. L’extrait
est incomplet, puisqu’il manque une page au périodique, mais quelques lignes suffisent à
donner le ton :
Tout au bout de cette galerie, qui n’avait pas moins de 1700 mètres, était une salle splendidement éclairée : dans cette salle se trouvait un trône de pierre et sur le trône son excellence le roi Juba, premier du nom.
Au bruit de mes pas il parut se réveiller, et ouvrit un œil. Ne connaissant pas le salut carthaginois, je me précipitai à terre en
lui faisant une révérence dite siamoise. Cet hommage parut le flatter. Il me rendit gracieusement mon salut,
et me tint à peu près ce langage : - Jeune homme, ne t’étonne pas de m’entendre parler français ; j’ai
employé utilement mes longues veilles, et si je n’ai pas adressé la parole aux savants qui m’ont visité, c’est qu’il n’y a rien que j’aime aussi peu que ces personnages-là. Ils vous posent une foule de questions scientifiques, et je t’avoue entre nous que mon éducation première a été sur ce point un peu négligée. Aussi je prends le parti de garder un silence éloquent. Mais à propos, jeune français202…
Le passé du territoire colonisé est donc objet de dérision, et manière pour le publiciste
de créer une connivence avec l’Antiquité et le roi numide. Ce saut par-dessus les siècles de la
conquête arabe, de la présence espagnole ou de la Régence turque tient au monument, bien sûr,
mais révèle aussi une proximité avec le passé antique qui complète l’autoportrait du colonial et
de sa culture.
Histoire coloniale
Sous le Second Empire, donc bien avant l’institutionnalisation d’une chaire d’histoire
coloniale203, la presse se fait l’écho de quelques cours donnés à la Sorbonne : Jules Duval,
homme de presse, s’est en effet chargé de soirées littéraires qui sont retranscrites dans des
202 « Au tombeau », Le Chitann, 3 juin 1866. 203 « La consécration est obtenue avec la création de la chaire d’histoire coloniale au Collège de France en 1921 qui s’effectue avec les mêmes protagonistes et dans les mêmes conditions que pour la mise en place du cours d’histoire coloniale à la Sorbonne quelques années plus tôt » : Colette Zytnicki, « ʺLa maison, les écuriesʺ. L’émergence de l’histoire coloniale en France », dans Sophie Dulucq et Colette Zytnicki (dir.), Décoloniser l’histoire ? De « l’histoire coloniale » aux histoires nationales en Amérique latine et en Afrique, (XIXe – XXe siècles), Paris, Publication de la Société Française d’Histoire d’Outre-Mer, 2003, p. 16.
328
périodiques aussi différents que L’Indépendant de Constantine en 1868, Le Moniteur de la
Nouvelle-Calédonie la même année ou Le Messager de Tahiti en 1870204. Qu’apportent ces
textes à l’identité coloniale, puisque ni l’Algérie ni Tahiti ne sont traités dans cette histoire
coloniale ? C’est sans doute un point de départ qui permet de donner au lectorat colonial ce
« sentiment individué de l’histoire205 » qu’évoque Alain Vaillant, mais sous l’angle d’une
actualité qui se fait par l’écriture historique. L’histoire qui se fait entre les lignes du journal est
alors celle d’une colonisation renouvelée, qui renoue avec le passé de la nation. Se développent
en effet dans les périodiques locaux des colonies des récits concernant l’histoire du territoire
depuis sa colonisation : il ne suffit pas de donner à lire le passé antécolonial, il faut encore
donner à lire le passé immédiat et colonial dont la population européenne doit tirer fierté. De
manière plus pragmatique, ces récits de la colonisation européenne semblent bien servir, en fait,
à combler les trous qui peuvent apparaître dans les périodiques : dans Le Messager de Tahiti,
une « Relation de ce qui est arrivé aux missionnaires espagnols à Otaheti en 1775 » reprend le
3 avril 1874 après une interruption de huit ans. On y lit en note de bas de page : « Nous
reprenons, après une interruption plus longue qu’explicable, la suite du voyage des Espagnols
à Tahiti. (v. Le Messager des 22 et 29 décembre 1866, 16 février, 2, 9, 16 et 30 mars 1867206) ».
Le récit se poursuit le 10 avril, reprend le 19 juin et le 26 juin ; le texte aura donc paru sous
deux régimes différents sans que l’on sache vraiment pour quelles raisons il a été mis de côté.
Il n’y a donc pas de plan concerté, pas d’urgence dans ces publications : elles constituent un
fond dans lequel les rédacteurs peuvent prendre quelques textes, selon les vicissitudes des
publications. D’autres publications sont plus clémentes ou mieux expliquées : en 1874 toujours,
La Malle réunionnaise publie un texte qui rend compte également des premiers temps de la
colonisation du territoire. Le rédacteur présente le texte selon quelques grands traits : le texte
est emprunté au Commercial Gazette mauricien, qui l’a traduit de La Revue pittoresque
française ; il s’agit en fait de la lettre d’un missionnaire à la Compagnie des Indes, datée de
204 « Extrait de la Revue des Cours littéraires de la France et de l’étranger », sous-titré « Soirées littéraires de la Sorbonne. Le premier âge des colonies françaises », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, du 13 septembre au 18 octobre 1868 ; « Soirées littéraires de la Sorbonne. Le premier âge des colonies françaises », L’Indépendant de Constantine, 18 juin 1868 ; « Les colonies françaises sous Louis XIV », Le Messager de Tahiti, du 1er janvier au 29 janvier 1870. Duval, rédacteur de L’Économiste français, est connu pour ses prises de position contre les « arabophiles ». Il a été rédacteur de L’Écho d’Oran en 1852, fondateur (en 1862) et directeur de L’Économiste français, « organe des colonies, de la colonisation et de la réforme par l’association et l’amélioration du sort des classes pauvres », périodique souvent échangé avec les journaux coloniaux. 205 Alain Vaillant, « L’histoire au quotidien », Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), La Civilisation du journal : Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2011, p. 1319. L’auteur développe : « le journal apporte un surcroît de sens aux existences individuelles et ce sens, tout illusoire qu’il soit, est le sens de l’Histoire ». 206 « Relation de ce qui est arrivé aux missionnaires espagnols à Otaheti en 1775 », Le Messager de Tahiti, 3 avril 1874.
329
1722, et « elle contient de curieux détails sur cette époque reculée de notre histoire
coloniale207 », ajoute le rédacteur. Seul compte alors le document ; mais dans le même temps,
la Réunion compte bien quelques auteurs d’histoire qui s’illustrent dans l’écriture historique, et
pas seulement dans la publication de documents. Dans le même journal, en 1860, Georges
Azéma, qui signe de sa qualité de « Greffier de la justice de Paix de Saint-Denis » est l’auteur
d’une « Histoire de l’île Bourbon depuis 1643 jusqu’au 20 décembre 1848208 », juste avant
l’histoire publiée par de Chateauvieux209 : une même année montre deux auteurs intéressés par
l’histoire, et notamment par les débuts de la colonie. Mais alors qu’Azéma adopte une vue large
de l’histoire, De Chateauvieux restreint à un seul endroit l’histoire qu’il veut raconter, la
commune de Saint-Leu, et il n’hésite pas à recourir à une forme romancée pour rendre compte
des exploits des créoles :
Le 5 frimaire, an 5 (1796) la vigie Saurin Lièvre arbore le signal d’alarme, des vaisseaux ennemis sont signalés dans le sud. On fait des préparatifs de défense, on bat la générale, les miliciens courent aux armes, chacun est à son poste dans les batteries. La vigie signale : deux vaisseaux ennemis mouillent devant la rivière Saint-Etienne. Elle signale encore : Deux autres vaisseaux sont à la voile. Elle signale encore : 5 chaloupes armées quittent les vaisseaux, elles se dirigent vers la passe de l’Etang Salé !... Un débarquement va s’opérer, et les scènes de pillage et d’incendie qui s’accompliront au mois d’août 1809 à Ste-Rose, et le 20 septembre suivant à St-Paul, menacent le quartier de St-Louis. Mais les hardis créoles du Gol, accourent en toute hâte, ils franchissent pieds nus les dunes de sable, ils se glissent le long des ravins, ils sont tout près de la seule passe où l’on peut aborder ; ils ont porté dans leur corne de la poudre bien sèche, des balles dans leurs poches et la pierre de leurs vieux fusils rouillés ne leur fera pas défaut : leur main est si sûre et leur coup d’œil si juste, que jamais leur balle n’a manqué le cabri marron [sic] lancé à toute vitesse dans les plateaux accidentés de l’intérieur. Cependant les chaloupes avancent à force de rames, et les voilà presque à portée de fusil, - elles avancent encore et elles sont accueillies par le feu le plus solide et le mieux nourri. Virant de bord à la hâte, et prenant la fuite, les matelots courbés sur les avirons les font voler sur la cime des vagues, jusqu’à ce qu’elles soient hors de portée et à l’abri des dernières bales qui décimaient leurs soldats. La vigie Saurin Lièvre signale : les deux frégates ont levé l’ancre. Le soir à 5 heures elle signale encore : les 4 vaisseaux ennemis sont devant St-Gilles, à la nuit : ils ont disparu. Cependant, les vaisseaux anglais croisaient toujours autour de l’île210.
La rédaction au présent de narration, le discours direct de la vigie et la description des
actions des « hardis créoles du Gol » participent à une mise en texte héroïque de l’histoire, et
207 « Premiers temps de la colonisation à Bourbon et à Maurice », La Malle, 29 mars 1874. 208 Georges Azéma, Greffier de la justice de Paix de Saint-Denis, « Histoire de l’île Bourbon depuis 1643 jusqu’au 20 décembre 1848 », La Malle, 15 février 1860. 209 De Chateauvieux, « Histoire de Saint-Leu, chapitre Ier. Origine, commencements, administration », La Malle, 13 septembre 1860. 210 Id.
330
ce particulièrement quand il s’agit de décrire des affrontements contre les Anglais, responsables
de la perte de l’île de France voisine. L’identité coloniale réunionnaise se nourrit de cette
opposition à une autre puissance coloniale ; les souvenirs de guerre offrent en outre des modèles
héroïques qui, propres à l’île, créent des références différentes de celles de la métropole. L’on
rejoint ici ce qui pouvait apparaître dans la mise en avant des héros de la colonisation : se met
en marche une transformation épique du passé de la colonie, particulièrement face aux
Anglais211. Dans les Antilles françaises, ce même intérêt pour l’histoire coloniale s’observe
dans les périodiques. Il peut s’agir de prépublications, soit que la publication soit avérée par la
suite, soit que l’auteur profite du support pour espérer une vraie publication. En 1846 paraît
une Histoire de la Martinique depuis la colonisation jusqu’en 1815212, par Sidney Daney, dont
on précise immédiatement qu’il est membre du Conseil Colonial de la Martinique. Le Courrier
de la Martinique en publie quelques extraits en 1848 : ainsi paraît le 26 février (coïncidence
assez amusante, rétrospectivement, avec ce qui se produit alors en métropole) la « Prise du
diamant » comme suite des numéros précédents, en troisième page, sous la rubrique des
variétés. En 1852, L’Avenir publie une « Histoire de la Guadeloupe. Révolte de Sainte-
Anne213 » dont le sous-titre précise qu’il s’agit en fait de l’extrait d’un chapitre de l’histoire de
la Guadeloupe de M. Lacour, qui doit paraître ensuite en volume. Plus tard dans la publication
de ce périodique, c’est le rédacteur et propriétaire, Anténor Vallée, qui se propose d’éclairer
l’histoire martiniquaise ; il publie, en 1859, une « chronique locale » qu’il intitule « petit avant-
propos pour tenir lieu de préface214 ». Et en effet, quelques numéros plus tard, c’est bien une
« Histoire de la Guadeloupe » que signe le publiciste, et qui déroule ses épisodes de juillet à
septembre, traitant des années 1848 à 1852 ; l’histoire est censée faire le pendant de Lacour,
qui est cité, et être comique. Vallée insiste d’abord sur les difficultés de son entreprise
(impression, censure, etc.)
On me dira peut-être : vous prenez mal votre temps ; de grandes choses se passent en ce moment en Europe et vous allez parler de petites choses qui se sont passées ici il y a dix ans ; à cela je réponds : il est assez d’usage de donner, après la grande pièce, la petite ; ainsi je ferai, et on ne lira la petite histoire qu’après la grande, une fois tous les quinze jours et quand il n’y aura rien de mieux à lire. […] D’ailleurs au moment même où L’Avenir publiera à la Pointe-à-Pitre une histoire de la Guadeloupe, est-ce que la presse du gouvernement n’imprimera pas à la Basse-Terre une œuvre semblable
211 Le Georges d’Alexandre Dumas s’ouvre sur ce passé colonial épique malgré la défaite, puisqu’il décrit la prise de possession de l’île de France par les Anglais. 212 Sidney Daney, Histoire de la Martinique depuis la colonisation jusqu’en 1815, Fort-Royal, E. Ruelle, Imprimeur du Gouvernement, 1846. Réimprimé en 1963 par la Société d’histoire de la Martinique. 213 Lacour, « Histoire de la Guadeloupe. Révolte de Sainte-Anne », L’Avenir, 18 février 1852. 214 A. Vallée, « Chronique locale : petit avant-propos pour tenir lieu de préface », L’Avenir, 18 juin 1859.
331
qui est due à la plume d’un éminent magistrat, d’un conseiller à la cour impériale ? On me dira : ceci est une autre histoire. Une histoire sérieuse et la vôtre une histoire pour rire, pouvez-vous comparer des choses incomparables ? M. Lacour fait revivre des morts, vous allez tuer des vivants215 !
Anténor Vallée revendique ici la capacité de la presse coloniale à participer à la mise en
place d’une histoire à part, modeste et marquée par la subjectivité d’un auteur plus ouvert au
dialogue avec ses lecteurs. Pourtant cette histoire écrite par Vallée est comme celles que nous
avons citées précédemment, au sens où elle va dans le sens de la valorisation des propriétaires
blancs. Bien différente alors, voire à contre-courant, est « L'Histoire des gens de couleur libres
aux Antilles françaises, publiée à partir du numéro 12 jusqu'au numéro 55 [dans le journal La
Liberté]. Écrite par Marlet, elle retrace l'histoire des affranchis et de leurs descendants depuis
leur origine jusqu'aux évènements de la Grande-Anse216 », événements qui ont lieu en 1833.
Nous avons plutôt trouvé le titre « Histoire des hommes de couleur aux Antilles françaises, par
Marlet. Fragments », publiée en effet de manière irrégulière dans La Liberté, journal qui se bat
contre la peine de mort, se revendique de Schoelcher et accuse Bissette par un bandeau à la une
d’avoir voté contre le suffrage universel, « en faveur des maîtres contre les ouvriers » et « contre
la subvention proposée par M. Schoelcher en faveur des Écoles d’arts et métiers à la Martinique
et à la Réunion ». L’histoire qu’écrit Marlet refuse le récit épique et lui préfère la précision des
décrets royaux, des faits et des témoignages, puisqu’en effet il est question d’événements alors
récents. Le procès des hommes de couleur accusés d’avoir fomenté une révolte à l’époque de
Noël 1833 constitue cependant la plus grande partie de cette histoire : Marlet y dénonce le
traitement des prisonniers, la partialité de la cour de justice composée de propriétaires blancs,
l’iniquité des peines. Cette publication, même si le journal est très lié à la République et ne lui
survivra pas, montre que l’histoire coloniale peut être écrite avec certaines nuances dans la
presse. Cette distance est maximale avec Marlet ; mais par moments, dans d’autres titres et à
d’autres sujets, apparaissent quelques dissonances par rapport à la pensée d’une séparation entre
les différents éléments de la population coloniale. En Algérie, ainsi, une introduction au récit
de Sidi-Ferruch paraît dans L’Akhbar en 1849, et arrive à placer à égalité les colonisés et les
colonisateurs par les lignes suivantes :
Tous les peuples ont cette poétique faiblesse de voir un fait providentiel dans ce qui n’est souvent que le résultat de l’ambition des uns et de la sottise des autres. Un coup de chasse-mouche fait de l’Afrique barbare une terre française et chrétienne ; nous disons : Dieu l’a voulu !
215 Id. 216 Stella Pamé, op. cit., p. 119.
332
Hussein-Pacha descendant de son blanc palais de la Casbah, et s’acheminant vers l’exil, disait aussi : c’était écrit217 !...
Le récit d’histoire coloniale qui assume le plus son statut médiatique, au sens de son lien
avec l’actualité, se trouve dans La Feuille de la Guyane française : c’est un feuilleton signé par
deux initiales non élucidées, A.J., et qui met en scène une « gangan », autrement dit une grand-
mère, par qui va passer le récit historique.
Il y a aujourd’hui deux cents ans, me contait, ce matin même, la bonne vieille amie, qui vient me visiter et me consoler sur cette terre lointaine ; - Il y a aujourd’hui deux cents ans jour pour jour, qu’une escadre de guerre, composée de six grands vaisseaux, quatre frégates et un brûlot, mouillait, le vingt décembre mil six cent septante six, à quelque distance de la ville, alors naissante, de Cayenne… Votre rade était d’un accès plus facile, à cette époque218.
On est bien loin alors de l’actualité telle qu’elle est écrite dans une Algérie marquée par
les combats : en 1858, le commentaire de récits publiés en recueil qui paraît dans L’Akhbar est
censé donner le sentiment d’une histoire en train de se faire pour les colonisateurs, puisqu’il
s’agit d’écrire la campagne de 1857. « En attendant que la muse de l’histoire grave de son burin
immortel les exploits de nos soldats en Kabilie [sic], on aime à lire ces récits sans prétention,
éclos au feu du bivouac et qu’un observateur exact, quoique spirituel, écrit au courant de la
plume219 ». Cet imaginaire de l’écriture authentique, quotidienne, qui réduit l’écart temporel
entre la lecture et l’événement, est intéressant car elle témoigne du sentiment de l’histoire en
train de se faire qui caractérise l’écriture de l’histoire coloniale en Algérie.
Par un dernier effet de l’utilisation de l’histoire dans la presse, le passé de la France peut
également être utilisé pour marquer l’appartenance des nouveaux territoires coloniaux au destin
national : c’est ce que l’on voit à Tahiti, quand l’annonce de la proclamation de l’Empire est
l’occasion d’une manifestation de la « revenance220 », cette fois liée à la perception du premier
Empire qu’ont eue les indigènes :
Mais sur les rivages de Taiti, séparés de la France par l'épaisseur entière de la terre, qu'il y ait de sympathiques retours vers cette époque mémorable de notre histoire, voilà ce qui a lieu d'étonner ; et pourtant il est vrai que le nom du vainqueur d'Austerlitz et d'Iéna est entré dans
217 « Sidi-Ferruch, une légende et un procès-verbal », L’Akhbar, 24 juin 1849. 218 A.J., « Une journée à Cayenne il y a 200 ans (contée par une bonne vieille Grand’Mère) », La Feuille de la Guyane française, 6 janvier 1877. 219 « Récits de Kabilie », L’Akhbar, 1er juillet 1858. 220 Selon l’expression empruntée à Jean-François Hamel, Revenances de l’histoire. Répétition, narrativité, modernité, Paris, Minuit, 2006.
333
la mémoire des indigènes comme si c'était le nom d'un de leurs héros ou de leurs dieux221.
La convergence des histoires est donc mise en scène pour prouver l’assimilation
opérante de la « civilisation » : c’est une manière d’écrire contre la diffraction que de montrer
ces vues convergentes. Mais plus largement, dans l’écriture de l’histoire coloniale, le corpus
des textes périodiques permet de faire un pas de côté, et de mettre en lumière une facette
supplémentaire de cette tentative pour faire primer la situation – de l’auteur, du lecteur, du
support – sur le récit à proprement parler. L’on commence alors à voir se confirmer une
particularité de l’écriture coloniale dans ce récit qui a pour finalité de créer une histoire parallèle
à l’histoire de la « mère-patrie ».
L’actualité coloniale L’un des événements marquants de l’actualité coloniale telle qu’elle apparaît dans notre
corpus, c’est l’abolition de l’esclavage ; or, dans Le Moniteur de l’île de la Réunion et au sein
de toutes les productions médiatiques engendrées par ce bouleversement, l’on remarque ce
passage, témoin de la conscience historique du rédacteur :
Le 20 décembre de l’année 1848, date mémorable, époque critique et solennelle où la Colonie, rompant avec un passé que la nature et la loi condamnent, a été lancée dans les voies inconnues d’un sombre et périlleux avenir ! le 20 décembre sera inscrit en caractères ineffaçables dans les annales du pays222.
À la même période, dans Alger que ne concerne pas l’esclavage, mais qui a participé
également au bouleversement révolutionnaire, un chroniqueur évoque l’impossibilité d’écrire
cette actualité toute récente et ses particularités algériennes :
Écrire l’histoire de tout ce qui s’est passé à Alger depuis trois mois environ ; mettre en scène, si cela était possible, tous les personnages qui ont pris une part plus ou moins active au contre-coup des événements révolutionnaires de France, rassembler en quelques pages les documents de tous genres que l’aberration humaine a si généreusement enfantés, raconter tout ce qui s’est dit, tout ce qui s’est fait pendant cette période de temps dans cette ville presque amphibie, toute composée d’éléments si hétérogènes, sorte de mosaïque ambulante dans laquelle tant de peuples viennent se confondre ; énumérer, si on le pouvait, tous les incidents, quels qu’ils soient, qui ont agité la capitale de l’Algérie, serait à la fois l’œuvre la plus burlesque, la plus amusante, la plus bouffonne, la plus curieuse et la plus grotesque qui ait jamais été produite223.
221 Le Messager de Tahiti, 24 avril 1853. 222 Ch. Ch., Le Moniteur de l’île de la Réunion, 23 décembre 1848. 223 « Revue d’Alger », Le Brûlot de la Méditerranée, 25 mai 1848.
334
L’actualité devenue un monstre littéraire, une chimère à peine envisageable : le propos
rend bien compte du rapport compliqué qu’entretiennent les journalistes coloniaux avec les
moments historiques vécus au sein de la colonie. Dans la compréhension de la temporalité
coloniale, l’outil heuristique que constitue le « régime d’historicité » permet d’avancer dans la
compréhension de l’identité coloniale construite par les textes médiatiques. « Selon que vient à
dominer la catégorie du passé, celle du futur ou celle du présent, il est bien clair que l’ordre du
temps qui en découlera ne sera pas le même224 » : dans les textes médiatiques que nous avons
consultés, c’est une confrontation entre ces différents régimes d’historicité qui se lit. L’histoire
coloniale n’accorde un sens au passé que s’il permet de justifier la conquête française, et de
l’asseoir dans une continuité qui permet de s’ouvrir à l’avenir. Or cette définition restreinte du
régime d’historicité (savoir comment une société traite son propre passé) aboutit bien à une
seconde définition, plus large : le régime d’historicité sert à désigner « la modalité de
conscience de soi d’une communauté humaine225 ». L’attention extrême portée à l’écriture du
passé ainsi que l’importance de l’avenir de la colonisation qui va jusqu’à obstruer la pensée du
présent et de l’actualité (constat paradoxal s’il en est, puisque nos textes sont médiatiques) : ces
deux perspectives dessinent un des traits de la communauté coloniale et de la conscience qu’elle
se donne. La question du régime d’historicité dans les colonies se pose avec acuité ; le journal
colonial traite d’actualité (presque) comme n’importe quel autre journal : n’eût été le délai avec
lequel les nouvelles métropolitaines transitent, il n’y avait rien de particulier. Et cependant
quelques événements mettent au jour une actualité propre à l’identité coloniale, quelques
indices dessinent une temporalité qui revendique une spécificité coloniale, sur le modèle de ce
que note l’auteur de « causeries » dans La France algérienne en 1845 : « Alger est dans l’état
d’indécision par lequel passe tout pays vieux qu’on veut faire neuf. Ce n’est plus la ville maure,
ce n’est pas encore la ville française. Rien n’est défait, rien n’est fait226 ». Cette « indécision »,
cette incertitude que l’auteur fait toute algérienne n’est pas commune à toutes les colonies,
notamment à celles héritées de la première période coloniale ; mais elle témoigne assez de cette
représentation d’une temporalité particulière que les journaux coloniaux mettent en place.
Habituellement, dans les textes coloniaux, c’est l’avenir qui occupe la place la plus importante.
Dans les premières décennies de la conquête algérienne, outre la critique violente de l’abandon
supposé du territoire par la Régence turque, le lecteur peut trouver des exhortations à l’avenir
224 François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Seuil, 2008 [2003], p. 15. 225 Id., p. 29. 226 J. L., « Causeries », La France algérienne, 6 juillet 1845.
335
comme celle-ci, signée par un épistolier qui revendique sa qualité de « pauvre exilé d’Afrique »
dans le texte, et d’Algérien dans sa signature :
Mais le temps de la réprobation est-il passé ? Une ère nouvelle s’ouvre-t-elle enfin pour cette terre qui possède des trésors et qui reste dans l’indigence. La mine d’or sera-t-elle exploitée ? Le diamant va-t-il être poli ?
Il est permis de l’espérer, puisque c’est la France qui a pris l’initiative de cette œuvre ; car la France, quoiqu’on en dise et quelques reproches qu’on puisse lui adresser sous le rapport du peu de persévérance qu’elle met dans les entreprises, est en possession de faire les grandes choses dans le monde. Et si elle a ce noble privilège, c’est précisément parce qu’elle agit moins au point de vue de son intérêt particulier, que pour la cause de l’humanité tout entière. Les croisades, mission aussi politique que sainte, l’indépendance de l’Amérique, la régénération de la Grèce, c’est la France, à son éternel honneur ! Ce Chevalier errant des nations, qui prenant d’une main le flambeau et de l’autre l’épée, a toujours dit la première : « Allons227 ! »
Cette représentation allégorique de l’avenir signale en fait la pensée sous-jacente d’une
modernité linéaire passant par l’urbanisation et la réforme morale ; et l’avancée du siècle
permet la publication de textes qui veulent anticiper les progrès coloniaux. Le Sport colonial
réunionnais, périodique plaisant et divertissant qui affirme sa portée littéraire en publiant des
pages entières de poésie, fait paraître le 26 juillet 1879 un texte anonyme intitulé « Simple
récit » :
C’était au plus beau mois de l’année 18.. Pour sûr, c’était le mois de mai, mais de quelle année ? Mettons que ce soit en 1884, car vous verrez tout à l’heure que cela ne peut guère se passer avant.
Ainsi donc, c’était au mois de mai de l’an de grâce 1884 ; la nature resplendissait, au lever du jour, sous un ciel sans nuages ; la crête des montagnes, éclairée par les premiers rayons du soleil, souriait à la population de Saint-Denis, au milieu d’une agitation inaccoutumée. Pourquoi donc semble-t-elle s’être donné le mot pour se réveiller de si bonne heure ? Où courent ces dames, ces enfants, accompagnés de leurs maris et de leurs pères ? Les voitures sillonnent les rues en tous sens, comme en un jour de courses, des flots d’indiens se portent vers la place Candide ; on s’aborde inquiet : - Dis donc ? as-tu l’heure juste ? – Non, et je me dépêche. – Oh ! mon ami, soupire l’épouse, et si nous allions manquer le train !...
Le train ! oui, lecteurs du Sport Colonial, le train pour Saint-Paul, grand train de plaisir à moitié prix du tarif, partant à 6h ½, retour à 4 heures, organisé à l’occasion des GRANDES RÉGATES DE SAINT-PAUL228 !
227 Un Algérien, « Lettres d’Alger et de Paris », Le Moniteur algérien, 25 octobre 1842. 228 « Simple récit », Le Sport colonial, 26 juillet 1879. Le thème du train apparaît dans les textes médiatiques comme la métonymie du progrès, le vecteur de rêveries sur l’avenir. Dans Le Mobacher algérien du 23 mai 1875, Eug. D. signe l’article intitulé « Les fêtes de Blida » dont nous citons un extrait : « Peut-être organisera-t-on des trains de plaisir non seulement d’Alger, mais aussi de Londres et de Paris, car les touristes qui voudraient passer quelques jours en Afrique ne pourraient choisir une époque plus agréable pour visiter Alger et ses délicieux environs, Blida, au moment des fêtes, et les belles gorges de la Chiffa avec leurs singes renommés !! Ils repartiraient enchantés du climat, émerveillés de la richesse de la végétation et emporteraient un souvenir agréable
336
Et l’auteur, après la description de la fête, des canonnades et des cris, de
conclure : « Mais ne verrai-je pas un jour pareille fête en réalité ? Pourquoi pas ? » Dans ce
court récit d’anticipation se lit une des obsessions coloniales : le progrès amené par le chemin
de fer. Si le récit est ici marquant par son utilisation du présent et sa description d’une scène de
foule au futur, d’autres situations aboutissent à la production de textes qui mettent également
en avant l’importance de l’avenir. Ainsi de la Guyane, avec cette particularité que l’on peut y
décrire le fonctionnement du bagne colonial. Les îles du Salut, au large de la Guyane, sont
envisagées en 1852, dans un article de La Feuille de la Guyane française, selon une perspective
historique et sous l’angle d’une double domestication : celle de la nature et celle des individus
qui participent aux progrès matériels de la colonisation.
Naguère, le navigateur qui côtoyait les îles du Salut s’étonnait de voir ce charmant petit groupe d’îles envahi jusqu’au rivage par la végétation luxuriante des Tropiques. À peine découvrait-il çà et là quelques touffes de bananiers chargés de plantes grimpantes qui se faisaient jour dans les massifs de verdure sauvage, comme pour témoigner du passage éphémère des hommes229.
Cette introduction montre comment ces îles sont le lieu d’une réussite coloniale : un
bagne y a été créé, qui se développe positivement, et l’auteur décrit d’abord l’activité qui règne
partout avant de préciser que les auteurs de cette activité sont des « transportés » ; le rappel de
la rapidité avec laquelle s’est opérée cette transition témoigne de la proximité de l’avenir visé
par la colonie.
Il y a trois mois à peine que les plateaux de l’île Royale (la plus grande des îles du Salut) ont retenti du premier coup de hache, et maintenant on y trouve une petite ville toute vivante, où se coudoient, dès le point du jour, des ouvriers de toutes sortes, travaillant avec ardeur à l’agrandissement de cette ruche naissante. Une belle route creuse ses lacets dans l’escarpement, et relie le débarcadère en construction au plateau principal : là, des lignes régulières de baraques, saines, solides, élevées sur leurs piliers de briques, largement aérées, forment un véritable bourg dont les rues s’allongent, se nivellent et sont incessamment encombrées de groupes en mouvement. Les jardins potagers se dessinent en plates-bandes ; des sentiers largement frayés serpentent dans les bois réservés sur les pentes abruptes ; les puits se creusent ; les carrières enfantent leurs blocs de pierres taillées, les forges tourmentent sans cesse le fer et l’acier pour remplacer les outils que le travail dévore ; les lourds fardeaux que jettent sur la plage les navires qui se succèdent sont portés sans relâche au lieu où ils doivent
des fêtes, des usages et des mœurs arabes qui, malheureusement, tendent à disparaître. – Blida est admirablement bien située, et si ses habitants savent, comme je le pense, en profiter et ne rien négliger pour donner dorénavant à ces fêtes tout le cachet arabe possible, elles deviendront d’autant plus recherchées qu’à Alger les étrangers riches venant passer l’hiver dans l’espoir de s’amuser et de voir les restes d’une ville arabe, ne trouvent pas plus de distractions que de vestiges de mœurs ou de costumes orientaux ». L’on voit ici qu’en Algérie, le progrès induit par le chemin de fer s’accompagne de la disparition de la culture indigène – et de la déploration de cette disparition. 229 J., « Les îles du Salut », La Feuille de la Guyane française, 3 juillet 1852.
337
être utilisés ; enfin, partout s’offre le spectacle si attrayant du travailleur satisfait de son œuvre et plein de l’espoir d’en recueillir les fruits230.
L’activité décrite ici est étonnante, parce qu’elle ménage une forme de suspense : les
ouvriers et travailleurs encadrent la description d’une activité qui se fait, grammaticalement du
moins, sans agent humain. La colonie prévaut pour son apparence, et le travail forcé n’est qu’un
détail. Mieux, l’auteur dépeint le calme de la colonie et une atmosphère qui est celle de la
régénération : « Le soir, devant chaque porte, les travailleurs s’attablent pour prendre leur repas
et jouir de la fraîcheur ; on parle de la grande terre, de l’avenir, on renaît à l’espérance ». Mais
le journal révèle sa pleine force quand, après une description méliorative de cette tentative de
bagne, l’auteur laisse, sous la forme d’un post-scriptum, entrer l’actualité dans cette description
déjà fortement temporalisée : « Lorsque cette note a été écrite, les îles du Salut n’avaient encore
été le théâtre d’aucun fait rappelant le passé de ses nouveaux habitants : nous le disons avec un
profond regret, un crime vient d’être commis par un transporté, sur un de ses camarades ». Le
publiciste parvient tout de même à sauver le récit idyllique qu’il a fait de la colonie pénitentiaire,
mais au prix d’un ultime retour à la description de l’apaisement colonial. À côté de cette
attirance pour la représentation du progrès, pour l’importance de l’avenir, le personnage de la
grand-mère à qui revient la charge de l’histoire de la Guyane et que nous avons évoquée plus
haut met en lumière l’une de ces « revenances de l’histoire231 » qui peuvent hanter la colonie,
dans une perspective qui augmente tous les jours le moment fondateur. Augmentation de ce
moment fondateur, cela revient à dire autorité :
Il pleut à verse, dans les rues désertes de votre ville, la nuit du vingt-et-un au vingt-deux décembre mil huit cent septante-six, comme il y pleuvait à torrents, dans la nuit noire du vingt-et-un décembre mil six cent septante-six, sur les casaques des braves soldats, matelots et volontaires français, que je crois apercevoir encore embusqués dans les gniaments et les grands bois qui entouraient alors le fort Cépérou232.
La mise en regard de ces deux textes témoigne de l’appréhension d’un flux temporel qui
joue également sur l’avenir et le progrès, d’une part en soulignant l’amélioration rapide des
conditions de vie, d’autre part en calquant sur le présent le passé militaire de la colonie. Dans
d’autres colonies de plantation, l’abolition de l’esclavage remplit le rôle de l’événement
marquant et constitue le point à partir duquel est écrit le temps colonial, selon une autre
appréhension de la temporalité. Dans Le Commercial guadeloupéen, périodique qui a publié la
230 Id. 231 Jean-François Hamel, op. cit. 232 A.J., « Une journée à Cayenne il y a 200 ans (contée par une bonne vieille Grand’Mère) », La Feuille de la Guyane française, 6 janvier 1877.
338
nouvelle de l’abolition avec enthousiasme, outre les textes strictement politiques, l’actualité
gagne le feuilleton et s’écrit en vers : en 1848, le publiciste qui signe « Le Solitaire233 » publie
un poème où la subjectivité est mise en avant à travers la posture topique de l’homme seul face
à l’Océan. En 1849, les vers sont restés mais leur contenu a changé : l’on trouve d’abord
l’apparition de Bissette – face à Dieu – dans un feuilleton234, puis, quelques numéros après, un
autre texte poétique, une « Dernière lamentinoise235 » qui traite de cette même question de
l’abolition, mais cette fois en deuxième page. En un an, si la forme versifiée s’est conservée,
l’actualité n’est pas traitée de la même manière : c’est ce que nous allons étudier ici. Le
Solitaire, après avoir évoqué sa promenade sur la plage et la découverte du Nouveau Monde,
écrit avec force aposiopèses son inquiétude (nous avons conservé la ponctuation exacte) :
L’homme lutte partout… De ces lieux je distingue Un flot rougi de sang… venant de Saint-Domingue… Il gronde en s’approchant…et, dans son noir courroux, Semble dire à chacun : Mortels, instruisez-vous… Celui qui fait mugir les flots et les tempêtes Tient aussi le trépas suspendu sur vos têtes… Ciel ! qu’entends-je au lointain ? … Quel horrible fracas !! La terre s’en émeut… et tremble sous mes pas. Belle Kérukéra, renais à l’espérance… N’as-tu pas dans ton sein les enfants de la France ? … Ah ! qu’ils soient tous unis ! ! ! Que la Fraternité Règne dans tous les cœurs ! … avec l’Egalité… Tandis que bien au loin… éclatent les orages, Que le ciel soit serein sur tes heureux rivages236 ! …
Bien différent est l’entretien prêté à Bissette et Dieu. L’homme prend la parole par le
biais d’alexandrins ; après s’être soumis à la volonté divine, il continue ainsi, dans une tirade
de facture très classique :
De mes frères captifs les odieuses chaînes Faisaient courir mon sang bouillonnant dans mes veines ; Mon esprit révolté ne pouvait consentir À les voir constamment destinés à souffrir. Emporté par l’ardeur dont pétillait mon âme, J’ourdis avec les miens une terrible trame. À ma voix, tous les bras s’empressent de s’armer, On jure de mourir ou de se rédimer, Plus léger que méchant dans ma fugue insensée Je crus beau de venger la nature blessée,
233 Le Solitaire, « Méditations d’un solitaire aux Antilles », Le Commercial de la Guadeloupe, 25 novembre 1848. 234 Rousseau St-Val, « Le Jugement de Dieu », Le Commercial de la Guadeloupe, 26 septembre 1849. Cyrille Bissette (1795-1858) est l’un des artisans de l’abolition ; il a été rendu célèbre par « l’affaire Bissette » en 1823 (il est emprisonné après avoir été accusé d’avoir publié un libelle sur la situation des gens de couleur) et a fondé en 1834 La Revue des colonies ; au moment de la parution de ce texte, il est député. 235 « Dernière lamentinoise », Le Commercial de la Guadeloupe, 17 octobre 1849. 236 Le Solitaire, « Méditations d’un solitaire aux Antilles », Le Commercial de la Guadeloupe, 25 novembre 1848. Saint-Domingue est devenu Haïti en 1804, mais 1848 réactive d’anciennes peurs dans les colonies de plantation.
339
Je ne redoutais point de payer de ma mort Un laurier qui des miens adoucissait le sort. Hélas ! j’oubliai trop dans cette circonstance Que le hideux système émanait de la France ; Qu’il naquit tout entier de règlements royaux, Reléguant l’africain au rang des animaux, Et qu’alors, au colon, ne revenait l’injure D’être l’auteur d’un mal dont son âme était pure. Du crime, à mon insu, je devins l’instrument : J’oubliai le fautif, m’en pris à l’innocent. Mais juste en vos décrets, ô divine lumière ! Je vis mon grand dessein se résoudre en poussière. Soudain, je fus vaincu, poursuivi, condamné, Et l’exil expira mon vœu désordonné237.
Enfin, dernier extrait de ces vers qui nourrissent l’actualité du Commercial en une
période en effet troublée, la « Dernière lamentinoise » fait preuve d’une inventivité linguistique
qui ne se résout pas dans la seule écriture du créole. Sur un air de chanson, le lecteur de 1849
trouvait donc cette dernière strophe :
Plus de passion, de haine et de chimères, Faut plus parler de préjugé de peau. La France vlé que z’enfants li soé frères, Noir, Blanc et Rouge unis comme au drapeau. Honte à céla qui vlé resté derrière ! Qui vlé croupir dans yon passé lointain ; Faut nous marcher là, sous même banière En tenant nous la main (bis238)
Un poème introspectif qui finit en invocation au gouverneur, un dialogue politique, une
chanson populaire : en un an, ces trois textes mettent en scène et informent l’actualité coloniale
et son rapport à l’abolition. Glissant donc de l’histoire à l’actualité, le périodique colonial en
tant que générateur de textes à la portée identitaire s’aventure également du côté de
l’ethnographie, cette discipline qui naît dans le siècle pour accompagner la colonisation.
L’écriture de l’histoire dans les colonies se rattache donc à une problématique plus large, qui
est celle de la transformation de la discipline historique au cours du XIXe siècle. Prise elle aussi
dans une tension entre la littérarité et la scientificité, entre la neutralité affichée ou la subjectivité
reconnue, l’histoire coloniale ajoute cependant au tableau complexe des écritures historiques sa
particularité : il s’agit d’écrire l’histoire des autres autant que de soi, et il s’agit aussi de refuser
parfois l’historicité même aux peuples colonisés afin d’affirmer sa position.
237 Rousseau St-Val, « Le Jugement de Dieu », Le Commercial de la Guadeloupe, 26 septembre 1849. 238 « Dernière lamentinoise », Le Commercial de la Guadeloupe, 17 octobre 1849.
340
2.3 Une écriture ethnographique
Dans l’un des premiers numéros du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, un texte
présente aux lecteurs le projet d’ouvrir un musée :
Si d'un côté les recherches des productions naturelles sont d'une utilité première, celles qui ont trait aux arts, à l'industrie indigène n'ont pas une moindre importance. À mesure en effet que leurs relations avec les Européens deviennent plus fréquentes, ces peuples trouvant dans notre civilisation plus de moyens de bien être abandonnent peu à peu leurs coutumes. Dans quelques années il n'en restera plus de traces, il serait convenable de conserver à ceux qui viendront après nous les monuments d'une nationalité qui tend à disparaître. Mais ces renseignements ne peuvent être obtenus, ces collections ne peuvent se faire qu'autant que nous y apporterons tout un concours désintéressé, nous faisons donc appel à la bonne volonté des résidents et colons, à MM. les officiers et soldats, que chacun contribue selon ses forces à l’œuvre commune. […] Les objets seront inscrits au nom des donateurs et envoyés au ministère de l'Algérie et des colonies par les soins de M. le Commandant particulier qui recevra les dons et prendra des mesures nécessaires à leur conservation. Des doubles seront mis de côté et formeront, pour la Calédonie, le noyau d'un musée qui réunira les productions naturelles du pays à celles de l'industrie nationale239.
La peur de la disparition de coutumes indigènes semble ici jouer le rôle de paravent, de
prétexte à la proclamation de l’efficacité de la colonisation ; mais ce premier jalon mettant sur
la piste de l’écriture ethnographique trouve un retentissement dans d’autres textes. Dans les
métadiscours qui apparaissent de point en point au fil des textes médiatiques se fait jour une
conscience des modèles d’écriture, par exemple lorsque F. Ratte écrit qu’il n’insistera pas « sur
ces mille détails d’un voyage dans la brousse qui frappent l’imagination du citadin et qui ne
gagnent qu’à être dits avec entrain ou décrits avec art, ou bien sont du domaine de
l’ethnographie et alors demandent à être exposés avec méthode et interprétés avec une
connaissance approfondie de la question240 ». Il existerait donc une stylistique de
l’ethnographie, bien différente des descriptions classificatoires de la première moitié du siècle
et des diverses études ou esquisses de mœurs. Dans les années 1870, en effet, l’ethnographie
est une référence de l’écriture coloniale, et elle peut apparaître dans l’énumération d’autres
disciplines visant à décrire le territoire, comme le signale le titre d’un feuilleton du
Mobacher : « Notes sur la géographie, l’ethnographie, la géologie, la zoologie et l’archéologie
239 1er janvier 1860. 240 F. Ratte, art. cit.
341
de l’Algérie241 ». Pourtant le terme en lui-même n’est pas bien défini : le 30 septembre 1860,
c’est bien « ethnologie » qui est mentionné dans le titre du feuilleton du Moniteur de la
Nouvelle-Calédonie ; se pose aussi la question de la distinction entre anthropologie et
ethnographie. Si en Angleterre la distinction semble nette, faisant des ethnologues des
universitaires darwinistes, et des anthropologues des conservateurs qui refusent la théorie de
l’évolution, Patricia Lorcin note qu’en France Darwin ne constitue pas le point majeur de
distinction entre ces deux termes, partant entre ces deux attitudes. La Société d’anthropologie
est créée en France en 1859 et suit la fin de la Société d’ethnologie242. Certains textes, s’ils
n’ont pas d’étiquette disciplinaire, font tout de même œuvre d’ethnographie. Le Courrier de
Saïgon publie plusieurs de ces textes : une « Étude sur le deuil et la parenté chez les
Annamites243 », « De la justice en Chine » qui précède « Mœurs et coutumes annamites244 »
paru dans le même numéro, mais en supplément. L’ethnographie représente-t-elle alors
l’hypotexte sur lequel se développe toute fiction ? L’histoire serait le concept utilisé pour
peindre les personnages des colonisateurs ; l’ethnographie le moyen par lequel peindre des
colonisés privés d’histoire : il y aurait ici quelque chose d’une confrontation245.
Les mœurs coloniales : décrire une société à plusieurs niveaux Le terme d’« ethnographie » n’apparaît que rarement dans la presse ; les « mœurs » sont
bien davantage présentes, pour des raisons qui tiennent à la vogue littéraire des physiologies.
Les descriptions sociales peuvent d’abord toucher le groupe des colonisateurs, sur un ton léger
et qui tend à rendre l’atmosphère coloniale, comme ici en Guyane, sous la plume du chroniqueur
local :
Oserais-je vous parler de nos causeurs de Cayenne, de cet aréopage fameux qui stationne au perron Chevalier, mélange de médecins, d’administrateurs, de jurisconsultes, de négociants ; tout y est représenté ; tout y est discuté ; la question de droit s’y dispute, côte à côte, avec une thèse médicale, le prix des denrées s’y établit en même temps que la coupe des habits ; la betterave, ce légume colonicide y est maudit mille fois par jour ; une place est réservée à celui qui (nouveau messie) aura le premier empoché l’indemnité ; puisse sa venue être proche. À l’instar de Tortoni, on y admire, on y critique les équipages ; il n’y en a pas beaucoup, mais il y en a…, la livrée des
241 Professeur Jourdan, « Notes sur la géographie, l’ethnographie, la géologie, la zoologie et l’archéologie de l’Algérie. Par M. le professeur Jourdan », Le Mobacher, du 12 au 21 octobre 1875. 242 Patricia Lorcin, Kabyles, Arabes, Français, identités coloniales, Limoges, Pulim, 2005, p. 177. 243 Achille Sinet, « Étude sur le deuil et la parenté chez les Annamites », Le Courrier de Saïgon, 20 novembre et 5 octobre 1868. 244 5 mai 1869. « Mœurs et coutumes annamites » se poursuit jusqu’au 20 novembre 1869. 245 Pour l’opposition entre histoire et ethnographie, voir Eleni Coundouriotis, Claiming History : Colonialism, Ethnography, and the Novel, New York, Columbia University Press, 1998. Ouvrage recensé par Neil Lazarus dans Modern Language Quarterly, volume 61, n° 4, 2000, p. 689-692.
342
grooms, des valets, des cochers, il n’y en a pas beaucoup, mais il y en a246…
Elles peuvent aussi prendre le chemin détourné de la correspondance, et dresser ainsi le
portrait de « l’habitant », autrement dit le colon, silhouette incontournable dont les auteurs
coloniaux jouent :
Monsieur le Rédacteur, Est-ce qu’il ne vous est pas arrivé, quelquefois, d’entendre dire par un père de famille les paroles suivantes : Dieu m’a donné quatre garçons ; Jacques, mon aîné, est un gaillard très éveillé, il a une grande mémoire, beaucoup de facilité et pas mal de volubilité dans la parole, parfois même il parle si vite qu’on ne comprend pas ce qu’il dit ; j’en ferai un avocat ; Antoine est doué d’un esprit observateur dont je suis moi-même étonné, de plus il est très studieux, j’ai envie d’en faire un médecin ; Jean-Baptiste connaît ses quatre règles, il est soigneux, ne laisse rien traîner, met chaque chose à sa place, et possède une belle écriture, sa place est toute trouvée, j’en ferai un épicier ; quant à Nicolas c’est un imbécile, il sera habitant ou… administrateur. Cela vous paraît fort, n’est-ce pas, M. le Rédacteur, et cependant rien n’est plus vrai. Le père ne dit pas précisément que son fils est un imbécile, il craindrait de blesser sa modestie, mais il dit quelque chose d’approchant, par exemple : Nicolas n’a pas beaucoup de vivacité, son esprit est un peu lent, il n’a pas de goût pour la lecture, il préfère un beau fusil à un bon livre et un cheval à un savant, donc il sera habitant247.
La critique est ici forte, qui assimile l’habitant ou l’administrateur, autrement dit les
deux figures les plus propres à la colonie, à des « imbéciles » : le trait est permis parce qu’il
sera détourné, et servira de prétexte à une dissertation politique sur la colonie. Mais en général,
et malgré l’attirance coloniale pour les jeux de miroir, la description des mœurs coloniales
s’intéresse bien davantage aux mœurs des indigènes. Et, sur le modèle des physiologies, la
proto-ethnographie que constitue la flânerie permet de voir à quel point le modèle des
« esquisses » ou des « mœurs » est prégnant dans l’imaginaire colonial : l’anecdote du flâneur
que l’on va lire ici reprend ces éléments, clefs de la compréhension du monde colonial, pour
mettre en scène le personnage d’un « titi » algérien.
Je flânais il y a quelques jours rue Philippe, quand tout à coup au milieu des nombreux bourriquots, qui comme tout le monde sait, obstruent toutes les rues de la ville d’Alger, une voix se fait entendre, et un jeune maure s’adressant à moi me dit : « Mosou, toi voulir sonnar pour moi ? » et il me montrait une porte dont la sonnette en effet, se trouvait hors de sa portée.
Je me fais jour à travers les quadrupèdes aux longues oreilles ; l’enfant me suit, je sonne, et me retourne afin de lui dire d’attendre qu’on lui ouvre… Je vois mon diable à une trentaine de pas, en train de me lancer du tabac, geste très commun aux gamins de Paris.
J’avais posé !!!
246 Lechertier, « La pointe des causeurs », L’Éclaireur de Cayenne, 18 février 1849. 247 « Lettre d’un Grandfonnier », L’Avenir, 12 avril 1867.
343
Si ça continue, nos titis algériens n’auront plus rien à envier aux moutards de la capitale248.
La description du « titi colonial », qui semble en effet être une réactivation du « gamin
de Paris », peut apparaître dans les chroniques qui se donnent pour but de décrire un trait
particulier de la colonie. Ainsi, dans une « causerie » que fait paraître le Courrier de Saint-
Pierre le 19 janvier 1870 apparaît un personnage nommé Guguste, caractérisé comme « le plus
heureux des saute-ruisseau qui parcourent les rues desséchées de la capitale de notre île », mais
aussi comme « un lauréat d’une de nos écoles primaires ». La description de Guguste le met en
scène dans un décor familier, au moment d’une activité habituelle : « Il était au coin d’une rue,
les deux mains chargées d’énormes cylindres de manioc bouilli, la bouche bondée de morceaux
qui paraissaient jaunes auprès de ses belles dents blanches249 ». Dans ces deux textes, issus de
territoires différents et publiés à des époques différentes, le face à face entre l’auteur et l’enfant
est une clef de la description, et un détail (le manioc, le discours direct) fait entrer la « couleur
coloniale » au sein de l’anecdote. En ce sens, on peut parler d’une forme d’ethnographie
attentive aux silhouettes quotidiennes de la colonie, et à ce qu’elles permettent de révéler en
creux comme identité coloniale. Ce n’est pas le seul contournement possible du discours
ethnographique au sens où F. Ratte le décrit, avec cette exigence de neutralité et de sérieux : le
journal colonial multiplie les tentatives pour parler des autres sans en parler vraiment, profitant
alors des ressources narratoriales. Au fil de la description que fait Ratte de son voyage, l’on
trouve le passage suivant, consécutif à un premier extrait déjà cité :
Vous dirais-je que plusieurs de nos canaques ont la tête ornée du tabou traditionnel en signe de deuil ; qu’ils se noircissent la poitrine ou se teignent les cheveux pour s’amuser ou se parer ; que celui-ci est le plus adroit à la fronde, celui-ci à la sagaie ; que ce grand hercule porte au milieu du front la cicatrice profonde d’un coup de pierre ; que l’habileté de ce vieux à sculpter le bois est connue des tribus de la côte à dix lieues à la ronde ?
Vous décrirais-je ces jeunes filles et ces vieilles décrépites ployant sous de lourds fardeaux de racines, de cannes ou de fagots, ces foyers où le soir chaque famille se réunit pour manger le taro ou l’igname et se raconter bien avant dans la nuit les événements du jour ?
Vous montrerais-je leurs cases construites avec soin et ornées de sculptures grotesques mais pleines d’originalité ? Quelques-unes de leurs habitations ont de vraies portes et ferment au cadenas. Je ne vous apprendrai pas que leurs présents ou leurs services se paient en monnaie d’argent, en pièces de cinq francs qu’ils appellent dollars ou en objets d’échange250.
248 « Esquisse de mœurs arabes », Le Brûlot de la Méditerranée, 25 mai 1848. 249 R. R., « Causerie », Le Courrier de Saint-Pierre, 19 janvier 1872. 250 F. Ratte, art. cit.
344
La prétérition employée par l’auteur transforme le compte-rendu d’exploration en une
discussion complice avec le lecteur que prévoit le texte : et ce jeu montre bien sur quels
présupposés ce texte se construit. En 1878, l’ethnographie semble être devenue un attendu des
descriptions coloniales, détourné ici au profit d’une énumération rapide qui esquisse quelques
traits de la vie kanak. On est bien loin alors du texte que pouvait produire un auteur antillais sur
les fêtes indiennes du Pongol à la Martinique :
Vous m’avez recommandé, mon ami, de vous faire le récit de la première fête du Pongol que mes cultivateurs indiens célèbreraient. Bien que j’aie peu de loisir, je vais essayer de répondre à votre désir. J’irai au courant de la plume : votre savoir des us et coutumes indous suppléera à mon insuffisance. […]
C’est le premier de l’an que les Indiens ont commencé leur fête, qui doit durer quatre jours. – Au lever du soleil, plusieurs d’entre eux, désignés dès la veille, vont chercher des branches vertes pour recouvrir la charpente d’une grotte élevée dans l’enceinte d’un ancien manège converti en moulin à vapeur. L’emplacement est grandiose et se prête admirablement au développement de la fête. La grotte, artistement travaillée, est assez semblable à celle que la ferveur des fidèles élève sur nos places publiques le jour de la Fête-Dieu. Seulement elle est surmontée d’arcades de verdure ornées de guirlandes de fleurs, et la porte, de forme cintrée, est beaucoup plus petite. Au fond de la grotte s’élève un petit tertre, où sera bientôt placée la Pagode qui présidera à toute la fête251.
Le récit suit alors la fête sur cette même tonalité : une description précise et commentée
d’une fête qui est censée être observée par un narrateur modeste et sans prétentions scientifiques
ou littéraires, selon l’écriture que recommande le modèle épistolaire. Sur un autre territoire, et
selon un texte qui se veut neutre, la cérémonie kanak du « pilou-pilou » est décrite en 1864, sur
trois pages, dans un article signé par E. Bourgey, lieutenant d’infanterie de la marine et officier
d’ordonnance252.
D’autres types d’articles stabilisent la publication d’articles à vocation
ethnographique : ainsi de la série des « arabesques » dans Le Moniteur de l’Algérie de 1862.
L’auteur, qui ne signe que par ses initiales C. M. (que nous n’avons pas élucidées), y traite des
« savants arabes253 », du « médecin arabe et [des] amulettes254 », de la « medersa ou école
secondaire arabe255 » selon un rythme régulier. Cette série de 1862 donne une plus grande
visibilité et une plus grande stabilité à un type d’écriture qui existait dès les premières années
251 « Immigration indienne. La Fête du Pongol à la Martinique », La Feuille de la Guyane française, 30 juin 1855. Pris dans Le Moniteur de la Martinique. 252 E. Bourgey, lieutenant d’infanterie de la marine, officier d’ordonnance, « Un Pilou-pilou », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 4 septembre 1864. 253 5 janvier 1862. 254 12 janvier 1862. 255 Du 25 janvier au 12 février 1862.
345
de la colonisation, puisqu’Adrien Berbrugger lui-même faisait paraître des textes à ambition
ethnographique :
Les Arabes de cette province diffèrent beaucoup et sur plusieurs points de ceux qui habitent les autres parties de l'Algérie : langage, mœurs, instruction, caractère, tout chez eux fait opposition avec ce qui s'observe ailleurs. [...] À l'Ouest, par exemple, l'Arabe est ignorant, grossier, belliqueux, rude dans la prononciation de son idiome local, qui s'est plus altéré qu'aucun autre ; tandis que les populations de l'est donnent lieu à des remarques diamétralement opposées. Pour bien se rendre compte de ce fait singulier, il faut se rappeler la manière dont s'est opéré la conquête musulmane. […] Les variétés de langage vont quelquefois plus loin et il y a des expressions qui diffèrent totalement : pour dire beaucoup à Alger on emploie le mot bezzaf ; à Bône, c'est yesseur. Les algériens appellent un cheval doud et les Constantinois hhaçane. Il est à remarquer du reste que la plupart des variantes de l'arabe vulgaire se retrouvent dans la langue savante ou l'idiome de Modhar dont Mahomet se servit pour écrire le Qoran256.
Les remarques sur les coutumes et la langue se complètent dans cet extrait, les unes étant
le reflet des autres ; mais cet article n’était que l’extrait d’un récit de voyage, alors que les
« Arabesques » citées sont pensée pour le journal257. Au cours du siècle se développe donc la
conscience d’un discours neutre, organisé et suivi que l’on peut servir aux coloniaux pour leur
donner l’idée qu’ils connaissent le territoire sur lequel ils vivent.
Le métadiscours et le discours : deux strates de composition ethnographique Les textes médiatiques qui affichent comme but la production d’une connaissance sur
les peuples leur attribuent, dans le XIXe siècle que nous étudions, des caractéristiques qui sont
autant de lieux communs. En ce qui concerne l’Algérie, le fait que l’imagination remplace le
savoir en est un ; et c’est ce que note par exemple le commandant Colomb dans sa tournée
d’exploration :
Quelques légendes mystérieuses et obscures, de celles qui exercent un si grand charme sur les imaginations vierges des Sahariens, m’avaient appris que ces contrées, que l’oiseau lui-même est obligé de fuir, parce qu’il n’y trouve pas la goutte de rosée qui le désaltère, avaient été habitées autrefois par une tribu nombreuse et puissante, les Hilel-Beni-Amer ; qu’à chaque point saillant, qu’à chacune de ces gour, qui s’élèvent, de loin en loin, dans cette immensité, comme des phares destinés à guider les caravanes, les guerriers, les héros de cette tribu,
256 A. Berbrugger, « Arabes de la province de Constantine », L’Akhbar, 15 novembre 1839. Une note finale précise : « Cet article est extrait du Voyage pittoresque en Algérie par M. A. Berbrugger, membre correspondant de l'institut, conservateur de la bibliothèque et du musée d'Alger. L'auteur a bien voulu nous promettre quelques autres communications du même genre, avant la publication de cet ouvrage qui paraîtra prochainement ». 257 À mi-chemin entre les publications d’extraits de livre et les séries d’articles pensés pour le journal, l’on peut trouver des textes comme les « Coutumes de la culture arabe » signées Fortin d’Ivry qui paraissent épisodiquement dans Le Saf-Saf du 20 octobre 1849 jusqu’au 16 mars 1850.
346
avaient attaché un nom, un souvenir consacré par quelque exploit ou par quelque calamité.
Parmi ces légendes qui donnent à ce pays, dans le passé, une vie qu’il n’a plus maintenant, j’avais remarqué celle qui raconte sa prise de possession par les Beni-Amer et une autre qui semblait révéler un phénomène géographique des plus curieux258.
L’assertion n’est pas nouvelle, et elle circule d’un territoire à l’autre comme un modèle
transposable, même si le texte qui relate cette idée peut, lui, varier. Ainsi, dans Le Courrier de
Saïgon, les nouvelles locales recèlent l’entrefilet suivant :
On lit dans le Gia-dihn-Bao : A côté du village de Vinh-truong, près de la source Tho’miêng, une veine d’eau vient de se créer ; les uns assurent que c’est une source immortelle, tandis que les autres prétendent que l’eau de cette source est lancée par un con cu (animal fabuleux dans le genre du dragon) ; on lui attribue une très-grande efficacité : elle guérirait les maladies de toute espèce : paralytiques, fiévreux, lépreux, etc. De tous côtés le monde arrive en foule pour puiser à ce trésor : on ne recule devant aucune dépense ; il y en a qui apportent de l’or et de l’argent pour sacrifier au génie de cette source ; d’autres, en offrant de l’or et de l’argent, font des vœux pour obtenir leur guérison. Il paraîtrait que la fontaine de Tho’miêng était tarie depuis 5 ou 6 mois, les veines d’eau auront dû suivre d’autres voies sous terre, n’auront pas pu parvenir à reprendre leur ancien cours, et, à force de creuser, par leurs bouillonnements, ont fait une ouverture qui s’élargit de plus en plus ; car plus une source se trouve obstruée, plus elle devient forte lorsqu’elle parvient à se faire un passage, elle fait crouler la terre qui l’environne. On dit que cette veine d’eau creuse très en-dessous ; par la suite la terre qui croulera en cet endroit formera des caves et des fosses profondes ; mais tout cela n’a rien d’extraordinaire, comme beaucoup de personnes le prétendent, en disant que c’est une source immortelle ; sans doute l’eau qu’elle produit peut être bonne à boire et très rafraîchissante, mais dire que c’est une source immortelle, une source formée par la puissance d’un animal fabuleux, c’est une tromperie faite dans le but d’exploiter le peuple, toujours enclin à attribuer à des êtres surnaturels ce qu’il ne peut expliquer259.
Les discours rapportés enclenchent cette représentation des indigènes dans les deux
textes : laisser parler un groupe supposé indigène, c’est s’exonérer de la responsabilité du
jugement, et effacer la voix narratrice pour mieux marquer les esprits. Mais le cas de la
Cochinchine est particulièrement intéressant, parce que Le Courrier de Saïgon ne se limite pas
à ce constat somme toute banal dans l’idéologie coloniale. Des premières observations aux
nouvelles locales en passant par la grammaire, beaucoup d’articles sont consacrés au peuple
annamite, à ses coutumes et sa langue. La tradition des journaux missionnaires peut en partie
258 « Tournée d’exploration dans les Ksours et dans le Sahara de la province d’Oran, par le commandant de Colomb », Le Moniteur algérien, 5 juin 1858. 259 « Nouvelles locales », Le Courrier de Saïgon, 20 avril 1866. Le Gia-dihn-Bao est le « journal annamite » créé par les autorités françaises en 1865.
347
expliquer cette tendance, et le journal colonial s’en nourrit, y compris dans ses « nouvelles
locales » :
Les Annamites et les Chinois célèbrent en ce moment leur premier jour de l’an (têt). Cette fête, qui dure toute une semaine, consiste chez les indigènes en une foule de cérémonies excessivement curieuses, qui ont pour but, d’après la coutume, de chasser les mauvais esprits et d’appeler de nouvelles félicités sur les maisons, après les avoir purgées des calamités anciennes. Pendant la dernière nuit de l’année, chaque famille plante devant la porte de sa demeure un long bambou, à l’extrémité duquel se trouve un vase recouvert de papier d’or et d’argent, renfermant du bétel, de la noix d’arec et de la chaux. Ce bambou reste là pendant huit jours, et, tant qu’il est debout, la maison est pour ainsi dire inviolable et les débiteurs y sont à l’abri des poursuites de leurs créanciers260.
Ce dernier exemple donne à voir une forme de ségrégation qui s’accomplit
textuellement, séparant dans le cadre du périodique colonial différentes identités face
auxquelles le publiciste est implicitement situé comme une figure d’autorité. Cette forme de
violence, toute textuelle, s’effectue dans le discours ; elle ancre la différenciation raciale au
cœur de la colonie envisagée en tant que texte.
L’interprète ou un avatar de l’ethnographe 261 ? Si l’on rencontre des interprètes dans presque tous les textes coloniaux, il est rare qu’ils
soient mis au premier plan : ils ne sont souvent que des noms, voire des silhouettes qui
traversent les textes d’exploration. Mais la situation est un peu différente en ce qui concerne le
territoire algérien : et d’un point de vue historique, les interprètes militaires des premiers temps
de la conquête française en Algérie sont autant de rouages fondamentaux de la « rencontre
coloniale » qui se joue à côté des combats, rencontre appauvrie sans doute, mais qui possède
tout de même ses nuances et ses ambiguïtés. Alain Messaoudi, qui a consacré plusieurs études
aux arabisants, écrit ainsi :
Les interprètes, par leur fonction même d’intermédiaires, par les compétences langagières et littéraires que suppose leur activité, par leur familiarité avec les usages des différents groupes dont ils permettent la communication, ont joué un rôle important dans les échanges entre
260 « Nouvelles locales », Le Courrier de Saïgon, 5 février 1870. 261 Quelques passages de ce développement sont issus d’une communication intitulée « La construction de la figure de l’interprète dans les premiers temps de la conquête en Algérie : autour d’Eusèbe de Salle », effectuée au Congrès de la Société Internationale d’Études des Littératures de l’Ère Coloniale (SIELEC) : « Parcours en regard : passeurs, alliés et transfuges à l’époque coloniale », à l’Université de Bourgogne, le 10 juin 2016. L’article est en cours de publication.
348
colonisés et colonisateurs et dans la constitution d’un savoir « colonial » sur l’Algérie262.
Ces « intermédiaires obligés du colonialisme263 », ces « incontournables264 » qui
arrivent avec l’armée en 1830 présentent cependant des différences de profils, d’origines ou de
carrières. Par leur utilité, ils sont aussi les héritiers des truchements nécessaires à la colonisation
du premier empire colonial : mais, contrairement aux truchements, ils ne courent pas le risque
de l’ensauvagement dont Étienne Brûlé, compagnon de Samuel de Champlain, vaut pour un
paradigme265. Ils se distinguent aussi des drogmans, figures nécessaires des récits de voyage en
Orient et personnages souvent caricaturés pour leur hybridité, leurs fanfaronnades, leurs
compétences linguistiques questionnables266. C’est que les interprètes militaires de l’Algérie
sont d’abord un corps constitué plus qu’une somme d’individus ; partant, le spectre de la
décivilisation tout comme celui de l’hybridité ne les menace pas. Ils sont aussi les héritiers de
l’expédition d’Égypte – parfois littéralement, comme c’est le cas pour Florian Pharaon
(Marseille 1827 – Paris 1887), petit-fils d’Élias267 – et à ce titre ils portent la responsabilité
d’une curiosité savante érigée en justification de la conquête. Si l’on voulait ainsi dresser une
galerie des traducteurs qui ont accompagné la colonisation française, les interprètes de la
conquête algérienne seraient un moment particulier, et c’est ce moment dont nous voulons
interroger le rôle littéraire. On pense ainsi à Ismaÿl Urbain le saint-simonien, ou à Léon Roches,
connu pour avoir été proche d’Abd el-Kader ; mais la presse publie d’autres
interprètes : Antoine Arnaud, Florian Pharaon, Charles Féraud entre autres. Dans les premières
années, les interprètes publient principalement dans Le Moniteur algérien ; par la suite, ils
jouent un rôle prépondérant dans le Mobacher : même si ce dernier a la réputation d’être peu
lu, il reste un moyen par lequel s’expriment les interprètes sur des sujets très différents.
Interprète et futur consul, Charles Féraud publie surtout dans le Moniteur algérien des textes
262 Alain Messaoudi, « Renseigner, enseigner. Les interprètes militaires et la constitution d’un premier corpus savant “algérien” (1830-1870) », Revue d'histoire du XIXe siècle, n°41, 2010. URL : http://rh19.revues.org/index4049.html. Consulté le 2 mars 2016. 263 Colette Touitou-Benitah, « Les intermédiaires obligés du colonialisme », Meta : Journal des traducteurs, vol. 40, n° 1, 1995, p. 15. 264 Raymond Mopoho, « Statut de l’interprète dans l’administration coloniale en Afrique francophone », Meta : journal des traducteurs, vol. 46, n° 3, 2001, p. 1. 265 Olga Jurgens, « Brûlé, Étienne », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003. URL : http://www.biographi.ca/fr/bio/brule_etienne_1F.html. Consulté le 9 mars 2017. Voir aussi Georges Van den Abbeele, « Qu’est-ce qu’un “truchement” ? Entre étranger et compatriote à l’époque des découvertes », dans Ana Clara Santos and José Domingues de Almeida (dir.), L'Étranger tel qu'il (s')écrit, Biblioteca Digital, Faculdade de Letras, Universidade do Porto, 2014, p. 189-196. 266 Sarga Moussa, La Relation orientale, Paris, Klincksieck, 1995. 267 Élias Pharaon (Damas 1774 – Paris 1831). Voir François Pouillon (dir.), Dictionnaire des orientalistes, Paris, Karthala, 2012.
349
« sérieux », documentaires : des « Notes sur Tiklat (Tubusubtus268) », une « Exploration
nautique de la Soummam et du Bou-Sellam, dans la grande Kabylie269 (extrait de la Revue
africaine) » ou encore des « Notes sur Bougie270 (extrait de la Revue africaine) » se succèdent.
Même dans le Mobacher, ses publications sont sérieuses : par exemple une « Histoire des villes
de la province de Constantine271 », qui sera publiée en feuilleton, donc très visible. Féraud
correspond à ce que l’on attend d’un interprète : sa connaissance de la langue est mise au service
d’un discours plus général sur l’ensemble de la colonie. Tout autre est Antoine Arnaud, autre
interprète (et père de l’écrivain algérianiste Robert Randau). Il publie les textes attendus d’un
interprète : un « Mécanisme de l’Administration française à l’usage des indigènes
musulmans », série d’articles publiés au début de l’année 1878 ; un article sur « Les sciences et
l’islamisme272 » ; la critique d’un manuel d’arabe273 ; une traduction274... La liste n’est pas
exhaustive. Mais l’interprète n’est pas seulement traducteur, puisqu’il publie deux textes dans
la rubrique des variétés : un « Colporteur indigène275 » puis « Quelques réflexions d’un âne
algérien276 ». Il y met en scène sa connaissance du territoire et de la population algérienne autant
que sa capacité littéraire, puisque, par exemple, le « colporteur » décrit rappelle le
fonctionnement de la littérature panoramique des années 1840 :
L’un des types les plus intéressants de notre population indigène est certainement celui du colporteur.
Qui de nous, s’il a fait quelque lointaine excursion dans nos possessions algériennes, n’a pas, parfois, rencontré sur son chemin des hommes, un pesant sac de cuir jeté en travers des épaules, ou le dos ployé sous une volumineuse charge ? Un certain air dépaysé, contraint, répandu sur leur physionomie, à défaut de l’ensemble des traits, nous aurait fait reconnaître des étrangers.
Ils marchaient péniblement appuyés sur un bâton verni et lissé par l’usage de la main. Ils passaient à côté de nous silencieux et tristes, comme des exilés que chaque pas éloigne de la patrie – ubi amor – et auxquels il tarde néanmoins d’arriver au terme de leur course, comme des hommes qui savent ne pouvoir goûter qu’aux devoirs et aux duretés de la vie277.
268 30 avril 1858. 269 5 août 1858. 270 15 septembre 1858. 271 De mars 1877 à novembre 1878. 272 Arnaud, interprète militaire, « Les sciences et l’islamisme », Le Mobacher, 23 juin 1877. 273 Arnaud, interprète militaire, « Cours pratique de langue arabe à l’usage des lycées, collèges et écoles de l’Algérie, par Belkassem Ben Sedira, professeur à l’école normale et à la medreça d’Alger », Le Mobacher, 5 janvier 1878. 274 Arnaud, interprète militaire, « Voyages extraordinaires et nouvelles agréables par Mohammed Abou Ras ben Ahmed ben Abd El Kader En Nasri », Le Mobacher, 9 août 1879. 275 Arnaud, interprète militaire, « Colporteur indigène », Le Mobacher, 17 février 1877. 276 Arnaud, interprète militaire, « Quelques réflexions d’un âne algérien », Le Mobacher, 19 et 25 mai 1877. 277 Arnaud, interprète militaire, « Colporteur indigène ».
350
Autre ton, plus décalé, pour les mystérieuses réflexions de l’âne algérien, dont voici les
premières lignes :
En Algérie – cette terre féconde en prodiges, – il y a des indigènes qui lisent couramment l’avenir sur l’omoplate fraîche d’un mouton, et d’autres aussi, devant lesquels les chacals ne comploteraient pas, sans voir aussitôt leurs desseins déjoués, le massacre des moutons. Rien de plus simple que de parler et de comprendre le patois pleureur de cette importante tribu canine : il s’agit, tout bonnement, de manger, pendant qu’on est en nourrice, de la cervelle de cet animal pillard. Pourquoi ce mets n’aurait-il pas cette vertu ? Une gousse d’ail, usée sur les lèvres d’un enfant, a bien eu, chez nous, le pouvoir d’en faire, non seulement un homme, mais encore un monarque célèbre278.
Le texte est ici divertissant et faussement pédagogique : le présentatif de départ donne
une information, reprise à la fin du paragraphe en comparaison avec une légende française, celle
d’Henri IV. L’humour se lit aussi dans l’usage des adjectifs : un patois « pleureur », une tribu
« canine », un animal « pillard » ; en arrière-plan se lit la parodie d’une description
ethnographique de l’Algérie. Ces publications nous mettent sur la piste d’Arnaud comme un
interprète construisant son éthos auctorial sous la forme du passeur : partant des genres
littéraires établis que sont la littérature panoramique et le conte, Arnaud tourne ses textes vers
une originalité qu’il lie explicitement au territoire décrit. L’interprète militaire peut donc se
révéler un auteur « gagné » par la colonie.
D’autres traductions supportent le projet des publications médiatiques : ainsi de la
publication de « Luc Van Tien », épopée publiée dans Le Courrier de Saïgon en 1866, et dont
nous avons cité l’introduction en première partie. Cette introduction est intéressante à plus d’un
titre : il y est question des « mœurs et [des] idées » qui signalent la portée ethnographique de
cette traduction littéraire ; l’on y lit également une justification de la colonisation française par
la défense contre l’impérialisme chinois ; l’on y remarque enfin l’annonce d’une « littérature
nationale ». Ce dernier point préfigure les tentatives qui seront faites dans les colonies – en
Afrique particulièrement – pour aboutir à la production de textes exprimant les particularités de
la culture indigène ; le traducteur occasionnel (ici un consul), enfin, est l’une des silhouettes
auxquelles le lecteur est habitué dans le cadre colonial. Ces paragraphes cristallisent en fait une
bonne partie des problématiques coloniales ; or elles introduisent un texte et le placent ainsi
dans une relation au contexte assez étroite.
278 Arnaud, interprète militaire, « Quelques réflexions d’un âne algérien ».
351
3 Grossir le trait : une esthétique coloniale ?
La place dévolue à l’histoire et aux conflits coloniaux au sein des périodiques est
importante ; mais elle n’empêche pas d’autres écritures du contact et des antagonismes. De
manière plus fine et dans les textes même se révèlent d’autres mécanismes pour écrire les autres,
sans qu’il y ait contradiction. C’est que la littérature médiatique coloniale vise à produire une
connaissance idéologique et du territoire et des peuples concernés par la colonisation : d’où une
tendance a priori à grossir les traits décrits, pour les rendre plus visibles et plus lisibles. Cela
peut pourtant sembler paradoxal : les plumitifs coloniaux revendiquent une écriture de la
précision, une justesse dans l’observation qui ne correspond pas à l’écriture caricaturale ou
stéréotypée que l’on peut observer aujourd’hui et dont le lecteur actuel a conscience. Décrire la
colonisation dans un flux historique permet une diffraction du portrait ; écrire le présent de la
colonisation demande d’autres mécanismes ; que le lecteur soit métropolitain ou colonial, le
propos reste bien de marquer les esprits par la presse. Grossir le trait pour traiter du présent de
la colonie, en littérature médiatique, signifie certes user de stéréotypes, mais encore les faire
ressortir par la satire, par l’ironie ; voire aller jusqu’à la fictionnalisation comme outil narratif
pour transformer l’actualité ou l’histoire. Les auteurs médiatiques ne sont pas aveugles à ces
problématiques du traitement de l’altérité ; parfois, quelques textes surprennent par le
traitement distancié qui est fait des stéréotypes nationaux. C’est le cas d’une introduction aux
« Observations sur le peuple annamite » que publie le Père Jourdain dans la première décennie
de la présence française à Saïgon. Il commence en effet par dénoncer les stéréotypes négatifs :
Que de gens sortent de notre belle France, tout imbus de l’amour du sol, ce qui est bien excusable, mais qui portent avec eux, partout où ils vont, un bagage de préjugés qui fait pitié à l’homme sérieux ! Les seuls mots d’Anglais, d’Italiens, d’Espagnols, de Juifs, de Turcs, de Chinois réveillent, dans l’esprit de ces gens-là, toute une foule de préjugés, plus ou moins singuliers qui viennent danser devant leur imagination comme les lutins suscités par un coup de la baguette de Merlin l’enchanteur279.
Plus largement, en fait, se pose la question de la représentation grossière, au sens
premier, de l’altérité : la diversité des peuples et des cultures n’est pas reconnue par le
colonisateur280. Une étude comparée des différents moyens de représenter les autres de la
279 R.P. Jourdain, « Observations sur le peuple annamite », Le Courrier de Saïgon, 5 février 1866. 280 Voir par exemple Michelle Cheyne, « Pyracmond, ou les Créoles : l’articulation d’une hiérarchie des rôles raciaux sur la scène française sous la Restauration », French Colonial History, 2005, vol. 6, p. 79-102. L’article dévoile le cas intéressant du passage d’un drame lyrique de 1826 qui, soumis à la censure, subit la modification de l’un des personnages principaux, mulâtre de Saint-Domingue et chef des esclaves, devenant un Arabe vivant à Madagascar : dans les deux cas, le personnage conserve un nom grec.
352
colonisation permet alors de mieux comprendre ces phénomènes de confusion, de réduction, de
classification qui se jouent dans les colonnes de la presse coloniale.
3.1 Le rôle des stéréotypes : de l’installation à l’utilisation
« L’observateur européen voit dans l’Autre une version inachevée, imparfaite, négative
de lui-même : un singe281 », écrit Martine Astier-Loutfi en évoquant la description des Arabes
dans les textes romanesques qu’elle étudie. Elle relie ensuite ces remarques à la répercussion
de la théorie darwinienne dans le traitement réservé aux Nord-Africains en général, et il est vrai
que le filtre zoologique appliqué aux autres coloniaux tient bien d’un racisme qui trouve ses
justifications dans la science de l’époque. Le racisme appliqué à la littérature cache en effet ses
procédés dans une stylistique précise, regorgeant d’analogies dégradantes, amoindrissant la
place du personnage au profit de son appartenance à un stéréotype, à un groupe dont il n’est
qu’un élément particulièrement probant – qu’un échantillon, pour rester dans la terminologie
scientifique. Parfois même ce recours au stéréotype se fait dans une perspective confuse,
« recyclant » une image régionale française pour l’adapter à une description exotisée282. Le
stéréotype est en effet au centre des écrits de la colonisation : par quelques termes, quelques
tournures, les journaux mettent en place une écriture de l’esquisse qui laisse davantage de place
à la finesse en ce qui concerne l’actualité. Tout se passe comme si le stéréotype en tant que
filtre posé sur une réalité complexe, et qui permet d’en raccourcir la pensée, se retrouvait en
synchronie avec le journalisme colonial, dont le peu de colonnes rend également nécessaire une
forme de raccourci, de rapidité de l’écriture. L’histoire du stéréotype est fortement liée aux
médias et à l’époque moderne, puisqu’il cristallise les problématiques collectives, jouant un
rôle « stabilisant et conservateur » pour la société dans laquelle il prend naissance, et permettant
de donner une signification aux éléments de cette société283. Il est ainsi quelques thèmes qui
sont familiers aux lecteurs de la presse coloniale, et dont l’utilité première réside dans cette
capacité à orienter la lecture.
L’anthropophagie Point d’achoppement pour l’imaginaire colonial en Nouvelle-Calédonie,
l’anthropophagie se développe aussi dans les autres textes médiatiques ayant trait aux
281 Martine Astier-Loutfi, op. cit., p. 58. 282 Philippe Martel, « De l'Auvergnat au Kabyle Le recyclage d'un stéréotype dans l'Algérie coloniale », Confluences Méditerranée, 2012/1, n° 80, p. 163-179 283 Ruth Amossy, Les Idées reçues. Sémiologie du stéréotype, Paris, Nathan, 1991, p. 36.
353
colonies : synonyme de « barbares », mais plus précis, les anthropophages représentent en un
sens le sommet de l’altérité coloniale. Plusieurs stratégies discursives sont à l’œuvre autour de
l’anthropophagie : l’une au premier degré, l’autre parodique, et la dernière enfin qui joue sur
les stéréotypes pour mieux affirmer la hiérarchie des peuples que la colonisation met en place.
La rhétorique coloniale portant sur l’anthropophagie est vivace en Nouvelle-Calédonie : les
premiers textes publiés par Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie contiennent des
avertissements qui devaient faire frémir les lecteurs métropolitains des échanges. Dans les
premiers numéros de la parution, l’on trouve des avertissements qui paraissent dans la partie
non officielle, à l’image de cet extrait que nous avons déjà cité en première partie et qui rappelle
qu’a eu lieu le service « pour le repos de l'âme de l'infortuné Capron, Français âgé de 27 ans
massacré et mangé par les chefs de Taw et Hyenouène284 ». L’anthropophagie apparaît ensuite
de texte en texte : dans les mêmes années, lorsque le père Montrouzier écrit l’histoire de la
Nouvelle-Calédonie, il use d’un discours indirect libre extrêmement efficace pour mettre en
garde, selon son projet, les trop naïfs défenseurs des Kanak : « On avait fait le complot de tuer
l'évêque et les siens ; on devait les manger à la récolte des ignames285 » ; le chroniqueur Félix
H. Béraud revient sur le « progrès colonial » par la force de questions rhétoriques : « Les
anthropophages de la veille oublieront-ils, du jour au lendemain, leurs coutumes féroces ? leurs
instincts barbares disparaîtront-ils au premier contact européen286 ? » ; plus tard encore dans les
années 1860, les récits de guerre mentionnent aussi l’anthropophagie : « En septembre 1863, le
chef de la tribu Monéo fit tuer et manger un des siens convaincus d’adultère : telle est la loi des
Aborigènes287 ». Ce récit, en particulier, fait intervenir aussi les colons comme personnages
impliqués dans le récit des cas d’anthropophagie :
Les uns prétendaient qu’elles ont commencé à l’instigation des catholiques ; les autres, que l’enlèvement de femmes et surtout le désir de manger de la chair humaine, étaient le prétexte d’une guerre qui a presque toujours existé entre les deux baies. Par une prudence facile à comprendre, chaque colon ne dit pas toute la vérité sur le chef du territoire qu’il habite288.
Les « nouvelles locales » dans lesquelles sont publiés ces récits ont valeur
d’actualité ; parfois, la présentation est explicitement liée à cette actualité, comme on le voit
dans l’extrait suivant qui fait du cannibalisme la rubrique sous laquelle le journaliste écrit les
284 Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 1859. 285 P. Montrouzier, curé de Napoléonville, « Nouvelle-Calédonie, fragments historiques », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 19 août 1860. 286 Félix H. Béraud, « Chronique néo-calédonienne », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 6 juillet 1862. 287 « Nouvelles locales », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 18 mai 1864. 288 Id.
354
affrontements : « Anthropophagie (côte ouest) – Nous recevons de la côte Ouest des nouvelles
assez affligeantes. La guerre désole les tribus de Konei, d’Ouma, d’Ouali et d’Ounouha, dont
les territoires comprennent cette partie de l’île dans laquelle nous n’avons pas encore
pénétré289 ». Mais cette actualité n’efface pas le propos idéologique, et le journaliste modifie
alors son propos pour lui donner une portée plus large que le simple compte-rendu
d’événements :
La réputation de nos indigènes en Europe est telle que beaucoup de personnes parlent de les faire disparaître. Quelle faute ce serait ! D’ailleurs, la vieille civilisation qui n’a pas encore détruit chez elle l’affreuse coutume du duel, pourrait-elle, au nom de l’humanité, exterminer les anthropophages ? Ne désespérons pas de nos cannibales. Ils sont forts, intelligents, peu travailleurs, c’est vrai, mais, à notre contact, ils deviendront des auxiliaires puissants de la colonisation. Déjà bon nombre de ceux qui avoisinent nos postes travaillent chez les colons, au prix de 10 à 15 francs par mois et la nourriture. Gardons-nous donc de détruire cette race. La sortir du servilisme abrutissant qui résulte toujours de la subordination à un pouvoir despotique et inintelligent comme celui des chefs calédoniens ; lui apprendre notre langage et les arts professionnels ; lui inculquer nos mœurs, nos idées, tel est le but qu’il faut se proposer ; et les écoles de Port-de-France, Napoléonville, Wagap et Lifou, premiers efforts tentés dans ce sens depuis 1863, donnent des résultats encourageants290.
Apparaît bien ici toute l’ambiguïté de la posture coloniale dans la presse : entre
indigènes et Européens, le journaliste colonial use de rhétorique pour développer un projet qu’il
peint comme un compromis. L’exemple du duel est, de ce point de vue, une ressource non
négligeable : par l’analogie se crée véritablement l’emplacement à partir duquel le colonial peut
produire son discours. Et plus largement, l’anthropophagie contamine d’autres parties du
journal que les faits divers, par les références à la chair, par la question de l’avenir, comme on
le voit dans l’une des « Chronique néo-calédoniennes » :
Encore une fois, coloniser, c’est donner une plus large place, sous le soleil, à des aspirations, à des intérêts, à des croyances ; c’est faire de la propagande et la plus énergique de toutes, car elle ne s’adresse pas seulement aux idées, elle coule, pour ainsi dire, dans la chair et dans les os. Or, pour arriver à ce résultat essentiel, que doivent faire ceux d’entre nous députés par la patrie pour coopérer à l’œuvre de civilisation que veut accomplir la France sur les rives calédoniennes ? Iront-ils, par des enseignements, des exemples, des paroles, inoculer, dans les veines des cannibales qui peuplent cette île si sauvage et si belle, les qualités principales, les vertus essentielles ? Les anthropophages de la veille oublieront-ils, du jour au lendemain, leurs
289 « Nouvelles locales », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 29 janvier 1865. 290 Id. Nous soulignons.
355
coutumes féroces ? leurs instincts barbares disparaîtront-ils au premier contact européen291 ?
La critique théâtrale elle-même est gagnée par l’anthropophagie, lorsqu’Armand
Closquinet évoquant Vent-du-Soir joue sur les mots – il faut dire que le sujet de l’opérette s’y
prête particulièrement :
Apprenez que Pas-peigné-du-tout, le prime-queux de S.M. Vent-du-soir, au lieu d’être, au théâtre de Port-de-France, un blanc barbouillé de noir, était tout simplement un insulaire, un ex-anthropophage (j’ai le droit de le qualifier ainsi puisque, comme Vent-du-soir, il me semble d’âge à avoir digéré son homme), un ex-cannibale qui répond au nom de Taoa dans sa tribu, et à celui de Chaton dans la compagnie de soldats indigènes où il sert avec le titre et les sardines de caporal292.
De la même manière, une citation du Moniteur universel permet même, à partir d’un fait
divers ayant eu lieu en Nouvelle-Hollande, de peindre l’anthropophagie comme la matière
d’une réflexion sur les peuples. Le détour par la presse métropolitaine confirme en outre cette
habitude de passer par la métropole pour reconsidérer l’anthropophagie, tout comme on avait
pu lire la comparaison avec le duel. Dans le cas présent, un certain Morrill, un « nouveau
Robinson » selon le titre, a vécu parmi des tribus et le récit en est fait ainsi :
Il confirme ce fait déjà trop certain des habitudes des cannibales des hordes nombreuses qui peuplent l’intérieur du continent ; seulement ses allégations jettent un jour tout nouveau sur le point de vue auquel il faut envisager l’anthropophagie. La férocité n’est pour rien dans l’habitude de se manger les uns les autres. Les Australiens ne mangent que leurs chefs ou leurs amis les plus chers, après leur mort ; par cela, ils croient s’approprier quelques-unes des vertus ou des qualités du défunt293.
Coexistent alors deux discours dans le journal : le texte sur Morrill date du 17 avril,
extérieur à la colonie ; le 1er mai, en revanche, quand il est question des guerres calédoniennes,
le propos se resserre sur l’actualité locale :
En novembre suivant, OipéKambo, chef de Nékoué, invita les tribus de Houaraye, de Bâ ; de Houaïlou, de Monéo à un grand pilou-pilou. Au milieu de la fête, deux indigènes de la dernière de ces localités furent saisis par ordre de Oipé, tués en présence des danseurs, découpés, rôtis, et mangés par tous sans conteste. Les convives se retirèrent enchantés de s’être repus de leur mets favori, et le remords d’une telle violation des droits de l’hospitalité ne troubla nullement la digestion de nos anthropophages294.
291 Félix H. Béraud, « Chronique néo-calédonienne », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 6 juillet 1862. 292 Armand Closquinet, « Vent du soir et les Kanacks », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 1er février 1863. 293 17 avril 1864. 294 1er mai 1864.
356
Ce qui frappe ici, c’est la tonalité burlesque avec laquelle sont évoqués des faits
d’anthropophagie décrits si durement ailleurs. Tout se passe comme si l’article gardait en
mémoire Vent-du-Soir ou l’horrible festin, opérette d’Offenbach jouée quelques années
auparavant dans la colonie. Ce n’est pas la seule occurrence de ce ton décalé : dans les
« nouvelles locales » déjà évoquées, le journaliste concluait que « les guerriers de Konei
auraient tué cinq hommes et se seraient donné le plaisir de les manger295 ». Une forme de
déréalisation de l’information apparaît alors : et l’on comprend que, par ces tournures, c’est un
autre détail de la posture adoptée par le journaliste qui se fait jour. La désinvolture semble là
encore être un des mots clefs de cette manière de rendre compte d’une altérité problématique : le
contraste entre la formule convenue mais élégante de « se seraient donné le plaisir », et l’acte
cannibale va dans ce sens d’un détachement étonnant, d’une forme de refus du sérieux. Pourtant
rien n’est fixé, et la mosaïque de l’anthropophagie traitée par Le Moniteur de la Nouvelle-
Calédonie connaîtra encore d’autres variations : l’on retrouvera l’utilisation de la formule
« massacré et mangé », jusqu’à l’annonce, faite en 1866, de l’érection d’un monument à la
mémoire de marins « massacrés et dévorés296 » en 1864 ; l’on lira même des descriptions plus
développées, allant jusqu’à faire entrer en jeu la parole indigène pour condamner plus sûrement
l’ennemi.
Les meurtriers de Taillard, frères de l’ancien chef de Houagap et parents des chefs fusillés en 1862 pour avoir pris part à l’incendie de la mission de Touho, habitent le territoire de Gondou, situé dans l’intérieur. Ce dernier est bien connu de nos lecteurs. Donnant asile aux mécontents de toutes les tribus et aux rebelles à notre autorité, il fait incessamment la guerre à celles qui résistent à la sienne. D’après les indigènes, ce farouche sauvage n’est pas un homme, c’est un chien se nourrissant de chair humaine ; il ne parle pas, il aboie ; les victimes qui ont servi à assouvir ses appétits cannibales sont innombrables297.
Le ton est radicalement différent entre le texte informatif du Moniteur universel et les
récits de faits divers locaux, ce qui incline à s’interroger sur le traitement textuel et générique
d’une même donnée, en fonction de la proximité qu’il entretient avec l’imaginaire colonial
local. C’est alors en observant la circulation de cet imaginaire dans les textes coloniaux que
l’on se rend compte de la plasticité de la presse coloniale : ainsi de la « promenade militaire »
effectuée à Tahiti, et durant laquelle le narrateur décrit deux femmes tahitiennes, concluant que
« la vue de ces frais visages qu’encadrent d’abondants cheveux noirs ferait complètement
changer d’opinion ceux qui se figurent la race tahitienne nègre, velue, crépue, lépreuse,
295 « Nouvelles locales », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 29 janvier 1865. 296 Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 9 septembre 1866. 297 « Expédition de Gatope », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 1er octobre 1865.
357
anthropophage et papouasse298 ». On est encore ici dans le commentaire sérieux d’un stéréotype
que le colonial peut déconstruire en sa qualité de « connaisseur », même si une phrase comme
celle-ci – est-il besoin de le préciser – fait frémir le lecteur actuel par tout ce qu’elle contient de
racisme et de mépris. La parole est alors au premier degré et renvoie à tout un arrière-plan
idéologique raciste qui pose comme équivalents des adjectifs divers, mais qui tous renvoient à
une hiérarchie implicite. Le regard qu’exprime ces termes est celui d’un observateur qui se
pique de précision tout en exposant une confusion exotique voulue. Autre preuve de la présence
« en embuscade » de l’anthropophagie dans l’imaginaire colonial, un fait divers relaté par Le
Créole de l’île Bourbon transforme les esclaves marrons en anthropophages dont la parole est
suffisamment terrifiante pour être rendue au discours direct :
Dix noirs de l'établissement de M. Richard le Bidan étant partis depuis le matin et n'étant point revenus, à la fin de la journée un commandeur et deux autres esclaves furent envoyés à leur recherche ; ceux-ci pour arriver plus promptement à leur découverte, prirent chacun une route différente : celle qu'avait suivie le commandeur le conduisit à l'endroit où les dix noirs s'étaient rassemblés ; dès qu'ils l'aperçurent, un d'entr'eux lui fit signe d'approcher lui faisant entendre qu'ils étaient tous disposés à le suivre ; mais à peine le commandeur fut-il à quelques pas, qu'ils s'élancèrent sur lui : ce dernier prit aussitôt la fuite et s'étant heurté contre un arbre couché sur son passage, trébucha et fut renversé, soudain celui qui l'avait invité à approcher, le perça d'un coup de lance et appela ses compagnons, leur disant : venez, voici de la viande ; ceux-ci accoururent et prenant leur part de ce festin du crime, criblèrent le malheureux de coups de lance et de flèches, puis, lui coupèrent la tête et le transportèrent sur un des étages du rempart voisin ; la police se rendit sur les lieux, et, guidée par les traces de sang, découvrit le cadavre que les assassins avaient presque entièrement dépecé299.
Le fait divers alimente ici la légende mauvaise que la presse coloniale épaissit autour
des esclaves marrons ; mais l’anthropophagie est bien un concept labile, plus encore qu’on
pourrait le penser, et il a pu être détourné pour exprimer une idée coloniale plus large : ainsi
d’un passage du Moniteur algérien, qui marque le lecteur par son utilisation décalée et à des
fins humoristiques d’une expression connue. Roland de Bussy en effet, magistrat et homme de
loi, écrit que « subsidiairement, quant aux Arabes, [il] demeure étrangement surpris qu’on les
tienne pour des anthropophages. Ce sont les meilleurs gens du monde ; ils mangent, comme on
dit, dans la main300 ». Thème ambigu, l’anthropophagie dans les textes coloniaux circule donc
de rubrique en rubrique, mais aide systématiquement le narrateur à se définir contre cet absolu
298 Le Messager de Tahiti, 2 mars 1862. 299 Le Créole, feuille de l’île Bourbon, 17 janvier 1840. 300 R. de B., « Type. Un nouveau débarqué », Le Moniteur algérien, 4 juillet 1840.
358
de la sauvagerie : c’est en ce sens que l’on peut parler d’un grossissement des traits, et d’un
stéréotype qui connaît un succès certain dans la définition d’une identité coloniale.
Barbarie et violence Il y a bien sûr plusieurs facettes à l’image que la presse donne des indigènes : celle des
proclamations officielles, celle des fictions, celle des nouvelles, celle des récits de tribunaux et
celle des annonces. L’on se persuadera assez facilement de la complexité de l’image renvoyée
en comparant la proclamation officielle parue dans Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie et un
des poèmes d’Armand Closquinet ; le poème semble en avance de plusieurs années sur la
proclamation qui paraît en 1870. Il y est bien sûr question d’anthropophagie, mais de la manière
suivante :
Ces hommes, qu’on nommait cannibales féroces, M’ont reçu franchement et m’ont tendu la main, Ces kanacks, dont on dit tant de choses atroces, Veillaient autour de moi, du jour au lendemain301.
Cette strophe condense la représentation des indigènes faite dans ce poème : il est
question d’un changement, d’une prise de conscience de la réalité de la population kanak par
rapport aux discours entendus. La proclamation que l’on lit, quelque six ans plus tard, n’adopte
pas le même angle de représentation :
Le petit nombre des indigènes occupant quelques parties du territoire sont dans un état social grossier et barbare. Les tribus ne parlent pas le même langage. Leurs traditions sont mal connues, si ce n’est par l’horrible coutume de l’anthropophagie. Cependant, les efforts généreux et persévérants de nos missionnaires sont parvenus à adoucir les mœurs de quelques-uns, à leur donner des notions de morale et de justice. Soyons pleins de mansuétude à l’égard des indigènes, appelons-les auprès de nos habitations par la douceur de nos procédés, car quelques-uns d’entre’eux sont encore de véritables bêtes fauves, vivant dans les montagnes, loin de tout contact européen302.
Cette image déjà complexe peut se compliquer encore : dresser un parallèle entre les
populations algériennes et les populations kanak n’est pas une réflexion évidente ; pourtant
c’est ce que fait Félix Béraud pour vanter l’action du gouverneur français de Nouvelle-
Calédonie, qui a fait venir quatre enfants kanak à l’école française. Le chroniqueur
s’enthousiasme alors pour cette action et cite les écoles françaises-arabes comme preuves de la
réussite d’une politique coloniale303 : les deux peuples sont envisagés sous le même paradigme
301 Armand Closquinet, « Hommage et adieu », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 17 avril 1864. 302 « Proclamation aux colons de la Nouvelle-Calédonie », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 28 août 1870. 303 Félix H. Béraud, « Chronique néo-calédonienne », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 6 juillet 1862.
359
d’une barbarie à civiliser. Le chroniqueur en vient même à une exaltation qui passe par la
prosopopée :
La France est venue sur les côtes les plus barbares de l’Océanie ; sur ces rivages splendides a éclaté la grande voix de la patrie qui disait : « Là, désormais, existera la France ; chacune des palpitations du cœur calédonien formera une voix française ; allez, mes braves et loyaux soldats ; allez, mes intrépides et hardis colons, allez conquérir, et après la conquête, accomplissez des œuvres plus sérieuses, plus magnifiques encore ; allez civiliser304 ! »
Le « barbare », même si le terme employé n’est pas toujours celui-là – les journalistes
utilisent alors les termes connexes de « brute » ou de « sauvage » – reste l’un des attendus des
études coloniales : et il est vrai que le discours colonial a largement usé du terme, en l’adaptant
aux types d’altérité qui devaient être construits305. Le « barbare » est étymologiquement celui
qui ne parle pas la langue : en remontant à cette définition, quelques textes parus dans la presse
coloniale permettent de constater la prégnance de cet imaginaire. Ainsi, si la poésie arabe est
publiée et commentée dans les journaux, il est clair que c’est parce que le journaliste colonial
peut mettre en avant sa beauté primitive et naïve : il est impensable que la poésie romantique
européenne et ses codes servent à exprimer un point de vue indigène. Ainsi, en 1846, La France
algérienne publie un poème aux allures romantiques, censé émaner d’un indigène, mais que le
journaliste – dont la parole encadre le texte – analyse comme un faux précisément à cause de
sa correspondance à une norme esthétique français. On lit dans le feuilleton :
On nous communique les vers suivants, qui, selon une personne digne de confiance, auraient été trouvés sur un jeune Arabe tué dans l’une des dernières affaires en Algérie : Quand le plomb des chrétiens, le sort des saintes guerres Sur le sable sanglant un jour me jetteront ; Quand il faudra répondre à la voix de mes frères, Qui dans l’éternité près d’eux m’appelleront, Heureuse, libre enfin, mon âme dégagée S’envolant vers Allah, joyeuse et soulagée, Peut-être d’un regard effleurant mon cercueil, Voudra-t-elle des miens voir quel sera le deuil… Oh ! puisse-t-elle alors sur ma tombe écartée, Ne point apercevoir le marbre somptueux De quelque urne à prix d’or splendidement sculptée, Ni lire un long fatras d’éloges fastueux ! Dans le dernier asile où sera ma poussière, Que nulle inscription ne surcharge la pierre ; Que pour tout épitaphe on lise mon nom seul. Si ce nom ne doit pas de quelque renommée, D’un rayon glorieux couronner mon linceul, Pourquoi de vains honneurs sur ma tombe fermée ! Un nom doit illustrer ou vouer à l’oubli
304 Id. 305 En ce qui concerne l’Algérie, voir Karima Aït Dahmane, art. cit.
360
La terre où le guerrier repose enseveli. Il y a dans ces vers, qui ne manquent pas d’une certaine élégance, une réminiscence mélancolique d’un passage de Lord Byron ; évidemment ils sont d’origine française, car il n’est pas possible d’admettre que celui qui les avait en sa possession connût assez notre langue pour avoir pu les écrire lui-même ; il serait curieux de savoir qui les lui a donnés. En tout cas, s’ils expriment le dernier vœu du fils du désert, ce vœu n’aura pas été exaucé… Son corps est resté en notre pouvoir après la dispersion de sa tribu, et son nom est mort avec lui306.
Le journaliste commente ici en enquêteur, déplaçant l’enjeu du texte publié : plutôt que
la scène romantique du guerrier mourant en portant sur lui un texte poétique qu’il veut
prémonitoire, il construit un mystère autour de la présence du papier sur le jeune homme. Le
journal dans lequel ce texte paraît, La France algérienne, s’il est bien publié à Alger, semble
destiné à un public plus métropolitain que colonial, comme il était précisé dans son
prospectus ; d’où, sans doute, les précautions prises pour amener le texte à la connaissance d’un
lectorat qui doit être influencé en faveur de la conquête de l’Algérie. En 1846, année de la
parution de ce texte, Abd el-Kader ne s’est pas encore rendu ; il reste donc à dissiper une trop
grande idéalisation des indigènes qui prennent les armes contre la France. L’utilisation de la
« sauvagerie » peut aussi modifier la lecture d’une scène, toujours dans cette perspective
axiologique : plus qu’un motif narratif que l’on retrouverait d’un texte à l’autre, la notion agit
comme un véritable catalyseur et accélère la description. Quand en 1851 le journaliste de
L’Akhbar décrit un café maure, l’adjectif « sauvages » transforme véritablement la scène du
vieux grognard racontant ses conquêtes aux indigènes : par cette pointe finale, le récit de café
devient un fragment de l’œuvre coloniale.
C’est le vieux Bab-Amin qui a fait la campagne d’Egypte, qui a été mameluck sous Bonaparte, qui a vu Desaix et Kléber, et qui a pris part à la bataille des Pyramides. Malgré ses quatre-vingts ans, il a encore l’œil vif et le corps vigoureux. Ses hôtes habituels sont des Arabes auxquels il aime à enseigner le grand nom de Napoléon qui jette sur cette vieille figure un reflet de gloire, et lui assure même le respect de ses sauvages auditeurs307.
La « sauvagerie » décrite ici ne ressortit en effet à aucun comportement qu’il s’agirait
de qualifier : ontologique plutôt que clef d’un événement précis, elle sert plutôt à donner à la
scène une force symbolique. Dans une perspective voisine, le barbare, selon les peuples,
apparaît dans des trames préétablies : la barbarie arabe garde le calque d’un orientalisme cruel,
alors que la barbarie tahitienne s’écrit différemment dans la presse. Pas de combats rangés, il
est vrai, pour dresser le portrait d’un autre en barbare : les périodiques suivent l’actualité. Le
306 La France algérienne, 18 mars 1846. 307 François Coquille, « Environs d’Alger. Le Frais-Vallon (Aïoun-Schrakna) », L’Akhbar, 18 février 1851.
361
texte correspondant alors à la situation tahitienne est davantage de l’ordre de l’avis, et ce
d’autant plus que Le Messager de Tahiti est un journal bilingue, qui revendique donc un accès
immédiat au lectorat indigène. L’on peut y lire des annonces comme celles-ci :
Aux CHEFS et aux autres membres des Conseils des Districts des Tuamotus. SALUT ! Plusieurs de vos compatriotes : Tepaiaba, chef dans l’île Fakarava Tuata, chef dans l’île Taenga Taumata, chef dans l’île Mihiru Mahiri, chef dans l’île Makemo Tehei, chef dans l’île Tepoto Tahoro, habitant de l’île Reao, Ont péri cruellement, le 23 septembre dernier à six heures du matin dans l’île Fakahina, victimes de leur confiance dans des hommes de votre race, mais qui sont encore à l’état sauvage. Les traîtres habitants de cette île ont assassiné de la manière la plus odieuse ces chefs et Indiens qui accompagnaient le régent Paioré dans son voyage d’exploration. Le Gouvernement du Protectorat ne peut laisser impuni un pareil acte de barbarie308.
La pensée de la barbarie sous-tend l’écriture de l’actualité telle qu’elle se fait dans les
périodiques coloniaux : davantage qu’un discours organisé, elle ressurgit quand l’occasion s’en
présente. De manière très épisodique surgissent quelques articles qui rendent compte de
coutumes indigènes décrites comme barbares ; l’intérêt du journaliste colonial réside alors dans
sa capacité à montrer ces coutumes sous l’angle du déclin, de l’affadissement de la barbarie.
Ainsi, en 1871, d’une « chronique locale » qui décrit un « pilou-pilou » organisé par le chef
Jack, d’après le journaliste, pour célébrer la récolte des ignames et déplorer la mort de sa nièce.
La chronique, que son appartenance générique rend anodine, est pourtant un morceau de
journalisme colonial intéressant à plus d’un titre :
Des groupes nombreux d’indigènes étaient accourus de divers points de la colonie à titre d’invités, et le spectacle qu’a présenté, pendant huit jours, cet assemblage de démons demi-nus, mangeant, hurlant, et dansant jour et nuit, a dû un moment faire oublier aux témoins venus de Nouméa et d’ailleurs que la civilisation avait déjà dix-huit ans de règne dans la colonie. Nous n’essaierons point de décrire ici ces monceaux d’ignames, de taros et autres provisions entassées sur l’herbe et dévorées dans ces festins, qui laissent bien loin, dans l’ombre, ceux de l’Iliade et ceux dont Rabelais nous a donné le menu pantagruélique. Sa plume et celle d’Homère seraient impuissantes ici ; il faudrait leur génie pour peindre les danses et traduire les chants sauvages qui accompagnaient ces orgies sans fin. Sans doute ils étaient pleins de poésie, car l’animation de tous était sans égale, et parfois l’enthousiasme s’élevait à un degré qui ressemblait de bien près à de la folie furieuse. Mais, outre que la langue dans laquelle ils étaient dits
308 Le Messager de Tahiti, 9 décembre 1860.
362
nous est peu familière, le sujet et la forme offriraient peut-être beaucoup moins d’intérêt à nos lecteurs qu’aux rapsodes et aux Tyrtées néo-calédoniens et à leurs noirs auditeurs309.
L’on retrouve ici le fonctionnement de la prétérition que l’on avait déjà observé chez
Ratte dans sa description des mœurs néo-calédoniennes : linguistiquement, l’indicible semble
le moyen récurrent de rendre compte d’une altérité prédéfinie comme barbare. La barbarie,
enfin, se loge aussi dans les faits divers du Courrier de Saïgon concernant les bandits :
On écrit du Tàn-hoà : Nous venons d’être débarrassés, de deux chefs de pirates, derniers débris des bandes de Quan-Dinh. La prise du doï-binh Luan, que nous avons mentionnée dans notre dernier numéro, a laissé sans chef et sans organisation tous les ennemis de notre domination dans cette partie du pays. Il n’y a plus que quelques malfaiteurs errant à l’aventure et vivant très misérablement. Ces jours derniers, le doï Nhien, célèbre par ses exactions, voulut passer la nuit dans la maison d’un propriétaire auquel il avait déjà extorqué plusieurs fois de l’argent. Il poussa même l’insolence jusqu’à vouloir user à l’égard de la femme de son hôte de droits seigneuriaux qui sont aussi peu admis en Cochinchine qu’en Europe. Le mari indigné l’a tué et a apporté sa tête à Go-cong. […] Après trois ans de troubles, nos cultivateurs sont excédés de tous ces désordres qui ne profitaient qu’à quelques aventuriers et plongeaient la masse du peuple dans la plus profonde misère. Ils sont bien résolus à se débarrasser eux-mêmes de tous les bandits qui ont vécu si longtemps à leurs dépens et à concourir vigoureusement au maintien de la paix publique. C’est au bon esprit de cette classe laborieuse de notre population que nous serons pour une bonne part redevables de la tranquillité et de la prospérité rapide de la colonie310.
La délégation du discours à un locuteur supposé indigène et traduit permet aussi de faire
de la référence à la sauvagerie un élément qui ne soit pas limité aux colonisateurs. Lorsqu’est
publié le discours d’un supposé Khmer, on trouve la même confrontation à l’altérité :
Je vous parlerai plus tard, des Stiengs, des Giaraï et des autres peuplades qui habitent entre la rive gauche du grand fleuve et les montagnes de Cochinchine. Chez nous, tous ces peuples sont appelés des sauvages, des hommes des forêts, mais quand je vous les aurai fait connaître, vous jugerez s’ils méritent absolument ce nom311.
La barbarie ne touche pas toujours que les indigènes ; elle peut également s’appliquer
aux colonisateurs, dans de rares cas d’autocritiques. Dans L’Océanie française, ainsi, un texte
sur les indiens esclaves des baleiniers indique ainsi :
Dans la plupart des îles de ces mers, il n’est que trop commun de rencontrer des indiens qui appartiennent à des archipels éloignés.
309 « Chronique locale », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 20 septembre 1871. De manière anecdotique, relevons que l’exemplaire des ANOM a été annoté, pour cet article, par la main d’un lecteur : « pauvre c… de colon ». 310 « Nouvelles locales », Le Courrier de Saïgon, 20 août 1865. 311 James (trad.), « Lettres sur le Cambodge », Le Courrier de Saïgon, 5 mars 1865.
363
Quand on interroge ces indiens sur les motifs qui leur ont fait quitter les lieux où ils sont nés et où ils doivent avoir leurs affections, on ne tarde pas à apprendre qu’ils ont été victimes de leur confiance en des blancs312.
Dans un autre texte, signé par le docteur Bodichon et paru dans Le Moniteur algérien,
c’est par la concurrence que se rencontre le déplacement de ces traits, puisqu’il décrit ainsi les
Arabes : « Jadis barbares et demi sauvages, ils se montrent maintenant plus civilisés que les
peuples chrétiens. Ils fondent des bibliothèques, des académies, des observatoires313 ». Ce
renversement de la barbarie accompagne en fait une inquiétude sourde, qui s’exprime pourtant
dans les périodiques sous deux formes : celle de la décivilisation et celle de la décadence.
Décivilisation et décadence
Différents types de craintes agitent les auteurs de la presse coloniale ; mais les deux
mots majeurs que les textes médiatiques cachent dans leurs trames sont les
suivants : décivilisation et décadence. La décivilisation est liée aux phénomènes
d’ensauvagement, d’assimilation, de métissage314 ; la décadence, quant à elle, reste plus large,
moins précise, et concerne davantage la représentation d’un temps qui va vers sa chute. Autour
de ces deux notions se figent une série de représentations, visuelles ou écrites, qui marquent
durablement l’imaginaire colonial. Il y a d’abord l’attirance européenne pour la figure du « bon
sauvage », présente encore dans certains environnements : ainsi d’une production donnée par
un « ami » au Propagateur sous la forme d’un poème qui refuse la connaissance au profit de la
vie naturelle.
Heureux sauvage des Antilles, Qui d’esprit et de sens pétilles, J’aime tes écrits éloquents, Et tes prophétiques accents. Oh ! Que la naïve ignorance Est préférable à la science315 !
Ce goût pour le « sauvage » innocent et non corrompu par les livres et le savoir est une
forme particulière d’un penchant plus général, et qui s’illustre particulièrement par la question
du costume. Il est en effet l’une de ces représentations importantes dans la pensée de la
décadence telle qu’elle s’écrit dans les colonies, et particulièrement en Algérie ; le vêtement
312 L’Océanie française, 18 octobre 1844. 313 Bodichon, docteur en médecine, « Des anciens habitants de l’Afrique septentrionale sous le rapport des races », Le Moniteur algérien, 20 août 1843. 314 D’où le titre d’un roman colonial qui connaîtra une certaine célébrité : Charles Renel, Le Décivilisé, Flammarion, 1923. Le héros est un Européen qui vit dans un village malgache isolé. 315 Y., « Au Sauvage des Antilles », Le Propagateur, 1er avril 1863.
364
marque un aspect non négligeable de l’assimilation qui cause tant de frayeur aux
colonisateurs316. Tartarin de Tarascon, emblème des lecteurs de littérature exotique et non des
récits de coloniaux, s’habillera ainsi en « teur317 » et suscitera l’étonnement des
Tarasconnais ; mais trente ans avant la publication du roman d’Alphonse Daudet, dès les années
1840, l’attirance pour le vêtement oriental est décrite comme un manque de discernement dans
des textes aux tonalités pourtant différentes. La critique virulente d’un ouvrage portant sur la
colonisation dans La France algérienne en 1846 se fait ainsi, en partie, sur l’apparence de
l’auteur : le journaliste décrit ainsi un « caban de satin turc et autres pièces de son excentrique,
disons mieux, hétéroclite tenue318 » ; dans les débats des années 1860 sur le royaume arabe, le
journal satirique Le Moqueur vise l’« arabolâtre », et définit ainsi le mot-valise inventé, ce
« hibou de la civilisation » : « C’est un homme dont la conscience trop à l’étroit dans nos
vêtements européens, si raides et si étriqués, cherche à se mettre à l’aise sous l’ampleur d’un
burnous et d’une gandoura319 ». Au contraire, l’on valorise dans la presse officielle – en 1857
tout du moins – « cette bigarrure de types et de costumes, - cette diversité de races et de
langages » qui caractérise les rues d’Alger. La « bigarrure » est ensuite explicitée et décrite :
ces mauresques voilées coudoyant les françaises comme de fantastiques apparitions ; - ces juives, avec leurs vêtements aux couleurs voyantes et leurs corsages chargés de riches broderies d’or, - l’arabe au burnous flottant donnant le bras aux européens et se promenant, étonnés, entre la mosquée de l’Islam et la cathédrale catholique320…
Dans la critique littéraire, dans les feuilletons, dans la fiction même, ces thèmes
reviennent durant tout le siècle, tant l’exotisme se marque par le costume.
Dans l’île réunionnaise, la décadence est traitée par la disparition de la poésie : plusieurs
textes mettent en avant le rôle grandissant de l’industrie. Quand Alphonse Alizart s’approprie
l’éthos d’un « vieux noir » pour l’un de ses textes, la description de l’île natale se fait à l’aune
d’un pessimisme marqué par les italiques :
316 Voir Pierre Michel, « Portrait du civilisé en costume barbare et du barbare en costume civilisé : le voyage romantique en Orient au miroir des races », L’idée de « race » dans les sciences humaines et la littérature (XVIIIe et XIXe siècles), Sarga Moussa (dir.), Paris, L’Harmattan, 2003, p. 299-310. 317 Alphonse Daudet, op. cit., p. 82. 318 Ed. Bourgogne, « Lettre d’un Parisien à un Parisien », La France algérienne, 5 novembre 1845. 319 Tinterio, « Les Dix plaies d’Alger. Les arabolâtres », Le Moqueur, 22 avril 1866. C’est un thème d’époque : au sein de la « Chronique-causerie » que publie Gustave Crance dans L’Indépendant de Constantine le 1er septembre 1865, le journaliste fait la critique d’une pièce de théâtre, La Femme arabomane, « vaudeville algérien en un acte, mélangé de sabir, par M. Siroco… ou autre » qui met en scène une héroïne attirée par « tout ce qui a rapport aux costumes et aux mœurs indigènes ». L’intrigue est racontée rapidement, insistant sur la langue employée par l’héroïne, et sur ses prétendants – dont un Alsacien déguisé en indigène. 320 Fenoux Maubras, « Revue de la saison », Le Moniteur algérien, 1er mars 1857.
365
Je revois en moi-même mes longues années de prospérité et de bonheur, et, quand je les compare à tout ce qu’il y a aujourd’hui de misère et de désolation, je ne puis m’empêcher de m’écrier : pauvre colonie ! toi, surnommée : La Perle de l’Océan Indien, toi, qui jadis regorgeais de richesses et de luxe, comme te voilà maintenant affaissée sous le poids d’une horrible décadence321 !
Ce sentiment exprimé en 1871 n’est pourtant pas nouveau : l’on en trouve une autre
expression en 1853, cette fois sous forme poétique, et peut-être avec davantage de précision.
L’auteur ne s’approprie pas alors d’autre subjectivité que la sienne ; le passé visé dans les deux
textes n’est pas le même, et il appartient au lecteur de deviner à quoi est due la décadence
mentionnée.
En objets enivrants nul sol n’est plus fertile ; On respire partout le souffle inspirateur, Aliment du génie ; et pourtant, ô mon île, En artistes ton sein reste toujours stérile, Ton aspect est menteur. De l’industrie, hélas ! la rapide gangrène De tes plus nobles fils a rongé jusqu’aux os. Le bonheur d’entasser chaque jour les enchaîne ; Ils boivent du porter en guise d’hippocrène, Et rangent des ballots322.
Même dans une fiction, le narrateur à la première personne trouve le moyen d’évoquer
cette décadence industrielle, mais avec précision cette fois, puisque c’est l’économie de la canne
à sucre qui est visée :
Ces nappes de cannes qui s’étendent à l’infini fatiguent l’œil par leur uniformité : quelque jour, j’en ai grand peur, on reconnaîtra qu’une industrie qui dénue notre pays de la plupart des choses nécessaires et le rend pour chacune d’elles tributaire de l’étranger, qui deux fois l’a grevé de dettes énormes, n’y rencontre pas en général toutes les conditions voulues de prospérité, et n’est peut-être qu’une grande déception…
Mais quel est cet homme qui vient en habit râpé et en chapeau crasseux ?... Je ne me trompe pas : c’est lui ; oui c’est lui323.
La réflexion sur la décadence de la colonie s’intègre au récit du narrateur : il joue le rôle
de transition, et son utilité diégétique réside dans la manière dont il confronte la réflexion à la
surprise du narrateur revoyant son ancienne connaissance. La « décadence » peut aussi être
envisagée de manière humoristique, comme l’envers de l’évolution de la colonie. Dans un texte
clairement dicté par une ambition humoristique inspirée de la littérature panoramique, l’un des
321 Alphonse Alizart, « Moi vieux noir, causerie », Le Courrier de Saint-Pierre, 22 septembre 1871. 322 François Saint-Amand, « À Bourbon », Le Bien-Public, 23 septembre 1853. 323 *** D.M.P, « Esquisses morales. Alice, ou une destinée de femme », La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, 7 août 1839.
366
« types coloniaux » que fait paraître Le Moniteur de l’Algérie en 1869 est sur le point de
disparaître :
Encore un type qui s’efface parmi nous. Les caissiers s’en vont ! Le caissier modèle, le véritable caissier a
suivi les rois et les Dieux. S’il est encore un vivant quelque part, dans un coin ignoré de la
colonie, il doit toucher aux confins de la vie, il ne tardera pas à rendre le dernier soupir.
Le caissier est mort parmi nous faute de caisse à tenir ; sa dernière maladie a été le Compte-courant en Banque.
Esquissons ce type pour qu’il ne soit pas entièrement perdu pour nos neveux324.
Le fait que l’on reconnaisse des « types coloniaux » dit assez à quel point la colonie de
peuplement est une idée acquise en 1869, à quel point l’identité coloniale est stable, puisque
l’on peut lui établir un passé. L’on sait à quel point la presse coloniale algérienne est attentive
aux « disparitions » qui témoignent de l’évolution de la colonie, à la fin de la couleur locale, en
un mot à l’européanisation du territoire conquis ; mais ce lieu commun de la disparition liée au
progrès peut aussi, même si le cas est rare, se retourner contre le colonisateur. Ainsi d’un
texte – isolé il est vrai au sein de notre corpus – dans lequel le journaliste se sert du fait divers
pour tout à la fois créer une scène et apporter un éclairage politique à la situation :
Avant-hier jeudi, vers sept heures du matin, les habitants de la rue Saint-Augustin voyaient un indigène portant avec difficulté sur ses épaules un de ses coreligionnaires malade et exténué de fatigue et de faim.
Son corps, à demi-nu, était si amaigri, qu’on pouvait distinguer, à travers la peau, les os et les nerfs de ce malheureux. Arrivé à la hauteur du n° 1, l’indigène qui le portait fut forcé de déposer à terre son fardeau. Le malade, n’ayant plus la force de se tenir debout, roula à terre au milieu des passants douloureusement impressionnés.
Un Arabe de la ville, fort âgé, s’écria en se tournant de notre côté : « Voilà ce que vous avez fait de notre malheureux pays ; au temps des turcs nous n’avons jamais connu pareille misère ; on nous frappait, mais nous avions toujours du blé dans nos silos. »
Quels terribles comptes auront à rendre ceux dont la mauvaise administration a amené là une population autrefois riche et aisée325 !
Pourtant cet extrait date de 1869 lui aussi : la référence au passé turc relève alors
réellement d’un temps ancien, et les références à la conquête française se font rares. Si ce
discours direct est utilisé ici, c’est bien dans le cadre des débats sur l’administration de la
colonie française, et selon un angle politique qui intéresse directement les coloniaux ; mais la
scène décrite permet de mettre en mots une décadence nuisible et remontant à 1830, et de mettre
à mal les stéréotypes négatifs et répandus qui ont cours sur la population indigène.
324 A., « Types coloniaux : le caissier », Le Moniteur de l’Algérie, 20 novembre 1869. 325 C. T., « Triste ! », La Seybouse, 27 novembre 1869.
367
L’utilité sociale du stéréotype est visible rétrospectivement à la lecture des périodiques
coloniaux : il s’agit bien de fonder une communauté coloniale contre les colonisés, d’affirmer
certaines images et certains comportements pour produire une altérité textuelle. Mais cette
ambition s’étend aussi, à une échelle plus large, à des phénomènes textuels plus généraux : les
stéréotypes sont ainsi utilisés de concert avec l’ironie et la satire, qui permettent une littérature
d’apparence plus récréative que la littérature documentaire.
3.2 Les traits déformés : satire et ironie
La satire peut être écrite ; elle peut être aussi visuelle, mais pour cela nous nous
appuyons sur un corpus restreint constitué par quelques périodiques algériens ou réunionnais
de la fin du Second Empire. On pourrait postuler que ces caricatures sont à inscrire dans une
forme de mise en image qui utilise et détruit les illustrations du récit de voyage : pour les satires
algériennes, il s’agirait en quelque sorte d’une réponse à Delacroix et à la peinture orientaliste.
Dans les textes, la satire est assez habituelle ; Martine Astier-Loutfi écrit ainsi à propos de
l’indigène qui sert d’intermédiaire : « ridicule, odieux ou pathétique, selon les circonstances et
les tempéraments, ce personnage illustre parfaitement l’attitude du colonisateur qu’Albert
Memmi a appelée la ʺdérision326ʺ ». Le procédé est en effet avéré dans les récits de voyage,
particulièrement au XIXe siècle :
L’agression que constitue en soi l’étranger, multiple et incontrôlé, n’est pas nécessairement anxiogène. Mise à distance par l’ironie, elle devient un élément ludique de la description. Ce processus de déplacement se retrouve d’un texte à l’autre, sous la forme familière et stéréotypée d’une accumulation de pluriels, fragmentaires, impersonnels et déconnectés327.
Parce que les coloniaux se sentent visés par un discours autre, particulièrement par le
discours métropolitain, la presse coloniale use assez naturellement des techniques qui
permettent de citer ce discours et de le déconstruire dans le même temps : d’où une tendance
certaine à utiliser l’ironie pour créer une voie spécifiquement coloniale de description des
autres. En outre, la polyphonie propre à l’ironie fonctionne particulièrement bien dans le
contexte médiatique : les italiques, par exemple, peuvent souligner le refus d’adhérer à un
discours qui n’est pas reconnu comme un discours local.
326 Martine Astier-Loutfi, op. cit., p.61. 327 Elisabeth Cardonne-Arlyck, « De l’exotisme à l’ethnographie : polype et collage », Alain Buisine, Norbert Dodille et Claude Duchet (dir.), L’Exotisme, actes du colloque de Saint-Denis de la Réunion, Cahiers CRLH.CIRAIO, n° 5, 1988, Paris, Didier-Erudition, 1988, p. 396.
368
L’indigène dévalorisé : entre caricature et ironie
Le journal est polyphonique par essence ; mais il est un autre degré de polyphonie qu’il
peut mettre en pratique, et qui permet au journaliste colonial de poser sa voix par rapport à une
voix métropolitaine mal située, mais repérable par des traits typographiques et discursifs. C’est
alors, par un renversement intéressant, ce discours premier qui est montré comme grossier ; par
contrecoup, le discours colonial présenté dans les périodiques se présente comme une voix
alternative et davantage proche de la vérité. Ce dispositif linguistique ne concerne pas que la
petite presse : c’est un trait général qui peut surgir au détour de n’importe quelle rubrique.
Un trait de mœurs – L’épisode suivant du voyage de l’Empereur dans notre province, nous était connu depuis plusieurs jours, mais nous n’avons voulu le publier qu’après informations précises.
Le 28 mai, l’Empereur, qui avait hâte d’arriver à Constantine, ne pensait pas devoir s’arrêter à Bizot, mais les colons rangés sur son passage, les jeunes filles vêtues de blanc, tenant en main des bouquets, et les préparatifs faits en l’honneur de sa Majesté, l’engagèrent à faire arrêter sa voiture. Les fleurs offertes furent gracieusement accueillies par l’Empereur.
Cependant l’empressement des Arabes à se porter aux pieds du sultan, avait été tel, qu’un des gendarmes maures, pour le contenir, avait usé du plat de son sabre. Un des indigènes reçut au cou une blessure très-peu grave et sans doute involontaire. Il n’hésita pas à la monter à l’Empereur et à se plaindre vivement en langue sabir.
L’Empereur, dont jusque-là la figure rayonnait de contentement, se rembrunit tout d’un coup. Il manifesta son mécontentement en termes très-vifs, et pour atténuer l’effet de cette scène, il jeta aux Arabes qui se trouvaient réunis une assez grande quantité de pièces de cinq francs neuves.
C’est ici qu’est le trait de mœurs. On vit nos nouveaux compatriotes, qui s’étaient rués et précipités sur cette pluie de douros, se retirer à l’écart, et faire sonner successivement toutes les pièces pour s’assurer de leur bon aloi. Servilité, fierté et défiance, voilà l’Arabe328.
Dans le même journal, mais un an auparavant, l’on peut observer un fonctionnement
semblable mais une autre cible. La voix contre laquelle se prononce le journaliste colonial est
alors celle de l’indigène, et plus précisément encore ici, les marabouts :
Alger est décidément la terre classique des Marabouts. L’un d’eux a déjà daigné répondre au mandement de Mgr l’évêque d’Alger ; et voici qu’un second, plus audacieux, plus déclamatoire, vient chanter à notre barbe, dans une langue où il faut bien reconnaître la plainte d’un français, et les malheurs et les vertus des musulmans, auxquelles les vices de notre patrie, grossis et augmentés, servent de repoussoir.
À la bonne heure ! Nous préférons les Marabouts, fussent-ils de faux Marabouts, à de vrais renégats, à des imposteurs. – Ces naïfs adeptes du Koran, quelque peu avancés dans la voie de la civilisation, auront lu la Presse, et, suspendant leur derbouka aux arbres indigènes si rares et si mal peignés, ils auront répété avec elle l’hymne de
328 « Nouvelles locales et algériennes », L’Indépendant de Constantine, 9 juin 1865.
369
l’évacuation sur l’antienne : super fumina Babylonis sedimus et flevimus !
Bons Marabouts ! allez, faites-nous des brochures en Français ; on finira par croire que vous le savez…
Mais de grâce, ne nous dites pas, en forme de menace, que le « vieux sang arabe bout dans vos veines… » etc ; si le sang vous incommode, nous vous conseillons le régime de la salsepareille329.
Outre le métissage haï (la derbouka que l’italique rapproche de La Presse comme pour
mieux témoigner du mélange entre culture arabe et culture française), ce texte cite des paroles
que la mention du « etc. » coupe de manière péremptoire. L’ironie résulte ici du décalage entre
ces deux niveaux de discours. La déformation visant les indigènes peut même s’étendre, sur le
modèle de diffusion que l’on a vu précédemment pour les anthropophages, jusqu’aux
colonisateurs : dans L’Enfant terrible réunionnais, journal de caricature, la description des
« Beni-Suzanniens330 » montre que les habitants de Sainte-Suzanne sont ici transformés par la
comparaison avec la description ethnographique des populations d’Algérie.
Et même quand l’image de l’indigène est positive parce que construite sur les premières
représentations d’un « bon sauvage », l’ironie et la caricature restent des moyens utilisés pour
décrire un personnage en particulier. C’est ce dont témoigne, dans Le Messager de Tahiti, le
début d’une chronique :
Connaissez-vous Anani ? C’est un bien digne garçon, mutoi par goût, fainéant par tempérament, musicien par occasion. Voyez-le étalant sa nonchalante personne à l’ombre d’un manguier quelconque et fredonnant un de ces airs tahitiens dont le rythme s’accorde parfaitement avec la pensée qui le domine, ne rien faire ! Et pourtant, il m’a rendu un fameux service hier : il a empêché ma cervelle de bouillir dans son enveloppe, ce qui m’a permis de prendre part aux joies qu’une table bien garnie offre aux gourmands331.
Le récit commence ainsi car le nommé Anani a ombragé et ainsi rafraîchi
l’auteur : l’article est bien le compte-rendu d’un banquet. La paresse indigène est ainsi le
stéréotype autour duquel tourne la description, quand bien même tous les traits donnés du
personnage semblent contredire ce trait principal : le tahitien dont il est question est décrit
comme musicien et agent de police, mais ces caractéristiques n’empêchent en rien la
reproduction du lieu commun ainsi que la précision du service rendu au colonial, dans une
relation de domination évidente et qui n’est pas questionnée. Entre le discours attendu sur la
paresse et la réalité du personnage, l’auteur du texte médiatique n’hésite pas : il reproduit les
329 Marle, « Un Nouveau marabout », L’Indépendant de Constantine, 17 avril 1864. 330 L’Enfant terrible, 30 avril 1871. 331 X., « À Papoa (communiqué) », Le Messager de Tahiti, 27 décembre 1878. Un « mutoi » est en tahitien un agent de police. Le terme est encore employé de nos jours dans les articles locaux.
370
deux, quand bien même il devrait y avoir contradiction entre eux. C’est en ce sens que l’on peut
voir la force d’attraction qu’exercent les stéréotypes sur les auteurs médiatiques, et
particulièrement dans ces années 1870 où la presse coloniale a suffisamment d’ancienneté pour
avoir rôdé ses mécanismes d’écriture.
La saynète satirique, une manière de traiter de l’actualité
L’étiquette de « coloniaux » est floue, vaste, et c’est volontairement que nous
l’employons avec toutes les indistinctions qu’elle comporte. Pourtant, dans la presse coloniale,
la population apparaît avec ses particularités et ses castes, et chaque colonie semble développer
ses silhouettes particulières, propres ensuite à être remodelées par l’ironie ou la satire, et plus
particulièrement en passant par le genre théâtral adapté au journal, autrement dit par la saynète.
Le colon et le soldat en Algérie, le bagnard en Nouvelle-Calédonie et Guyane, le propriétaire
et l’arriviste dans les colonies de plantation : ces quelques exemples désignent d’ores et déjà
quelques particularités que les textes mettent en valeur ; mais quelques types attirent
particulièrement les plumes des caricaturistes, et souvent les saynètes servent à mettre en valeur
ces personnages coloniaux devenus lieux communs. Car la forme théâtrale apparaît dans les
journaux coloniaux : elle peut consister d’abord en la publication d’extraits de pièces, à l’image
de ce que Le Moniteur algérien fait paraître en 1836 : un métadiscours critique inaugure le
feuilleton avant la publication d’un extrait de la pièce pour laquelle il est explicitement fait
réclame. Cet échantillon théâtral paru au sein du journal constitue donc une porte d’entrée sur
l’imaginaire colonial : on y retrouve deux « types », deux personnages appelés Basile et
Nigaudinos que le journaliste présente à ses lecteurs avec une connivence fondée sur la
connaissance de la colonie. « Pour peu que vous fréquentiez la place du Gouvernement, vous
avez dû y rencontrer M. Basile, car ce lieu est le centre de ses opérations332 », écrit-il ainsi.
L’extrait donné ensuite, après avoir décrit les personnages, conserve cette importance de la
place du Gouvernement : « Le théâtre représente la place du Gouvernement, avec sa population
habituelle de biskeris [sic], d’artistes en fait de cirage, de gamins indigènes et surtout de flâneurs
européens », précise la didascalie initiale de la scène qui est ensuite transcrite.
M. Nigaudinos. – Hé ! bonjour, mon cher M. Basile ; il y a une éternité qu’on ne vous a vu. Hé bien ! qu’avons-nous de neuf ? M. Basile. – Mauvaises nouvelles, M. Nigaudinos ; fort mauvaises nouvelles de France ! M.N. – Ah mon Dieu ! vous m’effrayez ; qu’y a-t-il donc ? quand le courrier est-il arrivé ?
332 « Les Nouvellistes algériens, comédie en deux actes et en prose », Le Moniteur algérien, 27 mai 1836.
371
M.B. – Le courrier n’est pas arrivé ; on l’a empêché de partir pour qu’on ne sût rien ici. M.N. – Bah ! mais alors comment savez-vous… M.B. – Vous ne comprenez pas ? Un navire du commerce. M.N – Ah ! j’entends. Hé bien ? M.B. – Le ministère est changé. M.N – Ah ! M.B. – Une révolte en a été la conséquence. M.N – Oh ! M.B. – La troupe est passée du côté des séditieux. M.N – Hé ? M.B. – Comme j’ai l’honneur de vous le dire. Passant contradicteur (montrant un paquet de journaux) – Vous mentez, Monsieur ; voici les journaux apportés par le courrier qui arrive, et ils ne disent rien de tout cela. M.B. (quelque peu déconcerté) – C’est étonnant : je tiens cela d’une personne bien informée, et… Passant contradicteur (en s’en allant) – Misérable imposteur333 !
La scène se répète ensuite avec des nouvelles militaires (la mort d’un colonel en
expédition, un nombre de tués trop élevé), là aussi contredites par un passant. Les éléments que
nous avons étudiés en deuxième partie sont présents ici : l’importance du courrier, le lieu
colonial par excellence (cette place fréquentée par des flâneurs) servent de toile de fond à
l’animation de types coloniaux. Le statut de réclame que prend la publication de ce texte n’est
cependant pas le plus fréquent et constitue en quelque sorte un cas limite de saynète, au sens où
il appartient au journal sans en être une production initiale. Mais d’autres publications, suivant
le principe de la saynète et des personnages, se retrouvent aussi dans les périodiques.
À la Réunion, ces personnages caricaturés par leur parole sont le plus souvent les
arrivistes, mis en scène et soupçonnés : ainsi du « premier dialogue, qui eut lieu à Saint-Denis,
en octobre 1821, entre Courenville arrivé depuis peu de jour de Bordeaux et Plabissac », comme
l’indique la didascalie initiale d’un texte théâtral paru sous le titre « L’aristocratie des richesses
ou les Européens à l’île Bourbon334 ». L’onomastique est claire : Plabissac est en effet à court
d’argent, et sa bourse est plate ; Courenville a des prétentions qui l’obligent à passer de salon
en salon pour se faire un nom. Le dialogue entre les deux a ceci d’intéressant qu’il joue sur des
mécanismes profondément locaux, et que des voix de commentateurs, celle du sténographe et
celle de l’éditeur, apparaissent comme des personnages surnuméraires sur lesquels repose la
connivence avec le lectorat. Courenville et Plabissac sont d’anciens amis ; ils se rencontrent à
la Réunion alors que l’un vient chercher fortune, et que l’autre veut lui faire croire qu’il pourra
l’y aider, mais finit par le tromper. Mais dans ces saynètes, la parole des personnages n’est pas
333 Id. 334 « L’aristocratie des richesses ou les Européens à l’île Bourbon », Feuille hebdomadaire de l’Île Bourbon, 27 janvier 1830.
372
seule : tout comme le chroniqueur algérien présentait les personnages, ici le sténographe,
l’éditeur, le narrateur, se donnent comme des voix adjacentes qui ancrent le récit dans la réalité
créole, comme des voix locales. Ainsi, dans une riche note de bas de page, le sténographe de
L’Aristocratie des richesses décrit rapidement l’allure des deux personnages, leurs vêtements
coloniaux et le changement de l’allure de Courenville :
Il est de notre devoir de fournir à ceux qui liront ces dialogues les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent se figurer les interlocuteurs en scène tels qu’ils étaient. Courenville, fraîchement débarqué avait tout l’accent et toutes les habitudes d’un véritable enfant des bords de la Garonne. Un habit noir râpé, percé aux coudes ; un gilet d’indienne fond blanc à grandes fleurs […].
Au contraire, Plabissac, qui habitait la colonie depuis 25 ou 26 mois, avait déjà échangé le ton, l’accent et les manières de son pays contre les usages et la tournure créole. […] Son chapeau gris très fin recevait une légère teinte de la lumière qu’un soleil ardent faisait pénétrer au travers du taffetas couleur violette d’un parapluie léger et élégant (Note du Sténographe)335.
Il décrit aussi, mais bien plus longuement, le fonctionnement du droit d’aînesse dans les
différentes provinces françaises, comme s’il s’agissait d’un Ailleurs aux coutumes exotiques,
dans un renversement qui semble normal si l’on songe aux destinataires principaux de ce
journal. Dans cette déformation que permet la comédie, le texte met en lumière les aventuriers
coloniaux, mais bien au sens mondain : il est question d’argent, de titres, de mariages. Les
coloniaux et les Européens ne sont pas les seuls à être représentés dans les saynètes : une variété
parue dans Le Bien-Public le 23 février 1852 met en scène plusieurs éléments de la population
coloniale. Un courtier d’élection veut convaincre les nouveaux électeurs de voter pour son
candidat : le cafre inaugure la parole, et le journaliste caricature à la fois les mots et la pensée
des deux personnages libérés qui sont les premiers à être mis en scène ; il répète ensuite le
procédé comique pour plusieurs types d’habitants. On lit successivement les réactions de
plusieurs personnages représentatifs de la société coloniale : un bourgeois de Saint-Denis, un
capitaine des Milices, un habitant de la campagne, un jeune avocat, un père de famille, un
propriétaire, un concierge de l’Hôpital, un jeune homme et un habitant de Sous-le-vent sont
ainsi convoqués par le courtier, avant que ce couplet final ne termine la variété :
Sur l’air : Je loge au 4ème étage Enfin grâce à tes félonies, Grâce à tes mille trahisons, Grâce à toutes tes perfidies, Par trois fois, nous te repoussons. (bis) Pour terminer ta comédie, Dans l’esclave mets ton espoir ;
335 Id.
373
Repoussé de la colonie, À la fin, sois l’élu du noir336 !
Autre pièce, autre problématique, mais même moyen littéraire, la saynète : dans celle-
ci, parue en 1848, un propriétaire est aux prises avec un ancien esclave, tout juste affranchi, qui
refuse de travailler et qu’il accuse d’entraîner les autres avec lui. Un juge de paix et son
gendarme – qui sera muet tout au long de la pièce – arrivent alors. La première scène est un
monologue de désespoir du planteur ; dans la deuxième scène, on lit le dialogue de sourd qui
réunit le planteur et le juge de paix, avant que, dans la troisième scène, ils n’aillent voir tous
deux l’esclave couché dans sa case :
Le propriétaire – Le voici, Monsieur le juge de paix, le plus mauvais garnement du bourg. Le juge – Le coquin ! approchez et montrez vos mains (à part) je respire, il n’a sur lui aucune espèce d’armes. (Haut) Eh bien ! mon gaillard, c’est donc vous qui ne voulez pas travailler… comment ! bâti en Hercule, comme vous l’êtes (il lui tape amicalement sur l’épaule) avec des omoplates comme les vôtres ; (signes de mécontentement du propriétaire), avec des muscles aussi arrondis, vous ne voulez rien faire. Voyons, mon ami, voyons ; il faut vous dégourdir, que diable… (pendant tout ce discours mouvements réitérés du propriétaire impatienté). La République ne vous a pas fait libre pour vous rendre tout à fait paresseux : elle veut que la raison soit substituée au fouet ; elle veut que le libre arbitre… Le propriétaire – Mais, M. le juge, il ne sait ce que c’est que le libre arbitre… Le juge – Laissez-moi faire, que diable, vous ne voyez pas que mes paroles le touchent. Elle veut, dis-je, que le libre arbitre soit substitué à l’arbitraire du maître, pour faire de vous des hommes, des hommes complets, des hommes en un mot, car jusqu’ici vous ne l’étiez guère. Voyons donc, allons, que diable ; je suis sûr qu’il ira demain au travail, n’est-ce pas, mon ami ? Le nègre – Oui, mouché. Les trois personnages sortent, le juge de paix d’abord, le gendarme le dernier. – Patate bouillie ! s’écrie le nègre (c’est le terme dont généralement ils désignent l’autorité) moi, pas qu’allé travail ; et il se recouche. Le juge de paix se félicite de son heureuse intervention, annonce au propriétaire qu’il va continuer une excursion qui débute si bien, et pique des deux, toujours avec son gendarme. – Le propriétaire s’enferme chez lui, ne veut voir personne, et répète toute la journée : mon Dieu ! mon Dieu ! quand aurons-nous un sabre à la tête de la colonie337.
Plutôt que d’écrire un billet sur le rôle de l’administration coloniale au moment de
l’abolition, l’écrivain occasionnel qui signe ce texte a préféré mettre en scène des paroles et des
actes, transformant en pièce humoristique les griefs qu’il pouvait exprimer. Le cas est ici
franchement politique, alors que l’on a vu dans d’autres textes que la portée de tels textes
336 U.V., « Dialogues entre un courtier d’élection et des électeurs », Le Bien-Public, 23 janvier 1852. 337 Un campagnard, « L’actualité, comédie en un acte et en prose », Le Commercial de la Guadeloupe, 23 août 1848.
374
pouvait être plus large et moins précise dans le temps, portant sur des mœurs plutôt que sur une
actualité précise. Il n’en reste pas moins que ce type d’écriture participe au reflet que le colonial
peut avoir de sa propre image et de sa propre situation au sein de la colonie.
Le théâtre d’actualité qui est publié dans les colonnes des périodiques peut aussi trouver
des échos dans des publications de librairie : dès 1835 paraît La Dame de comptoir ou le Colon
extravagant, où le personnage principal, Nopal, est un nouveau débarqué, comédien et rusé,
dont le projet consiste à assécher la Méditerranée. Mais au sein de la presse, ce que montre cette
utilisation de la saynète, c’est qu’il y a bien une forme de déclinaison locale d’un
fonctionnement médiatique national338. La saynète permet de rendre compte d’une situation
politique en exploitant l’oralité du texte, et le poids symbolique des personnages. Elle pourra
aussi intégrer le corps d’une lettre : c’est dans un échange de ce type que l’on peut trouver une
écriture du sabir339. Il existe cependant d’autres modalités encore dans lesquelles s’inscrivent
les saynètes : certaines sont versifiées, et la satire se fait plus cachée. Ainsi, le collaborateur
régulier du Propagateur martiniquais qui signe l’Hermite utilise les mêmes procédés
onomastiques que les auteurs que nous venons de citer : Simplice, Flambard et Basile sont ainsi
les trois personnages principaux, trois colons donc, qui s’expriment en vers pour regretter le
temps passé340.
Déconstruire les stéréotypes par l’ironie
Dans l’esquisse intitulée « Le Vicomte Tiburce de la Grenouillère341 », le Gascon
représente bien le type comique du fanfaron. Apprécié à Saint-Denis et sur le point de se marier,
le jeune homme n’est en fait qu’un garçon coiffeur venu chercher fortune loin de sa Gascogne
natale et de son enfance misérable. Dans ce récit, le personnage du jeune créole qui démasque
l’imposteur se détache sur le fond d’une société insulaire facilement impressionnée par
l’Europe. Le choix du Gascon en situation d’échec est une manière de signifier que la Réunion
n’est plus un Ailleurs de choix pour les aventuriers : ce texte affirmerait-il alors la fin d’un
exotisme antérieur qui identifiait l’île à un eldorado ? Il s’agit en tout cas d’une
déconstruction : le texte est conçu comme une réponse à un stéréotype, et ce mécanisme textuel
338 Fonctionnement étudié, en ce qui concerne la presse satirique illustrée, par Valérie Stiénon, « Effets de parole vive. Poétique de la saynète dans la presse satirique illustrée des années 1830-1840 », Presse, chanson et culture orale au XIXe siècle. La parole vive au défi de l’ère médiatique, Élisabeth Pillet et Marie-Ève Thérenty (dir.), Paris, Nouveau Monde, 2012, p. 259-272. 339 Un arabophone, « Un bruit de cruche arabe », L’Indépendant de Constantine, 20 mars 1863. 340 L’Hermite, « La Rencontre imprévue entre trois vieux colons », Le Propagateur, 3 mai 1862. 341 C.A., « Le Vicomte Tiburce de la Grenouillère. Esquisse », Le Courrier de Saint-Paul, 27 mars et 17 avril 1846. Texte édité par Fabienne Jean-Baptiste, op. cit., p. 925-940.
375
consiste à animer la représentation de la colonie par la réponse à un stéréotype. Tous les
périodiques ne fonctionnent pas ainsi : les titres privés sont bien plus susceptibles d’utiliser
cette écriture légère et biaisée que les titres officiels. Ainsi de cet article de La France
algérienne, qui présente « une des curiosités de nos provinces africaines » :
Hélas ! j’aurais voulu que cette curiosité fut un peu plus empreinte de couleur locale, mais, que voulez-vous, en ce moment la merveille, le héros, le lion le « digito monstratus », le « dictus hic est » est un Européen, un D.M.P., c’est M. Bodichon. Qu’est-ce que M. Bodichon ? Ah voilà ! M. Bodichon est l’homme le plus malheureux, le plus justement éploré, le plus désespéré de tous les mortels, au moins de tous les mortels qui habitent l’Algérie. Mais pourquoi M. Bodichon est-il malheureux ? M. Bodichon est malheureux parce qu’il n’est pas persécuté ; M. Bodichon est malheureux parce qu’il ne peut, comme devant, promener, tête nue, les bras en croix, sur la grande place d’Alger, son caban de satin turc et autres pièces de son excentrique, disons mieux, hétéroclite tenue ; parce qu’aucun gendarme, sbire, sergent de ville, chaouch ou autre suppôt du pouvoir, n’est encore venu l’arracher de son foyer342.
C’est par l’ironie qu’est ici dressé le portrait du Docteur en Médecine et en
Pharmacie : par l’écriture en creux, par les caractéristiques vestimentaires, Bodichon devient
un stéréotype décevant. La dimension dialogique conservée avec le lecteur est fondamentale
dans cet échange, et ce notamment parce que le stéréotype concerne l’un des coloniaux, et pas
des moindres : l’on a vu plus haut que le docteur Bodichon est un homme important dans la
colonie, et un contributeur régulier de la presse locale. Mais il est d’autres cas où le stéréotype
déconstruit se rapporte aux indigènes, et le propos est alors plus inattendu :
On s’étonne de ne pas trouver dans cette épitaphe la plus petite mention de la victoire mémorable remportée par Hassan-Aga sur Charles V. Nos héros chrétiens ne sont pas si modestes ; et si l’un d’eux mourait après avoir obtenu le plus léger avantage sur un ennemi quelconque, on se garderait bien d’oublier d’en parler dans son épitaphe.
Si un gouverneur-général repoussait victorieusement les attaques du plus puissant monarque de l’Europe et d’une nombreuse armée composée des meilleures troupes de l’époque, il n’y aurait pas de tablettes de marbre assez longues, assez larges pour contenir toutes les épithètes les plus flatteuses, toutes les louanges qu’on lui prodiguerait après sa mort.
Quelle leçon d’humilité chrétienne donnée par de barbares musulmans343 !
Dans cet extrait de L’Akhbar qui date de 1849, la comparaison entre les chrétiens et les
musulmans (pour reprendre les termes du texte) tourne plutôt à l’avantage de ces
derniers : contre le stéréotype de l’orgueilleux indigène, le publiciste écrit ici une forme d’éloge
342 Ed. Bourgogne, « Lettre d’un Parisien à un Parisien », La France algérienne, 5 novembre 1845. 343 « Légendes algériennes. Quatre marabouts et une sorcière contre un empereur », L’Akhbar, 2 janvier 1849.
376
des autres qui occasionne un retour sur soi. Dans le journal officiel lui-même apparait une autre
de ces prises de parole qu’on qualifierait volontiers d’étonnantes, puisque sous couvert de
subjectivité – grâce à l’écriture épistolaire – elle s’oppose au discours officiel. Le cas est rare,
mais explicite dans un texte comme celui-ci qui est publié, lui aussi, dans les années 1840 :
Mais aujourd’hui que sept années se sont écoulées depuis la date de ces lettres, aujourd’hui que les événements qui se sont succédés ont rendu évidente l’habileté de l’Émir, et que la connaissance du pays a prouvé la véracité des détails sur la société arabe, aujourd’hui, dis-je, je ris de cette idée si généralement répandue : que les Arabes sont des sauvages sans organisation, et qu’ils doivent considérer la venue des Français en Afrique comme un bonheur pour eux344.
Le texte clôt plusieurs « lettres » (l’intitulé signale davantage une rubrique que la
publication de lettres à proprement parler) qui ont décrit l’organisation de l’armée d’Abd el-
Kader. Or l’intéressant ici, c’est que cette parole finale est celle du correspondant de
l’épistolier : ce dernier a fini par convaincre son correspondant, qui le traitait pourtant de
« touriste » et l’accusait au départ d’« exagération ». Il y a donc une relecture à faire du début
du texte :
Eh ! Où allez-vous donc, mon cher, demandai-je, il y a quelques années, à un de mes amis, au moment où il montait à cheval pour aller trouver El Hadj Abd-el-Kader, dont le traité de la Tafna venait de faire un vassal soumis de la France.
Ma foi, me répondit-il, je veux travailler aussi au grand œuvre de la civilisation ; je gémis de vivre au XIXe siècle à côté de peuplades aussi barbares et aussi sauvages que le sont ces malheureux Arabes, pour le bonheur desquels la Providence a amené les Français sur la terre d’Afrique.
Je vais offrir mes services à cet Émir, fanatique ignorant, que le hasard a mis à la tête du peuple arabe, et je tâcherai de lui faire comprendre les bienfaits de notre civilisation, et l’avantage immense qu’il obtiendra s’il veut s’associer à nos idées de progrès, de sciences et de lumières.
Le discours initial et naïf de l’épistolier est contrebalancé par ses observations finales
sur la société arabe, et surtout par l’accord final de l’interlocuteur. L’observation de la réalité
coloniale est donc parfois mise en texte grâce à l’utilisation d’une ironie qui joue sur la mention
d’un discours préexistant. Dans une perspective voisine, le père Jourdain s’adresse
explicitement aux lecteurs du journal, non pas au fil du texte, mais en exorde à ce qu’il va
publier. C’est donc pleine conscience du danger de ces préjugés que le père, occasionnellement
publiciste, développe son sermon sur les caractères annamites.
344 Le Moniteur algérien, 5 février 1844.
377
Cependant comme les choses, même les moins bonnes, ont toujours un bon côté, c’est une consolation pour moi de réfléchir sur les bonnes qualités des Annamites, et d’en dire quelques mots un peu partout, comme contrepoison de la doctrine des pessimistes. Si les lecteurs du Courrier de Saïgon me permettaient de leur communiquer une petite dose de ce contre-poison, ce serait une vraie satisfaction pour moi, et peut-être un service rendu à la cause publique345.
Mais ces remarques diverses concernent des colonies récentes : il semble difficile de
rencontrer de pareils textes dans les colonies plus anciennes. Et ainsi, en 1863 dans Les Antilles,
le même fonctionnement de déconstruction du discours se lit, cette fois dans un récit à la
troisième personne et selon une perspective différente. Il s’agit de contredire par l’observation
un discours métropolitain négatif sur la Martinique.
Dès les premiers instants après son débarquement il avait reconnu les traces d’une civilisation avancée ; l’élégance, le luxe, le confort de la vie ; l’urbanité et la distinction parfaite des habitants, leur hospitalité biblique ; et, ô ébahissement ! ce nègre qu’on lui avait représenté comme la personnification de l’esclavage et de la misère, ce nègre, à qui il avait réservé toutes ses sympathies, il l’avait rencontré, se rendant au balcon de l’opéra, déguisé en gandin, portant stick, lorgnon et gants jaunes, et s’appelant Monsieur346 !
L’esclavage est alors aboli depuis quinze ans : est visé ici un discours humaniste que les
coloniaux ne sont pas tous prêts à entendre, mais selon ce même principe de la confrontation
entre le discours et la réalité.
Enfin, le cas particulier de « Toutoute » attire ainsi l’attention du lecteur par le trajet que
subit ce personnage – commerçante ayant réellement existé, au demeurant – d’un texte à l’autre.
Toutoute apparaît dans Le Propagateur martiniquais en 1862, dans une « Partie littéraire » qui
fait la part belle à la chronique parisienne : il y est question de Renan en premier lieu. Le
chroniqueur ensuite cite et résume une chronique de Pharès, célébrité de L’Indépendance belge,
produisant une lecture commentée du texte. Après avoir évoqué Renan et les « cocodès »,
comprendre les dandys qui ont dépassé la trentaine, on lit, entre guillemets : « Puisque le hasard
de la causerie, continue Pharès, m’a porté vers les noms bizarres, laissez-moi vous raconter
l’histoire de Mlle Toutoute et de son industrie ». L’anecdote est datée du 27 mars, et le
chroniqueur précise qu’elle est « toute chaude » – pour Paris sans doute, mais en Martinique on
est alors le 3 mai347. La flânerie pousse Pharès à rencontrer un vieil ami, quincailler, qui le mène
345 R.P. Jourdain, « Observations sur le peuple annamite », Le Courrier de Saïgon, 5 février 1866. 346 « Coup d’œil sur la Martinique par un Européen », Les Antilles, 26 août 1863. 347 Le texte original de la chronique est paru dans L’Indépendance belge le 30 mars 1862 ; c’est une correspondance issue du Courrier de Paris.
378
jusqu’à une boutique dont le commissionnaire lui raconte l’histoire de la confiseuse
guadeloupéenne.
Ces confitures sont plus romanesques que bien des romans, chaque pot est un chapitre, chaque fruit un épisode. Les goyaves, les ananas, les pommes d’acajou, les chadecs, les tamarins, les sapotilles vous plairont davantage quand vous saurez que l’amour les a confits. Oui l’amour. Il y a une quinzaine d’années vivait à la Guadeloupe une mulâtresse d’une incomparable beauté348.
Résumons la suite : la jeune fille est esclave ; un jeune homme fraîchement arrivé aux
colonies s’en éprend, essaie de l’acheter. Elle refuse, s’enrichit grâce à la confection de
confitures qu’elle vend, achète elle-même sa liberté : « Aujourd’hui chef d’une grande industrie
célèbre dans la Guadeloupe, affranchie par l’intelligence, le travail et l’amour, heureuse épouse,
heureuse mère, elle a l’ambition de devenir illustre en Europe ». Le 20 janvier 1885, La
Lanterne annonce la mort de la confiseuse, dans une rubrique « Hier et demain » où paraît
l’article intitulé « Feue Toutoute », qui s’ouvre sur la nouvelle reçue par l’intermède du
Courrier de la Guadeloupe reçu la veille. L’étonnant ici est que le texte traite le personnage de
la confiseuse exactement à l’inverse de ce que le chroniqueur de l’Indépendance belge avait pu
écrire une vingtaine d’années auparavant : décrite comme laide, « négresse » et non
« mulâtresse », célibataire jusqu’à sa mort, libérée par 1848 et non en se rachetant… On est loin
de l’héroïne romanesque que les lecteurs antillais avaient pu découvrir au moment des
expositions universelles, et loin d’un éloge funèbre : « Toutoute était une négresse des plus
vilaines, type africain, née il y a quelques soixante-dix ans » ; et l’auteur développe ainsi un
portrait raciste, qui insiste sur les défauts de la commerçante, par exemple « la passion inhérente
à toute négresse, la passion des gros bijoux en or » ; enfin le texte se clôt en évoquant une
postérité dans les livres spécialisés pour « la carrière de cette vieille négresse qui fut une des
types les plus curieux et les plus amusants des Antilles françaises349 ». Dans tous ces exemples
que nous avons cités, l’on remarque que les textes visent, par la voix narratrice, à corriger une
image qui est reconnue comme un lieu commun et que l’on identifie à un discours allogène,
produit par la métropole.
348 « Partie littéraire », Le Propagateur, 3 mai 1862. 349 « Demain et hier. Feue Toutoute », La Lanterne, 20 janvier 1885.
379
3.3 Enjeux et fonctionnements de la fictionnalisation
Le trait colonial, le plus souvent grossier et marqué par une idéologie que l’on peut
simplifier à quelques idées, passe aussi par une utilisation de la fiction dans le traitement des
personnages. L’on peut employer ici le terme de « fictionnalisation », si dans sa définition l’on
sous-entend les procédés textuels qui servent à rapprocher un texte quelconque d’une fiction,
et particulièrement d’un roman : voix narratrice mise en avant, description de personnages
insistant sur leurs traits particuliers, figures de style et discours rapportés se succédant dans la
narration… L’important est bien ici que le texte médiatique exhibe sa capacité à dépasser la
simple transcription d’un fait : il s’éloigne de la dépêche télégraphique, qu’il avoisine pourtant
à partir du milieu du siècle, pour gagner en autonomie. Au début de la période que nous traitons,
l’orientalisme en Algérie est l’une des manifestations de cette autonomisation de certains textes
par rapport au contexte médiatique ; à la fin de la période, l’on trouve le cas exemplaire d’un
fait divers subissant plusieurs transformations pour aboutir à la mise en avant de l’héroïne.
Enfin, et même s’ils ne viennent qu’en dernier lieu, les coloniaux eux-mêmes, au sens large,
peuvent être visés par ce traitement fictionnalisant.
Les influences orientalistes en Algérie
La parodie ou la satire ne sont pas les seules possibilités laissées aux littérateurs
coloniaux pour peindre l’altérité : dans Le Chitann, un feuilleton du 19 août 1866 signé
Walt’her s’intitule bien « Le Chant du Reïs », et il laisse poindre une mélancolie que ne dément
aucune portée satirique ou humoristique. L’auteur est familier, pour les quelques numéros
conservés que nous avons pu consulter, de textes poétiques orientalisants qui détonnent au sein
du périodique satirique : mis à part dans la case du feuilleton, ses textes portent la marque de la
« rencontre » coloniale. Le Reïs confronte le passé d’Alger à son avenir au cours d’une chanson,
et le poème se clôt sur un geste symbolique, celui du silence.
Le Reïs se tut… De sa mandore, Lorsqu’il la posa dans l’esquif, Sortit, comme un râle sonore, Un gémissement convulsif. Alors, dans la sombre prunelle D’El hadji, comme une étincelle Une larme brilla ; Larme d’orgueil et d’amertume Qu’il essuyait, lorsque la brume
380
Couvrit sa barque et la voila350.
Le même auteur fera jouer le même ressort narratif, celui de la parole alléguée à l’autre,
dans un poème mettant en scène un marabout : une poétique se dessine ici qui est un des ressorts
de l’orientalisme, mais un orientalisme dont la réception est différente, puisque les lecteurs
premiers de cette presse sont justement les « roumis » visés avec une violence complaisante
dans les textes351. Émerge alors l’image d’une littérature presque paranoïaque, qui s’offre le
reflet d’une communauté attaquée en laissant à ses propres écrivains le soin d’écrire la violence
et de l’inscrire dans un avenir problématique. Dans cette violence spéculaire, l’exemple du
poète du Chitann montre que la production n’est pas limitée aux décennies 1840, et la poésie
n’est pas seule à participer de ce mouvement. De manière plus étonnante, l’orientalisme
imprègne aussi les faits divers et comptes rendus de procès, fictionnalisant ainsi les statistiques
judiciaires que publie le journal officiel une fois que le système colonial est bien installé.
On nous communique quelques détails sur ce meurtre qui a été causé en effet par les motifs que nous avons fait connaître. Hadji Braham et son assassin, Oulid-Berremidan étaient liés d’amitié ; tous deux se trouvaient, le jour du meurtre avec leurs maîtresses à une fête mauresque qui se donnait dans la rue de l’Empereur. Hadji-Braham ayant placé, selon l’usage, des pièces de monnaie sur le visage de la danseuse qui n’était autre que la maîtresse de son camarade, celui-ci lui en fit des reproches. « Nous sommes amis, lui répondit Braham, et cette femme est amie de la mienne ; il n’y a pas de mal à cela ». À partir de cet instant, la physionomie de Oulid Berremidan prit une expression farouche. « Il y aura mort d’homme ce soir, disait-il, je vois du sang devant mes yeux ». Ces menaces ne devaient que trop tôt se réaliser ! À la sortie de la fête et lorsque ces deux indigènes furent arrivés sous la voûte de Sidi-Ramdan, Oulid-Berremidan renouvela ses menaces. « Si tu veux me tuer, lui dit Braham, ne me fais pas souffrir ; tue-moi d’un seul coup, car nous sommes amis ». Ces paroles étaient à peine achevées que le malheureux Braham tombait frappé d’un coup mortel. On assure que Berremidan, qui avait aussitôt pris la fuite, vient d’être arrêté à Blida ou à Cherchel352.
Alors que les variétés des numéros suivants sont consacrées à la culture et à la
dessiccation du tabac dans les pays méridionaux, puis à la culture du cotonnier, Le Moniteur
algérien du 10 mars 1843 fait paraître dans cette rubrique une « Notice sur Omar Pacha et sa
famille » qui commence par une scène toute romanesque. Pourtant la première phrase s’accorde
bien à l’écriture d’un journal qui rend compte de la vie sociale de la colonie :
À l’une des soirées de cet hiver, chez M. le Gouverneur-Général, on remarquait une petite fille indigène qui avait les plus beaux yeux et
350 Walt’her, « Le chant du Reïs », Le Chitann, 19 août 1866. 351 Walt’her, « Le Marabout. Esquisse algérienne », Le Chitann, 26 avril 1866. On y trouve des passages tels que : « À ces chiens, point de sépultures ! / Les vautours aux serres impures / Sauront leur donner des tombeaux ». 352 L’Akhbar, 7 janvier 1849.
381
le plus charmant sourire du monde. Chacun demandait quelle était cette jolie enfant dont les traits portaient l’empreinte d’une noble origine, et l’on apprenait que c’était la petite fille d’Omar-Pacha, qui fut Dey d’Alger, il y a une vingtaine d’années.
La notice qu’on va lire renferme l’histoire de son aïeul, de sa famille et particulièrement de sa grand-mère, la belle Jemna, veuve d’Omar, qu’on ne pourra, en lisant ces lignes, s’empêcher de plaindre et d’admirer. C’est une page intéressante de l’histoire de ce pays, sous la domination des Turcs353.
Le récit, très long, met en scène la succession de beys dans les dernières années de la
Régence d’Alger ; on y apprend la mort du mari de Jemna en 1818 ; c’est aussi l’occasion
d’égratigner l’image d’Abd el-Kader, lorsque ses hommes viennent chercher l’argent d’une
rançon pour le fils de Jemna :
Pour la première fois ces pauvres femmes furent exposées aux regards d’hommes autres que leurs maris, et les bijoux dont elles étaient parées leur furent brutalement arrachées. Si Jemna ne mourut pas dans ce jour affreux, c’est que la douleur ne peut pas tuer. Pauvre mère de deux fils dont l’un est à Alger chez les Chrétiens, l’autre dans les fers d’un ennemi de sa race, et qui voit leurs femmes exposées aux regards et aux mauvais traitements de vils Arabes, autrefois ses esclaves !
La fictionnalisation de la notice est assumée, puisqu’on lit même quelques prises de
parole de ce personnage féminin imposant :
« Regarde-moi, fils de Mahhi-el-Din : hier j’étais la femme du Pacha, devant lequel tremblaient ton père et tous les habitants du royaume d’Alger ; hier on venait implorer ma protection, aujourd’hui j’implore la pitié de celui qui était mon sujet. Songe donc à l’inconstance des biens d’ici-bas, pense à Zohora, ta mère, à Aïcha, ta fille, et prends pitié d’une pauvre femme qui t’implore pour son enfant ; crains d’attirer contre toi les imprécations d’une mère, car elles portent malheur.
Tu me demandes la bague d’Omar Pacha, c’est le seul souvenir qui me reste de lui ; mais la voici et rends-moi mon fils ; je te donnerais, avec ce bijou, tous les trésors du monde, si je les possédais ; mais je n’ai plus rien ».
Elle jeta en même temps la bague qu’elle tenait cachée dans son sein (Ce bijou fut estimé 25 mille boudjoux).
Et le récit se clôt enfin avec le geste des Français :
Le Gouverneur Général se rendit chez Omar avec son état-major ; lorsqu’il fut entré dans un modeste appartement, une femme au front majestueux et couverte d’un grand voile blanc s’avança, soutenue par Omar : Tu peux ôter ton voile, mère, lui dit-il ; tous les yeux ici sont amis et ne voient en toi que la femme d’un Pacha et la mère d’un de leurs plus fidèles serviteurs.
Elle laissa tomber son voile. Les personnes présentes ne purent retenir un mouvement d’admiration en voyant les traits
353 « Notice sur Omar Pacha et sa famille », Le Moniteur algérien, 10 mars 1843.
382
remarquablement beaux de cette femme qui, couverte d’une simple draperie blanche, avait toute la majesté d’une reine.
Autant la parole de Jemna face à Abd el-Kader était donnée comme un discours noble
et défensif, autant sa parole se fait ici parole de reconnaissance face aux Français, et
particulièrement face au Gouverneur Général, qualifié de « sultan des Français » : la périphrase
est gage d’authenticité de la parole. Mais l’un des intérêts de ce feuilleton, qui n’apparaît que
dans sa dernière livraison, réside aussi dans la signature : Léon Roches en est l’auteur, et le
texte est en fait pris dans ses Deux ans chez Abd-el-Kader, qui sera publié plus tard. La France
algérienne permet de lire des feuilletons plus longs que ceux des autres périodiques de notre
corpus : son frontispice même prouve que la revue a davantage de moyens que les quotidiens
locaux, et des ambitions plus métropolitaines. C’est sans doute pour cette raison qu’on peut y
lire un texte comme « Une Mauresque », récit anonyme qui paraît en feuilleton pendant l’été
1846 et met en scène les ingénieux moyens de communication développés par une jeune femme
et son amant européen, d’une terrasse à une autre354. Autre preuve encore de l’influence de
l’orientalisme, et donc de son dénigrement possible, le journal satirique Le Siroco commence
une critique de la vie politique locale par ces quelques lignes :
« Vieux frère, prête-moi deux sous », me dit une voix bien connue, mais morte depuis un an déjà.
Le dernier coup de minuit frémissait encore à la Mosquée, la lune avait des taches sanglantes, le vent gémissait dans les platanes et le cheval de bronze de la place du Gouvernement se cabrait sur son piédestal355.
Les mosquées ne sonnent pas les heures, et l’atmosphère fantastique du texte prouve
assez que le but n’est pas l’exactitude documentaire ; ce petit segment introductif rend compte
de la connivence grâce à laquelle peut prendre la greffe d’un faux orientalisme sur une écriture
médiatique. C’est sur cette connivence que se joue en partie le sentiment d’une identité
coloniale particulière, sur ce détournement des stéréotypes à partir desquels le journal met en
place une esthétique concurrente, orientée vers le réalisme.
La circulation d’un fait divers : construire une héroïne
Le 29 avril 1876, en troisième page de La Feuille de la Guyane française, on annonce
le naufrage de la goélette Sainte-Barbe : cela représente certes un événement, mais rien
d’inhabituel. Le 20 mai, puis le 17 juin, d’autres informations sont données sur ce naufrage. Là
encore, le journal suit un rythme habituel et remplit ses pages avec un fait divers local, et il n’y
354 « Une Mauresque », La France algérienne, du 23 juillet au 11 août 1846. 355 « Une rencontre inattendue », Le Siroco, 1er juin 1867.
383
a alors rien d’étonnant. Mais le 11 novembre de la même année, le fait divers se transforme en
feuilleton : quittant la troisième page, il prend une forme différente, un ancrage générique
différent, et il transforme Mme Gillain, survivante du naufrage, en héroïne médiatique. La
« chaîne médiatique356 » qui se déroule dans le journal gouvernemental guyanais ne fait pas
entrer en compte un quelconque procès, puisque le fait divers n’est pas criminel mais naturel.
Il s’agit plutôt d’un compte-rendu initial qui se développe, est repris au fil des jours et aboutit,
finalement, à une mise en récit remplaçant le procès. Le statut du naufrage comme événement
colonial est confirmé par l’évolution du statut de l’héroïne : d’abord comptée au nombre des
passagers anonymes qui ont péri pendant le naufrage, Mme Gillain est ensuite l’objet d’un fait
divers, avant de devenir véritablement le personnage d’une « robinsonnade » ébauchée. Le
premier texte est conforme à un récit de naufrage comme l’on peut en trouver dans la presse
coloniale : il prend acte du nombre de victimes, et rend compte des difficultés des survivants à
regagner la côte ; le récit se focalise sur la patron de la goélette et sur son action pour sauver les
matelots : « une filière fut installée par ses soins, de l’avant à l’arrière, afin que les survivants,
en s’y tenant cramponnés, pussent attendre les secours qu’on allait sûrement leur envoyer…
Peut-être trop tard ? Dures angoisses357 ! » Mais le compte-rendu ne s’arrête pas là, donc : sous
le titre « Une victime du naufrage de la Sainte-Barbe », un autre compte-rendu signale la
découverte de Mme Gillain, propriétaire à Iracoubo, par le commissaire-commandant de
Macouria alors parti chasser, dont le journaliste reproduit le récit à la troisième personne, et
selon des termes convenus : « Il s’approcha, et reconnut bientôt, avec la plus vive émotion, une
personne gisant dans la vase et recouverte d’un tas de haillons. Cette personne n’était autre que
Mme Gillain, perdue depuis le 24 avril358 ». Un autre relais permet au lecteur de compléter sa
connaissance du fait-divers : « Le Moniteur publie aujourd’hui le rapport suivant de M. le
Commissaire-commandant de Macouria. On y lira avec intérêt le récit émouvant, fait par Mme
Gillain elle-même, de toutes les péripéties du drame dont elle a failli être la victime ». L’article
se présente sous la forme d’une lettre dont le rédacteur a gardé toutes les formalités ; et on lit
ainsi :
Vers les sept heures du soir, m’a-t-elle dit, au moment où la goélette s’est renversée presque subitement sur son flanc, je me trouvais auprès de la petite cuisine du bord. J’ai été aussitôt précipitée dans la mer, sans pouvoir saisir un objet pour ne pas abandonner la goélette. Pendant quelques temps, j’ai nagé entre deux eaux ; en revenant à la surface, je n’ai plus vu de goélette, et n’ai plus rien entendu. A ce moment, une caisse passait tout près de moi, je la saisis pour ne l’abandonner qu’en
356 Amélie Chabrier, op. cit. 357 « Naufrage de la goélette Sainte-Barbe », La Feuille de la Guyane française, 29 avril 1876. 358 « Une victime du naufrage de la Sainte-Barbe », La Feuille de la Guyane française, 20 mai 1876.
384
arrivant à terre ; plus tard, je m’aperçus que j’étais sur une caisse de tabac. Il y avait montant, ce qui me rapprochait, il est vrai, de la terre que la nuit m’empêchait d’apercevoir, mais aussi ce qui occasionnait que j’étais très ballotée par la lame : j’apercevais le feu de L’Enfant-Perdu, tantôt dans une direction, tantôt dans une autre359.
L’affaire semble être passée après cette date ; mais en novembre, et en feuilleton, le récit
de Mme Gillain est repris. L’article se présente sous la forme d’une interview qui ne dit pas son
nom : l’auteur commence par inscrire son héroïne dans une galerie de personnages
spécifiquement guyanais. « L’histoire de la Guyane a aussi des pages intimes et
émouvantes ; mais combien de drames solitaires n’ont pas laissé de traces et se sont perdus dans
ses forêts sans bornes, dans le haut de ses rivières ignorées ». Après cet exorde viennent
plusieurs noms, traces de faits réels et de destins qui ont marqué l’histoire de la colonie :
Qui a lu, sans être ému, l’étonnant et triste voyage de Juan Martinez, esclave d’une tribu sauvage et traîné à travers les forêts de la Guyane, jusqu’à la cité inconnue de Manon. Qui n’a été pénétré d’une douloureuse pitié au récit de la perte mystérieuse de Mlle Dujay, cette jeune et intéressante artiste abandonnée, on ne sait comment, par l’expédition Patrix, entre les massifs boisés de l’Oyapock et du haut Maroni. Qui n’a frémi des émouvantes péripéties éprouvées par Gui[…], lorsqu’il osa s’engager à travers la grande plaine inconnue de la Mahury, et s’avancer jusqu’à la rivière de Kaw, sur un sol mobile et des vases perfides360.
Et le journaliste de reprendre la publication initiale contenant le récit du naufrage et de
la survie de Mme Gillain, avant de reprendre la parole pour justifier l’authenticité du récit de la
survivante, et prendre à parti son lecteur. L’on est ici dans le fonctionnement de l’interview : les
traits stylistiques mêmes prouvent bien que le journaliste colonial est dans une démarche
d’investigation et de vérification. Le portrait même qu’il dresse de l’héroïne est intéressant,
puisqu’il y est fait mention de traits spécifiques à la Guyane : et l’on sait quelle crédibilité
l’appartenance à la colonie peut apporter.
Connaissez-vous Mme Gillain ? Elle est d’une taille un peu au-dessus de la moyenne, ses traits sont allongés, sans expression bien vive. Ils ont cette teinte uniforme qui paraît un des caractères ethniques de la Guyane. Les regards, sans avoir conservé la vivacité communicative de la jeunesse, laissent deviner une certaine intelligence, un discernement sûr et une raison bien assise.
Je n’en ferai pas un portrait plus précis. J’avoue que je l’avais abordée avec des doutes. La relation ne cachait-elle pas quelque supercherie ? Je m’apprêtais à en saisir le point vulnérable. Mais il y avait chez elle un tel accent de vérité et de bonne foi, que loin d’avoir à exercer ma critique, j’en ai rapporté la conviction la plus profonde.
359 « Détails complémentaires sur le sauvetage de Mme Gillain », La Feuille de la Guyane française, 17 juin 1876. 360 « Mme Gillain », La Feuille de la Guyane française, 18 novembre 1876.
385
Je dois d’avoir été mis en communication avec Mme Gillain à une des plus hautes autorités de ce pays. Je l’aurai suffisamment désignée, en disant que c’est en même temps un esprit des plus éminents, capable de ressortir et de se distinguer dans les milieux intellectuels les plus élevés.
Les aventures de Mme Gillain lui ont paru si intéressantes dans leurs détails qu’il a eu la pensée de les faire publier aussi exactement que possible361.
Le récit en lui-même est interrompu à la fois par la publication périodique et par le retour
de la parole du journaliste, qui se pose en témoin attentif de l’extraordinaire récit.
Je regardais cette femme héroïque sans le savoir et j’écoutais avec étonnement les péripéties de sa lutte contre la nature sauvage et indisciplinée.
Qui donc a dit que le palétuvier était le pionner de la civilisation, qu’il allait en avant, s’implantant hardiment sur les vases à peine déposées par l’Océan et les retenant entre ses racines, comme entre les doigts d’une main consciente ? Lui, un messager du progrès, un civilisateur ! Non ! C’est l’arbre de mort qui bouche les rivages et les rend inaccessibles. C’est lui qui ferme les ports au commerce et l’abord des anses aux naufragés ; c’est lui qui étend sur les côtes du plus beau pays du monde ce rideau triste et morne qui saisit le voyageur et lui met au cœur une inexprimable tristesse. Il retient les vases, oui, mais pour en faire monter des haleines de mort, pour répandre en tous sens la putréfaction sur les ailes de la fièvre. Cette femme que j’écoutais n’avait-elle pas été prise comme une pauvre souche, dans l’horrible toile de verdure qu’il tendait sur la côte ? Quel supplice que de se traîner ainsi de racine en racine, avec de la boue jusqu’au ventre, comptant chaque pas par une lutte contre mille obstacles, chaque minute par une souffrance nouvelle362.
Si nous citons ici ce passage, c’est aussi pour ce qu’il reprend du rôle de la nature dans
la littérature médiatique coloniale : la déconstruction du palétuvier comme figure symbolique
de la colonisation permet à l’auteur de placer son récit du côté du vrai, du réaliste, et non de
l’exotique. Ce mouvement de déconstruction appartient lui aussi tout entier à l’écriture
coloniale qui se met en place dans les périodiques : ici, il entre en résonance avec la description
d’une héroïne dont on a déjà souligné l’appartenance à la colonie. Quant au récit de Mme Gillain
à proprement parler, l’on peut se convaincre du travail d’écriture qui a contribué à transformer
l’événement en comparant deux versions du même passage. L’une, celle du 17 juin, est une
parole rapportée par le commissaire-commandant ; l’autre est le fruit de la rencontre avec
l’auteur anonyme du feuilleton :
361 Id. 362 « Mme Gillain », La Feuille de la Guyane française, 18 novembre 1876.
386
17 juin 1876 11 novembre 1876
Il y avait à peu près deux heures que je naviguais sur mon épave, lorsqu’un chien vint pour s’embarquer avec moi ; mais ma caisse étant trop petite, à mon grand regret, je ne pus lui donner passage ; le pauvre animal alors me suivit de près pendant quelques temps, mais bientôt il poussa deux cris : je détournai la tête, et je vis qu’il était devenu la proie d’un requin, à trois mètres de moi. À la vue de ce requin, j’eus un moment de défaillance ; pendant toute cette nuit, il est vrai, j’ai tant souffert que, deux ou trois fois, j’ai été sur le point d’abandonner mon épave ; mes doigts étaient engourdis, mes jambes de temps en temps éprouvaient d’horribles crampes.
Tout à coup le bruit d’une respiration haletante frappa mon oreille et j’entendis nager à quelques pas de moi. Mille sentiments divers me pénétrèrent à la fois. Était-ce un secours ; était-ce, comme moi, une des tristes victimes de ce naufrage ? Je ne distinguais rien dans la nuit épaisse. La respiration s’approchait toujours avec un bruit de clapotement d’eau. Un corps velu passa soudain près de moi, et un chien posa ses deux pattes sur l’épave qui m’emportait.
Le pauvre animal venait me demander secours, secours à moi perdue dans la mer et roulant au gré des vagues. Il poussait de petits jappements plaintifs et suppliants. Malheureusement, chaque fois qu’il s’appuyait sur la caisse de tabac, elle s’enfonçait sous cette augmentation de poids, et, ensemble, nous disparaissions sous l’eau. Que faire ? … j’hésitais à repousser ce compagnon d’infortune que le hasard venait de me donner, à lui retirer la planche de salut sur laquelle, comme moi, il était venu demander asile. Une lame survint qui nous prit et nous submergea plus profondément. La caisse de tabac, pénétrée et alourdie par l’eau, revenait plus difficilement à la surface. Je compris que j’étais perdue si je continuais à partager mon frêle radeau. Avec un incompréhensible serrement de cœur, je saisis la patte du pauvre chien. Comme s’il percevait mon intention, ses cris devinrent plus plaintifs. Ses yeux brillaient avec une telle intensité que je voyais distinctement son museau noir, sur lequel roulait une larme. Je détournai la tête, et d’une main émue, je le repoussais loin de moi. Alors ses jappements devinrent plus forts, il aboyait après moi d’une manière furieuse et en même temps suppliante. J’avais le cœur tout remué d’avoir accompli cet acte sauveur, mais barbare. Par un phénomène singulier, je continuais à distinguer clairement dans les ténèbres, jusqu’à ses moindres impressions de physionomies. Ses yeux affolés par la peur luisaient comme deux étincelles. Tout à coup il poussa un cri strident, d’un retentissement étrange. La mer, violemment remuée autour de lui, eut des mouvements tumultueux, et le chien disparut dans un remous d’écume blanche.
Les requins !!! … Éperdue, les yeux fermés, tenant dans mes bras ma caisse convulsivement serrée, je sentais au fond de mon cœur des mouvements d’angoisse et d’effarement aussi tumultueux que la surface bouillonnante où j’avais vu s’engloutir le malheureux animal. Il me semblait les voir rôder autour de moi dans les plis sombres de la lame, ces sinistres voraces alléchés par l’odeur du sang répandu et plus âpres à la curée. Avec des efforts désespérés, je cherchais à m’éloigner de ce lieu terrible, sans songer que si la nature a doué d’un appétit féroce ces grands ravageurs de la mer, elle les a doués aussi d’une vélocité extraordinaire. Je m’épuisais en élans stériles. Une faiblesse indicible s’empara de moi, et je sentis que la vie m’abandonnait.
La transformation du récit est remarquable, et c’est en ce sens que l’on peut parler ici
d’une fictionnalisation : les procédés narratifs employés transforment le résumé en scène,
approfondissent la psychologie de l’héroïne en laissant place à une ponctuation expressive, et
construisent l’événement par les détails. C’est l’instant qui est mis en avant dans la version
développée de Mme Gillain, et à travers lui la tension narrative.
387
Transition : vers d’autres corpus
Étudier la représentation des populations coloniales dans la presse permet d’interroger
l’idée que s’en font les colonisateurs ; il n’est pas question de considérer ces discours comme
le reflet d’une réalité que d’autres documents (administratifs, officiels, comptables) permettent
de mieux approcher, mais de s’arrêter sur l’autoreprésentation des coloniaux. Dans
l’autoportrait qu’ils dressent de la communauté coloniale, la relation n’apparaît pas ; il s’agit
plutôt d’une construction, de l’affirmation d’une communauté atavique plutôt que composite,
pour reprendre les mots par lesquels Édouard Glissant analysera la créolité. Il écrit ainsi :
On s’aperçoit que les cultures composites tendent à devenir ataviques, c’est-à-dire à prétendre à une sorte de perdurabilité, d’honorabilité du temps qui semblerait nécessaire à toute culture pour qu’elle soit sûre d’elle-même et pour qu’elle ait l’audace de s’affirmer. Les cultures ataviques tendent à se créoliser, c’est-à-dire à se remettre en question ou à défendre de manière souvent dramatique – voir la Yougoslavie, le Liban, etc. – le statut de l’identité comme racine unique. Car en fait c’est de cela qu’il s’agit : d’une conception sublime et mortelle que les peuples d’Europe et les cultures occidentales ont véhiculée dans le monde, à savoir que toute identité est une identité à racine unique et exclusive de l’autre363.
Que pouvons-nous tirer de cette réflexion moderne sur la culture et l’identité ? Peut-être
que le contexte colonial amplifie cette recherche de « perdurabilité », et que pour cela le média
qu’est le journal organise la représentation de la population dans une perspective atavique. Cette
idée apparaît d’autant plus séduisante qu’elle s’accompagne d’une réflexion sur le lien entre le
territoire et la culture : « la culture atavique, c’est celle qui part du principe d’une Genèse et du
principe d’une filiation, dans le but de rechercher une légitimité sur une terre qui à partir de ce
moment devient territoire364 ». Le colonial, au sens large, quand il s’établit sur une terre qu’il
transforme en territoire, est à la recherche de cette Genèse qui va permettre d’entériner sa
présence, de la rendre légitime et non questionnable. Les autres de la colonisation, ceux que le
colonial – le journaliste, ici – désigne comme tels, sont l’objet de l’écriture, et rarement le
sujet : au mieux leur accorde-t-on le statut de narrateur second dans des récits enchâssés.
L’écriture de leurs contours se fait alors par tous les genres médiatiques, avec quelques traits
généraux que l’on a essayé ici de cerner. Pourtant il ne s’agit pas d’une stratégie concertée,
d’une organisation généralisée : si les textes médiatiques présentent des traits communs, ils ne
sont cependant pas tous catégorisables de la même manière, et l’on pourrait facilement trouver
des contre-exemples. Sans une vision surplombante de ces écritures, pourtant, l’on perdrait en
363 Édouard Glissant, Introduction à une poétique du divers, Paris, Gallimard, 1996, p. 22. 364 Ibid., p. 59.
388
clarté sur la construction textuelle et identitaire qui régit la littérature médiatique coloniale, et
qui permet la comparaison, dans un dernier temps, avec d’autres corpus soumis à des
tensions semblables et évalués ou expliqués selon ces tensions : ceux de la littérature exotique,
coloniale ou francophone ; trois corpus donc que l’on définit entre autres par leur rapport à
l’altérité. Positionner ces deux corpus sur le même plan peut sembler une réduction abusive de
leurs particularités : selon notre angle d’étude, nous voudrions faire ici l’effort de ne les
considérer qu’à l’aune des éléments identitaires qui sont mobilisés dans leur création – sans que
cela signifie le renoncement aux critères esthétiques ou poétiques.
389
Quatrième partie – De la presse coloniale au roman
postcolonial
Plusieurs points permettent de tisser des liens entre le corpus livresque postcolonial et
le corpus médiatique colonial : non pas des points historiques, mais des points poétiques,
relevant de la nature même des écrits. Les quelques traits que nous étudions ici vont en ce sens,
et approfondissent les rapports entre ces deux corpus : chaque étude précise d’un élément de
l’écriture médiatique coloniale appelle en écho un élément définitoire du corpus littéraire
postcolonial – avec tout ce que l’écho peut avoir de déformant. En effet, si l’identité coloniale
a été la perspective selon laquelle nous avons abordé les textes médiatiques des colonies, c’est
à présent l’identité de ce corpus lui-même qui nous intéresse, son identité littéraire, autrement
dit son fonctionnement poétique. Tout comme l’identité coloniale se joue dans différentes
oppositions et différentes altérités, la presse coloniale se situe au croisement de plusieurs
altérités, et ses « autres » se définissent par des aspects génériques et des aspects
chronologiques : littérature canonique, paralittérature, volumes, recueils, mais aussi littérature
coloniale du XXe siècle ou littérature postcoloniale gravitent autour de notre corpus et aident à
le comprendre. Adopter une perspective proprement littéraire pour clore l’étude est un moyen
de ne pas se limiter à l’étude des « images » coloniales, et de dépasser la mise en valeur du
contenu pour une réflexion plus étendue sur les textes eux-mêmes, tout en se gardant d’une
perspective téléologique qui ferait se succéder des auteurs selon une ligne aboutissant aux
littératures postcoloniales. Malgré la succession constatée des corpus, il est certain qu’« il n’y
a pas, comme le voudrait la téléologie du sens commun, de passage d’une littérature européenne
colonialiste à des littératures autochtones rendues à la vertueuse authenticité des cultures
indépendantes1 » ; il est également certain que les interactions des corpus les éclairent. Dans les
travaux de János Riesz, la relation entre la littérature coloniale et la littérature africaine est ainsi
décrite selon le principe de la greffe, principe repris à Gérard Genette et correspondant au
modèle de l’intertextualité : le chercheur conclut alors à la « nécessité (incontournable) de tenir
compte de la littérature coloniale quand on étudie la littérature africaine2 ». Greffe et non
1 Jean-Marc Moura, Littérature francophone et théorie postcoloniale, Paris, PUF, [1999], 2013, p. 63. 2 János Riesz, De la littérature coloniale à la littérature africaine. Prétextes – Contextes – Intertextes, Paris, Karthala, 2007, p. 57.
390
passage, influences et interactions plutôt que succession : à ces modèles nous rajoutons la
particularité du corpus médiatique. La presse coloniale non-métropolitaine est faite de
fragments qui révèlent beaucoup de ce qu’était l’actualité quotidienne des colonies ; il s’y
trouve une forme de justesse historique et littéraire pour ce qui a trait à la période. C’est en
raison de ce lien avec l’actualité que le biais « qui consiste à prétendre dévoiler des intentions
cachées là où elles étaient proclamées3 » lorsque l’on étudie la littérature coloniale est
quasiment impossible dans l’étude de la presse coloniale ; et cette connaissance d’un type
d’écriture coloniale permet alors de mieux comprendre les mécanismes d’écriture qui
répondent, d’une manière ou d’une autre, à la colonisation. En outre, les journaux dans les
colonies ont constitué une partie non négligeable de la vie littéraire – et pas seulement de la
réalité coloniale –, et l’on pourrait sans doute le prouver en étudiant les fonds des libraires
coloniaux, auxquels les annonces qui paraissent dans la presse sont un premier indice : il n’y a
pas pléthore d’ouvrages disponibles pour les coloniaux. À ce titre, tous les textes issus du corpus
médiatique colonial font bien partie de la représentation des littératures de langue française non
métropolitaines – sous la forme d’une « littérature familière4 » – constituant une proto-
littérature coloniale d’origine européenne. L’on peut alors étudier les liens entre la presse
périodique et les corpus littéraires selon ce qu’exprime Anne-Marie Thiesse :
[Il faudrait] montrer le rôle littéraire des journaux, c’est-à-dire non seulement la part faite à la littérature dans les journaux, mais aussi la répercussion du développement de la presse périodique sur la littérature, la substitution partielle et, en beaucoup d’endroits, totale de la revue, du magazine, ou du journal, au livre, la liaison ici ou là des restaurations de littératures provinciales à une presse puissante animée d’un vif esprit régional5.
Cet « esprit régional », particulier lorsqu’il désigne les territoires coloniaux, la presse
en a usé comme d’un critère définitoire : publiant les textes qui constituaient la colonie au jour
le jour, et non dans un esprit de synthèse ou de théorisation, la presse que nous étudions peut
être envisagée comme un socle sur lequel se sont développées d’autres écritures et d’autres
littératures.
L’on aurait pu, dans cette tentative pour élancer le propos vers d’autres corpus,
interroger les textes médiatiques francophones actuels : le premier obstacle cependant tient au
fait que les colonies sous leur forme passée ont disparu, et que l’idéologie coloniale n’est plus
3 Norbert Dodille, Introduction aux discours coloniaux, Paris, PUPS, 2011, p. 165. 4 Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, Vanves, Edicef, 1991. 5 Anne-Marie Thiesse, « « Rôles de la presse dans la formation des identités nationales », Presse, nations et mondialisation au XIXe siècle, Marie-Eve Thérenty et Alain Vaillant (dir.), Paris, Nouveau Monde, p. 137.
391
visible dans la presse actuelle. Autre obstacle : la presse d’aujourd’hui n’a que peu à voir avec
la presse du XIXe siècle pour des raisons structurelles et littéraires, et ce serait s’égarer sur la
nature des textes de notre corpus que de tenter une comparaison avec les textes médiatiques
actuels. C’est donc en ce sens que le modèle biologique de l’évolution buissonnante a été
convoqué dans l’introduction : il faut considérer que le corpus médiatique colonial n’a pas eu
de descendance littéraire directe, en termes de support en tout cas, et que l’on ne dresse pas ici
un arbre généalogique aux descendances évidentes. C’est pour cette raison également que l’on
se concentrera sur le genre romanesque : extrêmement présent dans la presse coloniale, le genre
narratif constitue également un repère des écritures occidentales, et son utilisation même dans
le cadre des écritures nationales postcoloniales n’est pas sans faire débat.
Plusieurs corpus se succèdent dans cette dernière partie, chronologiquement du
moins : les premiers romans que l’on peut dire coloniaux car écrits par des coloniaux, dans une
volonté d’authenticité qui signale également la mainmise sur un territoire : Noëlla de Georges
Azéma (1864), Les Drames du désert et Les Colons algériens de Léon Beynet (1862 et 1863),
Hier ! aujourd’hui ! demain ! ou les agonies créoles, roman de mœurs coloniales de Rosemond
de Beauvallon (1885), Au Pays Arabe de Vincent Huet (1899) en sont les exemples principaux.
Parallèlement à ces écrits locaux, des auteurs connus en métropole s’essaient à des romans
exotiques : Bug-Jargal de Victor Hugo (1826), Le Morne au diable d’Eugène Sue (1842),
Georges d’Alexander Dumas (1848). L’on trouve aussi, écriture intermédiaire, des ouvrages
publiés par des voyageurs qui se sont arrêtés quelques temps : Chez les anthropophages.
Aventures d’une Parisienne à la Nouvelle-Calédonie, du docteur Thiercelin (1872) en est un
très bon exemple. Les romans coloniaux à proprement parler, qui revendiquent comme un genre
l’écriture coloniale, prennent la suite de notre chronologie romanesque : Totia. Roman colonial
de Jean Box (1909), Raffin Su-su, mœurs coloniales de Jean Ajalbert (1911), Le Roman d’une
coloniale d’Hubert Clary (1911) constituent plusieurs exemples de ces écritures dirigées par la
pensée coloniale, que l’on retrouve également dans Vaudou. Roman de mœurs martiniquaises
de Louis-Charles Royer (1944), dernier jalon chronologique de nos lectures coloniales. En ligne
de mire apparaît alors un corpus postcolonial canonique, qui commence dans les années des
indépendances africaines et se poursuit jusqu’aux publications les plus récentes. Seront ainsi
étudiés Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma (1970), Femmes d’Alger dans
leur appartement d’Assia Djebar (1980), La Case du commandeur d’Édouard Glissant (1981),
Texaco de Patrick Chamoiseau (1992), La Belle Créole et Histoire de la femme cannibale de
Maryse Condé (2001 et 2003). Si le premier titre ne correspond pas aux territoires dont nous
392
avons étudié la presse, il est cependant fondateur dans l’écriture postcoloniale, et à ce titre
intéressant pour le modèle qu’il constitue ; dans cette même perspective de décentrement par
rapport aux territoires de notre corpus se trouve Le Roi de Kahel de Tierno Monénembo (2008),
œuvre récompensée par un prix Renaudot en 2008 et dont la facture coloniale apparaît dès la
quatrième de couverture – qui insiste sur le retournement de l’histoire coloniale permise par le
roman. D’autres titres, liés à l’Algérie plus spécifiquement et publiés récemment, sont eux aussi
présents : La Dernière nuit de l’Émir d’Abdelkader Djemaï (2012), Meursault, contre-enquête
de Kamel Daoud (2014), ou encore Nos Richesses de Kaouther Adimi (2017). Tous ces
ouvrages abordent un chapitre de l’histoire coloniale ; en outre, ils sont remarquables par la
visibilité dont ils bénéficient dans les institutions littéraires françaises. Récompensé par
plusieurs prix, Abdelkader Djemaï s’est penché explicitement sur le passé colonial avec La
Dernière nuit de l’Émir ; Kamel Daoud a obtenu plusieurs prix pour son roman6 ; Kaouther
Adimi est en lice pour le prix Goncourt et le prix Renaudot. Il est intéressant de noter que les
études littéraires, souvent limitées au genre romanesque, ne représentent pas aussi bien l’île de
la Réunion, la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie dans les corpus coloniaux et
postcoloniaux : alors que les auteurs antillais sont bien représentés et bien étudiés, l’on trouve
peu de grandes études sur les auteurs calédoniens7. Les études sur l’auteure kanak Déwé Gorodé
sont ainsi peu nombreuses et ne lui ont pas offert la même visibilité littéraire que d’autres
auteurs francophones ; nous nous intéresserons à Tâdo, Tâdo, wéé ! (2012), roman dont la
confrontation avec Les Contes de Poindi de Jean Mariotti (1941) offre une ébauche de littérature
calédonienne8.
1 Le texte médiatique colonial dans son environnement
Les textes du journal colonial obéissent au même fonctionnement médiatique que tous
les textes issus du corpus médiatique français, au premier rang desquels la rubrique apparaît
comme l’élément principal. En effet, elle
6 Prix Goncourt du premier roman 2015, prix des cinq continents de la Francophonie 2014, prix François Mauriac 2014. 7 L’on peut cependant citer quelques noms et quelques études : mais rien d’aussi massif que pour la littérature antillaise ou algérienne. La littérature réunionnaise a ainsi été étudiée par Jean-Claude Carpanin Marimoutou ; la littérature tahitienne par Daniel Margueron ; la littérature guyanaise par Catherine Le Pelletier ; la littérature indochinoise par Henri Copin… Ces études mettent en avant, et c’est l’un de leurs points communs, une chronologie élargie qui tient compte de l’époque coloniale. 8 Jean Mariotti, Les Contes de Poindi, Paris, Stock, 1941. Le fait que Déwé Gorodé soit publiée à Tahiti et non à Paris explique en partie cette absence d’études.
393
manifeste l’existence d’une temporalité plus pérenne que l’éphémère du quotidien : elle établit une continuité de lecture de numéro en numéro. Elle crée le cadre dans lequel le quotidien devient lisible. Les rubriques constituent l’invariant du journal et renvoient à sa position idéologique et esthétique : elles s’opposent par leur permanence à une information forcément labile9.
De ces rubriques stables émanent des textes qui pourtant interagissent avec les
publications plus éphémères ou liées à une actualité forcément passagère : elles sont en ce sens
touchées par une forme de plasticité, de labilité, et plus ouvertes que ce que l’on pourrait penser.
Sortir de la rubrique représente la première étape d’une réévaluation du corpus médiatique en
tant que corpus parfois parallèle, parfois à l’intersection d’autres corpus ; c’est aussi une
manière de prendre du recul par rapport à ces publications hors du livre et à la manière dont
elles s’insèrent dans leur époque. Les textes de la presse coloniale sont issus d’une même
matrice médiatique, mais se réalisent différemment selon les territoires sur lesquels ils
paraissent, et selon les principes de la colonisation qui y est en vigueur. C’est un premier pas
dans l’appréhension des textes que cette diversité qui ressortit au contexte social et
géopolitique ; un deuxième pas réside, toujours dans cette perspective, dans l’étude de
l’environnement textuel et immédiat des publications médiatiques. À la période étudiée, la
répartition des textes n’est pas aussi cloisonnée qu’aujourd’hui entre le fictionnel et le
documentaire, la chronique et la notice, la variété et le feuilleton : sans qu’il soit possible
d’étudier tous les écrits médiatiques dans une perspective littéraire, il n’est pas possible non
plus de ne pas prendre en compte, dans l’acte de lecture lui-même, la totalité du journal. Il est
impossible de négliger la quatrième page, constituée seulement d’annonces et de publicités
diverses ; de ne pas voir l’importance des gravures représentant les navires en partance ou à
vendre ; de ne pas s’arrêter sur les articles politiques ou d’ignorer totalement les notices
agricoles. Nous avons évoqué dans la partie précédente – en complément de l’étude des textes
– le rôle que jouent les annonces de marronnages ou les avis d’affranchissement au-dessus des
feuilletons traitant de l’esclavage ; c’est sur ce modèle, mais en mettant ce fonctionnement
poétique au premier plan, que l’on reviendra. Le texte publié dans la presse coloniale est irrigué
par son entourage : à ce titre, c’est une poétique du support que l’on fait émerger. Ces
contaminations se mêlent également à un modèle narratif qui enclenche un pacte de lecture
particulier dans lequel on reconnaît une double destination, entre lecteurs de la colonie et
lecteurs de la métropole certes, mais surtout qui opère à partir d’une forme de confiance
présupposée. Enfin, les périodiques coloniaux sont à même de présenter des textes
9 Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques du XIXe siècle, Paris, Seuil, 2007, p. 78.
394
remarquables et isolés, qui modifient la perception de tel ou tel passage de l’histoire
coloniale : ils témoignent des possibilités de l’écriture médiatique dans une société aussi
surveillée que l’est la société coloniale. Pour chacun de ces éléments étudiés, un texte
postcolonial sera pris comme un contrepoint, dans son sens musical : une deuxième mélodie,
liée à la première et qui s’en détache cependant par bien des points10.
1.1 Le texte et son entourage : contamination et échos
La plupart des textes littéraires du XIXe siècle fonctionnent selon des changements qui
se produisent de ligne en ligne, passant d’une tonalité à une autre, mélangeant différents
registres et allant chercher selon différents domaines et différentes intensités d’écriture. Mais
les textes médiatiques subissent ces changements également à une échelle plus grande
encore : voisins d’autres textes et d’autres tonalités, ils sont également soumis aux
contaminations et effets de voisinage. C’est que les textes étudiés constituent en quelque sorte
la « marge » du journal colonial, au sens où ils ne sont pas majoritaires, et ne constituent pas
l’essentiel des problématiques de publication médiatiques dans les colonies. Dans les
prospectus que nous avons cités dans la première partie, dans ces déclarations de principe qui
constituaient les premiers numéros, l’accent était porté sur l’aspect pragmatique de la
publication bien davantage que sur les productions fictionnelles ou ressortissant à des
problématiques littéraires. Il y aurait donc quelque chose d’une littérature marginale dans nos
textes, comme une piste pour aller explorer les liens entre ce que le journal colonial présente
comme sa colonne vertébrale (les textes techniques) et les excroissances que représentent nos
textes. Dans une perspective de la réception des textes, ce mélange médiatique est à analyser,
pour voir dans quelle mesure il a pu constituer un reflet de la colonie au point de vue textuel, et
informer ensuite l’écriture de textes coloniaux plus tardifs. Outre cette remarque générale, la
lecture des périodiques coloniaux amène aussi à noter deux phénomènes
poétiques : l’importance des « piratages » médiatiques et la prédominance de la lettre comme
modèle textuel – modèle qui se rapporte à l’identité coloniale : les lettres exhibent la distance
qui en est l’un des piliers. La publication de textes exogènes dans des journaux modifie la
10 Nous utilisons ce terme et sa force métaphorique à la suite d’Edward Said dans Culture et impérialisme : il explique ainsi : « Quand nous examinons les archives culturelles, notre relecture n’est pas univoque mais en contrepoint. Nous pensons simultanément à l’histoire métropolitaine qu’elles rapportent et à ces autres histoires que le discours dominant réprime (et dont il est indissociable) » (p. 97) ; puis il oppose le contrepoint à l’essence, expliquant qu’« il s’agit de la mise en place de ʺcontrepointsʺ – car le fait est qu’aucune identité n’a jamais pu exister toute seule, sans un appareil de contraires, de négatifs, d’opposés » (p. 98). Voir Culture et impérialisme, trad. Paul Chemla, Paris, Fayard, 2000.
395
lecture : l’entourage du texte est là aussi un facteur d’explication de la réussite de ces
publications qui trompent le lecteur sur l’origine du texte. Un exemple de ces republications de
textes, dont la signature est changée et dont le texte semble parfaitement correspondre à la
situation coloniale, permet d’interroger les effets de la réception médiatique.
Le journal colonial et les frontières des textes
Le journal, même quand il n’est pas colonial, est un espace littéraire particulier quant à
la question du genre : « les caractéristiques propres à l’écriture font du journal un espace
d’expérimentation où s’inventent sans cesse de nouvelles formes génériques, par mélange,
hybridation ou transformation de matrices d’écriture11 ». De cette inventivité liée au support, le
contexte de publication colonial tire cependant une forme particulière que l’on explique par sa
mission idéologique : tous les textes sont dirigés à plus ou moins long terme vers la formation
d’une communauté coloniale. En s’appuyant sur le corpus exotique de la fin du XIXe siècle, la
comparaison avec le corpus médiatique colonial prend même une coloration particulière. Ainsi,
dans l’analyse qu’il fait du Journal des Voyages, Matthieu Letourneux utilise le terme de
« contagion » pour qualifier le discours colonial qui ressort de la confusion entre textes narratifs
et textes informatifs : la « fonction idéologique d’une association entre récits de fiction et récits
documentaires12 » se joue dans les aventures médiatiques. L’exemple donné est celui d’un
« combat contre un tigre narré par Boussenard [qui] va trouver un écho dans toute une série
d’anecdotes authentiques de chasses aux tigres extraordinaires13 ». Autrement dit, la littérature
d’aventures dont Louis Boussenard est l’un des meilleurs représentants se conjugue aux récits
de chasse de la presse coloniale qui tiennent lieu de faits divers à la portée idéologique, comme
on l’a vu dans la partie précédente. Cet aspect hétéroclite est intéressant parce qu’il montre la
concurrence, au sein d’un même journal, entre deux types de récits auxquels l’on peut attribuer
deux origines, ce que faisait sans doute le lecteur de l’époque : d’un côté le romanesque
métropolitain, de l’autre le réalisme colonial. De la confrontation entre les deux surgit une
conclusion se lisant alors sur le champ de l’action : « Ce qui se produit, ce n’est pas le sentiment
que les héros de fiction sont plus réalistes, mais l’illusion, pour le lecteur, qu’il serait possible
de devenir lui-même un personnage de fiction14 ». Transposons donc ces questions et
11 Corinne Saminadayar-Perrin, « Stratégies génériques dans l’écriture journalistique du XIXe siècle », Romantisme, 2010/1, n° 147, p. 121. 12 Matthieu Letourneux, « La colonisation comme un roman ; Récits de fiction, récits documentaires et idéologie dans le Journal des voyages », Idéologie et stratégies argumentatives dans les récits imprimés de grande diffusion, Belphégor, IX, 1, 2010. URL : http://etc.dal.ca/belphegor/vol9_no1/fr/main_fr.html. Consulté le 6 juin 2017. 13 Id. 14 Id.
396
conclusions à la presse coloniale telle qu’on a pu la lire : quelles contaminations y sont à
l’œuvre, et pour quel effet ? Il y a bien une conscience, exprimée parfois dans les périodiques,
d’une distinction entre les textes à vocation littéraire et les textes documentaires. Les
introductions et métadiscours des textes médiatiques coloniaux peuvent en effet présenter les
rouages de l’écriture qui va suivre, et ces présentations peuvent s’avérer riches d’enseignement.
Ainsi du paragraphe qui précède l’intrigue à proprement parler qu’écrit Xavier Eyma dans
L’Avenir :
L’histoire que nous allons raconter a fait grand bruit en Europe et aux colonies. Les chroniques du pays et les archives du ministère de la marine sont les dépositaires des pièces officielles constatant cette étrange aventure, que nous avons eu au plus la peine d’arranger pour lui donner une forme littéraire15.
La transformation des chroniques d’une « étrange aventure » en une forme plus littéraire
étant ainsi amorcée, l’histoire peut alors se développer : les documents officiels que fait aussi
paraître le journal, les disputes politiques sont mises de côté par l’affirmation d’une prétention
littéraire. L’introduction clarifie le propos et dissipe les malentendus possibles sur le statut du
texte : mais d’autres cas sont moins évidents, et laissent planer une forme de doute quant à la
nature des textes publiés au sein du journal, partant quant à la signification de leur présence
dans les colonnes du périodique. Ainsi d’un poème reconnu par le canon littéraire français : « À
une créole » de Baudelaire paraît dans La France algérienne en 1845, dans le feuilleton, et
trouve une relecture différente à la lumière des textes qui l’accompagnent16. Outre le fait que le
nom du poète est développé selon une forme qui n’apparaît plus après 1846 (Baudelaire
Dufays), il suit en effet un article sur le théâtre d’Alger, qui présente les débuts de la troupe
italienne, ainsi qu’un autre article sur le daguerréotype à Alger. L’article portant sur le
daguerréotype est en fait une forme de réclame déguisée pour un artiste nouvellement installé
en ville : l’auteur propose notamment aux habitants d’Alger « d’envoyer à leurs parents et amis
d’outre-mer l’image en [vrai ?] du pays de leur adoption ». Plus précisément, le poème
baudelairien est donc lié, par la mise en page, aux lignes suivantes, qui concernent le
daguerréotypeur : « Nous ne saurions trop encourager cet artiste à continuer ses expériences si
intéressantes au point de vue de l’art. Déjà les terrasses du bazar Mantout, où il demeure, sont
fréquentées par beaucoup d’amateurs et de visiteurs dont le nombre ne fait qu’augmenter17 ».
Cette réclame ancrée dans la topographie de la ville algérienne précède donc les premiers vers
15 Xavier Eyma, « Le Grand cordon et la corde », L’Avenir de la Pointe-à-Pitre, du 24 juillet au 25 août 1852. L’auteur publie de manière récurrente dans la presse coloniale ; il écrit également dans La France d’Outre-Mer. 16 Baudelaire Dufays, « À une créole », La France algérienne, 5 juin 1845. 17 « Le daguerréotype à Alger », La France algérienne, 5 juin 1845.
397
du poème, tels qu’ils paraissent dans le périodique : « Au pays parfumé que le soleil caresse, /
J’ai vu sous un grand dais de tamarins ambrés, / Et de palmiers où pleut sur les yeux la paresse,
/ Une dame créole aux charmes ignorés ». Des terrasses aux tamarins, deux exotismes se
trouvent donc liés, et la réclame se trouve mise sur le même plan que le poème : les jeux d’échos
créés ainsi dessinent l’ébauche d’une carte coloniale qui progresse par touches, associant la
poétique baudelairienne à des écritures et des problématiques portées par le contexte. Dans un
autre feuilleton, le même journal s’autorise de la voix d’Hector Berlioz dans le Journal des
débats pour vanter les talents d’un musicien passé à Alger, et publie aussi deux fables du poète
ouvrier Lachambaudie, poète qui n’a pas de lien avec la colonie : la première de ces fables, aux
accents orientalistes, trouve pourtant particulièrement sa place dans la publication algérienne18.
Cette mixité dans la publication est tout à fait ordinaire ; mais la sélection des textes laisse à
penser que le choix des rédacteurs va dans le sens d’une identité coloniale comprise au sens
large, et reposant sur une forme d’exotisme : La France algérienne affirme son ancrage colonial
en sélectionnant des textes certes exogènes (ils n’ont pas été écrits par des coloniaux, ni même
pour la colonie) qui font cependant sortir le lecteur de ses références métropolitaines et ouvrent
des perspectives exotisantes.
Dans une perspective voisine mais orientée vers de possibles lecteurs indigènes, les
textes publiés dans Le Messager de Tahiti qui participent au projet d’une « éducation » bilingue
à la littérature française ont pour effet d’enserrer les textes devenus patrimoniaux dans le récit
au jour le jour de la colonisation. En outre, et puisque ces textes sont traduits en tahitien, la
contagion se fait aussi au niveau linguistique, et pas seulement générique ou idéologique. Il
s’agit bien de faire varier le statut des textes qui sont publiés, comme le précise l’un des textes
d’introduction :
Cet ouvrage, publié il y a environ cent soixante ans, est resté un modèle de la langue française. Il a été traduit dans toutes les langues Européennes. Ce qu’on en fait aujourd’hui ne peut augmenter sa réputation ; mais son illustre auteur, l’archevêque de Cambrai (archevêque français), dont la charité et les vertus ont tant honoré l’épiscopat français, se serait sans aucun doute intéressé à voir ses pensées reproduites devant la population Taïtienne19.
Passer par la réaction probable de Fénelon concernant son enseignement donné aux
Tahitiens est un biais intéressant pour marquer l’adaptation du texte à la colonie, de la même
manière que la précision entre parenthèses du statut de l’auteur assigne à l’auteur une forme
18 La France algérienne, 10 mai 1845. 19 « Les Aventures de Télémaque », Le Messager de Tahiti, 22 juillet 1860.
398
d’étrangeté que le journaliste doit expliquer. Ce même principe de rapprochement entre deux
cultures se lit également à propos de l’Algérie, mais toujours dans le même numéro du même
périodique tahitien :
Mort d’un dey d’Alger en 1754. Sous ce titre, M. Paul-Eugène Bache vient de publier, dans l’Écho d’Oran, une curieuse étude qui fait bien connaître ce qu’était, il y a cent ans, cette Algérie où flotte glorieusement aujourd’hui le drapeau de la France, et d’où s’élançaient alors les redoutables pirates qui pillaient les navires européens et réduisaient les Chrétiens en esclavage. Nous empruntons à ce travail quelques passages qu’on lira peut-être avec intérêt20.
Alors que le texte de Fénelon était traduit en tahitien, le récit de la mort du dey n’est
publié qu’en français. Pourtant ces deux textes paraissent au sein du même numéro de juillet
1860 : ces différences de langue montrent un ancrage double du périodique colonial, ainsi
qu’une double destination qui travaille l’ancrage des textes dans un seul genre autant que dans
une seule perspective de publication. Le pacte de lecture qui sera celui de la littérature coloniale
– et sur lequel nous reviendrons – est amplifié par le cadre du journal, au sens où ce mélange
de textes affirme une prétention identitaire. À titre d’exemple, les publications de l’état-civil
colonial dans Le Messager de Tahiti se chargent de donner aux textes qui paraissent ensuite
dans les colonnes du périodique un aspect sérieux, informé, positif : le périodique fait advenir
le texte de Fénelon ou celui de Bache au statut de représentants d’une culture coloniale
officielle, soutien de la communauté coloniale au même titre que l’état-civil. Ces éléments
structurels du journal colonial, peut-être plus encore que les signatures auctoriales étudiées dans
la première partie, contribuent à forger l’image non des auteurs mais des textes, et à affirmer
leur pertinence et leur degré de fiabilité. Un texte médiatique colonial paraît au sein d’un
ensemble d’informations qui appartiennent à la statistique, à la botanique, à la géographie : il a
donc ce surplus de connaissance que lui octroie le voisinage d’autres matières que la sienne
propre. C’est aussi de cet entourage qu’il tire, sans doute, un déficit de littérarité : sa naissance
même est entachée de soupçon.
Comme autre exemple de ces réseaux qui se tissent entre les différents espaces du
journal, l’on peut citer les liens entre les « genres du prétoire21 » tels qu’ils apparaissent dans
les chroniques judiciaires, et d’autres textes qui font jouer les mêmes ressorts dans la
présentation de personnages : portraits, chroniques, fictions. De la masse des textes nous tirons
l’exemple suivant parce qu’il date des premières années de la présence française en Algérie et
20 « Mort d’un dey d’Alger en 1754 », Le Messager de Tahiti, 22 juillet 1860. 21 Selon le titre de la thèse d’Amélie Chabrier, op. cit.
399
qu’il relève de cette contamination qui n’est pas le fruit du hasard mais plutôt le résultat d’une
démarche réfléchie. Il s’agit de la description que l’on lit dans Le Moniteur algérien du 11 avril
1835 :
Mohamed ben Mouktar est d’abord introduit. C’est une espèce de petit mulâtre à peine sorti de l’adolescence ; il est couvert d’un burnous jadis blanc et en mauvais état, sa physionomie assez agréable et parfois animée d’un sourire expressif annonce l’intelligence et l’astuce : il paraît comprendre parfaitement toute la gravité de sa situation et jamais il ne répond immédiatement aux questions qui lui sont transmises par l’interprète, il faut toujours les lui répéter deux fois ; son maintien est généralement calme et assuré, mais lorsqu’il est surpris par une demande qui le met en contradiction avec lui-même ou avec son complice, son embarras est évident, il paraît alors connaître tout le prix des paroles qu’il laisse échapper de sa bouche et qu’il semble compter une à une ; il porte plus fréquemment la main à sa tête nue ; l’on dirait qu’il veut y chercher quelque expédient pour sortir d’embarras. L’on procède à l’interrogatoire. Ce malheureux sait bien son nom, mais il ignore son âge ; il exerce la profession de berger et habite Coléah. D. Qui a pu vous porter à assassiner des européens ? R. Je n’en ai pas vu, ainsi je n’ai pu en assassiner22.
Le portrait de l’accusé repose sur les termes de l’univers colonial : « mulâtre », bien que
peu utilisé dans le contexte algérien, renvoie cependant à un imaginaire que l’on peut dire
colonial au sens large ; le « burnous » n’est ni souligné ni traduit, preuve de l’adaptation de la
langue médiatique à son territoire de parution ; enfin les expressions de la modalisation (il
paraît, il semble, l’on dirait) instaurent une présence narratrice discrète mais qui fait autorité et
déchiffre le personnage – trace d’une domination qui est celle du colonial. Par ces quelques
éléments discrets, une connexion se fait entre ce compte-rendu et les textes fictionnels que la
presse commence alors à faire paraître : jusque dans les tribunaux se lit un tropisme pour
l’orientalisme, la posture dominante de ses auteurs, l’insertion de termes se rapportant à la
langue et à la culture arabe. Cette attirance présente jusque dans la mise en mots des faits divers
ne se tarit pas facilement : même au cours des années 1860, l’on retrouve le même modèle d’une
innutrition orientaliste appliquée au tribunal. L’exemple que nous citons ici montre même une
forme de surenchère dans ce mélange : la lettre citée est attribuée à un auteur tunisien, et a été
transmise à la rédaction du journal par « un de nos abonnés, Si Chérif-ben-Cheik ». Il s’agit de
la condamnation à mort d’un haut fonctionnaire :
À la suite d’une de ces orgies dans le goût de celles qu’Horace et le pieux Virgile, Corydon et le pasteur Alexis se permettaient jadis, le bachamba (chef de police) et un postillon du bey se seraient pris de querelle parce qu’un des assistants, fuyant les violences du bachamba, se serait abrité derrière le postillon qui l’aurait défendu. Alors le
22 « 1er conseil de guerre de la division d’Alger », Le Moniteur algérien, 11 avril 1835.
400
bachamba aurait saisi un pistolet et aurait tiré sur le postillon à bout portant.
Ce que nous contons là n’est qu’un ouï-dire, mais, si c’est vrai, la condamnation qu’on nous annonce serait un acte de haute justice et le signe d’un progrès sensible dans les mœurs tunisiennes. Car, comme le dit le poète Sâdi dont il est question dans notre feuilleton : « Ménager le tigre, c’est sacrifier la brebis23 ».
Dans ce fait divers judiciaire, le lien est fait avec l’ensemble du journal, et
particulièrement le feuilleton qui contient le texte d’un poète arabe. Une culture mixte apparaît,
qui mêle les références latines – pour évoquer des affaires de mœurs en un effet de connivence
lettrée – et arabes tout en décrivant une anecdote judiciaire donnée comme véridique ; qui ancre
le récit dans une région élargie (l’anecdote est tunisienne) et ne regardant pas seulement la
métropole ; qui enfin utilise la langue arabe comme auxiliaire de justesse pour la langue
française (jouant ici le rôle d’un xénisme obligé). L’on voit par cet exemple à quel point le cas
des publications judiciaires algériennes est particulier, s’appuyant sur un réseau intertextuel et
des représentations déjà très fournies.
Chaque territoire colonial adapte donc à la culture locale cette écriture du mélange. En
ce qui concerne la Réunion, la publication du feuilleton « Un Drame à Saint-Paul » montre
comment l’articulation des articles laisse voir la manière dont les textes peuvent interagir24. On
lit au-dessus du feuilleton les demandes d’affranchissements appartenant à la partie officielle,
sur la colonne de gauche ; on lit aussi les nouvelles de la France dans les premières lignes de la
partie non officielle.
23 La Seybouse, 26 septembre 1863. 24 Nous prenons cet exemple en particulier pour illustrer les liens entre une publication fictionnelle isolée par l’espace du feuilleton et le reste des publications médiatiques.
401
Le feuilleton cependant occulte complètement la réalité de l’esclavage au sein de la
fiction : pas une seule fois il n’en est fait mention, et le seul serviteur qui apparaît est un
domestique français, veuf de la nourrice d’un des personnages principaux – autrement dit, une
figure paternelle. Les demandes d’affranchissement rendent étrange ce déni de réalité pour le
lecteur moderne ; pour le lecteur contemporain du texte, lecteur colonial et appartenant à la
société esclavagiste, l’absence de personnages d’esclaves ne devait poser aucun problème, pas
même quant au réalisme de l’histoire : il est des absences qui révèlent beaucoup. Autre texte
qui modifie la lecture de certains aspects du feuilleton : la mention de la France comme terre
forcément lointaine, puisqu’on en reçoit des nouvelles, est répercutée dans le récit, faisant
intervenir des personnages arrivés récemment de Toulon, d’autres à l’arrivée plus ancienne.
402
« Ainsi autant qu’elle serait un moteur idéologique, une telle confusion désignerait un
esprit du temps, un enthousiasme romanesque pour la colonisation qui passerait moins par
l’argumentation que par l’identification, la fiction et le fantasme25 » : telle est la conclusion de
Matthieu Letourneux concernant Le Journal des voyages, que nous pouvons adapter aux
particularités de notre corpus. Le lectorat n’est pas tout à fait le même, les ambitions non
plus : s’il y a bien, dans le mélange des textes, une idéologie en marche, ses conséquences sont
sans doute différentes. L’enthousiasme romanesque pour la colonisation n’est pas encore de
mise dans les périodiques coloniaux avant 1880 : la confusion est en effet un moyen de
contourner l’argumentation, mais l’on peut analyser sa présence comme une obligation
générique constituée par l’exiguïté du journal et son obligation de remplir plusieurs missions
dans le cadre de la vie coloniale.
Le contexte, le cotexte : l’importance de l’environnement en littérature Le contexte des œuvres postcoloniales est important et constitue à part entière un
élément de la poétique postcoloniale : si l’acception chronologique de l’adjectif
« postcolonial » n’est pas revendiquée, elle ne s’entend pas moins quand l’on prononce le mot,
et elle participe de la définition minimale du terme. Il en est de même pour la presse
coloniale : l’adjectif « colonial » ne permet pas de faire l’économie de la perspective
chronologique par laquelle l’on entre dans le corpus. Le contexte postcolonial et le cotexte
colonial sont les deux éléments qui font entrer plus avant dans le fonctionnement de corpus
littéraires revendiquant leur inscription dans une époque et dans un cadre. Ainsi, Le Roi de
Kahel passerait volontiers pour un « roman colonial26 » si l’on ne s’arrêtait pas sur l’identité de
son auteur. Le fait même que le guinéen Tierno Monénembo ait effacé les passages les plus
racistes ou violents des mémoires d’Aimé Olivier qui lui ont servi de matériau de départ
explique en partie cette impression : le personnage du héros explorateur est mis au premier plan
comme ce pouvait être le cas dans les publications du siècle passé. La geste coloniale est au
centre du texte, et malgré l’avertissement initial (précisant qu’il s’agit bien d’un roman et non
d’une biographie27), la prétention réaliste semble se lire à travers les citations des écrits
25 Matthieu Letourneux, art. cit. 26 Expression employée par Florence Paravy, « De l’archive au roman, ou les enjeux d’une réécriture : Le Roi de Kahel de Tierno Monénembo », Amnis, 2014, n° 13. URL : http://amnis.revues.org/2231. Consulté le 16 août 2017. Voir plus précisément le passage suivant, qui nuance le propos : « Mais si le roman ressemble beaucoup, à première lecture, à un roman colonial, il s’éloigne en fait de ses stéréotypes idéologiques par ce stratagème qui consiste à faire entendre, par la voix du blanc, une évocation lyrique, exaltée, du pays et de ses habitants : sous couvert d’un pseudoexotisme fondé sur la technique de focalisation interne, c’est bien le romancier qui chante ici l’amour de sa terre natale ». 27 Tierno Monénembo, Le Roi de Kahel, Paris, Seuil, 2008, p. 6.
403
d’Olivier de Sanderval, protagoniste du récit, roi de Kahel au Fouta-Djalon. Si cet écrit devient
postcolonial, c’est uniquement et entièrement par la compréhension du statut de son auteur,
Tierno Monénembo, originaire de la région décrite par Sanderval. C’est donc bien l’origine de
l’auteur, par-delà la voix de Sanderval, qui autorise une lecture postcoloniale du texte. En
élargissant cette perspective, le lecteur des littératures postcoloniales actuelles revient souvent
sur le contexte de publication des œuvres : d’où écrit l’auteur, mais aussi qu’a-t-il lu, où s’est-
il informé sont des questions fondamentales. Ce geste qui interroge les alentours d’une œuvre
se comprend : il se comprend d’autant mieux que la presse coloniale est soumise aux mêmes
questionnements. L’importance est alors celle du cotexte peut-être plus que du contexte : ce
sont les influences des autres textes, la légitimité de la signature qui interrogent le lecteur. Un
cas de piratage médiatique illustre bien cette importance de l’environnement du texte, qu’il soit
colonial ou postcolonial, issu d’un journal ou occupant tout un livre : c’est celui qui transforme
une pièce de vers romantique en dénonciation de l’esclavage réunionnais. L’exiguïté du cadre
médiatique fait obligation aux rédacteurs de compléter un propos strictement informatif par des
publications à prétention littéraire quand ils souhaitent élever leur journal à un statut culturel
affirmé. Ces feuilletons et variétés, ces poèmes et fictions ne peuvent pas toujours être le produit
de plumitifs locaux ; l’on a vu que le recours aux publications métropolitaines est fréquent.
Mais ces republications issues des productions métropolitaines ne sont pas toujours
signalées ; mieux, elles relèvent parfois du plagiat pur et simple. Sont plagiés des textes qui
n’appartiennent pas à la littérature la plus reconnue, ce qui rend l’identification de ces
occurrences difficile : statistiquement, l’on peut estimer que ce n’est pas une pratique répandue,
et qu’elle n’obéit pas forcément à un défaut d’auteurs locaux. Un feuilleton comme « Néhala
ou la fuite », poème narratif signé Auguste et paru dans La Feuille hebdomadaire de l’Île
Bourbon en juin 1836, est l’un de ces cas de plagiat : or la Réunion est pourtant une terre
médiatiquement riche. La particularité de ce texte, et ce qui justifie son étude, réside dans le fait
qu’il interroge les publications concernant l’esclavage28. Il y est question de deux Amérindiens,
Néhala et Telasco, qui fuient leurs « maîtres » ; la jeune femme, Néhala, meurt empoisonnée
par sa maîtresse blanche. D’Auguste nous ne savons rien, et l’usage même du pseudonyme
incline à penser que c’est voulu : c’est sur ce point qu’achoppe l’étude du texte produite dans
une thèse portant sur les feuilletons dans la presse réunionnaise. Il est vrai que c’est une
hypothèse tentante, et plausible, que d’envisager l’auteur comme un collaborateur local,
préférant garder l’anonymat précisément parce qu’il appartient à la société réunionnaise et que
28 Auguste, « Néhala ou la fuite », La Feuille hebdomadaire de l’Île Bourbon, 29 juin 1836.
404
traiter de l’esclavage dans une fiction est un cas compliqué, qui contrevient à l’idéologie
officielle. L’on pourrait même faire le pari d’un auteur voyageur qui se serait arrêté quelques
temps à la Réunion, puisque sa signature apparaît plusieurs fois dans le journal, pour différents
textes, et disparaît brusquement29. Pour expliquer le texte et sa parution, il est également
intéressant de remarquer que le thème – et le mot – de la liberté est mis au premier plan ; qu’il
s’agit bien de la fuite d’esclaves, et qu’à la Réunion, qui plus est en 1836, cela évoque forcément
le marronnage. Nous serions donc en présence d’un texte particulièrement provocateur, créé
pour la presse locale, dans le but de déclencher une polémique : c’est l’analyse que fait
l’historienne qui a donc, la première, exhumé le texte. Pourtant le poème se déroule en Ontario,
et c’est un premier signe qu’on aurait tort de négliger. S’il est vrai que l’Amérique du Nord est
à la mode dans ce début de XIXe siècle, le choix de ce détournement exotique pour évoquer
tout de même, par détour, une réalité réunionnaise pose question. Plusieurs indices peuvent être
analysés comme des références à un univers antillais ou réunionnais : c’est ce qui ressort
également de l’analyse faite dans la thèse sur laquelle nous nous appuyons ici. Nous pouvons
ajouter quelques points, dont l’onomastique. Le nom de Néhala réapparaît à la fin du siècle dans
un livret de Berlioz, mais c’est dans les années 1820 l’héroïne d’une tragédie indienne de
Casimir Delavigne30. Si ces premiers indices ancrent les personnages du côté de la métropole,
il existe cependant un contre-indice, une parenté phonique entre la Néhala du périodique et
Nélahé, personnage féminin qui apparaît dans la Chanson II d’Évariste de Parny, le poète
réunionnais : Nélahé est fille de roi, exhortée à accorder ses faveurs à l’invité de son père, un
blanc ; le nom, comme celui de Néhala, apparaît dans différentes œuvres – l’on se perdrait à
dresser une liste des apparitions de ce nom – et connote un exotisme mal défini31. Entre l’auteur
local et la circulation d’un nom connotant l’exotisme, c’est une sorte de syncrétisme colonial,
de flou exotique qui mêle des références artistiques et françaises à différentes régions du monde.
La mise en ligne par la BNF – le 15 août 2016, et nous précisons cette date parce qu’elle
permet de voir comment l’hypothèse de la publication locale était pertinente jusqu’à cette
numérisation – d’un recueil de 1868 permet de remonter aux origines du texte. Le terme de
« généalogie » peut sembler paradoxal : la parution sous la signature « Auguste » date bien,
29 Fabienne Jean-Baptiste, Feuilletons et Histoire. Idées et opinions des élites de Bourbon et de Maurice dans la presse de 1817 à 1848, thèse de doctorat en histoire contemporaine sous la direction de M. le Professeur Prosper Ève, soutenue à l’Université de la Réunion, 2010, p. 575-579. Les parutions sont précisées p. 576, et l’auteure ajoute : « Pour nous, Auguste serait un écrivain de passage à Bourbon et peut-être un homme métis car son œuvre avilit le Blanc ». 30 Voir Le Paria de Casimir Delavigne, et le livret de Sardanapale de Berlioz. Télasco évoque plutôt la culture inca – ce nom est utilisé en 1819 dans un mélodrame de Mélesville représenté à l’Ambigu, Les Mexicains. 31 Évariste de Parny, Œuvres de Parny, précédées d’une notice sur sa vie, Paris, Roux-Dufort, 1826, p. 208.
405
quant à elle, de 1836. En fait, si le poème est en effet édité chez Charpentier en 1868 comme
une des poésies de Charles Dovalle, avec une préface de Victor Hugo, il faut savoir que le poète
et journaliste, né en 1807, est mort en 1829 dans un duel consécutif à l’un de ses articles ; la
publication posthume du recueil n’a pas été rapide, mais les poèmes ont dû circuler
auparavant32. Dovalle, auteur originaire d’Anjou, lié aux romantiques parisiens, n’a aucun lien
avec la Réunion. Il est mort depuis déjà sept ans quand « Auguste » signe de son nom le poème
qui paraît dans la presse réunionnaise : il faut donc conclure à un plagiat pur et simple. Le
rédacteur a-t-il cru à une publication originale, ou a-t-il cautionné cette utilisation du texte ?
Pourquoi utiliser ce texte précisément, et comment est-il parvenu jusqu’à la Réunion ? À ces
questions nous ne pouvons malheureusement opposer que des hypothèses. Les analyses de
Fabienne Jean-Baptiste, quant à elles, restent valables : même si le texte n’est qu’une
republication, faire paraître un poème portant sur la fuite d’esclaves dans un périodique
réunionnais n’en est pas moins un geste fort. Mais il est possible à présent d’enrichir cette
analyse, en voyant à quel point le contexte de publication incline à deux types de lecture tout à
fait différents : ce qui apparaît ici, c’est la force du lien entre le territoire et la littérature, entre
le support et la réception. Paru en France et en recueil, le poème relève d’un exotisme
romantique empreint de « couleur locale » indéterminée, mais qui rappelle l’Amérique du Nord
principalement ; paru sur le territoire d’une colonie de plantation, et dans un journal, il semble
appeler à un changement de point de vue sur le marronnage, et gagne alors une portée
idéologique nouvelle. De la même manière, sa parution en recueil anesthésie une éventuelle
vision politique : entre « Un soir de mai au bois de Boulogne » et « La campagne après une nuit
d’orage », le poème n’est jamais, et c’est aussi un changement fondamental, que le « Souvenir
d’une nouvelle américaine », comme le précise le sous-titre : tous ces éléments convergent vers
une autobiographie poétique. À l’inverse, une fois le sous-titre disparu, sa parution dans une
publication périodique, au milieu de textes qui construisent l’identité coloniale et traitent de
l’esclavage comme d’une réalité, le constitue en partie prenante de cette identité : d’où une
vigueur différente dans le texte. Peut-être aussi le geste n’est-il pas idéologiquement si chargé,
quand bien même la disparition du sous-titre ôte la référence trop clairement littéraire : lu par
des coloniaux, le texte peut simplement leur évoquer la littérature contemporaine, les récits de
Chateaubriand – Les Natchez est paru en 1827 – au premier chef. L’on se retrouve ici face à
une forme d’énigme de la réception : aucun courrier dans le journal ne signale une indignation
ou des reproches. Il nous reste donc un texte dont le changement de signature prouve néanmoins
32 Charles Dovalle, Poésies, Paris, Charpentier, 1868.
406
que le périodique réunionnais veut intégrer ce qu’il publie à une forme de « local », et semble
tenir à donner à ses auteurs une origine réunionnaise, ou en tout cas à ne pas montrer
l’exploitation de textes métropolitains ; il nous reste aussi le témoignage d’une pratique de
publication qui correspond assez à la désinvolture coloniale qui constitue une partie des
pratiques médiatiques. Les journaux insistent sur leurs publications non autorisées ou en retard,
coupent parfois les textes, les commentent diversement, plagient certaines publications ou
affichent volontairement une distance critique face aux traditions indigènes. Un détachement
revendiqué par les rédacteurs apparaît face aux règles métropolitaines ainsi que face à tout
contenu qui n’est pas européen : de là une identité textuelle véritablement pensée comme un
entre-deux.
La lettre : l’expérience comme modèle esthétique La forme de la lettre se prête, dans le cadre médiatique, à plusieurs genres médiatiques
dont elle est l’ancêtre : la correspondance politique et le reportage de guerre en sont les deux
principaux représentants. Le journal publie également les lettres publiques, les récriminations
et les plaintes d’abonnés, voire les querelles entre journalistes ; et dans la presse métropolitaine,
les colonies sont souvent traitées par la forme épistolaire : ainsi Ismaÿl Urbain décrit-il l’Algérie
pour les lecteurs du Temps dans les années 1840. Qu’en est-il alors de l’écriture épistolaire dans
la presse coloniale ? Elle apparaît fondamentale, signalant la distance à la métropole et
matérialisant les liens entre les différentes parties du territoire local : son omniprésence dans
les écritures médiatiques coloniales et son caractère protéiforme en font l’un des points de
repère de l’entourage des textes. La lettre est l’objet écrit autour duquel gravite tout un
imaginaire colonial : elle permet de créer un jeu avec le lecteur du périodique, de marquer ce
qui est proche et ce qui est lointain, de s’adresser au rédacteur autant qu’à un lectorat large…
Lettre fictionnelle, lettre de reportage, lettre publique ou compte-rendu théâtral : la lettre
comme support se prête aux utilisations coloniales et à la révélation d’une identité propre aux
colonies, identité littéraire qui part de l’expérience et l’érige en véritable modèle esthétique. La
lettre permet l’authenticité, ou du moins le jeu avec l’authenticité : c’est également ce principe
d’écriture qui intéresse les publicistes coloniaux. Quand la lettre est utilisée dans le cadre d’une
fiction, l’on retrouve, convention réaliste oblige, la précision de cette authenticité et une identité
qui joue de plusieurs sources. Ainsi d’un article de 1848 paru dans L’Écho d’Oran où les
parenthèses signalent la voix du narrateur, distincte de celle de l’épistolier, dans un dernier
mouvement : « (Ici la lettre se trouve tellement barbouillée qu’elle devient indéchiffrable. Tout
ce que nous parvenons encore à lire, c’est un tendre adieu à Anastasie, et la promesse de lui
407
écrire le plus tôt possible, In cha allah33) ». La déclinaison de la lettre comme support à des
réalisations coloniales peut se poursuivre en explorant les autres possibilités épistolaires : une
forme de proto-reportage apparaît avec les lettres publiées par le Moniteur algérien dans les
années 1840 et qui rendent compte d’une entrevue avec Abd el-Kader :
1ère lettre Camp de Sour-el-Ghozlan (près les Ouennogha), le 19 novembre 1837 « Vous avez vu sans doute chez tous les marchands d’estampes une lithographie qui représente un mulâtre à la face cruelle et au regard sanguinaire, couvert de riches vêtements et de riches armes ; vous avez lu au bas : Abd-el-Kader, et dès-lors, vous et moi et toute la France, nous nous sommes fait une idée de ce chef arabe. Jugez donc de mon étonnement par le portrait que je vais vous tracer de l’Émir, auquel j’ai été présenté et que je vois chaque jour depuis un mois34.
Dans les années 1860, la lettre est devenue publique : elle sert d’éditorial ou de billet
d’humeur, et dans le cadre colonial elle permet de donner un point de vue précis, celui d’un
habitant, qui s’adresse à tous en jouant de son statut particulier. Publier une lettre dans la presse
coloniale revient à jouer de la particularité du support pour multiplier les possibilités de
réception, à l’exemple de ce qu’on peut voir dans l’extrait suivant :
Mon cher Vallée, J’ai reçu ce matin votre journal d’hier 15, ce qui prouve que la
poste du Moule fonctionne pour le moment à mon égard du moins, irréprochablement ; ce qui prouve aussi qu’il est bon de réclamer quelquefois !...
Votre causerie, si gaie dans la forme et si sérieuse dans le fond, m’arrive au moment où je fais mes paquets pour aller prendre quelques jours de repos à la Guadeloupe. Je me priverai du plaisir d’aller vous voir en passant, parce qu’on m’a assuré que votre abord est très difficile et que pour être admis en votre présence il faut des autorisations que je ne veux pas solliciter.
Je ne traverserai donc la Pointe-à-Pitre sans m’y arrêter ; j’ai hâte d’aller entendre chanter le rossignol dans les grands bois du Piton.
Quoi ! le rossignol ! Certainement beaucoup de créoles seront étonnés d’apprendre que le rossignol existe dans leur pays. Moi-même je l’ignorais il y a deux ans. Mais il m’est arrivé, étant à Sainte-Rose, à cette époque, d’être éveillé par un chant que je crus avoir entendu en rêve ; c’était le chant du rossignol tel que je l’avais entendu dans les belles soirées du printemps en France. J’écoutais, ravi, ces modulations harmonieuses, quand par la fenêtre entrouverte, s’introduisit sans façon dans ma chambre le chanteur ailé, puis il sortit et se posa sur un arbre dont les branches touchaient la fenêtre et recommença ses roulades. J’eus le temps de bien l’observer et de bien l’entendre : c’est le même rossignol que celui de France et il a le même chant. Seulement il est plus petit et sa voix a moins d’étendue, mais par contre il est beaucoup plus familier, puisque tandis qu’en France on n’entend le rossignol que de loin, dans les calmes soirées du printemps, ici, à la même époque, au mois de mai, il vient chanter sous vos fenêtres et pour peu qu’elles soient ouvertes, il entre jusque dans votre chambre.
33 « Lettre d’un voyageur », L’Écho d’Oran, 21 novembre 1848. 34 Le Moniteur algérien, 5 février 1844.
408
Ceci me rappelle un sot proverbe qui a cours en France : il y a dit-on aux Antilles de jolis oiseaux qui ne chantent pas, de belles fleurs qui n’ont pas de parfums et de charmantes femmes qui ne parlent pas ! Tel est le dicton que j’ai souvent entendu et contre lequel je proteste aujourd’hui avec connaissance et cause 35.
Partant de l’expérience sensorielle du rossignol, l’épistolaire aboutit à une confrontation
entre la métropole et la colonie, et il a ainsi amorcé son article qui porte sur le suffrage universel.
La lettre apparaît bien alors comme le modèle d’une société coloniale qui se situe au croisement
de plusieurs influences (la France, les Antilles) et qui vise, comme un leitmotiv, l’authenticité
d’un vécu comme principe de rédaction. Dans ce premier exemple, la lettre est publique, et c’est
son contenu qui la rend coloniale : l’on retrouvera le même principe dans d’autres utilisations.
Le courant du siècle complexifie encore les usages médiatiques de la forme épistolaire : un
article réunionnais présente la chronique théâtrale sous une forme originale, tenant de la
causerie autant que de la lettre, et jouant là encore, pour inaugurer le propos, de la distance à la
métropole.
Saint-Pierre, ce 15 décembre 1873 Mon cher ….
Mon séjour à la Martinique s’est propagé au-delà du terme que j’avais fixé, et les deux mois que j’ai passés dans cette île m’ont mis à même de recueillir sur les mœurs coloniales mille détails piquants dont je t’ai déjà transmis une partie dans mes précédentes lettres, et que je compléterai de vive voix quand je reprendrai avec toi cette bonne petite vie parisienne que ne peuvent réussir à me faire oublier les attraits de mes pérégrinations. Je vais aujourd’hui t’entretenir du théâtre de Saint-Pierre que je suis assez assidûment depuis environ dix semaines. Tu t’attends probablement à ce que je t’en conte des merveilles, car tu n’as pas oublié, n’est-ce pas, les tableaux enchanteurs qui nous étaient faits par ces braves créoles que nous rencontrions à notre cercle ; pour eux, l’Opéra et les Italiens n’avaient été que désillusion ; la Patti n’était rien à côté des cantatrices martiniquaises, et nous nous demandions comment le Directeur de l’Opéra pouvait s’arrêter à ne recruter ses sujets qu’au Conservatoire, quand il était si facile de recourir aux colonies françaises pour se procurer des étoiles de première grandeur. Je dois dire, mon ami, qu’il y a passablement à rabattre de ces prétentions ; mais le plus plaisant de l’affaire, c’est que nos excellents intertropicaux sont plus difficiles pour leurs artistes qu’ils ne l’étaient pour les nôtres ; ils parlent ici de Paris comme ils nous parlaient là-bas de Saint-Pierre ; rien n’est supportable, tout marche de travers ; ils critiquent, sifflent, interpellent, gesticulent, se démènent, et la vérité est que, si le théâtre local n’est pas précisément l’Opéra, il est à coup sûr supérieur, comme ensemble de troupe, à ceux des villes de province d’une égale population36.
Le destinataire ici n’est pas le rédacteur, et pourtant la lettre n’est pas fictionnelle (au
sens où elle ne produit pas une mise en intrigue, mais bien le jugement d’une réalité
35 É. de Poyen, « Mon cher Vallée », L’Avenir, 29 mai 1866. 36 Paul, « Lettres d’un voyageur », Le Propagateur, 17 décembre 1873.
409
coloniale) : dans cet entre-deux que permet le journal, la lettre vaut bien pour l’ouverture aux
discours autres qu’elle permet. Donner à entendre un point de vue métropolitain censé émaner
d’un particulier est une manière d’ouvrir les colonnes du journal, et encore cette critique initiale
n’est-elle que le prétexte à une critique théâtrale : le genre choisi relève d’une forme de
paravent, de captatio benevolentiae si l’on veut emprunter les outils de la rhétorique.
Des glissements génériques peuvent se produire, témoins d’une instabilité du modèle
épistolaire et de la contamination que subit la lettre quand elle est plongée dans un
environnement médiatique : en 1865, la correspondance du soldat Pitouchet est affichée comme
un élément récurrent de L’Indépendant de Constantine, mais le personnage se révèle ensuite le
protagoniste d’un feuilleton qui court sur plusieurs numéros. Pitouchet devient complètement
personnage et non plus auteur, aventure qui n’est pas sans rappeler ce qui était advenu à Mme
Gillain en Guyane. Seulement ici, Pitouchet dès le départ est sans doute une signature
fantaisiste, et le changement de texte interroge aussi une manière d’écrire proprement coloniale.
L’autre fois, cher monsieur, vous avez témoigné, devant certains amis de Pitouchet, le vœu d’obtenir de lui quelques lignes plus sérieuses que sa petite correspondance algérienne.
Nous lui avons transmis votre désir ; mais Pitouchet est modeste ; ce qui pourtant n’est pas l’ordinaire défaut de ceux qui se laissent imprimer. Enfin, Pitouchet est modeste, que voulez-vous ? … cela passera. Donc, nous avons essuyé un refus formel de nous donner le plus petit feuilleton.
Néanmoins, nous avons résolu de lui en arracher un malgré lui. Notre ami est l’homme de l’anecdote, et, entre deux verres d’absinthe, nous avons saisi ce qui suit, au col, avec ou sans calembour, à votre choix.
L’émeraude du stimulant liquide colorait le cristal de nos verres, lorsque Pitouchet commença en ces termes : I. Ah ! vous n’étiez pas là, en 52. Eh bien, moi, j’y étais. Ce fut une année fertile en événements que celle-là !... De janvier à décembre, chaque mois a fourni les siens.
Il ne faut pas vous imaginer que la colonie en était arrivée où elle en est à présent ; bien des fortunes commençaient, qui sont achevées aujourd’hui, et bien des négociants, qui deviendront peut-être demain des bourgeois millionnaires, n’en étaient encore qu’à l’alpha de l’a, b, c, de leurs spéculations commerciales.
Les mœurs étaient plus gaies, le théâtre de Sétif était couru par toute la fashion militaire, et la belle et brune Adelina, grand premier rôle de femme, était parvenue à se faire protéger ouvertement par un officier très-supérieur, dont le drapeau n’avait alors qu’une couleur libérale.
Hélas ! le temps a fui, et l’actrice et le drapeau ont perdu de leurs couleurs, puis l’officier est mort bien malheureusement37.
37 Henry Mac-Nathan, « Souvenirs de Pitouchet – 1852 », L’Indépendant de Constantine, 28 novembre 1865.
410
L’oralité affichée par rapport à la correspondance écrite est en effet intéressante : elle
révèle un changement de paradigme dans la perception du personnage de ce soldat, « homme
de l’anecdote », et de sa capacité à mieux incarner la colonie à l’oral. C’est par lui que passe
l’histoire de la colonie, enjeu fondamental comme on l’a vu de l’écriture coloniale – enjeu
fondamental également de l’écriture postcoloniale. La suite du texte est révélatrice elle aussi du
travail d’écriture, le tout dans le même numéro et donc au cours du même feuilleton :
Pitouchet, après avoir humecté ses lèvres, reprit ainsi : Le lieutenant-colonel de Wengis, appartenant à l’état-major, partit le premier avec quelques sapeurs du génie pour frayer la route. Je ne l’ai jamais revu. […]
Alors commença une retraite à la file indienne, comme disait Gustave Aymard, silencieuse et horrible. Marche qui heurtait des agonisants au milieu de ravins pleins de neige, dans lesquels nous avons précipité nos canons encloués, le trésor et les cantines des officiers38.
La conservation du périodique rend le récit incomplet, mais le feuilleton qui se poursuit
toujours avec la voix narratrice décrivant Pitouchet le fait voir à Constantinople ensuite, soldat
des guerres de Crimée, et raconte sa passion amoureuse pour la belle Paméra : la colonie a donc
joué le rôle de point de départ d’un récit qui a ensuite rejoint le canon littéraire des récits
d’aventure. Cette transformation double, fondée au départ sur le personnage du soldat, montre
l’inventivité d’une écriture médiatique qui sait s’épanouir à partir des inconvénients de la
colonie39. Cette écriture fragmentaire et épistolaire sera celle de Pierre Loti dans Aziyadé, mais
aussi de la littérature qui se revendique comme coloniale : dans Totia, roman colonial de Jean
Box, paru en 1909, après une première partie de narration omnisciente, la deuxième partie passe
par les lettres d’une jeune fille – l’héroïne – à sa grand-mère. Le sous-titre générique, cette
insistance sur le « roman colonial » dit assez à quel point l’auteur se revendique d’une écriture
particulière pour que ce trait soit, dans son esprit, consubstantiel à la colonie40. C’est que ce
38 Id. 39 Dans la même perspective d’une forme de travail effectué à partir de l’écriture épistolaire médiatique, les lettres à vocation humoristique et parodique prouvent la vitalité du modèle et sa capacité à être le lieu d’une connivence, même si elles ne sont pas nombreuses. L’on peut citer les « Lettres d’un zéphir à Flore » parues dans L’Avenir le 2 avril 1859, signées « Zéphir Mazagran » et par lesquelles on comprend l’histoire d’un soldat parti d’Algérie pour Pointe-à-Pitre après s’être battu ; la lettre d’un Émile à sa femme Éléonore, lui resté à la plantation, elle en ville (« Ma Chère Éléonore », L’Avenir, 16 août 1867). Quelques spécimens de lettres déformées par les accents apparaissent aussi, mais là encore tiennent davantage le rôle de l’anecdotique plus que du significatif : ainsi de la correspondance particulière du journal satirique Le Siroco, présentée sous la forme d’une lettre signée « Mistraou », et écrite avec l’imitation graphique d’un accent marseillais (voir par exemple le numéro du 13 octobre 1866). Autre forme, plus locale et plus tardive : Z., fils de Dennoun, « À M’Siou li Director di Courrier di Oran », Le Courrier d’Oran, 8 avril 1881. 40 Jean Box, Totia. Roman colonial, Bruxelles, Lacomblez, 1909. Ce fonctionnement épistolaire se retrouve ensuite dans la littérature du tournant du siècle : la lettre reste l’une des ressources narratives pour faire comprendre l’éloignement et l’authenticité du discours tenu. En outre, il y a un aspect didactique non négligeable dans le fait
411
modèle doit paraître respecter une forme coloniale par excellence, illustrant dans le texte même
les rapports entre les coloniaux et la métropole, la distance et les liens affectifs : sa présence au
sein du journal va dans ce sens. Cette compréhension de la lettre comme modèle d’écriture nous
invite à nous pencher sur la question du pacte de lecture, qui peut-être davantage encore que le
contexte de parution permet de comprendre les textes coloniaux médiatiques dans leur
spécificité.
1.2 Un pacte de lecture : modèle de narration et lectorat
À la lumière du rapprochement que l’on peut effectuer entre la littérature médiatique et
la littérature postcoloniale en ce qui concerne l’importance de leur environnement, l’on peut se
demander si ces deux corpus n’engendrent pas, alors, un pacte de lecture particulier. Dans les
deux cas, le rapport aux lecteurs est en effet guidé par une exigence de confiance, un
engagement de l’auteur dans son rapport au lecteur : il s’agit de revendiquer auprès du lecteur,
pas forcément la vraisemblance, mais la vérité du propos. L’auteur postcolonial se charge de
guider son lecteur, de lui révéler des parts d’une histoire cachée jusqu’alors ; l’auteur
médiatique colonial revendique aussi ce lien au lecteur, mais en le doublant d’une revendication
qui engage sa responsabilité en tant qu’artisan de l’écriture. L’on peut dans un premier temps
s’arrêter sur le pacte de lecture que met en place l’écriture médiatique coloniale. Ainsi, un
journaliste colonial salue dans l’une de ses chroniques ses lecteurs qui ont eu « le courage de
lire les vers tudesques et la prose othaïtienne de nos poètes et de nos faiseurs coloniaux41 » : le
« faiseur colonial », même si l’expression est péjorative et humoristique, témoigne d’une
appréhension de la littérature insistant sur le travail presque artisanal qui explique la littérature
médiatique coloniale. Dans la même perspective, et sous la plume du même auteur, la mention
d’un « poète colonial42 » est certes moins imagée, mais porte tout de même en germe l’idée
d’une littérature définie par l’identité coloniale : l’adjectif n’est pas si anodin. Le fait que
l’auteur de ces expressions soit réunionnais n’ôte en rien la particularité d’une désignation qui
insiste, non pas sur le territoire local, mais sur la condition et la qualité des écrivains, partant
sur la manière dont le lecteur leur est relié, et sur la spécificité de ce lien. L’on peut étendre
cette réflexion à des mécanismes plus généraux en reprenant, dans un premier temps, l’article
de Matthieu Letourneux. Quand il analyse la manière dont Le Journal des Débats publie sur le
d’adresser une lettre à un correspondant éloigné, et qui donc ne maîtrise pas les codes et coutumes du nouveau territoire à partir duquel on écrit. 41 H. Vignerte, « Revue et chronique de Saint-Pierre », L’Avenir de la Pointe-à-Pitre, 19 novembre 1843. 42 Ibid., 22 novembre 1843.
412
même fil des récits dont le rapport à la réalité varie pourtant, il écrit que « dans le cas du Journal
des Voyages, il n’y a pas seulement contiguïté, mais ambiguïté et contagion des formes, et
surtout contagion des pactes de lecture43 ». Cette remarque est valable pour bien des périodiques
coloniaux de notre corpus : chaque article du journal modifie le pacte de lecture, et le feuilleton
ne marque pas forcément le décrochement entre un texte fictionnel et son entourage informatif.
Les variétés peuvent contenir des textes fictionnels ; les signatures peuvent obscurcir la
référentialité du contenu. Plusieurs modèles permettent donc de comprendre le lien entre
l’auteur et le lecteur tel que le journal colonial l’établit, et en premier lieu le rapport entre
l’écriture et le territoire. Mais le pacte de lecture tel qu’il s’applique dans la presse coloniale va
également chercher du côté des réécritures, des « parodies » au sens premier, des voix parallèles
qui sont censées être celles des auteurs coloniaux.
D’où vient l’auteur, de la presse au livre Dans la presse réunionnaise paraît en 1851 une revendication étonnante par sa
formulation rapide et par la confusion qu’elle instaure entre le territoire et la production
littéraire : « La terre poétique des bananiers peut être aussi la terre du drame44 ». Cette
expression montre pourtant bien comment, au XIXe siècle et particulièrement dans les colonies,
un territoire peut être défini par les textes qu’il « produit », comme si le genre littéraire relevait
en effet d’une particularité locale et que le poème, au même titre que le bananier, était une
production insulaire naturelle. Pourtant, dans ces types de remarque, les théoriciens de l’écriture
coloniale ne font pas l’économie de l’auteur ; ici, le journaliste colonial ajoute ensuite :
que d’aventuriers ont abordé nos rivages, que de combats sanglants se sont livrés sur nos mers, que d’aventures dramatiques se sont passées sur nos montagnes, que de cœurs ulcérés sont venus chercher le bonheur dans l’amour de nos vierges créoles, que de douleurs notre belle terre a consolées, que de voyageurs errants, que de fugitifs, que d’exilés, notre hospitalité a reçus dans ses bras !... Tout cela est une mine féconde qui n’attend que la main d’un habile ouvrier45.
Et il n’est pas le seul à mettre en avant, non seulement le caractère artisanal de l’écriture,
mais encore le lien étroit qui est censé unir le texte et la terre, dans une mythologie littéraire
reposant sur la territorialité et que le contexte colonial amplifie forcément. À l’énumération des
aventures données comme réelles correspond en effet toute une littérature d’aventures
réunionnaises : l’on pourrait faire coïncider une œuvre existante à chaque situation citée par
43 Matthieu Letourneux, art. cit. 44 Raffray, « De la presse à Bourbon depuis quarante ans », Le Bien-Public, 14 mars, 21 mars, 28 mars, 4 avril, 11 avril 1851. 45 Id.
413
Raffray dans l’extrait ci-dessus. Le souci d’affirmer le caractère extraordinaire de l’île participe
à la constitution d’un pacte de lecture offert aux lecteurs coloniaux : ils sont bien les témoins
de l’extraordinaire de l’île, qu’elle soit antillaise ou réunionnaise ; et cet extraordinaire ne se
limite pas à la poésie, donc, mais s’aventure également du côté du drame. C’est que l’arrière-
plan sur lequel se développe le pacte de lecture des anciennes colonies de plantation repose, on
l’a vu dans les parties précédentes, sur la prédominance de la poésie créole : Le Propagateur
montre ainsi, au cours des années 1860, comment le portrait positif d’une poétesse créole peut
aussi aboutir à la publication d’un « Essai sur les poètes créoles46 » paru en une. L’éloge de
Louise de Lafaye est en effet l’occasion d’une réflexion sur l’île « la plus littéraire et la plus
artiste des Antilles ».
Mme de Lafaye – Mlle Arbey, de son nom de famille, – est créole : elle est née à la Guadeloupe, dans cette île la plus littéraire et la plus artiste des Antilles, patrie du peintre Lethière et des poètes Léonard et Campenon. En général les colonies, c’est une justice à leur rendre – malgré leurs conditions d’existence si défavorables à l’Art – ont toujours jusqu’ici tenu à l’honneur de se faire une place dans la littérature de leur patrie et de fournir, pour ainsi dire, leur contingent à la noble conscription des intelligences. Elles sont ainsi presque toutes – à l’exception peut-être des îles anglaises – arrivées à produire de remarquables personnalités poétiques : Bourbon, outre les Bertin et les Parny du siècle dernier, compte aujourd’hui dans le monde des lettres un talent des plus élevés et des plus solides, l’auteur élégant et grave des Poèmes antiques, le peintre oriental des Éléphants et des Jungles, - M. Leconte de Lisle. Plus près de nous, Cuba se glorifie à juste titre, dans le passé, d’Hérédia et de Placido, l’un vice-roi du Mexique, l’autre pauvre mulâtre au doux nom et à la sanglante destinée, tous deux, en des rangs si divers, dignes émules des Garcilaso et des Ponce de Léon – et de nos jours mêmes, elle ne nomme pas sans orgueil Dona Gertrudis de Avellaneda, cette Mme de Girardin espagnole, et don Guell y Rente, le sentimental auteur des Larmes du cœur, ce simple mortel qui triompha par l’amour de l’orgueil dynastique, et eut l’honneur, assurément rare, d’une alliance princière47.
Cuba, les Antilles et Bourbon sont donc des territoires placés sous le même signe de la
poéticité ; la pique contre les colonies anglaises rappelle seulement le contexte de concurrence
impérialiste, mais ne parvient pas à cacher l’idée selon laquelle le territoire insulaire et créole
commande un certain type de littérature, ici la poésie. L’on trouvera cette idée ailleurs : ainsi
de la présentation que fait Le Messager de Tahiti de l’un des auteurs qu’il publie.
Un homme qui a obtenu à la pointe de la plume le titre de poète de la Californie, M. Pierre Cauwet, arrivé tout récemment à Tahiti à bord du transport de l’État Euryale, a adressé à l’équipage de ce navire les couplets suivants, que nous insérons dans les colonnes du Messager
46 « Essai sur les poètes créoles », Le Propagateur, 20 novembre 1869. 47 J. Elsey, « Une créole poète. Mme de Lafaye », Le Propagateur, 10 octobre 1863.
414
comme un début heureux à des poésies que notre sol fertile et notre climat élyséen ne manqueront pas d’inspirer48.
La publicité donnée au poète « californien » et les espoirs exprimés à la fin de la
présentation expriment l’adaptation qui caractérise, elle aussi, l’image que l’on se fait de
l’écrivain colonial sur les territoires dont l’occupation est alors relativement récente, et où l’on
ne peut encore désigner une population créole. Si cette idée n’est pas exprimée clairement entre
les lignes des textes, elle peut se réfugier dans d’autres aspects des parutions médiatiques. Ainsi,
dans les territoires créoles, les pseudonymes affirment le rapport à la terre comme première
entrée dans le monde médiatique : le « Grandfonnier » ou « l’Hermite de la Case-Pilote » sont
des chroniqueurs qui se définissent par leur ancrage local. En Algérie, plus que les signatures
spirituelles, c’est dans les introductions que se réfugient les identités territoriales des auteurs :
Nous terminons aujourd’hui la deuxième partie du roman en cours de publication Frère Jacob par M. É. de la Primaudaie. Nous donnerons prochainement la fin de cette intéressante chronique. En attendant, nous commencerons, dès notre numéro de jeudi, la publication d’une nouvelle inédite, Les Horace, dont l’auteur, de même que celui de Frère Jacob, est un habitant d’Alger49.
Roman, chronique, nouvelle : si les identités génériques importent peu, c’est qu’elles
sont subsumées par cette appartenance territoriale de l’auteur. Si dans les représentations
médiatiques le territoire conditionne des productions, transformant alors l’auteur en point de
passage et non en producteur original d’un texte littéraire, il faudrait se poser la question des
productions littéraires antérieures à la colonisation. L’on a vu que quelques genres sont
reconnus à des territoires particuliers : le conte arabe, le chant tahitien, voire dans une autre
mesure la fable créole sont ces littératures premières que le journal reconnaît
occasionnellement. Mais il est d’autres cas où la littérature locale n’apparaît que
fugitivement ; lorsque dans la « chronique locale » néo-calédonienne il est question du décès
d’une jeune princesse peinte comme une grande chanteuse, le journaliste conclut que « le vide
qu’elle a laissé dans la littérature de son pays est déjà plus que comblé50 », avec une ironie qui
laisse assez à penser la qualité attribuée à la culture kanak : les seuls auteurs autorisés sont bien
les coloniaux. Enfin, dernier cas qui montre comment le pacte de lecture médiatique et colonial
circule, un recueil comme Les Veillées du Tropique montre la proximité entre le livre et la
presse. M. Poirié de Saint-Aurèle publie en effet en 1850 Les Veillées du Tropique ; il est
présenté ainsi sur la page de garde : « M. Poirié de Saint-Aurèle (de la Guadeloupe), auteur des
48 Le Messager de Tahiti, 6 juillet 1867. 49 Le Moniteur de l’Algérie, 12 janvier 1862. 50 « Chronique locale », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 20 septembre 1871.
415
Veillées françaises, du Flibustier, etc51. ». Dans un avertissement, en outre, l’auteur précise
qu’il a écrit pendant une période de maladie, en Guadeloupe, les textes qui composent le recueil.
L’appartenance territoriale ainsi marquée donne une origine au discours qui ne se retrouve pas
dans tous les textes, poèmes souvent religieux ou moraux sans « couleur locale » ou précisions
quelconques. Quelques fragments cependant exploitent l’ancrage local annoncé au
lecteur : « La Veillée des Nègres. Ballade », met ainsi en mots la supposée prise de parole d’un
esclave pour la femme qu’il aime. Après plusieurs strophes d’abord de cette parole autre, y
compris une note de bas de page explicitant une croyance, c’est le poète qui reprend le
texte : « Parmi les noirs enfants de la race africaine, / Ainsi retentissait la nouvelle chanson, /
Et le bruit du tambour se distinguait à peine / Dans le grand unisson52 ». Le récit en vers est
celui du chanteur initial : une histoire de rivalité amoureuse qui est aussi faite d’apparitions
magiques et terrifiantes. Un autre texte, « Patria », est dédié à Xavier Eyma, et met en vers la
concurrence des récits patriotiques français et des contes noirs, vaudous et marrons de l’enfance
du poète. Cette première opposition, littéraire, se redouble d’une opposition entre la
Guadeloupe et Paris qui structure le texte et revient comme un leitmotiv. L’on voit donc que le
pacte de lecture qui régit les écritures coloniales, et ce dès les publications médiatiques, fait
entrer en ligne de compte l’origine locale de l’auteur, et le rapport qu’il est censé avoir avec le
territoire colonial.
De la presse coloniale au récit de voyage : une transformation du pacte Ce pacte de lecture qui régit la presse coloniale en insistant particulièrement sur le
territoire à partir duquel l’on écrit a des antécédents, ou du moins des voisins : la littérature de
voyage est l’un de ces ancêtres et voisins en même temps, et son rapport à la réalité influence
les écritures coloniales, jusqu’à se constituer parfois en jeu d’écho. Ainsi, dans La Feuille de la
Guyane française, la relation avec les Indiens est un enjeu dont les textes – et leurs
titres – rendent le caractère problématique : d’un article expliquant « Nos relations avec les
nègres et les Indiens du Maroni53 » à un « Voyage chez les Indiens de la Guyane54 », un léger
glissement s’opère, qui semble dans le deuxième cas plus ouvert à un lectorat métropolitain, ne
serait-ce que parce que les coloniaux considèrent plus facilement être chez eux que chez les
Indiens. La formule est plus neutre, et promet plus de récit que pour le premier titre, davantage
51 Poirié de Saint-Aurèle, Les Veillées du Tropique, Paris, Perrotin et Furne, 1850. 52 Ibid., p. 251. 53 Sibour, lieutenant de vaisseau (Revue maritime et coloniale), « Nos relations avec les nègres et les Indiens du haut-Maroni », La Feuille de la Guyane française, 4 mai 1861. 54 A. Delteil, « Voyage chez les Indiens de la Guyane », La Feuille de la Guyane française, 27 mai 1871.
416
technique et informatif. Et il est vrai que le récit d’Arthur Delteil a pour première ambition de
raconter le voyage d’un homme qui ne connaît pas la Guyane : c’est sur ce texte que nous allons
maintenant focaliser notre attention, parce que sa parution double permet une comparaison
instructive sur les modalités du pacte de lecture colonial. Ce même récit est d’abord publié,
donc, dans La Feuille de la Guyane française, et par la suite il paraît en recueil chez un éditeur
nantais. Sans que nous ayons d’informations particulières sur le pourquoi de ce trajet éditorial,
notons pourtant que Nantes est un ancien port négrier – le premier au XVIIIe siècle – et une
ville atlantique ouverte vers les colonies : cela suffit à expliquer le lieu de parution. Plus
largement, la publication du voyage d’Arthur Delteil en Guyane est caractéristique des
modifications que peut subir un texte entre deux supports : comme premier indice, remarquons
que dans le périodique où il paraît en 1871, le récit est introduit par un mot du rédacteur qui
précise que l’auteur est « chef du service pharmaceutique » à la Réunion. Le statut de l’auteur
étant ainsi éclairci, et son écriture autorisée dans le cadre colonial, le texte commence alors par
l’évocation des motifs familiaux qui ont conduit l’auteur à voyager :
À la suite de l’assassinat commis par un métis brésilien sur un de mes oncles, qui vivait depuis plusieurs années au milieu des tribus indiennes, presqu’au centre de la Guyane, mon beau-père se trouva dans la nécessité de se rendre sur l’établissement jadis occupé par son malheureux frère, afin de recueillir les quelques restes de son modeste héritage. C’était un long et pénible voyage à entreprendre ; il fallait au moins huit jours d’un canotage difficile et périlleux pour remonter les sauts et les rapides qui forment des barrages dans le haut des rivières de cette partie de l’Amérique.
Je n’hésitai pas un seul instant à l’accompagner, considérant comme un devoir d’être à ses côtés pour partager les tristes et douloureuses impressions que ne manquerait pas de lui produire la vue des lieux où son frère avait passé ses dernières années et où s’était accompli le crime qui avait mis fin à ses jours. C’était en outre, pour moi, une occasion unique de visiter ces splendides merveilles de la végétation luxuriante des grands bois, dont la description des voyageurs les plus fantaisistes ne pourra jamais parvenir à peindre la majestueuse beauté. Et puis, j’allais pouvoir étudier, d’après nature, les mœurs des tribus indiennes qui ne se rencontrent plus que dans ces régions éloignées et presque inaccessibles, et voir de près ces premiers possesseurs du sol, dont l’ardeur belliqueuse avait jadis tenu bien souvent en échec les Européens qui s’étaient établis dès l’origine à Cayenne.
Une fois tous nos préparatifs terminés, nous partîmes par un beau matin du mois de septembre 1863, sur une goélette, fine voilière, qui faisait les voyages de Cayenne à Guisambourg, petit poste situé à l’embouchure de l’Approuague55.
En 1886, quand le texte est publié à Nantes, ces informations ont disparu : le voyage
apparaît comme un but en lui-même, et le récit commence précisément sur la goélette, pas
55 Id.
417
auparavant56. Ce que la publication en recueil a gommé, c’est donc l’actualité, le motif donné
aux lecteurs du journal et qui orientait la lecture dans une direction différente, prenant en
compte une forme d’aventure induite par la mention du meurtre initial. Le récit qui paraît dans
la presse coloniale est plus personnel, et offre plus de prise à la représentation du danger : la
mention du crime dès les premières lignes oriente le récit dans un autre sens que celui de
l’exploration. Il s’agit, dans le journal, de gagner une forme de légitimité par la justification du
déplacement : Delteil n’est pas alors un simple touriste, mais bien un colonial passé d’un
territoire à un autre pour des raisons familiales. Ce récit médiatique apparaît alors plus proche
du récit colonial que son équivalent en volume : l’on y retrouve l’exigence de lien avec le
territoire qui définit en partie une écriture coloniale et non une écriture touristique. Ouvrir le
récit sur la traversée en goélette, c’est au contraire donner prise au voyage avant tout, et non à
sa justification territorialisée ; si l’on a vu que le bateau et la traversée sont des invariants de
l’écriture coloniale, le motif du déplacement est souvent donné. Cette variation initiale confirme
alors l’idée que la presse coloniale refuse d’accorder trop d’importance aux récits de voyage, et
leur préfère des récits motivés par le lien avec la colonie. Le pacte de lecture médiatique était
établi sur une forme de ressemblance, ouvrant la possibilité d’une cooptation par les
coloniaux ; le pacte de lecture viatique s’appuie davantage sur la topique de la traversée
inaugurale, promesse de découverte à venir.
D’où le fait que, plutôt que de publier des voyages, l’on commente les voyages
anciens : c’est une autre manière de signaler la qualité accordée à ces récits d’auteurs qui ne
font que passer, mus par la curiosité et non par des motifs que la colonisation rend
légitimes : commerce, exploitation, expéditions scientifiques, affaires familiales. Il faut, pour
pouvoir commenter les récits anciens en tant qu’homme neuf de la colonisation, s’appuyer sur
un corpus suffisamment intéressant : c’est particulièrement le cas en Algérie, où les voyageurs
du passé sont traités selon un point de vue surplombant qui est celui du nouvel habitant. Ainsi
Henri Feuilleret critique-t-il le voyage de l’abbé Poiret dans La France algérienne57 ; ainsi
Adrien Berbrugger commente-t-il le voyage du docteur Shaw :
Le docteur Shaw nous a laissé une courte description de ces ruines qu’il désigne par le nom de Khadra (V. t. 1er, p.75 et 76). Ce savant anglais donne, dans sa 1ère édition (1738) – celle qui a été suivie par la traduction française – les deux nymies d’Oppidum Novum et de Zuccabar, laissant au lecteur le soin de se décider entre elles. Mais dans
56 Arthur Delteil, Voyage chez les indiens Galibis de la Guyane, Nantes, L. Mellinet, 1886. 57 H. F., « Étude sur les voyageurs en Algérie. L’abbé Poiret », La France algérienne, 21 et 31 janvier 1846.
418
sa 2ème édition (1757), faite après sa mort, on voit qu’il opte pour la dernière. L’avenir ne devrait pas confirmer ce choix malheureux58.
La mention du docteur Shaw est intéressante, parce que Berbrugger se montre comme
le correcteur du savant anglais, et qu’il révèle ainsi des bribes de sa bibliothèque. Dans cet
extrait, Berbrugger est en fait représentatif de toute une écriture coloniale : une description en
mouvement inaugure le texte, puis une mention des indigènes, confrontée immédiatement avec
une connaissance livresque ; enfin, l’apparition du narrateur qui revendique le « je » et une
posture de savant en recherche. On retrouve bien la polyphonie première par laquelle s’explique
le territoire algérien aux yeux des coloniaux : il ne s’agit plus pour eux que d’ajouter leur voix,
et de la faire si possible surplombante. Donner à lire ces deux phénomènes de publication de
voyages, l’un guyanais et l’autre algérien, résultant de deux postures différentes, permet de
donner une étendue supplémentaire au pacte de lecture colonial : les lecteurs prévus ne sont pas
les mêmes d’un support à l’autre, et la négociation de l’identité coloniale se joue dans ces
nuances que l’étude de la presse fait ressortir.
Alexandre Dumas lecteur de la presse coloniale La dernière modification que le changement de support, partant de genre littéraire, peut
apporter au pacte de lecture sera étudiée grâce au cas très précis d’une adaptation. Dans Le
Véloce, son récit de voyage que nous avons déjà cité, Alexandre Dumas commence l’un de ses
chapitres en expliquant son récit antérieur : « Pendant que j’avais pris dans le cabinet du général
Bedeau les notes que l’on vient de lire, Alexandre, Giraud, Desbarolles, Maquet et Chancel
étaient allés faire une cavalcade59 ». L’auteur se peint donc en lecteur attentif et consciencieux,
prenant des notes : mais sur quels documents, là est la question. Il vient en effet de développer
deux anecdotes concernant des spahis : deux cavaliers arabes combattant aux côtés des Français
dans l’armée d’Afrique ont retrouvé sur le champ de bataille, l’un son épouse, l’autre sa sœur,
toutes deux enlevées auparavant. Les scènes sont marquantes par l’intensité que Dumas y met,
et par la rupture que ces anecdotes constituent par rapport au récit de voyage ; précisant la
source authentique des récits, et refusant ainsi le statut d’auteur pour celui, plus modeste, de
copiste, le voyageur nous invite à nous demander quels documents il a pu recopier et ce que
l’on tirerait d’une comparaison entre les textes. Or la réponse se trouve dans une publication de
La France algérienne : un article y relate les mêmes anecdotes, avec la signature énigmatique
58 A. Berbrugger (Revue africaine), « À Duperré, la Khadra du docteur Shaw (vallée du Chelif) », L’Akhbar, 22 octobre 1858. 59 Alexandre Dumas, Le Véloce, Paris, Vve Dondey-Dupré, 1855, p. 424.
419
« A.D. » qui pourrait, à première vue, être celle de Dumas. Les différences entre les deux textes
inclinent à penser que le journaliste et le romancier sont deux personnes différentes, et ce
d’autant plus qu’A.D. signe au moins un autre article dans le périodique que l’on ne retrouve
pas dans les écrits de Dumas60. Dumas en outre n’ayant jamais fait allusion à sa collaboration
à un journal colonial, l’on postulera ici que les deux auteurs sont bien distincts ; et que les
écritures varient suffisamment, en tout cas, pour interroger le pacte mis en place avec le lecteur
dans le récit de voyage et dans le périodique.
Sur le bureau du général se trouvait donc le périodique algérien, ou un compte-rendu
plus officiel qui aurait été retravaillé par le journaliste d’un côté, et par Dumas de l’autre. Mais
quelques phrases à la ressemblance prononcée entre le texte médiatique et le texte viatique
laissent à penser que Dumas a plutôt consulté le journal algérien ; ce dernier en outre est d’une
bonne qualité, et ne déparerait pas dans les lectures d’un officier. Les dates confirment enfin la
généalogie probable du récit de Dumas : le texte médiatique est paru dans La France algérienne
du 10 septembre 1845, tandis que l’extrait du Véloce raconte un voyage fait entre novembre
1846 et janvier 1847, publié en 1848. Dans le pacte de lecture qu’il conclut avec son lecteur,
Dumas en tant que voyageur promet l’authenticité, et de fait il précise ses sources. Mais quelles
sont les modifications effectuées ? On trouvera en annexe les deux textes avec les passages qui
prouvent l’origine de l’écrit de Dumas ; quelques traits sont suffisamment importants pour être
traités ici.
Le premier personnage, Ali, est orthographié Aly chez Dumas : ayant reconnu sur le
champ de bataille sa sœur, il la libère. Dans le périodique algérien, il est écrit que le jeune spahi
reconnaît sa sœur, l’appelle et en profite pour aller jusqu’à elle ; chez Dumas, les cris du jeune
homme parviennent jusqu’à la jeune femme qui, voyant son frère, sort un poignard caché dans
ses vêtements et tue cavalier qui tient la bride de son cheval afin de rejoindre le camp adverse.
Cette transformation de la jeune femme en héroïne active n’a rien d’étonnant si l’on songe aux
héroïnes féminines de l’auteur de La Dame de Monsoreau ou de La Reine Margot : le poignard,
en outre, orientalise par un trait « sauvage » l’action féminine. Ce changement n’est pas le seul
opéré sur la matière pourtant déjà travaillée du texte médiatique, qui est loin d’être un texte brut
et administratif, même s’il est écrit tantôt avec un « nous » indiquant que
l’auteur – anonyme – appartient à l’armée, tantôt avec la mention de l’officier qui a rapporté
les faits, comme on le verra bientôt. Dumas, après cette première anecdote, continue : « un
60 Le 12 mai 1846, l’article « Un nouveau Gérard – histoire d’hier » est signé A.D.
420
instant après, on vit revenir un autre indigène ayant une tête accrochée à l’arçon de sa selle et
portant une femme entre ses bras, celui-là s’appelait Kédour ». Rien de tel dans La France
algérienne, où la transition se fait plus lentement, et de manière plus détaillée :
Vers la droite du point où cette scène se passait, un curieux épisode signalait aussi la charge bruyante des spahis. Un indigène de ce corps, jeune encore, d’une physionomie vigoureusement dessinée, mais portant l’empreinte d’une tristesse profonde à laquelle se mêlaient quelques éclairs de colère furieuse ou de haine implacable, allait devant lui en aveugle. Kadour (c’était son nom) labourait sans pitié avec ses éperons pointus les flancs de sa monture ; il l’animait de la voix et du geste, et le noble animal, bondissant sous son cavalier, courait en avant, effleurant à peine sous ses pieds les palmiers nains qui couvraient le sol61.
Alors que le publiciste insiste sur « l’œil flamboyant du spahis », sa physionomie
terrible et son courage, Dumas focalise son récit sur la tête coupée que le soldat ramène.
L’hypotypose travaillée du publiciste, avec force détails et implication du lecteur, devient chez
Dumas un récit rapide, enlevé. De la même manière, le voyageur néglige de réécrire le dernier
récit paru dans l’article de La France algérienne, et dont la liaison avec les autres anecdotes se
fait ainsi : « Pendant que ce drame faisait les délices des compagnons du spahis, un jeune
officier, celui dont nous tenons tous ces détails, poursuivait à outrance un cavalier ennemi ».
Ce duel entre l’officier et le Bédouin n’est pas relaté par Dumas, qui ajoute en revanche une
anecdote, celle d’un officier, le lieutenant-colonel Porey qui, ayant demandé à un indigène de
poursuivre des ennemis, le voit revenir avec des têtes coupées : l’insistance sur ce stéréotype
des combats algériens signale une forme de fascination de l’auteur pour ce trait là encore
« sauvage », brutal. L’officier mentionné comme source n’est a priori pas l’auteur premier d’un
récit que le publiciste et le voyageur auraient modifié : certaines phrases de Dumas, assez
travaillées, reprennent mot pour mot la version de La France algérienne, et il y a peu de chances
qu’il n’y ait là que coïncidence. Ainsi du passage, cité plus haut, sur les palmiers nains : « Alors
on vit le cheval de Kédour se cabrer sous l’éperon, puis bondir en avant, puis voler en rasant
les palmiers nains, qu’il semblait ne pas toucher des pieds », écrit Dumas. Une telle précision
dans les détails semble appartenir davantage au récit médiatique qu’au rapport militaire : même
si l’hypothèse n’est pas confirmée, il nous semble plus probable que Dumas ait donc écrit les
détails qui l’avaient le plus marqué dans sa lecture de La France algérienne, et que par la suite
ces notes aient généré son écriture. Une étude génétique des textes de Dumas permettrait de
61 A.D., « Bou Maza, l’homme à la chèvre », La France algérienne, 10 septembre 1845
421
discuter cette hypothèse ; du point de vue de la réception du texte, l’on peut s’en tenir aux
enjeux différents que révèlent ces deux écritures.
Le texte de Dumas insiste sur la violence indigène là où le publiciste du périodique
algérien fait jouer les ressources de l’héroïsation de ses personnages. L’écriture de la rapidité
dans un cas, de l’intensité dans l’autre, distingue le cadre de publication des textes : le
périodique se donne pour but de faire connaître l’Algérie à tous, y compris aux métropolitains,
dans le but du développement colonial ; Alexandre Dumas, quant à lui, écrit son voyage dans
une esthétique de la « couleur locale ». Il a ainsi employé le terme d’« indigène », ce que ne
faisait pas l’auteur du périodique algérien. Il a négligé l’invention poétique mise en place par
le publiciste autour des yeux :
À ce moment, je vous le jure, la physionomie du spahis [sic] était vraiment belle à voir : on pouvait facilement distinguer sur ses traits mobiles toutes les passions de son âme : le désir de la vengeance, la joie de retrouver sa femme bien-aimée, les tortures de la jalousie, les émotions du combat, s’y peignaient tour à tour. Aussi vite qu’un mot est dit, Kadour se rua sur son ennemi ; celui-ci ne put regarder sans pâlir ce visage effrayant d’expression ; il se trouva sans force pour la défense, et le farouche spahis [sic], le fascinant de son regard, l’attira brusquement à lui et sans sourciller lui trancha la tête62.
De ce passage Alexandre Dumas ne tirera pas une réécriture : le matériau de départ que
constitue ce texte, adapté au lectorat du journal, ne correspond pas assez aux critères du récit
qu’il est en train de construire. Plus largement, ces exemples montrent que le pacte de lecture
médiatique se comprend mieux par la comparaison avec les publications en recueil : souvent
objets de doubles publications, les textes médiatiques sont adaptés à leurs supports et à la
communication qui est propre à ces supports. Pourtant, la double publication n’est pas une règle
intangible, loin de là ; bien au contraire, quelques textes paraissent dans la presse dont l’on peut
souligner le caractère inhabituel, et qui peuvent ainsi éclairer ces moments où notre corpus
semble se refermer sur lui-même.
1.3 Une tératologie médiatique ?
Le journal colonial est le lieu de publications originales, et ce dans un double
sens : parfois originales car non reproduites ailleurs ; parfois originales car ne correspondant
pas à ce qui se publie alors, dans la presse comme en librairie. L’on parle ici de ces textes courts
62 Id.
422
qui échappent aux classifications génériques habituelles, des tentatives isolées de plumes
locales, des productions résultant d’influences diverses : toutes ces publications sont autant
d’expressions qui ne relèvent pas d’une pensée sérielle ou organisée. Le fait que ces textes ne
soient pas, dans leur majorité, publiés ensuite en recueils ou chez des libraires accentue encore
leur particularité : ils sont pensés pour le journal et pour son territoire, et c’est ce qui constitue
leur point commun le plus marquant. Les qualifier de « monstre » revient à isoler cette part de
leur identité littéraire : ils se démarquent du flux médiatique et constituent une galerie
représentative de ce que le journal a pu produire en contexte colonial. Ils émergent du corpus
comme des tentatives remarquables dont on peut chercher quelques traits communs : l’influence
d’un contexte particulier, la présence des histoires illustrées sont deux catégories à interroger
en particulier.
Le contexte, une source d’originalité Certains textes médiatiques provoquent une surprise réelle pour le lecteur
contemporain : soit qu’ils ne correspondent pas idéologiquement aux traits habituels de leur
époque de parution, soit qu’ils fassent preuve d’une inventivité poétique supérieure à ce qui a
été lu dans le périodique, ils permettent en tout cas de voir le journal comme un lieu de
publication à part entière. Des textes anonymes, courts, limités au journal, peuvent prétendre à
un statut littéraire par leur intensité, et cette intensité ressort d’autant plus par le contraste que
crée la page du journal avec d’autres textes. « Dans cette mosaïque de discours qu’offre le
journal, l’indexation générique est un facteur décisif pour reconnaître (ou dénier)
l’appartenance de tel ou tel texte à la littérature63 » : mais le journal colonial est méfiant face
aux tentatives littéraires, et il est même probable que les rédacteurs aient préféré masquer la
littérarité de certains textes, conservant ainsi une image plus sérieuse. C’est parfois par leur
insertion dans des séries médiatiques que certains textes voient éclater leurs particularités : si
Lechertier est bien un collaborateur régulier de L’Éclaireur de Cayenne, son texte sur « La
boule » est différent des autres feuilletons signés de sa main, parce qu’il y décrit véritablement
une scène, sans préoccupation d’une actualité ou d’une information pratique donnée à son
lectorat. Le texte n’est signalé que comme une variété, mais cette désignation vague abrite des
textes protéiformes, et présentant des qualités inégales. Il ne s’agit pas seulement d’une scène
destinée à introduire une réflexion politique, comme c’est souvent le cas dans ces écritures
médiatiques qui veulent tout à la fois distraire et débattre ; s’il y a des allusions politiques, elles
63 Corinne Saminadayar-Perrin, art. cit., p. 126.
423
ne sont pourtant que secondaires. Le ton y est toujours celui de la chronique, mais le sujet n’est
pas aussi colonial, aussi quotidien : et ce premier feuilleton, tout entier consacré à décrire cette
scène pourtant habituelle, apparaît pour ces raisons comme une forme d’hapax. C’est en tout
cas une manière de lire ces premières lignes :
La Boule ! Mot magique qui fait battre les cœurs, qui éveille les idées ; la boule ! Symbole d'espérance dans notre belle Guyane. La Boule ! Crie le négociant ; pour lui, les images qui se jouent autour d'elle, sont gros de ballots, de marchandises ; il y a des étoffes, des légumes dans l'air : vite ! Que l'on nettoie les magasins, que l'on prenne le visage le plus riant pour attirer les chalands. Caisse, réjouis-toi, la boule est l'image de la fortune64.
Cette description gratuite et étrange d’une scène coloniale, l’arrivée d’un bateau,
envisagée par la métonymie de la boule ; cette capacité à rendre burlesque ce moment important
par la superposition d’images ; cet appel enfin à l’inanimé de long en long, tout cela signale des
caractéristiques qui isolent le texte au sein de son journal, même si l’on prend en compte les
productions du même auteur. De la même manière et selon ces mêmes critères, le texte de L’Est
algérien déjà cité en première partie, le « Monologue du dernier des Arabes », mérite ici un
approfondissement : il n’appartient à aucune rubrique, ne s’insère dans aucune série, ne
revendique aucune littérarité – le « monologue » n’est pas même théâtral. Ce texte paraît sur
une colonne, rendant immédiatement perceptible sa structure hachée, marquée par de nombreux
retours à la ligne. Une posture romantique est adoptée ici, qui mise sur l’individu pour faire
valoir tout un peuple ; et pour conforter cette voix indigène qui parle pour tout un peuple,
l’article n’est signé que par un énigmatique tiret. Les premières lignes laissent percevoir un
discours fragmenté, ininterrompu : « …Voilà les ossements épars des derniers musulmans ! ʺIl
n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophèteʺ. Et ne pas pouvoir mourir comme
eux… La mort, c'est la fortune des vaincus65 ». Est exprimée ensuite la confrontation entre une
image positive du peuple colonisé et une image négative des colonisateurs : les « chrétiens »
sont mentionnés pour « la ruse et la dépravation de leur race » ; la colonisation est ensuite
décrite en quelques mots : l’ébauche des gens de loi est renforcée par un rythme ternaire
montrant qu’ils ne connaissent ni « [leurs] mœurs, ni [leur] religion, ni [leur] langue » et évoque
aussi les « prisons sans soleil » dans lesquelles est jeté le peuple colonisé. L’axiologie inversée
que l’on trouve ici par rapport au discours attendu est supportée par une rhétorique forte qui
légitime la dénonciation et lui donne une crédibilité pour le lecteur : la polyphonie du journal
64 Lechartier, « Variété », L’Éclaireur de Cayenne, 11 février 1849. Nous reprenons l’orthographe exacte du périodique, même si le nom correct est probablement Lechertier. 65 « Monologue du dernier des arabes », L’Est algérien, 4 décembre, 1868.
424
prend alors tout son sens, qui fait surgir une voix indigène et un point de vue divergent,
volontairement renversé, sur la colonisation. Mais pourquoi ce texte, pourquoi le faire paraître
en première page ? Est-ce une manière de défendre le royaume arabe ? Il apparaît peu probable
que ce texte ait été écrit véritablement par un indigène, pour des raisons pratiques autant que
symboliques. Cet article est publié dans les premiers numéros du journal : l’on peut parier qu’il
s’agit de frapper fort, de marquer un lectorat qui a déjà des périodiques à sa disposition, et
d’orienter clairement la politique éditoriale de ce nouveau venu dans le monde des « luttes de
la grande presse algérienne66 » que le rédacteur a mentionné quelques numéros auparavant.
Quelles que soient les raisons de cette publication, en tout cas, elle signale un espace de liberté
relatif, qui en empruntant une forme très littéraire permet de parler de politique : cette
subjectivité prétendue indigène et exprimée sur le modèle des litanies romantiques frappe bien
davantage le lecteur qu’un exposé de troisième page sur les méfaits de la colonisation. Cet
exemple algérien et son équivalent guyanais se retrouvent, non sur un plan thématique, mais
plutôt par l’inattendu qu’ils font entrer dans le cadre du périodique colonial : à chacun son
inattendu, selon les critères de la colonie et son identité ; en fait, selon ce contexte qui permet
de voir comment le journal a pu être le lieu d’émergence de certains hapax, sans antécédents ni
postérité, marquants par l’étonnement même que procure leur présence.
Les illustrations des périodiques : quand l’image parle
Quelques publications périodiques laissent aussi passer, davantage que des caricatures,
quelques histoires narrées par des images, ancêtres de bandes dessinées qui prouvent la
plasticité médiatique du siècle. L’un des cas, relativement connu à la Réunion, est « Le Voyage
de Monsieur Chose dans la mer des Indes » qui paraît dans La Semaine. Seul journal illustré de
l’île de la Réunion en 1862. Le journal, fondé par un Avignonnais qui est arrivé dans l’île en
1842, a été lancé en 1861, et est alors jeune. « Un ton facétieux […] le faisait tenir en haute
estime par les jeunes lycéens qui en raffolaient67 » : c’est ainsi qu’est présentée, dans un
ouvrage qui présente l’histoire de la presse à la Réunion, le journal ; dans le même texte apparaît
« la première histoire illustrée […] de l’île : Voyage de M. Chose dans la mer des Indes68 »,
cette publication qui se déroule du 24 juillet au 13 novembre. Dans notre perspective, son intérêt
réside principalement dans la manière dont elle présente la vie coloniale – ou plutôt l’aventure
coloniale. La première vignette du Voyage donne à voir une Mme Bovary au masculin et
66 Carle, « Aux lecteurs », L’Est algérien, 13 novembre, 1868. 67 Karine Técher et Mario Serviable, Histoire de la Presse à la Réunion, Sainte-Clotilde (La Réunion), Ars terres créoles, 1991, p. 33. 68 Id.
425
victime de l’exotisme plutôt que de l’amour, comme le précise la légende : « Les nuits, par le
vulgaire consacrées au sommeil, M. Chose les passait à lire l’Histoire des aventuriers et
flibustiers qui se sont distingués dans les Indes, ce qui lui donna la pensée d’aller chercher
fortune de l’autre côté de l’Océan ». Le globe, le portrait de Christophe Colomb dans un coin
de la chambre, le livre grand ouvert devant M. Chose : toute l’atmosphère est consacrée à
l’imaginaire colonial.
Le personnage, par la suite, se rend au Havre et se « déguise » en colonial pour réaliser
ses rêves d’exotisme ; embarqué comme mousse sur un navire, il a le mal de mer et est
maltraité par l’équipage : un décalage entre les images et la légende permet de donner au récit
un tour humoristique (« Son zèle et son aptitude lui méritèrent les encouragements du
capitaine… du maître d’équipage », etc.). Le trajet, passage obligé de toute représentation
coloniale, est donc traité par l’image et la dérision, renversant le récit du côté du burlesque et
inaugurant la série des échecs de M. Chose. Quittant enfin le navire sur les côtes de Bourbon,
le malheureux aventurier connaît alors des détails de la vie réunionnaise : mangé par les crabes,
piqué par les moustiques, il observe les noirs lire La Malle – petite pique d’un périodique à un
426
autre – et passe de ville en ville. La portée extrêmement locale du récit imagé se confirme de
vignette en vignette, jusqu’à une revue de presse et un éloge de La Semaine qui devait faire
sourire les lecteurs du périodique : la place accordée à la presse locale dans ce feuilleton imagé
affirme assez la portée locale de la publication.
M. Chose finit enfin par passer à Madagascar et épouser une jeune femme noire dont il
a un enfant, non sans avoir survécu à l’attaque d’un caïman : les vignettes décrivant la famille
de son épouse jouent du décalage entre les titres et la réalité, avec en arrière-plan un racisme
reposant sur les critiques d’imitation. Les légendes « Il le trouva méditant sur les destinées du
monde en général, et en particulier sur l’avenir de sa famille » puis « Au bruit des pas de M.
Chose, il s’empressa de se lever, passa son habit et lui dit ʺDonnez-vous la peine de vous
asseoirʺ » se rapportent ainsi au beau-père de M. Chose, et reprennent des stéréotypes racistes
anciens. Ce récit est intéressant à plusieurs titres, et l’image n’est pas le seul : l’évolution même
du personnage sert d’abord à expliquer un arrière-plan colonial répandu en métropole, et à
confronter ce personnage à la réalité coloniale. La connivence est permise par les situations
vécues par le personnage : de ce fait, l’histoire de M. Chose est sur le fil, à la confluence de
plusieurs sources et de plusieurs problématiques. On y lit, outre l’aspect local déjà souligné,
l’adaptation burlesque du récit d’une aventure coloniale répandue : rêver de voyage, partir,
427
s’installer et s’acclimater. Le motif du « nouveau débarqué » sur lequel joue fréquemment la
presse coloniale est ici réinterprété, et rendu plus vivace encore par les dessins ; apparaît
conjointement l’image du « décivilisé », et l’on sait que la presse coloniale est rapide à faire
passer un « nouveau débarqué » pas assez colonial pour un « décivilisé » qui est aussi, dans
l’idéologie de la colonie, un déviant.
428
Ce « Voyage », par l’humour qu’il instille dans la représentation des anecdotes
coloniales, rappelle d’autres récits par l’image, comme la « Conquête en Afrique69 » que
raconte en 1866 Le Chitann. On y lit les légendes suivantes : « Je ferais bien une expédition
avec cette colonne-là » ; « Attaque de la colonne » ; « La colonne s’est rendue » ; et enfin,
quand la jeune femme et ses enfants passent devant l’affiche qui annonce le « départ pour la
France », on lit enfin : « La colonne revient avec les fruits de l’expédition ». L’ironie palpable
dans le décalage entre le vocabulaire guerrier et la réalité amoureuse est l’un des classiques des
textes grivois ; mais le contexte de publication condense ces traits et rend ces vignettes
révélatrices d’une atmosphère d’époque. Là encore, c’est le détournement d’un des éléments
du discours colonial pris au sens large que l’on peut lire et voir : le discours idéal sur la
colonisation est confronté à une réalisation imagée qui montre cruellement la distance entre
l’imaginaire et la réalité de la colonisation. Le journal réunionnais jouait du mythe du nouveau
débarqué, le journal algérien se moque de la légende militaire : chaque périodique a repéré le
discours le plus répandu et utilisé contre lui les formules figées qui donnent une identité à la
colonie dont il émane.
69 « Une conquête en Afrique », Le Chitann, 12 avril 1866.
429
Ces deux exemples concernent deux territoires sur lesquels la presse locale est
particulièrement prolixe, et l’identité coloniale revendiquée : à des opportunités techniques se
mêlent donc des raisons idéologiques pour expliquer la mise en image, décalée et ironique, d’un
discours colonial que l’on devine omniprésent. Dans la publication réunionnaise, la
dévalorisation de l’indigène, traité par la dérision et le mépris, est visiblement l’un des attendus
du discours colonial sous-jacent : cela témoigne assez de la culture des colonies de
plantation ; le Chitann, quant à lui, arrive dans l’exemple que nous avons donné à ne se focaliser
que sur les éléments coloniaux du territoire. Pour ces récits dessinés, le terme d’« hapax »
s’avère un peu fort ; cependant, c’est bien d’une rareté qu’il s’agit au sein du corpus médiatique
colonial : les conditions techniques pour faire paraître ces illustrations indiquent que, même en
tenant compte des lacunes de la conservation, elles n’ont pas dû être nombreuses. Mais il est
temps d’élargir la perspective davantage, et de passer de cet aspect extrêmement fermé à une
perspective qui mette en relation le corpus médiatique colonial et d’autres corpus avec lesquels
il partage des traits. Cette première partie a exploré les micro-altérités qui sont celles du
journal quand il est envisagé en synchronie : parce qu’il est polyphonique et morcelé, le
périodique colonial développe une poétique médiatique et coloniale, sans qu’il y ait
contradiction entre les deux adjectifs. Mais une autre altérité, plus massive et plus déterminante
pour envisager le corpus, réside dans l’opposition entre le corpus médiatique et les corpus
littéraires : le livre comme support reste l’autre principal face auquel le journal colonial se situe
dans l’imaginaire de l’écrit colonial.
2 Histoire de connexions : d’un corpus à un autre
La presse coloniale est liée à d’autres corpus pour des raisons poétiques, thématiques ou
chronologiques : elle se situe dans un faisceau qui réunit plusieurs littératures caractérisées par
leur rapport à l’exotisme. La littérature postcoloniale connaît ce même type de
connexions : toujours située par rapport à d’autres corpus, elle est également définie par un
mouvement de comparaison, de contrastes. L’on peut préciser ces connexions : elles passent
par des personnages récurrents, par des transformations liées au support, par des catégorisations
qui se ressemblent. Dans ces corpus connexes, d’un point de vue chronologique, le roman
colonial apparaît comme le premier, et il se rattache aussi bien à la presse coloniale qu’à la
littérature postcoloniale ; objet particulier en littérature, il a pu être étudié malgré les difficultés
inhérentes à sa reconnaissance même :
430
L’aveuglante idéologie du chef-d’œuvre empêche, parmi d’autres raisons de nature politique, de se souvenir que la littérature française a possédé, elle aussi, une multitude d’écrivains dont les œuvres de fiction ont offert une Afrique romanesque imaginaire à deux ou trois générations de lecteurs70.
Comment définir la littérature coloniale ? Il ne suffit pas qu’un texte soit publié sur l’un
des territoires coloniaux régis par la France pour que le texte accède naturellement à cette
étiquette : appartiennent à la littérature coloniale les textes qui ont été reconnus comme tels par
les auteurs du mouvement ou par les théoriciens – les deux fonctions étant souvent liées71. L’on
peut en effet résumer les grands textes théoriques fondateurs ainsi : « la littérature coloniale
doit pour [Marius-Ary Leblond] se comprendre au sens étymologique : littérature
d’établissement dans un pays nouveau, qui devient peu à peu une référence identitaire72 ». Ni
littérature d’escale ni littérature fantaisiste d’après ses principaux théoriciens, la littérature
coloniale repose principalement sur le pacte de lecture proposé, et sur ce que le lecteur peut
savoir de l’auteur. L’une des définitions les plus précises et reconnues émane de Roland Lebel,
qui publie son Histoire de la littérature coloniale en 1931, chez Larose, dans une collection
intitulée « les manuels coloniaux », et qui s’est en effet spécialisée dans la « littérature »
coloniale, prise au sens premier de tous les ouvrages écrits concernant la colonisation,
appartenant à des disciplines différentes. C’est de Lebel, notamment, que provient l’idée d’une
évolution littéraire en plusieurs phases, passant de la « tradition exotique » (titre de sa première
partie) à la littérature coloniale à proprement parler. Il défend ainsi le point de vue selon lequel
« la littérature coloniale française ne date guère que du XIXe siècle et, plus précisément, de la
seconde moitié du XIXe siècle. Auparavant, elle se confond avec l’histoire de l’exotisme ; c’est-
à-dire que les écrivains coloniaux d’aujourd’hui ont eu des précurseurs dans notre littérature73 ».
En ce qui concerne les œuvres exotiques, le reproche de Lebel porte sur les personnages :
Mais, bien souvent, leurs scènes n’ont qu’une toile de fond étrangère, et leurs personnages restent des hommes de chez nous. Pour la plupart, ils ont ignoré les mœurs des peuples lointains, et leurs façons de sentir et de penser ; ils ont même plus d’une fois déguisé la réalité, en façonnant à leur guise les sauvages des îles, pour servir aux besoins de leur thèse74.
70 Jean-Marie Seillan, Aux sources du roman colonial, Paris, Karthala, 2006, p. 8. 71 Roland Lebel, Eugène Pujarniscle, Marius-Ary Leblond… L’on trouve aussi des brochures transcrivant des allocutions, comme À travers la librairie. Causeries françaises. La littérature coloniale, parue en 1925. 72 Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, Vanves, Edicef, 1991, p. 229. 73 Roland Lebel, Histoire de la littérature coloniale, Paris, Larose, 1931, p. 7. 74 Ibid., p. 8.
431
Roland Lebel revendique donc « une littérature coloniale d’expression française75 », et
une note à la fin de cette phrase précise : « Il n’est pas déplacé de remarquer qu’une sanction
officielle a été donnée à la littérature coloniale par la création, en 1921, d’un ʺgrand prix de
littérature colonialeʺ, décerné dans la métropole à des écrivains coloniaux76 ». Outre cette
reconnaissance institutionnelle, le critique affirme que « l’étude du milieu psychologique […]
est proprement le domaine de la littérature coloniale77 ». Ensuite, le livre traite chaque aire
coloniale à part, commence par l’Algérie, en différenciant littérature guerrière, littérature
touristique et descriptive, guides, récits de voyages, littérateurs en Algérie, poésie, théâtre….
Ces sous-catégories sont systématiquement nourries par des auteurs et œuvres précises. Vient
ensuite la Réunion, et Lebel commence par énumérer les poètes réunionnais ; puis l’Indochine.
Une note de bas de page justifie alors le manque de littérature dans les comptoirs de l’Inde78,
avant que Lebel ne s’attache à la littérature de l’Océanie, justifiant là encore le manque de
littérature qu’il traite par la mauvaise réputation que les œuvres littéraires, précisément, ont
apporté du territoire. Enfin, les Antilles et la Guyane sont traitées dans le même élan. Lebel est
l’un des théoriciens les plus connus et les plus systématiques de la littérature coloniale ; mais
bien d’autres essais, articles ou thèses en font un thème en vogue dans les années 1920.
Cette définition canonique de la littérature coloniale cependant est discutable : ainsi,
dans un ouvrage sur les littératures de l’Océan indien, l’on peut trouver une défense de
l’imagination même dans la description des colonies, moyen de conserver ainsi dans le corpus
colonial Taine, Flaubert, Chateaubriand et Stendhal ; moyen aussi de garder Ourika ou Bug
Jargal, de donner Jules Verne, Louis Boussenard ou des revues comme Le Tour du Monde en
tant que précurseurs de cette littérature coloniale79. Une définition plus précise de l’un des
corpus, celui de l’Océan indien justement, participe également à une perception également plus
précise des enjeux de la littérature coloniale, prise entre exigences littéraires métropolitaines et
volonté d’ancrage local :
Les colons ont beaucoup écrit, à Maurice et à la Réunion, au XIXe siècle. Beaucoup de poèmes, dont la fonction vise à attester une présence culturelle française : on y reconnaît des modes d’écriture désuets et les dispositifs littéraires de l’exotisme. Par sa soumission aux modèles européens et son choix du point de vue exotique, cette poésie
75 Ibid., p. 75. 76 On peut ajouter à cette remarque de Lebel ce qui concerne les auteurs coloniaux. « Créée officieusement en 1924, puis, officiellement, en 1926, la Société des romanciers et auteurs coloniaux français est une association régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique en 1952 ». Référence : Claire Ducournau, La Fabrique des classiques africains. Écrivains d’Afrique subsaharienne francophones, Paris, CNRS Éditions, 2017, p. 184. 77 Roland Lebel, Histoire de la littérature coloniale, Paris, Larose, 1931, p. 87. 78 Ibid., p. 161. 79 Ibid., p. 220.
432
reste comme étrangère en son propre pays. Et pourtant, elle y est remarquablement enracinée, car elle est produite, imprimée, diffusée, lue, louée et critiquée aux îles mêmes. Contradiction donc entre les modes d’expression poétique, tournés vers la métropole et la réalité du fonctionnement littéraire, bien ancré dans la société des îles80.
Cet exemple montre comment le corpus colonial ou exotique, selon les critères de sa
définition, en vient à former une espèce de ligne continue du traitement des colonies dans la
littérature. Le point de vue rétrospectif d’un Jean Déjeux sur la littérature coloniale algérienne,
prolixe et reconnue, montre aussi que l’on peut préciser ce corpus en sous-ensemble et écoles
littéraires plus restreints encore. Il définit ces mouvements historiquement, mais aussi
thématiquement, comme en témoigne le paragraphe suivant :
Des écrivains qui viennent d’être cités [Jean Bogliolo, J.-B. Canavaggia, Jacques Robichin, Lucienne Jean-Darrouy, Jeanne Montupet, René Cathala, Lucienne Favre, Irma Ychou, Blanche Bendahan], quelques-uns simplement se rattachaient au mouvement de l’École d’Alger. Plusieurs adhéraient en même temps ou avaient adhéré (Audisio, Roy), à l’Association des Écrivains algériens présidée par Pomier, dont l’un ou l’autre se séparaient. D’ailleurs le thème de la terre, de la fondation d’une colonie agricole, d’une famille de colons, bref, l’attention apportée au terroir et à l’intérieur du pays présente d’elle-même un certain éloignement des thèmes privilégiés par « L’École » : la mer et les villes (avec l’action et les luttes sociales dans ces villes du littoral81).
D’autres critères, eu égard à ce qui est ressorti de la presse coloniale et des perspectives
postcoloniales, peuvent cependant nuancer ou renforcer cette définition : l’on peut parler de
l’hétérolinguisme, de la désinvolture auctoriale aussi, interroger donc des particularités qui
dépassent les critères idéologiques des années 1920 et remontent, en revanche, jusqu’à la presse
coloniale et ses traits d’écriture. L’hétérolinguisme tient en effet à la manière dont les
périodiques coloniaux intègrent d’autres langues selon divers dispositifs ; jamais au premier
plan, la langue autre – voire les langues autres – se fond dans un texte qui revendique ainsi une
identité composite. La désinvolture est visible dans les journaux coloniaux à la manière dont
sont traités les problèmes de publication autant que certains rapports à l’altérité : or cette
manière d’écrire la légèreté appartient là aussi à une identité, certes de façade, mais qui révèle
une manière d’exprimer l’identité coloniale. Les œuvres qui ont traité des colonies, les auteurs
qui ont consacré leurs plumes à ces thèmes coloniaux ont en effet participé à la constitution de
la colonisation, à son aspect fictionnel qui a compté dans les développements de la colonisation.
80 Ibid., p. 11. 81 Jean Déjeux, La Littérature algérienne contemporaine, Paris, Presses Universitaires de France, Coll. « Que sais-je », [1975] 1979, p. 45.
433
2.1 La presse et le livre face aux colonies au XIXe siècle
Le corpus que nous étudions a pu être mal compris, nous l’avons dit, parce qu’il
manquait à son intitulé un adjectif, ou plutôt une précision : il s’agit bien d’une presse coloniale
locale, « non métropolitaine ». Cette précision ne laisse pourtant pas d’étonner : au premier
abord, elle tient presque du pléonasme ; et ce que cette répétition précise, c’est justement à quel
point la métropole est première dans la constitution de la colonie. La presse coloniale devrait
être d’abord entendue par tous au sens de « locale », suivant un raisonnement logique, et ne pas
faire immédiatement penser au corpus métropolitain des groupes coloniaux. À partir de cette
remarque, et en tenant compte des définitions de la littérature coloniale, l’on peut d’abord
s’intéresser aux échos entre la presse et le livre : avant 1880, la production littéraire n’a pas
encore acquis ce degré de conscience d’elle-même qui permet de parler d’une littérature
coloniale. L’on est alors dans un moment de transition, avec la porosité qui régit les rapports
entre les romans et la presse. Quant aux grands textes de la littérature française, de ceux qui
constituent les repères d’une culture de plus en plus scolaire au fil du siècle, leur caractère
patrimonial en fait des « contemporains » des publicistes coloniaux, au moins sous le chapitre
de la familiarité. Ce premier axe permettra de comparer ce que l’on pourrait qualifier de tenants
et aboutissants du corpus médiatique, afin de ne pas isoler une production littéraire d’une
autre : les lecteurs coloniaux, par les libraires et par les envois de journaux, avaient accès à
d’autres littératures que celles produites sur leurs territoires. L’on verra enfin comment il est
possible de tisser des liens entre le corpus médiatique colonial et le corpus postcolonial, preuve
de préoccupations voisines.
Le socle de l’écriture coloniale : les références aux livres canoniques Il existe dans les textes de la presse coloniale une intertextualité première avec les grands
textes de la littérature française, selon un modèle qui s’applique aux écritures de connivence,
de celles qui forment une identité culturelle entre les lignes82. La première forme de ces écritures
de connivence réside dans le choix des formes : par exemple, publier de la poésie dans les
82 Nous traitons ici de l’intertextualité avec la littérature française, mais des textes appartenant à d’autres traditions peuvent être convoqués : cette présence des livres étrangers est bien moins répandue, mais ses apparitions sont d’autant plus remarquables. Ainsi, dans le feuilleton de La France algérienne intitulé « Une Mauresque » qui paraît à l’été 1846, c’est par Fenimore Cooper que passe l’imaginaire du « sauvage » adapté à l’Algérie. Le héros cherche à communiquer avec sa voisine indigène par le biais de signes : « Un roman de Cooper lui tenait compagnie, et il annotait spécialement dans ce livre les imaginations symboliques des sauvages américains, qui ne connaissent point l’art d’écrire. La terrasse, qui partageait avec le livre son attention, demeura, jusque vers le soir, déserte et muette ». L’œuvre du romancier américain est ici reléguée au rang de manuel colonial.
434
colonies de plantation revient à affirmer le pouvoir et la culture de l’individu occidental face à
ce qui n’est pas lui. Le poème devient affirmation identitaire et marqueur idéologique, assigné
à l’île parce qu’il est censé révéler son caractère profond. Le plus significatif reste par exemple
cette « ode aux paquebots transatlantiques » qui non seulement s’ancre dans ce genre poétique
prestigieux, mais encore se clôt par l’appel suivant, nourri de culture classique en même temps
que de pensée du progrès :
L’univers vient à nous, marchons à sa rencontre ; Argonautes nouveaux, venez, venez encor, Où le droit de la France, à vos regards, nous montre, Pour conquérir, chez nous, une autre toison d’or83.
Mais les références ne sont pas toujours aussi antiques, et la référence échappe dans bien
des territoires au choix du genre. Citer les grands auteurs du canon français est une autre
manière d’affirmer une appartenance culturelle, et un autre filtre au moyen duquel envisager la
colonie. Rabelais est ainsi convoqué dans des textes très différents, par exemple pour décrire
les Néo-Calédoniens et dans une perspective qui le fait l’égal d’Homère – nous reprenons ici
une citation déjà donnée plus haut :
Nous n’essaierons point de décrire ici ces monceaux d’ignames, de taros et autres provisions entassées sur l’herbe et dévorées dans ces festins, qui laissent bien loin, dans l’ombre, ceux de l’Iliade et ceux dont Rabelais nous a donné le menu pantagruélique. Sa plume et celle d’Homère seraient impuissantes ici ; il faudrait leur génie pour peindre les danses et traduire les chants sauvages qui accompagnaient ces orgies sans fin84.
Homère est le pendant classique de Rabelais dans ce premier exemple ; mais l’auteur de
Pantagruel est également utilisé, seul, dans le cadre de la description des fêtes du Pongol à la
Martinique : « Ici, [la fête] a servi à tout pour ainsi dire, et a fourni aux Indiens des repas sinon
somptueux, dignes du moins par la profusion des héros de Rabelais85 ». Ces deux exemples
révélateurs d’une tendance d’écriture qui dépasse les frontières géographiques et ressortissent
à une pensée impériale poussent à s’interroger sur la valeur accordée à de telles citations au sein
de la presse coloniale. Signe d’abord de la culture européenne, et appartenant davantage à une
expression figée qu’à un travail de citation (il s’agit seulement de désigner un festin), Rabelais
est également révélateur d’une manière d’envisager les autres coloniaux, Indiens ou Kanak. La
citation agit comme un marqueur social et colonial : elle établit une communauté de lecteurs
cultivés, comprenant la référence. Mais il s’agit également d’un bond en arrière, d’une
83 L’hermite, « Ode aux paquebots transatlantiques », Le Propagateur, 10 mai 1862. 84 « Chronique locale », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 20 septembre 1871. 85 « Immigration indienne. La Fête du Pongol à la Martinique », La Feuille de la Guyane française, 30 juin 1855.
435
« altérisation » chronologique et symbolique : renvoyer aux géants rabelaisiens, c’est affirmer
le caractère irréductiblement différent des indigènes. Cette citation souligne enfin, par la
mention de l’impuissance des grands auteurs, le caractère inouï de ceux que l’on décrit ainsi,
partant une forme de nouveauté, d’exagération, d’altérité poussée à son plus haut degré.
D’autres auteurs ou textes connus servent à donner des repères au lectorat de la presse
coloniale, repères plus proches et qui établissent une connivence d’un genre différent : ainsi de
Paul et Virginie, cité régulièrement pour évoquer l’île de la Réunion – puisque l’île de France,
devenue Maurice, est « l’île-sœur ». L’on a déjà cité dans la deuxième partie ce qu’en dit Victor
Pujo, correspondant du Sport colonial réunionnais : « Vous devez déjà vous dire in petto que
celui qui vous parle ainsi est encore sous l’émotion de l’enthousiasme que lui a procuré la
lecture de Paul et Virginie de l’Île de France, d’Indiana, l’héroïne du Bernica, de l’Album de la
Réunion, aux pages colorées et brillantes, des poésies créoles de Lacaussade ou de l’auteur des
Érinyes86 ». L’auteur de l’idylle tropicale est placé sur le même plan que l’Indiana de George
Sand, et plus étonnamment que les poètes locaux : c’est marquer en effet sur quels textes
s’établit la connaissance des îles sœurs, dans une temporalité récente et qui signale
l’appartenance de la colonie à une histoire littéraire nationale récente. Pujo n’est donc pas le
seul à évoquer Paul et Virginie ; Ernest Cotterêt, le poète réunionnais que nous avons déjà cité,
écrit un poème sur « la baie du tombeau87 », se désolant que la tombe des deux amants n’existe
pas.
Quel désenchantement pour le poète avide De connaître le lieu de vos derniers malheurs !
Je ne trouve qu’une herbe aride Où je n’espérais que des fleurs88.
Cette déploration qui utilise les héros de Bernardin de Saint-Pierre semble en fait cacher
le motif plus répandu de la déliquescence des îles édéniques ; mais le recours à une fiction
fondatrice marque davantage le propos. La culture occidentale au sens large nourrit les textes
qui paraissent dans la presse coloniale : les références nationales s’élargissent à l’Europe,
suivant en cela le mouvement romantique. L’on retrouve alors le filtre culturel : quels que soient
le territoire et la culture que l’on envisage de décrire, le recours au canon européen ramène le
lecteur vers la métropole et son environnement. Ainsi de cet article algérien qui n’est qu’en fait
qu’une fausse lettre racontant les déboires et « tribulations » de l’épistolier : les œuvres
86 Victor Pujo, « Correspondance coloniale », Le Sport colonial, 18 octobre 1879. « L’auteur des Érinyes » désigne Leconte de Lisle. 87 Ernest Cotterêt, « À la baie du tombeau (île Maurice) », Le Sport colonial, 10 mai 1879. 88 Id.
436
littéraires quand elles sont citées – par leurs titres, ou métonymiquement par leurs personnages,
leurs auteurs – relèvent d’une stratégie d’auteur : faire primer la reconnaissance culturelle sur
l’exploration réelle. L’humour le signale ici clairement : la forme importe plus que le fond, au
sens où le jeu littéraire est bien le but premier du texte, et non une curiosité exotique.
Après une foule de tribulations et d’aventures où Child-Harod et don Juan, s’ils revenaient au monde, trouveraient tout ce qu’il leur faudrait pour occuper les loisirs de la mélancolique Albion, je suis arrivé sain et sauf, à Taza, première ville que l’on rencontre au Maroc. Après avoir traversé la Melouia, rivière dont tu dois te rappeler, car elle se mêle aux derniers souvenirs d’Abd-el-Kader, je profite pour t’écrire d’un taleb en guenilles dont l’amour s’est emparé et qui se dirige du côté de Tlemcen89.
Child-Harold et Don Juan, le héros de Byron et celui que Molière a popularisé, le
voyageur romantique et le séducteur itinérant : sous ces deux auspices littéraires, le récit de
voyage qui paraît dans L’Écho d’Oran affirme sa dimension littéraire plus que réaliste, son
caractère de récit de formation exagéré et humoristique. Il ne s’agit pas d’un récit de voyage,
mais bien d’un récit colonial dans lequel l’individu prime sur son environnement. La mention
d’Abd el-Kader, d’actualité alors – il n’a quitté l’Algérie que l’année précédente – complète et
complexifie cependant cette généalogie littéraire : le voyageur médiatique est aux confins de
plusieurs influences, et le « taleb90 » qui écrit n’en est que la dernière marque, lançant la piste
d’un récit que l’on devine à suspens. L’intertextualité ici fonctionne en surface, comme le
complément d’une écriture qui tient à rappeler sa culture occidentale et romantique, quelle que
soit la culture sur laquelle le journaliste écrit : la littérature citée joue le rôle d’un signe, d’un
marqueur de l’appartenance à la société coloniale, et révèle à quel point le texte est centré sur
la France bien plus que sur la colonie.
Enfin, et sans prétention à l’exhaustivité, l’on peut cependant ajouter une dernière
signification à l’utilisation d’un arrière-plan littéraire dans les écritures coloniales : le rapport
aux œuvres métropolitaines, y compris d’actualité, s’écrit en écho à ce que l’on a pu voir dans
la deuxième partie à propos de l’éloignement colonial. Les explications et détours des
publicistes affichent, là encore, une forme de désinvolture souvent explicite, qui tient à un
rapport affichant sa liberté face aux autres, et particulièrement face à la métropole. La note
finale d’un article sur un point des « mœurs algériennes » explique ainsi que
89 « Lettre d’un voyageur », L’Écho d’Oran, 22 novembre 1848. 90 Le terme est défini dans le Larousse universel de 1866-1867 : « nom donné par les Maures à un scribe public ou notaire ».
437
ce dénouement a été employé par M. De Balzac dans sa Physiologie du mariage ; mais comme il n'y a du reste aucun rapport entre l'aventure où il l'a encadré et celle que nous venons de raconter, nous avons cru pouvoir sans inconvénient reproduire une anecdote qui n'est guère connue ici que par les Indigènes91.
Balzac est alors un auteur contemporain, mais en vogue : le citer est une manière de
prévenir les critiques et de montrer la connaissance qu’a le journaliste de cette publication
métropolitaine et parisienne. Plusieurs modalités d’intertextualités irriguent l’écriture coloniale
qui ne veut pas être purement réduite à une écriture locale, mais conserve ainsi l’équilibre entre
le local et le national. L’on trouve même, mais le cas est rare, des comparaisons faites entre la
littérature indigène et la littérature française, par le biais de notations intertextuelles. Quand
Augustin Marquand présente la poésie arabe en la commentant et en rendant compte de son
voyage en Algérie dans ce but, il écrit :
Amar ben Selman mettait alors la dernière main à un livre épique qui a pour titre : Hyamina. C’est l’épopée de l’Algérie et du Sah’ara, comme Mireille, de Frédéric Mistral, est l’épopée des vastes plaines de la Crau et de la Camargue. Il n’est pas possible de lire les belles pages de cet admirable poème, sans avoir la tête remplie des éblouissements du Fiafi, du Kifar et du Falat, ces lumineuses régions des forêts de palmiers et des eaux murmurantes, des plaines impénétrables et des troupeaux errants d’antilopes, du néant pétrifié et des sables bouleversés par le choub92.
L’intertextualité est paradoxale ici, parce qu’elle met à égalité le texte alors récent du
félibrige Mistral, paru en 1859, et une poésie arabe valorisée – dans les paragraphes suivants,
le ton est certes condescendant, mais cette citation met en exergue une forme de parenté
intéressante93. L’Algérie comparée à la Camargue, c’est à la fois l’appropriation du territoire
algérien affirmée, mais également l’égalité, si ce n’est la prééminence, des écrivains indigènes
sur les écrivains coloniaux ; et c’est la colonie pour laquelle se multiplient le plus ces
comparaisons et explications qui passent par l’intertextualité. L’on peut pour terminer reprendre
la lettre du voyageur qui convoquait Child-Harold et Don Juan au rang de ses précurseurs
littéraires. « Tu sauras que, dans toute l’Afrique, on désigne par le nom de fondouk ce que les
Mille-et-une nuits nomment caravansérail, et ce qu’en français nous nommons auberge94 »,
écrit notre « voyageur » de L’Écho d’Oran. La référence au grand texte qui introduit
l’orientalisme en France par sa traduction au siècle précédent permet une forme de familiarité
avec l’Orient fantasmé ; Orient ramené ensuite à la réalité française par la mention, bien plus
91 « Mœurs algériennes. Le jeu du Yadace », L’Akhbar, 27 mars 1840. 92 Augustin Marquand, « Les Poètes du Sa’hara », Le Moniteur de l’Algérie, 13 novembre 1864. 93 Frédéric Mistral, Mirèio, pouèmo prouvençau, Avignon, Roumanille, 1859. 94 « Lettre d’un voyageur », L’Écho d’Oran, 21 novembre 1848.
438
prosaïque, de l’auberge. Du xénisme de « fondouk » au trop français « auberge », en passant
par l’étape intermédiaire que constitue le « caravansérail », le travail lexical fourni par l’auteur
est intéressant, parce qu’il révèle les connotations des termes, et le rôle que joue un texte
littéraire dans la conscience de ces connotations. Le déclencheur de ces évolutions,
l’intermédiaire sur lequel s’appuie l’imagination, c’est le fondamental Mille-et-une-nuits : le
lecteur est explicitement ramené à une forme d’orientalisme.
La créole, entre colonie et métropole, entre journal et livre Certains personnages circulent entre les espaces et les supports parce qu’ils sont
suffisamment stéréotypés pour constituer des points de repère, des condensés d’une
idéologie : le journaliste est un exemple de ces personnages omniprésents sur un long XIXe
siècle ; pour le domaine colonial, la créole en est un autre. Personnage féminin, émanation des
colonies de plantation et d’un temps colonial long, elle remonte au premier empire colonial,
évoque forcément l’esclavagisme et un outre-mer lointain : elle condense des problématiques
historiques, esthétiques et politiques qui expliquent son succès – et les variations de son
traitement entre le journal et le livre, la colonie et la métropole. Présente dans les Antilles et à
la Réunion, la créole est en fait l’un des rares éléments féminins qui trouve place dans les textes
de la colonisation : ailleurs, l’on aurait peine à en trouver un aussi monolithique, aussi lourd de
sens. Pour les lecteurs de la presse coloniale, et outre sa réalité sociale, la créole est d’abord
perceptible à partir des nécrologies : dans ces courts textes, c’est bien l’image de la mère de
famille aimante, douce, bien née, qui ressort et qui offre à intervalles réguliers un portrait
convergent. D’autres textes, relevant de la chronique, convoquent également la créole comme
figure inaugurale : un texte réunionnais paru en 1856 dans La France d’Outre-Mer s’appuie sur
une intertextualité coloniale pour inaugurer une description portant sur « les femmes créoles ».
Il révèle ainsi toute une matière préexistante, jouant ici le rôle du sommet d’un iceberg, pour
développer son propre propos qui est, quant à lui, lié à la l’actualité et au support médiatique.
« Écoutez si les oiseaux chantent », nous écrivait de la Martinique, il y a quelques années, un de nos compatriotes, jeune et brillant écrivain qu’une mort cruelle a prématurément enlevé aux lettres, « écoutez si les oiseaux chantent, je vais vous parler de Saint-Pierre ». Eh bien ! à vous tous qui avez traversé les zones brûlantes du tropique ou qui ignorez les usages d’outre-mer, je vous dirai à mon tour : Écoutez si les oiseaux chantent, je vais vous parler des femmes créoles.
Comme ces antiques mélopées qui pour être dignement chantées et comprises avaient besoin d’être accompagnées par une harmonie douce et lente, ce n’est que pendant une musique qu’il est permis de
439
vous raconter cette ravissante idylle, cette simple et grave histoire d’une vie toute patriarcale95.
S’adressant donc à deux types de lecteurs, le colonial ou le métropolitain, l’auteur de
cette spirituelle chronique continue en peignant le caractère édénique de l’île tropicale, de sa
flore et de sa faune ; puis le glissement s’opère jusqu’au portrait physique de la femme créole,
qui n’est pas seulement un élément de la « vie patriarcale » citée, mais encore une métaphore
de la vie coloniale : « La créole a un rayon du soleil dans les yeux, mais un rayon qui s’y noie
dans la langueur et l’enivrement96 ». Cette dualité renvoie en effet à la dualité de l’île coloniale,
maternelle mais dangereuse : la créole est souvent tenue, dans les textes du corpus médiatique,
pour un personnage symbolique au moins, métonymique sans doute97. Tout comme les épouses
des gouverneurs et généraux dans d’autres territoires, la créole représente la culture française,
la « civilisation » visible et affirmée : mais, à la différence des épouses de fonctionnaires, elle
est liée au territoire sur lequel elle est née, ou dont elle est issue. Médiatiquement, elle trouve
son utilité dans l’idéologie coloniale : elle en est l’un des meilleurs vecteurs, et permet en fait
aux journalistes d’introduire des propos sociétaux plus larges. Un feuilleton qui traite de la
société coloniale sous la forme d’une chronique montre une forme de permanence dans la
description des sociétés de plantation, étant presque interchangeable avec notre premier
extrait : c’est dire à quel point le fonctionnement est bien rôdé, qui veut que la créole soit une
première étape dans la description de la société coloniale. L’auteur écrit ainsi :
Saint-Pierre fait l’envie des étrangers, la vie y est douce et paisible, et c’est la seule ville des colonies dont les femmes jouissent d’une réputation de beauté bien acquise. Elles y sont ravissantes de grâces, de tournure et d’élégance. Leur luxe quoique très riche est simple, leur mise, quelquefois bizarre, souvent de très bon goût, est toujours bien entendue. La démarche de la créole de Saint-Pierre et de la Martiniquaise en général est aisée, molle et langoureuse : elle se traîne dans un doux laisser-aller, son pied invisible, dont la petitesse ferait le désespoir d’une Chinoise, semble effleurer plutôt que se poser sur le pavé ; son esprit est fin, incisif, agréable : c’est le pétillement du vin de champagne qui se répand en mousse brillante et intarissable ; sa bonté… tous les malheureux qui l’implorent sont consolés. Que d’infortunés elle soulage dans l’ombre et qui ignorent la main bienfaisante qui les secourt ! Elle compatit à toutes les misères. Combien de pauvres artistes dénués de ressources ont pu regagner la
95 « Les femmes créoles », La France d’outre-Mer, 8 janvier 1856. 96 Id. 97 Voir les poèmes également, par exemple « Et la brune créole à l’œil noir qui scintille, / Chaste trésor d’amour, de grâce et de beauté, / Sirène comparable aux femmes de Séville / Dont le regard mourant sous la noire mantille / Promet la volupté » (X., « La Patrie », Le Bien-Public, 31 juillet 1856) ; dans un autre poème intitulé « La créole », signé E..D et publié dans La Feuille de la Guyane française du 21 juillet 1860, un même vers revient d’une strophe à l’autre en déclinant deux éléments dans la description de la jeune femme : le hamac et les fleurs.
440
France, grâce aux suaves accents de sa voix généreuse. Mais silence ! elle n’aime pas qu’on divulgue ses bienfaits98.
L’on voit bien alors les sous-entendus symboliques de la description de la
Créole : représentante de la bonne société, c’est aussi une chrétienne marquée par la charité,
dans un calque intéressant de la mission coloniale. Cette représentation positive du rôle social
de la créole est l’un des invariants des textes médiatiques :
Il est, dans les coutumes patriarcales, un arôme de haute convenance et d’exquise poésie qui ne se rencontre pas, assurément, dans les usages mesquins du monde vieilli de l’Europe. Bourbon, placé à 3,600 lieues de sa Métropole, a religieusement conservé dans ses mœurs ce cinname de sociabilité antique ; si la maîtresse de l’habitation créole où s’arrête le voyageur ne lave point les pieds du voyageur que Dieu lui envoie, la cordialité de son accueil, l’aménité de ses manières nobles et pleines de politesse, la discrétion qui préside à sa joyeuse et franche hospitalité, en font la femme des anciens temps ; et l’étranger, satisfait, emporte par-delà l’océan, dans sa vive reconnaissance, l’image de la châtelaine bourbonnaise qui, souvent, est belle comme Rachel, toujours est fidèle comme Sara et pieuse comme Rebecca99.
La « femme des anciens temps » est donc bien la représentante d’une
idéologie : diffractée dans différentes chroniques, dans différents endroits du journal, c’est un
personnage complexe aux yeux des coloniaux ; mais en métropole, l’image que l’on se fait de
la créole est plus simple, plus accessible. La littérature métropolitaine vide le personnage de sa
substance idéologique : plutôt que comme la représentante d’un système colonial ancien, elle
la voit comme le reflet de l’Indiana de George Sand. On peut lire en ce sens l’article que
l’encyclopédie morale des Français peints par eux-mêmes fait paraître sur le type de la créole,
quand, après ses types parisiens puis provinciaux, la publication s’intéresse aux colonies. La
créole y est décrite comme paresseuse, « bonne et aimante, [mais] néanmoins volontaire et
emportée100 » ; surtout, ce qui retient l’attention de l’auteur, c’est son amie « de couleur » et
libre, son amour des bals, le hamac dans lequel elle passe ses journées101. En métropole, la
créole apparaît donc comme un personnage féminin parmi d’autres, dans la pulsion
panoramique qui caractérise une partie de la production littéraire de la première moitié du
siècle ; si sa description reprend certains éléments des productions médiatiques, c’est sous un
angle qui n’admet pas l’idéologie coloniale, mais cantonne la silhouette à un répertoire
romanesque.
98 H. Vignerte, « Revue et chronique de Saint-Pierre », L’Avenir de la Pointe-à-Pitre, 18 novembre 1843. 99 X., « La Patrie », Le Bien-Public, 31 juillet 1856. 100 Roseval, « Le Créole des Antilles », Les Français peints par eux-mêmes, Paris, Curmer, 1840-1842, p. 292. 101 Ibid., p. 283-295. Ces détails rappellent davantage l’Indiana de George Sand que les publications médiatiques coloniales.
441
D’autres textes, fictionnels, prennent également en charge cette image : dans les
« Esquisses morales » que publie Le Bien-Public, le premier chapitre porte sur un bal, et décrit
l’héroïne en précisant qu’elle a bien le « type créole » et une « beauté touchante102 ». Dans la
« Nouvelle trinidadienne103 » qui paraît dans La Liberté est l’une des rares fictions au milieu de
textes politiques qui défendent la République, l’abolition de l’esclavage et l’égalité ; mais le
tout sur un territoire qui n’est pas français. Le texte signé A.V. – initiales que nous n’avons pas
élucidées – traite d’une famille noble d’Espagne réfugiée sur son habitation trinidadienne, en
ville. La jeune fille de la maison est accompagnée de sa servante, une mulâtresse ; et l’on
apprend rapidement que le secret que cache la famille est l’amour incestueux du fils du comte
pour sa sœur. Le texte développe un chassé-croisé théâtral dans l’hôtel particulier : la jeune
femme et sa suivante, le vieux père, la sœur folle, le domestique curieux et le fils incestueux se
succèdent dans les salons. Il est fait allusion à la réalité de l’exploitation coloniale par quelques
indices : des mentions de la plantation, quelques mots sur la situation politique… Mais ces
allusions ne s’accompagnent d’aucune dénonciation, alors même que l’on pouvait penser, eu
égard à l’orientation politique républicaine du journal, que la fiction serait le support d’une
vision politique plus large. Le point qui focalise l’écriture de l’auteur est plutôt sa jeune héroïne,
représentative des créoles par sa beauté, son caractère à la fois emporté et vertueux : le poids
fictionnel l’emporte ici sur les prétentions politiques, montrant à quel point ce personnage de la
créole agit comme un véritable aimant.
Les périodiques qui se chargent de la créole, en métropole en tout cas, peuvent offrir
une liberté de ton plus grande que dans les colonies : l’on voit alors à quel point les fictions
médiatiques agissent comme des catalyseurs sociétaux. Si la créole des périodiques coloniaux
est le témoin des temps passés, la métonymie de l’île et la garante de l’idéologie coloniale, une
autre créole peut se lire dans La Revue pittoresque, en métropole : La Créole est le titre d’une
nouvelle signée Almire Gandonnière, auteur que nous avons cité comme collaborateur de la
presse algérienne : c’est pour cette raison que nous le citons ici, car l’on se perdrait à énumérer
tous les récits, opérettes, chansons s’intéressant à la créole comme personnage. Encore la créole
dont il est question est-elle espagnole, et l’on comprend à la lecture que ce détour est nécessaire
pour ne pas fournir une critique trop virulente des mœurs coloniales en général. Le début du
récit, et quelques autres passages, sont révélateurs de la manière dont elle est envisagée comme
un type colonial au sens large : « Vers la fin de juillet 1842, je revenais de la Vera-Cruz en
102 *** D.M.P, « Esquisses morales. Alice, ou une destinée de femme », La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, 7 août 1839. 103 A.V., « Un secret ou la vengeance. Nouvelle trinidadienne », La Liberté, du 8 au 22 novembre 1851.
442
France104 », commence le narrateur ; le reste est le récit enchâssé de son compagnon de voyage,
fils d’un armateur du Havre. « Les habitants de la Vera-Cruz la regardaient comme une
maîtresse douce et bonne ; mais ses quinze cents esclaves ne lui parlaient qu’en tremblant, et
auraient donné leur vie pour lui ôter la sienne105 » : cette première présentation trace en
quelques traits un portrait diabolique qui correspond assez aux femmes dangereuses de
l’époque… mais ici avec cet aspect supplémentaire des quinze cents esclaves. L’histoire est en
fait celle d’une jalousie conjugale : la terrible créole défigure la maîtresse de son mari en
répandant du vitriol sur le couple illégitime, fait torturer Rico, l’esclave qui avait servi de
messager, et emprisonner son mari. Le fils de l’armateur meurt sur le navire peu après ; le
narrateur premier, à Paris, croise dans un salon « l’ange maudit de l’esclavage106 » au cours
d’une discussion sur l’abolition. Son époux l’a retrouvée et raconte ses crimes ; déshonorée,
elle s’enfuit, mais Rico, qui a suivi son maître devenu son ami, la défigure au vitriol. La Créole
s’empoisonne enfin, et le récit se termine. La maîtresse est donc punie par l’esclave qui était
parti en marronnage et s’était libéré : cette complication apportée au thème de la vengeance
n’est pas si fréquente, et le texte montre le potentiel qu’il peut y avoir dans l’utilisation de
l’esclavage comme ressort narratif. Cette publication date de 1843 ; l’on comprend que sa
parution dans la presse coloniale était inenvisageable, car l’esclavage y est clairement dénoncé,
que ce soit par les actions de la créole ou par le discours de son mari dans le salon aristocratique.
Mais ce que cette publication aide à comprendre, c’est aussi la particularité des publications
coloniales – et non métropolitaines – sur les créoles, qui évacuent systématiquement la question
de l’esclavage, et dressent un portrait qui correspond à une sorte de synthèse de la mère de
famille française. Enfin, autre intermédiaire qui signale l’importance de la position des auteurs
dans l’écriture de la créole, le roman colonial de Rosemond de Beauvallon, Hier ! aujourd’hui
! demain ! ou les agonies créoles, roman de mœurs coloniales développe l’intrigue d’un roman
sentimental, mais rend compte dès son titre d’un pilier de l’identité coloniale, la fin d’un monde.
L’auteur, né à la Guadeloupe et qui y finit rédacteur à L’Écho de Guadeloupe après avoir été
journaliste à Paris, et surtout après un duel retentissant, fait partie de la bonne société créole107.
Il prévient dans la première page :
Le nouveau roman de mœurs coloniales que nous allons écrire commence au moment psychologique où, sous la triple influence de la venue du Crédit Foncier, du développement des usines et du retour de
104 Almire Gandonnière, « La Créole », Revue pittoresque, 1843, p.458. 105 Ibid., p. 459. 106 Ibid., p. 467. 107 Voir sa notice sur la plateforme Médias 19, URL : http://www.medias19.org/index.php?id=14290. Consulté le 18 juin 2017.
443
la République, l’ancienne société coloniale s’est complètement transformée. Cette société, composée de grands seigneurs, que les éléments qui la constituaient fussent aristocratiques ou plébéiens, était représentée, en 1870, par un jeune homme de vingt-sept ans. Il s’appelait Arthur Duplessis et descendait en ligne directe du premier gouverneur de la Guadeloupe au nom des seigneurs de la compagnie avec de Lolive, son compagnon de fortune et son émule en autorité108.
L’on retrouve dans cet avertissement la pensée coloniale : bien que l’ouvrage soit paru
en métropole, le propos relève du lieu commun créole, qui incarne l’idéologie coloniale dans
des personnages.
Publications métropolitaines et cadre colonial : des interactions
Dans les publications métropolitaines apparaissent parfois les colonies : dans le
domaine anglophone, l’on a déjà étudié la manière dont ces territoires impériaux sont en fait
présents en filigrane au sein du corpus littéraire le plus reconnu109. L’équivalent n’a pas été
prouvé dans le domaine francophone, et pourtant plusieurs publications métropolitaines
prennent les colonies comme cadre de l’intrigue : il s’agit de confronter ces publications
contemporaines de nos journaux à l’image que le corpus médiatique produit, de voir de quels
éléments est formée la distance entre le roman « exotique » (au sens où l’action se déroule hors
du territoire métropolitain, sans que l’auteur soit un colonial lui-même) et le texte médiatique
colonial110. Les romans « exotiques » de notre chronologie concernent principalement (mais
pas exclusivement, on le verra) les Antilles : si l’Algérie est bien mentionnée dans Les Mystères
de Paris comme point d’aboutissement du Chourineur qui s’y fait cultivateur et soldat
(autrement dit, dans le texte, colon111), si quelques œuvres mentionnent ainsi les nouveaux
territoires coloniaux ou leurs habitants112, les colonies de plantation fournissent un cadre
exotique intéressant, partant un contrepoint éclairant pour l’étude de notre corpus. La
comparaison permet de voir comment le texte médiatique, bien que colonial, peut s’avérer plus
nuancé que le texte métropolitain, non par humanisme profond, mais par une pensée de la
108 Rosemond de Beauvallon, Hier ! aujourd’hui ! demain ! ou les agonies créoles, roman de mœurs coloniales, Coulommiers, imprimerie P. Brodard et Gallois, 1885, p. 1. 109 Edward Said, op. cit. Il évoque ainsi les grands titres de la littérature anglaise en les intégrant à une étude des « structures d’attitudes et de références » (p. 99), reformulées par le traducteur p. 113 « système d’attitudes et de références ». 110 Nous mettons à part le Tartarin de Tarascon d’Alphonse Daudet, déjà cité : son fonctionnement satirique en fait une formidable parodie des écritures coloniales, mais sa prétention humoristique est précisément ce qui l’isole des textes que nous voulons étudier ici. En outre, sa publication en 1872 le situe vers la fin de notre chronologie : cela explique également la réussite du roman qui repose sur une connaissance de la colonie plus répandue en métropole. 111 Eugène Sue, Les Mystères de Paris, série 1, Paris, Gosselin, 1840-1842, p. 418 et suivantes. 112 L’arrière-plan colonial fait ainsi de furtives apparitions dans la littérature nationale la plus canonique : chez Émile Zola, Thérèse Raquin dans son roman éponyme de 1867 est ainsi la fille d’un soldat d’Afrique et d’une « indigène ».
444
colonie qui repose sur l’idéologie. Les premières décennies de notre corpus sont, à ce titre, les
plus intéressantes à étudier : les colonies ne sont alors pas autant connues que dans les années
1870, influencées par la politique colonialiste de la Troisième République.
Une distance existe entre la presse coloniale locale et le roman exotique : quand l’une
met en mots les bals, les mondanités, les questions commerciales ou le théâtre, quand elle se
construit sur des scènes de rues ou des anecdotes sociales – toutes preuves de l’urbanité de la
société coloniale –, l’autre recherche le dangereux et l’inaccessible. C’est le mouvement même
de l’exotisme qui se joue dans la manière dont ces textes organisent la représentation de la
société coloniale : le prétexte n’est pas le même, au sens premier du terme. Dans les périodiques
coloniaux, pas d’intrigues tournant autour des flibustiers d’Ancien Régime ou des esclaves : et
pourtant ces deux thèmes sont traités par les grands auteurs des années 1840. Le Morne au
Diable d’Eugène Sue, paru en 1842 et joué également à l’Ambigu-Comique en 1848, est un
exemple caractéristique de la vitalité des thèmes coloniaux et de leur utilisation métropolitaine :
dans ce roman d’aventures qui se déroule en 1695, l’on retrouve le personnage du Gascon
pauvre mais entreprenant tel que nous l’avons décrit dans la partie précédente : l’ambitieux qui
arrive à la Martinique prévoit d’épouser la femme la plus riche de l’île, surnommée « la Barbe-
bleue » à cause de veuvages rapprochés113. Le chevalier de Croustillac met en œuvre son projet ;
mais après bien des péripéties, et c’est là un deuxième thème colonial que celui de la
reconnaissance, le chevalier découvre – en même temps que le lecteur – que la jeune veuve est
la duchesse de Monmouth. Son époux, qui se déguise en flibustier, en boucanier et en Caraïbe
(Dumas reformule parfois en « anthropophage ») pour détourner les soupçons, est le fils naturel
de Charles II d’Angleterre, et passe pour mort après un coup d’état raté ; toute l’intrigue des
deux dernières parties du roman consiste en une méprise sur le personnage du duc, confondu
avec Croustillac et recherché par les Anglais comme par les Français. Les Antilles, on le voit à
travers cet exemple, sont envisagées à travers le filtre du passé pour ce qui est du
romanesque : l’attirance pour l’imaginaire flibustier y est pour beaucoup. Sue y concentre le
thème de la jeune femme mystérieuse et de l’aventurier Gascon, que les publications coloniales
reprennent également, mais il y ajoute trois silhouettes coloniales réunies en une seule, sur fond
de guerre contre les Anglais. Que le duc se déguise en flibustier, boucanier ou Caraïbe n’a que
peu d’intérêt d’un point de vue diégétique : un seul déguisement suffisait pour tromper ses
ennemis. Seulement cela permet des descriptions attendues, des morceaux de
113 Originellement : Eugène Sue, Le Morne au Diable, Paris, Gosselin, 1842. Le roman fait long feu : en 1879, La Tribune algérienne le publie dans son feuilleton.
445
bravoure : d’abord par le récit des compagnons de voyage du chevalier, ensuite par les yeux
mêmes du personnage. Les illustrations en sont elles aussi facilitées : peindre l’anthropophage
renforce le côté exotique du récit. À ce condensé d’aventures caraïbes s’ajoute une tonalité
grotesque, touchant au vaudeville ou au burlesque selon les cas, utilisant aussi le paysage de la
Martinique pour donner aux lieux une apparente inaccessibilité : le Morne au diable, entouré
de forêts et de précipices, est un bon exemple des fantasmes tropicaux ; la violence animale
aussi, caractérisée par un taureau furieux, un serpent venimeux et des chats-tigres mangeurs
d’hommes. L’on a vu dans la partie précédente que la presse antillaise, quand elle publie des
écrits portant sur le passé, met en lumière les guerres contre les Anglais et le comportement des
habitants créoles : pas de flibustier, pas de Caraïbe, pas de boucanier ; et l’on comprend ainsi
que la presse coloniale ait développé un discours d’authenticité face à l’exotisme des romans
d’aventure parus en métropole, réservant le personnage du Gascon entreprenant aux saynètes
humoristiques.
Les Antilles sont le théâtre d’aventures flibustières sous l’Ancien Régime : c’est une des
identités littéraires qui leur sont attribuées ; mais elles sont aussi, et ce trait ressort
particulièrement dans les premières décennies du XIXe siècle, le théâtre des drames de
l’esclavage. Avant 1830, et donc avant notre corpus, Hugo a publié Bug-Jargal et Mérimée
Tamango : ces deux œuvres font apparaître des esclaves et construisent leur intrigue sur
l’imaginaire de la révolution de Saint-Domingue – de façon explicite chez Hugo, détournée
chez Mérimée –, actualité qui a marqué les imaginations. Plus tard, dans les années 1840,
Dumas publie Georges : l’on est alors dans une autre vision de l’esclavage, qui fait entrer en
ligne de compte la question des métisses, des « gens de couleur ». L’évolution que signalent
ces trois œuvres interroge en retour le corpus médiatique colonial, vivant de près et se
nourrissant de l’esclavage. Avant les limites de notre corpus, le Bug-Jargal d’Hugo, œuvre de
jeunesse (1826), développe son intrigue autour du héros éponyme, ancien roi, esclave et chef
de la révolte, dans un face à face avec un jeune officier qui repose sur une rivalité amoureuse.
C’est à partir du jeune officier que se développe le récit, dans une analepse qui fait de Bug-
Jargal un héros second, et bien plus insaisissable que le jeune Français. Le Tamango de
Mérimée (1833), lui, est la version tragiquement burlesque d’une révolte d’esclaves : Tamango
est un anti-héros veule, cruel et méchant, qui meurt bêtement après avoir vécu auprès du
gouverneur anglais, et causé par sa révolte mal préparée la mort de tous ses compagnons de
446
chaîne114. Ces deux récits font ressortir par contraste le roman Georges de Dumas (1848), bien
moins négatif que ses deux prédécesseurs : dans ce récit en plusieurs parties, le héros est un
jeune mulâtre marqué par l’oppression coloniale que le romancier a incarné dans la famille de
Malmédie. La majeure partie de l’intrigue se fonde sur le retour à l’île de France du héros parti
faire ses études en métropole pour échapper à la haine des Malmédie, et qui prend part à une
révolte lorsqu’il revient dans l’île. Les esclaves présents dans le texte apparaissent sous un jour
plus positif, et la couleur même de Georges est le gage d’une vision nouvelle de la colonie.
De cette comparaison entre trois fictions, l’on peut remarquer que Georges apparaît
comme l’œuvre dans laquelle l’on retrouve le plus de traits qui correspondent à la littérature
médiatique coloniale. Par sa description du territoire dans le premier chapitre, par ses
comparaisons avec la métropole qui constituent l’incipit du roman, par l’importance accordée
au bateau enfin115, il semble afficher une forme d’harmonie, thématique au moins, avec le
corpus que nous avons étudié. Pourquoi cette parenté ? Loin de postuler des effets de lecture
qui auraient influencé Dumas, il nous faut plutôt avancer l’hypothèse d’un auteur refusant les
effets exotiques et allant chercher du côté de la justesse historique pour peindre les
colonies : privilégiant l’histoire à l’aventure, Dumas conformerait ainsi son écriture à ce qu’il
se représente comme une authenticité coloniale. En outre, en 1848, la presse coloniale a connu
un premier développement, et ce point démarque également le roman de Dumas de ceux d’Hugo
et de Mérimée. Un exemple signifiant de ces écritures métropolitaines traitant des colonies se
trouve dans une excursion à la Réunion extraite des Scènes et récits des pays d’outre-mer de
Théodore Pavie116. Le narrateur est accompagné d’un guide et d’un botaniste ; passant la nuit
dans une grotte, il donne la parole au guide pour faire le récit d’une « chasse aux nègres
marrons » – c’est le titre de la nouvelle. La narration enchâssée, les récits d’action, la description
114 Alexandre Dumas, Georges, Paris, Michel Lévy, 1848 ; Victor Hugo, Bug-Jargal, Paris, Urbain Canel, 1826 ; Tamango de Prosper Mérimée paraît en 1833 dans le recueil de nouvelles Mosaïque. Pour une étude plus générale, voir Roger Little, « Les Noirs dans la fiction française, d’une abolition de l’esclavage à l’autre », Romantisme, 2008/1, n° 139, p. 7-18. Cette dernière œuvre semblerait presque être quelque chose comme le négatif du Ziméo de Jean-François de Saint-Lambert, paru en 1769 et qui aurait subi le passage de la littérature dite « négrophile » à la littérature racialisée du XIXe siècle : indice d’une évolution des représentations à laquelle la presse participe. 115 Le deuxième chapitre s’ouvre sur une bataille navale observée depuis l’île et se clôt également sur une bataille navale ; et le quatrième chapitre commence ainsi : « C’est jour de fête à l’île de France le jour où l’on signale la vue d’un vaisseau européen ayant l’intention d’entrer dans le port ; c’est que, sevrés depuis longtemps de la présence maternelle, la plupart des habitants de la colonie attendent avec impatience quelque nouvelle des peuples, des familles ou des hommes d’outre-mer ; chacun espère quelque chose, et tient, du plus loin qu’il l’aperçoit, ses regards attachés sur le messager maritime qui lui apporte soit la lettre d’un ami, soit enfin cette amie en personne ou cet ami lui-même ». 116 Théodore Pavie, Scènes et récits des pays d’outre-mer, Paris, Michel Lévy, 1853. Les récits sont d’abord parus dans la Revue des deux mondes : celui que nous citons en 1845.
447
des lieux où vivent les marrons : tous ces traits rappellent les récits d’Alphonse Alizart ou de
Louis Héry, que l’on retrouve dans les périodiques coloniaux. Le récit du créole n’est pas
presque pas interrompu, et n’est pas contredit par les auditeurs attentifs. Faut-il expliquer ces
points communs par la parution première dans la presse ? Le récit de Théodore Pavie n’est pas
en effet publié d’abord en recueil, mais dans la Revue des deux mondes. Ce qui manque
également au récit de Pavie par rapport à celui d’Alizart, ou même par rapport au Bourbon
pittoresque d’Eugène Dayot, c’est sans doute cette désinvolture du narrateur : la technique de
l’enchâssement ne fait pas oublier qu’il y a un auditeur premier qui juge le récit du colonial.
Pavie est cet auditeur premier qui donne un aspect axiologique au texte : dans la presse
coloniale, ce regard extérieur qui peut mettre en cause les valeurs de la société coloniale n’existe
pas – quand il est exprimé, il est explicitement rattaché à une vue métropolitaine et donc fautive
des réalités coloniales. En outre, Pavie met en scène un petit blanc, ce que ne font ni Alizart ni
Dayot : le préjugé de couleur ne permet pas, dans les colonnes des périodiques insulaires, de
mettre en avant cette catégorie de la population qui embarrasse le schéma colonial raciste117.
Quelques points communs poétiques, quelques différences thématiques font ainsi ressortir la
manière dont Pavie, en tant que voyageur, utilise la poétique du récit enchâssé, mais y ajoute
des éléments que l’écriture coloniale ne pouvait comprendre.
Si Pavie est plus nuancé que les journalistes coloniaux, il écrit en 1840, à une époque
où l’empire colonial n’a pas atteint sa deuxième phase ; un aperçu des décennies suivantes
donne à voir un autre rapport entre les publications coloniales et les publications exotiques. Le
récit métropolitain, en cette fin de XIXe siècle, dépasse parfois en caricature le récit local,
particulièrement en ce qui concerne les colonies les plus récentes : les Antilles et l’Algérie ne
sont pas les seules colonies à être traitées par la littérature de métropole. Un certain Emmanuel
Istivie décrit en 1905 un épisode du bagne calédonien, puis complète ce premier texte par une
description de l’insurrection de 1878. Il commence ce dernier texte par « l’épouvantable
spectacle » que surprend un soldat français : les Kanaks sont en train de dévorer l’un de ses
camarades, enlevé plus tôt dans l’après-midi.
Leurs silhouettes fantastiques [des Kanak] se découpaient vigoureusement sur le fond lumineux de la clairière et leur ronde diabolique, d’abord lente, s’accélérait pour se transformer bientôt en une course vertigineuse autour du foyer, dont les flammes éclairaient
117 On désigne par l’expression « petit blanc » les habitants pauvres, mais à la peau claire, de la Réunion, habitant souvent les hauts plus que les rivages de l’île. Parce que leur statut social ne correspond pas aux préjugés racistes, ils ne sont pas souvent traités par la presse coloniale.
448
des visages hideux, aux bouches bestiales et tordues par un effroyable rictus de convoitise118.
Cette scène d’anthropophagie caricaturale et terrifiante est bien loin de ce que la presse
locale transmettait à ses lecteurs, y compris pendant l’insurrection de 1878. Le texte médiatique,
que l’on pourrait accuser de rapidité ou de racisme plus marqué que ses équivalents
métropolitains et livresques – deux critères d’apaisement – s’avère finalement plus nuancé que
ce que l’on pouvait prévoir : il n’a pas besoin de couleur locale, de stéréotypes mêlant la danse
et le festin macabre pour rendre compte de l’insurrection. C’est ce que prouve également la
lecture des Filles du pionnier, roman de Marc Le Goupils paru en 1910 : l’auteur choisit
également 1878 pour placer son action119. Appartenant à la liste des ouvrages distribués comme
prix dans les écoles, le roman est plus nuancé que notre exemple précédent ; mais l’on y
retrouve également la mise en scène du soulèvement comme pivot de la représentation des
Kanaks. Ces deux exemples tendent à montrer la manière dont la littérature livresque destinée
aux métropolitains se distingue peu à peu du journal colonial local : quand la première joue sur
l’exotisme des peurs coloniales, le deuxième promeut plutôt une écriture neutre, parce qu’il
s’adresse également aux coloniaux qui vivent l’insurrection ou en perçoivent les échos.
Il semble bien que ce soit le lot de la Nouvelle-Calédonie que de susciter ces récits
métropolitains prompts à fantasmer le cannibalisme : de fait, avant l’insurrection de 1878, c’est
sur l’anthropophagie que reposent les récits calédoniens. Ainsi du roman du docteur Thiercelin,
Chez les anthropophages. Aventures d’une Parisienne à la Nouvelle-Calédonie120. Le texte
commence par la description d’un voyage en bateau : l’on trouve à bord une jeune femme qui
se prépare à une nouvelle vie en compagnie de son mari. On apprendra en fait que la jeune
femme, qui se fait appeler Héloïse de Clairefontaine et se revendique de l’aristocratie, a
participé à la Commune par amour d'un officier, puis est rentrée dans son village épouser
l’homme avec lequel elle voyage et qui apparaît assez rapidement comme un rustre. Le récit se
fait alors quelque peu immoral, selon une perspective qui sera conservée ensuite pour les
aventures de la jeune femme parmi les Kanaks : on apprend qu'elle avait un protecteur, un
comte, et qu'elle a vécu maritalement avec le capitaine du navire. Pas d’aspirants coloniaux de
bonne famille, donc, mais des aventuriers au passé ambigu : la confrontation avec les religieux
puis avec les indigènes de l’île va pouvoir se jouer sur cette toile de fond. Dominique Jouve
118 Emmanuel Istivie, Vers la liberté ! suivi de Épisode de l’insurrection canaque, Paris, Librairie d’éducation nationale, 1905, p. 272. 119 Marc Le Goupils, Les Filles du Pionnier, Paris, Hachette, 1910. 120 Dr Thiercelin, Chez les anthropophages. Aventures d’une Parisienne à la Nouvelle-Calédonie, Paris, Lachaud, 1872.
449
identifie le docteur Thiercelin à tout un groupe d’écrivains, replaçant ainsi l’auteur dans un
cadre plus général :
D’autres [auteurs] n’avaient fait [en Nouvelle-Calédonie] qu’un bref séjour : Thiercelin, sûrement Dargène. Ils inscrivent dans le système colonial la présence française en terre calédonienne, avec une structure narrative qui suit le schéma suivant : une fracture violente initiale justifie le départ vers la Calédonie, un voyage et des aventures in situ, un final ouvert. Ce groupe n’a guère d’intérêt que comme un jalon dans l’histoire littéraire121.
Il est vrai que le roman du docteur Thiercelin mérite son manque de succès ; mais on y
lit quelques traits qui sont, dans notre perspective, intéressants : le modèle épistolaire, qui
revient à intervalles réguliers lorsque la jeune femme écrit à l’un de ses amis, permet de voir
comment le personnage du kanak est dévalorisé et ravalé au rang de personnage comique,
vaguement sensuel.
Me voilà donc, ma chère amie, en plein pays sauvage. J’ai dîné hier avec un chef calédonien dont les regards seuls m’ont fait frémir. Pourtant, l’avouerais-je ? j’ai été un moment flattée de ce que je regardais comme un hommage à ma beauté, bien que sa galanterie me parût un peu leste, quand il pressait tendrement mes bras, quand il appuyait ses pieds sur mes bottines, quand même il posait sa main sur ma jambe… au-dessus du genou. Moi naïve comme au village, je me figurais qu’il me faisait la cour à la mode de son pays, et imprudente que j’étais je le laissais faire. Eh bien ! il paraît que ce scélérat en voulait non pas à mes charmes, mais à mes chairs. Il tenait à frôler mes membres pour juger de leur valeur comme viande de boucherie. Ses claquements de langue, ses grognements de chien qui ronge un os, ses regards incisifs et ardents, que je prenais pour des démonstrations d’un amour un peu brutal, mais sincère, eh bien ! tout cela c’était l’expression de l’appétit d’un gastronome expert dans l’art de choisir ses mets122.
En 1872 pourtant, les textes du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie ont dépassé et ces
images burlesques, et cette représentation de la sensualité : le texte métropolitain semble
quelque peu retarder par rapport aux productions locales, ou plutôt accentuer certains traits que
la presse calédonienne a pourtant contredit – l’on pense ici aux poèmes d’Armand Closquinet
que nous avons étudiés dans les précédentes parties.
Pour compléter ce panorama rapide des œuvres exotiques, il est intéressant de prendre
l’exemple de Pierre Loti, que l’on classe parfois dans la littérature coloniale (quand le critère
121 Dominique Jouve, « Présentation de la littérature de Nouvelle-Calédonie ». URL : http://www.bib-cclachatrestesevere.net/userfiles/file/Pr%C3%A9sentation%20de%20la%20litt%C3%A9rature%20cal%C3%A9donienne%20par%20Dominique%20Jouve.pdf. Consulté le 17 juin 2017. 122 Dr Thiercelin, Chez les anthropophages. Aventures d’une Parisienne à la Nouvelle-Calédonie, Paris, Lachaud, 1872, p. 56-57.
450
identitaire n’est pas le plus important123), parfois dans la littérature exotique (et il est alors
davantage un voyageur qu’un colonisateur124). Un roman comme Aziyadé a pu valoir comme
l’œuvre exotique par excellence, et non pas comme une œuvre coloniale, ne serait-ce que parce
que l’action a lieu en Turquie, et non sur une colonie française. Pourtant, un rapprochement
peut s’opérer entre le roman turc de Loti et les romans coloniaux, sur le plan poétique au moins.
Aziyadé de Loti utilise l’écriture par fragments, censée être authentique, et qui se construit par
extraits de journal intime et de correspondance, avec la mention initiale de l’époque du décès
du narrateur. Si l’atmosphère du récit est bien celle d’une fin de siècle qui ne refuse pas le
spleen, le personnage du jeune officier de marine anglais présente des caractéristiques que l’on
pourrait retrouver dans d’autres œuvres exotiques : capacité à se fondre dans la masse, écriture
de la découverte, passages de description qui pourraient être tirés d’un guide de voyage – ainsi
de la description de la mosquée d’Eyoub125. On retrouve également dans le roman les
personnages obligés des relations amoureuses orientales : la « vieille négresse » qui
accompagne sa jeune et mystérieuse maîtresse ; jusqu’au personnage de Samuel, qui parle le
sabir au personnage principal. On note que la littérature exotique de Loti se définit souvent par
un rappel de la métropole, quand les œuvres coloniales peuvent donner l’illusion d’un monde
colonial qui s’il n’est pas autonome se suffit cependant à lui-même126.
Les récits que nous avons cités relèvent d’une littérature métropolitaine
quoiqu’exotique ; ils n’appartiennent pas au corpus bien délimité et bien constitué de la
littérature dite coloniale, qui fonctionne selon un rapport différent au territoire de la colonie et
à ce qui peut s’y inventer en termes de fictions. C’est donc dans un deuxième temps que l’on
peut aborder plus spécifiquement cette littérature coloniale propre à une époque et à des
territoires particuliers, afin de faire ressortir ses liens avec la presse coloniale telle que nous
l’avons étudiée.
123 Voir par exemple la brochure « La littérature coloniale » par M. Jean Vignaud, huitième causerie faite au Cercle de la Librairie le 12 juin 1925, À travers la librairie. Causeries françaises. 124 Bernard Mouralis insiste sur le fait que la littérature coloniale est une littérature qui se veut réaliste et « entend s’opposer à la littérature exotique, représentée notamment par le cas de Loti, et tient notamment à affirmer que seul l’auteur qui participe au groupe social des colonisateurs peut produire un discours "vrai" sur les "réalités" de l’Afrique, à la différence des simples "voyageurs" ». Référence : Bernard Mouralis, art. cit., p. 18. 125 Pierre Loti, Aziyadé, Paris, Gallimard, [1879] 1991, p. 72-73. 126 Voir à ce propos Vladimir Kapor, « Pour un exotisme antécolonial – l’œuvre de Pierre Loti dans la réflexion théorique de Marius-Ary Leblond », Yvan Daniel (dir.), Pierre Loti, l’œuvre monde ?, Paris, Les Indes savantes, 2015, p. 63-71.
451
2.2 Littérature coloniale et presse coloniale : des corpus gémellaires ?
Toutes les précisions données plus haut étaient utiles pour définir la littérature
coloniale ; mais les textes dont nous allons traiter maintenant relèvent d’une littérature
différente, en ce sens qu’elle est écrite avant les développements de l’entre-deux-guerres, et que
son statut n’est pas encore bien affirmé. Il s’agit, pour les décennies qui nous concernent, d’une
forme de littérature coloniale produite par des habitants des colonies et réunissant les critères
énoncés par Jean-Marc Moura quand il examine la « théorie littéraire coloniale » : l’acception
thématique, l’acception idéologique et l’acception sociologique du corpus désigné comme
« littérature coloniale » semblent bien réunies. L’on y trouve en effet une forme de témoignage
à travers la peinture de l’activité coloniale ; une glorification de l’entreprise coloniale ; et enfin
des auteurs issus du monde colonial et qui revendiquent ce statut127. Or précisément, en étudiant
les liens qu’entretiennent quelques romans du tournant du siècle avec les publications de la
presse coloniale, l’on peut affiner la lecture de cette littérature populaire et coloniale. Si l’on
peut chronologiquement estimer qu’il s’agit d’une littérature précoloniale – en Algérie, les
auteurs revendiquent l’appartenance au monde colonial mais ne sont pas nés dans les territoires
coloniaux, ne sont pas encore les héritiers des premiers colons –, elle est cependant déjà
travaillée par les problématiques du corpus à venir. Les auteurs des feuilletons de 1840 à 1880
ne sont pas les auteurs des fictions coloniales de la fin du siècle : la décennie n’est pas la même,
et le rapport au territoire colonial non plus. Pourtant, parce que les feuilletons locaux de la
presse jouent sur les mêmes ressorts que les publications coloniales qui écrivent plusieurs
décennies après eux, parce que le métadiscours y est également important, parce qu’enfin des
motifs et personnages récurrents permettent de lier les textes, l’on voit que le corpus médiatique
colonial permet un nouvel accès au corpus de cette littérature de l’entre-deux qui précède la
littérature coloniale du XXe siècle. Pourtant les textes que nous citons dans cette sous-partie ne
relèvent que de la fiction, et en ce sens s’éloignent du « discours colonial » englobant pour se
ranger du côté d’une spécialisation littéraire : c’est même ce qui autorise le rapprochement avec
les romans coloniaux.
127 Jean-Marc Moura, « Littérature coloniale et exotisme : examen d’une opposition de la théorie littéraire coloniale », Regards sur les littératures coloniales. Tome 1. Afrique francophone : Découvertes, Jean-François Durand (dir.), Paris, L'Harmattan, 1999, p. 22.
452
Feuilletons locaux et littérature coloniale : quand les corpus se confondent
Plusieurs récits qui paraissent dans la presse coloniale correspondent, rétrospectivement,
aux critères établis pour définir une littérature coloniale : la différence serait alors, entre le
roman colonial et le feuilleton colonial, de l’ordre du support et non de la poétique. Dans Le
Courrier de Sétif, ainsi, la parution du Roman d’un défricheur de Léon Beynet affirme une
identité coloniale développée selon les théories de Saint-Simon, dont il est un disciple. Le
défricheur, à défaut d’un ingénieur dont le titre aurait été plus clairement en accord avec la
doctrine saint-simonienne, est bien la silhouette que l’idéologie coloniale défend et promeut ; le
romancier ne fait pas l’économie de descriptions qui se veulent réalistes, documentées sur la
vie coloniale algérienne128. Il écrit ainsi, au cours des développements de l’intrigue, pour
justifier certains écarts de langage de ses personnages :
Cet ouvrage, par sa nature, ne comporte guère que des descriptions réalistes, s’il est permis d’ainsi s’exprimer. Quand nous étions dans les champs, au sein de la vie rurale, nous nous sommes efforcé de reproduire ces divers aspects de l’Algérie tels que nous les avons vus, sans en altérer l’éclat, sans en adoucir les ombres. Or, maintenant que nous sommes à la ville, il nous faut absolument, pour ne pas trop fausser le ton de la couleur locale, revenir à ce genre de peinture, lorsque le cours de ces récits nous y ramène129.
L’auteur est arrivé en Algérie en 1850 et n’y mourra pas ; mais ses publications
comptent parmi les premières qui racontent la vie algérienne. L’influence des saint-simoniens
sur le récit colonial, particulièrement en Algérie, est importante et permet de rendre compte de
certains développements ou de certains traits communs :
Dans la fiction romanesque, le saint-simonisme semble avoir colonisé trois mythèmes qui l’ont de beaucoup précédé. En les adaptant au monde colonial moderne, il a nourri et rénové trois scénarios de romans d’aventures – la chasse au trésor, l’île déserte et l’Éden perdu – en même temps qu’il a vu des fantaisies satiriques dénoncer ses aveuglements et son excès130.
128 Voir la notice biographique de Bernard Desmars, « Beynet, Léon », Dictionnaire biographique du fouriérisme, notice mise en ligne en janvier 2009 : http://www.charlesfourier.fr/spip.php?article602. Consultée le 9 août 2017. Le Roman d’un défricheur paraît dans Le Courrier de Sétif en 1874 et à Paris dans la librairie illustrée en 1876. Il reparaît en 1883 dans L’Avenir de Bel-Abbès, à la suite d’un autre feuilleton à la couleur algérienne, La Folle de Constantine, de Turpin de Sansay. Ce dernier auteur, librettiste et parolier, n’a cependant aucun lien avéré avec l’Algérie, et le roman n’est pas répertorié dans le catalogue de la BNF : difficile d’y voir une politique éditoriale locale. 129 Léon Beynet, « Le roman d’un défricheur », L’Avenir de Bel-Abbès, 1er décembre 1883. 130 Jean-Marie Seillan, « Organiser les nouveaux mondes : les rémanences saint-simoniennes dans les fictions coloniales françaises du XIXe siècle », Les Cahiers de la Sielec n° 10. Les nouveaux mondes coloniaux, Paris- Pondichéry, Kailash, 2014, p. 53.
453
Dans les textes de Beynet, la figure du défricheur conjugue plusieurs de ces
caractéristiques et constitue l’un des piliers de l’imaginaire colonial. La citation de son
feuilleton est une introduction à un propos plus large : l’on peut maintenant comparer deux
publications fictionnelles coloniales pour voir dans quelle mesure il y a une parenté entre eux,
et dans quelle mesure se révèle alors, de manière plus homogène que ce que nous avons pu
étudier auparavant, les traits d’une écriture coloniale. Ainsi d’un feuilleton de Léon Jurquet, Un
amour à la Martinique, paru dans Les Antilles en 1874 ; et du feuilleton Une Mauresque, publié
anonymement dans La France algérienne en 1846. Bien que les territoires concernés ne
relèvent pas du même statut colonial et ne bénéficient pas de la même image, les deux textes
sont explicitement, et dès leurs titres respectifs, locaux ; ils paraissent dans une presse elle aussi
locale. En outre, les deux incipits font comprendre comment se signale l’ancrage colonial dans
les récits, selon une continuité qui défie les trente ans séparant les publications : un ouragan
d’un côté, une pêche de l’autre ; un jeune homme mystérieux d’un côté, qui finit une promenade
dans la campagne martiniquaise, et deux jeunes touristes parisiens de l’autre, discutant sur un
bateau flottant en Méditerranée. Le cadre d’Un Amour à la Martinique est ainsi placé :
Par une lourde après-midi du mois de juin de 1830, un cavalier superbement monté suivait la route qui conduit de la ville de Saint-Pierre vers le nord de l’île. La température était accablante malgré l’élévation où se trouvait notre voyageur par rapport à la plaine qui se déroulait à sa gauche. Des nuages noirs et épais, arrêtés par les cimes des montagnes, couvraient le ciel comme un sombre manteau de plomb. À l’ouest, cependant, le soleil encore dans tout son éclat à l’horizon, jetait sur la nappe bleue de l’Océan, une lumière brillante qui contrastait tristement avec le lugubre aspect du ciel.
Un silence morne et désolé régnait à cette hauteur. Tout ce qui anime habituellement ces régions élevées s’était tu. Les oiseaux fuyaient à tire d’aile, sans un cri, sans une note dans la voix ; les arbres gardaient une immobilité pétrifiante, penchés sur le bord des précipices sans fond qui semblaient vouloir les aspirer. Pas un bruit, pas un bourdonnement, pas un souffle, la nature était muette.
Nul doute qu’un de ces ouragans, comme il en éclate parfois sous les tropiques, allait se déchaîner avant longtemps131.
Dans Une Mauresque, l’incipit joue sur la même utilisation de la nature comme cadre
reconnaissable :
Pendant les trois premières semaines du mois de juin 1838, le soleil qui se lève derrière le petit Atlas, sur le golfe d’Alger, vint régulièrement éclairer un spectacle le plus insolite, le plus extraordinaire, le plus phénoménal, le plus impossible des spectacles humains… deux jeunes touristes pêchant à la ligne !
Certes, on ne quitte pas communément sa famille, ses amis, ses bonnes causeries, ses bonnes promenades du boulevard de Gand, ses
131 Léon Jurquet, « Un amour à la Martinique. Chapitre premier : l’ouragan », Les Antilles, 30 mai 1874.
454
douces habitudes parisiennes, sa loge aux Bouffes, tout son monde élégant, facile, voluptueux de la grande capitale ; on ne subit pas la traversée de l’élément perfide avec toutes ses fatigues et toutes ses nausées ; on ne débarque pas sur la côte barbaresque, au bas de cette carrière pyramidale de maisons qui s’appelle Alger, on n’affronte pas son dur soleil, son brûlant simoun, ses Arabes infects et repoussants, pour venir ensuite chaque jour, à la première aube, détacher une barque du rivage, voguer longuement vers les parages du cap Caxine, jeter une amarre dans un fond sablonneux, et là, stationnaire dans son esquif immobile, tendre avec patience aux poissons de la Méditerranée une amorce quelconque au bout d’un fil qui fait vaciller entre deux eaux, sous une pâture perfide, un acier aigu et dentelé. Non ! il faudrait être devenu monomane ! Or, Messieurs Adolphe Marcian et Eudoxe de Bérail, qui avaient, de point en point, agi comme nous venons de le dire, n’étaient pas, n’avaient jamais été monomanes132.
Le ton du premier texte est sérieux, romanesque ; dans le deuxième, le narrateur affiche
d’emblée une proximité avec le lecteur qui passe par la dérision, et par une portée plus satirique
que l’on repère aux énumérations racistes qui décrivent Alger. De la même manière, les
hyperboles qui inaugurent le texte et se résolvent dans une chute déceptive signalent ce jeu qui
va régir l’ensemble de la nouvelle et lui donner son identité. Pourquoi, malgré des systèmes de
narration proches, un personnage mystérieux sur fond d’ouragan, et deux touristes vaguement
ridicules dans une barque ? La différence ne tient-elle qu’à la particularité des auteurs, ou peut-
on essayer d’en tirer autre chose, qui ressortirait davantage aux contextes de publication ? Le
récit martiniquais date de 1874, le récit algérien de 1846 : à tout prendre, l’on pouvait s’attendre
à ce qu’un auteur des années 1870 utilise la dérision, et qu’un auteur des années 1840 reste
davantage sur le modèle de la littérature de feuilleton, littérature dramatique mais sérieuse.
L’Algérie cependant, on l’a vu, va connaître une production humoristique et satirique
importante ; la proximité avec Paris lui permet de mettre en scène et de ridiculiser les touristes
dès les premières années de la production littéraire locale. La Martinique, plus éloignée, est
davantage régie par le motif littéraire des inconnus qui recommencent une vie loin de la
métropole : en fait, chacun de ces feuilletons respecte une identité locale déjà ancrée par
différents textes dans l’imaginaire colonial. Le délai entre le moment de publication et le
moment du récit est intéressant également, parce qu’il relève de la même mise en valeur de
l’identité du territoire en tant que colonie, avec ses particularités : en Algérie, cela se joue à
moins de dix ans ; en Martinique, le récit remonte à la période de l’esclavage, plus de quarante
ans avant la publication. L’on retrouve enfin dans les Antilles l’importance de la nature, en
Algérie la représentation de la ville et la scène, devenue lieu commun, des communications sur
132 « Une Mauresque. Chapitre premier : la vertu récompensée », La France algérienne, 23 juillet 1846.
455
le balcon : ainsi se développent les thèmes propres à chaque colonie, dans l’espace médiatique
dévolu au feuilleton.
D’autres feuilletons peuvent encore être mis en relation avec des publications livresques
et coloniales. Ainsi d’« Un Drame à Saint-Paul », feuilleton paru dans Le Courrier de Saint-
Paul en 1846 et signé C.A., initiales non élucidées133. Ce « drame » dont le titre dit
immédiatement l’ancrage local appartient à un journal qui affiche des prétentions littéraires, et
paraît sur quatre numéros. L’on y retrouve le mystère des nouveaux débarqués, exactement
comme dans « Une Princesse russe à l’île Bourbon134 » qui paraît dans Le Colon en 1854 sous
la plume de Georges Azéma – il « doublera » son propos avec son roman Noëlla135. Le narrateur
du « Drame à Saint-Paul » s’y met en scène dans les premières lignes, selon des modalités qui
font de lui un auteur colonial, présent dans l’île et conscient de ses particularités :
Or donc, après avoir promené quelques instants dans ma chambre, après avoir tenté de me livrer à une étude sérieuse, ayant vainement essayé du style épistolaire, et ne sachant à quel saint me vouer pour en obtenir une inspiration, je pris, en désespoir de cause, ma bonne pipe. […]
Le thermomètre marquait 28° Réaumur à l’ombre ; les rues de Saint-Paul étaient transformées en autant de fournaises ; aussi, avais-je établi des ventilateurs ; un énorme bouquet de roses et d’œillets que j’avais acheté le matin, remplissait ma chambre de son parfum si doux ; des petits anglais sautillant sur les citronniers de mon jardin, faisaient entendre leurs cris joyeux, et tous mes sens jouissaient à la fois. […]
Oh ! j’étais bien ainsi… j’avais banni loin de moi toute idée des misères de ce bas monde ; j’avais rompu avec tous les mortels ; je n’étais plus sur la terre ; je ne pensais plus à l’ennui qui dévore mes journées, aux tristes ressources qu’il me fallait mettre en usage pour tuer, comme on dit vulgairement, mon temps ; je laissai derrière moi l’insipide cortège des soucis ; j’oubliai même la France, mon si beau pays, et je rêvai.
133 Fabienne Jean-Baptiste écrit à propos de l’auteur, p.548 de sa thèse : « C.A. est feuilletoniste attitré du Courrier de Saint-Paul de février à juillet 1846. Il tient en haleine les abonnés du 6 au 27 février 1846 avec son feuilleton « Un Drame à Saint-Paul ». Cette fiction comporte amour, méfaits et mensonges, vengeances, fausses identités et rebondissements. « Un drame à Saint-Paul » peut être considéré comme un roman-feuilleton. C.A. est un publiciste polyvalent qui ne se cantonne pas au feuilleton. Il commente les quelques spectacles et concerts, dont « Concert d’artistes » que l’abonné du Courrier de Saint-Paul, peut lire dans le rez-de-chaussée du vendredi 16 janvier 1846. Dans le Courrier de Saint-Paul du vendredi 10 juillet 1846, il assure « les faits divers ». Dans son « Drame à Saint-Paul », C.A, en auteur implicite, nous transmet sa nostalgie de la France et ses « soucis ». Il soupire « […] je laisse derrière moi l’insipide cortège de soucis, j’oubliais même la France, mon si beau pays […] ». Ce regret est bien celui d’un Européen. Notre auteur serait gravement malade ; ses « soucis » seraient des soucis de santé. Effectivement, à partir du mois de mai 1846, il semble moins constant et moins présent au sein des colonnes du Courrier de Saint-Paul. En outre, il tarde à répondre à une attaque d’un certain L.R, furieux des moqueries à l’encontre de Tiburce Barbajot de la Grenouillère. Gustave Houpiart, rédacteur en chef excuse son feuilletoniste, « accablé de graves indispositions ». L’hypothèse de sa maladie est accréditée par la promotion de Bénédict Henry Lacombe en feuilletoniste en titre du Courrier de Saint-Paul. La signature de C.A disparaît de la feuille de l’arrondissement sous le vent à partir d’août 1846 ». 134 Georges Azéma, « Une Princesse russe à l’île Bourbon », Le Colon, 24 mars 1854 (numéros manquants). 135 Georges Azéma, Noëlla, Paris, Hachette, 1864.
456
Or, voici ce que je vis en rêve136.
Colonial, donc, le narrateur l’est d’abord par la description ébauchée de son habitation
réunionnaise, par la mention de la France également, voire par le « style épistolaire » qu’il
évoque initialement et que nous avons déjà étudié. Mais il affiche d’autres facettes, qui
transforment ce feuilleton colonial banal en tentative (certes peu concluante) de nouvelle. Le
narrateur reprend ainsi la parole d’épisode en épisode ; précisant qu’il est accompagné d’un
sylphe, il s’en aide pour des descriptions aériennes des paysages où se jouent les actions de son
drame. Cette attention portée aux paysages, ces personnages attendus dans la littérature
réunionnaise que sont les nouveaux débarqués cachant leur identité : ces deux traits relèvent
bien d’une littérature coloniale. Mais l’intéressant ici réside également dans la manière dont le
paysage est donc appréhendé :
La nuit profonde qui environnait Saint-Paul nous permit de nous transporter invisibles ; après avoir longé la Chaussée, nous suivîmes le chemin qui conduit à la ravine d’Yvon ; le sentier, en différents endroits, était obstrué par d’énormes roches que la nature avait détachées dans ses puissantes convulsions. Nous avions dépassé depuis quelques temps le pont délabré qui est au-dessus de la Source, et prenant à droite, à travers les champs incultes, nous foulions l’herbe appelée patate à Durand ; mes pieds embarrassés dans les tiges rampantes de cette plante si funeste aux punaises, ne m’auraient pas permis de continuer la route sans tomber, si je n’avais été soutenu par l’esprit des airs qui protégeait mes pas. Nous nous acheminions vers la rive droite du Bernica, et à travers les échappées que les nuages permettaient à la lune de nous donner, je distinguais une nature aride ; un gazon rabougri, desséché, tapissait le sol ; d’autres roches détachées gisaient çà et là, et quelques bois-noirs, quelques palmiers élevaient de temps à autre leur cime élevée au-dessus de cette désolation. La transition de cette contrée sauvage avec le site pittoresque et verdoyant qui, le matin, avait charmé mes yeux, me fit mal au cœur ; je me demandai pourquoi Dieu s’était tant complu dans les contrastes, dans cette palinodie de sa première idée lorsqu’il créa le monde. Le sylphe qui devinait mes pensées me dit : « Ce contraste que tu déplores tant, a été fait par Dieu autant pour la nature végétale que pour la nature animale. C’est ainsi qu’à côté du juste, du bon Menneval, tu as vu Gustave le pervers, le débauché137 ».
Le retour aux personnages permet au narrateur de revenir également à l’intrigue ; mais
ce décrochement aérien, cette pause permise par le « sylphe » qui l’accompagne – et qui
accompagne aussi son écriture – donne à voir le projet littéraire d’un publiciste du Courrier de
Saint-Paul dans les années 1840. Être local, mais sans être folkloriste ; connaître le territoire,
mais le faire découvrir, y compris par des biais surnaturels ; utiliser les ressources d’histoires
répandues sur les bons et les mauvais arrivants dans les colonies, mais en se servant de ce
136 C.A., « Un Drame à Saint-Paul », Le Courrier de Saint-Paul, 6 février 1846. 137 Ibid., 13 février 1846.
457
manichéisme pour afficher une prétention plus large. La prétention réaliste cède ici le pas : et
en effet, si le critère réaliste est souvent l’un des éléments définitoires de la littérature coloniale,
l’on peut poser la question de sa présence pendant la période romantique. Parler alors d’écriture
coloniale permet de contourner la catégorie stricte de littérature coloniale et de faire entrer dans
le corpus ces textes inspirés par la mode littéraire, mais conditionnés dans le même temps par
les exigences d’une écriture locale.
Ces feuilletons et fictions locales, qui constituent à proprement parler les formes les plus
reconnaissables de la littérature coloniale en formation, sont souvent accompagnées d’un
métadiscours qui constitue l’un des points communs entre le corpus de littérature coloniale et
le corpus de littérature médiatique coloniale ; car « l’obsession métalittéraire [est un] trait
marquant de l’écriture périodique au XIXe siècle138 », et la littérature coloniale ne se conçoit
qu’accompagnée d’un arsenal théorique propre à en expliquer les desseins. Dans cette
perspective, l’on peut citer une critique parue sur Léon Beynet, justement, et qui paraît dans Le
Moniteur de l’Algérie :
Sous le titre de : Les Drames du Désert, M. Léon Beynet vient de publier, chez Dentu, un ouvrage qui dénote, de la part de son auteur, des qualités littéraires incontestables et une connaissance sérieuse des mœurs indigènes. Nous en détachons les pages suivantes, dans lesquelles se trouve mise en lumière une physionomie de cadhi prévaricateur que nous recommandons comme un type accompli, au point de vue purement littéraire, bien entendu139.
« Qualités littéraires » et « connaissance sérieuse des mœurs indigènes » : ces deux
aspects que le publiciste anonyme trouve à l’œuvre de Beynet, on les retrouvera comme balises
des définitions de la littérature coloniale. La nuance finale même du jugement appartient à ce
qui ressortit à la littérature coloniale : le « type accompli, au point de vue purement littéraire,
bien entendu » signale la distance prise par rapport au réalisme. Le texte n’est pas complètement
documentaire ; l’on est encore à une période de transition, en quelque sorte, entre la
revendication de la fiction et l’approfondissement de la « connaissance ». Ce discours critique
est intéressant, en outre, parce qu’il désigne clairement un aspect non négligeable de définition
de la littérature coloniale, à savoir la formidable somme, descriptive ou prescriptive, de textes
qui accompagnent les publications.
138 Corinne Saminadayar-Perrin, art. cit., p. 127. 139 « Un mariage arabe », Le Moniteur de l’Algérie, 20 novembre 1862.
458
Le refus de la littérarité, un programme impossible
L’on a vu dans la première partie à quel point les prospectus des journaux coloniaux
comptent, tant ils définissent une part de l’identité coloniale en établissant le programme de la
publication médiatique à venir. Or dans la présentation du Courrier de Saigon, au milieu des
considérations politiques et techniques sur la colonisation de la Cochinchine, un paragraphe
explique plus précisément les ambitions du journal en ce qui concerne le genre des textes qui y
seront publiés :
C’est pourquoi ce journal ne saurait réussir qu’à la condition d’être une œuvre collective à laquelle chacun apportera le tribut de sa spécialité, et il est presque inutile d’ajouter qu’un tel plan interdit toute pensée de prétention littéraire. La forme s’effacera donc ici devant le fonds, et dussent ces colonnes n’être qu’une compilation un peu désordonnée des faits et des renseignements de tout genre dont nous manquons encore sur le pays, nous n’en croirions pas moins avoir rendu un service essentiel en leur ouvrant un asile commun140.
Le refus de la littérature, et l’affirmation de la compilation comme possibilité
d’écriture : dans ce métadiscours tenu sur le contenu à venir du journal, ils témoignent du statut
accordé aux textes médiatiques dans l’esprit du rédacteur, partant dans la représentation
officielle de l’objet qu’est le journal. De fait, il faut convenir que la « prétention littéraire » est
une expression difficile à définir : en 1864, sans doute cela vise-t-il les fictions d’abord ; mais
plus largement, et les phrases suivantes le confirment, il est aussi question d’écriture, de
procédés et de détails dans la rédaction qui font qu’un texte est « littéraire ». Pour le rédacteur,
cela semble clair : Le Courrier de Saïgon est un journal sérieux, à l’image de la colonie, orienté
tout entier vers la production agricole. Las, le journal fait pourtant paraître, et assez rapidement,
des textes qui ne remplissent pas entièrement ce programme : des variétés, des traductions, des
correspondances, des textes ethnographiques mêmes donnent à lire des écritures variées,
travaillées, agréables. Ce discours inaugural est donc intéressant par ce qu’il promet sans
pouvoir le tenir : c’est le cas de nombreux métadiscours reproduits dans les journaux. Tout
comme Roland Lebel, en produisant un discours sur les littératures exotiques, théorisait une
littérature coloniale canonique, la littérature médiatique coloniale peut avoir son métadiscours
révélateur, son développement théorique : il se construit seulement de journal en journal,
mettant en mot l’idéologie coloniale.
Pour faire le lien entre les deux programmes, revenons en 1931, lorsque Lebel
écrit : « Est-il besoin de rappeler l’image du caïd grand seigneur, de la musulmane
140 Le Courrier de Saïgon, 1er janvier 1864.
459
désenchantée, et les mobiliers en bois de bananier, et les pieds de table en vertèbres de tigre, et
les tiges de musc, et l’odeur des ʺisles141ʺ ? » Les littératures exotiques apparaissent ici avec
des ancrages et des représentations différentes : les personnages stéréotypés sont le fait de
l’Orient, les détails sont mis en relation avec les îles, les colonies de plantation ou l’Asie visible
aux « pieds de table en vertèbres de tigre ». La littérature coloniale se caractérise par son refus
proclamé des stéréotypes ; mais une lecture rapide du corpus de littérature coloniale montre
assez rapidement que d’autres stéréotypes sont utilisés à défaut de ceux-ci : il en est de même
pour le corpus médiatique, qui affiche un programme sans s’y tenir, refuse également les
stéréotypes au motif de l’expérience coloniale, mais écrit selon ces stéréotypes. Chaque terme
de l’énumération de Lebel peut se rapporter à un article que la presse locale produisait en
s’enorgueillissant précisément de l’origine coloniale de ses auteurs. Ainsi, dans le récit du
« Nouvel Actéon », la description du paysage passe par une connivence forte avec le lecteur
contre le personnage :
M. Duflos, honnête épicier d’Alger, avait l’avantage d’examiner cet admirable spectacle du haut de sa terrasse, vu qu’il joignait aux nombreuses qualités qui distinguent en général sa respectable, celle d’être excessivement matineux, et ne ressemblait ni à moi ni à vous peut-être, ami lecteur, qui n’avons jamais vu se lever le soleil ailleurs que dans le ciel de l’Opéra. Cependant, les idées qui occupaient M. Duflos dans sa profonde contemplation, ne se rattachaient que d’une manière très indirecte au culte de la nature. On va en juger par le monologue suivant, dont nous garantissons l’authenticité142.
Sous le couvert d’un ton badin, la garantie de l’authenticité qui clôt ce paragraphe ainsi
que la mention d’un lever de soleil factice signalent que la voix narratrice refuse un exotisme
bon marché : mieux vaut exhiber la fiction plutôt que de revendiquer un réalisme frelaté. Dans
ces connivences avec le lectorat qui valent presque pour une déclaration de littérature coloniale
tant elles reviennent à établir un programme, une forme de refus de la littérature nationale peut
se lire également par le jeu avec ce que laisse supposer un titre comme « Les Mystères de
Constantine ». En effet, le texte commence par l’avertissement suivant : « Il ne s’agit point ici
d’un tapis franc, franc ou arabe, découvert dans la cité élevée, mais de tout autre chose143 »,
plaisante manière de signaler que le texte sera propre à l’auteur, à la colonie, à la ville. Une
écriture de la désinvolture apparaît alors, au sens où le rapport à la métropole est envisagé sous
le chapitre du jeu, et du même refus opposé à la littérarité que représentent Les Mystères de
Paris. Autre voix médiatique, autre démonstration de l’impossibilité de se tenir au refus de la
141 Roland Lebel, Histoire de la littérature coloniale, Paris, Larose, 1931, p. 80. 142 « Un chasseur changé en cerf, ou le nouvel Actéon », L’Akhbar, 10 février 1842. 143 E.N., « Les Mystères de Constantine », La France algérienne, 4 février 1846.
460
« littérature » devenue synonyme d’imagination et non d’authenticité coloniale : dans le
commentaire que fait un publiciste français de la poésie arabe, le discours qui se développe est
à lui seul un morceau de littérature coloniale, malgré sa prétention à être un discours savant.
D’ordinaire, ces poèmes se chantent dans les vallons bleuâtres où les oueds éclairent de reflets d’argent les frêles rameaux du jujubier de Mauritanie, où les euphorbes du Soudant fleurissent au pied des dunes amoncelées, et où les gazelles s’égarent au loin dans un salem asiatique144.
La contextualisation « territorialise » ici le texte ; même si le terme n’est sans doute pas
le plus propre, il renvoie en effet à l’adjonction de stéréotypes renvoyant aux paysages et à la
langue dans un même mouvement. C’est par ce geste que le commentateur français établit
l’identité du texte qu’il produit, ainsi que son autorité ; et la concurrence entre la parole arabe
traduite et son commentaire ne laisse pas de poser quelques problèmes. Le terme de « salem »,
ainsi, mérite que l’on s’y arrête : il n’est répertorié ni dans les dictionnaires modernes ni dans
les dictionnaires d’époque. Sauf erreur d’impression, il faut donc faire l’hypothèse d’une
tentative de l’auteur : adaptant peut-être le mot arabe de « paix » dont la translittération n’est
pas alors fixée, il a pu faire le pari de l’insertion d’un xénisme afin de confirmer la « couleur
locale » de son écrit, et confirmer sa connaissance de la langue arabe qu’il met déjà en scène
par la préciosité du langage. L’hétérolinguisme qui apparaît sera celui que l’on retrouve dans
les publications littéraires coloniales affichant ce rapport à la langue comme preuve de leur
appartenance locale. Plus largement, ce que ces exemples tendent à montrer, c’est l’apparition,
par touches, d’un refus de littérarité. Cette littérarité est mal définie et se confond avec les
stéréotypes, l’exotisme fallacieux, le superficiel. Malgré les dénégations initiales ou
surplombantes, les productions coloniales finissent pourtant par user des mêmes moyens que
ceux qu’ils dénoncent. Médiatique ou non, l’écriture coloniale se signale ainsi par la pesanteur
d’un programme qui lui assigne une esthétique particulière, liée à son contexte social et
politique ; les textes produits se signalent par leur peu de conformité à ce programme, comme
en témoignent les motifs et personnages qui circulent dans des corpus aux supports différents.
Motifs et personnages récurrents : du feuilleton au livre
« La poudre a parlé ; les chiens qui peuplent les douars arabes se sont précipités au-
devant du bruit et ont poussé des gémissements tumultueux. Femmes, enfants sont sortis
144 Augustin Marquand, « Les Poètes du Sa’hara », Le Moniteur de l’Algérie, 13 novembre 1864.
461
aussitôt de leurs tentes, et les chefs de famille se sont avancés145 » : cet incipit in medias res
d’une « nouvelle algérienne » publiée dans le journal officiel de la colonie prouve assez
comment, dans les années 1860, une fiction dite algérienne se fonde encore sur les récits
orientalistes en vogue une vingtaine d’années auparavant. La métaphore initiale, la mention du
douar dont on précise qu’il est arabe ; le détail des tentes et des chefs de famille : cet ensemble
constitue le rappel du caractère oriental de la scène. De ce constat que les périodiques algériens
utilisent les stéréotypes littéraires naît un autre questionnement : quels sont les motifs, les
personnages récurrents que l’on peut lire dans les journaux coloniaux locaux et qui fondent la
colonie sur des procédés littéraires reconnaissables, qui seront utilisés par les défenseurs de la
littérature coloniale ? En établissant des allers-retours entre les textes reconnus comme
appartenant au corpus de la littérature coloniale et les thèmes de la presse coloniale, l’on pourra
repérer certains liens qui participent à la création d’une identité commune. Ainsi, quand Pierre
Jourda traite de La Dette de Ben Aïssa comme d’un « roman de la fraternisation », c’est
l’idéologie du métissage et de l’assimilation qui est ainsi mise en mots146. Dans ce roman publié
en 1876, un garçon kabyle dont la famille a été anéantie par les soldats est recueilli par une
famille française et élevé avec leur petite fille : après l’histoire d’amour entre les deux enfants,
Aïssa devient officier, chrétien, européen, et meurt dans les premiers jours de 1870 en sauvant
le fiancé de sa sœur. Publié dans le Journal de la jeunesse en 1874, et chez Hachette ensuite, le
roman bénéficie visiblement d’un certain succès de librairie. Sans pousser jusque-là le thème
de l’assimilation, l’on peut trouver des perspectives communes entre ce texte et les textes de
presse. Le Moniteur de l’Algérie varie ses publications fictionnelles : en 1865, le chaouch
Hassen est le héros éponyme d’un feuilleton dont nous avons cité quelques lignes pour
commencer ce développement. Auxiliaire des forces françaises, il se déguise en chef arabe ainsi
pour mener à bien une mission d’espionnage, et l’auteur de conclure : « Malgré une attention
soutenue, il eût été difficile de reconnaître dans ce brillant attirail le chaouch Hassen. Son maître
lui-même eût peut-être hésité, tant la métamorphose du spahi était complète147 ». Le spahi
colonial, témoin de la colonisation en marche, se déguise en chef arabe : par le costume, c’est
une transformation culturelle et temporelle qui a lieu, et qui fait d’Hassen le meilleur
représentant de l’assimilation au système culturel français. Toujours en repartant de notre
145 E.-J. Sartor, « Hassen le chaouch. Nouvelle algérienne », Le Moniteur de l’Algérie, du 29 novembre au 2 décembre 1865. 146 Pierre Jourda, L’Exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand, tome II. Du romantisme à 1939, Paris, PUF, 1956, p. 207. 147 E.J. Sartor, « Hassen le chaouch. Nouvelle algérienne », Le Moniteur de l’Algérie, du 29 novembre au 2 décembre 1865.
462
roman initial, l’on peut aussi trouver le pendant d’Hassen le chaouch, qui implique une plus
grande représentation de la France en arrière-plan. Le soldat de l’armée d’Afrique doit aussi
être Français – annonçant en cela le personnage de Pierre Loti quelques décennies plus tard148.
Dans « En vacances », feuilleton paru dans la presse algérienne en 1866, si l’action se déroule
en Auvergne, le personnage principal, Dauronne, a bruni au soleil de l’Afrique, puisque c’est
un capitaine des zouaves rentré dans son village pour quelques temps après dix ans
d’absence : « Notre voyageur n’était pas beau, d’un teint que la nature avait fait brun et que
l’Afrique venait de faire noir149 ». Le texte débute par un dialogue d’un villageois, camarade de
Dauronne, qui veut aller s’installer en Algérie : s’ensuit un récit enchâssé. Ce récit, publié par
une femme qui exerce sa profession de sage-femme à Alger, est suivi par la publication d’un
autre feuilleton, « L’agneau du docteur Reichenspercher », signé Ernest Zeys, un jeune
magistrat qui a droit, quant à lui, à une présentation en tant que « jeune magistrat
algérien150 » : le journal est bien alors dans une dynamique de publication d’auteurs locaux. Ces
personnages de soldats représentent un fond non négligeable des premières littératures
algériennes – au sens où l’Algérie est le centre du récit.
Quand Alphonse Alizart publie ses « Souvenirs d’un voyage de l’île Bourbon en
France151 » dans Le Courrier de Saint-Pierre en 1871, il précise en sous-titre « à bord de la
corvette l’Égérie » et décrit en effet sa traversée, on l’a déjà mentionné dans la partie
précédente. Mais l’on peut maintenant, puisque notre perspective s’élargit et perd de sa myopie
initiale, noter que ces descriptions sont habituelles dans les récits exotiques – de Farrère152 à
Londres, en passant par Céline ou de petits auteurs coloniaux du début du siècle, les occupations
sur le bateau sont une part importante du récit de voyage, jusqu’à des échos entre textes qui
prouvent que c’est un passage obligé du genre, difficile à renouveler mais révélateur des
esthétiques multiples que l’on peut trouver. Le bateau colonial inaugure également les
premières pages du Roman d’une coloniale au titre explicite, et qui tend en effet à condenser
plusieurs thèmes jugés coloniaux. Après le titre de la première partie, « En route », on
148 Paru en 1881. 149 Anna Puéjac, « En vacances », Le Moniteur de l’Algérie, du 7 au 14 mars 1866. 150 Ernest Zeys, « L’agneau du docteur Reichenspercher », Le Moniteur de l’Algérie, 4 avril 18566. Sur l’auteur, voir dans les Cahiers d’Histoire de la Justice l’article de Florence Renucci. « Le meilleur d'entre nous ? Ernest Zeys ou le parcours d'un juge de paix en Algérie », La petite justice Outre-mer, tome VI : Justicia illitterata : aequitate uti ? La conquête de la toison, CHJ éditeur, 2010, p. 67-85. URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00557527. Consulté le 11 avril 2017. 151 Alphonse Alizart, « « Souvenirs d’un voyage de l’île Bourbon en France », Le Courrier de Saint-Pierre, mai 1871. 152 Claude Farrère, Mes voyages. La promenade d’Extrême-Orient, [Flammarion, 1923], Paris- Pondichéry, Kailash, 1992.
463
lit : « Bord Djemmah, 25 septembre 1896. Nous sommes en route. Depuis quatre heures, nous
avons quitté Marseille, je suis une coloniale153 ». La transformation opère dès le rivage
métropolitain quitté : et c’est bien une transformation, ou mieux une éducation que le roman va
donner à lire. La traversée amène en effet la narratrice, jeune fille qui tient son journal intime,
jusqu’à Madagascar ; et tout y est des éléments attendus pour décrire la vie coloniale : la
fascination pour les toponymes étrangers, la description des passagers, les représentations
attendues – l’on trouve la mention d’un tirailleur sénégalais qui tient la tête coupée d’un ennemi,
habitude condamnée par son officier français qui parle de « cannibale154 » –, enfin l’épilogue
qui montre le courage de la jeune fille, devenue orpheline mais qui choisit de rester sur le
territoire colonial. Tous ces thèmes sont présents, épars, dans la presse coloniale ; faire entrer
en résonance ces corpus s’avère intéressant, tant on perçoit alors la force d’un imaginaire
colonial omniprésent au tournant du siècle.
Si l’on dépasse cette période, et ne serait-ce que d’un point de vue lexical, il est tentant
de confronter l’écriture coloniale et l’écriture postcoloniale : les deux corpus se succèdent
chronologiquement mais se font face idéologiquement. Dans cette dynamique qui rappelle
celle, plus générale, des mouvements littéraires, l’on décèle cependant des éléments
supplémentaires. Il s’agit de la relecture de toute une production à l’aune de bouleversements
idéologiques majeurs qui tendent à prouver les liens entre le contexte et la production
littéraire ; et la presse participe de cette succession par le rôle premier qu’elle a pu jouer dans
les colonies. Comprendre cette presse passe donc par la relecture orientée du corpus de
littérature postcoloniale, corpus immense et protéiforme, toujours en expansion, et dont l’on ne
peut étudier ici que quelques réalisations sous la forme d’hypothèses de lecture.
2.3 La littérature postcoloniale ou l’écriture comme réponse
L’idée d’une littérature postcoloniale constituée en réponse à la littérature coloniale a
fait florès, et est même devenue l’un des critères qui sert à définir la littérature
postcoloniale : elle est une littérature de réponse, de renversement, de retournement155. Mais, et
la construction lexicale en témoigne, il y a bien un premier discours auquel répondre, une
153 Hubert Clary, Le Roman d’une coloniale, Paris, Grasset, 1911, p. 1. 154 Ibid., p. 111. 155 Le paradigme de ce retournement se lit dans la manière dont Aimé Césaire réécrit La Tempête de Shakespeare en publiant Une Tempête et en retravaillant principalement le personnage de Caliban. De manière plus générale, les études littéraires utilisent ce motif, y compris comme modèle interprétatif : voir par exemple Jack A. Yeager, The Vietnamese Novel in French, a literary response to colonialism, University Press of New England, Hanover and London, 1987.
464
première idée à renverser ou à retourner. Parfois la réponse se fait par rapport à un texte
littéraire : l’exemple le plus éclatant serait sans doute Meursault, contre-enquête156. Le long
récit du narrateur, entremêlé d’analyses et de citations, plus largement d’échos de L’Étranger
(jusqu’à la longue réécriture finale signalée par les italiques), renverse le point de vue et
l’histoire, rendant ainsi à l’œuvre première son identité coloniale157. Ce premier type de réponse
oriente toute l’écriture et apparaît comme un fait massif ; mais il est d’autres cas plus discrets,
où la réponse est affaire de nuances, de reprises. Pour ces cas, faisons l’hypothèse que le
discours premier est constitué partiellement par la presse coloniale qui est une forme du discours
colonial, partant de l’identité coloniale. Envisager une comparaison entre la littérature
médiatique coloniale et la littérature postcoloniale peut ainsi se faire dans le cadre d’un
éclairage réciproque de deux corpus qui ne sont pas en lien direct : il est certain que les auteurs
postcoloniaux n’ont pas lu la presse des décennies 1830-1880. Mais si cette presse a bien
contribué, comme nous avons tenté de le montrer, à la formation d’une identité coloniale en
voie d’uniformisation au cours du XIXe siècle, alors la comparaison vise à faire ressortir cette
identité contre laquelle a pu se construire le corpus postcolonial. C’est d’ailleurs une remarque
que l’on peut faire à la lecture par exemple de Mongo Beti : Bernard Mouralis cite ainsi l’auteur
camerounais pour un passage de Ville cruelle, « lorsque le narrateur précise que la description
qu’il donne de la ville de Tanga, au chapitre II, n’a rien à voir avec ce que pourraient en dire
les ʺgéographesʺ, les ʺjournalistesʺ, ʺet encore moins les explorateursʺ (Beti, 1994 : 26158) ».
Dans le cadre de son étude sur les auteurs africains, cette remarque montre en effet comment
est représenté le discours colonial au cœur même d’un roman : et l’on remarquera que les
journalistes arrivent en deuxième position dans l’énumération des composantes de ce discours.
L’un des premiers traits communs serait à chercher dans cette représentation d’une production
littéraire en construction, marquée par l’effort contre : contre le colonialisme d’un côté, contre
ce qui est vu comme la nature hostile de l’autre. Littérature engagée, se représentant également
comme la voie d’accès à un discours authentique sur le territoire : les gestes inauguraux
semblent paradoxalement partager un dénominateur commun. Le but n’est pas de montrer que
la littérature francophone post-coloniale est issue du simple renversement de la littérature
156 Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête, [Alger, Barzakh, 2013], Arles, Actes Sud, 2014. 157 Identité confirmée par le parallèle établi au début du texte entre l’Arabe du roman camusien et le Vendredi de Robinson (p. 13-14) : « C’est un Robinson qui croit changer de destin en tuant son Vendredi, mais découvre qu’il est piégé sur une île et se met à pérorer avec génie comme un perroquet complaisant envers lui-même ». L’on retrouve alors une perspective semblable à celle dont Edward Said fait preuve quand il étudie L’Étranger dans Culture et impérialisme (op. cit.). Voir le chapitre « Camus et l’expérience impériale française », p.248-268. 158 Bernard Mouralis, « Le romancier africain et ʺl’énigme de l’arrivéeʺ », L’Illusion de l’altérité. Études de littérature africaine, Paris, Champion, 2007, p. 95.
465
coloniale : les liens entre les deux corpus sont complexes, et les corpus eux-mêmes s’avèrent
complexes. Les manières d’écrire sont a priori très différentes, et il serait erroné, en plus d’être
méprisant, de réduire la littérature postcoloniale à une simple répétition ou remotivation de la
littérature coloniale, comme si elle ne pouvait pas être pensée par elle-même ou pour elle-
même. Mais il s’agit dans les deux cas d’une littérature en situation, et dans une situation
compliquée, puisque l’on y trouve les problèmes de la langue, de l’identité, de la place du
document, de la légitimité et de la légitimation.
Ces territoires pourtant, dans la perspective qui est la nôtre, possédaient une littérature
coloniale – la Réunion plus que la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie, il est vrai. Il reste enfin
la Cochinchine, qui se trouvera comprise dans l’Indochine : à ce titre particulièrement
représentée dans le corpus de littérature coloniale, l’ancienne Indochine – aujourd’hui le Viêt
Nam, le Laos et le Cambodge – n’est pas souvent présente dans les corpus de littérature
postcoloniale.
Le territoire au centre des corpus
La littérature coloniale a la première, et par la voix de ses théoriciens, introduit l’idée
de l’origine de l’auteur comme facteur important de la présentation des textes, et de littératures
fortement liées aux territoires : la dynamique s’est parfois prolongée après les indépendances.
Un ouvrage comme celui de Jean Déjeux, La Poésie algérienne de 1830 à nos jours, publié
juste après l’indépendance justement, trace encore un trait continu entre les auteurs européens
d’Algérie et les auteurs maghrébins159. Préfacé par Albert Memmi, l’anthologie vaut donc pour
le moment historique qu’elle représente ; mais d’autres auteurs s’étonnent de cette mise en
perspective qu’opère Déjeux. Ainsi d’un article sur les historiens de la conquête : « c’est à la
seule curiosité d’un Jean Déjeux pour les écrivaillons de cette époque que l’on doit de pouvoir
voir Al-Naggâd tenir le rôle de précurseur de la littérature (romanesque) francophone, un rôle
étonnant160 » : l’auteur s’en étonne en effet, car l’analyse des écrits et de la trajectoire d’Al-
Naggâd en fait, dans son article, avant tout un indigène. En Algérie, donc, le territoire semble
primer sur les catégories coloniales instituées, en tout cas pour un auteur comme Jean Déjeux.
Si l’on élargit la perspective, l’on se rend compte que dans le domaine universitaire, plus
récemment, différents ouvrages sur les littératures francophones sont triés par territoire et
159 Jean Déjeux, La Poésie algérienne de 1830 à nos jours. Approches socio-historiques, éditions Mouton, Paris, Publications de l’école pratique des hautes études, 1963. 160 Isabelle Grangaud, « Un point de vue local sur le milieu du XIXe siècle. À propos d’historiens de la conquête », Insaniyat, 19-20|2003, p. 11.
466
embrassent une chronologie assez étendue, sans relever pourtant d’une démarche éditoriale
concertée : en 1991 paraît Les Littératures de l’Océan Indien par Jean-Louis Joubert chez
Edisud, en 1992 La Littérature franco-antillaise de Régis Antoine chez Karthala – et l’auteur
précise les enjeux de cette définition dès les premières lignes de son introduction161. Plusieurs
recherches témoignent encore de cette spécialisation et de cette territorialisation de la littérature,
dans une perspective cette fois recentrée sur les productions littéraires actuelles : que ce soit un
travail sur « la nouvelle caraïbe contemporaine162 », une anthologie parue sous le titre Écrire la
« parole de nuit ». La nouvelle littérature antillaise163, ou encore une thèse qui s’ouvre sur la
question « Qu’est-ce que la littérature océanienne164 ? » dans une perspective pas uniquement
francophone cette fois – l’auteur remarque ainsi : « Les textes des écrivains francophones de
culture océanienne se trouvent donc soit insérés dans les limites d’une littérature qu’on pourrait
qualifier de ʺpré-nationaleʺ, soit intégrés dans le plus grand ensemble francophone, mais assez
rarement dans un contexte géographique et culturel régional165 »... Cet éclatement du corpus
littéraire en corpus territorialisé correspond assez à l’idéologie littéraire promue par la presse
coloniale : chaque espace colonial produit sa propre littérature, même si c’est bien la métropole
qui régit idéologiquement l’ensemble. L’on peut donc s’interroger sur l’écriture du territoire,
différente dans la littérature postcoloniale de ce qui peut apparaître dans la presse coloniale,
orientée selon des perspectives parfois plus régionales, plus locales166. Le point de fuite de ces
différents traitements du territoire dans la littérature trouve son aboutissement dans la
discussion ouverte avec la littérature-monde : cela explique aussi la manière dont Lise Gauvin
dans son ouvrage justifie le découpage des chapitres selon les territoires différents comme une
réponse à la littérature-monde qui risque au contraire de dénaturer les spécificités en imposant
un modèle global167. Le territoire, enjeu des publications médiatiques coloniales, est également
161 Jean-Louis Joubert, op. cit. ; Régis Antoine, La Littérature franco-antillaise. Haïti, Guadeloupe et Martinique, Paris, Karthala, 1992. 162 Dominique Dubois, « La nouvelle caraïbe contemporaine : naissance d'une esthétique post-coloniale », Études anglaises, 2001/2, Tome 54, p. 193-204. 163 Écrire la « parole de nuit ». La nouvelle littérature antillaise, textes rassemblés et introduits par Ralph Ludwig, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 1994. L’anthologie insiste sur l’oralité, cette « parole de nuit » opposée à l’écrit des colonisateurs ; la quatrième de couverture précise également que les nouvelles « témoignent d’une prise de conscience du caractère original de la littérature antillaise, née à un carrefour culturel, lieu de rencontre entre Amérindiens, colons européens, esclaves africains et ouvriers indiens ». 164 Stéphanie Vigier, La Fiction face au passé : Histoire, mémoire et espace-temps dans la fiction littéraire océanienne contemporaine, thèse en littérature française sous la direction de M. le Professeur Paul De Deckker et de Mme la Professeure Raylene Ramsay, University of Auckland et Université de la Nouvelle-Calédonie, soutenue en 2008, p. 8. 165 Ibid., p. 10. 166 Nous pouvons redire ici que les exemples ne ressortiront pas tous aux territoires étudiés : nous faisons le pari que des textes d’Afrique subsaharienne, même s’ils ne répondent pas aux publications périodiques que nous avons étudiées, permettent néanmoins d’élargir la compréhension de corpus différents. 167 Lise Gauvin, Cécile Van den Avenne, Véronique Corinus et Ching Selao (dir.), op. cit.
467
l’enjeu des publications postcoloniales : s’il existe bien une « poétique du roman
postcolonial168 » générale, le territoire est l’une des notions qu’il faut interroger en ce sens. Que
ce soit la traversée des frontières à laquelle est soumis Fama dans Les Soleils des indépendances
ou la manière dont l’Afrique apparaît en transparence dans les pensées des personnages de La
Case du commandeur d’Édouard Glissant, la frontière et l’origine se jouent dans les lignes des
romans postcoloniaux – particulièrement dans ces romans des premières générations qui suivent
les indépendances. Ainsi, le passage de la frontière dans Les Soleils des indépendances arrive à
mêler la scène burlesque et la poéticité de l’espace, la remontée du passé et l’impasse du présent
à travers le filtre que constitue le territoire :
Les villages passèrent et disparurent dans la poussière. Leurs noms frappaient dans Fama des tam-tams de regrets. Déjà la camionnette roulait sur les terres de la province de Horodougou. Ce qui se voyait ou ne se voyait pas, s’entendait ou ne s’entendait pas, se sentait ou ne se sentait pas, tout : les terres, les arbres, les eaux, les hommes et les animaux, tout ce qui entourait aurait dû appartenir à Fama comme sa propre épouse. Monde terrible, changeant, incompréhensible ! De son intérieur sortirent des accents, les accents célébrant la puissance de sa dynastie, le courage de ses valeureux aïeux. À un virage il entendit leurs cavalcades montant à l’assaut des pouvoirs bâtards et illégitimes des présidents de la République et du parti unique. Ces aïeux en avaient le cœur, les bras, la virilité et la tyrannie. Maîtresse des terres, des choses et des vivants du Horodougou, la dynastie accoucha de guerriers virils et intelligents. Pas un grain de sable (la camionnette traversait une plaine grillée par les derniers feux de brousse), pas une main de cette plaine qui n’ait été chevauchée. Partout ils ont attaqué, tué et vaincu.
Le dernier village de la Côte des Ébènes arriva, et après, le poste des douanes, séparant de la République socialiste de Nikinai. Là, Fama piqua le genre de colère qui bouche la gorge d’un serpent d’injures et de baves, et lui communique le frémissement des feuilles. Un bâtard, un vrai, un déhonté de rejeton de la forêt et d’une maman qui n’a sûrement connu ni la moindre bande de tissu, ni la dignité du mariage, osa, debout sur ses deux testicules, sortir de sa bouche que Fama étranger ne pouvait pas traverser sans carte d’identité ! Avez-vous bien entendu ? Fama étranger sur cette terre de Horodougou ? Fama le somma de répéter. Le petit douanier gros, rond, ventru, tout fagoté, de la poitrine aux orteils, avec son ceinturon et ses molletières, se répéta calmement et même parla de révolution, d’indépendance, de destitutions de chefs et de liberté169.
La superposition des territoires se lit dans le passage marquant de la frontière qui coupe
en deux le Horodougou dont Fama est l’héritier. En tant qu’héritier, justement, ce personnage
incarne la manière dont le passé marque le territoire : les « accents » qui émanent de lui, la
façon dont il entend plus encore qu’il ne voit les traces des combats passés témoignent d’une
poétique postcoloniale. Et c’est bien à la littérature postcoloniale, ou plutôt au littérateur
168 Yves Clavaron, Poétique du roman postcolonial, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2011. 169 Ahmadou Kourouma, Les Soleils des indépendances, Paris, Seuil, 1970, p. 100-101.
468
postcolonial, que revient le rôle de mettre en mots et en texte un territoire dynamique, et non
pas figé comme au temps colonial : dynamique parce que parcouru, et dynamique également
par le croisement des temporalités qu’il signifie.
Pythagore était passé du côté des songes errants, qui ne repèrent pas leur paysage et ne s’ancrent dans aucune argile. C’est-à-dire qu’il perdit à jamais la possibilité (qui en vérité ne l’avait qu’effleuré) de distinguer entre le paysage du pays d’avant – que le roi prisonnier avait emporté dans ses méditations de guerrier abandonné, et les esclaves de la Traite bien avant lui dans leurs cauchemars recuits et leurs chairs déchirées : ce recommencement sans fin de terres labourées d’eaux, de bois ravinés, de villes taillées dans l’argile et le sable – l’Afrique –, cet infini qui vous portait à la limite de vos pas, ménageant partout des îlots tranquilles où les hommes et les bêtes voisinaient et s’aidaient comme le font à coup sûr les amas d’étoiles dans le firmament, et le paysage du pays-ci, où tout se répétait à toute allure dans un concentré tourbillonnant de tous les paysages possibles (mais où peut-être la paisible certitude d’être un îlot dans l’infini ou une étoile dans le firmament n’est donnée à personne) : qu’il perdit donc la voyance de ces deux paysages, la connaissance de leur écart : et qu’il ne sut jamais que ce pays d’aujourd’hui était aussi (dans son ressassement acharné) l’ouverture sur un autre infini – l’Amérique –, sur un recommencement d’espaces dilatés, que les découvreurs par prétention de découverte appelèrent le Nouveau Monde : et qu’ainsi cette terre qui le portait sans qu’il s’y plantât commodément était bien un relais originel, un compromis en condensé entre deux infinis au cœur170.
En ce qui concerne la littérature des colonies de plantation, le journal colonial
privilégiait l’histoire comme récit, et la décadence comme modèle. Le geste de la littérature
moderne, postcoloniale, consiste alors à sortir les Antilles, la Guyane et la Réunion de ces
schémas coloniaux pour les faire entrer une autre appréhension historique : c’est ce que fait
Édouard Glissant.
Des liens plus inattendus entre des corpus différents ont pu être analysés, à l’image de
ce qu’a écrit Serge Meitinger sur Évariste de Parny et la poésie en prose171. Si Parny a pu, par
imitation ou plutôt innutrition de la poésie malgache, devenir l’un des premiers auteurs de
poésie en prose et revendiquer cette écriture, alors d’autres liens sont possibles : considérer la
presse coloniale comme un corpus intermédiaire, une ébauche de mouvements à venir, permet
une relecture intéressante de fonctionnements littéraires mis en réseau. C’est donc une altérité
supplémentaire que celle des corpus littéraires constitués ; et puisque la nature complexe de la
170 Édouard Glissant, La Case du Commandeur, [Paris, Seuil, 1981], Paris, Gallimard, 1997, p. 39. 171 Serge Meitinger, « Les Chansons madécasses d’Evariste Parny. Exotisme et libération de la forme poétique », Alain Buisine, Norbert Dodille et Claude Duchet (dir.), L’Exotisme, actes du colloque de Saint-Denis de la Réunion, Cahiers CRLH.CIRAIO, n° 5, 1988, Paris, Didier-Erudition, 1988, p. 295-304.
469
presse coloniale la situe dans des configurations diverses, l’on peut l’envisager comme une
porte ouverte sur des problématiques littéraires larges, touchant toujours à des identités cachées.
De la littérature coloniale à la littérature postcoloniale : la question de la temporalité Le débat est nourri qui entend proposer des modèles de réponse à la question des liens
entre des corpus qu’une frise chronologique ferait apparaître comme émanant l’un de
l’autre ; avant Jean-Marc Moura, János Riesz écrivait dans l’introduction de son ouvrage :
L’évolution de la littérature africaine peut être décrite comme processus de positionnement et d’émancipation face à cette vaste « bibliothèque coloniale ». Nous ne voulons pas nier l’influence des langues et cultures africaines respectives sur les littératures europhones naissantes. Mais elles sont spécifiques et se rapportent à la langue / culture d’origine de chaque auteur ou groupe d’auteurs, tandis que le clivage par rapport aux littératures européennes parlant de l’Afrique sont communs à des auteurs venant de langues et de cultures aussi différentes que l’ibo (Chinua Achebe) ou le yorouba (Wole Soyinka172).
János Riesz aborde les questions coloniales en partant de sa formation de philologue : il
traite les littératures africaines comme les autres littératures, avec les mêmes instruments et les
mêmes lectures, sans partir du présupposé d’une « africanité » ou d’un côté ethnique spécifique.
Plus largement, dans les représentations courantes, l’explication donnée de la naissance d’une
littérature africaine tourne autour de la Première Guerre Mondiale : elle permet la prise de
pouvoir symbolique des auteurs africains, avec le prix Goncourt de René Maran en 1921 ou la
parution de Force-Bonté en 1926, récit autobiographique dans lequel le Sénégalais Bakary
Diallo met en scène un tirailleur qui refuse de perdre foi dans la supériorité française173. Il y
aura alors une réaction d’ouvrages écrits par des coloniaux, censés être « authentiques » : c’est
bien un moment où le monopole du discours sur l’Afrique est remis en question, et ce
mouvement dure jusque dans les années 1930, avec l’attente d’écrivains indigènes174. La
comparaison entre les deux corpus peut aller jusqu’à la remise en question de l’attitude des
lecteurs et chercheurs contemporains face aux textes, dans un dialogue qui porte principalement
sur les éléments des textes et leur interprétation175. Plus largement, plusieurs études ont
172 János Riesz, De la littérature coloniale à la littérature africaine. Prétextes – Contextes – Intertextes, Paris, Karthala, 2007, p. 5. 173 René Maran, Batouala. Véritable roman nègre, Paris, Albin Michel, 1921 et Bakary Diallo, Force-Bonté, Paris, Rieder, 1926. 174 János Riesz, op. cit., p. 34. 175 Ainsi de l’analyse que Pierre Halen fait de la reparution, dans la collection « Autrement mêmes », chez l’Harmattan, de deux romans de Jean Sermaye par Jean-Claude Blachère et Roger Little, en 2010 : Barga, maître de la brousse. Roman de mœurs nigériennes (1937) et Barga l’invincible. Roman de mœurs nigériennes (1941). Il écrit notamment : « Cette volonté de ʺfaire connaître un monde nouveauʺ et de ʺfaire concurrence à l’ethnographieʺ – jusqu’à constituer, dans certains passages, un ʺmanuel cynégétiqueʺ – (I, p. xi), fait bien partie du programme de la littérature coloniale, comme le rappelle utilement Jean-Claude Blachère. Est-ce, pour autant,
470
interrogé la manière dont l’on pouvait considérer les passages d’un corpus à un autre, comme
un lieu commun nécessaire avant de passer à une interrogation plus poussée : « La littérature
des colons prolonge celle des voyageurs, au point que la distinction semble parfois difficile à
soutenir176 ». Littérature des voyageurs, des colons, des anciens colonisés, des nouvelles
générations : par les identités des auteurs se dessinent des problématiques qui semblent
correspondre parfaitement à l’axe chronologique et politique de l’histoire coloniale. C’est ce
récit que nous voulons interroger, justement : il s’agit de faire entrer en résonance des corpus
que l’on place habituellement dans une continuité, de réfléchir selon un axe différent. Envisager
une production littéraire sur le temps long qui mène de la colonisation au moment où nous
écrivons cette thèse s’avère cependant riche, et particulièrement quand il s’agit ensuite d’isoler
des corpus pour faire ressortir leurs particularités et leurs originalités177.
En effet, la littérature coloniale et la littérature postcoloniale traitent le plus souvent des
mêmes sujets, au sens où la constitution même de ces deux corpus indique le rapport au colonial.
Écrire la culture locale, autochtone, est l’un de ces sujets : l’écrivain colonial s’en empare
comme preuve de son acclimatation réussie, l’écrivain postcolonial reprend ses droits sur ce qui
avait été transformé en matériau colonial auparavant. Jean Mariotti écrivant Les Contes de
Poindi dans les années 1940 et Déwé Gorodé dans Tâdo, Tâdo, wéé ! (2012) font ainsi tous
deux la part belle aux contes kanak : au centre de la première œuvre, ils apparaissent plutôt
comme la trame de la seconde, mais une trame cachée et qui se révèle par allusions. Cette
première différence, à savoir la place de la tradition dans le récit, se combine à d’autres traits
caractéristiques des deux corpus. Là où Mariotti décrit d’abord le chasseur Poindi dans une
temporalité vague et ancestrale, fermée sur la Nouvelle-Calédonie, Déwé Gorodé ménage au
conte une place au sein du récit des mouvements indépendantistes du XXe siècle et de l’actualité
de la Nouvelle-Calédonie comme terre de métissage178. Cette première approche fait donc
comme le suggère celui-ci, la ʺmaladie congénitaleʺ du corpus ? Ne peut-on en dire autant de certains romans africains (où les mêmes phénomènes littéraires, bien entendu, ne seront pas appréciés en termes de ʺmaladieʺ mais, au contraire, d’authenticité référentielle ? » Le débat que reprend ici Pierre Halen pose la question de l’image d’auteur dans l’appréhension du texte, partant de la distinction trop nette que l’on voudrait établir entre littérature coloniale et littérature postcoloniale. Référence : Pierre Halen, « Retour sur le ʺroman nègreʺ. À propos de la réédition d’un diptyque de Jean Sermaye », Cahiers d’études africaines, 212|2013. URL : http://etudesafricaines.revues.org/17533. Consulté le 27 janvier 2017. 176 Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, Vanves, EDICEF, 1991, p. 11. 177 Voir la thèse de Virginie Soula, Des ancrages littéraires et identitaires au « destin commun » : une histoire littéraire de la Nouvelle-Calédonie (1853 – 2005), thèse de doctorat en littérature française et francophone, sous la direction de M. le Professeur Xavier Garnier, soutenue à l’Université Paris XIII en 2008. 178 Les Contes de Poindi se rapprochent alors de ce genre colonial constitué par les recueils de contes : Georges Haurigot quand il publie ses Contes nègres sur la Guyane participe du même mouvement qui peint la société autochtone comme intemporelle, presque intraduisible pour les lecteurs métropolitains : devenu passeur, l’auteur
471
ressortir la manière dont c’est dans le rapport à la temporalité que se joue une des premières
différences entre le corpus colonial et son successeur.
Le retour de la créole La créole, personnage vers lequel convergent des problématiques issues des colonies de
plantation, est l’un de ces éléments qui permet de comparer des productions littéraires
différentes. Le personnage a été étudié auparavant pour ses réalisations dans la presse coloniale
et dans la littérature contemporaine de nos textes médiatiques, mais c’est un personnage trop
chargé pour ne pas être repris par la suite, pour ne pas être réécrit selon les modalités et les
obsessions de chaque époque : sans être une coquille vide, c’est un vecteur d’idéologies qui
trouvent à s’incarner dans un personnage féminin, une « figure problématique » sur laquelle des
études conséquentes ont été faites179. Une publication datant de 1944 constitue une sorte de
relais dans l’évolution de la créole, entre le médiatique colonial et le postcolonial : dans
Vaudou, roman de mœurs martiniquaises – dont le sous-titre est significatif du goût pour
l’exotisme colonial – Louis-Charles Royer utilise les mots de Moreau de Saint-Méry à deux
reprises. La première fois dans la bouche du directeur de l’instruction élémentaire, érudit qui
s’intéresse à la sorcellerie et lit à son épouse et son invité un passage du livre du créole ; la
deuxième fois lorsque le jeune héros, amoureux d’une créole mais rentré à Nantes, garde dans
sa poche un passage de l’œuvre portant sur la créole antillaise180. Dans ce roman aux allures
érotiques et coloniales, l’utilisation de l’auteur antillais sert le propos de l’auteur qui insiste sur
la sexualité de ses personnages, des créoles surtout ; mais la présence même de la citation est
intéressante dans le cours du récit, par le contrepoint et l’ancrage dans le passé de l’île qui est
ainsi présenté. Les créoles présentes sont deux sœurs, Valentine et Hortense de Myennes ; mais
elles sont en fait et surtout « quarteronnes », pour employer le terme qui obsède le héros, tenté
d’épouser Hortense mais terrifié par cette ascendance noire. Les créoles de ce roman
appartiennent bien au monde passé que décrit Moreau de Saint-Méry ; elles sont utilisées
comme personnages sexualisés, inquiétants – Valentine est une adepte du vaudou par le biais
colonial est alors érigé en arbitre. Voir Georges Haurigot, Contes nègres, sur la base Manioc, date de publication non déterminée. 179 Nous reprenons une expression du titre de l’article de Jean-Claude Carpanin Marimoutou, « La belle créole. Notes sur une figure problématique de la littérature réunionnaise », L’Océan indien dans les littératures francophones, K. R. Issur et V. Hookoomsing (dir.), Paris, Karthala – Presses de l’Université de Maurice, 2001, p. 407-443. Voir pour des études bien plus poussées la thèse de doctorat en littérature française de Christèle Cantet sous la direction de M. le Professeur Jean-Claude Carpanin Marimoutou, « Mythes et figures de la belle créole dans la littérature de langue française : France, Mascareignes, Antilles française », soutenue en 2005 à l’Université de la Réunion. 180 Louis-Charles Royer, Vaudou. Roman de mœurs martiniquaises, Paris, Les Éditions de France, 1944.
472
de son mari, un planteur noir originaire d’Haïti ; et la chaste Hortense est dépeinte comme la
réplique possible de sa sœur. Là où la presse coloniale constituait un tombeau à l’érudit antillais,
la littérature populaire du XXe siècle le cite à la manière d’un grimoire, rendant ses propos
consubstantiels à une forme de magie exotique. Dans ce roman, le personnage de la créole est
donc devenu objet de fantasme par le biais d’un écrit inaugural. Un roman de Maryse Condé
complète la vision de la Créole : de la mère de famille idéale quoique sensuelle à la femme trop
sensuelle pour ne pas être inquiétante, une première évolution s’est dessinée qui n’est pas
encore achevée. L’on peut voir que jusqu’à La Belle Créole de Maryse Condé – qui est en fait
le nom d’un voilier, mais qui peut aussi désigner Loraine Féréol de Brémont, la « békée »
assassinée –, le personnage de la créole connaît des variations intéressantes181. Là où la belle
créole, au sens premier, constituait le point de départ de la littérature coloniale, médiatique ou
non, au centre d’un faisceau lumineux qui la faisait à la fois héroïne sensuelle, mère de famille
idéale et parfois ange maudit, le roman de Maryse Condé met plutôt au premier plan Dieudonné,
l’assassin présumé, jeune homme noir, issu d’une famille pauvre, et sur lequel l’on transpose le
passé colonial – à tort, comme le précise l’avocat quand il réfléchit à ce schéma qu’il a défendu
dans un discours à l’argumentation « césairienne, voire fanonienne » : « La maîtresse békée
cruelle. L’esclave sans défense. La maîtresse humilie, manie le fouet. Un jour, l’esclave se
libère. En tuant. Baptême du sang182 ». Le renversement est ici complet : de la même manière
que l’île n’est plus synonyme de paradis, mais bien au contraire un espace régi par la violence,
les couvre-feux et les meurtres, la créole n’est plus le ressort principal d’une action dont l’on
pourrait décrire à l’avance l’intrigue : par ce personnage féminin, les Antilles sont en quelque
sorte entrées dans le flux historique qu’on leur refusait jusqu’alors – l’écriture coloniale
préférait le récit des faits d’armes passés, ou le modèle de l’île édénique –, et le mouvement de
renversement historique s’est opéré jusque dans la littérature. La « belle créole » promise par
le titre n’est pas une femme, et d’ailleurs Loraine Féréol de Brémont n’est ni exagérément
cruelle, ni bêtement exemplaire selon la compréhension qu’en a Dieudonné : la complexité du
roman tient, entre autres, à la vision du monde du jeune homme, bien loin d’une relecture
manichéenne de la société antillaise.
Le document et la parole : une représentation de la situation coloniale Le rapport de la littérature postcoloniale au document ne peut être résumé comme la
seule manifestation d’une problématique littéraire moderne plus générale qui remet en cause la
181 Maryse Condé, La Belle Créole, Paris, Mercure de France, 2001. 182 Ibid., p. 51.
473
fiction. Le fait que la littérature coloniale ait été structurée par un antagonisme profond, celui
de l’écrit colonial contre l’oralité indigène, joue un rôle prédominant dans cette question du
document. De cette problématique initiale surgissent deux orientations pour la littérature
postcoloniale : reprendre le document colonial pour mieux lui répondre, et établir sa propre
documentation, sa propre histoire. Dans les pages qui précèdent le récit de La Case du
commandeur, Édouard Glissant précise : « À l’intention du lecteur méticuleux, on trouve en fin
de volume un glossaire assez succinct pour ne pas être rebutant183 ». Ce premier contact avec
le livre signale un soin envers le lecteur non créolophone, non familier des réalités
antillaises ; le glossaire contient en effet des termes créoles utilisés au cours du roman. Il
enrichit également le texte littéraire en offrant une place au document, certes en arrière-plan et
mineure, mais tout de même ouverture sur la capacité qu’a le « lecteur méticuleux » de
connaître autre chose. L’on peut interroger l’adjectif « méticuleux », et l’expression de « lecteur
méticuleux » qui semble si savante et éloignée d’un plaisir de la lecture ; mais cette figure de
narrataire, parce qu’elle existe ainsi au seuil de l’œuvre de Glissant, met néanmoins sur une
piste qui est celle du document. Les glossaires linguistiques dans la littérature postcoloniale
apparaissent assez fréquemment : Déwé Gorodé utilise également ce paratexte dans Tâdo,
Tâdo, wéé !, mais sans cette connivence initiale mise en place par le biais de l’appel au
lecteur184. Chez Patrick Chamoiseau, dans Texaco, le glossaire n’existe pas ; les termes créoles
apparaissent au fil du récit, par la bouche de la conteuse. Parfois expliqués, parfois non, ils
contribuent à une forme d’« antillanisation » progressive du texte, si l’on peut se permettre ce
barbarisme : le lecteur non créolophone prend conscience, au fil des pages, de son acclimatation
progressive à un lexique nouveau, expérimentant ainsi une nouvelle temporalité de lecture. Sur
ce modèle de la présence ou non du document – entendu au sens de fragment écrit qui n’entre
pas dans la logique du récit mais s’y intègre comme une excroissance, des recherches font
apparaître la manière dont l’on peut lier littérature coloniale et littérature postcoloniale par la
place d’un document, symbole colonial par excellence et à ce titre enjeu symbolique, qu’il
appartienne au paratexte ou qu’il y apparaisse par le biais de citations et de jeux intertextuels185.
Au jeu des coïncidences qui font entrer des textes en résonance à plus d’un siècle d’écart, l’on
peut en effet noter que le réunionnais Georges Azéma dans son roman Noëlla (publié chez
183 Édouard Glissant, op. cit., p. 11. 184 Déwé Gorodé, Tâdo, Tâdo, wéé ! ou « No more baby », Tahiti, Au vent des îles, 2012. 185 Une thèse de doctorat est ainsi en préparation sous l’intitulé « La tentation encyclopédique dans les littératures francophones africaines : des documentations coloniales au glossaire contemporain », par Ninon Chavoz, sous la direction de M. le Professeur Xavier Garnier, Université Paris III. Voir aussi, pour la question plus spécifique de l’archive, le dossier intitulé « De l’usage postcolonial de l’archive », Amnis. Revue de civilisation contemporaine Europe/Asie, 2014.
474
Hachette en 1864, dans Le Moniteur de l’île de la Réunion en 1878) insère quant à lui des notes
présentant Bourbon et un glossaire… principalement botanique. Le paratexte, s’il existe dans
les deux cas et accompagne dans les deux cas un récit romanesque, ne vise pas les mêmes
enjeux, et à ce titre apparaît assez caractéristique des perspectives que ces deux productions
littéraires offrent au lecteur. Il est vrai que le geste de collecte qui a été celui des coloniaux est
réutilisé, repris et littérarisé : pour reprendre l’exemple d’Abd el-Kader, le romancier
Abdelkader Djemaï utilise dans son « récit » – et l’étiquette générique est importante – La
Dernière nuit de l’Émir des documents historiques de la colonisation française : mémoires,
journaux, lettres sont autant de voix sur lesquelles se construit le texte moderne et ses
problématiques186. L’exil, les voix coloniales contre la voix du conteur, le fragment et les dates
plutôt que le liant de l’épopée : autant de traces d’une écriture qui n’est pas que retournement
et réponse, mais qui complexifie les liens entre l’écriture coloniale entendue au sens large et
l’écriture postcoloniale dans le sens qu’elle peut avoir et qui dépasse l’acception chronologique.
Outre des scansions historiques qui fonctionnent comme autant de chapitres reprenant chacun
une date importante, la biographie originelle qui marque tout le récit se voit aussi dans les
documents français utilisés : le mémoire de Bugeaud au ministre de la Guerre occupe ainsi
entièrement le chapitre 18, et l’extrait du journal de Jean-Gaudens-Bernard Tatareau,
cartographe et aide de camp du général Boyer, le chapitre 12 ; il reste encore les citations du
duc d’Aumale ou de Saint-Arnaud, la mention des journaux de France aussi. L’ensemble est
donné sans notes de bas de page : il n’est pas question de faire un ouvrage universitaire, mais
bien plutôt, comme le laissait entendre l’épigraphe emprunté à René Char, de « rêver » à partir
des « traces187 ». Ces traces documentaires qui prennent une grande place dans l’œuvre lui
donnent une assise historique forte. Elles effacent aussi le narrateur tant elles sont données sans
transition, et souvent comme un matériau brut, peu commenté et à peine coupé, comme s’il
fallait donner au lecteur l’impression d’une entrée directe dans l’époque. Pourtant, par leur
présence et leur imbrication au récit des derniers instants de l’émir en Algérie, elles donnent à
lire comment l’auteur est parti à la recherche d’Abd el-Kader et dans quelles directions il a
lu : elles mettent en mot la problématique d’une écriture postcoloniale qui doit aussi composer
186 Dans Nos Richesses, Kaouther Adimi a utilisé les archives d’Edmond Charlot, et construit son récit en enchevêtrant l’histoire de Ryad, qui arrive de nos jours à Alger pour fermer l’ancienne librairie de Charlot, et le carnet de l’éditeur algérois qui commence en 1931. La part d’invention dans la publication des carnets n’est pas précisée. 187 « Seules les traces donnent à rêver », épigraphe de La Dernière nuit de l’Émir, Paris, Seuil, 2012, p. 9. Voir Anne Prouteau, « La Dernière nuit de l’Émir de Abdelkader Djemaï : "Seules les traces donnent à rêver" : quand le romancier réécrit l’Histoire ! », en ligne sur Limag. URL : http://www.limag.com/Textes/2015AlgerHommageNagetChristiane/Prouteau.pdf. Consulté le 30 mars 2016.
475
avec le matériau colonial par excellence que constituent les textes et documents. Mais chez
Djemaï les documents coloniaux entrent en dialogue avec la parole de Bachir el-Wahrani, le
conteur fictif qui prend en charge certains passages et est défini ainsi : « Bachir el-Wahrani […]
aimait raconter, en évitant de tomber dans la surenchère ou le lyrisme guerrier, quelques
moments de la vie d’Abd el-Kader188 ».
En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, Didier Daeninckx lorsqu’il écrit Cannibales
ne suit pas exactement le même chemin qu’Abdelkader Djemaï, et de fait les auteurs ainsi que
les sujets sont bien différents – si l’on excepte ce plus petit dénominateur commun que
représente, au départ, la mainmise d’une France coloniale et la confrontation d’une parole
indigène au discours colonial, écrit ou latent189. Et pourtant, par le récit enchâssé, par la présence
de personnages reliant l’époque moderne du soulèvement kanak et celle de l’Exposition
Coloniale de 1931, il met ainsi en réseau plutôt qu’en concurrence deux écritures de la réalité.
C’est de ce geste de mise en réseau, de commentaire et de lien que l’on peut tirer une
ressemblance entre deux écritures pourtant a priori si différentes. Ces exemples d’écritures
modernes autour d’enjeux coloniaux tracent ainsi un mode de relation au document qui n’est
pas celui de n’importe quel roman historique : il s’y joue l’exhibition du document ou du passé
raconté qui devient une véritable poétique. Ces deux récits ne se limitent pas à n’être que les
écrits d’une littérature engagée qui se veut réponse : ils sont le signe d’une certaine poétique
étroitement liée à la modernité et à la prise de conscience de la multiplication des supports et
des écritures. Le journal colonial avait promu le document au même rang que la fiction ; l’on a
vu précédemment les hésitations génériques, les contaminations et les simples présences de
documents scientifiques ou de textes informatifs dans les colonnes des périodiques. Certaines
œuvres postcoloniales retrouvent ce mélange des genres, mais dans une tout autre perspective,
qui est celle de l’élan donné à la littérature par le document ; et par un type particulier de
document : celui qui peut valoir pour témoin et symbole de l’époque coloniale190. À ces
réponses, à ces détournements et reprises, l’on peut enfin associer le recueil de nouvelles
d’Assia Djebar, Femmes dans un appartement d’Alger : reprenant le titre du tableau de
Delacroix, elle tresse autour de femmes algériennes un récit qui prend son élan dans la
confrontation avec l’orientalisme du peintre français – ou plutôt qui est compris dans cette
188 Abdelkader Djemaï, op. cit., p. 45. 189 Didier Daeninckx, Cannibales, Paris, Verdier, 1998. Une nouvelle édition parue en 2015 fait suivre Cannibales du récit Le Retour d’Ataï. 190 L’utilisation du document dans la littérature actuelle est une explication plausible à cette esthétique postcoloniale ; mais elle semble incomplète au vu des liens qu’entretient la littérature postcoloniale avec la bibliothèque coloniale et avec cette utilisation de l’écrit comme preuve de domination.
476
confrontation lancée par le titre et résolue dans la postface191. Le document alors n’est pas celui
que l’on croit ; même pictural, même reconnu pour ses qualités esthétiques, il a tout de même
partie liée avec l’imaginaire colonial, et il s’agit alors de confronter cette peinture, ce document,
à la voix de ces femmes algériennes : elles passent d’objets à sujets. Le lien affiché dans le titre
peut également se voir dans la progression de la première nouvelle, ajoutée à la version initiale
de 1980, « La nuit du récit de Fatima » : autour de Fatima, qualifiée de « narratrice » puis de
« conteuse192 », se trouvent reliées sa mère Arbia, sa belle-fille Anissa, qui elle ne se résout
qu’à faire une « confession ordinaire193 », puis sa petite-fille Meriem. Le récit parcourt alors un
siècle algérien, depuis la Première Guerre Mondiale jusqu’au départ d’Anissa avec sa fille, bien
après l’indépendance. La parole évolue en même temps que les personnages et le cadre,
dépassant la présence coloniale et donnant enfin à entendre les récits de femmes que la
colonisation ne représentait que muettes ou surprises dans leur intimité. Le défaut de parole du
tableau, document colonial initial, devient donc le support d’une écriture postcoloniale qui
réfléchit au silence, au regard et aux résonances entre 1832 et 1980, partant entre la parole
médiatique coloniale dominante et le silence imposé aux indigènes d’alors. Une question
dépasse en effet les problématiques culturelles propres à chaque territoire et tend vers le même
type de réponse : la prise de parole des indigènes et leur accession au discours. Eux que le
journal colonial ignorait, ou dont les élites n’avaient accès qu’à une parole encadrée, sont les
auteurs de la littérature postcoloniale et en sont également le centre. Contrairement aux textes
du long XIXe siècle, il s’agit, pour les romanciers postcoloniaux, de faire advenir un système
de narration qui ne se limite plus seulement à la délégation de parole, mais réorganise tout le
récit en fonction de la voix indigène. L’oralité est ainsi une représentation à interroger : il est
intéressant de la considérer comme une « production coloniale », selon les termes de Kasereka
Kavwahirehi quand il évoque tout un pan des publications coloniales qui « domestiquent » les
« contes », « légendes » ou « mythes » que nous avons évoqués pour notre part dans la partie
précédente, et qu’il relie ces questionnements historiques aux études actuelles194.
191 Assia Djebar, Femmes dans un appartement d’Alger, Paris, Albin Michel, [1980], 2002. L’auteure reprend l’anecdote de l’origine du tableau, développe et explique son geste dans la postface. 192 Ibid., p.29 puis 30. 193 Ibid., p. 44. 194 Kasereka Kavwahirehi, « La littérature orale comme production coloniale », Cahiers d’études africaines, 176|2004. URL : http://etudesafricaines.revues.org/4825. Consulté le 26 janvier 2017.
477
3 La presse coloniale comme clef heuristique
La presse coloniale a nourri des représentations et des imaginaires contre lesquels
s’écrivent les œuvres actuelles : sans que l’écriture postcoloniale soit pensée explicitement
ainsi, l’on remarque pourtant que bien des éléments définitoires de notre corpus sont repris dans
les écritures postcoloniales, mais à l’inverse. Une tension apparaît donc entre deux corpus
antithétiques : étudier cette tension et révéler ses mécanismes constitue la dernière étape de
notre recherche. En effet, la presse coloniale constitue un corpus littéraire étudiable pour lui-
même ; mais ce corpus peut aussi apparaître comme un moyen, comme une raison qui pousse
à relire le corpus postcolonial d’une manière plus poussée que ce que nous avons fait jusqu’ici.
Sans être l’alibi d’une lecture renouvelée du corpus postcolonial, la presse coloniale apparaît
comme un pré-texte au sens chronologique des publications actuelles : elle a tenu un rôle
suffisamment important dans la culture coloniale pour avoir marqué de son empreinte une partie
des productions contemporaines.
Ce dernier chapitre marque donc l’ultime développement d’une exploitation de la presse
coloniale en tant que corpus homogène sur le plan formel et hétérogène quant à son contenu.
Par ces deux traits définitoires, elle se rapproche de la littérature postcoloniale au sens où elle
est habituellement entendue : un corpus de textes réunis par des problématiques communes, par
des postures communes, et qui peut tracer des parallèles riches entre des cultures pourtant bien
différentes. De la même manière, l’on reconnaît à la presse coloniale le mélange de plusieurs
influences, et l’on sait qu’elle se nourrit de différents domaines ; l’on pourrait ainsi énumérer,
d’un point de vue purement théorique, les traits qui rassemblent ces deux corpus à un degré
poussé. Le but de ce troisième chapitre consistera donc à reprendre d’abord la comparaison
entre littérature médiatique coloniale et littérature postcoloniale en approfondissant leurs points
communs. Dans le deuxième chapitre, la démarche se voulait orientée vers la presse
coloniale : ici, la démarche partira de ce corpus pour aller vers le corpus postcolonial.
Littérature coloniale, ethnologique, orale : trois adjectifs que l’on peut rapporter à la presse
coloniale pour mieux comprendre cette effloraison textuelle du XIXe siècle autour des territoires
coloniaux, et qui va se poursuivre au siècle suivant. Pourquoi rapporter alors ces trois catégories
à la presse coloniale ? Parce qu’elle mêle, dans ses colonnes, des prétentions à faire paraître ces
trois axes. Micheline Cambron et Hans-Jürgen Lüsebrink présentent ainsi le fonctionnement
médiatique :
478
Or puisque le journal se présente comme une lecture du monde, un précipité du monde vécu, il faut en déduire que le monde vécu est conçu comme pouvant être saisi, d’un coup d’œil, par le lecteur, lequel redéploie ensuite cette saisie syncrétique en un récit qui, à n’en pas douter, se confond en partie avec un récit commun, une identité narrative commune dont le syncrétisme masque l’individualité des parcours de lecture. La lecture cursive totalisante suggère donc que le lecteur se coletaille avec la totalité du journal, à l’intérieur duquel il circule comme en un pays familier195.
Dans ce cadre, dans cette idée de monde vécu, il n’est pas étonnant qu’apparaissent
différentes entrées propres au monde colonial. Mais, et peut-être plus étonnamment, cette
ambition semble être la même chez les auteurs de littérature postcoloniale, qui visent souvent,
d’après les discours portés sur leurs œuvres, à dire le monde réel et non les fantasmes des
coloniaux ; à exprimer en un seul coup d’œil le monde postcolonial. Envisagés en-dehors de
leurs contextes de production et de réception, l’on peut trouver des similitudes entre les deux
corpus, entre la presse coloniale locale et la littérature postcoloniale. À supposer qu’il y ait bien
une poétique commune aux romans postcoloniaux, l’on peut suivre Yves Clavaron quand il
écrit la définition suivante :
Au-delà de l’esthétique retenue, le roman postcolonial se propose à la fois de contester l’ordre établi grâce à une prose dialogique, de construire une vision totalisante du monde – d’un monde donné – et de souder une communauté pour créer un corps social et une entité politique196.
Ces quelques lignes entrent en écho avec les problématiques de la presse coloniale telle
que nous l’avons présentée : prose dialogique – liée au support médiatique dans le cas de la
presse coloniale –, vision totalisante du monde – liée cette fois à la situation coloniale et au
développement de la mondialisation au cours du XIXe siècle –, création d’une entité politique
sont en effet trois axes sur lesquels nous pouvons reformuler ce qu’a établi l’étude de notre
corpus. Si théoriquement ce rapprochement peut être posé, il reste à en examiner les
implications, et à voir dans quelle mesure ces liens peuvent se révéler riches de sens.
3.1 Une production littéraire prisonnière de son époque
L’une des caractéristiques qui peut aider à définir le corpus médiatique colonial, c’est
son caractère périssable ; dès lors, il n’est pas évident de se livrer à l’exercice de la comparaison
195 Micheline Cambron et Hans-Jürgen Lüsebrink, « Presse, littérature et espace public : de la lecture et du politique », Études françaises, 2000, vol. 36, n° 3, p. 139. 196 Yves Clavaron, Poétique du roman postcolonial, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2011, p. 10.
479
entre une littérature médiatique coloniale et une littérature anticoloniale ou postcoloniale dont
les différences se signalent dès les premières lignes, dès les couvertures, dès le paratexte.
Pourtant, cet exercice peut, de marche en marche, révéler des fonctionnements communs qui
permettent, par retours au corpus de référence – ici, celui de la presse coloniale – de mieux
l’intégrer dans un paysage littéraire complexe. De la même manière, et dans un deuxième
temps, des réflexions théoriques sur l’orientation des œuvres et leur engagement à dire le monde
permettent de mettre en lien les publications de la presse coloniale et d’autres publications, plus
récentes, postcoloniales ; et dans cette perspective, l’image de l’écrivain qui ressort des discours
annexes autour des textes fait apparaître le portrait rassembleur d’un écrivain introuvable.
Des horizons d’attente : répondre aux lecteurs
L’horizon d’attente des lecteurs de la littérature coloniale se développe sur des
mécanismes qui font appel à la curiosité et à l’ouverture d’un lectorat métropolitain, si l’on en
croit les quelques appels aux lecteurs qui apparaissent comme autant de descriptions d’un
narrataire idéal. L’on y trouve d’abord les traductions et aides linguistiques que fournissent des
auteurs censés être au mieux avec la langue locale, à l’image de ce que Jean Ajalbert écrit pour
faire comprendre le titre de son roman paru en 1911.
Su-su ! Les deux syllabes qui, dans le langage laocien [sic], répondent à tout, et à un peu plus encore, sans vouloir rien dire ! Su-su qui se traduirait mal par : Assez bien, pas mal, mais oui, tout doux, ne nous frappons pas, laisse faire, compte dessus, ça va, ça ira ; quelque chose de discret, de soumis et de confiant, mais qui sert plutôt pour finir les phrases autrement que par des mots, si fatigants et inutiles, avec la seule caresse de l’haleine, avec la seule douceur suave du souffle, susu… Mais cela est intraduisible197…
L’on y trouve également le rapport à la métropole, qui dessine la silhouette d’un
narrataire métropolitain à qui l’auteur apporte son expertise coloniale, sa connaissance de
l’empire et l’ouverture à des circulations encore mal connues :
Quand vous applaudissez, dans quelque baraque métropolitaine, un éléphant habile aux dominos, ou jonglant avec des bouteilles, peut-être, s’il parlait, vous dirait-il qu’il s’est entraîné, dès le jeune âge, dans la montagne annamitique avec les boîtes et les ballots destinés au Falan’s Club198….
197 Jean Ajalbert, Raffin Su-su, mœurs coloniales, Paris, Publications Littéraires et Politiques, 1911, p. 11-12. 198 Ibid., p. 43.
480
La presse coloniale progresse, quant à elle, de manière plus complexe, jouant de
l’équilibre entre le lectorat local – qu’elle vise au premier chef – et le lectorat métropolitain
qu’elle peut atteindre par ricochet. Plus généralement, ce qui ressort alors de la confrontation
des corpus de livres et de journaux coloniaux, c’est l’extrême orientation des propos, que le
lecteur soit colonial ou métropolitain : contrairement à une littérature qui s’affirme d’avant-
garde par sa propension à se détacher du quotidien, les littératures médiatiques et coloniales,
bientôt les littératures postcoloniales, revendiquent une écriture non autotélique censée, dès
lors, répondre plus fortement aux attentes du lectorat. Anthony Mangeon dans Postures
postcoloniales fait ressortir l’analyse de Neil Lazarus selon laquelle on assiste à l’émergence
d’« une nouvelle écriture cosmopolite ou d’un nouveau genre littéraire constitué d’œuvres qui
donnent l’impression d’avoir été produites en vue de leur réception postcolonialiste199 ». Cette
première remarque pourrait être appliquée au corpus colonial si l’on considère l’extrême soin
apporté au lectorat, à sa représentation, à la mise en connivence des écritures. De la même
manière, si les textes postcoloniaux « favorisent de fait la traversée des frontières (génériques,
tout d’abord, mais aussi sociales, culturelles, historiques), le goût de la provocation, ainsi que
de riches dimensions intertextuelles et critiques, notamment dans leur propension à la réécriture,
d’un point de vue minoré, des grands récits littéraires ou de légitimation (sociale, politique,
culturelle200) », ces critères sont à faire entrer en résonance avec le corpus médiatique colonial.
Le journal peut favoriser la « traversée des frontières » et les « dimensions
intertextuelles » ; cette mixité de la matière coloniale est même l’un des piliers de la définition
de son écriture. De la même manière que l’on a pu noter à quel point la littérature postcoloniale
se nourrissait de pastiches, de parodies et de réécritures, l’on peut interroger ce même
fonctionnement dans la littérature médiatique coloniale : ce fonctionnement qui joue sur les
discours seconds est l’une des caractéristiques de la littérature médiatique au sens large, et le
contexte colonial ne fait que décliner ce principe poétique en l’adaptant à une situation coloniale
précise201. Le décalage par rapport à un centre s’écrit en effet dans une littérature médiatique
qui se ressent de l’éloignement métropolitain, et dans une littérature francophone qui se libère
du schéma du centre et de la périphérie. Mais se pose alors la question du lecteur prévu par le
texte, de l’horizon d’attente du lecteur, et de la manière dont l’auteur s’adresse à lui, des mesures
199 Anthony Mangeon, op. cit., p. 12. Citation : « The Politics of Postcolonial Modernism » in Loomba Ania, Kaul Suvir, Bunzl Matti, Burton Antoinette et Esty Jed (éd.), Postcolonial studies and beyond, Durham et Londres, Duke University Press, 2005, p. 424. 200 Id. 201 Lise Gauvin, Cécile Van den Avenne, Véronique Corinus et Ching Selao (dir.), Littératures francophones. Parodies, pastiches, réécritures, Lyon, ENS Éditions, 2013.
481
prises pour entamer un peu la distance – qui n’est plus cette fois du centre à la périphérie, mais
du lecteur à l’œuvre. Dans Écrire pour qui ? L’écrivain francophone et ses publics, c’est la
question que pose explicitement Lise Gauvin, et dès son titre202. Les quelques phénomènes que
nous avons repérés dans la presse coloniale – notes de bas de pages, traductions, explications –
ont été étudiés au sein du corpus postcolonial. Le lecteur de la presse coloniale était au moins
double, mais seulement double, autrement dit métropolitain ou colonial ; le lecteur de la
littérature postcoloniale a vu ses possibilités se démultiplier, et il occupe à lui seul des positions
encore plus diverses. Plus largement, le recours à la fiction explique certains changements qui
s’opèrent dans les productions écrites qui traitent des colonies. Ainsi, par la contamination des
récits d’aventure sur la paralittérature précoloniale qu’il étudie, et par cette nécessité qui régit
la fiction d’opposer un héros à des ennemis, Jean-Marie Seillan remarque que « la fiction
précoloniale offre des mondes lointains une vision agonistique bien plus pessimiste que les
récits de voyage qui lui servent de réservoir documentaire203 ». L’orientation donnée aux deux
types de littérature conditionne deux types de rédaction ; un peu à la manière de la réécriture
que Dumas fait subir au texte de La France algérienne, la destination prévue change le contenu
même des textes. C’est une motivation esthétique qui justifie la confrontation entre le héros
européen et des adversaires indigènes ; mais ses implications sont idéologiques, et marquent
ainsi l’appréhension qu’ont les lecteurs de ces colonies lointaines.
L’écrivain introuvable La production médiatique coloniale appartient particulièrement à son époque ; on l’a
dit, pour cette raison elle peut assez facilement passer pour une écriture périssable : destinée à
être « consommée » quotidiennement, sans horizon systématique de republication, la presse
coloniale ne parie pas sur la postérité et accepte son statut de production éphémère. Mais ce
rapport même à l’actualité n’est pas sans entraîner quelques conséquences poétiques
suffisamment marquantes pour nuancer, dans un dernier temps, ces remarques que nous venons
de faire. Dans un roman de Léon Beynet, publiciste saint-simonien et collaborateur occasionnel
de la presse coloniale évoqué plus haut dans notre étude, les dernières lignes sont assez
révélatrices d’un thème général, un leitmotiv des publications coloniales – leitmotiv que la
presse coloniale reprend. Après avoir critiqué la publication de « brochures apologétiques »
portant sur les indigènes ou sur Abd el-Kader, l’auteur ensuite précise : « Ce combat de Titans,
202 Lise Gauvin, Écrire pour qui ? L’écrivain francophone et ses publics, Paris Karthala, 2008. 203 Jean-Marie Seillan, « La (para)littérature (pré)coloniale à la fin du XIXe siècle », Romantisme, 2008, n° 139, p. 37.
482
du colon aux prises avec le vent du désert, le palmier nain, les maraudeurs, les fièvres, les
usuriers, les fourmis, les moineaux, les escargots et la calomnie, n’inspirera-t-il pas à son tour
une plume française204 ? » Cet appel lancé à un « écrivain à venir » situé quelque part en avant
sur la ligne chronologique met en lumière l’une des caractéristiques qui réunit les différents
corpus de cette dernière partie. L’un des points communs entre le corpus médiatique colonial
et le corpus postcolonial réside en effet dans la place accordée à l’auteur : il est important de
savoir d’où il parle et comment se justifie sa connaissance première – d’où la prédominance des
« abonnés » dans la presse coloniale, d’où l’importance des signatures et des présentations que
le rédacteur donne de ses auteurs. Mais, plus encore que cette authenticité que l’on attend de la
connaissance et de l’expérience, l’écriture médiatique locale et à visée identitaire se caractérise
par un lieu commun que l’on pourrait résumer comme suit : l’auteur de littérature coloniale est
un écrivain à venir, peut-être même un écrivain introuvable. On le cherche, on en parle, on
introduit les publications par des regrets sur son absence : en fait, cet écrivain que l’on veut
idéal participe de la galerie coloniale au même titre que le planteur vertueux ou le colon
courageux, voire l’interprète rusé ; il s’agit de silhouettes qui développent une fonction
symbolique à côté de leur utilité pratique. Il apparaît comme un manque à combler, au sein d’un
discours orienté vers l’avenir qui correspond bien au régime d’historicité qui subsume les
différentes temporalités coloniales : l’écrivain à venir est le témoignage de la confiance
coloniale en un avenir de progrès. L’effort pour le trouver est donc partie intégrante du
métadiscours littéraire, et ses implications symboliques sont à la fois lourdes de sens en même
temps que prétexte à écrire d’une plume facile : « L’Amérique n’est connue en France que
depuis la Case de l’oncle Tom. Il faudrait peut-être, pour l’Algérie, une bonne fortune de ce
genre ; un romancier habile ferait ce que n’ont pu faire tant d’économistes et d’historiens205 »,
écrit un chroniqueur théâtral du Moniteur de l’Algérie en 1861 ; il ajoute aussitôt : « En
attendant que cet heureux écrivain se rencontre et que la Métropole soit éclairée sur le compte
de sa colonie, la chronique a fort à faire pour se renseigner sur les sujets à l’ordre du jour206 ».
Attendre l’écrivain idéal autorise à écrire sans une pression identitaire trop forte ; mais signaler
précisément que cet écrivain n’existe pas revient à montrer que le phénomène colonial n’est pas
totalement accompli, qu’il n’a pas atteint le niveau américain – mesure d’une colonisation
réussie. Et le temps ne fait rien à l’affaire : selon les territoires coloniaux, l’on retrouve ce même
regret, y compris dans la critique littéraire portant sur la littérature coloniale des années
204 Léon Beynet, Les Colons algériens, Alger, Molot et Cie, Imprimerie du Courrier de l’Algérie, 1863, p. 73. 205 « Chronique », Le Moniteur de l’Algérie, 8 octobre 1861. 206 Id.
483
1930 : « Peut-être ce pays verra-t-il naître, un jour, un Kipling ? Mais peut-être est-ce de l’élite
indigène qu’il faut attendre la révélation d’un écrivain génial ? » est ainsi une épigraphe tirée
de L’Exotisme indochinois dans la littérature française depuis 1860 pour l’ouvrage Littératures
de la péninsule indochinoise207. Cette remarque vaut également pour la littérature d’Afrique
sub-saharienne, comme l’explique Jean-Marie Seillan quand il cite la romancière Myriam
Harry dans une interview en 1905 : « Peut-être aurons-nous plus tard une littérature lointaine,
une littérature coloniale. Elle sera d’action plus que de rêve. Les fils de nos colons nous la
donneront dans vingt ans208 ».
Chaque territoire, par la voix de ses auteurs et théoriciens, adapte donc à sa mesure cette
attente de l’écrivain qui saura rendre compte de la colonisation, de l’effort fourni. Sur ce modèle
du messie littéraire s’est développé l’écrivain colonial : qu’il soit apte à faire la publicité de la
colonie en métropole est un détail du portrait de cette absence d’auteur. Quelques lignes
suffisent pour, en passant, mettre en place l’écrivain introuvable et le dépasser : le chroniqueur
du Moniteur de l’Algérie que nous avons cité se revendique ainsi d’une écriture infime, badine,
sans prétention idéologique, et participe à la construction du texte colonial en refusant une
écriture sérieuse – écriture qu’il laisse à d’autres, à ces écrivains à venir. Ces premiers allers-
retours entre des corpus a priori éloignés ont mis en place certains éléments d’une histoire
littéraire qui accorde une place à la littérature médiatique au sein des écritures évoluant autour
de l’idée de colonisation. L’on peut maintenant, à la lumière de ce type de continuum, s’arrêter
plus longuement et plus précisément sur la littérature postcoloniale, toujours envisagée par le
filtre de la presse coloniale.
3.2 La littérature postcoloniale et la presse coloniale : une question d’échelle
Lire et étudier la littérature médiatique coloniale permet de revenir sur les grandes
périodisations et catégorisations de l’histoire littéraire, et de faire jouer ce qui se rapporte à une
conscience de soi dans la littérature : cet exercice de retour en arrière, fruit d’un décentrement,
apparaît comme un moyen de revenir sur le « même » en même temps qu’on étudie « l’autre »,
dans une perspective de comparaison. Comparaison des époques, des supports, des
idéologies : de ces éléments différents il fallait faire émerger pourtant des points communs pour
207 Bernard Hue, Henri Copin, Pham Dan Binh, Patrick Laude et Patrick Meadows, Littératures de la péninsule indochinoise, Paris, Karthala-AUF, 1999. Référence : Louis Malleret, L’Exotisme indochinois dans la littérature française depuis 1860, Paris, Larose, 1934, p. 28. 208 Jean-Marie Seillan, Aux sources du roman colonial, Paris, Karthala, 2006, p. 7.
484
faire advenir une meilleure compréhension des différents corpus. Philippe Régnier quand il
évoque les « productions illégitimes209 » à la fin de son article défend ainsi l’exhumation de
textes et l’étude de leurs conséquences : c’est pour nous une perspective intéressante que de
relire et de relier des corpus que l’on a tendance à opposer trop schématiquement. Dans cette
perspective, la nouveauté de la littérature postcoloniale serait en fait le dialogisme qui s’y
lit : l’on peut étudier le gain qu’il y aurait à considérer ce dialogisme comme le stade supérieur
de la polyphonie première que peut parfois faire apparaître le journal. La littérature que l’on
qualifie de « postcoloniale » n’est pas en effet « anticoloniale » : le lien entre les deux époques,
les deux corpus, les deux idéologies est plus complexe qu’un simple antagonisme. En outre, le
journal signale sa particularité dans le contexte colonial : la littérature dite coloniale, centrée
sur la voix d’une domination, met à mal ce principe dialogique qui est consubstantiel à la
littérature médiatique. Elle prend davantage soin de son lecteur, au sens où son ambition réaliste
se mêle d’ethnographie et emprunte donc les voies d’une écriture traversée par des moyens
d’explicitation et de clarification, si ce n’est de classification ; mais on y entend davantage la
voix de l’expert, de l’interprète qui n’est pas vraiment un passeur de culture mais plutôt l’étai
de la culture dominante. Dans ces thématiques qui font ressortir les contrastes, l’on peut aussi
interroger plusieurs points de repères. La presse coloniale locale mérite l’adjectif « ambiguë »,
parce qu’elle joue à la limite de plusieurs ancrages identitaires, de plusieurs ancrages
génériques, de plusieurs positions politiques aussi. La littérature postcoloniale gagne à être
revue selon ce modèle d’une ambiguïté première, et l’on peut alors commencer par interroger
le statut de l’auteur postcolonial. Si nous employons le terme « revisitée », c’est parce que nous
nous donnons pour but de reprendre quelques-uns des grands textes de la littérature
postcoloniale en profitant de l’élan donné par l’étude de la presse coloniale.
Le local : une négociation quant à la valeur littéraire des textes L’écriture médiatique coloniale présente des instantanés d’une idéologie mise en mots,
idéologie qui repose sur une conception historicisée du territoire : le local résulte bien d’une
forme de négociation qui se joue dans les textes. La négociation se fait par rapport à d’autres
espaces, au premier rang desquels l’on retrouve, pour des raisons symboliques et pratiques, la
métropole. La coexistence au sein du journal de publications des plumitifs locaux et des
journalistes métropolitains exprime cet équilibre. Cette négociation toute coloniale trouve un
équivalent dans les littératures postcoloniales : l’équilibre se fait alors entre la culture du
209 Philippe Régnier, « Littérature, idéologie(s) et idéologie de la littérature : un combat toujours actuel », Revue d’histoire littéraire de la France, 2003/3, vol. 103, p. 569.
485
colonisateur et la culture indigène, originale. Le dialogue qui caractérise la littérature
postcoloniale – jusqu’à des publications récentes – est appuyé sur la coexistence de plusieurs
cultures au sein du territoire ; le dialogue colonial visible dans la presse se fondait, quant à lui,
sur un arrière-plan métropolitain imaginé, transmis par les périodiques. C’est ce que l’on voit
dans les formules de présentation des feuilletons, à l’image de ce que publie le rédacteur du
Propagateur en 1869 : « Nous commencerons une suite de délicieux feuilletons reçus par le
dernier paquebot210 », promet-il à ses lecteurs, annonçant ainsi l’arrivée d’une nourriture
littéraire venue de Paris ; et il est vrai que le feuilleton du périodique est souvent occupé par
une littérature reprise des journaux de métropole. Or cette irrigation des médias par une
littérature parisienne contredit – ou du moins nuance – les tentatives d’écriture locales qui
paraissent dans le même temps, non seulement dans le Propagateur même, mais aussi dans
d’autres périodiques du même territoire. Cette concurrence entre les publications pose la
question de la particularité du temps et de l’espace dans la colonie. En Algérie, l’écriture locale
qui joue sur les référents de l’environnement est fréquente, et les feuilletons métropolitains se
font plus rare. Cette publication de textes locaux est liée à l’occupation récente et à la volonté
gouvernementale de peupler le territoire, d’attacher les Européens présents à ce qui apparaît
comme un nouveau rivage français ; elle s’explique également par la proximité avec la
métropole, qui permet aux hommes de lettre de traverser rapidement la Méditerranée pour tenter
leur chance à Alger.
La mer qui brille à vos pieds est la Méditerranée ; cette voile qui glisse là-bas vient de France ; la pierre où vous êtes assis fut Hyponne [sic] ; le chamelier en burnous blanc qui passe et vous salue, c’est l’Afrique, c’est le désert, c’est le mystère, c’est l’inconnu211.
Louis Seybous, lorsqu’il interpelle ainsi son lecteur en 1861, se prête à une démarche
qui relève du syncrétisme : la France, l’Antiquité chrétienne de Saint-Augustin, le burnous
arabe et le désert qui plonge vers l’Afrique sub-saharienne sont convoqués au sein d’un
maelström descriptif qui rend assez bien compte de l’ambition coloniale à ce moment précis.
La temporalité coloniale serait définie ainsi par sa capacité à faire se croiser différents régimes
d’historicité : à l’image de ce qu’on peut lire dans Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie en
1862, le temps colonial se vit en superposition avec un autre temps, celui du passé et celui de
la métropole. C’est le cas, du moins, pour les territoires qui vivent une colonisation nouvelle :
210 Le Propagateur, 13 février 1869. 211 L. Seybous, « Souvenirs de voyage. Fragments », Le Moniteur algérien, 14 septembre 1861.
486
Qui d’entre nous, à l’aspect de ces enfants agenouillés, n’aurait pas reporté, vers un passé déjà loin, les regards de l’esprit qui, en semblables circonstances, deviennent les regards du cœur ? N’est-on pas saisi d’une profonde émotion quand, sur cette terre lointaine où la France est venue se camper face à face avec la barbarie, on assiste à de pareilles fêtes ? Ne revoit-on pas, alors, sa famille, le clocher de son village, l’humble église du hameau ? Certes, ce sont là des souvenirs sacrés qui font parfois verser des pleurs, lorsqu’on s’est trouvé depuis lors trop maltraité au rude contact des grandes infortunes et des grandes injustices de la vie212.
La chronique néo-calédonienne dessine ici la silhouette d’un héros romanesque, mais
au fil d’un journal qui ne présente pas de si grandes prétentions : il y a héroïsation du colonial,
illustration de sa capacité à vivre presque en ubiquité. Il n’est pas question d’un retour en
métropole, mais bien plutôt d’une écriture spatialement double : et étrangement, en ce sens,
cette littérature médiatique résonnerait presque, dans sa structure, comme une littérature de
l’exil ; mais d’un exil qui procède par calque et disparition du territoire et de la population
locale. Or ces deux instantanés d’une pensée coloniale qui s’illustrent dans des territoires
différents, et sous des formes différentes, peuvent entrer en résonance – à défaut d’être
comparées – à d’autres saisies, syncrétiques aussi, auxquelles se livrent les auteurs
postcoloniaux. Quand Maryse Condé décrit les Antilles ou quand elle se penche sur Le Cap, le
récit ne s’arrête pas à un seul espace qui serait celui de la carte postale, mais interroge les
espaces intermédiaires, les bas-fonds, les friches ; met en jeu le passé et le présent dans une
perception mélangée213. Pas d’idéologie coloniale, mais une remise en question de
l’appréhension du territoire et de son histoire : le geste par lequel le roman postcolonial reprend
le contrôle sur son environnement témoigne d’un rapport au temps ancré dans la longue durée,
dans la remise en question214. Le rapport à l’espace distingue le corpus colonial du corpus
littéraire métropolitain, reconnu et classique, qui lui était pourtant contemporain ; et cette
problématique spatiale est l’un des éléments par lesquels peuvent se trouver réunis des corpus
aussi différents que la littérature coloniale médiatique et la littérature contemporaine sous sa
forme postcoloniale. Cette dernière va en quelque sorte inventer de nouvelles hétérotopies,
appuyées sur le passé colonial et sur ce que les lieux de ce passé colonial peuvent signifier. Au
fil du récit de La Case du Commandeur, c’est dans un ancien cachot réservé aux esclaves
débarqués d’Afrique que Liberté et Anatolie vont concevoir leur enfant, dans l’endroit « où
212 Félix H. Béraud, « Chronique néo-calédonienne », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 29 juin 1862. 213 Maryse Condé, La Belle Créole, op. cit., et Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003. 214 L’on peut penser ici à la chronologie qui ouvre Texaco de Patrick Chamoiseau et qui représente les phases de la colonie depuis 3000 avant Jésus-Christ jusqu’à 1989, mêlant histoire officielle et histoire de ces personnages, et divisant les périodes selon les habitations et leurs matériaux : carbet et ajoupas, paille, bois-caisse, fibrociment, béton. Voir Patrick Chamoiseau, Texaco, Paris, Gallimard, 1992, p. 13-15.
487
naguère on avait parqué les Africains nouvellement débarqués215 » ; et Glissant de conclure
avec ses personnages « que le passé comme l’avenir était tout entier dans ce rond de
cachot216 » : la rupture avec le régime d’historicité colonial ne saurait être plus nette. La
question de la temporalité, plus largement, semble hanter les textes postcoloniaux, dans une
tension entre le passé toujours réactivé et l’avenir incertain : là encore, l’on pourrait se servir
des « revenances du passé » pour mieux comprendre, dans une extension de leur application, la
manière dont ces littératures se nourrissent de problématiques temporelles plus que la littérature
contemporaine dite « nationale » ou « française » dans les librairies. L’hétérotopie, dans son
rapport à la temporalité, trouve une réalisation particulièrement intéressante dans les littératures
postcoloniales. Dans une autre forme que celle de l’hétérotopie, des problématiques plus
clairement postcoloniales encore peuvent se lire : en Nouvelle-Calédonie, le rapport à la terre
et à l’histoire est ainsi travaillé par les auteurs contemporains selon une perspective qui n’est
plus celle des colonisateurs ou, au sens large, des Européens, comme l’explique Déwé Gorodé
au cours d’un entretien.
Faut-il employer ce mot mythe que je n’aime pas ? Pour nous, ce que les Européens ont traduit par mythe, ce ne sont pas des mythes. C’est notre histoire, à nous. J’ai expliqué cela l’année dernière au salon du livre des DOM-TOM. Vous commencez vos contes par « il était une fois ». Dans la formule par laquelle on commence les contes dans ma langue, on ne peut pas employer le passé. Chez nous, quand on raconte le conte, on ramène l’histoire à maintenant217.
Cette auteure, qualifiée dans le même numéro de « figure pionnière de l’écriture
kanak218 », raconte cependant comment son père lui a transmis Le Petit Poucet ou le Gavroche
des Misérables dans la langue paîci, ainsi que ses études à Paris. L’intéressant est cette manière
qu’a l’auteur d’expliquer sa démarche en interview, de donner à comprendre à des lecteurs
métropolitains : refusant le regard ethnologique extérieur, elle commente cependant ses œuvres
en donnant aux lecteurs des clefs qui reposent sur la connaissance de la culture kanak, évoquant
ainsi son héritage kanak traditionnel, oral. Elle revendique plus tard dans l’entretien de
s’adresser à tous les êtres humains, ne limitant pas son cercle de lecteurs aux seuls kanaks.
Dans cette même négociation avec le cadre local, les littératures postcoloniales
s’accommodent plutôt du concept de « migritude », qui exprime la version moderne, plus
215 Édouard Glissant, op. cit., p.106. 216 Ibid., p. 107. 217 « Entretien avec Déwé Gorodé », propos recueillis par Blandine Stefanson, Notre librairie. Revue des littératures du Sud, « Littératures de Nouvelle-Calédonie », n° 134, mai-août 1998, p. 84. 218 Marie-Ange Somdah, « Déwé Gorodé ou la recherche de la parole kanak », Notre librairie. Revue des littératures du Sud, « Littératures de Nouvelle-Calédonie », n° 134, mai-août 1998, p. 87.
488
tragique et très différente idéologiquement de ce qui faisait l’enjeu de nombreux textes
médiatiques coloniaux : le déplacement, la distance, le changement. Ce concept forgé par
Jacques Chevrier peut s’expliquer ainsi :
[il] renvoie à la fois à la thématique de l’immigration, qui se trouve au cœur des récits africains contemporains, mais aussi au statut d’expatriés de la plupart de leurs producteurs […]. Ils puisent leur inspiration dans leur nature hybride et leur décentrement qui sont devenus les éléments caractéristiques de la « World Literature » à la française219.
Étape supplémentaire dans la définition des littératures postcoloniales, qui précise
encore le rapport que les auteurs entretiennent avec le territoire au sens large, la migritude remet
au centre du discours littéraire le poids du local, du territoire proche pour l’auteur – et pour ses
lecteurs. Il est évident que les migrations actuelles n’ont rien à voir avec les déplacements
coloniaux : cependant, d’un point de vue strictement littéraire, voire techniquement littéraire,
l’on peut trouver une parenté à ces textes qui se donnent pour mission de dire l’un des
bouleversements territoriaux de leur époque, et qui refusent par là une forme d’autotélisme. Ce
sont des littératures qui posent la question du lieu de l’écriture et de ses influences sur une
esthétique particulière.
Si l’on met de côté dans un premier temps les problématiques de domination, l’on
remarque que dans l’écriture médiatique coloniale, l’expatriation se dit par rapport à la
métropole, et se vit sur le territoire colonisé. L’on remarque aussi que le renversement est
complet dans les écritures postcoloniales, qui peuvent en effet être produites par des écrivains
vivant dans les métropoles des anciens empires coloniaux, mais qui tournent leurs regards vers
les anciennes périphéries de cet empire. Le support choisi peut lui aussi s’analyser à l’aune de
ce renversement : le journal souffre d’un manque de légitimité et d’autorité littéraire, alors que
le roman, genre prédominant des écritures postcoloniales, est marqué par une forme d’autorité
pleine et reconnue. Dans les textes médiatiques, l’auteur colonial vit une forme de minoration
de sa capacité à écrire : il n’est qu’un publiciste, un auteur dont l’appartenance locale est à la
fois une preuve d’authenticité mais également la marque du doute esthétique. Dans les textes
romanesques postcoloniaux, au contraire, l’auteur se retrouve placé en position de pouvoir, au
sens où il est seul en charge du renversement de l’histoire coloniale envisagée depuis les lieux
mêmes de son histoire. L’écriture locale apparaît comme le fruit d’une négociation, y compris
au sein de la littérature postcoloniale : les enjeux identitaires sont multiples qui s’attachent à
219 Dominic Thomas, Noirs d’encre. Colonialisme, immigration et identité au cœur de la littérature afro-française, Paris, La Découverte, 2013, p. 15.
489
l’aspect territorial, géographique et culturel d’une écriture220. Pour autant, le régionalisme est
une étiquette refusée par les écrivains antillais, qui postulent bien autre chose que l’adaptation
d’un modèle national à des particularités locales. Les écrivains régionalistes qui écrivent dans
les années 1930, au moment où la négritude s’affirme, ont payé le prix de cette poétique
d’adaptation, marquée encore par le modèle métropolitain221. Non réédités, oubliés, ils sont la
preuve de l’articulation nouvelle que l’échelle locale connaît dans la littérature : elle s’oriente
vers une reconnaissance nationale.
Le national : un but L’étude par corpus quand elle est construite sur le modèle des études de littérature
médiatique permet d’ouvrir des perspectives diachroniques, et notamment d’interroger la notion
de nation : parle-t-on de la nation française, ou de la nation indépendante post-coloniale ? Le
corpus médiatique, intégré au sein d’un ensemble mouvant de textes qui ne peuvent être tous
pris en compte, est en effet envisagé comme faisant partie d’un réseau plus vaste. Quand Mar
Garcia dans Postures postcoloniales interroge par exemple l’œuvre d’Abdourahman Waberi,
elle le fait dans les termes suivants :
Par le vertige citationnel qu’il impose au lecteur, un roman comme Aux États-Unis d’Afrique d’Abdourahman Waberi (2006) participe pleinement de la dérive post-politique de la société contemporaine et de la tendance à la consommation d’un exotisme fragmenté et ludique222.
Elle explique ensuite l’écriture de l’auteur d’origine djiboutienne par l’abandon du
« paradigme du writing back et de ses supposées propriétés subversives », dans le cadre d’une
complexité de l’exotisme actuel, pris également dans la dynamique de la marchandisation. En
partant de ces remarques faites à la littérature postcoloniale contemporaine, peut-être est-ce
justement le « back » qu’il faut interroger dans la pensée du « writing back », et voir si la
réponse est aussi binaire qu’on le voudrait. Un peu à la manière dont la presse coloniale ne se
constitue pas comme un bloc face à la presse métropolitaine, mais plutôt comme un ensemble
de références diverses et de points de vue, la littérature contemporaine postcoloniale serait ainsi
une mosaïque de réponses, ou plutôt de micro-réponses adaptées à l’époque et à la
220 Françoise Lionnet analyse ainsi les écritures postcoloniales à l’aune d’un partage du lieu plutôt que d’une réponse. Voir son article « Littérature-monde, francophonie et ironie : modèles de violence et violence des modèles », Littératures francophones. Parodies, pastiches, réécritures, Lise Gauvin, Cécile Van den Avenne, Véronique Corinus et Ching Selao (dir.), Lyon, ENS Éditions, 2013, p. 119-138. 221 Voir dans l’ouvrage cité ci-dessus, Véronique Corinus, « La nouvelle régionaliste créole et l’oscillation des modèles », p. 165-174. 222 Mar Garcia, « Postures (post)exotiques : ʺRéveiller les vieux démons de l’exotismeʺ », Anthony Mangeon (dir.), Postures postcoloniales. Domaines africains et antillais, Paris, Karthala, 2012, p. 278.
490
fragmentation des problématiques littéraires et politiques. Ce que l’étude de la presse coloniale
permet de mieux voir alors, c’est la manière dont se joue véritablement le rapport des corpus
littéraires aux territoires qu’ils traitent et informent. Une première étape se repère dans les
corpus de littérature populaire tels que Matthieu Letourneux les étudie :
Dans les récits du XIXe siècle, ce monde infiniment lointain de l’aventure prenait des airs d’atlas narrativisé. L’irréalité fantastique de la faune et de la flore, l’abstraction des espaces sauvages et désertiques, la distance mise en scène par le trajet du héros donnaient à l’univers de fiction des airs de neverlands hésitant entre la sécheresse du savoir livresque et le merveilleux des contes. Désormais [c’est-à-dire pendant l’entre-deux-guerres], l’espace est devenu mixte, il est peuplé de Blancs qui s’y sont installés depuis des générations et qui forment une société qui croise sans cesse les populations autochtones, et il arrive au roman de lier directement l’aventure à des problèmes économiques, politiques, stratégiques qui sont aussi les nôtres223.
La belle formule d’« atlas narrativisé » rejoint assez les missions de la presse coloniale,
avec toutes les nuances cependant que l’on a pu étudier dans la deuxième partie de la présente
thèse : l’atlas colonial est tout sauf irréel, et il vise au contraire une cartographie minutieuse,
exploratrice, documentée. Il formule aussi le défaut de transmission qui caractérise certains de
ces ouvrages de l’entre-deux-guerres, davantage préoccupés par les stéréotypes à employer que
par la description de la réalité. Une évolution a donc bien eu lieu, qui se trouve au croisement
de plusieurs dynamiques, comme le laissait supposer le titre de l’article : et cette évolution
trouve ses sources dans le corpus médiatique, lui-même soumis à des changements. Ainsi de la
naissance et revendication de littératures « nationales », adaptées en tout cas aux cadres
coloniaux : peu présente à Tahiti, elle se fait jour en revanche assez tôt dans les publications du
journal officiel de Cochinchine. L’avertissement donné aux lecteurs du Courrier de Saïgon
avant la lecture du feuilleton Luc-Van-Tiên a déjà été cité ; mais on peut le reprendre :
Quand on lit ces pages naïves et attrayantes qui sont si populaires en Cochinchine, on voit qu’en perdant les lisières de la phraséologie chinoise, les nouveaux sujets de la France pourront cultiver une littérature nationale, plus énergique et plus naturelle, capable de satisfaire les besoins de leur cœur et de leur imagination224.
Devenu l’élément d’une pharmacopée nationale, le récit qui est ainsi annoncé dans la
presse coloniale gagne un statut particulier. Dans cette perspective et correspondant à cette
mission, la mention de la « phraséologie chinoise » n’est pas anodine : il s’agit de remplacer
223 Matthieu Letourneux, « Du roman de découverte exotique au roman géopolitique d’espionnage : le roman d’aventures colonial dans les collections populaires de l’entre-deux-guerres », Les Cahiers de la Sielec n° 7. L’aventure coloniale, Paris- Pondichéry, Kailash, 2011, p. 476. 224 « Bibliographie », Le Courrier de Saïgon, 20 juillet 1866.
491
l’autorité des mandarins chinois dans les textes mêmes, en plus de les remplacer sur le territoire
colonisé. La parution du texte indigène est suffisamment longue pour que l’on s’arrête à cette
déclaration d’intention, ainsi qu’au contenu de ce qui paraît sous ce titre. Les pages « naïves et
attrayantes » ressemblent, dans ce récit d’éducation, à ce paragraphe, pour lequel nous avons
conservé la note de bas de page :
Ils entendent Van-tiên ; sa parole leur paraît sincère ; ils s’appellent l’un l’autre ; ils s’arrêtent et disent : « Voilà que des brigands, dont le chef se nomme Phon-laï, se sont réunis en grand nombre et habitent le mont Chon-daï. Leur puissance est grande ; aussi les craignons-nous beaucoup. Maintenant ils sont descendus de leur montagne pour ravager notre pays. Deux jeunes et jolies filles étaient sur la route, ils les ont enlevées ; mais, dans notre village, qui oserait dire un seul mot ? Et cependant nous sommes pleins de compassion pour le sort de ces deux jeunes filles si malheureuses. L’une d’elles est une perle, sa personne est semblable à l’or le plus pur. Ses joues sont rouges comme des pommes, ses sourcils allongés comme des arcs ; elle est belle, sa taille est délicate et élancée, son extérieur respire la convenance225.
La description de la jeune fille est traduite par l’expression littérale : mince moyen pour
donner au récit son ancrage spécifiquement cochinchinois aux yeux du lecteur, mais trace
cependant de l’effort fait pour désaxer le texte de la langue française. Le reste du récit est à
l’avenant de ce court extrait : l’on y suit un jeune homme courageux dans sa période
d’éducation. Le texte paraît en recueil en 1864, traduit par le consul de France toujours, mais
surtout publié sur l’Imprimerie impériale : c’est dire à quel point le projet identitaire est
important dans la parution226. Créer une littérature nationale est donc une volonté coloniale
assez ancienne, et qui contredit l’image trop rapide ou trop évidente des tentatives
d’amuïssement de la voix indigène. L’on trouve l’équivalent de cette pensée dans les œuvres
théoriques sur la littérature coloniale : Roland Lebel en arrive tout de même à l’apparition des
« écrivains indigènes d’expression française227 » que sont Bakary Diallo ou Abdel Kader Hadj
Hamou au fil de son développement : si un tel théoricien de la littérature coloniale fait le lien
entre deux corpus a priori si différents, surtout dans l’idéologie coloniale, c’est qu’il y a
exprimé dans l’idéologie coloniale le projet d’une écriture propre aux indigènes, d’un passage
de l’écriture coloniale jusqu’à l’écriture dite indigène. Cette évolution visée par les théoriciens
de la littérature coloniale rappelle, mutatis mutandis, d’autres recherches qui visent à tracer des
liens entre des corpus qui se succèdent chronologiquement. Ainsi, dans une perspective
d’élucidation des littératures postcoloniales, Bernard Mouralis traite de la question des
225 Littéralement : elle est mince et froide. Référence : « Bibliographie », Le Courrier de Saïgon, 20 juillet 1866. 226 Luc-Van-Tiên, poème populaire annamite. Traduit par G. Aubaret, consul de France à Bangkok, Paris, Imprimerie impériale, 1864. 227 Roland Lebel, op. cit., p. 86.
492
littératures nationales en Afrique après les indépendances228. Il note que les études de littérature
nationale sont encouragées par les pouvoirs locaux dans le cadre des indépendances, certes,
mais ajoute plus loin :
Il est probable alors qu’au cours de ce quart de siècle des habitudes communes se soient instaurées entre les citoyens de ce pays, des « similitudes essentielles », comme disait Durkheim, se soient établies, une certaine conscience collective même ait été forgée de telle sorte qu’on n’envisage guère l’avenir en dehors de ce cadre primitivement considéré comme artificiel et arbitraire. On le voit donc : l’existence de l’Etat n’entraîne pas nécessairement le développement d’une littérature nationale mais il peut y contribuer s’il constitue une des conditions de la durée historique. Et j’ajouterai qu’il n’y a de nation que dans et à travers la durée229.
Ces littératures nationales représentent la première période de la production littéraire
postcoloniale : d’autres générations viendront ensuite, qui complexifieront ce tableau230. Dans
les territoires coloniaux soumis à une forte pression de peuplement – l’Algérie au premier chef,
et les colonies de plantation – la presse a accompagné non seulement les débats politiques, mais
encore le développement d’une littérature locale : le geste va, après la période dont nous avons
traité, s’amplifier et se faire plus marquant. C’est que la presse et le livre sont soumis à des
évolutions voisines quand il s’agit des territoires coloniaux. Ainsi, en ce qui concerne notre
étude, la chronologie choisie ne nous a pas permis de traiter de l’Afrique sub-saharienne,
pourtant formidable espace de production médiatique au XXe siècle, avec des problématiques
propres qui ont déjà été ouvertes par la recherche littéraire, ou qui sont en train de l’être231.
Nous avons déjà cité cette formule d’Hans-Jürgen Lüsebrink quand il écrit
qu’« approximativement 95% de cette littérature publiée entre 1913 et 1960 parut non pas sous
forme de livres (monographies) mais essentiellement dans la presse232 ». C’est sur ce matériau
médiatique qu’il construit son étude d’un autre moment de la colonisation que celui sur lequel
nous avons travaillé, preuve de la vitalité et de l’évolution du corpus médiatique dont nous
228 Bernard Mouralis, « Le concept de littérature nationale dans l’approche des littératures africaines », op.cit., p. 635-650. 229 Ibid., p. 643. 230 Voir à ce propos l’ouvrage de Claire Ducournau déjà cité, La Fabrique des classiques africains. Écrivains d’Afrique subsaharienne francophones, Paris, CNRS Éditions, 2017. 231 Nous pensons ici au projet « L’imprimé “populaire” et les modes de lecture en Afrique francophone », financé par le fonds de recherche du Arts and Humanities Research Council (AHRC) consacré aux défis globaux, mené par Ruth Bush (Université de Bristol) et Claire Ducournau (Université Paul-Valéry Montpellier 3). « Il vise à élargir le champ des recherches menées sur les textes “populaires” en Afrique francophone et à rendre plus visible le patrimoine de l’imprimé produit au Sénégal ». URL : https://africanreadingcultures.blogs.ilrt.org/fr/a-propos-de/. Consulté le 24 juin 2017. 232 Hans-Jürgen Lüsebrink, La Conquête de l’espace public colonial. Prises de parole et formes de participation d’écrivains et d’intellectuels dans la presse coloniale (1884 – 1960), Québec/Frankfurt am Main/London, Éd. Nota bene/IKO-Verlag, coll. Studien zu den frankophonen Literaturen ausserhalb Europas, Bd. 7, 2003, p. 12.
493
n’étudions qu’un moment particulier. Les journaux sont des lieux d’écriture dans l’Afrique des
indépendances, tout comme ils sont des lieux d’écriture dans l’empire colonial français au
moment de sa montée en puissance.
Pour mieux voir la manière dont la littérature postcoloniale se développe après une
littérature elle-même guidée par des dynamiques proches, l’on peut enfin s’arrêter sur deux
types de littérature : l’écriture coloniale algérienne du début du XXe siècle ainsi que l’écriture
antillaise envisagée sur un laps de temps plus étendu. L’écriture coloniale algérienne connaît
deux mouvements concurrents et qui se succèdent en peu de temps : orientation exotique,
version colonialiste, tendance indigénophile, algérianisme et école d’Alger233 ; de la même
manière, les Antilles ont vu se succéder plusieurs mouvements que l’on peut résumer
ainsi : « exotisme, doudouisme, indigénisme, négritude, antillanité et créolité234 ». Les débats
et les réponses de ces deux exemples font en fait ressortir, paradoxalement, le manque de
reconnaissance d’autres productions littéraires liées à d’autres espaces. À ces successions
d’écriture en effet, qui reposent principalement sur une opposition dans la manière de concevoir
l’identité littéraire et sociale, l’on oppose le silence d’autres territoires en termes de
littérature : Saint-Pierre-et-Miquelon offre ainsi l’exemple d’une terre muette y compris dans
sa presse – le seul journal officiel – avant 1880. Dans la même perspective, l’on peut revenir
sur les territoires dont nous n’avons pas traité soit parce qu’aucun journal n’y était imprimé
(Nossi-Bé, Sainte-Marie de Madagascar), soit parce qu’il s’agissait de comptoirs qui rentraient
plus difficilement dans notre projet (Inde, Sénégal). Si nous avions dépassé 1880, ces territoires
auraient été envisageables, ne serait-ce que parce que la production médiatique s’est alors
développée pour certains d’entre eux. Certains territoires sont donc couverts par une presse et
une littérature exubérantes ; d’autres caractérisés par le silence. Un peu à part sur le nuancier
de ces prises de parole existent encore d’autres cas : la Nouvelle-Calédonie est un exemple de
ces territoires où se nouent autour de la littérature des problématiques qui touchent à l’identité
profonde, et où s’inventent des formes esthétiques que l’on renouvelle pour signifier ces
évolutions235. Ainsi, dans Tâdo, Tâdo, wéé !, le récit se déroule intégralement au présent de
233 Voir pour cette énumération Najet Khadda, « Naissance du roman algérien dans l’Algérie coloniale : un Royal Bâtard », Regards sur les littératures coloniales. Tome 1. Afrique francophone : Découvertes, Jean-François Durand (dir.), Paris, L'Harmattan, 1999, p. 106 ; et plus précisément pour les deux derniers mouvements Gérard Chalaye, « Les ʺnouveaux mondesʺ algérianistes (1831-1939) », Les Cahiers de la Sielec n° 10. Les nouveaux mondes coloniaux, Paris - Pondichéry, Kailash, 2014, p. 142-178. 234 Selon le résumé qu’en donne ainsi Jean-Pierre Jardel, « De l’hétéro-image à l’auto-image chez les auteurs antillais des XIXe et XXe siècle », », Les Cahiers de la Sielec n° 10. Les nouveaux mondes coloniaux, Paris - Pondichéry, Kailash, 2014, p. 318. 235 Voir, pour un aperçu des productions littéraires calédoniennes : Notre librairie. Revue des littératures du Sud, « Littératures de Nouvelle-Calédonie », n° 134, mai-août 1998.
494
l’indicatif ; scandé par des paragraphes courts, il mélange les temporalités dans le récit de la vie
de l’héroïne et donne à voir des moments de l’histoire kanak récente, des personnages issus de
tous les horizons et qui correspondent à la société calédonienne (kanak, indonésiens,
« coolies », colons236). Commence alors à s’ébaucher une forme de dilemme dans le traitement
des littératures coloniales et postcoloniales, qu’elles soient ou non médiatiques : à ces
littératures forcément engagées dans des situations particulières l’on ne propose le plus souvent
que l’analyse des contenus, et non une analyse esthétique.
Le mondial : deux fonctionnements L’on a déjà évoqué l’image d’auteur et son importance dans l’écriture médiatique
coloniale : une dernière étape de cette évocation réside dans le rapprochement entre deux types
d’auteurs que permet cette approche. Les auteurs postcoloniaux sont souvent présentés par leurs
éditeurs selon leur origine géographique : le lecteur doit savoir quel est le degré de connaissance
qu’a l’auteur du territoire sur lequel il écrit, d’où provient son discours et quelles prétentions il
peut avoir à (d)écrire une ancienne colonie. Ce fonctionnement est, mutatis mutandis, celui des
écrivains coloniaux : cette parenté, pour formelle qu’elle soit, et malgré ce qu’elle laisse de
côté, n’est pas négligeable. En comparant cette exigence d’information avec celle qui régit
l’identité des auteurs régionaux, une différence de portée apparaît qui est révélatrice. Les
auteurs régionaux sont certes soumis à cette exigence bio- et géographique, mais sa
conséquence est moins lourde idéologiquement : auteurs coloniaux et postcoloniaux se
démarquent par leur aspiration à dire le régional en visant le mondial, à exprimer un territoire
particulier pour marquer plus largement une nouvelle configuration territoriale.
Un peu à la manière dont les poètes ouvriers du XIXe siècle revendiquaient leur métier
tout en écrivant, les auteurs coloniaux ont dû préciser leur degré de connaissance du territoire
et de ses habitants en indiquant qui leur origine, qui leur métier, qui leur famille : face à cette
mainmise sur le territoire, les indigènes, devenus les « autres » des coloniaux, ont eux aussi dû
affirmer leur connaissance et leur lien au territoire. Cette première remarque montre comment
il est possible d’aborder les œuvres qui participent aujourd’hui du débat entre littérature-monde
et littérature francophone237. Un autre point encore éclaire ce débat. « Le Te Deum de la
conquête d’Alger, en 1830, sonne l’heure de l’Algérie, la vraie, celle qui porte ce nom dans
236 Déwé Gorodé, Tâdo, Tâdo, wéé ! ou « No more baby », Tahiti, Au vent des îles, 2012. 237 Voir pour l’analyse du manifeste et du mouvement le prologue (p. 31-83) dans l’ouvrage de Claire Ducournau, La Fabrique des classiques africains. Écrivains d’Afrique subsaharienne francophones, Paris, CNRS Éditions, 2017.
495
l’histoire : elle naît à la littérature française238 » : Gabriel Audisio délimite ainsi, à plusieurs
reprises, le champ de la production textuelle française en Algérie, se livrant lui-même à une
forme de dramatisation de l’histoire centrée sur la littérature française. C’est pourtant le même
Gabriel Audisio qui refuse de considérer qu’il a pu exister une production littéraire locale,
coloniale, avant la fin du siècle. Mais le propos est intéressant sur les liens entre l’identité et la
littérature, sur ce que l’on en tire d’une pensée coloniale liant la conquête à l’identité et à la
littérature. Cette conception de la littérature a fait long feu, mais revenir au corpus médiatique
colonial permet de réenvisager l’idée d’une production littéraire cloisonnée : parce qu’elle
affiche plusieurs dimensions, plusieurs modèles et plusieurs ancrages, la presse coloniale locale
aide à élucider ou à mieux comprendre quelques termes de ce qui apparaît aujourd’hui comme
la littérature-monde, et dont l’on pourrait trouver des traces dans la littérature médiatique. Cette
formulation même de « littérature-monde » n’est pas sans rappeler les définitions faites de la
littérature au XIXe siècle : c’est bien alors le moment des « œuvres-monde », des débuts de la
« mondialisation », bref d’un schéma de pensée occidental appliqué à l’ensemble des cartes
collectées, et aux réseaux qui s’établissent alors. L’écriture en série de certains auteurs
coloniaux, même si elle n’atteint pas le niveau des grandes œuvres que l’on peut qualifier
d’œuvres-mondes, témoigne cependant de la capacité à créer un monde :
L’idée d’une œuvre-monde, d’une œuvre littéraire qui tente de créer un monde clos, totalisant et complet, dans une volonté un peu mégalomane de représentation, de décryptage et d’élucidation du monde réel a cependant particulièrement fasciné le XIXe siècle, engendrant des chefs-d’œuvre comme La Comédie Humaine de Balzac, Les Voyages extraordinaires de Jules Verne, L’Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire d’Émile Zola, À la Recherche du temps perdu de Marcel Proust, étant à l’origine de séries éditoriales comme les physiologies ou les recueils panoramiques, influençant certains genres romanesques comme le roman-feuilleton239.
Les débats sur la littérature-monde ont été nombreux, et continuent à l’être, dans
l’obligation que la littérature a d’analyser son rapport aux identités territoriales, aux frontières,
aux circulations. Or ces thèmes sont bien ceux que l’on ne peut éviter dans l’étude de la presse
coloniale, puisqu’ils en constituent à la fois la raison d’être et le principe d’explication. Ainsi
les analyses portant sur la mondialisation littéraire offrent-elles une entrée intéressante pour
notre corpus. Si le roman moderne peut être analysé comme un « compromis entre une influence
formelle occidentale (habituellement française ou anglaise) et des matériaux locaux240 », alors
238 Gabriel Audisio, L’Algérie littéraire, Paris, Éditions de l’encyclopédie coloniale et maritime, p. 4. 239 Marie-Ève Thérenty, « Avant-propos », Romantisme, 2007/2, n° 136, p. 3. 240 Franco Moretti, « Hypothèses sur la littérature mondiale », trad. Raphaël Micheli, Études de lettres, Lausanne, 2001, n° 7, p. 15.
496
il est possible de reconsidérer nos textes sous cet angle, et également relire à sa lumière d’autres
bribes de la théorie développée par Franco Moretti :
les chemins autonomes empruntés par quelques littératures nationales, qu’on retient pour établir l’étalon de l’avènement du roman (les cas de l’Espagne, et la France et particulièrement de l’Angleterre), ne sont alors pas du tout des cas représentatifs, mais des exceptions. Ils ont la prééminence historique, certes, mais ils ne sont pas typiques, et ne préfigurent pas l’ensemble des développements que connaîtra le roman dans d’autres pays. L’avènement « typique » du roman, c’est Krasicki, Kemal, Rizan, Maran – et pas Defoe241.
Transposons ces propos à notre problématique : l’influence formelle occidentale est
celle du journal, et non du roman ; les matériaux locaux sont inventés mais revendiqués comme
tels par des auteurs qui mettent en avant leur posture de coloniaux. L’hypothèse apparaît ainsi
intéressante, quand bien même elle n’aboutit pas forcément à « l’avènement » d’un nouveau
genre : dans le cas colonial, elle semble se limiter à la pensée d’une littérature tournée
idéologiquement vers une identité qui joue du décentrement. Ce décentrement est analysable
de différentes manières : « lorsque Nguyên Van Xiêm décrit, en 1913, un intérieur breton ou
compose un poème intitulé La Paimpolaise, sa situation n’est-elle pas parallèle à celle d’un
Français décrivant une paillote ou imitant un chant laotien242 ? » Ce genre d’interrogation n’est
pas courant, parce que le corpus qui pourrait y correspondre n’est pas fréquent non plus : les
productions littéraires indigènes ne sont pas encouragées dans ce sens, mais bien plus dans le
cadre d’une production qui aide à faire connaître le territoire colonisé et son peuple. En outre,
il est vrai que cette question, ainsi posée, néglige précisément tout ce que la posture d’auteur
d’une part et le surplomb idéologique d’autre part peuvent apporter à l’écriture d’un texte ;
qu’elle ne mentionne pas la langue d’écriture du texte ou son appartenance à l’une ou l’autre
culture, colonisée ou colonisatrice : autant de paramètres qui font que les littératures croisées
se mettant lentement en place durant les ères coloniales ouvrent des perspectives d’études
littéraires qui doivent être attentives. Les postures des auteurs coloniaux et postcoloniaux se
construisent dans un dialogue au long terme : une « posture postexotique » existerait ainsi chez
les auteurs postcoloniaux, qui leur permettrait de répondre aux « schémas exotiques hérités du
passé243 ». Il nous semble que cette remarque est encore plus vraie si l’on précise le « passé »
par une de ses formes les plus accomplies, autrement dit la presse coloniale telle que nous
l’avons étudiée, et pour les raisons que nous avons précisées : la parution régulière, la volonté
241 Ibid., p. 17. 242 Bernard Hue, Henri Copin, Pham Dan Binh, Patrick Laude, Patrick Meadows, op. cit., p. 37. 243 Anthony Mangeon, op. cit., p. 15, présentation de l’article de Mar Garcia Lopez.
497
de dire et créer la colonie dans des textes divers, une forme de polyphonie qui s’adresse au
lecteur colonial en même temps qu’elle vise toujours le lecteur métropolitain… Ce pan du
discours colonial que représente le journal a mis en place des schémas qui ne correspondent à
la volonté d’originalité qui tend à s’appliquer à la production littéraire au fil du siècle : c’est
l’un des aspects d’un rapport au monde en train d’évoluer.
3.3 Idéologie et esthétique : le dilemme des corpus dévalorisés
La littérature médiatique, particulièrement quand elle est coloniale et donc liée à un
moment et à une idéologie qui refusent la littérarité, appartient à ce que Philippe Régnier
qualifie de « productions illégitimes244 ». Mais ces productions, pour illégitimes qu’elles soient,
ont partie liée avec d’autres productions plus ou moins reconnues, qui affichent un degré de
légitimité plus élevé – quoique fortement discutable encore – du fait de la parution en
recueil : la littérature d’aventures, la littérature coloniale bénéficient au moins du terme même
de « littérature », et d’un support de publication identifié et reconnu. Lorsque l’on traite
d’ouvrages coloniaux et d’ouvrages postcoloniaux, en revanche, un biais récurrent se repère
assez rapidement, et nous en prenons pour preuve le passage d’une thèse déjà citée :
comme l’a rappelé Michel Beniamino, avant même la question des outils d’analyse critique qui peuvent rendre compte de l’écriture des textes francophones, se pose celle de la priorité donnée à leur dimension esthétique. Il évoque ainsi la satisfaction de D.H. Pageaux à l’idée que dans les études francophones « la question esthétique du comment l’emporte de plus en plus nettement sur le pourquoi » mais aussi, en retour, la contestation des effets de cette position qui pourrait soumettre les écrivains francophones aux exigences d’un public et d’une critique exogènes245.
Car la question qui se pose est celle de ce que l’on peut appeler un « miroir
ethnologique246 », expression dont la reprise de livre en livre souligne l’importance. Cette
question de la valeur esthétique de corpus à la légitimité contestée est connue et discutée depuis
longtemps : Roland Lebel, quand il établit une définition de ce qui constitue la littérature
coloniale, le fait à l’aune de deux critères selon lui antithétiques que ce type de littérature
parviendrait à concilier. Il explique ainsi que, dans la littérature coloniale, « l’écart entre la
244 Philippe Régnier, « Littérature, idéologie(s) et idéologie de la littérature : un combat toujours actuel », Revue d’histoire littéraire de la France, 2003/3, vol. 103, p. 569. 245 Stéphanie Vigier, op. cit., p. 14. Elle cite Michel Beniamino, La Francophonie littéraire, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 185. 246 Id. La chaîne de citation fait remonter à Michel Beniamino, op. cit., p. 205, et J. Corzani.
498
littérature documentaire et la littérature d’imagination s’atténue singulièrement247 », puisque
toutes les deux sont « une méthode de connaissance ». Presque plus de distinction entre la
« littérature documentaire » – de fait une littérature fortement idéologique – et la littérature de
fiction : l’équilibre serait ainsi trouvé, les ambitions de la littérature coloniale expliquées. De
fait, la dichotomie entre écriture littéraire et écriture de la connaissance se retrouve au fur et à
mesure que le XIXe siècle se fait positiviste ; dans les périodiques eux-mêmes, fidèles à
l’idéologie coloniale, l’on trouve trace d’un refus de la littérature au profit du sérieux, du
documentaire, de l’utile. Pourtant, que ce soit par l’expression d’une subjectivité forte, par
l’emploi de figures de style remarquables, par l’appartenance à des sous-genres auxquels l’on
reconnaît une parenté avec la littérature, ces textes « hors livre » n’en forment pas moins un
corpus aux ambitions bien autres que les notices spécialisées en agriculture.
C’est que le corpus médiatique fait sans doute partie des « 99% de la littérature qui est
tombé dans l’oubli et que personne n’entend revendiquer », corpus que Franco Moretti
considère dans la phrase suivante comme « le territoire de l’historien248 » et sur lequel il s’est
arrêté avec la méthode qu’on lui connaît, et une vue large qui ne s’aventure pas du côté des
micro-analyses. Pourtant, la lecture de la presse coloniale montre bien qu’il y a précisément
motif à revenir sur ces idées selon lesquelles ne resteraient aux études littéraires que les grands
textes esthétiques, et pas les petits textes idéologiques – disons-le rapidement. Et les études
littéraires quand elles sont envisagées à l’aune de la géographie et du territoire font la part belle
aux journalistes et aux publicistes, à l’image de cette remarque sur les auteurs coloniaux de
l’Indochine :
Peut-être est-ce Marie-Charles David, qui se fera connaître sous le nom de l’aventurier David de Mayréna, futur roi des Sedangs qui, avec ses Souvenirs de Cochinchine, publiés à Toulon en 1871, mérite d’être considéré comme le premier auteur, après Mouhot, dont l’écriture manifeste quelque qualité littéraire. Fils d’un capitaine de frégate, d’abord journaliste, il s’était engagé, à 19 ans, en 1861, pour prendre part à l’expédition de Cochinchine. Après avoir quitté l’armée, il épousa, en 1869, la fille du colonel de la place de Toulon. En Indochine, il sera rédacteur au journal La Vérité249.
247 Roland Lebel, op. cit., p. 79. 248 Franco Moretti, Atlas du roman européen. 1800-1900, [Turin, Einaudi, 1997], trad. Jérôme Nicolas, Paris, Seuil, 2000, p. 11. 249 Bernard Hue, Henri Copin, Pham Dan Binh, Patrick Laude et Patrick Meadows, op. cit., p.93. Voir à son propos Sylvain Venayre, « En guise d’introduction. L’ʺaventure colonialeʺ entre littérature et histoire », Les Cahiers de la Sielec n° 7, Paris- Pondichéry, Kailash, 2011, p. 11 notamment : on y trouve des références plus précises sur ce personnage.
499
Dans une perspective voisine, faut-il voir la presse seulement comme la construction
d’un imaginaire colonial, sur un plan différent mais selon une pensée concurrente de celle du
manuel scolaire d’histoire ? Le parallèle est tentant, la comparaison des textes souvent
éclairante si l’on s’en tient à une perspective historique ou imagologique250. Mais en faisant
varier la focale, et en passant de l’individu à l’écrit, la différence entre ces deux supports
textuels idéologiques apparaît. Le statut du lecteur n’est pas le même, la mission n’est pas la
même, l’investissement personnel de l’auteur non plus : la presse vise clairement une écriture
littéraire. Les instituteurs, en outre, comme les rédacteurs de manuel, sont soumis à une
hiérarchie forte ; les journalistes, eux, sont plus libres, quels que soient les phénomènes de
censure en œuvre selon les gouvernements. En ce qui concerne la littérature postcoloniale, Jean
Bessière semble faire le même constat dans sa publication Littératures francophones et
politiques : il écrit dans l’introduction que l’ouvrage en question a pour ambition
d’identifier et caractériser les figurations du politique, que livrent ces littératures. « Figuration » indique que les œuvres jouent à la fois d’une représentation du politique et d’une réflexivité au regard de cette représentation même. On entend encore, par le même terme, marquer que cette représentation n’est pas dissociable d’une pensée de l’histoire et du pouvoir qui tente d’être ou de devenir indépendante des paradigmes occidentaux de cette double pensée. Certes, l’ouvrage est traversé de références au partage, aujourd’hui totalement usuel, du colonial et du postcolonial, comme il est traversé d’interrogations sur la place du discours tenu du dehors – par les Occidentaux, par des critiques issus des pays anciennement colonisés – sur ces littératures. Là n’est pas cependant l’essentiel ; cela n’est que le rappel des cadres et des précautions critiques contemporaines. L’essentiel réside dans la mise au jour des manières dont ces littératures, aujourd’hui, aident à penser le devenir et le futur des pays qu’elles évoquent – au-delà des impasses politiques et sans un explicite dessin politique, mais selon une perspective politique, qui se définit aisément comme la suggestion du dessin d’une communauté publique à venir251.
La perspective adoptée est bien celle d’une politique des œuvres : d’une idéologie que
ces œuvres, parce qu’elles sont engagées, mettent particulièrement en lumière. Partant de cette
question souvent posée à la littérature coloniale – et par extension à la presse coloniale – qui
consiste à savoir s’il s’agit bien d’œuvres qui ne sont pas principalement régies par un principe
esthétique, l’on pourra ensuite étudier la manière dont le décentrement comme principe
esthétique et idéologique semble une réponse intéressante à cette dichotomie. De la même
250 L’on peut ainsi lire l’article d’Éric Savarese, « L'histoire officielle comme discours de légitimation. Le cas de l'histoire coloniale », Politix, vol. 11, n° 43, 1998, p. 93-112. Il finit par étudier rapidement la représentation de la guerre du Rif dans la presse, après s’être penché sur les représentations de la colonisation dans les manuels. 251 Jean Bessière, Littératures francophones et politiques, Paris, Karthala, 2009, p. 7.
500
manière, et ce sera notre dernier point, la recherche de l’origine constitue également une réponse
double à cette dichotomie, peut-être plus profonde encore.
Des œuvres en défaut de beauté ? Un auteur anonyme regrette en 1856 le manque d’écrits historiques sur l’histoire
réunionnaise par la formulation suivante : « Un jour, nous le souhaitons, prenant la plume
austère de l’historien, une main plus habile que la nôtre, puisant dans les vieilles chroniques et
au foyer des archives officielles, tracera, dans des pages qui seront palpitantes d’intérêt,
l’histoire de notre belle colonie252 ». Cet extrait est intéressant, parce qu’il reprend plusieurs
éléments concordants que nous avons déjà étudiés : l’annonce de l’écrivain à venir, la « plume
austère » de l’historien et le rôle du document. Nous avons traité ces trois aspects à différents
moments de notre thèse, mais ce condensé d’idéologie coloniale nous permet d’accéder à une
dernière interrogation : il s’agit de la spécialisation de l’écrit, de l’affirmation de l’idéologie
primant sur l’esthétique, de l’esprit de sérieux primant sur la beauté. Les écritures coloniales
ont ceci de particulier qu’elles sont à même de faire naître ce soupçon qu’est le manque
d’esthétique, le défaut de beauté – elles ne sont pas les seules à être dans ce cas, mais elles sont
souvent envisagées ainsi. Idéologiquement condamnables, nous l’avons dit dans l’introduction,
elles n’ont souvent pas accès non plus au critère esthétique pour que leur survie soit assurée.
Ainsi, dans l’anthologie coloniale d’Alain Ruscio, la présentation du corpus intègre ces critères
avant de donner à lire les extraits :
La qualité littéraire ou artistique, la lucidité politique des documents n’ont donc pas forcément été prises en considération. Évidemment, on peut encore vibrer en lisant, en relisant les pages d’André Gide sur l’Afrique noire ou celles de Camus sur la Kabylie… Mais qui est certain qu’elles ont plus d’importance, toujours pour l’histoire des mentalités, que des vers de mirliton d’un petit Blanc chantant les yeux de braise des filles de l’océan Indien253 ?
À la page suivante, il oppose cependant le feuilleton Yasmina d’Isabelle Eberhardt, paru
dans Le Progrès de l’Est, à un livre de Louis-Charles Royer – auteur déjà cité pour son Vaudou.
Roman de mœurs martiniquaises, mais dont les romans traitent différents territoires – qui a
sensiblement la même intrigue. Il conclut : « les Français du temps lurent Royer, et ignorèrent
quasiment Eberhardt254 », puisque le livre de Royer fut tiré à 400 000 exemplaires alors que Le
Progrès de l’Est avait un rayonnement local. Il est certain qu’il est question ici d’une période à
252 X., « La Patrie », Le Bien-Public, 31 juillet 1856. 253 Alain Ruscio, Le Credo de l’Homme blanc : regards coloniaux français, XIXe – XXe siècles, Paris, Complexe, 1995, p. 16. 254 Ibid., p. 17.
501
laquelle le livre a pris le pas sur la presse dans la colonie algérienne, et que l’on est alors très
éloigné de la situation des premières décennies de colonisation. Et pourtant, si en effet le tirage
donné est extrêmement fort, il n’en reste pas moins que, dans notre perspective particulière, il
faut interroger la constitution du lectorat. C’est en ce sens que nous ne produisons pas une étude
concernant l’histoire des mentalités, mais une étude littéraire. Où sont vendus ces exemplaires ?
Peut-on penser qu’ils influencent la perception qu’ont les coloniaux de leur société ? Que révèle
le feuilleton Yasmina du dicible ou de l’indicible dans le cadre colonial tel que la presse le
présente à ses lecteurs quotidiens ? L’on pourrait renverser le constat, et au contraire remarquer
que la presse coloniale locale a pu publier un feuilleton d’Isabelle Eberhardt. Le récit commence
d’ailleurs par une phrase à la beauté toute coloniale, d’un point de vue thématique : « Elle avait
été élevée dans un site funèbre où, au sein de la désolation environnante, flottait l'âme
mystérieuse des millénaires abolis255 », puisque Yasmina la Bédouine grandit en effet au milieu
de ruines romaines, vieux thème colonial.
Plus largement, et en allant chercher du côté des théoriciens contemporains, il est tentant
et fréquent d’opposer idéologie et esthétique dans la manière même d’envisager la littérature : le
manifeste même de la « littérature-monde » en témoigne, qui prend pour cible un mouvement
tel que le Nouveau Roman en arguant de son incapacité à se pencher sur le monde256. De la
même manière, une « poétique du roman postcolonial », pour reprendre le titre de l’ouvrage
d’Yves Clavaron, incite forcément à réfléchir à l’articulation de l’esthétique et de l’idéologique,
jusqu’à fonder le terme de « poéthique257 » pour cerner cette approche postcoloniale de la
littérature et son inscription dans des mouvements littéraires au sens large – une nouvelle
appréhension de la littérature qui refuse « l’illusion textualiste258 ». Or l’on retrouve souvent ce
balancement quand il s’agit de décrire la littérature coloniale, qui rejoint alors la littérature
postcoloniale pour ces préoccupations. Parfois cette antinomie est racontée grâce au modèle
d’une évolution, comme ici à propos de la littérature coloniale algérienne :
Le grand roman colonial n’est pas apparu ex nihilo. La veine satirique, en présentant vers la fin du XIXe siècle des personnages typiquement « algériens », constitue la première émergence d’une littérature autonome, différente du courant exotique comme de la littérature française. Elle invente un certain nombre des thèmes classiques du
255 Isabelle Eberhardt, Yasmina, 1902. Texte en ligne saisi par S. Pestel pour la collection électronique de la Bibliothèque Municipale de Lisieux (30.01.1997). URL : http://www.bmlisieux.com/litterature/eberhardt/yasmin01.htm. Consulté le 11 avril juin 2017. 256 Michel Le Bris et Jean Rouaud (dir.), Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007. 257 Yves Clavaron, Poétique du roman postcolonial, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2011. Titre du chapitre III, dont les sous-parties traitent des liens entre le roman postcolonial et l’histoire, l’éthique et la politique. 258 Ibid., p. 99.
502
roman colonial « algérien ». D’une valeur littéraire souvent dérisoire, ces œuvres prennent volontiers la forme d’historiettes divertissantes, d’où le nom de pochades qu’on leur attribue parfois. Elles reflètent, très mécaniquement, les mentalités collectives et les événements historiques, car leurs auteurs ne s’embarrassent pas de laborieuses compositions esthétiques259.
Dans cette définition par ailleurs riche de la création du roman colonial, la « valeur
littéraire », les « compositions esthétiques » sont ainsi les grandes absentes de l’écriture locale
dans les premiers temps. Ce n’est qu’après, dans les publications en recueils, dans les « grands
romans coloniaux », que l’esthétique ne serait pas négligée. Dans une perspective voisine qui
est modifiée par le territoire dont il est question et partant son identité en tant que construction
textuelle, Dominique Jouve à propos de la Nouvelle-Calédonie écrit que « c’est dans la
littérature grise des rapports, études, explorations, que nous voyons se constituer certains
thèmes de l’identité calédonienne et la cartographie imaginaire de l’île260 ». Un corpus de
« littérature grise » précède donc la mise en forme d’un texte plus littéraire, celui du « voyage »
de Jules Garnier auquel aboutit la remarque de Dominique Jouve – et il est vrai que l’on donne
habituellement cet écrit comme borne pour représenter l’entrée dans la littérature française de
la Nouvelle-Calédonie261. L’on peut trouver la description suivante dans l’une des études
consacrées aux publications sur la colonie : « le romanesque n’est pas absent du Voyage, et le
narrateur prend parfois les allures d’un héros de Jules Verne, patient dans l’épreuve, calme dans
le danger, sachant en imposer aux Kanaks hostiles262 ». Tout se passe donc comme si la
littérature première, notamment celle contenue dans la presse, n’avait pas eu les critères
esthétiques souhaités ; le développement de la colonie aurait ensuite permis le développement
d’une écriture qui ne soit pas qu’utile. Recouper ainsi les discours critiques sur les corpus
coloniaux permet de voir comment un récit second se met en place qui témoigne d’un
épanouissement de la colonisation sous sa forme textuelle. Plus tard dans la chronologie
coloniale, si l’on reste sur le territoire calédonien, la presse jouera un rôle littéraire plus
affirmé ; et une étude fait le lien entre les textes de Louise Michel et ceux d’un certain Baudoux,
qui publie en métropole et sur le territoire calédonien, en recueil et en feuilleton,
alternativement, des nouvelles calédoniennes :
259 Alain Calmes, op. cit., p. 67. 260 Dominique Jouve, art. cit. 261 Jules Garnier, ingénieur des mines, publie d’abord son rapport dans Le Moniteur la Nouvelle-Calédonie en 1864-1865. 262 Frédéric Angleviel, « La littérature coloniale à vocation historique et la Nouvelle-Calédonie – 1853-1945, ou comment une colonie de peuplement génère des écrits historiographiques », Jacques Weber (dir.), Littérature et histoire coloniale, Paris, Les Indes savantes, 2005, p. 159.
503
Y compris en littérature, les journaux eurent une influence non négligeable car la mode du feuilleton toucha la Calédonie. En 1875, Louise Michel put ainsi éditer dans un journal anticlérical de Nouméa ses Légendes et chansons de geste canaques. Jules Durant publia ses nouvelles dans un journal « radical » d’opposition au gouverneur Feillet, à la fin des années 1890. Alin-Laubreaux lança Baudoux à compter de 1919 dans son journal Le Messager, qui publiait de virulentes campagnes pour le rétablissement de la transportation et contre le Canaque, « sa majesté » fainéante263.
L’itinéraire de parution des nouvelles de Baudoux se lit en note de bas de page, mais
contient pourtant des informations éclairantes :
Il n’est pas inutile de suivre l’histoire éditoriale des nouvelles de Baudoux : Journal puis livre à Nouméa (1925, toujours chez A. Laubreaux, personnage d’extrême-droite antisémite) ; livre à Paris (1928 chez Rieder, de gauche et antisémite) ; de nouveau à Paris (1952, pour le centenaire) ; enfin à Nouméa (1979 et 1996264).
Ces allers-retours entre le livre et le journal, entre la métropole et la colonie, ne sont pas
fréquents dans notre corpus, en ce qui concerne notre chronologie : sans doute le fait que ces
publications coloniales comptent est-il une prise de conscience de l’entre-deux-guerres.
Gagnant l’étiquette de « littérature » par ces parutions en recueil, les textes médiatiques
franchissent une première étape dans la reconnaissance esthétique : ils passent d’un statut
infralittéraire à un statut paralittéraire. Au fur et à mesure de leur décontextualisation par la
parution métropolitaine et livresque, ces ouvrages s’approchent selon une courbe inversement
proportionnelle de la possibilité d’être reconnus pour leurs qualités esthétiques.
La décentralisation et le décentrement : mots-clefs colonial et postcolonial ?
De la prise en compte de ce rapport complexe à la perspective esthétique surgissent deux
mots-clefs de la présentation politique de ces corpus : la décentralisation ou le décentrement,
tous deux signes d’un discours sur la littérature qui se pense en termes de centre et de périphérie.
De la même manière que l’on peut considérer que des domaines aussi différents que le mythe
et la science relèvent pourtant du même geste initial qui vise à lier le visible et l’invisible, le
phénomène et sa cause, la littérature médiatique coloniale et la littérature postcoloniale peuvent
relever d’un même geste initial ; geste caché, discutable sans doute, mais qui mettrait ainsi en
263 François Bogliolo, « Nouvelle-Calédonie, vieille terre d’édition », Mots, n° 53, décembre 1997, p. 105. 264 Id. L’écrivain Baudoux est intéressant dans notre perspective : apprenti à l’imprimerie du journal La France australe dans sa jeunesse, il écrit ensuite les légendes kanaks, les souvenirs du bagne, les mémoires de la brousse. On trouve le jugement suivant sur son œuvre : « Baudoux ʺcalédoniseʺ en fait le genre littéraire du roman d’aventure exotique ». Référence : Alain Martin, « Une ʺparoleʺ calédonienne : Georges Baudoux (1870-1949) », Notre librairie. Revue des littératures du Sud, « Littératures de Nouvelle-Calédonie », n° 134, mai-août 1998, p. 128.
504
exergue un fonctionnement majeur de la littérature. L’interprétation idéologique de la presse
coloniale incite aussi à relire différemment la littérature postcoloniale, et réciproquement. Le
renversement que l’on a observé dans le rapport au temps et à l’espace se conjugue avec la
pensée du décentrement comme mot-clef de la production littéraire postcoloniale. Pourtant cette
volonté exprimée, ce fonctionnement étudié n’est pas premier dans la chronologie que nous
avons établie. Si l’on retourne au corpus de la littérature médiatique, une première forme de
décentrement s’observe. Quelques métadiscours expliquent le potentiel de la presse dans la
nécessité d’une littérature régionale, et a fortiori coloniale. L’on peut prendre pour exemple ce
qui paraît dans L’Écho d’Oran du 6 janvier 1870, dans une deuxième page qui contient, sous la
rubrique « Bibliographie », une critique de Larmes et sourires par A. Duguay : l’introduction
est l’occasion, pour le journaliste, de développer un point de vue élargi sur la littérature locale,
avec en arrière-plan la question politique du passage de l’Algérie d’un régime militaire à un
régime civil.
C’est toujours avec bonheur que nous signalons l’apparition d’une œuvre africaine.
L’Algérie tenue en tutelle et gouvernée exceptionnellement prouvera bientôt qu’elle renferme dans son sein des éléments assez virils et intelligents pour conduire elle-même ses destinées.
Chaque tentative de décentralisation littéraire est une affirmation de force, et l’on ne saurait trop encourager les productions locales qui peuvent jeter quelque éclat sur notre nouvelle patrie.
Nul ne peut prédire quel appoint la littérature algérienne apportera au trésor des lettres françaises, mais il est certain que notre climat ardent fera éclore des œuvres chaudes et colorées comme notre ciel.
Les pays du Nord sont mieux doués que les pays méridionaux pour la production d’œuvres savantes et d’analyse, mais en revanche, la poésie, cette fille du ciel, s’est toujours complu dans les pays caressés par le soleil.
Toute la littérature arabe, y compris le Coran, n’est qu’une longue fiction poétique.
Aussi est-il probable que les œuvres d’imagination sont celles qui se développeront avec le plus de facilité en Algérie. Nous n’en voulons pour preuves que l’accueil flatteur fait il y a quelques mois aux fables de M. Simon, de Mostaganem265.
La littérature clairement mêlée au politique n’est pas l’aspect le plus remarquable de
cette introduction à une critique littéraire. « L’œuvre africaine », c’est bien l’expression qui en
résume tout le contenu : une théorie des climats appliquée aux genres littéraires, qui laisse
penser la littérature à la fois comme création spontanée liée au territoire, mais encore comme
héritière en quelque sorte du Coran. De cette filiation rêvée par laquelle le territoire engendre
une littérature propre, à l’affirmation qu’il apparaîtra une telle littérature dans l’avenir, la
265 Marial, « Bibliographie. Larmes et sourire par A. Duguay », L’Écho d’Oran, 6 janvier 1870. L’ouvrage est paru en 1869 chez la veuve Dagorn, à Oran, et sous l’étiquette « Bibliothèque oranaise » ; il est consultable sur Gallica.
505
production littéraire de la colonie semble bien être cet entre-deux qui reflète la situation
politique. Cette volonté de produire localement une littérature qui ne soit pas celle de la
métropole s’exprime aussi dans le terme de « décentralisation » ; et cette métaphore
administrative appliquée à la littérature apparaît plus d’une fois dans le corpus médiatique,
preuve de son lien avec la politique. Dans le premier numéro de La Revue africaine, en effet,
dès 1856 donc, l’on trouve exprimé ce point de vue : « La pensée de naturaliser ici les
institutions scientifiques, littéraires et artistiques de la métropole est contemporaine de la
conquête266 ». La « naturalisation » des années 1850 est devenue, à l’aube des années 1870, une
volonté de « décentralisation » : dans ces deux termes se joue un calque de l’identité coloniale
qui aide à comprendre comment la littérature a pu être l’un des appuis d’une création coloniale.
Le parallèle avec la littérature postcoloniale n’est pas aisé ; et pourtant, la portée politique des
études postcoloniales encourage à penser une parenté stratégique entre deux corpus liés aux
enjeux territoriaux et identitaires qui leur sont contemporains. La « décentralisation » en tant
que mot-clef est remplacée, un siècle et quelques années plus tard, un « décentrement » : il n’y
a pas d’égalité entre ces termes, et pourtant de ces deux déstabilisations émerge l’image d’un
même mouvement centrifuge qui a régi l’idéologie d’une production littéraire. Le décentrement
est « épistémologique et politique267 » en ce qui concerne les études postcoloniales ; mais on y
retrouve les accents de la définition du « texte exotique » en tant que production littéraire qui
répond lui aussi « à une perspective de décentrement268 », remplissant ainsi « un certain nombre
de fonctions dont chacune implique sinon une philosophie du moins une direction
idéologique269 ». Le « décentrement » est encore le mot choisi pour décrire la littérature afro-
française dans un ouvrage cité plus haut270 ; il peut s’incarner stylistiquement, devenant alors
une forme de poétique dans Le Bel immonde de Valentin-Yves Mudimbe271. Il y a donc bien un
nœud, transmis depuis la littérature coloniale jusqu’aux littératures contemporaines, autour de
cette notion de décentrement : de volonté coloniale elle est devenue constat d’une réalité
contemporaine, et son statut a de fait varié.
Autre décentrement possible, qui réunirait les deux corpus : le remplacement du lecteur
colonial dans la presse par le lectorat de la littérature postcoloniale, moins nettement défini,
266 A. Berbrugger, « Introduction », Revue africaine, 1856, n° 1, p.4. 267 Anthony Mangeon, op. cit., p. 7. 268 Bernard Mouralis, Les Contre-littératures, Paris, Hermann, [1975], 2011, p. 69. 269 Id. 270 Dominic Thomas, op. cit., p. 15. 271 Olga Hél-Bongo « Métatextualité, mise en abyme et anamorphose dans Le bel immonde de V.Y. Mudimbe », Revue de l’Université de Moncton, 421-2, 2011, p. 175-193.
506
plus problématique et plus ouvert. La littérature médiatique coloniale s’adressait principalement
aux colonisateurs, opérant en ce sens un décentrement symbolique fort. Quels sont alors les
lecteurs prévus par la littérature postcoloniale ? Commençons par les ouvrages du domaine
antillais : en ce qui concerne la langue, l’on a vu que les glossaires et traductions diverses
abondent bien plus que dans la presse coloniale : il serait facile d’opposer les fables créoles,
non traduites, aux passages traduits des romans contemporains postcoloniaux. Là où la presse
supposait un lecteur plus ou moins créolophone – le créole ne prenant que très
occasionnellement le relais du français –, le roman postcolonial préfère l’aide discrète au lecteur
non créolophone : le premier corpus refuse la métropole comme seul aboutissement ; le
deuxième semble refuser également l’assignation uniquement locale. De ces deux dynamiques
liées à un lectorat spatialisé, l’on peut retenir également l’idée de décentrement : c’est l’une des
dernières formes idéologiques lisible entre les lignes, et qui révèle les changements survenus
dans l’organisation du monde littéraire et de ses périphéries. Cette question d’un décentrement
des langues et des lectorats aboutit à une autre question, à un dernier mouvement qui clôt l’étude
d’une forme de décentralisation. Il s’agit d’analyser la littérature médiatique coloniale sous
l’angle d’une littérature mineure, mais au sens que Deleuze et Guattari développent dans leur
étude sur Kafka :
Les trois caractères de la littérature mineure sont la déterritorialisation de la langue, le branchement de l’individuel sur l’immédiat politique, l’agencement collectif d’énonciation. Autant dire que « mineur » ne qualifie plus certaines littératures, mais les conditions révolutionnaires de toute littérature au sein de celle qu’on appelle grande (ou établie). Même celui qui a le malheur de naître dans le pays d’une grande littérature doit écrire dans sa langue, comme un juif tchèque écrit en allemand, ou comme un Ouzbek écrit en russe. Écrire comme un chien qui fait son trou, un rat qui fait son terrier. Et, pour cela, trouver son propre point de sous-développement, son propre patois, son tiers monde à soi, son désert à soi272.
L’insertion de l’auteur postcolonial dans la littérature établie, tout comme l’insertion du
journaliste colonial dans ce même type de littérature, peuvent s’envisager selon ces modalités,
outre le fait majeur de l’écriture d’une minorité au sein d’une langue majeure. Les trois critères
énoncés au début de la citation permettent de replacer le décentrement au sein d’une dynamique
littéraire plus large que celle que l’on envisageait au début.
272 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Éditions de Minuit, 1975, p. 33.
507
La recherche de l’origine : une idéologie première ?
Décentrement et décentralisation sont deux termes qui présupposent un centre, partant
une origine : la métaphore n’est pas seulement spatiale, elle se joue aussi sur l’axe
chronologique. L’origine est bien un concept clef, mais également un terme flou autour duquel
évoluent des œuvres pourtant bien différentes dans leurs réalisations. Ainsi, l’idée de
« constituer [sa] propre tradition littéraire273 » s’applique aux écritures médiatiques coloniales,
qui tentent d’établir de nouvelles formes linguistiques ou un contenu nouveau, selon l’échelle
envisagée ; elle s’applique également aux littératures postcoloniales. Plus largement, l’origine
de l’auteur n’est pas la seule considérée dans les études littéraires lorsqu’elles touchent de près
ou de loin à la colonisation et à ses suites : l’origine de la littérature coloniale (quel est le
premier texte ?), l’origine des récits oraux que l’on retrouve dans la littérature postcoloniale
(comment intégrer cette « oraliture274 » dans les études postcoloniales) sont ainsi deux
directions qui permettent d’interroger les productions littéraires à l’aune de la littérature
médiatique coloniale, en se fondant principalement sur les discours théoriques et critiques qui
accompagnent ou ont accompagné les productions littéraires.
L’écriture médiatique n’est pas réputée, en son temps, être la plus novatrice ou
originale : pourtant, les études médiatiques ont démontré que le journal a constitué, à bien des
égards, un laboratoire ; mais on lui refuse facilement ce rôle originel. En outre, la recherche des
origines de la littérature sur les territoires colonisés va de pair – mais dans une direction opposée
sur l’axe chronologique – avec l’imaginaire des écrivains à venir que nous avons traité
précédemment. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la question semble particulièrement
féconde : Virginie Soula réfléchit ainsi sur la littérarité des premiers écrits de la Nouvelle-
Calédonie, étant entendu qu’il s’agit, dans sa perspective, des écrits missionnaires puisque
« leurs textes ont bien été écrits depuis l’archipel, contrairement à ceux des navigateurs qui ne
se sédentarisent pas275 ». Elle a précisé auparavant que « si la plupart de deux qui furent les
premiers à écrire en Nouvelle-Calédonie retraversèrent la mer vers la métropole, on peut
néanmoins considérer leurs textes comme les prémisses d’une écriture calédonienne276 ». Ces
interrogations sur les premiers textes, les prémisses, l’origine d’une écriture locale,
273 Lise Gauvin, « Introduction. Le palimpseste francophone et la question des modèles », op. cit., p. 8. 274 « Ce concept forgé par Ernst Mirville en 1974 […] constitue la combinaison de l’oralité et de la littérature. Plus précisément, le concept renvoie aux genres oraux structurés selon une textualité mémorielle, donnant une place affirmée à la gestuelle et se caractérisant notamment par leur aspect nocturne et collectif ». Katia Levesque, La Créolité. Entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française, Montréal, Éditions Nota bene, 2003, p. 8. 275 Virginie Soula, Histoire littéraire de la Nouvelle-Calédonie, Paris, Karthala, 2014, p. 22. 276 Ibid., p. 18.
508
s’épanouissent jusqu’à poser la question de la littérature actuellement produite en Nouvelle-
Calédonie :
la littérature calédonienne existe-t-elle par elle-même ? Est-elle une littérature française ultra-marine ? Les littératures martiniquaise et guadeloupéenne, bien qu’elles soient rarement distinguées l’une de l’autre, ne souffrent pourtant pas de cette ambiguïté. Plus anciennes, plus importantes en termes de production et surtout bénéficiant d’une plus large diffusion en métropole que celles de la Guyane, de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, elles sont désormais reconnues comme des littératures francophones à part entière277.
Pourtant, ces « littératures francophones à part entière », étudiées, reconnues,
problématisées et même soumises au débat sont assez régulièrement qualifiées
d’émergentes : tout se passe comme si les études littéraires n’en finissaient pas de lire les corpus
postcoloniaux comme l’origine d’une littérature qui n’existe pas encore, comme les prémisses
d’un corpus à venir. L’on retrouve alors, modulées selon un régime d’historicité différent, des
perspectives parallèles : l’écrivain à venir et l’obsession de l’origine semblent être les deux
facettes d’une même inquiétude. Cette mise en scène d’une littérature dont on prévoit qu’elle
est le point de départ et l’origine d’un mouvement à venir n’est pas sans poser problème. Dans
le recueil dirigé par Lise Gauvin et portant sur les réécritures, Françoise Lionnet évoque ainsi
« l’émergence interminable278 » des littératures postcoloniales telle qu’elle apparaît dans
certains discours critiques, dont ceux du manifeste pour la littérature-monde : la formule rend
bien compte d’une forme de contradiction dans les études des littératures postcoloniales. À la
lecture de la presse coloniale, nous interprétons cette expression comme l’une des
manifestations de ce que nous avons précédemment appelé « l’écrivain introuvable » : les
enjeux actuels ont déplacé la question de l’écrivain vers la production et de l’originalité
individuelle vers une conception plus politique et historique de la littérature, mais il nous
semble qu’il y a là l’expression d’une même inquiétude face à une situation d’écriture
ambivalente, ainsi que les traces en littérature d’une perception politique des territoires de
production. La colonisation visant le progrès s’écrivait dans la temporalité de
l’avenir ; l’émergence littéraire considérée comme propre aux littératures francophones
accompagne la pensée d’une émergence politique et économique, d’une temporalité à venir.
277 Ibid., p. 9. 278 Voir Françoise Lionnet, art. cit., p. 128.
509
Transition : vers la conclusion des recherches
Certaines continuités paradoxales entre la presse coloniale et la littérature postcoloniale
émergent parfois : ainsi du refus du paradis comme filtre pour envisager les Antilles, refus que
l’on trouve exprimé dès la presse coloniale – mais paradoxalement pour affirmer le caractère
édénique perdu – et jusqu’à Maryse Condé, en passant par le Césaire du Cahier d’un retour au
pays natal279. L’on trouve aussi des disparitions marquantes : ainsi de la littérature épistolaire,
que nous avons abordée ici en début de partie, épine dorsale des publications coloniales
médiatiques, forme suspecte à plus d’un titre. La lettre disparaît de l’écriture postcoloniale alors
que la littérature coloniale lui accordait une importance fondamentale, d’abord sans doute pour
des raisons esthétiques et poétiques : le roman épistolaire est en règle générale, même en-dehors
des écritures postcoloniales, associé au passé, et de ce fait peu utilisé dans les poétiques
actuelles. Mais sa disparition s’analyse également à l’aune de raisons idéologiques : la lettre est
l’apanage du colonisateur, son mode d’expression favori ; refuser la lettre, c’est aller chercher
du côté d’une esthétique neuve, et qui ne corresponde plus à l’affirmation identitaire coloniale.
La littérature de notre corpus est hors de France et hors du livre ; la littérature postcoloniale,
hors de France, ne connaît pas la deuxième exclusion qui frappe la littérature médiatique. Elle
garde cependant la trace de cette définition qui fonctionne par exclusion et référence à un corpus
idéal qui est celui, livresque et national, de la France métropolitaine. De ce fonctionnement par
exclusion l’on peut tirer un lien qui explique sans doute certaines des parentés que nous avons
tenté de mettre en avant. Post-coloniale donc, au sens chronologique, venant après la
colonisation mais lui étant inextricablement liée tout de même, la littérature du XXe siècle l’est
véritablement ; et pourtant, elle possède des traits esthétiques qui peuvent être identifiés comme
ceux des textes médiatiques coloniaux, porteurs de l’idéologie coloniale au sein d’écritures déjà
modernes. La littérature coloniale médiatique, comme la littérature postcoloniale, montre ainsi
que les textes sont affaire de domination : véritable renversement des mécanismes
d’appropriation du territoire par la fiction ou les textes « sociétaux », chroniques et variétés, les
publications postcoloniales s’appuient sur un fond qui se retrouve dans les journaux de notre
corpus. Pourtant cette littérature n’est pas seulement renversement ou contrepoint, bien
évidemment ; dans son ensemble, elle modifie profondément l’écriture et la perception du
monde par le biais des cultures dites jusqu’alors indigènes. Mais il n’empêche certains de ces
traits communs que nous avons évoqués ne laissent pas de prouver une parenté tenant à la nature
d’une littérature qui refuse l’apparence de l’autotélisme et un discours de repli sur soi. C’est en
279 Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris – Dakar, Présence africaine, [1939] 1994, p. 7-12.
510
ce sens qu’il est intéressant, dans une perspective postcoloniale, de relire des publications
oubliées ou ignorées : elles enrichissent la compréhension d’un certain rôle de la littérature, rôle
qui n’est pas le plus valorisé par la tournure qu’a prise la littérature canonique française depuis
le XIXe siècle. Une « autonomisation » de la littérature a eu lieu, qui a modifié le discours tenu
sur son rôle et son identité : en quelque sorte détachée de la réalité, la littérature s’est éloignée
des problématiques sociétales au cours du grand siècle de la presse. C’est là le trait qui permet
de clore notre étude : la revendication d’une littérarité autotélique s’est effectuée chez les
auteurs reconnus de France métropolitaine par l’opposition, avouée ou sous-jacente, au modèle
médiatique.
511
Conclusion
Le colonial n’est homogène ni dans le temps ni dans l ’espace et il se définit en
fonction des pays colonisateurs, de leurs méthodes, des époques et de son évolution
interne […]. La prise en compte de ce problème permettra de préciser la relation qui
peut exister entre, d’une part, type de domination et rapport au territoire, et, d’autre
part, attitudes l ittéraires1.
Cette réflexion de Jean-Marc Moura sur les situations coloniales aurait pu constituer le
point de départ de notre réflexion sur le corpus médiatique colonial envisagé comme un tout : il
est vrai que ce corpus a pour origine une formidable diversité, et qu’il ressortit au lien
fondamental qui peut exister entre domination, territoire et littérature. N’eût été un même
modèle littéraire, celui du journal français, le corpus n’était alors exploitable que fraction par
fraction, territoire par territoire : mais le fait que toutes les colonies françaises aient décliné un
même modèle médiatique offrait la possibilité, beaucoup plus forte d’un point de vue littéraire,
de comparer ces espaces divers et ses colonisations diverses ; de voir comment la diversité se
résolvait dans des fonctionnements semblables. La littérature médiatique qui se développe entre
1830 et 1880, parce qu’elle tient le rôle de littérature locale, est responsable de toute une partie
de l’identité coloniale – identité culturelle d’abord, mais également identité littéraire.
La structure du journal colonial constitue le premier rouage du mécanisme d’écriture
coloniale locale : c’est seulement une fois cette structure comprise que l’on peut développer
une étude des textes qui la constituent. Le rapport aux lois métropolitaines ainsi que la
répartition des textes vont dans le sens d’un lien avec la métropole ; les signatures des auteurs
et leurs biographies indiquent une tension contraire, puisque les publicistes coloniaux trouvent
leur légitimité dans le lien à la terre coloniale. La chaîne de communication médiatique qui
s’établit alors aboutit à la pensée d’un lectorat double : local d’abord, métropolitain ensuite.
Cette dualité est caractéristique de l’équilibre dans lequel se développent les écrits
coloniaux : l’on y retrouve un lecteur local toujours envisagé à l’aune du lecteur métropolitain,
et cette figure du lectorat double influence les modes d’écriture. Cette complémentarité se
1 Jean-Marc Moura, « Des comptoirs aux empires, des empires aux nations : rapport au territoire et production littéraire africaine », Littératures postcoloniales et francophonie. Conférences du séminaire de Littérature comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle. Textes réunis par Jean Bessière et Jean-Marc Moura, Paris, Champion, 2001, p. 12.
512
retrouve ensuite dans la manière dont le territoire colonial est le premier visé par l’écriture
médiatique, avant même que soient traités les divers habitants de la colonie. L’identité coloniale
se construit surtout par ce rapport au territoire qui va jusqu’à oublier la présence humaine : que
ce soit par des types d’écrit qui font de la description un moyen dynamique d’entrer dans le
territoire, ou par des textes qui prennent comme sujet la distance à la métropole, le lecteur du
journal colonial est soumis à quelques grands traits qui lui prouvent son nouvel ancrage
territorial, greffé pourtant sur un modèle national. Le territoire est le motif d’écriture par lequel
l’on arrive au plus près des variations de l’identité coloniale, identité qui est attribuée en
fonction des caractéristiques littéraires attribuées à chaque espace en fonction de son apparition
et de son traitement dans la littérature occidentale. Il y a bien, dans les périodiques coloniaux,
un effort protéiforme qui vise à donner une vision du territoire spécifiquement
coloniale : protéiforme parce qu’il emprunte à différents genres littéraires, à différentes
stratégies et à différents supports, mais néanmoins toujours tendu vers une construction
française du territoire conquis.
Les différences de traitement des territoires s’expliquent donc en partie par leur
représentation littéraire ; elles s’expliquent également par la manière dont l’altérité construit le
personnage du colonial. Un thème comme celui de la « rencontre » coloniale, avec les débats
que le terme lui-même a pu susciter, devait être revu par le prisme de la presse coloniale : par
différents moyens, l’on a vu que les publicistes coloniaux, plus qu’à décrire une rencontre,
visaient à établir une connaissance des peuples colonisés et faisaient varier leurs propres rôles
en fonction des territoires conquis. L’héroïsation du colonial n’est pas cependant synonyme de
dégradation des héros anti-coloniaux : il s’agit plutôt d’affirmer la légitimité coloniale en
adaptant le récit des conquêtes. Valoriser Abd el-Kader et faire disparaître Ataï, les deux gestes
se rapportent à la même ambition : trouver la meilleure perspective pour écrire une histoire de
la conquête française qui ne laisse pas prise au doute. D’où, également, un rapport à l’histoire
proprement colonial, et qui se nourrit du rapport à la temporalité que promet le journal, et
particulièrement le journal colonial. C’est enfin en passant par ce point commun que constitue
l’écriture du grossissement des traits que l’on peut comprendre la mise en place de l’identité
coloniale. Sans être un trait esthétique qui résume toute la production médiatique coloniale, il
explique cependant quelques fonctionnements de l’écriture coloniale au sens large, et de son
rapport problématique à l’altérité. À partir de ces axes qui montrent les ressemblances entre des
corpus médiatiques pourtant issus de territoires différents, c’est sur un temps plus large que l’on
peut épanouir le propos : en considérant que la presse a cristallisé des écritures propres à la
513
colonie, c’est toute la production coloniale puis postcoloniale que l’on peut interroger. Les
connexions entre différents corpus, la réécriture de silhouettes coloniales connues, le rapport à
l’histoire et à ses écritures constituent ainsi autant de points d’ancrage pour faire de la presse
coloniale, plutôt qu’un corpus isolé et limité dans le temps, la possibilité d’une relecture de
l’histoire littéraire dans les colonies. C’est en ce sens que certains points ont été étudiés d’une
partie à une autre, et repris comme leitmotivs : la lettre et son rôle particulier à différents
niveaux (pragmatique, esthétique, idéologique), le personnage de la créole sont les deux
meilleurs exemples de ces présences continues dans des corpus différents.
Cette étude de la presse coloniale, dans une période où elle est encore en évolution et
n’a pas atteint sa forme du XXe siècle, plus prolixe et plus aboutie encore, pousse à reconsidérer
également une histoire matérielle des publications coloniales. Les doubles publications de
certaines maisons d’édition (Mame à Tours, Challamel aîné à Paris) entre le territoire colonial
et le territoire métropolitain sont ainsi l’un de ces points qui permettraient de compléter l’étude
du corpus médiatique. Les journaux coloniaux du XXe siècle, dans leur face-à-face avec
certaines publications indigènes (particulièrement en Algérie) ou « indigénophiles »,
constituent également le point d’aboutissement de ce travail : les conditions de parution, les
réflexes identitaires et culturels ont évolué, mais la problématique de la formation d’une identité
coloniale est toujours valable. Cette ouverture vers le XXe siècle rend également possible
l’étude des corpus qui, pour notre période, ne s’avéraient pas assez riche. Il serait ainsi possible
de retracer l’évolution de la presse pour le Sénégal : la presse coloniale connaît une étape
importante avec le Moniteur administratif du Sénégal et dépendances qui paraît à Saint-
Louis en 1856, alors qu’auparavant le Bulletin administratif du Sénégal était édité à Paris2. L’on
pourrait aussi voir comment évolue la presse de Saint-Pierre-et-Miquelon ; comment les
journaux des comptoirs indiens participent également à l’épanouissement d’écritures locales en
français qui se donnent pour mission d’acclimater la presse française aux thèmes coloniaux. La
configuration médiatique coloniale au XIXe siècle représente le point de départ de cet
épanouissement à venir : sur ces fondations médiatiques vont se développer par la suite des
expressions littéraires de plus en plus fortes, de plus en plus particularisées : s’il n’existe plus
de presse coloniale à proprement parler, les mécanismes qui ont concouru à sa parution n’ont
pas disparu.
Pour le dire plus précisément encore, la colonisation au XIXe siècle a été
inextricablement liée au médiatique, et cette presse a donné forme au phénomène colonial.
2 Voir Jean-André Tudesq, Journaux et radios en Afrique aux XIXe et XXe siècles, Paris, Gret, 1998.
514
Littérairement, pourtant, on ne cherche pas à montrer que tous les territoires coloniaux ont subi
le même traitement et évolué de la même façon : ainsi que l’écrit Jean-Marc Moura à propos de
la littérature francophone, et suivant la même pensée que celle de notre épigraphe, « il n’est pas
question de découvrir une miraculeuse unité entre les œuvres abordées : on n’expliquera pas
l’émergence d’écritures francophones en Haïti de la même façon qu’au Maghreb3 ». Mais un
modèle permet sans doute de mieux voir la manière dont les émergences d’écritures
francophones postcoloniales ont pu être liées à des développements littéraires antérieurs : l’on
peut penser ces corpus selon le modèle d’une évolution « buissonnante » qui emprunte son
développement à la théorie darwinienne. Cette illustration organique peut s’avérer
stimulante : elle ne pousse pas à refuser tout lien entre littérature médiatique et littérature
coloniale, et reconnaît que certaines impasses, certaines tentatives isolées ou inabouties ont pu
imprégner la société coloniale et, partant, constituer des étapes – parfois aporétiques – dans
l’émergence de nouveaux corpus. Un point supplémentaire qui nous pousse à utiliser cette
métaphore biologique réside dans la manière dont les études médiatiques anglophones ont déjà
traité la presse coloniale, preuve d’une réussite de ce schéma : l’adéquation entre la société
coloniale et la presse comme vecteur d’information et de littérarité y est bien connue. Le modèle
impérial n’est certes pas le même : cependant, la compréhension même de la différence entre
deux modèles coloniaux ne remonte pas au XIXe siècle, mais à une période de réflexion sur les
empires : pendant le moment colonial, les empires français et anglais sont dans une dynamique
de concurrence qui les rend assez semblables. Étudier l’identité coloniale à partir de la presse
d’abord – et du livre ensuite – est une idée que les études anglophones ont développé de leur
côté, particulièrement en Australie et aux États-Unis, voire en Afrique du Sud, territoires où la
culture nationale s’est développée à partir de ces publications littéraires et qui ont, par la suite,
développé une littérature propre. Ainsi, un ouvrage sur la presse coloniale australienne fait ce
constat en ouverture de son étude :
Newspaper, magazines and journals have long been a principal means of creating communities at the local, regional, national and international level, of connectig colonisers to their European origins, townsfolk to one another, widely-dispersed citizens to the new nation, and Australians generally to international arenas of thought and action4.
3 Jean-Marc Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, PUF, [1999], 2013, p. 9. Il réitère cette idée, un peu différemment, p. 19 : « il n’est pas question de réduire la diversité francophone, postcoloniale ou non, à un dispositif énonciatif typique qui la distinguerait de tous les autres corpus littéraires ». 4 Ann Curthoys et Julianne Schultz (dir.), Journalism. Prints, Politics and Popular Culture, Queensland, University of Queensland Press, 1999, p. 1. Nous traduisons : « les journaux, les magazines et les périodiques ont longtemps été le principal moyen pour créer des communautés à un niveau local, régional, national et international ; de relier les colonisateurs à leurs origines européennes, les habitants de la ville entre eux, les
515
Cette citation met en exergue les différentes échelles et les différents enjeux des
périodiques australiens : la création de l’identité coloniale est complexe, tant sur le territoire
colonial que par rapport à la métropole et au reste du monde. De la même manière, l’on trouve
d’autres études ciblées5 : ainsi de l’étude d’un journal du Cap qui permet de lire des remarques
voisines des nôtres sur l’identité coloniale négociée à travers la production de textes locaux et
la reproduction de textes étrangers, la circulation des textes médiatiques et l’attention qu’il faut
porter au lectorat de ces textes6. L’échelle choisie par l’auteur étant la ville du Cap, l’étude
prend la forme d’un article et condense la problématique à une échelle urbaine ; mais il y a
davantage à dire lorsque l’on se penche sur les colonies françaises en tant qu’ensemble
cohérent. L’Australie, le Cap, les colonies françaises : ces parallèles entre des colonies pourtant
linguistiquement, culturellement et politiquement différentes s’expliquent bien par une base
commune, et la reconnaissance du rôle d’un certain type de littérature dans la constitution des
identités, d’une littérature infra-littéraire que représente au mieux la presse par rapport à
l’imaginaire du corpus littéraire canonique. La presse coloniale est en effet à peine
détectable ; et pourtant elle participe à la formation de « collectivités neuves7 », pour reprendre
l’expression du sociologue Gérard Bouchard quand il s’intéresse au cas québécois, conditionné
par des problématiques voisines des nôtres mais poussées plus loin, cependant, par l’histoire
canadienne8. Le propos touche cependant à des mécanismes coloniaux généraux lorsqu’il est
écrit qu’il s’agit du
moment à partir duquel les immigrants primitifs ou leurs descendants accèdent au sentiment de former une société autre, à distance de la mère patrie. […] Quoi qu’il en soit, au fur et à mesure du peuplement, une entité collective prend forme par la suite, qui s’emploie à se donner des
citoyens largement dispersés à la nouvelle nation et les Australiens en général aux arènes internationales de la pensée et de l'action ». 5 L’on peut citer ainsi l’article de Stephanie Newell « Something to Hide ? Anonymity and Pseudonyms in the Colonial West Press », Journal of Commonwealth Literature, vol. 45, n° 1, 2010, p. 9-22 : l’auteur commence par souligner l’importance de la culture médiatique dans l’Afrique de l’Ouest anglophone entre 1880 et 1930 et son rôle dans les expérimentations littéraires avant d’étudier plus précisément les signatures des articles parus. 6 Christopher Holdridge, « Circulating the African Journal : The Colonial Press and Trans-Imperial Britishness in the Mid Nineteenth-Century Cape », South African Historical Journal, 62/3, 2010, p. 487-513. Le projet expliqué correspond en partie au nôtre puisqu’il s’y intéresse au « rôle du journal dans la projection d’une image de respectabilité coloniale et de proximité culturelle avec la Grande-Bretagne, [à] la circulation importante des discussions sur les statuts et les identités coloniales reflétées par la littérature d’imagination, et [à] l’effet aliénant de la grande distance entre les colonies et la Grande-Bretagne pour forger ces identités » (« the role of the newspaper in projecting an image of colonial respectability and cultural closeness to Britain, the importance of circulating dialogues around colonial statuses and identities reflected in imaginative literature, and the alienating effect of vast distance between colonies and Britain in forging identities », p. 488). 7 Gérard Bouchard, « Le Québec comme collectivité neuve. Le refus de l’américanité dans le discours de la survivance », Gérard Bouchard et Yvan Lamonde (dir.), Québécois et Américains : la culture québécoise aux XIXe et XXe siècles, Montréal, Fides, 1995, p. 3-47. 8 Le titre même du livre fondateur de Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique (Montréal, Parti Pris, 1968), participe de ce changement de perspective.
516
représentations, des définitions d’elle-même, des finalités. Bientôt, une appartenance émerge, qui se nourrit des expériences du présent, d’utopies et de mémoire. On passe ainsi progressivement de l’entité à l’identité9.
Le passage de l’entité à l’identité peut s’effectuer dans le champ littéraire : présent,
utopies et mémoire sont apparus dans la presse coloniale, et les textes ont cristallisé ce
mouvement qui établit une société coloniale sur des fondements généraux. S’il applique le
concept de « collectivité neuve » aux sociétés coloniales dans lesquelles il y a eu
affranchissement de l’autorité métropolitaine par les descendants d’Européens, c’est selon une
perspective historique : le propos peut s’appliquer aux sociétés coloniales avant les
indépendances. Plus largement, Gérard Bouchard réfléchit ainsi à « l’existence d’une sorte de
grammaire qui se révèle dans les processus commandant la formation et les réaménagements
de l’imaginaire10 », et se fixe comme horizon théorique cette forme invariable. Si de notre côté
nous n’avons pas trouvé à proprement parler une grammaire de l’imaginaire médiatique
coloniale au cours de notre étude, sont apparues cependant des lignes de force dans la
formulation de l’identité coloniale : certaines colonies ont affiché des points communs qui les
mettaient à part d’autres territoires, et certains fonctionnements médiatiques se sont révélés
propres à une seule colonie. La comparaison des territoires et des colonies a montré ainsi
comment se tissent les ressemblances entre les colonies, et la manière dont l’empire colonial se
constitue à partir d’échos médiatiques. L’énigme que peut représenter la formation d’une
identité « nouvelle », formulée selon les impératifs coloniaux, gagne donc à être envisagée d’un
point de vue littéraire, et pas seulement historique : la presse participe de cette nouvelle manière
d’envisager la collectivité coloniale et de faire ressortir ses nuances et ses différences.
Corpus encore négligé, large et multiple, aux inflexions changeantes, la presse coloniale
non métropolitaine est en effet riche de nombreux textes qui ont non seulement construit les
colonies françaises, mais ont également participé de l’émergence de tout un pan de la littérature
française. Du journal des établissements français de l’Océanie au journal de l’arrondissement
de Guelma, des romans coloniaux aux nouvelles antillaises, un même mouvement qui identifie
le texte et le territoire surgit en effet, qui prend ses racines dans le XIXe siècle et sa formidable
production littéraire pour se répercuter ensuite jusqu’aux littératures actuelles. Dans cette
9 Ibid., p. 13. 10 Gérard Bouchard, Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde. Essai d’histoire comparée, Montréal, Boréal, [2001], 2002, p. 15. Il insiste plus loin sur le rôle de la littérature dans cet imaginaire colonial, mais sans adopter une perspective littéraire qui considère les textes pour eux-mêmes : « il semble en effet que le discours romanesque et poétique soit ordinairement en avance sur celui des idéologies et des sciences sociales, ce qui en fait un témoin précieux de l’évolution culturelle du Nouveau Monde, un confident de ses ambiguïtés, de ses angoisses et de ses réorientations » (p. 27).
517
perspective du lien au territoire, Claire Ducournau explique ainsi les scrupules qui animent un
auteur africain expatrié aux États-Unis quand il veut écrire sur l’Afrique, continent qu’il a
quitté : c’est dire à quel point l’ancrage territorial est significatif dans l’écriture littéraire
postcoloniale11. Or la presse coloniale – pour peu que l’on puisse ainsi autonomiser ce corpus
et le rendre ainsi vivant – posait les mêmes questions que les auteurs postcoloniaux, mais à
l’inverse, et elle réfléchissait selon ce patron qui mêle identité et territoire : c’est le nœud des
textes que nous avons étudiés, c’est la clef pour comprendre pourquoi les périodiques coloniaux
ne se sont pas contentés de notices pratiques et d’un peu de littérature métropolitaine importée.
Pourquoi en effet n’avoir pas limité la production médiatique coloniale à une cohabitation entre
Les Misérables et une notice sur la culture du vanillier ? Le territoire se crée et s’imagine par
les lettres, par une culture que l’on essaie de répandre quotidiennement : le journal a constitué
ce média par lequel se sont sans doute uniformisés certains comportements, en même temps
qu’ils se particularisaient aussi. Rien de paradoxal ici, ou d’antinomique : l’uniformisation par
le modèle médiatique est concomitante à une démarche de particularisation ; une mentalité
coloniale est née qui s’est adaptée à chaque territoire en suivant un modèle semblable.
La presse, les nations et la mondialisation : ces trois termes recouvrent un mouvement
général qui se lit particulièrement dans le développement de la presse coloniale, et qui explicite
justement ce modèle que nous venons d’évoquer12. C’est à la lumière du réseau mondial de
l’information qui se met en place au cours du siècle et que la presse coloniale illustre de manière
assez remarquable que nous relisons les liens entre la nation et les colonies, comme un apport
supplémentaire à cette reconstitution d’une construction nationale nuancée. La nation elle-
même se construit par les marges, par ses colonies longtemps qualifiées de périphéries, comme
cela a été démontré13. Cette construction marginale est prédominante dans les imaginaires
coloniaux : l’on rejoint ici l’une des scènes inaugurales du Chercheur d’or de J.M.G. Le Clézio,
qui rend visible les liens entre la nation et le territoire, mais également la langue et le territoire.
Sur l’île Maurice, le grenier de la maison familiale du jeune héros recèle une forme de trésor
qui est décrit ainsi : « de grandes malles pleines de vieux papiers, des revues de France attachées
avec de la ficelle14 ». Ces journaux qui matérialisent le lien à la France, qu’il s’agisse du Journal
des voyages ou de « journaux sans images », sont mêlés à L’Illustrated London News ; Alexis
11 Claire Ducournau, op. cit., p. 75-76. 12 Marie-Ève Thérenty et Alain Vailllant (dir.), Presse, nations et mondialisation au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2010. 13 Cécile Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre colonies et métropole, XVIe-XIXe siècle, Paris, éditions de l’EHESS, 2014. 14 J.M.G. Le Clézio, Le Chercheur d’or, Paris, Gallimard, 1985, p. 33.
518
(le héros) et sa sœur jouent à partir des réclames qu’ils lisent dans les dernières pages, regardent
les images de chasses aux tigres : un condensé de la vie coloniale apparaît alors, à partir duquel
l’on peut comprendre le poids littéraire et symbolique des journaux dans les colonies, cette
articulation entre le local et le national qui passe par l’ancrage régional. Resserrer le propos sur
les publications locales revient alors à explorer cette complexité du rapport à la presse sur ces
territoires. C’est d’ailleurs ce lien avec la mondialisation et les nations qui explique la portée
de notre corpus : par rapport aux périodiques du siècle précédent, et par rapport aux périodiques
du siècle suivant, les journaux publiés entre 1830 et 1880 sont concomitants d’une
mondialisation qui s’appuie sur les empires coloniaux15. Les gazettes du XVIIIe siècle ont cours
à la Réunion et aux Antilles16 ; mais elles ne rendent pas compte de la nouvelle inflexion
impériale donnée par la conquête de l’Algérie, de la même manière qu’elles ne sont pas
travaillées par les progrès techniques et les changements idéologiques du siècle de la
mondialisation. De la même manière, les colonies jouent un double jeu, entre la nation et la
périphérie, l’attirance régionale et la fidélité nationale : les périodiques construisent ce rapport
au temps et à l’espace qui n’est pas celui des Français métropolitains17.
Le journal colonial constitue bien, en ce sens, l’aboutissement des efforts faits par les
coloniaux pour dessiner et construire leur territoire : d’un point de vue géopolitique,
l’« énonciation identitaire » allant de pair avec une « prétention territoriale18 » constitue le
fondement de cette littérature médiatique coloniale. Ce lien fort se retrouve ensuite dans la
librairie coloniale, puis dans la bibliothèque postcoloniale : ayant marqué une étape importante
du développement de la culture coloniale française et de la culture postcoloniale, le territoire et
l’identité représentent les points d’ancrage de ces littératures. La « communauté imaginée19 »
de Benedict Anderson est également un territoire imaginé, tout aussi puissant pour la
15 Anne-Marie Thiesse date la « première mondialisation » de la décennie 1870, suivant en cela un ouvrage de Suzanne Berger. Voir : Anne-Marie Thiesse, « Nations, internationalismes et mondialisation », Romantisme, 2014/1, n° 163, p. 15-27 ; et Suzanne Berger, Notre première mondialisation. Leçons d’un échec oublié, trad. Richard Robert, Paris, Seuil, 2003, p. 6. Anne-Marie Thiesse note que « les histoires nationales, rédigées à partir des années 1820, se présentent comme les récits de vie de personnalités singulières, depuis leurs lointaines origines jusqu’au temps présent » (p. 15) ; et que l’essor de la nation accompagne paradoxalement (le paradoxe n’est qu’apparent) cette première mondialisation. 16 Ainsi des Annonces, affiches et avis divers pour les colonies des Îles de France et de Bourbon qui commencent à paraître en 1773. 17 Cette question de l’appartenance nationale est ainsi un point de réflexion des études actuelles ; on peut pour preuve citer cette thèse récente, qui interroge sur la période suivant la nôtre les liens entre la nation et le territoire ultramarin de la Réunion : Pierre-Éric Fageol, « Le sentiment d’appartenance et de représentation nationale à la Réunion (1880-1950) », thèse de doctorat en histoire sous la direction de M. le Professeur Yvan Combeau, soutenue en 2013 à l’Université de la Réunion. 18 Bertrand Badie, op. cit., p. IV. 19 Benedict Anderson, op. cit.
519
construction coloniale : et c’est par la littérature que cette construction passe. Par la littérature
médiatique au premier chef, eu égard encore une fois à la particularité des publications de
presse en contexte colonial ; mais également sous la forme du livre. L’on aurait tort de négliger
la portée identitaire de la littérature : le journal colonial invite à reconsidérer cet aspect, et à le
rendre plus marquant encore. Car il ne s’agit pas seulement, dans la presse, d’une image de telle
ou telle catégorie de population : le support médiatique est suffisamment inventif pour que s’y
révèlent des tendances poétiques plus larges, qui ouvrent la lecture sur d’autres corpus. C’est la
raison pour laquelle les auteurs de la presse coloniale nous ont autant intéressée : les postures
qu’ils adoptent, les trajectoires qui sont les leurs, les images d’auteur qui apparaissent autour
de leurs œuvres sont autant de signes d’une écriture qui se développe à part de la production
littéraire nationale, dans des marges qui sont vécues comme telles et qui commencent à être
revendiquées en tant que telles. Marge littéraire, géographique, idéologique : une littérature de
l’à-côté participe à la structuration de comportements de lecteurs et influence ainsi la formation
d’une identité coloniale. En ce sens, l’étude littéraire menée ici met l’accent sur l’activité
littéraire plus que sur la qualité littéraire : ce postulat n’a rien de nouveau, ayant été développé
notamment par Bernard Mouralis20. Au sein de cette marge – ou plutôt de ces marges –, c’est
en termes d’exotisme et de domination que notre corpus trouve sa place : la presse a joué un
rôle prédominant dans les mécanismes d’appropriation de l’espace colonial et des populations
colonisées. Ce phénomène littéraire concentré dans le temps, délimitable et étudiable, a
également cristallisé et cristallise encore un fonctionnement plus général de la littérature : elle
révèle une partie de ce que les textes littéraires recèlent comme problématiques de pouvoir et
de légitimité.
20 Bernard Mouralis, Les Contre-Littératures, p. 3.
520
Bibliographie
Presse et études de littérature médiatique
AÏT SIDHOUM, Slimane, Les récits de voyage en Algérie dans la presse illustrée et les revues du XIXe siècle ou l'invention d'un orient de proximité, thèse de littérature française et comparée sous la direction de Mme la Professeure Marie-Ève Thérenty, soutenue à l’Université Montpellier III, 2013.
BRAIVE, Georges, « Les groupes de presse belge en 1858 », Revue belge de philologie et d’histoire, tome 45, fascicule 2, 1967, p. 414-415.
CAMBRON, Micheline et Hans-Jürgen LÜSEBRINK, « Presse, littérature et espace public : de la lecture et du politique », Études françaises, 2000, vol. 36, n° 3, p.127 – 145.
CHARLE, Christophe, Le Siècle de la presse (1830 – 1939), Paris, Seuil, 2004.
CHARLIER, Marie-Astrid et Yvan DANIEL (dir.), Les Ailleurs de l’Europe dans la presse et le reportage littéraires (XIXe-XXe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016.
CODELL, Julie (dir.), Imperial Co-Histories. National Identities and the British and Colonial Press, Madison, Fairleigh Dickinson Univ Press, 2003.
COQUILHAT, Georges, La Presse de la Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle (1859 – 1900), thèse de doctorat en histoire sous la direction de M. le Professeur Jean Chesneaux, soutenue à l’EHESS, 1984.
CURTHOYS, Ann et Julianne SCHULTZ (dir.), Journalism. Prints, Politics and Popular Culture, Queensland, University of Queensland Press, 1999.
DEMOUGIN, Laure, « Can the Indigenous Speak? The Speech of the Colonized in the Colonial Press in Algeria in the Nineteenth Century », Literary Journalism Studies, 2016, vol. 8, n° 2. URL : http://ialjs.org/wp-content/uploads/2017/03/09-Demougin-Indiginous_90-101.pdf. Consulté le 1er juillet 2017.
DEMOUGIN, Laure, « Un pan de l’identité coloniale : la presse coloniale et la circulation de l’information au XIXe siècle », Les journalistes : identités et modernités, Actes du premier congrès Médias 19 (Paris, 8-12 juin 2015), Guillaume Pinson et Marie-Ève Thérenty (dir.), 2017. URL : http://www.medias19.org/index.php?id=22749. Consulté le 12 juillet 2017.
DEVREUX, Lise et Philippe MEZZASALMA (dir.), « Des sources pour l’histoire de la presse », avec la collaboration de Catherine Eloi, Denis Gasquez et Jean-Didier Wagneur, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2011.
521
DURAND, Pascal, « Presse ou médias, littérature ou culture médiatique ? Question de concepts », Contextes, 2012, n° 11. URL : http://contextes.revues.org/5392. Consulté le 2 septembre 2014.
FEYEL, Gilles, « Un journal départemental et son budget, Le Glaneur, journal d’Eure-et-Loir (1830-1851) », Presse, radio et histoire, actes du 113e Congrès national des sociétés savantes, Strasbourg, 1988, Paris, éd. Du CTHS, 1989, p. 59-84.
FEYEL, Gilles, La Presse en France. Des origines à 1944, Paris, Ellipses, 2007.
FOURNIER, Cécile, Les Deux rébellions métisses du XIXesiècle à travers la presse francophone, mémoire de lettres modernes soutenu à l'Université Jean Moulin de Lyon.
GRANFORT, « Le Moniteur algérien de 1841 à 1848, son rôle et sa tendance par Mlle Granfort », Institut d’histoire des pays d’Outre-Mer : bulletin n° 6, 1970-1971, p. 5-18.
HOLDRIDGE, Christopher, « Circulating the African Journal : The Colonial Press and Trans-Imperial Britishness in the Mid Nineteenth-Century Cape », South African Historical Journal, 62/3, 2010, p. 487-513.
IHADDADEN, Zahir, La Presse musulmane algérienne de 1830 à 1930, Alger, ENAL, 1986.
JEAN-BAPTISTE, Fabienne, Feuilletons et Histoire. Idées et opinions des élites de Bourbon et de Maurice dans la presse de 1817 à 1848, thèse de doctorat en histoire contemporaine sous la direction de M. Prosper Ève, soutenue à l’Université de la Réunion, 2010.
JENNINGS, Lawrence Charles, « La Presse havraise et l’esclavage », Revue Historique, 272, n° 1, 1984, p. 45-71.
KALIFA, Dominique, « L’entrée de la France en régime "médiatique" : l’étape des années 1860 », De l’écrit à l’écran, Jacques Migozzi (dir.), Limoges, Pulim, 2000, p. 39-51.
KALIFA, Dominique, Philippe RÉGNIER, Marie-Ève THÉRENTY et Alain VAILLANT (dir.), La Civilisation du journal : Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2011.
KRAEMER, Gilles, Trois siècles de presse francophone dans le monde, Paris, L'Harmattan, 1995.
LEGG-CHOPIN, Charlotte, Imagining the Peuple Nouveau : Medicine and the Press in French Algeria, 1870-1914, thèse de doctorat en études françaises et histoire sous la direction de M. le Professeur Edward Berenson, soutenue à New-York University, 2013.
LELOUP, Yves, « Festivités sportives populaires et presse coloniale (1844-1900) », Recherches en Communication, 2008, vol. 30, n° 30, p. 71-88.
LÜSEBRINK, Hans-Jürgen, La Conquête de l’espace public colonial. Prises de parole et formes de participation d’écrivains et d’intellectuels dans la presse coloniale (1884 – 1960), Québec/Frankfurt am Main/London, Éd. Nota bene/IKO-Verlag, coll. Studien zu den frankophonen Literaturen ausserhalb Europas, Bd. 7, 2003.
522
MARTHOT, Yves, « Histoire de la presse en Algérie : L’Écho d’Oran ». URL : http://www.cdha.fr/histoire-de-la-presse-en-algerie-lecho-doran. Consulté le 30 mars 2016.
MERRITT, Richard L., « Public opinion in colonial America : content-analyzing the colonial press », Public Opinion Quarterly, 1963, n° 27, p. 356-371.
MIGOZZI, Jacques (dir.), De l’écrit à l’écran. Littératures populaires : mutations génériques, mutations médiatiques, Limoges, Pulim, 2000.
MONTOY, Louis-Pierre, La Presse dans le département de Constantine, thèse de doctorat en histoire sous la direction de M. le Professeur Jean-Louis Miège, soutenue à l’Université de Provence, 1982.
PALMER, Michaël B., « De l’information étrangère dans la presse quotidienne française : les agences de presse et le journalisme anglo-saxon (1875-1885) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, avril-juin 1976, tome 23, n° 2, p. 203-225. URL : http://www.jstor.org/stable/20528332. Consulté le 24 avril 2015.
PAMÉ, Stella, Contribution à l'étude de la presse martiniquaise 1850 – 1855, Paris, Université Panthéon-Assas, Institut français de presse et de l'information, 1977.
PASQUIER, Roger, « Les débuts de la presse au Sénégal », Cahiers d’études africaines, vol. 2, cahier 7, 1962, p. 477-490. URL : http://www.jstor.org/stable/4390811. Consulté le 10 septembre 2014.
PERRET, Thierry, Le Temps des journalistes, Paris, Karthala, 2005.
PINSON, Guillaume, « L’imaginaire médiatique. Réflexions sur les représentations du journalisme au XIXe siècle », COnTEXTES, 2012, n° 1. URL : http://contextes.revues.org/5306. Consulté le 11 août 2015.
PINSON, Guillaume, L’Imaginaire médiatique : histoire et fiction du journal au XIXe siècle, Paris, Garnier, 2013.
SAMINADAYAR-PERRIN, Corinne, « Stratégies génériques dans l’écriture journalistique du XIXe siècle », Romantisme, 2010/1, n° 147, p. 121-134.
SCHMIDT, Elisabeth, La Presse dans les colonies allemandes en Afrique 1898 – 1916. Rapports à l’Allemagne et construction identitaire des colons, thèse de doctorat en études germaniques sous la direction de Mme la Professeure Anne Saint-Sauveur-Henn, soutenue à l’Université de la Sorbonne Nouvelle, 2008.
SERS-GAL, Georgette, « La Presse algérienne de 1830 à 1852 », Documents algériens : service d’information du Gouvernement général, 1948.
SERS-GAL, Georgette, « La Presse algérienne de 1870 à 1900 », La Revue africaine, 1959, p. 92 – 113.
SLAUTER, Will, « Le Paragraphe mobile. Circulation et transformation des informations dans le monde atlantique du XVIIIe siècle », Annales. Histoire, sciences sociales, 2012/2, p.363-389.
523
STIÉNON, Valérie, « Effets de parole vive. Poétique de la saynète dans la presse satirique illustrée des années 1830-1840 », Presse, chanson et culture orale au XIXe siècle. La parole vive au défi de l’ère médiatique, Élisabeth Pillet et Marie-Ève Thérenty (dir.), Paris, Nouveau Monde, 2012, p. 259-272.
SURUN, Isabelle, « Les figures de l'explorateur dans la presse du XIXe siècle », Le Temps des médias, 2007, n° 8, p. 57-74.
TÉCHER, Karine et Mario SERVIABLE, Histoire de la Presse à la Réunion, Sainte-Clotilde (La Réunion), Ars terres créoles, 1991.
THÉRENTY, Marie-Ève et Alain VAILLANT (dir.), Presse, nations et mondialisation au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2010.
THÉRENTY, Marie-Ève et Alain VAILLANT, 1836, l’an I de l’ère médiatique, Paris, Nouveau Monde, 2001.
THÉRENTY, Marie-Ève, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2007.
THÉRENTY, Marie-Ève, Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (1829-1836), Paris, Champion, 2003.
TOUSSAINT, Auguste, « Les Débuts de l'imprimerie aux Iles Mascareignes », Revue d'histoire des colonies, tome 35, n° 122, 1948, p. 1-26.
ZESSIN, Philipp, « Presse et journalistes ʺindigènesʺ en Algérie coloniale (années 1890 – années 1950) », Le Mouvement social, 2011, n° 326, p. 35-46.
Littérature : ouvrages généraux
AMOSSY, Ruth, « La double nature de l’image d’auteur », Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 3 | 2009. URL : http://aad.revues.org/662. Consulté le 24 avril 2013.
AMOSSY, Ruth, et Dominique MAINGUENEAU, « Autour des "scénographies auctoriales" : entretien avec José-Luis Diaz, auteur de l’Ecrivain imaginaire (2007) », Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 2009. URL : http://aad.revues.org/678. Consulté le 17 septembre 2014.
AMOSSY, Ruth, Les Idées reçues. Sémiologie du stéréotype, Paris, Nathan, 1991.
ANGENOT, Marc, 1889, un état du discours social. Disponible en ligne sur le site Médias 19. URL : http://www.medias19.org/index.php?id=11003. Consulté le 22 septembre 2014.
ANTOINE, Philippe, Quand le Voyage devient Promenade. Écritures du voyage au temps du romantisme, Paris, PUPS, 2011.
BROSSE, Monique, « Littérature marginale : les histoires de naufrage », Romantisme, 1972, n° 4, p. 112-120.
524
CHEYNE, Michelle, « Pyracmond, ou les Créoles : l’articulation d’une hiérarchie des rôles raciaux sur la scène française sous la Restauration », French Colonial History, 2005, vol. 6, p. 79-102.
DELEUZE, Gilles et Félix GUATTARI, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Éditions de Minuit, 1975.
GRUTMAN, Rainer, « Effets hétérolingues dans le roman québécois du XIXe siècle », Littérature, 1996, n° 101, p.40-52.
HAMEL, Jean-François, Revenances de l’histoire. Répétitions, narrativité, modernité, Paris, Les Editions de Minuit (Paradoxe), 2006.
MACHEREY, Pierre, Pour une théorie de la production littéraire, Paris, Maspéro, 1980.
MAINGUENEAU, Dominique, « L’éthos : un articulateur », COnTextes, 2013, n° 13. URL : http://contextes.revues.org/5772. Consulté le 20 septembre 2014.
MAINGUENEAU, Dominique, « Le tour ethnolinguistique de l’analyse du discours », Langages, n° 105, 1992, p. 114-125.
MAINGUENEAU, Dominique, Le Contexte de l’œuvre littéraire. Enonciation, écrivain, société, Paris, Dunod, 1993.
MAINGUENEAU, Dominique, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004.
MEIZOZ, Jérôme, « Ce que l’on fait dire au silence : posture, ethos, image d’auteur », Argumentation et Analyse du discours, 2009, n° 3. URL : http://aad.revues.org/667. Consulté le 17 septembre 2014.
MONTANDON Alain, Sociopoétique de la promenade, Clermond-Ferrand, Presses Universitaires de Clermont-Ferrand, 2000.
MORETTI, Franco, « Hypothèses sur la littérature mondiale », trad. Raphaël Micheli, Études de lettres, Lausanne, 2001, n° 7, p. 54-68.
MORETTI, Franco, Atlas du roman européen. 1800-1900, [Turin, Einaudi, 1997], trad. Jérôme Nicolas, Paris, Seuil, 2000.
RÉGNIER, Philippe, « Littérature, idéologie(s) et idéologie de la littérature : un combat toujours actuel », Revue d’histoire littéraire de la France, 2003/3, vol. 103, p. 563-578.
ZUMTHOR, Paul, Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, 1972.
525
Littérature : problématiques particulières
Littérature de voyage
BERTY, Valérie, Un Essai de typologie narrative des récits de voyage français au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2001.
HOLTZ, Grégoire et Vincent MASSÉ, « Étudier les récits de voyage : bilan, questionnements, enjeux », Arborescences : revue d’études françaises, n° 2, 2012. URL : http://id.erudit.org/iderudit/1009267ar. Consulté le 6 février 2015.
LE HUENEN, Roland, « Le Récit de voyage : l’entrée en littérature », Études littéraires, vol.20, n° 1, 1987, p. 25-61.
SEVRY, Jean, Un Voyage dans la littérature des voyages. La première rencontre, Paris, L’Harmattan, 2012.
Littérature coloniale, littérature exotique
AÏT DAHMANE, Karima, « Catégorisations et stéréotypisations de l’altérité dans le discours de conquête (1830-1847) », Insaniyat / تایناسنإ , [En ligne], n° 37, 2007. URL : http://insaniyat.revues.org/4134. Consulté le 10 septembre 2015.
ASTIER-LOUTFI, Martine, Littérature et colonialisme : l’expansion coloniale vue dans la littérature coloniale française, 1871 – 1914, Paris, Mouton & C°, 1971.
AUDISIO, Gabriel, « Les écrivains algériens », Documents algériens, n° 67, 1952.
BANARÉ, Eddy, La Littérature de la mine en Nouvelle-Calédonie (1853-1953), thèse de doctorat en littérature française, sous la direction de Mme la Professeure Dominique JOUVE, soutenue à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, 2010.
BOGLIOLO, François, « Nouvelle-Calédonie, vieille terre d’édition », Mots, n° 53, décembre 1997, p. 103-116.
BONGIE, Chris, « 1835, or « Le troisième siècle ». The Creole Afterlives of Cyrille-Charles-August Bissette, Louis Maynard de Queilhe, and Victor Schoelcher », Islands and Exiles : The Creole Identities of Post/colonial Literature, Stanford, Stanford University Press, 1998.
Cahiers de la SIELEC, Paris, Editions Kailash.
CALMES, Alain, Le Roman colonial en Algérie avant 1914, Paris, L’Harmattan, 1984.
CALVET, Louis-Jean, Linguistique et colonialisme, Paris, Payot, 1974.
DODILLE, Norbert, Introduction aux discours coloniaux, Paris, PUPS, 2011.
526
DUBREUIL, Laurent, L'Empire du langage : colonies et francophonie, Paris, Hermann Editeurs, 2008.
DURAND, Jean-François et Jean SEVRY (dir.), Regards sur les littératures coloniales, tomes I et II, Paris, L’Harmattan, 1999.
DURAND, Jean-François, « Littératures coloniales, littératures d’Empire ? », Romantisme, 2008/1, n° 139, p. 47-58.
EAGLETON, Thierry, Frédéric JAMESON et Edward SAID, Nationalisme, colonialisme et littérature [1990], Lille, Presses Universitaires de Lille, collection "Etudes irlandaises", 1994.
FIORI, Hermann, Bibliographie des ouvrages imprimés à Alger de 1830 à 1850, Genève, Slatkine, 1938.
HALEN, Pierre et Maxime RODINSON, « Pour en finir avec une phraséologie encombrante : la question de l’Autre et de l’exotisme dans l’approche critique des littératures coloniales et postcoloniales », Regards sur les littératures coloniales. Afrique francophone, Découvertes, 1999, vol. 1, p. 60-61.
HALEN, Pierre, « Retour sur le ʺroman nègreʺ. À propos de la réédition d’un diptyque de Jean Sermaye », Cahiers d’études africaines, 212|2013. URL : http://etudesafricaines.revues.org/17533. Consulté le 27 janvier 2017.
HALEN, Pierre, La Littérature coloniale, Bruxelles, Le Cri, 1994.
HAZAEL-MASSIEUX, Marie-Christine, Textes anciens en créole français de la Caraïbe - Histoire et analyse, Paris, Publibook, 2008.
HENRY, Jean-Roger et Lucienne MARTINI (dir.), Littératures et temps colonial. Métamorphoses du regard sur la Méditerranée et l’Afrique, Aix-en-Provence, Edisud, 1999.
HOFFMANN, Léon-François, Le Nègre romantique : personnage littéraire et obsession collective, Paris, Payot, 1973.
JOURDA, Pierre, L’Exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand, tome II. Du romantisme à 1939, Paris, PUF, 1956.
KAPOR, Vladimir, « Pour un exotisme antécolonial – l’œuvre de Pierre Loti dans la réflexion théorique de Marius-Ary Leblond », Yvan Daniel (dir.), Pierre Loti, l’œuvre monde ?, Paris, Les Indes savantes, 2015, p. 63-71.
KAVWAHIREHI, Kasereka, « La littérature orale comme production coloniale », Cahiers d’études africaines, 176|2004. URL : http://etudesafricaines.revues.org/4825. Consulté le 26 janvier 2017.
LEBEL, Roland, Histoire de la littérature coloniale en France, Paris, Larose, 1931.
LETOURNEUX, Matthieu, « La colonisation comme un roman ; Récits de fiction, récits documentaires et idéologie dans le Journal des voyages », Idéologie et stratégies
527
argumentatives dans les récits imprimés de grande diffusion, Belphégor, IX, 1, 2010. URL : http://etc.dal.ca/belphegor/vol9_no1/fr/main_fr.html. Consulté le 6 juin 2017.
LITTLE, Roger, « Les Noirs dans la fiction française, d’une abolition de l’esclavage à l’autre », Romantisme, 2008/1, n° 139, p. 7-18.
LÜSEBRINK, Hans-Jürgen, « La perception de l’Autre. Jalons pour une critique littéraire interculturelle », Tangence, 1996, n° 51, p. 51-66.
MALLERET, Louis, L’Exotisme indochinois dans la littérature française depuis 1860, Paris, Larose, 1934.
MARTEL, Philippe, « De l’Auvergnat au Kabyle, le recyclage d’un stéréotype dans l’Algérie coloniale », Confluences Méditerranée, 2012/1, n° 80, p. 163-179.
MOURA, Jean-Marc, « Littérature coloniale et exotisme : Examen d’une opposition de la théorie littéraire coloniale », Regards sur les littératures coloniales : Afrique francophone, Paris, La Découverte, 1999, p. 21-39.
MOUSSA, Sarga (dir.), L’idée de « race » dans les sciences humaines et la littérature (XVIIIe et XIXe), Paris, L’Harmattan, 2003.
MOUSSA, Sarga (dir.), Littérature et esclavage. XVIIIe - XIXe, Paris, Desjonquères, 2010.
MOUSSA, Sarga, La Relation orientale. Enquête sur la communication dans les récits de voyage en Orient (1811-1861), Paris, Klincksieck, 1995.
NICOLE, Rose-May, Noirs, Cafres et Créoles. Etude de la représentation du non blanc réunionnais, Paris, L’Harmattan, 1996.
POUILLON, François, Écrivains français d’Algérie et société coloniale, Paris, Kailash, 2008.
PUJARNISCLE, Eugène, Philoxène ou de la littérature coloniale, éd. Jean-Claude Blachère, Paris, L’Harmattan, 2010.
RIESZ, János, De la littérature coloniale à la littérature africaine. Prétextes – Contextes – Intertextes, Paris, Karthala, 2007.
RODA, Jean-Claude, Bourbon littéraire : Guide bibliographique des poètes créoles, Saint-Denis, Bibliothèque universitaire de la Réunion, 1974.
RUSCIO, Alain, Le Credo de l’Homme blanc : regards coloniaux français, XIXe – XXe siècles, Paris, Complexe, 1995.
SEILLAN, Jean-Marie, « La (para)littérature (pré)coloniale à la fin du XIXe siècle », Romantisme, 2008, n° 139, p. 33-45.
SEILLAN, Jean-Marie, Aux sources du roman colonial (1863-1914) : l’Afrique à la fin du XIXe siècle, Paris, Karthala, 2006.
528
SPURR, David, The Rhetoric of Empire : Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing and Imperial Administration, Durham, Duke University Press, 1993.
TAILLIART Charles, L’Algérie dans la littérature française : essai de bibliographie méthodique et raisonnée jusqu’à l’année 1924, Genève, Slatkine Reprints, [1925], 1998.
THOMAS, Dominic, Noirs d’encre. Colonialisme, immigration et identité au cœur de la littérature afro-française, Paris, La Découverte, 2013.
WEBER, Jacques, Littérature et histoire coloniale, Paris, Les Indes Savantes, 2005.
YEAGER, Jack A., The Vietnamese Novel in French, a literary response to colonialism, University Press of New England, Hanover and London, 1987.
YEE, Jennifer, Clichés de la femme exotique. Un regard sur la littérature coloniale française entre 1871 et 1914, Paris, L’Harmattan, 2000.
Littérature postcoloniale
« Littératures de Nouvelle-Calédonie », Notre librairie. Revue des littératures du Sud, n° 134, mai-août 1998.
BARDOLPH, Jacqueline, Études postcoloniales et littérature, Paris, Champion, 2002.
BENIAMINO, Michel, La Francophonie littéraire, Essai pour une théorie, Paris, L’Harmattan, 1999.
BERNABÉ, Jean, La Fable créole, Mantoury, Ibis Rouge, 2001.
BESSIÈRE, Jean et Jean-Marc MOURA (dir.), Littératures postcoloniales et francophonie. Conférences du séminaire de Littérature comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris, Honoré Champion, 2001.
BESSIÈRE, Jean, Littératures francophones et politiques, Paris, Karthala, 2009.
HÉL-BONGO, Olga, « Métatextualité, mise en abyme et anamorphose dans Le bel immonde de V.Y. Mudimbe », Revue de l’Université de Moncton, 421-2, 2011, p. 175-193.
BUISINE, Alain, Norbert DODILLE et Claude DUCHET (dir.), L’Exotisme, actes du colloque de Saint-Denis de la Réunion, dans les Cahiers CRLH.CIRAIO, n° 5, 1988, Paris, Didier-Erudition, 1988.
CARPANIN MARIMOUTOU, Jean-Claude (dir.), Études créoles : Des Fables créoles, Paris, L’Harmattan, 2002.
CARPANIN MARIMOUTOU, Jean-Claude, « Le lieu et le lien : à propos de la littérature réunionnaise », Hermès, La Revue, 2002/1, n° 32-33, p. 131-139.
CLAVARON, Yves, Poétique du roman postcolonial, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2011.
529
DÉJEUX, Jean, Dictionnaire des auteurs maghrébins de langue française, Paris, Karthala, 1984.
DÉJEUX, Jean, La Littérature algérienne contemporaine, Paris, Presses Universitaires de France, Coll. « Que sais-je », [1975] 1979.
DÉJEUX, Jean, La Poésie algérienne de 1830 à nos jours. Approches socio-historiques, éditions Mouton, Paris, Publications de l’école pratique des hautes études, 1963.
DUBOIS, Dominique, « La nouvelle caraïbe contemporaine : naissance d'une esthétique post-coloniale », Études anglaises, 2001/2, tome 54, p. 193-204.
DUCOURNAU, Claire, La Fabrique des classiques africains. Écrivains d’Afrique subsaharienne francophones, Paris, CNRS Éditions, 2017.
GAUVIN, Lise, Cécile VAN DEN AVENNE, Véronique CORINUS et Ching SELAO (dir.), Littératures francophones. Parodies, pastiches, réécritures, Lyon, ENS Éditions, 2013.
GAUVIN, Lise, Écrire pour qui ? L’écrivain francophone et ses publics, Paris Karthala, 2008.
HAUSSER, Michel et Martine MATHIEU, Littératures francophones. Afrique noire et océan indien, t. 3, Paris, Belin collection Belin Sup Lettres, 1998.
HUE, Bernard, Henri Copin, Pham Dan Binh, Patrick Laude et Patrick Meadows, Littératures de la péninsule indochinoise, Paris, Karthala-AUF, 1999.
JOUBERT, Jean-Louis, Littératures de l’Océan Indien, Vanves, Edicef, 1991.
JOUVE, Dominique, « Présentation de la littérature de Nouvelle-Calédonie ». URL : http://www.bib-cclachatrestesevere.net/userfiles/file/Pr%C3%A9sentation%20de%20la%20litt%C3%A9rature%20cal%C3%A9donienne%20par%20Dominique%20Jouve.pdf. Consulté le 17 juin 2017.
JOYAU, Auguste, Panorama de la littérature à la Martinique, Fort-de-France, Édition des horizons caraïbes, 1977.
LE BRIS, Michel, et Jean ROUAUD, Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007.
LE PELLETIER, Catherine, Littérature et société : la Guyane, Matoury, Ibis rouge éditions, 2014.
LEVESQUE, Katia, La Créolité. Entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française, Montréal, Éditions Nota bene, 2003.
MANGEON, Anthony (dir.), L’Empire de la littérature. Penser l’indiscipline francophone avec Laurent Dubreuil, Rennes, PUR, coll. « Plurial », 2016.
MANGEON, Anthony (dir.), Postures post-coloniales. Domaines africains et antillais, Paris, Karthala, 2012.
530
MOURA, Jean-Marc, « Postcolonialisme et comparatisme », Vox Poetica, 2006. URL : http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/moura.html. Consulté le 22 septembre 2014.
MOURA, Jean-Marc, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, PUF [1999], 2013.
MOURALIS, Bernard, L’Illusion de l’altérité. Études de littérature africaine, Paris, Champion, 2007.
MOURALIS, Bernard, Les Contre-littératures, Paris, Hermann, [1975], 2011.
PARAVY, Florence, « De l’archive au roman, ou les enjeux d’une réécriture : Le Roi de Kahel de Tierno Monénembo », Amnis, 2014, n° 13. URL : http://amnis.revues.org/2231. Consulté le 16 août 2017.
PROUTEAU, Anne, « La Dernière nuit de l’Émir d’Abdelkader Djemaï : "Seules les traces donnent à rêver" : quand le romancier réécrit l’Histoire ! », en ligne sur Limag. URL : http://www.limag.com/Textes/2015AlgerHommageNagetChristiane/Prouteau.pdf. Consulté le 30 mars 2016.
SAPIRO, Gisèle, George STEINMETZ et Claire DUCOURNAU, « La production des représentations coloniales et postcoloniales », Actes de la recherche en sciences sociales, 2010/5, n° 185, p. 4-11.
SOULA, Virginie, Des ancrages littéraires et identitaires au « destin commun » : une histoire littéraire de la Nouvelle-Calédonie (1853 – 2005), thèse de doctorat en littérature française et francophone, sous la direction de M. le professeur Xavier Garnier, soutenue à l’Université Paris XIII, 2008.
SOULA, Virginie, Histoire littéraire de la Nouvelle-Calédonie, Paris, Karthala, 2014.
VIGIER, Stéphanie, La Fiction face au passé : Histoire, mémoire et espace-temps dans la fiction littéraire océanienne contemporaine, thèse de doctorat en littérature française sous la direction du professeur Paul De Deckker et du professeur Raylene Ramsay, University of Auckland et Université de la Nouvelle-Calédonie, soutenue en 2008.
Histoire et sociologie
Généralités
ANDERSON, Benedict, L’Imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, La Découverte et Syros, [1983], 2002.
BADIE, Bertrand, La Fin des territoires, Paris, CNRS Éditions, coll. « Biblis », [1995], 2013.
DE CERTEAU, Michel, L’Écriture de l’histoire, Gallimard, 1975.
531
DEGLISE, Sabine (dir.), Le Dictionnaire biographique de La Réunion, Saint-Denis, Editions CLIP, 1993.
FOUCAULT, Michel, « Les utopies réelles ou lieux et autres lieux », Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 2015.
GINZBURG, Carlo, Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire, trad. Monique Aymard, Paris, Flammarion, 1989.
HARTOG, François, Régimes d’historicité : présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003.
JABLONKA, Ivan, L’Histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Seuil, 2014.
MARNOT, Bruno, La Mondialisation au XIXe siècle (1850 – 1914), Paris, Armand Colin, 2012.
PASSERON, Jean-Claude et Jacques REVEL (dir.), Penser par cas, Paris, EHESS, 2005.
REVEL Jacques, « L’émergence de la micro-histoire », Sciences humaines. Hors-série, septembre octobre 1997, p. 22-27.
REVEL, Jacques, Jeux d’échelles : la micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard, 1996.
THIESSE, Anne-Marie, « Nations, internationalismes et mondialisation », Romantisme, 2014/1, n°1 63, p. 15-27.
Colonisation et exotisme
AFFERGAN, Francis, Exotisme et altérité, Paris, Presses Universitaires de France, 1987.
AGERON, Charles-Robert, France coloniale ou parti colonial ?, Paris, PUF, 1978.
AMSELLE, Jean-Loup, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Payot, 1990.
ANGLEVIEL, Frédéric, Histoire de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle approche, nouveaux objets, Paris, L'Harmattan, 2006.
BALANDIER, Georges, « La situation coloniale. Approche théorique », Cahiers internationaux de Sociologie, XI, 1951, p. 44-79.
BERTHO, Catherine, « Télégraphes et téléphones », Culture technique, mars 1982, n° 7, p. 243-249.
BERTRAND, Romain, « Les sciences sociales et le ” moment colonial ” : de la problématique de la domination coloniale à celle de l’hégémonie impériale », Questions de recherche / Research in Question, n° 18, juin 2006. URL : https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01065637/document. Consulté le 7 décembre 2015.
532
BERTRAND, Romain, Hélène BLAIS et Emmanuelle SIBEUD (dir.), Cultures d’empires. Échanges et affrontements culturels en situation coloniale, Paris, Karthala, 2015.
BINOCHE-GUEDRA, Jacques-W., « La Représentation parlementaire coloniale (1871-1940) », Revue historique, t. 280, fascicule 2, octobre-décembre 1988, p. 521-535. URL : http://www.jstor.org/stable/40954790. Consulté le 28 mars 2017.
BLANCHARD, Pascal et Sandrine LEMAIRE, Culture coloniale. La France conquise par son empire, 1871 – 1931, Paris, Les Editions autrement, 2003.
BLANCHARD, Pascal, Stéphane BLANCHOIN, Nicolas BANCEL, Gilles BOËTSCH et Hubert GERBEAU (dir.), L’Autre et nous : scènes et types, Paris, Achac et Syros, 1995.
BLÉVIS, Laure, « La Citoyenneté française au miroir de la colonisation », Genèses, 2003, n° 4, p. 25-47.
BLÉVIS, Laure, « Les Avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes d'une catégorisation », Droit et société, 2001, n° 2, p. 557-581.
BOUCHARD Gérard, « Le Québec comme collectivité neuve. Le refus de l’américanité dans le discours de la survivance », Gérard Bouchard et Yvan Lamonde (dir.), Québécois et Américains : la culture québécoise aux XIXe et XXe siècles, Montréal, Fides, 1995, p.3-47.
BOUCHARD Gérard, Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde : essai d’histoire comparée, Montréal, Boréal, 2000.
BOUCHÈNE, Abderrahmane, Jean-Pierre PEYROULOU, Ouanassa SIARI TENGOUR et Sylvie THÉNAULT (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale, La Découverte, 2014.
BRONWEN, Douglas, « L'histoire face à l'anthropologie : le passé colonial indigène revisité », Genèses, 1996, p. 127. URL : http://www.persee.fr/doc/genes_1155-3219_1996_num_23_1_1390. Consulté le 24 mars 2017.
BURBANK, Jane et Frederick COOPER, Empires in global history. Power and the politics of difference, Princeton, Princeton University Press, 2010.
CLANCY-SMITH, Julia, « Le Regard colonial : Islam, genre et identités dans la fabrication de l’Algérie française (1830 – 1962) », Nouvelles questions féministes, vo.25, n° 1, 2006, p. 25-40.
CLANCY-SMITH, Julia, Rebel and Saint. Muslim Notables, Populist Protest, Colonial Encounters (Algeria and Tunisia, 1800 – 1904), Université of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1994.
COTTIAS, Myriam, La Question noire : histoire d'une construction coloniale, Paris, Fayard, 2006.
533
DARTIGUES, Laurent, L'Orientalisme français en pays d'Annam, 1862 – 1939, Paris, Les Indes savantes, 2005.
DECÉTY, Lorraine, « Le ministère des colonies », Livraisons d'histoire de l'architecture, 2004, 2e semestre, n° 8, p. 23-39. URL : www.persee.fr/doc/lha_1627-4970_2004_num_8_1_978. Consulté le 22 janvier 2017.
DESMARS, Bernard, « Beynet, Léon », Dictionnaire biographique du fouriérisme, notice mise en ligne en janvier 2009 : http://www.charlesfourier.fr/spip.php?article602. Consultée le 9 août 2017.
DULUCQ, Sophie et Colette ZYTNICKI (dir.), Décoloniser l’histoire ? De l’« l’histoire coloniale » aux histoires nationales en Amérique latine et en Afrique, (XIXe – XXe siècles), Paris, Publication de la Société Française d’Histoire d’Outre-Mer, 2003.
DULUCQ, Sophie, Écrire l’histoire de l’Afrique à l’époque coloniale (XIXe – XXe), Paris, Karthala, 2009.
ÈVE, Prosper, Les Esclaves de Bourbon : la mer et la montagne, Paris, Karthala, 2003.
FAGEOL, Pierre-Éric, « Le sentiment d’appartenance et de représentation nationale à la Réunion (1880-1950) », thèse de doctorat en histoire sous la direction de M. le Professeur Yvan Combeau, soutenue à l’Université de la Réunion, 2013.
FRÉMEAUX, Jacques, « Abd el-Kader, chef de guerre (1832-1847) », Revue historique des armées, n° 250, 2008, p. 100-107.
GIRARDET, Raoul, L’Idée coloniale en France de 1871 à 1962, Paris, Hachette, 1990.
GLEIZAL, Toriki, La Colonisation française des EFO : délimitation, représentations et spécificités de 1842 à 1914, thèse de doctorat en histoire sous la direction M. le Professeur Bruno Saura et M. le Professeur Alain Forest, soutenue à l’Université de Polynésie française, 2010.
JALLA, Betrand, « Les colons d’Algérie à la lumière du coup d’État de 1851 », Afrique & histoire, 2003, vol. 1, p. 131-132.
JURGENS, Olga, « Brûlé, Étienne », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003. URL : http://www.biographi.ca/fr/bio/brule_etienne_1F.html. Consulté le 9 mars 2017.
LEVALLOIS, Michel, Ismaÿl Urbain. Une autre conquête de l’Algérie, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001.
LORCIN, Patricia, Kabyles, Arabes, Français, identités coloniales, Limoges, Pulim, 2005.
MANCERON, Gilles, Marianne et les colonies. Une introduction à l’histoire coloniale de la France, Paris, La Découverte, 2005.
534
MELTZ, Renaud, « "Ici, l'on danse" : Tahiti et l'opinion publique sous la Monarchie de Juillet », Hermès, La Revue, 2013, n° 65, p. 41-49.
MERLE, Isabelle, « ʺLa situation colonialeʺ chez Georges Balandier. Relecture historienne », Monde(s), 2013/2, n° 4, p. 211-232.
MERLE, Isabelle, Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie (1853-1920), Paris, Belin, 1995.
MESSAOUDI, Alain, « Des médiateurs effacés ? Les professeurs d’arabe des collèges et lycées d’Algérie (1840-1940) », Outre-mers, 2011, tome 98, n° 370-371, p. 149-159. URL : http://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2011_num_98_370_4542. Consulté le 30 octobre 2015.
MESSAOUDI, Alain, « Renseigner, enseigner. Les interprètes militaires et la constitution d’un premier corpus savant "algérien" (1830-1870) », Revue d’histoire du XIXe siècle, [En ligne], 2010, n° 41. URL : http://rh19.revues.org/index4049.html. Consulté le 23 juin 2015.
METCALF, Bill, « Utopian Fraud : The Marquis de Rays and La Nouvelle-France », Utopian studies, vol. 22, n° 1, 2011, p. 104-124.
MOUREAU ; François, Captifs en Méditerranée (XVIe – XVIIIe siècles). Histoires, récits et légendes, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2008.
O’REILLY, Patrick, Tahiti au temps de la reine Pomaré, Paris, Publications de la Société des Océanistes, Éditions du Pacifique, 1975. Disponible sur http://books.openedition.org.
PANOFF, Michel, « Farani Taioro. La première génération de colons français à Tahiti », Journal de la Société des océanistes, tome 37, n° 70-71, 1981, p. 3-26.
POUILLON, François (dir.), Dictionnaire des orientalistes, Paris, Karthala, 2012.
RENUCCI, Florence, « Le meilleur d'entre nous ? Ernest Zeys ou le parcours d'un juge de paix en Algérie », Cahiers d’Histoire de la Justice, La petite justice Outre-mer, tome VI : Justicia illitterata : aequitate uti ? La conquête de la toison, CHJ éditeur, 2010, p. 67-85. URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00557527. Consulté le 11 avril 2017.
SAAÏDIA, Oissila et Laurick ZERBINI (dir.), La Construction du discours colonial. L’empire français aux XIXe et XXe siècles, Paris, Karthala, 2009.
SAID, Edward, Culture et impérialisme, trad. Paul Chemla, Paris, Fayard, [1993], 2000.
SAID, Edward, L'Orientalisme : L'Orient créé par l'Occident, trad. Catherine Malamoud, Paris, Seuil, [1978], 1980.
SAVARESE, Éric, « L'histoire officielle comme discours de légitimation. Le cas de l'histoire coloniale », Politix, vol. 11, n° 43, 1998, p. 93-112.
SCHAUB, Jean-Frédéric, « La catégorie "études coloniales" est-elle indispensable ? », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2008/3, p. 625-646.
535
SINGARAVÉLOU, Pierre (dir.), Les Empires coloniaux. XIXe – XXe siècle, Paris, Points, 2013.
SINGARAVÉLOU, Pierre, « Des historiens sans histoire ? La construction de l'historiographie coloniale en France sous la Troisième République », Actes de la recherche en sciences sociales, 2010/5, n° 185, p. 30-43.
SOUFI, Fouad, « Histoire et mémoire : l’historiographie coloniale », Insaniyat / تایناسنإ , n° 3, 1998. URL : http://insaniyat.revues.org/11601. Consulté le 16 avril 2015.
STORA, Benjamin, « L’Émir Abd El-Kader. Guerrier Lucide, Savant Mélancolique. Conférence Musée Du Quay Branly Avril 2011 ». URL : http://www.univ-paris13.fr/benjaminstora/articlesrecents/251-lemir-abd-el-kader-guerrier-lucide-savant-melancolique. Consulté le 14 septembre 2015.
TARTAKOWSKY, Ewa, « Le touriste, un ʺcolon en puissanceʺ ? », La Vie des idées, 25 mai 2017. URL : http://www.laviedesidees.fr/Le-touriste-un-colon-en-puissance.html. Consulté le 25 mai 2017.
THOMPSON, Anne-Gabrielle, « Une escroquerie à la colonisation : l’entreprise du marquis de Rays à ʺPort-Bretonʺ », Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 238, 1er trimestre 1978, p. 21-39.
VALLIÈRES, Pierre, Nègres blancs d’Amérique, Montréal, Parti Pris, 1968.
VAN DEN ABEELE, George, « Qu’est-ce qu’un ʺtruchement” ? Entre étranger et compatriote à l’époque des découvertes », dans Ana Clara Santos and José Domingues de Almeida (dir.), L'Étranger tel qu'il (s')écrit, Biblioteca Digital, Faculdade de Letras, Universidade do Porto, 2014, p. 189-196.
VIDAL, Cécile (dir.), Français ? La nation en débat entre colonies et métropole, XVIe-XIXe siècle, Paris, éditions de l’EHESS, 2014.
ZYTNICKI, Colette, L’Algérie, terre de tourisme, Paris, Vendémiaire, 2016.
Sites consultés
1. La presse coloniale sur Gallica
http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/presse-coloniale.
2. Le dictionnaire des journaux au XVIIIe siècle
http://dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/.
3. La plateforme Médias19
http://www.medias19.org.
4. La presse francophone égyptienne
536
http://www.cealex.org/pfe/presentation/liste_200ansPFE.php.
5. La presse belge
http://belgica.kbr.be/fr/coll/jour/jour_fr.html.
6. Le projet « L’imprimé “populaire” et les modes de lecture en Afrique francophone »
https://africanreadingcultures.blogs.ilrt.org/fr/a-propos-de/
7. La base de données sur la petite presse :
http://petitepresse.medias19.org/.
8. La thèse de Georges Coquilhat sur la presse de Nouvelle-Calédonie :
http://gnc.jimdo.com/
9. Le projet ARTFL
https://artfl-project.uchicago.edu/
10. Les sites généalogiques
- Bulletin Généalogie et histoire des Caraïbes : http://www.ghcaraibe.org/
- Dictionnaire biographique du Canada : http://www.biographi.ca/fr.
11. L’abolition de l’esclavage : documents juridiques
http://lesabolitions.culture.fr/medias/liberte/8campagnes/documents/cite-proces-senecal.pdf.
12. Le site de l’Université de Bourgogne sur le coup d’état de 1851
http://tristan.u-bourgogne.fr/1851.html.
Corpus littéraire complémentaire
XIXe siècle
ALBY, Ernest, Histoire des prisonniers français en Afrique depuis la conquête, Paris, M. Lévy frères, 1849.
AUMÉRAT, Joseph-François, Souvenirs algériens, Blidah, Mauguin, 1898.
AZÉMA, Georges, Noëlla, Paris, Hachette, 1864.
BEYNET, Léon, Les Colons algériens, Alger, Molot, 1863.
537
BEYNET, Léon, Les Drames du désert. Scènes de la vie arabe, Paris, Dentu, 1862.
BOILAT, Abbé, Esquisses sénégalaises. Physionomie du pays – peuples – commerce – religions – passé et avenir – récits et légendes, Paris, Bertrand, 1853.
DAUDET, Alphonse, Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, Paris, Dentu, 1872.
DAYOT, Eugène, Œuvres choisies. Avec une Notice biographique et littéraire par J.-M. Raffray et une préface par François Saint-Amand, Paris, Challamel aîné, 1878.
DELTEIL, Arthur, Voyage chez les indiens Galibis de la Guyane, Nantes, L. Mellinet, 1886.
DESPREZ, Charles, Alger naguère et maintenant, Alger, Imprimerie du Courrier de l’Algérie, 1868.
DOVALLE, Charles, Poésies, Paris, Charpentier, 1868.
DUMAS, Alexandre, Georges, Paris, Michel Lévy, 1848.
DUMAS, Alexandre, Le Véloce, Paris, Vve Dondey-Dupré, 1855.
FENECH, E.V., Récits et chasses d’Algérie, Philippeville, Denis aîné, 1867.
GARNIER, Jules, Voyage autour du monde : Océanie, Paris, Plon, 1871.
GAUTIER, Théophile, Loin de Paris, Paris, Lévy, 1865.
HÉRY, Louis, Esquisses africaines. Fables créoles et explorations dans l’intérieur de l’île Bourbon, Paris, Rigal, [1849], 1883.
HUET, Vincent, Au Pays arabe. Le Disparu, Paris, Guyot, 1899.
HUET, Vincent, Au Pays arabe. Les Cavernes de Hall-el-Oued, Paris, Guyot, 1899.
HUGO, Victor, Bug-Jargal, Paris, Urbain Canel, 1826.
LA ROCHÈRE, Comtesse de, La Fille du colon, Tours, Mame et fils, 1878.
LE GOUPILS, Marc, Les Filles du Pionnier, Paris, Hachette, 1910.
LE ROUX, Hugues, Je deviens colon. Mœurs algériennes, Paris, C. Lévy, 1895.
Le Tombeau de la Chrétienne, Paris, Dentu, 1845
LÉGIÉ-PROVANÇAL, Nicolas, La Déjézaïriade, Vichy, C. Bougarel, 1874.
LOTI, Pierre, Aziyadé, Paris, Gallimard, [1879], 1991.
Luc-Van-Tiên, poème populaire annamite. Traduit par G. Aubaret, consul de France à Bangkok, Paris, Imprimerie impériale, 1864.
538
MARBOT, François, Les Bambous. Fables de La Fontaine travesties en patois créole par un vieux commandeur, Port-Royal-Martinique, E. Ruelle et Ch. Arnaud, imprimeurs du gouvernement, 1846.
MÉRIMÉE, Prosper, Mosaïque, Paris, H. Fournier jeune, 1833.
MICHEL, Louise, Légendes et chants de geste canaques, Paris, Kéva et Cie, 1885.
MISTRAL, Frédéric, Mirèio, pouèmo prouvençau, Avignon, Roumanille, 1859.
MOREAU, Hégésippe, Le Myosotis, Paris, Desessart, 1838.
PARNY, Évariste de, Œuvres de Parny, précédées d’une notice sur sa vie, Paris, Roux-Dufort, 1826.
PAVIE, Théodore, Scènes et récits des pays d’outre-mer, Paris, Michel Lévy, 1853.
PHARAON, Florian, Récits algériens, Paris, A. Panis, 1871.
RIVIÈRE, Henri, Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. L’Insurrection canaque, Paris, Calmann-Lévy, 1881.
ROCHEFORT, Henri, L’Évadé, roman canaque, Paris, Charpentier, 1880.
ROSEMOND DE BEAUVALLON, Hier ! aujourd’hui ! demain ! ou les agonies créoles, roman de mœurs coloniales, Coulommiers, imprimerie P. Brodard et Gallois, 1885.
ROSEVAL, « Le Créole des Antilles », Les Français peints par eux-mêmes, Paris, Curmer, 1840-1842, p. 283-295.
SAINT-AMAND, François, La Navigation aérienne, Saint-Pierre (Réunion), Durand, 1878.
SAINT-AMAND, François, Madagascar : poème, Saint-Denis (Réunion), A. Biarrote, 1857.
SAINT-QUENTIN, Alfred et Auguste de, Introduction à l'histoire de Cayenne ; suivie d'un Recueil de contes, fables et chansons en créole. Étude sur la grammaire créole, Antibes, J. Marchand, 1872.
SALLES, Eusèbe de, Ali le Renard ou la conquête d’Alger, Paris, Gosselin, 1832.
SALLES, Eusèbe de, Les bas à jour. Nouvelle algérienne, Paris, Pagnerre, 1869.
SUAU, Édouard, Scènes de France et d’Afrique, Paris, Ollivier, 1834.
SUE, Eugène, Le Morne au Diable, Paris, Gosselin, 1842.
SUE, Eugène, Les Mystères de Paris, Paris, Gosselin, 1840-1842.
THIERCELIN, Dr., Chez les anthropophages. Aventures d’une Parisienne à la Nouvelle-Calédonie, Paris, Lachaud, 1872.
539
VILLACROSE, A., Vingt ans en Algérie, ou Tribulations d’un colon racontées par lui-même, Paris, Challamel aîné, 1875.
XXe et XXIe siècles
ADIMI, Kaouther, Nos Richesses, Paris, Seuil, 2017.
AJALBERT, Jean, Raffin Su-su, mœurs coloniales, Paris, Publications littéraires et politiques, 1911.
BARET, Roger, Le Tombeau de la chrétienne, Montpellier, Mémoire de notre temps, 2005.
BOX, Jean, Totia. Roman colonial, Bruxelles, Lacomblez, 1909.
CÉSAIRE, Aimé, Cahier d’un retour au pays natal, Paris – Dakar, Présence africaine, [1939] 1994.
CHAMOISEAU, Patrick, Texaco, Paris, Gallimard, 1992.
CLARY, Hubert, Le Roman d’une coloniale, Paris, Grasset, 1911.
CONDÉ, Maryse, Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003.
CONDÉ, Maryse, La Belle Créole, Paris, Mercure de France, 2001.
DAENINCKX, Didier, Cannibales, Paris, Verdier, 1998.
DAENINCKX, Didier, Le Retour d’Ataï, Paris, Gallimard, 2006.
DAOUD, Kamel, Meursault, contre-enquête, [Alger, Barzakh, 2013], Arles, Actes Sud, 2014.
DIALLO, Bakary, Force-Bonté, Paris, Rieder, 1926.
DJEBAR, Assia, Femmes dans un appartement d’Alger, Paris, Albin Michel, 2002.
DJEMAÏ, Abdelkader, La Dernière nuit de l’Émir, Paris, Seuil, 2012.
EBERHARDT, Isabelle, Yasmina, 1902. Texte en ligne saisi par S. Pestel pour la collection électronique de la Bibliothèque Municipale de Lisieux (30.01.1997). URL : http://www.bmlisieux.com/litterature/eberhardt/yasmin01.htm. Consulté le 11 juin 2017.
FARRÈRE, Claude, Mes voyages. La promenade d’Extrême-Orient, [Flammarion, 1923], Paris, Kailash, 1992.
GLISSANT, Édouard, Introduction à une poétique du divers, Paris, Gallimard, 1996.
GLISSANT, Édouard, La Case du Commandeur, [Paris, Seuil, 1981], Paris, Gallimard, 1997.
540
GORODÉ, Déwé, Tâdo, Tâdo, wéé ! ou « No more baby », Tahiti, Au vent des îles, 2012.
HAMPÂTÉ BÂ, Amadou, L’Étrange destin de Wangrin, Paris, 10/18, 1992.
HAURIGOT, Georges, Contes nègres, sur la base Manioc, date de publication non déterminée.
ISTIVIE, Emmanuel, Vers la liberté ! suivi de Episode de l’insurrection canaque, Paris, Librairie d’éducation nationale, 1905.
KOUROUMA, Ahmadou, Les Soleils des indépendances, Paris, Seuil, 1970.
LE CLÉZIO, J.M.G., Le Chercheur d’or, Paris, Gallimard, 1985.
LOESCH, Anne, Le Tombeau de la chrétienne, Paris, Plon, 1965.
MARAN, René, Batouala. Véritable roman nègre, Paris, Albin Michel, 1921.
MARIOTTI, Jean, Les Contes de Poindi, Paris, Stock, 1941.
MILLE, Pierre, Barnavaux aux colonies, éd. Jennifer Yee, Paris, L’Harmattan, 2002.
RACINE, Bruno, Le Tombeau de la chrétienne, Paris, Grasset, 2002.
ROYER, Louis-Charles, Vaudou. Roman de mœurs martiniquaises, Paris, Les Éditions de France, 1944.
RUSCIO, Alain, Amours coloniales, Paris, Editions Complexe, 1996.
SERVENT, Gaston, Le Tombeau de la chrétienne, Paris, Ergé, 1946.
541
Index des principaux journaux cités
L’Akhbar 12, 30, 32, 47, 51, 65, 79, 90, 91, 108, 109, 111, 118, 119, 121, 122, 141, 163, 164, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 195, 203, 224, 230, 265, 268, 286, 287, 309, 313, 319, 343, 356, 371, 372, 387, 392, 429, 448, 470
L’Atlas ........................................................................................................................... 35, 66 L’Avenir 37, 38, 47, 52, 55, 57, 58, 67, 68, 82, 85, 101, 107, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 139,
150, 172, 175, 215, 233, 234, 282, 304, 305, 312, 341, 342, 353, 407, 419, 421, 422, 451, 463, 464
Les Antilles 35, 44, 45, 47, 54, 81, 94, 110, 116, 150, 152, 155, 156, 172, 173, 217, 224, 225, 235, 269, 321, 388, 389, 456, 464, 465
Le Bien-Public 36, 40, 100, 141, 155, 170, 187, 223, 247, 248, 301, 376, 384, 423, 450, 451, 452, 511
Le Brûlot de la Méditerranée ....................... 39, 40, 65, 114, 121, 122, 251, 266, 269, 345, 354 La Caricature .......................................................................................................... 38, 41, 150 Le Chitann...... 29, 30, 32, 35, 38, 60, 61, 88, 119, 180, 190, 228, 267, 301, 302, 338, 391, 439 Le Colon ....................................................................................................... 35, 133, 167, 466 Le Colon de la Nouvelle-Calédonie ...................................................................................... 35 Le Colonial....................................................................... 35, 44, 169, 170, 175, 177, 204, 244 Le Commerce ............................................................................................................... 77, 167 Le Commercial 37, 40, 51, 52, 85, 101, 116, 124, 130, 171, 186, 191, 269, 283, 349, 350, 385 Le Conservateur de l’île Bourbon ......................................................................................... 38 Le Courrier d’Oran .................................................................................. 43, 87, 153, 203, 421 Le Courrier de Bône ..................................................................................................... 39, 140 Le Courrier de la Martinique ..................................................53, 157, 206, 215, 269, 271, 341 Le Courrier de la Réunion .............................................................................................. 36, 39 Le Courrier de Mostaganem ................................................................................................. 40 Le Courrier de Saïgon 13, 25, 34, 42, 43, 44, 47, 66, 70, 73, 74, 93, 106, 137, 187, 200, 201,
205, 210, 272, 280, 294, 298, 301, 312, 316, 317, 336, 352, 357, 358, 361, 373, 388, 469, 470, 502
Le Courrier de Saint-Paul ................................................... 36, 37, 75, 138, 305, 386, 466, 467 Le Courrier de Saint-Pierre36, 163, 173, 205, 207, 210, 218, 219, 237, 259, 306, 354, 376, 474 Le Courrier de Tlemcen ................................................................................................ 40, 203 Le Courrier du Havre...................................................................................................... 47, 56 Le Créole........................................................................ 80, 100, 158, 320, 368, 369, 452, 549 Le Créole de l’île Bourbon ..................................................................................... 35, 80, 368 Le Créole républicain ..................................................................................................... 35, 36 L’Écho d’Oran 39, 47, 51, 113, 114, 176, 201, 202, 268, 279, 285, 287, 288, 296, 308, 309,
313, 324, 339, 418, 447, 449, 515, 516, 533 L’Écho de l’Atlas ................................................................................ 110, 136, 137, 224, 255 L’Écho de la Guadeloupe ............................................................................................. 39, 169 L’Éclaireur de Cayenne ................................................................................. 36, 157, 353, 434 L’Enfant terrible ..................................................................................................... 38, 41, 380 L’Estafette d’Alger ......................................................................................................... 12, 26
542
La Feuille de la Guyane française47, 56, 156, 168, 173, 198, 199, 206, 207, 213, 216, 258, 261, 262, 272, 284, 297, 303, 304, 327, 328, 343, 347, 349, 355, 394, 395, 396, 397, 427, 446, 450
La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon .....115, 132, 161, 169, 177, 196, 245, 377, 414, 452 La France algérienne 41, 42, 79, 89, 128, 131, 133, 189, 253, 254, 256, 264, 266, 296, 299, 309,
313, 314, 319, 320, 322, 324, 334, 335, 345, 370, 371, 375, 386, 387, 393, 407, 408, 429, 430, 431, 445, 464, 465, 471, 493
La France d’Outre-mer ....... 35, 87, 133, 134, 159, 160, 164, 165, 173, 249, 250, 300, 407, 450 Gia Dinh Bao ....................................................................................................................... 88 La Goguette .....................................................................................................38, 60, 164, 252 L’Indépendant de Constantine 36, 53, 68, 76, 77, 114, 115, 134, 139, 175, 177, 185, 186, 274,
279, 281, 286, 287, 299, 311, 326, 339, 375, 380, 386, 420, 421 L’Indicateur colonial ............................................................................................ 57, 115, 151 La Mahouna ......................................................................................................................... 35 La Malle ............... 37, 47, 50, 53, 62, 66, 77, 120, 138, 171, 173, 242, 307, 333, 339, 340, 437 Le Messager de la Martinique .................................................................. 46, 66, 154, 160, 161 Le Messager de Tahiti 28, 29, 31, 34, 37, 47, 53, 66, 80, 87, 88, 104, 118, 131, 148, 151, 161,
162, 172, 188, 195, 196, 201, 205, 210, 212, 216, 220, 221, 236, 238, 241, 251, 263, 280, 290, 291, 292, 293, 338, 339, 344, 368, 372, 381, 408, 409, 425
Le Mobacher ......................... 30, 32, 83, 84, 119, 174, 205, 265, 281, 287, 326, 347, 352, 360 Le Moniteur algérien 12, 32, 33, 47, 59, 63, 80, 96, 97, 98, 107, 108, 118, 136, 160, 179, 181,
182, 184, 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 230, 231, 232, 233, 237, 253, 255, 256, 257, 261, 265, 271, 288, 289, 295, 296, 297, 309, 323, 346, 357, 360, 369, 374, 376, 382, 387, 392, 410, 418, 497, 532
Le Moniteur de l’Algérie 32, 33, 51, 60, 61, 62, 111, 115, 153, 164, 165, 167, 177, 183, 197, 198, 226, 231, 238, 252, 255, 256, 257, 266, 267, 268, 285, 287, 297, 313, 315, 319, 326, 335, 336, 356, 377, 425, 449, 468, 469, 471, 472, 473, 494, 495
Le Moniteur de l’île de la Réunion .............................................................. 150, 282, 344, 485 Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie 27, 34, 47, 56, 59, 60, 66, 71, 72, 73, 102, 103, 104, 105,
126, 127, 135, 158, 161, 167, 169, 174, 197, 198, 201, 205, 206, 225, 234, 241, 259, 264, 269, 270, 273, 328, 329, 331, 332, 337, 339, 356, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 373, 426, 445, 497, 514
Le Moniteur du Sénégal et dépendances ............................................................................... 14 Le Moqueur ................................................................................................................ 119, 375 La Numidie .................................................................................................................... 35, 39 L’Océanie française ........................................................................... 13, 34, 51, 264, 293, 374 Le Petit colon algérien .......................................................................................................... 35 La Pipe en bois ..................................................................................................................... 38 Le Propagateur 36, 47, 54, 87, 94, 129, 130, 149, 152, 155, 244, 245, 283, 285, 321, 375, 386,
389, 420, 424, 445, 496 Le Saf-Saf ..................................................................................................... 35, 309, 310, 356 La Semaine illustrée de la Réunion ................54, 62, 63, 81, 116, 120, 121, 127, 154, 175, 176 La Seybouse ................................................ 35, 47, 54, 111, 137, 158, 235, 310, 311, 378, 411 Le Siroco ............................................................................................................ 130, 394, 421 Le Sport colonial .............................................. 57, 59, 146, 248, 249, 321, 346, 347, 446, 447 Te Vea no Tahiti ............................................................................................... 31, 37, 38, 290 La Tribune algérienne ................................................................................................... 82, 456 La Vie algérienne ....................................................................................................... 130, 217 56 Le Zéramna .................................................................................................................... 35, 82
543
Annexes
1 Annexe 1 : bibliographie des principaux articles cités
Sont répertoriés ici les articles qui sont apparus au cours de l’étude, mais également des textes qui n’ont pas été utilisés mais dont la lecture a contribué à former les axes de lecture et d’études.
Les signatures ont été simplifiées : apparaissent seulement le nom et le prénom de l’auteur, ou les initiales si elles n’ont pas été élucidées. Quand les dates de publication ne peuvent être précisées à cause des lacunes de collections, nous donnons une période de publication (exemple : été 1848) à défaut de pouvoir délimiter les numéros précis de parution.
Algérie « 5e couplet. – Les Algériennes », dans les « Causeries d’un solitaire », Le Moniteur
algérien, 14 janvier 1869. « À travers l’Algérie », Le Courrier de Sétif, 17 avril 1881. « Arabe et panthère », Le Courrier de l’Algérie, 9 janvier 1870. « Arabes cultivateurs et Arabes pasteurs », La France algérienne, 26 juillet 1845. « Au tombeau », Le Chitann, 3 juin 1866. « Bou-Magha », Le Moniteur algérien, 10 janvier 1855. « Chronique algérienne. Sur une inscription arabe trouvée à Constantine », Le Moniteur
algérien, 30 novembre 1855. « Chronique judiciaire de la Cour d’Appel d’Alger », L’Akhbar, 23 juillet 1848. « Cinq mois de captivité dans l’intérieur de la province d’Oran », Le Moniteur algérien,
13 janvier 1837 et 20 janvier 1837. « Courrier de Blidah », L’Echo de l’Atlas, 24 avril 1846. « Courses de Mostaganem », L’Akhbar, 9 novembre 1848. « Dans notre dernier numéro, on a inséré par erreur deux articles qui se rapportent à une
même personne », L’Akhbar, 7 janvier 1849. « De la censure algérienne », L’Akhbar, 27 août 1848. « Eh ! Où allez-vous donc, mon cher, demandai-je, il y a quelques années », Le
Moniteur algérien, 5 février 1844. « Esquisses de mœurs arabes », L’Akhbar, 25 mai 1848. « Étude de la plaine de la Mitidja, premier article », L’Echo de l’Atlas, 28 avril 1846. « Excursion d’un médecin militaire dans le Kabylie de Collo, pendant le dernier
choléra », Le Moniteur algérien, 25 janvier 1855. « Excursion d’un touriste dans la province d’Oran », Le Moniteur algérien, 25
novembre 1843. « Exécution de Dahman ben Ouadour, à Bône », Le Moniteur algérien (pris dans La
Seybouse), 21 mars 1869. « Expédition de Bougie », L’Akhbar, 13 juillet 1848. « Expédition du général Cavaignac dans le Sahara algérien », L’Echo d’Oran,
épisodiquement du 19 juin 1847 au 2 octobre 1847 (numéros manquants). « Feuilleton de l’Oranais qu’il faut lire », L’Oranais, 1er juillet 1860.
544
« Hammam Melouan (le bain bigarré) », L’Akhbar, 8 août 1848. « Histoire d’Alger et de la piraterie des Turcs », La France algérienne, 14 mai 1846. « Histoire de la littérature arabe au Soudan », Le Moniteur algérien, 29 février 1856. « Il est rare qu’en fait de patriotisme, la pratique et la théorie marchent de conserve »,
L’Akhbar, 11 juin 1848. « Inauguration de l’église de Bouffarick », L’Akhbar, 2 janvier 1849. « La démolition du fort des 24 Heures, qui s’effectue en ce moment », L’Akhbar, 13
mars 1849. « Le carnaval n’a pas été gai cette année à Oran », L’Echo d’Oran, 24 février 1849. « Le fondouk, simple histoire d’un centre africain », L’Akhbar, 5 septembre 1848. « Le Fort du chien », L’Echo d’Oran, 30 septembre et 6 octobre 1848. « Le Marabout de Sidi-Brahim, récit d’un caporal », La France algérienne, 12
novembre 1845. « Le Marabout de Sidi-Ferruch », L’Echo d’Oran, 12 août 1848 et 19 août 1848
(numéros manquants). « Le Martyr du fort des Vingt-Quatre Heures », Le Moniteur algérien, 30 décembre
1853. Inclut un récit publié par BERBRUGGER dans l’Akhbar du 5 octobre 1847. « Légendes algériennes – Quatre marabouts et une sorcière contre un empereur »,
L’Akhbar, 3 avril 1849. « Les Aiçaouas – Scène de mœurs algériennes », L’Akhbar, 20 mars 1842 et 31 mars
1842. « Les Aïssaouas à Paris », Le Moniteur algérien, 5 octobre 1867. « Les Babouches d’Abd-el-Kassem », L’Echo d’Oran, 13 janvier 1848. « Les Bains de mer. A M. le maire d’Alger », L’Akhbar, 13 août 1848. « Les Kroumirs », Le Courrier de Sétif, 17 avril 1881. « Les Nouvellistes algériens, comédie en deux actes et en prose. On nous a communiqué
une comédie », Le Moniteur algérien, 27 mai 1836. « Lettre d’un voyageur », L’Echo d’Oran, 22 novembre 1848. « Mœurs algériennes. Les cafés chantans », La France algérienne, 15 novembre 1845. « Monographie des clubs algériens », L’Akhbar, 10 août 1848. « Monologue du dernier des arabes », L’Est algérien, 4 décembre, 1868. « Nous avons déjà fait connaître comment M. Defrance, lieutenant de frégate à bord du
Loiret, était tombé entre les mains des Arabes », Le Moniteur algérien, 7 janvier 1837. « Nous connaissons de longue date l’auteur des poésies que l’on va lire : le Zéramna a,
en effet, inséré ses premiers essais », Le Zéramna, 30 août 1865. « Nous empruntons au Mobacher du 12 juin des renseignements intéressants, dus à la
plume d’un indigène, sur le Hodna, dans la subdivision de Batna », Le Moniteur algérien, 14 juin 1864.
« Nouvelles de la province : la montagne des lions », L’Echo d’Oran, 2 juin 1849. « On nous communique les vers suivants… », Le Moniteur algérien, 18 mars 1846. « On nous écrit de Guelma », L’Akhbar, 14 mars 1863. « Origine du nom de Khadoudja », L’Echo d’Oran, 25 décembre 1847. « Origine du nom des Kouloughlis », L’Echo d’Oran, 29 juillet 1848. « Oroua et Afra », Le Moniteur algérien (pris dans le Mobacher), 13 décembre 1864. « Parcours rapide d’Alger à l’Oued-Guétard ou Ravin des voleurs, et de celui-ci à
Milianah », Le Moniteur algérien, 11 janvier 1866, 12 janvier 1866, 13 janvier 1866. « Promenade dans la ville », L’Est algérien, 4 décembre 1868. « Prospectus », La France algérienne, 18 février 1845. « Récits de Kabilie », L’Akhbar, 1er juillet 1858. « Salah Bey et les Khemmas (légende arabe) », Le Moniteur algérien (pris dans le
Mobacher), 3 janvier 1867.
545
« Sidi-Ferruch, une légende et un procès-verbal », L’Akhbar, 24 juin 1849. « Société climatologique d’Alger », Le Mobacher, 21 mars 1875. « Supplément : poésie arabe », L’Echo d’Oran, 17 juin 1848. « Testament d’un Arabe en faveur d’un Français », Le Moniteur algérien, 10 mars 1863. « Tournée d’exploration dans les Ksours et dans le Sahara de la province d’Oran, par le
commandant de Colomb », Le Moniteur algérien, 5 juin 1858. « Un Chasseur changé en cerf, ou le nouvel Actéon », L’Akhbar, 10 février 1842 et 13
février 1842. « Un de nos abonnés, Si Chérif-ben-Cheik, nous communique une lettre de Tunis »,
L’Akhbar, 26 septembre 1863. « Un Miracle d’Aïssa. Légende arabe », L’Echo d’Oran, 22 juillet 1848. « Une Chasse à la panthère », Le Zéramna, 11 février 1872. « Une chasse au lion », Le Moniteur algérien, 27 avril 1867. « Une chasse aux lions », Le Moniteur algérien, 17 juin 1868. « Une Farce du dentiste Enault », La Tribune algérienne, 26 novembre 1879. « Une histoire contemporaine bien que tirée d’un vieux livre », L’Akhbar, 25 mai 1848. « Une Mauresque », La France algérienne, du 23 juillet au 11 août 1846. « Variétés sur la poésie », L’Echo d’Oran, 23 septembre 1848. « Violence sur un Français au Pérou », Le Mobacher, 24 février 1875. « Voyage chez les kabyles de l’Est, par un de nos cadis de la province de Titteri », Le
Moniteur algérien, 24 février 1844. A.C., « L’Homme qui ne rit plus (conte arabe) », Le Moniteur algérien, 15 juillet 1864. A.D., « Bou-Maza (l’homme à la chèvre) », La France algérienne, 10 septembre 1845. A.D., « Un nouveau Gérard. – Histoire d’hier », La France algérienne, 12 mai 1846. A.E., « Lettres juives algériennes », La France algérienne, 7 février 1846. A… Dr., « Le roman de mon concierge », Le Moniteur algérien, 18 avril 1863. ALBY Eugène, « La Captivité du trompette Escoffier », Le Saf-Saf, 14 juin 1851 et 28
juin 1851. ALBY Eugène, « Voyage à la cour du Maroc », Le Saf-Saf, de novembre 1850 jusqu’en
février 1851 (numéros manquants). ALI BEN ABBADI, des Ouled Mdhi, « Note sur le Hodna (subdivision de Batna) », Le
Moniteur de l’Algérie, 14 juin 1864. ARNAUD, interprète militaire, « Cours pratique de langue arabe à l’usage des lycées,
collèges et écoles de l’Algérie, par Belkassem Ben Sedira, professeur à l’école normale et à la medreça d’Alger », Le Mobacher, 5 janvier 1878.
ARNAUD, interprète militaire, « Voyages extraordinaires et nouvelles agréables par Mohammed Abou Ras ben Ahmed ben Abd El Kader En Nasri », Le Mobacher, 9 août 1879.
ARNAUD, interprète militaire, « Colporteur indigène », Le Mobacher, 17 février 1877. ARNAUD, interprète militaire, « Les sciences et l’islamisme », Le Mobacher, 23 juin
1877. ARNAUD, interprète militaire, « Quelques réflexions d’un âne algérien », Le
Mobacher, 19 et 25 mai 1877. ARNAUD, interprète militaire, « Une inscription en arabe », Le Mobacher, 13 mars
1879. BACHE Paul-Eugène, « Regnard à Alger », L’Indépendant de Constantine,
épisodiquement du 2 mai 1862 au 3 juin 1862. BEN MOHAMMED KHODJA Ismael, « Chronique indigène », L’Akhbar, 21 août, 16
septembre et 21 septembre 1851. BERBRUGGER, « De l’esclavage musulman en France », Le Moniteur algérien (pris
dans la Revue africaine), 25 novembre 1856.
546
BERBRUGGER, « Exploration du tombeau de la chrétienne », Le Moniteur algérien (pris dans la Revue africaine), 25 décembre 1856.
BERBRUGGER, « Henri Murger en Algérie », Le Moniteur algérien, 20 juin 1862. BERBRUGGER, « Tombeau de la chrétienne », Le Moniteur algérien (extrait d’un
rapport), 20 janvier 1856. BERTHERAND Dr. E., « A propos d’un conte arabe », Le Moniteur algérien, 3 juillet
1869. BERTRAND (abbé), « Une soirée dans l’Atlas. Légende musulmane », Le Moniteur
algérien, 4 mai 1867. BESANCENEZ A., « Mariage français et fête mauresque », La France algérienne, 31
janvier 1846. BODICHON, Eugène, « Explications de quelques points de la mythologie qui ont trait
à l’Afrique septentrionale », L’Akhbar, 13 décembre 1839. BODICHON, Eugène « Rapports et rapprochements entre la composition physique du
sol et les hommes de l’Afrique », L’Akhbar, 18 septembre 1840. BOU ACHRA, « Souvenir d’un vieil Algérien. Une chasse au lion à Philippeville en
1844 », Le Moniteur algérien, 25 septembre 1863. BOUNOURE V., « Le Prisonnier de guerre », La Seybouse, été 1848. BOURGOGNE Edmond, « Lettre d’un Parisien à un Parisien », La France algérienne,
5 novembre 1845, 29 novembre 1845, 2 décembre 1845, 10 décembre 1845. BRESNIER, J.-L., « Origine des cinq prières des musulmans », Le Courrier d’Oran, 6
mars 1861. C. T., « Triste ! », La Seybouse, 27 novembre 1869. C.D., « Une Chasse au lion », L’Echo d’Oran, 9 septembre 1848. CARDENIO, « A propos de la pluie et du beau temps », Le Zéramna (pris dans le Don
Quichotte), 15 mai 1863. CARDENIO, « Un échange », Le Zéramna (pris dans le Don Quichotte), 22 mai 1863. CELLERIN Th., « L’escadre à Bône. Fête à l’edough », Le Zéramna, 18 août 1863. CHANDELLIER, « Un coup d’épaule ! », L’Akhbar, 5 octobre, 1851. CHANDELLIER, « Les petites misères de la vie algérienne », L’Akhbar, 16 août 1851. CHANZE Ernest de, « Histoire d’un cheveu. Nouvelle algérienne inédite », Le Moniteur
algérien, du 9 juin 1863 au 13 juin 1863. Parution sous la signature X. dans le Zéramna, du 13 novembre 1871 épisodiquement jusqu’au 1er décembre 1871.
CHAUVEAU Louis, « Lettres algériennes », Le Moniteur algérien (pris dans le Moniteur universel), 18 novembre 1868.
CHERBONNEAU A., « Archéologie romaine », Le Moniteur algérien (pris dans L’Annuaire de la Société archéologique de la province de Constantine, année 1853), 20 janvier 1857.
CHERBONNEAU A., « Chroniques algériennes. Ahmed-Chaouche surnommé le Kabyle, bey de Constantine. Année 1807 », Le Moniteur algérien, 30 septembre 1855.
CHERBONNEAU A., « Chroniques algériennes. Expédition de Mourad-Bey, pacha de Tunis, contre Constantine et Alger. 1700 », Le Moniteur algérien, 10 novembre 1855.
CHERBONNEAU A., « Chroniques algériennes. Mohammed-ben-bou-Diaf, muphti de Constantine », Le Moniteur algérien, 15 octobre 1855.
CHERBONNEAU A., « Voyage du Cheikh Ibn-Batoutah, à travers l’Afrique septentrionale, au commencement du XVIe siècle, traduit d’un manuscrit arabe de Si-Hamoudaèben-Lefgoun », Le Moniteur algérien, 20 avril 1856.
COQUILLE François, « Environs d’Alger. Le frais-Vallon (Aïoun-Schrakna) », L’Akhbar, 2 mai 1851.
COQUILLE François, « L’Algérie au roi des Français », La France algérienne, 30 avril 1846.
547
CUSSON Mahmoud, « Les Premières amours d’un renégat », L’Echo d’Oran, du 9 août 1851 au 27 août 1851.
D.T., « Causeries d’un solitaire », Le Moniteur algérien, 24 mars 1868, 23 juin 1868, 3 janvier 1869, 14 janvier 1869, 19 janvier 1869, 6 mars 1870
D’ESGRIGNY D’HERVILLE capitaine, « Etudes arabes et juives », L’Echo d’Oran, épisodiquement du 30 janvier 1850 au 1er janvier 1851.
DAUMAS colonel, CHANCEL A. de, « Le Sahara algérien – Tribu des Hal-Ben-Ali », La France algérienne, 20 août 1845.
DAUMAS E., « Voyage de l’émir Abd-el-Kader dans l’est de l’Algérie en 1839 », Le Moniteur algérien, 14 novembre 1844.
DE BUSSY Roland, « Fin tragique d’Hadj Aly, dey d’Alger », Le Moniteur algérien, 19 novembre 1836.
DE BUSSY Roland, « Type. – Un nouveau débarqué », Le Moniteur algérien, 4 juillet 1840.
DENOIX Fanny, « L’Inconnu », La France algérienne, 11 octobre 1845. DEVOULX Albert, « Assassinat du pacha Mohammed Tekelerli », Le Moniteur
algérien, 1er mars 1863. DEVOULX Albert, « Documents indigènes », Le Moniteur algérien, 14 juin 1863. DEVOULX Albert, « El Hadj Pacha », Le Moniteur algérien, 7 juillet 1864. DEVOULX Albert, « Enlèvement d’un pacha par les Kabyles », Le Moniteur algérien,
28 avril 1866. DEVOULX Albert, « La première révolte des janissaires à Alger », Le Moniteur
algérien, 3 janvier 1863. DEVOULX Albert, « Mort d’un Mezouar », Le Moniteur algérien, 1er mars 1866. DEVOULX Albert, « Un épisode du blocus d’Alger par les Français », Le Moniteur
algérien, 14 juin 1866. DEVOULX Albert, « Un muphti célèbre », Le Moniteur algérien, 5 avril 1866. DEVOULX, Albert, « Un exploit des Algériens en 1802 », Le Moniteur algérien, 3
février 1865. DEVOULX, Ernest [sic], « Le Capitaine Prépaud », Le Moniteur de l’Algérie, 20 juillet
1862. E.F., « Boghari ou une ville arabe », Le Moniteur algérien, 12 août 1865. E.F., « Justice indigène », L’Akhbar, 27 juillet 1848. E.N., « Les Mystères de Constantine », La France algérienne, 4 février 1846. E.V.F., « Un bal et une représentation théâtrale chez les Kabyles », Le Saf-Saf, 21 avril
1849 et autres numéros avec manques. EL HADJ EL OUED, « La Foire d’Alger », Le Moniteur algérien, 6 octobre 1868. FAURE Dr. L., « Alger de 1830 et Alger de 1867 », Le Moniteur algérien, 14 février
1867. FAVRE Adolphe de, « L’Epée de Saint-Bernard », Le Moniteur algérien, premier
numéro 14 juillet 1863. A vérifier. FENECH E.V., « Un Bal et une représentation théâtrale chez les Kabyles », Le Saf-Saf,
du 21 avril 1849 au 2 juin. FENECH E.V., « Une Chasse à la panthère et ses conséquences. Esquisse de mœurs »,
Le Saf-Saf, du 21 février 1852 au 6 mars 1852. FEUILLERET H., « Études sur l’Afrique. Abd-el-Kader et Jugurtha », Le Moniteur
algérien, 14 octobre 1844 et suivants. FEUILLERET H., « Promenade à Dellys », Le Moniteur algérien, 14 juin 1844. FEUILLERET H., H.F., « Étude sur les voyageurs en Algérie. L’abbé Poiret », La
France algérienne, 21 janvier 1846 et 31 janvier 1846.
548
FORTIN D’IVRY, « Coutumes de la culture arabe », Le Saf-Saf, épisodiquement du 20 octobre 1849 jusqu’au 16 mars 1850.
GANDONNIÈRE Almire, « Un passage de Marseille à Oran à bord du Pharamond », L’Akhbar, 21 décembre 1848.
GUYON Dr., « Histoire chronologique des épidémies du Nord de l’Afrique, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours », Le Moniteur algérien, épisodiquement du 15 février au 20 décembre 1853. Reprise en 1855 : 10 février 1855, 20 février 1855, 28 février 1855.
H.R., « Africana », La France algérienne, 27 juin 1846. H.R., « La nuit sur ma terrasse », La France algérienne, 9 mai 1846. J. L., « Causeries », La France algérienne, 6 juillet 1845. J.P., « Le Fils de l’aveugle », L’Echo d’Oran, 10 juillet 1847 et 17 juillet 1847. L.R., « Géographie ancienne de l’Algérie », Le Mobacher, à partir du 31 janvier 1875. LACHAMBAUDIE Pierre, « Le Laboureur », La France algérienne, 30 juillet 1845. LAFONTAINE Paul, « Les Châteaux en Afrique. Histoire contemporaine », L’Akhbar,
9 juillet 1848. MAC-NATHAN, Henry « Souvenirs de Pitouchet – 1852 », L’Indépendant de
Constantine, épisodiquement du 28 novembre au 12 décembre 1865. MAC CARTHY, O., « Le Chérif Mohammed-ben-Abd-Allah », Le Moniteur algérien,
22 octobre 1861. MARGERIDUN J., « L’Algérie. Au maréchal de Mac-Mahon », Le Moniteur algérien
(emprunté au Courrier d’Oran), 13 janvier 1865. MARIAL, « Bibliographie. Larmes et sourire par A. Duguay », L’Écho d’Oran, 6
janvier 1870. MARIE LEFEBVRE, « La France en Kabilie » (poème), Le Moniteur algérien, 10 août
1857 (pris dans l’Akhbar). MARIE-LEFEBVRE, « Le cimetière Bab-el-Oued, à Alger », Akhbar, 29 juin 1858. MARLE, « Un Nouveau marabout », L’Indépendant de Constantine, 17 avril 1864. MARQUAND, Augustin, « Alger Nouveau », Le Moniteur algérien, 18 mars et 1er avril
1866. MARQUAND, Augustin, « Les Poètes du Sa’hara », Le Moniteur algérien, 13
novembre 1864. MAUBRAS Fenoux, « Revue de la saison », Le Moniteur algérien, 1er mars 1857. MAURIN Dr., « Lettres sur l’Algérie », Le Moniteur algérien, à partir du 24 février
1863. MERCIER, « Sidi Aïssa », Le Moniteur algérien (pris dans la Revue Africaine), 7 avril
1864. MOLOT, « Terre arabe à vendre », Le Zéramna (Courrier de l’Algérie), 10 avril 1863. OLIVIER, « Voyage à Alger », La Seybouse, 17 juillet 1869. P.S., soldat au 12e léger, « L’Agonie du soldat à l’hôpital », L’Echo d’Oran, 5 février
1849 et 21 mars 1849. P… M. de, « Scheriffa », L’Akhbar, 27 février 1842. PERIER Camille, « La Fiancée du lion », Le Moniteur algérien (pris dans l’Etendard),
du 10 août 1867 au 16 août 1867. PERIER Camille, « La Panthère de l’Atlas », Le Moniteur algérien, 2 février 1868. PERIER Camille, « Les veillées arabes », Le Moniteur algérien (Le Moniteur de
l’Armée), 8 octobre 1867. PERIER Ch., « Quelques lignes de souvenirs de voyages », L’Indépendant de
Constantine, 27 juin 1862, 25 juillet 1862, 29 août 1862. PERRIER Ad., « A propos de la rue Regnard à Alger », L’Echo d’Oran, épisodiquement
du 30 avril 1850 au 16 juillet 1851 (numéros manquants).
549
PERRIER Ad., « Le Fort de l’étoile », L’Echo d’Oran, épisodiquement du 3 septembre 1851 au 31 décembre 1851.
PHARAON F., « Notes sur les tribus de la subdivision de Médéah », Le Moniteur algérien, 25 juin 1857.
PHARAON, Joanny, « Diorama de l’Algérie. Description de la rade d’Alger », L’Akhbar, 20 décembre 1839.
PICHON J., « À Méhémet schah de l’Iran », L’Echo d’Oran, 11 septembre 1847. PICHON J., « À une dame qui demandait quelques vers », L’Echo d’Oran, 11
septembre 1847. PICHON J., « Épisode du temps de Hassan, bey », L’Echo d’Oran, 6 novembre 1847. PINELLI Etienne, « Scènes de l’histoire algérienne. Prise de Bougie par les
Espagnols », La France algérienne, 1er novembre 1845. PRIMAUDAIE Élie de la, « Mémoires du capitaine Mathieu. Récit des guerres
d’Afrique », Le Moniteur algérien, épisodiquement du 6 août 1863 au 28 août 1863. Repris épisodiquement dans le même journal 13 février 1868 jusqu’au 5 mars 1868.
PRIMAUDAIE Élie de la, « Quelques pages d’histoire. Les Arabes en Sicile et en Italie », Le Moniteur algérien, épisodiquement du 26 janvier 1865 jusqu’au 31 mars 1865.
RAZOUA Eugène (Jockey), « Le fauconnier des Mokrani », Le Moniteur algérien, 8 mars 1865.
ROCHES Léon, « Notice sur les Coulouglis des Ouèd Zeïtoun. Combat soutenu par eux contre Abd-el-Kader », Le Moniteur algérien, 20 novembre 1843.
ROCHES Léon, « Notice sur Omar Pacha et sa famille », Le Moniteur algérien, épisodiquement du 10 mars 1843 au 21 avril 1843. Note : le numéro du 20 novembre 1843 apprend le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage dans lequel ce sera publié : Deux ans chez Abd-el-Kader.
ROUSSEAU Alphonse (trad.), « Chroniques du Beylik d’Oran, par un secrétaire du bey Hassan », introduction par A. BERBRUGGER, Le Moniteur algérien, 30 mars 1855, 5 avril 1855, 10 avril 1855, 15 avril 1855.
SALLES Eusèbe de, « Pérégrination d’Alger à Médéah », Le Moniteur algérien, 30 août 1843.
SALLES Eusèbe de, « Pérégrination en Sicile (Ascension au mont Etna) », Le Moniteur algérien, 15 février 1844.
SALLES Eusèbe de, propriétaire à Bir mourad raïs, « Pérégrinations dans le Sahel », Le Moniteur algérien, 24 octobre 1843.
SARTOR E.-J., « Hassen le chaouch. Nouvelle algérienne », Le Moniteur algérien, 29 novembre 1865, 30 novembre 1865, 1er décembre 1865, 2 décembre 1865.
SERIZIAT E., « Étude historique sur l’oasis de Biskra. Géographie physique », Le Zéramna, 3 janvier 1866.
SEYBOUS Louis, « Lettres parisiennes », Le Moniteur algérien, au cours de l’année 1863.
SEYBOUS, L., « Souvenirs de voyage. Fragments », Le Moniteur algérien, 14 septembre 1861.
SLANE baron de, « Dernière expédition et mort de Saint-Louis. Chapitre inédit de l’histoire des dynasties musulmanes et des tribus arabes et berbères de l’Afrique septentrionale, d’Ibn-Khaldoun », Le Moniteur algérien, 20 avril 1849.
SOMEBODY, « La machine ne fonctionne plus », Le Moniteur de l’Algérie, 2 août 1871.
SUE Eugène, « Le Morne au diable », La Tribune algérienne, 3 décembre 1879 (autres épisodes non présents).
TOURNIER Em., « Hamed le chérif. Histoire d’une prise d’armes chez les Kabyles », Le Saf-Saf, épisodiquement du 6 septembre 1851 jusqu’au 17 janvier 1852.
550
TOUSSENEL A., « Une Chasse au sanglier à l’allumette chimique – Souvenir d’Algérie », La France algérienne, 5 mai 1845.
TRIC-TRAC, « Origine des scorpions. Légende arabe », Le Moniteur algérien, 10 septembre 1865.
Un arabophone, « Un bruit de cruche arabe », Le Zéramna (pris dans le Courrier de l’Algérie), 20 mars 1863.
Un autre touriste, « Excursion sur la côte ouest », Le Moniteur algérien, 10 mars 1844. Un colon sérieux, « Les Colons de Mondovie », La Seybouse, 16 décembre 1848. X***Y***Z***, « Les Étrennes de la République », L’Echo d’Oran, 9 janvier 1850. X., « Le prince confiseur, conte arabe », L’Indépendant de Constantine, 1er avril 1862,
4 avril 1862, 15 avril 1862. X.X., « Un colon de Rouffach », La Tribune algérienne, 29 novembre 1879 Z., « Lettres sur le Khroub », Le Zéramna, 23 octobre 1863. Z., fils di Dennoun , « A M’Siou li Director di Courrier di Oran », Le Courrier d’Oran,
8 avril, 1881.
Cochinchine « Expédition de Corée », Le Courrier de Saigon, 5 avril 1867. « La colonie vient de traverser une épreuve bien douloureuse », Le Courrier de Saigon,
20 juin 1866. « Les Annamites et les Chinois célèbrent en ce moment leur premier jour de l’an (têt) »,
Le Courrier de Saigon, 5 février 1870. « Mœurs et coutumes annamites », Le Courrier de Saigon, épisodiquement du 5 mai
1869 au 20 novembre 1869. « Spectacle naval », Le Courrier de Saigon, 25 août 1864. « Nous recevons de Trambang la nouvelle suivante : un tigre, dont la présence
remplissait d’effroi les populations voisines », Le Courrier de Saigon, 5 janvier 1866. « Nouvelles et faits divers. Une tournée chez les Moi », Le Courrier de Saigon, 25 juillet
1864. « On lit dans le Gia-dihn-Bao : à côté du village de Vinh-truong, près de la source
Tho’miêng », Le Courrier de Saigon, 20 avril 1866. « Populations asiatiques de la ville », Le Courrier de Saigon, 10 janvier 1864. « Chronique annamite », Le Courrier de Saigon, 10 janvier 1864. « Communauté de Juifs dans l’Empire chinois », Le Courrier de Saigon, 24 février 1864. « Tribunaux », Le Courrier de Saigon, 20 décembre 1868 et 5 janvier 1869. « Une promenade sur les quais de Saigon », Le Courrier de Saigon, 5 octobre 1865. « Une tournée chez les Moi », Le Courrier de Saigon, 25 juillet 1864. BRIGNOLAS Louis, caporal au 2e régiment d’infanterie de marine, « Expédition à la
Nouvelle-Calédonie », Le Courrier de Saigon, 7 janvier 1869. CHAUNAC-LANZAC de, « Excursion faite à l’île de Phuquoc pendant le mois de
septembre 1870, par M. de Chaunac-Lanzac, inspecteur stagiaire des affaires indigènes », Le Courrier de Saigon, 5 décembre 1870.
D’ARFEUILLE, RHEINART, « Voyage au Laos. Notes sur un voyage au Laos, fait en 1869 du mois de janvier au mois de septembre, par M. D’Arfeuille, lieutenant de vaisseau et M. Rheinart, capitaine d’infanterie de marine, inspecteurs des affaires indigènes », Le Courrier de Saigon, 20 juin 1870 et 5 juillet 1870.
JOURDAIN R.P., « Observations sur le peuple annamite », Le Courrier de Saigon, 5 février 1866, 6 mars 1866, 5 avril 1866.
LE FAUCHEUR P., « De Saigon à Contior », feuilleton paru dans Le Courrier de Saigon, n°1 du jeudi 5 janvier 1865
551
Luc – Van – Tiên, feuilleton donné comme anonyme, Le Courrier de Saigon, épisodiquement du vendredi 20 juillet 1866 jusqu’au 5 janvier 1867.
PONS, capitaine d’infanterie de marine, « Expédition du Nord. Episode », Le Courrier de Saigon, 20 juin 1869.
R.P. Jourdain, « Observations sur le peuple annamite », Le Courrier de Saigon, 5 février 1866.
RICHIER, « Rapport de M. Richier, lieutenant de vaisseau, commandant la Couleuvre, à l’occasion de fêtes à Bang-kok », Le Courrier de Saigon, 5 avril 1870.
SINET Achille, « Etude sur le deuil et la parenté chez les Annamites », Le Courrier de Saigon, 5 octobre 1868 et 20 novembre 1868.
WYTS, « Notice sur l’île de Phu-Quovq (Extrait d’un rapport de M. Wyts, lieutenant de vaisseau, commandant l’aviso l’Alon-prah) », Le Courrier de Saigon, 5 novembre 1867.
Guadeloupe et Martinique « Dernière lamentinoise », Le Commercial de la Guadeloupe, 17 octobre 1849. « Adieux à l’Anacréon », Le Courrier de la Martinique, 3 mai 1851. « Boileau, le mariage, les femmes créoles », Les Antilles, 31 août 1861. « Correspondance coloniale », Les Antilles, 20 juillet 1861. « Étymologie. Quo fè crabb pas tini tête ? », Le Propagateur, 19 juillet 1862. « Fondoc allant toucher un mandat au Trésor », Le Commercial, 15 août 1866. « Lettres d’un grandfonnier », L’Avenir, 12 juillet 1867. « Lettres d’un zombien », L’Avenir de la Pointe-à-Pitre, épisodiquement du 5 août 1848
au 18 octobre 1848. « Nous apprenons qu'un crime affreux vient d'être commis à Saint-Pierre », Le Créole,
17 janvier 1840. « Tribune publique. Un préjugé français », Le Propagateur, 28 février 1877. « Une vision en mer. Nouvelle inédite », Le Propagateur, 14 octobre 1874. A., « Histoire anecdotique du sucre », L’Avenir de la Pointe-à-Pitre, 20 septembre
1843. A.B., « L’Église du Vieux-Fort », L’Avenir, 12 avril 1867. BLAINVILLE Céloron de, « Découragement », Le Commercial, 2 mars 1861. BLAINVILLE, Céloron de, « Le cimetière à la Pointe-à-Pitre. Un chapitre de mœurs
coloniales », Le Commercial, 31 octobre 1863. C. B., « L’Anse au diable », La France d’Outre-mer, 15 février 1859. C.P. « Petites misères coloniales », Les Antilles, 28 août 1869. DAKOÈ, lettres en créole, L’Avenir, 11 et 22 juillet, 22 décembre 1849. DHORMOYS, Paul, « Une histoire de serpents. Souvenirs de la Martinique », La
France d’Outre-mer, 15 avril 1859. DUBOSC Ed., « Souvenir de la Pointe-à-Pitre », Le Commercial, 8 avril 1865. DUPREY DE LA RUFFINIÈRE, « Impressions de voyage », La France d’Outre-mer,
4 juin 1854. ÉLÉONORE, « Lettre d’une femme à son mari », Le Commercial, 14 et 21 août, 4
septembre 1867. ELI, « A Madame Eléonore », Le Commercial, 31 août 1867. ELSEY, J. « Une Créole poète. Mme de Lafaye », Le Propagateur, 10 octobre 1863. EMILE, « Ma chère Eléonore », L’Avenir, 16 août 1867. FIORENTINI, « Le Flageolet », Le Commercial, 20 février 1861. FONDOC, « La voix di pèple à Mouché Vallé », L’Avenir, 8 octobre 1869. FONDOC, « Les deux cafiers. Fable », Le Commercial, 6 septembre 1862. FONDOC, « Portrait de Mme Roche, artiste », L’Avenir, 5 avril 1856.
552
HERVE E., « Les colonies et la Presse métropolitaine », Le Commercial, 12 janvier 1861.
J…, « Célébrités créoles (Guadeloupe). Léonard (Nicolas-Germain) », Le Propagateur, 4 octobre 1873.
J…, « Célébrités créoles (Guadeloupe). Lethière Guillaume Guillon », Le Propagateur, 19 juillet 1873.
J…, « Célébrités créoles (île Bourbon, aujourd’hui la Réunion) », Le Propagateur, 16 août 1873, 27 août 1873.
J…, « Célébrités créoles (Martinique). Moreau de Saint-Méry », Le Propagateur, 14 juin 1873, 19 juin 1873, 26 juin 1873.
JACOBY Léon, « A Monsieur A. qui m’a demandé quelques renseignements sur la ville d’Oran (Algérie) », Le Propagateur, 14 avril 1877.
JEAN, « Coq à l’âne. Lettre à un ami », Les Antilles, 15 novembre 1862. JULES, C., « Gethsémani », Le Propagateur, 28 mars 1877. L’HERMITE DE LA CASE-PILOTE, « Casser la corde », La France d’Outre-Mer, 4
octobre 1859. L’HERMITE DE LA CASE-PILOTE, « La Vie intérieure », La France d’Outre-Mer, 2
décembre 1859. L’HERMITE DE LA CASE-PILOTE, « Le Bateau à vapeur », La France d’Outre-Mer,
19 avril 1859. L’HERMITE, « Le Jérôme Paturot de la Martinique à la recherche d’une position
meilleure », Le Propagateur, 30 août 1862. L’HERMITE, « La Rencontre imprévue de trois vieux colons », Le Propagateur, 3 mai
1862. L’HERMITE, « La Vieille et la jeune Martinique. Dialogue » suivi de « Les serments
d’autrefois. Légende coloniale. 1664 », Le Propagateur, 19 mars 1862. L’HERMITE, « Légende coloniale. 1744 », Le Propagateur, 1er mars 1862. L’HERMITE, poèmes divers dans Le Propagateur en 1862 : « L’habitant vivrier et
l’habitant sucrier. Dialogue » suivi de « La Paire de souliers » (19 juillet 1862) ; « La Circulation arrêtée » (qui s’apparente davantage à une pièce de théâtre, 14 juin 1862) ; « Une Pensée ! » suivi de « Le Petit chien » (28 mai 1862) ; « Une Nouvelle représentation » (14 mai 1862) ; « La Prière » (3 mai 1862) ; « La Cocotte » suivi de « Le siècle ou l’âge des forts » (15 février 1862) ; « A mon ami le Propagateur, en réponse au sizain adressé à l’Hermite, dans la Revue Littéraire du 15 janvier » suivi de « Le Cacao » (4 février 1862) ; « La vie d’un économe » suivi de « Le Canot de poste ».
LACOUR, Auguste, « Histoire de la Guadeloupe », L’Avenir de la Pointre-à-Pitre, 18 février 1852.
LAHUPPE Thomy, « Les colonies et la presse francophone », Le Commercial, 22 mars 1862.
LE PRIEUR, PEYRAUD et RUFZ, « Éruption du volcan de la Montagne-Pelée à la Martinique », L’Avenir, du 14 février 1852 au 10 mars 1852.
Le Solitaire, « Méditations d’un solitaire aux Antilles », Le Commercial de la Guadeloupe, 25 novembre 1848.
LE VOYANT, « Lettres d’un zombien », L’Avenir, à partir du 2 août 1848 (5 août 1848, 23 décembre 1848.
M., « Fables de la Fontaine traduites en langue créole », Le Propagateur, 1er janvier 1862 et numéros suivants, épisodiquement.
MARSAN Jean, « A Monsieur le gouverneur de la Martinique », Les Antilles, 11 mai 1870.
MONTHAUBAN, « Huit février 1843, à la Guadeloupe », L’Avenir de la Pointe-à-Pitre, 20 mai 1843.
553
N., « Journal d’un Passager », Le Commercial, 18 août 1866. PAUL, « Lettres d’un voyageur », Le Propagateur, 17 décembre 1873. Rousseau St-Val, « Le Jugement de Dieu », Le Commercial de la Guadeloupe, 26
septembre 1849. SERPETTE, « Le Bon habitant », L’Avenir, 27 juin 1854. SYLVIUS, « La Pomme d’une fille d’Ève », Le Messager de la Martinique, 31 août
1864. SYLVIUS, « La Martinique pittoresque. Première lettre », Le Messager de la
Martinique, 13 juillet 1864. TIBON J., « Homme de couleur de la plus haute aristocratie », L’Avenir, 8 avril 1862. Un campagnard, « L’Actualité, comédie en un acte et en prose », Le Commercial de la
Guadeloupe, 23 août 1848. VIGNERTE H., « Revue et chronique de Saint-Pierre », L’Avenir de la Pointe-à-Pitre
(pris dans le Courrier de la Martinique), 18 novembre 1843 et 22 novembre 1843. X.X., « A Mademoiselle Bédora », L’Avenir, 20 mai 1870. Y., « Au Sauvage des Antilles », Le Propagateur, 1er avril 1863.
Guyane « Détails complémentaires sur le sauvetage de Mme Gillain », La Feuille de la Guyane
française, 17 juin 1876. « Exploration dans la partie sous le vent de la Guyane française, par ordre de
l’administration supérieure, faite par M. J.-P. Lougarre, habitant de Cayenne, pour la recherche des produits naturels du sol et notamment du caoutchouc, du 24 septembre 1852 au 26 janvier 1853 », La Feuille de la Guyane française, 19 et 26 février 1853.
« Les deux planteurs », La Feuille de la Guyane française, 17 avril 1830. « Naufrage de la goélette Sainte-Barbe », La Feuille de la Guyane française, 29 avril
1876. « Une victime du naufrage de la Sainte-Barbe », La Feuille de la Guyane française, 20
mai 1876. « Chien crabié qui pèdi so laquio », La Feuille de la Guyane française, 29 mai 1869. « Esquisses de la Guyane », La Feuille de la Guyane française, 9 janvier 1830. « Immigration indienne. La Fête du Pongol à la Martinique », Feuille de la Guyane
française (pris dans le Moniteur de la Martinique), 30 juin 1855. « Mme Gillain », La Feuille de la Guyane française, 18 novembre 1876. « Nouveau voyage d’exploration du docteur Chevaux dans la Haute Guyane », La
Feuille de la Guyane française, 7 septembre 1878. « Un de ces accidents qui malheureusement se reproduisent trop souvent sur nos côtes »,
Feuille de la Guyane française, 31 mars 1855. A. J., « Une journée à Cayenne il y a 200 ans (contée par une bonne vieille
Grand’Mère) », La Feuille de la Guyane française, 6 janvier 1877. C.C., « À travers la Guyane. Deuxième fragment. Bois et rivières », La Feuille de la
Guyane française, épisodiquement de janvier à mai 1867. C.C., « À travers la Guyane. Fragment », La Feuille de la Guyane française,
épisodiquement d’avril à mai 1866. CHANEL, C., « Le long des Guyanes », La Feuille de la Guyane française, 31 juillet
1858. CHANEL, C., « Martinique. Éruption volcanique de la Montagne-Pelée. Première visite
aux cratères », La Feuille de la Guyane française, 13 et 20 septembre 1851. CHEVAUX [sic], Jean, Jean Chevaux, « Voyage d’exploration. À travers la Guyane »,
La Feuille de la Guyane française, épisodiquement d’août à décembre 1877.
554
FRANCONIE, G., « Affreux événement », La Feuille de la Guyane française, 28 décembre 1833.
J., « Les îles du Salut », La Feuille de la Guyane française, 3 juillet 1852. LECHERTIER, « La Boule », L’Eclaireur de Cayenne, 11 février 1849. LEJEAN, G., « Cartologie de la Guyane française », La Feuille de la Guyane française,
25 juin 1859. Pris dans La France coloniale et maritime. RONMY, lieutenant d’infanterie de marine (Revue maritime et coloniale), « Excursion
dans le haut Maroni », La Feuille de la Guyane française, 21 septembre, 19 et 26 octobre 1861. VIDAL, G., lieutenant de vaisseau, « Voyage d’exploration dans le haut Maroni
(Guyane française) », La Feuille de la Guyane française, épisodiquement de septembre 1862 à avril 1863.
La Réunion *** D.M.P, « Esquisses morales. Alice, ou une destinée de femme », La Feuille
hebdomadaire de l’île Bourbon, 7 août 1839. « Le Phare de Saint-Paul », La Semaine illustrée, 17 juillet 1862. « Premiers temps de la colonisation à Bourbon et à Maurice », La Malle, 29 mars 1874. « À l’auteur des hirondelles », La Semaine illustrée, 17 avril 1862. « Aux dames de Saint-Paul », Le Bien-Public, 25 septembre 1856. « Causerie », Le Courrier de Saint-Pierre, 19 janvier 1872. « Dialogue. La France et Bourbon », Le Colonial, 2 juillet 1833 (publié une première
fois dans La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon en 1819, signé par D.). « L’Aristocratie des richesses ou les Européens à l’île Bourbon », non signé, La Feuille
hebdomadaire de l’île Bourbon, n°578 du mercredi 27 janvier 1830 (Fabienne Jean-Baptiste) « Les Jésuites en 1860 », La Malle, 27 décembre 1860. « Premiers temps de la colonisation à Bourbon et à Maurice », La Malle, 29 mars 1874. « Relation de voyage », Le Courrier de Saint-Pierre, 24 octobre 1867. « Scènes d’habitation », La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, 20 mai 1835. « Simple récit », Le Sport colonial, 26 juillet 1879. « Sobriété des affranchis », Le Colon, 1er décembre 1854. ALIZART, Alphonse, « Moi vieux noir. Causerie », Le Courrier de Saint-Pierre, 22
septembre 1871. ALIZART, Alphonse, « Souvenirs d’un voyage de l’île Bourbon en France, à bord de
la corvette l’Égérie », Le Courrier de Saint-Pierre, mai 1871. ALIZART, Alphonse, « Une excursion dans la rivière des patates-à-Durand et sur le
sommet du piton Grayel, au bois de nèfles », Le Courrier de Saint-Pierre, 23 décembre 1870. ALIZART, Alphonse, « Une promenade au château de Gol », Le Courrier de Saint-
Pierre, 11 avril 1871. AUGUSTE, « Néhala ou la fuite », La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, 29 juin
1836. AZÉMA, E. « Vers à l’occasion du buste de Poivre… », La Feuille hebdomadaire de
l’île Bourbon, 15 juin 1825. AZÉMA, Georges, « Impressions de Voyages », La Feuille hebdomadaire de l’île
Bourbon, juillet 1846. AZÉMA, Georges, « Une Princesse russe à l’île Bourbon », Le Colon, 24 mars 1854
(numéros manquants). AZÉMA, Georges, Greffier de la justice de Paix de Saint-Denis, « Histoire de l’île
Bourbon depuis 1643 jusqu’au 20 décembre 1848 », La Malle, 15 février 1860. BELLIER, Émile, « Salut à la France », Le Travail, 24 novembre 1877. C.A., « Un Drame à Saint-Paul », Le Courrier de Saint-Paul, du 6 février au 27 février
1846.
555
CHALVET DE SOUVILLE, « Discernement et sagesse », La Malle, 23 mai 1872. CHATEAUVIEUX de, « Histoire de Saint-Leu, chapitre Ier. Origine, commencements,
administration », La Malle, épisodiquement du 13 septembre 1860 jusqu’au 27 décembre 1860. Reprise épisodiquement du 4 avril 1861 jusqu’au 23 mai 1861.
COQUILLE, François, « La philanthropie triomphe, et il y a de quoi », La Malle, 28 septembre 1865.
COTTERET, Ernest, « A l’auteur des Salaziennes », La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, juin 1843
COTTERET, Ernest, « A M. Dayot », Le Courrier de Saint-Paul, 3 décembre 1847. COTTERET, Ernest, « A mes compatriotes. Liberté-égalité-fraternité », Le Courrier de
Saint-Paul, juin 1848. COTTERET, Ernest, « A mon pays », La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, 31
décembre 1843, [E.C., 1845]. Voir l’étude que propose Fabienne Jean-Baptiste, notamment p.507 – 508.
COTTERET, Ernest, « Adieux à M. Auguste Lacaussade », L’Indicateur colonial, mai 1844.
COTTERET, Ernest, « Invocation », Le Bien-Public, 4 novembre 1853. D.G., « Depuis mon arrivée de France, je ne suis pas encore fait à l’existence que l’on
mène dans la colonie », Le Colonial, 20 août 1833. DAYOT, « La Hache », dans le feuilleton signé F.M. du Courrier de Saint-Pierre, 2
mai 1867. Publié sous les initiales E.D. dans Le Créole du 27 mars 1840. DAYOT, Eugène, « Action de grâces. Réponse à Cotterêt », Le Courrier de Saint-Paul,
17 décembre 1847. E.F., « Une ascension », Le Bien-Public, 9 octobre 1856. FONTAINE, Édouard, « A un ami d’autrefois », Le Courrier de Saint-Paul, 14 janvier
1848. FONTAINE, Édouard, « Le Cimetière de Saint-Paul », Le Courrier de Saint-Paul, avril
1848. FONTAINE, Édouard, « Le Départ », Le Courrier de Saint-Paul, janvier 1848. (à
copier) FONTPERTUIS, Ad. F. de, « L’île de la Réunion. Son passé et sa situation actuelle »,
Le Travail, 14 janvier 1874. HACHARD A., « De la Presse dans les colonies », Le Courrier de la Martinique, 18
novembre 1848. JOUEN T.R.P., « Relation d’un voyage à Tananarivo, à l’époque du couronnement de
Radama II, par le T.R.P. Jouen, préfet apostolique de Madagascar », La Malle, du 18 décembre 1862 jusqu’au 28 décembre 1862.
LAHUPPE E. « Mélanges », La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon, octobre 1847. LE FRANC, Candide, « Actualité. Les Aveux piquants », La Malle, 19 décembre 1861. LE FRANC, Candide, « Un Signalement », La Malle, 26 décembre 1861. MAC-AULIFFE J.-M., « Le Naufrage du Dot », Le Travail, du 18 mars 1874 au 28
mars 1874. MARGERIE, Eugène de, « Deux rencontres », La Malle, 24 janvier 1861 et 31 janvier
1861. PROST de, G. J., « Espoir. A une Créole », Le Créole, 7 février 1840. PUJO, Pujo, « Correspondance coloniale », Le Sport colonial, 18 octobre 1879. R. R., « Causerie », Le Courrier de Saint-Pierre, 19 janvier 1872. RAFFRAY, « De la presse à Bourbon depuis quarante ans », Le Bien-Public, 14 mars
1851, 21 mars 1851, 28 mars 1851, 4 avril 1851, 11 avril 1851. SAINT-AMAND, François de, « A Bourbon », Le Bien-Public, 23 septembre 1853.
556
SAINT-AMAND, François de, « A propos d’une cathédrale », Le Courrier de Saint-Pierre, 25 août 1871.
U.V., « Dialogues entre un courtier d’élection et les électeurs », Le Bien-Public, 23 janvier 1852.
U.V., « Parodie », Le Bien-Public, 5 mars 1853. Un habitant de Saint-Pierre, « Le cimetière de Saint-Pierre », Le Bien-Public, 11
novembre 1854. VINSON, Émile, « Célébrités créoles. Philippe Commersen. », La Malle, 28 novembre
1861 et 5 décembre 1861. X., « La Patrie », Le Bien-Public, 31 juillet 1856. Z., « Une dernière rose », Le Bien-Public, 8 juillet 1853.
Nouvelle-Calédonie « Exploration faite de N’goé à Port-de-France par M. le lieutenant de vaisseau
Chambeyron », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 10 août 1862. « Voyage par terre de Port-de-France à Kanala, exécuté par M. Marchant, sous-
lieutenant d’infanterie de Marine », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 17 août 1862. « Expédition de Gatope », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 1er octobre 1865. « Naufrage sur la côte Nord-Ouest de la Nouvelle-Calédonie », Le Moniteur impérial
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 14 juin 1868. « Nous avons déjà parlé des guerres qui désolent le vaste territoire compris entre les
caps Kouha et Baye », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 1er mai 1864. BÉRAUD Félix H., « Chronique néo-calédonienne », Le Moniteur de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances, juin-juillet 1862. CLOSQUINET Armand, « En mer », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances, 14 septembre 1862, 5 octobre 1862, 26 octobre 1862, 14 décembre 1862. CLOSQUINET Armand, « Hommage et adieu », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances, 17 avril 1864. CLOSQUINET Armand, « La Sibylle », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances, 19 février 1865. CLOSQUINET Armand, « Vent du soir et les Kanacks », Le Moniteur de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances, 1er février 1863. CLOSQUINET Armand, poèmes publiés dans Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances tout au long de l’année 1863 : « La Nuit » (23 août 1863), « L’Enfant et la papillon » (6 septembre 1863), « Souvenirs et regrets » (27 septembre 1863), « La vie humaine » (25 octobre 1863), « Le Nid d’hirondelle » (24 mai 1863), etc.
KNOBLAUCH, F., « Voyage sur la côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie (mai 1862) », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 14 septembre 1862.
LE BOUCHER, A., ancien régent de sixième du collège d’Évreux, « Port-de-France n’est plus. Vive Nouméa ! », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 17 juin 1866.
LEMIRE, Charles, « L’insurrection canaque », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, série d’articles pendant l’été 1878.
LEMIRE, Charles, « Notice sur la baie de Prony », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 15 mai 1878.
MATHIEU A., « Aperçu historique sur la tribu des Houassios ou des Manongôés », Le Moniteur impérial de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 12 janvier 1868.
MONTROUZIER, Xavier, « Nouvelle-Calédonie. Fragments historiques », Le Moniteur impérial de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, épisodiquement du 19 août 1860 jusqu’au 17 mars 1861.
RATTE, F., « Sentiers canaques. De Gomen à la côte Est (Nord de la Nouvelle-Calédonie) », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 13 novembre 1878.
557
Un vieil Australien, « À M. le rédacteur de l’Herald », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 7 août 1864.
Tahiti « Archipel des Pomotous », Le Messager de Tahiti, épisodiquement du 30 avril 1854 au
29 octobre 1854. « Comme nous l’annoncions dans notre dernier numéro, le prince Ariiane, fils aîné de
Sa Majesté la Reine Pomaré, est mort », Le Messager de Tahiti, 27 mai 1855. « Couronnement de la reine de Borabora », Le Messager de Tahiti, 20 janvier 1861 et
24 mars 1861. « Édilité tahitienne », Le Messager de Tahiti, épisodiquement du 28 août 1853 au 23
octobre 1853. « L’Ile qu’on rêve à quinze ans », Le Messager de Tahiti, 2 juin 1866. « La Houpahoupah (Ute no te Upaupa) », dans « Mœurs tahitiennes », Le Messager de
Tahiti, 22 mai 1853. « La lettre suivante, qui ne sera pas sans intérêt pour nos lecteurs, a été adressée de
Nouvelle-Calédonie à l’un des correspondants de l’écho du pacifique », Le Messager de Tahiti, 2 novembre 1856.
« Le Convoi de guerre. Nouvelle », Le Messager de Tahiti, 27 octobre 1861. « Le Naufrage de la Clarissa », Le Messager de Tahiti, 12 mars 1870. « Le Petit oiseau », Le Messager de Tahiti, 14 mai 1854. « Le vieux chef de Papara, Tati, vient de mourir », Le Messager de Tahiti, 16 juillet
1854. « Les colonies françaises sous Louis XIV », Le Messager de Tahiti, du 1er janvier au 29
janvier 1870 « Mort d’un dey d’Alger en 1754 », Le Messager de Tahiti, 22 juillet 1860. « Par la goëlette du protectorat Gazelle, arrivée d’Ana le 6 du courant, nous avons reçu
de notre correspondant la lettre suivante », Le Messager de Tahiti, 13 juillet 1855. « Pitaferiro (ancienne élégie) », Le Messager de Tahiti, 24 septembre 1854. « Promenade militaire autour de Taïti », Le Messager de Tahiti, 16 février 1862. « Tiretire », Le Messager de Tahiti, 1er mai 1853. « Une fête tahitienne », L’Océanie française, 10 novembre 1844. « Voyage des Espagnols à Tahiti en 1772 et 1774 », Le Messager de Tahiti, 22 décembre
1866 et 29 décembre 1866. BARION, A., « Une promenade au lac de Tahiti », Le Messager de Tahiti, 22-26 février
1860. CAUWET Pierre, « Aux Marins de l’Euryale. Chanson », Le Messager de Tahiti, 6
juillet 1867. CELTIBÈRE, « Voyage autour du monde. Taiti », Le Messager de Tahiti, 28 janvier
1855, 4 février 1855, 11 février 1855. GARNIER, ingénieur des mines, « Ile Tahiti. Exploration géologique », Le Messager
de Tahiti, 6 octobre 1866 et 20 octobre 1866. HARDY E., « Excursion aux îles sous le vent », Le Messager de Tahiti, 30 novembre
1856. TRABAUD, « De Paris à Tahiti, par Londres et New-York. Souvenirs et impressions
de voyage », Le Messager de Tahiti, 14 mai 1870, 21 mai 1870, 28 mai 1870, 11 juin 1870, 25 juin 1870.
Un pionnier de la civilisation, « Nouvelles locales », Le Messager de Tahiti, 3 novembre 1861.
VALLÉE Louis, « Réunion de Tahiti à la France ou une sœur de plus », Le Messager de Tahiti, 16 juillet 1880.
559
2 Annexe 2 : tableau de dépouillement des périodiques
Figurent ici les titres consultés aux Archives Nationales d’Outre-Mer et à la Bibliothèque Nationale de France. N’apparaissent pas ici les nombreuses collections de la BNF qui se révèlent incommunicables.
Territoire Titre (date de création) Cote ANOM / BNF
(précision éventuelle du nombre de numéros conservés)
Algérie L’Akhbar. Journal de l'Algérie (1839)
BIB AOM 30637 JO – 11160 1848 - 1849
L’Algérie française (1870) BIB AOM 31046 1870 – 1871 – 1872 (n°)
JO 4089 (1n°)
L'Avenir algérien (1865) BIB AOM/30813 1868
Exemplaires trop tardifs
L’Atlas JO – 3068 Le Bavard (1867) BIB AOM 30743 Le Brûlot de la Méditerranée (puis « d'Alger »). Journal des intérêts algériens. (1848)
JO 3070
Chitann (1865) BIB AOM 30743 Le Courrier de l'Algérie. Journal des intérêts coloniaux, politique, commercial, maritime, agricole et littéraire. (1862)
BIB AOM /30810 (quatre numéros dans un carton commun)
Microfilm
Le Courrier de Bône (1849) BIB AOM/30629 1876 – 1882 (n°) /30043 (1 n° de 1872)
JO 3193 (1880 – 1898)
Le Courrier de Mostaganem. Journal politique, littéraire, commercial, agricole et d'annonces.
BIB AOM 30815 (numéro unique du 7 mai 1870)
JO - 3167
Le Courrier d’Oran (1850) BIB AOM 30799 1861
Microfilm JO-3076 1850 – 1852
1863 - 1869
Le Courrier de Philippeville BIB AOM RES 31205
Le Courrier de Sétif (1874) Gallica Le Courrier de Tlemcen (1860) BIB AOM 30814
(carton) Gallica
560
Territoire Titre (date de création) Cote ANOM / BNF (précision éventuelle du nombre de numéros conservés)
Le Démocrate de Blidah (1849) JO 3072 1849 – 1850
Don Quichotte (1863) JO – 4318 2 n° 1863
L'Écho de l'Atlas (1846) BIB AOM 30819 (1 n°)
L'Écho d'Oran (1844) MICR-D316 JO – 13582 1847 – 1849
1849 - 1852
L’Estafette de Constantine (1851)
JO – 4080 1874 ; 1876 ; 1880 - 1882
L'Est algérien (1868) Gallica La France algérienne (1845) BIB AOM 30606
1845 - 1846 Non
La Goguette (1865) L’Indépendant. Echo de Constantine (1858)
JO 3446 1861-1862
1863 Le Lorgnon (1869) BIB AOM 30747 La Mahouna (1867) JO – 3070
et MFILM JO – 86564 1871 – 1882
Gallica Le Mobacher (1848) BIB AOM 50202
1849 – 1927 JO - 3033
Le Moniteur algérien (1832) BIB AOM 50200 Rupture en 1861
Le Moqueur (1865) BIB AOM 30742 Le Nouvelliste de l’Algérie JO - 3680 L’Oranais. Journal universel des faits intéressant la province, paraissant le mercredi et le dimanche (1869)
Spécimen dans le carton BIB AOM
30810 – 30819
Le Petit colon algérien (1879) BIB AOM 30604 La Pipe en bois (1869) BIB AOM 30741
561
Territoire Titre (date de création) Cote ANOM / BNF (précision éventuelle du nombre de numéros conservés)
Le Progrès de l’Est BIB AOM 30619 trois numéros
Le Saf-Saf (1844) JO – 3052 1849 - 1852
La Seybouse (1848) JO – 1266 1848 –
1852 (mf) 1863 – 1865 1866
Le Siroco (1866) BIB AOM 30745 La Solidarité (1871) BIB AOM
30798/1873 et 1883
JO 90398 Exemplaires tardifs
début 1881 La Tribune algérienne (1875) BIB AOM 30285
1878 (3 n°)
La Vie Algérienne (1869) BIB AOM 30744 1869 (10 oct.-26
déc.)-1870 (2 janv.-20 fév.)
La Vigie algérienne BIB AOM 30463 1861 (3n°)
Le Zeramna (1850) JO – 91534
(1851 – 1880)
Cochinchine
Le Courrier de Saigon : journal officiel de la Cochinchine française (1864 – 1879)→ Journal officiel de la Cochinchine française (1879 – 1889)
BIB AOM 50064 (1er janv. 1864)-
n°14 (20 juil. 1879)
L’Indépendant de Saigon (1881) JO-4497 1882 (mf)
et 1/12/1877
Guadeloupe
L’Avenir de Pointe-à-Pitre = L’Avenir. Journal de la Guadeloupe (1843)
BIB SOM POM/E/582 1843 – 1844 1848 - 1870
JO 59481 1847 1848
Le Courrier de la Guadeloupe (1880)
BIB som pom/e/9
1834 - 1841
JO – 4263 Exemplair
e tardif (1881)
562
Territoire Titre (date de création) Cote ANOM / BNF (précision éventuelle du nombre de numéros conservés)
Le Commercial BIB som pom/e/589 1861 - 1870
L’Écho de la Guadeloupe JO 59480 1872 - 1880
Guyane Bulletin officiel de la Guyane française (1828)
BIB AOM 50094 1828 - 1927
L'Eclaireur de Cayenne (1849) BIB som pom/b/830
1849
Feuille de la Guyane française → Le Journal officiel de la Guyane (1819) puis le Moniteur officiel de la Guyane française (1872)
BIB AOM 50092 1833 - 1947
JO – 3036 1854
Le Guyanais BIB AOM / 30588
10/08/1882
Non
Le Réveil de la Guyane (1882) JO 5982 Ile de la Réunion (île Bourbon)
Le Bien-Public. Politique, commerce, littérature (1849 – 1861)
BIB som pom/e/880 1851 – 1854
1856 1861
La Caricature (1872) Le Colon (1853 - 1861) → Le Nouveau Colon (1862) → La Réunion
BIB SOM POM /e/856 1854 1856
Puis f/881 (1862)
Le Colonial (1833) → Le Glaneur
BIB som pom/c/685 1833
Le Conservateur. Feuille politique, commerciale, industrielle et littéraire (1837 - 1843)
BIB som pom/d/681 1837 - 1839
Le Courrier de l’Ile de la Réunion
BIB som pom/f/865 1872 - 1873
Le Courrier de Saint-Paul (1843 – 1848)
Le Courrier de Saint-Pierre (1862 - 1872)
BIB som pom/f/879
563
Territoire Titre (date de création) Cote ANOM / BNF (précision éventuelle du nombre de numéros conservés)
1862 – 1865 1867 - 1872
Le Courrier républicain de l’île de la Réunion (1848)
BIB som pom/e/690 1848 - 1849
Le Créole de l'île Bourbon (1840)
BIB som pom/e/683 1840 - 1842
Le Créole républicain (1849 – 1849)
BIB som pom/e/687/1849
La Feuille hebdomadaire de l’île Bourbon (1819)
BIB som pom/e/680
FOL- LC12- 145
(13) Le Glaneur (1832 – 1839) → Le Créole ex-glaneur →Le Courrier de Saint-Paul
BIB som pom/e/682 1832 – 1833 1835 - 1839
L’Indicateur colonial (1835 – 1848) → Le Moniteur (1848 – 1885)
BIB som pom/f/883
Le Journal du commerce (1846 – 1885)
JO - 3041
Le Journal officiel de l’île de la Réunion
FOL- LC12- 351
(1862 – 1909)
La Malle (1860 – 1886) BIB som pom/f/863 1860 – 1872
1874 1876
JO – 3044
Les Moustiques (1874 – 1878) 8- LC11- 886 (4)
Le Phare de Saint-Paul (janvier – décembre 1862)
BIB som pom/e/857
1862
La Réunion BIB som pom/e/689
1862
Le Réveil (1849 – 1849) BIB som pom/e/686 N°2 de juin 1849
Le Salazien (1833) → Le Nouveau Salazien (1872 – 1887)
4- LK9- 758 (4)
La Semaine (1862) Le Sport colonial (1865) Le Travail (1870 – 1882) BIB som pom
/e/875
564
Territoire Titre (date de création) Cote ANOM / BNF (précision éventuelle du nombre de numéros conservés) 1871 1874 – 1875 1877
L’Union coloniale (1850 – 1852) BIB som pom/e/688 1852
Martinique
Les Antilles (1843) BIB som pom/e/560 1850 – 1856 1861 – 1876
Gallica 1877 - 1881
Le Courrier de la Martinique BIB som pom/e/618 1833 – 1843 1848 1850 - 1852
Le Créole BIB AOM RES 1183 N°31 du 12/08/1888 ?
Le Journal officiel de la Martinique
La France d’outre-mer de la Martinique (1852)
BIB som pom/e/527 1852 – 1855 1859 1860
Liberté (1850) BIB som pom/e/658 N°1, 1850 (avr.)-1851 (nov.)
Le Martiniquais. Economie, politique, commerce, industrie, littérature
BIB som pom/e/616 1854 – 1855
Le Moniteur de la Martinique JO 3021 1879
Le Propagateur. Journal de la Martinique (1853)
BIB som pom/e/549 1854 – 1855 1859 - 1880
JO-5979 1864 – 1866 (3 numéros) 1875 – 1878 (carton)
La Revue des colonies (1834) Gallica Nouvelle-Calédonie
L'Avenir de la Nouvelle-Calédonie (1883)
Bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie (1853)
BIB AOM 50103 1853 - 1907
565
Territoire Titre (date de création) Cote ANOM / BNF (précision éventuelle du nombre de numéros conservés)
Le Moniteur impérial de la Nouvelle Calédonie et dépendances (1859)
BIB AOM 50104
JO – 3045
Tahiti Le Messager de Tahiti (1852) BIB AOM 50102
JO - 5953
L’Océanie française (1844) RES GR FOL-NFG-10
566
3 Annexe 3 : anthologie de textes médiatiques coloniaux
On se propose de reproduire ici une cinquantaine de textes transcrits des journaux du corpus et classés chronologiquement. Ils permettent de mieux comprendre certaines des citations insérées au cours de l’étude, et visent à produire un échantillon signifiant de ce qui a pu être lu au cours des dépouillements.
La retranscription des textes ne permet pas de rendre compte de la complexité de leur position au sein du journal, et des éventuels effets d’échos qui sont présentés dans la quatrième partie. On a cependant précisé leur emplacement au sein du journal. Certains passages ont dû être coupés faute de pouvoir les déchiffrer, ou parce que le journal était déchiré : dans le premier texte, les coupes finales sont liées à ces défauts de conservation. L’orthographe a été modernisée et les éventuelles coquilles corrigées.
« Esquisses de la Guyane », La Feuille de la Guyane française, 9 janvier 1830, deuxième page « C’est, je l’avoue, avec une prévention défavorable que j’ai abordé les côtes de la
Guyane française. J’avais quelquefois entendu parler de cette contrée, et toujours sous des dehors peu avantageux. Le hasard m’y a fait relâcher malgré moi. D’après ce que j’en ai vu depuis quelques jours, avec un aussi beau climat, des terres aussi fertiles, une végétation aussi riche, je m’étonne que la colonie soit restée si pauvre et si arriérée dans ses travaux ». Ainsi s’exprimait un étranger, M. James W…, récemment arrivé des Etats-Unis sur un navire qui avait fait échelle à Surinam et qui, destiné pour un plus long voyage, avait été forcé par quelques avaries à s’arrêter dans notre port. Un ancien habitant auquel il adressait ces paroles lui fit observer que peut-être ses préventions s’effaceraient s’il connaissait mieux un pays intéressant sous beaucoup de rapports. Sur ce, pour mettre à profit le temps que le navire devait donner à ses réparations, on proposa une promenade dans les principaux quartiers de la colonie ; la partie fut acceptée ; l’exécution fixée au lendemain.
C’était par une de ces belles matinées du mois d’octobre, si calmes, si fraîches, si suaves sous les tropiques à cette époque. Quelques nuages plus légers que le souffle qui les dirige, épars çà et là dans le ciel, colorés de pourpre et d’opale, se détachaient dans le plus bel azur. Une vapeur plus légère encore flottait en glissant sur la surface des eaux qui, reposées dans le calme de la nuit, présentaient l’aspect d’un vaste miroir. A travers ce brouillard du matin apparaissaient de loin en loin les palétuviers de la rive opposée, la point Tanguy, celle de Macouria, le Mont Mathoury couronné de forêts et de nuages, et dans le lointain les montagnes de Tonnegrande, horizon qui, comme une ceinture verdoyante, entoure la rade de Cayenne et que doraient à peine les premiers rayons du soleil.
Après quelques instants d’attente, nos voyageurs arrivent au rendez-vous sur le grand pont du débarcadère, où se trouvent réunis M. James W… en léger costume de campagne, deux Européens nouvellement arrivés de France, qui profitaient de l’occasion pour visiter notre pays, l’habitant qui leur en faisait les honneurs, et finalement votre serviteur qui, embarqué comme passager pour se rendre à Roura et entraîné dans la suite du voyage, se voit aujourd’hui l’écrivain de la compagnie, dont il se fait un plaisir de consigner ici les observations. Un canot muni d’un tendelet, armé d’un patron et de six noirs vigoureux nous attend au bas de l’escalier du pont. Chacun prend place ; l’équipage plonge les pagayes en mesure pressant l’eau qui jaillit de toutes parts, et le canot s’élance avec la rapidité du trait.
Plus on s’éloigne du rivage, plus la ville de Cayenne se développe aux regards. Nos européens aiment à se retourner en contemplant cet aspect si nouveau pour eux de constructions de tous genres et de toutes couleurs, entremêlées de jardins qui confondent la ville et la campagne ; ces maisons détachées avec lesquelles viennent se grouper, sous mille formes diverses, des arbres affectant un port insolite, le bananier à la verdure étagée, les gracieux
567
panaches du paripou, et le cocotier au tronc élancé chargé sans cesse de grappes fécondes, et la papaye à la tête arrondie, et le bananier aux larges feuillage, précieuse manne d’un sol privilégié. L’américain, fils d’une nation qui n’a dû sa puissance qu’à l’industrie, accoutumé à cet aspect des jeunes cités du Nouveau-Monde, se plaît à reconnaître les établissements publics qu’on lui indique, le magasin-général dont la première fenêtre sert de jalon au pilote pour entrer dans le port, l’arsenal nouvellement construit, l’abattoir dont l’architecture simple et sévère varie avec goût le quartier qui l’avoisine. Il porte surtout les yeux sur les casernes élevées depuis peu d’après les plans et la direction de M. Ronmy, capitaine du génie, habitant de Cayenne, qui se présentent majestueusement sur la rade qu’elles commandent, dans une position aussi salubre que sûre ; monument qui serait remarquable en tout lieu, et dont la masse imposante contraste avec l’aspect pittoresque des maisonnettes entourées de verdure qui montent en amphithéâtre autour du Fort. Il aperçoit avec intérêt les charpentes qui surgissent de la ville nouvelle, signes non équivoques de l’activité de la population ; il remarque les quais nouvellement construits, ceux qui se préparent pour achever de ceindre la ville, depuis le débarcadère jusqu’au canal Laussat ; ouvrage qui assainit les bords de la mer, les assure contre les ravages des raz-de-marée, et que l’aspect des digues dégradées et des rives marécageuses faisait désirer depuis long-tems.
Cependant le canot continue sa marche rapide, et tandis que les voyageurs discourent sur la beauté des rivages de la jeune Amérique, sur l’espoir du long avenir que ses destinées lui préparent, une voix se fait entendre d’abord incertaine et faible, bientôt plus assurée et plus forte, et le reste de l’équipage répond en chœur au chant qui lui donne le signal. Les coups mesurés des pagayes, les accents d’une harmonie sauvage et fortement cadencée animent les pagayeurs, et la barque plus légère et plus prompte, longeant à droite l’habitation Donez qu’annonce sur la rive une longue allée de palmistes de l’Inde, et que couronnent dans le fond le mont des Tigres et le Cabassou, arrive et pénètre dans le canal Fouillé à main d’homme qui joint la rade au Mahury.
En le parcourant on s’étonnait qu’un canal su avantageusement situé ne fût pas plus peuplé, lorsque ses bords se présentent si commodes et si variés pour une foule d’habitations. Plusieurs abatis ont été préparés çà et là, plusieurs carbets s’élèvent et semblent annoncer des projets de culture. On ne peut disconvenir que des établissements en vivres seraient merveilleusement situés pour l’agrément du voisinage de la ville, pour la promptitude des communications par terre et par eau, pour la commodité des transports. Une rencontre imprévue faillit nous arrêter plus long-tems que nous n’aurions voulu. Deux acons chargés de sucre se trouvaient échoués sur la vase, un peu avant la crique Beauregard. La marée n’était pas très-forte, et il paraissait probable que ces embarcations seraient dans le cas d’attendre la nouvelle Lune pour lever la séance, et se rendre dans le port. Chacun ne manqua pas d’observer avec une sagacité peu commune que le canal devrait avoir un peu plus de profondeur ; qu’un chemin de halage sur les bords serait de la plus grande utilité. Trouvant l’occasion de placer quelques paroles, je me hasardai d’ajouter que le projet de l’administration était de donner à cette route, la plus fréquentée et la plus utile de toute la colonie, toutes les convenances que les localités exigeaient.
Heureusement débarrassés de cette fâcheuse rencontre que compliquaient encore cinq ou six canots arrêtés comme nous, nous passâmes rapidement devant la briqueterie de l’Hermitage, d’où s’élevait une fumée épaisse provenant d’un four qu’on venait d’allumer et où plusieurs embarcations venaient à l’envi enlever des monceaux de briques pour mes diverses usines qui se construisent de toute part. Notre Américain témoignait le désir de s’arrêter ; mais après conseil, vu le retard que nous avions éprouvé, nous forçâmes de […] afin d’arriver à Mondélice, où nous étions attendus pour nous mettre à table. On ne trouvera donc pas mauvais que pressé par […], après avoir mis pied à terre, je termine ici ce chapitre, […] recommencer après déjeuner.
568
« Excursion dans l’Atlas. Le prince Pukler Muslaw », Le Moniteur algérien, 13 mars 1834, deuxième page
Le prince Pukler Muskaw que son voyage en Angleterre a placé au rang de nos littérateurs distingués, est depuis quelques temps à Alger où il s’occupe, dit-on du soin de recueillir des matériaux pour la publication d’un ouvrage sur notre colonie. Il vient de faire, dans l’Atlas, une excursion dont les détails remplis d’intérêt sont propres à répandre un nouveau jour sur les mœurs et le caractère des Arabes.
Personne depuis l’occupation n’avait encore pénétré aussi avant dans les terres, et l’on voit avec surprise trois Européens s’avancer, presque sans escorte, au milieu de tribus que l’on supposait plus ou moins hostiles, et en recevoir l’accueil le plus hospitalier. Cette excursion peut contribuer à rectifier nos idées sur un peuple que l’on est disposé à se représenter comme essentiellement vénal, sans aucun sentiment de moralité et de dignité individuelle : c’est sous ce rapport que nous nous sommes déterminés à en publier quelques circonstances qui nous ont été communiquées par M. Harbaïby, officier d’ordonnance de M. le comte d’Erlon, qui avait été autorisé par lui, à accompagner le prince. Nous n’avons d’ailleurs aucun motif de penser que son récit soit empreint de la moindre exagération ou dicté par un esprit de prévention que l’on ne peut supposer ; ce qu’il raconte de l’hospitalité arabe est, au surplus, attesté par les relations de tous les voyageurs ; c’est le trait distinctif du caractère national et on le retrouve dans les momens historiques des tems les plus reculés. M. Habaïby, fils d’un ancien colonel des Mamelucks de la garde impériale est un jeune homme judicieux, doué d’un caractère observateur ; possédant parfaitement la langue Arabe, il était très à portée de recueillir avec fruit les renseignements curieux que nous allons publier.
Le 27 février, le Prince, M. Habaïby et M. Haukman, major au service Belge partirent d’Alger sous l’escorte de quatre Arabes. Ils traversèrent la Mitidja, en se dirigeant vers la tribu de Beni-Moussa qui occupe une partie de la plaine vers son centre et s’étend sur les pentes du Petit-Atlas. Partout leurs regards furent frappés de l’énergie d’une végétation libre, sauvage mais vigoureuse, qui annonce tout ce que l’intelligence de l’homme laborieux peut attendre de ce sol lorsqu’il l’aura fécondé par ses travaux et que les marais qui couvrent quelques parties de sa surface auront été desséchés. Vers le soir ils arrivèrent chez le caïd de la tribu qui leur offrit l’hospitalité. Après un repas modeste mais offert avec cordialité, il les conduisit sous un gourbi (1) dans lequel on avait étendu des nattes et des tapis, pour y passer la nuit.
Le lendemain, ils parcoururent la plaine jusques aux premières rampes de l’Atlas et ils virent avec surprise que tout le territoire qui se prolonge à la base des montagnes est partout cultivé en céréales. Un beau haoutch (ferme) situé dans la plaine et appartenant à un turc de Belida, fixa leur attention ; les jardins étaient plantés de superbes orangers dont les fermiers s’empressèrent de leur présenter les fruits.
Arrivés à midi à Hadrah, ils y furent reçus par les Arabes qui les attendaient avec un déjeuner de couscoussou ; ce repas fut pris sur le gazon au pied de quelques beaux arbres qui couvraient de leur ombrage les cabanes voisines. Ils s’arrêtèrent ensuite au marché de la tribu désignée sous le nom de Souk-el-Arbah (marché du mardi). C’est une campagne isolée, où les Arabes se réunissent toutes les semaines pour faire leurs échanges ; ce lieu est remarquable par sa belle végétation, par son ruisseau limpide et par trois magnifiques palmiers qui s’élancent d’une même souche.
Le caïd de Kachna était venu au-devant des voyageurs, jusques à Hadrah, avec quatre hommes qui devaient les accompagner ; ils parcoururent le territoire de cette tribu et ayant été surpris par une forte pluie ils arrivèrent tard sous le gourbi que le caïd avait fait disposer pour les recevoir.
On servit un souper splendide dont on sera peut-être bien aise de connaître le menu. Le repas se composait de couscoussou, de pilau de mouton, de poulets rôtis, de dolmen (choux farcis avec du riz et des viandes hachées), des œufs en quantité, une espèce de ragoût de mouton avec des amandes, des marrons, et du sucre, du pain arabe, des crêpes ou galettes cuites à la
569
poêle, enfin un plat de viandes préparées avec des œufs, du lait, des artichauts et du jus de citron ; nos voyageurs ne furent point fâchés de faire connaissance avec ce dernier mets qu’ils trouvèrent délicieux. L’on voit que les Grimod de la Reynie, les Brillat-Savarin ont des émules au pied de l’Atlas.
Ce repas tout magnifique qu’il était, eut paru à nos Européens par trop patriarcal, s’il eut été arrosé de l’eau limpide des ruisseaux ; mais le prince y avait prudemment pourvu ; ses cantines chargées sur deux mulets étaient remplies de vins de Bordeaux et de Champagne ; ils ne manquèrent pas pendant tout le voyage ; les Arabes en goûtèrent sans trop se faire prier, l’on but à la santé du Gouverneur et le caïd de Beni-Moussa daigna en accepter gracieusement deux bouteilles. C’est toujours un commencement de civilisation.
Le lendemain l’on fut visiter l’emplacement du marché de la tribu de Kachna qui se tient dans un lieu nommé Souk’el-Jema (marché du vendredi) au pied de l’Atlas et dans une belle situation.
L’on se dirigea ensuite, à travers le Petit-Atlas, vers le mont Hammal, le plus élevé de toute la chaîne d’après les Arabes. C’est cette montagne que l’on voit d’Alger dominer toutes les autres crètes vers le sud-est.
Cette partie de l’Atlas couverte de cultures, de villages, de hameaux répandus dans les vallées et sur les flancs des montagnes, offre des aspects enchanteurs ; en contemplant cette belle contrée, en songeant à l’hospitalité de ses habitans, l’on ne peut s’empêcher de penser que ces vallées ignorées recèlent encore des vertus, que cette terre eut sa période de gloire, qu’elle rappelle de beaux noms et d’illustres souvenirs et que si sa grandeur passée n’existe plus elle peut renaître sous un gouvernement habile qui saurait lui préparer de nouvelles destinées.
Au pied du mont Hammal, l’on voit un immense souterrain : les Arabes y conduisirent le prince et ses compagnons de voyage. Ce souterrain est très vaste ; fort large à son entrée, il se resserre peu à peu et se termine par une issue étroite au haut de la montagne.
Le mont Hammal par sa forme fantastique semble rappeler les allégories dont la fable a embelli l’histoire de ces montagnes ; l’on dirait que la main puissante du géant qui leur donna son nom, cherche encore à les soulever. Son aspect extraordinaire ne présente qu’un amas confus de rochers entassés les uns sur les autres, dans le désordre le plus bizarre ; toute cette masse semble récemment sortie du chaos.
Après avoir laissé le caïd et sa suite au pied de la montagne, les voyageurs résolurent d’en gravir le sommet. Ce ne fut qu’après quatre heures de marche et avec des peines infinies pour franchir les parois des rochers escarpés, qu’ils arrivèrent au terme de leur périlleuse ascension.
Ils étaient parvenus à la moitié de leur trajet, lorsqu’ils aperçurent deux Arabes ; harassés déjà de fatigue, ils leur confièrent leurs fusils chargés à balles ; ces deux hommes prirent ces armes dont ils pouvaient faire un si dangereux usage s’ils avaient eu des intentions hostiles, ils les portèrent jusques au haut de la montagne et, au retour, les restituèrent fidèlement ; et lorsque quelques moments après on les chercha pour leur remettre la récompense qu’ils méritaient ; ils avaient disparu.
Une vallée dont la beauté surpasse tout ce que les voyageurs avaient vu jusqu’alors, s’étend du pied de l’Atlas jusques vers le rivage de la mer dans une étendue d’environ trois lieues de long sur trois quarts de lieue de large. Une végétation brillante d’éclat et de fraîcheur couvre partout un sol heureusement accidenté, et sur lequel on voit errer de toutes parts de nombreux troupeaux de bœufs, de moutons, de chèvres, etc.
Le lion, la panthère, le chacal, sont assez communs dans cette partie de l’Atlas ; ils causent souvent de grands ravages parmi les troupeaux. Cachés le jour dans les interstices des rochers, ils en sortent la nuit pour s’élancer sur leur proie. Les habitants ne redoutent nullement ces animaux qui fuient la présence de l’homme ; ils leur font une guerre continuelle et ordinairement à l’affut. Leurs riches fourrures offrent, en quelque sorte, une compensation des dégâts qu’ils occasionnent.
570
Il y a une quantité immense de ramiers ; le gibier est dans une prodigieuse abondance. Les perdreaux, les lièvres forment une partie de la nourriture des habitants.
Le pays est généralement peu boisé ; l’on voit cependant beaucoup de palmiers, d’oliviers, d’arbousiers, etc. Les aloès et les cactus sont sur leur sol natal ; ils servent ordinairement à clore les héritages.
Les voyageurs firent, dans un hameau, au pied du mont Hammal, une halte de quatre heures chez un Arabe qui leur offrit l’hospitalité et un repas substantiel. Ils quittèrent ce hameau, et déjà ils en étaient éloignés de plus d’une lieue lorsqu’ils virent un Arabe qui couraient après eux en les appelant à grands cris : l’on s’arrêta pour l’attendre. Dès qu’il les eût rejoints, après avoir baisé les pieds et les mains du caïd, il lui fit de touchants reproches de ce qu’il n’était pas descendu chez lui, et il ajouta que puisqu’un autre avait été assez heureux pour le recevoir en son absence, il comptait qu’on ne voudrait pas le priver d’offrir à son tour l’hospitalité pour la nuit ; il suppliait en grâce de vouloir rétrograder, de ne pas lui refuser cet honneur. Le mouton, les poulets étaient tués, disait-il, ses femmes préparaient le couscoussou, l’écurie, l’orge et la paille attendaient les chevaux ; mais malgré le vif désir de se rendre à des vœux exprimés avec tant d’empressement, il fut impossible d’accepter l’hospitalité du bon Arabe, à cause du mauvais temps qui se préparait.
En effet, de retour chez le caïd de Kachna, une pluie continuelle y retint les voyageurs pendant un jour et demi. Enfin le temps s’éclaircit et ils continuèrent leur route en se dirigeant à travers la plaine de la Métidja, vers le cap Matifoux, pour y visiter le fort et les ruines de la colonie romaine de Rostoum.
En traversant la plaine, ils aperçurent sur leur gauche la Rassouta, ancienne ferme du dey ; c’était autrefois le lieu de réunion de ses bestiaux et de ses chevaux ; il y faisait aussi déposer les contributions en nature que lui payaient les beys de la Régence. Lorsque ces denrées étaient en surabondance, il les vendait à crédit aux Arabes, et cet usage pouvait être considéré comme un moyen politique pour conserver son influence sur les tribus.
La contrée qui environne la Rassouta est sans contredit la plus belle, la plus féconde de toute la Métidja ; l’eau y est partout en abondance ; le sol s’étend en douces ondulations qui offrent les expositions les plus favorables pour les cultures les plus variées. Cette ferme appartient au Beylick, c’est-à-dire au domaine, et c’est l’emplacement le plus admirablement disposé pour y créer de belles entreprises rurales.
Aux approches de la mer, la scène change subitement d’aspect. Une zone d’une affreuse stérilité, large d’une à deux lieues, borde partout la plage ; le sol se compose de rochers, de terres arides entremêlées de flaques d’eau stagnantes ; il se couvre de quelques tristes chênes verts et de halliers qui semblent avoir été jetés dans cette solitude pour servir d’asile aux sangliers et aux chacals qui y sont très-nombreux.
En arrivant au cap Matifoux, les voyageurs visitèrent d’abord le fort situé sur une hauteur qui domine les ruines romaines ; il est abandonné et cependant il contient encore vingt-trois pièces de canon de vingt-quatre en fer, dont quelques-uns sont enclouées ; elles sont couchées sur la terrasse de la batterie, les affûts et les ferrements ayant été enlevés par les Arabes. Il y a aussi une grande quantité de boulets. Les bâtiments sont en très-bon état, ils peuvent servir à loger une compagnie.
Les ruines de Rustonium sont très remarquables ; elles occupent un vaste espace et annoncent une grande ville dont la forme était circulaire : quelques édifices composés de demi voutes semblent indiquer d’anciens bains. Il est cependant étonnant que les Romains, si judicieux dans le choix de l’emplacement de leurs colonies aient élevé une ville dont le territoire est si complètement aride et sur une plage où il n’existe point de port, car cette partie de la rade est hérissée de rochers ; l’on peut seulement conjecturer que la main lente du temps ou quelque conflagration subite, ont opéré ce changement dans la disposition actuelle du sol sous-marin et peut-être dans celui du littoral ; enfin une autre circonstance singulière, c’est que les vents
571
d’ouest-nord-ouest soufflent presque constamment dans ces parages avec une violence épouvantable et cette disposition atmosphérique n’a pu changer.
Le cap est très élevé au-dessus du niveau de la mer. Le fort est placé à 50 pieds environ au-dessus de sa pointe septentrionale et les ruines romaines en-dehors du promontoire.
Les voyageurs couchèrent près de la Rassouta chez un Cheik arabe, ancien palefrenier en chef de la ferme du Dey ; ces fonctions de palefrenier n’avaient rien de dégradant, elles étaient au contraire très honorables et très lucratives. Ce Cheik est un homme très remarquable ; ses manières solennelles, son maintien grave, son geste dramatique sont en parfaite harmonie avec sa taille élevée et noblement drapée du burnous, sa physionomie caractéristique, sa barbe noire ; tout cet ensemble en impose et ce grand air de dignité le suit partout, et ce n’est que par un geste qu’il donne des ordres à ses gens.
Il désigna au Prince un Gourbi qui avait été divisé en deux parties, l’une pour les hommes et l’autre pour les chevaux ; la première fut selon l’usage recouverte de nattes et de tapis et le Cheik après avoir fait servir un excellent repas à ses hôtes vint partager leur logement où il passa la nuit avec eux.
Le lendemain, l’on se rendit à la Maison-Carrée à travers les ronces qui couvrent le sol, et de là au fort de l’Eau gardé par Ben-Zegrii avec ses arabes de la tribu des Harribi ; il loge au fort qui est bien entretenu. Les indigènes habitent aux environs sous des tentes de poil de chameau ; ce fut le seul endroit de la route où les voyageurs aperçurent des femmes arabes.
Enfin après une absence de sept jours, passés au milieu des Arabes, ils rentrèrent à Alger le 7 mars.
« Les Nouvellistes algériens, comédie en deux actes et en prose », Le Moniteur algérien, 27 mai 1836, feuilleton
On nous a communiqué une comédie que son auteur se propose de faire représenter sur le théâtre d’Alger, au retour de la saison. Nous profitons de la permission qui nous a été accordée d’insérer dans notre feuille quelques extraits de cette pièce, nous proposant d’en user avec discrétion, afin de ne pas donner au public une connaissance complète anticipée, et diminuer par là le stimulant de curiosité qui attire la foule aux premières représentations.
Les héros de cette comédie sont un certain M. Basile, alarmiste de profession, et un M. Nigaudinos, badaud de Paris chez qui le soleil d’Afrique a développé outre mesure la crédulité et la niaiserie naturelles à ce caractère. L’un crée les nouvelles sinistres, et l’autre les propage ; l’un est le Christophe Colomb, le Newton du genre ; l’autre n’en est que l’homme affiche.
Pour peu que vous fréquentiez la place du Gouvernement, vous avez dû y rencontrer M. Basile, car ce lieu est le centre de ses opérations. Semblable à l’araignée, qui du milieu de sa toile regarde si quelque pauvre mouche ne vient pas donner étourdiment dans ses fils, M. Basile promène les yeux sur toutes les issues par lesquelles la population peut déboucher sur la place, afin de saisir au passage des oreilles complaisantes dans lesquelles il puisse couler mystérieusement la grande nouvelle, et une bouche bénévole qui consente à s’ouvrir, ne fût-ce que pour lui dire bonjour, ce qu’il transformera à deux pas de là en une importante communication qu’il tient d’une personne bien informée.
Une des jouissances les plus vives de M. Basile, c’est d’aller, en tems d’expédition, apprendre à un père, à une femme ou à un frère, que son fils, son mari ou son frère a été tué. Les gens qu’il envoie ainsi dans l’autre monde se portent ordinairement à merveille, et viennent protester en personne contre leur mort anticipée. Mais M. Basile n’en a pas moins eu le plaisir de plonger pendant quelques jours plusieurs familles dans l’inquiétude la plus douloureuse.
Quant à M. Nigaudinos, il vous serait difficile de faire un pas dans la ville sans le coudoyer, lui ou quelqu’un de ses nombreux parents. Mais si vous désirez voir ce personnage dans tout son éclat, c’est encore sur la place du Gouvernement qu’il vous faut aller. C’est là que sa physionomie, ordinairement insignifiante, prend un aspect qui ressemble à une expression quelconque. Cependant ce miracle n’a lieu que lorsqu’il s’est trouvé en contact avec M. Basile.
572
Tel que la bûche à laquelle on n’a pas encore mis le feu, il rappelle tout-à-fait, dans les circonstances ordinaires de la vie, l’inutile lignum du poète latin ; mais qu’un regard de M. Basile vienne à tomber sur lui, qu’une seule des paroles de cet homme supérieur arrive jusqu’à son nerf auditif, et soudain la bûche s’enflamme et la buse disparaît. Malheureusement cette métamorphose n’est pas de longue durée, et elle n’agit d’ailleurs que sur l’extérieur de l’individu ; car pour ce qui est de l’homme interne, c’est toujours Gros Jean comme devant. Si maintenant vous désirez avoir une idée de l’aspect de M. Nigaudinos, lorsque Basile, nouveau Prométhée, lui a lancé son rayon de soleil, nous vous dirons que la meilleure manière de vous en rendre compte, c’est de vous figurer un point d’admiration fait homme. En effet, s’il ouvre alors les yeux, la bouche ou les oreilles (et il les ouvre prodigieusement), c’est toujours pour s’étonner, admirer et s’exclamer.
Maintenant, pour résumer en peu de mots ce qui concerne ces deux individus, nous vous dirons que M. Nigaudinos et ses pareils ne sont que de pauvres sots, et que M. Basile est un insigne… Mais le mot est trop peu parlementaire pour l’imprimer en toutes lettres.
Après avoir initié nos lecteurs au caractère des deux héros de la pièce, nous allons les montrer en action. Nous retranscrivons ici la comédie en question.
Scène VI Le théâtre représente la place du Gouvernement, avec sa population habituelle de
biskeris, d’artistes en fait de cirage, de gamins indigènes et surtout de flâneurs européens. M. Nigaudinos. – Hé ! bonjour, mon cher M. Basile ; il y a une éternité qu’on ne vous a
vu. Hé bien ! qu’avons-nous de neuf ? M. Basile. – Mauvaises nouvelles, M. Nigaudinos ; fort mauvaises nouvelles de France
! M.N. – Ah mon Dieu ! vous m’effrayez ; qu’y a-t-il donc ? quand le courrier est-il arrivé
? M.B. – Le courrier n’est pas arrivé ; on l’a empêché de partir pour qu’on ne sût rien ici. M.N. – Bah ! mais alors comment savez-vous… M.B. – Vous ne comprenez pas ? Un navire du commerce M.N – Ah ! j’entends. Hé bien ? M.B. – Le ministère est changé. M.N – Ah ! M.B. – Une révolte en a été la conséquence. M.N – Oh ! M.B. – La troupe est passée du côté des séditieux. M.N – Hé ? M.B. – Comme j’ai l’honneur de vous le dire. Passant contradicteur (montrant un paquet de journaux) – Vous mentez, Monsieur ; voici
les journaux apportés par le courrier qui arrive, et ils ne disent rien de tout cela. M.B. (quelque peu déconcerté) – C’est étonnant : je tiens cela d’une personne bien
informée, et… Passant contradicteur (en s’en allant) – Misérable imposteur ! Après une pause de quelques minutes, M. Basile, qui s’et un peu remis, reprend le
dialogue. M.B. – Hem ! hem ! avez-vous des nouvelles de l’expédition ? M.N – Non. Est-ce que vous sauriez quelque chose ? M.B. (prenant une expression de physionomie des plus sinistres) – Comment, vous ne
savez pas que ce pauvre colonel… a été tué ?
573
M.N – Hé mon Dieu non ! c’est bien malheureux ; mais aussi il s’expose trop ; cela devait lui arriver.
En ce moment on entend le bruit d’un cheval (le colonel en question est dessus) qui piaffe et se cabre ; M. Nigaudinos regarde de ce côté.
M.N – Hé mais, Dieu me pardonne ? voilà le colonel… ! M.B. – Impossible. Il doit être mort. M.N – Alors c’est son ombre. Ici le cheval ayant fait un écart subit, arrive près de nos deux interlocuteurs et les
renverse l’un sur l’autre. MM. Basile et Nigaudinos se relèvent tout meurtris. Pendant quelques temps ils s’occupent à redonner une forme normale à leurs chapeaux qui, par suite de cette chute, avaient pris l’apparence des couvre-chefs de Robert Macaire et de son fidèle Bertrand.
M.N (reprenant la parole) – Si c’est une ombre, elle peut se vanter d’avoir furieusement de corps. Je suis moulu. Savez-vous, M. Basile, si nous avons perdu beaucoup de monde dans cette expédition ?
M.B. – Immensément. Au reste, j’aperçois une personne très bien informée qui va me donner le chiffre exact. (S’approchant d’un promeneur) Monsieur, pouvez-vous me dire combien nous avons eu d’hommes tués dans la dernière affaire ?
Le promeneur – Quarante-quatre. M.B. (courant à M. Nigaudinos) – Je vous disais bien, que nous avions perdu beaucoup
de monde : quatre cent quarante-quatre tués ! M.N (apercevant un jobard de sa connaissance, court à lui d’un air effaré) – Ah mon
Dieu, M. Bonardin, quatre mille quatre cent quarante-quatre tués ! Le promeneur (tout épouvanté) – Messieurs, Messieurs, j’ai dit quarante-quatre. Sans faire attention aux exclamations du promeneur, MM. Basile et Nigaudinos
parcourent la place à grands pas en criant, à qui veut les entendez, l’un 444, l’autre 4, 444. Nous ne poussons pas plus loin nos citations afin, comme nous l’avons déjà dit en
commençant, de ménager au public le plaisir de la surprise. Nous souhaitons à l’auteur un succès d’enthousiasme ; mais quand nous pensons au
grand nombre de Basiles et surtout de Nigaudinos qui pullulent dans notre ville, nous ne pouvons nous empêcher de redouter une formidable cabale contre sa pièce.
« Le Tombeau de la chrétienne », Le Moniteur algérien, 17 juin 1836, feuilleton (extrait) À l’extrémité ouest de la plaine de la Métidja, sur un des points les plus élevés du Sahel est un monument que les Arabes nomment koubar roumiah, ce qui peut se traduire également par tombeau romain ou tombeau de la chrétienne. Ce dernier nom a prévalu, probablement à cause d’une croix, ou du moins d’une figure qui en présente la forme qu’on remarque sur une pierre droite, isolée du monument. Bien des traditions merveilleuses se rattachent à cet édifice, dont les musulmans évitent de s’approcher. La plus accréditée est que des trésors considérables sont renfermés dans son sein. C’est à cause de cela, sans doute, et aussi pour la forme qu’il présente que les Turcs le désignaient par le nom de Maltapasy, qui veut dire dans leur langue le trésor du pain de sucre. On pense généralement dans le pays que les chrétiens seuls peuvent impunément s’emparer des richesses qu’il contient ; ces croyances forment une légende locale assez curieuse pour que nous la rapportions telle que le capitaine Pelissier la raconte dans ses Annales algériennes :
« Il existait, il y a fort long-tems, dans le pays des Hadjoutes, un homme nommé Jousuf ben Cassem, riche et fort heureux dans son intérieur. Sa femme était douce et belle, et ses enfants étaient robustes et soumis. Cependant comme il était très-vaillant, il voulut aller à la guerre ; mais malgré sa bravoure, il fut pris par les Chrétiens, qui le conduisirent dans leur pays, et le vendirent comme esclave. Quoique son maître le traitât avec assez douceur, son âme était pleine de tristesse, et il versait d’abondantes larmes lorsqu’il songeait à tout ce qu’il avait perdu. Un jour qu’il était employé aux travaux des champs, il se sentit plus abattu qu’à l’ordinaire, et,
574
après avoir terminé sa tâche, il s’assit sous un arbre, et s’abandonna aux plus douloureuses réflexions. « Hélas, se disait-il, pendant que je cultive ici le champ d’un maître, qui est-ce qui cultive les miens ? Que deviennent ma femme et mes enfants ? Suis-je donc condamné à ne plus les revoir, et à mourir dans le pays des infidèles ? » Comme il faisait entendre ces tristes plaintes, il vit venir à lui un homme grave qui portait le costume des savants. Cet homme s’approcha, et lui dit : Arabe, de quelle tribu es-tu ? – Je suis hadjoute, lui répondit Ben Cassem. – En ce cas tu dois connaître le Koubar Roumia. – Si je le connais… Hélas ! ma ferme, où j’ai laissé tous les objets de ma tendresse, n’est qu’à une heure de marche de ce monument.
Serais-tu bien aise de le revoir, et de retourner au milieu des tiens ? Pouvez-vous me le demander ? mais à quoi sert de faire des vœux que rien ne peut
exaucer ? Je le puis moi, répartit le chrétien. Je puis t’ouvrir les portes de ta patrie et te rendre aux
embrassements de ta famille ; mais j’exige pour cela un service : te sens-tu disposé à me le rendre ?
Parlez, il n’est rien que je ne fasse pour sortir de ma malheureuse position, pourvu que vous n’exigiez rien de moi qui puisse compromettre le salut de mon âme.
Sois sans inquiétude à cet égard, dit le chrétien. Voici de quoi il s’agit : je vais de ce pas te racheter à ton maître, et je te fournirai les moyens de te rendre à Alger. Quand tu seras de retour chez toi, tu passeras trois jours à te réjouir avec ta famille et tes amis, et le quatrième tu te rendras auprès de Koubar Roumia ; tu allumeras un petit feu à quelques pas du monument, et tu brûleras dans ce feu le papier que je vais te donner. Tu vois que rien n’est d’une exécution plus facile. Jure de faire ce que je viens de te dire, et je te rends aussitôt à la liberté.
Ben Cassem fit ce que lui demandait le chrétien, qui lui remit un papier couvert de caractères magiques dont il ne put connaître le sens. Le même jour la liberté lui fut rendue, et son bienfaiteur le conduisit dans un port de mer, où il s’embarqua pour Alger. Il ne resta que quelques instants dans cette ville, tant il avait hâte de revoir sa femme et ses enfants, et se rendit le plus promptement possible dans sa tribu.
Je laisse à deviner la joie de sa famille et la sienne, ses amis vinrent aussi se réjouir avec lui, et pendant trois jours son haouche fut plein de visiteurs. Le quatrième jour il se rappela ce qu’il avait promis à son libérateur, et s’achemina au point du jour vers le Koubar Roumia. Là il alluma le feu, et brûla le papier mystérieux ainsi qu’on le lui avait prescrit. À peine la flamme eut-elle dévoré la dernière parcelle de cet écrit, qu’il vit avec une surprise inexprimable des pièces d’or et d’argent sortir par milliers du monument, à travers les pierres. On aurait dit une ruche d’abeilles effrayées par quelque bruit inaccoutumé. Toutes ces pièces, après avoir tourbillonné un instant autour du monument, prenaient la direction du pays des Chrétiens avec une extrême rapidité, et formant une colonne d’une longueur infinie, semblable à plusieurs vois d’étourneaux. Ben Cassem voyait toutes ces richesses passer au-dessus de sa tête : il sautait le plus qu’il pouvait, et cherchait avec ses mains d’en saisir quelques faibles parties. Après s’être épuisé ainsi en vains efforts, il s’avisa d’ôter son burnous, et de le jeter le plus haut possible : cet expédient lui réussit, et il parvint à faire tomber à ses pieds une vingtaine de pièces d’or et une centaine de pièces d’argent. Mais à peine ces pièces eurent-elles touché le sol, qu’il ne sortit plus de pièces nouvelles, et que tout rentra dans l’ordre ordinaire. Ben Cassem ne parla qu’à quelques amis de ce qui lui était arrivé. Cependant cette aventure extraordinaire parvint à la connaissance du Pacha, qui envoya des ouvriers pour démolir le Koubar Roumia, afin de s’emparer des richesses qu’il renfermait encore. Ceux-ci se mirent à l’ouvrage avec beaucoup d’ardeur ; mais au premier coup de marteau, un fantôme, sous la forme d’une femme, parut au haut du tombeau, et s’écria : Aloula ! (1)1 Aloula ! Viens à mon secours, on vient enlever tes trésors ! Aussitôt des cousins énormes, aussi gros que des rats, sortirent du lac et mirent en fuite les ouvriers par leurs cruelles piqûres. Depuis ce temps-là, toutes les tentatives que l’on a faites
1 C’est le nom du lac qui est au pied de la colline où s’élève le monument
575
pour ouvrir le Koubar Roumia ont été infructueuses, et les savants ont déclaré qu’il n’y a qu’un chrétien qui puisse s’emparer des richesses qu’il renferme ».
Après avoir donné à nos lecteurs le côté merveilleux de l’histoire du tombeau de la Chrétienne, nous examinerons dans un dernier temps la partie réellement positive. […]
Le Moniteur algérien, 7 janvier 1837, première page Nous avons déjà fait connaître comment M. Defrance, lieutenant de frégate à bord du
Loiret, était tombé entre les mains des Arabes. Nous allons tâcher de donner une idée de ce qui lui est arrivé et de ce qu’il a vu de plus remarquable pendant son séjour auprès d’Abd-el-Kader. Nous emprunterons autant que possible les paroles de cet officier qui a écrit les faits principaux de sa captivité, ainsi que les observations qu’il a pu recueillir, dans un mémoire qu’on a bien voulu mettre à notre disposition.
Le 12 août, jour où il tomba dans une embuscade d’Arabes, M. Defrance aurait été massacré infailliblement sans un certain Adda qui le reconnut et cria aux autres cavaliers : Ne le tuez pas, c’est un officier, Abd el Kader nous paiera son corps plus cher que sa tête.
Le lendemain 13 août, M. Defrance fut amené devant Abd el Kader, qui le reçut très bien et lui promit que tant qu’il serait avec lui, il n’aurait pas de mauvais traitements à redouter. Il lui parla quelques temps de tous les généraux tant d’Alger que d’Oran et principalement du général Trezel, à qui il garde rancune pour avoir rompu cette paix qui lui était si profitable. L’Emir fit ensuite conduire M. Defrance dans la tente des vivres où se trouvait alors M. Meurice, prisonnier depuis quatre mois. Ce dernier fit par à son nouveau compagnon d’infortunes, des observations qu’il avait faites pendant les quatre mois qu’il avait passés à suivre Abd el Kader dans toutes ses courses. Nous allons en donner la substance.
Les diverses expéditions qui se sont succédées depuis un an, dans la province d’Oran, ont eu pour résultat d’épuiser les ressources d’Abd el Kader et de fatiguer les Arabes et les Kabaïles qui demandent la paix avec instance.
Après le combat de Trara (celui que nous désignons par le nom peu harmonieux de Sikak), l’Emir rentra à Mascara n’ayant que cinquante cavaliers et cent fantassins, tous habitants de la ville. Il trouva la population dans le plus grand désordre à cause d’une contremarche du général Bugeaud, qui avait causé une fausse alarme. Les magasins d’Abd el Kader avaient été pillés dans le tumulte, et ce chef ruiné et abandonné à peu près complètement, ne parvint à se relever un peu qu’à force de subterfuges et de fausses nouvelles répandues de tous côtés. C’est ainsi qu’il fit publier un jour que Madame la Maréchale, son fils, le Colonel Marey et seize passagers avaient péri sur mer. Une autre fois il annonçait une guerre civile en France, la mort du Roi, le retrait d’une partie de nos troupes, etc. Ces moyens qui paraissent misérables au premier abord ont beaucoup plus d’effet sur les Arabes qu’on ne se l’imagine ; et la tendance des français à exagérer les mauvaises nouvelles ou même à en créer est un puissant auxiliaire pour l’Emir qui se contente alors d’exploiter plus ou moins habilement les armes que nous avons la bonhomie de lui fournir contre nous-mêmes.
Lorsqu’Abd el Kader tomba dans le malheur, les Kabaïles de la Tafna refusèrent de laisser passer dans leurs montagnes les convois qui arrivaient, dit-on, d’un pays voisin. L’Emir parvint à les faire revenir sur cette décision qui aurait porté le dernier coup à son pouvoir.
Une note que l’on trouve sur l’agenda de M. Meurice peut expliquer l’importance qu’Abd el Kader attache à conserver les communications libres de ce côté. La voici :
« Le 7 août, il est arrivé un convoi apportant des chemises, des calottes, des souliers, des pantalons et des capotes pour 600 hommes ». Nous aurons occasion de citer quelques autres faits de ce genre.
Nous terminerons cette analyse des observations de M. Meurice, par la description de Drôma ou Ne-Drôma, ville Kabaïle qu’il a habitée quelques temps.
La ville de Drôma est située au bas d’une montagne, dans une petite plaine à cinq lieues des frontières de Maroc, et à deux lieues de la mer d’où on peut l’apercevoir. La montagne qui
576
la domine est couverte de Kermès que l’on vend, dit-on, jusqu’à 500 francs le quintal d’Alger. Le sol est très fertile aux environs de Drôma : les cerisiers, les abricotiers, les figuiers, les jujubiers, les grenadiers et les oliviers y croissent en grande quantité et rapportent d’excellents fruits. Les bestiaux sont nombreux et se vendent à très bas prix : un mouton, deux francs ; une vache, vingt francs et un bœuf trente. C’est de cette ville que les Arabes tirent leurs poteries ainsi que des Kaïks et des Bernous. La laine y vaut 20 francs le quintal d’Alger. L’émigration de plusieurs fabricants de Tlemsen a augmenté l’importance industrielle de Drôma. Mais ce qui rend surtout cette localité un point intéressant, c’est qu’elle se trouve sur le passage de la province d’Oran, dans le Maroc. C’est par ce motif qu’Abd el Kader a toujours cherché à se concilier les Kabaïles de ces montagnes et qu’il a toujours fait les plus grands efforts pour nous empêcher de nous établir de ce côté. Il a craint pendant quelques temps que nous n’occupassions Drôma ; il sentait que la présence d’une garnison dans cette ville empêcherait toute relation avec le pays voisin et le priverait de tous les secours qu’il en attend.
Ici se terminent les remarques faites par M. Meurice et dont il avait fait part à M. Defrance. Dans notre prochain numéro, nous publierons les observations recueillies personnellement par ce dernier.
« Cinq mois de captivité dans l’intérieur de la province d’Oran », Le Moniteur algérien, 13 janvier 1837, troisième page (extrait)
Lorsque M. Defrance fut conduit au camp d’Abd-el-Kader, ce dernier bivouaquait auprès de El Kaala, petite ville située entre Mostaghanem et Mascara, à peu près à moitié chemin de l’une et de l’autre. De hautes montagnes la dominent de tous côtés, et elle n’est défendue que par un petit fort où se trouvent trois pièces de six. La population se compose en majeure partie de Coulouglis, qui ont toujours été disposés à embrasser notre cause. C’est pour ce motif qu’Abd-el-Kader les fit piller. M. Defrance a vu rapporter dans le camp un grand nombre de tapis provenant de cette ville qui jouit d’une certaine célébrité pour ce genre de fabrication. La population s’était retirée dans la montagne.
Il n’est pas sans intérêt de connaître la situation réelle d’Abd-el-Kader que certaines gens s’obstinent à nous représenter comme disposant toujours de puissants moyens d’action. Laissons parler M. Defrance :
« A mon arrivée au camp, nous dit-il, surpris de ne voir qu’une cinquantaine de tentes, toutes plus mauvaises les unes que les autres, je m’empressai de demander à Meurice si c’était là l’armée du Sultan. J’appris alors que son Khalifa campait à trois lieues de Tlemsen, avec des forces à peu près égales ; de sorte que la totalité des troupes régulières de l’Emir s’élève à 250 cavaliers et 500 fantassins, tous dans le dénuement le plus complet ».
Quant à ses finances et à ses forces irrégulières qui consistent en contingents et en dîmes fournis plus ou moins volontairement par les tribus, M. Defrance va nous fournir encore des notions intéressantes sur cet important objet :
« Depuis la plaine de Mostaghanem jusqu’à l’Oued Mina, Abd-el-Kader obtient difficilement le paiement de l’impôt. Il a frappé ces tribus d’une double contribution, parce qu’elles avaient bien reçu le Bey Ibrahim. Celles-ci ne pouvant payer en argent, l’Emir prend des femmes, des nègres et des bestiaux qu’il fait vendre aux enchères dans le camp. Le mécontentement devient général ; plusieurs tribus manifestent l’intention de se placer sous la protection de Mostaghanem ; Abd-el-Kader fait arrêter les principaux chefs et les fait conduire à Mascara la chaîne au cou.
Au commencement de septembre, nous sommes allés camper sur les bords de l’Oued Mina où le pays est peu boisé mais très fertile. Ce déplacement du camp avait pour but de réduire un marabout, oncle d’Abd-el-Kader ; celui-ci méconnaissait son autorité et faisait cause commune avec les Flita et les Ouled Cherif qui refusaient de payer l’impôt. Les tribus situées au confluent de l’Oued Mina et du Chélif, que l’Emir avait forcées de marcher avec son camp, ne fournirent environ que cent cavaliers. La position du sultan était critique ; il savait que s’il
577
commençait la guerre avec ses coreligionnaires il marchait à sa perte. Aussi, plusieurs jours il resta dans l’hésitation, envoyant courrier sur courrier pour engager les insurgés à se soumettre. Mais pendant ces négociations, ses cavaliers désertaient ; ceux qui restèrent furent placés dans l’intérieur du camp. La consternation était peinte sur tous les visages et la défection gagnait jusqu’aux troupes régulières. Enfin, le 10 septembre, Abd el Kader se décida à marcher sur les insurgés et ne laissa qu’un homme par tente pour garder le camp. Les Flita et les Ouled Cherif commencèrent le combat qui dura jusqu’à la nuit. Abd-el-Kader y perdit douze hommes qui furent tués et il eut huit blessés. Quant à lui il rapporta cinq têtes et amena un prisonnier. Ce malheureux eut les pieds et les mains coupés, et fut ensuite brûlé. Quelques femmes et des enfants dont on s’était emparés furent conduits à Mascara ».
Ainsi Abd-el-Kader ne put réussir à réduire ces deux tribus et à en obtenir l’impôt : il lui fallut se retirer et se dédommager d’un échec par un acte d’une atroce cruauté. Nous engageons ceux qui ont fait de cet homme une espèce de héros aussi humain que brave à méditer le fait que nous venons de rapporter d’après le témoignage de M. Defrance.
Depuis la prise de Mascara, l’Emir paraît avoir conçu le projet de se choisir une autre capitale moins à proximité des armes françaises. Les événements militaires qui ont suivi les campagnes de 1835 – 1836 l’ont fortifié dans cette pensée qui vient même de recevoir un commencement d’exécution. C’est à Tekédemta qu’il a résolu d’établir maintenant le siège de sa puissance. Cette ville, ou pour mieux dire ses ruines sont célèbres dans l’histoire romaine (s’il faut en croire Dapper) sous le nom de Césarée. Cette ancienne cité qui confine au Bilduldjerid avait autrefois près de deux milles de circuit, ainsi qu’on pouvait le reconnaître il y a bon nombre d’années par les restes d’un ancien temple très considérable. Elle a été ruinée par les Califes de Carvan, l’an 959, et fut rebâtie par un célèbre Marabout. Elle a renfermé, dit-on, jusqu’à 1300 maisons. Le nom de cette ville, signifie une chose ancienne, une antiquité.
Si Tékédemta fut jadis une cité importante elle est bien éloignée de l’être. Voyons, pour en avoir une idée, la description que nous en donne M. Defrance qui y fut conduit vers la mi-septembre par Abd-el-Kader.
« Tekédemta, dit-il, est une ancienne ville arabe où il ne reste que quelques pans de muraille d’une vieille forteresse (ne seraient-ce pas les ruines du grand temple romain ?). L’Emir m’a dit que les rois qui en avaient fait leur capitale gouvernaient depuis Tunis jusqu’à Maroc et qu’il espérait en bâtissant sur ces ruines leur rendre leur antique splendeur. Il fait édifier une casbah sur l’emplacement de l’ancienne forteresse de laquelle il existe encore quelques tours. Les traces de l’enceinte indiquent pour la ville un périmètre de 1200 pas de longueur sur 900 de largeur ».
Une ancienne citerne voûtée et très-vaste située à environ 150 pas dans l’Est de la Casbah sert de magasin général. Abd-el-Kader y a renfermé ses poudres, plombs, fers et salpêtres. L’ouverture a été fermée et on a bâti dessus un corps-de-Garde.
Tekédemta est à environ 30 lieues dans l’Est-Sud-Est de Mascara et à peu près à la même distance de Miliana. Elle est dominée par de hautes montagnes couvertes de chênes-verts, de frênes, de genévriers, et de lentisques dont la graine fournit beaucoup d’huile. On a établi pour protéger les travailleurs une redoute armée de six canons amenés de Mascara. Ces pièces sont espagnoles pour la plupart et ont été toutes enclouées (par les français en décembre 1835). Leur lumière n’a pas moins de six lignes de diamètre. Une seule est en meilleur état, c’est celle dont Abd el Kader s’est servi dans le combat contre les Flita et que l’on chargeait avec des pierres à défaut de boulet.
Le climat est très froid à Tekédemta ; il y gèle en octobre. Abd el Kader éprouve beaucoup de difficultés à y attirer la population de Mascara. Il n’y a encore qu’une quinzaine de familles qui paient les denrées fort chères, attendu qu’elles viennent d’une demi-journée de marche ».
578
La route de Mascara à Tekédemta suivie par M. Defrance, est belle quoique accidentée. Mais il en existe une autre qui lui fut indiquée par un déserteur et qui est toujours en plaine. […]
« Traduction libre de quelques poésies orientales », Le Moniteur algérien, 8 février 1840, troisième page
« J’entends, au milieu des ténèbres, la voix de ma divine amante : je vole à elle, les bras étendus, pour la presser contre mon sein ; mais la cruelle s’échappe et me laisse enveloppé dans les longs replis de son voile parfumé, dont elle s’est adroitement débarrassée ! Au même instant son riche collier vient à se rompre et les perles roulent, dispersées sur le parquet. Soudain elle se met à rire et s’empresse de les ramasser à la lueur que répandent celles qui ornent sa bouche enchanteresse. »
GHAZZI (Ibrahim-Abou-Ismaïl-il) « On se trompe fort quand on croit que la Fortune est aveugle : elle a au contraire bonne
vue, quoique monocle ; le seul œil dont elle est pourvue se trouve placé au sommet de sa tête, en sorte que lorsqu’elle saisit au hasard l’individu qui rampe à ses pieds, elle est obligée de l’élever au niveau de cet œil pour l’examiner attentivement et juger s’il mérite ou non ses faveurs. Dans le premier cas elle lui continue ; dans le second elle le laisse tomber brusquement à terre, et c’est ce qu’on appelle la Chute des grands. »
Ode morale de SEIFI. « L’astre des nuits semble emprunter son éclat de ton éblouissant visage. La renommée
des belles a sa source dans la fossette de ton menton… Mon âme, prête à s’envoler, soupire sans cesse après ta présence chérie ; elle attend, languissante sur mes lèvres, que tu décides de son sort ! Doit-elle reprendre ses chaînes ou les briser tout-à-fait ? Que donnes-tu ?... Sous l’empire de ton regard vainqueur nul mortel n’a joui d’un instant de calme et de sécurité. Qu’ils se taisent, ceux qui prétendent être insensibles à tes charmes ; leurs transports amoureux ne les trahissent que trop !... Envoi-moi, par le zéphir matinal, une rose de ta joue ; en m’énivrant de son parfum, peut-être me rappellera-t-elle à la vie ! … Le Destin se réveillera-t-il pour moi, aujourd’hui que la source de mes larmes ne saurait plus tarir ?... Mon cœur se consume. O mes amis, appelez celle qui l’a embrasé d’un feu inextinguible ! Dites-lui, quand elle daignera venir vers moi, dites-lui de relever légèrement sa longue robe, car le chemin est inondé du sang des victimes de ses rigueurs… »
GHAZHEK, ou Ode de Hhafezh Chirazi. « Une vallée délicieuse nous a garanti des ardeurs du Midi ; assis à l’ombre de ses
bosquets touffus, qui semblent nous prodiguer les tendres attentions d’une mère envers son enfant qu’elle vient de sevrer, nous étanchons notre soif dans des eaux limpides, aussi agréables au goût que le nectar le plus pur. Des toits de verdure qui se balancent légèrement au-dessus de nos têtes repoussent les rayons du soleil, tandis qu’ils permettent au doux zéphir de s’insinuer à travers leur molle épaisseur pour venir nous caresser. Les cailloux qui brillent au fond et sur les bords fleuris des ruisseaux causent un moment d’erreur et de trouble à la jeune beauté dont ils fixent les regards naïfs : elle les prend pour des joyaux dispersés, et soudain d’une main inquiète et tremblante, elle veut s’assurer si son collier ne s’est pas rompu. »
MENAZI (Abou-Nasser-Ahmed-il)
R. de B., « Type. – Un nouveau débarqué », Le moniteur algérien, 4 juillet 1840, troisième page Le bateau à vapeur de la correspondance l’a déposé sur nos rivages. Il n’est envoyé
d’aucune académie de province, d’aucune association humanitaire ; il n’est même pas
579
orientaliste. Il est tout juste admirateur désintéressé de la belle nature et partisan fanatique de la colonisation. En cette éminente qualité il possède le droit d’étudier l’Afrique sous ses faces les plus pittoresques : le tabac à l’état de cigares, la population à l’état de mauresques, et, brochant sur le tout, la fusion à l’égard des pièces de 5 francs.
Il est facile de concevoir de quelle utilité doit être pour notre belle patrie un homme de cette force qui prétend appliquer son intelligence à l’amélioration d’une chose vaste et intéressante et quel intérêt il doit offrir à la colonie en général et aux restaurants en particulier.
L’ensemble de sa personne décèle tout d’abord les hautes pensées qu’il n’a pas ; un sentiment poétique est empreint sur sa physionomie qui de même que sa tenue est rigoureusement scandinave.
En daignant fouler du pied le sol brûlant d’Afrique son premier regard est aux Biskris chargé de ses bagages ; il demeure frappé de leur marche noble et rapide et surtout de la hardiesse de leur ajustement. Leur burnous sillonné d’honorables trouées et de respectable vermine constitue à ses yeux le beau idéal de l’antique.
Au détour d’une rue, une exclamation lui échappe ; il s’est arrêté devant la boutique d’un marchand de sardines, et la face barbue de l’Israélite lui a retracé les types perdus des personnages de la Bible ; toutefois il trouve que les salaisons de l’Algérien exhalent un parfum peu poétique, mais à cette nuance près le faciès le galbe est en réalité numismatique. Rue du Divan autre exclamation de notre homme qui marche ainsi de barbe en exclamation et d’exclamation en barbe sans trop s’apercevoir que les indigènes sourient passablement dans la leur.
Tant d’émotions le fatiguent ; il sort des murs de la ville au risque de se trouver face à face avec quelque lion de l’Atlas comme cela est arrivé vingt fois à Mad. Ida de St-Elme, la contemporaine, pendant les trois jours qu’elle a profondément étudié Alger. Il ne s’avance donc qu’avec précaution et ne s’aventure guère au-delà des fours à chaux de Bab-el-Oued ou du fort Bab-Azoun. Là encore ce sont extases nouvelles ! c’est un cactus, un aloès puis un palmier devant lesquels il demeure stupide. Il n’est pas jusqu’aux ânes et aux meules de foin qui n’aient le privilège de captiver son inépuisable attention. Le respect qu’il semble professer pour les ânes arrache à ces derniers un cri d’admiration homéopathique.
Nous sommes en hiver et il étouffe ; où est donc votre hiver ? c’est un climat mythologique ! arrière le drap ! le lendemain, en effet, vous le voyez en été quand nous revêtons nos cabans et chaussons nos plus imperméables semelles.
Dévoré d’orientalisme quand même, il songe d’abord à se déguiser en arabe puis à s’enivrer d’opium là où il est inconnu, à se saturer de moka là où l’on ne savoure qu’une désobligeante rinçure de faïence. Dans ses rêves parés des plus vifs rayons du prisme, il se croit transporté dans les harems les plus parfumés ; des odalisques comme Ingres n’a jamais pu en trouver pour ne pas peindre la sienne d’après nature, folâtrent mollement à l’entour de sa couche et caressent sa chevelure d’homme ; ses rêves ont influé sur ses idées ; il ne jure désormais que pipe, turban et minaret. Nos meubles lui font horreur, arrière nos meubles ! une natte et un flambeau rustique, une pipe et une cruche d’eau, voilà le vrai, l’actuel, le seul possible. Puis le ciel a aussi son tour, puis le sol, puis la végétation.
Vous n’avez ici que trois cultures : le café, l’opium, le tabac ; il y a fort peu de temps, il est vrai, que j’étudie la terre d’Afrique mais j’en ai vu assez peu pour avoir des principes parfaitement arrêtés ; ainsi donc : café, tabac, opium. Subsidiairement, quant aux Arabes, je demeure étrangement surpris qu’on les tienne pour des anthropophages. Ce sont les meilleurs gens du monde ; ils mangent, comme on dit, dans la main. Tenez, je vais chaque soir au café arabe de la rue Damfreville, eh bien dans ce même café tout lardé d’arabes des montagnes, j’ai de nombreux amis qui m’y accueillent avec une grâce parfaite : Francis bono, bono Francis, telles sont leurs expressions favorites. Il n’est pas jusqu’au petit arabe qui cire ma chaussure qui ne soit d’une aménité charmante. Or je ne crois pas avoir besoin de vous dire que toutes les variétés indigènes sont étrangement confondues dans sa tête ; c’est une incroyable macédoine.
580
Pour lui une juive est une mauresque ; celle-ci est à son tour une bédouine ; un juif est transformé en arabe. Toutefois son assurance l’abandonne à la vue d’un zouave ; il hésite ; il ne sait trop s’il doit les classer parmi les spahis ou l’insérer dans la catégorie des turcs ou des chasseurs d’Afrique.
Le sublime du progrès colonial est, à ses yeux, le café de la régence ; les cahuttes des faubourgs, ornées d’un fromage de gruyère et de quelques saucisses sont également des éléments et des preuves incontestables de la prospérité du pays.
Pénétré de l’importance de ses investigations et de la profondeur de ses vues, notre touriste désintéressé se hâte d’en composer une relation qu’il enverra à ses amis pour la faire insérer dans le journal du lieu ; mais par bonheur pour son lecteur et par suite d’une bizarrerie naturelle à tous les nouveaux débarqués, il n’a pas confié sa lettre à la poste, c’est trop simple, elle parviendrait ; il a, dit-il, profité d’une occasion sûre et prochaine ; c’est dire qu’elle n’arrivera jamais.
Enfin après s’être annoncé comme amateur désœuvré, chamois intrépide du Mont-Blanc, baigneur encore ruisselant des Eaux de Bade ; après s’être abreuvé aux mamelles des vaches de la vallée de Chamouny, s’être asphyxié aux exhalaisons sulfureuses du Vésuve, notre lion désintéressé horriblement fatigué d’extases et de flâneries orientales, commence à ressentir les premières atteintes du positivisme ; c’est désolant, mais c’est actuel et possible. Il cherche à se désennuyer ; déjà le lustre de ses habits d’Humann s’est étrangement flétri ; la physionomie de son feutre s’est modifiée, toute la tenue en un mot s’est ressenti de la condition hypothétique du propriétaire ; il cherche donc à se distraire utilement ; il accepterait volontiers un emploi gratuit mais non rétribué fi donc ! cependant vous l’obligeriez beaucoup, je vous jure, si vous pouviez lui donner quinze cents francs de traitement, ce serait pour rien, parole d’honneur !
« Un chasseur changé en cerf, ou le nouvel Actéon », L’Akhbar, 10 et 13 février 1842 Les premiers rayons du soleil commençaient à dorer les cimes de l’Atlas, du côté de
l’orient ; déjà, au-dessus du mont Anmal, on devinait l’approche de cet astre aux teintes pourpres dont le paysage commençait à se colorer. Sur toute la Mitidja, se balançait un brouillard d’une blancheur éblouissante, qu’un observateur inexpérimenté eût aisément pris pour une vaste rivière roulant des flots d’argent liquide. L’azur du ciel, d’une pureté inexprimable annonçait une de ces magnifiques et chaudes journées si communes dans l’espèce d’été de la Saint-Jean, qui sépare presque toujours les pluies de l’automne de celles de l’hiver.
M. Duflos, honnête épicier d’Alger, avait l’avantage d’examiner cet admirable spectacle du haut de sa terrasse, vu qu’il joignait aux nombreuses qualités qui distinguent en général sa respectable, celle d’être excessivement matineux, et ne ressemblait ni à moi ni à vous peut-être, ami lecteur, qui n’avons jamais vu se lever le soleil ailleurs que dans le ciel de l’Opéra. Cependant, les idées qui occupaient M. Duflos dans sa profonde contemplation, ne se rattachaient que d’une manière très indirecte au culte de la nature. On va en juger par le monologue suivant, dont nous garantissons l’authenticité.
« La chasse est ouverte depuis deux mois ! tous mes amis, tous mes voisins, tous mes collègues, et jusqu’à Daubru lui-même, malgré son abdomen phénoménal, tous ont saisi l’un après l’autre le fusil à deux coups, endossé la carnassière, et après avoir parcouru les environs d’Alger, depuis l’Harrache jusqu’au cap Caxines, ont rapporté triomphalement du gibier plus ou moins volumineux ; quelques-uns ont eu l’avantage d’apercevoir des Hadjoutes et celui plus grand encore, de ne pas être aperçu par eux ; il en est même un qui, plus favorisé en fait d’émotions, a failli rencontrer une panthère. Et moi, tristement confiné dans un comptoir, où me clouent les détails de mon commerce et les exigences de madame Duflos, je vois mon fusil Lepage et mon chien Pyrame, se rouiller de conserve. Il faut que j’écoute, en rongeant mon frein, les récits merveilleux de ces fortunés chasseurs qui ont eu l’inappréciable avantage de se désaltérer dans les eaux de l’Harrache, ou d’attraper des entorses dans les ravins du Bouzaréah. »
581
Surexcité par cet examen rétrospectif, M. Duflos en était venu à se demander s’il n’enverrait pas promener sa boutique et sa femme, afin de se livrer au moins une fois à un exercice pour lequel il était passionné ; une circonstance, assez indifférente en elle-même, fixa toutes ses incertitudes. Comme il arrive aux individus ordinairement agités par de grandes pensées, notre épicier gesticulait outre mesure ; dans la feu de sa pantomime, la casquette de loutre qui n’abandonnait jamais le chef de son propriétaire, (et cela afin d’éviter à ce dernier le désagrément de consommer, pour son propre usage, la détestable réglisse qu’il vendait fort cher aux bons gendarmes), la casquette protectrice fut lancée au bout de la chambre avec une énergie et une dignité qui rappelaient quelque peu l’action du Grand Condé jetant son bâton de commandement dans les lignes de Fribourg. Pyrame, le chien de M. Duflos, suivait depuis quelques temps avec inquiétude les violentes démonstrations télégraphiques auxquelles se livrait son maître, démonstrations qui contrastaient avec ses manières habituellement graves et posées ; s’élancer sur le loutre de M. Duflos, le saisir avec délicatesse entre les deux mâchoires et venir le déposer humblement aux pieds de son maître, ce fut l’affaire de quelques secondes pour ce quadrupède intelligent. L’épicier, voltairien en apparence, était superstitieux au font comme le sont presque tous ses collègues. Il vit dans cet incident un augure, une espèce d’avis du ciel ; et s’armant de son fusil, de sa carnassière et de son courage, il alla aussitôt se présenter devant le lit conjugal où sa chaste moitié dormait encore de ce profond sommeil qui est l’apanage d’une bonne conscience ou d’une excellente santé. M. Duflos réveilla résolument sa redoutable épouse et lui exposa ses desseins avec une fermeté dont le digne homme était tout surpris lui-même. Il s’attendait à une scène et cherchait déjà dans sa mémoire le passage du code civil que M. le maire lui avait récité le jour de son mariage, il y avait de cela quelque vingt ou vingt-cinq ans, passage duquel il résulte que la femme doit obéissance à son mari ; mais, contre son attente, il n’eut pas besoin de cet effort d’érudition, car Mme Duflos prit la chose avec une douceur toute particulière ; elle souhaita même une bonne chance à son chéri et lui demanda seulement à quelle heure il pensait rentrer au domicile conjugal. Elle ajouta que les dernières neiges ayant fait descendre les lions de l’Atlas dans la plaine, elle espérait bien que son courageux époux lui rapporterait au moins un de ces nobles animaux dont la dépouille servirait à faire une magnifique descente de lit.
Exalté par ce concours de circonstances favorables, M. Duflos s’élança dans la rue qu’il parcourut d’un pas rapide et fier. Lorsqu’il eut dépassé les dernières maisons du faubourg Bab-Aoun, c’était un plaisir de voir avec quel sentiment de jouissance exquise sa poitrine d’épicier se dilatait, aspirant de toute la force de ses vigoureux poumons la fraîche brise de mer qui ridait alors légèrement les eaux de la rade. Pyrame avait peine à suivre son maître dans la vivacité de sa marche, vu qu’il était affligé d’une obésité assez remarquable, fruit d’un long repos et du régime trop substantiel qu’il suivait dans la maison Duflos.
Pendant que l’orgueilleux épicier et son gras quadrupède arpentent à grands pas la route de la Maison-Carrée, nous allons donner la description de ces deux personnages essentiels. L’homme occupant le premier rang dans l’échelle zoologique, nous commencerons par M. Duflos. Cet honnête industriel, véritable type de sa profession, avait cela de caractéristique qu’il n’avait absolument rien de remarquable. Ni grand, ni petit, ni gras ni maigre, ni beau ni laid ; possesseur d’une physionomie que les grandes passions avaient constamment respectée, il eût été difficile de lire son âge sur sa figure ; et sans quelques fils d’argent qui brillaient çà et là au milieu d’une épaisse chevelure, que Mme Duflos, dans ses bons jours, appelait blonde, et que les mauvaises langues accusaient d’être rousse, on eût pu aussi bien le croire jeune que vieux.
Pyrame, bien qu’il n’eût jamais chassé autre part que dans le magasin de M. Duflos et qu’il n’eût jamais rapporté d’autres gibiers que le mouchoir de poche, les pantoufles ou la casquette de loutre de son maître, Pyrame pouvait cependant se vanter d’une noble origine. Il descendait d’une chienne de pure race ; mais soit que celle-ci eût eu quelque indigne faiblesse en amour ou qu’il lui fût arriver de se mésallier, on remarquait dans sa progéniture des caractères qui rappelaient involontairement l’humble mâtin ou même le carlin hargneux ;
582
Pyrame, nous le disons à regret, mais la vérité de l’histoire nous y oblige, Pyrame avait les oreilles d’une rectitude désespérante et sa queue affectait la forme de cette pétrification en spirale que les naturalistes appellent arme d’Ammon, ou, pour parler plus clairement, elle était en trompette.
Je commence la série des événements qui ont fait de cette journée l’époque la plus remarquable de la vie de M. Duflos. Je dois à un heureux hasard la découverte du récit que l’honnête épicier en a écrit lui-même et que dans un moment de distraction il m’a communiqué sans le vouloir, s’étant servi du papier où il se trouvait consigné pour envelopper une livre de sucre que j’achetai modestement dans son magasin. Je laisserai donc parler lui-même le héros de l’aventure ; le lecteur ne pourra qu’y gagner sous le rapport de la vérité et de l’intérêt.
Emploi de mon temps pendant la journée du 15 novembre 1841 Arrivé à la hauteur de Kouba, j’aperçois des alouettes et des étourneaux. Ayant promis
à Mme Duflos de lui rapporter un lion, je ne puis prostituer ma poudre à un gibier microscopique. Malgré les agaceries de Pyrame, je résiste à la tentation et continue ma route. Me trouvant auprès d’une ferme, qu’on appelle Modèle, je ne sais trop pour quoi, vu qu’elle ne paraît pas un modèle à imiter, j’ai tiré trois coups de fusil, malgré ma résolution primitive. C’était sur des lièvres ; mon fusil a raté trois fois, en dépit du proverbe qui assure que le troisième coup fait feu. Ce sera peut-être le quatrième, à moins que les proverbes d’Europe n’aient pas cours en Afrique. La chaleur est atroce ; si je n’ai pas encore de gibier, en revanche je possède un magnifique coup de soleil qui me donnera un aspect martial à ma première garde : j’aurai le faux air d’un troupier qui revient d’expédition. Enfin, un lièvre me part à six pas ; je crains d’abord que mon fusil n’imite pas ce quadrupède, mais cette fois il fait feu. L’animal est touché, car j’ai vu son poil voler sous le coup. Diable de lièvre, le voilà qui passe en furie et se blottit dans un fourré épais. Je m’élance à sa poursuite : les ronces, les cactus, les aloès, semblent s’être ligués pour m’empêcher de saisir ma proie. Je persiste, la sueur inonde tout mon corps, et se mêle au sang que les piqures d’épines font couler de mon pauvre individu. J’appelle Pyrame, ce chien stupide ne comprend pas mon embarras, ni ce que je veux de lui ; ouvrant de grands yeux, absolument comme mes miliciens quand je leur fais un commandement. Je vais à lui, le saisis par les deux oreilles et tâche de le mettre sur la voie : il m’oppose toute la force d’inertie dont il est capable, et s’obstine à ne rien comprendre, je l’abîme de coups de fouets : il va se réfugier dans la broussaille. Désespéré de cette résistance intempestive, je ne prends conseil que de mon courage. Cependant, au lieu de me buter à attaquer la position de front, je la tourne diplomatiquement, cherchant un endroit faible. Je suis sûr d’avoir blessé mon lièvre, et qu’il est blotti dans le fourré. Après un quart d’heure de recherches, j’entends remuer dans les herbes. Ce doit être mon gibier qui se débat ; j’ai encore un coup chargé, je tire au jugé. Damnation ! C’est Pyrame que j’ai frappé, Pyrame, qui cherchant à se rapprocher de moi pour se ménager un raccommodement, était venu dans le fourré ! Le pauvre animal tout sanglant se traîne à mes pieds, me lèche la main et meurt.
Pendant que je me désole, le propriétaire du terrain sur lequel je me trouvais, arrive flanqué de deux chiens monstrueux, et dont les aboiements féroces annoncent les intentions les plus malveillantes à mon égard. Il me reproche le délit dont il prétend que je me suis rendu coupable en pénétrant à travers sa haie ; et, sans pitié pour ma douleur, il m’oblige de lui donner mon nom et mon adresse. Troublé par la mort de mon pauvre Pyrame, fasciné par la présence des deux énormes cerbères qui paraissent vouloir me mettre en pièces, je n’ai pas la présence d’esprit de faire une fausse déclaration. Enfin, cet homme sans pitié s’éloigne avec ses redoutables gardes-du-corps ; je donne un dernier regret à mon pauvre Pyrame et je quitte un lieu qui m’avait été si fatal. Au moment où j’allais retraverser la haie, j’aperçois le lièvre cause de tous mes malheurs, qui se traîne devant moi. Mon fusil est déchargé, mais exaspéré par la fureur, je le saisis au canon et assène au lièvre en question, un coup de crosse à tuer un bœuf.
583
Je ne tue cependant pas le lièvre, qui gagne un taillis tout en boitant ; mais je casse mon fusil Lepage.
Puisqu’il faut renoncer à la chasse, faute de chien et de fusil, je veux du moins utiliser ma sortie en allant visiter un fleuve célèbre qu’on appelle l’Harratche. Tandis que j’examine un lit de sable où il ne manque que de l’eau pour faire une rivière, j’aperçois sur le bord opposé deux cavaliers bédouins qui paraissent étudier mon signalement. Je ne doute pas que ce ne soit des Hadjoutes ; et n’ayant aucune espèce d’arme pour leur livrer combat, je me sauve dans un marais où j’entre jusqu’aux aisselles. Il ne me paraît pas encore assez profond et je crains que mon buste ne soit aperçu par l’ennemi. Pour diminuer cette chance fâcheuse, je jette ma casquette et me courbe de manière à avoir de l’eau jusqu’au niveau de la lèvre inférieure. J’attrape un affreux coup de soleil sur la tête. Les bédouins s’éloignent enfin, je sors du marais en y laissant toutefois les débris de mon fusil, ma casquette, ma carnassière et mes souliers, trop heureux de n’y pas laisser la vie.
À moitié mort de faim, souffrant péniblement de mon double coup de soleil, je prends la route d’Alger et j’arrive chez moi deux heures plus tôt que je ne l’avais promis. J’entre dans la chambre de ma femme. Ô honte ! Ô douleur !... »
Je supprime la fin du récit de M. Duflos, qui raconte en termes trop naïfs pour être reproduits ici, la dernière et grande infortune qui devait couronner cette journée si néfaste pour lui. Je dirais seulement qu’il résulte de la péripétie du récit en question, que cet infortuné chasseur se trouvait comme le célèbre Actéon, transformé en cerf, avec la légère différence que cet accident arriva à Actéon parce que Diane avait été trop chaste, tandis que M. Duflos n’en fut affligé que parce que son épouse ne l’avait pas été assez.
B., Le Moniteur algérien, 10 novembre 1843, troisième page Alger, le Sahel, les Maures, les Arabes, l’ophtalmie, le taux de l’intérêt civil et
commercial, de la disproportion entre le prix d’achat des maisons et celui des loyers. Des destinées probables de l’ancienne régence, des progrès de la colonisation.
(1er article) Madame, Après un voyage de huit jours par terre et quatre jours de la plus heureuse navigation,
m’éveillant vers les cinq heures du soir d’un paisible et long sommeil suite assez ordinaire pour les gens de mon âge d’un bon et long dîner, je montai sur le pont du navire qui me portait en Afrique, et là sur le versant septentrional d’une des collines du Sahel, j’aperçus une ville et cette ville était Alger.
Bâtie en amphithéâtre et d’une forme triangulaire, elle descend du haut de la Casbah ancien palais des Deys jusqu’à la mer à laquelle le plus grand côté de ce triangle est parallèle. Vue magnifique du haut de ces collines, habitations charmantes, air délicieux, sites enchanteurs et surtout cette fraîcheur éternelle où les étrangers vont de temps en temps se dédommager de ces terribles degrés de Réaumur que la comparaison rend encore plus menaçants. Du haut du Sahel l’horizon est borné au nord et à l’occident par la mer et une mer toujours couverte de vaisseaux ; à l’orient et au midi par les montagnes du petit Atlas, à cinquante lieues duquel son frère que j’appelle l’aîné comme le plus grand, cessera probablement bientôt de braver nos soldats. Mais je m’aperçois, Madame, que je commence par où j’aurais dû finir, et le départ précéderait l’arrivée, si je ne craignais que les soins du style et les calculs de la méthode ne vinssent troubler le bonheur pour moi si grand d’oublier quelques instants au B… B…, que probablement je ne le reverrai jamais ; et j’ai la confiance, Madame, que je trouverai dans ce sentiment un titre à votre indulgence.
Ma première rencontre en entrant à Alger a été celle d’une multitude innombrable d’indigènes, et ce que la peinture et les relations des voyageurs m’en avaient appris n’est que l’ombre de ce que j’ai vu. Ces hommes excepté leurs proportions qui sont fort belles sont tout
584
ce que notre espèce peut présenter de plus révoltant. Les uns étaient assis à la turque c’est-à-dire les jambes écartées et sur leurs talons à la porte des maisons, dans tous les carrefours et à tous les coins de rue ; les autres frappaient à coups redoublés sur des ânes succombant déjà sous des fardeaux triples de leurs forces. Leurs vêtements sont hideux ; un bernous ou long manteau blanc à capuchon les couvre ou doit les couvrir de la tête aux pieds, mais ce bernous est loin de répondre à sa destination. Le plus vieux des Arabes l’a porté toute sa vie après en avoir hérité de son père, et cela sans que l’aspect de ces lambeaux aient jamais rappelé à sa mère ni à sa femme qu’elles avaient du fil et des aiguilles. Tous ont et doivent avoir les jambes nues, et la plupart ont les bras de même, attendu que leurs vestes n’ont plus de manches. Ajoutez enfin à une odeur de bouc des myriades de ces insectes que Dieu créa sans doute pour les loisirs toujours si longs des enfants du Prophète, et vous n’aurez encore, Madame, que des fashionnables près des Arabes du désert et des Kabyles des montagnes. Les jeunes ont des figures très peu différentes de celles des autres peuples ; mais celle des vieillards est infiniment plus expressive et plus caractérisée. Il est certain que l’on n’a pas fait poser les plus vilains pour peindre Abraham et Melchisédec ; j’en rencontre bien peu dont je n’aie vu le portrait dans les gravures de la Bible. Les Maures, ces descendants des vainqueurs de l’Espagne sont tous des hommes superbes. Leur physionomie, leur regard et toute leur attitude sont d’une fierté et d’une dignité qui étonnent, et ceux qui par leur fortune ont joui d’une grande indépendance deviennent encore plus majestueux. Quant aux Dames Maures vous allez savoir, Madame, pourquoi il me serait plus difficile de m’exprimer sur ce qui les concerne.
Je ne sais quelles capitulations ont été faites avec le Dey d’Alger lors de la conquête ; mais ce qu’il y a de remarquable c’est que les indigènes sont jugés en matière civile par le Cadi, et que ce Cadi leur fait de temps en temps administrer sur la plante des pieds des coups de bâton à tuer dix Français, sans que le patient paraisse se rappeler le lendemain de ce qui lui a été fait la veille. Mais je suis forcé de quitter la plume, Madame, voici le vent du midi et j’ajourne la suite de ma lettre au retour de celui du nord ; lui seul peut me rendre la force d’écrire et de penser.
Le 21 octobre, Voici la bise revenue, Madame, et si en me rapportant mes idées elle pouvait aussi me
parler un peu des habitants du B. B. elle serait encore mille fois mieux accueillie. Elle a passé par votre habitation charmante, elle a salué ses maîtres et c’est un bonheur que je n’aurai plus. Je chargerai le premier vent du Désert partant pour vos contrées, Madame, de vous dire mes regrets.
La ville d’Alger se divise en deux parties, la ville haute et la ville basse. La première qui est la plus grande et la plus peuplée n’est pour ainsi dire habitée que par des Maures. Il est impossible d’entrer dans leurs maisons ; et la police même ne pourrait y pénétrer qu’en cas de réclamation venant de l’intérieur ou sur la notoriété de crimes éclatants. Ils reçoivent même très difficilement leurs amis et leurs voisins qui les appellent du dehors ; et on doit juger par là que c’est moins à la différence des religions qu’à la jalousie que doivent être attribués la solitude et le mystère de ces manoirs. Leurs femmes et leurs filles ne sortent jamais que voilées, et cet usage me paraît infiniment dangereux. Des malfaiteurs trouvant à prix d’argent un asile dans ces maisons circuleraient pendant dix ans dans la ville sans être arrêtés ; ils s’embarqueraient sans aucune investigation pour la France ou l’Etranger, ces Dames ne permettant pas même de soulever leur voile pour prendre leur signalement. Mais, dans l’alternative de deux inconvénients le moindre doit être préféré. Si l’autorité ordonnait la chute de ces masques, la guerre d’Abd-el-Kader qui n’est encore que sainte deviendrait bientôt sacrée ; or l’époque est passée où toutes les colonies devaient périr avant un seul principe, et c’est celui de la prospérité de l’Algérie qui doit triompher.
585
H. Vignerte, « Revue et chronique de Saint-Pierre », Les Antilles, 18 et 22 novembre 1843 (extraits)
Le Courrier de la Martinique qui nous parvient aujourd’hui contient un feuilleton que nous nous faisons un plaisir de reproduire : Par pari refertur.
Revue et chronique de Saint-Pierre En attendant que les colonnes de votre estimable journal s’ouvrent pour la publication
de quelqu’intéressant feuilleton de nos grands écrivains de la presse parisienne, je viens vous prier de les mettre aujourd’hui à ma disposition. La prose poétique de nos princes littéraires sera remplacée par mon français barbare. Vos lecteurs perdront beaucoup au change ; mais je viens leur parler un peu de notre bonne ville de Saint-Pierre, dont on ne s’occupe pas assez souvent, et qui mérite pourtant bien de fixer leur attention. Si nous l’oublions quelquefois, ce n’est pas par ingratitude : elle est digne de toute notre sollicitude. J’ai compté sur la généreuse indulgence de vos abonnés. Ils ont eu le courage de lire les vers tudesques et la prose othaïtienne de nos poètes et de nos faiseurs coloniaux : ils feront encore un effort en ma faveur ; ils voudront bien s’armer de courage, et de patience surtout, pour lire cette Revue, que je n’ai pas la prétention de leur livrer comme le morceau de littérature le plus brillant que la Presse coloniale ait publié depuis dix ans2. Ce n’est pas non plus un discours qui, tombant du haut d’une tribune, émerveillerait tout un auditoire3. Je laisse à d’autres le soin de prendre leur Phébus pour de la brillante littérature et se croire des Berryer et des Lamartine. Dieu merci, je ne suis pas écrivain, pas même poète. A la Martinique, c’est une triste recommandation que celle de poète, surtout poète comme M*** M*** M***. Le mot poète est ici synonyme de Cireur : ensuite un des désagréments de cette peu lucrative profession, c’est que ceux qui l’exercent sont exposés à voir le public baver sur leur robe4… de chambre sans doute, car nous ne leur en présumons pas d’autre : ce qui est fort sale. J’écris seulement pour m’amuser, et… pour ennuyer les autres, me direz-vous ; mais non, vous êtes trop poli pour me le dire, vous vous contenterez de le penser. Ensuite, j’ai cru que vos lecteurs seraient bien aises de connaître la Chronique de Saint-Pierre. C’est ce qui m’a décidé à prendre la plume.
Mais avant de vous montrer Saint-Pierre, de vous mettre au courant de ses cancans, de son bavardage, des nouvelles du jour, enfin de tout ce qui constitue la vie publique et animée d’une ville, il est indispensable de choisir un endroit convenable, d’où, bien placés, nous pourrons promener nos regards sur le vaste et mouvant panorama qu’elle présente, et où les bruits de la populeuse cité ne viendront pas me troubler dans les petites narrations que je veux vous faire.
Je n’irai pas me placer en vedette sur les hauteurs de la Montagne pelée. C’est un peu trop élevé. Je suis très myope, très frileux, peu cavalier, et je n’aime pas à marcher. J’en suis fâché : car un honorable confrère donne la permission de s’y mettre. Il engage à venir prendre part aux curieuses observations astronomiques qu’il se propose de faire le 12 de ce mois sur la physique céleste. On doit être touché de cette aimable attention, et lui en adresser ici de bien sincères remerciements. Si jamais je me décide à faire une étude sur les étoiles filantes, alors peut-être prendrai-je la peine de faire le trajet de la Montagne pelée et de gravir quelques marches de cet escalier des géants ; mais je ne suis pas du tout curieux de voir filer des étoiles. C’est un spectacle sans doute fort joli, mais que j’abandonne volontiers aux inamovibles habitués du banc de craques de la savane du Fort-Royal, aux badauds et aux gobemouches de toutes les promenades de la Martinique, et à l’existence duquel je suis forcé de ne pas croire,
2 Voyez le Journal officiel de la Martinique du 16 août 1843 ; vous y trouverez une lettre incroyable écrite
par un M. M. et T. à un M. Louis de B. 3 Id. id. id. id. 4 Voyez le Journal Officiel de la Martinique du 16 août.
586
surtout si l’astronome qui a fait cette intéressante découverte est le même qui, au mois de mars de cette année, prenant l’étoile de Vénus pour… un BALLON !!!! (historique), ou si c’est celui qui faisait bravement mourir Horatius Coclès à la bataille de Marathon (historique). Vous concevrez maintenant, Monsieur, mon peu de curiosité d’aller voir les phénomènes célestes annoncés par des astronomes et des historiens de cette force, qui pourraient fort bien avoir pris une pluie d’étoiles quelques fusées ou chandelles romaines : avec un peu d’imagination et de bonne volonté, on croit tout ce que l’on veut, mais le difficile est de faire croire aux autres.
Je n’irai pas non plus me mettre à la Batterie d’Esnotz ; car j’ignore si la police a ramassé et fait mettre en fourrière les fourmis vagabondes qui se promènent le soir sans billets et sans lanternes (c’est un journal qui nous apprend ces jolies choses) et qui avalent, absorbent les flâneurs habituels de cette triste promenade qu’affectionnent particulièrement les fashionables nocturnes de la ville de Saint-Pierre. Voilà un problème que les savants futurs auront plus de peine à résoudre que celui de l’ingurgitation de Jonas par la baleine asiatique. Ensuite l’astronome dont je vous ai déjà parlé (celui qui prend une étoile pour un ballon), ou le savant historien (celui qui fait mourir Horatius Coclès à Marathon) y a déjà sans doute planté son observatoire pour suivre la marche des cailloux enflammés et les compter s’il le peut. (Numera stellas, si potes).
Ainsi donc, comme vous n’avez pas plus envie que moi de faire un cours d’astronomie sous de pareils professeurs, nous n’irons pas cette fois-ci fouler les sentiers fleuris du Morne-Pelé, où le gramen étale les verdoyants tapis d’un gazon éternel et répand les suaves émanations de ses arbustes odorants. Nous abandonnerons aussi discrètement la Batterie d’Estnotz à l’Arago colonial, afin de ne pas le troubler dans ses calculs astronomiques, et vous me suivrez sur les magnifiques plateaux du Trou-Vaillant, ou du Morne-d’Orange.
Là, vous jouirez du spectacle ravissant de Saint-Pierre ; vous respirerez un air pur et vivifiant ; les brises embaumées qui parcourent les vastes champs de cannes vous apporteront les senteurs parfumées qui arrivent des grands bois, et dilateront vos poumons comprimés par l’air vicié de la ville. Au bien-être physique se joint le plaisir moral. Ici votre âme s’agrandit : vous éprouvez des sensations indéfinissables, en contemplant cette nature riche et animée, en parcourant du regard les champs de cannes et le café qui vous environnent, en admirant cette végétation luxuriante et échevelée, ces fleurs aux couleurs vives et tranchées : vous énumérez ces trésors infinis que Dieu dans sa munificence a prodigués sur cette terre comme une compensation des maux inouïs et des catastrophes horribles qui en bouleversent trop souvent la face. Le Ciel étale sur votre tête les splendeurs de sa coupole d’azur, que son divin architecte semble avoir taillé dans un immense saphir5. Ici tout est calme : votre solitude n’est troublée que par le gémissement du vent qui soupire à travers les feuillages des grands arbres, ou qui fait frissonner les feuilles panachées des cannes : les bruits de la ville, aux fétides émanations n’arrivent pas jusqu’à vous. Vous êtes absorbé par l’imposante beauté du spectacle grandiose qui se déroule près de vous et sous vos yeux comme la vaste toile d’un panorama : vous êtes délivré des sombres préoccupations de la vie matérielle. Le monde est là où vous êtes. Votre vue se porte au loin sur le Morne-Pelé, qui vous apparaît comme un colossal géant couché, qui se repose de ses fatigues : ses flancs arides toujours couverts de nuages semblent une grève sur laquelle roulent incessamment des flots d’argent. A vos pieds, Saint-Pierre bruyant et livré à toutes les passions, à tous les vices des modernes Babylones, étend le vaste échiquier de ses maisons et de ses rues, qui se dessinent à vos regards comme les cases d’un immense damier ; un peu plus loin la rade avec ses navires immobiles comme des mouettes reposées, et qui ressemblent à des mouches collées sur une glace de Venise : pour faire cadre au tableau, la mer
5 Victor Hugo, Ombres et rayons.
D’une seule vertu Dieu fit le cœur du juste,
Comme d’un seul saphir la coupole du Ciel.
587
calme, unie, bleue, mais transparente, déroule devant vous les plaines scintillantes de son incommensurable horizon sur lequel se dessine vaguement la silhouette blanchâtre d’un bâtiment à voile, ou le noir panache de fumée d’un paquebot anglais que dorent les rayons étincelants du beau soleil des tropiques.
Mais pendant que notre confrère l’astronome (celui qui prend des étoiles pour des ballons) ou l’historien (celui qui fait mourir Horatius Coclès à Marathon) dresse son télescope, nettoie ses lentilles, tend le cou, ouvre l’œil, et cherche à lire un des feuillets du grand livre mystérieux de la nature nous regarderons à nos pieds et nous jetterons les yeux sur la ville.
Je ne sais si vous êtes comme moi, mais j’aime beaucoup Saint-Pierre, j’aime ses habitants généreux et bons chez lesquels l’hospitalité la plus franche se joint toujours à une intelligence cultivée, à une grande probité et à une bonté cordiale : je l’aime aussi parce qu’il me rappelle Paris, son bruit, son mouvement, ses joies et ses misères. Oui, j’aime Saint-Pierre, je prends un plaisir infini à le contempler nonchalamment étendu sur le rivage de sa mer d’azur aux pointillements diamantés, comme une odalisque qui s’apprête à prendre son bain de parfum, et qui folâtre et semble jouer avec les perles des vagues écumeuses qui viennent la caresser de leurs voluptueux baisers. Saint-Pierre fait l’envie des étrangers, la vie y est douce et paisible, et c’est la seule ville des colonies dont les femmes jouissent d’une réputation de beauté bien acquise. Elles y sont ravissantes de grâces, de tournure et d’élégance. Leur luxe quoique très riche est simple, leur mise, quelquefois bizarre, souvent de très bon goût, est toujours bien entendue. La démarche de la créole de Saint-Pierre et de la Martiniquaise en général est aisée, molle et langoureuse : elle se traîne dans un doux laisser-aller, son pied invisible, dont la petitesse ferait le désespoir d’une Chinoise, semble effleurer plutôt que se poser sur le pavé ; son esprit est fin, incisif, agréable : c’est le pétillement du vin de champagne qui se répand en mousse brillante et intarissable ; sa bonté… tous les malheureux qui l’implorent sont consolés. Que d’infortunés elle soulage dans l’ombre et qui ignorent la main bienfaisante qui les secourt ! Elle compatit à toutes les misères. Combien de pauvres artistes dénués de ressources ont pu regagner la France, grâce aux suaves accents de sa voix généreuse. Mais silence ! elle n’aime pas qu’on divulgue ses bienfaits.
Mais si j’ai à féliciter mes compatriotes de leur bienveillant concours pour le soulagement des grandes infortunes, comme mon enthousiasme s’amoindrit quand je viens à songer à leur ingratitude pour les poètes qui vivent parmi eux : hélas ! ils sont méconnus par leur ingrate patrie !... Mais ils savent depuis longtemps que nul n’est prophète… je veux dire que poète dans son pays ; aussi comptent-ils sur la postérité plus juste de leurs contemporains pour consacrer leur réputation et entourer leurs noms d’une auréole de gloire. Ils ont passé pendant leur vie, comme des baguettes de fusée après un feu d’artifice obscurs et inaperçus : après leur mort, ce sont des soleils de science, des comètes de génie. Ici les poètes sont incompris. Saint-Pierre est pour ses grands hommes une mer orageuse sur laquelle leur barque, sans cesse ballottée par les flots de l’envie ne peut atteindre le sommet du phare qu’on appelle la célébrité6. La société, cette stupide société, qui ne parle que la langue française, ne peut les comprendre et n’a pour eux que des sourires de marbre et des dents de fer7. Quelle barbarie ! quelle ignorance ! Aussi au séjour de la ville préfèrent-ils les sentiers fleuris où l’on trouve de doux rêves, dans le bruit de l’eau, dans le parfum des plantes, dans les rayons du soleil, sous des arbres touffus8 qui bordent cette route au bout de laquelle se trouve ce bel arbre aux rameaux d’or9 destiné à préserver leur précieux talent, qui est une cible incessamment percée
6 Voyez le Journal officiel de la Martinique du 16 août 1843. 7 Id. id. id. id. 8 Id. id. id. id. 9 Voyez le Journal officiel de la Martinique du 16 août 1843.
588
des flèches de l’envie10. En effet, jugez-en par vous-même : voyez si ce n’est pas le comble de l’injustice, et s’il ne faut pas être possédé du démon de la jalousie et de l’envie pour ne pas rendre justice à des vers comme ceux-ci :
Les poètes un jour seront faits anges A la droite de Dieu ; Ils chanteront en des hymnes étranges Son nom brillant de feu. Qu’en pensez-vous ? au moins celui-là se console en songeant au bonheur qui l’attend
dans un monde meilleur. Mais lisez ceux-ci : O mort………….. Déjà tu me disais, riant de mes angoisses. Parions ton heure sonne, il faut que tu te presses. Mais de Dieu suscité, soudain Aubry paraît Et, fameux en son art, confond ton noir projet Admirez le luxe oriental de ces rimes !!!!! Mais voici pour le bouquet : Au sommet de l’Atlas il marchait sur la tête, S’écriait un poète colonial en rappelant les exploits de l’infortuné duc d’Orléans. Aussi engageons-nous fortement notre conseil municipal à voter les fonds nécessaires
pour l’érection d’un Panthéon destiné à recevoir la cendre de nos grands hommes. Mais en attendant que notre édilité prenne cette sage décision, vous serez peut-être bien aise d’être au courant des travaux plus importants qu’elle fait exécuter, des embellissements qu’elle projette, et des améliorations utiles qu’elle se propose d’apporter dans l’administration de la ville que les suffrages des citoyens lui ont confiée. Partout se font déjà sentir les bienfaits d’une municipalité sage et intelligente. Les rues de la ville sont libres de tout encombrement et débarrassées de ce tas de caisses et de cuisines en plein air, qui en rendaient l’aspect si désagréable, affectaient l’odorat de nauséabondes odeurs, et rendaient superflus les abat-vents sous lesquels il était impossible au piéton surpris par une averse de s’aventurer sans exposer son Elboeuf ou son paletot à une foule de désagréments dont le moindre était ou d’en laisser un pan accroché à quelque clou ou à essuyer la casserole graisseuse de nos Véry populaires. La Place de l’Hôpital, où figurait depuis trop longtemps une ignoble masse de pierres, décorée du nom pompeux de fontaine, parce que trois ou quatre minces filets d’eau s’en échappaient, présenter bientôt un nouvel aspect : une fontaine véritable, d’une architecture moderne se construit en ce moment, et est destinée à remplacer la construction caraïbe de l’ancienne case à eau ; elle s’élèvera au milieu d’un vaste bassin pouvant contenir plusieurs tonneaux d’eau, précaution utile pour les cas d’incendie, et sera plus en harmonie et contrastera d’une manière plus agréable avec les belles maisons environnantes qui font déjà de ce quartier un des endroits les plus remarquables de notre ville. Les deux marchés du Fort et du Mouillage, qui, jusqu’à présent ne sont que d’infects cloaques, seront bientôt couverts de belles et vastes constructions, destinées aux bouchers, aux marchandes de poissons, enfin à tous ceux qui vendent les denrées nécessaires aux besoins alimentaires de la ville ; des mesures sages sont prises pour empêcher leur envahissement par cette foule de revendeurs qui accaparaient toutes les provisions pour les livrer ensuite aux citoyens à des prix exorbitants. La police, jadis une fiction, sera désormais une vérité ; elle a déjà reçu une forte et vigoureuse organisation ; espérons que son zèle et sa
10 Id. id. id. id.
589
vigilance empêcheront ou du moins rendront moins fréquents ces vols audacieux que les malfaiteurs qui s’en rendent coupables commettent presque toujours au détriment de la classe pauvre et laborieuse. Deux nouveaux dépôts de pompes, que l’étendue de la ville rendait indispensables, sont déjà désignés, l’un pour la rue de l’Hôpital, à proximité du greffe, et l’autre au centre de ces quartiers populeux du Port. Des pompes nouvelles et dont on passera souvent une minutieuse inspection remplaceront les anciennes qui ne pouvaient plus fonctionner, et depuis longtemps abandonnées aux soins d’un gardien négligent. Les parapets de nos ponts et de nos quais qui partout menaçaient ruine et n’existaient pas en beaucoup d’endroits, vont être reconstruits, et recevront une nouvelle solidité afin de pouvoir contenir les débordements de la rivière et préserver les piétons et surtout les cavaliers des dangers et des accidents heureusement fort rares qui ne pourraient manquer d’arriver. Notre théâtre, ce beau monument qu’un coupable abandon laissait dépérir, reçoit maintenant de nombreuses et plus solides réparations que celles que la négligence et l’ineptie y avait faites : son intérieur est approprié ; les peintures ou plutôt les sales badigeons qui en couvraient les murs, les frises et le plafond, seront effacés et offriront à l’œil des spectateurs des décorations plus en rapport avec sa belle architecture et les brillantes toilettes de la nombreuse société qui ne peut manquer de se presser dans sa magnifique enceinte, si les merveilles que l’on dit de la nouvelle troupe qui nous arrive se réalisent.
[…]
Le Moniteur algérien, 5 février 1844, deuxième page Eh ! Où allez-vous donc, mon cher, demandai-je, il y a quelques années, à un de mes
amis, au moment où il montait à cheval pour aller trouver El Hadj Abd-el-Kader, dont le traité de la Tafna venait de faire un vassal soumis de la France.
Ma foi, me répondit-il, je veux travailler aussi au grand œuvre de la civilisation ; je gémis de vivre au XIXème siècle à côté de peuplades aussi barbares et aussi sauvages que le sont ces malheureux Arabes, pour le bonheur desquels la Providence a amené les Français sur la terre d’Afrique.
Je vais offrir mes services à cet Emir, fanatique ignorant, que le hasard a mis à la tête du peuple arabe, et je tâcherai de lui faire comprendre les bienfaits de notre civilisation, et l’avantage immense qu’il obtiendra s’il veut s’associer à nos idées de progrès, de sciences et de lumières.
J’arrivais de France, je croyais, comme on le croit dans mon pays, que les Arabes étaient barbares, sauvages, ignorants, malheureux ; je les plaignais de vivre dans une société sans ordre, sans organisation, et je souhaitai un bon voyage à mon apprenti civilisateur, en le louant de cette généreuse résolution.
Je publie ici deux lettres de mon jeune voyageur qui donneront une idée de l’ignorance du chef arabe qu’il allait civiliser, et de l’état de misère et de barbarie dans lequel vivent ces sauvages Arabes.
1ère lettre Camp de Sour-el-Ghozlan (près les Ouennogha), le 19 novembre 1837 « Vous avez vu sans doute chez tous les marchands d’estampes une lithographie qui
représente un mulâtre à la face cruelle et au regard sanguinaire, couvert de riches vêtements et de riches armes ; vous avez lu au bas : Abd-el-Kader, et dès-lors, vous et moi et toute la France, nous nous sommes fait une idée de ce chef arabe. Jugez donc de mon étonnement par le portrait que je vais vous tracer de l’Emir, auquel j’ai été présenté et que je vois chaque jour depuis un mois :
Son teint est blanc, il est d’un pâle mat ; son front est large et haut ; des sourcils noirs et bien arqués surmontent deux grands yeux bleus bordés de cils noirs et remplis de cette humilité que donne à l’œil tant de brillant et de douceur ; son nez est bien fait et légèrement aquilin ; ses lèvres minces sans être pincées ; sa barbe noire fournie sans être épaisse, courte, et se terminant
590
en pointe ; sa face ovale ; un petit signe de tatouage entre les deux sourcils relève la pureté de son front ; ses mains maigres et petites sont remarquablement blanches ; une d’elles est presque toujours appuyée sur son pied, qui ne le cède en rien par ses proportions et sa blancheur.
Sa taille n’excède pas 5 pieds et quelques lignes, mais il est fortement constitué. Quelques tours d’une petite corde de poils de chameau fixant autour de sa tête un haik
de laine fine et blanche, une chemise en coton, une tunique de même étoffe, un burnous blanc et un burnous brun, voilà tout son costume.
Il tient toujours un petit chapelet noir dans la main droite, il l’égrène avec rapidité, et lorsqu’il écoute, sa bouche prononce toujours les paroles consacrées à ce genre de prières.
Si un artiste voulait peintre un de ces moines du Moyen-Age qui étaient animés par les idées sublimes de la religion et par le courage qui leur faisait souvent prendre les armes pour la défense de cette religion, il ne pourrait prendre un plus beau modèle.
De même qu’on est trompé sur son physique, on s’est trompé sur son moral. Il est instruit, il est clément, du moins il feint la clémence ; il a soulevé les Arabes au
nom de la religion, ce mobile puissant qui remue les empires. Il veut ramener les Musulmans aux institutions de Mohammed. Son gouvernement a la forme des gouvernements des anciens khalifas conquérants de l’Afrique. Son code et sa charte, c’est le Koran.
Il a partagé le pays dont nous lui avons abandonné la souveraineté en huit provinces ; il a choisi dans chaque province et dans son aristocratie la plus remarquable par son influence spirituelle et temporelle, l’homme le plus intelligent et le plus ambitieux, il l’a nommé chef de cette province, et lui a donné le titre de Khalifa.
Il a divisé chaque khalifat en trois, quatre ou cinq aghalics, et chaque aghalic est composé d’un nombre de tribus qui varie suivant leur importance ; chaque tribu est commandée par un kaïd.
L’impôt est perçu par les Aghas et les Kaïds, pour être versé dans les caisses du Khalifa. Tous les six mois, celui-ci représente à l’Emir un registre où sont consignées ses recettes et ses dépenses. Le surplus est versé dans le Trésor pour payer l’armée régulière et subvenir aux dépenses de l’Etat.
Abd-el-Kader se donne les titres suivants : Emir El Mouminin, Nadhyr Bit el Mel, El Moudjehed fi sebtil lila, Kalifat Moulai-Abd-
el-Rahman, Sultan el Ghorb. Prince des croyants, Inspecteur du Trésor de l’Etat, Guerrier dans la voie du Seigneur,
Khalifa du Moulai-Abd-el-Rahman, Empereur de l’Ouest. Voulez-vous avoir une idée de sa politique, écoutez : Abd-el-Kader soutenait depuis trois ans une lutte inégale contre la France. La dernière
campagne, pendant laquelle l’infatigable habileté du général Bugeaud l’avait constamment poursuivi et battu, venait de le mettre aux abois. Son trésor était épuisé, son armée régulière décimée et démoralisée, et sa domination singulièrement restreinte ; un grand nombre de tribus s’étaient révoltées. Le Kabla et tout le Cherg méconnaissaient son autorité ; il n’avait plus pour lui que les tribus de la province d’Oran, et encore quelques-uns hésitaient. Les impôts ne rentraient plus dans ses caisses, sa position devenait de plus en plus difficile ; il le sent, il fait tout pour obtenir la paix que des circonstances impérieuses forcent le Général à accepter ; le traité de la Tafna est signé, et Abd-el-Kader entrevoit un brillant avenir.
Nous, Français, éclairés et civilisés, nous ne tirons aucun parti de ce traité ; nous nous confions dans la bonne foi des Arabes, et nous nous renfermons avec la plus grande sécurité dans nos limites que nous ne cherchons pas même à bien connaître.
Lui, Arabe, ignorant et barbare, ne perd pas un instant, et ne considère cette paix que comme une trêve pendant laquelle il doit mieux se préparer à la guerre.
Il se garde bien de donner connaissance aux Arabes de la teneur du traité ; il ne leur en laisse apprendre que ce qui peut le servir dans l’exécution de ses projets.
591
Il augmente son trésor avec les impôts arriérés qu’il se fait payer immédiatement par les tribus qui lui sont restées soumises. Il recrute son armée de fantassins et de cavaliers, il appelle tous les auxiliaires ses amis, et va punir et soumettre les tribus de la Kabla.
Ses premiers succès décident pour lui tous ceux qui chancellent et font soumettre par la crainte ceux qui se sont révoltés. Aux uns il pardonne généreusement ; ceux-ci sont punis de mort ; à ceux-là il fait des largesses ; il caresse les autres, par l’appât de l’ambition. Plus il avance et plus ses forces deviennent formidables ; six mois à peine se sont écoulés depuis le traité de la Tafna, que sa domination est reconnue depuis les frontières du Maroc jusqu’aux frontières de la province de Constantine.
Mais où va-t-il dans l’Est, avec ses 12, 000 cavaliers auxiliaires, ses 3000 fantassins réguliers, ses 400 khiélas et son artillerie ?
Il va : 1° Etablir dans la province de Hamza et de Schaoa un Khalifa qui réunira sous son autorité les Kabyles et les Arabes qui habitent tout le pays qui s’étend depuis la première chaîne méridionale de la Mitidja jusqu’à la province de la Medjana, parce que quoique les Français n’aient pas entendu lui abandonner cette étendue de pays, pourtant ils ne se les sont réservés par aucune clause, et ce qui n’appartient à personne appartient primo occupanti ; et l’Emir a voulu être le premier occupant ;
Il va : 2° Appuyer par son approche l’établissement d’un Khalifa qu’il vient de nommer dans la province de la Medjana, parce qu’aussi dans le traité il n’est pas parlé de Constantine, et que bien que les Français se soient emparés de la ville, ils ne sont pas pour cela les maîtres de la province.
D’ailleurs le bruit court parmi les Arabes que les Français vont bientôt faire de Constantine ce qu’ils ont fait de Tlemcen. Ils ne s’en sont emparés que pour la livrer à l’Emir, qui seul désormais va régner dans toute l’Afrique. Les Français conservent encore momentanément le littoral ; mais aussitôt qu’Abd-el-Kader se sera bien raffermi et bien enrichi, il achètera Alger, et les chrétiens retourneront chez eux.
Que pensez-vous de cette politique ? Car il est inutile de vous dire que tous ces bruits sont répandus par ordre de l’Emir.
Je vous avoue que je suis atterré ; toutes mes illusions se détruisent une à une. Au lieu d’une paix plus franche pendant laquelle j’espérais travailler avec un chef ignorant, mais de bonne foi, à la civilisation des Arabes, j’entrevois un armistice qui sera funeste à mon pays, et qui ne sera qu’une suite de mensonges et d’intrigues.
Si jamais, dans la suite des temps, la France devait contracter avec un chef arabe, qu’elle se souvienne bien que les Arabes sont encore les Numides qui combattaient les Romains, il y a 2000 ans ; que leur inimitié est de plus augmentée de toute la haine que leur inspire la différence de religion ; qu’elle lise bien les traités si clairs et si laconiques que faisaient les Romains lorsqu’ils accordaient la paix à une nation barbare, et qu’elle se méfie de la foi punique hantée [entée ?] sur la foi musulmane.
2ème lettre Tlemcen, février 1838 Dans ma lettre du 19 décembre dernier, je vous ai parlé de l’Emir, de son gouvernement
et de sa politique ; vous avez pu vous convaincre que je n’avais rien à enseigner à un chef aussi habile ; ainsi vous voilà éclairé sur le compte d’Abd-el-Kader. Je vais maintenant vous donner une idée de la constitution de la tribu du Tell. Ce n’est qu’une esquisse de la société arabe en Algérie, et pourtant quand vous aurez lu ma lettre, je suis persuadé que vous me conseillerez d’examiner avec attention tout ce que je vois, mais de bien me garder de donner des conseils pour l’amélioration de l’état d’un peuple qui a l’inappréciable avantage de se trouver heureux.
592
La tribu est une grande famille qui porte le nom de son père et de son fondateur. Elle se divise en plusieurs douars (1). Chaque douar est commandé par un Cheikh (vieillard. C’est ordinairement les plus âgés des chefs de tentes qui le composent.
La réunion de tous les Cheikhs des douars forme le Djemda (assemblée), qui est le Conseil des Anciens de la tribu.
Tous les ordres du chef de gouvernement sont communiqués par le Kaïd à la Djemâa, qui lest fait exécuter.
Toute affaire concernant la tribu est discutée dans cette assemblée. Ses décisions sont toujours respectées par les parties intéressées ; elle juge de l’opportunité de telle ou telle alliance si, comme cela arrive souvent, l’anarchie règne dans le pays.
Elle fixe l’emplacement de la tribu et des douars. Lorsqu’un membre important de la tribu veut épouser une fille d’une autre tribu, c’est
la Djemâa qui fait la demande en mariage. C’est parmi les Anciens du Conseil que se conservent les traditions de la tribu et les
titres de propriétés de son territoire. Chaque chef de famille a sa propriété parfaitement établie par des actes rédigés par le
Kadhi ; les limites de ces propriétés sont connues par les Cheikhs qui, en cas de contestations, viennent témoigner en justice. Les biens communaux sont également connus de tous.
Toute affaire de police intérieure est réglée par la Djemâa ; toute discussion civile et criminelle est renvoyée par elle par-devant le Kadhi.
La réunion des Kadhis de plusieurs tribus forment le Medjeleès, Cour d’appel à laquelle les partis réfèrent des jugements d’un seul Kadhi.
Dans chaque douar se trouve un Taleb (lettré) qui fait la prière pour tous, et qui enseigne à lire et à écrire aux enfants des chefs de tentes. Il est payé par tout le douar.
Tous les troupeaux du douar sont gardés par un ou plusieurs bergers payés en commun. Au temps du labour, les Arabes qui ont des bœufs, des semences et de l’argent, font
labourer pour ceux qui sont sans ressources. Ces derniers, qui se nomment Khammés, ont, à la récolte le 5ème du produit net. Si une famille a perdu son chef ou que ce dernier soit dans l’impossibilité de subvenir à
ses besoins, le douar, ou même plusieurs douars, lui donnent une journée ou deux du travail de leur charrue ; ils lui fournissent les semences, et toute la récolte est pour la famille malheureuse.
Tous les grands travaux de moissons, de transports des gerbes et du dépiquage se font en commun. Chacun y contribue de ses bras et de ses bêtes de somme. (2)
Si on est dans un état de guerre, tous les cavaliers armés de la tribu protègent à tour de rôle les travaux de labour ou de récolte des différents douars.
Ceux qui ne possèdent pas de terres labourent celles de ceux qui en ont trop, sans donner de prix de loyer ; mais en ayant soin d’en demander l’autorisation à la Djemâa.
Les troupeaux paissent généralement sur les terrains communaux. L’impôt frappé par le chef de l’Etat est divisé par la Djemâa aussi justement que peuvent
le faire nos conseils-généraux de département. L’Arabe n’est véritablement assujetti au travail que pendant 2 mois d’hiver pour les
semailles, et un mois d’été pour la récolte. Il passe les neuf autres mois à cheval, tantôt à parcourir les marchés pour y échanger ses produits, tantôt à aller visiter ses amis. Une grande partie de ses journées se passe surtout à assister aux fêtes que les Arabes donnent à l’occasion des naissances, des morts, des circoncisions et des mariages.
Chacune de ces fêtes sont autant de tournois où il veut se faire remarquer par son adresse à manier son cheval et son fusil.
Ses soirées s’écoulent soit à entendre des chants en l’honneur de son Prophète, soit à écouter l’histoire des hauts-faits de ses aïeux.
Tous les travaux domestiques sont abandonnés aux femmes (car il peut en épouser jusqu’à quatre). Il ne se fit qu’à lui pour les soins à donner à son cheval.
593
Il se nourrit du grain que la terre lui produit avec abondance sans exiger de grands travaux, de la chair de ses troupeaux qui ne lui coûtent qu’un peu de surveillance. Il boit leur lait, se vêtit de leur laine qui est tissu par ses femmes.
Les toisons de ses troupeaux, moutons, chèvres et chameaux, lui fournissent la laine avec laquelle ces mêmes femmes tissent ses tentes.
Il vend le surplus de ses grains et de ses troupeaux, et s’achète ses armes, ses munitions et le peu d’objets de luxe qu’il permet à lui et à sa famille.
Voilà, mon cher ami, voilà l’Arabe, barbare, sauvage et malheureux que je suis venu civiliser. »
J’avoue qu’après avoir lu ces deux lettres, je taxai mon touriste d’exagération ; je crus que son imagination impressionnable avait à ses yeux grandi ce chef musulman et poétisé la tribu arabe.
Je fus, à la vérité, un peu ébranlé dans mon opinion primitive ; mais je ne fus pas convaincu.
Mais aujourd’hui que sept années se sont écoulées depuis la date de ces lettres, aujourd’hui que les événements qui se sont succédés ont rendu évidente l’habileté de l’Emir, et que la connaissance du pays a prouvé la véracité des détails sur la société arabe, aujourd’hui, dis-je, je ris de cette idée si généralement répandue : que les Arabes sont des sauvages sans organisation, et qu’ils doivent considérer la venue des Français en Afrique comme un bonheur pour eux.
(1) Douar veut dire en arabe, circonférence, parce que les tentes du douar sont placées
en rond. (2) Ce travail en commun que Fourrier ne peut obtenir qu’en théorie, est chaque jour
mis en pratique dans la tribu.
Eugène X., « Le sultan et la mouche », L’Akhbar, 19 mai 1846 Nous recevons à l’instant la lettre et le morceau de poésie suivant, que nous transcrivons
littéralement, et sans commentaire sur la richesse de la versification. Au rédacteur de l’Akhbar. Monsieur, La légende arabe de Sidi-Mohammed-Blidi dont j’ai lu dans le dernier numéro du
Courrier d’Afrique la traduction que M. Bérard en a faite en vers si élégants, m’a donné l’idée de livrer aussi à la publicité une fable arabe que j’ai extraite d’un manuscrit assez curieux que l’un des caïds les plus influents de la province de Constantine m’a prié d’accepter un soir qu’assis sous sa tente, à quelques lieues de Biskara, notre conversation roulait sur les bucoliques orientales dont nous admirions le plus la fraîcheur et l’originalité.
J’ai rimé en alexandrins, et le mieux que ma jeune muse m’a permis de le faire, cette suave production de l’imagination vagabonde du sublime El Said-Madoul, celui dont les chants et les idylles caressaient le plus agréablement la douce mélancolie du célèbre Hadj-Mohammed-Pacha, à la cour de Constantinople.
Je vous serai reconnaissant, monsieur le rédacteur, de vouloir bien donner place dans les colonnes de votre journal à ma lettre et à la fable ci-après :
Recevez etc. Eugène X. Le sultan et la mouche. Fable. Le sultan Soliman fumait sur une natte ; Il avait le teint blême et le nez écarlate
594
Près de lui son esclave armé d’un éventail Pourchassait gravement les mouches du sérail. Mais soudain l’une d’elles, à l’éventail rebelle, Sur le nez du Sultan se pose à tire d’aile. Orgueilleux, on eût dit, du lieu de sûreté Qu’il a choisi l’insecte, en sa sécurité, Se pavanait déjà en agitant sa trompe Quand tout-à-coup, plus prompt que l’éclair ou la bombe, De sa main, main de fer, sur son front pur et beau, Le sultan Soliman porte le large espace, (Il venait d’inventer quelque supplice nouveau !) Et soudain l’animal qu’il aplatit trépasse. Ce trait malin bientôt excita tous les ris, En exceptant celui d’une vieille houris Qui, voyant Soliman prendre un air calme et grave, Tel qu’un vieux cardinal présidant un conclave, Lui dit : réfléchissez, seigneur, réfléchissez, Votre peuple vous aime et vous, vous l’égorgez ! Cet insecte tué sans qu’on lui crie gare Est la victime, hélas ! d’une pensée barbare, Triste image de l’homme, cheminant à pieds nus Qui ne voit le serpent que quand il est mordu. ……….. Le soir du même jour on entendit un râle……. Celui de la houris expiant sa morale.
« Une Mauresque », La France algérienne, du 23 juillet au 11 août 1846, feuilleton Chapitre Ier : La Vertu récompensée
Quand on fut toujours vertueux, On aime à voir lever l’aurore.
Pendant les trois premières semaines du mois de juin 1838, le soleil qui se lève derrière
le petit Atlas, sur le golfe d’Alger, vint régulièrement éclairer un spectacle le plus insolite, le plus extraordinaire, le plus phénoménal, le plus impossible des spectacles humains… deux jeunes touristes pêchant à la ligne !
Certes, on ne quitte pas communément sa famille, ses amis, ses bonnes causeries, ses bonnes promenades du boulevard de Gand, ses douces habitudes parisiennes, sa loge aux Bouffes, tout son monde élégant, facile, voluptueux de la grande capitale ; on ne subit pas la traversée de l’élément perfide avec toutes ses fatigues et toutes ses nausées ; on ne débarque pas sur la côte barbaresque, au bas de cette carrière pyramidale de maisons qui s’appelle Alger, on n’affront pas son dur soleil, son brûlant simoun, ses Arabes infects et repoussants, pour venir ensuite chaque jour, à la première aube, détacher une barque du rivage, voguer longuement vers les parages du cap Caxine, jeter une amarre dans un fond sablonneux, et là, stationnaire dans son esquif immobile, tendre avec patience aux poissons de la Méditerranée une amorce quelconque au bout d’un fil qui fait vaciller entre deux eaux, sous une pâture perfide, un acier aigu et dentelé. Non ! il faudrait être devenu monomane ! Or, Messieurs Adolphe Marcian et Eudoxe de Bérail, qui avaient, de point en point, agi comme nous venons de le dire, n’étaient pas, n’avaient jamais été monomanes.
595
Pour preuve, écoutons un peu le dialogue qu’ils tenaient à voix basse en attendant que le soleil vint resplendir à l’horizon :
- Je suis pourtant arrivé jusqu’à l’âge de vingt-six ans, mon cher Eudoxe, avec un profond mépris pour l’exercice intéressant qui nous occupe depuis neuf jours, trois heures tous les matins.
- Et moi, donc ! C’est de l’horreur que j’avais vouée à cette occupation que je n’ose point nommer un exercice, mais à laquelle je confirme hautement l’épithète d’intéressante que tu lui as décernée. Oui, mon cher Adolphe… Et j’ai cependant eu ma grande majorité, vingt-cinq ans, l’âge où l’on peut prendre femme à sa guise, sans avoir expérimenté cette dernière et suprême douceur de la vie excentrique du célibataire… Pêcher à la ligne en Méditerranée !
- Sais-tu bien, Eudoxe, que ce fut un grand butor, un impitoyable ignare, celui qui a caricaturé l’homme que ce goût domine, et qui en a fait de toute nécessité un être stupide, vieux, obèse ; une sorte de fossile, en un mot…
- Sais-tu, Adolphe, que j’admire, moi, le personnage assez ferme dans sa résolution, assez absorbé dans son entreprise, assez immuable dans sa pose, pour que les araignées tissent leur toile entre sa hanche et son coude, entre les doigts de sa main droite et le bâton de la ligne qu’ils soutiennent. C’est le fortem ac tenacem proposait que célébrait Horace et qu’un plat faiseur de charges a voulu, mais en vain, ridiculiser.
- Nous le réhabiliterons, cher ami ! … nous le réhabiliterons ! reprit d’une voix plus haute Marcian, qui venait de tirer une très-belle dorade hors de l’eau.
- Silence donc ! ajouta plus bas son ami, tu ne prends jamais garde qu’en parlant de toute ta bruyante basse-taille, tu glaces d’effroi les habitants craintifs de ces ondes, et que tu fais fuir de mon hameçon quiconque s’y serait venu prendre. Va, va, je te l’ai toujours dit, l’homme est profondément égoïste !
Pendant ce temps, et sans l’écouter, Marcian avait amené à portée de sa main et de son regard une pauvre dorade pantelante qui se débattait au bout de l’hameçon meurtrier ; elle s’était déprise à demi, mais bien loin de s’assurer sa capture, le jeune homme, après l’avoir reconnue pour ce qu’elle était, la rejeta dédaigneusement dans l’eau et murmura quelques paroles de dépit.
On renomme cependant les dorades de la Méditerranée, et tout pêcheur, non seulement à la ligne, mais au filet, se fût ému de joie en saisissant ce qu’Adolphe venait de juger indigne d’être même recueilli.
Et pourtant il remit vite un appât au crochet de son hameçon, et le replongea précipitamment dans l’eau.
De Bérail n’avait pas eu, de son côté, cette curiosité si naturelle de jeter un coup-d’œil sur la prise que son ami venait de faire. Il ne remarqua pas davantage l’acte véritablement excentrique par lequel Adolphe venait de rendre à la pauvre victime la liberté, l’espace, la vie. Nous avons omis d’indiquer un détail qui n’était pas cependant le moins étrange dans l’attitude de ces deux étranges amateurs de la pêche. C’est que, venus ensemble avec une intention commune, un zèle égal, une confraternité parfaite dans leur genre d’occupation, assis dans la même barque, ils s’étaient placés aussi loin l’un de l’autre que possible : Eudoxe à la poupe, qui regardait la plage, Adolphe à la proue, qui regardait la mer. Isolés de la sorte dans leur action, se tournant le dos d’une manière obstinée, ils n’avaient pas une fois, ni l’un, ni l’autre, fait volte-face pour se parler plus commodément, incliné la tête pour voir de part ou d’autre les résultats obtenus. Gens bizarres, comme vous voyez ; car, savez-vous, un chasseur qui ne regarde pas d’un œil avide, impatient, jaloux, le gibier atteint par son confrère. En savez-vous qui ne veuille pas examiner le coup tiré, pour discuter du moins, sur la part que l’adresse doit céder au hasard dans le succès, et se consoler par la critique d’avoir été moins heureux !
Eudoxe continua tout simplement de tourner le dos à son camarade, et de reprendre la conversation au point où elle avait été momentanément interrompue, et où nous l’avons laissée.
596
- Oui, oui, mon pauvre Adolphe, c’est triste à s’avouer ; mais cela est ainsi : le cœur humain est doté d’un sentiment personnel tellement tenace, tellement exclusif, tellement prime-sautier, comme le disait le vieux Montaigne, que toi, qui te jetterais, pour me sauver, dans l’eau, sans savoir nager ; dans le feu, sans être aucunement salamandre ou incombustible, toi, mon meilleur ami, le premier mouvement de la nature t’emporte ! que tu oublies dans ta joie de voir frétiller au bout de tes lignes je ne sais quelle malheureuse bête, que tu dédaigneras peut-être de faire emporter jusqu’à ta cuisine pour le déjeuner ; tu oublies combien je t’ai instamment prié, tandis que nous voguions vers ce lieu, de modérer tout éclat de voix, tout mouvement immodéré, lorsque nous serions en période de pêche !
- C’est la vérité, répondit Adolphe ! tu as insisté sur cette abstention de mouvement et de bruit avec une rigueur, une exigence digne d’un pêcheur à la ligne ex-professo, digne surtout d’un meilleur sort. Il ne me resterait plus qu’à faire mon très-humble mea culpa pour cause d’égoïsme au premier chef, n’était qu’après tout, mes infractions doivent, si je ne me trompe, être nuisibles non seulement à toi, cher Eudoxe, mais encore plus à moi-même… que si je gesticule et crie, j’effarouche tout d’abord le poisson qui serait le plus voisin de ma ligne, et que je le chasse peut-être de ton côté ; de sorte que mon imprudence coupable tournerait bientôt moins à ton détriment qu’à ton bénéfice…
- Profond raisonneur ! on voit bien que cette tête-là s’est bourrée dans sa jeunesse de toutes les sciences exactes, depuis la chimie jusqu’aux mathématiques transcendantes. On voit bien qu’elle s’est évertuée à contraindre la nature de lui rendre, de guerre lasse ; la dernière raison des choses les plus occultes, les plus insaisissables… et que, dernièrement encore, ici, dans cette eau bleue, elle eut trouvé matière.
- À ton tour, ne t’emporte pas, ô mon admirateur goguenard ! interrompit Adolphe, tu pousses vers moi, si je ne me trompe, en les effrayant de ton babil enthousiaste, une légion de poissons qui va sans doute venir goûter mon amorce tout à l’heure, et que tu m’envieras ensuite.
En même temps, on put voir Marcian tirer avec joie et interroger d’un regard avide sa ligne, qui avait à peine vibré sous la morsure de quelque animalcule de la moindre dimension. Une légère proie frétillait au bout, traversée de part en part, de l’ouïe à la queue, par la courbe de l’hameçon. Autant il avait jeté un coup d’œil insouciant et dédaigneux sur la belle dorade, autant il examinait avec attention et ce feu de regard qui fait étinceler un vif et soudain espoir, ce fretin exigu qu’il venait de poser précieusement sur le plancher de la barque.
Il tira de sa poche une loupe, qu’il fit jouer au-dessus du poisson déjà pâmé ; il le tourna, le retourna dans tous les sens, le scruta dans tous les détails de sa petite structure, et ce ne fut qu’après un long, un scrupuleux examen, avec un air de profond regret, qu’il se détermina finalement à le renvoyer reprendre, s’il pouvait, au fond des vagues bleues, la vie que le contact de l’air, de la chaleur et de la main d’un homme paraissait avoir presque détruite en lui.
Après quoi, Marcian, très-empressé, très-attentif, tout en conservant encore cette longue mine qui témoigne d’un désappointement encore mal digéré, se remit à pêcher avec un de ces courages opiniâtres que semble accroître et raffermir la persévérance de l’insuccès. Eudoxe en eût lui-même été surpris, assurément, si Eudoxe eût le moins du monde songé à observer, soit les gestes, soit l’attitude, soit la physionomie de Marcian. Mais absorbé, lui aussi, pour son compte, dans une fixité analogue de regard et de pensée, il n’avait garde, vraiment ! de songer à autre chose, et surtout à épier son ami !
En vain le soleil s’était élancé radieux des cimes du Jurjura, dont il teignait les dernières neiges d’une pourpre dorée ; en vain sa lumière éclatante avait rempli et comme inondé tout d’un coup le cercle immense de l’horizon ; en vain les rayons qu’il dardait, à chaque minute plus incandescents et plus pressés, tombaient sur l’azur du ciel qu’il enflammait tout à l’entour de son disque de feu jusque sur l’azur de l’eau, dont le vaste et mobile miroir changeait ses myriades de rides fugitives en myriades de fugitives étincelles ; en vain ce spectacle splendide et majestueux de la nature qui s’éveille, qui s’épanouit et se colore toute entière sous les clartés
597
vivifiantes de l’astre du jour, devait-il attirer, commander même l’attention de deux hommes du nord, inaccoutumés à ces aurores sans transitions, sans nuages des climats méridionaux, si belles et pures que l’Orient tout entier n’a pu se défendre d’attribuer au soleil quelque chose de la divinité, soit qu’il lui adresse, comme au maître de l’univers son encens et ses sacrifices, soit qu’il se tourne pour prier le Dieu créateur du monde, dont la lumière est la plus magnifique merveille, du côté où ce foyer lumineux apparaît chaque matin à ses regards… En vain même, une chaleur déjà intense et pénétrante dès que l’astre a commencé, la chaleur, devait-elle se projeter vivement sur nos deux touristes immobiles. Eudoxe demeurait attentif et penché, le cou tendu, la main comme soudée au long roseau qu’elle tenait horizontalement étendu sur les vagues ; c’était à le prendre pour la statue du dieu de la pêche à la ligne ! Adolphe, dans la même attitude, semblait le digne pendant, la personnification jumelle du même dieu ; car il nous sera bien permis, sans doute, faute par les Romains ou les Grecs de nous en avoir transmis l’image à tunique flottante, à pallium drapé, de nous créer la représentation de ce dieu tout aussi bien de mise parmi les modernes que dans l’antiquité, avec le paletot gris et le pantalon rayé, et le chapeau de paille à larges bords, dont nos deux amis s’étaient, pour le moment, revêtus.
Cependant, malgré toute cette attention, toute cette fixité, c’était chose bien remarquable de voir que Marcian rejetait tout-à-tour, avec une moue de plus en plus prononcée, chaque poisson qu’il avait la chance de tenir suspendu à son amorce ; qu’il répudiait les plus gros, les plus renommés de préférence, et qu’il ne se lassait pas toutefois d’envoyer l’hameçon à la recherche de quelque prise nouvelle. C’était chose plus singulière encore d’observer que de Breuil laissait flotter, soubresauter, plonger incessamment le fétu de liège qui aurait dû lui indiquer le moment où il y avait lieu de retirer sa ligne avec probabilité de voir quelque capture accrochée au bout, qu’il ne remarquait rien de ces titillements d’ordinaire si curieusement suivis par l’œil du pêcheur, et qu’il eût laissé même s’en aller au fond des abîmes, et le fil de l’hameçon rompu par quelque trop lourde proie, si, depuis longtemps sans doute, l’amorce, impunément dévorée pièce à pièce par un millier de morsures inaperçues pour lui, ne l’eussent mis pour jamais à l’abri d’un résultat de ce genre. Son regard, au lieu de s’absorber sur les oscillations qu’il aurait été aussi naturel que nécessaire d’épier dans son apparente occupation, se promenait avec une sorte d’inquiétude aux environs de quelques roches ardoisées qui se prolongeaient sur le rivage, autour d’une petite anse toute jaunissante d’un sable fin et doré.
C’est que nos deux touristes pêchaient à la ligne à la manière des touristes, c’est-à-dire en recherchant l’un et l’autre quelque chose d’intéressant et d’inconnu ; qu’ils avaient chance, il paraît, de rencontrer dans ces parages, de guetter plus efficacement, grâces à ce semblant d’occupation, et surtout à cette réelle immobilité.
Adolphe, homme exact et quelque peu savant, était venu en Algérie dans le désir d’y étudier certains phénomènes inexpliqués jusqu’à ce jour, dont il aurait voulu surprendre le secret à la nature. Il avait mis à leur poursuite sa gloire, son ambition. Ainsi, notamment, chacun sait que les eaux de la Méditerranée sont bleues et phosphorescentes, à la différence de celles de l’Océan, qui n’ont pas la même propriété ni la même couleur. Pourquoi ? C’est ce que tout le monde ignore ; c’est ce que les plus érudits désespèrent d’expliquer ; c’est ce que Marcian avait à cœur de découvrir. Pourquoi ?
En rapportant dans la mère-patrie la réponse à cette infranchissable interrogation, une réponse ingénieuse, subtile, probable, vraie (ou peu s’en faut), n’était-il pas en droit d’espérer un renom subit dans les annales de la science ? Ne pouvait-il pas rêver à la suite les honneurs d’un ruban écarlate ; et qui sait, d’un siège peut-être sous le dôme du palais Mazarin !... Combien sont décorés de l’étoile inventée par le grand Napoléon, combien ont le privilège de dormir sur les chaises curules de la science moderne, qui n’ont pas fait une découverte plus importante, plus difficile, plus nécessaire à l’humanité que de lui apprendre d’où vient que les eaux de la Méditerranée sont phosphorescentes et bleues !...
Eudoxe, un de ces voyageurs plus éventés, qui prétendent observer les mœurs des pays qu’ils parcourent, et qui, pour observer ces mœurs, aiment surtout à les étudier chez le sexe,
598
auquel généralement n’appartiennent pas les touristes, mais qui résume et impose en toute société les nuances les plus délicates, les plus secrètes, les plus curieuses de la vie privée, quelquefois même de la vie publique, Eudoxe avait aussi l’ambition de résoudre un problème universellement ignoré. Il voulait savoir ce que c’était qu’une Mauresque. Il voulait savoir comment peuvent préciser, raisonner, aimer surtout ces créatures mystérieuses, même pour les hommes de leur race, que la loi musulmane éloigne de tout regard, de toute investigation… Quelle curieuse étude à faire ! quel résultat magnifique à rapporter dans les salons parisiens que le récit d’une intrigue complète, approfondie avec une de ces ombres voilées que l’Orient ne nous laisse voir que comme un mythe presque impénétrable !... Quelle source de succès auprès de nos belles dames que de pouvoir venir leur dire : Les musulmans prétendent que la femme n’a point d’âme ! je leur donne un démenti formel… et j’ai droit de le leur donner !... et ce droit, je leur prouve !
Or, voici quelles avaient été les remarques antérieures faites par nos deux observateurs dans la poursuite respective de leur but. Voici comme elles les avaient conduits l’un et l’autre, malgré leur préoccupation si diverse à cette manière de pêche à la ligne qu’ils pratiquaient simultanément avec une patience égale sous un soleil chauffant à 40 degrés.
Adolphe Marcian avait imaginé que la teinte lapis ardoisée de la Méditerranée et sa phosphorescence, devaient avoir pour cause le séjour dans ses ondes de quelque poisson trop exigu sans doute pour avoir pu être pêché au filet, puisque, jusqu’à ce jour, l’espèce en demeurait inconnue. Ce poisson, imaginait-il, devait posséder dans le sang, dans les écailles ou les intestins, ou la vessie, une liqueur plus bleue que l’indigo, plus phosphorescente que l’allumette chimique perfectionnée. Il se flattait, à force de persévérance, et par un heureux hasard, de trouver enfin le précieux animalcule frétillant au bout de sa ligne, et dégageant du bleu pur et du phosphore incandescent. De là, profond mépris pour les dorades, comme pour les mulets, comme pour les turbots, comme pour tout ce qui n’était pas enfin l’animalcule demandé.
Puis, comme Eudoxe, depuis longtemps, après avoir écouté d’une manière patiente, sinon très bénévole, ses premières déductions ; après avoir partagé ses premières épreuves, lorsque le soir, au soleil couché, le matin surtout, avant le lever du jour, son savant et inséparable ami l’avait conduit ramasser dans un récipient quelconque les parties les plus teintées et les plus scintillantes de l’eau marine, après avoir suivi les analyses chimiques par lesquelles Adolphe les avait décomposées, étudiées, quintessenciées ; comme Eudoxe avait fini par trouver la recherche de son camarade fastidieuse d’abord, ridicule ensuite, et qu’enfin, sous peine de le persiffler avec toute l’implacable malice de son esprit frondeur, il lui avait interdit toute action, toute parole même relative à ce redoutable sujet, il arriva que pendant quelques semaines, Marcian parut abandonner sa marotte, et comme disait Eudoxe, après Tristram Shandy, son insupportable dada.
Mais dans le même intervalle de temps, voici ce qu’il advint, un beau jour que le chimiste Adolphe avait conduit l’observateur Eudoxe au bord de la mer, loin de la ville, dans l’espoir secret peut-être de rencontrer là et de saisir à la main quelque flaque d’eau plus phosphorescente et plus bleue que celles qui baignent le pied fangeux de la cité ; ils arrivèrent ensemble à la plage qui suite la Pointe-Pescade et sa vieille forteresse démantelée qui surplombe les roches déchirées par la fureur des flots. Ils marchaient tous deux silencieusement, lorsqu’au détour d’un récif, Eudoxe aperçut une négresse debout, qui portait sur son épaule, quelques vêtements de laine aussi blanche qu’était noire la main rugueuse qui les soutenait. À deux pas en avant, une jeune femme, une Mauresque déjà découverte du visage, posait tour-à-tour avec précaution ses pieds nus dans l’eau, qui venait doucement expirer sur le sable moelleux où elle était assise. Evidemment c’était une baigneuse, qui pareille à cette Bethsabée, dont le roi David eut le malheur d’épier toutes les démarches en une semblable occurrence, se préparait à dépouiller le reste de ses vêtements pour se plonger dans les flots quand elle aurait mieux accoutumé à leur frais contact ses membres encore frissonnants à la suite d’une incomplète
599
immersion. Eudoxe, le doigt sur la bouche, allait faire comme le roi David, attendre et regarder. Mais Adolphe qui n’avait rien remarqué, parla : tout-à-coup la négresse prit la fuite, la Mauresque suivit effarouchée, en jetant sur l’indiscret observateur un regard suppliant. C’est un si grand malheur pour une femme musulmane, qu’un homme, qu’un chrétien ait aperçu seulement les traits de son visage !... La terreur, l’eau pesante dont s’étaient inondé déjà les plis de son sarhoual flottant, paralysèrent sa course ; elle chancela et ne put s’éloigner qu’avec l’appui de la négresse qui revint à son aide, mais qui n’y revint que tardivement. Bref, Eudoxe eut le temps de voir assez bien cette femme, pour qu’il pût ensuite la reconnaître quelque part qu’il la rencontrât, pour qu’il emportât dans sa mémoire l’image d’un front ouvert et blanc, d’un regard velouté, d’une bouche saillante plutôt par le carmin que par l’épaisseur de ses lèvres purpurines, d’une chevelure aussi noire que l’ébène. Il résolut de ne point en rester là d’une connaissance si heureusement commencée ; le hasard avait trop favorisé son premier pas vers la découverte de ce problème cherché depuis si longtemps par lui, ce que c’est qu’une Mauresque. Il ne pouvait pas faire défaut, par insouciance, au hasard !
Marcian ignorait de la manière la plus absolue ce qui venait de se passer. Au moment où Eudoxe voyait disparaître dans une porte de villa mauresque, la frange bariolée du haïk, dont la négresse était vêtue, et dont elle s’était empressée d’envelopper la mauresque tremblante pour la sauver, autant que possible, de l’œil du chrétien ; à ce moment où notre observateur concevait la pensée et cherchait déjà le prétexte de s’introduire dans la maison où les deux femmes s’étaient réfugiées ; alors seulement, Adolphe, livré à de bien plus sérieuses préoccupations, détourna son regard de la mer azurée, et le reportant sur son ami, s’écria :
- Que regardes-tu si fixement là-bas, Eudoxe ! Qu’y a-t-il de si curieux, voyons, dans cette muraille blanche comme un linge, qui m’éblouit aux reflets du soleil ; que veux-tu à cette porte close, à ces trous grillés qu’on appelle ici des fenêtres.
- Rien. Je ne veux rien, dit précipitamment de Bérail… Je me faisais une simple réflexion que les êtres humains qui vivent dans cette sorte de sépulcre, doivent y dormir sans cesse, ou bien y périr d’ennui.
- Bah, reprit Marcian, les musulmans avec leur pipe ont l’art de ne s’ennuyer jamais : quant à dormir, ils n’en ont pas besoin, leur pensée repose toujours dans la veille comme dans le sommeil ; et pourvu que leur corps soit dans une attitude commode et tranquille, ils végètent parfaitement heureux.
Du Bérail se toucha le front comme pour y caresser le germe d’une idée. Puis, reprenant son camarade par le bras, et le ramenant sans affectation vers la mer, pour lui faire tourner le dos à la maison mauresque, qu’il ne cessait pas d’observer du coin de l’œil.
- N’importe, reprit-il, je voudrais que la civilisation française, qui prétend laisser une trace bienfaisante parmi ces gens-là, sût ajouter quelque chose à leur bonheur, sans diminuer la somme de leur repos. Je proposerais, moi, d’ajouter à l’agrément de la pipe quelque chose, comme… oui, comme la pêche à la ligne, par exemple.
Aussitôt Eudoxe, par une de ces fantasques digressions auxquelles il avait dès longtemps accoutumé Marcian, Eudoxe se prit à faire un éloge éloquent et verbeux de cet exercice placide et intéressant tout ensemble, qu’on a trop dédaigné chez nous et qu’il voulait enseigner aux races musulmanes dont il semble complètement ignoré. Pendant ce discours il jetait toujours, en s’éloignant de la maison mauresque, des regards sournois, mais inutiles vers ses fenêtres, et sa porte toujours invinciblement fermées.
Il vanta si bien les charmes de la pêche à la ligne, que Marcian, subjugué apparemment, lui proposa, sans rire, d’en faire, avec lui, quelques essais, lorsqu’il lui serait agréable. Eudoxe répondit sans se faire prier : demain, si tu veux ! et, à sa grande surprise, il trouva dans son camarade un écho tout-à-fait à l’unisson. Demain soit, riposta Marcian.
Chacun avait son arrière-pensée qu’il cachait à son ami. Du Bérail comptait revenir dans les mêmes parages et à la même heure pour chercher à revoir l’apparition gracieuse dont il
600
regrettait la fuite. Adolphe… ; on devine quelle chimère il se promettait de poursuivre avec ses hameçons !
Tout l’attirail fut acheté dès le même soir, en double exemplaire : dès le lendemain, avant l’aurore, une barque fut louée au moins, et nos deux touristes commencèrent la pêche assidue où nous les avons trouvés absorbés au début de cette histoire.
À peine fut-il donné pendant quelques jours à la houle de retarder leur zèle rival ; jamais de le rebuter totalement. Tous les matins, pendant deux ou trois heures, ils s’asseyaient, tournés comme nous avons vu, épiaient, regardaient, attendaient, toujours inutilement.
Mais tant de persévérance de part et d’autre méritait d’être enfin récompensée ! au bout de trois semaines, elle le fut pour l’un comme pour l’autre. La jeune Mauresque reparut toute seule au bord de la mer, et il fut permis à de Bérail de la contempler sans qu’elle l’aperçût, en raison de ce miroitage éblouissant qui illumine la pointe mobile des vagues, pour l’œil de celui qui regarde la mer, quand un soleil encore peu élevé, y projette comme une longue traînée de flamme, son image brûlante.
Au milieu de ces papillotements d’éclairs, et la barque et lui-même disparaissaient noyés en quelque sorte dans un réseau de clartés. Quant à Marcian, il eut l’insigne bonheur de ramasser au bout de sa ligne un mince animalcule aux fines écailles, aux nageoires prismatiques, dont il toucha de sa langue le dos argenté. La saveur apparemment lui indiqua la présence du phosphore le plus pur, le plus quintessencié ; car il insinua, sans être vu d’Eudoxe, le précieux animalcule dans sa poche.
En ce moment, une égale expression de triomphe resplendissait sur leurs deux figures épanouies.
Chapitre II. Recherches. Les joies complètes et durables ne sont pas de ce monde ! Tandis que la Mauresque en préparatifs de bain ne pouvait, de la position
lumineusement stratégique choisie par Eudoxe, voir littéralement que du feu, elle commença de dépouiller un premier saroual de coutil blanc, puis un second de soie ratée : restait un troisième, de mousseline à fleurs et dessins perses ; et, pour atteindre le cordon qui l’attachait au-dessus de sa ceinture, elle écartait déjà ce vêtement qui constitue
Le plus simple appareil D’une beauté qu’on vient d’arracher au sommeil. Mais il arriva que Marcian, tout occupé d’examiner à la loupe le poisson qui lui
paraissait devoir expliquer la teinte bleue des flots méditerranéens, laissa l’animal versatile et fugace échapper entre les doigts de la main dont il serrait ses écailles glissantes, et retomber par un bond convulsif dans son élément. Un cri de désespoir éclata sur les lèvres du savant décontenancé. Ce cri, parvenu aux oreilles de la Mauresque, lui fit opérer, saisie d’une terreur subite, indéfinie, la même évolution que le poisson venait de faire : elle sauta et disparut au sein d’une vague écumeuse qui venait mourir à ses pieds… Et puis, avec une rapidité dont seraient incapables les plus habiles baigneuses de Dieppe ou du Tréport, mais fort commune parmi ces filles de la nature qui habitent les bords de la mer, elle glissa, cachée par les ondes, qui s’avançaient assez loin dans les flots, elle se trouva ainsi totalement à l’abri des regards indiscrets dont elle fuyait l’atteinte redoutée.
De là, elle put, sans crainte d’être aperçue, remonter sur la berge, et reprendre le chemin sans doute de la petite maison de campagne voisine.
C’est ce dont nous n’avons pas besoin de nous occuper, puisque de Bérail ne put suivre des yeux cette partie de la retraire à laquelle il avait réduit la pudique musulmane ; mais il se crut certain que ce fut elle qui passa, au bout de cinq minutes, remportée vers la ville dans un palanquin hermétiquement fermé, que portaient quatre nègres vigoureux dont une négresse hâtait, de la voix et du geste, la course rapide.
601
Au milieu donc d’une foule de regrets trop faciles à comprendre pour être expliqués, il restait à Eudoxe, de cette matinée, un seul avantage réel ; c’est qu’il avait eu, cette fois, le temps d’examiner la Mauresque de telle manière qu’il l’eût désormais reconnue du premier coup d’œil, entre toutes les Mauresques de la terre !...
Par malheur, il faut le dire, et de Bérail ne se le dissimulait pas, s’il est difficile de reconnaître une femme dans une cité populeuse de l’Europe, en raison du grand nombre d’habitants qui remplissent chaque maison, du grand nombre de rues qui s’enchevêtrent dans la ville, et de la rareté d’une chance qui vous fasse cheminer tous deux ensemble dans l’une d’elles à un même instant s’il est proverbialement difficile de discerner la personne qu’on cherche dans cette cohue tourbillonnante qu’on nomme un bal masqué, lorsque toutes les figures sont dissimulées par la superposition mystérieuse d’une physionomie postiche de carton, de velours ou de soie ; toutes les allures travesties par des accoutrements variés, insolites, étranges, torturés ; toutes les voix déguisées par une application soutenue à changer leur timbre et leurs intonations habituelles ; une chose, à coup sûr, superlativement difficile, c’est, dans une ville seulement grande comme Alger, de distinguer une Mauresque entre toutes les autres ; c’est-à-dire de trouver un point caractéristique et individuel dans ce je ne sais quoi d’informe en apparence, que des draperies multiples, croisées, superposées, compactes, environnent de pied en cap, et font ressembler, si j’ose le dire, à un long paquet mouvant qui ne laisse apparaître rien d’humain, sinon deux yeux ordinairement très-noirs, et toujours pareils à deux autres yeux quelconques du même terroir, soit que la nature se plut à les fendre universellement en amande, comme aux gazelles, soit parce que le henné qui les entoure, teignant les sourcils et les cils d’une couche uniforme de brun ardoisé, efface entre tous ces yeux les différences natives d’expression ou d’éclat.
Enfin, comme les Mauresques ne sortent presque jamais dans la ville ; comme il est rare, pendant leurs rares sorties, qu’elles parlent ni entre elles, ni, à plus forte raison, aux personnes qu’elles rencontrent, ni surtout à un chrétien, scandale inouï ! l’on conviendra que de Bérail tenait en aparté un propos de la plus téméraire outrecuidance, alors que, rentrant dans sa demeure et promenant un regard déjà triomphant sur les divers quartiers de la ville si compacte et si populeuse, il osait se dire : « Cette femme est dans Alger ! Alger n’est pas si grand ! je la rencontrerai ! »
Mais le culte du mystérieux, la foi de l’impossible sont l’apanage privilégié des amoureux. Eudoxe l’était assez déjà de ce que j’appellerai sa mauresque apparition, pour offrir, à un éminent degré, ce double symptôme qui caractérise la maladie des cœurs blessés : au reste, le goût inévitable de tout homme de volonté pour les entreprises malaisées, la soif avide de l’obstacle, la recherche passionnée de l’inconnu, qui sont de l’essence de la jeunesse, achevaient de développer en lui, jusqu’à en remplir toute sa pensée, ce que l’amour y avait déjà fait éclore d’aventureux desseins, de folles espérances.
Or, il faut en convenir, l’amour n’entraîne pas, sans quelque raison, à la foi confiante, à l’audacieuse curiosité, à la poursuite de l’impossible. Le hasard se charge presque toujours de prendre par la main ce charmant aveugle et de le conduire en pleine sécurité, à la rencontre du résultat.
Et cette providentielle assistance du hasard, Eudoxe de Bérail l’avait sans doute méritée par une grande semaine d’investigations tenaces, et, s’il faut le dire, de rêveuses insomnies. Ce qu’il y a de certain, c’est que, par hasard, en l’an de grâce, où il cherchait dans Alger, sa Mauresque disparue, le jour solennel de la Fête-Dieu tomba au huitième jour de ses pérégrinations quotidiennes. Par hasard, l’autorité locale accorda aux désirs du clergé non-seulement tolérance, mais encouragement pour célébrer cette fête avec une pompe jusqu’alors inaccoutumée, bien loin de la tenir, ainsi qu’on a fait longtemps, même en France, strictement recluse aux limites de l’église, non compris le péristyle, quand il y a péristyle ; par hasard la population catholique d’Alger se leva le matin du jour préfixé, en favorables dispositions d’apporter en abondance à l’ornementation de la fête, velours, tapis, or soie, flambeaux et
602
guirlandes pour les reposoirs, branchages et roses effeuillées pour les chemins, jeunes vierges et jeunes garçons dans leurs plus blanches parures pour le cortège ; par hasard, les musulmans, au lieu de regarder du coin de leurs jalousies, avec quelques sourires dédaigneux, cette adoration extérieure, dont le Koran, ennemi des images, s’indigne comme d’une idolâtrie coupable, les musulmans, Arabes, Turcs, Maures et Bédouins, se crurent permis de prendre, au spectacle qui leur était offert, la part plus ou moins grande que leur suggérait leur curiosité. Les plus haut logés dans la ville, qui se trouvaient aussi (qu’on me pardonne l’expression) être les plus collet-montés en fait d’islamisme, ceux-là sortirent seulement sur les terrasses de leurs maisons, spectateurs à distance et sous bénéfice de malédictions pour les chrétiens qui osent représenter et enchâsser Dieu ; les autres, plus voisins des quartiers européens, par cela même qu’ils étaient moins hostiles aux idées de leurs habitants, se portèrent dans les rues et sur les places que la procession devait suivre ou traverser. Par hasard, quelques femmes indigènes obtinrent ou dérobèrent, çà et là, le privilège de monter sur les terrasses ; et bien hermétiquement voilées, de jeter un coup d’œil plus ou moins prolongé sur les guidons de soie, les bannières dorées, les chœurs éclatants de blancheur qui commençaient à reluire au soleil, entre l’église et la place du Gouvernement. Par hasard, la Mauresque dont Eudoxe poursuivait la rencontre fut au nombre de ces rares privilégiées.
Quant à lui, un peu par combinaison, il s’était placé sur une des terrasses les plus culminantes de la ville. Il venait de s’asseoir au sommet de la maison d’un de ses amis, sur la plate-forme d’un belvédère qu’il avait fait surexhausser récemment. De ce point, qui dominait presque toute la ville, il regardait de toutes parts, observant, avec une attention qui faisait peu d’honneur à ses principes religieux, tout autre chose que la cérémonie, savoir, les Mauresques, éparses sur tous les sommets de maisons, jusqu’à la dernière perspective.
- Ah ! s’écria-t-il d’un air de pleine satisfaction. En effet, il s’apercevait à l’instant même qu’à peu de distance de lui se trouvait
d’aventure une femme voilée moins rigoureusement que d’habitude, qui fixait de son côté un regard assez persévérant. L’ami chez lequel Eudoxe avait choisi son poste d’observation, possédait, suivant l’usage de ceux qui font construire des belvédères, une longue-vue parfaitement douée du mérite de rapprocher les objets.
Du Bérail a réclamé l’astronomique auxiliaire ; il le tourne sans affectation du côté de la Mauresque ; la Mauresque ne se cache point avec le même empressement craintif qu’il a remarqué chez toutes les autres en pareille occurrence ! Tout au contraire, par-dessous les bords tombants de son haïk, deux grands yeux noirs...
Il s’agit, à cette heure, de se convaincre si ces yeux noirs appartiennent à la baigneuse des environs du cap Caxines ; grave question ! difficile examen !...
Les hommes raisonnants et sages de l’Algérie tombent d’accord qu’il y a impossibilité matérielle à discerner sûrement, l’une de l’autre, deux paires de prunelles, semblables de couleur, de velouté, d’éclat ; et partant une Mauresque d’une autre Mauresque, si l’on est réduit à ne voir de leur personne que cet échantillon si peu varié, si peu reconnaissable.
Les hommes sensitifs et passionnés assurent que les yeux noirs de la femme qui nous plaît et nous attire ne sauraient, en aucune manière se confondre avec les yeux également noirs d’une femme indifférente et sans attraction spéciale pour nous. Ils prétendent qu’une sorte d’électricité magnétique doit faire deviner, de prime saut, la présence du regard fascinateur, et qu’il y a chez les amoureux comme un sens plus perfectionné, une intuition plus exquise, en vertu de laquelle certains yeux ne peuvent désormais ressembler aux yeux de personne. Belle thèse !... que je vous laisse à juger, ô lecteur !
Ce que je puis affirmer, c’est qu’Eudoxe partageait cette dernière opinion, et que bientôt on put le voir donner en toute sécurité, une preuve bien notable de sa ferme croyance.
- Combien me louerais-tu ta chambre, située sur la terrasse, disait-il à un propriétaire juif dont il avait, non sans peine, découvert l’habitation contiguë à celle de la Mauresque qu’il brûlait d’avoir pour voisine.
603
- Je louerais cette chambre cinquante francs par mois. - C’est pour rien, répartit de Bérail, si elle est meublée. - Je n’y ai qu’un dépôt de marchandises, huiles et chandelles, reprit l’autre, mais
je les retirerai s’il vous plaît. - Il me plaît très-fort ! dit promptement Eudoxe : retire-les ce soir, et demain matin
je viens prendre logement ici ; je retiens la chambre pour deux mois : voilà cent francs d’avance. - Voudriez-vous d’abord visiter le local, reprit aussitôt, après avoir empoché les
espèces, l’israélite, qui se fût bien gardé de faire auparavant cette offre dangereuse. - Inutile ! inutile !... Et le soir même, Eudoxe envoya laver, peindre à la chaux, meubler enfin ce nouveau
domicile. Le lendemain, il y entra joyeux. À l’intérieur, des exhalaisons effroyables, fumet trop évident, traces trop opiniâtres des
marchandises auxquelles il succédait dans ce logis, sans préjudice d’une certaine famille de rats désorientés, désapprovisionnés et mécontents qui couraient encore par tous ses recoins déserts, mais odorants ; c’était plus qu’il n’en fallait à un homme comme il faut pour ne se sentir aucunement retenu dans ce taudis impur : à l’extérieur, le désir attractif d’épier si, par quelque circonstance heureuse, sa nouvelle voisine n’apparaîtrait point à sa vue, n’était pas un médiocre aimant pour l’entraîner sur la terrasse, en dépit d’un soleil droit et sans ombre, d’une réfraction presque intolérable.
Il y passa trois ou quatre heures, la première journée ; neuf ou dix, la seconde ; douze ou quinze, la troisième… et cela dans une contemplation héroïquement soutenue, qui devenait incessamment plus impatiente et plus avide.
Le quatrième jour, au moment où, vers la tombée de la nuit, son estomac recommençait à lui crier qu’il était temps de s’en aller dîner, n’importe comment, n’importe où : l’idée lui vint, en même temps, que les Maures, d’habitude, et à plus forte raison, les Mauresques, ne se hasardent guères sur leurs terrasses qu’à cette heure où l’air fraîchit, où la lumière s’éteint, double avantage pour l’hygiène tout ensemble et la sécurité de leur apparition.
Sur quoi, la soirée était magnifique, la lune claire et dans toute la plénitude de son rayonnement ; il cessa d’avoir faim et ne se coucha qu’un peu avant le lever du soleil.
Le cinquième jour, ma foi ! il se souvint que c’était une chose qui lui avait déjà porté bonheur que d’aimer à voir lever l’aurore, et il se fit un plaisir, en homme vertueux, de contempler une fois de plus les splendeurs de ce majestueux spectacle.
Si j’avais l’avantage d’écrire dans un journal quotidien, dans une de ces feuilles qui, par leur étendue, peuvent équivaloir à un volume ; dans un de ces volumes qui, par la multiplicité des interlignes, des têtes de chapitres, des pages blanches, permettent à une seconde édition, nullement revue ni augmentée, de se prolonger jusqu’à un dix-huitième tome, par exemple, alors que la première n’en comptait que douze assez mal remplis ; si, enfin, mes bénéfices d’auteur avaient la prétention de s’accroître en vertu d’un délayage abondant des moins utiles détails, surtout par l’emploi de cet ingrédient diffus et élastique, si abusivement utilisé dans plus d’une littérature et qu’on nomme : description. Oh ! certes, je ne résisterais point au plaisir de tracer ici, pour mes lecteurs de France, le tableau d’un lever de soleil en Algérie dans les plus beaux jours d’été. Je me fais tort, sans doute, en négligeant cette resplendissante peinture ; car on va croire que je ne saurais pas, tout comme un autre, grouper des teintes d’azur et de feu, des nuages blancs et empourprés, des rayons obliques, mais déjà rutilants, sur une mer bleue, sur des cimes de plus en plus violacées et transparentes à mesure qu’elles reculent vers la limite de l’horizon… Mais quoi ! N’ai-je pas fait déjà le sacrifice, inaperçu peut-être, d’une peinture de solennité religieuse, célébrée dans le rite chrétien, sur la terre, hier musulmane, aujourd’hui française ; pieux souvenir, touchant écho de la mère-patrie ! N’ai-je pas omis ce contraste, si attrayant à reproduire, entre les costumes, les idées des nations diverses, hétérogènes, que notre drapeau réunit de gré ou de force, et qui se portaient chacune, dans des
604
sentiments si opposés, au spectacle de cette imposante cérémonie ? N’avais-je point un beau champ ouvert pour les aperçus philosophiques, politiques, administratifs et autres ? N’avais-je pas ample matière aux digressions touchant l’effet matériel et moral des pompes du catholicisme et de la civilisation sur cette foule inculte qui nous environne… Et pourtant, ne me suis-je point sevré de toutes ces belles et poétiques fantaisies, avec le courage d’un homme qui préfère suivre d’un œil inquiet, d’une sollicitude incessante, son héros, Eudoxe de Bérail, dans la difficultueuse entreprise dont il le voit, hélas ! si plein, si tourmenté qu’il en va perdre tout à l’heure le manger, tout à l’heure le sommeil ?... Eh bien ! ce courage, il faut que je sache l’avoir encore. Il faut que j’oublie le soleil qui se montre radieux au-dessus des crêtes ondulées du Jurjura, de même qu’Eudoxe, tout inondé de sa lumière, l’oublie, lui aussi, dans l’attente muette où il est plongé, sous le coup du pressentiment qui lui révèle d’instinct que la belle Mauresque va venir chercher, avant que la cité ne se réveille, quelques rapides aspirations de la brise matinale, quelques rayons furtifs du soleil qu’on lui refuse tout le jour.
On l’a dit et écrit depuis si longtemps, que c’est presque un aphorisme : « Il y a des pressentiments qui ne trompent jamais ; ce sont les pressentiments de l’amour. »
Qui oserait le contester ? Non pas moi, sans doute. Mais la vérité historique me force de constater avant tout, qu’au moment où Eudoxe
goûtait dans sa plus grande douceur un pressentiment si positif qu’il n’était plus déjà qu’une espérance ; alors une voix se fit entendre à quelques pas de lui, une personne parut…
C’était Adolphe Marcian ! Chapitre III. Emblèmes télégraphiques Notre amoureux expectant fit un soubresaut et tout à la fois un geste de mécontentement
plus encore que de surprise, à l’adresse de son ami, trop inattendu pour ne pas lui sembler importun.
- Eh bien ! disait celui-ci, te voilà donc retrouvé ! Depuis cinq jours je me demande ce que tu peux devenir. On me répond sans relâche et sans pitié, dans notre hôtel, que tu es sorti avant le jour, que tu n’es pas rentré de la nuit. Je m’inquiétais ! Je t’ai fait suivre, hier. Tu n’as point reparu depuis vingt-quatre heures…Je suis venu. Tu avais laissé toutes portes ouvertes… et me voilà ! Et maintenant…
- Silence ! interrompit Eudoxe ; ne te déferas-tu point de cette voix qui met en fuite les poissons quand nous sommes à la pêche.
- Ah ! c’est sans doute par ce puissant motif que tu as résolu de m’y laisser désormais aller seul, n’est-ce pas ?
- Peut-être, reprit Eudoxe. - Non ! non ! c’est-à-dire que te voilà logé ici, à mon insu, pour quelque nouvelle
amourette ! - N’en as-tu connu d’autres en Algérie, fit brusquement de Bérail, sans réfléchir
que cette phrase n’était rien moins qu’un implicite aveu. - Je le crois bien ! Tu me les caches, sournois !... Et je suppose qu’à cette heure,
témoin certain froncement de sourcils, certains mouvements d’impatience, je te gêne, je t’incommode ; tu attendais quelqu’un ?...
- Oui, répliqua Eudoxe d’un signe affirmatif. Puis, corrigeant avec naïveté sa pensée : Je crois que oui, du moins…
- Comment, tu crois ? tu n’as pas une promesse formelle, positive ? Et cependant…
- J’ai un pressentiment… Mais il y a des pressentiments, vois-tu… - Qui ne trompent jamais, acheva Marcian d’un ton légèrement sarcastique et la
main posée sur son cœur. Alors, il entreprit de démontrer à son ami que tout pressentiment, que les faits viennent
démentir, n’attire pas notre attention ou est bientôt mis en oubli par nous, comme on fait des
605
songes une fois éveillé ; qu’il n’est plus à nos yeux qu’une sorte d’hallucination sans portée, une de ces courses divagantes de l’esprit dans les domaines du possible, dont il néglige le souvenir, faute d’une réalité qui lui ait donné quelque fixité, quelque valeur. Au contraire, chaque fois que le résultat est venu, par hasard, confirmer le rêve de notre idée, alors, nous en tenons compte, nous en faisons exemple, soit pour les autres, soit pour nous. Si bien que la prévision passagère et dubitative qu’une chose arrivera, n’est pressentiment que si la chose arrive, et qu’ainsi rien de plus puéril que cette sorte d’axiome : « Il y a des pressentiments qui ne trompent jamais ».
La froide métaphysique du logicien Adolphe, de cet homme en tout point amateur de l’analyse des causes en raison des effets, n’était sans doute nullement du goût de son ami ; toutefois, il le laissait dire et avait recommencé à fixer les yeux sur la terrasse de la Mauresque.
- Chut ! fit-il tout d’un coup, entendant ouvrir une petite porte, au sommet de la maison voisine. En même temps, lui et Marcian se dissimulèrent dans la pénombre de sa chambre.
Une femme toute couverte de blanc s’avança, et presque aussitôt ses yeux noirs semblèrent chercher quelque chose ou quelqu’un, promenés tour à tour sur chaque point de l’horizon.
- Vois-tu, dit Eudoxe, que mes pressentiments étaient justes. - Profond silence de Marcian, soit discrétion, soit surprise de voir son ami en
intrigue réglée avec une de ces femmes mystérieuses dont il ne connaissait point la langue, et auxquelles pour lui, à coup sûr, il n’aurait jamais songé. Il avait fait deux pas vers la porte, pour se retirer insensiblement, mais déjà la Mauresque inquiète et rapide avait disparu.
Le lendemain, à pareille heure, Eudoxe était seul dans son logis. Il avait promis à Marcian de lui raconter, comme échantillon de mœurs indigènes, les détails de la liaison qu’il espérait nouer, chaque jour plus intime, avec cette inconnue. Il voulait désintéresser de cette manière sa curiosité et se trouver désormais affranchi de sa présence.
Mais le philosophe Marcian n’était pas fort curieux en matière d’amour, ni en fait d’études sur les mœurs indigènes, et ce fut de Bérail qui, le soir, trop heureux sans doute d’avoir un confident tout préparé pour l’expansion de ses joies et de ses espérances, accourut spontanément dire à son ami :
- Je l’ai revue ! Elle m’a remarqué, reconnu de sa terrasse… Et elle ne s’est enfuie que lorsque je lui envoyai une fleur et le simulacre d’un baiser !
- A-t-elle accepté l’une et rendu l’autre ? - Tout au contraire… C’est la fleur qu’elle m’a rendue, répondit humblement
Eudoxe. Dès-lors il se montra pendant quelques semaines très-sobre de révélations, dans la
crainte d’avoir à finir par l’aveu d’une déconvenue. Cependant l’intrigue progressait de jour en jour. La suivre pas à pas serait pour vous, lecteur, et pour moi, chose trop-longue et monotone.
Il nous suffira d’en observer les phases principales, et surtout de reproduire les divers signes télégraphiques à l’aide desquelles on apprit d’une terrasse à l’autre l’art de se correspondre, de se comprendre sans recourir à la parole, car la parole aurait pu occasionner quelque bruit dont l’écho révélateur eût tout dénoué, peut-être d’une façon sanglante. Au reste, Eudoxe, ignorant de l’arabe et trop occupé de son amour pour avoir la tête à s’en instruire, aimait mieux regarder la Mauresque et lui adresser tous les signes d’intelligence que les chrétiens connaissent, que de pâlir sur quelque livre du genre des lexiques ou des grammaires. Et puis, la femme orientale accoutumée dès longtemps au langage des emblèmes ne semblait pas mal prendre goût à faire de son voisin le Français un élève distingué dans cette vivante télégraphie.
Dès la première fois que, bien assurée d’être à l’abri de tout regard, excepté celui d’Eudoxe, elle osa demeurer quelques moments sur la terrasse et accepter une correspondance directe de gestes avec lui, notre jeune homme (et c’était bien naturel), commença par lui faire
606
signe d’écarter son voile et de lui laisser voir son visage. Cependant il subit un odieux refus ; et comme il insistait, il vit une petite main effilée, blanche aux ongles coloriés de rouge, aux doigts chargés de pierre étincelantes que sortir de dessous ses vêtements la Mauresque inflexible ; elle agita dans un sens horizontal son index levé vers lui, en même temps que sa tête, pareillement balancée par des signes négatifs bien accentués, disait en français comme en arabe : Non, Monsieur, non !
De Bérail frappa du pied avec impatience. Elle sembla fléchir, lui désigna, en allongeant la main, une rose qu’il portait à la boutonnière, la même qu’il lui avait déjà vainement jeté dès qu’ils s’étaient trouvés en présence. Elle parut désirer, en l’acceptant, ne pas lui faire le chagrin d’un refus sur tout ce qu’il avait demandé. Et Eudoxe de lancer la fleur vers la jeune indigène. Celle-ci la ramasse, hume longuement le parfum qu’elle exhale, et puis, au lieu de la garder sur elle, d’un air recueilli, presque solennel, arrache ses feuilles tour à tour et les fait envoler dans les profondeurs d’une rue qu’elle dominait du faîte de sa maison, après quoi elle se retira doucement, non sans regarder à plusieurs reprises notre amoureux, qui n’avait pas mine d’un homme complètement satisfait.
Il aurait dû l’être cependant !... Cette fleur effeuillée, dispersée au vent, après avoir passé de sa main dans la main de la mauresque, voulait dire que désormais d’autres n’en devaient plus savourer le parfum ni admirer la forme et la couleur. Ce don offert et reçu tour à tour entre eux, personne n’y pourrait plus toucher, ni amis, ni ennemis, ni indifférents ; c’était le sauver par un sacrifice volontaire, du danger possible d’un contact profanateur. Mais qui pouvait expliquer à de Bérail ce langage des symboles ! Faute d’interprète, il ne comprit pas ; mais il n’en demeura pas moins, espérant toujours.
Et il avait raison. Pendant les trois matinées qui suivirent, la Mauresque se montra précisément à la même heure et à la même place que la veille. A son tour, elle jeta une rose sur la terrasse d’Eudoxe et lui fit signe de l’effeuiller comme elle avait effeuillé l’autre. Il obéit passivement. En récompense, il demandait à voir quelque chose de plus que les yeux noirs dont le regard paraissait le remercier avec ardeur : les voiles furent à demi dérangés, puis la Mauresque, toute rouge, au lieu d’avoir l’audace d’achever le mouvement commencé, baissa la tête et s’effaça comme un éclair.
Il attendit mieux du lendemain. Le lendemain, la Mauresque apparut un peu plus tard que de coutume ; mais, aussitôt sortie de la poterne qui s’ouvrait sur la terrasse, elle sembla mettre une opiniâtreté significative à se tourner vers un point qui ne regardait pas du tout la maison du chrétien, et, marchant toujours droit et vite dans le même sens ; elle arriva ainsi à l’angle de la maison qui l’éloignait le plus d’Eudoxe.
- Qu’est-ce à dire ? Qu’est-ce que cela peut signifier ? murmurait-il, non sans embarras et sans impatience.
Tout d’un coup, et comme si elle répondait aux interrogations tacites de sa pensée, elle lui fit volte-face, désigna de la main droite le côté de l’horizon qu’elle avait obstinément regardé, puis frappa six fois avec le pied contre terre et six fois dans sa main… après quoi, il ne la vit plus.
Que voulait donc lui indiquer ce signal de la Mauresque ? Quelle explication favorable pouvait-il s’en donner à lui-même ? L’avertissait-elle qu’elle était forcée d’aller passer douze jours à la petite maison de campagne vers le cap Caxine ? Fallait-il traduire que son jaloux mari (tous les musulmans doivent l’être), se proposait de l’emporter à douze lieues sud-ouest des perfides œillades européennes qui serpentent à travers tout Alger ? Ou bien, promettait-elle de rencontrer Eudoxe quelque part dans douze jours ou dans douze heures ?... ô difficile énigme ! O dieu des oracles, dieu des sphinx et des Œdipe, inspire-moi, inspire-moi ! s’écriait notre amoureux.
La dernière version lui paraissait la plus vraisemblable. C’était du moins celle, entre toutes, la plus suivant son désir. Un rendez-vous ! Rien moins qu’un rendez-vous ! Vraiment, ce serait adorable !... Donc, il regarde soigneusement l’heure à sa montre et l’horloge. Sept
607
heures !... Et maintenant il comptera les pauses de son attente, jusqu’à ce que soit accomplie la révolution de l’aiguille sur le tour du cadran : il se couchera même, afin de s’éveiller demain matin, sans faute, avant sept heures !... Avant sept heures, en effet, il s’acheminait du côté de la porte Bab-el-Oued, marchant à petits pas sur la voie populeuse ; allant, revenant, de long, en large, en diagonale, épiant, attendant, maugréant.
Savez-vous que son incertitude était cruelle, et sa perplexité diaboliquement tiraillée entre mille points d’interrogation qui s’accrochaient à elle de toutes parts.
Voici seulement comme se formulaient les plus tenaces ; je supprime les autres pour abréger.
La Mauresque serait-elle en retard ? Serait-ce Eudoxe lui-même ? Quelqu’un lui aurait-il fait devancer l’heure, changer le jour de partir ? A-t-elle pris une autre route ? S’est-il égaré dans ses conjectures ? Faut-il s’asseoir là, près de la fontaine ? Ne vaudrait-il pas mieux retourner vers la maison de ville, s’asseoir en vigie près du point de départ ?
Ici tout à coup, il s’élança d’une course rapide vers l’embranchement des deux chemins de l’hôpital du Dey et de la Bouzaréah, près le cimetière juif, et s’arrêta, visiblement satisfait de ce beau poste stratégique dont il venait de prendre possession ; à cheval sur le nœud de cet écheveau de sentiers et de routes bifurquées. Vaine joie ! passager triomphe !
- Il plonge un regard sur le chemin de la vallée… point de Mauresque ! Il redescend vers celui du bord de la mer… point ! Il s’engage dans une venelle sinueuse, qu’il se hâte d’explorer à quelque distance… point ?
Il était déjà plus de huit heures. Les femmes, pense-t-il, sont rarement exactes : se mettre en retard fut toujours et partout dans les habitudes de leur nature ; bien mieux ! dans les nécessités de leur toilette… patientons !
Ce raisonnement le soutint vingt minutes contre le désespoir. La pensée qui lui serait venue des premières, s’il se fût agi d’une Française, celle de lui prêter un caprice dont il aurait vu la belle face hier et dont il ne voyait plus à cette heure que le revers ; cette pensée, probablement en raison de ce qu’il s’agissait d’une Mauresque, ne commença qu’une heure après à filtrer dans son esprit… Ce fut dès ce moment un supplice, une torture que vous imaginez, et que je n’essaierai pas de décrire pour ceux qui ne l’auraient jamais souffert. Ce soupçon minait sa patience, comme l’eau mine le rocher par sa base, jusqu’à ce qu’il ne se soutienne plus et s’éboule avec fracas… L’éboulement des espérances d’Eudoxe s’acheva dans ce cri funeste :
- Oh ! se serait-elle moquée de moi !... Cinq minutes après, il rentrait dans son domicile d’observation… suant, haletant,
jurant, pestant… Bientôt, on le vit sur sa terrasse, occupé, comme malgré lui-même, à regarder la terrasse mauresque, et, sur cette terrasse, particulièrement à l’un des angles, certaine petite porte surbaissée par laquelle apparaissait ordinairement sa voisine ; qu’il se surprenait tantôt à regretter, tantôt à maudire.
La porte était fermée : mais, au-devant, brûlait une de ces senteurs orientales, que de Bérail ne connaissait jusqu’alors autrement que par leur cosmopolite renom. Il lui sembla se souvenir qu’il avait vu la Mauresque porter, en manière de bracelet, quelques grains noirs pareils à celui que dévorait la flamme et qui s’en allait en cendre odorantes.
Elle était donc venue ? Oui… tout à l’heure, elle était venue… Regrets amers ! Espérances nouvelles ! Et là-dessus derechef, en attendant, peut-être, une seconde apparition, calculs innombrables, afin de s’expliquer mieux pour l’avenir la valeur de ce signal, équivalent d’une promesse dont il avait probablement, par son absence, fait échouer l’accomplissement.
C’était le cas ou jamais, de faire à Marcian quelques confidences. Marcian, esprit analytique ; Marcian, amateur des questions abstraites, des mystères à pénétrer, pouvait lui être d’un excellent conseil. Il fut le trouver, et, reçu à bras ouverts par son ami, comme devait l’être un problème à résoudre, indépendamment de l’affection qui les unissait ; il remporta de chez Marcian, sur le sujet proposé, cette lumineuse et fatidique réponse :
608
- Douze coups frappés, six des pieds, six des mains, devaient te représenter six heures de nuit et six heures de jour, total douze heures. Ta Mauresque a dû partir hier soir ; elle passera cette matinée à la campagne : six heures de nuit jusqu’à l’aurore, et six heures de jour depuis l’aurore jusqu’à midi.
Une fois sur cette voie, de Bérail résolut de travailler de temps à autre, avec son savant ami, la langue des emblèmes. Cependant, chose qui ne cadrait point avec l’explication d’Adolphe, on n’aurait jamais pu lui ôter de l’esprit que le parfum brûlant sur sa terrasse représentait aussi hiéroglyphiquement une idée… Et plus il y réfléchissait, plus sa sagacité naturelle, considérablement aidée par son amour-propre, lui persuadait que par là, on lui signifiait la consomption suave, mais rongeuse, d’un amour enflammé à sa vue.
Bien qu’un peu de style régence, en vérité, ceci n’était pas moins admissible dans la correspondance symbolique d’une Mauresque. Certaines images, comme elles, furent de tous les temps, sont de tous les pays.
Au reste, la suite montrera si Marcian était plus heureux dans ses explications, ou de Bérail mieux inspiré dans ses conjectures… qui lira, verra.
Chapitre IV : Intelligence À midi, personne ne parut sur la terrasse ; le lendemain, personne ; le surlendemain,
personne encore… Et la cendre du grain de parfum brûlé devant la petite porte n’ayant point disparu, prouvait, d’une façon irrécusable, que, pendant les quelques instants d’absence qu’Eudoxe s’était permis dans l’espace de ces quatre journées, nul être humain n’avait posé le pied sur la maison mauresque. Sa jolie habitante n’était plus là ; et avec elle sans doute, les autres personnes quelconques vivant auprès d’elle avaient quitté cette demeure pour celle du cap Caxine. Combien durerait leur séjour dans la maison des champs ?
« Eh ! c’est clair !... c’est tout clair ! s’écria de Bérail, vers la fin du cinquième jour… ; comment ne l’ai-je pas deviné plus tôt ? Elle m’aura attendu là-bas, cherché, peut-être… Ah ! que je suis malheureux et maladroit… C’est pendant six nuits et six jours qu’elle devait s’absenter d’Alger… Ah ! trop tard !... j’ai compris trop tard !... J’ai manqué peut-être mon bonheur ! »
Ce monologue désespéré dura longtemps, et même ne put dispenser le pauvre Marcian, que son ami s’empressa de rejoindre, d’une apostrophe qui l’accusait inexorablement de toute l’erreur. Ils s’étaient trompés tous deux ; mais la passion est si colère, la colère si injuste ! Marcian pardonna cette iniquité à Eudoxe, et ils s’acheminèrent ensemble le lendemain matin, vers les deux heures, sans plus de retard, du côté de la Marine, montèrent dans leur embarcation et ramèrent dans le sens du cap. Cette course matinale était une expiation de la part d’Adolphe ; de la part d’Eudoxe, un moyen de chercher à reconnaître, par quelques indices, si l’on était encore, ou si l’on n’était plus dans la petite maison de campagne que vous savez. Hélas ! les habitations mauresques sont trop fermées, leurs existences trop murées pour qu’il transpire aisément au-dehors quelque signe de vie, témoignage de ce qu’elles recèlent.
Nos deux amis, après s’être amarrés depuis l’aube naissante jusqu’au moment où le soleil au quart de sa hauteur, menaçait de rendre suspecte aux passants, même les moins curieux et les moins intéressés, la longueur de leur station dans ces parages ; après avoir épuisé leurs regards sur les murailles discrètes, sans pouvoir constater aucun mouvement, aucun bruit, furent obligés de remettre à la voile pour cingler dans le port. Du reste, on était au sixième jour ; et de Bérail, en vertu de l’interprétation finalement adoptée, n’avait plus rien de mieux à faire que de regagner son observatoire de ville et d’attendre.
C’est ce qu’il fit. Un roman de Cooper lui tenait compagnie, et il annotait spécialement dans ce livre les imaginations symboliques des sauvages américains, qui ne connaissent point l’art d’écrire. La terrasse, qui partageait avec le livre son attention, demeura, jusque vers le soir, déserte et muette. Enfin, la petite porte donna passage à la Mauresque, si longuement attendue, si vivement désirée ; mais ce fut à peine pour quelques secondes.
609
Elles furent, au reste, merveilleusement employées : d’abord, à l’air triste et inquiet dont Eudoxe, malgré sa joie, ne put totalement se défaire en la voyant reparaître, la jeune indigène devina qu’il n’avait pas compris le signe qui aurait dû, en fixant un terme positif à son attente, la rendre moins amère, moins tourmentée. Ensuite, elle lui promit, d’un charmant regard, qu’elle saurait bien faire de telle sorte que pareil chagrin désormais ne lui arrivât plus ; enfin, comme pour le dédommager de cette pénible épreuve, si peu philosophiquement supportée, quoiqu’il dût s’accuser plutôt qu’elle, la Mauresque ôta de ses cheveux noirs, tombant à larges boucles, quelques fleurs de jasmin qu’elle y avait enroulées pendant son séjour à la campagne, et, les ayant effleurées de ses lèvres, elle les jeta, en fuyant, sur la terrasse d’Eudoxe.
Le signe était plus clair et plus expressif qu’il ne fallait pour qu’il en pénétrât la portée, pour qu’il portât, lui aussi, le bouquet à ses lèvres et le conservât, religieusement… premier gage d’un amour partagé ! Combien est plus poétique la pensée de le disperser aux vents, que celle de le garder si précieusement qu’on le puisse faire, jusqu’à ce que qu’on voie l’impitoyable temps amener sur les fleurs qu’on a reçues fraîches et embaumées, la flétrissure avec ses mortelles rides, la décomposition avec ses désolantes senteurs.
Il y eut encore, dans la conduite de cette femme, une autre délicatesse de sentiment que n’aurait pas eue une femme européenne : beaucoup se seraient facilement consolées de voir à leur tendre correspondant une figure mécontente et soucieuse ; elles auraient dit : c’est sa faute, il n’a pas compris ; l’intelligence lui viendra. Beaucoup même eussent trouvé mauvais qu’en dépit de la souffrance d’une attente perplexe et prolongée, il ne s’épanouit pas tout aussitôt à leur aspect, et que la suprême joie de leur retour ne dominât pas toute autre impression, tout autre souvenir. Plus d’une, que je sais, eût pensé très-convenable, très-ingénieux, très-coquet de punir leur monde par un accès plus ou moins rigoureux de bouderie… La Mauresque, avec ses habitudes de simplicité, sa douceur d’esclave, façonnée à regarder l’homme, et surtout l’homme dont elle est aimée, bien plus comme un maître que comme un jouet, n’imaginait qu’une manière de réparer le tort qu’elle s’attribuait à elle seule dans tout ceci : et c’était de faire si bien qu’Eudoxe ne pût s’empêcher de lui pardonner.
Elle ne se contentait plus du bouquet de jasmin, porteur de son premier baiser, à l’adresse d’un chrétien, dont elle lui avait envoyé, depuis sa terrasse, le charmant hommage ; elle voulut le revoir bientôt armé d’un symbole qui lui promît de ne plus jamais avoir dorénavant un jour presque une heure d’attente déçue.
En effet, au bout de quelques minutes et avant, comme elle le supposait bien, que le jeune homme, quitté si rapidement, se fût retiré et eût cessé de regarder la petite porte, que, d’ailleurs, elle avait eu le soin de laisser entrouverte, l’ingénieuse musulmane revenait munie, contre les malentendus, d’un talisman hiéroglyphique qu’elle se croyait certaine de conduire promptement Eudoxe à déchiffrer, à imiter, s’il en voulait prendre la peine.
Il remarqua, dès le premier pas, son attitude qui avait bien quelque chose, effectivement, de nature à appeler l’attention. Elle marchait, tenant son bras gauche replié derrière elle, tandis que son bras droit, allongé en avant, montrait au jeune homme une feuille verte de palmier-nain. Il s’aperçut, quand elle se trouva de profil devant lui, que, dans sa main gauche était une feuille semblable ; seulement celle-ci était jaune, flétrie, morte, en un mot.
La Mauresque s’arrêta et laissa tomber la feuille morte sur le glacis éclatant de blancheur dont la terrasse était revêtue. Elle retourna la tête de ce côté, et regarda longuement, de manière que le regard d’Eudoxe dut inévitablement s’y fixer à son tour. Il concevait déjà que cette feuille avait une signification symbolique dont il ne s’agissait plus que de se rendre compte, après examen et réflexion, il observa que, sur les huit pointes radiées qui la composaient, elle n’en conservait que deux restées entières et intactes : les six autres, celles du milieu, étaient tranchées à dessein par l’ongle de la Mauresque. Il conclut que cette feuille représentait une semaine, la semaine qui venait de s’écouler (car on était au dimanche, et la feuille n’avait pas été choisie telle sans raison). Il le conclut surtout de ce que, dans cette semaine, il y avait eu, pour la Mauresque et lui, entre le premier et le dernier des jours qui la constituent, six jours de
610
séparation, six jours qui ne devaient pas compter dans la vie de leur amour, et que l’absence avait comme annulées de la même manière que dans son image, la première et la dernière pointe restaient seules, les pointes intermédiaires ayant été coupées.
La Mauresque, en ce moment, soit qu’elle eût deviné que le chrétien avait compris, soit qu’elle voulût, par un indice nouveau, offrir à son intelligence un fil conducteur de plus, appela de son regard l’attention d’Eudoxe sur la feuille verte qu’elle tenait toujours dans sa main droite. Le regard du jeune homme suivit le sien : alors, devant lui, elle coupa avec l’ongle une des pointes de la tige-palmier, c’était la seconde, et la feuille, dans son ensemble, en comprenant huit, aussi bien que la précédente. Il devenait palpable cette fois que la feuille morte, abandonnée derrière les talons de la jeune femme, représentait la semaine qui venait de finir, et que la feuille verte était l’emblème de la semaine qui venait de recommencer. On était au premier jour : ce jour-là, on s’était vu, ou, pour mieux dire, on se voyait encore… et la première dentelure dardait aussi, dans tout son développement, sa pointe aiguë… La seconde, au contraire, venait d’être arrachée ; donc, on ne se verrait pas le lendemain.
Encore une fois, la Mauresque porta l’ongle sur la feuille… Cette fois un geste de détresse à moitié, à moitié de prière, que lui adressa vivement Eudoxe, la convainquit jusqu’à l’évidence que son élève, dans le langage emblématique, saisissait parfaitement sa pensée. Elle coupa cependant l’extrême pointe que son ongle avait déjà légèrement attaquée, posa l’emblème sur le bord d’un petit mur d’appui, limite extrême entre sa terrasse et la terrasse du chrétien… et elle s’éloigna précipitamment. De Bérail n’eut pas de peine à deviner que c’était lui dire : le troisième jour de la semaine, après-demain, vous pourrez m’attendre vers le premier quart de la journée.
Il ne se trompait pas. L’apprentissage est fait… Le voilà initié ! Le voilà savant en matière d’hiéroglyphes… oui ! Si bien que le jour marqué, en arrivant sur la terrasse, ayant jeté les yeux vers la feuille symbolique, il rougit d’impatience peut-être… peut-être aussi de plaisir à cause de la découverte, lorsqu’il remarqua de primesaut une augmentation de moitié, faite depuis l’avant-veille à l’entaille qui lui était déjà connue : c’est-à-dire que le rendez-vous était prorogé de neuf heures du matin à midi.
Telle fut sa confiance cette fois dans cette dernière épreuve, que Marcian, vers dix heures, le vit venir déjeuner… et déjeuner d’un appétit dont il avait perdu toute habitude, et qu’il put, chose inouïe depuis nombre de jours, le retenir en sa compagnie jusqu’à midi moins cinq minutes !
Que vous dirais-je ? Nos deux amants savent désormais se fixer de la manière la plus intelligible et la plus exacte leurs instants de rendez-vous, grâce à cette semaine en feuille de palmier-nain, que de Bérail n’eût pas échangé contre la plus magnifique semaine à compartiments coloriés de main de maître, que Giroux aurait pu lui offrir !
Les nervures de la feuille parlante, l’exactitude aux rendez-vous manqués marchèrent parallèlement ; et chaque semaine, la feuille morte, image du passé, temps que nous laissons derrière nous dans la vie, décoloré, perdu, invivifiable comme une plante fanée, était scrupuleusement remplacée par une feuille verte, frais symbole du présent qui se flétrissait à son tour à mesure que le présent tombait dans le domaine du passé.
Avant qu’un mois se fût écoulé ainsi, le plus souvent il n’était plus arraché à la fois qu’une moitié de nervure à la feuille de palmier… c’est-à-dire qu’on se voyait matin et soir.
Eudoxe n’avait pas encore obtenu davantage : la Mauresque avait même refusé très-obstinément de lui laisser voir ses traits autrement qu’à travers une mousseline transparente dont elle s’était permis l’usage, déjà bien coupable à ses yeux… Mais la nuit donne la hardiesse aux plus timides, déconcerte la chasteté des plus pudiques.
Il arriva donc à la fin qu’elle osa se laisser entrevoir dans un crépuscule qui lui semblait effacer quelque chose de sa faute et de sa honte, en même temps qu’il jetait une teinte plus indécise sur son visage. Et puis, à quelques jours d’intervalle, comme Eudoxe, plus exigeant en raison de ce qu’il avait obtenu, paraissait bien triste de voir qu’on se déshabituât tout-à-coup
611
d’écarter son voile parce que le ciel était brillant, la lune splendide… ; malgré la clarté du ciel, malgré les rayons de la lune, il fallut céder et lui montrer sous cette douce lumière argentée une des plus charmantes figure, un des galbes les plus délicieux que vous ayez pu rêver, ô sectateur du Coran, après la lecture de ses brûlants chapitres, qui vous promettent des houris enivrantes sous des palais enchantés. – C’était un crime ! un grand crime !
L’audace du chrétien s’accrut avec son succès… Un soir (celui de la troisième nervure de la septième feuille de palmier), résolu, impatient et leste, la Mauresque le vit s’élancer tout-à-coup des limites de son domaine vers les limites du sien. Sauter, courir… - Elle n’en vit point davantage, car, poussant un cri étouffé lorsqu’il posa le pied sur la terrasse intermédiaire, elle disparut de son côté, presque évanouie de terreur.
Il y aurait eu de la part d’Eudoxe, comme de l’inhumanité à ne point désormais s’en tenir plus timidement aux signes à distance.
Par exemple ils se multiplièrent promptement d’une manière si remarquable et avec des variantes si expressives, que vous me permettrez de ne m’arrêter qu’à un petit nombre, à ceux qui, par leur industrieuse excentricité, méritent principalement les honneurs de la description, de la publicité.
La Mauresque vint un jour avec deux rubans de soie dans les mains, l’un rouge foncé, l’autre rose pâle. Elle se mit à couper un bout de celui-ci, qu’elle appliqua sur sa poitrine longuement et significativement, avec un geste qui voulait dire : Ceci, c’est moi.
Et, en même temps, elle ceignit cette sorte de ceinture à sa taille qui parut au chrétien (soit dit par parenthèse) des plus sveltes et des plus gracieusement modelées, surtout pour une taille musulmane.
De l’autre ruban, le rouge foncé, elle retrancha ensuite également l’extrémité, puis son souffle fit voler ce fragment coupé vers le jeune homme, qu’elle montrait du doigt en même temps pour signifier : cela, c’est vous.
Les ramassant ensuite, elle se prit très-vivement, à les coudre ensemble, au moyen d’un fil d’or, de manière que le rose et le rouge, rassemblés dans toute leur longueur, représentèrent l’union de leurs deux âmes, pour toute la vie, sous l’attache pénétrante de l’amour.
Eudoxe, joyeux et reconnaissant, d’admirer, d’applaudir, de remercier par tout ce qu’il sut mettre de caresses dans son regard, dans son geste, dans son sourire. Et couvrant ses deux mains de baisers ardents, il les lança vers la Mauresque, à travers l’espace. Prosaïque imitation et véritable pont-aux-ânes des amoureux de France qu’un obstacle sépare, combien n’étiez-vous pas au-dessous des originales inventions dans lesquelles la Mauresque avait le génie de transcrire en quelque sorte toutes les nuances de sa pensée. – De Bérail le sentait bien : il était à l’école, mais vous pensez qu’il acceptait sans humiliation ni murmure les leçons de la jolie maîtresse sauvage que la Providence lui avait départie.
Une autre fois, ce fut une orange percée à jours par mille coups d’épingle qui lui fut envoyée par la Mauresque, laissant saigner par chaque ouverture son jus vermeil, de telle sorte qu’il vit bientôt ces points rouges dessiner, par leur disposition sur l’écorce du fruit doré, la forme grossièrement ébauchée d’un cœur. Emblème qui semblait lui signaler quelles douces et nombreuses blessures il avait faites à celui de la jeune musulmane.
Faute d’imaginer mieux, il répondait toujours de la même manière aux signes ingénieux et variés dont on l’accablait : mais cette fois, la Mauresque, pour lui témoigner sa joie et sa gratitude, lui renvoya tout d’un coup, à deux mains, cette foule de baisers en simulacre dont elle n’avait osé jusqu’alors accepter l’hommage qu’en fuyant rouge de honte… Heureux jusqu’à l’enthousiasme, de Bérail ne put s’empêcher de bondir, cette fois encore, jusque tout près du bord de la terrasse… Il s’élançait pour la franchir, lorsque la Mauresque, posant un genou en terre et joignant les deux mains, les tendit vers lui, suppliantes, avec une telle grâce de prière, une telle éloquence de regards épouvantés, qu’il s’arrêta aussitôt.
Elle ouvrit doucement les voiles qui lui couvraient la poitrine, et tira de son sein l’espèce d’écharpe à deux couleurs, symbole de leur union ; puis, après y avoir fait un nœud, elle la serra
612
contre ses lèvres, et parut s’oublier dans cette expressive attitude. Après quoi, elle arracha à la palme digitée qui représentait pour eux les jours et les heures présentes ou prochaines, la presque totalité de la nervure indicative de la journée actuelle. C’est-à-dire qu’elle promettait au chrétien de revenir le voir tard, bien tard dans la soirée… Il le comprit d’autant mieux, qu’avant de se retirer tout-à-fiat, elle lui adressa un geste qui voulait exprimer à la fois, comme le mot espagnol spera, cette double idée : Attends… et espère.
Chapitre V : le crime puni De Bérail avait traduit le geste de la Mauresque absolument dans le sens du mot
espagnol. De même, à la manière espagnole, il aurait voulu faire donner à sa belle quelque sérénade pour célébrer son amour… chanter du moins, de sa plus belle voix, faute de musicien, quelque douce romance nocturne, pour hâter sa venue ; mais, en vérité, le cœur lui battait trop violemment !...
Ce fut heureux pour lui, car s’il ne fut demeuré dans un profond silence, il n’eût pas entendu, vers onze heures du soir, deux petits coups discrets frappés à la porte du rez-de-chaussée de sa maison. À ce bruit si ordinaire, mais si plein, suivant l’ordre de ses pensées, des plus voluptueuses espérances, il descendit les degrés comme un fou, et, pâle d’émotion courut ouvrir.
Une négresse se présenta, une horrible négresse… affreux mécompte ! Mais sa noire main était munie d’un symbole qui le réconcilia avec elle tout aussitôt ;
elle portait le ruban rose et rouge, signe d’alliance plus que fraternelle entre la Mauresque et le chrétien ; et ce signe, pareil à l’arc-en-ciel de l’Écriture, remit instantanément la joie au lieu de la tristesse dans son cœur.
La négresse lui offrit un manteau noir à capuchon, un de ces larges cabans qui dissimulent des pieds à la tête celui qui les porte, puis elle se mit à marcher devant lui.
Impatient de la suivre, et sans prendre le temps de se couvrir de cet auxiliaire si intéressant pour les rendez-vous nocturnes, Eudoxe va s’élancer ; car il connaît depuis longtemps la porte qu’il espère voir tout à l’heure s’ouvrir devant lui.
Il fait quelques pas ; mais au tournant de la rue dont sa maison forme l’angle, il remarque que la négresse, tout-à-coup arrêtée derrière lui, indique du geste et du regard un tout autre chemin ; force lui est de se résigner à la suivre.
Après avoir tourné autour de l’îlot de bâtiments où sont comprises et sa demeure et celle de la Mauresque, elle touche une porte qu’on pourrait appeler non-seulement secrète, mais invisible ; tellement invisible que notre amoureux, dans toutes ses pérégrinations circonvoisines, ne l’a jamais soupçonnée… La porte s’ouvre comme d’elle-même… Sur le seuil, à l’intérieur, était la Mauresque, debout, le visage découvert, mais pâle… Saisir la main d’Eudoxe, l’embrasser vivement, rompre la moitié du ruban symbolique et s’enfuir vers le fond du péristyle avec ce doux emblème dans son sein… Tout cela fut l’affaire de quelques secondes, pendant lesquelles il demeura immobile de stupéfaction.
Lorsqu’il voulut s’élancer après la jeune musulmane, la porte intérieure du vestibule était déjà refermée devant lui. La négresse, en même temps, d’un bras se hâtait de le retenir, de l’autre lui imposait silence en appuyant ses doigts sur sa bouche. Ce qui venait de se passer lui signalait quelque chose de mystérieux, un péril sans doute. A la clarté vague que projetait dans le vestibule un reflet de la lune qui frappait en plein sur la blancheur des murailles situées à l’opposite de la rue, elle cherchait autour d’elle quelque signe indicateur qui, selon toute apparence, avait dû être laissé par la Mauresque pour lui faire comprendre ce qui s’était passé, ce qui restait à faire.
Presque au même instant, avec cette précision de regard que donne l’appréhension d’un danger, elle reconnut sans doute le muet et significatif emblème, car elle repoussa vivement Eudoxe.
613
Voici ce que la négresse avait distingué : une forme de main sculptée dans le plâtre, à côté du cintre de la porte basse derrière laquelle sa maîtresse venait de fuir, était marquée, vers le milieu, d’une raie noire figurant une croix : sans doute, ce signe avait été fait à l’instant même, avec un morceau de charbon dont elle remarquait encore sur le seuil la trace fraîchement écrasée.
Non moins habile que toutes les autres femmes que l’Orient condamne, par son ombrageuse tyrannie, à correspondre par des symboles, la négresse lisait là toute l’histoire que la Mauresque avait essayé de lui faire comprendre.
Une main coloriée ou sculptée sur la muraille près de la porte des maisons juives ou musulmanes est, dans leurs croyances superstitieuses, une arme contre les mauvais génies, un talisman qui écarte le mauvais-œil. La croix marquée dans la paume de cette main avait pour signification évidente que le talisman avait été moins fort que le démon dont il aurait dû déjouer les cruels desseins ; qu’il y aurait péril pour le chrétien de se hasarder plus avant. Le charbon écrasé sur le seuil avait pour but d’attirer l’attention au moment où l’on voudrait le franchir, et aussi de montrer comment serait pulvérisé l’aventureux jeune homme, s’il avait l’imprudence de passer outre.
Eudoxe n’avait rien vue de toutes ces choses ; la négresse ignorait notre langue pour les lui expliquer. Les moments pouvaient être comptés ; il se serait d’ailleurs refusé sans doute à rien comprendre d’une interprétation fatale à son bonheur. Elle ne chercha qu’à l’entraîner dehors. De Bérail hésitait encore sur la porte extérieure demeurée ouverte, lorsqu’il entendit quelqu’un de l’intérieur pousser l’autre en avant avec une impétuosité, un bruit extrêmes. La négresse referma sur lui celle de la rue.
Mais ce mouvement n’avait pas été si rapide que, pendant l’espace d’un éclair, deux hommes qu’il y avait péril de mort à laisser même s’entrevoir, ne se fussent réciproquement aperçus : Eudoxe et un vieux Turc à barbe grise dont les yeux étincelaient comme des étoiles, la main comme le passage d’un éclair.
La négresse, atterrée, n’eut pas même la force de reculer devant le châtiment du vieillard ; elle plia les genoux et attendit.
Cependant Eudoxe s’éloignait dans la rue : à dix pas du seuil, un long cri de détresse le fit frémit des pieds à la tête, en même temps qu’il entendait un bruit sourd et rapide, pareil à la chute d’un corps humain sur un plancher sonore. C’était un cri de femme. C’était dans la maison mauresque qu’un cadavre, sans doute, venait d’être précipité sous un poignard vengeur.
Le malheureux jeune homme bondit, comme blessé lui-même ; il courut tout d’une haleine chez son ami Marcian, pour lui demander des armes dont sa chambre était ornée et son assistance même, s’il y voulait consentir, afin de revenir forcer la maison mauresque et venger de leur main la victime de cette fatale soirée.
Adolphe, plus sage, l’entraîna, non sans peine, à la police, où ils déclarèrent ensemble et comme gens qui auraient, par hasard, surpris les indices d’un crime en passant dans la rue, qu’un assassinat venait d’être commis, selon toute probabilité, dans la maison qu’ils désignèrent.
La police courut avec eux vers le lieu signalé. Tout paraissait parfaitement calme ; aucune lumière, aucun bruit. On ne se crut pas le
droit de pénétrer nuitamment dans cette demeure, sur les douteux indices fournis par Messieurs de Bérail et Marcian.
C’était, en effet, l’habitation d’un ancien chérif d’Alexandrie, que la guerre, portée en Égypte par l’invincible sultan des chrétiens, avait fait émigrer vers Alger. Cet homme, plus tard, ayant encore vu poindre le même drapeau tricolore, qu’il avait fui aux rives du Nil, triomphant de nouveau sur la Casbah des corsaires méditerranéens, avait courbé la tête et s’était écrit avec la résignation désole, mais fatales des musulmans aux jours d’épreuve : « Dieu a mis la force dans la main des Français ; les Français doivent être toujours mes sultans, quelque part que j’essaie de porter mes pas… c’est écrit ; soumettons-nous ! »
614
Et dès lors, au lieu de songer à fuir une seconde fois devant ces maîtres inévitables, il était demeuré ; il avait reconnu des premiers la puissance du vainqueur.
Depuis la conquête, on s’était donc habitué à voir en lui un des plus calmes et des plus franchement soumis entre tous les Turcs d’Alger. La maison d’Hassan Mustapha était donc sacrée pour nos hommes de loi, à l’égal, sinon plus qu’à l’égal de celle d’un citoyen français ? Au reste, pourquoi, comment un meurtre chez lui ? Veuf de toutes ses femmes, il n’avait dès longtemps pour famille qu’une fille appelée Aziza, et pour tout domestique cinq esclaves nègres, de son âge, et une vieille négresse qui avait allaité sa fille.
On attendit le lendemain matin pour frapper à son seuil, de par la loi et le roi… Mais les sommations du magistrat demeurèrent sans réponse : alors on passa par les maisons voisines, on descendit par les terrasses : personne ne se trouva, soit dans l’habitation du maître, soit dans la douera des esclaves et des femmes. Aucune trace de sang nulle part ; aucune trace de fuite !...
On fut logiquement forcé d’admettre que nos jeunes gens avaient cru entendre ce qu’ils n’avaient point entendu ; et, cela, d’autant mieux qu’un émissaire envoyé à la campagne d’Hassan, rapporta, d’après Hassan lui-même et d’après les dires de ses serviteurs, que, depuis, sept jours au moins, il n’en était pas sorti.
Ces renseignements ne pouvaient suffire à calmer l’inquiétude d’Eudoxe. Il reprit, accompagné de son inséparable ami, ses habitudes de pêche matinale dans leur barque depuis deux mois délaissée ; d’abord, Marcian, lui aussi, ne pêchait plus par contenance, et pour surprendre, non pas le secret des eaux bleues de la Méditerranée, mais pour pénétrer le sanglant mystère qu’avait dû ensevelir la maison du vieil Hassan Mustapha.
Mais peu à peu, faute de rien apercevoir d’intéressant à cet égard, il se relâcha de son attention primitive, lui qui n’était pas sans cesse aiguillonné par la crainte d’avoir occasionné un meurtre, le meurtre d’une femme aimée !... Il se laissa, par moments, aller, sans le vouloir, à sa pêche scientifique d’autrefois… Hélas ! pardonnez-le lui !
Eudoxe était toujours le même, tout yeux, tout oreilles, la pensée incessamment tendue vers la maison de campagne d’où il espérait voir un jour ou l’autre échapper quelque précieux indice : son anxiété se ravivait avec le temps au lieu de décroître.
Enfin, par une de ces matinées d’octobre, où la terre longuement échauffée durant tout l’été, commence à répandre dans l’atmosphère plus humide, sous un soleil moins puissant, ces brumes condensées qui, bientôt, vont devenir des nuages et retomber en torrents de pluie, il arriva un moment où la vapeur environnait le rivage d’un voile si épais, que les yeux du jeune homme cherchaient en vain à ressaisir même la blanche silhouette de la maison mauresque, objet continuel de son attention.
À plus forte raison, dans cet opaque brouillard, ne pouvait-il apercevoir des êtres humains qui se mouvaient çà et là sur la côte voisine, et qui, tous, s’approchaient à l’envi de la mer, en suivant les anfractuosités les plus ténébreuses de ce promontoire de rocher qui, dans ces parages, domine partout les flots.
Soudainement et presque à la fois, douze ou quinze coups de feu très-rapprochés, éclatèrent ; douze ou quinze balles vinrent siffler à ses oreilles et se perdirent autour de lui dans les flancs de la barque.
Du côté du large, à une distance d’environ cent pas, un fort sandal, conduit à la voile, glissait en silence au milieu des brumes : il semblait fuir la terre et se diriger dans le sens du détroit. Bien que ceux qui l’occupaient eussent le dos tourné par rapport aux deux amis, de Bérail remarqua facilement qu’il y avait à la poupe un Turc à burnous écarlate, ayant une femme assise près de lui.
L’homme se dressa… : c’était Hassan !... Mais la femme, était-ce Aziza ? Mon dieu ! était-ce sa fille ?
Les détonations avaient semblé faire, par contre-coup, se mouvoir le vieillard et se tenir debout quelques secondes, avaient aussi, bien heureusement, fait refluer une espèce de courant
615
d’épaisse brume de noire fumée vers la yole des deux Français qui, grâce à cette circonstance, disparut pour quelques minutes comme noyée dans ce réseau d’obscure vapeur, sans quoi, le vieux Turc pouvait les apercevoir, et il fut venu probablement les frapper du long yatagan qu’on voyait briller dans sa main menaçante.
Sans doute, il ne supposa pas que les balles lui aient laissé cette besogne à faire ; car il se rassit, et le sandal continua à voguer, sans qu’il regardât même de leur côté.
L’embarcation de nos pêcheurs n’était point amarrée. Tous deux ensemble, de sauter sur les rames, de filer sur la vague de toutes leurs forces, et, vraiment, d’une façon très-rapide, malgré l’inexpérience de rameurs qui n’avaient guère pratiqué sérieusement depuis leurs courses de jeunesse entre Paris et Asnières.
Ils le firent, dans le premier instant, sans échanger une syllabe ; la stupeur, l’émotion, l’anxiété les avait matériellement saisis à la gorge et privés de la parole.
Ce ne fut guère qu’au bout de 5 minutes, quand ils se virent déjà loin du rivage, loi, surtout, de la barque ennemie, que tout à coup, ils parurent l’un et l’autre à la fois, reprendre la suite de leurs idées et l’expression de leurs sentiments, jusque-là comme paralysées par l’imminence du péril.
- Tu n’es pas blessé, Marcian ? - Tu n’es pas blessé, Eudoxe ? - Non. - Non ! Firent-ils simultanément. Et ils se serrèrent la main avec ivresse… Non
sans continuer d’un bras à ramer vers la Pointe-Pescade, leur terre de salut. Puis, un peu plus loin : - Dieu soit loué ! nous sommes bien heureux ! reprit Adolphe - Oui ! nous sommes bien heureux, ajouta de Bérail, mais va ! c’est un horrible
supplice que d’avoir vu là, cette femme aux côtés de ce Turc implacable, et de n’avoir pu distinguer si c’était Aziza… de ne pas être sûr que ce tigre n’a point poignardé ma bien-aimée, en expiation même de notre amour !
- Il n’avait plus sa négresse auprès de lui ? reprit Marcian. Crois-moi, on aime mieux tuer son esclave que sa fille… la vieille nourrice que l’enfant si jeune encore… Ton Aziza n’est pas morte, je t’en suis garant… mais, au nom du ciel, ami, renonce à de telles aventures !... elles nous ont porté malheur à tous.
- A tous, comment ? De quel malheur veux-tu parler pour toi ? - Regarde… ma ligne est toute brisée par les balles… et sais-tu dans quel moment
elle m’a échappé des mains ? C’est lorsque j’attirais vers moi, avec une précaution religieuse, un poisson énorme, coloré du plus magnifique indigo. Si bien que, frappé sans doute d’un de ces coups barbares, il a répandu à la surface une teinte, mais une teinte… celle enfin qui aurait, une seconde plus tard, résolu le fameux problème… celle qui aurait valu à celui qui l’aurait découverte, analysée, expliquée… Ah ! mon ami ! j’ai perdu là une belle chance ! J’aurais été décoré, Eudoxe… j’aurais été de l’Académie.
Nous qui avons, comme romanciers, le privilège de tout approfondir, de tout pénétrer, même ce qui s’est passé dans le mystère d’une villa mauresque, ou dans les abîmes de la mer, nous dirons que le vieux Turc, après avoir, la nuit dont nous avons raconté les sinistres catastrophes, renversé la négresse à ses pieds d’une blessure peu profonde, s’était résolu, peu de jours après, et voyant qu’elle revenait à la vie, à charger ses autres esclaves de la jeter, enchaînée, dans les flots. La pauvre créature se sentant noyer, avait, dans ses derniers efforts, déchiré de ses dents, de ses ongles, quelques lambeaux de son haïk bleu.
C’était un de ses lambeaux que l’hameçon de Marcian avait saisi par hasard, et qu’on aurait pu voir encore flotter à la surface de l’eau, comme une longue tache azurée.
616
L’Écho d’Oran, « Un miracle d’Aïssa. Légende arabe », 22 juillet 1848, feuilleton Le jeune Aïssa (Jésus) habitait le Caire, dans son enfance, avec son père et sa mère.
C’était un enfant tout de cœur, mais turbulent et aimant le jeu avec passion ; on n’en pouvait rien faire. Il passait le temps à jouer, sur les places ou dans les rues, avec ceux de son âge, et ne rentrait pas toujours à la maison sans porter des marques de son étourderie, ce qui donnait parfois de graves inquiétudes à Marie (sur laquelle soit le salut !)
Or il advint, un jour, que les petits camarades d’Aïssa, réunis, en son absence, sur la même place, dans un faubourg assez éloigné de la ville, se prirent de querelle ensemble, et que deux d’entre eux vidèrent la dispute à coups de pieds et à coups de poing. Le plus jeune et le plus faible des combattants, se voyant sur le point d’être terrassé, feint de trébucher dans la lutte, ramasse sournoisement une grosse pierre, et, se redressant tout-à-coup, la lance avec vigueur à la tête de son adversaire. Celui-ci tombe sous le coup, sans mouvement, sans couleur et sans vie…
Les enfants se jettent, épouvantés, sur le corps de leur camarade, le soulèvent, le secouent, l’appellent… il était mort.
Pendant ce temps-là, le coupable s’enfuyait à toutes jambes. Le plus âgé de la troupe (c’était aussi le plus méchant) dit alors aux autres : - Écoutez… il est mort, il n’y a plus rien à faire… mais il ne faut pas dénoncer celui qui
l’a tué… et puisqu’Aïssa n’était point avec nous aujourd’hui, si l’on nous demande qui est-ce qui a fait le coup, disons que c’est lui… que risquons-nous ?... Maintenant que c’est convenu, sauvons-nous ! …
Et tous les enfants se mirent à prendre la fuite, laissant le corps de leur camarade sur la terre.
Deux femmes passant par là quelques instants, ramassèrent le cadavre du petit malheureux, l’examinèrent, et, l’ayant reconnu, le rapportèrent à la ville, le déposèrent dans leur maison, et s’empressèrent d’aller informer les parents du triste accident qui venait d’arriver.
Ceux-ci, après avoir gémi sur un événement qu’ils auraient pu éviter en usant de prévoyance, se rendirent en hâte chez le cadi hanéfi, lui contèrent l’affaire, et prièrent, avec larmes, ce magistrat de prescrire les mesures nécessaires pour que le coupable, une fois découvert, fût puni suivant la loi.
Le cadi (que Dieu le rende illustre et nous fasse profiter de ses mérites !), le cadi, homme savant et sage, promit de faire ce qu’on lui demandait, d’autant plus que l’emploi dont il était revêtu lui imposait le devoir d’ordonner le bien et de défendre le mal. Il prescrivit, en conséquence, d’arrêter immédiatement tous les enfants qui couraient par la ville, notamment ceux avec lesquels on savait que le défunt avait coutume de jouer, et de les amener tous, de gré ou de force, à son tribunal.
Les chaouchs du cadi, quelques adouls même, partant aussitôt dans toutes les directions, se mirent à la recherche des enfants… et, en moins d’une heure, ils en ramassèrent un grand nombre, qu’ils conduisirent, malgré larmes et cris, dans la cour du prétoire. Parmi eux se trouvait l’auteur du meurtre, les témoins de la bataille et le méchant enfant qui avait engagé ses camarades à rejeter le crime sur la tête d’Aïssa absent.
Quant à celui-ci, un chaouch l’avait rencontré dans le voisinage, s’amusant, seul, au bord d’un ruisseau, à pétrir avec de l’argile des oiseaux qui, une fois confectionnés, ouvraient les ailes et s’envolaient. Sur l’injonction qui lui fut faite par l’agent du cadi de le suivre à l’instant, l’enfant avait marché, sans résistance et sans crainte.
Les enfants réunis, on ferma bruyamment les portes du tribunal. Alors le cadi, entouré de ses chaouchs et assisté de ses adouls et de l’agha des bâtons,
portant à la main l’insigne de sa dignité qui servait en même temps d’instrument de supplice, le cadi se fit amener les enfants et les interrogea successivement, les menaçant d’un châtiment terrible s’ils mentaient.
617
Tous nièrent le fait dont on les inculpait, même ceux qui l’avaient vu, même celui qui avait commis le crime.
Soit hasard, soit providence, le petit Aïssa était le seul qui n’eût pas encore été interrogé. On en avertit le magistrat, qui se fit présenter le dernier accusé.
- Est-ce toi, dit-il à l’enfant d’un air rude et sévère, qui as tué ? … - Non, répondit Aïssa avec assurance et sans laisser achever le cadi. - Il ne suffit pas de nier… ton apparente assurance ne m’en impose point… Où étais-tu
pendant ? - Ce n’est pas moi ! … - Qui le prouve ? Tes camarades s’accordent tous pour t’accuser… - Où est le corps de celui qui est mort ? … - Il n’est point ici… Mais à quoi servirait ? … - Qu’on aille le chercher et qu’on l’apporte ici ! … À ces mots, les membres du tribunal se regardèrent avec étonnement ; quel était cet
enfant qui osait parler avec tant de hardiesse devant une assemblée de juges redoutables ? Cependant le cadi, homme savant et sage, envoya prendre le cadavre de l’enfant tué
d’un coup de pierre, et, quelques instants après, le corps du petit malheureux, soigneusement lavé et enveloppé dans des linges blancs, était déposé sur la natte qui tapissait le prétoire.
Mais à peine ce corps fut-il placé à terre, que le jeune Aïssa, s’avançant, dit, en étendant la main sur lui :
- Lève-toi ! … L’enfant se leva incontinent, plein de force et de vie. Et, sans laisser aux assistants le temps de revenir de leur surprise, le jeune Aïssa ajouta : - Quel est celui qui t’a tué ? … Le ressuscité désigna aussitôt du doigt, parmi les enfants pâles d’effroi groupés devant
lui, celui qui l’avait frappé. Quant au méchant enfant qui avait voulu faire retomber la faute sur la tête d’un innocent,
ses camarades le dénoncèrent au cadi, qui l’invita à se disculper ; mais il ne put répondre : il était devenu sourd et muet.
Tous les membres du tribunal se levèrent, inclinèrent leurs rubans blancs, en signe de respect, et portèrent la main droite sur leur cœur.
Et le cadi hanéfi, escorté de tout son monde, reconduisit lui-même le jeune Aïssa à sa mère, et prédit à Marie que cet enfant deviendrait, un jour, un grand prophète.
Et louanges à Dieu, seigneur des deux mondes ! Que Dieu répande sur nous, sur notre maître Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons, la rosée odorante de ses bénédictions !
Un campagnard, « L’actualité, comédie en un acte et en prose », Le Commercial de la Guadeloupe, 23 août 1848 Personnages Un juge de paix. Un propriétaire. Un gendarme. (Personnage muet) Un ci-devant esclave. (Le théâtre représente le salon du propriétaire) Scène I. – Le propriétaire seul chez lui. – Mon Dieu ! que cette situation est terrible ! quel malheur de voir tomber en ruines un pays si riche et si fertile ! … (S’approchant de la fenêtre). Dire que ces campagnes sont perdues ; que des cannes si belles sont étouffées par les herbes ; que les pluies abondantes de cette année féconderaient si bien nos terre, si le travail venait en aide à la saison ; qu’il ne nous reste qu’à mourir de faim, nous qui ne demandons qu’à vivre, en
618
faisant vivre aussi les citoyens sur lesquels la liberté française vient d’étendre son bras protecteur. Mais qui sait ? Je nourris encore une espérance. J’attends le citoyen Juge de paix qui depuis huit jours m’a promis une visite. Il est vrai qu’il se fait bien attendre, et que ce n’est pas ainsi qu’on répond à une lettre aussi pressante que la mienne. Mais enfin il a peut-être de sérieuses occupations ; et puis j’ai confiance dans son énergie, dans sa connaissance immense du pays et de la classe des travailleurs. Mes oreilles me tromperaient, ou j’ai bien entendu le trot d’un cheval, de deux chevaux même ; car il n’aime pas à voyager seul… Oui, c’est lui enfin, accompagné d’un citoyen Gendarme. Scène II. – Le précédent, le citoyen Juge de paix. (En-dehors et devant la case, se promène le gendarme en fumant un bout à nègre, en lançant de temps en temps un regard furtif aux deux interlocuteurs). Le juge – Bonjour, Monsieur, eh bien ! Sommes-nous contents ? Le propriétaire. – Pas le moins du monde, Monsieur. Le juge – Comment ! vous aussi, vous ressemblez à tous les autres ; la situation présente vous préoccupe amèrement. Le propriétaire. – Il y a bien de quoi. Le juge. – Si je l’avais su je me serais rendu plus tôt à votre invitation. Mais nous sommes tellement habitués aux plaintes des propriétaires, que, vous comprenez… l’autorité est là, que diable. Le propriétaire. – Monsieur, donnez-vous la peine de regarder ces six pièces de cannes. Le juge – Elles sont magnifiques. Le propriétaire – Elles sont dévorées par les plantes parasites ; il faudra deux mois et cinquante travailleurs pour les sarcler seulement ; et pendant que tout périt je vois passer tous les jours sous mes fenêtres ces citoyens nouveaux qui chantent narquoisement la Marseille [sic], et s’en vont se promener, dormir ou s’amuser. Le juge – Vous êtes sans doute au-dessus de ces petites taquineries : prenez patience… Le propriétaire – Mais, monsieur ; ils habitent dans une case à moi, cultivent un jardin à moi, se nourrissent de mes vivres, de mes légumes, vendent mes légumes, gagnent de l’argent avec mes légumes. Le juge – Prenez patience, Monsieur ; tout cela est un feu de paille ; ça ne durera pas ; mais tout ne peut pas être fait un en jour. Le propriétaire – Hier, Monsieur, ces citoyens m’ont abasourdi toute la journée par leurs chants et leur tambour ; ils ont dansé jusqu’à la nuit, comme des bergers des premiers âges. Le juge – Vous voyez donc bien qu’ils ne sont pas méchants, et que nous avons raison de vous dire : attendez, attendez encore ; de la prudence. Soyez convaincu de ceci, monsieur, que nous nous occupons très vivement de notre situation ; nous sommes touchés des souffrances que vous éprouvez ; et nous allons dans quelques temps écrire en France pour faire un tableau palpitant de vos misères… mais, j’y pense, n’avons-nous pas à voir un nègre mauvais sujet ? Le propriétaire – Oui, monsieur le juge de paix ; par ses mauvais conseils, il empêche d’aller au travail quelques hommes qui ne demanderaient pas mieux ; il est impossible de pousser plus loin l’insolence, la méchanceté, on a eu même à lui reprocher déjà des vols assez hardis ; enfin, je lui ai intimé l’ordre de sortir de chez moi dans les vingt-quatre heures, voilà dix jours de cela ; et il est toujours dans sa case. Je voudrais, Monsieur, que vous lui prouvassiez aujourd’hui en l’expulsant, que le droit de propriété n’est pas encore illusoire. Le juge – Toujours donc pour les moyens de rigueur ; vous allez voir que je saurai faire respecter le maître, sans en venir à cette extrémité ; je m’en vais le secouer d’une façon solide, menez-moi près de lui (Ici la scène change : le salon du propriétaire devient case à nègre ; pendant ce temps, les citoyens propriétaires et juge de paix se dirigent vers l’endroit indiqué ; le gendarme les suit sur un coup d’œil du fonctionnaire ; sur le point d’entrer, le juge de paix fait passer devant lui le citoyen gendarme qui pénètre ainsi le premier dans la case).
619
Scène III. Les précédents, un nègre couché, mais qui se lève à l’arrivée des trois personnages. Le propriétaire – Le voici, Monsieur le juge de paix, le plus mauvais garnement du bourg. Le juge – Le coquin ! approchez et montrez vos mains (à part) je respire, il n’a sur lui aucune espèce d’armes. (Haut) Eh bien ! mon gaillard, c’est donc vous qui ne voulez pas travailler… comment ! bâti en Hercule, comme vous l’êtes (il lui tape amicalement sur l’épaule) avec des omoplates comme les vôtres ; (signes de mécontentement du propriétaire), avec des muscles aussi arrondis, vous ne voulez rien faire. Voyons, mon ami, voyons ; il faut vous dégourdir, que diable… (pendant tout ce discours mouvements réitérés du propriétaire impatienté). La République ne vous a pas fait libre pour vous rendre tout à fait paresseux : elle veut que la raison soit substituée au fouet ; elle veut que le libre arbitre… Le propriétaire – Mais, M. le juge, il ne sait ce que c’est que le libre arbitre… Le juge – Laissez-moi faire, que diable, vous ne voyez pas que mes paroles le touchent. Elle veut, dis-je, que le libre arbitre soit substitué à l’arbitraire du maître, pour faire de vous des hommes, des hommes complets, des hommes en un mot, car jusqu’ici vous ne l’étiez guère. Voyons donc, allons, que diable ; je suis sûr qu’il ira demain au travail, n’est-ce pas, mon ami ? Le nègre – Oui, mouché. Les trois personnages sortent, le juge de paix d’abord, le gendarme le dernier. – Patate bouillie ! s’écrie le nègre (c’est le terme dont généralement ils désignent l’autorité) moi, pas qu’allé travail ; et il se recouche. Le juge de paix se félicite de son heureuse intervention, annonce au propriétaire qu’il va continuer une excursion qui débute si bien, et pique des deux, toujours avec son gendarme. – Le propriétaire s’enferme chez lui, ne veut voir personne, et répète toute la journée : mon Dieu ! mon Dieu ! quand aurons-nous un sabre à la tête de la colonie.
Rousseau St-Val, « Le Jugement de Dieu », Le Commercial, 26 septembre 1849, feuilleton Approche ici, Bissette, et dévoile ton cœur Au Dieu de l’univers, ton divin créateur. Un chrétien tel que toi n’est pas dans l’ignorance Que l’esprit infini lit dans la conscience ; Qu’il sait en démêler les fils les plus tenus, Et qu’alors, tous détours deviennent superflus. Bissette Seigneur, ferme en ma foi dans vos divins mérites, Ces grandes vérités dans mon cœur sont écrites, Ce cœur sera loyal, parce qu’il croit en vous, Et qu’il veut apaiser votre juste courroux. De mes frères captifs les odieuses chaînes Faisaient courir mon sang bouillonnant dans mes veines ; Mon esprit révolté ne pouvait consentir A les voir constamment destinés à souffrir. Emporté par l’ardeur dont pétillait mon âme, J’ourdis avec les miens une terrible trame. A ma voix, tous les bras s’empressent de s’armer, On jure de mourir ou de se rédimer, Plus léger que méchant dans ma fugue insensée Je crus beau de venger la nature blessée, Je ne redoutais point de payer de ma mort Un laurier qui des miens adoucissait le sort. Hélas ! j’oubliai trop dans cette circonstance Que le hideux système émanait de la France ;
620
Qu’il naquit tout entier de règlements royaux, Reléguant l’africain au rang des animaux, Et qu’alors, au colon, ne revenait l’injure D’être l’auteur d’un mal dont son âme était pure. Du crime, à mon insu, je devins l’instrument : J’oubliai le fautif, m’en pris à l’innocent. Mais juste en vos décrets, ô divine lumière ! Je vis mon grand dessein se résoudre en poussière. Soudain, je fus vaincu, poursuivi, condamné, Et l’exil expira mon vœu désordonné. Dieu Bissette, c’est fort bien ; j’approuve ta franchise : C’est la noble vertu qui te caractérise. Criminel par les faits, tu fus grand par le cœur : Tu te trompes de route et voilà ton erreur. Mais apprends de ton Dieu, que jamais sur la terre Le bien ne peut surgir d’une coupable guerre ; Qu’un forfait ne saurait racheter un forfait, Et qu’un mal inutile est toujours un méfait ; Que le sang innocent a droit à ma justice ; Que je dois en punir l’injuste sacrifice. Bénis donc ma bonté de t’avoir empêché D’imprimer sur ton front cet horrible péché. Bissette J’ai reconnu, mon Dieu, votre sollicitude ; Elle a rempli mon cœur de vive gratitude ; L’école du malheur a mûri mon esprit, Et, de mes torts passés, je suis vraiment contrit. Un soleil plus heureux s’est levé pour mes frères, La douce liberté les voit sous ses bannières, Mais de ce grand bienfait ignorant les devoirs, Ils déclinent tous droits, s’arrogent tous pouvoirs. Des meneurs imprudents, montagnards égoïstes Exploitent leur esprit, les rendent anarchistes ; La discorde est le but de leur fatal mandat, C’est le vœu le plus cher de leur grand candidat ; Il sait qu’en l’union gît pour lui l’anathème, Aussi la combat-il à l’aide du blasphème. Dieu Mes yeux sont attachés sur ces hommes pervers Qui subiront bientôt un immense revers ; Ils sont déjà pesés dans ma juste balance, Et des remords cuisants seront leur récompense. Retourne près des tiens, et dessille leurs yeux, Dis-leur que la concorde est l’objet de mes vœux ; Que l’affreux désaccord, comme au malin ulcère, Ronge les nations et cause leur misère. Je ne te cèle point que souvent ton chemin
621
Sera loin d’être uni, comme un lisse vélin ; Quelques aspérités, de distance en distance, Arrêteront tes pas, mais non ta persistance ; Tu vaincras tout obstacle, en dépit de Schoelcher, Dont le prisme menteur est un don de l’enfer. Ton œuvre te fera le plus grand de ta race, Et déjà, dans le ciel, j’ai désigné ta place ; C’est le prix que j’accorde au dévouement humain, Consacré tout entier au bonheur du prochain. Pointe-à-Pitre, le 18 septembre 1849, Rousseau St-Val
« Dernière lamentinoise », Le Commercial, 17 octobre 1849, deuxième page Air : Du Dieu des bonnes gens Assez longtemps, nous ka fait nous la guerre, Et sans jamé trouver aucuns moyens De tirer nous de l’affreuse misère, Qui déjà tué combien de citoyens. Ah ! si chacun, cependant, té bien sage Et avant tout, té ton républicain, Nous sré déjà, sans faire aucun tapage, Allongé nous la main (bis) Oui, mé zamis, depuis la République, Si franchement nous té rapproché nous Sans mêler nous d’opinion politique ; Mais travailler au bonheur à nous tous. Campagne à nous sré déjà bien fertile, Tandis que non, nous ka jus manqué pain ! Gadé combien dans la rue sans asile Qui ka tende main (bis) Et zot, Gazet, assez de politique ; Pays à nous kallé périr, hélas ! Si plus longtemps, zot continué réplique Qui brouillé nous et dont nous déjà las. Devoir à zot, cé précher la concorde, Oubli de tout et l’amour du prochain ; Zot pé pourtant fait cesser la discorde, En donnant zot la main (bis) Plus de passion, de haine et de chimères, Faut plus parler de préjugé de peau. La France vlé que z’enfants li soé frères, Noir, Blanc et Rouge unis comme au drapeau. Honte à céla qui vlé resté derrière ! Qui vlé croupir dans yon passé lointain ; Faut nous marcher là, sous même banière En tenant nous la main (bis)
622
Chandellier, « Les petites misères de la vie algérienne », L’Akhbar, 16 août 1851 Hélas ! oui : la vie algérienne a ses petites misères ; elle en a même de grosses. Ainsi
les pluies torrentielles de l’hiver, les chaleurs accablantes de l’été, le sirocco, les moustiques et autres insectes, la dysenterie, l’ennui qui accompagne une existence monotone et peu émaillée de plaisirs, sont ce qu’on peut appeler les grosses misères de la vie algérienne ; mais ne nous occupons que des petites, et comme notre intention n’est pas d’attrister nos lecteurs, et surtout nos lectrices, par une peinture trop exacte et trop fidèle, glissons sur ce vaste sujet ; n’appuyons pas. Effleurons légèrement, sans vouloir tout embrasser.
Je ne connais pas de ville où il soit moins permis de rêver et de dormir qu’à Alger. Il n’y en a point où l’oreille soit déchirée de cris plus discordants, où le paisible promeneur soit en butte à plus de tribulations. O civilisation conquérante ! Voilà de tes bienfaits ! Les indigènes nous accusent, entre autres énormités, d’avoir importé le choléra en Algérie. Ils peuvent, à bien plus juste titre, nous reprocher d’avoir fait d’Alger une cité turbulente et désordonnée, avec de grandes rues, pleines de boue en hiver, pleines de poussière et de soleil en été, avec de hautes maisons à la française, puantes et malsaines, qui interceptent l’air et la vue, et qui, dressant leurs sombres murailles au-dessus des blanches terrasses à la mauresque, attristent et détruisent la gracieuse symétrie du vieil Alger.
C’était, avant les prouesses de l’architecture française, une ville des plus charmantes. On pouvait y marcher à sec quand il pleuvait, à l’ombre quand le soleil africain dardait ses rayons les plus brûlants. Les terrasses régulièrement étagées et s’élevant en amphithéâtre n’empiétaient pas les unes sur les autres. Une police intelligente le leur avait défendu. Lorsque, au soleil couchant, la brise de mer commençait à rafraîchir l’atmosphère, toutes ces terrasses se peuplaient de femmes et de jeunes enfants. Les rires, les gais propos s’échangeaient par-dessus les rues étroites, et, tandis que sur les maisons tout était bruit et gaieté, dans les rues tout était silence. La ville rentrait chez elle et se couchait de bonne heure. L’obscurité venue, la circulation cessait. On ne connaissait pas l’usage fallacieux des réverbères. Les passants attardés avaient soin de se munir d’une lanterne ou d’un fallot. C’était plus modeste et plus sûr. Mais ces passants étaient fort rares. Il fallait un firman pour courir les rues dans les ténèbres. Il en fallait un pour chanter et jouer des instruments. C’était là une ville où l’on pouvait dormir, une ville tranquillement affairée pendant le jour, et où, pendant la nuit, on n’entendait que la voix monotone du muezzin !
Médecins empiriques que nous sommes, nous avons changé tout cela. La ville n’a pas eu le temps de s’endormir, ou, du moins, elle n’est pas encore éveillée que déjà le tumulte commence. Les chèvres font sonner leurs sonnettes, les ânes et les chevaux braient ou hennissent. Les biskris, les nègres et les négresses se livrent à de furieux combats de paroles où chacun lutte à qui vociférera le plus vite et le plus fort. Aux abords des places et des marchés, le bruit dégénère en un vacarme étourdissant. Les idiomes les plus variés, le Français, l’Espagnol, l’italien, le provençal, l’arbia et la langue sabir qui les comprend tous, se heurtent, se mêlent et confondent l’oreille par la diversité de leurs intonations. C’est une image de la tour de Babel. Le Parisien même le plus alerte a fort à faire pour se frayer un passage dans ce fouillis d’êtres humains qui encombrent certaines rues, celle de Chartres, par exemple. Sur d’autres points, vous rencontrez des Maltais qui colportent des paniers de poissons, des garçons bouchers indigènes chargés de quartiers d’animaux tout saignants, des camions traînés à bras par des biskris, d’énormes futailles et des colis de toute forme et de tout genre portés par eux sur de longues pièces de bois. Le cri : balek, balek, vous arrive de tous les côtés à la fois. Il vous faut veiller sur vous avec une attention continuelle. Vous vous rangez contre le mur pour éviter ces grandes planches chargées de pain qui vont au four ou qui en reviennent, et vous vous jetez dans les jambes de quelques Arabes paresseusement étendus au soleil ; ou bien, accident plus grave, vous essuyez de votre fraîche toilette le dégoûtant burnous d’un bédouin. Le soir, c’est bien autre chose. Des matelots en goguette se répandent dans les rues. Des soldats en permission assiègent les débits. Des bourgeois, des ouvriers, et même des indigènes trop civilisés, qui n’ont
623
point observé les prescriptions du Prophète, promènent çà et là leur gaieté tumultueuse. Les chants patriotiques, bachiques, érotiques, retentissent, se mêlant au tintamarre des cafés-chantants et au fracas des tambours.
Après ces généralités, passons à quelques détails des petites misères de la vie algérienne. Nous avons émancipé les Juifs, et les Juifs, en leur qualité de quasi-citoyens français, se
croient autorisés à célébrer des fêtes nocturnes et bruyantes qui troublent le repos des voisins. Dieu sait le vacarme qu’une seule famille israélite est capable de faire sous l’influence du maïa, quelles notes perçantes les femmes excellent à tirer de leur gosier et de quels sons nasillards les hommes les accompagnent. Et remarquez que ces fêtes sont très multipliées. Noces, circoncisions, fête des galettes, fête des rameaux ou des cabanes, il n’y a pas de population qui ait plus d’occasions de faire du tapage et qui connaisse mieux l’art de s’en servir. Je ne dis rien de leurs synagogues, sinon que c’est un voisinage fâcheux. Je n’ai jamais compris que, sous prétexte de prier Dieu, il fût permis à des hommes d’abuser à ce point de leur nez, et d’incommoder si fort celui des passants.
Malheur à vous, s’il vous prend la fantaisie de vous établir dans la haute ville. C’est là que les Aissahoua célèbrent leurs mystères, et que cent à cent-cinquante hommes réunis dans un local chantent à pleins poumons pendant toute la durée de la nuit. C’est là que les négresses se livrent à ces danses échevelées qu’aucune description ne peut rendre, et auprès desquelles le cancan, les polkas et les mazurkas des étudiants et des étudiantes de la chaumière ont presque la gravité des menuets d’autrefois. Et ces danses sont accompagnées des mugissements d’un énorme tambour et du cliquetis de gigantesques castagnettes en fer ou en cuivre, ainsi que des you-you frénétiques des femmes. Le tambour français est dépassé. L’opéra qui a inventé tant de choses pour étourdir l’oreille est resté bien loin de cette musique infernale, et Muzard, le grand Muzard lui-même, paraît mesquin à côté de ces foudroyants musiciens nègres, lui qui n’avait rien imaginé de mieux pour animer la danse que le bris d’une chaise et un coup de pistolet. – Pauvre homme !
Malheur à vous encore si, fuyant le théâtre de cette musique et de cette danse, vous descendez dans la moyenne et dans la basse ville. Vous tombez en pleine musique espagnole. Cinq ou six amateurs, précédés de deux ou trois autres qui raclent de la guitare, s’en vont processionnellement dans les rues, chantant les airs que vous savez, et ils vous chantent cela avec le sérieux, avec l’air pénétré de gens qui ont la conscience de faire de la mélodie et de l’harmonie. De temps en temps ils s’arrêtent au coin de quelque carrefour, et ils s’envoient mutuellement au nez ces notes étranges qui composent leur mélopée. Les voisins se hâtent de fermer leurs fenêtres et les chats en mal d’amour suspendent leurs concerts, étonnés et confus d’avoir trouvé des maîtres.
Les chants et les guitares des Espagnols sont certainement une des pestes de la ville. La police en tolère les excentricités et semble s’y complaire, comme elle semble se délecter à la danse des nègres – ce que c’est que d’avoir l’instinct et la passion des beaux-arts ! – On rapporte à ce sujet un mot assez original d’un agent. Ce brave homme déclarait que le tapage nocturne n’était un délit que lorsqu’il était commis par des Français, mais que, même avec aggravation de guitare, il était permis aux Espagnols, la guitare étant comme le pain quotidien de ce peuple ; et de fait, on nous a raconté que dans l’incendie d’une maison d’Alger où logeaient des Espagnols, un d’eux se précipita résolument au milieu des flammes pour en retirer d’abord sa fidèle guitare, abandonnant à la providence son mobilier et sa femme. Ainsi Bilboquet s’écriait : « Sauvons la caisse ! »
Les musiciens espagnols ont des rivaux à Alger. Ce sont les musiciens provençaux. Les deux troupes sont bien dignes de s’entendre, et pourtant elles ne peuvent se souffrir. Qu’on en juge par le fait suivant : nous connaissons un jeune homme – musicien français, celui-là – qui locataire d’une famille espagnole, reçut congé de son propriétaire parce qu’il exécutait parfois des airs provençaux. Sa mauvaise chance lui fit choisir son gîte chez un marseillais, et celui-ci
624
non moins intolérant le renvoya pour crime de musique espagnole. On demande qui des deux propriétaires avait tort. Quelques gens soutiennent qu’ils avaient raison tous les deux.
Puisque nous parlons de musique, il ne faut pas oublier la peste des orgues de Barbarie. Ces malencontreux instruments ne peuvent manquer de se naturaliser dans un pays qui s’appelait de leur nom, et d’où sans doute ils sont originaires. Ils pullulent à Alger ; mais, comme il ne nous arrive que le rebut des fabriques de France, d’Allemagne et d’Italie, et qu’après s’être usées, enrouées et détraquées dans toutes les villes d’Europe, lesdites machines viennent ici, comme des invalides, terminer leur criarde carrière, la cacophonie qu’elles produisent est véritablement exceptionnelle. Les indigènes les écoutent et les contemplent avec admiration, soupçonnant qu’il y a là-dedans quelque diablerie, et ils ne se trompent guère. Quand on pense cependant que dans certaines villes d’Allemagne, aucun orgue de barbarie n’est autorisé à se faire entendre dans les rues, s’il ne justifie par un certificat en bonne forme qu’il a passé par les mains d’un accordeur ! Que nous sommes loin de nous aviser de cette sage précaution ! Quelle leçon, quel exemple pour notre municipalité !
C’est déjà une grande calamité quand un orgue de Barbarie s’arrête devant une maison ; mais si le hasard, qui se plaît parfois à déconcerter la philosophie humaine, en amène deux sur le même point, et si ces deux instruments jouent dans des tons différents, que faire, que devenir, où se cacher ? Jetez des poignées de sous par la fenêtre, et ils continueront leur concert pour vous témoigner leur reconnaissance. Que dis-je ? Alléchés par cette bonne aubaine, ils ne manqueront pas de renouveler leur visite ; ils n’étaient que deux : vous en aurez trois ou quatre. Que si vous ne leur jetez pas la monnaie, ils resteront là pour en attendre. Rien n’est obstiné comme un orgue de Barbarie. On les fait souvent servir à de très méchants tours. En voici un qui vaut la peine d’être cité :
Il y a quelques années, certain propriétaire qui, outre une grande maison située dans une des principales rues d’Alger, possédait une jolie femme, avait parmi ses locataires un jeune homme dont les assiduités lui avaient inspiré des soupçons jaloux. Le garder, c’était dangereux. Les facilités sont si grandes quand on habite la même maison ! Le renvoyer sans sujet, c’était se donner un ridicule, et notre jaloux ne voulait pas passer pour tel. Que fait-il ? sachant que le jeune homme avait en abomination la musique des orgues de Barbarie, il en paie deux pour venir chaque jour stationner une heure sous les fenêtres de celui-ci. Il espérait le forcer par là à déguerpir volontairement, et en effet, il y réussit ; le jeune homme quitta la maison à la fin du mois ; mais tous les autres locataires en firent autant, et le propriétaire demeura avec sa maison vide et avec sa femme, avec sa femme à qui le galant avait eu soin d’indiquer sa nouvelle adresser et qui trouva à ce déménagement des facilités bien plus grandes encore.
Pauvres Algériens ! De quelque côté que je regarde, je ne vois pour vous que petites misères : une place du Gouvernement où l’on cherche en vain des chaises pour s’asseoir ; un jardin Marengo, dont les allées supérieures sont dépourvues de bancs ; des fontaines dont l’urne tarie n’a pas une goutte d’eau à répandre, des réverbères auxquels l’huile ou le gaz sont dispensés d’une main trop avare, et qui, faute d’aliment, ne voient jamais lever l’aurore, ce qui ne les empêche pas d’être vertueux ; un théâtre où l’on ne va pas parce qu’il est trop petit, et qui est forcé de fermer parce qu’on n’y va pas ; enfin de petites rues, des rues à arcades, où des Espagnols et des Maltais, assemblés en cercle, interceptent entièrement la circulation.
Faut-il mentionner encore l’ouled-el-plaça, qui vous poursuit obstinément, pendant des heures en vous suppliant de lui donner quelque chose à porter. Tout lui est bon : le rouleau de papier que vous tenez sous le bras, le mouchoir que vous agitez à la main, voire même votre chapeau, quand, en sa présence, il vous arrive de vous découvrir pour saluer un passant ou vous essuyer le front. Et cet autre bohême indigène qui s’embusque sous les arcades, et veut à toute force rafraîchir la toilette de votre chaussure ! Que ladite chaussure soit nette et brillante ; qu’elle n’ait été injuriée ni par la boue ni par la poussière, l’opiniâtre indigène n’en démord pas, et ne cesse pas de répéter son éternel – cirez, cirez ! Si j’étais gouvernement… ou plutôt si j’avais l’honneur d’être membre du conseil municipal d’Alger, je demanderais, par pudeur, la
625
suppression, ou du moins la réduction de cette industrie qui infeste le bas de la ville, et qui me paraît être une critique vivante de la manière dont les rues sont entretenues en été comme en hiver. Ces petits drôles parlent d’adopter Mac-Adam pour leur patron. Où diable la reconnaissance va-t-elle se nicher ?
N'oublions pas l’étameur qui stationne longuement devant les maisons en annonçant sa présence à l’aide d’un marteau dont il frappe sur une poêle ou une casserole, attention ingénieuse dont l’effet est d’assourdir les gens ; l’étameur qui, non content de cet avis préalable, monte dans les maisons, s’arrête devant chaque porte, toujours en s’escrimant de son marteau, et après être parvenu ainsi jusqu’au bout de l’escalier, redescend de la même manière ! rêve, médite, travaille avec un pareil visiteur.
Ici je fais une pause pour donner une larme à la mémoire de cette femme qui vendait des plaisirs et provoquait les amateurs d’une voix si glapissante. La digne femme faisait merveilleusement sa partie dans cet abominable concert des rues d’Alger. C’était une des petites misères de la ville. Elle méritait même de figurer parmi les grosses. Mais elle est morte. On peut dire d’elle qu’elle a fait du bruit dans le monde. Puisse le repos de la tombe ne pas être troublé pour celle qui troubla si bien le repos des vivants.
Les marchands colporteurs juifs termineront cette revue. Ils s’en vont deux par deux, trois par trois, chargés d’énormes ballots et répétant sur tous les tons, chary, chary ! C’est-à-dire : achetez, achetez ! Vous les rencontrez dans les hauts quartiers où ils se croisent tout le jour. Parfois ils se tiennent accroupis devant quelque porte entrebâillée à laquelle ils tournent le dos, et qui laisse apercevoir le bras ou le profil d’une mauresque. Ces discrets personnages ne sont jamais tentés de jeter un regard curieux sur la beauté indigène qui se cache pudiquement. Ils n’en veulent qu’à son argent, et il faut dire à leur louange qu’ils excellent à débiter leurs marchandises. Il faut entendre ces honnêtes colporteurs s’évertuant à crier chary, chary. Mais quelque bonne que soit leur mélopée, elle n’approche pas de celle d’un vieux juif aveugle qui fait profession d’acheter les galons, ceintures et ornements d’or ou d’argent des femmes indigènes. Celui-là ne crie pas ; il hurle, il rugit, il siffle, il braille : sa voix est une tempête comme celle de l’âne, avec laquelle elle a quelque ressemblance. Passez au large et bouchez-vous les oreilles si vous le rencontrez, mais surtout ne faites pas affaire avec lui. Cet aveugle-là y voit clair.
Voilà un léger aperçu des petites misères de la vie algérienne. Il y en a bien d’autres que nous réservons pour un second article. Constations toutefois que bon nombre d’entre elles disparaîtraient si la police de la ville était faite avec plus d’intelligence et de sévérité, et si l’administration municipale avait souci du bien-être des habitants.
Quoi qu’il en soit, on conviendra, après cet aperçu, qu’Alger est une ville fort déplaisante et maussade. Sans doute ! et cependant nous avons connu plusieurs personnes qui, après quelques temps de séjour à Alger, aspiraient avec ardeur à retourner en France, à revoir Paris ; qui, tourmentées du mal du pays, obtenaient enfin de réaliser leurs vœux et qui, dans ce séjour de délices, ne tardaient pas à regretter Alger et s’empressaient d’y revenir. C’est qu’Alger ne s’oublie pas quand on y a une fois séjourné. C’est qu’Alger, la ville des beaux enfants et des jolies femmes, la ville bien-aimée du soleil et de la mer aux flots bleus ; c’est qu’Alger, disons-nous, séduit l’imagination par l’attrait de l’inconnu et par les mystérieuses perspectives de l’avenir ; c’est qu’on aime à s’y réfugier en laissant derrière soi les chagrins et les préoccupations du vieux monde ; c’est que la terre et le ciel y échangent leurs sourires, et y font fleurir comme une éternelle jeunesse.
Et voilà comment, malgré ses grosses et ses petites misères, la vie algérienne est, à tout prendre, fort supportable. La nature y console des hommes et des choses.
626
C. Chanel, « Martinique. Eruption volcanique de la Montagne-Pelée. Première visite aux cratères », La Feuille de la Guyane française, 13 et 20 septembre 1851, troisième page.
Dans la nuit du mardi 5 du courant, vers les 11 heures du soir, des mugissements venant du côté du nord se firent entendre à Saint-Pirere. L’attention de quelques personnes qui étaient encore éveillées, fut attirée par ce bruit ; bientôt on reconnut que ces grondements souterrains qui, par leur intermittence, leur prolongement et leurs détonations subites imitaient le bruit du tonnerre, provenaient de la Montagne-Pelée.
Après de fortes détonations, vers minuit environ, des colonnes de vapeur blanchâtre se dressèrent sur le versant méridional de la montagne, une fine pluie de cendres tomba sur la ville, saupoudra les rues, les toits et le feuillage des arbres.
Les habitants des quartiers qui s’étendent au pied et sur les flancs de la Montagne-Pelée, effrayés de ces phénomènes, alarmés aussi par une secousse de tremblement de terre qui a été très sensible sur différents points, se hâtèrent de s’enfuir.
Ceux du Prêcheur, particulièrement, quittèrent leur bourg au plus vite, quelques-uns même dans le costume le plus léger, et ils arrivèrent sur la place du marché du Fort, dans le milieu de la nuit.
Leurs récits sur l’événement dont ils avaient été les témoins rapprochés furent bientôt rapportés, commentés, amplifiés ; les passants troublèrent la tranquillité des rues, les uns par curiosité, les autres par effroi, se rendirent sur les points de la ville d’où l’on pouvait apercevoir les colonnes de vapeur.
J’avoue que pour mon compte, profondément enseveli dans le sommeil du juste, je ne me doutais pas qu’un vocan eût passé si près de moi. A six heures, une voix amie me réveilla et m’annonça ce dont il s’agissait. Il y avait une éruption à la Montagne-Pelée ; il fallait aller voir cela de près. Aussitôt dit, aussitôt fait ; une demi-heure après, notre rédacteur en chef, M. de Maynard, M. Vidal, négociant, et moi, nous chevauchions dans les rues du Fort.
Après avoir passé la Galère, nous fûmes rejoints par M. Houry, qui vint faire cette excursion en notre compagnie.
Arrivés sur l’habitation de M. Duchamp, nous fîmes emplette de quelques petites provisions de bouche et nous trouvâmes un guide pour les porter et nous conduire à l’habitation de M. Ruffin.
Chemin faisant, nous rencontrions beaucoup de gens, hommes, femmes et enfants, qui descendaient portant des paquets sur la tête et traînant après eux leurs bœufs, attachés à de longues cordes. A nos questions, tous répondaient qu’ils descendaient parce que les mugissements du cratère les inquiétaient (Bagage là qu’a crié trop, disaient-ils).
Arrivés à une certaine hauteurr, par un petit chemin fort rapide, quoiqu’aisment praticable pour les chevaux, nous fûmes entouré par un brouillard tellement épais, que nous trouvant sur une crête d’où l’on domine le nord de l’île, ayant par conséquent la rade de Saint-Pierre à notre gauche et l’Océan à droite, nous ne voyions rien qu’un nuage diaphane ; cela nous empêcha d’apercevoir en montant un spectacke que nous vîmes très bien à notre retour, celui de la campagne blanchie, à perte de vue, par une mince couche de cendres.
Les brumes se condensant à mesure que nous nous élevions, se changeaient en une de ces fines pluies d’automne, si abondantes en France au mois de novembre, et nous inondaient à petit bruit.
Passé l’habitation Paviot, nous avions en route rencontré M. de Pompignan, secrétaire de la marie de Saint-Pierre, et appris qu’avant nous était déjà arrivé le Lieutenant de gendarmerie, accompagné d’un de ses hommes.
Nous trouvâmes bientôt cet officier qui redescendait, et en ce moment avait mis pied à terre. Il nous assura que nous arrivions trop tard, que nous ne pourrions rien voir ; qu’en conséquence il était presque inutile d’aller plus loin. Pour lui, ayant pu profiter du beau temps, il avait parfaitement vu, et même avait pu esquisser un dessin ; enfin, il rapportait les
627
échantillons des produits provenant du volcan, qu’on nous montra effectivement enveloppés de feuilles de bananier.
Ce discours nous défrisa ; ce n’est point sans une certaine jalousie que nous sentions que pour être parti avant nous, M. le lieutenant de gendarmerie était arrivé à l’heure. Cependant qu’avions-nous à risquer ? d’être mouillés ? nous faisions déjà eau de toute part.
En avant donc ! et nous continuons. M. Labossière, garde de police de la banlieue de Saint-Pierre, qui avait accompagné M. le lieutenant de gendarmerie, s’offrit alors à nous guider, ce qui fut accepté avec plaisir.
Enfin la pluie commence à s’arrêter ; nous sommes en vue de l’habitation Ruffin, losque nous voyons s’avancer une caravane de cultivateurs portant des paniers, des paquets et des cassettes. Le premier emportait les clefs du logis, le dernier tenait à la main un grand crucifix ; c’était l’arrière-ban qui battait en retraite.
On parlementa : Où allez-vous donc ? – Nous nous en allons ; bagage là qu’a crié trop. – Mais nous venons voir ça de près. – Impossible. – Mais nous voulons descendre chez M. Ruffin. – Impossible ; tout le monde est parti. Tant pis ; nous allons.
On fait alors quelques frais d’éloquence pour nous empêcher d’avancer, nous n’en tenons compte et filons. Nos interlocuteurs se consultent un instant, puis reviennent derrière nous. Sur l’habitation, nous descendons de cheval ; on nous ouvre les portes, nous mettons nos montures à l’abri et nous demandons des détails sur les événements de la nuit.
On nous répond absolument les mêmes choses que nous avaient dites toutes les personnes que nous avions rencontrées précédemment, et nous constatons spécialement que ni au moment de l’explosion, ni après, on n’a aperçu des flammes jaillir de la montagne.
Un cultivateur nous apporte ensuite, dans un vase en fer-blanc, une pâte épaisse de soufre et de terre qui doit jouer un rôle important, sinon dans notre récit, du moins dans d’autres. – Notons seulement ici que ce brave homme nous dit être allé neuf jours auparavant à l’ancienne soufrière et en avoir rapporté cette matière.
Nous proposons alors de nous diriger vers le cratère d’où venait le mugissement, et nous demandons un guide de bonne volonté. Un cri unanime de désapprobation est la seule réponse que nous obtenons et on nous dit que chacun étant maître de son corps, nous étions libres d’aller nous exposer ; mais que nous irions seuls. Cependant, dit quelqu’un, M. le lieutenant de gendarmerie est bien allé voir cela ? – Mais non, il n’est allé que jusque-là, sur le haut du morne. – Cependant il a rarpporté du soufre. – C’est ce soufre de la vieille soufrière. – Ah ! c’est fort bien ; alors il ne vous a pas compris ; il a cru que vous lui donniez un échangillon des produits vomis par le cratère cette nuit. Ainsi donc c’est entendu : personne n’est encore allé au cratère. Non, personne ; personne ne les a encore vus ; il est impossible d’y… Nous n’écoutions plus. Nous éprouvions la fièvre des conquêtes qui agite les touristes anglais quand, du fond de la vallée de Lauterbrun, le chasseur de chamois leur dit, en montrant du bout de sa carabine la majestueuse Jungfrau : la voilà la Montagne-vierge. Nul pied humain ne l’a encore gravie ; seul le vautour des agneaux a, de son aile gigantesque, effleuré la neige rosée de son sommet.
À nous donc la virginité du cratère. Vraiment ; ils nous disaient cela pour nous dissuader, les imprundents ! Nous allons ; c’est entendu ; en marche. Par où passe-t-on ? Mais il y a cinq lieues à
faire dans les bois. Jamais vous ne pourrez vous tenir avec vos souliers… ; nous ne reviendrons pas avant la nuit, etc., etc. Arguments jetés au vent. – Nous irons seuls, s’il le faut, mais nous irons, dit M. de Maynard, qui venait de se faire indiquer, tant bien que mal, la direction du chemin ; en avant. Et nous voilà prêts à emboiter le pas. Un grand gaillard, bien découplé, prend alors son coutelas, et dit : Si ces Messieurs y vont, j’y vais aussi ; un autre l’imite, Jean Elie, je crois ; puis un autre. Le Rubicon était passé, chacun voulait être de la partie.
[…] Nous continuons et nous entrons dans le bois.
628
La principale question était de ne point s’égarer. Nos guides, familiers avec ces parages, avaient reconnu au juger le lieu du théâtre de l’éruption, le mugissement continuel qui se faisait entendre à notre gauche leur servait aussi d’indice. Ceux de nos lecteurs qui ont chassé dans les bois, à la Calebasse, par exemple, peuvent se faire une idée juste du terrain que nous parcourions ; les autres auront, en allant le voir, le double avantage de faire une jolie promenade et de le connaître.
[…] La pente s’adoucit, nous voilà devant l’habitation Belligny, où quelques-uns d’entre
nous vont prendre une rechange, et entre trois et quatre heures nous sommes tous rentrés au domicile, harassés, mais très contents de notre journée et plus contents encore le lendemain, de voir les trophées sulfureux complaisamment mis sur le compte du volcan.
C. Chanel
J., « Les îles du Salut », La Feuille de la Guyane française, 3 juillet 1852, troisième page Naguère, le navigateur qui côtoyait les îles du Salut s’étonnait de voir ce charmant petit
groupe d’îles envahi jusqu’au rivage par la végétation luxuriante des Tropiques. A peine découvrait-il çà et là quelques touffes de bananiers chargés de plantes grimpantes qui se faisaient jour dans les massifs de verdure sauvage, comme pour témoigner du passage éphémère des hommes.
Et, cependant, les îles du Salut offrent, non seulement un séjour gracieux et salubre, mais encore une des positions les plus intéressantes des Guyanes, sous le rapport maritime, commercial et militaire.
C’est, en effet, le seul point de ces côtes plates et alluvionnaires où des navires de toutes dimensions peuvent trouver un mouillage sûr et tranquille. C’est un port pour lequel la nature a tout fait, et qui est certainement destiné à devenir l’un des points de convergence des grandes lignes de navigation à vapeur qui relieront bientôt toutes les nations riveraines de l’Amérique et du vieux continent.
Mais nous n’avons pour but, ni de développer ce thème fécond, ni même de dérouler toutes nos espérances ; nous voulons seulement prendre acte du présent ; le lecteur conclura pour l’avenir.
Que l’on ne perde pas de vue, toutefois, que nous parlons d’un pays où les ruines suffisent à peine pour rappeler quelques instants d’une prospérité contestée, où l’industrie locale se meurt, où l’on ne trouve que peu ou point de ressources.
Il y a trois mois à peine que les plateaux de l’île Royale (la plus grande des îles du Salut) ont retenti du premier coup de hache, et maintenant on y trouve une petite ville toute vivante, où se coudoient, dès le point du jour, des ouvriers de toutes sortes, travaillant avec ardeur à l’agrandissement de cette ruche naissante. Une belle route creuse ses lacets dans l’escarpement, et relie le débarcadère en construction au plateau principal : là, des lignes régulières de baraques, saines, solides, élevées sur leurs piliers de briques, largement aérées, forment un véritable bourg dont les rues s’allongent, se nivellent et sont incessamment encombrées de groupes en mouvement. Les jardins potagers se dessinent en plates-bandes ; des sentiers largement frayés serpentent dans les bois réservés sur les pentes abruptes ; les puits se creusent ; les carrières enfantent leurs blocs de pierres taillées, les forges tourmentent sans cesse le fer et l’acier pour remplacer les outils que le travail dévore ; les lourds fardeaux que jettent sur la plage les navires qui se succèdent sont portés sans relâche au lieu où ils doivent être utilisés ; enfin, partout s’offre le spectacle si attrayant du travailleur satisfait de son œuvre et plein de l’espoir d’en recueillir les fruits. Suivons cette route que nous avons escaladée à la hâte : On nous montre l’hôpital, l’infirmerie, le logement des sœurs, celui des aumôniers, le corps-de-garde… que sais-je ? C’est à ne pas y croire, quand on songe que l’on est en pleine Guyane, sur la terre classique des impossibilités, des désillusions, des déceptions traditionnelles.
629
Et cependant, ce n’est pas tout, en face de l’île Royale, sur l’île Saint-Joseph, la même œuvre est entreprise et marche rapidement.
A quelques lieues de là, sur l’îlet la Mère, plus pittoresque encore que les îles du Salut, mais dont les abords ne sont pas accessibles à des navires de fort tonnage, on trouverait déjà tout un village qui attend ses hôtes.
Cela est remarquable, étonnant sans doute, mais ce n’est pas ce qui causera l’admiration de l’observateur intelligent.
Avez-vous jamais visité en France ce hideux séjour que l’on nomme le bagne ? Là, des misères physiques punissent justement le crime, mais l’abjection endurcit le criminel ; là, en voyant ces tristes groupes de condamnés qui travaillent sans courage sous le bâton, en voyant ces chaînes, ce costume uniforme et sinistre, ces regards implacables et désespérés, vous devinez que ces hommes, dégradés par une faute, ont laissé l’espérance à la porte et qu’ils se croient fatalement destinés à parcourir jusqu’au bout la route terrible qui côtoie l’échafaud.
Suivez-nous maintenant aux îles du Salut : voyez la confiance, la joie dans tous les regards, les transportés cachant, sous leur pantalon de travail, le simple anneau qui leur rappelle qu’ils sont encore bien jeunes dans la carrière de la réhabilitation.
Quant à ces hommes à la nature mauvaise qui trônaient au bagne et professaient le vice, ils n’osent plus ici se montrer au grand jour : ils savent qu’un châtiment sévère les frappera dès leur première faute, et ce châtiment est d’autant plus redoutable, qu’ils doivent le subir au milieu des huées et des malédictions de leurs anciens frères, dont ils retardent l’émancipation.
Aussi quel calme général ! Le soir, devant chaque porte, les travailleurs s’attablent pour prendre leur repas et jouir de la fraîcheur ; on parle de la grande terre, de l’avenir, on renaît à l’espérance : L’espérance !... N’est-ce pas un pas immense vers la purification.
Arrêtons-nous, car il ne nous est pas permis de sortir de la limite des faits, disons seulement que la main puissante qui a signé le décret du 8 décembre semble avoir imprimé sa dévorante énergie à l’homme choisi entre tous pour l’exécuter.
Les débuts sont magnifiques, puissent-ils, comme nous y avons foi, être les prémices de succès croissants.
J. Lorsque cette note a été écrite, les îles du Salut n’avaient encore été le théâtre d’aucun
fait rappelant le passé de ses nouveaux habitants : nous le disons avec un profond regret, un crime vient d’être commis par un transporté, sur un de ses camarades : la justice informe, nous devons garder le silence.
Hâtons-nous de dire, toutefois, que le commissaire général de la Guyane française qui s’est transporté, aussitôt, aux îles, a trouvé sur tous les visages l’expression de la consternation et de la douleur.
Le Messager de Tahiti, « Mœurs tahitiennes », 22 mai 1853 Nos lecteurs se rappellent l'arrêté par lequel le gouverneur a cru devoir défendre la
upaupa, danse toujours accompagnée et suivie d'excès regrettables. La ronde que nous publions aujourd'hui en donnera l'idée, bien affaiblie toutefois par la décence du langage.
LA HOUPAHOUPAH (Ute no te upaupa) RONDE DES ARIOYS (1) Air noté par M. Noctua...z (ou des Bohémiens.)
Oah ! La pahou (f) bat, oah ! (2) Jour de joie
Où tout deuil se noie ; Oah ! Le pahou (3) bat, oah !
630
Courons à la houpa-houpah (f) !
Chalumeaux de Taütira, L'air frissonne Aux doux vents d'automne ; Chalumeaux de Taütira, Sonnez, le bonheur nous luira.
Fraîche et parfumée entrera Toute belle, Qu'amour appelle, Fraîche et parfumée entrera, Dès qu'un amant la nommera (5) Aux jaloux disons « ahoua ! » (6)
Hors la ronde, L'époux qui gronde ! Aux jaloux disons « ahoua ! » Dieu même à l'enfer les voua.
Quand sur son cocotier monta Mammatroffre Qu'un mari coffre, Quand sur son cocotier monta Puis du haut se précipita (7).
Voltige, nymphe de Para, D'œil, de geste Et de jambe leste ; Voltige, nymphe de Para, Sème tes fleurs, désir naîtra.
Bondis, crins épars, dans l'houra (8) Gorge nue, Eblouis la vue ; Bondis, crins épars, dans l'houra ; Ta ceinture s'y dénouera.
Tournoyez, filles de Marra ; Comme trombe Abou (9) vole et tombe ; Tournoyez, filles de Marra, Sans voiles, la beauté vaincra (10)
II
Oah ! La pahou bat, oah ! Jour de joie Où tout deuil se noie ! Oah ! Le pahou bat, oah !
Humectons la houpa-houpah !
Dents blanches ont mâché l'ava (11) ; Dans sa tonne Ardent il bouillonne ; Dents blanches ont mâché l'ava. D'un coup défonçons l'apoua (12) !
Vierges, plongez-y le taha (13) ; Coupe emplie, Aux baisers s'allie ; Vierges, plongez-y le taha ; Sur vos lèvres l'amour boira.
Beauté qui craint s'enivrera ; Dans l'ivresse Est franche caresse ; Beauté qui craint s'enivrera, Et d'ardeurs son sein gonflera.
L'Urû (14) m'inspire : « oaoa ! » (15) « Pêle-mêle « Qu'on s'entremêle ! » L'Urû m'inspire : « oaoa ! » « Volupté, sois notre Atoua ! » (16) « Si l'amour s'égare, il rira : Nouvelle âme, Nouvelle flamme, ; « Si l'amour s'égare, il rira ; Son feu dans tout troc doublera. »
« Tournons, tournons, sonne l'apa (17) ; Qu'on s'unisse ! L'heure est propice ; Tournons, tournons, sonne l'apa ! En festons le chœur s'enlaça. »
Le jour s'éteint ; soudain voilà Qu'en liesse, Un couple s'affaisse ; Le jour s'éteint ; soudain voilà Sein contre sein que tout roula.
Le vent dort, pahou plus ne bat ; Nuit soupire Un mourant délire ; Le vent dort, pahou plus ne bat ; Ci finit le joyeux sabbat.
631
Réveillez la mémoire des vieux chefs qui, dans leurs beaux jours, ont dansé cette
houpahoupah échevelée, vous verrez leur visage s'épanouir, leurs lèvres se gonfler, le plaisir briller dans leurs yeux, et du fond du cœur ils vous diront : c'était bien amusant. Et pourtant ils en ont tous demandé et voté la suppression comme d'un symbole du paganisme.
(1) Arioys, sorte de Bohémiens de haut rang, qui formaient une association dont la débauche était l'unique règle.
(2) Oa ! Crie de joie ; l'oeh des poètes anacréontiques. (3) Pahu, espèce de tambour ; long cylindre dont l'une des extrémités est recouverte
d'une peau de requin bien tendue sur laquelle on frappe avec les doigts. (4) Upaupa, dans frénétique. (5) … Au moindre signe toute femme devait se prêter à ce qu'on demandait d'elle.
C'était la loi du lieu. (6) Ahua ! Cri de malédiction. (7) …. on raconte encore à Tahiti l'histoire de cette jeune fille, pour donner une idée
de la passion des Tahitiennes pour la upaupa. (8) Hura, figure de danse dont les mouvements sont vifs et lascifs. (9) Ahu, tout vêtement jusqu'au dernier. (10) …. A la fin de la pirouette les danseuses se trouvent dans l'état d'Hina (l'Eve
tahitienne) quand elle sortit des mains du Créateur. (11) Ava, plante dont la racine mâchée et fermentée donne une liqueur enivrante. (12) Apua, vieux mot qui signifie une espèce de jarre. (13) Taha, coupe faite d'une noix de coco. (14) Urû, souffle divin dont se prétendaient inspirés les prophètes tahitiens. (15) Oaoa, cri de joie délirante ; l'évohé des bacchantes. (16) Atua, Dieu. (17) Apa, entrelacement des mains
« Le martyr du fort des Vingt-Quatre-Heures », Le Moniteur algérien, 30 décembre 1853, première page
Une découverte bien émouvante vient d’être faite au fort des Vingt-Quatre-Heures. Mardi dernier, vers onze heures du matin, les artilleurs occupés à la démolition du rempart qui regarde la route, aperçurent, en enlevant les déblais produits par l’explosion d’une des mines, une excavation occupant le milieu d’un bloc de pisé dans le sens de sa longueur et renfermant un squelette humain visible depuis la région occipitale du crâne jusqu’à l’articulation du tibia avec le fémur : en un mot, sauf le haut de la tête et la partie inférieure des jambes, tout le corps était très-apparent.
M. Suzzoni, capitaine d’artillerie, chargé des travaux de démolition du fort, fut aussitôt prévenu. Un rapide examen lui fit penser qu’il avait sous les yeux les restes du martyr Géronimo que l’on recherchait depuis le commencement des travaux et que l’on désespérait de rencontrer, la démolition étant près d’être terminée. Il s’empressa de faire avertir Monseigneur Pavy, évêque d’Alger, de cette heureuse découverte, et notre vénérable prélat se hâta d’accourir avec une partie de son clergé. M. le Préfet et un grand nombre de personnes de l’armée, de l’administration et de la population vinrent aussi visiter le martyr.
Celui-ci est étendu sur la face, les jambes très-rapprochées l’une de l’autre. La position des os de l’avant-bras et une corde collée encore à l’endroit correspondant aux poignets, sur les parois du véritable moule que le corps de Géronimo s’est fait dans le pisé avant la destruction des parties charnues, tout porte à croire que la victime avait les mains attachées derrière le dos.
632
Il paraît probable, d’après la juxtaposition des os des jambes, que celles-ci étaient liées également.
Les vêtements, qui consistent en une chemise courte, et un haïk ou une gandoura, sont restés collés aux parois du moule où leurs moindres plis et les plus petits détails des tissus se reconnaissent parfaitement. Géronimo, ayant été pris en mai 1569, resta un peu plus de trois mois au bagne d’Alger, jusqu’au 18 septembre de la même année, jour de son glorieux supplice. On lui avait sans doute fait prendre la tenue des esclaves dont Aranda a donné la description et qui était des plus simples, puisqu’elle devait être coupée et cousue par l’esclave lui-même, au moyen de cinq aunes d’une étoffe grossière que le beylik octroyait à chacun de ses captifs.
L’Akhbar a reproduit une intéressante notice sur Géronimo, publiée il y a six ans dans ce journal (le 5 octobre 1847) par M. Berbrugger qui l’avait extraite du très-curieux ouvrage que le bénédiction espagnol Haedo a fait paraître en 1612 sur la Régence d’Alger ; nous la reproduisons à la suite de cet article. Pour apprécier combien ce récit mérite de confiance, il faut savoir comment le livre de Haedo a été composé.
Cet auteur, abbé de Fromesta, avait été au service de l’archevêque de Palerme, Don Diego de Haedo, qui devait être son parent à en juger par la ressemblance des noms. Le vénérable prélat, qui était aussi président capitaine-général de Sicile pour Philippe II, roi d’Espagne, employait une très grande partie de son immense fortune à racheter les captifs chrétiens d’Alger. Il prenait note de toutes leurs aventures ou observations, surtout quand ils avaient fait un long séjour dans le pays. C’est en coordonnant et rédigeant ces notices que l’historien a composé son livre. Haedo nous donne lui-même tous ces détails dans une dédicace adressée à l’archevêque de Palerme, qui, en acceptant cet hommage, a consacré le livre de toute l’autorité de son nom, de sa haute naissance, de ses éminentes fonctions et de ses vertus qui furent grandes et manifestées par des œuvres évidentes.
Il est à remarquer, d’ailleurs, que l’ouvrage de Haedo, qui donne sur Alger une foule de détails topographiques, historiques, etc., s’est toujours trouvé d’une merveilleuse exactitude, toutes les fois qu’il a été possible de contrôler ses assertions. La découverte du corps de Géronimo dans le rempart du fort des Vingt-Quarte-Heures, lieu qu’il avait indiqué et toutes les particularités observées sur cette glorieuse sépulture seraient à elles seules de bien éclatantes preuves de la véracité et de l’exactitude de notre historien.
Un procès-verbal très détaillé de cette précieuse découverte a été dressé par M. le
capitaine Suzzoni, signé par tous les témoins, et envoyé à M. le colonel Dalayrac, directeur de l’artillerie. Une commission de médecins civils et militaires, chargée d’examiner le corps, fera connaître son opinion sur les questions de sexe, d’âge et de race. Nous publierons ces deux documents essentiels dans notre prochain numéro.
Nous lisons ce passage dans L’Akhbar de jeudi dernier : « Couché au bord de cette glorieuse fosse, il (Mgr Pavy) contemplait avec une émotion
bien naturelle ce tombeau, en même temps, instrument de supplice ; ce corps si fidèlement moulé dans la terre dont on l’avait accablé, et sculptant lui-même, pour le retour triomphant de la Croix, jusqu’aux traits de la noble victime ; ce corps dont les muscles tendus et crispés, reproduits sur le pisé qui les enveloppe, raconte des souffrances extrêmes.
Ce matin (28 décembre, M. le Gouverneur-Général comte Randon, Mme la comtesse et Mlle Randon, M. le général Chabaud-Latour et sa famille et un très grand nombre d’honorables personnes ont visité avec empressement la sépulture du martyr de Bab-el-Oued. »
Nous donnons ci-après le récit du martyre de Géronimo, tel qu’il a été publié par M.
Berbrugger dans le n° de l’Akhbar du 5 octobre 1847, et reproduit par ce journal dans son dernier numéro.
633
Le martyr du 18 septembre 1569 Au-dessus de la porte du Fort des Vingt-Quatre-Heures, on voit encore une inscription
arabe qui porte la date de 1569, année dans laquelle le renégat calabrais Ali, alors pacha d’Alger, et plus tard capitan-pacha du grand-seigneur, fit bâtir ce bastion pour empêcher les débarquements que l’on aurait pu tenter à la plage de Bab-el-Oued. La muraille septentrionale1 de la construction, qui est toute en pisé, sauf les arêtes des angles, contient probablement la dépouille mortelle d’un chrétien qui y reçut la palme du martyre dans les horribles circonstances que nous allons raconter.
A la suite d’une razia de la garnison espagnole d’Oran, sur les Arabes insoumis, vers l’année 1538, on ramena plusieurs prisonniers, parmi lesquels se trouvait un jeune garçon de bonne mine qui, selon l’usage, fut mis en vente avec le reste du butin, afin que le tout, converti en argent, pût être partagé entre les capteurs. Le licencié Juan Caro, vicaire-général, acheta cet enfant, l’instruisit dans la religion chrétienne, le baptisa et lui donna le nom de Géronimo.
En 1542, la peste sévissait à Oran, et presque tous les Espagnols avaient quitté la ville pour aller vivre sous la tente, dans la campagne. Le petit nombre de soldats restés à l’intérieur, préoccupés par le fléau, se relâchèrent un peu de la surveillance habituelle. Quelques prisonniers arabes en profitèrent, prirent la fuite, emmenant avec eux le petit Géronimo, alors âgé de huit ans, et le rendirent à sa famille.
Dans un âge aussi tendre, le nouveau chrétien pouvait oublier facilement, parmi les siens, les idées religieuses que le vénérable Juan Caro lui avait inculquées. Il devint, en effet, musulman à l’exemple de ses parents et de tous ceux qui l’entouraient. Cependant, les germes du christianisme, déposés dans ce jeune cœur, ne furent pas entièrement étouffés, car, vers l’âge de vingt-cinq ans, il conçut et exécuta le projet de retourner à Oran pour y professer de nouveau le vrai culte.
Il y fut reçu avec une joie bien vive par le digne Juan Caro, qui, pour l’affermir davantage dans ses pieuses résolutions, le maria avec une jeune fille arabe devenue chrétienne. Ceci avait lieu dans l’année 1559. Géronimo passa dix années à Oran où on l’avait incorporé dans un des escadrons de l’extérieur, appelés alors cuadrillas de campo. Il s’acquittait de ce service avec bravoure et intelligence ; ses chefs et ses camarades avaient pour lui beaucoup d’estime et non moins d’amitié.
Mais la Providence avait destiné le nouveau chrétien à sceller de son sang la foi qu’il avait embrassée volontairement, et qu’il pratiquait avec une ferveur qui le plaçait d’avance au nombre des élus.
Au mois de mai 1569, il était parti d’Oran dans une barque, avec neuf compagnons, pour aller surprendre un douar placé au bord de la mer. Déjà ils touchaient au but du voyage, lorsque les premiers rayons du soleil leur firent apercevoir deux brigantins de Tétuan, qui aussitôt leur donnèrent la chasse. Géronimo et les autres soldats eurent beau forcer de rames, ils furent pris, conduits à Alger et vendus comme esclaves.
Géronimo se trouva un des deux prisonniers que le pacha prélevait comme droit sur chaque dizaine de chrétiens enlevés en course, et il fut conduit dans le bagne d’Ali-el-Euldj, ce renégat calabrais dont nous avons parlé plus haut. Les Algériens réalisaient jadis de grands bénéfices par le rachat des captifs aussi, ils employaient toute espèce de ruse, et l’espionnage le plus actif, le plus adroit, pour savoir ce qu’étaient en effet leurs prisonniers, afin de proportionner la rançon à leur qualité et à leur fortune. Ces moyens mis en usage envers Géronimo firent connaître tous ses antécédents, et notamment son origine musulmane.
Dès-lors, les efforts les plus grands furent déployés pour le ramener à l’islamisme. Les muftis, les cadis, les marabouts, tous les théologiens d’Alger ou des environs accoururent au
1 La découverte du corps de Géronimo prouve que cette orientation, fournie par le récit d’Haedo, n’était pas exacte.
634
bagne où Géronimo était attaché par une forte chaîne, et dont il ne sortait plus, même pour aller au travail avec les autres esclaves, depuis qu’on savait qu’il était un musulman converti au christianisme.
Mais les docteurs algériens épuisèrent vainement toutes les ressources de leur éloquence et de leur savoir : Géronimo déclara avec énergie qu’il s’était fait catholique volontairement et par conviction, et qu’il mourrait catholique. Les oulémas, voyant que les séductions n’avaient rien obtenu de cette âme incorruptible, eurent recours aux menaces, mais avec aussi peu de succès.
Tous ces théologiens musulmans allèrent alors trouver Ali-Pacha, et lui racontèrent ce qui venait d’arriver, le priant de punir une aussi coupable obstination, et d’effrayer par un châtiment terrible quiconque serait tenté de suivre l’exemple de Géronimo. Le renégat Ali, comme tous les renégats du reste, se montrait plus cruel que les indigènes eux-mêmes envers les chrétiens. Il saisit avec avidité cette occasion de faire un grand étalage de zèle religieux, et promit ce qu’on lui demandait.
On était alors au milieu de septembre 1569, et le pacha était très occupé de la construction d’un fort qu’il faisait élever hors la porte Bab-el-Oued, celui que nous appelons aujourd’hui (on ne sait pourquoi) le fort des Vingt-Quatre-Heures ; il visitait fréquemment les travaux et pressait beaucoup les ouvriers. Ce jour-là, il examinait tout pensif les manœuvres qui foulaient la terre dans ces grandes caisses qui servent à la confection des blocs de pisé. Une pensée subite vint dissiper sa préoccupation ; il appelle Michel de Navarre, un chrétien qui était son maître maçon. Il lui montre une caisse toute préparée, mais qui n’avait pas encore été chargée de terre. « Michel, lui dit-il, laisse cette caisse vide jusqu’à demain ; car je veux faire du pisé avec le corps de ce chien d’Oran, qui refuse de revenir à la religion de Mohammed. » Après ces paroles, Ali-Pacha retourna à Dar-Soulthan, que nous appelons aujourd’hui Djenina, et qui était alors le palais des gouverneurs d’Alger.
La fin de la journée approchait : Michel, après avoir préparé la caisse, assembla ses ouvriers et retourna avec eux au bagne. Il alla aussitôt trouver Géronimo et lui apprit ce qui venait de se passer, l’exhortait à la résignation. – « Dieu soit béni pour toutes ces choses ! s’écria le futur martyr. Que ces infidèles ne se flattent pas de m’effrayer par le supplice horrible qu’ils ont inventé, et de me faire renoncer par peur à la véritable religion. Tout ce que je demande au Seigneur, c’est qu’il ait pitié de mon âme, et me pardonne mes péchés. »
Dès ce moment, Géronimo se prépara à l’éclatant témoignage qu’il devait rendre le lendemain. Il y avait dans le bagne une chapelle et parmi les esclaves un prêtre ; Géronimo se confessa, communia, se fit donner l’extrême onction, et passa la nuit en prières.
Le 18 septembre 1569, quatre chaouchs du pacha Ali vinrent de bonne heure au bagne et demandèrent Géronimo, qui, en les entendant, sortit de la chapelle où il priait encore.
- Eh bien, chien, juif, traître, pourquoi ne veux-tu plus redevenir musulman ? lui crièrent-ils à l’envi en l’apercevant. – le pauvre esclave ne répondit pas un mot et se remit entre leurs mains. Il arriva, au milieu d’eux, devant le fort des Vingt-Quatre-Heures, où se trouvait déjà Ali Pacha, accompagné d’un grand nombre de Turcs, de renégats, et de Maures, tous gens altérés de sang chrétien.
- Holà, chien, lui cria Ali, ne veux-tu pas retourner à la religion musulmane ? - Pour rien au monde, répondit Géronimo. Je suis chrétien, chrétien je resterai. - Hé bien, hurla le pacha exaspéré, tu vois cette caisse, je vais t’y faire piler et enterre
vivant. - Fais ce que tu voudras, répliqua courageusement le martyr de Dieu, je suis préparé à
tout, et rien au monde ne me fera abandonner la foi de mon seigneur Jésus-Christ. Ali Pacha, voyant que rien, en effet, ne pouvait vaincre cette énergique résolution,
ordonna qu’on débarrassât Géronimo de ses chaînes et qu’on lui liât les pieds et les mains. En cet état, le saint fut saisi par les quatre chaouchs, qui le jetèrent au fond de la caisse.
635
On vit, en cette occasion, que parmi ces corsaires féroces, les plus cruels n’étaient pas ceux qui étaient nés dans le pays. Un espagnol appelé Tamango, pris à la déroute de Mostaganem, où le comte d’Alcandete perdit la vie, et qui s’était fait musulman sous le nom de Djafar, sauta à pieds joints dans la caisse sur Géronimo, prit un des pilons de piseur et demanda instamment qu’on lui apportât de la terre, ce qui fut exécuté aussitôt. Ce misérable commença alors à frapper violemment sur le pauvre martyr, qui ne poussa pas un cri, ne laissa pas s’échapper une plainte.
D’autres renégats, ne voulant point paraître moins bons musulmans que Tamango, saisirent des pilons à leur tour et finirent d’étouffer Géronimo sous les couches de pisé.
La caisse était remplie jusqu’aux bords, le martyr reposait, pour trois siècles, dans sa glorieuse tombe. Tous ces tigres repus à la vue de l’horrible supplice, rentrèrent joyeux dans Alger à la suite d’Ali-Pacha, qui répéta plus d’une fois en chemin : « Je n’aurais vraiment pas cru que ce chrétien recevrait la mort avec tant de courage. »
Les esclaves chrétiens qui travaillaient au fort des Vingt-Quatre-Heures songèrent plus d’une fois à tirer de la muraille le corps du saint martyr ; mais la surveillance continuelle des Turcs rendait la chose fort difficile. D’ailleurs, ils abandonnèrent plus tard ce dessein en réfléchissant que le lieu même où il était mort pour la foi, lieu remarquable, exposé à tous les regards, et où chaque jour, les chrétiens, les musulmans et les renégats pouvaient l’apercevoir, les uns pour s’affermir dans leur croyance, les autres pour apprendre à estimer la religion qui inspire un pareil héroïsme, et les derniers pour rougir de leur lâche apostasie.
Don Diego de Haedo, auteur de la topographie d’Alger, à qui nous empruntons les détails de cette touchante histoire, indique en ces termes l’endroit du fort des Vingt-Quatre-Heures où se trouve le corps de Géronimo :
« En examinant avec attention les blocs de pisé qui forment les murailles du fort, il sera facile de retrouver l’endroit où repose le corps du saint. Si l’on regarde la paroi du nord, on y verra un bloc tassé et qui semble avoir été remué. Cela provient de ce que le cadavre de Géronimo étant tombé en dissolution par l’effet du temps, il s’est formé dans le bloc un vide qui a déterminé le tassement dont on vient de parler et qui est très-visible. Confiant dans la bonté du Seigneur, je crois qu’il viendra un moment où on le tirera de cet endroit pour le placer dans un autre plus convenable, lui et tant de saints martyrs qui ont arrosé cette terre de leur sang. »
Bien des fois nous avons examiné avec une pieuse attention cette paroi qui recèle un martyr sans y voir d’autre trace que les trous creusés par quelques boulets chrétiens. Mais dans cet assemblage de blocs, il en est un qu’on ne peut bien apercevoir, parce qu’un figuier y a pris racine et le couvre de son feuillage. C’est peut-être là que repose le corps de Géronimo ; et cet arbre qui s’est développé si extraordinairement au milieu même de la muraille, n’est-ce pas une sorte de palme de martyre, destinée à protéger de son ombre les saints ossements jusqu’au jour où le christianisme revenu triomphant sur la terre d’Afrique, pourra et voudra vérifier les pressentiments de l’historien Haedo.
Nous rappellerons que le fort des Vingt-Quatre-Heures, destiné à être démoli, est déjà vendu à un particulier. Mais l’Etat a sans doute fait des réserves pour les objets intéressants qui s’y pourraient rencontrer. En tous cas, le zèle pieux de Mgr l’Evêque d’Alger nous est un sûr garant que les restes de Géronimo seront précieusement recueillis. C’est dans le but de hâter et de faciliter ces résultats que nous avons publié ce simple récit.
Le Messager de Tahiti, 14 mai 1854 On nous demande la suite de la chanson de Raïroa, dont nous avons publié le
refrain dans notre numéro du 30 avril. Voici la ronde toute entière. LE PETIT OISEAU
636
Ronde des Pomotous Ia ha ! trarara, trarara rara ! Que je voudrais être un petit oiseau Qui vite vole Qui vole, vole Que je voudrais être un petit oiseau Qui vole vite et vole si haut ! Dans la brise Que tamise Le feuillage vert et frais, Plus léger que l’écume Au front de l’onde qui fume Plus léger que n’est la brume, Joyeux je voletterais. Deux voix aux extrémités du groupe : 1ère Ici-bas je lorgnerais Ia ha ! trarara, etc. 2ème Et moi je caquèterais Jeune fille Qui babille, Et croit cacher ses secrets ! Ce que souffle à son oreille L’amour qui point ne sommeille, Ce que son cœur lui conseille, Dans mes chants je le dirais. 1ère voix. Comme elle je gémirais 2ème ----. Comme elle je m’en rirais. Ia ha ! trarara, etc. Pauvre mère, L’âme amère Pleure un fils mort de regret ; Sous le toit de la chaumine, Où le noir souci te mine, Mon chant que rien ne chagrine ; Attendri te distrairait. 1ère voix. Mon chant sur toi pleurerait 2ème ---. Mon chant te consolerait. Ia ha ! trarara, trarara rara ! Que je voudrais être un petit oiseau Qui vite vole Qui vole, vole Que je voudrais être un petit oiseau
637
Qui vole vite et vole si haut !
Le Messager de Tahiti, 16 juillet 1854 Le vieux chef de Papara, Tati, vient de mourir à l’âge de près de quatre-vingts ans,
emporté par l’épidémie qui a déjà fait tant de ravages dans nos îles. La mort de Tati est une date funeste dans l’histoire du pays. En lui s’éteint l’un des
derniers et le plus illustre représentant des âges héroïques. Il avait vu Cook ; il avait assisté aux événements remarquables des temps barbares ; il se souvenait des sacrifices humains, des guerres incessantes qui ont ensanglanté les rivages de Tahiti. L’ami de Pomaré II dont il avait favorisé l’élévation, qu’il avait soutenu de tout son pouvoir, car il sentait qu’un pouvoir unique et dominateur pouvait seul assurer quelque repos dans l’île, à la mort de ce grand chef, quand il vit les luttes intestines se réveiller, il fut le premier promoteur du protectorat étranger et suprême qui garantit le pays de ses propres fureurs. Il se montra toujours le plus ferme et le plus zélé soutien du protectorat de la France ; c’était sa foi politique dont il ne varia jamais, et il est mort satisfait d’avoir puissamment contribué à fonder ainsi le bonheur de sa patrie. Et quand le Gouverneur vint assister à ses derniers moments, son âme sembla se réveiller pour exprimer la joie qu’il ressentait d’exhaler son souffle dans les bras du représentant de ce système qui avait été le vœu de toute sa vie.
Tati était d’une taille et d’une force musculaire remarquables. Son âme eût à faire de grands efforts pour s’arracher de sa vigoureuse enveloppe mortelle. L’agonie fut longue. Il fut brave au combat, éloquent dans les assemblées, plein de prudence et d’habileté au conseil ; homme de bien toujours. Quelle perte pour Tahiti ! L’île voit disparaître aujourd’hui l’une des plus grandes figures de son histoire. Il mourut emportant les regrets de tous les habitants. Mais personne ne sent plus vivement cette perte que le Gouverneur.
Celtibère, « Voyage autour du monde », Le Messager de Tahiti, 28 janvier, 4 et 11 février 1855, feuilleton (extraits)
Voilà donc Taïti, la perle de la mer, Ce port hospitalier, ce fortuné rivage ! Nous la touchons enfin. Favorable présage, Un iris merveilleux, dans les plaines de l’air, Le ciel libre partout et pur de tout nuage, Nous l’avait annoncée, avant qu’à l’horizon, Au milieu des vapeurs qui voilaient l’étendue, Elle sortît de l’onde et charmât notre vue. Maintenant à loisir foulant son doux gazon, Je tourne mes regards vers sa rade admirable Que des bancs de coraux, barrière inébranlable Défendent longuement des flots tumultueux. Vainement souffleraient des vents impétueux, Dans ces ondes mouillé, sur son ancre immobile Le nocher peut dormir dorénavant tranquille. Mais détournant les yeux du liquide séjour, Saluant Morea qui du flambeau du jour, Nous cache à son déclin la mourante lumière, Lorsqu’il semble ici-bas terminer sa carrière ; Contemplons Taïti, sa plage et ses coteaux, Ses vallons odorants, ses rapides ruisseaux
638
Qui charmant à l’envi ces lieux de leur murmure, Y maintiennent sans cesse une fraîche verdure, Que d’arbres inconnus, que de nouvelles fleurs, Quels parfums étrangers, quels fruits, quelles couleurs ! Ici s’offre à ma main la banane sucrée, Là, du mol hibiscus la corolle pourprée. La noix du cocotier parmi de longs rameaux, Sur les bords de la mer, s’incline vers les eaux. Je cueille la goyave à la chair rougissante, Tout près, de l’arbre à pain la pomme nourrissante : L’indigène naïf l’appelle maïoré. Quel est ce grand mauvier à la fleur jaunissante ? Voici le pandanus au fruit lourd et serré Qui, servant de ces lieux les mœurs hospitalières, Donne en toute saison son feuillage acéré, A ce peuple indolent pour couvrir ses chaumières. Partout croissent ici l’odorant ananas, L’orange, le citron, les vrais acacias, La tendre sensitive, une noble immortelle Où de l’antique Assur la couleur étincelle. Le robuste bambou, sa délicate sœur Plus que le miel d’Hibla chère par sa douceur, Le café célébré par les fils de l’aurore, L’évi, le cotonnier, et mille autres encore, Qui dès les premiers temps, bénis par l’Eternel, Renouvelant leurs fruits, réparant leur parure, Sollicitent la main du fortuné mortel Qui vient à leurs rameaux chercher sa nourriture. Ah ! ce n’est point hélas ! ainsi que sans culture, Nos avares sillons nous cèdent leurs trésors. Que d’amères sueurs, que de constants efforts, Coûtent au laboureur sa moisson florissante, Coûtent au vigneron sa vendange abondante. Contre le sol ingrat luttant avec ardeur, Sans cesse des hivers redoutant la rigueur, Les ardeurs du Lion, et la grêle et l’orage, Au sein de la misère exerçant leur courage ; On les a vu souvent, intrépides héros, Abandonnant leurs champs et leurs obscurs travaux, A travers les périls, suivis de la victoire, Se couvrir noblement d’une immortelle gloire. Heureux Taïtiens, O ! vous qu’un doux soleil, Que de limpides eaux, qu’une terre fertile Accablent de bienfaits ; vous qui d’un cœur facile, Au sein de longs loisirs, dans les bras du sommeil, Sans peine, mollement coulez votre existence ; Apprenez à bénir du moins la Providence, Et dignes des faveurs dont vous comble le ciel, A mériter enfin le bonheur éternel.
639
II Après six mois de mer, qu’il est doux sur la terre, De pouvoir au hasard porter ses pas rêveurs Et parmi des sentiers bordés de jeunes fleurs, D’oublier quelques temps les vents et l’onde amère. Qu’il est doux de s’asseoir au bord d’un clair ruisseau, De s’armer en passant d’un fragile rameau, De suivre dans les airs le papillon volage, D’entendre le lézard s’enfuir sous le feuillage Et le vol de la mouche et le chant du grillon. Qu’il est doux de tremper ses pieds dans la rosée, Quand le soleil se montre à peine à l’horizon, Et de gravir les flancs d’une colline aisée, Que revêt mollement un verdoyant gazon. A ces vulgaires biens l’âme entière attentive, Semble en jouir alors pour la première fois Et bientôt s’élevant plus ardente et plus vive, Dans l’œuvre de ses mains bénit le Roi des rois. Vainement de sa voix la jalouse science Vient et m’importuner et troubler mes plaisirs, Loin de me tourmenter d’ambitieux désirs, Je poursuis, sans rougir de ma douce ignorance. Eh ! voudrais-je jamais barbare dans mes vers De cent étranges noms hérissant leur mesure, Savoir, amant naïf de l’aimable nature, Bizarrement parler de ses produits divers ? Mais cette île m’est-elle à ce point étrangère Que je n’y sache un peu reconnaître la terre ; De ses vallons au moins, distinguer ses coteaux Et des flots de la mer, ses salutaires eaux ? L’arbre n’y croit-il pas, étendant son ombrage ? Dès le matin, l’oiseau caché dans le bocage, Ne m’y charme-t-il pas de sa joyeuse voix ? Au chant de la cigale, en rêvant dans le bois, Rappelant à mon cœur, hélas ! son innocence, N’ai-je pas reconnu les jeux de mon enfance ? Cela seul me suffit. Eh ! que voudrais-je encor ; Quand je connais l’insecte à son rapide essor, A sa chanson l’oiseau, la plante à sa verdure, L’arbre à son noble port, la fleur à sa parure, Le sol à sa couleur, la couleur du tombeau,
640
Dans l’insulaire oisif, l’humaine créature, Dans le soleil, du jour le radieux flambeau, Et partout la beauté du Dieu de la nature. III. Hivernage Quoiqu’un été constant règne sur ce rivage ; Il est une saison où de sombres vapeurs, Où la pluie à longs flots, en ces lieux enchanteurs, Répandent la tristesse : on l’appelle hivernage. Non quelle que les aquilons fils des âpres frimas, Y soufflant longuement la neige et la froidure, Y viennent dépouiller ces bois de leur parure : Non, exempts de rigueur, ces prospères climats, Sans cesse sont couverts de fleurs et de verdure. Mais quand l’astre divin qui mesure les jours Abandonnant le Sud, traversant dans son cours Le signe du Verseau, s’avance vers cette île Echauffant et les flots et sa glèbe fertile ; On voit s’y condensant les effluves des mers, Insensibles rampant d’abord dans les campagnes, Aller sur les sommets de ses fraîches montagnes, Se mêlant aux vapeurs qui flottent dans les airs, Y verser le tribut de leur onde légère. Mais c’est alors surtout que sombre et passagère, Souvent une nuée envahissant les cieux, Du fond de l’Océan vient inonder ces lieux. Tel est l’heureux hiver que dans sa prévoyance, Dès le commencement la sainte Providence A voulu répartir à cet heureux séjour. Eh ! comment l’arbre à pain eut-il pu voir le jour ? Eh ! comment l’Eoutou de son large feuillage, Au paresseux Canac donnant le doux ombrage, D’aigrettes eut-il pu couronner ses rameaux ? Comment l’apé qui vit auprès des clairs ruisseaux, Comment le taro noir aux pesantes racines, Et l’herbe des vallons, et l’arbre des collines Eussent-ils prospéré ; si la saison des eaux De ce sol humectant les plus profondes veines, N’eut comblé ses bassins et rempli ses fontaines ? Comment du cocotier la verdoyante noix, Par la brise bercée au-dessus de ces bois, Eut-elle jamais pu sur une aride plage À souhait présenter un doux et frais breuvage Au mortel accablé de soif et de chaleur. Qui jamais en défaut vous surprendra Seigneur ? Pour moi plus je m’avance au sein de ma carrière,
641
Plus je sais contempler ce monde et sa beauté ; Plus j’abaisse mon front vers la vile poussière Devant votre sagesse et votre majesté.
En mer Lever de soleil – août 1834 Ainsi qu’au voyageur attardé par la nuit, Une lumière au loin, faible apparaît et luit ; De même à l’orient que l’ombre occupe encore, Se montre le premier des rayons de l’aurore. Bientôt le firmament s’anime et se colore D’une teinte rosée : une clarté la suit Qui des feux du soleil sereine avant-courrière, Aux humains diligents annonce la lumière. De la nuit cependant le croissant radieux, Dans l’ombre resplendit à la voûte des cieux. Mais la clarté s’étend et tendre et jaunissante, Comme d’un heureux champ la moisson florissante Et la lumière enfin, partout brille ici-bas. L’astre du jour encor, pourtant ne paraît pas ; On l’attend et l’on craint que quelque nue impure, De ses feux renaissants ne prive la nature. […] Mi-octobre 17° 21’ lat.S. – 63° 39’0. Dieu ! que ne sommes-nous plus près de la patrie, Ou du moins navigant vers la France chérie, Si nous songions enfin à l’instant du retour, Combien je jouirais, o ciel ! de ce beau jour. Comme la mer au loin légèrement ondée Emprunte au firmament son vêtement d’azur, Comme de son haleine, heureusement guidée, Notre docile nef cède au vent frais et pur. Comme l’astre du jour dans nos voiles rayonne, Comme le flot murmure en s’éloignant de nous, Comme le ciel est tendre et comme l’air est doux ! Enfin c’est un beau jour, un jour charmant d’automne, Ou plutôt de printemps. Mais cependant, hélas ! Séjour de la tempête, entouré de frimas, Funeste aux nautoniers, ce cap, borne du monde, Devant nous, menaçant, se dresse au sein de l’onde.
Cap Horn Ouragan. Novembre …54 […]
Le Messager de Tahiti, 13 juillet 1855, première page Par la goélette du protectorat Gazelle, arrivée d’Ana le 6 du courant, nous avons reçu de
notre correspondant la lettre suivante, que nous nous empressons de publier :
642
Monsieur, J’ai l’honneur de vous adresser la relation de la cérémonie funèbre organisée
spontanément par les habitants de l’île d’Ana, à la réception de la nouvelle de la mort du prince royal de Tahiti, Ariiane, et des honneurs rendus à sa dépouille mortelle par le Gouvernement du protectorat et les populations de Tahiti et Moorea. Si je ne puis vous faire le récit d’une fête aussi imposante que celle à laquelle vous avez assisté, au moins verrez-vous que nos Indiens n’ont rien négligé pour la rendre aussi digne que possible, et, en cela, ils ont été puissamment aidés par les RR. PP. de la mission française.
Le jour même de l’arrivée du navire qui a apporté cette triste nouvelle, le chef Tematiti a envoyé des lettres de faire part dans tous les districts. A partir de ce moment les indigènes n’ont plus été occupés que de préparatifs de deuil. Le 27 et le 28 le lagon intérieur s’est couvert de pirogues, amenant les habitants de tous les points de l’île à Tuuhora, où devait se célébrer le service funèbre. Pendant la nuit du 28 au 29 tout le monde était sur pied, les derniers préparatifs s’achevaient, les toilettes se préparaient. A 9 heures tous les districts se sont réunis devant la maison du chef Tematiti, qui remplit les fonctions de régent en l’absence de Paiore, en mission dans les îles Tuamotou ; ils s’y sont rangés de la manière suivante : Tuuhora, Tematahoa, Tekahora, Putuhaara, Otepipi et Temarie. En tête de chaque district, et à côté de son chef, marchait son drapeau aux couleurs du protectorat, avec le nom inscrit en lettres noires dans la bande blanche intermédiaire, puis venaient les fonctionnaires, juges et mutois, les propriétaires et enfin les femmes. Tous avaient adopté un vêtement uniforme de grand deuil ; plus de couleurs éclatantes, plus de longues chevelures ; ce dernier sacrifice, bien grand pourtant, tous l’avaient fait sans regrets.
Lorsque tout a été prêt, le cortège s’est mis en marche et s’est dirigé vers le camp de la gendarmerie française où tout le monde s’est rangé en cercle avec un ordre parfait. Une députation s’est alors rendue près des RR. prêtres de la mission, de M. Sue, aide-commissaire, que des affaires de service retiennent parmi nous, du brigadier Lecourt, chef du petit poste qu’entretient ici le Gouvernement du protectorat et de M. Labbé, négociant de Tahiti, pour les prier de se joindre à la population indigène dans cette cérémonie. Ces messieurs sont venus immédiatement au milieu du cercle, et ont été reçus, avec une vive sympathie, par tous les Indiens, qui se sont découverts à leur arrivée. Le toohitu Ufara, ayant à ses côtés les chefs Tematiti et Taneopu, décorés dernièrement chacun de deux médailles par S.M. l’Empereur et S.S. le pape Pie IX, pour leur dévouement à la cause française et catholique, lors des derniers troubles d’Ana, leur a adressé une allocution dans laquelle il les a remerciés de leur bienveillant concours et au nom de toute la population de l’île leur a remis la direction de la cérémonie ; le P. Clair Fouqué a répondu quelques mots pour exprimer combien ils prenaient part au deuil général et avec quelle reconnaissance ils acceptaient la mission qu’on leur confiait. Puis le cortège a repris sa marche pour sortir par la porte du nord et se rendre à l’église ; en tête les enfants des districts, conduits par les Pères, qui dirigent leurs écoles, puis M. l’aide-commissaire Sue, le brigadier Lecourt, M. Labbé, les Européens et les Indiens. L’église catholique était tendue de noir ; tout ce qui a pu entrer y a pris place. Catholiques et mormons sans distinction, un très grand nombre a dû rester en dehors, et c’est à peine si quelques-uns des dissidents se sont rendus dans leurs temples, triste et misérable protestation de quelques malheureux, en faveur d’un culte méprisable, né de la folie et de la dépravation, que le bon sens des naturels eux-mêmes condamne à l’oubli, où il eût dû tomber dès son premier jour.
Lorsque l’office des morts a commencé, que la grande voix de l’orgue s’est jointe à la musique grave et imposante si bien appropriée à ces hymnes sublimes de la liturgie romaine, qui élèvent le cœur vers Dieu, rien ne saurait peindre le recueillement des Indiens. Pendant toute cette cérémonie ils ont été sous le coup d’une émotion profonde, et une fois de plus encore je me suis convaincu de cette incontestable vérité, c’est que plus que tout autre secte, le
643
catholicisme, avec la poésie de ses dogmes, la magnificence de ses chants et l’éclatante majesté de ses pompes religieuses est pour parler aux âmes naïves de ces peuples primitifs et les guider dans le chemin de la civilisation.
Au milieu de l’office le P. Clair Fouqué a prononcé devant l’assistance quelques paroles, derniers regrets adressés au jeune prince défunt, dernier éloge de celui dont la jeunesse promettait un brillant avenir. Il a rappelé que, de son vivant, Ariiaue avait toujours joui de l’estime et de l’affection de ceux qui le connaissaient, à cause de sa douceur et de sa générosité ; que les Indiens avaient l’habitude de lui dire qu’il ferait un bon roi, car il avait dans le jeune âge la sagesse et les lumières de l’âge mûr ; qu’il avait su gagner l’amitié des étrangers par son désir de s’instruire et de se mettre au courant des usages des nations civilisées ; qu’il s’était appliqué à apprendre leurs langues ; qu’il parlait déjà l’Anglais et le Français, et que les Européens avaient vu, avec douleur, s’anéantir, par sa mort, les espérances qu’ils avaient fondées sur lui. Il a rappelé qu’Arriaue avait été son élève pendant 6 mois, que son caractère égal et obligeant l’avait fait aimer de tous ses condisciples, que ses succès avaient fait l’orgueil de ses maîtres et la joie de sa mère. « Joignons, a-t-il dit en terminant, nos pleurs et nos regrets à ceux de son auguste mère et prions le Très-Haut de recevoir l’âme d’Ariiaue dans ses tabernacles éternels ».
Le service funèbre a été suivi d’un grand repas, d’après la coutume des naturels, qui ont aussi fait des présents aux Européens. Tout s’est parfaitement passé, et je ne sais lequel mérite le plus d’éloges ou de la spontanéité avec laquelle les habitants de l’île ont organisé cette fête ou du recueillement avec lequel ils y ont assisté.
Marie-Lefebvre, « Le cimetière Bab-el-Oued, à Alger », L’Akhbar, 29 juin 1858, feuilleton (extrait)
Nous n’aimons pas les cimetières tristes. De nos jours, à force d’entendre prononcer ce nom, par des acteurs de mélodrame, des
chanteurs de romance à effet, ou des poètes qui se croient poitrinaires, on s’est habitué à trouver dans la composition du mot, dans son harmonie même, je ne sais quel sens lugubre, et il semble que les accessoires obligés d’un cimetière doivent être toujours un ciel bas et brumeux, des ravins arides, un horizon borné et froid, avec des odeurs de tombe dans l’air et des frissons de bise dans les hauts cyprès…
Il ne devrait pas en être ainsi. Ce sont les Grecs, à l’imagination riante, qui ont inventé ce beau mot de cimetière, qui
ne veut rien dire autre chose que dortoir et qui déguise ainsi sous une image pleine de douceur et de paix le nom de la suprême demeure où nous sommes assurés de trouver enfin le repos.
Les Grecs avaient raison : la mort est déjà bien assez terrible par elle-même sans qu’il faille encore en augmenter l’horreur par cette fantasmagorie de mauvais goût, dont les bons cœurs n’ont pas besoin pour se souvenir de ce qu’ils ont aimé.
Dans les pays du Nord, où les âmes sont tristes et pesantes comme le ciel, mais en revanche froides et fermées comme lui, nous comprenons qu’on se plaise à donner aux cimetières une mise en scène lugubre qui stimule l’imagination quand le cœur se récuse, et qui pousse aux larmes pour ainsi dire. C’est une invention de gens qui n’ont jamais ressenti de douleurs vraies et qui ont besoin de tout ce sombre appareil pour se créer du moins cette mélancolie factice et malsaine que le vulgaire prend pour le chagrin réel.
Mais dans les pays de soleil, l’éclat de la lumière, la puissance de la végétation, la sérénité, les parfums de l’atmosphère, la joie indéfinissable et profonde qu’on éprouve à se sentir vivre, tout cela jette sur l’idée de la mort elle-même, je ne sais quel reflet qui la pare et qui fait qu’on l’envisage sans épouvante et qu’on passe sans se déranger à côté d’elle.
644
Voilà pourquoi les cimetières turcs ressemblent plutôt à des jardins qu’à des nécropoles ; voilà pourquoi nous y voyons les enfants jouer sur les tombes sans que cette gaieté en pareil lieu paraisse un irrévérencieux contraste.
Car le respect bien entendu pour les morts n’oblige point à leur faire une demeure sinistre, et c’est pour cela qu’il serait bon de réserver aux cimetières les sites les plus riants, les fleurs les plus odorantes et les plus gais feuillages.
A ces points de vue, le cimetière d’Alger, à Bab-el-Oued, nous a toujours paru admirablement placé : si quelque chose peut consoler nos morts de ne pas reposer sur la vieille terre de France, c’est à coup sûr d’avoir trouvé dans les tombes africaines, une si douce et si gracieuse hospitalité !
Ils sont là, sous le ciel bleu, au pied des côteaux verts, en face de la baie : tout près d’eux, l’ancienne ville découpe, sur une pente rapide, les dentelures de ses hauts remparts, nettement tranchées sur un fond d’azur intense ; par derrière, s’enfoncent les ravins du Frais-Vallon, pleins d’ombre et de murmures, - mystérieux asiles où il semble qu’on sente la vie sourdre à chaque instant autour de soi ; au-dessus, enfin, la Bou-Zaria dresse ses contreforts d’un seul jet à une hauteur dont la mesure élève la pensée et fait rêver du ciel.
Et puis la grève est si belle ! Sur un plan doucement incliné, recouvert d’un sable fin, des vagues indiquées à peine par une frange d’écumes légères, viennent l’une après l’autre s’étaler en nappes minces, indéfiniment prolongées ; et les navires arrivant de France, passent là, tout près du champ de repos, comme pour donner des nouvelles de la partie à ceux qui n’y retourneront jamais. […]
« Tournée d’exploration dans les Ksours et dans le Sahara de la province d’Oran, par le commandant de Colomb », Le Moniteur algérien, 5 et 10 juin 1858, troisième page (extraits)
Ce récit est dû à M. le commandant de Colomb, commandant supérieur du cercle de Grévyville. A côté de renseignements très-utiles, de relations légendaires des plus attachantes, l’auteur a placé des descriptions empreintes d’un grand cachet de couleur locale et a fait de tout cela des pages pleines d’un véritable intérêt : nous les offrons à nos lecteurs, persuadés qu’elles seront accueillies avec faveur.
I Au Sud de Grévyville, s’étend une immense zone entièrement dépourvue d’eau et
inhabitable pour les nomades, autrement que pendant les hivers pluvieux, lorsque les ghedirs sont pleines ; c’est le véritable Sahara de la province d’Oran, le pays de la soif, le désert par excellence, abandonné d’une manière absolue par l’homme, pendant neuf mois de l’année, aux gazelles et aux meha (1) que Dieu semble avoir créés exprès pour brouter la végétation des sables et pour vivre sans boire sous le soleil foudroyant de ces latitudes.
Je savais, par renseignements, que ces mornes solitudes s’étendent en plateaux rocailleux, qui s’abaissent insensiblement vers le Sud, jusqu’aux Areg, haute et large barrière de sable qui les sépare du Gourara ; qu’elles sont sillonnées par cinq grands canaux qui sont comme les gouttières de ces immenses plates-formes, destinées, en se transformant pendant quelques heures en gros torrents, à recevoir et à conduire les pluies qui tombent dans les montagnes du Nord, et à porter ainsi la vie jusqu’à cette mer de sable déshéritée des rosées du ciel.
Quelques légendes mystérieuses et obscures, de celles qui exercent un si grand charme sur les imaginations vierges des Sahariens, m’avaient appris que ces contrées, que l’oiseau lui-même est obligé de fuir, parce qu’il n’y trouve pas la goutte de rosée qui le désaltère, avaient été habitées autrefois par une tribu nombreuse et puissante, les Hilel-Beni-Amer ; qu’à chaque point saillant, qu’à chacune de ces gour ‘2), qui s’élèvent, de loin en loin, dans cette immensité,
645
comme des phares destinés à guider les caravanes, les guerriers, les héros de cette tribu, avaient attaché un nom, un souvenir consacré par quelque exploit ou par quelque calamité.
Parmi ces légendes qui donnent à ce pays, dans le passé, une vie qu’il n’a plus maintenant, j’avais remarqué celle qui raconte sa prise de possession par les Beni-Amer et une autre qui semblait révéler un phénomène géographique des plus curieux.
Les voici, dans toute leur naïveté : Les Hilel-Beni-Amer qui étaient venus de l’Est à la suite des Mehal (colonnes
musulmanes d’invasion), trouvèrent les vallées du Tell déjà occupées par ceux qui les avaient précédés et furent obligés de s’enfoncer dans l’Ouest, en se tenant sur les plateaux sahariens, qui leur offraient, du reste, plus d’analogies de climat et de végétation avec les déserts de l’Yémen, leur patrie abandonnée.
Un jour, un vieux chasseur de la tribu, Ben-Kedim-el-Raï (le fils du vieux conseil), qui s’était porté en avant avec ses lévriers, revint après une absence prolongée. Quand les guerriers se réunirent pour la prière du soir et causèrent des affaires de la tribu, après s’être prosternés, il leur dit :
Je vous ai trouvé trois rivières (ouiden) Une d’eau courante, Une pour les chevaux, Une pour tous les troupeaux (mot à mot, où peuvent traîner toutes les queues). Leurs rives sont rocheuses (mot à mot, leurs dos sont bossus) Leurs lits plats et unis (leurs ventres lisses) ; Le Rega, le Reguig, le Gahouan (3) Et toutes les bonnes plantes y abondent. Les ghazias y sont rares ; Les chacals inoffensifs ; Si vous voulez vous y établir, Chacune de vos chamelles enfantera un troupeau. Ces trois sources de richesses dépeintes si poétiquement par Ben-Kedim-el-Raï
séduisirent la tribu et elle planta ses tentes. La rivière d’eau courante, le phénomène si rare dans un pareil pays, était l’Oued-
Zergoun. Je connaissais déjà cette grande gouttière des plateaux sahariens ; je l’avais explorée sur une grande partie de son cours, mais je l’avais trouvée bien dégénérée. Hélas ! l’eau courante et permanente que Ben-Kdeim-el-Raïs y avait trouvée avait disparu, et Zergoun, comme l’Oued-Seggueur, comme l’Oued-el-Gharbi, comme l’Oued-el-Namous et l’Oued-Messaoura, n’était plus, pendant l’été, qu’une longue traînée de sable et de gravier brûlant à sa sortie des montagnes, qu’une large dépression du terrain dans laquelle le passage annuel des eaux pluviales et des alluvions qu’elles entraînent, donne seulement la vie à une végétation plus vigoureuse et plus verte que celle des plateaux voisins.
Cependant, tel qu’il est encore, l’Oued-Zergoun est la ressource, le paradis terrestre des Ouled-Yayoub qui nourrissent sur ses rives de gras et nombreux troupeaux de chameaux et de moutons. Pour eux, il n’est pas de pays au monde, comparable pour l’abondance à ces immenses plateaux où croissent de rares plantes ligneuses fort appétées des chameaux, à cette rivière desséchée dans laquelle les crues d’eau laissent des mares bourbeuses qui donnent la vie à quelques grêles tamaris.
Cet aride pays, cette chétive végétation sous laquelle le lièvre trouve à peine un abri de l’ombre, n’inspirent pas à l’Européen la même confiance qu’au pasteur saharien. Le premier, habitué aux riches cultures, aux prairies, aux forêts, aux larges fleuves du sol natal, est saisi d’une vague appréhension quand il doit s’enfoncer dans ces profondes solitudes et craint le manque absolu de toutes choses, là où le second bénit l’abondance.
646
En 1853, lors de notre premier voyage à Ouargla, le général Durrieu, alors colonel, commandant la subdivision de Mascara, devait traverser, avec une colonne de cavalerie, les plateaux qui séparent El-Maïa de Mitlili. A mesure qu’il avançait dans ce morne désert, cette mélancolie, cette espèce de terreur que ces espaces inspirent, l’envahissaient sans doute, car il interrogea à diverses reprises et toujours avec une inquiétude croissante, le caïd des Ouled-Yagoub, Tahar-bel-Fathmi, qui le guidait, sur les ressources en eau, en bois et en fourrage qu’il avait devant lui. Le vieux caïd lui répondit : « Mais vous êtes sur l’Oued-Zergoun » de l’air à la fois étonné et narquois que pourrait prendre un parisien pour dire : « Vous êtes à Paris ! » à un étranger qui semblerait craindre d’y manquer du nécessaire. Le Yagoubi ne pouvait pas admettre qu’on pût craindre la faim ou la soif dans cette vallée qui était pour lui le type de la fécondité.
La seconde de ces légendes fait disparaître deux tribus ennemies l’une de l’autre, dans une daya qui est située au Nord et au pied des Areg et qui, selon la tradition, engloutit tout ce qui l’approche. Sa surface est formée de petits monticules qui paraissent solides, mais qui s’affaissent sous la moindre pression. Les Arabes s’en éloignent, parce que souvent des chameaux qui ont voulu la traverser, ont disparu au milieu d’un nuage de poussière avec un bruit semblable à la détonation d’une bonne quantité de poudre non comprimée.
Ils lui ont donné le nom de Habessa : celle qui arrête, qui absorbe. Au temps où vivait Sidi-Seliman-bou-Semaha, l’un des chefs vénérés de la famille des
Oulad-Sidi-Chikh, il y a quatre cents ans à peu près, deux fractions des Meharza, les Zebeirat et les Oubeirat faisaient paître leurs troupeaux et labouraient dans la large vallée de Meguidem, entre les Areg et les rochers qui bordent les plateaux de Goléa.
Les Zebeirat, dit la légende, avaient sept puits ; chaque puits avait sept bassins, à chaque bassin venaient boire sept troupeaux de chameaux, et chaque troupeau était suivi de sept chevaux.
Les Oubeirat avaient sept tentes ; dans chaque tente, sept frachat (1) ; sur chaque frach, sept coussins, et sur chaque coussin dormaient sept guerriers.
Le cheikh, le guerrier le plus écouté de ces deux familles, se nommait El-Hadj-el-Zebeir. El-Hadj-el-Zebeir et les siens avaient déplu à Sidi Seliman-bou-Semaha qui leur
reprochait de n’être ni assez respectueux pour lui, ni assez généreux pour sa zaouia. Le marabout prononça contre eux cette malédiction : Que Dieu aveugle l’esprit d’El-Hadj Et le raye du nombre des vivants ; Qu’il détruise les familles de ceux qui le suivent ; Qu’il prépare une terre pour l’engloutir Et qu’il ne laisse pas une femme de sa race Pour le pleurer. A la suite de cette malédiction, la discorde survint entre les Zebeirat et les Oubeirat ; ils
se battirent. Les Oubeira vaincus se retirèrent avec leurs familles et leurs richesses ; poursuivis par leurs ennemis, ils traversèrent péniblement les Areg et arrivèrent pendant la nuit à une daya dont le sol leur parut solide. Ils voulurent la traverser et furent tous engloutis. Les Zebeirat conduits par les traces des vaincus jusqu’à la daya disparurent à leur tour.
Une femme, parente de El-Hadj, mariée dans une autre fraction, restait seule des familles maudites. Un jour Sidi Seliman-bou-Semaha l’entendit qui pleurait et chantait le deuil en tournant le moulin. En apprenant qui elle était, il dit : « Que la terre l’engloutisse comme elle a englouti les siens », et la femme toujours pleurant, chantant et tournant son moulin, s’enfonça en terre, et son chant et le bruit de son moulin s’éteignirent peu à peu.
Les Arabes sont si chaudement, si naïvement enthousiastes quand ils racontent ces traditions, ces fantastiques légendes, quand ils parlent de la végétation, des pâturages et des
647
chasses des solitudes sahariennes ; ils ont des gestes et des mots si expressifs pour peindre leurs horizons infinis ; l’attrait qu’ils paraissent éprouver pour les solitudes est si vif, que leur enthousiasme a quelque chose de communicatif et qu’on se sent entraîné, malgré soi, à désirer l’immensité, le désert et la vie contemplative qu’ils y mènent.
J’avais ressenti cette attraction, un jour que j’étais avec Sidi Hamza sur les hauteurs de Brezina. Le profond Sahara s’étendait devant nous sans autre borne que notre pensée. Lui, semblait vouloir s’y élancer, l’air qu’il respirait en vue des palmiers et de nos tentes paraissait trop lourd pour sa poitrine ; là-bas, là-bas seulement il aurait pu respirer à pleins poumons. Ses yeux humides brillaient, sa figure rayonnait d’enthousiasme en me faisant les récits des chasses de sa jeunesse, alors qu’il partait avec deux ou trois de ses fidèles, quelques chameaux chargés d’outres pleines d’eau et d’orge pour les chevaux, et qu’il se perdait pendant des mois entiers dans le Sahara, vivant de la chair des outardes, des gazelles et des meha, couchant mollement sur le sable chaud, sous ce ciel toujours étoilé, toujours pur.
Déjà, cependant, j’étais familiarisé avec les déserts ; les heures de la conquête ou de l’administration du cercle m’avaient conduit jusqu’à Ouargla, à l’Est, jusqu’à Figuig, à l’Ouest. J’avais traversé d’immenses plateaux arides où mes yeux avaient en vain cherché un oiseau ou un insecte ; j’avais ressenti un peu de cette émotion écrasante qui saisit l’homme quand il se sent isolé dans l’immensité, mais toujours j’avais eu devant moi un but que je savais pouvoir atteindre à jour fixe, et j’avais pu supputer les lieues, les pas que j’avais à faire pour trouver une source, un puits et l’ombre de quelques palmiers.
Ces excursions m’avaient toujours tenu, pour ainsi dire, sur la lisière de cette partie du Sahara qui m’attirait ; je l’avais toujours vue devant moi sans pouvoir jamais trouver l’occasion de l’explorer ; j’avais vu souvent les caravanes de nos tribus s’y enfoncer et disparaître peu à peu, comme disparaît un vaisseau sur une mer calme à l’œil de ceux qui sont au port. Elles allaient au [Gourga], au Touat, à Ouaguerout, ces riches oasis qui s’étendent au-delà des Areg dans une large vallée, couvrant près de cent lieues de l’ombre de leurs palmiers.
Mais le Gourara était pour moi un but trop éloigné, un but impossible. Je désirais vivement cependant explorer un pays qui pour moi avait emprunté aux récits
des Sahariens une couleur mystérieuse. Je voulais me rendre compte, par mes propres impressions, de l’attraction étrange qu’il exerce sur eux ; je voulais chercher sur les lieux mêmes, la cause de cet abandon par les hommes, d’immenses espaces, sur lesquels vécut, il y a à peine trois cents ans, une nombreuse, riche et puissante tribu ; je voulais trouver l’explication des phénomènes qui ont tari les sources, comblé les puits où elle s’abreuvait et converti en déserts arides et inhabités pendant l’été les pâturages qui nourrissaient d’innombrables troupeaux de chameaux.
Le phénomène de la daya d’Habessa certifié par tous les Arabes qui ont parcouru le Sahara ou fait le voyage du Gourara m’intriguait ; ma raison se refusant à le croire, était en lutte avec les affirmations de ceux qui prétendaient avoir vu, et il résultait pour moi un grand désir de voir de mes yeux un gouffre si extraordinaire.
Il était, du reste, important d’explorer et de reconnaître un pays qui, pendant près de trois mois de l’année, sert de refuge aux tribus du cercle et à leurs troupeaux, contre les froids du haut pays. C’était le seul coin du cercle qui fût resté ignoré, une véritable lacune dans nos connaissances topographiques.
Au mois de décembre 1856, je demandai au général Durrieux, commandant la subdivision de Mascara, l’autorisation d’aller faire une tournée dans ces parages inconnus. Il me l’accorda sans difficulté, et je n’eus plus qu’à organiser mon expédition.
Un jeune médecin touriste, qui s’occupe beaucoup de géologie et de météorologie, M. Marès, se trouvait en ce moment à Grévyville. Le phénomène de Habessa l’intriguait fort ; il désirait, au moins autant que moi, s’égarer dans les solitudes sahariennes et explorer un pays que jamais pied européen n’avait foulé et qui semblait promettre bien des révélations, bien des
648
merveilles à sa science favorite. Il nous accompagna et donna à notre expédition une tournure d’exploration savante qui lui seyait à merveille.
Armé d’un baromètre de Fortin, d’un baromètre aménoïde, de plusieurs thermomètres, de masses, et marteaux et de piochettes de toutes les formes, il marchait intrépidement à la conquête scientifique de ce coin de terre abandonné de Dieu et des hommes.
M. de la Ferronays, sous-lieutenant au 4e de chasseurs, stagiaire au bureau arabe de Grévyville, muni d’une boussole, était chargé de la topographie du terrain à parcourir.
Je consultai le khalifa Sidi-Hamza et quelques hommes des Chaamba-Mouadhi, la seule tribu qui ait une profonde connaissance des solitudes que nous allions explorer. J’acquis auprès d’eux la certitude que la meilleure direction à donner à notre petite expédition, pour en tirer tout le fruit possible, était celle de l’Oued E-Gharbi que nous suivrions jusqu’aux Areg, pour de là, nous rabattre vers l’Est sur les Oued Seggueur et Zergoun.
Il s’agissait d’atteindre les derniers ghedir ; et, après avoir renouvelé notre provision d’eau, de nous enfoncer dans les sables à la rechercher de la daya de Habessa et des émotions de toute sorte que nous promettait une nature si nouvelle pour nous.
Sidi Hamza fut des nôtres, et le désir que nous avions de voir un pays si neuf, était bien certainement plus tiède que le sentiment qui l’attirait vers ces régions qu’il avait, dans sa jeunesse, parcourues en tous sens, et qui devaient réveiller en lui des souvenirs aimés.
Je fis un appel aux quarante meilleurs chasseurs du cercle : chacun d’eux s’engagea à venir avec ses lévriers et des chameaux portant des provisions pour un mois, et, chacun, vingt outres.
Je supputai que nous pourrions rester dix ou douze jours sans trouver de l’eau, et je pris mes précautions en conséquence : soixante tonnelets de cinquante litres portés par des chameaux m’assurèrent, avec les huit cents outres de nos chasseurs, l’eau suffisante pour hommes, chevaux et lévriers. Seuls, les pauvres animaux qui les portaient devaient en rester privés pendant douze jours peut-être, et, pliant sous le poids de nos provisions de bouche, et de l’orge de nos chevaux, vivre des plantes quelquefois trop rares des plateaux arides que nous devions parcourir.
Quelques hommes des Chaamba-Mouadhi de Goléa parmi lesquels Breïk-ould-Aïssa, le Bas-de-Cuir des sables par excellence, le chasseur le plus adroit et le plus infatigable de cette tribu qui ne vit que de chasse et de pillage, devaient nous servir de guides.
II. Rendez-vous fut donné pour le 2 janvier à El-Abiod-Sidi-Cheikh, et le 31 décembre,
notre petit groupe d’européens accompagnés de quelques spahis, quitta Grévyville, sur lequel tombait à gros flocons une neige épaisse que nous nous réjouissions de laisser derrière nous, en nous enfonçant dans les régions plus tempérées du Sud.
Nous allâmes coucher ce jour-là à Sid-El-Hadj-ben-Ameur. J’ai peu de choses à dire du pays qui sépare Grévyville de ce Ksar. Ce sont des plateaux
ondulés couverts de halfa (stipa tenacissima), de [chibh] (Artemisia herba alba), de harmel (Peganum harmala), de sengha (Ligeum spartum) et de allel… ; ils sont traversés du Nord-Est au Sud-Ouest par l’étroite chaîne du Ksel, nue et rocheuse à la base, boisée aux sommets de kerrouch, chêne-verts (quercus ilex), de chêne-ballotte (Quercus ballota) qui produit ce bellout, gland doux, dont le nom arabe a été emprunté par les naturalistes pour désigner l’espèce et qui rend aux indigènes le même service que la châtaigne rend aux Limousins ; de tagga, genévrier (Juniperus oxicedrus) et de el-iazir, romarin très parfumé (Rosmarinus officinalis).
Le chemin coupe cette chaîne par un col d’un accès facile, et se dirige ensuite vers l’Ouest, sur la goubba de Sid-El-Hadj-ben-Amer que l’on aperçoit dans le lointain.
Le marabout qui est enterré dans cette chapelle est l’aïeul des Oulad Sid-El-Hadj-ben-Amer, qui vivent encore autour de son tombeau, moitié cultivateurs, moitié pasteurs nomades.
649
Il vint, il y a environ deux siècles, s’établir dans cet aride pays, pour fuir le Tell (la Yagoubia) où ses femmes avaient été insultées par des soldats turcs qui, pendant son absence, s’étaient introduits dans sa tente et les avaient forcées à se dévoiler.
Le Ksar qu’il fonda et qu’il habita est sur la rive gauche de l’Oued-Sebeïhi ; ses ruines et ses vergers donnent une assez médiocre idée de ce qu’il fut. Ruiné dans les premières années de ce siècle par les Zegdou (1), qui partout, dans ce pays-ci, ont laissé la trace de leurs passages réitérés et de leurs ravages, il a été relevé à demi depuis notre occupation et abrite aujourd’hui cinq ou six familles de métayers (khammas), qui labourent la vallée et donnent leurs soins à quelques arbres fruitiers, restes des anciennes plantations si longtemps abandonnées.
A Sid-El-Hadj-ben-Amer, nous étions sur le versant Sud du Ksel et abrités par sa longue chaîne dont les plus hauts sommets ont une altitude absolue de 1950 mètres et de 814 mètres au-dessus du point où nous nous trouvions ; aussi, la neige s’était convertie en une pluie fine, et la température était beaucoup plus douce.
Les Oulad Sid-El-Hadj-ben-Amer vinrent nous offrir un mouton que nous n’acceptâmes pas et quelques fagots de tamarix qui nous firent plaisir et dont la flamme bleuâtre égaya bientôt notre camp.
Le lendemain, 1er janvier, au point du jour, les sons criards du clairon (2) nous arrachèrent sinon à nos rêves, du moins à la douce chaleur de nos lits de camp ; et, bientôt, nous nous souhaitâmes mutuellement une bonne année autour des restes enflammés de nos fagots.
Le temps était encore sombre et froid, de gros nuages gris chargés de neige couronnaient les sommets du Ksel ; nous nous mîmes en route en faisant caracoler nos chevaux pour les réchauffer, en les lançant de temps en temps à la poursuite des lièvres qui se levaient à chaque instant devant nous, et en devisant joyeusement sur les fêtes de ce jour dans les pays civilisés, fêtes dont nous n’aurions pas échangé les plus brillantes contre notre voyage d’exploration à peine commencé.
Nous avions pour but, ce jour-là, les Arbaouat (les deux villages d’Arba). Le pays que l’on travers pour y arriver change d’aspect à mesure que l’on avance vers le Sud ; il devient plus rocheux, plus aride ; il est coupé par des ravins peu profonds dans les talweg desquels croissent des Retem, espèce de genêt (Retama Durvoei) et quelques betoum (Pistacia atlantica). L’horizon est borné de tous côtés par des montagnes peu élevées, mais escarpées, profondément déchirées et entièrement dépourvues de végétation ; dans le lointain seulement, la chaîne du Bou Nocta, qui domine les Arbaouat est profilée en noir et indique par cette couleur, en opposition avec celle rouge brique des pics ses voisins, qu’elle est couverte de broussailles de genévriers et de chênes-verts.
On est encore à huit ou dix kilomètres des Arbaouat lorsqu’on les aperçoit ; ils s’élèvent sur la rive gauche de l’Oued-Gouletta dont on voit serpenter dans la vallée la ligne verte tamarix. Quelques palmiers qui ont l’air d’avoir froid donnent à ce site un vernis oriental que démentent, au moment où nous le découvrons, les sombres montagnes qui le dominent et les nuages gris attachés à leurs cimes.
Les deux Ksour (châteaux) entourés de murs d’enceinte, flanqués de tourelles ayant la forme de pyramides carrées fort élancées et tronquées à leurs sommets, le tout percé de petits créneaux ronds, se confondent presque avec les berges de la rivière à cause de leur couleur terreuse ; de loin ils ressemblent à ces châteaux du Moyen-Age dont nous voyons encore les imposantes ruines sur notre sol. On est étonné de ne pas voir sur les tourelles le profil d’un archer et de ne pas entendre le beffroi ou le cor qui annonce l’arrivée d’une chevauchée : bientôt, sans doute, les chaînes d’un pont-levis grinceront et le héraut d’armes viendra nous reconnaître !
Hélas ! cette fantasmagorie s’évanouit à mesure que nous approchons : le château féodal devient un affreux amas de masures bâties en pisé, qui cependant, grâce aux tourelles, conserve un certain cachet pittoresque ; aux dames châtelaines se promenant sur les terrasses, sont
650
substituées de malheureuses femmes étiolées, jaunes, couvertes de haillons sordides, produit de la vie sédentaire des Ksour du Sud, de la fièvre, des ophtalmies et d’autres maladies sans nom.
Nous fûmes reçus par le chikh Maammar qui vint au-devant de nous pour nous offrir ses services. Nous dressâmes nos tentes entre les deux ksour, dans un jardin inculte, à l’abri de ses murs de clôture, et bientôt, grâce au chikh, nous eûmes sur notre bivouac une ample provision de paille, d’orge pour nos chevaux et de bois à brûler (tamarix et genêt).
Notre géologue, M. Marès, après avoir fait les observations barométriques avec le lieutenant De La Ferronays, se mit, le fusil sur l’épaule, la gibecière pleine de piochettes et de marteaux, à la recherche des richesses géologiques du voisinage, des perdrix qu’on entendait appeler dans les jardins et des canards sauvages qui barbotaient dans les eaux boueuses de l’Oued-Gouleïta.
De mon côté, je fus assailli par les Ksouriens des deux Arba qui profitaient du passage du [Hakim] (chef) pour lui soumettre leurs petites contestations d’intérêt et leurs interminables querelles, dont la légèreté et l’inconduite des femmes sont souvent la cause cachée sous un prétexte futile.
Il faut remonter jusqu’au 14ème siècle à peu près pour trouver l’origine des Arbaouat. A cette époque, Sidi-Moammar-ben-el-Alia, descendant de Sidi-Abou-Beker-Soddik, beau-père du Prophète, chassé de Tunis par son frère qui y commandait, vint s’établir sur l’Oued-Gouleïta. Ses enfants y construisirent un ksar, ruiné aujourd’hui et connu sous le nom de Ksar-Cherf (vieux château). Plus tard, des dissensions intestines partagèrent sa descendance en deux partis : les Oulad-Saïd et les Oulad-Aïssa. Ces derniers vaincus et chassés de leurs maisons allèrent se réfugier dans le Tell, sur les bords de l’Oued-Taghia. Mais, après leur départ, vint une invasion de Zegdou ; trop faibles pour leur résister, les Oulad-Saïd furent obligés de fuir dans les montagnes, abandonnant leur ksar qui fut ravagé et démoli. Au lieu de relever ses ruines, ils en construisirent un autre sur les berges de l’Oued-Gouleïta. Peu de temps après, Sidi-Seliman-bou-Semaha, descendant direct de Sidi-Moammar-ben-el-Alia, ramena les Oulad-Aïssa du Tell, et rétablit la concorde entre les Capulets et les Montaigus de ce coin de terre. Mais, dans la crainte sans doute qu’elle ne fût pas de longue durée s’ils étaient voisins et en contact journalier, il fit élever à ses protégés un ksar à peu près pareil à celui de leurs rivaux également sur les berges de la rive gauche, à un kilomètre environ en amont. Ce dernier ksar fut appelé Arba-Foukani (Arba d’en haut), et, par opposition, celui des Oulad-Saïd prit le nom de Arba-Tahani (Arba d’en bas).
Maintenant, ces deux Arba ont à eux deux 65 maisons et environ 500 habitants. Toute trace des anciennes querelles n’a pas disparu, et il est facile de reconnaître dans leurs relations un vieux ferment de haine. Mais le chikh qui les commande réside à Arba-Tahtani, et, aujourd’hui comme autrefois, les Oulad-Saïd ont l’avantage sur les Oulad-Aïssa. Pourtant, les deux partis se sont beaucoup modifiés depuis ; ils ont même dérogé, par suite de mésalliances, et accepté parmi eux des Arabes des Oulad-Ziad, des Oulad-Mounien, etc., à tel point, que les Oulad-Sidi-Chikh descendant comme eux de Sid-Maammar-ben-el-Alia, nobles et chefs religieux du pays, les acceptent à peine pour cousins.
L’histoire détaillée de ces deux bicoques serait trop longue et sans intérêt ; il faudrait d’ailleurs, pour la dire, puiser dans des légendes miraculeuses, qui seules, à cause de leur merveilleux, se sont transmises de génération en génération jusqu’aux vieillards qui les racontent encore maintenant en les défigurant. Je ne veux cependant pas être irrévérent envers les marabouts vénérés auxquels les deux ksour durent souvent leur salut, au point de ne pas signaler en passant, leurs Goubbah (1) construites en moellons blanchies à la chaux. Elles sont au nombre de quatre qu’on désigne par les noms des marabouts dont elles abritent les tombes : Sidi-Maammar-ben-el-Alia, le fondateur des Arbaouat, Sidi-Aïssa-ben-el-Alia, Sidi-Brahim-ben-Mohammed ses descendants et Sidi-bou-Tkheil de la famille de Sidi-Abd-el-Kader-el-Djelani un des plus grands saints de l’islamisme. Lorsque le bey Mohammed-el-Kebir, après
651
avoir saccagé Chella’a, vint camper devant les Arbaouat pour leur infliger le même sort, un tourbillon noir sortit de la goubba de Sidi-Maammar, et alla renverser la tente du bey turc, qui, effrayé par cette menace du saint, se retira. Sidi-Maammar ne devait pas moins à sa lignée.
Ces quatre goubba ont été édifiées il y a à peine cent-cinquante ans, par Sidi-ben-ed-Din, le chef des Oulad-Sidi-Chikh. Il n’avait songé d’abord qu’aux marabouts de sa famille et pendant que trois des dômes s’élevaient déjà sur leurs tombes, celle de Sidi-bou-Tkheil restait une simple Haouita (1) entourée de quelques pierres et surmontée comme toutes les Haouia possibles de quelques chiffons éraillés par le vent et la pluie.
Il paraîtrait que la jalousie est un sentiment d’outre-tombe, même parmi les plus saints marabouts, car, Sidi-ben-ed-Din s’en retournant à El-Abbad-sidi-Chikh, fut arrêté en son chemin par Sidi-bou-Tkheil qui s’était débarrassé de son suaire pour lui reprocher en des termes assez vifs son manque d’égards envers lui. Sidi-bou-ed-Din fut sensible à ces reproches mérités et Sidi-bou-Tkheil eut sa coupole sous laquelle il a dormi parfaitement tranquille depuis.
Ces goubba sont entretenues par la piété des fidèles qui les blanchissent souvent à la chaux et les décorent de tapis et de foulards. Chacune d’elles à son Mekadem, espèce de sacristain, qui est chargé de recueillir les offrandes, d’en faire l’emploi, et qui vit grassement aux dépens de son saint.
L’Avenir, 23 mars 1859, troisième page Dans la crise où nous sommes, personne n’est gai. Les commissionnaires ne sont pas gais – parce que l’année dernière a grossi la balance
de compte de leurs commettants. Les habitants ne sont pas gais – parce que le prix des Immigrants, sur lesquels ils
comptaient pour remplacer leurs cultivateurs indigènes, a presque doublé et que le prix du sucre a baissé.
Les marchands de calicot ne sont pas gais – parce que les traites sont à 15% de prime, que toute remise en France leur est impossible et que, sans remise, le crédit cesse.
Les employés municipaux ne sont pas gais – parce que beaucoup d’entre eux ont eu pour étrennes une diminution de traitement.
Les Miliciens ne sont pas gais – parce qu’ils ont en perspective l’amende, la prison, le fort fleur d’épée, s’ils ne parviennent pas à s’habiller… Chose difficile, sinon impossible pour la plupart.
Que faire pour dérider tous ces fronts sombres ? Il me vient une idée. – Si nous leur contions de temps en temps un petit conte drôlatique,
ce serait le contrepoison de ces grands articles de fond que nous donne depuis quelques temps votre Avenir, et qui ne sont pas gais non plus.
Les contes ont cela de bon, qu’ils détournent un moment la pensée des choses sérieuses ou tristes.
Schéhérazade en faisait au sultan des Indes pour lui faire oublier qu’il était cornard du fait d’un vilain bossu.
Mme Scarron (il y a encore du bossu là-dedans) en faisait à ses convives pour leur faire oublier qu’elle ne leur donnait pas de rôti.
Jasons comme Schéhérazade et Mme Scarron, servons à nos lecteurs, commissionnaires, habitants, marchands de toile, employés, miliciens, un petit conte : ce sera peut-être le moyen de les distraire de leurs préoccupations.
En voici un comme essai : Il y avait, une fois, un maire… Ce maire apprit que 2 ou 3 congos marrons se cachaient dans un certain grand bois et
que de là ils sortaient la nuit pour faire main basse sur les patates et les maïs de ses administrés.
652
Il leur arrivait parfois de vouloir y joindre un peu de viande et, alors, ils volaient des poules, même des cabrits.
Il se dit dans sa sagesse, c’était un lettré : il n’est pas bon (non bonum est) il n’est pas bon que ce désordre continue. Je m’en vais traquer ces congos et les arrêter… si je puis.
Il s’entendit avec le commandant des milices, ainsi que le veut l’article… de l’arrêté du Gouverneur général en date de…
Puis, à eux deux, ils convoquèrent la compagnie des pompiers et l’envoyèrent à la chasse des Congos.
Les Pompiers partirent sans pompe, mais avec pompe et de plus avec leurs fusils et leurs coupe-choux. Il y avait bien deux lieues à faire pour arriver au repaire des Congos.
A mi-chemin, la moitié des Pompiers qui avaient des souliers (car il y en avait qui n’en avaient pas) n’en eurent plus.
C’étaient sans doute des souliers de Fanien. Ce Fanien est un fabricant dont le nom en italien (Farniente) veut dire : fainéant, ou qui
ne fait rien. J’ajouterai : de bon. Si bien que les souliers qu’il nous envoie, et qui nous coûtent 15 francs, ne durent pas 15 jours.
La moitié des Pompiers n’eut plus de souliers. Ceux-là s’arrêtèrent à un cabaret qui se trouve sur le bord du chemin.
L’autre moitié, qui avait des souliers, continua bravement à marcher. Je dis bravement et c’est à dessein, et non pas pour rendre ma phrase plus sonore. Il est généralement reconnu que les Miliciens sont braves. Ils n’ont pas pris Sébastopol, c’est vrai – mais ils la prendraient, comme les autres que
vous savez, avec un peu de temps et de patience et beaucoup d’exercice, comme disait un ancien Gouverneur.
L’autre moitié continua donc, mais ils s’aperçurent bientôt que le soleil était chaud, que leurs fusils étaient lourds et seraient embarrassants plutôt qu’utiles dans les grands bois inextricables qu’il leur fallait parcourir.
Ils laissèrent donc leurs fusils à la garde d’une vieille négresse, et munis de leurs seuls coupe-choux, ils entrèrent dans le bois.
Je me trompe – ils s’arrêtèrent sur la lisière du bois et ils délibérèrent. Il résulta de leur délibération qu’ils se partagèrent par groupes et en avant. Un de ces groupes eut le bonheur de tomber sur deux Congos assis et occupés à faire
rôtir des patates. Quant aux autres groupes, trouvant de l’ombrage, ils s’assirent au frais, lâchèrent leurs
bretelles pour se remettre de leur fatigue. Les deux Congos, troublés dans leur cuisine, se levèrent. C’était le moment de leur sauter dessus et de les appréhender au corps. Les Pompiers en jugèrent autrement. Ils s’enfuirent en criant au secours, sans penser à
éteindre le feu, comme c’était leur spécialité. – il est vrai qu’ils n’avaient pas de pompe. Puis, aux cris poussés par eux, tous les groupes s’étant réunis, on décida qu’on en avait assez fait pour aujourd’hui, et qu’il était temps de rentrer dans ses foyers.
Aussitôt dit – aussitôt fait – on partit en clopant, on rallia les braves qui, faute de souliers, s’étaient arrêtés au cabaret de la grande route, on y but un coup de mort-à-rat (ne lisez pas Mortara) à la plus grande gloire Milice en général et des Pompiers en particulier, et l’on rentra au chef-lieu, tambour battant, heureux et fier d’avoir fait son devoir.
Un des Pompiers, dit-on, portait au bout de sa baïonnette, une tête de cabrit, reste du festin des Congos.
On condamna à l’amende les Pompiers qui ne s’étaient pas rendus à la convocation. A quoi bon l’amende ? mon Dieu ! ils étaient bien assez punis d’avoir manqué cette glorieuse affaire !
653
Je n’ai pas pu savoir si un ordre du jour avait récompensé les Pompiers zélés ; si c’est un oubli, il faut espérer qu’on le réparera.
Quoi qu’il en soit, lecteurs, mes amis, convenez que c’est une belle institution que celle des Pompiers, surtout pour la guerre des grands bois !
N. B. – Ceci se passait dans les Indes en 1759.
« Chronique locale : petit avant-propos pour tenir lieu de préface », L’Avenir, 18 juin 1859, troisième page
Quelquefois un bon conseil, un salutaire avis nous vient, je ne dirai pas de nos ennemis (je ne me crois d’ennemi ni dans ce monde ni dans l’autre), je dirai de nos adversaires, de nos contradicteurs.
Il y a peu de jours, un écrivain de la presse coloniale, sous forme de critique, me disait : pourquoi donc vous êtes-vous arrêté en si beau chemin de votre histoire de la Guadeloupe dont nous ne connaissons guère que la préface ? Vous feriez mieux de la continuer que d’écrire contre la milice.
Tiens, me suis-je dit à mon tour : ce monsieur a raison peut-être ; peut-être, sans le vouloir, me donne-t-il un bon avis. Pourquoi donc me suis-je arrêté ?
Je ne m’en souviens déjà plus. Je m’en suis ressouvenu. Je m’étais arrêté pour deux causes : j’avais de la peine et n’avais pas de profit, cela
m’allait peu et même pas du tout ; ne pouvant, à cause de la censure, qui florissait alors, imprimer ici, j’imprimais ailleurs, j’envoyais à New-York mon histoire et quand elle revenait, il fallait pour la vendre, l’annoncer par la presse, et dame censure me guettait au passage…
Et puis il y avait la douane qui est la censure des choses, comme la censure est la douane des idées :
Il y avait le consignataire du navire importateur, qui avait peur de la saisie ou de l’amende pour fait de contrebande et qui me disait, la larme à l’œil : j’avais à bord un ballot de votre histoire, j’ai vu venir la douane, je l’ai jeté à l’eau ;
Et moi je répondais : c’est bien fait, périsse mon histoire plutôt que votre navire. Depuis lors, les choses ont changé de face, je change ma préface et reprends le fil de
mon histoire : on nous a donné la liberté de parler, je n’ai plus le droit de me taire ; je continue ou plutôt je recommence ; quelques pages seulement avaient paru, elles paraîtront dans L’Avenir, à partir du premier juillet prochain, afin que tous les abonnés aient l’œuvre complète.
Je ferai grâce à mes lecteurs de la préface, on l’a lue une fois et c’est assez, d’ailleurs comment la donnerais-je, je ne l’ai plus et ne sais plus où elle est.
On me dira peut-être : vous prenez mal votre temps ; de grandes choses se passent en ce moment en Europe et vous allez parler de petites choses qui se sont passées ici il y a dix ans ; à cela je réponds : il est assez d’usage de donner, après la grande pièce, la petite ; ainsi je ferai, et on ne lira la petite histoire qu’après la grande, une fois tous les quinze jours et quand il n’y aura rien de mieux à lire.
Mais ne craignez-vous pas d’éveiller les passions assoupies, en retraçant cette période encore trop près de nous ?
Non, je ne le crains pas, par la raison que je ne m’attaque pas à la queue, je prends l’hydre de 48 et 49 par ses sept grosses têtes ; j’écris sans haine et sans passion ; témoin de ce que je raconte, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, si je mens, qu’on me condamne à la peine des parjures. D’ailleurs au moment même où L’Avenir publiera à la Pointe-à-Pitre une histoire de la Guadeloupe, est-ce que la presse du gouvernement n’imprimera pas à la Basse-Terre une œuvre semblable qui est due à la plume d’un éminent magistrat, d’un conseiller à la cour impériale ?
On me dira : ceci est une autre histoire.
654
Une histoire sérieuse et la vôtre une histoire pour rire, pouvez-vous comparer des choses incomparables ?
M. Lacour fait revivre des morts, vous allez tuer des vivants ! Tant mieux pour ces morts, tant pis pour ces vivants ! Je publie mon histoire parce que peu de personnes la savent et que je crois utile que tout
le monde la connaisse ; Je la publie encore pour une autre raison, superlative ; c’est une besogne déjà faite au
lieu d’une besogne à faire ; car il y a des fois où je ne sais que servir aux abonnés de L’Avenir ; ces jours-là, qui arrivent quand le packet d’Europe n’arrive pas, je donnerai mon ours à mes lecteurs ;
Si l’autorité chargée de la sécurité publique pense qu’il y a le moindre danger à le lâcher au milieu de la foule, elle m’arrêtera ;
Si les lecteurs le trouvent peu amusant, Je m’arrêterai. A. Vallée
Bou Achra, « Souvenirs d’un vieil Algérien. Une chasse au lion à Philippeville en 1844 », 25 septembre 1863, feuilleton
Jules Gérard a singulièrement dépoétisé le lion. Adroit tireur, doué à forte dose d’une impassibilité courageuse, qui lui fait braver froidement les plus grands dangers, il a détrôné l’ancien roi du désert. Le récit de ses exploits, - et Dieu sait s’il en est avare, - a fait descendre le lion au rang de simple bête de vénerie. Bonbonnel et Chassaing, de leur côté, n’ont pas peu contribué à activer cette décadence. De sorte qu’aujourd’hui, il n’est pas de sanglier poltron de la Macta qui ne semble à nos modernes Nemrod, tueurs de cailles et de bécassines, aussi redoutables pour le moins que Sa Majesté le lion elle-même. Les Arabes seuls, - peut-être parce qu’ils n’ont pas lu les livres de Gérard, - ont conservé une crainte superstitieuse et probablement salutaire, de ce farouche animal, à la crinière noire, à la griffe cruelle.
En 1844, - époque à laquelle se passèrent les faits que je vais raconter, - on n’était pas aussi rassuré qu’à présent. Le lion avait conservé sa splendeur légendaire, et si sa présence était annoncée dans un quartier, c’était avec terreur que l’on parlait de ses farouches exploits.
Moi-même, j’étais arrivé depuis peu de temps en Algérie. Ma passion pour la chasse, peut-être aussi le vaniteux désir d’envoyer à mes amis de France le récit d’exploits peu communs me poussait vers les aventures. J’avais tué des chacals et tiré des hyènes. Un jour, même, l’on m’avait entraîné jusqu’à El-Arrouch pour exterminer une panthère. Ce dernier épisode mérite quelques détails.
Je remplissais à Philippeville les fonctions de régisseur du théâtre. Les zéphyrs du 2e bataillon, qui, eux aussi, avaient organisé un théâtre à El-Arrouch, où ils tenaient garnison, vinrent un jour me prier d’aller les aider à mettre en scène une pièce à grand spectacle. Pour me mieux engager, ils me promirent une chasse à la panthère. Comment résister à une pareille tentation ? J’acceptai, et me voilà au camp.
Un soir, après la répétition, on me met dans les mains un fusil de munition, en me disant : nous allons chasser la panthère. Le chef de l’expédition, un zéphyr pur sang, fils de l’un de nos plus célèbres peintres de marine, nous conduit sur les bords de l’Oued Ensa, et nous embusque chacun derrière un bouquet de lauriers roses. Un clair de lune superbe éclairait le terrain comme en plein jour. Au bout d’une demi-heure d’attente, la panthère parut et descendit lentement la rive opposée ; elle s’avançait vers nous avec la sécurité et les grâces d’un jeune gandin se promenant le soir sur le boulevard de Gand. Dès qu’elle eut baissé sa tête vers l’eau pour y boire, je la mis en joue, ainsi que cela m’avait été recommandé. Le commandement « feu ! » se fit entendre. Nous étions douze ; douze coups partirent à la fois, et douze balles trouèrent la
655
panthère, qui fit un bond formidable et retomba morte. Nous l’avions fusillée presque à bout portant, et sa peau était abîmée.
Armand Closquinet, « Hommage et Adieu », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 17 avril 1864, deuxième page
On lit dans l’Économiste français du 7 janvier 1864 : « La poésie est en honneur à Port-de-France, si nous en jugeons par les odes et
idylles que publie fréquemment le Moniteur. M. Armand Closquinet a de la grâce, de l’élégance, une sensibilité toute féminine ; aux souvenirs et regrets qu’il aime à chanter, nous l’invitons à opposer les perspectives et espérances que ne peut manquer d’évoquer dans son âme de poète le spectacle de la civilisation prenant possession d’un pays et d’un peuple aussi sauvages l’un que l’autre. »
En réponse à cette appréciation flatteuse, nous publions les adieux à la Nouvelle-Calédonie du poète que nous a enlevé la Sibylle et dont nous aimons le talent non moins que l’Économiste.
Hommage et adieu Poésie dédiée à M. I. Je pars ! le sort le veut ! J’abandonne cette île Où, plein d’illusions, de loin j’étais venu ; Où le bonheur pour moi semblait chose facile ; Je pars ! le sort le veut ! triste et déconvenu. Hélas ! Monsieur, le vent qui va gonfler ma voile Et pousser mon vaisseau vers le vieux sol natal Emportera mes pleurs, tels que ceux dont se voile Tout regard s’attachant sur un passé fatal. Sur un passé fatal ! … c’est l’expression vraie Du produit de mes jours perdus, mis en lambeaux. J’ai peur de l’avenir : à cette heure il m’effraie ; Mes jours, mon avenir devaient être si beaux ! Que ce sombre tableau s’éloigne de ma vue ! J’ai des devoirs encore à remplir en ces lieux ; Si, du bien qu’on m’a fait je passe la revue, Je me trouve, il me semble, un peu moins malheureux. Parmi des bienfaiteurs que comptent mes années, Oh ! vous êtes, Monsieur, l’un des plus généreux ! Les preuves de bonté que vous m’avez données Me suivront, croyez-moi, là-bas, sous d’autres cieux. C’est pour vous en laisser un dernier témoignage Que je viens vous offrir, vous adresser ces vers ; Veuillez, je vous en prie, en accepter l’hommage ; Prenez-les ; je serai moins triste sur les mers.
656
Pour éviter, d’ailleurs, une lecture sombre, J’ai préféré parler du pays enchanté Auquel vous prodiguez, vous, des labeurs sans nombre ; Que moi, dans quelques jours, hélas ! j’aurai quitté. II. Terre aujourd’hui française ! Ile calédonienne : Magnifique pays par Dieu même doté : Qui viendra m’inspirer, ô perle océanienne ! Les riches vers qu’il faut pour chanter ta beauté ? Tout est splendide en toi ! – Tes montagnes superbes ; Tes plaines embrassant un immense rayon ; Tes arbres et tes fleurs, jusqu’à tes hautes herbes, Tout est plein de grandeur sous ton pur horizon. De tous côtés s’étend la chaîne de montagnes Qui semble protéger tes timides vallons. Le regard suit, ici, de riantes campagnes Où de charmants ruisseaux ont tracé leurs sillons. Là, sous la forêt vierge et toujours verdoyante, La pudique rivière a façonné son lit ; On l’entend murmurer, tandis que l’oiseau chante Sous le palétuvier, ou dans le Niaouli. Puis, enfin, tout autour de tes flancs, c’est le sable ; C’est le sable et la mer, avec de frais îlots Parsemés au hasard, d’un effet admirable, Et ceints du ruban bleu que leur forment les flots. J’ai vu, j’ai vu de près tes cases, tes villages ! Je me suis même assis au foyer indien ; J’ai passé plusieurs nuits chez tes guerriers sauvages ; Leur hospitalité fut large ; ils la font bien. Ces hommes, qu’on nommait cannibales féroces, M’ont reçu franchement et m’ont tendu la main, Ces kanacks, dont on dit tant de choses atroces, Veillaient autour de moi, du jour au lendemain. J’étais Tabou2 pour eux. Et pourtant tous ces êtres Naguère auraient bondi de joie en me voyant, Et de mon pauvre corps, facilement les maîtres, Ils eussent fait, sans doute, un festin attrayant. Non ! non, plus de sagaie, et plus de casse-tête ! Plus d’idoles non plus ; aujourd’hui, c’est la croix !
2 Sacré.
657
Au temple prosterné, chacun tout haut répète : O Jésus Christ, salut ! – Salut au Roi des rois ! Civilisation ! voilà ton noble ouvrage : Gloire à Dieu, gloire à toi ! Gloire à la France aussi, Car c’est par ses enfants, armés de leur courage, Que ces gens sont si doux et réduits à merci. Nouvelle Colonie, allons, marche, prospère ! Ouvre tes routes, creuse et canaux et sillons ; La France et Dieu sont là ! poursuis ton œuvre ; espère ! Qu’on n’entende qu’un cri sur ton sol : Travaillons ! Et maintenant, adieu, terre calédonienne ! Si le sort rigoureux ne m’avait abattu, Aux sueurs du travail j’aurais mêlé la mienne, Et vaillamment, peut-être, aurais-je combattu ! Nouvelle-Calédonie, le 11 novembre 1863, Armand CLOSQUINET.
Augustin Marquand, « Les Poètes du Sa’hara », 13 novembre 1864, deuxième page Chante ta chanson. Quelle qu’elle soit, une voix se trouvera peut-être pour qui elle aura
été écrite. Amar ben Selman. I Dans des publications plus ou moins récentes, la plupart empreintes d’une érudition
profonde ou d’une grande élégance de forme, MM. Ernest Fouinet, Resike, Victor Berard, Paul-Eugène Blache et le général Daumas nous ont fait connaître quelques poèmes arabes, persans, hudeilites, seljoukides et algériens, poèmes souvent remarquables par le désordre lyrique des idées, mais à travers lesquels le sublime et la grâce percent. Victor Hugo, Filigratz, Lamartine, Théophile Gautier, Henri Heine, Désiré Léglise et Jules Vernier ont emprunté aux Pindares du douar ou de la tente leurs plus brillantes inspirations. Il est à regretter, pour la gloire des lettres, que les voyageurs qui, depuis Mungo-Parck jusqu’à Henri Duveyrier, ont traversé le Sah’ara immense, n’aient pas rapporté quelques-uns des chants des nomades, ces chants qui, dit le Hamaza, donnent une idée, par l’enchaînement de leurs rimes, d’une étoffe rayée d’Yémen.
Si, chez les peuples civilisés, l’influence des chants populaires est à peu près nulle, il ne saurait en être de même chez les peuples errants du désert. La chanson est pour eux ce qu’est pour nous le journal, la revue, le livre : la distraction de tous les jours, l’enseignement de toutes les heures. C’est la chanson qui endort l’enfant, charme la jeune fille, enflamme le soldat, console l’agonisant, accompagne le mort, et fait goûter à ces hordes d’une région torride toute la savoureuse âpreté de l’existence saharienne.
Pendant le voyage que nous fîmes, en 1861 – 1862, dans l’Ouad-Souf, cette contrée si bizarrement étrange, nous nous appliquâmes à recueillir avec soin toutes les chansons qui venaient frapper notre oreille. Ce que Macpherson avait déjà fait pour les pays de brouillards du Gaël, nous voulûmes le faire, malgré l’insuffisance de notre savoir, pour les pays de feu du Sah’ara.
II
658
Dans ces chants populaires des contrées lointaines sont prodiguées les images les plus gracieuses de la solitude, et rien n’égale le luxe de cette harmonie étrange, toujours riche, toujours imprévue, clochette d’or qui sonne au bout de chaque pensée. C’est transparent et pur comme l’eau des fontaines, et ne peut admettre qu’une goutte d’essence : émeraude, diamant ou rubis pour la couleur ; hyacinthe, héliotrope ou fleur d’oranger pour le parfum.
Un nomade énumère ainsi les bonheurs de la vie errante : De l’utilité des voyages Voyage, et tu trouveras des richesses et des merveilles. La perle voyage et monte sur les
couronnes ! Cours loin de ta patrie ; va chercher l’imprévu : voyage. Dans tes excursions, tu peux rencontrer ces cinq bonheurs rares : Chasser le souci, être aimé d’une belle jeune fille, acquérir la science, orner ta mémoire,
presser la main d’un ami ! Un autre nomade sollicite un baiser de la houri vivante de ses rêves : A Djemila Djemila ! mes regards ont semé des roses sur tes joues. La loi du Prophète permet à celui qui sème de récolter. D’ordinaire, ces poèmes se chantent dans les vallons bleuâtres où les oueds éclairent de
reflets d’argent les frêles rameaux du jujubier de Mauritanie, où les euphorbes du Soudant fleurissent au pied des dunes amoncelées, et où les gazelles s’égarent au loin dans un salem asiatique.
III. Le lendemain de notre arrivée à El-Ouad, on nous entretint longuement d’Amar ben
Selman, jeune souafa du plus grand mérite et qui, après avoir visité les trois provinces de l’Algérie et les oasis les plus reculés du Sah’ara, semble s’être fixé à El-Ouad.
Deux jours après, nous nous faisions présenter, comme promeneur, à l’éminent rhapsode du Souf.
Amar ben Selman mettait alors la dernière main à un livre épique qui a pour titre : Hyamina. C’est l’épopée de l’Algérie et du Sah’ara, comme Mireille, de Frédéric Mistral, est l’épopée des vastes plaines de la Crau et de la Camargue. Il n’est pas possible de lire les belles pages de cet admirable poème, sans avoir la tête remplie des éblouissements du Fiafi, du Kifar et du Falat, ces lumineuses régions des forêts de palmiers et des eaux murmurantes, des plaines impénétrables et des troupeaux errants d’antilopes, du néant pétrifié et des sables bouleversés par le choub.
Cette magnifique épopée du désert est dédiée à une jeune fille, merveilleuse enfant qui a donné son nom au poème :
A Hyamina O Hyamina ! ta gorge, c’est du papier blanc. Laisse-moi écrire dessus un conte d’amour. Le quatrième chant du poème s’ouvre par ce gracieux hommage aux jeunes filles du
désert :
659
Aux jeunes filles du désert Dans ses immortels Mekamât, le savant Hariri a écrit les strophes suivantes : 1 Ma bonne chamelle, marche toujours, marche la nuit, marche sans cesse ! 2 Parcours le Téhàma, parcours d’un bond le Nedj ! 3 Fends l’écorce du sol, galope de désert en désert ; qu’un peu d’eau suffise à ta soif. 4 Ne t’agenouille pas avant le but ; car je jure, sur ma foi. 5 Je jure sur le temple saint aux majestueuses colonnes. 6 Que si tu me conduis vers les belles jeunes filles du pays des sables, je te traiterai comme
mon enfant ! O jeunes filles du Sah’ara ! C’était vous, il n’en faut pas douter, que désignait ainsi le
grand poète. Car d’Al-Djézaïr à Tuggurt, de Touat au Soudan, du Cora au pays des gommes, où
trouverait-on vos pareilles ? Votre front a la couleur de ces coquilles de nacre que roulent les eaux vertes de l’oued
Ma’adjen, dans le pays des Djebel-Maïs. Vos cheveux ressemblent à des rameaux de tamaris et vos oreilles à deux roses
nouvellement épanouies. Vos yeux sont comme ceux des gazelles, ils ont les reflets de la baie de Stora, quand
elle est calme. Vos dents sont si fines et si blanches, qu’on croirait que vos propres colliers de perles
sont restés dans vos bouches, un jour que vous vous amusiez à les rouler entre vos lèvres. Vos épaules ressemblent à un lac transparent et vos seins aux vagues palpitantes d’un
golfe qui s’éveille. Votre taille est souple et élancée comme un jeune palmiste. En marchant, vous ployez
au vent comme une herbe humide. Vos pieds sont des morceaux de neige et vos mains de l’ivoire du Cora tourné par les
fées. Et quand, le soir venu, vous vous asseyez un moment au seuil de vos tentes, pour prendre
le frais, Le soleil couchant qui vous colore vous donne la splendide apparence d’autant de
coquelicots noyés dans du lait. Un jour viendra où les poètes de l’Algérie célébreront enfin les miracles de votre beauté
insolite, depuis les cimes ardues du Djebel H’ogga jusqu’aux rives de l’Oued el A’neb, qui coule chez les Attouas, au pays d’Edough.
Ma poésie vous fera des komboloïos dont tous les grains seront d’ambre ; ma poésie vous fera des colliers dont toutes les perles seront d’or.
Vous porterez les komboloïos d’ambre à votre bras droit et les colliers d’or à vos jolis cous.
Le marabout Kaddour Habdousi ben Saïel, de la sainte tribu des Ouled Sidi Elmedjheel, m’expliquait, un jour, sous sa tente hospitalière, les admirables surates du Coran ; on y lisait que les fidèles enfants de l’Islam iraient, après leur mort, dans un paradis étoilé du monde, où on leur donnerait pour compagnes et pour épouses, de blanches houris, toutes ruisselantes de cheveux noirs.
660
O jeunes filles du Sah’ara ! n’êtes-vous pas les resplendissantes houris promises par le Prophète !
On le voit, Amar ben Selman est un lapidaire habile du style. Il taille le diamant avec
une plume d’or. Traduira-t-on quelque jour l’œuvre prodigieuse du jeune poète souafa ? Il faut l’espérer.
Seulement, ce qui ne sera pas facile à entreprendre, ce sera de faire passer dans notre langue ce mélange de naïveté et de grandeur, cette grâce efféminée et voluptueuse, cette langueur d’amour, cette profusion de parfums, ces ruissellements de perles, ces bruits d’ailes d’oiseaux, ces épanouissements de comparaisons fleuries, tout ce luxe primordial, délicat et barbare, qui font de ce poème tout un Alhambra sculpté en vers !
IV. On ne se figure pas en Europe combien la plupart des poèmes orientaux sont admirables
de mélancolie, de profondeur et de grâce. Il y a un poète inconnu de l’Yémen qui a écrit les strophes suivantes. Fleurs de la solitude, il n’en reste que le parfum.
A mes deux filles La fortune m’a fait descendre d’une montagne élevée dans une vallée profonde ; La fortune m’avait élevé par la profusion de ses richesses ; à présent je n’ai d’autre bien
que l’honneur. Le sort me fait pleurer aujourd’hui : combien autrefois il m’a fait sourire ! Si ce n’était mes deux filles à moi, faibles et tendres comme le duvet des petits oiseaux
du désert, Certes j’aimerais être agité de long en large sur la terre ; Mais nos enfants sont comme nos entrailles, nous y tenons. Mes filles ! Si le vent soufflait sur l’une d’elles, mes yeux resteraient fixes. Cet hymne suprême de l’amour paternel, dont la traduction est due à M. Ernest Fouinet,
écrivain de savoir et d’imagination, qui met une vaste érudition d’orientaliste au service de son magnifique talent de poète, est beau autrement sans doute que Job, Homère ou Ossian, mais c’est aussi beau.
E.-J. Sartor, « Hassen le chaouch. Nouvelle algérienne », Le Moniteur de l’Algérie, du 29 novembre 1865 au 2 décembre, feuilleton
La poudre a parlé ; les chiens qui peuplent les douars arabes se sont précipités au-devant du bruit et ont poussé des gémissements tumultueux. Femmes, enfants sont sortis aussitôt de leurs tentes, et les chefs de famille se sont avancés.
Pourquoi cet empressement ? C’est un marabout vénéré dans la contrée qui, suivi de ses partisans, vient prêcher la guerre sainte contre la domination française et demander l’hospitalité. Une horde de paysans montagnards et de cavaliers aux allures sauvages l’accompagne et l’air retentit d’une musique discordante et des clameurs poussées par ces soldats.
Sois le bienvenu, Sidi Kaddour, a dit le plus ancien de la tribu, en baisant la main du prêtre musulman. Que notre hospitalité soit digne de ton mérite. Nous attendions ton arrivée avec impatience.
Merci, vrais croyants, et que Dieu comble vos silos de l’abondance de ses biens. Malédiction aux ennemis du Prophète !
Oui, répondent les assistants, que la race des Roumis soit anéantie, et que le feu du ciel les accable, ces infâmes mécréants !
661
Aussitôt on introduit l’illustre personnage dans la plus vaste de toutes. Les plus riches tapis sont étendus et de magnifiques coussins remplis de blé servent d’appui à ces hommes aux mœurs encore patriarcales. – Rien, en effet, de changé dans la peinture que nous fait le Bible des mœurs de l’Orient et une longue suite de siècle n’a apporté aucune modification à cette existence de pasteurs. – Des parfums brûlent en l’honneur de l’hôte vénéré que le ciel a envoyé et dont la présence comble de joie tous les cœurs. On apporte du lait, du miel, des dattes, des fruits de toute espèce. Le mets national, le couscoussou n’est pas oublié, et tous attendent avec anxiété que le marabout daigne parler. Des mots vagues sur ses projets de guerre sainte ont transpiré, et, à l’apparat qui préside à cette réception, chacun devine qu’il se prépare un événement important pour le pays.
Sidi Kaddour est grand ; sa figure, pleine de dignité et ses manières sobres, mais distinguées, annoncent un homme de noble race. – On sent malgré soi le chef habitué au commandement et devant lequel rien ne doit résister. – Son regard a tantôt le calme de la méditation religieuse ; tantôt aussi, à la vivacité de ses yeux, on peut deviner les mouvements divers qui agitent son âme.
Ennemi implacable des Français, ce marabout voit avec effroi son autorité, forte de l’ignorance du peuple, faiblir tous les jours, et il cherche à reconquérir le prestige qui va lui échapper. Pour arriver à son but, il n’est rien qu’il n’emploie : inspirations célestes, révélations des génies, récits de songes horribles, manifestations de voix intérieures, il simulera tout. Il sera théologien, poète, orateur, guerrier, ne dédaignera pas d’employer les tours d’un jongleur, d’user des artifices les plus ridicules pour impressionner les masses. Au respect que tous les arabes lui témoignent, on devine l’influence que cet homme doit exercer sur ces peuplades primitives. A ses côtés se trouve une cassette en bois de rose ornée avec le luxe excessif du clinquant oriental ; elle repose sur un tapis aux dessins cabalistiques ; et il ne la touche qu’avec un saint respect. Là sont enfermés les talismans enfermés apportés du pèlerinage de la Mecque que tout bon musulman doit accomplir une fois en sa vie. Là sont les sentences tirées du Coran ; suspendues au cou des hommes et des animaux, elles les préserveront du mauvais œil des génies. Là sont enfin les reliques de quelques santons et la fameuse pierre noire aux vertus philosophales. L’origine de cette pierre est assez curieuse et il faudrait entrer dans trop de détails pour en expliquer le bienfaisant usage.
Tout à coup le marabout se lève ; un long frémissement parcourt l’assemblée. « Approchez, dit-il d’une voix lente et majestueuse, approchez, fidèles représentants de la véritable religion du prophète, venez embrasser ces saintes reliques. Dans ces temps de calamités et d’effroi, priez le ciel de jeter un coup d’œil favorable sur ses enfants. Que vos fronts se courbent devant la majesté d’Allah, que votre esprit se détache de ce monde matériel et que votre aumône soit grande et généreuse. Dieu reconnaîtra un jour ceux qui auront aidé sa cause ». Alors les cheikhs s’avancent, les femmes se précipitent sur les reliques, les malades appuyés sur les bras de leurs parents implorent les prières puissantes de l’imam et les soins du toubib (médecin) religieux3.
Poussés par leur admiration, ils oublient qu’ils n’ont devant eux qu’un mortel et lui rendent un culte qui n’appartient qu’à la divinité. Dans leur fanatisme religieux, quelques assistants vont jusqu’à presser de leurs lèvres sa blanche gandoura. Déjà les uns apportent du blé, de l’orge, la redevance aumônière du dixième imposée par le prophète ; les autres, de magnifiques frechias, des moutons, des chevreaux, enfin de superbes toisons. Fait surprenant, l’avare Ben-Digui a disparu un instant. Seul dans sa tente, il a décousu minutieusement les plis de son burnous. Bientôt il revient en courant et donne généreusement une pièce luisante à force de s’assurer qu’il ne l’avait pas perdue. Son ami, ou plutôt son ennemi Ben Tahar (un avare
3 En Algérie, les prêtres musulmans s’occupent de la médecine.
662
peut-il avoir un ami ?) fait présent, dans son délire religieux, d’une magnifique mule, avec son harnachement complet.
L’enthousiasme est à son comble ; il a saisi les plus indifférents. L’entreprise marche avec un succès éclatant. Il ne s’agit plus que d’exciter les passions de la multitude. Les promesses, les paroles ne manqueront pas ; l’éloge ne tarira pas. Les mots magiques de patrie, de religion en péril exciteront les passions toujours nobles et généreuses de la jeunesse. Les mères verront redoubler leur douleur au récit du dernier combat qui leur a enlevé un fils chéri. Le fanatisme toujours haineux ira grandissant, et tous, d’un commun accord, jureront dans leurs vengeances de marcher contre les ennemis et de défendre leurs montagnes jusqu’au dernier soupir. Certains guerriers ont même levé la main et pris le ciel à témoin de ne couper leur barbe, de ne raser leurs têtes qu’ils ne soient vainqueurs.
« Oui, a dit l’imam, le moment est favorable ; les Français s’avancent tous les jours, et bientôt les retraites les plus cachées ne leur seront pas inconnues. Bientôt les Anemchas, cette race de hardis montagnards qui, à l’exemple des Kabyles, n’ont jamais porté le joug de la servitude, verront les terribles toiles rouges (nom donné aux soldats français). Réveillez-vous donc ! que tout homme capable de porter les armes obéisse à ma voix. Vengeons l’outrage fait au drapeau et courons reprendre au centuple les biens que la dernière razzia nous a enlevés si malheureusement.
La ville d’Aïn-Beïda est presque sans garnison, je le sais de bonne source. Abd-el-Kader, le fils du divin Maheddin, harcèle, fatigue l’ennemi du côté du Maroc par des marches et contre-marches. Près de nous, sur la frontière de la régence de Tunis, les troupes des chrétiens sont en échec, et devant un coup de main aussi terrible qu’on peut l’attendre d’hommes audacieux et pleins de courage, à nous la victoire, à nous le butin !
Mais que vois-je ? quel esprit inconnu s’empare de mes sens ? Grâce, grâce, je tombe accablé ! C’est Dieu qui se révèle, qui me parle ! J’entends sa voix terrible ! Je vois sa redoutable majesté ! Sa main puissante est étendue vers l’Occident. Ce Dieu, c’est le Dieu de Mohamed, de tous les grands Califes ses successeurs. Il nous montre le chemin de la victoire, comme il le faisait pour les légions de nos ancêtres. Que le Coudiat-Aly tremble dans sa base énorme ; que l’affreux Bardo à l’atmosphère empestée disparaisse au milieu de ces bouleversements. Mort à ceux qui adorent la croix, qui triplent le Dieu objet de leur culte ! Dieu seul est grand, et Mohamed est son prophète. »
Alors il tombe épuisé. Ses yeux sont hagards, ses traits bouleversés, et son haleine s’échappe avec peine de sa poitrine oppressée.
Tels étaient les discours du marabout Sidi-Kaddour ; tels étaient ses gestes. Il se faisait appeler l’Aigle du Moment, et prêchait la guerre sainte contre la domination française. Déjà on citait son nom comme signe de ralliement et sa voix éloquente et passionnée était écoutée avec transport. L’esprit des populations voisines avait été profondément remué. Le pays fermentait et chaque guerrier faisait ses préparatifs pour aller au combat. Le secret était bien gardé, et la petite ville d’Aïn-Beïda devait être attaquée comme représailles.
La faible garnison de cette ville naissante, appelée dans un temps prochain à une grande destinée, et les colons européens qui étaient venus, sous la protection des armes, chercher une patrie plus clémente, couraient dans ce moment les plus grands dangers. Mais la vigilance du commandant n’était pas endormie. Grâce à ses soins, à sa prudence, des agents secrets veillent au repos commun. L’argent a été répandu au milieu de ces montagnes. Dans l’espoir de parvenir à quelque commandement, passion innée chez l’Arabe, certains se sont laissés séduire. On a fait briller aux yeux du fakir mécontent la fortune, la gloire ; peut-être lui a –t-on promis l’investiture du burnous rouge de cheik (maire), et devant de telles promesses la vertu facile ne peut résister.
Le moment est critique : bientôt l’ennemi marchera sur le bordj. Demain peut-être les Arabes seront sous ces murs, élevés avec précipitation. Résisteront-ils devant un choc aussi
663
impétueux ? La mort n’est-elle pas présente à tous les yeux ? La garnison est faible, la place peu sûre, les secours éloignés. Que faire dans cette circonstance ? Il n’y a qu’un moyen extrême qui puisse faire sortir de cette pénible incertitude. Il faut frapper un coup terrible, plein de hardiesse, et la fortune, qui a toujours aimé les audacieux, viendra nécessairement en aide.
Le commandant fait appeler son chaouch. Serviteur fidèle et dévoué, cet homme énergique n’a jamais reculé devant les coups de main les plus incertains. Il a un culte pour son maître, et son obéissance ne peut être mieux comparée qu’à celle d’un Séid. L’histoire nous parle des fameux assassins qui, sous les Croisades, étaient vendus corps et biens au terrible Vieux de la Montagne, et qui, en présence des ambassadeurs de Saint Louis, se précipitèrent du haut des remparts sur un simple geste de leur chef. Hassen eût été capable d’agir peut-être avec la même soumission sur un ordre formel du commandant. Son obéissance ne saurait être mieux comparée qu’à celle de ces derniers musulmans, et sa reconnaissance envers son maître était un véritable culte. Plusieurs fois, dans des expéditions dangereuses, le commandant n’avait pas hésité de s’exposer aux plus grands périls pour venir au secours d’Hassem, et l’occasion s’était souvent montrée pour ce spahis de prouver à son tour combien sa reconnaissance et sa vigilance étaient précieuses.
« Hassen, dit l’officier, te souviens-tu du coup tenté sur Si-Khelil ? Ce chef ne nous a pas toujours laissé dormir tranquillement. Il tombait à l’improviste sur les troupeaux de nos alliés et ravageait avec sa bande les douars voisins. Que de soucis, que de tracas pendant plusieurs mois !
Si je me souviens de Si-Khelil ? Oui, par Allah, je me rappelle ce terrible coureur des nuits. On n’oublie jamais de semblables adversaires. Pour moi, je me suis toujours figuré qu’il était en relation avec quelque mauvais génie. Il paraissait, disparaissait, tel jour il signalait sa présence d’un côté, telle autre fois, il se jetait à l’improviste à cinquante, cent lieues de là.
Oui, c’était un voyageur prodigieux, il était partout et n’était nulle part ; enfin je puis dire que, grâce à ton concours dévoué, nous parvînmes à le faire tomber entre nos mains. Te souviens-tu aussi de ce combat si acharné que nous avons livré lorsque nous étions campés à Medjez-Amar ?
Je me le rappelle, maître, et je vous dirai même que demain, jour pour jour, il y aura deux ans.
La nuit était sombre, des bandes de Bédouins couraient dans le pays et effrayaient nos jeunes soldats par leurs audacieuses tentatives. J’étais souffrant, accablé de fatigues, et, tandis que je prenais quelque repos, tu veillais sur mes jours. Quel n’eût pas été mon sort si ton œil vigilant n’eût pas aperçu le piège qui était dressé contre mon existence ? Il me semble le voir encore ce buisson simulé qui était poussé par la main d’un assassin. Il s’avançait dans l’obscurité, et après avoir trompé par ce système la vigilance des sentinelles qui veillaient autour du camp, il épiait les moindres mouvements. Déjà il allait s’élancer sur moi, lorsque ta main courageuse l’arrêta ; et alors, quelle lutte !!! C’est un spectacle qui ne sort jamais de la mémoire, et ce serrement de main que je te donne, mon cher Hassem, est un signe du lien qui nous unira toujours. »
En sentant serrer sa main par le commandant, Hassem ne put s’empêcher de protester avec chaleur de son dévouement envers l’officier auquel il était déjà lié par des souvenirs aussi grands.
« Eh bien, tout cela n’est rien ; il faut de plus grands efforts. Toi seul peux éviter une catastrophe des plus terribles. Ecoute bien : il faut que seul, sans aucun secours, tu amènes prisonnier ici, à Aïn-Beïda, le marabout Si Kaddour.
Si Kaddour ! s’écria Hassen saisi d’étonnement. Oui, lui-même, et pas plus tard que demain. Je viens d’apprendre qu’excités par lui, les
Arabes vont se soulever et qu’ils se préparent à descendre des montagnes voisines des Anemchas. Ce marabout exalté est l’âme de la révolte et ne craint pas de violer les traités de
664
paix. Ses partisans se sont déjà répandus dans les tribus qui avoisinent le cercle d’Aïn-Beïda et la défection n’attend qu’un ordre, qu’un signal, pour se produire publiquement. J’ai envoyé des messages à Constantine, mais malgré leur rapidité les secours arriveront trop tard, et un malheur semblable à celui qui nous attend ne pourrait jamais être réparé si nous n’usons pas de quelque expédient.
Mais c’est impossible et je ne sais quel parti prendre. Kaddour est au milieu des siens, entouré de nombreux serviteurs qui empêchent de l’aborder. Et puis, voudrais-je me présenter à lui, qu’aussitôt je serais reconnu, car vous devez savoir, mon commandant, que je ne suis pas en très-bonne réputation chez les musulmans. De quels actes les grands, mes ennemis, ne m’accusent-ils pas et de quelles calomnies n’ont-ils pas cherché à souiller mon existence ? Mais c’est à eux seuls que je ferai toujours la guerre, car je me souviens de la conduite de l’agha Ben Sadok à l’égard de toute ma famille. Il est temps que l’on mette ordre à cet état des choses, et qu’une foule de familles honnêtes soient délivrées de la tyrannie de ces hommes qui ont la prétention, parce qu’ils sont riches et qu’ils portent un grand nom, de nous regarder comme des gens nés pour suivre leurs caprices et fantaisies. Les Français ne sont-ils pas égaux entre eux, et chacun n’est-il pas maître de conduire ses affaires comme il le juge à propos ?
Silence, pas un mot. Va, marche, tout est à ta disposition : or, argent, vêtements. Prends, choisis les chevaux les plus rapides ; emmène, si tu veux, mon cheval Selim ; mais obéis. »
Bientôt après, un homme en costume de chef arabe du désert sortait du caravansérail, et, après avoir pris des chemins détournés pour tromper la vigilance des espions, se dirigeait rapidement vers le pays des Arectas. Vous auriez admiré ce superbe cavalier à l’attitude guerrière, au regard plein d’assurance. Il se dressait sur ses étriers d’argent et laissait flotter au gré du vent les larges plis de son burnous. Par suite de ces rapports physiques et mystérieux qui s’établissent quelquefois entre deux êtres, le cheval semblait participer aux impressions de son maître et être fier d’un semblable fardeau. La selle était couverte de perles et de pierreries. Une longue étoffe de soie de Damas, ornée de dessins comme en portent pour leurs robes les juives d’Alger, couvrait les flancs de l’animal. De petits grelots appendus aux extrémités de la housse faisaient retentir l’air de leur timbre cuivré. L’œil plein de feu, la crinière au vent et en désordre, les oreilles toujours dressées, la jambe sèche, les narines largement ouvertes, le cheval Sélim poussait des hennissements joyeux et bondissait comme une gazelle. Un nègre du Soudan à la stature vigoureuse, aux traits fortement accentués, menait en laisse un troisième cheval, et se tenait derrière à une certaine distance.
Malgré une attention soutenue, il eût été difficile de reconnaître dans ce brillant attirail le chaouch Hassen. Son maître lui-même eût peut-être hésité, tant la métamorphose du spahis était complète.
« Tu entends, Messaoud, je ne suis plus Hassen. Je suis ton seigneur et maître le grand, le noble, le vertueux Abdallah, le fils du Serpent du Désert. Tu m’appelleras ainsi avec toutes ces qualités, puisque c’est l’usage entre ces messieurs. Mais non, ne dis, rien, observe seulement mes regards. Tu sais ce que je t’ai promis, et déjà tu as appris que je ne manque jamais à mes engagements. Du courage, de la confiance. » Et ce disant, Hassen ne se contenait plus de joie et d’orgueil. Il était fier de l’éclat de son armure, de la nouveauté de ses riches vêtements, du rôle important qu’il était tout à coup appelé à jouer dans une entreprise pleine de hasards, et de laquelle dépendait l’existence de toute une population. « Oui, disait-il tout à coup, je les sauverai et rentrerai en triomphe au milieu d’Aïn-Beïda. » Et alors, l’imagination de Hassen bondissait en torrents impétueux. L’avenir qui lui était révélé le transportait de joie. Son esprit se plaisait à se représenter le spectacle où, à la tête de nombreux guerriers, il fournirait carrière. Déjà il entendait retentir les coups de fusil tirés en son honneur ; il voyait les jeunes femmes arabes battre des mains et pousser des youyous frénétiques en frappant leurs lèvres agitées par la volupté. Elles étaient là, belles, joyeuses, le visage épanoui, le proclamant le roi de la fête et
665
lui envoyant des baisers amoureux comme au temps de nos ancêtres, lorsqu’un chevalier avait brisé plusieurs lances dans un tournoi.
Alors le sang bouillant de la race orientale se révélait : c’était une fantasia prodigieuse. Il brandissait son yatagan, frappant à droite et à gauche. Il agitait son long fusil et lançait son coursier avec impétuosité, comme s’il se fût trouvé en présence de l’ennemi. « Ma mère, mes frères, soyez dans la joie. Une existence nouvelle, pleine de bonheur, va commencer pour nous à dater de ce moment. Et toi, mon noble père, toi, vertueux vieillard, qui as été indignement chassé de la tribu par les intrigues du marabout Tahar et du cadi Ben Bouri, ce marchand de justice (que Dieu confonde ces misérables !) tu pourras vivre en paix, car tu seras vengé, oui, vengé !
Point de crainte, point d’hésitation sur les traits d’Hassen. Son plan était bien dressé ; il savait déjà la manière dont il devait agir et les moindres circonstances étaient prévues.
En voyant son maître si exalté, le nègre Messaoud ne pouvait se contenir et il chantait les chants guerriers qu’il avait appris de ses anciens propriétaires, les Touaregs, lorsqu’ils se préparaient à attaquer quelque caravane dans les plaines du Sahara.
En avant ! en avant ! Et les chevaux dévoraient l’espace. Ils arrivèrent vers deux heures du matin à l’endroit qui leur avait été désigné et où se
trouvait le marabout Sidi Kaddour. La nuit était profonde et des feux énormes allumés pour écarter les bêtes fauves et surtout les maraudeurs, indiquent seuls la présence de l’homme. La terre est si riche dans ces contrées que l’élevage du bétail et les échanges de leurs produits suffisent pour faire vivre ces tribus nomades. Parfois le berger excite par un cri saccadé les aboiements des chiens dont à la fin la vigilance s’endort. Dans ces solitudes, un lion ou une panthère affamés pourraient profiter de la nuit pour enlever quelques brebis. Souvent aussi, au milieu de l’obscurité silencieuse, les échos voisins répètent la voix du maître qui, dans sa vigilance, parcourt le cercle formé par ses troupeaux, et examine si les serviteurs font bonne garde.
Il s’adresse aux maraudeurs qui, dépouillés de tout vêtement, poussent l’audace jusqu’à venir détacher un cheval en face de la tente et s’aider de ce dernier pour prendre la fuite. On affirme que les chiens se taisent lorsqu’ils voient un homme nu qui rampe par terre, et que ce spectacle leur fait oublier d’avertir le berger.
« O esclaves de Dieu ! vous entendez, s’écrie le maître : celui qui tourne autour de nous, tourne autour de sa mort. Il n’y gagnera rien et ne reverra pas les siens. S’il a faim, qu’il vienne, nous lui donnerons à boire ; s’il est nu, qu’il vienne à nous, nous le vêtirons, et s’il est fatigué, qu’il vienne se reposer. »
L’arrivée d’Hassen occasionna un certain tumulte, et chacun se leva précipitamment pour s’informer de ce redoublement de bruit inaccoutumé.
« Braves gens, dit Hassen, est-ce que le vénérable Sidi Kaddour est ici ? Oui, répondirent-ils. Conduisez-moi vers lui, j’ai besoin de lui parler de suite. Lui seul, dans ce moment
d’effroi, peut donner un peu de repos à mon cœur de père. Courez, dites-lui que Sidi Abdallah, de l’oasis de Tugurt est campé avec ses goums et ses troupeaux sur le bord du lac Salé, et qu’il le cherche depuis le lever du soleil.
Quoi ! c’est le fameux, le terrible seigneur Abdallah, surnommé le Serpent du Désert, l’effroi des Touaregs, pillards de la caravane, qui est venu planter ses tentes dans les plaines voisines ! La bienvenue est pour lui et sa famille !
Vite, pressez-vous, amis ; je suis trop affligé. Conduisez-moi près de Sidi Kaddour. Les moindres instants sont précieux en cette circonstance. »
A la nouvelle que le fameux chef du désert, dont la réputation de bravoure et de chevalerie s’était répandue au loin parmi toutes les tribus, le demandait, Kaddour s’était levé
666
précipitamment. Il allait courir au-devant de lui, quand le faux Abdallah se précipite dans ses bras. Il embrasse ses vêtements, lui serre affectueusement la main.
Ils se donnent l’accolade musulmane et récitent le verset de salut du Coran. Son émotion est grande, il verse même des pleurs. « Hélas ! dit-il, vous voyez en moi le plus malheureux des hommes, le père le plus
infortuné ! Mon fils, mon fils unique se meurt d’un mal inconnu. En vain ai-je consulté l’expérience des vieillards et de nos tebibs. Une fièvre brûlante le dévore, et peut-être… Mais non… Venez à son secours ; un effort de votre part peut le sauver. La renommée de vos vertus, de vos cures merveilleuses a troublé agréablement nos solitudes. Dès que j’ai appris que vous étiez dans les environs, j’ai remercié Allah de ce bonheur inespéré. De grâce, venez, tout est à votre service. Je donne, en présence de ces braves guerriers qui m’entendent et que je prends à témoin de mes promesses, dix chamelles, trente sacs de blé et deux nègres.
Je donne un cheval de race dont la filiation est connue depuis trois cents ans et dont la renommée s’étend déjà dans les oasis de Biskra. Je donne aussi un jeune vierge, blanche comme l’ivoire, que j’ai achetée du juif maure Ben Yacoub ; mais sauvez mon fils ! Un cheval vous attend, il est là. Il a été amené exprès pour vous. Jamais il n’a bronché. En route donc, brave seigneur, et votre retour dans ces montagnes sera un véritable triomphe. Tous mes serviteurs prendront les armes pour faire honneur au savant interprète de la science et de la religion, et que Dieu a regardé jusqu’ici d’un œil si favorable. Les femmes des Anemchas pousseront des cris joyeux, enfin la poudre parlera comme la tempête, car votre retour sera des plus glorieux. »
Ce langage saisissant, ces promesses généreuses entraînent l’esprit du marabout. La confiance sans bornes qu’on lui témoigne, ces éloges, la gloire qui lui est réservée ont échauffé agréablement son cœur.
« Partons, dit-il, et que Dieu nous guide ! » A l’aurore, Kaddour, le marabout, le faux Abdallah et son serviteur noir étaient assis sur
les bords d’une fontaine, et, pendant que les chevaux réparaient en liberté leurs forces, ils partageaient un gâteau de dattes et quelques autres provisions. Le temps était magnifique. C’était une de ces belles journées où l’air, rafraîchi par de douces brises, semble convier la nature à célébrer le retour du printemps. L’alouette faisait entendre son chant matinal, et des bandes de kourouglis au plumage blanc jouaient dans les airs. Sur les bords du lac voisin, des oiseaux aquatiques des espèces les plus variées, des flamants prenaient tout à coup leur essor, et leurs ailes de couleur incarnat simulaient, lorsqu’ils étaient réunis, un effet de soleil couchant. Dans le lointain, on distinguait des groupes d’hommes en marche. A certaines époques de l’année, ces plaines sont sillonnées par de nombreuses caravanes qui fuient les chaleurs du désert pour se répandre sur ces vastes espaces qui s’étendent entre Batna, Sétif, Aïn-Béïda, Tebessa, et le long des frontières de la Tunisie. Rien de plus curieux que la marche de ces tribus emportant tout et chassant devant elles leurs troupeaux. On évalue à deux cent mille le nombre de ces indigènes qui chaque année se déplacent.
Du haut des collines du massif de Bouarif, on aperçoit le Medrassein, ce fameux tombeau de Syphax. S’il faut en croire la commune renommée, ce monument servit, comme les pyramides de Giseh, de lieu de sépulture aux rois de Numidie. Placé au centre de trois plaines immenses, ce mausolée ressemble de loin, par ses proportions grandioses, à un mamelon naturel, et appelle involontairement l’esprit vers ces temps où ces régions fécondes étaient habitées par un peuple laborieux et industrieux. Maintenant, tout est ruine, tout est solitude. A chaque instant, le voyageur n’aperçoit que les traces désolantes de l’invasion des Vandales et des Arabes. Quelques vestiges que le temps impitoyable ou la main dévastatrice de ces conquérants n’ont pu atteindre, racontent seuls l’histoire d’une ville éteinte et font présumer son ancienne splendeur.
Parfois, du sein des nuits, une ombre errante traverse ces lieux solitaires et vient se reposer sur les débris d’un temple. C’est le génie de ces lieux.
667
L’âme attristée, il songe à ces temps fortunés où il veillait sur ces campagnes florissantes, répandant avec profusion la richesse et l’abondance. Il semble appeler pour les combler de joie ces hommes valides et laborieux qui vont en foule chercher loin de la partie un bonheur qu’il leur offre si généreusement.
« Viens, traverse cette mer qui te sépare de ton village de quelques heures, arrive, le cœur confiant et doublé de quelque fermeté, dit-il au laboureur qui matin et soir demande à une terre fatiguée le prix de pénibles sueurs que souvent elle lui refuse. Ce sol vierge depuis tant de siècles te récompensera largement de tes peines et de tes travaux. Tes enfants seront toujours heureux, leur visage sera rayonnant, car la nature, la riche nature de l’Algérie te dévoilera ses immenses trésors. Tes jardins fleuriront à chaque retour de saison, les moissons se succéderont tour à tour, les prairies seront émaillées de fleurs, et l’eau, sagement aménagée, tempérera, pour les rendre bienfaisantes, les ardeurs d’un ciel toujours pur. Et un soir, assis sur le seuil de la porte, à la vue de ces champs, qui naguère étaient abandonnés, et qui bientôt seront sillonnés par de superbes troupeaux, tu éprouveras un des bonheurs les plus grands et à la fois les plus doux. Voilà, diras-tu avec orgueil, le fruit de mon travail et de ma constance ».
Tout à coup, sur un signe d’Hassen, le nègre se précipite sur Si Kaddour. Pris à l’improviste, il cherche à se défendre et une lutte terrible s’engage. Des coups affreux sont portés de part et d’autre. Le sang coule, Hassen même roule à terre avec lui. Un moment, le marabout parvient à se débarrasser de ses ennemis, mais sous la main de fer de Messaoud ses efforts sont inutiles.
« Lâches, vils scélérats, est-ce ainsi que vous vous jouez de la confiance des hommes ? Vous n’avez pas craint de vous servir des moyens les plus indignes pour m’attirer dans vos pièges. Mais malheur à vous, et que Dieu vous maudisse ! »
Sa voix est bientôt étouffée, ses mains ne peuvent plus agir, et ils l’attachent sur le cheval. Au milieu de précautions nombreuses pour s’assurer de la personne du prisonnier, Hassen cherche cependant à soulager autant que possible les souffrances du marabout. Si Kaddour fait un dernier effort pour rompre les liens, mais sur la menace d’un pistolet, il se voit forcé de céder.
Alors commence la fuite et la plus aventureuse et la plus émouvante. Le groupe traverse les fourrés, cherche les endroits les plus retirés. Tantôt Hassen, laissant son prisonnier à la garde de Messaoud, monte sur le sommet des collines pour observer ce qui se passe dans la plaine. On marche avec précaution ; dès qu’on aperçoit quelques cavaliers, on se cache dans les ravins. Ils montent, ils descendent, contournant les villages à de grandes distances pour ne point attirer l’attention des habitants par un aussi étrange spectacle que celui du malheureux prisonnier. La curiosité, le sentiment d’une juste pitié peuvent être dangereux, et l’incident le plus léger changer le succès de cette entreprise.
Ils marchent, ils courent, s’arrêtent pour prêter l’oreille au moindre bruit. Inutiles détours, inutiles précautions. Soudain un cavalier débouche au détour d’un sentier. Surpris, à la vue de ce cortège extraordinaire, il s’arrête, se jette bientôt à l’écart, et se demande ce que peut cacher un pareil dessein. Mais son œil exercé a reconnu le marabout Si Kaddour ; c’est bien lui, les mains garrottées et au pouvoir de l’ennemi. Le prisonnier se tourne timidement vers lui, et, d’un regard attristé, le supplie de venir à son secours. Un coup part, mais la balle n’a pu atteindre cet inconnu. A bride abattue, il vole aussitôt porter la nouvelle à son douar. Nul doute, il va avertir ses amis, il va publier le sacrilège, la profanation commise envers leur chef religieux, et peut-être l’issue sera-t-elle des plus fatales. Alors, plus de détours, plus de précautions, la bande fuit avec rapidité, et chaque pas la rapproche d’Aïn Beïda, cet asile que leurs regards cherchent avec anxiété, car ils entendent déjà les cris d’alarme que se répètent les villages voisins. Un mouvement extraordinaire règne dans la plaine, et les cris de ralliement viennent parfois frapper les oreilles d’Hassen.
668
Déjà dans le lointain surgissent les tourelles blanches de la maison de commandement. Déjà ils distinguent confusément les quelques maisons groupées autour des murs du bordj. Le pays est parfois accidenté ; tantôt la ville apparaît, tantôt elle disparaît complètement. Espoir, espoir ! Que dis-je ? L’ennemi se montre tout à coup sur un monticule.
« Nous sommes perdus, s’écrie le nègre ! Vois, maître, ils sont là ; vois comme ils avancent, et nos chevaux sont fatigués. J’ai senti déjà le mien fléchir sur ses jarrets. »
En voyant l’anxiété peinte sur le visage du serviteur, le marabout renaît à l’espérance. C’est le salut, c’est la liberté, c’est la vengeance qui descend du ciel. Au milieu des mouvements qui l’agitent, il attend avec une douce confiance ce secours inespéré. Mais Hassen ne le quitte pas des yeux, et, lui montrant un certain signe assez terrible, l’oblige, devant cette menace, à détourner involontairement la tête… « Le moindre oubli de ta part, et je me vois, par Allah ! obligé malheureusement de te faire disparaître.
- Mais voyez encore, maître, comme ils avancent. Encore vingt minutes de course et ils nous auront rejoints.
- Aurais-tu peur, par exemple ? Croirais-tu au prophète Elie ? au spectre du terrible Barberousse ? Pendant deux nuits j’ai couché seul dans le fort qui porte son nom, du côté de la Pointe-Pescade, et je n’ai point surpris le moindre bruit. Malheur à toi, si tu hésites ! S’il le faut, nous nous défendrons comme doit se défendre tout Français qui a du cœur. Nous avons des armes, et l’homme armé qui ne vend pas chèrement sa vie en présence du devoir est méprisable et indigne de respect. Prends la gourde, fais boire le prisonnier, humecte les narines des chevaux. Laissons un peu reprendre haleine à ces excellentes bêtes. »
Et parlant ainsi, Hassen avait mis pied à terre, et, avec un sang-froid extraordinaire, passait en revue ses armes et faisait ses préparatifs de défense. Il regardait la disposition des lieux, calculait le chemin qui pouvait lui offrir le plus d’avantages et examinait chaque chose dans tous ses détails. Mais pendant ce temps d’arrêt l’ennemi approche, on entend déjà le bruit fait par les chevaux, encore un mamelon à gravir, et les Arabes sont sur le point de les atteindre.
« A cheval ! » s’écrie Hassen tout à coup. Ranimés par ce repos de quelques instants, les chevaux ont repris une nouvelle
ardeur et laissent loin derrière eux ceux qui les poursuivent. Mais la fureur des Arabes grandit au fur et à mesure qu’ils marchent et que leur proie semble sur le point de leur échapper. Ils poussent des cris féroces et pleins de vengeance.
Hassen doute un moment de pouvoir échapper. Il interroge l’horizon pour voir si on ne vient pas à son secours. Il le sent, les chevaux ont fait leurs derniers efforts et ne peuvent plus fournir une longue course. Mais heureusement, les éclaireurs postés dans les environs du fort ont donné le signal. Le cri d’alarme a été porté jusqu’au camp, on sonne le boute-selle, et les escadrons des hardis chasseurs d’Afrique et des spahis se portent avec rapidité au secours du chaouch, et bientôt le reçoivent au milieu de leurs rangs. Quel que soit le nombre des ennemis, ils forcent, par leur attitude, les Arabes à se tenir à distance et à abandonner une proie qu’ils croyaient sur le point de saisir.
Ainsi fut sauvée, par la hardiesse extraordinaire d’un seul homme, toute une population. Privés de leur chef, les Arabes, pris à l’improviste, n’osèrent se révolter ouvertement, et bientôt, par de sages mesures, on vit arriver à Aïn-Beïda les principaux notables des tribus qui venaient implorer l’aman et livrer des otages.
Ami lecteur, si vous avez assisté aux courses brillantes et d’un caractère si original qui se donnent à Alger chaque année au commencement de l’automne, sans doute vous avez remarqué un Arabe à l’attitude guerrière et à la figure très-accentuée, qui marche à la tête de son escadron. Il monte un cheval blanc, et ses cavaliers se distinguent par leur discipline et par l’ensemble avec lequel ils dirigent leur fantasia. Ce
669
chef est l’ancien chaouch Hassen. Bien des années se sont écoulées depuis le jour où Aïn-Beïda lui dut son salut, mais l’âge ne l’a point accablé, et tout dans lui semble respirer la même décision.
Si jamais, poussé par l’amour des voyages et par le désir de vous instruire, vous abandonnez les routes battures de nos villes et que vous vous aventuriez, au gré de vos caprices, dans les plaines de la province d’Alger, soyez sûr de recevoir de ce chef l’hospitalité la plus franche et la plus cordiale. Hassen aime sa patrie adoptive et n’oubliera jamais l’engagement qu’il a pris le jour où il a reçu le burnous d’investiture officiel.
Sartor
E.F., « Boghari ou une ville arabe », 12 août 1865, troisième page Boghari se compose de deux parties distinctes : du Ksar el Boghari, petite ville arabe, et
des établissements français, gendarmerie, auberges, magasins, caravansérails, réunion de constructions situées auprès de la route, et qui ont pris le nom de la cité au pied de laquelle elles sont bâties. Mais c’est de la seule ville arabe dont je vais m’occuper.
Boghari, situé à 40 lieues environ d’Alger, sur la route de Laghouat, non loin du Chélif qui, pour ainsi dire, coule à ses pieds, se trouve pittoresquement assis sur une montagne inclinée vers le couchant. C’est une petite ville industrielle et commerçante, pleine de vie, d’activité et de mouvement ; les maisons basses, aux ouvertures étroites, et proprement blanchies à la chaux, ont toutes leurs magasins :
A côté de la petite boutique du cordonnier, au-dedans de laquelle on voit apprendre toutes sortes de chaussures et d’objets en maroquinerie, se place le magasin plus large, plus spacieux, plus élégant du marchand de châles, de foulards, de burnous, de ceintures et de ces petits riens de fantaisie. – Ici c’est un juif, à la fois épicier, quincailler et mercier, qui, derrière son comptoir, détaille sa marchandise. Là, assis au milieu de ses légumes, de ses dattes, de ses figues, de ses citrons, le moabite fruitier attend patiemment les acheteurs. – Dans le fond de cette petite boutique obscure et émergeant du sol, l’armurier indigène, auprès de son enclume, confectionne ses poignards, ses yatagans et ses fusils aux longs canons richement ciselés avec art ; à deux pas de distance se trouvent entremêlés un fondouk encombré d’ânes, de mulets, de chevaux, un bazar, un café maure, où les nombreux chalands assis sur des nattes et pressés les uns sur les autres savourent à petits traits leur tasse de café que le khaouadji a peiné à se servir.
Dans les rues raides, non pavées, étroites et mal propres, et qui rappellent un peu les hauts quartiers de la Casbah d’Alger, il y a tout un peuple qui va, qui vient, qui se heurte et se coudoie à chaque instant ; des Arabes coiffés de hauts chapeaux de paille aux larges bords ; des nègres poussant devant eux les agiles et intelligents bourricots, qui chargés de pierres trottinent en montant et en descendant au milieu de cette cohue ; des robustes négresses accroupies devant des pyramides de pains ronds qu’elles offrent complaisamment aux passants ; des femmes indigènes aux bras et aux jambes chargés plutôt qu’ornés de pesants bracelets, et qui se drapent nonchalamment dans leur haïch : enfin des cavaliers alertes dominent cette masse vivante au sein de laquelle ils ont de la peine à se frayer un passage. Tels sont les acteurs qui animent cette petite ville qui, malgré les maisons européennes de quelques débitants français, espagnols, maltais, a conservé tout son cachet original.
Il se tient tous les lundis, dans le Ksar et auprès de l’hôtel de la gendarmerie, un marché fort important et très fréquenté, dont la laine et les bestiaux forment les principaux objets de transaction.
On sait que l’exportation de ces bestiaux et de ces laines devient de jour en jour des plus considérables sur tout le littoral méditerranéen ; mais ce qu’on ignore peut-être, c’est que les laines renommées de Ségovie tirent leur valeur de nos laines africaines.
670
A l’époque de la domination romaine sur tous les peuples et sous l’empire de Claude, Collumelle, riche fermier établi à Cadix et oncle du célèbre écrivain agronome du même nom, frappé de la blancheur et de l’éclat de la laine des moutons venus de nos parages, conçut d’acclimater chez lui ces animaux et d’en établir la race en Espagne. En conséquence il croisa des béliers africains avec des brebis espagnoles, et il obtint des produits de la toison maternelle, la blancheur et les qualités de la laine du père.
Cette réussite ne devait porter ses fruits d’abord que sous Dom Pedro IV, et plus tard sous le cardinal Ximénès en effet, le premier profita de sa bonne intelligence avec un prince maure, et le second des succès obtenus sur les côtes de Barbarie par les troupes de Ferdinand, pour en exporter à diverses époques des brebis et des béliers de la plus belle espèce, qui furent principalement parquées à Ségovie, où ils sont restés acclimatés merveilleusement.
Walt’her, « Le Marabout. Esquisse algérienne », Le Chitann, 26 avril 1866, feuilleton Croyants, voyez ma barbe blanche ; Je suis vieux, et mon front se penche Comme un antique minaret. J’ai vu naître et mourir vos pères… Qu’Allah me rejoigne à mes frères, Tranquille, j’attends mon arrêt. Car sa justice est éternelle, Et j’ai vécu comme un fidèle, Sans jamais enfreindre ses lois. Or, Allah, connaissant ma crainte, A rendu ma parole sainte… Il vous parle, ici, par ma voix. Levez-vous tous, croyants, c’est l’heure ! … Que pas un de vous ne demeure ! … A vos chevaux mettez le mors… C’est l’heure où doit parler la poudre, L’heure où, plus prompte que la foudre, La balle doit coucher les morts. II Les fusils dorment dans vos tentes… Faites-en jouer les détentes, Aiguisez vos flissas rouillés… Car c’est l’heure de la vengeance : Ces chrétiens enflés d’arrogance Nous ont assez humiliés ! Que pour le signal des batailles Un immense feu de broussailles Sur le Nador soit allumé ! … Qui tombera dans la mêlée Entendra son âme appelée Au paradis de Mahomet. Relevez la verte oriflamme,
671
Et que de vos candjars la lame Pour gaine, ait le cœur du Roumi ! Dans sa maison livrée aux flammes, Tuez tout… les enfants… les femmes ; Et ne faites rien à demi ! Lancez vos chevaux dans la plaine, Que vos burnous de blanche laine Se gonflent au vent du combat ! … Celui qui coupera vingt têtes Sera chanté par les poètes, Et le bienvenu près d’Allah. Sur les Francs ruez-vous en foule, Ainsi qu’au désert gronde et roule Le sable au simoun attelé… Prouvez que de fortes mamelles Etaient l’apanage de celles Qui vous ont nourris de leur lait. III. A ces chiens, point de sépultures ! Les vautours aux serres impures Sauront leur donner des tombeaux. Dans leurs entrailles palpitantes Promenant leurs lèvres sanglantes, Que les chacals rongent leurs os ! Quand vous quitterez la curée, Oignez vos corps d’huile épurée, Vos haïks de douces odeurs ; Car vos sœurs, vos femmes, vos filles, Aux stridents accords de leurs trilles Viendront acclamer les vainqueurs. Levez-vous tous, Croyants, c’est l’heure ! … Que pas un de vous ne demeure ! … A vos chevaux mettez le mors… C’est l’heure où doit parler la poudre, L’heure où, plus prompte que la foudre, La balle doit coucher les morts.
Walt’her, « Le chant du Reïs », Le Chitann, 19 août 1866, feuilleton Sur la mer aux reflets de moire, Un vieux Reïs, au corps déjeté, Guidait, un soir, sa barque noire Sous la lune au disque argenté. Il avait une barbe grise,
672
Les traits rudes et basanés, Et des manches de sa chemise Sortaient de longs doits décharnés. Son front, tout chargé de vieillesse, Son front ployait sous le turban, Et sur la rame, avec mollesse, Sa main s’appuyait tristement. Son œil jetait des regards sombres, On eût dit le vieux batelier Qui passe au Ténare les ombres Dont Pluton devient l’hôtelier. Bientôt, pour une mandoline, Sa main délaissa l’aviron ; Il chante, d’une voix chagrine, Un air, dont voici la chanson. Connaissez-vous Alger la blanche ? C’est dans le Tell La grande ville qui se penche Sur le Sahel. Elle s’appuie à la colline Nonchalamment, Ainsi qu’une nymphe, une ondine, Sur son amant. Elle possède pour ceinture Des murs épais ; Elle possède pour parure Trois cents palais. A ses pieds, comme un chien fidèle Couche la mer ; C’est la patrie où l’hirondelle Passe l’hiver. Là, sous des cieux tièdes et calmes, Et toujours bleus, Le palmier balance les palmes, Ses longs cheveux. Dans son port veillent les tartanes Aux larges flancs, Et les galères capitanes Aux bras puissants. Moi, je suis reïs d’une galère !
673
Trois-cents forbans Que je commande font la guerre Aux vaisseaux francs J’ai sur la tombe du Prophète Posé mon front !... El-hadj Omar, on le répète, Tel est mon nom. Je suis riche, puissant et brave, Et le Pacha Tremble à mon nom, comme un esclave, Dans sa Kasba. J’ai dans mon harem, des captives De tous pays : Des Espagnoles et des Juives Aux seins brunis ; Des Moscovites, des Anglaises Aux blonds cheveux ; Des Italiennes, des Françaises Aux reins nerveux. L’Arabe reçoit à ma porte Force boudjous, Et le Franc, que le diable emporte ! Reçoit des coups. Hélas ! tout cela n’est qu’un rêve, Un souvenir ! … Le flot qui vient mordre la grève D’Aldjezaïr, Est déchiré par les carènes De ces chrétiens Qui ployaient le cou sous nos chaînes, Chiens, fils de chiens ! Par leurs sortilèges infâmes, Tuant nos fils, Ils sont venus jusqu’à nos femmes… Qu’ils soient maudits ! Les tricolores oriflammes De ces impurs Ont guidé la mort et les flammes Dans nos vieux murs. Ils ont séduit Alger sultane,
674
Belle, aux seins blancs : Ils en ont fait la courtisane Aux seins tremblants. Sous leurs coups, mes braves corsaires Autour de moi Sont tombés. Ils ont pour suaires Le ventre froid. De la panthère ou de l’hyène, J’ai survécu, Et malgré mon fiel et ma haine, Pauvre vaincu, Qui n’ai plus ni palais ni femme, Comme un mesquin, Je loue et mon bras et ma rame Pour un sequin. Le roumi m’insulte et m’offense… Un jour viendra Où le soleil de la vengeance Se lèvera. Je souffre et je prie en silence En l’attendant… Et me confie à l’espérance… Allah est grand ! Le Reïs se tut… De sa mandore, Lorsqu’il la posa dans l’esquif, Sortit, comme un râle sonore, Un gémissement convulsif. Alors, dans la sombre prunelle D’El hadji, comme une étincelle Une larme brilla ; Larme d’orgueil et d’amertume Qu’il essuyait, lorsque la brume Couvrit sa barque et la voila.
« Monologue du dernier des Arabes », L’Est algérien, 4 décembre 1868, première page … Voilà les ossements épars des derniers musulmans ! « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. » Et ne pas pouvoir mourir comme eux... La mort, c'est la fortune des vaincus. Ô race disparue, tribu éteinte, braves fils de l'Islam que la misère a fauchés, que Dieu
vous prenne en miséricorde ! C'était le temps où la horde orgueilleuse des cheiks et caïds s'abaissait à nous baiser les
mains pour obtenir nos plus belles vierges...
675
Et nous les leur donnions. C'est qu'alors il y avait encore du bonheur sous la tente du croyant : ses silos
regorgeaient de grains, la toison argentine de ses troupeaux blanchissait la verdure des plaines. - La fidélité de ses femmes était proverbiale : le soir, à la veillée, on n'entendait
que le cliquetis de leurs bijoux d'argent et les refrains de leurs chansons d'amour. Et lorsque Dieu dirigeait sur notre tribu le voyageur attardé, nous lui donnions
une hospitalité de sultan. Partout on vantait notre générosité, - car dans les jours de diffa le couteau
sacrificateur se teignait du sang de nos plus belles victimes. Quand, les jours du marché, on voyait fuir avec le vent un goum de cavaliers,
dont les chevaux suant de l'écume avaient les flancs ensanglantés par le long éperon, on disait : Voilà les Ouled-Sliman, - leurs pieds ne touchent pas la terre !
Et ils passaient, - droits sur leurs étriers, supprimant l'espace, ne laissant après eux que des nuages de poussière...
Louange à l'Eternel pour les grâces qu'il répandait sur ses serviteurs ! … Dans ce temps-là, les chrétiens commandaient. - Ils n'avaient apporté de leur
pays lointain que leur ruse et la dépravation de leur race. Nous les combattîmes à outrance, toujours avec succès, si bien que dans les jours de poudre on vit plus d'un de nos braves accrocher à l'arçon de sa selle un chapelet de têtes chevelues.
Dieu soit loué ! Les anges de l'Islam étaient les porte-étendards du Croissant ! - Nous étions invaincus, invincibles !
… Ce fut dans ces jours de splendeur que l’œil de Satan le lapidé remplaça l’œil de Dieu.
Les jours noirs se succédèrent sans fin. On corrompit nos chefs : - on les rassasia de femmes impudiques et de liqueurs enivrantes. - Le burnous immaculé du musulman se tacha de la croix des infidèles. - la polygamie islamique devint un crime. - On oublia Dieu !
Nos chefs s'en allèrent par-delà les mers, dans des villes sultanes, admirer le produit des intelligences rebelles au Prophète : ils revinrent de ces voyages, ayant tout vu et rien compris, - sinon que les croix qu'on leur avaient données étaient l'apogée de l'honneur et que le peuple musulman n'était pas digne de vivre.
… La sécurité déserta la tente du croyant. - Des cavaliers infâmes enlevèrent nos plus belles filles pour satisfaire la
lubricité d'un caïd impuissant. - Nos femmes se prostituèrent aux soldats rouges des chrétiens. - Les amendes injustement infligées grossirent les trésors de nos chefs.
Et nous, fils de la liberté, - volés, ruinés, mis à nu, on nous plongea dans des prisons de pierre. - Nous demandâmes justice : on nous conduisit à des gens de loi qui, ne comprenant ni nos mœurs, ni notre religion, ni notre langue, nous replongeaient dans leurs prisons sans soleil pour y subir des condamnations iniques.
Un avilissement sans nom dégrada nos âmes. - Pas un parmi les nôtres n'osa lever un bras contre tant d'oppression.
… Et en quoi cela nous eût-il servi ? - - Tous ceux qui auraient pu nous conduire s'étaient vendus à nos oppresseurs. Dieu se lassa de toutes ces infâmies et de toutes ces lâchetés : Azraïl,
l'exterminateur, vomit sur nous son souffle destructeur. - La terre devint inféconde ! Alors on vit surgir un de ces fléaux qui ébranlent la raison humaine et font douter
de Dieu. - La famine !! … Les tribus effarées se dispersèrent ; la famille se dissolut. - On vit un peuple
tout entier disputer l'herbe des champs à des bêtes immondes. La folie s'empara des bandes affamées, et, dans des jours que l'Eternel effacera de son livre, on vit les morts de faim se repaître du sang de leurs propres enfants !
676
… Que la malédiction de Dieu soit sur tous ceux qui ont dévié du sentier de la justice ! ( - )
Dr. E. Bertherand, « À propos d’un conte arabe », Le Moniteur algérien, 3 juillet 1869, troisième page
Charles-Quint disait que par sa noblesse la langue espagnole devait être préférée pour parler à Dieu ; - par sa clarté, le français pour s’entretenir avec un ami ; - par sa douceur, l’italien pour converser avec une maîtresse ; par sa rudesse, l’allemand pour parler aux chevaux ; - par sa prononciation sifflante, l’anglais pour inviter les oiseaux à chanter. Cette opinion de l’empereur d’Allemagne peut avoir sa justesse, mais on doit regretter qu’il n’ait pas en même temps exprimé son avis sur la langue arabe. Peut-être avait-il une excellente raison pour s’en abstenir ; peut-être aussi l’échec qu’il essuya devant la capitale algérienne, en 1541, lui fit-elle garder contre les habitants des Etats-Barbaresques une rancune qui ne lui permettait guère de trouver le moindre attrait dans leur langage.
Pour obvier au silence de ce prince à cet égard, nous pouvons puiser les éléments d’un jugement – tout intéressé qu’il paraisse – dans un proverbe des indigènes eux-mêmes :
« Le serpent séduisit Eve en parlant arabe ; Adam et Eve parlaient leurs amours en persan ; l’Ange qui les chassa du Jardin s’exprima en turc ».
Laissons aux linguistes, aux savants, aux hommes compétents, le soin de démontrer toutes les beautés du langage musulman ; bornons-nous à parler du profond et ineffaçable souvenir que l’on garde toujours d’une de ses formes caractéristiques ; un exemple sera joint à l’appui.
La langue arabe est très-énergique dans la détermination de la chose ou de l’être ; elle doit à cette particularité un cachet de grandeur dans l’expression, et de profondeur dans la pensée qu’elle rend. Chaque terme représente si bien l’idée qu’il la sculpte en quelque sorte. Rien que ce caractère suffirait à démontrer que la langue musulmane est primitive, car elle exprime on ne peut plus fortement le besoin, le désir, le jugement sur une chose, sur sa qualité la plus saillante ; c’est de la pensée en relief.
Si les termes sont d’une heureuse et riche appropriation, il en est de même de la phrase qui, concise et nette comme les mots dont elle se compose, se présente le plus ordinairement sous la forme sentencieuse.
Le conte, la légende, n’est-ce pas un creuset commode et immuable dans lequel se fondent en caractères indélébiles la pensée, le sentiment, les idées d’une nation ? On les retrouve, en effet, constamment marqués au coin de son génie spécial. Il n’en saurait être autrement chez les peuples où il n’y a pas de livres, point d’imprimerie ; la tradition est alors l’unique héritage et le seul mode de communication d’une génération à l’autre. Le proverbe est donc l’histoire, la morale, la science, etc., réduites à leur plus simple expression, à leur quintessence, semblables ainsi à ces monuments, à ces chroniques de pierre qui parlent au fait et en transmettent fidèlement les détails symbolisés sur leurs faces éloquentes, selon que le temps veut bien en respecter l’intégrité.
L’immutabilité propre au caractère national arabe et qui nous le fait retrouver aujourd’hui dans ses mœurs et ses institutions, sous beaucoup de points de vue, à peu près comme il était après l’hégyre, - cette immutabilité, disons-nous, se reflète jusque dans les formules naïves et moulées de langage qui rappellent si bien les premiers pas de la civilisation antique. On croirait encore entendre les vieux patriarches enseignant la vertu par des sentences concises, et leur voix autoritaire se perpétuer ainsi d’âge en âge, comme des échos fidèles, qui, répétés par des générations, constituèrent bientôt le vox populi. Les lois, la science, les maximes de la religion ont dû, dès l’époque la plus reculée des temps, la transmission assurée de leurs axiomes, de leurs décrets, à cette formule aphoristique de la vérité. Les prophètes et les orateurs n’ont jamais eu recours à un plus puissant moyen de parler aux yeux et à l’intelligence des
677
masses, et de graver dans toutes les mémoires, comme dans toutes les conférences, les éléments du sens commun. Le temps peut altérer les ouvrages des hommes, modifier leurs institutions, mais la vérité seule impérissable, a toujours eu son moule indestructible de conservation, que chaque nation a coloré et nuancé suivant ses instincts, son imagination.
Diderot l’a dit avec une grande justesse d’expression : « les sentences sont comme des clous aigus qui enfoncent la vérité dans notre souvenir. »
Telles sont les réflexions qu’on ne peut manquer de faire, pour ainsi dire malgré soi, quand on se trouve en contact avec un peuple qui, comme le peuple arabe, ne développe pas une idée sans l’éclaircir immédiatement, à titre de base irréfutable, de toute l’énergique clarté d’un dicton proverbial. La légende est donc un excellent exercice gymnastique pour la mémoire autant que pour l’intelligence et l’imagination. Telles sont l’origine et la raison de cette belle et juste réputation de conteurs que se sont de tout temps acquis les Orientaux.
Il me souvient toujours d’une charmante histoire que racontait un de nos cavaliers arabes, par une de ces belles nuits d’été, splendidement étoilées, comme on en jouit si souvent en Algérie, surtout dans le Sahara. La voici dans toute son exactitude :
« Il y avait un sultan du pays de l’Irak-Persique, nommé Hadjedj Ben Youcef et renommé pour son vaste savoir. L’unique plaisir de ce prince était, dans ses voyages de mander tous ceux qui passaient pour les plus instruits, et de leur poser mille questions de haute science. Malheur à celui qui ne répondait pas conformément à la parole du Prophète ! Il était immédiatement mis à mort.
Soixante-dix-sept floba4 avaient déjà eu ce triste sort, lorsqu’un jour Hadjedj, arrivant avec ses troupes à la Mecque, dit aux habitants : « Existe-t-il parmi vous un descendant de Mahommed ?5 »
Un chikh6 se levant aussitôt : « Oui, Seigneur, il y a ici un enfant de douze ans qui prétend à cette origine. Son jugement est précoce : faisant régulièrement sa prière et son carême, poli, gracieux, il ne parle jamais que de la parole de Dieu et de notre Prophète Sidi Mohammed.
Hadjedj, entendant cela, ordonna à un de ses serviteurs de lui amener cet enfant ; puis il se retira chez lui. Le serviteur trouva le jeune musulman couché, se tournant alternativement tantôt sur le côté droit, tantôt sur le côté gauche. On lui banda les yeux, il se mit alors à pleurer. « C’est donc ainsi que vous me livrez à l’ennemi ! » criait-il de toutes ses forces.
Dès qu’il parut devant le sultan, celui-ci lui demanda son nom, sa croyance, sa famille, sa pensée.
O Hadjedj, répondit l’enfant, mon nom est Mohammed ben Abd Allah ben Hassen ben Ali bin Taleb7, ma croyance est en Dieu ; ma famille, c’est la terre ; ma pensée, c’est la bienveillance et la charité.
Bien : mais je te prie, ne me cache rien, s’il te reste encore quelque chose à avouer. Dis-moi ton histoire, ton commencement, ta fin, ta mère, ta fortune, surtout ce que tu penses faire ultérieurement.
Je suis né de la goutte d’eau ; ma fin sera la mort ; ma mère est la mère de tous les musulmans ; ma fortune, le zekhat8 ; mon but unique, c’est de prier Dieu.
J’ai encore d’autres questions à te poser, dit Hadjedj, après avoir approuvé ces paroles. Quelle est la ville que Dieu chérit le plus.
La Mecque. Dans quel mois Dieu la chérit-il le plus ?
4 Savants 5 Le Prophète, par corruption du langage, on dit vulgairement Mahomet. 6 Vieillard, chef de tribu. 7 C’est-à-dire Mohammed, fils d’Abdallah (le serviteur de Dieu), fils d’Hassen (le charitable), fils d’Ali, fils du Taleb (savant). 8 Impôt prescrit par le Koran concernant les troupeaux dont il frappe le centième.
678
Dans le mois de Ramadhan9, celui dans lequel est descendu le Koran. Quelle est la meilleure des nuits ? La nuit d’El Kedri10 bien préférable à mille nuits. Quelle est la meilleure heure ? L’heure de la prière. De quel pays es-tu ? poursuivit Hadjedj émerveillé. Je suis de l’Arabie. Es-tu du pays de ces gens qui parlent l’arabe et qui mentent toujours ? Je suis de l’Arabie. Mais, enfin, es-tu de cette partie de l’Arabie qui ne croit pas à notre Seigneur
Mohammed ? Non, certes, je suis de la ville de Yatriba11. A ce mot, Hadjedj entra en fureur. « Je le jure par le Thours et le Ketab el Mesthouri12,
s’écria-t-il, je ne te laisserai point partir ; et puisque tu persistes à cacher ta véritable famille, je t’ôterai la vie.
En ce moment, un Vizir supplia le Sultan, au nom d’Allah13, de ne pas maintenir une décision aussi sévère ; mais l’enfant se prit en même temps à rire aux éclats. Hadjedj, lui jetant un regard courroucé, lui demanda le motif d’une telle gaieté, ajoutant : « Certes, tu mourras aujourd’hui même ».
C’est votre faiblesse d’esprit, ô monseigneur, qui me fait rire ainsi. Vous n’êtes pas capable de me mettre à mort ! Comment sauriez-vous que c’est aujourd’hui mon temps de mourir ? Si je venais de quitter la vie, vous ne pourriez pas certes me faire revivre ; et si je revenais à la lumière, vous ne pourriez pas plus me renvoyer à la mort.
Eh ! qui donc m’empêcherait de te faire mourir ? Dieu ! s’écria le jeune enfant. Mais c’est Dieu même qui m’ordonne de te faire périr aujourd’hui ! Comment Dieu vous aurait-il donné ce commandement, puisqu’il a dit : « Ne tuez
personne, à moins que la justice et la raison ne l’exigent ? » Mais alors, pourquoi persistes-tu à me cacher que tu es de la famille de Notre Seigneur
Mohammed ? Parce que Dieu a recommandé de cacher sa famille en présence de l’ennemi. C’est encore vrai, dit le Sultan. Tu t’es sauvé de la mort. Cependant un dernier mot :
Quelle est la meilleure parole ? La Ilah ill ellah ! Mohamed Rassoul Allah14 Par quoi Dieu a-t-il commencé la création ? Par cinq choses : le feu, la lumière, l’obscurité, la terre et l’eau. Qu’ont produit ces cinq choses ! Le diable est venu du feu : les anges, de la lumière ; la flamme de l’obscurité ; les
hommes, de la terre, par le ventre de leurs mères ; tout ce qui existe, enfin, est sorti de l’eau. Comment Dieu a-t-il fait la création ?
9 Le carême, ainsi appelé parce qu’avant Mohammed il était fixé au mois le plus chaud (ramad, brûlant) de l’année. 10 Kedri, la puissance. Les Arabes disent que la veille ou dans le courant du Ramdhan, il y a une nuit éblouissante par sa clarté, et pendant laquelle le ciel s’entrouvre pour laisser tomber toutes les bénédictions de Dieu sur les bons musulmans : alors chacun s’empresse de profiter du moment pour demander à Dieu ce qu’il désire et il l’obtient de suite. Cette bienheureuse nuit ne pouvant être ni prévue ni fixée, il en résulte pour les musulmans l’obligation de veiller tous les mois de Carême. 11 Primitivement le nom de la ville ou est né Mohammed, et qui, depuis, devint Medinet-el-Nebi (la ville du prophète). 12 Thouri, Ketab el melthouri, noms du Pentateuque et du Koran. 13 Dieu 14 C.A.D. « il n’y a de dieu que Dieu ; Mohammed est son prophète ».
679
Il a créé quatre choses : le ciel, la plume15, le paradis et Adam. Pour ces quatre choses, Dieu n’a qu’à dire : « que cette chose soi ! », et de suite le fut.
D’où vient Adam ? Dieu l’a tiré de la terre. La terre d’où vient-elle ? De l’écume de la mer. Et cette écume ? Elle vient de l’agitation des vagues. Et les vagues agitées ? D’un gros diamant. D’où vient ce gros diamant ? 16 De l’obscurité. Et cette obscurité ? De la lumière du jour. Et cette lumière ? D’un nuage17 Et ce nuage ? De la bonté éternelle de Dieu. Tout, sur terre, adore Dieu, car c’est lui qui fait tout
exister. Il n’y a point d’autre Dieu que lui. Tu as raison, reprit le sultan. Mais, dit l’enfant, vous vouliez donc me prendre pour Cahin, cet individu qui, ayant tué
son frère, le portait sur son dos et se trouvait fort embarrassé d’un tel fardeau. Alors Dieu lui envoya deux anges, sous la forme de deux corbeaux, qui se battirent sous ses yeux. L’un fut tué, et l’autre aussitôt de gratter la terre, de faire un trou pour y déposer le corps de son adversaire. « Eh ! pourquoi, pensa Cahin, ne ferais-je pas comme ce corbeau ? » Et à l’instant, il enterra son frère qu’il portait depuis sept jours, sept mois et sept ans, dit-on.
Très bien ! Sais-tu tout le Koran ? Je veux que tu m’en fasses connaître quelque chose de nouveau pour moi. Si tu y réussis, je te donne tout ce que tu voudras.
Je n’accepterais de vous qu’une chose, Monseigneur, c’est la liberté. Je ne veux seulement pas vous regarder, après tout ce que vous m’avez fait souffrir aujourd’hui.
Je ne te demande cette dernière chose que parce que je suis amoureux de ta parole et de ta science.
Votre conduite à mon égard me peine beaucoup ; rappelez-vous donc : « Celui qui fait du bien aura du bien ; celui qui fait du mal, aura du mal. »
Et aussitôt l’enfant rapporta le passage du Koran relatif à l’histoire de Jospeh (Chap. XII du Koran).
Le sultan ne tarissait pas d’admiration et d’étonnement. « Quels sont, poursuivit-il, les gens qui vont en enfer ? Ceux qui trompent sur terre et disent sans cesse que s’ils revenaient sur terre ils feraient
toujours le bien. Qui va au paradis ? Celui qui dit : « El hamdou illah elladi la ilah illa hona18. Du siège la raison ? Dans la tête. Et l’amitié ?
15 C.A.D., l’écriture. 16 La transparence des eaux de la mer, leur aspect vitreux font penser aux arabes que la mer n’est qu’un gros diamant fondu. 17 Parce que c’est d’un nuage que Dieu parle à Moïse et à Mohamed. 18 C’est-à-dire : « Gloire à Dieu, celui qui seul est Dieu ».
680
Dans les yeux. Et la sagesse ? Dans la langue. Et l’injustice ? Dans les oreilles. Et la force ? Dans l’épaule ? Et la gaieté ? Dans le foie. Quels sont les chevaux qui courent le mieux ? Ceux qui ont le dos court, le front large, les jambes antérieures bien droites, les jambes
de derrière avec deux balzanes, les membres minces, les avant-bras et le cou longs, la poitrine large, la corne du pied bien ronde, comme un douro ; la vue assez perçante pour distinguer, la nuit, un poil gris dans une tasse de lait.
Très bien ! Maintenant, dit le jeune Mohamed, je vous prie de me laisser partir. Non, il me faut encore un mot sur les femmes. Je suis trop jeune pour les connaître. Il faut absolument que tu m’en parles. Que diras-tu de la jeune fille de dix ans ? Ce n’est pas l’âge qui convient au mariage. Et celle de vingt ans ? Elle manque de raison et de religion ? Et la femme de trente ans ? N’est d’aucune utilité pour le ménage. Et celle de quarante ans ? C’est le meilleur âge pour l’embonpoint et les formes ; c’est aussi celui auquel la femme
se conserve le mieux pour le ménage. Et celle de cinquante ans ? C’est le meilleur âge pour les soins de la vie. Et celle de soixante ans ? Elle gâte tout, et fait plus de mal que de bien. Et celle de soixante-dix ans ? Complètement inutile en toutes choses. Et celle quatre-vingts ans ? Le cœur ne prend pas chez elle. Et celle de quatre-vingt-dix ans ? Je n’ai rien à y dire : c’est la maîtresse du charlatan. Et celle de cent ans ? Pas de réponse pour celle-là. Je te remercie bien, ô mon fils ! Dieu te conserve, car il t’a sauvé. Pas un seul de tous
ceux que j’ai interrogés jusqu’ici n’était point encore sorti sain et sauf de mes mains. Tiens, voilà une jument, mille dinars, un diamant rose, une femme : je te fais présent de tout, Allah t’a secouru contre Hadjedh ! »
Grâce à leur forme concise, les sentences, les dictons, les vérités proverbiales dans les contes, les légendes, les récits arabes sont parsemés, infiltrent dans l’esprit public des notions nettes de législation, de religion, de science, de morale, d’éducation, d’amour du prochain, de conduite, etc.
Quand on voit l’Orient si sobre de paroles, si substantiel et si expressif dans son langage, on le croirait constamment inspiré de cette belle maxime de Pythagore :
681
« Il faut ou se taire, ou dire des choses qui vaillent mieux que le silence ; jetez plutôt une pierre au hasard qu’une parole oiseuse et inutile ; et ne dites pas peu en beaucoup de paroles, mais en peu de paroles dites beaucoup ».
Dr. E. Bertherand
Tric-Trac, « Origine des scorpions (légende arabe) », Le Moniteur algérien, 10 septembre 1869, feuilleton
Connaissez-vous Chocolat ? ou plutôt, qui ne connaît pas Chocolat ? Tour à tour porteur d’eau, commissionnaire, interprète, messager d’amour intelligent et discret, se faisant tout à tous, enfin, Chocolat est un de ces êtres que le Darfour ou le Soudan semblent avoir fait naître tout exprès pour les besoins de la civilisation créole.
J’ai un faible pour Chocolat ; j’aime sa bonne humeur, son regard vif et doux tout à la fois, sa parole naïve, pittoresque, imagée ; car il est éloquent quand il s’y met, et sa peau fortement bistrée ne me déplaît point.
Il y en a qui s’en moquent cependant. – Peut-on avoir la peau rouge ? Pourquoi pas, Sidi ? riposte Chocolat en riant. Il n’y a pas de sottes peaux, il n’y a que
de sottes gens. Et le moqueur de rengainer sa mauvaise plaisanterie. Chocolat, qui a longtemps vécu sous la tente et suivi les caravanes, a la mémoire
abondamment garnie d’histoires, de légendes et de fables orientales. Il a de plus l’imagination assez fertile pour suppléer à la mémoire au besoin. Je suis convaincu que, pour charmer les nuits d’un autre Schabriar, il serait aussi intarissable que la belle Schéhérazade. On se le dispute dans les cafés maures. Pour moi, quand je puis attraper Chocolat, je n’ai pas de plus grand plaisir que de lui faire raconter une de ces histoires qu’il conte si bien.
La semaine dernière, je rencontre mon Soudanien ; je l’aborde et je l’entraîne chez le kaouadji le plus voisin. – Je m’ennuie, Chocolat, il faut que tu me racontes quelque chose.
Oh ! Monsieur Trictrac, il fait bien chaud… Raison de plus. Et puis, voyez-vous, Sidi, ce diable de siroco a mis tout à sec chez moi, la tête et… Il
tira de sa ceinture sa bourse dont la platitude révélait le vide le plus absolu. Je compris et déposai sur le plateau que venait de nous servir le kaouadji une pièce
blanche que Chocolat ramassa de l’air le plus naturel, le plus indifférent du monde, Et comme accoutumé à de pareils présents. Après quoi il toussa légèrement et commença ainsi : « Il y a bien longtemps que Mohamed est mort… Connu ! connu ! allons au fait. Il ne s’agit pas du prophète, mais de l’un de ses plus fervents et plus saints serviteurs.
Le Mohamed dont je vais vous raconter l’histoire était un marabout puissant, riche et vénéré. Après avoir mené dans sa jeunesse une vie de plaisirs et de débauches, il se sentit un jour saisi par le remords et par le besoin de travailler à son salut. Sans faire part à personne de son dessein, il quitta brusquement sa famille, son harem, ses vastes terres et ses innombrables troupeaux, et s’établit dans le désert pour y vivre à la manière des derviches, ne se nourrissant que de sauterelles, de racines et de fruits sauvages, suivant les saisons.
Il espérait pouvoir, par les austérités de cette vie contemplative, racheter toutes les iniquités, effacer toutes les souillures de sa vie passée.
Mohamed le prophète (que sa puissance nous protège !) est le grand-vizir d’Allah pour ce monde sublunaire : à ce titre, il a mission de punir les méchants et de récompenser les bons ; il est donc tenu de surveiller les actions de tous, même les plus secrètes.
C’est là une rude besogne, comme vous le pensez, et pas toujours très amusante. Mais notre grand prophète se multiplie au moyen de suppléants, de délégués qui sont les marabouts,
682
les mokhadem et confrères de Zaouïas. Ne pouvant donc surveiller lui-même le nouveau derviche, il chargea de ce soin un vieux marabout du voisinage, nommé Ibrahim. Il pouvait d’autant plus compter sur la vigilance de ce surveillant, qu’Ibrahim, pour des raisons que l’histoire ne dit pas, était le mortel ennemi du pauvre Mohamed.
Cependant, tout entier à la méditation et à la prière, Mohammed ne donnait aucune prise à la malignité de son espion. C’est en vain que celui-ci avait obtenu que des houris plus séduisantes les unes que les autres vinssent tour à tour minauder, folâtrer autour du solitaire. Le derviche ferme comme un roc restait inattaquable à toutes leurs agaceries, et le vieil Ibrahim se voyait dans la nécessité, bien dure pour lui, de témoigner chaque jour de la vertu de son ennemi ; si bien que le Prophète commençait à le noter dans son estime comme le modèle des marabouts.
Oh ! la belle koubba, disait le Prophète, qu’on élèvera un jour sur la tombe de ce saint homme !
Cela ne faisait pas le compte d’Ibrahim ; que fit alors ce méchant ? Grâce à la vertu d’un talisman qu’il avait dérobé autrefois à la naïveté d’un taleb trompé
par son hypocrisie, il s’éleva jusqu’au septième ciel où réside Allah (que sa bénédiction soit sur nous !) au milieu de son divin cortège de houris.
Il se présenta devant Aïcha, reine brillante de ces beautés immortelles, et après les prosternations d’usage, prenant son air le plus patelin, il lui dit :
« O vierge du ciel, mère des amours éternelles et des voluptés sans fin, tu connais la puissance de tes charmes ; tu sais qu’aucun mortel ne peut regarder ta chevelure d’or sans en être ébloui foudroyé ; ni contempler ta splendeur et la majesté de toute ta personne sans en être fasciné, transporté hors de lui-même et noyé dans un abîme de désirs et de folie.
Tu es plus brillante que la plus belle des étoiles du firmament, plus blanche que la lune à l’heure où elle se dérobe aux clartés de l’aurore. – Eh bien, je sais un homme, là-bas, sur la terre, qui ose se vanter de mépriser tes charmes et de braver ta puissance… C’est en vain qu’un grand nombre de tes sœurs ont essayé de faire brèche à son austérité : elles l’ont trouvé plus inflexible que le granit, plus dur que le diamant.
Est-ce toi qui les avais envoyées et t’ont-elles rendu compte de leur défaite ? – Oh ! non, sans doute, car tu les aurais déjà vengées… »
Aïcha était houri, mais avant tout elle était femme. Elle sentit son amour-propre, vivement piqué par le discours d’Ibrahim, et s’approchant du trône d’Allah (que sa puissance nous soit en aide !) – « Vous venez d’entendre, dit-elle, ce que vient de dire ce respectable marabout. Croyez-vous que ce Mohamed, ce sage inébranlable, résistera jusqu’à la fin ? – Il faut que je m’en assure : l’honneur du corps des houris est engagé dans cette affaire ; avec votre permission, je descends de ce pas sur la terre, et je vous promets de vous montrer bientôt combien la vertu des hommes est fragile, et combien faible leur volonté devant la puissance d’une femme qui veut bien ce qu’elle veut.
A peine la reine des houris avait-elle prononcé ces derniers mots, qu’elle traversait l’espace avec la rapidité d’une étoile filante et abordait notre globe, au lieu même où se trouvait la retraite du pieux Mohammed.
S’approchant du derviche, elle le trouva sur l’autel de la pénitence, égrenant dévotement son chapelet. Elle essaya bien de le distraire par des œillades et des sourires qui auraient affolé un mortel ordinaire ; mais le derviche restait profondément absorbé dans sa prière.
Elle comprit qu’elle n’obtiendrait rien de lui tant qu’elle ne lui aurait pas fait perdre cette position inexpugnable, et que le contact de l’autel de la pénitence était le principe de sa force contre toutes les séductions. – C’est à quoi n’avaient pas songé les houris qui l’avaient précédée.
Il fallait donc à tout prix détacher le derviche de cette pierre de salut ; alors, prenant sa voix la plus douce et son accent le plus aimable, elle se mit à dire :
683
« Mohammed, le plus digne, le plus aimé des serviteurs d’Allah, interromps un instant ta prière et viens à moi, car j’ai une bonne nouvelle à t’apprendre. Je suis envoyée par Mohammed, le prophète, et ton puissant protecteur, et je t’apporte la récompense de tes vertus et le prix de ta longue pénitence. »
Trompé par ces paroles, dont l’accent semblait garantir la franchise, le pauvre marabout s’empressa de courir au-devant de la perfide Aïcha.
Mais à peine s’était-il éloigné de l’autel, qu’un feu dévorant s’emparait de tout son être, et qu’il s’abandonnait à tous les transports d’un amour insensé. Le malheureux était tombé dans le piège qui lui avait été si droitement tendu.
Fière de sa victoire, la houri avait bien vite regagné sa demeure céleste. Dire que le malheur de ce pauvre homme fut l’œuvre de la reine des houris, et que ces
êtres charmants, destinés à faire notre bonheur dans l’autre monde, se plaisent à travailler à notre perte dans celui-ci ! Mais il y a des mystères qu’on ne doit pas chercher à pénétrer… Allah Kerim !
Ibrahim, qui n’avait cessé d’épier le pauvre marabout, se précipita sur lui en s’écriant : « Misérable ! n’as-tu pas honte de tromper ainsi Allah et son prophète, et de profaner aussi indignement que tu viens de le faire le sanctuaire de la pénitence ! »
En disant ces mots, il lui abattit la tête d’un coup de yatagan. Mohammed tomba par terre en ouvrant les bras, et Mohamet le prophète le changea en
scorpion couleur de cendre, qui a toujours les bras ouverts. Ibrahim, dont la vengeance n’était pas encore satisfaite, alla chercher Fathma, épouse
de celui qu’il venait d’assassiner, et l’ayant amenée près du cadavre de son époux, lui dit en lui montrant le corps horriblement mutilé :
Tu dois partager son sort, car tu ne valais pas mieux que lui. A ces mots, il fit rouler sa tête à côté du cadavre du marabout.
Fathma fut aussitôt changée en scorpion couleur de feu, et, en cherchant à se cacher sous les pierres de l’autel, elle y rencontra son époux.
Tous les scorpions descendent de ce malheureux couple et c’est par un souvenir instinctif de la catastrophe qui marqua leur apparition sur la terre, qu’ils se tiennent toujours cachés sous les pierres.
Quant à Ibrahim, il n’échappa pas à la punition que méritait son double crime : il fut changé en sauterelle !
Si vous rencontrez un scorpion, ayez moins de peur que de pitié. Quant à la sauterelle, c’est une méchante bête, qu’on ne saurait trop détester. Telle fut, avec sa morale, l’histoire que me raconta Chocolat : soyez certain qu’il sera
heureux et fier de se la faire lire demain dans le Moniteur.
C. l’une, « Alger, la nuit », La Vie algérienne, 23 et 29 janvier 1870, deuxième page Une excursion dans notre bonne ville d’Alger, vous sourit-elle, lecteurs ? Suivez-moi.
Ne vous sourit-elle pas ? Suivez-moi quand même. Il est onze heures du soir, nous sommes le sixième jour de la semaine, et vous savez,
que depuis quelques temps, le samedi est fertile en rencontres, de onze heures du soir à 7 heures du matin.
La rue Bab-el-Oued est déserte ; on est au Théâtre, ou à la Perle, ou couché : c’est le faubourg Saint-Denis de Paris, à Alger.
La place du Gouvernement est animée ; qu’aperçois-je sous les arcades, en face de la statue du duc d’Orléans ?
Une buvette… ma foi, hurlons avec les loups, entrons, nous verrons ce que c’est.
684
Pouah ! quelle horreur ! mais c’est un bouge à matelots, ou un tapis franc ; consommations à dix centimes ; quelles figures patibulaires ! la police, heureusement, surveille cet antre ou, peut-être, ce repaire, je ne sais comment le qualifier.
Ne buvons rien, et partons, lecteurs, c’est écœurant. L’heure s’avance ; avançons aussi. Ah ! c’est la rue Bab-Azoun. Grande animation ! pierrots et pierrettes, débardeurs, laitières, bébés et autres
travestissements se bousculent ; où vont-ils ?... à la Perle. Ne nous mêlons pas à cette cohue, soyons calmes et dignes, comme M. Capdevielle,
lorsqu’on lui adresse une provocation. Avançons toujours, c’est la sortie du théâtre ; vous la connaissez, lecteurs, c’est
continuellement la même chose. On a plus ou moins applaudi, plus ou moins baillé, et chacun s’en retourne chez soi, pour changer de tenue et faire apparition à la Perle : c’est là qu’est le bal.
J’y ai mes entrées, profitez-en, mêlez-vous aux groupes joyeux, dignes émules du grand Chicard, et dont quelques rosières de la Vie algérienne, comme les appelle M. Adrien Griffet, ne dédaignent pas de partager la joyeuse humeur et les spirituels lazzis.
Je vous laisse pendant quelques heures, et vais prendre mes ébats dans la salle ; je n’ai pas faim, et comme il est indispensable et du dernier genre de souper à la Perle, je tiens à fatiguer mes jambes pour me creuser l’estomac, que je remplirai à l’heure voulue, par un casse-croûte ou un souper complet, suivant l’appétit que j’aurai.
L’heure arrive, je vous offre à souper, lecteurs, je vous le commanderai, vous le paierez, nous serons quittes.
On soupe gaiment ; remettez le montant de l’addition à Pierre, le garçon de la Perle, et recommencez à vous vouer au culte de Terpsichore.
Un ou deux quadrilles et nous sortons ; remontons la rue Bab-Azoun. Brrr… il fait frisquet ; pas un café pour vous offrir un cordial : Diable ! quelles sont ces lanternes à 5h ½ du matin ? Approchons.
Rue de l’Aigle, buvette de l’Aigle… C’est un partisan de l’Empire ; entre amis, on ne se gêne pas, allons-y gaiment. C’est peut-être un Héritier présomptif qui tient ce petit Baratte algérien. Des huîtres, de la volaille, du bon vin ; Diable ! c’est une bonne ressource, en sortant de la Perle ; on se met à son aise, on peut retirer son masque, sans crainte d’être écorché.
Après tout, un héritier peut se permettre toutes sortes de choses ; une, cependant, doit faire exception : héritez de qui vous voudrez, peu m’importe, mais n’attentez pas à mes jours pour hériter de moi, cela n’en vaudrait pas la peine ; il vaudrait mieux pour vous, prier mon ami M…. de vous conduire à la poste hériter, ce qu’en cas de refus de sa part, la Vie algérienne ne manquera pas de faire, si Dieu et les abonnés lui conservent la vie.
Le jour paraît, nous rentrerons chacun chez nous, et nous reprendrons nos pérégrinations
nocturnes, en visitant d’autres quartiers moins aristocratiques. Je suis noctambule, comme les chats, et, pour peu que vous preniez goût à ce métier
d’observateur, je vous promets, ce soir, de satisfaire vos appétits. Rendez-vous sur la place de Chartres à 11h ¾, nous commencerons par explorer les
aboutissants de la rue du même nom… Vous êtes exact au rendez-vous, bravo, suivez-moi : Ne dites rien, nous allons dans un
quartier où le meilleur est de se taire, quoi qu’on vous dise, quoi que vous voyiez y faire. La rue de Chartres est assez mal fréquentée, la nuit : nombre d’établissements borgnes
offrent un asile à ce qu’on appelle l’armée roulante d’Alger ; là, on boit l’anisette à un sou le cran, d’autres consommations à des prix aussi modérés, et dont l’absorption malsaine exerce de terribles ravages sur la raison des consommateurs.
685
C’est le cas ou jamais de se dissimuler ; ces messieurs n’aiment pas les gens en paletot et ne manqueraient pas de nous invectiver de sottises ; soit que nous voulussions les corriger, soit que nous eussions l’air de les narguer par notre silence, le pugilat deviendrait indispensable : il faut y renoncer avec eux, car ils ont souvent la désagréable manie d’emmancher au couteau au bout de leur poing.
La plus vilaine race d’ivrognes de ces quartiers, c’est la race indigène ; l’européen, à quelques exceptions près, dans l’état le plus complet d’ivresse, garde cependant, sinon le raisonnement, du moins conscience de ses actes : l’indigène, point ; il est mahboul et réduit à l’état de bestialité qui ne fait même pas plaisir aux animaux auxquels je pourrais le comparer ; plus il boit, plus il veut boire, et, l’alcool agissant, il devient furieux. Ne vous montrez pas à lui, en ce moment, ou garnissez votre poitrine d’une bonne cotte de mailles ; malheur au premier qui lui tombera sous la main. Attention ! regardez bien : un de ses coreligionnaires, à peu près dans le même état, s’approche : ils causent ensemble, et le résultat de leur entretien est qu’il faut encore boire : nouvelle station au cabaret, nouvelles libations ; puis, il faut payer… Vous allez voir.
Ils se lèvent tous les deux, mais sans mettre la main à la poche ; le cabaretier réclame, les indigènes se regardent : - toi payer. – Macache, toi inviter moi. – Toi mahboul ? moi pas de l’argent. – Ah ! kelb, toi inviter moi, et toi pas de l’argent, tiens… ; et la lutte s’engage.
Un attroupement se forme, on les regarde, mais personne ne les sépare ; bientôt, les couteaux se mêlent de la partie, cela devient intéressant ; les spectateurs s’avancent pour mettre le holà et alors toute la rage des deux adversaires se tourne contre les nouveaux arrivants ; la mêlée devient générale ; il n’est pas rare de voir les larges traces de sang aussitôt que le groupe a été dispersé.
Nous ne sommes plus au temps des métamorphoses, mais la vue du fer en opère quelques-unes, des ivrognes sont complètement dégrisés, des gens bien portants se trouvent mal, des impotents se sauvent à toutes jambes, les médisants se rétractent, etc., etc.
Voulez-vous en voir une des plus curieuses ? priez M.X., journaliste très gros et très connu à Alger, d’assister à l’une de ces scènes nocturnes ; il sera assis sur un fauteuil des mieux rembourrés ; au bout de dix minutes, regardez, oh, miracle ! le fauteuil se métamorphosera en chaise percée : Tentez l’aventure, je vous garantis la réussite.
Trabaud, « De Paris à Tahiti, par Londres et New-York. Souvenirs et impressions de voyage », Le Messager de Tahiti, du 14 mai au 25 juin 1870 (extraits)
A Madame J.A.L. Je vous dédie, Madame, ces modestes pages. Cet hommage vous est dû, car toutes les
fois que, dans mon long voyage, j’ai admiré la tendresse d’une fille, d’une épouse, d’une mère, j’ai rapporté mes sujets d’observation à un type unique – et ce type unique, c’est vous.
De Paris à Tahiti, par Londres et New-York. Souvenirs et impressions de voyage19. C’est le 26 octobre que j’ai quitté Paris pour la dernière fois. Si je précise la date, c’est
que ce jour aura sa place dans l’histoire des émotions qui ont agité la France en cette année 1869, de turbulente mémoire. C’est le 26 octobre, en effet, qu’expirait, au dire d’un casuiste en constitutions, le délai pour la convocation du corps législatif. En l’absence d’une convocation par le pouvoir, il fallait, disait-on, que cette grande assemblée se réunît d’elle-même. Chacun sait aujourd’hui, même à six mille lieues de la France, ce qui advint de cette thèse, qui a fait
19 Droits de reproduction et de traduction réservés.
686
verser des flots d’encre et fourni un aliment à la presse pendant plusieurs semaines. Le dernier jour, la pluie, qui a toujours été un élément politique modérateur, se mit du côté du gouvernement. Et Paris, quand j’en suis sorti, était une ville sage, pacifique, humide et boueuse.
Pour prouver la vérité du proverbe que l’homme s’agite et que Dieu le mène, je venais à Tahiti, comptant aller à Londres. Un tel voyage, aujourd’hui qu’il se fait en moins d’un jour, et que la dépense ne va pas à celle d’une excursion de Paris à Dijon, ce n’est plus le lointain et dangereux pèlerinage que nos pères ont connu. On part sans crainte et sans émotion. D’ailleurs je connaissais déjà cette ville immense, et je quittais, pour ainsi dire, mes relations françaises pour celles que j’avais eu la bonne fortune de me créer en Angleterre dans de précédents séjours. Je prenais la route de Dieppe. Tous ceux qui ont suivi cette voie savent quel pays magnifique traverse le chemin de fer. L’enchantement commence à Asnières, à quelques minutes seulement de ces fortifications qui, créées dans un but de défense nationale, sont devenues, depuis, la limite d’octroi.
C’est à Asnières que le train traverse pour la première fois la Seine. Ce fleuve, qui est le plus national de nos cours d’eau, la Loire exceptée, commence, au sortir même de la grande ville, ses méandres si nombreux qui donnent tant de beauté aux paysages normands. Un piéton parcourrait en quelques heures, la vapeur en quelques minutes, la distance la plus courte du pont de la Concorde à celui d’Asnières. Mais le fleuve fait un parcours énorme pour arriver d’un point à l’autre. Dans sa course nonchalante et superbe, il baigne Meudon, Sèvres, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux et enfin Courbevoie, qui est le plus proche voisin d’Asnières, sans compter les localités au moins aussi nombreuses de sa rive droite. Tous ces lieux qu’on aperçoit ou qu’on devine dans la distance, éveillent un souvenir et sont pour ainsi dire une page d’histoire. Meudon, avec ses bois magnifiques, son immense perspective, son château qui domine la ville et la vallée, rappelle les tantes de Louis XVI, pieuses filles que les premiers actes de la révolution épouvantèrent et que la fuite sauva du sanglant destin de leur famille. C’est sur le pont de Sèvres que passait le Grand Roi quand, de son œuvre splendide de Versailles, il venait à Paris, sa capitale nominale. On croirait voir encore la pompe de son cortège. Soixante-quatorze ans après sa mort, le regard attristé aurait pu suivre, sur cette route ardue et poudreuse qui franchit la colline, le défilé d’un souverain captif de son peuple, arraché à son palais par une foule furieuse, salué ou outragé à son passage par des cris confus et conduit à Paris, où l’attendaient la déchéance, la prison, l’ignominie d’un jugement public et la mort sur l’échafaud. C’est à Saint-Cloud qu’Henri III, le dernier des Valois, reçut de la main d’un moine le coup mortel qui donna la couronne au premier des Bourbons. Et c’est de Saint-Cloud que, deux cent quarante et un an plus tard, partait pour son dernier exil le dernier des Bourbons. C’est à Saint-Cloud que le jeune et brillant Consul reçut la couronne impériale et que Bonaparte devint Napoléon. C’est là que sa dynastie a été restaurée. Suresnes a toujours un petit vin qu’aimait Henri IV et n’a plus un château qui appartenait à un roi de la finance et que l’incendie consuma en 1848. Puteaux et Courbevoie sont des lieux modestes et sans histoire connue. C’est ma tendresse pour les déshérités qui leur donne une place dans ce récit. L’avenue triomphale qui part de la place de la Concorde, dans l’axe même du pavillon central des Tuileries, franchit la Seine entre Courbevoie et Puteaux, et s’allongeant entre les deux villes, aboutit au rond-point que décore aujourd’hui la statue de l’Empereur Napoléon, statue exilée, mais exilée avec honneur, de son piédestal de bronze de la place Vendôme.
Voilà l’horizon immense, émouvant, instructif, que le voyageur peut contempler d’Asnières, s’il dirige ses regards en amont du fleuve. S’il les porte dans le sens contraire, le spectacle a moins de grandeur et de solennité. Il peut voir, à droite du pont, en face d’Asnières, apparaître confusément le vieux bourg de Clichy, qu’habita le roi Dagobert. De tous les villages qui forment une ceinture continue autour de Paris, ce dernier est certainement le plus triste, le plus noir, et sa population semble se composer de l’écume d’une grande ville. Sic transit gloria mundi. […]
687
Trabaud.
Somebody, « La machine ne fonctionne plus », Le Moniteur de l’Algérie, 2 août 1871, troisième page
Ceux de mes lecteurs qui se sont trouvés soudainement réveillés en pleine mer, par une violente secousse immédiatement suivie de l’arrêt complet du bateau, comprendront seuls ce qu’ont d’effrayant ces quelques mots sourdement répétés par chacun : « La machine ne fonctionne plus ! »
Le sang se glace dans les veines, on se voit sombrer, et, sans force, sans volonté on attend dans des angoisses horribles, une fin qu’on croit aussi rapprochée qu’inévitable.
Combien plus terrible est l’effet de cette affreuse nouvelle lorsqu’elle menace la population de toute une ville quand, comme à Alger, l’autre soir, les victimes, au lieu de se compter par centaines, se comptent par milliers !
C’était le 29 juillet, à la tombée de la nuit. L’atmosphère était lourde, le ciel avait un aspect sinistre. Epuisé par la chaleur de la journée et de plus, poursuivi par un pressentiment que rien ne justifiait, je me proposais, au lieu de sortir, de vérifier l’exactitude du proverbe : « qui dort dîne », en demandant tout simplement à mon lit, pour ce soir-là, la table et le logement. Hélas, que j’eusse bien fait ! Mais le fatal destin ne le voulut pas. Une soif canine s’empara de moi. La perspective de boire frais me fit surmonter ma paresse et ma peur, et je me mis en route pour l’hôtel de *** où je prends pension.
C’était entre chien et loup. Les rues me semblèrent avoir un aspect inaccoutumé. De rares passants se hâtaient de rentrer chez eux. Oubliant que c’était le jour du sabbat, je m’étonnais de voir beaucoup de boutiques fermées. Le sol me brûlait sous les pieds. Je n’eusse pas été surpris de ressentir une secousse de tremblement de terre.
Enfin, j’arrive à l’hôtel, ruisselant d’eau et la bouche d’autant plus sèche. En entrant dans la salle à manger, je fus frappé de l’air mécontent des convives. Chacun semblait regarder son voisin d’un œil de menace ou d’envie. Mon commensal, arrivé avant moi, répondit à peine à un salut, qu’au milieu de mon inquiétude je m’efforçai de rendre gai. Les garçons faisaient leur service d’une humeur plus que silencieuse. Assurément, mon pressentiment ne m’avait pas trompé ; il y avait ou il allait y avoir quelque chose. Voulant me mettre à l’unisson de la mauvaise humeur générale, je renvoyai brutalement le potage qui me fut servi. – Donnez-moi de la glace, dis-je au garçon, d’un ton qui ne souffrait pas de réplique. – Il n’y en a pas, Monsieur. – Comment, il n’y en a pas ? Envoyez-en chercher. – Monsieur, il n’y en a pas à Alger : la machine ne fonctionne plus : - Mots terribles qui mirent ma bouche en feu et m’empêchèrent d’articuler une autre parole.
Quand je revins à moi, car cette réponse fut pour ma pauvre tête un vrai coup de foudre, je compris l’importance du malheur qui frappait tout Alger et je m’expliquai alors l’abattement général.
Un tremblement de terre n’engloutit pas tous les habitants. Une inondation est impuissante contre les vigoureux nageurs, et les bons pompiers savent se rendre maîtres d’un incendie. Mais le manque de glace atteint tout le monde, et boire chaud par une température de 35°, c’est à faire rendre… l’âme.
Ces sinistres paroles : « La machine ne fonctionne plus » suggérèrent aux nombreuses victimes une question que je soumets à l’appréciation du lecteur : Comment se fait-il qu’à Alger il n’y ait qu’une fabrique de glace, tandis qu’à Oran, avec trois fois moins de population, il y en a trois ?
L’Algérien proprement dit serait-il moins entreprenant que l’Oranais ? Le désappointement de mon aimable commensal qui, au prix d’or (il en remue à la
pelle), ne put obtenir qu’une carafe frappée, nous dérida un peu. Chacun plaça son mot et cette fois, ce fut le mot pour rire.
688
L’un supposa une taquinerie méphistophélique de la part de l’unique industriel rafraîchissant, pour donner un avant-goût de l’enfer aux impurs d’Alger.
Un autre affirma que l’honnête fabricant de glace, souffrant d’un violent accès de goutte trouvant un certain soulagement à faire souffrir toute la population.
Les Prussiens seraient-ils complètement étrangers à ce nouveau malheur public ? avança un troisième.
Vous cherchez bien loin et vous oubliez ces maudits bureaux arabes, dit ironiquement un jeune officier. – Dame ! qui sait s’ils n’y seraient pas pour quelque chose ? répondit un grincheux presque convaincu. Quelle qu’en soit la cause, oh ! mes chers algériens, plaise aux Dieux immortels que jamais plus vous n’entendiez, comme un glas funèbre, tinter à vos oreilles ce cri maudit : LA MACHINE NE FONCTIONNE PLUS !...
Somebody.
Tinterio, « Les Dix plaies d’Alger. Les arabolâtres », Le Moqueur, 22 avril 1866, feuilleton Gros sujet pour un petit journal ! ! Chaque pays a son fléau : l’Europe a la trichnine, l’Asie, la peste et le choléra ;
l’Afrique, le simoun et les sauterelles ; L’Algérie a ses arabolâtres. Définissons : qu’est-ce qu’un arabolâtre ? C’est un homme dont la conscience trop à
l’étroit dans nos vêtements européens, si raides et si étriqués, cherche à se mettre à l’aise sous l’ampleur d’un burnous et d’une gandoura.
Un homme, préférant au joug civilisateur de la croix le licol abrutissant du croissant. C’est le taret qui perce à bas bruit le vaisseau colonial et veut le faire sombrer au milieu
du port. Quelles épaves espère-t-il recueillir dans cet immense naufrage ? Il ignore donc ce
proverbe arabe qui reflète énergiquement l’esprit des sectateurs de Mahomet. « Baise le chien sur le museau tant que tu as besoin de lui, et chasse-le dès que tu t’en
es servi ». L’arabolâtre, que nous nous garderons de confondre avec l’arabophile, bien que tous
deux soient issus de même race, comme le tigre et le chat, diffère essentiellement de son antique congénère, autant par ses appétits que par ses violences.
L’Européen est sa bête noire ; c’est son cauchemar ; l’Arabe son Dieu, le Coran son idéal.
Hibou de la civilisation, il n’aime que les vieilles murailles lézardées et à demi écroulées ; il ferait, s’il le pouvait, plus de ruines à lui seul, en un an, que n’en ont fait les douze siècles de barbarie qui ont précédé la conquête.
Si, comme en Hollande, le noyau civilisateur était renfermé dans une plaine basse, il romprait lui-même les digues, à la plus grande gloire du Prophète des prophètes.
Quel est son mobile, son but, son intérêt ? Est-ce un fou, un prodigue, un avare ou un fanatique ? Il n’est rien de tout cela. C’est une nature atrophiée qui veut le mal pour le mal, rien que
pour le mal. Que voulait Erostrate en brûlant le temple de Delphes ? Est-ce un orgueilleux vulgaire ? Peut-être ! […] Vous le rencontrez partout, sous les lambris dorés, dans la boutique, sur la place
publique, dans la modeste maison du colon, sous la chaumière du paysan français. Il se fait tout à tous : humble avec les grands, grand avec les humbles, naïf avec les
badauds, tranchant avec les ignorants et les incrédules, insinuant envers les indécis ; courtisan envers ses supérieurs, insolent et despote avec ses inférieurs, - quand il en rencontre…
689
Il porte tous les habits : le frac brodé, le paletot du commerçant, la blouse du laboureur. Il écrit dans la grande Presse, et va lire le journal dans les caboulots maltais.
Il fait de l’Algérie ce que faisaient, mais innocemment, de l’Egypte, nos vieux soldats républicains, un briarée, un ogre.
C’est un pays, disaient-ils, où le Cocodrille avale un sapeur comme un cornichon ; - avec son hache, sergent, répliquait le naïf conscrit : Parbleure, à preuve que notre tambour major s’insinua un jour, en moins d’une seconde, dans l’estomac de l’un de ces affreux marsouins d’eau douce.
L’histoire est toujours au fond la même, elle varie seulement dans la forme. Pour les uns, l’Algérie est un pays inhabitable ; la fièvre y fauche comme le moissonneur
dans les guérets ; l’usure vous suce jusqu’à la moëlle des os.
« Chronique locale », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 20 septembre 1871, première page
La petite localité de Païta vient d’être témoin d’une de ces fêtes étranges qui deviennent de plus en plus rare en Nouvelle-Calédonie et qui, à plus d’un titre, méritent sinon de disparaître entièrement des habitudes du pays, au moins de subir une transformation radicale que la civilisation chrétienne peut seule opérer. Nous voulons parler d’un grand pilou-pilou donné par le chef Jack et sa tribu à l’occasion de la récolte des ignames et aussi de la mort de sa nièce qui a imprimé à cette solennité un double caractère parfaitement reconnaissable pour ceux qui connaissent les mœurs des indigènes. Des groupes nombreux d’indigènes étaient accourus de divers points de la colonie à titre d’invités, et le spectacle qu’a présenté, pendant huit jours, cet assemblage de démons demi-nus, mangeant, hurlant, et dansant jour et nuit, a dû un moment faire oublier aux témoins venus de Nouméa et d’ailleurs que la civilisation avait déjà dix-huit ans de règne dans la colonie. Nous n’essaierons point de décrire ici ces monceaux d’ignames, de taros et autres provisions entassées sur l’herbe et dévorées dans ces festins, qui laissent bien loin, dans l’ombre, ceux de l’Iliade et ceux dont Rabelais nous a donné le menu pantagruélique. Sa plume et celle d’Homère seraient impuissantes ici ; il faudrait leur génie pour peindre les danses et traduire les chants sauvages qui accompagnaient ces orgies sans fin. Sans doute ils étaient pleins de poésie, car l’animation de tous était sans égale, et parfois l’enthousiasme s’élevait à un degré qui ressemblait de bien près à de la folie furieuse. Mais, outre que la langue dans laquelle ils étaient dits nous est peu familière, le sujet et la forme offriraient peut-être beaucoup moins d’intérêt à nos lecteurs qu’aux rapsodes et aux Tyrtées néo-calédoniens et à leurs noirs auditeurs. La jeune princesse dont le départ pour le paradis néo-calédonien et l’admission au pilou-pilou éternel étaient ainsi célébrés, était l’une des meilleurs chanteuses nationales et sa perte a dû être vivement sentie dans l’occasion. Mais nous espérons que son génie n’a pas quitté tout à fait sa tribu et, à en juger par le nombre d’improvisateurs de tout âge et de tout sexe qui s’y sont révélés ces derniers jours, le vide qu’elle a laissé dans la littérature de son pays est déjà plus que comblé. Aucun accident n’est arrivé pendant cette fête nationale, à part une blessure de peu d’importance, faite par une sagaie mal dirigée, à la jambe d’un guerrier qui en est tout glorieux.
La Feuille de la Guyane française, « Mme Gillain », 11 et 18 novembre 1876, feuilleton L’histoire de la Guyane a aussi des pages intimes et émouvantes ; mais combien de
drames solitaires n’ont pas laissé de traces et se sont perdus dans ses forêts sans bornes, dans le haut de ses rivières ignorées.
En effet, cette nature merveilleuse est faite de forces hostiles, cette immensité de verdure cache de sinistres embuches, ces [?], ces mers ont des eaux perfides et des profondeurs traîtresses.
690
Qui a lu, sans être ému, l’étonnant et triste voyage de Juan Martinez, esclave d’une tribu sauvage et traîné à travers les forêts de la Guyane, jusqu’à la cité inconnue de Manon.
Qui n’a été pénétré d’une douloureuse pitié au récit de la perte mystérieuse de Mlle Dujay, cette jeune et intéressante artiste abandonnée, on ne sait comment, par l’expédition Patrix, entre les massifs boisés de l’Oyapock et du haut Maroni.
Qui n’a frémi des émouvantes péripéties éprouvées par Gui[…], lorsqu’il osa s’engager à travers la grande plaine inconnue de la Mahury, et s’avancer jusqu’à la rivière de Kaw, sur un sol mobile et des vases perfides.
Mais ce sont là les épisodes d’un passé déjà lointain. Qui aurait cru qu’ils pouvaient se renouveler à notre époque, non pas dans la profondeur des bois, dans le sombre désert de verdure, mais là, aux portes de Cayenne, pour ainsi dire sous nos yeux…
Je veux parler de l’incroyable aventure de Mme Gillain. Le 20 mai dernier, on lisait dans le Moniteur de la Guyane les lignes suivantes :
[répétition de l’article du 18 mai] Il ne peut exister de doute sur la réalité des faits. Le naufrage est un accident avéré, et
c’est par un agent officiel de la colonie que Mme Gillain a été retrouvée après vingt-cinq jours de disparition.
Que s’est-il passé dans l’intervalle ? Mme Gillain raconte les événements qu’elle a subis avec une sûreté de souvenir qui ne
laisse pas prise au moindre équivoque. Qu’a-t-on à lui opposer ? Les négations de la science. La science ne peut admettre qu’elle soit restée vingt-cinq jours sans nourriture. Mais la science n’a encore rien de définitif que la mutabilité de ses doctrines. Elle voit chaque jour son cercle agrandi par la constatation de phénomènes nouveaux. Son rôle est donc d’examiner et non de nier. Qui sait si elle ne se trouvait pas en présence d’un cas nouveau de pathologie, s’il n’y avait pas dans l’état de Mme Gillain quelque découverte intéressante à faire ?
Personne n’ignore que la nourriture est l’acte le plus spécifique de la vie. Mais, quelque rapide que soit l’échange des matières constitutives de l’organisme, il n’en existe pas moins des exemples singuliers d’abstinence absolue, prolongée au-delà des limites ordinaires. Je ne citerai que les deux cas de suicide par inanition qui furent communiqués, en 1831, à l’Académie royale de médecine. La première victime avait enduré son supplice pendant soixante jours ; la seconde pendant soixante-trois !
Je pourrais en rappeler d’autres non moins remarquables. Mais, si quelques esprits ont été pris de doute à ce sujet, c’est qu’ils n’ont pas eu, comme moi, la bonne fortune d’entendre, de la bouche de Mme Gillain, le récit inséré dans le Moniteur de la Guyane.
Connaissez-vous Mme Gillain ? Elle est d’une taille un peu au-dessus de la moyenne, ses traits sont allongés, sans
expression bien vive. Ils ont cette teinte uniforme qui paraît un des caractères ethniques de la Guyane.
Les regards, sans avoir conservé la vivacité communicative de la jeunesse, laissent deviner une certaine intelligence, un discernement sûr et une raison bien assise.
Je n’en ferai pas un portrait plus précis. J’avoue que je l’avais abordée avec des doutes. La relation ne cachait-elle pas quelque supercherie ? Je m’apprêtais à en saisir le point vulnérable. Mais il y avait chez elle un tel accent de vérité et de bonne foi, que loin d’avoir à exercer ma critique, j’en ai rapporté la conviction la plus profonde.
Je dois d’avoir été mis en communication avec Mme Gillain à une des plus hautes autorités de ce pays. Je l’aurai suffisamment désignée, en disant que c’est en même temps un esprit des plus éminents, capable de ressortir et de se distinguer dans les milieux intellectuels les plus élevés.
691
Les aventures de Mme Gillain lui ont paru si intéressants dans leurs détails qu’il a eu la pensée de les faire publier aussi exactement que possible. C’est le récit que nous allons entendre de la bouche de Mme Gillain :
J’avais pris passage sur le bateau [tapouïe] de M. Evariste, pour me rendre à Orgambo. Nous nous embarquâmes dans l’après-midi du 24 avril 1876. Au moment de notre
départ, rien, ni dans l’aspect du ciel, ni dans l’état de la mer, ne pouvait nous faire prévoir un malheur. Les passagers étaient nombreux, tous étaient gais, tous exprimaient l’espoir d’une prompte arrivée au terme de notre voyage. Dans tous ses projets, dans toutes ses combinaisons, l’homme compte sur l’avenir ; combien ce roseau est fragile et qu’il se brise souvent !
Pendant que le bateau courait sous voile dans la direction de l’Enfant-Perdu, je m’occupai, avec l’égoïsme particulier au passager, à me faire la place la plus commode possible. Nous avions une nuit à passer à bord et j’étais accompagnée de ma petite nièce, un enfant encore en bas âge, à laquelle je voulais épargner le plus possible les fatigues de ce voyage. Vers sept heures du soir, au moment où je prenais mes dernières dispositions, elle me fit remarquer que l’eau pénétrait dans le bateau. Les linges que nous arrangions pour notre couchage étaient mouillés. Qu’y avait-il donc, d’où venait cette eau ? Nous n’eûmes pas le temps de nous livrer à de longues interrogations ni à éprouver les agitations de la frayeur, une violente secousse nous renversa pêle-mêle, et la froide sensation de la mer nous saisissait, nous enveloppa tout à coup.
Je me sentis irrésistiblement entraînée dans les profondeurs noires de la vague. Des bourdonnements tumultueux emplissaient mes oreilles, et les battements de mon cœur semblaient arrêtés par une constriction pénible.
Dans mon jeune âge, je m’étais livrée avec passion à la nage. Je me souvins de cet exercice qui avait été autrefois pour moi un amusement et qui pouvait maintenant me sortir du pire. Un simple effort me ramena à la surface, sans même que j’eusse atteint le fond. Le spectacle qui frappa mes yeux était navrant. La nuit tombait, noire, sinistre. Plus aucune trace de bateau. Je ne distinguais que la côte lointaine et, autour de moi, des objets flottants que la lame insouciante roulait dans ses plis.
L’âpre sensation du gouffre me serrait la gorge. Vainement j’ouvrais parfois la bouche pour jeter un appel de détresse. Ce cri, dont je sentais l’inutilité, expirait sur mes lèvres sans se faire entendre. Ah ! quelle atroce angoisse que d’éprouver le vaste abandon qui vous entoure, la mer solitaire et ténébreuse, que dis-je ? la mer vivante, la mer cachant dans ses profondeurs ses monstres rapaces et terribles dont la pensée me faisait dresser les cheveux sur la tête.
Mes forces étaient affaiblies. Pour m’aider à me soutenir dans l’eau, je saisis au passage une caisse qui passait à ma portée. Il s’en exhalait une affreuse odeur de tabac. A chaque instant j’en étais suffoquée, mais je m’y tenais cramponnée avec une force désespérée. Par moment, la lame nous soulevait sur sa crête et nous roulions l’une sur l’autre dans un tourbillon d’écume.
Le ciel bas et noir s’étendait sur la mer obscure. J’étais entraînée par le courant dans ces immenses ténèbres sans savoir où j’allais. Seul, l’œil rougeâtre de l’Enfant-Perdu flamboyait dans le lointain. Il semblait une épave lumineuse flottant au hasard dans la sombre épaisseur de l’horizon. Je le voyais se déplacer, monter sur la vague et en descendre. Je croyais être immobile et le centre de ses mouvements, tandis que c’était moi que les flots, autour de lui, emportaient dans leur course éperdue.
Pas une étoile au ciel. Il régnait autour de moi une obscurité dense et pour ainsi dire saisissable.
Tout à coup le bruit d’une respiration haletante frappa mon oreille et j’entendis nager à quelques pas de moi. Mille sentiments divers me pénétrèrent à la fois. Etait-ce un secours ; était-ce, comme moi, une des tristes victimes de ce naufrage ? Je ne distinguais rien dans la nuit épaisse. La respiration s’approchait toujours avec un bruit de clapotement d’eau. Un [être ?] velu passa soudain près de moi, et un chien posa ses deux pattes sur l’épave qui m’emportait.
692
Le pauvre animal venait me demander secours, secours à moi perdue dans la mer et roulant au gré des vagues. Il poussait de petits jappements plaintifs et suppliants. Malheureusement, chaque fois qu’il s’appuyait sur la caisse de tabac, elle s’enfonçait sous cette augmentation de poids, et, ensemble, nous disparaissions sous l’eau. Que faire ? … j’hésitais à repousser ce compagnon d’infortune que le hasard venait de me donner, à lui retirer la planche de salut sur laquelle, comme moi, il était venu demander asile. Une lame survint qui nous prit et nous submergea plus profondément. La caisse de tabac, pénétrée et alourdie par l’eau, revenait plus difficilement à la surface. Je compris que j’étais perdue si je continuais à partager mon frêle radeau. Avec un incompréhensible serrement de cœur, je saisis la patte du pauvre chien. Comme s’il percevait mon intention, ses cris devinrent plus plaintifs. Ses yeux brillaient avec une telle intensité que je voyais distinctement son museau noir, sur lequel roulait une larme. Je détournai la tête, et d’une main émue, je le repoussais loin de moi. Alors ses jappements devinrent plus forts, il aboyait après moi d’une manière furieuse et en même temps suppliante. J’avais le cœur tout remué d’avoir accompli cet acte sauveur, mais barbare. Par un phénomène singulier, je continuais à distinguer clairement dans les ténèbres, jusqu’à ses moindres impressions de physionomies. Ses yeux affolés par la peur luisaient comme deux étincelles. Tout à coup il poussa un cri strident, d’un retentissement étrange. La mer, violemment remuée autour de lui, eut des mouvements tumultueux, et le chien disparut dans un remous d’écume blanche.
Les requins !!! … Eperdue, les yeux fermés, tenant dans mes bras ma caisse convulsivement serrée, je sentais au fond de mon cœur des mouvements d’angoisse et d’effarement aussi tumultueux que la surface bouillonnante où j’avais vu s’engloutir le malheureux animal. Il me semblait les voir rôder autour de moi dans les plis sombres de la lame, ces sinistres voraces alléchés par l’odeur du sang répandu et plus âpres à la curée. Avec des efforts désespérés, je cherchais à m’éloigner de ce lieu terrible, sans songer que si la nature a doué d’un appétit féroce ces grands ravageurs de la mer, elle les a doués aussi d’une vélocité extraordinaire. Je m’épuisais en élans stériles. Une faiblesse indicible s’empara de moi, et je sentis que la vie m’abandonnait.
Combien de temps dura cette défaillance ? je l’ignore. Lorsque je revins à moi, j’éprouvais une lassitude inouïe. Mes membres, endoloris, ne pouvaient aucun mouvement. J’essayais vainement d’étendre mes bras, d’étirer mes jambes. Mes muscles, racornis par un trop long séjour dans l’eau, refusaient de s’étendre. La douleur que j’éprouvais en ce moment était intolérable. Elle me traversait comme des éclairs lancinants et répétés à intervalles fixes. Chaque fois que le trait de feu pénétrait dans mon cerveau, je ne sais quel incendie il y allumait : mais ma tête semblait prête à éclater et mes yeux à jaillir de leur orbite.
Je regardais cette femme héroïque sans le savoir et j’écoutais avec étonnement les péripéties de sa lutte contre la nature sauvage et indisciplinée.
Qui donc a dit que le palétuvier était le pionner de la civilisation, qu’il allait en avant, s’implantant hardiment sur les vases à peine déposées par l’Océan et les retenant entre ses racines, comme entre les doigts d’une main consciente ? Lui, un messager du progrès, un civilisateur ! Non ! C’est l’arbre de mort qui bouche les rivages et les rend inaccessibles. C’est lui qui ferme les ports au commerce et l’abord des anses aux naufragés ; c’est lui qui étend sur les côtes du plus beau pays du monde ce rideau triste et morne qui saisit le voyageur et lui met au cœur une inexprimable tristesse. Il retient les vases, oui, mais pour en faire monter des haleines de mort, pour répandre en tous sens la putréfaction sur les ailes de la fièvre. Cette femme que j’écoutais n’avait-elle pas été prise comme une pauvre souche, dans l’horrible toile de verdure qu’il tendait sur la côte ? Quel supplice que de se traîner ainsi de racine en racine, avec de la boue jusqu’au ventre, comptant chaque pas par une lutte contre mille obstacles, chaque minute par une souffrance nouvelle.
693
Mme Gillain continua : Pendant trois jours, je poursuivis cette route incroyable. L’espoir d’atteindre promptement la rivière de Sinnamary me soutenait. J’apaisais sa soif comme je le pouvais, le matin en aspirant les gouttelettes de rosée déposées sur les feuilles et en recueillant dans mes mains la pluie lorsqu’elle tombait. C’était mes moments de fête ; mais ils étaient rares. Le charbon qui brûlait les lèvres d’Isaïe n’était pas plus ardent que celui dont je sentais le feu sombre dans ma poitrine.
La faim que jusqu’à ce moment j’éprouvais d’une manière supportable commençait à se réveiller au fond de mes entrailles. Elle me causait pourtant peu d’appréhension, car je ne pouvais tarder à atteindre le Sinnamary, où je devais trouver du secours.
Bientôt, en effet, les palétuviers s’écartèrent et j’atteignis une rivière aux eaux troubles, mais dont je ne reconnus pas l’aspect. Ce n’était pas le Sinnamary. Où donc me trouvais-je, ô mon Dieu ! Avoir marché si longtemps pour aboutir à un point inconnu ! La déception était trop grande ! Je me laissais choir de tout mon long sur le sol et je me mis à sangloter.
J’éprouvais là une prostration de force si grande que je me sentais impuissante à me relever. Il me semblait que mon corps était écrasé sous le poids d’un invisible fardeau qui collait également, mais à n’en pouvoir les détacher, chacun de mes membres au sol. Il ne me restait pas même la force mentale nécessaire pour me dégager de cette situation. Si elle avait persisté, il est inévitable que la marée en montant m’aurait reprise dans son filet d’écume. Je l’entendais rugir dans le lointain entre les racines de palétuviers ; je distinguais sa ligne blanche, vivement éclairée, qui montait sur la rampe de vase. Tout à coup, une impression galvanique pénétra dans ma poitrine. Je me levais l’œil en feu, les pensées troublées et confuses. Je sentais en moi les instincts d’une louve qui a faim et qui cherche quelqu’un sur qui se précipiter. Avec quelle joie j’aurais déchiré de mes dents une chair pantelante. Jusqu’à l’extrémité de mes ongles j’éprouvais une démangeaison de rage, mais je ne trouvais sur qui l’apaiser. Quelques crabes seulement couraient sur la vase. Je me mis à leur poursuite. Mes mouvements étaient lourds, mes yeux troublés. Combien d’efforts je dépensais en vain. Enfin je réussis à saisir un de ces crustacés. Ses pinces me déchiraient les mains sans pouvoir me faire lâcher prise. J’arrachai violemment sa coquille et j’allais avidement m’en repaître, lorsque la vue de ces pattes convulsives qui s’agitaient au hasard, me causa une impression d’horreur telle, que je laissais tomber la malheureuse bête à mes pieds.
Pendant longtemps je n’osai m’en approcher. Les mouvements s’étaient peu à peu éteints et la souffrance avait cessé. Je repris la coquille d’une main hésitante et j’essayai de m’alimenter de la graisse et des œufs de l’animal. Avec une répugnance et un écœurement indicibles, je pris l’affreuse nourriture. Elle demeurait lourde et pesante sur mon estomac, où, à mon tour, j’éprouvais des tressaillements comme ceux qui agitaient tout à l’heure les dernières convulsions du malheureux crabe.
Un peu de courage m’était revenu, j’essayais de remonter les bords de la rivière qui me barrait le passage. On sait combien une semblable route est impraticable. Que de difficultés ne présentait-elle pas à mes forces épuisées ! Mais je pouvais là rencontrer un secours. Qui sait si quelqu’embarcation ne viendrait pas s’offrir à ma vue ! J’espérais d’ailleurs trouver de l’eau potable dont j’aurais voulu, à chaque instant, désaltérer mes lèvres et dont la privation me faisait cruellement souffrir. Que de fois, marchant sous un soleil en flamme, j’appelais la pluie à mon aide pour rafraîchir ma tête embrasée, et apporter quelque répit à mes souffrances. Vaine prière ! L’astre versait sa lumière implacable sur les vastes surfaces que la mer laissait découvertes et l’immense réverbération flamboyait autour de moi. Je me traînais sur les vases brûlantes, la respiration sèche et les yeux éteints, attendant vainement qu’un nuage prît pitié de moi et m’inondât de ses eaux bienfaisantes.
Précieusement j’avais emporté la coquille du crabe dont je m’étais assouvie. À l’aide de ce récipient d’un nouveau genre, je puisais de temps en temps quelques gorgées d’eau saumâtre et je m’en désaltérais. Faible soulagement à ma détresse ! Que n’eussé-je aussi trouvé de quoi
694
apaiser ma faim ! Mais ma vue s’était tellement affaiblie que je ne distinguais plus que d’une manière confuse, et comme à travers un rêve, les crabes qui se promenaient sur la vase. Ils évitaient ma main ou fuyaient dans leurs trous. Je me trouvais dans l’impossibilité de les atteindre. C’est en poursuivant cette chasse infructueuse que j’arrivai sur le bord d’une large crique qui venait affluer à la rivière. Ma première pensée fut d’y puiser des eaux moins saumâtres. Puis je songeais à la passer. Mais je me défiais de mes forces et n’osais me jeter à la nage. A l’aide d’un bâton, j’essayai d’en sonder la profondeur. Il disparut complètement sous l’eau sans rencontrer le fond. C’aurait été folie que de se risquer dans un pareil courant. Mais que faire ? Fallait-il revenir sur mes pas, reprendre ce chemin où j’avais épuisé tout ce que la souffrance peut réserver aux forces humaines ! Je me sentais perdue dans la solitude. Un seul espace me restait, c’était de voir passer le canot de quelque habitation voisine.
Je m’asseyais dans cette inutile attente regardant les eaux couler devant moi. Le soir fini, mais sans amener la pluie. En revanche, l’air était saturé de moustiques et de mackes. Je n’en ai jamais rencontré une si formidable quantité. On eût dit qu’on m’arrosait de ces êtres vivants. Que pouvaient-ils puiser sur mon corps émacié par la faim ? Ils ne s’en acharnaient pas moins à leur proie et j’étais lacérée d’innombrables piqûres. Qu’avais-je à opposer à leur atteinte : que mon inertie. Je passais encore là une nuit douloureuse.
Pendant trois jours je restai sur le bord de cette crique, attendant la venue de quelque canot. L’eau que je puisais aux marées basses me désaltérait et me faisait oublier ma faim. Enfin, lasse de ne rien voir venir, je me décidai à rebrousser chemin. Cette résolution me fut pénible à prendre. Tout mon être, affaibli par de si longues privations, était tombé dans une atonie profonde. Mes yeux ne voyaient plus. Je marchais dans une sorte de rêve qui n’était pas le sommeil, mais qui y ressemblait par la confusion de mes idées et l’engourdissement de mon corps. J’avançais au hasard, comme un aveugle qui a perdu son guide. Rarement je faisais plus qu’un quart de lieu par jour, tant la voie que je suivais était hérissée d’obstacles, semée de difficultés. Je la suivais d’une manière inconsciente, obéissant sans le savoir à l’instinct de la vie qui me guidait à travers le vert dédale des palétuviers.
Qui n’aurait eu pitié de cette pauvre créature qui se traînait ainsi le long d’un rivage impraticable, épuisée de souffrance et loin de tout secours. La nature, elle, restait inflexible dans son hostilité. Elle semblait, au contraire, s’acharner sur moi avec une espèce de persistance et de rage. Elle promenait au ciel un soleil de feu, et la nuit, elle me refusait la pluie qui m’avait tant soulagée les premiers jours.
A chaque pas je rencontrais maintenant des épaves provenant du naufrage dont j’avais été victime. Des barils, des caisses étaient çà et là disséminés sur la côte. J’essayai de les défoncer, mais aucune ne contenait des vivres. N’était-ce pas une ironie de la mer de placer ainsi à ma portée tant d’épaves dont je ne pouvais tirer aucun parti ?
Un jour, j’aperçus dans les palétuviers une malle défoncée. Je m’en approchai et je reconnus celle qui renfermait mes effets. Elle était intacte quoique mouillée et bouleversée. J’y retrouvais même mes madras, mes bijoux et une somme de 65 francs attachée dans un mouchoir. J’emportai avec moi ces objets précieux, trop faible pour m’occuper du reste. Un peu de nourriture m’aurait paru préférable à l’or que le hasard me rendait, tout en me disputant les restes d’une vie à moitié éteinte.
Ainsi se poursuivait ce pénible voyage durant lequel j’appelais vingt fois la mort pour me délivrer de mes tortures. Aussi je me traînais pendant de longues journées le long des palétuviers de Macouria, mourante de faim et consumée par la soif. Oh ! mon Dieu, m’écriai-je, délivrez-moi enfin de tant de souffrances. Faites que demain matin je ne me réveille pas ! Fermez tout à fait mes yeux à cette triste lumière du jour dont j’ai déjà tant souffert. A quoi sert de disputer plus longtemps une existence qui semble condamnée ? A quoi sert de la traîner encore de misère en misère. Ayez pitié de moi, mon Dieu, voyez mon corps décharné, mes membres couverts de plaie, mon [épiderme ?] devenue noire comme si j’avais été meurtrie de
695
coups ! Me ferez-vous souffrir plus longtemps. Prolongerez-vous plus longtemps ce martyre sans nom que nul ne connaîtra jamais. Il n’y aura d’autre témoin que ces lieux déserts et insensibles ! Je ne vous demande plus de me sauver, mon Dieu ! J’en ai […] l’espoir, mais hâtez, je vous en conjure, la fin de mon supplice…
Je levais mes mains vers le ciel et des sanglots remplissaient ma voix. De ces aspirations ardentes vers la mort, j’éprouvais je ne sais quel funèbre soulagement et je reprenais cette route [...] et désolée qui ne semblait jamais devoir finir. Par moments, ma faiblesse était si grande, j’étais si exténuée, que je ne pouvais plus avancer qu’en me traînant sur mes genoux. L’état misérable où j’en étais réduite de ne pouvoir plus rester debout et d’être obligée de ramper comme un ver.
J’avais un voile épais devant les yeux qui me permettait de [bouger] à peine à quelques pas de moi. Etais-je bien sûre de […] que j’avais suivie ? Mille angoisses m’assaillaient. En même temps que mon corps éprouvait l’altération ardente de la soif, ma pensée éprouvait la sombre altération de la mort. Je pensai à en finir. Assise sur le bord d’une crevasse qui [jetait] dans la mer les eaux limoneuses de la savane, je regardais avec une envie sinistre la rapidité du courant et j’aurais voulu être entraînée avec lui. Que le soir était sombre ! Il me semblait que le ciel tendait autour de moi des tentures noires et funéraires. Pour quelle cérémonie funèbre l’orage allumait-il ses flambeaux, sur quel cadavre la voix lugubre du tonnerre officiait dans le lointain ?
Nuit de deuil ! J’avais conscience que c’était la dernière que j’allais souffrir. Au milieu du courant se trouvait un amas de broussailles et de débris sur lequel je m’étendis comme sur une sorte de lit funéraire. Mes yeux ne pouvaient se fermer. La rumeur de la marée emplissait l’étendue. Son bruit rauque dominait par moment le tonnerre : j’éprouvais une joie terrible de pouvoir mourir enfin emportée comme une de ces feuilles d’arbre que le vent arrachait autour de moi.
Toute la nuit fut pleine des gémissements de la nature. Parfois ces clameurs, ces cris, ces soupirs, les détonations de la foudre, les rafales du vent, le crépitement de la pluie, l’assourdissement de la marée se mêlaient confusément ensemble et je croyais reconnaître, mais grandi dans des proportions considérables, la voix du pauvre chien que j’avais repoussé de mon radeau et que j’avais sacrifié pour me sauver. Comme je regrettais maintenant de n’avoir pas partagé son sort. Il aboyait furieusement après moi et je revoyais distinctement sa tête éclairée par ses yeux étincelants et tristes.
Vainement je plaçais mes mains sur mon visage pour chasser cette image, j’entendais toujours son hurlement lamentable et je distinguais toujours distinctement le museau plaintif du pauvre animal.
Pendant que cette hallucination me poursuivait de ses images sinistres, je sentais le lit de broussailles sur lequel j’étais couchée se soulever par soubresauts étranges. Sur quel fond reposait-il donc ? Ce n’était pas le courant qui lui imprimait ces oscillations en quelque sorte vivantes. Qu’était-ce alors ? L’idée que quelque énorme couleuvre pouvait être là, sous moi, me remplit d’une horrible angoisse. J’appelais tout à l’heure la mort, mais la mort sous cet aspect me paraissait hideuse. Il me semblait éprouver le froid de son étreinte visqueuse, voir sa gueule enflammée s’avancer vers moi, et je retenais à peine sur mes lèvres les cris de terreur prêts à en jaillir. Pour échapper à toutes ces horreurs, aux images affreuses qui me poursuivaient, je m’enveloppais la tête comme un enfant peureux et j’attendis dans les transes.
C’est à ce moment qu’une voix rude m’interpella : Qu’est-ce que tu fais ici paresseux ? Tu as quitté ton placer pour venir marronner ici… ? Etait-ce toujours un rêve ? Cette voix que j’entendais avec un indicible plaisir, était-ce
bien une voix humaine. Je me levais sur mon séant et je lui dis : Je suis une naufragée
696
D’Evariste ? me répondit-il vivement. Mes lèvres articulaient difficilement, je lui dis : oui. Vous êtes Madame Gillain, alors. Oui, continuai-je en répondant toujours par monosyllabes. Pauvre Madame Gillain ! Attendez, je viens vous chercher… J’entendis le choc d’un sabre d’abattis sur les branches et les racines de palétuviers et je
compris que la personne qui m’avait interpellée cherchait à se frayer un chemin vers moi. Il lui fallut de longs efforts pour y réussir. Elle parvint enfin sur le bord de la crevasse et m’aida à sortir de l’îlot de branches sèches sur lequel j’avais passé la nuit.
Je me développais alors la tête et à l’aspect de ma figure couturée et complètement noire, il ne put retenir un cri d’étonnement et de pitié.
A mon tour, je levais mes yeux sur lui et je reconnus M. Romieu, le commissaire-commandant de Macouria.
Je suis bien faible, lui dis-je, et j’ai bien faim. N’avez-vous rien à me donner à manger ? Rien ici, mais mon frère est là à quelques pas, avec son canot. Nous y trouverons sans
doute ce qu’il vous faut. J’essayais de marcher, mais tous mes membres étaient contournés et tordus, mes pieds
déchiquetés par les crabes. M. Romieu, sur lequel mon état d’épuisement, les tristes haillons dont j’étais couverte, la vase qui me souillait, faisait une impression pénible, se hâta d’appeler ses compagnons de chasse et je fus, avec toutes les précautions possibles, portée vers leur canot.
C’était là la fin de mes aventures. Pendant vingt-quatre jours, je suis restée sans prendre d’autre nourriture qu’un crabe cru dont j’ai eu horreur et que je n’ai pu achever. On doutera du fait, mais je l’affirme devant Dieu.
En me parlant ainsi, Mme Gillain était sincère et convaincue. Son récit m’avait ému et je la contemplais avec une sorte de vénération.
Puissé-je être assez heureux pour communiquer cette émotion à mon lecteur, pour ne pas tomber dans la monotonie, conséquence fatale d’une situation toujours la même et des mêmes émotions toujours répétées.
A. Ralu fils, « Les Fastes de l’histoire des Antilles », Les Antilles, 16 février 1876, troisième page
Marie d’Orange Il faut convenir d’une chose, c’est que les Colonies sont bien peu reconnaissantes envers
leurs grands hommes ; envers leurs héros, ou envers leurs enfants d’adoption. Est-ce parce que le nombre en est trop grand ? La phalange est trop serrée, que l’on ne
saurait à qui donner la palme ? J’aime à le croire ; car ces terres de feu au sein desquelles la lave bouillonne, ont toujours produits les grands dévouements, les grands cœurs, et les actions d’éclat.
La Martinique, cette petite île dont les bords fleuris resplendissent au soleil comme un diamant, dont les montagnes sous les rayons nacrés de la lune ressemblent à des perles, n’a-t-elle pas son héroïne ? sa Jeanne Hachette ? tout comme la grande patrie dont elle est la fille d’adoption ?
Oh oui ! Le Martinique peut revendiquer cette palme parmi toutes les Antilles, comme la terre qui a produit le plus de héros et de dévouement : c’est elle à juste titre qui doit porter la couronne comme reine des Antilles.
Voyez les Annales. Lisez le père Dutertre. Fouillez l’histoire, et vous la verrez toujours sanglante, présenter sa poitrine nue à l’ennemi, en criant : Victoire !
Victoire ! au nom de la France. Victoire ! au nom de l’honneur et du dévouement. Victoire ! toujours victoire.
697
Demandez aux Anglais, aux Hollandais, aux Espagnols ce que la Martinique leur a coûté d’or et de sang.
Demandez à la vague tandis qu’elle berce la pirogue, combien d’ossements ennemis ont blanchi sur nos plages ?
Demandez aux roches, à ces noires sentinelles, combien on a enfoui de cadavres à leurs pieds !
Demandez même à l’arbre, au palmiste centenaire, à l’acajou superbe, qui s’élève vers le ciel, combien ils ont vu d’hommes mourir sous leurs ombrages ?
Et toujours, diront-ils, les créoles furent des lions : la Victoire fut à eux. Ah Martinique chérie ! Martinique ! ma patrie ! toi qui fus toujours la citadelle avancée,
le refuge de l’honneur, sois bénie ! Même les femmes, dans ce temps, se battaient comme des lionnes : Marie d’Orange en
est la preuve. Qui donc est Marie d’Orange ? Une femme du peuple, la femme d’un canonnier. Etait-elle esclave ou libre ? Noire ou de couleur ? Qu’importe ! L’héroïsme n’a pas de couleur, l’héroïsme est sacré ! Et qu’a-t-elle fait ? Ce qu’elle a fait… je vais vous l’apprendre : Le 29 juin 1667, le chevalier Harmant, commandant l’armée navale d’Angleterre, venait
à la portée du canon reconnaître le mouillage de nos vaisseaux ; il avait appris par un certain Lombardon, corsaire, que la flotte française arrivée à la Martinique dans le plus grand désordre, manquait entièrement de poudre.
Sûr de la victoire, le chevalier Harmant avait juré d’hiberner au Fort-Royal, après avoir pris le carénage.
De Loubières, lieutenant du roi à la Martinique, avait fait prévenir de suite de la Barre et Clodoré, qui faisaient une tournée à la Cabes-Terre de cette île, que l’ennemi était en vue. Aussitôt leur arrivée ils firent chanter un Te deum, et les troupes tant royales que coloniales se disposèrent au combat.
Trois fois la flotte anglais essaya de pénétrer dans le port, trois fois elle fut repoussée victorieusement.
Enfin, le 6 juillet 1667, favorisée par la brise, elle fondit de nouveau, toutes voiles dehors, sur la rade de Saint-Pierre.
Le combat engagé de part et d’autre durait déjà depuis cinq heures, avec un acharnement sans égal, quand un brûlot anglais, se détachant de la flotte ennemie, accrocha un de nos navires commandé par le capitaine d’Elbée. Ce vaisseau armé de 38 pièces de canon, ainsi que plusieurs autres, furent la proie des flammes.
Cet incident jeta l’alarme parmi nos matelots, et persuadés que tous les vaisseaux allaient être incendiés, ils les abandonnèrent cherchant leur salut dans la fuite.
Le vent changea, et la flotte française fut sauvée. Mais durant ce désarroi, une frégate anglaise était parvenue à s’embosser assez près de la batterie Saint-Sébastien où se tenait le Gouverneur, la lutte recommença plus terrible que jamais.
Que faire ? Il ne restait que quelques artilleurs aux pièces. Le feu ennemi avait moissonné la plupart de ses défenseurs, et devant une mort certaine, chacun s’enfuyait terrifié.
Déjà la batterie ne répondait plus. De la Barre, fou de rage, sentait tout l’imprudence de l’ordre qu’il avait donné aux navires de rester à Saint-Pierre.
Encore quelques instants, et c’en est fait de nous. Les Anglais poussent des hurrahs frénétiques, déjà ils crient… Victoire !
La batterie est battue en brèche, l’assaut va se donner. Victoire ! … Non ?
698
Car en ce moment apparaît une femme, les cheveux épars, la figure noire de poudre, criant : Vive la France ! Sus aux ennemis !!!!
Cette femme, c’est Marie d’Orange ! Cette femme… c’est notre héroïne ! Durant deux heures, elle tint ferme, fournissant courageusement cartouches et boulets,
rampant jusqu’aux canons, à travers les morts, sans s’étonner aucunement ni du fracas de la mousqueterie, ni du massacre que fait le feu ennemi.
Durant deux heures, elle ne baissa jamais la tête devant les milliers de boulets qui la menaçaient, donnant ainsi un grand exemple d’héroïsme et de dévouement, qui sauva en partie la flotte française, et lui assura plus tard la victoire !
Eh bien ! oui, la voilà cette Marie d’Orange ! cette femme du peuple pour laquelle je demande une statue, la voilà cette nouvelle Jeanne Hachette, montrant aux hommes le chemin de la bravoure.
Eh quoi ! l’impératrice Joséphine a sa statue à Fort-de-France, et il sera dit que l’héroïne de Saint-Pierre n’aura pas un souvenir, une marque d’admiration de ses concitoyens !
Allons donc ! le granit ne manque pas dans notre île, et un simple bloc taillé en citadelle, avec une pièce de canon auprès de laquelle se tient une femme les cheveux épars, les traits contractés, le regard étincelant de courage, ne peut-il s’ériger ?
Oh ! réparons l’oubli. Réparons l’injustice, j’en appelle aux femmes créoles, à ces descendants de cette grande famille de héros, qui ont su conserver sous les grâces féminines la virilité de leurs aïeux, pour élever à Marie d’Orange cette statue qui lui est due.
Et qu’ici on ne me parle point de parti ni de couleur, car le drapeau porte… héroïsme ! et le vainqueur… est une femme !
A. Ralu fils
F. Ratte, « Sentiers canaques. De Gomen à la côte Est (Nord de la Nouvelle-Calédonie) », Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 13 novembre 1878, deuxième page (extraits)
Lorsqu’on n’a pas sous la main le personnel nécessaire, il en résulte souvent une grande perte de temps dont il faut tenir compte dans les projets d’itinéraire.
De notre campement, situé au pied et à l’Ouest du mont Ouazangou, il faut presque deux heures pour se rendre au village du chef, à Ouemba ; les canaques qui passaient de temps à autre et auxquels nous avions demandé des guides et des porteurs, nous avaient fait défaut ; il nous fallut donc envoyer José, mon interprète canaque, à Ouemba, ce qui nous fit perdre un jour. Or nous avions projeté, M. B… et moi, de nous rendre à Galarinou, en passant par la tribu de Pouanloït, ce qui eût peut-être un peu allongé notre voyage, mais nous eût fait connaître des points intéressants. Depuis longtemps déjà on y avait, disait-on, trouvé la couleur de l’or, et j’avais la perspective de pouvoir constater au S.-E. des monts Taom la continuation de la chaîne calcaire qui commence, dans le Nord, à la roche Mauprat. […]
Ayant ainsi esquissé les traits principaux de notre itinéraire, nous pouvons maintenant le partager en quatre tronçons distincts, dont les points de division seront situés sur les lignes de crêtes des montagnes qui séparent les différents bassins hydrographiques, autrement dit, sur les lignes de partage des eaux. […]
Lorsque du mouillage de Gomen on regarde sur la droite des Monts Kaala en suivant des yeux les crêtes qui forment un rideau dans le fond de Gomen, on aperçoit une montagne qui présente la silhouette d’un éléphant ; les canaques donnent à cette montagne le nom de Tchiongopau. Or, s’il est bon de conserver les noms indigènes lorsqu’ils sont harmonieux et faciles à retenir, celui-ci ne nous paraît pas dans ce cas. […]
Je m’étais proposé de relater un voyage de Gomen à Galarinou, et voilà que nous sommes sur le point de passer le col du Cou-Iri pour descendre vers Hyenghène par la vallée
699
de Puyembenq ; il n’y a qu’un instant, n’étions-nous pas menacés de voir défiler sous nos yeux tous les noms canaques des montagnes qui dominent la rive gauche du Diahot, depuis les Pamboas jusqu’à la pointe nord de la Nouvelle-Calédonie ?
Mais nous n’abuserons pas de la patience du lecteur, car, en ce qui concerne la géographie de la colonie, il est plus aisé de pécher par défaut que par excès, aussi prions-nous les personnes qui relèveraient quelques inexactitudes dans ces notes de nous faire part de leurs observations afin de nous permettre de rectifier ce qu’un premier aperçu peut présenter de trop confus.
Nous n’insisterons pas sur ces mille détails d’un voyage dans la brousse qui frappent l’imagination du citadin et qui ne gagnent qu’à être dits avec entrain ou décrits avec art, ou bien sont du domaine de l’ethnographie et alors demandent à être exposés avec méthode et interprétés avec une connaissance approfondie de la question.
Vous dirais-je que plusieurs de nos canaques ont la tête ornée du tabou traditionnel en signe de deuil ; qu’ils se noircissent la poitrine ou se teignent les cheveux pour s’amuser ou se parer ; que celui-ci est le plus adroit à la fronde, celui-ci à la sagaie ; que ce grand hercule porte au milieu du front la cicatrice profonde d’un coup de pierre ; que l’habileté de ce vieux à sculpter le bois est connue des tribus de la côte à dix lieues à la ronde ?
Vous décrirais-je ces jeunes filles et ces vieilles décrépites ployant sous de lourds fardeaux de racines, de cannes ou de fagots, ces foyers où le soir chaque famille se réunit pour manger le taro ou l’igname et se raconter bien avant dans la nuit les événements du jour ?
Vous montrerais-je leurs cases construites avec soin et ornées de sculptures grotesques mais pleines d’originalité ? Quelques-unes de leurs habitations ont de vraies portes et ferment au cadenas. Je ne vous apprendrai pas que leurs présents ou leurs services se paient en monnaie d’argent, en pièces de cinq francs qu’ils appellent dollars ou en objets d’échange.
Vous sauriez peut-être, si j’ajoute que les camarons que l’on pêche dans les ruisseaux de l’intérieur ont fréquemment le corps gros comme un œuf de poule et les pattes grosses comme des tuyaux de pipes, que la sauterelle rôtie dans une feuille de bananier constitue un mets estimé des canaques, que ceux-ci sont très friands des entrailles de poissons noircies par la fumée.
Comme nous l’avons dit, ces régions sont essentiellement montagneuses ; à partir d’une certaine altitude, les cocotiers deviennent très rares ; à Pangou, je ne me rappelle pas en avoir vu, à Coungnha non plus. […]
Lorsque je passai par là, le 7 janvier 1877, j’avais pour guide un homme de Tamac, qui ne négligerait pas de me faire noter tous les endroits remarquables : un trou, une roche, une place, tout avait son nom, mais je vous en fais grâce, car, de ces noms, il y en a que je n’ai pu transcrire avec moins de dix-huit ou dix-neuf lettres.
Toujours plein de zèle, mon guide m’arrêta dans la forêt, au milieu du col, et, me montrant une pierre, il me dit : « C’est Caourraouk, la pierre qui a crié ». Il y a des années Coungnha était en guerre avec Hyenghène à propos d’un enlèvement ; pendant le combat, un cri s’éleva dans la montagne, les canaques de Coungnha comprirent qu’ils n’étaient pas les plus forts et l’on cessa les hostilités ; c’était la pierre qui avait jeté ce cri, voilà ce que dit la légende. C’est là un procédé ingénieux pour sauvegarder devant l’histoire la responsabilité du chef qui a enterré la sagaie dans le sentier de la paix.
Mais ne quittons pas le lit de la Téadja. Lorsque l’on considère dans son ensemble cette immense crevasse et les parois rocheuses qui en forment le fond et les bords, on est frappé de l’uniformité qui règne dans la direction des fissures et des clivages naturels de la roche, et l’on est conduit à admettre que les convulsions géologiques ont dû contribuer pour une forte part à sa formation en déterminant dans le principe une grande fracture que le courant des eaux a sans cesse agrandie dans la suite des âges, arrachant des flancs de la montagne de gigantesques blocs pour les pulvériser dans ses flots.
700
[…] Lorsque nous passâmes là, en juillet 1877, nos guides de Gomen nous baptisèrent des
noms de Sandamaris et Sandamas ces deux excavations dans lesquelles le mouvement de l’eau se manifeste de façons si différentes, l’une si profonde et si terrifiante, l’autre si pure et si calme. L’un de nos canaques nous conta cette courte légende : Deux tayos tombèrent dans ces trous ; celui qui tomba dans le gouffre disparut pour toujours, l’autre revint à la surface et fut sauvé.
Un touriste, en Nouvelle-Calédonie, ne serait pas embarrassé pour noircir ses tablettes ; un peintre remplirait sans peine, les pages de ses albums ; il trouverait en maints endroits ce caractère imposant et sauvage que les roches impriment aux sites montagneux ; ces oppositions de teintes qui animent le paysage, ces anfractuosités sombres et ces fouillis impénétrables qui font mieux ressortir les parties éclairées, mais s’il aime à varier ses sujets, il lui faudra souvent abandonner les gorges resserrées et les vallées étroites, les ruisseaux encaissés et leurs tumultueuses cascades et transporter son point de vue sur les flancs ou sur les hauteurs des montagnes. De là il découvrira un horizon plus vaste ; à ses pieds s’écouleront les eaux des torrents, des rivières serpentant à travers ces petites chaînes schisteuses qu’elles ont découpées, ou ramant au bas des énormes massifs qu’elles usent constamment, mais sans pouvoir les traverser, sans qu’il leur soit jamais permis de changer leur cours limité par ces solides barrières. Du faîte de ces montagnes le touriste embrassera le vaste panorama des chaînes dont les sommets élevés couverts de nuages se déroberont malheureusement trop souvent à sa vue ; que l’on nous permette donc quelques étapes. Des hauteurs de Ouarou nous voyons devant nous sur la droite, le Kagalé dont les deux extrémités forment deux cornes et sont réunies par une ligne presque droite. […]
Moyoma, chef de la tribu, est un homme de quarante à quarante-cinq ans ; il est assez laid, mais ses yeux sont intelligents ; il use de manières polies et d’un certain cérémonial que je n’ai pas remarqué chez d’autres chefs. […]
D’ailleurs, dans ces notes, j’ai eu pour objectif principal de donner, au point de vue physique, une simple esquisse d’une des parties les moins explorées de la Nouvelle-Calédonie, c’est une reconnaissance rapide qui comporte encore bien des points douteux. Espérons que ces lacunes seront bientôt comblées par un levé général de toute la colonie, à une échelle suffisante pour que ce levé soit utile à tous les points de vue.
X., « À Papoa (communiqué) », Le Messager de Tahiti, 27 décembre 1878, deuxième page Connaissez-vous Anani ? C’est un bien digne garçon, mutoi par goût, fainéant par
tempérament, musicien par occasion. Voyez-le étalant sa nonchalante personne à l’ombre d’un manguier quelconque et fredonnant un de ces airs tahitiens dont le rythme s’accorde parfaitement avec la pensée qui le domine, ne rien faire ! Et pourtant, il m’a rendu un fameux service hier : il a empêché ma cervelle de bouillir dans son enveloppe, ce qui m’a permis de prendre part aux joies qu’une table bien garnie offre aux gourmands.
Eh ! oui, je suis gourmand. Est-ce un défaut, une qualité ? Je laisse aux soi-disant sages le soin de la discussion, et je crois que si, pour tenter saint Antoine, le malin esprit s’était servi d’une dinde truffée ou même d’un simple poisson du lac Moorea avec une bonne mayonnaise, il eût peut-être réussi. Cette petite digression achevée, commençons.
S.M. Pomaré V avait convié pour le soir de Noël le commandant de la colonie et quelques amis à pendre la crémaillère à une petite maison de campagne qu’il a fait construire à Papaoa au bord de la mer. Une table de cinquante couverts, placée sous une de ces cases légères et gracieuses dans la construction desquelles excellent les Tahitiens, attendait les invités, tandis que les himene de Piare et d’Arue se préparaient aussi à faire honneur aux mets qui leur avaient été réservés. A notre arrivée, nous sommes reçus par le Roi, qui, joyeux et souriant, nous souhaite la bienvenue ; nous saluons le Commandant, et nous allons présenter nos respects à la Reine, dont la présence et celle de la princesse Tamatoa embellissaient cette petite réunion.
701
Vers 6 heures, le Commandant, donnant le bras à la Reine, se dirige vers la salle à manger et chacun de suivre et de prendre sa place. Nous remarquons parmi les convives le directeur des affaires indigènes, le chef du service de santé, l’aide de camp, la secrétaire archiviste, des notables, quelques chefs et toohitu et… mon voisin d’en face, qui reste en extase devant les bonnes choses qui couvrent la table, dont la stupéfaction augmente lorsqu’un indiscret lui assure que douze plats doivent se succéder, et qui finit par m’affirmer que s’il ne peut tout manger il mettra dans ses poches. Je veux lui faire comprendre que le procédé ne serait pas très délicat, mais comme je m’exprime en français et lui en un sabir quelconque, je ne sais si je réussis à le convaincre.
Ah ! coquin de soleil, je le reçois en plein sur la tempe gauche et je crois que sous l’action de ses rayons mon cerveau, déjà peu solide, finit par se détraquer tout à fait. De drôles d’idées me passent par la tête : je me souviens avoir lu jadis que certains rois invitaient à leur table ceux dont ils voulaient se défaire, et c’est avec terreur que je vois un des teuteu arii me présenter le premier plat. Heureusement qu’Anani a vu le danger que court ma pauvre tête ; grâce à une toile, mon occiput est protégé, mes idées reprennent leur lucidité et je puis faire honneur à toutes les bonnes choses.
Ariipaea, chef honoraire de Pare, se lève, et dans quelques paroles senties souhaite la bienvenue aux amis du Roi qui ont bien voulu accepter son invitation. Un vieillard, parlant au nom des indigènes présents, dit qu’eux aussi ont voulu prendre part à cette petite fête et que c’est pour cela qu’ils ont préparé des tables près de celle du Roi. Puis la conversation s’engage entre voisins ; la gaieté paraît sur tous les visages et on fait honneur aux plats qui se succèdent, ainsi qu’aux différents vins. Mon voisin d’en face s’en tire à merveille ; son assiette est toujours vide, son verre toujours à sec, et je prévois que s’il doit retourner à pied à Papeete, il aura fort à faire.
Vers le milieu du repas commencent les « himene », le plaisir du Tahitien. Anani, toujours à son poste, fredonne un accompagnement en battant la mesure de la tête ; il semble attendre impatiemment le moment où nous quitterons la table pour prendre notre place et se délecter à son tour. Le champagne pétille : le Commandant porte un toast au Roi ; Ariipeu, chef d’Arue, au nom du Roi, répond au Commandant ; les hurrahs retentissent, et mon voisin d’en face perd l’équilibre.
Le café est servi dans le salon de la nouvelle maison ; chacun s’y rend, et du haut de la véranda écoute la « Marseillaise », chantée par l’himene du district d’Arue, le lauréat du dernier concours pour les chants français.
La soirée s’avance ; chacun fait ses préparatifs de départ, et nous prenons congé de notre royal hôte en le remerciant du moment agréable qu’il nous a procuré.
Alexandre Dumas et La France algérienne : comparaison Comparaison des extraits : texte paru dans La France algérienne du 10 septembre 1845,
et extrait du Véloce, voyage fait entre novembre 1846 et janvier 1847, publié en 1848. C’est un hardi Bédouin que Bou-Maza, ce chériff infatigable, qui a su mettre en émoi
les tribus des cercles d’Orléanville, de Ténez et d’autres points, où son nom, inconnu jusqu’à ce jour, pénètre et se familiarise au moyen de cette prodigieuse influence que la superstition, le merveilleux et certains dons physiques, donneront toujours aux aventuriers qui voudront exploiter les passions arabes.
Bou-Maza est jeune encore ; sa taille est imposante ; sa physionomie expressive et régulière ; il parle avec une remarquable facilité ; sa bravoure, son activité sont maintenant justement appréciées. Enfin son ascendant sur les Arabes (ceux avec lesquels il a eu le temps d’être quelque peu en contact), est, dit-on, décisif ; les femmes même se passionnent pour lui,
702
et elles poussent à la guerre leur maris, leurs enfants et leurs frères au nom de ce brillant chérif, qui est trop beau, pensent-elles, pour ne pas être un pur descendant de Mahomet.
On le voit, Bou-Maza est un Abd-el-Kader au petit pied, et il attend que les événements l’élèvent aussi haut que son modèle. Mais il attendra indéfiniment, car la guerre incessante que lui font nos troupes fera bien certainement justice de son pouvoir nouveau. Il ne serait devenir redoutable pour nous que s’il était en quelque sorte encouragé ainsi qu’Abd-el-Kader le fût le 24 février 1834, par le traité du général Desmichels ; ce traité faisait à l’émir des concessions que le Maréchal Bugeaud se gardera bien de faire à ses successeurs. Du reste, les populations sur lesquelles pèse l’autorité de Bou-Maza commencent à s’apercevoir qu’il ne leur a donné en échange de leur crédulité qu’une perpétuelle agitation et toutes les cruelles conséquences d’une guerre dévastatrice.
Ce n’est donc pas au point de vue de l’avenir de ce chef que nous parlons de lui ; son règne, que nous croyons éphémère, touche à sa fin ; et, si nous nous occupons ici de ce hardi partisan, ce n’est qu’en forme d’exorde à certains épisodes qui nous ont paru intéressans.
On sait que depuis plus de deux mois des poursuites incessantes sont dirigées contre Bou-Maza ; mais, véritable Protée, il change sinon de forme, du moins de tactique, d’allure, de moyens d’attaque et de défense. Ainsi aujourd’hui, à la tête de 200 cavaliers, il rase impitoyablement telle tribu qui la veille s’est soumise à nos troupes ; le lendemain, vivement poursuivi par nos colonnes, il disperse ses bandes, et on l’aperçoit fuyant suivi seulement de cinq ou six fidèles. Un instant, pareil à un fantôme, on le voit seul sur la crête des plus hautes collines ; là, il fait une halte fantastique, se drape dans son burnous, jette un long regard sur ses ardens ennemis, puis s’évanouit comme une ombre. On le croit alors à bout de ruses, on le proclame anéanti, on le crie bien haute, on l’écrit même ; et peu de jours après, des tribus lointaines se soulèvent au nom de Bou-Maza ; de nouvelles ghazias sont insolemment consommées, et l’incendie, attisé par lui, s’élève aux portes de nos villes.
Le fantôme a donc reparu ; nos colonnes se remettent en campagne ; on court dans sa direction, on l’aperçoit encore, on se le montre du doigt ; on se dit : c’est lui, le voilà, je reconnais le cheval qu’il monte et qui a été volé à un de nos capitaines ; hourra ! nous le tenons : la charge sonne, chasseurs, spahis et goum, se précipitent, franchissant les ravins, les vallées et les collines ; les chevaux sont sur les dents ; nos cavaliers enragent ; mais comme Satan, Bou-Maza pousse un infernal éclat de rire, et disparaît encore comme par magie. C’est donc à recommencer.
Écoutons maintenant un officier du 4ème chasseur d’Afrique, qui a eu, lui, l’heureux privilège de voir de très-près l’insaisissable chériff :
C’était le 14 août ; notre cavalerie venait de faire une longue et difficile marche de nuit ; au point du jour elle couronnait toutes les hauteurs du littoral à l’ouest de Ténez, près de l’île des Colombes. Bou-Maza fuyait devant nous et nous apercevions ses cavaliers se sauvant dans toutes les directions. La charge est ordonnée ; nos chasseurs et spahis, obéissant au commandement énergique du commandant d’Allonville, se portent en avant de toute la vitesse de leurs chevaux, et alors nous jouissons du spectacle chevaleresque de plusieurs charges individuelles suivies de maints combats singuliers dignes des temps les plus héroïques de notre histoire militaire. Bientôt ce fut une sorte de fantasia ardente, échevelée, sans frein, où les plus braves durent faire assaut de vigueur et d’audace, dans le double but de la gloire et de l’esprit de conservation, deux mobiles également recommandables. Mais cette fois encore Bou-Maza disparut à nos regards…
Parmi nos alliés indigènes, était le jeune Ali, fils de l’aga Adji-Achmet. Il chargeait les cavaliers du chériff avec un élan remarquable ; tout-à-coup il arrête court son cheval, et nous le voyons considérer attentivement certain objet qui bientôt paraît l’absorber profondément : c’était sa jeune sœur qu’il venait de reconnaître ; sa sœur Fatma enlevée peu de jours avant par Bou-Maza ; elle était mêlée à la troupe du chériff et fuyait entraînée par ses ravisseurs. Ali était
703
supérieurement monté ; en quelques minutes il eût rejoint sa sœur que venaient d’abandonner les cavaliers de Bou-Maza. Fatma ! Fatma ! cria le fils d’Achmet ; et Fatma, à la voix chérie de son frère, s’arrête soudain ; l’intrépide Ali court à elle, l’enlève dans ses bras nerveux et la place en croupe derrière lui ; puis il veut poursuivre sa course aventureuse ; mais de côté l’ennemi est en pleine déroute. Ali calme l’ardeur de son bon cheval ; il s’arrête encore, et, tout entier à la joie de cette touchante réunion, il échange avec sa sœur de tendres caresses.
Vers la droite du point où cette scène se passait, un curieux épisode signalait aussi la charge bruyante des spahis. Un indigène de ce corps, jeune encore, d’une physionomie vigoureusement dessinée, mais portant l’empreinte d’une tristesse profonde à laquelle se mêlaient quelques éclairs de colère furieuse ou de haine implacable, allait devant lui en aveugle. Kadour (c’était son nom) labourait sans pitié avec ses éperons pointus les flancs de sa monture ; il l’animait de la voix et du geste, et le noble animal, bondissant sous son cavalier, courait en avant, effleurant à peine sous ses pieds les palmiers nains qui couvraient le sol. Il y avait plaisir à voir ce fier spahis bravant ainsi tous les périls d’une charge audacieuse ; chacun de nous admirait son élan, sa bravoure ; et pourtant un mobile qui lui était tout personnel, une de ces causes que certains esprits chagrins ou blasés regardent comme secondaire ou puérile : l’amour, ce sentiment inexplicable, source de pures jouissances ou de cruelles angoisses, l’amour enfin qui tour-à-tour poétise ou flétrit la vie, était le motif puissant qui exaltait ainsi le vaillant spahis.
Peu de jours avant, Kadour avait épousé la jeune Saïda, ardente brune aux grands yeux noirs, Saïda la voluptueuse, qu’il aimait d’amour et qui répondait à ses transports avec toute l’énergie d’une âme africaine. Or Saïda, cette fleur du désert, à peine épanouie au souffle brûlant des caresses conjugales, lui avait été enlevée par le terrible Bou-Maza et c’était elle qu’il cherchait, lorsque cédant à son ardeur on le voyait charger en insensé les soldats du chériff. Cependant aussi heureux qu’Ali, Kadour aperçut au loin un cavalier bédouin emportant en croupe une jeune femme ; l’œil flamboyant du spahis reconnut cette femme, c’était la sienne, c’était Saïda. Alors vous eussiez vu le cheval de Kadour se cabrer violemment sous la pression de son maître, puis, par un bond prodigieux, se précipiter en avant avec l’agilité du daim, et un clin d’œil rejoindre le Bédouin ravisseur. A ce moment, je vous le jure, la physionomie du spahis était vraiment belle à voir : on pouvait facilement distinguer sur ses traits mobiles toutes les passions de son âme : le désir de la vengeance, la joie de retrouver sa femme bien-aimée, les tortures de la jalousie, les émotions du combat, s’y peignaient tour à tour. Aussi vite qu’un mot est dit, Kadour se rua sur son ennemi ; celui-ci ne put regarder sans pâlir ce visage effrayant d’expression ; il se trouva sans force pour la défense, et le farouche spahis, le fascinant de son regard, l’attira brusquement à lui et sans sourciller lui trancha la tête. Cela fait il appela Saïda ; la courageuse femme fût à lui en un bond, elle s’enlaça à son corps à la manière de la couleuvre ; Kadour l’étreignit passionnément, puis ayant pendu à l’arçon de sa selle la tête du ravisseur, il revint triomphant parmi les siens chargé de ce double fardeau. Pendant que ce drame faisait les délices des compagnons du spahis, un jeune officier, celui dont nous tenons tous ces détails, poursuivait à outrance un cavalier ennemi. Ce dernier bientôt atteint et vigoureusement attaqué, allait succomber sous les coups décisifs du brave officier, lorsque en désespoir de cause le Bédouin parvint à diriger le bout du canon de son fusil sur la poitrine de son adversaire ; une seconde d’hésitation de la part de celui-ci et c’en était fait de lui, mais prompt comme l’éclair, on le vit écarter avec sa main le fusil de l’Arabe, se prendre avec lui corps à corps, l’étreindre vigoureusement, et se jeter à bas de son cheval, entraînant avec lui jusqu’à terre son ennemi terrifié. Alors une lutte désespérée s’engagea entre les deux champions ; le Bédouin bien que déjà blessé n’en était pas moins d’une force peu commune, et il avait encore à la main son fusil chargé dont il cherchait par des efforts inouïs à diriger l’embouchure sur son rival. L’officier sentait ses forces faiblir ; cette lutte aurait pu avoir pour lui une issue fatale, lorsqu’heureusement un maréchal-des-logis de son régiment passa près de
704
là ; à la voix de son officier, il accourut et vint fort à propos séparer les combattants en donnant au bédouin le coup de grâce.
Et maintenant Bou-Maza court encore, mais nous le répétons, les poursuites sérieuses dont il est l’objet, auront avant peu une heureuse solution ; en un mot la ferme volonté de le vaincre étant dans la pensée du pouvoir, nous devons considérer ce prétendu chériff comme un aventurier qui bientôt devra être entièrement à notre merci. Mais pour arriver à ce résultat indispensable, comme aussi pour paralyser à leur début toutes les ambitions individuelles dont le foyer vit et vivra longtemps encore au sein des tribus récemment soumises, il faut de la force, il faut des bataillons. M. le maréchal duc d’Isly l’a dit assez haut : il y aura encore des révoltes partielles, des soulèvements accidentels parmi ces populations qui sont à peine sous le joug, et nous devons toujours être forts contre elles, jusqu’au jour où la grande colonisation civile et militaire, opposera aux Arabes la puissance du nombre.
Même anecdote, mais reprise par Alexandre Dumas Mentionnons un fait qui semble se rattacher aux anciens temps de la Bible : quand un
kabyle vient à mourir, celui des frères du défunt qui le premier enlève un objet à la tête de la veuve, celui-là a le droit de l’épouser. Si, au lieu d’essayer de lui enlever cet objet, il égorge un chevreau en son honneur, le droit est le même. Il n’y a pas d’exemple que la veuve ait jamais essayé de se soustraire à cette convention.
Nous avons tous connu Bou-Maza, le Père de la chèvre, ce pauvre prophète qui, comme la brillante Esmeralda, devait le prestige qui l’entourait à la chèvre qui caracolait autour de lui. Cet autre El-Mohdy, qui devait demeurer invulnérable et chasser nos soldats devant l’éclair de ses yeux, qui, prisonnier et nourri à un louis par jour aux frais du gouvernement, vint amuser la curiosité des Parisiens jusqu’au moment où vint la révolution de Février, qu’il avait oublié de prédire, vint l’épouvanter à un tel point qu’il s’enfuit de Paris et qu’on ne le rattrapa qu’à Brest.
Bou-Maza, l’homme à la chèvre, Bou-Maza, mauvais prophète, fuyait donc, poursuivi par nos spahis, vers le littoral, à l’ouest du Ring.
Aly, cavalier indigène et fils de notre allié l’aga Madj-Achmet, chargeait l’ennemi qui fuyait dans toutes les directions, lorsque tout à coup on le vit arrêter son cheval, se lever sur ses étriers, et placer sa main en abat-jour devant ses yeux qu’il fixa ardemment sur un point éloigné.
Aly était supérieurement monté ; il se remit en selle, rendit la main, rapprocha ses longs éperons de flancs de son cheval, et s’élança vers les fugitifs avec une rapidité effrayante. Deux jours auparavant, sa sœur, nommée Fathma, avait été enlevée, et une jeune fille fuyait entraînée au milieu des soldats du Père de la chèvre.
Au fur et à mesure que Aly se rapprochait du groupe au milieu duquel fuyait la jeune fille, il s’assurait de plus en plus que c’était bien Fathma qui fuyait, et il n’eut plus aucun doute lorsque ayant crié le nom de toute la puissance de sa voix, il vit la jeune fille se retourner : mais un cavalier tenait la bride de son cheval, et elle n’était pas maîtresse de le diriger.
Seulement, au second cri que poussa son frère, et quand elle fut bien sûre que c’était Aly qui la poursuivait, elle tira un poignard de sa ceinture et se pencha vers le cavalier.
Le cavalier poussa un cri et tomba. Aussitôt redevenue maîtresse de son cheval, Fathma tourna bride : dix seconde après
elle était dans les bras d’Aly, qui la ramena à Madj-Achmet. Un instant après, on vit revenir un autre indigène ayant une tête accrochée à l’arçon de
sa selle et portant une femme entre ses bras, celui-là s’appelait Kédour. Un second épisode à peu pareil à celui que nous venons de raconter s’était accompli en
même temps. Huit jours auparavant, celui qui rapportait cette tête et cette femme s’était marié, il avait
épousé une jeune fille nommée Saïda, qui avait disparu depuis la veille.
705
Pour lui il n’y avait aucun doute que cette jeune fille eût été enlevée par les soldats du cheick, et il s’était lancé à leur poursuite avec toute la vitesse que peut donner à un cheval la rage et la jalousie se disputant le cœur de son cavalier.
Tout à coup il aperçut un Bédouin emportant une femme en croupe. Alors on vit le cheval de Kédour se cabrer sous l’éperon, puis bondir en avant, puis voler
en rasant les palmiers nains, qu’il semblait ne pas toucher des pieds. Il rejoignit le Bédouin, le tua, lui coupa la tête, l’accrocha à l’arçon de sa selle et revint
rapportant, comme nous avons dit, sa femme entre ses bras.