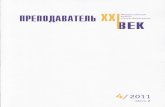Qu'en est-il du plaisir au XXI e siècle ?
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Qu'en est-il du plaisir au XXI e siècle ?
Jean-Claude Milner — Je m’associe entièrement à tout appel en faveur de la liberté. Ce qui ce passe en Syrie importe.
D’un certain point de vue, cela fait écho à la question du XXIe siècle. Quand a-t-il commencé ? A-t-il même commencé ? La question après tout n’est pas tranchée. La poétesse russe Anna Akhmatova a dit d’août 1914 : « En une seconde, nous avons vieilli d’un siècle ». Concernant le XXIe siècle, y a-t-il eu une seconde où nous aussi avons vieilli d’un siècle ? Pour ma part, j’aurais tendance à penser que le 11 septembre m’a donné ce sentiment. Je peux imaginer qu’on donne d’autres réponses, mais ma propre réponse est bien déterminée; elle me permet de paraphraser le thème de cette soirée sous la forme « qu’en est-il du plaisir après le 11 septembre ? ». Je reviendrai sur ce que le 11 septembre a, à mes yeux, ouvert.José Rambeau a fait allusion à une opposition que j’ai faite dans Le triple du plaisir entre le modèle antique, et, disons, le modèle moderne. Je rappelle que le monde antique est aussi le monde de l’épistémè, par opposition à la science moderne; c’est un monde clos, par opposition à l’univers infini; c’est un monde où le travail est saisi dans la forme de l’esclavage et non pas dans la forme du salariat. Il me semblait que dans ce monde, le modèle du plaisir était l’incorporation, autrement dit, le plaisir avait pour horizon l’incorporation par un corps de l’occasion de son plaisir. Je ne reprendrais pas toute l’axiomatique que j’avais mise en place, mais un des éléments fondamentaux, c’est que, selon moi, le plaisir est toujours le plaisir d’un corps. Pour dire les choses autrement, les êtres incorporels ne connaissent pas le plaisir. Les
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
Jean-Claude Milner
anges ne connaissent pas le plaisir. Dieu ne connaît pas le plaisir, ni Dieu le Père ni le Saint-Esprit. Le Fils peut-être, parce qu’il s’est incarné en un corps. En tout cas, il a connu la souffrance. Or, la question d’un corps qui a connu la souffrance se lie à la question d’un corps qui connaît le plaisir.Dans le modèle antique, le modèle le plus primitif et le plus simple est celui du boire et du manger, mais bien entendu, toutes sortes de plaisir se déclinent sous la forme de l’incorporation. Éprouver au théâtre le plaisir de voir, éprouver du plaisir à écouter la belle langue grecque des orateurs, éprouver du plaisir à entendre Socrate démonter un interlocuteur simplement par la parole, tout cela peut se moduler à partir de l’incorporation. La seule chose qui ne puisse pas se moduler en termes d’incorporation, c’est la rencontre charnelle entre deux corps, ce qu’on appelle du terme latin le coït. Si le plaisir naît de l’incorporation, cela veut donc dire qu’il ne peut pas y avoir de plaisir qui puisse naître du coït. Vous le lisez en toutes lettres dans Lucrèce, qui décrit le coït comme une opération d’où le plaisir ne cesse de s’absenter, à l’instant même où on le recherche. La contrepartie de cela, c’est de supposer que la rencontre entre les individus affectés d’un corps puisse se transmuer pour devenir incorporation. Puisque l’obstacle consiste dans le caractère charnel des corps, l’incorporation passe précisément par la désincarnation des corps, c’est-à-dire par l’âme. Quelque chose de l’ordre du plaisir peut être atteint dans la rencontre d’un corps par un autre, à condition que cela passe par cette partie du corps qui est la seule partie qui puisse parvenir à l’incorporation par fusion du deux en un. Vous avez là une façon d’entrer dans la théorie platonicienne, dont Lucrèce prend le contre-pied.Ce modèle de l’incorporation, on peut le décliner. En le déclinant, on rencontre l’obstacle, en tout cas la faille que j’indiquais
Jean-Claude Milner
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
à savoir que si l’on prend le coït au sérieux, alors il ne peut pas être l’occasion d’un plaisir parce qu’il ne peut pas y avoir incorporation dans le coït. D’où cette formule dont je reconnais le paradoxe : il n’y a pas de plaisir sexuel dans le monde antique. Par opposition au modèle de l’incorporation, j’avais le sentiment que le monde moderne reposait sur le modèle de l’usage. Un corps use d’un objet, éventuellement du corps d’un autre être parlant comme moyen dont il va faire usage pour obtenir le plaisir. On peut parfaitement penser le boire et le manger sur le modèle du moyen. On peut parfaitement penser que dans la dimension du plaisir lié au boire et au manger, ce n’est pas l’incorporation qui compte, mais le moyen de nutrition. Manger, c’est alors se nourrir et boire, c’est se désaltérer; boire et manger sont des moyens qui satisfont un besoin. Si le plaisir est pensé sur ce modèle-là, alors il n’y a pas d’obstacle à penser le coït comme occasion d’un plaisir, puisqu’il suffit que chaque partenaire du coït considère l’autre comme le moyen de satisfaction. Il n’y a aucune difficulté à cela. Cette doctrine, qui est une pure et simple conséquence du modèle de l’usage, est énoncée en toutes lettres par Kant. Kant enchaîne une série de thèses. La première, c’est que le plaisir sexuel existe ; la deuxième, c’est que non seulement le plaisir sexuel existe, mais que c’est le plus intense plaisir sensible possible ; et troisièmement que le coït, c’est cette relation où un corps use d’un autre corps comme moyen. Chacun des deux corps use de l’autre corps comme moyen. Puis Kant ajoute une quatrième thèse tout à fait intéressante pour nous : l’horizon de la relation charnelle, dit-il, c’est le cannibalisme. Le même Kant qui a poussé la théorie de la loi morale au point extrême où elle rencontre Sade, pousse la théorie du plaisir comme usage au point extrême où elle va rencontrer en quelque sorte son
retournement : le cannibalisme. C’est-à-dire que le modèle de l’incorporation vient hanter comme une sorte de fantôme le modèle de l’usage.Dans Le triple du plaisir, j’opposais les deux modèles en terme de périodisation. C’était, je pense, la manière la plus claire de présenter l’opposition. Aujourd’hui, je pense toujours qu’il y a deux modèles qui s’opposent, qui en tout cas sont distincts. Mais je ne dirais plus que dans le monde antique, il n’y a que le modèle de l’incorporation et que dans le monde moderne, il n’y a que le modèle de l’usage. Il y a périodisation, certes, mais ce n’est pas en termes d’exclusion mutuelle qu’elle doit être pensée. Les deux modèles sont toujours co-présents, sauf que l’un domine l’autre. Dans le monde antique, le modèle du moyen, de l’usage concernant le plaisir, est présent, mais il est subordonné au modèle de l’incorporation. Dans le monde moderne, le modèle de l’incorporation est présent, mais il est soumis au modèle de l’usage. Voilà un premier ensemble de remarques.Un deuxième ensemble de remarques, c’est que le modèle de l’usage a été absorbé par le développement de la forme marchandise. Dans l’univers moderne, la relation entre le moyen et l’usage est plongée dans la forme marchandise ; autrement dit, tout ce qui est pensé sur le modèle de l’usage (et donc le plaisir), est pensé à l’horizon de la forme marchandise où la valeur d’usage va être constamment rongée par l’émergence de la valeur tout court. Si le modèle du plaisir, c’est l’usage et puisque l’usage va être plongé dans la forme marchandise, le plaisir va être lui-même plongé dans la forme marchandise. Ce qu’on appelle la consommation n’est rien d’autre que la matérialisation de la prise de la forme marchandise sur le plaisir. Mais il y a des formes beaucoup plus subtiles qui nous révèlent que, littéralement, nous n’arrivons plus à penser, même quand nous nous débarrassons
Jean-Claude Milner
des formes grossières de la consommation, des formes massives de la marchandisation. Nous n’arrivons plus à penser au-delà des limites qu’impose la forme marchandise. Ces limites, je voudrais les préciser. Bien entendu, il s’agit d’abord de la forme marchandise dans son sens le plus élémentaire, c’est-à-dire ce qui se vend et ce qui s’achète. Mais ce n’est pas simplement ça. C’est aussi une forme de raisonnement. Il y a un raisonnement, une capacité logique de la forme marchandise ; une capacité logique ou même ontologique. Je m’autorise un détour dont je ne vais pas donner toutes les clés, bien que ce soit important. Lisez La Logique de Port-Royal, inspirée de Descartes et rédigée par deux théologiens, Antoine Arnauld et Pierre Nicole. Ils s’interrogent sur l’Eucharistie. Selon le dogme catholique, il y a transsubstantiation, c’est à dire transformation de substances. Le pain devient le corps du Christ et le vin devient le sang du Christ. Comment peut-on résoudre ce mystère autant que faire se peut puisque cela reste fondamentalement un mystère ? Comment peut-on le résoudre dans les termes de La logique de Port-Royal, c’est-à-dire, dans des termes qui soient aussi proches que possible de la philosophie cartésienne ? La réponse repose sur la distinction entre la substance et ses qualités. Le vin se transforme quant à la substance, mais ses qualités restent les qualités du vin. Lorsque le prêtre en boit une gorgée, son corps éprouve toutes les sensations liées aux qualités du vin. Même processus pour le pain. Eh bien je dirais que cette logique de séparabilité entre la substance et les qualités, c’est la logique de la forme marchandise. Je ne m’étends pas sur les conséquences qu’il faut en tirer concernant le rôle du christianisme et en l’occurrence du catholicisme dans le développement de la pensée de la forme marchandise, mais je m’en tiendrai à l’analyse de Marx. Dans l’échange d’un objet contre un autre, la forme marchandise
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
Jean-Claude Milner
émerge à partir du moment où les qualités des objets échangés ne sont plus pertinentes. Ce qui fait fonctionner l’échange, ce ne sont pas les qualités des marchandises, mais la valeur de ces marchandises. Or, la valeur est totalement indifférente aux qualités. C’est pourquoi on pourra construire un équivalent général qui permettra de mettre en mouvement l’échange pur, quand l’aveuglement aux qualités se sera complètement accompli. Cet équivalent général, c’est tout simplement l’argent, totalement indifférent aux qualités des objets échangés et même aux qualités de son propre support, la monnaie. Ce n’est pas l’argent qui est le moteur de la forme marchandise, c’est la forme marchandise qui rend possible l’argent. Et comment le rend-elle possible ? Par la disjonction entre les qualités et la substance des objets. Donc, les objets circulent. Mais ce qui circule véritablement, ce ne sont pas les qualités, ce sont des objets réduits à leur valeur et de ce fait disjoints des qualités qu’ils supportent. Ce qui me frappe, c’est qu’il ait fallu quelques années, dans un système de réflexion totalement différent, pour penser la réciproque, c’est-à-dire la possibilité que des qualités fonctionnent en disjonction de la substance qui les porte. Il me semble en effet que dans la théorie freudienne, ce qui compte dans le fétichisme, ce sont uniquement les qualités de l’objet-fétiche. Et peu importe en vérité le support. Il se trouve que c’est parfois un support qu’on pourra isoler et auquel on pourra donner un nom. Mais en vérité, ce sont les qualités qui fonctionnent en indifférence totale au support. Le parfum, le cri de la soie, le soulier sont des paquets de propriétés sensibles qui se posent, dans le fétichisme, en disjonction des supports qui sont empiriquement les leurs. Le modèle de l’usage pour le plaisir va rencontrer le fait que l’usage est absorbé par la forme marchandise. Le modèle va de ce fait dépendre d’une logique où les qualités de l’objet d’un côté
et la substance de l’objet de l’autre sont séparables. Le plaisir va se heurter à cette séparabilité. Ce qui fait que la théorie du plaisir moderne bifurque. Ou bien elle va aller du côté de la marchandise à l’état pur – c’est-à-dire ce qui se vend et ce qui s’achète; peu importent les qualités, le plaisir vient de la valeur exprimée par le prix – ou bien le plaisir vient des qualités totalement disjointes de la substance, ce que je réfère au fétiche. Entre la marchandise vénale et le fétiche, vous avez une sorte de bifurcation du plaisir moderne.J’en viens maintenant à votre question sous-jacente concernant le XXIe siècle. Comme je vous l’ai dit, je ne peux répondre sur la question du XXIe siècle qu’en tentant de répondre à la question de savoir ce qui permet de dire que le XXIe siècle a commencé et que le XXe siècle a fini. Comme je vous l’ai dit, le sentiment de bascule a pour moi été le 11 septembre. A ce moment-là, j’ai eu le sentiment que plusieurs choses se passaient. Premièrement, et dans un certain sens c’est l’inverse de ce qu’un certain nombre de commentaires ont fait valoir, c’est le triomphe de la forme marchandise. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il était si facile d’acheter ces avions. Je veux dire par là que ces avions que l’on a lancés sur les Tours, on n’avait pas besoin d’autre chose que d’un marchand d’armes pour les avoir. C’est-à-dire que les armes sont devenues des objets plongés dans la forme marchandise. On le savait, mais pour la première fois, j’ai vu ce que cela voulait dire. Cela voulait dire que n’importe qui peut acheter un avion s’il en a les moyens. Un avion qui peut être utilisé comme un projectile est un objet qui s’achète et qui se vend comme n’importe quoi d’autre. Je le répète : on le savait abstraitement. Mais jusqu’à présent quand on disait qu’il y avait des marchands d’armes, on pensait à des états qui achetaient des armes, on pensait à des forces politiques qui avaient une stratégie.
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
Là, c’était prendre un avion qu’on a payé très cher, mettre un pilote dedans qui n’est là que pour faire que l’avion vole, c’est à dire qui est simplement un appendice de la marchandise qui a été achetée et on traite l’avion comme un pur et simple projectile. C’est-à-dire qu’une fois qu’on l’a acheté, on en fait exactement ce qu’on veut, y compris s’en servir pour autre chose que ce pour quoi il est fait. De ce point de vue-là, je dirais que la fameuse doctrine du bricolage qui a été développée par Levi-Strauss peut être retournée en son contraire. Loin que le bricolage infirme la forme marchandise, il peut en être l’accomplissement extrême. Il permet, quand vous avez acheté quelque chose, que vous en fassiez littéralement ce que vous voulez, y compris ne pas vous en servir, y compris vous en servir pour autre chose que ce pour quoi c’est fait. Il accomplit ainsi la négation de la valeur d’usage, négation qui est le secret de la forme marchandise.J’ai vu de mes yeux ce que voulait dire l’universalisation de la forme marchandise, non pas parce qu’elle concernait des espaces nouveaux (après tout, c’était un temple de la forme marchandise qui avait été détruit), mais parce qu’elle était poussée à son point extrême d’intensité. Et cela, sous une forme que je n’attendais pas du tout. La deuxième chose que j’ai vue, c’est ce qui accompagne l’universalisation de la forme marchandise, à savoir la transformation des corps parlants en choses. J’ai parlé des pilotes, ils ont été eux-mêmes transformés en projectiles. A ceux qui sont tombés des Tours, transformés en corps pesants, c’est purement la loi de la gravité qui s’est appliquée, rien d’autre. A quoi s’ajoute la suite des événements. On ne peut pas séparer le 11 septembre de Guantanamo et de la transformation des corps parlants de Guantanamo en réservoirs à informations. Les prisonniers y sont traités comme des boites, des cartons dont il faut trouver le moyen de les ouvrir. Réciproquement, ceux qui
Jean-Claude Milner
font ce travail d’investigation sont eux-mêmes transformés en choses, c’est-à-dire en pied-de-biche qui ouvre les caisses. La politique des choses, telle que je l’ai dénoncée, je ne pense pas qu’elle ait commencé au XXIe siècle, mais elle a pris au XXIe siècle une extension nouvelle. Bien entendu, vous me poserez la question « Mais si le XXIe siècle, c’est cela, alors, est-ce que cela ne veut pas dire que le XXIe siècle n’ouvre au plaisir qu’une seule possibilité, c’est-à-dire le plaisir des choses ? Si c’est le règne des choses, est-ce que cela ne veut pas dire que le plaisir est plaisir des choses ? » Ma réponse sera la suivante : si j’ai raison sur le XXIe siècle, à savoir que la forme marchandise déploie à la fois son extension planétaire, mais aussi son intensité logique ; si la conséquence de cette extension, c’est que les êtres parlants sont transformés en choses, traitées comme les autres choses, c’est-à-dire comme prises par la forme marchandise, le seul propos que nous puissions tenir consiste à relever, dans ce que laisse le XXe siècle, les éléments qui permettent – je reprends une formule de Lacan – de dire que non ! Si je me trompe là-dessus, alors effectivement la voie que je dessine me paraît extrêmement difficile à clore. Elle conduit pas à pas, étape par étape, de l’universalisation de la forme marchandise à l’universalisation du statut de chose, à la prise des choses par la forme marchandise elle-même, et de là à l’établissement du gouvernement des choses, c’est-à-dire la transformation de tous les corps parlants en choses qui gouvernent ou qui sont gouvernées. Si je me trompe sur le « dire que non », le passage me paraît impossible à stopper. Si en revanche, j’ai raison, alors ça veut dire que quelque chose nous reste du XXe siècle, qui nous permettra de faire que quelque chose dans cette marche soit mis en suspens. J’espère que la question du plaisir pourra aussi se situer du côté de ce qui dit que non. Si ce n’est pas vrai,
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
alors la question du plaisir sera simplement du côté des choses; autrement dit, le gouvernement des choses, c’est aussi au bon plaisir des choses. José Rambeau — Vous semblez partager la position de Freud qui disait qu’une strate dans l’histoire de l’humanité, n’exclut pas les strates plus anciennes. Comme si le modèle antique du plaisir pouvait encore être contemporain du modèle de l’usage. J.-C. M. — Mais la réciproque est vraie. Ce n’est pas orienté dans le temps. Autrement dit, je pense qu’on peut trouver dans le monde antique des traces du modèle de l’usage. Réciproquement, on peut trouver dans le monde moderne des traces du modèle de l’incorporation. Souvent, le modèle freudien est un modèle orienté dans le temps. Ce n’est pas comme ça que je verrais les choses. J. R. — Si on prend par exemple le cas de l’incorporation, du boire et du manger, ça pose la question de savoir s’il y a encore trace de cette incorporation-là aujourd’hui, et sous quelle forme? Serait-ce du côté de l’usage ? Peut-on dire par exemple de quelqu’un qui se soucie de la diététique (du comment on doit manger pour avoir tel plaisir du corps, comment on doit manger pour maigrir par exemple) que c’est une forme d’usage de quelque chose qui est du côté de l’incorporation ? J.-C. M. — Tout à fait, le boire et le manger sont maintenant globalement plongés dans le modèle de l’usage. De manière plus large, le rapport à son propre corps est plongé dans le modèle de l’usage. Vous faites allusion à la diététique. On pourrait donner beaucoup d’autres exemples. Nous traitons notre corps comme
Jean-Claude Milner
un moyen et ce moyen, il faut qu’il dure le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Concernant le corps, jusqu’à présent, on n’en a pas de rechange. Ce qu’on appelle la diététique, c’est en gros : traiter votre corps comme vous traiteriez votre voiture, si vous ne pouviez pas changer de voiture. De fait, vous ne pouvez pas changer de corps. Les gens qui traitent mal leur voiture ont dans l’idée que le jour où elle aura capoté, ils en prendront une autre. Le corps, ce n’est pas exactement comme ça.L’incorporation nutritionnelle est soumise au modèle de l’usage. Cela étant admis, il n’est pas extraordinairement difficile de retrouver les traces évanouissantes du modèle de l’incorporation. Lacan note les appellations amoureuses qui naissent au cours du coït. Il cite «chou» et «rat». Le chou se mange et le rat dévore les provisions. Remarquez que le rat est censé être nuisible et donc ne servir à rien. Il s’oppose au modèle de l’usage et de manière générale à la forme marchandise. En tant qu’animal dévorant, il est pure incorporation. En m’appuyant sur cet exemple de Lacan, j’ai fait remarquer que ces appellations – remarque que Lacan n’a pas faite, je crois, mais qu’il aurait sans doute acceptée – apparaissent aussi dans le langage qu’on tient aux enfants, ce qu’on appelle le langage bébé. Il ne s’agit évidemment pas de coït (on touche là à une prohibition radicale, sans doute homogène à la prohibition de l’inceste), mais il s’agit d’un plaisir né de la rencontre d’un corps. « Bout de chou, mon petit bonhomme en sucre, mon petit chat, mon poulet, mon petit loup… » Tout tourne autour de ce qui se mange ou de ce qui mange. Manger quelqu’un de baisers : ça se dit et ça se fait. La nutrition n’est pas en cause, mais bien l’incorporation en tant que distincte de l’usage. Darwin a écrit un livre très étonnant sur l’origine des expressions du visage. Il a ensuite été repris par Lorenz et ses élèves : pourquoi
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
montre- t-on les dents pour menacer ? Ce n’est pas la même chose de sourire avec les lèvres fermées ou sourire, toutes dents dehors, etc. Les données ont été rapportées à l’évolution. Je ne mets pas en cause la pertinence de cette analyse, mais ce n’est pas cette dimension-là qui m’importe. Je m’attache à la coprésence. Dans un monde dominé par la forme marchandise, qu’en est-il d’un rapport de plaisir que l’on voudrait faire échapper à la forme marchandise ? On retrouve l’incorporation. L’exemple du tout petit enfant est particulièrement frappant. À son égard, la dimension de protection et d’affection est immédiate ; Lorenz la tient pour innée. Elle s’accompagne d’un plaisir des yeux, de l’oreille, du toucher, mais on ne voudrait pas penser que le corps du bébé soit réductible à une marchandise un peu plus jolie qu’une autre. Explicite ou non, le langage de l’incorporation resurgit alors.
Charles-Henri Crochet — Si la forme marchandise est concomitante avec l’incorporation, à l’époque de Platon, l’incorporation est un impossible, d’où le passage à l’usage. À notre époque l’usage permet le plaisir… Le discours qui faisait que l’incorporation était impossible tenait les choses et on tenait les choses autrement. Peut-on dire qu’à notre époque il n’y a plus rien qui tient, qu’il n’y a plus de signifiant-maître qui tienne et donc qu’on en viendrait à un possible de l’incorporation ? J.-C.M. — Peut-être que le XXIe siècle se caractérisera par ceci que les limites de l’impossible et du possible soient devenues mouvantes. Je suis très frappé par l’émergence dans le discours de propos qui prennent en quelque sorte à revers les formes les plus acceptées, les plus solides de ce qu’on pensait être des limites du possible et de l’impossible. Je prends un exemple : autrefois,
Jean-Claude Milner
pour expliquer la puissance du parlement anglais, au XIXe siècle, le dicton était : le parlement anglais peut tout sauf changer un homme en femme. Au XIXe siècle, changer un homme en femme était la forme de l’impossible. Il est tout à fait évident que personne aujourd’hui ne prendrait cela comme la forme ultime de l’impossible. Toute une série de choses qui apparaissaient comme la forme ultime de l’impossible à volé en éclats. Cela ne veut pas dire que la fonction d’impossible a cessé, mais que les valeurs de cette fonction ne sont plus les mêmes. Si la fonction de l’impossible n’a pas cessé, alors le réel continue d’insister. Que le réel comme impossible insiste, je le dis et le maintiens, mais je suis obligé de reconnaître que le discours de l’opinion est animé de la conviction contraire. Il n’est pas simplement question des valeurs de la fonction d’impossible; la fonction elle-même est en suspens. Autrement dit : « Il n’y a pas d’impossible ». Cette conviction-là convoque. L’idée que l’immortalité est à portée de main est une conviction très répandue dans l’opinion. Mais ce que l’on appelle l’opinion, à mes yeux, c’est le discours du maître.
C.-H. C. — Lacan disait : il n’y a pas de maître, il y a un discours du maître.
J.-C. M. — Exactement. Le discours du maître, c’est le discours de l’opinion. Il n’y a pas de disjonction à faire. Parmi les opinions les plus courantes, il y a celle que je viens de résumer : il n’y a pas d’impossible. Cette opinion courante est un défi lancé à toute doctrine qui, au contraire, repose sur l’affirmation Il y a de l’impossible.
Anne-Marie Landivaux — Dans Clartés de tout, vous parlez des pratiques sadomasochistes des américains gays avant l’apparition
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
du sida, disant qu’ils sont un effet métonymique de la dé-marchandisation. À l’époque, nous n’étions pas encore dans la mondialisation. Pouvez-vous nous donner un éclairage sur ce point ?
J.-C. M. — Le mouvement gay américain est un mouvement extrêmement intéressant et important. Il a commencé par une revendication des civil rights, ce que l’on traduit par droits civiques. Le modèle, c’était Martin Luther King. Il fallait faire pour les gays ce que Martin Luther King avait fait pour les Noirs. On oublie souvent qu’aux États-Unis, beaucoup d’états considéraient l’homosexualité entre adultes consentants comme un délit. Dans beaucoup d’états, la sodomie, qu’elle soit pratiquée entre hommes ou entre homme et femme était condamnée par la loi. Comme les Noirs, les gays voulaient obtenir des droits : modification des lois, mais aussi modification des comportements et notamment des comportements policiers. Dans cette progression, une fois qu’un certain nombre de droits ont été acquis, s’est déployé le fait que Freud a raison ; c’est-à-dire que la sexualité n’a rien à faire des règles civiques. La communauté gay se pensait elle-même comme analogue à la communauté noire, or elle était définie uniquement par un choix sexuel. On pensait que cela ne poserait pas de problème, que ce serait pareil. En vérité, ce n’est pas pareil. Les préférences sexuelles, les attirances sexuelles sont littéralement indifférentes à la question des droits civiques; elles les prennent comme des moyens, pas comme des fins. Sur la base des droits acquis, se sont développées des pratiques sadomasochistes dures, avec des ventes d’esclaves, des pratiques de tortures. Les pionniers de la première génération en ont été scandalisés. Ils y ont vu une contradiction insupportable. Ceux qui pratiquaient le sado-masochisme dur leur répondaient qu’ils
Jean-Claude Milner
ne faisaient qu’exercer les libertés pour lesquelles le mouvement gay s’était battu. Ce que je voulais dire en parlant de dé-marchandisation, c’est que le mouvement gay américain a toujours été pris, et d’emblée, dans la question « Est-ce que nous voulons construire une communauté qui soit strictement analogue aux autres communautés ? » La société américaine est fondée sur le fait qu’il y a une infinité de communautés possibles, chacune ayant les droits que la constitution américaine accorde aux communautés politiques, religieuses ou ethniques etc. Toutes ces communautés sont insérées dans le fonctionnement de la société marchande. La communauté gay a été confrontée au choix, être une communauté comme une autre ou pas. Si oui, alors elle sera comme les autres, prise dans le réseau marchand; si non, alors elle est une contre communauté, qui use de ses droits pour exercer son altérité radicale. A terme, elle sera hors du système marchand. Ainsi, la grande différence entre la vente d’esclaves telle qu’elle existait à l’époque de l’esclavage et la vente d’esclaves sadomasochiste, c’est que la seconde ne repose pas sur le bénéfice financier. Elle mime la vente et l’achat, mais fondamentalement, elle vise à s’échapper des règles de la vente et de l’achat. Je ne sais pas ce qui se serait passé si les choses s’étaient déployées dans leur simple logique, mais on a le sentiment que le processus s’engageait dans une impasse monstrueuse.
Michèle Simon — Vous dites que du XXe siècle, il y a la possibilité d’un dire que non qui pourrait limiter ce qui est en train de se passer au XXIe siècle. Mais, ce dire que non du XXe siècle me semble reposer sur un ordre symbolique qui ne mettait pas en doute la fonction de l’impossible. Aujourd’hui, quelle forme peut prendre le dire que non ? Je pense aux formules de la sexuation
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
et en particulier au pas-tout.
J.-C. M. — Je crois que la pointe fondamentale est l’affirmation qu’il y a de l’impossible. Soyons clairs, c’est une affirmation que personne ne peut entendre. La demande est qu’on ne dise pas qu’il y a de l’impossible. Cette demande vient de partout. La refuser est d’autant plus ardu que par ailleurs, il y a toujours, comme de toute chose, un usage canaille - pour reprendre le mot de Lacan - un usage canaille de l’affirmation qu’il y a de l’impossible. Autrement dit, ça peut être aussi la voie par laquelle passe la tyrannie. La nomination de l’impossible peut être utilisée à des fins catastrophiques. C’est pourquoi je ne présente pas ici un remède ou une recette. Je dis simplement que le discours du maître dans sa forme murmurante, ce murmure de l’opinion, a comme base continue le thème du « rien n’est impossible », « il n’y a pas d’impossible ». Mais il arrive extrêmement souvent que le discours du maître, dans sa forme injonctive explicite, prenne la forme « il y a de l’impossible. »
C.-H. C. — Dans la conclusion du Triple du plaisir, vous parlez de stratégie et dans Clartés de tout, vous dites que c’est du côté du un par un, de la contingence, de la rencontre que l’on peut miser sur l’impossible, le dire que non.
J.-C. M. — Oui, ce serait de cet ordre-là. C’est vraiment extrêmement circonstancié. Chaque fois qu’on se fait entendre dans ce que j’appellerais l’espace social, ça passe par le discours du maître. Ne soyons pas comme les colombes qui imaginent qu’elles voleront mieux dans le vide. Autrement dit, sachons bien que dès l’instant qu’un propos que nous tenons fait vibrer les ondes de l’espace social, c’est le discours du maître qui se met
Jean-Claude Milner
à consonner, quoi que vous disiez. Je n’ai pas besoin d’attirer votre attention sur le fait que les propos de Lacan, pris à des fins malignes, peuvent consonner de telle façon que n’importe quel maître peut s’en servir. La voie du silence absolu serait plus sûre, mais à quel prix… Reste le mi-dire ou le demi-mot; même alors, le risque demeure.
Participant — Il y a néanmoins une stratégie - en tout cas celle de Jacques-Alain Miller - qui serait de dire quelques mots au maître qui fassent suffisamment résonner ce discours du maître, de telle façon qu’il soit possible que quelque chose de la fonction de l’impossible puisse se faire entendre et que, du coup, du côté du discours analytique puisse être repris le un par un.
J.-C. M. — Tout à fait. Si j’ai pris part dans le passé à des entreprises tactiques ou stratégiques de cet ordre, c’est parce que je suis convaincu qu’elles sont légitimes. Mais je ne peux pas répondre pour d’autres que moi. Jacques-Alain Miller, lui, engage l’histoire du mouvement analytique. Moi, je ne l’engage pas. Je n’engage que moi-même et moi-même suis dans une espèce d’interstice entre le discours de l’université, le discours de l’analyste, le discours de l’hystérique et le discours du maître. Je ne peux pas dire que j’engage un discours et notamment pas le discours analytique. Je ne peux pas faire autre chose que ce que je sais faire. Ce que je sais faire implique que je prenne à l’égard des résonances parasites des précautions qui soient d’un autre type que les précautions que prennent ceux qui engagent le discours de l’analyste. Donc, je ne peux pas vous donner de conseils.
Participant — Je n’ai pas très bien compris votre exemple à
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
propos des avions qui ont frappé les tours de New York. Je n’ai pas compris pourquoi vous preniez la valeur de marchandise puisqu’ils n’étaient pas achetés par ceux qui les ont pilotés contre les tours. Il me semble que c’était plutôt une valeur d’usage détournée.
J.-C. M. — Vous avez raison. C’est un détournement de la marchandise. Il ne s’agissait que de ma perception immédiate, puisqu’au début je ne savais pas que c’était des avions de ligne. Je parlais de ma première réaction, et d’un certain point de vue, elle a obscurci tout le reste.
Participant — Avec cette notion de l’impossible, que faites-vous de la castration, de l’acceptation de la castration ?
J.-C. M. — C’est une question que seul un analyste peut poser ou à laquelle il peut répondre. Je ne peux pas répondre.
Participant — Une troisième question : c’est à propos du fétiche. J’aurais aimé être éclairé. Par exemple, dans le fétichisme classique de la bottine, qu’appelez-vous les qualités qui sont primordiales dans le fétiche par rapport à la chose, à l’objet ?
J.-C. M. — Je vais prendre une analogie. En linguistique, on considère qu’un son, une voyelle par exemple, ne vaut pas par toutes ses propriétés phonétiques, mais seulement par celles qui sont pertinentes. Il me semble que dans le fétiche, ce ne sont pas toutes les propriétés, mais seulement les propriétés pertinentes qui importent. Dans le cas de la bottine, ce serait les propriétés pertinentes de la bottine, mais pas la série illimitée de ses propriétés sensibles. Je dirais que le sujet fétichiste a de lui-même
Jean-Claude Milner
construit une sorte de système de traits qui sont en quelque sorte portés par hasard par telle bottine ou telle autre. Ce sont les traits qui comptent et non pas la bottine en elle-même.
C.-H. C. — Si l’on fait le lien entre la question sur l’objet fétiche et celle sur la castration, le fétiche ne veut rien savoir de cette castration, de cet impossible. La castration ne serait-elle pas un autre nom de l’impossible, ce trou du discours qui fait qu’il y a un impossible ? Quand vous disiez que cet impossible pouvait être mêlé à toutes les sauces, l’évaluation c’est exactement ça. L’évaluation c’est le discours sur un impossible qu’on va chiffrer et qu’ensuite, on va recouvrir même cet impossible. L’impossible est là, mais on va faire en sorte que l’impossible n’existe plus.
J. R. — En 2004, Jacques-Alain Miller introduit le fait qu’on était rentré dans l’hypermodernité. Pour vous le 11 septembre est une bascule du XXIe siècle. On a entendu dire au Forum des femmes que l’on va vers une féminisation de la civilisation. Pourrait-on envisager qu’il y ait une autre modalité du plaisir que l’incorporation ?
J.-C. M. — Je ne vais pas au-delà de ce que je peux observer. Je suis empiriste et je n’observe rien qui me donne à penser que, concernant le plaisir, il y ait autre chose que la forme dominante de la forme marchandise et comme forme dominée, presque élidée, l’incorporation.
Participant — Au XXe siècle, cet un par un, cette contingence, ce détail, cela paraît tellement petit par rapport à la masse énorme de tout le mouvement social.
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
J.-C. M. — Oui. Je ne suis pas sûr qu’il y ait aujourd’hui de discours globaux qui puissent prendre à bras le corps l’ensemble de ce que vous appelez le mouvement social. C’est plus varié que cela. Ce n’est justement pas global. Je ne crois pas que l’on puisse faire mieux ou autre chose que du point par point et du circonstanciel. Simplement, on peut le faire le plus souvent possible sur des objets les plus multipliés possibles. Si je prends mon cas, dans Clartés de tout, je me suis présenté comme un savant en série. En tant que savant en série, à chaque fois que j’interviens sur un point de savoir, mon rôle, c’est de montrer comment on peut prendre ce point de savoir de telle façon qu’on empêche les cordes du maître de vibrer, qu’on empêche ce phénomène de consonance avec le discours du maître. D’autres peuvent faire autrement. Mais la question, c’est cela, il s’agit de parler de telle manière que cela ne fasse pas résonner les cordes du maître. S’il s’agit d’actions, je dirais qu’il faut faire aussi de telle façon que votre action n’entre pas en correspondance avec des actions du maître. Mais cela, c’est très difficile. J’ai été marxiste, même maoïste et je suis assez bien placé pour savoir ce que c’est que d’agir de telle manière que ça entre en correspondance avec ce que le maître souhaite, contrairement à ce que vous souhaitez vous. Voilà, c’est ce genre de choses que je pourrais dire.
J. R. — Pour revenir à ma question du 21ème siècle, je rebondis sur une de vos formules de la soirée, vous avez dit qu’il n’y aurait plus que le plaisir des choses. Que pensez-vous de l’évolution de l’usage des préservatifs aujourd’hui ? Pendant très longtemps, cet objet était interdit de toute publicité. Aujourd’hui, c’est un objet qui est entré dans la publicité, au départ pour des raisons de prévention du sida. Aujourd’hui, cet objet est présenté dans les spots publicitaires comme recommandé pour y trouver un plus
Jean-Claude Milner
de plaisir. Cet objet va produire lui-même un plaisir.Du coup, la satisfaction sexuelle se trouverait paradoxalement déplacée sur l’usage même du préservatif. Ce n’est plus la rencontre de l’autre sexe qui va vous faire jouir, mais la rencontre de cet objet industriel. Voilà, je voulais avoir votre point de vue.
J.-C. M — Ce que vous signalez est une question tout à fait intéressante et tout à fait importante. Il y a d’abord le cas particulier de la France. Ce n’est pas un tabou, c’est autre chose, une niaiserie à l’égard du préservatif, qu’on ne trouve pas par exemple en Grande-Bretagne où c’était une pratique tout à fait courante de contraception. En France, c’était utilisé, mais il ne fallait pas en parler. L’église catholique a joué là un rôle tout à fait important; mais vous évoquez aussi une donnée bien plus générale : la croyance que les choses sont plus sûres que les êtres parlants. Elles sont plus fidèles, plus fiables. Je suis assez sensible à un certain nombre de films de science-fiction qui paraissent sur ce point d’un réalisme absolu. Le robot est plus digne de confiance qu’un être parlant. C’est une thématique extrêmement présente dans les films des années 1990-2000. Je pense à un petit film où tous ceux que vous voyez dans la rue sont les robots jumeaux de quelqu’un qui reste à la maison, dans sa chambre, parce qu’il trouve qu’il se fait un peu trop vieux ou parce qu’il est déprimé et ne veut pas sortir ou des histoires de ce genre. Cela se termine assez mal pour les robots, mais l’idée est celle-là : si le plaisir est pensé sur le modèle de la forme marchandise, alors, il n’y aucune raison pour que le plaisir qu’un corps parlant trouve au moyen d’un autre corps parlant ne puisse pas être assuré de manière plus sûre par la rencontre d’un corps parlant avec une chose, surtout si cette chose est perfectionnée au point d’être indistingable d’un être parlant. De ce point de vue-là, le
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
préservatif est la métonymie de cette chose très perfectionnée. C’est de la science-fiction, mais je ne vois pas pourquoi on en resterait au niveau des poupées gonflables. La technologie qui est en cours de développement permet d’aller beaucoup plus loin.
C.-H. C. — Dans ce film, les corps restent couchés dans le noir. Ils sont convaincus que le rapport sexuel n’existe pas et ils le savent. Jacques-Alain Miller dit qu’au fond nous savons que le rapport sexuel n’existe pas et du coup, avec cette mise en avant de la forme marchandise, avec cet objet qui est perpétuellement dans la poche - qui d’ailleurs est source d’angoisse - est-ce qu’on ne vire pas vers quelque chose du côté, comme dit Jacques-Alain Miller, du Un-tout-seul, d’une rencontre des corps qui ne se fait plus ?
J.-C. M. — Que le plaisir solitaire soit le dernier mot du plaisir est une hypothèse qui ne date pas d’aujourd’hui, mais qui a pris une vraisemblance de plus en plus affirmée. Cela ne répond pas à votre question, mais si je reviens au monde antique, il y a une école philosophique à laquelle j’accorde une grande importance, qui est l’école cynique. L’école cynique repose essentiellement sur la thèse que, non seulement le modèle du plaisir, c’est boire et manger, mais qu’au-delà de cela, tout est parasite. Tout ce qui va au-delà du boire et du manger, c’est parasite. Autrement dit, pour le philosophe (c’est toujours un monsieur à cette époque-là), avoir besoin d’une dame pour satisfaire son appétit sexuel, ce n’est pas agir en philosophe. Comme dit Diogène à cette courtisane qui lui fait des propositions : « Il n’y a rien que je puisse faire avec toi que je ne puisse faire avec ma main. » On mange avec la main, on boit avec la main et tout ce qu’on peut faire avec la main, on le fait, sans se cacher. Mais ce qui s’ajoute,
Jean-Claude Milner
c’est de trop. C’est de trop, parce que la seule chose qui compte, c’est le plaisir.Quand la forme marchandise l’emporte, cela ne veut pas dire que la dépense l’emporte. L’avare est dans la forme marchandise aussi bien que le dépensier. Gobseck, c’est celui qui va dépenser à chaque fois le moins possible. Pour autant, il n’est pas la négation de la forme marchandise, il en est une version. Celui ou celle qui ne veut pas dépenser beaucoup pour son plaisir peut se retrouver dans la forme autarcique. On peut donc parfaitement imaginer que s’inscrivant dans la forme marchandise, le plaisir puisse aboutir au plaisir solitaire. De ce point de vue-là, la remarque de Jacques-Alain Miller que vous rapportiez ne me paraît nullement invraisemblable.
Participant — Est-ce que le plaisir aujourd’hui relève de la logique des Antiques ou des Modernes ? Cette évolution de la forme marchandise produit un retour à l’incorporation. Peut-être bien que la solution ne sera pas trouvée du côté du maître, mais peut-être du côté du pas-tout ?
J.-C. M. — C’est pour moi une question ouverte. Je suis sensible, comme Jacques-Alain Miller et comme la plupart des lacaniens que j’ai pu entendre, au fait que le genre féminin est aujourd’hui celui qui tient le manche. Il n’est pas évident que ce soit éternel. Il n’est pas absolument certain qu’il ne se produise pas des retournements. Je perçois la possibilité d’un déplacement.
Participant — Est-ce qu’à partir du triomphe de la forme marchandise, avec la demande de ne pas dire qu’il y a de l’impossible, ce n’est pas entretenir dans cette forme marchandise une forme de jouissance sans fin ?
Qu’en est-il du plaisir au XXIe siècle ?
J.-C. M. — La forme marchandise peut s’emparer du plaisir et le polymériser, passer du plaisir singulier aux plaisirs pluriels. Vous savez comme moi que la différence singulier/pluriel, ici, est véritablement un changement radical. Il est possible que ce ne soit pas la jouissance sans fin, mais les plaisirs sans fin. Il ne faut jamais oublier cette espèce de résolution imaginaire qu’est la transaction; entre deux termes qui s’opposent, on fait passer un troisième terme qui dit oui à l’un et qui dit oui à l’autre. Parmi les sociétés qui sont les nôtres, la société française y recourt largement. La fécondité de l’imaginaire transactionnel me confond toujours par sa capacité d’invention. La forme marchandise et l’imaginaire de la forme marchandise peuvent secréter une figure de transaction entre le plaisir et la jouissance : c’est ça que j’appellerais les plaisirs.
J. R. — Jean-Claude Milner, je vous remercie. Nous avons été plusieurs à lire votre texte Le triple du plaisir et nous avons buté sur le mot « épeler » : « Seule une qualité matérielle peut épeler le plaisir ». Pourriez-vous nous éclairer sur ce terme ?
J.-C. M. — Prenons un autre mot : « projeter ». On projette ce singulier qu’on appelle le plaisir sur un corps. Le corps est morcelé. Suivre le parcours de l’objet qui cause le plaisir, c’est donc le soumettre à un morcellement, comme si l’on épelait un mot, lettre par lettre. Telle ou telle qualité de l’objet épelle le plaisir du corps.
Jean-Claude Milner