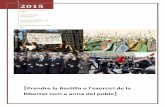Prendre la route à bord du microbus. Mobilités, ancrages et territorialité chez des Roms roumains...
Transcript of Prendre la route à bord du microbus. Mobilités, ancrages et territorialité chez des Roms roumains...
Migrations humaines et mises en récit mémorielles
Approches croisées en anthropologie et en préhistoire
presses universitaires de paris ouest
sous la direction de Michèle Baussant, Irène Dos Santos,
évelyne Ribert et Isabelle Rivoal
2015
© Presses universitaires de Paris Ouest
isbn : 978-2-84016-210-0
collection
Sociétés humaines dans l’histoire dirigée par Frédéric Hurlet et Isabelle Rivoal
www.pressesparisouest.fr
Logiques mémorielles et temporalités migratoires. Une introduction. ................................................................................. 11
Michèle Baussant, Irène Dos Santos, évelyne Ribert et Isabelle Rivoal
1re partie Récits institutionnels
Memory Studies and Migration Studies at the Crossroads: an Anglo-Saxon Perspective. ................................................................ 37
Irial Glynn and J. Olaf Kleist
Retracer des migrations préhistoriques : un cas d’étude sur la néolithisation de l’Europe. .................................. 59
Catherine Perlès
L’expansion bantoue : dynamiques des populations et dynamiques environnementales. ...................................................... 93
Augustin F. C. Holl
Du pot au mythe : « Nos ancêtres les Lapita… » ou la production d’une « épopée » préhistorique. ................................117
Rémi Hadad
2e partie Entre mémoires vives
et mises en récit publiques
Interprétations plurielles d’une migration planifiée. Des usages de l’histoire et des légendes en amont du barrage des Trois Gorges (Chine). ..................................................149
Katiana Le Mentec
Sommaire
Temporalités et appartenances dans les récits de « retours » des anciens réfugiés laotiens et de leurs descendants. .......................................................................183
Brett Le Saint
« We didn’t drop from the sky ». Récits du passé et enjeux du présent pour les organisations portoricaines de New York. ......................................203
Audrey Célestine
Entre crise politique et phénomène migratoire à Madagascar, le cas du doany, demeure royale devenue esprit. .....................................................................................225
Elisabeth Rossé
Mémoire diasporique, mémoire exilique : réflexions à partir des exemples marocains et polonais. ......................249
Thomas Lacroix
3e partie La migration comme séquence biographique
Des plantations ivoiriennes à la rue ouagalaise. Transmission silencieuse d’une tradition de mobilité . ........................ 275
Muriel Champy
Prendre la route à bord du microbus. Mobilités, ancrages et territorialité chez des Roms roumains entre Arad et Montreuil. .....................................................295
Norah Benarrosh-Orsoni
Allers-retours. Le genre dans les récits migratoires des Afghans en Iran. ....................325
Azita Bathaïe
Rhythm and blues de sans-papiers parisiens. ....................................343
Frédérique Fogel
Un étudiant sahélien en URSS. Temporalités fragmentées et récits d’expérience . ................................369
Michèle Leclerc-Olive
Les auteurs. .........................................................................................397
295
Prendre la route à bord du microbus. Mobilités, ancrages et territorialité chez des Roms
roumains entre Arad et Montreuil
D epuis le début des années 1990, les migrations internationales durables ou temporaires ont remplacé en Roumanie les mobilités de travail internes qui prévalaient avant 1989. La restructuration
de l’économie locale qui a suivi la fin du régime communiste a été particu-lièrement longue et difficile pour nombre de Roumains. La transition s’est réalisée, au niveau individuel, au travers de séjours temporaires à l’étran-ger1. Les circulations pendulaires du début des années 1990, orientées vers le commerce informel de biens matériels encore inabordables à l’Est, ont été décisives dans le développement et la diversification des migrations dans cette région. Les mobilités marchandes de courte durée se sont multi-pliées jusqu’au pic de cette pratique, en 1992-19932, avant de diminuer pro-gressivement à partir de 1994, remplacées par des mobilités de travail toujours temporaires3. L’abolition progressive des contrôles aux frontières et l’avènement d’une liberté totale de circulation4 au sein de l’Union européenne (UE) ont transformé de façon fondamentale les pratiques migratoires des Européens pauvres5. Aujourd’hui, environ 10 % de la popu-lation roumaine est concernée par des mouvements migratoires de natures et de durées diverses. Le pays est en retour parmi les premiers bénéficiaires
1. Sandu Dimitru, 2010 : 35.
2. Konstantinov Yulian, 1996.
3. Diminescu Dana, 2003b.
4. L’année 2002 marque la fin de l’exigence de visa pour les déplacements des citoyens roumains au sein de l’espace Schengen, dont les séjours restent cependant limités à 90 jours. L’entrée du pays dans l’UE en 2007 leur permet de circuler et de séjourner sans limitation de temps, mais ne leur donne pas, en France du moins, accès au marché du travail.
5. Pour une description des pratiques migratoires et des stratégies de passage des frontières terrestres en Europe avant 2002, voir notamment les travaux de Dana iminescu (Diminescu D., 1999, 2001, 2003a).
296
Norah Benarrosh-Orsoni
des remises de fonds à l’échelle européenne6, qui sont principalement investies dans l’acquisition de biens non productifs7 et les constructions immobilières8.
Les migrations des Roms roumains s’inscrivent donc dans un contexte national et régional fortement marqué par des circulations pendulaires. Mais si les stratégies migratoires de nombre d’entre eux continuent d’im-pliquer une grande mobilité internationale, pour les Roms d’Arad installés à Montreuil, la mobilité s’est désormais doublée d’un réel ancrage dans leur lieu de résidence. Pour beaucoup des Roms dont il est question ici, la liberté de circulation se manifeste avant tout comme une possibilité de se déplacer à leur guise entre les deux pays, ce qui leur permet de se penser à la fois « ici » et « là-bas », de s’inscrire dans une dualité spatiale9, et d’entretenir de solides attaches avec leur village d’origine.
Se maintenir ainsi « dans » la mobilité10, et profiter simultanément de la complémentarité de deux lieux d’ancrage est une stratégie d’ajustement quotidienne adoptée par les groupes et individus migrants les plus divers11. Cette tendance, qualifiée de multilocality12, constituerait une « technique culturelle », voire même une « stratégie subversive ». Elle rejoint l’idée de simultaneity développée par Peggy Levitt et Nina Glick-Schiller13, qui désigne des modes de vie « qui incorporent des activités, des routines, des institutions quotidiennes localisées à la fois dans le pays de destination et transnationalement14 ». Ces deux notions intéressent notre propos en ce qu’elles insistent sur le fait que des modes de vie mobiles, qui multiplient les références spatiales, ne sont pas synonymes de perte d’ancrage.
6. SOPEMI OECD 2011.
7. Anghel Remus-Gabriel, 2010.
8. Grigoraş Vlad, 2006.
9. Les transformations du paysage des migrations informelles survenues ces deux dernières décennies résultent par ailleurs de facteurs technologiques qui ont fait émerger la figure d’un migrant « connecté » (conceptualisée par Diminescu D., 2005 et Nedelcu Mihaela, 2002, 2010a et 2010b), ainsi que de facteurs socio-éco-nomiques qui ont contribué à généraliser l’inscription des migrants dans des réseaux variés (Potot Swanie, 2006).
10. Diminescu D., 1999.
11. Rolshoven Johanna, 2007 : 19.
12. Ibid.
13. Levitt Peggy et Glick-Schiller Nina, 2004.
14. Ibid., p. 1003.
297
Prendre la route à bord du microbus…
Au contraire, les ancrages locaux simultanés se renforcent mutuellement, et créent davantage de liens significatifs que de séparation15.
L’existence d’un tel double ancrage est au fondement des circulations des Roms installés à Montreuil, et c’est sur cette mobilité que notre analyse est centrée dans cet article. Pour ce faire, nous allons rencontrer les Roms alors qu’ils s’apprêtent à prendre la route, qui pour rentrer à Montreuil, qui pour rentrer « à la maison » (khere), en Roumanie. En abordant ainsi « la route », nous déplaçons quelque peu notre regard sur un certain type de circula-tions transnationales, pour nous intéresser aux opérateurs de ces déplace-ments, à leurs composantes matérielles et au voyage lui-même. Partout dans le monde, des transporteurs mettent en circulation des personnes, marchandises et devises qui structurent le champ migratoire16 spécifique à chaque groupe de migrants. Ils méritent une attention particulière et une description détaillée si l’on veut comprendre de quoi est fait ce quotidien ancré dans plusieurs lieux, comment des flux divers et continus composent et transforment ces champs.
Il s’agit donc de comprendre une forme de migration transnationale par une approche du dispositif de mobilité qui relie les deux lieux d’ancrage principaux des Roms. L’ethnographie montre notamment que les déplace-ments baignent dans une atmosphère d’improvisation, qui témoigne d’une temporalité particulière, dont les ressorts sont examinés ici. À partir de l’exemple de ce groupe et des interactions qui émergent sur la route, nous dégagerons certaines logiques de circulations où se rencontrent parfois Roms et gadjé (non-Roms), et qui structurent le champ social original de ces migrations européennes. Les Roms de ce groupe ne sont pas très loquaces lorsqu’il s’agit d’évoquer des souvenirs datant de leurs premiers déplacements à l’étranger. La plupart relatent quelques anecdotes en des termes plutôt vagues, adoptent une chronologie fantaisiste, et passent rapi-dement des difficultés de la vie sous Ceausescu à leur décision de se rendre en France au début des années 2000. Cette approximation générale est certes liée à l’ennui que leur provoquent les situations d’entretien formel, ainsi que les questions sur des événements historiques qui d’après eux, n’ont jamais intéressé personne. Mais l’absence de développement d’une mémoire partagée des circulations internationales de ces vingt dernières années remet également en question l’idée du départ en migration comme événement de rupture.
15. Rolshoven J., 2007.
16. Simon Gildas, 1981.
298
Norah Benarrosh-Orsoni
Organiser le mouvement
Roms de Montreuil
Les Roms dont il est ici question sont originaires du bourg de Ghireşteni17 et de certains villages alentour situés à quelques dizaines de kilomètres au nord d’Arad (ouest de la Roumanie). Dans chaque famille, une partie, voire tous les membres vivent à l’étranger et subviennent aux besoins écono-miques de celles et ceux qui restent vivre au village. Un certain nombre de ces Roms se sont installés à Montreuil au début des années 2000, où ils ont peu à peu noué des liens avec des habitants, des militants et parfois des associations, trouvé quelques opportunités de travail ou de commerce. Au fil des années, une partie des familles a exploré de nouvelles destinations, en particulier la Grande-Bretagne, mais beaucoup sont restées à Montreuil, malgré la précarité économique et les longues années de vie en squat ponctuées d’expulsions. Depuis 2008, ce groupe a été relogé par les services de la Mairie dans une installation transitoire, sur un terrain équipé de caravanes, accompagné par des travailleurs sociaux, avec l’objectif de les faire accéder, individuellement, au logement de droit commun, à la sco-larisation, la formation et l’emploi18. La plupart passent l’année à Mon-treuil, ne retournant au village que pour les « vacances ». Un temps où l’on visite sa famille, où l’on s’occupe de sa maison – à construire, à rénover, à redécorer selon les modes les plus récentes –, où l’on retrouve les parents éloignés qui vivent ailleurs en Europe. Le village est devenu le lieu qui « mange » en quelques semaines toutes les économies patiemment thésaurisées pendant l’année.
Le système de transport que les Roms empruntent pour leurs déplacements entre les deux pays s’est révélé être un des outils majeurs de leur organisation migratoire19. Ce microbus de neuf places est, à quelques exceptions près, le seul moyen de transport qu’ils utilisent, et c’est celui que j’ai expérimenté chaque fois que je me suis rendue en Roumanie dans le cadre de cette recherche.
17. Les noms des lieux situés en Roumanie sont fictifs, et les prénoms des inter-locuteurs cités dans le texte également.
18. Pour une analyse du relogement des Roms à Montreuil et de la mobilisation militante qui l’a rendu possible, voir Benarrosh-Orsoni Norah, 2011.
19. Aux côtés des technologies de l’information et de la communication (TICs) qui ont servi au développement et au maintien d’une coprésence quotidienne dans ces familles élargies, dispersées entre différents pays, ce moyen de transport fait partie d’un ensemble d’outils qui leur permettent d’entretenir un sentiment de groupe et une cohésion sociale au-delà de la dispersion géographique.
299
Prendre la route à bord du microbus…
Il a la particularité significative d’être possédé, organisé et géré par Vasile et Ioana, un couple roumain, non-rom, originaire du nord du pays. Depuis plus de dix ans, le couple et leurs deux associés sont les convoyeurs presque exclusifs des Roms originaires de la région d’Arad qui ont migré à Montreuil. Ils sont aussi connus de tous les Roms roumains des squats et terrains pari-siens, dont beaucoup ont déjà utilisé les services de « Vasile Transport ».
Ce microbus s’inscrit dans un phénomène bien plus large, que l’on retrouve dans de nombreuses migrations : des systèmes de transports, qua-lifiés d’« autoproduits », sont mis en place par les groupes directement concernés, « en marge des opérateurs classiques du transport tout autant que des institutions locales et régionales20 ». Comme le résumait Alain Tarrius dès 1985, « il s’agit d’une sorte de savoir-faire de populations ou groupes sociaux particuliers, capables d’une grande créativité en matière de définition des services, indépendamment des impératifs régle-mentaires, techniques ou économiques […]21 ». Cette double caractéris-tique – informalité et organisation par les groupes sociaux concernés – a son importance puisque, nous allons le voir, elle conditionne en grande partie leur succès.
Un fonctionnement en réseau
Les clients de Vasile, en majorité, sont Roms ; ils se déplacent en famille et viennent du même réseau de villages proches de Ghireşteni. Dans le microbus, il n’est pas rare de rencontrer également des voyageurs gadjé qui se déplacent seuls ou en couple, ainsi que quelques Kaştalé22. Utilisateurs moins réguliers des services de Vasile, ils se situent à la marge du vaste réseau de clients-voyageurs roms. L’accès aux services de Vasile n’est en rien secret ou fermé mais nécessite de faire partie, sinon d’une communauté bien définie, du moins du réseau élargi où existent les ressources relation-nelles indispensables pour être présenté aux conducteurs. C’est en étant d’abord introduite par les personnes avec qui j’allais voyager la première fois que j’ai par la suite pu traiter directement avec Vasile ou son épouse
20. Faret Laurent, 2004 : 159.
21. Tarrius Alain, 1985 : 39.
22. Les Kaştalé (pluriel de Kaştalo) existent partout où il y a des groupes dits « tsiganes », sous des appellations qui varient en fonction des régions (Olivera Martin, 2007) – et qui ne correspondent, pour les individus concernés, à aucun autonyme. Ils représentent pour les Roms « respectables », non seulement les « autres » par excellence, mais précisément les « pires autres », des « Tsiganes ratés » qui n’ont ni langue, ni culture, ni moralité (Olivera M., 2007, 2009).
300
Norah Benarrosh-Orsoni
pour organiser mes déplacements vers et depuis la Roumanie. Pour moi et tous les autres voyageurs potentiels et ponctuels, l’unique point de négociation a concerné la destination du trajet.
Le réseau commercial de Vasile est donc composé de différents cercles, au sein desquels ses services ont une importance très variable. Si pour les gadjé, Kaştalé et autres voyageurs ponctuels, il n’est parfois qu’une res-source périphérique dans l’organisation de leurs déplacements et de leur migration, pour les Roms de Montreuil en revanche, le microbus ainsi que tous les services et individus qui l’accompagnent sont des ressources pré-cieuses, centrales dans la perpétuation de leur double ancrage. En effet, bien que les liens familiaux, d’alliance et de voisinage soient la véritable base et le support premier du processus social qu’est la migration, ces rela-tions étroites ne suffisent pas, seules, à la mise en mouvement des per-sonnes, des biens et des informations. Le développement de « liens faibles23 » est également nécessaire à la constitution d’un réseau migrant24 efficace, qui doit permettre l’organisation des mobilités, et assurer le développe-ment et la diffusion, l’efficacité et la légitimité du système de transport informel utilisé, ici, par les Roms25.
Des transports insuffisants et inadaptés
La première raison du succès des services de transport informels interna-tionaux réside dans l’insuffisance chronique et l’inadaptation aux migrants26 des offres des transports disponibles. Comme le résume Abel Valenzuela, « le transport communautaire se développe quand les résidents – qui par-
23. Granovetter Mark, 1973.
24. Utilisée depuis la fin des années 1980 pour décrire les migrations internatio-nales informelles, la notion de réseau migrant peut être définie comme « l’ensemble des liens interpersonnels qui relient les migrants, les futurs migrants, et les non-migrants dans les espaces d’origine et de destination, à travers les liens de parenté, d’amitié, et une origine communautaire partagée » (Massey Douglas et al. 1993 : 434). Swanie Potot ajoute à cette définition le « vaste ensemble d’acteurs qui participent à l’économie de la migration », composé non seulement des employeurs, mais aussi des agents du marché noir des titres de circulation, du financement de ces circulations, et de la gestion des transferts de fonds (Potot S., 2006).
25. Faret L., 2004.
26. Parmi les nombreuses études qui se sont intéressées au développement de ces offres informelles, on peut citer en désordre Stéphane de Tapia (1996, 2004), Jean-François Pérouse et Céline Borgel (2004) pour la Turquie, Serge Weber (2003, 2009, 2010) pour les Roumains et Ukrainiens en Italie, Alain Tarrius (1985, 1987) pour Lyon et Marseille, Abel Valenzuela (2005) à propos des camionetas des Mexicains en Californie, Camille Schmoll (2004) pour les Algériens de Naples.
301
Prendre la route à bord du microbus…
tagent un même lieu ou un même réseau social – s’aperçoivent qu’un besoin en termes de déplacements reste insatisfait et s’organisent, soit comme volontaires soit comme entrepreneurs, pour y remédier27 ». Cette carence constitue sans surprise, pour les entreprises informelles, un espace commercial opportun, ainsi qu’un contexte favorable à l’émergence de nouvelles offres plus adaptées aux besoins des migrants.
Entrepreneurs migrants
Parcours
Dans chaque région ou continent, les mutations successives des régimes migratoires influencent de manière décisive les pratiques de mobilité des migrants et de fait, celles de leurs transporteurs. Au sein de l’UE, l’établis-sement progressif d’une libre circulation des personnes a peu à peu faci-lité les déplacements des migrants roumains28 et l’essor des offres de transport informel. Vasile s’est une première fois lancé dans le transport en 2001, au moment où beaucoup de Roms de Ghireşteni sont arrivés à Montreuil. Son activité a pris un premier essor après 2002 et la fin de l’exigence de visa pour les citoyens roumains qui voulaient circuler dans l’espace Schengen. Cette évolution a sensiblement réduit les coûts non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les transporteurs : moins de contrôles à chaque frontière, et autant moins de bakchich à payer pour les franchir. La durée légale de séjour restait cependant limitée aux trois mois touristiques, ce qui entraînait pour les voyageurs des frais supplé-mentaires de déplacement pour faire tamponner les passeports à l’étran-ger, en Belgique notamment. Vasile a renoncé à cette activité lorsqu’elle a engendré plus de frais que de bénéfices, avant de s’y consacrer de nouveau à plein-temps quand la Roumanie est entrée dans l’UE, en 2007. Le couple est entre-temps retourné à des activités économiques plus classiques. Pendant un temps, Vasile et Ioana ont vécu dans une maison squattée de l’est parisien, travaillé au noir dans la construction et le nettoyage, et mis à profit l’accessibilité du système de soins français pour leur enfant malade, qu’ils ont alors scolarisé à Paris. Entre 2004 et 2005, ils ont de nouveau vécu à Arad, où ils ont monté une petite entreprise de bâtiment
27. Valenzuela A., Schweitzer L. et Robles A., 2005 : 898, traduction de l’auteur.
28. … tandis que, bien sûr, les frontières extérieures de l’UE se sont vues peu à peu renforcées, sécurisées, jusqu’à devenir théoriquement infranchissables (Rodier Claire, 2010).
302
Norah Benarrosh-Orsoni
indépendante, qu’ils ont exploitée pendant quelques années. Lorsqu’ils ont repris leurs activités de convoyage, ils ont confié la gestion de l’entre-prise de bâtiment à un associé, mais ont tenu à en conserver la propriété afin de faciliter leur reconversion en cas de revers de fortune ou de bou-leversement législatif qui mettrait en péril leur activité actuelle. « On ne sait jamais ce qui peut arriver ici » est une phrase que l’on entend fort souvent parmi les migrants roumains, qui sont pourtant peu nombreux à prendre de telles mesures de précaution.
Réseau et famille
Depuis 2007 donc, la circulation entre la Roumanie et les autres pays membres de l’UE est devenue complètement fluide ; Vasile Transport a prospéré et s’est développé. C’est d’abord lui qui a travaillé seul au volant d’un microbus, puis le couple a acquis un second véhicule, conduit par Ioana. Enfin, ils se sont associés à un, puis deux autres conducteurs rou-mains, eux aussi propriétaires de leur véhicule. Tous les quatre sont instal-lés dans le même quartier de la banlieue de la ville d’Arad. Aujourd’hui, Vasile continue de superviser la liste des passagers potentiels ; il confirme les jours de départ, s’assure du paiement de chacun, du chargement des coffres. Les clients roms s’adressent d’abord toujours à lui, et il n’hésite pas à distribuer les cartes de visites de la petite entreprise qui porte son nom.
Bien qu’elle soit restée totalement informelle, l’entreprise est très structu-rée et la famille proche du couple a été mise à contribution. À Paris, ils ont mis en place un système de résidence collective avec leur fille aînée et le frère de Ioana, qui travaillent à Paris, et leurs deux conducteurs associés. En 2010, tous louaient ensemble un appartement de deux-pièces en banlieue pari-sienne. Ils racontent que c’est grâce à leurs relations de longue date et de « confiance » avec le propriétaire de l’appartement, qui possédait également le kebab situé au pied du même immeuble, que ce dernier a accepté de leur louer le logement bien qu’ils n’aient pas de revenus fixes. C’est là que les transporteurs logeaient lorsqu’ils arrivaient à Paris en milieu de semaine, pour une nuit ou deux. Les membres de la famille restés à Arad sont eux aussi impliqués dans l’affaire. Vasile et Ioana sont venus de Satu Mare pour s’ins-taller dans la banlieue d’Arad il y a une quinzaine d’années. La sœur de Vasile et son mari les ont suivis, et c’est à eux qu’incombe une partie du « secréta-riat ». Dans leur maison commune d’Arad, le téléphone sonne en perma-nence pour organiser les départs, les arrivées, les livraisons de colis, etc. L’un ou l’autre est toujours là pour décrocher, prendre des notes, transmettre les messages qui proviennent des clients, mais aussi des épouses des deux conducteurs associés. Pour le bon fonctionnement et la pérennité d’une
303
Prendre la route à bord du microbus…
entreprise aussi informelle que celle-ci, et pour s’assurer une trajectoire sociale lentement, mais sûrement ascendante, les entrepreneurs migrants doivent donc pouvoir compter d’une part sur l’existence de réseaux au sein desquels jouent des liens de confiance, et d’autre part sur les liens familiaux, maillon indispensable de ce développement économique entre deux pays.
Vasile et sa famille ont investi une part conséquente de leurs ressources financières dans la construction d’une impressionnante maison, dont le chantier a duré près de quinze ans. Après avoir célébré le mariage de leur fille à Satu Mare, leur région d’origine, et mangé la pièce montée en forme de Tour Eiffel, c’est dorénavant à la construction de sa maison à elle, dans le même quartier d’Arad, que sont dévolus les bénéfices engendrés par leur activité. En cela et en bien d’autres points, les transporteurs partagent avec leurs clients roms certaines stratégies et expériences migratoires, mais sur-tout la plupart de leurs rêves et ambitions. Mais plus largement, les trajec-toires des uns et des autres ressemblent à celles des innombrables Roumains partis travailler à l’étranger, notamment à celles des migrants du Pays d’Oaş, réputés pour leur acharnement au travail… et leur penchant pour les mai-sons monumentales29. Pour ces migrants qui circulent aisément en Europe, les investissements immobiliers en Roumanie, et les pratiques et habitudes quotidiennes développées dans le lieu de résidence, alimentent la construc-tion d’un chez-soi nécessairement double. Dans ce contexte précis, la maison apparaît comme un « investissement émotionnel30 » doublé d’une obligation de compétition31. Les constructions ostentatoires au village, qui sont parfois la raison première de l’installation à l’étranger, permettent finalement aux migrants d’articuler de façon cohérente leur attachement à deux lieux d’an-crages distants.
Tenter sa chance
Parmi les Roms de Montreuil et ceux rencontrés à Ghireşteni, plusieurs hommes se sont lancés, à un moment ou un autre, dans le transport de leurs pairs. La plupart ont littéralement « tenté leur chance » avant de renoncer devant l’ingratitude de la tâche, la difficulté de rentabiliser ce qu’ils investissent dans les véhicules, leur coûteux entretien32, l’essence et les lourds frais de la route.
29. Moisa Daniela, 2009 ; Calinescu Petrut, 2012.
30. Anghel R.-G., 2010.
31. Moisa D., 2009.
32. Comme l’expliquait l’un des conducteurs, pour justifier leurs soucis méca-niques à répétition : « Vous, les Français, vous faites 2 000 km par an… Nous on fait 2 000 km chaque jour ! »
304
Norah Benarrosh-Orsoni
Certains ont conservé cette possibilité comme activité d’appoint, qu’ils pratiquent encore de temps à autre. Ce sont en particulier des villageois qui ne migrent pas, souvent des gadjé, qui, dans les villages, sont désormais sollicités par les Roms de retour pour leurs déplacements locaux33. Les Roms « en vacances » pourraient, bien sûr, prendre le car qui passe à heure fixe pour se rendre dans les villes alentour, ou le taxi collectif – qui ne part que lorsqu’il est plein – pour un prix modique. Mais devoir se soumettre à des horaires précis semble être pour tous une raison suffisante pour préfé-rer les services d’un chauffeur individuel, dont la rémunération vient grossir les nombreuses dépenses des Roms au village.
Les activités éphémères des transporteurs, locaux ou internationaux, s’inscrivent dans les multiples essais des migrants, entrepreneurs et un peu aventuriers, qui tentent leur chance à répétition dans les activités les plus diverses. Mais, si peu de migrants réussissent à pérenniser et rentabiliser leur activité de transporteur, pourquoi Vasile et ses partenaires ont-ils réussi mieux que les autres ? Pour comprendre le succès d’une telle entre-prise, il nous faut examiner ses caractéristiques, ses modalités de fonction-nement, comprendre quels sont les besoins spécifiques des migrants roumains, et notamment des Roms, que les services de Vasile Transport satisfont si bien.
Un service « intégré » de transport
Avec leurs quatre véhicules, Vasile et ses partenaires passent littéralement leur vie sur la route. Le trajet entre l’Ouest de la Roumanie et la région pari-sienne dure une vingtaine d’heures – auxquelles il faut ajouter les embou-teillages, les rendez-vous, les retards, les chargements qui traînent en longueur… Pour combattre la fatigue, le conducteur consomme quantité de Redbull, de graines de tournesol, et de chansons d’amour diffusées à plein volume dans l’habitacle du véhicule. Chacun d’eux fait un aller et un retour par semaine, minutieusement planifiés, en théorie. Ils quittent Arad en début de semaine, après avoir été chercher leurs clients dans les villages de la région, et arrivent à Paris le lendemain midi. Ils passent une ou deux nuits à Paris, remplissent de nouveau leur bus de passagers et de colis, et sont de retour à Arad en fin de semaine. C’est de la manière suivante que Vasile, lors d’une de ses visites chez les Roms à Montreuil, m’expliqua l’organisa-
33. À Ghireşteni par exemple, tout le monde a le numéro de téléphone de Tibi, que l’on appelle du jour pour le lendemain : qui pour effectuer une démarche administrative en ville ; qui pour passer quelques heures chaque matin, sans excep-tion, avec un parent hospitalisé à Arad…
305
Prendre la route à bord du microbus…
tion de leurs trajets, alors que je m’apprêtais à voyager de nouveau avec lui, en février 2010 :
V : Vous voulez aller en Roumanie ?N : Oui. La semaine prochaine.V : La semaine prochaine, pas de problème. Il y a trois voitures qui
partent. Une part mercredi, une jeudi, une vendredi. Mercredi, peut être c’est ma femme qui part.
N : Alors à quelle heure partira votre femme ?V : Elle arrive ici, sur le terrain, à midi.N : Et votre voiture à vous elle part quel jour ?V : Euh… Je pars mercredi, ou vendredi… Normalement, je viens…
C’est moi qui pars en dernier. Même de la Roumanie, je viens en dernier. Nous sommes trois voitures : je prépare une voiture, deux voitures… la troisième voiture, c’est moi que je pars. Toutes les semaines nous sommes là. Tous les… lundi, mardi : on vient de Roumanie. Mardi… Mercredi, jeudi, vendredi : on a des bus qui partent. Et le week-end, c’est en Roumanie. Parce qu’avant, on travaillait le week-end aussi, mais c’est pas bien. Parce que dimanche… Dimanche c’est l’église. Et travail-tra-vail, on oublie. »
Si cette coordination des véhicules est effectivement celle que l’on observe le plus souvent, il arrive parfois que deux conducteurs s’organisent en binôme pour un trajet – au début de l’été notamment, période à laquelle les voyageurs sont nombreux à rentrer en Roumanie. Cas plus rare enfin, en juin 2011, trois microbus revenaient ensemble de Roumanie, formant un joyeux convoi de Roms exclusivement Ghireşteani, qui s’apprêtaient à retrouver leurs caravanes, toutes situées sur le même terrain montreuillois. En entrant dans le détail du travail quotidien des transporteurs, nous allons comprendre ce qui fait de cette entreprise un véritable service « intégré » de transport, « où s’associent différentes formes de prise en charge et où l’inté-gralité du déplacement est assurée, depuis le lieu d’origine et jusqu’à la destination finale34 ».
Visites à domicile
Les conducteurs ne lésinent pas sur les efforts pour remplir leur bus avant les départs depuis Montreuil. Vasile et ses partenaires font le tour des installations, des plus précaires et éphémères aux plus confortables et pérennes, passent du temps chez les gens pour démarcher les éventuels voyageurs. Ils récoltent les colis à convoyer, négocient les prix pour que le plus de gens possible voyagent. Le téléphone portable reste l’outil princi-
34. Faret L., 2004 : 162.
306
Norah Benarrosh-Orsoni
pal d’organisation, et c’est par ce biais que l’on établit le contact préalable à l’organisation d’un voyage. Les microbus sont toujours en circulation dans un sens ou dans l’autre et lors de ce premier contact, Vasile donne systémati-quement son accord aux futurs voyageurs. Mais c’est ultérieurement que sont fixés les détails, lors du passage des conducteurs sur les lieux de vie des Roms… et les voyageurs doivent patienter, sans savoir à quel moment ils vont se montrer. Lorsqu’un des conducteurs arrive aux abords d’un lieu d’habita-tion des Roms à Montreuil, l’attroupement autour de son véhicule est immé-diat ; les voyageurs potentiels, autour de Paris, sont toujours très nombreux.
La question n’est donc jamais de savoir si l’on pourra partir, mais d’at-tendre que le conducteur décide quand aura finalement lieu le prochain départ. Sara, qui voulait s’assurer que je voyagerais dans de bonnes condi-tions, déclara un jour « je vais lui parler pour toi ! » et décrochant son télé-phone, demanda à Vasile à quel moment je pourrais partir avec lui. Ce dernier donna un accord de principe, ajoutant simplement qu’il viendrait sur place plus tard dans la journée. À travers la fenêtre de la caravane de Sara, on voit presque toutes les allées et venues sur le terrain. Vasile arriva bien plus tôt qu’il ne l’avait annoncé, et s’arrêta un moment devant différentes caravanes, visiblement habitué à se repérer parmi les emplacements et leurs nombreux occupants. Sara toqua contre la vitre pour l’inviter à entrer et suite à la dis-cussion – l’entretien relaté plus haut –, on convint que je partirais le mercredi avec sa femme. Rendez-vous me fut donné sur place… et le départ eut fina-lement lieu le jeudi. Une indécision apparente semble être le trait marquant de cette organisation. Les voyages ont pourtant lieu chaque semaine, sans exception, et jamais le microbus ne circule à moitié plein.
Porte-à-porte
Le porte-à-porte inclus dans les services de Vasile ne s’applique qu’à la région parisienne, et à un rayon géographique limité au nord d’Arad, où sont concentrés les villages qui constituent les quelques destinations habituelles des voyageurs Roms.
Costi est un autre transporteur rom avec qui j’ai voyagé en 2010 depuis Prisani, le village de Sara. Il part quant à lui de la région de Beiuş, qu’il relie principalement à Bruxelles et Charleroi. Cependant, dans ce paysage d’in-formalité et d’incertitude, rien n’est trop strictement établi, et toutes les négociations sont envisageables. À Prisani, les choix de migration sont divi-
307
Prendre la route à bord du microbus…
sés également entre Bruxelles et Marseille35, et Costi fait ponctuellement route vers le sud de la France, lorsqu’il se trouve suffisamment de candidats au départ et bien sûr, au retour. De la même manière, si un convoi entier de fidèles clients montreuillois doit exceptionnellement se rendre en visite à Prisani36, Vasile peut trouver son compte à faire 120 km supplémentaires pour les amener à bon port, plutôt que de laisser les passagers choisir les services d’un autre transporteur.
Les usagers du microbus rappellent souvent que la prise en charge de porte à porte reste à leurs yeux le principal avantage de ce service. À Mon-treuil comme au village, ils détestent devoir se rendre à pieds à l’épicerie, à l’église ou en visite, et prennent leur voiture – ou paient un chauffeur, comme on l’a vu – pour le moindre déplacement. Ce dédain pour les trans-ports en commun est d’autant plus fort que les Roms voyagent très chargés – du moins vers la Roumanie –, déplaçant avec eux d’impressionnants stocks de nourriture, de cadeaux et parfois de meubles. L’équation que fai-sait Florica semble en effet, dans une telle situation, sans appel. Si elle voya-geait avec une compagnie de bus officielle, elle paierait de toute façon une centaine d’euros pour le trajet Paris-Arad. Elle devrait ensuite se débrouil-ler avec ses nombreux bagages et trouver un taxi privé qui accepterait de la conduire à son village, moyennant une trentaine d’euros supplémentaires. Quant au voyage en avion, il ne trouve aucune grâce à leurs yeux, si ce n’est en l’unique occasion que représente l’aide au retour humanitaire (ARH37). La grande majorité des Roms que je connais a bénéficié de cette manne financière, ponctuelle et littéralement tombée du ciel et a, à cette occasion, vécu son unique expérience d’un voyage en avion.
35. Sara constitue le lien qui m’a permis de fréquenter les deux villages dont il est
question ici. Originaire de Prisani, elle a épousé un jeune homme de Ghireşteni avec qui elle vit aujourd’hui à Montreuil, alors que sa propre famille est installée à Marseille.
36. Comme ce fut le cas lors de mon premier voyage, quand Sara, sa famille et moi-même nous rendîmes directement de Montreuil à Prisani pour séjourner chez ses parents.
37. Instaurée en 2007, l’ARH impliquait qu’en échange de 300 euros par adulte et de 100 euros par enfant, les étrangers qui acceptaient de quitter la France pour se « réinsérer » dans leur pays grâce à ce pécule, étaient rapatriés par avion. Ce dispo-sitif a principalement permis de faire grimper les chiffres annuels du nombre des expulsions, à frais bien moindres que les expulsions forcées. En pratique, l’ARH a surtout été proposée à des Roms roumains et bulgares, qui restaient libres de reve-nir sur le territoire français. Elle a été supprimée début 2013 en raison de son inef-ficacité à éloigner durablement ses bénéficiaires.
308
Norah Benarrosh-Orsoni
Enfin, il est vrai que voyager seul et en ayant recours à des compagnies officielles implique de devoir s’occuper soi-même de formalités adminis-tratives que tous ne maîtrisent pas parfaitement : la limitation des inter-médiaires et des interactions avec les fonctionnaires, douaniers et les autorités diverses est un avantage qui n’a pas de prix38. Partout, les clients-voyageurs partagent « avec les tenants de ces sociétés le même souci de diminuer au maximum les aléas du voyage et les surcoûts auxquels il donne traditionnellement lieu39 ».
Flexibilité
La flexibilité, dont on a évoqué quelques aspects, est l’une des caractéris-tiques majeures de cette organisation. Elle se manifeste également par la possibilité de voyager à crédit (ujilè) lors des trajets vers la France. Après avoir dépensé toutes leurs économies durant leur séjour au village, les Roms qui rentrent à Montreuil doivent en quelque sorte « se refaire » une situa-tion, pour pouvoir tout d’abord payer la somme due aux transporteurs. Ces derniers, pour faire fonctionner leur affaire, sont fatalement amenés à accorder quelques jours de crédit, une semaine tout au plus, à leurs passa-gers qui retournent rapidement au travail, à la manche, à la ferraille. Lors des trajets en sens inverse en revanche, aucun crédit de paiement n’est négo-ciable quand chacun sait que personne ne « fait » d’argent pendant son séjour au pays. J’ai ainsi fini par m’apercevoir que lors des trajets de retour vers la France, j’étais la seule à payer comptant (pokinel tele). L’absence totale de négociation de ma part est apparue aux autres voyageurs comme tout à fait surprenante, leurs haussements de sourcils exprimant à la fois un étonnement devant mes ressources financières, et une sorte de dédain face à mon incompétence manifeste à négocier un délai de paiement.
Le succès de ces entrepreneurs s’explique, on l’a vu, par l’insuffisance et l’inadaptation des services de transports officiels. Vasile, comme un grand nombre de convoyeurs dans le monde, doit aussi une large partie de son succès au fait que ses associés et lui-même sont fortement ancrés dans les réalités des collectifs migrants, et qu’ils vivent encore aujourd’hui la migra-tion économique comme moyen d’ascension sociale. Ils restent directement concernés par les besoins non satisfaits des migrants et pour cette raison, ont su élaborer des stratégies pour surmonter les obstacles à la mobilité40,
38. Valenzuela, A., Schweitzer L. et Robles A., 2005 : 896.
39. Faret L., 2004 : 164.
40. Valenzuela A., Schweitzer L. et Robles A., 2005.
309
Prendre la route à bord du microbus…
et créer un service « intégré » de transport, à la fois souple et parfaitement adapté aux circulations des migrants41.
Les différentes caractéristiques de ce système de transport sont vécues par les clients roms comme autant d’avantages uniques et leur font, depuis toujours, préférer le microbus à n’importe quel autre moyen de locomo-tion. Si l’avantage ne réside pas dans l’économie financière, ni dans la rapi-dité du transport, ce dernier est pourtant tout à fait « efficace », selon des critères autres. Nous allons maintenant voir comment les moments parta-gés sur la route, ainsi que l’expérience répétée de ce trajet long et éprou-vant, contribuent au développement d’une « intimité culturelle42 » entre transporteurs et voyageurs ; intimité qui fonde un autre volet, tout aussi important, de l’appréciation positive des Roms sur ce mode de transport.
Sur la route
Improvisations
Dans l’attente du départ du véhicule qui doit les conduire ici ou là, les clients Rom se trouvent dans l’incertitude quant à la date ou l’heure précise de l’embarquement. À l’attente, parfois très longue, de la moindre informa-tion, succède toujours une précipitation collective, qui laisse à peine le temps de dire au revoir de loin à ceux qu’on laisse derrière soi. Cette impression d’improvisation générale n’est cependant pas une conséquence spécifique à l’organisation de Vasile ni, comme je l’ai cru un temps, un trait particulier auquel les Roms ne renonceraient pas. Ce que disait Dana Diminescu des premières circulations internationales à l’aube des années 1990 est finale-ment devenu un trait structurel des migrations d’une partie des Roumains, et l’improvisation caractérise aujourd’hui encore certains déplacements :
Chacun sait qu’il doit partir, mais les modalités sont encore incer-taines, fonction des opportunités du moment, et l’opportunité joue dès la décision de départ. Cette dernière est parfois soudaine, et prend quelques heures […]. [Elle] est tellement présente, tellement intériori-sée, que les départs peuvent être improvisés à la dernière minute, parce que les villageois y sont préparés43.
41. Faret L., 2004.
42. Herzfeld Michaël, [1997] 2007.
43. Diminescu D., 1999, s. p.
310
Norah Benarrosh-Orsoni
En réalité, il ne s’agit pas tant de l’incertitude latente qui entoure les futurs voyageurs, mais bien plutôt de leur promptitude permanente au départ. Hier comme aujourd’hui, si les départs sont parfois soudains, ce n’est pas qu’ils sont imprévus, c’est que partout, les gens sont déjà prêts.
Une des clés de compréhension de cette caractéristique se situe peut-être avant même la chute du régime communiste. Les circulations des Européens de l’Est ont, dès l’ouverture des frontières, été très remarquées dans les pays de destination, et sont apparues comme un phénomène inédit. Mais en Roumanie, dès 1970, des mobilités de travail internes ont été pratiquées par de larges pans de populations rurales, employées pour des travaux agricoles saisonniers44. Dans certaines régions, cette mobilité s’est étalée sur plu-sieurs générations, jusqu’à devenir quasi structurelle et agir comme un « habitus familial et villageois45 ». Les Roms âgés de Ghireşteni et des alen-tours affirment tous avoir été ouvriers agricoles dans diverses régions du pays à la même époque. Accompagnés de leurs enfants, ils allaient se faire embaucher pour des contrats de quelques mois, durant lesquels ils étaient logés de façon sommaire et collective. Des années 1940-1950, période à laquelle ils situent la mémoire des premières installations à Ghireşteni46, à la chute du communisme, les évocations de mobilités de travail à l’intérieur du pays sont nombreuses parmi les Roms. Tout en se considérant comme sédentaires et résidants d’un village particulier, ils étaient installés dans une mobilité de travail intense longtemps avant l’ouverture des frontières,
44. Daniela Moisa mentionne ces mobilités de travail sous le terme de rîtas, décrits comme des « travaux saisonniers organisés dans toutes les régions monta-gneuses de la Roumanie consistant à défricher des terres afin de les transformer en pâturages ou en terres arables » (Moisa D., 2000 : 80).
45. Diminescu D., 1999, s. p.
46. Les personnes âgées (nées au début des années 1940) interrogées individuel-lement livrent des récits dont les grandes lignes se recoupent. Ils permettent d’éta-blir que leurs parents et grands-parents étaient tous établis et originaires d’un certain village situé à une dizaine de kilomètres de Ghireşteni. Quelques « pion-niers » seraient venus s’installer à Ghireşteni à la fin des années 1940, avant que cette micro-migration s’accélère et se généralise à partir des années 1960. À mesure que les alliances matrimoniales se poursuivaient entre les Roms des deux villages, de plus en plus de jeunes familles préféraient s’établir à Ghireşteni. Les récits qui recomposent le passé récent du groupe ont été recueillis par bribes et ont toujours été relatés au singulier. Pour leurs émetteurs, ils semblent avoir une valeur indivi-duelle, celle du parcours de leurs parents, rapporté comme une anecdote. Si les dates et les événements convergent, jamais ils ne sont mis en récit ou scénographiés comme une histoire collective. À ce titre, on ne peut donc y voir une forme de conscience historique des origines du groupe.
311
Prendre la route à bord du microbus…
à l’instar de nombreux paysans roumains47. Cet « absentéisme villageois48 », qui n’est pas un nomadisme, a largement influencé les pratiques migratoires qui lui ont succédé. Beaucoup des Roumains circulant en Europe dans les années 1990 avaient en effet l’expérience de cette mobilité interne au pays49. La décision de partir à l’étranger s’inscrit donc, dès le début, en continuité avec les stratégies économiques à l’œuvre avant 1989, et ne constitue en rien un moment de rupture. Comme le souligne Daniela Moisa50, les Roumains ont simplement élargi leur espace de mobilité, en conservant un mode de vie qui leur était déjà familier, fait de départs, de séjours de travail, et de retours temporaires dédiés à l’amélioration du niveau de vie au village.
Dans le microbus garé devant le terrain de Montreuil, le coffre est chargé de sacs Tati bien ficelés et scotchés. Des colis, des tapis, des objets non iden-tifiés, emballés dans des sacs plastiques sur lesquels sont inscrits au feutre le village et le nom du destinataire. On roule jusqu’à Maisons-Alfort, où l’on retrouve, au pied de l’immeuble où ils logent, la femme de Vasile, qui nous conduira jusqu’en Roumanie. Quelques rues plus loin se situe leur « par-king », une rue choisie depuis plusieurs années parce que la faible circula-tion ne risque pas de déranger les chargements et déchargements. Avant chaque départ vers la Roumanie, cet arrêt leur sert à régler d’ultimes for-malités, à se coordonner, se répartir les multiples téléphones portables indispensables à l’organisation en continu et à distance. C’est ici que l’on charge les coffres de façon définitive, les meubles, colis et bagages répartis en fonction de l’ordre dans lequel seront desservis les villages.
Reconnaître ses pairs
Prendre la route dans le microbus c’est, avant tout, s’apprêter à passer 24 heures en compagnie de neuf autres personnes51. Pour fonctionner en bonne entente, il est d’abord important de bien s’installer. Chacun tente de se composer une place confortable, dans la limite du possible.
47. À tous ces travailleurs mobiles s’ajoutent les employés et ouvriers des grandes villes qui, entre 1950 et 1989, ont fait la navette chaque jour entre les centres urbains et leurs villages de résidence (Mihailescu Vintila, 2011). Le phénomène s’est encore accentué après l’interdiction d’émigrer en ville décrétée en 1980 (ibid.).
48. Ibid.
49. Diminescu D., 2003b.
50. Moisa D., 2009.
51. Le microbus compte officiellement neuf places assises, mais presque toujours, un ou deux enfants voyagent avec leurs parents et les convois comptent en général une dizaine de passagers.
312
Norah Benarrosh-Orsoni
Les bagages, très nombreux, sont entassés dans le coffre et sous les sièges, laissant peu de place aux jambes et dépassant parfois au-dessus des ban-quettes, entre les têtes des voyageurs qui doivent retenir un clavier d’ordinateur, ou négocier avec un coin de meuble.
Les individus et familles qui voyagent ensemble ne se connaissent pas toujours bien – voire pas du tout – et afin de rendre acceptable cette pro-miscuité exceptionnelle, il faut établir, dès les premiers instants du trajet, des valeurs morales communes, se reconnaître comme pairs. Les affinités et alliances momentanées évoluent en fonction des contextes, et dans l’espace social temporaire créé par le microbus, c’est entre les conducteurs gadjé et leurs fidèles voyageurs Roms montreuillois que s’affirme la plus grande familiarité. Aucun d’entre eux ne se méprend sur la nature essentiellement commerciale de leurs relations, mais les années de trajets réguliers ont développé, si ce n’est une complicité, du moins une habitude réciproque, ainsi qu’une franche cordialité. Les Roms, d’un côté, ont toujours pris soin de m’assurer toute la confiance qu’ils accordaient à Vasile et son équipe. Quant aux conducteurs, ils sont devenus fins sociologues, ont un avis expert – et pour cause ! – sur le goût des Roms pour les maisons « trop grandes » et la dernière mode architecturale en vogue chez eux. Les jeunes enfants de l’un des conducteurs, rencontrés lors d’une étape à Arad, jouaient avec leur père à « parler Romanès », répétant chacun leur tour toutes les expressions qu’ils connaissaient. Tous semblent considérer leurs clients comme des Roms fort respectables, comparés à d’autres, si vulgaires qu’ils refuseraient de les fréquenter.
Il pourrait d’ailleurs presque suffire aux Montreuillois et à leurs transpor-teurs d’avoir en commun le même autre, d’être d’accord sur la définition de l’étrangeté et de l’immoralité. Dans cette configuration originale, c’est fina-lement celui qui voyage seul, qui fait office de « barbare » : parfois un gadjo, souvent – et c’est alors pire pour tout le monde – un Kaştalo. Pour les conducteurs, tous les hommes et femmes qui voyagent seuls ont des pra-tiques économiques suspectes et, bien entendu, des mœurs douteuses. Pour les Roms, les Kaştalé « forment la catégorie antithétique : les Barbares mena-çant la Civilisation romanès. […] Contrairement aux Gaže, [ils] auraient eu vocation à vivre romanès mais ne l’ont pas réalisée : bibaxtale manuşe (« hommes maudits »), sans respect (patjiv) et sans honte (laža), sales (melale) et mauvais (žungale), ils sont l’humanité corrompue52 ».
52. Olivera M., 2007 : 525. Les Kaştalé ne revendiquent pas, pour la plupart, cette « ethnicité » que les Roms leur refusent, mais aux yeux des gadjé et de l’état
313
Prendre la route à bord du microbus…
Pour toutes ces raisons, leur compagnie, et plus encore leur contact, sont soigneusement évités.
Une fois que les passagers sont installés et alors que l’agitation du départ est encore palpable, les conversations fusent, désordonnées, le sujet est abordé de façon détournée, au travers d’anecdotes, de considérations géné-rales et de questions innocentes, et les catégories sont vite établies. Je ne connaissais pas Ramona lorsqu’elle a insisté, très amicalement, pour que je m’installe près d’elle sur la banquette arrière du bus. Ainsi, elle se tient à l’écart de la jeune femme qui s’assied à ma droite. En roumain, celle-ci me raconte qu’elle vit à l’hôtel avec son petit ami portugais. Très maigre, vêtue d’un pantalon rose moulant, elle fume beaucoup et pendant tout le voyage, se recoiffe et se remaquille alternativement. Personne ne lui adresse la parole ; en sa présence, on la désigne par le terme plutôt neutre « i rakli » (la jeune fille53) et lorsqu’elle s’absente, elle devient « i jungali » (la laide). Alors qu’elle voyage en tee-shirt, la température chute au milieu de la nuit, et elle emprunte le blouson de Ramona. À son réveil, celle-ci déclare, furieuse, qu’elle ne peut plus le porter, et contraint la jeune femme à le lui racheter. Dans notre véhicule, un autre jeune homme voyage seul. « Kaştalo san ? » (Tu es Kaştalo ?) : les hommes éclatent de rire. Tard dans la nuit, nous le déposons dans une station-service d’Allemagne où l’attendent deux jeunes Roumains devant une grosse voiture. Alors que l’on reprend la route, les passagers sont bien réveillés, et chacun y va de son commentaire. Le conducteur explique : « Vous savez ce qu’il fait ? Il va en Hollande et il vend de la drogue ! Je n’ai que faire de ces types-là54 ! » On se moque de lui ou d’elle en son absence, on lui trouve des surnoms, et dès qu’il ou elle est parti(e), que l’« entre soi », a priori surprenant, des transporteurs et de leurs passagers roms est retrouvé, on s’empresse de se mettre d’accord, témoignages à l’appui, sur son immoralité. Comme pour mieux réaffirmer que l’on est si bien entre nous, gens de bonne vie, qui avons l’habitude de voyager ensemble et nous faisons confiance.
Le moment du voyage, qui met à l’épreuve les valeurs de chacun, mais également les valeurs communes, est une occasion de les réaffirmer publi-quement. Dans le microbus, les Roms montreuillois évitent soigneusement
roumain ils restent sans doute aucun membres du vague ensemble des « Tsiganes » (Dorondel Stefan, 2008 ; Chelcea Liviu et Ionescu Vasile, 2008).
53. Rakli (masc. raklo) est un terme romanès générique qui désigne une jeune fille non rom et non mariée. J’étais, moi aussi, désignée par ce terme parmi les Roms.
54. « Ştiţi ce face ? Merge in Olanda si vinde droguri ! N-am ce sa fac cu saraci ! »
314
Norah Benarrosh-Orsoni
la moindre interaction avec les voyageurs isolés, tandis que les conducteurs s’en tiennent au minimum nécessaire à l’échange commercial. Mais entre la conductrice et les Romnia de Montreuil, ce sont parfois des conversations sans fin de ménagères passionnées, sur les vertus respectives des marchés de banlieue55. Les interactions que l’on observe dans le microbus sont en réa-lité un véritable condensé des rapports sociaux qui peuvent exister, dans des contextes et des régions extrêmement variés en Roumanie, entre des individus roms et gadjé. Et dans le contexte précis du voyage, la présence des Kaştalé « joue un rôle intégrateur fondamental entre Řoma et Gaže. Elle permet l’interaction et la bonne entente sans jamais mettre en danger leurs ontologies respectives56 ».
Espaces et étapes
Au départ de Paris, le voyage commence toujours par la route nationale que les conducteurs suivent jusqu’à la frontière allemande, où ils rejoignent ensuite le réseau autoroutier gratuit. La lenteur du véhicule surchargé annonce la longueur du trajet à venir, toujours le même, à l’aller comme au retour, dont l’itinéraire ainsi que les étapes sont choisis par les conducteurs pour minimiser au possible les dépenses. En Allemagne, en Autriche, en Hongrie, les autoroutes se suivent et se ressemblent, les pays sont traversés « en terre étrangère, lieu de passage obligé pour rejoindre le sol natal, que l’on va traverser le plus rapidement possible57 ».
En quittant Montreuil, Ghireşteni ou Prisani, un premier arrêt a toujours lieu au bout d’une cinquantaine de kilomètres, dans un grand supermarché discount où chacun achète les vivres nécessaires au voyage, et se met en quête de la dernière « bonne affaire » susceptible d’être réalisée avant de s’engager pour de bon sur la route. Des arrêts expéditifs dans les stations-service, toutes les trois ou quatre heures, ponctuent ensuite la longue tra-versée. Au bout de quelques heures, les voyageurs tentent de s’endormir pour un court moment tandis que le conducteur unique, qui doit tenir jusqu’au lendemain midi, décide seul du rythme qui lui est nécessaire pour rester éveillé : « Tu sais pourquoi il met la musique ? Parce que si le chauf-feur il a envie de dormir la nuit, il y a la musique qui fait du bruit et il dort pas ! Tout le temps il conduit, c’est dangereux quand même ! » expliquait Florica avant de prendre la route.
55. Celui de Saint-Denis est loué pour ses fabuleuses dentelles, celui de la Croix-de-Chavaux à Montreuil, pour ses tissus aux motifs Chanel…
56. Olivera M., 2007 : 52
57. Gauthier Catherine, 1993 : 134.
315
Prendre la route à bord du microbus…
Les déplacements sont ponctués d’étapes qui « mettent en action de nombreux prestataires rencontrés sur la route : cafetiers, restaurateurs, hôteliers, stations-service, garagistes et réparateurs, péages d’autoroutes […]58 ». Elles constituent le paysage que transporteurs et passagers retrouvent d’un trajet à l’autre, une toile de fond qui devient familière. Les conducteurs retrouvent les mêmes lieux, les mêmes employés avec qui ils échangent les mêmes paroles de circonstance, les mêmes menus plaisirs qui allègent la fatigue de la route – le sandwich et le café que Ioana savoure à l’arrêt de 6 heures du matin, seule au comptoir du petit snack, tandis que les passagers font quelques pas autour du véhicule. Dans ce contexte pour le moins singulier où ils travaillent de nuit et 24 heures d’affilée, jalonner ces espaces et y créer des habitudes permet aux conducteurs de domesti-quer ces « territoires produits par la mobilité59 », de rendre leurs « lieux de travail » praticables voire même, dans une certaine mesure, habitables. Depuis 2002, année où les circulations sont devenues libres à l’intérieur des pays de l’espace Schengen60, il faut être attentif sur la route pour noter le moment précis du passage des frontières. Même si le marquage des fron-tières et les postes de douane restent pour le moment inscrits dans le pay-sage, les douaniers et autres agents de l’état se font souvent particulièrement discrets. La seule interaction, presque rituelle, qui a nécessairement lieu dans les deux sens du trajet, se situe à l’entrée et à la sortie du territoire roumain. Parce que la frontière entre la Hongrie et la Roumanie constitue une des limites extérieures de l’espace Schengen, les douaniers roumains et hongrois contrôlent les véhicules à l’entrée de leurs pays respectifs. Chaque fois, le conducteur du microbus réunit sur son tableau de bord les passe-ports de tous ses passagers, ouverts à la page d’identification et calés les uns dans les autres. Peu avant l’arrivée au poste de douane, il y glisse également un billet de dix euros. Parce que nous sommes dix au lieu des neuf passa-gers autorisés, parce que nous n’avons pas de siège enfant, parce qu’il veut surtout éviter de voir fouiller le chargement du coffre qu’il a mis tant de soin à ranger et organiser. Après avoir saisi les passeports, le douanier ouvre la porte latérale du véhicule, vérifie l’identité de chaque passager à partir des documents qu’il a en main. Pendant qu’il pose les quelques questions de formalité, le billet disparaît dans une poche de chemise, et nous continuons bientôt notre route.
58. Tapia S. (de), s. d. : 33.
59. Brachet Julien, 2007 : 21.
60. Espace Schengen dont sont, pour le moment, toujours exclues la Roumanie, la Bulgarie et Chypre.
316
Norah Benarrosh-Orsoni
Les allers et retours d’un pôle à l’autre constituent pour les voyageurs une véritable « traversée des hiérarchies sociales61 » au cours de laquelle chacun prétend sortir du rôle et de la position qu’il occupait ou s’était vu assigner jusqu’alors. Pendant le voyage, s’opèrent en chacun des transformations nécessaires à l’incarnation de l’image de lui-même qu’il souhaite donner à son arrivée. Les Roms, qui vivent et voyagent côte à côte, jouent tous, en même temps et de bon cœur, ce jeu de la transformation et de la perfor-mance sociale. Ils veulent arriver au village en portant à bout de bras leur réussite économique, incarnée dans une abondance matérielle et des pro-jets immobiliers de diverse ampleur. Au retour vers Montreuil, c’est un tra-vail d’illusionniste qui est à l’œuvre, pour maintenir une position de vacancier dépensant sans compter, alors que tous ont depuis longtemps les poches percées. La dernière pause avant l’arrivée est l’occasion de recoiffer et débarbouiller les enfants, de revêtir la belle robe inconfortable et les sandales à strass achetées « pour le voyage ».
Des rencontres
Tout au long de ses trajets, cette microsociété de la route rencontre ses nombreux homologues. On les reconnaît à leur plaque d’immatricula-tion, au type de véhicule ou de convoi, au chargement des microbus d’où émergent les visages des voyageurs, souvent roms. Ce sont encore les sta-tions-service qui remplissent durant le trajet la fonction d’« étapes poten-tielles des caravanes » de véhicules62. Des caravanes improvisées et éphémères, comme celle qui se forme lorsque sur l’autoroute, notre véhi-cule arrive au niveau d’un autre microbus, que les Roms remarquent en se gaussant parce que son coffre est plein… de passagers entassés. Le conduc-teur accélère sa conduite pour faire un signe, à la fois moqueur et complice, à celui de l’autre véhicule. Mais entre les deux bus, plusieurs passagers se reconnaissent, et il est vite décidé, par signes interposés, que l’on s’arrêtera ensemble à la prochaine aire d’autoroute. « Eh, tu me reconnais pas ? On était en prison ensemble en Allemagne, il y a dix ans ! » C’est par cette apostrophe que débute la conversation enthousiaste entre les deux groupes de voyageurs, au cours de laquelle on fait la liste des connaissances com-munes, dont on prend des nouvelles, on actualise les parcours migratoires de chacun et on échange quelques anecdotes et récits de mésaventures. Cependant, il faut vite repartir. Les passagers de l’autre véhicule sont bien trop nombreux, et alors que l’on approche de la frontière autrichienne
61. Gauthier C., 1993.
62. Ibid.
317
Prendre la route à bord du microbus…
– et malgré l’absence de contrôle douanier – deux d’entre eux embarquent momentanément avec nous, avant de remonter dans l’autre bus, quelques kilomètres plus loin. On le voit, pour qui emprunte régulièrement les axes principaux des flux migratoires Est-Ouest, les aires d’autoroute se transfor-ment souvent en « lieux de rencontre et de rendez-vous où se constituent les caravanes ou les convois d’amis, de familiers, disséminés sur toute l’Europe63 ». Mais ces prises de contact éphémères n’ont lieu que lorsque les individus se reconnaissent comme pouvant être des « familiers » ou des pairs potentiels. Cette estimation, très élastique, est directement dépendante du contexte de circulation dans lequel tous se trouvent. On se tient à une dis-tance hautaine et glaciale des Roms de Bucarest, vulgaires et sans aucune manière, qui circulent dans un microbus identique au nôtre et que l’on croise sur le parking d’un supermarché. Mais dans la station-service sui-vante, en apercevant les voitures tractant des caravanes rutilantes, immatri-culées en Moselle (57), on bombe le torse pour donner les plus chaleureuses poignées de mains à ces Roms français, des Lovara en costume brillant. Et l’on échange avec eux les formalités d’usage dans un Romanès châtié où sou-dain, les interlocuteurs ajustent leurs accents, accordent leurs vocabulaires, rendant anodine la distance géographique de leurs origines respectives.
La route transforme momentanément les rapports sociaux et ses courtes étapes deviennent des espaces carrefour, où des solidarités de circonstance avec d’autres Roumains se nouent également. Certains clivages sont alors suspendus au profit d’une commune condition d’expatrié s’apprêtant à retrouver son pays, et c’est celle-ci que l’on s’applique à mettre en avant. On s’échange des considérations de bon sens sur la condition de migrant, sur lesquelles tous s’accordent – « C’est bien la Roumanie quand on a de l’argent ! Mais quand y’en a plus, alors tout de suite on court à l’étranger64 ! » Ces manifestations d’une condition partagée n’ont certes aucune consé-quence, elles ne durent que quelques instants et leur souvenir disparaît bien vite pour tout le monde. Mais elles nourrissent de sens le court moment où dans une aube glacée, on se dégourdit les jambes en serrant son gobelet de café. Même improvisées comme celles que l’on a relatées ici, les associations momentanées sont empreintes d’une solidarité, d’une entraide que seul le contexte de la route produit. Malgré la superficialité des échanges, cette jeune Roumaine que l’on rencontre en Autriche, salariée en Italie et qui rentre au pays au volant de sa voiture neuve, décide de poursuivre le voyage « avec » nous, roulant au même rythme et nous rejoignant à chaque pause.
63. Tapia S. (de), s. d. : 35-36.
64. « E bine Româniă cînd sunt banii ! Si cînd nu mai sunt, iară fugim afară ! »
318
Norah Benarrosh-Orsoni
La route peut aussi provoquer le réagencement de certaines hiérarchies sociales, notamment celles qui opèrent entre Roms et gadjé. Ainsi, le fait que notre suiveuse roumaine partage le temps des pauses avec la passagère de notre véhicule qui voyage seule – la jeune Kaştali à qui personne n’adresse la parole – nous apprend que si les clivages ne sont pas tous annulés par le voyage, ce dernier est parfois l’occasion unique de rapprochements pour le moins surprenants.
Le microbus s’avère être pour tous – y compris les Kastalé, malgré leur mise à l’écart relative – un espace qui préserve, le temps du voyage, « … cet entre-soi culturel qui est constitutif d’une sociabilité commune, cet impli-cite qui assure un sentiment d’appartenance partagé face aux “autres”65 ». Cette affirmation va à l’encontre de certaines représentations que l’on peut se faire des Roms comme n’éprouvant cet « entre-soi », précisément, qu’entre eux. Mais les frontières du proche sont dans leur essence même, malléables et adaptables aux situations, et dans les moments de mobilité physique en particulier, les sentiments d’appartenance se transforment rapidement au gré des situations et des étapes66. Par ailleurs, en voyageant dans le microbus où l’on parle roumain ou romanès, où l’on écoute les mêmes manele67 qu’au quotidien, les voyageurs s’épargnent de vivre le trajet comme un moment constitué de ruptures répétées dans les repères culturels et sociaux68.
Conclusion
Au-delà du rôle évident de tout service de transport consistant à relier lieux et territoires, le microbus de Vasile s’avère constituer un véritable dispositif social aux facettes et fonctions multiples, indispensable au fonc-tionnement et à la cohésion de ce petit monde en mouvement. La pra-tique répétée des circulations crée une territorialité spécifique qui conjugue espaces traversés, de résidence, espaces racontés et imaginés, individuellement ou collectivement. Structuré par les flux continus de personnes, de biens et d’informations, l’espace, et donc le champ social
65. Abélès Marc, 2007 : 9.
66. Brachet J., 2007 : 7.
67. « Les manele (pluriel de manea) sont des chansons devenues très populaires en Roumanie après 1989, surtout auprès des plus jeunes. Elles sont portées par un rythme syncopé, des timbres artificiels et des techniques surpuissantes d’amplifica-tion » (Stoichita in Radulescu Speranţa, 2010 : 172).
68. S’ils avaient par exemple pris l’avion, où tout est strictement régi par des horaires fixes, des mesures de sécurité, où un comportement spécifique est attendu en fonction des interlocuteurs successifs.
319
Prendre la route à bord du microbus…
transnational69 du groupe est composé de différentes qualités de territoires qui se superposent et s’entremêlent. L’hypothèse d’une « déterritorialisa-tion » des espaces sociaux70 n’est peut-être pas à rejeter complètement : la circulation de valeurs et de normes fait effectivement exister le groupe au-delà des frontières et des territoires locaux. Mais dans le cas des Roms, il s’agit bien plus à mon sens d’une « re-territorialisation ». La temporalité particulière des déplacements actuels, marquée par l’improvisation et la liberté de circulation, permet aux Roms d’entretenir un double ancrage fort entre Montreuil et Ghireşteni Cette mobilité contribue dès lors à redé-finir les appartenances qui ne sont plus exclusives les unes des autres, tant au niveau territorial qu’identitaire. Le lieu d’origine est ainsi inscrit dans un réseau de lieux, éloignés les uns des autres mais « dont les dynamiques respectives s’interpénètrent de façon complexe71 », formant un espace rela-tionnel dense, où ceux d’« ici » et ceux de « là-bas » sont pris dans le même ensemble social.
Nous avons vu qu’à bord des véhicules transitent conjointement infor-mations et valeurs, qui à leur tour imprègnent et transforment les pra-tiques, les représentations et les mentalités dans les lieux d’origine comme d’installation72. Au fil des années s’est développée ce que l’on peut appeler, à la suite de Massey, une culture de la migration73, que partagent les migrants et dont bénéficient leurs parents proches dans le pays d’origine. À Ghireşteni comme partout en Roumanie, les fractures sociales les plus visibles se situent désormais entre migrants et non-migrants74. Il reste que cette culture de la migration, qui structure toutes les relations sociales, se déploie au quotidien sans recours à un quelconque discours mémoriel, du moins concernant la migration elle-même. Durant les trajets en microbus, aucune anecdote ne rappelle la mémoire de circulations passées. Les nom-breuses rencontres de la route n’ont quant à elles de signification que le temps de l’interaction. De manière générale, une fois vécus, les événements sont remisés et très rarement évoqués.
69. Levitt P. et Glick-Schiller N., 2004.
70. Appadurai A., 1996.
71. Lombard Jérôme et Steck Benjamin, 2004 : 6.
72. Tapia S. (de), s.d.
73. L’expression, qui a plusieurs acceptions, est ici entendue au sens de l’impor-tation par les migrants d’« ideologies, practices, expectations, and political claims from both societies to create a “culture of migration” that is distinct from the culture of both the sending and receiving nation » (Massey Douglas, Goldring Luin et Durand Jorge, 1994 : 1501).
74. Anghel R.-G., 2010.
320
Norah Benarrosh-Orsoni
Il y a bien une mémoire collective qui compte parmi les Roms et les gadjé, c’est celle des mobilités de travail internes pratiquées sous le régime communiste. Cette histoire collective n’est cependant ni mobilisée ni rela-tée dans le cadre des mobilités contemporaines. Si les Roms ne valorisent pas leurs circulations comme pratique sociale à l’aide d’une mémoire par-tagée, il leur est également difficile de décrire précisément le moment de leurs premières migrations. Les migrants roumains actuels évoluent depuis plusieurs décennies dans un paysage social marqué par des mobilités de travail, donc des absences temporaires répétées. On comprend alors que la décision de s’engager dans la migration est avant tout un prolongement de ce mouvement général. Parmi les Roms de Ghireşteni, elle ne représente pas un tournant majeur dont il faudrait entretenir la mémoire collective.
Norah Benarrosh-Orsoni
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, UMR 7186, LESC (Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative),
Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès, Nanterre.
Bibliographie
Abélès Marc, 2007, « Avant-propos », in Herzfeld Michaël, L’Intimité cultu-relle. Poétique sociale de l’État nation, Québec, Presses de l’Université Laval.
Anghel Remus-Gabriel, 2010, « La migration internationale : panacée ou entrave au développement local ? étude du changement social récent dans une ville roumaine de forte émigration », Revue d’études compa-ratives Est-Ouest, vol. 41, n° 4, p. 73-96.
Appadurai Arjun, 1996, Modernity at Large: cultural dimensions of globali-zation, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Benarrosh-Orsoni Norah, 2011, « Bricoler l’hospitalité publique : réflexions autour du relogement des Roms roumains à Montreuil », Géocarrefour, vol. 86, n° 1, Roms migrants en ville : pratiques et poli-tiques en Italie et en France, p. 55-65.
Brachet Julien, 2007, Un Désert cosmopolite. Migrations de transit dans la région d’Agadez (Sahara Nigérien), Thèse de doctorat, Université Paris 1.
Calinescu Petrut, 2012, www.mandriesibeton.ro.
Chelcea Liviu et Ionescu Vasile, 2008, Resurse şi consum cultural în comunitătile de romi : Un studiu pilot în judeţul Ilfov. Raport de cercetare,
321
Prendre la route à bord du microbus…
Centrul Naţional de Cultură al Romilor, Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii.
Diminescu Dana, 1999, Installation dans la mobilité, d’après l’étude de recherche « Faire une saison. Pour une anthropologie des migrations rou-maines en France. Le cas du Pays d’Oas », Paris, ministère de l’Emploi et de la Solidarité, DPM, Adri, note de synthèse parue in Migration/études, n° 91, s. p., (nov.-déc.).
— 2001, « Le système D contre le SIS : Navigateurs, passeurs, prisonniers des frontières informatiques », Hommes & Migrations, n° 1230 (mars-avril), p. 28-34.
— 2003a, « Les circulations migratoires roumaines : une intégration euro-péenne par le bas ? », Cahiers de recherches de la MIRE, n° 15, p. 61-69.
— dir., 2003b, Visibles mais peu nombreux : les circulations migratoires rou-maines, Paris, éditions de la Maison des sciences de l’homme.
2005, « Le migrant connecté : pour un manifeste épistémologique », Migra-tions Société, n° 102 (nov.-déc.), p. 275-293.
Dorondel Stefan, 2008, « Ethnicity, State, and Natural Resources in the Southeastern Europe. The Rudari Case », in Serban Stelu, dir., Trans-border Identities. Romanian-Speaking Population in Bulgaria, Bucarest, Paideia, p. 215-240.
Faret Laurent, 2004, « Pratiques de mobilité, transport et acteurs transna-tionaux dans le champ migratoire Mexique-états-Unis », Autrepart, vol. 32, n° 4, p. 149-167.
Gauthier Catherine, 1993, « La route des Marocains : les frontières d’un parcours de retour », Revue européenne des migrations internationales, vol. 9, n° 1, p. 131-142.
Granovetter Mark, 1973, « The Strength of Weak Ties », American Jour-nal of Sociology, vol. 78, n° 6, p. 1360-1380.
Grigoraş Vlad, 2006, « Venituri şi investiţii din migratie. Locuirea temporară în străinătate », in Sandu Dumitru, dir., Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor : 1990-2006, Bucarest, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, p. 40-45.
Herzfeld Michaël, [1997] 2007, L’Intimité culturelle. Poétique sociale dans l’État-Nation, Québec, Presses Universitaires de Laval.
Konstantinov Yulian, 1996, « Patterns of Reinterpretation : trader-tou-rism in the Balkans (Bulgaria) as a picaresque metaphorical Enactment of Post-totalitarism », American Ethnologist, vol. 23, n° 4, p. 762-782.
322
Norah Benarrosh-Orsoni
Levitt Peggy et Glick-Schiller Nina, 2004, « Conceptualizing simulta-neity : a transnational social field perspective on society », International Migration Review, vol. 38, n° 3, p. 1002-1039.
Lombard Jérôme et Steck Benjamin, 2004, « Quand le transport est d’abord un lieu ! », Autrepart, vol. 32, n° 4, p. 3-19.
Massey Douglas, Goldring Luin et Durand Jorge, 1994, « Continuities in Transnational Migration : an analysis of nineteen mexican commu-nities », American Journal of Sociology, vol. 99, n° 6, p. 1492-1533.
Massey Douglas, Arango Joaquin, Hugo Graeme, Kouaouci Ali, Pellegrino Adela et Taylor J. Edward, 1993, « Theories of Internatio-nal Migration: a review and appraisal », Population and Development Review, vol. 19, n° 3, p. 431-466.
Mihailescu Vintila, 2011, « Comment le rustique vint au village. Moder-nité domestique et domestication de la modernité dans les campagnes roumaines », Terrain, n° 57, p. 96-113.
Moisa Daniela, 2009, « Amener l’ailleurs chez soi : pratiques architectu-rales domestiques au Pays d’Oas », Ethnologies, vol. 31, n° 1, p. 77-109.
Nedelcu Mihaela, 2002, « E-stratégies migratoires et communautaires : le cas des Roumains à Toronto », Hommes et Migrations, n° 1240 (nov.-déc.), p. 42-52.
— 2010a, « (Re)penser le transnationalisme et l’intégration à l’ère du numérique. Vers un tournant cosmopolitique dans l’étude des migra-tions internationales ? », Revue européenne des migrations internatio-nales, vol. 26, n° 2, p. 33-55.
— 2010b, « Les migrants roumains online : identités, habitus transnatio-naux et nouveaux modèles du lien social à l’ère du numérique », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 41 (déc.), p. 49-72.
Olivera Martin, 2007, Romanès ou l’intégration traditionnelle des Gabori de Transylvanie, Thèse de doctorat, Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
— 2009, « Les Roms comme “minorité ethnique” ? Un questionnement roumain », Études tsiganes, n° 39-40 (3e trimestre), p. 128-150.
Pérouse Jean-François et Borgel Céline, 2004, « La gare routière du “Grand Istanbul”, une étourdissante plaque tournante », Autrepart, vol. 32, n° 4, p. 51-73.
Potot Swanie, 2006, « Le réseau migrant : une organisation entre solidarité communautaire et “zone de libre échange” », Migrations société, n° 105-106 (mai-août), p. 49-74.
323
Prendre la route à bord du microbus…
Rădulescu Speranţa, 2010, « Les Manele : symbole de la “décadence” », Études tsiganes, n° 38, p. 172-176.
Rodier Claire, 2010, « Frontex, l’agence tout risques », Plein droit, vol. 87, n° 4, p. 8-11.
Rolshoven Johanna, 2007, « The Temptations of the Provisional. Multilo-cality as a way of life », Ethnologia Europaea: Journal of European Eth-nology, vol. 37, n° 1-2, p. 17-24.
Sandu Dumitru, 2010, Lumile sociale ale migratiei romanesti in strainatate, Iasi, Polirom.
Schmoll Camille, 2004, Une Place marchande cosmopolite. Dynamiques migratoires et circulations commerciales à Naples, Thèse de doctorat, Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Simon Gildas, 1981, « Réflexions sur la notion de champ migratoire inter-national », Hommes et Terres du Nord, numéro spécial, tome 1, p. 85-89.
SOPEMI OECD, 2011, Perspectives des migrations internationales, Paris, SOPEMI.
Tapia Stéphane (de), s. d., Migrations internationales et Anthropologie du voyage. La circulation des hommes et des biens dans le champ migratoire turc : itinéraires et impacts économiques, FASOPO.
— 1996, « échanges, transports et communications : circulation et champs migratoires turcs », Revue européenne de migrations internationales, vol. 12, n° 2, 10e anniversaire, p. 45-71.
— 2004, « Entre “Nord” et “Sud” : le dynamisme international des trans-porteurs turcs », Autrepart, vol. 32, n° 4, p. 169-186.
Tarrius Alain, 1985, « Transports autoproduits : production et reproduc-tion du social », Espaces et Sociétés, n° 46, p. 35-54.
— 1987, « L’entrée dans la ville : migrations maghrébines et recomposi-tions des tissus urbains à Tunis et à Marseille », Revue européenne de migrations internationales, vol. 3, n° 1-2, 1er-3e trimestre, p. 131-148.
Valenzuela Abel, Schweitzer Lisa, Robles Adriele, 2005, « Camionetas: Informal Travel among Immigrants », Transportation Research Part A, n° 39, p. 895-911.
Weber Serge, 2003, « Proximité et éloignement. Comment maintenir la proximité malgré l’éloignement ? Migrants d’Europe centrale et orien-tale à Rome », Arches, n° 6, p. 117-132, www.arches.ro, consulté le 18 avril 2012.
Norah Benarrosh-Orsoni
— 2009, « Les mobilités induites par les migrations : émergence d’un champ circulatoire transnational », Méditerranée, n° 113, « Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée », p. 121-126.
— 2010, « Immigration, démographie et villes européennes », Communi-cation au colloque La ville est vivante, organisé par « la fabrique de la cité » (VINCI), Hambourg.