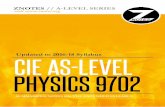Perugia, CIE 4538
Transcript of Perugia, CIE 4538
Perugia, CIE 4538.
Herbert Sauren1
La pierre a été retrouvée en 1822. Elle est bien taillée et inscrite sur deux parties.
Selon le texte il est une stèle votive. On trouve une inscription plus longue sur la partie large, A, et une plus courte sur la partie latérale, B.
La pierre, connue comme CIE 4538, est conservée à Perugia dans le Museo Archeologico Nazionale et inventarisée comme « cippo perugino » inv. : 366. Les mesures sont : 149 cm. de hauteur, dont 45/48 cm. d’un socle sans écriture, Les deux parties inscrites sont large de 54 cm. et 24,5 respectivement.2 La pierre est grande et massive, les inscriptions sont monumentales. Calculant le travail dans la carrière, du transport, d’aplaner et de sculpter les lettres, on attend une inscription royale, un message d’une famille très riche, ou une inscription importante pour la propriété.3 Je comprends donc, que les lettres A 22-23, B 4, lues : ŠPEL, B 6 : ŠPELTHI, ont été identifiées avec lat. : sepult(um), « tombeau, crypte ». Mais la lettre P, tient la forme du chiffre 1, à lire : G, bien connue dans le système d’écriture ancienne dans l’Europe occidentale, spécialement au nord d’Italie, dans les inscriptions retrouvées en Suisse, attesté à Pyrgi et dans d’autres inscriptions étrusques, qui sont pratiquement contemporains. En plus la traduction proposée n’a rien à faire avec une inscription funéraire.
La lettre, dont la forme est identique avec le chiffre 1, représente les phonèmes occlusifs vélaires, g, ğ, q. Le mot, A 22-23, B 4, B 6, est : ŠGEL, šiqil, schequel, nom de monnaie, qui correspondant à un denier et qui est utilisé avant tout en hébreu. B 6 ajoute ThI, *deu, il a donné. On trouve en parallèle dans les mêmes phrases, le terme ZVCI, *zūzū, deniers, le nom dans les langues sud-ouest sémitiques pour la monnaie de la même valeur. Il était donc nécessaire de revoir tout, l’épigraphie, vocabulaire, syntaxe, pour arriver à une traduction cohérente. Le résultat est étonnant. L’inscription parle de deux personnes, d’Hillatina, la petite amie, et d’Alluna, l’homme de couleur, un homme libre riche, qui cherchait s’installer dans la ville et qui y habite avec sa femme et ses enfants. La femme est une blanche, probablement née dans la ville. Elle fait naître un enfant après l’autre. Le texte parle du neuvième enfant né. Entre les deux personnes du couple existe une convention. La femme reçoit de l’argent, si l’enfant est un blanc. Le texte est satirique, on se moque de la situation. Les deux veulent beaucoup d’enfants, la femme se hâte pour les deniers. Lors de la naissance du neuvième enfant, se pose un problème. Alluna ne veut pas accepter, que l’enfant est blanc et il ne paye plus. Le texte dit : il mente. Les auteurs de la stèle venaient au secours. On veut chanter le miracle de tant de naissances des enfants blancs d’un couple mixte, on veut ériger une stèle votive. La pierre de Perugia est la stèle mentionnée dans le texte. On veut colliger de l’argent pour ériger la stèle, que Hillatina mérite et qui est offerte par la municipalité selon le texte. Le récit de la famille de provenance différente et la critique amusante avec un flair de racisme est un motif de la création des textes, mais on peut se demander si c’est
1 Prof. Dr., émérite UCL, Belgique, [email protected] 2 Je remercie le musée et Monsieur le Soprintendente M. Pagano pour les informations supplémentaires. 3 M. Pittau, L’Iscricione Etrusca del Cippo di Perugia, (CIE 4538; Pe 8.4 – rec.), nuove acquisizioni. Internet.
le seul. Des gens étrangers provenant des pays très éloignés ça signifie aussi la présence de langues différentes. Les textes sont pleins de lexèmes de langues différentes. Ce phénomène se trouve dans toutes les inscriptions étrusques, mais les graphies des lexèmes de manière variée pour le même mot sont tellement cherchées, qu’on est incliné d’accepter des graphies intentionnelles. Qui sont les neufs enfants blancs ? Qui pourraient être les douze ? Le petit texte, B, montre une forme poétique, comptant les syllabes, on pourrait penser à une chanson. Les phrases montrent des synonymes, qui permettent la lecture. Ce texte trouve une interprétation plus profonde pour l’usage des lettres et langues. Le texte A adopte un autre style. Le récit est identique et on constate des parallèles entre les deux textes et des synonymes. Le texte devient ainsi complètement compréhensible. Les mots peuvent être détectés par les dictionnaires des langues sémitiques des deux grandes familles, sud-ouest et nord-ouest, et par le latin ou grec. L’écriture court senestrorsum. Les points de séparation ont été mis peu systématiquement, mais aident pour la lecture. Le texte A montre trois paragraphes, dont la dernière ligne du deuxième paragraphe se trouve attachée à gauche. Il est donc évident, que le sculpteur travaillait avec un croquis et qu’il réalisait la gravure des lettres de gauche à droite contre le sens de l’écriture. On observe ainsi quelques erreurs. Il n’est pas facile d’identifier les mots corrects dans un texte, où plusieurs langues se trouvent côté à côté. Le fil rouge du récit décide la lecture dans beaucoup de cas, les répétitions et parallèles aident, les dictionnaires offrent des preuves, néanmoins des erreurs puissent se trouver.
La pierre monumentale
La translittération est faite en majuscules latines. Les mots sémitiques ont écrits en italique y inclus des suffixes et les éléments formatifs. Les mots provenant du latin, du grec, et des langues indigènes gardent la position verticale. Le vocabulaire reprend les mots de la translittération en ordre alphabétique. L’épigraphie explique les difficultés de l’écriture.
J’ajoute une reconstitution en minuscules, où les consonnes ont été normalisées selon les dictionnaires et où voyelles ont été ajoutées. J’ajoute la transcription en minuscules pour mieux identifier les lexèmes. La transcription contient les lettres de l’orthographie des dictionnaires, même si l’écriture phonétique du texte avise l’omission.
L’inscription A 1HVRAT.TANNA.LAR E ZHL * 1hūrat danna lar e sahlan Un grand et puissant souhait. De bon pour la famille et bienvenu.4 2AME H�AT2R LAVTN.H�ELThINA Š E 3ŠTLA AL8VNA Š SL ELETh L3ARV
* 2�amin hat�ar liwat�ani h�illatina ša e3stala Al-luna ša solu eleta laru
Un vrai danger, non pour la patrie, est Hillatina, qui excite Alluna, qui choisit uniquement une famille. 4TEZAN L8VŠ LHRI TESN Š TEI Š 5RA Š NEŠ IGA AMA D�EN NAGER 6XII
4 La première ligne contient la formule des bons souhaits en arabe au moment d’un rencontre : ’ahlan wa sahlan. Au lieu de ’ahl, �ٲه, famille, se trouve le mot de la langue indigène : lar, famille. On obtient ainsi un mot dans deux langues et la certitude des langues sémitiques aussi parlées dans la région.
* 4tis‘anin luza lihurri tis‘anin ša deu ša 5ra’ ša nasca aga ama d�āna niğarr 6XII Le neuvième, elle l’a mis bas pour l’homme libre, le neuvième, qu’elle a donné, qui regarde, qui est déjà né. Elle travaille, elle aime, elle a beaucoup d’enfants. Nous en allons tirer douze. 6HELThINA ThVRAŠ ARAŠ GE7RAŠCE<Š>5 MVLM LESCVL ZVCI E N8ESCI HGL TULARU 6h�illatina surras arras ge 7rasces molem li–escol zūzū e n 8asca šiqlū tolarū Hillatina tu coupes le cordon ombilical, tu te remues, (et) tu recommences à gérer. Une grande quantité pour choisir. Des deniers et elle donne naissance. Les schequels permettent tout. 9AV LEŠ I.HELThINA Š ARZNA LCL10EN ŠI.THII.THIL ŠCVNA.CEN V.H11G. L3.L8HLIC LAR ThAL Š AL8VNE Š 12CLEN Th VNT2V LThE * 9aw laiša wa h�illatina ša arrantsa licl–10en si deu tal ğān(d)a gān(d)a wa h11ğl ša lihalīs lar tal ša Al-luna ša 12clen ša unitū lidar Ou, il n’y a pas. Hillatina, qui se met en marche pour les enfants. Si elle donne de tels, blancs, elle est une toute blanche. Les schequels sont pour le teint blanc. La famille est telle d’Allūna. Ce sont les enfants, qui les unissent pour donner. 13L8ALA Š.T2IEM L8V ŠLH.H�ELThINA 14D�IN ThAL3 AGE MVNIC L HT MASV * 13lulu ša tēm lu šalaha h�illatina 14d�āna tal aga municipium lā hat�a ma’asu Le plaisir, qu’il a, quand Hillatina se dépouille. Elle a une telle postérité, elle travaille. La ville ne fait pas faute : il y aura une stèle votive. 15NAGER.ŠRAN CZ LThII L8A LŠTI H�16ELThINA D�VT.NAGER.GENE ZŠ 17MASV. *nağarr ‘išr īn zūz lideu lā laišta 16h�illatina d�āt�a nağarr gan(d)ī zūz 17ma’asu Nous allons tirer vingt deniers parce qu’elle a donné. Tu ne laisses pas Hillatina marcher, secouant les épaules ? Nous allons tirer des deniers blancs (d’argent) pour la stèle. 17AL3NINA.CLH L.AL8VNA H�EL18THINA ML HRZ INIA.INTE MAME 19R.C NL. H�ELTHINA.ZIA ŠAT E NE 17al-lunina šalaha lial-luna h�illa–18tina mil harisa unia inde mama 19ra’ ša nail h�illatina ziyya šatta et ne Allunina se dépouille (seulement) pour Alluna. Hillatina accouche mille fois, elle se réunit, quand elle encore allaite, vois, que profit. Hillatina change de forme, se met séparée et il (l’enfant) est né. 20TES NE.ECA.HELThINA ThVRAŠ Th21A V RA D�EL V TES NE RA Š NE L3HI * tis ne ecce h�illatina surras da wa ra’ d�alla wa tis ne ra’ ša ne lih�i Neuf sont né. Voici Hillatina, tu coupes le cordon ombilical. Elle donne et regarde. Elle est séduisante et neuf sont né. Vois, ce qui est né durant une vie. 22TESN Š T2EI Š RA Š NE Š T2IM Th ŠG 23EL ThUTA ŠCVNA AL8UNA MENA 24D�EN. NAGER.CIC NL D�ARE V T2HŠE * tis‘anin ša deu ša ra’as ne ša tem ša šiq – 23al tuta ğan(d)a Al-luna mana 24d�āna nağarr zūzū nīl d�arra wa t�ahaša Le neuvième, qu’elle a donné, qu’on voit, qu’il est né, qui tient de schequel. Il est tout clair. Alluna mente, elle a une grande postérité. Nous allons tirer les deniers du profit. Il a fait du mal et il a gâté son travail à elle.
5 Omission de la lettre, désinence de la 2ème p. sing. La suite des trois verbes permet la reconstitution.
L’inscription B 1H�ELThINA Š 2ATENA.ZVC 3I.E NESCI.IG 4A ŠGEL AN H�.
*hillatina ša 2atena zūz 3ū et nasca ag 4a šiqil �an h�i Hillatina, qui amincie. Il y a des deniers et elle a donné naissance. Elle a travaillé, il y a le schequel, voilà, c’est la vie. 5ThI L8VLV MT 6H�A ŠGEL ThI 7RENE ThI E Š T 8AL3. * 5deu lulu muti 6h�a šiqil deu 7rene deu et ša t 8al Elle a donné du plaisir au mari. Elle a donné vie, il a donné le schequel. Elle a donné une naissance de nouveau, il donne, et c’est ainsi. 8H�ELThINA 9ACIL VNE. 10TVR V NE.ŠC 11VNE.ZEA. * 8h�illatina 9agil une 10 tura wa nasca 11une ziyya Hillatina, elle est agile, elle s’unit. Elle fait le tour, et elle a donné une naissance. Elle s’unit, elle change de forme. 11ZVC12I E NESCI ATh 13HMIL 3Š AL8V 14NA Š GENThN15A * 11zūz12 ū et nasca ate humilas Al-luna ša candina Des deniers et elle donne naissance, au point, que tu humilies Alluna avec la couleur toute blanche. 15AMA H ELTh16INA AL 8VNA 17ThVR VNI. * 15ama h�illat 16ina Al-luna 17tura una Hillthina aime Alluna. Elle fait le tour, et elle se réunit. 17HIN 18ZERI VNA.CL 19A ThIL Th VNT 20V LThL.IT.CA 21CETA ZIT V T 22E 17h�ān siru unia cl 19a thal ša unit 20wa lital it ša 21šatta ziyyat wa d22eu L’amour de l’épouse réunit. L’enfant est tel, qu’elle se réunit. Et elle passe pour tel. Qu’elle vient se mettre séparée, elle change de forme, et elle donne.
Observations à l’épigraphie et à la grammaire
Le texte se compose des éléments de plusieurs langues. La langue des inscriptions étrusques est toujours une langue mixte, où les éléments sont plus ou moins intégrés dans une nouvelle langue, la langue étrusque. L’inscription de Perugia montre une situation extraordinaire de mélanges linguistiques. Les gens, qui ont écrit le texte, parlaient ainsi et le gens, qui voulaient lire le texte, pouvaient comprendre le message. Le souhait de A 1 donne la preuve : LAR E ZHL, *lar et sahlan, la famille et un grand bien. Le souhait en arabe correspond exactement : ’ahlan wa sahlan, أه�� � و , la famille et un grand bien. On constate le mot bien connus dans les inscriptions étrusques : LAR, *lar, famille, et ZHL, *sahlan, un grand bien, bienvenu, un mot des langues sémitiques affines à l’arabe, prouvé par l’arabe actuel. L’influence des langues sémitiques ne peut pas être niée dans les inscriptions étrusques. Acceptant une graphie phonétique mais défective par l’omission des voyelles et des désinences, quelle était la langue prononcée et la grammaire de cette langue mixte des éléments tellement différents ? Existait une liste alphabétique ou plusieurs ?
Les lettres
Il n’était pas possible d’utiliser la liste alphabétique élaboré pour les inscriptions étrusques. Une série de lettres n’est pas identifiée correctement, d’autres manquent, et on a oublié de noter les fonctions phonétiques des lettres, qui sont parfois plusieurs. J’ai donc noté les lettres selon sept groupes phonétiques. On arrive à 20 formes différentes des lettres, qu’on pourrait enregistrer dans une liste alphabétique eu égard l’alphabet latin et grec. Si l’on déduit les lettres en double : L8, T2, on compte 18 lettres, et neuf, le nombre des enfants, est la moitié. D’autre part, le nombre de neufs enfants d’une seule femme semble être un fait exceptionnel et le membre de la cour, CIE 4196, le mentionne aussi dans l’inscription, qui se trouve sur la bande de sa toge.
On constate la tendance de supprimer les phonèmes des langues sémitiques, de réduire le nombre des phonèmes, d’utiliser deux lettres pour un phonème. Peut-on appeler les lettres avec une seule fonction phonétique des tout blancs ? Il y a les lettres 1 A, 6 H, 10 D, à prononcer d, 11, 12 L, 13 M, 14 N, 15 R, et 4 H, si les phonèmes cha et kha n’étaient plus distingués. Le texte. A 22-24, fait la remarque, que le neuvième enfant, lettre, était en doute d’être tout blanc. 1 : , A (phonèmes: a / e / i, incertain : alif) 2 : , C (phonèmes : c = ca, c = ci, s, ś, sin, cs, g, ğ, L3) 3 : , E (phonèmes : e = a / e / i, h, h�, 3ème lettre ancienne) 4 : , H (phonèmes : h�, h, 2ème lettre ancienne) 5 : , G (phonèmes : g, ğ =djim, q, 1ère lettre ancienne) 6 : , H (phonème: h) 7 : | , I (phonèmes : i = a / e / i, w) 8 : O, Th (phonèmes : š, shin, ś, sin, d, ct, th > t) 9 : , Z (phonèmes : z, ś, sin, ts) 10 : , D (phonème : d�, dhad) 11 : , L (phonème : l) 12 : 8 , L8 (phonème : l)
--- : , L3 (phonème : l, cf. 2 C) 13 : , M (phonème : m) 14 : , N (phonème : n) 15 : , R (phonème : r) 16 : , S (phonèmes: s, ś, sin, sc) 17: , Š (phonèmes: s, ś, sin, š, shin, sc, dernière lettre ancienne) 18 : , T (phonèmes : t, t �, thet, d) 19 : , T2 (phonèmes : t, t �, thet, d) 20 : V, V (phonèmes : u, w) 1. Les laryngales : 1.1.1º , H , خ, cf. : voyelle E. 1.1.2º , H� , 1.1.3 .ח ,حº , H = Š.
1.2.1º , A , א ,أ, cf. : voyelle A, 1.2.2º ---, ע ,ع. 1.3º , H, H, ה ,ه�.
En outre des cinq laryngales cités ci-dessous, les langues sw. et l’arabe
distinguent ġ, ghayin. Le phonème est rare dans les inscriptions de l’écriture ancienne, et il est toujours indiqué par deux lettres. Il n’arrive pas dans les deux inscriptions de Perugia. 1.1º Les consonnes laryngales kha et cha.. 1.1.1º Le phonème kha, en arabe : خ, arrive dans cinq lexèmes du texte A. La graphie est toujours : . La prononciation des langues sw. était probablement changé et devenu : ch. La confusion avec la laryngale 1.1.2º, et la graphie phonétique, 1.1.3º, le prouvent.
La raison pourrait être l’influence des langues nw., qui ne distinguent pas les deux phonèmes et ne connaissent que heth. Les cinq lexèmes attestés n’ont pas de mots correspondants dans les langues nw. La lettre : , est utilisée pour la voyelle : e, dans beaucoup de mots. Il est cependant impossible d’accepter toujours une prononciation avec la voyelle e. Le phonème kha changeait dans des emprunts vers f, p. ex. : ’al-hass, port. : alface, salade, vers q / c, p. ex. : ’al-harūb, angl. : carob, caroube, ou l’aphérèse, l’omission totale de la première syllabe, p. ex. : frz. : lis, la fleur, on dit : blanc comme un lis. Il faut accepter une graphie de tradition, qui a été préservée pour une série de lexèmes, pendant l’évolution parallèle de la lettre pour la voyelle e, provenant d’autres sources.
A 11 : HLIC, *halīs, couleur blanche, A 18 : HRZ, *harisa, elle accouche, A 14 : HT, *hat�a’a, il fait une faute, A 1 : HVRAT, hūrat, bonne, A 17 : CLH, A 13 : ŠLH, *šalaha, elle se dépouille.
1.1.2º Le phonème cha, en arabe : ح, heth, en hébreu : ח, est parfois écrit avec la lettre : . A 21, B 4 : HI, *h�ī, vie, B 17 : HIN, *h�ann, amour, A 4 : HRI, *h�urri , homme libre. 1.1.2.1º Le phonème cha, en arabe : ح, heth, en hébreu : ח, montre la forme : , dans les deux textes. La lettre arrive une fois pour le phonème cha. La lettre est rare dans la stèle de Perugia. Elle est toujours utilisée pour des lexèmes sémitiques dans les inscriptions étrusques et elle se trouve de règle au début des mots. La transcription traditionnelle V est fausse. On constate la confusion avec le phonème kha, cf. ci-dessus 1.1.2º. B 6 : H�A, h�ā, elle donne la vie. Cf. : ci-dessus 1.1.2º.
1.1.2.2º Le phonème cha, en arabe : ح, heth, en hébreu : ח, montre la forme : , pour le phonème kha. A 2 : H�AT2R, h�āt �ar, danger, A 2, et pass. : H�ELThINA, *Hillatina, cf. : H�EL, *hill , amie. 1.1.3º On trouve en plus une graphie phonétique de schequel / chequel, écrite avec la lettre : . A 8 : HGL, A 10-11 : HGC, *šiqil, schequel, cf. : A 22-23, B 6 : ŠGEL. 1.2º Les consonnes laryngales alif et ayin. 1.2.1º alif. Les deux textes ne distinguent pas la consonne alif de alif+a. La graphie est toujours : . La consonne alif arrive toujours au début des lexèmes. La voyelle suivante est dans la majorité des cas la voyelle a. L’aphérèse de la consonne et la chute dans la prononciation est probable. Des cas de alif+i , alif+u , ne se trouvent pas dans les deux textes. La lettre alif à la fin des mots n’existait probablement pas encore, elle est le résultat de la systématisation trilittère, cf. A 21, passim : RA, *ra’ , elle voit, vois ! A 3, 11, 23, B 16, AL8 –, A 17 : AL3–, *’al–, article arabe, A 2 : AME, *’amin, vrai, B 4 : AN, *’an, voilà, A 9 : AV, *’aw, ou. 1.2.2º ayin. La lettre est totalement disparue, cf. la forme pour la lettre Th. L’exemple du texte montre l’aphérèse ou la lettre est supprimée. A 15 : ŠRAN, *‘išr īn, vingt, A 20 : TES, *tis‘a, neuf. 1.3º La consonne h, he.
Consonne laryngale h possède une prononciation égale dans les langues sémitiques et dans le latin. Le phonème n’existe pas dans la langue grecque. Un ancien alphabet grec, vase du musée national, montre la lettre : , utilisé pour le spiritus lenis.
La forme de la lettre : , qui pourrait être une simplification de : , réduction à deux traits caractéristiques et une courte hampe. Précède la forme : dans l’écriture ancienne, remontant au signe cunéiforme sumérien GAL, et au signe pictographique du Sinaï. Des formes réduites à deux traits sont attestées en Espagne.
La lettre est semblable à Y, mais correspond dans les deux textes au phonème laryngale h. La lettre de cette forme est utilisée dans l’inscription étrusque de Gramiccia pour la consonne alif dans le lexème : ’iwaz, oie, où le français montre l’aphérèse.
B 13 : HMILŠ, *humilas, tu humilies, A 24 : T2HŠE, *t �ahaša, il a gâté, A 1 : ZHL, *sahla > sahlan, bienvenu.
2. Les dentaux : 2.1.1º = D, T, T, 2.1.2 .ד , دº = D, T. 2.1.3º O = D, Th.
2.2.1º , T, T, ت .2.2.2º , T. 2.2.3º O , Th .ת , 2.3º , D�, ض. 2.4.1º , T, 2.3.2 .ט ,طº , T, ט ,ط. 2.5º O, Th, cf. : Sibilants. 2.1º Le phonème dental sonore, dal, dalet, delta, de, ne possède aucune lettre
dans les deux textes. Il est probable, que la prononciation était toujours comme le phonème dental sourd. Ce phénomène se montre dans les dés de Numantia et Calahorra, où la lettre est écrite : , t2 dans la translittération. Cf. aussi l’orthographie Catalan : ciutat, contre esp. : ciudad, port. : cidade, dérivé du lat. : civitatem. La lettre n’est pas écrite parfois, cf. ci-dessous –d.
L’épigraphie montre quatre lettres différentes pour les phonèmes dentaux. 1º La lettre : , forme de la majuscule grecque et latine, avec la barre assez courte caractéristique pour l’écriture étrusque. 2º La lettre : , est écrite inversée dans les
inscriptions étrusques eu égard aux inscriptions depuis Byblos au début du 2ème millénaire et jusqu’à l’écriture ancienne dans l’Europe occidentale. Elle indique principalement le phonème dental sourd. La transcription X est fausse. 3º La lettre : O , translittérée, Th, qui semble être dérivée de la majuscule grecque theta, mais indique une série de phonèmes dentaux, des sibilants, et des phonèmes composés. 4º La lettre : , qui est utilisée uniquement pour le phonème dhad, 2.3º.
2.1.1º La lettre : , indique le phonème dental sonore. A 1 : TANNA, *danna(t), fort, puissant. Le lexème est attesté en assyrien. A 4 : TEI, *deu, B 21-22 : TE, elle a donné, cf. : port., prétérit parfait., A 18 :
INTE, *inde, encore, cf. : lat. et port. : ainda. 2.1.2º La lettre : , translittérée T2, indique le phonème dental sonore. A 22 : T2EI, *deu, elle a donné, cf. : 2.1.1º. 2.1.3º La lettre : O , translittérée, Th, indique le phonème dental sonore. A 12 : ThE, *dare, donner, B 5, B 6, B 7 : ThI, A 10 : ThII, *deu, elle a donné,
cf. ci-dessus 2.1.1º, B 14 : GENThINA, *candina > candi{di}na, très blanc, cf. ci-dessous –d pour d’autres graphies de ce lexème.
2.2º Le phonème dental sourd. 2.2.1º La lettre : , indique le phonème dental sourd. Les lexèmes provenant des
langues indo-européennes ne sont pas notés. A 1 : HVRAT, hūrat, bonne, morphème, langues sémitiques, désinence féminine,
A 15 : LŠTI, *laišta, tu ne laisses pas, désinence de la 2ème p. m. sing., B 5 : MT, *muti, mari, A 19 : ŠAT, *šatta, elle se met séparée, A 20, A 21 : TES, *tis‘a, neuf, chiffre cardinal arabe, A 3 : TEZAN, A 4, A 22 : TESN, *tis‘anin, neuvième, chiffre ordinal arabe.
2.2.2º La lettre : , translittérée T2, indique le phonème dental sourd. A 13 : T2IEM, A 22 : T2IM, * tem, il a, cf. port., présent. 2.2.3º La lettre : O , translittérée Th, indique le phonème dental sourd. A 2, pass. : H�ELThINA, *hillatina, Hillatina, morphème, langues sémitiques,
désinence féminine.
2.3º Le phonème dental sonore emphatique. Le phonème est connu de l’arabe et le nom de la lettre est dhad. Étant donné, que le phonème est typique pour l’arabe et considéré comme unique dans l’arabe, les lexèmes écrits avec cette lettre fournissent une autre preuve de l’existence des langues sw. dans l’écriture ancienne et étrusque.
Le phonème est attesté dans les inscriptions anciennes de l’Europe occidentale. La forme de la lettre montre la dérivation : z3 : , t� : , d� : , et la place dans l’ordre alphabétique ancien était derrière zeta, position dans l’alphabet grec. L’identification traditionnelle dans les publications de l’étrusque h se base sur l’inscription d’Ahiram, mais elle est fausse dans l’écriture ancienne et dans l’étrusque.
2.3º La lettre : , se trouve cinq fois dans le texte A. A 5, A 24 : D�EN, A 14 : D�IN, *d�āna, elle a beaucoup d’enfants, A 21 : D�EL,
*d�alla, elle est séduisante, A 16 : D�VT, *dāt �a, marcher, secouant les épaules. 2.4º Le phonème dental sourd emphatique. Le phonème, tha, thet, existe dans les
deux familles linguistiques, nw. et sw. Le phonème n’existe pas dans les langues indo-européennes. Les deux textes de Perugia ne montrent aucune lettre réservée pour le phonème, mais utilisent des lettres, qui servaient pour le phonème dental sourd à l’origine. On constate, que les phonèmes des langues sémitiques étaient en train de disparaître.
2.4.1º La lettre : , indique le phonème dental sourd emphatique. A 16 : D�VT, *dāt �a, marcher, secouant les épaules, A 14 : HT, *hat�a’a, il fait une
faute, A 2 : VTN, *wat�ani, patrie. 2.4.2º La lettre : , translittérée T2, indique le phonème dental sourd
emphatique. A 2 : H�AT2R, h�āt �ar, danger, A 24 : T2HŠE, *t �ahaša, il a gâté son travail. 2.5º La lettre : O , translittérée Th, indique des cas spéciaux. 2.5.1º Th = ct > t. A 3 : ELETh, *eleta > eleita > electa, > eleta, choisir, lat. : electum, port.:
eleito. 2.5.2º Th = th > t. B 12: ATh, *athe > ate, jusqu’à, au point que, port.: até, avec l’accent sur la
dernière syllabe, A 10, B 19 : THIL, A 11: ThAL, A 14: ThAL3, B 20 : ThL, *thal, tal, tels, B 17 : ThVR, B 10 : TVR, *thura, tura, elle fait le tour, A 23 : ThUTA, *thuta > tuta, tout.
3. Les sibilants : 3.1.1º , Z, 3.1.2 .ז ,زº = Ś, Z, ש ,ש ,س. 3.2.1º , Š, 3.2.2 .ש ,شº , Š = S. 3.2.3º , Š = Z. 3.2.4º , Š = SC. 3.2.5º , ŠC = SC. 3.3.1º , S. 3.3.2º , SC 3.3.3º , S, nw. 3.4.1º O, Th = S / Ś. 3.4.2º O, Th = Š. 3.5.1º , C = Z. 3.5.2º , C = Ś. 3.5.3º cf. : 3.3.5º, 3.3.2º. 3.6º , C = sibilant latin C. Les sibilants font partie des dentaux. Ils sont des phonèmes constrictifs fricatifs. Le grand nombre de ces phonèmes dans les langues sémitiques et la confusion dans les deux textes exigent de les décrire séparément. En outre des formes et phonèmes cités, les langues sw. possèdent les sibilants assibilés, ts, thé, ث, et ds, dal, ذ. Le phonème emphatique sad, sade, n’est pas attesté dans le deux textes. 3.1º Les langues sw. distinguent les phonèmes sin et šin. La distinction n’existait pas dans les inscriptions nw. de l’Antiquité. L’hébreu biblique et moderne utilise des points diacritiques. Le phonème sin est aigu et plus fort que le sibilant grec et latin s, bien que la transcription moderne des toponymes arabe utilise la majuscule latine, p. ex. : Said, Saudite, mais aussi : Cid. La lettre : , correspond avec l’écriture étrusque et pour la phonème z, za, zayin, zeta, zet, bien que les traits caractéristiques ne se trouvent plus aux bouts de la hampe. Le rapport avec la lettre : , z3 dans les inscriptions d’autres régions est évident, mais on a tourné la lettre de 90º. L’ancienne position dans la liste alphabétique n’était pas à la fin, cf. : l’alphabet grec pour la suite : 5, E, e-psilon, Z, zeta, 6, H, ēta, 7, Θ, theta. Les formes de la majuscule grecque ēta, et la majuscule latine H, ont été dérivé de cette lettre. Le phonème d’origine de cette lettre était ds, le phonème dental sonore assibilé. On comprend ainsi, que la lettre peut indiquer plusieurs sibilants.
L’écriture ancienne connaît trois lettres pour le phonème z : , z, , z2, , z3. 3.1.1º La lettre : , indique za, zayin, zeta, zet.
A 19 : ZIA, B 11 : ZEA, *ziyya, B 21 : ZIT, *ziyyat, elle change de forme, A 8, B 11-12 : ZVCI, *zūzū, deniers, zūz, B 1 : ZVC, *zūz, dernier, A 15 : CZ, A 16 : ZŠ, deniers, argent, cf. : 3.5.1º.
3.1.2º La lettre : , indique le phonème sin. A 17 : HRZ, *harisa, elle accouche, A 4 : TEZAN, *tis‘anin, neuvième, B 18 :
ZERI, *siru, épouse, A 1 : ZHL, *sahlan, bienvenu. 3.1.3º La lettre : , indique le phonème ts du participe latin. A 9 : ARZNA, *arrantsa, se mettant en marche, reconstitution selon la désinence du participe, cf. lat. : laudans, *laudants, laudantis, elegantia, it., port. : elegância. La suite des lettres : ZN au lieu de NZ semble être une erreur du scribe ou du sculpteur. 3.2º L’écriture ancienne et étrusque utilise la forme inversée pour le phonème šin. La transcription dans les langues européennes modernes est multiple comme dans les deux textes, p. ex. : šaih, de l’arabe, est en angl : sheikh, alem. : scheich, frz. : scheikh ou cheikh, port. : xeque. Cf. : 1.1.3º pour la prononciation ch : A 8 : HGL, A 10-11 : HGL3, *šiqil, schequel. 3.2.1º La lettre : , indique le phonème šin. A 9 : LEŠ, *laiša, il n’y a pas, A 15 : LŠTI, *laišta, tu ne laisses pas, A 2, passim : Š, *ša, que, pronom relatif nw., utilisé passim dans l’écriture ancienne aussi pour les inscriptions sw., A 19 : ŠAT, *šatta, elle se met séparée, cf. : 3.5.3º, A 22-23, B 4, B 6 : ŠGEL, *šiqil, schequel, A 13 : ŠLH, *šalaha, elle se dépouille, A 15 : ŠRAN, * ‘išr īn, vingt, A 24 : T2HŠE, *t �ahaša, il a gâté. 3.2.2º La lettre : , indique le sibilant des mots indo-européens. A 6-7 trois fois la désinence, présent 2ème p. sing. A 6 : ARAŠ, *arras, tu te remues, A 2-3 : EŠTLA, *estala, elle incite, A 6-7 : GERAŠCE<Š>, tu recommence à gérer, B 13 : HMIL3AŠ, *humilias, tu humilies, A 11 : ŠI, *si, si, A 6, A 20 : ThVRAŠ, *surras > sarras, tu coupes le cordon. 3.2.3º La lettre : , indique le phonème z dans un mot indo-européen. A 4 : LVŠ, *luza, elle donne naissance, port. : dar luz. 3.2.4º La lettre : , indique un phonème, qui est rendu dans la langues modernes comme : CS, cs. A 5 : NEŠ, B 10 : NE.ŠC, *nasca, elle donne naissance, cf. : 3.3.2º. 3.2.5º La lettre : , ensemble avec la majuscule grecque ancienne : , indique le phonème, qui est rendu dans la langues modernes comme : CS, cs. A 6-7 : GERAŠCE<Š>, tu recommence à gérer. 3.3.1º La lettre : , indique le sibilant des mots indo-européens. A 3 : SL, *solu, seul, seulement. 3.3.2º La lettre : , ensemble avec la majuscule grecque ancienne : , indique le phonème, qui est rendu dans la langues modernes comme : CS, cs.
A 7 : ESCVL, *escol, pour choisir, A 7-8, B 12 : NESCI, B 3 : NASCA, *nasca, elle donne naissance, cf. : 3.2.4º. 3.3.3º La lettre : , indique le phonème samaech, des langues nw. A 14, A 17 : MASV, *ma’asu, stèle votive. 3.3.4º La lettre : , indique le phonème sin. A 20 : TES, *tis‘a, neuf, A 22 : TESN, *tis‘anin, neuvième, cf. 2.2.1º et 3.1.2º. 3.4.1º La lettre O, Th, indique soit le phonème sin, soit le sibilant des mots indo-européens. A 6, A 20 : ThVRAŠ, *surras > sarras, tu coupes le cordon, A 22 : Th, *ša, que, pronom déterminatif. 3.4.2º La lettre O, Th, indique le phonème šin. A 12, B 19 : Th, *ša, ce, pronom démonstratif. 3.5º La lettre : , est la majuscule grecque sigma et présente des sibilants. Elle n’est pas la majuscule latine C, indiquant le phonème vélaire. 3.5.1º La lettre : , indique le phonème za, zayin, zeta, zet.
B 1 : ZVC, *zūz, dernier, A 8 : ZVCI, A 24 : CIC, *zūzū, deniers, zūz, cf. : 3.1.1º. 3.5.2º La lettre : , indique le phonème sin. A 11 : HLIC, *halis, blanchâtre, teint blanc. 3.5.3º La lettre : , indique le phonème šin. A 19 : C, *ša, B 20 : CA, *ša, que, pronom relatif, cf. : 3.2.1º, B 21 : CETA, *šatta, elle se met séparée, cf. : 3.2.1º, A 17 : CLH, *šalaha, elle se dépouille, cf. 3.2.1º. 3.5.4º La lettre : , cf. 3.3.2º. 3.6º La lettre : , comme le sibilant latin C. A 20 : ECA, *ecce, vois !, A. 14 : MVNIC, *municipium, municipalité. 4. Les vélaires : 4.1.1º , G, g. 4.1.2º , G, g. 4.2.1º , C. 4.2.2º , C. 4.3º , G, 4.4 .جº , Q, ק , ق. On compte quatre phonèmes dans ce groupe. Une seule lettre les indique. La lettre montre la forme du chiffre 1 : . Les phonèmes sont : 1º 1º Le phonème sonore oral, que l’écriture latine rend avec G, et qui est connu aussi dans les langues nw., 2º le phonème sonore oral précédé de d, prononciation comme djim, connu des langues sw. et de l’arabe, 3º le phonème emphatique sourd oral, que correspond à Q, qaf, qof, 4º le phonème sourd oral, que l’écriture latine rend avec C, Il n’est pas étonnant, que le phonème sourd ka, et la lettre correspondante manque. Bien que la lettre existait depuis le début de l’écriture alphabétique, et que le phonème est attesté dans les deux familles linguistiques des langues sémitiques, l’écriture étrusque ne montre pas cette lettre à aucune époque de l’écriture. Les langues
romanes utilisent ce phonème occlusif, sourd vélaire pour des emprunts et le dictionnaire ajoute pour des emprunts germaniques et slaves. 4.1.1º La lettre : , indique le phonème G / g. A 14 : AGE, A 5, B 3-4 : IGA, *aga, elle travaille, A 6-7 : GERŠE<Š>, *geresces, tu commence à gérer. 4.1.2º La lettre : , indique le phonème G / g. B 9 : ACIL, *agil, elle est agile.
4.2.1º La lettre : , indique le phonème de la lettre latine C. B 14-15 : GENThNA, *candina, couleur toute blanche.
4.2.2º La lettre : , indique le phonème de la lettre latine C. A 10 : CEN, *gan(d)a > cand(id)a, tout blanc, cf. 4.2º, B 18 : CLA, *clan,
enfant, A 9-10, A 12 : CLEN, *clen, enfants. 4.3º La lettre : , indique le phonème djim. A 5, A 15, A 16, A 24 : NAGER, *niğarr, nous allons tirer, A 10, A 23 : ŠCVNA, *gan(d)a > cand(id)a, tout blanc, cf. 4.4º. 4.4º La lettre : , indique le phonème qaf, qof.
A 8 : HGL, A 10-11 : HGL3, A 22-23, B 4, B 6 : ŠGEL *šiqil, schequel. 5. Les nasaux, M, N, et les liquides, L, R. Les phonèmes correspondent dans les langues indo-européennes et dans les
langues sémitiques des deux familles linguistiques. On constate la forme standard de l’écriture étrusque. Il y a une exception pour la lettre l. En outre de la forme standard : , on constate la forme 8, L8, et , L3..
5.1º Le chiffre 8 comme lettre est attesté dans une inscription du Sinaï pour le
phonème qof. La pierre de Garvão, Portugal note la forme parmi une série de variantes de la lettre l. La lettre était souvent la huitième des listes alphabétiques. Le chiffre arabe pour 8, ٨, est identique avec la majuscule grecque lamda : Λ.
A 3, passim : AL8VNA, *Alluna, A 11: L8, li–, pour, A 13 : L8ALA, B 5 : L8VLV, * lulu, plaisir, A 13: L8V, *lū, si, A 4 : L8VŠ, *luza, elle donne naissance.
5.2º La forme de la lettre : , L3., se trouve souvent dans l’écriture ancienne et
dans d’autres inscriptions étrusques. La monnaie d’Odeceixe, Portugal, utilise deux lettres rares à l’époque et dans la région : , au début de la légende et marquée avec un point au milieu pour indiquer le début de la légende, et la lettre : , H , cf. ci-dessus 1.1.1º. La monnaie montre ainsi les contacts avec l’Italie et peut-être des étrusques, ennemies communs contre Rome. La forme se trouve souvent dans les inscriptions retrouvées en Espagne datant du 1er siècle av. C. Tournée en direction dextrorsum, on obtient la forme de la minuscule latine écriture à mains sans ligature aux lettres voisines.
Le scribe de Perugia note les mots écrits avec cette lettre aussi avec la lettre standard, ou L8.
A 17 : AL3NINA, Allunina, cf. Al8VNA, A 10-11 : HGL3, *šiqil, schequel, cf. A 8, A 3 : L3ARV, * laru, famille, cf. A 1, A 14 : ThAL3, B 7-8 : TAL3, tal, ainsi, tel.
6. Les labiaux. Les phonèmes labiaux n’existent pas dans la langue étrusque à l’exception du
phonème labial nasal m. Les deux textes mentionnent seulement le phonème wa des langues sémitiques, dont la prononciation est plus forte que le phonème fricatif sonore ve.
6.1 Le trait vertical : | , indique le phonème wa. La lettre est connue dans l’écriture ancienne et la lettre hébraïque : ו, est à comparer.
A 9 : I, *wa, et. 6.2 La majuscule latine V indique le phonème, cf. aussi les voyelles. A 9 : AV, *aw, ou, A 24, B 10, B 20, B 21 : V, *wa, et, A 2 : VTN, *wat�ani,
patrie. 7. Les voyelles A, E, I, et la voyelle V. Les voyelles avaient reçu probablement une prononciation peu distincte. Selon la
reconstitution soit des mots sémitiques soit des mots indo-européennes toutes les trois les voyelles A, E, I, peuvent indiquer la prononciation : a, e, i. Il est donc probable, que la prononciation était un e muet. Si la voyelle A servait aussi pour le alif des langues sémitiques, si elle se trouve au début des mots, reste incertain.
La lettre V peut indiquer avant tout les voyelles u et o, mais la voyelle a ne peut pas être exclue selon les normes orthographiques des dictionnaires.
8. La réduplication. L’écriture ancienne et étrusque ne note pas la réduplication des lettres, même si
la prononciation l’exige. La réduplication des consonnes est notée une seule fois. A 1 : TANNA, *danna, fort, puissant. 9. L’omission. On constate l’omission de plusieurs phonèmes à la fin des mots. –d : A 10 : CEN, *can(d), A 16 : GENE, *ğan(d)a, très blanc, A 10, A 23 :
ŠCVNA, *ğan(d)a, cf. : B 14 : GENThINA, *candina > candi{di}na, très blanc. –m : La consonne de la désinence du latin est supprimée et reste –u. –n : A 1 : ZHL, *sahlan, perte de la désinence ou perte dans la langue
colloquiale, A 2 : AME, *�amin, vrai, phonème non prononcé ? VTN, *wat�ani, patrie, non final par la déclinaison ?
–t : A 1, pass. : E, *et ou e, et, lat. : et, frz. : et, port. : e, prononcé : i, et, esp. : y, et. Évolution différente dans le latin et dans les langues romanes. L’origine du latin ? L’origine des langues sémitiques ? Cf. la graphie du texte : V, *wa, et, lexème sw. : wa, .et, l’évolution : wa > va > ve > e > et ,و –u, –um, –ū : A 1 : LAR, A 3 : LARV, *laru, famille. La désinence est notée une fois et sans la consonne –m. Le cas est l’accusatif. On devrait postuler la désinence identique pour le nominatif, et possiblement –ū pour les cas du pluriel.
Le latin note : nom. : lar, gén. : laris, acc. : lar. La déclinaison changeait, lors de l’intégration du mot dans la langue latine.
10. La morphologie. Les textes non vocalisés ne permettent pas toujours de contrôler les désinences.
Il semble cependant, que les omissions sont intentionnelles et caractérisent le procès de l’intégration des langues sémitiques avec les langues des autochtones.
La désinence féminine des lexèmes sémitiques est : –at, –ata. La désinence est correctement notée A 1 : HVRAT, *hūrat, bonne, mais elle est omise dans tous les autres cas et devient –a. La désinence des mots indo-européens est pareille, B 14-15 : GENThNA, *candina, couleur toute blanche. La désinence : –a / –e, reste dans les langues romanes pour les mots féminins. Les verbes montrent une adaptation pareille. La forme du parfait, 3ème p. m. sing. se termine à : –a, A 23 : MENA, *mana, il mente. La forme du parfait, 3ème p. f. sing. devrait être : –at, et elle est parfois notée, B 21 : ZIT, *ziyyat, elle change de forme, mais les formes sont pratiquement toujours notée sans la lettre t, avec le sujet de Hillatina. D’autre part, le latin exige pour le présent, 3ème p. sing. la désinence : –at, –it. Cf. : A 12 : VNT2V, *unitū, ils réunissent, 3ème p. pl., tandis que la forme du sing est : VNIA, INIA, * unia, elle se réunit. Le présent, 2ème p. sing note la désinence : –as, B 13 : HMILŠ, *humilas, tu humilies. A 6, A 20 : ThVRAŠ, *surras > sarras, tu coupes le cordon, se trouve dans une série de formes avec la 2ème p. sing., mais la lettre final du verbe sémitique appartient à la racine.
Vocabulaire. ACIL, * agil, « agile », adjectif, lat. : agilis, cf. AGA, *aga. AGA, *aga, elle agit, présent, 3ème p. sing., lat. : agere. Dans le contexte en parallèle avec nasca, il est né, donc travailler lors de l’accouchement. AL3NINA, Allunina, nom de Hillatina, diminutif afectif de Alluna pour indiquer sa femme. AL8UNA, AL8VNE, *Alluna, nom personnel. Sw. : ’al–, article, lawn, ن./, « couleur », lat. : alumnum, port. : aluno, disciple, fils en relation à la patrie. AMA, * ama, aime, présent, 3ème p. f. sing., lat. : amare.
AME, *�amin, vrai, adjectif, sw. : �amin, 013أ, pl. : �amanā�, �53أ, constant, fidèle,
personne de confiance ; nw. :� m n4, adj. utilisé comme adverbe : certainement, vraiment.
AN, *�an, « vois, voilà », sw. :�an, أن, particule qui exige le futur, que. ARAŠ, *arras, tu te remues, ARNZA,*arrants, se mettre en marche, participe, sw., port., esp. : arre !, 6ٲر, crie pour stimuler les animaux. L’expression provient de l’arabe, sw. : VIII stimuler, cf. port. : arrancar. ATENA, *atena, amince, présent, 3ème p. sing., lat. : attenuare. Dans le contexte : amincir après la naissance des enfants. ATH, *ate, « au point, que », adverbe, lat. : ad tenus, port. : até.
AV, *aw, ou, si non, sw. :�aw, ٲو, ou, ou bien. Isoglosse, lat. : aut. C, cf. : Š, *ša. CEN, cf. : GENThNA. CETA, *ziyyata, cf. : ZIA. CLA, *cla, fils, CLEN, *clen, fils, pl.
CZ, CIC, ZS, *zūz, ZVCI, *zūzū, denier, deniers, nw. : z z, certain type of weight/coin, for Egypt in the fifth century BC prob. Weight corresponding to half a shekel, in Palmyra, Jewish Aramaic, late Hebrew a coin with the value of an attic drachma = denarius = 1/4 shekel; equal with the denarius. B 4 : en parallèle se trouve šeqel. D�ARE, *d�arra, il fait du mal, parfait, 3ème p. m. sing., sw. d�arra, 89:, nuire, faire du mal. D�EL, *d�alla, séduire, être séduisant, sw. : d�alla, �:, II séduire. D�EN, D�IN, *d�āna, elle a beaucoup d’enfants, une nombreuse postérité, parfait, 3ème p. f. sing., sw. : d�āna, ن�:, avoir une nombreuse postérité, beaucoup d’enfants. D�VT, * d�āt �a, elle marche en secouant les épaules, parfait, 3ème p. m./f. sing., sw. : d�āt �a, .marcher en secouant les épaules ,:�طE, *et, et, lat. : et, port. : e, prononcé : i. ECA, *ecce, « voici », lat. : ecce. ELETh, *eleta > electa, il choisit, présent, 3ème p. sing., lat. : electere. ESCVL, *escol, « choisir, choix », lat. : excolligere, port. : escolha. EŠTLA, *estala, excite, présent 3ème p. sing., fr. : estaler > étaler, faire exhiber, déployer, cf. : étalon, cheval entier destiné à la reproduction. Mot du latin probable, en fr. attesté depuis le Moyen-Âge. GENThNA, *gandina > candina, GENE, *gan(d)a, très blanc, ŠCVNA CEN, *ğān(d)a gān(d)a, blanc du blanc, lat. : candidus. Omission de la répétition du phonème dental et ajout de l’infixe diminutif, avec le sens du superlatif, omission du phonème dental sonore. GERAŠCE<Š>, gerasces, tu commence à gérer, lat. : gerere, verbe inchoatif. H�, *h�i, vie, nom., sw. : h�iyy, <=>, vie ; nw.: h� y1, life. H�A, *h�a, elle donne la vie, fait vivre, h�ayya, 8=>, vivre, II conserver en vie, laisser vivre, faire vivre, nw. : h� w y2, vivre, faire vivre. H�AT2R, *hat�ar, danger, nom., sw. : hat�ar, 9?@, péril, danger. H�ELThINA, *hillatina, la petite amie, nom personnel, cf. : –IN–A. HEL, *hill , <�@, ami intime, amitié. HI, cf. : H�, *h�i, vie. HGL, *šiqlū, cf. : ŠGEL. HIN, *h�ann, amour, sw. : h�annat, A85>, femme, épouse, amour, affection. Mot correspondant : siru, désir. HLIC, *halīs, couleur, génitif, sw. : halīs, @B1C , fort, teint offrant un mélange de blanc et de basané. HRI, *h�urri , libre, génitif, sw. : h�urr, <9>, libre, bien né. HRZ, *harisa, elle accouche, parfait, 3ème p. f., sing., sw. : harisa, 9س@, boire à une cruche, II donner à l’accouchée des aliments. Suivent les élément de diminution et la désinence, –in – a. HT, *hat�a’a, il fait une faute, parfait, 3ème p. m. sing., sw. : HVRAT, *hūrat, bonne, sw. : hayr, 91@, bon, excellent, hūrā, رى.@, très bon, rempli de bonnes qualités. IGA, cf. : AGA, *aga. IN, *–in–, infixe de diminution et affective. INIA, * unia, cf. : VNE. INTE, *inda, , encore, adverbe, port. : ainda. L, LA, LE, *li , préposition, phrases subordonnées devant l’infinitif, sw. : li : ل ,préposition inséparable, pour, aussi avec l’infinitive, nw. : l5, preposition in, for.
L, LA, L8A, *lā, « non, ne pas », sw. : lā, � : non, pas de, nw. : l �1, adverbe de négation. L8ALA, *lala, dame, matrone, accusatif, sw. : la’ la’ , HI/, dame, matrone. Cf. : L8VLV.
LAR, LARV, *lar, laru, famille, nominatif, lat. : lares, cf. : ’ahlan wa sahlan. LAŠ, LEŠ, *laiš, il n’y a pas, cf. : LŠTI. LŠTI, *laisti, « tu as laissé faire », sw. : laisa, B1/, n’être pas, n’être point; nw.: l y š2,
combination of adverb of negation, l �1, and noun � y š. Désinence : –ti, parfait, 2ème p. sing., post-latin, cf. fr. : 10ème siècle : laxare, 12ème : lazsier > laisser. L8V, *lū, si, quand, conjonction, sw. : lū, ./, si L8VLV, L8ALA, *lulu, plaisir, mot de lallation, cf. : génie assyrien. LVNA, *l ūn – a, couleur, sw. : laun, ن./, couleur. Cf. : AL8VNA, nom personnel. L8VŠ, *luza, donner lumière, donner naissance ». lat. : lux, lucis, port. : dar luz. MAMA, * mama, elle allaite, port. : mamar. MASV, *ma’asu, stèle votive, nw. : m ’ š1, prob. meaning, votive donation, statue as votive donation. Cf. Pirgi. MENA, *māna, « il mente », parfait, 3ème p. m. sing., sw. : māna, �3ن, mentir. –n, suffixe possessive, 1ère p. pl. ML,* mil, « mille », lat. : mille. MT, *mutu, « mari », accusatif, ass. : mutum. MVLM, * molem, grande quantité, masse, lat. : molem. MVNIC, * munici(pium), municipalité, abréviation. NAGER, *niğarr, nous allons tirer, imparfait, 1ère p. pl., sw. : garra, 89J, tirer, extraire. NE, *ne, il (l’enfaut) est né, passé de naître, fr. : né, NESCI, NEŠ, *nasca, elle donne naissance, présent, 3ème p., lat. : nascere. Cf. : RENE. NL, *nīl, profit, sw. : nāil , �1K, faveur, profit.
RA, *ra’ , il, elle, regarde, parfait, 3ème p. m. sing., sw. : ra�ā, رأى, nw. : r � y, voir, RENE, *rene, elle a donné de nouveau une naissance, préfixe: re–, faire de nouveau, une autre fois. SL, *solu, seul, uniquement, adverbe, lat. : solus. Š, ŠC, C, *ša, « qui », pronom relatif, nw. : š10, pronom. ŠAT, *šatta, elle se met séparée, parfait, 3ème p. f. sing., sw. : šatta, 8LM, séparer, être séparé. ŠCVNA CEN, *ğān(d)a gān(d)a, cf.: GENThNA. ŠGEL, *šeqel, sheqel, denier, nw. : š q l3, shekel. En parallèle se trouve zūzū. ŠI, *si, si, conjonction de condition. ŠLH, *salaha, elle se dépouille, ôter les vêtements, parfait, 3ème p. f. sing., sw. : salah, NC , ôter la peau d’un mouton, dépouiller. ŠRAN, *‘išran, vingt, sw. : ‘ašar, ���, dix, pour le f., ‘ašarat, ���ة , pour le m., ‘ išarūna, 9ونOP, vingt. L’aphérèse du chiffre se trouve aussi dans la tablette de Cortona. TANNA, *danna, puissant, adj., f., ass. : dannum, puissant. ThA, ThI, *da, elle donne, présent, 3ème p. sing., TE, TEI, ThE, ThII, *deu, elle a donné, port. : prétérite parfait, 3ème p. sing. de dar, donner. TEZAN, TESN, *tis‘anin, le neuvième, chiffre ordinal, acc., sw. : tis‘ , QRS, neuf. T2HŠE, *t �ahaša, il a gâté son travail à elle, parfait, 3ème p. m. sing., sw. : t�ahaša, T�U, gâter, troublé dans son travail au point de gâter l’ouvrage que l’on fait. ThAL, ThAL3, ThIL, TAL3, *thal, tel, telle, lat. : tale. ThVRAŠ, *surras > sarras, tu coupes le cordon ombilical, désinence du présent, 2ème p. sing. selon les trois formes verbales en séries, cf. : sw. : sarra, 89 , couper le cordon ombilical. Le verbe est incorporé dans la langue indigène, la voyelle changeait, moins convaincant est la dérivation de lat. : serrare, serrer. T2IE, *deu, elle a donné, cf. ThA.
T2IEM, T2IM, * tēm, il tient, il a, il a (rapporté,) présent, 3ème p. sing., port. : tem, lat. : tenere, posséder. TULARU, * tolarū, « on tolère », présent, 3ème p. pl., impersonnel, lat. : tolerare. TVR, *tūr, « elle fais le tour », présent, 3ème p. sing., sw. : tāra, ر�S, faire le tour. V, *wa, et, lexème sw. : wa, و, et. HMIL 3S, *humilas, « tu humilies », présent, 2ème p. sing., lat. : humiliare. VNE, INIA, * une > unia, se réunit, présent, 3ème p. sing., VNT2V, *unitū, ils réunissent, présent, 3ème p. pl., lat. : unire. VTN, *wat�ani, patrie, gén., sw. : wat�an, 0Uو , patrie, demeure, domicile. ZEA, *ziyya, cf. : ZIA. ZERI, *siru, « désir », lat. : desirare, sans le préformatif. Mot correspondant : h�ānn, « amour ». ZHL, *sahla, > sahlan, facile, grand bien, cf. : ’ahlan wa sahlan. ZIA, *ziyya, elle change d’aspect, parfait, 3ème p. f. sing., CETA, ZIT, *ziyyata, elle est changée de forme, parfait, 3ème p. f., sw. : zayya, =8Vز, II, revêtir une forme, donner un extérieur. ZS, cf. : CZ. ZVCI, cf. CZ.
Bibliographie
Je réfère aux autres inscriptions étrusques et au vocabulaire, publiés dans http://www.herbertsauren.netau.net , ainsi qu’aux dictionnaires de J. Hoftijzer, K. Jongeling pour les lexèmes des langues nw. et de A. Kazimirski de Biberstein, pour les lexèmes des langues sw. La consultation des langues romanes et spécialement du portugais est utile pour les textes étrusques en transition.