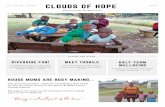"Parrêsia, persiflage, falsification: le Vanini de Voltaire," Romanic Review, 103.3-4 (March-April...
-
Upload
johnshopkins -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "Parrêsia, persiflage, falsification: le Vanini de Voltaire," Romanic Review, 103.3-4 (March-April...
The Romanic Review Volume 103 Numbers 3–4 © The Trustees of Columbia University
Le Vanini de Voltaire
Elena Russo
PARRÊSIA, PERSIFLAGE, FALSIFICATION!: LE!VANINI DE VOLTAIRE
Dans l’article «!Athéisme!» du Dictionnaire philosophique, Voltaire fait un sort singulier à Giulio Cesare Vanini, le philosophe exécuté sur le
bûcher comme «!athée et blasphémateur du nom de Dieu!» par le Parlement de Toulouse le 9 février 1619. Celui que Bayle avait nommé «!martyr de l’athéisme1!», celui-là-même que Voltaire, une trentaine d’années auparavant, désignait comme le «!martyr de Toulouse2!», apparaît sous d’étranges guenilles. Dans la troisième section de l’article, intitulée «!Des injustes accusations, et de la justi"cation de Vanini!», Voltaire se porte garant non seulement de la foi de l’accusé, mais aussi de sa parfaite orthodoxie. Il tient à souligner que non seulement «!il n’y avait en lui veine qui tendît à l’athéisme!», mais que, bien au contraire, «!sa notion de Dieu est de la théologie la plus saine et la plus approuvée!»! ; qu’il ne s’agissait que d’un «!pauvre prêtre napolitain, prédicateur et théologien de son métier, disputeur à outrance sur les quiddités et les universaux et utrum chimera bombinans in vacuo possit comedere secundas intentiones3!»! ; qu’il avait été mis à mal par d’autres disputeurs aussi pédants que lui, qu’il avait eu l’imprudence d’irriter4.
Voilà qui est édi"ant!; mais voilà aussi un fâcheux déclassement pour celui qui avait autrefois partagé avec Machiavel le titre de «!prince des athées5!»,
1. Pensées diverses sur la comète [Rotterdam, 1682] Paris, Droz, 1939, t. 2, ch. 182, p.!135.2. Voltaire à Pierre Joseph Thoulier d’Olivet, le 30 novembre 1735, D950.3. C’est le titre d’un des volumes que Pantagruel répertorie dans la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor à Paris!: «![Question très subtile] si la chimère bourdonnant dans le vide peut manger des intentions secondes!», Pantagruel (ch. 7), Rabelais, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, «!Bibliothèque de la Pléiade!», 1955, p.!198.4. Dictionnaire Philosophique (1764), article «! Athée, Athéisme! », Les Œuvres complètes de Voltaire (ci-dessous OCV), sous la direction de Ulla Kölving, t. 35, 1994, p.!381–382.5. J.-P. Cavaillé, «!Le Prince des athées, Vanini et Machiavel!», L’Enjeu Machiavel, sous la direction de G. Sfez et M. Senellart, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, p.!59–74.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 527 4/17/13 4:44 PM
#$% E&'() R*++,
et qui avait joui au "l du temps de surenchères telles que le «!Patriarche!», l’ «!Aigle!», l’ «!Apôtre!», le «!César!», le «!Sisyphe!» des athées6!:
Il voyagea pour faire fortune et pour disputer!; mais malheureusement la dispute est le chemin opposé à la fortune! ; on se fait autant d’ennemis irréconciliables qu’on trouve de savants ou de pédants contre lesquels on argumente. Il n’y eut point d’autre source du malheur de Vanini! ; sa chaleur et sa grossièreté dans la dispute lui valurent la haine de quelques théologiens! ; et ayant eu une querelle avec un nommé Francon, ou Franconi, ce Francon, ami de ses ennemis, ne manqua pas de l’accuser d’être athée enseignant l’athéisme. Ce Francon ou Franconi, aidé de quelques témoins, eut la barbarie de soutenir à la confrontation ce qu’il avait avancé7.
Il y a du Molière dans ce portrait du cuistre aristotélicien, avec une pointe de comédie italienne!: l’accusateur, ce Jean de Mauléon de Francon!–!gentilhomme français de souche, mais sur le nom duquel Voltaire laisse -otter un soupçon tout inédit d’italianité («!un nommé Francon ou Franconi!»)8!–!suggère un lazzi du genre Franconi contre Vanini!; Pantalon contre Bartolo.
Ce récit s’inspire largement de La Doctrine curieuse des beaux-esprits de ce temps, ouvrage violent et fantasque, publié en 1623 par le truculent jésuite François Garasse, que Voltaire avait lu attentivement et annoté9. Voltaire ne professe que du mépris pour Garasse «!un malheureux dont le nom est devenu ridicule parmi les fanatiques mêmes!»!; c’est lui qui a «!induit le public en erreur sur Vanini!» par sa manie de trouver partout des athées (mais certes le Parlement de Toulouse l’avait dévancé dans cette bévue)!; c’est pourtant bien
6. «!Le Maudit Lucilio Vanino grand Patriarche des Athées!», La Doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps ou pretendus tels, contenant plusieurs maximes pernicieuses à l’Estat, à la religion, & aux bonnes Mœurs, combattue et renversee, Paris, Sebastien Chappelet, 1623, t. 2, p.!641!; «!l’hypocrite Sisyphe Vanini!», Martin Schook, L’Admirable Méthode, 1643, in La Querelle d’Utrecht, textes établis, traduits et annotés par Theo Verbeek, Paris, Les impressions nouvelles, 1988, 317. Voir aussi les documents cités dans http://www.iliesi.cnr.it/Vanini/.7. Dictionnaire Philosophique, «!Athée, Athéisme!», p.!381–382.8. Pour une analyse de l’usage satirique de cette procédure largement pratiquée par Voltaire, voir Gillian Pink «!Over-Naming!: When Voltaire Doubles a Proper Name.!» Communication présentée au colloque Naming, Re-naming, Un-naming, Oxford, The Voltaire Foundation et Johns Hopkins University, 23–25 Novembre 2011. 9. Corpus des notes marginales de Voltaire, OCV, sous la direction de Christiane Mervaud et Nicholas Cronk, Oxford, The Voltaire Foundation, t. 139, 2011, p.!66–67.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 528 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' #$2
le texte de La Doctrine curieuse qui transparaît comme un palimpseste sous sa version édulcorée!:
Pour Lucile Vanin, il estoit Napolitain, homme de neant, qui avoit rodé toute l’Italie en chercheur de repuës franches, & une bonne partie de la France en qualité de Pedan! : Ce meschant belistre estant venu en Gascogne, l’an 1617 faisoit estat d’y semer advantageusement son yvroye, & faire une riche moisson d’impieté, cuidant avoir trouvé des esprits susceptibles de ses propositions!: il se glissoit dans les Noblesse effrontément pour y piquer l’escabelle aussi franchement que s’il eust esté domestique & apprivoisé de tout temps à l’humeur du pays10.
«!Bélître!», c’est-à-dire vagabond mendiant son pain, coquin ou gueux11! : caractérisation à peine assouplie dans l’image du «!pauvre prêtre napolitain!» voyageant «!pour faire fortune et pour disputer!» de l’article voltairien. «!La "n malheureuse de Vanini ne nous émeut point d’indignation et de pitié comme celle de Socrate!», ajoute Voltaire, «!parce que Vanini n’était qu’un pédant étranger sans mérite!» (Garasse, au contraire, soulignait la rapide, et sans doute diabolique, intégration de l’étranger aux réseaux du mécénat en France, notant que celui-ci semblait avoir été «!apprivoisé de tout temps à l’humeur du pays!»). Parasite vaniteux, le cuistre déballe un savoir dogmatique et toujours aristotélicien!; socialement inadapté, il se comporte d’une manière grossière et maladroite. À l’exemple des Hortensius, Grangers et Diafoirus, il est évacué et publiquement humilié!; avec cette différence que cette fois-ci le pédant est rudoyé plus fort que d’habitude12. Dans les Lettres à Son Altesse Monseigneur le Prince de *** sur Rabelais et sur d’autres auteurs accusés d’avoir mal parlé de la religion chrétienne (1767), Voltaire recopie ce passage de Garasse, faisant mine de se décharger de toute responsabilité, mais enchaînant désormais
10. La doctrine curieuse, t. 1, p.!144–45. «!Lucilio!» ou «!Lucile!» est le prénom que les apologètes attribuent le plus souvent à Vanini, par une confusion due au pseudonyme qu’il avait emprunté à Toulouse. On était d’ailleurs convaincu que le nom de Jules-César, dont il signait ses œuvres, n’était que l’expression de sa vanité de «!conquérir!» la Gaule en y disséminant l’impiété (conviction quelque peu étayée par les éloges sur son nom dans le paratexte de l’Amphithéâtre). Bien sûr Lucile évoque aussi le nom de l’impie Lucien et celui de Lucifer, l’ennemi du genre humain par dé"nition.11. Jean Nicot Le Thresor de la langue francoyse (1606), base de données ARTFL.12. Claudine Nédélec, «!Haro sur le pédant!», Les Dossiers du Grihl, mis en ligne le 14 novembre 2007, http://dossiersgrihl.revues.org/422
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 529 4/17/13 4:44 PM
#34 E&'() R*++,
l’écrivain au portrait qu’en donne son détracteur13. On se demande pourtant ce que vient faire ici Socrate!: pourquoi suggérer un rapprochement, même négatif, avec le philosophe vertueux par excellence, alors qu’on vient de nous informer que l’œuvre du «!malheureux napolitain [.!.!.] très mauvais auteur!», aux mœurs «!libres!» (c’est-à-dire louches), «!n’est pas bien philosophique!»!? Ce parallèle fait ressortir davantage le ton de commisération que Voltaire affecte envers l’aventurier nécessiteux. Le verdict est clair!; contrairement à ce qu’on a pu croire, Voltaire n’entend pas nous dire comment il a lu ces œuvres!: il veut nous dire de ne pas les lire, car elles ne valent même pas le bois du fagot.
Ce désaveu d’un personnage emblématique qui avait lancé le type du «!libertin!» qui hantait les écrits des apologètes, et dont l’exécution, suivie du procès de Théophile, avait marqué le début d’un nouveau régime répressif!; cette liquidation sommaire d’une œuvre qui véhiculait une critique des fondements théologiques du politique et exaltait une philosophie de la nature, méritent d’être regardés de près. Qu’est-ce qui permet à Voltaire de livrer, à l’encontre de tous les témoignages, un certi"cat de bonne catholicité à ce penseur sulfureux!? Certes, au dix-huitième siècle l’auteur était moins lu qu’il n’était donné en exemple comme le type même de l’athée (par Jean Meslier, par exemple, ou par Sade, qui en recommande la lecture à Juliette, avec Spinoza et le Système de la nature)14!; l’assez long article de Jaucourt dans l’Encyclopédie tient à souligner un maximum de distance de l’auteur et des textes15.
L’œuvre de ce penseur baroque, sur la vie duquel pesaient rumeurs et truquages, les mystères du procès et le magnétisme du supplice, avait eu un destin particulier. Publiés sous son propre nom, avec privilège royal et approbation des censeurs, ses ouvrages avaient circulé clandestinement, après la mort scandaleuse de l’auteur et leur mise à l’index. Leur diffusion s’était faite sur le mode d’une disparition assimilatoire!: l’œuvre s’était comme dépecée et fondue dans une littérature philosophique clandestine qui avait trouvé en elle un réservoir d’arguments, un langage et un style qu’elle avait à son tour légué à la pensée critique des Lumières16. Transmis par des textes que Voltaire connaissait bien, comme L’Esprit de Spinosa ou Traité des trois imposteurs,
13. «!Troisième lettre. Sur Vanini!», OCV, sous la direction de Christiane Mervaud et Nicholas Cronk, t. 63B, Oxford, The Voltaire Foundation, 2008, p.!403–404.14. Histoire de Juliette ou les prospérités du vice [1798], Œuvres complètes du Marquis de Sade, sous la direction de Annie Le Brun et Jean-Jacques Pauvert, 15 tomes, Editions Pauvert, 1986–1991, t. 8 (1987), p.!68. 15. «!On voit moins dans ses écrits un système d’athéïsme, que la production d’une tête sans cervelle & d’un esprit déréglé.!» Art. «!Taurisano!» (décembre 1765), vol.!15, p.!942–944.16. Françoise Charles-Daubert, «!La critique anti-théologique dans les Dialogues de Vanini et le libertinage érudit!», Kairos n. 12, 1998, p.!275–307.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 530 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' #35
le Theophrastus Redivivus, les Dialogues d’Orasius Tubero de La Mothe Le Vayer, repris dans les œuvres de Naudé, Cyrano (dont l’énonciation ironique, équivoque et polyphonique est la plus proche de la manière de Vanini) et Bayle, ces thèmes avaient "ni par n’appartenir plus à personne, ils étaient devenus des passages obligés, presque une topique, reprise tantôt par les tenants du déisme, tantôt par ceux qui embrassaient des conceptions matérialistes.
Mais dans les premières décennies du dix-septième siècle c’était cette œuvre qui avait véhiculé l’attaque la plus radicale et concertée contre la version christianisée de la métaphysique aristotélicienne et contre les fondements théologiques du pouvoir! ; c’était elle qui avait galvanisé les réactions des théologiens, en particulier Marin Mersenne et François Garasse17. Unissant la critique machiavélienne de la théologie politique aux acquis de la philosophie naturaliste (Telesio, Pomponazzi, Cardano), Vanini les avait interprétés et refondus dans une synthèse nouvelle!: en même temps vecteur d’une critique amère des fondements de l’autorité, mais aussi élan vers l’émancipation de la raison humaine par la science, son œuvre évitait les retombées dans ce scepticisme désenchanté, renfermé par le sage dans son for intérieur, qui caractérisait la pensée d’un Charron (d’où l’exigence périlleuse de la publication)18. La religion était dénoncée comme imposture, instrument du pouvoir des prêtres et des monarques, enracinée dans les craintes du peuple qui se laisse mener par l’épouvantail des rétributions!; on lançait de rudes coups contre la prescience divine et l’immortalité de l’âme! ; les miracles et la sorcellerie étaient vus comme frauduleux ou bien réductibles à des processus naturels!; Moïse et Jésus n’avaient été que d’habiles politiques!; il était possible, malgré l’amoralité naturelle des êtres humains, de fonder une morale émancipée de la foi, prenant pour règle la «!loi de la nature!». Les Admirables Secrets de la nature, reine et déesse des mortels (Paris, Adrien Périer, 1616)!–!ensemble de dialogues à visée encyclopédique sur les sciences de la nature, sur la religion et la morale!–!défendaient le principe d’une nature éternelle et in"nie, agissant selon des lois invariables et d’une matière douée de sensibilité19. Contestant la vision anthropocentriste chrétienne, l’ouvrage recourait aux théories épicuriennes de la génération spontanée et à de rudimentaires notions évolutives pour expliquer la formation de l’être humain, révoquant ainsi, souvent par une ironie mordante, le droit de l’homme de
17. Marin Mersenne, Quaestiones celeberrimae in Genesim, Paris, Sébastien Cramoisy, 1623!; L’Impiété des Déistes, Athées et Libertins de ce temps, Paris, Pierre Bilaine, 1624.18. Tullio Gregory, Genèse de la raison classique de Charron à Descartes, Paris, Presses Universitaires de France, 2000; 19. De Admirandis naturae reginae deaeque mortalium arcanis, in Giulio Cesare Vanini, Tutte le opere, textes présentés et annotés par Francesco Paolo Raimondi, traduits par Francesco Paolo Raimondi et Luigi Crudo, Milano, Bompiani, 2010.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 531 4/17/13 4:44 PM
#3$ E&'() R*++,
dominer la nature!; il promouvait une connaissance basée sur l’expérience sensorielle, dans laquelle les sens répondent directement à la matière et non pas à une quelconque essence métaphysique véhiculée par elle20.
La "gure du philosophe italien apparaît à plusieurs reprises dans les écrits et la correspondance de Voltaire. Depuis 1735, à Cirey, alors qu’il informait l’abbé d’Olivet avoir lu l’Amphithéâtre de l’éternelle providence (Lyon, 1615)21!–!à l’époque où il composait un Traité de Métaphysique resté enseveli dans les papiers de Mme du Châtelet, qui l’avait reçu en cadeau avec ce quatrain!: «!L’auteur de la métaphysique!/ Que l’on apporte à vos genoux!/ Mérita d’être cuit dans la place publique,!/ Mais il ne brûla que pour vous!»22!–!jusqu’au démenti véhément (et pour une fois, sincère) de la paternité d’un pamphlet comparant le roi de Prusse à Vanini, que la rumeur lui avait attribué en 1775, des renvois et redites plus ou moins développés émaillent ses écrits et ses cahiers de notes23. En octobre 1735 Voltaire emprunte de l’abbé d’Olivet une biographie très polémique, dans laquelle l’auteur, un certain David Durand, se faisait l’écho de rumeurs colportées par Garasse, Mersenne et Patin (il éventait des accusations de sodomie et même une tentative de faire chanter le pape .!.!.). Durand s’y efforçait de démolir le portrait de l’athée vertueux présenté par Bayle!; il avait transcrit de longs extraits parmi les plus provocants de l’œuvre et propres à ne pas laisser beaucoup d’illusions sur son orthodoxie24.
20. Voir l’essai introductif de F. P. Raimondi aux œuvres complètes de Vanini, p.!7–293. Mark Bannister, «!Vanini and the Development of Seventeenth-Century Thought!», Seventeenth-Century Studies, n. 19, 1997, p.!25–36.21. Amphitheatrum aeternae providentiae, in in Giulio Cesare Vanini, Tutte le opere.22. Traité de Métaphysique!; Appendice II, Dédicace à Mme du Châtelet, OCV, sous la direction de W. H. Barber et Ulla Kölving, t. 14, Oxford, The Voltaire Foundation!/ Taylor Institution, 1989, p. 503.23. Parfois c’est sur un mode elliptique, comme dans cette trace d’un train de pensée non formulé! : «! Vanini, Levayer, lettres persannes! » [sic] Carnets de Léningrad, [Notebooks] OCV, sous la direction de Theodore Bestermann, Genève, Institut et Musée Voltaire!/ University of Toronto Press, t. 81, 1968, p.!390. Ailleurs l’implication est plus Claire!: «!Ce Cramer a gagné plus de quatre cent mille francs à imprimer mes ouvrages depuis plus de vingt ans. Il "nit par une édition dans laquelle il glisse des ouvrages beaucoup plus dangereux que ceux de Spinosa et de Vanini, des ouvrages qu’il sait n’être pas de moi!». Voltaire à Charles Augustin Feriol, comte d’Argental, le 6 mars 1776, D19969.24. La Vie et les sentimens de Lucilio Vanini, Rotterdam, chez G. Fritsch, 1717. Bibliothèque de Voltaire, Catalogue des livres, Éditions de l’Académie des Sciences de l’URSS, Moscou-Léningrad, 1961, n. 1182. Voir Voltaire à Pierre Joseph Thoulier d’Olivet, de Cirey, le 30 novembre 1735, D950. Bayle commente l’expérience de Vanini dans Pensées diverses sur la comète, t. 2, chapitres 177–182.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 532 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' #33
L’ayant reçu quelques semaines plus tard, l’antipathie de Voltaire est si violente qu’il pense en faire un auto-da-fé domestique et regrette de ne pouvoir s’en débarrasser par retour de courrier!: «!J’ay reçu hier la vie de Vanini, je l’ay lue. Ce n’étoit pas la peine de faire un livre. Je suis fâché qu’on ait cuit ce pauvre napolitain mais je brûleray volontier ses ennuyeux ouvrages, et encor plus L’histoire de sa vie. Si je l’avois reçu un jour plutôt, vous l’auriez avec ma lettre25!». Voltaire a dû pourtant ressentir le besoin de s’en procurer un autre exemplaire, car on trouve le volume dans le catalogue de sa bibliothèque à Saint Pétersbourg, aussi bien que l’Apologia pro Julio Caesare Vanino de Peter Friedrich Arpe (1712)26 et les Entretiens sur Divers Sujets D’Histoire, de Littérature, de Religion et de Critique de Mathurin Veyssière de la Croze (1711) qui inclut un long essai sur la vie et les œuvres des athées dogmatisants modernes, en particulier Bruno et Vanini27. Cette abondante documentation détonne un peu avec la déclaration que «!comme personne ne s’intéresse à la mémoire d’un malheureux Napolitain, très mauvais auteur, presque personne ne lit ces apologies28!».
Quelle est donc la signi"cation de cet effort pour forclore toute prise en compte de l’œuvre et de l’auteur!? Par delà la question évidente de la politique de Voltaire envers l’athéisme, faut-il croire que cette écriture, avec son jeu d’esquives et d’équivoques, ses emprunts d’écrits préexistants, sa démarche dialectique et sa polyphonie tortueuse laissant ample jeu aux partis pris du lecteur, soit devenue désormais illisible aux yeux d’un écrivain comme Voltaire, qui recommande stratégiquement de «! n’écrire que des choses simples, courtes, intelligibles aux esprits les plus grossiers29!»!? Peut-on, au contraire, reconnaître une empreinte «!baroque!» dans certaines stratégies d’écriture des philosophes des Lumières, et de Voltaire en particulier!? Et en"n, à une époque éprise de l’idéal du sacri"ce philosophique, mais en quête de respectabilité et tatillonne sur ses modèles!; au sein d’une communauté ayant appris à jouer sur toute la gamme du permis, dans un espace relativement institutionnalisé et prévisible, quelles sont les modalités de parrêsia, de dire-vrai, dans lesquelles les écrivains sont prêts à se reconnaître!? Pointe extrême de l’engagement avec l’œuvre, («!les parrèsiastes sont ceux qui entreprennent de dire le vrai à un prix
25. Voltaire à Pierre Joseph Thoulier d’Olivet, de Cirey, le 6 janvier 1736, D980.26. Bibliothèque de Voltaire, n. 114.27. Cologne [Amsterdam] Pierre Marteau, 1733, Bibliothèque de Voltaire, n. 3435. 28. Dictionnaire Philosophique, article «!Athée, Athéisme!» p.!385.29. Voltaire [François Marie Arouet]. «!To [unknown], prior to 12 July 1763!». Letter helvclUT0050094_1key001cor of Electronic Enlightenment. Ed. Robert McNamee et al. Vers. 2.3. University of Oxford. 2011. Web. 19 Mar. 2012. http:// www.e-enlightenment.com/item/helvclUT0050094_1key001cor/.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 533 4/17/13 4:44 PM
#36 E&'() R*++,
non déterminé, qui peut aller jusqu’à leur propre mort!»)30, la prise en charge d’un risque «!non déterminé!» est, nous le verrons, objet de malaise, bien plus que d’adhésion de la part des philosophes des Lumières!–!même lorsqu’ils l’envisagent à loisir et à une bonne distance de sécurité.
Dans l’article «!Athéisme!», Vanini illustre le seul exemple d’incroyance à l’époque moderne!; or, étant «!précisément tout le contraire!» d’un athée (c’est à dire, non pas un croyant tout court, mais un théologien entêté), celui-ci joue le rôle de faire-(dé)valoir!: il permet à Voltaire de démysti"er cette ef"gie de l’impie dont ont tiré parti des générations d’apologètes, parmi lesquels Gysbert Voët, qui s’en était servi, avec retentissement, contre Descartes. En sacri"ant la mémoire de ce personnage fondateur et trop réel, Voltaire cherche à saper les bases mêmes du pouvoir inquisitorial, à insinuer que l’infâme se bat contre des moulins à vent. Si Vanini ne fut qu’un médiocre spécimen de l’engeance des «!prêtres!» (et partant, des «!infâmes!»), s’il périt non par son audace critique mais par la bêtise de ses semblables!–!trop fanatiques et portés à s’entre-dévorer pour reconnaître en lui l’un des leurs!–!alors l’athéisme est une chimère et les théologiens des fous et des imbéciles. Dans un autre article des Questions sur l’Encyclopédie, Voltaire pousse le zèle jusqu’à déclarer «!que le mot d’athée même ne se trouve pas dans l’arrêt qui le condamna!». Non sans quelque inconséquence, il poursuit en nous informant que celui-là même qu’il appelle ailleurs un «!barbouilleur thomiste!» et un «!disputeur à outrance sur les quiddités!», avait été mis à mal pour .!.!. «!s’être élevé fortement contre la philosophie d’Aristote31!».
Cet argument ad hominem fonctionne à peu près comme un syllogisme. Au fond Voltaire semble emprunter ici, en la renversant, la stratégie des apologètes. Des théologiens comme Mersenne et Voët avaient ratissé large, car il y avait pour eux divers modes et échelles d’incroyance, les voies du bûcher étant, si non in"nies, comme celles de la providence, du moins très nombreuses. Ainsi pour Mersenne la catégorie d’athéisme pouvait accueillir déistes et hétérodoxes de tout bord32! ; pour Voët il existait un athéisme «!indirect!» qui recoupait le scepticisme et même toutes les nuances du "déisme le plus dévot!: en favorisant le doute, le sceptique se rendait responsable de toutes les conséquences néfastes envers la foi, même les plus éloignées, que ses
30. Michel Foucault, Le Gouvernement de soi et des autres, Cours au Collège de France. 1982–1983, Paris!: Gallimard!/ Seuil, 2008, p.!56!; Le Courage de la vérité. Le Gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France. 1984, Paris!: Gallimard!/!Seuil, 2009. 31. Article «!Dictionnaire!», OCV, sous la direction de Christiane Mervaud et Nicholas Cronk, Oxford, The Voltaire Foundation, t. 40, 2009, p.!413.32. Francesco Paolo Raimondi, «!Vanini et Mersenne!», Kairos n. 12, 1998, p.!181–253.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 534 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' #3#
paroles pouvaient éventuellement susciter33. Voltaire renverse cette stratégie maximaliste!: la catégorie d’athée est vide, tant comme extension que comme intension. Cela lui permet de priver les attaques des apologètes de leur support rationnel!: à ses yeux, tout con-it philosophique ou théologique recouvre un fondamental vide spéculatif!; ou, si l’on veut, il ne contient que des arguments spécieux masquant une animosité nue, aveugle et irréductible. Évidemment, cela ne va pas sans faire quelques dégâts!: Voltaire regarde Descartes, dans ses démêlés avec Voët, non comme le défenseur d’une méthode et d’une vérité philosophiques qu’il défend par un engagement rationnel, mais «!comme la victime un peu sotte, mais innocente et inoffensive, de l’éternel fanatisme34!». Par une forme de violence toute nouvelle, Voltaire s’efforce de mâter la parole séditieuse en la neutralisant!: du coup, le philosophe se trouve réduit à une parfaite insigni"ance!; il est celui qui n’a proprement rien dit.
Ce parti pris est con"rmé dans de nombreux textes voltairiens, qui mettent en scène des intrigues à peu près identiques, dans lesquelles tous les différends de principe s’expliquent par des effets de champ, par le goût universel de cabale et «!le secret penchant!» des gens de lettres à se faire la guerre. Tantôt c’est le fanatisme à l’état pur qui, vidé de son substrat théorique, écrase les innocents et les gens de talent!; tantôt deux partis ennemis, mais au fond identiques, tournent leurs armes l’un contre l’autre dans une guerre aussi féroce que futile. «!Sottise des deux parts est, comme on sait, la devise de toutes les querelles!», explique Voltaire dans le court texte éponyme!: c’est le cas, par exemple, de la querelle du pur amour, qui opposa Bossuet à Fénelon35. Socrate lui-même, ce héros de la philosophie, n’échappe pas à cette réduction!:
Il est évident d’ailleurs qu’il [Socrate] fut la victime d’un parti furieux animé contre lui. Il s’était fait des ennemis irréconciliables des sophistes, des orateurs, des poëtes, qui enseignaient dans les écoles, et même de tous les précepteurs qui avaient soin des enfants de distinction. Il avoue lui-même, dans son discours rapporté par Platon, qu’il allait de maison en maison prouver à ces précepteurs
33. Theo Verbeek, La Querelle d’Utrecht, Introduction, p.!31.34. La Querelle d’Utrecht, Introduction, p.!23. «!Ses infâmes ennemis le comparèrent à Vanini dans un écrit public!: ce n’est pas que Vanini eût été athée, le contraire est démontré!; mais il avait été brûlé comme tel, et on ne pouvait faire une comparaison plus odieuse.!» Le Siècle de Louis XIV [1738], Catalogue de la plupart des écrivains français qui ont paru dans Le Siècle de Louis XIV, in Voltaire, Œuvres historiques, Paris, Gallimard, «!Bibliothèque de la Pléiade!», 1957, p.!1155.35. Sottise des deux parts, 1728. OCV (sous la direction de Nicholas Cronk) vol. 3A, Oxford, Voltaire Foundation, 2004, p.!229–30.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 535 4/17/13 4:44 PM
#37 E&'() R*++,
qu’ils n’étaient que des ignorants. Cette conduite n’était pas digne de celui qu’un oracle avait déclaré le plus sage des hommes. On déchaîna contre lui un prêtre et un conseiller des cinq-cents, qui l’accusèrent!; j’avoue que je ne sais pas précisément de quoi, je ne vois que du vague dans son Apologie!; on lui fait dire en général qu’on lui imputait d’inspirer aux jeunes gens des maximes contre la religion et le gouvernement. C’est ainsi qu’en usent tous les jours les calomniateurs dans le monde!; mais il faut dans un tribunal des faits avérés, des chefs d’accusation précis et circonstanciés!: c’est ce que le procès de Socrate ne nous fournit point36.
On serait tenté de voir dans ce Socrate itinérant, disputeur et même querelleur, accusé de pousser la jeunesse à l’impiété, dans cette victime d’obscures machinations ourdies par des sophistes jaloux et vindicatifs, dans cet auteur d’une apologie un peu vaseuse, dans cette victime d’un procès inique, la transposition, en style anobli, de l’aventure du «!pauvre prêtre napolitain!» .!.!. Par ailleurs, La Mort de Socrate, tragédie que Voltaire avait composée en 1759, arrangeait le con-it entre le philosophe et ses concitoyens à la manière d’une comédie larmoyante, sortie tout droit de l’imagination de Voltaire!: la condamnation à mort était précipitée par le mariage d’Aglaé, la jeune "lle que Socrate avait adoptée et richement dotée, avec Sophronime, le rival d’Anitus, grand prêtre de Cérès et ennemi juré du philosophe.
Voltaire fait pourtant mine d’appuyer son jugement sur Vanini sur quelques éléments textuels. En 1735 il écrit à l’abbé d’Olivet qu’il vient de lire «!cet ennuyeux Amphithéâtrum!» et il conclut! : «! c’est l’ouvrage d’un pauvre téologien ortodoxe. Il n’y a pas d’aparence que ce barbouilleur tomiste soit devenu tout d’un coup athée37!». Voltaire a-t-il réellement eu ce texte en main!? C’est possible. L’ouvrage était rare, mais il y en avait plusieurs exemplaires dans les bibliothèques de particuliers, libraires et collectionneurs à Paris et en province, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, et aussi en Russie et en Pologne38. Il peut donc l’avoir lu!; rien dans ses écrits ne nous indique
36. Traité sur la tolérance, 1762, ch. 7! ; OCV, vol. 56C, sous la direction de W.!H.!Barber et Haydn Mason, 2000, p.!160, je souligne. 37. De Cirey, le 4 octobre 1735, D923. 38. Andrzej Nowicki, «!Le vecchie stampe vaniniane nelle biblioteche del mondo!», Italia, Venezia e Polonia, tra umanesimo e rinascimento, a cura di Mieczyslaw Brahmer, Wroc8aw!: Zak8ad Narodowy im. Ossolinskich, 1967, p.!291–321 (liste mise à jour dans http://www.iliesi.cnr.it/Vanini/). L’exemplaire de l’Arsenal, par exemple, avait appartenu à Marc-Antoine-René de Voyer de Paulmy d’Argenson, le neveu du René Louis de Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson, qui était correspondant de Voltaire et des philosophes et membre du club de l’Entresol. Mais Marc-Antoine n’était entré en sa
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 536 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' #39
pourtant qu’une lecture de l’œuvre n’ait été nécessaire pour en dire ce qu’il en dit. En d’autres termes, tout ce que Voltaire nous transmet de l’Amphithéâtre (et des Admirables secrets de la nature) a pu être puisé de seconde main chez les nombreux théologiens, nouvellistes et polygraphes qui avaient dénoncé et expliqué ses «!méthodes!» (notamment Garasse et Mersenne) et transcrit des extraits. La source la plus probable est les Entretiens sur Divers Sujets D’Histoire, de Littérature, de Religion et de Critique de Mathurin Veyssière de la Croze (1661–1739), érudit orientaliste, linguiste, journaliste et bibliothécaire du roi de Prusse; Voltaire avait trouvé dans son œuvre des précieux renseignements sur la religion de l’Inde39.
De tout l’Amphithéâtre, Voltaire ne cite, dans l’article Athéisme, qu’un seul passage, qu’il paraphrase et abrège!; mais il l’avait déjà transcrit "dèlement et en entier dans un texte plus ancien, Les Contradictions de ce monde (1742)!:
Voici ce qu’on lit dans son Amphitheatrum, ouvrage également condamné et ignoré!: «!Dieu est son principe et son terme, sans "n et sans commencement, n’ayant besoin ni de l’un ni de l’autre, et père de tout commencement et de toute "n!; il existe toujours, mais dans aucun temps!; pour lui le passé ne fut point, et l’avenir ne viendra point!; il règne partout sans être dans un lieu!; immobile sans s’arrêter, rapide sans mouvement!; il est tout, et hors de tout!; il est dans tout, mais sans être enfermé!; hors de tout, mais sans être exclu d’aucune chose!; bon, mais sans qualité!; entier, mais sans parties!; immuable en variant tout l’univers!; sa volonté est sa puissance! ; simple, il n’y a rien en lui de purement possible,
possession qu’en 1770, lorsqu’il avait acheté la collection d’un Jean Milsonneau, avocat au Parlement et bibliophile connu sous le pseudonyme de Simon Vanel (1680–1766). Voir Henri Martin, Histoire de la bibliothèque de l’Arsenal, Paris, Plon, 1900, p.!179–90. Milsonneau était un bibliophile enthousiaste! : «! Il y a plusieurs bibliothèques considérables et des cabinets précieux qui appartiennent à différens particuliers qui se font un plaisir de faire part à leurs amis, aux savans et aux gens de lettres, ce qu’ils possèdent de plus curieux, de plus rare et de plus instructif!». (Note rédigée par l’abbé Boudot entre 1737 et 1749; cité dans Histoire de la bibliothèque de l’Arsenal, p.!180). Il était aussi un homme d’affaires habile, très lié avec les frères Pâris, qui lui con"èrent souvent des missions dif"ciles!; l’un des frères, le banquier Joseph Pâris-Duverney était très proche de Voltaire!: on peut imaginer que ce dernier ait fait, par l’entremise de Pâris, la connaissance de l’avocat et de sa riche collection. C’est un scénario générique et je ne le donne qu’à titre d’exemple.39. Ancien bénédictin de Saint-Maur et de tendances arminiennes, La Croze s’était réfugié à Berlin et converti au protestantisme. Voltaire s’était beaucoup servi de ses recherches. Catalogue des écrivains français qui ont paru dans Le Siècle de Louis XIV, p.!1169.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 537 4/17/13 4:44 PM
#3% E&'() R*++,
tout y est réel!; il est le premier, le moyen, le dernier acte!; en"n étant tout, il est au-dessus de tous les êtres, hors d’eux, dans eux, au delà d’eux, à jamais devant et après eux40!». C’est après une telle profession de foi que Vanini fut déclaré athée. Sur quoi fut-il condamné!? sur la simple déposition d’un nommé Françon. En vain ses livres déposaient pour lui41.
Il y a une ironie parfaitement délicieuse dans le fait que Voltaire ait choisi cet énoncé abscons pour étayer sa thèse de l’orthodoxie de l’auteur, car c’était le document le plus cité pour af"rmer précisément le contraire. Une foule de lecteurs, protestants, catholiques et libres penseurs, parmi lesquels Jacques Saurin, Jacques Abbadie, Mathurin Veyssière de la Croze, Jean Le Clerc, David Durand et Jean Meslier s’étaient accordés à le lire comme un détournement particulièrement astucieux du discours théologique, et comme un modèle exemplaire des stratégies d’attaque libertines42. «!Cet homme!», commente La Croze (qui cite ce passage dans l’original latin selon le même découpage de la citation de Voltaire), «!avoit imaginé une plaisante manière d’enseigner des Dogmes, en substituant par tout des argumens fondez sur des notions obscures et incompréhensibles, aux anciens raisonnements, qu’on n’a point de peine à réduire aux idées les plus évidentes de l’entendement humain. [.!.!.] Il rapporte une longue dé"nition de Dieu qu’il croit embarrassante, et qu’il propose avec beaucoup d’emphase43!». Et La Croze enchaîne sur la traduction du théologien réformé Jacques Saurin, qui en fait un long commentaire dans son Sermon sur les profondeurs divines44. «!Cet homme!», écrit Saurin, «!se prit d’une façon bien singulière pour prouver qu’il n’y a point de Dieu!: ce "t d’en donner l’idée. Il crut que le dé"nir c’étoit le réfuter45!». Sur quoi La Croze remarque!: «!Il est aisé de voir où buttoit Vanini par cet amas de contrarietez et de contradictions apparentes. Il vouloit jetter le trouble et les premiéres sémences du doute et de l’incrédulité dans les cœurs!». Et il termine en recommandant de lire la «!belle réfutation!» qu’en fait Saurin.
Il vaut la peine de suivre ce conseil, car le commentaire de Saurin éclaire parfaitement la méthode qu’il dénonce. De nombreuses pages sont consacrées
40. Voir Amphithéâtre, 2, Dé"nition de l’essence de Dieu, p.!351–52.41. Sur les contradictions de ce monde OCV, t. 28B, sous la direction de Nicholas Cronk, Oxford, Voltaire Foundation, 2008, p.!65.42. On connaît le rôle joué par Voltaire dans la popularisation de l’œuvre de Meslier!; quant aux autres auteurs mentionnés, Voltaire possède dans sa bibliothèque des exemplaires des ouvrages que je viens de citer.43. Mathurin Veyssière de La Croze, Entretiens sur divers sujets d’histoire et de religion, Cologne [Amsterdam] 1711, p.!357.44. Le texte est inclus dans un recueil des œuvres de Saurin, Sermons sur divers textes de l’Écriture Sainte, Genève, Fabri & Barrillot, 1717. Bibliothèque de Voltaire, n. 3106.45. Cité dans La Croze, Entretiens, p.!357–58.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 538 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' #32
à démêler le noeud de contrariétés que l’auteur avait produit par simple collage ou parataxe. Pris et commentés chacun séparément, les attributs de la nature divine exaltent sa transcendance par rapport à une raison humaine qui s’ «!humilie!» devant Dieu!: «!Bien loin que cette dé"nition nous porte à dégrader l’objet de notre culte!», observe Saurin, «!elle nous porte à lui rendre l’hommage le plus profond dont la créature puisse être capable, et de prosterner notre faible raison devant son immensité46!». C’est là précisément la cible de la critique vaninienne, qui, reprenant à son compte le langage de la théologie négative, le porte à son point extrême de tension, dans une retombée de concepts discordants et inintelligibles47. Elle souligne par là le naufrage d’un thomisme raidi dans l’offensive de la Contre-réforme, qui ne parvient pas à réconcilier les dogmes de la foi avec la raison, ni à forcer la raison de se plier à la foi. Le succès de ce passage consiste dans sa remarquable économie de moyens! ; on se sert des armes mêmes de l’adversaire pour le désarmer!: le savant montage d’énoncés arrachés au discours théologique et malicieusement recomposés dans une surenchère dévote, porte à lui seul le poids de la critique. Comme ses adversaires l’ont très bien vu, la méthode est d’une étonnante simplicité!: «!dé"nir pour réfuter.!» Bien sûr l’ef"cacité de ce discours consiste aussi dans une énonciation polyphonique qui permet d’échapper à une lecture univoque, l’auteur pouvant, au besoin, se réclamer d’un déni plausible et protester sa bonne foi. Cette zone d’ombre est peut-être ce qui a permis à Pierre de Bérulle de récupérer ce texte controversé et de le réintégrer au discours mystique48.
46. Sermons choisis de Jacques Saurin, Paris, Charpentier, 1834, p.!132–33.47. «!On ne prétend pas seulement que la nature de Dieu soit incompréhensible!; ce que nous avouerons volontiers!: on soutient que l’idée de cet Être suprême enferme mille contradictions, et que par conséquent elle se détruit elle-même. C’est ce que Vaninus, célèbre Athée qui fut brûlé à Toulouse, semble avoir voulu insinuer dans un Ouvrage qu’il avoit publié en aparence pour combatre l’Athéïsme, et en effet pour répandre son venin avec plus de sûreté!». Jacques Abbadie, Traité de la vérité de la religion chrétienne [1684], Rotterdam, 1705, t. 1, p.!89 (Bibliothèque de Voltaire n.!6). «!Il est visible que cette description est pleine d’absurdités et de contradictions palpables! : ce qui fait clairement voir qu’elle ne peut s’entendre que d’un Etre qui est [.!.!.] tout à fait imaginaire et chimérique!». Jean Meslier, Testament, Amsterdam, 1864, t. 2, ch. 66, p.!315–17. Voir l’analyse de Francesco Paolo Raimondi, qui en retrace la source dans les doctrines néo-platoniciennes véhiculées par Giulio Cesare Scaligero in Giulio Cesare Vanini, Tutte le opere, p.!1566–1567. Voir aussi Jean-Pierre Cavaillé, «!’Vel Deus es, vel Vaninus,’ I. C. ou les équivoques du libertin!», La Liberté de pensée!: Hommage à Maurice Laugaa, sous la direction de François Lecercle, Poitiers, La Licorne!/ UFR Langues et littératures, 2002, p.!119–144.48. Pierre de Bérulle, Vie de Jesus, Préambule [1629], Œuvres complètes, Paris, J.!P.!Migne, 1856, p.!417. Il est possible que Bérulle, qui était non seulement un contemplatif mais aussi un adroit politique et controversiste (et qui, dans le cercle de Mme Acarie, avait fréquenté ce Père Coton qui avait interrogé Vanini lorsqu’il était
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 539 4/17/13 4:44 PM
#64 E&'() R*++,
Cette manière de satiriser va bientôt recevoir un nom!: le persi-age. Cela se fait tardivement, car le terme n’apparaît dans le Dictionnaire de l’Académie qu’à parti de 1762, mais la pratique de cette raillerie devance de loin son baptême. Le persi-age est un éthos complexe dont la discussion dépasse le cadre présent!: je ne m’arrêterai ici que sur son sens le plus répandu, à savoir, celui de «!rendre quelqu’un instrument et victime de la plaisanterie par les choses qu’on lui fait dire ingénument49!». Dans Les Égarements du cœur et de l’esprit de Claude Prosper Jolyot de Crébillon (1735), le petit-maître Versac persi-e l’hypocrite Mme de Lursay en l’humiliant publiquement (la victime, consciente ici de l’attaque, se trouve dans l’impossibilité d’y répondre sans perdre la face). Dans Le Sopha (1737), les petits-maîtres Mazulim et Narsès persi-ent avec beaucoup d’adresse l’hypocrite Zulica, en simulant une croyance naïve aux mensonges de celle-ci! : Zulica ne se doute d’abord de rien et se laisse séduire par des discours dont le lecteur, complice de ceux qui mènent le jeu, peut apprécier le caractère railleur. Mazulim et Narsès «!auront!» donc Zulica non parce qu’ils la désirent, mais par dérision et mépris, la sexualité mondaine étant indissociable d’un éros discursif dont la violence ne se dévoile que par degrés.
Que ce soit dans le salon ou dans l’intimité du boudoir, ce qui caractérise le persi-age est d’être une comédie en miniature comportant le persi-eur, la victime persi-ée (ignare ou bien paralysée comme la mouche enlacée dans une toile d’araignée, lentement dévorée par sa prédatrice), et un spectateur, complice «!déniaisé!», pour l’édi"cation duquel se joue la comédie. Le persi-eur fait prise sur la bêtise, les atermoiements ou la duplicité des discours de la victime pour les retourner contre elle, et la rendre ainsi instrument de sa propre défaite. On entrevoit cette structure dans la petite comédie vaninienne, dans laquelle l’auteur se coule dans le rôle du théologien maladroit et enthousiaste, laissant néanmoins dans le texte des traces de son dédoublement.
On pourrait s’étonner de voir émigrer vers la cour, le salon et le boudoir une technique af"née au sein de la controverse religieuse!: mais ce déplacement
emprisonné), ait pu reprendre et paraphraser ce texte en connaissance de cause, pour le réinvestir de sa signi"cation mystique. 49. Dictionnaire de l’Académie française, 4ème édition, 1762. Voir aussi Louis-Sébastien Mercier, «!Du persi-age!», Les Tableaux de Paris, édition établie sous la direction de Jean-Claude Bonnet, Paris, Mercure de France, 1994, t. 1, ch. CLXIII, p.!384!: «!Le persi-age est une raillerie continue, sous le voile trompeur de l’approbation. On s’en sert pour conduire la victime dans toutes les embuscades qu’on lui dresse!; et l’on amuse ainsi une société entière, aux dépens de la personne qui ignore qu’on la traduit en ridicule, abusée qu’elle est par les dehors ordinaires de la politesse!». Voir Elisabeth Bourguinat, Le Siècle du persi#age, 1734–1789, Paris, Presses Universitaires de France, 1998!; Pierre Chartier, Théorie du persi#age, Paris, Presses Universitaires de France, 2005.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 540 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' #65
paraît moins improbable si l’on se souvient que les romanciers dits libertins n’étaient pas étrangers aux débats religieux. Crébillon pouvait bien se réclamer à la fois du salon et de la controverse!: cet ancien élève des Jésuites, membre de plusieurs sociétés satiriques50, séjourna au donjon de Vincennes (où sera emprisonné Diderot) en 1734, à la suite de la publication de L’Écumoire ou Tanzai et Néadarné, dans laquelle on avait cru voir, sous le voile d’une allégorie licencieuse, des allusions moqueuses à la bulle Unigenitus51. Il est vrai que de l’esprit fort, au petit-maître et au roué, son lointain et moindre épigone, les enjeux ont baissé de quelques crans! ; qui plus est, ce dernier doit sans doute une bonne part de sa cruauté au fait d’avoir incorporé à sa physionomie la caractérisation négative du libertin qui se pro"lait dans les attaques des apologètes.
Voltaire maîtrise bien sûr l’art d’asservir le persi-age à la controverse religieuse!: si c’est la prudence qui l’a d’abord porté, lors de la publication des Lettres philosophiques, à émousser ses propos par l’humour52, c’est ensuite le besoin de séduire le public qui lui a fait af"ner sa pointe et tremper ses armes dans la satire!: «!On n’a cause gagnée avec notre nation qu’à l’aide du plaisant et du ridicule53!». Il se trouve que les stratégies de précaution pratiquées par les premiers libertins ont partie liée avec l’exigence de séduction!: les voies traverses éveillent le désir et la curiosité, elles débouchent sur cet esprit de délicatesse qui est le propre de l’esthétique libertine du XVIIIe siècle (mais qu’on trouve aussi dans un auteur aussi peu suspect de libertinage que l’abbé Bouhours)54. C’est un principe que Vanini (suivi en cela de Cyrano) avait été
50. La Société du caveau et la Société du bout du banc. Jacqueline Hellegouar’c, «!Un atelier littéraire au 18e siècle!: la Société du bout-du-banc!», Revue d’histoire littéraire de la France, 2004, vol. 104: 1, p.!59–70. 51. Il y aurait dans le style de Vanini l’aspect mondain du «! cynique à la mode [.!.!.] la légèreté d’un esprit fort salonnier!» marquant «!une chute de la méditation philosophique au pamphlet satirique!». Giorgio Spini, «!Vel Deus, vel Vaninus!», Ricerca dei libertini. La teoria dell’impostura delle religioni nel Seicento italiano, Roma!: Editrice universale, 1950, p.!117–35.52. «!Il n’y a qu’une lettre touchant mr Locke. La seule matière philosophique que j’y traite est la petite bagatelle de l’immatérialité de l’âme, mais la chose est trop de conséquence pour la traiter sérieusement. Il a fallu l’égayer pour ne pas heurter de front nos seigneurs les théologiens, gens qui voient si clairement la spiritualité de l’âme qu’ils feraient brûler, s’ils pouvaient, les corps de ceux qui en doutent!». Voltaire à Jean Baptiste Nicolas Formont c. le 15 décembre 1732, D545.53. Voltaire à Claude-Adrien Helvétius, le 15 septembre 1763, D 11418.54. «!Une pensée où il y a de la délicatesse a cela de propre, qu’elle est renfermée en peu de paroles, et que le sens qu’elle contient n’est pas si visible ni si marqué!: il semble d’abord qu’elle le cache en partie, a"n qu’on le cherche et qu’on le devine!». Dominique Bouhours, De la Manière de bien penser dans les ouvrages d’esprit (1687), ed. Suzanne Gellouz, Atelier de l’Université de Toulouse-Le-Mirail, 1988, p.!158–161.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 541 4/17/13 4:44 PM
#6$ E&'() R*++,
l’un des premiers à appliquer. Ses manœuvres de connivence avaient pour effet d’inscrire l’auteur dans son discours et d’établir une complicité vitale avec le lecteur!: celui ci, cherchant à cherchant à suivre les détours du propos, était invité à lire l’énoncé philosophique non sur un mode impersonnel, mais comme porteur d’une intentionnalité sans cesse à recomposer. D’autre part, les mesures de précaution étaient contrecarrées par une énonciation théâtralisée, traversée de soudaines ruptures de ton, de passages du haut au bas, d’éloges paradoxaux comme l’éloge de l’inceste, ou le regard indiscret porté sur le lit de ses parents et sa propre conception (il y a déjà du Dom Juan et du théoricien sadien dans cette voix). L’auteur se rendait présent par des incartades à peine contenues, vantant tantôt ses propres talents, qu’il portait aux nues («!vel Deus es, vel Vaninus!»)55, tantôt persi-ant ceux dont il semblait vanter les mérites, comme le redoutable inquisiteur Bellarmin, l’adversaire de Galilée56!; faisant l’éloge des papes et des princes, «! les seuls à être sages dans ce monde de fous!», ou celui de Thomas d’Aquin, «!l’astre resplendissant de la très illustre et très sainte religion Dominicaine, le Docteur Angélique, ou pour mieux dire, l’Ange des Docteurs et le Docteur des Anges57!».
Que Voltaire ait donc lu le texte dans l’original ou qu’il en ait pris connaissance par le relais des nombreux apologètes et controversistes qu’il fréquentait assidûment, et qui, de Garasse à Mersenne, à Voët, à La Croze, n’avaient cessé de dénoncer, et par là-même de mettre à jour et diffuser, les méthodes exécrables de l’impie, ne change pas grand chose à la transmission d’une af"nité de manière et de style. Il est donc inexact de présumer qu’un «!large fossé intellectuel!», une sorte de changement kuhnien de paradigme sépare le monde de Voltaire de celui de Vanini, comme l’a noté son biographe français58. Certes, Voltaire n’était pas un lecteur patient et on l’imagine rétif à se frayer un chemin à travers les subtilités de la métaphysique!; mais l’Amphithéâtre n’aurait pas été pour lui une terre inconnue. Paul Vernière avait raison d’af"rmer que «!comme les rédacteurs de l’Encyclopédie, comme Diderot lui-même, [Voltaire] reprend malgré lui, malgré ses prétentions à la méthode expérimentale, les procédés et le langage de l’École chaque fois qu’il discute de métaphysique59!». On est en effet frappé, à l’ouverture du Traité
55. De Admirandis, IV, 54, p.!1425.56. Amphitheatrum, «!Épître au candide lecteur!», p.!xiii.57. De Admirandis, respectivement IV, 56, p.!1453 et IV, 56, p.!1430. Pour une analyse de ces pratiques d’écriture voir Jean-Pierre Cavaillé, Dis/simulations. Jules-César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto, Religion, morale et politique au XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2002.58. Didier Foucault, Un philosophe libertin dans l’Europe baroque, Giulio Cesare Vanini (1585–1619) Paris, Champion, 2003, p.!16–17.59. Spinoza et la pensée française avant la Révolution, 2 tomes, Paris, Presses Universitaires de France, 1954, t. 2, p.!519.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 542 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' #63
de métaphysique de Voltaire, par un certain air de famille dans la reprise des arguments traditionnels pour et contre la création divine du monde et la question de l’éternité de la matière! : loin d’avoir enjambé le fatal fossé paradigmatique, le deuxième chapitre du Traité (S’il y a un Dieu!: Sommaire des raisons en faveur de l’existence de Dieu!; Dif"cultés de l’existence de Dieu!; Conséquences nécessaires de l’opinion des matérialistes) semble solidement campé dans les méthodes et les arguments d’un texte comme l’Exercitation IV de l’Amphithéâtre60.
Comme l’ont montré Nicholas Cronk et Geneviève Artigas-Menant, Voltaire est un écrivain essentiellement stratégique, dissimulé et secret, qui applique ce qu’on serait tenté d’appeler une logique de la raison d’État à la gestion de son rôle de «!patriarche!» de la république des lettres et à son rôle de propagandiste et producteur d’œuvres clandestines61. C’est moins dans les contenus de la critique (qui porte sur les thèmes désormais traditionnels du rôle de Dieu dans la création et la conservation du monde, sur le problème du mal et la prescience divine, sur l’imposture des églises), que dans l’utilisation stratégique du discours de l’ennemi (les Écritures et la théologie) à des "ns de détournement et de sabotage, que consiste le legs le plus durable de l’écriture libertine. On retrouve chez Voltaire, dans le Dictionnaire philosophique et dans des textes de la même époque, l’usage du collage malicieux (par exemple dans l’article «!Conciles!» du Dictionnaire philosophique, ou encore dans Les Questions de Zapata, 1767). À cela s’ajoute la stratégie la plus fréquemment dénoncée par les polémistes, celle du débat piégé dans lequel la position hétérodoxe (souvent attribué à un tiers mystérieux, un juif ou «!l’athée d’Amsterdam!»), est contrée par des arguments orthodoxes soutenus avec grandiloquence, mais peu convaincants. «!Cette methode d’attaquer ce qu’on fait semblant de défendre n’est pas nouvelle!», déclare David Durand!: «!Il [Vanini] fait semblant de combattre les Athées anciens et modernes et véritablement il leur donne cause gagnée par la faiblesse et l’impertinence de ses réponses62!». On voit ce procédé à l’œuvre dans les Questions sur les miracles (1765), série de lettres qu’un piètre apologète adresse à un confrère, dans lesquelles il expose avec chaleur une batterie de mauvais arguments en faveur de l’existence de miracles, que le naïf auteur croit absolument invincibles.
Voltaire s’obstine néanmoins à jurer, envers et contre tous, qu’il n’entend "nesse aux discours de Vanini. À l’écouter, toute duplicité imputée à l’auteur ne relèverait que du fanatisme et de la malveillance du lecteur!: «!On donna un sens impie à plusieurs passages de ses livres, ce qui est très aisé et très commun,
60. Traité de Métaphysique, OCV, p.!424–439.61. Geneviève Artigas-Menant, Du secret des clandestins à la propagande voltairienne, Paris!: Honoré Champion, 2001, surtout p.!305–319. Nicholas Cronk, «!Voltaire and the Posture of Anonymity!», MLN 2011, 126: 4, p.!768–784.62. La Vie et les sentiments de Lucilio Vanini, p.!76.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 543 4/17/13 4:44 PM
#66 E&'() R*++,
en prenant des objections pour les réponses, en interprétant avec malignité quelque phrase louche, en empoisonnant une expression innocente63!». Dans la pratique de l’équivoque, Voltaire ne cesse de le rappeler, deux partenaires hostiles s’affrontent dont le plus captieux n’est pas l’auteur, mais le lecteur fanatique s’adonnant à une surinterprétation sauvage qui en dit moins sur le texte que sur sa propre perversité. Chez Voltaire, l’équivoque et la dissimulation ne sont jamais des pratiques authoriales au service des philosophes et d’un public complice, mais l’obsession exclusive des apologètes et inquisiteurs, malades de soupçon!; l’équivoque est à ses yeux la source non seulement des con-its confessionnels, mais aussi des dogmes religieux les plus pernicieux64. Il est signi"catif que le jour même où il écrivait à l’abbé d’Olivet l’informant sur sa lecture de l’Amphithéâtre65, Voltaire donnait à Thiériot cette preuve incontestable de la bêtise de l’abbé Desfontaines, son ennemi!de toujours!:
Il veut faire l’extrait d’un ouvrage anglais intitulé Alciphron du docteur Barclay66, qui passe pour un saint dans sa communion. Ce livre est un dialogue en faveur de la relligion crétienne. Il y a un interlocuteur qui est un incrédule. L’abbé des Fontaines prend les sentiments de cet interlocuteur pour les sentiments de l’auteur, et traitte hardiment Barclay d’athée67. (D924)
L’erreur, ou la malice, de Desfontaines partent de la même source que celles de Voët et Schoock, qui avaient autrefois prétendu mettre Descartes en dif"culté!: «!Vanini écrivait contre les athées, mais était lui-même le plus grand des athées, comme Descartes [.!.!.]!; mis à l’épreuve et étudiés de plus près, les arguments opposés par Vanini aux athées, comme un Achille ou un Hector, se trouvaient être chétifs et timorés!: ceux de Descartes sont absolument du même genre68!»
63. Dictionnaire philosophique, article «!Athées, Athéisme!», OCV, p.!383.64. «!Près d’elle était le galimatias,!/ Monstre bavard caressé dans ses bras,!/ Nommé jadis le docteur séraphique,!/ Subtil, profond, énergique, angélique,!/ Commentateur d’imagination!/ Et créateur de la confusion,!/ Qui depuis peu "t Marie à la Coque.!/ Autour de lui voltigent l’équivoque,!/ La louche énigme et les mauvais bons mots!/ A double sens, qui font l’esprit des sots.!/ Les préjugés, les méprises, les songes,!/ Les contresens, les absurdes mensonges!», La Pucelle d’Orléans (1730), Chant 17, v. 52–62, OCV, t. 7, sous la direction de Théodore Besterman, Genève, Institut et Musée Voltaire, 1970, p.!520–21. Voir aussi «!Des allégories!» (1759) OCV, t. 49A, p.!321–326.65. Voltaire à Pierre Joseph Thoulier d’Olivet, de Cirey, le 4 octobre 1735, D923.66. Alciphron, or the Minute Philosopher, Containing an Apology for the Christian Religion Against Those who are called Free-Thinkers, 1732.67. Voltaire à Thiériot, de Cirey, le 4 octobre 1735, D924.68. La Querelle d’Utrecht, p.!316.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 544 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' #6#
déclarait Schoock. Descartes n’a pas de dif"culté à faire rebondir l’imputation sur ses accusateurs!: «!Personne n’écrira jamais contre les athées, personne ne passera pour les avoir combattus avec succès sans que vous puissiez en écrire ce que vous avez écrit de moi [.!.!.]!: et, si l’on ne veut être proscrit par vous, comme athée digne du dernier supplice, et diffamé dans un gros livre, [.!.!.] on doit se garder de réfuter les athées. Ainsi, autant qu’il est en vous, vous défendez, vous nourrissez l’athéisme!» (393). Ce qui montre que l’athéisme est très exactement comme le papier à mouches!: il suf"t d’y toucher pour y rester collé.
Voltaire se montre donc profondément hostile envers les écrivains qui ont fait recours à des pratiques énonciatives indirectes. Qu’il soit question de persi-age, d’équivoque ou d’allégorie!–!de ces procédés "guraux que Boileau déjà avait mis au rebut et qui demandent à se parachever dans l’interprétation du lecteur!–!Voltaire refuse de collaborer et se cantonne dans une attitude obtuse et mutine. De là peut-être son acrimonie envers un auteur qu’il associe souvent à Vanini et qu’il traite à peu près de même, à savoir Bonaventure des Périers. Poète et valet de chambre de Marguerite de Navarre, des Périers était l’auteur anonyme du Cymbalum Mundi (1537), recueil de quatre dialogues lucianesques qui satirisaient les controverses religieuses et mettaient en scène un dieu Mercure trompeur et sophiste et des théologiens querelleurs. Dès sa parution, l’œuvre, accusée de contenir «!grandz abus et heresies!», fut supprimée, l’imprimeur battu, tourné au pilori et banni du royaume, ses biens con"squés au pro"t du roi69. Dans les Lettres à Son Altesse Monseigneur le Prince de ****, Voltaire éreinte l’ouvrage d’après la méthode que nous connaissons!:
Il n’y a pas assurément, dans tout ce fatras de plat écolier, un seul mot qui ait le moindre et le plus éloigné rapport aux choses que nous devons révérer. [.!.!.] Le minime Mersenne, ce facteur de Descartes, le même qui donne douze apôtres à Vanini, dit de Bonaventure Desperiers!: «!C’est un monstre et un fripon, d’une impiété achevée.!» Vous remarquerez qu’il n’avait pas lu son livre. Il n’en restait plus que deux exemplaires dans l’Europe quand Prosper Marchand le réimprima à Amsterdam, en 1711. Alors le voile fut tiré!: on ne cria plus à l’impiété, à l’athéisme!; on cria à l’ennui, et on n’en parla plus70.
69. Voir l’introduction de Max Gauna à son édition critique Cymbalum Mundi, Paris, Honoré Champion, 2000, p.!7–52.70. «!Septième lettre. Sur les Français!», OCV, sous la direction de Christiane Mervaud et Nicholas Cronk, t. 63B, Oxford, The Voltaire Foundation, 2008, p.!433–35.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 545 4/17/13 4:44 PM
#67 E&'() R*++,
Voltaire en reparlera pourtant en 1770, lorsqu’il publie une édition «!critique!» du Cymbalum Mundi «!enrichie de notes intéressantes.!» Nicholas Cronk a bien analysé l’absurdité de cette édition trompeuse et bâclée, qui obscurcit le texte, supprime les illustrations, ignore les efforts philologiques et explicatifs de Prosper Marchand et l’accompagne de notes ni intéressantes ni éclairantes!: Voltaire vise non pas à diffuser l’œuvre, mais à l’écraser71. Certes Montesquieu avait vu juste quand il écrivait!: «!Quant à Voltaire, [.!.!.] tous les livres qu’il lit, il les fait!; après quoi, il approuve ou critique ce qu’il a fait72!». Charles Nodier, qui en 1839 rendit en"n justice à Des Périers, saisit bien le paradoxe de cette rencontre manquée!: «!Le petit livre de Desperiers était de tous les écrits de cette époque celui qui allait le mieux à son esprit et auquel il devait plus de sympathie!; car ce livre, il l’aurait fait lui-même deux cents ans plus tôt73!».
Voltaire n’hésite pas à emprunter les méthodes de falsi"cation et de propagande qu’il trouve chez ses ennemis, mais son antipathie pour certains de ses devanciers est trop tenace pour être mise sur le compte de la simple nécessité, de la part du général, d’avoir parfois à sacri"er la piétaille. En réalité, rien ne répugne davantage à Voltaire!–!qui a tout mis en œuvre pour ne plus être «!enclume!» et qui, doublant magistralement sa stratégie de réussite institutionnelle d’une stratégie de succès (de scandale)74, est parvenu à se rendre inattaquable et à «!vivre comme un fermier général!»!–!que de solidariser, même de loin, avec ces martyrs peu fréquentables, aventuriers étrangers, gens de lettres provocateurs, tout hérissés d’allégories et d’équivoques, mais si vulnérables75. A cela près que, tétanisé par un mélange d’horreur et de fascination perverse, il ne peut s’arrêter d’en parler.
71. Nicholas Cronk, «!The 1770 Reprinting of Des Périers’s Cymbalum Mundi! : Voltaire’s uncritical edition! », Revue Voltaire, n. 4, 2004, p.! 194. Voir aussi ses remarques sur l’édition du Philosophe de Dumarsais (1773), que Voltaire «!trahit!», comme il l’avait fait autrefois avec Meslier, en diminuant sa portée matérialiste «!pour en faire quelque chose de plus anodin et de moins radical!»!: Nicholas Cronk, «!Voltaire éditeur du Philosophe de Dumarsais!», La Lettre Clandestine, n. 16, 2008, p.!174–186.72. Montesquieu à l’abbé Guasco, le 8 août 1752, Correspondance de Montesquieu, Paris, Librarie Ancienne Honoré Champion, 1914, t. 2, p.!436.73. Cité dans «!The 1770 Reprinting of Des Périers’s Cymbalum Mundi!», p.!193.74. Alain Viala, Naissance de l’écrivain, Paris, Éditions de Minuit, 1985, p.!183–185.75. «!On me demande par quel art je suis parvenu à vivre comme un fermier général!; il est bon de le dire, a"n que mon exemple serve. J’ai vu tant de gens de lettres pauvres et méprisés, que j’ai conclu dès longtemps que je ne devais pas en augmenter le nombre. Il faut être en France, enclume ou marteau!: j’étais né enclume. [.!.!.] Depuis que je vis dans cette opulence paisible et dans la plus extrême indépendance, le roi de Prusse est revenu à moi!». Mémoires pour servir à la vie de Monsieur de Voltaire, écrits par lui-même, OCV, t. 45C, sous la direction de Nicholas Cronk, édition critique de Jonathan Mallinson, Oxford, the Voltaire Foundation, 2010, p.!402–403.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 546 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' #69
Quelque chose pourtant remonte à la surface dans ce palimpseste de témoignages piégés, renvoyant les uns aux autres, dont aucun n’émane d’une source désengagée, tous asservissant l’œuvre et l’expérience de l’auteur à leurs propres "ns!: c’est le statut particulier d’une œuvre que l’auteur, volens nolens, a cautionnée de sa propre vie76. Cette question travaille les écrivains des Lumières, qui sont en même temps inquiétés et séduits par les dangers qui accompagnent la pratique de l’écriture. Certes, nul n’a marivaudé autant que Voltaire avec les périls de la parole!: ses lettres retentissent d’un bout à l’autre de la clameur chagrine d’une persécution constamment subie (il s’agit, le plus souvent, de la persécution dont l’accablent ces «!délateurs!» qui veulent lui arracher le masque d’anonymat et lui imputer la paternité de ses œuvres les plus risquées)77. Mais c’est Diderot qui pose avec le plus d’intensité la question de la parrêsia. Dans une lettre à Mme de Maux, Diderot rapporte un débat qu’il vient d’avoir avec le baron d’Holbach, Naigeon, Suard et quelques autres, pendant un pique-nique à Saint-Cloud!:
O comme ils se sont moqués de moi, parce que je voulois à toute force être brûlé!; le douillet Naigeon en frissonne encore, j’en suis sûr. [.!.!.] Voici ce dont il s’agissoit. Je disois qu’il m’étoit impossible de ne pas estimer un homme qui, appellé au tribunal des loix pour un ouvrage hardi, repondoit avec fermeté, au hazard de tout ce qui pouvoit en arriver!: «!Oui, c’est moi qui l’ai fait, c’est ainsi que je pense, et je ne m’en dédirai pas.!» C’est la conduite pusillanime d’Helvetius qui avoit amené la question, et que j’excusois par sa mère, par sa femme et par ses enfans. Je disois que je souffrirois à faire injure à la vérité en la rétractant, à parler contre ma pensée après avoir écrit selon ma pensée, à me traduire aux yeux de mes juges, de mes concitoyens et aux miens comme un lache, à oter à mes discours toute leur autorité, à refuser à la vérité un aveu et un sacri"ce que cent fanatiques ont faits au mensonge. Je disois que
76. Les raisons de l’arrestation et de la condamnation de Vanini restent obscures, puisque les documents du procès ont disparu et que les témoignages contemporains sont réticents et contradictoires (ils ne mentionnent que le crime de blasphème imputable à un accusé se présentant sous une fausse identité). Il y a pourtant de bonnes raisons de conjecturer que sa véritable identité fut vite découverte et que quelques-unes au moins de ses œuvres jouèrent un rôle crucial dans le procès. Voir Francesco Paolo Raimondi, Giulio Cesare Vanini nell’Europa del Seicento, Pisa, Istituti Editoriali e Poligra"ci Internazionali, 2005, p.!294–362.77. Rousseau en fut un, dans l’affaire du Sermon des cinquante. Voir OCV, t. 49A, Introduction au Sermon des cinquante, édition critique de J. Patrick Lee et Gillian Pink, p.!36–40.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 547 4/17/13 4:44 PM
#6% E&'() R*++,
celui qui oublie sa vie en pareille circonstance se recommande à moi par la fermeté et la véracité de son caractere, que je voudrois être son pere, son frere, son ami. Je leur objectois Socrate que j’ai exposé à leur ironie, et à qui j’en fais amende honorable. Je reculois l’évenement dans les tems passés et je leur faisois lire les lignes de l’histoire. Eh bien, mon amie, ils m’ont écrasé de raisons. Mais, vous l’avouerai-je!? ils ne m’ont pas fait changer d’avis. Ils ont prétendu que tout cela n’étoit qu’un tour de tête poetique. À votre avis, qui est-ce qui sent juste, d’eux ou de moi!? Décidés sans partialité. [.!.!.] Je trouve le desaveu de ses sentiments, surtout en matiere grave, honteux. Je ne saurois souffrir qu’un homme qui se laisse appeller philosophe, prefere sa vie, sa misérable vie, au témoignage qu’il doit à la vérité. Je ne veux pas qu’on mente devant la justice. Je ne saurois souffrir qu’on imprime blanc et qu’on parle noir. Quelle con"ance le peuple, et il y a bien du peuple, aura-t-il en vos discours, si vous les abjurés!? Il vous laissera dire, et vous jugeant d’après votre conduite, il vous méprisera, et il fera bien!; et vous remarquerés que ceux qui blament Vanini, Jordan Brun et quelques autres, font un crime à de Voltaire de faire ses paques. [.!.!.] Les lignes tracées avec le sang du philosophe sont bien d’une autre éloquence78.
On aurait envie de s’arrêter plus longtemps sur cette lettre remarquable tant par les multiples rebondissements de ses mises en abyme que par le fait que c’est l’un des rares cas où les modèles ne sont pas «!reculés dans les temps passés!», (avec le passage obligé par Socrate), mais sont pris aussi dans l’histoire moderne79. Plusieurs instances énonciatives se croisent ici. Il y a d’abord le débat entre les amis réunis dans un pique-nique, dans cette «!journée folle et gaie!» à Saint-Cloud, locus amoenus où le drame de l’histoire se déroule pour le plaisir de la conversation, dans la théâtralisation ludique d’un procès80. À cela se superpose le récit de l’épreuve qu’il vient de subir, que Diderot offre en cadeau à sa maîtresse, dans une demande d’amour qui va le dédommager d’avoir perdu son «!procès!» (et qui lui donne la chance d’en gagner un autre auprès d’elle!: «!décidés sans partialité!»). L’amour qu’il attend d’elle en retour est le double symbolique de l’amour qu’il af"rme
78. Denis Diderot à Madame de Maux (?) été 1769 (?), Denis Diderot, Corrspondance, recueillie, établie et annotée par Georges Roth, t. 9, Paris, Minuit, 1963, p.!112–116. 79. Ces questions reapparaîtront dans la Lettre apologétique de l’abbé Raynal à Monsieur Grimm, 1781.80. Didier Foucault, «!Diderot, Vanini, le courage socratique et le jugement de la postérité!», Anabases, 13, 2011, p.!121–29.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 548 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' #62
porter à «!celui qui oublie sa vie!», dont il voudrait être «!le père, le frère, l’ami!»!; et dont il voudrait, surtout, dérober la place. Par-delà cette cour de justice toute privée, il y a l’appel au tribunal de l’opinion publique, dont le jugement devrait dédommager l’écrivain courageux des peines que lui in-ige le tribunal monarchique, puisque à la condamnation des «!juges!» fait pendant, symétriquement, le triomphe du philosophe auprès des «!citoyens!», dans un échange rétributif équitable.
Ce beau système se heurte d’emblée aux sarcasmes de la communauté des écrivains, qui voient l’engagement de la parrêsia comme quelque chose d’inconvenant. Dans la petite coterie holbachique, ces «!lignes tracées avec le sang des philosophes!» font pis que scandaliser!: elles suscitent le rire. Le vrai danger pour l’écrivain n’est donc pas tant l’exil, la perte de ses biens ou même la mort!: c’est le sens de la futilité!du geste, l’incapacité de susciter auprès des siens cette -ambée d’enthousiasme dont Diderot se montre si épris. L’idée d’un engagement sans réserve est répudiée par ceux-là même qui devraient le plus s’y reconnaître, mais qui, au contraire, n’y voient qu’étourderie et imprudence. Le philosophe est dès lors piégé dans une double forme de dérision!: ou bien être pris pour un vaniteux forcené s’il s’expose au danger (d’abord en publiant sous son nom, une œuvre risquée, ensuite en refusant de le désavouer)!; ou bien être méprisé comme lâche s’il la désavoue, abjure, rétracte. Le cas d’Helvétius illustre bien les embûches de la réputation!: il se "t tout à la fois traiter de dupe pour avoir publié en France, sous son nom (plutôt qu’à l’étranger, sous couvert d’anonymat)!; d’irresponsable pour avoir (involontairement) attiré la colère du Parlement et de l’Église sur l’Encyclopédie!; et de lâche pour avoir rétracté81. Par ailleurs les notes de Voltaire sur son exemplaire de la Lettre à Christophe de Beaumont font bien voir son dédain pour le choix pris par Rousseau de signer ses livres82.
Dans sa sentimentalisation de la gloire, Diderot ne peut donc éviter de se heurter, lui aussi, à l’éternel questionnement sceptique de ceux qui la désavouent!: à ce même scepticisme dont Vanini (au grand scandale de Durand) avait fait preuve à l’égard de Socrate, et qu’on n’avait pas manqué de lui rétorquer!: «![Socrate] courait le risque de se livrer à la moquerie et au dédain si dans ce siècle de constance et de courage il avait renoncé à achever ce qu’il avait commencé!; et peut-être les inquisiteurs athéniens ne lui permirent-ils pas de se retracter83!». Parmi ceux qui n’ont pas -échi devant le martyre il y a d’ailleurs «!un nombre in"ni d’imbéciles prêts à s’exposer à la torture au nom
81. D.!W. Smith, Helvétius. A Study in Persecution, Oxford, Clarendon Press, 1965.82. George R. Havens, Voltaire’s Marginalia on the Pages of Rousseau, Columbus, Ohio, Ohio State University, 1933, p.!138–139.83. De Admirandis, IV, 58, p.!1491. «!Voilà de quelle manière cet indigne Pedant outrage un illustre philosophe! : nous verrons tout à l’heure s’il se souvient bien
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 549 4/17/13 4:44 PM
##4 E&'() R*++,
de leur religion!», leurs motifs pouvant s’expliquer surtout par une puissante imagination ou par l’humeur hypocondriaque84. Il n’y a pourtant pas une page de cette œuvre qui ne décèle la prise de conscience que la parrêsia comporte bien son prix à payer! ; cela se donne à voir dans les allusions récurrentes à la vulnérabilité des philosophes qui n’osent pas exprimer leurs idées par crainte du peuple et du pouvoir85 et à la "n malheureuse des «!prophètes désarmés!» (tel par exemple Jésus)86!; dans les aveux ironiques de l’auteur sur sa propre crainte à lui, aussi bien que dans l’écart entre les précautions énonciatives qui enrobent le discours et le dé" insolent de propos qui ne cessent de le compromettre. Contrairement à Helvétius qui, jusqu’à la publication de L’esprit, avait mené une vie tranquille et publia son œuvre dans une heureuse inconscience de son potentiel de scandale, Vanini savait très bien qu’il risquait à tout moment de glisser dans l’abîme!; (ce qui ne l’empêcha pas d’essayer de toutes ses forces de ne pas y sombrer, allant jusqu’à simuler la dévotion pendant son emprisonnement).
Le scepticisme exprimé dans cette œuvre porte avant tout sur la valeur pédagogique et exemplaire de l’engagement pris par l’écrivain!; contrairement à la situation imaginée par Diderot, il n’y a pas chez lui d’ouverture vers la postérité, pas de revendication explicite d’une fonction éducative auprès du peuple. Il est vrai que cette parole véhicule un enseignement, mais c’est sur le mode d’une provocation à peine retenue!: d’où l’indétermination totale quant à ses conséquences. À l’encontre des énoncés performatifs dont l’ef"cacité est codée (comme la situation judiciaire envisagée par Diderot), «!la parrêsia n’ouvre pas un effet codé, elle ouvre un risque indéterminé!». C’est une parole qui est «!de l’ordre du dé", de l’ironie, de l’ordre de l’insulte, de la critique!; [.!.!.] il y a toute une violence, tout un côté abrupt de la parrêsia, qui est tout à fait différent de ce que peut être une procédure pédagogique. Le parrèsiaste [.! .! .] lance la vérité à la tête de celui avec lequel il dialogue, ou auquel il s’adresse87!». Face à cela, l’adversaire «!ne peut plus que se taire, ou s’étrangler de fureur!», passer à l’acte, voire au meurtre.
Dès lors, la provocation transmise par l’œuvre écrite s’apparente à celle qui se manifeste dans le rituel des dernières paroles, dans le refus de faire amende
lui-même de cette belle moralité lorsqu’on le mit en prison!». David Durand, La Vie et les sentiments de Lucilio Vanini, p.!161–62.84. De Admirandis, IV, 50, p.!1349. La question de la nature et des motivations de l’engagement éthique du philosophe incroyant avait été longuement discutée par Bayle dans les Pensées diverses sur la comète. 85. De Admirandis, IV, 50, p.!1365!et IV, 52, p.!1399.86. De Admirandis, IV, 50, p.!1355.87. Le Gouvernement de soi et des autres, 1982–1983, p.!54.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 550 4/17/13 4:44 PM
L' V)(.(. /' V,&0).1' ##5
honorable et de reconnaître la légitimité du tribunal!: «!Lors qu’on lui dist qu’il criast mercy à Dieu, il dit ces mots en la presence de mille personnes, il n’y a ny Dieu ny Diable, car s’il y avoit un Dieu, je le prierois de lancer un foudre sur le Parlement, comme du tout injuste et inique!; et s’il y avoit un diable ie le prierois aussi de l’engloutir aux lieux sous terrains!: mais parce qu’il n’y a ny l’un ny l’autre, ie n’en feray rien88!». Ces mots accompagnent la performance de fermeté «!philosophique!» devant la mort, attitude célébrée dans les modèles stoïciens et épicuriens, qui est en même temps une sauvegarde et un dernier affrontement («!sortant de la Conciergerie comme joyeyux et allegre, il prononça ces mots en Italien!; allons, allons allaigrement mourir en Philosophe!»)89. C’est en"n dans la brèche creusée entre le témoignage de l’œuvre écrite, celui de l’auteur sommé devant le tribunal et celui du corps violenté, que se glissent, avec impudeur, traînant après eux tous les aléas de la transmission, les regards des témoins, chroniqueurs et controversistes.
Écartant la stratégie de publication clandestine pratiquée par Voltaire, qui consistait à «!lancer la foudre et retirer la main90!», Diderot rêve d’un engagement personnel et direct entre l’écrivain et ce «!peuple!» spectateur d’un théâtre!du sacri"ce!: l’œuvre écrite n’est presque plus qu’un moyen permettant à l’écrivain d’af"rmer publiquement sa responsabilité envers sa tâche de pédagogue, la véritable œuvre consistant en «!ces lignes tracées du sang des philosophes!». Il y a certes une différence considérable entre l’obligation, soufferte par Helvétius, de rétracter le contenu d’une œuvre parfaitement explicite, et la tentative, dans le procès de Toulouse, de forcer l’auteur à donner à ses juges une clé de lecture, à trancher sur la signi"cation de son œuvre!et par là à s’accuser lui-même. Mais ce qui détonne le plus par rapport à l’expérience du siècle précédent, c’est la con"ance qu’a Diderot dans les mécanismes de publicité véhiculés par l’apparat répressif de l’État, dans cette «!justice!» qui, bien contre son gré, devrait se trouver asservie à la diffusion d’une vérité qu’elle ne pourra s’empêcher de rendre publique, alors même qu’elle s’apprête à l’étouffer. Qui plus est, Diderot n’a pas encore désenchanté, il n’a pas perdu, comme cela lui arrivera quelques années plus tard, «!le cercle des "délités et des protections!» qui ont conditionné sa pensée91!; pour l’instant il n’imagine
88. Mercure François, année 1619, t. 5, p.!63–65. Cité dans Marcella Leopizzi, Les sources documentaires du courant libertin français! : Giulio Cesare Vanini, Schena, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2004, p.!260.89. Mercure François, ibid.90. Voltaire à Jean Le Rond d’Alembert, le 31 mai 1761, D9798.91. Georges Benrekassa, «!Scène politique, scène philosophique, scène privée!: à propos de la Lettre apologétique de l’abbé Raynal à Monsieur Grimm!», Interpréter Diderot aujourd’hui, Colloque de Cérisy-la-Salle, 1984, p.!169–196.
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 551 4/17/13 4:44 PM
##$ E&'() R*++,
pas que ce puissent être précisément les philosophes (avec Voltaire en tête, qui s’est donné pour tâche de dresser les monuments ou de jeter aux oubliettes, de trancher sur ceux qui en sont et ceux qui n’en sont pas) à entraver cette transmission, à trahir les œuvres en les asservissant aux visées du moment, à tracer des fausses pistes dans la grande route qui devrait mener tout droit à la consécration par la postérité!: cette inquiétante pensée ne trouvera sa pleine expression que dans le cauchemar des Dialogues de Rousseau.
Johns Hopkins University
Romanic103i03-04_16 Russo.indd 552 4/17/13 4:44 PM