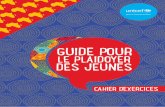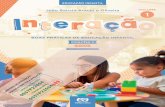Page 203- L'émigration intellectuelle des jeunes : Elément de Communication de la société...
Transcript of Page 203- L'émigration intellectuelle des jeunes : Elément de Communication de la société...
1
REVISITATION DE LA POLITIQUE EXTERIEURE DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : NECESSITE
IMPERIEUSE.
KISIMBA Kimba Emmanuel*
Introduction
Depuis deux décennies, la partie orientale, surnommée à juste
titre le "maillon faible" de la République Démocratique du Congo est
en butte à plusieurs conflits dont la dernière en date est celui du
"Mouvement du 23 mars" en abrégé M23. Si les causes réelles de ces
conflits n’ont jamais été révélées par les belligérants, mais les
conséquences ont été très importantes dans tous les domaines de la
vie nationale : déplacements massifs des populations, les violences
contre les jeunes filles et les femmes, la destruction de l’écosystème,
le pillage systématique des ressources naturelles, etc.
Malgré les actions militaires du reste très insignifiantes pour
arrêter la guerre que mènent les Forces Armées de la RD Congo
(FARDC), l’on s’interroge chaque jour qui passe sur les stratégies à
mettre en œuvre en interne comme en externe pour arrêter ces
conflits armés dans cette partie de la RD Congo et partant dans toute
la sous-région des Grands Lacs, et rétablir la paix dans ladite sous-
région.
En externe, on semble imputer la résurgence des guerres à
répétition à l’Est à la politique extérieure de la RD Congo qui ne
serait pas agissante sur le terrain. Ce constat nous interpelle à mener
une étude analytique qui se propose de faire l’état des lieux de la
politique extérieure de la RD Congo entre 1960 et 2010 en vue d’en
proposer des nouvelles pistes. Celles-ci seraient principalement
basées sur une diplomatie agissante mettant au premier plan le
processus d’intégration régionale en attendant, en plus en interne, que
soit réalisée la refonte de l’armée et des services de sécurité en cours
de gestation.
En d’autres termes, notre préoccupation consiste, en premier
lieu, à circonscrire les variables et les paramètres de la politique de
2
coopération régionale visant à réactiver la CEPGL dans l’intérêt
national de la politique de la RD Congo.
Secundo, notre étude se propose d’examiner les tenants et les
aboutissants de ce que doit être une diplomatie agissante de la
politique extérieure de la RD Congo en nous inspirant des prescrits
de la Constitution congolaise de février 2006 en matière de
coopération et d’intégration.
I. Définition des concepts utilisés dans l’étude
I.1. Le concept de "politique étrangère" ou "extérieure" d’un Etat
La politique étrangère est à la fois l’expression officielle et la
poursuite concrète des intérêts nationaux d’un Etat donné, en d’autre
termes, elle consiste à exprimer des positions mais aussi à
entreprendre des actions ; et enfin elle est supposée avoir été décidée
nationalement, dans le sens des intérêts de l’Etat représenté. (1)
Pendant longtemps, la politique étrangère s’est appuyée en
interne sur des acteurs que sont les institutions étatiques publiques :
le chef de l’Exécutif, le Ministre des Affaires Etrangères entouré
d’un réseau de diplomates se retrouvant dans son ministère ou à
l’étranger dans les Ambassades.
La bonne santé de ce ministère dépendait et continue à
dépendre aujourd’hui de la bonne qualité de ces agents doués,
expérimentés, intègres et voués à l’intérêt national.
Mais aujourd’hui, cette donnée s’est sensiblement modifiée,
plusieurs acteurs privés du domaine économique et commercia l des
mines, etc. ont vu leur rôle s’accroitre si bien qu’il faut tenir compte
de leurs points de vue dans la conception et conduite de la politique
étrangère, puisqu’ils sont souvent mieux préparés que les
administrations d’Etat dans certaines questions liées aux droits de
l’Homme, à l’environnement, à l’exploitation minière, etc.
* Professeur Associé à l’Université de Lubumbashi (RDC). 1 BLOM, CHARILLON, F, Théories et concepts des relations internationales,
Crescendo, Hachette, Paris, 2001, p.95.
3
I.2. Le concept "d’intégration régionale"
Selon les co-auteurs d’un ouvrage collectif déjà cité plus
haut, l’intégration régionale est un processus de collaboration et de
coopération par lequel plusieurs pays voisins constituant une région
géographique décident de s’intégrer et d’intensifier leurs échanges
économiques, culturels, environnementaux, etc. même si du point de
vue politique l’intégration est butée à plusieurs obstacles dont le refus
souvent opposé à la gestion politique supranationale de l’espace
intégré.
C’est dans ce cadre justement que fut créé la Communauté
Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) dont il sera
largement question dans notre analyse.
II. Etat des lieux de la politique extérieure de la RD Congo
(1960 – 2010)
La marche de la politique extérieure de la RD Congo a été
conçue et façonnée par les déterminants externes notamment la
guerre froide caractérisée par la rivalité idéologique Est
(communiste) – Ouest (capitaliste).
Les acteurs internes des institutions publiques nationales ont
travaillé à la lumière de cette guerre froide et leur politique extérieure
a été jugée et appréciée en termes de celle-ci en non en termes de
l’intérêt national qui devait guider toute action de la politique
extérieure de la RD Congo comme l’ont démontré les éléments à
travers le temps en RD Congo : la première République (1960-1965),
la deuxième République (1965-1997) et la troisième République
(2006-2012) précédée d’une longue période de transition (1997-
2005).
II.1. Sous la première République
Le Congo-Belge accède à son indépendance en 1960 au
moment où la guerre froide se met déjà en place et les animateurs de
la scène politique congolaise et plus particulièrement le Chef du
4
Gouvernement, le Premier Ministre congolais de l’époque qui
conduit la politique extérieure du pays est jugé par ses actes, ses
déclarations et ses visites antérieures en fonction de l’appui ou non
apporté à l’un ou l’autre bloc idéologique.
En effet, ses déclarations lors de la passation du pouvoir
politique aux congolais le jour de l’indépendance furent jugées par
l’Occident très radicales et teintées d’un soutien au bloc communiste.
Cela constituait aux yeux de l’occident une menace évidente pour
l’avènement du capitalisme dans un pays au cœur de l’Afrique, que
l’on voulait faire ami de l’occident pour contrecarrer l’expansion du
communisme en Afrique Centrale.
L’histoire de l’assassinat du premier ministre Patrice Emery
LUMUMBA est bien connue pour qu’on y revienne ici. L’on sait
déjà que celui qui devait devenir le prochain animateur de la
politique extérieure de la RD Congo, M. Joseph Désiré Mobutu était
entrain d’y être préparé si bien que cela ne pouvait les surprendre les
hommes ainsi du monde capitaliste.
II.2. Sous la deuxième République
Pendant la deuxième République, la politique étrangère de la
RD Congo (Zaïre) a été édifiée essentiellement sur la forte
personnalité du Président de la République (Mobutu) et sur la
situation géopolitique du pays (position centrale au cœur du continent
africain). Ce dernier facteur a contribué à générer dans l’esprit des
zaïrois (surtout chez les dirigeants) la folie ou l’excès de grandeur
sans équilibre à la base de laquelle a été instituée la diplomatie de
prestige. Cette recherche de prestige a présenté des failles et a glissé
vers les débordements incompréhensibles et déroutants ; à savoir des
dépenses incontrôlées et exagérées, des investissements irrationnels
d’expressions de grandeurs (références aux nombreux éléphants
blancs). Ce qui a conduit à l’endettement énorme de la R.D.Congo
(plus de 12 milliards de dollars) 2 et à la paupérisation de la
2 Avant le 30 juin 2010, la dette extérieure s’élevait à 13,7 milliards de dollars USD
pour un PIB d’à peu près 11 milliards de USD. Cf. www.7 sur
7.cd/index.php ?option=com. content. endettement…rdc.
5
population congolaise, bref à la faillite de l’Etat congolais. Ce
déséquilibre empêche les congolais de bien vivre.
En bon stratège diplomatique et probablement sous le conseil
de ses amis (Kasavubu) et fort de l’expérience du conflit Président-
Premièr Ministre Mobutu va supprimer le poste de Premier Ministre
pendant longtemps pour qu’il soit le seul acteur de la politique
extérieure du Congo devenu Zaïre. Il va nommer les Ministres des
Affaires Etrangères et des diplomates (Ambassadeurs) qui lui sont
fidèles et pas nécessairement bien formés et compétents pour
accomplir ce que l’Occident lui demandait de faire dans le cadre de
l’éloignement du bloc communiste de la région centrale africaine
d’autant plus que celui-ci est déjà pendant les années 1970 aux portes
de l’ex-Congo Belge.
Dans pareil cas, il est évident que les principaux axes de la
politique extérieure du Zaïre sous Mobutu étaient prioritairement
dictés par le souci de tenir promesse au bloc capitaliste et aux intérêts
de celui-ci plus tôt qu’à l’intérêt du pays.
Les composantes de l’intérêt national de la R.D.C, pour
diverses raisons ont été compromises au profit des intérêts des privés
sur le plan intérieur et au profit des étrangers dans les relations
extérieures alors que la politique étrangère des Etats doit avoir
pour ambition première de défendre et promouvoir leur intérêt
national. De ce fait, ce déséquilibre intérieur n’a pas manqué
d’affecter la conduite de la politique étrangère depuis la première
République, la deuxième, durant la transition et pendant la troisième
république avec l’instauration des pratiques préjudiciables à l’intérêt
national à savoir : l’irrationalité, le favoritisme, le non patriotisme, le
non nationalisme, la trahison, la traitrise, le détournement des biens
publiques et des aides internationales, le bradage, la spoliation du
patrimoine de la R.D.Congo à l’étranger tels les bâtiments
d’Ambassade, les résidences de Chefs de Mission diplomatique
bradées à vil prix. En effet, le congolais a transformé le slogan :
servir oui se servir non ! En servir oui ! Voler un peu et non
beaucoup disait-on. Et le résultat est connu : pratique de prédation à
tous les niveaux de la vie sociale.
De ce qui précède , nous constatons que les trois facteurs
précités (personnalité du président, la géopolitique de la RDC, la
6
rivalité (Est-Ouest) qui ont été prépondérant dans l’orientation de la
politique extérieure de la RDC dans les premières années de
l’indépendance n’ont pas su faire atteindre les objectifs lui assignés
non seulement du fait de la nature du régime mais aussi du fait des
déséquilibres observés entre les intérêts privés et les intérêts
étrangers par rapport à l’intérêt national .L’ intérêt national a été
délaissé au profit des privés sur le plan national et au profit des
intérêts étrangers dans les relations extérieures de la RDC3.
Aussi, la nomination de n’importe qui dans la diplomatie
congolaise a porté atteinte à l’image de marque de la RD Congo
(alors Zaïre) malgré sa position géographique et son poids
économique considérable. Cette situation a été dictée par le souci de
Mobutu de servir l’Occident tout en sauvegardant son fauteuil
présidentiel, d’où le caractère dictatorial, voulu par les circonstances
du moment, qui a accompagné l’exercice de son pouvoir. Le
caractère dictatorial du pouvoir de Mobutu est incarné politiquement
par l’existence d’un seul parti politique, le Mouvement Populaire de
la Révolution (MPR) de triste mémoire. La situation est pareille dans
tous les pays africains jusqu’en 1989/1990 quand commence une
nouvelle période de démocratisation incarnée par l’organisation des
Conférences Nationales Souveraines (CNS) chargée d’organiser la
transition, de concevoir le processus démocratique par le
multipartisme et l’organisation des élections.
Dans le cadre de la politique extérieure, il s’agit de concevoir
d’autres axes de celle-ci en tenant compte d’une nouvelle donnée
internationale : la fin de la guerre froide marquée par la victoire des
américains et du bloc capitaliste.
II.3. La politique extérieure de la RD Congo pendant la période de
transition (1990-2005)
Enfin, pendant la transition en RD Congo (depuis 1990 en
passant par l’avènement de l’AFDL de Laurent désiré Kabila
jusqu’aux élections démocratiques de 2006) ; la politique extérieure
3 www.memoire online.com…relations internationales
7
de la RD Congo suite à la crise de légitimité politique interne a
charrié une décennie de guerre civile à l’Est avec des millions des
victimes congolaises. La dite politique a connue une inertie
relationnelle ayant conduit à l’isolement diplomatique du reste en
passe d’être brisé pendant la troisième République.
Les conséquences de cette inertie privilégient les intérêts des
particuliers nationaux qui ont été défendus avec acharnement à
l’étranger et cela, au détriment de l’intérêt national. Et le résultat ne
s’est fait pas attendre ? Paupérisation de la population.
Par ailleurs ces comportements irresponsables dictés par
l’intérêt personnel des acteurs de la politique étrangère de la
R.D.Congo ont abouti à la signature de nombreux accords dit
« léonins » et à la prise des décisions irrationnelles ayant contribué à
précipiter l’Etat congolais dans le gouffre du sous-développement et
de l’endettement international dans lequel il se trouve ces jours.
Les raisons évoquées ci-avant pour expliquer cet état de
déséquilibre sont de trois ordres ; ordre structurel, ordre juridique
(impunité généralisée et absence de justice punitive) et ordre culturel
(introversion de l’échelle des valeurs cardinales des congolais). Mais
quels sont les remèdes appropriés pour palier à cette situation
préjudiciable au développement de l’entité nationale. En ce qui
concerne la question de la nature du régime politique et de la
légitimité politique, a été résolue depuis le 20 janvier 2007 par
l’instauration d’un régime démocratique à l’issue des premières
élections libre et transparentes de juillet 2006 en R.D.Congo. C’était
la première fois que le président de la république était élu au suffrage
universel direct (4).
Pour ce faire, la problématique qui émerge, porte notamment
sur : l’instauration de l’Etat de droit (justice impartiale, sans
discrimination, sans une classe des privilégiés avec comme mot
d’ordre, la tolérance zéro) et celle de la définition de l’intérêt national
pour la troisième République naissante par la détermination de
stratégies afin de la préserver, la protéger et la concrétiser.
4 Constitution de 2006 approuvée par le Référendum Constitutionnel du 18 au 19
décembre 2005 par le peuple congolais.
8
II.4. La politique extérieure de la RD Congo sous le signe d’une
diplomatie agissante (2006-2012)
La nouvelle phase de la politique étrangère de la RD Congo
coïncide avec l’organisation en 2006 des élections qui portent Joseph
Kabila Kabange à la Magistrature Suprême, ce qui mettait ainsi fin au
manque de légitimité que la communauté internationale reprochait
aux principaux animateurs notamment le Président de la République,
et le ministre chargée de la politique extérieure.
Du coup, il s’agissait aussi de mettre fin à la primauté des
intérêts privés qui l’emportaient sur l’intérêt national pendant la
période mouvementée de transition.
L’intérêt national de la troisième République, période de la
reconstruction nationale, devrait être défini en termes de quête d’une
sécurité pérenne afin de procéder à la réalisation du programme du
gouvernement censé assurer le bien être de la population par le biais
d’une prospérité exempte de tensions et des conflits récurrents. La
R.D.Congo par sa politique de « Cinq Chantiers » initiés par le
président Joseph KABILA et portés par le gouvernement à l’issue du
scrutin de 2006 était susceptible à apporter la satisfaction au sein de
la population en l’appliquant de manière positive et effective la
définition de l’intérêt national.
Pour revenir au discours d’investiture du 20 janvier 2007 du
président Joseph KABILA, la « politique de 5 chantiers », constitue
la stratégie de la reconstruction nationale comprenant les cinq
domaines prioritaires à développer à savoir :
1. Le chantier emploi ;
2. Le chantier infrastructure et voies de communication (routes,
voies ferrées, voies navigables)
3. Chantier projet agricole de grandes envergures
4. Chantier réforme éducative
5. Chantier énergie, soins de santé et habitats (5)
5 Discours présidentiel in Congo Afrique n°411, 2007 : 17
9
Pour éviter que le territoire Congolaise ne soit l’objet
d’incursion des bandes armées, le deuxième chantier infrastructure et
voies de communication (routes, voies ferrées, voies navigables)
devrait être l’unique grand chantier pour des raisons suivantes :
1. Des voies ferrées pourraient relier les villes congolaises les
unes aux autres, par exemple :
- Lubumbashi – Kinshasa – Mbandaka –Kisangani – Goma-
Kamina – Kabinda – Lodja – Lusambo – Ilebo – etc. L’avantage des
ces liaisons serait de renforcer l’unité nationale et / ou l’identité
nationale.
Car, jusqu’à ce jour, les congolais ne connaissent pas leur
territoire. Ceci contribue à le diviser, ceci explique pourquoi la
conscience nationale est plutôt une conscience clanique, territoriale,
provinciale. Lorsqu’un congolais vit dans une partie de la province
ouverte à la modernité, il n’hésite pas de considérer l’autre partie
comme inutile. Pourtant s’il avait visitée, il n’allait pas tenir un
langage si boiteux. Ce chantier devait être l’unique chantier aussi
parce que ;
Il allait accélérer le développement économique. D’abord le
rail (cesserait d’être) jouerait pleinement son rôle social d’intégration
nationale. Et, sans être dubitatif à l’endroit de la SNCC, dans les
conditions actuelles de son développement, la SNCC est à
restructurer en fonction de cette nouvelle visée d’un développement
durable. D’aucuns croient que la SNCC est toujours là pour le
transport des minerais. Avec la chute de la Gécamines, la SNCC
devrait changer de politique de développement.
Ensuite, partout où le rail passerait, l’électrification du pays
serait possible car, elle suivrait le tracé du chemin de fer. Entre les
nouvelles gares érigées dans les nouvelles régions, le développement
agricole et l’élevage serait facile. Cette mise en valeur du territoire
nationale par le rail donnerait du travail aux populations congolaises
et de l’emploi qualifié aux finalistes en économie, médecine
vétérinaire, agronomie-condamnés Quasi éternellement au chômage
et sans cause. Bref, tant que le Congo ne sera pas mis en valeur de
cette façon, les incursions de tout genre seront toujours nombreuses.
Les routes asphaltées pourraient aussi suivre les lignes de chemin de
10
fer et lorsqu’elles s’abiment, il sera facile de les réparer grâce aux
taxes perçues sur les usagers.
L’armée nationale s’impliquerait aussi dans cette mise en
valeur placée sous la conduite des architectes, maçons, ingénieurs
nationaux et internationaux.
A notre avis, nous nous proposons, dans le cadre du présent
article, à reformuler ladite politique en d’autres termes afin de
permettre un réel développement du Congo longtemps meurtri et
absent de la scène internationale, de revenir jouer un rôle de
leadership par l’application de la diplomatie agissante.
Ce qui aboutira par un changement significatif grâce à la
jouissance par tous des richesses dotées par la nature à la République.
De quelle manière par la concrétisation de l’intérêt national et les
programmes de développement du pays sans oublier la
sanctuarisation du territoire pour éviter qu’il ne soit l’objet
d’incursion des bandes armées le deuxième chantier infrastructure et
voies de communication (routes, voies ferrées et voies navigables)
Intérêt
national
Identité (A)
(
A
)
Survie (B)
Prospérité (C)
G
Ex : d’un Etat fort
(I
11
Le triangle équilatéral (I) que nous élaborons montre à
suffisance que les trois composantes de l’intérêt national sont liées et
indissociables. Dans le cadre de la RD Congo, le pays doit refondre
l’armée pour la rendre dissuasive et gardienne de l’entité congolaise
avec ses neuf frontières. "Cette réalité entraine fatalement des
problèmes de coopération différenciés avec chaque pays limitrophe,
mais aussi des problèmes de sécurité"(6). Les trois composantes de
l’intérêt national ne sont pas réunies. Pour cela, la R.D.Congo doit se
doter des atouts appropriés lui permettant de sanctuariser le pays tout
en participant à la reconstruction du pays. Par ailleurs, grâce à la
diplomatie agissante, la R.D.Congo pourra s’assurer que les
partenaires en quête d’un investissement seront crédibles car les
diplomates bien rémunérés seront à même de faire un tri des bons et
mauvais investisseurs et appliquer pour tous le principe de gagnant-
gagnant prescrivant tout investissement onéreux et non bénéfique au
pays . Une gestion orthodoxe et saine génère des recettes
substantielles susceptibles d’améliorer le vécu quotidien de congolais
par l’octroi des salaires décents. Ventre affamé n’a pas d’oreilles!
Pour avoir une bonne armée, grâce à une diplomatie agissante, la
RDC, pourrait envoyer les meilleurs de ses fils dans les académies
militaires de renom. L’argent est le nerf de la guerre, sans argent on
ne fait pas la guerre, on attend d’être envahi et submergé par
l’ennemi. Avec une économie prospère, la R.D.Congo est capable
de mener à bon port la bataille du développement .Le Congo est
devenu le malade de l’Afrique et ne parvient pas à faire décoller le
NEPAD, pour lequel beaucoup d’espoir était placé dans ce plan.
NB : Intérêt National
( AB=BC=CA)
(AG=BG=CG)
Les tentatives de mettre en exergue l’identité occultent les
autres composantes de l’intérêt, national.
6http://fweley.wordpress.com/2011/06/13/problematique-de-la-nationalité-en-
rdcongo/
12
NB : La réputation de la RD. Congo, la fait considérer
comme, un pays de démesure à tout point de vue : sous continent,
doté d’immenses richesses, mais classée parmi les derniers pays de la
planète en ce qui concerne le revenu par habitant.
AC BC
AG CG
BG=CG
Dans le triangle isocèle (II) il y a un déséquilibre flagrant.
Les composantes de l’intérêt national ne sont pas bien représentées
donc ne sont pas préservées. Dans ce type de représentation, le pays
est déséquilibré, et est en butte au disfonctionnements internes. Le
pays est un Etat faible voire défaillant. Il vit grâce aux aides
extérieures, l’armée n’assure pas la défense du sanctuaire. Les
rebellions naissent et perturbent le sanctuaire.
Avec la définition faite de l’intérêt national, il ya lieu de
s’assurer de la mise sur pied d’une stratégie capable de protéger le
pays des prédateurs et ce grâce à la diplomatie agissante. Les grands
stratèges ne disent-ils pas que les grandes victoires se gagnent à la
table de négociation. Cela signifie qu’une victoire sur le champ de
bataille n’est pas synonyme de victoire dans les cœurs et les esprits
et peut être un prélude d’un échec retentissant après que les armes se
soient tues. Aujourd’hui aucun pays ne peut se passer d’autres. Il y a
l’interdépendance car l’autarcie n’est plus de mise dans le contexte
mondial actuel. Du moment que l’intérêt national est défini, il y a lieu
de repenser à une stratégie pour le protéger, le préserver surtout
parvenir à le concrétiser sans atermoiements funestes. La stratégie à
appliquer est la diplomatie agissante basée principalement sur la
politique d’intégration régionale.
II.4.1. Les composantes d’une diplomatie agissante pour la RD
Congo
Dans ce présent point, il est question d’insister sur la
nécessité pour la R.D.Congo d’appliquer à la nouvelle politique
extérieure; la politique de la diplomatie agissante en lieu et place de
13
la politique de la diplomatie de prestige qui du reste n’a pas fait ses
preuves.
En effet, le Congo doit sanctuariser son territoire et faire des
voisins immédiats des partenaires en tissant des relations pacifiques
devant aboutir à une intégration positive. Toutefois, il y a lieu de
souligner que la RD Congo cohabite avec huit autres pays
limitrophes sans trop de conflits liés à la question de minorité et de
nationalité, en revanche la question reste récurrente en ce qui
concerne les relations entre la RD Congo et le Rwanda, notamment
sur la question des Banyamulenge et des Banyarwanda.
II.4.1.1. Les problèmes du Kivu
Les facteurs fonciers et densité de la population à l’accession
de la RDC à la souveraineté nationale sont devenus un problème non
de moindre qui n’a pas été résolu. Ce sont les populations du Rwanda
ayant émigré au Congo Belge qui n’ont jamais été intégrées par la
population autochtone. Celle-ci (population) est appelée
Banyarwanda ou congolais d’expression rwandaise pour les
distinguer des rwandais habitant le Rwanda. Il y a lieu de noter qu’il
y a 5 phénomènes qui seraient à l’origine du développement d’une
population rwandaise dans la province du Kivu : la proximité avec un
Rwanda surpeuplé, l’immigration des Banyarwandas, le recrutement
de la main d’œuvre rwandaise, la présence des réfugiés politiques, les
immigrés clandestins. A cela s’ajoute la porosité des frontières et les
diverses lois sur la nationalité congolaise, ainsi que la facilité avec
laquelle on acquiert la carte d’identité congolaise. Depuis plus
presque trois décennies, la RD. Congo n’a pas procédé à un
recensement sérieux de sa population. Il est prévu l’annonce des
résultats, de recensement de la population en 20157.
Comment arriver à taire les bruits de botte. La situation serait
d’envisager une politique d’intégration devant aboutir à la fin des
antagonismes. C’est ce que les pays occidentaux et l’ONU proposent
7 Communication du Ministre de l’Intérieur au Parlement au cours de la session
ordinaire de Mars 2013.
14
afin de taire les bruits de botte par exemple l’exploitation commune
de l’énergie électrique.
II.4.2. Nécessité d’une politique d’intégration régionale comme
coopération d’abord interétatique
La nécessité d’une politique d’intégration régionale pour
l’ensemble de régions de l’Afrique Centrale en général et de la région
des Grand-Lacs en particulier remonte à la fin des années soixante.
En ce qui concerne cette dernière région particulièrement,
l’idée fait jour le 29 Août 1966 quand les Ministres des Affaires et de
la Coopération de l’ex-Afrique Belge (Burundi, Rwanda et la RD
Congo) se réunirent à Kinshasa, signèrent le projet d’accord de
coopération en matière de sécurité en vue de garantir la paix dans la
région.
Cet accord de coopération en matière sécuritaire va
progressivement embrasser de domaines divers (judiciaire, sanitaire,
commercial, touristique, culturel, scientifique et technique) et se
transformer en conférence des Ministres des Affaires Etrangères
pour qu’enfin en septembre 1976 on arrive ainsi à la création de la
Communauté Economique des Pays des Grands-Lacs, CEPGL, en
abrégé.
Comme on le voit, la CEPGL a pour objectif l’intégration
économique régionale entre les trois pays, la libre circulation des
personnes, des biens et des capitaux, la sécurité régionale et le
financement d’institutions communes dans les domaines de la
finance, de la recherche et de l’énergie.
Mais à la suite des différentes difficultés dues aux conflits
armés survenus dans la région (crise burundaise en 1994, le génocide
rwandais, l’agression de la souveraineté territoriale de la RD Congo
par les troupes de l’AFDL, conflits armés menés par les troupes du
CNDP) et plusieurs tentatives initiées pour relancer la CEPGL
comme celle tentée en 2004 par l’ancien Ministre belge des Affaires
Etrangères, Louis Michel n’ont pas jusqu’ici abouti. Bien au
contraire, elles ont été freinées par des conflits armés récurrents dans
la région comme celui du M23, le dernier en date dans cette région,
mais soutenu par le Rwanda.
15
La situation d’agressions répétées de la RD Congo à partir
des pays voisins censés participer au processus de sécurité collective
dans la région et d’incessantes négociations suscitées par celles-ci en
vue de ramener la paix recommande pour ce dernier pays la mise sur
pied d’une nouvelle politique extérieure axée principalement sur une
diplomatie agissante qui devra désormais constituer le socle de la
nouvelle politique extérieure privilégiant l’intérêt national sur les
autres intérêts particuliers et/ou individuels.
II.4.3. La politique de la diplomatie agissante8
Est une politique devant encourager les diplomates affectés à
l’extérieur du pays à privilégier l’intérêt national par la signature des
contrats "gagnant-gagnant", l’exemple avec l’Empire du Milieu est
éloquent.
Avec cette politique, le diplomate sera réaliste, souple et
efficace à tout point de vue, la compromission est proscrite. Le
diplomate voit d’abord l’intérêt national dans toutes ses prises de
positions.9
II.4.3.1. La coïncidence des principes directeurs de la diplomatie
agissante et l’intérêt national
La zone vulnérabilité doit requérir une attention soutenue.
Les neufs voisins doivent constituer une ceinture de sécurité et non
une porte d’entrée des groupes armés et divers malfrats, la sécurité
nationale passe par l’établissement des alliances avec les voisins.
Ainsi, des efforts considérables et soutenus, grâce à une
diplomatie agissante doivent être entrepris afin de faire des Etats
voisins de partenaires privilégiés et des alliés voire de décourager
dans leur chef toute velléité d’immobilisation devant aboutir à des
incursions. Par ailleurs, ce sont des pays voisins qui s’intègrent, et
qui, grâce à la proximité géographique permet d’envisager
l’intensification de leurs échanges économiques.
8 www.cnrtl.fr/définition/diplomatie 9 www.digitalcongo.net/article/91513
16
Napoléon ne disait-il pas : "la moralité se trouve du côté de
la grosse artillerie ; ceci pour souligner l’importance et la nécessité
d’avoir une armée réellement dissuasive et républicaine (10
)." A tout
indéniable pour la RD. Congo afin de sécuriser les frontières
nationales, mais aussi d’épargner toute violation du sanctuaire en
provenance de ces Etats voisins.
En effet, il y a lieu de noter que les créneaux de vulnérabilité
d’un Etat se situe au niveau de ses frontières d’où nécessité
impérieuse de bonnes relations de voisinage et posséder une armée
dissuasive et républicaine.
II.4.3.2.La vocation africaine
Compte tenu des contraintes budgétaires, la RD Congo doit
rapidement procéder à un repli stratégique pour s’atteler à des tâches
spécifiques de développement national. La République Démocratique
du Congo doit s’abstenir à se lancer d’une manière non réaliste et
hasardeuse dans l’affirmation de sa position de puissance régionale
sur le plan africain en pareille période de reconstruction nationale.
Toute son énergie et toutes ses ressources doivent être consacrées à
l’effort de concrétisation de la prospérité nationale, bref, à atteindre
et parachever les cinq chantiers.
Mue par sa conscience de la vocation africaine, la RD Congo
doit garder sa place de manière symbolique au sein de l’Union
Africaine (U.A.) pour ne pas se désengager de manière irréversible
car l’alternative de se désengager serait mal interprétée et ne
manquerait de susciter des nombreuses interrogations voire de
l’hostilité.
Pour ce faire, la RD Congo se contentera de participer dans
les débats jugés importants sur la scène africaine et ne pourra s’y
investir à conditions que les résolutions y afférentes présentent des
impacts réels sur la promotion de l’intérêt national.
10 Déclaration de Napoléon Bonaparte à la campagne de Russie en 1812 in
fr.wikipedia.org
17
II.4.3.3.Les principes d’intégrité dans les grandes organisations
internationales
Dans la mesure où l’organisation internationale peut être
considérée comme un instrument de la politique étrangère des Etats,
comme un relais de leur action sur la scène internationale, la RD
Congo devra opérer un choix judicieux entre les organisations
internationales existantes pour s’intégrer dans celles susceptibles de
favoriser sa prospérité nationale. En plus de l’U.A. sur la scène
africaine, la RD Congo doit prioritairement s’intégrer dans l’ONU
notamment le FAO, le FMI, le BIRD, l’UNESCO, l’OMS,
l’UNICEF, OIT. La RD Congo ne peut échapper à l’intégration dans
les programmes des NU comme le PNUD, le CNUCED.
II.4.3.4.Réduction des missions diplomatiques
Dans le cadre de la politique de la diplomatie agissante, il est
souhaitable de procéder à la restructuration du nombre des missions
diplomatiques et des postes consulaires pour de raisons de
restrictions budgétaires et pour éviter la diplomatie de prestige de
naguère. Certaines missions diplomatiques qui ne présentent pas des
avantages réels pour les intérêts nationaux de la RD Congo doivent
être fermées ou mieux représentées au niveau des accréditations
multiples et en examinant le regroupement des fonctions avec nos
partenaires de la CEEAC.
Nous citerons à titre d’illustration : les Ambassades de la RD
Congo au Libéria, Sierra-Léone, Haïti, Yougoslavie, Djibouti,
Erythrée, doivent être fermées ou réduites au niveau des
accréditations multiples. Par contre, d’autres Ambassades doivent
être renforcées et maintenues à savoir :
- Toutes les Ambassades des pays voisins de la RD Congo
constituant la zone de vulnérabilité ;
- D’autres pays en Afrique comme l’Afrique du Sud, la
Libye, la Côte d’Ivoire, le Maroc, l’Egypte et le Nigéria.
- En Europe, nous citerons : la France, la Belgique, le
Royaume-Uni, l’Allemagne, la Grèce, la Suisse et la Grande-
Bretagne.
18
- En Asie, nous désignerons principalement : la Chine, le
Japon, l’Inde, le Pakistan, Dubaï, la Corée du Sud.
- En Amérique du Nord : les USA et le Canada.
- En Amérique du Sud : le Brésil, le Venezuela, le Mexique,
le Chili.
A noter qu’il serait également opportun de partager le
bâtiment avec les pays amis en ce qui concerne le personnel d’accueil
et de sécurité. Tout en réduisant le personnel diplomatique. Ceci
permettra de mettre fin à la diplomatie de prestige et éviter que la
clochardisation des diplomates en poste à l’étranger.
II.4.3.5.Privilégier les intérêts bannir les accords léonins et des
décisions déséquilibrées.
La politique de la diplomatie agissante s’inscrit aussi dans
l’optique d’une coopération bilatérale mutuellement profitable entre
les partenaires en présence. Il vise l’instauration de la symétrie dans
la coopération bilatérale entre la RD Congo et ses partenaires
extérieures, c’est-à-dire l’établissement de l’équilibre entre les
intérêts nationaux de la RD Congo et ceux des étrangers. Toute
situation de déséquilibre doit être dénoncée tels que les accords
léonins qui doivent être renégociés et au besoin être dénoncés par la
RD Congo.
Toutefois, l’instauration de l’Etat de droit où l’indépendance
du pouvoir judiciaire et la justice doivent être effectives et non
inféodés à l’exécutif.
Ainsi, le politique de la diplomatie agissante apporterait à la
politique extérieure de la RD Congo et dans le comportement de ses
animateurs le nationalisme, le patriotisme, le sens élevé de
responsabilité et de loyauté. Pour être le fondement de la politique
extérieure, la politique de la diplomatie agissante doit intervenir à
l’élaboration et à l’exécution de la politique extérieure de la RD
Congo. Notamment dans le recrutement et la formation des
animateurs, dans la définition de l’intérêt national et la prise des
décisions, dans la gestion des ressources financières et leur affection,
dans l’instauration de l’Etat de droit et la constitution d’une armée
19
républicaine dissuasive ; et enfin, dans la mise en œuvre de la
diplomatie réellement de développement.
II.5.Les axes et les principes d’une politique extérieure à
appliquer par la RD Congo grâce à la diplomatie agissante
Pour être efficace, notre politique extérieure devra tenir
compte de trois composantes rationnelles, à savoir : la survie, la
postérité et l’identité.
La RD Congo a besoin d’un cordon sanitaire pour sa survie,
cela qu’on suppose que le pays devra avoir des diplomates
compétents et de carrière. C’est dans ce contexte que nos diplomates
devront apprécier la force de chaque voisin pour en faire un
partenaire, afin de permettre au pays de l’éviter ou de l’affronter le
cas échéant.
Il faudra noter que notre pays ne pourra pas s’aligner lors
d’un conflit, derrière un quelconque camp sans tenir compte des
conséquences de cette prise de position et son impact sur les
populations. Il faudra à ce sujet éviter des prises de position
fantaisiste, non réfléchie, sans au préalable en calculer les
conséquences.
Il sied, comme le dit si bien Jean B. Duroselle, "d’éviter
d’être joueur par légèreté comme l’a été Benito Mussolini qui a
entrainé l’Italie dans la guerre aux côtés de l’Allemagne." L’idéal,
c’est d’être fin calculateur. C’est le lieu et le moment d’apprécier la
"real politik" de Joseph Kabila, à l’inverse de ses prédécesseurs et
aussi celui de Mobutu, qui malheureusement, finira par privilégier
l’intérêt personnel.
- La prospérité quant à elle, sous entend l’amélioration des
conditions existentielles des congolais après une si longue période de
crise socioéconomique. Pour ce faire, le pays appliquera quelques
principes dont le bilatéralisme où l’on devra cibler un certain nombre
d’Etats dont on devra tenir compte. Ce rapprochement avec d’autres
Etats devra se faire soit par des organisations sous-régionales telles
que la CEEAC, la SADEC soit par les relations bilatérales avec
plusieurs Etats à la fois. Cette prospérité peut revêtir plusieurs
aspects dont l’intégration sociale, politique ou économique.
20
Notre article démontre à suffisance que les pays à démocratie
balbutiante voire les Etats défaillants ont des difficultés de donner
satisfaction aux besoins élémentaires de leur population. Ils
s’illustrent souvent par la gabegie et la dilapidation des ressources du
pays et l’enrichissement personnel des dirigeants au détriment de la
population.
La situation politico-militaire de la RD Congo est la
résultante du manque de compétitivité de l’économie qui génère
aucun emploi durable et provoque des guerres cycliques plongeant
ainsi le pays dans une situation d’insécurité propice à la prolifération
des bandes armées animées par l’appât de gain facile que présente
l’exploitation illégale des ressources naturelles.
Par ailleurs, cette situation doit interpeller plus d’un
congolais. En effet, il est temps de revoir l’objectif de la politique
extérieure. Que veulent les Congolais pour le Congo ? Un Etat fort
ou défaillant ?
Conclusion
Notre recherche s’inscrit dans une logique d’études
prospectives pour la reforme et la revitalisation constante de la
politique extérieure de la RD Congo grâce à l’application de la
politique de la diplomatie agissante. La politique de la diplomatie
agissante est un courant de pensée innovatrice pour relancer et
redorer l’image ternie de la RD Congo à la suite de ses déboires.
Ainsi, avons nous voulu présenter cette approche scientifique
par les moyens qui y sont développés, lesquels se montrent par la
vision de la révisitation de la politique extérieure de la RD Congo et
de la dynamisation et l'adaptation de la diplomatie agissante
congolaise dans les pays de Grands Lacs Africains.
Nous avons souligné que depuis l’indépendance de la RD
Congo jusqu’aux élections démocratiques de 2006, l’intérêt national
a été compromis au profit des intérêts privés sur le plan national et
aux intérêts étrangers dans les relations extérieures. Ainsi, il y a lieu
de revoir notre politique extérieure grâce à une diplomatie agissante à
tout point de vue. Cette politique n’est pas asymétrique mais
converge vers un seul objectif : l’harmonisation d’intérêt
21
apparemment divergeant vers la convergence et ce dans l’intérêt
national d’une part et d’autre part, de sortir du déséquilibre présent
pour s’avancer vers la réalisation progressive et pacifique des
objectifs fixés ; c’est-à-dire atteindre la prospérité nationale par
l’établissement des relations des coopérations constructives et
durables. Ainsi, la compromission de l’intérêt national, bref, toute
compromission de l’intérêt national devra être reniée avec la dernière
énergie tout en coopérant avec les organisations internationales et
régionales comme : U.E, OCDE, OTAN, elle devra élaborer la
politique d’intégration des fonctionnaires congolais dans les
structures administratives des O.I. (Organisations Internationales) de
sorte que ces fonctionnaires par leur compétence puissent plaider de
manière honorable et par leur efficacité plaider pour les causes
défendues par la RD Congo dans ces O.I.
Par ailleurs, la consolidation de la paix fait partie des
objectifs du Gouvernement car sans paix durable, il est difficile de
concevoir un programme viable de développement. Comme pour l’un
ou l’autre objectif, la diplomatie agissante privilégiant l’intérêt
national est exigée comme soubassement de la nouvelle politique
extérieure de la RD Congo et le processus d’intégration dans le cadre
de la CEPGL doit se poursuivre quelles qu’en soient les difficultés,
car c’est au sein d’organisations régionales et/ou internationales que
s’épanouissent les nations comme l’ont démontré plusieurs exemples
à travers le monde.
22
ABREVIATIONS – SIGLES ET SYMBOLES
A.F.D.L : Alliance de Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo
A.L.E.N.A. : Accord De Libre-Echange Nord-Américain
A.S.E.A.N. : Association des Nations de l'Asie du Sud-est
B.I.R.D. : Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (Banque Mondiale)
C.E.A.C. : Communauté des Etats de l’Afrique Centrale
C.E.P.G.L. : Communauté Economique des Pays de Grands
Lacs
C.N.D.P. : Congrès National du Peuple, rébellion de Laurent
KUNDA à l’Est de
C.N.U.C.E.D : Conseil des Nations-Unies pour la Coopération
Economique et le Développement
E.I.C. : Etat Indépendant du Congo
F.D.L.R. : Forces Démocratiques de la Libération du Rwanda,
rébellion Hutu à l’Est de la RD Congo
F.M.I. : Fonds Monétaire International
F.A.R.D.C. : Forces Armées de la République Démocratique du
Congo.
F.D.L.R. Force Démocratique de la Libération du Rwanda
M23 Mouvement du 23Mars 2012
MERCOSUR : Le Marché Commun du Sud, couramment
abrégé Mercosur, (de l'espagnol Mercado Común
del Sur) ou Mercosul (du portugais Mercado
Comum do Sul)
O.C.D.E. : Organisation de la Coopération et de
Développement en Europe
O.I.T. : Organisation Internationale du Travail
O.M.S. : Organisation Mondiale de la Santé
O.TA.N. :Organisation de l’Atlantique Nord
P.N.U.D. : Programme de Nations Unies pour le
Développement
S.A.D.E.C. : South Africa Developpement Community
(Communauté de de Développement des Etats de
l’Afrique Australe)
23
U.A : Union Africaine
U.E. : Union Européenne
UNESCO : United Nations for Education, Science and
Culture
UNICEF : Association Humanitaire pour la survie et la
protection des enfants
Bibliographie
1. Blom, A, Charillon, F, Théories et concepts des relations
internationales, Hachette Supérieure, Paris, 2001, pp.164-
167
2. Chute du mur de Berlin suivi de l’éclatement de l’URSS,
1947-1989
3. Constitution de 2006 approuvé par le Référendum
Constitutionnel du 18 au 19 décembre 2005 par le peuple
congolais.
4. Déclaration de Napoléon Bonaparte à la campagne de Russie
en 1812 in fr.wikipedia.org.
5. Discours présidentiel in Congo Afrique n°411, 2007 : 17
6. http://fweley.wordpress.com/2011/06/13/problematique-de-
la-nationalité-en-rdcongo/
7. Archives du Sénat (annales et comptes rendus) 1960 à nos
jours.-Commission des relations extérieures du Sénat de
2009 à nos jours.(Travaux).
8. www.7sur7cd/index.php?option=com.content
dendettement…rdc
9. www.memoire online…relations internationales
10. Diverses déclarations
25
PPAASSSSEE,, PPRREESSEENNTT EETT AAVVEENNIIRR.. LLEESS RREESSSSOORRTTSS DDEE LLAA
CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN MMUUSSIICCAALLEE VVEERRBBAALLEE DDEE TTRRAADDIITTIIOONN
OORRAALLEE..
IBILI Akwer*
00.. IInnttrroodduuccttiioonn
Henri POUSSEUR, compositeur et théoricien en sociologie
de la musique affirme que l’art cherche souvent à organiser des
communications différentes, des communications d’un autre ordre
que celles des sens.1 Comme d’aucuns le savent, la musique
d’Afrique noire est une expression et une communication de
l’homme à lui-même, à son semblable, au monde de l’au-delà et
même à l’être transcendant.
Nous tentons, dans les lignes qui suivent, d’identifier et
comprendre cette communication d’une autre valeur, d’un autre plan
auxquels la musique de tradition orale peut également conduire.
Qu’on ne se méprenne pas. Il ne sera question ici de l’analyse
ni des déictiques temporels ni de la temporalité narrative2 moins
encore du temps construit par le récit ou des fonctions de celui-ci.3
Le cheminement de cette analyse empruntera plutôt
l’itinéraire que voici : nous servant de la théorie de la temporalité
dans ses dimensions du passé, du présent et de l’avenir, notre
réflexion entreprend de découvrir la signifiance des symboles clés de
quelques mélopées funèbres mbuun et partant la valeur de la relation
que l’homme noue avec lui-même, son semblable, la tradition et le
Dieu créateur.
* Professeur à l’Université de Lubumbashi(RDC) 1 Cf. http://fr.Wikipedia.org/wiki/sociologie de la musique, 29.04.2006
2 Cf MAINGUENEAU D., Eléments de linguistique pour le texte littéraire, Bordas,
Paris, 1986, pp 22-25 3 Nous pensons ici à Y. REUTER, dans son ouvrage intitulé : L’analyse du récit,
Armand Colin, Paris, 2007, pp 37-39
26
II.. LLaa tteemmppoorraalliittéé
II..11.. LLee ccoonncceepptt ddee tteemmppoorraalliittéé
L’étant humain est, par essence, un étant qui se comporte. Il
faut entendre par là que cet étant est constitué d’une relation
intrinsèque à l’autre, quelle que puisse être la diversité des modes
concrets sous lesquels cette relation apparaît. Cette relation est la
transcendance même. La temporalité se caractérise aussi bien par une
certaine forme de spontanéité : elle est déploiement du soi qui va vers
l’autre de lui-même, que par une certaine passivité : par cette
articulation, la temporalité ne met pas seulement en présence de
l’autre comme autre, elle est aussi réception de la présence de cet
autre. Ce processus, fait d’un perpétuel renvoi de l’un à l’autre de ces
moments, se réduit donc au passer même, il est la transition en tant
que telle.4
La temporalité est la forme intime du sujet. Le temps n’est
pas une succession de maintenant, il est vécu par nous avant tout
découpage du temps. Le sujet est présent en intention au passé
comme à l’avenir. A chaque instant, apparaît mon faire futur qui
modifie le moment précédent. Le temps n’est pas une ligne mais un
réseau d’intentionnalités.5
Il est donc établi que la temporalisation est au centre de la
réalité humaine tout entière. C’est à partir d’elle-et à partir d’elle
seulement-qu’il nous devient possible de concevoir et d’interpréter
tout ce qui fait l’existence de l’homme : sa connaissance, son pouvoir
d’agir ou de poursuivre des fins siennes, sa liberté, sa capacité
d’affection au sens le plus général.6
4 De WAELHENS A., La philosophie et les expériences naturelles, Martinus
Nighoff, La Haye, 1961, p 169 5 CHATELET F., La philosophie au XXème siècle, T4, Hachette, Paris, 1974, p 245 6 De WAELHENS A., op cit., p 174
27
II..22.. LLee ppaasssséé,, llee pprréésseenntt eett llee ffuuttuurr cchheezz llee nnooiirr aaffrriiccaaiinn
Orienté vers le passé, l’africain ne trouve pas la justification
et le sens de son action dans le futur mais dans le temps déjà écoulé.
Son raisonnement est de ce fait de type « régressif ». Car dit-il : « je
fais ceci parce que mes pères, mes ancêtres l’ont fait ». C’est ici où
apparaît la liaison nécessaire entre le passé et l’activité actuelle. La
tradition qui est dans l’africain et non derrière lui joue un rôle
déterminant dans la culture africaine.7
Le passé, on le sait, n’a aucune forme d’existence objective,
aucune espèce d’existence séparée du présent. Et puisque ce passé est
constamment porté et actualisé chez les vivants, il s’assure d’avance
de l’avenir.
II..33.. LLee tteemmppss ddaannss ll’’oorraalliittéé
Avant de nous appesantir sur le temps tel que conçu dans
l’oralité, un mot s’impose à propos de ses liens avec l’espace, réalités
inhérentes à la vie de tout homme. Tellement liés, les deux
s’appellent inéluctablement. A leur sujet, H. BERGSON est arrivé à
ce constat : si nous voulons réfléchir sur le temps, c’est l’espace qui
répond. Ainsi la durée est toujours exprimée comme une extension et
le passé est compris comme quelque chose d’étendu (physiquement)
derrière nous, le futur comme étendu quelque part en avant de nous.8
Dans l’oralité africaine, le facteur temporel n’y a pas droit de
cité. En effet, lorsqu’ils nous sont transmis par la tradition orale, les
7 Lire à ce sujet :
- ELUNGU Pene ELUNGU, Tradition africaine et rationalité moderne, éd
L’Harmattan, Paris, 1987, pp 30-38
- MUDIMBE V.Y., « Réponse à Jacques L. Vincke sur quelques questions
de méthodes », in VINCKE J.L., Le prix du péché. Essai de psychanalyse
existentielle des traditions européenne et africaine, éd du Mont Noir,
Kinshasa-Lubumbashi, 1973, pp 51-52 8 BERGSON H. cité par ARENDT H., in HIGHWATER J., L’esprit de l’aube.
Vision et réalité des indiens d’Amérique, Traduit de l’américain par R. Tricoire,
l’Age d’Homme, Paris, 1984, p 99
28
événements ne sont en général racontés ni en termes de temps passé
ni en termes de temps futur, au sens linéaire. La raison en est que le
message de la tradition orale se trouve au carrefour de deux axes.
Dans l’instant actuel, il est un échange entre deux interlocuteurs.
Dans la durée, il est un échange entre une tradition ayant existé dans
le passé et une situation à laquelle s’applique cette tradition.9
IIII.. HHoommmmee,, ccoommmmuunniiccaattiioonn aarrttiissttiiqquuee eett ffoonnccttiioonnss ddee llaa mmuussiiqquuee
aaffrriiccaaiinnee
IIII..11.. CCee qquu’’eesstt ll’’hhoommmmee eenn ssooii
L’homme est le fruit de nombreuses et diverses expériences,
expériences de son corps propre, de ses sentiments, de ses émotions,
de ses craintes, de ses espérances. C’est pourquoi, en même temps
que l’unité est affirmée dans sa permanence, la diversité est
également affirmée soulignant ainsi la fluidité de la personne
humaine. Les composés divers et différents sont au moins au nombre
de deux : il y a le corps et le double. Mais en général, ces composants
sont assez nombreux pour traduire par là la pluralité des expériences
vécues.
En bref, on peut retenir avec ELUNGU Pene ELUNGU, une
fois de plus, que l’homme est un flux d’expériences sur le fond
immuable et invariable qu’est la vie. Celles-ci sont parfois
conflictuelles.
Pour M. HEIDEGGER, l’homme se définit essentiellement
comme projet et qu’il est orienté essentiellement vers l’avenir. Celui-
ci fait partie de son être fondamental. HEIDEGGER juge que le futur
qui donne sens à l’être de l’homme est l’extase temporelle la plus
déterminante ; elle passe avant le passé et le présent.10
9 Lire à ce sujet :
- EPES BROWN J., cité par HIGHWATER J., op.cit., p 94
- CAUVIN J., Comprendre la parole traditionnelle, coll. les Classiques
Africains, éd Saint Paul, Paris, 1980, p 7 10 OKOLO OKONDA W’Oleko, « Avenir et Tradition », in Les Nouvelles
Rationalités Africaines, Vol 3, n°9, octobre 1987, p 14
29
IIII..22.. OObbjjeeccttiiffss ddee llaa ccoommmmuunniiccaattiioonn aarrttiissttiiqquuee eett ffoonnccttiioonnss ddee llaa
mmuussiiqquuee aaffrriiccaaiinnee
La communication est un concept qui trouve son application
dans plusieurs secteurs de la vie humaine. Parmi les nombreux
objectifs qu’elle poursuit, l’on peut retenir dans l’art oral ceux par
lesquels l’émetteur veut faire passer un message, une information ou
une connaissance, exprimer un sentiment, donner son identité,
persuader le destinataire ou l’auditeur et ainsi l’amener à changer son
opinion, etc.
Les fonctions de la musique africaine, nombreuses elles
aussi, dépendent de la nature de celle-ci et du but qu’elle poursuit.
Ainsi les fonctions suivantes : intégrative, récréative ou ludique,
didactique ou éducative, initiatique, politique, laudative, soutien-
effort, thérapeutique, etc.
C’est ici le lieu de rappeler, à l’instar de tout texte littéraire,
que le compositeur d’un morceau chanté initie une signification alors
que l’auditeur lui, suivant son expérience, son éducation, ses états
d’âme, son rapport à la musique, dégage une signifiance comprise
comme une signification plurielle.
IIIIII.. CCoorrppuuss
III.0. Les textes chantés que nous avons retenus pour étudier le
phénomène de la temporalité sont des mélopées funèbres dites
« Engung » récoltées par MAZINGA MASHIN.11
Il s’agit d’une
forme de jeu individuel où les pleureurs professionnels prennent la
parole à tour de rôle pendant les veillées funèbres. Cette étape
succède au premier jeu où s’affrontaient, sous forme de palabre
11 Cf sa thèse de doctorat en Information et Arts de Diffusion, intitulée : Engong et
langong. Etude comparative de deux formes de dramaturgie populaire chez les
Ambuun du zaïre, Université de Liège, (s.d). Dans notre propre thèse de doctorat
(1998), ces deux chants apparaissent aux pages 301-304
30
jouée, des chanteurs regroupés en deux équipes concurrentes.
Chacune veut se faire apprécier comme la plus talentueuse.
Loin d’être un monologue béat, le jeu individuel des
pleureurs se mue en réalité en dialogue étant entendu que chaque
intervenant tient compte des propos lancés avant lui par un autre
pleureur.
IIIIII..11.. TTeexxtteess eett ttrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee
Pleureur 3
Me likal likal likal
Maam m’osur labwak labasodzu
Maam asas ayasodzu
Maam labwak layasosim
5. Maam kayi osaam lakal mwan a mpɛng
Maam kayi osaam ɛnkos mwan Opfing
Traduction française
Moi, je suis resté longtemps
Ma mère dans la forêt n’est pas morte d’anémie
Ma mère a été tuée par des balles
Ma mère est morte d’anémie
5. Ma mère m’a dit de faire attention au neveu
Ma mère m’a demandé de m’entendre avec Enkos, fils d’Opfing.
Pleureur 4
Ndzɛ lakal y’Onok odm a mwan Onkéén
Mɛ likɛl y’Asɛk mpɛng a mwân Oléél
Lawin awin awin
Ndzɛ ɛkwɛbwa ɛwa Ekwɛl
5. Ekwɛl mon awéén awɛla
N’asa ongung tɛ mɛ n’ab’sendel n’amɛndel ?
Mɛ baan amɛndel
Mɛ baan amɛndel
Mɛ alung abéndél
10. Mɛ alung abéndél
31
Baan abendel m’odm Etyer mwan Ekol
Bol aluum akandél !
Abesa Olool noon ekorowusa, baan b’awundel
Ekuk mpɛng mboome
15. Ankyem baan abis ɛbul
Ampal baan abis Ekob
ÓÓ mɛ wa, ÓÓ me wawo
Ibi yakwɛ nkyé? Maam kayuun!
Traduction française
Tu as épousé Onok, fille d’Onkeen
Moi, j’ai épousé Asɛk, fille d’Oleel
Tu es parti
Toi, tu as épousé la fille d’Ekwɛl
5. Mais Ekwɛl était déjà mort
C’est pourquoi je leur dis : qui me pleurera, qui me pleurera ?
Ce sont mes enfants qui me pleureront
Ce sont mes enfants qui me pleureront
Ce sont les ancêtres qui me pleureront
10. Ce sont les ancêtres qui me pleureront
Les enfants me pleureront, moi le mari d’Etyer, fille d’Ekol
Le village se lamentera aussi sur mon cadavre
A vos cris, je risque de me lever pauvres enfants
Ekuk, ma sœur, laisse-moi (parler) !
15. Ankyem est d’Ebul
Ampal est d’Ekob
Oh oh tu me vois, oh oh je suis là
Avec quoi m’en irai-je ? Ma mère le sait !
IIIIII..22.. AAnnaallyyssee
Prenant en compte des énoncés musicaux dits au passé, au
présent et au futur, notre analyse des mélopées funèbres mbuun part
32
de la tradition comme de toute œuvre humaine considérée comme un
symbole au sens d’une expression significative et multivoque.12
Nous empruntons notre grille de lecture à une théorie de la
temporalité et à Victor TURNER dans son interprétation du symbole.
IIIIII..22..11.. UUnnee tthhééoorriiee ddee llaa tteemmppoorraalliittéé
L’existant ne peut se rejoindre qu’en se quittant à travers un
intervalle infini. Ceci sous-entend qu’il est à la fois toujours séparé
de lui-même et toujours capable de se réidentifier à lui-même dans
cette séparation même, qu’il s’affecte sans cesse lui-même d’une
altérité qui n’est elle-même qu’un moment dans une opération
synthétisante. Autrement présenté, on peut retenir que le temps est la
forme dans laquelle l’existant se rapporte à lui-même comme écart
par rapport à soi. Ainsi :
- le passé représente ce qui s’est déjà éloigné,
- le futur représente la possibilité indéfinie de la séparation
d’avec soi, et
- le présent est l’unification incessante de cette possibilité et de
cet éloignement ; il réassume sans relâche les deux versants
de l’altérité, la distance qui s’est déjà creusée dans l’existant
et celle qui s’annonce en lui inépuisablement.13
IIIIII..22..22.. LLee ssyymmbboollee eett ssaa ssiiggnniiffiiccaattiioonn
Examinant la signification d’un symbole V. TURNER
distingue au moins trois niveaux ou champs de signification et qu’il
propose d’appeler le niveau d’interprétation endogène ou en bref, la
signification exégétique, la signification opérationnelle et la
signification positionnelle.14
12 OKOLO OKONDA, « La tradition comme médiation et symbole du sacré », in
Médiations Africaines du Sacré. Actes du Troisième Colloque International, Faculté
de théologie catholique de Kinshasa, Kinshasa, 1987, pp 70-71 13 Cf. LADRIERE J., « Le monde », in Encyclopaedia Universalis, corpus 12, Paris,
1988, p 520, Col 1 14 Cf. SPERBER D., Le symbolisme en général, Coll Savoir, Paris, 1974, pp 24-25
33
IIIIII..22..22..11.. SSiiggnniiffiiccaattiioonn eexxééggééttiiqquuee ddeess ssyymmbboolleess
La signification exégétique est celle fournie par le
commentaire autochtone. Ici comme dans la suite de cette analyse,
les symboles seront lus selon qu’ils renvoient au passé, au futur et au
présent.
a. Au passé
Comme signalé plus haut, le passé représente ce qui s’est
déjà éloigné.
Dans sa mélopée funèbre, le pleureur 4 s’appesantit sur
deux symboles : le mariage (Vers 1, 2, 4) et la mort (Vers 5-13). Un
index de valeur15
, le mariage est ce par quoi se forme la famille,
cellule de base de la société mbuun. Il s’agit d’un processus qui part
des fiançailles passant par le versement de la dot jusqu’à la
cérémonie ultime dite mariage et qui consacre l’union légitime de
l’homme et la femme.
A la brièveté de la durée du pacte s’oppose l’étendue de la
vie du couple dont le souci majeur, toujours vivace chez le négro-
africain, est la perpétuation de la société par la procréation. C’est par
la vie conjugale responsable que la communauté entrevoit en même
temps son avenir. Par le mariage, la personne marque son temps pour
ainsi s’imposer dans le souvenir de ses congénères.
La mort, réalité naturelle, est quant à elle, la cessation de
vie terrestre. Elle est ce passage obligé pour la vie de l’au-delà. Par sa
vie et ses œuvres, le souvenir du sujet décédé reste gravé dans la
mémoire des vivants. En même sur le temps qu’elle crée un vide, la
mort fait réfléchir en vue de l’avenir.
b. Au futur
Le futur représente la possibilité indéfinie de la séparation
d’avec soi. Non seulement le futur mais même « le mot humain
15 Cf. GUSDORF G., La porale, PUF, Paris, 1966, p 8
34
permet d’échapper à la contrainte de l’actualité pour prendre position
dans la sécurité de la distance et de l’absence.16
Ce que déclare le pleureur 3 permet au pleureur 4 de marquer
une distance par rapport à lui. Le pleureur 3 servant de miroir au
pleureur 4 aide celui-ci à identifier l’autre de lui-même. Dans ce face
à face, l’identité du pleureur 4 est le lieu d’une proximité. Celle-ci se
remarque, se définit lorsque ce pleureur 4 se fait une idée claire et
juste de la nature, de la forme et du contenu de l’espace qui sépare en
lui ce qu’il prétend être ou savoir de son image réelle que l’autre, le
pleureur 3 et donc son miroir a permis de circonscrire.17
Il est aussi un autre miroir en face duquel se place l’un et
l’autre chanteurs de mélopées funèbres mbuun. Il s’agit bel et bien de
l’événement lui-même, en l’occurrence la mort d’un sujet. En effet,
c’est par rapport à celle-ci que se justifie également le sens de
l’interaction entre les deux groupes concurrents des pleureurs
professionnels.
Mais le futur se dessine aussi au regard du passé et du
présent des symboles internes à un chant funèbre. En effet, du vers 7
au vers 12, le chanteur 4 parle de sa mort future en citant ses enfants,
toute la communauté villageoise et les ancêtres qui le pleureront.
Comme on peut le constater, ce pleureur 4 se sépare de lui-même en
se projetant dans l’avenir par sa mort prochaine, inévitable.
L’espace que représente la distance entre lui et l’autre de lui-
même est le symbole d’une vie pleine par le mariage et la progéniture
et le bon comportement dicté par l’éthique ancestrale.
c. Au présent
Le présent est l’unification incessante de la possibilité
indéfinie de la séparation de l’homme d’avec soi et de ce qui s’est
éloigné de lui. Par le présent, l’homme réassume sans relâche les
16 GUSDORF G., op.cit, p 6 17 Lire à ce propos : OKOLO OKONDA W’Oleko, Pour une philosophie de la
culture et du développement. Recherches d’herméneutique et de praxis africaines,
PUZ, Kinshasa, 1986, p 91
35
deux versants de l’altérité, la distance qui s’est déjà creusée dans
l’existant et celle qui s’annonce en lui inépuisablement.
Vers 13 : A vos cris, je risque de me lever pauvres enfants.
Ici, le pleureur 4 opère une fusion entre son passé qui est en
lui et sa mort future dans laquelle il s’est projeté. Ce mélange suscite
en lui une sorte de détente indispensable pour le corps et l’esprit.
IIIIII..22..22..22.. SSiiggnniiffiiccaattiioonn ooppéérraattiioonnnneellllee
La signification opérationnelle d’un symbole est équivalente
à son usage et aux qualités affectives liées à cet usage : agressive,
triste, repentante, joyeuse, moqueuse, etc.
L’affectivité est comprise comme l’ensemble des sentiments.
On distingue les sentiments liés à un état de passivité (plaisir,
douleur, émotion) et ceux qui sont liés à l’action, ou tendances
affectives (désir ou répulsion, amour, haine).18
a. Au passé
A l’instar du pleureur 4, le chanteur 3 traite lui aussi de la
mort, par maladie (anemie) et par balles. On le sait, le décès d’une
personne crée un vide dans sa communauté. D’où la tristesse qui
s’empare de ses proches. Mais reprise dans un chant, la mort devient
cet exutoire qui soulage quelque peu la peine de la famille éplorée.
Dans le texte sous examen, le chanteur insinue simplement que la
mort a toujours existé, qu’elle frappera, qu’on le veuille ou non, de
telle ou telle autre manière.
b. Au futur
La mort future dans laquelle se projette le pleureur 4 le
sépare de lui-même et de ses proches. Par rapport à la circonstance
du jour que sont les funérailles, cette mort future apaise aussi
l’auditoire. Par elle, en effet, le public réalise la fragilité de
18 JULIA D., Dictionnaire de philosophie, Larousse, Paris, 1964, p 13
36
l’existence humaine. La mort concerne donc tout le monde, le
chanteur et le danseur des lieux mortuaires y compris. C’est cette
évidence qui fait basculer la douleur en gaieté bénéfique pour le
groupe concerné.
c. Au présent
Les différents messages des textes ici considérés
s’enchaînent et se complètent par divers rapports. La mort qui
accompagne l’homme dans son existence depuis la nuit de temps
frappera toujours sans distinction de race, sexe, âge, fonction, etc.
voilà qui réclame à toute personne d’accepter cette réalité
mystérieuse avec stoïcisme.
IIIIII..22..22..33.. SSiiggnniiffiiccaattiioonn ppoossiittiioonnnneellllee
La signification positionnelle tient aux relations structurales
que les symboles entretiennent entre eux. Le mariage et la mort que
chante le sujet dans le texte 4 entretiennent quelques liens qu’il
importe de clarifier.
En effet, la naissance d’un être humain n’est que la résultante
de l’union de deux sexes opposés. C’est donc par elle que la vie
commence pour s’achever par la mort. Vie et mort sont donc les deux
faces d’une même et seule réalité qu’est l’existence. Mais la mort se
veut aussi point de départ de la vie par le phénomène de
l’incarnation. Les deux se révèlent l’une à l’autre dans un rapport de
contiguïté et de coordination dans cette existence.
Toutefois, sans procréation, le mariage, entraîne la mort sous
quelques formes. On parlera ici d’un lien de cause à effet.
Par rapport au présent, ceci veut dire en définitive qu’à une
naissance par le mariage dans le passé devra correspondre une mort
dans l’avenir de tout existant. A la famille endeuillée de le
comprendre et de se comporter en conséquence.
37
CCoonncclluussiioonn
Un contexte, quel qu’il soit, est un prétexte pour tout texte
dont la visée première est plutôt l’avenir, un avenir que le chanteur
veut radieux. Le destinataire d’un message est le miroir de l’émetteur
de celui-ci. Ce miroir l’aide à réaliser l’autre de lui-même. Cet autre
de lui-même longtemps resté à l’ombre et ce que cet émetteur
exprime constituent alors la vraie identité de celui-ci
Le passé et le présent sur lesquels l’homme s’appuie sont
pour lui un tremplin pour un avenir plus sécurisant. Ainsi, nous a-t-il
été donné de comprendre que le mariage et la mort sont les deux
faces d’une même et seule réalité qu’est la vie.
L’évocation de l’un et l’autre phénomène dans les
mélopées funèbres mbuun est une occasion pour l’homme de la
parole de réinstaller la cohésion qui s’est effritée en invitant le sujet
éploré à saisir l’existence avec responsabilité et stoïcisme car ce qui a
été, ce qui est n’a de sens et de valeur que pour l’avenir.
BBiibblliiooggrraapphhiiee
CAUVIN J., Comprendre la parole traditionnelle, Coll. les
Classiques Africains, éd Saint Paul, Paris, 1980
CHATELET F., La philosophie au XXème sicèle, T4,
Hachette, Paris, 1974
De WAELHENS A., La philosophie et les expériences
naturelles, Martinus Nighoff, La Haye, 1961
ELUNGU Pene ELUNGU, Tradition africaine et rationalité
moderne, éd l’Harmatan, Paris, 1987
GUSDORF G., La parole, PUF, Paris, 1966
HIGHWATER J., L’esprit de l’aube. Vision et réalité des
indiens d’Amérique, Traduit de l’américain par R. Tricoire,
L’Age d’Homme, Paris, 1984
http://fr. wikipédia.org/wiki/sociologie de la musique,
29.04.2006
IBILI AKWER, Les chants des Ambuun du Kwilu
(république démocratique du congo). Modes de
38
communication, thèse de doctorat en langues et littératures
africaines, Université de Lubumbashi, 1998
JULIA D., Dictionnaire de philosophie, Larousse, Paris,
1964
LADRIERE J., « Le monde », in Encyclopaedia Universalis,
corpus 12, Paris, 1988
MAINGUENEAU D., Eléments de linguistique pour le texte
littéraire, Bordas, Paris, 1986
MAZINGA MASHIN, Engong et Langong. Etude
comparative de deux formes de dramaturgie populaire chez
les ambuun du zaire, thèse de doctorat en Information et Arts
de Diffusion, Université de Liège, (s.d)
MUDIMBE V.Y., « Réponse à Jacques L. VINCKE sur
quelques questions de méthodes », in VINCKE J.L., Le prix
du péché. Essai de psychanalyse existentielle des traditions
européenne et africaine, éd du Mont Noir, Kinshasa-
Lubumbashi, 1973
OKOLO OKONDA W’oleko, « Avenir et Tradition », in Les
Nouvelles Rationalités Africaines, Vol 3, n°9, octobre, 1987,
pp 5-19
OKOLO OKONDA W’oleko, Pour une philosophie de la
culture et du développement. Recherches d’herméneutique et
de praxis africaines, PUZ, Kinshasa, 1986
OKOLO OKONDA, « La tradition comme médiation et
symbole du sacré », in Médiations Africaines du Sacré. Actes
du Troisième Colloque International, Faculté de Théologie
Catholique de Kinshasa, Kinshasa, 1987, pp 67-72
REUTER Y., L’analyse du récit, Armand Colin, Paris, 2007
SPERBER D., Le symbolisme en général, coll. Savoir, Paris,
1974
39
LA ROUTE DES CARAVANES D’ESCLAVES A L’EST DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
KISONGA Kasyulwe Désiré*
Introduction
Le colloque du 10 au 12 janvier 2012 a été organisé dans le
cadre de la célébration de l’année jubilaire 2012, de la fondation de la
ville d’Albertville-Kalemie, 120 ans après. Le colloque était ainsi
sommairement intitulé : « 120 ans après, quel avenir pour
Kalemie ? ». Il s’est concrètement agi, dans l’esprit des
organisateurs, semble-t-il, de voir dans quelle mesure la ville
d’Albertville-Kalemie aura été, au cours de ces 120 dernières années,
un instrument de développement (ou de sous-développement
pourquoi pas) social, politique, économique, moral et culturel dans
son environnement local, provincial et national.
C’est précisément dans ce contexte que nous avons préparé
une communication sur « la route des caravanes d’esclaves à l’Est
de la République Démocratique du Congo ».
Loin de prétendre analyser profondément tous les aspects,
l’étude se veut succinctement une sorte du coup de sonde et a comme
objectif fondamental, montrer que la traite des esclaves et ses
corollaires auront influé négativement ou positivement sur les
transformations (politique, économique, sociale, morale et culturelle),
les structures, le fonctionnement et le développement du District du
Tanganyika en général et de la ville d’Albertville-Kalemie plus
particulièrement.
Disons de prime abord que l’Afrique équatoriale et sud-
tropicale aura été l’une des dernières parties du monde à subir les
influences étrangères. Certaines parties ont connu un long passé,
ainsi que l’attestent les sites préhistoriques découverts entre les
Grands Lacs et l’Océan Indien, mais leurs habitants n’entraient pas
directement en contact avec le monde extérieur. L’initiative revenait
aux étrangers, premièrement les arabes qui vinrent se fixer sur la côte
Est, et, tardivement, pénétrèrent plus loin dans l’intérieur du
Continent. Leur expansion s’étendra alors progressivement sur une
40
vaste zone qu’il convient de préciser dès maintenant, pour délimiter
le cadre géographique de la présente étude. Elle a couvert les pays ci-
après, désignés sous leurs appellations actuelles : moitié sud du
Kenya, moitié nord d’Uganda, Tanzanie, nord-est de la Zambie,
Malawi, moitié nord du Mozambique, et moitié est de la République
Démocratique du Congo. C’est cette dernière partie qui fait l’objet de
notre communication.
Hormis la conclusion, l’essentiel de notre article s’articule
autour des axes ci-après :
- L’arrivée des Arabes et les routes de caravanes en
Afrique centrale,
- L’expansion arabe en Afrique centrale et les aspects
généraux de la pénétration,
- La pénétration et le système d’implantation,
- Les rapines et le marché intérieur,
- L’exportation des esclaves,
- Les conséquences de la traite des esclaves.
1. L’arrivée des Arabes et les routes de caravanes d’esclaves en Afrique centrale.
Le grand carrefour commercial de l’Afrique centrale était
Kazembe, au Sud-ouest du la Moëro. Kazembe, qui
signifie « gouverneur », était le titre d’un chef de troupe envoyé au
XVIIIème siècle par Mwant Yav, le souverain Lunda. Le Kazembe
avait conquis de vastes territoires sur le Luapula dont il devint le chef
héréditaire. Théoriquement vassal du Mwant Yav, il avait acquis une
puissance et une notoriété qui le rendaient égal à ce dernier et parfois
même lui donnait-on ce titre souverain. Puissance à la fois
commerciale, car sa capitale devint le rendez-vous des traitants venus
de l’Est et de l’Ouest ; et politique, car il exerçait chez lui une très
forte autorité. Chef absolu, sa volonté constituait la loi ; une vraie
cour l’entourait avec des ministres chargés de fonctions précises.
La route entre Kazembe et Kilwa passait par la région des
Bemba. Ces populations se répartissaient en chefferies dont le
titulaire avait une autorité assez étroite sur les villages dépendant de
41
lui ; il commandait l’armée et certains cas judiciaires plus graves lui
étaient réservés ; il n’avait vis-vis du roi que des liens de dépendance
assez lâches. Mais en 1840, un chef, Cilesye, se révolta, assuma le
pouvoir suprême et établit une cohésion d’ensemble beaucoup plus
étroite.
A la même époque, surgissait un autre peuple venu du Sud de
l’Afrique : les Ngoni. Cinq à six d’entre eux, fuyant la tyrannie des
Zoulou, avaient quitté leur pays au début du siècle et entamé une
longue migration vers le Nord. Pour se frayer un chemin, ils durent
s’organiser militairement, non seulement par l’encadrement des
hommes en compagnies, divisées en sections, etc., et le tout sous
l’autorité d’un chef unique ; mais aussi par l’esprit combatif inculqué
aux garçons dès leur jeunesse. Peuple pasteur, la garde des troupeaux
servait en même temps de préparation à la guerre avec des exercices
de lutte et affrontement des taureaux excités. Ils semèrent la terreur
partout où ils passèrent : les populations qu’ils abordaient étaient
exterminées, dispersées ou réduites en esclaves. Les esclaves étaient
ensuite acheminés par caravanes vers les marchés de Zanzibar et
d’Udjidji à l’Est du Continent.
Les routes de caravanes disposaient, à partir du Katanga, de
la façon suivante :
- Du Katanga, l’une se dirigeait vers le centre du Nyassa
qu’elle traversa d’abord à la hauteur de la localité de Bendawé pour
se déplacer ensuite un peu vers le sud et contourner une région
nouvellement conquise par un groupe Ngoni ; cette ligne, située
approximativement sur le 13° de latitude sud, deviendra la principale
voie de passage du lac, et c’est là que se constitua l’établissement de
Kota-Kota.
- Du Katanga toujours, une autre route passait au sud du lac
Nyassa, puis divergeait en plusieurs directions : l’une rejoignait la
route précédente vers Kilwa ; d’autres rayonnaient vers le reste de la
côte portugaise, principalement au Mozambique.
A l’ouest de Tabora, une route s’ouvrait vers le Tanganyika.
Deux Swahili visitèrent Udjidji pour la première fois en 1840, et un
centre s’établit qui devait devenir le principal point d’appui du
commerce arabe sur le lac.
42
Udjidji offrait donc une situation particulièrement favorable.
Une colonie s’y développa, non qu’elle fut jamais très nombreuse en
éléments proprement arabes, cinq ou six tout au plus ; mais il fallait
compter leurs serviteurs et esclaves, et les éléments fixes ou
mouvants qu’attirait leur activité : conducteurs de caravanes,
charpentiers, forgerons, etc. ils devaient payer aux Djidji une taxe
lorsqu’ils traitaient une opération commerciale ou prenaient demeure
chez eux ; cette position d’infériorité se trouvant compensée par
l’existence d’une sorte de commission mixte qui réglait les affaires
d’intérêt général les plus importantes et faisait régner une certaine
justice.
Mais à Udjidji les affaires n’étaient jamais définitivement
réglées. Un rien relançait les palabres, et la querelle se concluait en
ce sens que tout restait comme auparavant.
A cette époque cependant, la balance penchait peu à peu du
côté des arabes au fur et à mesure que leurs entreprises prenaient de
l’extension sur le lac.
Le pays qui les attirait alors était le grand centre commercial
de Kazembe et le Katanga. Le territoire de Kazembe attirait les
trafiquants par les esclaves et l’ivoire tandis que le Katanga attirait
les mêmes trafiquants par son cuivre. D’Udjidji on pouvait s’y rendre
par deux voies différentes :
-La première voie traversait le lac Tanganyika jusqu’ à
Mtowa (au Nord de la ville de Kalemie) ou Mpala (au Sud de la ville
de Kalemie) et de là passait par l’Urua, région où la sécurité avait pu
être assurée par des chefs suffisamment puissants. Des hommes
hardis s’y engagèrent et, poursuivant leur lancée, traversèrent tout le
continent. En 1852, cinq arabes, dont deux nouvellement arrivés de
Mascate, parvinrent ainsi à Bangwela après être passés par Udjidji, le
Marungu et Kazembe où ils avaient rencontré un commerçant
portugais qu’ils accompagnèrent dans son voyage de retour vers le
Bihé. A cette même époque, la traversée transcontinentale à peu
d’années de distance par deux groupes d’arabes aurait pu signifier le
début de communications directes d’un océan à l’autre. Il n’en fut
rien cependant. Ces premiers pionniers n’eurent pas de successeurs
chez leurs compatriotes, et cette même route qu’ils avaient suivie
43
entre Udjidji et Kazembe sera interrompue et perdra toute
importance.
-Une seconde voie était possible qui permettait d’éviter la
traversée du lac : descendre le lac dans sa longueur jusqu’au sud, puis
continuer vers l’ouest. Les équipages fournis par les Djidji facilitaient
cette entreprise, qui fut expérimentée. Elle n’en restait pas moins
hasardeuse. Couper le lac d’Udjidji à Mtowa ne présentait pas de
grandes difficultés car le trajet pouvait être couvert d’une seule traite
en une trentaine d’heures, mais pour aller au sud, il fallait dix à
quinze jours en retrouvant, vu la faible capacité des canots, les
mêmes handicaps que sur le lac Victoria.
Aussi la grande voie d’accès de Tabora vers Kazembe, puis
le Katanga ne passa-t-elle pas par Udjidji, mais se dirigeait
directement vers le sud du lac qu’elle contournait et dont elle resta le
seul accès par suite de l’impossibilité d’une route directe venant de
Kilwa. Le grand carrefour commercial du centre africain allait
toutefois perdre de l’intérêt pour les arabes. Les Nyamwezi ou
Bayeke (un peuple de la Tanzanie) tenaient de fortes positions le long
de la route qui y conduisait ; et lorsqu’un de leurs compatriotes se
tailla au Katanga un pouvoir indépendant, ils concentrèrent entre
leurs mains presque tout le commerce du cuivre. Ainsi, il fallait
désormais compter avec le rigoureux monopole que Msiri (un
Nyamwezi) imposait sur celui de l’ivoire.
L’on se souviendra que, lorsqu’au 19ème
siècle,
s’ouvrit le « scramble » des Puissances en Afrique centrale, le
Katanga est encore un « désert ». En ce moment, Katanga est le nom
d’un petit village ou de son chef qui, vers 1850, donna sa fille en
mariage à un jeune chef Yeke appelé tantôt Mushidi, tantôt Msidi,
tantôt Mchiri, resté célèbre sous son dernier nom de M’siri. Aussitôt
le mariage célébré, M’siri empoisonna son beau-père, vainquit ses
beaux-frères, obtint la succession du chef Panda, détruisit les
guerriers de Kazembe sur le Luapula, conquit les Baluba dans l’Urua
et se fit prêter serment de vassalité par des populations couvrant
l’immense territoire du bassin du Congo à celui du Zambèze.
L’empire de M’siri était donc né. Très vite, M’siri se révéla
autocrate. Son règne est celui de la force. D’être roi ne lui suffit pas ;
il se proclame dieu. Son armée est puissante, redoutable, et ses
44
gouverneurs lui sont totalement soumis. Il épouse d’ailleurs une sœur
ou fille de chaque gouverneur et se constitue ainsi un harem de
femmes. De cette façon, les femmes, il en totalise bientôt 700. C’est
alors qu’il organise un commerce intense avec l’Est et l’Ouest, avec
les Portugais de la côte occidentale, avec les Arabes de la côte
orientale. Son objectif est d’obtenir avant tout des armes et de la
poudre à canon. Les esclaves sont, bien entendu, le moyen habituel
de paiement. Enfin, c’est autour de M’siri que se concrétise la rivalité
belgo-britannique dans le sud-est du Congo. Son empire entre, de ce
fait, dans l’histoire du Congo et de sa métropole.
Ainsi donc, au regard de nombreuses relations, l’histoire de
l’Afrique Orientale et Centrale, durant la seconde moitié du 19ème
siècle, est dominée, avant tout, par l’invasion arabe et européenne.
Partant de l’île de Zanzibar, cette pénétration commerciale,
scientifique, missionnaire et politique visait en premier lieu les
grands lacs : Tanganyika, Victoria et Nyassa1.
L’Ouest du lac Tanganyika, notamment le Marungu, Mpala
et Mtoa - qui n’était à l’époque, qu’un repaire des fauves, une zone
de hauts plateaux et des marais boueux - fut aussi une région de
chasse gagnée au commerce des esclaves. Les marchants d’esclaves
fréquentaient la région où les jeunes gens et jeunes filles étaient
enlevés et vendus sur les marchés d’Afrique Orientale. Les vols des
femmes et des enfants en bas âge étaient des faits journaliers dans
* Professeur à l’Université de Lubumbashi (RDC). 1 A ce sujet, voir les détails dans les publications ci-après :
- RENAULT F., Lavigerie, l’esclave africain et l’Europe 1868-1892, Tome I,
l’Afrique Centrale, Ed. E. de Boccard, Paris, 1971 ;
- HADDAD A., L’arabe et le swahili dans la République du Zaïre, Etudes
islamiques, histoire et linguistique, SEDES, Paris, 18983 ;
- KISONGA, K. et NKUKU, K., « Notes sur la traite des esclaves et ses
conséquences dans la Zone de Moba », in LIKUNDOLI, VII (1987)2, pp.127-
142.
- MWENDANABABO, M., L’impact de la pénétration arabe dans la Zone de
Fizi (1858-1900), T.F.C., UNILU, 1987.
45
cette partie du Congo où le commerce de l’ivoire marchait de pair
avec celui des esclaves2.
2. L’expansion arabe en Afrique centrale et les aspects généraux
de la pénétration.
L’expansion arabe s’est réalisée de façons fort diverses et
suivant les conditions physiques et humaines des régions différentes.
Cependant, quelques traits fondamentaux communs la caractérisaient.
Elle ne fut pas une conquête territoriale, mais plutôt l’ouverture de
grands axes lesquels, en se prolongeant, se rejoignaient et tendaient à
former un réseau. Ainsi, par exemple, de Tabora à Kazembe, les
caravanes rejoignaient assez facilement celles de Nyassa.Tippo-Tip,
par exemple, une fois arrivé dans l’Utetela par le Sud du lac
Tanganyika, n’eut qu’à pousser un peu plus au Nord pour retrouver à
Nyangwe les traitants venus d’Udjidji. Ces différentes branches
formaient elles-mêmes des lignes de départ pour l’exploitation des
pays voisins suivant les possibilités offertes3. Un ensemble
d’agglomérations s’y trouvait finalement constitué, inégalement
dense, mais aux vastes proportions.
Des centres quasi permanents de résidence s’y répartissaient
de façon tout aussi inégale, mais importants par leur influence. Les
arabes y reconstituèrent tout naturellement les conditions de vie qui
étaient les leurs dans leurs pays d’origine en y intégrant plus ou
moins la population locale, comme à Udjidji où une hiérarchie
sociale s’édifia ainsi : au sommet, les vrais arabes et les commerçants
les plus importants, ensuite la classe moyenne formée par les Djidji
et les Ngwana, enfin les esclaves qui constituaient la plus grande
partie de la population. Ces derniers se répartissaient comme à
Zanzibar en esclaves proprement domestiques et en travailleurs de
plantations. Pour les harems, on recherchait particulièrement les
2 ANTOINE N., « Notice historique sur le V.A. de Baudouinville », in LOVANIA, 8
(1945), pp. 9-32. 3 Certains pays se fermaient rigoureusement à toute pénétration, comme le Rwanda,
d’autres s’y ouvraient mais en se plaçant sur un pied d’égalité comme les Yaho ;
d’autres étaient soumis et payaient tribut comme au Congo.
46
femmes ganda et maniema en raison de leur complexion, car c’était
le personnel de « luxe » de l’intérieur. Et dans les maisons, gravitait
autour du maître tout un cercle de gens de confiance venus de la côte,
ou distingués sur place parmi les hommes achetés et donnés comme
volontaires.
L’impression d’ensemble laissée par ces centres arabes en
tenant compte des relations nouées avec les chefs locaux, est celle
d’une implantation se superposant aux structures africaines
traditionnelles et sachant en même temps s’y intégrer.
Il faut noter que la pénétration arabe ne se réalisa pas par
déplacement des masses humaines comme les populations de
Kalemie venues de l’Est , comme les migrations des Ngoni venus du
Sud ou les invasions des Cokwe venus de l’Ouest et la formation du
Royaume de Msiri avec les Yeke, qui ne constituèrent de nouvelles
positions qu’en abandonnant les précédentes. Elle ne se basa pas non
plus systématiquement sur la violence.
Bien sûr, l’usage de la force brutale chez les arabes n’a pas
manqué, mais on y trouvait une part assez large d’une certaine
autonomie et partant, d’une certaine diplomatie. En fait, les ententes
conclues avec les chefs locaux aboutissaient bien souvent à des
actions guerrières. Cependant, à considérer l’ensemble des zones
qu’ils ont pénétrées, on remarque chez les arabes une grande
souplesse dans les moyens employés. Ils ont su s’introduire dans des
régions très diverses, physiquement (la grande forêt équatoriale aussi
bien que la savane tropicale) et humainement (états puissants ou
groupes inorganisés). Ils ont fait preuve à la fois de ténacité et d’une
aisance dans l’adaptation. Il s’agissait plutôt d’un accroissement de
leur aire d’opérations et ce phénomène amorcé au début du 19ème
siècle, se poursuivait de façon active lorsque les européens vinrent
l’interrompre. En fait, les arabes n’ont pénétré en Afrique centrale
que dans un but commercial où leur influence se fit sentir
remarquablement par la création de certaines richesses, outre les
échanges commerciaux, comme nous le verrons dans la suite.
Cet aspect est caractéristique de leur présence jusqu’au
moment où la menace européenne provoquera un raidissement de
leur part. Cela ne veut pas dire cependant que leur influence se soit
limitée à ce domaine, car l’exploitation commerciale se trouvait, en
47
fait, liée à des activités de nature différente : politique, colonisatrice
et surtout religieuse où en certains cas, une action directe de
conversion était entreprise. Toutefois, les arabes n’avaient pas besoin
d’imposer leur religion. Un contact permanant et prolongé avec eux
la rendait attirante à bien d’africains comme marquant le passage à
un stade supérieur de civilisation, même s’il se limitait à quelques
pratiques extérieures. D’autant plus que cette religion était
facilement accessible puisque les arabes et les africains avaient bien
des points communs dans leur style de vie et la structure sociale.
3. La pénétration et le système d’implantation
Après la consolidation des positions des arabes sur la côte
orientale et le début de leurs incursions à l’intérieur, certaines
populations africaines entrèrent vite en contact avec eux et élargirent
leurs relations commerciales. Ce fut le cas des Bashaga et des
Bakamba au Kilimandjaro, des Nyamwezi et des Wasumba de
Tanzanie4. Les arabes se contentèrent de se rendre eux-mêmes vers
l’intérieur du continent à la recherche surtout de l’ivoire. Au début,
ils suivaient les sentiers battus par les Nyamwezi, pour se limiter à
Isanga, localité située juste au milieu du pays de Bagamoyo (côte de
l’Océan Indien) Karema (Lac Tanganyika). C’est vers 1850 qu’ils
entreprirent de fonder une colonie importante à l’endroit qui devra
s’appeler quelques années plus tard Tabora. De cette localité, partait
une route qui conduisait jusqu’au Buganda où un arabe, un certain
IBRAHIM, serait arrivé en 18445.
Une autre route partait de Tabora vers le lac Tanganyika en
passant par Udjidji et c’est celle-ci qui permettait d’atteindre le
Congo soit part la traversée du lac, soit alors par la voie passant par
le Buha, le Burundi et qui atteignait Uvira, point de transit vers le
Maniema, l’Urua et le Bubembe.6 Deux Swahili, dont les noms ne
sont pas livrés, visitèrent Udjidji pour la toute première fois en 1840,
4 KALUNGWE, M., Les Babwile du lac Moëro. Essai d’histoire politique
précoloniale, Mémoire de licence, UNAZA, L’shi, 1974, p. 61. 5 RENAULT F., Op. cit. T1, pp. 39-50. 6 MWENDANABABO, M., Op. cit., pp. 14-15.
48
alors qu’un centre important s’y établissait avec comme chef reconnu
MWENYI HERI. D’Udjidji, deux voies importantes et différentes
touchaient le Sud-est du Congo.7 La première traversait le lac
Tanganyika jusqu’à Mpala et de là passait dans l’Urua. De l’Urua, on
pouvait facilement atteindre les terres de Mwant Kazembe.
La seconde voie était lacustre avec des pirogues ou des
voiliers qui descendaient le lac dans sa longueur jusqu’au Sud ; de là,
on pouvait contourner vers l’Ouest et rejoindre les routes
commerciales de l’Urua.
Ce fut d’abord la recherche de l’ivoire qui attira les
trafiquants arabisés vers l’intérieur du continent. Par la suite, le seul
commerce de l’ivoire s’étant avéré insuffisant, il sera complété par le
trafic d’hommes. Il convient de noter que le commerce d’ivoire était
plus rentable, car celui des esclaves occasionnait tout au long du
parcours, de fortes pertes. Ceci alourdissait les conditions de trafic,
alors que l’ivoire pouvait être indéfiniment conservé. Néanmoins,
l’esclave, comme le fait ressortir RENAULT, offrait bien d’autres
avantages8. Il était un parfait moyen de transport qui pouvait porter
de lourds fardeaux, de l’intérieur du continent jusqu’à la côte. Il était
aussi une marchandise fort appréciée, car, même si son prix de vente
à la côte ne dépassait pas son prix d’achat à l’intérieur du continent,
il rapportait plus au traitant arabe ou arabisé qui l’avait utilisé au
départ comme moyen de transport et qui était sûr de l’écouler
facilement auprès des planteurs de Zanzibar. En définitive, la traite
du « bois d’ébène » était donc aussi rentable que celle de l’ivoire.
C’était là les deux denrées qu’on ne pouvait pas séparer, car elles se
complétaient selon la formule « l’esclave portant l’ivoire et l’ivoire
créant l’esclave ».
Au départ, les traitants se procuraient les esclaves grâce au
concours des populations autochtones chez lesquelles l’esclavage
existait déjà. Par la suite, la demande de cette « denrée » étant
devenue de plus en plus croissante, ils procédaient par des razzias
systématiques au cours desquelles des femmes, des hommes et
même des enfants étaient enlevés. Comme nous l’avons dit ci-haut,
7 RENAULT F., Op. cit., pp. 39-50. 8 Idem, pp. 323-324.
49
dans les régions où il y avait de l’ivoire en abondance, les traitants
recouraient au système des razzias afin d’avoir des porteurs qui
pouvaient faire arriver la marchandise vers les marchés situés à la
côte.
L’esclavage, c’est-à-dire, la possession d’êtres humains en
propriété privée, a existé en Afrique comme dans d’autres coins du
monde depuis des temps immémoriaux. A ses premiers temps, il s’est
agi d’un phénomène relativement mineur, limité, et, peut-être,
logique. Mais l’esclavage, comme trafic des muscles humains, est un
phénomène lucratif, nouveau, imaginé par l’esprit mercantiliste et
impérialiste de l’Occident. Rappelons que ce commerce allait de
l’Europe vers l’Amérique via l’Afrique. Ce qui lui a valu le nom de
« commerce triangulaire ». C’est dans ce circuit qu’est né le
commerce des esclaves noirs pratiqué à grande échelle par les arabes
et arabisés à la côte Est de l’Afrique, au centre et à travers le Sahara.
Le principe de départ était le suivant : si le coran interdit aux
musulmans de réduire en esclaves d’autres musulmans, il n’interdit
cependant pas l’esclavage ; il permet de l’imposer à ceux qui
s’opposent à la foi islamique. Ainsi, l’esclavage a-t-il toujours été
pratiqué dans les territoires pénétrés par les arabes. Notons que les
arabes et les chefs arabisés travaillaient pour leur propre compte (et
non pour celui de la religion), se livrant couramment à des razzias
dans les régions visitées et amenant en captivités les personnes qu’ils
pouvaient prendre vivantes.
Les premiers arrivés dans le Marungu furent les arabes et
arabisés appelés Wangwana. Ils venaient de Zanzibar où ils avaient
auparavant entrepris des plantations de girofliers qui exigeaient une
main-d’œuvre abondance. Ils arrivèrent vers 1845 au bord du lac
Tanganyika où ils évitèrent, au début, d’effaroucher les populations
établies sur les côtes. Ils avaient tout simplement besoin d’elles pour
la garde de leurs embarcations, de leurs dépôts des marchandises et
de leurs cargaisons d’esclaves. Ils leur remettaient, en échange du
service rendu, des articles de traite : savons, allumettes, assiettes
émaillées, étoffes, perles ou leurs imitations en faïence. C’est ainsi
50
qu’à Lubanda (Mpala), le Cheik Saïd Ben Habib et, plus tard, Djuma
Mérikani, protégèrent les chefs de la dynastie Mpala de 1869 à 18809.
4. Les rapines et le marché intérieur.
La recherche de l’ivoire et des esclaves a conduit à la
naissance des marchés intérieurs situés dans les différentes zones
gagnées au commerce arabe. L’élargissement de ces marchés a abouti
à la création des centres de négoce d’où partaient les caravanes vers
les zones de chasse ou d’échanges. Dans ces zones se trouvaient des
traitants permanents qui contrôlaient la chasse et les échanges avec
les autochtones.
Ils organisaient aussi le départ des caravanes vers la côte et
ne se transformaient pas en autorités politiques même s’ils exerçaient
une influence sur les chefs locaux devenus leurs complices.
L’autorité politique arabe ou arabisée s’est installée uniquement dans
les régions d’occupation comme le Maniema, avec Tippo-Tip, plus
tard, comme nous le verrons dans la suite, dans le Litabwa où le
même Tippo-Tip avait eu maille à partir avec le grand chef Tabwa,
Nsama, en 1867.
Les arabes avaient déjà atteint cette zone de forêt lorsqu’ils
traversèrent le lac Tanganyika, après 1840, pour s’établir dans
l’Uguha, au Nord de l’Urua ; mais ils s’étaient détournés quelques
instants après vers le Sud pour se diriger sur Kazembe, tentative qui
n’aura pas cependant fait long feu. Jusqu’alors, ils avaient parcouru
des pays de steppes ou de savanes qui offraient des possibilités
relativement aisées de déplacement, où les habitants avaient pris
l’habitude de voir les étrangers venir chez eux. La grande forêt
présentait, par contre, un tout autre milieu : maints obstacles
s’opposaient à la circulation, surtout celle des caravanes, et les
populations y vivaient dans un isolement qui ne les avait pas
préparées à accueillir de nouveaux venus. Toutefois, certains
avantages contrebalançaient ces difficultés. En effet, à travers la
forêt, le fleuve (Congo) formait une magnifique voie de passage,
9 NAGANT G., et alii, Mpala-Lubanda, la première communauté chrétienne du
diocèse de Kalemie-Kirungu (1885-1985), L’shi, 1987 et Kin, 1988.
51
pour la simple raison que les populations, faute d’avoir pu constituer
de grands Etats centralisés, étaient émiettées en groupes réduits,
lesquels le plus souvent, devaient se trouver en situation d’infériorité
vis-à-vis des traitants organisés et nombreux. Là, ces derniers
n’allaient avoir à compter avec aucune autorité locale gênante. Ils
pouvaient ainsi être des maîtres absolus, de sorte que ce fut
paradoxalement dans ce milieu tout naturellement hostile et ouvert
très tardivement qu’ils exercèrent, en définitive, l’action la plus
dévastatrice.
A l’époque, la partie Sud-ouest du la Tanganyika, qui
couvraient la presque totalité des Territoires actuels de Moba et de
Kalemie, était aussi une zone de chasse par excellence, gagnée au
commerce arabe. Les traitants arabes et arabisés fréquentaient
régulièrement cette région où les jeunes gens et jeunes filles étaient
enlevés et vendus comme esclaves sur les marchés d’Afrique
Orientale. Dans cette région, le rapt des femmes et des enfants étaient
des faits journaliers, le commerce de l’ivoire et celui des esclaves y
allant de pair.10
Stefano KAOZE, premier Prêtre congolais ordonné peu après
l’installation du pouvoir colonial (en 1917) a, dans ses nombreux
écrits, situé la pénétration arabe dans cette partie du pays et décrit le
commerce des esclaves ainsi que ses conséquences, plus
particulièrement dans le Marungu. En effet, la proximité du Marungu
de la région des populations qui se livraient au trafic à longue
distance, notamment les Nyamwezi, a joué un rôle déterminant dans
les incursions négrières sur la contrée. Les postes de Karema et de
Kirando, tous deux en face du Marungu (Moba) d’une part, et le
poste de Kigoma en face de Mtoa (Kalemie) d’autre part, déversaient
sur le lac Tanganyika, des bandes de chercheurs d’esclaves qui, à la
faveur du vent qui souffle de l’Est à l’Ouest durant le jour (le
Karema) et dans le sens inverse durant la nuit (le Lubangwe),
traversaient assez facilement le lac, razziaient le Marungu et Mtoa et
repartaient la nuit avec le butin. A Moba, les villages de Mpala (au
Nord) et de Kapampa (au Sud) respectivement en face de Karema et
10 ANTOINE N., « Notice historique sur le Vicariat Apostolique de Baudouinville »,
in LOVANIA, 8(1945), pp.9-32.
52
de Kirando, servaient de points de pénétration vers l’intérieur de la
région, car c’est ici que venaient s’entasser les navires des marchands
d’hommes avant de repartir nuitamment.
Il convient, toutefois, de remarquer que la proximité peut
avoir signifié peu de chose devant la présence au Marungu, de
denrées très recherchées à l’époque, à savoir, l’ivoire et l’esclave. Les
hordes d’éléphants n’étaient pas à rechercher. Elles fréquentaient les
cours d’eau de tout l’arrière-pays du Marungu, qui déversent les eaux
dans le lac. Ces éléphants étaient surtout nombreux dans les actuelles
collectivités de Kansabala, Kayabala et Nganie ; et les Nyamwezi,
qui fréquentaient le Marungu, se livraient tout particulièrement à la
chasse de ces herbivores.
Naturellement, les hommes n’y manquaient pas, car le
Marungu semble avoir été très peuplé à cette époque, s’il faut s’en
tenir aux déclarations de nombreux voyageurs qui ont eu à traverser
la région, tels que BECKER, LIVINGSTONE, STANLEY.11
Ces
déclarations ne peuvent cependant pas donner lieu à des estimations
qui conduiraient inutilement à des erreurs d’appréciation. Ce qu’il
faut retenir tout de même est que, à Zanzibar, on recherchait
beaucoup les gens de Marungu, parce que, disait-on, ces esclaves
étaient réputés excellents ouvriers pour les travaux des champs et très
dociles à leurs maîtres.
Aussi, dans cette singulière entreprise vers l’intérieur du
continent, les arabes bénéficiaient du concours très efficace des
« Wangwana » et des « Ruga-ruga » qui étaient leurs fidèles
collaborateurs.
Le terme « Ruga-ruga » désignait en bloc les mercenaires
recrutés pour une action armée (la chasse ou la guerre) et les brigands
occasionnels qui opéraient par groupes très réduits de quatre à cinq
individus. Le plus souvent ces mercenaires étaient des éléments
enlevés de leur milieu à la suite des guerres ou des razzias. Des
razzias, il y en avait fréquemment entre le Tanganyika et le Nyassa. Il
11 BECKER J., La vie en Afrique, T1 et T2, Ed. Lebègue, Bruxelles, 1887 ;
LIVINGSTONE D., Dernier journal, T2, Hachette, Paris, 1878 ; STANLEY, H.M.,
A travers le continent noir, T2, Hachette, Paris, 1870.
53
s‘agissait aussi des fuyards rescapés des raids des Ngoni et des
Babemba.12
Quant aux « Wangwana » - hommes civilisés, en swahili -
c’étaient d’abord des habitants de la côte qui exerçaient le commerce
à leur propre compte ou à celui des arabes. Au fil du temps, le terme
a pris l’habitude de désigner indistinctement les habitants de la côte,
les gens de l’intérieur et les esclaves qui étaient associés de plus près
aux affaires du Maître. Ils se voyaient confier la direction des
caravanes, la garde des entrepôts et la charge d’entreprises
commerciales connexes. Dans le cas des chefs remarquables comme
Tippo-Tip et Rumaliza, ce furent également ces Wangwana qui
s’occupaient du prélèvement du tribut chez les populations soumises.
Le vocable désignait anormalement aussi d’anciens esclaves
affranchis ou de petits trafiquants qui, de concert avec quelques chefs
locaux, se lançaient à leur propre profit. Ils razziaient pour la plupart
de temps, dans les contrées jugées peu propices par les grands
opérateurs.
Disons, en substance, un mot sur les personnages de Tippo-
Tip et de Rumaliza qui furent les têtes de file de ce trafic.
Hamed Ben Mohammed el-Murjebi, dit Tippo-Tip13
fut un
métis, descendant d’une famille de commerçants arabes originaires
de Mascate (Golfe Persique) établie sur la côte en face de Zanzibar.
Rajab Ben Mohammed Ben Saïd el-Murjebi, arrière-grand-père de
Tippo-Tip, est la toute première branche généalogique avec son
épouse, elle, une afro-arabe nommée Mwana-arabu (fille de l’arabe,
ce qui n’est pas à confondre avec Mwana-haramu : bâtard, non
civilisé, allusion faite aux esclaves), issue d’une africaine et d’un
arabe. Tippo-Tip serait né de l’union entre Bint Habit Ben Bushir el-
Wardi (originaire de Mascate) et Mohammed Ben Juma dont le père
12 KALUNGWE, M., Op. cit., p.63. 13 Hamed Ben Mohammed el-Murjebi avait été surnommé Tippo-Tip par les
Africains qui s’étaient enfuis à Pulungu. L’interprétation de ce surnom est aussi
diverse que sa graphie (Tippo-Tip, Tippo-Tipo, Tippu-Tipu, etc.). Selon lui-même,
son nouveau nom africain n’était qu’une onomatopée imitant le bruit des balles de
ses fusils. D’autres y voient une référence à un tic de Tippo-Tip, à savoir, un
continuel clignement des yeux.
54
Juma Ben Rajab conduisait déjà des caravanes dans la région du
Tanganyika.
Beaucoup d’auteurs ne s’accordent pas sur le lieu et la date
de naissance de Tippo-Tip. A.SMITH situe l’année de la naissance
de Tippo-Tip en 1840, alors que H. WISSMANN, E. TRIVIER et
W.H. BENTLEY le font naître en 1837.14
Par ailleurs, d’après les
dernières recherches réalisées par F. Bontinck, les déclarations du
père de Tippo-Tip et celles de Tippo-Tip lui-même coïncident sur son
âge. En effet, le premier affirme avoir voyagé avec son fils en 1858
et le second déclare avoir accompagné son père en voyage quand il
atteignit l’âge de 18 ans. Il est ainsi plus probable qu’il soit né en
1840.15
Quant au lieu de naissance, il est situé tantôt sur la côte
(Mrima) à Mbwamaji, près de Bagamoyo, tantôt à Kwarara, un
village de l’île de Zanzibar, situé près de la ville de Zanzibar.
Au Congo, le potentat s’était établi au Maniema où il
jouissait d’une certaine notoriété, non seulement sur tout le territoire
soumis à son autorité, mais encore sur toutes les peuplades des
contrées environnantes qui le savaient redoutable.
Mohammed Ben Khalfan dit Rumaliza était né près de Lindi
vers 1850 d’une famille originaire d’Oman. L’ordre « Maliza »
(achève !) qu’il donnait en toutes occasions : expéditions guerrières,
soumission des chefs vaincus, etc., lui fit gagner son surnom de
Rumaliza, celui qui achève.16
A partir d’Udjidji où il s’était installé,
il assura et étendit son pouvoir. Dans ce qui devint en pratique sa
capitale, les habitants durent lui payer tribut, système normal d’une
évolution qui tendait à renverser les rapports entre les arabes et les
anciens monarques du pays. Mais cet autre potentat ne résidait
qu’assez périodiquement dans ce qu’il conviendrait d’appeler son
fief. Il passait la bonne partie de son temps en inspection dans ses
domaines d’outre-lac, conduisant des expéditions lointaines,
notamment dans ses possessions d’Ubwari et de Masanze. Dans ces
14 BONTINCK F., L’autobiographie de Hamed Ben Mohammed el-Murjebi, Tippo-
Tip (Ca 1840-1900), ARSOM, Bruxelles, 1974, p. 49. 15 Ibidem 16 Idem, p. 223.
55
régions, il s’adonnait à diverses activités, essentiellement les
exigences de livraisons d’ivoire de la part des chefs, les réquisitions
pour des corvées diverses au service des Wangwana, et lorsque les
hommes optaient pour la fuite, femmes, enfants, jeunes et vieux
étaient saisis et détenus jusqu’à ce qu’ils revinssent.
Notons qu’avant 1840, les razzias étaient l’œuvre sporadique
des ressortissants Sumbwa et Nyamwezi ; c’est vers 1867 surtout
qu’on remarque la présence de Tippo-Tip dans la région suite à son
éclatante victoire sur le grand chef tabwa Nsama dont nous avons
parlé au début.
Après 1880, le Marungu était devenu un champ de
concurrence intense entre négriers, car Tippo-Tip cessait d’être le
seul maître sur terrain. Cette intensification était sans doute
consécutive aux ambitions d’autres trafiquants, notamment un certain
Juma Ben Salen, dit Mérikani, à cause, certainement de la cotonnade
américaine qu’il trafiquait souvent et, surtout, Rumaliza qui cherchait
à monopoliser les régions riveraines du lac Tanganyika, après avoir
envahi toute la région de Rubembe, où il opérait à partir d’Udjidji.
Les Wangwana à son service descendaient le long du lac Tanganyika,
à la recherche non seulement de l’ivoire, mais aussi des esclaves.
C’étaient surtout les hommes achetés par ce groupe qui étaient
acheminés dans les ports de d’Ubwari et de Baraka, avant d’être
conduits à Udjidji où Mohammed Ben Khalfan, dit Rumaliza,
s’occupait lui-même de la commercialisation.
Dans la suite, en 1881, Matimula, qui s’était réfugié au
Marungu refoulé par Mirambo à l’Est du lac, s’était avéré grand
chasseur d’éléphants dans la région où il disposait d’une troupe
armée de centaines de fusils. Il resta huit ans dans la région, exerçant
sans la moindre inquiétude, son métier : la chasse à l’éléphant et aux
hommes pour le transport de l’ivoire. Enfin, les hommes au service
de Mwenyi Heri (un potentat d’Udjidji), les traitants de Karema et de
Kirando, ainsi que les autochtones eux-mêmes, pratiquaient les
razzias hors de leurs contrées.
Le reste des habitants allaient se cacher dans la forêt afin de
se soustraire aux exactions dont ils étaient victimes de la part de leurs
propres frères et de leurs partenaires arabisés. Les évaluations en
proportions présentées par les voyageurs situent entre 5 et 10 le
56
nombre des vies humaines supprimées pour un esclave parvenu à
destination.
5. L’exportation des esclaves
L’esclave ayant été un objet d’achat et de vente, la
connaissance précise de ce trafic aurait exigé, semble-t-il, les mêmes
éléments de base que toute étude commerciale : des relevés
suffisamment complets des prix et du « volume » des échanges. En
ce qui concerne les prix, les renseignements que nous pouvons
recueillir de différentes sources sont très dispersés et leur utilisation
assez délicate. Sur la côte, avaient cours légal, les monnaies de type
européen, mais leur convertibilité n’était pas toujours sûre. A
l’intérieur du continent, l’incertitude était encore beaucoup plus
grande.
Cependant, ce qui est utile pour notre étude, c’est de dégager
sommairement sans doute, le « profit » tiré de ce commerce. Le
Consul britannique à Zanzibar, Monsieur ELTON, affirme que sur la
côte portugaise, il rapportait 300 à 400%, alors que le commerce
légitime ne fournissait qu’un profit de 25 ou 30% au plus, quoique
les statistiques fassent défaut pour corroborer cette affirmation.17
Sur
la côte zanzibarite par contre, des comparaisons chiffrées ont été
faites par rapport à l’intérieur du continent. Le capitaine COLOMB,
se basant sur le témoignage fait au Select Commitee de 1871,
établissait le calcul ci-après : un enfant pouvait être acheté au centre
de l’Afrique à dix pence (= 1 franc). Les pertes des caravanes, la
nourriture, la douane, etc., faisaient monter le prix de revient à
Zanzibar à 7 dollars,auxquels il fallait ajouter 5 dollars
d’amortissement pour l’équipement de la caravane et le travail fourni,
soit 12 dollars en tout. Or cet esclave était vendu 20 dollars (=110
francs). Ce qui laissait un bénéfice considérable.18
17 Rapport de Mr ELTON au Foreign Office, 5 janvier 1876, F.O. 514/42-46/1876, p.
140 18 COLOMB (capit.), Slave-catching in the Indian Ocean, Londres, 1873, p. 55.
57
Par ailleurs, le prix d’achat parait excessivement bas. Le
Consul RIBBY, vers 1860, l’estimait à 1,5 dollar, soit 2,75 francs19
,
et le capitaine GUILLAIN en 1848 donnait le chiffre de 5 à 7 piatris,
soit, 25 à 35 francs.20
Même en tenant compte de la baisse des prix à partir de
1860, la différence d’appréciation est très forte et on ne peut que la
constater car ces esclaves étaient achetés dans l’intérieur de
l’Afrique centrale, termes trop vagues cependant, puisque ne tenant
pas compte de la diversité des régions et de leur éloignement de la
côte. En outre, le prix de vente à Zanzibar semble exagéré. Présenté
comme moyenne, il n’était, en réalité, qu’un maximum atteint
rarement.
Au contraire, LIVINGSTONE qui parcourait les régions de
Nyassa où la traite d’esclaves était la plus active, affirmait que le
profit était faible pour les trafiquants. Malheureusement, dans ses
écrits, s’il indique 7 $ (soit 38 francs) comme prix d’un enfant à
Zanzibar, en 1866, il ne fournit aucun point de comparaison avec
l’intérieur.21
Pour le trouver, il faut s’étendre sur la période durant
laquelle les Européens résidant en diverses régions ussent donner des
renseignements chiffrés. Leur apparente précision ne doit cependant
pas nous tromper, car ils paraissent plus aléatoires qu’à Zanzibar.
Lorsqu’il s’agissait, en effet, d’esclaves rachetés par les
missionnaires, ou proposés par les arabes, ceux-ci devaient les coter
plus chers, car les Européens passaient facilement en Afrique, et il est
vrai, pour des gens d’une richesse à peu-près inépuisable. C’est ainsi
qu’à Kilwa, des esclaves qui valaient 5 $ étaient facilement vendus
30 ou 40 $ aux Français de l’Ile de la Réunion qui les achetaient
comme « libres engagés ».
Une autre source de difficulté se trouve dans la pratique du
troc. Beaucoup de prix sont exprimés en « doti », pièce d’étoffe, dont
la valeur variait suivant la qualité (qui n’est malheureusement pas
19 RUSSELL C., General Ribby, Zanzibar and the slave trade, Londres, 1860, p. 131. 20 GUILLAIN H., Documents sur l’histoire, la géographie et le commerce de
l’Afrique Orientale, 2ème partie, TII, 1848, p.305. 21 LIVINGSTONE D., The last Journals of David Livingstone in Central Africa,
from 1805 to his death, continued by Horace, Vol. I, Londres, 1872, p. 107.
58
souvent indiquée) et suivant le lieu : de plus en plus cher à mesure
que l’on s’éloignait de la côte, le « doti » valait en moyenne 2,5 à 3
francs à Tabora, 4 francs au Sud du Victoria-Nyassa et 5 francs sur le
Tanganyika, mais une interruption dans les arrivages pouvait
facilement doubler ces chiffres.
Les trafiquants, en parcourant les régions, se livraient aux
pillages, lesquels étaient facilités par les rivalités claniques. Durant
leurs nombreux voyages, ils éprouvaient la nécessité d’augmenter
leurs marchandises et par conséquent, grossir leurs colonnes de
porteurs. Les rapts d’hommes s’accompagnaient donc de tueries,
d’incendies des villages et de destructions des plantations. Par leurs
conséquences néfastes, ces violences affectèrent très profondément
les sociétés de l’Est de la République Démocratique du Congo.
6. Les Conséquences de la traite des esclaves
Le récit de Stefano KAOZE circonscrit les conséquences de
l’époque arabe qu’il considère comme étant celle qui a le plus
apporté malheur et désolation au sein de la population congolaise.
Pour lui, loin de se limiter au seul commerce de l’ivoire, les arabes et
leurs auxiliaires s’étaient livrés au trafic honteux des hommes, et leur
présence a, à coup sûr, accentué la dépopulation de tout l’Est du
pays, à la suite des maladies et autres épidémies qu’ils avaient
ramenées de la côte; et ce sans compter les nombreux sévices dont
les populations ont été victimes.
Parler des conséquences des rapines négrières revient, tout
naturellement, à analyser le commerce des esclaves lui-même, en
envisageant les retombées de toutes les considérations quantitatives
et qualitatives de la traite des esclaves dans la région, dans tous les
aspects : politique, démographique, économique, culturel et social.
Les conséquences politiques
Les rapines négrières ont eu, pour effet direct, le
morcellement du pouvoir politique caractérisé par l’ébranlement des
chefferies. En effet, dans cette partie du pays, l’organisation politique
59
fut dominée, à l’époque, par le système clanique. Un clan formait une
entité socio-politique. Il était composé d’une constellation de familles
étendues regroupées par la suite en lignages. La participation au
pouvoir hiérarchisait ces subdivisions. A la tête du clan se plaçait un
chef de la famille traditionnellement dirigeante.
Non seulement chaque clan possédait son terroir, mais aussi,
au sein du clan, chaque groupement avait son lopin de terre. Le
caractère politique d’un clan ou des chefs n’était reconnu qu’en
fonction de la mainmise qu’ils détenaient sur leurs territoires. Cette
équation entre le pouvoir politique et le contrôle d’une terre sous-
tendait toutes les réactions politiques qui s’en étaient suivies.
A l’arrivée des Arabes donc, les rivalités claniques mêlées à
leurs menées ébranlèrent trop fortement les structures traditionnelles,
avec comme résultat majeur la scission des clans et des chefferies.
L’emplacement géographique de ces dernières, aide à
comprendre aisément cette situation. Le clan des Tusanga s’étendait
du Sud du mont Murumbi(Luilingilingi) au bassin de la Lukuga. Le
chef Tumbwe Kisompo22
gouvernait le Nord. Le chef Kansabala et le
chef Mwindi se partageaient le centre. Le clan Bazimba habitait
traditionnellement la région méridionale du territoire de Moba. Et les
chefs de la dynastie Nsama détenaient le pouvoir. Il existait par
ailleurs des enclaves du clan Bazimba sur le territoire du clan des
Tusanga.
Le clan des Baanza dominait la bordure occidentale du
Territoire de Moba. D’autres groupuscules à dimensions diverses du
reste des clans tels que les clans des Tumanya, des Bakwa-Kyomba,
des Bena-Mumba étaient disséminés à travers le Territoire.
Vers 1880, deux clans étaient en pleine lutte : le clan des
Bazimba et le clan des Tusanga. La position géographique enclavée
du clan des Bazimba centraux constituait un facteur qui incitait ces
derniers à l’expansion. Le clan des Bazimba qui dominait déjà le Sud
avait juré de soumettre tout le territoire depuis le Tanganyika
jusqu’aux frontières de l’Urua. Ses guerriers avaient parcouru tout le
22 Pour SCHMITZ, H., il s’agit de TUMBWE KITALA, cfr les Baholoholo, Ed.
Dewit, Bruxelles, 1912, p. 551 ; pour VERHULPEN, E., de KAYA TEMPE, cfr
Baluba et Balubaïsés du Katanga, Anvers, 1936, Annexe II.
60
Marungu.
23 Les raids de cette entité étaient entretenus par les chefs
du clan des Tusanga tels Mazonde et Lusinga, après de violentes
batailles. Mais les Arabes donnèrent une autre tournure aux
conquêtes du clan des Bazimba qui, forts de l’aide de ce Arabes,
menèrent des campagnes plus victorieuses qu’auparavant.
Les rivalités claniques entremêlées des razzias et de
chercheurs d’esclaves entraînèrent la désintégration des forces dans
tous les clans. Le chef Tumbwe du clan des Tusanga ne parvenait
plus à garder l’unité politique de ses administrés. Et lorsqu’au Nord,
il luttait contre les traitants arabisés, ses subalternes Kaengele et
Kalonda collaboraient avec eux. Au Sud l’autonomie Tabwa avait été
brisée depuis 1867 par Tippo-Tip.
Par ailleurs, appuyés par les Arabes et à la faveur du
morcellement politique, une génération des chefs sans assises
politiques apparut. Cependant ces chefs, de véritables trafiquants, ne
cherchaient qu’à profiter des troubles pour mener leurs activités
commerciales. Ils disparaissaient aussitôt enrichis.
Les clans et, partant, les chefferies, se scindèrent. Une partie
du clan des Baanza a su garder son autonomie politique et a
constitué la base d’une circonscription cohérente de la famille
Mitenge. Mais les Nganie, chefs luba, s’ingéniaient toujours à ravir le
pouvoir aux chefs du clan des Baanza les plus rapprochés d’eux. En
même temps, dans le clan des Bazimba, les uns refusaient de
reconnaître l’autorité des chefs d’origine étrangère. La lutte se
poursuivait. Les autres s’étaient placés sous la protection des chefs de
lignage. Ces derniers, tel que Katele, soutenus par les Wangwana et
les Ruga-Ruga, se croyaient assez puissants pour s’imposer en
maîtres dans la région. Le clan des Tusanga se scindait également.
L’expansion des lanières territoriales du clan des Bazimba l’avait
divisé géographiquement. Ses membres se rassemblèrent en
communauté sous l’égide des chefs qui s’étaient distingués dans des
luttes hégémoniques, tels que Mazonde et Mwindi. En résumé, à tous
les niveaux des clans, le pouvoir se morcelait.
23 ROELENS, V., (Mgr), Notre vieux Congo 1891-1917, T1, Ed. Grands Lacs,
Namur, 1948, p.148
61
Les conséquences démographiques
La traite a considérablement décimé la population au
Tanganyika. On estime qu’à cette époque, 30 à 35 mille vies
humaines au moins étaient sacrifiées annuellement dans cette région.
Le Tanganyika à lui seul perdait ainsi des milliers d’hommes valides,
car, les négriers, comme on le sait, triaient leurs captures. Comme
nous l’avons dit, ne chose demeure certaine : à Zanzibar, on
recherchait beaucoup les gens du Tanganyika, parce que ces esclaves,
disait-on, étaient réputés meilleurs ouvriers des champs et plus
soumis à leurs maîtres. Alors qu’au Maniema on recherchait surtout
les femmes pour leur complexion. Au demeurant, les considérations
qualitatives et quantitatives étant faites, le reste de la population (les
vieillards et les enfants) ne pouvaient donner dans l’immédiat le
meilleur rendement quant à la reproduction des espèces humaines.
Une autre raison découle de l’emplacement géographique du
Royaume de Kazembe. Ce Royaume, grand centre commercial à
l’époque, se situait à cheval sur le Luapula. De l’Afrique Orientale,
deux possibilités d’accès se présentaient. Le contour par le Sud du lac
Tanganyika, traversant ainsi la région de Marungu. Ou bien, encore,
après avoir traversé le lac, à la hauteur de Mtowa, l’on partait vers le
Royaume de Kazembe, en empruntant la direction Sud-ouest.
Les trafiquants, en traversant les régions, se livraient aux
pillages. Durant leurs multiples va-et vient, ils éprouvaient le besoin
de renforcer leurs marchandises humaines ou de grossir le nombre de
leurs porteurs. Les rapts d’hommes eux-mêmes s’accompagnaient de
tueries et d’incendies de villages, ainsi que de destructions méchantes
des plantations.
Ainsi donc, dans cette région du Tanganyika, où les Arabes
et Arabisés constituaient une force considérable d’occupation, leur
présence a contribué à la régression démographique notamment avec
la traite des esclaves et ses corollaires, étant donné que la traite dans
cette région était suivie par un cortège de fléaux tels que les maladies
diarrhéiques, les maladies vénériennes, la trypanosomiase, les lésions
causées par les chiques, la famine, etc.
Tippo-Tip, dans son autobiographie, raconte que lors de son
premier voyage à Ugogo, lui et sa suite, avaient été attient par le
62
choléra. En somme, ils étaient atteints par une épidémie qu’il appelle
« maradhi ya tauni ». En swahili « maradhi » signifiant maladie et
« tauni » la peste. Il s’agit tout simplement ici de l’épidémie de
choléra. En effet, l’épidémie s’était déclarée à Zanzibar déjà en
novembre 1869 ; elle y sévit jusqu’en 1870 faisant 25 à 30.000
victimes pour faire son apparition quelques mois après sur le
continent24
.
En outre, comme tout transport se faisait à cette époque-là
par dos d’hommes, le porteur atteint de trypanosomiase portait avec
lui la maladie que la mouche tsé-tsé se chargeait d’inoculer aux
autres habitants le long des parcours. Un grand nombre de ces
trypanosés furent atteints de folie et on se vit réduit à lier ces
malheureux qui, plus d’une fois, réussissaient à mettre du feu aux
hangars et à s’y brûler tous vivants. Les agonisants au dernier stade
tombèrent quasi en décomposition avant la mort. Pour comble de
malheur, les enfants furent également atteints et les femmes
n’avaient plus le courage de soigner leur cuisine25
.
En définitive, de toutes les causes qui provoquèrent la
dépopulation en Afrique centrale, singulièrement au Tanganyika, il
est inadmissible de chercher à isoler la traite, car le commerce des
esclaves faisait partie d’un système social et commercial lequel, bien
que bénéfique dans certaines régions, s’est transformé en véritable
fléau dans d’autres. L’esclavage, principalement sous sa forme de
traite, aura constitué un élément puissant de destruction et de
tarissement des vies humaines. Tout rapport entre le nombre
d’esclaves vendus et les pertes en vies humaines s’avère, dans
beaucoup de cas, aléatoire. Le fait n’en reste pas moins que les
méthodes employées par les Arabes et Arabisés ont indubitablement
provoqué une dépopulation en Afrique, et spécialement au Congo où
leur action pouvait s’exercer sans contrainte.
24 VERSTRAETEN, L, « Le demi - siècle de Mpala », in Grand Lacs, (1935), pp
9-12. 25 Idem
63
Les conséquences économiques
Outre les échanges commerciaux, l’influence des Arabes se
fit sentir dans le domaine économique par la création des certaines
richesses. Partout où les Arabes se sont établis, des changements
notables furent constatés. Il y eu au Tanganyika, principalement dans
le Marungu, une amélioration de l’élevage et de l’agriculture,
l’introduction d’un bétail de race plus perfectionnée et de quelques
légumes et arbres fruitiers jadis inconnus dans la région. Les terres
laissées en friche pendant plusieurs années, furent mises en valeur et
des plantations introduites développées : caféier, manguier, papayer,
citronnier, oranger, grenadier, mandarinier, ainsi que la culture du riz,
des légumes, sésame, safran, du tabac ; certaines techniques furent
enseignées : soit d’ordre agricole comme l’irrigation méthodique et le
drainage des fonds humides, soit d’ordre artisanal comme la
fabrication du savon, le tissage des nattes employées comme tapis et
lits, le montage des couteaux à poignée d’ivoire , la fabrication des
fusils. Les Arabes apprirent aux autochtones à construire des
habitations de forme rectangulaire avec toits à quatre versants. Et,
pour prévenir la variole, ils prenaient des précautions par la
vaccination des populations en leur inoculant de la matière prélevée
sur un varioleux, technique que les missionnaires vont généraliser
dans tout le Vicariat apostolique de Baudouinville, quelques années
plus tard, après leur arrivée.
Il faut noter que tout ceci n’était évidemment conçu que pour
le service des centres arabes et l’idée n’existait pas de répandre ces
techniques chez les populations africaines pour améliorer leurs
conditions de vie, conséquence de ce qui a déjà été constaté : les
établissements créés par Arabes étaient des centres d’exploitation et
non d’administration. Toutefois, nous devons reconnaître que les
Africains avaient sous leurs yeux des apports techniques qu’ils
auraient pu adapter pour eux-mêmes s’ils s’y intéressaient.
Malheureusement, dans beaucoup de contrées, les populations
demeuraient indifférentes aux innovations apportées, et il en fut ainsi
dans la plupart des régions du pays.
64
Tout naturellement, une économie repose notamment sur la
force de la population. L’affaiblissement de celle-ci entraîne un
déséquilibre économique fondamental. A cette réalité, le Tanganyika
n’a pas fait exception. En examinant de plus près la vie économique
durant ces chambardements, nous arrivons à distinguer deux formes
d’économie, toutes deux ayant résulté du déséquilibre qui s’était
créé : l’économie de la rive et celle de l’arrière-pays.
En fait, les négriers avaient intérêt à disposer de solides
points d’appui pour pouvoir mener la chasse à l’homme et résister
ainsi aux concurrences de toutes parts. Ils aménagèrent, de ce fait,
quelque relation avec les autochtones. Il s’est agi surtout des chefs
riverains du lac qui collaboraient avec les traitants arabisés. Leurs
sujets, jouissant d’une paix relative, exploitaient intensivement les
lopins de terre. Ils se regroupaient de préférence autour des
embouchures des cours d’eau importants. Les villages s’y
développaient à la suite de la concentration des habitants fuyant les
contrées exposées aux razzias. C’est justement ces endroits qui, de
prime abord, retiendront l’attention des Agents de l’Association
Internationale Africaine (A.I.A.) dès leur arrivée et c’est aussi là que
naîtront les premiers postes.
STORMS qui, à cette époque, visita le village de Mpala (à
l’embouchure de la Lufuko) n’a pas retenu sa satisfaction d’atteindre
un centre aussi populeux où l’on pouvait facilement trouver à se
nourrir, comme le confirment certains de nos informateurs interrogés.
Les cultures du maïs, de l’arachide, du riz et de la patate douce y
fleurissaient, importées par les Arabes. Il parle également de
nombreuses améliorations introduites dans la région par les Swahili :
apport d’objets tels que les perles, les armes à feu, les assiettes en fer
émaillées ; introduction de la culture du coton, de l’élevage des
bovins, apprentissage d’une certaine façon de tuer les poules en leur
coupant le cou au lieu de les étrangler comme on le faisait autrefois.
Dans cette économie riveraine du lac, le commerce était
caractérisé par de nouvelles tractations d’échanges, car l’homme,
l’ivoire, le fusil et le tissu composaient désormais les articles du
trafic. Il se passait le jeu capitaliste de vendre pour acheter et
d’acheter pour vendre, mené par de fins traitants. Ces spéculations
supplantaient ainsi le troc traditionnel. Ce dernier était, en plus,
65
entamé du fait de la ruine des relations entre la rive et les régions
intérieures. Celles-ci étaient devenues pour les gens du lac un champ
de rapts où la force musculaire procurait les articles exigés.
Ainsi, la région du Tanganyika, à partir des bases lacustres,
était amenée à participer à une activité commerciale depuis
longtemps internationale. La tentation de nouvelles marchandises de
l’Afrique Orientale : étoffes, perles, fusils d’un côté ; réservoirs
d’hommes, d’ivoires de l’hinterland de l’autre, poussaient les centres
lacustres à se livrer à ce commerce.
Alors que la bande riveraine connaissait cette prospérité
relative, l’arrière-pays était le théâtre des razzias de plus en plus
violentes et des malheurs. En effet, vivant toujours dans une crainte
perpétuelle de nouvelles incursions esclavagistes, les populations de
l’hinterland ne pouvaient plus s’adonner, comme il se devait, à leurs
occupations quotidiennes. En outre, utilisant un outillage
rudimentaire, ils ne pouvaient que labourer de petites surfaces juste
assez pour la survie de la famille. Il en est résulté un délaissement
total des cultures de subsistance, de l’élevage, et un abandon forcé de
l’entretien des cases. D’où, la famine et la maladie ravageaient cet
espace.
« Le pauvre sauvage(…) maltraité, abattu(…) ne cultivait
plus, ne forgeait plus, ne faisait plus rien, c’est alors qu’il y eut
beaucoup d’émigrations. Des milliers et des milliers d’hommes
moururent. Des pays entiers perdirent leurs habitants », décrit
l’Abbé Kaoze26
.
Les survivants, chassés de leurs sources vivrières,
s’imposaient une forme d’économie dictée par les circonstances.
Concentrés dans des vallées fertiles (appelées « Munana »), ils y
développaient des plantations assez prospères. La pratique de la
jachère ayant été délaissée, ils labouraient alors le sol qui était
fréquemment disposé à recevoir la succession des cultures, étant
donné que dans ces vallées, les caprices des saisons n’avaient pas
d’emprise sur la production, le sol étant constamment irrigué par les
eaux des rivières. Seulement, il fallait opérer le choix des plantes qui
26 KAOZE, S., cité par NAGANT, G., Famille, histoire, religion chez les Tumbwe
du Zaïre, Thèse de doctorat, Sorbonne, 1976, p. 5
66
convenaient le mieux à une terre constamment humide. Les céréales,
importées par les négriers, étaient mieux indiqués. C’est ainsi que le
sorgho (masaka) et le maïs (visaka) dominaient les plantations. L’on
y cultivait également les légumes tels que le haricot, le « nsepa »
(une autre variété de haricot), ainsi qu’une légumineuse propre à la
région, appelée le « kinoë ».
La chasse aux rats des roseaux complétait l’essentiel de
l’alimentation. En fait, l’hinterland vivait dans une économie fermée.
Le commerce traditionnel avec les tribus voisines était rompu. Des
communautés assez compactes parsemaient la région. De cette façon,
aux activités commerciales intenses le long du lac, s’opposait une vie
quasiment spartiate de l’arrière-pays. Un pouvoir politique morcelé,
une économie totalement ébranlée par les rapines négrières, eurent
des répercussions très sérieuses sur la vie culturelle dans toute la
région.
Les conséquences culturelles
Sur le plan strictement culturel, les autochtones qui vivaient
avec les Arabisés, furent influencés par ces derniers. C’est ainsi que
le modèle du mariage polygamique s’accentua davantage, surtout
parmi les chefs et les notables, et l’on vit se généraliser aussi dans la
région, des mariages précoces (entre 13 et 18 ans). En effet, les
autochtones empruntèrent plus d’un élément culturel de leurs hôtes.
Et par simple jeu de comparaison, ces partisans de la civilisation des
dominateurs, crurent posséder la culture la plus fine. Ils crurent aussi
maîtriser la technique la plus développée pour subjuguer leurs
compatriotes. Ils furent portes à vouloir devenir, ou tout au moins à
se faire passer pour les « Wangwana » ou « hommes civilisés », de
quelque manière que ce soit. Kaoze, parlant de la période arabe au
Tanganyika, décrit cette situation comme suit : « …Alors, les idées
sont changées, les jeunes sont frappés par les étoffes. Partout, on
tend à devenir Mungwana ; homme des Arabes. Le sauvage est
méprisé, il n’est qu’un chien, Kafiri, homme sans religion »27
.
27 KAOZE, S., cité par NAGANT, G., Op. cit. , p. 51
67
Une constatation du même genre peut être faite dans les
domaines religieux, linguistique et rituel, car au Tanganyika en effet,
les populations empruntèrent, en plus de l’habillement, la religion
(l’Islam), la langue swahili et les rites de la circoncision, la
circoncision elle-même ayant été pratiquée depuis longtemps. Les
jeunes, particulièrement, étaient circoncis, sans doute pour les
intégrer totalement à la famille du maître, et dans l’intérieur du
continent, on imposait parfois le même rite à des esclaves
nouvellement razziés.
Jusqu’à ce jour, à Moba, à Kalemie et à Kongolo, non
seulement les personnes, mais aussi les avenues principales et les
quartiers les plus populaires continuent à porter les noms d’origine
swahili ou arabe, tels que Regeza Mwendo, Mwenyi Mvua, Mwenyi
Kambi, Bwana Pio. Et pour les noms des personnes : Mawazo,
Mwamini, Sinandugu, Songa Mbele, Alfani, Rajabu, Baruti, Bushiri
(Bushir) Muke Mwendo, Mukeina, Mwenda Mbali, Mutoka Mbali,
Mwenda Karibu, Kazi Mbaya, Bahati, Ramazani, Mukosa Mali,
Baruti, Balimwacha, Machozi, Neema, Rehema, Aliki Mali,
Bulimwengu, etc.
A ce sujet, on notera que le domaine le plus touché par la
culture arabe, c’est sans nul doute celui de l’éducation par les
proverbes. Ces derniers ont tellement été usités que pour le moment
toutes les pirogues et les embarcations portent les appellations sous
forme des proverbes tels que « Mtenda Mema kaliwa », « Dunia »,
« Ogopa Mungu », « Kiburi si Ungwana », etc.
Cependant, les Arabes n’avaient pas tellement besoin
d’imposer leur religion. Un contact prolongé avec eux la rendait
attirante pour bien d’Africains, comme marquant le passage à un
stade supérieur de civilisation même s’il se limitait à quelques
pratiques extérieures ; et stade assez accessible, puisqu’ils avaient
bien des points communs dans le style de vie et la structure sociale.
En fait, l’Islam a atteint les régions côtières d’Afrique
Orientale, dès le VIIème siècle, par l’intermédiaire des commerçants
Arabes et persans. Mais, c’est au XIXème siècle que démarre
véritablement l’expansion vers l’intérieur, en suivant les pistes
esclavagistes :
- au Sud : de Dar-Es-Salaam à Udjidji via Tabora ;
68
- au Nord : de Mombassa à Kampala via Nairobi.
De ces contacts naîtra une langue mixte afro-asiatique : le
Swahili (dérivé du mot arabe « Sahil » ou « Dahel », c’est-à-dire : la
côte, le rivage : le Swahili veut donc dire, la « langue de la côte », du
« littoral »). Cette langue, devenue la « lingua franca » ou langue
véhiculaire de l’Afrique Orientale et Centrale, est incontestablement
la langue africaine la plus répandue et l’une des langues les plus
étudiées au monde28
.
Disons enfin que les Arabes et Arabisés ne s’étant pas
totalement mêlés de la politique strictement interne des chefferies,
leurs actions s‘étant limitées à se servir de certaines rivalités entre ces
dernières pour occasionner des razzias, ils n’eurent guère une
influence totale dans le domaine religieux. Le chef Tumbwe, par
exemple, conserva son « Mupasi » (le Mpungwe) devant sa résidence
et les habitants continuèrent comme par le passé, à pratiquer leur
culte communautaire aux « Esprits » de la région (les Ngulu).
En definitive, la présence des Arabes et Arabisés dans le
Tanganyika eut de graves et inquiétantes répercussions sur la vie
sociale des populations.
Les conséquences sociales
Les nombreuses défaites devant les esclavagiste, les crimes
incessants ainsi que les multiples surprises d’agression de ces
derniers semèrent un climat continuel de peur, de méfiance et
d’insécurité. Les jeunes de leur côté s’habituaient à perpétrer les
actes des violences sur leurs compatriotes, à l’instar des Wangwana.
Il leur suffisait de se rendre dans une contrée où ils n’étaient pas
connus pour se proclamer Wangwana et se comporter en
conséquence. Les familles traquées perdirent confiance en elles-
28 Il faut noter aussi que l’implantation des Asiatiques dans l’Est africain déclencha
un brassage des populations et des races. La nouvelle race issue de ce métissage
(bantou-arabes-indiens) fut appelée « Banians ». les Arabes appelèrent « Zandj » ou
« Zendj » (c’est-à-dire nègres), les Bantou qui s’installèrent le long de la côte
orientale, et le nom actuel de l’île de Zanzibar ne signifie rien d’autre que « Plage »
ou « Pays des Noirs ».
69
mêmes et offrirent très peu de résistance aux pillages. C’est alors que
l’esclavage domestique, qui existait déjà, prit des proportions
abusives. Qu’on se hasardât dans un terrain étranger, qu’on s’égarât
ou qu’on pratiquât le « lwinzo »29
, l’on se retrouvait directement
menotté.
En février 1892, à Mpala, lorsque les petits esclaves
arrivaient de tous côtés pour être rachetés par les Pères Blancs,
Monseigneur ROELENS leur demandait pourquoi ils étaient
esclaves ; ces derniers disaient ceci, à tour de rôle :
- « Mon père et ma mère étaient esclaves, et moi aussi !».
D’autres répondaient :
- « J’ai été pris à la guerre, ou j’ai été volé dans les champs ».
L’un d’eux disait :
- « J’ai été fait esclave parce que mon père avait perdu
l’aiguille d’un arabe dont il portait les bagages ».
Un autre :
- « Accusé de sorcellerie, mon père a été tué. Nous, ses
enfants, avons été vendus et dispersés ».
Il en était un qui avait été vendu pour payer le pari de son
frère qui s’était engagé à briser un œuf en le pressant entre ses mains
et n’y avait pas réussi30
.
Cette perversion des coutumes était due aussi et surtout à
l’accroissement de l’importance de l’homme comme donnée
commerciale, philosophie en vigueur à l’époque et dont
paradoxalement l’Africain lui-même n’a pas pu se départir. Un grand
nombre d’esclaves traduisait la richesse du Maître. Ce dernier était
alors en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres obligations, en
offrant, d’après le nombre exigé, ses esclaves.
Il faut ajouter, naturellement, à tout ceci, les fléaux de la
nature, comme le souligne l’Abbé Kaoze, pour saisir l’ampleur des
conséquences sociales des rapines négrières au Tanganyika :
« …le pauvre sauvage est maltraité, il est battu…, ajoutons à
son malheur des fléaux immenses : la petite vérole, une diarrhée
29 « Lwinzo » ou « lupulo » = le fait de rendre visite à quelqu’un avec l’intention
manifeste et inavouée de profiter de ses repas. 30 ROELENS, V. (Mgr), Notre Vieux Congo (1891-1917), p. 22
70
inguérissable qui dura deux ans, les funza, puces et tiques, syphilis,
mais pas du tout vénérien, tout cela suivi d’une famine qui dura trois
ans (1890-1893). Dans tout cela, le pauvre sauvage se retrouva
complètement sans courage »31
.
Conclusion
Que faut-il retenir en définitive, de la traite des esclaves ?
Il paraît donc évident que le mot « traite » recouvre en
Afrique quatre réalités différentes : à savoir, l’esclavage africain
traditionnel, la traite orientale, la traite européenne, le trafic des
marchands arabes. Ces derniers se sont africanisés physiquement et
les Africains se sont arabisés culturellement. Ce brassage a créé un
peuple de métissage avec des cultures nouvelles, des institutions
nouvelles, des langues nouvelles.
Etant connu et pratiqué en Afrique, même avant l’arrivée des
Arabes, l’esclavage a pris, l’arrivée de ceux-ci, un caractère intensif
et joué surtout un rôle très remarquable, et dans la prospérité
commerciale, et dans l’émancipation culturelle et sociale de certaines
régions. Il prenait, semble-t-il, sous cette « forme civilisatrice », des
racines très profondes dans l’organisation sociale que son abolition
brusque aurait provoqué des torts irrémédiables et des régressions
catastrophiques. Situation étrange qui a souvent intrigué certains
européens, bien intentionnés d’ailleurs, mais qui se sont contentés
d’interpréter l’esclavage à l’européenne avant de l’étudier et de
comprendre ses relations (entre maître et esclave) à l’africaine. En
1882 par exemple, le Sultan de Zanzibar écrivait ceci à la Reine
VICTORIA :
« Votre désir est que l’esclavage cesse. J’excuse vos paroles
et j’obéis à vos souhaits. Mais, que votre Majesté soit informée que
ces régions seront, en conséquence, totalement et entièrement
ruinées »32
.
31 KAOZE, S., cité par NAGANT, G., Op.cit. p.52 32 HADDAD, A., L’arabe et le swahili dans la République démocratique du Zaïre.
Etudes islamiques, histoire et linguistique, SEDES, Paris, 1983, p. 34
71
A son tour, le Cardinal Lavigerie, que l’on ne suspectera pas
sans doute d’esclavagisme, proposait à Sa majesté le Roi Léopold II
la solution suivante :
« Vouloir abolir l’esclavage africain d’un seul coup, par la
force, car on ne peut le faire que par ce moyen, c’est vouloir une
œuvre irréalisable : toutes les armées, tous les trésors de l’Europe ne
suffiraient pas à l’obtenir. De plus, l’état social de l’Afrique indigène
étant fondé sur l’esclavage depuis des siècles, tout se trouverait jeté
dans le chaos, si on abolissait ainsi, en un jour, une organisation
lamentable sans doute, mais cependant préférable au chao »33
.
Enfin, au plan strictement religieux, nous ne pouvons ne pas
faire ressortir ici l’apport de l’Islam dans le développement global
des communautés que les Arabes ont eu à côtoyer. En effet,
l’expansion de l’Islam en direction de l’Asie centrale, de la Chine,
de l’Inde et de l’Indonésie à l’Est, et en direction de l’Afrique et de la
Péninsule Ibérique à l’Ouest, a amené l’adhésion d’innombrables
peuples sans discrimination raciale, notamment à l’occasion des
rencontres de pèlerinage (à la Mecque). Ce grand brassage racial fut
incontestablement à la base de l’éclosion d’une civilisation prospère,
dynamique et universelle. Une civilisation qui résulta de l’apport de
multiples peuples et communautés. Aujourd’hui, il paraît difficile de
délimiter le rôle qu’ont joué les négro-africains et tirer au clair leurs
contributions à l’épanouissement et au développement de la culture
arabo-musulmane par exemple34
.
33 Cfr Lettre à sa Majesté le Roi Léopold II, en date du 8 septembre 1889, in
Document sur la fondation de l’œuvre esclavagiste. Paris 1889, cité par
DSCHAMPS, H., L’Afrique nouvelle, Paris 1913, Page 165. 34 Lire à ce sujet, plusieurs et intéressantes publications de KIZOBO, O. et de
VERCOUTTER, J., notamment :
KIZOBO, O. :
- « L’Ethnonyme négro-africain” et ses synonymes dans la littérature de
Byzance », in Mélanges offerts au Professeur Emérite Paul de MEESTER,
linguistique et littérature, P.U.L., 1993.
- « L’Image des Négro-africains » dans les sources byzantines du VIe siècle au Xe
siècle, Thèse de doctorat, Athènes, 1986.
- « Le recrutement des soldats négro-africains par les musulmans du VIIIe au XIIe
siècles », in Journal of Oriental and African Studies, Volume I(1989), pp. 25-29.
72
Une chose reste certaine cependant : là où ils s’installèrent,
les Arabes se mélangeaient, sans aucune discrimination, avec les
peuplades autochtones et adaptaient souvent à leur mode de vie ce
qui n’était pas en contradiction flagrante avec leurs convictions
sociales et leur foi religieuse, et cette culture négro-arabe fut, au
XIXe siècle, l’un des ferments du nationalisme africain dans les
guerres de résistance à l’occupation coloniale. Il faut noter qu’à l’Est
du continent africain, l’Islam, en tout cas, s’implanta très tôt à Kilwa
ainsi qu’en d’autres points plus méridionaux de la côte orientale y
compris Zanzibar. De là, l’Islam, grâce aux initiatives individuelles,
jamais officielles, et avec le concours de la traite négrières, se fraya
un sentier vers l’intérieur du continent.
En définitive, l’éthique islamique, dans son essence, est
basée sur deux principes bien précis : l’égalité et l’unité : égalité
entre tous les membres de la communauté islamique ; unité de toutes
les parties territoriales de cette communauté. Se trouvant à la base de
l’idéalisme africain, les deux principes ont conféré à l’Islam un
aspect d’influence très différent qui s’est réalisé, comme le dit
WELCH, dans le « mélange des musulmans de couleurs différentes,
les Blancs et les Noirs et dans leur fusion en une seule masse
musulmane »35
.
- « Les Négro-africains dans les relations arabo-byzantines (Ve-Xe siècles), in
GRAECO-ARABICA, First International Congress on greeck and arabic studies,
Volume II(1984), pp.85-95.
- « Les Négro-africains dans le jihad », in Likundoli (Histoire et Devenirs),
8(1996)1-2, pp.69-90.
Et pour des soldats noirs en Egypte pharaonique, lire essentiellement :
- « L’iconographie du Noir dans l’Egypte ancienne », in VERCOUTTER, J.,
LECLANT, J., SNOWDEN, E., et DESANGES, J., L’image du noir dans l’art
occidental des Pharaons à la chute de l’Empire Romain, Fribourg, 1976, pp 43
et suivants.
- VERCOUTTER, J., « Nature et importance des rapports entre l’Egypte
pharaonique avec l’Afrique noire sous la XXVIIIe dynastie (1580-1914) », in
Afrique noire et monde méditerranée, dans l’Antiquité, colloque, Dakar,
1981, p. 81.
35 WELCH, G., L’Afrique avant la colonisation, Edit. Fayard, Paris, 1970, p. 108
73
On comprendra aisément pourquoi l’opposition des
populations du Tanganyika à l’occupation des Arabes et Arabisés
aura été plus passive qu’active. Tout simplement parce que l’Islam,
par suite de sa vocation de religion de dialogue et d’entente, excepté,
bien sûr dans les cas des djihads, a eu le mérite d’être réceptionné
facilement par rapport à d’autres religions en Afrique en s’adaptant
notamment à la réalité vivante.
Ainsi, à l’Est tout comme à l’Ouest de l’Afrique, et même
dans une certaine mesure au cœur du continent, l’Islam se développa
dans un contexte culturel intense qui déboucha sur l’âge d’or de la
culture arabe. Cette ambiance culturelle, animée et entretenue par la
circulation des livres et des manuscrits, suscitera sur les côte
orientale et occidentale, une florissante et abondante littérature écrite
et variée. Les lettres de ces contrées ont transcrit en peul, haoussa et
swahili, des poèmes, des chants, des chroniques et des légendes en
utilisant parfois des caractères de l’alphabet arabe.
Disons pour terminer qu’à l’Est du Congo, avant 1890, les
populations s’étaient organisaient en tribus sous la conduite d’un
chef, qui tenait un pouvoir des ancêtres. Certaines tribus ont même
connu une organisation politique assez développée. Cependant,
toutes souffrirent de l’instabilité due aux dissensions ethniques. Les
révoltes tribales causèrent ainsi l’altération du système politique
traditionnel.
Le développement économique du Congo à cette époque est
très faible. Il se résume en une économie de subsistance et de troc.
Un commerce est cependant très florissant, presque dans tout le
bassin du Congo : celui de la traite du noir qui constitue un fléau pour
le continent africain et une honte pour le reste du monde.
Un pouvoir politique morcelé, une économie affectée par les
Arabes et Arabisés, une société en crise, telle se présentait le
Tanganyika vers les années 1890. En revanche, à travers ce tableau
sombre, se dessinaient et se développaient certaines forces qui
extériorisaient la vitalité des populations. C’est cette image qu’offrait
la société congolaise dans l’Est du pays à l’arrivée des Européens.
Le Poste de Kalemie venait d’être fondé en 1892, après la
libération de la localité de Kataki par le Capitaine Jacques, au même
moment qu’au sud, le Capitaine Joubert, commandant des troupes de
74
L’Association Internationale Africaine (A.I.A.) dans la région,
libérait le poste de Kirungu à Moba, ayant reçu l’appellation de
Baudouinville déjà en 1891, en mémoire de feu Baudouin, fils du Roi
Léopold II, décédé en bas âge, la même année 1891. C’était la fin de
l’aventure arabe à l’Est de l’Etat Indépendant du Congo (E.I.C.),
principalement dans le Tanganika.
75
REFLEXIONS SUR LA THEORISATION DE L’HISTOIRE
CAS DE LA SITUATION AU NORD ET AU SUD KIVU EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
KISIMBA Kimba Emmanuel * et
NGANDU Mutombo Marcel *
Introduction
Le présent texte examine une question d’importance capitale
dans l’historiographie contemporaine congolaise, à savoir a-t-on
besoin d’une théorie en science historique susceptible de servir de
soubassement dans l’explication et la compréhension des événements
historiques ?
Dans la recherche d’une réponse à donner à cette inquiétude,
l’étude s’interroge d’abord sur le sens à donner à chacun de deux
concepts de notre analyse, notamment histoire et théorie et ensuite
sur le lien que les deux entretiennent dans la recherche scientifique.
Enfin, notre étude questionnera l’histoire des relations extérieures du
Congo avec ses voisins de la région des grands lacs à la lumière des
guerres de l’Est et des théories en présence.
1. L’histoire : discipline scientifique ou simple narration des
faits ?
La question s’est posée pendant des lustres quant à savoir si
l’histoire est une science ou non !
Le débat est vieux et semble aujourd’hui dépassé, sauf
peut–être en R.D.Congo et plus particulièrement à l’école historique
de l’Université de Lubumbashi où, dans une publication assez récente
d’un de ses éminents membres, il était repris une affirmation selon
laquelle l’histoire est une narration(1).
* Professeur Associé à l’Université de Lubumbashi (RDC).
76
Aujourd’hui tout le monde reconnait que l’histoire fait partie
intégrante des sciences sociales et l’historien français Pierre Vilar
voulait même, dans une étude de1974 que l’histoire soit reconnue
comme la seule science à la fois globale et dynamique des sociétés
donc comme la seule synthèse possible des autres sciences
humaines(2)
Il faut reconnaitre tout de même qu’à ses débuts, l’histoire a
été considérée comme une simple narration des faits historiques de
grandes batailles, de grandes manifestations liées à la vie des grands
hommes ; par exemple, les rois, les monarques, les seigneurs, etc.
Ces faits, très racontés par les vainqueurs, constituaient l’histoire
"officielle" ou l’histoire d’"en haut" perpétuée par les fonctionnaires
consacrés à la tache de sa conservation, et dans laquelle était vantée,
la bravoure ou le courage du Roi vainqueur. Etc.
En Afrique, ce type d’histoire d’"en haut" est connu dans
certaines régions où l’on forge la fonction de "griots", ces
fonctionnaires chargés de la conservation de la "version" officielle de
l’histoire du royaume ou de l’empire.
Ainsi, le "petit peuple", ou des catégories sociales dominées
ou anciennement dominées pouvaient également participer à
l’écriture de l’histoire de leurs communautés.
Cette tendance a été remise en question lorsqu’on a pensé
que même le "petit peuple" est faiseur ‘’ de l’histoire de son pays ou
de son royaume ; d’où l’on revient à cette tendance de l’histoire d’
‘’en bas’ ’qui vient compléter l’histoire d’ ‘’en haut’’ pour devenir ‘’
l’histoire totale ‘’ ou ‘’globale’’ de l’école des annales des
années1930.
Cette nouvelle histoire "totale" ne concerne pas seulement
les "grands" et "petits" peuples pour la faire, mais aussi elle prend en
compte toutes les sources disponibles : écrites, orales,
iconographiques, vestiges matériels et immatériels dont dispose
* Professeur Ordinaire à l’Université de Lubumbashi (RDC). 1 Kasongo Numbi K, L’Afrique se recolonise une relecture du demi-siècle de
l’indépendance du Congo Kinshasa, l’Harmattan, Paris 2008, p.7. 2 VILAR, P, "Problèmes théoriques de l’histoire économique" in J .Berque et alii
Aujourd’hui l’Histoire, Editions Sociales, Paris, 1974, p.122
77
l’historien sur son objet d’étude aussi elle fait naître d’autres thèmes
qui ne figuraient pas dans le champ historique et qui font leur
apparition. Tel est le cas de l’histoire environnementale.
Aussi cette approche "globalisante" a permis la remise en
question partielle, des découpages historiques classiques : les notions
du Moyen –Age, Epoque Moderne ont-elles grande signification
pour l’Inde, la Chine, l’Afrique ou l’Océanie ainsi que les aires
culturelles ?
Cette évolution de l’histoire est bénéfique car une science qui
ne reçoit pas de nouvel apport s’étiole comme une fleur finit par se
faner à l’instar des anciennes civilisations. L’histoire en tant que
science doit s’adapter et évoluer avec le contexte du moment.
Bien avant cela, Henri Irénée Marrou, l’un des plus grands
historiens qui ont forgé les normes de la scientificité de la science
historique, avait déjà relevé le caractère tout à fait particulier de
l’histoire : il faut la considérer à la fois comme réalité historique et
connaissance historique ou science de l’historien qui existe avant
tout dans et par la pensée de l’historien. A ce titre, Henri Irénée
Marrou rejette la conception des positivistes qui voulaient que
l’histoire s’élève au niveau des sciences "exactes" où la
quantification l’emporte sur la qualité (3)
Pour ces derniers, n’est science que celle qui se fonde sur
l’analyse mathématique pour l’élaboration des lois générales.
Cette critique a amené aux Etats-Unis à la naissance de
l’école historique appelée la Nouvelle Histoire Economique (ou New
Economic History) qui a mis en place un modèle théorique de
l’évolution historique auquel on soumet l’évolution de différents faits
sociaux pour voir si ces derniers ont évolué conformément à ce
modèle théorique ou à cette "théorie".
La discipline historique entre dans l’âge de la raison
pragmatique. Dire combien ce moment décisif se traduit dans les
démarches originales et trouve son unité dans les modèles
d’intelligibilité inattendus est une préoccupation de l’histoire comme
pratique sociale. L’histoire quantitative, plus précisément sérielle, ne
3 Marrou H.I, De la connaissance historique, Ed. du Seuil, Paris, 1954 ;
78
semble plus guerre attractive. L’analyse du discours sous ses formes
les plus variées, est devenue en quelques années la référence presque
exclusive pour les pratiques historiennes, avec les subtils jeux de
miroirs et des renvois et les effets d’irréel qu’elle suscite.4
Comment expliquer un événement unique alors que par
définition l'explication scientifique dans les sciences "exactes" ne
cherche pas à rendre compte de l'événement en tant qu'unique mais
de le déduire à partir de l'établissement de lois générales (5) ?
Tout le débat classique entre Carl Hempel et William Dray se
résume à ce problème. Le premier essaie de prouver que l'explication
historique est un mode particulier de l'explication scientifique tandis
que le second soutient que l'explication historique est par nature
différente de l'explication scientifique dans la mesure où la rationalité
des Hommes, objet de l'histoire, exige un autre type de
compréhension fondée sur l'analyse des intentions des acteurs.
Alors qu'au début du XXe siècle, Windelband avait accordé
un statut scientifique égal aux sciences nomothétiques (établissement
de lois générales) et à l'idéographie (science du particulier), les
positivistes ont réduit la scientificité aux seules investigations
nomothétiques. Les néo-positivistes avancent qu'il n'y a de science
que du général. Contre la thèse de la compréhension historique qui
prolongea la distinction entre deux types de science, l'une allant vers
le singulier, l'autre vers le général, le chef de file des néo-positivistes,
Carl G. Hempel défend le primat de l'explication et l'unité de la
connaissance scientifique. Selon lui, il n'existe qu'une seule science
digne de ce nom : la science nomothétique à laquelle l'histoire
appartient. Le début du célèbre article de Hempel "The function of
general Laws in History" affirme sans détour le lien étroit unissant
l'histoire à la science nomothétique : "general laws have quite
analogous functions in history and in the natural sciences (6)".
4 Jean –Yves, G, ‘’Expliquer et comprendre la construction du temps de l’histoire
économique" in Bernard Lepetit (éd.), Les formes de l’expérience. Une autre
histoire sociale, Ed. Albin Michel, Paris, 1995, p.228. 5 En ligne inhttp://www.er.uqam.ca/nobel/m200550/explication.htm 6Hempel, C, The function of general Law in History
79
Selon le modèle Hempel, aussi appelé "covering law
model", il n'y a explication scientifique que dans la mesure où une
relation directe entre événements singuliers peut se déduire d'une
proposition générale. L'explication historique ne peut être qualifiée
de scientifique que si elle repose sur une déduction logique.
Dépouillé de son statut narratif, l'événement historique devient
semblable aux événements physiques comme la rupture d'un
réservoir d'automobile. Pour expliquer un événement historique, il
faudrait procéder comme dans les sciences naturelles, soit dans un
premier temps, en décrivant les conditions initiales (antécédents,
conditions) et dans un second temps, en énonçant une hypothèse de
forme universelle qui sera appelée une loi si elle est vérifiée
empiriquement. Un événement est expliqué lorsqu'il est "couvert" par
une loi et que ses antécédents peuvent être considérés comme des
causes. En posant la primauté du modèle déductif, Hempel veut faire
de l'histoire une véritable science.
Bien sûr, l'histoire satisfait difficilement ce modèle car les
propositions générales qu'elle énonce n'ont pas la rigidité d'une
régularité stricte et encore moins d'une loi. De nombreux positivistes
ont cherché à "sauver" le modèle Hempel en atténuant le
déterminisme de la structure déductive de l'explication en passant de
l'explication causale à l'explication probabiliste. En fait, Hempel, lui-
même, fait cette unique concession pour préserver la validité de son
modèle idéal lorsqu'il introduit l'idée des "explanations sketches"(7).
Il n'en demeure pas moins que tous les néo-positivistes ont en
commun leur refus d'accorder une quelconque valeur
épistémologique et explicative aux méthodes de la compréhension et
d'empathie par lesquelles l'historien explique un événement en se
mettant à la place des acteurs et en saisissant les raisons, intentions
rationnelles de ces derniers. Selon Hempel, ce modèle de la
compréhension rationnelle ne peut être considéré comme une
explication, mais tout au plus comme un procédé heuristique parfois
utile, mais aucunement nécessaire pour répondre à la question
"pourquoi". Hempel ne se réfère jamais à la nature narrative de
7 Idem
80
l'histoire, il n'admet pas la différence entre un événement historique,
et un événement physique : car l'événement ne consiste pas
seulement à raconter, mais à déduire une proposition générale(8).
Les historiens des Annales optent généralement en faveur du
modèle de l'explication historique. La distinction entre l'histoire-
problème et l'histoire-récit maintes fois utilisée par ces historiens
pour rendre compte des différences entre l'explication et la
description en histoire le prouve. Selon eux, l'histoire doit rompre
avec le récit, l'événementiel, l'unique, le particulier. La forme
narrative qui établit les faits et les ordonne dans un ordre
chronologique fondée sur une chaîne causale simpliste sans les
expliquer, sans poser de question ou d'hypothèse préalable doit être
délaissée au profit d'une histoire-problème. Dans ce type d'histoire,
l'historien accorde une place primordiale à l'explication. Expliquer
c'est rendre compte de la réalité et la rendre intelligible en répondant
à la question "pourquoi" et en identifiant les causes d'un phénomène.
La description est alors perçue comme une tache préliminaire à
l'explication qui consiste en une simple récolte et mise en œuvre des
faits historiques.
Eu égard aux éléments ci-avants, a-t-on besoin de recourir à
une théorie en histoire, telle est la question posée par maints
scientifiques. En effet pour ces derniers, avant d’y répondre, il faut
tout d’abord donner le sens de ce deuxième concept utilisé dans notre
analyse, qu’est la "théorie".
2. Le Concept « théorie » en recherche scientifique
Une théorie est une construction spéculative de l’esprit
opposée à la pratique et à la connaissance. Sur le plan scientifique, la
théorie est un système hypothético-déductif ou un ensemble
d’hypothèses structurées.
D’après V. Dobrian : "la théorie est la mise à jour des lois
d’évolution sous une forme abstraite alors que l’histoire étudie le
cours concret du processus historique avec toutes ses particularités
8 Hempel,C, Op.Cit
81
individuelles, ses déviations et ses zigzags". Selon cet auteur , "si
l’histoire n’examine et ne décrit que les manifestations des lois du
processus historique découvertes et formulées par la théorie, cela
signifié qu’elle se contente d’illustrer la théorie, et ne fournit pas des
nouvelles connaissances sur l’objet et que sa valeur se ramène à la
vulgarisation des thèses théoriques(9), souvent élaborées par d’autres
sciences sociales comme la sociologie, l'économie" etc…
Lorsque les historiens bourgeois appellent à enrichir
l’histoire par la sociologie, il s’agit souvent tout simplement de
rehausser le niveau théorique de l’histoire, d’y dépasser le
descriptivisme qui y prédomine.
En d’autres termes, l’explication d’un fait social ou mieux,
d’un événement historique, pour être scientifiquement valable et
surtout vérifiable, elle devra s’appuyer sur une élaboration théorique.
La théorie en un mot n’est qu’un système explicatif que
l’expérimentation ou l’enquête confirme ou non. L’opposition entre
théorie et recherche revêt deux aspects.
- Le premier oppose la réflexion théorique et abstraite aux
recherches concrètes sur le terrain, celles-ci pouvant déboucher soit à
la découverte d’une théorie, soit au contraire sur des applications
pratiques.
- Le deuxième aspect oppose la recherche fondamentale à la
recherche appliquée. Alors que la recherche appliquée tente le plus
souvent de surmonter, à l’aide de principes connus, les obstacles
auxquels se heurtent les utilisateurs, la recherche fondamentale
réclame pour le savant la liberté de travailler sans objectif pratique.
Ainsi, la théorie apporte à la recherche : l’ordonnancement
de la réalité, le choix des concepts utiles, un schéma d’observation,
la mise sur pied des hypothèses et le cadre des explications. A son
tour, la recherche remplit pour la théorie, d’après R.K. Merton,
quatre fonctions majeures : "elle suscite, elle refond, elle réoriente et
elle clarifie la théorie"(10
).
9 Dobrian, V, Les problèmes méthodologiques de la connaissance théorique et
historique, Moscou, 1968, cité par J. Berque et alii (éds), op.cit pp.155-156- 10 Merton R, K, Eléments de théorie et de méthode sociologique, Ed. Gérard-
Montfort, Paris, 1965, p.46
82
La théorie et la recherche sont indispensables aux sciences
sociales comme à toutes les sciences. A-t-on besoin d’une théorie en
histoire ? Peu d’historiens répondraient par l’affirmative car pour les
sceptiques à tout concept de conceptualisation serait par avance
condamné, du fait de la nature du domaine étudié .En effet, le débat
fondamental porte sur la nature explicative de l’histoire. Comment
l’historien peut –il expliquer des événements historiques qui sont par
définition uniques et singuliers, c'est-à-dire qui ne se sont produits
qu’une seule fois ? Par ailleurs, l’emporte sur la régularité. Par
ailleurs, la théorie par nature réductrice serait en outre conservatrice,
voire totalitaire. Ce qui, on le peut comprendre, suffit à jeter le
discrédit sur les tentatives de théoriser l’histoire. Au début, parler
d’histoire pour le commun des mortels, il s’agit de la narration ; c’est
pourquoi le Professeur Yogelelo, explique que "l’histoire n’est que
lecture" (11
).
Cette conception de l’histoire (narration) est restée inchangée
pendant des lustres. Ensuite, l’historien a été décrit comme le
prophète du passé, aujourd’hui, de plus en plus de voix s’élèvent
pour dire que la prospective est utilisée pour analyser et exploiter les
faits à venir. L’historien devient alors prophète tout court.
Cette évolution de l’histoire est bénéfique, car une science
qui ne reçoit pas de nouvel apport, s’étiole comme une fleur et finit
par s’éteindre à l’instar des anciennes civilisations. L’histoire en tant
que science doit s’adapter et évoluer avec le contexte du moment.
3. Les trois tendances enregistrées en histoire
A l’examen de tous les faits connus, il se dégage trois
grandes tendances pour conceptualiser l’histoire, n’en déplaise aux
sceptiques. Au regard de l’histoire du monde, il y a bien de
dénombrer trois tendances : les faits sont mouvants, certains se
reproduisent, d’autres disparaissent à jamais :
a. La tendance linéaire
b. La tendance cyclique
11 Kasongo Numbi, Op.cit, p.7
83
c. La tendance cyclo-linéaire peut
expliquer les déroulements et les faits historiques
dans leur globalité.
En résumé, il existe donc trois tendances possibles pour
conceptualiser l’histoire. Pour certains, les faits historiques sont
cycliques, ils reviennent à des périodes données selon certaines
circonstances ; pour d’autres, les faits sont linéaires dès qu’ils
apparaissent une fois, ils ne se reproduisent plus ; tandis que pour la
dernière tendance, les faits sont mouvants, certains ne se produisent
jamais d’autres réapparaissent selon certaines circonstances que nous
reprenons comme suit :
1. La tendance cyclique : les mêmes causes reproduisent les
mêmes effets ; un temps historique circulaire et répétitif.
2. La tendance linéaire : les faits ne se reproduisent qu’une fois,
donc ne se répètent plus d’où la singularité des événements.
3. La tendance cyclo-linéaire : les mêmes causes produisent les
mêmes effets selon certaines circonstances de temps et de lieu.
Depuis presque une décennie nous tentons de théoriser
(mieux de conceptualiser) l’histoire qui se résume en une simple
narration d’événements, et autres faits des activités humaines selon
certains intellectuels ; bref, l’histoire est l’étude du passé humain.
En dépit des preuves irréfutables sur les tentatives de
théoriser l’histoire, la plupart des intellectuels restent sceptiques sur
cette délicate question en n’oubliant pas l’assertion selon laquelle les
mêmes causes produisent les mêmes effets, et à nous d’enrichir selon
le temps, le lieu, les circonstances et les hommes, car l’histoire est
l’étude du passé du genre humain dans tous ses aspects. Avant
d’arriver à l’objet de notre article, nous devons savoir si : l’histoire
peut elle être théorisée ? Il nous a semblé opportun de faire
l’historique du sujet pour éviter tout malentendu et ainsi faciliter la
compréhension de tous sur ce sujet qui suscite la polémique.
84
A ces débuts, l’histoire a été une simple narration des faits
avérés et dans la plupart de cas, elle était relatée par le vainqueur
lequel à sa guise pouvait influencer indirectement et même
directement le scribe. En effet, malheur au vaincu, il a droit qu’à des
quolibets et aux qualificatifs peu réjouissants.
Pour revenir au sujet proprement-dit, l’histoire est une
science, cela signifie qu’elle présente les normes requises pour se
faire. L’historien avant de s’orienter dans le temps historique, doit se
livrer à un pronostic (projection) sur l’avenir dont la lumière se
reflète sur le présent pour l’éclairer.
Le présent n’existe que parce qu’il a été fait par un passé.
En effet, l’homme doit rester vigilant afin d’être capable de
déceler ce qui dans le temps présent (contemporain) risquerait de
s’avérer une répétition sinistre du passé.
Toutefois surenchérir sans cesse sur le passé c’est aussi
risquer d’alourdir le présent d’un poids écrasant et irrévocable. Dans
la figure (B) Marque l’apogée le point d’équilibre supérieur à partir
duquel le déclin s’enclenche inexorablement (C)
1)
A Apogée
(maturité)
Fin
B
Déclin
(Décade
nce)
Naissanc
e
85
Quand un empire disparait, un autre apparait et le cycle
continue.
Tout empire nait, atteint son apogée et connait la chute
(décadence) « loi naturelle». L’histoire est édifiante dans ce
domaine.(Cf. Figure 2)
2)
Où sont les empires et royaumes de naguère florissants ?
Aujourd’hui tombés dans les oubliettes de l’histoire.
L’illustration schématique ci-après, représente et explique
l’évolution des empires pendant la confrontation.
(B) Apogée
(A)Naissance
(C)Chute (décadence) et disparition
86
Quand un empire A décline et étale sa faiblesse A’, un autre
surgit B prend l’envol et s’affaiblit également B’ – Le cycle reprend.
L’empire émergent chasse l’empire décadent.
Un vieil adage africain insiste à ce propos sur le fait que :
"deux coqs ne peuvent faire bon ménage dans un même poulailler.
L’un d’eux doit disparaître et faire profil bas."
Le XXe siècle a connu deux guerres mondiales de 1914-1918
et 1939-1945. Un même pays a été à la base de ces deux guerres :
l’Allemagne (le Kaiser Guillaume et le führer Hitler) avec pour
objectif : la recherche de l’espace vital. Aujourd’hui, l’Allemagne ne
peut pas se lancer sur la voie impérialiste ; mais à participer avec son
ennemi séculaire (la France) à la création d’un ensemble unique au
Monde « l’Union Européenne » et a abandonné les visées
expansionnistes, devenant la locomotive de l’Europe meurtrie par
plusieurs conflagrations. L’Allemagne ne peut plus se permettre
d’être à la base d’une autre guerre mondiale. Au contraire, elle œuvre
pour la paix et connait aujourd’hui une ère de prospérité. Ne dit-on
pas que les démocraties ne se font pas la guerre !
Le cas de la RD Congo et les voisins de l’Est peuvent
illustrer les concepts de l’histoire décrit ci-avant.
Pour rappel, il s’agit de linéaire, cyclique et la combinaison
de deux concepts : cyclo-linéaire.
Il est vrai que le premier pas pour toute discipline consiste à
s’inventer en tant que concept distinct de l’objet qu’elle s’est
B A
B’ A’
87
assignée d’étudier en sélectionnant des éléments et en les
interprétant. En effet, une théorie se fonde sur le choix de certains
facteurs jugés plus explicatifs que d’autres et sur la disparition des
relations que ces facteurs entretiennent entre eux. Une théorie est
alors fondée sur une hypothèse qui ne prétend pas être vraie mais
seulement utile (12
). En effet, la théorie a pour objet d’apporter une
grille de lecture parmi d’autres de la réalité, avec pour condition de
validité, un minimum de permanence dans l’interprétation, et pour
limite acceptée sa possible réfutation dès lors que le changement de
circonstances porte atteinte à la cohérence de l’explication.
4. Illustration de la situation au nord et au Sud Kivu
Pour illustrer nos affirmations, nous prenons l’exemple du
problème au Nord et Sud Kivu dans le territoire Congolais.
Eloignés de plus de 1500km à vol d’ oiseau de la capitale, le
Nord et le Sud Kivu sont tournés pour les échanges vers l’Afrique de
l’Est et l’océan Indien. Ainsi les guerres récurrentes ont tendance de
renforcer les forces centrifuges d’une périphérie coupée de
l’hinterland Congolais. C’est pourquoi il y a lieu de saluer les
programmes de reconstruction des infrastructures et de modernité de
la communication afin que le Grand Kivu soit a nouveau ancré à
l’espace économique Congolais
En attendant, on se demanderait à qui profite la situation
d’imbroglio actuelle ?
Sans nul doute que c’est au Rwanda que profite la confusion
du Nord et du Sud Kivu. Les ambitions expansionnistes pour
déverser le trop plein de sa population, ses positions économiques
dans la commercialisation des ressources minières et son influence
politique, confirme à suffisance le désordre des ressources
économiques, sociales et environnementales dans cette région.
Ainsi, les questions identitaires, les ambitions politiques,
l’exploitation des ressources naturelles n’explicitent que
12 Roche, J.J, Théories des relations internationales Montchrestien, Paris ,2006
pp13-14
88
partiellement un conflit qui renvoie en dernière instance à des causes
beaucoup plus profondes.
En effet, les guerres de la région des Grands Lacs peuvent en
effet s’analyser comme des violences du trop-plein. Les petits
espaces du Rwanda et du Burundi, corsetés depuis la colonisation par
des frontières rigides, sont pris au piège d’une nasse démographique.
La forte baisse de la mortalité amorcée pendant la colonisation n’a
pas été suivie par une baisse significative de la fécondité : celle-ci est
encore proche de 4,81%. Le taux de croissance approche les 2,65%
par an conduisant à un doublement de la population en 25 ans. Or,
avec près de 10 millions d’habitants au Rwanda en 2008 la densité
atteint déjà 380 hab./km2, ce qui est beaucoup pour un pays rural à
près de 90 %. Chaque famille paysanne ne dispose plus en moyenne
que de 40 ares de terre à cultiver. Qu’en sera-t-il demain ? La
question n’est plus seulement de savoir comment vivront dans une
génération 20 millions de Rwandais, mais où vivront-ils sur un
territoire exigu, appauvri ou chercheront-ils de l’espace(13
).
Comme les vents, les mouvements migratoires vont des
hautes pressions vers les basses pressions, ici démographiques : la
migration vers l’ouest, vers les terres moins peuplées du Kivu
s’inscrit dans l’ordre des choses et dans le temps long. Elle n’a pas
posé de problème tant qu’il y eut d’abondantes disponibilités
foncières. Ce n’est plus le cas, même si l’acuité des problèmes est
inégale du fait d’une répartition différenciée des densités : en
quelques décennies, la saturation foncière a complètement changé la
donne, multipliant les conflits pour la terre, dressant les autochtones
contre les étrangers dans un contexte juridique confus où droits
coutumiers et droit moderne incarné par l’Etat se chevauchent(14
).
Circonstance aggravante, les migrants tutsis sont principalement des
éleveurs qui ont besoin de vastes étendues pour leurs troupeaux. Ils
ont trouvé des conditions idéales pour leur activité dans les pâturages
d’altitude, mais la constitution de grands domaines d’élevage réduit
13www.statistiques_mondiales.com/rwanda 14 Matthieu P, et Tsongo Mafikiri A., « Guerres paysannes au Nord-Kivu
(République démocratique du Congo)
89
d’autant les terres de culture(
15). La question foncière constitue le
fondement socioéconomique structurel des conflits du Kivu, lieu
d’une véritable « conquête foncière » liée à une immigration mal
contrôlée depuis les indépendances(16
). La création du vaste parc
national des Virunga sous l’administration belge a en outre soustrait
780 000 hectares à l’activité agro-pastorale, au cœur de la zone la
plus peuplée du Nord Kivu. Celle de Kahuzi Bieza 600 000 ha au
Sud Kivu.
15 Tallon, F, Données de base sur la population : Rwanda, CEPED, décembre 1991. 16 Idem
Nord-Kivu
RD Congo Rwanda
Rwanda
Sud-Kivu
Régions moins peuplées : 11.044.923 habitants 124.553Km²(superficie)
Surpeuplement :
11.689.696 habitants 26 800 km²(superficie)
90
B
B
Ce même principe peut s’appliquer au reste de la RD Congo.
La densité moyenne de la RD Congo s’élève à 29,4 mais Kinshasa a
la densité la plus élevée soit 974,5hab/Km² (17
). En se référant à la
ruée vers l’ouest des Etats-Unis les siècles passés, il y a lieu de
désengorger Kinshasa au profit de deux Kivu en suscitant une ruée
vers les deux Kivu.
17 Idem.
Principe du trop plein vers le
moins plein pour atteindre
l’équilibre
Ce principe s’explique dans
le sens où les récipients
d’inégale densité vont
parvenir à trouver un
équilibre par le versement
du contenu A’, vers le
récipient B’, afin de
trouver l’équilibre.
Exemple sur le Rwanda qui
surpeuplé avec
436,18hab/km² voit son
exécutoire dans les deux
Kivu, qui n’ont que
102,4hab/km².A=B(17)
Déséquilibre
= tensions
L’équilibre est
atteint
‘
‘
‘
Rwanda N et S Kivu
RD
Congo
91
C’
A pratiquer alors une politique de déplacement afin de
désengager Kinshasa et certaines autres provinces au profit des deux
Kivu en créant des logements sociaux et en facilitant l’installation
des entreprises et la pratique de la priorité d’embauche pour les
nationaux : la ruée vers les deux Kivu pour endiguer les velléités
d’annexion du Rwanda est une mesure à examiner.
Pour revenir à la situation de deux Kivu, il y a lieu de noter
que pendant la guerre civile, les troupeaux ont beaucoup souffert de
la présence de militaires, quels qu’ils soient. Seuls quelques grands
ranchs protégés par des milices armées ont pu sauver une partie du
cheptel. Après des années de décapitalisation, les éleveurs
reconstituent leur troupeau : des convois de camions chargés de
bovins provenant du Rwanda en direction du Masisi restaurent au
pacage imposées au Rwanda renforcent cette migration bovine. Selon
le rapport des Experts, des transactions foncières ont eu lieu dans les
D
‘
C
‘
N e
t S
Kiv
u, R
D C
on
go
1
02
,4
Densité Rwanda +436,18
Densité RD Congo 29,4
Densité 1024 Ville de Kinshasa en 2011, 974,5 (Cf. De Saint Moulin,
op.cit.)
92
zones contrôlées par le CNDP : bénéficiaires, des hommes d’affaires
proches des rebelles, et des officiers. Les violences récurrentes entre
Maï Maï et Tutsis ont pour principal fondement cette compétition
pour une terre de plus en plus rare et donc disputée : elles ne sont pas
prêtes de s’arrêter.
La question foncière, principale cause des violences
interethniques, ne date pas d’aujourd’hui, mais elle n’a cessé de
s’aggraver au rythme d’une croissance démographique qui fait de la
terre l’enjeu central des conflits sociaux. Les mutuelles agricoles
apparues après l’indépendance eurent d’emblée une forte identité
ethnique. L’ACOGENOKI, Association coopérative des
groupements d’éleveurs du Nord-Kivu était à dominante tutsie, tandis
que la MAGRIVI, Mutuelle agricole des Virunga (Nord-Kivu)
représentait les intérêts des agriculteurs hutus18
. On mesure à travers
ces mutuelles l’articulation étroite entre enjeux fonciers et crispations
identitaires dans un contexte de pression démographique critique. La
situation devient chaque année plus insoutenable dans ce petit espace
saturé d’Afrique centrale où la guerre semble s’être substituée aux
famines comme régulateur démographique. La dernière grande
famine, en 1943-1944, aurait fait selon certaines sources un million
de victimes au Rwanda-Urundi, dont plus de la moitié au Rwanda
pour une population de l’ordre de 2 millions de personnes. Si ces
chiffres étaient exacts, cela représenterait une énorme saignée
d’environ 25 % de la population. Famines, massacres, provoquent de
terribles à-coups démographiques qui traduisent un déséquilibre
structurel entre population et ressources. Les thèses dites « néo-
malthusiennes » comme celle de l’école de Toronto qui autour du
politologue Thomas Homer-Dixon s’intéressent aux conflits
environnementaux et aux liens de causalité entre pénurie et conflit
peuvent être sans difficulté appliqués à la situation du Kivu.19
Sans une politique de population résolue portant sur
l’organisation des flux migratoires et surtout sur les moyens de
ralentir la croissance démographique dans ces hautes terres africaines
qui comptent parmi les plus prolifiques du monde, il n’y a aucun
18 www.syfia.info/index.php? 19 Idem
93
espoir d’apaisement durable des tensions et de disparition des
terribles violences périodiques qui rythment l’histoire des Grands
Lacs depuis quelques décennies. Quand on connaît les effets d’inertie
démographique, on ne peut que s’inquiéter de l’absence des questions
de population dans les initiatives visant à restaurer la paix dans la
région. Les sommes faramineuses dépensées sans résultat tangible
par l’ONU seraient plus utiles si elles étaient consacrées au
développement socio-économique et à la résolution de cette question
cruciale qui conditionne toutes les autres. Les politiques actuelles,
qu’elles soient nationales ou portées par des acteurs internationaux,
restent malheureusement à courte vue, car elles ne vont pas au fond
en ignorant le lien étroit entre guerre et démographie.20
5. Comparaison sommaire
1) Densité très élevée
2) Faible densité Densité élevée
20 www.pole-institute.org/documents
Kinshasa
Rwanda R.D.Congo
94
3) Porosité des frontières Invulnérabilité du sanctuaire
Etat défaillant Etat faible
Un Etat est donc qualifié de défaillant lorsqu’il n’y a aucune
autorité centrale en mesure d’assurer à titre exclusif l’exercice de la
violence légitime au sein des frontières dudit pays lorsqu’il n’assure
pas le respect des droits de la personne et la satisfaction des besoins
fondamentaux des populations(21
).
Si l’on transpose sur le plan économique le questionnement
sur les risques politiques suscités par les Etats défaillants, on en vient
alors à considérer qu’au même titre que la sécurité internationale,
l’ouverture des économies et l’extension des échanges internationaux
serait elle-même micacée si les phénomènes des Etats défaillants
venaient à s’étendre. S’ils répondent évidemment à des facteurs
spécifiques, des caractères historiques ou culturelles, s’ils relèvent
sans doute le comportement atypiques des certains élites, les Etats
défaillants sont surtout la résultante de l’extrême pauvreté, de
maladies endémiques, de l’analphabétisme, de l’absence d’avenir
pour la genèse qui frappe encore des régions importantes de la
planète, tout particulièrement sur le continent africain. L’urgence de
l’éradication de ces poches de sous-développement et de la pauvreté
extrême n’est donc pas seulement une affaire de conscience
collective. Il faut en effet considérer que le sous-développement est
une menace en termes de sécurité globale, les Etats faibles
corrompues ou défaillants étant une source des conflits internes, des
21 Carpanis A, Cercles des économistes : défit politique, on line
http// :www.lesercledeseconomistes.Asso.fr/IMG/pdf/S07.carpanis.pdf
ETAT
95
guerres régionales mais aussi des ramifications avec la criminalité
régionale (22
).
Carpanis cite une dizaine des pays considérées, dont la RD
Congo, comme défaillants : par effet "boule de neige" la défaillance
des certains Etats pourrait perturber tout le système mondial
(économique, sécuritaire, etc.…) Et la RD Congo défaillante peut
perturber par les effets collatéraux l’ensemble des pays de l’Afrique
Centrale. Les rebelles de tout abord trouvent un sanctuaire pour
fomenter des troubles contre leurs pays.
5. Cycles de violence extrême et fratricide depuis 1990 (Rwanda
RD. Congo) tendance Cyclo – linéaire
1994 Opération Turquoise
1996 Entrée de l’AFDL
1998 Réplique du RCD
2006 CNDP
2012 M23
7 2013 M23
22 Idem
6
8
2
2
19 ans
2013
Relative accalmie : Mais partition du pays en 3 zones d’influence
Gouvernement MLC RCD
1996 1994
2013
2006 1998
96
Deux décennies de conflits intenses. Il ne se passe pas deux
ans sans que les relations entre les deux Pays la R.D.Congo et le
Rwanda ne soient émaillées de tensions et des rébellions dont la
dernière en date du 23 mars 2012, celle-ci n’a pas été provoquée par
la colonisation Belge ou par la politique de Mobutu consistant à
diviser pour mieux régner. Elle a été probablement déclenchée par
une combinaison d’événements récents : l’insistance de la Cour
Pénale Internationale à extrader Bosco Ntaganda , les plans de Kabila
pour démanteler les réseaux de l’ex-CNDP dans l’Est du Congo, et le
refus de Kigali d’abandonner ses intérêts économiques, militaires et
politiques au Kivu et pourtant, le fait que le gouvernement et les
groupes armés jouent des sentiments sécessionnistes pour rallier des
appuis montre que l’histoire de la région continue à être importante
aujourd’hui.
Le passé de la région ne justifie pas les interventions
rwandaises au Kivu. Loin de là. Pourtant, il est clair qu’il faut
prendre aussi en compte les évolutions à long terme c’est- à-dire les
relations profondes entre les peuples, les cultures et les histoires de la
région, plutôt que de se concentrer sur les seules causes immédiates
des crises de la région. Il est probable que les mémoires partagées de
la violence vont continuer à façonner l’avenir commun de la région.
Aussi, afin d’empêcher les idéologues d’exploiter ces
souvenirs, la prochaine étape devrait viser à mitiger leur nature
potentiellement dangereuse. On pourrait ainsi faire avancer les
choses en promouvant les initiatives locales qui visent à créer une
plateforme où les victimes, les auteurs des violences et les
observateurs de l’un ou l’autre camp puissent parler de leurs
expériences du passé violent et les partager.
N.B. N.B.
-M23 – Mouvement du 23Mars 2012
…
..
-CNDP - Conseil National pour la Défense du Peuple.
N.B.
-RCD – Rassemblement Congolais pour la Démocratie
-AFDL – Alliance de Forces Démocratiques pour la Libération du Congo
97
*Un constat qui n’est pas sans conséquence sur le plan
économique
Sur le plan économique, les Etats défaillants sont une menace
pour le respect des règles du marché mondial mais aussi la
conséquence du maintien de la pauvreté.
En ne parvenant pas à assurer de façon complète les
fonctions régaliennes et la satisfaction des besoins fondamentaux des
populations concernées, les Etats défaillants dérogent également aux
règles qui s’appliquent au commerce international, aux transferts des
capitaux ou au respect des droits de propriété. Ils favorisent, on l’a vu
toute une série de comportements illicites : piraterie internationale,
corruption généralisée, blanchissement d’argent, activités illicites, …
Au-delà des principes du droit international ou du respect du droit de
l’homme, il y là autant de facteurs de distorsion de concurrence, de
menaces sur la sécurité ou la légalité des échanges, de source de
captation de rentes ou de détournements des recettes fiscales. Mais en
même temps, la carte mondiale des Etats défaillants recouvrent
étroitement celle de la pauvreté et du sous-développement23
.
La RD Congo doit sortir de cette situation afin de prétendre à
l’émergence d’ici deux décennies. Par ailleurs, la présence dans les
trois pays de la zone de turbulence à savoir : l’Ouganda, le Rwanda,
le Burundi des réfugiés de tous genres constitue également un facteur
permanent de tensions. Pour revenir au cas du Rwanda, l’HCR ( Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), dénombre 1000
réfugiés ou prétendus tels au Rwanda et du coté de la RD Congo il y
a la présence avérée de 10 à 15 000 réfugiées rwandais22
.
Paradoxalement les réfugiés congolais ne connaissent aucune
des langues nationales du pays et ne sont locateurs que du
Kinyarwanda.
23 Carpanis, A, op.cit.
22 M’Buze Momu, jammbonews.net.23.20012, La situation des réfugiés.congolais et
ruandais
98
En perspective, le retour desdits réfugiés pourrait poser des
problèmes d’intégration et seront tentés par ce fait à se cloisonner,
suscitant par ce reflexe l’’animosité des autres tribus doutent de
l’intégrité de leur vie une fois de retour au pays.
A)89000 B)53000
Réfugies Rwandais Réfugies Congolais ou
En RD. Congo prétendus tels au Rwanda
A) Les rwandais veulent des garanties pour regagner
leur pays le cas échéant souhaitent demander une naturalisation
doutant de la sincérité du dialogue inter rwandais.
B) Les réfugiés congolais aspirent à regagner leur pays
sans poser de préalable.
C) Naturaliser ces populations (rwandaises) serait
allumer à nouveau une bombe à retardement en RD Congo
susceptible d’embraser à nouveau la sous région des Grands Lacs.
En Egard à l’examen des différends entre le Rwanda et la RD
Congo et portant sur la réflexion que nous élaborons desdits
rapports : il y a un point important qu’il convient de souligner est que
la pensée historique est relative.
A chaque époque de chaque société l’étude de l’histoire,
comme les autres activités sociales, est liée aux tendances
prédominantes d’un temps et d’un endroit donné.
Toute étude, qu’il s’agisse de l’homme ou de la nature, est
soumise aux limites de la pensée humaine. La première et de plus
importante d’entre elles est que la pensée ne peut s’empêcher de faire
Tentative d’intégration
Difficile à envisager dans le contexte actuel
99
violence à la réalité dans son effort pour appréhender. La solution
préconisée par la RD Congo pour sortir du bourbier ne peut se
réaliser sans passer par notre image mentale de la réalité ou l’image
que la réalité donne d’elle. Le point de départ de l’interprétation
historique comme de toute entreprise intellectuelle, c’est l’hypothèse
que la réalité a, pour nous, un certain sens qui nous est accessible par
le procédé mental de l’explication.
La situation au nord et au sud Kivu pourrait se décanter si les
politiciens exploitaient les faits et les opinions antérieurs à notre
époque et propres à notre temps.
Cet article ne se limite pas à constater mais va au-delà de
l’explication empirique en proposant un modèle à suivre, la
négociation et non pas le recours aux armes pour se mesurer aux
Rwandais. La violence dit-on est l’argument des faibles.
Le recours à une théorie peut amener le chercheur à
découvrir voire à de redécouvrir la solution à son problème car dit-
on c’est dans le chaos que l’on peut trouver la réponse à l’ordre
(théorie de chaos).
Conclusion
Reconstituer l’histoire ancienne d’une région avant les
périodes couvertes par les traditions orales puis par l’écriture est un
défi que peut relever l’archéologie, du moins en ce qui concerne
l’évolution des techniques, des environnements naturels , du
peuplement et parfois des marques de puissance. Dans une approche
pratiquement théorique pour l’histoire moderne, une certaine
méthode consiste à combiner les analyses comparatives, lexicales et
étymologiques, l’éclairage ethnographique des champs sémantiques
concernés, qui permet de classer ces données dans un modèle
évolutif.
La division du métier d’historien en une multiplicité
d’approches locale, la parcellisation généralisée des sciences
humaines et sociales, la fragmentation de la philosophie en zones
séparées ne témoignent-elles pas d’un vide théorique plutôt que d’un
modèle satisfaisant ? C’est ce vide théorique que nous entendons
100
mettre en valeur, tant du point de vue de ses conséquences
épistémologiques que du point de vue de ses implications politiques.
En effet, la théorie apporte à la recherche un ordonnancement
de la réalité, elle permet de choisir des concepts utiles en traçant un
schéma d’observation, elle émet des hypothèses et fait parvenir des
explications. D’un autre côté, Merton R.K. montre ce que la
recherche apporte à la théorie : elle, la recherche remplit quatre
fonctions majeures :
- Elle suscite ;
- Elle refond ;
- Elle réoriente ;
- Elle clarifie la théorie.
Théorie et recherche sont indispensables aux sciences
sociales comme à toutes les sciences. La tentative de
conceptualisation de l’histoire est donc nécessaire et doit permettre
d’approfondir la recherche dans ce sens.
Bibliographie
1. Carpanis A, Cercles des économistes : défit politique on line
www.lecerledeseconomistes.asso.fr/IMG/pdf/S07-
Carpanis.pdf
2. De Saint Moulin, L, S.j, Atlas de l’organisation
administrative de la République Démocratique du Congo,
Cepas, Kinshasa, 2011, p.23.
3. Dobrian, V, "Les problèmes méthodologiques de la
connaissance théorique et historique", Moscou, 1968, cité
par J. Berque et alii (éds), op.cit pp.155-156-
4. Grenier Jean Yves, "Expliquer et comprendre la
construction du temps de l’histoire économique" in Bernard
Lepetit (éd), Les formes de l’expérience : Une autre histoire
sociale. Editions Albin Michel, Paris ,1995
5. Hempel, C, "The function of general Lawsin History"
6. Kasongo Numbi K, "L’Afrique se recolonise une relecture du
demi-siècle de l’indépendance du Congo Kinshasa", Paris,
l’Harmattan, Paris 2008.
101
7. Marrou H.I, "De la connaissance historique", Ed. du Seuil,
Paris, 1954
8. Matthieu P., et Tsongo Mafikiri A., "Guerres paysannes au
Nord-Kivu (République démocratique du Congo)
9. M’BUZE MOMI Jambonews.net
10. Merton R., K, Element de théorie et de méthode
sociologique, Paris, éd. Gérard-Montfort, 1965.
11. Roche, J.J, "Théories des relations internationales
Montchrestien", Paris ,2006
12. Tallon, F, "Données de base sur la population : Rwanda",
CEPED, décembre 1991.
13. www.er.uqam.ca/nobel/m200550/explication.htm
14. www.statistiques_mondiales.com/rwand
15. www.syfia.info/index.php 5?
16. www. pole.institute.org/documents
103
L’ATTITUDE DE QUELQUES EGLISES LOCALES FACE A
LA SECESSION KATANGAISE DE 1960 A 1963.
KASONDE Kyawama K. Germain*
0. Introduction
Le présent article porte sur l’attitude de quelques églises
locales face à la sécession katangaise. Il s’agit notamment de l’Eglise
catholique, l’Eglise protestante (Méthodiste) et la Communauté juive.
Comme on le voit, l’Eglise Orthodoxe et Kimbanguiste ne seront pas
prises en compte par notre article. Ce choix est purement subjectif.
1. L’Eglise Catholique face à la sécession katangaise
Il est à rappeler que la pénétration de l’église catholique
romaine dans le Haut-Katanga industriel date du 29 septembre 1910
avec Monseigneur Jean-Félix de Hemptinne. Ce dernier fit plusieurs
différentes interventions pour éclairer la politique congolaise
coloniale en général et katangaise en particulier. Malheureusement,
Monseigneur Jean-Félix de Hemptinne trouva la mort le 06 février
1958 deux ans avant l’indépendance du Congo le 30 juin 1960 et
celle du Katanga le 11 juillet 1960.
Cette église catholique du Katanga, alors Préfecture
apostolique deviendra le Vicariat apostolique en 1932. En 1958,
Monseigneur Cornelis, alors Curé de la paroisse Saint-Jean de la
Kamalondo, en fut promu Vicaire Délégué à peine quelques jours
avant la disparition de Monseigneur Jean-Félix de Hemptinne.
Monseigneur Joseph Floribert Cornelis est né à Gand le 6 octobre
1910. Il sera ordonné prêtre à Saint-André le 28 juillet 1935. Nommé
Vicaire délégué quelque jours, à peine, avant le décès de Mgr de
Hemptinne, il est ensuite sacré le 27 décembre 1958, par le Pape Jean
XXIII, comme évêque titulaire de Tunès avec pour devise « Recto-
104
Tramite »
1. C’est durant la retraite préparatoire à son sacre qu’il
médita sur la pastorale de Saint-Grégoire le Grand. Il en fut inspiré
de « Recto-Tramite » (par le chemin le plus droit).
Le 10 novembre 1959, à la veille de l’indépendance, le Saint-
Siège fixa la hiérarchie au Congo-belge, « le 17/11/1959, le vicaire
apostolique du Katanga devint le premier Archevêque
d’Elisabethville »2. Mgr Cornelis occupa le siège Métropolitain du
Katanga pendant huit ans, différemment de l’épiscopat de son
prédécesseur, en ce qui concerne les réactions socio-politiques. Il se
préoccupa beaucoup de doter son diocèse d’une organisation solide et
stable en vue de l’accession de l’Eglise locale à sa pleine maturité.
« Il fut aussi l’Evêque qui sut mener sa chrétienté d’une main sûre à
travers les remous de l’indépendance du pays et de la sécession
katangaise »3. Mgr Cornelis participa également au concile Vatican II
et s’était appliqué à en mettre en œuvre les orientations.
Durant sa charge épiscopale, Mgr Cornelis accomplit
plusieurs œuvres sociales, dont les plus remarquables sont les
suivantes:
Fondation de l’Institut Saint-Jérôme (I.S.P.) en 1959.
Transfert du Grand séminaire interdiocésain de
Baudouinville (Moba) à Lubumbashi ex Elisabethville, intervint en
1961 pour le Philosophat et en 1962 pour le Théologat.
Création de l’Institut des Sciences Religieuses et construction
du centre interdiocésain pour le Katanga à Elisabethville en 1963.
Acquisition du Domaine Marial à Elisabethville, en 1963.
Construction de l’Archevêché et agrandissement de la
procure diocésaine en 1963.
Transformation de l’habitation de Monseigneur Jean-Félix de
Hemptinne en procure diocésaine.
1 Esprit, Histoire et Perspective, Actes du colloque sur le centenaire de
l’évangélisation de l’Archidiocèse de Lubumbashi, MédiasPaul, 2010, p.37. 2 Mutombo Mwana, A., L’évangélisation de l’Archidiocèse de Lubumbashi (1910-
1986), p.16. 3 Katebula Kimbala, V., Op.cit. p.23.
105
Par ailleurs, il favorisa l’installation de plusieurs
congrégations religieuses masculines et féminines dans son diocèse.
L’église catholique fondée au Katanga était une église nationale
belge, au même titre que l’église catholique de Belgique, cependant
avec parfois plus d’avantage, et de privilèges que l’église
métropolitaine elle-même comme l’atteste encore l’abbé André
Mwansa : « Bien que désirées ou même appelées en Afrique par les
organes du gouvernement, les missions, catholiques belges sont
restées des institutions purement religieuses, indépendantes de toute
ingérence officielle et uniquement soucieuse de la promotion
intégrale des indigènes. Elles basèrent leur action religieuse
exclusivement sur le mandat que leur a confié le Saint-Siège. Elles
exploitaient aussi le principe de la collaboration voulue par le Roi,
dès le début de l’Etat Indépendant du Congo. Cette indépendance
mutuelle de l’Eglise et de l’Etat et cette franche collaboration entre
les Missions et le gouvernement constituent la caractéristique la plus
originales des missions catholiques au Congo »4.
De ce qui précède, il n’était pas aisé à l’église catholique du
Katanga de définir sa position vis-à-vis de l’indépendance
katangaise. Mais, elle s’aligna sur celle du gouvernement belge qui
avait refusé de reconnaître l’existence d’un Katanga distinct du
Congo. Monseigneur Cornelis fut l’opposant le plus farouche à toute
idée d’indépendance. Par contre, certains chrétiens catholiques
étaient acquis à la cause d’un Katanga libre et souverain. Plusieurs
d’entre eux assumèrent des postes importants au sein des institutions
katangaises sécessionnistes.
Selon l’opinion généralement répandue à cette époque,
« Monseigneur de Hemptinne, un bénédictin, aurait été un fervent
défenseur de la cause d’un Katanga distinct du Congo. Mais sa mort
avant l’indépendance du Katanga ne permet pas de confirmer ou
d’infirmer cette opinion.5
4 Mwansa André, Dynamique d’une pastorale d’ensemble axée sur la mission des
laïcs selon Vatican II. Essai d’application à l’histoire religieuse du Zaire, These,
Vol. II, Rome, 1978, pp.138-140. 5 Mr Mbenga Sandongo, Interview accordé le 28/02/2011.
106
Par ailleurs, il est connu que le choix de Leader pour la
direction de la Conakat se pencha sur Moïse Tshombe parce qu’il
était protestant libéral en lieu et place de Godefroid Munongo
(catholique) à cause de sa qualité d’agent administratif de la colonie
et de petit-fils du Roi M’siri assassiné par le capitaine Bodson de
l’expédition Stairs le 20/12/1891.
Pendant cette période, Mgr Cornelis ne pouvait pas soutenir
la sécession katangaise parce qu’il était lié à la politique belge. Aussi
son oncle Cornelis, Ministre de colonies, soutenait-il l’unité
congolaise parce que les Belges avaient des intérêts dans chaque
province du pays. Par contre, « L’homme de la sécession fut Edward
Kileshye qui avait failli même devenir l’Archevêque de Lubumbashi
pendant l’Etat indépendant du Katanga, n’eût été des enquêtes qui
révélèrent qu’il était Zambien dont les parents avaient tout
simplement habité Bunkeya »6. Pour revenir à Monsigneur Cornelis,
il est à signaler que dans sa lettre du 18 novembre 1960, à Monsieur
le directeur de la maison de presse " Il Quotidiano " de Rome, il
écrit : « Il n’est pas question pour l’église de prendre des options
politiques. C’est le rôle de la presse catholique »7. En effet, Mgr
Cornelis précise dans cette lettre ce qui suit :
Rome, ce 18 novembre 1960
A Monsieur le Directeur
"Il Quotidiano" ROME
Monsieur le Directeur,
A Rome depuis un mois et demi, j’ai été interrogé à diverses
reprises sur la situation du Congo. Je constate que le public italien
ignore tout du problème, en dehors du drame de Kindu.
Tout le monde semble ignorer que le vrai problème n’est pas
d’ordre politique mais bel et bien d’ordre idéologique. Or, il faudrait
que les chrétiens soient au courant et sachent de quoi il s’agit.
Il n’est pas question pour l’Eglise de prendre des options
politiques. C’est le rôle des laïcs et spécialement de la presse
6 Prof. Kalaba Mutabusha, Interview du 22/04/2011.
7 Archives sur le Katanga, Archidiocèse de Lubumbashi, Farde 1960-1961.
107
catholique. C’est pourquoi, je me permets de vous adresser, sous pli
séparé quelques documents que j’ai sous la main à Rome, dans
l’espoir qu’ils susciteront peut-être le désir d’une recherche plus
approfondie.
Dois-je préciser qu’il serait tout à fait inopportun de citer
mon nom dans votre journal.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma
considération très distinguée.
Jos. Flor. Cornelis
Archevêque d’Elisabethville
Adresse romaine :
Collegio San Anselmo-Aventino
lô Via di Porta Lavernale.
A en croire Monsieur Godefroid Kangala, « la sécession
katangaise avait séparé les prêtres du secteur rural et ceux des centres
urbains. Ceux du monde rural soutenaient la sécession par rapport à
leurs confrères du milieu urbain »8. Il va s’en suivre le massacre de
19 prêtres, un frère et de nombreux laïcs à Kongolo 1er janvier 1962
perpétré par les soldats Lumumbistes de la branche gizengiste qui
étaient contre la sécession.
En dépit de cela, l’église catholique du Katanga n’a jamais
condamné ni soutenir officiellement la sécession. Mais dans les
homélies, certains prêtres fustigeaient l’attitude de Lumumba à cause
de sa tendance communiste, doctrine qui était contraire au
catholicisme»9. Cette attitude de l’église catholique fut
compréhensible dans la mesure où elle ne pouvait pas aller à
l’encontre de la volonté de l’ONU. A ce sujet, Mgr. Michel Ngoya,
témoin vivant de la sécession déclare : « L’Archevêque de
Lubumbashi, Mgr. Cornelis, ne s’était pas engagé de quelque
manière que ce soit. Il avait délégué son Vicaire général Mgr Edward
8 Mr. Godefroid Kangala, Interview du 01/02/2011 (Cfr. Essor du Congo du
30/06/1960). 9 Mr. Donatien Mwitaba, Interview du 29/01/2011.
108
Kilesye pour tout contact avec les autorités katangaises. Mais celui-ci
joua le double jeu alors que l’église voulait demeurer neutre»10
.
Cependant, le gouvernement katangais de cette période avait
fait bénéficier à certains séminaristes des trois diocèses en
l’occurrence Kamina-Kolwezi, Elisabethville et Kalemie-Moba des
études en Europe. Hormis ces séminaristes, d’autres élèves tels que
Bernard Munongo, Nguz-A-Karl-I-Bond J., Maître Lumande…furent
également envoyés en Belgique pour la même cause. A cet effet, la
« maison de Louvain » fut acquise par le gouvernement katangais
pour les héberger»11
. Les abbés tels que C. Kiwila, E. Kabanga., E.
Kileshye bénéficieront de l’Etat katangais quelques actions au niveau
de la brasserie. Certains Abbés apportèrent leur contribution à la
population sinistrée par la guerre. C’est le cas de l’Abbé André
Mwansa qui parcourait même les champs de bataille en soutane pour
secourir les blessés. « Il était presque un aumônier militaire »12
. Il est
à noter que certains ministres pouvaient donner un coup de main dans
la catéchèse après leur service.»13
En 1961, eut lieu la première Assemblée après l’érection de
la hiérarchie au Congo et après l’indépendance du pays. Seuls les
évêques du Congo y siégèrent notamment Mgr Kimbondo de Kisantu
et Mgr Nkongolo de Lwebo. Vingt et un vicaires généraux, tous
congolais parmi lesquels il y avait 4 évêques auxiliaires Mgr Joseph
Malula de Léopoldville, Mgr Nzundu de Kikwit, Mgr Nzita de
Matadi, Mgr Nganga de Lisala, tous congolais, furent aussi
convoqués. Assistèrent également à cette assemblée le secrétaire
général et son adjoint ainsi que sept membres du comité des
supérieurs Majeurs des religieux. Cette assemblée avait revêtu un
caractère spécial parce que tenue à l’aube de l’indépendance et aussi
parce que le Pape Jean XXIII, venait de convoquer le concile Vatican
10 Mgr. Michel Ngoya, Interview du 29/01/2011
11 Mr. L’Abbé Charles Kiwila, interview du 27/01/2011.
12 Mr. L’Abbé Ildephonse Teta, interview du 07/02/2011.
13 Mr. L’Abbé Ildephonse Teta, Op.cit.
109
II pour l’année suivante et il fallait ainsi une large concertation au
niveau de chaque pays pour sa préparation.
Les actes de cette Assemblée traitèrent essentiellement des
problèmes sociaux, au moment où les Congolais s’efforçaient
d’affirmer leur indépendance. Le ton en était prophétique et anticipait
quelques points fondamentaux des déclarations du concile Vatican II.
Mais l’Assemblée ne tint pas compte des problèmes politiques. En
effet, elle ne dit rien de l’offensive Lumumbiste menée depuis
Kisangani sur Bukavu et le Katanga à partir de janvier 1961, ni de la
conférence de Tananarive qui tenta en mars de mettre fin à la
sécession katangaise, ni de celle de Coquilathville (Mbadaka) le mois
suivant, qui se solda par l’emprisonnement de Tshombe du 26 avril
au 22 juin, ni du gouvernement Adoula investi uniquement par le
Parlement le 2 août 1961 mais qui ne put établir son autorité sur le
Katanga. L’Assemblée ne condamna pas les adversaires du
gouvernement, elle ne soutint pas non plus le gouvernement»14
.
1. L’Eglise protestante (Méthodiste) dans la tourmente de la
sécession katangaise
Que retenir de cette église lorsque le Katanga proclamait son
indépendance ? Trois figures de proue retiennent notre attention. Il
s’agit de l’Evêque Méthodiste Booth, M. Janson Sendwe et de Moïse
Tshombe.
En effet, l’Evêque Booth était de la famille de John F.
Kennedy alors président des Etats-Unis élu en 1960. Pour le
président Kennedy, laisser le Katanga devenir indépendant, tout le
reste du Congo basculerait dans le camp du communisme. Voilà
pourquoi il s’opposa farouchement à l’indépendance du Katanga.
C’était la période de la guerre froide entre le bloc Est et le bloc Ouest
avec comme ténor le président des Etats-Unis. Mr Mbenga Sandongo
précise : « En réalité, l’administration américaine sous la présidence
14 Léon de Saint Moulin (S.J) et Gaise N’Ganzi, Op.cit., Eglise et Societé. Le
discours socio-politique de l’Eglise catholique du Congo (1956-1998), C.A.E.K,
F.C.K, 1998, p.65.
110
de John Kennedy souffrait de n’avoir pas eu la main mise sur l’Union
Minière du Haut-Katanga et les Katangais semble-t-il ne l’avaient
pas réalisé à temps,»15
.
Les relations de l’évêque Méthodiste Booth et Janson
Sendwe remontaient à l’histoire de la mort de Kanene, le fils de
l’Evêque dont Janson Sendwe devait protéger la tombe.
Les relations de l’évêque Booth avec d’autres Occidentaux
avaient semble-t-il amené Janson Sendwe à adhérer aux thèses
unitaristes. Par contre, bon nombre de fidèles méthodistes et d’autres
pasteurs étaient totalement pour l’indépendance du Katanga. A
Sandoa par exemple, les chrétiens avaient chassé le missionnaire
Kenneth Enrigth parce qu’il s’opposait à l’indépendance du Katanga
et soutenait l’évêque Booth. Il se refugia au lac Kafwankumba où il
fut encore chassé pendant la guerre de 80 jours en 1977»16
.
En ce qui concerne, Janson Sendwe, Méthodiste et Assistant
médical au service de la colonie, il se montrant favorable pour un
Congo-uni suite à l’influence aussi de Mgr l’Evêque Méthodiste
Booth. Il s’opposa à l’indépendance du Katanga et de ce fait il ne
pouvait se hisser à la présidence de la Conakat.
Quant à Moïse Tshombe, un fidele méthodiste, avait des
divergences profondes avec Janson Sendwe. Pourtant, tous deux
étaient des anciens élèves de la mission méthodiste de Kanene. En
définitive l’Eglise protestante Méthodiste ne fut pas non plus très
favorable à l’indépendance du Katanga et partant garda sa neutralité.
3. La Communauté Juive au secours de la sécession katangaise
L’action de la Communauté juive durant la sécession
katangaise est liée au talent du Grand Rabin Moïse Levy. En effet,
avec le pillage lié à l’indépendance du Congo et celle du Katanga, il
y a eu un marasme économique. Le 13 juillet, le Leader Katangais,
Moïse Tshombe invita Levy dans son cabinet et lui demanda sa
collaboration. Ce dernier intervint en sa faveur pour lui éviter la
15 Maître Mbenga Sandonga, Interview du 28/02/2011.
16 Maître Mbenga Sandonga, Op.cit.
111
faillite. Il fallait faire venir les juifs qui avaient fui en Rhodésie et les
indemniser. Une négociation s’engagea. Finalement, Tshombe
déclara que, dans un premier temps, « il remboursera 35% des dégâts
causés par les pillages »17
avec l’exigence des bilans de chaque
commerçant aux affaires économiques qui pourra établir les chiffres
de leurs pertes. Le Rabbin accepta les termes de cet accord.
Il y eut beaucoup d’autres interventions du Grand Rabin en
faveur du Katanga. En effet, l’intervention diplomatique par
exemple, révèle les talents du Grand Rabbin Moïse Levy, le chef de
la communauté juive. En effet, au mois d’avril 1961, un incident qui
aurait pu déboucher sur une catastrophe nécessita de nouveau son
intervention. Moïse Tshombe et son ministre des affaires étrangères,
Evariste Kimba, s’étaient rendus à Coquilathville pour y rencontrer
les membres du gouvernement de Léopoldville dans la perspective
d’un compromis entre l’Etat central et la province sécessionniste.
Mecontent de la tournure des négociations, Tshombe décida
subitement de quitter la conférence et de rentrer chez-lui. A son
départ, il s’expliqua devant la presse internationale : « Nous sommes
prêts à reprendre le dialogue mais, il faut tout recommencer, déclara-
t-il. Moi, je reste fidèle à l’esprit de Tananarive (où s’était tenue une
autre conférence), mais les membres du gouvernement de
Léopoldville ont tout démoli. Nous ne pouvons pas continuer à
travailler dans ces conditions… »18
.
Ces paroles provoquèrent la colère de la partie adverse et,
comme ils se rendaient à l’aéroport, le président Katangais et son
ministre furent entourés par une vingtaine de soldats en arme qui les
enfermèrent dans un local sans aucune possibilité de communiquer.
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. A
Elisabethville, le ministre de l’intérieur Godefroid Munongo
convoqua immédiatement le Rabbin Moïse Levy, l’ami de Moïse
Tshombe et lui confia la mission de le faire libérer. Ce qu’il accepta
volontiers. « Il envoya son message au Président de la République du
Congo, Kasa-Vubu ainsi qu’à chacun des membres de son
17 Milantia Bourla Errera, Op.cit., p.129.
18 Idem p.138
112
gouvernement dès que Munongo l’eut approuvé. Le président du
Katanga fut libéré grâce à l’appui apporté par les ministres Bomboko
et Bolikango, grands amis du Rabbin. Tshombe et Kimba reprirent
l’avion pour Elisabethville et la première chose que fit le président en
retrouvant son sol natal fut d’aller embrasser Moïse Levy, qui
l’attendait à l’aéroport »19
.
Les deux Moïse avaient beaucoup d’estime l’un pour l’autre
car au mois d’août de la même année Moïse Tshombe proposa à
Moïse Levy de laisser le Rabbinat et de travailler pour lui comme
conseiller à la présidence. Le rabbin refusa en estimant que cela
pourrait irriter le gouvernement central et nuire à ses co-
religionnaires de Léopoldville. Il accepta toutefois d’apporter son
aide de façon discrète. C’est ainsi qu’il fut envoyé par Tshombe en
mission en compagnie de Daniel Tshombe, le frère du président et du
ministre de l’agriculture du Katanga pour voir si Israël pouvait
soutenir et reconnaître officiellement l’Etat du Katanga qui n’était
reconnu par aucun état au monde. En Israël, « Moïse Levy obtint une
audience de Moshé Dayan alors ministre de l’agriculture. Ensuite, il
fut reçu par Golda Meir, ministre des affaires étrangères, qui lui dit
que son gouvernement suivait la politique des Etats-Unis et qu’ils ne
pouvaient reconnaître que le gouvernement central de Kinshasa »20
.
Ce qui prouve qu’Israël ne pouvait pas se démarquer de la
politique américaine en la matière. La mission connut donc un échec.
En 1961, Tshombe chargea son ami d’une autre mission
secrète en France. A Paris, Moïse Levy eut une entrevue avec
Shmitlein, sénateur et président des amis France-Israël, Arthur Conte,
président de l’assemblée européenne et André Marie, ancien ministre,
qui lui remirent un message d’encouragement pour Tshombe. « Mais
du côté du gouvernement, rien n’indiquait que la France pouvait
changer de politique en dépit de sa sympathie pour le président
katangais »21
.
19 Milantia, Op.cit, p.139
20 Ibidem
21 Idem, p.142.
113
Convaincu qu’il fallait aller plus loin, Moïse Tshombe
persuada Moïse Levy de se rendre à Washington pour y rencontrer le
président Kennedy. Devant tous les échecs, il voulut refuser. Mais
Samuel Hasson, président de la congrégation israélite le persuada
d’aller. Le Grand rabbin donna son accord à la mission diplomatique
et Tshombe le recommanda vivement.
A « Rome où Moïse Levy rencontra Monseigneur
Sigismondi dans le but d’obtenir le soutien du Vatican »22
. Mais son
éminence expliqua que la Maison Blanche s’opposait à
l’indépendance de la province Katangaise : elle devait choisir entre le
conseil de sécurité de l’ONU ou Moïse Tshombe et elle donnerait
évidemment la préférence à l’ONU. Pour les Américains, Tshombe
devait donc être écarté.
Qu’à cela ne tienne : « La mission doit être menée ! Moïse
Levy se rend en suite à Paris. Il est reçu par Arthur Conte, lequel lui
annonce qu’il part également pour les Etats-Unis et lui dit que
l’audience avec Kennedy est fixée à 11 heures, le lendemain. Ils
prennent l’avion ensemble et logent dans le même hôtel à
Washington. Juste avant l’audience, au dernier moment, on lui fait
savoir que le président est appelé par son frère Robert et c’est
Harriman qui reçoit le Grand Rabbin. Non, les Américains ne
peuvent pas reconnaître l’Etat katangais car ce serait s’opposer à la
décision du conseil de sécurité qui dit clairement que les frontières
coloniales doivent être maintenues. Le refus est poli mais sans appel.
Moïse est bien forcé d’admettre que la meilleure diplomatie a
ses limites. Mais Tshombe tente une ultime démarche. Il prie
Joachim Frenkiel, recteur de l’université d’Elisabethville,
d’intervenir à son tour auprès du gouvernement américain. Frenkiel
demanda au Grand Rabbin Levy une lettre d’introduction et de
recommandation pour le grand conseil rabbinique des Etats-Unis afin
qu’il use de son influence sur Kennedy, mais il n’obtint pas
davantage satisfaction »23
. Aucun Etat ne semblait, finalement,
vouloir avaliser l’indépendance du Katanga.
22 Milantia, Op.cit.142
23 Idem, p.143.
114
Conclusion
Quelle a été l’attitude des églises locales vis-à-vis de la
sécession katangaise ? Sinon l’attitude de la Belgique parce qu’elle
avait des intérêts dans toutes les provinces du Congo, celle de l’ONU
et des USA qui prônait l’unité congolaise.
Il n’était pas aisé à l’église catholique de définir sa position
vis-à-vis de l’indépendance katangaise. Mais elle se serait alignée sur
celle du gouvernement belge qui a refusé de reconnaître l’existence
d’un Katanga distinct de l’Etat du Congo et Monseigneur Cornelis fut
l’opposant le plus farouche à toute idée d’indépendance. Par contre
les chrétiens catholiques étaient acquis à la cause d’un Katanga libre
et souverain et plusieurs d’entre eux assumèrent des postes
importants au sein des institutions katangaises.
L’église méthodiste s’opposa farouchement à l’indépendance
du Katanga tandis que la communauté juive par le truchement de son
Rabbin Levi soutint la politique du gouvernement de Moise
Tshombe. Le rabbin fut même des interventions diplomatiques
auprès des grandes puissances pour demander la reconnaissance de
l’indépendance. La fin de la sécession a été voulue par le monde
entier et Colette Brackman de renchérir : « On pense à Bruxelles
pouvoir ainsi contribuer effectivement à la reconstruction de l’unité
congolaise, et on ne manque pas de faire valoir auprès de Tshombe
que se serait folie de s’obstiner dans une politique que désapprouve
le monde entier »55
.
55 Baeckman Col. et al, Congo 1960. Echec d’une décolonisation, André Versailles
éditeur-GRIP, 2010, p.95
115
Bibliographie
1. Ouvrages
« Afrique Rédaction/Actualité/ », 12/07/2010, in Le
Potentiel, p.2.
DE SAINT MOULIN LEON (s.j.) et Gaise N’ganzi, Eglise et
Société. Le discours socio-politique de l’Eglise catholique du
Congo (1956-1998). C.E.A.K, FCK, 1998.
Esprit, Histoire et Perspective, Actes du collogue sur le
centenaire de l’évangélisation de l’Archidiocèse de
Lubumbashi, MédiasPaul, 2010, p.37
LEKIME, F., « La mangeuse du cuivre, le salon de l’UMHK
de 1706-1966 », in Coll. Grand document, éd. Didier Hatier,
Bruxelles 1992, p.222.
Livre blanc du gouvernement katangais sur les événements
de septembre et décembre 1961, p.83.
MILANTIA BOURLA ERRERA, Moïse Levy Un Rabbin au
Congo (1937-1991), La longue vue, 2000, p.124.
MUTOMBO MWANA, A., L’évangélisation de
l’Archidiocèse de Lubumbashi (1910-1986), p.16.
NYEMBO SELEMANI, G., Témoignage sur les trois ans de
vie de l’Etat indépendant du Katanga et de la gendarmerie
Katangaise, Inédit, 2010.
2. Mémoires et thèses
Katebula Kimbala Véronique, Organisation et Activités de
l’archidiocèse de Lubumbashi (1960-1998), Mémoire,
(1997-1998), ISP Lubumbashi, p.23.
Mwansa André, Dynamique d’une pastorale d’ensemble axée
sur la mission des laïcs selon Vatican II. Essai d’application
à l’histoire religieuse du Zaire, Thèse, Vol. II, Rome, 1978,
pp.138-140.
116
3. Interviews
Kabamba Sambwa, Interview (G.K) du 28 septembre 1998 à
Lubumbashi
Maître Mbenga Sandonga, Interview du 28/02/2011.
Mgr. Michel Ngoya, Interview du 29/01/2011.
Mr Mbenga Sandongo, Interview accordé le 28/02/2011.
Mr. Donatien Mwitaba, Interview du 29/01/2011.
Mr. Godefroid Kangala, Interview du 01/02/2011 (Cfr. Essor
du Congo du 30/06/1960).
Mr. L’Abbé Charles Kiwila, interview du 27/01/2011.
Mr. L’Abbé Ildephonse Teta, interview du 07/02/2011.
Ndaya, L., Interview du 08/02/2011.
Père aDb 79 ans Etienne, interview du 08/02/2011.
Père aDb 76 ans Michel, interview du 08/02/2011.
Prof. Kalaba Mutabusha, Interview du 22/04/2011.
4. Archives
Archives sur le Katanga, Archidiocèse de Lubumbashi, Farde
1960-1961.
« Discours prononcé par son Excellence Moïse Tshombe,
Président du Katanga à l’Assemblée nationale le 7 septembre
1962», in Archives sur le Katanga, Archidiocèse de
Lubumbashi, 1960-1963.
5. Dictionnaires
Larousse classique illustré, Larousse, Paris, 1972
Petit Larousse illustré, Paris, 1981.
117
L’EDUCATION TRADITIONNELLE DES BEENA LULUWA
TSHISANDA Ntabala Mweny Emery*
0. Introduction
Les Beena Luluwa constituent aujourd’hui une des plus
importantes ethnies prolifiques du Kasaï Occidental en République
Démocratique du Congo. Ils habitent actuellement dans les territoires
de Kazumba, Dibaya, Demba, Tshikapa et Luebo. La région des
Beena Luluwa est située entre 4°30’ et 6°30’ de latitude Sud et entre
21° et 23° de longitude Est. Sa superficie totale est d’environ
34.350km2.
Au cours de leur histoire, les Beena Luluwa ont été désignés
ou ils se sont désignés eux-mêmes sous diverses appellations :
Baluba, Bapemba (Bahemba, Bafemba), Bashilange (Baschilonges,
Tuschilanges), Beena Diamba (Bena Diamba, Bena Riambo, Bena
Diambo), Bena Moyo et enfin Beena Luluwa (Bena Lulua, Bena
Luluwa, Luluwa, Lulua, Baluluwa, Balulua).1
Pas de société sans éducation. L’éducation est inhérente à la
vie de tout groupe social qui, par cette transmission de sa culture, lui
assure les conditions de sa perpétuation et survit aux individus qui le
constituent.
L’éducation est définie par l’UNESCO en ces termes :
« l’Education recouvre des activités qui ont pour fin de développer
les connaissances, les valeurs morales et les modes d’intelligence
dont l’individu a besoin en toutes circonstances de sa vie. Elle a
comme objectifs de développer les aptitudes et les compétences
* Professeur Associé à l’Université de Lubumbashi 1Pour plus d’informations sur ces différentes appellations, le lecteur peut consulter
les auteurs ci-dessous : -Van BULCK, Les recherches linguistiques au Congo,
Bruxelles, 1948, Mém., in-8°, I.R.C.B., Section Sci. Mor. et Pol., XVI. –VAN
ZANDIJCKE, A., Pages d’histoire du Kasaï, Namur, Collection Lavigerie, Grands-
Lacs, 1953, -WAFUANA KUTAMBI K.M., Emery, L’Epopée de Kalamba
Mukenge, Naissance du peuple Lulua, 2002, Tournai, Institut Don Bosco, 2002.
118
d’ordre physique, intellectuel, moral et social qui permettent aux
enfants, aux adolescents et aux adultes de trouver leur place dans la
société où ils vivent et de se réaliser dans les différentes dimensions
de leur personnalité ».2
Cet article se propose d’étudier la conception et la pratique
de l’éducation ancienne en milieu ethnique traditionnelle des Beena
Luluwa du Kasaï Occidental. En fait, nul ne l’ignore, l’éducation
demeure un fait social légitime pour toute société consciente de sa
perpétuation. De ce fait, l’enfant occupe une place prépondérante
dans la mentalité des Beena Luluwa et tous les soins sont pris pour
assurer non seulement une bonne croissance à l’enfant mais aussi
pour le doter d’une forte personnalité par une éducation qui se veut
intégrale.
Le lecteur trouvera dans les lignes qui suivent les grandes
étapes du cycle éducatif et les principes éducatifs sous-jacents à
chaque étape conformément aux types d’homme et de femme
attendus dans et par la société luluwa ancienne. Il s’agira donc ici de
retracer tout simplement de manière synthétique les principes
directeurs de l’éducation de base, commune à tous les enfants luluwa
et transmise dans un cadre beaucoup plus vaste.
Nous présenterons d’abord la conception de l’enfant dans la
société luluwa traditionnelle et ensuite nous passerons en revue les
différentes étapes du cycle éducatif ainsi que les principes éducatifs y
afférents. Une petite conclusion résumera les éléments importants à
retenir sur l’éducation ancienne des Beena Luluwa.
1. L’enfant dans la société luluwa ancienne
Dans ce paragraphe, nous essayons de répondre aux
questions suivantes : Qu’est-ce qu’un enfant aux yeux des Beena
Luluwa ? Qui est l’enfant dans la société luluwa ancienne ?
Comment le percevait-elle, le concevait-elle, que voyait-elle en lui ?
Chaque groupe ethnique a sa manière propre de voir l’enfant
d’homme, de le traiter, d’envisager ce qui a trait à son éducation et à
2 ANONYME, Terminologie de l’éducation des adultes, Paris Ed. IBEDATA, 1979,
p.112.
119
son intégration sociale. Etre c’est vivre. Une force vitale semblable à
celle de l’homme anime chaque objet : depuis Dieu jusqu’au grain de
sable, l’univers négro-africain est sans couture. L’être force vitale est
en liaison nécessaire avec d’autres forces, s’il veut croître et non
dépérir ; il est inséré dans une hiérarchie dynamique où tout est
solidaire. Nous sommes ainsi introduits dans un univers de
correspondances, d’analogies, d’harmonies, d’interactions. Homme
et cosmos constituent un même réseau de forces, leur saisie
intellectuelle est identique. Les correspondances analogiques ne sont
pas seulement valables au niveau de la pensée, mais aussi de l’action.
Les rapports sont dynamiques, porteurs de force et d’influence, et on
en attend une efficience. L’univers africain, a-t-on dit, est comme une
toile d’araignée : on ne peut toucher au moindre de ses éléments sans
faire vibrer l’ensemble ; tout est relié et solidaire : tout concourt à
former une unité. L’homme y occupe cependant une place à part, il
en est le centre et tout converge vers lui.
Parler donc de l’enfant et de son éducation en soi, en tant
qu’objet séparé d’étude ou d’action, n’a donc pas de sens dans une
pareille vision du monde. Il faut le situer dans ce cosmos, voir à quoi
il se relie, ce qui agit sur lui et ce sur quoi il agit. Homme, il
récapitule en quelque sorte cet univers, lui sert de modèle, concentre
l’ensemble des présences et des influences. S’interroger sur l’être
profond de l’enfant et les modifications ontologiques qui surviennent
au cours de son développement, le situer dans cet univers qui
l’entoure et avec lequel il établit des correspondances multiples,
telles nous semblent être deux directions essentielles de la réflexion
luluwa sur l’enfant. Un enfant, s’il faut définir le concept, est un être
qui croit alors que chez l’adulte taille et forme sont achevées ; il a en
lui comme une force progressive qui ébauche déjà le « je » futur ; il
est un élan, un mouvement en avant, l’adulte en volonté bien plus
qu’en puissance. Il se trouve écarté, par la force des choses, des
travaux réels, du monde sérieux des grands, et pourtant il cherche à
s’y insérer de son mieux. L’enfance se définit ainsi comme une
plénitude de projets, une audace, un départ vers de multiples
horizons. L’enfant, selon Jean CHATEAU, c’est l’être et le seul être
qui vive par-delà lui-même… Disons même que l’homme ne vaut
120
jamais que par ce peu d’enfance qu’il conserve par devers lui comme
son plus précieux trésor.3
Fidèles à l’ensemble de la culture négro-africaine, les Beena
Luluwa ont une très haute idée de l’enfant. Leur croyance dans la
transcendance éclaire et renforce leurs convictions sur l’ascendance
et la descendance qui déterminent le lignage par lequel se perpétue
l’espèce humaine à travers la famille, le lignage, le clan, la chefferie,
l’ethnie.
La société luluwa est patrilinéaire. Chaque individu doit
descendre de quelqu’un, génétiquement ou légalement. La légitimité
d’un enfant dans une famille s’établit par rapport au droit qu’un
homme a sur la mère de cet enfant dont il est coutumièrement le père.
Ainsi, la paternité correspondait moins à la question : de qui est
l’enfant qu’à celle plus réglementaire : à qui est l’enfant ? Comme
dans toutes les sociétés lignagères d’Afrique noire, où les enfants
sont la principale source de richesse et de prestige, les enfants sont
souvent désirés par les Beena Luluwa. La stérilité constitue une
véritable catastrophe et les pratiques abortives sont inconnues des
Beena Luluwa.
L’enfant était donc un apport si précieux qu’on était toujours
prêt à le recevoir, à le revendiquer et à le garder. Déjà à l’étape de la
grossesse, tous les soins et stratégies étaient mis en place pour
protéger le fœtus ainsi que la femme enceinte.4 Mourir sans enfant
représentait la pire des calamités, car une descendance mâle s’avérait
indispensable à la perpétuation du lignage ancestral. La tradition en
reconnaît la nécessité par ce proverbe : « Bakulela walela biebe,
nansha ka mutu mampakashi », ce qui veut dire : « Tu as été
engendré. Tu dois aussi engendrer même un enfant à la tête
difforme ». Nous trouvons presque le même proverbe chez le Basaa
3 CHATEAU, Jean, « Qu’est- ce qu’un enfant ? », in : Psychologie de l’enfant, de la
naissance. Cahiers de Pédagogie moderne, Bourrelier, Paris, 1959. 4 Lire DIAMBILA, LUBOYA Albert, De la conservation du bukolè-santé du couple
Mère/Enfant dans la société africaine en mutation. Une contribution à l’étude des
stratégies de gestion de la santé chez les Beena Luluwa, Thèse de doctorat en
Anthropologie, Université de Lubumbashi, Faculté des Sciences Sociales,
Administratives et Politiques, Département de Sociologie et Anthropologie, Année
Académique 1996-1997, pp. 135-212.
121
du Cameroun qui disent : « De même que ton père t’a laissé, de
même tu dois laisser quelqu’un après toi » ou encore « Un fils (dans
une famille) est comme une pièce maîtresse d’un fusil pour
éléphant ! ».5
La société luluwa ancienne distinguait les catégories
suivantes d’enfants :
- Bana balela : enfants légitimes
- Bana ba pashi : enfants bâtards
- Bana ba bamfumu : enfants des chefs
- Bana ba musoko : enfants d’hommes libres du
village
- Bana ba bapika : enfants des esclaves
- Bana ba mapanga : enfants nés dans des
circonstances particulières
- Bana banshiye : les orphelins
- Bana ba cilengulengu : les enfants monstres
Les Beena Luluwa distinguent les enfants anormaux
(monstres ou difformes), les enfants particuliers et les enfants
normaux ou ordinaires. Les anormaux étaient considérés comme
signe de mauvais augure, comme l’incarnation de mauvais génies et
comme une malédiction « Mwana wa cidika ou bana ba bidika »ou
encore « Cilengulengu ». On les supprimait tout de suite en leur
faisant boire de l’eau et du natron et on les enterrait loin de la maison
avec des malédictions et interdiction de revenir sur terre. Les Beena
Luluwa croient fermement à la réincarnation des esprits des morts.
Voyons à présent les grandes étapes du cycle éducatif chez les Beena
Luluwa.
5 NJAMI-NWANDI, Simon BOLIVAR, « L’éducation traditionnelle bassa », in :
SANTERRE, Renaud et MERCIER-TREMBLAY, Céline (Sous la direction de), La
Quête du savoir. Essais pour une anthropologie de l’éducation camerounaise,
Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1982, p. 277.
122
2. Les grandes étapes du cycle éducatif et les principes éducatifs
sous-jacents à chaque étape
Toujours liée à l’action, l’éducation traditionnelle luluwa
présente l’avantage d’être permanente. Nul barrage ne s’oppose à
l’étude qui ne souffre d’aucune limitation.
Elle se déroule dans la société, avec la participation de toute
la collectivité de telle sorte qu’elle demeure gratuite, populaire et
démocratique. Cette éducation couvre pratiquement toutes les phases
sinon tous les éléments principaux de vie d’un individu depuis la
conception jusqu’à la vieillesse et à la mort. Nous nous proposons,
dans ce deuxième point de donner un aperçu plus ou moins complet
de grandes étapes et des principes éducatifs majeurs sous-jacents à
chaque étape. Nous parlerons d’abord du tronc commun de
l’éducation, et ensuite de l’éducation spécifique des garçons et enfin
de l’éducation des filles.
2.1 Tronc commun de l’éducation : de la grossesse à l’âge de
raison
En dépit de certaines particularités dues aux circonstances de
naissance et de la dation du nom, il est possible de dégager des
grandes lignes directrices de l’éducation mixte ou de tronc commun ;
elle se donne depuis la conception jusqu'à l’âge de raison.
2.1.1 La grossesse (Dimi, difu dia mwana)
La raison d’être du mariage chez le Beena Luluwa à l’instar
d’autres groupes ethniques du Congo et de l’Afrique noire, est la
perpétuation de l’espèce humaine par la procréation. Ainsi, à
l’exception de la mort, le plus grand malheur qui puisse arriver à un
Mwena Luluwa est sans aucun doute l’infortune dans la procréation :
ne pas avoir d’enfants ou se les voir enlever par la maladie et la mort
commande ipso facto un revirement dans la conduite sociale des
conjoints, l’adoption d’un nouveau type de comportement. Etre privé
d’une descendance, c’est se sentir « humilié » aux yeux du monde ;
« humilié » parce que les deux conjoints ses croient « diminués »,
123
inférieurs aux autres personnes qui connaissent les joies de la
paternité et de la maternité.
Devant une telle situation de stérilité du couple, non
seulement le couple en question mais aussi les membres de deux
familles des conjoints mettent toutes les batteries en marche en vue
de trouver une issue heureuse dans la vie du couple infortuné. On
s’adressera alors à Dieu, aux ancêtres, aux devins et aux féticheurs
pour provoquer et maintenir des naissances d’enfants tant désirés.
Les enfants, don gratuit de Dieu, quel que soit le moyen
utilisé pour les engendrer, sont seulement considérés comme la plus
grande forme de richesse qui soit chez les Beena Luluwa.6
C’est pourquoi les Beena Luluwa mettront au point toutes les
stratégies possibles pour provoquer une grossesse dans le mariage.
En effet, la femme enceinte jouit d’un statut tout à fait particulier.
Elle est considérée comme une personne sacrée, vivant en dehors des
relations normales et communiquant incessamment, par le
truchement du fruit qu’elle porte, avec les forces invisibles. Tant que
la grossesse ne s’est pas encore manifestée ouvertement au grand
public, personne ne peut en parler ni y faire même allusion. Il est
interdit à quiconque d’oser regarder le corps de la femme enceinte à
ce stade de gestation, d’une façon effrontée ou intriguée. Tout
accident, en effet, mettant en péril la mère ou l’enfant risque d’être
imputé à cet imprudent. C’est l’une des raisons qui expliquent
l’empressement avec lequel on consulte le féticheur ou la sage-
femme afin de procéder sans tarder au rituel de « mubangu »,
autrement appelé « kubanga difu » c'est-à-dire « couvrir » ou
« cacher » le nouvel être à venir, le soustraire dès le sein de sa mère
aux influences maléfiques.7
6 Quelques proverbes traduisent cette soif intense d’avoir des enfants : « Kulela
nkwabanya mesu » qui veut dire « Avoir des enfants c’est multiplier les possibilités
d’avoir ce que l’on désire, c’est multiplier les potentialités d’une bonne vie » ;
« Balela, walela biebe, nansha kamutu mampakashi, nansha ka mutu dibungu » c'est-
à-dire « Tu as été engendré, engendre toi aussi, même un enfant macrocéphale ou
malingre » ; « Kuatshila mwana mpasu, pakolaye ne akukuatshile biebe » signifiant
« Attrape une sauterelle pour ton enfant, à ta vieillesse, il fera autant en ta faveur ». 7 TSHIBWABWA. Mukuku, Relations sociales autour de la nourriture de base chez
les Beena Luluwa, Mémoire de License en Anthropologie, Université Nationale du
124
Par courtoisie, les Beena Luluwa recourent généralement à
un style métaphorique pour signifier qu’une femme est enceinte. On
dira, en effet, qu’elle est « kûlu » c'est-à-dire qu’elle haut
perchée, haut placée. L’expression métaphorique « kwikala kûlu
kule » signifie « être enceinte », « avoir une grossesse », « attendre
famille ». Cette métaphore trouve son sens profond dans le fait que la
conception est comparée à une montée et que l’accouchement est
comparable à une descente ; c’est une question de vie ou de mort.
Ainsi, pour dire avec courtoisie « qu’elle a accouché », les Beena
Luluwa diront « wakutuluka » c'est-à-dire qu’elle est descendue ou
elle a accouché.
Cependant, quant la grossesse atteint un certain âge et qu’il
n’y ait plus de raison de la cacher, la femme enceinte est appelée
dans les relations de plaisanterie, « mwa kadi munda », ce qui veut
dire « mère de celui (celle) qui se cache dans le sein ». Dès que tous
les symptômes de la grossesse se révèlent au grand jour, les Beena
Luluwa prennent toutes les précautions nécessaires pour protéger
cette grossesse afin d’éviter l’avortement ou la fausse-couche et
aboutir à un bon accouchement. Les soins qui entourent la grossesse
sont assurés à travers les rituels dits « mubangu » et « cisaba » qui
imposent à la femme enceinte des interdits « bishila » à respecter
scrupuleusement et des tabous « mikiya » à éviter aussi
scrupuleusement.
2.1.1.1 Le rite de « mubangu » et de « cisaba »
La grossesse se traduit par deux concepts différents : « difu »
et « dimi ». Le concept « difu » est ambigu parce qu’il signifie à la
fois ventre, abdomen ou la grossesse. C’est un terme d’usage courant.
Mais le terme le plus approprié pour désigner une grossesse reste
celui de « dimi » qui dérive du verbe « kwimita », c'est-à-dire
‘’concevoir’’, ‘’tomber enceinte’’. Ainsi, pour dire par exemple
qu’une femme est enceinte, on dira en ciluba : « udi ne dimi » tout
comme on peut dire : « udi ne difu ».
Zaïre, Campus de Lubumbashi, Faculté des Sciences Sociales, Politiques et
Administratives, 1974, p.57.
125
Les Beena Luluwa établissent une nette différence entre les
manières dont une femme conçoit. Les circonstances de la conception
déterminent l’intensité de l’attention et des soins préventifs à
accorder à la grossesse qui est considérée soit comme une grossesse
normale ou ordinaire soit comme une grossesse circonstancielle. La
grossesse normale est celle qui se forme sans poser des problèmes
particuliers et qui évolue normalement jusqu’à l’accouchement sans
risque. La grossesse circonstancielle est celle qui se forme dans les
circonstances particulières, par exemple la conception de Ntumba wa
kuulu ou Cibola.8 Mais, d’une manière générale, toute grossesse est
entourée de soins particuliers par mesure de prudence tout
simplement parce qu’une grossesse est toujours considérée comme
un mystère. Voilà pourquoi les rites de « mubangu » et de « cisaba »
et tous les interdits et tabous qui les entourent, interviennent
pratiquement à toute grossesse, qu’elle soit normale ou
circonstancielle.
Qu’est-ce que donc le rituel de « mubangu » ? Le concept
« mubangu » vient du verbe « kubanga » qui signifie protéger,
entourer de soins. Parfois, on parle aussi de « kukwata difu » c'est-à-
dire « couvrir » ou « cacher » le nouvel être à venir, le soustraire dès
le sein de sa mère aux influences maléfiques comme nous l’avons
déjà dit.
Le « mubangu » consiste à faire porter aux hanches de la
future mère une sorte de cordelette tressée de raphia (cipia) ou encore
un morceau de tissu (mukaba) que les femmes portent aux hanches
pour soutenir leurs pagnes ou leur cache sexe. Cette ceinture est
pourvue d’ingrédients magiques. Ces ingrédients varient d’un
« nganga » ou initiateur (initiatrice) à l’autre et de la nature même de
la grossesse. La ceinture peut contenir un certain nombre de nœuds
correspondant au nombre de mois prévus pour l’accouchement.
La ceinture magique ou fétiche est un symbole. Autant elle
lie les vêtements au corps, autant les vêtements tombent dès qu’elle
8 Pour plus de détails sur ces deux cas, on peut lire TSHISANDA NTABALA-
Mweny, Le thème de la maternité dans l’art luluwa du Kasaï, Mémoire de Licence
en Histoire, Université Nationale du Zaïre, Campus de Lubumbashi, Faculté des
Lettres, 1974.
126
se dénoue, autant également, par analogie, cette ceinture de
« mubangu » fait tenir l’enfant dans le sein maternel jusqu’à
l’accouchement.
Parfois le « mubangu » est façonné dans une petite corne
d’antilope remplie d’ingrédients magiques attachées à une cordelette
de raphia tressée et que la femme enceinte portera au hanche, au cou
ou en bandoulière.
Le « Mubangu » sécurise et protège la grossesse et permet
d’aboutir à un accouchement normal et sens risque. Toute mauvaise
influence extérieure susceptible d’entraver l’évolution normale de la
grossesse s’en trouve écartée et même neutralisée.
Un deuxième rituel de sécurisation et de protection de la
grossesse est appelé « cisaba ». Le « cisaba » est une sorte d’écuelle
en terre cuite ou en calebasse dans laquelle on conserve de l’eau pour
le bain de la femme enceinte ou pour la toilette du bébé. Cette eau est
mélangée à toutes sortes des feuilles, racines, sciures qui sont censées
procurer bonne santé et protection de la femme enceinte ou du
nouveau-né après accouchement.
L’efficacité de « mubangu » et « cisaba » tient non seulement
aux gestes symboliques, mais aussi et surtout à l’observance
rigoureuse des interdits et des tabous. Parmi ces derniers, il y en a qui
sont d’ordre alimentaire tandis que d’autres relèvent du
comportement social spécial auquel doit se conformer la femme
enceinte. Signalons que les registres d’interdits et de tabous
dépendent de chaque initiatrice et du cas particulier de la conception.
Cependant, certains interdits peuvent être passés outre par l’initiatrice
moyennant payement compensatoire. La femme enceinte incapable
de se conformer à un interdit ou à un tabou devra payer à l’initiatrice
un bien matériel ou verser un montant en argent pour être dispensée
de l’observance dudit interdit. Dans ce cas, l’initiatrice présente une
paille sèche ou un bâtonnet sec à la femme enceinte et les deux
coupent cette paille ou ce bâtonnet qu’elles tiennent chacune entre le
pouce et l’index. Cela s’appelle « kukosa kaci ». Ce geste annule
ainsi l’obligation de respecter un interdit ou un tabou déterminé.
Néanmoins, il n’est pas inutile de signaler qu’il existe de grands
interdits et tabous qui ne peuvent souffrir d’aucune annulation et qui
doivent à tout prix être respectés.
127
2.1.1.2 Les interdits et les tabous liés à la grossesse
D’une manière générale, chez les Beena Luluwa, une femme
enceinte est soumise aux interdits alimentaires dont les principaux
sont les suivants9 :
- interdiction de consommer la viande de porc (ngulube). Le
porc met bas difficilement et péniblement. La consommation de sa
chair par une femme enceinte est préjudiciable et néfaste pour elle car
cette consommation risque d’entraîner un accouchement pénible et
difficile et qui traînerait en longueur, assimilé, à cause de ses
grognements, aux derniers efforts de respiration déployés par les
moribonds avant de rendre l’âme. Le porc est considéré comme
l’incarnation de mauvais esprits et ne peut donc pas être mangé
surtout par les femmes. Soulignons que les Beena Luluwa ne
connaissent pas l’anthropophagie. Pour la même raison, la femme
enceinte ne peut pas consommer la viande de l’oryctérope (nshibu) ;
- interdiction de consommer la viande de singe (nkima, ncima)
pour la simple raison que l’enfant à naître risque de ressembler au
singe et d’acquérir ses caprices et turbulences ;
- interdiction de consommer les œufs (mayi, makela) car
l’enfant risque de naître chauve ou sans chevelure ;
- interdiction de consommer certaines volailles ; le hibou
(cipungulu), oiseau, porte-malheur, incarnation des forces occultes,
incarnation des sorciers, « nyunyu wa beena mupongo, oiseau sorcier
ou oiseau des sorciers ; le corbeau (cikololo), oiseau charognard,
censé accompagner les morts à leur dernière demeure ;
9 Pour en savoir plus, on peut lire : -KABASU, NTUMBA Moussim, Le fondement
moral des interdits africains : Cas de Luluwa. Une approche analytique, Mémoire
de Licence en Philosophie, Université de Lubumbashi, Faculté des Lettres, Juillet
1987, p. 37.
-TSHIMBOMBO, Mudiba Petrus, La famille Bantu-Luluwa et le développement,
Rome, 1975, pp. 162-167.
128
- interdiction de consommer certains reptiles notamment le
serpent (nyoka). Sa consommation provoque de fausses couches ou
des enfants difformes ;
- interdiction de manger la viande d’un animal trouvé mort ; de
boire des liquides amers qui provoqueraient l’avortement. Nous ne le
dirons jamais assez, les interdits alimentaires et même les tabous
dépendent de la nature de la grossesse et de la volonté de l’initiatrice
qui les imposent. Ils sont nombreux et diversifiés. Ils touchent même
à la consommation de certains légumes locaux.000000
La femme enceinte liée au rituel de « Cibola » ne peut pas
manger les poissons frais pris le même jour, la viande du gibier
abattu le même jour, la viande de la perdrix ni celle de diverses
antilopes. Elle doit prendre ses repas seule ou avec son mari la
journée avant le coucher du soleil. La nuit, elle ne peut ni manger, ni
boire ni se promener. Il lui est interdit de pleurer les morts, de se
rendre au lieu de deuil et au cimetière. Le rituel de Cibola concerne
les femmes qui perdent les enfants en bas-âge ou qui font des
avortements ou des fausses-couches répétés.10
En ce qui concerne les tabous, les plus importants sont les
suivants. Une femme enceinte doit s’abstenir de tout commerce
charnel avec une tierce personne. Les rapports sexuels avec son mari
sont interrompus aux sixième et septième mois de la grossesse et ne
reprendront, en principe, qu’après le sevrage. La femme enceinte est
frappée d’interdiction de se rendre au marché et de voir un cadavre.
L’explication donnée à ces derniers tabous est que l’enfant qui est
dans le sein de sa mère peut communiquer facilement avec les esprits
de morts. Un esprit malveillant peut rappeler cet enfant dans la
demeure de défunts en le trompant d’une manière ou d’une autre, le
persuadant des souffrances qui attendent cet enfant sur la terre des
vivants si jamais il s’entêtait à naître. Certains avortements et fausses
couches sont interprétés de cette manière par les Beena Luluwa.
Au cours de la grossesse, la pratique la plus courante de
prévention et de protection de la grossesse est l’utilisation de certains
10 TSHISANDA NTABALA-MWENY, Op. cit., p.68.
129
produits alimentaires spéciaux que les Beena Luluwa appellent
« myanya ». Qu’est-ce à dire ?
2.1.1.3 Les « myanya »
« Mwanya » au singulier et « myanya » au pluriel viennent
du verbe « kwanyika » : sécher et les « Myanya » sont des feuilles ou
légumes séchés, des écorces pressées et moulues, des racines de
certaines plantes, cueillies dans la forêt, dans la savane ou au village
dans les jardins potagers, qui sont coupées en petits morceaux ou
pulvérisées et que la femme enceinte doit consommer durant la
grossesse.
Les « myanya » sont préparés soit sous forme de légumes
soit sous forme de sciures dans un pot spécial en terre cuite ou sur
une houe non encore utilisée. Ils sont mâchés et avalés ou léchés et
avalés. Ils sont mélangés à l’huile de palme et au sel indigène ou sel
végétal. Les « myanya » sont consommés d’une manière plus ou
moins cérémoniale. On les consomme soit avec les doigts, soit avec
une pastule, un couteau ou un bâtonnet dans une position debout,
assise, accroupie ou à genou à des moments bien déterminés de la
journée ou de la nuit.
Précisant l’apport des « myanya » aux soins apportés à la
grossesse, Albert DIAMBILA Luboya écrit : « Pendant les trois mois
de grossesse, leur consommation favorise la croissance du fœtus et
prévient l’avortement. Ils serviraient également à corriger la
mauvaise position éventuelle du fœtus, à augmenter la « quantité de
sang » chez la mère, à empêcher les malaises abdominaux, etc. Les
propriétés de ces feuilles et de ces racines sont multiples. Les
« myanya » sont au centre d’une véritable science gynécologique
traditionnelle chez les Beena Luluwa.11
Après tous les soins assurés à
la grossesse et à la femme enceinte, qu’arrive-t-il à l’accouchement ?
11DIAMBILA, LUBOYA Albert, Op. cit., p. 149.
130
2.1.1.4 L’accouchement
L’accouchement se fait à un endroit caché soit dans la case
soit sous la véranda soit encore en brousse, en-dessous d’un arbre,
non loin de la case de résidence de la parturiente. Celle-ci accouche
assise, soutenue par une sage-femme qui la soutient par derrière.
Une autre sage-femme aidée de quelques femmes âgées de
l’entourage encouragent la parturiente à pousser fort pour permettre à
l’enfant de sortir. Si elle ne parvient pas à expulser l’enfant dehors,
la femme est d’abord encouragée par l’assistance en vue de faire de
son mieux pour la sortie de l’enfant. Mais si on constate qu’elle est
trop faible et n’a pas assez de souffle, on l’insulte parfois et on lui
enfonce une pastule (mutengu) dans la bouche afin de l’obliger à
expulser l’enfant dehors.
Très souvent durant le dernier mois de la grossesse, avant
l’accouchement, la femme utilise des remèdes et consomme certains
légumes comme le gombo, sorte d’oseille, afin de préparer la voie
vaginale à l’expulsion facile de l’enfant. Si, toutefois la femme
n’arrive pas à s’en sortir, les accoucheuses la soupçonnent d’avoir
commis l’adultère ou d’avoir transgressé certains tabous pendant le
mariage. Elle est alors soumise à un interrogatoire sévère et doit
passer aux aveux ou à une confession publique. Cette confession
consistera à nommer à haute voix tous ceux avec qui elle se serait
méconduite ou à déclarer un forfait quelconque commis dans sa vie
de mariage. En cas d’adultère, dans le cas où elle ne saurait se
rappeler tous ses amants ou si elle tient à taire certains noms, elle
présentera une quantité de grains de maïs ou de millet et la présentera
pour signifier qu’elle est coupable d’adultère avec beaucoup de gens.
En principe, après cette confession, la parturiente se tire bien
d’affaire en accouchant normalement.
Avant la colonisation, le cordon ombilical était coupé à l’aide
d’une herbe tranchante ou avec un couteau en fer. Avec la
colonisation, on utilise une lame de rasoir. Le cordon ombilical est
bien gardé et sera plus tard enfoui dans le sol avec cérémonie selon
qu’il s’agira d’un accouchement normal ou de la naissance d’un
enfant « déviant » c’est-à-dire « mwana wa bupanga ». Le cordon
ombilical est censé représenter l’enfant selon les Beena Luluwa. Le
131
placenta, « nkishi wa bende », est enterré à côté de la case
conjugale. Dés lors, la mère et l’enfant sont lavés et font l’objet de
soins spéciaux d’hygiène, d’alimentation et de protection.12
2.1.2 De la naissance à la marche
Dès sa naissance, l’enfant reçoit un nom. Ce nom est
déterminé par les circonstances de conception et de naissance. Un fait
important à signaler est l’assistance de la nouvelle mère. Les Beena
Luluwa parlent de « dikola ». La nouvelle mère est appelée
« mufyele ». A elle seule, surtout quand il est question du premier
accouchement ou du deuxième, la jeune mère est incapable
d’assumer convenablement tous les soins du bébé, les tâches
domestiques et ses propres soins par manque d’expérience. C’est
pourquoi, les Beena Luluwa, par un élan de la solidarité familiale ou
clanique, apporte leur assistance au jeune couple et particulièrement à
la mère et à son bébé.
La pratique de « dikola » est bien observée chez les Beena
Luluwa. L’assistante « ndeshi wa mwana » est choisie parmi les
femmes de la famille de la jeune mère : sa propre mère, une grande-
sœur, une cousine parallèle ou croisée, une grand-mère, etc.
L’assistance commence souvent un peu tôt avant la naissance
de l’enfant, vers le terme de la grossesse car à cette période, on pense
que la jeune future mère n’a plus assez de force pour accomplir tous
ses devoirs domestiques. L’assistance se prolonge jusqu’à la marche
de l’enfant. Ainsi l’assistante est généralement une femme d’un
certain âge qui peut assumer, parce qu’elle en a une longue et bonne
expérience, toutes les tâches domestiques : cultiver, chercher le bois
de chauffage, puiser de l’eau à la rivière, préparer la nourriture, laver
le nouveau-né, le porter, laver ses linges, etc. il arrive des fois que
l’assistance est assurée par une jeune fille sans expérience en matière
de puériculture. Elle recevra alors un apprentissage de la part de
l’entourage social.
12 DIAMBILA Luboya, Albert, Op. cit., pp. 149-150.
132
L’assistante est aussi une bonne conseillère en matière de
santé de la mère et de l’enfant. Elle vit au foyer de la jeune mère
durant son apostolat. A la fin de celui-ci, le père de l’enfant offre des
cadeaux à l’assistante en signe de remerciement. Pendant toute la
période de « dikola », le mari de l’accouchée s’exile. Cependant, il
vient prendre ses repas chez lui à la maison mais il dort ailleurs. Cette
pratique permet à la jeune maman de se reconstituer et d’éviter une
grossesse inattendue.
Toutefois. Il arrive aussi très souvent que le mari envoie son
épouse dans sa belle-famille et reste seul dans son foyer. L’assistance
est dans ce cas assumée par la famille même de sa femme. Pour
récupérer sa femme et son bébé après la naissance, le mari doit
donner certains biens en nature à ses beaux-parents. A défaut de ces
biens, il lui sera demandé d’exécuter certains travaux manuels au
bénéfice de sa belle-famille.
La pratique de « dikola » est significative à deux niveaux.
D’abord, aider la jeune femme dans les travaux de ménage et des
champs, l’initier aux soins à apporter à l’enfant, lui montrer comment
le laver, lui faire boire et manger, l’allaiter, l’habiller, dormir avec le
bébé sans l’écraser ; bref, l’initier à tous les soins relatifs à la
puériculture. Ensuite, cette assistance a l’avantage d’éviter des
grossesses trop rapprochées et d’espacer les naissances. Quels sont
les principes éducatifs au profit de l’enfant entre sa naissance et sa
marche normale sur les deux pieds ?
Le premier élément éducatif est d’ordre préventif et
protecteur : le « cisaba ». L’enfant est lavé avec de l’eau conservée
dans une écuelle magique, « cisaba », contenant des ingrédients
réputés prévenir et neutraliser tout mauvais sort des esprits et des
hommes malveillants tout en protégeant et en favorisant la santé du
bébé. Le « cisaba » assure à l’enfant une croissance normale,
harmonieuse et sans risque. Ses vertus sont préventives et
protectrices.
En deuxième lieu, l’enfant dès sa naissance est soumis aux
soins de propreté (bain régulier) et aux exercices physiques en vue de
lui doter d’une bonne forme de la tête et des jambes. A ce sujet, des
massages appropriés sont appliqués à la tête, au dos aux jambes, aux
bras, aux mains et aux pieds du bébé. On souffle, après le bain, dans
133
les oreilles, on lui nettoie les narines, la gorge et la bouche. On lui
frotte de l’huile sur tout le corps en vue d’une peau douce. On le
lance deux ou trois fois dans l’air pour fortifier son souffle et lui
éviter la peur. Chaque matin, on lui étire les bras, les jambes, les
doigts et les orteils tout en massant les mollets. Toute cette
gymnastique du bébé vise l’assouplissement et un bon
développement du corps et des membres. Les trois premiers mois de
sa vie confèrent à l’enfant le nom de « mwana mutoke », enfant blanc
c'est-à-dire jeune bébé ou nourrisson.
Avant le troisième mois, l’enfant est nourri exclusivement au
lait maternel et à l’eau. A un mois, on lui parle et on lui sourit. Quand
il pleure on lui chante des berceuses afin qu’il puisse se taire et
dormir.
A partir de trois mois environ, l’enfant est nourri à la bouillie
de la farine de manioc. Le nouveau-né est l’objet de soins maternels
tendres et continus ; toute la journée l’enfant reste ainsi attaché à sa
mère. Pendant toute cette période, le nourrisson est sous l’entière
responsabilité de sa mère, qui ne le quitte presque jamais si ce n’est
qu’en cas d’extrême nécessité.
Vers quatre ou cinq mois, le bébé commence à s’asseoir tout
seul. On lui confie de petits jouets sonores. Les bruits de ces petits
objets le distraient. Mais on veille beaucoup à ce que le bébé ne
tombe pas. C’est pourquoi, aux premiers jours de sa position assise, il
y a toujours derrière lui une personne qui le surveille ou le place
entre ses jambes.
Vers le huitième mois, le bébé se met debout. Il tient aux
objets et se met debout. Vers une année, le bébé fait déjà ses premiers
pas. A cette occasion, les parents sacrifient une poule (nsolo) pour
saluer la marche de l’enfant. Les premiers pas de la marche de
l’enfant est un événement bien accueilli par les Beena Luluwa qui
s’adressent à l’enfant en chantant:
« Kenda Katamuna, kaya kutemeshila nshandi kapia, shandi
mulale kabumanyi », ce qui veut dire : « Il marche, il accélère, il va
allumer du feu pour son père endormi. A son réveil son père est
surpris ».
On chante encore à cette occasion en disant à
l’enfant : « Enda tudie nsolo, nsolo wa citala ne cikuku ciende », ce
134
qui signifie à peu près : « marche pour que nous mangions un poulet,
un coq avec sa poule ».
La poule de la marche de l’enfant est partagée à tout le
monde car c’est un événement de grande joie pour les parents et
l’entourage.
La dentition est un élément important qui retient l’attention
des Beena Luluwa. L’enfant dont les incisives supérieures
apparaissent en premier lieu est considéré comme un porteur de
l’insuccès ou de la malchance. Pareil enfant est écarté de la
consommation des prémices de champs ou de toute autre activité
économique. A titre d’exemple, il ne peut pas manger les premières
fourmis ailées, « nswa », attrapées par les parents ou par quelqu’un
d’autre ; il ne peut pas non plus boire le premier vin tiré d’un
palmier. On dit généralement de cet enfant : « udi ne mwinu » c'est-à-
dire c’est un porte-malheur. Un bon enfant est celui dont les incisives
de l’arcade dentaire inférieure poussent en premier lieu. Ajoutons en
passant que la fente entre les deux premiers incisifs constitue un
élément de beauté particulièrement chez les filles. Le phénomène est
rarissime chez les garçons.
2.1.3 De la marche à l’âge de raison
On apprend à l’enfant à marcher vers un an, à courir en cas
de danger et à danser vers deux ans. Quand il marche, on lui apprend
à ne pas s’éloigner de la maison en lui faisant peur.
La prise en charge personnelle de la propreté corporelle ne
commence guère avant dix-huit mois. L’entraînement au sommeil
n’est pas systématique : le petit enfant dort quand il veut dans la
journée et presque jamais sur le dos mais toujours sur le côté. On
utilise un langage de bébé lorsqu’on s’adresse à un petit enfant afin
de lui faciliter l’apprentissage linguistique ; par exemple le sein
maternel sera « mbele » au lieu de « dibele » ; la bouillie « sabu » au
lieu de « musabu ».
Le sevrage du nourrisson n’a pas lieu avant deux ans, à
moins que la mère ne redevienne enceinte. Pour sevrer l’enfant, la
mère met un peu de piment sur les seins au niveau de mamelons et
donne le sein à l’enfant ou elle applique un liquide amer au sein et
135
l’enfant qui cherchera à téter sera découragé par l’amertume.
Signalons en passant que certaines femmes allaitent leurs enfants au-
delà de deux ou trois ans. Même si l’enfant marche déjà tout seul et
court, et que sa mère le laisse seul au cours de la journée alors qu’elle
se rend aux champs, à son retour, l’enfant de trois ans et même plus
non encore sevré cherchera toujours à téter. Sa mère ne l’en
empêchera même pas.
Une fois sevré, la mère n’a plus la charge exclusive de
l’enfant. Mais on ne laisse pas encore trop les voisins s’en occuper.
Les agents socialisateurs sont donc encore les membres de la
maisonnée : le père, la mère, aussi et de plus en plus les frères et
sœurs aînés, qui servent de gardiens aux plus petits et restent avec
eux à la maison lorsque les parents sont aux champs. Généralement
les Beena Luluwa font aussi appel à une grande fille, une cousine ou
une nièce, une sœur à la femme ou au mari pour assumer le
gardiennage de petits enfants, on l’appelle aussi « ndeshi wa
mwana ».
C’est à cette époque que l’enfant apprend à se situer dans la
hiérarchie des germains et qu’il commence à faire l’apprentissage de
la subordination. La socialisation commence aussi à se différencier
selon le sexe.
Dès le sevrage, l’enfant se nourrit comme tout le monde. On
lui explique comment manger le « bidia »13
sans le mâcher dans la
bouche avec de la viande, du poisson, de légumes ou autres
nourritures de complément comme le champignon par exemple ou les
termites. On apprend alors à l’enfant comment recevoir sa part de
nourriture avec les deux mains et comment se positionner quand on
prend les repas en famille. Les filles doivent s’asseoir complètement
par terre, les jambes allongées ; les garçons peuvent rester accroupis,
assis ou à genoux. Les filles mangent avec leurs mères, les garçons
avec leurs pères.
13 Pâte à base de farine de manioc ou du mélange de la farine de manioc et du maïs.
C’est la nourriture de base des Beena Luluwa.
136
Ce que l’on donne aux enfants, on ne les laisse pas le prendre
avec la main gauche ou la main droite seule ; ils doivent recevoir
avec les deux mains et dire merci.
La distribution des cadeaux et de la nourriture suit la
hiérarchie basée sur le sexe et rang de naissance. Souvent aussi les
petits reçoivent moins et les grands beaucoup plus.
Les Beena Luluwa éduquent par l’injure. C’est le domaine
des femmes spécialement. La maman luluwa injurie très facilement
son enfant fautif mais elle ne supporte pas que l’enfant injurie les
autres enfants et surtout pas une grande personne. Un conflit qui
oppose un enfant moins âgé à celui qui est plus âgé est souvent
tranché en faveur du plus jeune. Mais quand le plus petit a mal agi,
les parents le réprimandent en faisant allusion notamment à lui
refuser un repas ou un service.
Ainsi l’enfant est jaloux de celui qui le précède directement,
qui reçoit plus, et de celui qui le suit, qu’on soutient toujours contre
lui et que, pense-t-il, on le lui préfère. La perception des rapports
aîné/cadet qu’il a alors est très ambivalente puisque le pouvoir va
effectivement à l’aîné, mais l’amour au cadet.
Jusqu’au sevrage, le petit enfant était chaleureusement porté
ou pris sur les jambes par les membres de la maisonnée ; après, cette
attitude cesse progressivement. C’est définitif vers cinq ans.
Les Beena Luluwa traitent un peu brutalement un enfant de
trois ou quatre ans qui pleure. On lui demande pourquoi il pleure et
on le « chicotte », ou on lui pince les joues ou on lui tortille les
oreilles. On peut aussi chercher à lui faire peur en lui disant, par
exemple, qu’un animal féroce va l’attraper ou qu’une personne que
ledit enfant craint va le saisir et l’emporter avec lui.
Vers trois ou quatre ans, on apprend à l’enfant à se laver seul.
Filles comme garçons ne sont encore vêtus, à cette époque, que des
colliers, bracelets, ceintures de perles ou ceintures de tissu. Ils sont
pratiquement nus.
L’apprentissage linguistique est soutenu après le sevrage.
Souvent on pose la question au petit enfant : « c’est quoi ça ? ». S’il
ne sait pas, on le lui explique et l’on corrige sa prononciation.
Vers quatre ou cinq ans, les enfants commencent à rendre de
menus services mais la conscience de sexe se renforce. On renvoie
137
avec fermeté un garçon chez son père : « va chez ton père », « va te
réchauffer avec ton père », « qu’est-ce que c’est qu’un garçon qui
reste toujours avec les filles ? ».14
Quand la mère prépare les repas,
elle ne garde pas le petit garçon près d’elle. Par contre les petites
filles restent encore dans le sillage de leur mère.
Les enfants d’environ cinq à sept ans se mettent à imiter les
activités des adultes, surtout d’ailleurs les petites filles, pour qui le
conditionnement à la maternité commence déjà. Elles jouent avec des
poupées en bois ou en argile qu’elles traitent comme des bébés, font
leur cuisine avec du sable considéré comme de la farine, cueillent des
légumes et imitent leurs mamans faisant cuisine. Tous les jeux des
enfants s’inspirent des réalités du vécu quotidien, qu’il s’agisse des
garçons ou des filles. Parfois on observe même dans leurs jeux
mixtes, la formation des foyers : papa, maman et leurs enfants.
Entre six et sept ans, âge de raison, même jusqu’à la puberté,
les agents socialisateurs sont essentiellement les aînés et les amis, les
adultes n’intervenant guère que pour récompenser ou corriger un
enfant. De six à dix ans environ d’ailleurs, les enfants ne sont jamais
avec leurs parents ni avec des adultes, mais toujours en groupe avec
leurs germains et leurs amis.
Entre l’âge de raison et de la puberté, les termes qui
désignent les enfants ne sont pas identiques pour les petits garçons et
pour les petites filles, ce qui est bien significatif d’un enseignement
diversifié selon le sexe. Le garçon est appelé « nsongalume » et la
fille « nsangakaji ». De manière générale, en parlant de deux sexes
ensemble, on dira « bansonga ». Les termes « nsongalume et
bansongalume », « nsangakaji et bansongakaji », « bansonga »
désignent les enfants à partir de la puberté jusqu’à l’entrée en
mariage et même après l’entrée en mariage lorsqu’il s’agit de jeunes
foyers. Il y a donc des mariés encore appelés « bansonga ». Voyons
maintenant les traits spécifiques de l’éduction et de la socialisation
des garçons et des filles en milieu traditionnel des Beena Luluwa.
14 On se moque souvent des garçons de cet âge qui restent dans l’entourage de leur
mère et on chante : « Cienda ne bana bakaji, pafwa bana bakaji, bwalu bushale
bwende », c'est-à-dire le garçon qui se promène avec les femmes sera responsable de
leur mort.
138
2.2 Education spécifique : de l’âge de raison à l’âge adulte.
2.2.1. L’éducation des garçons
De l’âge de raison à l’adolescence en passant par la puberté,
l’éducation des garçons et même des filles consiste essentiellement à
aimer le travail manuel, à se rendre utile à la famille et à la
communauté villageoise, à devenir une personne responsable,
respectueuse et respectable.
On enseigne ainsi aux enfants de cet âge à être polis, à
respecter les personnes plus âgées, à ne pas se moquer d’eux, surtout
quand il s’agit des personnes handicapées physiques, et à être
serviables vis-à-vis d’eux. Garçons et filles commencent à rendre
énormément des services : la garde de la maison et de plus petits
enfants durant la journée alors que les parents sont aux champs ;
surveiller les bébés près de la maman qui travaille ; apporter des
messages et faire des courses de leurs parents, grands-parents ou
autres membres de la parenté ou de la communauté villageoise.
Vers sept ans, le garçon entre en plein dans la structure
économique de la famille. On lui apprend à prendre part aux petites
tâches masculines de cueillette et du ramassage, on lui apprend à
tendre des pièges et à faire la petite pêche à la ligne dans les
ruisseaux du village. Le premier produit de ses pièges ou de ses
ramassages et cueillettes est mangé dans une cérémonie spéciale par
le père seul ou parfois par le père et la mère avec beaucoup
d’encouragements, d’éloges et de louanges sans oublier de petites
récompenses en nature.
Toute la vie du garçon, il en est de même de la fille, est
comme un apprentissage à servir le groupe familial. Aussi les
vertus comme le « cisumi » (constance dans l’effort), le « dipa » (la
générosité), « didifila » (l’engagement) le « dipeta » (la productivité)
sont très appréciées chez les enfants par les Beena Luluwa.
La division du travail étant organisée selon le sexe et l’âge,
personne ne se sent vraiment inutile. Au village, un enfant qui
apporte à la famille un produit consommable (champignon, chenilles,
rats de brousse ou de forêt, poissons pris à la pêche, etc.) sera plus
139
loué que celui qui revient de l’école avec un bulletin que les parents
analphabètes ne savent pas déchiffrer.
L’éducation et la socialisation des garçons reposent sur la
connaissance de l’environnement social et physique. Le garçon est
initié à connaître les membres de sa parentèle tant patrilinéaire que
matrilinéaire. On lui apprend la généalogie du lignage et les rapports
de son lignage avec les autres lignages qui forment le village.
Toujours au plan de l’environnement social, les garçons sont
présents lors des sacrifices pour les ancêtres, des mariages, des
funérailles et des procès judiciaires. Aucun enseignement religieux
formel ne leur est donné. Mais les adultes répondent à leurs questions
et leur apprennent ce qu’il faut savoir sur les bienfaits et les malheurs
envoyés par Dieu ou par les ancêtres, les risques encourus à négliger
ses parents paternels et maternels ou ses ancêtres, les dangers de la
sorcellerie, des fétiches, le rôle du devin dans la détection des
manquements aux règles de la vie sociale.
L’éducation porte aussi sur l’apprentissage de l’expression et
sur le développement intellectuel. Les erreurs de tons et l’accord de
classes, comme les erreurs grammaticales faites par les enfants sont
nombreuses. Les adultes les remarquent et les corrigent surtout aux
heures de loisirs, lorsque le père passe un moment à parler
familièrement avec les enfants, ou que la mère, après le repas du soir,
participe à des veillées de contes. Lorsque la nuit est tombée, les
garçons se réunissent dans une case ou dehors dans la cour et narrent
les contes ou s’interrogent autour de devinettes et des énigmes. Au
clair de lune, les jeux nocturnes ne manquent pas. Certains jeux sont
constitués de danses et des chants. Les contes sont stéréotypés mais
non appris par cœur. Le conteur peut enjoliver et perfectionner sa
maitrise de la langue. Les auditeurs corrigent les erreurs de langage
ou les erreurs dans le déroulement de l’histoire. On ne trouve pas de
comptines ou devinettes qui aient pour le but spécifique
l’apprentissage de la langue, par exemple des accords de classe. En
revanche, contes, proverbes et devinettes ont une forte teneur morale
qui met l’accent sur les vertus à acquérir et sur les défauts à éviter.
Le développement intellectuel porte sur la mémoire et la
réflexion. On demande à l’enfant de transmettre des messages et de
rapporter fidèlement la réponse. On lui demande, le soir, de raconter
140
très exactement ce qu’il a vu et entendu dans la journée, en brousse
ou dans la forêt. On l’incite à la réflexion en lui posant de
nombreuses questions.
Quant à la formation de la personnalité, l’éducation
traditionnelle des Beena Luluwa insiste sur le développement de
l’obéissance, de la réciprocité, de la responsabilité et de l’ardeur au
travail. L’ardeur au travail était une vertu réellement déterminante et
le gros du travail se faisait en brousse. Et pour paraphraser Simon
BOLIVAR NJAMI-NWANDI : « La brousse était l’école, le champs,
la salle de classe, et la nature, un livre ouvert, ou mieux une immense
bibliothèque où l’on trouvait tout. On n’y introduisait pas l’enfant en
touriste, mais en élève, en ouvrier, en explorateur et en
chercheur ».15
Le jeune homme était ainsi appelé et initié à la connaissance
des sols et de leur assignation à différentes cultures ; à l’étude des
plantes, de leur reproduction et de leur utilisation ; à la connaissance
de la nature et des saisons, à la communication avec la nature par la
faune et la flore ; rien n’était laissé au hasard. Dans la société de
l’économie de subsistance qui est celle des Beena Luluwa, chacun
devait être tout pour soi et pour les autres. La nécessité du travail
apparaissait en relief, raison pour laquelle nous insistons beaucoup
là-dessus. Car tout s’obtenait par le travail : santé, science, richesse et
considération. Bref, on apprenait au jeune homme que le travail était
physiquement un bien et moralement une vertu. Pour cela, il devait
occuper le plus clair du temps d’un homme valide.
Bien que le travail occupe une bonne partie de la journée
pour les hommes et les femmes adultes en brousse, en forêt ou même
au village pour certains métiers, l’horaire des enfants, ici les garçons
était plus souple et toujours adapté à leurs forces et à leur âge.
Souvent, après leur libération en début de l’après-midi par les adultes
qu’ils accompagnaient tôt le matin, les garçons se livraient eux-
mêmes à des explorations techniques dont on leur demandait des
15 NJAMI-MWANDI, « L’éducation traditionnelle basaa », in : SANTERRE Renaud
et MERCIER-TREMBLAY, Céline, La Quête du savoir, Essais pour une
anthropologie de l’éducation camerounaise, Montréal, Les Presses de l’Université
De Montréal, 1982, p. 285.
141
comptes en fin de journée. Ce quartier libre n’était donc qu’un
prolongement d’étude à l’initiative des élèves eux-mêmes.
Le programme d’études des garçons comportait entre autres
la fabrication de différents engins ou matériels de la chasse et de la
pêche : lances, arbalètes, sagaies, filets de pêche et de chasse,
hameçons, nasses, etc. On associait donc l’enfant à tout. La
communication était directe et presque automatique. Le maître
prêchait par l’exemple, suscitant chez l’élève un esprit d’émulation.
Les études, faut-il se permettre de le dire, étaient moins ennuyeuses.
On en faisait presqu’un jeu ; sans contrainte aucune, même le pénible
travail des champs. Les enfants y prenaient donc plaisir. Ils
apprenaient des choses sérieuses en s’amusant. Le débutant entrait
effectivement dans un nouveau cycle de formation, mais il s’y
introduisait sans trop s’en apercevoir. Il y accédait sans émotion,
encadré par des instructeurs familiers, dans un cadre naturel et
rassurant. Toutes choses différentes de l’école occidentale imposée
dont le début est toujours dramatique pour le tout jeune élève paysan,
qui s’y perd et s’en effraie (milieu, cadre, ambiance, discipline
forcée, maître trop sévère, etc.). L’entrée brutale de l’enfant dans
cette jungle scolaire le traumatise et le marque pendant longtemps
avant qu’il ne s’y adapte.
L’initiation des garçons se clôturait par la cérémonie de la
circoncision « ditengula ». La circoncision se faisait dans le cadre
d’un rite de passage appelé « mukanda », mais notons qu’elle se
faisait aussi en dehors de ce rite. La circoncision est une pratique
ancestrale des Beena Luluwa. La pratique de « mukanda » restait
confinée à quelques clans et lignages mineurs. Le « mukanda » est
d’origine cokwe. Il a été adopté par les Beena Luluwa, pas tous, sous
l’impact du commerce luso-africain. La circoncision est une
préparation psychologique au mariage dans la mesure où les femmes
luluwa redoutaient de s’unir aux incirconcis, objets de raillerie.16
Lors de « mukanda », les jeunes gens subissaient une
réclusion d’environ trois à six mois et étaient initiés à différents
métiers, aux enseignements d’ordre moral et spirituel et passaient par
16 TSHIJUKE WA KABONGO, S., Op. Cit., P. 63.
142
diverses épreuves pénibles en vue d’en faire des hommes complets.
L’initiation au « mukanda » visait non seulement la circoncision mais
aussi l’inculcation d’une éducation intégrale. L’initié était un homme
adulte capable d’affronter la vie individuelle, familiale et
communautaire sous tous leurs aspects.
Un homme n’est pourtant considéré comme un adulte chez
les Beena Luluwa, quel que soit son âge, que s’il est marié. Un
célibataire est toujours considéré comme un enfant c'est-à-dire
comme une personne irresponsable car il n’a aucune charge sociale.
Il n’a aucun avis à émettre dans les assemblées « masambakanyi »
populaires ou familiales où l’on débat de problèmes de la vie des
personnes et du groupe.
2.2.2 L’éducation des filles
La multiplicité et la diversité des tâches rendaient l’éducation
des filles délicate et complexe et leur laissaient moins de temps libre.
Une fille mal élevée était la honte de la famille et l’insulte de toute la
gent féminine. C’est pourquoi dans bien des cas, la mère Luluwa était
très sévère vis-à-vis de ses filles dont elle contrôlait tous les
mouvements, corrigeant les défauts et encourageant les qualités. Rien
chez la fille n’était négligé. On veillait jusque sur sa démarche, ses
attitudes en public et en privé, son sourire, son rire, etc. On voulait en
faire un être correct en tout.
Les filles étaient les assistantes de leurs mères aux champs.
Conformément à leur âge et à leur habilité, elles remplissaient des
tâches qui leur convenaient : aller puiser de l’eau, servir les repas
déjà préparés, surveillance des bébés déposés à l’ombre des arbres,
semer, sarcler, élever des buttes, transporter du bois de chauffage et
une partie de la récolte. A tout cela, il faut ajouter aussi les activités
économiques de ramassage, de la cueillette de la petite pêche.
De retour à la maison, les filles devaient accomplir encore
des tâches mineurs en assistant leurs mères ; laver la vaisselle,
allumer le feu, surveiller les casseroles au feu et autres menues
commissions nécessaires à la préparation du repas.
Après le repas du soir et avant le coucher, les filles passaient
leur temps soit à l’éducation sportive soit à la formation purement
143
intellectuelle. Cette dernière se donnait habituellement dans le cercle
de la famille, autour du feu ou, à la belle saison, au clair de lune. Les
sports et jeux se déroulaient au sein du village, dans les cours de
certaines familles ou sur la voie publique.
La partie gymnique comprenait des jeux divers ; jeux
d’adresse, d’observation, de mémoire, de compétition, jeux
comiques. Il s’agissait toujours de jeux collectifs où les filles
rivalisaient d’ingéniosité, d’habileté et d’adresse. C’est à partir de ces
groupes ludiques que se formait le caractère de la jeune fille. Ici,
c’était une épreuve d’endurance qui exigeait discipline et maîtrise de
soi. Là, c’était un poste de commandement qui demandait de
l’autorité, du sang-froid et du dynamisme. Ailleurs, c’était un rôle
d’arbitre où le héros devait faire preuve de discernement, de
jugement et de loyauté. Le jeu, chez les Beena Luluwa, était une
épreuve de discernement, de jugement et de loyauté. Le jeu était
aussi une excellente école de formation du caractère, dont l’influence
était d’autant plus grande qu’elle pénétrait sous la forme apparente de
distraction.
A ces jeux s’ajoutait l’initiation à la danse. Il existait diverses
danses accompagnées d’instruments de musique et d’autres sans ces
instruments. Mais les danses les plus importantes sont celles de
jeunes filles pubères qui se déplaçaient d’un village à l’autre,
apprenant aux filles des villages voisins une nouvelle danse qui
venait d’apparaître.
Nous ne pouvons clore ce paragraphe consacré à l’éducation
de la fille luluwa sans évoquer un aspect de la préparation au
mariage. Cet aspect concerne les filles qui portent des seins debout et
non encore mariée. Il s’agit de deux pratiques très en vogue et très
courante dans la société luluwa ancienne : les tatouages et les
scarifications « nsalu » et le développement de petites lèvres
« bisuna » et du clitoris « mukoto ».
Les tatouages et les scarifications, symbole de courage, de
fécondité féminine mais aussi de la beauté, étaient pratiqués durant
l’adolescence de la jeune fille. Les tatouages et les scarifications
occupaient une place prépondérante dans l’éducation de la fille
luluwa. C’était un élément culturel d’esthétique de premier ordre
dans la société luluwa ancienne.
144
La deuxième pratique est le développement de petites lèvres
« kufweta » et l’allongement du clitoris.17
Dès que les seins de la
jeune fille commencent à se développer, celle-ci est initiée par sa
grand-mère mais surtout par les filles plus âgées aux techniques du
développement de petites lèvres. Ces techniques s’apprennent et se
pratiquent en brousse, à la lisière de la forêt ou en-dessous d’un
arbre. Une équipe de filles se rassemblent, en cachette, toutes les
précautions étant prises pour échapper à la curiosité des hommes et
se livrent à étirer et à allonger manuellement leurs petites lèvres ainsi
que leurs clitoris. Les hommes luluwa apprécient beaucoup les
femmes dont les petites lèvres et clitoris sont suffisamment
développés pour les caresses érotiques. Néanmoins, chez les femmes
grasses, on conseille de ne pas trop s’adonner à cette pratique parce
que les petites lèvres trop développées gênent non seulement la
démarche mais surtout la transpiration provoque des liquides qui
indisposent la femme elle-même.
L’excision est inconnue des Beena Luluwa18
bien que cette
pratique constitue la clé de voûte de l’initiation de la jeune fille dans
beaucoup de sociétés de l’Afrique noire. Chez les Bambara,
l’excision des filles a un sens équivalent à celui de la circoncision des
garçons d’après Viviana PAQUES.19
Elle les libère du support
physique mâle résidant dans le clitoris.
Parlant de la pratique de la clitoridectomie chez les Gikuyu
du Kenya, Jomo KENYATTA écrit : « Il importe de comprendre
l’importance énorme de cette opération dans les réactions
psychologiques de la tribu ; elle est toujours considérée comme la
base même d’une institution qui a de multiples implications
éducatives, morales sociales et religieuses. Il est impossible
actuellement à un membre de la tribu d’imaginer une initiation qui se
déroulerait sans clitoridectomie. Pour les Gikuyu, l’abolition de
l’élément chirurgical signifierait l’abolition de l’institution elle-
17 TSHIJUKE WA KABONGO, S., Histoire politique des Luba-Luluwa et Lubaïsés
du Kasaï (Des origines à 1968), Tome I, Kananga, Ed. de l’Institut Supérieur
Pédagogique de Kananga, 2006, p. 63. 18 Ibidem, P. 64. 19 PAQUES, Viviana, Les Bambara, Paris, P.U.F., 1954, pp. 92-93.
145
même ».
20 Une étude anthropologique sérieuse, poursuit l’Auteur,
montre que la clitoridectomie - tout comme la circoncision chez les
Israélites – est une mutilation corporelle considérée, en quelque sorte,
comme la condition « sine qua non » pour recevoir un enseignement
religieux et moral complet. L’initiation des garçons et des filles est la
plus importante des coutumes Gikuyu. Grâce à elle, l’enfant atteint sa
majorité, il peut s’intégrer à la communauté. La plupart des peuples
africains en sont les adeptes, et on en trouve trace à peu près sur tout
le continent. Il est nécessaire d’étudier de très près les éléments d’une
pratique largement répandue, afin de saisir pourquoi les Africains
s’attachent à ce qui passe aux yeux des Européens pour un traitement
« horrible » et « douloureux », qui ne peut convenir qu’à des
barbares.21
Pour mieux saisir la portée de cette prise de position de Jomo
KENYETTA, il faut la situer dans le contexte de l’accusation de la
pratique de la clitoridectomie. En effet, cette pratique à été l’objet de
vigoureuses attaques de la part de nombreux Européens influents :
missionnaires, Pro-Africains sentimentaux, dirigeants, médecins et
éducateurs.22
Les Beena Luluwa éduquent-ils toujours dans la
douceur ?
3. Violence, humiliation et récompenses dans l’éducation
traditionnelle des Beena Luluwa
Nous ne pouvons pas passer outre un aspect négatif qui fait
tâche d’huile dans l’éducation traditionnelle des Beena Luluwa : la
violence faite à l’enfant, qu’il soit garçon ou fille. Injures, punitions
corporelles, coups des poings, coup de fouet et voire tortures
accompagnent souvent les remontrances et les remarques adressées à
l’enfant.
La méchanceté des personnes adultes, sous prétexte
d’éduquer, atteint ou frise parfois le scandale et le crime. Les erreurs
20 KENYATTA, Jomo, Au pied du mont Kenya, (Traduit de l’anglais par G. Marcu et
P. Balta), Préface de Georges Balandier, Paris, François Maspero, 1960, p. 117. 21 Ibidem, pp. 117-118. 22 Ibidem, p. 115.
146
et les fautes commises par les enfants sont souvent mal digérées par
les adultes. D’où que l’enfant se trouve victime de toutes sortes de
mauvais traitements évoqués ci-dessus.
L’humiliation de l’enfant, dirait-on, est inhérente et
inséparable de son éducation en milieu social luluwa. L’injure facile
est le lot de la mère principalement. Une mère luluwa manque
souvent des tacts dans l’éducation de ses enfants. Un enfant qui a
manqué à son devoir ou qui a déçu les espoirs est toujours victime de
mauvais traitement de son entourage familiale et communautaire. Les
injures telles que « kanyama »,23
« kabi »,24
« kabole »25
,
« kasenji »,26
« kapote »,27
« kabwa »,28
etc., sont distribuées aux
enfants par leurs mères, pères, leurs grandes-sœurs, leurs grands-
frères ou par d’autres personnes. Le « Ka » est un diminutif qui
accentue et renforce l’aspect humiliant et péjoratif des termes utilisés.
Eduquer en humiliant est à la mode dans l’éducation
traditionnelle luluwa. Bref, l’éducation traditionnelle luluwa
s’accompagne toujours de l’humiliation de l’enfant et de la violence
verbale faite à ce dernier.
Néanmoins cette humiliation et cette violence s’adressent
particulièrement aux enfants paresseux, impolis et espiègles et ne
cachent point les récompenses encourageantes dont bénéficient un
enfant soumis, poli, brave et débrouillard. Pareil enfant est couvert
d’éloges et de récompenses afin de stimuler davantage son bon
comportement ou ses petits exploits. Il est pris en modèle et vanté par
son entourage.
Conclusion
L’éducation dans la société luluwa ancienne était un système
qui assurait une formation intégrale à l’enfant quel que soit son sexe.
23 KANYAMA : Bestiole, de « Nyama », bête, animal. 24 KABI : Lait : Kabi est diminutif de « Mubi », lait, mauvais. 25 KABOLE : Puant, pourriture. 26 KASENJI ; Imbécile ; Kasenji est diminutif de « Musenji », imbécile. 27 KAPOTE : Importun ; Kapote est diminutif de « Mupote », importun. 28 KABWA : Chiot ; Kabwa est diminutif de « Mbwa », chien.
147
Cette formation touchait tous les aspects de la vie individuelle, de la
vie familiale et de la vie communautaire tant au niveau magico-
religieux et moral qu’au niveau économique et social. L’éducation
traditionnelle luluwa reposait sur un idéal de travail manuel et de
responsabilité mais elle était aussi graduelle c'est-à-dire s’étendait de
la naissance à l’âge adulte. L’idéologie dont se nourrissait le système
éducatif luluwa était les croyances et les pratiques coutumières ou
tout simplement la coutume au sens ethnologique du terme. Selon
cette acception, la coutume luluwa englobe l’ensemble d’usages, des
pratiques, des rites, des mœurs et des croyances de l’entité ethnique
luluwa, le tout vécu et exprimé dans une même langue, le Céena
luluwa.
L’éducation traditionnelle luluwa était dans l’ensemble
l’affaire de tout le monde. Toute personne majeure ou même plus
âgée sans être majeure, avait mission de participer à l’éducation des
plus jeunes pour leur faciliter l’accès à la vie active et civique, même
si le gros de la tâche revenait à la famille dans la première enfance.
La spécialisation intervenait dans l’apprentissage des métiers, mais il
y avait un effort constant de tous pour assurer à chacun une base
culturelle commune.
Tout au long du texte, il est apparu que l’éducation luluwa
répondait aux conditions économiques, sociales, magico-
religieuses et même politiques de la société traditionnelle ; qu’elle
embrassait aussi bien la formation du caractère, le développement des
aptitudes physiques et des qualités morales que l’acquisition des
connaissances et des techniques nécessaires pour permettre à tout
homme et à toute femme de participer activement à la vie sociale
sous ses différents aspects ; qu’elle n’était pas séparée de
l’instruction, et qu’au contraire ces deux aspects étaient constamment
et intimement liés. L’éducation traditionnelle des Beena Luluwa se
présente donc comme une éducation gratuite, populaire, coutumière,
démocratique, collectiviste et surtout intégrale. Cependant, la
violence verbale, l’humiliation et les sévices corporels ne cessent
d’accompagner cette éducation nonobstant les récompenses, les
éloges et les encouragements occasionnellement réservés aux enfants
obéissants, laborieux, respectueux et débrouillards.
148
Bibliographie
1. ANONYME, Terminologie de l’éducation des adultes, Paris,
Ed. IBEDATA, 1979.
2. CHATEAU, Jean, « Qu’est-ce qu’un enfant ? », in : Psychologie
de l’enfant, de la naissance, Cahiers de Pédagogie moderne,
Bourrelier, Paris, 1959.
3. DIAMBILA, LUBOYA Albert, De la conservation du bukolè-
santé du couple Mère/Enfant dans la société africaine en
mutation. Une contribution à l’étude des stratégies de gestion de
la santé chez les Beena Luluwa, Thèse de doctorat en
Anthropologie, Université de Lubumbashi, Faculté des Sciences
Sociales, Administratives et Politiques, Département de
sociologie et Anthropologie, année académique 1996-1997.
4. KABASU NTUMBA, Moussin, Le fondement moral des
interdits africains. Cas des Luluwa. Une approche analytique,
Mémoire de Licence en Philosophie, Université de Lubumbashi
(UNILU), Faculté des Lettres, juillet 1987.
5. KASONGA BETUKAYI WA NDAYE et KABAMBA
KABATA, « Le pays des Beena Luluwa : cadre géographique »,
in : Les cahiers du CEREKA, numéro thématique, Vol. I, Juin
1988.
6. KENYATTA, Jomo, Au pied du mont Kenya, (Traduit de
l’anglais par G. Marcu et P. Balta), Préface de Georges
Balandier, Paris, François Maspero, 1960.
7. NJAMI-NWANDI, Simon de Bolivar « L’éducation
traditionnelle basaa », in : SANTERRE Renaud et MERCIER-
TREMBLAY, Céline (Sous la direction de) La Quête du savoir.
Essais pour une anthropologie de l’éducation camerounaise,
Montréal, Les Presses de l’Université De Montréal, 1982.
8. PAQUES, Viviana, Les Bambara, Paris, P.U.F., 1954.
9. TSHIBWABWA, Mukuku, Relations sociales autour de la
nourriture de base chez les Beena Luluwa, Mémoire de Licence
en Anthropologie, Université Nationale du Zaïre, Campus de
Lubumbashi, Faculté des Sciences Sociales, Administratives et
Politiques, 1974.
149
10. TSHIMBOMBO, Mudiba Petrus, La famille Bantu-Luluwa et le
développement, Rome, 1975.
11. TSHISANDA NTABALA-MWENY, Emery, Le thème de la
maternité dans l’art luluwa du Kasaï, mémoire de Licence en
Histoire, Université Nationale du Zaïre, Campus de
Lubumbashi, Faculté des Lettres, Département d’Histoire, 1973-
1974.
12. WAFUANA-KUTAMBI KAPANDA Mbuembue, Emery,
L’épopée de Kalamba Mukenge. Naissance du peuple luluwa,
Tournai, Institut Don Bosco, 2002.
13. VAN BULCK, A., Les recherches linguistiques au Congo
Belge, Bruxelles, mémoire in-8°, Section Sci. Mer. Et Pol., XVI,
I.R.C.B., 1948.
14. VAN ZANDIJCKE, A., Pages d’histoire du Kasaï, Namur,
collection Lavigerie, Grands-Lacs, 1953.
151
LES FORMES DE L’ETAT EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO DE 1960 A NOS JOURS
LWAMBA Bilonda Michel * et
SANGWA Masikini.Bin Musinde Hancko*
Introduction
Le présent exposé porte sur les différentes formes que l’Etat
Congolais a revêtues depuis son indépendances en 1960 jusqu’à ce
jour. Mais avant de retracer l’histoire même de la RDC, nous avons
estimé qu’il fallait pour faciliter la compréhension de notre thème, en
définir les concepts clés. Voilà pourquoi cet exposé est divisé en
deux parties ; la première, théorique, consacrée à la définition des
concepts et, la seconde, concrète, retraçant l’histoire des formes de
l’Etat au Congo. Une petite conclusion clôture notre texte.
Première partie : la définition des concepts
Les concepts clés de notre communication sont : l’Etat
unitaire, l’Etat fédéral et la Confédération. A ces termes s’ajoutent
secondairement la décentralisation et la centralisation.
1. L’Etat Unitaire
Le concept unitarisme n’existe pas dans le dictionnaire. Par
contre il existe l’expression Etat Unitaire. Et pour la définir, nous
nous sommes référés, outre le dictionnaire Larousse, à l’ouvrage de
Paul Leroy, Professeur à l’Université de Grenoble (1). Selon ce
* Professeur Ordinaire à l’Université de Lubumbashi (RDC).
* Assistant à l’Université de Lubumbashi
152
professeur, l’Etat unitaire est celui qui est caractérisé par l’existence
d’un centre unique de décision politique. Des organes de l’Etat
siégeant dans la capitale émanent un ordre juridique unique valant
pour l’ensemble de la population sur tout le territoire national.
L’Etat unitaire, dans le cadre de son ordre juridique unique
peut se présenter soit exclusivement dans sa logique centralisatrice
ou, au contraire, admettre que, sous conditions particulières précises,
certaines décisions lui échappent. L’Etat peut ainsi être centralisateur
au sens où toutes les décisions sont prises par ses organes, qu’ils
siègent dans la capitale ou qu’ils soient disséminés sur l’ensemble du
territoire (ce qu’on appelle déconcentration). Mais l’Etat peut surtout,
tant pour des raisons techniques que pour tenir compte d’urgence
démocratiques, admettre la décentralisation. Avec elle, des décisions
sont le fait d’entités internes à l’Etat mais distinctes de lui. Mais avec
elles également, ces décisions sont prises sous un certains contrôle de
l’Etat et surtout dans le respect de la réglementation constitutive de
son ordre juridique. Même étendue la décentralisation (le fait de
donner certains pouvoirs aux collectivités locales) ne porte atteinte au
caractère unitaire de l’Etat.
En France (le prototype de l’Etat unitaire), la décentralisation
s’exprime au plan fonctionnel avec l’attribution à certains services de
la personnalité juridique (Aptitude d’un groupement d’un individu à
être de droit) et d’une certaine autonomie (par exemple les
universités) et surtout au plan territorial. L’article 72 de la
constitution du 4 octobre 1958 accordés aux communes et aux
départements, ainsi qu’aux collectivités territoriales (les régions), le
pouvoir de s’administrer librement par des conseils élus dans des
conditions prévues par la loi.
Lorsque la centralisation se développe, l’accroissement des
compétences accordées aux entités qui bénéficient peut faire hésiter
sur la nature de l’Etat.
1P. Leroy, les régimes politiques du monde contemporain. Introduction Générale.
Les régimes politiques des Etats libéraux, Grenoble, P.U.G., 2001, 176p. N.B. Les
définitions sont tirées des pages 26 et suivantes.
153
2. L’Etat Fédéral
D’après le dictionnaire Larousse, la fédération ou l’Etat
fédéral est un regroupement d’Etats–succédant souvent à une
confédération- qui constitue une unité internationale distincte
superposée aux Etats membres, et à qui appartient la souveraineté
externe.
Paul Leroy qui reprend les mêmes éléments du dictionnaire
les explicite d’avantage. Dans le langage courant, dit-il, l’Etat fédéral
est un « Etat fait d’Etats ». Mais ajoute-il, cette formule est
paradoxale et doit être écartée du fait qu’elle manque de valeur
explicative au regard du caractère souverain de l’Etat. Les entités
composantes, même si elles possèdent l’appellation d’Etat, n’en ont
pas vraiment le caractère. L’Etat fédéral est un Etat marqué par
l’existence de plusieurs ordres juridiques subordonnés. Structure
complexe, l‘Etat fédéral dépasse la pluralité des entités composantes
par l’unicité de l’existence d’autant d’ordres juridiques chaque
« Etat » fédéré dispose d’une structure étatique propre : parlements
gouvernementaux, tribunaux agissent dans le cadre d’un
ordonnancement juridique spécifique. Naturellement ces ordres
juridiques sont placés dans une situation de subordination par rapport
à l’ordre juridique fédéral là où ce dernier s’exprime.
L’organisation de l’Etat fédéral répond à deux principes.
Selon la loi d’autonomie, chaque Etat fédéré a le droit d’exercer
certaines compétences. Dès lors la constitution fédérale répartit les
compétences entre la Fédération et les Etats membres selon un
partage évidemment susceptible de connaître les modalités les plus
variables, au centre ou à la périphérie. La pratique habituelle accorde
des compétences d’attribution c’est –à-dire des compétences de
souveraineté à la Fédération, et celle de droit commun aux Etats
fédérés, mais d’importances respectives diverses. Naturellement, un
tel système porte en lui-même le conflit. Tant la fédération que les
Etats membres peuvent chercher à établir leurs champs
d’interventions respectifs. Il importe dès lors qu’un organe de l’Etat
juridictionnel pour être indépendant (cas de la cours suprême des
Etats-Unis), puisse dire le droit par application et interprétation de la
constitution et agir ainsi en régulation de ce système complexe. La
154
logique du système est également prise en compte par la loi de
participation des entités composantes au fonctionnement de
l’ensemble. En tant que telles, les entités composantes sont
représentées au niveau de la fédération et interviennent ainsi dans son
organisation. Très habituellement le parement de l’Etat fédéral est
bicaméral : l’une des chambres représente la population avec ses
membres désignés en considération de données démographiques (un
parlementaire pour 100.000 ou 300.000 électeurs par exemple) ; la
seconde représente, elle, les Etats fédérés et ceux-ci désignent,
éventuellement par leurs assemblées (Allemagne), les membres de
cette chambre sans tenir compte parfois même de l’importance de
population (Etats-Unis où chaque Etat désigne deux sénateurs).
Le système fédéral, par logique, est un système complexe
mais sa complexité porte en elle ‘avantage de la souplesse au plan de
la répartition des compétences comme à celui de la participation à la
gestion de l’ensemble, les solutions les plus variées peuvent être
retenues. Le fédéralisme peut ainsi s’adapter à la réalité des Etats
occidentaux (Etats-Unis, Suisse, Allemagne…) ou socialistes (URSS)
ou encore des Etats du tiers monde parmi les plus importants (Brésil,
Nigeria, Inde…). Il peut aussi s’adapter à l’évolution de la société.
En certaines circonstances, comme aux Etats-Unis depuis deux
siècles, il peut évoluer vers un renforcement de l’influence fédéral
mais aussi tolérer, comme dans les années 90, de momentanés retours
de balancier. En revanche, en Yougoslavie dans les années 70, il
admet le renforcement des républiques fédérées au détriment de
l’organisation centrale de l’Etat. Mais dans cette voie, à la limite, la
dissociation de l’Etat fédéral peut être atteinte.
3. La confédération
Selon le dictionnaire Larousse, la confédération est une
union d’Etats souverains qui constituent une forme de transitoire dont
l’aboutissement consiste soit en sa dissolution, soit en sa
transformation en Etat fédéral. Et ici, Larousse nous donne l’exemple
de la Suisse qui, tout en conservant son nom officiel de confédération
helvétique constitue depuis 1874 un Etat fédéral.
155
Amplifiant la définition du dictionnaire, Paul Leroy précise
que la confédération est l’union des Etats qui demeurent
véritablement des Etats, donc des entités indépendantes, sujet de droit
international. La confédération elle-même, n’est pas un Etat. Les
Etats membres tout en conservant leurs caractéristiques d’Etat,
renoncent à exercer seuls certaines de leurs compétences. Ces
compétences ainsi gérées en commun ne marquent pas pour autant
l’abandon de souveraineté dans la mesure où l’organe commun ne
peut agir qu’en prenant les décisions à l’unanimité.
Dans le passé, les confédérations ont surtout pris en charge la
gestion commune de la diplomatie ou de la défense des Etats qui,
seuls, redoutaient les conséquences de leur faiblesse et qui
entendaient s’unir pour se préserver d’une domination de puissants
voisins.
La confédération a parfois précédé l’Etat fédéral. Tel est le
cas aux Etats-Unis ou en Suisse où elle se révèle insuffisante et fait
prendre conscience de la nécessité d’une plus forte intégration. Il
apparaît, actuellement, qu’elle pourrait succéder à l’Etat fédéral. Cela
aurait pu être le cas en Yougoslavie si la guerre intérieure n’avait pas
voué à l’affrontement irréductible les républiques qui accédaient à
l’indépendance. Cela aurait pu être surtout le cas en URSS, après sa
dissolution, si la structure d’ensemble mis en place en décembre
1991 sous la dénomination de « communauté des Etats
indépendants » (CEI) et chargé essentiellement, d’une mission de
coordination aux plans économiques et militaires, était devenue une
réalité.
Deuxième partie : les formes de l’Etat au Congo de 1960 à ce jour
La partie théorique ayant présenté la réalité de
chaque forme d’Etat, nous pouvons aborder la situation concrète de
l’histoire de la RDC depuis son indépendance en 1960. Nous
présentons dans un premier temps l’antécédent colonial.
156
1. La forme de l’Etat congolais à l’époque coloniale (1885-1960)
De 1885 à 1960, le Congo n’a été qu’un Etat unitaire, tantôt à
forte centralisation, tantôt décentralisé. Pendant la période de l’Etat
indépendant du Congo (1885-1908), tous les pouvoirs étaient
concentrés dans les mains du Roi Léopold II, fondateur et
propriétaire de l’E.I.C. il dirigeait à Bruxelles le Gouvernement
Central du Congo composé au départ de 3 départements dont le
nombre sera porté à 4 en 1894. Au Congo, le Roi était représenté par
le gouvernement local établi d’abord à Vivi, ensuite à Boma. A la
tête de ce gouvernement se trouvait un gouverneur général, secondé
par un vice- gouverneur général, un inspecteur d’Etat, un secrétaire
général et plusieurs directeurs. Le Congo fut divisé en 11 districts en
1888, nombre qui sera porté à 12 en 1890 et à 15 en 1895. Les
districts seront subdivisés en zones, les zones en secteurs, en postes.
Les décisions étaient prises à Bruxelles, répercutées à travers le
Congo par le gouvernement local de Boma. Cette centralisation était
quelque peu atténuée par le système des compagnies
concessionnaires (compagnie du Katanga, comité spécial du Katanga,
Compagnie du Kasaï, etc.) auxquelles l’Etat avait délégué certaines
de ces prérogatives dans les parties du territoire congolais non encore
bien occupées.
En 1908, le Congo cessa d’être une propriété privée du Roi
Léopold II pour devenir la Colonie Belge. Il demeura un Etat unitaire
mais à partir de 1910, la Belgique amorça la décentralisation avec la
création de la province du Katanga dont le gouverneur était doté de
larges pouvoirs qu’aucun autre gouverneur de province n’aura au
cours de la période coloniale. La décentralisation qui était aussi
judiciaire avec la création de la 2ème
Cour d’appel du Congo Belge à
Elisabethville et de quelques tribunaux de 1ère
instance, sera
consacrée par l’arrêt royal du 28 Juillet 1914 instituant la division du
Congo en 4 provinces, 22 districts et 185 territoires. Certains services
furent transférés de Bruxelles à Boma. Le gouverneur général fut
secondé par un conseil de gouvernement et les gouverneurs de
provinces par des comités régionaux. Cette structure va rester en
place jusqu’à la grande crise mondiale des années trente.
157
Pendant ladite crise, la décentralisation fut abandonnée au
profit d’une centralisation à outrance. Tous les pouvoirs furent de
nouveau centralisés à Bruxelles et Léopoldville, la nouvelle capitale
du Congo Belge. Le nombre de province fut porté de 4 à 6, chacune
portant le nom de son chef-lieu. Les gouverneurs de provinces furent
appelés commissaires de province et un corps des inspecteurs d’Etat
chargés d’inspecter les provinces fut mis sur pied à Léopoldville. Le
Congo Belge, toujours unitaire, demeura centralisé jusqu’en 1947.
Avec l’arrêté royal du 1èr juillet 1947 la décentralisation reprit le
dessus sur la centralisation c’est la structure qui parviendra au 30 juin
1960.
2. La 1ère
république et l’Etat fédéral au Congo (1960-1966)
A la proclamation de l’indépendance, le Congo était régi par
la loi fondamentale promulguée par le Roi Baudouin le 19 mai 1960.
Cette constitution de 260 articles, était l’œuvre de spécialistes belges
assistés de 6 congolais (Bomboko, Kama, Kanga, Kapongo, Kibwe et
Kititwa). Inadaptée aux circonstances de lieu et de temps, elle fut la
source de la plupart des conflits qui entraînèrent le Congo dans le
chaos et l’anarchie. La constitution du 19 mai 1960 reproduisit en
Afrique le régime politique parlementaire appliqué en Belgique : un
pouvoir exécutif bicéphale (président et premier ministre) dont les
attributions n’étaient pas très bien précisées, un parlement bicaméral
(sénat et chambre des représentants) dont aucune chambre n’avait la
préséance sur l’autre ; un régime fédéral permettant à toute province
de se transformer en Etat indépendant. Ainsi au terme de la loi
fondamentale, le Congo avait un président (Kasa-Vubu) et un
gouvernement dirigé par un premier ministre (Lumumba) dont on ne
voyait pas bien qui avait la préséance sur l’autre. On comprend dès
qu’ils se soient révoqués réciproquement le 5 septembre 1960. Au
parlement congolais, la chambre des représentants était composée de
137 députés, à raison d’un député pour 100.000 électeurs. Aucun
parti politique n’y détenait la majorité absolue. Le MNC/Lumumba
avec ses alliées détenait 41 sur 137, soit 30% ; le PNP, 23 sièges soit
16,78% ; le PSA 13 sièges, soit 9,48%, l’ABAKO, 12, soit 8,75% ; le
CEREA et la CONAKAT, 10 sièges (5,10%). Par contre le Sénat
158
était composé de 84 sénateurs, à raison de 14 par provinces, tous élus
par l’assemblée provinciale.
Dans chaque province, une assemblée élue élit à son tour un
gouvernement de 11 membres : 10 ministres et un premier ministre
président. Dans les 6 provinces, les gouvernements furent présidés
respectivement par Cléophas Kamitatu Massamba (Léopoldville),
Laurent Eketebi Mooyidiba Mondjo-lombwa (Equateur), Jean pierre
Finant (Povince Orientale), Jean Miruho (Kivu), Moise Tshombe
(Katanga) et Barthélemy Mukenge (Kasai). Pour les assemblées
provinciales, les seuls présidents dont nous avons pu trouver les
noms sont ceux de l’Equateur (Ekoko), du Kivu (Abraham Lwanwa),
du Katanga (Charles Mutaka wa Dilomba) et du Kasai (Dominique
Manono). L’indépendance du Congo était acquise dans une
atmosphère empoisonnée. Voilà pourquoi le pays a vite sombré dans
l’anarchie. Il y avait trop de contradictions à gérer : entre unitaristes
(Lumumba) et fédéralistes (Kasa-Vubu, Tshombe,Kalonji), entre les
extrémistes (Lumumba, Gizenga) et les modérés (Kasa-vubu,
Tshombe), entre le pouvoir central et certaines provinces (Katanga,
Kivu, Equateur), entre les civils et les soldats, entre certains groupes
ethniques et, entre les citadins et les ruraux, entre pro-capitalistes et
pro-communistes.
Le 4 juillet 1960, soit 5 jour après la proclamation de
l’indépendance, la force publique se mutina et fut africanisée le 8
juillet. Cet évènement fut le détonateur de beaucoup d’autres, plus
graves encore : l’intervention des troupes belges (10 juillet 1960), la
sécession du Katanga (le 11 juillet), l’appel de Kasa-vubu, et
Lumumba au Secrétariat Général des Nations Unies (l’arrivée des
troupes de l’ONU au Congo (le 15 juillet), la sécession du Kasaï (le 9
août 1960), le massacre des Bakwanga (27-31 août), la révocation
réciproque du Président Kasa-Vubu et du premier ministre Lumumba
(le 5 septembre 1960), la création du collège des commissaires
généraux installé le 29 septembre 1960, la fuite de Gizenga et
l’installation d’un gouvernement lumumbiste à Stanleyville (octobre
1960), la tentative manquée de fuite de Lumumba (27 novembre
1960) suivie de son arrestation (2 décembre 1960) son incarcération à
Thysville et finalement son transfert et son assassinat au Katanga (17
janvier 1961). Cet assassinat sera suivi de l’arrestation à Léopolville
159
de 7 Lumumbistes (Elengesa, Finant, Fataki, Lumbala, Muzungu,
Nzuzi, Yangala) et leur transfert à Bakwanga où ils seront massacrés
après avoir été condamné à mort par le tribunal des Chefs coutumiers
Baluba du Kasai. Il y avait à ce moment-là (février 1961) sur le
territoire congolais 4 gouvernements (Léopoldville, Stanleyville,
Bakwanga et Elisabethville) et 5 armées (Léopolville, Stnleyville,
Bakwanga, Elisabethville plus les forces des Nations Unies). L’ANC
se réunifia en Avril 1961 et mit fin au gouvernement Gizenga de
Stanleyville (Janvier 1962) l’ONU résorba successivement les
gouvernements du Kasaï (Janvier 1962) et du Katanga (janvier 1963).
Le gouvernement de Léopoldville demeura l’unique gouvernement
du Congo. Dans l’entre-temps, de nouvelles provinces virent
progressivement le jour à travers le Congo, à l’instar de celle du Sud-
Kasaï, née le 9 août 1960 sous le nom de l’Etat autonome du Sud-
Kasaï, ou encore la province du Nord-Katanga, née en octobre sous
le nom de province de Lualaba dont l’objectif était d’affaiblir le
gouvernement de Moïse Tshombe à Elisabethville.
C’est surtout en 1963 que la prolifération des nouvelles
provinces s’affirma et le Congo passa de 6 à 21 provinces réparties
comme suit : 3 au Katanga, 3 au Kivu dans la province orientale, 3 à
l’Equateur, 4 dans la province de Léopoldville et 5 au Kasaï. Ces
nouvelles provinces furent appelées aussi provincettes. Le système
fédéral fut maintenu. Etant donné que la plupart des leaders congolais
attribuaient la crise politique congolaise à la loi fondamentale du
19mai 1960, il fut décidé d’élaborer une nouvelle constitution. Du 10
janvier au 11 avril 1964, une commission constitutionnelle siégea à
Luluabourg pour ce faire. Présidée par Joseph Iléo, secondé par
Marcel Lihau, la Commission réunit 127 participants dont 84
délégués des 21 provinces à raison de 2 par gouvernement provincial
et 2 par assemblée provinciale, 4 membres du gouvernement central,
12 représentants des syndicats, 6 des Eglises, 15 des employeurs, 2
de la presse, 2 des associations des étudiants, 2 du conseil national de
la jeunesse et 9 des collectivités rurales. Cette constitution élaborée
d’une façon consensuelle, fut promulguée le 1èr août 1964 par le
président KASA-VUBU. Elle totalisait 204 articles.
Avec une constitution, le Congo devenu République
Démocratique du Congo, demeurait une république fédérale,
160
composée de la ville de Léopoldville et de 21 provinces : Katanga
Oriental, Lualaba, Nord-Katanga, Maniema, Kivu central, Nord-
Kivu, Haut-Congo, Kibali-Ituri, Uele, Ubangi, Moyen-Congo,
Cuvette centrale, Lac léopold II, Kwango, Kwilu, Kongo central,
Unité kasaienne, Luluabourg, Sankourou, Lomami, Sud-Kasaï. Les
provinces étaient autonomes et avaient une personnalité juridique.
Les assemblées et les gouvernements provinciaux étaient maintenus.
Cependant, les pouvoirs des gouvernements provinciaux furent
réduits. A titre d’exemple, la constitution a remplacé le titre de
Président Provincial par celui de Gouverneur de province. Et celui-ci
devait prêter serment devant le Président de la République. D’autres
part elle a institué la conférence des gouverneurs de province qui
devaient se réunir au moins une fois sous convocation de son
président, le chef de l’Etat. Cette conférence avait comme objectif de
renforcer l’unité de la République et de faciliter la coordination de la
politique des provinces. Avec pareille structure, il n’était plus facile
de faire sécession. Au niveau national, les institutions prévues par la
constitution de Luluabourg furent :
- La présidence de la République ;
- Le gouvernement dirigé par un premier
ministre ;
- La cour constitutionnelle ;
- Les cours et tribunaux.
Les pouvoirs du président de la République furent renforcés
ainsi que sa prééminence sur le gouvernement et le premier ministre
qui était d’ailleurs nommés et le cas échéant révoqués par lui. Son
mandat était de cinq ans comme l’avait prévu aussi la Loi
fondamentale. Il était renouvelable une seule fois. Le président
n’était pas élu au suffrage universel, mais plutôt par un corps
électoral composé par les membres du parlement et ceux des
assemblées provinciales. La constitution de Luluabourg a également
réparti les compétences entre le pouvoir central et celle des droits
communs en provinces.
161
3. L’Etat unitaire au Congo (1967 à nos jours)
Le 24 novembre 1965, le Général Mobutu s’empara du
pouvoir, officiellement pour 5 ans, mais en réalité pour toujours. Il
instaura la politique de l’élimination physique des opposants qui
coûta cher à Evariste KIMBA, Jérôme ANANY, Emmanuel BAMBA
et Alexandre MAHAMBA, pendus publiquement le 2juin 1966 à
Kinshasa. Il réduisit d’autorité le nombre de provinces qui qui
passèrent de 21 à 12. Et après avoir fait arrêter quelques gouverneurs
de province, il prit le 25 décembre 1966 une ordonnance qui réduisit
encore le nombre des provinces de 12 à 8 plus la ville de Kinshasa à
la tête de laquelle fut nommé un gouverneur militaire (Colonel
Bangala). Par la même ordonnance, il supprima les assemblés et les
gouvernements provinciaux. Il fit élire des gouverneurs le 27
décembre 1966 avant de les permuter le 3 janvier 1967. Depuis le 24
octobre 1966, il avait limogé le Général Léonard Mulamba de ses
fonctions de premier ministre et cumula depuis lors les fonctions de
Chef de l’Etat et Chef de gouvernement. Toujours en 1966, il avait
crée le corps des volontaires de la République (CVR), chargé de
traquer les opposants et d’orchestrer sa propagande. Et le 20 mai
1967, il créa un parti unique, appelé Mouvement Populaire de la
Révolution (MPR) dont les congolais étaient membres dès leur
naissance. Ce parti fut institutionnalisé en 1970 avant de devenir en
1974, l’unique institution du pays et parti-Etat en 1984. Le 24 juin
1967, jour de la sortie de la nouvelle monnaie le Zaïre et de la
création du syndicat unique, l’UNTC, Union Nationale des
Travailleurs Congolais, il promulgua une nouvelle constitution dite
révolutionnaire. Selon cette constitution de 82 articles, la RDC est un
Etat unitaire, démocratique et social, qui comprend la ville de
Kinshasa et les 8 provinces. Les provinces n’ont plus aucun pouvoir
par rapport aux institutions centrales qui sont par ailleurs dominées
par le Président de la République. Ce dernier est désormais élu au
suffrage universel pour un mandat de 7 ans renouvelable à l’infini. A
chaque élection, il était candidat unique (1970, 1977 et 1984). Après
avoir supprimé le parlement congolais en 1967, il créa en un autre en
1970 sous le nom de Conseil législatif au sein duquel il nomma lui-
même tous les députés appelés alors commissaires du peuple. Le
162
parti avait la prééminence sur toutes les autres institutions de la
République réduites au rang de branches spécialisées du parti. Le 1èr
juillet 1977, à la suite de la guerre des 80 jours, il instaura le système
électif au sein du MPR et nomma un premier commissaire d’Etat
(premier ministre) mais qui, loin d’être le Chef du Gouvernement,
n’en était qu’un coordonnateur, le chef n’en étant autre que le
Pr2sident Mobutu. Les élections furent alors organisées au niveau des
conseils respectifs de collectivité, de zone et du conseil législatif
ainsi qu’au bureau politique. Elles furent renouvelées au niveau des
collectivités, des zones urbaines et du conseil législatif en 1982 et en
1987-1989. Le conseil législatif eut le droit d’interpeller les PDG
d’entreprises et les ministres. Mais lorsque le président Mobutu se
rendit compte du danger que représentaient les interpellations au
conseil législatif. Il y mit fin par son discours du 4 février 1980. Et le
2 septembre suivant, il créa un Comité Central du MPR ayant la
préséance sur les autres organes d’une part, dont le conseil législatif,
renvoyé au 7ème
rang. C’est contre cet état de chose que les 13
parlementaires réagirent par la pétition du 31 décembre 1980.
Entre temps depuis 1973, l’animation politique avait été
instituée au Congo, devenu depuis le 27 octobre 1971, la République
du Zaïre. Des groupes d’animation furent créés a tous les niveaux de
la structure administrative et dans toutes les entreprises et institutions
d’enseignement pour chanter et danser à la gloire du Président
Mobutu, devenu le Président Fondateur, le timonier, le guide
clairvoyant, le père de la nation, le bâtisseur, l’unificateur, le
pacificateur, etc.
Le Président Mobutu a structuré l’armé de manière à
renforcer sans cesse son pouvoir effectif. En 1962-1963, garde était
portée à la hauteur d’un bataillon de 800 parachutistes, commandés
par le major Tshathi. En 1976, la garde du président atteignit une
brigade avant de devenir la division spéciale présidentielle (DSP)
dont le rôle consistait à protéger la personne, la famille, les biens du
Président Mobutu.
C’était une armée dans l’armée. Le président a multiplié les
corps d’arme pour mieux diviser les militaires. En 1966, il avait
réunifié toutes les polices du Congo en une seule et unique police
nationale congolaise (PNC) en 1972, il la supprima en la fusionnant
163
avec la gendarmerie de l’armée nationale (ANC), devenue au cours
de la dite armée les forces armées zaïroises (FAZ). Les FAZ étaient
alors structurée en plusieurs corps et armes : la Force terrestre, la
Force aérienne, la Force navale, la Gendarmerie nationale, la D.S.P.
auxquelles s’est ajoutée la garde civile en 1984. Il avait aussi
abandonné l’organisation militaire belge héritée de la colonisation au
profit de l’organisation française qui lui a permis de s’octroyer le
grade de maréchal en 1983.
Bref, avec le président Mobutu, la RDC était un Etat unitaire
à forte centralisation dont tous les pouvoirs étaient réunis entre les
mains d’un seul individu. Tout partait de lui et tout aboutissait à lui.
Après la chute du mur de Berlin (09/11/1989) et l’exécution
de son ami Roumain, le président Nicolae Ceausescu (décembre
1989), il organisa les consultations populaire qui se terminèrent par le
discours du 24 avril 1990, par lequel il mettait fin au parti-Etat et
donc la 2ème
République. Il nomma un premier ministre de la
transition (Lunda-Bululu) et après quelques remaniements, la
Conférence Nationale Souveraine (CNS) s’ouvrit le 7 août 1991. A
l’issu de la CNS, le Zaïre eut comme structure politique, le président
de la République, le Haut-conseil de la République Parlement de
Transition (HCR-PT) et le gouvernement. Le président nomma les
gouverneurs de provinces originaires, mais le Zaïre était toujours un
Etat unitaire. Des conflits ethniques éclatèrent ça et là, à travers le
pays.
Le 17 mai 1997, le président Mobutu fut chassé du pouvoir
par l’AFDL de Laurent-Désiré KABILA, soutenue par les Rwandais
et les Ougandais. Le nouveau Président, Laurent-Désiré KABILA, se
retrouva lui aussi devant un boulevard, car il avait, en face de lui,
aucun autre pouvoir concurrent, d’autant plus qu’il venait de
supprimer les conseils communaux en état de déliquescence ainsi que
tous les partis politiques à l’exception du sien, l’AFDL. Il gouverna
par décrets et renforça la centralisation politique et administrative. En
juillet 1999, il supprima l’AFDL et créa le Comité de Pouvoir
Populaire (CPP) qui existe en Libye. Mais depuis le 2 août 1998, une
nouvelle guerre avait éclaté à l’Est, supervisée par le Rwanda et
l’Ouganda.
164
La guerre dite d’agression a eu des conséquences
incalculables sur le Congo : beaucoup de destructions, des morts qui
se comptent par millions, des déplacés de guerre, etc.
Le 16 janvier 2001, le Président Laurent KABILA fut
assassiné. Son fils Joseph KABILA KABANGE accéda au pouvoir et
fit stopper la guerre. Des négociations se poursuivirent pour aboutir,
le 17 décembre 2002 à Pretoria à la signature de l’accord global et
inclusif dont est issu le gouvernement de transition (205 articles)
stipule en son article 5 que la RDC est un Etat unitaire décentralisé,
composé de la ville de Kinshasa et de 10 provinces dotées de la
personnalité juridique.
Conclusion
Etat unitaire, Etat fédéral, Confédération, il n’existe pas à
priori une forme de l’Etat qui soit mauvaise ou soit meilleure par
rapport à l’autre. Le tout dépend de la façon d’appliquer la loi. La
France est Etat unitaire, tandis que l’Allemagne est une fédération.
Mais chaque système se défend. Comme l’a affirmé le Professeur
Leroy, la forme de l’Etat la plus souple c’est l’Etat fédéral. Même
pour le Congo, en considérant son étendue, le système fédéral serait
le mieux venu. Cependant dans l’histoire du pays, le fédéralisme n’a
pas eu beaucoup de chance de s’imposer. Tout d’abord au cours de la
période coloniale (de 1885 à 1960) le Congo n’a connu d’autre
forme que l’Etat unitaire, tantôt centralisé tantôt décentralisé. D’autre
part au cours de la première République lorsque le fédéralisme fut
instauré, ses propres partisans, Tshombe et Kalonji ont péché en
proclamant l’indépendance du Katanga et du Sud-Kasaï. Cette double
sécession a fait peur aux congolais qui entrevoyaient une possible
balkanisation du pays. Ce danger était d’autant plus réel qu’à la
conférence de Tananarive (mars 1961), dominée par les fédéralistes
(Kasa-Vubu, Tshombe, Kalonji), il fut proposé que le Congo
devienne une confédération d’Etats, ce qui signifie que l’Etat
congolais devait disparaître si l’on se réfère à la définition d’une
confédération. Tout ceci explique pourquoi la formule de l’Etat
fédéral fut modifiée par la constitution de Luluabourg du 1èr août, le
coup d’Etat du Général Mobutu constitua une deuxième malchance
165
pour le fédéralisme. Mobutu étant partisan de l’Etat unitaire doublé
d’un dictateur, il ne pouvait que mettre fin à l’Etat fédéral. D’autres
part son règne ayant dépassé les 30 ans, les congolais ont eu le temps
d’oublier que le Congo a connu par le passé le régime fédéral.
Bien plus usant du mensonge et du matraquage médiatique, il
a fait croire aux congolais que le fédéralisme est le synonyme de la
sécession et du séparatisme. Et lorsqu’au début de la transition des
années nonante, les troubles ont éclatés de ça et de là,
particulièrement au Katanga, ceci a achevé de convaincre beaucoup
d’observateur que le fédéralisme aboutirait à une chasse à l’homme
dont serait victime les non-originaires. Outre l’arrivée du pouvoir
d’un autre unitariste en la personne du président Laurent-Désiré
KABILA, la troisième malchance du fédéralisme au Congo aura été
la guerre dite d’agression qui a donné naissance au R.C.D. soutenu
par le Rwanda. En effet le R.C..D. ayant opté pour le fédéralisme,
beaucoup de congolais sont convaincus que cette option n’est qu’une
formule trouvée pour faciliter le contrôle du Kivu par le Rwanda et
peut-être de l’Ituri par l’Uganda. Pour éviter cette éventualité un seul
remède se présente : l’Etat unitaire.
Bibliographie
1. Bulletin Officiel du Congo Belge, années 1885-1959.
2. Constitution de la République Démocratique du Congo, 1èr
août 1964, 3ème
édition.
3. DENUIT, D., Le Congo champion de la Belgique en guerre,
Bruxelles, éd. Frans Van Belle, 1946, 189p.
4. Echo du Katanga (L’). Quotidien indépendant et
démocratique, volume 1959-1960.
5. Emerson, B., Léopold II, Le royaume et l’empire, Paris-
Gembloux, éd. Ducolot, 1980, 324p.
6. Essor du Congo (du Katanga) (L’). Quotidien africain
indépendant, Volumes 1958-1970.
166
7. JEWSIEWICKI, B., Etude analytique des archives zaïroises,
Cours de licence en Histoire, Lubumbashi, UNAZA, 1974,
22p.
8. LECLERC. CQ, C., L’ONU et l’affaire du Congo, Paris
Payot, 1964-367p.
9. LEROY, P., Les régimes politiques du monde contemporain.
Introduction générale. Les régimes politiques des Etats
libéraux, Grenoble, PUG, 2001, 176p.
10. LOUWERS, O. et G. TOUCHARD, Recueil usuel de la
législation de l’Etat indépendant du Congo Tome IV 1901-
1903, Bruxelles, P. Weissenbrugh, 1906, 971p. Tome V
1904-1906, Bruxelles, 1909, 888p.
11. LWAMBA Bilonda. M., Les accords de paix en RDC et la
réconciliation nationale : aperçu historique de 1960 à nos
jours, in Université de Kinshasa, Faculté des Sciences
Sociales, Administratives et Politiques, Premières journées
scientifiques : Quel type d’homme, quel projet de société
pour une transition efficiente en RDC ? Les Sciences
Sociales s’intérrogent., mai 2003, pp. 29-39.
12. LYCOPS, A. et G. TOUCHARD, Recueil usuel de la
législation de l’Etat indépendant du Congo. Tome premier
1876-1891, Bruxelles, P. Weissenbrugh, 1903, 685p. Tome
II 1892-1897, Bruxelles, 1903, Tome III 1898-1900,
Bruxelles, 1904-731p.
13. MULAMBU Mvuluya, Réflexion sur les remaniements
ministériels au Zaïre de 1960 à 1983, in LIKUNDOLI
Enquête d’Histoire Zaïroise, Volume IV (1984), n° spécial,
pp. 51-139.
14. NDAYWELL è Nziem, I., Histoire générale du Congo. De
l’héritage ancien à la République Démocratique du Congo,
Paris/Bruxelles, éd. De Boeck et Larcier, 1998, 955p.
167
15. PETILLON, L.A., Récit Congo 1929-1958, Bruxelles, La
Renaissance du livre, 1985, 618p.
16. Rapport annuel sur l’administration de la colonie du Congo
Belge présenté aux Chambres législatives, années 1917-
1958.
17. Recueil mensuel des circulaires, instruction et ordres de
services, année 1898-1934.
18. SAMBA, A., Congo nouveau. Réalités politiques,
économiques et diplomatiques de la République
Démocratique du Congo, Kinshasa, édition 1970-929p.
19. VELLUT, J.L., Guide de l’étudiant en Histoire du Zaïre,
Kinshasa-Lubumbashi, éditions du Mont Noir, 1974, 207p.
20. YOUNG, C., Introduction à la politique congolaise,
Kinshasa-Lubumbashi-Kisangani, édition universitaire du
Congo, 1968, 391p.
169
AUX ORIGINES DE L’ETAT MODERNE EN AFRIQUE
KIZOBO O’Bweng-Okwess*
Prolégomènes
Il est plus aisé de parler du tronc et des branches d’un arbre
que de ses racines, déclame une sagesse africaine. En effet, à
l’opposé du tronc et des branches, les racines sont invisibles. Mais
sans elles, un arbre ne peut jamais exister. Il en est de même de
l’Etat africain moderne dont les manifestations extérieures s’offrent
facilement à l’analyse scientifique. Par contre son archéologie,
s’avère ardue à saisir d’emblée parce que liée à un mécanisme
historique non moins complexe. En dépit de cette difficulté certaine,
est-il impératif, d’appréhender le fondement historique de ‘Etat
moderne en Afrique si l’on tient à répondre avec satisfaction au
questionnement : « Quel Etat pour l’Afrique de demain ? Mais avant
de se livrer à une sorte d’exégèse factuelle ayant concouru à
l’émergence de l’Etat moderne sur le continent africain, une
interrogation s’impose. Qu’est-ce qu’un Etat moderne ? Si l’Etat,
concept combien polysémique que plusieurs scientifiques ont défini,
se conçoit comme un ensemble d’individus régis par un code
permettant la manière d’être ; la modernité, quant à elle, est une
rupture avec l’ancienneté à laquelle on confère généralement des
pratiques jugées rétrogrades. L’Etat accède ainsi à la modernité
quand il cesse de se concevoir comme l’émanation divine ou
ancestrale pour se considérer comme le produit précieux de la
volonté d’un peuple. L’Etat moderne se reconnaît ainsi par l’usage
qu’il fait de la justice sociale, de l’alternance politique démocratique,
du souci de servir pour le développement du peuple, des droits de
l’homme, de la transparence dans la gestion, etc. A l’intérieur, l’Etat
moderne, comme on peut lire dans l’encyclopédie Encarta, se
caractérise par son monopole de la violence légitime, c’est-à-dire
l’usage légal de la contrainte sur les personnes. Vis-à-vis de
l’extérieur, le trait distinctif de l’Etat moderne est sa souveraineté,
autrement dit son indépendance totale, et sa compétence illimitée.
170
Enfanté par le génie occidental depuis le siècle des Lumières, un tel
Etat moderne n’est que le synonyme de l’Etat démocratique libéral.
Comme on le sait aujourd’hui, beaucoup d’auteurs pensent
que la modernité semble avoir pris en partant a cédé sa place à la
post-modernité que J.-F. Lyotard analyse dans son ouvrage intitulé
« La condition postmoderne ». Selon lui, dans le monde
postmoderne, chacun doit s’accommoder des différences cultures de
l’autre sans attente qu’elles se fondent sur un idéal de civilisation
unique1. Cela étant, on peut se demander sincèrement si ce n’est pas
un Etat post-moderne qu’il faut construire pour l’Afrique en général
et pour le Congo Démocratique en particulier ou encore, l’Etat sur-
moderne pour reprendre l’expression de Georges Balandier dans son
livre dont le titre est : « Civilisé, dit-on ? » Les concepts de « post-
modernité » et de « sur modernité » constitue une interpellation
importante en ce début du XXIe siècle car ils démontrent à
suffisance que l’époque caractérisée jusque-là par les idéaux
progressistes telles que rationalité, science, liberté, vérité, révolution,
etc. mise en cause par les guerres du XXème siècle et par la fin des
Etats totalitaires vient de se terminer et qu’une autre commence.
Dans ce cas, le modèle de l’Etat d’hier, fut-il moderne, risque d’être
anachronique par rapport au « Nouveau Monde ». La formule est
également de G. Balandier. Par ces prolégomènes, je voudrais
susciter un débat de fond sur la problématique de la construction d’un
autre type d’Etat en Afrique du XXIème siècle.
1. Naissance des Etats en histoire
Cela m’amène à m’intéresser à la naissance des Etats en
histoire dans le monde et en Afrique. Plusieurs théories sur les
origines des Etats existent toutes placent à la base de l’émergence des
structures étatiques, la volonté de l’homme de relever un défi donné
dans l’optique de l’historien anglais Toynbee et de s’imposer sur son
semblable, comme le traduit si bien l’adage latin « Homo homine
* Professeur Ordinaire à l’Université de Lubumbashi (RDC). 1 M.FOURNIER, « Postmodernité. Une idée fin siècle ? dans SCIENCES
HUMAINES, Hors série, n° 30 Septembre 2000, p.125.
171
lupus ». A partir de cette double volonté de l’homme, acteur
historique, quatre types d’Etats peuvent être distingués2. Le premier
type d’Etat naît à la suite des travaux hydrauliques. Ce fut le cas de
l’Etat pharaonique en Egypte et des Etats mésopotamiens et
asiatiques. Ce type d’Etat étudié par Marx et Engels, est appelé « Etat
de type asiatique ou Etat à mode de production asiatique (M.P.A.).
Au sein de ce genre d’Etat, l’aristocratie militaire joue un rôle
secondaire. Mais soumis aux aléas de l’histoire, cet Etat peut se
militariser. Le second type d’Etat est celui qui prend naissance à la
suite de la résistance à l’ennemi commun. En effet pour faire face à
un ennemi commun, les populations se réunissent pour lutter contre
le danger en se mettant sous l’autorité d’un chef. Tel fut le cas de la
Nubie ancienne contre les forces armées de César Auguste. Le
troisième type d’Etat et l’avant dernier, émerge quand les populations
autochtones mettent en place, de façon délibérée, un arsenal juridique
visant à écarter les étrangers de la gestion de la société. C’est l’Etat
athénien antique qui avait exclu les métèques de la gestion de la
Cité ? Le dernier type d’Etat, vient au monde lorsqu’un groupe
ethnique s’impose sur les autochtones par le biais d’une conquête
militaire ou non et refusé de se mêler aux vaincus. Dans cet Etat,
l’aristocratie militaire joue un rôle déterminant. La contestation est
toujours ethnique et se termine généralement par le génocide. C’est le
type d’Etat est appelé « Etat de type spartiate ». Exemple, l’Etat
ancien du Rwanda. Certains l’appellent « l’Etat du type tutsi ».
Au total, l’Afrique ancienne a vu émerger par-ci par-là, à
travers le temps, ces différents types d’Etat. On citera à titre
illustratif ; les Etats tels que Kerma, Nubie, Axoum, Ghana, Kongo
Mali, Monomotapa, Lunda, Kuba, Kanem Borno, etc.3 Ces Etats
furent dans la majorité de cas, des monarchies électives comme au
Royaume Kongo. Ce trait politique avait d’ailleurs frappé les Grecs
en séjour en Egypte comme Solon, Diodore de Sicile, car chez eux la
monarchie était héréditaire. La monarchie élective est une des
preuves de la pratique ancienne d’une certaine démocratie dans les
2 C.A.DIOP, Civilisation ou barbarie, Présence Africaine, Paris, 1981, p. 165-171. 3
172
Etats africains antiques. Car cette pratique ne diffère pas du système
de grands électeurs connu aujourd’hui à travers le monde.
Quel fut le sort de ces Etats Africains anciens au contact de
l’Occident ?
L’histoire des relations entre l’Afrique et l’Occident remonte
très loin dans le passé. En effet, les archéologues les situent
volontiers à l’époque préhistorique avec les migrations des
préhominiens comme l’attestent les peintures rupestres qui vont de
l’Afrique australe au sud de l’Europe en transitant par le Sahara.
L’Afrique a aussi eu des contacts avec le monde gréco-romain. Les
écrits des auteurs antiques et les études récentes le témoignent. Dans
l’imaginaire médiéval, l’Afrique devient « Terra incognita ». Et
partant, les rapports entre l’Afrique et l’Occident vont entrer dans
une ère de turbulence et se compliqueront avec l’avènement de la
traite négrière à laquelle le monde arabo-musulman naissant amena
sa caution historique. L’absence des armes à feu à la laquelle il faut
ajouter ce que l’on conviendrait d’appeler « naïveté africaine » ont
fait que beaucoup d’Etats africains anciens courbèrent l’échine
devant les Négriers très bien armés et très rusés. L’intérêt scientifique
couplé de l’amour du gain incitèrent l’Occident à pénétrer par
l’entremise des expéditions diverses à l’intérieur de l’Afrique. Sur les
ruines de ces Etats africains, émergeront les Empires coloniaux
florissant à l’instar de l’Empire britannique, l’Empire français, etc.,
que la Conférence de Berlin de 1885 essaya d’organiser afin d’éviter
les antagonismes entre les puissances extra-africaines de l’époque.
L’heure de la colonisation ou mieux de l’occupation, avait sonné. Les
quelques Etats africains agonissant rendront leur dernier soupir. Il ne
restera sur ce champ des ruines que des chefs africains de titres
quelque peu moqueurs de « chefs coutumiers », de « chefs
médaillé », etc. En Afrique, le Congo Démocratique actuelle, fut le
seul territoire à avoir eu le « privilège » d’inaugurer son ère coloniale
par l’indépendance. On le désigna, contre toute attente, par l’Etat
Indépendant du Congo avec le roi Léopold II, comme souverain. La
suite, on la connaît.
173
2. Etat Colonial
L’Etat colonial qui se mit en place Afrique après Berlin, se
ressemble à quelques choses près à l’Etat de type spartiate. En effet,
quelque soit la subtilité du langage utilisé pour désigner les différents
systèmes d’administration coloniale, en l’occurrence l’assimilation,
l’administration indirecte, etc., il y a eu le refus manifeste de
l’Occident vainqueur de se mêler aux colonisés, c'est-à-dire aux
vaincus. L’Odyssée des Africains à travers les soubresauts de
l’histoire coloniale a fait l’objet de plusieurs publications et continue
encore à inspirer les jeunes générations tant en Afrique qu’en
Occident. On veut par-là savoir ce qui s’était passé réellement entre
l’Afrique et le monde occidental. Il est connu que l’occupation
coloniale avait été mal vécue tant en Afrique qu’en Occident. Pour se
donner une conscience tranquille, comme cela est de coutume dans
tout Etat spartiate, il sera échafaudé par la colonisation une littérature
expiatoire. Car l’anéantissement de tout un peuple, ne devait susciter
chez les colonisateurs que le sentiment de la culpabilité. L’Etat
Colonial s’employa à démonter de manière systématique l’incapacité
des colonisés de s’assumer comme les êtres adultes. Ces derniers
étaient taxés de « Grands enfants » qu’il fallait guider à chaque
instant. Certes au nom de la mission salvatrice de l’Occident, l’Etat
colonial se mit à construire des routes, des chemins de fer, les ports,
les écoles, les hôpitaux, des barrages, etc. L’Afrique fit ainsi son
entrée dans la modernité comme un aveugle qu’il fallait guider à
chaque instant. On a beaucoup regretté en Afrique que l’Etat
colonial n’ait pas fait ceci, ou cela. Mêmes certains intellectuels
africains respectables se livrent à ce genre regrets assortis d’une
véritable amertume. A ceux-là, je recommande le voyage dans
l’histoire. Je ne sais pas s’ils trouveront l’expérience d’une
colonisation heureuse. Aux non-africains, je demande de s’abstenir
de citer l’Etat colonial, comme « Modèle de gestion » d’une société
humaine. Un bon Etat colonial n’existe jamais. La colonisation est
une négation de l’autre. C’est pourquoi durant les années 1960,
beaucoup de pays africains accéderont à l’indépendance. L’Etat
colonial avec son refus de se mêler aux colonisés rendit l’âme. Le
bilan de cet Etat colonial est difficile à dresser ici. Mais ce que l’on
174
peut retenir ce qu’il a détruit complètement l’Homme africain. Car
l’Homme, comme le disait L.S. Senghor, c’est-à-dire la culture, était
au commencement et à la fin du développement.
3. Etat post-indépendant
L’Etat colonial sera suivi de l’Etat africain post-indépendant.
En effet, les nouveaux Etats africains seront confrontés au problème
de l’Etat-nation. Si historiquement l’Etat apparaît à la fin de l’époque
médiévale, ce ne fut qu’à partir du XVIème siècle que naîtra l’idée
selon laquelle, à un Etat doit correspondre un groupe humain
cohérent tant sur le plan ethnique que culturel, c’est-à-dire une
Nation. L’idée d’Etat-Nation se répandra largement dans le monde
par l’entremise du mouvement des nationalités au XIXème siècle.
Les pays africains qui venaient d’être proclamés indépendants,
étaient constitués de groupes ethniques multiples. Le Congo-
Kinshasa par exemple en compte 365. Comment élaborer l’Etat-
Nation dans un tel contexte ? Pour éviter les conflits ethniques et
territoriaux, les membres fondateurs de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA), l’actuelle Union Africaine, établirent le principe de
l’intangibilité des frontières héritées du découpage arbitraire opéré
par la Conférence de Berlin (1884-1885) et consacré par la
colonisation. L’Eta africain post- indépendant se livra à la quête de
l’unité nationale non sans peine pour réaliser les promesses
électorales. Mais hélas, beaucoup de jeunes Etats africains, faute de
modèle original, eurent recours au modèles d’Etat de type occidental
que leurs peuples respectifs ne maîtrisaient pas très bien. D’autre se
tournèrent vers le modèle d’Etat de type communiste ou socialiste
d’où le règne de fameux partis uniques. A cause de la déception
engendrée par l’échec de ces modèles, on se mit à expérimenter la
recette des coups d’Etat militaires. L’armée devint ainsi la voie
privilégiée d’accès à la magistrature suprême. Comme si cela ne
suffisait pas, la carrière du président de la République devint à vie.
Quelqu’un poussera même son audace à l’extrême en se proclamant
« Empereur » en plein XXème siècle. Tout cela s’accompagna de la
dégradation économique sans précédent. Et à même, pointait à
l’horizon un Etat ethnodémocratique en Afrique. Car la majeure
175
partie des régimes politique en Afrique allait s’élaborer autour de
l’ethnie, du clan, de la famille, etc.
4. Etat ethnodémocratique
Cet Etat ethnodémocratique provoqua comme l’on pouvait
s’y attendre, beaucoup de conflits sanglants en Afrique dont le plus
meurtrier est le triste génocide rwandais en 1994 qui coûta la vie à
des milliers des Tutsi et des Hutu modérés. Quatre ans après ce
désastre humain, la République Démocratique du Congo connut « la
grande guerre africaine », comme on la désigne, avec plus de six
millions de morts dont les conséquences ne sont pas encore très bien
évaluées. L’Angola, le Mozambique, le Libéria, la Sierra-Leone,
Tchad, la République Centre Africaine, le Soudan, l’Algérie, la Côte
d’Ivoire, et ne furent pas épargnés par la folie meurtrière des
animateurs de ces Etats ethnodémocratiques. Il est souvent question
dans ces conflits de la main de l’étranger, de la recherche des
matières premières, de l’ambition individuelle, etc., Et les peuples
dans tout cela ? Rien que la misère, la maladie, la désolation. Le
continent africain continue ainsi à perdre le poids politique sur le
plan international. Il y a lieu de se demander, au regard de tout ce qui
précède, si l’Afrique a vraiment connu l’Etat de type moderne tel
qu’il a été défini plus haut ? C’est-à-dire un Etat qui garantit les
droits fondamentaux de l’individu tels qu’ils sont proclamés dans la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme ; un Etat qui fournit à
la population non seulement un cadre juridique lui permettant de
vivre et d’agir dans l’ordre et la sécurité mais aussi de promouvoir
son développement intégral. La réponse à cette question ne peut-être
que mitigée. En effet, la difficulté première qu’éprouve l’Afrique
pour réaliser pleinement un Etat moderne réside dans l’Homme
africain lui-même. C’est bien lui qui se trouve, comme on vient de le
voir, aux origines d’un Etat moderne qui devra émerger sur son
continent. A l’instar de phœnix, il devra renaître de ses cendres. Mais
comment ? Avant d’esquisser le processus de la renaissance de cet
Homo africanus, je voudrais dresser un état lieu susceptible de
circonscrire l’environnement dans lequel devra se réaliser la
176
construction de l’Etat moderne ou postmoderne en Afrique en ce
début du XXIème siècle. En un mot quelle est la situation actuelle de
l’Etat ethnodémocratique en Afrique ?
L’Etat éthnodémocratique actuel en Afrique est en train de
vivre des mutations internes profondes dues essentiellement à
l’émergence des forces sociales, économiques et politiques nouvelles.
Suite à l’écroulement du mur de Berlin mettant par-là fin à la
bipolarisation du monde, au rôle de plus en plus croissant de la
société civile dans la gestion politique de l’Etat, à la mondialisation
ou à la globalisation qui fait du monde d’aujourd’hui un village
planétaire, etc. l’Etat ethnodémocratique est véritablement pris des
vertiges. En Effet, l’Ethnie, la Tribu ou le Clan, qui jusque là, était
perçu comme une donnée monolithique autour de laquelle se
construisait cet Etat ethnodémocratique en Afrique, est fissurée par
les revendications internes d’ordre identitaire. Comme le dit Jean-
François Bayard, la revendication identitaire paraît dangereuse
lorsqu’elle devient4 un programme politique incluant l’exclusion et
l’épuration ethnique. La notion de la territorialité, composante
indispensable de tout Etat, se trouve, elle aussi, remise en question
par les effets de la mondialisation et des nouvelles technologies de la
communication et de l’information. L’Afrique est entrée ainsi dans le
monde des réseaux.5 Le gouvernement voit son pouvoir centralisateur
concurrencé par les ONG, les Associations socioculturelles multiples,
etc. C’est pourquoi Jean-Claude Ruano-Borbalan parle des
métamorphoses du pouvoir dans les sociétés contemporaines. Au
total, tout bouge en Afrique et dans le monde au même moment.
C’est pour la première fois dans l’histoire de l’Humanité que cela
arrive ainsi.
Devant cette évidence, l’Etat ethnodémocratique qui prévalait
presque partout en Afrique, est voué à la métamorphose si pas à la
disparition. A sa place doit s’ériger un Etat moderne ou post-moderne
fondé sur trois piliers, à savoir l’Education, la Formation et la
Culture. En effet, grâce à une politique éducative nouvelle, bien
pensée qui mettra l’élève africain au centre, l’Homo africanus devra
4 BAYARD, J.-B., L’illusion identitaire, Fayard, Paris, 1996, p.55 5 FORSE, M., Les Réseaux sociaux, Armand Collin, Paris, 1994.
177
déconstruire ses représentations erronées pour les remplacer par des
conceptions plus adéquates susceptibles de le transformer en un être
responsable.6 Par la formation, l’Africain devra se transformer afin de
transformer également son environnement immédiat et lointain. Dans
cette édification de l’Etat moderne ou post-moderne en Afrique, une
place de choix sera accordée à la culture selon l’entendement
senghorien du terme, c’est-à-dire, CULTURE = HOMME =
DEVELOPPEMENT. L’Etat ethnodémocratique en Afrique,
influencé sans doute par l’excès de l’analyse structuraliste et du
marxiste, avait oublié de placer l’Homme, c’est-à-dire la Culture au
carrefour de ses principales préoccupations. Aujourd’hui, les
problèmes culturels s’imposent avec force. L’homme est aussi,
comme le dit Gaëtane Chapelle, culturel. Avec la Culture, l’individu
redevient ainsi l’épicentre de toute l’action de l’Etat. Les éléments
culturels tels que le sens de la parole donnée, le respect de la
personne humaine et de l’autorité, l’esprit communautaire, le devoir
de la solidarité, la tolérance, la justice sociale, etc., hérités des Etats
paléo-africains vus plus haut, seront enseignés aux jeunes, futurs
acteurs de l’Etat moderne en Afrique.
Conclusion
C’est dire que le budget de ce futur Etat moderne africain,
quel que soit son importance, devra réserver des pourcentages
conséquents à l’Education, à la Formation et à la Culture. Dans cette
tâche, combien immense de l’édification de l’Etat moderne en
Afrique, le concours des autres peuples du monde, épris de justice et
de paix est indispensable. L’Afrique n’a pas été détruite par un seul
peuple, comme on l’a vu. Ce n’est pas de la réparation dont il est
question ici, mais c’est le simple bon sens. Le poète Senghor disait :
« on marche mieux avec deux jambes qu’avec une seulement. »
Les racines de l’arbre étant explorées, il reviendra aux autres
chercheurs d’examiner son tronc et ses branches.
6 (FOURNIER M., « Sciences de l’éducation l’élève au centre », dans
Sciences Humaines n° 100, décembre 1999, p. 29.
178
Bibliographie
Ouvrages
Curtin, P. Feierhan, L. Thompson & J. Vansina, African History,
London, 1978.
Diop, C.A.? Civilisation ou Barbarie, Anthropologie sans
complaisance, Présence Africaine, Paris, 1981.
Forsé, M., Les réseaux sociaux, Armand Collin, Paris, 1994.
Fragonard, M. La Culture du XXème siècle, Bordas, Paris, 1995.
Ndaywel, I., Histoire Générale du Congo. De l’héritage ancien à la
République Démocratique, Duculot, Paris, 1998.
Articles :
Bourjea, S., « Léopold Sédar Senghor : Poète et francophonie » dans
Notre Librairie, la Littérture Sénégalaise, Paris, Décembre, 1985. P.
P. 99-108.
Chapelle, G., « Psychologie, l’ère cognitive » dans Sciences
Humaines n°100, décembre 1999, p. 38-39.
Fournier, M., « Post-modernité une idée fin d siècle ? » dans
Sciences Humaines, Hors-série, 100 ans de sciences Humaines,
septembre 2000, p. 124-125.
Lellouche, S., « Les Sciences Sociales au temps des réseaux » dans
Sciences Humaines, Hors-Série 100 ans de Sciences Humaines,
septembre 2000, p. 126-127.
Ruano-Borbalan, J.-C., « Les métamorphoses du pouvoir » dans
Sciences Humaines, n° 100, décembre 1999, 40-41.
179
LA POLITIQUE RELIGIEUSE DE LEOPOLD II :
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE AFRICAINE ET LA
CIVILISATION EN AFRIQUE.
KALENGA wa Kubwilu Jean jacques*
Introduction
A l’ouverture de la Conférence Géographique de Bruxelles
en 1876, Léopold II avait lancé un défi à l’Europe, celui de porter la
civilisation dans le continent africain. Ils s’expriment en ces termes :
‘’ouvrir la civilisation la seule partie de notre globe où elle n’était
encore pénétrée, percer les ténèbres qui enveloppent des populations
entières, c’est, j’ose le dire, une croisade digne de siècle de progrès’’
(1).
La Conférence Géographique de Bruxelles provoqua
beaucoup d’enthousiasmes dans toute l’Europe. Pour les uns, c’était
un moyen propice pour faire pénétrer la civilisation parmi les
peuples encore barbares et mettre fin aux horreurs de la traite. Pour
les autres, un moyen d’organiser les explorations scientifiques et
commerciales dont profiteront les nations européennes (2).
Si la convergence des points de vues était la même de porter
la civilisation en Afrique, mais la divergence fut sur les moyens à
user. Ceci dépendait qu’on soit catholique ou libre-penseur.
1. L’église catholique et l’Association Internationale Africaine
Dans le milieu catholique, l’œuvre de Léopold II suscitait
beaucoup d’intérêts. Les missionnaires y voyaient un moyen pour
ouvrir l’intérieur de l’Afrique centrale. En effet, depuis déjà plusieurs
siècles, ils ne s’étaient arrêter qu’à la côte. Ils craignaient de
* Professeur associé à l’Université de Lubumbashi. 1 Conférence géographique de Bruxelles, p.4.
2 Cfr Journal de Bruxelles du 3 octobre 1876 in ROEYKENS A., La politique
religieuse de l’Etat Indépendant du Congo, Document I, Léopold II, le Saint-Siège et
les missions catholiques dans l’Afrique équatoriale (1876-1885), document n°9
180
s’aventurer à l’intérieur où les populations étaient considérées
sauvages et barbares. Ainsi aux premiers pas des explorateurs
suivraient ceux des missionnaires (3) cette œuvre était considérée
comme la seule œuvre civilisatrice capable de porter le règne de
Dieu, de faire sortir les peuples sauvages de l’état de misère à l’état
de civilisé. Elle servira aussi de bannir la traite d’esclaves dont les
Africains sont victimes. ‘’J’approuve beaucoup les idées du roi, m’a
dit Pie IX, elles me semblent bonnes et très généreuses ; j’ai été moi-
même, en Amérique, révolté de voir des marchés d’esclaves ; ce
serait une grande chose de détruire cet affreux trafic, et d’ouvrir
l’Afrique à la civilisation. La religion catholique ne peut qu’y
gagner ; je suis tout disposé à seconder le projet du roi. Veuillez le lui
dire et lui faires mes compliments’’ (4). Le pape fait état de sa
disponibilité de collaborer à cette œuvre si humanitaire et y met
l’espoir de voir la disparition de la traite. Une confirmation d’une
volonté ferme contre ce crime. Mgr Lavigerie et Mgr Comboni
avaient déjà commencé à lutter d’une autre manière contre ce
commerce, comme par les moyens de rachat des esclaves.
Quelques catholiques prévoyaient dans les futures stations,
les bases de la propagation de l’Evangile et la découverte du
continent profiteront aux missionnaires, soit par les routes les peuples
à connaître. Les missionnaires pourront suivre les commerçants(5).
2. L’appel aux missionnaires
Déjà au cours de la conférence de Bruxelles, Léopold II
avait demandé au supérieur des Scheuts, M. Vranckx, de fonder une
nouvelle mission en Afrique et un autre appel fut aux pères
trappistes. L’ambassadeur auprès le Saint-Siège était chargé d’en
3 Cfr Lettre du 15 novembre 1876, Vranckx au rédacteur en chef du journal de
Bruxelles in Ibib., document n°16. 4 Lettre du 5 décembre 1876, d’Anethan à d’Aspremont Lynden, in Ibib. Document
n°27. 5 Cfr Lettre du 27 août 1877, Duparquet à Schwindenharmmer in Ibid., document
n°49.
181
informer le Vatican sur le projet de la civilisation lancé par la
Conférence.
Si les congrégations répondirent qu’il ne leur appartenait pas
d’ériger des nouvelles missions, mais l’appel fut bien reçu à Rome où
le pape déclara : ‘’Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour cela. Je
sais qu’il y a des ménagements à garder, mais le roi peut être assuré
du concours de la propagande et je lui demande l’aide bienveillante
des explorateurs belges pour nos missionnaires. La civilisation et les
sciences sont de nobles buts ; la religion ne peut que seconder ceux
qui veulent les atteindre’’ (6).
L’appel fut lancé aussi à tous les belges et à tous les
catholiques du royaume afin qu’ils contribuent à répandre la
civilisation. Mais on notera une certaine réticence du milieu
catholique belge à cause de l’intransigeance des libéraux qui
considéraient l’Association comme œuvre exclusivement laïque où le
religieux n’avait pas de place.
A Rome, le Pape demanda Mgr Comboni, l’évêque de
Vérone de se mettre en contact avec sa majesté. Pour Comboni, c’est
une occasion pour combattre par tous les moyens moraux et
civilisateurs l’horrible fléau de la traite (7).
3. La franc-maconnerie
Les catholiques comme le maçon étaient intéressés du but de
l’Association internationale, c’est-à-dire porter la civilisation et
abolir la traite en Afrique, mais les moyens à user divergeaient les
uns des autres.
Pour la franc-maçonnerie, l’Association internationale est
une œuvre entièrement dans l’esprit de la maçonnerie et digne par
conséquent digne d’obtenir l’appui de l’ordre. Le but de l’œuvre est
l’ouverture de l »’Afrique au commerce, à la science et à l’abolition
de la traite qui épuise chaque jour le continent africain. L’Association
permettra l’abolition de la traite et ouvrir l’Afrique à la civilisation
6 Lettre du 30 mars 1878, D’Anethan à D’Aspremont Lynden in Ibid., document
n°106. 7 Cfr Lettre du 4 mars 1877, D’Anethan à Lambermontn in Ibib, document n°34.
182
européenne. Elle est exclusivement humanitaire et pacifique sans
arrière-pensée politique ou religieuse (8).
Les maçons s’y engagent donc pour les raisons évoquées ci-
dessus. Les uns pour empêcher que l’Eglise détourne l’Association
de ses objectifs exclusivement humanitaire pour en faire un
instrument d’évangélisation (9). Les autres cherchent d’abord à
s’assurer de l’absence du clergé au sein de l’Association : ’’s’il ne
s’agissait que d’établir en Afrique des relations industrielles et de
créer des débouchés pour nos produits manufacturés, il serait de notre
intérêt de nous associer au mouvement. Mais il est certain que le
clergé veut en faire une œuvre de christianisation et de lors prenons
garde’’ (10
). Il s’agira donc seulement d’établir en Afrique des
relations industrielles et de créer des débouchés pour des produits
manufacturés. Elle doit rester une entreprise humanitaire et
civilisatrice n’ayant ni arrière-pensée de conquête militaire ou de
prosélytisme religieux, apporter la liberté aux populations et
supprimer la traite.
Les stations à ériger seront essentiellement scientifiques pour
l’observation astronomique et météorologique, dans la formation de
collections d’histoire naturelles la confection de la carte, du pays,
rédaction du vocabulaire et de la grammaire du pays, dans les
observations ethnologiques.
Les stations auront une mission hospitalière pour accueillir
tous les voyageurs. Les chefs des stations seront priés à refuser
l’accès à la station aux voyageurs qui troubleraient l’application du
programme exclusivement scientifique et hospitalier. Les stations se
livreront à l’agriculture et à l’enseignement aux populations (11
).
La guerre était donc déclarée à l’Eglise dans son entreprise
d’évangélisation. Pour mieux comprendre l’esprit intransigeant de la
8 Cfr Assemblée générale du Grand-Orient de France. Septième séance samedi 15
septembre 1877 in Ibid., document n°54. 9 Cfr Séance du 11 décembre 1876 du Suprême Conseil de l’ordre du Rite Ecossais
Ancien et Accepté de Belgique, in Ibid., document n°29 10 Assemblée générale du 12 décembre 1876, in Ibid., document n°30. 11 Cfr Rapport sur la question du Congo 1877 de Couvreur, Goblet d’Alviella,
Anspach à la loge bruxelloise les amis philanthropes, in Ibid., document n°44.
183
franc-maçonnerie, il faut lire le discours de couvreur à l’Association
libérale de Bruxelles reporté par le journal ‘indépendance belge du 10
janvier 1877 : ‘’Un grand danger du projet en question serait de livrer
les nègres des controverses religieuses. Nous n’en voulons à aucun
prix. Mais l’œuvre sera laïque et scientifique, ou elle ne sera pas (les
applaudissements interrompent l’orateur). Le parti clérical a bien
senti cela, aussi a-t-il commencé par dénigrer l’œuvre. S’il nourrissait
l’arrière-pensée d’en tirer un avantage pour ses propres intérêts, ses
espérances seraient déçues, parce que l’œuvre a un caractère
international et cosmopolite. Les Anglais, les Allemands hérétiques,
les Russes schismatiques, les Français voltariens y participent, ils ne
permettront pas que l’œuvre s’écarte de son programme et livre le
centre de l’Afrique à toutes les jalousies des actes chrétiens et aux
horreurs des guerres religieuses.
D’ailleurs les tentatives de civiliser les peuples barbares par
la religion n’ont jamais réussi qu’avec l’aide du pouvoir séculier.
Derrière le crucifix était le bras du bourreau. C’est ainsi que les
jésuites ont imposé leur autorité aux indiens du Mexique, aux
Guaranis du Paraguay, aux Taglas des îles philippines ; ils ont détruit
tout ressort moral chez les peuples. La véritable civilisation ne
pénètre chez les races barbares que par la science’’ (12
).
4. L’association internationale africaine et la question
religieuse
Dans son rapport sur la Conférence Géographique de
Bruxelles, Banning présente le point de vue de celle-ci sur sa
politique religieuse. En effet, les missions religieuses sont d’un utile
concours et salutaires pour les peuples d’Afrique. Les établissements
à créer porteront un cachet purement laïc, c’est-à-dire ne
représenteront aucune confession et aucun culte. ‘’Loin d’être
hostiles à la prédication de l’Evangile, la plupart des membres de la
conférence ont été d’avis que cette prédication serait hautement
12 Journal l’indépendance belge du 12 janvier 1877 in Ibid., document n°32.
184
salutaire, qu’elle pourrait devenir le principe le plus actif de la
régénération morale des peuples de l’Afrique’’ (13
).
Par sa vertu, le christianisme sera capable de retirer de la
barbarie les Africains et les faire parvenir rapidement à la
civilisation. Quant aux missionnaires, ils pourront s’établir librement
à côté de la station, érigée dans leur rayon des temples et des écoles :
ils recevront aide et appui, ‘’ les stations n’excluent pas les autres
initiatives, elles les provoquent plutôt et les couvrent de leur
patronage’’ (14
).
Léopold II avait une attention particulière à l’Eglise dans son
œuvre de civilisation qu’il venait de créer. A Devaux il écrit : ‘’ Les
stations doivent garder leur caractère laïc, la tâche de l’évangélisation
doit être laissé aux missionnaires. C’est la grande puissance morale
qui détournera volontairement les noire des crimes que nous
chercherons à empêcher par la création des stations’’ (15
). Léopold II
dissocie le devoir approprié aux explorateurs et aux missionnaires.
Aux explorateurs, il s’agit donc de découvrir le centre de l’Afrique,
de fonder les stations. Aux missionnaires auxquels il reconnaît la
puissance morale, apporter l’Evangile.
Il s’était adressé aux congrégations de trappistes, Jésuites,
scheutistes d’aller en Afrique centrale afin d’y fonder des nouvelles
missions. Il croyait à l’œuvre civilisatrice de l’Eglise et ne cachait
pas de l’exprimer publiquement. L’ambassadeur d’Anethan informait
le Saint-siège du dit projet et le Pape Pie IX exprima son accord
total : ‘’Je ferai tout ce qui dépendra de moi’’ (16
).
C’est aux missionnaires qu’il demande des conseils. Les
missionnaires connaissant un peu bien l’Afrique sont aptes à donner
les informations appropriées, comme à Comboni et Lavigerie. Il les
invita aussi de fonder les missions en Afrique centrale.
13 BANNING., L’Afrique et la Conférence géographique de Bruxelles, p. 93. 14 Ibid., p. 93. 15 Lettre du 24 octobre 1876, Léopold II à Devaux in ROEYKENS, op.cit., document
n°13. 16 Lettre du 30 mars 1878, D’Anethan à D’Aspremont Lynden, in Ibid., document
n°106.
185
5. L’affaire Abbé Debaize
L’affaire Abbé Debaize avait mis de la poudre au feu entre
l’association internationale et les missionnaires. En effet, Debaize, un
prêtre français du diocèse de seez, s’était volontairement offert pour
accompagner la première expédition de l’Association en Afrique.
Avant son départ pour la Belgique, il écrivit une lettre au Pape Pie IX
dans laquelle il lui fit savoir sa volonté de se rendre en Belgique
pour solliciter auprès du roi d’être associé à l’expédition (17
).
Arrivé à Bruxelles, le roi lui fit savoir la difficulté qu’il peut
rencontrer en l’associant à l’expédition étant prêtre : ‘’Il me déclara
qu’à son grand regret il ne pouvait pas donner une réponse favorable
à ma demande. Voici les raisons de son refus. Le roi n’est pas libre
de faire tout le bien qu’il voudrait ; il aime de tout son cœur la
religion catholique, mais il est obligé de traiter avec des
ménagements infinis le parti anticatholique, très puissant chez-lui ; la
présence d’un prêtre étranger dans l’expédition susciterait de grandes
difficultés à son gouvernement, d’abord de la part de ce parti hostile
à la religion, et ensuite de la part des états voisins dont il avait refusé
les voyageurs qui s’étaient présentés’’ (18
).
L’expédition arriva à Zanzibar le 12 décembre 1877, Crespel
était chef d’expédition. Mais à peine arrivé, la mort emporta Maes
docteur ès science naturelles le 14 janvier. Crespel suivit 10 jours
après. Tous deux reçurent des funérailles religieuses très solennelles
et ils furent enterrés dans le cimetière de la mission. En signe de
reconnaissance, le roi envoya à la mission une charpe et une chasuble
avec un drap mortuaire (19
).
Père Horner voit dans cet avènement la punition de Dieu :’’
Les membres de l’expédition ont exclu le prêtre, et voici qu’à
quelques pas de trois prêtres, ils meurent à deux sans sacrements’’
17 Cfr Lettre du 13 septembre 1877, Debaize à Pie IX, A.P.F., S.C.R., Afrique
centrale, vol. VIII, f. 591-592. 18 Ibid. 19 Cfr Bulletin de la communauté deS. Joseph de Zanzibar du (24/25 janvier 1878) in
ROEYKENS, op.cit., document n°74.
186
(
20). Ce double décès amena les membres de l’Association à changer
d’attitude à l’égard des missionnaires. Ils comprirent la nécessité
d’acquérir des informations auprès d’eux avant de se lancer dans
l’aventure. Sur l’expédition de 1878, Horner écrit : ‘’ c’est une
entreprise bien malade, sinon complètement manquée. A présent on
s’adresse à, la mssion pour des conseils et des hommes de
confiances’’ (21
).
La libre pensée comprendre plus tard le rôle incontournable
des missionnaires dans l’exploration de ‘Afrique. En parlant de la
politique religieuse de la France, le journal libéral progressiste de
Bruxelles écrit le 18 novembre 1884 : ‘’Si le gouvernement veut
réussir, il doit nécessairement s’appuyer sur l’œuvre des missions et
l’influence du clergé, son intérêt exige désormais l’Eglise avec plus
de bienveillance et d’équité’’ (22
).
6. L’enquête de Mgr franchi sur l’association Internationale
Africaine
6.1. Le point de vue du père Planque
La Société internationale fondée à Bruxelles sous la
présidence du roi des Belges a comme but : ‘’la civilisation de
l’Afrique. Son programme est humanitaire, mais n’exclut pas
l’élément religieux.’’ ‘’Au contraire je sais de bonne source que
plusieurs des organisations et des membres influents de cette Société
désirent voir arriver des missionnaires catholiques dans ces pays’’
(23
). La Société se propose de frayer les routes à l’intérieur et
d’établir des stations pour le ravitaillement et le secours.
Le Père Planque propose donc à la propagande d’envoyer
dans cette contrée les missionnaires catholiques pour explorer
d’abord et choisir les lieux qui paraîtront propres à s’y établir. Le
20 Lettre du 7 février 1878, Horner à Schwindenhammer, in Ibid., document n°84. 21 Lettre du 24 août 1878, Horner à Schwindenharmmer, in Ibid., document n°133. 22 Journal la réforme du 18 novembre 1884 in Ibid., document n°423. 23 Rapport du 7 mai 1877, Planque à Franchi, A.P.F, S.R.C., Afrique centrale, vol
VIII, f. 485-486.
187
champ d’action serait l’équateur au nord jusqu’aux Zambèze au sud ;
à l’ouest ils pourraient s’étendre jusqu’aux limites de Luanda et de
Benguela ; à l’est ils s’arrêteraient aux limites de Mozambique et de
la mission de Zanzibar pour empêcher l’avancée des protestants et
des musulmans (24
).
Suite à cette proposition, la propagande le chargea d’étudier
les modalités et recueillir des données plus abondantes et plus
positives qui seraient examinées et proposé à l’assemblée plénière
des cardinaux. Quand la propagande confiera cette charge à Mgr
Lavigerie, le Père Planque dira : ’’ La propagande m’avait chargé
d’étudier cette question et ensuite d’y pourvoir’’ (25
).
6.2. Le rapport de Mgr Comboni sur L’Association
Internationale Africaine
Mgr Comboni se dit connaître bien l’Association grâce à
l’entretien qu’il avait eu avec le roi. Il se dit connaître tous les
comités internationaux qui se sont fondés dans les capitales d’Europe
et d’Amérique parce qu’il est en relation avec leurs présidents sauf le
chef de l’expédition écossaise (26
).
Selon Comboni, l’œuvre conçue par Léopold II se propose
d’abolir l’esclavage en Afrique. On peut donc espérer d’en tirer des
avantages pour la religion catholique après les échecs essuyés par les
expéditions qui veulent se passer de l’aide du catholicisme. Les
membres de l’expédition n’ont ni foi ni loi ne sont pas persévérants
comme les missionnaires. Ainsi conclut-il : ‘’Je suis certain qu’on
n’obtiendra aucun résultat ni pour la suppression de l’esclavage, ni
pour la civilisation européenne’’ (27
).
Parmi les membres, la plupart sont franc-maçons. Ce qui qui
amène Comboni à un jugement sévère : ‘’Le but final (de beaucoup
de membres, non pas du roi) est civiliser sans Dieu, sans la vraie
24 Ibid. 25 Ibid, p.8. 26 Cfr Rapport du 19 janvier 1878, Comboni à Franchi, A.P.F., S.R.C., Afrique
centrale, vol VIII, f. 734-737. 27 Ibid.
188
religion et sans morale. Il est impossible d’introduire la vraie
civilisation dans l’Afrique centrale et d’abolir l’esclavage sans
prédication de l’Evangile, sans la foi et l’apostolat catholique : pour
obtenir le résultat, tout effort purement humain est vain. C’est
pourquoi, tout en exhortant gentiment le roi des belges je ne casse de
lui suggérer qu’il n’y aura pas de bon résultats sans résultats sans le
concours des misions catholiques’’ (28
).
Mrg Comboni propose à la propagande de laisser agir
l’Association sans trop se soucier, car elle est vouée à l’échec. La
Propagande pourra donc agir au temps opportun. Grâce à
l’abnégation, au sacrifice et la persévérance des missionnaires,
l’Eglise en tirera un bon résultat. Ce qui explique peut-être le refus de
Mgr Comboni de fonder une mission en Afrique centrale à la
demande du roi, prétendant de vouloir fonder une nouvelle mission
sur le lac Nyanza Albert et une seconde au lac Victoria (29
).
6.3. Le mémoire secret de Mgr Lavigerie
Mgr lavigerie passe dans l’histoire comme un personnage qui
a grandement influencé les missions de l’Afrique centrale avec
‘’Mémoire secret’’. Bien que donnant l’impression de ne pas être
bien informé, Lavigerie, dans ce document, parle de l’Association
Internationale, de ses dangers, et de ses avantages pour l’Eglise.
Finalement il propose un programme des missions pour l’Afrique
centrale.
6.3.1. L’association Internationale Africaine au point de vue
religieux
Lavigerie voit dans l’Association ‘’la centralisation sous une
direction et une action unique de toutes les sociétés formées et de
toutes les entreprises tentées, depuis un demi-siècle pour
28 Ibid. 29crf Ibid.
189
l’exploration et la conquête de l’immense continent africain’’ (
30). Il
regroupe toutes les sociétés d’exploration dans l’Association
Internationale Africaine et ne fait aucune distinction entre les
explorateurs nationaux et ceux de l’Association.
Selon Lavigerie, les explorateurs qui composent
l’Association, sont la plupart libres-penseurs. Ce qui met l’Eglise
catholique dans une mauvaise posture, car étant protestantes, ils
favoriseront l’action protestante. ‘’Ils parlent de l’Eglise catholique
avec dédain et les missions protestantes en des termes très
favorables’’ (31
).
L’Evangile ou le christianisme est nommé en second plan
dans la civilisation de l’Afrique, derrière la science, et à côte du
commerce. Son cachet et son drapeau ne portent aucun signe
religieux, même pas la croix. Il voit ce qui s’est produit à Alger la
leit-motiv de cette Association. ‘’Le consul d’Alger, composé de
libre-penseurs dans sa derrière session, pris deux décisions qui
s’éclairent très bien l’une de l’autre. Par la première il a voté qu’ils
n’accordaient aucune subvention à tout établissement où serait
admise l’influence religieuse. Par la seconde, il a accordé une
subvention de cinq cents francs à l’Association internationale de
Bruxelles’’ (32
).
Lavigerie présente deux périls, le premier la connivence ou
moins ouverte avec les missions protestantes, et le second avec la
libre-pensée. Comme la plupart de ses membres sont protestants, ils
favoriseront certainement l’action protestante. Par conséquent, le
protestantisme envahira l’Afrique équatoriale, d’autant plus qu’il est
déjà planté dans la colonie anglaise du cap, des Républiques
hollandaise d’Orange, du Transvaal, Natal, du Zanzibar et exerce en
Egypte une primatie réelle. A la côte occidentale, les républiques de
Libéria et de Sierra-Leone où le protestantisme est représenté par les
nègres affranchis installés dans cette contrée.
30 Mémoire sacret du 2 janvier 1878, Lavigerie à Franchi, A.P.F., S.R.C., Afrique
Centrale. Vol. VIII, f. 546-574. 31 Ibid. 32 Ibid.
190
Néanmoins l’Association internationale présente des
avantages matériels pour les missions africaines. Elle permettra
d’ouvrir aux missionnaires de l’Afrique équatoriale. Les
missionnaires pourront trouver dans les stations de l’Association au
point de vue matériel, protection, appui et même facilités pour leur
établissement. Ils bénéficieront aussi des faveurs de transport gratuit,
hospitalisation, et protection contre les violences des indigènes que la
conférence a promis aux missionnaires. Ils pourraient aussi espérer
quelques dons ou subventions en argent, surtout par l’intermédiaire
du roi (33
).
6.3.2. Le programme d’évangélisation de l’Afrique Centrale
Deux problèmes de première nécessité à résoudre s’imposent
en Afrique centrale ; celui de l’avancée du protestantisme et la libre-
pensée avec l’Association Internationale. Lavigerie propose à Mgr
Franchi de créer immédiatement plusieurs vicariats nouveaux : celui
d’Ujiji, celui de Kabebe, celui des grands lacs Victoria et Albert et
peut-être aussi de l’Equateur africain qui pourrait se situer entre le
vicariat des grands lacs et celui de Guinée.
Il faudra donc créer autant des vicariats, autant qu’il y a des
stations. Des vicariats distincts et indépendants qui créeront ensuite
dans leur voisinage des établissements ou résidences de simples
missionnaires. Il faut créer des vicariats et non des préfectures, car un
vicaire apostolique ou un pro-vicaire aura plus d’autorité morale pour
contenir le représentant de l’Association.
Lavigerie propose finalement que le vicariat des grands lacs
de l’Afrique équatoriale et même le vicariat de l’Equateur soient
confiés à Mgr Comboni. Les missions d’Elobeid, Karthoum, du
Darfour, du Kordofan, du Djebel-Nouba soient aussi confiées à Mgr
Comboni qui pourra y envoyer un pro-vicaire. Quant aux vicariats
d’Ujiji et de Kabèbe, Lavigerie promet de mettre à la disposition de
la propagande des prêtres de sa Société.
33 Cfr Ibid.
191
LES CINQUANTE ANS DE MBUJIMAYI
MUYA Bia Lushiku Lumana Norbert*
D’après Le Petit Larousse 2OO2, le mot anniversaire
signifie : « Retour annuel d’un jour marqué par un événement, en
particulier du jour de la naissance, la fête, la cérémonie qui
accompagne ce jour. »(1) A la lumière de cette définition, une
question nous préoccupe aujourd’hui : Quand tombe l’anniversaire de
la ville de Mbujimayi, ancienne Bakwanga ? Pour répondre à cette
pertinente interrogation, examinons les points essentiels suivants :
Bakwanga avant la fondation de la ville de Mbujimayi, naissance de
la ville de Mbujimayi, Mbujimayi et sa survie.
1 .Bakwanga avant la fondation de la ville de Mbujimayi
En 1959, Bakwanga fut un point qu’il était difficile à
localiser sur la carte géographique du Congo Belge. Mais, ce petit
territoire était très bien connu économiquement par le monde entier,
à cause de ses mines de diamant industriel découvert par le
prospecteur écossais George S. Young en décembre 1918 et
exploité depuis par la Société Internationale Forestière et Minière du
Congo, la Forminière ². Cette vallée s’étendait entre les trois cours
d’eau qui forment ses limites naturelles : la rivière Mbujimayi qui
donne son nom à la ville à l’Est, la rivière Muya au Nord et la
rivière Kanshi au Sud. Le plateau de Tshibombo constitue la limite
Ouest. Le centre de la vallée était occupé par la cité européenne
habitée par les agents blancs et les cités africaines appelées baudines
où vivaient les travailleurs noirs de la société. Ces cités constituaient
un bouclier du Polygone, c’est-à-dire, les installations minières qui se
situent au confluent des rivières Mbujimayi et Kanshi. Ce Polygone
est appelé en tshiluba Mwitu, ce qui veut dire dans la forêt.
* Professeur Ordinaire à l’Université de Lubumbashi (RDC).
192
A cette époque, la contrée était habitée par les populations ci-
après :
1° Le groupement des Bakwa Nyangwila qui comprenait les clans
suivants : Bakwa Dianga, Bakwa Kapanga, Beena Dipumba, Beena
Kabongo, Beena Kansele, Beena Mabika, Beena Mbobo, Beena
Nkumbi, Beena Nyanzala et Beena Tshibuyi ;
2° Le groupement des Beena Kabeya Nkongolo, composé des
Beena Kabangu, Beena Kabundi, Beena Kapwadi, Beena Mbala,
Beena Mbayi, Beena Mpoyi et Beena Ngoyi ;
3° Le groupement des Bakwa Tshibuyi, divisé en Beena Kalanda,
Beena Mubenga, etc. ;
4°Le groupement des Basangana parmi lesquels on trouve les
Bakwa Nzevu et les Bakwa Tshibanda ;
5°Le groupement des Bakwa Tshimuna qui se situe essentiellement
au-delà de la rivière Kanshi et qui compte les clans que voici : Beena
Kaseya, Beena Madiatu, Beena Muteba, Beena Tshiabayembi,
Beena Tshiamanga, Beena Tshilumbu et Beena Tshishimbi.
Ces populations des Bakwanga pratiquaient l’agriculture
du manioc, du maïs, d’arachide, de haricot, de patate douce, etc.
Elles consommaient une partie de leur production et vendaient le
surplus à la Forminière ou sur les marchés environnants. Elles
élevaient les volailles, les chèvres, les moutons et les chiens. La
chasse, la pêche et la cueillette (champignons, chenilles et
sauterelles) n’étaient pas ignorées de ce peuple de la savane boisée.
Les agents et les travailleurs de la Forminière qui vivaient dans les
cités modernes étaient ravitaillés en produits vivriers et manufacturés
par la société. Les loisirs, les sports, l’instruction et la santé n’étaient
pas oubliés.
Erigé en territoire le 1er juin 1950, Dibindi, puis
Bakwanga, avait pris de l’importance en 1954 lorsque la Forminière
y transfère le siège de sa direction générale qui était basé à Tshikapa.
La présence de l’Etat était assurée par un commissariat de police
à Bakwa Dianga ; un camp des gendarmes, celui des agents et
commis territoriaux et une prison à Diulu.
Bakwanga était ainsi divisé en deux parties : la concession
minière de la Forminière et le reste du territoire séparées par le
193
boulevard Ngalula, aujourd’hui débaptisé sans raison profonde en
boulevard d’Inga, dans une ville sans lumière ! La concession de la
Forminière était composée de zone A, c’est-à-dire les mines et les
installations de la société appelées Polygone à Tshikisshi, et de la
zone B qui protégeait la zone A. Les deux zones étaient interdites à
toute personne étrangère à la Forminière.
Pour les étrangers à la société, il fallait avoir un laissez-
passer ou une autorisation de séjour de huit jours. La police de cités
passait avant et après le huitième jour à l’adresse du visiteur pour
avertir d’abord et pour vérifier ensuite si l’étranger était
effectivement parti. Toutes ces mesures à la fois de sécurité et de
racisme vont tomber en désuétude au moment de la naissance de la
ville de Mbujimayi, en 1960.
2. Naissance de la ville de Mbujimayi
Le Larousse de poche 2OO7 définit le terme ville comme
suit : « Ville : Agglomération d’une certaine importance où la
majorité des habitants est occupée par le commerce, l’industrie ou
l’administration. »(3) Dès l’arrivée des Baluba de la diaspora à
Bakwanga en 1960, ce poste d’Etat avait brusquement changé de
statut. Sa population avait considérablement augmenté (16.500
émigrés + 19.000 occupants) (4) ; son genre de vie avait été modifié
par le commerce, l’artisanat et l’administration.
En effet, le 8 août 1960, Albert Kalonji avait déclaré depuis
Elisabethville que « Bakwanga était désormais la capitale de l’Etat
Minier ».(5) Depuis cette déclaration, les textes ci-après furent
publiés par les autorités du moment sur l’organisation territoriale et
administrative du nouvel Etat. Il s’agit de l’arrêté n° 20/11 du 10
novembre 1960 portant l’organisation territoriale de l’Etat
Autonome du Sud-Kasaï (E.A.S.K.) , des arrêtés n°s 40/11 et40/12
du 10 novembre 1960 fixant l’organisation de l’Etat Autonome du
Sud-Kasaï. C’est ainsi que l’organisation politique et administrative
de l’Etat Autonome du Sud-Kasaï qui va survivre pour l’essentiel à
tous les régimes qui vont suivre, à savoir les régimes Ngalula en
1962 et Mukamba en 1965, qui avaient divisé le Sud-Kasaï en 10
arrondissements dont la ville de Mbujimayi, 59 communes et 39
194
quartiers au 6 avril 1966 (6). En conséquence, toutes les institutions
de l’Etat y furent établies : le Chef de l’Etat fédéré, le Parlement et le
Gouvernement.
Concernant la date précise de la proclamation de Bakwanga,
puis Mbujimayi comme ville, les sources disponibles consultées
restent muettes. D’ailleurs, la définition d’une ville donnée par le
Larousse de poche 2007 ci-haut ne mentionne pas le critère de date
d’arrêté, de décret, d’ordonnance ou de loi. Souvent, une ville existe
avant sa reconnaissance officielle. Mbujimayi en est une. C’est
pourquoi nous avons retenu et nous demandons avec insistance le
maintien de la date de la proclamation par A. Kalonji de l’Etat Minier
à Elisabethville, c’est-à-dire le 8 août 1960, avec Bakwanga comme
siège des institutions. La reconnaissance par Léopoldville de la
Province du Sud-Kasaï ne change en rien le statut de la ville de
Mbujimayi. Elle est venue confirmer ce que les gens connaissaient
déjà.
Quant aux nombreux problèmes connus par les Baluba au
Sud-Kasaï, l’histoire a retenu les plus importants ci-
après :l’installation des réfugiés venus de Luluabourg, du Katanga et
d’ailleurs, l’occupation de la population des adultes et des jeunes ;
l’alimentation ; la santé et l’éducation. Pour faire face à toutes ces
urgences, les Baluba s’étaient lancés un mot d’ordre appelé « Article
15 bis », « Débrouillez-vous. » (7) Cet article, qui ne figure nulle part
dans les deux constitutions du Sud-Kasaï , invitait les Baluba à
beaucoup travailler pour assurer leur survie et celle de leur Etat.
Mobilisés autour de ce slogan, les dirigeants politiques et religieux,
les populations valides, les organismes humanitaires et les personnes
de bonne volonté ont tous lutté pour réussir ce pari. Nous avons vu
A. Kalonji et J. Ngalula en politique ; Mgr J. Nkongolo,les prêtres ,
les abbés , les religieux et les pasteurs en religion ; V. Hutu Mukele,
H. Kadima, C. Mwamba wa mampa et C. Bajikijayi dans la
boulangerie ; C. Mbikayi, F. Tshibalabala, P. Mukendi wa tubobo, P.
Mukendi, Maison Lukusa, Ets Kansebu,etc. dans le commerce ;
Tshibangu Biayi, Mukendi Fontshi wa Tshilenge, Betu Miba, M.
Mbala et les Ouests Africains, communément appelés les Sénégalais,
dans le trafic du diamant, sans oublier Tatu Nkolongo, Tshishimbi,
195
Nkumbikumbi et les autres dans l’hôtellerie, tous, comme un seul
homme, mobilisés , pour sauver ce qui pouvait encore l’être.
Tous ces problèmes ont été partiellement ou totalement
résolus à l’exception de ceux d’eau et d’électricité qui bloquent
totalement le développement de la ville de Mbujimayi. Certains de
ces vaillants bâtisseurs ont résisté à la faillite, tandis que les autres,
les plus nombreux, ont définitivement disparu, laissant derrière eux
des écuries des femmes et d’enfants errants. Que faire alors pour
développer Mbujimayi et pour stabiliser sa population ?
3. Développement et survie de Mbujimayi
La ville de Mbujimayi a été créée par les Baluba du Kasaï
dans les conditions pénibles que l’on sait. Elle est appelée à
demeurer à jamais. Les combattants de l’époque chantaient ceci pour
manifester leur détermination : Nansha bashala banayi, kabena mua
kunyenga Etat wa minière. La ville de Mbujimayi doit, pour se
maintenir, s’attaquer et vaincre les défis essentiels qui se dressent sur
sa voie du développement. Il s’agit de la lutte contre les érosions, de
la production d’eau et de l’électricité, de la création des emplois, etc.
L’expérience nous a montré que l’individualisme, l’indifférence, la
haine, la jalousie et la méchanceté sont à la base de toutes les
souffrances que les Baluba du Kasaï connaissent à Mbujimayi et
partout où ils vivent. La solution de tous ces challenges réside dans
la mise en commun d’efforts et des moyens financiers , en créant des
sociétés anonymes ou des coopératives, possédant des statuts
notariés, dirigées et contrôlées par des gens compétents et honnêtes.
Des « lobbys » ainsi constitués peuvent aider les Baluba du Kasaï à
lutter efficacement contre les érosions, à se stabiliser à Mbujimayi et
à mettre fin aux va et vient qui les caractérisent aujourd’hui.
Après l’échec des entreprises de type familial comme Maison
Lukusa, Groupe Fontshi, etc., le temps est venu de se tourner vers
les initiatives collectives, intelligemment montées et dirigées. Les
Baluba du Kasaï doivent tout faire pour que Mbujimayi cesse d’être
un éternel foyer d’émigrations massives pour devenir une ville où il
fait bon vivre. L’argent produit par le trafic du diamant, s’il existe
196
encore, doit servir à préparer l’avenir de nos enfants par la création
des infrastructures de base de remplacement, car les mines du
diamant s’épuisent.
Il est impardonnable de constater que certains Baluba du
Kasaï fuient Mbujimayi aujourd’hui pour aller vivre ailleurs au
Congo et plus particulièrement au Katanga. Ces Baluba ont-ils déjà
oublié les exodes de 1960, de 1962, et surtout l’épuration ethnique de
1992 organisée par les génocidaires Mobutu Sese Seko, Nguz a Karl
bond et Kyungu wa Kumwanza ? Ces trois leaders sont responsables
du plus long cimetière du monde qui s’étend de Sakania à Ilebo, sans
oublier le tronçon Kolwezi-Tenke Fungurume. Ce cimetière
historique serpente le rail de la Société Nationale des Chemins de fer
du Congo (S.N.C.C.).Le génocide, le crime de guerre et le crime
contre l’humanité étant imprescriptible, nous pensons que l’Histoire
rendra un jour justice à ces dignes enfants de la République
Démocratique du Congo (R.D.C.), même à titre posthume. A ce sujet,
il existe une documentation abondante et adéquate que tous ceux qui
s’intéressent à ces massacres barbares et inutiles doivent consulter
pour être édifiés. Il s’agit des ouvrages, des bandes cassettes, des
bandes dessinées, des journaux, des chansons, des slogans, des
discours, des meetings, d’injures, etc. A ces témoignages irréfutables
sur les génocides au Katanga, il faut ajouter la Constitution de
l’époque et l’éloquent C.D. de Pie Tshibanda intitulé : Un fou noir
dans le pays des blancs. .
Devant le silence coupable du Tribunal Pénal International
(T.P.I.), les Baluba du Kasaï doivent se défendre en déposant une
plainte en bonne et due forme au T.P.I., conformément à la sagesse
de leurs ancêtres qui les oblige à le faire dans ces termes :Kazolo
dilumbuluila, c’est-à-dire , Poulet défendez-vous, ou Bupua bupua
mmukana mua muenabu. Ce qui veut dire que la parole du concerné
met fin à tout.
Depuis 1959, les Baluba du Kasaï souffrent et vivent toutes
les sortes de discrimination. La plupart des Congolais, de nombreux
Occidentaux et Africains les considèrent comme leurs ennemis et
vont jusqu’à leur attribuer de qualificatifs négatifs tels que : de mulu
vantard, de mulu orgueilleux, de mulu intelligent, de mulu tribaliste,
etc. et que s’il arrive à obtenir le pouvoir politique, il va dominer les
197
autres Congolais. Qu’est-ce que les ennemis des Baluba du Kasaï
n’ont pas fait pour diviser les fondateurs de l’Union pour la
Démocratie et le Progrès Social (U.D.P.S.) et réduire ce grand parti
politique national aux Kasaïens et aux deux Kasaï, en dépit de sa
réalité nationale congolaise ? Pensez-vous que c’est par hasard que la
ligne de haute tension Inga-Shaba puisse traverser les deux Kasaï
sans prévoir des possibilités de conversion pour alimenter les
provinces et les villes traversées ?
Les constitutions congolaises étant violées à tout moment
sans qu’il y ait poursuites judiciaires ni réparation des dommages
subis, les Baluba du Kasaï doivent tirer des leçons contenues dans
leur culture et qui vantent les mérites de leur propre patelin comme
suit :
1) Katende wasankila muenu, ku ba Luvila kudi diyoyi.
(Passereau, épanouit-toi sur ton terroir, car ailleurs, c’est la
bagarre.)
2) Luvile kupitshi kuenda, ne uye kupia tshibanda tshidi
budimbu.(Luvile, limite tes déplacements, le risque d’être pris
par la glue est permanent.)
3) Kua bende kakuena bu kuetu. ( On n’est vraiment mieux que
chez soi.)
4) Kua bende nkulu kua mutshi, dikuabu ne ukuluke. (A
l’étranger, on est comme sur un arbre perché, le risque d’en
tomber ne peut être écarté.)
5) Nkutshi wadia watangila kuenu, kua bende nkumona makenga.
(Tourterelle, consomme le regard tourné vers ton terroir, la vie
où tu es est un malheur.)
6) Kashikuila bena bilowa, biende bishala bisendame.
(Cultivateur qui, calebasses d’autrui, redresse, les siennes,
abandonnées, dégénèrent et se déforment.)
Cette sagesse ancestrale luba invite les Baluba du Kasaï à être
prudents, à ne pas rester les éternels constructeurs et bâtisseurs
d’ailleurs, alors que chez eux ils ne font rien. Ce qui est une
évidence.
La génération d’avant 1960 a été sacrifiée : elle a connu des
disettes, des tourmentes, des migrations, d’esclavage et de
198
colonisation. C’est ainsi qu’on a trouvé des Baluba du Kasaï à
travers tout le Congo, au service de la colonisation. A la veille de
l’indépendance, le colonisateur belge a dressé les Congolais contre
les Baluba du Kasaï, présentés comme envahisseurs, conquérants,
tribalistes, dominateurs, bref, »ennemis public numéro un des
Congolais ». Ce cliché est devenu une marque indélébile des
Baluba du Kasaï en particulier et de tous les Kasaïens en général.
Acculée, la génération de 1960 lutte pour sa survie et pour l’avenir
des générations futures. Elle est parvenue, au prix de sacrifice
suprême de ses dignes filles et fils, à obtenir deux résultats
mémorables que voici :
1° La création de la Province Muluba qui porta successivement
les noms ci-après : Province Minière, Etat Minier, Etat Autonome
du Sud-Kasaï , Etat Fédéré du Sud-Kasaï, Royaume Fédéré du Sud-
Kasaï, Province du Sud-Kasaï, pour terminer le 14 juin 1962, par le
Sud-Kasaï tout court.
2° La libéralisation de l’exploitation du diamant représenté par le
populaire « Article 15 bis, débrouillez-vous », qui ne figure nulle
part dans les deux constitutions qui ont existé au Sud-Kasaï et dont
les fruits du trafic sont bêtement dilapidés par les millionnaires du
dimanche que nous connaissons dans la société luba.
Les générations actuelles et à venir doivent conserver et
développer ces deux acquis précieux si elles veulent se valoriser et
pérenniser la mémoire collective des Baluba du Kasaï tombés sur les
champs d’honneur. Il ne sera pas superflu d’ériger un jour, devant la
cathédrale Saint Jean de Bonzola, un monument dédié aux Baluba
morts pour le Sud-Kasaï afin de glorifier leur lutte. Celui-ci portera
les inscriptions de leur devise suivante : Kayi kayee. Ee.
Katubengela. Kafua. Tuettu peni ? Muluee ! C’est-à-dire : A mort
notre ennemi. A nous la victoire. Cette devise qui a sauvé les Baluba
du Kasaï à Luluabourg en 1960 à la suite du rapport Dequenne sur le
conflit Baluba-Lulua, doit être un mot d’ordre de chaque instant,
car, un homme averti en vaut deux.
Les Baluba du Kasaï doivent craindre de nouvelles
migrations et épurations ethniques qui les menacent sans cesse
partout où ils habitent au Congo. Le fédéralisme que la constitution
du 18 février 2006 envisage d’appliquer en 2009 nous semble être
199
mal compris par les Congolais qui voient plus le fédéralisme
d’originaire et non celui de résidence. Donc, ils doivent agir en
conséquence en se méfiant des articles 13, 30 et 66 de cette
constitution qu’on ne respecte pas et qui disent respectivement ceci :
« Article 13
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès
aux fonctions publiques ni en aucune autre manière, faire l’objet
d’une mesure discriminatoire qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de
l’exécutif, en raison de son origine familiale, de sa condition sociale,
de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de
son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité
culturelle ou linguistique. »
« Article 30
Toute personne qui se trouve sur le territoire national a droit
d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y
revenir, dans les conditions fixées par la loi. »
« Article 66
Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses
concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des
relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de
renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques.
Il a en outre, le devoir de préserver et de renforcer la
solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. »
(8)
Ces articles, comme tant d’autres de constitutions
précédentes, constituent, depuis l’indépendance de notre pays, un
trompe-l’œil, destiné à la consommation extérieure ; leurs
contrevenants ne sont ni inquiétés, ni traduits en justice, ni punis.
Les Baluba du Kasaï de la diaspora ont beaucoup souffert. Ils
ont tout perdu en 1960 lors de l’accession du Congo Belge à sa
souveraineté nationale et internationale. Ils ont encore tout perdu au
Katanga en 1960 lors de la sécession katangaise et en 1992 à la suite
de l’épuration ethnique organisée et planifiée fortuitement par
Mobutu Sese Seko, Kyungu wa Kumwanza et Nguz a Karl Bond.
200
Aujourd’hui, ils sont diabolisés pour n’avoir pas voté massivement
Joseph Kabila aux présidentielles de 2006 et 2011.
Pour mettre fin à toutes ces misères chroniques, les Baluba
du Kasaï doivent comprendre le danger qui les menace dans le
fédéralisme d’originaires qui se prépare en République Démocratique
du Congo. Ils doivent se mobiliser afin de développer leur patelin
qu’est Mbujimayi, actuelle capitale d’érosions et d’affaissements (9).
Que ceux qui se disent riches s’associent pour sauver Mbujimayi et
stabiliser sa population. Ils feront œuvre utile.
Si nous admettons aujourd’hui que Mbujimayi est une ville,
nous devons lui reconnaître son statut d’une ville, c’est-à-dire, lui
reconnaître son autonomie urbaine qui couvre toute sa superficie. En
conséquence, toute la ville de Mbujimayi et ses cinq communes :
Bipemba, Dibindi, Diulu, Kanshi et Muya, dépendent de leur chef
qui est le Maire de la ville, nommé par l’ordonnance du chef de
l’Etat. Ceci signifie que la ville de Mbujimayi et ses dépendances
échappent à l’administration de l’autorité coutumière. Le chef des
Bakwanga n’a rien à dire sur la population urbaine, qu’elle soit
Mukwanga ou autre. Donc, l’expression Bena kalaba (propriétaires
fonciers) est nulle et de nul effet. D’ailleurs, elle viole la Constitution
du 18 février 2006. Surtout son article 9 qui stipule ceci : « L’Etat
exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-
sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et
maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur
le plateau continental. »
201
Notes.
(1) LE PETIT LAROUSSE 2002, Paris, 2001, p.69.
(2) LA FORMINIERE 1906-1956, Bruxelles, 1956, p. 109.
(3) LE LAROUSSE DE POCHE 2007, Paris, 2006.
(4) MUYA Bia Lushiku Lumana, Les Baluba du Kasaï et la
crise congolaise (1959-1966), Lubumbashi, 1985, p. 17.
(5) MUYA Bia Lushiku Lumana, Op.Cit.p107.
(6) MUYA Bia Lushiku Lumana, Op.Cit.p.114-116.
(7) MUYA Bia Lushiku Lumana, .Op.Cit.p.184.
(8) CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006, C.E.I., Kin., 2006,
pp.4, 5 et 8.
(9) Il y a à Mbujimayi, 450 têtes d’érosions et 350 affaissements
environ de terrain.
Bibliographie.
1.C.E.I.,CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO, Kinshasa, 2006.
2. LA FORMINIERE 1906-1956, Bruxelles, 1956.
3. LE LAROUSSE DE POCHE 2007, Paris, 2006.
4. LE PETIT LAROUSSE 2002, Paris, 2001.
5. MUYA Bia Lushiku Lumana, Les Baluba du Kasaï et la crise
congolaise (1959-1966), Lubumbashi, 1985.
203
L’EMIGRATION INTELLECTUELLE DES JEUNES :
ELEMENT DE COMMUNICATION DE LA SOCIETE
LUSHOISE
SUKADI Mangwa Christelle*
et KIZOBO Fel Opel Guy*
Introduction
Depuis un bon nombre d’années, le désir des jeunes
congolais de voyager hors du pays pour leurs études n’a pas cessé de
s’accroître.
Qu’il s’agisse du cycle d’études secondaires ou universitaires, les
jeunes congolais recherchent le meilleur. Ils recherchent l’excellence
dont sont caractérisées la plupart des institutions de l’enseignement à
l’étranger. La dégradation du niveau de l’enseignement en
République Démocratique du Congo n’améliore guère la situation et
précipite de ce fait, les Congolais en général et les Lushois en
particulier, à n’avoir qu’une seule destination pour leurs projets
d’étude les plus sérieux : l’extérieur des frontières congolaises. Ce
sont surtout des pays comme la République Sud Africaine, la France,
la Belgique,...qui deviennent berceaux pour des intellectuels
congolais. Cette situation est souvent source des difficultés sociales
aussi bien dans la diaspora congolaise, qu’au sein de la population
lushoise car cette « émigration » reste un grand problème pour la
communauté intellectuelle locale.
La communication semble s’inviter partout, dans toutes les
activités, dans la vie sociale. Le terme « communication » désigne à
la fois la production de sens et de représentation individuelle ou
collective, le transport et la transmission d’information, l’échange
intentionnel de messages.1 La communication est une activité
Assistante à l’Université de Lubumbashi.
204
d’interprétation. Nous considérons qu’il est important de relever
l’aspect communicationnel de l’émigration intellectuelle des jeunes
Congolais. Chacun, en fonction de ses expériences, de sa culture, de
son statut social, etc.2, attribue des significations différentes à un
même message. Dans cet article, nous allons interpréter sous un œil
de communication, cette émigration intellectuelle des jeunes lushois.
Nous considérons ce phénomène comme une communication car il
nous permet de déduire des réalités vécues par les jeunes intellectuels
lushois, il nous permet de conclure à des affirmations sur la société
congolaise et il nous permet de nous faire une idée concrète sur la
question. Bien au – delà de tout cela, nous analyserons cette situation
sous un angle de communication pour obtenir de chacun des lecteurs
un feed-back et, une réaction.
Le présent article s’article autour d’une triple interrogation à
savoir :
1) Quelle est la proportion des élèves finalistes lushois qui veulent aller
en dehors de la RDC pour les études universitaires ?
2) Quels sont les pays les plus convoités par les finalistes pour leurs
universités ?
3) Pour quelles raisons les finalistes lushois préfèrent effectuer leurs
études universitaires à l’étranger que dans leur propre pays ?
Pour répondre à ces questions, il était logique de mener une enquête.
1. Univers et résultats de l’enquête
L’univers de l’enquête est composé des élèves finalistes
lushois. Notre choix a porté sur 5 écoles de la ville de Lubumbashi. Il
s’agit du complexe scolaire Anuarite, du Collège Imara, du
Assistant à l’Institut Supérieur de Commerce/Lubumbashi 1 Mpungu Mulenda, Information et communication, 2
ème édition, Presses
Universitaires de Lubumbashi, Lubumbashi, 2011, p 88 2 Wolton D., Dacheux E., Silvoz E., la communication, CNRS Editions,
Paris, 2001, p 21
205
Complexe scolaire Imani /Mgr Nsolotshy, du Complexe scolaire
l’Age d’Or et du Lycée Tuendelee. 100 élèves de ces écoles ont
constitué l’échantillon pris pour l’enquête. La méthodologie utilisée
pour l’enquête s’est basée sur le quantitatif et sur le qualitatif. Les
données quantitatives qui ont résulté du dépouillement des
questionnaires nous ont permis de déterminer les proportions exactes
des divers avis de la population enquêtée, afin de parvenir à fournir
des explications sur ces chiffres.
La partie qualitative quant à elle a consistera en l’explication des
résultats chiffrés obtenus à l’issu du questionnaire. Le quantitatif a
été un élément capital car de lui, nous avons tiré des réponses de
notre problématique.
La technique utilisée pendant l’enquête est celle du
questionnaire. En effet, pour recueillir les informations, nous avons
procédé à l’établissement d’un questionnaire auquel devront répondre
les sujets enquêtés de l’univers de l’enquête. A la question qui
consiste à savoir si les élèves préfèrent étudier dans une institution
locale ou étrangère, 15 élèves sur 100 ont prétendu préférer étudier
dans une institution locale d’enseignement et 85 élèves sur 100
préfèrent étudier à l’étranger. Cette question peut être considérée
comme le cœur de ce travail. Le simple fait d’avoir les résultats de la
question dit beaucoup sur l’image des institutions locales
d’enseignement. Seul 15% d’élèves désirent effectuer leurs études à
Lubumbashi après leur cycle secondaire. Ce chiffre est plus alarmant
que nous ne pouvons le penser. Cela voudrait dire que le sol lushois
serait presque totalement vidé de sa population intellectuelle d’ici
quelques années si certains élèves n’éprouvaient pas des difficultés
financières ou autres pour partir à l’étranger. La question a été posée
de manière à obtenir des réponses libres c'est-à-dire sans prendre en
compte les facteurs qui pourraient influer sur le choix des élèves.
C’est une manière de voir réellement quelles sont les intentions
profondes qui règnent au sein de la population finaliste du cycle
d’études secondaires.
Autre chiffre parallèlement alarmant, 85% d’élèves
interrogés disent vouloir poursuivre, s’ils ont le choix, leurs études à
l’étranger. Cela veut dire que des pays étrangers regorgeraient de
milliers et de milliers d’intellectuels lushois. Pour analyser
206
qualitativement ces deux situations, nous pouvons dire qu’à la base
de tout, il y a d’un côté un problème de communication des
institutions locales et d’un autre, une excellente politique de
communication non seulement des universités étrangères, mais aussi
de leurs pays respectifs. Ces 15 et 85% résultent :c
Une image peut être acceptable par des institutions locales
devant retenir les futurs étudiants. Les élèves, dès le début de
leurs études du cycle secondaire, si pas plus tôt, se forgent
déjà une image négative de ce que sont les études supérieures
à Lubumbashi.
Le pire dans cette situation, c’est que des 15% qui veulent poursuivre
leurs études ici, la majorité avance comme raisons le fait de pouvoir
réussir facilement, sans aucun effort intellectuel considérable.
Cela veut dire que, non seulement, la majorité préfère s’en aller, mais
aussi que la minorité qui reste le fait pour des raisons
inacceptables en l’occurrence le moindre effort.
Une communication bonne image des institutions
d’enseignement universitaire à l’étranger. Cela est dû à leur
meilleure politique de communication. Il s’agit d’un
processus global comportant l’effort d’une bonne image
provenant des institutions étrangères et l’effort des pays
bénéficiaires de la « fuite des cerveaux ».
Devons-nous nous estimer heureux que la grande majorité
d’élèves qui désirent étudier à l’étranger ne s’en aille pas à cause du
manque de finances nécessaires ?
Les sciences de l’information et de la communication peuvent
remédier à cette situation catastrophique en élaborant une bonne
politique de communication pour les universités congolais. A la
question qui consiste à opérer un choix sur un pays étranger pour les
études après le secondaire, 15 élèves sur 100 ont choisi l’Afrique du
Sud, 22 ont choisi la France, 29 ont choisi les Etats Unis d’Amérique,
16 ont choisi la Belgique et 18 le Canada. Comme on le voit le plus
grand nombre d’élèves à porté son choix sur les Etats Unis
d’Amérique, soit à 29%. Ceci est dû au fait que c’est un pays qui
offre beaucoup d’opportunités, c’est le pays qui a toujours fait rêver
la plupart des jeunes. Car il possède des centaines d’universités très
207
réputées. Il est donc tout à fait logique que les élèves l’aient choisi en
grand nombre.
En seconde position, c’est la France qui est choisie par 22%
des élèves enquêtés.
L’une des grandes raisons est le fait que le pays francophone et en
tant que tel, c’est déjà un grand avantage pour ceux qui désirent y
étudier. En dehors de l’aspect francophone, il y a le fait que la France
regorge aussi comme les Etats Unis d’Amérique, de plusieurs
universités très bien réputées. C’est le pays européen par excellence
pour les jeunes étudiants. Le troisième pays choisi à 18 % est le
Canada. Le Canada est en partie francophone, et est le pays qui est le
plus favorables aux « nouveaux venus ». Il n’est pas difficile de
s’installer au Canada, de trouver du travail, il a une politique
d’immigration très souple. Il arrive d’ailleurs souvent que le Canada
lui-même fasse appel à des personnes pour travailler sur son sol, pour
y habiter. Le quatrième pays choisi est la Belgique avec 16%
d’élèves qui l’ont choisi. C’est un des pays d’Europe qui a une
grande concentration de la diaspora congolaise. Il possède aussi en
son sein des bonnes universités qui offrent une formation de qualité.
Le lien nostalgique de paternité entre anciens colonisateurs et
colonisés est encore très présent.
Le pays qui vient en cinquième position est l’Afrique du Sud
avec un choix de 15 élèves sur 100. Ce pays est souvent convoité par
les jeunes congolais déjà de par la facilité qu’il y a d’y arriver : si
pour aller aux USA, en France, au Canada, en Belgique il faut
prendre l’avion, en Afrique du Sud on peut y arriver par route. Les
prix sont plus ou moins abordables dans les universités qui sont de
qualité et ont l’avantage d’être bien cotées sur le plan international.
L’anglophonie ajoute un plus à la formation académique de par
l’émergence des domaines exigeant la pratique de l’anglais.
Quand on demande à 100 élèves les raisons pour lesquelles
beaucoup de congolais vont poursuivre leurs études à l’étranger, 57
disent que c’est parce que les conditions d’étude y sont meilleures, 5
pensent que c’est parce qu’ils ont le goût de l’aventure, 3 disent que
c’est parce qu’ils pensent que la vie y est moins chère, 21 pensent
que c’est pour obtenir facilement du travail après les études, 12
prétendent que c’est parce que ceux qui sont partis avant réussissent
208
mieux leurs vies aujourd’hui et 2 donnent d’autres raisons comme le
fait qu’à l’étranger on s’épanouit mieux qu’en RDC ou encore qu’il
est possible d’avoir plus d’opportunité de choix de spécialisation
dans les autres pays. C’est dire que 57% d’élèves pensent que les
congolais vont étudier à l’étranger parce que les conditions d’étude y
sont meilleures. Ceci montre à quel point les fameuses conditions
d’étude dont les congolais se plaignent souvent y sont pour
beaucoup. Les bâtiments en piteux état n’ayant dans la plupart des
cas pour seul éclairage que la lueur du soleil, le matériel de pratique
insuffisant, les points difficilement obtenus,… A couse de tous ces
éléments, les jeunes congolais partent à l’extérieur de leur pays. 5%
pensent que les Congolais partent parce qu’ils ont le goût de
l’aventure, qui les pousserait à s’en aller découvrir de nouveaux
horizons, de nouvelles cultures, de nouvelles façons d’être formés à
l’université, dans des instituts supérieurs. 3% d’élèves a choisi
l’option qui dit que c’est parce qu’ils pensent que la vie y est moins
chère. Cette conception erronée sur l’étranger est encore présente
dans le chef de beaucoup de jeunes congolais. On s’imagine que la
vie est facile ailleurs et ce, parce qu’on estime ne pas pouvoir plus
souffrir en dehors des frontières congolaises. 21% pensent que c’est
pour obtenir facilement du travail après les études que les congolais
s’en vont. C’est un pourcentage important qui reflète une autre réalité
de la vie du jeune congolais. Obtenir du travail après les études est un
vrai parcours du combattant dans la plupart des cas. On est sûr
qu’ailleurs il suffit de finir ses études, rédiger une lettre de demande
d’emploi pour devenir travailleur contrairement à la réalité locale.
Ceci est dû au fait que la culture de la création d’emploi n’est pas très
répandue et que les nouveaux émergents sont souvent matés.
12% des élèves interrogés pensent que les jeunes congolais
quittent le pays parce que ceux qui sont partis avant réussissent
mieux leurs vies aujourd’hui. Il y a encore aujourd’hui dans la culture
congolaise, le besoin de ressembler aux aînés. Quand on observe un
homme, une femme dont la vie a réussi, on s’imagine qu’il faut
passer par la même voie pour arriver aussi soi-même à la réussite.
Ainsi, le désir de réussir sa vie influe aussi grandement sur la
décision de quitter le pays.
209
Deux autres pourcent ont donné d’autres raisons comme
qu’ailleurs on s’épanouit mieux qu’en RDC ou qu’il est possible
d’avoir plus de choix de domaines de spécialisation. Tout homme a le
besoin de s’affirmer dans le milieu où il évolue. Les institutions
étrangères contrairement aux locales ont l’avantage d’encourager les
étudiants à effectuer des recherches, à créer, à imaginer des pistes de
solutions à apporter à la science. L’esprit d’initiative est prôné. En
dehors de cela, quand un jeune congolais vous parle de spécialisation,
vous pouvez être sûr qu’il pense l’effectuer à l’étranger. Parce que
bien entendu, il y a plusieurs domaines de spécialisation qui ne sont
pas développés localement. Somme toute, l’étranger demeure un
« paradis » rêvé par les jeunes Congolais.
2. L’étranger, Eldorado des jeunes congolais
Depuis l’accession des pays africains à l’autodétermination à
aujourd’hui, soit exactement deux générations, nous entendons parler
de l’aide, de dons, de coopération entre les pays africains et les
nations occidentales. Seulement, cette aide n’a eu aucun effet majeur
pour sortir l’Afrique du cercle vicieux du sous-développement, du
goulag de la pauvreté, de la misère et de la dépendance de
l’extérieur3. Dès lors, le meilleur recherché par les jeunes africains se
trouve en dehors de leurs frontières. Plusieurs années après son
indépendance, la RDC assiste impuissante à un départ massif des
jeunes élèves et étudiants vers l’étranger, en vue non seulement
d’entreprendre ou de parfaire des études, mais également de réaliser
le rêve qu’ils n’ont pas pu accomplir chez eux. L’Europe exerce sans
aucun doute un grand attrait sur ces jeunes gens. Il faut, déclarent-ils,
voir un jour l’Europe, y vivre, y entreprendre facilement les études, y
tailler dans la pierre (kobeta libanga, disent-ils en lingala), autrement
dit y trouver du travail, peu importe lequel. C’est tout un programme,
et aucun obstacle ne peut gêner ni contrarier leur ambition.
3 MAYEGA F., L’Avenir de l’Afrique La diaspora intellectuelle
interpellée, L’Harmattan , Paris, 2010, p. 17
210
Tous les moyens sont donc permis pour y parvenir. Les
immigrés rêvent d’y amasser rapidement une fortune qui leur
permettra d’accéder à un rang social meilleur par rapport à celui de
leurs camarades restés au pays. Quoi qu’il en soit, l’Europe apparaît à
leurs yeux comme un modèle et synonyme d’aisance matérielle,
c’est-à-dire, l’absence des problèmes inhérents à l’Afrique : la faim,
l’analphabétisme, le manque et/ou l’insuffisance des places dans les
universités, les mauvaises conditions d’étude, l’injustice, le chômage,
etc. Mais une fois sur place, que des désillusions, des déceptions.
Chaque année l’Afrique perd ses espoirs, ceux qui sont censé
la construire ou la reconstruire, ceux qui sont censée lui donner un
nouvel élan vers le développement, ceux qui sont censé faire d’elle
un eldorado…Le congolais aussi s’en va vers cet eldorado. Le désir
de chercher le meilleur à l’étranger dépasse de loin le désir de
développer le pays en acceptant de croupir dans la « misère » .
3. La fuite des cerveaux
Selon le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), la fuite des cerveaux se produit lorsqu’un
pays perd sa main d’œuvre qualifiée en raison de l’émigration. Il
faut donc entendre ici par fuite de cerveaux, l’émigration des
travailleurs qualifiés, des universitaires et d’autres intellectuels, vers
d’autres pays pour diverses causes. 4
La fuite des cerveaux ou exode des cerveaux ou drainage des
cerveaux, désigne les flux migratoires des scientifiques et des
chercheurs s'installant à l'étranger pour trouver de meilleures
conditions de vie, de travail ou de rémunérations.Plusieurs termes,
essentiellement des anglicismes sont employés pour désigner ce
phénomène et traduire sa dynamique multipopulaire, accélérée et
diversifiée, dans les contextes économique, politique et
technologique actuels : « profesionnal transients », « brain gain »,
« reserve transfert of technology », « transit brain drain », « delayed
4. Kouvibidila G.-J, La fuite des cerveaux africains, Le drame d’un continent
réservoir, L’Harmattan, Paris, 2009, p 9.
211
return », « skilled transients », « brain mobility », « brain
exchange ».Le terme couramment employé par les Anglo-saxons est
« brai drain », c’est-à-dire drainage des cerveaux. Pour les Anglais
par exemple, il s’agissait , à l’origine de recruter, à leur profit, des
cerveaux dans d’autres pays en leur proposant des conditions
professionnelles salariales plus avantageuses. Chez les francophones,
certains l’appellent « fuite des cerveaux », d’autres la qualifient de
« traite des cerveaux », la comparant, à tort ou à raison, à la traite
négrière dont les anciens colonisateurs furent les vils bénéficiaires.5
Au début des indépendances, les pays d’Afrique au sud du
Sahara voyaient leur avenir avec optimisme. Ils ont misé sur le
développement rapide pour « sans tarder » venir à bout de
l’ignorance, de la pauvreté, de la maladie et de l’insécurité
alimentaire. Cette tendance tablait sur la croissance continue de
l’économie mondiale dont il semblait que l’Afrique subsaharienne
devait bénéficier de façon prioritaire. La communauté des bailleurs
de fonds partageant ce sentiment n’a pas manqué de fournir l’aide
nécessaire. Dans cette dynamique de modernisation, de nombreux
pays africains ne possédant pas d’institutions, ont envoyé leurs
étudiants se perfectionner dans les universités et centres de recherche
des pays du Nord afin d’accélérer la formation des ressources
humaines. Mais plusieurs d’entre eux ont choisi d’y rester une fois
leur formation terminée. Le même phénomène touche les
professionnels qui, n’étant pas parvenus à réintégrer totalement leur
pays d’origine, décident de retourner dans celui où ils ont fait leurs
études. Selon l’UNESCO, plus de 30 000 africains titulaires d’un
diplôme de 3ème
cycle universitaire vivraient en dehors du continent
et 25 000 boursiers africains qui sont allés faire leurs études dans les
pays de l’Union Européenne n’ont pas regagné leurs pays d’origine.
Le phénomène de « fuite de cerveaux » n’est pas nouveau et
remonte aux années 1950. A cette époque, le terme désignait le
départ massif des scientifiques et ingénieurs britanniques vers les
5 Nedeleu M. (dir), La mobilité internationale des compétences-situations
récentes, approches nouvelles, ouvrage sous la direction de Mihaela
Nedelcu, Paris, L’Harmattan, Paris, 2004, pp 11-12
212
Etats–Unis. Depuis, il est réservé aux migrations scientifiques du Sud
vers le Nord et depuis peu les scientifiques de l’Est. La migration est
favorisée par la politique de séduction que mènent les pays
développés vis-à-vis de ceux qu’ils ont formés (bien souvent aux
frais de leurs pays d’origine). Il est une évidence qu’il existe une
corrélation étroite entre le lieu de formation et les flux migratoires
des intellectuels. Afin de réduire cette migration internationale
préjudiciable au développement, de nombreux pays d’Afrique se sont
engagés dans un processus de création (parfois de revitalisation) des
universités, des institutions régionales de formation professionnelles,
et des centres nationaux et régionaux de recherches qui sont
potentiellement les institutions les plus compétentes des pays
d’Afrique subsaharienne pour mener des recherches qui enrichissent
le savoir par des connaissances nouvelles ou qui acquièrent et
adaptent les savoirs aux conditions locales, pour favoriser
l’assimilation et l’utilisation des connaissances qui renforcent les
moyens humains et pour s’investir dans les nouvelles technologies
qui produisent des biens et services.
Pour une coopération plus judicieuse Mr Cheikh Modibo
Diarra disait que « les pays devraient mettre en commun leurs
maigres moyens pour créer des institutions sous-régionales de
formation et de recherche pour contribuer à la lutte contre la fuite des
cerveaux africains ». Les institutions sous-régionales d’enseignement
supérieur constituent alors un dispositif essentiel dans le plan
stratégique de lutte contre la fuite des cerveaux.6 Les principales
raisons de la fuite des cerveaux sont: insécurité politique,
insuffisance, voire quasi inexistence des moyens de travail ; risque
pour leur vie en cas de conflits armés, car les intellectuels sont
souvent la cible de l'homme fort du moment lorsque ceux-ci sont
opposés à ses idées politiques et à sa gestion du pouvoir. Les
exemples sont légion partout en Afrique. Il y a aussi la quête
permanente des biens matériels qu'ils ne peuvent acquérir dans le
6 KABORET Y., Eviter la fuite des cerveaux en Afrique subsaharienne :
Rôle des institutions sous-régionales de formation et de recherche
.Communication présentée à la Conférence Régionale sur l’exode des
compétences et développement des capacités en Afrique.
213
pays d'origine où les dirigeants brillent par leurs politiques
hasardeuses et contre productives. Même si la responsabilité
principale incombe aux Etats africains, qui ne font pas grand-chose
pour éviter cette hémorragie, les pays d'accueil sont coupables du
recrutement abusif des cadres africains qu'ils n'ont pas contribué à
former, sinon partiellement, ce qui aggrave une situation déjà
dramatique sur le continent. Ils sont d'autant plus responsables qu'ils
le font en connaissance de cause. Plus grave, les cerveaux africains
sont sous-employés et sous-payés dans les pays riches. Ces pays n'ont
donc aucune excuse.
Des solutions existent pour lutter contre la fuite des
cerveaux: il y a des solutions internes et externes à l'Afrique. Selon
les analystes économiques et politiques, soit les Etats africains
mettent en place, maintenant, des politiques audacieuses qui
favoriseront le développement économique et portant l'inversion de la
tendance de l'émigration, soit c'en est fini d'une Afrique responsable.
Et tous les cerveaux s'en iront dans les pays riches.
Malheureusement, ces Etats ne semblent pas prendre réellement la
mesure de ce phénomène qui pénalise plus l'Afrique que d'autres
continents. Très peu d'entre eux ont compris qu'il faut créer des
structures économiques, des Centres de recherche technologique et
des logements pour recevoir les cerveaux expatriés. 7Comme on le
voit, avec le désir effréné des jeunes Congolais d’aller étudier à
l’étranger, la RDC favorise également la fuite des cerveaux.
Conclusion
Le présent article se veut être un outil révélateur d’un
problème important que vit la ville de Lubumbashi en particulier et la
République Démocratique du Congo en général. Des milliers de
jeunes congolais quittent le pays sous les regards impuissants et
passifs du peuple congolais. Les Sciences de l’Information et de la
Communication sont à mesure de résoudre à long terme ce problème
7 http://www.senat.fr/rap/r99-388/r99-388_mono.html
214
important en mettant à la disparition des universités congolais une
meilleure communication pour les élèves.
Cet article révèle des chiffres effrayants mais qu’on ne veut
prendre la peine d’analyser sérieusement. Il ressort le désir profond
de toujours chercher l’avenir en dehors de frontières de la République
Démocratique du Congo. Les questions posées ont trouvé des
réponses à l’issue de l’enquête menée posées au début du travail dans
l’introduction. La société congolaise est rongée par un mal auquel il
faut remédier. Le remède par excellence à ce problème n’est rien
d’autre qu’un immense plan de communication qui serait réalisé par
des communicologues à tous les niveaux concernés par la mauvaise
image que les jeunes congolais ont des institutions locales
d’enseignement supérieur et universitaire. Pendant des années,
l’homme s’est posé des questions sur la résolution de certains
problèmes et beaucoup de ces problèmes n’ont été résolus qu’avec
l’avènement de la communication.
Des efforts doivent se faire sentir dans tous les domaines et encore
plus en communication. Une organisation peut posséder des finances,
des ressources humaines et techniques, des matières à transformer,
tant que la communication ne s’y intègre pas, le fonctionnement de
cette grosse machine institutionnelle est voué à l’échec. Les sciences
de l’information et de la communication sont donc destinées à sauver
ce qui se meurt où les autres sciences n’ont rien pu faire.
Au niveau des institutions respectives, il est important de
mettre sur pied un plan de communication en collaboration avec la
hiérarchie et tous les services et ainsi s’entendre sur les actions à
entreprendre pour améliorer, redorer ou même créer une image
favorable pour l’organisation. Chaque organisation devra effectuer ce
travail en tenant compte du contexte dans lequel elle évolue. Ainsi
seront élaborés des documents qui informent sur ces institutions, des
sites internet bien entretenus seront mis sur pied, des descentes dans
les écoles seront organisées pour accrocher les futurs étudiants, des
travaux seront opérés sur les infrastructures,… bref un colossal
travail des relations publiques doit être entrepris… Tout ceci en
recherchant premièrement un sentiment de sympathie auprès des
étudiants et des futurs étudiants, en recherchant leur confiance.
215
Au plus haut niveau de l’enseignement national des décisions
de communication doivent aussi être prises afin qu’il y ait une
concordance dans la politique générale de toutes les institutions
d’enseignement. De plus, il ressort au cours de ce travail que ce qui
est recherché par les futurs étudiants, c’est la nécessité d’évoluer, de
réellement grandir intellectuellement, d’appartenir fièrement et avec
enthousiasme à une institution, d’en être un élément important et
pour cela il y a toute une organisation autour qui doit être montée. Un
des enseignements tirés est que la société congolaise est un vaste
champ d’action pour les communicologues. Les sciences de
l’information et de la communication, bien qu’étant des sciences
nouvelles par rapport aux autres, ont aujourd’hui beaucoup à
entreprendre. Toutes les institutions d’enseignement qui sont vidées
de 85% de leur population, tous ces grands professeurs, chefs de
travaux et assistants disposés à transmettre leur savoir, tous ces
agents prêts à leurs postes à chaque rentrée académique, même sans
le dire, ont le regard tourné vers la communication.
Bibliographie
1. MAYEGA F., L’Avenir de l’Afrique La diaspora intellectuelle
interpelée, L’Harmattan, Paris, 2010.
2. Mpungu Mulenda, J., Information et communication, 2eme
Edition, Presses Universitaires de Lubumbashi, Lubumbashi,
2011.
3. NEDELCU M. (dir), La mobilité internationale des compétences
situations récentes, approches nouvelles, l’Harmattan, Paris,
2004.
4. WOLTON D., E. DACHEUX, E. SILVOZ, La communication,
CNRS, Paris, 2001.
217
L’IMPACT SOCIO-CULTUREL DE L’USAGE DE
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO.
KIZOBO Fel Opel Guy et
SUKADI Mangwa Christelle*
Introduction.
En ce début du XXIe siècle, le monde vibre au rythme de la
mondialisation ou de la globalisation. Le village planétaire s’est
construit grâce entre autre aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Lesquelles nouvelles
technologies liées à la création de réseaux satellitaire, la numérisation
des signaux, la convergence entre le multimédia, les
télécommunications et l’informatique ayant réduit sensiblement les
distances entre les différents coins de la planète grâce notamment à
l’Internet, l’e-mail, le fax, le téléphone cellulaire, etc., accéléré le
temps entre les interlocuteurs. D’emblée la mondialisation a-t-elle
suscité un certain nombre des répercussions nouvelles qui affectent
tous les secteurs de la vie allant de la politique à la culture en passant
par l’économie et le social.
En effet dans son intéressant article intitulé : « Penser la
mondialisation », Jean-Claude Ruano Borbalan résume les principaux
axes des recherches scientifiques sur la mondialisation en ces
termes : « En dix ans, les interrogations se sont portées sur trois
aspects différents : d’abord la réalisé de l’intégration économique et
ses conséquences sur les Etats, puis la relation de l’impact de la
mondialisation. Enfin, on se préoccupe depuis quelques années
fortement des aspects culturels de la mondialisation » (1).
C’est dire que les hommes de sciences ne sont pas en reste
depuis l’explosion des nouvelles technologies de l’information et de
1 -J.C.R- BRBALAN, "Penser la mondialisation" dans Sciences Humaines, Hors-
série, n° 30, Septembre 2000, p. 116.
218
la communication qui, en Afrique, date des années quatre-vingt-
vingt-dix avec comme produit phare, le téléphone cellulaire. (2) Les
scientifiques ont pris à bras le corps aussi l’évaluation de l’impact de
ces nouvelles technologies tant sur la société que sur la culture.
La présente communication s’inscrit dans cette
préoccupation. Mais évaluer l’impact d’un secteur aussi vaste que les
nouvelles technologies de l’information et de la communication dans
un sous-continent qu’est la République Démocratique du Congo, se
veut une tâche ardue. D’abord, le processus de l’impact de ces
technologies n’a pas encore pris fin. Ensuite la pluralité de ces
technologies rend toute évaluation de l’impact difficile au niveau
global car les répercussions de l’Internet par exemple ou du courrier
électronique ou encore du téléphone cellulaire, ne s’exercent pas de
la même façon sur une culture ou dans une société donnée. C’est
pourquoi mon analyse ne prendra en compte, que quelques domaines
susceptibles de faire ressortir l’impact réel des nouvelles technologies
de l’information et de la communication sur le secteur socio-culturel
congolais. Il s’agit notamment du rapport des Congolais avec le
temps de l’émergence de la société en réseaux, de l’économie
culturelle, de la culture-jeune et de la cyberculture. Mais avant cela,
un mot sur l’avènement de ces nouvelles technologies de
l’information et de la communication en République Démocratique
du Congo s’avère indispensable.
1. Avènement des nouvelles technologies de l’information et
de la communication au Congo.
En 1997 lors des Journées Scientifiques de la Faculté des
Lettres consacrées à la libération de la ville de Lubumbashi pour les
troupes de l’AFDL, parlant des NTIC en 1997 le Professeur Jeff.
Hoover faisait une sorte de prophétie en ces termes :
« D’abord, disons un mot sur la révolution informatique qui se
passe comme un vent à travers le monde et qui arrive aujourd’hui à la
porte de la République Démocratique du Congo. Elle va transformer
2 -P. LADERLIER, " Le temps de la communication" dans Sciences Humaines,
Hors-série, n° 30, Septembre 2000, pp. 110-111.
219
votre vie pendant les prochains dix ans qui encore difficiles à
prévoir » (3). Oui, aujourd’hui, la vie des Congolais en matière de
l’information et de la communication est en train de se modifier. La
République Démocratique du Congo est loin de s’échapper
aujourd’hui aux influences multidimensionnelles notamment socio-
culturelles des nouvelles technologies de l’information et de la
communication à l’instar des toute l’Afrique. (4)
« A la fin des années 90, peut-on lire dans la revue Sciences
Humaines, Hors-série, n° 30 DU septembre 2000, Internet fait une
irruption fracassante autant dans les foyers que dans la plupart des
sphères de la vie sociale des pays occidentaux (dans les entreprises,
les écoles, etc. En juillet 1997 par exemple, plus de 100.000
personnes se sont connectées au site Internet diffusant les images de
synthèse de la planète Mars. On parle de plus en plus de société de
l’information et du savoir, et du savoir, et de globalisation
culturelle. » (5) La révolution Internet venant des Etats-Unis
d’Amérique se généralise dans le monde. La vague atteint aussi
l’Afrique et partant le Congo (6). Mais c’est surtout le téléphone
cellulaire qui explose en Afrique en général et au Congo en
particulier. En effet en mai 1997 l’AFDL libère le Congo, le régime
Mobutu tombe. Pendant cette guerre de la libération, les hommes de
l’AFDL font usage intense de l’Internet du téléphone cellulaire, bref
des nouvelles technologies de l’information et de la communication
par rapport au camp gouvernemental.
Jeff Hoover écrit encore à ce propos ce qui suit :
« La Campagne qui a transformé la République du Zaïre de
nouveau en République Démocratique du Congo est peut-être la
première révolution du 21ème
siècle. Les communications
3 - J. HOOVER, "Le rôle de l'internet dans la libération du Congo" dans Histoire
immédiate Récits de Libération
d'une ville, cas de Lubumbashi, Presses Universitaires de Lubumbashi,
Lubumbashi p. 151. 4 "L'Afrique est-elle bien partie" dans Sciences Humaines, mensuel- n° 225, Avril
2011, p. 31-33. 5 "La Révolution internet" dans sciences Humaines, Hors-série, n° 30…, p. 115. 6 - J. HOOVER, "Le rôle de l'internet…, p. 151.
220
informatisées sur l’Internet ont joué un rôle critique en transformant
une petite affaire localisée en croisade national ». (7)
Et depuis lors, en dépit de sa situation de guerre, le Congo se
trouve envahi par les nouvelles technologies de l'information et de la
communication. Hormis l'Internet et la téléphonie mobile, les grandes
villes congolaises y voient l'installation des radio privées, des chaînes
de télévision non officielles, de cybercafés, des agences de
messagerie, ,des téléboutiques, des publiphones et des télé centres. Il
suffit de circuler par exemple au centre ville de Lubumbashi pour
s'en convaincre.
Qu'on le veuille ou pas, la RDC a fait son entrée dans le monde
communicationnel du XXIe siècle. Le mouvement ira en s'amplifiant.
D'où la nécessité d'évaluer d'ores et déjà les répercussions
qu'engendre cette nouvelle situation.
2. Le rapport des Congolais avec le temps.
Depuis l'avènement de nouvelles technologies de l'information et
de la communication, des Congolais en tant que Négro-africain
voient leur vision cyclique du temps subir, un coup d'accélérateur à
l'instar de leurs partenaires européens dont la vision du temps est
linéaire. En effet, si la mondialisation se réfère surtout à l'espace, en
l'occurrence, l'espace économique, la globalisation, quant à elle,
laisse penser à l'accélération du temps (8). Dans tout ce qu'ils
entreprennent actuellement les Congolais ne sauront plus dormir sur
leurs lauriers. Ils seront soumis à la vitesse vertigineuse qu'imprime
la globalisation. A l'heure actuelle, on assiste à deux types de sociétés
congolaises. D'un côté la société qui marche au rythme de la
globalisation et d'un autre côté celle qui ne sait pas encore être
branchée. Cela pose le problème au niveau de la gestion de temps,
7 - J. HOOVER, ''Le rôle de l'internet…, p. 151. 8 - D. CORREGES, "La tyrannie de la vitesse" dans Sciences Humaines, Mensuel,
239, Juillet 2012, p. 32-35; voir
aussi P. VIRILO, Le Grand Accélérateur, Galilée, Paris, 2010; H. ROSA,
Accélération. Une critique sociale du
temps, La Découverte, Paris, 2010.
221
c'est l'argent comme disent les Anglais. Dans une société où certains
filent vite tandis que les autres traînent les pieds, le développement
est difficile à envisager.
Avec l'existence des Congolais d'en haut et ceux d'en bas, pour
ainsi reprendre l'expression chère au Premier Ministre Jean-Pierre
Raffarin, l'in assiste à une société congolaise du savoir qui amplifie
les disparités sociales et même l'exclusion. Alors que les nouvelles
technologie de l'information et de la communication sont faites pour
permettre à chacun d'avoir accès au savoir planétaire. C'est pourquoi
la lutte contre la pauvreté devra être amorcée réellement afin que
chaque Congolais puisse accéder aux merveilles de ces nouvelles
technologies de l'information et de la communication. C'est à cette
unique condition que les Congolais pourront véritablement faire leur
entrée dans la société internationale des réseaux (9).
3. Emergence de la société en réseaux au Congo.
Au niveau mondial, la mutation culturelle due à la liberté qui a
caractérisé le XXe siècle, et la révolution dans le domaine des
technologies de l'information et de la communication, ont donné
naissance à ce que l'on nomme aujourd'hui, la société en réseaux. (10
)
La RDC se trouvant impliqué, malgré lui, dans la mondialisation fait
de cette société en réseaux.
En effet une observation attentive de la réalité sociologique
congolaise actuelle révèle que le goût de la musique, du sport, les
croyances religieuses, l'adhésion politique, quête du savoir, les
amitiés, le travail, etc. ont engendré des nouveaux acteurs congolais
qui agissent sur la scène international. Tout cela est renforcé par
l'échange des e-mail, par la communication interpersonnelle, etc. En
clair, les Congolais appartiennent aujourd'hui à plusieurs réseaux
internationaux lié à la religion, au savoir, aux affaires, même le
9 - Réseaux Sociaux, Comment protéger sa vie primée et ses données personnelles"
dans l'Ordinateur
Individuel, n° 250, Juin 2012, p. 26. 10 - S. LELLOUCHE "Les Sciences Sociales au temps des réseaux" dans Sciences
Humaines,...,pp. 126-127.
222
moins catholique, comme le trafic de la drogue, au militantisme de
tout bord.
Ce qui est vrai au niveau externe, l'est aussi au niveau
interne. En effet, les habitants de villes congolaises telles que
Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Kamina, Kananga, Mbuji-Mayi,
Isiro, Bukavu, Goma, Kikwit, Matadi, Butembo, etc. entretiennent en
grand partie des relations avec leurs compatriotes de 'arrière pays par
l'entremise des phonies, des téléphones portables, des e-mail, etc.
Cela renforce le fonctionnement des réseaux. Compte tenu de
l'immensité du pays, beaucoup restent encore à faire dans le domaine
de la télécommunication. A ce stade, tous les espoirs sont permis car
les sociétés multinationales qui investissent dans les nouvelles
technologies de l'information et de la communication se livrent,
depuis un certain temps, une véritable guerre commerciale en Afrique
en général et au Congo en particulier. A titre d'illustration, on peut
citer France-Télécom en Côte d'Ivoire, et dans les autres pays
africains ex colonies française; Télécel International (société
américaine) qui opère au Burundi, en République Centrafricaine, en
République Démocratique du Congo, en Guinée, à Madagascar et en
Zambie; Milicom (société luxembourgeoise) au Ghana, à Maurice et
en Tanzanie; Telekom Malaysia en Malawi, Vodacom (société
britannique) en Afrique du sud, au Lesotho, en République
Démocratique du Congo, etc. () Dans ce dernier pays, autres Télecel,
Stracel, Sogetel, on a Oasis, Comcel, etc. D'ici quelques années, la
télédensité au Congo sera sensiblement augmentée, entrainait du
coup, le développement des réseaux nationaux et internationaux.
L'Etat congolais devra prendre en compte cette nouvelle donne. Car
le Congolais ne sera plus seulement le sujet national mais il est
entrain de devenir le citoyen du monde. Les nouvelles technologies
de l'information et de la communication font ainsi donc des
congolais, des acteurs importants au niveau de l'économie culturelle
mondiale.
4. L'Economie culturelle au Congo.
L'explosion des technologies de l'information et de la communication
a transformé aussi la "Culture" en véritable produit économique au
223
même niveau que le cuivre, le pétrole, le bois, etc. En effet, cette
nouvelle perception de la culture est due aussi à la globalisation.
D'aucuns n'hésitent pas à parler de la globalisation culturelle. A ce
point, la mondialisation heurte les susceptibilités des gens. Car au
nom de l'identité culturelle, chaque individu, chaque nation, tient à
garder sa spécificité culturelle. N'oublions que la culture se définit ici
dans l'optique senghorienne, c'est-à-dire, la culture c'est l'Homme
tout court. Si la Culture égale l'Homme de ce fait, elle est au début et
à la fin de tout développement.
La mondialisation ne pourra donc pas réussir dans le secteur
culturel. Ce qui n'empêche pas l'économie dite culturelle de faire son
chemin (11
).
En RDC, l'économie culturelle est encore à ses débuts en
dépit du fait que ce pays soit le scandale culturel. La musique, la
danse, la peinture, la sculpture, la céramique, la coiffure, la littérature
orale et écrite, l'architecture, etc. tous ces produits culturels, un
marketing culturel. Il se crée ainsi des nouveaux métiers depuis le
développement des nouvelles technologies de l'information et de la
communication. Il appartient aux entrepreneurs congolais de se
lancer aussi dans l'économie culturelle.
Dans cette dernière comme le disait Jean-Michel Djian,
professeur à l'Université de Paris VIII, dans l'économie culturelle tout
ce qu'on donne, on le garde (). Avec l'appui des nouvelles
technologies de communication, l'économie culturelle a pris de
l'envol au Congo. En effet, les artistes musiciens congolais, par
exemple, ne produisent plus uniquement pour leur pays mais aussi
pour le marché culturel international. A ce mouvement, il convient
d'associer également leurs compatriotes scientifiques. Secteur
d'avenir, l'économie culturelle vise surtout une clientèle jeune. D'où
l'émergence du concept de Culture jeune.
11 - M. DONDEY, L'économie culturelle et créative, Document, 05/03/2009, p. 1-8.
224
5. La culture Jeune au Congo.
Loin d'être un bloc monolithique, la culture dite jeune par les
adultes est un ensemble composites d'éléments caractéristiques
divers. (12
) En effet depuis l'avènement des Nouvelles technologies
de l'information et de la communication, on assiste au Congo comme
d'ailleurs dans d'autres pays de par le monde, à une culture nouvelle
que d'aucuns désignent par culture jeune. Elle se caractérise par un
argot qui emprunte beaucoup au vocabulaire de ses nouvelles
technologies de l'information et de la communication. Prenons le cas
termes tels que "biper" "load byte", "unité", que les jeunes utilisent
de façon argotique.
Cette culture se caractérise aussi par le vestimentaire, penser
par exemple aux chaussures appelées "télécel" par les Congolaises;
un véritable look masculin et féminin et féminin s'installe mais pour
qu'il soit complet, il faut que le téléphone cellulaire vienne compléter
le tout. La possession d'un portable devient un véritablement
snobisme pour la jeunesse congolaise.
Il y a aussi la musique. En effet, hormis la musique qu'on
peut écouter à partir des appareils miniaturisés, le téléphone cellulaire
a aussi incorporé la fréquence modulée (FM)…, des mélodies
diverses, etc. qui affolent la jeunesse congolaise.
Les envois des messages à partir du téléphone cellulaire est
encore une activité qui enchante les jeunes d'aujourd'hui. Au total, la
révolution informatique a engendré une culture-jeune avec lequel il
faut se familiariser. Tout cela conduit à ce que l'on peut appeler la
cyberculture pour ainsi reprendre le titre de l'ouvrage de Pierre Lévy
(13
).
1212 - X. MOLENAT, "Les enfants du numérique" dans Sciences Humaines,
Mensuel, n° 226, Mai 2011? P. 44-45.
Culture Jeune, WIKIPEDIA, L'encyclopédie libre p. 44-45; M. FRAGONARD, La
Culture du 20ème siècle, Bordas,
Paris, 1995, p. 125-127. 13 - P. LEVY, Cyberculture, Odile Jacob, Paris, 1997; p. 224-225.
225
6. La cyberculture au Congo.
Le symbole de la société de communication passe aujourd'hui
par l'usage de l'Internet.(14
) Ce dernier est entrain de prendre son
envol au Congo. Les universités telles que celle de Kinshasa, de
Lubumbashi, etc. sont à l'heure actuelle connectées à l'internet. Les
entreprises comme la Gécamines; la SNCC, la MIBA et tant d'autres
ne sont pas en reste dans le domaine de l'internet. Les missions
religieuses toutes confessions réunies, œuvrant au Congo sont
également branchées sur le net. Les maisons commerciales privées
continuent à ouvrir de cybercafés dans les différentes villes
congolaises. L'internet se présente ici comme le lieu d'affirmation
d'une universalité et même d'une intelligence collective, comme le
pense Pierre Lévy.
Certains chercheurs qui s'intéressent à ce problème comme
Dominique Wolton estiment que la question qui se pose à ce niveau
est celle de savoir si l'internet entraînent un changement des modèles
sociaux et culturels car un système de communication ne peut se
réduire à une technologie comme internet. Comme on le sait , la
communication est avant tout affaire des contenus culturels. Quoi
qu'il en soit, les chercheurs congolais doivent à même temps que se
développe l'internet dans leur pays, analyser son influence tant dans
les milieux scientifiques que dans la communication entre eux. Ils ne
doivent pas non plus oublier de réfléchir sur l'internet à l'école ou
dans l'entreprise.
De toutes les façons, on assiste au Congo actuellement aux
nouveaux modes de sociabilité et de l'échange via internet. D'ici
quelques années, la RDC sera en plein dans le "nouvel art de
bavarder". La cyberculture est entrain de gagner aussi le milieu
congolais. Il y a des raisons légitimes de s'en occuper sérieusement.
14 -"Internet: vers de nouveaux rapports sociaux" dans Sciences Humaines., Hors-
série,…, p. 127.
226
Conclusion.
Au terme de cette communication, il y a lieu de retenir que
des nouvelles technologies de l'information et de la communication
ne laisse pas insensible le social et le culturel. Bien au contraire, ces
technologie viennent bousculer sérieusement les modèles sociaux et
culturels qui régissaient jusque là les Congolais. Si par exemple hier,
l'enseignant était perçu comme le seul dépositaire du savoir vis-à-vis
de son élève, aujourd'hui il devrait être modeste car l'élève peut en
navigant sur la toile avoir accès à ce que lui ne connaît pas encore.
Les éducateurs doivent prendre en compte cette nouvelle évolution
pour mieux former les enfants et les jeunes. La RDC est contraint à
intérioriser cette nouvelle réalité, qui, à tout point de vue, s'annonce
révolutionnaire et par conséquent, ses répercussions sur le socio-
culturel restent évidentes.
Bibliographie.
Articles
- BORBALAN J.-C.R., "Penser la mondialisation" dans Sciences
Humaines, Hors-série, n° 30, septembre 2000, p. 116-117.
- CORREGS D., "La tyrannie de la vitesse" dans Sciences Humaines,
Mensuel, n° 239, Juillet 2012, p. 32-35.
- HOOVER J., "Le rôle de l'internet dans la libération du Congo"
dans Histoire immédiate Récits de Libération d'une ville, cas de
Lubumbashi, Presse Universitaires de Lubumbashi, L'shi, 199., p.
151-157.
- "Internet: vers de nouveaux rapports sociaux" dans Sciences
Humaines, Hors-série, n° 30, septembre 2000, p. 127.
- LADELLIER P., "Le temps de la communication" dans Sciences
Humaines, Hors-série, n° 30, septembre 2000, p. 110-111.
- "L'Afrique est-elle bien partie?" dans Sciences Humaines, mensuel
n° 225, avril 2011, p. 28-38.
227
- LE LLOUCHE S., "Les Sciences Sociales au temps des réseaux"
dans Sciences Humaines, Hors-série, n° 30, septembre 2000, p. 126-
127.
- MOLENAT X., "Les enfants du numérique" Sciences Humaines,
Mensuel, n° 226 S, mai 2010, p. 44-45.
- "Réseaux sociaux, comment protéger sa vie privée et ses données
personnelles" dans L'Ordinateur Individuel, n° 250 Juin 2012, p.
26-31.
Ouvrages
- FRAGONARD, M., La Culture du 20ème siècle, Bordas, Paris,
1995.
- LEVY P., Cyberculture, Odile Jacob, Paris, 1997.
- ROSA H., Accélération. Une critique sociale du temps, La
Découverte, Paris, 2010.
- VIRILIO P., Le grand Accélérateur, Galilée, Paris, 2010.
- WOLTON D., Internet at après? Une théorie des nouveaux
médiaux, Flammarion, Paris, 2010.
228
TABLE DES MATIERES
1. REVISITATION DE LA POLITIQUE EXTERIEURE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO : NECESSITE IMPERIEUSE. PAR KISIMBA KIMBA ... 1
2. PPAASSSSEE,, PPRREESSEENNTT EETT AAVVEENNIIRR.. LLEESS RREESSSSOORRTTSS DDEE LLAA CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
MMUUSSIICCAALLEE VVEERRBBAALLEE DDEE TTRRAADDIITTIIOONN OORRAALLEE. PAR IBILI AKWER ............................ 25
3. LA ROUTE DES CARAVANES D’ESCLAVES A L’EST DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO. PAR KISONGA KASYULWE DESIRE ........................... 39
4. REFLEXIONS SUR LA THEORISATION DE L’HISTOIRE CAS DE LA SITUATION
AU NORD ET AU SUD KIVU EN RDC. PAR EMMANUEL KISIMBA KIMBA ET
MARCEL NGANDU MUTOMBO .......................................................................................... 75
5. L’ATTITUDE DE QUELQUES EGLISES LOCALES FACE A LA SECESSION
KATANGAISE DE 1960 A 1963. PAR KASONDE KYAWAMA K. GERMAIN ................. 103
6. L’EDUCATION TRADITIONNELLE DES BEENA LULUWA. PAR TSHISANDA
NTABALA MWENY EMERY .............................................................................................. 117
7. LES FORMES DE L’ETAT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DE
1960 A NOS JOURS. PAR LWAMBA BILONDA MICHEL ET SANGWA MASIKINI. BIN
MUSINDE HANCKO ............................................................................................................ 151
8. AUX ORIGINES DE L’ETAT MODERNE EN AFRIQUE. PAR KIZOBO O’BWENG-
OKWESS ................................................................................................................................ 169
9. LA POLITIQUE RELIGIEUSE DE LEOPOLD II : L’ASSOCIATION
INTERNATIONALE AFRICAINE ET LA CIVILISATION EN AFRIQUE. PAR
KALENGA WA KUBWILU JEAN JACQUES ..................................................................... 179
10. LES CINQUANTE ANS DE MBUJIMAYI. PAR MUYA BIA LUSHIKU LUMANA
NORBERT ............................................................................................................................. 191
11. L’EMIGRATION INTELLECTUELLE DES JEUNES : ELEMENT DE
COMMUNICATION DE LA SOCIETE LUSHOISE. PAR SUKADI MANGWA ET
KIZOBO FEL OPEL ............................................................................................................. 203
12. L’IMPACT SOCIO-CULTUREL DE L’USAGE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO. PAR KIZOBO FEL OPEL ET SUKADI MANGWA ..... 217