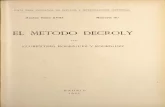Etudes Expérimentales en Turbulence d'Ondes - Laboratoire ...
Enfmts, jeunes et vie= au monastbe : en etudes m&ii&ales
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Enfmts, jeunes et vie= au monastbe : en etudes m&ii&ales
Enfmts, jeunes et vie= au monastbe : la perception du cycle de vie dam les sources
clunisiennes (909-1156)
Par
Isabelle Cochelin
Dtpartement d'6tudes clwiques et m&iikvales
Facult6 des arts et des sciences
prdsentee a la Facult6 des etudes supkrieures en w e de l'obtention du grade de
Philosophiae Doctor (Ph.D.) en etudes m&ii&ales
Juillet 1996
O Isabelle Cochelin 1996
Nationai Library 1*1 of Canada Bibliot hwue nationale du Canada
Acquisitions and Acquisitions et Bibliographic Se~-ces services bibliograp hiques
The author bas gnmted a non. exclusive licence allowing the National L i i of Canada to reproduce, loan, distri- or sell copies of Mer thesis by any means and in any fonn or f- making this thesis available to interested persons.
The author retains ownership of the copyright in hismer thesis. Neither the thesis nor substantial extracts fiom it may be printed or otherwise reproduced with the author's permission.
L'auteur a acwrdi m e licence non exclusive pennettant a la Blalioth&qye nationale du Canada de reproduire, p&er, distrriuer ou vendre des copies de sa these de
fonne qye ce wit pour mettre des exernplaires de cette Wse a la disposition des personnes intkessks.
L'auteur cooserve la propriCte du h i t d'auteur c p i prot&ge sa these. Ni la thCse ni des extraits substantiek de ceile-ci ne doivent &re imprimbs ou
Universitt5 de M o n W Facult6 des etudes supCrieurrs
Cette t hb intitulde :
Enfants, jemes et vieux au monadre : la perception du eyele de vie dans Ies sources
clunisiennes (909-1 156)
presentee par Isabelle Cochelin
a Ct6 6valut5e par un jury compose des personnes suivantes :
These acceptke le :
Jamais jusqu'ici, le discours de ~ ' B ~ l i s e medievale sut le cycle de vie n'a Ct6 6hldi6
en detail. Pourtant, les sources eccl~astiques constituent & peu de choses p&s notre seule
source d'idiormation sur la socia6 mddiCvale avant le XII' sikle. U est donc fondamental
de savoir comment les hommes d'gglise de cette petiode concevaient et divisaient le fil
d'une existence humaine. Pour Fepondre au moins partiellement ii cette question, j'ai choisi
d'titudier les kr i ts du premier grand ordre monastique occidental, celui de Cluny, depuis sa
fondation en 9O9/9lO, jusqu'ii la fin du dgne de son d e e r grand abE, Pierre le VCn&rable,
en 1 156. Je me suis concent& sur les dew plus importants ensembles de sources littkraires
r&iigees par les clunisiens, a savoi les Vies de saints et les coutumes : les premi5res
permettent de savoir comment les moines de Cluny concevaient l'enchainement successifdes
8ges et quel discours ils tenaient sur chacun d'eux ; les secondes expliquent le traitement et
la place faite dans la hierarchic communautaire aux enfants, jeunes et view de L'abbaye.
I1 a d'abord fdu etablir les principes sous-jacents a m multiples d&uitions
mkdit5vales des iiges. L'homrne du Moyen Age central percevait trois iiges majeurs dam le
cycle de vie : Iapueritia, la iuuentus et la senectus. L'hagiographie clunisienne permet de
mieux comprendre les caract&istiques et subdivisions de chacun d'ewc. Le premier
correspond awc annees OII le corps se forme, avant la puberte. I1 comait une coupure
importante avec la st5paration du monde fiminin et le debut des 6tudes : aussi est-il souvent
d6coupk en infantia et puerilia. Le deuxihe ddbute par une #node de quete et d'attente ;
il se prolonge par me phase de plus grande maturitd : ces dew phases expliquent la division
usuelle de la iuuentus en adolescentia et iuueotus. Le troisi6me b e est celui oil les forces du
corps diclinent mais il equivaut aussi, dam un premier temps, B une dpoque de plein
Cpanouissement aux niveaux social et psychologique. Il est donc parfois scinde en deux
&apes, la senectus et l'iige de la d&r6piude, le senium.
Cette division tripartite des iges inauenqa la structure monastique definie par saint
Benoit et reprise par les clunisiens. La communautC de Cluny etait constituee par Ie groupe
des pueri (Ies oblats), celui des iuniores, qui dunissait des individus d6jk pubkres mais
encore jeunes, et les seniores/priores. Seul ce demier ensemble n'etait pas dSni en fonction
de i'sge, sinon que Ies moines plus Qds s'y trowaient aux c6t& d'autres plus jeunes.
Parce que Ies moines percevaient les e d i t s c o m e des Otres peu dou& de raison,
l'essentiel de lern formation consistait h leur f e imiter les gestes de l e m ah&. Sur le plan
mat&iei, les oblats Went ento& de soins mais il existait autrement m e grande mefiance
ii leur egard : celle-ci s'explique avant tout du fait que P e a t rep-ntait un objet de desk
potentiel. La fin du XP sikle, avec l'arrivde massive de convertis adultes ii Cluny,
bou leve~ profondbent les structures de l'abbaye, entmhnt, a court terme, I'instauration
d'un noviciat et, B long terme, la d i sp t ion de l'oblation.
Cette &ohtion eut 6galement des rdpercussions imprtantes sur le traitement des
jeunes adolescents dam la communaute. Le group des 15-20 am ne fut plus admis dam les
rangs des profa : cette modification du statut des jeunes pukres est peut4tre Sindice d'une
"dCcouverte" de I'adolescence. Les a n n b de pubat6 Went particuli&ernent critiques dam
la vie d'un jeune moine car il fallait lui apprendre ii nier sa sexualit6 naissante. De manikre
plus genirale, la jeuaesse inquietait Ies moines clunisiens et ils essayhmt, ii travers leurs
tcrits, d ' o e un modde du "bon moine" dipourvu de toute camct&istique juv&ile, excepte
une certaine vigueur.
Aussi longtemps que le view moine ttait capable de se conformer au mode de vie
clunisien, son anciennetk et son 5ge lui confkaient prestige et autorit6 ; il pouvait mal@ tout
lui Stre reprochC de trop se soucier de son confoa et de ne plus faire preuve de la meme
ardeur daas le service liturgique. Puis, devenu trop faible, il etait contraint de se retirer a
I'infmerie pour y finir ses joun ; son statut changeait alors radicalement : il perdait son
rang, ses compagnons de vie et toute fonne de pouvoir. La fin du XI' siMe vit pourtant un
adoucissement de ses conditions de vie.
Cette h d e a ainsi mis en Mdence l'importance fondamentale des iiges dam
l'imaginaire et la vie quotidieme des moines du Moyen Age. En etudiant la perception et Ie
traitement de chaque iige, il a et6 possible de mieux comprendre le mode de penser clunisien,
et d'apprbhender sous un nouvel angle Ies transformations profondes qui prirent place dam
la sociCtt5 monastique au tournant de la fin du Me-debut du XI[' sibcle.
TABLE DES MATI~UZS
Liste des tableaus
Liste des abMations
Remerciements
Introduction
L Les trois ages de Ia vie Introduction A* La perspective anthropologique du cycle de vie B. Le fd d'une existence au Moyen Age C. Les definitions midikvales des iges D. La perspective clunisienne du cycle de vie Conclusion
IT. Les trois degrCs de la hihrchie Introduction A. Similitude structurelle B. Pueri par Sage, pueri par le statut C . Iuniores - senioresJpriores dam la Ri[e de saint Benoit D. Une hidrarchie parallele mais encore secondaire (sacerdoes. leuitue, conuerso E. Iuniores - seniores/priores dans les premiers coutumiers clunisiens Conclusion
m. L'enfance : Ie corps avant I'esprit introduction A. Les domees brutes de l'enfance clunisieme B. L'esprit de l'enfant : une passivite quasi totale C. Le corps de l'enfant : au coeur de la question Conclusion
IV. Iuirenis ou la diffIcuXt6 d'gtre Introduction A. Des jeunes sous surveillance B. Les erreurs de jeunesse C. A chacun sa beaut6 ConcIusion
V. Gloire et misere du senex Introduction A. Powoir et piM : l'avantage symbolique de la vieillesse B. Retraite mentale : la q u k du confoa a I'avande en 6ge C. Le corps du vieillard, entre le mQris et la tendresse Conclusion
Conclusion
Bibliagraphics Liste des sources Bibliographic des ages B ibliographie cornpl6mentaire
Annexes A. Sources hagiographiques B. Sources normatives C. Difinitions des iges de la vie D. L'absence de noviciat a Cluny avant Hugues
LISTE DES TABLEAUX
Tableau I : Tableau chronologique de la division des &es par les auteurs cMtiens latins
Tableau II : Tableau chnologique (Nivant la date de traduction en lath) de la division des 8ges par quelques auteurs non chrdtiens influents 52
ii
LISTE DES AB~&VIATIONS
En gras sont les abn5viations des sources premi6res qui foment le corpus de la Wse. Ces mcrnes oeuvres sont pdsentk en dCtail dam les annexes A et B.
AB A ~ l e c t a Bollandima, BnnreUes: SociW des BoUandistes, tI (1 882)-.
ADH Annules de De'mogrrghie Historique, Paris: s.n., 1964-
Les ciges de la vie, 1992 Les dges de la vie au Moyen Kge, Actes du colIoque du Dkpartement d'~tudes mt5diivales de IYUniversit& de Paris-Sorbonne et de lYUniversit6 Friedrich-Wilhelm de Bonn, Provins, 16-1 7 man 1990, dir. H. Dubois et M. Ziok, Paris: Presses de lYUniv. de Paris Sorbonne, 1992.
Annales ESC
A S
Asbin.
Bern.
BHL
BHL Suppl.
BHL Novum
Bibl. Clrtn.
Annales, ~conomies, Sociiti, Civilisations, Paris: A. C o h , 1 (1964)-
Acta Sanctorum quotquot toto orbe colmhv, i d . Socii Bollandiani (par I. Bolland et ses successews), I' dd.: jan., t.1 (Anvers, 1643) a nov., t.2 (BrweiIes, 1894) 2' Cd.: jan., t.1 (Venise, 1734) a sep., tV (Venise, 1770) 3' kd.: jan., t.1 (Paris, 1863) a oct., t X (1 869)
J. Mabillon. Acta Sunctomm ordinis S Benedictini, 9 vol.; 1 ed., Paris, 1 668- 1 70 1 ; 2= ed., Venise: S. Coleti & J. Betinelli, 1733-1 740.
Bernard de Cluny, Ordo cluniacensis, 6d. Mqrquard Herrgott, Vetus disciplina monastics, Paris: Osmont, 1726, p. 1 34-264.
Bibliutheca Hagiographica Latina Antiqua et Mediae Aetatis, 2 vol., (SH 6) Bruxelles: Socii Bollandiani, 1898-190 1.
BHL Supplementurn, (SH 12) Bnucelles: Soci6tt5 des Bollandistes, 19 1 1.
BHL Novurn Supplementum, Cd. H. Fros, (SH 70) Bnucelles: Socikte des Bollandistes, 1986.
Bibliotheca Cluniacensis, M. M. Mamer et A. Duchesne, Miicon: Protat, 1915.
iii
BS
C4
CatuZ. Pan3
Cath.
CC CM
CCM
CCSL
CLU
Co Kist.
Bibliotheca Sanctonun, dir. F. C d a , 13 VOI. avec Index, Rorna: Istituto Giovanni XXIII della PontXcia Universitil Lateranense, 1961-70.
Consuetudines Cluniacensium antiquiores cum rehctionibus derivatis, a. K. Hallinger, Col~suetudinum suemIi X-XI-AZ momnnenta, II, (CCM 7/2) 1983, p.3-150.
CataIogus c o d i ~ n hagibgraphicorum la t i nom antiquiotum sfwculo XYI qui asservmtur in Bibliotheca Nationali PPmisiensi, Bwelles: Socikti des BolImdistes, 3 vols., 1889-93,
Cathdiciinn, Hier, Aujowd'hui, Demuin, dir. G. Jacquemet, Paris: Letouzey et A&, 1948-.
Corpus Chn'stianorum, Continuatio Mediaevalis, Tumhout: Brepols, vol. 1, 1971-
Corpus Consuetudinum Monosticarum cura Pontifcii Athenaei Sanci Anselmi de urbe edihnt, dir. Kassius Hdlinger, Siegburg: Apud Franciscum Schtnitt, 19630.
Corpus christianom, Series ~atina, Turnhout: Brepols, vol. 1, 1 953-
RenreiZ des chartes de I 'abbaye de Cluny, dd. A. Bernard et A. Bruel, 6 voi., Paris: Imp. Nationale, 1876-1903.
Collectanen Cisterciensa, Forges (Belgique): Abbaye de Scourmont, 1965- Suite de Coilectaneu Ordinis Cisferciennrm Refomatorurn ( 1 93 4-1 964).
COTTINEAU L.H. CO'ITINEAU, RPpertoire topo-bibliogruphiqtre des abbayes et prieurPs, 3 vol., Miicon: Protat, 193 5-1 970.
CSEL Corps Scriptorum Ecciesiesricorum Latinom, Vindobonae (Vieme): C. Geroldi filium, vol. 1 ( 1 866)-
D- D-can. R. NAZ dir., Dictionnaire de Droit cunonique, Paris: Letouzey et An& 7 vol., 1935-1965.
DELISLE, Cluni 1884 DELISLE, Lkopold, Inventaire des munuscrits de la BN. Fonds de Cluni, Paris : Librairie Champion, 1884.
DHGE Dictionnaire d71Wroire et de gifogruphie ecclt!ii~l~nque, dir. A. Baudrillart et als., Paris: Letouzey et Ad, 1912-.
DIP Ditionario degli Istihcti diperfezione, dir. G. Pelliccia et G. Rocca, Roma: Ed. Paoline, 7 vol. (A-R), 19744983.
DLF-Mt Dictionnaiie des Leffres Fran@es - k Moyen Age, dir. G. Hasenoh et M. Zinlr, Paris: Fayard, 1992.
DM Pieue le VQlkabIe, Petri Cluniacem's abbatis- De miraculis libn' duo, 6d. D. Bouthillier, (CC CM, 83) Tumhout: Brepols, 1988.
DOLBEAU 1979 F. DOLBEAU, Anciens possesseurs des manuscrits hagiographiques latins conservb 1 la bibliotheque nationale de Paris *, Revue d'histoire des textes, 9 (1979): 183-238.
Dictionnaire de Spiritualiti e'citique et mystique, fond6 par M. Viller, Paris: Beauchesne, 1 932-
Odilon, Epitaphiurn dornne Adalheide a u p t e , Cd. Herbert Paulhart, Die Lebembeschreibung der Kaiserin Adelheid von Abt Odilo von CIuny, dam Mitreilungen des I&tuts fiir &terreichische Geschichtsforschung Ergdnpngsband AX 2, Graz-Kdn: H. Behlau, 1962, p.27-45.
EHESS ~ c o l e des Hautes ~tudes en Sciences Sociales
EOi Jotsaud, Epitaphium ad sepulcrum domni Odiionis, Cd. E. Sackur, a Handschrifliches aus Frankreich. II zu Iotsaldi Vita Odilonis w, Neues Archiv, 15 (1 890): 123-26.
FIeury Cunsuetudinesjloriacenses antiquiores, 6d. A. Davril et L. Domat, (CCM 7/3) 1984.
Fnlh. St- Fnihmitteldterliche Studien, Berlin: Institut fiir Friihmittelalterfo~~chung der Universitat MWer, v. 1 (1 967)-
GaIlia Xiana Gallia Christiana in prouincius ecclesiasticas distributa qua series et historia, 16 vols, Paris: ex typ. regia, 17 15- 1865 [rep 19701.
HALLINGER, "Klunys" 1959 K. HALLINGER, a Klunys Briiuche zur Zeit Hugos des Grossen (1049- 1109). Prolegomena zur Neuherausgabe des Bernhard und Ulrich von
Kluny m, Zeitschnf der Sizvigny - St t jhg fir Rechtsgeschichte - Kanonistische Abteihng, XLV ( 1 959): 99-1 40.
Histoire des saints et de la sm'ntete' chre'tienne, t.V: Les sainretis &ns les empires rivaux (812-1053), dir. P. Rich&, Pads: Hachette, 1986 et tVI: Au temps du renouveau &ange'Zique 10544274, dir. k Vauchez, Paris: Hachette, 1986.
Hildemar, Expositio reghe, a. R MittermUUer, VFtu et regula SP. Benedicti lasa na eqmsitiune regulw ab Hildemaro tradita et mmeprimum wis mandaa, RatisbonnefNew YorWCincinnati: F. Potet, 1880.
Histoire Lite'rai're <sic> L la Frmce, o m g e commenct5 par des EnCdictins de la Conegation de Saint Maw et continu6 par des membres de I'Institut, 33 vol., Paris: V. P a d , 1733-1 906 @Claw Reprint, 1971 -1 9801.
D. IOGNA-PRAT, a Panorama m, 1992. D. IOGNA-PRAT,. a Panorama de I'hagiographie abbatiaie clunisienne (v.940-v.1140) m, clans Manucrits hagiographiques et travail des h~giogt~phes, 6d. M. Heinzelmann, Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag, 1992, p.77-118.
JMH
JPH
Lanfianc
L e x M
LMM
LPV
LT
Journal of Medievcl History, Amsterdam: North-Holland Publ. Co., vol. 1 (avr. 1975)-
History of Childhood Quarterly-rhe Journal of Psychohisimy, New York: Atcom, vol. 1 (M 1973)-. Intitule simplement Journal of Psychohistory, vol. 4 (&k 1976)-
Lanfianc de Cantorbdry, Decretu Lanfianci monachis cantuariensibus transmissa, i d . D. Know1es, (CCM 3 ) 1967.
Lexikon des Mirtelaters, 6d. R Auty, MiinchedZurich: Artemis-Verlag, 1977-
Anonyme, Libn' duo miraculomm sancti Maioli abbatis Cluniacensis quarti, BibLClun., ~01,178748 14,
Pierre le Vdn&able, The Letters of Peter the Venerable, Gd., intro. et notes G. Constable, 2 vol., Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 1967.
Liber tramitis aevi Odilonis abbatis, 6d- P. Dinter, (CCM, 1 0) 1 980, p.7-287.
Rb
Rep. Font.
RIM
SC
SH
Stat.
Anonyme, Mi*cda de Babolein, premier abM des Fossds, AS, Iun., VIT, ParidRoma: Pal&, 1867, p. 159-62.
Monuments Gennmriae Historic4 Srripotm tomus, U. GH. Pertz et al., 34 vol., Haaovre: A. Hiersemm, 1826-1933.
New Catholic Encyclopedia, 15 vol., New York: McGraw-Hill, 1967-79.
Patrologiae cursus completw. Series latim, 6d. LP. Migne, 22 1 vol., Paris: Migne, 18444891.
Jotsaud, Planetus de trunsitu sancti OdiIonis, 6d. F. Ennini, a 11 pianto di Iotsaldo per la morte di Odilone m, Siudi Medievali, 2 (1 928): 40 1-05.
Saint Benoit, La RPgle de Saint Benoit, hint., trad. et note par A. de VogiiC, texte Ctabli par J. Neufville, 6 vol., (SC 18 1-86) Paris: Cerf, 1972.
Revue Binidictine, Nammur: Abbaye de Maredsous, 1884-
Repertorium Fontitim Historiae Medii Aevi, U. A Potthast [etc.], Roma: apud Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1962-
Revue Mabillon, Paris: C. Poussielgue, 1 (1905)-
Sources chretiennes, Paris: ~ d . du Cerf.
Subsidia hagiographica, Brwelles: SociM des Bollandistes, 1 (1 886)-
Pierre le VWrable, Statuta Petri Venerabilis abbatis Cluniacensis K (I I46/47), 6d. Giles Constable, dam Cometudines Benediflinae Variae (Saec. XT- Saec. XW), (CCM 6) 1975, p.39-106.
ULrich de Cluny, Antiquiores cometudines rnonasterii Cluniucensis, PL 149, CO~. 635-778.
Eudes de Saint-Maw-des-Fosses, Vita domni Burcardi, venerabilis comitis, Vie de Bouchard le Vinirable, comte de Vendhe, de Corbeil, de Melun et de Paris et XPsiicles), kd. C. Bourel de la Roncitre, (Collection de textes pour servir P I'enseignement de i'histoire) Paris : Picard, 1892, p. 1-32.
Anonyme, Vita de Babolein, permier abbe des Fossds, P o d . Chifflet, Bedae presbyteri et Fredegarii scholastici concordia, Paris, 1 68 1, p.3 56-7 1.
vii
VG1 Odon de Cluny, Yira de Wraud d'Adac, PL 133, ~01.639-704.
VGf Anonyme, Vito de Gcraud dtAurillac, Catal.Pm's, vol.II, 1890, p.392-40 1.
v G ~ Tramitus Transihrs de la VZta anonyme de Ghiud #Adlac, 6d. V. Furnagalli, a Note sulla Vita Geraldi di Oddone di Cluny w, Bulletino dell%tituto storico italiuno per il medio evo, 76 (1964): 23540.
V G Bouange Miramlapst mortem de la VirP anonyrne de G h u d d'AuriIlac, ed 0.-M.-F. Bouange, Histoire de l'abbqe d'AuriIZac, pre'cPd6e de la vie de saint GPraud sonfondateur, Paris: &. Albert Fontemoing, 1899, tome I , p.370-97.
VHP" Anonyme, Vita sancti Hugonis par 1'Anonyme II, BibL C l u ~ , ~01.44762.
KW Gilon de Toucy, Vita Hugonis cluniuce~tsis abbatis, Cd Herbert E.J. Cowdrey, Two Studies on Cluniac History : I. Memorials o f Abbot Hugh of Cluny ( 1 049-1 109) *, 3udi Gregoriani, XI (1 978): 45-1 09.
K?P Hildebert de Lavardin, Vita sancti Hugonis abbatis, PL 1 59, col.8 57-94.
VHhm Hugues de Goumay, Vita sancti Hugonis Cluniacensis abbutis, 6d. Herbert E.J. Cowdrey, a Two Studies on Cluniac History, 1046-1 126 r, Studi Gregoriani, XI (1978): 12139.
Mlhu Ep. Hugues de Goumay, Epistola de vita sancti Hugonis Cluniacensis abbatis, Bd. Herbert E.J. Cowdrey, a Two Studies on Cluniac History, 1046-1 126 r,
Studi Gregoriani, X I (1978): 113-17.
Renaud de Vizelay, Vita sancti Hugonis abbatis (en prose), dam Vizeliacensia 11- textes relot@ ci 131istoire de I'abbaye de Ve'zelqv, ed. R.B.C. Huyghens, (CC CM, 42. Supplementum) Tumhout: Brepols, 1980, p.39-60.
Renaud de V&elay, Vita sancti Hugonis abbatis (en vers), dans Vizeliacensia 11- textes refatfs ti 1I'istoir-e de l'abbaye de Vtzelay. U. RB.C. Huyghens, (CC CM, 42. Supplementum) Tumhout: Brepols, 1980, p.6167.
Anonyme, Vita beatae idae, PL 155, co1.437-48.
Anonyme, Vita alteru beati Maioli abbatis, Bibl. Clun., col. 1 783-86.
Anonyme, Vita breuior sancti ac venerabilis Maioli abbatis, BibL Clun., COI. 1763-82.
viii
von (OU von PL)
VOn Fini
VOrS
VO8 Sackur
Nalgod, Vita sancti Maioli abbatis, AS, Mai I1 (l68O), p.658-68.
OdiIon de Cluny. Vita beati Maid abbatis, PL 142, ~01.943-62.
Synrs, Vita scllfcti Maioli B.RL 5179, M. D. IOGNA-PRAT, Agni immacuIati. Recherches sur les sourees hagiographiques relatives b saint M i a 1 tie Cluny (954-9941, Paris: hi. du Cerf, 1988, p. 163-285.
Jean de Saleme, Vita sancti Odonis abbatis, PL 133, co1.43-86.
Anonyme, Epitom& de la Vila Odonis, 6d. M.-L. Fini, a L7Editio minor della "Vitaf1 d i Oddone di Cluny e gli apporti del17HmiIlimus. Testo critico e nuovi orientamenti *, L Xrchigrnnmio - Bollerino delh Biblioteca communale di Bologna, 63-65 (1968-1970): 208-59.
L'HumiIlimus (Anonyme), yita d'Odon de Cluny, U. M.-L. Fini, a L'Editio minor della a Yita r di Oddone di Cluny e gli apporti dell'HwniZlimm. Testo critico e nuovi orientamenti m, L 'Archiginnasio - Bolletino della Biblioteca communale di Bologna, 63-65 (1 968- 1970): 208-59.
Nalgod, Vita Odonis reformata, PL 13 3, co1.85-104.
Nalgod, Vita Odonis refrmata, tidition partielle par ML. FINI, a Studi sulla "Vita Odonis reformatam* di Nalgodo. I1 fhgmentum mutilum del codice latino N.A. 1496 della BN di Paris *, Rendiconti dell 'Accademia di Scieme dell 'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali (Bologna), 63R ( 1 975): 134-47,
Jotsaud, De Vita et uirtutibtls sancti Odilonis abbatis, PL 142, col. 897-940.
2 chapitres manquants de Jotsaud, De Vitu et uirtutibus sancti Odilonis abbatis, &do, E. Sackur, a HandscWches aus Frankreich. II zu Iotsaldi Vita Odilonis m, Neues Archiv, 1 5 ( 1 890): 1 1 8-2 1.
Pierre Damien, Vita sancti Odilonis, PL 144, co1.925-44.
Raoul Glaber, Vitu domni Willelmi abbatis, dd. N. Bulst, dam Rodul& GZaber, Opera, &i. J. France, (Mord Medieval Texts) Oxford, 1989, p.254- 99.
Pow mes trois grands-mtres, Maman Line, Maman Da ct Mamy
[...I ce qui comptait cldtait, plus que la possession des choses, Ie souvenir qu'on avait d'efles, fe souvenir en face duquel
toute possession ne peut, en soi, apparaitre que ddcevante, banale, insuffisante. I...] Mon d&ir que Ie passe devint rout de mite du pa&, pour pouvoir raimer et
le contempler h mon aise, etait aussi le sien, exactement p a d - Cetait Ih nope vice : d'avancer avec, toujours, la t5te toumte en amtre.
Bassani, Le jardin des Fimi-Contihi
J'aimerais, pour commencer, remercier mon Directem, monsieur Jacques MC@ qui, en attendant la conclusion de ma t h b , a su faire preuve d'une patience, ii bien des egards, aussi incommensurable que Ie Dieu de rnes saints clunisiens envers une brebis 6garCe. Je regret& de ne pas avoir tt6 me M a n t e plus docile et d'avoir souvent tad6 ii suivre ses judicieux conseils. Je voudrais dgalement srpriwr ma reconnaissance am autres professeurs d'histoire qui m'ont traasmis leur amour du mttier et offkt leurs encouragements : tout p;nticuLihent ma dhdrice de maitrise et de D.E.A. h la Sorbonne, madame P. L'Hennite-Leclercq, mais aussi ma professewe B Marie-de-France, madame Lasserre, et mes makes pendant rnes "ann&s McGill", J. Hellman, L. Rothkrug et G. Hundert. Je remercic le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui, en m'octroyant une bourse de Doctorat, m'a permis de me consacrer corps et biens ii cette ache.
J'adresse un chaleurrw merci B ceux et celles qui furent contrahts d'empidter sur leur emploi du temps pourtant t& charge pour lire des sections de ma thhe : Aline Charles, Amy Remensnyder, Adalbert de Vogii6, Nora Berend, Benjamin Victor, Susan Boynton et Pascal Boulhol. Ma dette est tds l o d e envers Dominique Deslandres et Guy Lobrichon qui ont Iu ce travail dam sa presque totalie : j'e- que je saurai me montret digne de l'amitik dont ils m'ont offert un si beau timoignage ; ces memes paroles s'adressent aussi i Jean- Pierre Blanchard qui m'a tant aidee pour la mise en pages et rimpression du texte.
Que les divers employ& des trois bibliotheques dont j'ai si souvent use le fond des chaises soient ici remerciks. Celle des Dominicains de Saint-Albert-le-Grand avec Rosaire, qui o f l k a t longtemps un Mvre de paix propice a la recherche aux m&iiCvistes montrblais. Celle de la Sorbome oh je fis mes premi&es armes, voM onze ans. Lors de mon dernier sqour a Paris, la veille de mon dbpart, d o n que je me prdsentais & un guichet avec mes ultimes r&lamations et que l'heure de fenneture venait malfieureusement de sonner, le magasinier regarda avec un grand Serieux mon voisin, qui e@rait, lui aussi, contre toute attente, qu'on veuille bien prendre sa liste de livrrs, et hi dklara : a Tu vois, je vais accepter ta demande puce que, B elle, je ne pew hi refuser, cela fait trop longtemps que je la connais. Les chercheurs demeurant loin de Paris comprendront la valeur inestimable d'un tel geste. Celle e n h que j'appelle "ma deuxi&me maison", la Bibliothhue Nationale de France, depuis le temps oh, avec Dominique, nous y passions nos joumeeS et y blitissions de belles amitids. I1 y avait Marie, maintenant B la retraite, qui me fit tellemeat plaisir lorsqu'elle ddclara vouloir m'adopter, l'autre Marie, toujours si enjoude et gentille, et tous les autres rnagasiniers de la grade salle des imprim&, qui me recevaient n5gulietement avec le sourire lonque j'anivais de M o n M et me demandaient, inquiets : Alors, il fait toujours aussi froid IA-bas ? J'ai decowert trop tard le Jriew et l'amabilite des employ& des manuscrits, Lucien, Fn5dkic et les autres, que j'esp&re bien mettre ii contribution encore de nombreuses annees.
Surtout, cette these ne serait rien sans les innombrables sentices que m'a rendus ma
petite m5re toutes ces d-t : j'eSptFe ne pas hi avoi occasiomt5 trop de cheveux blancs. Le soutien moral inddfectible apporte par mes amis, leur a vas-y, tiens bon, t'es capabk m, exprim6 de mille et m e fjlpons et sln mille d un suppozts, fut irrempla#Ie. Outre les personnes d6jh mentiomtks cidessus, maci & Lude et Pierrot, Daniel et filizab*h, Anouchka, MAX, Sylvie, VCro (et ses parents), Tatie, Maxime, Micbel, Nathalie et Olivier (et leu Corinne, Olga, Jenny et Andrewy me cousins J'-Luc a Sylvie, ainsi que les autres membres de mes s i pmlifiques famills provenpLes et benichomes.
Toute ma t e n h s e enfin B cehi qui a nndu les dernim mois de ma these ... presque ... aussi l6gers que le vol des go6lands au-dessus des sapins de Norv6ge.
INTRODUCTION
Qu'est-ce qu'un &t, qu'est-ce qdun jeune, qu'est-ce qu'un view pour l'homme
mddi6val? Si dew etudes h t consaa6es au cycle & vie dans le monde lafque pour Ie bas
bioYen Age - celle de Michael Goodich, couvrant les arm& 1250-1350, et celle de Barbara
Hanawalt, pour les campagnes an@aises des We et XVC sikles' -, jamais jusqu'ici, le
discoun des ecclCsiastiques sur le cycle de vie n'a 6tk 6tudi6 en detail2. Pourtant, leurs hits
constituent & peu de choses pr6s notre seule source d'information avant le We siecle. Or,
qu'entendaient-ils lorsqu'ils usaient de termes comme pwr ou iuuenis ? Quels sous-entendus
se cachaient sous leurs appellations adolescem et senex ? Et enfin quelle place accordaient-
ils B chaque gmupe d'ige au sein de leurs institutions' ? Les ~su la t ts d'une pareille enquete
t. M.E. GOODICH, From Birth to Old Age - The Human L$e Cycle in Mediwal Thought, 1250-1350, LanhamMew YoridLondon: University Press of America, 1989. B.A. HANAWALT, The ZXes That Bound - Peasant Families in Medieval EngZond, Oxford= Oxford Univ. Press, 1986. Le premier de ces auteurs se base largement sur des sources eccl&iastiques, mais il ne mite ni du cycle de vie de l'homme d'Eglii., ni de la spkcificitti du discours eccl&iastique sur les Qes. J A BURROW et El SEARS se sont int6md.s pour leur part a la mani&re dont les homma du Moyen Age s'ingCnihent h dtcouper le cycle de vie en divenes tranches d'5ge. Parce qu'ils c o n ~ i d ~ e n t ces d6finitions c o m e des jew intellectuels ptesque compktement ddpourvus de liens avec la rklitd, ils se sont peu int6re& la perception des ages, mais essentiellement aux questions de filiation entre ces dbfmitions (respectivement The Ages of Man -A Study in Medieval Writing a d Thought, Oxford: Oxford Univ, Press, 1986 et The Ages of Man: Medievat Interpretation of the Life Cycle, Princeton: Princeton Univ. Press, 1986). Je parle plus en dCtail de ces deux ouvrages dans le chapitre I qui mite des d6Einitions des 5ges. '. 11 faut mentionner malgrC tout une exception notable, l'dtude d ' ~ LAMIRANDE sur a Les lges de
I'homme selon saint Ambroise (Cahiers des kmdes anciennes, XIV (1982): 227-33). Le travail d t A. GNILKA, Aetas Spwitualis : die Obe7~1~ndwrg der natWchen AIlersst@en ak fdeatjkihchrbtlichen Lebens (Cologne: P. Hanstein, 1972) ne traite pas du discours ecclbiastique sur les diffdrents ages mais d6veloppe une thbe bien specifique, b savoir que, pour les auteurs eccldsiastiques de l'Antiquit6 tardive et des tout premiers siecles du Moyen Age, le cornportement ideal h i t de transcender son 8ge en adoptaut les qualith des autres iiges. Je reparlerai de cette thdorie dt Gnika dam le courant de ma thh .
'. G. B A W I E R ddclarait & props de l'irnportance des diffkrences Cage et de sexe vis-8 vis de la structure sociale :
a [...I 118ge et le sexe sont les mat&riawr premiers de toute formation sociale, des donndes de la nature - plus inmcturelles, si le teme est acceptable, que les infrastructures par lesquelles I'homme produit sa vie mattrielle (Anthropo-Zogiques, Paris: PUF, 1985 (2'€d.), p-130).
Les histonens se sont peu intdress6s jusqu'ici au cycle de vie, la diffhnce des anthropologues ct des sociologues pour qui ce theme est fondamental. Ccs derniers se sont d'ailleurs plaints du manque d'Ctudes historiques car elks leur seraient utiles pow mener & bien leurs recherches (cf, par exemple D.I. KERTZER,
Introduction m, dans Age Smctwing in Comparative Perspective, Cd. David. I. Kertzer et K. Warner Schaie, Hillsdale (No: Erlbaum Ass., 1989, p.4). Les choses sont mal* tout en train de changer en histoire : ainsi, une importante conference internationale est-elle pdwe h Odense, au Danemark, en 1997, sur Ie theme
ne concement pas seulement les chercheun cpi s'intkssent aux institutions eccl6siastiques
du haut Moyen Age, mais aaussi caa qui W e n t la sociM ldque contemporaine : en effet,
il faut comprendre la grille de lecture que les moines et les clercs appliquaient sm Ie monde
qui les entourait, pour interpdter colLecfement les te2ctes qu'b nous ont 16gutk. Par ailleurs,
une meilleure compre'bension de ce qu'est la culture cl&icale permet, par contraste' de mieux
saisir la particularit6 de la culture laique?
Quelques &udes h t d6jA co- B des @es Specifiques. L'enfmce a intkssl
plusieurs chercheurs : Pierre Rich6 en a par16 ii diverses reprises dam ses travaux ; plus
recement Mayke de Jong et Maria Lahaye-Geusen ont utilid des sources normatives
monastiques pour evoquer la vie des oblats, ces enfants dorm& aux monast&res par Ieurs
parents pour qu'ils devie~ent moines? Les jeunes et les vieux ont en revanche moins retenu
['attention des historiens de 1'~~lise jusqu'8 phnc6. Quoi qu'il en soit de ces travaw, il est
Childhood and Old Age - Equals or Opposites ? m, qui dewi t dunit de nombreux historiens. '. J.-C, SCHMrIT, te Sarit Uvrier - Guinefort, gue'rbsew d 'enfants depuk fe XIIF sicle, (Bibliotheque
d'ethnologie historique) Paris: Flammarion, 1979, p.10. s. M. de JONG a surtout utilist le commentaire de la RZgfe de saint Benoit par Hildemar de Civate, tcrit
dans Ies a n n h 845-50 (In Sirmuel's Image Child Oblalr'on in ErrrQ Medieyal West, LeidenMew York/KUln: EJ. Brill, 1996), tandis que M. LAHAYE-GEUSEN s'est bas6 sur les coutumiers clunisiens d'Ulrich et de Bernard des anntes 1080 (Das Opje der Kinder : ein Beitrag air Litwgie- und SoriaZgeschichte des Mdnchfuns im Hohen MitteIafter, Altenberg: Oros Verlag, 199 1). La liste des publications de P. RIC& est trbs longue, or presque tous ses travaux abordent la question de I'enfance ; cf, enm autres, &ucation et Crrlrure dam f 'Occident barbare, Vlr-VIP si6cle, Paris: Seuil, 1995 (€d, revue et comg6e). Pour d'autres r6f€rences, voir la bibliographie sur les ages en fin de thtse.
6. Quelques articles h t consacrts A l'image de la jeunesse dam les sources eccldsiastiques mCdiCvales, entre autres ceux de I. LECLERCQ pour les Cistcrcieas (cf. par exemplc Saint Bernard et Ies jeunes n, CofICht., 30 (1968): 120-27 ; pour d'aufres d f 'nces , cf, la bbliographie sur I s ages), mais rien n'a dtC &it
ma connaissance sur la place faite awt jeunes dam ~'tglise mCdiCvak L'image de la vieillesse fbt trait& pour ltAntiquit6 tardive pat A. GNILKA (cfi art, Greisenalter n,
Realfexikotz j2r Antik wd Chrktentum, Xn (1983), 995-1094) et pour la fm du Moyen Age par R SPRANDEL (Altersschickd tmd Alretsmorai: die Geschichte akr Eimtellungen turn AItem nach der Parker Bibefexegese des 12.4 6- Jahrhund ' , (hdonographien arr Geschichte des Mittelalters, 22) Stuttgart: A. Hiersemann, 198 1). Quant h I'dtude dc G, UINOIS, a La vieillesse dam la litttratute religieuse du haut moycn- age w (Annales de Bretagne et des Pays de I'Otrest, 4 (1985): 389-401), elle laisse beaucoup d&ircr, Le traitement de la vieilksse dam l'gglii ed un =jet qui devrait intdrtssef dc plus a plus de chercheurs car c'est dans cette institution que se ddcouvrent Ics premieres maisons de retraite et les premiers versements de pensions des personnes Ag&s (cf. J.-P, BOIS, Hiktoire de la vieillese, (Que sab-je ?, 2850) Paris: PUF, 1994, p33 et N. ORME, Sufferings of the Clergy - Illness and Old Age in Exeter Diocese, 1300-1540 m, dam Life. Death. and the Efderfy in Historical Perspectives, €d, M. Pelling et RM. Smith, LondonMew York: Routledge, 199 1, p.62-73). MalgrC tout, il serait errant d'ttudier la place des personnes i3gCes dam l'dglise mkfiCvale uniquement sous I'angIe du d€part la retraite des plus dtfavorisb.
fondmental, au moins dans un premier temps, d'observer le cycle de vie dans son
inte!gralit6? JZn effet, le traitement et la perception d'un &e ne prennent vraiment tout leur
sens que lorsqu'ils sont cornpads am traitement et perception des ages adjacent& Ceci est
d'autant plus vrai pour I'epOque mt!di€vale que, sous la plume Mque comme sous la plume
eccMsiastique, les dbfauts de la jeunesse correspondent am qualit& de la vieillesse, et
inversement : il est donc impossible de traitet des uns sans 6tudier les autns. Ce fut apds
avoir remarquk cette caract6ristique du discours sur les ages en d y s a n t pour mon D.E.A.
l'image de la vieillesse dans plusieurs Vitae des We et Xme siecles9, que j'optai de ne pas
me restreindre d un seul ige pour ma Wse, mais d'6tudier l'ensemble du cycle de vie.
Cette recherche me fit aussi prendre conscience qu'il existait des divergences sur la
manikre dont Ies auteurs pksentaient les titapes de la vie d o n l'epoque ou ils icrivaient, ce
qui n'a rien de tr& 6tonnant, mais aussi selon l'ordre religieux auquel ils appartenaient. Cette
derni6re constatation me dicida P lire, puis B incorporer dam mon corpus, les sources
normatives rnonastiq~es~~. Je fis donc, dam un premier temps, le chemiwment inverse de
tout etudiant au doctorat : plut6t que de restreindre mon sujet au fil des mois de recherche,
je L'Clargissais, en passant de I'titude de la seule vieillesse h celle de tous les tiges, et en
choisissant de ne pas me cantonner aux sources hagiographiques, mais d'ajouter les r8gles
M a l e tout I'intdr6t qu'aurait prisente une etude comparative de plusieurs ordres - ce que je d6sirais entreprendre initialement -, je ddcidai de me concentrer sut Cluny.
'. Cf. par exemple C.L. FRY, Toward an Anthropology of Aging 8, dam Aging in Culture and Society - Comparative Vieypoinrs andstrategies, 6d. C.L. Fry, New York: Praeger Publ., 1980, p.20.
'. Cf. B.A. HANAWALT, Growing up in Medievoi London - The fiperieme of Childhood in History, Oxford: Oxford Univ. Press, 1993, p.1 I.
9. I. COCHELM, a "Le cuer ouvrir et les i'ex c b e n - Saintetd et vieillesse aux XIF et XIIIe siecles m,
Mimoire de recherche pdsente en vue de l'obtention du D.E.A., Universitd de Paris N-Sorbonne, 1989. lo. II est 6vident que je ne partage pas le point de w e de f .-P. BOIS qui affimait tout rkemment dam son
Histoire de la vieiflesse : (I. Dam Ia vie conventuelle se rassemblent des hommes ou des femmes fig& dans une litanie rdcitde sans commencement ni fur, Membres d'une communautt5 et non plus individus, les moines et les nonnes ne naissent pas et ne meurent pas, De meme qu'ils n'ont plus de farnille ni de lignee, de mime aussi qu'ils n'ont plus de nom que celui du saint dont iIs petpdtuent I'image, ils n'ont pas d'iige, pas de vieillesse. Les r&gles monastiques ne parlent pas de I'ige I...] w (Histoire de la vieillesse, 1994, p.30).
Plusieurs raisons expliquent ce choix : Clmy est non seulement le premier ordre monastique
occidental, mais aussi le plus important pour Le Moyen Age central ; ses sources
hagiographiques et nonnatives sont exceptiome11ement abondantes ; enfin, en dtudiant cet
o r b , il etait possible d'analyser le discours sur les ages sur plusieun si5cles et au cours
d'une p&iode pour laquelle il n'existait encore aucune recherche sur le cycle de vie, c'est-a-
dire avant le XIIIe sikle.
Cette etude porte sur 1es annees d'essor et l'3ge d'or de Cluny, depuis la fondation
en 9O9/9 10 par Guillaume d' Aquitaine, jusqu'h la mort de Pierre le Vdn6rable en 1 156. Dans
l'histoire euro@eme, ces 247 ans correspondent au passage du "sikcle de fer", 1e X sikle,
ii la renaissance du XIP : les structures fdodales se mettent en place1', tandis que I'Europe
connait une pdriode de formidable dkveloppement demographique, scientifique et
intelle~tuel'~. Apres un lent debut pour l'abbaye bourguignome - les donations restkrent
de faible valeur jusque dam les annties 98013 et seulement deux Vitae firrent rkdig6es avant
la mort de MaTed en 994 -, l'ordre clunisien fut instaurti en meme temps que commensait
une periode d'intense production hagiographique et normative, depuis les toutes dernieres
armties du XC ~ i & l e ' ~ jusqu'a l'abbatiat de Pierre le Vtint5rable.
". Pour Ies environs de Cluny, cf, la tnis cC1ebre thhe de G. DUBY, La sociPte' auxXI* er XI1* siScles &m ia rigion mdconnaire, Paris: ~ d . de I'EH&s, 1988 (1971). Plus gCnCralement, pour la France, c t D. B A R ~ E M Y , Nouvelle Hktoire de la France mt!di&ale, III: L 'orbe seigneurial -XP-XIF siZcle, Paris: ~ d . du Seuil, 1990.
I t . Cf. P. GRMAL, L P . MILLOTTE, M. PACAUT et R RAYNAL, Histoire ge'ne'rale de ['Europe, I : L 'Europe des origin- au dgbut rhc XTP siicle, Paris: PUF, 1980, p342,
13. Cf. B.H. ROSENWETN, Rhinoceros Bound : Cluny in the Tenth Cenmty, Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1982, p.34. Sur le CIuny du Xe sikle, cE aussi G. CONSTABLE, a Cluny in the Monastic World of the Tenth Century I, dans I2 secolo diferro : mito e reulrri del secofo X, vol.1, (Settimane di Studio del Centro italiano sull'alto medioevo, 38) Spoleto : Presso la Sede del Centro, 1991, p.391-448.
14. Sur ce toumant charnih des alentouts de I'an Mil pour les CIunisiens, cf. D. IOGNA-PUT, Agni immucuIati- Recherches SUI Ies sources hagiogruphiques relatives h saint Maim1 de CIuny, Paris: ed. du Cea 1988, p.307sv. et Id, r Panoma ., 1992, p.104. Pour une vue &ensemble de la production narrative dunisienne, cf. Id, Coutumes et statuts clunisiens cornme sources historiques (ca 990-ca 1200) m, RM, n.s. 3 (1992): 4445.
Pour dtudier le traitement a la perception des Qes dans l'ordre de Cluny, j'ai utilik
toutes les sources aagiographiques et tour les f i t s normati& qui k n t compost% entre 909
et 1 156, soit directement par des ClUILisiens, soit B la demande de Clunisiensl? La
presentation en est faite dam les Annexes A et B B la fin de la pdsente thtse. Dam cette
introduction, jYexpIiquerai pourquoi j'ai considctt ces sources camme significatives pour
traiter du sujet des Hges et queue me'thodologie j'ai employ& pour ies intexpdter. Entre
crochets, sont indiqu&s les abr6viations dont j'ai fait usage tout au long de mon travail
loaque je faisais kfdrence B un de ces textes. Quaad j'ai ins&& dans ma these des extraits
de sources, j'ai toujours repris le texte et la graphie tels qu'ils 6taient pdsent6s dam la
meilleure ddition qui existait a ce jour : je n'ai donc pas essay6 d'unifonniser I'dcriture des
diphtongues, ni celle des u-v ou des i-j, etc.
Les coutumes h e n t des sources fort negligees des mddi6vistes jusqu'i tout
r6cemment1b ElIes sont pourtant d'une tr& grande richesse : les plus dktaillees d'entre elles
permettent de connaitre la vie quotidieme d'un groupe social au Moyen Age, du lever au
coucher, pour des Cpoques sur lesquelles nous ne possddons que tres peu d'informations
semblables. Ainsi, tous les coutwniers de Cluny furent r6digCs au XIC sikle : grice a eux,
il est possible de reconstituer heure apds hewe la journk d'un moine, ce qui est absolument
impensable pour les laics de ce meme sikle, qu'ils soient nobles ou paysans.
Is. Ainsi, Hildebert de Lavardin n'ttait pas moine clunisien, mais Mque du Mans, Iorsqu'il ddigea une Vita Maiofi la demande de Pons de Melgueil.
16. Selon K. HALLINGER, ce ne fit qu'h partit de 1972 que les Cometudines commenctrent A interesser veritablement les historiens (Consuetudines Chniacensium Antipiores cum Redactionibtrs Derivutis [CAI, (CCMVIV2) Siegburg: Apud Franciscum Schmitt, 1983, pix). I1 faut e r e r que la monumentale entreprise d'edition qu'il commenp au d&ut des annCes 1960, se poutsuivra dans le futur. Le Corpus Consuetudinum Monasticorurn [CCW compte i ce jour 12 volumes, dont le dernier date de 1987. Beaucoup reste A faire : en ce qui concerne Cluny, les deux plus importants coutumiers, celui de Bernard et celui d'ulrich, attendent encore une nouvelle ddition. Sur le projet du CCM et, plus gdn&alement, sur l'histoire des coutumiers, cf. L. DONNAT, a Les coutumien monastiques - Une nouvelle entreprise et un temtoire nouveau m, RM, n.s. 3 ( 1992): 5-2 1.
Le premier des coutumiers clunisiens, habituellement intitul6 les Cometudines
antiquiores [CAI? qui £bt composC dans les ann& 1000-1015, est essentiellement un
ordimire" : il ne p&ente donc auMlne information sur les ages, sinon sur I'activitd
liturgique des oblats. Le premier lim du Liber tramitis [LTJI9 est egalement un ordiaairr ;
il est m a l e tout plus d&aUt5 et permet donc de mi- comprendre la struchue h i b h i q u e
de Cluny. Son deuxi6me livre surtout, qui d b i t Ie mode de vie clunisien en dehors de
ly6glise, est une mine d'informations sm le lraitement &em6 aux enfmts, aux jeunes et aux
plus view. Les m6mes remarques s'appliquent aux coutumiers de Bernard [Bern.] et
dYUlrich [Udal-] compos6s dans les m d e s 1080, ainsi qu'aux Statuts de Pierre r6unis en
1 146/1147.
Le problhe majeur auquel est confiontt5 le lecteur modeme des coutumiers
monastiques est que ces dcrits sont destinds une communaut6 de moines connaissant
habituellement une borne partie de leur contenu. Ainsi, nombreux sont les sous-entendus,
les points non iclclaircis, cat cornus de l'auditoire. MEme a propos du texte d'Ulrich - le seul
qui ait 6t6 conqu @ciquernent pour une cornmunautt5 sans lien avec Cluny, donc moins au
courant de ce dont parlait l'auteur, ce qui aurait dCi contraindre ce demier P se montrer clair
et pricis -, H.R. Philippeau note :
a Le principal reproche qu'on puisse lui [ii Ulrich] faire est de trop bien savoir de quoi il parle, au point de supposer que son lecteur saisit toute allusion ii une circonstance de lui connue et qui le falt a tout propos dtvier de son objet Il en arrive 1 parler par ellipses de bien des choses dont I'inteUigence suppose, du Cluny primitif, une conaaissance que persome ne pouvait plus posseder depuis les modifications subies au cows des iges par les institutions. m20
S'il est possible de faire ce reproche a l'owrage d'Ulrich, combien plus est-il possible de le
faire aux coutumiers clunisiens pour usage interne, tel celui de Bernard.
". Cometudines Cluniacemiwn antiquiores cum rehctionibus derivatir, dd. F. Schmitt, Consue~udinum saeculi X-XT-XI' monuments, IT, (CCM 712) 1983, p.3- 1 SO.
18. Sur les ordinaires, cf A--G. MARTIMORT, Les "ordinbl~",les ordimties et Ia ct!r&moniota, (Typologie des sources du Moyen Age occidental, 56) TTwnhout: B ~ p o I s , 199 1. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi cet auteur cite le premier volume du Liber tramitk comme 1e premier ordinaire clunisien (ibid, p-75).
19- Liber tramitis aevi Odilonis abbatk, €d. P, Dinter, (CCM, 10) 1980. 'O- H.R. PHILIPPEAU, Pour I'histoire de la coutume de Cluny w, RM, 44 (1954): 143.
Pour cette raison, la principde mdthodologie que doit employer le chercheur pour
interpreter un coutumier dom6 est la conhntation, premibment et principalement, avec
d'autres passages du texte l u i - h e , deuxihement kec 1es dgles et surtout les coutumiers,
tant ant6rieurs que post&iem, du m h e otdte ou d'un ordre diffhnt? En d'autres mots,
il doit appliquer la methodologie dont a ust Adalbat de Vogtit5 pour expliquer la Rigle tie
sairzf Benoit [R.@? Cest pame que le rituel et la vie quotidiere monastiques sont rCp&iti.f!s
et d'6volution lente, qu'il est ainsi possible de combler les silences et rdpondre aux points
d'intenogation suscit6s par certains passages nonnatifs plus sibyllins que d'autres. A
l'inverse, lorsqu'un auteur ditaille et justifie tel ou tel point du Sglement, c'est tds souvent
l'indice qu'il feit P oeuvre novatrice.
M a l e une indbniable constance dam le mode de vie monastique au fil des sikcles,
pennettant d'expliciter (par exemple) un couhunier du XIIIc sikcle ii l'aide d'un autre rddigk
au XIc, les ~glements 6voqu4s dam m e pareille source peuvent ttre devenus obsol5tes tr6s
peu de temps aprks avoir W dig&, voire meme n'avoi jamais kt6 suivis dam le monastkre
oB k t trouve le texte. En effet, un coutumier n'est pas une rkgle : il ne ddcrit pas ce qui doit
absolument &re fait aujourd'hui et tous les autres jours P venir, mais plut6t ce qui est la
couturne en un lieu pkcis2f, parce que les auteurs aimeraient qu'il en soit toujours ainsi fait
en ce meme lieu, demain et les jours B venir. Telle est par exemple la raison pour laquelle
Bernard prit la plume2'. I1 peut aussi arriver qu'un coutumier soit rbdige en un monastere
donne, que j'appellerai le monasttre-source, pour etre envoy6 vers une autre communautk
qui, soit par choix, soit par obligation, pense imiter le mode de vie du monastkre-source. I1
faut alors Etre bien conscient que le monast8re-nkepteur a pu ne jamais suivre ces coutumes
ou encore les a interpdtges d'une rnmiere toute persomelle?
". La tiche pcimordiale que se fmkent les tditem du CCM fut pdcisdment de dktinguer les filiations entre les coutumiers et de distinguer ainsi des "famiIlcs" rnonastiquts
*. Cf.. en particulier A. de vOG= Lu comnru~utd et 1 'abbi, Bmges: Daclee de Brouwer, 196 1. *. Sur le fait que les coutuxniers sont des h i t s davantage descriptifs que vdritablement normatifs, cf. L.
DONNAT et W. WITTERS, art. a Consuetudini monastiche a, DIP, 2 (1975). col.1692- =4. Bern. Epist.,p.l34. 3. Je n'ai malheureusement pas pu consulter I'article portant sur ce sujet, de B. TUTSCH, a Die
Co~~erudines Bernhards und Ulrichs von Cluny im Spiegel ihrer handxhrifilichen Oberlieferung m, qui a dQ paraitre dans le volume 30, de I'annCe 1996, des F&St-
Cette particularit6 des coutumiers, le fait qu'ils ne repnisentent que la rtMit6 du
moment ou ils h t k i t s et du lieu dont ils sont origimhs, n'est pas probl&natique pour
qui &die Cluny, au contraire. L'abbaye bourguignonne est en effet le monastere-sorcef6 :
le mode de vie decrit par ses coutumiers reprbnte donc bet et bien son mode de
fonctiomement. En outre, du fait de la transformation de la coutume clunisieme au fil des
dkendies, il £bt nkessaire de ddiger un minirnum de quatre coutumiers sur un seul si&cle,
sans oublier les corrections apportks par les Stututs de Pierre environ un demi-siiicle plus
tard. Grrice ii cette profhion de sources, il est possible d'observer I'evolution de la Liturgie
et de la vie quotidieme clunisiennes de &s pks. Cette dernike remarque s'applique aussi
au th6me des iges : les coutumes ofknt L'occasion de suivre les transformations du discours
clunisien de mani&e beaucoup plus pdcise que ne le permettent les Vitae. Celles-ci sont
pourtant des oeuvres incontournables pour qui veut t5tudier le cycle de vie au Moyen Age.
Les yitap constituent Ies seules sources kdig6es avant le Xme sikcle qui pennettent
de suivre un individu B travers tous les iges, de l'enfance a la mort2'. La mt5thodologie pour
Ies anaiyser, mise au point par H. Delehaye et plus ghkralement par les Bollandistes, parce
qu'elle a pour principal objectif de dkbarrasser les dom6es historiques de leur
". Sur les &res d'influence des coutumiets clunisiens, cf le tableau dcapitulatif de D. IOGNA-PRAT, = Coutumes.., =, RM, n.s, 3 (1992): 46.
27. Les lignes qui suivent reprennent en partie le texte d'une confdrence donnde pour ta Hagiographicd Society, dam le cadre du 27e Congrk international des Ctudes mdditvales de Kalarnamo. Ie 7 mai 1992, Ion de la session Saints and Society. I : Historical Uses of Hagiography m, confdrence qui s'intitulait The Ages of Life as descnid in the Monastic Vite @F%I@' c.) m. Pour des analyses plus d&tailldes sur la rn&.hologie a suivre pour Ctudier les Vitae, cf. Ies ouvrages sur l'hagiographie cith dans la bibliographic compldrnentaire. Sur la question des Vitae comme sources historiques, cf, F. LIFSHITZ, r Beyond Positivism and Genre : "Hagiographical" Texts as Historical Narrative m, Viator, 25 (1994): 95-113. Sur les probttrnes m€thodoIogiques que p e n t les Vitae pour qui veut faire I'histoire des reprbentations mentales, cf. tout particuli&rement LC. POLJLIN, L'idPcrl de sainteti &m 1 'Aquitaine carolingienne d'apr6.s les sources hagiogruphigues (75&950J, uravaux du laboratoire d'histoire rdigieuse de L'Univ. LavaI, 1) Quebec: Presses de 1'Univ. Laval, 1975, p.22-30.
Avant le XIIIt siecle, les autobiographies sont exceptionnelles ; les marchands italiens n'ont pas encore pris I'habitude de dunk leurs souvenirs dans des ricordi pour les ltguer B leurs fils ; les chmniques ne suivent le diroulement d'une vie qu'au Iong des anndes oh elle a agi sur 1'Histoire ; et enfin Ies cycles retraqant Ies exploits d'un heros laique, qu'ils soient originaires de Bretagne, du Languedac ou d'ailleurr, ne prdsentent pas son evolution B travers Ies iges de la vie, mais dressent des portraits €ies ii des lges donnds.
. enveloppement r merveilleux29, est de faibe utilitk lorsque la question po& ne prte pas
stzr les 6v6nements qui jalomhnt I'existence des saints et le dtiveloppement de leur culte
mais s'adresse plut6t au mode de penser des auteurs? Compte tau du fait que les Vitae ne
sont pas de simples biographies, mais remplissent m e fonction panCgyrique et
rnoralisatrice3', et qu'elles abritent toujours un paad nombre de lieux cornmum, on peut
s'interroger sur la pertinence d'dtudier ii travers elles le discours sur Ies gtges de la vie.
Une Vie de saint a certahes simiIitudes avec un magniiique bijou : Les fsits
miraculeux en sont les diamants, qui captivent l'intMt du lecteur. Pourtant, iI faut seair ces
pierres, les fixer sur une base condte : le support du bijou, s'il peut Stre d'une matiere
noble, se doit avant tout #&re solide. La structure de la Vita qui fgit passer le saint de
L'enfance a la mort est semblable h ce support : les hagiographes doivent offrir une armature
realiste B leurs merveilleuses anecdotd2, les enchihser sur la trame de l'existence humaine,
quelque part entre I'enfance et la mod du saint Il est en effet hoa de question pour le heros
de mdconnaitre (par exemple) la puberte. Or, tandis que l'hagiographe explique comment le
saint a su en eviter les icueils, il ofEe par la r n h e occasion B ses lecteurs de riches
informations sur cette &ape de la vie, telle qu'il la perqoit.
3. Pour reprendre l'image utilisCe par Jacques FONTAINE dam son edition de la Vie de saint Martin de Subice Shrtre ((SC, 133) Paris: hi. du Cerf. 1967, p.188).
'O. La question du faux, par exemple, ne se pose absolument pas avec la meme urgence (cf. B, DE GAIFFER, = Mentatitti de l'hagiographie rn&li&aIe d'apds quelques travaux dcents *, AB, 86 (1968): 391- 99). I1 importe peu que l'auteur ait invend de toutes pieces certains dvdnements puisque les remarques sur les fges de la vie qu'il a pu y inst?rer restent d'dgal intdet A celles dnoncdes dam les autres passages plus "historiques" du texte. On peut mtme consid6rer que les prernitires sont encore plus significatives pour une etude sur la perception car, pour cacher son entrepcise ct ne pas bveiiler la suspicion de son lecteur, l'auteur aura tendance il inscrire l'anecdote invent& dans un cadre parfhitement andin : sa pdsentation des gges coincidera donc plus exactement avec l'irnage mentale des iges dc ses contemporains.
". P . DELEHAYE, k s le'ge& hagiographipes, Bruxelles: So&& des BolIandistesv I955 (Qe Cd.), p.64. If. W.M. METCALFE ecrivait deja la fm du sikcle demier que 1 s Vitae Ctaient particulDrement
int6ressantes [for] those permanent kcts which the biographer had no interest in altering (Ancient Lives of Scottish Saints, Paisley: A. Gardner, 1895, p s i . Je ne suis pas d'accord avec Michel de CERTEAU, locsqu'il afirrne, au sujet de la Vie de saint, qu'elle a m?e3 hors du temps ct de la r&gle, un space de "vacance" et de possibilitds neuves rn et que son discours d e une liberte par rapport au temps quotidien, collectif ou individuel (art. a Hagiographie s Encyclopaedia Universalis, 9 (1984): 70). La caracttristique des Vitae est prticisernent d'offiir un modtle de vie riche de possibilitds neuves, certes, mais qui s'inscrit dans le temps d'une vie.
En se basant sur un large corpus de Yies de saints, iI est possible de distinguer la
position ori-e d'un auteur de ce qyi constitue damtage la norme ou le discours tenu par
la majorite sur la question des hes. Cette distinction est fondamentale pour mon propos
puisque je veux prbenter la e o n clunisienne du cycle de vie a non celle d'un &xivain
spkifique.
Il faut noter par ailleurs que ce discours tenu par h majorit6 n'a rien de statique : les
r&critures des Vitae sont particuli5rement dvdatrices, ii cet dgard, des innombrables
inflexions que subissent les Cvocatiom des 5ges d'un hagiographe P l'autre. Pour revenir a
I'image des diamants, si ceux-ci sont rarement retaillb d'une premiere ddaction a la
suivaate, il en va diffdremment de leur support : les mentions sur les iges sont fiequemment
retouch&s, le plus sowent de manik d i d t e , parfiois plus radicale. Ce travail de r&criture
atteste que les remarques sur les iiges pewent Stre attribuk I l'auteur de la Vita, d o n qu'il
est difficile, voire impossible, de d6terminer avec certitude la provenance des histoires
miraculeuses : en effet, celles-ci peuvent tout aussi bien etre des Gemplois de sources &rites
plus ou moins anciennes, n'ayant p a s aucun Lien avec le saint bvoqut, des kchos d'une
tradition orale, ou encore des inventions pures et simples de l'hagiographe. En d'autres
tennes si les diamants sont souvent chargb d'un lourd passe, la monture est habituellement
contemporaine de la piiode de redaction.
Le saint n'est pas le seul individu kvoq1.16 dam sa Vira : nombreux sont les
personnages secondaim qui in te~ement kgalement. Or les hagiographes prkcisent parfois
s'ils sont enfants, jeunes ou vieux. I1 est alors important d'observer si le discours de l'auteur
est louangeur ou deprkiatif par rapport B cet age et quel comportement il lui associe.
Certains de ces protagonistes sont decrits de mani&re positive quel que soit leur nombre
d'annies : la confiontation entre leurs portraits et celui du saint permet d'6tabli.r une echelle
entre ce qu'il est desirable de faire h un 5ge domk et ce que seul un saint peut accomplir.
Enfin, il est nkessaire de toujours faire t r s attention h qui parle dam une Vila.
L'hagiographe decrit parfois une sche ou un individu h travers les yew d'une autre
personne que lui-meme : dam semblable situation, il n'adopte g6nkralement pas le point de
vue qu'il expose, mais donne celui-ci B titre informatif. Ici encore la confrontation est
enrichissante lorsqu'on dtudie le statut de l'individu qui parle et la difference entre son point
de w e et celui du narra!eur principal. Cette question se pose surtout B props de la jeunese
et du comportement attendu pendant cet @e.
Tandis que les Yirae tendent possible l'analyse de la petreption des @es de la vie par
les moines clunisiens, l a coutumiers nous informent principalement sur le traitement &em5
ii ces mEmes iges. Ainsi, la premih & o n expliquant ma dhision d'dtudier conjointement
ces deux ensembles de sources reside dans le fait qu'ils se complttent l'un I'autre
parfaitement : la place faite il un groupe a l'intdrieur d'une socidtt5 domk ne peut ttre
correctement 6valu& B moins de comfitre le regard port6 sur ce groupe ; mais, inversement,
ce regard ne prend vraiment tout son sens, qu'une fois dkterminde la position socide du
groupe concern& Traitement et perception sont intimement lib et s'dclairent mutuellement.
La deuxikme raison pour analyser ces sources de concert est qu'elles ont habituellement la
m h e origine et la meme fonction : elles constituent donc un corpus relativement homoghe.
En effet, les Vitae comme les couhuniers pennettent B ceux qui detiennent le pouvoir
d'expliquer ce qui fait le "bon moine" et la "bonne cornmunautt5", tout en s'attaquant aux
erreurs individuelles et communautaires? Ceci est evident pour ce qui est des coutumiers,
qui sont des listes de eglernents hunCrant ce qu'il faut ffaire et ne pas f&. Cela I'est rnoins
B prime abord pour les Vitae. Pourtant ces ecrits transmettent les memes messages, mais sous
la forme d'anecdotes et non de kglements : la description du saint dome l'occasion de
dresser Ie portrait du moine parfat, et 1'6vocation de ses combats permet d'expliquer les
erreurs qu'il faut comger. Enfin, ni les Vitue ni les coutumiers ne rendent compte de ce que
pensaient et faisaient rtiellement les groupes des enfants, des jeunes et des view : aussi me
suis-je concentnie nu le discours sur les 4ges et non sur Ie mode de penser et les occupations
des divers groupes d'iige. Malgr6 tout, Vitae et coutumiers expriment le point de vue des
". L-C- POULM souligne que les Vitae Cnurn&ent les &gIes de dussite m pour atteindre la saintete, tandis que Ies sources normatives pdsentent les dgles de conduites ndgatives n (L 'Wal de saintetit.., 1975, p.3-4). Malgre ceae divergence, la fonction de ces deux ensembIes d'Ccrits reste tt.es proche.
34. C f. D. IOGNA-PRAT, Agni imtnaculati, 1988, p.309.
hornmes dirigeant l'abbaye, c'est-Adire des seniores~riores. Or, c o m e je le montrerai dam
ma thh, ce groupe etait surtout wmpos6 des plus igds de la communaM. Ceci ne powait
manquer d'avoir une m e influence an la m a n i b dont ces sources traitaient du cycle de
vie. D'ailleurs, lorsqu'un t&s jeune abb6 prit le powoir, il savoir Pons de Melgueil, ce
discours changea radicalement pour un bmf laps de temps ; ce ne fit probablement pas un
bard. J'y reviendrai.
Je n'ai pas utilist5 systtmatiquement les autres sources clunisiennes compodes entre
909 et 1156 parce qu'aucune d'elles ne parle directement des iges de la vie. Le fait est
evident pour les Jcrologeg5, les nombreux sermons qui subsistent, tout specialement
d90don et d'OdilonM, les Lettres de Pierre le Vtn6rable35 ses trait& poldmiques,
I'Ocnrpato3* et Ies Collati~nes~~ du dewchime abbe, ou les autres ecrits spirituels clunisiens :
il arrive i l'occasion que ces auteurs fassent me remarque sur un Pge particulier - et je fais
parfois r6f6rence dans mes notes a telle lettre de Pierre le Vtn6rable ou tel sermon
d'Odilon - mais la pkhe est trop maigre pour justifier de passer avec minutie B traven tous
ces Ccrits. Ma decision de ne pas utiliser les t r b nombreuses chartes clunisiemes qui
subsistent nkessite en revanche une plus ample explication"? En etudiant les signatures des
35. Cf. Die Synapse der clunlbcenskchen Necrologr'en, 1: Einleifung und Regkter, 11: Die Synopse, dd. W.D. Heim, I, Mehne, F, Neiske, D. Poeck, I. Wollasch, ~Unstersche MittelaIter-Schriften, 39) Mmchen: Wilhelrn Fink, 1982.
36. De nouvelles editions des semons d'Odon et d'Odilon seraient Ies bienvenues (cE D. IOGNA-PRAT et C. SAPM, Les etudes clunisiennes dam tous leurs &tats - Rencontre de Cluny, 21-22 septernbre 1993 m, RM, n.s. 5 (1994): 242)- En attendant, les principawc sennons des a b k clunisiens se trouvent dam la Bibliotheca Cluniucensk [BibLClu], &i. M. Maniff et A, Duchesne, Macon: Protat, I9 15. Raymond OURSEL a par aitleurs traduit plusieurs sennons d'Odon dans son ouvrage Les saints abbk de Cluw - Text- choisis, traduits et prPsent& (Namurr ~ d . du Soleil levant, 1960).
Pierre le V&ndrable, The Letters of Peter the Venerable [LPVJ, dd., intro. et notes G. Constable, 2 vol., Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 1967.
''. Odon de Cluny, Occupatio, Cd A. Swoboda, Liepzig: Teubner, 1900. Sur cet ouvrage, cf en tout dernier lieu I. ZIOLKOWSKZ, a The Occupatio by Odo of Cluny, A poetic manifesto of monasticism in the XIth cent. m, Mittellatein&ches Jahrbuch, XXIV-XXV (1 989-90): 55947. Une nouvelle edition de ce texte par K. SMOLAK (Vienne) est en cours (ct D. IOGWPRAT et C, SAPIN, Les etudes clunisiennes ... *, RM, n.s. 5 (1994): 242).
j9. Odon de Cluny, Collationurn libri III, BibLClun, co1.159-262. 'O. La nouvelle edition par H. ATSMA et J. VEZIN des chartes ~Iunisiennes (5 volumes prevus dans les
Monzmrenta Medii Aevi de Zurich) est tnk attendue car elle devrait pennettre de resoudre de nombreuses
moines, il est possible d'6tudier de p&s le cheminement de ceaains d'entre eux. B. de
V~giIle a pu ainsi suiwe le p o u r s du moine AudebadAldebald de Cluny, d'abord simple
timoin en 974/75, puis scribe en 976/77, idvite en 978, pritre en 992/93, puis demeurant
encore une dizaine d 'annb dam I'entourage du nowel abbe 0dilon4'. On peut donc
constater qu' Aldebald est rest6 actifpendant m e trentaiw d'anndes ; mais iI est impossible
de savoir l'iige qu'il avait en 974/75, ni pourquoi il a disparu des chartes apds le debut de
I'm Mil : est-il mort, a-toil &tt diclassd pour une faute quelconque ou est-iI entd ii
l'infmerie ? Ces mimes questions, presque impossible ii &oudre, se posent pour la trk
grande majorit6 des moines 6voqus dam les chartes. A supposer qu'une recherche
minutieuse permettrait m a l e tout de suivre la trajectoire de vie d'un groupe de moines
clunisiens - un groupe suffisamment large pour &re reprksentatif et n'incluant pas
seulement les membres Ies plus prestigieux de la cornmunautt5 -, Ies rkdtats obtenus
rendraient compte, non plus du discours sur Ies 5ges mais be1 et bien des activitks des
groupes d'iige, ce qui nicessiterait une tout autre approche et constituerait un sujet bien
different-
Le premier probltme auquel je fus confiontie avant meme d'amorcer I'analyse du
discours clunisien sur les iiges fbt de savoir quels ktaient ces iiges. Les auteurs de l'ordre
n'avaient en effet jarnais jug6 nhssaire d'expliquer a leur audience comment ils divisaient
questions de datation et de mauvaise -ption, parfois meme des problhnes cruciaw de falsification (cf. H, ATSMA, a L'acte de fondation de I'abbayc de CIuny dexarnin€ (r&m6) Bulletin de la Sucidte' nationale des Ant iquaires de France, 199 f (1 993): 263).
'I. B. de VREGILLE, Le copiste Audebaud de Cluny et la Bible de I'abM Guillaurne de Dijon m, dam L 'Homme doant Dieu - Milanger of- ctu PZre Henri de Lubac, vo1.E Du Moyen Age au si2cfe d ' LurniCres, (ThCologie, 57) Paris: Aubier, 1964, p.11-12 ; pour de plus arnples informations sur ce moine, cf. D. IOGNA-PUT, Agni immaculati - Recherches sur I t s sources hagiogruphiques relatives li saint Maieul de CIvny (954-994), Paris: hi. du Cerf, 1988, surtout p.102-03. Sur la population claustrale de Cluny sous I'abbe Maieul, cf, F. NEISKE, Der Konvent des Ktosters Cluny zur Zeit des Abtes Maiolus. Die Namen der Mi3nche in Urkunden und NecroIogien a, dam "VincuIum Societa~is~ Joachim Wolhch zum 60. Geburtstag, dir. F. Neiske, D- Poeck et M. Sandmann, Sigmaringendorf;. Glock & Lutz, 199 1, p.118-55. Sur les moines de Cluny dam les a n n h 105040, cf. I'anatyse de P, DlNTER de la distriiution des livres pour le Careme, dam son edition du Liber Tramitis [LTJ (LT p. Ivi et 190,p.261-64).
Ie f3 d'une existence humaine ni ce qu'ils entendaient par des terms c o m e i#m ou
senium. Le risque d'anachronisme inconscient est ici particuliikement eleve. En l'absence
d'dtudes sufiisamm~ pouss&s sur la definition des ages au Moyen Age et afin de preadre
du recul par rapport B la perception actueUe du cycle de vie -pour ne pas rechercher dam
l'"autret le reflet de la m a n i h de pawr du XXC si&le -, je me suis 8abord int&e&e aux
6tudes-anthropologiques sur la question. J'ai ensuite =lev6 les definitions des ages offertes
par des auteurs ant6rieurs ou contemporains de Cluny : 64 d&nitions du cycle de vie,
Cchelomees entre le debut du s k l e et l'extr8me fin du MI' , sont ainsi r th ies dam
IyAnnexe C, puis &umdes dam les Tableaux I et 11. De cette longue Liste, iI est possible de
did& comment un homme d ' ~ ~ l i s e du Moyen Age central percevait les diverses 6tapes du
cycle de vie. J'ai donc compad ces rtsultats aux informations Cparses sur le cycle de vie
contenues dam les sources hagiographiques clunisiemes.
Le monde monastique est par d6finition un monde d'ordre. Volontairement, les
moines du Moyen Age opposaient I la violence et au dCsordre de l'existence siculi&e leur
vie reglb jusqu'au moindre ditail. Les chercheurs ont peu, voire jamais, app&hende les
modkles qui ont inspire les rkguliers pour forger ieur mode de vie. Or, les supdrieurs du
momstere etaient appeles Ies seniores ou les priores ; en-dessous d'eux se trouvaient les
izrniores et en tout dernier les pueri. L'emploi d'un semblable vocabulaire m'incita a
examiner le rapport entre I'organisation hi6rafchique monasfique et la division des Sges. Tel
est le sujet du demci&me chapitre. Pour parf'aitement comprendre le fonctionnement interne
de la communautc5 clunisienne, il faut 6galement examiner la manikre dont les nouveaux
venus itaient form& et incorpor& B celle-ci : la question des oblats est abordtie dam le
chapitre consacre aux enfhnts, bndis que I'hnexe D traite des adultes. J'interroge dam
celle-ci la pertinence de parler d'un noviciat ii Cluny avant la deuxikrne moitie du XIC siecle
et montre comment cette institution ne fut vdritablement mise en place que sous l'abbatiat
de Hugues de Semur (1049-1 log), par suite de l'entde de tres nombreux adultes dam
I'abbaye. Ce flot de nouveaux venus eut Cgalement de profondes repercussions sur la
position des enfants, des jeunes et des view dam l'abbaye clunisienne.
Les chapitres III, IV et V de la th&e &oquent cette question en certains points de leur
d6veloppement Plus globalement, ils portent sur ie traitemat et la perception de chacun des
8ges : le troisieme est c o d B l'enfbnce, ie quatrihe I la jeunesse a le cinqube ii la
vieillesse. Ils cornmencent tous par un sumo1 bibliographiqye oh je mentio~e les principales
tendances et les dcueils de I'historiographie, mais lli s ' d t e n t ensuite l e m points de
similitude. En effkt, pour chacun des chapittes, plutBt que de dpondre toujours aux memes
questions (par exemple : vie quotidie~e et topos), j'ai prdfCr6 organiser les informations
giankes dam les coutumiers et les Vitae autour d'un theme central, qui synthdtise le mieux,
a mes yeux, le discours clunisien sur cet Hge. Pour Ies e d i , je montre comment les moines
de Cluny etaient bien davantage pdoccqds par Iem corps plutat que par leurs esprits. Pour
Ies jeunes, je mets en Mdence comment les caractdristiques principales de cet 5ge 6taient
directement ou indirectement d6valuees par les Clunisiens. P3ur les vieux, j 'explique
l'arnbivalence du discours sur cet iige, oii l'doge se mele au mepris.
CHAPITRE I
LES =IS AGES DU CYCLE DE VIE
L'objectifde w chapitre est de pnhnter la dbfinition clunisieme de la division des
ages. I1 n'dtait pas possible de I'extraire directement de la lecture des Vies de saints : les
informations etaient I& nombreuses, mais offertes de faqon trop diffuse et fiagmentk pour
comprendre quel systtme unissait les iges en& eux dans l'esprit des moines de Cluny. 11
m'a donc fdu rechercher comment les pensews de I'epoque definissaient les iiges et, A partir
de la grille ainsi bitie, voir queues nuances les auteurs clunisiens y apportaient. Aussi les
sections de ce chapitre s'enchainent-elles du gdnkral au particulier, des grandes &apes de la
vie au discours sur ces mEmes &apes. L'archGtype anthropologique de la division des Bges,
toutes societk confondues, est d'abord brosse ; vient ensuite la description du cycle de vie
a l'kpoque mddiCvale9 la prbentation anhpobgique offerte en premi6re partie pernettant
de mieux en saisir les moments-clk. De l'6tude du ddrodement de I'existence au Moyen
Age, on glisse vers celle de son interpdtation par les contemporains : les dkfinitions des ages
de plusieurs penseurs du h u t Moyen Age (jusqu'au We inclusivement) sont donc andykes
et un nouvel archetype est dressd. Wce ii celuici, I'ktude du discours sur les iiges de la vie
dam les Vitae clunisiennes peut enfin &re menee a bien : cette demikre section permet non
seulement d'exposer comment les moines de Cluny percevaient le cycle de vie, mais aussi
de rendre comprehensibles certaines caract~stiques des d6fitions mentiom6es
precedemrnent, en montrant leur ddpendance - peu Gvidente prime abord - avec la
division du cycle de vie teUe que dcue par les hommes du Moyen Age. ParaUelement sont
pr6sentis les trois iges qui seront les sujets d'dtude des chapitres ult&iem : l'enfance, la
jeunesse (iuuentus) et la vieillesse (senectm).
Avant mEme de commencer cette h d e , iI est ndcessaire de preciser quel sens je
donne aux diffiirents tennes designant les iiges de la vie. Pour mieux mettre en Mdence la
confonnitk ou la divergence de mes dtifinitions par rapport aux sens habituellement allou&
Q ce vocabulak, je me propose de les c o h n t e r am definitions offines dam les deux
dictiomahs les plus populaires de la langue fh@se, le Petit Lmousse de 1996 et le Petit
Robert de 1995-
L'dmce est, toutes flodes confondues, SSge le plus facile ii definir : il s'6tend de
la naissance ii la pubertC. Telle est la ddfinition off- par le Larotuse' ; le Robert, pour sa
part, situe l'enfmce entre la naissance et I'adolescence, mais, puisque, comme now le
verrons plus loin, il fitit commencer I'adolescence a la pubert6, sa dkfinition est par
consequent identiqus. Tel est tgalement le sens que j'associe A ce vocable.
Par gge mtlrlmaturit6, j'enteds l'iige d'indipendancef qui fait suite a la jeunesse.
Cette definition est t d s proche de celle donnee dans le Robert : a ige G..] qui suit
imm6diatement la jeunesse et coflere h l'&e humain la pltnitude de ses moyens physiques
et intellectuels m4. Mal@ tout, le concept d'independance sousentend que lY3ge d'un
individu est dt5fini en vertu des rapports que celui-ci entretient avec son entourage, tandis que
la definition du Robert utilise comme seuls crit&res les qualit& intrins5ques de cette
personne. Le Larousse insiste encore davantage sur cet aspect de la question : la maturite
serait la a bleriode de la vie caracterisee par le plein d6veloppement physique, affectif et
intellectuel m5. A en moire ces dictionnaires, il existerait donc m e sorte d'iige parfait, un iige
de la "plenitude", dam la vie humaine. Je montrerai que les auteurs du Moyen Age central
ne dkfinissaient pas d'etape equivalente dans l'existence.
J'utilise le substantif jeunesse pour designer l'ige de semidtipendance sY&irant de
la pubertt5 jusqu'l la matUritC. Cette definition correspond parfaitement ti celle des
dictionnaires, le terme de semi-dipendance mis a part : le Robert parle du a temps de la vie
entre I'enfmce et la maturitC et le Lmousse de a [p]&iode de la vie humaine comprise entre
l'enfance et 1'5ge min m6. Selon le contexte, je peux aussi utiliser "jeunesse" pour traduire le
I. Le Petit Larousse iIIwtrk 1996, Paris: Larousse, 1996, p387 =. Le Nouveau Petit Robert, Paris/Montr& Dictionnaires Le RobedDicoRobert, 1995, p-760. '. J'explique plus loin cet empmt au discours anthropologique. '. art. a MaturitC *, Petit Robert, 1995, p. 1369. '. Petit Larotrsse, 1996, p.64 1. 6. Petit Robert, 1995, p. 1227 et Petit tarousse, 1996, p.573.
vocable iuuentus, mgme si, comme on le verra, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la
iuuentrcs d'autrefois.
Le meme phenomhe se produit avec le substantifadolescence. Dans l'anaiyse des
tableaux I et 11 de ce chapitre, par exemple, j'utilise ce terme pour dbigner I'adolescentia
des auteurs mBdievaw. Au chapitre IV en revanche, loque j'emploie "adolescence",
j'entends la d6finition actuelle de ce teme, c'est-&-dire, d o n le Robert, I'Hge qui a succede
B I'enfance et pr&&de i'iige adulte (envimn de 12 & 18 ans chez les filles 14 i 20 am chez
Ies gaqons), immediatement apds la puberte m7. Le Petit Luromse le d6finit quant B lui
cornme la a [p]&iode de la vie entre la pubertk et L'iige addte nu.
Ce meme dictionnaire explique L'adjectif "adulte" comme signitiant a blamenu au
terme de sa croissance, de sa formation m, tandis que le Petit Robert ddcliue que l'ige adulte
s'ktire chez l'homme a de la fin de l'adokscence au commencement de la vieillesse 2. Ces
deux ouvrages font donc debuter cet ige B la fin de la M o d e de croissance de I'&e humain.
J'utilise pour ma part une definition sensiblement diffdrente : par "age adulte", j'entends la
periode de la vie qui commence avec la puberte - c'est-&-dire avec la phase majew de la
croissance physique, et non avec la phase fude - et s'interrompt avec la mort. Ce choix
s'explique du fait que, pour l'homme m6di6val -plus pdcigment, pour le moine du Moyen
Age central dont je m'occupe ici -, la coupure la plus importante dam la vie humaine est
la pubert6 ; il me fdlait donc un terme pour disigner les ann* qui suivaient. Une semblable
d e f ~ t i o n permet d'opposer Ie groupe des enfi ts i celui des adultesI0.
Au vocable vieillesse, j'asocie dew significations diffirentes, selon que je traite de
la sociktk contemporaine ou de la rnddihile. La seconde appelait g6nCralement la demihre
grande &tape de la vie humaine la senectur ; nous verrons que traduire ce terme par
"vieillesse" n'est pas tout a fait approprie, mais que toutes les autres alternatives sont encore
'. Petit Robert, 1995, p 3 1. '. Petit Larousse, 1996, p39. 9. Petit Larousse, 1996, p.40 et Petit Robert, 1995, p.33. lo. La mime defmition du terme adulte se retrouve chez plusieun autres rnedievistes, cf, par exemple A,
HIGOUNET-NADAL, Pkriguaa ota XIV et XIC siBcIes - ~ t u d e de demographic historique, Bordeaux: Fideration historique du Sud-Ouest, 1978, p.3 10.
moins adtiquates. Pour ce qui est du XXe sikle, Ies dew dictionnaires Robert et housse
o&nt une definition de la vieillesse bas& exclusivement sur la rUte biologiqueu. A cde-
ci, je p~~ la definition habituellement prise en compte par les cherchem (mhe si c'est
souvent pour la critiquer violemment), savoir I'"Qe de la retraitenl2.
Ce rapide survol donne un apequ de la difficult6 de tradui. le vocabulaire latin des
ages en b p i s modeme ; mais Ies siecles h u l & ne sont pas les d s responsables de cette
divergence entre dew langues. La prudence est aussi n & e h pour qui veut utiliser Ies
travaux des historiens non francophones abordant la question des ages de la vie. Je d e n
ofEirai qu'un seul exemple B partir de 1'anglaisS Cette demi&e langue W e r e sut des points
fondamentaw de la langue frangaise quant au dicoupage du cycle de vie. Elle poss6de
premierement un terme *cifique pour la petite enface, directement herite du latin,
infancy13. Deuxiemement, tandis que childhwd dquivaut bien ii l'enfance, l'adolescence et
la jeunesse ne sont pas les exacts equivalents d'adolescence et youth. Teem, qui est d'origine
am6ricaine, est probablement le terme le plus approprie pour traduire "adolescence",
puisqu'il couvre les annkes 13- 19 and4. A la diffirence du hqais , adolescence et youth
sont habituellement employ& comme des synonymes ; ils definissent tous dew l'iige entre
'I. a Derniere pdriode de la vie normale, caract6&e par un ralentissement des fonctions (Petit browse, 1996, p.1065) ou 8 [dlernitre pdriode de la vie normale qui succede h la maturitd, caractdris6e par un affaiblissement global des fondions physiologiques et des facult& mentales et par des modifications atrophiques des tissus et des organes (Petit Robert, 1995, p.2388).
12. Cf. A.M. GUILLEMARD, Lu Vieillwe et I'E!~, Paris: PUF, 1980, p22. k mnercie Aline CHARtES pour m'avoir hitide aux ddbats t ds complexes des chercheun en sciences sociales sur la question de la dCfmition de la vieillesse ; pour une bonne pr6sentation de ceux-ci, cf. son DEA en histoire, Vieillesse et retraite f4minines dans le milieu hospitalier montdalais entre 1940 et 1980 (UniversitC de Paris Vn, 1980, p.23-24), en attendant sa thbe qu'elle devrait soutenir dans le courant de l'annde 1997 il I'UQAM. La proposition de certains spticialistes de ddfmir la vieillesse comme couvrant Ies cinq ou dix demitres annees qui restent A v i m (cf. par exemple P. BOURDELAIS, L 'dge & b vieiIIksse, Park: Editions Odile Jacob, 1993, p217-37) est fort int6ressante pour qui travaille sur Ie monde accidental de ce dernier sitcle, mais absolument inapplicable en dehocs de ces limites spatio-temporclls.
". SeIon N. ORME, les deux tennes "infancy" et "puericien ne sont appam en anglais qu'au XVe si&Ae, tandis qu'auparavant, on ne distinguait pas entre les differentes phases de I'enfance (From Childhood to ChivoIry - m e Education of the English kings undaristocracy 106&I530, LondodNew York: Methuen, 1984, p.7).
' I . Cf. IVe6ster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York/AveneI: Gramercy Books, 1994, p. 1459 et The Concise Oxford Dictionnmy of Current English, Oxford: Clarendon Press, 1990, p. 1253-
l'enfance et I'aduIthoods. Ce dernier age corrr~pond de par sa d6finition ii l'@e adulte (tel
que d6fini dans les dictionnahs franpis), puisqu'un adult est une persome qui a hi son
ddveloppement physique (a grown up) ; mais iI a aussi des connotations modes (mature)
et 16gales (3ge de la maj~ritt)'~. II peut donc, selon le contea ou la Hiode historique
envisage equivaloir B I'iige adulte ou A la maturit6. Ainsi, adolescence et youth
correspondent B I'adolescence ou B la jeunesse, d o n le cas.
En anglais, ahIthood peut donc &re synonyme de maturity. Bien que je ne l'aie pas
mentionnd pricddemment, pour ne pas compliquer outre mesure les pdsentations des
defhtions des iiges, le meme phhornene se note aussi en h q a i s : lorsque le Robert
explique l'adjectif m&, il renvoie au terme adultel'. !'Age miklw, "ige adulte" et "maturit6"
sont en effet souvent utilisis comme synonymes. Ce flou dans le vocabulaire et dam la
definition de I'ige central de la vie (commence-toil avec la fin de l'adolescence, c'est-Mire
apres la formation physique, ou avec la fin de la jeunesse, autrement dit, aprks la semi-
dipendance ?) trowe son origine dans la langue latine. L'analyse de la perception m6di6vale
des iges qui suim l'expose sur l'archetype anthropologique permettra de mieux comprendre
ce phtnomhe.
A. LA PERSPECTIVE ANTHROPOLOGIQUE DU CYCLE DE VIE
Comme nous venom de le voir, les soci&ks occidentales contemporaines privilegient
une division de l'existence humaine en quam grandes Ctapes : enfance, jeunesse, maturite
et vieillesse'. Dans les pages qui suivent, je voudrais montrer qu'une division tripartite -
Is. Cf. Webster's, 1994, p.M-20 et p.1657 et Orfiord, 1990, p.16 et p.1423. 16. Cf. Webster 's, 1994, p20 et Oxford, 1990, p.17. 17. Petit Robert, 1995, p.1458. '. Cf. par exemple M.N. FRED et M.H. FRIED, Transitions - Four RituaIs in Eight Cultures, New
YorWondon: Norton & Co., 1980, p.14. Si les Fried affirment que la soci4te occidentaie contemporaine divise ['existence humaine en quatre 5ges (in$mcy, adofescence, maturity et senescence), leur ouvrage n' analyse pourtant que quatre rituels (la naissance, la pubertC, le mariage et Ia mort) et non cinq, comme il aurait Ct6
e&ce, jeunesse, maturit&vieiilesse - est non seulement acceptable d'un pint de w e
anthropologiqye mais aussi plus appropi& B I'W du cycle de vie dans un contexte autre
que celui du monde contemporain.
1. Le trio dipendance - semi-dependance - indLpendance
La division de l'existence humaine en tranches d'@e par une socidtd donnee
s'explique par des facteurs biologiques et culturels. M b e si Honorius Augustodunensis
(~1080-cl137) imagiaait l'homme du paradis terrestre naissant avec un corps d'adulte puis
disparaissant au Ciel1 rage parfait de trente am, sans avoir jarnais comu l'enfance ni le
dkclin physiqus, et m a l e les amusantes constructions intellectwlles d'un Jonathan Swift
Iogique. Ainsi, m a l e leur afknation, tr& dicutable d'aillem, qu'il existe des cituels pour chaque passage d'un ige & un autre, ils n'en dtudient aucun pour la transition entre I'avant-demier age et le dernier. Ceci confme la t k e que j'avance plus Ioin dans ce chapitre, comme quoi il est souvent prt?fCrabIe de percevoir I'iige mirr et la vieillesse comme constituant un seul et meme age.
P. SPENCERdonne appmximativement les mtmes quatre ages pour I'humain, &blissant pour sa part un parall&le entre le cycle de vie des primates et celui des hommes :
= The model of primate ageing is seen to have an intringuing parallel with human society, where fill adulthood is similarly bounded on its margins by the anomalies of adolescence and old age, especially among males : those that have difficulty in entering the arena and those that are edged out. rn (8 The riddled course : theories of age and its transformations m, dans Anthropology and the Riddle of the Sphinx - Paradoxes of change in the Lge Course, dd. P. Spencer, (ASA Monographs, 28) LondodNew York: Routledge, 1990, p.5).
Mais il affirme aussit6t qye, lors du processus qui Ctoigna I'homme du primate, donc de Ntat de Nature, pour Ie rapprocher de la Culture, la puissance physique du jeune fbt peu & peu supplant& par la puissance morale des ah%- L'auteur evoque le savoir riael, diplomatique et mythologique associC aux personnes &&es dans Ies socidtt?~ dites traditionnelles. Certes, tous les view n'obtiennent pas le pouvoir mal* ces connaissances et l'lge chronologique n'est pas toujoun un critere pour aquCrir de I'autocitd mais il est evident que la simple existence de ce phenomhe dCtruit la dt?tinition de la vieillcsse donntt auparavant par Spencer, soit l'&e au cours duquei I'homme, de mtme que le primate, est rejett? hots dc la soci6te.
2. Honorius Augustodunensis, L'Eiucid~ium et les lucidaires, Cd Y. L t f h e , Paris: de Boccard, 1954, p. 1 f 8 et p374-75. Thomas d' Aquin, plus d'un sikle plus tard, professe unc opinion diff6rente sur la gCdration de I'homrne au Paradis : Et ideo in s t m iflo poluissent esse aliqui defictus pueriles, pi consequurrtw generutionem ; non autem &$ectus senifes, qui ordinuntur ad cowuptionem. rn (Summa theologioe, I,99,1, Roma: Cornmissio piana, 1953, co1.605b). Pour ce demier, I'dimce peut donc se conjuguer avec l'innocence du Paradis mais la vieillesse est obligatoirement synonyme de conuption. Il -t tds int&esant de rassembler et Ctudier d'autres texts similaires sur rage de l'homme rcsmcit6 pour voir si cette transformation du discours d'Honorius il Thomas - assez proche de celk que j'avais not& dans les textes hagiographiques pour les rntmes Cpoques (cf. I. COCHELM, In senectute bona : pour une typologie de la vieillesse dans
ou d'un Pierre Daniw8, pour ne citer que ces dew auteurs, l'homme, quel qu'il soit, de
toute race et de toute tpoque, suit le processus de ddveloppement de n'importe quel
organisme vivant. II traverse en e f f i trois phases biologiques distinctes : la croissance, la
maturite a le dklin. Pourtant L'&e humain ne calque pas sa perception du dhulement de
l'existence sur cette seule rWt& physique'.
Chaque socidt6 semble privilCgin un ddcoupage Specifique de la vie avec,
habituellement, rites de passage, fonctions et comportements Specifiques attach& ii chacune
des ttapes. Dam le foisomement de constructions culturelles qui en dd ten t , cenains
anthropologues distioguent trois @es fondamentaw, qui sont universe11ement pdsents dans
la division du cycle de vie, mEme s'il arrive qu'on les subdivise ou que d'autres iiges leur
soient ajoutb. Des appellations Mdremtes peuvent &re apposdes A ces trois gges ; les plus
neutres (c'est-Mire celles dbpourvues des signifiCs spkifiques B chaque soci6te) sont, B ce
qu'il me semble, celles proposties par Joseph F. Kett, 8 savoir d@endance, semi-dkpendance
et indkpendance? La dkpendance, qui dam notre vocabulaire est appeltie enfance, est la phase
l ' h a g i ~ ~ p h i e monastique des XIl' et XnIe siecles *, dam tes 6ges de la vie, 1992, p- 1 19-38) - est gdntrale ou particulitre ces deux exemples.
3. Jonathan SWIFT ddcrit I'hom'ble tragCdie d'une soci6tt5 d'immocteis soumise au vieillissement dans Grdiver's truvek, tandis que Pierre DAMNOS monte, dans Les came& du Bun Dim, comment Dieu, pour se dbennuyer, mit au monde un vieillard ayant les traits d'un barnbin- Celui-ci ne fit que rajeunir mentalement en meme temps qu'il vieiliissait physiquement, jusqu'g fmir barnbin, sous les traits d'un vieillad.
'. I1 arrive tout de mCme que certains auteurs suivent A la lettre ce modk1e de croissance-rnaturit~-d~c1in ; pour la pCriode mhdidvale, il s'agit avant tout d'auteurs s'inspirant d' Arktote, donc asset tatdifs par rapport h mon champ de recherche (cf, JA, BURROW, Tise Ages o m -A Stu& in Medievai Writing and Thought, Oxford: Oxford Univ. Press, 1986, p.5-11).
'. Joseph F. KETT, Rites of Passage. Adolescence in America, 1790 to the Present, New York: Basic Books, 1977, p.11. La meme division tripartite se retrouve chez G- BALANDIER, dam son article a Age . (dam son livre Anthropo-logiques, Paris: PUF, 1985 (1974), p.90-91), mais cet auteur parle pour les deux premiers iges de ddpndance biologique p i s de ddpendance sociale, L'opposition entre le biologique et le social est t& juste mais je ne parlerais pas de ddpendance totde pour te second 4ge : le tenne semiddpendance me sernble plus appmpri6, Denise PAULME commence son article sur Is Classes d'&e (Anthropologie) . dam I'EncycIopaedia Universufis par l'afknation pdremptoire suivante :
Toute sacit36 comait une division tripartite entce enhts, adolescents nubiles et couples marib. Partout, l'ige autant que Ie sexe &finit la position, les droits et les devoirs de l'individu. Seuls Ies vieillards peuvent accdder ii I'autoritd dans 1es socidt6s n'ayant pas une hieramhie politique bien dessinde. (Enqdopaedia Universaiir- Corpus, V, Paris, 1989, p.959).
Dans son articIe Vie (cycle de) W, P. SMITH donne une division tripartite de la vie assez simiIaire A celle de D. Paulme - enhce , l'apds-pubertk mais I'avant-inddpendance, I'inddpendance -, avec comme difference notable qu'il accentue considdrablement l'influence du facteur biologique :
La notion de cycle de vie rend cornpte du diroulement de I'existence hurnaine individuelle en rant qu'elle
la plus fade h dCfinir. Biologiquernent, elle correspond exacternat ii la premik phase, celle
du d6veIoppement physique. Sa fin est estgdement dixemabk, il s'agit de la pubert6 ou des
a n n h trh pfoches'? Suit me nowclle phase, la jeunesse, qui comespond la ptkiode de la
vie humaine o~ l'homme, m b e s'il est d6veIoppC physiquement, n'occupe pas m e place
B part enti& dans la sociM : bien qu'il remplisse ou, tout au moins, puisse remplir ddjh m e
pleine charge de travail et que son corps soit capable de p&, l'individu appartenant h
cette tranche &age reste dans un 6tat de partielle soumission k 1'Cgard de ses ah%, et ce,
pour diverses raisons inhdrentes ii la structure propre de la societt! dtudide
(kducation/fonnation, gestion du patrimoine, etc.)'. Puis l'homme passe dam la troisieme
phase, celle de l'inddpendance, qui peut se pomuivre jusqu'ii la mort.
Il est evident qu'une telle division tripartite suscite plusieurs questions. J'en traiterai
dew qui me paraissent particulibement significatives, d'autant plus qu'elles ressurgiront
rkgulikrement tout au long de cette thhe . Premikment, la definition de la semiddpendance
pose un double problkme de definition quant B ses bomes infirieure et supdrieure : dans
quelles circonstances peut-on parler d'adolescence et quelle limite separe le deuxitme du
troisikme Pge ? Deuxi&mement, qu'advient-il de la vieillesse dans un tel schema ?
est universellement vdcue sinon identiquement conceptualistie par toutes les cultures. Le fondement du cycle de vie est, en efTet, biologique avant d'&e social. La repduction de I'esp&ce humaine implique I'amdnagement, entre la naissance et la mort d'un individu, d'un temps de maturation conduisant le nouveau-nC I I'Qe de la procdation et d'un temps au long duquel l'adulte accompagne l'enfant de ses oeuvres jusqu'au parachkvement de sa personne IB (art. a Vie (cycle de) m, Dictionnaire de I 'ethnologic et de Ihnthropologr'e, du. P. Bonte et Michcl Iratd, Paris: PWF, 1991, p.740-41). 6. La "pubertC physiologique" ne correspond que rmrnent la "pubertt sociologique", cL le chapitre VI
dlAmold VAN GENNEP, Rites & p ~ ( ~ g e , New York: Johnson Etep~t , 1969. Ce mtme age, marquant la fur de I'enfance, peut fort bien varier au fil du temps dans une socidt6 donnee. Ainsi pour les Romains, il firt d'abord jug6 au cas par cas, d o n le d6veloppement du corps des individus concern& ; par la suite, un age fi t fwC, celui de 17 ans, pour Ia e p t i o n de la toga uirifk ; ii la fin de la Rdpublique, cette cedmonie avait plus souvent Iieu vers I'iige de 14-15 ans (cf. IX- EVANS, Wbr. Women and Children in Ancient Rome, LondonMew York: Routledge, 199 1, p.190, n.83 et E. EYBEN, w The Beginning and End of Youth in Roman Antiquity a, Paedagogica Historim, (1993): 25940).
'. 11 peut arriver aussi que certains Cldments du groupe des jeunes choisissent, volontairement ou non, de vivre en marge de la societC : je reviendrai sur a h&ne en parlant du cycle de vie au Moyen Age. Le cas des jeunes Nyakyusa, au sud du Tanganyika, partant fonder un nouveau village, et donc une nouvelle communautd, est asset exceptionnel (cf. P.H. GULLlVER art. Age Differentiation a, Inrer~ional Encyclopedia of the Social Sciences, vol, I, dd. D.L. Silk, New York: The Macmillan Co. and The Free Press, 1968, p. 160).
2. Un deuxi&me ige difiicile P d6limiter
Pour ddmontrer qu'il n'existe pas obligatoirement de limite pr6cise entre le deuxihe
et le troisi&me iige, il d t d'o& un seul exemple, peu importe la mitt6 choisie. Le plus
simple est donc de prendre notre propre culture. Dam celle-ci, le deuxi&me age n'a pas de
&el tennirms a quo : en effet, qui pourrait dire si la semid6pendance se c16t avec le ddpart
de la maison familiale, ou bien avec la fin des etudes et l'entde sur le march6 du travail, ou
encore avec le mariage et la paternit~matemit68 ? Tout individu ayant rempli I'ensemble de
ces conditions est indiscutablement perqu cornme une personne m h t par ses pairs mais il
peut 6galement Etre considdr6 tel s'il den remplit que quelques-unes.
Cette absence de criteres pricis pour marquer la fin de la semi-ddpendance se
retrouve Cgalement dam d'autres sociCtds : I.F. Kett l'a notee pour I'Amdrique antebellum
(avant la guene de S6cessi0n)~ ; je l'etudierai dam le cadre du monde clunisien. M a l e ce
flou, et B moins de d&& ou de circonstances exceptionnelles (incapacitds physiques graves
ou debilite), il advient toujours un temps, dam la vie d'un individu, H partir duquel celuici
est pequ par I'ensemble de ses contemporains w n plus comme un jeune mais comme une
personne milre ; et l'inddpendance totale ou quasi totale par rapport a ses ah& etlou la
paterniWmatemit6 sont Ies dew cri ths essentiels justifiant cette transformation.
Une autre question que se pos&rent et se posent plusieurs historiens, sociologues et
anthropologues par rapport a cette deuxieme phase du cycle de vie conceme l'adolescence.
Faut-il la considerer comme un iige B part entiere et donc la dissocier de la jeunesse ?
Plusieurs chercheurs repondent par la nbgative car ils considerent que I'adolescence est une
creation du monde contemporain, suite h une en& de plus en plus tardive des jeunes sur le
march6 du travail. Pourtant, s'ils different sur la date d'apparition de ce phinomene, ils ne
'. Pour une Iiste semblable, cf. par exemple B.X.,. NEUGARTEN et GO. HAGESTAD, Age and the Life Course m, dam Handbook of Aging and the SuciaISciences, ed. Robert H. Binstock et Ethel Shams, New Y o k Van Nostrand Reinhold Co., 1976, p.37.
'. J.F. KETT, Rites of Passage, 1977, p 3 I .
semblent surtout pas s'entendre sur m e d&.nition claire de cet SgelO. Puisque les termes
adolescenr, aaddescentia, dolk.scere existent pour la @ode que je vais Ctudier, j'essayerai
dans le chapitre IV de &pondre I la question de l'exisfence ou la non-existence de
L'adolescence dam le monde clunisiea.
3. Absence d'une cathone spicifique pour la vieillesse
Pourquoi ne pas faire ici de la vieillesse m e categorie B part de telle sorte qu'elle soit
nettement distinguee de I'iige mOr" ? Parce qu'une telle distinction n'est pas le propre de
toutes les soci6t6s12. Pour ddmontrer ce point, il sufft de mettre en valeur le fait qu'aucun
des trois differents critiires permettmt, dans notre sociM, d'afEmer qu'untel est vieux,
c o m e le debut de la retraite, le depart des enfants de la maison et la decr6pitude physique,
n'est universel.
Certes, il existe dans certaines soci6t6s un rite de passage pdcis, habituellement suivi
d'une transformation du r6le social joud par les individus, qui entrake l e u entree en
vieillesse. Dans notre culture, il s'agit du depart B la retraite ; dans certaines communaut6s
d' Afrique orientale avec classes d'sge, il s'agit de rituels permettant le retrait de I'homme
5gk des rangs des guemers et son incorporation dam le groupe des ainCs. Mais toutes les
cultures ne proposent pas de semblables transitions institutionnalisees entre la maturitC et la
'9 M. VINOVSKIS, = The Historian and the Life Course : Reflections on Recent Approaches to the Study of American Family Life in the Past n, dam Lfedpan Development and Behavior, Cd. Paul B. Baltes, David L. Featherman et Richard M. Lemer, vol, 8, Hillsdale (NJ)/London: Lawrence Eribaum Ass. Publ., 1988, p.48- 49.
". Les memes anthropologues mentioants ii la note nOS de cette section et professant la division tripartite de la vie semblent bien en ma1 de situer la vieillesse : ils kvoquent le demier age sans lui accorder aucun statut precis (cf, par exemple la citation dom& de D. PAULME). G. BALANDIER delare pour sa part : 8 Le cours de IT&e conduirait les individus de la ddpendance h la pddominance, puis la situation ambigut! de la fm du cycle de vie. w (Anthropo-logiques, t 985, p.9 1).
". Cf- B. ARCAND, = La construction culturelle de la vieillesse m, Anthropologie et sociPtPs, 613 (1982): 7-23,
vieille~se'~ ; or, en l'absence de celles-ci, aucun changemeat veritable ne distingue ces dew
iges. Ainsi, dam la sociM occidentale avant la r6volution d6mographique de la fin XVIIle-
debut X W sitcle, la retraite, si elle exisbit dtjh dans toutes 1s couches de la soci6t6, restait
optiomelle et la grade majoritt des hommes a des femmes travaillaient jusqu'h leur mort.
Dam un tel contexte, il n'est pas possible d'opposer la vieillesse B la maturitt-5 sur la question
du travail, ni, de f q n plus large, sur celle du tdle social occupC.
On ne peut pas non plus utiliser l'argument de la structure f d a l e pour maquer
l'entrk en vieillesse. Les signes pdcurseurs ou marqueurs de vieillesse que sont aujourd'hui
Ie "syndrome du nid vide" ou le statut de gt.ands-parents n'ont que peu de sens dam les
sociWs n'ayant pas connu les prom mddicaux occidentaux des dew derniers si5cles, tout
particuliiirement celui de la dgulation des naissances. Dans I'Europe pd-XIXe sikle, les
parents se retrouvaient fi6quemment au seuil de la mort avec encore un e n h t a charge.
Quant au veuvage, iI frappait sans discrimination tous les iiges et donnait t& souvent Lieu
& un remariage par la suite, au m o b dam le cas des ho~nmes'~.
Plusieurs r4torqueront que l'argument physiologique est ici incontournable : avec
I'gge, le corps decline. Mais ce d6cli.n se manifeste par de multiples signaux. Lequel choisir
pour signifier I'entrh en vieillesse : les cheveux blancs, les rides, une mauvaise we, l'usage
13. P. SPENCER explique cette fhkpente absence de division des iges au-deh de Ia maturitt? par le fait que les hommes mars sont plus port& soigner leurs intMts propres (famille, biens) qu*& s'impliquer dans des activitds de group, implication s h e qua non pour constituer m e classe d'iige (Anthropology, 1990, p.11-12). Cette explication me semble avant tout traduire le discours assez mtprisant de Spencer face awc ah&, dans un article au demeurant t ds savant.
Sut la difficult6 de diviser le groupe des individus m h pour en extraire Ies plus Q#s, cf. D. ANGERS, Vieiilir au XV' sikle : r Rendus 1, et retrait& dam la rdgion de &en (1380-1500) mv Francis, 16 (1 989): 1 13-
14 et G. MINO1 S, Histoire de la Vieillesse de I 'Antipiti ti la Renaissance, Paris: Fayard, 1987, p. 18-1 9. Sur la perception naissante de la vieiilessc comme un age nettement distinct de Mge mQt B la fm du MXL
siecle, cf. TX, HAREVEN* a The Life Course and Aging in Historical Perspective I, dam Aging rrnd the Life Course Trmitions : Inrerdi&cQlincuy Perspectivev &d.T.K. Hareven et IUI Adams, New YorWLondon: The Guilford Press, 1982, p. 12-13, Mais Ics affiations de cette auteure doivent litre prises avec circonspection car, selon ses dim, I'enfance et la jeunesse sont aussi des eations dcentes. Elle admet malgrd tout que Ies transformations les plus marquantes dam le cycle de vie concement le dernier iige et que cette dvolution est avant tout le produit de I'aIIongernent de I'esp6rance de vie (ibid, p.16).
14. La Iitttrature sur ie sujet de la structure familiale avant le MX' sikle est extremement vaste ; pour une perspective plus socioIogique du phhomCne, cf par exemple T.K. HAREVEN, 8 The Life Course ... m, op-cit., 1982, p.16-17.
d'une came, la mhopause ? TOUS ces signaux pewent atteindre des individus jeunes ; en
revanche, beaucoup de petsames @es ne les accumulent pas tow avant de molair.
Il p a t m a l e tout e v e r un temps ok la persome 3gie ne parvient plus ii suivre le
rythme de vie de ses contemporains et doit donc &re pnse en charge : elle quit& par
conskquent le groupe des indCpendants - pour reprendre les d6finitions des @es de J.F.
Kett. A w dires de Leo W. Simmons, le premier grand Speciaiiste de I'hde de la vieillesse
dam les peuplades dites primitives, I'extdme vieillesse, qui est souvent sumomm~ la
seconde enhce, est me dalit6 qu'aucune socidte n'ignorel' le m o n d d'ailleun que Les
hornmes du Moyen Age la connaissaient L'interprktation de cette &ape de la vie peut
cependant changer de maniere radicale Gune culture 1 l'autre ; elle demeure en outre un
phenomhe marginal dam toutes les socidtds n7ayant pas connu l'allongement drastique de
l'esp6rance de vie que nous comaissons aujourd'hui dam les societ6s occidentales".
Autrement dit, si toutes les sociCt6s comaissent l'existence de la sCnilit6, seule une faible
proportion de leurs mernbres la vivent, abstraction faite de quelques cultures bien
sp&5fiques, et encore sur des Hiodes limitees dans le temps. Cette met6 explique pourquoi
cette derniere etape n'est pas consid&6e universellement comme un iige proprement dit-
Ainsi, la distinction entre la maturite et la vieillesse ou meme lYextr5me-vieillesse ne
va-t-elle pas de soi si la sociitk concemee n'a pas volontairement dtabli une barritre sociale
entre ses hommes m h et ses hommes igCs, comme l'est aujourd'hui la retraite.
Is. Leo W. SIMMONS, Aging in Preindustrial Societies W, dam Handbook of Social Gerontology : Socieai Aspects ofAging, dd- Clark Tibbits, Chicago: University Press, 1960, p.87-
16. I1 est impossible de savou combien de vieillards dependants compte une socidt& puisque chaque individu connait une vieillesse diffdtente de celle de son voisin- Meme aujourd'hui ce calcul serait malais&, &ant donnd que ['entree dam une maison de retraite ne signifie pas specifiquement la dependance et que beaucoup de personnes %g&s sont encore prises en charge par leurs familles. Pour les p6riodes anciennes, il est m h e difficile de savoir quel etait le pourcentage de personnes ayant v h jusqu'h un age avarice. Pour I'Athbnes antique, nos connaissances reposent pour l'essentiel sur les 82 squelettes enteds sur 1'Agora (cf- LN. CORVISIER, aLes grands-parents dam Ie monde grec ancien m, ADH, I99 1, p.22) ! Pour fa pdriode mddibvale, Ies chiffres varient sensiblement d'une pdriode B I'autre et d'une dgion ii l'autre (cf. LC. RUSSELL, How Many of the Population were Aged ? a, dam Aging and the Aged in the Medieval Europe, dd. M. Sheehan, (Papers in Mediaeval Studies, 1 1) Toronto: Pontifical Institute, 1990, tableau 1, p. 123).
Au fi.I de ce travail, je montrerai que les m b e s questions - comment cl6e l'iige de
semi-dependance et quelle place accotder h Pad01escence et I la vieillesse vis-I-vis,
respectivement, du deurritme et du troisitme 5ge - se posaient egalement dans le monde
mt5diCval en g 6 n M et le milieu chukien en jxuticulier. Un autre fbcteur qu'il est n&essak
de garder i l'esprit est la diffknce entre ks cycles de vie masculin et ferninin. Si, dans notre
sociCt6, la division tripartite des 6ges peut aussi bien &e appliquk aux hommes comme aux
femmes i condition d'admettre certaines nuances, il en va autrement dans beaucoup d'autres
cultures" : employer les temes de dkpendance - semi-ddpendance - independance pour des
individus remplissant avant tout un rdIe de procdatrices et occupant presque exclusivement
une position de dipendance n'a @re de sens. De ce fait, la femme ne connait bien sowent
qu'une seule et grande coupure dans son existence, le mariage - il s'agit quelquefois, plus
spicifiquement, de la maternit6I8 -, que celui-ci prenne place ou non au moment de la
pubertef9. Dans la mesure oc le permettront les sources mises ici h contribution - sources
", Cf., entre autres, M, FORTES, a Age, Generation, and Social Structure m, dans Age and Anthropological Theory, id- D, I. Kertzer et I. Keith, Ithadondon: Cornell Univ. Press, 1984, p.119 et P. MERCIER,
Anthropologie sociale et culturelle m, dam Ethnologie gPnPrafe, vol- I, Cd. J, Poirier, (Encyclopddie de la PICiade) Paris: Gallimard, 1968, p.952-53. A tim d'exempk, pour les femmes des sociCtCs non-occidentales, le cas des Baruya de Nouvelle-GuinCe, tel que ddcrit par Maurice Godelier, dans son livre Laproducriorr dm grands hommes - Pouvoir et domination masculine chez f a Banrya de NouvelIe-GuinPe, Paris: Fayard, 1982, p.62 ; pour les femmes de la socidtti romaine antique, cf. E. EYBEN, Restfess Youth in Ancient Rome, LondodNew Yo* Routledge, 1993, p 3 ; pour cellts de It€poque mbdi&ale, cf. B. HANAWALT, Growing up in Medieval London - The Erperience of Childhood in Hdtory, New York/Oxford, 1993, p, 12- I3 ; pour celles de I'Arn&ique pr&XX' si&cIe, cf. J.F. KETT, a Adolescence and Youth in Nineteenth-Century America m, dans The Family in Hisroty - Inrerdkciplinary fisays, 6d. T.K. Rabb et RI. Rotberg, New Yo* Harper, 1973 (197 I), p. 108.
Certains auteurs notent essentiellement une divergence chronologique cntre les cycles de vie masculin et f6mini.n (cd par exemple, H.C. COWEY, a Old Age Portrayed by the Ages-oGLife ModeIs From the Middle Ages to the 16th Century m, The Gerontologist, 29 (1989) : 693) mais j'espre montrer dans la suite de ce chapitre, au moins pour la @node medievale et les h i t s clunisiens, qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de chiffks.
Is. Chez les Grecs, en etTet, le plus important rite de passage pour la femme n'dtait pas 1e mariage mais la premiere matemit6 : la femme conservait toute sa vie I'appellation dont elk heritait a p e son premier accouchement, gun& (R GARLAND, The Greek W;ay ofLge From Conception ro Old Age, Ithaca 0: Cornell Univ. Press, 1990, p.199-200). L'emploi d'une appellation Wcifique pour designer la jeune man'& sans enfant, mrmph6, n'atteste pas tant de I'existence d'un age intennddiaire dam la vie de la jeune fille mais temoigne pIut6t d'une phase d'attente, certainement assez come en I'absence de moyens de contraception sirs, except& pour Ies couples stdriles.
19. P.H. GULLIVER, art Age Differentiation m, op. cit., 1968, p. I6 1.
produites dans des monas&es m a s d m et pariant presqye exclusivement des homrnes -,
ce &&me sera efneurC, aussi bien daas ce chapitre que les suivants.
La section p M e n t e a permis de pksenter diveses &flexions des anthropologues
sur la division des Gges. I1 faut maintenant se demander comment s'articulent ces memes
questions dans le cadre ecifique de la societe midiCvale. Dans ce but, le cycle de vie des
h o m e s du Moyen Age, tel qu'il a W possible de le retracer h la lecture des Ctudes
secondaires sur le sujet', sera ici dessink. Ce portrait sera volontairement t& schematique
(couvrant plusieurs sikcles et diff6rents milieux, agricole, seigneurid, bourgeois et
eccldsiastiqu$) car l'objectif est precikment de degager les grandes Lignes du cows de
['existence au Moyen Age, afin de les codionter ensuite aux definitions m4di&ales
thkoriques de la division de la vie. Une telle madre de faire pennettra de rendre beaucoup
moins abstraites et plus comprt5hensibles ces derrieres dont I'btude suivra.
Les sources du haut Moyen Age itant quasi muettes sur le theme de la vie
quotidieme (mariage, naissance, enhce, etc.), exceptee ceue de quelques tr2s grands
personnages, les rn6dikvistes ont presque exclusivement dkfhi le dbrouiement de l'existence
humaine pour les XIe-XVe sikcles ; or les dkfinitioas des iges que j'ktudierai par la suite
couvrent prtkisernent l'ipoque prgcidente, I savoir du Ve au MIC si&cle. Malgr6 tout, rien
I . Cette section est une synthbe de diverses Cmdes portant sur l a Sges de la vie au Moyen Age. Les principaux auteurs sont mentiomb en note ; pour une bibliographie plus compl&te, cf. la bibliographie sur les ages.
'. La question du dCmu1ement de la vie des mernbres de l'eglise sera B peine Cbauchde, premihcment parce que les historiens ont plus ou moins ignod ce sujet, deuxiemement pour eviter les redites avec les sections et les chapitres suivants. t e liwe recent de Barbara F. HARVEY, Living and Dying in England lIO&l54O - The monmtic experience (Oxford: Clarendon Press, 1993), malgrt? son titre, ne traite pas du cycle de vie mais de I'existence au quotidien des moines de l'abbaye de Westminster.
n'indique que le rythme de I'eru'stence humhe se transformiit radicalement d'une +ode
i lYautre3 : la diff6rence se situerait avant tout dam 1'6volution des rituels de transition.
L'adoubement, par exemple, n'existait pas encore mais le jeune gtiemer quiet
l'apprentissage des annes pour se laucer sur les champs de batailIe vers les m h e s @a, soit
vers 15-20 ans, et cela depuis l'tpoque romaine ~USQU'& la fin du ~ o y e n Age, voire audels?.
Avant le We sitCle7 Ie marhge d o d t rarement lieu & une ddmonie religieuse officik par
un prgtre mais les mariages avaient be1 et bien c o d -
Le vocabulaire latin des iges sera mentiom6 parall&lement a la presentation des
grandes divisions de la vie au Moyen Age. Les appellations r6servCes au sexe mascuiin
seront analysees plus en dbtail au fil des sections suivantes de ce chapitre, sur la base,
premikrement, des d6fhitions mddi6vales de la division du cycle de vie, et, deuxikmement,
des informations sur les iges offertes par les Vitae clunisiennes. Tel ne pourra
malheureusement pas etre le cas pour les remarques concernant le sexe ferninin, faute de
sources sur le sujet. En effet, les defnitions m&Wvales des iges kvoquent le dkroulement
de l'existence des hommes, non celui des femrnes6. Par ailleurs, seules une Vita, celle d'Ide
3. Les chapitres 111, IV et V de cene these, qui dtudient la perception et le traitement des ages dans Ies sources clunisiennes entre 909 et 1 156, permettent de s u i m et comprendre les changements qui eurent Iieu par rapport ces questions 21 l'aube du MIe sitcle,
4. Ddj& chez les Romains, la fin de lapuen'ria marquait pn!ci&nent le debut du service militaire, soit vers l'ige de 15- 17 ans (cf- D- SLUSANSKI, Le vocabulaire latin des gradus aetatum gn) I, Revue roumaine de linguistique, XDV4 (1974): 361-62). Chez les Francs, = la rnajoritt delle comespond A la remise des ames entre 15 et 20 ans. On sort de I'enfance lonqu'on devient puMre et lorsqu'on cst capable de mania des armes I (P. RICH& L'enfant dims le haut Moyen Age W, dans Enfin! et So&&, n u m b spCcial des ADH, 1973, p.95). Sur le d6veloppement de f'adoubement comme rituel la toute fur du me sikle, cf, I. FLORI,
Sdmantique et sociM mCdidvaIe : le ve&e adouber er son dvolution au XII' si&cle e, AnnaZes €SC,3 1 (sept- oct, 1976): 8 15-940 et Id, a Chevderie et liturgie : Remise des arms et vocabulaire "chevalemqucsn dam les sources liturgiques du IX' au XIV siWe m, Le Moym Age, 1978, p.247-78 et 40942. D. BARMLGMY soutient que ce phdnomhe f i t pIus prdcoce (cf. s Note sur I'adoubement dam la France des XIe et XIF siecles m, dans Les a'ges de vie, 1992, p.107-17).
'. Sur le fait que h sociCt6 du haut Moyen Age connaissait essentiellernent deux rites de passage, le bapttme et les funhailles, cf. I. C&M, L 'mbe du ~ i g e n &e, Park Picard, 199 1, p.446. Sur le mariage pmpnmmt dit, cf. entre awes J. GAUDEMET, Le mariuge en Occi&nt : les nroercrs et le clroit, Paris: ~ d . du Cerf, 1987.
6. Le fait est aidment ddmoncrable. Dans les defmitions des ages donnCes en 1'Annexe C, il n'est jarnais question des femmes. De plus, seul 14/15 ans, IT5ge de pubertC des gaqons, est mentionnC, jarnais celui des filles (I2 ans).
de Boulogne, et m e eitaphe, ceIle d'AdeMde, dessinent le cours de vie des femme parmi
les Ccrits hagiographiques clunisiens : c'est trop peu pour en duuire le langage des iiges
f~minins. Les remarques ci-dessous, sur le champ dmantique de pello, anus et uetula, ne
sont donc offertes q y ' B titre d'hypoth&es7. J ' ere mal@ tout qu'elles convaincront de
I'importance d'entreptendre des 6tudes sur cette question.
1. Le trio enfance-jeunessc-Pge mtrhieillesse
Meme si I'enfance jusqu'h la pubertd (ou approximativement) est presque toujours
evoquee, tant par les anthropologues et les historiens que par les auteurs mMiCvaux, comme
un iige en soi il arrive nhmoins Equemment qu'elle soit subdivisie en plusieurs sections.
La division de loin la plus importante et la plus cowante est celle qui se situe a peu pres a la
moitiC du temps de l'enfance, soit ves sept am (parfois tm peu moins, 5/6 am, parfois un
peu plus, 8 am)'. Telle est par exemple l'itge-bite entre les deux enfances qu'kvoque Ie
droit canonique m&ii6va19. Le dkroulement de cette premiere partie de l'enfance d'un
'. Les remarques que je fonnulecai ci-dessous, sur le langage des ages ftminins, dtcoulent de la lecture des nombreuses sources hagiographiques qu'il m'a dtt? donne de lire, non seulement dam le cadre de rnon doctorat, mais aussi dam celui de ma maitrise (I. COCHELIN, Saintete Iarque : l'exemple de Juette de Huy (1 158- 1228) =, fe by en Age, XCV (1989): 397-417) et de rnon DW (a "Le ocer m i k et IPJ ikr cfonen - Saintete et vieil1esse a m Xn. et Xme si&cla n, dir. P. L'Hennite-Leclercq, Ddpt d'hdes MCdiCvaIes, Universitt de Paris IV-Sorbonne, 1989)-
'. Les ages de 7 et I5 am symbolisaient, dam la soci€t€ noble tarque des X E et Xm sikles, des points tournants dam L'existence d'un individu ; cf, il ce props D. Desclais BERKVAM, E n f i e et la maternitre' k la litt&aeturejian~ake des XIP et XIIF sh?cies, Paris: Champion, 198 1, p.59.
9. Ct R METZ, a L'enfant dans le h i t canonique rn6diCval. Orientations de recherche I, dam L 'enfanr, 11: Europe midiivaIe eet modeme, (Recueils de la socittt Jean Bodin pow L'histoirc comparative des institutions, XXXVI) Bruxelles: hl. de la Librairie EncyclopCdique, 1976, p. 18.11 fallait avoir au minimum sept ans pour recevou la tonsure eccldsiastique, mais 1'6ge de la puberte &ait nkessaire pour recevou des benefices doubles Wnefices avec charge d'hes ou charges administratives) (R METZ, L'enfmt.. W, dam L 'enfan!' 1976, p.40 et p.45). Lorsque, h partir du XIIe sikle, I'obiation nc k t plus irr6vocable, ce fht 1'8ge de quatorze am accomplis que L'enfant dcvait ou non dkider de rester moine ct, dans L'affiative, faisait sa profession (ibid, p.58). La confirmation prenait place soit avec Ie bapthe, soit rage de dowe am, sait ap* sept ans (ibiu!, p.60-61). Ce ne f i t qu'd partit du MI' siecle que fht exigt5 Page de sept ans pour recevoir la communion, et meme parfois, celui de douze ou quatorze ans (ibriL, p.61-63) ; un phenornhe similaire se note pour la confession ([bid, p.64-65). Pour tCrnoigner en justice lors d'une cause civile, 1'6ge de quatone ans (douze ans pour les filles) etait exigd, de vingt ans pour les causes criminelles (ibid, p.78-79). La promesse
individu semble tenk de l'histoin de la longue En effet, dans beaucoup de soci6t6s
traditionnelles, chez les Grecsl1 et les Romakd2, dam le monde musulman m6di6vd3 et
dam L'Europe de 1'Ancim Rtgimel', les premih de la vie s'tcoulaient
principalement dans la wmpagnie des femmes1*. Ainsi, qu'il fi3t gaqon ou fille, le petit
de mariage puvait sc tirin partir de l'& dt scp aus, mais L'@e de pubat6 (12 pour les f i l l s et 14 pour les gawns) &it n k c d r e pour le mariagc propcement dit (ibriL, p.28)- Lcs rntmcs limites (originaim du h i t romain en ce qui a trait la pubat&) existaient aussi dam I t dm& byzantin (cf. H' ANTONIADISBIBICOU, u Quelques notes sur l'enfant de la moycnne @xpt byzaattine m, dans E$mt et suci&&, no M i a 1 des ADH, 1973, p.78 et E. PATLAGEAN, L'enfant et son avcnir dam la Fdmille byzantine *, ibid, p.8687).
lo. Approximativement I t3 mCmcs @s sement de bmes majeures & J. Piaget pur d m le diveloppement dc I'enfhnt, La pew& abstrar-te commcncerait aux alentours do 7-8 am, tan& que l'enfance s'acheverait vers 16 ans, avec Sent& dans lc monde ad& (cf, J. PIAGET et B- INHELDm La Psychologie de l 'enfit, (Que Skzirge ?, 369) Paris: PUF, 1973 (1966)).
'I. R GARLAND dome six ans cornme ilge limite pour h vie dam le gunaikeiun pour les filles comme pour les gaqous (Ttw Greek Wq. .., 1990, p. 134)- Maria ARCANJA GOMESFERNANDES parle de son c6t6 de sept ans, %ge en-dessous duquef l'enht spartiate, gaqon ou fille, m * t avec sa mtre tandis que le @re etait quasi absent puisqu'il rbidait dam les baraquements de l'ktat (a Youth, Education and Gender "Equityn in Antiquity - The Spartan case m, dam Proceedings of the Meeting of the Iniemationczf S t d i n g Conference fw the History of E;ducotion, 18'" Internationid Congress of Historical Sciences, M o n W , Sarnedi 2 septembre 1995, p.2).
l2. D. SLUSANSKI, . Le vocabulaim., W, op.citi, 1974, p362-63. ICR BRADLEY ddmontre que, dam les farnitles romaines Ws aisdes, des esdaves males pouvaient aussi 8tre assign& ih la garde des petits enfants (Discovering the Roman Family. Studies in Roman Social Hhtory, New Yo& Odord Library Press, 199 1, p.49).
13. La Ioi rnusulmane allait jusqu'& laisset la garde de I'enfant ii la m&e ou aux femmes de la branche rnaternelle avant qu'il n'ait atteint I'iige de sept ans pour un gaqon, neuf ans pour une fille (A. GIL'ADI, I. Concepts of Childhood and Attitudes towards Children in Medieval Islam W, Journai of the Economic and Social Hktory ofthe Orient, 32 (1 989): IS 1).
14. F. LEBRUN, = La place de l'enfmt dam la sociM fian~aise depuis le XW sitclc 4 dam De'natalite'- t'nnte'rioritkfian~abe (I8OO-lgf 4), Communicationr, 44 (1986): 252-53, E. WIRTH MARWICK, Nature versus Nurture : Patterns and Trends in Seventeenth-Century French Child-Rearing v, dam The Hbtory of Childhood, dd. L. deMause, New Yo* Psychohistory Press, 1974, p260 et M. SEGALEN, Life-Course Patterns and Peasant Culture in France : A Critical Assessment a, Journal of Family Hktory, 12 (1993): 215. La description du cycle de vie que M. SegaIen donne dans cet article vaut pour la France paysanne du XIX' sikle et les sikles ant€ricurs.
Is. Pour la pCriode mddi~vale, voir eatre autm D. LETT, La mtre a l'enfhnt au Moyen Age m, L 'Hizoire, 152 (fev- 1992): 14 et P. GAFFNEY, = The Ages ofMan in Old French Verse Epic and Romance v, Modern Language Review, 85 (1990): 575. N. ORME reptend cc lieu comrnun au profit de I'aristocratie anglak du bas Moyen Age, ma* il le nuance en monP;nn cp'il exiaoit de nombceuses exceptions d'cnfants pris en charge par un maitre bien avant l ' e e de sept ans (From Chitdhodto ChivuIty - The Education of the English Kings and Arktucracy 10664530, LondonMew Yo* Mcthucn, 1984, p.7, p.18 ct p.14445). Toujours dam I' Angletene des XIV' et XV' sikles, mais en ce qui conccrne Ie monde paysan, B.A. HANAWALT remarque que les petits gaqons n'attendaient pas l'%ge de raison pour trottiner d e m h leurs pCres ; mais elle souligne que c'est uniquement ih partir de 6-8 ans que des tiiches sp&it?ques Ctaient impost& aux e n h t s (The I"= Thar Bound - Pearant Families in Medikvaf England, New York/Oxford: M o r d Univ. Ress, 1986, p. 157-58 pour 6 ans, p- 168 pour 7 ans et p. I83 pour 8 am). D, HERLIHY a C. KLAPISCH-mER montrent que, au moins dans le cas de FIorence, le rnonde des fernmes des premieres annCes de l'enfmce se dumai t rarement & la
enfant Entficiait du meme traitemeat ; il est significatifal cet &gad que le terme latin le plus
couramment employ€ f l'm mCditvale pour dbigner i'enfhnt entre dro a sept am ne
connait qu'un seul genre, Ie masuh, avec infolts. Il ne faut pas en conclure pour autant qye
ces mikes parents ne fegardaient pas dtjh diffhnment Ierns gaqonnets et lem fillem,
et cette diffdrenciation pouvait influer SIX certaines modalit& des soins &sends a w uns et
a m autresi6.
Toujours selon les histonens, pass& cette premih enfiance, ddbutaient
I'enseignementl' et la participation a w activies des adultes. ~ e s dBCrences de sexe et de
aatut social commenpient alors i jouer un r6le. La petite me, la puella, etait mise a
contribution pour les travaux fdminins ; le fils, le puer, quittait les jupes des femmes et
apprenait, qui Ie maniement des armes, I'dquitation et la chase, qui le b-a-ba des travaux
m&re, compte tenu de la grande propension faire usage de noumces ; mais c'ttait bien vers 6-7 ans que d6butait la socialisation de L'enfant avec le ddbut des btudes (k Tmcans er lew fmifle - Uire 6'tude du catasto Jorentin & 1427, Paris: &itions de I'E-, 1978, p.555-58, p.563 et p.601). U.T. HOLMES souligne que ces premikres ann- sont des anndes de compltte liberte et de jeux (a Medieval Children w, Journal ofsocial Studies, 2 (1968-69): 165)-
16. Cf., pour la pCriode medievale, tous Ies diffbrents travaux sur I'infanticide qui parlent avant tout de la mise A mort des petites filles ; pour une mise au point ecente sur ce sujet par un auteur relativement partial (cornme bien d'autres d'ailleurs oeuvrant sw ce theme), L. MILIS, rn Children and Youth, The Medieval Viewpoint w, Paedagogica Historica, =I (1993): 21-24, Cf. aussi le silence assez g&ndralist! des quelques p h s du Moyen Age ayant pris la plume nu I'existence de lews petites filles @. HERLMY et C. KLAPISCH- ZUBER, L-es Toscam, 1978, p330 et C. KLAPISCH, a L'enfance en Toscane au dCbut du X V sikcle w, dam Enfant er soci&%, no spkial des ADH, 1973, p. 108- 1 1 ct p. 1 14-16 sur l'infanticidc, I'abandon, I'oubli dam les livres de Fdmille, la mise en nourrice plus Iongue et le ddpart plus pdcocc dc la maison familiale pour les filles). Les petites filles Ctaient peutdtre allaitdes moins longtemps que Ics g q o n s (cf, Mary Martin McLAUGHLIN, a Sunrivors and Surrogates : Children and k n t s fiom the Ninth to the Thirteenth Century W,
dans History of Chi.ldhood, 1974, p. 1 16 ; sur I' infanticide dcs fiIles plutdt que des gaqons, cf. ibid, p- 120). On amenait moins souvent ies petites ftlles que Ies petits gaqons en Nlerinagc dam I'espoir d'obtcnir leur guerison (PPA. SIGAL, L 'Homme a le miracle ckmr la France rnddibrrle W-XiF si&fe), Paris: td. du Ce* 1985, p261). A cette demihc remarque, il p o d &re r&qu6 que l a premi&es sont habituellement moins fragiles que les seconds et put- moins p o w vets les jeux dangeurcux ; mais cet argument est discutable puisque I'on a pu observer, dam le L o n h de la fin du Moyen Age, un taux de mortalit6 des fillettes plus dlevd que celui des gaqons (cf. B. HANAWALT, Growing up.,., 1993, p58-59 ; cctte auteure donne aussi en note d'intbressantes pistes anthropologiques). MErne P. RIC& et D. ALEXANDREBIDON, qui autrement dressent une image idyllique de Penfancc au Moyen Age (voir plus loin, chapitre In), doivent a d m a que ceIIe-ci s'applique au gaqon et non d la petite Rlle (Lee@nce a Mwen Age, Paris: SeuiVBiblioth&que Nationale de France, 1994, p.47).
". Selon Villani, dam sa celebre description c h i m de Florence, la majorit6 des enfants entre six et treize ans alIaient A I'dcole (cf, C. KLAPISCH, . L'entance ... W, dam Enfant et socikths, ADH 1973, p. 1 14)- I1 s'agit bien entendu d'une situation tout fait exceptionnelle pour le Moyen Age.
agricoles, qui Ies psaumes et les latnsu. Ces divers enseignements se dhulaient parfois en
dehors de la demeure fada le , par suite du "fosterage" ou de roblation.
Aux dentours de la pubertt, entre I'iige de 12 ans et le de%ut de la ~ingtaine~~, la
jeune fille &it marib. EUe passait donc de la domination des parents (ou des ou
d'une abbesse) B celle du ma& sans avou jarnais Maiment goate B la #tiode de semi-
independance que constitue la j e u n d . Or, le vocabulaire latin mddi6val ne c o n d t pas
d'iquivalent ferninin a iuuenis. Iimencula et adolescentula sont d'un emploi peu &pandu2'.
Le substantlfde loin le plus courant estpuellu, dont le contenu s 6 m d q u e est extremement
etendu : il designe aussi bien la mette, la jeune We, objet et ddclencheur par excellence du
desk masculin au Moyen Age=, ou encore la moniale.
In. Pour une bonne description de la diffdrence des activitds entre filles et gaqons 8 la campagne, cf BA. HANAWALT, The 7k.s Zhat Bound, 1986, p-158-59 ; pour la ville, Id, Growing up.. , 1993, p .75~ .
19, D. HERLIHY, M i d Ho~(sehol&* Cambridge (maytondon: Harvard University l?resst 1985, p-103- 07. Sur I'ige de la pubertC pour les femmes au Moyen Age, cf. I.B. POST, Ages at Menarche and Menopause : Some Medieval Authorities m, Popfation Studies, 25 (1971): 83-87. Cet auteur ddmontre i L'aide des trait& mt5dicaw de L'Cpoque que les premibes dgles survenaient awt mCmes ages qu'aujourd'hui, soit vers 12-14 ans.
Cf. U.T. HOLMES, Medieval Children m, J o m l ofSucialHistory, 2 (196849): 165. B. HANAWALT remarque que, h en croire Is trait& mddicaux de la fm du Moyen Age, la femme ne subissait pas un changement d'humeur h la puberte, la difference du jeune homme (Growing up..-, 1993, p.111). Les jeunes filles jouissaient probablement d'une plus grande Liberte dam le monde agricole et se mariaient h un 5ge assez proche de celui de leur mar& 8 savoir dans la vingtaine. Mais, d&s 13 ans approxirnativement, Ieurs occupations quotidie~es dtaient sirnilah A celles de leun m h , P la diffdrence des jeunes gaqons dont les activitb continuaient differer dc celles dc leur p&rc jusqu'au scuil des 20 ans (cf. BA. HANAWALT, me Ties That Bound, 1986, p. 160-6 1 et p. 187-204). Chez les Toscans, la jeune ftlle n'etait plus libre de sortir 8 son @ de la maison familide i partir de l'5ge de 13 am, alors que, P Soppod, ii partir du mCme Qe, le jeune garqon etait encourage i Wquenter les jeunes dc sa gdndration @. HERLIHY et C. KLAPISCH-ZUBER, Les Toscam, 1978, p.567 et 584).
". Cf P. SIGAL, te vocabulaire de l'enfance et de t'adolescence dans les recueils de miracles latins des XIe et XIte sikles rn (dans L 'enfant au Moyen ige: litthrature et civil&ution, Aix-en-Provence/Park Publ. du CUERMA/Champion, 1980, p.150-51) et I. SWANSON, Childhood and Childrearing in ad status Sermons by Later Thirteenth Century Friars m, JMH, 16 (1990): p.322.
". On trouvera un exemple entre mille de pueIfae tentatrices dans la Vita de saint Benoit par Gdgoirt Le Grand (Dialogues, tII, tcxte critique ct notes A. de VogUC, aad P. Antin, (Soucces cldtiennes, 260) Par*: Ed du Cerf, 1979, II194,p.163). Dans le mOme ordre d ' i d h (selon lequcl le corps de la pueffa correspond au summum de la beaut& fdminine), me recluse romaine dont la poitrine et les seins grouillaient de vers gudrit miraculeusement ap& une visite de saint Dominique et il lui repoussa des seins de puelfa de douze ans ("sicuti p~~ef le duodecirn annorum" ; cf. M.-H. VlCAIRE Saint Dominique de Caleruega d'upn% les documents du XIIP siticie, Paris: ~ d . du Cerf. 1955, p292 et A. WALi!, a Die "Miracufa Beati Dominici" der Schwester Cacilia- Einleitung und Text a, dans Miscellanea Pio Paschini - Swdi di Storia Eccfesi'a~tica, vol-1,
Le jeune g q o n vers les rnemes ages, mais audelh de quatorze-quinze am et non
douze am, etait d&gne par deux substantifs principaux, adolescens et iuuenb, distincts du
p e r utilis? pour les am& pdct?dentes. Th6oriquement, il avait atteint L'be de la ~najoritt?~.
Dans la vie, il Ctait alors soit adoube et w a i t dans la cohorte arm& d'un seigneur -
(Lateranum, XIVl1-4) Roma: Facultas Theologica Pontificii Athenaei Lateraneasi, 1948, p.323). Sur le fait que la hommes du Moyen Age appeiaient les =ins tr& et piacts W&S hhauts w, ef. J. BERLIOZ, ~ r o s et la Vierge w, L 'Hktoire, 1 SO (Sept, 1994): 44).
Comme il a ett ddj& mentionnt, le grec poss4de un vocabulaire beaucoup plus riche pour denommer la jeune femme selon les files qu'clk occupe, I1 existe un premier temc pour dbigner la jeune fille lorsqu'elle est en 5ge d'etre marib, parthenos, un autre pour la jeune Cpoust5e qui n'a pas encore eu d'enfant, numphe?, et un demier qui dbigne la rntre, qu'elle ait un enfant ou plus et quel que soit son ige (jusqu'i la mdnopause ou meme au-delii), la gun6 (R. GARLAND, 7%e Greek Way..., 1990, p.200).
*. Sur ces different. sens depuelfa, cC OxfordLatin Dictionnory, Word: Clarendon Press, 1968, p.15 14, A. BLAISE, Dictionnaire katin-fiqaik dks auteurs chre'tiem, Turnhout: Brepols, 1954, p.683, et J. NIERMEYER, Mediae Lutinitutk Lexicon Mhs, Leiden: EJ. BriU, 1976, p.870- Pour un exemple de pueIh comme rnoniale, cf. Regufa Virgimm Cesatit Soncti Caesmii Arefatensis Opera Omnia, 6d. Germain Morin, Maredsous, LII, 1942, Prol., p.102. Autre exemple de L'usage dtendu de ce teme : il peut servir ii dbigner une femme sainte ayant ddpass6 les limites chronologiques habituellement assocides A ce substantic Ainsi FdKcitb et Pe-e, bien qu'elles firsscnt toutes dew dm, sont appel6cs puellae dans le dcit final de leur martyre (The M i d o m of Sclinl~ Perpetua and Fdicitas, dans dans Acts of Chrrjiim Miwtyrs, td. et trad. H. Musurillo, Oxford: Clarendon PressT 1972, radl ,p. 128).
". Tel est en effet I'Bge le plus m e 1 de majorit6, tout du moins avant les demiea siecles du Moyen Age. La question est en &alitd tem'btement complexe ct la rdponse varie selon Ie temps, I'espace et la situation considCrCs. Voici quelques rCfdrences P titre d'exemples. A Rome, jwque 200 av. J.-C., h pukrtt confCrait la plenitude de la capacitt! juridiquc, mais il ne faut pas p e r k dc w e que, dans la pratique, la puissance patemelle retardait de beaucoup le debut de la vtritable indtpendance (cf. LP. NJ~WDAU, La j-se alms la fitt&rature et fes illstitutions de la Rome r&ubficaine, Paris.. Lcs Belles Lettres, 1979, p . 1 0 5 ~ ~ . et in&, chapitre IV). R MET2 remarque que, dam le h i t de rEglise, avec la pubertt, k mineur voyait ses incapacitds juridiques grandemcnt diminuet ; quelques cares catdgories d'actes Iui fCStiil-ent mterdits. 1,
(a L'enfan t... ., dam L 'enfint, 1976, p.67). Dans les diffdnnts droits batbares, q u a t o m - q u k ans conespondait habituellement i 1'8ge de la majoritt (ct P. RICE&, Cducation et culture &m I 'Occident burbare W-MIP sikfes, Park a. du Seuil, 1962 (3 %d), ~27748). Dam I' Angletern des Xnr S X V 'sikles, la question ktait beaucoup plus complexe : ii park de 12 ans, le jeune devenait responsable de ses actes, A 14, il lui fallait maintenant payer lapoN f u r et il avait droit de se marier, i 16, iI etait eligible pour &re incorpord dans l'arrnde du roi, tandis qu'8 21, il pouvait hdriter (cf. B. KANAWALT, Growing up ..., 1993, p. 1 12 et p.202).
sowent son oncle matemel= -, soit plack comme apprenti ou gaqon de ferme26, soit Mni
et devenait moine B part e n t i k Il se trowait donc enwre sous la coupe d'un homme m&,
qu9iI s'agisse de son ptre dont il attendait I'hdritage, de son seigneur, de son maitre ou des
seniores d'une communaut6 monastique ; mais il beneficiait paralltlement, pendant cette
meme periode, d'une indbiable m q e de manoeuvre : gains il la guerre, possibilite de
changer de maitre, liberte de mowement, activi* dans les abbayes de jeunesse ou leurs
equivalents, etc. Pour quelques-us, cet iige pouvait aussi correspondre, au moins en ses
debuts ou par bclipses, une 6poque d'exrance, de quete (d'aventures guem&es ou de
savoi.), theme cher aux auteurs en langue vemaculake? Si un jeune occupd de la sorte &it
alors, pour un laps de temps IimitC, dtlest6 de toute autoritb, il se trouvait bgdement en
marge de la sociW dont il provenait et qu'il devait r6integrer tbt ou tard2=.
=, G. DUBY donne la deuxitme moitik de la dimine (15-1 7-19 am) comme la pCriode limite pour la fm de I'enfance et I'entde en jeunesse w (a Les jeunes l dans la soci&k aristocratique dam la France du Nord- Ouest au XIIe sitck w, dans Honmes et smctures du Moyen Age - Recueif dncrrtcles, Paris/ La Haye: hi. de I'EHESS, 1973, p.213). Les nkdtats de Duby furent corrobor& par I'Ctude des romans des Xne-me s i k k s (cf. D. Desclais BERKVAM, Enfince et maternitk, L981, p.65-66). D. BARTI~~LEMY donne en revanche un intervalle un peu supdrieur pour I'adoubement, 16-22 ans (m Note sur I'adoubernent .,.a, dam Les dges de la vie, 1992, p.113). Sur l'extdme importance de I'ige de 15 ans dans les &its dpiques et romans du XII' s- en ancien fhnpis, cf. aussi P, GAFFNEY, The Ages of Man ... w, op.cit., 1990, pS73 et 575. Pour ce qui est de ['ige de la profession monastiquc, j'en parle longuement aux chapitres 11 et UI.
26. D. ALEXANDRE-BIDON donne 8-12 ans comme &ge &insertion professionnelle pour les filles et les garcons du monde agricole (a Grandeur et Renaissance du sentiment de I'enfance au Moyen Age m, dam &ucations mPdi&ules : L'eniollce, I'iok, l)Cgfbe en Occident, (YTW siPcIes), du. J. Verger, (Histoire de 118ducation, SO) Paris: S e ~ c e dlHistoire de l~ducation de IWRP, 1991, p.61) mak B.A. HANAWALT montre bien qu'il existait me nowelle &p, vers rilgc de 12-13 ans, dans ks -ens des jeunes des dew sexes vivant la campagne (7Re 7Xes Thclt Bound, 1986, p.160-61)- Les pqons ne pas toujours servir en dehors, mais leur position et travaux dans la demeure familiale ne diff'eraient gu&e de ceux de leurs cornparses plack chez des &rangers (ibid., p.164-67) ; cette meme auteure affimc qu'en ville (Londrcs), 14 ans repeenhit I'ee habitue1 &en- en apprentissage des m a n s , tandis que les filles commen@ent un peu plus jeunes (B. HANAWALT, Growing up. .., 1993, p.113). F. MICHAUD-WAVILLE (a Contrats d'apprentissage en Orltanair : les enfmts au travail (1380-1450) a, dans L'entnt au Mown jge, p.61-71) demontre que 18,s % des contrats d'apprentissage concernaient des enfhts de moins de 13 ans ct 40,75 % des enfants entre 13 et 15 ans r&olus. Pour un survol sur Ies @nodes de formation des fils de paysans, artisans et nobles, cf. P. CHARBONNIER, a L'entrk dam la vie au XV' sikle d'aprts les lettres de dmission m, dans Les enfries dans lo vie - initiations et apprenthuges, XIe Con@ de la Sacittt des historiens mtdiCvistes de 1'Enseignement suptrieur public, Nancy 198 1, Nancy: Presses universitaires de Nancy, 1982, p.71-103.
". P. GAFFNEY, = The Ages of Man... m, op-cir., 1990, p.575-76 ; H. FICHTENAU, Living in the Tenth Century - Mentaities andSociaI Orders, trad. P. Geary, Chicago et London: Chicago Univ. Press, 1991 (dd. allemande de 1984), p. 1 12-13 ; G. DUBY, = Les = jeunes R.. a, op.ci~, 1973, p.2 13-25.
x. Dans Ie rnonde fictif de la littdrature, Ie retour Q I'ordre n'est bien entendu pas obligatoire : le jeune homme peut se faire aimer d'une f6e et ne plus devoir jarnais reintegrer le monde des hommes. Sur ce th&me
Il demeurait un a jeune jusqu'8 ce qu'il contr6lat en pmpre une terre (comme
seigneur ou paysan) ou m e khoppe, plus une femme et sa proghiture, car une des
caract6ristiques de celui qui est d'be mQ est justement le fitit de posdder et d'avoir des
de!per~dants~~. C'est donc A un &ge trts Hci l e B d6limiter avec pt6cisiodO que l'homme
quittait le groupe des a jeunes pour entrer dans le troisitmc b e : l a deux bornes extdmes
seraieht les dentours de la quipzaine, d'une part, et la q-taine, d'autre part, avec une
pointe vers la fin de la vingtaine - dipons respectivement quarante-neuf et vingt-huit am,
nous venom plus loin pourquoi ces chok3'. Ainsi, en admettant les iiges-chis propos6s ci-
dam les litt6ratures celtiques, cf, C. DROEGE, a Le pays de la jeunesse dans les litt&atures celtiques m, dam Les 6ge.s de la vie, 1992, p.23-36, suxtout p.25-32,
29. La mSme id& se retmuve par cxcmple chez D, Desclais BERKVAM (a ... dans la conscience mddidvale, il semble bien que seule cette autoritC sm soi-meme et plus encore sur les autres confete l'individu sa qualitd d'aduIte. m, Enfance et maternit& 1981, p.80) , I. ROSSIAUD (a Le maciage ne met pas fin la jeunesse ; ce qui sembk en constituer le tenne c'est, Mge venant, le plein dtablissement qui fait de I'heritier le maitre dam 1e group h i l i a l comme I'khoppe ou sw ies t e r n m, FrafemMs de jeunesse et niveaux de culture dam les villes du Sud-Est it la fm du Moyen Age m, Cahim Chinoire, d l - 2 (1976): 68) et B. HANAWALT (qui indique que certains individus devenaient des hommes m b de seconde classe lorsqu'ik demeuraient des semi- ddpendants au-dela de la jeunesse, cf, Growr'ig up. .., 1993, p.217)-
Sur I'ige des hommes au mariage, les d o n n h sont rares avant Ie XI1 ' siecle. Jane K. BEITSCHER Cvoque les conflits de generation, dans le Limousin du Xl' sikle, entre des p&es tr& fg& et toujours tout- puissants, et des fils dej8 mhs mais encore en €tat de ddpendance (( "As the twig is bent.." : children and their patents in an aristocratic society m, Journal of Medieval H b t o ~ , 2 (1976): 187). Pour les chevaliers de la France du Nord-Ouest au MIe sitcle, G. DUBY dome 45 ans comme exemple e&me d'6pousailles tardives et expIique pourquoi des situations semblables pouvaient suwenir (a Les a jeunes m... m, op-cit-, 1973, p.214). D. HERLIHY ne donne des informations que pour la pdriode apds le Xae sitcle. I1 montre que les gges au mariage pour l'homme vari&ent beaucoup, selon Ics Cpoqucs et Ies liewc (le jcune ram*€ avait en- vingt et quarante et quelques am&), mais il se trouvait, pcesque toujours, une nette difftrence d'age cntre lui et sa femme (Medieval Householdr, 1985, p.107-I I). C. KLAPISCH a f f i e que le jeune Florentin ne devenait v6ritablement un homme milr qu'avec l'inddpendance fmanci&re, ce qui pouvait avoir lieu trh tard, surtout s'il devait, pour cela, attendre la mort de son @re ; ellc souligne quc, sur ce point, la situation du fils de seigneur et celle du fils de paysan 4taient identiques (cf. a L'enhce en T'e au d&ut du XV' sikle m, dam Enfmt et s d t & no special des ADH, 1973, p.102 ; cf. aussi les remarques de la mtme auteun dam Histoire de Lpopufationfianqarje, vol. I: De. o r i g i , d la Renahance, par I. Duptlquier, I.-N. Biraben, R Gtienne, C. et L. Pietri, H, Bautier, H. Dubois, A. Higounet-Nadal et C, Klapisch-Zukr, Paris: PUF, 1988, p.475).
". Vers la fm de la vingtaine, un pourcentage Clev6 de lacs, nobles, paysans ou marchands, devaient enfm possCder une source de revenus propre (que le @re soit dCcCdd ou qu'il ait "installCW son fils), plus femme et enfan@). A partir de la litthture en langue vulgairc composde en France a m XIIe et XIIF siCcles, Doris Desclais BERKVAM a not6 que s I 'mhce cesse manifestcment un moment dome, mais il semble que l 'ee Iimite se situe aux environs de trente am, don que les enfances d'un hdms peuvent aussi prendre fin ven quatorze ans. Le mariage, la position sociale, I'adoubement, I'Ctablissement dans son heritage apparaissent souvent comme des mMttres de la fm d'une cnfance, mais pas systematiquernent [...I (Enfince et /a maternitt5, 198 1, p.8-59). Je traite en dCtail de la place ambigue de I'adolescence comme partie inttgrante de I'enfance ou de la jeunesse dam Ie chapitre IV.
dessus, tan& que quatoneqyhze ans rrprCsentait pour les gaqons L'iige 16gd pour devenir
adulte, vingt-huit am (fin de la vingtaine) symbolisait en revanche l'iige moyen oh la
majoritti Centre e m 6taimt devenus des hommes m b dam les f5ts et non plus seulement
en t b r i e , alors que quarante-neufans cottespondait B l'Hge ultime de cette transformation.
- Par la suite, lorsqu'il considhit que la fin de sa vie appmhait, il arrivait, a
l'occasion, que l'homrne medieval d6ciat de quina la vie active, soit en entrant dans un
monastike ou un Mpital, soit en se retirant simplement dans une partie de sa demeure ; il
laissait alors le contrde de ses possessions A son successeur ou a l'institution ~hoisie)~.
Shulamith Shahar, qui a ktudi6 la d6finition de la vieillesse pour la socidt6 mt!ditvaIe, a
remarque que, si la retraite &it tan phtnomhe relativement sporadique, certains iiges lui
Ctaient pourtant associds plus fitiquemment que d'autres : 60 ans etait davantage la nonne
dam le cas d'activitis manwlles (service militaim pour un fief, tour de garde, etc.), tandis
que 70 ans &it plutat mentiom6 pour les activitks non physiques, telles les tiicches
administratrices publiques, la fonction de jd, et$).
Pour ce qui est de la femme, me traosformation radide de son mode de vie pouvait
avoir lieu si elle devenait veuve et trop vieille pour se remarier, ce qui correspondait
gt5niralement B la fm de la trentaine-debut de la quarantaine ou au-delaM. Pour la premiere
32. Le Wme de la retraitc dam le monde m&di&al sera aborde au chapitre V- S. SHAHAR, a Who were Old in the Middle Ages ? W, Social H&tory of Medecine, 6 (1993): 329-39.
". Voir par exemple il ce sujet, D. HERLMY et C. KLAPISCH-ZUBER, L a Tarcam, 1978, p.610 et (pour la longue dude) D.I. KERTZER et C. BRETELL, Advances in Italian and Iberian Family History m, dans Family Hbtory at the C r a s s ~ d . A Journal of Family History Re&, €d. T. Hareven et A. Plakans, Princeton (NJ): Princeton Univ, Press, f 987, pJ05. L'Qe n'etait pas le seul facteur ddcidant des possbilitds de remadage des vcuves au Moyen Age. La situation demographique jouait tgalernent un grand r61e : lorsque les hommes se faisaient cares, cornme ce fbt le cas la suite de la Grande Pestc, les veuves @&s n'avaimt guere de succes (cf. par exempie, BA. HANAWALT, lke Ties Th42 Bound, 1986, p224). Les autres facteurs decisifs etaient l'attitude plus nkgative de rEglise face au remariage d a temmcs (P. FEDELE, Vedovanza et seconde noae m, dans Ii matrimonio neUa societii oltomedi~~~ale, LII, Spoleto: Rcsso la Sede del Centro, 1977, p.8 19- 27). le nombre et t'&e des enfants encore & charge (A. COURlEMANCKE, La richesse des femmes -Potrimoines et gestion ri Manosque au D si6cle, Montdalhrh: BelIarminNrin, 1993, p265-9 1 ), et les clauses particuliiires du testament de 1'~powc dk&E. Ce demier specifiait en effet souvent qu'il ne Ieguait une Iarge part de son heritage A sa femme qu'A la condition expresse que celle-ci ne se remarie pas (cf. par exem p le M.-Th. LORCN* Vbre et mourir en Lyonnais d lafin du Moyen Jge, Paris: ECI. du CNRS, 1 98 1, p.65-73).
fois, elle devenait libre de la M e des hommd5 ; mais cette libert6 pouvait s'accompagner
d'une grande paumt6. Ckbhes, mihe parmi les plus ais6es, choisissaie~~t alors de se retinr
du monde en entrant au rnomst&P. Ces formes part icul ih d'"entrCes en vieilksse" (ici
et seulement ici, je pmds vieillesse dans le sens modeme de retrait de la vie active, B savoir,
pour I'Cposue mM6vale, travaillet pout I'homme et, avant tout, etre *use pour la femme)
demeuraient rares dam le cas de l'homme tan& qu'eIles dtaient trts Wuentes dims celui
de la femme.
11 est significatifa cet 6gard que, s'il n'existait pas de terme distinct pour designer la
jeune femme et qu'il fallait directement passer de pueIZa B mulier ou matrona, Ie latin
&didval &it en revanche relativement f h d pour signaler m e vieille femme, avec les
deux substantifs pjoratifs amcs et uetula. Ces deux texmes n'dtaient pas sp5cialement utilids
pour qualifier la veuve, qui possddait son appellation propre, uidua, dtipourvue de sous-
entendu d'gge (5 la difference de l'usage de veuve dam notre soci6t6) ; ils etaient pourtant
employ& de pr6ftrence dam le cas de femmes fig&, pawres et isolees, ou mdprisdes. Une
vieille sainte, par exemple, n'6tait jamais trait& d'anus ni de uetuld7, pas davantage (i ma
connaissance) l'dpow 8gde d'un seigneur ; en revanche, tels Went les termes choisis pour
designer, soit une personne inconnue de l'auteur - qu'il s'agisse d'une pauvresse croisee
sur la route ou d'une malade implorant la gu6rison ou la charit6 -, soit un peaonnage
ferninin peu ap~r ic i@~.
Ceci n'dtait pas toujours m i car elks pouvaient se retrouver sous la domination paternelle ou celle de la farnille du ddfunt ; cf. par exemple D. Desclais BERKVAM, Enfance et maternit&, 198 1, p.60.
'S Cf. M. PARISSE, Des veuves au monasttre W, dans Vorwr et veuvages dans Ie k t Mwen Age, ed. M. Parisse, Paris: Picard, 1993, ~255-74.
j'. Une ttude doit absolument Ctre entreprise nu l'idw physique fdminin des clercs w la sainte femme, aussi bien dam leurs discours que dans l'art chretien, est pnsque toujours repr&entke comme une belle "jeunette", meme lorsqu'elIe atteignit des ages plus que mars, comme ce fit le cas de la Vierge, au moment de sa Dormition, de Marie l'&ptiennc en son dben ou de Marie-Madeleine en hvence . Le portrait d'um sainte, qu'il soit sculpt6, peint ou prCscnt& par &it, faissc rarement place I'tvocation de la vieillesse (et ceci reste m i au moins jusqu'au XIX sikle) : lbabeth et Aane sont des exceptions mais c a deux femmes sont avant tout des faire-valoir pour leurs enfants, Jean-Baptiste et Marie. Ce parti-pris de la sainte femme jeune doit Etre opposC i I'image du saint h o m e : je d6montrerai dam le IVe chapitre que les cheveux blancs constituaient un ornement recherche de la saintetb masculine, La tyrannie de l'image du mannequin trouve peut-9tre ses sources en des oeuvres plac&i jusqu'alon au-dessus de tout soupqon ...
". Les divenes remarques qui prgctdent sur le vocabulaire fgrninin des ages pour I'dpoque rn&Mvale se compnnnent mieux en regard de la situation romaine, telk qu'elle est prdsentee par LP. &MUDAU :
Il existait un 6qyivalent masculin A ces dew substantifis d6signant la vieille femme,
le terme uel~lw, mais son emploi etait limit& Les hommes du Moyen Age utilisaient
dgalement le terme senex, mais aussi ii I'occasion gran&et(tl~, popout dCnommer un homme
Sg6 ou un vieillard. Il est important de nota que ces deux substantifs n'avaient pas de
coloration mdprisante, au contraire : Ie premier, tout ecialement, dtait fiequemment
appliqut5 I un saint pour le ddcrire dam son grand @.
2. Divergences en- h pratique et le discours ?
Voici donc, esquissk dam les grandes lignes, le cycle de vie masculin au Moyen
Age : l'enfaace, divisee entre la premiere enfance jusqu'a l'lge de 7 a m environ et la
seconde jusque vers 14/15 ans, la jeuwsse, dont la limite sup6rieure est difficile P estimer,
puis l'lge r n b qui, dam la vie de la majorit6 des hommes, se poursuit sans rdelle coupure
jusquY8 la mort. Les liens avec le schema tripartite anthropologique pn5cddemment Cnonce
(dependance, semid6pendance et inddpendance) sont mdestes.
En revanche, lorsque 1,011 compare le cycle de vie "reel", tel qu'il vient d'etre
prksentt, au cycle de vie "theoriquel', determine par les auteurs du Moyen Age, les
divergences paraissent B premikre w e i.&conciliables. Celui-ci, sous sa forme la plus
d6taill6ey se presente cornme suit : l'infantia (0-7 am), la pueritiu (7-14/15 ans),
l'adolescentia ( MI1 5-28 am), la iziuentus (28-49 am), la senectw (49-70 ans), puis le
I.,.] seuls les hommes sont definis par leur b e . Les femmes, d&ign&s par ieur condition physique jusqu'h leur mariage (uirgo), le sont ensuite par leur Ctat civil (uxor) et leu; matemite (matronu) ; seule leur vieillesse est signaKe par a m Pour daigner la petite fille, il a hllu recourir au diminutif puello et I'habitude d'utiliser pour la jeune fille adoles~ens~ adoIescenhrlo et encore h e n & est secondaire : on a calque un lexique ii I'originc exclusivement viril. Ce qui intdtcssc la cite, c'est, pour Ies femmes, leur aptitude physique, Idgal& par le mariage, la prodation, et pour Ies hommes, l'age, qui les rend aptes il la procreation aussi et & la d6fcmc du group. De meme que le mariage et la naissance des enfants donnent A la femme une place fonctio~elle dam la famille et la cite de mCme l'ilge fu<e pour les hommes leur fonction dans la cite, et h un degd moindre, dam la famille. (Lo jmnesse,.., 1979, p.101).
C'est volontairement que je n'ai pas mentiom6 cette citation au debut de cette section, pour que le vocabulaire mCdieva1 des Bges utilist pour les femmes ne soit pas pequ cornrne une simple reiteration du vocabulaire romain.
senium jusqu'h la r n ~ & ~ . Le choix des Bges 7,14/15 et 70 am se comprend bien, compte term
de ce qui a 6t6 dit sm le cycle de vie des hommes du Moyen Age. 7 ans symbolisey
physiquement, la maitrise de la parole et le debut de la raison, cultureliement, le debut de la
formation et la fin de la prise en charge par le monde des femmes. 14/15 ans marque,
physiquement, la pubert6 et, culturellement, lapossibilitt! d'acquCtir tous les droits des
adultes, h i t s de se h e r , d'h&iterY #&re adoubt, de tboigner, etc. Entin, si l'on se place
dam la perspective d'une existence non-manueIIe, comme celle des eccl6siastiques, 70 ans
represente, physiquement, L'iige de l'idrnt5diable dklin physique et, culturellement, celui
d'un possible retrait de la vie active. Il w demeure plus dors qu'une seule, mais
fondamentaley question traiter : oh se situe l'indipendance anthropologique dans un schema
oh il n'est nullement question de matwitd mais uniquement, semblerait-il, de jeunesse et de
vieillesse, c'est-A-dire de iuuentus et de senectus ? Si eUe correspond B la iuuentus - ce qui
sous-entendrait qu'il ne faut pas traduire ce teme par jeunesse -, pourquoi s'dte-t-elle
Q 50 am puisque, dam les faits, il ne semble pas qu'il ait exist6 de coupure pour l'homme
medi6val entre la quarantaine et la cinquantaine ? Et pourquoi deux vieillesses ... ? En
revanche, si I'ige de l'indkpendance doit &re assimile h la senectus - qu'il ne faudrait donc
pas traduire par vieillesse -, pouquoi commence-t-il si tard ? Et pourquoi alors dew iiges
de la semi-dkpendance, I'adolescentia et la iuuenfus, avec cette eontiere & 28 ans ?
Ces points d'interrogation indiquent qu'une traduction littgale des vocables latins
relatifs am ages est inaddquate. Ils expliquent aussi pourquoi la majorit6 des r n ~ d i ~ v i s t e ~ ' ~ ~
19. Les dCfmitions des 8ges sont 6nurndrks dam I'Annexc C et pdsentks schematiquement dam les tableaux 1 et tI,
a. Cf. par exemple S. SHAHAR, I Who were Old in the Middle Ages ? w, Social Hktory of Medeciire, 6 (1993): 3 19 et C. DE'TTE, Kinder und Jugendliche m der AdebgesellschaA des fiiZhcn Mittelalters m, Archiv fit= Kuiturgeschichte, 76/1 (1994): 6. Plusieurs chercheurs, qui Ctudi&ent le cycle de vie au Moyen Age, pawinrent & des conclusions qui concordaient avec 1 s divisions mCdi&ales des ages et, pourtant, critiqutrent ces demi5res. Ainsi B. G-E coastate I'absence d'un age mllr entre la jeunesse et la vieillesse mais juge artificielles les divisions des ages ( E m 1&1rje et 1 *tat - @atre vim deprdlatsfiancaik ri tu$n du Mbyen Age. Paris: NRF, 1987, p.42). G. MINOIS souligne avec justesse I'irnportance du bou1eversement qui survicnt A la fin de l'enfance et l'absence d'une entrde en vieiIIesse proprement dite, mais ne retrouve pas ce schCma du cycIe de vie dam les divisions medidvales des ages (Hktoire de la vieillesse - De lBAnti'guile' ci la Renaissance, Paris: Fayard, 1987, p.18-19). C. GALWARD note, en accordavec les ddfmitions des ages (qui, A partir du XIIe siecle, donntrent habituellement des entrtes en vieillesse, non pIus vers SO ans mais vers 40, cf., entre autres, le tableau II), que la jeunesse peut se pourmiwe jusqu'g 40 ans et la vieillesse commencer
qui se sont penchds sur les d6finitions rn6di6vales du cycle de vie, ont estim6 qu'elles
n'etaient que de belles constxuctions de l'esprit, sans attache avec la Me, shpIes jeux sur
la symbolique des nombres". Ce jugement e e m e n'est cependant pas fondt.
Pour comprendre les liens existants entre la &die, telle que now, historiens,
parvenom B la di, et le discours sllr cette Me, que tenaient les hommes du Moyen Age,
il faut commencer par determiner Ies structures dgissant ce meme discom. Il n'existait pas
en effet i l'ipoque mddihale une seule et unique d&.ition ducycle de vie - un semblable
consensus ne se trouve d'ailleurs pas non plus dam notre soci6t6 -, mais iI est malgr6 tout
possible d'extraire de la multitude des dihitions qui nous sont parvenues les principes de
base qui les sous-tendaient Tel est Sobjectifde la section qui suit. Il est dgalement dcessaire
de garder en mimoire que, au m o b jusqu'au XIIe sikle, Ies auteurs de ces d6finitions
Ctaient tous des eccl~siastiques. Jamais, B ma conaaissance, les m&iiivistes qui se sont
penches nu ces questions n'ont essay6 de comprendre les iges de la vie a l'aune de
l'existence religie~se'~ ; tel sera le sujet de la demi8re section de ce chapitre, avec la
confrontation entre les definitions des iiges et les Vitae clunisiemes.
ce meme iige ; pourtant, cette auteure ddclare que de tels c6sultats tdmoignent du fait que a le langage savant et celui du quotidien ne coihcident pas (I De Grace especial - Crime, &tat et socie'te' en France ri lafin du Moyen &e, (Histoire ancienne et mCdiCvale, 24) Paris: Publications de h Sorbonne, 1991, p.368). Sa discussion des Qes est au demeurant une des plus inthssantcs qu'il m'ait dt6 domdes de lire (ibrhl, p347-82) avec celle de 8. GUE&E, dam a L'Pgc des personnes authentiques; ceux qui comptent dam la societt medievale sont-iIs jeunes ou vieux ? I., dam Prasopographie et Gembe de I 'Elat modeme, Actes de la table ronde organisCe par Ie CNRS et I'ENS de jeuncs fillcs, Paris, 22-23 oct. 1984? d d Francoise Autrand, (Collection de I'ENS de jeunes filles, 30) Paris: k o l e Normale SupCrieure de jeuna filles, 1986, p249-79.
''. Ainsi, le modtle ci-dcssus mendome utiliserait des divisions qui sont des multiples de sept (7, 14,28, 49, 70), uniquement parce que la Cdation f i t accomplic en sept jours et que les Heurcs canonides sont au nombre de sept (cf. A ~ e x e C). Certes, Phomme du haut Moyen Age jouait un par avce k r6alitC pour gu'elle puisse 5tre lue spirituellement, mais rl m'apparajl surfout remarquable dans son aptitude jouer avec le spirituel pour qu'il puisse &re lu avec dalisrnc (ou, pour parler plus dment, comme bon lui semblait selon ses fins
du moment). Lt 7 est un nombre trts synrboliquc, mais tout autant le 1,2,3,4,10, 12, etc. Si les divisions par 7 ne lui avaient pas convenq il await trow6 m e autre manitre de dkouper les ages qu'il aurait tout aussi bien su expliquer spirituellement.
"- C. D m a mentionnk le lien existant entre le mode de vie des moines et les divisions des gges, mais sans approfondir la question et uniquement en ce qui avait trait ii I'enfance (a Kinder ... m, op.cit., 1994, p.5). De rnanitke un peu contradictoire, il a r m e dam ce mCme article que I'&e de I'adofescenfia (s'dtirant de Ia pubertk i 28 ans) s'appliquait uniquement i Ia classe des bellatores et teprbentait la deuxieme phase de leur formation (ibid, p. 17-1 8).
C. LES D E ~ I T I O N S &DI&VALES DES
1. Les Ctudes sur It sujet
Ainsi que le remarquait &cement un rnddi&iste, a Life time divisions seem an
intellectual activity occupying mankind h m antiquity into our own days. Non seulement
tous les sikles se sont int&ess& h une telle activit& mais dgaiement toutes les classes
sociales semblent y avoir pris goiie. Les Clunisiens n'auraient pas ici fait figure d'exception :
il est possible que deux chapiteaux du ddambulatoire de Cluny III, datb du premier quart du
We sikcle, repksentaient les quatre saisons et les quatre vertus cardinales en liaison avec les
quatre ages de la vid.
Au cows des dix demikes am&s7 trois monographies ont W consacr6es aux Ccrits
et B l'iconographie traitant de la division du cycle de vie au Moyen Age ; elles furent
redigees par John A. Burrow, Elisabeth Sears et Michael E. Goodich4. Ces trois auteurs ont
I. L. MILIS, e Children.., m, opcit,, 1993, p24. f . Selon Elizabeth SEARS, le thtme de la division des ages se diffiwa encore plus largement i p h r du
moment oB une importante section de la population Wqumta les teoles, soit h la fin du Moyen Age (Ihe Ages of Man : Medikwal Interpretation of the Lre Cycle, Princeton: Princeton Univ. Press, 1986, pmii). Le grand succb des gravures populaires ayant pour sujet Les Degrk d a dges entre le X V et le XIX' sikle atteste en effet de la tr& large audience dont MnCficiait cc Wrne (cf. J, MISTER, 8 Lcs origines de I'imagerie populaire a, dam J. Mistler, F. Blaudez et A. Jacquemh, ~ ~ i n o l et I'inrogerie populaire, Paris: Libraire Hachette, 196 1, p.46-53).
'. J, MICHAUD, = Les inscriptions romanes des musks Ochier et du Farinier A CIuny v, Cahiers de Civilisation MPdi&ule, 38/2 (1995): 168. Pour des interpdtations un peu diff6rentcs de I'ornementation du d6arnbulatoire des angcs, cf, C.E. SCKLIA, = Meaning and the CIuny Capitals : Music as Metaphor *, dans Current Studii on Cluny, 6d. W. Cab, I.H. Forsyth et W.C. Clark, no spdcid de Gesta, XXVIVI-2 (1988): 13348 et P. DIEMER, What does Pmukntia Advise ? On the Subject of the Cluny Choir Capitals m, ibid, p. 149-73.
'. Le premier, John A. BURROW, est un IittCraire qui s'est penchC sur la p&iode s'khelonnant depuis Bede ii la fin du XVe siecle ; il s'est concentd presque exclusivement sur I t s sources anglaises, l'exception d'auteurs aussi incontournables que C i c h n ou Dante (The Ages of Man -A Stu& in Medieval Writing and Thought, Oxford: Oxford Univ. Press, 1986).
La deuxieme, Elizabeth SEARS, est une historienne de l'art qui s'est tout spdcialement interessde a u filiations des divenes repr6sentations possibles du cycle de vie (The Ages of Man, 1986). Son ouvrage est divise en deux parties : elle a d'abord couvert la phriode allant jusqu'au XIIe siecle, analysant donc
essay& autant que f k se peut, de se ddrnarquer de leurs pddkesseurs. Les travaux
antdrieurs &ent habituellemmt divi& d o n le nombre d'&s composant le cycle de vie,
avec un premier chapitrr sur la division par trois, le suivant sur la division par qua-, etcS ;
Burrow et Sears ont pdfM classer leurs chapitres selon le type de mhphore employ& en
liaison avec la description des @es (Ies quatre saisons eVou les quatre humem, les Qes du
monde, les paraboles tvang&ligues, etc.) ; Goodich a pour sa part organist! son analyse en
fonction de chacun des &ges consid& (l'edmce, l'adolescence, et ainsi de suite). Cette
derniere etude est donc, de par sa structure, ceUe qui se rappmhe le plus de mon props. Elle
couvre rnalheureusement me piriode trop tardive, l savoir Ies a n n h 1250-13 50 ; or, cornme
je le demontrerai plus loin, d'importantes transformations appanuent dam la division des
iiges B partir de la fin du XIe - debut du MIe siecle, qui rendent impossible l'application de
la division des 6ges ttablie par Goodich sur la "rtialitt5" clunisienne transmise par les
Vitae. Les remarques qui suivent portent donc essentiellement sur les travaux de Sears et de
Burrow ; elles donnent un apertp de ce qu'il reste a dire sur les d6finitions rnt5dievales des
iiges ddigies avant le XmC siecle 6.
Les m&hodologies employ& par les deux premiers chercheurs ont pour consdquence
d'obscurcir le lien entre le cycle de vie au Moyen Age et le discours tenu sur lui par Ies
penseurs de 1'Cpoque. Pour Burrow et Sears, le theme des 3ges donna avant tout lieu B des
constructions intellectuelles presqw enti&rement dipendantes de l'h6ritage classique et peu
principalement Ies sources d'origine eccl&iastique, puis elle a analyst! la floraison de productions picturales sur Ies iges dam divers= branches du savoir, du XI[r sitcle & la fm du Moyen Age.
Le troisieme, Michael E. GOODICH, un historien, surtout spkialistc de I'hagiographie, s'est concentrC exclusivement sur les ann& 1250-1350 ; il souligne les divergences du diiours sur Ies &es entre les divests sources employ& et &die sdpar&ment chacun des &cs (From Birth to Old Age - The Human Lge Cycle in Medieval Thought, I25O-I 350, L,anham/New YorWLondon: Univ. Press of America, 1989).
'. E. SEARS, rite Ages of Man, 1986, p 3 4 . Cf. par exemple LW. JONES, Observations on the Divisions of Man's Life into Stages m, Archaeofogia, 35 (1853): 167-89 et Samuel C. CHEW, The Pilgrimage of Lile, New Haven/London: Yale Univ. Press, 1962, chap, VI: "The Path of Life", p .144~~ .
6. Pour une prbentation critique de I'ouvrage de M. Goodich, cf. mon compte-rendu dam la Revue hisroriqzre, 576 (0ct.-DCc. 1990): 47 1-73,
iduendes par les transformations historiques qui l e u finent contemporaines' ; je montrerai
qu'il y eut au contraire des modifications significatives clam les d&itions des @es a la fin
de I'Antiquite et lors de la Renaissance du We sikle.
En outre7 soucieux de pnknter m e Iiste trb oompkte des descriptions du cycle de
vie, ces deux cherchem n'ont pas essay6 de fairr m e synthbe de leun d&ouvertes pour
tracer Ie portrait-type du dkoupage rnMdval des aes. Pourtant, un tel exemice pennet de
mieux observer I'originalitt de certains auteurs et, surtout, de comprendre la @cificite du
vocabulaire rnddi6val des 6ges. II faut en effet eviter d'appliquer sur les sources m e manitre
hop "vingtieme si&clew de consid6rer le cycle de vie : Burrow et Sears, par exemple, n'ont
guere port6 d'attention a I'absence ou au flou de la terminologie utilist pour dbsigner la
matwit6 ; il leur semblait probablement inconcevable que cette 6tape n'exist3t pas au Moyen
Age. 11s ont dgalement accord6 plus de poi& dam leurs travaw a w interprdtatiom
"naturelles" du cycle de vie (iistant sur la question des humeurs ou sur le cycle croissance-
dicroissance), au detriment de celles avant tout religieuses (6voquant le rapport de l'homme
avec le Divi.). Or m e teUe p6fdrence est discutable pour l'6poque mdi&ale, tout au moins
avant l'essor de la philosophie aristot6licieme au Xme s%cle. Par ailleurs, elle est lourde de
consiquences pour qui veut comprendre la perception m6dikvale des iges car si I'approche
"scientifique" porte am nues la jeunesse cornme I'ige de la force et de la beautk, opposde
a une vieillesse qui repksente un indeniable dklin, rapproche "spirituelle" peut en revanche
domer lieu une perception positive de la vieillesse et ndgative de la jeunesse.
2. numeration des definitions
Parce que la probltimatique de Bunow et de Sears me semblait laisser beaucoup de
questions en suspens, j'ai jug6 nCcessaire de reprendre I'dtude de la division du cycle de vie
'. Cf- E. SEARS, The Ages of Man, 1986, p.6, JA. BURROW, The Ages, 1986, p.93 et le compte-rendu de ce dernier Iivre par A. ACHENBAUM, Ageing andsociety, 7 (1987): 102.
par les auteurs chre'tiens latins d'avant le Xme sikle. Le Tableau I offir un &entail aussi
large que possible des divers dkoupages de l'existence conw d@s TerhrUien (tc.240)
jusqu'ii herhard de ~6thune (c. 1200). Les premiers auteurs citb appartiement ib l'htiquitd
tatdive et pr&&dent donc de beaucoup la @ode dtudi&e daas ma &he, les Xe-XIIe sisibcles.
Deux raisons justifient ce choix : d'une part, le sm9 d'un terme, une +ode doante, ne se
comprend vdritablement qu'h Isaide d'une connaissance approfondie de son 6volution
s6mantique dans Ies sitcles pr&dents, d'autre part, le poi& de l'aucton'tas au Moyen Age
etait telle que les dires d'un Augustin d'Hippone sur les Sges de la vie avaient beaucoup plus
d'influence que ceux d'un contemporain, tout au moins jusqu'au XIIe siecle. Bien que mon
etude du discours clunisien des iiges s'arr0te en 1 156, j'ai dkidt5 de poursuivre l'observation
des d6finitions jusqu'au toumant des We-MIIC sikles. Des transformations importantes
dam la division du cycle de vie appanuent en effet ii partir du &but du XII' sikcle et il etait
nCcessaire de Ies suivre sur plusieurs ddcennies pour bien les appdhender. M9int&essant
essentiellement au vocabulaire mddi6val des iges tenu par les hommes d'~glise, j'ai fait
abstraction des kits en langue' vernaculaire. Par ailleurs, j'ai reserve pour le Tableau II les
definitions non-latines des iges, qui influenc&ent les auteurs cmtiens du Moyen Age9 mais
a une date assez tardive ; les divergences padois hppantes entre les dew tableaux
justifieront cette sdparation. Les references exactes concernant toutes ces definitions, ainsi
que les analyses succinctes de la perception des iges par les divers auteurs, se trouvent dans
1'Annexe C.
Quelques explications doivent etre foumies sur la maniere dont j'ai r6parti les
informations entre les colonnes des tableaux. Dans la mesure du possible, c'est-B-dire lorsque
les auteurs les mentiom&rent, les iiges awquels ddbute chaque &tape de la vie firrent pr6ciA.
Ces indications chifMes 6taient malheureusement trop rares pour &re utilist?es pour classer
les donnees sur les d~fhitions des Hges. J'ai donc opt6 pour m e mise B plat brute de cellesci,
en sachant pertinemment qu'une pareil1e manitre de faire Ctait souvent fautive. Tous les
termes ayant une meme racine (par exemple infantia et infam) sont placQ dans la meme
colome : en consequence, une senectus cornmenqant A 70 ans peut se trouver par erreur
associCe ii une autre senectus debutant a 50 ans. La cinquEme colonne r6tm.it en revanche
tous les substanti& qui semblent hire d f h c e ti un 8ge mQ. mihe si ces termes n'ont pas
de racine commune. Ici encore, je man- qu'un tel classement est injustifit puisqu'une
grmitus debutant A 50 ans devrait etre placCe clans la c d o ~ e de la senectw commeqant au
meme ige. L'andyse des tableaux qui va suivre permettra de coniger ces diverses errem
de classement,
I- TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE LA DMSION DES AGES PAR LES AUTEURS CH-TENS LATINS
pueritia
pueritia I Prudence (~405) infantia
adolescentia iuuentus -oris a/
adokscentia iuuentus tFJ i t= pueritia
pueri adolescentes iuuenes I l -Ores
adolescentia iuuentus I I infantia pueritia
pueritia a decrepita a ueterana
pueritia
pueritia
pueritia luu pueritia 7uw
I4 ms 28- SOms adolescentia iuuentus
pueritia a atiulta I iuuenta I Bede (c703) 6 - - -
infantia
infans
pueritia
infantia pueritia adolescenda iuuentus I-
a sen-oris senectus iegrauitas 70- I I
pueritia
pueritia
infantia
infantia
M s (X' s. ) de Chartres b pueritia
7- adolescentia 14 8ns
iuuentus 21 ms
de Paris
iuuentus
I Xls (XI' s.) de Chiemsee
infantia
infantia Grammaticus
pueritia 7ans
senior 48 urs
pueritia 1
Anonyme (deb. X.W) pueritia I adolescentia iuuentus
iuuemus 25/30 ans iuuentus pueritia
iuuentus
infantia pueritia 7, I senectus I decrepitus
infantes I I 1 iuuentes I prouectiores
I
pucritia ' iuuentus
primaew aetas adolescentia 1 iuuentus
adolescentia iuuemus
decrepita a + Werner (f 1 126) 1- pueritia
adolescentia iuuentus/ I -- pueritia adolescentia iuuemus
iuuentus
Ien- I senium prima aetas
puecitia adolescentia iuuentus uiriIis a infantia
I
pueritia adolescentia iuuentus i.e. uirilis a
senectus I senium uel decrepitas a
infantia
adolescena'a iuuentus 25/30 ~ru
pueritia adolescentia uel iuuentus
senectus I senium
senectus I Jean Beleth (mi X F ) 3 I pueritia I 1 iuuentus I
adolescentia iuuentus I pueritia
infantia I
adolescentia iuuenW 14 uw uirilis a
28- adolescda iuuentus uiriIis a IS urs 21 ans 32/33 urs
senectus S 6 . a ~
seniud a decrepita
Tractatus (MI') 7
pueritia 7 lns
scnium uel a decnpita
Richard (T 1 173)
pueritia adolwcentia 7-
Godefioid (t 1 1 96) 5
pueritia 1 adolesceatia
aQolescens
pueritia adolescentia + senex
senectus senium Sicard (c 1200) 6
11- TABLEAU CERONOLOGIQUE (suivanf la date de tmduction en latin) DE LA DMSION DES AGES
PAR QUELQUES AUTEURS NON CH'TIENS UWLUENTS
Ali [trad fin ibn d-Abbas
Ali [trad. 1 12q pueritia ibn al-Abbas
w
Aviceme [Uaa tin mj
Ptolemie Bad. 6 xrrcl
infantia pueritia a d o l m - a 4 u u 14 uu
iuuentus grandiorum senectus etas
3. Analyse des tableaux
En quelques mots, voici les conclusions auxqueUes je suis parvenue suite A l'andyse
des definitions miditvales des ages de la vie. Cornme I'atteste la simple lecture des dew
tableaux, d'importaates modifications dam les d6finitions des Qges eurent lieu au ddbut et
ii la fin de la p&iode M&. A la fin de I'AntiquitC tardive - d&ut de 1'Cpoque rn€d.%vale,
le tres episodique age mtn romain disparut presque compl&ement, tandis que la senectus
recula de cinq ans pour commencer & 50 ans (et non plus 45) ; surtout, elle se scinda en dew
pour constituer la senectzis et le seniwr. Dans le courant du XIP si&le, l'iige miir refit
d a c e ; paralldement et presque simultadrnent, L'udolacentia glissa vers la pueritia dont
elle devint une partie intdgrante, se scindant ainsi de la iuuenhis, tandis que la senectus
comrnenqait i nouveau B un ige plus bas, tel35140 ans. Ces trois transformations w doivent
pourtaat pas Stre g~n&ali& & toufes les d6fhitions du cycle de vie produites durant le bas
Moyen Age : le tableau I montre en effet qw, au moins en ce qui conceme le XII' sitcle, les
anciennes formes de division subsistkent en nombre presque Cgal B c6t6 des nouvelles, que
celles-ci aient incorpord une, deux ou trois des modifications t5voqu6es ci-dessus. On obtient
de la sorte un eventail extrhement contrast6 des d6finitions du cycle de vie, qui fit dire a
plusieurs medievistes que ces derni&es n'ktaient que des jeux de l'esprit. I1 me semble qu'il
faudrait plutBt concevoir la Sunrivance des anciemes fonnes de division comme la
conskquence du poi& de la tradition dans la socidt6 m6di6vale dont tdmoigne I'influence
toujoun vivace, d m e au-dela du XIe si&cle, d'un Augustin ou d'un Isidore. Les nouvelles
tendances dans les d&nitions doivent en revanche etre explorkes comme sympt6mes d'une
transformation dans la perception du cycle de vie. Dam le but de comprendre ce dernier
phenomhe, je propose quatre hypoth&ses complementaires et inter-dependantes, dont
seulement la derni&re sera traitde dam le cadre de cette thhse. Premitrement, le tableau IX
temoigne de l'idluence de la p e d e philosophique et scientifque transmise, sinon Qaboke,
par les Arabes ; ceIIe-ci se fit justement sentir B partir de la premih moitid du W' si6cle8.
Deuxihement, la littdmtme empSnme vemaculaire se dkreloppa au cours de ce r n h e We
si6cle ; or l'essentiel de son discours etait cent& sur les a ~ k s de la iuuentus, ces mimes
ann&s dont les d6finitions subirent de pfonddes mutations. Sans vouloir aller jusqu'ii
afEmer qye les auteurs eccltsiastiques finmt beaucoup plus seasib1es au mode de pens&
l a v e ap& le XP sikle, on peut au moins supposer que, interpelI& par les productions de
la culture laique, ils ~ f l d c h k n t &vantage sur le bien-fond6 des bomes traditionnetles
assignees i la iuuentus. Troisitmement, I'essor d6mographique amorcC avec la fin des
invasions eut cornme cons6quence, d&s la fin XI' - ddbut du W e si&cle, que plus de jeunes
se retrouvikent en attente #heritage ou contraints de quitter la demeure familale pour
chercher fortune, ce qui accentua l'importance de ce groupe d'gge sur la scene socialeg.
Quatri8mement, une certaine 6volution dam le mode de perception des iges vit le jour au
sein mEme de la culture monastique, cornme le confirmera l'etude des sources clunisiennes
entreprise dam la derni&re section de ce chapitre.
Entre ces dew periodes extribes, fin de I'Antiquite et ddbut du X . si6cle, les
definitions des &ges furent regies par une r6gle facile H discerner. 11 existait trois 5ges
fondamentaux, lapueritia, la iuuentus et la senectus. Chacun de ces fges pouvait Ctre divid
en deux, si bien que le premier d o ~ a i t souvent I'infantia et la pueritiu, la iuuentus se
separait presque toujours en ado2escentia et iuuentw, et la senectus formait a I'occasion la
senectus et le senium. L'extdme majorit6 des auteurs regroupaient trois, quatre, cinq ou six
de ces six Sges (infmia, pueritia, adolescentia, itmentus, senectus et seniwn) pour constituer
leur ddfinition du cycle de vie.
En admettant ce principe de hgmentation des trois iges de base, on comprend mieux
powquoi, aussi bien dam les dCfhitions qu'ailleurs dam les sources, l'infm etait egalement
appeIC puer, et l'adolescenr, iuuenis. Ces dewt premi5res divisions se retrouvaient ddja a
'. A propos de ['influence arabe sur les defmitions des ages, cf. E. SEARS, The Agm..., 1986, P-30 et M. GOODICH, From Birth. .., 1989,p.l I,.
9. G. DUBY, a Les a jeunes n ...*, op-cit,, 1973, p.213-25.
I'6poque romaine classique, mais non la d e m i k (come je viens de le dire) ; ce fit
probablement pour cette raison pu'uae seule appellation etait associde am deux &es ultimes,
B savoir le senex ; les hommes de i'epoque mBdi6vale e s s a y h t sans grand s u d s
d'inventer un noweau vocable pour distinguer l'homme ayant dCj& atteint le senim de celui
qui etait encore clans la senectm
- Sur ce sch€ma t d s simple, il est m a l e tout ntkessaire d'apporter une nuance
#importance : c o m e l ' d y s e des mentions des Qges dam les Vitae clunisie~es l'attestera,
une personae dam la tranche d'iige de la senecfus (de 50 ans jusqu'a 70 ans ou jusqu'au
dCds) Ctait rarement appelee senex aussit6t qu'elle avait h c h i la barre fatidique des 50
ans ; de la meme maniere, un individu dam la iuuentus (15-50 am) w se f ~ s a i t jamais
appeler iuuenis jusqu'ii l ' e d m e limite de cet iige (49/50 am). Pendant de nombreuses
ann&es, dont le nombre variait selon le statut et le r6le de l'individu consid6r6, celui-ci, ex-
iuuenis et peutdtre funu senex (si Dieu lui pretait vie) &tit un simple uir, qu'il f i t encore
dam la iuuenhcs ou dCjP dam la senectus. le montrerai que ces m & s correspondaient trks
approximativement a celles s'ins6rant entre la fin de l'adolescentia et Ie debut du senium.
Telles sont donc les conclusions auxquelles m'a arnenke l'analyse des tableaux I et 11. La
dkmonstration suit.
a) Ptieritia et iuuentus
Slusanski a demontrti qu'8 la £in de l'epoque romaine, lapueritia et la iuuentus se
dt5compos5rent respectivement en infantia et pueritia d'une part, et en adolescentia et
iuuen(us d'autre partm. En d'autres termes :
lo. D. SLUSANSKI, Le vocabulai re... m, op.ci!., 1974, p-574. La meme thdorie st retrouve chcz LP. NERAUDAU, mais celui-ci pense quc la division tripartite commmGa i se scinder kaucoup plus tbt (Lo jezmnesse.,, 1979, p.101)- Selon E. EYBEN, la iuuenfus se transfoma en adolescentlr'a plus iuuenfus apes 200 av. J.-C. (a The Beginning and End of You th... S, op.ci&, 1993, ~259). Ces divergences de point de vue s'expliquent parfaiternent si l'on considere que la division tripartite simple continua ii itre de mise, mtme ap& le developpement de la nouvelIe division, beaucoup plus d&aillte, quelle que soit l'dpoque oit cette dern ih es t apparue.
pueritia = infmtia +puetitia imemtus = adolescentia + iuuenttrs
La limite entre ces deux ensembles wmspndait ih la pubert6 "sociale", c'est-&-dire & la
veture de la toge virile vers 15-16 ansH. J. Cousin parvenait am msmes constatations apds
avoir 6tttdit5 diverses citations d'auteurs antiques oih adolessem et iuuenis btaient, soit
* a Par suite, on peut admettre les limites mivantes : seize ans pour la pueritia, l'adolescentia r e c o r n m e part de la iuuentus, cpi qui t toutefois embrasser un plus long espace, se termine vers quarante-cinq am et s'oppose surtout B senectus. d2
Les auteurs chdtiem de I'Antiquit6 tardive et du Moyen Age accept- pour la
majorit6 d'entre eux ce schema La prelaitre equation
pueritia = infmtia + pueritia
est facile a demontrer a la lecture du tableau I : il d t de noter que dans 14 casI3 mt 64, la
seule pueritia englobe toutes les annks de l'enfance. Autrement, la division de ces premi6res
annees en infantia + pueritia est majoritaire avec 41 occurrences. Dam les 9 ddfinitions
subsistantes du tableau I, 3 surnomment ces premitres am&s prima aetasjwinzaeua aetad
". Sur Ies fluctuations de I'&e de la prise de la toge virile* cf. supra, section A 1. Pour une analyse dCtaillCe de cette cedmonie, cf. A. FRASCHETll* Jeunesses rornaines m, dans Histoire des jeunes en Occident, v01.I: De I 'Antiquit& ci I Zpoque mdwne, dir. Giovanni Levi et Jean-Claude Schmitt, Paris: Seuil, 1996, p.77-82.
'5 J. COUSIN, pdface de son Hition de I*Im~imtion ordo& dc Quintilicn (Paris: Les Belles Lettrrs, 1975, pxv-vi). En revanche, P. COLMART notait, dans son article La quatrc &es de Ia vie (Horace, Aripop'rigue, 153-75) a (Revue classique, 24 (1956), p.59). que le syst&mc romain dcs Ages de la vie se divisait entre la pueritia, la itmento et la matwitas. A l'interieur de ccs ages, cet auteur d i i g u a i t d'autres sous-divisions. Ainsi, la pueritia se composait de I'infantia (jusque 7 a), la pueriria ( j q c 14 am au minimum) et I*adolercentiu faisant encore partie de la pueritio tant pue le jeunc hommc cst It&ole,. La iwenta dtait div* entre ItadoIescentia aftera (de la prise de la toge virile jusqu'h la €m dc la croissance) et la iuuenta de 20 B 40 ans. La matwitas se d6cornmt entn I'wra~ vkilis alteru (a gui s'dtend en p ~ c i p e de 40 60 ans .),
Ia senecta, oO I'homme pdsente encore quclque validit& a qu'il hut d i g u e r du senium, 0.5 la decdpitude trop flagrante met L'individu en dehors de tout age m. Les sous-divisions de Colmart ne sont g u h convaincantes avec les deux adolescentrbe et I'aetar uirifis divise entre la fin de la iutrenta et le debut de la mafurifas ; mais il est intdressant de souligner qu'on retrouve ici encore le trio puwita, iuuenttcr ct mat uritcrr/senecfus.
". Tel kt le cas chez Ambroisd (le chifie romain en exposant indique A laquelle des definitions de cet auteur je fais dference), Ambroise$ Gdgoirei, Grtgoicek , R€my d'Auxed , Byrhtfetth, Pseudo-Wde* Anonyme anglaisiiit Honoriusiv, Weme+, Werner", Rupert, Jean Beleth et Aelred de Rielvaux. Dam I'Annexe C, on peut aussi noter ce phenomtme chez Prudence, Jedrne, Augustin (Semon 49), Raban Maur (Comm. in h.iarthmt) et Honorius Augustodunensis (Sucramentarium).
[infantia + pueritia]14 tan& que 3 les appellent simplement infmtia Is : il s'agit de
formulations dB&entes recowrant normulemenf la m&ne dab!, c'est-&dire les a n n h du
doublet inf~nffi +puerin'a. Ah& dans presque le tiers des d6finitions (14 + 3 + 3 = 20, par
rapport ii 64), l'enfance, de la naissance B la puberte, est c o a s i d ~ comrne constituant me
seule entitb. Du fait de rimportance de cette tendance, on m peut a€fj.rmer que les quiaze
premi6res m e e s etaient peques come constituant deux ages nettement distincts ; il est
preferable de se les repdsenter cornme formant un seul age, lapuen'tia, marqu6 par dew
phases, l'infanria puis la pueritia. Une telle ddfinition est nrffisamment flexible pour
s'appliquer a 6 1 (20 + 41) des 64 definitions du tableau I.
Les 3 dernihs d&itions tdmoignent d'un cas de figure b premiere w e assez rare :
pour 1'Anonyme anglais @remihe et dewi6me d6finitiofls)16 et Guillaume de Saint-Thierry,
le premier 5ge inclut (et meme s'intitule) I'adolescentia. On se retrouve alors devant la
nouvelle kquivalence :
adolescentia = infmtia + pueritia + adolescentia
L'adolescentia est de la sorte associb B l'enfance. Mais s'agit-il reellement des seules
occurrences de ce mode de division dans le tableau I ? Rien n'interdit en fait que ce "grand"
premier 2ge ne s'intitule a l'occasion infmtia oupueritia, plut6t qu'adolescentia, et qu'il soit
5 l'origine de toutes les definitions ou lapueritia (ou l'infmia) est immkdiatement suivie
de la iuuentus, sans l'adolescentia comme intermediaire. Or, Prudence, Jlr6me et Bedeii
presenteat les 3 seules d6finitions des 3 1 pk-We sitcle oii, peut-itre, l'adolescentia est
incorporie H lapueritia et non B la iuuentus En revanche, H padr du d&ut du We sikcle,
outre les 3 d6finitions dejjl mentionnCes dans le tableau I, la question peut se poser pour
Honoriusz, Howriusiv, Marbode, Guillaume de Conches, Jean Beleth et Alain de Lille, soit
9 (6 + 3) definitions pour un total de 33 cas. De plus, parmi les 24 subsistantes, a l'exception
du Tr~ctattts'~ et de Julien, oh lapuerilia est nettement distingude de l'adolescentiu, la plupart
14. Bruno, Guillaume de Conches et Tractutdi. Is. Bede', Honorius' et Alain. 16. Notons cependant que cet auteur est trh hesitant sur la question puisque, d m sa troisitme definition,
pueritia et adoIescentia sont synonyrnes mais s'intenompent db 14 ans, tandis que, dam la quatr ihe definition, la pueritia est nettement distinguee de I'adolescentiu.
des autres phntent m e division des pretnib a n n h en ih#~nnhl pueritia 1 udolescentia
I iuuentus, qui, finalement, laisse le champ hire B toutes les sortes de regroupements
possiiles entre ces quatre &es- Enfin, la lecture du tableau IIv confinne qu'une tdle division
devint relativement courante B partb de la fin du XP - daut We sibk, peut4tre sous
l'intluence des trait& m6dicaux non cMeas, mak aussi, c o m e on le vnra dam le chapitre
ID, it la suite de transformations intemes B la socW mddi6vale occidentale.
En d'autres termes, ti, avant le We sikle, I'adolescence est presque toujours
rattachtie i la jeunesse, il lui arrive ensuite quelques fois de se confondre avec l'enfm~e'~.
Compte tenu du f ~ t que le premier 6ge est celui de la dQendance totale, son prolongement
de quelques armies pour englober I'adolescence n'est pas sans signification.
La deuxierne equation
iuuentus = adolescentia + iuuentus
est plus malaiske demontrer que la pec6dente. En effet, par suite de la position centrale du
doublet adolescentia 1 iuuentus, l'absence d'un de ces dem 6ges ne permet en rien de
certifier qu'il a 6t6 absorb6 par le second : il pourrait fort bien (en th6orie tout du moins)
avoir kt6 incorpon! par l'autre 5ge qui lui est adjacent, I savoir lapuen'tia pour le premier,
I'2ge rn* pour le second. Nous l'avons w, I'adolescence est associb B la iuuentw jusqu'a
17. Sur les 5 ddfmitions du tableau 11, la premiere, Ia deuxiiime et la troisieme pdsentent trh clairement I'equation
pueritia~adolescentiu = infantia + pueritia + adolescentid ". Cene incorporation de l'adolescentia A L'enfmce n'existait pas avant le XIF siWe et demeura
occasionnelle par la suite. Margarete NEWELS note encore au XV' siecle cctte fluctuation continuelle de la position assignee B I'adolesccnce par rapport I'enfance (8 Lcs ages de la vie daas quelques moralit& frangaises I la fin du Moyen Age m, dam Les dges de la vie, L992, p260), tandis que P. CHARBONNIER remarque que les jeunes cntre 16 ct 20 ans dtaient appeJ4s aussi bien enfaats que jeunes hommcs ( L'entr6e dans la vie au XVe siecle d'aprb les lettres de dmission m, dam Les entrPes &m la vie - Initiationr et apprentissages, Nancy: Presses Unv. de Nancy, 1982, p.72). Plusieurs mtdi6vistes ant pourtant voulu considdrer ces deux ages c o m e constituant un seul et unique ensemble. L. MILIS, par exemple, agrege systCmatiqucment l'adolescence dam l 'enhce dam son article a Children and Youth. The Medieval Viewpoint l (Paedagogica Historica, XMX (1993): 15-32). P. SIGAL, dam sa communication Le vocabulaire de I'enfmce et de I'adolescence dam les recueils de miracles latins des XIe et ?UIe si&cles . (dam L 'enjot au Moyen jge: iitte'rature et civiIisation, Aix-en-Rovence/Paris: Publ. du CUERMA/Charnpion, 1980, p. LU), commence par affhmer que l'adolescence est le troisi&me 5ge de l'enfance, apds Ivinfantia et la pueritia, mais ['etude des sources le contraint & rkviser cette m a t i o n puisque adolescens est synonyme de iuuenis.
la fin du XIe sitcle, mais aprb cette p6riodey sa position est ambig* entre lapueritia et la
imentus : elle est tant6t partie de I'une, tan& partie de l'autn. Le wai probIhe est donc de
savoi ce quyiI en est de la iuuentw par rapport ce que j'ai intide L'"3ge mltr". Les
conclusions ressemblent fort A celles concernant l'udolescentiu : l'Hge milr ne se confond
parfois avec la iurcentus, c'est-Mire l'iige qui le pdcMe, qu'h partir du deuxi&me quart du
XIIe siecle ; auparavant She de la matmite aurait plut6t tendance, soit I &-re absent (le cas
le plus fkdquent), soit I se confondre avec la senectus. La ddmonstration de ce phenomtne
nkcessite de se pencher un peu longwment sur cet Pge.
Ceaains m6di&istes, tout midement Hoheister et De Ghellinck dam la premi&e
moitiC de ce si&9e1gy ont ddjii souligd I'absence d'un iige rnk dam les divisions m6di6vales
des igep, mais leurs conclusions n'ayant pas W reprises d m les etudes les plus rdcentes
sur les iiges de la vie ou sur la vieillesse, qu'il s'agisse des travaux de Sears, Burrow,
Goodich ou Minois, i1 n'est pas inutile de demontrer a nouveau ce phdnom&ne2!
19. A. HOFMEISTER, 8 Puer, iimenir, senerc. Zurn Vestiindnis der mittelalterlichen Altersbezeichnungen W,
dam Papsttuna undkiiertum fbmchwtg~ nrrpolitrjchen Geschichte undGebfeskrrlhu & Mittlcrlters, P d Kehr nrnt 65. Gebwtstag dargebracht, dd. A. Brackmann, Aalcn, 1973 (1926), p.287-3 16 ; Joseph DE GHELLMCK, 8 Iuuentus, grmittar. senectus w, dam Studio medioevdia in honarem RaymurrdiJarephi Mmin, Bruges: Apud Societatcrn editricern "De Tempel", 1948, p39-59.
? La soci€tt mddi&ale e w ~ c n'cst pas la seule B nc pas avoir f i t place un age mCir dam son cycle de vie, Le meme pbtnomtne x notait par exemple chez les Grecs. Robert GARLAM) en a conch que i'dtude du group des ainb tquivaut B cclle de l'cnsemblc des "vicux" :
(I Since adult Greek society was primady organised on a two-generational principle, withdrawal h m the ranks of the neoi was accompanied by immediate promotion to the prebusteroior elders- It follows h m this that the investigation of "elders" in Greek sociev is essentially inseparable tiom that of its "elderly". The word mesos, which is the closest approximation in Greek to "middle-agedw, is used only rarely and never to my knowledge to descn'be a middle-aged woman. (The Greek Wqy ..-, 1990, p242).
Chez les Romains tgalement, le schCma dominant de la division des ages ne peente pas d'&e mQr : la iuuentus coum toutes les anndcs allant dt 15/17 am 1 45 ans (cf. enm autres 1.-P. ~@UUDAU, La jmnesse.., 1979, p.5).
". M. GOODICH a remarque que la division tripartite proposde par J.F. Kett - ddpendance, serni- dCpendance et inddpendance (ment io~k dans Ia premiere section de ce chapitre) - en souvent plus approprike pour comprendre le dtroulement de I'existence telle que p&ent& dam les biographies mCdi6vales
noms ne trahit-eIIe pas la Wtd du concept de L'Qe milt ? D'ailleurs, tous ces termes
dB&ents font-2s dfhce la mkie H t d ?
Sur les 64 d6Mtions du tableau I, 21 semblent admettre un Sge moyen entre la
jeunesse d la v i e i l l d , mais a nombre relativement ClevC est trompeur. Dam les fkits, si
l'on porte atteation a w appellations utili& et am Qes qui leur sont associ&, on observe
que 10 de ces @es mQrs sont des senectutes ddguis6es sous d'autns vocables. On admettra
en effet qu'un age qui debute A 50 ans, meme s'il finit & 70 ans, fait partie de la senectrcsZ4.
Or, tel est le cas pour la grauitrm d'Isidor& de Raban M a d et de Lambert de Saint-Omei,
pour l'aetus senioris de Raban M a d et du manuscrit de Fulda, pour le senior de Papias et
enfin pour I'iige des prouectiores d'Honoriuss. Compte tenu de I'absence de cas contraires
- oii ces memes vocables ddsigneraient un Sgc commenqant beaucoup plus tbt -, il est
possible d'afEmer que ces diverses appellations cowrent toutes ce qui pourrait s'intituler
un 5ge rnCrfvieiUesse. On peut par consdquent ajouter aux ddinitions d6jjl mentiomties,
celles ne donnant pas un Bge d'entr& 1 50 am, mais prdsentant les m6mes vocables, soit
~ugustid, ~ugustin', Augustiniii et Alcuin*. Seuls, les cas de B6dei et du Pseudo-BWe sont
ambigus. Les transgressores du premier ont, entre autres caractt5ristiques, celle dT~tre
graues ; il est donc probable, mais non certain, qu'il faille les considdrer comme appartenant
eux aussi 1'8ge rniirhieillesse. La mutwitas du second rappelle la maturitus/senectm
Po&tique, 153-175 w, tRF dtudes classi~ues, 24 (1956): 38-63), Du latin, le phdnomtne est ensuite pass6 dam la langue fian* : age mUr, iige adulte, matwit&, aucun de
ces vocables n'a jarnais gagnt sur les autns une supdmatie incontestable au point de devenit aussi incontournable que nos enfsnce, adolescence, jeunesse et vieillesse,
O. J'ai fait abstraction de toutes Ics ddfinitions 6voquant un 8ge moyen tout en l'associant ii la itmentar ou 8 la senecfus, comme par excrnple AmbroiseE qui donne commc dernicr age: maturitrrs/senechCs. Demeurent donc Prudence, Jedirne, Augustini, Augustin? ~ugustin" Isidore!, BMeS Alcuin, Raban Mauri(qui donne dew noms ii cet i5ge intermediaire : uetus senioris et grauitus), Ms de Fulda, Papias, Pseudo-B&de, Honorid, Larnbert!, Hugues de Saint-Victor, Tractad, ~ r u c t a ~ , Robert de Meld, Alain de Lille, Richard de Saint- Victor et herhard.
*'. J'emploie voIontairernent ici le terme latin de senecfus, et non pas "vieillesse", parce que cet iige de 50 ans et plus ne correspond pas notre vieillesse, mais un age mar cornbind & la vieillesse, de meme que la iurrentus mt?di€vale est en f i i t e une jeunesse matin& d'Qe mQr, La ddmonstration de ces deux ph&nom&nes ne sera vraiment faite qu'a la fm de ce cbapitre.
=. Cf. M a et les setions concernant Augustin et Isidore dam 1'Annexe C, pour comprendre pourquoi plusieun auteurs du Moyen Age, pour Cvoquer Ies deux vieilleses, fucnt appel d'aums ddnominations que les habituelies senectzs et senium ; la lecture de ces passages, il est indiscutable que, pour Augustin, la grauifczs et I'aetas senioris ne correspondaient pas A un age rnh obligatoirernent distinct de la vieillesse.
d'Ambroiseii ct cette appdation est tr&s proche s6mantiquement de grm'tas ; mal@ tout,
l'absence de iuuenhrs dam cette division interdit d'assimiler en toute certitude rnaturrlas A
senecrtls.
I1 ne subsiste donc que 9 dtfinitions du cycle de vie avec un h e moyen nettement
distinct de la senectw, et 2 autns oh cette distinction reste m e possi'bilitt!. Ces 11 &es
moyeris peuvent Stre regroupCs en trois ensembles ind6pendants : l'aetas roboris de
Prudence et I'aetar robzuta de JMme, d'une part, les frclllsgreesores de B2deii et la
maturitas du Pseudo-BCde, d'autre part, et enfin tous les d6rivds de uir. Onze occurrences
de I'ige mOr sur 64 d6finition.s des iiges, dont uniquement 2 - et encore sont-elks
arnbigues - pour la ptiriode s'etendant entre le milieu du Ve siecle et le premier quart du
We siecle, voila qui indique clakment qye les auteurs du Moyen Age, avant le W sikle
tout du moins, ne fisaient quasi jamais r6fknce B un b e miir lorsqu'ils dthivaient le cycle
de vie. En cons6quenceY si M. Goodich avait en partie raison de traiter la maturite sdpartment
de la jeunesse et de la vieillesse dam son etude sur le cycle de vie de 1250 ii 1350, une telle
probMmatique n'est pas envisageable pour qui travaille sur un intervalle chronologique
portant, pour l'essentiel, sur des sikles anterieurs au XIIe sikle - comme c'est le cas de ma
th&e qui englobe la piriode 909-1 156.
Enfin, i1 est important de noter les divergences majeures, entre l'Antiquit6 tardive,
le haut ~ o ~ e n Age et le courant du We sikle, dans ia fa~on de nommer I'iige mJr (qu'il soit
un iige moyen v&able ou un age mWvieillesse) et dam la place qui lui fit assignde dam
le cycle de vie. Pendant le haut Moyen Age, le PseudoBede utilise un terme ayant une
connotation morale, matwitas. La mibe caractdristique se retrouve dans les termes utilisCs
depuis Augustin jusqul Lambert de Saint-Omer pour d6signer l'iige mt/vieillesse :
gtauitus, gruuis aetus et matwitas font tous rCf6rece aux qualit6s de I'Hme. Si Bede ne
donne pas A ses transgressores une appellation faisant rCference I la morale, il les dkcrit
malgd tout comme &ant a stabiles, gruues, compositos moribus, dolososque s. En revanche,
les noms donn6s a I'iige moyen par Prudence et JMme pendant 1' Antiquite tardive renvoient
B des caractiristiques physiques - roboris aetas, robusta aetas -, mEme si le discours de
ces auteurs 6voque aussi, B Poccasion, la maturit6 de ces ees. Surtout, ils distinguent
wttement Ieur 4ge moyen de la senectw. Au XIIe sitcle, le pht5nom6ne est moins tranche ;
maI@ tout, les d&v& de uir semb1ent ciavantage &oquet le corps et ses forces (uires) que
la morale? Par aillews, de par l'anntk o t dhute cet Qge virilm et de par son occasionnelle
association avec la iuuenttdt, il apWt clairement que le centre de gravitt5 des Hges s'est
I nouveau d@l& vers la iuuen-
Pour en revenir A l'equation
iuuentw = adolescentia + iuuentus,
il faut admettre que ceIlesi n'est pas v6riablement dimontrable I I'aide du seul tableau I.
En effet, l'incorporation possible de l'adolescentia dam lapueritia et de la iuuentw dans
l'aetes uirilis - m8me si ce double phenomene ne prit d lemen t place qu'a partir du XII'
sikle - rend albtoire toute interpn5tation des d6finitions depourvues de l'adolescentia ou
de la iuuentus, toutes @nodes confondues. De plus, le fait que ces deux iges soient presque
toujours don-& simultan~ment, c o m e deux ages distincts (approxirnativement Ies trois
quarts des dgf~t ions : 48 cas sur 64) rend malaisee l'itude de leurs rapports. On note tout
de meme 4 dkfhitions oh ces dew iges sont prksentes comme &ant interchangeables :
~mbroise', Grt!goirefi, Julien et Tractatusi? De plus, nous savons d6jA que tel etait le cas a
l'ipoque romaine tardive, comme L'attestent les recherches de Slusanski et de Cousin
mentionnCes ci-dessus. E n h et surtout, les appellations adolescens et iuuenis sont
26. Marbode Cvoque I'aetar uirilis dam le chapitre intitul6 = De tempore et evo 8 de son Liber Decem Capitulorum et l'explique comrne suit : a Etatem sequitur iutreni[em d&a vriilid Hum- corpus solidis quia viribus implet. (6d. W. Bulst, Heidelberg: Carl Winter Universittltsverlag, 1947, U,p.7,v.24-25). le n'ai pas incorpord, dans le tableau I, la liste des &es qu'il donne en cette section, premibment parce que je 1% dtcouverte tardivement, deuxitmement parce que je ne mis pas parvenue A comprendre quelle place il faisait ii la senectus vis-&vis de l'uetus uiriiis et le senium-
Le manuscrit d'Oxford du Xn' sikle tiit commencer I'aetas uriilir B 28 ans et le Tracrahrs du XIIe sikle ii 32-33 am, tandis que le traducteur de Ptolernee appelle aetas uirih Mge qui debute A 4 1 ans.
". Wernep, AAWlard, Ms d'Mord d peut4tn Robert de Melun (71 167) associent la iuuentus avec Page moyen. Le Tracta~trs'~ offie un contre-exernple en donnant commt synonyme de senecm + senium l'appellation uirih3 aetas ; mais sa definition etant tout sauf limpide - puisqu'i1 dome aussi l'appellation aetar tririlis ii l'ige prdcCdant la vidlesse -, ce cas peut &re ignor6.
'9. II faut aussi ajouter & ceIa deux cas possibles &absorption de I 'adoIescentlb par la iuuenrur, chez Jdr6me et Augustin (sermon LXXXVII), mention& dans 1'Annexe C.
fi6quemrnent synonymes dans les h i t s l a b , tant pour 1'ePOque romaine que pour le
Moyen Age? La lecture des m e chmisiennes le confinnera,
Apr& avoi trait6 de la iuuentus et du probkme que posait Page mk, il est
maintenant n&essaire de r6flkhir sur le mode de ddcoupage des demi5res ann6es de la vie.
Celui-ci est d'autant plus inthssmt que son dvolution est la seule qui prenne place en amont
des sources Ctudih dam cette &be, et non en aval : en effet, c o m e nous allons le voir, la
scission de la senectur en deux vieillesses se fit dam les tout premiers si&cles du Moyen Age,
tandis que Ie glissement de I'adolescentia vers l'enfance et Sessor d'un iige "viril" empiitant
et faisant suite ii la iuuentus sont deux phhomines qui s'inscrirent B la toute fin de l'epoque
t5tudiie. Ce "travail" des penseurs du haut Moyen Age sur les derni&res a n n h de la vie, saus
oublier le fait qu'ils aient associe B la premiire senectus des tennes comme giauitas,
maturitas et aetus senioris, trahit I'importame qu'ils accordaient B cet ige. Je ne pense pas
trop exagerer en affirmant que, pour ewc, le centre de gravitti du cycle de vie se situait
pendant la senectus, ou tout au moins I! l'ige-charniire la separant de la iuuentus, c'est-idire
a 50 ans-
C o m e je 1% mentiom6 plus haut, D. Slusanski a montre, dam son h d e du
vocabulaire latin des iges, comment le trio
pueritia I iuuentur (ou addescentiu) 0 senectus (ou senectu)
M. Cf. B. AXELSON, a Die Synonym odulescem und h e n & m, dans Me'Imges &philofogiev & litt&ature et dvhi30ire anciennes, ofletls ti Miiouzeau, Paris: Les Belles Lettres, 1948, p.7-17, D. SLUSANSKI, Le vocabulaire ... w, op.cit., 1974, p.364 et P. SIGAL, a Le vocabul aire... m, op-cit., 1980, p.141-60. Dans le gIossaire A b m w du VIIIe-IX' sikle, iubenrj est don& cornme explication du tenne adolescens (Glossae abavus, dam Corpus GIossariorum Lutinona, vol.lV, ed G. Goetz et G. LUwe, Liepzig: Teubner, 1888-1923, p.304 ; sur ce glossaire, cf. 0. WEUERS, Dktionruzirer et Reperloires au Moyen Age- Une h d e du vocabutaire, (CMCIMA, IV) Brepols: Tumhout, 1991, p.180). Les autres glossaires qu'il m'a et6 possible de parcourir, soit 1'Abstrusa du We s. et Ie Glmae cadreis sangalfensLs 912 (tous dewt dditb dans le Corpus GIossarionrm Latinorurn, tn/, ibid.) ne mentiomaient pas ces iges.
qui suffkit B dbigner les @es de la vie au de'but des temps mmains, sY6largit graduellement
@our diverses raisons politiques et sociales), pour &re remplace, vers le premier siMe ap.
LC., par le nouvel ensemble
infmtia +pueritiu I udolescentia + iuuenttls senectus (ou seneeta)".
La division des dewc premiers @es ae s'accompagna donc pas d'une division du troisi5me.
Aucun terme du vocabulaire latin classique ne se serait d'ailleurs ptOte ii m e semblable
scission : celui qui devait ulfieurement servir le plus Wquemment ih dbigner la deuxihe
vieillesse, senium, signifiait B la fin de I'Antiquitd "&nilitP ou "dkhhce" , et nullement
"dernier ige". Slusanski affirme meme que son emploi occasiomeL comme synonyme de
senectus dispamt peu B peu des d6finitions du cycle de vie pour ne laisser que I'usage du
doublet synonymique senectus/senectd2. La lecture du tableau I jusqu'8 Isidore semble
confmer ses dires : senium est absent des d6finitions pendant les quatre premiers sikles
etudi6s. Pour comprendre selon quels processus il fit soudahement kapparition au We
siecle, B patrir d'Isidore, il faut suivre, dam 1'Annexe C, l'6volution du discours sur les 2ges
faisant suite B Ia iuuenttrs. Je la r&umerai ici tres succinctement.
Si des penseurs comme Prudence et JerCrne faisaient place dans leurs divisions a un
5ge moyen, nettement distinct de la senectus, cette distinction devint ddj& plus floue chez
Ambroise et Augustin. Chez ce dernier auteur tout sp6cialement, on persoit bien comment
I'avant-dernier 5ge etait d&i, tant6t comme diffirent de la senectur et de la iuuenw tantat
comme equivalent a une premitre vieillesse. Cette deuxi8me tendance s'accentua pour
devenir progressivement la norme. I1 se posa don un serieux probleme de ddnomination :
il existait en effet dew vieillesses, mais un seul terme pour les &voquer, senecfus. Au VC
si&le, ce vocable ddsignait encore le demier 5ge de la vie, que celui-ci fasse directement
suite ii la iurrentus ou B un age inteme'diaire, mais ii paair du VIC sitcle, c'est-&-dire B partir
de C6saire et Gr6goire dam le tableau I, il commenp B etre employ6 de preference pour la
premike vieillesse') ; parallelement, senium et aetm decrepita 6taient choisis pour indiquer
l'. D. SLUSANSKI, Le vocabulaire. .. w, opcit., 1974, p.574. It. D. SLUSANSKI, Le vocabulaire ... m, opcir., 1974, p.572. 13. Sur les 5 1 ddfmitions des 5ges dom€es dam le tableau I ii partir d'Isidore :
- 7 seulement presentem la senectrcr cornme la dewieme et fiabituellement) derniere vieillesse : Isidorei,
la deuxieme v i e i l l d . Cedes, cet&e transformation dmantique de senecfus ne fbt jds
dCfbitive, du fbit de ridluence durable da &finitions d'Augustin et d'Isidod Par ailIeurs,
il continua d'dver fk&pmment qu'uue seule et unique vieillesse fssse suite B la iuuentus
ou 1 la uirifiirar : eUe etait habituellement iotitul& senecw. Quoi qu'il en soit, l'ensanble
des remarques pdc6dentes attestent du bien-fond6 de I'dquation
senechcs = senechrs + senium.
Pour conclure sur les d6finitiom mddidvales du cycle de vie jusqu'au We siiicle
inclus, on peut noter premikrement que la division par trois
pueritia 1 iuzientus I senectus,
bien qu'exceptionneIIdS, demeure pourtant l'axe de base autour duquel toutes les autres
dkfinitions des iiges f h n t constituees. Deuxikmement, les diverses transformations de ces
Alcuin, Rabani, M s de Fulda, Papias, Ps--B&de, Lambed. - 21 presenteat au contraire la senecrtls comme la premiike de dew, et parfois mtme de trois vieillesses : Isidore", 1sidodT, Bed&, Hildemu, Ms de Paris, Ms de Chiemsee, Anonyme anglaid , Anonyme anglaiS' , Anonyme anglaks, Honoriusi, HonoriusP, Lambee, Werneii, Guillaume de Conches, Abdlard, Guillaume de Saint-Thieny, Julien, Jean BelethE, Tractad, Romuald de Salerne et Sicard. - 12 pkentent la senectus conune l'unique et demier age faisant suite A la i u u e n t ~ : Remy", Ms de Chartres, Byrhtferth, Anonyme anglaisiv, Honoriusiv, Marbode, Bruno de Segni, Werner', Rupert de Deutz, Jean Belethi, Ms d'oxford, Godefioid- - I 1 dt%nitions sont inclasables sur Ia base d'un tel cr i th , soit par suite du vocabulaire qu'elles emploient, soit parce qu'il est difficik dc savou que penset de leur age interm&diairc, soit pow ces deux raisons simultan6ment : B&deZ, RabanE, Rernf, Honorid, Hugues de Saint-Victor, Tract& , Robert de Melun, Aelred, Alain de Lille, Richard de Saint-Victor et Ikrhard.
W. Sur les 3 1 ddfmitions des ages domt?es dans le tableau I il partk d'bidore qui mentionnent plus d'une vieiksse : - t 6 paentent le seniurn cornme une vieillesse trh avancde, la dewi&me de deux ou trois vieillesses, ou mtme (plus rare) la troisi&me : Isidad, Eugene, Ms de Paris, Ms de Chiemsee, Anonyme anglais: Anonyme angIais" Anonyme anglaisG, GuiUaume de Conches, A#l& Guillaume de Saint-ntierry, Julien, Jean Beleth!! , Tractatw', Tractutd5, Robert de Melun et Sicard. - 14 utilisent plut6t l'appellation aetas decrepita : BMe, Rabanii, Hildemar, Anonyme anglais ', Honoriuri, Honoriusz, Lamberr', Lambdi, WerneF, AbClard, Jean BelethK, T r a c t d , Robert et Romuald,
Cinq noms se remuvent dans les deux list-, soit parce quc les auteurs proposent ies deux termes comme synonymes ("senium uei aetm decrepita"), soit parce qu'ils donnent trois vieillesses.
35. I I ne se tmuve que 4 occurrences de cette division tripartite sur les 64 du tableau I : Ambroise; Gdgoire; Honorius* et Jean Belethi Sur quatre de ces dt%initions, 3 d€couIent de la meme interpdtation de Luc 12,3540. On peut d'ailleun ajouter a ce trio Haymon d'Auxerre (Homiiiae de tempore). Dans I'Annexe C est aussi mentionnee une liste tripartite donnde par A e k d de Rielvawc.
d&fhitions, au d&ut a ii la fin de l'dpoque considC16e id, interdisent de les percevoir comme
de simples redites des dtfinitions de I'ePOque romaine.
Il r a t e a comprendre les liens existant en- le cycle de vie des hommes du Moyen
Age (tel que dessin6 i la section prccedente) et leurs discours sur les divisions des @es. La
section suivante, sut l'emploi des vocables relatifs a w iiges par les Clunisiens, ofliira ddj jh
quelques 616ments de dponse.
D. LA PERSPECTIVE CLUNISIENNE DU CYCLE DE VIE
Une seule etude a trait6 jusqu'h pksent du discours clunisien sur les 5ges de la vie,
a savoir l'article de C. Carozzi intitulC a De l'enfance P la manuit6 : etude d'apres les Vies
de GCraud d ' A d a c et d'Odon de Cluny *I. Comme son titre l'annonce, les sources
employees sont hagiographiques : il s'agit de dew Vitae du corpus clunisien, celle de
GCraud, composee par Odon, et celle d'odon, composC par Jean de Saleme. C. Carozzi
remarque que le ddcoupage du cycle de vie offert dans ces oeuvres ne concorde pas vraiment
avec le schema de la division des 5ges donne par Isidore dans ses Etymologiue? A vrai dire,
'. C. CAROZZI, a De l'enfmce A la mamite : etude d'apds les Vies de Gdraud GAurillac et d'Odon de CIuny V, dans ktudes sur lo senribilitd mr Miyen jge, Actes du 102. Con@ national des rocittb savantes, Limoges - 1977, (Section de phi1ologie et d'histoirc jusqu'8 1610,II) Paris. Bibliothtque Nationale, 1979, p.103-16. ', Le vocabulaire employ6 dans I'unt et I'autre Vie ne s'en &me pas [de la classification isidorieme des
iges] mais jamais aucun des deux ne s'cnfermc dam Ies limites d'unt &ahation numdrique. Ricn ne permet de saisir quel moment on passe d'un b e l'autrc. [...I L,c vieux cadre des ~elafes d'Isidoce de SCvilIe divisb en pCriodes de 7 ans, assez artificiellemcnt, ne put convenu P cette conception. Il y a un decalage ressenti par Odon, entre le vocabulaire traditionnel ct la -lit6 qu'i1 constate- v (C. CAROZZI, a De I'enfance ... m, op.cit., 1979, p.104 et p.106). Sur le fait qu'it faille accorder une importance tr& secondaire aux divisions chronologiques des Iges, cf, la fin de ce chapitre.
Marjorie CHIBNALL parvint h une conclusion assez similaire celle de C, Carozzi ap& avou btudie le discours sur les ages d'Orderic Vita1 (1075-1 142) :
a I,..] Orderic's language when he is not citing documents is inclined to be non-technical, and words may be used with a double meaning, or with different meanings in different places. In indicating age, for instance, he does not consistent1y observe the rough limits proposed by Isidore ; oblate monks may be called both inJantes and pueri ; the same person at the same date may be called both adolescentulus and izrzrenis ; Robert Curthose is even called iuuenk when first betrothed to Margaret of Maine, adolescenrulus
Le contraire elit ete 6tonnant : si le but recherche est me adequation parfaite entre me
definition p&ise des 8ges - rappelons au passage qu'lsidore en a dom6 plusieurs et
qu'elles s'accordent nrrrment entre ell& - et les discours sut les @es de dan Vitae
spicifiques - quels que soient les liens intimes unissant ces deux o e u d - les chances
de rtiwsite sont infimes. Ce qu'il faut cornparer, ce sont, d'une part, les principes qui
rigissent les d6finitions m6di6vales des @es, comme ils oat Ctt dtfinis dans la section
pdddente, et, d'autre part, les mentions sur les g%es provenant d'un ensemble consdquent
de Vitae, de sorte que les w particuliers soient reconnus comme teis et ne genent pas la
comparaison. C'est ce qui sera entrepris ici avec les sources hagiographiques clunisiennes
ddig6es entre 909 et 1 156 et pr&ent&s dam 1'Annexe A. L'objectif vise est, premiiirement,
de voir s'il y a ou non adequation entre les dkfinitions sur les iiges et le discours clunisien sur
le cycle de vie et, deux.i&mement, de nuancer les unes B hide de l'autre, et vice-versa.
La premikre comparaison ii faire conceme l'&helonnement des 8ges : retrouve-t-on,
dam Ies Vitae clunisiennes, une suite des iiges identique P celle obtenue dans la section
prkidente, c'est-&-dire oscillant entre le simple trio pueritia I iuuentus senectus et la liste
Ctendue infuntia 1 pueritia 1 udulescentia I iuuentus senectus 0 senium ? La rdponse ne
poum malheureusement &re donnee qu'au cas par cas - c'est-&dire ige apds iige, en
notant si, a la suite d'une discussion sur un iige d0nu6~ les hagiographes passent bien i 1'8ge
qui doit lui &re subgquent - car il est exceptionnel qu'un hagiographe mentiome d'un seul
after her death, and puer still later, in I068 (a reversal of the normal order) (The EccIesiastic~I Hisrory of Orderr'c Vitalis, Oxfo& Clarendon Press, 1980, vol-1, p.244)
A I'exception du dernier exemple, que M. Chibnall prtrente elk-meme comme une occurrence unique, ies r6sultats auxquels elle est parvenue ne contredisent pas le schdma des &cs tel que prbentt dam la section prticedente.
3. Cf. la section concernant Isidore de Seville dam I'Annexe C. C. CAROZZI justifie sa dCcision de traiter de ces deux oeuvres simultanement en affumant,
premitrement, qu'une partie de la Vim Odonk est autobiographique - ce qui est vrai - et, deuxiemement, qu'Odon etait jeune quand il ddigea la VG1 tout comme Jean quand il rddigea la VO' et que donc le mSme kart de temps correspond aux mEmes rapports mentaux - ce qui me semble un argument plus discutable (a De I'enfance,.. a, op.cit., 1979, p.103-04).
n est f d e de mdtipIier les exemples de semblabfes formulations8. Leur emploi p o d t &re
6voqd pour confumer l'absence d'un tige mQ cians la division m6di6vale des 5ges ; pourtant
cette prewe est inecevable. En effet, un tel couplet "jeunes-vieuxn a survku par-delii
l'trnergence de la maturit6 dans le cycle de vie : aujourd'hui, par exemple, now continuoxu
a en faire usage, bien pue notre vieillesse ne h s e pas immaatement suite ih la jeunesse.
Syrus ofEe en revanche un contre-exernpIe dans sa Yira M i , lorsqu'il6voque la
transmission de la nowelle de la h i o n de Maieul, apds son emprisonnement par les
Preuia fmncr ruens t o m circa conciuerat orbem,/mille trahens seam rumores, mille slmaros,/G.. J- Compertum idpoplli umio sennone ferebmt .-/iabibus et uicis. per compitu perpue plated hoc uir, hoc mulier, hoc tuncque infansque semxqueJ hoe iuuenis, mediurn et si quid iuuencmque senernqudd&pesci% v9
Ce passage n'est pas de la plume de Syrus, mais un empnmt A la Vila sancti Gennani
composee par HQic d' AuxerreIO, qui hi-mgme s'inspira de Sdn5que". On retrouve B
nouveau ici la formule usuelle pour dire qye tout le monde participait B m e activitd don& ;
en en offrant le detail (A savoir homme, femme, enfant, jeune, view, etc.), I'auteur montre
qu'il ne veut oublier personne. C'est dam cet esprit qu'il mentiorme I'homme "moyen", si
', Pour ttmoigner du fait que Mafeul servait d'avocat i tous, son hagiographe Cnumtre les upmperes & diuites, uiduae & orphani, sen= cum iunioribus (VM xv,col. I773B). Pour souligner qu'Odon traitait bien tous ceux qui venaient lui rendre visite dots qu'il etait chanoinc de Tours, Jean de Salerne reprend le cornmandement benedictin a Seniwes uenerore, luniolres difiggete * (RB 4,70-71) en Ie modifiant quelque peu : Odon omit correctionem/uvenum, honorem smum w (YO' I, l4,col.49C). L'abdviateur et I'Humillimus reprirent ses paroles (YO a 10,p215). Sur l'importance du couplet antinomique "jeunes-vieux" dans la littdrature en ancien franpis, cf. P. GAFFNEY, a The Ages of Man in Old French Verse Epic and Romance m, Modern Language Review, 85 (I 990): 571.
9. VM III,6,p.255. lo, Sur cet auteur et son influence sur Cluny, cft D, IOGNA-PRAT, Agni immaculati Recherches mr les
sources hagiopaphiques refarives d saint M a i d tie CIwy (954-994). Paris: kd- du CeR 1988, p. 12 1-4 1. 'I . Lors fun voyage b Naples, SCntque &rit ih son ami Lucilius et tvoque le temps qui passe trop
rapidement ii son gr& : [t.J sic in hoe cursu rapidhimi temporis primum ptieritim abscondimw, deinde adulescentiam, deinde
quidquid est illud inter iuuenem et senem medium, in utriusque confrnio positurn, deinde ipsius senectutis optr'nros annos (SCn&que, epmor., 702).
On ne retrouve pas dam ce passage la forme conditiomelle d'Hdric, avec I'emploi du si ; pourtant, sefon le classiciste Benjamin Victor, I'emploi de quidpid atteste que I'auteur reste dubitatif sur l'existence de cet 8ge intermCdiaire. Au sujet de I'Ige prktdent dam le cycle de vie, on peut noter que, pour Seneque, l'adolescenti. et la iuuenfus ne constituent qu'un seul et mEme Ige (cf. aussi ibi.., 70,l).
jamais celuici existe. L'hfitation d'HCric quant a la possible existence d'un groupe d'&e
qui s ' i n s e d t entre les jeunes et les vieux, l'absence de tame pour ddsigner ce group et
enfin le fait que ce passage de Syrus ne soit qu'un emprunt d'Hetic, qui hi-meme recopia
S6n*ue, sont, i mes yew, autant d'indice de l'absence d'un tel Qe. En effet, si celui-ci
faisait vraiment partie de la division medi6vale des la question de son existence
continuerait-elle &&re poset mille ans ap& avoir 6te fod lce ?
I1 sera maintenant trait6 de chaque iige individuellement, pour savoir quelle place hi
est accord& et ii quels autres iiges il est associe. Pour ce faire, je me pencherai avant tout sur
le vocabulaire employ&. Les caract6ristiques modes ou physiques attachees B chaque Hge
par les Clunisiens seront 6tudik en ditail aux chapitres ID, N et V. Je ne les 6voquera.i ici
que daos la mesure oh elles permettent de miewr adjoindre B un substantifparticulier, tel
I'adulescentia ou le senium, une tranche d'iige donnee, tel l'iige de la post-pubert6 ou l'gge
de la d&xkpitude.
1. L'in fans et le puer
Les tennes infans et p e r ne posent gu&e de dficultes d'interprdtation : ils
disignent, dans la trks grande majorite des cas, un individu dam Ies prexni5res andes de sa
vie, avant la pubertkl*. Le fait qu'ils soient habituellement synonymes est egalement
12. Les exceptions sont doiscut& au fiu a i mesure de ce chapitre. Je n'ai pas trait6 ici de l'cmploi de puer pour ddsigner un serviteur (ct par exernple Gdgoirc le Grand, Didogues, tcxte critique et notes A- de Vogi)C, m d P. Antin, (SC 260) Park hi. du C& 1979, v o u IV, t3,pJ 1). Le cas cst en effet peu courant au Moyen Age central : je n'ai note que trois passages daw m a sources qui appellent p t & e cette traduction. Deux se trouvent dam des anecdotes tr&s similaircs de la P7ta UdiIonrj par Jotsaud. Odilon h i t arrive B l'improviste pour passer la nuit en une dglise de Toulon qui appartenajt B l'ordre ; pris de court, A&aIdm, le e r e en charge du lieu, envoya les pueri rassernbler tout ce qu'ils pourraient trouver pour satisfaire aux besoins du nouveau- venu (a et rnksis circumquaque puerrj domus ad quaerendum necessaria w, YO$ II,miii,col.934B). I1 est malaise de savoir si Jotsaud entendait par ce tenne les famuli ou Ies oblats de I'endroit- Alors qu'odilon Ctait de passage dam une dtpendance de I'abbaye de Saint-Denis, une multitude de fiihes vinrent lui rendre visite.
indiscutable13. La seule vraie question qui se pose ii leur egard est de savoi s'ils sont
parfatement intmhangeables : leper, est-il aussi bien l'enfmt de 0 ii 7 ans que celui de 7
$i 15, et, inversement, l ' infr , est-il aussi bien le gamin de 7 15 am que le baxnbin de 0 &
7 ? Pour ce qui est de la premitre question, la mnse est afbmtive ; il faut se contenter
d'un "probablement non" pour la seconde.
Un foetus peut Etre dt5signt5 par le substantifper, ce qui thoigne d6finitivement de
la tr6s grande extem'bili* de ce tenne. En effet, alors que Gbud est encore daas le ventre
de sa mere, Odon, puis, I sa suite, l'auteur de la Vita absgtk, l'appellent indiff6remment
i n f m et perL4. Plus pr&isdment,puer peut Etre employe des la conception (a [wet: le @re
de Gkraud] Cognovit ituque laorem. qwre jlata condicha visionis puerunr concepit. .IJ), le
Odilon les invita h souper. II s'adressa aux cuisiniers et infioorer du lieu en les appelant egalement pueri (YO# Il,viii,coL922D et 923A). Pierre Damien traduit cette formule par Vexpression quiiabn ac fmilr'cr smiv (VOP co1.933B). Je ne suis pas totalement convaincue que cette interpn!tation de Pierre soit fondee puisque, thdoriquement, seuls des Mres powaient &re en charge de pdparer et servir la noumhue des moines. M a I e tout, il ne s'agit pas d'un mon&re usuel, mais d'une sorte d'infherie ; or dans cellcs-ei, les fmdi faisaient le service (cf, Stat. 24,p.61). La troisierne occunence se trouve dam la Vita Hugon& par HiIdebect de Lavardin : il est question des pueri qui cteus6rent un trou, sous les ordres d'un chanoine, pour construire un xenodochium ( V P II1,15,co1.870C). Tds probablement, il s'agit ici de semitews, mais il faut prendre en compte qu'Hildebert n'est pas un moine et qu'il n'associe peutdtre pas, B la difference des Wres, le pluriel de pueri au group des oblats (d infia, chapitre III, section Cl, oir je discute de sa tra&ormation erronCe du terme pueri, utilist5 par Gilon, en itcniores).
Dam son article = Canonistic Determinations of the Stages of Childhood a (dam Aspectus et Aflectustus Essays and Editions in Grosseteste and Medieval Intellectual Lfe in Honor of Richard C. Dales, 6d. G. Fre~krgs, (AMS Studies in the Middle Ages, 23) New Y o k AMS Press, 1993, p.67-75), Glenn M. EDWARDS essaye de dCmonhPr que la definition biologique de l'mfhce util* par les canonistes etait bien differentc de celles d6jh en usage. Non seulemcnt cct auteur ne semble pas avou trb bien compris les divisions de la vie et le rapport entre puer et infans, mais il accorde en outre une importance dCmesutt celle faisant du puer un simple serviteur.
13. Les exemples oir, dam une mtme scene, un enfant est tant6t appelc! puer, tantiit infm sont nombreux et il serait de peu d'intMt dc tous les rcpmdrc ici. Outre les r6fdrenccs offertcs dans Ics notes suivantes, on peut dgalement mentionner C. CAROZZI, De l'cnfance ... m, op.cit., 1979, p.105 (qui a constate le fait pour la VG' et la V03, VIFii,p39 et ~ I ~ c o l . 1 7 9 8 D - E . 11 d v c Cgalement qu'8 un puer soient associk des actus infintiles (VGt 1,4,co1.645A ct V G 2,p.394) ou vice-versa
14. Neuf jouts avant l'accouchement (cinq, d o n la Vm, l'infm GCraud cna trois fois dam le ventre de sa mere (VG1 I,3,coI.643C ; V@ 1.~393-94).
Is. VG1 1,2,co1.643B. I1 ne faut pas en conclure que Ie foetus Ctait pequ commc un e n h t ddja forme. Odon distingue en effet entre l'enfant encore dans Ie ventre de sa mtre - dgalement appele p a t ~ - et celui qui est d6jA n6 : B ses yeux, Ie premier n'a pas encore ni la raison ni toutes ses facult& pour voir, entendre, paler, etc. L'hagiographe etabIit mtme une cornparaison entre l'opposition foetus/homme d&j& nC et vie sur Terrefexistence &Adam avant la Faute (ou des saints apr& cette vie) :
Num sicut purfus in alvo matris degens, vivit quidm, sed nullurn sensum Irabef. sic omne g e m humanum in huc vim post reatum printi horninis, velur inter unp t ias uteri cI0usum tenetur. ubi Iicet per
de sa mike, jarnais par la suite, m h e s'il use de l'adjectif infmtiIi.3 en parlant du
comportemat d u p e r Odonu. Jotsaud a Piare Damien parlent de 1 'injimtiapuerilis et de
1 'in$ik Odilon tandis que celuki est encore sous la g d e d'une nounice, avant qu'il m soit
envoy6 etudiep. Nalgod utilise l'adjectifsubstantiv6 i n j i i pour decrirc le neveu d'odon
loaqu'il fbt enlev6 avec sa nomice par les Nonnands : la p&ce de cette demik, plus
le fait ipe le petit n'dtait pas encore baptid t6moignent de son tout jeune @e? Renaud de
Vkzelay appelle infm Hugues qyi vient tout juste de dtre? Les riws fois oh un 8ge CW
est donn6, celui-ci ne contredit pas l'impression que 1 'infmtia s'interrompt le plus souvent
bien avant la puberte : un enfsnt de sept am, muet de naissance, est appele tour B tour infm
et puer par un des ddacteurs du LU.*
La Vita de Mdieul par Odilon o E e un indice de ce que peut &re la limite de
l'infantia : cet ige comespond & la m o d e oh l'enfmt grandit au sein de son environnement
familial, tandis qu'ensuite debute sa formation en w e de son m6tier funn :
a Fuit vir iste, beatissinnrr pater noster Maioiuss. prueclaro stemmute ortur ac nobiIibusparentiburpe~igili cura ub ipsa infantiu nobiIiter enutritus. hocedente pueritiae tempore, addictus est eccIesiasticis studiis, ut imbueretur litteris spirifuaiibus. nz4
La m h e impression se degage de la lecture de la Vita Hugonis par Hildebert de Lavardin :
Is [Hugues] cum inflrmitatern evaskset infantiae, Daimatius pater e j u vir scilicet consularis, muterque, Aremburgiis nomine circa erudilonent pueri diversum gerebant @ectwn. P
19. VG1 13-5,~0I.643-45. YO$ II,i,col-915A et VOP co1.927A. Les dew hagiographes utilisent egalement les vocables puer et
pueruitls. 'I. VU' 4 0 , ~ - 100-0 I.
VIF I,p39. LMM II,x,1806D-1807A. Une Ctude dtymologique du term infanr permet de mieux comprendre
I'emploi de ce terrne vis-his de puer. In* signifiait initialement "sans parole" et ce ne f i t qu'h partir du dernier sikle avant Jesus-Christ qu'il servit de plus en plus Mquemment B designer le puer de la premi&re enfance (cf, D. SLUSANSKI, Le vocabuIaire.., ., op-cir-, p.361-62 et p.575). Sur le fait que, aux XIe-XIIe siecles, 1e temepuer dbigne indiffdremment tout enfant entre 0 et 15 ans, tandis que infans n'est utilis6 que pour les petits de 0 a 7 am, cf. P, SIGAL, . Le vocabulaire.-- W, opcit-, 1980, p.150.
". V W ~0I.947-48.
Une fois qu'on a pris conscience de l'importance de cette dsun, il est possible de la d6tecter
en filigrane dam d'autres Vit~e. Dans celle d'Odilon par Jotsaud pat exemple, pour expliquer
quand un miracle eut Lieu pendant P&ce du saint, l'auteur dklare : a Dunr adhucpuerulus
in domo p a i s nutniettu, antequm e t im scholk dmeha m8.
Aiasi, l'inf-a serait bien lapremih phase de l'enfhce, en accord avec la majorit6
des ddfinitions des Hges ttudih dans la section pWente. 11 est plus malais6 de dire si, a
contrario, la pueritia est definie I'occasion comrne designant Miquement la deuxi&me
partie de cet Hge, lorsque daute la formation. Quelques phrases, prises ici ou I& dam les
sources hagiographiques, pewent le laisser mire, mais leur contenu den resterait pas moins
vrai si lapueritia correspondait it l'enfmce au sens large? Plus important est de noter que,
dam la majorit6 des descriptions d'enfaoce, il existe une coupure profonde que marque le
debut de la formationu, coupure qui justifie la nkcessitt5 de dkfinir deux enfances comme il
26. VOJ II,i,col.g 1 SA. ? VB I, p.5 : (I N m peritig tmpora durn transigeret, curie reg& more#uncorum prtxertl~, a pentibus
rraditus at v ; DM I,viii,p.24 : a Hic a pueritia in clericdi habitu adpedes memorandi suncti patr3 Huganis educutrrs.,. w ; DM Il,iiii,p.l03 : Hic matthieu d'AIbano) et rir puericb Iitterk traditus est, ... B
*. A props de cette formation, la question reste ouverte de s w o i si le petit la recevait alors qu'il continuait de v i m dam la demeure famiIiale ou s'rl h i fdait s'en eloigner. L'&hantillon des Vitae sur lequel je travaille ne permet pas d'en extraire une n5ponse claire, d'autant plus que tous les cas de figure sont offerts. Ainsi, l'hagiographe de BaboIein semble distinguer entre le debut des etudes du saint et son entrde comme oblat li Luxeuil (VBa 1-2,p358), tandis que lean de Saieme affme qu'Odon f i t envoy6 chez un pstre pour y &re iduquC dks qu'il fbt sem? (VG1 I,7,co1.46C-D). Odon de CIuny de son cbt6 ne pr&ise nulle part, lorsqu'il dvoque I'dducation eccl&iastique que rgut G h u d durant ses premihes a n n h , si elk lui fbt oEerte chez ses parents ou en dehon (VG11,4,co1-644-45) ; la prcmi8n rCpousc cst probablement la bonne, autrement Odon aurait spCcifi6 la chose ; mais rien n'est certain. LC facteur temps (jusqu'au Xe siMe et aprts) doit &re pris en compte (cf, ICF. WERNER, Formation et des jeunes aristocrates jusqu'au Xe sitcie ID, dims Georger Duby - L Ycritzue de I 'hist~ire~ dir. C. Duhamel et G. Lobrichon, (BibliothQue du Moyen Age. 6) Bruxelles: De Boeck, 1996, p.305). mais Cgalernent le niveau de richesses. Au Xe sikle. G6md avait les rnoyens d'entretenir plusieurs pcrsonnts en sa derncurc ct pouvait ainsi y former dcs ecclCsiastiques (cf, VG' I, 1 S.col.652C) ; en revanche, la familk d'Odon n'dtait peutGtre pas suffisamment aisk pour avoir un pdtre A demeure. Sur ce sujet, mais pour unc p&iode antdrieure, cf. M. HEINZELMANN, a Studiu sanctorum. ducat ion, milieux d'instruction et valnm tducativcs dans l'hagiographie en Gaule jusqu'h la fm de I'Cjmque mtmvingienne w, dam HIM ~ o y ~ n Age - Culttuq Education et SociPIe Meflanges offwts d P. Rich!, dir. M. Sot, La Garennc-Colomk Ed. Europdenne ~fasmt, 1990, p.105-38.
La coupure pendant I'enbce qut constitue la tin de I'aIlaitement a dtC mentionnde par Odon de Cluny et Jean de Salerne (cf, C, CAROZZI, a De l ' e n h ct... m, op-cit, 1979, p.105) ; mais il ne faut pas surestimer son importance. Le premier auteur dCclare simplement qu'ap& cette chre, il devient possible d'entrevoir le caract&re h r de I'enfant (VG1 1,4,co1.6446-C). Les hagiographes d'Odon en revanche ont mentionnt la fin de son allaitement pace que celle-ci conespondait au dtbut de ses Ctudes (VO1 1,6,co1.46C, Y O a h 4,p211 et C/O" 4,coI.87A).
est d'usage dans les d6fkitions du cycle de vie. Qu'il n'y ait pas ensuite exacte adequation
entn les d6finitions et le vocabulaire courant sur ce qu'il faut entendre par infmtia ou
pueritia est relativement secondaid?
D'autres vocables pewent & ik dMgner un enfit mis B part i n f m etpwr, mais
leur emploi est beauwup plus t?pisodique. La formufation recenr nattrs n'appelle aucune
explication tant elle est proche de notre "nouveau-nCn? P4121~lus et p u e d u s semblent
couvrir la m6me tranche d'iige que p e r " , tandis qu'infmfuIrlus est plus probabiement
? Avec, dam mon corpus, seulement deux sources hagiographiques tvoquant le cycle de vie fdminin, dont une, celle d'Addade, qui ne traite absolument pas de I'enfance mais commence avec son mariage A I'iige de seize am, il m'etait impossible d'dtablir des comparaisons entre Ie discours monastique sur le premier age pour Ies hommes et celui pour les femrnes. Ide btn€ficia d'un certain enseignement pendant son enfance, tout comme les gwons, mais L'ablatif absolu de la phrase Iaisse entendre qu'une telle pratique n'allait pas obligatoirement de soi : = IfIis [parents] nimhm olra et humifh pro ratione gerentibzis, praedictupuefla Iitterk imbuta est, usque ad aetatem congrum in annk st& puerifibus. . (M I,2,col-438D). Toujows est-il que ses annies d'enfance ne sont evoqutes que pour transmettre cette information ; autrement, il n'est question que d'Ide adofescenttrla, pueffa ou vrigo, se pdparant ii sa firture &he de mtce (M I2-3,coI,438-39). Je discuterai plus loin de ces diffdrents vocables.
loI VG2 I'p394 : les trois cris que Geraud poussa dam Ie ventre de sa mere dtaient similaires ceux d'un recens natus ; I'hagiographe de la Vita abdg& jugea ndcessaire d'offiir cette pnkision, absente du texte d'Odon,
-Pourpcayufus : VOa 11, ii,coI.916-17 (l'enfant, Cgalement nommdpuer, ne devait pas Ctre tout jeune puisqu'iI se trouvait deja piace au service du saint), VHP II,xiv,p.l04 (Gilon tvoque ici les enfants encore incapables de parler), DM II,xxviiii,p.lSQ (enfants offerts par Ieur @re paysan ik me comrnunautt! de chartreux ; le terme p e r est dgalement utilise), DM iI,xxxii,p. 162 (I'enfant ressuscitd par Maieul etait iige de plus de trois ans ; il est app& puer etpanrufus par Pierre). Dam VG' I,4,644B-C, Ie terme p~nnrfus apparait deux fois pour &signer les enfants ap& le sewage. Dans le plus ancien tdmoin de cctte Vita, la deuxitme mention se trouve ttre pueri et non ponnrfi (BN Iat. 15436, fo1.47'1, Tellc Ctait peutGtre la l e ~ o n initiale du texte puisqu'on trouve dgalement pueri dam le passage cormpondant de la V@ (Z'p.394: ... im quopueri solent irasci.- m), mais ces deux terms 6taient si bien interchangeables que le templacement de I'un par I'autre n'a jamais pose de probltme.
- Pourpuetllk : VU? II,i,cal9 lSA (Odilon est dgalernent appelt p e r ct in* dans cettc histoire qui cut lieu alors qu'il &.it encore tout enht), ~ I ~ c o l . 1 7 9 3 A - B (mentio~e avec per pour d€signer w enfaat qui devait etre trb pmhe de Hge de la pubcrte, comme le l a k e entcndn I'expression . puerif& aetatis non transcendens termimm m), DM I, 1,p.S (puenrIus est utilisk parall&lement avec puw, mais il s'agit du Christ nouveau-nb s'dtant substitut & I'ostie), DM 198,p.28-29 (avec puer ct intans, pour un miracle identique au precedent), DMII,rrxxi,p.l59 (moinillon qui Wneficia d'une vision ; compte tcnu de la complexit6 du dcit qu' il rapports, il ne devait pas etrt tout jcunc).
- Pour les femmes, pueffufu est d'usage peu courant L'hagiographe d'lde I'emploie pour dbigner une jeune sourde qui fbt guCrie par ide. ~ t a n t domi! que, peu apis cette guCrison (. non post longurn tempus suae curarionir m), la demoiselle en question perdit sa virginit6 et devint m8n, il faut supposer que I'emploi de puellula ne sert pas ik dtkigner une toute petite fille (VI 111,10,co1.4434).
- En revanche, dam le cas de iuuencula (E4 I,p.29-30), h la difftrence des autres vocabIes ci-dessus mentionnb, le dirninutif -ula semble remplir sa fonction norrnale, savoir sous-entendre la pctitesse, si bien
tquivalent il i n f d . &mi, I'emploi du diminutif -uhs ne sert pas delimiter un sous-
groupe "plus jeuae" parmi les pen' ou les injhntes, meis donne l'occasion de sodigner la
fiagilrtd enfaathe, pour meta Gautant en valew les drames qu'ils f in tent , et peutdtre
pour faire vibrer la sensibilitt5 de l'auditok. Pour signaler le premier be, hormis pueritia
et i n f m a (et leurs d&iv6s tels annipriles ou anni infanfiies), on trowe egalement prima
ae ta~?~ - comme nous l'avait d'ailleurs dejh appris la lecture du tableau I -, uetutulu
(auquel s'appliquent les memes remarques que pMemment sur l'emploi du diminutif "- u l ~ " ) ~ , pn'mordid5 et annipupilmes @ien que ce denier terme puisse aussi designer les
annees de la iuuent~s)~~.
La fin de lapuen'tia et l'entm5e dans 1'5ge suivant (adiilescentia etlou iuuentus) sont
presque toujours marqu6es par les hagiographes, indice que, pour les Clunisiens, ce passage
Ctait majeur. Odon d&uta une nowelle phase de son *it de la vie de Geraud par ces mots :
a Transmissapueritia, cum jam adolesceret, membrorum robur nocivMn corporis connmpsit
humorem : G 6 d avait en effet 6tk malade jusqu'alon, ce qui h i avait dom6 l'occasion
que le tenne dkigne une jeune fille dans les premieres a n n h de la Wen- Il est remarquable S ce p r o p que ce tennc n'existe pas sans diiinutif, contraircment aux autres pdc&jemrnent dtudiCs.
32. VO" 3-4,co1.86C-87D (uti1W avec p e r c t p u d u s , pour dbigner Odon encore au b e a u ou dots qu'il venait d'Ctre sew6 et qu'il etait place a u p e d'un p&re pour &re Cduque ; mal@ tout, il est encore appek infntufus h la fm de cet episode, avant de retournet chez ses parents, dots qu'il ae devait plus &re tout jeune), VO" 40,col. 100-0 1 (a propos du neveu d'Odon, non encore bapW et soigne par une nourrice), VFV ii'p.258 (rdcit d'une vision qu'eut la mere de Guillaume alors qu'il avait moins d t sept am).
33. VGI I,4,co1.644C (cette lecture ne se retrouve pourrant pas dam les plus ancins manuscritts de la Vita que j'ai pu consulter : A la place de f'adjectifprima, se trouvent les pronoms-adjectifs dhonstratifi his, dam BN lat. 1 5436, fo1.47" et BN lat 1 1749, fol. 122, i ' dans Ars. 162, fol. 1 19': enfm huius, qui est une correction sur un tenne initial qui a Ct6 gratte, dans BN lat.53 15, fo1.6").
VG1 1,4,~01.644B. Is. Cette appelIation peu couraatc se trouve dam la Vita d'OdiIon par Jotsaud : Fuit OdiIo vir beatissimrrs,
nobiIitatis sternmare procream, inter fpso primordia trrnquam dter Isaac Christ0 consecratus* ... . (VOC I,co1.989A)-
M. V.V Il,p.49. Dam la Vita de Hugues ticrite par Hildebert de Lavardin, ks annipupillares ddsignent celles de la ittuentus, puisque les coaevi du saint sont appelb iuuenes (VPi I, l,col.86OC).
". VG1 1,5,~01.645B.
d'6tudier Ie chant a la grammaite beaucoup plus longtemps qu'il n'&t d'usage pour un fils
hentier. L'abrMateur cbntracte ce passage, mais en conserve l'esprit : a Tr~ltcsactupueritia,
cum jam in virile robw exctesceret, injtmitas illa cessavit,.. 3'. Lorsque Jean de Saleme
raconta ces memes annh dans la vie d'Odon, il fit p i e r l'abb6 de Cluny 6 la premihe
personne : a Fuchnn est autem am adolmissem ego - quem mod0 wtulurn i n W s ac
turpem - stremm praedicabant et conspicubilem jwenem mS9 L'abdviateur et
1 'Hmill imu reprirent le ddbut de la phrase, Fachmt estpust hpc, nrm adoIwisset, ... ., tandis que Nalgod, P son habitude, enjolivait (ou alourdissait ?) le texte : a Ernenso pueritie
spacio, cum in pleniorem adolescentie gratim fonnaretw, -.. r Le premier hagiographe
de Maieul ne marque pas aussi clairement l'entrk en jeunesse de son ht?ros, mais l'idde est
pourtant bien 14 sous-jacente : a @sum waieul] ljlorentenz iam iuuenili aetate respectus
supeme prouidentiae in Matisconemi Eccksia Archidiaconatus sublimauitgratia, ... r. Son
successeur, Syrus, est beaucoup plus pecis ( Processu uero t e m m s denasapuen'tia, cwn
eum iam sibi uindicmet adolescentia, ... w), tout comme Odilon (a Juvenili jam imrninente
aetate, ... r), puis Nalgod ( a J m pueritiae metas evaserat, et in jlorem adolescentiae
ferebatur ; w ) ~ ' . Raoul Glaber dcrivit au sujet de Guillaume de Volpiano : a In processu
narnque temporis cum adoleuisset. .. d2. Les dew hagiographes d'OdiIon n'oublikrent pas
de souligner la meme cisure ; Jotsaud remarqua : a Decursis itaque puerilibus annis, ubi
robzr juventutis succedere coepit. .. B, et Pierre Damien a sa suite d6clara : a Quipraeterea
durn ad grundiwculae jam aetatis adolesceret incrementurn, prim qud sanctum Julianum
la. V 6 2,p.394- 19. V O 1,8,coL47A. Le verbe pdolescere put aussi signifier simplement "grandir". Dans l'introduction de
la Vita, Jean de Salerne dklare ne pas pouvoir p a r k ni de la famille d'Odon ni des petsonnes avec lesquelles il a grandi (= progenitomm morum, caeterorumque Gallorum, cum quibus @we adoleuir m, VO' 1,8,co1.47A).
'? V P a 5,p212 (nous vemns plus loin que cette enMe dam l'adolescence ne signifiait pas la fm de I'enfance) et YO" PL 5,co1.87C = F i i 6,p. 134.
'I. VM iii,col. l76SC, VMg I,3,p.184 et VM" 1,4,p.657€. k reviens un peu plus loin sur lc cas un pcu probICmatique de la Vita composde par Odilon. La Vita altera est la seule B ne pas mentionner d'entrde en adolescence. I1 est fort possible qut, pour cet auteur assez tardif, I'adoIescentia n'etait pas separde de la puerifia, mais constituait la derniere &ape d'un seul et mCme Ogc (cf. VM col. 1783). Malgrd tout, ce texte tronqud est extremement difficile & analyser.
''. YCV iii,p.260.
mwtyern factus est clen'w, ... mu. Le r&hteur de la Kta Bzuchardi wcommv m e phrase
de son owrage par D m vero adolescentit atque jwennnis qprrlit annos, ...., tandis que
celui de la Vita Baboleni, s7inspiraat peutdtre du pdcddent, inscrivit : a Ui uutem
adolescentiae, sive juventtctis mnos aftrigri, ... mu. Pierre le Vh&able rtsume en une seule
locution lapueritiu et le passage h l'adolcscence de Matthieu d'Albano : Hic et in puericia
litter& baditus est, etpostquam adoh i t in Laudmemi eccfesiu clericale oflcim adeptus
est, m4=
Dam cet ensemble t k s uniforme, seuls detoment, d'une part, les hagiographes de
Hugues et, d'autre part, cew des deux femmes, Ide et Ad6laide. Dans le cas de ces demietps,
les recits de leun vies w marquent aucune coupure entre l'enfance et la jeunesse. II est vrai
que l'dpitaphe d'Adelaide commence directement avec la mention de son mariage alors
qu'elle avait seize am ; mais l'hagiographe d'Ide Cvoque en quelques mots L'enfance de la
sainte. Une seule Vita ne permet pas de tirer de conclusion gtinhle ; je reviem pourtant B
la question deja posk dans la deuxi&me section de ce chapitre : peut-on v6ritablement parler
de jeunesse dam le cas des femmes mt5di6valesY tout du moins des nobles ? Pour ce qui est
des Vitae Hugonis, Gilon prkise qu'il ne parlera pas de la puberte du saint ; pourtant, par le
fait meme, il atteste de l'existence de ce passage de la vie : a Taceo pubertatis Deo dedicate
tironicia, uolenr progredi ad sequentiu. ma. Ni Renaud de Vezelay ni Hugues de Gournay
n9Cvoquent le passage de l'edance B l'adolescence de Hugues de Semur ; mais ils intercalent
tout de meme une brisure trh nette qui met fin a leur evocation de lapueritiu du saint. C'est
en effet a ce point prdcis dans leurs r6cits que Hugues quitte la maison familiale et entre ii
Clunf7 : or le saint avait pscidment 15 ans ion de cet 6vt!nement?. Hildebert est le seul
43. VOP cot928A et VOi I,coI.S99B. VB 1,p.S et VBa 2,p358.
4s. DM II,iiii,p. 103. VG" II,p.SO.
". Renaud dcnt : I t q e relictis omnibus o s d o nutius evmir et beati Odifonis magisterio se submittens CIuniaci monuchur eficifur. (FW iiii,p.40). Aussitet a p k , il evoque les anni adolescentiae du saint. Je discuterai plus loin du discours d'Hugues de Gournay en ce passage, car il fait de Hugues directernent un homme rnbr ( V P i,p. 121).
''. Hugues h i t nt en 1024 et entra it Cluny en cachette de son @re en 1039 (cf. H . U . COWDREY, = Two Studies in Cluniac History, 1049-1 126 m, Studi Gregoriani, XI (1978): 17). 11 semblerait que Hugues
qui 6voque distinctement pour Hugues m e en- en jeunesse : a Unde cumjm pupiIZm-es
annos uttigisset, e m cum coaatilr [sujt: le p h de Hugues] urgebat equitare jwenibus,
e q u ~ n flectere in gynmr. ... m49.
L'importance accord& par les Clunisiens au passage de la pueritia a
l'adulescenfiaiiuuenitrs est B mettre en p d k l e avec le fhit cpe, dans le mo&, l'arzivde
des obiats ii la pub& entta laait un cbgement radical de leur sta?ut : le d6part de la schola
et I'incorporation dam le groupe des Mres9 symboliste par le rituel de la profession. Cette
question sera traitee au chapitre suivant, en meme temps que sera analyse le discours tenu
dam les coutumiers sur les g r o u p hidrarchiques monastiques.
Comme l'attestent quelques-unes des citations pdc6dentes9 les dew termes
adulescens et iuuenis (ou aduZescentia et iuuentus) sont fidqyemment utilisb comme
synonymesJO ; maigr6 tout, la relation exacte entre ces deux iiges est complexe. En effet,
hormis les Vitae oii ces deux termes sont interchangeables, il anive que, dam certains cas,
l'individu passe directement de lapuerith a la iuuentd', dam d'autres, apes lapueriticr,
suit l'adulescentiu puis la iuuenhJL, dans d'autres enfin, l'adulescentii est mention& seule
apr& l'enfance, puis il n'est plus question d'ige, cornme si la s ' d t a i t la jeunesse? La seule
solution pour comprendre cette diversite de situation est de se refbrer aux principes qui
rigissaient dkjjh le cycle de vie ii la fin de l'epoque romaine. La jeunesse est un ige en soi
qui, le plus souvent, n'est pas ddcomposd : on hi donne alors equemment Ie nom de
iuuentus, mais parfois aussi celui d'addescentia. Lorsqu'elle est dkfinie plus en detail par
connaissait son annee de naissance, puisque celle-ci h t inmite dans la Chronologzb des abb& de Cluny, r€dig&e sous son @ne (cf. BibLClun, co1.1620C ; sur la date de rt5daction de cette source, cf, ibid, cot.1621A)- Le fait qu'il avait 15 ans quand il se fit moine est p*isC par Hugues de Gomay (YHb" xxxiii,~. 139).
49. Vw I,coI-860C. Cf. par exemple V O PL 5-6-7-8,co1.87-88 = Fini 6-7-8-9,p. 134-36, V P I, IO,p.659C, VB I.p.5, VBa
2,p.358, MB 10,p.161€ et C. CAROZZI, De l'enfance ... m, op-cit., 1979, p.105- ". VM iii,coI. l76SC et VOi I,co1.899B. ". DM I1,iiii-v,p.103-06 (bien qu'il ne soit pas tout iZ fait evident que Pierre le Venerable fasse dellement
une distinction entre adulescem et iuuenk). "- VOPco1.928A, W iii,p260, DM I,viii,p.24.
un hagiographe, elle se pdsente comme &ant constitu6e de l'adidescentiu puis de la
iimenftrs. Un tel s c h h a permet d'expliquer la majorit& des mentions des Hges dam les yitae
cluaisiennes. L'exception majeure - quand l'addescentia est prtkntk comme partie
prenante de lapueritia - sera trait& un peu plus loin. Pour I'iaStant, il faut se demander
queues limites sdparent la puen'tia de 1'uduIescenticJiuuentw et Iesqdes divisent
l'adulescentiu de la iuuentw.
L'ilge qui fait suite B Iapueritiu (qu'il s'appelle iuuentus ou adzdescentia) est une
pCriode oh le corps devient puissant, oh l'individu subit des tentations, surtout sexuelles,
acquiert un savoir plus grand et, en fonction de ces dB6rents factem, prend des ddcisions.
Telles sont en effet les divenes mutations qui se dtkouvrent B la lecture des sources
hagiographiques clunisiemes. L'adolescence, parce qu'elle s'accompagne d'un
accroissement des forces, marque la gu6rison temporaire d'Odons et celle d6finitive de
G6raudsS. Les deux apprennent don le mdtier des armes ; puis le premier retombant malade,
son destin reste quelques ann6es en suspens, avant qu'il n'entre Q Saint-Martin de Tours, y
devieme chanoine, se cherche encore en s'adonnant h la pauvret6, puis abandome sa
prtibende pour entrer ii Cluny. Mai'eul part etudier a Lyon, entre ensuite dam 1 ' ~ ~ l i s e de
'4. VO 1,8,~01.47A et YOe " S,p2LZ. Nalgod se montre plus pdcis que ses prt?ddcesseurs sur les changements qui cmnt Iieu dam la vie d'Odon avec la venue de t'adolesccnce. AIors que ce demier avait simplernent appris pendant son cnfance ks rudiments litteratoria, le ddbut de l'adolescence marqua le debut d'etudes sup&feures. Surtout, elk signifia une tranfomation radicale du corps du saint :
Emenso pueritie spacio. cum in pleniorem adolescentie gratiam formmetw, clericalibus studiis futurus clericus smiebafI ETOI in eo temperata totiur corporrj habitudo, stamra solidior et in w n pulcritudinem formo proficiem, qzip inter collactaneos et copspredicabilis hpbwe~rrr.[ ...I [Le +re d'Odon] Advertit injilio copor& elegantiam, flat& accasum, plen&diirem virium,fr~lllamen!a mfclnbrorum. * (VO" PL S,co1.87C = Fiii 6,p.I34).
Je mite des caracttristiques des portraits de beaux jeunes hommes dam la demi&re section du chapitre N. ''. Les transformations physiques subies par le corps pendant la pubert& sont Ie mieux d€ctites dam la Vita
de Geraud par Odon de Cluny. Au sujct de GCraud, il tvoque la force des membres ("robw membrorumn, VG' I,S,co1.645B). Plus loin dans le &it, il dtcrit tgalement la transformation de I'aspect physique des adolescents :
Siquidem nobiles clericos nurrt'ebat, quibuc et m o m honestas, et enrditio sen= certatim adhibebatur. Pubescentibus enim austeriorem se praebebut, dicens guod illius adatis vatde sit periculosum, quando quillbet adolescens matetnae wcis simiIitudiirem, veI faciei deponens, patemam incrfpif mumere vocem vei vuhtm : et qrri se tunc servore studem, faciIe dehinc cumis incen/ivo superaret. w (VG' I , 15,co1.652C).
Miicon, oa il acquiert rapidement les c o m a s ndcessaires aux nouveues charges qu'il
vient d'assumer, puis ddcide de se fairr mohe B Cluny et apprend Y un nouveau mode de
vie. Pendant sa jeunesse, W o n , d'uue part, se dedia corps et b e B la Vierge et, d'autre
part, changea d'habit edh*aStique en passant de Saint-Juien de Brioude & Cluny ; dans ce
demier geste, Iui, k iuueni;s/iunior, fbt guide par les conseils du senex/senio Selon
la Vita de Guillaume de Volpiano, celui-ci, adolescent, s o f i t de l'aiguillon de I'envie, en
m&ne temps qu'il recevait une education sup6rieure B Verceil et Pavie". Bouchard n'est
plus simplement eduqu6 B la cour : il commence A s'y faire un nom. Il c o ~ a i t dgalement
pendant ces anndes de jeunesse le d6si.r sexuel, qui le pousse P prendre femme". Comme je
l'ai dit p-demment, les hagiographes de Hugues cessent d9&oquer l'enfance de celuiti
en meme temps qu'ils lui font prendre son destin en main et quitter la demeure paternelle.
Les dewr premiers auteurs, Gilon et Hildebert, parlent d'un depart progressif : Hugues
convainquit d'abord son piire de le hisser se former aupds de son oncle, 1'Wque
d'Auxerre ; ce n'est qu'ensuite que le jeune homme vola d6finitivement de ses propres ailes,
entra B Cluny, patre nesciente, pour s'elever ensuite rapidement dam les vertd9. Les autres
hagiographes accentuent la rnaturitC precoce du saint en le faisant lir la maison paternelle
pour Cluny". G6rard, moine dont Pierre le Vddrable chante les vertus dans le DM, subit et
vainquit les tentations chamelies pendant ses iuuenifes onni et apptit de plus en plus a aspirer
aux choses divines6'. Matthieu d' Albano, qu'kvoque egalement Pierre, c o ~ u t peu prks la
meme &olutionb2.
D'autres vocables peuvent &re utilisCs par les hagiographes pour &signer les a ~ & s
de jeunesse de leurs hdros. Odon est le seul hagiographe qui semble en &e particuli&ernent
%. YO? I,i-ii-iii.col.899 et II,i,co1.915-16. Le dcit de Piem Damien cst beaucoup moins dtveloppd et ne fait que mentionner le changement d'option d'Odilon ; il souligne malgd tout que celui-ci se plwa sous le magisrerium de MaTeuI (VOP co1.928A).
n. VW iii,p.260. ''. VB 1,p.S-6. 59. V P I,iii,p.SO et VHhi I,2,co1.861A-B. @'. V . i,p.12 1 et VHC III,p.40. 6'. DM l,viii,p.24. *'. D M I1,iiii-vi, p. 104-06.
£iiand : dam la Vie de Ghud , il emploie tour ii tour, pour l'ilge, iuueniora, et pour les
individus, pubescenr (speciti~uement pour les adolescents quittant I'enfmce), uirguncuZus
et iuuencuZ&. Come en temoigne me citation pr6sent& ci-dessus, 1'abrCviateur de la Vita
GeraM use pour sa part du vocable uirifis [&etas] pour indiquer l'ae qui faisait
immediatement suite ii la pueritd'. Le meme emploi de ce terme se retrouve dans les
coutumiers : le moine qui soit de la schdo a vient tout jwte de @tkr l'enfmce est wmm6
un uir et se trowe dans I betas uin'lh? NaIgod a w e m e fois Odon adolescent 8filius jam
adultus m, et Cluny en 5ge d'avoir son propre epoux (it savoir un abb6) afilia jam adulta *,
tandis que Jotsaud parle Y& certainement de I'adolescence dYOdilon lorsqu'il use de la
formule a jam adultus aerate m66. Pour les jeunes fernmes, il semblerait que le terme uirgo
serve B disigner plus sp5cifiquement une fille en ige de se marier. C'est ainsi qu'Ide est
appeMe jute avant son mariage, alors que son hagiographe employait pdct5demment les
appellationspuella et adolescentuld' ; la jeune fille qu'Odon armha A ses parents peu avant
ses noces pour l'entrafner au momstere est nornmde uirgo jam adulto? Malgrd tout, si ce
substantif a put-&re pris, de par cet usage sptkifique, une certaine comotation relative a
I'Pge, il sert essentiellement B d6crire une realit6 physique bien precise et sans rapport avec
1'Pge. Plus gtWalernent, les jeunes fifles sont appelees puellae, telles Ide et deux jeunes
qu'elle soigna miraculeusement ; ces demikes sont egalement nommees respectivement
puellula et mulierda? Le tenne iuuenda est utilid pour Addade (avant son mariage et
meme aprhs, alors qu'elle est m e jeune veuve au tout dCbut de la ~ingtaine)~~. On ne peut
63. VO1 1,9,~01.648A et I, IS,coL652C. Gilon affmne que Hugues de Semur h i t dans l'aetus pubescenr lorsqu'il devint le parrain d'Henri N. Or, nous savons par d'autres sources que cet evdnement eut lieu en 1051, tandis que Hugues etait agt! d'approximativernent 27 am. I1 avait donc traverse depuis longtemps deja sa pubertt!. Je discute au chapitre N des particulari du discoun tenu par Gilon sur la jeunesse de Hugues de Semur, qui s'expliquent peut-etre par des cisconstances politiques spdcifiques.
@. VOr 2,p394. ". Uduf.. IIl,ix,coi.747D-748A et Born I,xrcviii,pllO. 66. VO" PL 1,5,~01.87D = Fini 6,p.135, V O 27,co1.97-98 et YO? II,i,col.91SD. 67. VI I J-3,~01.43 8-39. a. VO' 1,36,c0159A. *. VI 12-3 ,c01.43 8, VI III,10,~01.443C-D et VI N, 16,coL447A. "'. EA II,p29-30. L'emploi du vocable mmom pour designer une femme d'lge mfir ou une femme marite
est relativement rare (cf. VG' I,36,co1.664% et VM III, 14,p269).
donc nia me certaine tendance des aagiographes clunisiens &user de vocables Specifiques
pour decrirr les premi&res anndes de jeunesse de la femme, celles o& elle devient apte ii la
pmcrCation. MalgrC tout, ce vocabulairr n'est pas fhr6, pui~pu'il reste trts d i v d 6 . Par
aillerns, l'emploi rCpetC du diminutif-ufm, qye les auteurs utilisent uniqyement pour park
des homes encore tout enf'ants ou du corps des vieillards, trahit leur perception un peu
patticuliQe de la femme : faite de ddpendance et de fhgilit&
Si le schema le plus classique des Vitae est de fairr passer le saint de lapueritia a
1'adulescentia~iuuentu.s~ it se trouve m a l e tout quelques exemples discordants, dam
lesquels l'adolescence est, parfois peut<tre, parfois ddinitivement, incluse clans i'enfan~e'~.
Dans les sections des Vitae Odonis communes a l'abdviateur et l'HumiZlr'mtcs, il est monte
comment Odon fbt envoy6 B la cow de Guillaume d'Aquitaine pour y &re form6 5 la vie
militaire a czirn adokuisset r., comment il tomba pavement malade dans sa seE&ne ande,
et enfin comment, li l'iige de dix-neufaas, il entra B Saint-Martin de Tours. Or, pendant tout
ce recit, il est uniquement appelk puer. I1 est donc clair que, dam ces deux oeuwes, les
premikres annies de l'adolescence sont consid6r6es comme partie prenante de l'enfance.
Malheureusement, nous ne comaissons pas leur date de rddaction : la seule certitude est
qu'elles k n t kdigCes avant 1 109. La V@ date du kgne de Hugues de Semur (1049-1 log),
mais la V V peut &re aussi ancieme que le milieu du X sitcle. Avec la Vita de Mai'eul
composke par Odilon (103 1 ou 1033), les incertitudes sont d'un autre ordre. Le texte n'est
en effet pas tout I fait clau. Le passage p a n t probkme est le suivant :
a Procedente pueritiae tempore, addictus est eccfesiasficis snrdiis, ut imbueretur Zitteris spirituallibus. Stiperno igitw nutu et divina providentia ac tm est ut tam
". k n'inclus pas ici le cas offert par w e anecdote de la Vim Geraldi d'Odon car je pense qu'il s'explique pat une tout autre pratique du langage- Alon que le comtc d'Autillac se promenait a cheval dans la carnpagne, i1 voit les iuuenes de sa suite manger des pix chiches ap& &re pass& & c6t6 d'un paysan en train d'en recolter. La premiere daction du seigneur fit de penser que les p u d les avaient volb, mais, renseignement pris aupri3 du rustictls, il apprit que ce dernicr les leur avait domb (VG1 1,22,co1.656B). Cette anecdote est dCcrite de mani&re trh entevtk par I'hagiographe, avec la discussion entre le paysan et G h u d retransmise en style direct. Je soupConne I'usage de pueri, pour dkigner le group des cavaliers auparavant appelCs iuuenes, de tenir de ce langage tr& vivant : c'est ainsi probablement que le seigneur appelait les jeunes qu'il "nourrissait" en sa demeure.
bonae spci puer tunc in divii?k aciibus arcfr*us intentus as&, ut totum adoiacentiae mepus sfnc perkuio c o s i i i i ILallslie&, et ita fuctm est u& per t o m vitae spolum dem m copore suo retiheref virginem. Jienili jam imminme adale, dtiota etpotiora in divr'nis, actibra in h m i s sncdiis et g r m i non distdit attentare, et ideo per utmmque exercitatus doctrinam non timuit uccedere Lugdunensem udmmn mn
L'interpdtation de cette citation est reIativement d a i s & : il est poss~'bIe qu'odilon a f t h e
que Mdieul Ctait telIement concentd sur ses etudes depuis la pueritia qu'il traversa
ult&ielaenent I'adolescence sans subir de tentation chamelle ; il est Cgalement possible que
l'adolescence soit pour I'abM de Cluny la phase ultime et sexude de l'enfance. Si cette
dernike explication est la borne, il faudait alors abaisser la date oil I'adolescence devint
partie int6grante de l'enfance 21 la fin du premier tiers du XIe si&cle, et non a la fin du XIc - debut We si&le, comme le laissaient moire les definitions des @esn.
Dam la Vita Maioli de Nalgod et le De miramlis de Pierre le V6n&able, qui datent
tous dew du deuxieme quart du We sikle, on tmuve des exemples cette fois-ci ind6niables
de l'incorporation de l'adolescenria a laperitiu (ou vice-versa). Nalgod appelle B nouveau
Maied unpuer, apres avou sp6c56 que celui-ci avait quitt6 lapueritia et &it entrd dans
l'iige supdrie~r~~. Pierre le VCn6rabIe emploie quant h h i iuuenis comme synonyme de
per'? Ce dernier mode &appellation ne veut pas dire que la iuuentur &it maintenant
incluse dans lapueritia, ou l'inverse, mais il est Gvident que, compte tenu que iuuenis et
~duiescens dtaient synonymes, si le deuxihe devenait I L'occasion interchangeable avec le
=. VM co1.948A. n. Un doute sirnilaire surgit B la lecture de la Vita OdiloniS par Jotsaud (rbdigCe entrc 1049 et 1053). Dam
le deuitme l i m de cettc oeuvre, I'hagiographe s'etend un peu plus longuement sur certains Cpisodes de la vie du saint. 11 raconte ainsi un miracle qui eut lieu dans une dglise d€diCe A la Vierge dots qu'odilon etait encore un tout jeune enfant se depl-t B q m pattes. Jotsaud pursuit en relatant un Mnement qui eut lieu i4 nouveau dam une dglise d€di& A Marie, alors que le saint etait "jim crdultw aetute" (c'cst-&-dire WjA adolescent") 11 conclut l'ensernble en dedamnt : Haec depueriia dicro @ciant. nunc veniendum esf ad ilkl quae jam iit peflectiori aetate p m i . er regimine ubbatiae &coratus, Domino cooperantefeceri~~ (VUP II,i,co1.9 15-16). Faut-il alors supposer que Jotsaud inclut I'adukcentia dam la peritfa, ou sa phrase de conclusion ne fait-eIIe dftrence qu'au premier miracle ? Je pencherai pour la deuxitme solution puisqu'it commenp toute cette section par ces mots : (I In erordio vero vimtum ejus, dicendum quid illicontigerit cum adhuc puer esset, ... =
". VM I,4,pS657E-F et p.657F. 7s. DM II,xxviiii,p. 154-55.
vocable p e r , le mEme phhomtne devait aussi se produk avec iuuenis lorsque celui-ci
semiit & designer un jeune adolescent,
Si nous faisons abstraction & ces quelques cas bien speeifiques, Ie saint, apds avoi
W un i n fdpe r , devenait ensuite un adoIesceI1S/iuuenis. Aucun tern hagiographique ne
pdsente Ie schtma rigoumnr des d6finitions des Hges, avec m e udolescentia claimnent
d6limit&, suivie par m e iuuenttrs tout aussi distinctement chnscrite. On peut simplement
noter, sur la base du phhomtne qui vient d ' k Mt5 mais aussi i partir d'autres passages
des sources, qu'adulescenr sert davantage ii disigner le jeune des premieres m i e s qui
suivent imm6diatement la pubertb, tandis que iuuenis est utilisi de manik plus exten~ive'~.
NOW nous retrouvons en fait devant le meme phinomhe que celui dijii note pour l'enfance :
les deux &apes de la iuuentw k n t dCnornmtks dolescenia et iuuentus par les auteurs de
definitions du cycle de vie, meme si, dam la pratique, ces dew termes etaient souvent
confondus. La question n'est pas tant de savoir ce qui diff6rencie l'addescentia de la
iuuentus sous la plume des hagiographes, que de distinguer une &ape importante dam la vie
de l'homme mkdi6val qui pourrait expliquer l'origine de cette cdsure des annees de la
iuuentus.
- eunesse 3. L'aprh j
A partir d'un certain seuil, les auteurs cessent, sait de faire dfkrence ii la jeunesse de
leurs personnages, soit de les decrire en train d'acquerir tds rapidement savoir et v e d .
16- Si NaIgod, par exemple, emploie indiff&ement itmenis ct adkcens propos d'Odon jusqu'h ce qu'il devienne chanoine de Tours, il n'utilise plus ensuite que le teme h e n i s ( V O PL 5-8,co1.87-88 et 11- 12,co1.89-90 = Fini 6-9,p.134-36 et 16-17,p.138), Dans ses Stoncta, Pierre Ic VMrable fixe rage minimum de 30 am, au pice, 25 ans, pour devenir pdtre, afin, sptcifie-t-il, que des adofescemfes n'endossent pas cette fonction (Stat. 44,p.76).
". Certains hagiographes font progresser leut saint tout au long de son existence (cf. pat exemple LMM II,xix,col. 18 I 1 B), mais cette progression est differente de celle des anndes de jeunesse : il s'agit d'un lent processus, 6voqu6 tth Cpisodiquement au fil de la Vita.
Ceci xnarque, habituellement, la fin de la premih itape de la jemesse : en effet, un individu
continue nodement de se f& qualifier de "jeune" tant Nil n'est pas devenu tout i fait
stable, socialement mais a d moraiemenfn.
Par ailleurs, iI n'est que trts ranment fait mention d'une fin de la iuuentw et Curie
entn5e dam la senectus. Le plus sowent Ie lecteur dtkouvre "par hasard" que le saint est
devenu un senex, soit au travers de formules du style il fit telle et telIe chose usque ad
senectutem (ou wque ad uItimm senectutem) bm, soit clans la longue description de la fin
du h6ros. Ce dernier type de ricit peut malgd tout donner I'occasion am hagiographes
d7&oquer une forme particdike de vieillesse, que j'associerai avec la seconde des
dkfinitions des Sges, a savoi me @node de retraite ou de semi-retraite de la vie active.
Entre le "jeune" et le vieillard commenGant B se retirer de la vie, les hagiographes
inskrent une longue phase au cows de laquelle le facteur temps semble avoir perdu toute
signification. Elle s'appellerait aujourd'hui I'iige mia. Pour l'homme mddikval, il s'agissait
plut6t de la deuxitme &ape de la iuuentur et de la premi5re de la senecfw, a savoir une
jeunesse/iige min qui se transfonnait insensiblement en un iige mWvieillesse. Je traiterai de
", I1 est dificile de fake le portrait des iuuenes mentionnes dans les recueils de miracles, car tr6s peu d'infonnations sont fournies A leur sujet. Mal@ tout, ils sont habituellement pdsentb sans dependant et sernblent avoir une tendance plus marqude que Ies autres miraculb i I'errance, I1 est par exemple question de Pierre, un iuuenis dgalement appeld aduIescens, dam le livre des miracIes de Babolein. I1 vivait de mendicitd parce qu'it Ltait sourd et muet. Amve dam la uiffu des Fossb, il fut log6 par un certain Foulques (Fulco), La nuit de I'anniversaire du dd& du saint, il MnCficia d'une vision dam laquelle Babolein lui apparut et I'enjoignit de se rendre B son &gIise. Ayant miraculcusement tetrouv6 l'usage de la voix, il dveilla aussit6t son hbte et lui conta son e v e : au matin, celui-ci le conduisit jusqu'au tombeau du saint abbd a p e lui avoir place une corde autour du cou, Les moines s*~merveiIl&rent de ce qui ttait amivt et demandtrent des d6tails sur la vision, voulant connaitre Ies gestes accomplis par Babolein pour gudrir le malade : Pierre obtempdra. Cette anecdote est interessante car elle montrc que le miracul6 etait un individu independant, mdmc s'il vivait en marge de la socidte : Foulques le mena jusqu'8 I'Cglii mais c'est Pierre qui raconta par lui-mCme son histoire. Le d&oulement des faits est totafement diff'tent de ce qui survient dam I t cas d'un miracle d'enfant car celui- ci est presque toujours passif, sauf quand, partois, i1 mentionne le nom du saint qui lui a Ct6 miraculeusemcnt transrnis. Un autre exemple de bent3 miracul6 se trouve clans la Vita d'Odilon par Jotsaud (VO? IIl,ii,col.935- 36) : deux jeunes, dont un qui est sourd et muet, emnt en qu&e de la gudrison du malade.
Ces trois jeunes surgis de nulle part, soidisant malades, Cveillent quelque peu ma suspicion. I1 serait intdressant de determiner ce que pouvait gagner un individu il feindtt une guerison miraculeuse : Pierre, avec sa corde au cou, essayait peut4tre d'obtenir une place de sewitcur dam l'abbaye.
%. CE par exernple DM I 3 I ,p.63-64 et IIJ5,p. 143. L'expression incluant u adsenectutem a, de mime que ceIle incIuant 8 ab infuntia n (cf supra) -elks vont d'ailleurs souvent de pair -, doit &re considdde avec une certaine m6fiance car il pourrait s'agir d'une simple formule de style ; je n'ai malgr6 tout jamais note de cas oit elle ttait appliquCe a un individu ttant decddd avant la cinquantaine,
front toutes ces questions de definition, en Cvoquant tour B tour le debut et la £in de cette
longue phase de stabilitt dans l'existence de chacun des sahts de mon corpus
hagiographique.
J'ai d@ souligmi qu'il etait aujourd'hui dEcile de d6terminer avec prticision ou
cessait la jeunesse et oa commenqait l'iige mk. Cette remarque est dgalement vraie pour
I'Cpoque m6dievale : il est malaid de fixer la fiontih Scparant les deux &apes de la
iziuenlus. M a l e tout, les hagiographes hivent aprks les Mnements ; ils Mneficient donc
d'un certain r e d par rapport a ceux-ci, Meme s'ils ne s'accordent pas toujours sur le
marqueur diffirenciant la ptemi&e de la deuxiiime &ape, ils font &f&nce a des dpisodes ou
des comportements bien pgcis qui entdntrent la transformation de la vie du jeune.
Les quatre saints Mques de mon corpus foment bien bvidemment un group a part
puisque les Ctapes marquantes de leur existence diierent totalement de celles des rnoines.
Les Vitae de Bouchard et d'Ide ne posent aucun probleme d'interprt5tation. Le mariage du
premier avec flisabeth, veuve du comte de Corbeil, et la mainrnise qu'il fit dots sur les biem
de sa femme marquent, dam le rkcit de sa Vie, la fin de l'emploi de termes le dkcrivant
comme un iuueni?". Pour ce qui est de sa vieillesse, le lecteur append qu'il atteignit un 6ge
avanci au hasard d'une phrase d6aivant la fin de sa vie. Bouchatd tomb6 malade etait en&
dans l'abbaye des Fossb pour y molair ; gudri, il ddcida d'y rester et prit I'habit monastique.
Les moines s'imerveillhmt alors qu'un tel home, aussi puissant dam le siecle et d6ja brisd
par la vieillesse (a tam nobilis vir seculan' dignitate prgcelsus et senectutis jam iabore
fractris n), accept& de s'humilier de la sorte8'.
m. VB 1,p.S-6. Dam la realitd, Bouchard devint seigneur et maitre quelques anndes avant son mariage, en heritant du comt6 de VendBme la moct de son @re.
'I. VB xip29. NOUS ne co~aissons pas l'annde exacte de la naissance de Bouchard, mais il dut naitre aux environs de 935 et mourut en 1005 ; iI avait donc approximativement soixantedix ans.
En ce qui concerne Ide, aucun vocable relatifl l'&e ne lui est plus asaeid apds son
rnariage et ce, jqd8 son d&s. J3le mourn *& d ' e n h n 73 am ; pourtant, rien dans sa
Vita ne laisse supposer qu9elIe atteignit un iige auai avian&.
La m b e remarque s'applique 6gatement B I'imphtrice Addlade, ddddde vers 1'8ge
de 68 ans : Odilon mentionne bien I'anntk a le jour p&is de sa mort, mais non son age, ni
mime-le fait qu'elle &it 8gCen. Ces constatations sont ii mettre en paraUele avec ce que
j'avais dit pdc&emment sur k grande dticence des auteurs eccl6siastiques P bvoquer la
vieillesse physique des saintes femmep. Odilon n'interrompt pas en revanche l'emploi de
terznes marquant la jeunesse d'Adda%de ni P son mariage ni h la maternit& En effet, trois ans
seulement ap* avoir epous6 le mi Lothaire d'Italie, elle en devint veuve, aloa qu'elle &ait
igie approxirnativement de 19 am. Odilon explique que Dieu lui envoya de nombreux
malhem en ces annk pour Iui M e r de succomber B la tentation de la chair, si courante a
cet iige :
a A- ei [AddaTdel ut vere fatear, nutu divino exterius corporalis @ictio, ne intus cremaret earn, urpore iuvencufam, incentiva cam& libido. L..] b e Seigneur] Iudicubat enim oportunius sibi fuisse, ut ad ternpus temporalibw fuisset occlrpala anxietatibus, quam vivens in deliciis perpefue mortis esset subdita legibm. rw.
Ainsi, malgre les rites de passage que symbolisent normdement le mariage et la maternit6
pour Ies femmes Iaiques, la confrontation de IYh&oIne avec le ddsir sexuel en-dehors des
liens du mariage peut faire en sorte que les hagiographes prolongent 1'6vocation de cet ige
au-dela des b i t e s usuelles. En d'autres mots, meme aprh que la jeune fille soit devenue
stable comme epouse et m&e9 elle reste "potentiellement" une jeune d des circonstances
particdi&es, caractiristiques de la jeunesse dam I'esprit des auteurs monastiques, peuvent
entrainer la r6surgence de qualificatifs tel iuuencula.
L'etude de la Vira GeraIdi d'Odon of i un autre exemple de ce meme phknomene ;
surtout, elle montre bien comment la progression ou la dgression sur la voie spirituelle est
EA 2 1 ,p.44. U. Les chercheurs doivent prendre en compte cette carad6ristique de I'hagiographie Erninhe et ne pas t k r
des conclusions hdtives sur I'iige de ddcb d'une sainte, bas- sur le simple fait que le tthiacteur de sa Vita n'a pas par16 de son grand 5ge (cf. par exemple VI colA44n.)
w- EA l,p.30.
dicrite comrne &ant intimement lide B la progression ou dgression sur l'hhelle des bes. Le
dk& des parents de Wud fit de lui un seigneur ; B ce point du &t, Odon d t e d'utiliser
des terms hroquant la jemesse : Gthud semble Etre devenu un homrne m W . L'imptession
est pourtant tmmpeuse : l'hagiographe a de noweau mours aux vocables tels adolescens,
iziuencul~~~ et tnigtrncuflus quelques chapitres plus loin, lorsqu'il raconte la terrible tentation
sexuelle que dut e n t e r Ghud alon qu'il etait dCj& comte d'Aurillac'6. Puis noweau,
toute reference relative B l'iige d i s p d t de la Yito tandis que les demiers chapitres du
premier Livre sont consac& au mode de vie de Ghud comme seigneur laque. Le deuxieme
livre traite en revanche des aspirations religieuses du saint, de sa grande admiration pour les
cornmuoaut& monastiques et de son dtsir de se fake moine ; or ce livre de%ute par Ie theme
(exceptiomel en hagiographie) de l'arrivee a maturitd de Gkraud :
a Quin potius, maturescente jam uetate, quiburlibet vitiis paulatim compressis, quotidie seipso robustior virfulbus succr~~cebaf~ J m in corde suo quusdam ascensiones disponebut, jam super aZtitudines terrae, juxta illud propheticurn, eminebat. Cerneres auroram sanctitatb ejw in diem festum clarescere, cerneres lilium inter spinas crevisse, et quo vicinior maturitaie/iebat, eo repansos virtuturn jlores dif / ius expnd&se. w"
Ainsi, B en croire Odon, Giraud, m h e seigneur et maitre des pulsions de son corps, n'itait
pas vraiment mk ; il ne Ie fit veritablement que lorsqu'il biitit le monastkre d'Aurillac et
devint un moine rnanq~6*~.
Une anecdote du De Miradis de Pierre le Vent5rable presente le meme type de
discours : la jeunesse masculine prend habituellement fin, dam le monde laque, avec
l'acquisition de la puissance, mais un comportement jugc! inacceptable selon les crit&res
". VG' I,6-8,~01.645D-647D. '6. VG1 1,901 O,col.dQf-49. *, VG1 11, l,coL669C. *. Ghud dtait n6 vers 855 et construisit Aurillac en 894-95, don qu'il avait approximativement qumte
ans. Lonque I'hagiographe d'Ide raconte comment celle-ci se dCdia plus compktement A des activitds "para-
monastiques" I partir d'un certain moment, il ne nous la ddcrit pas comme ayant atteint un ige plus avancC (A la difference d'Odon), mais declare tout du moins qu'elle s'ttait alors Clevde plus haut dans la saintete :
Et quia sancm ut sunctijcetur de virtute in virtutern condescendwe conatut, idem Ida@cirse veracitet not ftca~ur. Eodem namque tempore, quo ilka frequenter versabatur infia coenobium, diu noctuque obse~am/aciemque monachonrm servitiurn, venit admirabike prodigiumfactura ( VI III,col.443 B-C).
religieux de l'auteur annihile les btn6fices cod€* par le pouvoir ; rage r k l est alors
evoqud comme prewe et explication de l'attitude r6pdhensible. Piem mentiome un
seigneur dont les activit€s guerrikes &aient, & ses y e w ddploables ; aussi @ifie-t-il
l'adolescentia du personnage tout ii la fois comme justificatifet cause de ses activit6sR.
L76tude de la £in de la jeuuesse dam les Vitae de m o k est plus complexe parce que
cet ige est p q u e toujours ni6 par les hagiographes ii 17int&ieur de I'enceinte monastique.
I1 ne se trouve qu'une seule exception, le groupe des Yirae Hugonis, qui sera & W e en
dernier. Pour les autres saints moines, les auteurs semblent vouloir kviter de trop parler de
la jeunesse de leur h6os quand celui-ci porte I'habit Aussi, pour indiquer qu'il n'est pas
encore tout & fait miir maI@ sa conversion, ils parlent de prefirence de progression
spirituelle. M a l e tout, I'analyse pnkddente des Vitae de saints lafques a permis de prendre
conscience des liens entre un tel discours et la description de I'avancee en iige.
Pierre le Vdnerable est le seul auteur clunisien ii ma connaissance B avoir spc5cifZ la
fm de I'adolescenceliuueniles mni lorsqu'il raconte la Vie du moine CZmd : a In his [choses
divines] el huimcemodi studiis, toto pene adolescentie tempore dennso, a iam dicto beato
palre Hugone, in monachum surcepfum est. m9". Ainsi, l'entrde au rnonasftke rnarquerait la
fin de cette &ape. L'etude du discours des autres sources hagiographiques dvde qu'il s'agit
d'un symbole m e P t mais chaque cas est particulier. Gkrard f i t simple moine toute sa vie ;
aussi, la prise de I'habit marque-t-elle la fin de son d6veloppement Pierre le Vindrable
souligne l'unit6 de I'existence de Gerard apres sa conversion, jusqu'ii la toute fin de sa vie,
avec l'ablatif absolu : a Istis bonorum operonnn exercitiis, a prima iuuetztute sua ad
ultimam wque senecfutemfke perductis 8 (imentus devant &re compris ici comme l'tige
'9. DM 1 2 7 , ~ - 172. *. DM I,8,p24.
Pierre le Ve'nerable s'attarde beaucoup plus Ionguement sur les annees de jeunesse de Matthieu qu'i1 ne I'avait fait pour celles du moine GCrard. Malgrd tout, il cesse ici encore d'user du terme iuuenis au moment de la prise d'habit monastique (DM II,7,p. 108).
=. DM I,8,p.94.
de la "post-~dolescentiO")- En revanche, d'autres htros devirvent abffi a on a l'impression,
h lire l e m Vies, que ce ne fut qu'ap* leur Clection qu'ils atteignirent leur pleine maturit6.
I1 est evident que de telles limites entre la jeunesse et Pap&-jeuness @rise de l'habit ou
reception de la crosse abbatiale) ne peuvent &re fix- par les hagiographes qu'a poste~ori.
Le falt importe peu ; ce qui compte est l'image de la jeunesse qu'ils laissent ainsi paraitre,
comme l'Hge oii riadividu est en devenir, n'a pas compris encore sa raison d'titre.
Les Vitae d'Odon de Cluny attestent que le tenne iuuenis peut continuer d'ttre utilisd
d o n que l'individu '3eu.e" est d6jji un modkle pour d'autres, s'il continue de se chercher et
d'Ctudier encore. Apr& son entr6e a Saint-Martin de T o m h 18 am, Odon devint un guide
pour beaucoup de gens (a quasi ex aperta bibliotheca. omnibus c o n p a minishabat
exempla m) ; il continuait m a l e tout parallelement d'apprendre et d'hesiter sur son mode de
vie : dam un premier temps, il abandonna l'etude des auteurs pgiens classiques, puis se fit
volontairement pauvre, enfin q u h Tours et entm 8 Cluny. Au moment du premier et du
dernier de ces Cvknements, les hagiographes (Jean de Saleme, l'abn5viateur et I'Humillimus)
emploient l'appellation de iuuenis. Ses confSres de Tours ~'Cnervkrent de le voir perdre la
"fleur de la jeunesse" dans l'etude des textes exegitiques - ce qui sous-entend que la
jeunesse devrait plut6t s'tcouler dam le plaisir et non dam l'6tudeg3. Peu apes son arriv6e
a Cluny, il dut faire face B une accusation de ne pas respecter le reglement : mtme s'il
pouvait se defendre et se justifier, il se plia hurnblement au chgtiment. Bemon en conclut
qu'il avait affaire B un iuuenis patient, chose, sernble-t-il, exceptiomelleW. A partir de ce
moment il l'aima beaucoup : en d'autres terms, l'ivolution d'Odon avait atteint un sommet
spirituel - il avait enfin trouv6 sa voie - et social - Bemon allait le nommer son
hkritier - dont il ne redescendrait plusgs. Les hagiographes metent de classer les 6pisodes
93. VO' I, I ~ , C O I . ~ ~ B ct YOah 9.~215. '? VO' 1,33,coL58A et V O a 22,p226. 95. Dans sa version de la Vita Odonis, Ndgod a jug6 en revanche qu'Odon avait atteint cette "pldnitude"
dks son entr6e Cluny. I1 n'emploie en effet jamais les vocables adul.cens ni iuuenb B son sujet aprh sa prise de ['habit monastique (cf. I'Cpisode de l'accusation au chapitre, Va" PL 21,co1.93B-D = Fini 27,p.144). Aprds avoir mentionne I'arrivee d'Odon A la porte de Cluny, Nalgod dcrivit : a [Odon et Adhegrin] ad societatem fratrum regu Iariter udmircuntur et, initiali professione premksa, in veram CItrisri pleniludinem
selon un ordre chronologique peu aprk avoir &oc@ I'blection d'Odon et son installation
ii Cluny. Le f ~ t que celuici atteignit par la suite un b e avand est mentionnt d&s le debut
du premier Iivre de la Viro par Jean de Saleme. Ce dernier Cvogue ii diverses reprises dam
son oeuvre les senilia membru d'odon ou d'autns cacact&htiques du saint en rapport avec
la senecnrP6 ; pourtant, iI n'est nulle qyestion d'me en&&! en vieillesse, pas plus qu'il n'est
possible de dire qu'8 partir d'un moment pr6cis dans le &it, L'hagiographe commence a
I'appeler senex.
Dam la Vita breuior de Ma'ieul, il n'est plus question de sa jeunwe aprks son
incorporation dam l'~glise de JNkon. Pourtant Ie heros n'est pas encore devenu parfitanent
saint ni n'a fini d'apprendre. L'hagiographe explique son en& I Cluny par le fait que Dieu
u eum ad altioris sumtitatis gradus ascendere voluit. .. En ce Lieu, le prieur Hildebrand le
"nourritt' - enutrienr, teme habituellemeat employe pour evoquer l't5ducation des enfants
et des jeunes - au service de Dieu. Puis, tout de suite ap& dam le rkcit, Mafeul devient
abb6 de la grande abbaye. Le temps - et, par consiquent, l'iige du saint - perd aloa de son
importance. La premikre phrase qui suit la mention de son election en tkmoigne puisqu'elle
r6sume les activites du saint jusqu'a sa mort : Vbi [Cluny] quampiurimam monuchorvrn
nunzerositatern , vitae moribus & doctrina instruem, unte se in coelestis parriae gaudium
foeliciter introduxit mg7.
Mdeul mound A un 5ge t& avanc6, aux alentours de 84 ans. Nous ne savons
comment l'auteur de la Vita breuior conclut son oeuvre puisque sa conclusion ea perdue.
I1 faut donc se toumer vers le texte de Syrus pour connaitre le premier nict des dernieres
annees du saintg8. La VM mentionne une entrde en vieillesse, mais, tout c o m e dans les
transformantur. (YO" PL 1 g,coI.!iUA = Fini 24,~. 143)- %. Cf, VO' lT,8,~01.65D et U1712,co1.84B. La formule f i t aussi reprise par 1'Humillimus : Y O Q b HS,p256
et H6,p.258. Nalgod se contente de dklarer qu'Odon attint le seuil de sa mort alors qu'iI etait apferms dierum et vitae I. (VO" 53,~. 104).
''. VMb vi.co1.1769A-B. ~ ' h a g i o ~ r a ~ h e essaya dam un premier temps de consewer une structure chronologique A son dcit, en commenpnt ses anecdotes par des adverbes tels dehinc et deritde, puis il abandonna cette approche et se contenta d'CnumCrer les miracles les uns ap&s Ies autres.
9B. Syrus qualifie Mareul d'adolescens jusqu'i son entde Cluny (VMs 1,10,p. 194). I1 le dCcrit ensuite progressant de vertu en vertu (VM I,lS,p203), jusqu'h ce qu'Aymard le choisit c o m e son successeur. CeIui-
Vitae Hugonis qui seront 6tudiks ua peu plus loin, iI s'agit plut6t de I'extrhe vieillesse.
L'hagiographe mentio~e en effet le terme senim. Il discute du grand Bge de Maieul pour
nous dire que, mal@ la venue de celui-ci, le saint ne aiminua en rien ses activi* ; poutant,
aussitdt apds, cet auteur nous montre h b b e se ddtoumant de la vie publique, et se
consacrant p~cipalement aux questions spirituelles. En d'autres mots, l'6vocation de
1'enMe en vieillesse sat d'introduction pour traiter le suja C u e semi-retraite :
a Iginn Maiotus senectuth tempore quo solent ceten' remissits uiuere : acri se Iabore in domini studuit senrintent redlgre. Et qwn' tune noma accederet ac iuuenilis uigor in toto corpore ferueret, ita incredibiii mentis feruore diuino fumuZamini insisebat. Corpus namque defatigatum senio, null0 modo quiescere sinebat ab opere conrzIeto- Birnnio Itaque priurquam obiret, coorpus plus solito uiribur cepit destitui et ex hoe uocationis sue tempus adpropinquare deprehendit. Ideogue ad publicurn iam procedere nolebat, [...I **.
Lorsque Nalgod &crivit la Vita Maid, i1 indiqua que, pour h i , ce passage i un autre iige
Cvoquk par Syrus correspondait bel et bien ii celui allant de 1 'aetas prouectior au seniurn :
a Jam provectior aetas vergebat in senium :jam e m ad ot im et quietern ipsa carnis debilitm hortabatur ; spirihu tamen ejus, victor aetatis, sequebatur tirocinii mi Zegem ; et quasi recenter msurnptus in militem, viribw innovatus, in agonejustitiae demdabat. *Io0
ci le remarqua pr€cis&nent pace qu'il avait observd sa progression spirituelle : Cernem intweu uir domini Heimmdw beeturn Maiolwn uritutum pennh ad aha subuehi, terrena cuncta
despicere, mundi gIorim declinare, uerbis pluere, miraculk corncare et toto conamine de uirtute in uirtutem uelle proficer e... ( V ' II,l,p.207=08).
Ap& le &it de I'bleaion abbatiale @, 1-2), Sym ad te de suivce un ordrc chronologique. I1 o f ' un portrait spirituel du saint @,3- L 11, puis commence l'€vocation des anecdotes miraculeuses. La premitre ddbute par le complkment de temps [i&xibm tempore (II,12,p.229).
99. VM IIIZ,p.BO-8 1. Ce passage se trouve Cgalement dam la Vita breuior, mais il s'agit d'une addition postdrieure (VM xwi,col.l78 1 ; cf. l'analyse de cette Vita dans rabbcxc A). L'auteur de la Vita aftera semble s'ttre inspin! du modtle de Syrus pour evoqucr lui aussi une en& en viciUesse :
Maiolus i g i . totitrs stremitat& moribus omatus, aetateprouectus, sicut solitus, membrotum viribur destituebatur, sic animi virtutibus semper imralescebat, & de die in diem in Dei seruitio indefesms profrciebat- ( KW co1, l784B).
Pourtant, cette Yira est telIement tronqu&, fhisant ditcctement passer m e u l du smut d'archidiacre de Macon au rale du saint vieillad, qu'il cst difficile &en tirer des concIusions.
lm. V W N,43,p,666C-D. Nalgad appelle MaTeul un adolarcenr/iztuenis jusqu'a son enwe h Cluny (VMn I, I O,p.659C). Pourtant, il n'dvoque sa perfkcti-on qu'aprts son Clection l'abbatiat et apds son portrait tds succinct, jute avant son premier miracle c o m e abM (= Cum jam fere summos gradus attingeret sanctitatis, ef in vir~utumpIenitudinem ertlpfiset orationisgmtiu, ... ID, vM II? IS,p.66OD). A partir de cet instant, il adopte une structure chronologique t r b kche : i1 place parfois telle anecdote avant telle autre car, dans les faits, elks se suivaient, mais, le plus souvent, it neglige de faire toute dference au temps.
Avec Guillaume de Volpiano, il n'ttait par possible de f* cohcider l'entde dans
l'~~.glise avec l'arrivk ii mafurit6 puisque Ie saint wait pris L'habit d&s I'@e de sept ans I
l'abbaye Saint-Michel de Locedia Aussi, Raoul Glaber interrompt-il les mentions sur
l'adolescence de Guillaume aussit6t ap&s avoir hroqut son en- en cet b e et avoir trts
sch6matiqyement we ses tentations et SCducation qu'il requt en ces an-&. Il explique
ensuite les diverses fonctions de responsabilit6 qu'occupa Guillaume dans l'figlise et, prewe
incontestable de maturitk, iI le decrit guidant son p6re vers le rnona~tete~~~. A l'autre e d m e y
il n'est nullement question d'une en* en vieillesse, mCme si Guillaume dec6da I l'ige de
69 ans'02.
Le meme cas de figure se pdsente avec Babolein qui, aux dires de son hagiographe,
entra comme oblat I Lweuil : aucune pdcision n'est o f f i e sur le ddoulement de ses annks
de jeunesse (a anni adolescentiae sive juventutis m) apds que l'auteur ait afErm6 qu'il les
avait atteintes ; mal@ tout, le dcit enchatne immCdiatement avec une description de
l'&oiution spirituelle du saint Quand celle-ci prend fin ap& quelques Lignes, il est clair que
Babolein est devenu un etre parfait1o3. Presque aussit6f il remplace Colomban sur le sPge
OdiIon &te quant B lui de parler de la jeunesse de Maeul dans la meme phrase ou il mentionne son entde dans cet ige et son depart B Lyon pour dtudier (VIM" co1.948A). De cette ville, il suit le saint jusqu'ih Miicon, puis de Miicon jusqu'i Cluny. En ce Iieu, il Ie d&rit progressant trh vite dam les vertus au point d ' h nornmC abbe six ans seulement apds son anivee. Le ecit cesse ensuite d'ttre chronologique. Odilon offie le portrait physique et moral du saint, monte son activite dfomatrice et ses relations avec les Grands de ce rnonde. I1 passe ensuite directement au dcit de sa mart, sans avoir fait mention d'une en- en vieillesse.
'01, YW iii'p.260. L'en- Cluny fbt tardive et ne marqua pas, dam Ie cas de Guillaume, la fm de sa jeunesse. D'ailleurs, lors de son h v 6 e dans ce rnonastkrc, il ne fbt pas cequ comme le dernier selon I'ordo, mais ht immediaternent promu une position supdrieure par MaTeul (VW v,p266).
la', Le &it du dk&s commence par une phrase expliquant que le saint &ait consid& par tous, mCme ceux qui dtaient les plus haut piactis de la hidratchie, comme leur supCricur :
a Beatitzido igitur patris Willelmi im ad tantam excreuerat arceIIentim ut cunctas Latii ac Galfiarum prouincirrs @sitrs wnor ac ueneratirbpenetrare~ Nam reges ut patrem, pontfices ut magistrum, abbates et monachi ut archagelum, omnes in commune ut Dei amicum supJue prgceptorem salutis habebant. (VW xiiii,p296).
Cette place d'lminence, Guillaume I'a atteinte B la fur de sa vie ; il ne faut donc pas voir la fin de la jeunesse comme marquant l ' d t complet de toute progression du saint.
I*. Je reproduis un long passage de cette section, car c'est un v6ritable programme spirituel en plusieurs &apes qui est ici offert par I'hagiographe.
a Ut outem odalescentiae, she juventutis mnos attigir, semper de magnb ad rnajora, de mediocribus ad excelfentiora scandere certabat virtuturn erercitiir. [...I . Timor enim Domini initium est sapientiae Orationi quoque itu erat intentus, ut divinae contemplationi cerneretur esse conjunctus. Dehinc orationi adiungebatur lectio, atque sanctarum Scri@ttrarum meditatio. Postremo vero scribendi exercitatio. [..- ]
de Lweuil. La Yiro se conclut avec le &it de sa mod. Bien que l'hagiographe commence
celIe-ci en insistant sur les nombreures Wsations de BaboleidW, il ne prkise pas s'il
mourut view ou non.
Piem Damien n'usa plus de termes relatifi il la jeunesse aprts avoir d k l d
qu' OdiIon avait atteint cet glge ; mais iI faut pdciser qu'en deux phrases, hcluant celle oh
il fit cette annonce, il dklara que le saint etait deveau clerc ik Saint-Julien de Brioude, puis
ttait entre B Cluny, dont il devint abbe dans les quatre ans qui suivirentlO*. Ainsi presque
immkdiatement aprh avoir evoqu6 l'entde en jeunesse du saint, l'auteur le fit traverser
grand pas plusieurs &apes fondamentales de sa vie. Malgd tout. l'impression que le hdos
ttait encore a cette mque un jeune ne dispamCt pas irnm6diatement. puisque Pierre evoque
dew fois la question de la progression quad il parle de ces m e e s de de la vie d'Odilon :
a [i vient d'arriver a Cluny] Ubi dm quietus et simplex h i l i t e r in sancta religione persikteret, et in @so rudir ac novitiae conversationis exordo, quaedam jam in eo perfectionis insignia praelucerent .... Mafed d&de et il devient abbd] Jam vero in commissi regiminis sollicitudine comtitutus, pplurimk sanctae religionis coepit florere virtutibus dM
Par la suite, bien que le saint soit encore dtcrit comrne progressant sur le chemin des
vert~s '~ , il den est pas moins dvident qu'il a deja atteint un certain somrnet et une stabilite
dont il ne descendra plus. L'Coulement du temps n'a alors plus d'importance : la premiere
Succedebatque sanctu compunctio, & in cubili cordis jugis Dei vkio. Coritute denique sic erot plena ut per hanc Deo placeret, & hhorninibus. n (ma 2,p.358). IM. Sanctm autem Domini Bobolenus dwn mu110 kabore jamdictum constmxikset Coenobium, multus
ibidem coadunavit Fratres, Chrtjto semper &vote fmukantes ; w (ma 28,p.371) lM. VOiP c61.928A. Dans les fits, Odilon, n6 en 961 ou 962, fut phcd encore tout enfant it Brioude (cf, VOii
I,co1.899A). I1 entra B Cluny dors qu'il &tit agt de 28-29 ans (vers 990) ct en devint abM vers I'4ge de 33 ans (994). Comme rien ne certifie que P i m t Damien connaissait ces donnks, on nc peut confronter son discours avec la realit&
Io6. VOP coL928A et B. Io7. a Kr i ' s a n c l t c s cum in bonk moriburper quotidiana piae conversationis incremenfa mccresceret,
seseque quotidie mefior cuiperfectio'anis culmen ferventius anhelmet, coepit nonnulli3 cowscare miraculis (VOiQ co1.930B). C'est par cette phrase que Pime Damien commence le *it des miracles accomplis par Odilon a p e avoir trait6 de son comportement et de ses qualie. I1 est Cvident que, pour cet auteur, le pouvoir d'accomplu des gutrisons n'est pas innt, mais s'acquiert par l'exercice des pdnitences et des vertus. Aussi, lorsqu'il monte ce qu'il considBre Ctre le premier miracle d'Odilon, iI explique pourquoi le saint rdcita des prieres en cachette par le fait que a ut puta quia talia nondum expertus (VOiQ co1-930C).
anecdote qui fait mite h la citation pr&dente evoque la demiere atztl6e de la vie du saint'O8.
A l 'edrne fin de l'oeuvre, Pierre Damien Hise qu'odilon dCcdda l'Qe de 87 ans, ap&
56 ans ii la tete de Cluny I*. Or, daas 1es historiettes honctcs entre le dcit de son election
et celui de son d&, si Odilon est parfois pdsent6 comrne un vieillad, il n'a en revanche
jamais b i t A me "en* en vieillessen : les de son grand 4ge ne sont absolument pas
dissocitk de celles qui L'ont prWd6. En revanche, il est fdt mention d'une "entrte dans la
rnort" : a Porro cum vir Dominijam in extrernis ageret quinquennium fere contpul~~l~ est
gravissimi ianguoris molestia cruciari mHo. En dsum6, am yew de Pierre, la jeunesse
d'Odilon finit au moment de sa nomination A l'abbatiat ; les m 6 e s qui suivent sont
indB6renciks jusqu'au seuil de la mort Bien que, techniquement parlant, Odilon soit entr6
d m Ie senim B la £in de sa vie, il d e n est nulle question ici.
Ce mCme phtinomhe a p p d t de manitre encore plus 6vidente dam la Yira Odilonis
Ccrite par Jotsaud et dont s'inspira Pierre : le terme iuuenis est utilisd par L'hagiographe
jusqu'l l ' e n ~ e au monast&e du saint ; malgr6 tout, il lui reste ensuite des 6chelons B gravir :
Odilon est encore une brebis (ovis) nouvellement tondue, la premike par ses actions, mais
la dernikre selon l'ordo. Puis Maeul d&de et le nouvel abbe devient en trks peu de temps
conforme a I'exemple des saints, a savoir le guide qu'il faut imiter et craindre"'.
L'hagiographe cesse alors de suivre la chronologie : il ofie le portrait physique et moral du
saint, comme si celui-ci Ctait rest6 exactement le meme pendant les cinquante-six annkes de
son rtigne. Cette description du corps nous apprend qu'odilon, quasi immuable et parfat,
n'etait pas un titemel iuuenis, malgr6 son jeune 5ge au moment de son Clection : en effet, il
lo'. VOiP ~01.928-29, Im. VOip co1.943B. I1O. VOP c01943A. ' ' . [Aprb I'entde au rnonast&re] Jam sumpto h b i a videres nastram ovem inter alias primam opere,
extremum ordine, aeternae viriditatis parmu requirere, lucetnarum minirteria conchnare, infanfum clistodiendorum excubias observare, pmimenta verrere et quaeque vilia oflcia humifiter [virifiter dam Ars 162, 1 ! 17 peragere. ( V ' j I,iii,co1900B). [Aprb l'tlection comme abM] Succepto ituque regininis oficio, nragis ac magis sanctorum conformabutw exempfo, et in omnibus coefesti adornabattrr magisteria Pruelucebat in eo quoddam insigne documentum, quod sub,jecrlc imitundum =set et timendurn n (VOi I,iv,co1.900D).
est fait mention de sa blanche chevelun (. crmire decorattis m1'3. Jotsaud recommence
seulement B s'intksser ii l'horloge du temps lorsqu'il dccrit 1'"ene dans la mortn du saint
(a in extremis itaque vitae suaejklicis memoriae Odilo per quhquennim novis i t e m et
gravissimis mciat ibw coepit vehementet am@. m) 9
La pdsentation de la division des iiges daas les Vitae Hugonis Were sensiblement
de celle des autres Vies de saints abbts, parce que la premi&e Vita par Gilon de Toucy, qui
s e ~ t de modde I toutes les autres, accorde m e t&s grande place & la iuuentus du saint Cet
auteur krivait sous les ordres de IYabM Pons, qui prit le powoir tr& jeune, ualde iuuenis aux
dires de Pierre le Vt5n&able114. Tds certainernent, il chercha ii consolider la position de son
sup~rieur en dressant le tableau de Hugws, simultan&nent jeune et abbe tout-puissant,
estim6 de tous, au sommet de sa gloire et de sa vie. le discuterai de cette question politique
et de la reaction negative des hagiographes successifk face a l'image de la jeunesse ainsi
vihiculde, dans le chapitre IV coma& ii cet Sge. Pour I'inStant, l'important est de remarquer
que, si la Vita de Gilon contredit mon hypothhe - selon laquelle un saint est appelc5 un
"jeune" tant qu'il est instable -, des motivations tris @ci.fiques expliquent ce phenomene :
cette oeuvre est en quelque sorte l'exception qui confirme la r&gle. Un indice de ce parti pris
de Gilon est offert par 17extr6misme meme de sa position. Pour que la jeunesse de Hugws
soit indiscutablement associ6e ii ses ses&s de gloire et d'action, il la prolonge bien au-deli
des limites usuelles. I1 commence en effet son livre II, consac& aux demikres activites du
saint (reconstruction de Cluny, riception de novices, meme s'il avait 6t6 d6ja question de ce
sujet B diverses reprises, et enfin maladie et d k b de celui-ci) en afknant :
"*. VOi I,v,col.90 1A. 'I3. VO? I ,xiv,col.909A, 'I4. Cette accusation fitt portee contre Pons par Pierre Le Vdndrable dam son De miramlk (DM n,xii,p 1 17),
mais il nTCtait pas le premier II l'avoir fomulde ; dCj& le parrain de Pons, le Pape Pascal 11, I'avait prononcde A son dgard. I1 avait refuse pour cette raison que Pons devienne Mque de Lirnoges et I'avait encouragd ii entrer plutdt & Cluny (cf. Cadaire de I 'crbbuye Scrint-Berlin, B. Guhrd, (Coll. des cartulaires de France) Paris: Imprimerie Royale, 1841, Pars2a,lb.&LXXXT,p280 et H.E.J. COWDREY, a Two Studies in Cluniac History 1049- 1 I09 n, dam Studi Gregoriuni, XI (1 978): 194).
a lam decumo fel'iier iuuentutk stud20 pater s m c ~ s i m u s sexaginta quihque annos a naiuitate gerens a susceptione regiminis @u,ginta numerabat ; atque ut 0ssoZet gefida senectw laborum immeltsllate adducta feruentiorils robur aetatis sensim subtdiebat.
Cet extrait semble confirmer qw, dans l'esprit de I'homme meditval, la iuuentus est
imm&iiatement suivie de lasenectzs. Uais alors qu'habituellement, les hagiographes cessent
t& viie de park de la premi&e7 GiIon choisit la position exacternent inverse. II ne fait pas
cl6re la jeunesse ih 65 am mais son discours est mffisamment ambigu pour qu'il semble
associer a cet ilge la c5sure de la fin de la iuuentwdel,ut de la senectw. Le portrait qu'il trace
de la senectus et 17&e d'enttie tardifqu'il lui assigne tdmoignent que, pour hi, la senectus
est la d e d h &ape de la vie, celIe de la semi-retraite.
Les autres hagiographes n'ont pas repris ce discours t d s louangeur sur la jeunesse,
car il est contraire au discours habituellement en vigueur dam les Vitae monastiques.
Hildebert de Lavardin et Renaud de V6zelay conserv&ent les coupures des iiges faites par
Gilon, mais s7appliqu6rent B nier les signes de jeunesse d'Hugues pendant ses annies de
pouvoir : ils n'&oqu&ent aucune des qualitis qui auraient pQ Stre associees ii cet lige, mais
uniquement les ddfauts, tout en montrant comment le saint les surmonta avec succksH6.
Quant a Hugues de Goumay, il avait comme premier objectif de dsumer radicalemeat la
Vita ; aussi, choisit-il une solution plus simple que celle optde par ses deux prdddcesseun :
il ne dit mot de la jeunesse du sixikme abbe de Cluny, ni lors de son ascension au pouvoir
'I5. VHP If,i,p.90. 'I6. Je ddmontrerai ce point au chapitre IV, Hildebert a repcis l'idk de Gilon, de mentiomer la fm de la
iuuenfus-dCbut de la senecm en rapport avec l'tlge de 65 am, mais ce meme passage refonnult sous sa plume transmet une image tout h fait differente de la jeunesse :
Jam lubricae juventutk oflendimfa vir s a n c ~ inoflensis gressibus evaserat. a nativitate quidem sexaginta q~inque~ a susceptione awem regthinis, mnos gerem ~acliaginta Cafefaciebat e m virgo saientiae* warn beatus senex vefut David ampleatus.lus. (W W,3 8.coL883C).
En outre, cet hagiographe avait &voqu€ Wge avanct du saint bien plus tdt dam son k i t . I1 avait en effet qualifik Hugues de Christi veteranus et parlt de sa smta senectw lors d'dpisodes, oh Gilon n'avait dit mot de I'ige du saint ( V ' IV,27,cot.877B=YIir Ipcxii,p.77 et YHbi V,3O,cof.878D=YFF I,xxxix,p.81).
Renaud de V&elay d t e de suivre un ordre chmnologique mais privilegie une organisation thdmatique aprb que Hugues soit devenu abbd. I1 place ainsi pnsque A la toute fm de son k i t les anecdotes concernant les liens entretenus par le sixikme abM de Cluny avec les Grands de ce monde. Parmi celles-ci, il s'en trouve une dont une partie de la valeur a i d e dam le fait que Hugues Ctait alon un adoIescem (VFf xxxvii,p.56). Je pense que cette mention trb tardive de la jeunesse du heros s'explique par la structure inhabituelle du texte- m6re dcrit par Gilon.
ni par la suite, le faisant directement passer de l'enfance a la maturitd. La fin de lapueriticz
du saint est marqude par son d- du monde h-que et son en* & Cluny. Aussit6t, il n'est
plus question d'iige et le jeune convexti cbient un exemple pour les autresy m d'autres mots,
il a totalement achev6 ses anates d'apprentissage :
a Hicpuer intemperadm curialiton sectmi n o l a mansuetudinem crrm simplicitate retimit. Impudicos et raptores ubhorrul~ pietati seruire deuotus elegir. Unde factum est ut imdlspentib2(~ admonasterium firgeret seque saneti Odilonis Cluniucemis abbulis magiserio cornmemet Fadus itaque monachus, fanturn sfafim religionis apicem ascendit ut quos imifari uenerat h b imifandi exfiler& .'I7
Deux phrases encore et Hugues devient Ie nouvel abb6 de Cluny.
Avant d'extraire M schema explicatif simple de la manitre dont les hagiographes
clunisiens divisaient le cycle de vie des hommes adultes, il est Jcessaire d'approfondir
quelques questions de detail sur l'dvocation des demieres annies de la vie.
L'etude prkedente soul6ve la question du vocabulaire utilisd par les Clunisiens pour
Cvoquer la vieillesse des individus. Pour comprendre la distinction existant entre senectus
et senium, deux facteurs doivent etre pris en compte. Premikement, si senium signifie padois
I'iige ultime de la vie humaineH8, il a aussi conserve le sens qu'il posskdait pendant
I'AntiquitC tardive. a savoir celui de d&lin119. Dewiemement, il existe me cassure pendant
l'dge de la senectus @is au sens large) qui permet de Merencier entre deux palien et
explique la n6cessit6, pour les auteurs des dkfinitions des iiges, de parler de dew vieillesses.
I1 se trouve d'abord une phase dam la vie des saints o t ceux-ci sont b I'occmion appeles
senes, souvent pour pennettre & l'hagiographe de domer m e certaine saveur & l'anecdote
qu'il monte. Si on inclut dam cette categorie les diverses occurrences oh Ie grand 5ge du
It'. V P i,p.lZI. ' I8 . Cf. par exemple LMM I,xiii,coI. 1793C. 'I9. Ce sens se retrouve surtout quand il est question du sen- d'une institution ou de I'hurnanitC. Cf. par
esemple DM 1,9,p.36.
saint n'est mentionni que dam le f i t de sa fin, nous arrivons ii la conclusion que les
hagiographes ne distiaguent habituelIement pas entre la maturitt et la vieillesse : celle-ci
prend place dam l'existence du saint sans en rien changer. En revanche, il existe quelques
cas de figure qui indiquent que I'ultime vieillesse p u t s'accompagner de transformations
radicales dans la vie du saint ou de tout autre persomage secondaire. L'hornme &t s'est
alors nitid de la vie active de diverses manikes qui ne sont pas mutueIIement exclusives :
soit en prenant be1 et bien sa retraite aprb avoir nommk un successeur (ainsi que firent
Bernon et ~yrnard'~?, soit en se consacrant de plus en plus & la p r i h et autres activites
spirituelIes, soit en se delestant d'un large nombre d'obligations m o d q u e s . Je traiterai de
ces diffirents aspects de la "retraite" au chapitre V.
A I'exception de senex, senilis, senectus et senium, de aombreux autres termes sont
employ& pour 6vqueer le demier 8ge ; ils n'ont pas tous la miime connotation. Les adjectifs
annosus, grandaeuus et longaeuus peuvent Stre appliqub a un saint - Odon qualifie G a u d
d'annosus et Nalgod appelle Mdieul le lorzgaeuus viatort2' - mais leur coloration est
relativement neutre. Ainsi, Nalgod emploie m o m s dam sa Vilo Odonis au sujet de Bernon
pour souligner le fait que celuici etait d6cid6ment trop vieux pour continuer I diriger ses
abbayes et devait definitivement se trouver un remplaqanttu. Le substantif matwitas et
I'adjectif grmis permettent d'&oquer aussi bien Le comportement milr d'une personne que
son iige avance : Gilon parle de 1'. inbecilitas matwitatis * de Hugues au seuil de la mort,
tandis que Jotsaud pdsente Odilon cornme un a senior iam grmis p o .IU ; ainsi, dam un
meme terrne, se codondent 1'3ge et m e caract6ristique mentale jug6e positive par les
moines. Ce phenomkne est encore plus kvident avec le vocable cmities. Celuiti est
r~solument positifet son usage est presque exclusivement r6se& aux saints ou aux envoy&
Im. VO' 1,38,co1.60C, VO" 27,co1.96B-C, YlCf col9SOC, V . 111-l,p207-11, V M II,l2-13,p.659-60. "I. VG' 111 Praef,689B, V@ Truns i . I,p235 et W IV,44,~.666E. In. Interim Betno ubbas annosa smfi gravitate &tIciens, exitiali etiam languore correprus decubttir.
Urgebatur duplci molestiit, aegtitudlnis et adatis, dque ad rollenrlhm & medrb v i t m ejus morbus n senium in eodem corpore cornpugnabanti w (VO" 27,coL96&C). 11 est dvident que I'hagiographe veut convaincre son audience de I'absolue ndcessid pour Bernon de se nommer un successeur.
'=- VHs If ,vii,p.97 et YO3 Sackur p.120.
cdIe~tes~*~ : il marque littkdernent m e chevelure blanche etlou alkgoriquement la maturitC
spirituelle. Il est inutile de traiter ici de I'adjectifmtiquus car celuici signifie "ancienn a w n
"vieux" ou "HgP : son usage ne renvoie pas I I'ilge de la vie humaiae, mais aux decennies
et awc siiicles d6jh &oult% de l'histoire du monde : on peut tout de mtme souligner que,
m a l e sa Wuente association avec le Diable ( ~ * q m s hostiQm, il ne semble pas avoir un
sens dtpdciatif? L'adjectif uetus est surtout associb avec l'injonction padhiemre
a Deponere veterem hominem (Eph. 422 et Col. 3,9)1n, d'oh sa coloration
occasionnellement ndgative, accentuee par le fit que ce terme s'applique indiffikemrnent
aux objets et aux hommes, tandis que senex et ses d6rivb sont quasi exclusivement r6serv6s
Iz4. Pour un saint, cf. par exernple VOj I,v,col.90 IA. Pour un envoy6 celeste, cf. par exemple VO" 49,p.255 et V@ 29,co1.97C.
Is. Par exemple VG 4,p395. Le Diable est Cgalement sumommd le vieux serpent (uetw serpem, V O Fini 12,p. 137 = PL 9,co1.89B) ou Ie pillard 8gt5 @raedo v e t n u r VOP p,I 19). Sa fourberie est ancienne (uefernosa Jrm, VG' 1,9,co1.648B) et sa peste, v6tuste (uetwa pest& DM I, 15,p.S I).
Odon 6voque par exemple les "anciens" (antipi) qui appelaient la n?gion de Gdtaud la Gaule celtique (VG1 I, I ,coI.64 1 D). Jean de Saleme appelle ant ipus Pat* un P k c des premiers temps de 1'~glise ('VO ProL,coI.rldA) ou Vat- anfiqui les prophetes anciens (YO' lI,l2,col.688). Eudes de Saint-Maw-des-Fossb nornme antipi patres les moines du lieu qui enterrtirent Bouchard quelque cinquante ans plus t6t (VB XII,p30). L'hagiographe de Babolein appelle anfiqui aussi bien les contemporains de Jules Cesar ( VBa 9.p.361 = Recueit p565D) que les hornmes plus Sgds qui lui ont conte certains miracles de Babolein (MB 1,p. 1590. Hildebert de Lavardin a f h e que Hugues rdfonnait des abbayes pour leur faire retrouver leur dignitas anfiqua (m 11, I2,col.869A). L'adjectif anfitpas est aussi Wquemment applique pour qualifier un objet, par exemple les histoires anc ie~es , hktoria a n t i p a (DM II,Prol.,p.94), ou le temps passe, fernpus antipus (Stat- 22,p.60)-
In. Elk est souvent reprise dam les sources hagiographiques monastl*ques, par exempk VOi UI,co1.899D et DM II,7,p.IOS. On doit aussi Cvoquer le uetw du U e m T~amentum, qui a une connotation Mg4rement negative face au n o w du Nouum Testamentum-
t'opposition nouusfuetus n'dquivatait pas exactement au couplet jeundvieux pour I'hornme du Moyen Age : nouveaulancien ou us4 peuvent Ctrc I'occasion des adjectifk plus appmprib pour haduke comctement I'allkgorie nbtestamentairc, de m€me que nous parlons aujourd'hui de 1'Ancien et du Nouveau Testaments. Ainsi, lorsque Nalgod dvoque I'ent.de de W e u l au monastke, il ne trouve nullement contmdictoire de parler de la uetwtos du jeune homme. 11 n'assimile en effet pas la conversion de MaYeul ii la transformation d'un vieil homme en un jeune, mais iZ I'irnage de l'aigle se debarrassant de son plumage usC pour en revetir un neuf ( V W I, IO,p.659C).
I1 existait malgd tout des occasions, ou les hommes du Moyen Age percevaient I'opposition nouuc/uefus comme relite ;l ['age. Ainsi, au XIVe sikle, dam un spectacle liturgique, Philippe de Mdzihs p*entait 1 ' ~ ~ l i s e (symbole du Nouveau Testament) sous l'aspect d*un aCs beau jeune homme imberbe, VEN de blanc, et la Synagogue (symbole de L'Ancien Testament) comme une vieille femme pauvre qu'on jette ni plus ni moins en bas des escaliers de I'estrade, sous ks rires de l'audiencc (P. L'HERMI?E-LECLERCQ, a Avignon en Ete : Mentation de la Vierge au Temple de Philippe de M€zi&tes le 21 novernbre 1372 a, dam MPIonges Henri Dubois, Paris: Presses universitaires de la Sorbome, 1994, p.329, p.332 et 334).
Mans employait ueterums, non dam dame sens commun de "vieil homme", mais dam celui plus
technique de " ~ 6 t ~ " ' ~ ' . Ce terme est utilisC autnment en relation avec des individus
secondaires (les persomes &ecS en g h b l , dans la Yira de Gdraud13$ un vieil aveugle dam
la Vita Maioii b r e u i ~ r ~ ~ ~ ou Gunzu, I'ancien abbe de Baume-la-Messieurs qui vit en &ve
Cluny III daas le t e e de GilonL3') ou m@risabIes (les ennemis d'Odon ii B a d 9 ).
L'emploi de substantifk tels seniores et priores pour dtsigner des hommes Hg6s ethou des
moines haut plac6s dans la hidrarchie monastique sera trait6 dans le chapitre suivant.
En r6sum6, alors que uetm et ses ddrivk peuvent evoquer I l'occasion la face
negative de la vieillesse, sa ddcdpitude, son c6t6 fig& "encrasdl' dans I'e~eur'~, les
vocables de la f a d e de senex, exception f ~ t e de senium, font davantage dferetlce a la face
positive du dernier &es le c6tt sage, calme et noble du vieillard. Ces dew images &sument
parfaitement la perception t& contradictoire que les Clunisiens avaient du dernier 6ge, qui
sera etudiee plus en detail au chapitre V. Face cette multiplicite des vocables latins pour
designer les personnes iigdes et aussi Ieur grande variCt6 sdmantique, on est £kip@ de la
pauvrete du vocabulaire des langues modemes. En hqais par exemple, si nous excluons
les termes artificiellement construits comme "trois9me age" et "ige d'or", il ne subsiste plus
que "vieillesse", "vieux", "6gP et "vieillard" .
13'. Syrus emploie aussi ueteranus dam le sens d'ancien soldat, lorsqu'il affvme qu'Aymard voulut ddmissionner en partie parce qu'il dtait un = iam ueterunus emerite mifitie rn (VM Il.l,p.207). La mSmc dkfmition de ce texme se retrouve tgalement dam le DM, quand Pierre le Vdndrable oppose les moines uetercwi aux tirones (cf, DM I,xv,p52).
IJ6. Les ueterani (VG' IIIfrae1:,col.689C, rcpris dam VC? Fumagalli 1964,I,p.236). VM xxii,col. l777D. Cf, aussi LtMMf,xiii,coLl793C-D oil il est question d'un ueterollus se trouvant ddjh
A la fm de sa vie (a in @so aetatik iamfim m)), dans le senium de l 'he d t d p i t (a in decrepitae aetat* senio n).
Senium doit probablement ici itre traduit par "ddclinN, ce qui d o ~ e r a i t I'expression un peu redondante "au d6clin de I'5ge dtcrepitN.
13'. Quidurn ueterunus inJinnus (KW II,i,p.90). 11 est ensuite appeld senex (ibid, p.9 1). 13'. Des ueteranipersemtores ( VO' II,I,coldlA et VQ 28,p232). "O. CC par exemple I'&ocation de Pierre le V6ndrable de I'imeteratus tepor des moines qu'ont su
rkchauffer les premiers Clunisiens (Stat- 22,p.60) ou la mention par Hildebert d'une corruptela inveterafa qu' Hugues de CIuny parvint m a l e tout & gu&k ( W HI, I8,col.872A).
4. L9importance de Plge chronologique ?
De manib gdn&aley histonens et antbpologues ont nott que l'homme n ' a p p d t
sa date de naissance, et donc ne cormaissait son 8ge chronologique, que lorsque les structures
ecclCsiastiques (enregistremeat des bapGmes) ou adrninistratives (payemeat des imp&,
contr6le de la mise en tutelle, ddpart il la retraite, etc.) l'exigeaient de luii4'. Aussi n'est-ce
que pendant le bas Moyen Age et presque exclusivement dans le milieu des elites, que
l'homme m6dikval commenga ii bien connaitre sa date de nai~sance~~~.
Pourtant, quelquefois, Ies auteurs clunisiens offrent des chiflkes prdcis en meme
temps qu'ils mentioanent un Sge, ce qui dome l'occasion de verifier queues am6es ils
associent P tel ou tel vocable. Beaucoup mohs signiscatifs sont les recoupements que nous
parvenons aujourd'hui & faire, sachant, par des domdes ext6rieures au texte, quel 5ge
approximativement avait un personnage lors d'un Mnement do& : compte tenu que nous
ne savons absolument pas si l'hagiographe connaissait ou non cet ige - et pouvons mSme
supposer que, dam la majorit6 des cas, il l'ignorait -, il serait vain de lui reprocher, par
exemple, d'avoir utilisd le vocable puer pour disigner quelqu'un qui avait d6jP h c h i la
barre de la vingtaine. Malgrd tout, il reste intiressant de savoir vers quels 5ges les saints
traverskrent les h p e s les plus dCcisives de leur vie.
14'. Cf. par exemple 8. MORNET, Age et pouvoir dam la noblesse danoise (ven 1360-vers 1570) w,
Journal des Sman~s, janv.-juin 1988, p.136-37,B. G-E, a L'iige des personnes authentiques; ceux qui comptent dam la societ6 mCdi6vale sont-ils jeunes ou view ? m, dam Prosopogmphie et Genhe de I'Etat moderrre, Actes de la table mnde organ& par le CNRS ct I'ENS de jeunes filles, Paris, 22-23 oct. 1984, Cd- Francok Autrand, (Collection de PENS de j e ~ a fiUes, 30) Paris: b l e Nonnak Sup&ieure de jeunes fills, 1986, p36-58, K- THOMAS, Age and Authority in Early Modem England m, Proceedings of the Britrjh Academy, 62 (1976): 207, C. FRY, The Life Course in Context : Implications of Comparative Research m,
dam Anthropology andAgtng : Comprehensive Rewiews, &L RL. Rubinstein, J. Keith, Do Shenk et D. Weland, The Netherlands: Kluwet Academic Publ., 1990, p.144 et M, FORTES, a Age, Generation, and Social Structure w, dam Age and Anrhropologr'cal Theoty., a. D.I. Kertzer et J. Keith, IthacalLondon: Cornell Univ, Press, I 984, p.99- 1 0 1.
Cf. par exernple J. GAUTIER-DALC~, = Co~aissance de ['Age et Cvaluation de la dude chez les habitants de quefques agglom&ations du dim& de Pdencia d o n une enquete de 1220 w, Anuario de Eitudios nredievaks, 19 (1989): 19 I-204. Ceci ne veut pas dire que personne ne connaissait sa date de naissance avant la fin du Moyen Age : Hugues de Semur, par uternpk, savait etre ne en 1024 (cf. supra).
Dam la Vita d'Odoa, ce dernier monte I la pmnike persome son adolescence.
Durant sa seizihe aade, alors qu'il se nomrne hi-m&ne un a impatrenr jwenik is, il fbt pris
d'un trZs violent ma1 de tb, qui m s'intemmpit que trois ans plus tad, avec son anivb &
Saint-Martin de Tours. Ce handicap mit fin ik I'dducation militaire repe dans les cours de
Foulques d'Anjou et de Guillaume d'Aquitaine. Puisqu'il dklare que celle-ci avait dud
quelques anntks (a evoluh's aliquot mmis m), elle wait donc cornmen& avant qu'il n'ait
atteint 14/15 am, c'est-&-dire avant la Limite marquant habitueuement l'entr6e dam
I'adolescence selon les ddfinitions des 6ges. Or, pour Odon, le d&ut de cette kducation avait
marque la fin de son enhce (a nmr adoleuissem ego, ... strenuwn ... et conspicabilem
juttenurn .)I4'. Jean de Saleme nous apprend plus loin qu'odon entra B Cluny ii 1'Qe de trente
am ; or, il est encore appde un iuuenis peu apr& cet 6vCnementIu. A l'autre extreme, Odon
dkciara ii son propre sujet avoir dt6 physiquement vieux depuis I'ige de trente ans, ce qui
placerait la fin de la iuuentus et le debut de la senectus vers ces mhes annbt4? L'exemple
du cycle de vie du premier grand abbe de Cluny montre que I'age proprement dit est moins
important que les coupures rythmdes par I'tivolution du corps, Ies changements de statut et
le comportement spirituel - meme pour un individu aussi sensible am questions d'iige que
se montra 0d0nI~~.
Gkmud d9Aurillac herita de ses parents aux dentours de 24 ans ; son aventure avec
la pztefla dut prendre place peu a p h . Sa "jeunesse' se serait donc achevke dam la deuxi2me
moitid de la vingtaine, lui faisant ainsi me en& I'iige miirjeunesse assez proche de
'". VO' I,8-g'co1.47. '". YO' I,23,co1.54B et I,33,co1.58A. On trouve mention d'un autre iutrenis ayant au minimum trente ans
dans le coutwniet d'Ulrich : celui-ci en effet sc serait renseigne au sujet de certaines coutumes de Cluny aup& d'un iuuenk ayant d6j8 vdcu 25 ans dam le claim (U&L I,xvii,cpl.666B)
Sean de Salerne raconte ses voyages avec Odon : Praeteritb namque his duobus a i r , cum simul loca sumtonun, quae SUM intra et extra urbem Romam
orationb ccl~lsa#equentatemus, venetabikm ejm saagtnariam scneCnrttm nostra non valebatjuventus nun sulum praerie, wnrm etim nec sequi : sed cumjafiggali ut sibi nobikque pcirceret rogaremus dicebat : Cette videtk p i . omnem virtutern perdidi, Longu enim scnectus fecit me esse silicemirmt. Sun2 ecce triginta antri, p o d lalist qualem nunc me viddis,,/rrt I (YO' 1,16,colSOD). la. La Vita Geraldi (avec ses remarques nu I'absence de sens des nouveaux-ds et sur la transformation
de I'adolescent de I'image de sa mere en I'image du @re ; cf. in to) et la Vita Odonb par Jean de Salerne (oi Odon intervient assez souvent pour puler de son ige) attestent du grand intdriit que portait le second abbe de CI uny au cycle de la vie.
la limite thbrique de I'&escentta (28 aos). Odon d k k G b u d anmsw a la fin de sa vie
et va rnhe jusqu'g hroquer sa senectus et son seniunr, bien qu'il dia dkeder vers rage de
54 ans147. L'6vocabion des dew @es de la vieillesse n'est en rklitd qu'un rappel de la phnw
du Ps 70'18, a urque in senectrrtem et senium Dew ne dereihquus me . ; Odon declare en
effet, i propos de la relation qui unit Wud au Seigneur, a qmd urque in senectam et
seniuni non dereliquit te, ... .. Il ne faut donc pas y attacher une signification trop grande ;
il est po-t intdressaut de noter que l'hagiographe l a k e entendre que le saint dWda I un
iige avanc6, B I'encontre des f~tsl".
Pierre le V6nCrable utilise I'adjectif iuuenis pour designer Matthieu d' Albano jusqu'a
ce qu'il rentre P I'abbaye de Saint-Martin-des-Champs ; or, il Ctait iig6 d'environ 25 ans a
cette 6p0quel~~. AiIlem, il parle d'un senex que, par d'autres sources, nous savons iige de
67 ans et plus pendant ses annies h ClunyIn.
Ces diffirents exemples attestent qu'il n'existe pas de divergences flagrantes entre
les Bges donnis dam le Tableau I et la manitire dont les hagiographes clunisiens went du
vocabulaire des iiges ; on ne satuait parler pour autant de parfaite corrdation. Ce demier
point ne devrait pas ktonaer. En effet, de meme qu'il ne faut pas se fier trop aveuglhent au
vocabulaire utilisk par les auteurs de definitions des Hges mais plut6t s'intCresser aux c k m s
dam I'existence qu'attestent ces dkfinitions, de meme, il ne faut pas attacher me importance
trop grande aux iiges que mentioment ces auteurs pour rnieux marquer ces c6sures. Ces
nombres (7,14/15,28/30, etc.) soot surtout indicatifs : ils donnent un ordre de grandeur, mais
ne repssentent nullement la "vCritP. L'important pour un hagiographe - mais il en allait
certainement de meme dam la vie, en dehon des livres - n'dtait pas l'@e chronologique
'". VG' III,PraeJ,689B et III,viii,col.695B. 'I8. Outre les passages cittis ci-dessus, Odon afirrne egalernent que Gtraud = consenuit inter opera
virltrtum = (VG1 III,vii,col.694C). '4 Cf. U. BERLT~E, Le cardinal Mathieu d9Albano (c. 1085-1 135) m, RB, 18 (1 90 1): 1 16-1 7. lS0. DM I, 17,p.53 et LPV I, Lettre #89 et II,p.158.
108
de I'individu tvoqu6, mais sa position par rapport am trois gtndrations que formaient les
pueri, les iutcenes et les sene^'^'.
CONCLUSION
Le chercheur passant des definitions stricto semi des Hges au discours tenu sur
I'existence hurnaine dans les Vitae remarque a prime abord de notables diffiirences. Ceci
s'explique en partie du fait qu'il n'existe pas dew descriptions du cycle de vie qui soient
identiques, meme lorsqu'il s'agit du meme saint et que le deu&me auteur s'est inspM de
la prose du premier : chaque individu en effet perqoit le cycle de vie difErernment de son
voisin. Malgre tout, il est possible, pour une piriode donnee et pour un groupe dome,
d'extraire quelques kgles de base qui rt5gissent le mode de division des Sges et ce sont celles-
ci qu'il faut confronter aux conclusions de la section prkidente.
On note d o a que les vocables utilis6s par ceux qui d6finissent les iges ne sont pas
employes selon les mEmes crit6res par les hagiographes : I'infuntia ne pr6cbde pas
obligatoirement la pueritia, qui n'est pas suivie automatiquement par I'aduZescentia, puis la
iznzientus, puis la senectm, puis le senium. Le phtinom&ne est explicable : cewc qui d6fmissent
le cycle de vie doivent avoir un nom pour chaque phase ; aussi ont-ils puis6 dam le
vocabulaire des Sges et assign6 B chaque terme une place (ou dew places) et un sens (ou
deux sens) trks spM'iques. Mais la langue ne fonctionne pas selon de semblables criteres
rationnels.
Is'. Cf. Les remarques de B. G&E la suite de la communication de F. AUTRAND, a La force de l'ige : jeunesse et vieillesse au sem-ce de ~'Etat en France a m XIVt et XV sikcles n, Comptes-rendw de I 'AcadPrnie des Imcriptionr et dm B e k r Leib'es, 1985, p.220-21. Ceci n'est pas seulement vrai pour le Moyen Age, mais auni dam d ' a w sccidtts traditionnelles, cf. par exempk T.K. HAREVEN, = Preface a, dam Aging and Lfe Course Transitions - An Interdisciplinmy Perspective, dd. T.K. Hareven et KJ. Adams, New York: Guilford Press, 1982, p.xiv.
Dans les sources hagiographiques, le premier 6ge de la vie est appel6 pueriria et,
beaucoup plus episodiqwment, injimtia, avec, cornme nuance, que L'infmtiu est &vantage
&en& aux prernih a n n k de la vie. La gmde coupwe clans l ' e h c e - qui explique
la n W t 6 de sa division en d e w 8ges avec deux noms distincts dans les dCfinitions - est
le ddbut des ttudes. Ce passage est d'autlmt plus important pour les eeckiastiques qu'il
marque le ddpart de l'oblat de la maison W i d e et son incorporation dam 1'eglise.
L'enfance s'achtve avec la puberte (et les tentations physiques qui l'accompagnent) et/ou
le d&ut d'etudes plus avaudes etlou um ptriade de &flexion pour dicider de son fbtw. Au
sein d'une commuaaute monastique, la pubertk repksente une c h r e fondamentale pour le
moinillon, puisqu'il quitte alors laschola et rejoint les rangs des moines adultes. Aiosi, les
Bges limites de 7 et 14/15 am, mentiom6es dam les definitions du cycle de vie, s'ils sont
avant tout symboliques, restent somme toute assez proches de la r6alitk. Par ailleurs, cette
premiere phase de la vie correspond parfatemeat I I'iige de d6pendance evoqude par les
anthropologues. Les concepts de semi-d6pendame et de dependance sont fort utiles pour
comprendre les ages qui font suite B l'eafance, spkialement la divergence entre, d'une part,
I'adolescentia et la iuuentus et, d'autre part, la senectus et le senium.
Si la fin de l'enfance e a presque toujours clairement stipulbe par les hagiographes,
les autres iiges oat des limites beaucoup plus flouesl. ELles sont difficiles B discerner, non
seulement p e que chaque individu rnentio~e dam les Mtae a connu dam la vie &lle des
aventures et, donc, une 6volution qui lui etaient propres, mais aussi parce que I'hagiographe
dkplace les bomes des iges selon l'anecdote qu'il veut nous conter : dans un contexte donne,
un penomage ne se vena pas assigner le meme vocable lit5 h l'gge que dam une autre
situation.
'. La remarque avait dCj& dtC faite au d6but de ce chapitre B partir des Ctudes anthropologiques. D'autres histonens pow d'autres p6riodes fivent conhntb au meme phtnomtne, mtme si leun sources n'Ctaient pas littdtaires : cf. par exemple MI SEGALEN, Life-Coune Patterns and Peasant Culture in France : A Reassessment m, Journal of Family Histo y, 12 (1987): 215 et A. PLAKANS, Stepping Down in Former Times : A Comparative Assessment of "Retitenrent" in Traditional Europe m, dam David I. Kertzer, et K, Warner Schaie, Cd., Age Structuring in Comparative Perspective, Hillsdale 0: Erlbaum Ass., 1989, p-279.
MalgrC cette incertitude, on remarque que la majorit6 des hems portent pendant un
certain nombre d'annh apds l 'enhce I'appeIlation d'odulescentes ou de iuuenes (avec,
parfois, le premier terme utW5 plus specifiquement pour les premikes a u n b et le second
pour les demih). Ces a n n b sont caract&i&s par la position encore instable du
protagoniste, tant sur le plan (sexe ou r e h du sexe), etlou financier (attente d'un
hGritage), etlou de la d & r e (I& hatant i deveair eccldsidque, chanoine pensant devenir
moine, ou moine n'ayant pas encore de poste de responsabilite) ; elles s'interrompent
normalement, dans ie monde eccl6siastique, avec l'entre dam 1'~~l ise pour les nonsblats
ou une fonction &lev& pour les oblats, et, dans le monde laique, avec les rites de passage
usuels que sont le mariage et la matemit6 pour les femmes, le mariage et le powoir pour les
hommes. Elles correspondent donc a w annees de semi46pendance 6voqu6es au debut de
ce chapitre. Il faut les associer avec la premi&re division de la iuuenfus mentiornee dans les
d6£initions, B savoir I'adolescenfia, qui s'interrompt vers 28/30 am. Ce n'est d'ailleurs pas
un hasard si, selon les normes ecclGsiastiques du haut Moyen Age, 30 am etait jug6 13ge
minimum pour acceder ii la pr&is$.
Poquoi aloa nommer encore "jeunesse" (iuuentus) l'iige qui suit ? La iuuentus est
un 5ge d'ind@endance mais encore potentiellement instable, qui peut glisser i nouveau dans
la semi-dkpendance, si l'individu change de mode de vie ou tombe dam les erreurs de i'iige
precedent3. Pour comprendre ce phhom&ne, il faut observer le terminus ad quem de ces
m & s de "jeunesse" tel qu'on peut l'&udier, par exemple, dam les Vies de Gdraud, d'Odon
ou d'Odilon analyskes ci-dessus. I1 reste i expliquer la limite 6totonnamment tardive de 50
ans. Celle-ci est particuli6re am auteurs d'avant le XIIe sikle, tous hommes d'~~1ise. Dam
2. Cf. L. THOMASSIN, a Age nkessaire pour la cKcicature m, dam Dictionnalie de disc@Iine eccIdkiizsti~11e ou truiti du gowernement I I 'Eglise, Cd J.P. Migne, TroirlPme Encyplpddie thiologique, t r, Park, 1856, co1.69-78. Piem le V6ntrabIe rappela cette Iimite dam son statut 43 (Stat. 43,p.76).
=. Cette id6e que la "folie" de la jeunesse peut tr&s bien se prolonger au-dell de la limite des 30 ans n'est pas pmpre au milieu ecclbiastique du Moyen Age central ; cf, par exemple, pour I'Italie des XIIIC-XVC sitcles, 8. CROUZET-PAVAN, Une fleur du ma1 ? Les jeunes dans l'ltalie rnddidvale (XIIIe-XV' siecle) m, dans Histoire des jeunes en Occident, vol.1: De I 'Antiquit6 6 I 'e'poque moderne, dir. Giovanni Levi et Jean-Claude Schmitt, Patis: Seuil, 1996, p.20 1-08.
une perspective religieuse, B la diffhnce d'une perspective liGque4, I'individu ne devient
tout a fhit mJr qu'aprb une assez longue ptkiode d'oMissance a d'apprentissage, lorsqu9il
contr6le totdement les impulsions de son corps, surtout les sexuelles, et IorsquW est devenu
"pQe" dans le sens spirituel du tenne, c ' e s t - B . ayant charge d'hes, wmme les abbes ou
les Mques : trois exigences qui pewent nkssiter beaucoup de temps? La premiere, la
phase oblig& de soumission B un senior (ou des seniores), peut dBciIernent se traduire en
un nombre pdcis d9ann&s, mais certains auteurs du Moyen Age ont pequ 50 am comme
I'iige minimum pour satisfaire B la deuxieme. Selon Gdgoire lo Grand, c'est en effet 1 50 ans
que l'homme devient maitre de son corps et peut alors guider spirituellement d'autres
personnes6. On peut trower des discours sirnilah dans l 'hnexe C : Isidore, par exemple,
affme que L'individu ne contrdle Maiment sa Libido que dam la senectw7. Tout comme
Gregoire, ceaains auteurs en conclurent que 50 ans etait l'ige minimum pour les grandes
charges ecclbsiastiques. Tel etait L'ige exig6 pour &re eveque au tout debut du
christianisme8. Isidore demandait que soit choisi pour ablk un individu se trouvant B la Limite
'. Dam une perspective "laTqueW, comme celle qu'on powait trouver dCjh it I'Cpoque romaine, puis dam un nombre croissant de divisions des iges ii partir du XII' sikle, rage limite d'entrer en vicillesse Ctait plus bas de 5, 10, parfois meme IS ans (cf. tableaux I et IT). Une des raisons de cette divergence par rapport au modiIe "eccl&iastique" Ctait que, pour Ics larcs, la pate des forces physiques jouait un plus grand r6le pour fixer la ddmafcation entre la iuuentus et la senectus-
s. Si les deux demiers crit&res sont defmitivement ecclksiastiques et non laques, le fait peut paraitre moins evident pour le premier. Pourtant, les hornma d'~g1ise au Moyen Age insktaient beaucoup sur la ndcessitt de se plier aux enseignements ct ordres d'un rncien pour quiconque voulait g n v i l a Cehelons spirituels ; cE par exemple G d g o k le Grand, Dialogues, textc critique et notes A. de Vogtlt, trad. P. Antin, (SC 260) Paris: ~ d . du Cetf, 1979, voI.II, I,I.Sd,p20-U. La trts striae hi6rarchie monastique offtc une parfaite illustration de ce phdnomhe : thtoriquement, il est impossible de devenu senior avant d'avoir CtC iunior. Je mite de ce sujet plus en ddtail au chapitre suivant.
Gdgoire le Grand, DiaIogues, (SC 260) 1979, II,IT,3-4,p.l38-4l. CF. auui Particle plein d'humour d ' ~ . GILSON, Sur l'&t de la maturite philosophique selon saint Thomas d'Aquin *, dans L 'Hornme b u n t Dim - Me'fanges [email protected] uu Pke Henride Luba, vol.[I: hc ~ o y m Age ou s i l c & L w n i h , (ThCdogie, S T ) Paris: Aubier, 1964, p.151-67. Selon saint Thomas dYAquin, 50 ans serait I'gge n6cessaire pour ttudier la morale et la metaphysique car Ie itruenk se l a k e trop facilcment guider par sts passions ct manque d'ex#ricnce. Pourtant, l'entde en religion et une existence trb pieuse pennettent de transccnder cette l i i te . Pour saint Thomas, comme pour les Clunisiens, la prise de l'habit tquivaudrait 8 la perte dcs caracttristiques juvthiles.
Isidore de SCville, EtymoI0~41Urn she Origimm Librim, dd. W.M. Lindsay, tl, Oxfonk Clarendon Press, 19 1 1, IbXI, c.ii,3O, Cf. aussi Christian GNILKA, art. Greisenalter I., ReaIIaikon fiir Antike und Christenrum, XI1 (1 983): col. 1060.
'. Cf. J. DELMAILLE, art. a Age *. D. D-cam, I, ~0132 1. Bonifke (~673-t754) refusa de deven t M q u e a 1a place de Willibrord trCs iige parce qu'il n'avait pas encore 50 ans. I1 expliqua que cet 6ge tietait en effet cxigc! par I' ~g1ise : a quoniam quinquogesimi muti imta canonicae rectitudinis nonnam necdm plene reciperet
entre la iuuentrcs et laseneed. Au We sikle, Honorius Augustodunensis aflkmait encore
que la senectw etait la ptriode de la vie qua plerique ex dero e c d e ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i c a s dignitates
quasi graviora vineae pondeta subimus .lo.
Cet @e de 50 ans m e mal@ tout purement symboiique pour ce qui est de la
distribution du powoir. Dam le mode clunisien par exemple, aucun abbe n'avait atteint cet
8ge Iors de son accession au pouvoir, sinon peut4tre les deux dont nous ne savons rien,
Ayrnard qui pnt un co-adjuteur do- ans plus tard et surtout Hugues de Marcigny qui
d6cbda aprks trois mois : Odon devint abM aux dentours de 48 am, MaEed avait environ
44 am, Odilon 37-38 am, Hugues 25 am et Pierre 28 ou 30" ; nous avons vu que l'un des
principaux reproches lam& contre Pons de Melgueil fut &&re uaZde iuuenis. Mais Mge
chronologique importe peu ; ce qui compte est de noter qu'un individu ayant dejjl me
position apparente d'ind6pendance avant qu'il n'atteigne un age avanc6 - disons de 50
ans - pourra toujours Etre en butte i des critiques sur sa sexualitti, ou sur son inaptitude 1
gouvemer, ou sur toute autre accusation habituellement portte contre la "jeuwsse".
L'iige qui suit la jeunesse, s'il est normalement apte a bien gouvemer et s'il sait
ordinairement contrder son corps - rien n'est plus violemment tan& qu'un senex
aetatem (cf, C.H. TALBOT, Tlte Anglo-Saxon Mksionaries in Germany, Being the Lives of SS. Wilibrord. Bonface. Sfum, Leoba and Lebuin together w'rh the Hodoeporicon ofSt Willibafd and a Selection fiom the Correspondance of St Boniface, London/New York: Shed & Ward, 1954,5,p.24-25).
Platon considdrait aussi qu'il fallait accorder les charges les plus aux hornmes de 50 ans (Re'publiipe VII,539-40) ; Aristote Ic suivait sw ce point, ce qui n'em@chait pas ces deux pbilosophes d'avoir une perception trb nuanck du dernier @e (cf- S. BX, Platon et Aristotc ont-ils profess6 des vues contradictoires sur [a vieillesse ? n, lles e'ttrdes cfassi~ues, XLIY2 (avril 1974): 1 13-26). Aux d i m de I' Aplitre Jean, les Juifs considCraient qu'il fallait avou atteint 50 am pour mdriter de voir enfm le Seigneur (Jn 8,57)- Sur la base de cette croyance, Thomas GAquin considCnit que la sagesse ne venait pas avant 50 ans (B. GUE&E, L'ige des personnes.., m, op.cit., 1986, p.254).
9. Isidore de SkvilIe, Repla monachomm, PL 83, c.II,l,co1.870. Honorius Augustodunensis, Gemma Animae, PL 172, lb.II,c.LIV,co1.633. Cf. Annexe C pour une
presentation du contexte. 'I. Bernon avait environ 60 am lotsqu'il devint abbd de Cluny, mais il etait ddjii abb6 d'autres monasttres
depuis plus de vingt ans. Au sujet des premiers ab& de Cluny, cf, D. IOGNA-PRAT, = L'ordre de Cluny a,
Ha, V ((1 986): 98-100. Pour I'iige de Hugues au moment de son dection, cC H.E.J. CO WDREY, Ibid, 1978, p. 17- A propos de Pierre, cf. I.P. TORRnL et D. BOUTHILLER, Pierre le Vkne'rabfe - livre des Merveilles de Dieu @e Miraculis), Fniourg/Paris: ~ d . univenitairdd. du Cerf, 1992, p.4.
libidinew~'~ - connait lui aussi un h e 3 potentiel important, celui de l'inaptitude ca&e
par la perte de la vigueur. Ciaquaate am n'est pas seulement l'gge oii l'individu contr6le
mieux les pdsions de son corps, il est aussi L'&e ou ce m h e corps commence H ddcliner,
B se faire "v ie~x"~? Ainsi m e large part de la senectw doit &re incluse daas I'iige de
I'ind@endance cher aux anthropologues, mais elle peut rnalgd tout bascuier dam m e
nouveIIe semidCpendance (ou d6pendance) suite iL une forme de "retraitem de la vie active.
De &me que l'adolescentia des divisions des ages cornspond plus spkifiquement i l'iige
de la jeunesse, le senium repdsente plus particuli5rement l'iige de la dkr6pitude physique
et du retrait de la vie active.
En conclusion, les caract6ristiques du cycle de vie pn!sentees daas la section sur les
dkfmitioas mddikvales des 5ges doivent &re considQees comme des bomes de
reconnaissance, nticessaires pour interpder les grandes phases du cycle de vie rnentio~mies
dam les sources littthkes medi&ales, mais sans valeur normative. De plus, le vocable lit
a l'ige qu'utilise l'hagiogmphe clunisien, commepuer, iuuenis ou senex, doit titre pequ, non
comme un indice temporel, mais avant tout comme une technique de mise en relief de
l'anecdote racontie. Le fait d'appelerpuer tel individu, tout particulihment dam un rkcit
de miracle, permet souvent d'evoquer en un seul mot, sans longues phrases d'explication,
l'absence de defense des enfants, leur complete dipendance par rapport h Dieu et aux aduites
pour les protdger du mal. Le tenne iuuenis suscitera I'image de l'impatience, de la force
physique et de la tentation de la chair, taudis que le senex sera associk B la fablesse du corps,
B la sagesse (thdoriquement), etc. Le contenu &mantique que les Clunisiens attachaient a ces
difftrents vocables de l'ige sera analysC en detail dans les chapitres III, IV et V. Enfin, le
schema anthropologique du cycle de vie, avec la dkpendance, la semi-dCpendance,
I'independance et une possible e-me vieillesse, se retrouve bien dans la division
Ce theme fondmental est t& ancien, cf. par exempIe dans la Bible. Prw-, 252. 13. Dans la Rigle du Moirre, il e n prescrit que les adultes analphabetes de moiw de 50 am doivent
apprendre ii lire (texte, md. et notes, Adalbert de Vog(l6, (SC 106) Paris: ~ d . du Cerf, L,13,p225). Une penonne ne sachant pas lire mais ayant depassti la limite des 50 ans &ait donc pergue comme hop vieille pour apprendre.
114
clunisieme des Qes ; pourtant, c e k i est &tie de telle sorte qu'elle ne privilegie aucun
ige : il n'existe pas d'tige moyen, #age de la pI6nitude. Checun des dew Qes qui
constituent la phase de I'ind6pdance, la iuuentus et Iasenectw, possede sa propre Cptk de
Damocih.
CHAPITRE I1
LES TROIS DEG&S DE LA H ~ ~ ~ A R C H I E
Ce chapitre traite de la structure des communaut6s dam les abbayes clunisiennesl :
je montre que I'organisation hihuchique de celles-ci etait dhctement inauenc6e par la
division des ages. En retour, la mise en valeur de ce lien me pennettra, dam les chapitces
ult&kurs, d'utiliser 1e discours sur les pupes hibhiques pour alimenter mon aaalyse du
traitement clunisien des iiges de la vie. La premi6re section est d'ordre g h d d et souligne
la similitude structurelle entre la division des @es et la division hi6rarchique monastique. I1
ne faudrait cependant pas en conclure qu'il y a adequation parfate entre les tmis statuts et
les trois iiges. Si la deuxjbe section prowe que le gmupe despueri clunisiens rdunissait ni
plus ni moins les enfmts de la communaut6, m e semblable demonstration est impossible,
taut pour Ies iuniores vis-a-vis des iuuenes, que pour les seniores/piores vis-i-vis des senes.
Pour les deux groupes hihrchiques des moines addtes, la question est en effet beaucoup
plus complexe et divers factem doivent &re pris en compte. Dam ce but, la regle
bdnddictine (RB), puis les coutumiers clunisiens sont tour tour analys6s. Le couplet
iuniores-seniores/priores, tel que difini par Benoit, presente de nombreuses analogies avec
le couplet iuuenes-senes : outre la question du vocabulaire et l'importance accordee a
1'anciemetC comme facteur d'avancement, il existe une ttonnante ressemblance entre les
rapports des senioredpriores avec les imiores et les rapports qu'entretiennent normdement
des individus ages avec de plus jeunes. Apr& cette troisi6me section sur la RB, les deux
derrieres sont consacrCes A la nkeption de l'heritage ben6dicti.n par les Clunisiens, au moins
dans Ies premiers temps de Cluny, c'est-&dire jusqu'k la nidaction du Liber tramitis (LQ.
I1 est d'abord d&nont& que la nouvelle division qui se fit jour petit B petit dam les
monast&res, celle entre les convers, les diacres et les pribes, n'entama pas la primaut6 de la
'. Je parle d'abbsye et non pas de prieud pace que Ia RZgle de saint Bcnoft (RB) et les couturnien dticrivent Ie mode d'organisation d'une communautt dirigCe par un abbe, I1 n'est guere question du mode de fonctionnement des prieurh, ni dans la RB, ni dans les Connretudines antiquiores (CA), ni dans Ie Liber trantitis (LT),
division MnCdictine bas& sur I'anciennetd. robserve ensuite comment les principes
r6gissant la hithchie MnMctine finent ou non incup& dans la dglementation
clunisienne. Ceci fit, je ne p o d pas plus loin dam le temps I'analyse de la hi6rarchie
clunisieme- En ef f i celle-ci devient de plus en plus cornplace au fiI des decennies de la fin
XIe-debut XIIe sitcle : &diet son 6voIution ii partir des coutumiers de Bernard (Bern) et
d'Ulrich (Udai.) et des statuts de Pierre le V h h b l e (Stat-) constituerait la mati&e d'une
autre thh. Malgd tout, l'analyse qui va suivre, mEme hcompl&e, ofEe un premier aperu
des principales forces agissantes au sein de la structure hikrarchique clunisieme-
Les communaut6s monastiques, au m o b jusqu'aux Clunisiens hclus, sont des
mondes cIos2 qui, thdoriquement, se suffisent 1 em-mhed : la RB et les coutumiea
clunisiens traitent pesque exclusivement du diroulement de l'existence intra mwos4. Si un
2. Cette caractdristique des monast&es a donne lieu quelques etudes sociologiques qui appliquaient, au milieu rnonastique de I'AntiquitC tardive ou du Moyen Age, la thhrie de 1'"institution totale" c h h & Foucault. L'idCe est t&s intdressante et vaut la peine #&re poursuivie, mais ces travaux restent pour I'instant des exercices d'kole de faible inter& pour les m&Wistes, soit que Ies chercheurs qui les ont entrepris n'avaient qu'une comaissance trh limitee du monde monastique, soit qu'ils ne savaient tmp comment appliquer cette mithode d'analyse et dtrivaient vers d'autm questions. Cf. N. GRADOWCZ-PANCER, Enfennernent monastique et privation d'autonomie dans les dgles monastiques (V'-We sibcles) m, Revue historipe, 583 (juil--sept 1992): 3-1 8 et J. SAYERS, Violence in Medieval Cloister v, J o d of Eccfesi'tica[ Nktory, 4 114 (Oct. 1990): 533-42,
Je dis thdoriquement puisque, dans Ies faits, I'abbaye de Cluny mise part, Ie seigneur et l'bveque ont beaucoup & dire. Mais tant dans la RB que dam les c o u t u m i ~ clunisieas (B I'exception des sections non originaires de Cluny : cL par exemple le mode d'tlectioa de I'abbd & Farfa, LT tY,144,p.208), il n'est fait aucune mention dc premier, quasiment rien du second et uniquement B p r o p de I'ordination de l'abM (cf. RB 64'4-6). Autrement, Cluny ne s'inthsst awc grands de ce monde que lorsqu'ils viement jusqu'a lui, vivants ou mom (cf. les diffCrmts chapitrcs du LT sur la dception des rois, d a Mques, etc.). Le mCme phdnomene se remarque pow 1 s autrcs lafcs,
'. Sur cette caractdristique de la RB, cf, D. KNOWLES, From Pachomius to Ignafius. A Stu& in the Constitufiona[ Hktory ofthe Religious Orders, Word: Clarendon Press, 1966, p.6. Sur le fait que Ie mEme phdnomhe se retrouve dam les coutumiers clunisiens, cf. k DUBOIS, Les or&es monastiques, (eue saiyie, n02X 1) Paris: PUF, 1985, p.40.
A partir du coutumier de Bernard, il devint de plus en p b difficile de ne parler que de I'abbaye sfricto s e w dam les sources nonnatives et de continuer ignorer le monde exterieur : Cluny etait devenu une trop importante institution. Ainsi, Bernard contraint d'aborder par exemple la question des fermts sous la responsabilit6 des moines-Decmi. Le malaise qu'il ressentit iZ parIer d'un sujet aussi inhabituel se devine par la structure de son texte : il ne savait 05 traiter de la question, aussi le f i t4 dam Ia section dserv4e au prieur majeur (Bern l,ii,p.139-40). Bien que Bernard et Ulrich fassent, dans leurs coutumiers, quelques excursions en dehors du cloitre, ils se contenttirent tous deux de park des prie- dependant de Cluny ou des individus, moines, moniaIes (surtout les soeun de Marcigny), clercs ou larcs, r e p dam Ia "sociCtd" de Cluny et pour
Ere sort, m6me tds temporairement, de I'abbaye, il doit fXre amende honorable pour s'etre
kotte i l'autre mond& Dam catc societC, dont les limites 6tpivalent am mrus de l'abbaye.
la hi6rarchie qui d6fhit les rapports des rnoines en& eux accupe une place fondamentale-
Qu'on prenne la RdgIe de saint Benoit ou les coutumiers clunisiens, la Mute premik
division hihrchique au sein de k communad monastique est bien entendu cclle searant
I'abbk des moines. Je ne trait& pas de celleci dans ce chapitre car son intCrSt pour mon
propos reste assez secondaire. I1 faut m a l e tout souligner que l'abbd est le "pike", et les
moines, ses "fils" : en effet, ces derniers appelaient leur sup&ieur Abba, qui signitie "pkre"
lesquels la communautt5 priait (cf. Bern I~mi,p2OO, I,xlii,p.233 et I,lxxiii,p266 ou Uhl-, I,v,co1,645C-B et 649C-D). Sur le fait que les communautds monastiques e m n t de plus en plus recoun a des p r i e W i partir du Me sikle pour g e m leurs biens trop d@e&s et sur le foisonnement des p r i e d qui en nisulta, cf, A--M. BAUIER, De nPraeposihrsn 1 "Prior", de "Ce~llo" & "HriorrrtrrsF". ~volution linguinigue et gentse d'une institution (jusque 1200) w, dam Pri's efprieurPs d m 1 'Occident mPdiha1, dik LL. Lemaitre, (Hautes h d e s medilvales et modernes, 60) Gen&ve/Paris: DmKhampion, 1987, p.1-22,
Un changement de mentalit& se note d&j& dam les Statuta de Pierre le Vlnerable puisque certains statuts, sinon tous, fiuent adtessb it l'ordre clunisien en son ensemble et non une communaut6 donnle (cf. Stat. 5,p.45, 10,p.49, 1 t,p.50, etc, et G. CONSTABLE, Stat., p a ) et qu'ils f m n t pr&entds la premih fois au cours du Chapitre gdntral de 1 132 (G. CHARVIN, Stclnts, chupitres ge'npimx et vhites de I'0rCli.e de Cfuv, tl, Paris: E& E de Boccard, 1965, p20n). Un an plus t6t, en 1 13 1, Guillaume de Saint-Thierry organid le premier Chapitre general de moines Mnedictins (cf. S. CEGLAR, GuiIlaume de Saint-Thierry et son r6le directeur aux premiers Chapitres des abbes Wn&lictins - Reims 1 13 1 et Soissons 1 132 W, dam Saint-Thierry, une abbaye chr Y1* au XX sikfe, Ades du coUoque international &Histoire monastique, Reims-Saint-Thierry, 1 1 au 14 octobre 1976,dd. M. Bur, Saint-Thicny: Association des Amis de f 'abbaye, 1979, p300-09. Avec les Cisterciens, les relations inter-abbatiales prkent une importance primordiale : en effet, tel est le sujet premier de la Carta caritatk (cf, W. BRAUNFELS, Monasteries of Weslam Europe - The Architecture of the Orders, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1972, p.68). Ainsi, I'abbaye perdit progrcssivement sa primaut6 ; elle n'dtait plus l'axe amour duquel s'ordonnait la vie des moines, c'ltait maintenant I'ordre entier qui constituait le centre des int€&ts. Cette perte de pr&mincnce du mon&re ne fit que s'accentuer avec Ies ordres mendiants : les mtMu se concentraicnt maintenant sur le monde extdrieur. Le couvent n'Ctait plus que le centre de formation ou le a lieu de resourcement 0 (cE J. C&LINI, Hhtoire religieure tie ['Occident mPditivaI, (Coll. Pluriel) Pack: Hachctte, 199 1, p. 433).
'. Cf, RB 67, LT l47,p.Z 12 et Bern II,I,p. 139-4 1. Cette fermtture dcs sources nornatives monastiques au monde extdrieur doit &re opposde & I'ouverture
des sources hagiographiqucs : un pourcentage etonnant des miracles des saints k n t accomplis lors de leurs voyages, c'est-&-dire lorsqu'ils se trouvaicnt extra mwos (cf. par exemple F. BARLOW, a The Canonization and the Early Lives of Hugh I, Abbot of Cluny m, RB, 98 (1980): 303-05). Thhriquement, les moines de retour de voyage n'avaient pas le h i t de discuter de ce qui l e u etait advenu en mute (ct RB 67,s : Nec praesumat quisquam referre alio quaecumque foris monasterum ui&t a t audierit, quiaplurima destmctio est *). On peut se demander si cet interdit ne domait pas une aura de mystere aux evtnements survenus hors de la cldture qui contribuait beaucoup A la transformation d'actions peut-€tre anodines en miracles sublimes.
(ce que les moines du Moyen Age savaient fort bien), ou plus directemat P&, tandis que
celui-ci appclait ses moinesfiIii. Le rapport entre les Wres et leur sup&ieur se dessinait donc
avant tout selon la mhphore familiale? Une teile image now amhe B la division en-
S Ct par excmple RB 23. Cc nt fbt vraiment qu'au We si&k que abbut, comme mode d'appellation de I'abbc, s'imposa en Occident (d A. dc v O G ~ La comnnmotrld et I'd& cimy la r&fe de s a i ~ t Benoit, Bruges: Desck dc Bmuwerl 1961, p.402). Sur I'cmploi de ces appdlatioos pour l'abb6, bien qu'elles saient en contradictionavec Pinjonctioa & M 239 & n'appeler paomae P h c homb Dieu, c t A. DE V O G ~ , Hkfoue Iinpiuk + mouvement r n o l y u ! ~ thns I 'Anthpit4 I: Le monachbme lath de 1 'llnpiaire d '&g~ie d I 'e'fogefin6bre de Ne'putien (XU-396). Paris: Ed du M, 1993, p.72-74.
'. Ce rapport pbfiIs se maintenait d'aieurs au-deh de la moct, amme l'atteste cette tr& belle conclusion au sermon lu le jour axmiversaire dt la mort de saint W o n :
a et nos quad- ex hm s d o migratwov, patronus nuster O&o in sedem suam & simm mum u e h Abraham pemrlimes aec@iar, & ih illo die imolumnes ouessuas l ~ p a s t o r agnarcat, @so adiuwnte. qui uiuit & regnat in saecula saecufaonmt, Amen. (BibLCIum 1764B-C)- Sur I'abM comme @re de ses moines, cf. cntrc autres A- LENTIN, I1 monastem-famiglia cmzione di
S-Benedetto w, dam Dbcorsi e Cumjikrenze t m i nde celebrmronic~iiaesip il Wcerttenario &Ia nascita di san Benedeto (48&1980), (Monastics, U. Miikceif~ea Cassinese, 46) Montecasino: Pubblicazioni Cassinesi, 1984, p.278, et ies nuances appor th par A. de VOGE la cornnumte'et l 'abbd, 1961, p. 19 et 124-26 (a Le coenobium n'est donc pas une socidtd cMe par la volone des hommes sur le mod& d'une
fmille profane, mais une ~ ~ ~ g l i s e organis& par Dieu, a qui, c o m e l'&ise propaanent dite, prbente dans sa structure hiCtafchique une andogie fiappante avec la fmif ia m). Voir aussi I'analyse kudienne du rapport moine-abbd, dimtable sur certains points mais intksante, par N- GRADOWICZ-PANCER, Papa, maman, I'abbd et moi : Conversio momm et pathologie familiale Cap& les sources hagiographiques du haut Moyen Age m, Le ~ o y e n Age, C V I (1996): 7-25. Dam la RB. I'abbC se prbeme sow deux images, celk du make et celle du pere (cf. par exemple la toute premih phrase de la R2gfe RB, Prol.,l) ; mais, tant dam les sources hagiographiques que dam les coutumiers clwisiens, la seconde est plus Wquente que la premitre, car plus compl&te. En effet, les deux traits fondamentaux du maitre, que Benoit juge complhentaires de la boat6 paternelle (RB 2,24), font aussi partie des caract6ristiques associks i l'image du @re : tout comrne le maitre, ce dernier a charge d'dduquer ses enfants ; de plus, la s&v&ite n'est pas l'apanage du seul maitre, mais peut trk bien se retrouver aussi dam I'autre personnage (cf, la menace que Dieu 1e Rre, init&, puisse dhh6riter ses fils, RB ProL,b)-
I1 ne faut pourtarit pas cmire que les rnoines k n t les seuls ii utiliser la mbphore familiale pour dCfmir des rapports humains ii l'extdn'eur du contextc de la famille. Si "p&ren en 6=an@s a prcsque exclusivement le sens de "ghiteur", il n'en fut pas toujours ainsi. Dam la langue latine, Pater signifie aussi bien "@re physique"l"gCniteurn (cf. Isidore de Stvillc, &mologies, Cd. M. Reydelkt, Paris: La Belles Lettm, 1984, livre IX, 5,p. 186-89) que "chef de maisonW/"Dieu supr€meW (&oh le nom de J i & r ; c t A. ERNOUT et A. MEILLET, Dictionmire itymologique de Ia langue iatine, Patis: Librairie Klincksieck, 1967, p.487-88). L'usage d'un seul et meme tenne pour dbigntr deux Wtds signifie que cclles-ci dtaient intimement lib dam I'esprit des hommes d'aIors : si le p&egCniteur ct le ptre spirituelnfmlu2h/Dieu devaicnt se cornporter envers leurs "fils" avec la bont6 du premier, ils exeqaicnt sur ccux-ci la toute-puissance du second.
En verite, L'origine, p e r etfialer admt avant tout un sens social, ct ce ne iit qu'ensuite qu'ils acquirent un sens familial [cf. E BEMrEMSTE, L vucabulcrrie cles imtifutiom indoleuropPe~ I: fhnomie, prenfh, sociitti, Park bitions de Minuit, 1969, p2lO-13). Il est possible que, dts PCpoque d'lsidoce, la signification familiale ait commenc6 supplanter la sociale, si bien que cette dernitrt perdit de plus en plus de son importance. Mais je pense que, dans le domaine monastique rn6didval, les deux sens du terme ont continud ik cohabiter et que la place de I'abbC au Moyen Age ne peut €tee comprise si I'on fait abstraction de I'un des deux sens des tennes Pater et Filius. Sur ce sujet, cf. aussi L'article assez complexe de K. MUCK, 8 Formes de parenre artificiel le dans le haut Moyen Age ID, dans F'milfe et parent& dam I 'Occident m6di&d, Actes du
g6niraioas et donc B la division des iiges. Aux dires de Syrus un des hagiographes de
Maieul qui raconte, dans L'introduction de la Viro, Ie martyre de Porcaire, abbe de Ltrins,
avec cinq cents de ses moines, cpand celui-ci s'adressa A sa communaut6 pour l'encourager
B choisir la voie du sacrifice, il l'appela a o rtirnium d k t a iuuentus m, tandis que lui-meme
est le senior'. M h e si l'abbe etait bien souvent plus jeune qu'une bonne partie de ses fils,
il end~ssait, de par sa nomination, le rdlt a le titre de chef de la gbhtion supCrieure9. Je
montrerai dans les lignes qui suivent qu'un tel renvetsement &it tr& Wquent : meme si les
tenants du pouvoir dam un monasttire n'etaient pas toujours les plus i&#s du lieu - des
crit5res tels la valeur individuelle, I'origine sociale et les liens avec l'abbe jouant un r61e non
negligeable, bien que ficilement mesurable, dans la promotion des fk&es -, leur position
les transformait en aids, de par l'appellation qui leu h i t confdrde, mais aussi de par le
comportement qui etait exigt d'ewr.
colloque de Paris (6-8 juin 1974) organis6 par I'EI-&SS (W section), dir. Georges Duby et Jacques Le Goff (Publ. de I'ECOI~ F r a n w e de Rome, 30) Rome: kale fianpise de Rome, 1977, p.4347.
VM I,l,p.l81. 9. A Cluny, cette position de PabbC etait renforde par sa toute-puissance rur I'ordre en son entier, la
saintete de ses p ~ k e s s e u r s et, surtout, le fait que les moines de Cluny ne pouvaient se dLmettre de leur abbt meme si, selon eux, celui-ci agissait ma1 (cf. A. BREDERO, 8 Comment les institutions de I'ordre de Cluny se sont rapprochks de Citeaux m, dam Istihzioni monustkhe e irtituzioni canonicali in Occi&e (1 123-1 2 I5), Atti de la settima Settimana internazionaie di studio, Mendola, 28 agosto-3 settembre 1977, (Miscellanea del centro di studi rnedioevali, 09 Milano: Vita e Pensiero, 1980, p.170-74). Pourtant, a p e la dt5mission de Pons et les luttes intestines qui s'easuivirent, il fut plus difficile pour Pierre le VCnCrable d'asseoir sa puissance comme parer#omiIr'&r, LA ddvelopperncnt de I'ordrt cisttrcien ct une nouvellc conception du pouvoir dam les miiiewc monastiques oat peut4tre fiagilisd encore davantage I'autorite du p&re-abN de Cluny au Xnt si&cle. Les moines blancs adopterent une stnrctute hietarchique diff6rente de celte des moines noirs : 1'abM n'etait plus un "p&reu tout-puissant puisqu'il &it sotunis aux ddcisions des Chapitres gdn&raux, qui pouvaient le ddrnettre de ses fonctions s'ils lc jugeaient n-. Parall&lemcnt, l'image de I'autorid abbatiale se m d i : I'abM Ctait toujours le "@reu, mais il devint aussi la "mtrcn des fr&m (cf, C,W. BYNUU, J i as Mother. Studim in t k Spbitdity of the High M ' e Ages, Berkeley: Univ, of California Press, 1982, p.146-66)- On retrouve une telle symbolique chez les Clunisicns (ct par exemple VOi I,xi,co1.906B et EO? l9,p. W) , mais elle est tr& sccondairc, sauf peut-€tre dam les Vitue Hugonis oB elk commence & pmndrt plus d'importance. Ce que I'abbe-m&re cistercicn avait perdu en autoritt sur ses hls, il le rcgagnait gdce il la tendrcsse ct I'amour qui liaient ceux-ci leur supdriew. De rnanik plus g4nUe, alors quc, chez Its Clunisiens, les rapports entre les moines s'6taient toujours ddfmis esentiellement par des relations du bas vers le haut ct du haut vers le bas (le ptre et ses fils, le senior et Ie imior), les C i r c i e n s commendreat B insister sur les relations horizontales (la mere et ses fils, Ies Wres entrc ewc), d'oQ l'importance de l'amitie et de l'affectivitd dans leurs &its. Cette tendance atteint son point culminant avec saint Fraqois et sa ndgation de toute relation verticale au sein de la communautC des fdres ; puisqu'il fallait tout de meme un sup&ieur, celui-ci prenait le titre de minhter, c'est-&- dire de serviteur des frrkes, et sa position Ctait strictement limitte dam le temps.
Cette division en- l'abbe et ies moines, tant dam la RB que dam les coutumiers
clunisiens, a fait couler beaucoup d'encre. Il en va autrement de la hitrarchie des moines
entre eux : on s'est fort peu intksd il ellel'. Pourtant, elle est fondamentale pour
comprendre, tant le mode de vie des moines, que leur mode de penser. Il est en effet evident
que le cadre institutio~el dam lequel se meut un individu influe non seulement sur la
perception qu'il a de hi-mike a de son en.nnement immaat, mais aussi sur celle qu'il
a du monde en g6n6ral. Or, je vais montrer que cette hidrarchie clunisieme, outre qu'elle
reprend m e structure et un vocabulaire intimement lids avec la division des lges
(infantes/jmeri, iuniores, seniores/p~ores), a en commun avec celle-ci des similitudes de
fait : les infantess/pueri sont de v6itables enfants, les iuniores sont avant tout des jeunes ;
seul le cas des seniores/priores est relativement complexe.
A. SIMILITUDE STRUCTURELLE
La premiere similitude entre la division hierarchique dam la communaut6 moaastique
et la division des ages en socikti est une similitude structurelle. Je parlerai d'abord de celle-
ci, a h de rniewc expliquer celle-lA.
Tout individu dam n'importe queue sociCt6 donnee, du fait de son lge, peut se due
plus jeune ou plus vieux que tout autre individu de cette m b e socidte : il est donc possible
de classer tous les hommes le long d'une khelle, chacun occupant un echelon specifique,
ayant d'un cbt6 les hommes plus jeunes que lui, et de l'autre les hommes plus vieux. En
outre, de la meme faqon que cet individu occupe un rang tr&s precis dans l'kchelle des iiges,
lo. Cf. G. CONSTABLE, Seniores et pueri A CIuny aux X , XF sikles B, dam Hktoire er sociird - Mklanges oflerts G Georges Duby, III: Le rnoine, le clerc er le prince, textes dunis par les mddi&istes de I'Universit6 de Provence, Aix-en-Provence: Publ, de 1'Univ. de Provence, 1992, p.17. Bien que l'argument a silentio ne veuille pas dire grand chose, il est tout de m h e remarquable que, dans l'index du Iivre de J. LECLERCQ, tudes sur le vocabulnire monmtiqw du Moyen &e ((Studia Andmima, XLWm Rorna: Herder, 196 I , p. 16 1-66), aucun tenne, A I'exception d'abbas et parer, n'dvoque la hierarchic monastique.
il appartient aussi B un groupe d'Qe particulier : pour le monde rnedi6val jusqu'au milieu
du We si&de -camme je I'ai dbnontrt au chapitre peccdent -, tout individu s'inscrit soit
dam la pueritia' la imentus, ou la senectw. La division des gtges permet donc deux
classements d i f f h t s d'um d d t 6 domde, qui sont interdCpendants I'm de I'autre : il est
evident que l'appartenance d'un h o m e B tel ou tel p u p d'tige est indissociable de sa
place sur l'dchelle des ees.
De la m6me d & r e que chaque homme occupe une place Spccifique et unique sur
I'dchelle des kes, un moine occupe au sein de sa communautC une place Specifique et unique
dam L'echelle bidrarchique. Chaque moine sait exactement lesquels de ses fibs sont ses
supkrieurs et lesquels sont ses id'rieurs, et toute la communaut6 est h ses yew scindee en
deux groupes bien distincts, ceux au-dessus de lui et ceux au-dessous. C'est saint Benoit lui-
meme qui a ddfini cette structure hihrchique dam le chapitre 63 de sa r&gle et les
appellations qu'il utilise B ce props trahissent l'iduence de la division des &es : un moine
regarde ceux au-dessus de lui comme ses priores ou seniores, et ceux au-dessous de lui
comme ses iuniores.
J'&udierai plus loin dans ce chapitre les critkres qui font qu'un moine occupe tel ou
tel tchelon dam sa communautd, se trouvant ainsi "plus view" que certains mais "plus
jeune" que d'autres ; mon objectif est de dtmontrer que I'iige a un rdle non ndgligeable a
jouer dans ce classement, soit directement (avec l'iige del), soit indirectement (avec
l'anciemet6 et l'importance determinante de l'irnaginaire associt B chaque Age dam
l'attribution des tilches). D6s maintenant, il est poutant possible de remarquer que l'gge reste
I'unique critere pour fixer Ies rapports entre un enfant et un fiere adulte : le plus jeune se
trouve autornatiquement en statut #infinorit& Cette inf6rioritt5 hihrchique des infmes ne
ressort pas clairement a la lecture de la RBI, mais elle est indiniable dam les coutumiers
I . 11 semblerait que Benoit ait vouIu pousser la fidtlite au cr i th de la date d'enee jusqu'8 situer dam 1'Cchelle hierarchique en fonction de Ieur jour d'arrivde au monastere non seulernent les adultes, mais aussi les enfants : les dcemment convertis se trouvaient alors en arriere de bambins tout jeunes mais anives avant eux. La justification que Benoit jugea ndcessaire d'ofEir aussitet apds avoir CnoncC cette r5gle de classement indique que cene dernikre posait des problemes, pnkistment suite ii la place accordte aux petits : a et in
cIunisiens : Ies enfants constituent le bas de I'eCheIIe hihhique, quek que dent Ies
@&s egisant l'ordre dans les dchelons s q d r i d . Ceci ne veut pas dire pour autaat qu'il
omnibus omnino locis non &cernrrt ordines nee praeitrdicet. QYiQ Smuhel et Danielpueripresbiterm iudicauerunt (RB 63S-6)- Plus loin clam I t mCme chapitre, il s'empressa d'aanuler mute co&quence pratiqut dCcoubt de son rtglcmart en @&ant que Ies eafiints (praerr) devaicnt &re sous la garde de tous lai erts : en d'autres mots, Im rang dans l'dchelle hitrarcbique &it purcmcnt fomel (RB 63,9)- Ce dcmier point est r M k n C i rextrCme fin du chapitre 63 : Benoit pdcise que les edbts, qu'ils soicnt petits ou s'apptochant de la pubert6 Cpuerijmui uel adirIkmmtes), conswent leur place dans l'tchelle hidrarchique uniquement it I'oratok et au rtfcctoih (RB 63,1849)-
A. DE V O G ~ a tnduit I'expression ci-dcssus, .pueripmui uel diescenter. par la tormule = les petits enfants et les adolescents R On peut effectvement penscr que "aduIescenzresn est un substantif et non un adjectif : dam tel cas, certains Mns, qui ne font ddj8 plus partie du p u p e des puert; seraient m a l e tout trait& comme ces dernicn. Je doute quelque peu du bien-fond& de cette traduction puisque, dans le meme chapitre, Benoit a dejii dvoqut la mrveillance qui doit s'cxerccr sur les enfants et il n'a alors mentionne que le seul cas des pueri (RB 63,9)- I1 pamitrait donc plus logique de penser que per ipanr i uel adulescentres &ale 8 pueri dam I'esprit de Benoit.
Mais pour mon propos, I'important est surtout de comaitre Ia position des rCdacteurs de coutumiers clunisiens : ont-ils &erv&, peut9tre sur la base de la phrase ambigul! de Benoit, un sort particulier aux adulescentes ? Je reviendrai sur cette question lotsque je traiterai du groupe des iuniores.
Pour compnncfre dam quel esprit Benoit voulut laisser awc enhts Ia possibilit6 d'acquerir une place dlevk dam la hibrchie monastique s'iIs en avaient les aptitudes morales, cf. C. GNILKA, Aetm Spiritalis. Die (iberwinrrhmg der mliirkhen Aftersstqfien ols IddfdchrktIichen Lebens, Bonn: Theophaneia Band, 1972, p. 189-202. Gnilka a tr&s certainement SuteStimt cette volontb Cgalitaire entre les ages de la dgle MnCdictine. 11 n'a en effet note ni les restrictions imposdes par Benoit lui-mime h cet idea1 initial, ni les dcarts entre la thCorie et la pratique.
*. Benoit voulait que les enfants se placent A I'oratoire selon Ieur rang dam la hidrarchie monastique et non en fonction de leur 8ge, mais les justifications et accommodements qu'il offie parall&Iernent trahissent I'opposition que pouvait susciter une telle m a n i h de Faire (RB 63,l%, cf. note pdddente). DdjA au We siecle, Hildemar faisait des enfants un groupe d i i c t (cf, Erpositi'o reguloe a6 Hildemrvo tradita [Hildemur], Cd. R Mittermtlller, Regensburg/New York/Cincinnati: Frederic Postet, 1880, p.576 et M. DE JONG, Growing up in a Carolingian monastery : Magistcr Hildemar and his oblates W, J d of Medieval Studies, 9 (1 983): 1 10). I1 en allait de m h c 8 Cluny, commc I'atttstcnt 1 s plus anciens coutumicrs. J'en donnerai deux illustrations. Premit~ment, les enfants entraient h I'Cglise dpadrnent des adultes (cf, par exemple CA 6,p.l I et 38,p.67 ; je reviendrai sur le pourquoi dc cctte cut& cliff&& au chapitre suivant), Deuxi&mement, Ies infonles formaient toujours un groupe nettement distinct des autrcs membres de la communaut6 lors des processions (cf, iirfia, les discussions sur I'ordo des processions),
Cette demiere place des e n h t s est Ie mieux attest& dam les sources clunisiemts plus tardives, lorsqu'elle est remise en question. Dans Ie premier des chapitres de Bernard ct UIrich consac& aux novices, il est clair que les enfants occupent I t bas dc I'€cheIle hiCrarchique : du fait de cette position, ils entrent en dernier I'CgIise et au Chapitre. Mais cette information cst o f f i parce que les novices prennent maintenant place dem6re eux et sont trait& par les frhs avcc la mdme ddference r&crv€e habituellement awt enfants (Bern 1,xv.p. I66 ct UhL IT,ii,col,702A), Dam 1' Annexe D, sur Ie noviciat, je ddmontre que, en revanche, avant Ie milieu du XI' sihcle, les novices nT€taicnt pas diffinci6s du rcste des f i res : ils se fondaient immediaterncnt dam la communaut6. Puisqu'ils avaient plus de q u k ans -autrernent ils auraient Ctd oblats -, ils prenaient rang parmi les iuniores et les seniores, audessus des enf'ants, Dernih preuve de I'infCriorite des enfants dans Ies coutumiers clunisiens ii la difftrence de la RB : Benoit demandait qu'un moine croisant un autre moine ayant plus d'anciennet6 1'appellSt ""nonnus", tandis qu'un prior devait user envers un iunior de I'appellation de '~ater". En revanche, dans Bern et Udai., quand un fike interpeIle un autre fdre, il emploie le vocable
n'existe pas m e h i h h i e entre les e a t s , mais simplement qye les cr i tks d6finissant la
hiQarchie depuis I'abM, I la t&e de la communa&, jusqu'au d e m k des edmts difkent
selon I'tige des individus concern&.
Le deroulement du rndahmr, le jour de la Ctne, met bien en dvidence la coupure
existaht entre les e d i t s , d'une part, et les fires, d'auhe part ; il atteste &dement de
l'existence d'un classement hi6rarchique au sein de chacune de ces entit& :
a Ereunfibus de refctorio f atribus sonet prior tabdam, comenimt omnes in cIaush~m iuxta prornpl~m~um, dent ibi sicut sunt priores ordinatim ut mos est ad processionem stare- Pueri eant in scola magfstris inter eos stantibus iuxta ordines suos in ante <sic> suospmcperes @es pauvres r6serv6s aux enf'ts]. 2
Dam les l i p s qui suivent, je m'interrogerai sur les kgles qui determinent L'ordo des pueri ;
la plus epineuse question de I'ordo des fkhes sera traitCe ultCrieurement.
Pendant les Chapitres conventuels du temps pascal, l'a infns, qqui primus de oiiis
est . avait m e Gche bien precise h remplir' : il existait donc un enfant qui occupait le rang
Ie plus Clev6 dans le grape des petits. En-dessous de lui, tous les autres possedaient
igalement une position spicifique. Cette hierarchisation des enfants est plus particuli&ement
ivoquie dam certaines descriptions de la messe majeure, quand les enfants devaient fake la
Zectio selon l eu place dam I'ordo. La retmnscription des informations offertes sur ce sujet
dam le LT va suivre ; elle permettra d'offrir un exemple des difficult& rencontrdes par le
lecteur modeme atFmntant m e telle source : le ou les &iactem ne se sont en effet pas donne
la peine d'donniser leurs discoun et certaines des descriptiom sont extrtmement
succinctes et f i c i l e s B comprendre en premikre lecture. Cest que, pour les auteurs, les faits
Ctaient trop cornus pour ndcessiter de longues explications. La seule mdthodologie a
employer dam tel cas est la confrontation avec d'autres passages similaues du coutumier.
"Donznurn, mais pour un enfant ceIui de "fiatern (Bern I,MX,p.177 et Udal, II,XX,coI.709C). '. LT 55.5,p.76'. Je discute de I'expression = ut mos est adprocessionem stare r dans I'avant-derniere
section de ce chapitre. '. LT 62,p-9S6,
Lors de la fete de l'ap6tre saint Thomas, a infmtzun wro primitus legut leetiones
<qui est i m > iuniores, deinde s i i ~ smtpri~resproseQuanha~ Pendant le Carhe, pour
la messe msjeure d'un samedi avec doup Ieqpns, a Iiprimib l e g a infm~es iraiares, deinde
aiii ut uenemnt. .. Pour le samedi qui suit la PenWte, a Lectiones injEiintes legant, inprim&
iuniores, dein alii sicut suntpriores. v. Pour la messe majeure du samedi de septembre du
j e b e des Quatre-Temps, a Leetiones legant infmtes, in prirnis iuniores et postmodurn
priores. ns
L'avant-derni6re citation est la plus limpide de toutes : les plus jeunes des enfants
cornmencent la lecture, puis les autres suivent selon leur ordre d'ancienwti. La premiere
citation laisse entendre que c'est le plus jeune qui de%ute la lecture, mais c'est la
connaissance des autres phrases du mime type qui a permis de combler l'oubli du a qui est
inter m. GrZce aux autres citations, le "deinde alii uf uenenint" de LT 44 n'est pas interpret6
comme l'ordre selon lequel les enfants sont arrives pele-mSle P I'&lise, mais celui selon
lequel ils arriv6rent au monastkre pour y devenir moines ; inversement, il confirme que le pan
de phrase "dein uiii sicut ~ p r i o r e s " 6voque bien le facteur d'anciennetb. Peut4tre faut-il
comprendre a la lecture de la demiere citation qu'il existe dew groupes d'enfants, comme
parmi les fieres adultes les iuniores et les priores.
Comme l'analyse de ces divers extraits en imoigne, les deux principes d6tenninant
l'ordre dans le groupe des pueri sont l'iige et la date d'entde au monastke. Puisque nulle
part dans les coutumiers il n'est dit &vantage sur ce sujet, il est impossible de savoir selon
quelles modalit& ces dew crittres interagissent Malgr6 tout, il est &range de noter les
similitudes entre l'echelle hihrchique des seuls edants et celle de toute la communaut6,
c o m e si cette demi5re fonctiomait comme un hologxamxne6. Dam les dew cas, le bas de
l'bhelle est determind par l'iige : au bas de la premibe division se trouve le plus jeune des
pueri, au bas de la seconde, les moins de quinze ans. Puis des facteurs autres que I'iige
'. LT I0,p.14s, LT44,pSP, LT 76.4,p.l 1811, et LT 1 12,p.16g2. 6. L'irnage de I'hologramme ne s'applique pas A ce seul cas. Dew moines pris au hasard reproduiront A une
petite tkheIIe l'inthction entre le groupe des iuniores et celui des seniores, puisqu'il y aura obligatoirement un d'euu qui sera Ie iunrbr de L'autre. Ce mtme rapport est similaire, bien que moins intense, au rapport liant tout moine i son abbe.
interviement, faisant en sorte que, plus on avance haut dans la hidmhie, plus on risque de
trouver, mEl& am plus anciens, des jeunes pdcoc6rnent "mQis" : 1'6volution ne se fdt pas
des "plus jeunes" aux "plus vie&"' mais des "plus jeunes" aux "plus haut @&".
Pour en revenir la question de la similitude structurelle entre la division des ages
et la division hi&archique rnonastr-que, les lignes pdctklentes attestent que les moines
clunisiens forment me chaine inintemnnpue, s'6tira.t du plus jeune ii celui de rang
superieur, similaire ii celle que constituent Ies 5ges dam un ensemble quelconque
d'individus. Dam les sections ult6rieures de ce chapitre, il sera demontr6 que tout moine
s'inscrit dans un des trois ensembles des infmtedperi, des iuniores ou des senioredpriores,
de la meme manihre que tout homme dam la socidte m6diCvale fait partie du p u p e des
enfants, des jeuaes ou des vieux.
B. PUERT PAR L'&GE, PCIERI PAR LE STATUT
Dam toutes les sources normatives de mon corpus, qu'il s'agisse de la RB, des
Consuetudines antiquiores (CA), du Liber tramitis, des coutumes de Bernard, de celles
dYUIrich ou encore des Statuta de Pierre le V&&abie, il est une division fondamentale, tres
certainement la plus importante aprks celle entre l'abbe et la commuaautt5, il s'agit de celle
entre les pueri et Ie reste desfiatres. Cette cCsure au sein du momstere clunisien se retrouve
d'aiueurs dam les sources hagiogmphiques. Dam sa Vita d90don de Cluny, Jean de Saleme
jugea ngcessaire d ' o f i A ses lecteurs quelques explications sur les coutumes en usage au
monasttke de Baume : paxmi celles-ci, il evoqua le fait qu'un maltre ne pouvait jamais se
trouver sed de nuit avec unpuer, mais devait &e accompagne a alium e pueris, aut u n m
exfiatribus J. Si dam cette phrase, les enfants sont distinguds desfianes, celle qui lui fait
suite tkmoigne que ce demier tenne pouvait aussi, B I'occasion, inchre les enfants. La Viro
-
I . VO', I,3 O,coI.S6C.
d'odilon par Jotsaud offie un autre exemple de cette premitre division binaire du couvent.
Au moment du tr6pa~ d'un abbe, tous les membres de la corxununad devaient venir lui
rendre visite ; Odilon avant de mourir s'inqyih de ~avou s i la c o m e &it bien respect& :
a Deinde si infmtes et c o n v e n n c ~ f i a ~ adessent solIicitlrs interrogat a2.
Les pueri sont aussi appelb i n f e s : Ies dewc substantifis sont employ& sans
distinction dam les sources normative& J'ai montd clans le premier chapitre que, m6me si
ces dew temes sont giobalement synonyrnes, "infm~es" est plus spicifiquernent attache B
la petite enfance (0-7 am). Le fait que les moines les utilisent indiffiirexnment dam leurs
h i t s normatifis, dolors qu'ils ont surtout affiaire B des oblats igis de 7 it 14 ans, illustre la
position d'inf6rioritk et de soumission dam laquelle ceux-ci sont maintenus. Cette impression
est con£irmde par la symbolique du signe utilise par les moines clunisiens pour ddsigner les
enfants, qui consiste a porter le petit doigt A la bouche comme pour le sucer? Ce geste trahit
non seulement le fixit que les enfants du monastere sont pergus cornme des tout petits, mais
aussi qu'ils sont au plus bas de I'kheUe hiCrarchique. En effet, tandis que la main &endue
symbolise ce qui est gmnd (maior) hierarchiquement parlant, le petit doigt designe ce qui est
petit @ a m ) , comme I'explique Bernard B propos du prieur majeur?
'. VOj, l,xiv,9 12A '. Les exemples peuvent etre mukiplids A I'infmi car tous les auteurs de sources normatives monastiques
utihent de manit re indifferente les temes pueri et ir#antes. Tel est le cas avec Benoit dont la >e p&ente 8 occurrences de pueri et 6 d'infmtes ; une particularitd
de cet auteur, qui ne se retrouve pas ult&ieuremcnt, est qu'il use souvent de la formule "minon' aetare" avec le substantifpueri(Rl3 30,T-2,39,10 et 59,1), probablement pow diff6rencier les oblats des esclaves, puisque "pert' servait aussi dhigncr ces demien. Dam son commentaire de la RB ddige entrc 845 et 850, Hildernar emploie aussi pueri et infantes c o m e synonymes (cf. par exemple HiI&mar, ~chapXXII~p.33 1-32 et M. de JONG, Growing up in a Carolingian Monastery : Magister Hildemar and his Oblates m, Journal of Medieval History, 9 (1983): 102-03).
Les CA connurent plusieun n5dactions et il anive souvent que de nouveaux ddacteurs, repfenant les textes plus anciens, changent un "ikfimtes" pour un nperiw ou vice-vena, sans raison apparente (cf. par exemple BG avec infntes et C avec pueri dans 9,p.13, puis G avec umrs puer et C avec urms infanturn dans 10,p. 13). Dans le LT, dans le meme paragraphe, un enfant p u t &re apple tant6t i ,m tantbtper (8 mpedurn puer 1egeril.-. Durn infans dire&.- *, LT 154,p.222 ; cf, aussi 157,p.230 et 165,p.238).
'. Bern. I,xvii,p.170-73 et Uduf. II,iv,col.704A. Sur le langage des signes chez les Clunisiens, cf. W. JARECKI, Signa fquendi. Die cfmi.cem~chen Signa-Listen, (Saecula-Spiritalia, IV) Baden-Baden: Koerner, 1981.
$. Bern. I,xvii,p. 172.
Il arrive aussi que le tenne scholu d&pe le p u p e dcs eafants6. Parfois, mais t d s
rarement, d'autres substanti& sont utiWs : a h i , P a m du LT pale d'infmtnli et de
puemli, Bernard de schol~es7~ Infaes et pwn' restent malgd tout et de trb Ioin Ies deux
termes les plus f%quemment employ&.
A l'encontre des ensembles hihrchiques sup6riellls dont le contenu ne peut &re
defini sans recherche pnklable, oelui des i.fmtes/peri est e s simple ii ddlimiter : il est
constitd uniquement d'enfimts. Mieux encore : le premier groupe hi&archique clunisien
correspond point par point au premier groupe de la division des ages8. Divers facteurs
l'attestent. Il y a d'aburd parfaite identit6 des appellations (A la diffirence des vocables
utiIisC pour les deux autres groupes hidrarchiques) : infmes et pueri designent aussi bien
les individus appartenant au groupe d'iige de l'enfance que les moinillons de la schola.
Mieux encore : lorsque ces demiers quittent cet ensemble, ils sont alors dtnomds du meme
terme qui sert B disigner Ies individus sortis de l'enfance : iuuenes? En outre, lorsqu'une
9 Benoit utilise une seule fois schola, non pour dhigner le groupe des enfants, mais pour d€clarer que le cloitre est 1'. kcole l du sewice de Dieu (RB ProL,4S). 11 reprend cette formule du Maitre (cft Adalbert de V O G ~ , s La formation et les promesses du moine chezsaint Benoit D, Coll.C& 53 (1991): 49-50). Tel Ctait 6aIement ie sens pddominant de schokl pour Hildemar et Smaragde, les dewc principaux commentateurs de la RB au IXe sikle (cf. M. DE JONG, Growing up in a Carolingian monastery : Magister Hildemar and his oblates D, Journal of Medieval Studies, 9 (1983): 114-15). Mais dans les CA, schola reprtsente avant tout le groupe des enfants, particulierement dam la description du service litutgique et des processions (cf. par exernple B' 1 1.1 ,p. 15, BB1#G,c 3 I ,p.48 et BB 'B2,G,C 35,p55) ; cettc appellation peut aussi correspondre au lieu oh Ies enfants etudient, qui se trouve pmbablement dans m e section sptkiale du cloitrc (cf. chapitre IU, section 82). Les deux sens de schola se retrouvent awsi dam le LT: l'enscmble des enfants (LT40,p51", 4 3 3 , ~ . 5 8 ~ ~ , 65,p.97", etc.) et leur lieu d'ttude (LT3S2,p.4617-4710, 55.5,p.766, etc.).
'. LT542,p.6g3 (infintulr'), 10 1,p. I S J 6 (infintuIus), 353,p.4e (puerlrfiprrruuli) et 73,p. 1 LO1' (pueruf~]. L'auteur du LT utilise egalement une fois "'II~ seul, mais pour dbigner les Saints lnnoccnts dont on cCl5bre la Ete ce jour-I& (LT 16,p26). Bern. Ipcvii,p.20 I. Comme il a ddj& dt6 note au chapitre prdcddent, I'emploi du diminutif "-ulus" ne sert pas A ddsigner Ics plus petits des enfants et il ne faut pas lui accorder de signification particuli&re.
'. Je suis donc ici en ddsaccord avcc M. LAHAYE-GEUSEN lorsqu'elle affume qu'il est impossible de clairement delimiter le groupe des pueri dam les rnonasttres clunisiens (Das Opfer der Kinder. Ein Beitrag rur Litwgie- und Soziafgeschichte des Mdmhfums im Hohen Mittelalter, Altenberge: Oms Verlag, 199 1, p. 102-05).
'. Ainsi, dans le LT, l'auteur nomme les moines nouvellement sortis de la schola (c'cst-bdire ceux qui v i e ~ e n t de faire leur profession) des iuuenesfiatres : Iuuenesfiatres pi exeunt rlk scola post &positas albas non praesummt legere uel conture niki scpraecepto abbatk m (LT 154,p.223). Dans le Bern et 1' Udat., mCme phenornhe : apres que ces auteurs aient dCcrit de quelle faqon se dtroule 1'ent.de des enfants au monast*re, ils conciuent cette section par la certmonie qui marque la sortie d'un jeune du groupe des pueri ; or celui-ci,
limite c h i f h k est do~lde, audelg de IaquelIe on s'attend A ce qu'un moine quitte le groupe
des i n f m s , il s'agit habituellement de I'ae de quinze a d 0 (B une exception pr& que
j'6voque ci-dessous) ; or, la m h e limite d'figc avait C t t mentiom& au chapitre pdcMent
comme borne suptkieure de lapuetftia. Mais - et ici Ie pouaUtle est encore possible avec
la socictc 1ai:que -plus importante quc l'&e1I (souvent meoOnnu par Ies hommes du Moyen
Age), etait la dkision par la c o m m u ~ e d'organiser pour le jeune m e c0drnonie de
passage au monde adulte : la profes~ion'~. Ainsi, tout cornme le groupe des pueri dans la
pour la premiere fois, pork I'appetlation de iuuenir (Bem I,xxv&p2Ol et Odd IH,viii,coL742B). Une phrase du Bent Iaisse meme deviner qu'un fk&e quitte la schola d& qu'il cst devenu un imenh, en d'autres temes, d&s qu'il a mu6 : l Cum ponuniur juvenes -a scholam pumarum, & benedimtur, cometudo est, ut juniores ontniwn sint q ~ i p r i t r r f i ~ h t benedicti r: ((Bent, Qmhii,p.211). Je reviens sw cette question au debut du chapitre IV,
lo. RB 70,4 ; Bem Ipcvii,p20 I ; U&L III,viii,coL742B- Hildemar et Samaradge donnent la meme lirnite de quinze ans dans lews c o m m e n ~ de la Regle de saint Benoit du I F sikle (cf. Hifdmar, chap.LXIII,p.576 et MI DE JONG, a Growing up in a Carolingian monastery : Magistet Hildemar and his oblates W, J u u d of Medieval Studies, 9 (I 983): f 0%).
". Dans le LT, aucun age p e i s n'est mentionn6 pour cette cedrnonie : il est simpkment spdcifit5. cum aetatk tempus consecration& uenerit (LT 155,p.228), Gcatien ne dome pas non plus d'Oge chi= pour la profession monastique, mais declare qu'elle a lieu apds les annipueritiue, pendant les annipubertatk, aussi appeIdes aetos achrlta, c'est-adire lots de la p u M (cf. Concordiu D i s c o r ~ i u m Canornun, ed, E. Friedberg, Corpus Jurk Canonici. Lieptig: Taucbnitz, 1879-1881, vol.1, cuusa 20,question I.co1.843-54 (= PL 187,col. 1097-99), et R METZ, L'enht tiam le droit canonique mddi6val- Orientations de recherche W, dam L 'enj'imr, 11: Europe mPdiPvaIe ea madme, (Recueik de la societ6 Jean Bodii pour I'histoire comparative des institutions. XXXVI) Bruxelles: &L de la lib& encyclopddique, 1976, p.13).
I=. Cf. LT 15S,p.228- Les Gf n'abordent pas cette question, mais il n'y a rien d't5tomant A cela puisqu'ils traitent presquc uniquement du sem-ce titurgique- I1 est en revanche remarquable que ni la RM ni Ia RB ne parlent de cette cdlQlonie dam les chapitres sur l'oblation (RM91, RB 59). Pour Adalkrt de V W ~ , ce silence dam les deux dgles s'expliquc par l'aspcct dtfmitiidu don d t l'enfant : celui-ci, une fois en&, ne pouvait aucunement choisir de ressortir (RB, vol.VT, p-1357)- I1 devenait donc inutile de lui faire faire une profession, Je suis d'accord avec A. de VogU que l'oblation &it certainernent pe@tutIle pour ces deux Idgislateun, rnais ne mis en revanche pas convaincue que leur silence sur la profession soit une preuve indtniable de son inexistence : les coutumicrs clunisiens montrent qu'on p u t tds bien avoir une oblation irrdversible accompagnte, m a l e tout, de la profession. I1 est possible que, ni le Maitre, ni Benoit n'aient discut6 de la profession des oblats, pour la simple raison qu'aucun enjeu ne lui &sit attache : elle constituait un simple rituel marquant le passage d'un individu du groupc des i n t i e s & celui d e s ~ ~ . En effet, les deux auteurs adoptent une position trts pdculi&rt dam Ieurs chapitre. stu l'oblation : ils ne ttaitcnt que dcs cas- probkmes- Ainsi, le premier pule uniquemcnt de I'c5ventualite d'enhts arrivant volontairemeut au mona&re, alors que, pour lui, la norme est un enf'ant donne par ses parents (cf, cbapitre III, sedan B 1). Le second oublie ce thtme du Maitre. probablement parcc qu'il s'agit d'un cas de figure assez care. fl p d f fe s'attaquer au probleme central de l'oblation, A savoir comment stassurer qu'un e n h t de nantis ne quitte pas ultdrieurement le monast&e, attin2 par les biens de sa familk. Parce que, docs, le danger est infmiment moins grand, il mite ensuite, de facon trk exptditive, la question des enfants de pauvres, Une fois not6 ce parti pris des discours du Maitre et de Benoit sur l'oblation (ne parler que des difficult& qu'elle pose), leur silence sur la profession perd toute signification. On peut donc envisager que les deux Idgislateurs n'aient pas 6voquC cette cerdmonie
soci6tC mddi6vale au seas large, ce groupe monastique connat des limites pdcises. Autre
point de similitude : i l s'agit du seul ensembIe, dans la socidte et dans la communaut6, qui
en posstde. En eEet, il n'existe pas de cri- absolus pour dhe quad un individu passe de
la iuuentw B la seneem, de m h e on ne trowe, dans aucune de mes sources normatives, de
prdcisions sur le comment du passage du groupe des iuniores i celui des seniwesfpriores.
Mais je reviendrai sur ce thhe dans les sections suivantes.
C o m e je l'ai mentiomt, il existe me exception B la pmtique de placer la professon
des oblats vers quinze am, mais elle est d'importance car elle illustre bien, et peut4tre meme
explique, 1'6volution de la d6finition de Sadolescence qui vit le jour dam le premier quart
du We sikcle et fut 6voquie au chapitre pdctident, B la suite de l'analyse du tableau I :
Pierre le V6drable demande dam son statut 36 que Les enfants (infmtes) ne revetent pas
L'habit moaastique des moines adultes avant l'iige de vingt am". En d'autres termes, le
depart de la schola h i t repoussb de 5 ans et la tranche d'Bge 15-20 ans &it assimilke
maintenant au groupe des pueri. J'avais d6jA note a la fm du premier chapitre, & propos du
vocabulaire des iiges utilises par les hagiographes clunisiens, que L'auteur du De Mirarnlis
avait parfois tendance a confondre l epe r et l'adolescert~/iuuenis : le fait que, dam ce statut,
il prolonge l'enfance jusqu'i vingt ans confirme cette impression. Pour Pierre, tout comme
parce qupelle n'6tait qu'un simple rituei de passage et n ' o m t absolument pas & l'enf8nt la possibilit6 de choix. Le passage du LT consad & la profession des enfimts semble confvmcr cette interpdtation. L'auteur n'aborde le sujet que pour discuter du seul point oh le c€rt?monial de la profession des enfants dimre de celui des grands :
Cum aetutk tempus consecrutiunb uenerit, cucullam non exuulur ed abbas, sed professio legat cum caeteris atque benedictio data, sicut mos esl, mittat ei capelfurn in capud atque oscufetw. De reliquo faciant sicuti aliifiatres. rn (LT 1 SS,p.Z8).
Sur Ie fait que l'auteur du LT oublie souvent de mettre un accusatifou un abiatif I& oh il aurait normalement dQ en mettre un, cfi P. DINTER, Zur Sprache der cluniazenser Consuctud'ies des I I . Jahrhunderts B, dam Cometudines monasticae, Eine Festgabe fk Kassius Hallinger, (Studia Anselmiana, 85) Roma: Pont Ateneo S Anselmo, 1982, p- 175-83.
". Statumm a t , ut mIlus etiam ex concessioneficIurus monachus regufaribus usque ad viginti annos vestibus induatur.
C'a instituti hius firit, immutura nimkque c& rirfantum mceptio, qui antequum aliquid rationabilk intelligentiae hubere possent* sacrue refigionb vmibus indrceb~nna, et &&ti afiis puerifibus ineprik omnes perturbabant. et ut quaedam taceam, et multa bratiter colfigm, et sibi nihil puene roder rant^ et alionrm religiom propositurn non parum, immo quundoque plurimum, impediebant. w (Stat- 36,p.70-7 1 .)
plusieurs de ses contemporains du XII' siede, les premitres armh de
L'ud~iesce~diuuentw Went &vantage B rappmher de lapueritia que de Mge qui lui fait
suite. L'usage & garda des iuuenes sub wtodia (des oblats ayant d6jk St leur profession
mais qu'on maintieat encore sous surveillance) entre l'iige de quinze et vingt am, 6vo@
dam le Liber tramitis1 mais d6hitivement explicit6 dam les coutumiers clunisiens
post&ieurs, indique que la position B pFemi&e vue novatrice de Piem d h u l e en d'un
lent processus de transformation de la perception des @es au seh de l'ordre de Cluny et non
de la vision persomeue du neuvi8me abk& Je ne traitemi pas de ce tMme ici, car je
l'aborderai ii diverses reprises, tant dam la section qui va suivre, sur la ddfinition des
iuniores, que dims la partie du chapitre IV de la t h h traitant qdcifiquement des probkmes
de definition lib B l'odolescentia/izmentus. Par ailletus, il ne faut pas perdre de we que cette
transformation dam la structure du premier groupe hi&archique clunisien ne se produisit
qu'8 la toute fin de la pCriode 6tudi6e dam cette thhse, ii savoir le deuxieme quart du XII'
sitcle.
Puisqu'il est indeniable que le groupe des puen' rassemble be1 et bien tous les enfants
du momstere, soit ceux qui ont approximativeme~ moins de quinze ans, il est inutile de
m'attarder dks maintenant sur le discours tenu a leur props ni sur le traitement qui leur est
reserve : tel est en effet le sujet du chapitre suivant Malgre tout, et pace que je n'aborderai
pas ce theme ult&ieurement, il est important de souligner il quel point, dam les sources
normatives monastiques, la coupure entre le groupe des proRs et celui des infuntes est
14. Pour G. CONSTABLE, qui a edit& et annote les Sfatuta de Pierre, le statut 36 concemait non les oblats mais les novices (Stat., p.70n.). I1 est en effet possible que, A la suite de la promuIgation de ce texte, aucun novice ne pouvait plus joindre Ies rang des W e s avant Mge de vmgt ans ; m a l e tout., du fait des remarques acerbes de Bernard et Ulrich sur les oblats pro& de quinze ans agissant encore de maniece infantile, i la diffirence des novices du mCme age beaucoup plus mQrs dam leur comportement (cf. infia la section sur les iuniores), il est logique de penser que ce statut essayait dc remddier & ce probI5me et visait donc les oblats et non les novices. D'ailleuts, les quatre statur 35 A 38 semblent former une suite ordonnee sur les modaIit& d'entn2e au rnonastere : le 35 traite de qui peut etre introduit dam la cornmunaut6 (les paysans, les vieillards, les enfants et Ies idiots doivent litre accept& en m o b grand nornbre), 1e 37 du temps de probation des novices, Ie 38 de leur Mddiction a p e la probation et le noviciat Comment expliquer alors que, d&s le statut 36, Pierre ait abordC la question de I'sge minimum des novices lots de leur btinediction ? II pamitrait plus nonnal que, avant de p a r k des novices, il ait trait6 le tMme de la profession des oblats.
profonde. Dej& daas la RB, se notent un rituel &en&, m e nourriture, un mode de
correction, certain= OCcllpBtions dsew6s uniquement a w petits ; les coutumiers clunisiens
vont beauewp plus loin dans ce sens.
Premien hrolution d'importance, le groupe des d t s fonm maintenant m e entit6
nettement distincte dans la commmmad : il constitue la partie infdrieure de l'khelle
hiCrarchique9 De la sorte, dts que les moines se placent sdon leur rang, c'est-Mire moult
fois tout au long d'une journk, la dlff6mciation enfants/f&es est rendue visible. EUe se
manifeste aussi par une multitude d'autres signes : sikges particuliers pour les enf'ad6,
habits diff&entst7, etc. Dans la mort, cette distinction entre ces deux groupes se maintient :
Iors du ddck d'un rnembre de la cornmum&, un bref est &dig6 qui pdcise s'il s'agit d'un
nostrae congregationis monuchus ou d'un .per nostrue congregationis nonachus .I8.
Deuxikme 6volution majeure, les enfits jouent un r6le de plus en plus @ci£ique
dam la liturgie monastique. La ne dome aucune prkision sur les activitk des petits dans
les douze chapitres qu'elle consacre a 170pus Dei ; on sait seulement qu'ils se rangent a
l'eglise avec les autres *, selon le crit&re de l ' anc ie~e t i~~ . Dts les manuscrits B et B ' des
CA, se note une &olution radicale. C'est l'arrivee des pueri l'oratoire qui signale
habituellement le d&ut du service ; il est es souvent pr6cisd qu'un enfmt, ou deux, ou tous,
I*. Cf supra- 16. Ulrich ddclare que, dans le cloitre et au Chapitre, les enfants doivent s'asseoir sur d u trunci pour etre
dirs que meme leurs vetements ne s'efneurrnt (U&L III,viii,co1,743C). La question des si&ges des enfants au choeur est e-mement complexe (cf. indcx du LTet U& IU,viii,co1,743C-D). Dam la RB, diff'€rents temes sont utilisds pour dbigner les sieges des moines au choeur, mais tous, laissent supposer qu'il s'agissait de bancs : sedilia (RB 9,7), scamm (RB 9,s)' subseilia (RB 1 1J). Cf. le coutumier de Fleury, oh il est cIairement stipuld que les c n h t s ont des taboufes commc si&ges au choeur (Co~l~dihesjZoriocemes anfiquiores. screc. X, 6d. A. Avril ct L, Donnat, Cometzfdirirrcrn saeculi XRZKU - Mommenta non cluniacemia, dir. K. Hallinget, (CCM MY3) Sieburg: F. Schmitt, 1984, n,24,p.34-35).
". Les enfants nc portent quasi jamais de c h a p pow Ies fetes important= B la difference des Wres plus BgCs, rnais sont rev€tus d'aubes ou de tuniques dc soie (cf. i@a, l'analyse des phrases ddcrivant Ies habits portts par les divers groupes de la commuuaut6 lors des messes majcures des grandes Etes ; voir aussi, par exemple, Udal. II?,viii,col.743B et Bem I,xxvii,p202).
"- LT 209,p287. 11 s'agit de la lettre destinCe aux autres monasttres annonwnt un dCcis dam la comrnunaut&
19. RB 63,IS.
doivent accompk t d e ou tefle section pdcise du cdte. Dam les coutumiers dt6rieursy leur
r6le ne fait que cmi:t&'.
II est impossi'ble de savoir quand les enfants ont commend B i3re ainsi diffirencids
du reste des M. En ef f i les couhrmjers ne sont que la mise par k i t de dglements qui
preexistaient h leur &daction. On peut m b e envisager quey d6jB du temps de Benoit,
intervenait B l'occasion une s 6 p t i o n en& les infmtes et lesfiatres pendant les services
religieux : l'abbi du Mont-Cassin ne l'aurait pas tvoqu&, uniquement pour ne pas
compliquer ni alourdi. sa r6gley dont la fonction etait de brosser les grandes lignes de la vie
monastique. Une question n'en demeure pas mains : pourquoi cette distinction de plus en
plus marquee entre les enfants et les eres d6jA adultes ? I1 faut ici distinguer entre
17~volution hierarchique et celle plus sptkifiquement liturgique. La place des enfants aux
derniers rangs de la comrnunautt5 ne peut se comprendre sans une analyse de la perception
monastique de I'enfance, qui sera menie au chapitre suivant, D&s maintenant, il est malgd
tout possible de suggerer qu'une telle position hikrarchique suppose une image negative du
premier iige. I1 s'agit en effet du seul groupe pour lequel on refuse de considerer d'autres
facteun de classement, telles l'anciemet?' ou la pi&& qui auraient seuls permis aux enfants
d'acqukrir des positions QevCes dans les rangs de la communaut6.
Quant a la raison pour laquelle, des premiers manuscrits des CP jusqu'aux coutumiers
ult&ieurs, le r6le des edants dam le service lihugique n'a fait que croitre, je w pense pas
qu'elle trouve sa raison d'etre dam une perception changeante des enfants' mais plut8t dam
le raffinement, ou alourdissement progressif, de la liturgie clunisieme dans son ensemble.
En effet, ce n'est pas la Gche seule des e d i t s qui devient plus ddtaillke et imposante au fil
des co~etudines , mais celle de tous les membres de l'abbaye. Par ailleurs, je n'ai pas not6
=. Une comparaison enbe les divers manuscrits des U est cet Cgard trr3 parlante : en comparaison des premiers manuscrits, B et B1, les plus tardifS fourmillent d'annotationr presque scCniqum sur la place des enfants dans les manifestations liturgiques : cf. particulierement B2 et G pour la procession des rameaux (389p.65)-
21. L'anciennetk Ctait prise en compte pour ordonner les enfants, mais uniquement B I'intCrieur mtme de Ia schola : un enfant qui &it entd au monastkre depuis cinq am n'avait pas pk&mce sur un nouveau converti de deux ans.
de message seifique d d & e I'tvolution du rdle des enfants B I'eglise, sinon une volontd
de "faire beau". Un exemple de nouvelle pratique linagique illustrera ce point : ii paair du
Liber namitis, 3 est westion qye les enfants soient habill& de rnanik particdike pour
marquer certaines fte& De sembhbles am6liorations indiquent bien qu'il s'agit du long
perfectiomement d'me mise en Scene, dont chaque acteur se voit atbibuer une gestuelle de
plus en plus &labor& et dont le metteur en Scene sait chaque fois d e w mettre en dvidence
les kldments scbiques dont il dispose, mais dont les traasformations n'ont pas toujours de
sens idgologique precis?
Si le groupe des enfmts forme un ensemble aisbent discernable, avec une
terminologie spdcifique (infmtes,puerii, le reste de la communautt5 qui lui fait face Eneficie
d'appellations moins rigoureuses : les infantesbueri sont confront& parfois auxfiatres,
d'autres fois aux wutres] maiores, et meme, B I'occasion, aux senioreS4. Le fait que
". Absente des manmaits B et B' des C4, la pratique d'habiller tous les enfants pour une fete importante apparait dam le manuscrit G : cf, par exemple C4 47.3,~-108,5I,p-I11 et 52.1,p.113. EIle est eMmement courante dam le LT(par exemple LT 1O,p.14, l32,p.Z I, 553.p.74). L'auteur du LT I'a mtme rafkde : il arrive parfois que tous les enfants soient en auk, sauf un qui prend place panni le choeur des cantores avec une chape (pour la Vigile de la Nativite LT 12.2,p117).
=. Si l'tvolution de la participation des e&ts dam la liturgie clunisienne me semble peu significative, ce n'est pas le cas de la transformation du rituel des fetes, Entrt I s U et le LT, de manitre globale, le nombre de Etes donnant lieu il un c€rCmonial spdcifiqut a I s d-ls quant B celui-ci ont consid€rablement augment&. Pourtant, ce dCveloppement n'cst pas totalemcnt uniForme. On note, cntre autns, une multiplication des descriptions de fetes de saints, surtout nbtestarnentaires, mais pas seulement (cf la Ete de MaTeul, de Maur, etc.). Par ailleurs, dam les C4, la Fete de la Purification de la Vierge occupait une place tr& importante, avec cierges pour tous et procession particulih (U 27,p3741) ; en cornparaison la Nativitd du Seigneur bQCficiait d'un c&&moniaI trb restmint (C1 19,p.29-33). Ce choix est etonnant, mais peut-itre serait-cc trop exagere que d'y voir la preuve d'une importance plus grande accord& B I'adulte, meme simple humain (la Vierge), qu'i l'cnfant, meme divin ( J h ) . Cette pm*cularitC a disparu du LT: la Purification de la Vierge entraine toujours un grand d@loicment des forces du rnonast&re (LT 3 1 3-3 1 .S,p.4043), mais sans commune mesure avec 1a NativitC (LT 12.1-13.4, p.15-24). Dam le m?me ordre d'iddes, la Fete des Saints Innocents, trait& de mani&re extdmement sommairc dam Ics CA (22,p34), connait un Ctomant ddveloppement dans le LT(16-18,p.X-29), S w la grande importance accodk il la Fete de la Nativite du temps de Hugues de Semur et de Piem Ie Vendrablc, cf. DM I,xv,p.SO.
*'. Dam la RB, il existe un seul cas o& une fois soustraits les pueri minore aetae de leurs rangs, les fieres portent une appellation pdcise : Benoit les nomme alors les maiores (RB 39.10).
Dam les CA, les oppositions enfants-adultes sont plus nombreuses, mais il est malaise #en tirer une rkgle. Le pIus souvent, quad une activit& spdcifique aux enfants st mentionnCe, avec le tenne inrntes ou pueri clairement stipulC, un verbe seut, h la troisitme penonne du pluriel et sans sujet, ddcrit les activith des fitres
"j-atres" puisse designer aussi bien les seuls moines ayant ddj8 fdt leu profession, que ces
demiers plus les dints , illustte un phCctom~e-cIC pour comprendre les dgles Semiantiques
de la hibrchie monasbique : le tenne qui dtsigne le group W e u r des fibs put, ii
l'occasion, servir de signifiant & ce groupe additiom6 du ou des groupes iafikieurs, comme
si ces demiers repdsentaient une quantiitt sufbmment negligeable pour &re oublik ou
absorb&?
C. IUIWORES-SEMOREHRIORES DANS LA &GLE DE SAINT BENO~T
De meme que les 6crit.s mddibvaux traitant des lacs n'6voquent que tr6s
exceptiomellement les couches infiiriewes de la societe, les Ctudes historiques portant sur
le monde monastique s'attardent peu sur la question des iuniores, les regards &ant presque
exclusivement centres sur les plus buts Cchelom de la communaut6. Pour avoir des
moins les enfants (par exemple BG 9,p.I3). 11 arrive que Ies infanta soient opposb auxjFatres tnaiores (par exernpIe B1 4,p.lOlpp.. BB 'B2G 13,~.17~ et B2 40,p-73 '), mais il peut s'agir aussi desfiatres tout court (par exemple BGC 4,p. lo'', G 40,p.86I0).
Dam le LT, le meme flou se retrouve. Les infates sont oppo* soit auxjhtres (cf. LT 10,p. l3=, 3 1 .3,p.4 I f , 40,p.S 19, S72,p.Ut0, etc.), soit aux maiorex (41 35.2,p.4616, 542,p6V et 7 0 3 , ~ . lOS3. La seule nouveautt est qu'ils peuvent aussi, A l'occasion, &re confront& awc seniores (par exemple LT 54.2,p.6P, 58.2,p.8gn ct 70.2,~. 10Q14.
Cette tenninologie fluctuante pour ddsigner les Wres sans les enfants complique de beaucoup I'ttude de Ia place des plus au monastkre, puisque, bien souvent, le lecteur modeme ne pawient pas savoir si les infmtes participaient ou non ii telle ou telle aaivitC. La position ambigut des enfants (Waicnt-ils ou non partie intdgrante du group desfiatres ?) est le mieux i1lustrCe par une fomule asscz Wquente du type : 8 omnes agant hex, e t i m injdes a (par cxetnple, dam ks U, a ad omnesfiatres, etiam ad iMantes w BB' 38,p.63, c t aussi C 19,p33, BB1m40,p.78, dc. ; dsap k LT, 55.4,p.75", 562,p-82' a 70.2,~. 1049. Faut-il en conclure, pour les autres empbis d'"omnes", que Ies enfants ttaient inclus sous ce tenne ou qu'ils d e n faisaient pas partie ? Bien souvent la premih dponse est la bonne (par exemple LT 4O,p.Sl14, mais il atfive dans certains cas que ce soit la deuihne solution qui doive &tn choisie : cf. par excrnpb C4 BB1ffi 14,p.18'5, oh les ftkres (omnesj restent dans le choeut, tandis que I t s ir$intes vont chanter au Chapitre en attendant le lever du solcil. Je donne un autre exemple de ce dernicr phdnomene un peu plus loin dans ce chapitre, lorsque j'dtudie Ies difftrentes phrases du type a ad maiorem miwarn, omnes [ou bien d'autres terrnes : sacerdates, leuitae, etc.] debent esse uestifi cappis *. Ici encore, seule la conhntation avec d'autres phrases du meme genre dans le coutumier peut Cclairer Ies points obscurs.
s, C'est ainsi qu'il faut interpdter les occurrences oir "seniores" sert A dkigner la totalit6 de la cornrnunaute monastique, y comprk les iuniores et les enfants (par exemple LT 3 1.1 ,p.403, 55.6,p.7? et 56-3.p.821').
informations sur ceux qyi se t r o ~ * e n t atre les enfmts et les senioredpriores, c'est-&-dire
au milieu de I'eChelle h i b h i q u e monasti~ue, nous n'avons d'autre alternative que de nous
int6resser en tout premier lieu & a qui advenait en haut de celle-ci.
Le trait le plus fkappant, pour qui debute une analyse de la hidraxchie mo&que a
l'aidede la RB et des coutumiers clunisiens - mais Ie m h e phdnomtne se lit aussi dans
les autres dgles et coutumiers occidentauxl -, est l'impossibilit6 de parvenir i une
definition clah des vocables employ& pour distinguer les personnes les plus haut pIacees2.
Le terme senior designe, au singulier, aussi bien un seigneur IaTquS, un abM, un "plus
ancien" (par rapport B un iunior), un "des anciens" ou, litt6ralement, un plus view ; au
pluriel, il correspond au pluriel des tennes pSc&dents, mais peut dgalement indiquer les
hommes du passe ou toute une communauti4, parfois avec, parfois sans les enfmd. Plus
I . Dejik, dam les ecrits sur les P&es du Ddsert, le terme gw&, qui signifie litt6ralement "vieil homrne", pouvait aussi bien dbigner un supdrieur, un simple moine ou meme un lac de grande pitit6 (cf, J.T. WORTLEY, . Aging and the Desert Fathers : The Process Reversed m, dans Aging and the Aged in Medieval Europe, Cd, Michael M, Sheehan, (Papers in Medieval Studies, 1 I) Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1990, p.64-65)-
'. Cf. par exempIe G. CONSTGBLE, (Eeniores ... D, dans MkIunges Duby, op-cit., 1992, p.17-18 et J. DUBOIS, Le r6le du Chapitre dans Ie gouvernement du monastere ., dam Sous la rZgfe de saint Benoit - S~mctures monastipes et suci6tds en Frunce du Moyen jge b I 'epoque moderne, Abbaye bdnedictine Sainte- Marie de Paris, 23-25 octobre 1980, GenbdParis: Libcairie Drog 1982, p.22 et p.25. Sut la difficult6 d'interprdter le teme "seniores" utilise en droit canon, c f Bruce C. BRASINGTON, Non imitundo set veneranda : The Dilemna of S a d Precedent m Twclfkh-Century Canon Law m, Viator, 23 (1992): 136n. ', Pour I'emploi de senior dam Ie scns de seigneur IaYque, cf. LT 144,~208~. Ccs lignes nc sont pas
originaires de Cluny, mais de Farfh ; malgrC tout, les Vitae de mon corpus confment - comme de bien entendu - I'emploi par les Clunisieos de senior pour dbigner un seigneur larque @at exemple VG' I,l7,coL6S4A, VM III,l6,p272, VOij II,xix,93 1D et YB W,p. 19). Cf. aussi d'autres exemples clunisiens donnds par GI CONSTABLE, Seniores ... m, dam Milunges Dub, op.cif., 1992, p. I 8.
'. Outre les exernples dtja dom& ci-dessus, A partir du LT, le phenomhe se retrouve peutdtre aussi dam les chartes clunisiennes, quand les donateurs dtclaraient o m leurs biens aux seniores de Cluny ou seniores mei ; cf, G. CONSTABLE, 8 Senior- ... m, dans MPImges Duby, op-cit., 1992, p.18-19. Ce chercheur declare au sujet de ces emplois de seniotes : 8 ... les seniores fomaicnt un groupc distinct, mais il n'cst pas impossible que ce terrne fasse tCf€rence soit a w moines ancicns [...I soit B l'ensemble des moines. - (ibid, p.19).
'. Pour saisu rnaitexneut k sau quc l a moiaes du Moyen Age domaient au teme senior(@, il faudrait aussi etudier les diverses significations de cc vocable dans les dcits des hauts faits des Peres du D&ert, tels les Verba Seniorurn, car ces oeuvres ttaient beaucoup lues dam les monast&es mtdidvaux. On y dectle dej& le flou de la limite entre sen= et senior, I'opposition iunror/senior, l'image des seniores comme tdmoins du pass6 et le fait que ubbrrs et senior puissent &re synonymes (cf par exemple Josd Geraldes FREIRE, Commonitiones Sunctorum Putrum - Una nova coIec@o de apotegmas. Esrudo filoltjgico. TW critico, Coimbra: Centro de estudos clhicos e humanisticos, 1974, I, 1 1,p320-21, I, I3,p323, N,2,p.345,1,5,p.3 16,
raremerit un seigneur Mque sera appelt5 "priorn6 ; en outre7 I partir des X-Me sikles, ce
vocable au singulier sat principalement, mais non exclusivement, il dkigner le second de
ITabbe7 ou le suptkieur d'un prierd ; B ces exceptions prb, prior prCsente un contenu
s6mantique aussi k d u qye senior7. Now nous retrouvons donc avec deux termes pouvant
avoir m e muhiplicit6 de sens ; or jamais l'autan monastique ne juge nkessah de prkiser
celui auquel iI se dfke. Comme l'attestmnt les exemples citb au fil de cette section, le
contexte permet de comprendre dam approximativement 75 % des cas quelle signification
associer B ces substantifis ; malgr6 tout, l'incertude demeure et on ne peut y voir un simple
hasard, un oubli involontake de presque tour les auteurs de sources monastiques- 11 est donc
I,L6,p325, II,lO,p.339). S "Priores" peut sewir I dbigner des hommes puissants dans k sikle : lorsqu'un voleur de grand chemin
se convertit il la vue d'Odon et le supplia de I'adrnettrt aussitbt en religion, I'abM de Cluny le pria de revenir le lendemain avec un despriores de la &@on le co~aissant (YO1 II,20,71C). Sur ce persunnage de voleur, cf. H. GRUNDMANN, Adelsbekehrungen im Hochmittelalter. Comersiund nupiti im Kloster m, dans Adel rind Kirche. Gerd Teffenbuch nrm 65- Geburtrtag won Freuden und Wr?fm, 6d. I. Fleckenstein et K. Schmid, Freibwg/BaseVWien: Herder, 1968, p330sv-
'. Pour un survol de Pt5volution du t e r m prior pendaut le ~ o ~ e n - A ~ e , tout EpCfiaIement son emploi, I partir des Xe-XI' sikles, pour dkigner le second dans un monastere ou le sup&ieur d'un pried, cf. A,-M. BAUTIER, De 'Prepositas' il 'Prior', de 'Celfa' & ~ri0ratu.s' : ~volution linguistique et genbe d'une institution (jusque 1200) m, dam Priews et priewk dans 1 'Occident m&iii&af, d k J.-L- Lemaitre, (Hautes ~ t u d e s mt5dit5vales et modernes, 60) Gen&ve/Paris: DrozKhampion, 1987, p.2-4 et Jean BECQUET; Le prieur6, maison autonome ou dependance selon les ordres (moines, chanoines, ermites) m, ibid, p.47-50.
A I'epoque de Benoit, maior est Cgalement synonyme de prior et senior. Sur l'emploi de maior pour designer !'abbe, cf. RB 2,1 ; sur ['usage de prior dam le mtme sens, cf. RB l3,l2,2O,S, 38,9,40,5,43,19, 53,3, 53,8, 53,IO. En ces divers passages, ces deux vocables ne posent aucun probl&me d'interpdtation puisqu'il n'est alors question que d'un seul individu qui accornplit une action precise devaat toute la communaut6- I1 s'agit donc indiscutablement du plus haut grad6 de l'abbaye, c'est-B-dire de l'abbe, ou, s'il est absent, de son second-
11 est impossibk d'affiumer si le maior de RB 5,4 (a M' afiquid imperafum a maiorefirit, ac si diuinitus imperefur rnoram pati nacionl infhciedo m,) et le prior de RB 6,7 (a si qua requriemb swrt apriore, cum omni humifitate et subiectione reuerentiae requiimfw, m) et de RB 7,41 renvoient uniquement B l'abM, ou plus gCnCralement & un ancien : les passages pdc6dents de la RB n'avaient Kt dfCrcncc qu'aux seuls ordres de I'abbC, mais Benoit parlera ensuite des praecepta des anciens, comme je le mentionnerai plus loin. Dans les trois cas, A. de V O G ~ traduit maior et prior par "un supCrieurw, l'emploi de l'utick Wfui pennettant de Iaisser la question en suspeos. La m h e incertitude pdvaut avec les maiores de RB 5, IS et le maior de RB 7,34. En revanche, d m RB 735 (a Octauus humifitatis gradur est si nihif agar monachus, nisi quod communis monmterii re& uel maiorum cohortantw exempfa, m), Its maiores sont tds probablement les anciens (d'aujourd'hui ou d'autrefois) puisqu'il n'est question que d'un monasth a qu'il ne saurait y avou en celui-ci plusieurs abbes.
Comme je I'ai dejh mentionne I la fm de la section prdcddente sur les pueri, le vocable maiores peut igalement designer I'ensemble de la communaut6, non compris les enfants (RB 38.10). Dam les sources nornatives clunisiennes, il n'a conservd que cette derni&re ddfmition (cf, les index des C4 et du LT), avec celle, Iitt&ale, de "personnes plus Bgt!esn (cf Bern I,xxviii,p.210). Aussi, n'en parIerai-je pas ici.
n&essak de s'attarder sur les diverses ddfinitions de senior(es)/prior(es) pour y dkeler une
explication plausible de leur mode d'emploi.
Il est evident que, mentiom& dans le cadre d'un M t normatif monastique, ces
vocables dtisignent les plus haut @6s de la communaute. Pourtant, on peut noter que le
termeprior marque littthlement L'anciennet6 : "celui qui est en avant", mais aussi "celui qui
etait lA avantn. Parall&xnent, senior Cvoque Hge avand : "celui qui est le seigneur ou
~&nieur"~, mais aussi "celui qui est le plus viewn9. Le fait que les termes marquant le pouvoir
puissent tout autant signifier I'Qe etlou la dm& et que Ies auteurs monastiques aient jug6
inutile de prkiser si le vocable senior/Ptior qu'ils employaient renvoyait B l'un ou l'autre
de ces signifit% atteste du lien intime unissant, dam i'esprit des moines tout du moins, la
puissance et I'anciennett?" Dam les lignes qui suivent, je soulignerai l'importaace de ce Lien
en d6montrant que les fonctions et privilgges qui sont attribues aux supirieurs d'un
monastkre dam la RB sont caract~ristiques de ceux accord& am individus lg6s, et que
l'anciemete, sinon I'lge, permet de devenir un senior/prior. Puce que la tradition joue un
r6le fondamental dam la ddaction d'une rkge - y compris celle de I'abbb de NmieH -
'. Cette traductian de senior par "dnieur" est peu courante. Adalbect de v O G ~ , par exemple, a toujours privikgit? ['usage d'"ancienn. C'est J. HOURLER qui utilise "sdnieur" quad il Cvoque les chartes dunisiennes, mais sa phrase trahit ses incertitudes : sdnieurs ou "recteurs", c'est-&-dke [..,I quelques-uns des moines jouissant d'une autorite partiili&e dam la maison, et que les chartes nomment parfois. (Saint O d i h abbC de Cluny, Louvain: Publ. Univ. dc Louvain, 1964, p.166).
9. Ce &me facteur-temps -t dans I'attniution de l'appellation seniores et priores B des hommes d'autrefois, B des temoins d'ev&nemcnts pass&, ou Q des hommes 6g& ; mais les sources nonnatives monastiques thoquent habituellement le p-t dans le but d'influencer le f h r ; elks font rarement dfdrence au passd. Aussi ces emplois de s~ior(es)/prior(es) sont-ils & peu pr& inexistants dam ce type d'dcrits. On les retrouve en revanche dam les Vitae (cf. par excmple W iii,p258 ct YB Prol.,p. 1).
'O. Si nous reprenow la multipIicitd des dCfinitions de sMlbr ctprior tvoquks p&&iemment, l'association anciemet&puissance semble fort discutable dans deux cas, abstraction fZte de ceux qui seront expliqub dam la suite de ce chapitre. Le premier at lorsque l'auteur appelle seniordpriores toute la cornmunautt! (avec ou sans les t n h t s ) ; mais j'ai dCjB expliqu6 ce phCnorntne ii la fur de la section sur Ics pert' : les infdrieurs sont inclus dam l'appellation dcs sup&icurs comrne s'ils constituaient une addition ndgligeable, Le deuxihe est Iorsque senior dtsigne le seigneur IaYque : on voit rnal ici le lien avec l'anciennete* puisque seul I'hCddite ou la force entraicnt en jeu pour l'accession II un tcl titre, Pourtant, le seigneur, tout c o m e I'abM, s'il voulait bien remplir son rile, devait faire preuve d'une attention patemelte ii I'Cgard de ses sujets (cf. sur ce thtme, entre autres, F. LESAUX, Relations farniliales et autorite myale : de 1'Historia regum britanniae au Brut de Layamon *, dans Les refations tie parentd d' ie m o d e mPdi&uI, (Skndfiance, 26) Aix-en-Provence: Publ. du CUERMA, 1989, p.218-19). Or, qui dit ptre W, dit Cgalement, symboliquement, a ancien .-
". A. DE V O G ~ , Saint Benoit, su vie et sa r4gk &d& choisies, (Vie monastique, 12) Begrolles-en- Mauges: Abbaye de Bellefontaine, 198 1, p, 176-77 et Id, art. s Regola I. Visione generale filologico-storica
et parce qu'une telIe source ne se camprend bien qu'en la conhntant P d'autres sources du
meme type - pour noter les divergences, &, surtout, pour comprendre un point trop peu
expliqut! ici et davantage d6veloppC lii -, j'6tablirai dans les notes en bas de page des
p d 6 1 ~ enm le discours de la RB sur le couplet iuniores-seniored~riores et celui d'autres
r2gIes monastiques oc~identales'~.
C o m e il ht mention& prMdemment, le chapitre 63 de la RggZe de saint Benoit
definit l'ordre hierarchique de la communaut6 b6nt5dictine. En voici le passage le plus
important :
a Ordines suos in monusterio ita conseruent ut conuersationis tempus ut uitae meriturn discernit utque abbar co~tstituerit~ [...I Ergo secundum ordines quos [abbas] constituerit uel quos habuerint ipsi fiatres sic accedant ad pacern, ad communionem, adpsaIrnm inponendum, in choro stundm ; et in omnibus omnino iocis aetas non discemat ordines nec praeiudicet, quia Smuhel et Danihel pueri
delIe regole e costituzioni religiose- If- Regole cenobitiche dtOccidente (sec. V-MI) m, DIP, VII (1983): 1421- I t . Les Clunisiens connaissaient ces autres egles, au moins indiiement, puisqu'ils lisaient la Concordrb
regulae de Benoit d'Aniane et la citaient, ii I'occasion, cornme ouvrage de df€rence (cfi LT 190,p26# et S83,p.g 13. Plutdt que d'utiliser cette oeuvre, j'ai pdfer6 Cvoquer d i n t ici les textes Wit&, Sur les dates de raaction de ces rtgles et leurs relations les unes aux aums, cf. A. de v O G ~ , Ler rZgfs monurtipes (JOQ700), (Typologie des sources du Moyen Age occidental, 46) Tumhout Brepols, 1985. Sur le pouvou des "anciens" dans les anciemes regles monastiques, cf. V. DESPREZ, RZgIes monustiques We-Vie siscle d'Augustin ri Ferrkol, (Vie monastique n09) Bt?grolles-en-Mauges: Abbaye de Bellefontaine, 1980, p33-34. Seront c i t h ici : - La R&le dite des Quatre P&m [R IYP], €d A. de Vogl)C, Les R2gIes des sain~ltphs, vol.1, (SC 297) Paris: ~d du Cerl, 1982, p. 180-205. Lieu d'origine et date pmbables de ddaction : LC*, vers 400-410. - La Seconde Ugle des P k s [R Pat2 1, Cd, A. de VogO6, L a R&gles dessaiitsp&es, SC 297, ~274-83. Lieu d'origine et date probables de edaction : Urins, en 427. - La Regle de Macaire [R Mac.], 4- A. de VogUC, k R2gles a k saints pires, SC 297, p.372-88. Lieu d'origine et date pmbables de ddaction : Urins, f'i du Ve siklc. -La Ugle du M&iRre [RMJ, €d. A. de Voglld, La RPge dh Maiire, (SC 105-106) Paris: &. du Cee 1964. Lieu d'origine et date probables de ddaction : prts de Rome, premier quart du VP sitcle, - La Rtgle Orientale [R Or.], Cb A. de Vo@C Ler R2gles uks saih&p&es, volJI, (SC 298) Paris: Jk du Cee 1982, p.462-93. Lieu d'origine et date pmbables de ddaction : monadre de Condat, vets 515-20. - La Troisieme Rhgle des Perts [R P a 3 ] , &I. A. de VogW, k s d g k s &saintsj&zr, SC 298, p.53241. Lieu d'origine et date probables de daction : Concile de Clennon& 535, - La Rtgle de Fnrctueux [R Fnrc.], Cd, J. Camps Ruiz et I. Rocca Melia, San Leanriio, Sun Isidoro, Son Fmcruoso, Regias mondsticas de la fip& visigoda - Los tres libros de las "Sentenciast', (Santos Padres Espafioles, Ii) Madrid: Biblioteca de autores ctistianos, 1971, p.137-62. Lieu d'origine et date probables de rddaction : monastere de Compludo, deuxieme quart du Va' s,
Cette liste de &g!es anciennes est loin &Cue exhaustive, mais I'Cchantillon est asset large pour offiir deji un bon apercu du discours monastique nonnatif sur le rapport des seniordpriores avec les iuuniores.
presbiteros iiudcauenint Ergo exceptos hos quos, ut dmmrcs. altiori consilo abbas praetderit uel degr&mit certik ex ~M(Sils# reliqui omnes ut comertunfur ita sint8 ur uerbi grafr'a qui s e d kwa diei uenerit in monasterfo iMforem se nouerit illus esse quiprima hora uenit diet cuiurlbet aetarilr aut dignitatis sit, L...] d3
Benoit explique que, des dewr critks dt5finissant l'avancement dam la hi6rarchie
communautaire, I'm est plus exceptiomel - Iorsque l'abbe dkide de promowair ou de
dtklasser cpxelqu'un en fondion de sa valeur -, I'autre wnceme tous les fi&res
et repose sur I'ancierme& Il interdit fonneIIement y e rage soit pris en compte, mais le fait
qu'il ait jug6 ntkssaire de le prtkiser et, surtout, qu'il en ait donne une justification, laisse
entendre que, dans la pratique, la tendance de privilegier les plus iigds, les presbiteri,
existait16. Par ailleurs, du temps de Benoit, les entrtes d'adultes titaient encore monnaie
[I. RB 63.1-8. A. DE V O O ~ remarque que cette organisation de la communautC par rangs n'existait pas chez le Maitre, mais qu'en la mentionnant, Benoit ne W i t que reprendre un theme pdsent dam la majorit6 des autres dgles cenobitiques (La commu~utd et 1 'abb6, Bruges: Desclk de Brouwer, 1961, p.439-40). Une autre particularit6 du Maim a qu'il n'utilisait jam& les termes senior ni iunior (A. de V W ~ , L a communaute', 1961, p.30). Ce ne fut qu'& partir de L'Cpoclue de Benoit quc Ies abbds s'appuykent de plus en plus sur le groupe des anciens cornme conseitlers et collaborateurs (ibid, p.260).
14- Tel est le cas pour la nomination des doyens, les &canii Ceux-ci sont des nipliques de I'abbd une tichelle plus petite, don: la tiche primordiale est de transmettre les dCcisions abbatiales B leur "d&anien. Or Benoit refbse que I'ordre hierarchique soit pris en compte Iors de la dbignation de ces penomages : et nun elegantwper ordinem, sedsecundum uitae merirum et sapienfiue doctrinam. w (RB 2 I&). Tel est &galemeat le cas pour I'abM, qui p u t Etre choisi mCme s'il est le tout demier en rang selon I'ordre hitrarchique (a Viroe autem merit0 et supientiae doctrina elegatur qui ordinandk est, etiam si ultimus firerit in ordine congregationk n, RB 642). Ainsi 1'abM et Ies plus hauts en grade apds lui peuvent fort bien ne pas &re des anciens et, par voie de cons&pnce, &trc des jeunes II hut m a l e tout consid6rer leur statut cornme exceptionnel. Benoit rappelle, non sculment dam ce chap*, mais aussi dans d'autres, B quel point ces promus hors du rang doivent rester humbles (cf, aussi RB 62.7). I1 est d'aillem intCnssant de noter que l'w des principaux reproches Ian& contrc Ies "jeunes" dam la littdrature m t d i h l e est leur facile vanitt ; j'y reviendrai au chapitre V. Dans le cas de l'abbe, cette exclamation de Benoit sur le fbit qu'll peut &re le demier selon l 'ordo est essentiellement une formule de style puisque, plus loin, il pdcise que le nouvel6lu doit &re
doctus lege diuim (RB 64.9) ; il ne peut donc &re tout jeune. Is. Sur I'importance primordiale de l'anciennct6, c t A. DE VOGM, L a commuMurP et l 'ubbd, 1961,
p.445. Meme si un moine Mntficie pour le service divin d'une place supdricurc - cc qui arrive surtout dans le cas des prStres -, 19anciennet6 reste I t facteur decisif pour les nominations (cf. RB 60,607 et 62,597, ainsi que RM2,49).
16. Benoit critique assez dWtement dam ce chapitre l'origine familiale, la dignitas, comme possible faaeur d'avancemcnt au sein du monast&re. Il est remarquable qui, dam le chapitre 2, il interdisc uniquement aux abbb de distinguer entre les Iibres et les serfs (RB 2,18), comme s'il n'existait par, selon Iui, d'autres crit&res sociaux de diffdnnciation en ce tout d&ut du Moyen Age. I1 est evident que, dam la pratique, la dignitas n'etait pas toujours ignode. Cela nc fait aucun doute quand il s'agissait dc remplir Ie poste d'abbC, mais est tds dificilement mewtable retrospectivement pour Ies autres fonctions monastiques, compte tenu du manque de sources.
courante, si bien qye, 1 supposer que ces pdceptes du grand abM de Nursie firssent suivis,
un classement bas6 sur l'anciennett, alors que certab moines 6taient en* dims et
d'autres ii un iige plus avand, diffQat totdement d'un classement bas! sut Mge. En
revanche, & l'6poque des ClMiSiens, tout au m o b avant le d e e r tiers du XIe sikle, dew
moines sur trois approximativernent Merit ient wmme oblats" ; et, pour autant qu'il nous
est permis de le constater, tous ceux qui entraient A un h e adulte, occupaient tr&s vite des
postes d'importmce'*. Dans un td contexte, un classement selon l'anciemete ne devait gu&e
differer d'un autre bas6 sur l'gge.
Une autre remarque que suscite la lecture de cet extrait de la RB - sans lien direct
avec la d6monstration ici en cours, mais attestant de l'interet de ce chapitre - est
l'importance fondamentale accord& ii l'ordo dam une abbaye. Plusieurs fois par jour, les
moines devaient se placer selon l'ordre hidrarchique, tout particulikanent lorsqu'il s'agissait
d'accomplir leur tiiche premiere, celle de l'opus divid9. Inversement, la punition la plus
usuelle pour les addtes &it de se retrouver temporairement tout au bas de la hidrarchie,
ultimus omnium r, ou, pour les cas les plus graves, &e ddfkitivement d&lass6O.
Fructueux interdit egalement dans sa &gle que I'iige &el soit pis comme crit&re d'avancement, tandis qu'il insiste longuement sur les droits que donne 19anciennet6 au sein du monast5re (ct R Fnrc. xxii,p. 161). Pourtant, ailleurs dam cette oeuvre, il oppose Ies iuniores ceux qui ont ddja atteint I'aetus perfecta (iv,p. 144) et dernande que Ies fautes soient jug& en fonction des ages (xiv,p. 153).
''. Cf. la discussion B ce propos dans Ie chapitre m, section A- ". DdjA, dans la RB, il est spCcifi6 qu'un pstre, un c k ou un moine Ctranger entrant au monast&e doit
bCndficier au sein de la communaut6 d'une position plus Clev6e que la demikre i laquelle il est thdoriquement astreint (RB 60 et 6 1).
19. Cf. aussi RB 1 1,2 et RB 47.2, L'ordre hidrarchique n ' b i t en revanche pas observe dam Ic choix des lecteurs hebdomadien au dfectoire : commc il leur fallait capter I'intddt de leur auditoire un moment oir l'individu avait pat& trop tendance portcr attention ih son corps, Benoit prdconisait de choisit ceux qui aedifrcant audienm rn (RB 38,12).
Sur le fait que les fieres psalmodiaient d o n leur place dam l'ordo, cf. R IVP vi.p.186-87. 20, Ces "mises au ban" dtaient habituellement temporaires (cf, RB 43,s et 43,lO). Les seules exceptions
concernaient les grand5 coupables, A commencer par ceux qui avaient quitt6 la communaut6 (RB 29,102) et ceux qui avaient Ct6 excommuni& un certain laps de temps. Ces derniers devaient ensuite prendre place au rang que leur assignait I'abW (a [...I et mc, si iusserit abbas. recbiatur in choro, uel in ordine quo ubbus decreuerit ; m, RB 44,5).
Sur le fait qu'un moine qui changeait de monastere prenait place au dernier rang de sa nouvelle communautd, cf. R IVP xiii,p.200-01. La mtme chose arrivait A ua moine equernrnent trouv€ dans l'eneur selon R Pat.2 (~ii~p.282-83) ; ce passage est repris textuellement dans R Mac. (17,p.380-81).
Panni les injonctions faites par Benoit aux moines, iI leur demande de seniores
uenerme, ilmiores diligere . (RB 4.70-71). A. de Vo@ remarqw dam les notes qui
accompagnent son &Won de la RB que ce cornmandement est identique B RB 63,lO:
Imiores iginapriores suos hotwren& piores minores suos diligent 3'. Cette CgaIitt atteste
de l'interchangeabiitd de senior= etpriores- ElIe indique aussi que iuniwes et minores sont
synon+, bien que, f i t remarquable, lyernploi du second vocable soit exceptiomel. EUe
montre enfin que Benoit h e les rapports entre les iuniores et les seniores/pores selon les
criteres qui, habituellement, dgissent les rapports entre les jeunes et les plus vieux : un plus
jeune doit respect & un plus view, tadis que celuici doit faire preuve d'une ceaaine
indulgence et compghension enven un plus jeune. La suite du chapitre 63 de la RB suscite
les mEmes remarques. Si les priores doivent appeler l em iuniores "fiatres", les iuniores
doivent interpeller leurs seniores "nonni", qui signifie "pke"*. Lorsqu'un iunior croise un
prior, il doit lui demander sa Mn&iiction, lui hisser sa place assise et ne s'asseoi que
Iorsque Ie senior lui en aura donne la permissionu.
Parfois, la ache assigde aux senioreslpriores n'aurait pu &e, en toute logique,
decernee a un "jeune". Les$=afres adulescentiores ne doivent pas avoir l e m lits cdte a cBte
mais proches de c e w des seni0re9~. On con~oit ma1 dam ce cas que les seniores puissent
&re des jeunes puisque leur tgche consiste justement a surveiller les plus jeunes. Notons aussi
que, daas cette injonction, le terme "senior1' ne d6signe plus, comme dam les mentions
'I. Ces deux formules sont de la plume mime de Benoit ; elks ne se trouvent pas chez le Maitre (A. de V O G ~ , La com~unuutd et l 'abbe', 196 1, p.44 1).
". 8 In ipsa appelIatione nutninum mIli liceat a h puro appeIIare nomine, sed priores iuniores mos fiatrum nornine, iuniores m e m priores mos nonnos uocenf, quod inte/fkghr pafema reuerentia. s (RB 63.1 1-12). Sur ce passage, c t A. de V O O ~ Lo cummumtP et I'abb4, 1961, p.442-44.
n. RB 63,15-16 : a Vbicwnque autem sibi obuiantfiatres, iunior p r i m benedictionem petat- Transeunte maiore minor surgat et det ei locum sedendi, nec praemmat iunior consedere nisi eipraec$iat senior suus, L.. ] w.
Selon R Pat.2 (iiii,p278-79), un ancien a toujours p&Cance pour parler et un infdrieur ne prend la parole que lorsqu'elle lui est donnde. La meme idte se retrouve aussi dans la R Fmc- : * Coram seniore suo prior nullus ambulet. neque nun iussus sedeat, uel Ioquotur ; sed honorem fatri seniori et reverentiam uf condecet conperenter exhibeat- w (x,p. 149).
". RB 22,7.
p&&ientes, un "plus mcienW par rapport un "plus jeune", mais un membre du p u p e des
"plus anciens" au sein du monast&e.
Dans certaines occasions, Benoit etablit da distinctions entre les anciens : il
pr6conise en effet de choisir Catains moines B L'int6rieur de I'ensemble des seniores pour
accomplir des missions ddlicates, oh il est &es& d'intervenir aupks d 'hes
particulihent hgiles. Ainsi, lo~squ'un fk&e est excornmunid pour avoir gravernent fautt!,
l'abbC lui envoie des seniores exp&hent&, qui sauront &valuer les progds de sa
contritiofl ; quand un moine a une pensee mauvaise dont il doit se confesser, il s'adresse
soit Zi l'abb6 soit aux seniores spiriruales26 ; am novices install& dans leur logement &em&
Benoit demande que soit envoy6 un senior a qui aptus sit ad lucrandas mimas 3'.
Malgr6 tout, la puissance des seniores/priores dam leur ensemble, c'est-&-dire
Iorsque Benolt ne mentionne aucune restriction et donc que seul le rang dam la commuuaut~
est pis en considhtion, est co&quente. Certes, ils se tmwent sournis au powoir de l'abb6
et de ses doyens, mais il leur reste une marge de manoeuvre importante? Les ordres d'un
senior/prior doivent Ctre automatiquement oMis par un iunior, sans discussion ; lonqu'un
fiere faute B diverses reprises, ce sont ses seniores qui ont le pouvoir et le devoir de le
tance?? Si un %re pease que xspriores sont init& contre hi, il doit aussit6t se prosterner
*- RB 272 : [abbasj &bet L..] imitere senpctar, id est seniores sqientesficrtres m. A. de v O G ~ p e w que ce tenne de senpectus signifie peutdtre congregatio semrnr ct il conclut : De toute faqon, il s'agit pour Benoit d'un tenne &ranger. L'impoctant n'est pas ce qu'il signifie en grec, mais ce qu'il Cvoque pour des oreilles lathes. w (Rf?, p.549n.).
=. RB 46,s. La R Fruc. parle de seniores probati (xii'p, 15 I). *, RB 58'6. ". Afm qu'un ~ i 0 r imocem ne soit pas poursuivi et opprime par la mCchancet6 d'un senior, la R Fnrc.
ordonne l'abM de ne pas nndre ses jugements en fonction des status des penonnes (xiii,p.l52) ; un tel reglement lahe deviner a conturio la g rade marge d'intervention dcs seniores.
29. RB 23'1-2 : Si quis fiater conhrmm aul inoboediem aut superbur aut murmuram uel in aliquo contrarius erktem sanctae regdae etpmcccpt& smiomm suorum contemptor r e p e m ficerit, hic secundum Dominici nostripraecepncm admoneatw semel et secundo secrete a smioribus sub. *.
RB 71'4: si les Wres doivent avant toutes choses oMir aux ordres de L'abM, du pdvat et des doyens, de cetero omnes iuniores prioribus suis omni caritute et sollici~udine oboedianl. *
Le chapiue 68 de la MgIe de saint Benoft h q u e le w oh une action impossible est ordonnt?e un fiere. Celui-ci est appelC m e fois 8 h i o r W. Celui qui lui a donnt I'ordre est dCsignC par les tennes a iubem n, a pi sibipraeest et prior m. Du fait du flou de ces temes, il est peu probable qu'il s'agisse de I'abbe. Dans les dgles anciennes, telle celle dite des qua= P&res, il anivait que Ie supt?rieur soit appeld a b quipraeest r, mais
devant eux et leur demander pardon? Pout toute dtkision que doit prendre i'abbe, celui-ci
doit consulter les seniores ; il ne prcnd aussi en campte l'avis des imiores que lorsque
I'affaire est de grande importance? Un ou deux seniotes mupent la difticile charge de
circatores, sosorte d'espions cpi enent dans Ie rnomtb am hems creuses et doivent punk
les &es occupds ides &hes ohues? Si tous les moines ne peuvent d o e dans le m h e
dortou, ils se rassemblent en groupe de dix ou vingt a se reposeat sous la surveillance des
seni~re?~. Lorsque I'abbt q o i t B sa table les &es de son choix, un ou deux seniores
doivent m a l e tout demeurer aup* des autres eres pour les meillex?
Ainsi, les seniores remplissent p~cipalement des &hes de conseillers et de gardiem
a u p k des autres membres de la communautt5 Or, lorsque Benott p k i s e qui, des fikres, est
place sous surveillance et soumis aux restrictions, iI s'agit toujours de jeunes. Les iuuenes
ne peuvent prendre des bains fiequemment? Comme il a W mentio~t5 plus t6t, Ies
adulescenfiores ne doivent pols donnir cate B cdte mais &par& par des seniores. De meme,
ainsi que les pueri, ils ne doivent pas etre soumis h la peine de SexcommUILication lorsqu'ils
cette formule n'etait jamais accornpagnee d'un compl&nent d'attriiution specifique, comme c'est le cas ici avec sibi V. I1 faut donc envisager que ce chapitre concerne tout rapport entre un senior/prior et un hior . La conclusion de Benoit est que ce dernier doit essayer d'accomplir l'ordre donne, mOme s'il est au-dessus de ses forces-
Si le fautif ne s'amende pas, I'abM seul decide alors de la gravitt de la fiute et du mode de punition ; personne n'a le droit de fiapper ou d'excommunier un autre 6 - h sans son ordre (cf. RB, 24.25 et 70).
Selon R Mac (3-p.374-75 ct 12,p376-79), un ordrt d'un ancien doit &re q u cornme le salut et celui qui n'obtempke pas est aussit6t puni Une id& similaire se rctrouve dans la R Or., sinon qu'il est question des praecepta maionnn et des consilia senionan (I9,p.476-77), mais par la suite l'auteur insiste diverses reprises sur la ndcessite de s'en temettre awt ordres et avis des senior- (22,p.478,25,p.480-82,26,p.482,27,p.484, 28,p.486,29-30,p.486,3 l,p488,32,p.48%). Ce sant aussi les sariores qui cornmencent par cumger un @chew dans la R Flue, (xv,p.154).
30. RB 7 1,608: Si quk autem fiater pro quauris minima cuusa ab abbate ue[ a quocumque priore suu corrbitw quolibet modo, uel si Ieuiter senserit animus prior& cuiuscumque contra se iratos uel commotos quamuis modice? m a sine mora tamdiu prostratus in terra ante pedes e i . iaceat sati$aciemP usque dim benedictions anem illu commotio. rn
''. RB 3'1-12. Jc discutctai longuement du sens dome au iunior de la phrase RB 3 3 dam le chapitre des enfants, car, selon mot il n'inclut pas ces derniers.
Selon R Put.2 (ii,p.276-77), les iuniores ne devaient prendre la parole au Chapitre que lorsqu'ils dtaient intenogb.
If . RB 48,17-2I. ". RB 22'3. H. RB 56,3, ". RB 36,8.
ont fad , n'ayant pas l'intelligence nCcessairr pour compmcire ce mode de c o d o n , mais
sont punis par des j e h et des co* ; combim donc plus -powons-nous exbapoler - doivent-ils C t n jug& hcapables de sunmiller et punk leurs f k h s , & la diffknce des
seniores.
A L'oppod, BenoIt ne mentiorme expressbent que deux fois 1 s senes dam sa we,
et jamais popleur interdjre quelque chose ou sugghr la mise en place d'une quelconque
surveillance de leurs agissements. Dam un cas, il s'agit de leur pennettre de dQoger B la
regle si jamais ils desirent manger en-dehoa des heures? Dam l'autre, Benoit demande
qu'un senex sapiens soit p l d comme portier a la pork du monasttre pour servir de filtre et
de point de contact avec le monde extCried8. On Etrowe donc B nouveau ici le rdle de
surveillant habituellement attribue aux seniores. Si jamais ce senex se sent incapable de
sutFre B la tiiche, un iuniorjiater lui est assign6 porn hider. L'expression hiorjiater put,
soit &e traduite IittCrdement par un a Mre plus jeune que ce senex *, soit dksigner un fitire
du groupe des iuniores. Le fait que ces deux interpr&ations soient plausibles montre B
nouveau la frontitre tr5s hgi le skpamt i'interprtitation litterale et 19interpr6tation
hi6ran:hique des termes iuniores et seniores/priores. Cette information atteste aussi que les
membres les plus jeunes de la communaut6 remplissaient probablement des aches
subalternes.
Que put-on donc d6duire sur les iuniores, B partir de lY&ude des seniores/prioores ?
Si seniores, en tant qu'appellation des personuages les plus bu t s places clans la hitrarchie
monastique, ne fait pas uniquement rdf6nce B l'iige, du fait de l'usage simultan6 depriores
(qui 6voque l'anciennetk et la pds&nce, non l'ige) et du sens de senior comrne seigneur, il
en va autrement pour le vocable iuniores. Aucune autre appellation ne fait rt5eUement
concurrence B ce terme, minores restant d'usage peu Mquent. Or iunior renvoie directement
16. RB 30,203. ". RB 37,1-3. le reviendrai bien entendu nrr ce sujet dam le demier chapitre de ma thbe. ''. RB 66,l.
et indiscutablement A l'tlge : il est significatifh cet egard qu'Adalbert de V o w ait ttaduit
iuniores par les "jeu~les", dtjh dam son owrage Lu communuufe' ef l 'abM, et encore dans son
6dition de la RB? Cette distinction ahantique en- iuniores et seniores n'est pas un simple
hasard. Dans le groupe des seniores d'un monastk bencdictin, se trouvaient certainement
Ies moines les plus fig& du licy qui avaient gmvi les echelons g r h A l'ancienaette, mais
aussi des individus plus jeunes, qui avaient ete nommds abbe, p&v& ou doyen, de par leur
origine ou @ce B leurs v-. Les rangs des imiores dtaient en revanche plus unifonnes,
compos6s pour l'essentiel de jeunes moines. Certes, en thbrie, quelques l a b en&s sur le
tard et ne pouvant se pdvdoir d'aucun grand nom ou dons cons6quents au monastkre pour
etre promus, plus des moines endurcis dam le ma1 et d6clas&s7 devaient se mEIer I eux ;
pourtaut, je n'ai jamais trouvk dam les sources un iunior qui soit &em. [I est impossible de savoi vers quel 5ge et a la suite de quelle action, un moine, en^
comme oblat dans m e abbaye, ~joignait enfin le gmupe des seniores : nu ce point encore,
Ies sources normatives monastiques sont totalement silencieuses. A l'exception des quelques
iuniores qui ktaient soudainement promus abbes, prieurs ou doyens, les autres moines
passaient le cap de la "&nioritP aussi dis&tement qu'ils hchissaient I'ige o t Ies auteurs
cessaient de les appeler iuuenes mais ne les qualifiaient pas encore de senes, c'est-a-dire
aussi discr&tement que, dam bien des soci6tis, les hommes glissent de la jeunesse B la
39. D m ses editions d'autres rCgles anciennes, il arrive malgrC tout qu'A de v O G ~ propose des traductions diffCrentes de iwtiores. Ainsi, dans la Rtgle orientale, iI traduit "paler ak iunioribur" par " f k h non gradd" (R Or, 32,p.489) et dans la Troisihe R&gle des Phtes, "iuniores" equivaut ;2 "inf6rieursw (R P a ~ 3 2,p.532). Dam cette derniere oeuvre, le iunrbr est oppod & celui qui est dtja clerc (13,p.540) ; mais, comme le remarque A, de VOO-, cctte dgle, composCe lon d'un concile, pone aussi la marque de son origine cldricale (Les rtgfes monastiipes, 1985, p.58).
". L'histoire du vieil abW Pinufius, qu'evoque Cassien dam ses Iktitutiom ce'nobitiqties, est pstentde par I'auteur Iui-rnhe comme un cas de figure cxceptiomeL Il etait h Gte d'un grand monast&e lorsqu'il ddcida par humilitt! d'abando~er ses fonctions et cssaya de se f a i i admettre en unc autn abbaye comme vieillard IaTque, p a m a inconnu de tous, On tarda beaucoup B l'acccptcr et ccla fbt fait avec &pugname- I1 fit place sous les ordhs d'unfiurer Mior t t insCrd dam les rangs dts cnfants c t des iuniores. Quand, trois am plus tar& les rnoines de la communaut6 apprirent la vttitable identit& de Pinufius, ils s'ex&rent dc I'avoir gad6 aussi longtemps dans Ies rangs des iafdrieurs (texte, intro, trad et notes par LC. Guy, (SC 109) Paris: &I. du Cerf, 1965, IV,30,p,166-69)- Cette anecdote montre, premitnment, qu'un riche ou puissant vieillard n'dtait pas laiss6 u&s longtemps dam les derniers khelons, et, deuxi&memcnt, que les vieillards demunis, qui, eux, auraient Ctd pIac6s aux derniers rangs panni les iuniores, etaient exceptionnellernent admis. Ainsi, paradoxalement, ce passage de Cassien confirme que les iuniores Ctaient littkralement les "plus jeunes" des communautds.
rnattuit6. T& certainement la promotion une charge importante, accompagnde de
fe~~0nsabilit6s, telle la &he de celI&ier, attestait que son b6ficiaire etait ou devenait par
ce fait m h e un senior. Mais la question du pourquoi un junior h i t soudainement m u
comme apte A devenir senior demeure.
En M t e , tout Wt fonction de comportentent. Or le comportement egg6 d'un
individu pour qu'il f it promu au long de l'dchelle hihrchique ben6dictine etait celui d'un
hornme mk. A diverses teprises daas la RB, il est question de matwitas ou grm'tter, &st-i-
dire de quaiit& qui, si on se rappelle le tableau I, etaient habitue1Iement associees avec les
50 ans et plus. Le cellkrier doit &e mafuris moribus ; on doit powou Stre siir de la vie
et des moeurs des fitres en charge des outils et autres biens matdriels du monasttre ; la
grauitas est de rigueur pour bien accomplir l'opus divin ; le fitre a qui l'abbd permet de
parler pendant les heures de silence doit dgaiement en faire preuve ; Benoit & o q e la
matwitas du portid'. Dans la longw citation qui suit, Marianne Bo~efond explique selon
quels crit&es un Romain at consid6ri miu pour occuper une position au Senat. L'Sge el
irnporte peu, dam le sens oa un jeune peut endosser une position de pouvoir, mais, pour ce
faire et en se faisant, il est devenu "vieux". Une telle manitre de penser et un semblable
vocabulaire (avec I'emploi de senior) ne devaient pas etre &rangers B Benoit lorsqu'il nSdigea
sa rggle car celui-ci connaissait bien les institutions romaines.
a [...I il y a deux comportements possibles de la jemesse ; I'un, courant, attendu, est la dissipation ; I'autre est l'acceptation des normes qui dgissent la conduite des autres (les view), categorie qui n'est pas definie par l'tige mais la fonction : ce sont eux qui composent la cite en tant que structure politique. La jeunesse est donc ddfinie 2i la fois par un &ge, domde neutre, qui s'impose au sujet, et par un comportement, qui est au contraire un effet de sa volont6. L'intdgration h la cite ne se fait pas automatiquement par I'arrivde ii un ige p k s , elle & d t e d'une initiative qui fait renoncer B la conduite qui est ordinairement ~ l l e des jeunes pour adopter les normes du monde politique avec pour W t a t la ~econnaissance de ce demier. L'addescentia n'est donc pas considdrt?e par Tite-Live comme un tige aymt ndcessairement ses propres valeurs, mais cornme un &at tcaasitoire, qui prend fin non par un rite imps6 mais par un acte de volonte du sujet pour sYint@er ii la spMre politique. Sans doute cette conception originale de la jeunesse explique-t-elle que I'historien ne mette
jamais en sctne, dam ses comptes rendus de dances, des iuuenes : les jeunes gens entds au Senat se sont d@ouilleS de l eu comporternent pass6 de jeunes ; ils ne se diffhncient pas des autrcs &ateurs en tant quc tels. On rejoint ainsi l'hypoth&se formul6e pr6ddemment d o n laqueUey sym&iquement, seniores ne fait pas r6fCrence L'ee, mais & m e attitude politique. 42
Benoit prit beaucoup de prbutions pour que la communaut6 monastique qu'il
dessinait au travers de sa dgle n'ait pas les d6fButs du sikle. Dam m e f a d e chamelle, les
liens de sang d6finissaient les f h n t i h de L'amour : Benoit proposa ii la place une filiation
spirituelle. Dam une f d e chamelle encore, la patemit6 et l'iige donnaient le pouvoir B
quelques individus, q u e k que soient lem qualit& in-ques : Benoit fit en sorte que la
valeur spirituelle fit le critQe premier pour ddsigner ceux qui devaient commander aux
autres. PeutPtre parce qu'un tel crit&re &it subjectif, ou peut4tre parce qu'il6tait conscient
que peu d'hommes Ctaient dignes de s'dever ainsi d&s leur enMe au monastiire, il fixa en
outre c o m e critkre de base pour l'avancement, I'anciennete. Malgr6 toutes ces
transformations, et B condition de prendre beaucoup de prkautions, je pense qu'il est
possible de faire le cheminement inverse de Benoit, B savoir utiliser son portrait ideal de la
famille monastique pour comprendre quelles qualites et quels defauts dtaient associt5s aux
plus view et aux plus jeunes.
La toute premi&re prkcaution ii prendre, du fait que cette thkse porte sur les annees
909-1 156, et non la premi6re moiti6 du VIe sikle, est de savoir comment les Clunisiens
interpreterent cette famille bdn6dictine idthle.
". M. BONNEFOND, Le Sdnat dpublicain et les conflits de gendration m, M'iunges de l'hole Fran~aise de Rome - Antiquit&, 94 (1 982): 2 16.
D. UNE ~ R A R C H E PARAU&LE MAIS ENCORE SECONDAIRE
(SACERDOrn, UUITAE, CONVERSQ
Avant d'aborder la question de la definition des groupes iuniores-sniiores/priores
a Cluny, il faut s'intemger sur une autre fome de division, celle entre les convers, les
pstres et les diacres. Elle etait encore quasi inexistante dans la Regah Benedicti, compte
tenu de la presque cornpkte absence de pr6tr-e~ dans le monachisme des premiers si&clesl,
mais prit peu h peu m e importance gandissante, comme le laissent enbvoir le Liber
tramitis et plus encore les dew demim coutumiers clunisiens. Je vais d6montrer que
l'apparition de ce noweau mode de dhupage de la communaut6 monastique ne signifia pas
a court terme la disparition du classement tripartite pueri-iuniores-seniores/priores.
Simplement, le nombre &randissant de pretres dans les monastke~ et les r6ajustements
cultuels qui en dCcoul5rent donn&ent naissance a une seconde mani5re de structurer la
communaute, qui fut d'abord utilisie en des circonstances bien Specifiques).
'. A la simple lecture de h RB, il a p p d dvident que le nombce de p6tres prenant place dam ks rangs des moines etait extr2mement bas du temps de Benoit ; d'aitleurs, ce demier se montrait d'une e d m e rn4fiance & I'6gard des pr&es dkireux de rentter au monastere : il craignait que ceu-ci ne fassent preuve d'orgtleil en se voyant entourer de simpIes moines, tous laiques (RB 60 et 62).
II n'existait pas non plus de convers dam Ie premier monachisme occidental, ni dam Ie sens ou le haut Moyen Age entendait ce terme (lak qui s9est convetti B Piige adulte), ni dam le sens qui se fit jour A pactir du XIIe sikle (moine lakpe ciavantage voue aux aches manueIIes). On note pourtant, dam la Vie de Benoit par Grtgoire le Grand, h mention d'ua certain Goth, p p e r spiri., qui, aptts son en- au monast&e, fbt astreint B des occupations essentiellcment physiques, cumme d#roussaiUcr un pan de tern pour en fairt un jardin (Diafogues, I i m 11, dd. A. de V o w , (SC 260) Paris hi- du C e ~ 1979, W,15plS4-57). Hormb cet individu, trb secondaire dam le &it, Ics trois personnages principaw de l'abbaye Ctaient : I'abW Bcnoit, un iuuenior' Maur, qui servait de second B Benoit ( m a m i diutor), et w puer, Placidc. Celui-ci mnplissait de petites tilches, comme d'dlcr chcrcher de I'eau, mais il avait parallelement besoin #&re protegd (cf. episode du sauvetage de Placide par Maur, sur Ies ordrrs de Benoit, lorsque I t premier f'ailllit se noyer). On rctrouve ainsi les archetypes des trois principaux g r o u p d'un monast&re Mnddictin, les seniores, ies iuniores et Ies pueri,
2. Sur I'accroissement du nombre des pr&cs B Cluny, cf, mtre autres H.R PHILIPPEAU, Pour l'histoire de Ia couturne B Cluny =, RM44 (1954): 148.
Le travail de refdrence sur les convers clunisiens est celui de W. TESKE, Laien, LaienmUnche und Laienbmder in der Abtei Cluny- Em Beitrag prm "Konver~c~l-Problem" W, FrrikSt-, 10 (1976): 248-322 et 1 1 (1977): 288-339. Bien que cet auteur declare d& I t s convers du Me sikle, il base principalement son etude sur tes coutumiers de Bernard et dtUlrich. De ce fait, il ne timt pas asxz compte, me semble-t-il, de l'&oIution de la place des convers au fil dcs coutumcs clunisiennes, Cf, aussi G. CONSTABLE, a "Famuli" and "ComersrW at Cluny - A Note on Stahlte 24 of Peter the Venerable n, RB 83 (1973): 326-50 et I'article, peut- etre peu ddtailIC et politique, mais tr6s tin de C. DAVIS, a The comernu cf Cluny : was he a lay-brother ? m,
Si, dans un premier temps, on fait abstraction des convers, on remarque que la
division SO us-diacns I diacm I ptih.cs s'int&gre parbhment dans ceUe des pueri I hiores
I seniores. En effet, la RB nous apprend quc les p r h s Merit plads dans les rangs les plus
dev& de la c~mmuna~~. De plus, le LT nomme ceux qui portaient Ies leliques en t&e de
procession, tan& des sacerdores, tanat des seniores, p u v e que les prrmiers faisaient partie
du grow des seconds? Ceci ne veut pas dire pour autant que tolls les p&res participaient
au Conseil restreint de l'abbt a jouissaient d'un p o d important dam l'abbaye, mais
qu'ils prenaient tous place dam les echelons supc!rieurs, avec certahs d'entre eux plus hauts
et plus puissants que d'autres.
De la mtme manih, on note que le terme sous-diacre est synonyme de puefl.
Comme les enfants, les sow-&acres portent les textes 6vang6liques lors des processions7 ou
pendant le service LiturgiqueB, et, comme les enfmts, ils ne sont jarnais revetus de chapes
( cap~ae )~ . Lorsque, dans le LT, il est pdcisb que les enfbts ne doivent pas participer au
senice de la messe matutinde, ii est ajouti que le pStre doit se ddbrouiller seul avec le
levite, c'est-&dire en l'absence de sou~aiacre~~. En dehors du cadre pdcis du service a
l'autel, il n'est jamais question des sousdiacres dam les coutumiers : lorsque les pri3res sont
&stingutis des lkvites et des convers lors de certaines processions, les membres restant de la
communaute sont rCunis sous l'appellationpueri ou infantes, jamais sow celui de sous-
diacres. Si tous les sous-diacres etaient des enfants, il est impossible d'affinner avec certitude
dam Benedictus - Studies in Honor of St Benedict of Nursia, (Cistercian Studies, 67) Kalamazm (MI): Cistercian Publication, 198 1, p.99-107.
'. RB 60,4 et 6l,l2. D&s la RB, on note que la prkunce de pdtres dam Ies rangs de la communaut~ pouvait necessiter la mise en place d'un double systhe de classement : l'usuel, 0th I'anciemete reste le &&re de base, et un autre, employe surtout a I'dglise, oil sant pris en compte Ies ordrcs cldricaux (RB 60,6-7).
$, Les sacerdotes : LTS4.2,p.68 et 58.2.p.89. Lts seniores : 23,p.41 et 72,p.108. 6. LT 16 l,p.2W4 a 19. '. LT 70.2,p.lO4' '. Pendant la mcsse, un enfant fait le tour du chocur en portant les kvangiles (LT 154,p22*1-0), ache que
rem plit habituellement le sous-diacre (LT 16 1 ,p234l0Ii). 9. Cf. index des G4 et du LT "cappa" et n~bdiaconusn. I1 sera discute plus loin des viitements des pueri
lors des grandes eta, alors que tous les f&es y compris les convers, ou seuls Ies pretres et les kites, sont en chapes.
lo. LT 154,p.227', Cf, aussi LT44,p.S9".
que I'inverse &it vrai : rien ne certifie en effet que Cluny formait tous ses oblats a la
prrise.
Puisque les pr&es Went des senfores et les sousldiacres despm; on peut supposer
que les &acres appaaenaient B l'ensemble des iuniores ; ce point doit malheureusement
rester B L'ttat d'hypoth&se et ne put &re demon&. En effet, en dehors du sewice Ii l'autel
et de quelques rams processions, il n'est jamais question des diacreSflCvites - les dew
tennes sont synonymestl - et j'ai d6j& soulign6 la faible Bquence des mentions des
iuniores. On verra tout de meme plus loin, avec l'analyse de la structure des processions,
qu'une telle hypothese est plus que vraisemblable.
Par dt!finition, les convers n'etaient ni des enfants, ni des clercs12 : ils ne prenaient
donc pas place dam le groupe des pueri, ni dans celui des leuirw, pas plus que d m celui des
sacerdotes. Une autre appellation qui leur ktait consacrke etait "idiotre". Les coutumiers
clunisiens montrent par ailleurs qu'il existait deux ensembles distincts de convers, ceux qui
chantaient et ceux qui ne chantaient pas. La Vita Geraldi permet d'tclairer ces diverses
designations. La demiere distinction &it probablement le miroir d'une difference d'origine
sociale. Odon sptcifie en effet que Gdraud apprit tout edaat le psautier : il apprit
certainement ainsi, non seulement 5 mkmoriser ce texte, mais aussi a le chanter. On peut
supposer que seuls les lgcs venant de familles relativement aisdes itaient initids de la sorte
au chant pendant leur petite enf'ce. Si jamais il leur arrivait ensuite d'entrer dam un
couvent, ils pouvaient alors prendre place d m les rangs des convers qui savaient chanter.
Lonque G6md tomba malade et que ses parents cornmendrent B craindre qu'il ne le restit
tout sa vie, i l s lui firent exceptionnellement poursuivre ses etudes, pour lui pennettre, si
n&essaire, d'incorporer 1'~~lise. I1 apprit aloa la grammaire, en plus du chantt3. Le fait est
". LT208,p287". Cf. aussi f'index du LToh P. D N E R cenvoie pour "diacrcs" h "ltvites" et invencment. 12. Cf. W. TESKE, * Laien ... -, FrthSt-, 10 (I 976): 295, 13. VG' I,iv,colcoL645A-B. Para que cettaiDs des membm de l'@k dculi&re ignoaient Ie latin, des plSas
pouvaient B I'occasion &re qualit?& d'idiotae (cf. par exemple DM l,iiii,p. 13-14), Probablement, de tels personnages dtaient mal@ tout class& dans les rangs des clercs, si jamais ils 6taient accept& dans un monasdre.
dicrit par Odon come inhabitue1 pour un laic, ce qUi explique pourquoi les convers
Ctaient appelh des idioae en cornparaison des o b k .
Avant de traiter de la Question centrale de cette section, c'est-Adire de l'importance
de la division convers I 16vites Ntres, il ne serait pas inutile de savoir oil se situaient les
convers entre les izmiores et les seniores. Le vrai pmblhe qui se pose est de comprendre si
certains convas pouvaient devenir des seniores ou s'ils d e n t tous obligatoirement des
iuniores- Un dglement du LT permet de &pondre B cette question-
In itinere si pergunt duo conueni et unur sacerdos qui iunior illarum sit, ubi-que sederint, debet sacerdos sedere in medio iIIorum, @ando uero perrexerit unus ex eis nnn sacerdote, sempet debet sacerdos sedere super illum ; e t im loqui non conceder illurn nisiper eius licentim. m M
Je souligne au passage qu'aucune pdcision ne permet de savoi si le vocable "imior" ci-
dessus doit etre interpdtk au sens littdral ou hidrmhique du terme ; mais peu importe, ce
flou montre bien Simportame des points de contact entre la division des @es et la division
higrarchique monastique. Ces deux phrases nous apprennent que, dam le cas pdcis d'un
sacerdos iunior, en voyage en dehors de la cldture en compagnie d'un ou deux convers, le
premier avait pr&hce sur les deux autres : en effet, il s'asseyait, ou bien plus haut que son
unique compagnon, ou bien entre les deuxH, et le convers a'avait le droit de parole que
Iorsque le pretre le lui conctidait Cette prdcision de l'auteur du LT est tr&s intdressante car
elle suppose que, face au monde extdrieur, un pr&e devait se cornporter comme le supirieur
hierarchique d'un convers, mais que tel n'dtait pas le cas P I'int6rieur du monast&e :
autrement pourquoi pdciser ? Entre les murs du cloitre, ranciemete ou I'iige (selon le sens
de iunior) &it pris en compte, non la p&trise, ceci en accord avec la RBI6. L'autre intest
de ce passage est d'attester que des convm pouvaient &re des seniores vis-a-vis d'un p&tre.
'? LT 147,p212. IS. Sur la pratique pour un supdrieur de se placer entre deux inf6rieurs, cf. par exemple LT 1 83,p.BP7. 16. RB 62,5.
Les pfitres faisant partie du gtoupe des seniores, on put en conclure que certains convers
en faisaent partie aussit7.
Dam quelles circonstances les wnvers Went-ils sortis des tangs des iuniores I
seniores, de telle sorte quc la c o m m ~ se divisait non plus enpueri I izuzzbres I seniores,
mais enpueri I conuersi I leuitue 1 sucerdotes ? Dam Ies Consuetudines antiquiores et le
Liber hmitis, les mentions de cette nouveIle division du mo& restent limit& h des
moments tr& pdcis de la vie communautaire. Le seul cas de figure oh l'emploi de ce
decoupage est incontournable est bien entendu celui de la messe : un pdtre, ou plusieurs
selon la ctlebration du jour, est aide d'au moins un 16vite (&acre), d'un ou deux sous-
diacrest8 et de plusiem conved9 . Deux fois par jour donc, pour la messe mineure et la
messe majeure, la division que j'appellerai cldricale, pour l'opposer ii ceUe baste sur
l'anciennet6, etait actualis& ; c'est beaucoup, pourtant elle ne concecnait qu'une part infime
de la communautt : le petit groupe qui servait 9. l'autel. Une autre remarque que suscite cette
repartition des tithes lors du service divin est que les conven den dtaient nullement exclus :
ils se distinguaient certes des clercs par les ~ c h e s qui leur etaient dbvolues, mais ils
participaient malgrk tout au grand myst6x-e de la messe et avaient le droit, eux aussi, de servir
& l'autel.
". Comme p r a m que Ies convers pouvaient atteindre les khelons 1es plus &lev& de la socidtd monastique, cf. par exemple l'histoire du comte HeIdric, qui entra h Cluny sous MaYeul, apt& avoir abandome sa femme et tous ses biens, et qui devint ult~ricurcmtnt abM de Saint-Germain d'Auxcm (987-89), de RCome (1003), puis dc Flavigny (987189-tl010 ; cf. D. IOGNA-PRAT, Agni immacuIati, 1988, p.134). Cf, aussi le a s du convers D m d , qui devint ensuite abb6 de Moissac (1047-1055) puis 6v€que de Toulouse (1055-1071 ; W xxip.69 et C. DAVIS, a The C O ~ W S S L S ... m, dans Bedictus ..., op.cP, 198 1, p.99400) ct celui dc G e o m y III de Semur-cu-Briomais, neveu dc SHugues, qui fbt n o d prieur de Mmigny (qui avait &6 fond6 par son oncle et son @re Geofby I1 ; DM IJ6,p.80). Stu le fait quc certains convers pouvaient changer de statut au sein du monast&re, cf- W. TESKE, Laien ... m, FHkSt, 10 (1 976): 3 12sv.
I t . L a structure habituelle dunissait un p&e, un diacce et un sousdiacrc, mais ces nombres pouvaient &re sensiblement augment& Ion des grandes Etcs (cf. les index des C4 et du LT "subdiacon~")~
19. IIS n9Ctaient pas rnoins de cinq convers pour les messes domnicales et celles des jours h douze le~ons (cf. LT 162,p.235).
L'autre 6vocation de cette division dans Ies GI et Ie LTconcerne en revanche toute
la population c 1 a d e : elle prenait place lors des grandes f&esY B l'extdrieur de l'tglisey
pour la ptocession, et dam le choeur, pendant la messe majeure. Deux faits sont ii noter : la
place missante donntk & cate division entre les C1 et Ie LT, et paraU&ment, de manitre
un peu contradict~ire~ l'incertitude des Clunisiens sur le dle qu'ils devaient assigner am
convers.
Dans les C1, la structure de la tds importante p d o n des Rogations est dkrite :
les conven ne sachant pas chanter dtaient d&1& pour prendre place en avant des enfats ;
le reste des e&es suivaient par ordre d'anciennetb.
Cum uero exierint. sonentw omnes si'os. Cantor uero inchoet antiphonam De Hierusalem. Secuntur illos alii conuecsi qui nmciunf canfare, deinde scola. Post eos cantores retro ordinate sicut sunt priores. duo et duo. w2O
Ce qui donne la formation suivante :
convers ne chantant pas I enfmts cantores
Aucune autre des processions mentionnk dam les manumits B et B1 des CA n'est d6tailIQ
de la sorte : faut-il en conclure que ce tableau pksente le classement habitue1 des forces de
la communaut6 ou doit-on plut6t supposer que ces pkcisions sont dom6es parce que,
prkisement, le plan de marche pour cette occasion etait inusitt ? Par aiUeurs9 ces coutumiers
n'expliquent pas ce qu'ils entendent parfiatres lorsqu'ils dklarent que a C ~ o s uere debet
donme ad omnesjFatres cappas @our la Purification de la Vierge) ou Fratres esse debent
reuestiti in cappas @our I'Exaltation de la Sainte Croi~)~'. Incluent-ils les enfaats et les
convers ? Pour mieux cornprendre comment s'habilIait et processionnait la communautC les
jours de grandes Etes, il faut se toumer vers le LT.
On apprend ainsi que les enfants ne portaient jamais de c h a p : le fait n'est pas
prdcise pour chaque grande Ete, d s dsamment Wquemrnent pour comprendre que telle
20. CA BIB2 45,p.101'. Le manuscrit B des C4 s'intemrnpt avant la dactiption de cette fete (cf. C4 p.88 et p. 196).
". CA BB'B2G et C 27,p-40 ; CA B1 60,p. 13 1. Pour I'Exaltation tie la Sainte Croix, les manuscrits B2 et G pn5cisent que Ies enfants portent des tunicae (U p. 13 1). Hornis ces dew Etes, il n'est pas autrement question de cC1Cbrations pour lesquelles "tous" les eres revetent des cham mais il est possible qu'il ne s'agisse 18 que d'un oubli et que telle Ctait la pratique lors des autres grandes Rtes religieuses.
etait la pratique gdnWe. Pour ce qui est des convers, la we variait : lors des Etes les plus
importantes, ils endodent me chapen, mais les p&tres et les diacres Went les seuls A le
faire pour les fm seoondai.m#. Il existe dew d e s exceptions B ce sch- le jour de la
". Pour la Nativitd : Indwnnv omnes cappis &nte secretario she armario r (LT, 13.4,p.23"). Pour ~'~piphanie, = omnes adomertl se cqp& e t im idiote. (22.2,p.34s). Pour la Purification de la Vierge : a Tmc &ntw ab armario uel secretario ub omnibus cappae, etiam ad conuersos, adpueros pippe condonentru tunicae rn (LT 3 1 3 ,p.421 I). Pour la Cathe&a de Saint-Picm : Ad m h a m maiurem omnes sint adormti cuppis er infanta tunicis. - (LT 39,p.4g13. Pour le Dimanche de PiIques : a El nuw: imQiot ipe secretark distribuere -apprrs> per singulcas afiar, e t im ad comersos, ad infmtes micas. (LT 58.2,p>O'0). Pour la S.Maeu1 : Qua dicta tribuat armurius uel secretark cappclr per singufos, p e r k tonicas. (LT 6 9 , ~ . I0 I '3. Pour l' Ascension : = Sonantibus interea sipis accipipt cappas aecciesie custos et tribuat per singufos, etiam ad conuersos, <a& in$ i i e~ uera tunicas. . (LT 72,p.lOV). Pour la S Jean Baptiste : Ad maiorem missam cuncti sint uestiti cappis, etiam idiora Pueri toti tunicas habeant indutas. * (LT 83,p. 1 2 0 . Pour la S.Pierre et Paul : a Turn personantibus cunclis signk det secretmius omnibusfrnribus cappar, peris tunicas. rn (LT 85.4,~. 132") Pour la Commemoration de S.Paul : 8 Ad maiorem <missam> omnes sin2 circumdati capptk pueri tunicis- * (LT 86,p- IM3). Pour 1' Assomption : a Secretmius tribuat cappm ad omnes, ad infanta hmicps. . (LT lOO.4,p. 15 1'"). Pour I'Exaltation de la Sainte Ctoix : a Tum dentur ad unumquaemquefia!mm cappae, ad infants tunicue. * (LT 1 1 t ,p. 167"). Pour la Toussaint : Induant se cappir omnes, etim comers& i@mtes tunicis. (LT 125.4,~. 1853. Pour la S.Martin : m Ad maiorem ommfiufres siht in cappis . ( ~ 2 9 , ~ . 191') Cet habillement (les ares en chapes, Ies enhts en tuniques) est 6galement -is pour transporter des reliques A l'extdrieur du monast6re (LT 168,p2412 a 9, pour la venue d'un mi, d'un dvEque ou d'un abb6 (LT 169,p.242I0, 170,p.243' , 171,p243' ), et lorsque la congdgation reqoit la dCpouille d'un M q u e (LT 205,p.283%). 2f. I1 est inutile dc dp&r ici les fonnules u t i l ' i puisqu'elks di-t peu entre elles. l e ne donnerai que
les deux premiiircs il titre d'exemple. Pour la S.Thomas : a omner sucerdotes atpe dimonisint indufricappk rn (LT IO,p.12'3. Pour la tieme me : a Omna sucerdotres atque diuconi circum&ntur cappb. . (LT 14,p.24-25). I1 en va de meme pour la SJean (LT IS,p.29'), I'Octave a p e NoCl (20,p301'), les tmis jours qui suivent le Dimanche de Piiques (58.4,p.92'4, l'Octave de la Rtsumction (60,p.949, k SShilippe et S Jacques (67,p.W 3, l'octave de S.Picm ct S.Pa~l(89,p.l37~7, la Translation de "notre saint p&c &now (90,p.13g1'), la dception des retiques de S.GrCgoire B Cluny (92,p.1413, la SJaques (93,p.142'), la caefebratio de I'tveque S.Germain (94.p. 14216), la S-Laurent (97,p.144"), la S.Tstuin (98,p. 147' ), la S.Bartholorn6 (104,~. IS6 ' ), la S Julien (105,~. 1583, la decollation de SJean-Baptiste (106,p.lS9I7 ), la Naissance de la Vierge (109,p.163' ), la S-Matthieu (1 I3,p.l7I '3, la S.Maurice (1 L4,~.173~), la SMicheI (1 15,p.174'8), la S.Aquih (l23.1,p.l 802'), la SSimon et S Jude (124,p.182[), et enfm l'annivenaire de la consCcration de la grande Cglise (l36,p.197l1).
S.Piem-am-Lied4 et celui de la S A M : lors de ces occasions, les convers sachant
chanter endossaient des chapes aux &tt% des p&tres et des d i d .
Compte tenu de cet &entail de possibilitb, il paraft difficile 5 premiere w e de
diterminer quel p o d t &re l'usage en cows queiques dhnnies plus t& lors de la nkktion
des CR ; j'inclinerais rnalgd tout 8 pemer qye les jours de grade f&e, les convers se vitaient
d'une chape, tout comrne les autres moines adultes. Jamais, en effet, ils n'ttaimt autrement
distinguds du restant des ens , except6 pour le service 8 l'autel. Cette hypothese parait
d'autant plus vraisemblable que, pour la Purification de la Vierge et l'ExaItation de la Sainte
Croix, a savoir les dew seules E t a o& le port de la chap par tous les fibs est 6voque dans
les CA, le LT inclut les converse
Comment expliquer la diversit6 des pratiques dans le LT ? Entre la tin du Xe et le
milieu du XI' siecle, les Chisiens ont considirablement &6 et enrichi leurs activitCs
Iiturgiques. 11s ont tout sp6cialernent accord6 une plus grande importance a la c616bration de
nombreuses Gtes secondaires qui n'etaient pas m b e mentionndes dam les CA. Peut-Etre
parce que le nombre des convers cornmen@ a croitre ou peut9tre pace que, clans I'esprit
des hommes de ce temps, le foss6 entre les lacs et les clercs se creusait de plus en plus,
certainement pour amener &vantage de complexit6 et de couleur a Ieur rituel, les Clunisiem
joutrent sur la distinction entre les ciercs et les convea dam leur cdrdmonid du choeur :
ainsi, lors de ces Etes secondaires, seds les pdtres et les diacres endossaient-ils une chape,
non les convers.
La question de la procession est plus complexe et il faut ditailler ici toutes Ies formes
possibles de cette cdrimonie. Certes, W. Teske a d6jh men6 ce travail en 1976, dans sa
". Sur la cdl~bmtion de cette fEte Cluny, cf, Donat R LAMOTHE, Mati- at Cfunyfor thefiast of Saint Peter 's chai . : @er the monurcr@t, Pm&, Bib. nat. Iat. 1260 I (around IO75), London: Plainsong & Medieval Mwic Society, 1986.
25. Pour la Ete de S.Pierre-aux-Liens : a Ad maiorem induantur omnes sacerdotes atque feuitae cappis, etiam et conuersi qui sciunt cantare. Infmtes habeant tunicas. rn (LT 95,p. 1443. Pour la S.AnM : Ad missam maiorem omnes sacerdots atqtie leuitae coornent se cappa etiam conuersi qui cantare ualent. = (L T 1 3 5,p. 195' I).
grande ktude sur les canvers c lu l i i s id , mais j'ai jug6 pdf-le de le reprendre nu ce
tMme particulier. Cet auteur n'a en effa pas mfEsamment tenu wmpte de l'&olution, d&j&
discernable mtre le C1 a Ie LT, mais qui s'accentua depuis le LTjusqu'h Bern et U&., qui
entra ma m e difficiation accrue des convers vis-his des autres moines clans le domaine
liturgique et pLOCeSSionne1. Par ailleurs, son interpdtation de catains termes peut &re remise
en question. Selon hi, les convers a les a convers ne sachant pas chanter ne formaient
qu'un seul et meme group, tout cornme par aillem les cantores, les prlores, les seniores,
et les sacerdors plus leuitoe. Enfin, il ne mentioxme pas dam son etude Ies processions qui
ne verifient pas sa the'orie (c'est-Mire oh les convers ne sont pas sdpar6s des cantotes), B
savoir celles de Nos, la Che, le Dimanche de Ptlques, la Pentecdte et pour l'onction des
malades ; et il ne fiiit qu'kvoquer en note la disparitd entre la description de la procession des
Rameaux dam le Bern. et dam le LT. Or, ces six cdlebrations sont les plus fondamentales
pour m e communaut6 de moines ; de ce fait, il s'agit probablement des processions ayant
la plus grande antiquitC.
Pour la procession de NoeL apks 4 seniores munis de reliques, 2 iuuenes ou infantes
presentant les ~van~i les et 10 convers portant candelabres, eau bhite, croix, encensoirs, et
autres objets de cet ordre, a [t]um subsequuntur infuntes cum magishis. deinde domnus
abbas, postmodum reliqui simt suntpriores. m2' Ce qui donne, pour la premiere procession,
le classement :
1. enfants 1 abM I moines adultes
Pour la purific&on de la Vie- ap&s 4 seniores, 2 edmts et 10 cowers, a subseguantur
eos infmtes cum magistris, deinde seniores bini ac bini sictit priores sunt et hmc conuersi
qui nesciunt cantare. A d ultimvm dornnw abb as.... r28
2. enfants I cantores I convers ne chantant pas 1 abbc
x. W. TESKE, Laien ... D, FriihSt-, 10 (1976): 294. ". LT 1 3,4,pa9. =. LT 3 12, p.41'.
Pour le ajds dem convers partant l'eau Mnite a m e mix, a et emt
sic per ordinem, ut infantes dseqtlcmha eos cum magistrik, deinde caeteri conuersi. in
nouissimo alii sicziti mt pn'ores.
3. enfants I convers I moines adultes moins les convers
Pour les Rameaw. a p S des fmnuli aves des fmones, deux iuuenesfiatres qui portent les
~ v m g i l e s ~ onze wnvers avec eau M&ey mix, etc., un pr&e portant le bras de Saint-Maw,
3 i 8 autres p&tres avec le reste des omements, 16 convers avec des reliques ( i i g e de
S . P i e d , corps de S.Marce1, etc.),
a [e]x him sequuntur i h s infintuli bini ac bini c m magisb+.s, exin caeteri maiores, simt sunt priores, duo et duo per ordinem procedentes cum dphon i s his, qui cuntare possunt et s c i m omnibus admatiss Ad ultimunm domnus abbus subsequentibus cum miversorum ordinibus laiconun
4. enfmts 1 moines adultes 1 abbe
Pour la BCkdiction du feu et les deux jours suivants, aprks f'eau Mnite, l'encens, la croix,
un petre et le secret&, viennent ensuite a dein infantes etpostmodum abbes et alii simt
sunt priores et post conuersi eos imitantes in nouissimis locis duo et duo. m32
5. enfants 1 abbe 1 moines adultes moins les convers convers
Le Jour de Ja Ckne, apres le mandatum des fieres, pour aller du Chapitre au r6fectoire, B la
suite du lutrin (anaIogium), de l'encensoir, de deux canddabres et d'un diacre, prenaient
place a dehinc alii duo et duo ; infates quippe in nouissimo loco ueniant ante abbatem- m33
6. moiaes adultes I enfmts [ abb6
Pour le Dimwhe de P S a apks la messe matutinale, 2 iuuenes ou 2 e d i t s portaient les
textes &atngdliques, 4 pretres les reliques, 12 conven les canddabres, encensoirs, etc. ; les
suivaient a dein mugismi cum infmtibu, abbm post eos, alii<s> senioribus uenienti<bus>
duo et duo sicut priores sunt- r3'
". LT 40,pS23. 'O. Au =jet de cet objet qui conteaait plusieurs reliques, & LT 189.p.260-61, LT 54.2.p.68 et LT
7 1 ,p,10621, LT S4.&p.6g3.
". LT SS3,p.74". 33, LT SS.7,p.78'. ''- LT S82,p.8g1'.
7. enfmts l abbt moines adultes
Pour les soit la seuk procession qui etait d M t e par ies CA, tous les moines
adultes, except& ceux aysnt eu un petit accident cette nuit-l& (a qui uliquid contagonis
admiserunt noais sopare m), portaient des phylact&es. A la suite des fmziIi, de 4 convers et
d'un sousdiacre avec les ~vangiles, venaient a qui cantme nesciunt, deinde scoh cum
mag'sh7's. Subsequ~ha eos cantores dm et duo per ordinem gradientes. dS
8. convers ne chantant pas I e n f i t s I cantores
Pour 1'Asc- apds 4 seniores portant des reliques, 10 convers munis de candelabres,
encensoirs, etc., deux enfats portant les ~vangiles, et un pr&e avec les insignes royaux,
a Post eum ueniat scola cum rnaghtri's. Dein sacerdo<te>s sicut smt priores. Et tmc laeuife
et alii qui nesciunt cantare. nM La formulation de cette phrase ne permet pas de savoir si les
diacres Ctaient ou non sdpards des convers, mais la procession de L'Assomption permet
d'opter pour le premier cas de figure.
9. enf'mts 0 sacerdotes I diacres I convers
Pour la Pentecbte, l'auteur ne mentiome pas qui porte quoi mais simplement l'ordre dam
lequel les objets @vangiles, croix, eau bhite, reliques, etc.) etaient port&. Viennent ensuite
a [dlein magistri cum infantibus. Abbas post eos. Alii seniores uenientes duo et duo sicut
priores sunt. n3'
10. enfants 1 abE 1 moines adultes
Pour 1'Asspmpyipa l'auteur se contente tgalement de domer le plan des objets pr6sentCs en
procession. a Dein infantes cum magistris et turn domnus abbm, ex hinc sacerdo<te>s et
postmodurn leuitae, nouissime conuersi. Ja
11. enfants I abbe I sacerdotes I diacres 0 convers
Les autres processions ne concement pas de grandes fetes, mais des occasions particulieres.
Is. LT 7O2,p. 104'. Le mEme schema se retrouve chez Lrutfimc :&tres faki ( enfmts I cantores ( rex~emis prrbribus et praecenribus iunioribus, simt est ordo eorum rn ; 55,p.44').
LT 72,p. 108". ". LT 75,p. 1 1 St6. ". LT 1OOA.p. 15 1 9.
Pour la yrmre d ' u 3 9 , aprh les objets port& en proasion (dont l'ordre de classement est
o f f a a [cfinuersi bbini ac bini, tunc iqfiianfes cum wgi&h.ilS, deinde domrmr abbas et tmc
aliifiutres duo et duo sicut suntpriores 8
12. convas I enfints I abbC moines addtes moins Ies convers
Pour 1'- d'unmsladc. ap& l'eau benite, la mix, i'encens, l'huile et un pdm, ex
hinc ihfantes et hmc dornnus abbas. AIii ueniont bini ac bini sicut stmtprfores. m4'
13. &ts I abbc 1 moines adultes
Pour l'gnterreaent d'un frt& apks l'eau benite, la croht, l!encens et deux cand61abres,
a subsequantw infaes cum ma@tris, adiunganhrr eis conuersi qui nesciunt cantate, dein
alii duo et duo sictit a n t priores, ad extremum sacerdos et illi qui deferuntferetrunr. md2
14. enfants I convers ne chantant pas I cantores
Pour l'pnterrement d'un lalc m o m .. apds I'eau Mnite, la croix, L'encens et deux
candelabra, a infantes et conuersi. caeteri incedant simt sunt priores m43
15. enfants I convers 1 moines adultes moins Ies convers
La premiere chose qui frappe a la lecture de ces quinze structures processiomelles
clunisiennes est la distinction tr&s nette dtablie entre les enfants et le reste de la
communautti : les premiers sont toujours st5parks des seconds. Comme il avait 6t6 deji
mentiom6 au debut de ce chapitre, les mains de quinze am fonnent sans contredit un groupe
a part au sein de l'abbaye. La deuxi&me constatation suscitk par cette &num&ation est
I'absence d'unit6 ; or cette diversite rMte essentiellement de la place changeante des
convers. Le schha Ie plus usuel est celui oh ces m h e s convers ne sant pas diffdrencids du
reste des Bres adultes, lorsque tous les prof- sont amalga& et class& selon I'anciemetd :
tel est le cas pour 6 processions, ndrotkes 1, 4, 6, 7, 10 et 13 (c'est-&-dire Noel, les
39. Sur cette cddmonie, cf. P. WILLMES, Dw Herrscher-Ahventus iin Kloster des Frihzit~eIaIters, (Mthstersche Mittelaf terschriften, 22) MUnchen: W- Fink, 1976.
LT i69,p242I6. 'I. LT 193,p.2709. 42. LT 195,5,~.275~. 'I. LT206,p.28430.
Rameaux, la Cbe, Pfiques, la Pentedte et l'onction d7m malade). Il existe autrement 3
stnraurrs difkentes pour Ies 9 processions restantes : une avec 3 occumnas, trts proche
de la pdc&nte sinon pue les convers qUi ne savmt pas chanter ont ett exclus des rangs des
f?&es adultes (2, 8 et 14 ; la Purification de la Vierge, les Rogations, l'entmement d'un
fiere), m e a m avec 4 occurrences, o& les convers (chanteurs et non chanteurs ihmis)
foment un p u p e A part (3,5,12 et 15 ; le Mercredi des Cendres, la Bt!n&Iiction du feu, la
venue d'un mi et l'ent-ent d'un Mc), a m e d e m i h , avec =dement 2 occummces, 0%
non seulement les convers sont exclus du groupe des Mres? mais celui-ci est bgalement
scinde en deux avec, d'une part les pGtre!s, de l'autre Ies diacres (9 et 11 ; 17Ascension et
1'Assomption).
Mise P part la co&lation existant entre I' Ascension et 1'Assomption - toutes dew
cdtbrent I'ilCvation au Ciel d'un tr&s saint personnage, la premih, du Christ, la seconde,
de Marie -, qui explique peut-&re l'emploi d'une meme structure pour les deux cddmonies,
j'avoue ne pas voir les raisons qui firent que telle ou telle Ete fit associee a tel ou tel ordre
processiomel. En revanche, il me semble possible de deviner quel etait l'ordre qui etait jug6
usuel, celui auquel l'auteur se &re quand il Ccrit a d m ordinatifuerint sic^ mos est r.
Telle est la formule employee pour 170ctave de Piques4, mais des phrases similaires se
retrouvent aussi pour la S.Mai:eu14*, les mercredis et vendredis j e h d s depuis 1'Octave de la
Pentecate jusqu'en ~epternbre~~, ou Iorsque la d6pouille d'un Mque arrivait au monastkre4'.
Selon toute probabilite, le classement par IYanciennett5, dam lequel les convets ne se
diffkrenciaient pas des autres fieres adultes, Ctait la structure classique des processions
clunisiemes. En effet, il s'agit de la fonne la plus courante parmi les quatre dZErentes
decrites cidessus. En outre, pour le manhtum des pawres, il est prkis6 a stent ibi simt s ~ t
*. Pour I'Octave de la Rburrection (LT 6O,p.943, 45. ordinatin ut mos est <in> aiiis proce~sionibus rn (LT 69,p. 10 1 f'). 46. Turn fiat processio per ordinem sicut imn crebrius prompsimw rn (LT 77,p. 12 1'' ). De meme, il est
pr6cist5 que la procession prenant place Ies mercredis et vendredis jeilnh du mois d'octobre se faisait s h t mos est (LT 120.p. 179')-
47. a stenf per ordinem simt adprocessionem rn (LT 20S,p283-84). Peu auparavant, il avait kt& expliquC selon quel ordre les moines devaient aller & la rencontre d'un cercueil venu de I'extdrieur : a Si occurrerint f;atres aiimius corpori deficmti, in eundi hmpsalmm &antent .... Per ardhem ean!, iuniores antea, priores posterius. (LT 203,p.282 I).
priores ordirurtim ut mos est adprocessionem stare. 8% Pour la f E E des saints Piem a Paul,
tout devait &re fitit exactement cornme pour la Nativit6 du Christ ; seule exception, la
peinture qyi tcptbentait la Vicrge et le Christ n'Mt pas promenk pendant la procession49.
On put donc en dauire qye ies s'ordodent d o n le mike ordre qui etait en usage
h Noel, P savoir e d i t s I abW I moines adultes ; or l'auteur se wntente de prtkiser a Et
wnimil itaper ordinem in oratorim v. A contrano, le caract& inhabitue1 & l'organisation
en vigueur lors de la p~ocession des Rogations est attest6 par la description de la formation
des Mres le chemin du retour : le ddacteur n'utilise pas la formule a sicut mos est ou
per ordinen, nM, mais juge utile de p&iser Uenientibus denique per ordinem simt
inserturn est supra 2 I.
L'ttude des processions permet donc de remarquer que la hiCrarcbie bask sur
l'anciemetd pdvdait de beaucoup sur les autres qui, toutes, diffikenciaient a un degrd plus
ou moins grand les p&es, les 16vites et les convers. Ceci etait Mai au milieu du XIe si&le,
alors que le LT &it remanic!, mais l'Ctait encore bien plus au d&ut de ce sikcle, au moment
de la composition des CA. Entre ces deux p e n e s , l'icart entre les convers et les autres
frkres ne cessa de s'accroitre : en effet, tandis que seule, dam les CA, la procession des
Rogations mettait en scene cette diffc!renciation, huit nouvelles processions ddtaillees d m
le LT excluaient, soit partietlement, soit totalement les convers des raws des fikres? Cette
h6sitation entre une integration totale, ou une partielle, lorsque seuls les convers sachant
chanter ktaient assimilds aw cantores, ou l'exclusion pure et simple des convers, qtmd ces
LT SS.S,P.~~~. 49. LT 85.4,pM 1-32. (cf. aussi LT 85.19p.12V).
Pour le retour de la procession de Noel, l'auteur pecise Uenr'entes in cIuushlrrn per ordinem s i d prim ... rn (LT 13.4,p.23").
51. LT 70.2,~. ? Paradoxalernent, Ie fait que la majoritti des processions ddtaillb dam le LT, IZ savoir 9 sur IS, excluent
en partie ou en totalitt les convers doit Ctre p e p comme me autm pceuve du catact&re inhabituel de ces memes processions. En effet, le monast&te Ctait le thCatre dc nombccues processions, les mercredis et vendredis jeGnb, certains samedis et I s diianches de I ' m & liturgique (cf. LT 53,p.66', 542,p6p, 76.5,p.120', 109,~. 164': I lO,~.l65~~, 1 12,p. I68 lo, t209p.179', 127,p.189 '0, 154,pZO '0, B4.p 223 7, 167,p239- 40, l72,p243'9. Or le, ou les ddactem, du LT ont juge inutile de peciser selon pe l ordre ces processions se faisaient, trhs certainernent parce qu'eks se ddroulaient simt mos es!.
derniers Merit sollftrats des mgs des p&es et des 16vites, ttemoigne de I'incertitude des
moines sut la place B accorder am convertis IaFques t d i f b au sein de leur communaut&
Encore un demi-sible et Ies noweaux ordres, tels ceux des Chartreux et des Cisterciens,
constitueront d& leur origine d m groupes bien distincts, les m o b s a 1es convers. Il ne sera
alors plus question d'intdgration, ni totale ni partielle. L'etude des coutumiers clunisiens Gf
et LT aide ii mieux comprendre la g e n k de cetk noweIle institution- EIle ne d h d e pas
sedement de la volontb de certains f-Ii dd'tre int@t% am grandes abbayes qu'ils
servaienP3. Elle provient tgalement du graduel rejet vers les marges, non pas de tous les
convers clunisiens, mais de ceux qui Went sufhmment incultes (et pawr~s ?) pour n'avoir
jamais appris & chanter.
Pour bien faire, il faudrait appliquer la m&hodologie utilisQ ci-dessus a w
coutumiers de Bernard et d'Ulrich, afin de suivre I'6volution de la place f ~ t e a w conven
cluaisiens jusqu'i la fin du XIe sikle. Ceci permettrait d'arriver P la veille de la crdation de
l'institution des convers et domerait l'occasion d'6vduer comment Ies transformations au
sein du rnonachisme traditiomel - tout particulierement la distinction qu'on a pu y noter
entre les convers qui chantent et ceux qui ne chantent pas - permirent I'6tablissement de
cette nouvelle institution. Particulikrement fascinant serait dgalement d'expliquer pourquoi,
avant m h e Citeaux et la Grande Chartreuse, CTlrich pr6na d6jB I'incorpomtion des famuli
dans la communaut~ monastiqueH. Mais ceci constitwrait un tout autre sujet de these ...
En conclusion, ii Cluny, au moins jusqu'au milieu du XIe siecle, la division des
moines adultes entre pri%res 1 lhites I convers, meme si elle prenait de plus en plus
d'importance, demeurait secondaire par rapport B celle, traditiomelle, entre les iuniores I
seniores/priores. I1 reste A juger de la place, non pas relative, mais absolue qu'occupait cette
". Sur les fmulicIunisicns, cf. W. TESKE, a Laien ... *, FriihSt., 10 (1976): 265-75 et G. CONSTABLE, "FamuliW ... w, Rb 83 (1973): 327-34.
%. UdaI. Epkt.,co1.637C-D, Ulrich conseilla B son ami Guillaume d'Hirsau d'incorporer ih I'abbaye les famuli qui servaient les Wres dam I'espoir d'obtenir leur salut. Sur le fait que ce conseil ne fit pas suivi par son destinataire, d J. WOLLASCH, = A props desfiatres barbati de Hirsau m. Histoire et socikte' - MPIonges o f i t s c i Georges Duby, In: Le moine, le cierc, leprime, Aix-en-Pmvence: Publ. de I'Univ. de Provence, 1992, p 3 8,
demi&re s ~ ~ c t u r r dans lavie quotidieme clunisienne : jouait-dle un r6le aussi important qw
dans le monastk d M t par Benoit dans pa R4gle ? Et comspondait-eUe vraiment & la
division W e per l'W & N d e qyelqpe quatre sibles plus tbt ? Uue W e du discours
des cotrtrullic~~ C1 et LT sur le couplet irariores-seniote~riores sera men& din de &pondre
ii ces qyestions. A l'occasion, les sources bagiographiques seront &dement examink. Les
Virae, qui se sencentrent sur un personoage, habituellement un abbe, sont peu probes sur
la question des dgles dgissant les rapports en- les moines ; mal& tout, les quelques
informations qu'elles contiement A ce p r o p permettent de combler, mSme partiellement,
les d6cennies silencieuses pour lesquelles nous ne possddons aucun coutumier clunisien.
E. nnvIORES4EMORES/PNORES DANS LES PREMIERS COUTUMIERS
CLuNISlENS
La Yita Odonis par Jean de Saleme, &tee de 943, offre un apercu du discours
clunisien sur les divisions hi6rarchiques monastiques peu aprks la fondation de l'abbaye.
L'hagiographe explique que, apds la mort de Bemon, le groupe des "mtichants" refusa de
recomaitre Odon comme abE de Baume ; celui-ci choisit dots de partir pour Cluny et les
seniores du lieu d&cid&ent de le suivrel. A l'oppos6, les ememis d'Odon sont decrits par
Jean come &ant a mente et actione juwnes m2. Nous savons que ces 6v6nements sont des
pures inventions, probablement soufitl6s & l'oreiile de Jean par Odon lui-dm$, mais ceci
importe peu : pour qu'ils puissent paraitre plausibles h l'audicnce de la Vita, il fdlait qu'ils
soient rialistes. On peut donc affirmer qu'aux origines de Cluny se retrouve be1 et bien
l'opposition iuniores (jeunes ou "pseudo-jeuaes")-seniores CMquke par la R&le de saint
'. VO' II,l,col.6IA, =. YO' 1,34,co1.58A. I. Cf, I'analyse de cette oeuvre dans 1'Annexe A.
k n & Cette opposition etait encore significative lors de la f i c t i o n de la Yira abr6g6e
puisquc k m&ne discours y &it npis' ; mais la date de cette oeuvre est inconnue : elle fbt
&dig& quelque part entre 943 et 1109.
Les Conwettcdines onhkpiores n'tvoquent pas les relations interpersonnelles des
f&es, mais ceci s'explique du fkit que cette source est trts succincte quant au dhulement
de la vie quotidienne et traite presque exclusivement de litwgie : il est donc impossible de
savoir quelle signification et quel r6le elle associait aux seniores/priores et aux iuniores.
Mal@ tout, elle a w e que les moines clunisiens attachaient une grande importance a
I'orQe h ihh ique . Comme je l'ai dkj& dit prkddemment, les infmtess/pueri y sont decrits
wmme un groupe nettement distinct du reste des f%res, mais hi-meme d6jh bien structurk,
avec son propre ordo. Avec ou sans les enfmts, la communautC se plapit trh souvent selon
l'ordre hiimchique pour remplir telle ou telle &he. Elle se rendait par exemple au Chapitre
.per ordinem s i d smt priores 2. Du Mercredi des Cendres jusqu'aux Rameaux, les Mres
processionnaient chaque mercredi, a omnesper hordinem simt suntpriores duo et duo ad
processionem m6. Le jeudi suivant la Quadragd~ime~ peu aprh None, les fieres a exeant de
aecclesia hordinate duo et duo sicut suntpriores m7. Pour le mandatum du jour de la Cene,
a per ordinem faciant abbu incipiente et ceteris sequentibw- Similiter, siait per ordinem
Imemtpedes, itaper ordinemprebeant g u m manibus. 3 A ces diffintes occurrences,
il faut ajouter les dglements benedictias, pour la communion, la paix, la psalmodie, ainsi que
les trks nombrews processions accomplies par la communaute et non d&aill&s d m les
a9*
4. C t VOL 23,p.227 (a mente et actione iwenes D) et 28,p232 (a Secutismt autem seniores loci illius.. D)
? C4 7,p. 12. C4 3 1 ,p.49'.
'. CA 3S,p.56'. '- CA B14O,p.82'O- 9 Cf. Ia t d s longue notice de I'index des C4 pour "Processio".
La lecture du LTpamet d'm apprendre uu peu plus sur le sujet. On compread ainsi
p l'ordrr h ihhique n7&ait pas dement mis en dne B Cluny de fipn 6pisodique mais
bim h e m a m hem. Il intwenait et Muait sur toutes les actions des firtrrs : non
d e m e n t lorsqy'ils allaient cornrnunier, plcsrlmodier, recevou la p a mais aussi lorsqu'ils
mtraient a prrnaient place au dfectoire, au Cbapitre et au choeur. De telles informations
coulaient de source pour les auteurs monastiques ; a w i jugeaient-ils inutile de les
mentiornet. En manche, Ie lecteur modeme, w n cautumier avec Ie mode de vie
monastique, ne peut saisir ce phdnomhe que lors de bouleversements en haut et en bas de
I'icheIIe hi&archique. Quand un a b E etait dlu, un des gestes symboliques marquant sa
nouvelle en&& en fonction etait son changement de rang au choeutxO. La meme chose se
produisait pour un prieur: il occupait me nouvelle place au choeur, au Chapitre et au
rkfectoire : a Denique per unrm debet stare in uecclesium ex leu0 choro, in capihdo austri
pmte, in refetotio septemtrionalipmte .Ix. En ces trois lieroc, il s'installait dans la section
qui Eaisait face ii celle de i'abbe, de telle sorte que chacun dorninait une moitii de
l'assemblee. A l'inverse, au bas de L'dcheUe, lorsque des novices incorporaient la
communautd, il leur etait assignk les demi6res places du choeur et du rfectoire ; I'auteur ne
dit rien de leurs rangs au Chapitre, mais son silence s'explique par l'interdiction qu'ils
avaient d'assister cette rimion pendant les trois jours qui suivaient leu. profession12. Au
cours de cette derniere c&nonie, iIs devaient se tenir devant l'autel selon leur anciennete
(a stentper ordinem quernammodm uenennt m13, pnuve de I'onmipr6sence de ce mode de
classement, puisque tous y ttaient astreints, meme des nouveaux Venus w n encore
incorpods I la communau~. C o m e le pdcisait d6ji la RB, celui qui avait commis une faute
grave, apds avoir 6te excommuni6, &.it dadmis au demier rang de la communautd,
symbolis& entre autres, par la demikre place au Chapitd4. Au moins dans certaines
lo. Puis tous les fieres I'ernbrassaientper ordinem (LT l44,2OP). It. LT146,~212~. 9 LT 143,p20BZ. Ces dernikes places ne se trouvaient bien entendu pas en-dessous des enfants, mais tout
en bas des iuniores. ". 11s devaient ensuite embrasser les fitires per ordinem (LT 143,p207'0"24). 'I EZ iubente ipso [I'abbe], eat sedere noukimus w (LT t53,p.218f3. La sctne se ddroule au Chapitre.
occasions, les moines entraient au dfectoireper ordinem'? Lorsqye7 pendant le Carbe, les
aches hebdomdahs de lectcurs et sentitem au lufwire etaient &*bu& pour
I'annCe, on les &ass&& par odre d7anciem&, en cornmenpat par les priores pour
ensuite passer ~LUC iu1~0res'~. JUSQU'~ la nourriture qui Ctait distributk aw f?&es selon l'ordrr
hi&a&que : les hebdomadiers devaient commencer le service tan& par les
Ces deux dernieres phrases t6moignent que le couplet iMliores-seniores/priores se
-wait be1 et bien a Cluny. Il reste I savou s'il pdsentait les d i m e s caractkristiques que
dam la rZgle de saint Benoit Si l'analyse de la RB avait permis de concIure que les iuniores
dtaient surtout des jeunes et qu70n les traitait comme des jeunes, le LT utilise le vocable
iuniores ni plus ni moins cornme synonyme de iuuened8. Peut4tre s'agissait-il m6me plus
specifiquement des iwenes sub wtodia, formule qui servait ii dhigner les jeunes
adolescents (de quinze am, approximativement, jusqu71 un Qe ind&tenain& put-etre aux
dentours de vingt am), deji profes, mais places individuellement sous la garde d'un
surveillant, en attendant que leur comportement devint SufEsamment min pour qu'ils pussent
etre abandon& B e~x-rnErnes~~. En effet, dam un passage dkctivant certains riiglements en
Is. LT352,p.461s. 16- LT 42.2,p.S6'. 17. LT 156~028. Lcs coutumiers de Btnrard et d'Ulrich nous apprennmt que I t s enfbnts dtaicnt pour leur
part epartis entre divcrses tables pour &re swveillds par des Wres @is d'ordre (cf. Berm I,xxvii,p207 et UdaL IIl,vii~co1.744D).
18. PI Dimter considtrc d'aillews ces deux terns c o m e synonymes dans son index du LT, mais il est mi qu'il fait aussi de "series" le synonyme de "seniores".
Iv. Ccttc dtfmition des iuuenes sub c u r & ne se trouve pas dam le LT, mais seuiemcnt dam U ' I . (III,~co1.74748) ct B e m (I ,di ,p210). Je miens sur Ie contcnu de ccs ouvrages au chapitre N, quand j'dtudie l'institution dcs iuuMes sub ct~stodia. I1 n'y a pourtant aucune raison de croire qu'elle ne s'appliquait pas aussi aux itluenes sub custdiu dvoqu& dam le LT.
Tous Ies oblats m e fois bdnis ne passaient pas automatiqucmtnt sous la surveillance d'un gardien, mais seukment ceux dont I t comportemcnt n'6tait pas jug6 mfltisamment mQr. L'Qge auquel prenait fm cette surveillance n'cst pdcisd dans aucun coutumier. Vingt ans correspandait peut-h A l'iige moyen de cette "dmancipation" : en effet, Pierire le VMcable dkida &us son Stahrhun 36 de laisser B la schola tous les jeunes de IS 20 ans, Par ailteurs, fe coutwnier MnMictin d'Eynsbam, &dig& au MIIt sitcle, nous apprend que puer servait designer le moine de moins de quinze am, imenk celui 8gt5 de quinze B vingt ans, et prouecciores ceux de plus de vingt ans (The Customary ofthe Benedictine Abbey of Eymham in Ojorakhrie, Cd. A. Grandsen, (CCM II) Siegburg: F, Schmitt, 1963, II, l,p33). Pour comprendre une semblable ddfinition, il faut
rapport avec le dortoir, l'auteur Cvoque en quelques lignes tour ii tout les iuniores, ppuis la
et rnbe ensemble :
Nmn inter @SO men'diona cle senioribus qui uoluerit legere fegat, iuniores frattes et hfonia ne4uzquam hocpraesumcmtesumcmt In @srS tempribus qui uulr se cooperire de pellicia m a wl tie m d f a fa cia^ sed uideat, ne se cum cakeis collocet. Iuue~es
- atque hfanits sicuti & node ita ex toto se coaptitent Iuuenes f k t m nor^ exeant tie dormiton'o, anteqmm pueri stugmt. Post hinc
d m i$mtes exierint, eant et ipsi cum s m custodia Sine custodiu uero non praesumant quoquam hamire, etiam in ecdesict, quando uolunt accipere eucharistiaam do
Je serais pourtant tent& de considhr le p u p e des imioresiiuuenes c o m e &ant plus large
qpe celui des iuuenessub N l o d a ; malheureusement, les Cvocations de ces diffdrents termes
sont trop 6pisodiques pour powoir aftinner avec certitude quoi que ce soit ii leur props.
Entre autres indices qui m'inclinent'6 adopter cette position, se trouve le &glement suivant :
lonqu'un iuuenis &it sees il I'excommunication suite h une fame &&re, il ne pouvait
aller nulle part sans smreillance (a cum cuctodia per@ ubique a2'). Une telle
recommendation semblerait redondante si elle s'adressait aux seuls iuuenes sub custodia
puisqw ceuxci ktaient continuellement soumis 1 la surveillance de leurs gardiens (a Sine
mtodia uero non praesumant quoquam i rm're , etiam in ecclesia, qumdo uolunt accipere
eucharistiam wP). On peut Cgalement noter qu'i divenes reprises dans le LT, i1 est
uniquement question de iuuenes et non de iuuenes sub custodia. Par ailleurs, dans le Bern,
il est interdit ii deux jeunes de se tenir ensemble, meme si l'un d'eux n'est pas sous
surveillance : il existait donc des traitements particulien pour les iuuenes qui n'dtaient pas
sub ct(stodi#.
prendre m compte l'&olution du iunior Muedictin en iuuenis sub mtodia (ou, plus succincternent, iuueni3) et, par contrrcoup, Sextension du terme senior (ou prouecctor) pow dbigner tous les autres moines profes.
=, LT 1 54,p224t6-22Y" 21. LT, 152,p.217=. U, LT 1 54,p2ZS4. =. Benr I ~ i i , p . 2 l l . Dans k coutumier de Lmfhnc, i1 est question de iuuenes sans gardien qui doivent
se faire raser par des seniores : Iuuenes quoque siue nutriti siue de saeculo uenientes utrique tamen extra /ruiusmodi cusfodiam
erisrenfes non praestlmant ut alter afterurn ra&nt, sed seniores a6 i f h et illi a senioribus radantur. w
Quoi qu'il en soit, il est clair que le group des iuniores clunisiens se confond
presque plvfatement avec celui des itcwnes. D&s lors, il devimt inutile d'dyser ici le
discom des coutumiers Ieurptopos ; ce sujet sera trait6 dans le chapitre IV.
Parce que le ppe des iuniores a dimin116 entn la r6daaion de la RB et celle du LT
pout rie plus englober, gross0 modo, que les seuls jeunes de la fin de la dizaine au debut
vingtaine, l'I'auernble d a senioredprrores ss'est par contrecoup agrandi, au point d'englober
tous les fibs adultes, exception faite du petit nombre des tr& jeuaes. C'est dam ce sens
qu'il faut comprendre poquoi, dans le LZ", "senioresn dCsigne presque toujours la totalit6
des eres addtes et, par extension, l'ensemble de la communaut&. Un autre factew qui
explique ce nouvel emploi de seniornr est la prise de conscience par les Clunisiens de leu
importance (ou bien faut-il parler de leur vanit6 ?). A partir du milieu du XIe siecle, ils
voulurent se voir comme des "seigneurs" (donrini ou donmi, et seniores). hi, pour montrer
ii quel point, M&ed &it appr6ciC des Grands, Odilon juge utile d'attirmer dam sa Vita que
les emperem, les impthtrices, les rois et les princes l'appelaient senior et dumind4. Dam
la fifa Odilonis de Jotsaud, plusieurs Sres sont nommds a senior A. w ou a d'nus A. . ; ils occupent tow des postes avec responsabilit&, mais ces appellations semblent &re &vantage
des titres de respect, que le signe d'une appartenance Z i un groupe particulier de la hihrchie
monastique?
Ceci ne signifie pas qu'il faille traduire toutes les occurrences de seniores@iores de
manike aussi large. Le sens classique d'"anciens/hommes de pouvoir" s'est maintenu,
parallelement P la d6finition plus vague de B r e s prof& ou "seigneurst' de Cluny. C'est
cette conclusion qu'est parvenu G. Constable apks avoi dtudit les diverses occurrences de
(tanpanc 94,p.769. VIP c01.936B.
ZI. U est question d'un senfor Pernu en charge des objets du saint (VQ? lT,xiv,coL930A). En note, redition de la PL nous apprend que, dans un autre manuscrit, il cst €crit domrmr Petm. Dans un autre passage de la mCme Vita, il cst fait mention d'un senior Ivo, qui s'occupait de I'intendance it Saint-Denis (VOa II,viii,col.92 IC). Ailleurs encore, it est question de senior Eidebertus qui avait pour &he de donner les aum6nes aux pauvres (a min&tram egenk eleemosynae subsidium n, VOi lI,xiv,co1.928D). Le pdposC de la celIe de saint Makul A Pavie est appele domnur P e w (n,xiv,co1.928B).
seniores, tant dans la couttmiem q ~ e dam les chartes clunisiennest6. Quelques passages du
LTpintcat en ef f i v m rm sens plus traditionnel du vocable. Il est mentiom6 que, la jeudis
du Carhe, its seniorees wlfirtrees recevaient trois plats @1(Imenta)Z7 ; or "'atres" ne
degne certaiaement pas ici les seuls enf'ts et iuuenes sub ctcstodiu? Aillem dans cette
m h e source, il est afknt5 qu'odilon instaura la fete des mom le 2 novembre avec l'accord
de tous les seniwes de Clun? : cette f o d e rappelle l'injonction faite par Benott it I'abbe
de ne jamais prendre de dtdsion sans consulter au minimum les seniores. Quand Hugues fbt
requ au Chapitre pour ttre admis dims l'abbaye, un des seniores prit la parole pour dire que
Cluny venait de recevoir un tdso?". L'6tude des processions a permis de constater que,
lorsqu'il &ait prescrit que les reliques devaient &re portees par des seniores, seuls les
sucerdotes Went visesf'. Ainsi, le terme "seniores" peut avoir m e multiplicit6 de sens dans
le cadre clunisien, et chaque occurrence doit &e analyseie avec pdcaution avant d'Ctre .
26, Cf. GI CONSTABLE, a Seniores ... m, dans Mdanges Duby, 1992, p. 19. =. LT43,l,pJ7'? ? I1 est plus difficile de savoir si l'expression seniores etfiatres n, qu'on retrouve parfois dans les Vitae,
d6signe ou non deux g r o u p distincts. Sous le dgne de Hugues (1049-1 log), I'Humitiimus dtclare avoir rPdig6 Ia Vita d'Odon A la demande des seniores etfiarres de Cluny (a horiotu seniorwn etfiatnurt nostrorum m, V@ HI p.208). Veut-il ddsigner ainsi les seuls seniores, qu'il appellerait aussi Mres, ou les dew group compIdmentaires des seniores et des Mres, ou encore tow les fires, qui seraient aussi des "seigneurs" ?
OdiIon d m sa l&a Maioti A son fUhu successem, Hugues, ct au pricur claustral, Almannus. Or, plus loin dans la pdfgg il s'adresse aux diIex~issimiseniores et@otres (W P~~,co1944B); il est fort probable qu'il s'agisse B nouvcau des dcux mdmcs personnagcs qui seraient don appelb, par I'abM de Cluny, "seigneurs et Wres".
L'instauration de la Fite des morts est amon& deux fois dam I t LT, preuve que cet ouvrage fin ddig6 par plusieurs mains (cf, LT 126,p.I86, 138,p.199 et les remarques dc P. DlNTER, LT, p.liii). La premiere mention cornspond trb ccrtainement au texte officiel Wig6 par (ou B la demande de) Odilon pour conttaindre les p r i e d (a ctlncti tuci ad btm Idcum pwiinentes n) ;2 suinc I'cxemple de l'abbaye-m&n : en cffct, celui qui p m d la parole cst Odilon, Ic "nous" cst employ6 tout au long et Ie ton est directif. La deuxitme mention reprend le tcxte oficiel, mais en le rctravaillant quclquc peu. Odilon cst maintenant p&cntt comme I'auteur de ce *glement. Les omnes seniores momhi Clunienses qui ont accept& I'instauration de la Rte sont devenus omnesfiatres CIuniemes. Le passage de seniores Bfiatres attcstc que, premitrcment, les dew tcrmcs ne sont pas synonymes, autmnent it aurait & inutile de changer l'un pour I'autre, ct que, deuxi*rnement, avecfimes, la dtcision prend plus de poi& car le consensus devient total.
30- VIT I,iii,pSO et V . iii,p.40, 31. Mal@ tout, ces seniures-ci pouvaient €trc trb jemes. Dans le dglement 43 de ses Stututa (Stat.
43,p.76), Piene le V€n&rable exige qu'aucun Mre n ' a d e h la pdtrise avant I'Qe de trente am, au pire vingt- cinq. Dans la justification qui fait suite, il se plaint entre autres des adolescenfes devenus prttres alors qu'ils n'hient pas encore en mesure de comprendre la sacralit6 de cet office.
in- ; mid@ tout, Ie sens a2s g6nCral et n e w de "f%resn reste dominant, au moins
en ce qui conceme le LT.
En meme temps que Ie tame "seniores" perciait de sa pnkision en se g6ntralisant,
les seniores (dam le sens cfassique duteme) voyaient leur puissance partiellanent diminuer,
suite & me -tion plus rig& des files et ii m e wementation plus lourde. Un exemple
ilIustrna chacun de ces dew d6velopparmts Alors qu'ilbtait autrefois permis aux seniores
de commander aux iuniores et de les tamer verbdement s'ils les ttouvaient en faute, il ne
Rste aucune trace d'une telle pratique &as Ies coutumiers clunisiens. Elle &it probablement
toujours o b s d e : dam la Vita Odonis de Nalgod, &rite dans les andes 1120, celuiti
dklare qu'Adhegrin et Odon durent se plier awc ordres des seniores ap&s leur arrivee i
Baump. Malgr6 tout, la specialisation des tiiches faisait en sorte que les occasions d'agir
etaient m o b Mquentes. Les deux groupes les plus facilement en butte aux r6primandes de
leurs ainds, les enfants et les adolescents, avaient maintenant leurs surveillants attids, les
magisti pour les premiers et Ies custodes pour les seconds. Jamais il n'est question d m le
LT des injonctions bh6dictines sur la nkessit6 de laisser sa place assise il unprior, de lui
demander sa Mntkiiction quand on lc croise, de I'honorer, etc. PeutStR 6taient-elles toujours
appliqueep, mais ce silence est en lui-meme significatif. Du temps de Benoit, la
=. VO" Fiii Z4,p. 143 = PL I9,co1,93A. n. Dans son commentah dc la dgte de saint Benoit datd des mdcs 845-50, Hildemar discute longuement
de ccs cornmandements car il lcs juge &s importants (HiIdmar, chapJXm, p.578-81). I 1 explique par aillem que te rapport entre un iunior et un senior/prior doit &re similaire A celui qui existe entrc un fils tr&s cher et son piire :
L..] skwt dilectirshusflliur patrisuo honorem impendit, ie cum quanta dilectione ifli impendit honorem, cum tanto scilicet more &bet isre junior priori suo i'ndere honorem- D e i d itenrm : cum quanta diktione amorir @ectum impendit paterfdio suo dilecto, cum tanto more debet ilfe senior diIecto suo juniori dilecrionem irnpemkre, * (ibrTd, p.579).
11 ne fait donc aucun doutc que, encore au TXC sitcle, tout au moins dans certains monast&res, le meme idQl se rnaintenait En revanche, la lecture du Ben. laisse supposer m revanche que, dam le Cluny de la fm du Mt sikle, ccs ~ g l e s de bienshcc n'dtaient plus appliqudes envers Ics seniores, mais cnvers lc seul abbC :
Quicumque Fratrum ih j t l~~t l~ venit corm eo, nec sedere debet sine ejus licentia (expectata quidern, nun quaesita ab eo) nee dicere quidquam niri ipse ve1 sigm vel verb0 innuerir illi ; & tunc imprimk dicet Benedicite, deidepropter qumn c~tll~ant venit ; si vero aliipem ah,occuiprecepit, ex: quo coram eo venit sine omni licentia vef signo dice2 Benedicite : simititer debet Benedicite dicere quisquis locutus cum @so recedir de coram illo, & aim ejw ficentia debet recedere. (Bwn. I,i,p- 136-37).
communaut6 monastique fonctionuait & 1'- d'une familiu romaine, ou plut6t d'une tribu
v~tcstamcntairt, avec le pouvoir daus les mains des "anciensn, pouvoir qui Mt faciltte
par la &&ace qui lem &it due et limit6 par l'inddgenee dont 3s devaient f h preuve &
I't5wd de lem "cadets". Ainsi, m e grande place h i t fhat clans la gestion de la vie
communauiaire amc principes moraux et am sentiments "familiauxn. Cew-ci ont
compIetement disparu du discours normatifclunisien. Le Cluny du LT etait m e institution
d'une centaine d'individu~, oil des dgiements techniques ddfhhaient les rapports des f&es
en= euxW. La fonction de chacun etait d6tailltk avec minatie, si bien qu'il n'dtait plus
nkcessaire de fhke Gfknce aux "boas sentiments" des uns et des autres. Toutes les tiiches
du celI&er le mettant en contact avec la commrmaut6, par exemple, 6taient clairement
stipuI&s dam le LT, jusqu'h la manik dont iI devait set* les ibgumes, les poissons et les
hits. Cette 6numhtion exhaustive rendait obsolete la recommendation de saint Benoit
qu'un tel personnage se comportfit comme un #re a lY6gard de ses Bres?
I1 ne faut pas en conclure pour autant que les Clunisiens ignoraient la definition
ben6dictine des rapports iuniores-seniores. Au contraire, elIe leur etait probablement
beaucoup plus familihe que la dt3inition qui leur Ctait offerte au fiI des pages du LP6. Ce
demier owrage etait avant tout un outil de &fknce, ok on allait puiser pour savoir comment
cie'brer telle ou telle Ete, tandis que la R6gZe de saint Benoit etait lue quotidiemement au
Chapitre. Les autres &gles moaastiques occidentales de l'Antiquit6 tardive, qui, c o m e on
a pu le voir ci-dessus, dans Ies notes en bas de page, partageaient la perception Mnddictine
". I1 sexnblcrait que Gilcs CONSTABLE ait aussi conclu a unc progressive institutio~alisation do Cluny A la mite dt son Ctude du tame seniores (a Skniores ... n, dam Mklcrnges Duby, op.ci$., 1992, p.20). I1 ne faut pas croirc qu'une telle &votution Ctait inCvitable. Le coutumier dc Flcury (Ffewy), ddigd dam la premi&re m o w du XT sikle et dCcrivant un monasth d'environ tmis cents errs, en tCmoigne. A l'instar de Benoit, le ddactcur a mom divenes reprises B la symbolique familiale pour d h k e Ics rapports des membres de la communaut6 entre cum
"- LT 156,p228-29 ct RB 3 13. =. Un be1 exemple dc la SUNivance de l'opposition classique imiores-seniorrer dam la litthiture
monastique est offcrt dam une Iettre de Pierre It VCnCrable, oQ cclui-ci oppose l a moines noirs traditionnels, dont les Clunisiens faisaient partie, aux nouveaux moines blancs &Is Ics Cisterciens : a Qutkpatiahu nouos uezeribur. iuniora sdribus, albos nipk ntonuchir ~nleferri ? n (LPY; iikp.29 1). Cette interrogation perdrait beaucoup de sa force si Pierre entendait simplement par senior= tout moine pro& qui n'a plus de gardien au- dessus de hi.
du powoir des anciens, *ent Cgalement lues et dues, sinon directement, au moins par le
biais des &its de Benott d'Aniane- Ces lectures n'Ctaient pas superficielles : f'exemple du
ceU&ier dcja &oq@ ci-dcJsus en tcmoigne. CeIui-ci devait signer tout @culi&ement la
nourriture des Ehes le jour o& la &on de la RB qui lui h i t consraaCe ttait r&it&' ; le
lendanaia, au Chapitre, il Wt amen& honorable ii I'abbt ou ih son supplht porn toutes
les fiutes qu'il avait pu commettre par rapport ii la R4gle ; un tel rituel n'a de seas que si les
moines dunisiens attachaient une grande importance au contenu meme de ce chapitre et h
son application La Vita Odilonis, k i t e par Jotsaud peu a p h .le Liber tramitis, c'est-kik
au de%ut des am& 1050, confirme l'emcinement du message UnUictin dans Simaginaire
clunisien. L'hagiographe raconte comment Mdieul encouragea le jeune Odilon, alors
chanoine de Saint-Julien de Brioude, B venir se joindre a la communauti clunisieme. Dam
cette &e, il appelle le premier senior et senex, et le second iunior". L'image typiquement
ben6dictine du senior, qui est plutdt un homme iig6, eduquant avec une certaine tendresse le
iwrior, qui est jeune, se retmuve donc ici ; le fait que Jotsaud en use pour d6crire les rapports
entre I'abM et le chanoine temoigne de I'importance de l'hkritage b6n6dicti.n. Plus loin dans
Ie rkit, apes avoir expliqu6 comment Odilon se comportait avec les rois, Ies empereun et
les papes, comment il etait a h t i des villes de Pavie et de Rome, comment les oficiales, les
moines et les clercs de cette derni&re cite I'accueillaient comme un fi*re, Jotsaud explique
le comportement du saint vis-a-vis des infiirieurs : . Jmn vero de inferion'bus seniores honorabat ut patres, juniores utfiatres, unus ut matres, virgines ut sorores ; omnes tamen aestimans sibi superiores, cunctis in commune praebebat fomiliare consortium et safutare colloquium m39
I1 est malaise de savoir si, dam ce passage, les termes seniores-iuniores doivent etre pris
litthlement ou non, mais ce flou est en lui-meme significatif. Je semi plut6t tentde de les
consid6rer comme desi-t les deux groupes du monastkre, de meme que les anus et les
virgines @sentent les veuves et les vierges parmi les moniales. Mal@ tout, il est evident,
de par la d i f f h c e de traitement qu'Odilon dservait awc uns et aux autres, et de par
173
I'association senioressm~~ et jmiores-virgrnes, sow-entendue par le texte lui-meme, que
Wge jouait un r6le non ndgligeable dans ees divisions.
En conclusion, i Cluny, les anciens du monast&e - qui se divisaient entre les
relativemmt jeunes soudainement promus I des postes importants et ceux pr6sents depuis
longtemps dam la communautt, autrement dit les plus 5g6s encore actifsl - ne possddaient
peut2tre pas un pouvoir rkl, mais Mn6ficiaient m a l e tout d'un pouvoir syrnbolique non
negligeable. Celui-ci reposait sur deux 616rnents, pmnitrement, le prestige attach6 a des
oeuvres cornme la RB, deuxihement, I'imporkmce fondamentale dam la vie quotidieme
du moaastke accord& B l'ordre hidrarchique, lui-meme ddpendant de l'anciennet6. Sans ces
elements, il est impossible de comprendre poquoi le d6classement collstituait, avec
l'excommunication, les deux formes essentielles de punition des moines2. Les anciens
powaient &re appel6s seniores/priores, mak ces terms servaient maintenant plus largement
1 dCsigner tous les fi6res profes, h o d s les plus jeunes ayant encore besoin d'une stricte
supervision. Ces deniers, habituellement 5gis entre quiDze et vingt am, f o d e n t I'essentiel
des iuniores, mdis que le groupe des pueri/ifuntes etait compose avant tout des moins de
quime aas.
11 sera discute au chapitre V de la "retraiten des vieux moincs. 2. On retrouve cw deux fonnes de punition dans Ies coutumien ult€riews, cf. par exernple chez Ulrich
(II,xviii,co1.708-09 et III,iiicoI.735A) et Lanfinc (100,p.84').
CHAPITRE 111
L9ENFANCE : LE CORPS AVANT L'ESPRIT
INTRODUCTION
L'histoire de l'edhce est devenue ces derniks dkennies un sujet "P la mode". Le
f ~ t qu'm des thhes SpdcialiSeS du d e m h con- des sciences historiques tmu & Montrtal
B la fin de 1'W 1995 s'intitulait a L'edsnce et l'histoire . offie un bon exemple de cet
engouementf. Tmis synthhY me en auglais par Shulamith Shahary I'autre en italien par A.
Giallongo et la dernik en firanpis par P. Rich6 et D. Alexandre-Bidon, sans compter un
recueil de sources en demand par K Arnold et m e multitude &articles et de monographies
portant sur des t h h e s plus @ciali&, attestent de la richesse de ce sujet pour la Nriode
m*wale. Sans vouloir minimiser la valeur de ces travaux, je voudrais souligner quelques-
uns des 6cueils auxquels se heurtent trop facilement, me semble-t-il, certains m6didvistes
travaillant en ce domahe. Inversement, ces remarques permettront de mieux comprendre
pourquoi j'ai consid6r6 important d'6tudier le discours clunisien sur l'enfance, B pare des
Vitae et des coutumiers compods a l'intdrieur de l'ordre entre les ann6es 909 et 1 156.
Quelles que soimt les nombreuses critiques qui peuvent etre forrnuldes ii l'encontre
de l'owrage de Philippe Ari& L 'enfrmf et la vie fmilide s o u 1 'Ancien Re'girne3, il faut lui
', Cf, les Actes/Pmceedings du xVme Con@ international des sciences historiques, MonMal 1995,27 aoQt au 3 scpttmbre 1995, Montrtal: Wpt d'Histoire de I'UQAM, 1995, p.283-91 (avcc Ics dsumds des communications). Neuf communications abordaient I'bistoirc de l'cnhce dam diverses cultures judto- chr6tienaes, dont trois portaicnt sur la p&iode m6diCvale- I1 s'agissait de cells de Klaus ARNOLD,
Childhood, Gender, and Education in Medieval Europe a, de William Chester JORDAN7 a Adolescence and Conversion in Medieval Europe a, a d'IsabclIc COCHELIN7 L'Cducation monastiquc mCdi6vale : primaute du corps ? a (qui r h m a i t trts succintcmcat k contcnu de c t chapitre).
2. Pour Ies articles ct Ies monographics @ciah&s, je tcnvoie A la bibliographic sur les Sges de la vie off& m anncxe. A la lecture dc celle-ci, il ap- clairement que le thtme de I'enfaacc a suscitC un bin, plus grand nombrc d'&dts quc ceux dt fa jtuncsse et de la vicillsse. S. SHAHAR, Childhood in the Middle Ages, London- New Yak; Routledge, 1990. A. GIALLONGO, I2 bambino medievale. E;lhrcazione ed infpltziu nel mediwvo. Ban': Dedalo, 1990. P. RIG* ct D. ALEXANDRE-BIDON, L 'enfance ou Mayen Age, Paris: Le Seuil, 1994. K. ARNOLD, K i d und GeselLschof) in Mittelalter und Renafisance. Beitrdge u d Tate rur Geschichte der Kindheit, Paderborn: Ferdinand SchClningh, 1980.
'. P. A-S, L 'enfint et Ia viefimiiiale sour 1 'Ancien Re'gime, Paris: Seuil, 1 973 (1960).
rewnnaitre le m&ite d'avoir owert le champ de L'histoire de l'dmce. C'est d'ailleurs en
partie parce que son oeuvre se p&it si fkilement A la poldmique que de nombreux travaux
sur ce theme virent le jour. Mais voilh d6jP trente-cinq am que ce texte fiat edit6 a il est
grand temps que les rn&lievistes cessent d'Mer le traitemat de I'enfance pour appuyer
ou, surtout, contrecancr les &innations les plus pkmptoires et injwtifi&s de ce grand
histonen. En d'autres mots, il faut nuancer notre approche et &ter que le balancement du
discours de l'historien sur l'dance au Moyen Age erre encore entre le misdrabilisme
d'Ari8s et Simage d'gpinal de ses opposants.
Dans ce but, il est necessaire de multiplier les travaux portant sur la p&iode prc5c&kint
le We sikle. En effet, la majorit6 des chercheurs se sont cantonn6s presque exclusivement
dam les sources de la fin du ~ o ~ e n Age QCP-XVe s.), se dfbrant parfois meme a celles de
la Renaissance (fin XVcdebut XVIC s.), pour dkrire ce que h n t les milk ans de I'histoue
m&hivale de l'enf'ce. Un tel dtsdquilibre justifie a lui seul la ndcessiti de se concentrer
maintenant nu les pkriodes pr&dentes, mais une autre raison, encore plus importante,
explique cette ndcessite. Plusieurs historiens sont d'accord pour dire que s'amoqa h partir
du MIC siecle une transformation de la perception du premier ige dont le signe le plus
manifeste (qu'il soit une cause ou une consdquence du changement de mentalit6 qui s'op6ra
B cette Cpoque) est le dtiveloppement du culte de L'Enfant-J6sus4. Progressivement, un
discours plus positif sur l'enfice vit le jour. La grande question est de savoir si cette
transformation de la perception du premier Sge touchait egalement toute la socidt6 ou si les
'- Cf- par exemple Mary Martin McLAUGHLIN, Survivors and Surrogates : Children and Parents from the Ninth to the Thirteenth Century m, clans History of Chiidhood, &i. L. deMause, New Yo&: Psychohistory Press, 1974, p.117-I 8, Doris Desclais BERKVAM, En#41#:e et matmitt! &m la Iittkrutwefian~atke & X P et XIIF si&Ies, Park Champion, 198 1, p.14 ct 137, R CARRON, E @ ~ u etprentP alms & France m&di&aIe 2 - X I . ' sikkr, GenCve hoq 1989, p. 169-73 et E. BERTHON, Lc sourirc aux ages Enfanu ct spiritualat au Moyen Age QCl.P-W sitcle) m, Maibdm, 25 (1993): 106-07. Memc P. RICH& admet cettc barri&rc enm l'avant MI' et I'aprb-XLIe sitcle : cf, par cxemple Ie petit k i c u l c qu'it composa, RedPcammte de I 'e@nt m&i&aI, (Histoin aujourd'hui : nouveaux objets, nouvelles m&odes ; B-22). Litge: Section d'Hoistoire, s.d., p.6. ParaIl&lement i l'essor du culte pour I'Enfant-Jtsus et indissociable de celui-ci, il faut noter le dtiveloppement d'une nouvellt perception de la Vierge, comme Mtrc du Christ-Enfant et de I'humanitt soufbnte ; sur ce thtme, outre touts les df€rences ci-dessus, voir aussi RW- SOUTHERN, The Making of the Middle Ages, New HavenLondon: Yale Univ. Press, 1977 (24= Cd-), p.238-40.
laics avaient tojours r e g d les petits avec tendresse, mais que la main-mise SIP l'ccriture
par l'figlise avait jusqu'alors ernp8cher d'entendre leur v o k Trts probablement, la rtponse
se trouve & mi-chemin entte ces deux extxbes. Dans les Vitae ciunisiemes, il est fait h
diverses reprises df€tence l'amour matemel : ainsi, Gilon declare que Hugws pkpatait
toutes choses pour I e s novices comme la fuhnr m&e a Phabihde de le fhke pour l'enfmt qui
va matre? Le comportetnent de la m&e vis-&-vis de son e&nt srrvait parfiois de symbole
pour ddcrire les bons soins d'un abbe ewers ses fils6. Hormis ce type d'indices, il est
difficile, faute de sources, d'6vaIuer la forme pnse par le sentiment parental avant le XIIe
si2cle. Les fits de miracles mettent en s cbe des parents pdois tr& malheureux devant Ies
souffiances de leus enfsnts et psts de grandes ex&mit€s pour les soulager, mais etaient-
ils reprt5sentatifs de la population en g&&a17 ? Dam le L W , date du ddbut du XF siecle,
sont 6voqu&s les gu&isons de 51 personnes, dont d e m e n t 5 e d i t s (4 gaqons et 1 fillep.
Compte tenu du fait que, dam la soci6t6 m~di6vale, comme dam toute sociitk de type
traditiomel, le pourcentage des enfimts dam la population etait trtis dev6 et la morbidit6
infantile t r h grande, ce rapport de 5 eafants pour 46 adultes est &omamment bas9. Est-ce
que les adultes partaient plus rarement en p d e ~ a g e pour unpuer que pour un des leurs
s. V . I,lii,p.89. Sur Shistoire d'une miire terriblement dprouvde par la mort de son enfant, cf. DM II,xxxii,p.16 1-63,
6. C t par exemple YO@ I,xi,col.906B et VOP co1.930A. ? Sur la dou1eu.r des parents devant Iew e n h t malade ou d M € , cE par excmple L W , xii,p. 1793 (8 IIlius
[cnfant aveugle] miseriae condofentes antici & pcaentes ... a) et DM II,xxxii,p. 162 (* Indofuit acriter mulier, a@tu racra materno. ac dolor& nimiistimulis agi'rat~ totam vim animi non tam adfieturn muliebriter, quam adjidem comtanrer conuertiti *).
'. LMM, I,xi-xii,xviii ct II,i d m 9. Sur la place des enfiants dam les &its de miracles, cf. cnfrc autrts PA. SIGAL, d e vocabulaire de
l'enfance d de I'adolscence dam les rccucils de miracles Iatins des XI' et XP siklesr, dans L'en* au Moyen Age r littdranae et civilisation, (SCn&fiance, 9) Aix-en-Prov~cc/Paris: CUERMAILib. Champion, 1980, p.41-60, Id, L 'Hornme et fe mirude, 1985, p.261 (mais voir aussi ~163,268,273 et 282) et Eleanora C. GORDON, a Child Health in the Middle Ages as seen in the Miracles of Five English Saints, A.D. 1 150- 1220 *, Bulletin of the Hisrory ofMedicine, 60 (1986): 502-22- Dam ce dcrnicr article, l'autcur a comptt 216 miracles concernant dcs cnfirnts et des jeuncs (20 am &ant I'ilgc limite) pour un total de 1067 miracles, soit approximativernent 20%. En revanche, si I'on fkit la somme des moycnncs de miracles de malades pdsentks par P.-A. Sigal, on apprend que 28,48% des miracults ttaicnt des jeuncs (enfivlts et ado1escent.s). Ces pourcentages sont plus &lev& que celui not6 dans le w, mais ils restent mal@ tout trb bas cornparts la rtialitk, puisque les moins de 20 ans devaient composer approximativement 50% de la population (cf. J.C. RUSSELL, a How Many of the Population were Aged ? a, dans Aging and the Aged in the MedievaI Europe, id- M. Sheehan, (Papers in Mediaeval Studies, 11) Toronto: Pontifical Institute, 1990, p.120).
mid etpentes * (arplesson cpi appadt f%quemment dam le ncueil) ou est-ce que les
moines jugeaient & moins gmde valeur la gucrison d'un e n h t par rapport A celle d'un
grand, si bim qu'ils w Ies ttanscrivaient pas toUtes ? Pour dpondre & cette question, un
pnmier irnpcratirse pose : il faut mieux comprendre la perception monastique du premier
Bge et son Cvolution avant et pendant le We sitcle. Ce ne sera qu'ensuite qu'il sera enfin
possible les rapports em&-parents d m t le haut Moyen Age, tels qu'ils
apparaisssent B travers la grille du discours eccl~astique.
Une autre errem trop Wquente des historiem de l'edmce est de sauter alkgrement,
non seulement entre Ies si&les, mais @dement entre les sources10. Il est evident qu'une telle
mani&re de faire' puiser i toutes les sources (iconographiq~es~ archdologiques, rn&iicales,
modistes, eiques, etc.) sur plusieurs sikles et dans de multiples pays, pemet de demontrer
tout ce que Yon desire, qu'il s'agisse de nous faire pleurer sur le martyre des enf'ts
d'autrefois" ou de s'dmerveiller sur la trb grande importance, symbolique ou dmotiomelle,
attachie B cet iige pendant 1'6poque rnM6vale. Pour s'opposer B ce penchant, il est
fondamentd de multiplier les etudes prkises d'un discours dome, qui prennent en compte
le contexte dans lequel les sources fiuent compos6es12. La valeur des r6sultats de ceux qui
'9 Un exemple est le fait d'utiliser des sources atabes pour comprendre I'histoire de l'enfance medievale occideatak (cf P. RIC& ct D. ALEXANDRE-BIDON, L 'en#ance mr Moyen &e, 1994, p.42-44). La civilisation musulmane mtdidvale scmble avoir dtployt une attention bcaucoup plus grande h l'enfance quc la civilisation occidentak qui lui etait contemporaint (cf I t s travaux de Avner GIL'ADI, Concepts of Childhood and Attitudes towards Childrm in Medieval Islam, A Preliminary Study with Special Refcrcnce to Reactions to Inf'ant and Child Mortality m, JimmzI of the Economic andSdcial Hrjtory of the Orient, 32 (1989): 121-52 a Chihah of fsfam : Concepts of Chifdhood in Medieval Mudim Socier),, New York: St. Martin's Press, 1992. ainsi me I'artiile de A.M. EDD& Un trait6 sur la enfants d'un auteur srabe du XIIIa sihle m. dam tes dges de la vie, 1992, p.139-49). I1 est donc peu ii propos de puiser dans les Ccrits dc I'une pour comprcndrc l'autre,
". Cf, commc exemple e e , la trb discutablc introduction dt L. deMAOSE h son Mition de The Hirtory of Childhod New York: Ihe Psychohistory Press, 1974, p.1-73.
If. Je ne mcntionnerai qu'un scul exernple du danger de citcr dcs auteurs sans comaitre Ie contexte dam 1equeI ilr r t?dight Picm RXm hit souvent r6fCtcncc la Vita d'~ticnne dVObazine (tll59) pour illumfr la t e n h s e des moincs & I'egard des enfimts. Dans cette oeuvre cornposb peu aprb la mort du saint, I'hagiographe ddclart que les enfants &w& ou monarthre (pdcision fondamentale) sont des e m s purs et innocents (E. BaIuze, Misceflaneorum, IV, Paris, 1683, II,49,p.I58 pour Ies pueri et II,S,p.l 19 pour les puellae). Cette description des oblats est exceptionnelIe sous la plume d'un rnoine, comme nous pourrons le constater plus loin avcc i'analyse du discours clunisien : non que les moines n'etaient pas convaincus de
men&rent de semblables e n q u k (on peut citer entre autres les tmvaux de Mayke de Jong
et Nicholas Orme pour l'bistoire eccKsiastique, et le beau livre de Doris Desclais B e r b
convaincre du bien-fond6 de se i.cstreindrt, au moins temporaitement, ih des etudes plus fines
La dernik critique que je formulleras B l'encontre des recherches sur I'enhlnce est
qu'elles codiontent trop sowent le traitement de I'enfmce dam les sikles pass& a notre
propre comportement en cette fin du XXe si5cle1', qu'il s'agisse de mettre en evidence les
diff6rences (comme le firmt les disciples d'Ari5s) ou les similitudes1\ Le danger est grand,
non seulement parce que le traitement et la perception de l'enfant ont beaucoup 6volut en
I'espace de ces trente demi&es a n n h - comme l'atteste, par exemple, le discours
aujourd'hui tenu sur les punitioe corporelles - mais aussi parce que les chercheurs
universitahes ont bdnCfici6, pour la plus grande part, d'une enfance et d'une jeunesse peu
pnkxver I'innocence de l'enfant en le soustrayant au moade, mais ils avaient surtout I'habitude de diicourir sur ses ddfiuts et gu&e sw ses qualit&- Le contexte historique trb particulier dam lequel cette oeuvre vit le jour explique I'originalitC de son contenu : le monasthe d'obazine, fond6 par ~tienne et Pierre, son cornpagnon-ennite, k t furdement int6grC & l'ordre cistercien, or celui-ci interdisait I'admission d'oblats. La Vita est en grande un plaidoycr pow pdserver L'originalitt5 du lieu et de ses usages, y compris I'oblation. D'oG cette envo1k lyriwe exceptio~elle dam laquelle les enfants oblats apparaissent sous les traits de petits anges Beaucoup plus repdsentative des attitudes contemporaines est la critiqye contre les oblats que ce mtme autendt!plore et combat, soit que ces sont compl~tement aMtis par l e u mode d'6ducation. I1 n'est peut- Etre pas non plus dCnu6 dc signification que I'auteur ait dO intammpre la ddaction de la Vita pendant plus de quatorze ans du fait des critiques qu'elle mscitait (ibid, p.70-72).
IS- Mayke de IONG, Growing up m a Carolingian Monastery : Magistcr Hildemar and his Oblates m, JMN, 9 (1983): 99-128. N. ORME, a Children and the Church in Medieval England m, Jowml of EccIesi4sticaI Hbtoty, 4514 (oct, 1994): 563-87, Cf. aussi I t s a u m travaux dc ces mEmes auteurs dans la bibliographie en Annexe. D. Dcsclais BERKVAM, Enfme et muternitd, 198 1, Cet ouvrage est assez pauvre en df€rcnccs ii des sources secondaircs, ce qui n'enltve pourtant rim sa finesse.
14. Sur le fsit qw P. An'& adopta volontairemcnt cettc position, comme la scule vraimcnt instructive pour I'hiiocicn, cf, A. NELSON, The Infancy of the History of Childhood : An Appraisal of Arih m, H~31ory and Theoty, 19 (1980): 132-53.
". Sur cc demier point, I'artick dcent de Didiw L m , a Lcs p&cs du Moyen Age aimaient-ilo leurs enfants ? l (1; 'Histoire, no I87 (avd 1995): 46-51), est particuli&emcnt syrnptomatique. Sur la base des illustra!ions reprbentant Joseph s'activant autour de I'Enf8nt J-, I'auteur a f f i e que les p&es du Moyen Age s'occupaient adimnent de leurs mhts, ccrtains allam mCme jlupu'ii l a langcr et leur donna le bikron. Cette ttude trahit bien le besoin d'aller chcrcher dims le pass6 I'image de notre comportement actuel. A l'opposd, son article plus ancien, intitult L'enhce : Etas idima, Etas i n h a 8 (MPdi&vaIes, 15 (1988): 85- 95) pdsente ceae fois-ci we image exagdrhent noire de l'enfant, ptcsque assirnil6 aux nains, aux fous et aux muets-
mprkntatives... Cette m~odologie susciterait La controverse en tout autre domaine, mais
le thhe & I'edimce semble s'y ypeta sans que pasome ne s'en offbsque, peut4tre parce
qu'il nous touche tous 8 coeur, pad- aussi parce qu'un discours Manichh (grand amour
ou d6sintM des parents pour Ieur pmghiture) est plus apte ii satisfaire (selon les
chercheurs) les attentes Bun large public, t d s in*&, semble-t-il, par le traiternent des
barnbins au Moyen Age16. Le discours tenu sm l'oblation illustre parfaitement ce parti pris
des recherches et les distorsions qui en dsdtent, Nombreux fiuent les m6di6vistes qui
essaykeat d'expliquer les motivations des parents pour offrir un fils ou w e fille en bas age
B l '~~l ise , parce que cette pratique Ctait choquante pour notre sensibilitC. Aucun I ma
fonnaissance n'a mis en valeur le fat que le placement d'enfants en d'autres demeures (qu'il
s'agisse du "fosteragen en un chateau, sur une fenne ou dam une echoppe #artisan, ou de
l'oblation en un monastire~ pouvait etre mieux appre'hend6 si nous d&ournions les regards
de notre societ6, choisie ici encore comme unit6 de mesure, pour en observer d'autres o l ces
pratiques sont, ou k n t , chosa couranted8. Par aillem, si les motivations des parents
'9 L ' i n d ~ t du grand public pour le traitemem de l'mfance au Moyen Age se manifests t d s claimnent lors de I'Exposition consade il ce t h h e il la Bibliothtque Nationale (Paris), en 1994. Le livre de P. Rich6 et D. Alexandre-Bidon sus-mentiom6 allait de pair avec cette exposition. CC le compte-rendu des deux par une histoneme de l'art, Sophie OOSTERWUK, An Exhibition of Childhood W, Medieval Lge, 3 (automne 1995): 33-34.
". I1 existe, certcs, des differences importantes entre l'oblation et la mise en noumture dans un envwnnement laique- Entre aufrcs, l'enfht donnd un monast&c &it fiequcmment plus jeune que celui qui &tit plad chcz un W c : Ie premier ayant habituellcrnent 8ux ahtours de 5-7 ans et Ie second aux alentouts de 8-12 ans (cf, D. ALEWRE-BIDON, Grandeur et renaissance du sentiment de l'cbfaace au Moycn Age m, dam &cations rnpdiides - t 'tznjiiince, HCOI~, I gg1ae en Occirdent (M-XP sitMes), dir. I. Verger, (Histoire de l'&lucation, 50 (mai 1991)) Paris Service de l'hmaion de I'INRP, 1991, p.61). Surtout, il nV&ait pas possible il l'oblat de se mmmancr (mais cct intcrdit ne s'appIiquait vfaiment qu'aux moines, et non aux clem, avant la dfonne grCgoriennev et encore ! Dc plus, les jeunes la~cs, tout au moins les nobles, se voyaient souvent dictcr par Ieurs parents le choix de la p e r s o ~ e B qui ik devaient s'unir). Malgrt tout, l'oblation, tout comme le "fostcragt", entrainaient le ddpart dc la maisan familiale avant la pubcrtt, et permettait l'cnfant d'acqu* une formatjon qui avait CtC choisic ct imposte par 1cs parents. Pour bicn comprmdre I'une a l'autrc de ces pratiques, il serait donc important de les analyser conjointcmcnt, sans pour autant fairt abstraction de leurs diffhnces.
", Pour men- i bien une ttlle ncherche mi-chcmin entrc I'histoire et I'anthmpologie, il faudrait lire les nombnux travaux sur I'adoption ct le "fosterage" dcpuis I'article de Jack GOODY, a Adoption in Cross- CuItural Perspective -, Comparative Studies in Socie~ and Hbto'y, 1 111 (1969): 55-78 jusqu'll la synthbe dcente de Suzanne LALLEMAND, Lu cthd~dion & enfonls en socidtP tradftionnelle - Pr& don, ichmge, Paris: L'Harrnattan, 1993. Sur la base de tels ouvrages, j'ai donne une confdtence en mars I994 intitulbe
Pourquoi otfrir son enfant au monastere ? Diverses hypothhes pour expliquer l'oblation au Moyen Age (offerte dans le cadre des "Jeudis des lectiones", conferences donndes au Ddparternent d'Ctudes classiques et
180
doivent effdvement susciter wtxe intMt, il est significatifque les raisons qui poussaient
les moines B accepter les &ts dans 1- mgs ne sont quasi jamais d t~dkks~~ . LB encore,
nous mom eu trop tendance B observer Ie traitement de I'enfhnce sous l'angle qui nous est
m€di€vales de l'Univcrsit6 de MontrQE) ; j'csptrt avoir l'mcasion de lrvenir ult&ieurernent sur ce thtme qui m'a sernble par&iculi&emcnt prometteur. En peu de mots, le "fosterage" et L'adoption dans les soci&& traditionnellcs s'expli~uar~ent principalcmcnt pat dcs motivations tconomiques (placement dam une "fbnille" plus riche ou apte & tnseigner un ma=) eVou politiques. Dam cent demi&re perspective, l'oblation ne doit pas &re simplement perFue c o m e le meilfeur moycn d'6tabIir un contact entre le Ciel (l'abbaye) et la Terre (la famille). En offhnt l e u enfant il unc communaut6, I t s parents tissaient un lien vivant avec un voisin qui b i t doublcment puissant : en effkt, il dtait non sculemmt le ttpdsentant du Seigneur divin, mais &dement un important agent bnomique en cc bas monde. M- DE JONG a ddjA mis en dvidence cet aspect de l'oblation, lorsqu'elle -a que cctte pratique constituait une sorte de commenribrio d'un e&nt un puissant, que cclui- ci soit abM ou M q u e ; mais elle pcnsait que la dforme carolingicnne et I'imposition de la RB dam 1 s monastEres avaient dome lieu h me reddfmition de l'oblation : c e b c i etait maintenant devenue une offtande des parents A Dieu (a In Samuel's image : Child Oblation and the Rule of St Benedict in the Early Middle Ages w, Regulue BenedictiStdk, 16 (1987): p.72-73). fe ne vois pas en quoi ccs dew explications du don ne peuvent pas co-exister simultandmcnt (cf, nu la richesse du sens du don dam les soci&& traditionnelles, les marques de U MAUSS, non seulement dam son Ersai mr le Don, mais aussi dam Oeuvres, m: Cohhion sociaIe et diYiFom de !a socioIogie, Park gd- de Minui~ 1969. p.47-48 ; cf. aussi Joseph H. LYNCH, Simoni'acrl Entry into Religious Lfepom I000 to 1260 - A Sociuf, Ekonomic and Legal Study, Colombus: Ohio State Univ- Press, 1976, p. 1 I).
L'image de l'oblat comme offi.ande f%te au Seigneur se retrouve dans la Vita Odifonb par Jotsaud Celui-ci dklare en effet au tout debut de I'oeuvrc : Odilo uk beathimus tanto nobifitatis stemmate procreatus iwer Qsa primordia trr?nqtuun after Isaac siue Sollluirel Christ0 co~tsecrottlr & Brkate apudsanctum Iuiibmm gloriosum mawem clericali sorte donahrs est. (Vm I.co1.899A-B et Ars.162, foL1 1 lv qui pdsente, B la diffhnce de l'tdition de la PL, la pdcision "siue (Smnuhel").
Lcs travawt anthropologiqucs nous font aussi prcndre conscience du fit& qut notre sociM, il I'oppo* de nombrcuses autres socitt6.s d'aujourd'hui ou d'autrcfois, valorise outre mesure la patemite charnelle, au detriment des autres patemit&, spirituelIe ou adoptive*
Je ne rejette ma!@ tout pas compl&tcment l'hypothtsc avanc& par John BOSWELL, dans son ouvrage The Kindness of Strangers - l%e Abandonment ofChil&en in Western Europe fiom Late Antiquity to the Renarjsonce (New Y o k Pantheon Books, 1988, chapitre V), scion laquelle les oblats dtaient souvent des enfants abandon& par leurs parcnts, parce qu'ils Ctaient dcs handicap& (physiques ou mentaux) ou dcs bouchcs en trop il nounir. Je rcviendrai plus loin sur ce t h h e car il est incontournable pour qui tram*lle sur les coutumins clunisiens, UIrich Ctant l'un des principaux rrsponsablcs dc la difftsion de cettc theone. Si Boswell adrnet lui-mEme que l'abandon nTCtait pas la caw principdc de l'oblation (ibid, ~ 2 . 2 9 ) ~ il revient ensuite sur cctte affirmation, en avangmt des arguments pcu convaincants (ibid, p.235).
''. PA. QUINN, dam son ouvrage Better than the Sons of Kings -Boys and Monk in the b& Miriiae Ages (Studies rir Histoty and Culture, 2) New YorWBonn(Frankfurt am W a r i s : Peter Lang, 1989) dtctare vouloir expliquer pourquai Ies moines acceptaient dm e a t s dam leurs rangs mais Ies raisons qu'elle offie, tant pour l'kglisc orthodoxe que pour I'occidentale, demeurcnt tr& schtmatiques ; ainsi, elle reprend I'affinnation de Leon le Grand, selon qui les oblats doanent de ats born hommes d'8glise. sans o f i de justifications (cf. p.26.27-28 et 33).
le plus familier, lles rapports parents-edbts, et non SOUS few qui sont tds doignh de notre
mode de vie et de notre semi'bilit@'.
Alors que j'avais d6jii commend mes recherches, la t h h doctorale de Maria
LahayeGaseq abordant le Wme de l ' d c e en grande partie sm la base des coutumiers
clmkiens, M publi&? Son approche difftrr de la mie~me dans le sens oh son objectif
1D. Certains chercheun affirmat que l'oblation cntdnait chez l'oblat de graves troubles psychologiqucs, entre autres para que l 'dmt, il un b e encore trts tendre, &it brusqutment arrache et rejet6 par scs parents loin du foyer hilial , privt d'arnour f m a contraint d'oublier sa langue matcmelle (cf. par excmple C.A. MOUNTEER, Gu* Martyrdom and Monasticism W, Jownrrl of Pg~hohi&tory, 9/2 (19% 1): 159 ct David W. PORTER, No Mother, no Mother Tongue : Boyhood under Bcntdict's Rule W, confdrence donnk le 9 mai 1993, dans le cadre de h h c e 11.~363, Chiiden in the Midliie Ages : Litteracy and Historical Perspectives, du Congrb annuel des m€di&istes se tenant Kalamazoo. Peut-on v6ritablemcnt les suivrc sur cem voie ? A I'Cpoque m t d i ~ c , h plupart des gaqons quittaient Ie monde des femmes aux alentoun de 5-7 am, pour commencer leur Cducation dans un envitonnement cssentiellement masculin (cf.. supra chapitre I). De plus, ce- des enhts d&& i la vie skuIi&e devaient traverser& un ggt i peine plus &lev& que celui des oblats une eprewe sirnilah, lorsqu'ils etaient envoy& en d'autrcs derncures pour commencer leur formation en servant comme valet ou page. Enfin les oblats retrouvaicnt souvent des mcmbrcs de leur propre famille dam I t s communautds qu'ils int@aient. Quant au tramatisme de Ia langue, il dcvait aussi existcr, au moins en partie, pour quelques-uns des enfants soumis au "fosteragen. D'ailleurs, parlait-on W e n t le lath ct sedement Ic latin dam Ie cio'itre ? Ulrich, qui &it d'origine gcrmanique et connaissait p a t e m e n t cette langue, m a qu'il h i &it malaid de d- les coutumts de Ciuny puce qu'il n'etait pas un oblat du lieu et n'en parlait pas la langue (U& I,Pruem., co1.644A). En dernier lieu, les chercheurs qui veulent appfiquer uae grille d'interpdtation psychologique A une pratique ancienne ne choisisscnt souvcnt que les concepts qui renforcent leur thhe de d€part, Ainsi, c e w qui critiqucnt l'oblation ne font nulle mention des conclusions psychanalytiques qui permettent de m i e u comprendrc comment cette pratique a pu subsister sur plusieurs sitcles. Un exemple : Erik ERlKSON a attach& une importance primordiale A I'existencc d'un syst&me de valeun fort a d'une solidarit& cultutclle pow un hcureux d6vcloppcment de l'enfant (cf Enfance et sucidtd, trad de l'anglais, Neuch~teVParis: Dclechaux & NitstlC, 1976 (1966), p.17 1 a 275-76) ; or, la famille rnonastiqut &ait dtfmitivemcnt apte B o m un tcl "sentiment collectif d'identit&" i un oblat.
A l'autcc cxtdme, sur le fait quc Poblation pouvait, sous un ccrt*n angle, Ctrc w e comme o h t a un ideal climate for foster children w, cf. L BOSWELL, K i n d k s of S~angem..-, 1988, p.239. Cf. aussi le discours un peu m o b partisan ct donc certaintment plus rCatiste de M. Martin McLAUGHLIN, Survivors and Smog atts... dans Hbtory of Chiirihoud, 197 1, p. 132.
21. M. LAHAYE-GEUSEN, Das Opfer der Kin& : ein Beitrag zur Liturgre- und Sozial'geschichfe des Mdnchms im Hohen Mitteldter, Altmberg: Oros Vcrl., 199 I. Parmi les autres travaux dccnts sur l'oblation, il faut aussi mcntionner le liw de P A QUTNN, Better r h the Som. .., I989 (qui prrnd comrne sources Ie plan de Saint-Gall dessinC au IX' sitcle a I t s reprhntations d'enfants dans Ic Psautier d'utrccht) et celui de MI de JONG, Kind en Klooster in de Vroege Mi.Ieemwn: Aspecten van de &henking van Kinderen an KIoosters in her Frankische Rgk (50&900), (Amsterdamse Histocische Reeks, 8) Amsterdam: Historisch Serninarium van de Univecsitcit van Amsterdam, 1986 (qui mite plus Wifiquement de l'oblation au W siecle). Cettc demi&re monographie cst parue cctte am&, en anglais, dans une version modifide ct comgCe : In Samuel's Image. Child Oblation in Emly Medieval W;esi, LeidcnMew YorkK6ln: EJ- Brill, 1996. Je n'ai malheureusemcnt pas eu la possibiIit6 de la c o d t c r . I1 n'est put4tre pas hintdressant de noter que les trois auteurs de ces monographies sont des fernmes.
principal est d'expliqwr la pratique de l'oblation? Pour ma part, je ne traite pas directemat
de cate question clans les pages qui suivent : I'oblation y est abordk, non comme un =jet
en soi, mais pour illustrer, avec d'autres pratiqyes, le traitement des d i n t s daas l'ordrr
clmisien. Une autxe Jpscificitt5 & mon approche est l'emploi des Vies de saints pour ajuster,
an moins partiellernent, l'image tronqy6e ld@ par les coutumiers. Surtout, je p a t e en
ce chapitre ce qui me semble 2tn d s t i q u e du traitement et de la perception de
l'edaact cornpads au traitement et B la perception des deux autns ages de la vie. Je
d i m o h ainsi que, pour de multiples raisons, tenant aussi bien I la croyance en la faible
intelligence de l'enfant, qu'8 la place qui lui etait Fate au bas de l'dchelle hi6rarchique et a
I'image clunisienne du moine ideal, la formation de l'oblat etait principalement centlee sur
son corps.
Comme les pages pr6cedentes en temoignent d&j& j'ai rel6gu6 dans les notes les
divmes conclusions auxquelies je suis parvenue i p r o p de l'oblation en ge'ne'ral (et non
specifique h Cluny) : je n'ai pas incorpod celIes-ci daas le corps du texte car elles ne
concement qu'indirectement le sujet de cette thke. L'intirt de ces remarques
contrebalancera, je l'e*re, I'impression de dt5sdquilibre qui pourrait resulter d'une
semblable structure.
? M. Lahayffieusen ddmontre quc i'oblation rep-nte avant tout une offiande faite h Dieu par les parents. Cette explication est la plus dvidente, puisque c'est celle que proclament les parents et les moines Iors de la ckrkmonie d'oblation, dam les chartes confmant celle-ci et dam les textes hagiographiques (cf. par exemple le trb intdressant dcit de LMM, I~ ,coI . l798D-E) , mais elle ne repr&ente, selon moi, qu'un seul cdtC de la rnddailIe. Cf, supra, la note sur rapport des travaux anthropologiques pour I'analyse de I'oblation.
A LES DO-ES BRUTES DE L'ENFANCE CLUNISXENNE
Dam les pages qui suivent, quand je parle despueri de Cluny, j'kvoque dquement
les cnfimts mtrCs dans I'abbaye pour y devenir moina : je ne traite pas des dcoliers, c'est-b
dire des d t s pl& temporakemeat au monasthe pour y Stre 6duqut5s1. De ceux-ci, il
n'est nulle question dam mes sources, ni dam la RB et les coutumiers, ni dam les Vitae2.
Trb probablement, il ne s'en trouvait pas dam l'abbaye meme puisqu'il existait, dam le
bourg de Cluny, une &ole exteme : en effet, dts 1147/48, Pierre le V6ndrable faisait
ref&ence, dam sa Dipsitio rei fmiIimis Cluniacensis, a des petits cfercs nobles
(clericellos nobiles) iduquis dam la vill&.
Quelques mots sur l'iige des oblats. On conndt bien leur 5ge maximumum Ils
devenaient moines profs au moment de l e u puberte, soit approximativement quinze ans ;
I. Cette pratique avait d d interdite par Benoit d'Aniane, 10;s du deuxi&me synode d9Aix-la-Chapelle en 8 17, par le caphulaire surnomm6 ult~riewement ut scola, cf. Synodisecundhe aquirgranensis Deereta authentica (CCM I), &I. f- Semmler, Siegbwg: apud F. Schrnitt, 1975, V,p.474 (a YI scolu in momsterio non habeam nisi eonun pi oblati antt *)- M a l e cct interdit, certains rnonast&es continutrent abriter des kales &ricures, d U. a J%oles c l a d e s au Moyen Age m, Acde'mie &e L BeI@p. Bdfetiw & fa clbsse &s lerires a cdes sches moral" et politiips, 1921, p350-72 et surtout M M HILDEBRANDT, The E x r e n d School in Cmalingicut Society, education and Society in the Middle Ages and Renaissance, I) LeidcnMew YoMbIn: EJ. Brill, 1992.
2, M. DE JONG fithit la meme remarqyc A la lecture du commcntake dc la RB par Hildcmar, c t Growing up in a Carolingian Monastery : Magister Hildcmar and his Oblates m, Jourrrrrl of Medieval HIjtory, 9 (1983): 102 La scule exception se trouve dam la Vita de Guillaume dc Votpiano. RAOUL GLABER y cxplique que le saint, d&oM de voir Ic bas nivcau d'6tudes du clergt tant en Nomandie qut dans toute la Gaule, instaura des scolhe sacrii minkterii dam scs monast&rcs (Wvii,p272), Mais ccux-ci n'appartemicnt pas iZ la s p h h clunisiennc U. BERL&RE affrmc m effa qu'en France a dam la pays o t ~ I'influcnce clunisie~e fut pdpond&antc, les kolcs claustrales cxtcmes fumn abandomh. m (8 Ihoies claustralu ... m, Acad&mb r&e de BeIgique, 1921, p565 ; cfc aussi ibid, p362 et p.566-67). '. Cf. Piem le Vtn€rable, Dirpmitio rei fmilicab cluniacentis, PL 189, col.105 lC $.-Hum PIGNON,
Hisroire de 1 'orrlie tie Clutry depurj lafondation de 1 'ubbgye jusqu 'ri fa mort de Pierre-fe-Vt?nProble (909- IISI), Autuflaris: Michel Dejussieu/Durand, 1868, p.414 (qui af£ime quc dcs koles extemcs existaient aussi i Sauxillanges, la Charitd et Saint-Martin-derChamps) et G. CONSTABLE, a The Abbot and Townsmen of Cluny in the Twelfth Century m, dans Church and City 1&X'l0-1500. B y s in Honour of Christopher Brooke, td. D. Abulafia, M. Franklin et M, Rubin, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992, p.158.
sous Pierre, cette limite fut dlev6e ii vingt ans pour des raisons que j'analyserai plus en dktail
dam le chapitre suivant En revanche, les sources normatives ne disent rim de 1'8ge
minimum. Odon fbt place cha unpdtre pour iitre dts qu'il fbt Sene (habitwllement
vers l'iige de daocaois am), mais il w s'agit pas P d'm m0nastk4. Guillaume de Volpho
fit fait oblat alors qu'il avait e n . n sept ans (a aim essetfere septennis ms). Selon D.
Boutbillier a JtP. Tomll, Pierre le VtnhbLe devint oblat h Sawcillanges d o n qu'il etait
igC de cinq ou six atls6- Celuiei raconte dans son Liber Mraculomm qu'un enfsnt rrssuscite
au tombeau de MaTed, I Sowigny, fit d o ~ 6 au saint dots qdil etait Sg6 d'un peu plus de
trois ans ; mais peutGtre devint-il simplement un sainted- Il faudrat analyser les chartes
pour voir si cues doment des informations plus prkises A ce sujet, mais, i premiere we,
I'iige des oblats y est trop rarement menti0nn6~. D'autres sources wrmatives monastiques,
telle la R&gle de saint C& pour les monides, exigent que l'editnt ait au minimum 7 am,
car autrement il ne serait pas apte I apprendre B lire ni i obeir? Cette b i t e de sept ans etait
4, Cetfe information f i t dp6tt?e par les quatre principaux hagiographes d'Odon, khelonnds entre 943 et les annks 1 120 : VO' 1,7,coL46C, V t F h 4,p.21 I et V@ 4,co1.87A. Le bienheureux Morand (71 1 IS), qui naquit vers le milieu du XIC siMe p r b de Worms, mais dont la Vita I date de la deuxi6me moitik du XI ' si&cle, fit lui aussi place c o m e oblat de I'tglise s6culi&re (a I'eglise Sainte-Marie de Worms) peu ap& sa naissance (a nec mufto post m, BHL 6019, AS, Juin, I (Paris, 1867), I,p341). Sur ce saint "para-dunisien", dont l'hagiographe &it probablexnent de la ville d'Altkitch, cf, D. fOGNA-PRAT, 8 La GuIIia du Sud, 930-1 130. Archev&h& de Besan~on et de Lyon m, dam Hagiographies. Hktoire internationale de la iitt&ature fatine et vernaculore en Occident des or&ines ri 1550, d i . G. Phiiippart, Turnhout: Brepols, 1994, p.325-26 et T. de MOREMBERT, art. 8 Morand a, Cath,, IX (1982): 73 1.
s. YWii,p258. 6. J+P. TORRELL et Do BOUTHILLER, Cd, Livre des merveilIes de Dieu (De miracuit3) de Picne te
VCnCrable, Fniurg/Paris: fd univccsitaim de ~ n i & . du Ccb 1992, p.3. ? Piem Ie V€n€rable dklare Ccrirt sept ans aprts ie miracle, qui cut lieu dors que l'enfant avait un peu
plus de trois am (8 cwn puer i1feplu.s gucan trim& esset... r, DM 11,xxxii,p.l62). D'aprts son &it, l'oblation semble avoir suivi de peu l'6vhcment : a Obtulrt &him: dkuota mrrlrerpuenrm smcto... * (ibid, po 163). Pow un autre &it de miracle A la tomb de Maeul qui se conclut, cclui-ci, ddfmitivemcnt avcc l'oblation d'un enfant, cf, WI,mc,coi-l798D-E. Sur Ic sujct des saintcurs, cf. PPA. SIGAL, L 'Homme et le miracle &m lu France ntMit%afe @T--MF siBcle), Paris Ed. du C e e 1985. p.107~.
'. Lc temps m'a manqud pour fairc unc Ctude cxhaustivt dcs chartes clunisicmcs ; la remarque ci-dessus ddcoule de la lecture rapidc quc j'ai faitc de ccttc source . R MET2 dCmontre que, dam le droit canonique, le flou dgnait sur l'!ige minimum pour rrcevoir la tonsure ~ I ~ c a I e : il sernblerait qu'h 1'Cpoque classique, Ics d6dtistes et les d ~ i s t c s ont fmd scpt ans comme Iiiitc mfdtieufc, mais que ccttc prCcision n'existait pas dans les textes plus anciens (m L'enfht dam le droit canonique dditval. Orientations de recherche m, dam L 'enfont, 11: L 'ipoque mddihuIe et maderne, (Recucils de la saciCt6 Jean Bodin pour I'histoire comparative des institutions. XXXVI) Bruxelles: ~ d . de la Librairie Encyclopddique, 1976, pAO).
9. Regula Virgimnt S. Cesarii, Sancti Caesarii Arelalensis Opera Ornnia, Cd. Gemah Morin, Maredsous, LII, 1942,7,p.104. La dgle d'Aurtlien pour les moines exigeait que les garcons aient au minimum 10-12 ans
certainement un ideal que les moines de tout ordre auraient aimt powoir applicper, mais qui
n'bit pas toljours suivi dans Ies Sts : ainsi, dam son comrnentaire de la RB compoSe entre
845 et 850, Hifdernar &oque la ~ULLiture que les m o k doivent 0- aw e&ts iigk de
trois a n s l O . Lanfiranc traite dans son coutumier du cas des pannrlipueri encore trop petits
pour se lava les cheveux par em-mhes, que leurs maitres doivent aiderlI. A Cluny comme
ailleuis, il n'existait probablement pas d'ge minimum #en*, sinon celui imp& par la
Nature, soit la fin du sevrage, ven deux-tmis a d 2 . Les histonens s'accordent mal@ tout
pour din que les oblats etaient off- le plus souvent il partir de Mge de cinq-sept ans13,
c'est-Mire I l'iige ofi l'enfant &it soustrait du milieu ferninin et cornmenpit
l'apprentissage du metier auquel le destinaient ses parents1*.
I1 est impossible de savoir exactement quelle etait la proportion d'enfants dam la
communautd clunisienne. Il n'est pas siir qu'une dtude mEme e s fine des chartes du lieu
pennettrait de r6ponh 8 cette question'? J. Hourlier afknait qu'ils constituaient entre le
pour etrc requs afin qu'on n'ait pas besoin de les Clever (mtrue) et qu'ils soient sutfisamment && pour savoir iviter de *her (cf. ('edition de A SCHMIDT, Zur Komposition der MOnchsregcl des heiligen Aurelian von Arks m, Studia Monastics, 17 (1975): l7,pA6).
Dam la Vita de I'dveque Wi16iid de York (f709l710) par Eddius Stephanus, dui-ci raconte la dsurrection d'un enfant par le saint (B. Colgrave, Wius Stephamr 'L@ of St Wilfirl?, Cambridge, 1927, pxviii,p38-40). Le ressuscit6 devait &re tout jeune puisqu'il n'etait pas encore haw. L.%v€que demanda comme contrepartr-e A la m&e de h i ramener l'enfant lorsqu'il aurait 7 ans. CelIe-ci voyant son fils grandir ct le trouvant beau se laissa convainm par son mari de ne pas obternphr la dcmande de I'€ve<lue.
lo. Hildemar, xxxvii, p.4 19. Cf. M. DE JONG, Growing up ... m, op.ciL, 1983, p.102. 'I. Larrj'ianc, 94p.77 = The Molulstic COI~S~~M~ON of LanjFmc, Cd D. Knowks, London: Nelson, 195 1,
p.93. ? Dans un sermon de MaYeuI, celuisi s'adtessc aux o b k du m o n d r e en des tcmes qui laissent suggdrer
que leur oblation se fit pcu apds leur sewage : Tom mihi mcnc ad uos sermo, o pueri, qui scgrcgati rslLr a fade, appuhi ab uberibus, quos undo
boptimatis per donum saneti s p m . in notiam tramtufit adoptionir g r t i m , qui ad exemplum Isaac deo obfati estik, qui ab @is cunabifh potum sandae predicationis s&fr cum fade camis. @. IOGNA- PRAT, Agni immacufati. Recherches nu les sources ha~ogruphi~ues relatives 6 saint MaieuI de Cfuqy (954-994). Paris: &I. du Ce* 1988, pa9 1). *. Cf. par exemple L BOSWELL, The Kindress ..., 1988, p.304 et PA. QUINN, Better than the So nr....
1989, p.32. 14. Cf. chapitrc I, section B. Is. Toutes les enaCes au monastb n'ayant pas ett! ratifiees par une charte, une semblable recherche serait
ardue : il faudrait enregistrer les entdes sur plusieus dkennies @our obtenir un khantillon suffisamment large) et ensuite caIculer le pourcentage d'enfants conccxn6s.
A Westminster, h partir de el03 1, les moines out inscrit sur un manuscrit le statut de tous les postulants au
cinquihe a le tim des b, mais il ne s'appuie sur aucun argument fond6 pour avancer
cela16. La lecture des sources nomtives permet de supposer qu'environ un membre de la
c o m m d monastique sur cinq Ctait un dt, tout au moins au milieu du XTC sikle, et
probsrblement dans les d6ceanies pr&dentesL7. La description d'une cMmonie quotidieme
sugg&e en effet cette proportion. Les e-ts fbisaient le mondrdunr quotidien le samedi et
le dinianche : deux enfhnts le samedi avec leurs maitres, deux aums le dimaache avec
l'abb&'. Le reste de la semaine, d'autres membres de la communautC s'en occupaient, a
raison de trois par jour. Cette oewre de pdnitence etait w e dquitablernent sur les dpaules
de tow les ; elle devait donc &re divisde hebdomadairement de manitre
fitr et ii meam de Ieur arrivk. G c h cetk Liste exceptionnelIe, C. BROOKE a pu noter la transformation du profil de ces derniers partir du dernier quart du XI' si4cIe. En- el03 1 et ~1072, parmi les 41 penonnes nouvellement en*, se trouvaicnt 35 pueri ; dcux individus dont le statut n'est pas identifib, d e w diacres, un pdtre et un "convtts et pdtre" (?) fomaient le groupe restant (The Monastic World 1000-1300, London: EIek, 1974, p.88). Ainsi, au milieu du Xl' si&Ae, les enfants constituaient au minimum 85% des nouveaux enti&. Je laisse C- Bmke dvoquer le virage qui prit ensuite place : From 1072 on, the pattern begins to vary. Men who joined as lay and priestly converts alternate with tbt boys, and a class of "young men", iuuenes, a term of various connotation, also appears. By I IS0 the convemi much outnumbered the pueri : but the last p u p which bears these designations, from the early to mid 1 180s, still included three boys to five converts. These facts are the outward and visibte sign of a period of rapid social change. (ibrii). 3 enf- pour 5 adults conespond une proportion d'un peu moins de 4P?. Sur d'autres proportions d'oblats par rapport aux conversi dans b monastttw du haut Moycn Age, cf. H. LECLERCQ, art. Oblat m, DACL, XIV2 (1936). coLI 86l-67 (en- d'un convcrs pour, pmbablement, 37 oblats dam I'abbaye Saint-RCmy de Reirns, deuxi&me moitid du Ke sikle).
16. a Par contre, ce sont de vdritables moines que tous ccs enfants dont il cst si souvent question dans les usages de Cluny. A lire ceux-si. on a l'impmrion qy'ils fonnaient un groupe important, peut-Cm le tiers de la communautC A en jugcr par la place qu'ils occupcnt dans lc coutumicr ; ce qui semblt beaucoup. Si Ies a Mres nommCs par le Brcf dcs l i m dc W m c sont 1 s enfants, leur nombn atteint presque 1e cinquihne de I'effectif alon p&mt A Cluny : mais ccci n'est pas certain, de sortc quc now restons sur la donnk plus vague du coutumier, . (l. HOURLIER, Saint Odilon, abbe' & Cluny, (Bibliothtqut de la Revue d'histoirc eccl&iastique, 40) Louvain: PubL universitaihs de Louvain, 1964, p. 15 1)- La M e des livres p&tk au Cadme nc concerne nullement les seuls c n b t s (ct P. D m LT, pXLIV ct 190,p.261-64n*). Guy de VALOUS ddclare simplcment quc Ies oblats Went nombreux B Cluny m (Le monuchkme clwrtkien des origiltes ou XV siBck Vie intkiewe ddes monast&es et organisation de I'orrte, I: L 'abba~~? & Cluny. Les monusthres cfunIjiens, Paris Picard, 197 0 (2. Cd. corrigk), p.42).
17. Lcs &ants &ant rarement des acteurs de premier plan, leur place dam les Vitae est extriirnement minime : il est question de l'cnfancc dcs saints, mais pas assez dcs enfants entourant ccw-ci pour que Ies sources hagiographiquts nous soicnt d'aucune utilit6 pour co~~itl 'hr le n o m k des enflints dam Ics monasths.
". Un des maitrcs des enfants devait aussi €tre p e n t pour surveillcr ; je suppose que sa ache consistait A observer I'attitudc des enfants et leurs rapports avcc les paums, I'abM Ctant trop pris par son travail pour pouvoir le faire : Die dominico domnus abbas cum duobus i$iantibus efaciat7 er eorum maghter eat ad eonm custodiam. . (LT f 83,p354).
19. L'ar~~fiius Ctait en charge de fmer la rtpartition de cette dche au dCbut de chaque annde, c'est-bdire pendant la pdriode du Careme (cf. LT40,p.S3).
proporci01llleUe pour qw, an bout d'm nombre donne de semaines, tous les eafsnts et tous
les y aient parti- une fok, abstraction f ~ t e des magistripueronmt a de l'abbe qui
s'y c o d e n t plus souvent. Si 1'011 oublie ces pasonnages, sur 19 f b s qui intemenaient
chaque semaine, quatre Went des enfants : ce qui incliquenit que ceux-ci constituaient
approximativement le cinquibe de la population ciaustrale.
Cette situation s'Ctait probabIement d6jA m&& du temps de Bernard, dam Ies
annh 1080, alors qu'un grand nornbre d'adultes ne cessaient d'entrer dam la communaute.
Du fait de cet f l u x d'hommes ayant dej& d@a& la p u M , le pourcentage d'enfants a dQ
baisser. Or, la c6dmoaie quotidie~e du mandatum teue que la ddcrit Bemard h i t
maintenant dpartie difErernment : les enfmts n'y participaient plus que le dimanche, avec
l'abbe ou le maatre- Ceci dome me proportion de 2 enfsnts pour 18 Mres, soit un newikme
des effect&?
Quantitativement parlant et en admettant que les calculs ci-dessus soient justes,
puisque la communaut6 clunisieme comptait m e centaine de membres a l'dpoque de 1s
redaction du Liber tramiris sous Odilon, les enfats auraient alors &6 m e vingtaine2'. En
revanche, la communaute ayant trip16 ti la mort de Hugues en 1 109, en supposant qu'elle se
situait entre dew cents et trois cents membres du temps de la ddaction des coutumes de
Bernard, les enfants auraient alors constituk un groupe d'une vingtaine A une trentaine de
personnes?
m. B e m I,p.204. 2t. Avec un enfant pour quatre adultcs, la communaut6 des pro& clunisiens h i t compodc de fason
majoritaire d'ancicns obiats, avec sculcmcnt un quart enviran de convertis A 1'8ge adulte ; ce &&it a Ctt! dCduit du calcul suivant Supposons que I'unique cause de ii&& dcs pro& (c'est-Mite des plus de 15 am) etait I'dpuiscment du earps A 45 ans, tandis qu'un enfant sru trois mourait avant l'&e de la profession (ce qui est assez vraisemblable comme esphmce de vie B 5 ans et cspCrancc de vie I IS ans pour des moines ; cf. B. HARVEY, Living curd Dying iir E n g f M 1 I O O - i M L 27te Monastic Experience, Word: Clartndon Prcss, 1993, p. 127-29 ct P. L'HERMlTE-LECLERCQ Le mollochi3me fhinin rlbnr la socidtd de son temps. Le monm12re & fa Celle &MEbur dh XYT siclfe), Paris: a Cujas, 1989, ~ 2 1 6 ) ~ et supp~olls que les qua- v i n e aduItes Ctaient rtpartis dc manik parfaitemat &piIibr& entre chapuc Qe. Dans ce cas, chaque annte, approximativement 9 3 d'enfants atteignaient rage de q u h ans ct faisaient leur profession, tandis que 813 d'adultes atteignaient I'@e de quarante-cinq a dCcCdaient. Compte tenu de la mortalit6 infantile assez &lev&, on peut considtrcr que pour 8 nouveaux postuIants, 6 Ctaient des pueri, ce qui donne une proportion de 75%, un peu plus base que ceIIe de Westminster.
? Sur (es fluctuations du nombre des f h s Cluny, cf. la discussion A ce propos dam I'Annexe D sur le noviciat.
Avant de traiter de la perception de I'd-, telle qu'elle se dtgage de la lecture des
sources hagiographiques, il me fhut &mudre m e question t& pointue de I'historiographie
clmisieme, qui est pourtant fondamentale pour mon props. La majorit6 dm histotiem de
Cluny jusqu'h tout nkemment ont pens! que le nombre des e d h t s &it tomb6 h six lors de
la ddaction du coutumier d'ulrich, puisque celui-ci dblare : Pueri mtem qui mnt in
conventu nostm, non dita semllCRlum protendunr, et eortn m a m i sunt duo, si non plures,
tmen nunquam mtpmreiores. P Un passage du couturnier de Bernard parle 6galement de
six ou quatre enfmts :
a Esr etiam collsuetudo, ut cum itw ad Processionem, & omnes mt generaliter revestiti, simt in Dominicis, Magism* eonan injFoccis stmr inter eod ideo sex pueri. vel quatuor habent multo plures Ma@stros/: quonimn nun licet aiim usumi mquam pro Magr3h.o praeter eos qui depuati sunt ; tamen Cellmanus, Hospitarius & major Camermius, si viderint opur esse sine Ikentia possunt infrare inter iUos, & in loco Magitroorun, eis esse. rZ4
*, UubL IU,viK,coL742B. Je reviens plus bas sur la signification donner 8 ce in conventu nosfro W. Parmi Ies histotiens qui ont pens& que Ies oblats n'etaient qu'au nombre de six du temps de la nkiaction du couturnier d'tnrich, on peut rnent io~er : J.-H- PIGNOT, Histoke de I'orrlie de Chny ..., II, 1868, p.383, J. EVANS, Monastic Lqe at CIuny 91 0-1 157, Oxford: Oxford Univ. Press, 193 1 (ddd. 1968), pA7, N, HUNT, Cfuny under Saw Hugh 1049-1109, London: Edward Arnold Publ-, 1967, p-96-97, H. GRUNDMANN,
Adelsbekehmngen irn Hochmittelalter : Comersi und nutriti im KIoster *, dans Adel und Kirche. Gerd Teflenbach zum 62. Geburtstag abgebracht von Freunden und SchiiIem, dd, J. Fleckenstein et K, Schmid, Freibwg/ BaseV Wen: Herder, 1968, p328n. et G. de VALOUS, Le monachikme clunikien, 1, 1970, p303n.
24. Bern. I,x~cvii,p204. J'ai ajoutk les banes transversales pow marquet 18 oh, peut4tre, il faudrait interrompre ICS phrases.
Dans un autre passage de Bernard, il est qucstranon de a dcwc des quatrc maim * (ct Bern Ipcvii,p207) qui doivcnt suppl&r & la ache des enfants lors~ue cewc-ci sont de service aux cuisines pour la semaine. S'il faut en conclure qu'il ne se trouw-t que quath maitres pour les enhuts dans rout Cluny, ceci p o u d t constituer un nouvel indice pour appuyer la thhe quc sculcmcnt six enfants etaicnt admis dam l'abbaye. En effet, Bernard cxige la configuration suivante aux toilettes, au dortoir ct la salle de bains : un maitre (qui &pare les enfants des adultcs), puis dcux cnfhnts, un maitre* dcux enfants, ctc. (a Inter duos, & duos jacent Magisfri in donnitorio, & sedent ad rrecessaria nattu~e ; w Benr I,xxvii,p202 ct cra iavant ad Iavatorium inter duos, & duos Magistri ant, duo vero per consuetudinem de Magistris extremis ant, urmr ex una parfe, alter ex alrerapwte cingemtes eospropfer alias Bern I,xxvii,p.203) ; or, pur constituer une telle suite dans le cas de six enfbts, il faut avou quatrc ma-.
La formation pdconisk par Bernard pour les processions (mention& dans la citation pdcedcnte) s'expliquerait alors de la sorte : il y aurait toujours un m a b & chaque extdmitd du groupe de six (ou quatrc) enfants, mais cate fois-ci, chacun dcs periserait &pard du suivant par un autre maitre. I1 faudrait alors avoir, dam le cas de six enhts , sept meillants, c'est-Mire les quatre habituels plus les trois proposds par Bernard comme suppl~ants.
Malgre tout, et comme je I'explique plus loin, on peut envisaget une toute autre solution : que les pueri Ctaient divisds par sous-groups de quatre ou six enfants, pour se rendre en procession, se placer au choeur, partir travailler aux cuisines, etc.
Ces quelcpes lignes indiqwnt que, lors de certaines pmcessions, les e a t s etaient divigs
en g r o u p de quatrr ousixafhde firdlita leur sutveillance : soit ptt~ce qu'un groupe mique
de quatre ou six &it admis A joindre le reste des f%res (et qu'ils M e n t alors soumis B la
garde de plusieuts maatres choisis pami Ies magistri auxquels incombaient la surveillance
de tous les enfants), soit parce que I'ensemble des d t s Ctait divisC par groupuscules de
quatte ou six pour la procession, soit enfin parce qu'il ne se trouvait que quatre ou six ed i t s
dans tout Cluny. k penche pour I'une ou l'autre des dew premihs solutions et d6montrerai
que c'est probablement sous cet angle qu'il faut aussi comprendre la phrase d'Ulrich.
Divers passages des coutumiers aaestent que, seuls, sixpueri ktaient admis dam les
choeurs de chaque c6t6 de l'autel, trois se plagant ii droite et trois A gauche? Tout c o m e
les adultes de ces deux c h o e d 6 , ces enfants Ctaient astreints a des regles de dkplacement
tr& precises : ainsi le rnaximur (ou major) de chacun des deux groupes de trois &tit tantiit
plus proche de I'autel que ses dew cornpagnomy tan& plus proche du choeur (ce qui laisse
entendre qu'ils prenaient tous place l'eWmit6 Est des deux choeurs, du c6t6 de l'abside).
Faut-il alors en conclure qu'il ne se trouvait dans tout Cluny que six enfants,
pnkisdment les six evoqu6s dans les deux choeurs et les six 6voqutis par Ulrich, ou bien qu'il
n'ktait admis dans les dewc choeurs que six enfmts, mais qu'il en existait beaucoup plus dam
le monastere ? A la suite de G. Constable, j'opte plut6t pour cette dewieme explication27,
mais, avant d'avancer des preuves dam ce sens, voici deux contre-arguments. Aucune
=. Cf, par exemple Bern I,xvi,p.l69 et U&II III,viii,col-743A-B. %. Cf_ Bern I m p - 169 et Udoll If,ii,col.7OZD. n, Selon Gilts CONSTABLE, la s e w i u 6voquee par Ulrich ne serait en didit6 qu'un sous-ensemble des
enfants, &vantage incorpdrt B la vie communautaire a ayant un r6le p&is & jouer dam la Iiturgie (St&, p.86- 8711.). Jc ne Ie suis en revanche plus lorsqu'il afEme que ccs six enfants etaicnt coup& du rcste de kurs compagnons du meme 4ge : je supposerais pour ma part qu'ii st faisait un certain muItmcnt, comme pour les tiiches liturgiques oh des bebdomadiers dtaient d6ignb pour &re les sousdiacres, diacrts et pr€trcs dc la semaine, Ce ne serait qu'ult€ricurcment, alors que l'obtation masculine n ' W d&j& p v c plus pratiqyk rnais que la voix enfantine Ctait encore ndcessairc pow constituer un choeur dc voix parfait, qu'un groupe fuce de six enfants aurait CtC constituC (cf. & ce props G. CONSTABLE, ibid et G.-M.-F. BOUANGE, Histoire de I 'abbaye d 'Aurillac, 1 $90, p.238).
I. BOS WELL offk une autre interpretation du a non uipu s e n d m m (Kindness. .., 1988, p298n.). Cette fonnule servirait B designer 1'8ge maximal d'entrde des enfants : ceux-ci n'auraient pas dQ avoir plus de six ans lors de leur oblation. Compte tenu de ce que I'on sait sur cette pratique, cette dgie n'aurait que peu de sens.
information prkise n'est donnet sur l'occupation des autres enfmts pendant les senices
liangi~ues. On put tout sp6ciaIement se demander comment ils 6taient mei l lk la nnit de
la Ctnt, don p toute 1'Cglise &it plongCt dans le noir a que les six &ants et les jeunes
du choeur Went maintenus sous we trk stricte surveillance? Mal@ tout, cet argument
a siIentio est de Sble port& puisque les auteurs sont globkmeent peu d i m sur la place
et le comporternent exigk des fibs ne s'asseyant pas au choeur (c'est-8-dire dam les deux
choem principaux, de b i t e a de ga~che)~ pui ne participaient pas directement I la E w e ,
tels les malades capables de se mouvoir et les moines qui venaient d'ttre saignt5sB. Le
deuxi2me contre-argument est que, ni Ulrich ni Bernard ne ddclarent jarnais parler Sun sous-
groupe des puerf lorsqu'ils 6voquent le comportement que doivent avoir les enfants du
choeur. Est-il possible d'admettre qu'ils glissent r&uErernent d'une discussion sur tous les
enfants B m e autre sur les six du choeur sans prGvenir leurs l e c t e d ?
Parmi les arguments incitant B penser que les enfants de Cluny Went beaucoup plus
nombrewt que les six sus-mentionnes, il est fait mention d'un Iocus infanturn dam l'6glise
qui serait siW face a l'autel3Is donc ni dam le choeur de droite ni dam celui de gauche.
Bernard en pale dam son chapitre mr la dception d'un mort amen6 ii Cluny pour y &re
e n t d : une fois le cercueil en& dillls l'dglise, les enfats w devaient pas prendre leur place
habituelle (ce famew locur infanturn) mais s'installer jlata rnarcheriam cmczjixi ad
sinisham partern my car le mort etait d@sC leur place et ils ne devaient pas gtner les
d6ambulations du pstre entre le cercueil et I'autel. Tandis que le prttre et les convers
? Bent II,xv,p309 et U&. &xi jc01.657D. w. Les Wres qui ont dtt sillSillgnCs se ticment pour quelques jours extra chontm ; ils ne sont pas punis s'ils
s'assoicnt pour sc nposcr a nc doivcnt pas s'agcnouillcr moins qu'ils ne le dtsircnt ( B e m I,xxix,p2 13- 14). Sur I t s a r c s malades, capables malgr6 tout de suivre partiellcment le rythme de vie communautaire, cf. G. ZTMMERMANN, Ordensfeben und Lebemstundard Die cura corporis in den Orrtemorschrflen des abendldndkchen HochmitteIafters, MQnstcr. Aschendorffkhe Verlagsbuchhandlung, 1973, p- 1 6 1 sv.
30, Ainsi, apds avoir prCcisC quc les enfants doivcnt toujours eciter trois psawnes dbbutant par Miserere avant la confaion, Bernard et UIrich affirmat : a od omnes horm fucies eorunt versa esl contra uccidentem. quantum pula, zit videripmsint apriorib ur... (Bern I,xxvii,p201 et U&L II&viii,co1.743A). Or cette phrase ne peut concerner que les six oblats du choeur.
3'. Je suppose que ce locus infinrum se tmuvait d e m t Pautel, puisqu'il correspond au lieu o~ etait dCpos6 le cercueil lors d'un service hn6raire.
partaient entma le corps, les enfants nprenaient leu place pour chanter l'office avec le
comennd2. Une autre drdmonie semble confirmer cette position particulih des enfits
dans l'6glise. Pour le d&s d'un moine du lieu, mute la wmmuna~ oblats y compris, se
rendait au cimetike. Les fFhes s'y rangeaient cornme suit :
hi qui de d ' o choro sunt, stent ad dextrum partem, juxta ecclesim B. Mmbe, prioribw st~mfi'bw versus caput majbris ecclesiae ; & hi qui de sinistro ad sinistram pmtem, prioribus e o h mod0 astarttibus versus cqmt majoris eccclesiae. s3=
11 n'est fat ici aucune mention des enfantsy mais il est p&d un peu plus loin, que, le pdtre
s'doigaaat de la tombe : a recedit a Sepulcho simul nnn Processione, & procedit in
medium Cemeterium inter pueros, qui versir vuitibus ad Orientem cantmerunt
PsaImos ... sY. Ainsi, au moment de la mise en terre, les enfits n'dtaient pas repartis entre
les dew choeurs, mais prenaient place au milieu du cimetitre, le visage tom6 vers I'Orient
(cornme les pie& du mort) tandis qu'ils chantaient des psaumes. Je pense que les Clunisiens
reprenaient ici les places qu'ils occupaient dans l'6glisey avec le choeur droit a droite, celui
de gauche B gauche et les enfmts au milieu, en retrait, face B l'orient. Le mort occupait pour
sa part la place de l'autel et symbolisait t'oblation faite au Seigneur. Une telle position du
d e b t ne doit pas etonner puisque les moines faisaient tout pour que leur trepas bquivaliit
a celui d'un martyr'*. S'iI existait un emplacement dam 1'6glise oti s'iostallaient les enfants
*. Bern I,xxxiv,p2 19. Ulrich, dam le passage correspondant cclui de Bematd, ne parle pas d'un foctcs ih$antum, mais dit simplemcnt que les enhts se plactnt usque daftare Sbnctae CmcI3, et ibistant magist& interpositik in sinIjtrapte a (I/&- III,viii,col.744A).
33. Bem I,xxiv,p.l97. Cettc disposition n'a de scns que s'il s'agit de Cluny II et non m. En effet, le cimetih sc tmuvait en avant de la grande CgIise dam CIuny 11, mais sut la b i t e dc celle-ci dans CIuny 111 (cf. KJ. CONANT, CIunjr. Les &gibes et la mukon drr chefd'orbe, Cambridge (M&)/M&on: the Medieval Academy of Amcrica/Impr. Protat Frhs, 1968, Planche IV, figure 4 ct Planche VI, figure 6).
14. Bern. I,xxiv,p-197 ; sur les difficult& d'interpc&ation quc posent ce passage, cf. H.R PHILIPPEAU, a Pour I'histoire de la coutume de Cluny R, RM, 44 (1954): 14940 ; cf. aussi description de la position des enfants dans LT 19S.5,p27Sm.
3s. Cf. LT 195.1,p.272c4u9 et Bern I,xxiv,p.192 : des Passiones dtaient lues pendant I'agonie d'un Wre. Pour une description ddtailk du ddmonial d6ployC pour la mort d'un moine. cf- S.-H. PIGNOT, Histoire de I 'ordre de Cfuv ..., IT, 1868, p.466-71.
La lecture de Bernard et dTUlrich nous apprend qu'il cxistait, en plus des choeurs de droite et de gauche, un troisi6me choeur, nomme c h o w minor, chorusporutrs ou c h o w derior. Celui-ci (a supposer qu'il ne s'agissait que d'un settl et meme lieu) se situait probablement cntre Ies deux choeurs principaux puisqu'un moine qui sT6tait endormi se prbentait avec sa lanteme d'abord celui de droite, puis A I'extdrieur et enfm i celui de gauche : a arcitatus p e r h r a t primurn cum ea dextrum Chorum; & per medium rediem, Chorum exleriorem; novissime, sinistnrm. * (Bern I,xviii,p.l74 et Udal. II,viii,col.7OW). Aux dires d'UIkh, Ies
pour la 4eIbration du service Iiturgiqpe, c'est donc qye les six du choeur ne coIlStituaient pas
ii eux seuls la totalit6 des pen' de la communautt. faut maintenant revenir & la phrase
d'Ulrich et voir si elle n'a pas CtC ma1 interprMe.
Comme l'aaeste l'amt-demier exemple cidessus, le teme comentw peut tr&s bien
ne pas inclure les &ts. Bernard et Ulrich emploient ce substantif& diverses reprises pour
d&igrier tous its moines adultes 0. wmpris ou non les convers) A l'exclusion des pueri. En
voici divers exemples pris dans ce &me chapitre oil Ulrich affirme que seuls six enfants
sont admis in conventu nostru : il dklare que les e&ts entreat habituellement i l'eglise par
1'Orient et le conventus par I'Occident, que le maatre doit se placer devant les enfants aux
toilettes lorsque le conventus est absent, que, a p e complies, les enfants doivent fake les
pri2res avant le conventus et sortir des toilettes avant que le conventus n'y vienne, que les
enfants doivent 6tre v6tus de tuniques de soie quand le couvent est rev6tu de chappes et
enfin, quand il pnkise que les d s n t s doivent rester debut ii tel et tel moment tandis que le
couvent est incline ou prostre a t e d .
novices prenaient place dam ce choeur (ct U ' L II,ii,col,702A)- Bernard ne pdcise rien de semblable, mais simplement quc, pendant la deuxi&me phase du noviciat, les novices ne s'asseyaient plus avec Ies &tires : (I In ecclesia sepmatim, in loco sibideputafo manent, scilicet inter charurn & cruc~~mrm rn (Bern I,xv,p.166). 11 ddclare en revanche qu'un h e n & n'avait pas le h i t de promener la lanterne en dehors du choeur rnajeur pour savoir qui donnait et quc c'dtait un des convers qui se trouvaient l'extt5rieur du choeur (a extra c h o w *) qui devait k remplacer (Bern I,acviii,plll). Pendant Ies dew messes, a p e les ~vangiles, le Iecteur hebdomadaire du dfectoire avait le droit de s'asscoir dam le choeur minew avec le livre qu'il lui faudrait lire au repas, pour se pdparer sa tgchc, moins qu'il ne fOt un iuuen& in cllftudia, dam td cas, il devait rester dans son propre choeur (Udbl, II,x~xiv,coi.726A)- Sans en avoir trow6 aucune preuve manifcste, je me demande si ce troisihe choeur ne regmupait pas en tout premier lieu les enfants non admis aux choeurs principaw,
Dam les coutumes dc Flcury en revanche, le groupe prcnant place face h L'autcl, p r b de Ia balustrade, Ctait compost5 dcs rnoines Ies plus anciens. Thierry de Flcwy sc sent oblige d'expliqucr I t pourquoi dc cette situation, pcut4trc parce qu'elk h i t hhabituelle : il dklare que le choeur est similaire un camp militaire dont les soldats les plus Cprouvds gardent les portes les plus mcnacks. Les enfants 6taicnt assis devant le chocur de droitc et de gauche, sur des tabouhs (cf. FIetay, II,24,p34 et A- AVRIL, La vie des moiires en I 'an Mille, Gien: Imp. Jeanne &Arc, 1985, p.34n).
? Respeaivcmcnt U&. III,viii,coL74!iB, co1.745B, coI.747A, col-743B et co1,743BI Certains emplois de convmm par Ulrich dam cc mCme chapitre sont en revanche ambigus ct indiquent que, h l'occasion, Ie terme conventus pouvait incorporer le group dcs enh t s . Ainsi, lonqu'un nouvel m f h t est admis au mondre , deux enfants vont Ie cherchct la porte du cloitre ct Ie pdscntent au convenhcs (Udai- III,viii,col.745C). Lorsque la communautC s'est rendormie a p e I t s laudes matutinaks, Ies enf8nts doivent &re dveill6s d&s que I'aurore apparait et s'habiller, afin d'ttre p+ts A Ia sonnerie = quodtom corntentus eodem modoficere debet (ibid, 747A). Quand des enfants sont de service la cuisine, deux chandelles doivent itre allumdes dam les toilettes pour les nocturnes tanturn usque durn conventus recedat rn (ibid 7478). On se trowerait donc ici
Ainsi, les six e&ts acceptes dans le conventus noster a w dires d'ulrich devaient
correspondre aux sixperf sitgeant au c h d 7 , tan& qu'une viagtahe d'autrrs prenaient
place en m e section diffcrrnte de PCglise, probablement dans ce locur ijz$imm sit& devant
l'autel. D'aiUeurs, dans I'6ventualie ott la communaw clUILiSieme n ' d t compris que six
edimts pour plus de deux cents moines, on compmdrait mai les accents de fiueur d'Ulrich
conire tous ces a poulets sembavort6s m qui encombraient les momW&res et monopolisaient,
i I'iige adulte, les postes de pow02~, ni les t&s nombnuses pages consades aux oblats par
devant la mtme transfornation shantique d'un teme dej& no& pour maiores (cf, chapitre Il). Dans le Bwn, et dam le ms G des CA, iI est en outre question, mais une seule fois, d'un conventus iNantum (cf. Bern I,xxvii,p.206 et C4 44,p.97).
''. Ulrich ne voulait pas d'oblat au monastiirc, comme I'indique ttts clairement sa lettce introductive adresst?e & Guillaume, abb€ d'Hirsau (Ucibf., Epirt- co1.635-37 ; je reviendrai sur ce parti pris d'Ulrich ultdrieurement dam ce chapitre)- Pour cette taison, je me demande si sa phrase, atTimant que seuls six oblats etaient admis dans le conventus, nn'&ait pas volontairement floue et plack en un tndroit strategique du texte, jute avant la dcscncScnption du traitemcut en gdnirol des cnhts, de tclle sortc qu'ellc pusse induire le Icfteur en errcut ct lui laisser croire qut seulement six oblats c~ectivcmcnt admis dabs rout le rnonasthe. Ce nc serait pas I'uniquc fois oh Ulrich aurait agi dc la sorte. Jc mvoie rn effet A l ' h d e du noviciat Cluny, daw SAnnexe D, oh l'on voit cet auteur parlcr d'un temps de probation, alors quc d'autres sources indiqucnt par ailleurs que 1es novices n'y avaicnt pas droit dans Ia gmde abbayc bourguignonne. Le passage dvoquant I'obIation, aussi bien que cclui parlant de la probation ont dtd inclus dans la rCdaction du Bern. Or, dans Ics deux cas, les d e w phmws-clds d'Ulrich ont CtC, pour l'une, rctranch& (dam I t cas des six enfants du conventus, cf. Bern. Iptvii,p.20 1), pour l'autm, modit?Cc afin d'en changer le scns (dans It cas dc la phrase parlant d'un temps de probation). I1 faut alors sc demander si cct auteur n'a pas r6digC certains rtglerncnts clunisicns, qui lui sembhient plus critiques que d'autns, dc telle wrtc qu'ils s'accordcnt A sa vision persome!le de ce quc devait &re le rnonast&c i M , [I n ' e t pas tout & f& fautifcn agissant ainsi, puisque le but vist par son coutumier n'Ctait pas de rctranscrirc, pour les Clunisims, les dglements qu'ils suivaicnt ddjh ct devaient continuer de suiwc, mais de dictcr h Guillaume, pour une abbaye non clunisienne, un idbl de compoctcment monastique (cf J. WOLLASCH, Zur Verschrifflichung d a kl8stcrIichen Lebensgewohnheiten untcr Abt Hugo von Cluny m, FHhSt, 27 (1993): 34748). En revanche, lorsque des pans entiers de son coutumier k t mclus dam le texte de Bernard pour servir, cette fois-ci, directement aux Cluniskns, les petites transformations hauternent significatives d'Ulrich hrent Ciimindes. ''- Udal., Epist- ~01.635-37.
194
Ulricb et Bernard39. Car ces deux auteurs eurent beaucoup dire sur le traitement des enfants,
comme en tCmoignera la fin de ce chapitre.
2. Un regard pht6t neatif sur cet Pge
Pierre Rich6 a afEm6 que les moines du haut ~ o ~ e n Age avaient transform6 I'image
ek n6gative de I'enfance, hiritde de 1'AntiquitC et des peuples germaniques, pour en faire
une nouvelle, faite &innocence et de tendresse. Avec d'autres chercheurs40, il a 6voqu6 les
quatre qualie associtks B l'enfiillt par les auteurs ecclisiastiques : il ne pedvtire pas dans
la col&e, iI oublie Ies offenses, il n'est pas attin5 par m e belle femme et il est sinc&e. Cette
M e , qui se trouvait dij i dam Krbme, fi~t reprise par B+de, Saint Colomban, Isidore et
Smaragde4'. Sa lecture pennet-elle vt5ritablement de declarer que les etlfants etaient les bien-
39. Pour la mort d'un moine, la cornmunaute veillait A tow de r6le toute une nuit, d'abord le choeur de droite, puis ceIui de gauche, et enfin les enfants:
a ncllc autem per connrerudi'nem sive magna sit* sive pantaw in tres vigiiiar secundum sui quantitutem partitw L..] dater chom cum Armario facit primamp sinater excitaltrs ab Annario cum absconra. cum secretariir s e c u h usque ad Mmimun. i@mtes autem cunt magktrik tertiam wque ad matutikas [,..I m (Bern I,xxiv,p. 199.
On imagine ma1 que les dew cents et quelquts moines clunisiens adultes sc divisaient en d e w groupes pour les deux prcmi&cs veillk, tandis quc la troisi&ne nY6tait confide qu'aux seuls six cnf'ants et leun quatre maifrcs. Du temps dc la rtdaction du LT, la n'&ait pas aiusi faite entre le chbtur de b i t e puis celui de gauche, mais d&j& Ies enfants et leurs makes s'occupaient sculs de la dernih p&iode de veille (cfc LT 1 953,p274). La meme dpartition se retrouve dam tonfianc (1 l3,p.lO 1 = The Monertic Conrtitutions of fm~Fanc, &L D. Knowls, 195 1, p. 125). Cette distriiution avait probablement pour but d'kviter d'abandonner ensemble enfsnts ct adultes pendant ies hems troubles de la nuir.
P. RICH& Erhrcation et C U I . rlbnr I rocci&nt barbare, VP-V'I. siScIes, Paris: &l. du Seuil, 1962 (3e H), p.505, M DE JONG, Gmwing up ... W, opxit, 1983, p.105 et Bric BERTHON, Sowkc aux ages ... m, op.ci&, 1993, p.98.
". JMrne, Commenrariorum in Evangeiium Matthaei ad Eusebium Libri quurtuor, PL 26, III,xviii,coLS33A-B. Btdc, Bedbe Venerabiih Opera, W3 : 1 , Mmci Evangeiium fipositio, dd. D. Hunt, (CCSL 120) Tumhout: Brepob, 1960, p.559. Colomban, Epktoiae, M3H, Epistolw, III, dd. W. Gundlach, 1892, #2, p.163. Isidore, De Veteri et N'vo Tizstamento Quaestiones, PL 83, Quaestio xI,#54,c01.207A. Smaragde, Diademu monachorum, PL 102, Ii~c,co1.655-56.
Xr6me cherchait h expliquer I'affmnation du Christ reprise par Matthieu : a Quicunque ergo humilimerit se s i a t panrtllus Me, hie esr major in regno coelonrm, w (Matt. 18,4). I1 d6clara donc :
Sicur isle pamIar, cujus vobk exemphm rribuo, non perseverat in iracundia, non Iaestls meminit, non ridenr pulchrum rnuIierem delectancr, non diudcogita!, et aliud ioquitur : sic et vos nisi taIem haherifis
aim& des moines ? Je dirai p l d t que Ceaains moines voyaient certaines qualitb dam
l'enfjracc ; mais swtout, cettt m b e liste tknoigne des limites de cette attitude bienveillante,
comw le sugg-t les constatations suivantes- Premienment, elle est tr&s c o r n
Deuxiemement, sa rCpCtition p q u e mot pour mot travers les sikles indique que les
auteurs du haut Moyen Age n'avaient pa9 l'habitude de s'attarder B &fl&hir sur les qualit&
des pueri. Troisitmement, les qualie qu'elle Qonce sont l'envers de dkfauts (versatilit6
d'huwur et 16gkett5, qui permet de ne pas prendre conscience de la portte des injures) ou
la marque d'un d6veloppement encore inacheve (absence de desk sexuel et absence de
raison, qui fait que l'enfant dit tout ce qui lui passe par la tete). Or, ces caracttkistiques
nggatives de l'enfance 6taient bien connws des hommes du Moyen Age, comme l'illustrent,
par exemple, les diverses remarques sur les @es d o m h dans 1'Annexe C, khelomks entre
innmentiinn, et unimi puritatem, non patetiti3 regna codomm intrare w
Ces chercheurs a-ent pu €@ernat mentionner la phrase pwdente de JMme qui en dit long sur la s a g e amiu€e aux eafants : .: NonprcdecI;Pitur apmtoIb. ut aetatem habe~tpantlrlorum, sed ut i~ocen t im . et pod ifliper annos pmidmt, hipossideant per industrr'm : ut malitia, non sapientia paml i sin& r
B&de reprend presque mot pour mot Ies explications de J&r&rne, mais il en ajoute une autre qui est par t icu l i~en t int€ressante pour ce chapitre car elle indique comment les moines percevaient I'education des enhts :
Regnum Dei. id est doctrinam emngeIi& sicut p d u s accipre iubemw quia quo mod0 paruuh in discendo non contradicit doctoribus neque rationes et uerba componit aduersum eos resktens sedfideliter susceit quddcxetur et cum metu obtemperat et piescit ita et nos in obiendiendo simpliciter et sine ulla
- rerractutiome w t b k dominifacere &bewtus m. Cotomban est le seul qui cite sa source, c'est-&-dire M6rne. I1 affme que Basile a Cgalexnent dit quelque
chose de similaire, mais I'Cditeur n'a pas pu rctmuver It passage en question. Ccttc lcttre est un appcl B l'humilitt land aux mrmbres de l'$glice ; I'auteuf a change en cons€quence le dtbut de la liste des qua- qualitds pour y instrer son message : Ii@rs enim humilis est, non laesus meminit, non nuIierer videns concup&cit, nun aIitrd ore, a h d code temet.
Dans le texte d'lsidorc, l'abscnce & contcxtt ne pennet pas d'interpr€ter Ies motivations de l'auteur pour OW cctte liste ; on peut simplcmcnt noter que cclle-ci est pr€sent& comrne compkte. Elle &urnerait donc la totalit6 des vcrtus enfatines : Die mihi infuns pcuvulus qumtas virtutes habet ? Respondit : iv : Non Iaesus meminit ; nun paseverat in ira ; non &ectizturpIchrafiminu ; non aliud cogitat vel aiiud loquil~r. *
Srnaragde rcprmd h i aussi prrsquc mot pour mot les paroles de J€r6me, mais il fait une leg&rc correction, qui met miax en evidence la di fknce de qualie de l'innocence enfantine par rapport celle des fideles du Seigneur :
a Non ergo nobk praecipitw ut aetatent habeamus panwlorurn, sed ut conversationem teneamus innocentiae. et quod ifli per annos possident infmtiae, nos possidemnus per purirarem innocentiae, ut malitia nun sapientia p m l i sirnus. r
Je reviendrai sur ce theme de I'innocence de l'enf'ance un peu plus loin, dans I'analyse des qualitds et des dCfauts associds au premier Pge par les hagiographts.
le IV" et le MI' sikle, ou la conclusion de D. Desclais Berkvam ii la suite de son &ude sur
a Senfimt est fatbley il a pew, il rit et pleure f d e m a t , il &lame sa m&ey se lance dans des atreprises pui Ie dwsent, se vante, change d'humeur d'une minute B l9autreY manque de suite dans les id- e x d e ou au contraire attendrit ceux qui I'entolKent. .'z
D'ailIetas, qu'est-il possible de conclure avec certitude du fait que cette liste fitt dp6tee sur
presque chq dkles en setdement cinq oeuvres (disons rnhe dk, en supposant que d'autres
auteurs mobs comus ont aussi repris ce texte) ? Pour avoir id& jute du poi& de l qu'il
faut accorder ce discours positif sur l'enfance, il est nkessaire de le co&onter aux autres
formes de discours tenus sur ce Wme.
Les Vitae clunisiennes compo&es en- 909 et 1 156 constituent un bon Cchantillon
d'&t.de, puisqu'elles sont nombreuses, r6partiessur deux si&cles et demi, abordent presque
toutes le Wme de l'enfance et permettent de suivre l'6volution de la perception de cet iige
jusque dam la premiike moiti6 du XII+ si6cV3. Dans celles-ci, le discours sur le premier iige
D. Desclais BERKVAM, Enfince. .., I98 1, p. 134. '3, Les recueils de rnitac1es (exception faite du DM, car celui-ci est tout it la fois un mr Cluny, un
regroupement d'Ccrits hagiographiques et m recueil de miracles Ctonnamment ddtaille) oftient des portraits trop somnrains de leurs persomiages pour qu'il soit possible d'en extraire la perception clunisienne des ages, d'autaat plus que l'cxtr5me majorit6 dcs protagonistes sont simplcment pdsmtts c o m e faisant partie de la catCgorie vir ou mutier. 11 est maI@ tout intdressant, du fait meme du cata&re Ms e#ditif des anecdotes de ces textes, de pnndre note des infomations que les ddactcurs jug&tcnt important d'Mrer sw les ages de la vie. Les autcun du LMM sont habhellement dcmcuds silencicux sw la question de r'cnfance (cft LMM &xi jcol, 1793A-B7 xviii,coL l79SC, xxx,coI. 1798D-E et II,i,col. l8W-Ol), mais Iorsqu'ils n t I t fiuent pas, ils intervinrent pour rappcler Ic peu dc sennrs dont faisait ptcuvc cet age. Du prcmicrpuer malade, il est dcrit :
8 Cum crescente aetate corporis, mescebat quotidie in iffaparte augmentum i'rmitatis, & qzuamuis non haberet Wem per aetatem, ad pefectri sensus retinenhm gratimn, inuenit sibi tmnen safubris cu)ssilii semitam. * (LMM I,xi,col. l792E).
Du fils unique d'un vieillard malade qui essayait d t se rcndrc au tombeau de MaRul, il est dit : [...I fdiiis qui nnn eo remamerat, eum diuuare nun poterat, vel pro aetatis teneritudine* vet pro patuo
il2iu.r inteIIecta (LMM II,xiv,col. f 8O9A). Dans un autre passage, on apprend que M a h l intervenait cnvers chaqut &e en fonction des aptitudes mentales de celui-ci :
a Qui qutxdam in matrtk tctero, quas&m iuuenes & pe$itos, quosci'am iam & vegefos, commendat tamen iilos omnes vnanimi & diuerso miracuIonim mod& Illque subuentionik medicurnhe vni'cuique subuenit, quo expedke sibi secundam salufis viam intelligit. m (LMM IT,x,col. 1806D).
est parfois neutnu, mais lolsqu'il ne I'est pas, 1s mnaques negatives surpassent en nombre
Ies que1ques touches positives'?
Dam sa ma Odonir, Jean & Salem Mssa Odan raco~ter son enfsncc : alui-ci d m Is agissemcnts de ses parents, mais non scs propm ct ne passa aucun commc11taitt sur cct agt dc la vie (VO' 1.5- 7,coL45-47). a Nalgod ont pcutdtrejug6 cpc Jean n'en avait pas assez dit sur le suja car ils ont tous deux &off€ le *it dt ccs memes ~ll l lCes : le premier eut rccoufs au t o p du puw-setter, tandis que le second drtssa le poMt d'uac enfaace fragile mais ignomtc, que les adults foment avec tendtesst (cf. infia). A u c u d'eux ne d6veloppa le t h h c d'une enfanu s h e propmcnt dite.
L'auteur de la Vita d'lde de Boulogne (t 1 1 13 ; dd. 1 130-35) ne prononce aucun jugernent, ni positif ni nCgatiE sur I 'enhce dans son &it extdmcment succinct des preari&res annb de la sainte. Mal@ tout, il emploie dam cette section l'adjectif l~sciua, habituellement utilise par les hagiographes pour stigrnatiser les defauts de l'enfance : Ditata vero moribus honest& non vitaepraesentis lntendebat Iusciviae, sed magi3 ac magis ad amorem suspirabat coefestir patrim ; rn ( M I,2,~01.438D).
L'kpitaphe d'Addlaide compos4e par Odilon de Cluny n'o& aucune infomation sur l'enbce de la fiture impdrawice puisqu'elle dtbute avcc le rnariage dc cclle-ci, rage de seize ans (E( I,p.29) ; mais, comme le souligne D. IOGNA-PRAT, l'objectifde-l'auteur etait essentiellement de parler de son c6le maternel (8 La GaIOia du Sud, 930-1 130. Archev+ch& de Besanqon et de Lyon 0, dam Hagiographi'es, I, ~323).
La Vita de Bouchard de VendGme (t 1005 ; dd 1058) ne comporte aucune constatation ni allusion, positive ou ntgative, sur I'enhce (YB kp.5). Mais, comrne je I'ai d€rnontd dans I'Anntxe A, Ie propos tenu par I'hagiographe, Eudes de Saint-Maur-des-Fo&s, est t c b pmhe de la position myale, La Vita ne peente donc pas les topof hagiographiques usuels, en accord avec les idhux rnonastiques, tels les critiques du sexe et de la guem : Bouchard se marie et guemie, et Eudes juge inutile de jhfier ses actions.
Ces derni&res remarques s'appliquent aussi 8 la Vita d'Ide de Bouiogne et B I'6pitapht d'Addlarde. I1 est signifmtif que les trois sources hagiographiques qui Cvoquent des personnap larques (et dont I'audience visde n'dtait pas limitfie aux seuls groupes monastiques) tinrent un discours neutre sur le premier Pge,
Odilon ne s'attarde pas sur l'enfance de MaYeuI. 11 ne consacre en effet que trois phrases ce sujet, pour pdciser que l'enfant fit Clew5 (nutritus) noblement parses parents, qu'on le consacra aux €tudes eccldsiastiques et que son comportement pendant le premier be, plus la divine providence, lui permirent de demeurcr chaste lors de son adolescence (VW 947A48A). Ccttc absence de critiqycs negatives sur l'enfance est peut4tre & rnettre en paralltle avec la grande tcndresse qu'Odilon t4moigna aw enfbts, aux dim de ses hagiogtaphes (cf- i'jio et I. HOURLIER, SPint Odifon, abbe' & Cluny, Louvain: Publ- Uaiv. de Louvain, 1964, p.130).
'I. L A. BURROW faisait la meme constamion pour la pueritia (l'iq#iinmtrb non comprise) h la lecture des V h avant tout anglaists qu'il a Ctudih (The Agar of Man A Stu& in Medieval Writing and Thought, Oxford: Clarcndon Press, 1988, p, 105-06). Mon h d e pow Ic DEA, qui consistait en I'analysc de quarante- trois Via de saints des MIe et MII' sitcles, m'avait permis de fonnulcr dcs conclusions sirnilaim, h savoir que la description dc l'enfanct par les hagiographes etait globalement ndgativc. Pourtant, A l'occasion, et de plus en plus partb du Xm' si&ctc, un discours positif et r&listc sur l'enfance se faisait parfois entendre, Ainsi, dam l'dtonnante Vita du pr6montt.t Hcrmann-Joseph (Vita B.Hennmni Josephi, AS, Avr,, I (Patis, 1865). p.684-90), si l'cnfmce en gentrai est toujom critiqu&, l'utilisation de ce topar cst en bonne part contredite par le comportement d'Hermann-Joscph : celui-ci joue avec J & w enfant, comme avec un compagnon de son gge, sous la surveillance de Mark (cf. Isabelle COCHELIN, Le cuer ouwir et les ye% dome. Spintetk et vieiflase uurXI1* er MIF siZcZes, DEA, Paris IV-Sorbonne, 1989, Annexe 4, p.42-45). Pour des exemples d'enfants saints joueun dans l'antiqu* tardive, d: E, GIANNARELLI, a Inf-A e santia-. m, dans Bambini santi, op.cit., 1991, p-4445. Pour d'aum exemples dam 1'hagiographie arrnoricaine, cf. B. MERDRIGNAC, Recherches sur I'hagiographie annoricaine du KIP au XP sigcie, I: L a saints bretons, tt!ntoi.. de Dim ou rhoim des homntes ?, (Dossier du centre egional archkobgique d'Alet, 4) Saint-Malo: s-e., 1986, p.94-97.
Pour mettre en valeur la s a k e d'un at, les hagiographes emploient
f%quemment cornme pnm Ie fat qye le saint a su &happer aux d6fButs de son ILge ; cette
mani6re d'agir permet de connarAtre les tares que les Clunisiens associaient habituellement
ii laprreritia. Selon Odon de Clrmy, la nature conompue des petits les incite 4 &re eol&iqyes,
envieux et vindicab'fs ; le deuxihe dciacteur de la Yira Geraldi a rep& ces paroles en les
modifiant l dghen t , montrant ainsi qu'il les fhisait bien s i d - Pour Nalgod, qui, en tant
que moine, devait placer la dhcretio parmi les toutes premitres vertus' l'edmce est un iige
sans mesure, aetas non discretd7. Les activitds enfmtines sont a w i critiquks : un saint se
doit de ne pas participer aux infantiles iocosi,t*rrs & ineptiaeeu. Mais de tow les dkfauts que
46. VG1, I,iv,644C : Nam in prima aetate, uz s a e p videmur, incitammenta corruptae nattuae, solent p m I i irarct et
invidere* et velle uIcbci vel alia hujusmodi attentme rn Et VGf, p372 :
L.-J ctim ad illam pervenrjset aetutem in qudpuerisolent itact; vel i'ideree, et velle ulcisci [...I rn
Dans le BN lat.15436, qui pdsente la plus ancienne version de la VG1, le sujet de la phrase estpueri et non pcautlli (fol. 477, tandis que le compI€ment de temps [n* in prima aerate a toute autre tournure : Nrun in hi3 aetatir... incitamentir rn (foL47" ; BN lat. 53 t 5, fo1.6" : = N m hius pat&... incitamentrj rn, avec Ie huius qui fit inscrit i2 la suite d'un grattage), Ces divergences attesteat que cette phrase si critique vis-i2-vis de l'enfance n'dtait pas recopiee aveugl€ment ; pourtant, aucun copiste den modifia le message,
Odon n'a pas ici fait d'empmts ii la liste pourtant bien fournie des defauts de l'enfance domde par Augustin (Sancti Augustini Conjiessiontun LibriXlli, €& L. Verheijen, (CC SL, 27), Turnhout Brepols, 198 1, p-6 et nutout Soncti Augustini & Civiate Der; (CC S., 48), Tumhout: Brepols, 1955, XXII,22,p.842-43). Sur I'irnage de l'enhce transmise aux sikles postt?rieurs par saint Augustin, cf, S. SHAHAR, ChiI.ood.. , 1990, p. 14.
". 0 dkcreta benignitas circa etatem etiam non discretam ! Puer, n e c h scientiam electionis hubens* in sortem electionis &i, ewctione sanctorum spliituuwt trizhebutur. rn ( V ' PL co1,87B = Fini 5,p. 134).
% AU tout debut de la citation qui suit, l'hagiographe Cvoque la docil'i de W e u l c n h t : il s'agit d'unc des caract&istiques principalcs de l 'enhce aux vucs des Clunisicns, Dans la &on suivante, je ddmontre qu'une totale passivitC ttait en fitit attcndue dts eafants, m€me dcs saints.
DocM quoque puera, diuim non d;eFit gratia, qui syllubarum element& vix a&uc informatus, ultra aetatem literas combibebat, & qdm sapientiae firlgore iitsignitus praenitebat, & praecliaris morum ornmentk iamjlorebat Nom e n h aetafuiae illius ka#&atem sectabanu; sed Domino Dm duce, qui sibi ewn iam PeCJi~luerat~ honest~~&gmu&ate dotabam* & mirandis vh-tuhm prcaesclgiis ditabahu. Vmbonmr obscoenitat~~ hitabat, & ut magis shrperrr, picquid honesum awibus hatviebut* w o r k urmarioio cornmendabat. His nimirum gab* animi sui t h e s m m curnulabat ; infantillbus a se dumtaxat remotis locositutibus, & inqtiis. (W 17838).
D'autres hagiographcs dc Makul critiqueat aussi la Mtisc dcs pmpos enfantins. Ainsi Synrs dCclart : a Cuius [MaTeul] Iems h m nac suaparsi&s dignoriom corptrrculum non hoc f i b ab antiquo permisit hoste polhi lusibus obscenkue adibus, quli,pe pi mum, antequum nascerehu* in eo prescierat consecrare sedem- Dumque adhuc esset paruulus apostoIum non Iegwat et tamen, eiw ium imitator exfitens* a n i k fa6ufa.s et uerborrrm obscenitafes deuitabat (I Tim. 4,7), L..] * (VM 12 ,~ . 183).
Tandis que NaIgod h i t : s Cumque adhuc sub annis puerilibus, aetatis impotentia teneretur, et ipso debilitas pupihrir virtutik
les hagiographes reprochmt aux enfants, il en est un qui revient encore et encore sous leur
plume, m i w s'iI prend des appektions divases : il s'agit de L'inconstance, 16g&td, etlou
fk.iii1esse de caractb, en d'autres mots, de l'absence de gm2&d9 : Odon parle depue2Zm~
molZitiid0, Ie r6dacteur de la Vita altera de W e u I mentiome la leuitus aetdue illid' , Nalgod € v q e la lasciva IeuiilmO, tandis que Jotsaud et deux des autem des Viloe de
Hugues de Cluny critiquent la lmdiuia de lapwritid'! Ces d d e r s citeat ce d&ut enfmtin
pour memp en valeur l'innocence du saint, qualit6 qu'ils jugent atypique pour unpuer".
s ~ p r o ~ a r e t ; concepo spbitrr fwiitudhis cwpitpuuilc~ inepfiiu declinme, et lenochiu verbaturn manu sianctae grmitath abigere. rn (KW 1,3,p.65?D-E).
Autre exemple du peu de vaIeur attach& aux paroles eafmtines, pour dki rc la folie dont fin atteint Geoffioy le Barbu B la fin de sa vie, Hildebert de Lavardin d&lare qu'il pmf6rait des a puwiIes ineptiae (m V,D,coI38 1B).
J- LECLERCQ a -t dans son article P6dagogie et formation spirituelle du VIe au TX' sikle a (dam La smoIa neU'Occirtente Iatino &/I 'uIto mediuevo, Spoleto, 1972, p283) une fsscinante description des props enfantins, extraite de la Vita de I'ermite GutIac (7714) : I1 n'imitait ni Ie badinage des enhts, ni le bavardage dCIirant des vieilles femme& ni Ies vaines rumtun du vulgake, ni Ies sons inarticuI& des bards de carnpagne, ni les pmpos fiivoles et mensongers des parasites, ni les cris divers des oiseaux, comme on le fhit, it cet age, habituellcment, D. Cette liste nous donne non seulement un apequ dcs jeux enfantins de cette Qoque, mais auni de I'image coclCsiastique de l'enbce- Les homes d'egIise voyaient les e n f w c o m e des imitateurs, n!p&ant les sons qu'ils avaient entendus, avec une nette pdfdrence pour Ies sons vides de sens. On vem plus loin que, lorsque les Clunisiens donnaient la parole aux oblats durant le chapitre, c'&ait avant tout pour dpdter les paroles des autres, et non pour exprimer leurs id&s penomelles- Ces diverses constatations comborent I'image d'une enfance pevue et voulue comme passive-
49. La iasciuia peut aussi Stre associ€e A la jeunesse, mais son sens est alon different : elle signifie la Iascivitk, et non la folfitrie. J'aborde cette question au chapitre N.
50. VG1, II,vi,co1.674B. VM l783B. Cf- citation mpra.
=. VA4" I$,p.657E (cf. citation t'rrfia). n. J o ~ d cxplique qu'wilon aimait Ies enfsnts a non Ioscivim sectam, sedaetutis innocentim pie in illh
arnplexam... (YO# II,ii,col.9 l7A). Ulrich p-te aussi I'cnfancc cornme I'aetas lacivu dam un passage oh il violemment I'oblation
(UdaL EpC,co1.636B). W. Sur l'antiquitd de cette critique con= l'enfhuce, qui se retrowe d&j& dans la Vita d'Antoine par Athanase
et sa traduction latine, cf: E. GIANARELLI, I n f W e sanw : un pmblema della biografia crkitha antica W,
dans Bambini sunti. hppresentuzioni &dl 'info~sia e mocdelIi agiogr@ci, 6d. A. Benevenuti Papi et E. Gianarelli, Torino: Rosenbcrg & Seller, 199 1, p3S-36.
". hpupifhi'bur mrj constiMw, non ut iltp etas arsoId hciuiej5ena kizuwit nec inerti lam emo/~in~c nugales inepticzs sectatus est ; sed, sectlndtcm quadscr@tum est, innocenter habitabat domi, (UP I,ii,p.49).
= Nec larciviae, ut ilia aetm pssoIet, sed imocenttrbe et simpiicitati operam &bat, frequenter eriam et Iectioni invitis parentibur incumbebat rn (KW, lT,p.40).
Compte tenu des similitudes cntrc ces deux textes, i1 cst clair que le portrait de Hugues, ne s'abandonnant pas A la Ieg&ret€ (lasciuitus) caractdristique de I'enfance, est originaire de Gilon (ou du premier recucil d'anecdotes concernant Hugues, appe1C d1 par F, BARLOW ; cf. son schtma des Vitae, a The Canonization and EarIy Lives of Hugh I, abbot of Cluny W, AB, 98 (1980): 328). Renaud jugea cette image suffisamment
non seulement n'agit pas comme un &t, mais a d6j& adope toutes les caract6ristiques du
dernier @e de la vie? Cette image se retrowe dans uniquemat trois des Vitae
cl&=# mais il fiut la voir comme m e des manifesbtions d'un sentiment beaucoup
n. Attention : It tbbt du puer-s- n'a rien du t h h e faustien du c o p jeune avec esprit mth (comme 1epmseU SACQUIN, elntrodudim*, darukPIiiorenpsrlesgdk~--k~4nisprodigss, 6d.U Sacq&, Paris R LafFimtlBibbthaqUe Natianalc, 1993, p.8). Il nc hut pas confondre puer a itnrenb, ni l'enfant avec le jeune. Ce derniu a w corps pad& non le pmnier, En W, le thtme du puer-senex est purcment a sirnplcment la ndgation de I'eafana, sans m€mt la louaage de son corps.
Les BCnddiaias M e a t d'autant plus sensibles B ce t o p que Gdgoire le Grand I'avait utilist & props de saint Benoit ; la nta Benedicti dam 1 s Di'ogues commmct en effi ccs mots :
.: Fuit uri uitae uenerabilir, grgrcltirr Benedicfus et nomr'ne, ab @so punllirre suue fenpure cor gmem s e n k Aeratun quippe moribus fmnsiclls, d I i animum uolqtati Mit, s d & m in hac term a d h c esset, quo remporalitr Iibere uti pornisset, &petit iam q u ~ s i arichun d m cunr Ifore. (Vie et mrirrcles du ve'npiable abbd Benoit, dam l a Dialogues, II, Cd A. de VogW, (SC 260) Paris I%. du Cerf, 1979, l ine II,intm,p. 126).
De la Vita Benedicti la fomule e cor g e r e ~ senile w s a b l e &re ensuite pass& dam I'office lhgique du saint (cf. J.-C. POULN, L 'id&! tak sainteie' dims I 'Aquitaine caroIingienne d d'crpr6.s les sources hagiographiques (750-950), (Travaux du laboratoire d'hiioire religieuse de l'Universit6 Laval, 1) Laval: Presses de I'Univ. L a v a 1975, p.44n)-
La bibliogcaphie sw ce t o p est vaste. Voici quelqyes n5fmces bibliographiques titre d'indication : L- C, POULM, L'k&I& saciuetd.., 1975, p.43-45 (saints de I'tpoque carolingieme), M. GOODICH, La Vita perfects : 27te irikol of sainthood in the thtileenth century, Stuttg* Anton Hiememam, 1982, p.88 (divers exemples pour les MIC-Xme sihles), D. WEMSTEIN et RM, BELL, Saints and Society - The Two Worfdr of Western Chritendom IWO-1700, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1982, p29 (aums exemples), E. LAMIRANDE, a Ages de I'homme et ages spirituek selon saint Ambmise: le cornmentake du psaume 36 m, Science et Esprit, 35 (1983): 215 (borne bbliographie), E.R CURTIUS, L4 Iitte'ratwe..,, 1986, p.176-80 (bonne liste d'exemples, mais remarques persannelies peu fondtes), JA. BURROW, The Ages of Man, 1988, p-96-100 (dfdrences d'oeuvres m&di&vales anglaises), la th& de P. BOULHOL, Le complexe de Melchisedech. Farnillc et saintet6 dam l'hagiographie antique, des origines au VIe sikle W, Thhe pow le Doctorat, Paris IV-Sorbonne, 1990 ct E- GIANNARELLI, a Wbzi& e santi&.- m, dans Bambini santi,, op.ciL, 199 i , p.34-39 (depuis I' Antiquit6 jusqu'au Xme sitcle).
n existe aussi des top or con^ : A CAQUOT a ttudit I' image de l'enfant aux cheveu blancs comme symbole de malhur dam la mWqe juive (.: Les cnfirnts aux cheveux bIancs. Mflexions sw un motif m, dam Mklmges dDhirtorie & mligiom oflerts ri H.C Puach, Paris, 1974, p. 161.72) ct J A BURROW s'est pench6 sur I'histoirc d'un proverbe, "Young Saint, Old Devil" : Rtflections on a Medieval Proverb n, dam Ess4ys on Medieval Literature, 66 I.A. Burrow, Oxford: Clamdon Press, 1984, p.177-91.
s9. V O 4.p.211 (cf. citation supra) ; cctte dftrence devrait en rUitC compter double puisque la meme citation se retrouve dans la VOh. KW 193,p.657E :
a Videres in virgine p e r 0 litsch,urn puerifiae /n,iYatemt censoriae gradtatis acrimonia condemnari : vidies i n s o / e n ~ I . puerifem d motus incomposHos adafk illJw mafura monrm canitie castigari. I.
Et YO? 1,8998 : Delectabrriur in @a pueritia, humiIitute, castitate, innocentia et p i ra te , et prout aetas admittebat,
mirericordiae operibus insisfebat Superabat cwetaneos sapientia et moribus, ita ut jam non puer, sed senex ma!uritafcc, non tempore, ab omnibus putarer~r~
La p r e m i h partic de la phrase de cette citation scmble associer B I'cnfance du saint divetses qualitds "enfantines" (tellcs la chastett, I'innocence et la purete), mais I'autcur ne pdsente pas ces vertus comme des caractCristiques propres au premier ige ; la phrase suivante indique bien en revanche quelks qualit& un saint devait opposer ce qu'il y avait d'enfantin en hi,
plus r@andu, I savoir que 1'8ge d'dmce etait antithCtique avec la saintett. En effet, les
hagiographes ne parlent jamais de teIle ou telle qualit6 de l'enfmce qu'aurait posddk un
saint juspue dans sa vieillessea ; ils ne mettent pas davantage en sdne leu saint ayant
conjointernent un comportement &itin ct m e expCrience religieuse6'.
La far'ble Bquence du topar du p e r - s e m dam Ics Ttue clunisiennes ne doit pas faire per& de vue l'emploi pat Ies auteurs d'imagcs t&s prochcs, Ainsi, dam la Vita breuior de Malleul, l'hagiographe prCcise au sujet du saint cnfaut :
Et i~ it$intiI& aetatir tempore, quasi quwkbn praemomtrabat mcdutiorir aetatb ihreprehemibile : [.,.I MuItijdicibus hn i ipe viitutum adornatus donis beam Parer MaioIusP vita crperibque laudctbifis, mue aelatis ihjicuttilem teneriruditenr maturiorik mimifinnitate reddidit perfectrun. (VM ii,col, I765A-B).
Dans la Vita Baboleni, l'auteur m e au sujet de Bablein : Qui mon'bus annos r n n s c c n d c ~ ) s p ~ ~ ~ i a ~ in Chrbti Wocinio studebaf se jugrler exercere, a t p e plus
pain pueri atos palrpalrpteratP corps propriwn atterenr, moribus perfactommP operibuscpe & dfe in diem nitebatur octhaere, * (VET 2,p358). 6a. Dans son liwe Aefa Sptitdis : Dt'e'oberwhdimg der Mt17rlic:hen Aliersstu$en als IcllePIfiiihchrb~lichen
Lebem (Cologne: PI Hanstci 1972, plus particulitrcment p.23-46)' Christian GNILKA insiste sur le fait que I'homme saint est un individu qui, quel que soit le nombre de ses a&, transcende les limites de son age en faisant sienna lcs qualit& des autres ages : ainsi, I'auteur conbnte le per-senex au senex qui sait adopter I'innocence ct la simplicit& enfimtines (cf, aussi E X CURTIUS, La Iitt&atwe ewopfenne et le nroyen rige lath, LI, Agota: PUF, 1986 (2* Cd,), p178), Je pense que cc schdma ne s'applique pas A toutes les epoques confondues. S'il s'avere fond6 pour les auteurs chdtiens des premiers sikles dtudids par G n i h il est en revanche rare au Xe-dCbut XIF sikles. John T, WORTLEY a-e pour sa part que les Phes du M e r t n'aimaient pas les eofants car ils rcpdsentaicnt en quelque sorte le bmuillon de L'image parfaite qu'ils voulaient devcnir, de m&ne que les hommes de I'Empire byzantm meprisaient les Juifs par qu'ils rep&entaient le mod& audessus duquel ils voulaient s'elevet ; j'avoue &re peu convaincue par son argument (a Aging and the Desert Fathers -The Proccss Reversed w, dans Aging andthe Aged in Medieval Europe, Cd, MM, Sheehan, (Papen in Mediaeval Studies, 11) Tomto: Pontifical lastitUte of Mediaeval Studies, 1990, p.72).
". Ide de Boulogne Wficia d'unc vision avant son mananage, docs qu'dlc h i t encore unepueIla, mais son comportcrncnt de L'Qpoque n'avait dtjh plus cien d'enfmtin (YI 1,2,co1.438PA ct c t note supra sur Itattitude trts picuse d'Ide dts son cnfmcc).
Dam leurs Yitue Orli'fonis, Pierre Damicn et Jotsaud Cvoqucnt tout dew un rniracie qui prit place pendant l t i ~ ~ i a p r r e r i I b du saint, gtgct auquel cclui-ci ntrouva l'usagc de ses mcrnbres pcrdus quelques temps plus tiit, Sa noumce I'avait labs6 & la porte d'une basilique d€di& h Maric, pour &re libre de vaqucr & diverses occupations. Mii par la force divine, a&rmcnt les deux hagiographcs, Odilon st traha jusqu'h f'autcl oh il put se relever, ddbarrassd de tous ses m a w (VOiP co1.927A-B ; VOii II,i,col,915A-C). Cctte anecdote est intdressantc il plus d'un titre. Rtmi~nmeat, le gcste s i usuel d'un enfant parti h quatrt pattcs en exploration et faisant scs pmnicn pas cst pr&mtC ici, par les auteurs, comme le h l t a t d'une intervention divine et cst paralklement vidt de sa substance rCalkte, De plus, t o e l'ambipRd de l ' b enfantine aux yeux des moines est r6sumtk m I'appellation d o m k par Pime B Odilon, innwens reus Dei. I1 s'explique en ces tcnnes : a Innocens, inquomP ut puta qui non peccaverat ; reus autem Dei, quia cwlesti verbere vapulabat. b*. Ainsi, mime dam le cas d'un enfant, non seulement saint, mais de plus incapable de se rnouvoir, I'innocence n'est pas chose certaine (pula), mais sa culpabilit6, en revanche, est chose admise.
Sur les miracles accornplis par Dieu au traven des enfanr (comme par exemple des enfants de quelques jours qui parlent), cf. in&z
Les qualie que nous gualifierons aujodbui le plus facilement d'"e&mtinest', telle
la simplicit& la p d et l'innocencet pewent, 8 L'occasion, &re mentionn6es pendant
l 'd~~llce d'un saiap mais, A 1'exceptreon de la d e m i h Centre elles, elles ne sont jamais
explicitement associks B l'enhce et peuvent tout aussi bien orna un personuage Gune
autre tranche d'@ea. Quant B I'innocence, sa position dam I'kheUe des vertus est assez
". Par excmple, dam la Vita de I'abb6 Hugues par le moinc du meme nom, it est Ccrit : a Hi' p e r intemperantiom curicrlium sectan* notuit, mansuetudinem cum simpiicitate retimrit. m (YH"U i,p. 12 1). Cf. aussi VO* 48998, citation mpra.
Une autre qualit6 assign& B I'enfance, mais dont je n'ai trouve qu'une seule mention, est l eu incapacite de mentir (cf, DM IT-pJ6 1).
". Ainsi P i m Damien dklara au sujct d'Odilon h e n & et dcvenu rnoine qu'il h i t q u i i er simplex . ; le mime auteur ptesenta un moine qui Mntficia d'une vision comme nunaae simplex et innocenr vitae (VOP co1928A et 9430. Jotsaud afbna, au sujct du moine qui l'aida & trouver des temoins pow M r e la Vita W o n k , qu' il &ait I m h e simpiicitaris et innocentiae rno~chur (VO? &I,col.9 I6A-8) ; tandis que Renaud de V6zelay parla de G u m , l'abbe de Bame, comme d'un vir mugnae honestatb et simpticitatk m et de Durand, l'6vQae de Toulouse, comme d'un VK p i h mriue simpiicitufis et grutiae nomine . (VH mp.47 et -&p51). Aucun de ces trois auteuts n'a5ma que ccs qualm ttaient alles de I'&ce et que ces saints penonnages avaient su I e s collsc~er j w p e dans un age plus a m & Ces cxernplcs pomaicnt &trc multipliCs.
Il txistc malgrd tout un cas oh I'ha@ographie clunisienne a prcsque fait la iouange d'une " h e enfantine" en un pieux personnage ; mais ici encore, ce qui est Ctomant est que, bien que tous les ingdients firssent p-ents, l'auteur n'a pas &bli le lien entre la saintete et 1'enhce. Au huiti*me cbapitre du livre I de son De rniruclllir, Piem le VCnCrabk fait I'Cloge du view moine Gerard gui fut oRett & l'l?glise - stculihe, et non rdgulitre, mais il v&ut comrne s'il s'dtait trouvC dans une abbaye - d&s I'enfance. Ce portrait apparait d'autant plus idyllique, qu'il s'agit du premier persomage saint rencontd dans le DM, Ies p&&Ients ayant tous 6tC des pdcheurs- Puisque Gerard est aussi le premier oblat, tandis que tous les autres moines mentionnds anterieurement &aient en& sur le tard au monast&e, son &loge offic, par contraste, un louaagt de l'oblation il une Cpoque oii celle-ci &it violemment critiquk Si la saintete de Gdrard est pr&cnt€e comrne la cowdquence de son oblation et si la liste de ses qualii rappellent hngcmmt la liste des qualit& dcs enfants CnonW par saint SMme (cf, supra), Pierre n'assacie paurtant pas qficitemmzt Ics qualit& de Gerard A des qualit& enhtincs :
Pure et simplicis momchus uite, uuett, sectlndunt Domini dictum, Israclita in quo dolus non est Inirrrirrnrm inmemor, pientiem comenrclb~ ; quem si irarci conlingerer, padopast riulumfirjse gtmiter penitebat- Nil sintuIiue nouera, set @is hterius drtebat, taiem se erterircs rdemol~~~irtzbrrt, Ad 0s eius si accederes, statim que dico uera esxe comprobareseS Diuimm rerum saporem, quem a puero imbiberat sic te~citer consmabat, ut eiut pene uniuersu uerba uelfita diligenter comi'derntibbus, nil uliud quom celestem fiugtantiran redoterent . (DM I,viii,p.24-25). Ceae description d'un saint penonnage (encore une fois, d'autant plus important qu'il est le premier dc tout
le DM) est un mdice d'une progressive transformation des iddam dc saint& & partir dc la fur Xe-debut XIIe stcles. I1 n'existe en effet aucun portrait de saint, oh il cst accord& une tellc importance aux qualit& ditcs "enfantines", dam I'hagiographie clunisienne dcs pCriodes ant&ieures,
Aprb cet Clogc quasi fianciswin de Gtrard, Pierre 6voque dcs qualitts plus habituelles sous la plume des Clunisiens : sa constance, son oMissancc, son amour pour le sacrifice divin, e t c ; et ce f i t seulement pendant son ultime vieillesse, en rdampense de sa constance, que Gerard Mnbficia d'une vision divine. En effet, lors d'une ctlCbration de la Fete de la Circoncision, il vit apparaitrc, la place du corps et du sang du Christ, un nouveau-n6 sur I'autel. Je discuterai plus Ioin de ce type d'apparition.
ambig&, surtout Iorsqu'elle est reconnue dans un enfmt. En effet, s'il anive pabois qu'un
saint entimt soit 10116 pour son innocence, son hagiographe peut le faire en soulignant le
contraste qu'il foxmait avec les autres d t s , prkntk cornme de grands pdcheus :
l'innocence n'est pas alos peque comme m e @tC "enfimtine", au contraire? En
revanche, il peut advenir aussi que k substantif innocenr soit accoM il des e d i t s qui n'ont
aucune valeur spirituelle particuliw : dam ce cas, I'edmt est un innocent parce qu'iI n'a
gu&e encore eu I'occasion de fain le mal, mais cette innocence n'est pas de la m6me eau que
celle de l'adulte p o r n d'une teile qualitd parce qu'il a su lutter victorieusement contre les
tentatioxd6- Ces diverses remarques montrent qu'il fsut analyser au cas par cas Ies 6vocation.s
Cf, supra les citations extraites de YIF I,ii,pA9 et W II,p.40* a- Jotsaud k i t qu'OdiIon aim& les d t s , noon pour Ieur imciuitop, mais pour Ieur innocence ; or il parle
ici de tous les e n h t s et non spdcifiquement de petits saints (cf, supra VOi &ii,col.97 tA). Trois des hagiographes d'Hugues ont monte I'episode de la gu6rison miraculeuse d'un oblat Ccrasd par
une piem : aucun des trois auteurs n'a do& de pdcision sur les qualites spirituelles du ble&, mais un d'entre eux I'a qualifie d'imocem (cf, i@a FW d . p . 7 7 ) . Je ne pense pas qu'i1 cherchait de la sorte i souligner la vaIeur de I'enfant accident&, mais qu'il cssayait pIut6t de suxitet la pitie de ses Iecteurs : ce petit n'avait @re eu jusque-l& le temps de p6cher et son accident en paraissait d'autant plus difficile il accepter. Dans Ie meme ordre id&, 1e &it de l'enl&vement par les Normaads, puis de la fuite miraculeuse du neveu d'Odon dam les bras de sa nounice, est cone par tous Ies hagiographes d'Odon, mais seul Nalgod use de I'adjectf substantivd innucens pour dhigner I'enfmt ; cclui-ci devait etre tr& jeune, puisqu'il n'avait pas encore dt6 baptid (VO" 40,col. 100D).
Cf, discussion sur l'innocence des enhfs dans l'hagiographie par D. WEINSTEIN et R BELL, Saints and Socier),, 1982, p.28-30.
66, Cf, supra citations de I6r6me (Commentmiorurn ifi Eva~gelliun Matlhueiad Earebium Libri quclttuor, PL 26, ~ i i , c o l . l 3 3 A ) et de Smaragde (Diiadmu rno~chonrrn, PL 102, LIX.coL6SSD) sur l'innocenct que les e n h t s *per c~vlarparsidmt a, h la diff 'nce dc cellc qu'acqu9nnt Ics hommes pieux per industrim ou perpwirafem rirnucenti~e~ Augustin a offert une explication un pcu diffhnte de l'innocence enfmtinc dam ses Co$essiom : Ita imberillitas membrorum infpnlifiwn innucenr est, non animus iimjicmriwn. ( C o ~ ~ i o n e s , ed. L. Vcrhcijen, (CC SL, 27) Tumhout: Bnpols, 1981,1,7(1 I), p.6). Gdgoirc le Grand (qui sera sur ce point rep* il la tin du XIII sitck par J&MC de Paris, dam un commentah de la RB destine aux mohes du Mont- Cassin) reconnail que I'cnfant vit innoccmmcnt, mais qu'un tcl comportcmcnt n'cst pas raisamt : e Prima quidem horninis etas infibcia est, que et si innocenter vkit, nescit indefiiteri innocentiam qwm ha be^ (J- LECLERCQ, a Ttxtcs sur la vocation ... m, dam Corona Gratiorum, II, op.cit-, 1975, p.172). Sw Arnbroise et sa conception de I'enfimce, cf les bonna miss au pint 68 LAMIRANDE, dam. Enfance ct dtveloppement spiritueL Le commentah de saint Ambroisc sur saint Luc rn Science et Esprit, XXXWl(1983): 103- 16 (tout specialement p.110, sur le fait quc Pignomct du ptehd ne signifie pas Ctrc vertucux) et Ages de l'homme et dges spirituels selon saint Arnbroise. Le commentaim du psaurnc 36 m, Skience et Esprit, XXXV/2 (1983): 214-16. Pour illustrer la Sunivance du topm de l'cnfant innocent mais "sans aucune connaissancen jusqu'& la tin du Moyen Age, cf. I'exernple donne dans Marga te NEWELS, 8 Lcs Ages de la Vie dans quelques moralit& fian@ses I la fm du Moyen Age W, dam Ler dges de la vie, 1992, p.259-
de l'innocence enfatine et ne pas concIure trop vite que Ies moines admiraient les enfimts
pour cet aspect de leur personnalit6.
Les Vitae clunisiennes ofFnnt quelques exempIes de l'amusement et surtout de la
compassion cpxe Ies h t s pouvaient susciter chez les moines. Il semblerait que ce dernier
sentiment soit all6 en s'accentuant au fil des sikles ; il est particulikment frappant - toutes proportions gad- - sous la plume de l'hagiographe Nalgod, a la fin des anndes
1120.
Pendant ses nombreux diplacements, Odon faisait chanter les enfants rencontnis en
chemin pour d6lasser ses cornpagn~ns~~. Un jour de Piques oh Odilon se trouvait dam
I'abbaye de Saint-Denis, aloa qu'il n'y avait plus de poisson pour le repas, I'intendant
envoya des @hem 5 la Seine qui revinrent chargb d'uae *he miraculeuse ; Ie saint abbe
pensa faire admirer la chose a w infaes scholae du m0nast6re~~. Ce meme saint couvrit de
son manteau puis fit enterrer dew enfmts qu'il avait trow6 nus et morts de faim et de fioid
sur le bord d'un chemin, alors que la famine sevissait en Gaule? Il gu&t ii diverses reprises
des enfants malades ; les formules utilistb par Pierre Damien pour justifier l'ht&t
d'Odilon pour ces malheureux montrent que la tendresse qu'ils suscitaient ttait toujours
teintie de pitit! : a Cui mox piu benignitate cornpatiens,.. r, a vir Dei vere rnisericors r et
Huic homo Dei misericorditer condescend ens... mm. La vieille expression biblique de la
*- VO1 lT,5,63B- K. Hallinger trouve des accents fianciscains B ce passage, ainsi qu'h quclques autres de la trta (K HALLMGER, Zur gcistigen Welt der Anfhge Klunys w, Deutsches Archiv, X (1954): 422-3 1 ; partiellement traduit dam l'article Le c h a t spirituel des premiers temps de Cluny w, RM, XLVI (1956): 124).
". VO# II,viii,col.922B. Pierre Darnicn n'a pas consew6 cette anecdote. ? YO? I,i%,coI.904A-B a YOio eoL929B-C. Ce qui cst le plus &omant dam cc &it, aux yeux d'un Iecteur
modemc, cst que ce gestc d'Odilon, apparemmcnt si naturcl, soit p e w comme un signe manifcste de sa grandeur & h e , au point que Pime Damin ait jug6 bon de garder cettc anecdote dans sa Vita trk succinde. Faut-il d o n a conslure quc la msjotitd dcs hommes du Moyen Age auraient continut leur chemm ? On doit aussi se demander quellt signification accord& au fait qu'il s'agissait d'cnfants. Auraitsn plus facilement ented des adultes ? Je ne pensc pas. Il est dic i le dc rCpondre, mais je scrais tentee de croire que les lectern larques et eccl&iastiqucs dtaient plus bus, ct par consdquent plus rcconnaissants envers Odilon, parce que Ies dew corps nus et famC1iques dtaicnt ceux de puwi.
'0. I1 s'agit d'un enfhnt la'fquc aveuglc de naissance, d'un moiniIlon (puetulus momchur) de Payerne atteint d'une sorte dc cancer de la gorge et enfin du puer Gdrare du monast&e clunisien de Rornainm6tier, fiappC peut4tre d'dpilepsie (VOP co1.930B-C, co1.939A et coL940A). Jotsaud avait dvoqud ces rnemes miracles avec un peu moins de condescendance (YO# I&ii,co1.916-17, (I Mkertrrs itaque vir Dei tantue cafumitati. .. .
a veuve et de l'orphelin r & qui il faut venir en aide7' a toujours vdeur d'axiome pour les
hagiographes clunisiens et m e des actions pieuses attendues d'un saint, surtout lorsqu'il
s'agit d'rm riche lark, est de pmdre soin despupifti et vi&en. Tmis des Vitae d'Hugues
de Cluny racontent comment l'abbc un oblat de Panty-le-Mod, ecrad par une pierre
tom& du clocher en pleh choeut ; a deux des hagiographes &-t il ce pqms la peine
6prouvde par les f iks lorsqu'ih arnent la d&&e heme de leur petit wmpagnon acrivt!ef3.
Dam la dernih nkktion de la Vita Odonils, celle de Nalgod des annth 1 120, celui-ci a jug6
nkcessaire, B la M i n c e de ses prdd6cesseurs, de faire allusion i l'affection dont la nourrice
entourait le noweaud : a A h c infmtulus in czinis jacens nutricis diligentia fovebatur :
[...I mT4. Tandis qu90dilon avait affirm6 que Maeul tout e&t avait W "nourri" (enutrifus)
par un soin incessant (cum pervigil), le mtme Nalgod pn5fera user, dans sa Vita Maioli, de
xv,co1.929B-C et a Tali cahi tafe vir Dei contpw~ctus~,. rn xvii,col.930C-D). ". Cf, par exemple Er 2 2 3 , Dex 10,18, Deu, 1429 et Jac. 127. ". Cf. VG ' I,vii,co1.646C, VI 1,5,col.440C, YI III, 1 l,co1.444D et VI III, IZ,col.4QSA, mais aussi VMn
1,7,p.1.658C, YHr I,v,pJ3-54, VII,48,coL890C et Vl#"' xxvi,p-135. Dans la liste des malheureux B qui Cluny distrl'bue quotidiemement de la nourn-ture, Ulrich et Bernard citent en tout premier lieu les orphelins :
pupiIIts* & vidub. cladis & caecb, senibrrs. & animfb, mnctkque supervenientibus rn (Udal- III,xxiv,co1,767B et Bern. I,xiii,p.lS% ; il est question de senimfi dam l'ddition d'lllrich de la PL, mais de senes dans BN n.al 638, €01.1 11")-
Cette triple r&p&ition de la formule vcuves et oqhelins dans la seule Vita d'lde 6 t o ~ e quelque peu- Est- ce parce quc, en tant quc veuvc a mht, Ide s'occupa effcctiverncnt beaucoup de ses pareillcs et dcs enfants ? C'est possible, mais me autre explication est envisageable paralltlcment la premi&rc. Les Wn6ficiaires des miracles d'ldc ou, en d'autres mots, les quhandeurs de miracles d'Ide, sont surtout dcs puellae. Le public de la sainte, tant cccl&iastique (I'bagiographe) que laque (les miracul&s), n'a-t-il pas p e w celle-ci avant tout comme unc mtre, qui, du fhit de sa fonction et de son sac, se dkwait d'etre PIUS cldmente l'tgard des tout jeunes a des vcuves ? Sur le thtme conjoint de saintctt ct matemitt, cf. J. CARPENTER, . Iuette of Huy, Recluse and Mother (1 158-1228): Children and Mothering in the Saintly Life m, dam P o w of the W d - Studies on Medievui Women, &I. J. Carpcntcr ct S.-B, MacLean, UrbandChicago: Univ. of Illinois Press, 1995, p.57-60.
n. Gilon de Toucy e v i t : Dolorem impendirnt qui consulere nesciunt, nunciuntque patripuenim icm, extinctum qui in miliciae spriifuPIisprocinctu uk uiuere inchausset, (YIP xrrxii,p.77) . Hildebert de Lavardin reprit I*id€c mais avcc d * ~ mots : rn [.., J f i o b e ~ veht e~rriirctum @ent puenun* p i v i i in casfrb spwitualb militioe viwre imhouzsseti (m IV,27,co1.877A). Rcnaud de Vtzelay se contenta de conter le miracle (VIP dii,p53-54). On pcut se demander pourquoi c t dcmicr auteur jugea inutile de dp6ter les paroles de Giion quant ii la douleur des moines ct, surtout, pourquoi ni Hugues de Goumay ni 1'Anonyntu.r II ne voulurent reprendre cette anecdote qu'ils avaient powtant h e dam les o e u m de lem prt!d&cesseurs, Gilon et Hildebert. I1 faut aussi prendre en compte le fait qu'Hildebert n'Ctait pas un rnoine clunisien mais I'dveque du Mans.
". YO" 3,co1.86C.
l'adjeaiftener (tener wo)n. Sa description du comportement du p&tre qui Muqua Odon
met en tvidence la de L'enfant et ses besoinsy taut physiques que mentaux :
Suscepttan p n m r blande ac ieniler, sicut aefas infimibr exr'gebat, sacerdos insn'tuem, Iitteraton'is e t i m dimea t i s rudem ejus infnthm imbuebat. Gemim circa puennn diligen tiit presbyter utebatur, d m ei et honestis v i m suis colloquiis indcaret et in ejus fenemm d tenacem nw~~~)n'ant scie~tiae m n t a trtxmjkderet. P
La meme image se degage des raisons avanc6es par NaIgod pour justifier la nomination
d'Odon & la tite de la schola de Baumen. Dam ces deux demim passages, I'enfance est
@sent& comme I'aetas intrmcr, ou inmior , mais, de ce f ~ t mGme, il s'agit d'un iige dont
on prend soin avec diligence.
Ainsi, l'af'finnation de saint Benoit dans sa dgle, que I'iige de Iapueritia suscitait la
misCricorde (. Licet ipsa mtwa k a n a ttahatw ad rnisericordiam in his aetatibus, senum
videlicet et infanturn mn), etait toujom d'actualit6 chez les Clunisiensn. Dam la section C1
de ce chapitre, je montraai comment cette attitude des moines donna lieu B divers niglements
dam les coutumiers, ayant tous pour objectifle bien4tre physique des oblats.
II f d u t attendre les Cisterciens et le X I e siecle pour que ce parti pris monastique,
insistame sur les defauts de l'enfance et quasi silence sur les qualit&, se modifiiit avec
l'essor d'une nouvelle forme de discours : les moines blancs, avec Ieur spirituaIit6 tr6s
affective, imistkent sur l'enfitllce du Christ et encourag&rent les hommes a devenir comme
l'Enfa.t-J6sus pour atteinh la saintet6. Il faut tout de mGme noter que la premi&e
caractCristique de l'enfance sur IaqueIIe insista Bernard est la fiagilitt! et ce qu'il Ioua avant
". V W co1.947A et VM p.657D. 76. Y O 4,coL87A, Sur I t choix du verbe imbuo la place de jubeo, cf. M.-L. FINI, a Studio sulla Vita
refomuta w di Nagoldo. I1 afiagmennmr mm'Ium del codicc latino NA 1496 della Bibliothtque Nationale *, Rendiconrr' &I Xccrrckentia di S i a e &dl 'Istituto di Bologna CIosse di Scieme morafi, 6312 (1975): loon,). Je mite plus loin en detail de la mani4re dont les moines conccvaictlt la transmission du savoir aux enfants.
". VO" Fini 26,p. 144 (=2l,co1.93C-D). n. RB 37,1,p572, J'ai d6jA dbmontr6 dam le chapitre pecedent que l'infintia de Benoit comprenait
Cgalement les annCes de puwitia, soit jusqu'8 14/15 ans. %. On tmuve d'ailleurs un Ccho de cette phrase dam Ia Vita dc Hugues par Gilon : a Quis infatibus, quk
senibus, quk infxnnis cwam difigentlius exibuit ? m (VHP I,xii,p.63 ; cette phrase fit reprise par I'Anonymw 11, V p ~01.45647).
tout dam 1'Enfit-Dieu est son h d t 6 pour avou accept6 de descendre aussi bas que le
smut d'un e d b t Cet &loge de I'humilie est inseparable, non seulement de la nouvelie
image de l'dance qui se dtveloppa alors, mais aussi de I'essor du culte ewers des
pasormes humbIes, cornme les d i e m s smtae ou Ies convers de la dgion de Litgem. Quoi
qu'il en soit, l'importrmt pour mon props est de mumper que ceux-U m h e qui nfi&ent
les enfants dam 1em monasttrrs, non pour pmtCget la Ir'bertC des petits, mais pour ne pas
etre dCrang6s dam leur quEte spirituellet1, dCvelopp&rent un symbolisme mystique de
l'enfance. Quelques sources cluukennes de la premitre moitie du XIP sible se firent 1'6cho
de cette transformation des mentalit6s.
Dans les W e d'Hugws, il est question de L'apparition de Hugues tout e d i t dam
un calice, alors meme qu'il ttait en train de &tren. Dans les Miramla de Pierre, il ne se
trouve pas moins de trois anecdotes sur la Wormation miracdeuse de l'hostie en eafant*.
L'apparition du Christ-edmt I la veille de la FEte de N&l dont beneficia Hugues de Semur
est rnentionnk dans cerbines Vitae Hugonis et dam le D P . Beaucoup plus ktonnant est le
fait que, d6jjl dam les Vitae de Maied pa. Syrus et par Nalgod, et dam les Yiroe de Hugues
". Cf. Amatus VAN DEN BOSCH, = Le Christ, Dieu devenu imitable d'apr&s saint Bernard ., CoIICkt., 2 1 (1960): 34 1-55 et Monique SIMON, Sanctu simpiicitur : la simplicite d o n GuilIaurne de Saint-Thierry B, CollCkt, 41 (1979): 52-72. Dans son ouvrage ~J~ avaitdotrre am, Aelred de Rievaulx utilisa I'image de Jesus faisant la l e~on aux docteurs et seniores du Temple cornme preuve que les enfants et ado1escent.s devaient rester silencicw, humbles ct obdissants devant leurs ah& ( i i . et texte A. Hoste, &ad. J. Dubois, (SC 60); Paris: &L du W, 1958, 1,8,p.64). Il ne faut donc pas atrrrthner h Mkur que la Cistenieas attachCrcnt B l'enfance. Sur le f d quc l 'kglii (a la difference des l a b ) n'accepta que ab tardivernmt de reco-tce c o m e saint un cnfhnt, cE A. VAUCHEZ, Lrr saikfdk en Occident urcr dentiers siLcles chc Moyen Age d *apr& les procis de canonIjation, Rome: k o l c fian@sc de Rome, 1988 (2. &I.), p. l82n. Sur Ie dt5veloppement tardif, au XIV sikic, du culte pour la Vierge enfant, cf. par exemple P. L'HERMITE- LECLERCQ, a Avignon en @te : PrCscntation de la V i m au Temple de Philippe de MUhs k 21 novembre 1372 D, dans Mkfanges Henri Dubair, Paris: Pt#scs univenitaites de la Sorbannc, 1994, p328 et p.335.
'I. Cf. infia 'f, Tandis que la mkre du saint accoucbit avcc difEicult6 dc cclui-ci, tlle avait demand6 A un petre de
cdldbrer une mtsse pour sa h i o n ; d o n qu'il tlevait I t c a k e vcrs le Ciel, il y vit appdtrc un cnfant : il en dMuisit w e le nowcauUn6 qui allaii mi remplirai! de haws fonctions dYls ~'@k (W I,p.48-49, I, l,coL860B ct VW I,p3940). Cet Cpisodc est absent de la Vita d'Kugues de Gournay. Sur Ie miracle de I'enfant apparaissant A la pIace de l'hostie, cf. J.-P. TORRELL et D. BOUTHILLIER, Livre des merveifles, 1992, p.98n.
". DM I,i et viii (dew fois). ". VHg II,vi,p96, VP vii,col.887B-C et DM I,xv,p.SO-5 1. Sur cette vision, cf. I. LECLERCQ, 8 La
christologie clunisienne au sitcle de S.Hugues D, Studia Monastics, 3 11'2 (1989): 274.
par Gilon a Hildebert de L a . l'ange-gardien est p h e amme &ant unpwr ; Gilon
utilise m&me le substantif injt41~~ mais Hildebert ne le suit pas sur ce point!? Ce cas est
remanpble car les envoy& d i h sur tem avaient surtout Ctt jusqu'alors des imenes ou,
mieux encore, des hommes aux cheveux blancs? Cette nouveauttc doit mal@ tout Ctre
contrebalaactk par le fait que range-gardim m a i t surtout d'aide et de messager et qu'il
remplissait donc des thhes quelqye peu subaltemesn.
Par ailleurs, dans tous les exemples 6voqu6s ci-dessus, ces enfits qui suscitaient
l'admiration n'etaient tvidemment pas de vtiritables enfants, faits de chair et d'os, mais
l'Enfmt-J6sus ou des envoy& Celestesa. La multiplication de ce type de visionslg ne signifie
pas qu'un noweau sentiment de l'ed'hce vit aussittit le jour dans les oewres monastiques :
en effet, le discours sur le premier 3ge des saints en ce debut du XII' siMe s'est ii peine
charge d'un peu plus d'im0tivit6~ ; mais ces visions n'en sont pas moins une des
causes/manifestatiom d'une lente transformation de la perception monastique de I'enhce.
Une autre cause, qui agit A beaucoup plus long terme, fbt probablement la diffusion de la
VMs II/17,p274 et YM. IVJ9.p.666A (PUemIus). YH' I,xxxvii,p.,p.lO et VH V,29,co1.878A. Ct I. DUtlR, arf. 8 Anges W, DSp., 1 (1937): 600-02. Sur la reprbentation des anges au Moyen Age, qui n'dtaient pas des enfants avant la Renaissance et meme l'iige baroque, mais plutbt des jeunes hommes imbetbes, cf. J. HALL, art, = Angel et Putto W, dam Dictioltcny of Subjects udSymbols in Art, London; Cox and Wyman, I979 (dv. &I.), p.17 et p Z 6 , K. ONASCH, art, Engcl. lkonographie n, M, 2 (1986): 1912 et P- FAURE, I Pourquoi les anges ont des ailes m, L 'Histoire, 194 (Ddc. 1995): 14-16. Cet auteur renvoie au colloque 8 Le corps des mges a, tenu Thomas More de L'Atbresle, le 25-26 mars 1995.
=. Ainsi, range qui avait pris soh de rccouvrir Odon pendant son sommeil pour qu'il ne prenne pas fioid etait quidrua vir senex venercmclb canitie rn (YOa d,p.49). Cctte anecdote, comme l a autres ajouts de I'abdvhteur, serait de la plume de Jean de Salcrnc a &emit donc du milieu du X sitcle (ct l'analyse de cettc Vita dans I'Anncxe A). J'autai pourtant tcndaace B pcnser quc Ics hommcs mQrs demeuttrcnt pdponddrants panni les envoy& cClestes m h e aux XII' ct XIIIe siklcs ; c'est tout du moins la conclusion laquelle j'6tais parvenue aptts l'analyse de 43 Vitae pour rnon DEA (d Isabelle COCHELIN, Le met owrir. .., 1989, p.37- 39).
n. Benoit 6voque dam la RB Ics anges envoy& jour et nuit par Ie Seigneur pour garder les homma et prdvenir Dieu de leurs agissemcnts (RB 7.28).
U. M a l e tout, la d d p t i o n de ces enfimts-apparitions devint de plus en plus daliste au fil du temps. Ainsi, dam I t DM, ces cafimts id&m pouvaknt, il I'occasion, adopter des comportcmcnts enfantins. Le bCbt que Gbsrd vit a p p a r a i i na rautel alas qu'il dlebrait la FClt dc la Circoncision xcouait ses bras a ses mains comme lc font habituellement les enfants dc cet @ : pcauwn uero puerulum, manibus et brachiis more infantie gestientem w (DM I,viii,p.B)- Le Christ-mht, que Hugues apewt lors d'unc vision qu'il cut la veille de Ia Fete de la Nativit6, battait des mains (DMI.w,p.SO-51)-
Cf. gric BERTHON, Le sourire aux anges ... w, Mddihales, 25 (automne 1993): 93-1 11. 90. Cf. supra A propos de l'ajout, par Nafgod, de petites touches plus tendres sur l'enfance dam sa version
de la Vita Odonis.
culture lsque, par l'eneemise d'oeuwes en langues vernad- et par l'arrivk massive
de convatis adultes dans les rnonast&es. En e f f i conme je L'ai dit en introduction, l'irnage
laique de I'enfance etait d e m e n t plus positive que celle des moims.
Le discours sm l'enfhnce (&lle, et non symbolique) que je viens de decrirc, f ~ t de
m e f i e ii I'tgard de l'edhce, adouci par la compassion que suscitait sa faiblesse, dtait le
propre des ecclksiastiques du Moyen Age central, et plus Specifiquement des moines. Un
exemple pemettra de rnieux illustrer que, 1% oh s'adtait la compassion des moines, se
prolongeait la tendresse des &culiedl. J'ai d6jH 6voqu6 I'anecdote des Mres pleurant la
mort prochaine d'un oblat : celui-ci vivait ii leurs c8t& et ils ne souffiirent pas l'idde de sa
disparition. 11 existe en revanche me autre historiette, d'un ordre bien diffirent, dam la Vita
Odonis de Jean de Saleme, que seul un public monastique, tourn6 vers la vie apds la mort
et theoriquement didaigneux de l'existence terrestre, pouvait trouver miraculeuse. M c e a
ses prikes adressdes au Ciel, Odon sauva des mains des Normands son neveu nouveau-n6 ;
son objectif n'btait nullement de restaurer la liberte de celui-ci, mais de s'assurer qu'il fit
baptis6 ; Odon pria ensuite le Seigneur d'appeler I lui le bambi. et celui-ci mourut dam les
trois jours qui suivirentg2. Trh probablement l'entut d&&da, non des pri6res d'Odon, mais
des suites de l'exktence terrible qu'il dut mener en captiviG et pendant sa l i te, clam les bras
de sa nounicem ; l'important est pourtaat de noter que Jean voulut rendre Odon responsable
de la mort de I'enfant. Cette anecdote fit reprise teUe queue par les hagiographes qui
&crivirent la Vita Odonis entre 943 et les ann& 1120, soit par I'ab~viatem, 1'HumilIimus
et Nalgodw.
91. Cf, aussi pour Ies pQes du Mat, Ies remarques ;1 ce sujet de A. BOWS, te moine et sa fmille ., ColZC& XL (1978): 84 ct 90.
92. ... mar. ut puer parri nostro deialll~fiir, sacro e m fecit baprbmate tingi- D e i d eievatik in codurn o d i s ut moreretur ormit, utque dehihc past t r i h cod0 W d i t spiriturn. w (VO1, II, l6,coL7OB).
". Telle cst l'hypothbe avanck par M.-L. FINI, dans Studio ... m, op-cit., 1975, p.122. VOCa 3 6 , p 2 4 3 4 et V P 40,c01,100D. Dans la derniere version, l'auteur utilise l'adjectif innocens,
mais dam un contexte qui met bien en evidence le sens ambigu de ce teme Ionqu'il est applique ii l'enfance, puisque cet innocent n'a droit au repos &ernel que s'il obtient It bapteme : a [Udo] Indoluit ex animo, et innocentis animam sine baptimi remedio pereunfem ueqditer pati non pot& (YO" 40,~01.100D). Sur le pkdobaptisme au haut Moyen Age, cf. J. C&LINI, L'aube du Moy~ Age. Naissance de la Chritientg
Dans les nkits en langue vdgaire, ddigb p~cipalement pour un public laique, il
existe des *meuctresn, ou tout du moins des tentatives de meurtres d'enfmts, cacauJes soit par
un individu mauvais (voir par exemple les &Its de la Manekine), soit pour cause de fatalit6
(l'histoii d'oedipe daas ZWbes), soit par devoir chistoire d'Amis et Amiles). Mais quelle
qu'en soit la cause, borne ou rna~~sak, Iapossi'biW du d6ces de l'enfant est toujours p q u e
cornme m e tragCdie ; et encore plus significatif, les dmts s'en sortent Wement sains et
saufs dam presque tous les cas de figure9? Au contraire, dam les Vitae Odonis, la mort de
I'enfant caw& par Odon est peque c o m e un miracle.
Je pense que ce n'est pas un hasard, si les Cisterciens, qui avaient m e plus grande
intimitC avec la culture laiqye pour etre rent& plus tard dam le monde monastique, furent
les premiers A dbvelopper progressivement un discours dB6rent sur l'enfance, plus proche
de celui tenu par les skuliers. Mais encorr plus fondamental, leur position etait facilitbe par
le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants dam [em rangs : parce qu'ils n'etaient plus confront6s
jour apr& jour, nuit apr& nuif au problhne d'avoir des pueri ii former (ache du mugister
bien diffirente de celle d'Etre #re ou mere' ou simple spectateur de I'enfancP6), ils purent
developper une nouvelle image idaisee du premier ige. En revanche, la perception des
moines jusqu'au We sikle etait ins@arable du traitement qu'ils accordaient aux oblats clans
leurs abbayes. C'est donc sur celui-ci qu'il faut maintenant se pencher pour comprendre
toutes les facettes du discours clunisien sur l'enfance.
occide~ufe, Park Picard, 1991, p.47-51 et surtout M. RUBELLIN, a Entrde dam la vie, entrte dam la cMtient6, en* dans la so&&. Autourdu bapt&ne A l'dpoque carohgieunc W, dans dans En~kes &)IS lo vie Initiations e! apprenfissager, (XXIIe Congrts dc la SociM des histotiens mCdi6vistes de I'Enseignement superieur public, Nancy 198 1) Nancy: Presses Universitairts Nancy, 1982, p.3 1-5 1. ?Cf, D- Desclais BERKVAM, Enf~ll~e .., 198 I, p.115. Le meurtre de I'cnfant est toujours tragddie mais
n'est pas obligatoirrmcnt suivi de son retour h la vie ; d la belle Ctude par Alain L A B B ~ L'eahnt, le lignage et la guem dam Girtart de Roussiflon w, dans tes reIations de p e n t & &ns le monde mhdiPva1, (Shbfiance, 26) Ak-cn-Provencc: Publ. du CUERMA, 1989, p.4748). En outtt, ces &its de "meurtrcsu d'enfants tdmoignent que, dam l'esprit dc I'Qxxpe, ceux-ci pcuvent &re sacrifib pour satisfaire aux besoins des aduItes, alors que I'inverse n'est pas vrai (cf. M . 4 , GARNER-HAUSFATER, r Mentalit& dpiques et conflits de g6nCrations dam Ie cycle de Guillaume d'Orange JP, Le Mo)pn Age, XCIII (1987): 18-19}.
*. Doris Desclais BERKVAM a soulignC le ton trh ndgatif vis-his de l'enfance des modistes des XIP et XIIIe sitkles, la diffdrence des auteurs de romans (Enfmrce. .., 198 1, p.59 et p.94).
Dans les sections suivantes, je cornpl6terai ih l'aide des coutumiers clunkiens L'image
monastique de l 'enhce transmise par les sources hagiogtapbiques ; mais il faut garder
l'esprit que les deux principales oeuvres normatives sur lesquelies je me base, 1'Ordo
~Iuniacellsl's de B e d et les Comehrdines d'ulrich, datent des am& 1080. Par
condquent, le traitemeat des dmts qu'ils pdconisent est specifique B cette Cpoque ; or,
pour de multiples raisons que j'hoquerai en conclusion, il est certainement plus rigide et
plus sombre qu'il ne le fbt pendant les six sikles pnkddents de L'histoire du monachisme
occidental, au cours desquels L'oblation etait aussi pratiqude et constituait bien souvent la
principale source de recmtement des monastQes. Il n'y a en effet rien de fortuit dam le fait
que, en ces mimes ii~l~lies 1080' les critiques contre cet usage s'accnuent de maniere trks
nette, avant que l'oblation masculine ne commence a tornber en disudtude : s'il existe un
faisceau de causes pour expliquer le discredit jete sur les oblats, la formation qu'ils
recevaient au monastere pendant leur enfance den est pas des moindres.
B. L'ESPRIT DE L'ENFANT : UNE P A S S M ~ ~ QUASI COMPLETE
1. Toute-puissance des adultes
La premiere caractiristique du traitement de l'enfance, quu'attestent aussi bien
l'hagiogxaphie que les sources normatives, et qui se v&Se aussi bien pour l'enfant encore
dam le siecle que pour celui qui est diijj8 entr6 au monasttre, est I'attitude passive dam
laquelle est maintenu le petit : l'enfimt des Xe et XF siecle - nous kudierons plus loin
I'arnorce du changement de discours ii partir du debut du XUe sikcle - est un &re pour qui
les adultes ddcident des activitds et du fbtur' sur qui ils d6versent leu savou et qu'ils
moddent selon leurs d i s k Avant que l'enfant n'ait atteint la puberti ou q u h am, sa
volonte et son raisonnement propres ne sont jamais pris en consid&ation.
Les Vitae clunisiennes indiqyent qw ce qui est particulihment vrai pour la vie
monastique l'est aussi pour la vie &culi&e. Je dirai un mot de celle-ci avant de traiter plus
longuement de celle-k
Les &ts lar*ips, qu'ils soient des petsonnages sccondaires ou un saint non encore
en& au monasttn, ont leur destink &tee par Dieu eUou les adultes : eux-rnemes n'ont
jamais droit de parole, tout au moins si 1,011 en aoit les auteurs clunisiensl. Dans le cas des
fdes, qui sont d'6temeLIes mine- avant le vewage, quel que soit leur b e , cette
constatation code de source : quand elles sont nobles, leurs parents leur trowent un mari,
sans s'inquieter un seul instant de savoir si celui-ci l e u a*, comme l'atteste l'histoire
d'Ide de Boulogne?. Il n'y a rien l& de trb nouveau, sinon qu'il est int6ressant de noter que,
I. Je &ume ici ce qu'il est possible de conclure ik la lecture des sources hagiographiques clunisiemes : celles-ci ne sont bien entendu pas des instantan& de la socidt6 des Xe-Xne sikles, mais repdsentent plut6t la vision qu'avaient les moines du monde qui les entowait. Malgr-6 tout, et dam l'attente de preuves contraires, il y a peu de raison de croire que la position des moines dtait atypique en ce qui concernait la Iiberte des enfants. La pratique de l'oblation atteste en effet que les parents ddcidaient du fitur de leurs enfants sans s'inquiCm de leur bon vouloir. A h lecturc des semons od stam cornpas& avant le MUe sitcle, lemy SWANSON concluait : a In a sense the children are defmed pwely by the relationship to their parents : they are dependent sons and daughters- (a Childhood and Childrearing in ad status Sermons by Later Thirteenth Century Friars m, JownaI of Medieval Hhtory, 16 (1990): 3 13) ; Mary Martin McLAUGHLIN terminait son article par une remarque B peu pds similairc : a The idea of the child as the possession and property of its parents continued to dominate parental attitudes and actions in these, as in earlier and later centuries. (a Survivors,, m, dam Hiktory of ChrIrl;hoocl, 1974, p, l4O),
11 existe malgr6 tout un type de sources dam lesquelles les enfants sont parfois p&ent& comme prenant des d6cision.s : il s'agit des &its de miracles. Leper malade est alors debit comme voulant aller au tombeau du saint, puis implorant de hi-meme celui-ci pow qu'il le gudtisst : cf, par exemple, dans le L M les anecdotes oh Ies enfants sont plutdt Ics agents actifk (&xi, i,mriii, ct II,i), et d'autms oSI ils sont davaatage passifs, mais raremat cornpl&ment (I,xi, 1- et II,x). I1 faut dire que les rtdacteun de tels rCcits se concentrent toujours sur I'&wcation de la maladie et les rnodalitds de la gdrison miracultuse ; ils simplifient donc au stcr*ct minimum Ies interventions dcs pcrsonnagcs secondaices, P moins que L'attitude de ceux-ci permette d'accmtucr la valm du miracle. Dc plus, la gu-n n'cst pas une fin en soi, elk n'a de raison d'etre que Farce qu'elle augmrnte la foi du miracult a de son entourage : Ie rnalade ne doit donc pas Etre totakment absent du processus.
*. VI I,3-4,coL439A-B : Muftom quJPpe relatione verkima comes E~achius mores et actus atque pufchritudinem pradictue
virginis I&e, generkque dignittatem ejus audiem* mkit nuntios* s e m et efogueutia instmctos, ad praedietum ducem Godefridum, urflfiam smm Idam sibi durtt in conjugiitm ; fig.] Inito ergo co&Iio super huc petitione, quia non d@it gratia cwIestb, honori/icam virginan I i m , virk qui propter earn venerant, adjuncciis nondIb personis honestb, iradidernnt parat!esCS L.-] Recepta namque, ut decuir, honorifrce, copulata est comiti Boloniae, sciIicet Eustachio, pro more EccIcsiae cafhalkae. *
Dans pi pit hap he d'Adt!lalde, Odilon n'a pas us6 de v e h P la voix passive, pourtant il ne fait aucun doute que, en cette premih moiti6 du Xe siecle, la fille du roi Raoul II de Bourgogne n'a pas Cpousd I'du de son coeur mais celui qu'avaient dbigne ses parents : [.,.I a m a&c esset iuvencula er sexturn decimum elark
dans les amks 1 130-1 135, date de la z&htion de la VIIo idae, dors que di j i les camnistes
commeqaient A dclamer le ewsentement des fianets pour rendre valide une union3, les
moines ne semblaient avoir aucune critique B formula contre le mode traditiomel des
tpousailles, B condition que ceIIes-ci se fksmt d o n le rituel ddfini par I'&lise (.pro more
EccIesrae catholicae m) : iI est &dent qu'autnment, dam son souci de dessiner un mariage
parfhit pour sa parfaite hhihe , l'hagiographe d'Ide aurait mentiom6 son consentement Le
cas le plus inthssant, car iI nous renseigne sur les groupes sociaux les plus dCmunis de la
soci6t6 d7aIors, est celui d'une fille de d, pour qyi Geraud d7Alaillac 6prouva un soudain
et violent d e . II prit contact avec sa m P , lui annonvt sa venue chez eux le soi mi2me.
Lorsqu7il arriva dam la maison, il trowa la jeme paysame qui l'attendait pds du feu,
oEerte, semblerait-iIt A son bon plaisir. M c e B Dieu, elle lui parut brusquement t& hide
et le saint s'enfuit dans la nuit glaciale sans perdre sa chastete. Ne voulant pas risquer de
succomber B nouveau B l a tentation, il ordonna B son pQe de la marier dam les plus brefs
dilais. La jeune me, objet du dkir et objet des transactions, n'eut aucun avis B formuler de
tout I'episode, que ce soit sur le fat d'&e prise ou non par GCraud, ou de se marier : tout se
decida entre GCxaud, d'une part, et son p&e ou sa mere, d'autre pad. Ainsi, quel que soit son
sue ageret an-, Dm donante udeptu est regaIe rn~trimoniwn, h c t a scificet regi Lotbio Hugon& ditksimi reg3 Itulici~IioO (EA l,c0129).
La bibliographic sur k rnan'age au Moyen Age et sur la rnanih dont il passa sous le cono6le de 1 ' ~ ~ l i s e A partir du XIIe sibcle est t&s richt. Cf,, eatre auues, J. GAUDEMET, Le mariage en Occident : les moeurs et le h i t , Park du 1987, C. BROOKE, Z k Medieval I& of Mmiage, M o d : Oxford Univ. Press, I989 et P. L'HERMITE-LECLERCQ, L'ordre fbodal (XP-MIe sikles m, dam Hhtoires desfemmes, dir. G. Duby a M. Perr- Ik Lo Mo)len Age, Park Plon, 1990, ~22841 . Comme 1e fsit cemarquer cette autcure,
En posant le p ~ c i p c du libre mnscntement, ~'kglise ne dtfendait pas la libeN pour elle-meme. Elle ne defendah pas non plus 1e b i t au bonheur, Cettc rcvendication appdifi t a d dam l'histoirc de I'Occident et ne doit xien au christianisme. RCoccupd du salut des h, il estimcrait plut6t que I t bonheur peut faire oublier Dieu, ddteadrc I'effort pour lutttr contre Ie mal. Le libre consentement des @oux avait pour but de met= fm aux errcmcnts des Iaks qui d4tnrisaicnt la stabilite de la cellule conjugate alors que 19 seulement devait, au rnoindre MchC, se Pcrpctuer I'esptee. rn (ibid, p.235).
Ces remarques sant d'importance car cllcs pemcttent de mieux comprmdm pourquoi, dans les m h e s annbts, les canonistes mCXIgtrent aussi que Ies oblats soient lais& Iibrcs de choisir leur destinee, une fois attcint I'ige de la proftssion, Ici non plus, I'objectif n'dtait pas la dbfenst de la IrM6 pour eIIe-meme, ni 1e droit au bonheur, mais le dbir d'assurer une plus grande stabilitt dam Ies rangs des moines*
'. La jeune paysanne ne tirt pas perdante dam 1e drame, puisqu'elle y gagna sa Iibert6 - Gdraud la libdra du servage - et une petite propri66, sans compter Ie mari, en espdrant que celui-ci Iui convint (VG' 1,kcol.B- D). Cette anecdote fbt sagement retranchde de la deuxieme Vita GeraIdi ; il n'dtait certainement pas tr&
que les auteurs de nes de saints n'accodent jamak de pouvoir d&siomel i leurs heros
pendant leur enfimce est le meUeur indice qui soit qu'un tel pouvoir n'etait en aucune
manike reconnu aux edb ts du Moyen Age central : m h e saint, I'edmt est le jouet des
d6cisions dcs adultes jusqu'ik son adole5cence7.
Dam les phrases tvoquant leur edmce, lorsque ces saints enfats sont sujets, les
verbcs sont habitueuement au passif ; presque toujow, Dieu ou leus parents sont les
principes adif. La Vita Bwcardi en ofEe un bon exemple. EUe est la seule Vita dam
laquelle l'hagiographe n'avait nul besoin de parler de I'intervention parentde, puisqu'il &it
pr&u d& la naissance de Bouchard qu'il succ&iefait h son #.re. Or le saint est tout de m5me
dCcrit comme un penomage totalement passif. Les premieres lignes du texte sont les
suivantes :
a Incl~tcs comes Burchmdw, nobili stiqpe progenitw, sucro baptismate s t renatus, atque nobiliter in religione cathoiica miIitari tirocinio edoctus. Nam pueriti~ fempora durn trmrrigeret, cur& regali, more fimconmt procerum, a parentibus traditus a t ; qui christianitatis operibus pollens totius prudent# atque honestatis assumpsit commoda ; in aula enim gloriosi Hugonis Franconnn regis, mcctis turn cgdestibus quam militaribus imbuebatur imtitutis. Durn vero adolescentip atque juventutis appulit unnos [...I mg.
Les voix des verbes ne sont pas les seuls indices de cette passiviti ; le ecit meme des
Mnements en tdmoigne9. h i , Guillaume fut fait oblat a l 'ae de sept am par dkision des
parents et avec l'encouragement du reste de sa famille : Raoul Glaber explique que cette voie
fbt choisie ii la suite de divenes visions matemelles (envoy& par le Seigneur, certainemeat
dam ce but) et du fait du comportement du saint ; mais l'avis de celui-ci ne W pas mcherchk
et I'hagiographe ne se donne absolument pas la peine de meme suggtker que Guillaume, en
', I1 est evident que cctte dgIc s'applique Cgalement aux penomages secondairts dcs Vitae. Cf, par exemple Ic cas du fib du seigneur de Goumay, dont Hugucs de Scrnur avait prddit la naissance ct I'entde en religion. L'emploi de "&ptatusn atteste que l'avis de I'enfant ne fut pas pris en compte quand les parents le consacrhmt A la vie guem&re : creuit, militari deputanrr oficio gladium accepit. ... (VHbU xi,p.127) et a Creuitpuer, et amatortrm depurms oflcio, ... w ( V I P Epikt.p.1 f 3).
'. VB 1,p.S. 9. M+me le Christ Enfant est perqu comme Ie syrnbole de I'humilite. Nalgod declare h propos de la prise
d'habit monastique de MaTeul: Pannb iflantiae Jksu et vestibus humilitatis indutus. sacraments ordinis, humifitatem scilicet et obedientiarn, miro fentore animi sequebatur ; rn ( VIC1" I, 1 1 ,p.659C).
son b e et conscience, vouIait entrer dam 1'&lise1O. Les explications de Jotsaud quand il
raconte comment Odilon xqpt la tonsure sont encore plus succinctes. La prernib phrasp de
la Vita coneanant directement I'&t, et non plus ses parents, est la suivante :
Igiha Odilo w beutbsiint~~, nobilitatik stemmate procreafus, inter ipsa primordia tamqwm alter Isuac C M t o consecratus, et Brivate a p d sanctum Juliionurn gloriomm martyrem cIeticaIi sorte est donatas. vn
Ici encore l'hagiographe juge inutile d'aborda la question des aspirations persomelles de
I'enf'ant.
Les cas de Geraud et d'Odon sont un peu plus complexes puisque leurs parents
hksitkrent beaucoup entre les d a e r 12 l ' ~ ~ l i s e ou en faire des guerriers. Lem tergiversations
permettent de rnieux camprendre selon quels principes les parents decidaient du fbtur de
leurs fils. J'ai dkjii 6voqu6, dam le cas de la Vita WiZIenni, la prise en compte du
cornportement de l'enfant et des visions reques par les parents. Beaucoup plus centrale b i t
la force physique du petitt2. Quand celui-ci paraissait f8ible, peu d&eloppt! pour son Sge, on
lo. VW iiTp2S8. ll. VOi I,coL899A-B. Pierre Damien n'est g u k plus disert : r Quipraetereu dum adgmnditlsmiae jam
aetatis adoiesceret incrementwn, prius apud sanctum Juliunum martyrem factus at c le r iw ... l (VOrQ co1.928A).
I=. le parte ici de L'oblation de m o m . Je n'ai pas d'exemples ferninins dans mon corpus puisque Ies deux femme du group, 1de et Addlarde, sont des Wques. Mais cette abscnce d'oblatc est peut4tre significative : l'oblation de fills, si elk fin pcut4tre importante dans les pmniers sitcles du monachisrne occidental (J. BOSWELL, Expositio and Oblatio. The Abandonment of Children and the Ancient and Medieval Family ID,
American Historical Revim (Washington), 89 (1984): 20), semble avou &! m o b pra!iqu& pendant Ie Moyen Age central (cf. P A QUINN, Better t h the so-, 1989, p.36~1). Marcigny, par exemple, n'acceptait pas de iuuencda et Ctait surtout peuplk de vcuves (cf. DM I,x~ii,p.6!5). En revanche, l'oblation des filles prit de l'ampleur a partir du XUe sikle, d o n m h e quc e l k des gaqons commengiit h tombcr en dhCtude. Ainsi, au Xme sitcle, alors que les Cistcrcicns, Dominicains a Francisaim refirsaient d'adrnem des jcunes de moins de 15-18 ans dam l e m fangs, leurs pendants ferninins acceptaient Its petites filles (cf'. P. L'HERMITE- LECLERCQ, 8 L'imagc dcs monialcs dans les are@ n, dam dans vie quotidienne des moi'nes el chanoi'nes re'guliers orc M i n Age et Temps mod'es, Actcs du Premier Collopue International du LA.RH.C.0.R WroclawKsi#, 30 novernbrc-4 ddccmbm 1994, dir. M. Derwich, Wroctaw: Publ. de L'Institut d'Histoirc de I'Univenit4 de Wmdaw, 1995, p.482-83, R CREYTENS, Les constitutions primitives des soars dominicaines de Montatgis (1250) m, Archivumfialn~n praedcatoonrm, 17 (1947): 63, CLAIRE D'ASSISE, RGgle* dam &its, Cb M.-F. Becker, JzF. Godet et T. Matura, Paris: gd. du Cerf, 1985, II,17,p.128-29 a J. BOSWELL, Kinciiress ..,, 1988, p319n.).
Quoi qu'il en soit, dans le cas des fiIles, le critere physique etait Cgalement pris en compte pour decider Iesquelles devaient absolument rester dam le si&cle, mais il nlt!tait pas le seul : la b o ~ e moralite (assurance contre lTinfidC1it6) et l'intelligence (de bonne gestiomaire de Ia rnaisonnde) pesaient aussi dam la balance. Car,
supposait qu'il ne f d t pas un bon guerrier ni un bon "reproducteur", et la voie
eccl&iastique (monastiqye et cl&icale) semblait toute track. Si au contraire son corps
semblait fort et beau, on le destinait ii la vie dculihe. Gbud ayant eu la peau couverte de
pustules pendant son &ce, ses parents d&id&rent de le pr@arer, non plus au m6tier des
armes mais B une fonction ecc16siastique. A l'adolescence, le jeme h o m e fut d&arras&
de son probkme cutan6 et se montra soudainement t d s fort a trb agile. Ses parents
revinrent alors sur leur decision et lui fkent apprendre les diverses occupations dignes d'un
seigneur- Pendant toutes ces m k s , meme apes la pubertt, l'avis de Ghud ne fit jamais
pris en compte? Odon pdcise (bien entenduy que Geraud regretta ses Ctudes et ne
s'appliqua qu'h contre-coeur aux activites guerriires- Mais il n'est ride question de rivolte
et Odon ne s u g g h absolument pas que les parents du saint auraient dB prendre en compte
les complaintes de leur fils.
La situation est exactement similaire dam la Vita Odonis, sinon que celui-ci tomba
si gravement malade pendant son adolescence qu'il devint hoa de question d'en faire un
guerrier. Odon detest& le mode de vie I-ue ( d m Odon i Jean de Saleme), mais la
decision patemelle de le diriger halement vers ~ ' ~ ~ l i s e ne reposa nullement sur les ddsirs
du fils : tout simplement, celui-ci se mourait et il etait devenu impensable d'en faire un
ainsi que l'atteste la Vj14 de Cristina de Markyate, une puelia belle, chaste et fine pouvait trouver sans pine un mari et m e w au monde dcs enfhnts A son image ; il Ctait alors impensable pour ses parents d'acceptcr qu'elle mtm au couvcnt ct qu'ils n'obticnnent pas d'elle Ies descendants qu'ils cscomptaient (cC The Li/e of Cristina ofMwkyate. A T w N h Centmy recluse, 666 et trad C.H. Talbot, Oxford: OxCord Clanndon Press, I987 (1959), #20,p.66-69 ct P. L'HERMITE-LECLERCQ, L'ordrt f€ odal-.. w, dam Hktoire des Femmes, II, opcit, 1990, p.233-35). 13. VG' 1,iv-v,col,645A-D. 14. Les t6moins dont a & Odon pour Cctire sa Vita &ant des mtriti du saint, ils n'ont pas pu le renseigner
sur Ies pens& de Gdraud pendant son adoIexxnce ; il n'cst donc g u h hawdeux de supposer qu'Odon a invente de touts pi- 1 s regrets du jeune Geraud. Dam un tel contexte, il est rcnrarqwble qu'il n'ait placC cew-ci quVap&s la puberte. Lcs desiderata de G h u d cnfant ne I'intCrcssaient donc pas.
Is. YO' 13-9,co1.45-47. Les m h e s concIusions pcuvcnt &re formul6es la lecture de la Vita abrCg& et de la Vita de I'Hmillimus (VQ a 5 4-6,p.2 1 1 - 13). Dims la Vita Odanis compode par Nalgod dam Ies a n n b 1 120, le diiours a changC. LC fils n'est toujours pas libre de ddcider de sa destinde, mais le bicn-fondd de sa soumission totale ct entHrc aux decisions paternclles est entienrncnt remis en question. En effet, le @re d'Odon est maintenant prhntd comme un parhit hMcile (8 curnaiis pater eiur, cmnem in eo plus diligens, de spiritu mi= curam *, p a t m a stultitia R), qui r e b e d'honorer t'offiande qu'ii avait faite de son enfant a saint Martin, rnalgrt! les conseils des plus sages (YO" Fini 6-7,p.I 34-36 = PL 5-7,co1.87-88).
Ainsi, cornme l'illustrent les d e w cas de GCraud et d'odon, la pubert6 ne matquait
pas la limite auada de laquelle Ie jeune &it itire de dtcider de son destini6, mais
simplement celle pardelk Iaquelle on cornmenpit h admettre qu'il pat avoir un avis
persome1 sm la question, m h e si celui-ci n'dtait pas pris en compte tent que le ptrr &it
vivant Quant auper, iI semblemit bien que ce qu'il pensait n'int6ressait petsome, m8me
lorsqu'il s'agit d'un saintL7. Les divers &its d'oblation de l'hagiographie clunisienne
mentiom& ci-dessus attestent qye la dkision parentale powait prendre en consid&ation le
comportement de l'enfaat et, surtout, la force de son corps, mais jamais son &at d'esprit.
Une etude un peu plus po& de la pratique de l'oblation permettra, non seulement
de passer du monde Isque, les donateurs, au milieu monastique, les donataires, mais aussi
de prendre conscience d'un changement d'attitude vis-&vis du premier age qui survint B
partir de la fin XIe-de'but XIIe si6cle.
Comme l'attestent les exemples ci-dessus W s de l'hagiographie, et comme le
continne la lecture des dgles et des ~outumiers'~, l'oblat est toujours offert par ses parents.
Sur le pouvoir totalitaire des Nres de G€raud et d'Odon, cf. C. CAROZZI, De I'enfance la maturitC. ~tudes d'aprb les vies de GCraud d'Awillac et d'Odon de Cluny m, dans ~md' sur fa semibilire cru noyon dge, Actes du 102e Con@ national des soci€t& savantes- Lirnoges 1977- Philologic ct histoire jusqu'8 1610, 11, Paris: Biblioth*que Nationale, 1979, p- 11 1. B.H. ROSENWEIN a etudi6 l'importance du modtle de Martin dam la Vita G d d i par Odon et dans la Vita Wonk de Jean de Salerne (a St Odo's St Martin : the uses of a model m, J ' , 4 (1978): 3 17-3 1) . Dans la lip& de cctte Ctude, un autrt paralltle peut &re trace en- la vie de Martin et celle d'Odon : tous d e w jeuncs adolescents, aux dentom dc rage dc quinze ans, sc vircnt contxaints par lam @rcs de x c o m & me existence guemmhc ct, tous deux, durcnt obtcmptrer malgrC leur dCgott (cf. Sulpice SCdre, Vie de saint Martin, intro., texte ct trad par I. Fontaine, (SC 133) Paris: &i. du Cerf, 1967,1,2,5,p.254).
16. En revanche, dans la thbtie, d o n le droit canon, 14 aas manpait See au-delh duquei les jeunes & a t libres de ddcider par eux-miimcs (cf. R METZ, L'enfant dam le h i t canonique mCdi6val. Orientations de recherche w, dans L'enjiant, Ik Europe m&liPvaie e! m d , (Recueils de la socidd Jean Bodin pour I'histoke comparative des institutions, XICXVI) Byceller: &L de la Librairic EncyclopCdiqw, 1976, p28, p.40. p.45, p.58 et p.78-79).
'? Cette attitude des hagiographes par rapport h l 'cnhce a beaucoup &oIut dam I t s siklcs post&rieurs, cf. D. WEINSTEIN et R BELL, Spin& dsbciefy , 1982, p3 1 4 . LC &&me de I'enfance, obsCdte par l'idte de @ch€ et de pdnitence, est totalement absent de mon corpus. On ne peut s'emwher de se demander si, dans Ies faits* c o m e tel at k cas dam les Vies de saints, la sositt6 du bas Moyen Age a hansfCrC oux enfhts ses inquidtudes psychologiques, allant parfois jusqu'h fa morbidit& en meme temps qu'elle leur donnait droit de parole..,
''. RB 59,p.632-35 : a Si quis forte de nobilibm offeritfiIium s u m Deo in momer io [...J Similiter autem el pauperiores
L'kventualit6 d'un cas diff&ent, celui d'ua enfant s'offrant malgr6 la volont6 parentale, est
dlkmment rare pour n ' k j d s envisagde par les auteurs de sources normatives. La
R2gZe dh Masbe est la seule exception, mais je vais montnt que son discours est beaucoup
moins original qu'il n'y @t h premihe we. Dans celle-ci, la seule et unique 6ventualitC
envisagk est celle d'un fils de noble qui se m n t e de son plein g,d & la porte du
rn0nast&d9. Certains auteurs en ont conclu & tort, me semble-toil, que I'oblation etait
volontaire c h a le Maitre? En rUte, le cas de figure d'un oblat volontaire est pdsente par
l'auteur parce qu'il pose un terrible dilemm h la communaut6 : que faire vis-A-vis des parents
si ceux-ci refieent de se plier ii la volonte de leur enfaot ? Entre Dieu le P&re et les parents
charnels, le Magisrr &pond que l'abbaye doit &re p e e I &sister aux seconds pour mieux
ob& au premier. En revanche, le cd~monial a suivre si les parents appuient le choix de leur
enfant indique qu'un enfant se pdsentant I l'abbaye de par sa decision propre b i t pequ
comme me anormalit& En effet, le Maitre demande que les parents viennent alors faire
sembfant d'oW eux-memes leur e n h t :
a Quod si magisjiierint consentientes eius uoto parentes, connucatis eis ab abbate in monasterio, uotum filii conuettentis exquiratur ab eis, ut ab @is potius uideatur deuoueri uel offerri, qui eurn genuerunt- *
facibnt, Qui u r n er toto nihil hbent. simpliciter petitionem faci't, et cum oblatione offerantjillum swim coram tesfibsls. -.
Cf. pour la RB, M.-P. DEROUX, ter origines de I'oblatwe bdnkdictine (Prude hhlorique), &itions de la Revue MabiUon, no 1) Liguge: E. Aubin, 1927, p.13-15, Cf, tout spkialement pour Cluny : LT 155,p.227 Cwn pmentes srrosjTtios &O in monasterio dare ~~oluerint, f4chnt.. a. Wjii du temps du LT, les parents ne participaient plus B la cddmonie &oblation qui se ddmulait B 1'autcI principal de l't!gIise. C'cst un f i re qui offbit l'&t & lewplace, cornme I'attcstent de manik plus pdcise les coutumicrs de Bernard ct d'Ulrich :
WabMJ Jubet etiam uniflatrum ut puentm offerat vice parenturn ... rn (UdaI. III,viii,coI,741D ct Bern I,xx~ii,p200). Dam la @ition off- avcc l'enht ct lue par It Wre, celui-ci dklarait : Egofiater N. oflero Deo et sancfir ejru apostoIb PetPo et P d o hum: puerum nomine N. vice pafenIrrm ejw. .. rn (U&i- ibid, co1.742A ct Benr ibid). Ainsi, quelle quc soit Ia formule choisie et meme l o q u e Ics parents sent eloignds de la scene, ils demeuraient toujours Ics donateurs ; l'enfmt ne se do~iaitjamais lui-m&nc.
L'abscncc dcs parents dcs obhfs au moment de fa ddmonie h l'autel n'avait pas pour objectif dt facilitcr I'abandon de bBtards mais d'intcrdire I'approche de l'autcl B des nonckrcs, quoi qu'en ait pens4 J. BOSWELL (a L'&positio..- I)( op.ci!., 1984, p 2 1 ct Kinciiress, 1988, p.302). DCj& du temps d'Hildemar, m e partie de la c&&nonie ne se ddroulait plus l'autel, cf. M. DE JONG, = In Samuel's Image ... m, ReguIae Benedicfi Studio, 16 (1987): 74-75. Pour une h d e minuticuse du ddmonial de l'oblation Cluny, cf. M. LAHAYE-GEUSEN, Dm Opfer der Kider, 199 1, p.43-68.
". La RZgie du Maitre [RM), intro., texte, trad et notes A. de VogOt, 2 vols, (SC 105- 106) Paris: ~ d . du Cerf, 1964, XCIlp.398-99.
*O. C f. par exemple M. de JONG, In Samuel's Image ... m, Regulae Benedicti Studia, 16 (1 987): 7 1.
221
Avec cette c&6monie, rauteur revient & ce qui etait la pratique usueue, c'est-B-dire des
parents ofEant leur enfaat : le reste du chapitre traite de la nCcessit6 de ddshdxiter I'enfimt
pour &re certain qu'il ne retournera pas au sitcle. Notons par ailleuts que la 16gislation
eccl6siastique intetdjsait B un enfant de s ' o m A un monastike sans la pamission de ses
pared'.
Une fois entrd au monast&e, l'enfaat ne put revenir sur la decision parentale et
rejeter le funn qui hi a Ct6 trace : roblation est idvocable. La @tition qu'il signe loa de
son arrivee stipule en effet t&s clairement que ce geste l'engage B vie. Le moine qui l'ofEe
au monastkre au nom de ses parents declare :
a trado coram testibus @uemm] regulariter p e m m , ita ut ab hac dk non liceat iIli collum de sub iug0 regulae acutere, sed mag3 eiusdem regulae fideIiter se cognoscat institufa sentme et domino nnn caeteris gtatanti animo militme- d2
D'ailleurs, lors de la professon, qui avait lieu vers l'ige de quinze am, sinon plus tard, et qui
pemettait a l'enfant de quitter le groupe des puen' pour incorporer definitivement le
conventus des moines, la question du choix, de savoir si oui ou non l'enfant voulait de son
plein gr6 devenir moine, ne se posait pasU.
zt. Cf, R METZ, L'enfm~-- 8, dans L 'enfant, 1976, p.52 et p.89-92. Meme interdiction dam la loi salique, cf. J. BOSWELL, K i . s . , . , 1988, p23 1.
*, LT 155,p.227. Les pdtitions dam Benr et OM. oat des tcxtes Idghrcrnent differents, meme entre eux (avec le texte d'Ulrich beaucoup plus proche du LT), mais Ie fond m e le meme, cf. Udal, m,viii,coI,742A et Bern. I,xxvii,p.20 1.
*. LT, 155,p.228 : Cum aetatis t e m p consecrationis uenerit, cucullam non exuatur ei ubbar, sed profmsio legut cunr
caeterk atque b e d c t i o &ta, simt mos est, mittat ei capellurn in cupud atque os~llfetur~ De refiquo facianl sicuti aliifiatres.
Cf. &m W i , p 2 0 1 ct C/&L III,vii&co1.742B. B e d dome unc deuxitmt et plus kmgue version de cette cbdmonie un peu plus loin, Je la reproduis ici htdgdcmcnt car elk est moins connue et indique trh clairement la totale passivite de l'enfant pendant ct proccsms, Une autrc caractdrristique intCtcssante de ce passage est que B e d qwlifie la w o n ate par l'oblat lors de son aetivte au monastCre de plus parfaite et plus ferme ; Bernard plapit donc roblatiou au-dessus dcs autres modes d'entr4e au monasttrc :
m Skiendurn vero de ikdem injmtibus, guod nunquam ereunt & Scholis, donec benedicti ant, nec faciunt pro benedictione petitionem ; sed cum v i ' t w Abbutt inter caetera quue in Capitufo loquihrr, addit etiam hoc &ens Fratribus : Fratri huic, si bonum vobis videtur, volo misericordiarn facere : quo faudato ub omnibus. stulim surgit ille de quo dici~ & vadir adpeaks Abbatik : h i d e stat corm eo ubi stant pi veniizs s w z ~ petunt, donec pruecipiot ei ut eat sessum, & tunc ad ham mum redit, semper enim in custodia cum
Cette caractdristique de l'oblation a pu &re remise en question par l'gglise dculitre,
ou par certains parents ou o b k , mais ih peu pds jamais par les moind4. L'histoire de
Gottschalk de Metz illushe que, padois, les autorit6s eccl&astiques se sont opposks B
I' idvocabii de I'oblation?? Surtout, il at fofi probable que, dans les fhits, il advenait que
I'oblat quittiit l'abbaye, soit la suite d'une dkision personmll~, soit par obcissance B la
infcmtiblu est. do= eidkm benedicro coputium s u p octllos trohana ; nam tune &mum &nn illi altb custodio, & & in &is ultimt~~ stat in refa Notandurn veto quad cum dcbd benedici, idco non facit petitloncm ; quia/am fec&perfecl~s &flnnus qurrm qui olio modo faciuni: I, ( B e m Ipcvii,p206)
J. DUBOIS a conclu & la lecture du couturnier de Bernard qut les oblats dtaient lib= de npartir s'ils le d6siraient au moment de leur profmion (art. Obluto m, DP, VI ((1980): 657) : on peut se demander si ce grand chetcbeur, qui &it aussi un Mn6dictin et qui ne trouvait gu&e louable l'oblation idvocable, n'a pas lu dam Bernard ce qu'il d K i y trouver. N. HUNT a h i s m e opinion sirnilah, appuyk par une preuve fort peu convaincante (CIuty unak Srrint Hugh, 1967, p.96-97 et p.97n.).
Dans les Smutu, Pierre rcpousse Mge de profession vingt ans mais ne remet pas en cause l'absence de choix IaissC il I'enfant (St& 36,p.70-71).
24. Ce qui etait d pow reglike #Occident par& de saint Benoit ne l'dtait pas pour l'&$ise d90rient, qui elk, au moins depuis Basile, donnait 1a possibW ii l 'enht de choisir sa voie au moment de la profession (cf, MS. DEROUX, Les origines ..., 1927, p.10 et I. BOSWELL, Kindness. .., 1988, p.232).
11 est probable que Benoit d'Aniane exigea, lots du deuxihe synode d'Aix, k libre choix de l'obIat, une fois atteint I'iige de Ia profession. R est en effet stipuld :
a XVII. Vt puerum parer et mat* al~ari tempore oblationis offerant et petitionem pro eo coram laicis testibus facimt quam et tempore intelligibil @se p e r confirmeet, a (Synodi secundae aquirgranensis Decreta authenticu. CCM I, 1963, p.477).
Se dis "probabk" parce que cette cxigence de confmation pouvait ttre une simple fomalite, oB cours de iaquelle l'avis de l'enfant n'€tait pas vraiment rechercht!. D'ailleurs, peut-on dellement parler de choix lorsqu'on propose & un e n h t derneurant ddjh depuis plusieurs a n n h au monast&re, qui n'a pas appris A manier les armes mais seulement le psauticr, et qui est sans possession aucune dans le siMe puisque ses parents I'ont ddsh&itti, de choisir en- la vie dculi5re ou la vie cccl&iastique (ct M. GOODICH, Childhood and Adolescence among the Thirteenth-Century Saints w, JPH, 1 (1973): 291) ? Quoi qu'il en soit, si jamais ce dglernent permettait be1 ct bicn a L'cnfmt de donuer son avis, il ne fit pas suivi.
? A p r o p dc Gottschalk d du trait& de Raban Maur pourjustifiet l'oblation, De puerorun, oblmione, cct K, VIELHABER, GottschaIk der &chse, Bonn: Ludwig Rokcheid, 1956, p.15-39, M.-PI DEROUX, L 'or'j0ii.-, 1927, p.26-27, J, BOSWELL, lk K i m h s ofS~rmgers, 1988, p.245-48 et PA. QUINN, Better than the Sons..-, 1989, p33-54 et p. XOf-09 .
Sur la rnanih dont la position des d&&istes et des dMtalistcs se modifia prognssivernent, si bim qu'ils rendireat obligatoire le consenterncnt de l'oblat partir de 1234, cf, l'excellent article de N. BEREND, La subversion invisible : la disparition de I'oblation idvocable des cnfants dans le droit canon m, MhdihaIes 26 ( f 994): 123-36.
f6, Les auteurs monastiqucs sont peu diserts mr la fiite de certains hors dcs monast&rcs, peut4tre par crainte de donner des id&s & ceux qui restaient. Dans le chapitre 29 de sa rtgle, Benoit bvoque le cas d'un moine revenant B l'abbaye a p e I'avoir quitt6 proprio uitio (RB 29,192). Dans le chapitre pdcldent, il expose explicitement un cas de depart involontaitc : un rnoine coupable d'unt grave faute peut &re rejet6 B I'extCrieur par I'abbC s'il a r e W de s'amendcr apt& avoir 6tt5 excornmunib puis battu. M a l H tout, la formule 8 propriu uitio laisse place, me sembIe-t-if, B 1'6ventuaIit6 d'un ddpart vobntaire, le cas d'un moine qui serait parti de son propre gr6, ma!@ la promesse de stabilitt! qu'il avait prononcCe. Cette hypothese est confinn&e par le tenvoi B cc chapitre de la RB dans Ie LT, quand il est question de la punition qui doit Etre infligee A un moine
volontt parental$' ; autrement les moincs n'auraient pas fix6 autant de gde-fous pour
rendre aussi difficile ce retour vers le sikle. En e f f i en exigeant qw l'enfant o f f i soit
d6sh&it& dts son en* au monastke, la communaw s'assurait que celui-ci a d t toutes
les peines du monde ii rtitdgrer la socidtC Ialque puisqu'il s'y trowerait ddpou171u de tout
bien3 ; par ailleurs, en f i h n t sigm aux parents la charte &oblation enprCsarce de temoins,
I'abbaye p d t des garanties contre un revirement possible des parents dans r a v e s .
Ainsi, les moines tenaient absolument B ce qu'un oblat, une fois entd au monastike
y demedt. M h e lorsque l'oblation commenqa a Me remise en cause au sein des ordres
monastiques, B partir de la fin XIe-debut XIP sikle, son inevocabilie ne fit pas. le point
litigieux : les critiques portaient a i l l ed . Les Chartreux et les Cisterciens reh+$rent des
s'etant enfbi du monasth ou d'un p r i e d (LT 177,p2489. La fkite n'ttait pas facile parce que, de jour, un portier contrijlait les enHes ct sorties, et les Mres se surveillaient mutuellement (cf. DM I, l3,p.p.43, tandis que, de nuit, les portes domant sur l'extdrieur etaient fermdes (ct DMII,xxiv,p.l41).
? CF. par exemple Ie cas de Jarentus, qui grandit Cluny sous l'abbatiat de Hugues, puis retouma dam le monde pendant son adolescence, avant d'entrer h la Chaise-Dieu (Chronicon Hugonir monachi virdunensis et divionensis abbatbfl4viniacemir, MGHSS, VTII, p.4 13 d N. HUNT, C l q u& S r r ~ Hugh, 1967, p.97).
I1 est possibIe qu'A partir de la deuxi&rne moitie du XI' sihle, les p a n t s tinrent de plus en plus souvent i pnkwer Ia I1kt6 de dkision de leurs enfhts. Diverses chartes clunisiennes dvoqutes par J.-H. Pignot, G. De Valous et P. Rich6 indiquent, en effet, que, parfois, I'oblation h i t conditiomel1e A sa confirmation par I'enfant a p e quclques a n n h (J.-H. PIGNOT, Hatobe de I brae de Ciuny, depuir lafondarm de I 'abbaye jmqu 'd la mort & Pime le Vinetable (9094I57), IT, Autun/Paris: Michel Dejussieu/Dumd, 1868, p 3 8 In., G. DE VALOUS, fe monachkme cluntkiea.., I, 1970, p.43 et P. RICE&, s Les moines bentdictins maims d'€cole VIIIe-XIe sikles n, dam Bedictine Cul~we 750-1 050, dd. W. Lourdawc et D. Verhetst, (Mediaevalia Lovaniertsia, -.I, 1 I) Leuven: Lcuven Univ. Rcss, 1983, p.98-99). Autrrs exemplcs contemporains dam U. B E R L ~ E , holes claustrales au Moycn Age a, AcauEmie royale de Bef'pvg BulIet i~~~ de la c ~ ~ e rhr lettres a cd;es sciences m w d . etpolitQws, 1921, p555-59 et J. BOSWELL,, K*. .., 1988, p 3 16. II serait fondamental de savou qucl &it le pourcentage de ces chartes par rapport il celles de contenu plus classique. Parall~lment, on note que, toujours il la fm du Xl' siklc, I'enfant cornmen@t A &re appelC B signer comme temoin dans les chartes @as spCcialement ccfles concernant une oblation), cf. J.K. BEITSCHER, "As the Twig is ben t..." : Children and their Parents in an Aristocratic Society a, JMH, 2 (1976): 183 et C. WHITE, Mmic and Ceremony at Notre Dame of Park, 500-1550, Cambridge: Cambridge Univ. Prcss, 1989, p.166). Ceci poumit signifier que, d'une part, on rcconnaissait pmpssivcment le pouvoir dkisionnel des enfants, et que, d'autre part, ceux-ci se retournaient de plus en plus fk6quernrnent contrc I s dkisions priscs par leurs aink dam le pass&, d'oh la n&cssitC de s'assurrr leur accord a signature quad ils Went encore sous la coupe de ces dernicn.
=. Cf. RB 58, p.632-35 et M X C L , p.398-411 (car le Maitre dlaboce tr& longucment sur le sujet). 8. Dam lc LT, les thoins srmblent &re facultatif% (a Si Iaici adrunt praesenta, aduocentrv, ut u i d ~ et
audirrnt ut sint testes. LT 155,p.228), mais il ne s'agit Ih que de la cddmonie religieuse de prise d'habit de l'oblat, et non de la donation proprement dite par les parents. Dans le Bern. et ITUdaiI, mhme pour cette ckrkrnonie, la peence des temoins est obligatoire (Bern I,xxvii,p20 1 et UdaL IIlTviii,co1.742A).
'O. Cf. N. BEREND, La subversion ... n, op.cit., 1993, p.124. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les moines n'etaient pas devenus tr&s sensibles A la question du chob. A partir du Xne sitcle, conscients qu'une
enfants en leurs rangs pane que ceux-ci Ies ernpiichefaient d'&e aussi ascttes qu'ils le
desiraient : le corps des dmts h i t en effet un objet de d&, donc de danger ; de plus il
&it trop hi1e pour les restrictions alimentaires et le labcur physiquc que Ies noweaw
ordm voulaient s'irnpodl. Certains h, Ulrich en t&e, repr~~h-t en revanche a m
conversion volonraite valait d u x qu'une passive, ils font de tour leurs httos des convertis de plem @, p d o k mCme der convertis qui eucent i vaincre moult obstacles pour parvcnir il h c b i r ks portes du rnomstk de leur choix. Ainsi, toutes les de Hugues loucnt le firit qu'il ait choisi la voie eccltsiastique, m a l e l'opposition de scs parents. Dans k DM, tow ks rnoines, dont Ies conditions d'entde dam Cluny sont specifitks, furcnt, a m dim de Piem, dto convertis volontaires (ct tout sptsialement DM 19). Cet ounage donne pourtant un bon apequ de L'ambiguW de la position des moines noirs en ce dCbut du XII' sitele, car cewt-ci, alors meme qu'its ne voulaient plus parlcr d'oblation involontaire, continuaient de penser qu'une conversion ab pudtia &tit sup&ieurc aux autms formes de conversion (cf. la description du moine GCrard et du Idgiit Mathicu d'Albano, DM 48 et II.4 a 17). La solution trouvCe par certain% comme Ies hagiographes d'Anastase et de Morand, fit de dire que leurs saints furrnt faits oblats par leurs parent., mais qu'ils Ctait consentants (cL Gauthier d'Oydes, Vita SAmsfmir; month SMchaeIk momchi [BHL 405, c. 1 1 151, PL 149, #2,co1.427A ; Vita I du bx Momd [t 1 1 15; BHL 60 19, c. 1 165-751, AS, Juin (Paris, L867), I, 1,4,p.349 et Vita N [BHL 6020, ap.1165-751, BibLCk, & M, Macrier et A. Qumatcnus, Paris, 1 614, col.SO1D).
Inutile de p&iser que de teUes affixmatiom, sur Ie cacacttce volontaire de I'entde en religion d'individus jeunes (enfants et adolescents), doivent h i l l e r notre suspicion : cf. en effet M.-T. LORCIN, Vbre et Mourri en Lyonnoir ci kajin du A 4 d g e , Lyon: Ed du CNRS, 198 1, p.75-83 (oh cetk auteutc ddmontre que, dam les milieux nobles Iyonnais dts XW et XVC sikles, tes ptrrs poussaient 3 l,l% de leurs filles et 23,l% de leurs fils vers 1'~gIise) et P.L'HERMmLECLEFtCQ, Roseliuc, Jeanne ct Jeanne-Diane, tmis bienheureuses chez les ViIleneuve en un sikle ? Ddfaillanccs et complaisances de la mdmoire, vertiges de I'irnagination m, M, 65 (1993): 133-76 (oh cellc-ci dernontre que le rtcit de la lutte t&s @re, men& par Roseline de Villeneuve contre sa fmille pour entrer en religion, est une puce invention : Roseline f i t destint?e A la vie conventuelle par decision paternelle),
Ainsi, le discours hagiographique a change radicalement entre Ie Xe ct le XIIesi&le mais la r6alitt beaucoup moins. Il ne faut pas pourautant minimiser I'irnpodance du premier car les iddam qu'une sociM se dome sont fondamentaux pour compccndre celleci. Jusqy'il preuve du contraice, saint Fraqois et sainte Claire se sont be1 et bien convertis en s'opposant viokmmcnt leurs parents, ct ccs dew individus ont Ctt port& awc nues par leurs contemporains et Iem successcurs : que des pmonnagcs ayant une a d o l ~ e n c e aussi "r6volttkn gagnmt une mromrnct aussi grande est un phtnomtne difficllcment concevablc pour Ics X ct XI' sitcles ; or cette divergence en dit long sur les diffdrcnccs en- ces dew Cpoqucs. Mais je reviendrai plus en d€tail sur ces questions d'adolcsccnce rtvoltte au chapitre suivant,
Sur l'cnf8nce des saints de t 100 a 1700, cf. D. WEINSTEIN a R BELL, Saihts andSa:ie@v 1982, p.1947. Sur la w o n relativemcat &gale entre les enfantts saints "r6volt&sn ct I t s "non-r6vol!&s", cf. le tableau donnt p. 124 et son analysc p.45-46. M. GOODICH note que, dans les orQes les plus traditionnels et les moins ascdtiqucs du XIU' sikle, tels Ics BCnCdicths, 1es Cistercicns et Ies chanoines, les saints led less turbulent childhoods, and merely fulfilled familial desires in their religious vocation, (a Childh d.. *, JPH, 1 (1973): 288 et 291). Ce type d7Ctudes ne prend pas assez en compte Ics distortions possiblcs du discours hagiographique. Qui vcut M u e r la plus ou moins grande margc de manoeuvre IaissQ aux enfints et adolescents vis-bvis de leu avmu A une ptriode d o h devrait davantage x pencher sur le comportement des personnagcs secondains des oeuvres litteraires contcmporaines, plut6t que sur cehi des htros, car ce dernier est, par ddfmition, hors norme.
' l. L a p(d6rastie n'dtant pas un sujct N lequel aimaient h s'attarder les moines, il est parfois dificile de discerner, dam leurs critiques sur l'oblation, s'ik evoquaient la premitre forme de danger que repdsentaient Ies enfants ou la seconde. Des critiques similaires sur l'oblation avaient dtj8 t t t formultes plusieurs siecIes
parents d'utilkr les m o m comme des dtpotoirs o& ils ddversaient leur tmp-plein
d'edhts et leur proghiture handicap&? Cette attaqye clttaquelle les motivations des parents
de Gkaud et dodon lorsqu'ils offdrrnt leur e n h t B l'&lise ; mais 5 L'dpocp (deuxibe
quart du 3P sikle pour la rekidon des d m premih Rtae), me telle manihe de faire - donner son enfant A l'&lise parce cp son cop, malade ou faible, h i t impropre au metier
auparavant par Ics auachor&s, cf. A. BORIAS, rn Le moine d sa famille a, op.ci&, 1978, p.90 ct P A QUINN, Bener than the Sonr.,., 1989, p* 16-18,
Dans les Cuutumes & Chartreuse, Guigucs Iu s'explique en ces terms sw les raisons des Chartreux de refker les cnfaats :
Pueros sive adotescentufm non recI;arimrs, quaepw ear molu~steri& mufta contighse dofemtrs et magna, spiritafia simul et corparafia peri~uiafonniihntes~ sed Warm qui iuxta praeceptum domini per manum Mrryst viginti atirnim annorum, s o c ~ u ~ i n t ad beffa procedere. I, (Cuutumes de Chartreuse, (SC 3 13) Paris: a du Cerf. 1984, c- 1 ,p220).
Sur les Cisterciens, cf, J.H- LYNCtl, The Cistercians and Underage Novices M, Gteuza, 24 (1973): 283-97. M a l e leurs &dements s'opposant b cette pratique, ces deux ordtes regmnt A l'oaxsion des enf8nts dam
leurs rang% Au sujet des Chartreux, il ne s'agit peut4tre pas d'un simple hasacd, si les seuls oblats, dont Pierre le V&n&able dMt I'oblation saas dice qu'eUc fbt voIontaire, appiutemicnt b cet ordre (DM II,29,p. 1%) ! Pour les moines blancs, d: J. LYNCH, ibid, p295sv. Le cas Ie plus dtbre d ' d t non encore p u b h amen6 dam un monastke cistercien est celui d'Ami?dde (futw &v&pe de Lausannc, tcl159). Son p&e, le seigneur AmUk de Hauterive, entraina avec lui son fils A Bonnevaux quand iI y entra te 25 fdvrier 1120. Les Cisterciens refus&rent de donner I'habit l'enfant car il n'avait pas encore l'ee requis, mais ils ne le renvoyhent pas pour autant dans le si&cle, L'affaire eut ensuite de nornbreux rebondissemcnts puisque Amddde fire, jugeant que son fils ne recwait pas une t5ducation ad6quate en ce lieu, I'offiit A Cluny ; celui-ci l'envoya docs la cour de I'empereur gennanique pour €be ford (cf, la Vita du #re : MI-AnstIme Dimier, Vita Venerrrbifk Ameubei Altue R i p (fc 1 150)- auctore moncrcho q u h Bonaevaffensi synchrono et ocufcrto I,, Studio Monastics, 5 (1 963): I-VI,p273-9 1, [BHL 38Sb], &I- ~1160, peut4tre plus tardive). Outre le cas d'Amt?d& fils, Ie cartulaire de I'abbaye de Bonnevawc devoile au moins trois cas &oblation en 1160, c1160 d 1 195 (Ulysse Chevalier, CmnJaire & I'abbqye Noire-Donre dk Bonnevclux au dioche tie Vienne, or&e de Ci- prrblii d'4prZs fe mamcrit aks Archives natiodes, Gcenoble: Imp. Allier, 1889, #158, p.68-69, #160,p.69-70 et #53,p.30)-
UribL @-,coL63S-37. On tctrouve ccUe m h e critique chez GuiIlaume dlAndrcs, Chronicon An&emik monasterii Ordriis S-Benedicti in dioecesi Tmavensi ab a b o I082 ad 1234, dd. J. Heller, MGH SS 24, #49,p.705 ; cettc chroniquc, d g d e cntm 121 1 d 1234, rapporte ici des tvCncments qui prircnt place en 1 160- 6 1 (cf- R AUBERT, art. Guillaumc, abb6 d'Andrcs m, DHGE, XXII (1988): 840).
Cettc a w e contre I'oblation n'est pourtant pas beaucoup epandue, rnalgd ce qu'a&nncnt U- BERL&RE (a Le mtemcn t dam ks monastkes btnCdidim aux Xm' et XIVe sikles a, AcadPnie Roycfe de Befgique. C k s e des fettra et &s sciences moraks et poiitiqques, XWW6 (1924): 7) et I. BOSWELL (a [Clonstant complaints m, Kihokss..,., 1988, p.298). Ccs deux sources, Ulrich d GuiUaume, sont, h ma connaissance, les d c u principales c i t b pour Ics XI' et XIF sKcles. Auttcmcnt, ccttt mtme accusation a affleure & d'autrcs Cpques, mais trts dpisodiqucment : ainsi J M m t I'avait d€j& lanck au tout d6but de l'implantation de I'oblation, c t Lettre h DCmCtrias n°CXXX, dans Letbes, VII, Paris: Les Belles Lcttres, #6,p 172-73 et PA. QUMN, Better t h the Sum ..., 1989, n,115,p.434. Pour le XU8 sikle, il est souvent fait mention aussi des critiques de Gui'bert de Nogent contrc I'oblation, mais celui-ci ne p-te pas les monasteres comrne des ddptoirs, il critique simplement les moem relachb des communautds oti prddominent les oblats dues B leur absence de ferveur religieuse et leur mauvaise gestion (Autobiogrophie, Cd- et trad- E.R Labande, Paris: Les Belles Lettres, 198 1, viii,p.S 1).
des annes - s d a i t m t e m e n t Ugitirne aux yew des mohes, autrpment ils ne l'auraient
pas mentiom& cornme mode d'entde d'un saint, ou encore ils L'auraient &oq&
uniquement pour la critiqper violemment Ce revirement #attitude peut avok dB6tentes
causes, qu'il n'est pas & mon props d'Clucider id? L'important est de noter qw, dam ces
deux attaques contre l'oblation, le corps de I'dant reste I'enjeu majeur. La question de ce
qu'il veut n'intemient pas?
Une des causes du dklin de l'oblation a pourtant trait ;i I'esprit de I'enfant ou, plWt,
au manque d'esprit des oblats. En effet, les moines prirent conscience en cette deuxihe
rnoitit du XIe siecle que les enfants form& en leurs monast&es devenaient r n b plus tad
que ceux du meme &ge qui avaient grandi dans le sikle. Apds avoi ~ t C des puen' du
rnom&re, Bernard et Ulrich consacrent tous deux quelques folios aux iuuenes sub custodia.
Je traiterai plus en detail de ce sujet dans le chapitre W, d M 6 prkise'ment aux iuuenes ; mais
33, 11 fsudrait ddji savair si le pourcentage d'enfants handicap& a d d s dam les monastkres augmenta brusquement dans la deuxieme moiti€ du XIe sikle ou si nous avons affaire une situation stable depuis le Xe sikcle, rnais soudainement devenue inacceptable pour les moines h partir du dernier quart du XIe sikle, Je pencherais pour la seconde solution car je n'ai pas encore trow6 de raison pour expliquer fa premi&re : la hausse dt!mographique amor& en Occident il partir du M' sikle, avec la fm des invasions, ne pourrait en E t r e une, car une augmentation de la population nc donne pas lieu i un pourcentage pIus &lev6 de ddbiles physiques et mentaux. 11 faut plutbt se pencher sur les motivations d'Ulrich : pourquoi vitup&re-t-il de la sorte contre certains de ses con- ? Bien qu'il ait &6 offect tout enfant ii l'abbayc de Saint-Emmeran, il compte au sein de I'ordre de Cluny panni les convertis tardifs ; et il se plaint que le pouvoir soit aux mains des obtats, I& oh ils sont majoritaims :
[ a p e avoir mention6 1a pm*qye de ccrtains parents d'abandonncr a w monastttcs leuts enfants "semihomirtes wl itasemivivi", il s'attaqyc am oblats qui sant sains de corps ct d'esprit] qumto minus ub illis qui bonae sunt vaIetudinik. ubicunque fanti sunt congngati, fantaeque pafentiae, habifudu monastalisit ih UIorum manu ? E@i&m quae i6i sit vita, qui vigor d h c @ I i ~ e reguImis. amnes sciunt. quicunque sciunt id genus mo~chonun ibi regnare. Adeo tritum est et uxitutaim, si qua dhtrictio hujus spiritdb militirae i&er has natrortlm tempwwn/clw:es esse potest, no@ esse, nijl ubi major mi numew et auctoritus major i&8orum qui nu# oetate laschu. nee iiryrcrio parenturn sed s p n t e ma. et mqbrb aetatis, solo Chttjto impante, ad ejur se obsequium rebus saecdi abdicatb contaiIenrnt- * ( U ' L &pi& ,63 6-37)
J'avancerai ici unc hypothhe. Lt phhomhe v&itablement nouveau de la dewi*me moitib du Xl' sikle n'est pas une haussc dc la proportion dcs handicap& dans Ics couvcnts mais l'arriv6e massive d'homrnes c o m e Ulrich. Auparavant minoritaircs, ils ne powaicnt gutrt exprimer leurs revendications, Lorsqu'ils devinrent plus nombrcux, ils se petmirent d o n d'attaquet lcurs concurrents, les nutriti, pour I'obtention des charges importantes. Pour ce faire, des auteurs tel qu'Ulrich rendirent inacceptable me f i i t 6 longtemps pratiqude pour le bonhcur des monastkres, qui ainsi se rernplissaient et s'enrichissaient, et des parents, qui ainsi se d~bamssaient des enfants inutiles : I'oblation des plus faibles.
H. Selon Ulrich, les convertis volontaires font de meillcurs moines que les autres (cf. citation supra) ; mais il ne juge pas inadmissibile de contraindre quelqu'un ih &re moine.
egg& despuen'et le fait @'on ne Ieur decemait auaur responsabiite ne pouvaient donner
lieu qu'l des adolescents tnmahrrrs#.
L'enfmt donnt par ses parents et accept6 comme oblat etait entihment ddpourvu
de libertt de mowement et de parole, depuis son en& B l'abbaye jusqu'au moment de sa
profasion. Cornme pour l'ensemble de la comrnunaute clunisienne, ses fdts et gestes
devaient &re le fhit, non de sa volontt propre, mais de sa soumission aux rtgles et
coutumes ; mais, il la diffknce des moims (exception faite des imenes sub ct~stodiu), il etait
sorunis a la tr& stride surveillance des maitres. Ceux-ci devaient observer ses actions avec
me telle attention que l'dmt ne powait prononcer utle parole ni fairp un delacement hors
de leu champ de vision. J'en domerai un exemple, particdi&rement parlant car il est un peu
e e m e : il s'agit de la surveillance exem% sur les enfaots pendant qu'ils sont aux toilettes,
c'est-B-dire en un lieu plus dangeureux que d'autres puisque I'individu s'y denude
partieUemenf7. Bernard et Ulrich abordent ce sujet ii trois reprises. Ils expliquent en premier
Erik ERIKSON a &voqu& les dangers B long tame d'une autonomie retard& ; ses conclusions, obtenues B partu de l'analyse d'individus du XXe sikle, ne peuvent pas &re appliqu6es tel ls quelles au monde mddidval ; mal@ tout ses affmations rappellent btrangement le tepmche dnoncd contre Ies moines noirs d'avant Ie MI' sitcle (qui etaicnt, pour la majorit&, d'ancicns oblats) :
a For if denied the gradual and well-guided experience of the autonomy of fiee choice (or if, indeed, weakened by an initial loss of trust) the child will turn against himself all his urge to discriminate and to manipulate. He will overmanipulate himself, he will develop a precocious conscience. [...I It is also the inhti le source of later attempts in adult Iife to govern by the letter, rather than by the spirit. 9 (Chiidhood rurdsociety, New York: W.W. Norton & Co., 1963 (2' a), p.252).
I1 est dvident quc ce type dc ghCraiisation doit &re employ& avcc beaucoup de pdcautions, comme I'illustrera I'exemple suivant. Won L. MILIS, l'impottancc accord& h I'oMissance dans Ic mondc monastique mddidval expliquerait pourquoi Things changed very slowly during the Middle Ages, at least until the twelfth century 9
(U Children and Youth. A Medieval Vimpoint 9, Pae&gogka H&tw&a- Intemationai Journal of the History of Edircotion, 29 ((1993): 30-3 1). Je vois difficilancnt comment I'oMissance appliquCc h I'inweur des abbaycs en canfornit& avcc Ics dglcs monastiqus aurait pu avoir un impact sur la sociCtC rnCdi&de en son entier. I1 est peutdtre possible d'affirmer quc I ' o W i c e exigtt par Ics parents, aussi bica charnels que spirituels, donna lieu ih une cercsine stagnation de la sociNC du haut Moyen Age ; mais je trouve ces accusations dc "stagnation" t& subjtctives. En revanche, Itaccusation lanctt contre Ics moincs noirs d'avant le XIIC sihlc, qu'ils attachaient me importance trts grande au comportcmrnt cxtCrieur du moine ct h I'application de la rhgle ct de la coutumc, cst aisement vdrifiabte h la lecture des coutumiers. Savoir si oui ou non ce type d'attitude dtcoula de l'absence de 11'berte hiss& aux oblats appartrknt au damaine de la speculation : l'idee restera attrayante, rant qu'il ne sera pas dCmontd qu'elle cst fausse ; mais il est impossible de prouver qu'elle est vraie.
*. Le fait que, pour les rnoines, I'acte d'aller aux toilettes correspondait ii un moment propice au mat est attest6 par leur association Mquente entre ceae occupation et les apparitions ddmoniaques. Le DMen donne
lieu comment un dt, q~ veut alIer fate ses besoins de nuit, ne peut y aller seul, ni seul
avec rm maitre, mais doit &re accompagn6 d'un d t r e et d'un autre enfa~1t3~ ; je reviendrai
en fin de chapitre sur ce dglement car il Ctait pequ cornme fondamental par les Clunisiens.
Les deux auteurs M v e n t aussa8t ap& comment les eafants doivent se cornporter dam la
salle d'aisance lorsqu'ils sont entow de tout le reste de la corrrmunaut6 :
a Cum mtem ctmcti @es f ibs et les enfaets] se levmen'nt ad nocn~nos, emat simul ad necessmias e t p e r i et mqistrr; ita ordimti ut jm de duobur praemiisi- Sedes eis in ntedio duobus circulis li&neiis suntpraenotatae, in quibus eis venientibw mllus mdet tit sedeat- CapeZJum non induunt, sicut a& nisi q m d i u sedent ; surgentes sfant nudis capitibus, iinvcem expectantes. m39
Le f&it qd b doivent rester de tout temps la ete d6nud&, except6 lorsqu'ils sont assis, trdhit
probablement le desk de sllrveiller lii oit l em regards se portent. Plus loin, Bemard et Ulrich
pdcisent ce qu'il faut fake lorsque les enfants veulent aller am toilettes P un autre moment
que celui oc toute la commuaautd est prdsente : le maitre doit alors se tenir devant e w
pendant tout Ie processus.
Sed nee ad necessarias nec ad lonun ullum divertunt, nisi semper duo sint simul, et urcs rnugister eorum in nwdio, qui nec sedet, sed stat ante illos ad necessarias, si defierit comentlllslllS ma
La surveil1ance des enfants n'est B aucun moment relSch&. Dtis qu'il f;ait sombre, ils
doivent etre tclairCs par des lantemes ou des chandelles pour que tous puissent savoir ce
qu'il leur advient Pendant les longues nuits d'hiver, un des mbitres doit se lever pour verifier
s'ils sont bien tous couverts4'. Celui qui se sera partiellement d&udk pendant son sommeil
n'est pas fouett6 -proprerfianes, expliquent Bernard et Ulrich : est-ce A dire que I'on
quelques exmples : ainsi, les diables apparaissaient aux Wres qui faisaient leurs besoins en des coins ret- du monastkre (cf, DM 17,pS) ou utilisaient les latrines comme voie de sortie (DM- 16,p33).
". Bern I,xxvii,p2Ol ct UdaL III,viii,coI.742C. 39. Bern I,xxvii,p2Ol et Uhl. III,viii,coL742C-D. 'O. UdaL l,viii,co1.745B et Bern I,xxvii,p.207 (en plus succinct). 'I. On ne craignait pas que les enfants prcnnent h i d (bien que rien n'interdise de penser que cette cause
ait aussi 6tk prise en compte), mais que leurs corps d6couverts ne deviennent visibles ii d'autres fieres. Sur ce theme du corps partieilement denude pendant le sommeil et I'action des ddmons, cf. DM 14,p.46 et 17,p.54. Sur ['attrait que pouvait reprbenter le corps du jeune oblat aux yeux des moines adultes, cf. infia
craignait que les cris de l'&ts ne tmublassent le sommeil des Mtes42 ? - mais le maitre
le dveille du bout de son fouet d le fait se miew disposer- Un autre exemple de cette
sumeillance incesante est qu'il n'est nulle pucstion de temps de jeu porn les oblats. On sait
powtant que de telles @iodes de libcrtt &ient accotddes dans certains monast&s.
Hddemar, dans son commentaire de la RB, parle d'me heme par SemajIIe, ou par mois, selon
le bon vouloir du rnalt~e'~. Dens ses CoItoquiu, l'abbe d'Eynsham AeEc (tc1020) Cvoque
aussi ces mdes de dWte pour ses t&s d61dspueri scholmes : elles 6taient de dew
sortes, ceues, courtes, tandis que les e-ts attendaient le maltre, et celles, plus longues,
certains jom de mes, qquand les e d i t s obtenaient la permission de sortir des b&timents du
doitre? Je n'ai trow6 aucune mention sur ce sujet dam les coutumiers clunisieas". Or la
=. a [...I si quik @sorum est discooperhc~, tanturn rangit vtiga lwiterpropter Frutres (Bent, I~xviiip.203)- Une autre explication serait que le terrne @sorum fasse dfbrence aux autres maitres (dont la position des cowertures devait aussi &re v&ifik par le maim principal). Sur Ie fait que les hems et les infunfa devaient Etre entitrement couverts la nuit, cf. LTII,lS4,p.225.
I1 existe une autre restriction aux coups dom& aux enfhnts clunisiens, bgalernent intrigante pour le lecteur modeme. Bernard et Ulrich pdcisent que, si Ies obIats cornmettent une emur pendant Ies Heures, soit dam la psaImodie, soit dans un autre chant, soit en dormant, leur coule et leur h c leur sont irnmddiatement reti*, et ils sont fouettes en simple chemise. Or, Bernard peise que ce chibiment ne p u t avou lieu qu'en L'absence des IaTcs, de crainte qu'ik n'ape~oivent la scene (a n&i Laici sint in ecclesia. u quibus videripossint m, Berm Ipcvii,p201 et cf, UdaL III,viii,co1.742D). Tds probablement, les moines de Cluny ne voulaient pas se voir accoler I'image de boumaux d'enfhnts. A moins que le problhne n'ait consist6 dam le fait de dhhabiller le fautif au vu et au su des lam.
Pour une raison que j'ignore, il fit a f f i d par plusieurs histonens que les en&& dormaient dam un dortoir stpard de cclui des advltes (ct par exemple LH. PIGNOT, HHirrorie h I'orrlre.., n, 1868, p383 et P. RIC& et D. ALEXANDRE-BIDON, L 'etficurce,.., 1994, p. 1%). I1 est pourtaat &rit :
fi,Jprimo siml in loco [una) dormPorii jocent, & singula eorum lecta a Magktrorum eotum lecth sunt dbcreta ; milus eo aliw accedere praesumit. 0 { B e m I,xxvii,p20 1 et U&L III,vii jco1.742C avec, entre crochets, les mots absents d'UribL et, sans italique, les mots d'U&lI absents de B m ) .
I1 est donc affirm6 qu'unc --on du dortou (sous-cntendu, du dortou commun) &it rtservd aux enfants. I1 est de plus spW% que persome hormis les c n h t s et les mabcs (a mIIw diur n), c'est-adire aucun des tXres adultes, except6 les ntagistri, n'avait le droit de se nndre en cctte partic du dortou (a eo m). Cc passage a Ct6 traduit par P. RIC& et D. ALEXANDRE-BIDON cornme suit : [..I ils dormcnt ensemble h s un dortoir et leurs lits sont de part et d'autres de ceux des maim, c'est pourquoi personne n'ose s'approcher d'un autre. I. (ibid ).
''. Et h a notundurn at: pr0pte.r naturam humanmn, nefimgutur, per hebdomadum velper mensem, pour vi&it magister, debent iili i 'mtes in p r a m vet in alipem locum ire et magirter illorurn cum itlh. ut dimitfat illos jbcari usque unam horam. &ide &bet i tmm habere mtodiam super illos mugnam. m, (Hihiemar, 37,p.418-19). Cf. M. DE JONG, Growing up ... n, p.113-14 qui cite d'autres exemples.
U. W.H. STEVENSON, Earfy Scholastic Colloquii, (Medieval and Modem Studies, 15) Oxford: Clarendon Press, 1929, #9,p.32 :
r "Domne rnagister. ficet nobis Idere padisper ! quia modo scimus bene nostros acceptos et nostras Iecriones et responroria n o w et anrr;bhonas nostras. "
rknktion est par excellence me pause au cours de laquelle l'enfsnt choisit de lui-mhe ses
~ccupatiom, organise son temps selon son rythme propre, inwnte ses rZgles de
comportemeat et reddfinit m e nowelle h i h h i e avec ses compagnoas de jeux (mjetant
ternporairement celle qui lui est imps& par sa commulsautt) ; en d'autres mots, il s'agit
d'un temps d'aflhation de soi4.
"Etiam Iicet ; quiiz festivitar est, i&o uobh Iicentiam do mod0 hw: uice iocpndi wque ad signum uespertintan " "Bene est nobis modo, quuduitn'rm~~ ! Pergarnus om= simui ioctarefikis crun b d i r nestris et pila nmtra seu trocho nos@oOw~
Cf. aussi ibid, #3,p.28 et #6,pJO. Les Colloquia originaux d'AeWc sont @us et iIs ne subsistent plus que sous h fonne remanit% par son disciple AeKc Bata (ibid, p-vii. Se ne pense pas que ccs te-, qui servaient ii enseigncr le latin aux jeunes moims anglo-saxons du moaast&rc, peentent une image tout fait reprhntative de la vie c l o M : ccrtaincs scenes sont trop oniriqucs, comme cette d-ption d'un repas qui eat fait bonneur Rabelais (ibid, #11,p35-36) ; d'autrcs pmviement peutdtre de sources plus anciennes. Pourtaut, ces temps de tedation devaicnt bien exister dam les faits, autrcment I'autcur ne les aurait pas fait miroitcr aux dl&vcs.
Selon S. SHAHAR, les petites nonncs des Xme-XIVt sikles Mneficiaient aussi d'un temps &ewe pour le jeu, comme I'attestent les Vitae de 1'Cpoque (Chiirihood, 1990, p. 196).
Campte tenu de h grande pdcision des C O ~ C I S clunisiem en a qui a trait A h formation des eafbts, i! est peu probable que les auteurs aient simplement oubli6 de p a r k de ces temps de d d a t i o a Un exemple illustrera le fait que, pour les Clunisiens, hisser les enfhnts ii eux-mCmes, sans surveillance, meme quelques minutes, etait simplement inconcevable- Le lundi du Cadme, les rnaitres et les enfants devaient suspendre et ddpendre A diverxs hems du jour un tissu (cortim) dam le choeur. Or, Ie ddacteur du LT pdcise qu'A aucun moment les enfants ne devaient se tmuver seuls cachb par le voile : = InjFa @am infmtes sine mtodia numquam maneontI (LT 42.2,pJ5), Meme Ies temps de relaxation dans Ie cloitre, alors que les eres pouvaient discuter librement, dtaient strictemeat r@lement& pour les enfants : premi&rement, i1 ne leur Ctait pennis de pader qu'a I'intkriew de la schola (LT 1 S4,pZ01) ; deuxihement, si cette p6riocie de Iiktte prenait place apds Sexte, les enfants devaient dors se rendre au Chapitre et y rester compktement silenciewc (LT 154,pZZ03.
Dans ce qui p&Me et ce qui suit, je suis assez en accord avec ce quta&rmait J.-PI DEROUX il props de I'oblation B Cluny et des raisons qui tirent que cct!c pratique dCciina a la suite de I'asor de cct ordm : 8 A lire ces Constitutions, on a l'imprcssion d'un college, oh rtgnent la plus stride discipline ct la plus attentive surveillance, mais oh manque l 'atTion si n tkcsah l'tducation d'un enfant ; la situation de I'oblat n'y est guere diffmtc de cclle d'un mteme dc @on, mais d'une pension sans vacances, 05 l'enfant n'a jamais un moment de campl&e detente. I1 n'est plus un cnfant vivant en famille @a famille monastique], c'est I'inteme, soumis & la fdnrle de mar'tres qui souvcnt ne ie comprenncnt pas, l'astrcignant une discipline tmp rigide et trop aust6re pour son jeune 8ge- (L 'origine, 1927, p38 ; c f aussi p.48).
". A la d i f f h c e des ebb, a plus sp&ifiquement des oblats clunisiens, les enfants rest& dans le monde IaTque semblent avou bCn6fici6 d'une trb grande liber&& de mouvement pendant leurs temps de jcux (cf. S. SWANSON, a Childhood ... W, JWi, 16 (1990): 326-28 et C. DETT'E, a Kinder und Jungendliche in der Adelsgesellscbaft des m e n Mittelalters * (Archivpl KtlIrurgeschichte, 7611 (1994): 25-27).
Sur I'irnportance des temps de jcux, oii l ' d m t a le loisir de 8 jouer aussi bnrtalement et aussi bruyamment qu' i1 lui piaira ., cf. F. DOLTO, Psychoncrljve et Pairrttic Les grand' notions de la p~ychana&se Seize observa~iom d'et@anis, Paris: Seuil, 1971, p38 et p.48. fe juge utile de mentionner en note ces remarques des psychologues ou psychanalystes (quand il m'a CtC possible d'en prendre comaissance), car elles pennettent d'avoir un aperqu tout autre, et donc enrichissant, sur les questions mitees en ma thbe. Je considere mal@
L'enfant clunisien est un &e contmint & la passivitt!, non seulement prce qu'il n'est
pas de ses gestes, qui doivent &e accomplis en accord avec la coutume a surveillb
par ks Ma-, mais aussi parce qu'il n'a pas "voix au Caapitrew, B la di f fhce des moines
adultes. Ceux-ci sont autant de gardiens en second, qui pewent et doivent critiqyer les
actions despueri pour qu'ils soient punis en codquence dans la d e capitulaire4' : L ' d t
n'a pas ce powoir d'accuser, cette possi'bW d'agir sur sa communad, except6 au sein de
son petit gmupe. Entre les oblats, la dClation est encoufag&, et le fait de cachet la fbute d'un
autre est punie aussi s6vhnent que I'acte dClictuel lui-meme : le Chapitre des edants est
sp6cialement r&erv6 B cette finu. En revanche, au corn du Chapitre principal, celui qu'exige
la R2gle de saint Benoit pour statuer sur les flakes de l'abbaye, I'enfmt doit rester
silenciew. Cette affirmation va A I'encontre de ce que pens5rent diffd~nts histonens et
appelle m e dt5rnon~tration'~.
tout que le danger est graad d'appliquer de teHes grilles d'interpdtation aw. sources mtdi€vales ; et le liwe de Dolto offic un bon cxemple du pourquoi d t mes hatations. Erik Erikson, cit€ plus haut, a dtudi6 d'autres socidtks que la n&e (occidentaIe' capitalkte, de la deuxihe moitiC du XXe sikcle), ce qui h i a certainement permis d'acquCrir une perception asser relative de ce qu'est la nomalit& ; or, tel ne fut pas le cas de F. DoIto. Pour celle-ci, notre facon d'Clever les e n h t s aujourd'hui a ccrtes besom &&re amCliode, mais reste la nome B suivre. Par consequent, docs que Ic sewage tardif a &ti et est encore pratiqud dam la majorit6 des cultures, Dolto pense qu'il faut absolumcnt qu'il prenne place au 7' ou 8' rnois, autrement les enfants 4prouveraient de la a difEicultt5 a jouir compl&ement de leur facult6 d'aggressivite sans provoquer un besoin d'auto-punition, . (ibid. p.32-33). D'aum part, alors que la charnbre individuelle est une invention tardive du Moyen Age, et, encore, uniquement pour Ies couches t& ais€es de la population, Dolto afhne que I'cnfant devrait toujours coucher dam une autre pikc que cclle dcs parents, avtc la prte fcrmb. Cela d&s Mge de 6 mois au plus tard. On tviterait ainsi la plus importante cawe de nwosit6 chez I ' e n h t (ibid, p.5 1).
". Lcs iuuenes ne sont pourtant pas lib= d'attaquer Ics pueri au Chapitrc principal. k rcviendrai sur ce point au chapitre suivant.
a Recfamant alter & altero, si tale quid n d t & ifh8 aut si r2eprehendim de industria cefare, vapuht tam qui celaverit8 q u a [illel qui &Iiquit, r (Bern I,xxvii,p.207 ct U&L III,viii,coI.744B-C). Ce Chapitrt existait d6j& du temps de la &action dcs Cometudines antiquiores, c'est-hdi au tout ddbut du XIe sikle (cf. C4 7,p.lZ). I1 avait lieu immddiatcment ap& I'autm9 mais B la diff'rence de celui-ci, il Ctait assez fiequemmcnt annuK : pour les cinq f&cs principales de Cluny, plus 1e jour de la Purification de la Vierge, le jour de Ramcaux, le jour de I'Ascension, Ies jom de rasage, bains, nettoyage des vetemcnts, labeur manuel et lorsque quclqu'un devait ?trt cnted h cettc meme hcurt (ibid), J'en parlcrai 8 nouvcau B propos des corrections in f l igb aux enfants.
*. Parmi les auteurs qui considhcnt que Benoit pemettait a m enfants d'avoir voix au Chapitre se trouve A. L E N T M (a 11 rnonastera-famiglia creazione di S.Bencdetto a, dam Discorsi e Codereme tenuri nelle celebrazioni cassinresi per if XV centenatio delta nascita di san Benedeto (480-1980)' (Monasti~a~ D. MiscelImea Carrinesse, 46) Montecassino: Pubblicazioni Cassinesi, 1984, p.279). Les conclusions de cet auteur timoignent de I'importance de savoir si oui ou non cate conviction mjcrstifik : Questo ascolto del pensiero altrui 6 un dato molto cospicuo, che awicina S-Benedetto ai nostri tempi democratici, specialrnente post-
La croyance en i'intervention des d t s Iors de cette importante &mion repose en
partie sur la juxtaposition de dew phrases de saint B d t dam sa dgle, qui sont t d s
6loigaCes rune de I'autrr a qu'il n'y a pas de raison d'8SSOCieP'. Benoit declare que L'ordre
hibrchique m doit pas d@endre de P e e , mais de la date d'entde a des qualie discem-
par I'abbi : a aetas non discemt ordines necpraeiudicet, quia Samuehel et Danielpueri
presbiteros iudicauemnt 3'. ll est inddniable que cette p b vise s'opposer B ceux qui
m k n t d'accorder am mts un rang dl& dans L'ordo. J'ai dtja analyd ce rtglement de
Benoit dam le chapitre pnicddent, pour ddmontrer que, premkment, I'abM de Nursie en
diminua lui-meme la pode en le faisant suivre immediatement de certaines restrictions pour
les pueri, deuxi*mement, qu'il ne fut probablement jamais appliqu6 par les moines, meme
avec ces restrictions, si bien que les enfi ts se retn,uvQent au plus bas des dchelles
h ihh iques monastiques. M a l e tout, le fait que cette phrase traite des enfants pr6-pubires
est attestC, non seulement par I'usage du terme pueri, mais aussi par le choix des exemples,
Samuel et Daniel, de la bouche desquels la vdritt5 fba aloa qu'ils etaient encore edants. I1
en va autrement de la seconde phrase de Benoit. Dam le chapitre rdserve aux dilibdrations
capitulaires, celui-ci dklare que, lonque des dicisions importantes doivent etre prises pour
le monast&e, a Ideo autem umnes ad consilium uocari dmmus quia saepe iuniuri Dominus
reueiut quod melius est. rR Benoit ne parle pas ici d'enfant mais de iunior. Toujours au
chapitre pnickdent, j'ai demontr6 que ce terme de iunior designe le plus sowent les moines
profes ayant peu d'anciemetd et n'occupant pas encore des postes de pouvou, en d'autres
mots, des h s n'etant dtjii plus despueri mais pas encore des seniores. Si tel est le sens i
domer au terme iunior utilise dans ce passage et compte tenu de ce qui pdcdde dam la RB,
on peut alors retranscrire l'idk de Benoit comme suit : les seniores sont libres de prendre
les decisions concernant les affifaires mineures, mais, pour celles d'importance, ils doivent
conciliaci, in cui si awerte tanto il bisogno della fonnazione alla corresponsabilitA e il rispetto per la dignit& della personalitil umana, anche det piir debole nella scala sociale. * (ibid)-
? P. RIG* entre autres, est =jet & cette emur : = Beaedetto pensa che il pame del fmciullo debba essere rispettato come quello di Sarnuele e di Daniele, e ammette i giovani monaci al Consiglio. (at a Educazione e monaci v. DIP, 3 (1976): 1064 ; meme idCe dam id, &ucation et mhre .., 1962. p.509.
''- RB 63,s-6,p.644. "- RB 3,3,p,452-
domer Ie h i t de parole aux iuniores. Dans quel cas, Benoit affirmerait lui-mhe que les
e h t s n'ont pas vok au Chapitre.
Malgd tout, imior peut aussi prendre le sens de "tout moine qui n'est pas seniorn,
c'est-&dire dfigner ausi bien les iuniores que les pen'. Dans une telle alternative, Benoit
accorderait aux enfants m e voix au Chapiw. Plusieurs indices incitent B penser que les
moines en g h t b l , a les Clunisiens en particdiet, ne se conformkent pas B semblable
injonctio11. Benoit etait ddjh conscient que son r4glement - qu'il pork sur les iuniores seuls,
ou Ies iuniores plus les pueri - await du mal B s'imposer, puisqu'il jugea prt5ftrable de le
justifier : pour ce faire, il nn'6voqua pas les qualitds intrhQues des iuniores, d s le fait que
Dieu les utilisait parfois comme commie de transmission pour parler aux hommes. Une telIe
explication trahit le peu de valeur accordtie aux capacitb de jugement des iuniores?
n. J'utilise B dessein ce tenne un peu rneprisant de "courroie de transmission". Certains histonens dvoquent les miracles d'enfants, Sg& d'un jour, dew mois, meme trois ans ou quatre am dnonmt une grande veritd religieuse, comme preuves que les enfmts en gCntral Ctaient pergus par les hommes du Moyen Age comme des ttres meweilleux, qui pouvaient dire des choses sensees et sen& d'intennddiaires avcc le Divin (ct par exernple A- BENWNUTI PAP1 et E. GIANNARELLI, a Santi bambini, santi da bambini m, dam Bambini spllli, op.ciL, 1991, p.12 et L BERTHON, * Le sourire aux anga ... m, o p c i ~ , 1993, p.94-97). Je mentionnerai un autre miracle pour montrer ce qu'il y a d'erronb dam un tel raiso~ement : I'histoire de la foi qui fit &placer une montagne (qui se rrtrouve, par exmple, dam le Devtjement du m o d de Marc0 Polo). Une telle anecdote ne fit conclurc P a u m chcrcheur (a ma comaissance) que, pour l a hornma du Moycn Age, la montagne un r6ceptacIe a i d de Dieu a y e ce d6pIaamcnt &it la pnuvt que Ics montagnes avaicnt des jambes. L'Cnonciation d'une vtrit6 par un tnfant &it pcrquc comme un miracle par les hommcs du Moyen Age parce qu'ils considCraient lcs i@curtes comme dcs &cs incapables de p a r k sinon pour dire des bttises (le tenne igans proviendrait de "non fd, cf. Anncxe C sur l a dCfinitions des &cs ; cf. supra au =jet des ineptim i ~ ~ i f e s ; les hagiographes d'Odon et de Hugues demandcnt II Dieu qu'il parle II travers cux, lui qui rend diserts Ics muets et Ics petits enfimts, cf. YO1 Prol,,col.4SA ct YIlr II,xiv,p. 104 ; etc.) ; ainsi, Ics paroles sages en provenance de la bouche d'un eafant, puisqu'elles ne pouvaient en aucun cas provcnir de son propre cerveau, devaient avoi. 6td dictCes par le Seigneur.
I1 est possible que, & pa& du Xm' sikle, avec la croisade dcs enfants (qui den Ctaient pas) et la multiplication dc *its de saintes dmccs, Ics mfants k n t cffectivement petgus comme des intermddiaires priviltgib enm Dieu et les hommes, mais je ne penst pas qut cette image s'applique aux siecles anterieurs. Les miracles l ib h I'enfmce que E. GIANNARELLI d€crit dam son be1 article 8 Xnfandh e santith (dam Bambini sanfi, op.cit., 199 1, p.45-49, soit concerncnt l'enfant mais ne sont pas de son fait @ar exemple les signes pdcurseurs de sa naissance et de sa saint&), soit pdsmtent I'enfant comme un pantin au travers duquei Dieu s'exprirne (par exemple foetus ou bdb6 de trois jours qui parle). PIutdt que d'attester d'une croyance en I'enfmce comme interm6diaire avec le Divin, de tels &its ne sont ii mon avis qu'une nouvelle illustration de la passivitt assignee B I'enfant,
Astreint au silence lorn du Chapitre principal Penfant n'avait donc aucun powou au
sein de sa communaut.6. Il exktait mal@ tout, au m o b jusqu'ii 1'Cpoque bodilon, un choix
qpi lui Nait lais& : celui de &per son codisem. Le LT qkirfie en effet que chaque p e r
pouvait elire pour cette fonction I'abbt, le prieur ou le doyens8. Cette possibilitt a peut4t1e
disparu au moment de la rcdsction du Bern et de I'U&L pukqpe aucun des dera auteurs ne
pale plus de choix. Bernard laisse les novices dCsigner Ie confesseur qu'ils ddsknt, mais
d6clarr simplaneat & pmpos des d i n t s que l'abbe attend leurs confwsions au Chapitre, o~
le m*tre lui ambe les petits, taadis que le prieur va lui-meme les chercher puis les ramhe
de la scholu au Chapitd9. Les memes pdcisions se retrouvent chez Ulrichw.
Quoi qu'il en soit, cate confession bi-hebdornadaire B I'un des trois personnages les
plus hauts en grade de l'abbaye, plus le mandatum accompli chaque dimanche par l'abbe
avec les enfmts6', pemettaient aux petits d'avoir dguli&ement des contacts directs avec les
+rieurs du monastQe. Bien &, ces rencontres n'avaient pas comme objectif premier de
f& &outer P l'abb6, au grand prieur et au prieur c l a d , les complaintes des oblats ; au
contraire, leur fonction, comme d'aillem celle du Chapitre des edants, Gait de mettre nu -
les fautes des petits. M a l e tout, dam les dew cas, on peut supposer que les infntes en
profitaient pour faire &at de leurs griefs. Leur auditoire consistait volontairement en me
minime portion de la communautC, mais il s'agissait de la plus p~issante~~. Ainsi, privks de
liberti* d'iatimite, de detente et de pouvoir, les oblats clunisiens avaient au moins la
possibilite de se faire entendre.
sa. Cum uwo priori uel decano claustri uoluerint esse confcssim cum magister ad @sum eos perduxerit, statim ipse recedat, rn (LT 16S,pB8),
59. B e m I~wiii,p. 175, I,i,p. 138, et I~xvii.p.203. "O, UdaL III,iii7c01.737B et Uk1. III,viii,col,747B-C (a Vicibur duabtrs in septimana veniunt ad
co~essionemm qum non recipir nisi domrmr abbar, velprior mojor, vei ille qui tenet ordinem w).
6'. WdaI. m,iii,co1.737A et Bern. Ipcvii,p.204. ". Outre ces contacts avec les plus haut gradCs dc la communautd monastique, les enfants devaient aussi
recevoir la visite frequente du camdrier et du cellerier. Ces derniers avaient pour mission de verifier que les mernbres de la schola ne manquaient de rien sur le plan strictement materiel (cf. par exemple UdaL IIT,viii,co1.744C). Je reviendrai sur ce point dans la section C1 de ce chapitre.
2. Une formation qai ne fkvorise guke te dCve1oppement de I'iatelligence
Pour les hagiographes clUItiSiens (comme d'ailleufs pour bien d'autres auteurs
m ~ d i h ~ , I'enfknce est, dans I'ensemble, un stade qu'l faut vite traverser afin d'atteindre
sans trop tarder le coeur du &it. Con= et auditoire m se pennettent de p a w pendant ce
premier Sge p s'il d e n t un bhement merveiI1eux qui, soit atteste de la saintet6 fbture
de I'edhnt, soit est lit5 ii la question de l'entrte en religion. Dans la Vie de Ghud, il est
avant tout question des h&tations des parents entn d&iier l 'edht h la vie ecc16siastique ou
le former au m&er des armes ; dam cetle d'Odon, de l'oblation de l'enfant h saint Martin
faite par son p&e et de la vision survenue au pr&e qui I'6duquait ; dans celle de Maleul, de
l'application de l'enfant aux ttudes eccl~astiques ; dam celle de Guillaume, de la vision de
sa mkre, de l'oblation de I'enfsnt et du miracle de la vieille femme, etc? Autrement,
l'existence enfantine i n t h s e peu ou prou, ce qui est comp~%ensibie puisque le heros y est
decnt et pequ c o m e totalement passif.
Pour que l'enfaat traverse rapidement ce premier ige et devienne enfin un adulte
conforme aux voeux de ses sinks, il faut le former et donc l'appliquer am 6tudes6? Ceci est
Cf, au sujet des auteurs de romans des XIIe-XUIe sikles et pour les parents de leurs heros, D. Desclais BERKVAM, Egme... , 198 1, p.28-29 : a I1 arrive ensuite cap& Ie &it de la naissance] que les parents n'aient qu'une hate, c'est que L'enht grandisse. On sent alors que I'enfance n'cst considCr& que comme un passage dont il faut pmrdre grand soin, mais qui nc dispense des satisfdons que lorsqu'on en so& m- J * C POULN note, B la lecture des Yirue caralingiennes de rA@mine : Qucl quc soit le sexe dcs saints, la pcrfection Ctait une &ah d'adulte ; I'intC&t de l de I'existence d'un saint ne cornmen@ qu'au moment de sa conversio. (L *id&[ de suintetL, 1975, p.43-44). P. RIC& et M. GOODICH font la m h e constatation la lecture des Vitae, respectivement, prC-carolingiennes et du Xm' sitcle, mtmc si ca demi8m 6taient plus riches d'infonnation sur lc premier Q e que ler sources des sikles antdrieun (Cducation et aftwe &ms f 'Occident borbme, 1962, p276 et = Childhood and Adolescence among the thirteenth century saints m, M, 1 (1973): 286). Enfur, A. VAUCHEZ note pour sa part un progrcssifintMt pour ks a n n b d'&cc & partir des prod de canonisation du X W sikle (to saintde' en Occi&nt (M h i m siler & Moyen Age d 'aprb lesproceF de canoniration et les d m e n t s hgiopqhiqrces, (BibliotheqUcs des Ccoles 6an- dTAth&nes et de Rome, 241) Rome: &ole fianme de Rome, 1981, p.594-95).
U. Comme je l'ai dtjh souligne auparavant, cenains hagiographes s'attardent tgalement sur le t h h e de I'ige d'enfance, le plus souvent pour me= en valeur les qualie du saint, si differentes de celles de ses contemporains du mime 5gt (cf. supra la section A2).
Comme J. LECLERCQ l'a k i t a props de I'Cducation des oblats : 8 les enfants sont considdds comme ind&ermint?s' capables de devenir ce que l'on fera d'ew, B (8 Pedagogic et formation spifituelle du VIe au IX' sikcte a, dans L a scuola neIl'Occidente latino dell'ulro rnedioevo, (Centro di Studio sulI'aIto medioevo, 19) Spoleto: Presso la Sede del Centro, 1972, ~ 2 8 7 ) .
vrai mOme pour les saints : le~ etudes contenu religieux sont jug& tellement
fondamentales arm yeux des hagiographes qu'aucua n'oublie de les mentionnet dans sa
description de I'enfitoce, m b e lorsque celle-ci est t&s succincte6? Nous avons d'ailleurs
mmqd, dam le chapitre I, qye le &but de 1'6ducation marquait Ia cCslne entre la prrmike
et la deuxihe a c e , B savok entre l'in$iantiu et lapueritio.
Dam la VZta Geraidi, W o n deait les diffikences entre IY&ducation chevaleresque et
l'eccl6siastiqge. La premihe est entiihment centrte sur le corps : L'eafant appread Les
diverses facettes de la chasse (mener les chiens, le tit I l'arc, le lbher du faucon, etc.) ;
l'auteur park d'a inane studium et de a h-mire in vumo m6'. La seconde se veut tournee
Dam ua or& d ' i d b assez similaite, ou il cst toujours question de la supdriorit6 de la culture sur la nature, on peut noter que 1 s hommes du Moyen Age essayaicnt de donner de l e m pmpres mains m e belle forme au corps de Ieur enfant en le massant, puis en l'emmaillotant d& la naksance : cf. MM. McLAUGHLM,
Survivors and Surrogates .., w, dans Hbtbry of ChiIdzood, op.ciL, 1974, p.113-14 et D. LETT, a La mere et I'enfant au Moyen Age -, L 'HIjtoe no I52 (I%), p.10. Ce d d c r auteur atlirme : Le corps du nomison est souvent cornpar& B de la cire laquclle on peut donner la fome de son c h o k .
66. La "nisistance consid~rable" des hagiographes de la Gaule mhvbgienne fkce sZ la supientiu mundiafis, qui Ieur t k h i t take certaines informations sur t'dducation de l e m saints (cf. M, HEINZELMANN, 8 Studia smrrorum. kiucation, milieux d'instruction et v d e m Cducatives dam I'hagiograpbie en Gaule jusqu'ii la fin de I'Cpoque mCmvingieme m, dam Culture, &ucation et Socii't5 khrdes ofl ies ci Pierre Rich&, dir. Michel Sot, L a Garenne-Colombe: tb Europde~e b e , 1990, p.108-lo), n'avait plus de rawn &&re aux Xe-XIIC sikcles, alors que le contenu de 1'6ducation 6tait devenu avant tout chdtien, A moins #&re, pour les IaTcs, essentiellement physique.
Deux exemples tids du corpus hagiographique clunisien illustreront I'irnportance accordde ii L'Cducation dans la description de I'enfance d'un saint. V ' ~01,94748 :
a Fuit vir irte* bentksimt~l~ Maio fur, praecloo stemmate orius ac nobifibus parentibus pervigili mra a6 @a i.antia nobifiter arulrttw. Procedkntepwll'rise tempore. add- cst ecclesiasticcis studiis ut imbuerctur fitter* spiritdib W. w
Dam la phrase suivante, l'auteur s'€rnerveille du fait que Makul ait m conserver sa virginit6 pendant son adolescence, On rctmuve ici la quintessence du dcit des prerni&res ann& d'un saint : noblesse des parents, education rcligieuse d&s I'enfance, chastete pendant l'adolcscencc. Dans le cas d'un saint IaVque, la formule ne change @re, sinon que le mjet de la virginii pea ne pas etrt abordb, a que les contacts avec de tds hauts seigneurs sont valorisCs- Tcl est le cas dans la Vita Burcmdi :
(I incfitus comes Bwchordus, nobifi stirpe progenitus, sacro baptismate est rentmu atque nobififer in religione cathofica militmi tirtxinio edo~nrs. Nam pueritip tempora dim transigeret* c w i p regafi* more fiancorum procerum* a pamntibur traditus est ; qui c~tianitcrtis operibus pollens totius prudentip atque honestatis assumpsit commalb ; itz ado enim gforiari Hugonis Francorum re@* nmcctis tam c#estibur quam mifitaribur imbuebatur i m t i . . r (Kt? 1,p.S).
L'hagiographe abode ensuite Ie th&me de l'adolesccnce du hCros. Dam ces deux extraits, les verbes utilisds pour 6voquer l'tducation des saints sont au passif; le savoir est deverd sur I'enfant. Celui-ci ne I'acquiert pas : il en est "imbibE Je reviens plus loin sur cctte formute trb particulih.
67 . .I SciIicet ur MoIossar agerer, arciktafreret, cappos et acc@itres cornpetenti jacru emitrere consuesceret. - (VG1, I,iv,co1.645B). La Vifu d'Odon, dans laquelle Jean de Saleme le fait raconter son enfance i la premiere personne, confume
sdement vers I'esprit : 19edht y apprend d'abocd le Psautier @ d & e &tape I laquelle
~csseulsedhtsdesbints B ~ B ~ I ~ S S O U I ~ S fils detrbgrandsaristocrates). Les avantagespour
I'inteIligence sont bien mis en evidence par I'hagiographe :
Quodeiposteu mulnmrpru~t, cum acres ingeniiper illud exercitium elimata, ad - omne pod wIIet, amtiior re&eretw. Ineruf autem illi vivax nentis sagucitas, et ad
dfscendum qucre vellet sat& prompta P
Odon &it un homme particuliihment cultivt! pour son 6poque et son goilt pour les etudes
transpan& I la simple lecture des Vitae Getaidi et Odonis ; riais il v6cut dam la premiire
moitit5 du Xe sitcle. Dam ce chapitre, je demontrerai que, un si&cle et demi plus tard,
l'objeaif de l'dducation clunisieme nY&ait plus taat d'affiaer l'esprit des oblats que
d'imprdgner leurs cerveaw d'un certain savoir pour les modeler ; la rn6moire des enfa ts
etait mise a contribution et activee, mais gu&e leur esprit d'analyse, et encore moins leur
esprit critique. Cette constatation Pa rien d'dtonnant pout qui connait la culture monasfique
mddi6vale mais merite d'&e mentiom& compte tenu du mode d'kducation qui se ddveloppa
progressivement ii partir du We sikle, tout particuli6rement dans les icoles cath6drales. Par
ailleurs, je veux mettre en vaieur le fait que la part la plus importante de la formation des
oblats clunisiens consistait B leur fake imiter les gestes et les paroles des profes. Or un tel
enseignement s'adresse davantage au corps qu'B l'esprit.
I1 n'existe, B ma connaissance, qu'un seul manwl monastique, expliquant en quoi
devait consister la formation des oblats, qui soit plus ou moins 1% au monde clunisien : il
le mepris du grand abM de Cluny pour le mode &Mucation dcs nobles laks. I1 en avait Mndfici6 pendant son adolescence B la cour de Guillaume d'Aquitaine ct avait peu appr4ci6 I'expCriencc :
Relictis t d m litteranma shrdiir, venotonm rnrcupumee cwpi &emire oflcib. Sed omn@otens Dear qur' imitir saI~lem praertat [..,I coepit me in som~ir tetrete, et vi(am memn p m m ad malum ostendere ; sed imper totam meum ve~tionem vertebat in fatigationem. (YO' 1,8,~01.47A-B). 68. VG1 l,iv,coI.64SB. Odon de Cluny Cnoncc une id& similairc dam son Occuputio (6d. A. Swoboda,
(Tcubncr, 187) Leipzig: Teubncr, 1900, UI, 1 13 1 ,p.64) ; cf. J* LECLERCQ, 8 Lcs Ctudes dans Ies monast&es du Xe au Xn' si&lm,, dans Las MoqnJes y fos Ejtlldios, IV ~ a n a de estudios monasticos, Poblet 196 1, Abadia de Poblet, 1963, p. 108. L'auteur de la VG? a comgt quelque peu l'aflhation faite par Odon dam la VG'. Les gains pour l'intelligence de GCraud n'dtaient plus rant act83 (avou un esprit plus aiguise une sagesse "vivm"), que passifs (apprendre et memoriser) : quod eiparten mulrum profirit, cum mem illius velud elimata ad ea quae veIIet instructiorjieret, el memoria sensarior ad tetinendum. (V@ p.372).
s'agit d'une oeuvre trop souvent associk aux novices alors qu'eUe den mentionne pas une
fois le nom, le Tractatus de ordine vitae et m o m ihstitutione (OU De Docrrinupuerorum
ou De V e r e d i a a&flecentum) de Jean, abb6 de Fndhlaria depuis 1014, d U 6 vas la mi-
XIe sikle? Il est signXEatif que, dam cet k i t , ce disciple de Guillaume de Volpiano ne
traite absolument pas de 1'6ducation inte11ectuelIe des moinillons mais uniquement des
qualit& morales et du comportement physique qu'ils doivent adopter. Son premier conseil
est d'acqudrir la ve re~ ld ia (d'oh I ' m des titres de I'owrage) : porn ce f k , outre la
virginit6 qu'il faut consawr, il est tgalement n&saire de p k son corps ii m e gestuelle
trks pdcise car vox quaed' cmimi est corporis motus mm. Le deuxi&me cornmandement
de Jean est d'obeir a m seniores din de devenir confonne I l'image de l'ap6tre Jean
adolescent : a E m enin, in eo senectus venerubiiis m o m et cana prudentia virtutum
omniurn m7I. Aussi, les trois qualit& que doivent acqudrir Les pueri adolescentes des
monast&es sontsIles la verecundiu, la taciturnitas et 1'oMissanceR. Deux des themes d6jP
6P Jean de Fmttuaria, Tractatus de ordine vitae et m o m i~titutioone, PL 184, ~01.559-84 (introduction : PL 147, coi-477-80)- Sur cc texte, cf. E, ANCILLI, L'opuscolo di Giovanni di Fruttuaria suila formazione dei novin' I), dam Monosteri iit ufta Ifafia dopo fe imaxioni sarracerre e magiare (sec- X-Xr), (XXXII Congresso storico subalpine, Pinemlo, 6-9 settembre 1964) Torino: Dep-one subalpina di storia patria, 1966, p. 167-74- Jean traite essentiellement de la formation des adoIescentes, non des infuntes, mais ses "adolescents" sont t& jeunes (il parle de per i lk vita, ibid, II,3,co1562C) et ont €t& offerts d& l'enfance (a ab ips3 fudimentrj infuntiae educoti mm-, w, ibid I,2,col56ID), Son opusculc abode ensuite les qualit& dernandees aux moines de tous 1 s ages-
Sur l'absence d'autres trait& de ce genre, cf. L-Y, TILLIE'ITE, = LC vocabulaire des dcoles monastiques d'aptes les prescriptions des consuctudincs QP-XIIe siklts) m, dam V'buIuire &.s Pcoles et des mdth& d'enreignement mr Mo)ren Age, Actcr du coUoque, Raw 21-22 mobre 1989, dd, 0. Weijas, Gtudes sur I t vocabuIaire intellectuel au Moycn Age, v) Tumhout Brepols. 1992, p.60-63 ct P. RICH& Sources pidagogiques et trait& &&hation W, dam k Enrrkes alms la vie Initiiion ef qprentksages, (?CW Con@ de la sociCtC des historicns mCdi&istcs de I'Enseignement sup6ricur public. Nancy, I98 1) Nancy: Presses Univ. de Nancy, 1982, p.20121. Les textes mentiom& par I. LECLERCQ, d m Tcxtcs sur la vocation et la formation des moms (dam Corona Gratianan, MuceIIaneo Pafrktica, Hfiforicu et Litwgr'ca Elijtyo Dekkers O.S.B. X2ILush.a Complenti oblata, II, Bnrggt: Sint Pietcrsabdij, 1975, p.169-94) et dans Deux opuscules sur ta formation des jeunes moines v (Revue d'usce'tique et de mystique, 32 (1957): 387-99) sont plus tardifs que Ie XIe siCcle ct concement presquc uniquement les novices. Cet auteur signale sinon un seul autre texte traitant de p&gogie monastique avant k XLl' sitclc - 00 il n'est question ici encore que d'apprcntissage de Ia grammaire a de la morale : il s'agit du manwait Stuttgart, Codthtol, 8" 68, qui rcproduirait, aux dires de I. Leclercq, un texte du XI' sikle (cf, Les dtudes dans les rnonasths du Xe au XIle siMe m, dam Lar monjes y 10s estudios, N semana de estudios monasticos, 196 1, Poblet: Abadia de Poblet, 1963, p. I 16-1 7). l e n'ai malheureusement pas pu verifier cette infonation,
Jean de Fruttuaria, Tractatus, ibid, II16,co1.564B. "- Ibid, 111, I01c01.S67B. R- Ibld I, 1 ,coI.S6 1 A.
abordk pr&demment sont donc prCscnts dans cet owrage : PidCal duper-senex a la totale
o b i i i c e demand& ara enfhts. Je montrerai en cette section que la graade importance
accord& au candle du corps et Ie quasi silence sor la formation inteflectuelie sont
6galement des caract&tiques de la formation clunisieme des oblats. Cette similitude de
m&odes 6ducatives mtre Clmy et Fnmuaria ne doit pas hmer puisque GuiUaume, form6
dam le premier, fonds le second?
a) Impdgnation du savoir
Compte tenu de l'absence de trait& decrivant l'enseignement intellectuel dispense
a w oblats, il n'existe gtkre d'autre recours pour comaitre celui-ci que les sources
monastiques nonnative~~~. Les statuts de Murbach de 8 16, qui servirent d'actes prt51-
au concile d'Aix-la-ChapeUe, demandent que les scolizstici apprennent par coeur, en premier
lieu, les psaumes, les cantiques et les hymnes, puis par la suite
a reguIa, post regulae textum Ziber comitis, interim uero historiam diuime auctoritafi et expositores eius necnon et conZationes patrum et uitas eorum Zegendo magistris eorum audientibus percurrant. Postquam uero in istis probabiliter educati fkerinr, ad artern litferaturae et spirituales se tran.$erantflores. m7s
n. Dam la Vita de Guillaume de Volpiano, Raoul GIabcr evoque I'adoption du mode de vie clunisien Fnrttuaria : bien vitc il se trouva en ct licu une munerosajktnm congregotio Daun timentiurn, institutu h i Benedicti ubbatir precipa seruuntes, qup kdem pater Wiifeimus a sancto Maioio Cluniaci didicerat. I (VW ix,p278).
". Le colloque d'Aelfiiic cst une some savourcusc pour comaitre les conditions dam lesquclles 1 s petits oblats anglo-saxom apprenaicnt le latin, mais non seulmcnt il f- s'en mCfier en ce qui a trait ii la description de l e u vie quotidieme, il cst tgalement de peu d'utilit6 pour savoir le contenu de I'enseignement du maim, hon du latin ct des c&glu de bon comportment (cf. supra ct P. RI-, 8 La vie quotidieme dam les Ccolu monastiques d'aprb Ies colloques scolaires m, dans Sour la r2gIe de saint Benoit : strrrctwes monustiques et so&d en France du M' Age b I 'Ppa~ue mudhe, Calloque de Pabbaye bcncdictine Sainte-Marie de Par* du 23-25 octobrt 1980, Gentvc/Paris: DrozfChampion, 1982, p.419-20). Pour d'autres manuels latins du Moyen Age, cf. Ian THOMSON a L. PERRAUD, Ten Lutin Sctooffex~? of the later Middle Ages. Tramiufed selections, (Mediaeval Studies, 6) Lewiston: Edwin Mellen, 1990.
Actmm praeIimirrcaium Synodiprimae aqurjgranensik commentationes, she Stafuta Murbacemia, dd. J. Semmler, dam Initia cansuetudink benedictinae Consuettidines saecuii octaui et noni, (CCM I ) Sieburg: F- Schmitt, 1963, p.442. Le Iiber cornit3 est un lectionnairc (cf. DU CANGE, Giossarium Mediae et inpmae la~initatis, 11, Niort: Fawe, 1883, p.422 et CyriUe VOGEL, Medieval Lincrgy : An In~roduction to the Sources, trad et rev. W. Storey et N. Ramussen, Washington @C): Pastoral Press, 1986, p.382, n.138 ; je remercie S.
La base pdncipale de l'education monastique est donc la mkmorisation des textes et des
chants religieuxf6. Les enseignants s'adonnaient Certainanent h un peu d'extgh et
d'analyse des &its et mdlodits que leurs Cltvcs apprenaient par coeur, au moins pour
bclairer certains points obrmrs de musicologie, grammaire, ou autren : ainsi, dans le
counnnjer de Fleury, d g t au tout dtbut de I'an mille, l'adjoint du prtchantre devait parler
am e h t s des a caracttns des modes a des miantes psalmiques rn (a t onom dzpnitiones
etpsalmorsnn disrnctiones w ) ~ . M a l e tout, cette &he dwait s'adter assez court, except6
dans les grandes abbayes rest& Celbtes pour l em activitks culturelles, comme Saint-Gall
ou le Mont-Cassin, ou sou la direction de dtres remarquables, tels Hildemar de Civitatem :
les chercheurs s'accordent en effet pour dire que l'kducation monastique n'avait d'autre
objectif que de former le moine au service divin et lui faire "nuninern la parole divine, d'oG
l'accent mis sur la mQnorisationm. D'ailleurs, les gloses des oeuvres i m6moriser, les leqons
Boynton pour m'avoir indique ces dfdrences). ". Cette constatation s'applique auai aux si4cles antdrieurs au conciie d'Aix-la-Chapelle, cf. P. RICH&
&heation et culture denr I'Occi&nt burbure, 1962, p.154-63. Sur Ies techniques pddagogiques utiiisCes pour enseigner la lecture, le chant et I 'hhre , puis la m&rnorisation des texts religieux, cf. Id, L 'enfmce. .., 1994, p.138-57 et B. MERDRIGNAC, Recherches sur l'hagiographie armoricaine.., I, 1986, p . 9 7 ~ . Sur I'importance de la mhoire dans la cuIture cwtienne en gCnW ct dam L'Cducation mCdi6vaIe en particulier, cf. Jeux de m6moire. Aspects de la mdmotechnie me'diPvaIe : recueil d'Phrdes, dir. B. Roy et P. Zumthor, Paris/Montm!al: VrinIPresses Univ. de Montdal, 1986, J. LE GOFF, Histoire et Mhmoire, Paris: Gallhard, 1988, p-11-42 et M. CARRUTHERS, The Book of Memory. A Stu& of Memory in Medieval Culrwe, (Cambridge Studies in Medieval Literature, 10) Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990.
". Ct la t h k en cows de Susan BOYNTON, Glossed Hymns in Eleventh-Century Continental Hymnarks n, au ddpartment de Musique de Bcandeis University ct Id, a The Didactic Function and Context of Eleventh-Century Glossed Hymnaria m, dam Der lateinische Hymltfls irn MitteIulter, €d. Andtcas Haug, Kassel: BiWnreitcr, 1997, ii pafzuatrc.
". Flewy, p.15. Cf. aussi Lu vie & moiha en I 'an mille, €d. A. DAVRlL, Gien: Imp. Jeanne d ' k , 1985, p. (17-1 8.
f). Le commentiiire de la RB par Hildemar, camp& ven 845, nc traite jamais directcment du contenu de l'tiducation offerte aux enfw, mais on y appnnd cntn Ics Iigncs que Ic cursus comprcnait non sculcment le chant et la grammaire, mais aussi la ma!hCmatiques. Selon Mayke de JONG W e line n'est pas repdsmtative, car peu nombma sent Its magirtri contemporains ou post€rieurs B Hildemar qui hucnt aussi inmuits que h i et donc aptes B apprcndrc autant de choses B lcurs Ckves (a Growing up ... w, op.ci&, 1983, p.1 IS).
'", Cf. par cxcmple J. LECLERCQ, Pcdagogie ct formation spin'tueUc du VI au IX siecle m, dans La scuola ..., 1972, p.260 et 268, P. R I ~ ah = Educazione e monaci w, DIP, 3 ((1976): 1057-65, D. ILLMER, Erriehung und Wicsenrvermitzlung imfihen Mittefafter. Ein Beitrag zur Ents~ehungsgeschichte der Schuie, (MOnchener Beitriige zur MediWi.stik und Renaissance-Forschung, VII) Mbchcn, 1971, p 3 1, Graziella BALLANTI, dans I'introduction de son edition du texte de Pierre AMlard destink A Astrolabe, Imegnamenti ajiglio, Roma- Armando, 1984, p39-40, M. HEINZELMANN, a Studia ssmtcmm ... n, dam Haut M~ Age, 1 990, p. 129 et p. 13 5, H. FICHTENAU, Living in the Tenth Century. MentaIities and Social Orders, trad. P.
des offices, la lecture au repas et au Chapitre, les a quatre ou cinq fedlets lus tow ies soirs
avant complies, les hems comacdes h la lectio ~ M M , qqui fhisaient de la vie monastique
m e #cmelle domini schoia senn'n'E1, permdent au mohe de tout 5ge de rnieux apprendre
et comprendre les textcs spirituels, jamais de les discuter ni les conhnter? La schola des
oblats n'avait gu&e de similitude avec la yeshiva contemporaine : si les 6coliers de celle-ci
deMimt d y s e r Ies passages du Talmud, pour ensuite rivaliser entre em et determiner qui
les inttqdtait avec le plus de brio, rim de semblable n'ttait encowag6 dans les ecoles
monastiquesm. Telle ttait en revanche, avec l'apprentissage de la dialectique et de la
rhetorique, l'occupation des jeunes clercs dam les dcoles dpiscopales et urbaines qui se
developphnt en cette m5me fin du XIe siiicleu. On peut comprendre aloa que les Mcs
prt5f-nt, l partir de cette tpoque, diriger lem enfbnts vers de tels centres educatifs? meme
Geary, ChicagoLondon: Univ, of Chicago Ress, 1991, ~284-85 et M.M. HILDEBRANDT, Eaernul Schools, 1992, p.25-56.
'I. A. DE V O G ~ La formation et I s promesses du mome c h a saint Benolt a, CollCi&., 53 (199 1): 50. O. Sur le fkit que le moine n'a pas h instmire ni il philosopher, mais doit seulement tduquer son entourage
par sa &$on de vivre, cf, Hugues de Saint-Victor, Dicibscalicon - De Studio tegendi A Critical Text, 6 6 C.H. Buttimer, (Studies in Medieval and Renaissance Latin, X ) Washington: The Catholic University of America Press, 1939, V,8, p. 108-09 = intro., trad. et notes par M. Lemoine, Paris: &I. du Cerf, 199 1, p.203.
A. GRABOIS, holes et structures sodales des communautts juives dam POccident aux l!X -XI1 sikles W, dans Gli Ebrei neII ' d o medibeyo. 30 marzo - 5 aprile 1978, II (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, mi, Spooleto: Prrssa la Sede del Centro, 1980, p.950sv. I1 est ici question de 1'. t?cole aux vieux w & la diff6rence de 1'. &ole aux jeunes l qui correspandait B I'dcole dltmentaire- Le programme de cette derni4re resemble fort B celui de 19&ole monastique : il s'agissait d'apprendre l'alphabet, lire les textcs bibliqucs et apprcndrt pat coeur des textes liturgiquts et la M~hlt4h [ibld, p.942). Bien qu'il puke pararb dii table de cornparer deux systernes scolaires qui nc s'adressaient pas cxactcment au meme groupe d'ige, 1'. &ole aux vieux * juive (dont les Ccolicrs avaicnt dCj& quintc ans, cT. M.A. SIGNER, 8 Honour the Hoary Head - The Aged in the Medieval European Jewish Community a, dans Aging and the Aged in M e d a d Europe, dd- M- Sheehan, (Papcrs in Mediaeval Studies, 1 1) Toronto: Pontifical Institute, 1990, p-44) et la scholu monastique, l'impottant est de noter qut, dam un cas, 1'~ucation des Clitcs rcligiewes se concluait par le ddveloppemmt de l'esprit critique de I'individu, dam f'autre non. La rnemcs remarques sont Cgalement valables pour la cornparaisan qui suit entre les 4coles urbaines et les Ccoles monastiques.
". Sur la diffdrence entrc les €colts monastiques et cclles Cpiscopalcs a urbaines, Ics dcrnitrcs encourageant l a tcolias il s'afkner, cf en- aumr U. BERL&R. bla c I a d es... w, Acadimie w e de Belgiipe.., 1921, p-567-68, C. BYNUM, The Spirituality of Regular Canons in the Twelfth Century : a New Approach W, dam MedievaIia et Humanktica Studies in Medieval ond Rena&sance Culture, 4 (1973): I 1 et J. LECLERCQ, L 'amow des lettres et le dkir de Dim Initiation aur auteurs monustiques du Moyen Age, Paris: &i. du C e ~ 1990 (3' Cd.) p.146. Sur les consCquenccs B long tame de ces divergences, les tcoliers des monast6res &ant des "traditionnalistes" ct ccwr dcs 6coles urbaines des "rt!fonnateursN, cf, L.K LITTLE,
Intellectual Training and Attitudes toward Reform m, dans Pierre AMiud- Pierre le Vin&able : les courants philosophipes, IittPraires et arfistiques en Occident au milieu dulYIP si&cle, Actes et memoires du colloque international tenu il I'Abbaye de Cluny, du 2 au 9 juillet 1972, Paris: ~ d . du CNRS, 1975. p.235-54.
(et surtout ?) s'il s'agissait ensuite, pour em, de briguer un poste de powoir dans un
Les mCtaphores utilistes par les moines pour dCcrire la transmission du savoir des
makes aux edimts mettent en 6vidence l'attitude totdement passive attendue des seconds.
Je ne mentiomemi ici quc deux autMq qui avaient des liens intimes avec Cluny et sont bien
conaus des rn&ii&&tes, entte autres pour Ieur relative clbnence ii I'egard des oblats,
Amelme de CantorbCry et Pierre Damien. Le pltemiet pade de cire qu'on imprime, d'arbres
que les sup&ies ne doivent pas tailler trop arbitrairement, de feuilles d'or ou d'argent qu'il
faut modeler avec dClicatesse'.'. Pierre Damien utilise pour sa part l'image du potier qui
modde I'argile sans rudesseU. A l'aide de ces images, ces dew hommes essayaient de
convaincre leur auditoire de limiter les coups donnes aux tkoliers, mais eHes r&ument
Cgalement la perception qu'avaient ces memes auteurs du rapport maftre41evesr.
*. Cf Eadmer de Cantorbdry, The L@ of St Ameim, Archbirhop of Canterbury [BHL 526 ; rBd c l 1 14-253, &I. et trad. RW, Southern, Oxford: Clarendon Press, 1979 (1972), I,xi,p20-21 et I,xxii,p37-38.
le ne sais s'il fiurt voir un pro@ dam le fait que John of Wales et Gux'bert de Tournai, dewc pddicateurs franciscains de la deuxihe rnoitid du XIIIt siecle, illustdrent I'impressionnabilit6 des jeunes enfants, non seulement par les images de la cire et de L'arbre facile B tailler, rnais aussi par celle des jeunes animaux ais& B domestiquer (cf. J. SWANSON, Childhood and Childrcaring.,- w, JiMH, 16 (1990): 317 et 320). Le symbolisme animal avait dejh ete employ6 par Guillaume de Saint-Thierry (7 1 148149) dam son Epistola ad jFutres de Monte Dei (6d. J.M. Dkhanet (SC 82), Paris, 1%2), sans qu'il associe sptcifiquement I'dtat animal a la situation des enfants, mais plutdt B celle des novices, les inci@ienres ; pourtant, les passages qui d w v e n t cet &tat montrcnt que Ies similitudes sont trts grandes (cf, par exemple I,ii,i,#43-45,4944; 68,71 ct 73).
=. Pierre b i e n (t1072), De Pe&ectiorse mona~:horurn~ &L P, BIZ- Edliiom naziomle &i ckassici del pensiero italimo, V, 20.
". r i d & que l'enfant est tr&s impressionnable et qu'il est aisC de I t modeler quand on le p m d tout jeune est tds anciennc, L'irnagc de la cire se retrouve par exernple, A quclques nuances p&, dans la G r d e mgle de Basile (Les r i g h monasriques, mtro. et oab Uon Ubc, Namur: Ed. de MarcQous, 1969, Q.lS,p.82) et dans le beau trait& de Jean Chrysostorne, Sur la Vaiiw Gloire et I 'Phcution des enfits (imtro., t e e critique et trad. Anne-Marie Malhgrey, Pvir Ed du C e ~ 1972, q p . 104-05 a p.1OSn. avec d'autrcs rCfCcenccs ; A PA. QUINN, Barer thcm the Sonr. .., 1989, p.22 et M. de JONG, Growing up.., w, JMH, 9 ((1983): 106). MjB Platon -it dim B Socratt quc la xn&noirc &it xrnblable & un bloc de c k (ntPBtPte, trad. M. Narcy, Paris: Flammarion, 1994, 1 9 1C-D,pZO et J. LE GOFF, Histork et mPmo&, Paris: GaIlirnard, 1988 (1977)' p, 126). imm6diatement a p e son evocation de la cice, Jean Chcysostome compare 1'6ducation des enfants la fabrication des perles : ccllcs-ci ne sont ;l l'origine que de l'cau, mais r o u k avec savoir-faire dans la paurne du #chew, elks deviennent des pcdcs. I1 utilii ensuite l'image dc la d o n d'ocuvm d'art 0% m e fois-ci, l'enfant apparait comme une toile nue ou un bloc de marbtt informe, Seule la derniere image qu'il emploie et sur Iaquelle il starr&e longuernent p&ente l'enfint commc un ttre vivant et non un objet quasi inexistant avant I'intervention des adultes : Jean compare le petit il m e ville dont les portes correspondraient aux cinq sens et dont I+zs parents doivent contr6ler avec une e e m e attention les enwdes et les sorties (Jean
Un discours similaire se retn,uve sous la plume des hagiographes clunisiens lorsqu'ils
&oquent 1'6ducation de l e m hhs. La majorit6 d'mtre eux, Jean de Saleme et, it sa suite,
Sab&viatan de la YO et l'Hmillilllus, l'auteur de la m, Odilon a les hagiographes de
Bouchard, Baboleinet I&, utilismt tous le verbe imbuere aupassif("&re imptegne, imbiben)
pour d&%e le pocessus de man du savok du make par L'&ve. Je den do~erai qu'un
seul exemple. Jean f i t dire au deuxihe abbt de Cluny B pmpos de L'enseignement qu'il
recut enfant : a Post haec abIactatm cuidmn suo presbyter^^ remotiori manenti loco, me
tradidit educandumt et litterarum sludiis imbuendum mag. -
Cette formulation ne se retrowe dans aucune des Vitae d'Hugues, tan& que Nalgcxl
en use, mais avec des nuances importantes : entre autres, il emploie paralliilement le verbe
informme? Jl est possible que cette 6volution illustre l'emergence d'un noweau discours
sur I'tducation, qui se proloerait en ce debut du We siecle (plus prkishent, les annees
1 120) jusque dans les rangs des moines. Le phhomkne semble d'autant plus vraisemblable
que Nalgod fsit un interessant apart6 sur les objectifs qui doivent guider le travail des
maitres, qui ne doivent &re, ni le goGt du gain, ni celui de la gloiregO. Ces commentaires
trahissent le nouvel intest des e r e s pour les activitts des tcoles urbaines.
Chrysostome, ibid ., xxi-xxiii,p- IO'lw.) Cf, YO1 I,7,co1.46D, YOab, 4 ,p l l l , VMO ~01,94748, VOin, 4,co1.87AT VB 1,p.S , VBa i,p.358 et VI
I,2,co1,438D. Dans la Vita Maioli aftera, MaTeul s'abreuve luEmCme de savou : a ultra aetatem literas combibebd,. w ; mal@ tout, l'auteut 6vuque la mem tenerrima du saint ( V ' col. f 783A-8).
Le verbe imbuere est aussi utilisd dam 1'UdaL pour Cvoquer la formation des novices : Ulrich fait dire A Guillaurne de Hirsau = I... ] hodierno flagitamus audire, maxime de novitik, et praeceptis, pibus imtruendi sunt et imbumdi, uz inter vos possi~t reguiartrecr conw~ar i a (ITfraef:,co1.700C), I1 faut m a l e tout noter I'usage du verk "instruere" dans cctk mime pbrase ; c'est celui-ci qui cst utilisd de pdffrcnce par la suite (cf. par exemple UribL II,i,coL701A, U,ii,coL702B ct ~,xxv,712D), p u v e que la formation des adultes est peQue comme un processus bien d i f f h t de cclle des cnfants.
a9. Dam la Vitu Muioli de NaIgod, le saint est encore "imbibCm mais par Ia @ce divine : a Ylderes imolenfiam perilem ef mom incornparitas ueratb iflius matura morum cunitie carfigmi. Haec in eo* muter gratia, semimia virtlrtum spargens, suis e m artibus imbuebat, mi3 disciplini3 et legibus infonnabaf [...I * (VM" 1,3,p.657E). Peu avant, ce meme hagiographe avait ddcrit I'action du Saint Esprit sur I'enfant comme celle d'un sculpteur modelant un objet : a et [Spirifus = sujetJponenr in ej~pectore thrommr suum, in illius conscientiue tabula amoris sui rudimenru s c u f p b ~ t ~ I, ( V M I,3,p.657E). Pour ddcrire I'enseignement offert par MaTeul lorsqu'il dirigea I'ecole de l'l$ise de Macon, I'bagiognphe we aussi du verbe imbuere, mais paralI&Iernent avec Ie verbe informare (a liberolibusque dkciplinis et unibus suos imbuenr ef ritformonr m, ViW I, 1 O,p.659A). Cf. aussi V0" 4.co1.87A
90. VM 1,9,p.659A1
Pierre le V h h b l e est B mi-chemin entre le discours traditionnel et celui plus
novateur sur le rapport du maitre et de L'CI&ve. S'il fitit usage du v a k imbuere dans sa
description du moine Gbrd, il ne L'emploie pas B sa place usuelle, c'est-&-dire lors de la
description de f'cducation &tine du saint, mais dans le portrait moral qu'il trace du
personaage- Autre petite divetgence, mais qui a son importancey Piare n'emploie pas le
verb imbuo au psssifl mais le vabe imbibo, absorber, h l'actif :
Diuillorron re- saporem, quem apuero imbiberut sic tenociter conseniabat, ut eius pene uniuersa uetbu uel factu diligenter considerantibus, nil aliud quam celestemfirgIuntium reedolerent. m91
Il use d'une image similaire a celle employ& dam cette citation, lorsqu'il 6voque la
formation d'un oblat par un t& pieux chartreux : il pksente I'enfant comrne une amphore
neuve qui s'imbik pour toujours du premier liquide dont on l'a emplie? Cette metaphore,
t d s proche de celles d'Anselme de.CantorMry et de Piem Damien, est indissociable de la
pratique de I'oblation et d'une certake id& du monachisme. Panni Ies diveaes raisons pour
lesquelles les moines acceptknt des enfants dam leurs rangs &it leur conviction que 1'Etre
int6rieu.r de l'enfant - qu'il s'agisse de son b e , de sa m6moire ou de son esprit - &it
facilement impressionnable et powait donc absorber et faire sien le langage religiew. En
insdrant cette image de 1"'enfant imbibtYabreuv&", Pierre f&sait indirectement I'eloge de
I'oblation, P une ipoque oSI cet usage etait en butte a de nombreuses critiques. Comme je lyai
dkjji mentiom6 auparavant, le neuvieme abE de Cluny ne parle jamais, dam son De
Mirrcdis, d'enfants donntk par leurs parents B I'ordre clunisien, mais il n'oublie pas de faire
B l'occasion I'eloge de cette pratique.
Ainsi sous la plume d'autem clunisiens, comme d'ailleurs sous celles d'autres
tcrivains monastiques antt5rieurs ou contemporains, et cela au moins jusqu'8 la fin du XI'
sibcle, l'enfant etait pdsent6 comme passif dam I'acte d'apprendre : il etait irnpdgnd d'un
9'. DM I,viii,p25. Piem le V6ntrabIe use en revanche du verbe imbuere pour koquer la formation d'un fils de paysan par un convers chartreux, formation qui dut Ctre, sur le plan intellectuel, assez, sinon complttement, limit6 (DM II,xxviiii,p. 154).
*. DM I1,xxviiii.p. 155.
savoir qui devait petit A petit le modeler de l'intdrieur en un adulte parfait. Cette image de
la formaton inte11ectuelIe n'ttait pas simplement lithire ; les faits la confirmaient.
L'6ducation rnomstique consist& avant tout emplir la m h o h de l'oblat par le texte et
la mtlodie des psaumes, par la we, etc. : l'enfimt &it donc kl et bien irnbiW par ces mots
et ces chants qui lui Went &vex& de l'ext&eur. Il ne faut pourtant pas en conclure que,
dans tow les monasttrrs, ce seul mode d'Mucation &it de rigueur : il existait en effet,
durant le haut Moyen Age, de p d e s vatiations d'une abbaye B l'autre, et certaines d'entre
elles fiuent des centres culturels de mom. EIIes ne p m t obtenir semblable rdputation
qu'en dtveloppant chez leurs moinillons la soif du savoir et un esprit analytique, sinon
critique. Qu'en hit- i l de Cluny ?
b) Le presque silence des sources ~Iunisiennes
Je ne reviendrai pas sur la querelle qui divisa J. Leclercq et K. Halliager sur le
a monachisme du culte . et le a monachisme de culture (KuZtm~nchtm et Ie
Kult~rrndnchtum)~~, et n'essayerai pas d'dtablir des cornparaison entre la biblioth6que0 et
les productions Iittdraires de Cluny d'une part, et celles d'autres grandes abbayes
contemporaines d'autre part, tout cela afin de d6terminer si oui ou non l'abbaye
bourguignonne aimait les lettres et constituait un centxe culture1 d'importance du Xe au d&ut
93 Cf, I. LECLERCQ, = Cluny fbt-il ennemi de la culture ? W, RM, 47 (1957): 172-82 et Id, a Pour une histoire de la vie CIuny v, h e d'Hrjtoire EccI&iizstique, 57 (1962): 792-80 1 en rdponse I'ouvrage de K- HALLINGER, Gone- MU^, 2 vol., (Studia AmeImiima, 22-25), Roma: Herder, 1950-51. CE, en dehors de toute poldmiquc, Guy de VALOUS, Le momchirme cIwt&iee, I, 1970, p 3 12-19.
". Vers la mtmt tpoque oil Ulrich et Bernard fmicnt par Ccrit la coutumt dt CIuny, un catalogue dc la bibliothtquc de I'abbayc &it r6dig6. Pendant longtemps les chercheurs crurent qu'il Wait I'attri'buer au dgne de Hugues III (1 158-1 16l), mais Vcronika VON B- a ddmontd de manih convaincante qu'il Ctait de presque un sitcle ant&icur, ayant 6tt5 compos6 sous Hugucs de Semur (1049-1 109) (cf. Le grand catalogue de la bibliothbque de Cluny a, dans Le gouvernement d'Hugues de &mu ti Chy , Actes du colloque scientifique international (Cluny, septernbrc 1988), Cluny: Mude Ochier, 1990, p.245-63). Cette chercheure, qui compte publier sous peu le catalogue tel qu'elle a pu le reconstituer, a mis en valeur la grande richesse du fonds de CIuny, = une bibliothtque qui comptait A cettc epoque parmi les plus fournies . (Id, e Le cataIogue de Ia bibliothtque de Cluny du XIe sikle reconstitue m, Scrr'porium, XLVV2 (1992): 267).
du We sikle. Je vais simplement dtmontrer sur la base des coutumiers que, d m t le XF
sikle, et plus ~ ~ e n t vcrs la fin de ceiuizi, I'Cducation des oblats ne f a t pas partie
des pr6occupati011~ maje- des moines de Cluny. Au con-, p1usieurs indices portent
i croire que celle-ci K ttSumait A sa forme la plus succincte, c'est-&dire au simple
d&eloppement de la mhoire.
Avant de se plonger dans la lecture ddtaillk des coutumiers, il est important de
rappeler que, pour les Clmkiens, ces sources pdsentaient l'essence m b e de leur ordre : en
ces pages, la communaut6 de Cluny rassemblait tout ce qu'elle jugeait opportm de
transmettre i ceux qui desiraient l'imiter. On ne peut donc expliquer son quasi silence sur
I'bducation par le f ~ t que de tels a t s n'avaient pas h aborder un semblable sujet : en W t 6 ,
le fait qu'ils en parlaient si peu impliqw que, premitrement, les moines clunisiens
considbient que leurs techniques ~dagogiques n'avaient rien d'original par rapport i?t celles
des autres congdgations, et que, deuxikmement, ils ne jugeaient pas ce domaine essentiel
pour atteindre la "perfection de vie monastique" laquelle ils aspiraient, Dam le demier
quart du XIC sikcle, avec Ulrich, mais surtout avec Bernard, le couturnier s'enrichit d'une
nouvelle fonction : il n'avait plus pour unique objectif d'offrir le mode de vie de Cluny
comme modtile au monde ext6rieur mais servait Cgalement i former les novices a l'intdrieur
des mun de I'abbaye. Cet usage indique clairement qu'une telle some pouvait, B l'occasion,
s'intkesser aw questions de formation et servir elle-mike d'outil en ce domaine. Or, dans
les lignes qui suivent, je monwrai que jamais elle ne nmplit une fonction similaire pour les
enfants.
Bien que les coutumien discourent longwment sur le traitement des pueri, ils
accordent une place edmement minime a leur &ducation. 11s ne doment aucune indication
sur les techniques pidagogiques e r n p l ~ y ~ ~ ~ . En ce qui a trait au contenu de I'enseignement,
95. Je renvoie ii la thbe en cows de Susan BOYNTON (Brandeis University) sur les gloses des recueils monastiques d'hymnes du XIe sikle. fl est possible que celles-ci aient Ct6 utilish par les enseignants Oes maitres, l'armaris et son aide) pour expliquer awc enfants le sens des rnClodies et textes qu'iIs devaient apprendre par coeur. Aucun de ces recueils n'est 52 proprement parler clunisien, Id, m The Didactic Function and Context of EIeventh-Century Glossed Hymnaries ., dans Der lateinhche Hymnus im Mittelalter, Cd.
m e seule comstaWion peut &re f~te : les e h t s chantgent et lisaient pendant les hems
consaertcs i leur formation ; padiois que1qu9m &it p k n t pour les c o m g e .
IndQiabIernent, les enfats clunisiens, comme les oblats d'autres motlSISfhs, apprenaient
par coeur les psaumes, la canti-, les hymns, la we et autres ouvrages religieux, mais
les coutumiers ne le p&isent pas? Ces h i t s ne pennettent de rCpondre qu'B dew
questions, a encore partiellement : q d les oblats &exit-ils eduquk a qui en &tit charg6.
Avant de traiter de ces d e w points, il serait utile de pdciser oh se d6roulait la
majeure partie de leur enseignement, c'est-hdire ou se situait la schola dam Cluny. Son
emplacement exact est inconnu ; malgri tout, m e lecture attentive des coutumiers clunisiens
permet de fonnuler m e hypothk Certains passages des CA laissent entendre que la schola
se trouvait dans Ie cloitre. bi, en un m&ne passage des Cometudines antiquiores, le
manuscrit C parle de la schola, alors que les mmuscrits BB1B2G mentioment le cloitre
comme lieu oii les enfants devaient chanter A voix hautega ; ailleurs dam ces memes
coutumes, le manuscrit G 6voque la schola c o m e emplacement oa les enfants doivent
chanter, alors que BB' declarent que tous doivent chanter au cloitre et que C mentionne le
Chapitre comme lieu de chant pour Ies seuls enfmts*. Du temps du LT, Cluny II etait d6ji
en partie construit, sur un espace beaucoup plus etendu que celui de Cluny I. La schola
occupait certainement une partie precise du cloitre principal qui Iongeait, d'un c&t, le sud
de I'bglise et, de I'autre, Ie dfectoire ; le plus probable est qu'elle se trouvait sur le c6t6 est,
entre la bibliotheque des fitires et le calefactorium. I1 est en effet question en LT 35.2 que,
Andreas Haug, Kassel: B&miter, 1997, i4 paraRrc, L'art firt aussi mis a contribution par les Clunisiens pour tduquer 1 s moinillons. Dew chapiteaux de
I'hdmicycle de I'eglise de CIuny expliquaht les huit tons par I'imagc ct par I t texte ; ils dateraient du premier quart du Xn' siede (cf. J. MXCHAUD, L# inscriptions mmanes des mWes Ochier et du Farinier i4 Cluny m, Cahiers de Civilisation Me'dihale, 3812 (1995): 169).
96, CE toutcs les citations ir#a. *. 11 existe une seule exception cela Bernard Wcifie que Ics cnfants avaient seuk le h i t de lire au
choeur pendant la messe : cela leur etait pennis la veille d'une Ete ii douze lecons, ou lorsqu'ils avaient Ct6 design& pour Ia lecture de la Collorio, ou encore s'ils &ient "novices" (ici, dam Ie sens d'"enfants nouvellement arrivds"), dam Ie but d'apprendre (fmmre) Ieurs psaumes (Bern I,xxvii,p204).
*- CA 14,pJS. ? CA 40,p.88.
5 la sortie de 1'6glise, les fhhs se &pent des e t s a aillent au dfmoire en passant par
ce m h e cloitre, taudis que les petits travetsent la schola pour se rendre en cate ~ a l l e ' ~ :
compte tmu qye seul le c l o k l'@lise du dfectoire, ces pnkisions n'ont de sens que
si les &ts passent par un bras du doitre, cehti oh est laschou, et les fkes de l'autre. En
LT 65, il est dit que les hebdomsrdiers, en sortant du dfectoire, passent par la schola pour
atteindre l'oratoire de Marie, except6 s'il fait dejh tado1 ; dans *el cas, ils doivent se
rendre I la petite 6glise par un autre c loh . Or, l'6tude du plan de Cluny [I montre que le
chernin le plus court pour aller du dfectoire 1 L'dglise de Marie passe pdcidment par le c6tC
est du cloitre. Dam le grand cloitre, respectivement le long de l'dglise et du bras du transept,
KJ. Conant suggere de placer le scriptoxiurn et la bibli~th@ue~~. Si cette hypothk s'av6rait
fondee, la schola se trouvait donc tout pds de ces deux lieux, ce qui se compread fort bien
puisqu'elle avait besoin d'ktruments d'dcriture et de Iivres. Bernard confirme que la schola
se trouvait bien dam Ie cloitre lorsqu'il interdit aux jeunes sous surveillance instalks dam
le cloitre de tourner leurs regards vers la scholalo3.
La R6gZe de saint Benoit stipule que, pendant les longues nuits d'hiver, des calendes
de novembre jusqu'a PHques, les f k s qui en ont besoin consacrent B l'itude du psautier et
des leqons les heures qui s'dcoulent entre les Nocturnes et les Laudes matutinalesl'? Parce
que les enfants clunisiens s'inscrivaient parfaitement dans cette catigorie, mais peut9tre
aussi pour les &parer, pendant les heures trop obscures de la nuit, des Wres adultes Iaissis
inactifi dam le c h ~ e u r ~ ~ ~ , les maitres en-ent leurs pupilles au Chapitre pour y chanter :
'? tT3 52,p,46'? lo'. LT 6STp,91? '(C Ct Ie plan de Cluny II donnC par KJ. CONANT, dans CIuny- Les hghes et la maison du chefd'orde,
Cambridge (MayMlrcon: The Medieval Academy of America/lmp. Ratat Fdres, 1968, Groupe 1, planche IV, figure 4.
I"'. Bern I,xxviii,p.2 1 1 ; cf. aussi J.-Y. TILL- .: Le vocabul aim...*, dans Vmbulaire des Pcoles. ..., op-cit-, 1992, p.65-66.
RB 8,3,p50849, lo'. Cette interpdbtion est plus evidente en d'autns passages des coutumiers. Ainsi, pendant I'automne,
si, B la suite d'un mauvais calcul du sacristain, il faisait toujours nuit aptb Prime, les moines prof& devaient attendre la pointe du jour dans le choeur, le capuchon rabattu sur Ieur visage, tandis que les enfants dtaient entrain& par Ieurs maims au Chapitre :
r Igmes autem pergmt u[g necessitates. Post hm uenihat in capitulum el canunt mgisnr'
nan ij@ntii,ibus w1O6 Pendant ce temps, les Mres pro& qui voulaient fXre des p r i b privh
pouvaient s'exkuter, mais maispidement ; ils devaient ensuite =join& le choeur. Les 0
cometudiines antiqu1'0res prCcisent en outre qut, avant les Nocturnes, mais a@s les
oraiiones, les e-ts Went, tandis que IS maioresfretes rkitaient Wte psaumes :
- a A Rrrlendis nouimbris uspe in Pascha ante Noc- post orationes canunt triginapsaImos -ores f attes &.I. lnfmtes uero illa ora leg- m~gi&ter autem defeat candellmr. dm
La RB stipule aussi qu'apds Prime, les moines se consacraient, soit au travail manuel, de
Piques aux calendes d'octobre, soit P la lectio diuindo8. ParaUiilement, il est spCcifi6 dam
Ies C4 qu'en automne, mais peut2tre aussi tout au long de I'anuee, les Mres et les enfants
s'installaient ap&s Prime dans le cloitre pour lire et chanter. Les seconds prenaient
certainement place dam la section du cloitre qui Ieur etait dm& pour la schola : a Infuntes
uero debent aut legere aut cantme excelsa uoce. Primitus enim debent Iegere infontes et
posteu canant. Frutres autem sub silentio legant uei cantent. dm Ces trois extraits des CA
constituent toutes les idionnations que nous posddons sur I'education des enfants de Cluny
awc alentours de l'an mille. Les magistri ci-dessus 6voqu6s remplissaient B cette epoque,
semble-t-il, un r6le d'6ducateurs, mais la formulation de la premi&e citation, la seule oh l'on
voit Ies maitres a&, pounait tout aussi bien signitier qu'ils n'gtaient que des r6ptititeur~~~~.
post cujusfinem [de la litanie qui suit RimeL si contigerit pw illc~viurn ctlstodis Ecclesiae, ut nondum sit clam dies. in choro sedetw, & cappefii in capr'tibus tenenttu : pue~i quoque cum Magijrris suir in capituIo sedent ; donec cum fuce diei fegere possumus.
Venientes in cfausnynt, domc sciifupu&etur lectioni vacamur. w (Benr II,xxxi,p.35 1). Si ufiquundo contigerit pe* incuriam autodis eccfesiue ut non sit cfwa d i i , sedemus in choro capite
cooperto et pueri cum magistris suis in capitdo usque fegere cum luce diei parsrimus. ~r (Udal., BN n.a1.638,fo13SV= I,xl,685-86).
La formulation de ces dew passages, plus le fait que ce djour au Chapitre devait Etre de t d s courte dude, I'aurore &ant immincnte, indiquent clairrmcnt que ce retrait dcs h t s n'avait aucune fonction pddagogique, mais pnnettait simplement d'empCcher que les moines ct Ics cnfants ne soient ensemble, inoccupCs, dam I'tiglise trop obscure.
'06. CA BB1B2G 13-14.p.17-18. Io7. CA 13,p. 17. la. RB 48'3 et 48'10- IdP. C4 4,p. 10- "O. Sur la signification du tenne magism dans 1es consuetudines, ccf. LY. TILLIETTE, Le
vocabulaire ... *, dam Vocabulaire des Pcoles, op.cit, 1992, p.67sv. Cet auteur n'a pas tenu compte du facteur
Les deux autres mentions des dtres dans les manUSCLits B et B' des C4 ont esentiekrnent
trait a lem &he de surveillance des enfantslll. Il den demeure pas m o b certain que les
oblats bhdficiaient de qye1qucs heures chsque jourpour pratiqyer la lecture a le chant, tout
spkialement en fiver.
Le LT confirme partielIement I'existence de ces temps d'appenbssage. On y apprend
que, les jours Mri6s du mois d'octobre, ap* Prime, les f%res s'asseyaient au clottre pour
lire silencieusement, tandis que a Pueri primihu altu uoce legmt, pposa suauius uel
cantent. m112. Par ailleurs, la RB demande que le dimaoche soit consacni I la lectio diuina et
le LT atteste de cette pratique qui concemait tow les membres de la communaut6, pas
seulement les edantsH3. Enfin, apr& les VSpres, au moios pendant la semaine qui suivait
l'octave de l ' ~ ~ i ~ h a n i e , les enfants s'instalIaient dans la scholu avec leurs maitres a et
codices aperuerint et quantulurncumque subter silentium leguerint rH4. Puis les e d i t s
rejoignaient les f i res a I'Cglise et chantaient avec eux 170ffice des morts.
Sans qu'il soit pdcid B quel moment de la joumk cet examen avait lieu, ni d'ailleurs
s'il Ctait quotidien, le LT indique que les enfmts rdcitaient leurs lectiones uel respomorio 5
l'armariw. Le but de cette mention est de pr&iser que les &ves devaient tow, du plus petit
au plus grand, se tenir debout pendant cet exercice : compte tenu de la transformation de ce
chronologiquc qui est, ii mon avis, fondamental. "I. 11 s'agit pour 1s m a i l de prrndrc place au cot4 dts cnfants pendant la Procession des Rameaux (C4
38,p.64) et dc s'hdnr cnm lcs cnfimts au moment des Laudes matutinalts du jour de la Ctne, alors que I'eglise Ctait plongee dam la totale noirccur (CA 40,p.71), Commc je Ie soulignerai plus bas et commc I'attestent tous I s coutumiers s u b ~ e n t s , ces dew Mnernents donnaient lieu une surveillance t d s stricte des cnfants,
LT 120,p.177. "'. LT 154,p223. 'I4. LT, 352,p.47. Cc passage indiquc que les cnfants avaicnt dcs livres h leur disposition (cL aussi LT
15 1,p2 1920). Ccci cst confirm& par les coutumicrs plus tardifi. Bernard interdit quiconquc de leur prcndr~ lews l i m ou lcurs vttements (Bens. I,xxv&p203). Dans la schola, ils utilisaicnt un codex ct une tabuh breviak, puisqu'il est question qu'ils demandcnt la permission au m a i i d'allcr chercher ceu-ci lorsqu'ils ne se trouvaient pas dans la section du cloitrc oh ils W e n t assis ( B e m I,wvii,p.209 et U.1 - III,viii,co1.747B). HERRGOTT inscrit en note au sujct de la Tabula breviaIis = idem forte q d tabula officialis, qua seriem Minirtromm. vef o~ciuIum, qui per hebdomadam publicis finctionibus deputantur, continet, Vel tabula brevialis idem est ac charta scr@torrb, in quam dkcipuli repias a Magishis acceptas scribant, ut habetw in actis =Ord nostrisuecul- IV. I (Bern p.209~). Ces liyfes des enfants etaient, sembIerait-il, pIac6s dam des urmuria & I'entr6e de la schola (Bern. I,xmii,p.209),
r&lement &ns le Bern a l ' U i , que nous poucfons obsemer plus loin, il s'agissait d'une
pdcaution pour empkher tout contact physique entre Ie bibliothdcaire et ses Cltvesus.
Puisque la seule activiitt des m,rn*pueroltrm qui avait un lien avec L'education
consistait dans le fait que ceux-ci accompagnaient l a enfimts dam la schola apds v@ms7
on at en droit de se demander s'ils remplissaient encore une quelconque fonction Mucatrice.
La vingtaine Bautns mentions des maEtres dans le LT ne conceme que leur tfiche
d'accompagnement et de surveiIIance aupds des oblats.
D m le coutumier de Bernard, on apprend indirectement, par le biais d'une
description des t o d e s #inspection quotidiemes du prieur claustral, que celui en charge
de faire chanter les enfmts au Chapitre entre les Nocturnes et les Laudes etait maintenant
I ' m d ~ minor116. Cette information est confimde clans le chapitre consam5 au pdchantre
de Bernard et d'UIrich : le second de cet officier pueris cantet n1l7. Malgr6 tout, au
minimum m e fois par jour, son sup6ieur se pnisentait devant les enfhnts pour les dcouter.
I1 venait m e premike fois I la sehola pour entendre celui des pueri qui aIlait faire la lectio
au Chapitre ce jour-lii Puis, au plus tard aprh None, mais jamais au-dell des Vepres,
probablement parce qu'il faisait alors trop sombre, il faisait pratiquer (dam la schola ?) les
lectures et les r6pons qui seraient dcitds am Nocturnes. Je reproduis ici le passage des
coutumiers qui atteste de cette fonction de l'urmarius. A nouveau, l'important pour les
auteurs n'est pas de traiter de l'enseignement mais de dCfinir les pr&autions B prendre pour
qu'il n'y ait pas de contact physique en- l'adulte et les enfants. Entre autres, il est question
de la meilleure mani&re de fouetter les enfants, mais je reviendrai I la fin de ce chapitre sur
cette question :
Omni die dilumlo postquom pueri ires psulmos, ut nos est, perlegerint, continuo venit ad eos ut illi ipueri] qui lecturus est in capitulo auscultet [audiw leetionem ;
I". Pueri q u d o mmariw obscuitat fectiones uel responsoria sw, sten! semper erecti ante eum omnes, uspedum finiantut, a minimo tuque ad muximrcs. rn (LT 154,pZl). L'marius devait Cgalernent Ccoutet les lecriones et respomoria des adultes pendant le sewice liturgique pour ddtecter les fautes qu'ils cornmettaient, mais ces deniers, h la difference des enfants, n'avaient pas de pratique pdiminaire (cf. LT 166~~239).
"6. Bern, l,iii,p,143. I". Berm I,xiv,p. 162 et UduL 11I,x,c01.749A.
ea etiam vice [id etim rite], si ipsipueri aliquid offendimtD [-me] cantando. vel legen& negligentec veC d mimu diligenter c a m a~i;scunt. d i m ab eo dic@linmr experiutttw- [suivent les pdcautions prendre pour que I'armmtus ne touche pas l a &ts en les punissant]. Et propter hoc, quamdiy vel @se, vel pra4attrs ejus s@agcmeus m o r e inter eosD nurgrsterpuero~pn'nci~i;s [&#us mperius memihi] non le@& ne~? quikquam did fmi mki quodArmmium etpueros jugiter intuehrt- I i e r quos et liber in quo legi.., ita sempw ponitur. ut una de colramris clar~rrn* [WiaJsit ihter dientem et &en&. kctiones. qtuw legendoe s~ladN0cturnos vel respo~tsoria, rite d t a t [diimfur) eis post Nonam, vel in diebus in ~ll l ius nonnisi semel comeditur extra Quadmgesimam post prandium et in Qua&agesimu post sextant ; post Vesperas nunqumn.
Ainsi, le dle de l'annaritls n'Ctait pas d'enseigner la lecture et le chant aux enfants,
cette &he revenait P son aide, mais de s'assurer qu'ils ne commettraient aucune faute en
remplissant lem fonctions liturgiques* Dam les deux coutumiers de Bemard et d'Ulrich, les
m@stipuerwun, mal& ce que leu titre pourrait hisser mire, ne sont jamais prt5sentd.s
en train d'eduquer les enfants B leur charge. Comme la citation ci-dessus en o& un bon
exemple, la seule de l em occupations dont traitent Ionguement ces sources normatives est
la surveillance des oblats. Celle-ci se faisait, semble-t-il, dam le silence le plus complet. 11
est prdcisd en effet que seul le matre principal avait le droit de faire un signe aux enfants,
et cela encore, rarementLL9 Le dglement auquel il h i fallait s'astreindre quand il desirait leur
"'- Bern. I,xiv,p. 163 et UdaL III,x,co1,749C-D. Cf. aussi Oenr I,lxxiv,p.267. Ailleurs dam le coutumier, Bernard declare que I'annmius doit Ctre surveil16 de pds par les maitres, pow Etre sik qu'aucun signe n'est &hang& :
a debent Magisbi in me, pd i~ewdlmn podest inter Nocturnm & Lauds. & innrper quandocllmque Armarirrs canrat ek, velauscultat Lectiones, sollicite habere oculos super eum, ne ulfo modo unquam signum faci~l eis. w (Bern I,xxvii,p209).
Dans un autrc passage encore, Bernard attniue cctk ache dt dp4titeur au cantor et non B I'mnmius : Cantor mnquam tanget eas, vel e t im tantum ummr sigrnrm facfet ertra Scholam. & cum ausmltat eis
fecrionem vel responson'a, omnes pi rir crastino fecturi. she cmtaturi sunt. stml corm eo. (Bern I~cxvi~p.203).
Selon toute pmbabilig, il s'agit ici bun empnmt i d a Ccritr normatifs plus anciens (cC. citation du LTsupra), alon que Ics dl&vcs devaient encore se tenir debout d e m t lcur cnseigaant et que cclui-ci portait toujours le titre de cantor. Margot E. FASSLER a d6rnontd comment I'ufmmius cammenpi petit & petit cmpiCter sur la charge du cantor A pareir de la moitid du M' sitcle, rant et si bien qu'l la fin de ce sBck, il avait presque cumulC les deux fonctions en une seule (a The Office ofthe Cantor in Early Western Monastic Rules and Customarks : A Preliminary Investigation n, Eort'j Mwic Hbtov, 5 (1985): 44-51). Quoi qu'il en soit, on renouve dam re passage la crainte de contacts entre un prof&, en I'occurrcnce le cantor, et les oblatf.
Aprb avou a f f d que l a maims ne devaient jam& sortir de la schda sans la permission du maitre principal, Bernard ajoute = NuNvs unqumfaciet eir signum, nec eriam Magister major nisi raro, & vaide necessarium- (Bern. I,mii,p202).
pafler laisse supposer que le fsit n'tbit pas &&pent, a que les autres mattes n'y avaient pas
droit : a venuntumen si mo/w Magister voluerit eis aliquiddicere, sedebit ante e m ~ i e
ad t e r r m & mdientibus aIi& MagrSm's, dicet podquid eis dixetit. dm
Ces diverses citations extraites des coutumiers permettent de fomuler quelques
conclusions. Prernikement, il n'est jamais &on d'hdes poussCes pour les edants mais
simplernent de lectures et de cbants, conigeS B l'occasion par le prtkbantre (devenu ou non
l'mmo~ius) et appris avec son second [I est donc difficile-de croire que les Clunisiens
soignaient I'education de leurs oblats. Deuxitmement, I l'exception de l'intervalle apks
Prime, le temps consad I 1'6ducation des enfmts cornspond dtrangement aux hems
sombres du soir ou du math, alors que les fk&s Went inoccupds. Compte tenu des tr6sors
de pr6cautions pris par les Clunisiens pour empikher Ie contact physique entre un profes et
un oblat - dont je traiterai longuement a la fin de ce chapitre on est en droit de se
demander si les @nodes d'enseignement n'btaient pas perques en premier lieu comme des
mesures pr&entives, permettant de dparer les adultes des enfmts aux moments opportuns.
En d'autres mots, la formation intellectuelle ne serait pas la fin premiere de ces intervalles
tducatifs mais la meilIance. Troisitmement, dam le meme ordre d'idees, on nmarque que
la fonction des maltres en est devenue une de surveillancey sans qu'il ne soit plus jamais
question pour em, dam le demier quart du XIe siMe, d'enseignementt2'. C'etait maintenant
donc sur les 6paules de l'armm*w/cantor et de son aide que reposaient la ache d'tduquer
les oblats. Or l'emploi du temps du premier &it excessivement chargtl* ; comme nous
'? Bem I,xxvii,p20Q. lZ1, Dam k langage muet invene par Ics Clunisiem pour €be utilid pendant les longues plagcs de s i h c c
impodes par la e l e , Ic magtrterpuerortrm cst d&i@ par b succession de dcux signes : d a n t (le petit doigt ii la bouchc) et m i l l a n c e (l'index sous l'ocil) (Bern I,XVII,p. 17 1).
Lorsque Nalgod, dam sa Vita Odonis, Cvoque la nomination d'Odon au postt de maitre de la schola de Baume, il dklare qu'il s'agissait d'unc ache ditiicile parcc que lapueritia etait l'aetas intrma, mais surtout parce qu'il fallait qu'Odon 8 invigilat pueromm discIpIinb rn (VO" Fii 26,p,144 ; PL 133 21,co1.938-C). L'hagiographe ne parle donc absolwnent pas ici d'enseignrment intellectuel. I1 utilise plut6t le terme avec lequel Bernard et Ulrich dwnent tous les dglements imposb aux enf-, disciplina : la fonction essentielle du maitre etait de suweiller que le comportenrent de ses pupilles soit en accord avec ces discI;PIinae.
Dam le LTcomme dans Ie coutumier d'ulrich, la lourdeur de la charge de l'armarius est soulignCe par les auteurs (cf. LT 166,p.239 et UdaI. IIT,x,col.748-51).
l'avons vu, il ne remplissait aupds des d t s guke plus qu'un r61e d'ewminateur final. L,e
second de Smmarircs &it La persome v&tabIement en charge de l'erwiguement des petits.
Sa position mbalteme, l'absence de mseignements sur le cuntenu de sa &he, enfin le f ~ t
qu'il soit seul pour B lire, dcrire, et chanter d me vingtaine d'enfants d'Hge tous
difErents permet de formuler des doutes sur la qualit6 et surtout Mendue du savoir qu'il
pouvaitdispenseraux~ts.
c) Imitation des ah&
Chaque jour, pendant quelques heures, les enfsnts pratiquaient donc le chant et la
lecture et s'appliquaient ti mt5moriser les milodies et les textes en compagnie de l'ammius
ou de son second. Pourtant leur tiducation ne s'dtait pas I& au contraire, ceci den
consistait qu'unc minime section. Saint Benoit avait di j i expliqud dam sa dgle que, pour
les a hommes au coeur dur et pour les &es tr& simples *, leur formation devait se faire, non
par la parole, mais par le gestel? La technique Hdagogique principale qu'utilisait Ctuny,
comme d'ailleurs la majorite des m o d r e s qui repent des enfants dims leurs rangsIu, h i t
l'imitation. Aussi, les oblats clunisiens participaient-ils P toutes Ies activitks des grands. Les
seules diffirences d'occupation s'expliquent toutes par trois causes, qui seront 6tudiees tour
B tour dam les sections suivantes de ce chapitre : la fragilit6 du corps enfantin (d'oix les
traitements de faveur), la faiblesse de l'intelligence des enfits (d'o& les corrections
la. RB 2.12 : (ce chapitre est consad A la d-ption de la ache de l'abbd ; celui-ci est donc le sujet de la P-1
Id esl omnia bona et samta fmt& ranplitrs q w ~ l verbis oste&* ut capacibur d&c@u& m&a Domini verbk proponere, duris cor& vwo et simplicioribus fmth suis diVi~prtZeceptt2 momtrure
De tout temps, I'imitation a dt6 la technique p&dagogiquc principdc du monde monastique. Ainsi, Marie- GCmd DUBOIS ddclarait au * du rBle de Pancien dam la tradition des moines d'kgyptc : . il s'agissait d'abord pour lui d'Ctrc un mod& un exemple vivant de ce qu'il faut fad. C'est en regardant les vieillards de son village qu'Antoine s'est form&. w (a L'accompagnement spirituel dam la tradition monmique hier et aujourd'hui m, CollCkt-, 5 1 (1 989): 30).
"I. Le cas de St Gall, qui aurait &em! un cloiae ec i f ique pour les enfants, est phculier (cf. PA. QUINN, Better than the SO ns..., 1989, p.45-73). Habituellement, en accord avec la RB, les oblats partageaient entitrement la vie des profis.
essentie11ement physiques) et la c&te de l'attirance physique des dants entre eux, mais
surtout d'un adulte pour un exhut (&oh la sweUance trtS stride ex& par les rdtres
sur les Sts et gestes de leurs pupilles).
Dam le but de former la oblats en les faisant qfoduire les gestes de 1- ah&, les
prem6ers ne vivaient pas sCp&s des seconds mais partageaient l e u q~otidien'~. Ils
dodent dans le m h e do- ( m h e s'ils ocapaient m e section specifiqye de ~ c l u i - c i ) ~ ~
allaient avec eux au Chapitre ( m b e s'ils devaient y demeurer silencieux), allaient travailler
aux champsf27 et au moulintu avec les Sres adultes (msme si ce n96tait pas pour remplir
exactement le mike labeur, compte tenu de Ieur faiblesse), aIlaient comme eux faire le
service a w cuisines (m6me s'ils ne remplissaient pas certaines tiiches qui les auraient mis
en contact trop intime avec les pro&), etc. A L'exception des entreprises qui necessitaient
de sortir du monast&e avec un groupe trh restfeint de Sres ou de tout ce qui pouvait mettre
en prknce un enfaot avec un individu venant du monde ext6rieur, les enfats intervenaient
d m toutes les activites des moines, ce qui l eu donnait l'occasion de se famiiiariser avec
celles-ci et, petit it petit, de Ies apprendre.
La pdparation hebdomadaire du Bref, sur lequel &it inscrit la liste des intervenants
dam le service liturgique pour la semaine ii venir, offre un bon exemple de cette pratique.
Quatre personnes devaient chaque samedi se r6unir pour produire ces tablettes. L'mmurius
y inscrivait qui lirait quoi, le cmor qui chanterait quoi et 1'armariw hebdomadaire qui f e t
quoi dam le service liturgique ; un e n h t se joignait ii eux : il w prenait, bien entendu,
aucune decision mais il avait pour tiche de recopier sur le Bref les chapitres des responsoria
tanfianc de Cantohdry, plus probablement par ddlicatesse pour la fiagilite des h e s enfantines, mais peut4tre pour nc pas Ieur donncr dcs id& lubriques, interdlsait que les oblats nettoyassent le corps d'un des leurs B sa mort (Lmjkanc, 1 12,p. 100 = The Momtic Comti~utionr of LU@OIU=, 195 1, p. 124). Cette pdcaution Ctait absente des coutumiers c1unisiens : de mtme qu'un convers etait lave par Ies convers et un pri%rc par les pretres, la toilette mortuaire d'un enfant Ctait accomplie par Ies autres enfants (LT 15.5,p.276).
l3. CE mpra la discussion sur ce point- '=. LT 149.l,p214. Is. LT l49.!&p.2 14.
de la semaine? Ceci donnait auxpuen' non seulement l'occasion de pratiquer l'ecriture
mais aussi de prendre connaissance du dhulement intime de l'organkttion de l'abbaye.
Ainsi, cornme l'a rrmarqut D. lllmer dam son beau livre sur la formaton des eafiuts
dam les monsstkcs a comme a pu Ie confinner M. de Jong dam son article sur le traiternent
des enfmts dans le commentaire de la RB d'Hildemar, 1'~ucation des oblats dans les
monast&es rnedihux se rCsMlait pour I'essentiel B la foxmule a Lernen durch
Nachleben mt? Philippe Ari&s avait remarque cette pratique des homrnes du Moyen Age
d'associer trb t6t 1es petits aux activitb des grands. Il avait cru toutefois B tort que cette
incorporation marquait la fin de l'enf'ance et l'en* daos i'iige adulte. Il s'agissait en fit du
de'but de l'apprentissage, rien de plus131. En imitant gestes pour gestes les occupations de
leurs ah&, les enfants apprenaient progtessivement cell& : on pensait que le sens de cette
gestuelle leur viendrait par la suite, tout comme, d'ailleurs, la comprt5hension des textes
religiew dont ils 6taient parall&lement imbiEs.
I? t T I66,pZ8-29, 'I0. D. ILLMER, Erziehwrg und Wissensvermi'rtlung im @hen MitteliaIter. Ein Beitrag nrr
Ents~ehungsgeschichte &&hie, Kastellaun und HunsrIJck, 1979 (2' td.), p.445 et M. de JONG, a Growing up ... m, JMH, 9 (1983): 1 15.
13'. P. &S &it conscient que cette participation de Penfaat au travail de Padulte avait pour but de le former (a Il apprmait Ics choses qu'il fsllait savoir en aidant les adultts 4 les faire. m, L 'en$ant et Ia viefirnilride sow I Xncien &!@me, Paris: Seuil, 1973, p.6), mais il en deduisait I'inexistence des classes d'gge :
Or la pratique de l'apprentissage est incornpatile avcc Ic syst6rne des classes d'gge, ou tout au m o h , il tend en se ghtralisant h le d h i r c , Je ne saurais trap insister sur I'importance qu'il convient d'attribuer A I'apprentissage. I1 force les enfants vim au milieu des adultcs, qui lcur communiquent ainsi k savoir- faire et le savoir-vim. Lc mtlange des ages qu'il cntcaine me parait un des traits dominants de notre sociHC, du milieu du Moyen Age au XVm. sitcle. Dam ces conditions ks classements traditioanels par dge ne pouvaient quc se brouiller et perdrc dc l e u n4cessitC. (ibid, p.13 ; cf aussi J. LE GOFF, La civifisation de I 'Occident mhdihai, Paris: Axthaud, 1984, p.325).
Je pense qu'i1 est inutile de demontrer A quel point le modele monastique b6nCdictin detruit totalement cet argument.
C LE CORPS DE L'ENFANT : AU COEUR DE LA QUESTION
Les lignes plecsaentes ont dtmontd qpe la formation des oblats cltmisiens avait pour
fonction essentielle de leur apprendre la dkc@Ziha exigk par la c o m e : le carps dupuer
occupait donc unc place primordiale dans son Cducation. L'aualyse de tous les autns
rkglenients des coutumiers concemant L'enfirnt codinnera cette particularit6 du traitement
clunisim des pen' : la ptimaut6 accord& au corps enfitin.
1. Trnitements particuliers dispensb aux enfants
a) Les traitements de faveur
les enfants btaient consid6ds comrne des 6tres physiquement faibles. L'enfance,
l'aetas debilior c o m e l'appellait Pierre le V6n6rable1, itait effectivement Mge le plus
dangerem pour l'homme du Moyen Age : boa an ma1 an, approximativement un e n h t sur
trois mourait avant l'iige d'un an et un sur deux decddait avant d'atteindre vingt a d . La
I. Stat, 56,p.66. 2. I1 n'cxiste pas de statistiqucs ddfinitivts sur la question. LC- RUSSELL dome des chiffies &omammcnt
bas pour le Moyen Age : 15-20 % de dtcts pour la prcmihr a ~ k et 30 % avant vingt ans (a Population in Europe, 500-1500 n, dans The Middle Ages, Cd. C. Cipolla, (The Fontana Economic H i r y of Europe, I) BrightontNcw Yo& Harper & Row, 1976, p.45-47). Pour des chiffics beaucoup plus tragiqucs (un e n h t sur deux dMdC avant l'be de cinq ans ou avant douzc am)? cf. S, SHAHAR, Childhood, 1990, p.145 ct Histoire de fa populmionfian~aike, I: Dm origines ci la Renabsunce, par J. Dup4quier9 J.-N. Birabcn, R Etieme, C- et L. Pietri, H. Bautitr, H- Dubois, A. Higomet-NaaI ct C Klapisch-Zuber, Paris: PUF, 1988, p.437. Hans- Werner GOETZ adopte une position mitoymne : d o n lui 54 % des cnfants vivaicnt au-deb dc 18 ans (Lfe in the MiiMe Ages : From the Sevenrh to rife Ttrirteenth Cenfzuy, trad d t MI., Notre-Dame: Univ. of Notre- Dame Press, 1993, p.53)- Si I'on observe des tchantillons prtcis, Ics calculs changent encore : ainsi, il a bte possible dc suivre six families limousines eatre 1360 ct 1510 gdce aux l i m de raison. Dans celles-ci, 5 4 3 % des enfants d&Cdtrrnt avant Page de 20 am, 27, I 1 % atteigninnt cet age, tandis que 18,54 % b6nCficihnt d'un sort incertain (cf, J.L. BIGET ct J. TRICARD, L i m de raisoa et dCmographie farniliale en Limousin au W sikle n, ADH, 198 1, p346). Ccs Mltats t d s inquiCtants s'cxpliqucnt en partie par les ravages de la peste- En &lit& la mortalit6 infantile n'a vraiment commcncC h baisza dam ie monde occidental qu'g partir de la fin du XVIIIe sikle, et dam certaines egions, c o m e par exempk Montrtal, beaucoup pIus tard. Avant ce bodeversement dhographique, au minimum un enfant sur deux mourait avant rage de vingt am, sans qu'il y ait de grandes diff6rences, ni cntre les couches sociales ni entrc les pays (cf. M. TERISSE, A propos de
courbe de 1'-ce de vie se rrdressait sensi'blement apds cette limite. Renant en compte
cate faibesse dupranier &e, les C l d e n s ddictkent dans leurs coutumiers de nombrew
riiglements qui vedlaient au bien- physique de leurs oblats. Sans chmhet B &re
exhausfives je donnerai plusieurs aremples de ce phtnomhe.
En ce qui a trait au sotlltlleils les pueri ne ben6ficiaient pas d'un dgime trts diffikent
de celui de leurs aids. IIs etaient les d d e r s en- daas l'dglise le math a les premiers
i en sortir le sou pour aller se coucher. Bien que ces meslnes aient W tr&s certainement
prises pour empzcher dam le sanctuaire le d6sordre d'un deplacement massif de tous les
moines, a pour s'assurer que les adultes ne trouvassent pas 1% l'occasion de contacts trop
intimes avec les enfants, on w peut s'empikher de penser qu'elles permeaaient egalement
aux petits de demeurer moias longtemps dam l'eglise et de se coucher un peu plus t6t-
M a l e tout, ce gain se chiffrait en minutes et w devait pas Etre tr& substantie13. Si un enfaat
s'endormait pendant la nkitation des Hems, deux traitements diffdrents Went p r 6 w par
le rkglement. Dam le Ltber tramitis, iI est stipuld que, si le phkwmhe se reproduisait
sowent, le maitre ne devait pas fouetter Sendormi a chaque occasion mais lui donner un livre
d soutenir pour que le poids du volume le tint eveill& La mEme mkthode est pr6conis6e par
Bernards. Pourtant celui-ci, en accord avec Ulrich, en pksente ailleurs une seconde : I'enfmt
devait &re dkshabillt! et fouettk sans delai, chaque fois qu'il s'endormait pendant les Hews6-
d€mographie mtdi6vale : de modernistc 8 mddieviste, notes de lecture W, AnnaIes ESC, 30 (juil,=&c 1975): 68 1)-
3. A m Complies, les enfants ne rkitaknt qu'une seule dcs trois orationes que les Wns ptononpicnt et partaient aussitdt se coucher (Bern. I,xxx,p.213). Pendaut le temps de la sicrte, Ie LTexigeait que les enfats et les iuniores aillent dormir ; seuls Ies s e n i m lisaient ou se reposaient selon teur choix (LT 154,p.224) ; mais cene exigence n'est pas reprise dam Ies coutuniers ultCricurs, ce qui sousentend peut4tre que tous dtaient maintenant libm de vaquer & I'occupation qu'ils pdf&raient.
'. LT, II,154,p223 : Si pue* grcnrottv sopore ad opus && non q i i h pro hoc omni horn est uopulLUtdt(S, sed cum u i ' i t eum
magisrer saepe somno grauari det unumqumlibet fibelltun in suo brachia susfetuabchm, quoupe de @a pigritia a m exciret. m
'. Bern I,xxvii,p204 : Si qua e o m oppressus somnofentia ad Nmnvn0.r nun bene cantaverit ; MagiFler dat ei in manus unum
codicem grandi~c~mlum, iidonec experge fat. w.
6. Bern. I,xxvii,p2OI et Udd IlI,viii,coI.742-43. = Ad Nocturnes autem, into ad omnes Horas, si quid ipsi pueri oflendunt in Psalmodia, vel in alio cuntu,
Si le premier traitement (qui dut &re en vigueur au m o b jusqu'au milieu du XIe sitcle)
atteste d'une cataine compdhension porn les grands besoins en sommeil des enfhuts, le
second haha en revanche unc extrhe rigueur. Compte tenu de la mce de celui-ci dans
les coutumiers les plus tar&, fi est possible que cette &v&it6 mt ua phhomtne dcent7.
AU rCfeire8, les oblats cent dkpeds atre les tables a pl& B c6tC de ceux des
moines cpi ne laissaient passer aucun Ccaa au r&glement9. A la difference des Mres, il leur
fdlait manger debuti0 ; cetk couhrme fit abmgk par Pierre il la toute fin de la enode
Ctuditk". En accord avec la rigle de saint Benoit If ils recevaient des parts moins importantes
de nourriture que les moines adultes ; mais Hugues (1 049-1 109) interrompit cette pratique
pendant son rQpe, avant que ne fussent ddig6s les coutumiers de Bernard et d'ulrich13. Lii
vei dormitando, vel dipid tale ulfo mod0 committendo, tninime d@ii?rtur : absque morafrocco & ctlculo erutijudiccml~r, & & sofa camiiia caedkntur (nisi laici sint in ecclesia, a quibus videri possint) & hoc fit vel a priore, vvef a prae$ato eorum Magtjtro [.,,I, D. 7. B e d ayant fhit oeuvre de compilation, il a consew6 la mention de la pratique la plus ancienne ; celle-ci
brait pmbablement toujours utiWe conune ~rnede contre ia somnolence, mais une fois I'enfant d h e n t puni. '. Sw cette question, c t MI LAHAYE-GEUSEN, Dm Opfir. .., 1990, p.276-300, M M McLAUGHLIN,
.: Survivors,.. m, dam Hkrory ofChildhod, 1974, n.195, p.174, G. ZIMMERMANN, Ordendeben und Lebenstamizrd: Die cura corparis in &n Orkorschr@en rl;es abenridndischen Hochmittefafters, (%eiWge zur Gesch. des aiten Munchturns, 32) MIInster: Aschendorff, 1973, p.159-65 et D. KNOWLES, a The Monastic Horarium as indicated by Lanfianc V, dam dans Monastic Comtitutiom of Lanfianc, London: Thomas Nelson, 195 1, pxxxv-xxxvii.
9. Ben I,xxvii,p207 n U ' III,viii,col.744D : r Per memas sunt divisc et sin& ante tafesfiatres pmiti. qui non dirsimulent, si q w m vik in t negiigentim eorum inter come&& 8.
lo. Je nc sais si cctk coutume W i t une habitude plus anciemc, alors que Ics cnfants devaient fairt le service aux tables ct donc conserver une plus grandc l~'bert& de mouvcmcnt, ou, plus pmbablcmcnt, s'il s'agit d'une prdcaution pour Cvitcr tout fi6lcmcnt tntrc I'oblat ct son voisin (cf. supra Ie rtglcment obligeant les oblats ii se tcnir dcbout devant l'armmiw).
It. Stat 56,p.85- D6jA 8Mlatd a Ulrich d€claraicnt que It maitre, avcc I'accord du prieur, pouvait donner une petite table et une petite scmMct!t un enfant fable (a Si p i s eorunr ita infirm- ut non bene srme posit. .. w, U&f. IlI,viii,cof~745A ct r Cum quis eomm ita debilb & infinnus esr, ut non possit bene stare.. r Bern. ~ v i i , p 2 0 6 ) . I1 faut notcr en outre qu'il cst question des si&ges des cnfants au dfectoire dans le LT: il s'agit de mmci, alors que les adultes avaicnt des sedifiu (LT 154,p.222).
'1. Saint Benoh conscillait d'&c trk indulgent cnvers les a h t s (igantes) ct Ics vieillards (series), et de permettre que l'hcurc de leur repas soit avanc& (RB 373); mais, paralltlcment, il d6conseillait de servir les petits aussi copieusement que fcs adultes (RB 39,10), Plut8t que de fakc manger lcs enfants & des hems diffkrentes des adultes, Ics moiaes prircnt l'habitude de leur s c ~ r une collation supplCmentairt (cf. hfia et M. de JONG, a Growing up ... m, JMH, 9 (1983): 10344).
13. Sur Ie kit que les e n h t s devaient recevoir des parts a w i importantes que Ies moines adultes, cf. Bern. I,xxvii,p208 et Udd IlI,viii,co1.747A. Sur Ie fhit que ce fut Hugues qui I'ordonna, cf. VHs I,xii,p.63. Certains chercheun pedrent que ce statut concernait Ies jeunes moines ct non les enfants, puisqu'il allait B I'encontre
s ' d la liste des dCsavantages des e e t s par rapport I leurs ah& en ce qui avait trait &
la not)lTitwe a A Ia boisson. S'ils rnangeaient moins que les moines adultes, ils le faisaient
plus sowent : chaque jour, a m leur Chapitre, Tieme ou la Messe majemr ils allaient
preadre un mirnan au ~ecto ire en compagnie des Wes qrri avaient Ctt sai@ &cemment
Lorscp'un cnfant arrivait en retard au reps, il pouvait se rmdre directemat ii sa place, sans
attendre la permission du prieur, h la d i f f h c e des moines adultes, les des e&ts
y comprisl? Pour convaincre les moines clunisiens de s'abstenir de graisse le vendre&,
Pierre souligne le fait que m h e les enfmts et les maiades de tome la CMtient6 latine se
passent de viande en ce jour ; un tel argument sousentend que le dgime alimentaire de ces
dew groupes &it habitueuement plus foumi et moins SevQe pw celui des autres h ~ m m e s ~ ~ .
du cornmandement de la RB (cf. note supra) ; cettt supposition &it en partie b& sur la transformation du tenne "pertw en "i'iores coenobitkn dans la Vita d'Hildebert de Lavardin (YHh II,12,co1.869A ; cf. A. L'HUItLlER, Vie de saint H'pes abbe' de Ciuny lO24-fJO9, Solesmes: Saint-Pierre, 1888, p.587n). Giles CONSTABLE a Ionguement dvoqu€ cette question dam une note de son ddition des Sfahrta de Pierre, sans vMablement trancher (Stld, p.86n) ; il est pourtant possible dc Ie faire. Hidebert, qui ne faisait pas partie de s ~ g ~ i i rCguli&re mais rCeuliCrr. Ctait tds peu familier avcc k syst&ne dc la hidramhie monastique ; il nc peut donc pas &e utilii comme d f h c e sur ce point. D'autre part, sa codon ne fbt pas reprise par I'Anonyme Il qui connaissait pourtant son travaiI (W co1.457A ; cf. F. BARLOW, a The Canonization and the Early Lives of Hugh I, Abbot of CIuny ., AB, 98 (1980): 328 et A. KOHNLE, Abt Hugo von Cfuw (1049-1 log), Sigmaringen: Thornbecke, 1993, p.263)- En dernier lieu, il ne faisait aucun doute que les iuniorcs recevaient d6jh autant de nounitwe que les priores, puisque Ie prieur avait justement, entre autres fonctions, celle de vtkifier que les portions de ces demiers n'etaient pas plus grosses (U&I., III,xviii,col.76f C).
". Les Wres qui avaient &d saign& recevaient trois plats (trrb cocra pulmenfaria), mais les enfants seulement un (CA 8,p.12, LT 178,pZO et B e m I,xxk,p.213),
Dans les anciennes coutumes, le m k t m Ctait semi aux e h t s ap& l e u Chapitre en hiver et apds Tierce en dt6 (cf, CR 7-8,p-12, LT 2l,p3 1-35 1 lO,p.l65, et 120,p.178). La place qui lui etait assignee dans les coutumcs de la fm du Xle sikle cst plus difficile A dtrcrmincr. I1 scmblerait que cctte collation ait C t t retard& durant le jour, pour prendre place aprts Ticrce en hiver et a p e la Mtsse majeure en Ct& (Bern l,lxxix,p.267 et II,xx,p324, UdaL II,xxii,col.711A). Cf, pourtant Udd II,xxi,col.710A ct III,viii,co1.744C ct Bern. I,xxvii,p207. Dam ces dew dmiers passages, il est A la fois question de distrt'bucr des pains aux d i n t s ap* leur Chapitre et de leur d k i i Ic mirtwn aprts la Messe majcut ou aprts Tiem, d o n l'dpoqpc de I'ann&.
I1 existc pluieurs autres ftgIements concernant la nourrituh ou la boisson des obtats, mais qui sont tous ponctuets dam le temps. Lorsqu'un fitre dkddait, aucun moine n'avait le h i t de prendre de la nouffiture avant son entemmcnt, sinon Ies enfants ct les malades (LT 195.5,p.276). Les dimanches d'w, il dtait Cgalement ve& a m pueri une mrjericordia de lait pendant Ie repas (Bwn I,xxvii,p.207 et UdaL III,viii,col.744C). Par ailleurs, si un cnfant Zener erpannrr dev& accomplir un travail dam le cloitre, on Iui apportait un peu de vin et de pain (Bern I,xmrii,p206 et Ucibf. III,viii,co1.744C-D).
Les enfants de Cluny n'avaient pas le droit de manger de la viande sinon lorsqu'ils Ctaient malades (cf, i@u). Dans d'autres monast&es, ce droit leur avait Ctt concCd6, comme au Mont-Cissin au IX' siecle (M. de JONG, Growing up.., a JMH, 9 (1983): 104).
Is- LT 154,p.223, Bern I,x~wii,p205 et Uduf. III,viiicol.745C. 16. Stat. 10,p.49.
Quand un Mre etait pris d'une soif tenible pendant les H e w , il devait se rendre 1
I'idimerie pour y boire, a ensuite se fish excuser pour reprendre sa place ; un &t, en
manche, allait boim a reprenait sa place sans avou A implorer pardon. En ptriode de grand
h i d , des charborn ardents Went apport6s dans le dfeCt0i.e et devaient Opccifiquement &re
placds B c8t6 des e&ntsl? Particuli&ement important et significatifest le fait que, tout au
long & l'annk, Le cell& a le cameer (rcspcctvement le Mre en charge de la nodture
et de la boisson, et celui qui s'occupait des habits et de la Iiterie) devaient quelquefois
(afiquoties) se rendre aupds des enfmts pour savoir s'ils ne manquaient de rienl!
Les diff6rences de traitement entre un adulte malade et un enfant malade illustrent
miew que d'autres l'attention accordde i la sant6 des petits. Il est fort possible qu'un autre
motifait egalement di& cette divergence dans Ie dglement : un rnoine 5g5 powait peutdtre
mentir et fairr semblant d'&e sodhnt pour protiter d'une meillewe alimentation et d'une
p&iode de repos, beaucoup plus rarement ua edmt ; d'autant plus que, clans son cas, le
mairre 6tait d@i la pour verifier ses dires. Lorsqu'un moine proEs amonpit au Chapitre
qu'il &it maiade, il devait attendre deux-trois jours au cas oh sa sante s'am6liorerait. Si tel
n'ktait pas le cas, il &it alors admis & l'infinnerie. Il lui fallat ensuite attendre un nouvel
intexvalle de deux-trois jours avant d'avoir le droit de manger de la viande. Une fois gudri,
le fi&e devait faire amende honorable au Chapitre et ce n'itait qu'ensuite qu'il r6integrait
sa place habituelle dam la hi6farchie de la communauti. Pour un enfant, d8s que le matre
principal avait not6 sa maladie, il demandait l'abb6 la permission de Ie faire entrer B
l'infirmerie. CeiIe-ci obtenue, le jeune malade s'y rendait accompagn6 de deux autres
enfants, qui ne faisaient que I'y conduire, puis l'y chercher la fin de son sejour. DQ son
17, Bern. I,viii,p. 152. Is. U&i. III,vii,co1.744C, Bern I,v,p.146 et I,xxvii,p.204 : a & per consuetudinem aliquoties debent ire
Ce1Ierariu.s et Cumerarius, & possunt ire & sedere sine licentiu omni, & dicent eei infantes, audientibus omnibus, qua re indigeat de minkteriis eomm m. D6jh dam la RB, il Ctait demand6 au cell6n'er de se conduire comme un ptre pour la comrnunautt5 et de prendre bien soin des malades, des enfants, des hdtes et des pauvres (RB 3 12 et 9).
anb&, il powait commencer B manger de la viande. A sa sortie de l'hfberie, il dint@&
aussit8t la schola et n'avait pas B demander pardoni9.
D'autres distinctions dam le traitement des enfhnts malades valent la pine d'&e
mentiodes ici, car elles sont autant d'indices, d'une part de la surveillance sans relhhe
exacte sur les &ts, d'autre part du d&ir de dpondre k leurs besoins. I1 est Specifit dans
le LT que, pendant tout le temps du djour de l'enfirnt l'infirmerie, un senior choisi parmi
la malades lui &it assign6 comme gardien ; la nuit, malgd tout, l'oblat d o d t non pas a
ses c6tds mais sous la lumiere? Le Bern nous append que, quelques decennies plus tard,
par bienveillance B IVgard de l'enfant ou par pdcaution, un des maitres etait envoy6 i
l'infirmerie pour demeurer avec le petit malade. Ici s'insere la seule et unique remarque de
tous les coutumiers clunisiens oh la question des sentiments de l ' e h t est prise en compte :
ce maitre, qui est le seul avec le prieur i avoir le droit de lui adresser la parole, l'entretient
de ses besoins et de sa familia, mais cela, avec beaucoup de mod&ation2l.
l 9 Cf. LT 19 l.l-S,pXM7 (nulle question des modalitk d'entde ni pour les adultes, ni pour les enfants). Bwn, &xxiii,p.l87, Benr I,xxvii,p.206, Bern Ipcvii,p207-08 et Udaf. IXI,viii,col.745-46 (pour un enfant), Bern, I,xxiii,p. 186-87 et Udol, III,xxvii,co1.769-70 (dans le cas d'un malade aduite).
Tou Ies coutruniers insistent longuement sur Ie grand soin qu'il faut pprendre des malades ; pmlI&lement, on devine que le comportement des moines dans l'infinnerie suscitait beaucoup d'inquidtude car il &tit jug6 trop relichti. De plus, la pr&ace de famufi dans les lieux posait des probltmes car ils risquaient de colpocter A l'ext€rieur ce qu'ils y avaient vu et entendu Je reviens plus longuement sur ce sujet dam le dernier chapitre consacn? A t'ige miir/vieillesse puisque l'infinnerie servait aussi de moumir pour les vieillards.
LT 191.5,p267 : Cum pueri in ipsa domo conductifierint, rum susc@iat wnrs erx: @sk seniuribus qui ibi sunt iflorum
custodiam quiswproui& sc i i et aIiem non negIegere. HOT* nmque com~entibtrs quibtrs dii ckvm interna procedere mos est simifiter et @si fmiant, P r o p lumiiwia iacemt, non k t a se. h i d e exantes pro hoc satrjlactionem non faciunt ad maiorem capi~lum nec ad mum, 8
2'. Bern. I,~cxiii,p.187. I1 s'agit du chapitre consad I'infmier. L'autcur vient de d t d e I'cnsemble du cCrdmonia1 II suivrc pour entrcr a sortir de I'infirmwie lorsque l'on cst profes. I1 aborde maintenant cette question dam le cas d' un cnfant :
Puer vero nihil eonrnr agit, sedpatejZacta mqori Magktro suo vafetudine mcr, ipse Magkter innotescit Abbati vel Prior& & accepta licentia, prdvkkt mum ex dih Magishis. quem novit esse majoris gravifatb, & momm maturiorum, imponemque eicustodiam per& mittit cwn eo in I@nnariam ;puff ovtem ~u~mdiu sic potat, vadit ad Matutiras aim afiis, sed mcsquam in nocte sine I a ~ e m a incedit ; legit kctiones ad Mumtinas iiftrmorum, & a d p r d ' , & adcwmn, in prima die carnem comedit, cum cucullato capite, & semper, ubimmpe sit, mrlli unquran f o q u i ~ niri Priori, si venerit* & suo Magistro, in Ininnaria, inter prandedum de ma necessitate, veI fmiIia, & cis muItuin m&te : jwta Itrmen jacet, dG si necesse fierit, possunt duo simul esse in In-maria m
I1 est possible que ces lectures assign& B l'enfant malade, pendant Ics Matines ct lors des repas, avaient pour but d'occuper son esprit et, tout comme ses eatretiens avec son mattre, de combattre son abatternent. On ne peut alon s'empkher de se demander si ces "maladiesn qui fiappaient Ies oblats 6taient toutes de nature
Cette longue b e d'exemples montre B 1'6vidence le souci des moines ben6dictins
m gh&al, a clunisiens enparticulier, pour le bien- physique de leurs oblats- Un tel souci
peut s'expliquer, comme Hildemar le fkit dam son commentaim de la RB, du fkit de la &lle
fragile physique des &ts dans une sociCte orl la mMecine etait encore bdbutiants.
Aussi fondamentale que soit cette taison, elle n'explique pas tout Il est nCcessaire de
perce~oir ce traitemat de faveur accotdt au corps de I'enfant dans une perspective plus
large, o~ I'on observe qye les Clunisiens s'inquietaient beaucoup du corps de l'enfaat, saus
montrer un empressement sirnilah pour soigner son esprit. Comme si, de l'edhnt, ils
voyaient la chair bien avant l'iime.
b) Le mode de correction
De meme que les traitements de faveur consentis am enfsnts concemaient avant tout
le bien-Ctre de leur corps, de meme les corrections qui leur 6taient infligbes btaient
uniquement physiques. Les adultes, au contraire, etaient habituellement soumis B des
punitions d'ordre psychologique. La raison principale de cette divergence h i t que l'esprit
des enfii~lts &tit jug6 trop faible pour apprehender les autres formes de correction.
Dans la RB, Benoit edge qu'un adulte qui a commis me erreur dans le service
liturgique fasse immediatement amende honorable ; l'enfmt, pour sa part, est bat@. Pour
des fautes plus graves, il demande que les moines fautifs subissent l'excomrnunication ;
uniquemcnt physique. UIrich ne mentiome pas la pratique d'un rnaitre tenant compagnic A l'cnfant malade : il dt?clare simplement
que I'enfant a ubi guPndiiu moratw c o m m e ~ est cautissimo custodk a quo die ndchtque eustdiatur I...] (U& III,viii,col-745C). I1 ajoute que le m a i principal doit ti&pemmcnt Iui rendre visite et le rarnener dam Ia cornmunautC d b qu'il est gu&i (ibid, co1.74SD). Dans Ie passage comespondant dans Bern, au Chapitre des enh t s , Bernard a recopid pmque mot pour mot Ies paroles d'UIrich, sinon qu'il a pdcisC que le pro& assign6 au petit malade etait un de ses maitres vel ulius Custodus maturn & cautbsimus m (Bern. I,~~ii,p207-08)-
=. Les hommes du Moyen Age tel Hildemar expliquaient cette fragilitt de l'enfant selon la theorie d a humeurs : le petit manquait de sang (cL M- de JONG, 8 Growing up ... m, JMH, 9 (1983): 103).
RB 45-
celle-ci Ctait suivie d'un d6classernent tempo& o t le coupable se retrouvait plad jute au-
dessus des enfhts, c'est-Adire tout en ba9 de l'&heUe Mrarchiqye des adultesZ4. Dam le
cas des apueri uel crduescentiores acme, aut qui minus intelligere pusmt V, le chstiment
&it le fowt ou le jebe? C o m e l'atteste cette citation, ces m&hodes coRectives 6taient
6galement appliquks aux moines plus &Cs qyi U e n t incapables de comprendre la
signification de I'excommunication, en d'autms term-, aw fables &esprit. D'autres adultes
powaient aussi recevoir le fouet, mode de punition jug6 plus ngoweux (acrior) que
l'excommunication : il s'agissait des coem dm, des en&% sur lesquels l'excommunication
n'avait pas obtenu I'effet escomptE
Cluny s'est inspi& du modtle benedictin de correction, sans en changer semble-t-il
grand chose. Le iudicim ieiunii (?a pine du jeime) &i t pratiqu6 envers les enfants, ppuisque
le LT6voque 1'6ventualite oG S e h t design6 pour manger a la table de L'abM devait subir
ce chatiment?? Au Chapit~e des enfants tout comme au Chapitre des grands, le fouet servait
ii punir les oblats fautifs2! Le fouet pouvait tgalement &e utilise contre em s'ils avaient mal
appris leur leqon, s'ils se tenaient ma1 P l'gglise, etc?
-- RB 23-29, 3 RB 30. Le fait que les corrections par le fouet soient &w&s aux enfants n'cst pas spdcifique ii 1a RB ;
Bade en revanche usait du chitiment du jehe cnvcrs eux (PA, QUINN, Better than the Sons. .., 1989, p. 18 ct 2 1).
=- . &t honestiores quidem atque intellcgtbiles aninros prima uel secundu aahonitione uerbb corripiat. hpmbos mtcm a &ms ac supabos uel hobadides uerberum uel c o p & casfigatio in i p o inifio peccati coerceat &L] rn (RB 227-28)- 8 Sin autem hpmbw est, uidictae corporati subdcrtur- rn (RB 23.5). Si quis jkterfiequenter correptus pro quatibet cufpa, si etiam excommunicatus non emendmerit, a d o r ei accdaf correptio. id est ut rretbenurr atindicta in eum prucdant (RB 38,l). Cf, M. de IONG, Growing up ... m, J . , 9 (1 983): 10849 sur les rcmarqucs des commentatcurs de la RB ce p r o p .
Ies mauvais moines a les enfants h k n t pIa& h la meme mscigne en matiere de comction- Benoit e q h i t probablcmcnt que l'hwniliation de ceae posture activerait I t ccpcntir en l 'he de I'adulte coupable. Quoi qu'i1 en soit, ccttt conClation ne doit pas &re ignode de qui vcut comaitre la perception monastiquc de I'cnfance. I1 existe d'a- associations similaires, qui ne sont gu&re I'avantage dcs enfants : Ion de Ia procession des rogations par cxemple, Ics adultei qui avaicnt Cjaculd pendant la nuit et I# enfants n'avaient pas le droit de porter des phylacths (LT 702,p. 103 et Bern II,xxi,p328). Ulrich pour sa part ne precise pas Ies limitations dans la distriiution (UdaL I,xxi,col.670A).
? LT 152, p217 et lS4,p2 IS+. ? Cf. Bern Ipcvii,p202 et U'. III,viii,col.744B. '9. C f. Bern. i,xiv,p. 163 et supra.
L'usage du fouct, surtout envers les adultes, ne codait pas de some. Benoit juge
nkssaire de justifier sa recommaudation d'en user avec les moines rtealcitrants par dew
citations bibliques : a Stulttrs uerbis non com0@tur et a Percute filium tutm virga et
libeta& animam eiur a ma* Dens Ie cas des edits , cette technique c o d v e , dejh
encouragk par la Bible au sein de la M$l, ne fbt jamais remise en cause dam la
litthtuce modque. Mil@ tout, plusieum auteurs, B &verses Cpoques, h n t valoir que
la douceur permettait d'obtenir de meillem &uIta&2. La circulation d'anecdotes sur des
seniores qui avaient bless6 s&ieusement ou meme tut5 Ies enfaats B leu charge par l'exc8s
de Iem coups servait dgalement I rappeler aux sup&ieurs qu'il existait une limite it ne pas
depasse~?~.
Dam cet &entail d'attitudes possibles, allant de la clemence B l'extrsme violence,
il est difficile de situer Cluny. Aucune voix ne s'est &lev& des rangs des Clunisiens pour
critiquer l'usage excessif du fouet enven les enfants et encourager l'indulgence ; mais
aucune histoire d'exc5s n'est davantage parvenue jqu'ii nous. Les maitres des enfants ne
semblent avoir jamais quittk le fouet des m a s : c'est par exemple en tenant celui-ci qu'ils
50. RB 2,28029. Ces citations sont retraasctites de maniere assez Iibre de Prm.29,19 et Prov.23,14 (cf. A. DE V O G ~ RB, p.449n.). Le fait que Benoit propose de fouetter aussi les adultes at une nouveautt! par rapport ih la RMqui ne parlait que des enfants (ibid, p555n.),
Cf. P. RICE&, De i96ducation antique d I 'education chewaIkresque, Pa&: Flammarion, 1968, p. 17 et M. BAR-ELAN, Battered Jewish ChiIdrcn in Antiquity m, confi5renct d o m k au xVme Con@ International des Sciences Historiques, MontrCal1995, (d rCsumd dans les Actesflpruceedings du Con@, Montrtal: M p t &Histoire de I'UQW t 995, p.283). Il cst possible d'obtcnir le textt entier d t la communication de M. BAR- ILAN sur WEB B l'adrcsse httpJ/~ww~biu.ac.il/barilm/bomeh~L
'2. Ct par a ~ l p k les auteurs mention~lCs par P. RI& et D. ALEXANDRE-BIDON, L 'e~ance,.. , 1994, p.28-29, J. SWANSON, Childhood-.. w, J ' , 16 (1990): 324 ct M- DE JONG, Growing up -..., JMH, 9 (1983): 108. P. RICH& f i t malgd tout un peu trop grand ear de la d M t i o n q u ' a d t exigk BenoFt en ce qui cmceme la punition da enfaatr (cf. par exemple Education et cuirwe.., 1962, p.504) : k chapitre 70 de la RB qu'il &que n'est pas consaw6 spkifiquemcnt I'attitude mod&& que les rnoines doivcnt avoir envers 1es moins de quintt ans a. LL'abM de Nursie demande effcctivemcnt de h mesure quand un Wre fiappe un enfant, mais cc qyi est surtout rmarquable dam ct chapitre a en compose 1e point central est la diffdrence de traitemcnt demand& ewers un adulte, que pemnnc n'a le droit de fiapper ni excornmunier sans la permission de I'abbt, ct cnven un enfant, que tous peuvent fiapper, meme si ce!a doit se faire - cum omni mennrra el ratione m.
". Cf- M, MATTHE1 ct E. CONTRERAS, a "Seniores venerme" "Iuniores diiigere" - Conflit et reconciliation des gdndrations dam le monachinae ancien W, CoIICrjt-, 39 (1977): 38-39.
". Les mattres clunisiens ne devaient pas itre les seuls dans ce cas puisque, selon I. FORSYTH (a Children in Early Medieval Art : Ninth Through TweIAh Centuries m, JPH, 1976, p.53). switches or bundles of sticks m e to symbolize the schoolmaster in the Middle Ages. m.
cauchaient les petits le soir et les r6veilIaient le math3? Le fait que les e&ts de Cluny
devaient s'endormir et se dveiller daas de telles conditions permet de pdsumer de l e w
j o m n k - MdprC tout, il m faut pas conclure de la pdsence constante d'un fouet que celuici
&it s a m am& en action. Outre son utilit6 cornme chitiment, il devait tgalement sewir ik
susciter la pew dans le coeur des oblats c l u n i s i d et, factM non negligeable mais, B ma
connaissance, jamais envisage jusqu'alors, il rrpCsentait Cgalement m e sorte de
prolongation de la main des maitres. Il pennettait en effet de toucher directcment l'oblat
quad ntcessaire, sans qu'il y ait contact physique en* l'adulte et l'enfmt. Ainsi la nuit,
ies dtres usaient du fouet pour dveiller leur &ve qui s'etait dGcowert, mais sans le
fiapper* simplement pour qu'il emerge du sommeil, et il Ieur etait formellement interdit de
toucher l'endormi avec la main :
a si p i s ipsorum ~uerorum] est discoopertlus, tanturn tangit virga levitet prupter Fmtres ; quando sit excitatus, signflcabit ei ut cooperiol se, manu aufem ibi nunqwrm tangit e m , nec verberabit nisi cum collocant se, aut surgunt. m3'
Plusieurs passages des coutumien clunisiens laissent supposer que les mitres Ltaient prompts A fouetter leurs dl&ves. Quand un oblat faisait une eneur pendant les Heures, il etait puni ubsque mora (Bern I,xxvii,p20 1 et U&L III,viii,col.742D). Dam le Chapitre principal les enfimts dtaient Wuemment (multo~ies) jug& pour des fautes graves. Le fouet s'abattait alors sur l e m dpaula d b que leur nom avait tit& prononcd, sans attendre que I'ordre en fit donne, ni que Ie fautif offiit sa propre version des faits. Le maitre se levait aussst (statim) et faisait pleuvou les coups jusqu'8 ce qu'on lui ordonnit d ' d t e r (Berr I,mii,p202). M d g d tout, au Chapitre des enfants, oh il Ctait discute dts fautes mineurcs, la carad6ristique principale des codons infligh est quc ccllcssi devaicnt s'hterrompre dts quc la cloche somait pour marquer la fin de cette rcncontre (a qua audit4 mllus partea perorum emitur* & @sum Capitulum citiusfrnitw Bern I,xxvii,p.207 et UiM III,viii,col.744C).
=. Deux passages du B e m et de I' UdbL traitcnt du coucher et du d c i l des cnfants : l e m coliocant se in lectulir, s a q w t Magbtw stat cum virgu cum eis, & candela si ntx est ; si p k p h ufio forte moratusfirerit, statim fortiter tangitw ; L..]. . ( Berm I,~~~ii ,p202-03) 8 Stat ante ear nun virga princli)ulir Magister eonun, ut dictum cst, usqw dvnr omnes mt cohati . et @as facies bene coopertt:. Similitet, quado se levant, si tmdhs se levent, continuo est virga super eos. - ( Ben. I,xmrii,p208 ct U&l. IU,viii,co1.747A). 36. Dans le De Miramfir, P i m le VdnCrable racontc i'histoire d'un oblat qui cut unc vision au cows de
laquelle il vit apparaitre son oncle gui venait de mourir ; a l u i s i lui daaanda d'da au cimeth mais I'cnfant ne voulut d'abord pas obtrmpCrrr de crainte d'&e fouette par son maitre (DM II,3 1 (27),p- 158-6 1). La peur jouait un r6le non negligeable dans l'dducation des moinillons (cf. Fieury 9,p. 176), mais elle Ctait &galemeat employ& A I'egard de leurs ah&. Won avait recours A clle pour rdprimer Iw mouvements juvhiles (iuveniks maus) de ses moines : il leur racontait des exempla oh des Wces fiutiG trouvaient des morts hornfiles (YO1 III,I,co1.75C). Sur I'usage de la peur dans I'Lducation enfantine au Moyen Age, cf. P. RIC& et D. ALEXANDRE-BIDON, L 'enfance. .., 1994, p30-3 1.
". Bern I,mwii,p.203.
2. Pew et beination exercics par le corps enf'antin
Cette demitre constatation permet de passer h I'dtime section de ce chapitre : le
contact physique en- un &t et un autn moine, qu'il soit e n h t ou adulte, etait &it6
dam toutes les mesurrs du possiile. Si l'on fhit abstraction des dglements concernant la
participation des eafants B la litq@e, la majorit6 des passages des coutumiers conwmant les
pueri portent sur les prbutions prendre pour 6viter que Ies enfants ne se touchent entre
eux et que les adultes ne les touchent. Ce corps enf'mtin, 6duqu6 et protege avec soh, puni
lorsque nbcessak, etait egakment aaint pour l'attraction qu'il pouvait susciter.
a) Ne pas iaisser Ies edanb se toucher entre eax
Quelques dglements des coutumiers laissent deviner la cminte des moines qu'une
activite illicite ne preme place entre les enfants ou lorsqu'un enfant est laisse B lui-meme.
Il n'existe pas de prewe explicite que cette inqui&ude concemait sp6cifiquement des gestes
B teneur erotique ; il pourmit s'agir simplement de &primer tous les jeux, luttes et rires (j
compris ceux & connotation sexuelle) auxquels se consacrent naturellement IGS rnoins de
quinze ans dts qu'ils bintficient de quelques minutes d'inattention de la part de leurs
gardieas. le domerai quelques exemples de ces r&glements mais laisserai entendre
parall61ement que la veritable phobie des contacts physiques avec les enfacts ne concemait
pas les rapports des enfants eatre eux.
Au cloitre et au Chapitre, lespueri ne s'asseyaient pas sur des bancs, mais sur des
troncs, a h qu'ils ne puissent pas se toucher : u ita sepwuti ab imicem ut iNe nec arnictm
alteriur aIiquo mod0 tungat nU. Ils ne pouvaient se parler entre em, moins d'en demander
3'- Bern. I,xxvii,p202 et Udal. III,viii,co1.743C.
la permission A leur -tre et que toute la schofu puisse Ccouter a qu7ils avaient & d i d 9 .
Lors des Nocturnes ou des Mathus, le jour de la Cke, tandis que i'dglise etait plongde dans
I'obscuritd la plus totale am que les chandelles aient Ct t toutes mouchteq les mnttes
venaient prendre place entre les en$lrts pour den Iaisser a m c6te wt& Pendant les
seaeta et le canon, ils ne s'agenouillaient ni ne se prostemaient & la diffknce des pro& ;
un restait debut pour les sumilldl. Ces dglernents sont les seuls qui interdisent
explicitement les contacts entre enhts. Les autres interdits sont plus ambig car iIs
impliquent igalement les adultes.
Les lits des enfmts devaient certes Stre scar& par les lits des matees, mdg& tout,
selon Bernard, la division en vigwur etait de dew lits d'enfants, un lit d'adulte, deux lits
d'dmts, etc., tout comme aux toilettes a~ un maitre prenait toujours place entre deux
enfcant~'~ : deux oblats se trouvaient donc toujours c6te I cate. Unpuer ne pouvait jamais se
rendre seul aux latrines, de pew, probablement, qu'il ne s'y pr&e i des actes d6lictueux ;
mais peutgtre craignaitsn aussi qu'il w croise un autre &e dans la salle dgserte, quel que
soit l'ige de celui-ci. Plus ginirafement un enfant ne pouvait jamais se dbplacer seul, mais
avec un maitre et un autre enfanP3 ; je parlerai plus loin de la raison d'un tel trio. Un enfant
ne powait pas non plus se promener seul entre les eres dunis B I'&lisea ou au d f ~ t o i r e ~ ~ :
39. Bern. I,xxvii,p.204. '6, LTSS-1,p-72 (a Ei rnogktriproprer ctutodiam inter irif~ltles tcenkm~ m), U& I,xii,col.657D (a in d i o
quoque duomm puerurum stabit unus magister eorum* quiambosper manicas tembit wque dum matutiwe fnitae stit m) et Bent, II,xv,p309 (a in medrb q u q e thonun puerorunt stabit unrrs ma@ter, done Matutini fni&tur* ita ut scire passit quid ipsi agant ; pod si serfierint pert tertius afterirrs chori vadit ad aIterum, & ibi SUN h o Magbtrisimifiter stantes inter ear m). Sur le fait que, dans ce demier passage, il est uniquement question des six enfants du choeur, ccfc supra la discussioa sur le nombre d'oblats B CIuny.
Les enfants n'Ctaicnt pas les seuls h etre placts sous une swveillance trk stride lors de cette Ett, les iuuenes I'etaicnt tgalement- Dans Bern, on apprend que ces deux p u p e s devaient quitter I'tglise a p e Matines, munis de lanternes pour les Cctairer, De rctour dam I'eglise pour chanter Prime, ifs Ics &eignaicnt- 11 s'agit d'un nouveau r&glrmcnt, comme Ie spCcifie Bernard lui-meme (cf. Berm IT,m,p.313), quc ne connaissait pas Ulrich. Cette cntorse l'ancienne coutume montrc la swveillance missante dont Ics enfants faisaient I'objet
". Bern I ,~x~ii ,p204 et Udd III,viii,c01,743B. ". Cf. supra au =jet des l ieu d'aisance. Udal, l'II,viii,co1,742B-C, Bern I,xxvii,p20 I et idem, p202- '=. Udal, III,viii,coI.74SB.
Lorsqu'un -re s'etait endormi pendant une lectio, on ddposait h ses pieds une lanterne et il devait avec celle-ci faire Ie tour des diff6rents choeun jusquY& ce qu'il se fit trouvd un rempla~ant, sinon il la laissait sur les marches rnenant li I'auteI. Un iuuenirfia~er n'avait le h i t de se promener qu'entre Ies rags du choeur
soit par crainte qy'il den profit& pour commetke des b&ses, soif et c'est plus probable, par
peurqu'iln'ca~cnw~avecdcspro~Loa&la~dclaPurifidondelaViagc.
les enfants devaient aIIumcr leurs chandelles B ceUes des m'tres : il l eu &it intcrdit de
l'allumcr & celle d'un autre moine, pas m h e & ceUe d'un enfimt : a Pueri denique mllo
mode ad aliran#atrem ace@ od iII'illQItdrrm s u m ceman etiam inter semetipsos nisi
ad ma&stros suos tc~~lftnnmdo. .'" La formulation de cet interdit indique que son objectif
premier etait d'empikher tout khange entre un fitrc p d s et un edmt
b) Ne pas hisser la adultes toucher aux enCInts
C'est en effet cette interdiction qui domine dam les kglements concernant la
disciplia irnposee aux eafmts. La crainte que suscitait tout rapport intime entre un adulte
et un enfant n'ktait pas uniquement liie ii la lutte contre la ptiderastie au sein de la
communaut& 11 e a t @dement le risque qu'un profes de l'abbaye, surtout s'il etait de la
m h e fitmille que L'enfmt, d6veloppit un amour pour celui-ci (sans connotations erotiques)
qui aurait dkstabilis6 la "famillel' monastique. En outre, les adultes &rangers au monasttre
pouvaient conompre les enfits trop mallkbles en leur transmettaut de mauvaises habitudes,
acquises avec l'tige ou h&hies du monde extkrieur : cette pew transparaSt entre les l i p s des
c o d e r s par le f ~ t que, plus encore que les contacts avec les moines de l'intdrieur, c'dtait
principal. Un e n h t n'avait en revanche absolwncnt pas le h i t de sc dbplacer (LT 1 SO,p.2 15-1 6). Cf, supra les techniques cmploydes pour dveillcr Ics enfimts.
4s. Lorsque des dints htritaient pour une scmaine de la charge de la cuisine, ik n'avaicnt pas Ie droit de distriiuer la nourriture aux fittts, mais dcvaicnt sc faire rcmplacer par leurs (LT WQ.236, Bern I-i,p.207 d C/& IlI,viii,mL746B). Indissociable de cctte fonction h i t la n€ccssitC de nettoyer Ies pie& des Wces Ic samedi vcnu. Du temps du LT, Its &ants accomplissaient encore c t maruiu~m & la condition qu'ils Went aid& de leurs magijtri seniores et noa de irmiores (LT ibid) ; en revanche, du temps du Bern et de I'UdaL. cette ache menait uniquancnt aux rndm (Benr ibid a I ~ i i , p 2 0 8 . Udai.. bid). Cettc 4volution cst significative : ellc est un indice de la d'rstancc dc plus en plus grande faite entrc les prof& ct les pueri. ParalIClement, comme nous avons pu b constatcr dam Ia -on sur les traitcments de faveur; les enfants dtaient de mieux en micux trait& physiquement : on l eu donnait maintenant autant il manger qu'aux aids, on faisait asseou les plus faibles, etc.
&. LT3 1.3,p.41,
ceux quc les oblats pouvaient tisser avec les hommes de l'ext&ieur que la communaut6
interdisait Loqa'un moine &anger se plcscntait ik la pork de l'abbaye, il devait emb-
tous les brtrrs, mais pas lespwn' ; il ne pouvait pas damtage 1e f h lors de l'khange du
baiser de paix B 1'6glise ; en& pour le mandatum, il n'adt pas le b i t de leur laver les
pie& ni de f&e lava les siens par les enfjlntd7. Au cows des mes i n d o n s des enfmts
hors de la clhre, dans Ie cadre des grandes processions, ils ttaient encad& des firtres de
telle sorte qu'ils ne puissmt en- en contact avec la fouIe misee en chemin. Si ndcessaire,
des convers ou des fcmtuli prenaient place am ~ 6 t h des d t r e s pour renforcer le cordon de
dcuritk protggeant les oblate.
M a l e tout, ces contacts avec I'ext&ieur ttaient @hdm&res et rares. La majorite des
reglements concement donc le rapport entre les profes et les oblats d'me meme abbaye, et
quelques indices suggiirent que le danger principal qu'on cherchait A dviter G a i t la
p~d6ra~t ie~~. Une telle constatation va A l'encontre de la thbe exposCe par J. Boswell dam
son ciliibre ouvrage Christianity, Social Tolerance and HomosexuaIity, selon laquelle,
1'~~l ise chretienne se serait rnonee de plus en plus tol6aate a l'kgard de l'homosexualite
apr& la chute de I'Empire romain, jusqu'ii ce que cette attitude atteigne un sommet dam les
". Bern I~xvii,p206 (mention uniqurmcnt de l'interdiction du baiser Q l'arrivtt) a U& III,viii,coL747B. U. Le LT tvoque la n&essitC de mfort quand le public Ctait n o m b m lors dc la Procession des Ramcam : .: Si plurimorum miuersitas excesserit, famufi Itxi eant iurto seniores ad infmfes proregendo<s> ne in@- opus &L Hic non est necerrse Pliquki nobik imerere, quad umquirque &iprofessor memoriter scrie &bet, quantum a expedit mi ordini<s usus> optime tenere atque custdim. (LT S42,p.699.
Le Bern parle du rcnforcemcnt du groupe des magistri par l'inttlyention des CelIertuirts, Hospitmiw & mojor Camerrarius w lors de mute procession s u f f i i e n t impomtc pour nkessiter un changemcnt d'habit (Bern I,xxvii,p204), L'analyse des divcrses descriptions de processions offertcs dam lc LT d v & k que les mfbnts, qui ddfila*nt en portant l a tcxtes dcs hmgiles, Ctat*ent toujours placCr dam I'aIIdc du centre ct jamais sur la cM6 (ct LT 13.4,pZ7, 3 l3 ,~ .42~ , S8zp.89l6 *I7, '10.2,~. 104 I, 72,~. 108 'q 75,p. 115 ", lOO.4,p. 15 1'). En revanche, l'unique occasion oh dcs itnrenes nmplii*cnt cette meme &he, l'un d'cntrc em prcnait place dam I'alltk de cBtd (LT S41,p,689. E n f i dans les dem coutumien plus tardifs, pour I t s dew processions Ies plus importantes, cellc des Rameaux ct celle des Rogations, les enfants ne se plapient pas juste aprh la Croix, c o m e c'dtait le cas auuement, mais entrc les idiotw ct les cantores, de sorte qu'ils ttaient parfaitenrent encadds (Bern. I,xxvii,p207 ct Udaf. IIT,viii,coL744B).
'9. J'utilise le vocable pt?d&astie au sens sfrict du teme, savoir 1e c [cJomrnerce charnel de I'homme avec 1s jeune garCon a (Le petit Robert I, Paris/Mon&al: Dictionnaires Le RobdDicoRobert, 1995, p. 16 18).
a d e s 1050-1150% La lecture des sources clunisie~mes contemporaines permet de
comprendre en comment m e semblable hypoth&se a pu &re €labor&, mais surtout,
pouquoi elle n'est finalemat pas recevabie.
En effet, un silence prrsque complet atiste dam ces =ts sur le sujet de
l'homoSexuaIi@' : eUe n'est quasi jamais dhonc6e de hnt , d'ot la possibilit6 de mire
qy'elle n'ctait pas 1.6eUement combattue. On ne trowe que deux critiques de cette pratique,
une au tout debut de la m o d e ici Ctudik et m e autre P la toute fin. Dans la Vita Odonis,
Jean de Saleme place une mise en garde contre l'homosexualit6 dam la bouche mtme
d'Odoa La scbe ne se situe pas I Cluny, ni meme I Baume, mais alors que le saint h i t
encore chanoine en i'abbaye de Saint-Martin de Tours, ce qui n'est peut9tre pas fortuit : on
rappelle ainsi am lectern de la Vita que l'acte est tout i f i t con&tnnabIe, mais sans que son
ombre n'entache les oripines du m o d r e bourguignon. Le jeune h o m e avait coutume de
donna des conseils B tous ceux qui venaient lui rendre visite et en profitait pour fbstiger les
graves defauts humains, telle la gourmandise et l'alcoolisme. ll s'en prenait Cgalement, et
semblerait-il avec une plus grande violence, am concubitores moNes et mascuionim,
dCclarant qu'ils Went pires qu'H&ode qui avait massacr6 les Innocents : celui-ci s'dtait en
effet content6 de faire perdre la vie il ses victimes, non leur h e ? L'accusation est
M- 3. BOSWELL, Chrkfimity, SmiaI Tolerance dHomtxeniafir) , : Gv People rir Western Europe- the Beginnir'g of !he Chrktim Ero ro the Fourteenth Century, ChicagotLondon: The Univmity of Chicago Press, 1980, cE surtout p2O6 ct 2 16-17, p243sv. L'oumge de Boswell souleva une am& de boucliers, taut pami 1s mCdiCvisra gue pani l a mpupcmmts homoscxuels. A titre d'exemples, je ne doancni quc deux df6rmces : M. SHEEHAN, a Christianity and Homosexuality m, J o d of ficIesips1ic(1l Histv, 330 (1982): 43 8-46 ct H o m m d i t y , htoferance dChristiorriiy -A Critical Examhution of John B d l ' s Work, (Gay Saber Monograph, 1) New Yo& Thc Scholarship Committee-Gay Academic Union, 1981,Zp.
? L'Cvocation de l'homoxxualit6 est Cgdcment e x c q t i o ~ t k dans les rtgles monastiquts, mais Ics rams fois oii cettc paticpie cst mcntio~ke, elk est trb vioIcmmmt combattue (cf. par cxcmple la dgle dc Fructueux ol il est plus spkifiquemcnt question de pCd&astk (consectator ponnrforum olct udufescentium), Cd. J. Campos Ruiz et I. Rocca Melia, Sm Lean&o, S4n Isidoro, Smt Fmctumo, Regla mon&ticus de h E s p d visigodh - h s tres libros de I- " ' ~ I ~ I ~ c ~ Q s " , (Santos Padns Espaflal~s~ n) Madrid: Bibliotcca de autores ctisa'anos, 1971, xv,p.154). Sur la grande mCfiance dont fimt prcwe les Phes du Dbcrt B I'Cgard des enhts, entre autres par craintc du &sir qu'ils pouvaicnt suscitcr avec lem visages ferninins, cf. J.T. WORTLEY,
Aging and the Desert Fathers -The Process Reversed ID, dam Aging andthe Aged in Medimaf Europe, 4d- M.M. Sheehan, (Papers in Mediaeval Studies, 11) Toronto: Pontifical Institute of MediaevaI Shdies, 1990, p.69-71. s. Cf. VO' I, l7,col.5 1C. Sur les citations bibliques de Jeaa, cf. G. SITWELL, Sf Odo of CIuty- Being the
Lfe ofSt Odo of CIuny by John of Salerno and rhe LijZ of St G d ofAuriIfac by Sl Odo, London; Sheed and
particuliikment virulente, compte tenu de cette cornparaison nCgative avec I'm des
archetypes du MaI dam I'- c W e n . Il est possible qu'eIle ait ttt &rig& plus
#diguement antre les p&bsks, puisque, pdkement , HWe, le Uassacreur
d'enfimts, cst estoqUe, et que, deuxi&mement I'accd est p a t e comme le Scriba vero
quiprobabat tirones v.
La deuxibe critique de l'homosexualit6 dans les sources clunisiennes est
&finitivernent &rig& cone les pddCrastes. Pierre le V h h b l e monte en son De Mramiis
qu'un l l~~ghter d cm de ses p e r i eurent un rapport sexuel. Ici encore, le crime est place en
dehors de Cluny, bien que pas trop loin physiquement, puisqu'il s'agit de I'abbaye de
Tomus, et dam un contexte Specifiquement rnonastique. En stigmatisant un tel acte chez
les "autres", Pierre rappe1Ie B ses fils qu'il est &pte'bensible, mais il redorce aussi en e m la
volonte de Ie combattre, en les encourageant ii se montret meilleurs que les "autres", B se
dominer P oc les autres ont failli. Cette attitude est mise en Mdence par la forme du rkcit :
il est dit que le diable charge de pewertir Cluny s'ktait retrouve bredouille, bndis que celui
qui s'etait pn5sente ii Tournus avait, hi, bien dussi en sa missionn.
Une telle anecdote, de mkne que toutes les pr6cautions que j'dnum6rerai ensuite et,
peut4tre egalement, un chapiteau de I'abbaye clunisienne de VCzelay, reprdsentant
I'enEvement du jeune Ganym6de par Zeu?, sont autant d'iadices que le danger de la
pt5dirastie existait be1 et bien dam l'ordrr clunisien et &it combattu, et non tolid, par les
moines. I1 n'existe pourtant aucune trace qu'il avait be1 et bien cow. Deux explications
peuvent Stre avancCes pour ce fait. La premi8re est que la egle de silence Ctait appliquee
lorsqu'une accusation d'homosexualit6 survenait. C'est ce qu'afhne Idung de Prlifening
dam son Dialogue e w e rn clunisien et un cistercien, compost! autour de 1155. Selon lui,
Odilon aurait instad la coutume, peut9tre hentee de Baume, que si un mohe &it accuse
Ward, 1958, p . 2 0 ~ DM I,xiiii,p.46-47.
54. Cf. M.M. McLAUGHLIN, Survivors ... m, dans History of Childhood, 1974, n.186,p.I72 et Ilene H. FORSYTH, a The Ganymede Capital at Vdzelay V, Gesta, 15 (1976): 24 146.
de sodode, il devait &re pmi en cachette, dans la mesure oh son acte etait rest6 incomu de
la majorit6? Aucun des coutumiers, ni celui du Liber trumitilr, ni cew de Bemard et
d'ulrich, ne mentiorme un semblable &@ernento M a l e tout, ceci st compnndrait dam
l'wenidit6 o& les ClUILiSiens prCfeent ne jamak &oqyer ce sujet de manih explicite.
L'application 6 la rtgle du silence est en revanche confirm6e par un passage du Benr , dans
le cas;plus gcncrsl, d'une grm's d p a ; or, I'acte de sodomie etait sans wnteste me "faute
grave". L'extrait en question indique que, lorsqu'un crime &tit rest6 cache 1 la multitude,
son pro& et sa peine devaient &re accomplis dans le secreh par l'abIx5 aide de quelques
f&s. A l'autre extdme, si le pctcheur occupait une fonction P I'extdrieur de la cf6hue et que
sa Gute &it connue publiquement, il &it alors homblement (horribiliter) fouette au vu et
a Sed si quis aliquidpaucis notum cornmisit - quod si in public0 esset, dignum judicio p a v i s culpae ducetetw - ducit eum Abbas, sive Prior, in secreturn locum, m m e n s secum duos. aut tres eonnn quibus notum est crimen, aut alionnn quos voluerit, atque facit ei grave judicium senmdm commissi quantitatem, & injungit penitentiam. Si vero quilibec ad aIiquum obedent im exteriorem degens, crimen cornmiserit quod mmtifestum sit, in eodem loco pubfice coram omnibus, qui ejurdm habitores sunt, exuetur & ltorribiliter verberabitur, inde in Conventurn reductus ponetur in gravi culpa rS6
s5. Idung de PrIlfening, Dielogus duo- monachonun, &39 (dans R.B.C. Huygens, Le moine Idung et ses deux: omages : *Atgumenrunt super ~ u t u o r questionibus r et a Dialogus duorunt monachorum m, Spoleto: Centro italiano di studi sull'alto mediavo, 1980, p.106). Cf, aussi Jeremy O'SULLIVAN, Cktercians and Uuniacs. The Case for Citmux, Kdamamo (Mi.): C i i i a n Publ., 1977, p.43.
%- Bern t,lviiip.254. Un statut de Pime le V&&able laisse devincr la crainte de pratiquu homosermeIles entre un pricur d'un ptieud et un famulus mais, ici encore, tout nste au niveau du non-dit. L'abbC interdit formellement qu'un prieur mut& emmtne avec iui un de scs famuIi parce que :
Cataa imtitutihuiusfiit* srirktra quarumrlbm mum* nsc non diicembum wpicio, immo ma@ probatio, quae etsr' o h in hir fmulorwn de loci$ ad adloco ~rmiolionibus prmnerint, hoc dkcreto quantumjieri potuit, provhm est ne de reiiqrro provenirent. (Stat. 46.~~78).
Deja dam &m, il etait dit que I'Hmpiturius d le Conestabulus devaicnt observer si 1s moincs et prieurs de passage B Cluny ttaient accompagneS de rn famuli regulares, barbati scilicet, & idonei (Benr I,ix,p. 152 ; cf. G. CONSTABLE, introduction de I'Apologiae h e - Gozechini Epbtolu ad Walcherum - Burchurdi ut videtur, Abbatis Beilevallh Apologia de Barb&, dd. R.B.C. Xuygens, Tumhoutr B p l s , 1985, p.124-25).
Les moincs clunisicns craignaient non seulement que des activitb sexuelIes ne soicnt commiscs en leur ordre, mais aussi que la rumeur publique ne Ics accuse d'en commettrc. C c s t une des raisons qui expliquent I'existence de la r&gle du silence ; cette attitude est probabkment aussi B I'origine du 1.egfernent sebn lequel il etait interdit pour un prieur (de prie- de se ddplacer avec unfamultls encore imberbe ou rase (Bern f,ii,p.140). De rnanih plus ghdrale, i1 etait interdit un moine de Cluny de raconter les erreurs qu'il avait pu commettre & un moine Ctranger quia s e p euenit, utphrima destructiofiat in @so loco. (LT 198,p.27916).
Ainsi, la premih raison pour expliquer le silence des sources par rapport la pratique
possie de la pedCrastie B l'int&ieut de l'odre clunisien est que les moines de Cluny eux-
m h e s avaient prescrit m e rtgle du silence sur cette queston. La deuxi&me est la quintit6
&omante de pr&autions qu'ils prinnt, et ceci d& le debut de l'ordre, pour empfcher cette
pratique entre les prof& et les oblats.
Lorsque Jean de Saleme evoqua les coutumes en usage A Baume au moment de
rent& d'Odoa, il en d e v i t trois qu'il jugeait certainemat les plus rep&sentatives et qui
h t ensuite exportks ii Cluny et conserv6es au fil des sikles : la pratique du silence sur
de longs intwalles au cours de la joumb, l'habitude de rtblter Les rniettes la fin des repas
et la rnaniere dont un maitre devait accompagner de nuit un e n h t am toilettes7. Lorsqw
Bernard et Ulrich commenc&ent leur description de la disciplina des oblats (imm6diatement
aprh avoir expliqd comment ils ttaient q u o dans le mooastiie, puis comment ils quittaient
la schda pour s'incorporer dans le group des iuuenes sub wtodia), iIs d ~ c l d r e n t qu'ils
dormaient tous daas me meme section du dortoir, enc&& par Ies magz'sfri, qu'aucun autre
des profis n'avait le h i t de s'y rendre, puis ddcrivirent la manikre dont un maiw devait
accompagner de nuit un e n h t a w toilette?. Ce dernier dglement etait donc perqu cornme
fondarnental par les Clunisiens. Or sa teneur exacte justifie qu'on s'y mete. L'enf'ant
d6sireux de se rendre aux latrines devait dveiller son maitre, ceiui-ci devait a son tour
rCveiIler un autre enfimt, et tous les trois, 6clairts d'une lanterne, daient aux toilettes. Au
retour, le maitre ne pouvait 6teindre la lanteme qu'une fois les dew enfats couch&. La
lanterne plus le dewikme enfant arrach6 h son sommeil etaient autant de pdcautions pour
? VO' 130-33,co1.56-58. Deux dcs qua= chapitms* dont Ie premier, sont consacds au fait qu'un maim ne devait jam& 6trc IaissC seul avcc un oblat, pas meme pour l'accornpagaer de nuit aux toilettes :
Mos enim ejlll~dem Iocifirerats ut mogirter schola sol= nun solo puero nec gutupam iret solrem. nec ad nancrae digestionems sednec so fur puer seeretius ifli loquiproeswnetet : sed et proptw bonum tesfimonium dium epuerks aut umm exfiah'bus in cotnitu& vel l0~11tione semper rusumeret. Si uutem noxHer, er cusu accidente secessum puer petere, sine lucernae Iumine et a l rbme extra dormirorium pedem non mderet protendwc n (YO' 1,3O,col.S6C). Ct Bern I,xxvii,p.200-0 1 et UduI. III,viii,col,74 1-42.
que le maitn ne fnt pas laisst seul, sans thoin, en cornpapie d'un sed enfit?. Ainsi, d&s
les origines de Cluny, ua des principes fondatnns du r n o e fbt d'interdke toute
pmmiscui~ entre un oblat et un pro& : puisque Ies mauatres Went, de par leu position, les
miem places pour k6ficier de moments de solitude avec unpuer, ils k n t les premiers
Etre rtglement6s sur cctte question.
Un maitre ne devait pas marcher am CMS des edhnts mais les s u i d ; dans la
schola, les Cltves s'installaient d'un cdte du corridor du cloitrey les m a g i ! de l'autre, le
long de la balusttade, ce qui pI@t entre eux toute la largeur du passage ; et aucun fiere
n'avait le h i t de passer entre ces dew groupes6'. Toutes les occupations en rapport avec les
soins corporels nbssitaient des &dements particuliers pour &&lit. m e distance protectrice
entre les enfants et Ies adultes. Une section particulitre &it dservde aux oblats dam Ies
toilettes et au I ~ ~ r i u m ~ ~ ; en ce dernier lieu, des maitres devaient Ies encadrer pour les
? Par Ie commentaire de la RB d'Hildemar, on apprend qu'un enfant dhireux d'aller aux toilettes de nuit devait dveiller un senior et s'y rendre avec lui (cf. Hil&mar, p334 et M. de JONG, Growing up ... 1, JMH, 9 (1983): 1 12). I1 n'ttait donc pas question de se f k k accompagner par un deuxi&me enfant, ni de se munir exptessement d'une lantcme.
Bernard et Ulrich ont tous deux spdcifie que le maitre ne devait pas &in& la lurni&e avant que les deux oblars ne fussent couch& ; il existe cependant unt It?g&e diffdcence entrc l e a textes lorsqu'il est question de la sche de I'&eiL Dans les deux cas, I'enfant dveille b maitre h ide d'un son (sonitum), mais dans Bern, avant de I t fairt* il allme une bougie ; dans U&l., c'est Ie maitre qui l'allume puis la place dam la lanteme. Bent ~ i , p . 2 0 1 :
Si quik eoruwt heronun] opus habuerit in node ad necessarius irep prius latema accensu majore Magistrum sonitu excitat prop se jacentem, qui mrgerts surgere fucit & alium puerum, eonun alterutro eos ducit & redtccit, nec candelam extinguit* wpe dum ambo simt recolIocati ; rn
UclbI. IIIm,vii,co1.742C : Si pis eorum @uerorrmJ opus hobuerit in nocte ad necessaries ire, pprtus magistrum son& txcirat
proprese jactntan, qui -em gccendit 1tu:etnu.m. mittit in l~lemam~ surgere facit alium puerum. Eomm aIterutro summ tenente latentclm, medius inter illar mag&ter incedit ; sic niminm em ducit et reducit, nec cande' extinguit usque dim ambo sint recolfocati. I,
Le passage de Bern, est tds probablcment un &urn6 de celui d'Ulrich, mais un r€sume qui n'a pas Ct6 fait m~caniquanent. Pas question que Ie mak et I'dhnt fbcn t tous dcux Cveillds quelqucs instants dam le noir. Avant que le maitre n'oumi Ics yeux, I ' m t devait dlumer la lumi&c, Cette l&g&re correction du r&gIement indique qu'il n'dtait pas lettre mom.
a ESl etim coll~tletudo~ ut qummque ipsipueri insimul emtt vel in dormitori~m~ vel in Monasteriump vel in quemcumque locumt Magimi debent subsequi. (Bern. I,xxviiTp202)-
6'- Bern I,xmrii,p+209 et UhL III,vii,co1,747C. c- Bern I,xxvii,p.20 I et U ' III,viii,col-742C et 7441).
isoler des a m (a after ex olretaparte cingenfes eospropter aIim ma). Les edmts
se lavaicnt la t& a se sdparhent dcs pro@s? Au dfectoire, les prof& ne
pouvaient emroyer les ed&s leu chercher du sel ou a m chose, B moins qu'il ne s'agisse
des smicres, du prieur et & l'abbt assis B la table de ce dernier ; dam tel cas, l'enfaat devait
ttansmcttre le message & son maitre, qui allait chercher ce qui manquait et le remettait a
I'enhti Les pro& n'aV8ient pas nonplus le h i t , B l'exception de l'abbe et du celldrier, de
faire cadeau d I'M des pwri de quelque chose B manger. Enfin, les enfants pouvaient
seulement fairr signe ii leur metre s'il l e u manquait quelque chose i table6s. Compte tenu
de toutes ces restrictions, il n'y a rien d'ttonnant B ce que les echanges entre les enfants et
les adultes, qu'il s'agisse de paroles ou de signs, fussent &bits au strict minimum? Meme
ceux qui avaient le h i t d'entnx en contact avec les enfmts, c'est-&dire L'abM, Ie prieur,
le cell&, le cam&er, 1'~~11s/cantor et les rnagisfii, devaient le faire le plus rarement
possible et selon des dgles tr6s strictes, qui fwnt dCja t5voqu6es en diverses parties de ce
chapitre.
La n5glementation concernant S&hange de gestes entre les adultes et Ies enfants est
bien entendu la plus significative pour mesurer toute l'ampleur des mesures prises par Ies
Clunisiens pour empecher toute promiscuitd entre les dew groupes. Lorsqu'un £?&re h i t
r6inttgrd dam la communaute, au dernier rang, apris avoi commis une grande faute, il
devait s'agenouiller a w pie& de tout le monde, meme des enfants, mais B me certahe
distance de ceux-ci :
& provolvitur in primis pedibus Abbotis, & deinde Prioris, & omnium qui ex eu parte s ~ l f ; similiter ficit pedibus aliorwn ex alteru prrrre, & ad uitimum i~ fanturn, sed mufto remotius, quarn afiorum, ut nan iangat vestes eorurn ; d7
Bern. I~cxvii,p203. @. LT 154,p220, Berm I,xxvii,p209 et Udal. IIIm,viii,co1.747C. 65. Bera I,xxvii,p.204 et UdaL III,vii jcoI.7MS.
NuIIus unquam loquitw ukui eonun private. sini ad Confihsionem tunturn. (Bern. I,xxvii,p203). 6'. Bern I,lviii,p.254. Cette recommendation rappelle celle faite aux iuuenes Venus accuser des pueri
pendant leur Chapitre : a & @se chmabit eos in ilforwn C q i t d o ; sicut stab& muItum rem~tus rtb eis, & dicro Benrdicite, dicer oflemarn ; (Bern. I~vii ,p202).
La description de la d k e de comiger physiquement les dmts enlbe tout dome sur le
fhit qpe, dans le rapport obIat-adulte, Ies prhutions prises n'avaient pas pour objet
d'empikher l'dmergence du d&b de lte&t mais bim de restreindte celui de l'adulte. Le
premier passage provient du coutumicr d'tntich et explique comment l ' ~ ~ devait
a Siimmopere tumen obsmcrt, tam ipsr qumn alii, +0 eos verberct, non solum ne tangant camem enrum cum manu, sed e t im ne vestis ejus eonan adhaereat vestibw ; nunquum namqae e m puIm eorum percuntiuntvr mQlEjlIue, seed, si oplcsfierit magisret solm, qui eos ducit putest capiIIos excutere ; o h rnmqu4n1, m6'
Le deuxjhe est extrait de k. II y est explique comment le maitre doit coniger les petits
lorsque ceux-ci tardent ik se coucher :
& sciendunr quod hoc est tota disciplia eorum, a t caedwtur virga, aut fortiter vellunlw eis capilli, nunquam enim calceo, pugno. palma. vel alio quolibet mod0 disciplinantur, nisi solum ut dictum est. d9
L'usage de l'adverbe fortiter inierdit de croire que ces restrictions impos6es am mdthodes
punitives avaient pour but de limiter les souf3kmces infligh a w oblats.
Je conclurai cette liste des interdits par la conclusion d'ULrich au chapitre des
enfants :
Vbicunque fierint, panluntIibefO locus firerit angustus, et quantalibet sit fiatrum multitude, tumen omnes cownt ita appropiare ut vel tangatur ab aliquo vestis eorum [des enfants]]. Et ut tandem de ipstkpuen's concludmn, saepenumero videns quo studio die noctuque clcstodiuntur, d m in corde rnoo dz@cilefieriposse ut ullw regis fiIitls majore diligentia ntltriatur in pakatio quum p e r quilibet rninimrcr in Cluniaco. m7'
% UribL XII,viii,coL749C- Le mCme passage, qui se trouve dam Bern dam le chapitre sur l'mmills, est plus succinct (Benr I,xiv,p. 163).
Bern I,xxvii,p203. 'O. Con. quantumbl'bet. 'I. U&L ilI,viii,co1.747C-D. La premik phrase de ce passage a C t t reprise prcsque mot pour mot par
Bernard : ubicumquefieriht quantumIibet sit locus angustus, & pantalibet sit Fratrum muItitudo ; tamen ornnes cmer ita eir apprpiare, ut non tangatur ab ~Iiqtro vestis eonun (h I , ~ ~ ~ i i , p 2 0 9 ) . Bernard utilise la seconde pour conclurc son chapitre mais en la -ant, si bien que le verb mtrire cn est absent ; il a ju te conserve I'idCe principale qui h i t que le plus petit des oblats clunisiens &it mieux tlevd qu'un fils de roi : a Et ut tandem de ipsis peris c o n c l u h : d8ciIe mihi v i k , ut d b Regkfilitrs majuri diligentia nutriatur in palotro, quam per quilibet pamlus in Cluniaco. . (Bern., I,xxvii,p.2 1 0)-
Ulrich est Qnc fier d'armoncer que jamais les Sres n'efneuraient mhne le vetement d'un
dant , aussi petit puc mt le local oil ils se trouvaient a aussi grande que Bt la multitude.
Puis il termine en affirmant, que les d t s clunisiens Went teIIement bien gad&
( c t c s z o d i ~ ) que m h e un fils de mi ae powait pas &re mieux &lev6 (numbm). En ces
deux d e m i k phrases, sont &nun& dcux des caracttristques majeures de la f o d o n des
oblats Cluny : leur surveillance hcessante et la clainte qp'ils n'aient des contacts physiques
avec les addtes, la troisi&me caracf&istique &ant la formation par !'imitation. L'etude des
coutumiers permet donc de conclure, en accord avec ce que l ' d y s e des Vitae avait mis en
valeur, que la perception clunisienne de l'enfmce &it surtout faite de mdfiance : mefiance
par rapport i la nature des entsnts avant qu'elle ne soit model& par I'bducation, mefiance
par rapport I leurs aptitudes intellectueUes mais surtout mefiance que le m o d e exterieur ne
leur trmsmette ses vices et que le moine adulte ne succombe ii leun charmes. I1 fallait donc
qu'ils soient sans cesse placb sous le regard de tous, mais jamais en contact avec un seulR.
Une large part de cette mefiance s'tvanouit B partir du moment o~ les oblats
d i s p m n t presque complktement de la scene monastiquen ; ce qui explique partiellement
l'image plus positive de l'eot8nce qui se fit jour des le dibut du We siicle. L'enfant n'dtait
plus pervu comme lYinfCrieur de la communautC puisqu'il den etait plus membre, mais
comme un candidat potentiel I la vie monastique : or, en rkgle gdnhle, les infiirieurs, que
Je suis amvaincue qu'il s'agit ici d'un emprunt de Bernard B UIrich du fhit, pcemiercment, de l'emploi du "je". exceptionnel dam les coutumiers mais habitue1 sous la plume d'lllrich, qui indique quc cette phrase ne peut que difficilement provenir d'une sour# perdue dam laquelle Ulrich d Bernard auraient tout d e w puisd ( thh de J. WOLLASCH, 8 Zur Verschriftlichung der IciUsterlichen Lcbcnsgewohnheiten unter Abt Hugo von Cluny m, FrlihSr. 27 (1993): 3 17-49), ct deuxi&mement parce qu'il est plus logique que la phrase de Bernard soit une contraction de ceUe d'Ulrich plut8t quc cellc d'Ulrich un ddveloppement dc ccUe de Bernard.
=. te regard joue d'aillcurs un r6Ie central dam Ie sys the clunisien. C'cst setdement par lui qu'on pcut r6ellcrnent apprendrc la complexit6 de l'ordo (U&, II,iv,co1.704D). Ccst @ce lui que sont relev& les fautes d u uns et des lpma ; celles-ci ae sont pas aussitbt dCnonder mais tues jusqu'au prochain Chapitre : Ies circatores cmnt en effit au hasard dans Ie monasth de faqon que les Mres aicnt toujours I'impnssion que quelqu'un les observe (UiW, LII-vi-vii,co1.740-41). Mais c'est aussi B cause du regard qu'on peut commencer ii pdcher, d'oG la Wquente obligation de kisser le capuchon sur le visage, entre autres am toilettes.
n. La suspicion de ptd&astie restait potsrtant attach& aux moines, cf, la plaisanterie racontk par Walter Map sur le f& que saint Bernard s'ttait couch& en vain sur un enfant pour k ressusciter, De nugis curiaiium (dd. et trad M.R James, C.N.L. Brooke et MS. Mynors, Oxford: Clarendon Press. 1983, Dist.I,c.24, p.8 1 ; l'anecdote est reprise par J. BERLIOZ dans Saint Bernard, le soldat de Dieu % dans Moines et reIigiez# au Moyen Age, prb. J. Berlioz, Paris: Seuil, 1994, p.52-53).
cette infiorit6 soit dCMe par leur be , leur sexe ou Ieur race, wnt presque toujours pequs
par les tenants du powok comme des &cs l'csprit h%le a au corps dangarx. Ce danger
qye icpPbclltat le corps 6 t h etait accru par la situation Specifique qui avait cours dans
les monashs : en ces espaces dcpounm de h e s , comment eertains m o k auraient-ils
pu ne pas @ewer du dtsit & 19€g2d de ces p r C - p u b qui ressemblaient plus leurs r n h
qu'k lews p k s , d o n les p r o p mots d'odon de Cl~ny'~ ? Parce que les dmts
rrpFCscntaent un tei danger et parce que, pour terrains, ils suscitaient la s o m c e du d6si.r
&prim& il est n o d que la majorit6 des moines n'aient pas perqu lespueri sous un oeil t&s
clement L'indulgence, la tendresse et m i k e pdois L'&nerveillement qu'on s'attend
aujoclrd'hui i tmwer dam les adults en charge de l'enfance n'dtaient pas totalement absents
des abbayes mais fiisaient concurrence P des sentiments plus negatifk, que la situation assez
exceptiomeUe de la vie monastique permet d'expliquer, saas pour autant les justifier.
CONCLUSION
Le portrait assez sombre que je viens de dresser du traitement des enfmts I Cluny ne
doit pas &re g6nit.alist5, ni a tout l'ordre, ni surtout I toutes les 6pques. Pierre le Vh6rable
est indeniablernent un des $rands homes de la prerni&re moitid du We siecle, dont la
qualie de I'drudition ne peut &re mise en doute ; or, il fut requ oblat vers l'iige de cinq-six
aas dans l'abbaye clunisienne de Sarodllanges et c'est en ce lieu qu'il fit s& 6tudes. A l'autre
extremite de l'histoire clunisieme, Odon fut egalement remarquable pour sa culture et
VG' I, 1 S,coL652C : Pubexentibus enim ~ltl~teriorem se ptrrebebat, dice- q u d iiliur aetatis tempus vdde sir pericuIostlmP
quado quiiibet adoiescens matemae wis sinrJIiVudinrrrr, vtifaciei dopontns, pafernam hc@& assumere vocem vet vul'um a.
I1 est evident que I'absence de femme n'explique pas tout et qu'il faut garder I'esprit le fait que, quelques sitcks plus t6t, pendant I'Antiqyitt!, plus particulihemcnt chez les Grecs mais aussi chez les Romains, le corps enfantin, mile ou femelle, h i t pew comme un objet sexueI potentiel (E. EYBEN, R d e s s Youth in Ancient Rome, LondonMew York: Routledge, 1993, p.24 1-43).
I'impoxtance qu'il attachait h la quEte du savoul ; or ce fbt pdcis6ment pmce qu'il &ait un
scholasticus qu'on le nomma llulg&ter de la schola de Baume dts son arrivk en ce lieuz.
Cette information du fait qpe, Baume tout au moins mais pmbabiement aussi A
Cluny, il Ctait jug6 important en ce dtbut du X siWe qye le plus savant de tous se consaae
ii la formation des enfimts ; le but de celle-ci ne se limitait donc certainement pas h la simple
mhorisation de tcxtes a chants religieux, a B l'imitation des ah&. Au milieu du XICsi&cle
'. Par la trta Odor&, on apprend que son p&e &it un homme fort savant pour son temps, Odon prkente son p&c en ccs tcnncs :
Pater, inquit, meur Abbo est vmalu~, sed oiferius mork viiakbcltrrr er actibus. quum nunc hami'rres presentis temporis esse vhkntm Vierum namque hktorias, Jitstinimi Noveflm memoriter retinebat, In suo n e w convivto evangeIicus senper resonabat senno. (YO' I,S,co1,4546).
Outre son influeace, son fils benCfich egalement des cnseignemcnts d'un vieux pdtre (VO1 197,co1.46D), puis de la formation offeat Saint-Martin de Tours (mais il rejcta I9~tudt de Virgile pour ceUe des tcxtcs cMtiens, au grand dam dc scs conWcs, VO' IJ2-13,coL49A-B). En ce lieu, on le voit aller de nuit prier au tombeau de saint Martin, emportant toujoun avcc lui de quoi Ccrk (YO' /14,coL49D). I1 partit ensuite parfaire ses connai#ances A Paris, sous la direction de Rhny d'Auxerrt (YO' I,19,coL52A), Lorsqu'iL entra Q Baume, puis lorsqu'il passa de ccttc abbayc B Cluny, il appotta avec lui cent livrcs (YO' I,23,co1.54B), ce qui repdsente, pour l'-e, me bibliothtquc de vdeur, le s i x h e du fonds clunisicn tel qu'ii se p-tait caviron un sikle et demi plus Prd (Veronika von B w , Le catalogue ... m, Scriptorium, XLW (1992): 256). L'important n'est pas de savou si cctte information est fond& ou non, mais de noter que, pow l'hagiographe d'Odon, elle est source de glorification : il juge fondarnental d'expliquer que Cluny se d4vcbppa sur une base intellectuelle aussi e~ceptionnelle~ Devenu abM, Odon est ddcrit par Jean cornme ayant souci d'tduquer les jeunes qui I'entouraicnt, dpondant & Ieun questions (cf. par exemple YO1 III, 1 ,coL75C).
Dans la Vita Gerddi, Odon insiste, cornme je I'ai dtj& soulignt, sur la fmesse d'esprit du saint, acquise ii la suite d'une 6dudon religieusc t& pousstc pour un l a k I1 Cvoque le ddroulement des repas i la cow de Gekaud, oh cefui-ci et lcs cIcrcs dont il aimait s'entower dhtaient de religion a d'intcrpr6tation des texts ( V f I,xv,co1.6S2B-D).
. s Nom p t r i Odmt quia e m vir schoIastic~ls, laboridnun scholae imposuemnt mug&terium. (YO ' IJ3,co15QB). ', I1 faudrait pourtant nuancer ceae affirmation. L'autcur dtait un Clwisien de fiaiche date, &digcant pour
un public du Sud & 1'Italie. En 4crivant cela, Jean de Saleme essayait de convaincrc son p r o p auditoire, les moines de son monastere de Saleme, dc la valeur de Cluny. On ne peut donc pas afEkncr avec certitude, sur la base dc ce seul texte quc, pour lcs Clunisicns cux-m&ms, la culture b i t une prioritt. I1 est seulemcnt possible de d6clarer que, d o n Jean, montrtr que I'institution dont il se proclamait It rept3sentant h i t tr& soucieuse de savoir b i t un argument positif pour convainere les moines du Sud de 1'Italie de se raIlier ii ce mouvement.
Odon et Pierre le VdnCrabIe ne fiucnt pas les dew seuls abbts cultiv& de Cluny, loin de h : Maeul par exemplc r c p t unc solide fornation a ses hagiographes n'oubli&rent pas dc souligner ce fait, prewe qu'ils y attachaient de I'importance (cf, D. IOGNA-PRAT, Agni immacufoti - Recherches sw les sources hagiogruphiques relrtliwr ci saint MareuZ & C . (954-994). Paris: kd. du Cerf, 1988, p.322-23 a Kkf' ii- iii,col- 1765, VM 12,p0183 et I.4,p.185-87, W colO948A, KIP IJ,col.658A-B et Wco l . l784A). Md@ tout, le cheminernent intellectuel des h o m e s choisis pour diriger Cluny n'est absolurnent pas repdsentatif. On ne peut rien en deduire sur le bagage intellectueI du moine clunisien "moyen".
enfin, le PZancttrs de Jotsaud a sa Vita Odflons tdmoignent du trts haut niveau de culture
qw p~uvait OW
Pourquoi cette situation se modifia-t-elle duraat la deuxi&me moiti6 du XIe sikle ?
J'expoStrai &verses hypothhcs pour expli~uer ce phhom&ne dans les lignes qui suivent,
En prrmier lieu, I'acx~oissement trts net de la wmmunad fit en sorte que les occupations
usuelks d'une jom&, tels les repas, l ' o p Dei et le Chapitre, pirent de plus en plus de
temps et empicttrrnt sur 1s @odes qui powaient ihr dsewdes B l'education des enfa&.
Par ailleurs, la c o m e prit une place grandissante si bien que toutes ces activitds
quotidiemes h n t accompagDks d'un decorum qui w cessait de s'alowdir et entrainait
d'autres retards dam I'accomplissement des tiiches ordinairrs. Je suppose donc que les
e h t s furent de moins en moins bien eduquds. Surtout, la coutume devint le dogme, et ceci
d'autant plus facilement qu'elle itait maintenant fix& sur le parchemin : en voulant imiter
ce qu'ils pensaient &re l'existence des anges, les Clunisiens voulurent fonctionner sur la base
de *dements idtaw, qui devaient pennettre d'tviter tout dimpage. Or la pdsence d'enfants
constituait une some de danger, d'instabilitd : il fit donc jug6 n6cessaire d'enfermer ces
pueri dans un tissu tr&s sent5 de dglements, qui les empEchaient de parler avec quiconque,
de toucher qui que ce soit, de ne rien faire qui n'dtait pas agr& par la loi, en un mot, un
carcan de lois qui les empkhait de grandir et de s't5panouir normdement.
L'anivde de plus en plus massive de convertis adultes d m l'enceinte du momstere
ii partir du milieu du XIe siicle dut faire en sorte que cet immobilisme dam lequel &it
rel6gue l'enfant se prolongeait au-delh des annks oh il prenait habitwuement fin. Parce que
les *lux de morbidit6 et de mortalit6 dam une abbaye m&i%vale dtaient relativement &lev&,
'. Cf. F- ERMINI* I1 Pianto di Iotsaldo per la mom di Odilone m, Sfudi MedievaIi9 1 (1928): 392-40 1. '. UIrich ct Bernard constatent tous deux que l'agrandissement dc la communaut6 a f i t en sorte que les
moines dtsireux de ctlt?bcr des messes ptiv6cs pendant les p&iodes dc temps libre n'arcivaient plus h Ies achevcr (UdaL I;xviii,coL668A a Bern II,xx,p.324). Puisque les enfants dtaient souvent &duquCs dam la schola pendant ces rnihes mtervalIes de la joum&, on p u t en deduin que Ie temps allou6 h IT6ducation avait egalement diminut.
9 Un excrnple de l'importance dcs taux de morbidit6 clans les abbaycs est donne par I'architecture mEme de CIuny 11. L'infmerie comptait de la place pour trcntc-dtux lits, qui devaient servir a w malades mais aussi aux vieillards, alors que Ie dortoir des Wres contenait seulemcnt cent places (KJ. CONANT, a MedievaI Academy Excavations at Cluny. VIII': Final Stages of the Project m, SpemIum m, 29 (1 954): 9).
un roulement assez rapide existait dans la distniution des charges, si bien que Ies &ts
devaient assumer assa tbt dcs responsabiit6~ cornme seconds des officiers monastiques :
entre Ies ksoias que nkcsitait le bon fonctio~ement de l'abbaye d'une part, et la crainte
qu'l n'y ait promiscUie mtre un adulte a un oblat d'aum part, les moines donnaknt sans
aucun doute priorit6 aux premiers. Ainsi, pame que l'oblat ne tadait gutre B obtenir un
powoir auJsi minime soit-il, il rnthhait plus ou m o b normaSement En revanche, partk
du moment oir des convertis ne asstrent d'afnuer 8 l'abbaye, il est logique de penser que,
entre l'enf8nt 11~~tu.s sans e m e n c e et l'adulte convers dej& habitut i I'action, le second
fbt #f& d& qu'un poste venait & s'ouvrir. L ' d m t restait donc dans un &at de soumission
totale un plus long laps de temps.
L'essot de l'ordre clunisien ne put qu'accentuer cette tendance. Tant que la "famille
monastique" se & d t B un monastere, les nuhiri, qui connaissaient par coeur les rites,
modes de vie, espace et envirormement du lieu pour les avoir pratiqu6s depuis deji de
nornbreuses annies, Mneficiaient d'un serieux avantage sur les convers. D&s lors que
l'abbaye ne fbt plus qu'un rouage dans l'imposante machine de 1'Ecclesia cluniacensis, les
postes de powoir devaient &re pourvus par des h o m e s ayant une borne connaissance des
dgles de vie en vigueur a l'ext&ieur de la cl6ture. Ce qui avait W un atout pour les oblats
devenait bwquement un terrible handicap.
Enfin, lice a B'anivke massive de convers et le d6veloppement de l'ordre clunisien,
la mise par ecrit des coutumes mina le demier bastion du pouvoir des nutrM Cornme l'admet
Ulrich lui-meme, il ktait encore usuel de son temps que la charge d'amturi~s~ une des plus
importantes du monastire, soit remplie par un oblat7. Cette pratique s'explique par le fait
qu'un tel moine connaissait padhitement le rituel liturgique pow I'avoir pratiqu6 pendant des
d6cermies. UIrich cite ainsi un iuuenis, ayant vdcu depuis ddjh vingt-cinq am au monast&re,
comme sa source pour savoir queues antiennes il fdait chanter ii partir de l'octave de la
R&wrection8. Mais, I partir du moment oh les cometudines fixrent £k&s sur le parchemin,
cate JllpCrioritd des oblats sur les convers d h q m t Le statut 66 de Pierre le V€n&able nour
apprend que, B peine rm dd-s ikle a* la rddaction du coutumier d'ulrich, aucun oblat
ne remplissait plus les charges d'importance de l'abbaye, telles celles de cantor
hebdomadaire a de prieur claustral, deux fonctions qyi nkesitaient pourtant m e
connaissaace intime de Ia coutume?
A partk de la fin XIr d&ut We sitcle, les oblats, tardant trop & devenir adultes, peu
ou ma1 Cduquds cornpads a w convers form& dans les b l e s urbaines, compl&ement
ignorants des us et coutumes du monde hors des murs du monasth et devenus minoritaires
B lTint&ieur de ceux-ci ne reprent plus de charge importante dans les abbayes. Le ddclin de
l'oblation au sein du monachisme traditionnel devint dots Wm6diable ; cet &tat de fait
influa ii son tour sur l'attitude du monde extdrieur vis-&+is de cette institution. Les lacs,
peut-etre parce qu'ils considhient maintenant important de laisser a leurs fils la ddcision
d'entrer ou non en religion, certainement parce qu'il n'y avait plus gu&e de futur pour ceux-
ci s'ils entraient comme oblats, donn8rent moins sowent lem gaqons encore infantes awr
abbayes. Les noweaux ordres religieux fond& h la mkne m u e l a r e h k n t . Maintenant
que les oblats dtaient devenus inutiles au sein d'une abbaye, pour les raisons exposies ci-
dessus, les d6savantages lies a leur pr6sence clans I'enceinte monastique parurent
inadmissibles : ils empechaient une vie ascetique stricte du fait de la faiblesse de leur
constitution et reprkentaient une menace sexuelle pour des homes voub la chastet6.
Quelques decennies plus tard, le droit canonique enttrina ce changement des rnentalitts en
d6clarant qu'il fdait laisser I l'enfant le libre choix de devenir moine. 11 serait ironique de
noter que ce grand progrts par rapport aux droits de la persame ddcoula en bonne part du
fait que les monast&res n'avaient plus g u h besoin des enfants.
Le constat du dklin de l'oblation au sein de l'ordre de Cluny au toumant des XIC-XIIC
siecles soul&ve a posteriori la question du pourquoi d'une telle situation. Cette pratique
occupa me place fondamentale dans l'bistoire du monachisme occidental depuis saint Benoit
jusqu'h la fin du XIC sikle, au point que, sm p&s de six sikles, les oblats mnstitubnt la
M e source de recmtement des abbayes. Les motivations des parents ne seront pas ici
&oquCes, mais miquement celIes des moines. Un fact^ non negligeable est qu'ils
n'avaient pas le chok : si les pfemiefs 6lans du monacbisme domknt lieu ik la conversion
Nmie, cette source dut se tarir en grande part. Mais la contraiate n'explique pas tout. Les
h i t s monastiques Wssen t L'importance fondamentale qu'attachaient les moines au fait
qu'un individu fit entd dam 1 ' ~ ~ l i s e ab infintia1'. Quelle en etait la cause ?
L'enfant qui arrivait au monast6re Ctait m e tabula raw1'. Les moines coasiddraient
qu'en le prenant tout jeune, dots qu'il ne connaissait pas encore le sexe ni les habitudes
avi1issantes du monde sdculier, il etait ais6 d'en faire un individu pur, P l'exemple des anges.
Dam une societt ob la sexualitti n'etait pas encore controlde par l ' ~ ~ l i s e par le biais du
mariage, ce qu'elle sera beaucoup plus B paair du ddbut du We siMe, c'est-Mire au
moment meme ok I'oblation est st5rieusement remise en cause, les jeunes seigneurs perdaient
leur virginit6 bien avant leu nuit de noces, le plus souvent en compagnie de serves. Pour
cette raison, Odon trowa tout ii fait exceptio~el que Geraud sGt esister I une semblable
tentation durant sa jeunesseL2. Pour obtenir me armee de vierges qui prient le Seigneur, il
'9 On peut muver des exemples de t'impartana aftachde iZ unt conversion ab infantia dam la majorit6 des Vitae de mon corpus (cf. par exemple, au sujet de MakuI, a Dulcoren nitor hic a rurcro imbiberat et tdeo pudicitie nitor in eo incanduerat m, KiV 1.3,p.185), mais i1 nc s'agit absolumcnt pas d'un t o p s particulier A ces sources. Ainsi, dans 1'Electio Domini Odilonb dditde par D- IOGNA-PRAT, !'auteur trouve le moyen de souligner la conversion enfantine d'Odilon clans les quelques lignes qu'il dMie au grand abbC :
Qui elark patribus prenobifb Odilo dictus* Terrea mlufirgiens tenw annis cefica qrcerens, Pafri Maioio iumit se preduce chrbto. w (Agni immacuI'i, 1988, p303-04, v. 10-12)
P.A. QUINN constatt la transformation de cet iddal B partir de la fin du XIe sikle, c'est-adire au moment mime oh I'oblation dCcline (Better than the Sons..-, 1989, pxvii). MalgrC tout, Philippe de Novanr dklarait encore dam son owrage Des i ' t e n z d'ages d'om que, pour devenir chevalier ou homme d'kglise, soit les deux KUIS mdtiers ouverts a m fils nobles du Moycn Age central, l'tducation devait commencer particuli&cment tbt (cE Los Quatre Ages de 1 *Homme - Trait6 moral de Philippe de N'me, &d. M. de Freville, Paris: F. Didot & Cie, 1888, 14p.10 et M.M. McLAUGHLIN, a Survivors ... a, dans Histoy of Chifdho~d, 1974, p. 13 7-39)-
'I. M. de JONG, a Growing up ... a, JMH, 9 (1983): 106. ". a N m m numque et inusitaturn illi erut, quodaIiquis jwenculus naufiagium pudoris tutu evasisset.
(VG' f,Lx,co1,648A).
fdait donc exhairr les d t s du monde d'ici-bas, avant l eu pukatu. Par ailleurs, la
croyance en I ' e m e mall&ibilit& de l ' h e enfhtine, coup16e avec la conviction que le
l e p e r le pIw tbt possible B l'influeace Iaque. Surtout, c'Ctait l'image que se faisaient les
moines de la vie monastique idtale qui nhssitait me formation dts I'edhce. Le
comrn'andement qui occupe la ptemik place dam la rtgle de saint Benoit est de fain
abnegation de sa volonte pmpreI4 : or la passivitt eafmtine rend& cette injonction facile A
appliquer, puis ii maintenir au-delii meme de I'enfsnce, puisque le moinillon ne connaissait
pas d'autre mode de comportement, Si I'obeissance &it la premik qualit6 exigde du moine,
son occupation essentielle etait la lausperennis. Pour que celleci soit parfate, il ffaait lui
adjoindre le choeur enfit in. L'idM musical des Clunisiens est indissociable de la presence
des oblats en leurs rangs : tandis que Ies Cisterciens, qui les refidrent dam leur ordre,
demandaient un chant d e , les moines de Clmy pkfiraient les intonations aigues, presque
feminines1< Enfin, les Cluaisiens ttansform&rent toute leur existence, et pas seulement leur
activitg liturgique dam L'Cglise, en un duel tds pdcist6. Pour que celui-ci soit accompli avec
". Sur I'importance capitale de la virginit6 pour Ies Clunisiens, cf, D. IOGNA-PRAT, Agni immacdati, 1988, entre auttes p-vi, p.50 et 324-34.
''. Il n'est pas fait rnoins de quatre mentions de I'ob&issance dts les deux premi&es phrases de la dgle : a Obsmlta, of& prueceptu ma@@ et i m l i ~ -em cordk mi, et ahonitionem pri'patrik libenter exc@e er ecac i te r conpie. ut ad eum per oboedientiae laborem redeas. a quo per inoboedimtiae desidiam recesseas. Ad re ergo nunc mihi senno dirigitw, pikqui3 abrenunfians propriij ualuntatiaus, Domino Christ0 uero regi mifitahmu, oboedlmtiae foribima atque pwecIaru anno sum&- (RB Prof.,l3).
Sur l'ixnportance de I'humilii& et de I'obeissance pour les Clunisiens, cf. D. IOGNA-PRAT, Agni imntaculati, 1988, p.3 19-2 1.
'I Cf, C. WADDELL, A Plea for the fmtitutio sanctiBemcadiquomodo cantare et psallere debamus B,
dam Shim Bernard of Clai~410t. SIUde commemo~ating the eighth cententvy of his cononbtion, M. Basil Pennington, Kalamaun, (MI): Cist, Publ., 1977, p.191 et Idung dc Mfening, Dialogus, 1,40/41, Cd. RB.C. Huygens, Le moim Idung, 1980, p107.
16. Cettc importance accord& par les Clunisiens A une vie rdglde ap-I d& la Vita Geruldi d'Odon. Dans ce texte, I t d-tme abb6 dc Cluny & q c la faute &Adam ct ddclare que cclui-ci fbt damn&, non parce que Ies h i t s de I'arbtt Ctaient mauvais, mais parce qu'il lui avait &6 interdit d'cn manger (VG' D,Praef:, co1.669A). Ainsi, pour Odon, lc tout premier impratif impod B l'hornme par Dieu est de se conformer a w Iois de son groupc d'appartenance : pour les moincs, fa RB additiomh de la coutume, pout Ies laPcs, les cornmandements que donnent pdcidment la Vita de Gdraud. Le dcit par l'hagiographe de la fondation du rnonastere d'AuriI1ac o f h un apequ dc ce qui fait un bon moine. Odon ne fonnule aucune critique quant au fait que Gtraud ait empli son monastere de nupiti, c'est-hiire d'enfants qui lui avaient ttt! confids par leurs parents. Ceux-ci furent envoy& dans un rnondre oh la dgle &it strictanent mivie, dans le but de les former (a apud froternitatem illam sub n o m regulwi a), puis on Ies installa ii Aurillac. Si le monasttre dCclina
perfection, il fallat que les moines l'aient entibment inttgd dam l e u chair et dam leur
h e , au point de l'accomplir aan~ellernent. Or, un enfht qui I'avait dp&t am& apds
an&, depuis qu'il etait tout petit, le comahait beaucoup mieux que des homws d v b
deji m b H l'abbaye et habit& B un rythme de vie tout autre.
Tant qye le but de l'exktence monastique fbt d'apprenb B imiter la vie dleste des
anges, un moine baignant depuis l'edmce dam ce milieu Ctait jug6 supdrieur ii un adulte
conveai sur le tard et encore trop impdgn6 des miasmes du m o d extdrieur. A partir du
moment o~ les moines ne mirent plus l'accent sur le comportement exttirieur, mais plut6t sur
la spiritualit6 int6rieure17 (& rnoins que ce chmgement d'objectifsoit une co&quence et non
une cause des transformations dans le recrutement des monastkres, ce qui est fort possible),
'ImmMiatement, ce ne fkt absolument pas parce que G h u d ne s'&ait pas prtocxupk de l'adhbion des enfants au pmjet modque - non, cet aspect de la question n'est pas meme envisage par Odon - mais pace qu'i1s se retrouvhnt sans supt?rieur ii leur Gte dam la nouvelle fondation- La const!quence desastreuse fit qu'ils ne se somirent pas B la dgle : a rrgorem dkciplinae negf'exerunt,. (VG' II,6,co1.674A-B). Ainsi, peu importait la conviction inerieure des momes, seul cornptait leu comporternent extdrieur ; et celui-ci h i t pew comme Iouable, si et seulement si, il b i t cn accord avec la dkc@lina.
", CE par cxemple I, VAN'T SPUIER, Learning by Experience : Twelfi-Gentury Monastic Ideas *, dans Centres of Lemming. Learning and Location in Pre-Modem Europe and the Neor East, €d, LW- Drijvers et A.A. MacDonald, LeidenNew YotWKOln: EJ, Brill, 1995, p.197-206, oh le terme experience ne signifie nullement I'irnitation des anciens, mais I'expdrience intcrieure,
I1 ne faut pas m a l e tout concluh qu'll partir du XII' sikle, l'dducation ecclCsiastiqut (ou toute autrt d'ailleurs) porta exclusivement sw l'esprit a l 'he au ddtriment du corps. L'Ctude de LC. SCHMITT, Lo r&on dis gates u k r I 'Occident mpdidval (Paris: Gallimard, 1990), a bien mis en valcur toute I'importance du geste pour l'hommc mBdiCval. Pourtant, selon ce chcrcheur, cet intdrEt pour la gestuelle ne prit vkritablement son cssor qu'au XIe siecle ; 1'Ctude des coutumiers monastiqucs engage modulcr une telle affmation. De manih plus g€nCralc, Roy PORTER a soulignd le fait que 1'6ducation cut ratcment une vocation uniquement intetlcctutfle travers I'histoirc :
= Similarly, a history of education which exclusively concentrates on the achievement of skills such as reading and writing will miss one of the prime firnctions ofthe ragged, charity or elementary schoot in the past : instilling physical obedience, or education as a process of breaking children in. rn (a History of the Body rn, dam New Perspectives on Historical Writing, &I. PI Burke, University Park (Pa.): Penn State Press, 1992, p 2 19).
En rkalitd, l'apprentissage d'un %ona comportement fit toujours une priorit6 pour les dducateun comme I'atteste la d6finition du Paedrrgogus d'bidorc de SCviIle : I P. R F ~ cuiporvuli adrigmntw- Graecum nomen est ; et est conpasiturn ab eo quodpuerm agat, idest dirctet et fascivimtem r+net aetatem. 1 (Etymulogi~rn she origimm Librim, De Vocabuiark, livre X, Cd W.M. Lindsay, I, M o d : Clarendon Press, 1957 (191 I), ff206). Mais ce qui est remarquable dans Nducation clunisienne de la deuxi&me moitie du XIe sikle est qu'elle semble n'avoir accord6 que tr6s peu de place au dkveloppement de l'intellect.
la fone d'he qye dhotait m e conversion sur le tard rendait le repenti sup6rieur & renfant
qui n'avait jamais eu ik choisit, pas plus le Mil que Ie B i d
L'oblaaion se maintint dam l'@ise m6diMe au-deb du We sikle, car il existait
toujorrrs des parents t&s puissants dont les monestbes ne pouvaient que Mcilement refiser
la progeniture, m2me d&iIe, et 1s richesses qui I'accompagnaient ; malgr6 tout, m e telle
dans la vie moaastiqpe n'ttait plus une source de glorification, au contraire. Puique
les enfants etsient plus rares B I'int&ieur de la c16ture, les moines cesserent de les percevoir
B travers le regard du magister, c'est-A-dire c o m e d a p e ~ u r s d'ordrr et des menaces
pow la paix de l ' h e des adultes. Un discours plus positif sur l'enfance powait alors
commencer B se faire entendre.
". D. IOGNA-PRAT a mane dam son dtude sur les sources hagiographiqucs de MaVeul comment le .t sacrifice virginal place Ics moines entre anges ct homrncs (Agni imm~cs~iuti, 1988, p-vi). Cctte image du monachismc s'averait fondde tant que la majorit6 dcs moincs etaient en- commc oblats au monast&tt, autrement dit, vicrges, Un peu plus tard, quad un plus grand nombre d'adultes convertis se joignirent aux rags des fi&cs, rnais avant que l'oblation ne mt stricuscmcnt critiqude, Anselmt dc Cantorbdry cxpliqua les divergences entre les mrtriti ct les convm en cornparant I t s premiers aux anges ct Ics seconds aux saints. Ses paroles b e n t reprises par Eadmer de CantoMry dans son Liber rte SAmelmi simiiitudinibus (PL 159, c.78,co1.649-50). Sur ce texte, cf, RW, SOUTHERN, St, Anselm and his English Pupils *, Mediaeval and Renuirsance Studies, I (1941-43): 7m. et H. GRUNDMANN, r Adelsbekehrungen im Hochmittelalter. Comersi und mrriti im Kloster W, dam Adei und Kirck Gerd Telenbach a m 65. Geburtstag dargebracht von Freundem undSchriIern, td. L FIeckenstein et K- Schmid, Freiburg/BaseVWien: Herder, 1968, p.325~.
CHAPITRE IV
~ N I S ou LA DIFFICUL~ ~ 9 t h ~ ~
La jeuncssc reprknte I'amour (sexuel), la beaut6 et la force, pour I'homme
m6di6valY comme pour l'homme modeme. Si. au Moym Agey en faison d'une telle
perception, les jeunes occupaient les plus belles positions dam les oeuvres romanesques
profanes, ils ilsent, par le fat m h e , la able de multipks temarques negatives dgrenh par
les moines. Cette dichotomie - lscs louant la jeunesse et eccl6siastiques la critiquant - doit pourtant &re nuancCe : les Clunisiens savaient, dam certaines limites que nous
explorerons, appdcier le channe physique ec surtout, la vitalit6 de leurs jeunes hbros, de la
meme manieie qu'une c e d e mbfiance face a m exch des jeunes se rencontrait dam le
sikle. Les deux a m c ~ q u e s du discours clunisien sur cet Sge ont trait I ses limites
infirieure et sup&ieure. Les jeunes, ou tout au moins les plus jeunes parmi les jeunes, 6taient
trait& i bien des 6gards comme des enfhts, d'ok comme on Ie verra, la surveillance et les
interdits qui l eu 6taient impo&s, dont la fonction essentielle dtait d'eliminer, sinon limiter,
leur libido. Inversement, fes plus igds des jeunes etaient pew c o m e les concurrents des
moines 2gks pour les postes de powoir. Ces trois themes attestent de la difficult6 d'etre un
jeune dam la perspective monastique rnfidi6vale, tirail16 qu'il &it entre son enfance et l'iige
mirr, le mepris et l'envie, I'obligation de se soumettre et le d6si de dominer.
La prerni&e section de ce chapitre portera sut la ddlimitatioa entre I'enfmce et la
jeunesse, et la possibilit6 ou non de parler d'adolescence pour les moines du Moyen Age
central. Par ce vocable, je ne veux pas dire f'adolescentiu, qui, telle que d6finie dam le
tableau I, s'btend habituellement de 14/15 B 28/30 ans et symbolise la phase de semi-
dipendance dam la vie de I'homme du Moyen Agey mais ce que I'homme modeme entend
par "adolescence", c'est-&-dire les amties pendant et imddiatement apds la pubertb,
perques cornme d6Iimitant un age en soi, avec des caracttristiques psychologiques et des
besoins sp&ifiques. La deuxihe section 6tudiera le discours monastique avant tout nkgatif
ii I'egard de la jeunesse, dhulant en grande part de l'association jeunesse-sexuditt. La
troisihe abordera le thhne de la beaut€ dam l'hagiographie et discutera du bien-fond6 de
I'association jeamesse-beaut6 dam un tcl contexte. La vigueur (force) des jeunes, en
opposition i la pate de vitalit6 d a view, a les conflits de powoir entre ces dew group
seront trait& dans Ie chapitre suivant.
Je rappelle que, dam ces deux cbapitres, je qualifie de "jeunes' ceux que les
Clunisiens em-mtmes nommaient deseentes et irnrenes. Ceci Cccigdie que je parle surtout
du groupe d'8ge s'etirant de 14 i 30 am. Pourtant, puisque dans l'esprit des hommes du
~ o ~ e n Age central rage mk proprernent dit n'existait pas, les critiques contre la jeunesse
knoncth par les auteurs rn6dihux c o n d e n t aussi les imenes de la tranche d'ige 30-50
ans, lorsque ceuxci n'avaient pas dussi P sublimer leurs penchants pour deveni. des moines
parfaits, & l'image des saints.
Les jeunes, comme les iuniores, sont les grands oubEs de l'historiographie du
Moyen &e, exception faite pour Ies X m W siicles. Pour ce qui est du monde laique, t&
peu d'6tudes historiques k n t consacdes aux iuuenes ap& le cekbre article de G. Duby,
Les "jeunes" dans la socidt6 aristocratique dam la France du Nord-Ouest au We siecle m',
dont la premiZre parution dam les A d e s date de 1964. Comme en temoigne la
bibliographic sur Ies Qes offerte en annexe, les litthkes s'intdress6rent beaucoup pour leur
part B I'image de la jeunesse dam les &its en langue vulgaire Ces chercheurs codim&ent
les conclusions de G. Duby : ils rnonwnt l'importance des conflits de gdnCration entre les
jeunes et les mob jeunes? et affinnknt que cette littkrature exprimait surtout 1 s aspiratioations
'. G. DUBY, 8 Lts "jeunes" dam la socitte aristoccatiqut dam la France du Nord-Ouest au XII' siecle *, dam Homnres ef s t m c ~ e r du Moyen Age, PParis/La Hayc: &L de I'&&SS ct Mouton, 1984, ~213-25.
'. Cf. par excmple les deux articles h t s de C, MARCHELLO-NIZfA, Mort du neveu, meurtre du fils : Ie cas "liistan" m, dam Georges Duby - L '&crime de I 'HMoim, dii. C. Duhamel-Amado et G. Lobrichon, (BibliotMque du Moyen Age, 6) Bmellcs: De beck Univ., 1996, p.33 1-39 ct Chevakrie et courtoiserie m,
dans HWoire desjeunes en Occident, v01.I: De I 'Antipith ri I2poque modeme, dir. Giovanni Levi et Jean- Claude Schm& Paris: Seuil, 1996, p. 186-94, ou encore celui de Marie-Gabrielle GARNER-HAUSFATER, = Mentalit& Cpiques et conflits de gCndrations dam le cycle de Guillaume d'Orange m, Le ~ o y e n Age, XCIII (1987): 17-40.
et msentiments des premiers? En revanche, le manque de sources limita sensiblement le
nombre des travaux sur l'existence du jeune guerrier en dehors des romans. Peu de
chdeurs sont capable de mener bien des Csyses aussi complexes que celle eatreprise
par Jean-CIaude Schmitt, dans son article a "Jeunes" et dame des chevaux de bois - Le
folkore m&idional daas la litttnrtlne des exempIa m-XNC sik1es) v4, cependant, celui-ci
nous apprend beaucoup sur la culture populaire, mais fort peu sur le sja des jeunes. 11 en
va de m h e des &udes sur des t h h s trts prkis, comme la e m o n i e de l'adoubement ou
la question du lieu de forxnation des jeunes elites b q u e s ? II faut donc espdrer que les
articles trb d e n t s comme celui de C. Dette, a Kinder und Jungendliche in der
Adelsgesellschaft des When Mittelalters m6, se multiplieront dans I'avenir car il reste
beaucoup i dire et i apprendre sur le sujet.
La majorite des informations sur les jeunes pour l'epoque m&ii&ale concement les
tout demiers si2cIes, B cheval entre le Moyen Age et I'6poque modeme, et h n t extraites
des sources jluidiques ou notariales. IL faut citer en tout premier lieu les publications de N.
Zemon Davis, J. Rosiaud, N. Pellegrh, N. Gontbier, C. Gauvard, et B. Hanawalt (ici encore,
on note parmi les auteurs la pkpond6rance des femmes, comme c'etait Ie cas pour
'. Cf par exemple P. MhJARD, "le sui encore bacheler de joventn (Aimeri de Nwbonne, v.766) - Les repr&entations de la j e u n a ~ dans la Wrature bnagaisc am XUe a WL. sikles. Etude des sensibilitts et mentalit& m6ditvales . (dans Les dges & lo v i ~ 1992, p. I8 1 et p. 185-86), qui note que . @]es potma epiquts confvmcnt pour leur part les hypothtscs de G. Duby w, I. nOR.1, . Qu'est-ce qu'un Backler ? h d e historique de vocabulain dam les chansons de gcste du Xn' sikle (Romania, % (1975): 307-08), qui affme que plusieurs chansons de gcste apparaknt amme de vCritablcs apologia de la j e u n a ~ c m, a E. K~HLER,
Sens et fonction du tcnnt rn jcuncsse I, dans la @it des troubadous a (dam MZlonges ofletts ri Renk Crozet, €cL Pierre Gallais ct Y-I. Riou, t.I, Poiticrs: SociCtC d'hudes mCdiCvales, 1966, p.582-83). qui ddclarr que la jeunesse cst non pas seulcmcnt le public, mak la some a le milieu nounicier de cette litt&rature [dite chevafetcsque]
'. J.-C. S C M W I T , "Jcunes" a danse des chcvaw de bois - Le folklore mCridiona1 dam la litttrature des exemph (xm'-XW sikles) I,, dam Religronpopuiaue en hguedix buXZP sihcle la moitie'du sikfe, (Cahiers de Fanjeaux, 1 1) Toulouse: Privat, 1976, p.127-58.
'. Cf, par exemple, D. BARML~MY, Note sur l'adoubement dam la France ddcs XIe et Xne sikles ., dam Les riges de la vie, 1992, p.107-17 et KF. WERNER, Formation et &re des jeunes aristocrates jusqu'au X sikle I,, dam Georges Duby - L '&itwe & I 'Hbtoire, did C. Duhamel-Amado et G. Lobrichon, (Bibliothtque du Moyen Age, 6) Bmelles: De Bocdr Univ., 1996, p.295-306.
6. C. DETTE, a Kinder und Jungendliche in der AdelsgcseIlschafi des Mlhen Mittelalters n, Archivfir KuI~ttrgeschichte, 76/1 (1 994): 1-34.
l'enhce)? Malgrt leur grand htW, ces analyses sont de peu d'utilite pour comprendre les
sources plus anciennes. Lcs abbayes de jeunesse, les pticulariitcs de la vie urbaine, Ie cycle
de vie des fib d'artisans a de commeqants (M&, entre autres, P partir des contrats
d'apprentissage) n'ont @&re d'inW pour qui s'intbesse la noblesse ou au clerg6 du
Que!ques Spccialistes de I'hagiographie ont dej& abrd6 le Wme de la jeunesse daas
les Vies de saints, tels Nora Berend, Michael Goodich, D. Weinstein et R Bell8. Bien que
l'ouvrage Saws & Society par ces deux derniers auteurs couvre th6oriquement les annees
fitisant mite B l'an h43, l em conclusions sur la jeunesse concement pour l'essentiel le XIIe
siecle et au-delA, tout comme les travaux des autres chercheurs ci-dessus menti011116s. Par
ailleurs, ces diffints historiem se sont surtout intdressds au Wme des conflits entre
g&&ations, ce qui laisse beaucoup de questions en suspens. Dam les Lignes qui suivent, je
montrerai a pa& d'un seul exemple (la Vita Hugonis de Gilon) comment il peut &re
dangereux de pte& en compte une dvolte adolescente dans une source sans une mise en
contexte, c'est-&-dire sans bien c o d t r e les conditions de re'daction de cette Vita et l'attitude
gMrale des hagiographes de cet ordre sm la question des iuuenes.
A ma comaissance, aucune etude n'a ett5 faite jusqu'l present sur l'existence des
iuuenes dans les monastires. Ce qui suit n'est qu'uae premi&re dbauche en w e de combler
cette lacune. Beaucoup peut encore Ptre dit B la seule condition d'6largir le corpus des
sources, tout spkialement en utilisant les Ccrits normatifs et hagiographiques d'autres
communaut~s r€guli&res. I1 serait particuli6rement intdressant de voir I'Cvolution du
traitement des jetmes entre les abbayes de moines noirs, ceUes de moines blancs puis chez
les Sres mendiants. Il est evident que le portrait que je dessine ci-dessous de la place des
'. Pour les titres des publications de ces diffdrcnts auteurs, cf, Ia bibliographic sur les gges. '. N. BEREND, Rapports earn parents et adolescents uu 12e-14e sikles m, DEA, &@ss, Paris, 1990 ;
M- GOODICH, Vita PHecta : The Ideal of Sainthood in the Thirteenth Century, (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 25) Stuttgart: Hiersemann, 1982 ; D. WEINSTEIN et RM, BELL, S a i m & Society, Chicago/London: The Univ. of Chicago Press, 1986.
294
jeunes au sein des communautk cluennes ne sera pas complet sans la confi.ontation avec
d'autres Mes sirnilaim porn d'autres moaabttw, contemporains ou noe
A, DES JEUNES SOUS SURVEILLANCE
1) La particularit6 du stntut des jeunes pro&
Ulrich et B e d consacrent tous deux un chapitre entier de leurs coutumiers a la
custodiu jwemu~l'. Le premier &the pour dbfinir qui des pr&s devait &e ainsi maintenu
sous surveillance &tit l'aspect physique, c'est-&-dire les signes de pubertk ; mais ceux-ci
pouvaient etre trompem, aussi les moeurs constituaient-eUes la rdfCrence ultime : etait
surveil16 de p6s celui qui avait atteint l'ige adulte mais n'avait pas encore des moeurs
adequate& Cette surveillance etait encore plus contraignante que celle exerck sur les oblats.
'. C'est ainsi qu'Ulrich intitule ce chapitre. Ce titre, donne dans la PL (IIl,k,col,747D), se retrouve dam les manuscrits : cf, par exemple BN rial, 638, fo1.99. Pour Bernard, il s'agit du chapitre I,xxviii,p310-12.
La description qui suit du traiternent des irnrenes sub custodia pmvicnt pour f'essentiel de ccs dew chapitres, le II1,ix d'U1rich et le 1,xxviii de Bernard. Une dfCrence est offerte en note en bas de page uniquernent lorsque I'infonnation a dt6 puisk aillcurs.
2. Utrich prtcise h limite inf&ieure de cc group lorsqu'il &lare qu'un jcune encore imberbe, s'il a de lui- m h e muon& au si&clc ct s'il est de trts bonne rCputation, peut se passer de gardien :
Frater qui esr h u t izetatk ut adhc sit imberbb etsi ulrro saemio mminttaven't, et optimae sit opinionis, minhe tamen custodia caret. Wet diqtrdo illi maxiine pi nutriti sunt in moll~~tmo, si ifi moribtrs viri esse noluerint, virilk adas nihil eis profkerf ut a custodia soIvanturnlta (U& IlI,k,co1.74748).
Le sous-entendu de la p m i h pbrast est quc, pour les convertis qui ~ ' ~ c n t pas en& c o m e oblats, Ie fait d9&e imberbe (caractCWque physique) dtait habitucUcrncnt suffmt pour entra'her I'incfusion dans fe group d s rinrenes sub custdia (sur le dCvcloppcmcnt du -me pileux c o m e maqueur pour diffdrencier les enfants des adults, cf, R BARTLETT, a Symbolic Meanings of Hair in the Middle Ages m, Trollsucrions of the Royal Hbtoricaf Society, 6. s&k, IV (1994): 43-44 ; sur le premier rasage comrne symbole rimel de l'cntr& dam l'@ adulte? cf. ibid, p.4748). Bernard a change quclque peu la formu1ation d'ulricb dc sorte qu'on appmd que Ie premier mitere pour dkider de placer un jeune sous ~ ~ r ~ e i l l a n c e h i t plus globalemmt son aspect : le ut a&c sit imberbis rn est devenu a ut indigere vi- Cast& a, autrcmcnt lcs deux phrases sont mot pour mot identiques (Bern, I,xxviii,p.210). La deuxitme phrase atteste de l'importance attachde au comportcmcnt.
A Hinau, qui r eha i t 1 s oblats, seuIs dtaient admis les laks dont on pouvait dCjA raser la barbe (Comtitutiones Hirsazigiemes seu Gengenbacembp, PL 150, I,i,co1.934D ; cf. GI CONSTABLE, introduction de 19Apologiae duae - Gozechini Eprjrola ad WaZcherum - Burchardi ut videtw, AAbbatis BeIleyaIlis Apologia
Tandis que les enfants st partageaient leurs makes, chaque jeune avait son gardien
sp8eifique. Ce crcstos jwenb ne devait pas quitter un seul instant son compagnon avant de
l'avoir conduit en des lie= d7afTluence, comme le dfectoire ou le choem. M6me en ce
d d a m&t, les mouvemcnts du jeme 6hient strictement circoLlSCrits puisqu'il ne lui Ctait
pas pamis de se &placer aillem qu'entre les deux choMs principawf. Jusque dam les
proce&ons, le iuuenis et son g d e n w devaient pas se &parer, ce qui pouvait poser de
graves probkmes d'organisation- Dts qu'il faisait sombre, le jeum devait etre muni d'une
chandelle allum* par son gardien, avec laquelle il se tendait partout et qui faisait en sorte
qu'aucun de ses gestes ne pouvait passer inapequ Cette surveillance des d6placements des
jeuws en g&nW, et des jeunes sous weiIlance en particulier, transparaissait dkj jh dam le
LF; elle apparait plus constmite et plus dtitaille'e dam les deux demiers coutumiers
clunisiens. Une lecture attentive de ces sources permet de comprendre le but poursuivi :
Sprimer B tout prix la sexualitt naissante des pulkres pour r@ondre aux impdratifs de la vie
cloitr6e.
L'inquiitude des moines mClrs face B la libido des jeunes se devine par Ie type de
reglements auxquels ils les soumettaient Une importance centrale etait accordtie aux
modalit& du coucher. Dkji, dam la Rsgfe de saint Benoit, il &it demand6 que les lits des
adolescentioresfiafres fussent places aux cat& des lits des senfore.? ; cette demande est
r6tMe dans le LTpour les iuuenes sub custodid ; elle est simplement sous-entendue dam
de Barbk, Cd. R B C Huygens, Turnhout Brepols, 1985, p.62). '. LT 150,~.2IS-16. '. Les itcuerws mb crcstedia comme les novices et les enfants ne pouvaient parler h des moines &rangers en
visite (LT 198,p279'q ; dam le cloitrc, ils devaient s'asseoir aux c6tb de leur gardien (LT 154,p22St). ? RB 22,7, Dam son cammentake de la RB, Hildemar explique ct teglement par la crahte de la sodomie :
[.,.I sdomiticum scelw virandi ccarrsa dki4 sive vitium immunditiae Attendendurn est, quia foeditatem honestis verbis manijiestuvitn cum &itn singuiar dormire et c d m jugiter usque mane mdere et seniores soIIicitos esse super ear debere, quiu rjhrd sceius vafde nefandissimum est. ldeo praeuenit ilk4 ne. quud absit, unquamfiutt (Hildmar, chapXXIf,p.332),
Cet auteur traduit adolescentiores par infantes/pueri, mais ceci s'expliquc par le fait qu'il laisse les jeunes puberes au comportement immature dam le group de la schola (ibid, chap.LXnI,p.SS 1 et cf. iirJa).
9 I...] in dormilorio uero izatu magistrum uef anteta habeant lecta I, (LT I 54,pXS'). Cette phrase laisse entrevoir comment les lits des fi&res Ctaient rang& clans le dortoir : comme au dfectoire, au Chapitre, au choeur et dans les processions, un ordre tr2s strict etait observe. On note ausi dam cette citation I'emploi de
le Ben a 1' Ud. lorsqu'il est afkn6 qu'un tel jeune voulant aller aux toilems devait
&eillerson gardien, Il est aussi p&id dans Ie LTque Ies eDfsllts et les jemes devaient &e
bien couverts iorsqu'ils Merit couch&' ; on retrouve ce m6me dgIement dans le Bern Par
ailleurs, avoir offat m e definition du p u p e des pro& placer sws surveillance, ce
coutumier et P UiI . cornmencent imm-ent leurs cbapitres par des prrsaiptions ayant
trait au coucher.
Ce qui etait le pIus doutef, hormis le f ~ t de hisser un jeune abandomd a h i -
mEme clans un coin sombd, &dent les contacts physiques des jeunes entre eux, et non des
moines iges avec les imenesI0. Si un gardien ne powait pas raser le iuuenis place SOU sa
garde, il devait choisir de pkference une persome miire pour le remplacer. Un jeune ne
pouvait s'associer a autre jeune (que celui-ci soit ou non place sous nuveillance) dam le
cadre d'une activitC quelconque, ni lui paler, ni l'aider s'habiller, ni hi fake signe, a moins
qu'une nkessite I'y obligdt ; le gardien devait alors donner son accord, les voir, les tcouter
et s'asseoir entre em". La pgsence simultande de deux jeunes ensemble dans une mSme
magister comme synonyme de autos, ce qui appuie indirectement I'hypothke avancee dans le chapitre precedent, seIon laquelle Ies mugktri des enfants itaient surtout des gardiens.
? LT 154,pZS1. '. Bern f,~cxviii,p.212.
Bien que Ies ddacteun de coutumiers nT6vquent pas d i i x n e n t leur crainte que Ies jeunes abandon& ii eux-m~rnes s'adonnent la masturbation, iI est Cvident qu'elle est sous-jacente aux divers interdits faisant en sorte qu'un jeune ne se trouvc jamais seul (cf. i@a la citation de Hidemar, Hifcdenrcnr, lMII,p.332). Sur lcs pdcautl*ons que devait prendre le gardien d'un jeune lorsque ce dernier avait eu une tjaculation nocturne, cf. Berm I,xviii,p.l'lS.
'9 Ce qui suit atteste que cc que l'on craignait I t plus cntre 1es adolcsccnts Ctait I t toucher. Mal@ tout, les moines chcrchaient probablernent aussi, mais dam une moindrt mesure, &vita que Ics jeunes ne s'associent et s'encouragent pour dsister aux dgiements de lcurs ain&, Bien qu'il s'agisst d'autres g r o u p sociaux, Ies travaux dc G. DUBY (a Lts wjeuncsw... n, op-cit., 1984 (1973), p.215), N. GONTHIER (MIi'uance, justice et socide' cknr le Lyonnais nrpdibd - De b J n du X W sikie au &bm du MV siscle , Paris: editions arguments, 1993, p- 137) ct C. GA WARD ( w Do Grace especial I - Crime, bat el So&& en France d Iafln du ~ q e n Age. VOU, Pack Publ de la Sorbonne, 1991, p.366) ont rnonat que c'dtait surtout en groupe que les jeuncs "faiiaient jeunesse".
'I. Bera I,xxviii,pdll : Nunquam dehet se juvenis jungere alil qni videatur juvmls esse, in quovis negotio, efiamsi ilfe non sit
rir cllsfodi4 nec loqut nec adjamare eum ad vestienchrm, vei ad tale quid, vel efiam signum facere, nisi de qrialibet re necessaria, vidente & audhte, & concedenre Custode, & sedente i.ter ufrumque. Alii vero maluriores qui bonae opinion& sunr, possunt cum jwe~ibus fogui de necessariis & utilibus rebus, sed turnen semper midientibur Custodibus. w
salle de l'hfhmerie (a in i n f l m a in lmcr m411st'one m 1 3 etait particuli8rement 1 craifldre.
Dam ses Statuta, Pierre interdit m b e que les pasomes chargks du soin des malades
fhent jeunes a recommanda acprrssCment L'attntbution de cette &he B des conversi
barbdU. Enfin, s'ils vouIaient hriter de reawoir le fouet, les h e w s devaient tout f&e pour
ne jamais se rctrower dite B c6te sans mtdiateclr, ni s'asseuir B proximitt5 les uns des autres,
que ce M A 1'€glise, dam la s d e du Chapitre, au df-ire, ou en quelque autre lieu, m pas
se toucher lors~u'ils allaient chercher un liMe dans la petite armoire (arm411oIum) du cloitre,
ni lorsque la cornmunaut6 entrait ou sortait dam le ddsordre de l'eglise, enfin ne pas se
retrouver dos i dos dans Ie choeur (sp6cifiquemeat le chom medius)14. Bernard conclut ce
chapitre en d6clamnt que, tout comme les fires profis ne devaient jamais toucher les
e d i t s , les jeunes moines ne devaient jamais se toucher entn eux :
Hoc quuque cavendum est omnibus illis pes iuuenes sub mstodirr] invicem, ne unquum ullo mod0 alter contigat alferwn, s imt mos est, quod ornnes m e s ] custodiant se de tactu infantiurn, *I5
De 1 i B pensex que le m h e principe justifkit ces deux interdits, I savoir la peur des contacts
charnels, il n'y a qu'un pas.
Les moines essayaient tigalement d'interdire tout rapport particulier entre les jeunes
et les enfhnts. ns craignaient tks probablement les &changes de grimaces et de rires, mais il
faut aussi garder B I'esprit les conclusions du chapitre prkident, comme quoi les oblats
constituaient, au sein du monast&ey de potentiels objets sexuels. Ainsi, les jeunes sous
'=. Cette phrase laisse entendre que l'infumerie de Cluny II comptait ddjh plus d'une pi6ce pour loger les malades. Du t aps de Picm le Vdntrable, elle en comptera cinq (cE Stut. lg'p.57, St& p.5Sn- et K. CONANT, Ciuqy - Les &tires ef la maison du chefd 'orhe, Mkon: Imp. Protat fires, 1968, p. I 1 1).
''- StaL Z4,p.6 I et G. CONSTABLE, "Famult* and "ComersiW at CIuny - A note on statute 24 of Peter the Venerable m, RB, 83 (1973): 340sv.
"- WdaL n,ix,coL748C-D ct Bern I~acviii,p212 : Singuliautem tda , st ut aiunt, fergoribus suk voluerint ewe codturn, turn summopere cavent in omni
loco ne obsque mediiatore stent simut, aut simul sedeant in ecclesia, in capitulo, in rejiectorio, vel se ad invicem impingant quado conventus ita cumdatim quque incedit, ut aliquando eccIesiam intrando vel a m d o , vet q u d o tibras in mmatiolum quod est in claustro reponunt. Hoe etiam nun negIigrgrtur, si est eorum status &c in medio choro, et urcs e* unapotle, dius ex a k a , ut ita sint sfantes ne doma eotum e regi'one ad hvicem sint conversa. .
Ce r&glement soukve h nouveau fa question de la structure et de la place qu'occupait ce fameux "choeur du milieu" (cf, chapitre IIT, section A).
Is. Bern I~cxviii,p2 12.
surveillance n'avaient pas le h i t de regarder dam la direction de la schola pendant les
hems de l i b discussion au cloftre : il leur fUait au contraire lui toumer le dos. 11s ne
powaimt pas non plus s'occuper de la suweillauce des enfiints pendant le mandatum dont
ceuxci dtaient chargb le samediI6. Enfin, un jeune n'avait pas le h i t #accuser un dint
pendant I t Chapitre, mais devait s'en d f h au mitre despuen"'.
Dam la Vita Geraldi, Odon explique que I'iige de la puberte est me m o d e
particuli&ement mci le mais que, si le jeune arrive A la traverser sans 6cueil et a se
dominer, il saura par la suite contrdler les appels de sa chair.
a Siquidem nobiles clericos [Ghud] mtnebat, quibus et morum honestas, et eruditio s e w certatim d ibebat tu . Pubescentibus enim austeriorem se praebebat.. dicens quod ilLius aetatis tempuF valde sit periculosun. q m d o quilibet udolescens matemae vocis similitudinem, veL faciei deponens, patemam inc@it a s m e r e vocem vel vultum : et qui se h e servure studeret, facile dehinc camis incenriva superant .la
Ces quelques mots rdsument parfkitement le pourquoi et le comment du programme
monastique mis en place B Cluny pour les jeunes pubkres sortis de la scholaIg . L'objectif
16. LT 164,p.236- 17. Bern. I,xxvii,p.202 :
[.,,I juvenes passunt cfamare eos ak illik tanttm oflensis qua fpccitutt contra em, sicut est de r h , & sign0 fucto sibi, aut si quk sit hqu/usmodr; de afi3 mquam, nbi quae debenf nota facere Magktro suo [maitre des en.fautsJ, & ipe clamobi! ear [Ies iimenes accusateun] in iiiomm Cupitulo [dcs cnfants] ; simt stabit muftum remoms ab e&, & dicto Benedicite, dicet offensmn ;/uvena vero nunquam cfamabunt illos in matori CapiVula.
Ce dglemcnt pmnet d'evitcr que le Chapitre de toute la con@gation ne serve de th&m A des disputes firtiles ; cette pdoccupation est claircment Cnonch dans le commentairc de la RB par Hildernar (Hifdemar, chap.LMn,p.578). I1 s'agit &galcrncnt de retirtr tout candle aux iuuenes (qu'ils soient ou non sous surveillance) sur les objets habituels du powoir, A savou les inf&eurs hiCrarchiqucs. le soupConne enfin que, par ce dglcment, les moincs chcrcbaient aussi limiter Ics points de contact entm Ies enfants ct les jeunes.
Is. VG' I,xv,co1.652C, Une id& simrlairc se trouve dans la Vita Maioli d'Odilon : Superno igiha nutu et divr'haprovihhtirr acturn est ut tam bonae speiputr tunc h dhrhk actIbus a r d k
intenfurs asrt, ut toturn adalccmribe tempus s i n c ~ I u castitati;F transigeret, el &a f a c ~ m rsf ut, per rorum vitae surrc spatturn decus ih cotpore suo retintref virgincum v ( W co1.948A). '9. Ce programme n'Ctait pas particulier Cluny. La su~eillance des jeunes etait un phtnomCne ancien
puisqu'ellt se pratiquait dLjh dans les a n n h 84540, dam le rnonast&c de Civate, bien qu'avec des modalitds un peu diffdrentes. Lorsqu'un oblat attcignait I'iigc de quinze ans, on Ctudiait son comportement. S'i1 se montrait incapable de comprendre la discipline, on le laissait dam le groupe des enfants aussi longtemps que ndcessaire, jusqu'k trente am si le besoin s'en faisait sentir. En revanche, s'il Ctait 8 bonus et sobriru, ita ut non sit ilIi necessitrar magbfros habere n, il etait alors plact sous la surveillance d'un unique gardien. CeIui-ci ne
&it qu'ils demeutassent vierges a maEtrisasSent leurs pulsions sexuelles. Dam ce but, une
surveillance Ms &mite Ctait ex& sm eux pour Ieur interdire tout geste d'abandon.
Pd&ment, la p k c e &ouff.gIIte et orrmiprCsente de leur g d e n devait Ies inciter ii se
conrrdler em-mbes afin d'&e h i le plus rapidement possible de cette trop voyante
tutelle. Poutqwi alors, clans la premiere moitie du We sikle, l'attitude clunisienne en ce
d o h e changea-t-elle radicalement ?
2) A propos des "d6couvertes" de Padolescence
Depuis les Cometudines antiquiores, oi, il n'est jamais question des iuuenes, en
passant par le Liber hmitis, jusqu'aux deux coutumiers clunisiens de la hn du XIe siecle,
il est possible, mais non certain, que les ri%gIements et interdits concernant les iuuenes sub
mtodia se d e n t progressivement multipliCs ; le bien-fond6 d'une telle hypothese est
impossible h dkmontrer, puisque le LT et, surtout, les CA sont edmement succincts sur tout
ce qui n'a pas trait, directement ou indirectement, B la liturge. En revanche, l'kvolution est
indhiable depuis le Bern et 1' Udal. jusqu'aux Stututa de Pierre le V6nthble. En effet, le
statut 36 promdgut! par celui-ci exige qu'aucun individu ne devieme moine avant 1'Pge de
vingt ans : a Statutum est, ut nullus etiam ex concessione fictutus monachus replaribus
usque ad vi@nti annos vestibur induatur. m2* h i , entre le debut des anndes 1080 et le
devait pas I'ernploycr cornme son xrviteur, mais s'asseoir B ses c6t& quand il lisait et I'accompagner lorsqu'il avait une m e accomplir (obediimtia). L.c meillant devait Fdirt tout ~ * c u l i h m e n t attention A sa mani&e de se cornporter avcc I s enfants a les gaqons de son bge ct surveiller s'il n9Ctait pas vitiosw. Au bout d'une am& @arfiois m b e am un plus court laps de temps), le jeune perdait son gardien ct MnCficiait enfm d'un traitement @I A a l u i dcs maiores (Hildemur, chap.LXIII,p.S8 1-82).
Sur l'adolescrnce comrne I*@ du choix mtre Ie Bicn et le Ma1 d o n Gdgoire le Grand, cf. J. LECLERCQ, Pddagogie et formation spirituelle du VIe au EX sitcle W, dam Lu scuola nell*Occidente latino dell 'alto
medioevo, I, (Settimane di Studio del Ccntro Italiano di studi sull'alto medioevo, XfX) Spoleto: Presso la Sede de1 Centro, 1972, p.272-73.
a. Sta~, 36,p.70. Sai dej8 explique dans le chapitre Il pourquoi je considtre que ce statut porte sur 13ge de profession des oblats, p1utdt que sur celui des convertis lafques, premi&rement, du fait de la place qu'il occupe dans les Stotm de Pierre et, deuxitrnement, du fait des r&glemcnts de Bernard et d9Ulrich sur Ies imenes sub custodia, qui indiquent que les jeunes fauteurs de trouble n96taient pas les convertis mais Ies ex- oblats.
deuxieme quart du We sikle, c'est-&dire a p h plus d'un demi-sikle, la pdsence des
iuuenes HgCs de qaiazt h vhgt ans dans les mugs des firheJ adultes fbt jug& d6finitivement
iaacceptabIe, m h e lorsqu'ils Ctaient plads sub nrstodiu. Je voudrais avancer I'hypoth6se
qu'un tel dglement est le symptdme principal de la reconnaissance d'une "adolescencen
(dam Ie sens oi~, aujodhui, au XXc sikle, nous entendons ce terme). Pour justifier une
telk aBhution, iI est necmaire de &fl&hirqpeIque peu sur le concept d'adolescence. Dam
Ies Iignes qui suivent, je me contenterai pour l'essentiel de formulcr des hypoth&es.
Si l'on fait exception de la p6riode allant de la fin du XIXC siMe jusqu'ii nos joun,
Ies travaiux des historiens traitant de L'adolescence (strictement distingude de I'enfance et de
la jeunesse) demeurent itonnamment peu nombreux. Tout travail en ce domaine est par
co&quent fob rnalais6, faute de Wres. La majoritti des historiens de I'Ancien Regime qui
ont abordt le sujet de I'adolescence ne l'ont pas dissociee de la jeunesse. Parmi ceux-ci, et
non des moindres, doivent Etre comptdes N. Zemon Davis et B. Hanawalt? I1 est vrai que
ces auteun sont surtout anglophones ; or, come , je I'ai dejh dit au debut du chapitre I, il
21. N. ZEMON DAVIS, a The Reasons of Misrule : Youth Groups and Charivaris in Sixteenth-Century France *, Past and Present, 50 (1971): 41-75, plus sp6cialement p.61-62- 11 est A noter que Jacques ROSSIAUD, qui reprend et corrige quelque peu les thhes de Zcmon Davis sur les Abbayes de jeunesse, distingue t ds nettement cntre l'adolcscence et la jeunesse, I1 fait correspondre la prerniike B la tranche d'ige 1U13-16/18 ans et fait durer la seconde de 16/18 jusqu'8 35/40 ans, mais avcc une @node consacde plus spticifiqucrncnt aux activites juvhiles, allant de 16/18 jusqu'a 25/26 ans (a Fraternit& dc jeuncsse a niveaw de ~ l t u r e dam lcr villa du Sud-Est P la fin du Moym Age W, Crrhims d'histoike, 21 (1976): 68-70).
B. HANAWALT, a Historical Descriptions and Prcscn*ptions for Adolescence *, J d of Family History, I714 (1992): 341-51, plus @cialement p344 ; elk reprend en b e part ses conclusions dans l'introduction de son ouvrage Growing up in Medieval London - The Experience o/Chi~&ood in Hktoty, New YorkIOxford: Oxford Univ. Ress, 1993, p.1 lm. En confondant, cornmc elk Ie fait, I'adoiescence et la jeunme, cette historkme arrive B une contradiction, car i1 est evident que, pour I t s Anglais des X W et XV' sikles, les jeunes ayant fianchi le cap des 21124 ans n'entraient pas d i i c n t dans le group d'gge des sad and wyse I. La r n h e m se ntrouvc aussi dans l'ouvragc de M, GOODICH, From Birlh to OId Age - The Human we Cycle in Medieval Ilroughr. 1250-1350 (Laham: University Press of America, 1989, p.105-14) a dam celui de R.A. KOULBROOKE, 27ie English Fmib, 14504700 (London/Ncw York: Longman, 1984, p. 166).
Invemcnt, J.A. SCHULTZ p s c qu'il n'exiac que deux phases dsns la vie des hommcs du Moyen Age, l'iige adulte d'une part, et les am& qui l'ont p-dt ("prc-adulthood" ) d'autre part. Aussi, lonqu'il veut demontrer qu'il n'existait aucune trace d'adolescence dans les textes &dig& en haut allemand entre 1050 et 1350, iI chcrche en r#alit€ prouver que ni la conception d'adolescence ni celle de jeunesse ne se trouvaient en ces siecles (cf Medieval Adolescence : The Claims of History and the Silence of German Narrative a, SpemIum, 66 (1 99 1): 526n- et 527n.).
n'existe pas en mglais deux concepts bien distincts comme adolescence et jeunesse en
fhq#. II est aussi exact que, dans les divisions mddidvales d& @es, la tranche #age
s ' W depuis 14/15 ans ~USQU'B 28/30 ans powait s'appela indiff-ent adofescentia
ou iurrentw, tan& que les ntae clunisiennes dccrivaient cew qui appartenaient gross0
mod0 i ce groupe d'fige comme traversant m e phase de formation et de tentation. Mal@
tout, de long intenmUe ne peut &re codondu avec "notre" adolescence, PHge des teenagers ;
il doit plut6t &re rapproch6 de l'actuelle jeunesse? ii savoir un Hge de semi-ddpendance, au
cours duquel le jeune, sorti de l'dcole, commence m e formation sp&ialis6e. Si nous
acceptons d'interpr6ter l'adolescentiu dam ce dernier sens, il faut alors admettre que, au
moins jusqu'au XIC si5cle inclus, aucune place n'etait fhite i l'adolescence striido s e w dam
la division rn&ii&ale des Qes. Certes, comme Ie remarque B. Hanawalt, avec l'exemple de
la famille nucl&ire au Moyen Age, ce n'est pas parce qu'un terme n'existe pas, que son
signifid ne se rencontre pas? Pourtant, cette absence d'adolescence dam la definition du
cycle de vie est ii mettre en p d & l e avec l'idw moaastique du fonctionnement de la
communautk : d&s quinze am, un jeune moine devrait thdoriquement etre intdgrd dans le
groupe des adultes, c'est-i-dire dans celui des profs ; s'il fdait en garder un nombre plus
ou moins &lev6 temporairement sous surveillance, ceci constituait une ddrogation B la riigle.
En revanche, au de%ut du W' siiicle, la c o m e monastique changea, et, presque au meme
moment, la place de l'udolescentia dam la division des 5ges 6volua : elle devint parfois
partie intdgrmte de l'enfance, plut6t que de la jeunesse, et pouvait s'interrompre d5s l'iige
de 21 ans, et non plus celui de 28*'. Une semblable ddfinition poturait peut4tre correspondre
". Ce qui n'empeche pourtant pas ceaains auteurs anglophones de pnndre conscience de l'existence de cette distinction dam d'autres cultures, cf. par cxemple Richard C. TREXLER, Ritual in Florence : Adolescence and SaIvation in the Renaissance m, dam dans Pursuit of Hofinbts in Late Mediwal and Renaissance Religion, Papers fiom the Univ. ofMichigan Conference, (Studies in Medieval and Reformation Thought) Leiden: EJ, Brill, 1974, p.2010.
". B. HANAWALT, Growing up. .. , 1993, p.8- 24. Bien qu'une limite aussi basse pour I'adolescence ne se retrouve pas dam les d6fmiths Cnumhks dans
les Tableaux I et II, exceptions faites de celles d'Honoriusl, du Tractatd et de PtolQlCe @lus celle du manuscrit de Chartres, mais il s'agit probablement d'une erreur), elle apparait dans d'autres defmitions ultirieures ; cf par exemple M. GOODICH, From Birth.,., 1989, p. 105.
i Sadolesxnce modeme ; pour le savoir, il faudrait dCja dCtexminer ce que now entendons
par ce concept,
Dam &verses M e s , l'adolescence est #finie come la @ode de reIbeIlion contre
les parents et de profondes crises identitaircs. Certains historiens ont msme consid&& que
traiter de cet &ge tkpivalait & rechercher les signes de ces drama individuels dans les sources
qu'ils consultaied? User d'une telle mdthodologie est trts discutable dam le sens ota, m h e
dam notre sociW - pour laquelle nous ne satuions mettre en doute I'existence de cet
iige -, le processus de rejet est loin de toucher tous les adolescents?
De ce fat, il est plus appmprie de d6finir l'adolescence comme 1'5ge au cours duquel
un individu est contraint, suite B un usage plus ou moins rapidement sanctiomt5 par une loi,
ii une compl6te dendance vis-his des adultes, et ce bien qu'il soit en train de h c h k ou
ait dejii h c h i le cap de la pubertC. En d'autres mots, il y a adolescence dam les socidtds qui
imposent des riiglements sociaux ayant pour effet de maintenir le jeune dkji p u b h dam le
groupe des d i n t s et ainsi de retarder son acch au monde des adultes. Il est evident qu'une
semblable situation est g6nCratrice de conflitss meme s'ils n'kclatent pas obligatoirement au
sein de toutes les families. En effet, daos m e societe prdsentant un tel traitement des anndes
post-pubertk, un des modes d ' m a t i o n du jeune vis-Lvis de ses &6s est de mettre en
evidence les errem de ces derniers et de proposer en contrepartie de nouveaux modes de
comportement, voire une nouvelle vision du monde. A I'opposd, dam une culture oh les
? CE par exemple le chapitre Adolesunce dans l'oumge de D. WEINSTEIN et Rudolph M. BELL, &in& & Society - Z%e Two WorIds of Western Christendom, ChicagofLondon: The Univ. of Chicago Ptess, 1982, p.48-72, surtout p . 5 8 ~ et M, GOODICtl, . Childhood and Adolescence among the Thirteenth-Century Saints m, JPH, 1 (1973): 2 9 2 s ~ Un autre problhe fondarncntd de ccs analyses sur l'adalescence kites A partif des Vitue est que les chercheurs traitat ces &its comme des biographies et ne tiennent pas compte du message que l'hagiographe (et derr ih lui, son monast&rc ou son ordre tout entier) dbirc transmettre 11 son public, qu'il s'agisse du couvent ou d'unc audience plus large.
26- Telle est la critique soulev& avec justesse par JA. SCHULTZ, dans son article a Medieval Adolescencc,.. *, Spemlum, 66 (1991): 520-21. La question se posait d6jh 11 la sonic du c&bre livre de Margaret MEAD, Coming ofAge in Srnnw (Gloucester (Ma): P Smith, 1978 (1961)) paru pour la premitre fois en 1927, dam lequel cette auteure opposait les belles ann&s de la pubertt des jeunes des iles Samoa B l'adolescence douloureuse qu'ofhient les socidtCs modemes, cf. J.F. KETT, Rites of Pasage AdoIescence in America, 1790 to the Present, New York: Basic Books, 1977, p.259.
jeunes pubtrrs peuvent obtenir des responsabilit6s et me partielle ind@endance I la
condition d'adopter la fbpm d'&e a de se cornporter des plus @ds, de tels conflits wnt plus
rareso La condqyence dgative d'une telle situation est peut -h une Cvolution plus la te de
la soci6tC concemt?e, puisque les jeune~ ne s'y affinnent pas en proposant de nowelles
manietes b e , mais en adoptant celles de l e m prt?dt!cesseurs.
Une semblable "&mergence1' de l'adoIescence p u t &re observtk ii dive- 6poques
dam l'histoire accidentale. Dew cas de figure saont &oqu& avant de revenir ii la question
clunisienne. Le premier exemple est proche de nous. Divers historiens, mais surtout
anthropologues, mciologues et psychologues se soot accordes pour affirmer que l'adolescent
etait "nbW a la fin du XIXe sikte, plus pn5cisdment aux ktats-uais, avec les recherches du
psychologue americain G. Stanley Hall2'. Telle est en effet, avec quelques nuances, l'idbe
que John et V i a Demos d&elopp&ent dam une des premikres etudes d'importance sur
I'histoire de l'adolescence, leur article a Adolescence in Historical Perspective rn paru en
19699 Ces auteurs Merit pawenus I la conclusion que l'adolescence devait son apparition
ii des transformations dam la structure familide amt5ricaine au fil du XIX' sikle, tout
particuliiirement suite a l'urbanisation : un plus grand inttrit avait 6td port6 par les parents
ii leun enfants, tandis que les occupations (travail et jeux) des uns et des autm se
diff6renciaient consid&ablement (a discontinuity of age groups m). Les etudes ult6rieures ont
montd qu'on ne peut v6ritablement parler de "d6couverten de I'adolescent qu'I partir de la
premikre moitie du XXC sikle, quand ce phdnomkne toucha toutes les classes sociales et que
les scientifiques ne furent plus les seuls B en discourir. Elles prodrent surtout que la
nkcessite pour les jeunes d'acqugrir me formation jusqu'au niveau du "High School" (et
". ParticuIi&ement importante fbt la parution en 1904 du monumental ouwage de G. StanIey HALL, Adolescence : I& Psychology, and I& Relation to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion, and Education (New York). Joseph F. KETT' a souIignC que des dtudes scientifiques sur I'adolescence a p p a m t bien avant les travaw de Hall, mais que ce fit uniquemeat & partir de 1900 que cet 6ge devint a unique topic of interest because of social conditions peculiar of our time rn (a Adolescence and Youth in Nineteenth-Century America ID, dam The Farnib in Hktory - Interdisc@Iinmy Essays, 6d. T.K. Rabb et R1. Rotberg, New York: Harper, 1973 (1971), p.95).
John DEMOS et Virginia DEMOS, = Adolescence in Historical Perspective m, Journd of Marriage and the Family, 3 1 (1969): 632-38.
mOme audeb) eoastituait la caractCristique fondamentale de ce changement sociala ; en
effet, auparamt, la majoritt des individus ne kbficiaient pas d'un temps Spcc'ique pour
l'Mllration, car cefle-ci &it hchdable dutrawd, soit que I'm& se partage& entre l'unc
et 1'- activit6, soit qu'elles fusscnt inexfricablement l i b pendant les aantks
d'apprentissage? Ces mutations dam les pratiques sociales furent renforcCes par la
promulgation de lois proegeant les jemes de moins de 18 ou 20 ans, limitant trks strictement
leur travail avant 16 am et obligeant les parents & mettre leurs enfmts & L'kole jusqu'h un
iige avanc6. Joseph F. Kett en conclut qu'en 1950, aux ~tats-unis, adolescence became a
legal as well as a social category. 3 1
En &lit&, le phhomkne ne se limitait nullement a w ~tats-~nis. Surtout, il n'6tait
pas unique dam l'histoire. Une autce "d&ouverte" de l'adolescent s'dtait produite plus de
2000 am auparavant, vers 200 av. J.-C., pendant la Rome kpublicaine. Le premier qui, B ma
connaissance, mit clairement en 6vidence ce phhomhe fit J . 9 . N&audau, I la fin des
a n n h 197p ; I'idk &it -te, mais m o b clairement, dans les travawr contemporains
de E. Eyben et L. Giul ian~~~ . Tous s'accordent pour dire que I'origine de cette mutation fut
". Pour l a ~ ta t s -~nk , c t J.F. KETT, Rites of Pmage, 1977, p235 ; pour I'Allemagne, cf. S. FISHMAN, = Suicide, Sex, and the Discovery of the Gennan Adolescent n, Hktory of Edicafion QuuterQ, 10 (1970): 172 ; pour I'Angletezre et plus g€n€ralement l'Ewope, d: John R GILIS, Youth curdHbfory. Tradition and Change in Ewopem Age Relations, /77&Present, New Yorlckondon: Academic Prtss, 1974, p.133-35.
Cf, aussi l'artkle relativement went de Hugh KLEIN, I Adolescence, Youth, and Young Adulthood, Rethinking Cumnt Conccptudizations otLife Stage D, Youth & Suciw, 21 (1990): 455, Ce texte donne un bon apcqu des grossitrts encws dTintcrpr&ation du pa& qu'engendrtrcnt les h i t s dTArik pami les psychologues et 1 s ancbropologues : on y append que ni l'cnfana ni lTadolescmcc n'txiscaient au Moyen Age (a Indeed, at that time [XFb cent], society conceived of no d'rfferrncc between the 6- and 21-years-old ! m), pas plus quc la vicillcsse (a since people typically died by the age of 40 W, ibiu!, p.448) !
'*. J.F. KMT, Adolescence ... m, dam The Fami& in History ..., 1973, p. 106. S-F. KETT, Rites of Passage, 1977, p.245.
=. M. ~ U D A U , Lo jeunesse u k la Iitt&ature et les iN(iMons & lo Rome Rdpublicaine, Paris: La Belles Lettns, 1979, cf plus spdciakmcnt p.106.
". L, GIULIANO, Giovenrir e iktituzioni m1Ia Roma antica Condizione gimaniIe e processi di socialkazione, Roma, 1979. E EYBEN, Dejonge Romein volgenr de literaire bronnen derpriode c a ZOO
Chr. tot ca 500 n Chr., Bn~~clIes, 1977 ; cet auteur rcprit ce t h h e dans I'ouvrage De omtuimigen Jeugd en (odd- in he) Oude Rome (Kapellea, 1987, traduit en anglais sous le titre Restless Youth in Ancient Rome, LondodNew Yo* Routledge, 1993), ainsi que dans divers articles, dont Was the Roman "Youth" an "Adultn socially m (Antiwit6 cfafsiipe, 50 (198 1): 328-50) ct = The Beginning and End of Youth in Roman Antiquity = (Paedagogica Hiszorica, XXIX (1993): 257-85). Panni les Ctudes plus dcentes qui reprirent les id& de ces diffkents auteurs, cf. aussi J.K. EVANS, War, Women and Chifben in Ancient Rome, London: Routledge, 199 1, p. 190-9 1.
l'imposition de muvelles lois, tout particulihent la lex [P]uetorfa, &tee de c200 av. J.-
C., et la lex Yilla W i k , & 180 av. J--CM. Il est m t de noter que la premike n'avait
initialement amme objeaifque de pmt&ger les orphelins, car il arrivait trop sowent que
cew-ci devinsscnt la p i e de profiteurs irnmtkliatement ap& avoit 6tt hbCrt?s de la tutelle,
c'est-&-dire B la pubertt ; g r k B cate loi, il leur h i t permis de dvque r les transactions
qu'b avaient Stes avant 1'8ge de 25 ans. Sa codquence fut de rendre Ies mobs de 25 ans
incapables sur le plan juridique. La seconde loi lern interdit de se lancer dam le w s t c s
honorma avant l'iige de 27 ans. Compte tenu de cette bite trh tardive de 25/27 am, on peut
se demander s'il ne serait pas pr6fdbIe de p a r k de jeunesse plutat que d'adolescence. Je
pense mal@ tout que ce demier terme est plus appmpriC. C'est d'ailleurs celui-ci
qu'employa N6audau dam son Ctude. En effet, m a l e ce qu'en dit Eyben, on ne peut
c o n s i d b la irruenfus, s'etendant de 15 ans A 45 am, telle que ddfinie avant la la Pluetoria,
c o m e equivalant a la pleine maturite du jeune Romain, puisque celuici demeurait au moins
partiellement sous la coupe de son @re aussi longtemps que celui-ci etait en vie et ne lui
leguait pas son hdritage? I1 est donc prbf6rable de percevoir la iuuentus c o m e m e
jeunessdlge mk, c o m e je l'ai definie ti la fin du chapitre I, se caract&isant habituellement
pa. une phase de semidtipendance, suivie d'une nowelle phase de pleine indtpendaoce. En
revanche, la nouvelle tranche d'ige 15-25 ans, qui apparut partir de 200 av. LC.,
correspondait i une phase de ddpendance.
". Cette H i a t i o n pdremptoire est probablement nuancer. La "ddcouverte" de I'adolescent au XX 'si&cIe atteste que la promdgation des lois n'est souvent que Ie point d'aboutissement d'une lente transformation de la perception des anndcs faisant suite la puberte. Je ceviendrai sur cette question du rapport entre loi et "naissanceW de l'adolesccnce h propos dc Cluny. E. EYBEN dvoque le caracttre progressif du phCnom&ne romain lorsqu'il dklarc :
Alongside the rut& impubemm there grew up the m a minorum, which gnawed more and more at the de facto capacities oftht young man and towards the end of Antiquity was extended so far that the limits between m a and ~ d a became blurred and in pfactf-ce almost no di ic t ion was any longer made between impuberes and minores (orpubem). R (S Was the Roman Tout h"... R, opcit-, 198 1, p330).
Cette citation est inthssmte dans le sens oh elk met en lumihe le memc processus qui cut cows par la suite dam les monast&m clunisicns : la custodia iuuemm -t initialement diflrdrcnte de la surveillance exercde sur les enfants, mais elle finit par se confondre avec celle-ci, et les adolescentes de rnoins de vingt ans devinrent, B toute fin pratique, des pueri.
35. CC. A- FRASCHETIT, = Jeunesses romaine m, dans Histoite des jeuues en Occident, vo1.I: De 1 'Antiquit& 6 1 'hpoque rnoderne, dir. Giovanni Levi et lean-Claude Schmitt, Paris: Seuil, 1996, p-87-9 1.
3) Une adolescence dtxnisienne ?
La difErence majem entre I'adolescence romaine et celle d'aujourd'hui est que la
premiih ne se rapporte qu'8 me hfhe partie de la population de la Rome antique, B savoi
les individus de sexe d appartemnt aux &helons les plus CIev& de la societC16.
Quelles sont les caract&istiques de I'adolescence "clunisie~e", outre le fait qu'elle ne
conceme que les moines ? Il y a d'abord t'intervention d'un statut (le numdro 36) de Pierre
le V&&able. Celui-ci voulait que des jeunes dCjh pubhes b s e n t amalgamis aux eafants
et leur entrtk dam le monde des adultes retardie d'approximativement cinq am. Il n'ktait
plus question de faire comme cela avait ett5 la coutume jusque-l& c'est-il-dire traiter les
jeunes au cas par cas pour savoir lesquels Centre eux seraient soumis B une stricte
surveillance : la loi etait maintenant la miime pour tous. Si auparavant les iuuenes sub
mtodia n'avaient presque aucune libert6 d'action, ils Went m a l e tout potentiellement des
adultes, ayant quiae le groupe des enfants. Surtout, leur assujettissement 1 un gardien
reposait en partie sur leur volontd propre. En effet, Bernard et Ulrich pricisent qw tous les
jeunes sortis de la schola n'etaient pas soumis ii un surveillant, mais uniquement ceux-15 dont
le comportement le justifiait. Ainsi, si le moine pubtre se contraignait de hi-meme a se
cornporter c o m e ses aink, il powait alors Stre directement inclus dans les rangs des profes
sans autw contrainte. En revanche, le statut de Pierre etait tel qu'aucune libertd d'action
n'etait IaissCe am jeunes en* quinze et vingt am, quels qu'ils fbssent. 11s etaient des
dipendants complets et non plus des semi-dependants.
Un tel rkglement ne peut pas, malgr6 tout, &re considdr6 comme la cause strict0
sensu de I'tmergence du concept de l'adolescence. En effet se pose l'dtemel dilemme de
savoir qui de la pule ou de l'oeufa p&&6 l'autre : m e loi maintenant les adolescents sous
le plein pouvoir des adultes est bien souvent la manifestation d'une conviction d6ji bien
36. E. EYBEN, = The Beginning ... a, opcir., 1993, p258.
mm*e dans la population concede que les puWres sont complttement immatures. Il
fkudrait donc repusset le problbe dam le temps et se demander & partir de quelles
circa- dans un gmupe social d o d , tow 1es jeunes ayant k c h i le cap de la pubert6
P a m k n t bmquement inaptcs A venk p s s i r les rangs des add&? Tds pmbablement, les
causes d'un pareil phtoomtae difltrent selon les 6pques et les ensembles sociaux
considkts. Comme nous dons le voir, les dponses que donne I'Ctude des sources
clunisiemes ne pewent que malaistment &re projettes sm d'autres modes, ou sur des
groupements lafques.
Au chapitre lU, j'ai suggM que le champ d'action des jemes oblats nouvellement
profZs avait W drieusement M C , dam le courant de la deuxitme moiti6 du Xl' sikle, avec
l'amvde massive de convertis aduttes : iI leur etait difficile de faire concurrence ces
derniers pour l'obtention de postes avec responsabilitds. Une telle situation eut probablement
pour consdquence de retarder l'arrivde I rnaturitt5 des jeunes pubhes, ce qui, a son tour,
nCcessita la &ision de leur stahlt. Il pourrait ttre ktorqu6 B cela que, du temps de saint
Benoit, les convertis adultes etaient Cgalement nombreux ; or la question des adolescents
semble s'etre po* de rnaniere beaucoup m o b pressante. C'est qu'il faut prendre en compte
un autre facteur, 5 savoir S~volution des rapports entre les &es au sein m h e de la
communaut& Dans le chapitre 11, nous avoas observe que la "structure familiale" du
monastee avait beaucoup perdu de son importance dam le LT par rapport a la RB. Selon
cette dernih, tow les ah& devaient s'occuper avec diligence des plus jeunes ; en dchange
de quoi, cew-ci les traitaient avec dv6rence. Parce que Ia surveillance des adolescents etait
de la sorte plus diffuse et intigrde dans un systQne d'ichange, elle devait paraitre moins
oppressante et donner de meillem rdsultats. Cette 6volution dcs rapports entre les Wres
rrahit une transformation dans la mani&e qu'avaient les moines de se percevoir. Le
monast&e se voulait maintenant une n5plique aussi parfaite que possible de la troupe trib
D6jh Hugues de Semur fit en sorte que les iuuencdae fussent interdites dims sa fondation de Marcigny (cf. V'H" II,ii,p.868B) ; il precisa sa pensee vers la f i de sa vie, dam une lettre qu'il envoya il Marcigny oh il demandait specifiquement qu'aucune soeur ne at adme avant I'5ge de 20 ans (a Epktola b e d figonis Sanctimoniafibus trammrjsa apud Marciniacum Domriro servientibus m, Bibl.C.un., 494D)-
ordonn& des anges am Cieux, a societas imitatrik caelestis collegii rn3'. Pour saint Benoit,
au conbake, le mo& aMit pour fonction essentieIIe de former les hommes pour qu'ils
deviennent ultimement padhits : il etait la scholP seruz'tr'i Dei. Dam un tei contexte, la
formation &it natwellcment int6grde la vie quotidieme. 11 n'existait donc pas un temps
r 6 s e d exclusivement ik l'&ucation : tous, q d s que fussent l e u age et date d'entr6e,
6taient tduquk pogressivement, en m5me temps qu'ils partageaient ies aches de toute la
communaut& Il s'agissait donc d'une socidt6 en devenir, o& l'objectifvist! etait l'&olution
progressive de chacun des membres : les eflfants et Ies adolescents y trouvaient parfaitement
leur place. Dam le Cluny de la fin du XIe sible en revanche, nous avons daire a m e sociite
qui se voulait le miroir terrestre du choeur cdleste des anges. En tant qu'image de la
pezfection, elle se devait #Stre statique. La formation n'etait plus alors integrde au
qpotidien : elle devenait me annexe de la vie monastique. II existait maintenant un temps de
formation rt5senk spkifiquement awc convertis aduites, le noviciat, et un autre pour les
enfants, la schola. Dam un tel cadfey les adolescents dej& sods de la scholu mais pas encore
tout I f ~ t form& dtaient perGus comme des poi& morts qui retardaient le bon
fonctionnement de l'ordre monastique. Ainsi, il est possible que plusieurs facteurs aient
convergb pour entrainer H plus ou moins long teme Emergence de I'adolescence au sein du
milieu clunisien : d'uw part, le mhissement des jeunes Ctait retard&, d'autre part, le regard
port6 sur eux par les moines plus iigds avait cbangd.
". VIF II,ii,p.92. Le theme nt€tait pas nouveaq mais il devint de plus en plus important au fil du XIe siecle et occupa une place centrale dans f'bagiographie c o m d e i saint Hugues. Particulietement significative cet f gard est la Vita de 1'Anunpu.r lI oi~ les limitcs cntrc Cluny ct le Ciel sont pkcnt6es comme Ctant totalement perm&bles- Ainsi, Ia pnmi8re anecdote con* Cvoquc la troupe dcs personnages cdlestes cbldbrant le service divin dans I'dglise de Cluny de telle manitre que Ie sacristain, qui venait pine de s'&vcilIer, crut qu'il s'agissait IB simplcmcnt de sa communaut& (W ~01.44748). La tmisi&me atteste que I'entrCe au Paradis pouvait Etre symboliste par rent& ct la prise d'habit & Cluny (w ~01.449). La septitme montrt le Christ participant au Chapitre ct suggdrant A Hugues les &glemtnts de I'ordo monasticus (w co1-45142). La dixikme tCmoigne quc la bdntdiction d'Huguer Ctait pergue comme Cquivalent B celle d'un ange (w coI.453B). La douzikme raconte comment saint Pierre dessina lui-rntme les plans de Cluny 111 et nous apprend que Ie ddambulatoire etait nunomm6 le "dtambulatoire des an@ ( V p co1.457-58).
? J*ai monM dant I'Amexe D que le noviciat benddi- n9€tait pas tant une pdriode d'instruction qu'une de probation.
Parallklement me ttansformation du traitement rhme aux adolescents dam Ies
coutumiers clmkiens, se note I'Cmergence d'une nowelle image de cette tranche d'ige dans
les sources hagiographiques de l'abbaye : ce n'est pas, contre mute attente, I'adolescent
dvoltt5 mntre les auto* du monastike qyi y appadc mais I'adolescent rCvo1tC contre ses
parents laYques, qui accourt pour se placet volontairement sous la coupe des moines. Bien
que mtre khantillon de sources soit trop h i t 6 (avec le seul cas des Virw de Hugues) pour
alla audelii de l'hypothise, on peut se demander si, parall&lernent m e mise en tutelle plus
stricte des pub&es, les Clunisiens ne leur owrirrnt pas les portes de la libert6 onirique :
d'une part, ils restreigaaient leur champ d'action, mais d'autre part ils leur Merit que
Ie simple fait Getre ii l'intkieur des moaast&res faisait d'eux des h&os.
Je mentionnais au debut de cette section qu'une des const!quences possibles de la
"naissance" de l'adolescence en une p6riode donnee etait la multiplication des conflits
opposant les teenagers B leurs parents o y de maniere plus g6n6rale, P leurs a ids ; or,
exception faite pour le statut 36 de Pierre qui 6voque l'indocilit6 des jeunes entre 15 et 20
ans, il n'existe pas de trace de tels conflits au sein de l'abbaye bourguigno~e. Ce silence
peut peut4tre s'expliquer. Les sources clunisiennes qui subsistent emanent des hommes au
powoir, soit que les auteurs aient 6td eux-mtmes des abEs, soit qu'ils aient pris la plume
B la demande d'un abM. Les tentatives de rt5volte des jeunes moines puMres contre l'autorite
ne les int6ressaient pas car ces demiers ne constituaient pas un Ckment asset cons&pent
pour que leur mise au pas vdle la peine d'&e citk amme illustration de la toute-puissance
d'un saint En revanche, il n'est pas sans signification que, deux decennies I pine avant la
promulgation du statut 36, B savoir dam les andes 1120, on trouve dam les Vitae
clunisiennes les premiers tCmoignages d'une dvolte adolescente contre I'autontC paternelle.
La divergence du dcit de ces m6rnes ann6es dam les dcrits hagiographiques
clunisiens antirieurs est fiappante. Dam le chapitre III, j'ai montd comment tous les saints
clunisiens avant Hugues, exception faite de MaTed qui fbt soi-&ant orphelin, se voyaient
imposer leur desthee par leurs parents : il a'&& pas question de prendre en compte la
volontt des edh ts , ni m h e eIle des adolescents'? Hugues, en revanche, refha d'kouter
son p h , le hornpa en allant en cachette ii I'ble et I la messe, puis s'enfbit pour en- I
Cluny, to- ainsi ddhitivernent le dos au destin qui lui avait W trace. 11 s'agit 1A d'un
evident cas de dvolte, mais dans le milieu lafque a non monastique. Discuter des causes
in-es A la vie Mkpe qui purmt donna lieu B ce conflit oppovtnt le comte Dalmace de
Semur ii son fils n'entre pas dam le ppos de cette thbe41. Il hudrait d'ailleurs commencer
par &cider la qyestion de savoir si oui ou non, dans les hits, il y eut v6ritablement conflit.
La sede certitude qu'il soit permis d'avoir A la lecture des diverses Vitae de Hugues e a que,
en ces a n n h 1 120 -plus de 81 ans apds les ivhements -, il fut soudainement jug6 Licite
par le pouvoir en place a Cluny d'offiir au public clunisien le dcit de la dvolte d'un jeune
face A son pke.
Pour comp~ndre cette traasformation radicale du discours clunisien, il est possible
d'evoquer d'autres causes que la seule 6volution du statut des adolescents. Premierement,
la kfonne gn5gorienne avait ddjh eu lieu, suxitant, non seulement dam les faits mais aussi
dam les &rits, m e opposition plus stricte entre les sph&es Iatque et eccksiastique.
Demiiimernent, les premiers hagiographes de Hugues icrivirent tous la demande de Pons ;
or celui-ci, 6 hasard, prit le pouvoir trh jeune et sa grande jeunesse lui fbt reprochee I
diverses reprises. En encourageant I'daboration de L'image d'un saint qui, diis son
"'. Le fkit que ce discours n'Ctait plus de mise daas Ics mdes 1120 B Cluny est attestd non seulement par l'originalitd de la d-ption de radolesccnce de H u p rnais Cgalement par la transformation du portnit du p&re d'Odon dam la Vita d i g & par Nalgod. L'image d'Abbon avait CtC tout li la fois ernbellie (cf, M.-L. FINI, L'Editio m h r defla a Vita n di Oddone di Cluay e gli apporti deIl'HumiIfimur w, L 'Archiginnusio, 63- 65 (19684970): 141-42) a &om& dam la Vita de I'abdviatcur ; elk est en revanche ddfuritivement noircie sous la plume du dcmier hagiographc : il dwient un camafkpater qui sc prtoccupe beaucoup plus de la chair de son fils que de son esprit (YO" Fini 6-7,p. 13&36=PL 5-7.co1.87-88 ; cf. citation offer& iea).
'I. L'analysc dc A, BARBERO sur la raison des remarques n6giuivcs de Gilon A props du @re de Hugucs me semble monk- I1 a fhne en c f f i que I'insdon d'un tel motifa pub dunque csscn considerata un indizio sicuro dclle itlclinazioni fortemcnte dche c rigoriste dell'agiografo. w (Un sunto in famigha.., 199 1 , p. l l I ; c t ausi A. BARBERO, FamiIy Reactions to the Vocation of Future Saints : Shifting Cultural Attitudes and Changing Hagiographic Pattenrs from Lam Antiquity to the Middle Ages n, confCrence domQ il Binghampton (N.Y.), en octobn 1989). Oilon est tout sauf Ie chantre d'un rigorisme monastique ; le CIuny de Hugues qu'il d h i t n'est absolument pas celui de l'austdritd. Cettc erreur d'inte~dtation ilhstre parfaiternent le danger d'utiliset Ies V h e cornme des miroirs de la dalitd sociale, sans cormaftre les circonstances exac!es qui furent A leur ongine et, surtout, sans prendre en compte que ces oeuvres sont des ouvragcs didaaiques. non des biographies.
adolescence, sut mieux que les adultes quel chemin suim, Pons cherchait pmbablement I
dbtruire toutes les vellCites d'attaque con- lui Ces deux raisons d s e n t peut4tre &
expliquer I'originalitt! de la q&atation de I'adolesamce par l a hsgiographes de Hugues.
Mal@ tout, ceux-ci mirens au moins autant, sinon &vantage, l'accent sur la h o k e du saint
contre son p&e, que sur son e-e pi& ou sur sa supCriorit6 en tant que iuuenis face B
I'emefnbIe de ses ah#. Us r n o n w t ainsi l'adolescent hvant en cachette les intdts.
Gilon, dont la V1ta sewit de source principde I tous les aums hagiographes, insista le plus
sur cette image subversive de Hugues : C..] sepenumero furto iitudabifli limina
aecclesiamm terebuh scolis ultro se ingerebat, colldusque expiorator latenter id agebat ut
patrem Iafereg 8 Par c ~ ~ q u e n t , alors meme que la position du jeune puMre au sein du
monasthe 6voluait et quyil etait progressivement enfernti dans un 6tau plus s e d , les &its
banant de ses supdrieurs lui offraient un imaginaire od il s'opposait a w lois de l'autre
monde, le mode sicdier. Ce couplet enfermement-mythe de liberte fit indeniablement
construit avant tout au profit dcs jeunes e n e s tt I'abbaye apds Ila pubertd : il permettait de
les rassurer sur le bien-fond6 de leur nouvelle vie et de leur faire accepter la perte de la
grande libert6 de mouvements qu'ils avaient connue d a m le si&cle4. Je pense pourtant que,
par le biais du meme processus, cette litt6ratwe servait aussi I faire accepter aux oblats
auparavant plus libres la soumission toujours plus grande exigee d'eux4*.
% Je d- dam la &on suivante dt L'image dc Ia iuuenracs transmise par les diffiiwnts hagiographes de Hugucs et de la situation particulih dc Pons en tant que tr4s jeune abbd de Cluny.
". W IJi'p.49. Seul, Renaud suit quelque peu Gilon sur cette voie subversive lorsqu'if appelle Hugues fe "coupable de pi&&" (a reus &piefate m), dans sa Vita en vers (VF l,ii,p,49)- Dans cclle en prose, il declare que le saint encore cnfant sc d W t des activit& spirituellcs en cachette (a horisfivlivb .) et II I'encontrc de sa farnillc (a imitispotentibus m, KW l,ii,p.40). Hildebcrt le d k i t aussi Wquentant I'tglise 8 sedfiriivtls ( V P I,2,coI-S6IA). Lors~lr'il Cvoquc I'entrk dc Hugues B CIuny, il reprend I'ablatif absolu dc Gilon, apufre nmciente I. (VIP I,iii,p.50 et YH' 1,2,co1,861B), Hugues de Gownay, dont la Vita cst particulihement conden*, se wntmte de dQIacer que Hugues en- A CIuny imitkparenibus . (V* i,p.121).
"- Pour un apequ de la IibertC de mouvemcnts dont Mntficiaicnt les enfants de la noblesse guemert pendant le haut Moyen Age, cf. C. DETIE. Kinder und Jugeadliche ... B, Archivjb Kufnvgechichfe, 7611 (1994): 25-27. J'avoue avoir quelque mal II imagine ks convertis lafques ct clercs sdculiers qui vinrcnt tripler les effectifs de CIuny en un demi-sikle c o m e de jeunts adolescents, 4g6s cntre 15 et 20 ans et agissant de leur propre chef, avec ou sans I'accord de leur fmillt, Un semblable individualisme serait pour le moins Ctonnant il cette epoque.
45- De manitre un peu ironique? on peut noter que Ie developpement d'un tel mythe ne pouvait, B long terrne, qu'entraher I'effet contraire de celui escomptd, faisant du jeune revolt6 I'image mime de la pi&&.
A@ avoir dflkhi sur les circonstances entourant la "naissance" de l'adolescent,
il faudrait se demander & qud moment et comment cet tige peut "disparaltre" certaines
6poqyes pour reparaftre enaxiP. fitant do& que miter de cette question me conttaindrait
sortit des hmites temporelles fixCes par cette recherche, je Iaisserai d'autres le loisir d'y
dponk On peut tout de mQr nmanpr que le ddclin de L'obhtion masculine fit en sorte
que la question de I'adolescence perdit sa raison &Stre en ce qui concerne le milieu des
monasths d'hornmes,
Comme I'analyse de la situation des iuuenes sub mtodia a permis de Ie noter,
I'aspiration A I'ind6pendance et les pulsions sexuelles Went les deux grandes craintes des
moines par rapport aux iuuenes inclus dam leurs rangs. En revanche, celles-ci ne se posaient
pas pour les pueri. En premier lieu, la potentielle r6volte de l'enfant ne codtuait pas un
sujet d'inqui6tude : on est surpris de voir I quel point, dam la perception monastique
rn&ii&ale de l'eflfmce, cet iige etait pequ comme w e t docile. On dkidait de tout pour
hi, tant son fbtur immddiat que son futur lointain, sans envisager qu'il piit jamais se
rebelleP7. Deuxi*rnement, les enfats representaient une menace sexuelle, non pas parce
qu'on cfaignait qu'ils eussent entre eux des attouchements sexuels, mais parce qu'ils
pouvaient &e des objets de desk pour les Wres adultes. Au contraire, dam le cas des
iuuenes, le danger &it pequ comme inherent B eux-mimes : on s'inquietait qu'ils pwent
". M. ROUCHE tvoque la disparition de I'adolescence pendant k haut Moyen Age, mais sans foumir d'explication, I1 pcnse que ccttc division refit surface avec I'Ccolier, I'apprenti, l'kuyer, etc... w
(a Conclusion w, dam Les entre'. &ns fa vie - Initiations et apprentirsages, XIIe Con- dc la Socidte dcs historiens mCdi&istes de I'Enseignemcnt su#icur public, Nancy I98 1, Nancy: Presses Univcrsitaircs de Nancy, 1982, ~250). Pour cornprendre la disparition de I'adolescence, je formulerai une hypothCse t d s gtin6raIc : dam une socidtt oir la mortalit6 ttait grande et 05 toute dkision sc f k h i t en prcnant conscil des amis et des familicn, les adolescents pouvaient et devaient Ctre lac& rapidement sur la s c h e de la vie. Ceci etait m i aussi bicn pour le monde lalque que I t monastique.
*. A supposer que la criminalit6 p u k e &re considdrte comme o f b n t un indice du dbir de dvolte de certains group sociaw, Ics moins de quinre am sont absents dcs documents judiciaires de la fm du Moyen Age, d o n que ks jeuner y occupat une place, sinon de premier plan, du moins hCI importante. Les crimes de ces dernitn sont lies aux interdits que leur impose la socidt6, tout particulikement Ies dew probkmes indissociables de leur manque d'argent (d€pendance konomique) ct de leur statut de celibataires. Cf. J. ROSSIAUD, Prostitution, jeunesse et sociW dam les villes du Sud-Est la fm du Moyen Age w, Annaler E X , 1976, p.289-325, C. GAUVARD, e& Grace especial 8, 1991, p.366-67, N. GONTHfER, D&linquance.., 1 993, p. 146 et B. HANA WALT, Growing up ..., p. 120s~. et p. 127.
wok des contacts avec les *ts, mak aussi et surtout entre eux. Ces considhtions nous
a m h t h lademibe -*on de ce chapitre, queI genre de critiques les moines forulaient-
iIs habitueflement contre les jeunes ?
B. LES ERREURS DE JEUNESSE
A une exception prks, la Vita Hugonis de Gilon, les sources hagiographiques
clunisiemes dofftent pas de portrait positifde I'sge de la jeunesse, bien au contraire : un
jeune saint est habituellement lou6 pour avoir agi ditEtemment des individus du meme ige.
h i , Syrus declare au sujet de MaTed, imm6diatement apr8s avoir mention& qu9iI etait
entri5 dans I'adolescen&ia/imentus : a [antegrum se et sincerum omni mtodia ub his
oberseuabat vitiik quibus contaminori solent liom'nes Luicrs efatik mi. Un tel discours
s'explique en partie par la fonction remplie par les Vitae. Celles-ci doivent encourager leurs
lecteurs a progresset sur les chemins de la vertu ; dam ce but, les auteurs M g e n t les dkfauts
humains les plus usuels, plut6t que de chanter les vertus de tel ou tel groupe social. Pourtant,
ceci n'explique pas tout : I'absence d'doges directs sur le deuxi&me 5ge tire aussi son origine
du fait que les moines en ont une perception globdement nbgative. Ce parti pris se devine
en conhntant Ie discours des hagiographes sur les dewc Qes de la vie adulte, la iuuentus et
la senectus. En s'attaquant a chacun d'entre ewc, les auteurs mentioment indirectement les
qualit& qu'ils peqoivent dans l'autre iige : par exemple, les vieux font telle chose de mal,
sous-entendu, parce qu'ils ne possedent plus telle vertu de la jeunesse. L'Uude de ces "sous-
entendus" confume que les moines du Moyen Age central trouvent peu de raison de faire la
louange, meme indirecte, de la jeunesse. Cet tige est certes mieux nanti que lapueritia,
puisque, c o m e nous l'avons vu au chapitre pdcident, aucune qualit6 spirituelle n'est
attachee spicifiquement a I'enfance, tandis que la jeunesse est au moins l ode pour son
hergie ( m h e s i les auteurs m o d q u e s ne cessent de rappeler qu'il faut canaliset et
tem- celle-cit). Pourtant, cette M e des attxibuts positifs reste tds sommailLe en
cornpamison des nombnw reprocha f o d l c s contre le d e w i h e Qe. Inversement, le
troisi6me Hge se ttowe violemmmt tand pour un seul d e w majeur, sa perte d'energie.
Dam cette d o n , j'mue les remarques ndgatives Cgren6es pat Ies hagiographes
I l'encontre de la jeunesse. Cepadant, tous Ies dt%uts de cet h e w sont pas analyst% ici en
d6tail. En e m l'accusation de vanit6 B lY6gard des jeunes n'est trait& qu'au chapitre
suivant, dam la partie consactee ii la distribution du powoir entre les gdndrations. Il en va
de meme pour I'impatience (ex& d'6nergie) des iuuenes, abord4e en parallele avec la
critique de paresse lancte con- les vie= En demier lieu, j'ttudie comment le seul portrait
positif de la jeunesse, celui de Gilon dam sa Vita Hugonis, s'explique par des circonstauces
politiques tr6s particukes et, surtout, comment il fut complktement rejet6 par les
hagiographes successifs.
Si le vrai moiw est un moine adulte, et non un enfmt, le boo moine est ce1u.i qui a
su nier sa jeunesse'. Au risque de caricaturer le discours des Clunisiens, il est mGme possible
d 7 & i e r que la jeunesse est antithktique au monachisme. Cette remarque decode de la
lecture de divenes petites phrases riches de sens et glissees ici et 1ii dam les Vitae.
Lorsqu'Odon etait encore chanoine de Tours, il renonqa (soi-disant) a I'dtude des auteurs
pdiens pow se coasacrer A la lecture des ex6ghtes. Les autm chanoines du lieu w comprirent
pas qu'il piit ainsi p e r k la fleur de sa jeunesse. Furieux, ils s'exclam&ent :
a Quid agere velis, inquiunt ? cur invadere quaeris opus alienum ? hoc opus pretii perdidisti ctim flore juventutis. Pmce tibi, et relictis his inextricabiliter connexis litteris, ad psalmos abi. .
La mZme exclamation est reprise par l'abdviateur et par I'HmilZirnus, preuve que le &&me
Ctait classique4. Ainsi, la jeunesse est thtoriquement l'iige de la failit6 oh l'homme d ' ~ ~ 1 i s e
'. Ce thtme sera discutc! au chapitre suivant, section B '. Cf par exemple Ie grand nombre de fois ou appamhmt les mots grmitas et maturitas, ou leurs derives,
dam les chapitres consads awc, iuuenes sub mtodia de Bern. (I~xviii,p.2 10- 12) et d' UdaL (III,kco1.747sv.). '. VOt, I,l3,49B et V P d b , 9, p.215.
Le lien Ie plus fort Missant la jeunesse ii la vie laque - et, par comdqyent, oppsant
cet Qe au monachisme - est la sexualit610. Alors que les moines doivent l'avoir
thbriquement rejet6 de leur existence, le jeune est, plus qu'aucun a m , aux prises avec le
d&ir scxuel. L'Ctude des coutumiers clans la d o n p&c&nte a indiquC que les adolescents
inquidtaient Specialement Ies moines du fkit de leur sexualit6 missante ; nous avons aussi
obsed que Ies fkes es#raient amihiler celle-ci en exeqant me sumillance de tous les
instants sur les premi&res am& de la pubate ; mais il fallait pour ce faire que l'individu se
trouvilt ii I'int6rieur de la clhre. Les Vitae clunisiennes attestent que, dans l'esprit des
r&diers, les jeunes demeurant hors de l'enceinte du cloitre, qu'ils firssent laics ou clercs, ne
pouvaient que trs exceptionnellement tviter de pdcher.
I1 peut arriver qu'un hagiographe admette l'association jeunesse-sexualit6 comme un
fsit de la vie, sans la critiquer. Tel est le cas d'Eudes de Saint-Maw, dam sa Vita Burchardi,
lorsqu'il mentionne Ie mariage de Bouchard tout en rappellant pa. deux fois en deux phrases
sa iuuentus :
a Quo [Aymon, comte de Corbeil et mari d'~1isabeth qui deviendra l'epouse de Bouchard] defincto, ammonetur streme jimntutfr tiro Burchardus tam a rege quum a ceteris Francorurn prinroribus ut prgdicti comitis urorem sibi conjugio copularet. Ille vero quem jam juventutis seu nature human p necessitas taliafacere cogebat, prpceptis regalibtcs libenter paruit. m"
Pourtant, cette attitude est exceptionnelIe et s'explique par les circomtances tr& particulieres
qui domerent lieu a la kdaction de cette Vita : elle s'adressait en effet autant, sinon plus, ii
un public laque, compost5 du mi de Fraace, H e d 15 et de Guillaume, le noweau comte de
Corbeil, qu'a Sassembltk des rnoine~~~. Dans de telles conditions, l'hagiographe ne pouvait
se pennettre de critiquer owertement les pratiques du sikle.
En revanche, les autres auteurs clunisiens ne se souciirent aucunement d'dpargner
les susceptibilitbs des dculiers. Odilon explique que Dieu envoya de nombreux malheurs a
lo. Philippe WARD remarque que les troubadours qui went du terme Joven I'associent principalement it I'amour et il propose de traduire ce tenne, non pas par "jeunessen, mais par Ylan amoureux" (m "Je sui encore bacheler de jovent" ... *, dam Les iges de la vie, 1992, p.177-78)-
". VB I,p.6. 12. Cf. I'anaIyse de cene Vita dam I'annexe A.
Ad61Tde aprb son vewage, afm qu'elle ne succomMt pas B sa Iibido malgd son jeune iigc :
Amt ei, ut vere fatem. maU dMno exten'w corporalis q#lictio, ne f n l u ~ cremaret eam,
a t e icrwncuf' incentiva cmnis libido. Odon raconte que Geraud se gar& vierge
pendant sa jemese et il ajoutc que le DiabIe den revemit pas tant le cas &it rare : . Novum
nmnque et imrritclnm, illi [au Diable] mat, quodaliw jwencuIiu naz@agiumpudorb tutus
ev-sei: vM. La suite de I'bistoire montre d'ailleurs qu'au regard des moines, la libido des
jeunes constituait leur principal talon d' Achille et la cause la plus dpandue de Ieur chute
dans le @h&. Ap* avoir W tent6 et avoir ett d miraculeusement de la faute, GCmud
passa la nuit dehors, dans le grand h id , pour 6teindre le feu qui l'avait devod. Cette image
trks sttkiotyp6e renvoie aux theories m6dicales sur Ies quatre humeurs et les quatre iiges.
Comme I'Annexe C en tdmoigne, la jeuwsse est habitueuement associde au sang et a la
chaleur'" Cette caract6ristique expIique non seulement le d* sexwl qui l'occupe mais
aussi sa grande vitalitC sur laqueue je reviendrai.
Pierre le V6nCrable souligne B diverses reprises le lien entre la jeunesse et le &sir
sexuel. ~voquant un jeune homme de Charlieu qui prit pour maitresse m e femme mariCe,
il declare : a Erat ibi iuuenis mundavle uanitati deditus, eet ut in itla etate liomines solenf,
uolupfati frena reIaxans rI6. Pour mettre en valeur la saintet6 du moine Gkrard, le meme
auteur 6voque le fait qu'il ne succomba point au dQi. pendant ses jeunes andes, mais
prt5fera prendre pour compagnons des hommes m h :
Nam quod non patum dz~cile est, in medio seculi constitutus, et in igne non adustus, iuueniles annos absque cesliatis naufragio ucgU. Coetaneorunt quippe fasciuiam innato pudore abhorrens, matwis clericis, siue monachis, adherebat. .I7
L'association negative sexe-vie laque-jetmew-feu transpararat clairement dans cette citation.
I1 est dgdement fort possible, B supposer que la ponctuation de D. Bouthillier soit fondCe,
". EA l,p30. Sur la critique des uiduae adufescentiores par saint Paul, cf. I Tim. 5,114 5. '? VG' I,ix,col.648A. Is. Pour 6vuquer sa conversion et son e n w au rnonasthre, Jean de Salernt declare s'ttre refioidi au sihcle
et avoir ensuite dt6 po&dC par un feu d'un tout aum ordre : s picu] qui me dudm voluitfiigescere saeculo, er in urnorem tantipattis [Odon] esse accennun (YO1 Prof.,col.45A). On retrouve ici, bien qu'indirectement, rid& que l'entr6e au monast&re equivaut B un vieillissement (refkoidissement) p&maturt.
16. DM I,iii,p. 12- ". DM I,viii,p.24
que Pierre le V ~ ~ l e ait &bri l'bquation moines = clercs miirs, comme s i la mafitriti &it
sous-entendue dens le fXt m h e d'9tre moine ; ceci comborerait ce qui a W dit au
chapitre I, A savoir que le jeme n'est ghQalement plus pdsent6 amme tel apl'es son en&
au cowent. Cet auteur use d u tame lasciuitas dans un sens diffkent de celui qui a ete
mentiond props de I'enfance. Le signifi6 n'est plus ICgtrett, absence de gtavitC, mais
& . e Iascivitc5 ou luxure. Le meme nowel emploi du teme larciuitas se retcowe chez
Hildebert, ce que nous v c m ~ s plus loid8, mais aussi dans un autre passage d u De Miraculis,
o t Piem le Vhhble raconte l'entde de Matthieu d'Albano adolescent a I'l$@se de Laon :
a 6.. 1 et postquam adoleuit, itt Lizudunensi ecclesia clericale oficium adeptus est. Hic statim aprimis mi' contra multorum ciericorum deprauatum morem, cum etate cepit et honestate inualescere, et ieuitatem uel l&uiam consoda~~uum fugiens et execrans, quodperrarurn est, in huiumrodi horninurn genere, famosis honestate ac religione clericis adherebar. J9
L'insistance de Piem le V6ndrable sur le bon choix des compagnons se comprend
parfaitement si l'on se dfere aux pratiques clunisiennes, oil le jeune est soustrait de la
cornpagnie des moines du meme iige et soumis B la garde ininterrompue de son custos.
L'idtie que I'adoiescent doit etre bien conseill6, bien entom5 et bien occup6 se retrouve dam
un texte contemporain, la Vita Muioli de Nalgod. Celui-ci raconte que I'Mque de Miicon
encourageait Maeul adolescent B conserver sa virginit& si bien que ce demiet,
in custodiant cmtitutis tanta ambitione concaluit, ut minus honestas confabulationes et suspecta consottia fugieits, honestis et gravibus personis adhcrerem et suos quoque contubernales honestos faceret et pudicos ; tetrm quoque cordis sui et agrum conscientiae spiritalium virorum doctrinis spiritalibus compluebat ; et mentem suam, ne otiantem et osciiantem spiritus malignus irrumperet, honestis occupationibus uercebat.. n2O
la. Ces rniimes auteurs avaient aussi Ct6 les deux seuls avec Synrs & utiliser ueterunur dans son sens plus technique et moderne de "vCtdranW, cf. chapitre I, section D.
Sur 1'6voIution de I'adjcctif larciuut et du substantif Iarciuitas, caractdrisant initialement une attitude enfantine avant d'&cquer la Iwure et la lascivitd des jeunes, cf. A. ERNOUT et A. MEILLET, Dictionnaire htymologique & fa langue latine - Histoke a& mots, Paris: Lib. Klincksieck, 1959 (4' Cd.), p.342. Voir aussi L C SCHMITT, Ln rakon des gesres duns I *Occi& m&di&vaI, Patis: Gallimard, 1990, p. 1 80-8 1, qui discute de ce defaut dam le cadre de son &ude du De institutione noviriorwt de Hugues de Saint-Victor.
19, DM Il,iiii,p. 103. 20. V ' I,4,p.657-58. Cf. aussi VM I,S,p.188. Le verbefigere qui revient souvent pour ddcrire l'attitude
du jeune saint e a peut-etre tan rappel de I'exhortation de saint Paul h Timothtie : iuvenilia autem desideriu
Ces divers extraits de sources hagiographiques semblent &re des programmes &ducatifis
offerts au public monastique, tant at5 quc jeune. 11s thoigaent du travail de &flexion des
moines sur la meillem manik d9Mupua Ies adolescents dans l em rangs, travail qui doma
findement lieu B la dkision du newibe abb6 de Cluny d'mcer les jeunes puMres du
group des adultes.
Face B ce discours relativement W o m e des auteurs clunisiens, Gilon o f i un
portrait exceptionnel de la jeunesse de Hugues de Semdl. Faut-il en deduire qu'il existait
un courant positif, m b e minoritak, parmi les Clunisiens vis-his de la jeunesse ? Je
montrerai la f d e importance d'une telle tendance, puisque aucun des successeurs de Gilon
ne se fit l'icho de ce discours. Par ailleurs, lii n'dtait pas la question. Ce portrait positifd'un
jeune abM, saint et brillant, devait essentiellement servir une cause politique bien pr6cise :
imposer ti l'entourage de Pons l'image que celui-ci voulait transmettre de lui-meme.
Gilon utilise les caract&istiques habituellement associkes i la jeunesse, h savoir la
chaleur et l'impatience fi6lant I'excb, et montre B quel point celles-ci donnerent m e trks
grande valeur i la foi de Hugues :
a Letatur iuuenis in adolescentia sua ubertim faciem lacrimis rigans q u a rnag~itudo letieae indices pwi cordis emdebut. Cotpsls laboris impatiens et delicatum semitio spiritus manc@auerat,jlammamque diuini amoris qum gestabat in pectore o d i s scintillafidei radiantibus dedarabat- Conrepenter de rubigine mmdana in cantino disciplnae adplaum excoctus, subito culore longum teporem plurimorum supetauik [..I Stiscipit iwenis senum negotia, idque celittis agitur ne uirtw racita sine exercitio consenesceret wn
Comme cet exrrait en tdmoigne, avec ses r6f'rences & la longus tepr et I la vertu qui vieillit
(consenescere), l'eloge de la jeuaesse est indissociable de la critique de la vieillesse. Les
deux autres mentions du jeune age de Hugues par ce meme auteur sont dgalernent
#tge 01 Tim. 2.22). ". Ce portrait est exceptio~el, pour le Moyen Age central uniquement ; une image positive de la jeunese
(et plus ndgative de la vieillesse) devint plus habituelle dans les sikles ult6rieurs (cf. I. COCHELIN, In senectute bona : pour une typologic de la vieitlesse dans I'hagiographie monastique des XII' et XIIIe si&cIes w,
dans Les o'ges de la vie, 1992, p. 136-38). =. VHB I,iii,pJ I.
louangeuses. En outre, leur place hautement symbolique dims la structure du &it accentue
leur impact Elles m e t en c&t le rddt plus ou m o b a-temporel faisant sowent suite,
dam 1 s Vitae de saints abb& ib l'tlection abbatide et au portrait moral et physique du
nowel tlu - ici, les cbapitns I& a v -, dcit qui se prolonge habituellement jusqu'a
t'"entrtc dans la moan - ici, le Wut du Ewe II? : le chapitre 1,vi met en sctne un Hugues
uenumrpukcenfi aetate, tan& qye l'introduction du livre II Cvaque un Hugues sortant de
la iuuentsrs et entrant I pine dam la senecm Ces pdcisions temporelles ne sont pas
gratuites : du f ~ t de leur position, I'autettr indique au lecteur que les huts faits du saint
prirent surtout place pendant sa jeunesse. Une d y s e plus d6biIlt5e de la premiere anecdote
pennet de rnieux comprendre le but vi& par l'hagiographe.
L'histoire se passe dam l'Empire, en 1051, au moment du bapteme du firtur Henri
IV puis de la cele'ration de Pikpxes. Hugues &tit don iig6 de 27 ans ; Gilon ne connaissait
peut9ee pas l'iige exact du saint, mais il savait parfaitement que celui-ci avait au minimum
25 am, 1'5ge de son dlection. C'est donc sciemment qu'il rajeunit Hugues en afErmant que
celui-ci etait uernam pubescenti a e t ~ t 8 ~ . Il decrit un abbe (soi-disant) tout juste pub&=,
occupant le centre de la scene, avec, autour de lui, comme formant des cercles concentriques
de plus en plus distants et de qualit6 infCrieure : I'empereur, la troupe angdique des seniores
de Cluny, les princes, puis les Saxons et les Alamans.
a Itaque sanctum Hugonem pubescenti aetate uernantem uenire ad se [sujet = Henri m] inuitauit, imnmntatum gloriosissime excepit, et utfiIium Henrictmt tertium de sucro fonte l e ~ gratanter obtinuit. T i c etiam parcha celebrauit parchalis agni filius una cum impratore, angelica Chniacensium seniurum stipatus cateruu, in Agrippina Coloniae. Qui c u l . humilitate purputatos principes, suaui persuasiune magniloquos Smones, uultus mametudine Alamannos crudeles ad gloriicandum Deum mirubiliter excitabat- P
=. Le deuxieme livn ne hgitc pas uniquemcnt de la mon du saint puisqu'il debute avcc une anecdote qui avait eu lieu vingt ans plus t6t ; m a l e tout, a p k seulement cinq historicttes toumant autour du thCme de Cluny, Gilon aborde Ic sujet du d-.
''. A l'autre extdrne, Gilon semble retarder la fin de la h e m s bien au-delh de sa limite usuelle, lorsqu'il Ccrit au ddbut du Iivre I1 : a Iam decurso feiciter iuuentutis sfadio pater sancthsimtcs sexaginta quinque annos a nati~~itate gerens a mrceptione regirnink qua&aginta nurnerabat (VHP If,i,p.90)-
*. V f P I,vi,p55.
Les anecdotes qui suivent immfiaternent celle-ci mettent tgalement en valeur les liens
Mi entretenus par Hugues avec les puissants de ce monde, I ~avoir les paps et les mis.
Or de semblab1es contacts constituaent pdcishent l'atout essentiel de Pons quad il devint
I'abbe de Cluny maI'd son jeune bge? 11 parait alors tr&s vraisemblable qye ce dcbut du
p o d du sixitme abbt de Cluny ait surtout sen6 de fithe-valoir et de justification indirecte
au powoir du septibe abb6 du lieu.
Ce tableau idyllive d'un jeune abbc brosd par GiIon ne se retrouve sous la plume
d'aucun de ses successeurs. Hugues de Goumay 6limina purement et simplement toute
rtiference i l'iige. Renaud de Vezelay, qui Mvit aprts la chute de Pons, ddplap la
description des importants contacts de Hugues avec les papa et les princes de ce monde ti
la toute fin de la Vita. Par ailleurs, ses mentions de la jeunesse du saint sont toutes teintees
de critique. Immddiatement apds avoir dvoque la nomination de Hugues B I'abbatiat, il
mentiorme comment celui-ci dompta sa jeunesse. 11 laisse ainsi entendre qu'un tel Sge n'est
acceptable pour un abbe que lorsqu'il est nit5 :
a Tunc denique q u a cmces sibi indirerit, Iorica ilia, qua indutus ad camem iuventuiem suam perdomuit, una pro caeteris ad medium deducta &ciat, sub qua et suam, iicet innocens, et patris mi, qui de mundo iam excesserat, penitentiam agebat. m2'
En un autre passage, Renaud monte comment Hugues encore adolescens fbt choisi de
preference a d'autres membres du clerge beaucoup plus ig6s que lui pour proclamer le
sermon d'un synode. Sa manib de dCcrke l'dpisode tdmoigne qu'il ses yew, une telle
situation appelait une justification : c'dtait parce que Hugues avait W exceptiomel qu'il
avait dtd choisi pour p d e r et cela, malgd son jeune Sge?
=. Sur les liens unissant Pons B la Papaute et au pouvoir impdrial, cf. H.E J. COWDREY, Two Studies in Cluniac History, 1049-1 126 m, Shuji Gregorimi, XI (1978): 194-99. Sur ses rapports avec l'Espagne, ibid, p200sv. Sur la jeunessc de Pons au moment de sa nomination A la tEtt de Cluny, cf. supra, chapitrc I, section D.
? Kw l4p.41. *. Le synode de Reims de 1049 traitait de simonie et de nicolalinne- Hugues donna une dponse restde
c6kbre lorsqu'il fit interrogt5 sur les modalit& de sa propre election : "Caro quidem cornensit, sedspiritus repgnavit, "In quo verb0 apud omnes tantae ammirationi a gratiae
Irabiius est, ut inter tot eloquentissirnos viros, inter tot scniores, ipse adhuc adolescens tit sermonem ad rotam faceret sinodum eligerencr, . (VHC xxxvii,p.S6).
Ironiquement, le plus virulent dans son discours con- Iajeunesse est Hildebert,
celui-I& m b e B qui Pons avait demand6 d ' h k une Vita Hugonis sur la base de celle
&dig& par Gilon. L'Mque du Mims reprend sans exception tous les topor mentionnts ci-
dessus i props des d t W de Ia jeunesse : il la d6crit Iarciw, toujours en q u k de plaisir,
prompte au chapardage, ayant tendance &&re orgueilleuse et rebelip. Lorsqu'il declare que
le saint n'avait abaolument aucune cmcttkistique de la jeunesse (a Cum juvenibus nihil
@vemCplaeter aetatemfidt. t.9, il va m h e plus loin qu'aucun autre hagiographe clunisien
rdservant habituellement un tel discours P la seule enface. Le meilleur exemple du tmvail
de rdecriture open5 par Hildebert se trouve dam 1'6vocation du passage de Hugues de la
iuuentus A la s e n e c d l :
La m h e id& se m u v e A l'ani&e du &it par Renaud de la nomination de Hugues comme prieur de Cluny, alors qu'il etait encore adolescent L'hagiographe a f f i i e que la preuve des innombrables vertus du saint se trouve dans le fait qu'il ait dt6 promu A un age aussi bas. Ce meme argument pcut &re invcrsd : iI faut avoir un nombre dtonnant de vertus pour etre nomme A ua &e aussi bas :
Quipstea quantae humi;lilatis, quantae pur&at& et honestat& quamque fervtns in amore dei extiterit, non sermo naster sed beati Odifonk soliertiiz, qui e m i vra annos adoicscentiae CIuniacensem ordinavit prepositum, declarat. m (VIF iiii,pAO). =. Hildebert dCcrit Hugues refusant de commettre des vols avec les jeunes de son b e (a nufli consors in
czdpa. guia d i comors in rapinu m* W 5l,co1.860C). Le portrait qu'il trace du jeune saint est ceIui d'un iuuena-senex :
In pupilIari a h c iIfe constitutus aetate, morosam vwbk et actu praeferebat senedutem Jam tunc inexorabiliter I11sciviam perscc~lIrrs, hilitatem pudicitia assumpsit cutadem. firm tunc molliork cuftus et deIici0rum contemptor, in iflecebris illecebras ignorovir w (m 1,2,c01.860-61).
Dans la meme pbrase ou Hildtbert tvoque l'absence d'orgueil de Hugues a p e sa nomination comrnt pnew de Cluny, it rappelle sa jeunessc, laissant entendm que a dtfaut va normalemem de pair avtc cct &e : a Juweni sipidem ex promotione notl mbrepsit dorto, non ordinbfhvor intepuit ; w ( Y p IJ,co1.862A). 11 mentionne aussi t'abscnce d'orgueil de Hugues au moment de son election comrne abM, mais il choisit @eut4tre volontairement) de nc pas nppeler n iuuentra lorp de ca Cvtnement ( V p 1,4,co1.862D). Lonqu'il reprend la sche de la c61Cbration pascale ii Cologne, Hildebcrt nie toute jcunesse en Hugues :
a Celebravit -ern Pmcha c ~ , imperatore, rir Agr@piha Cofoniae, Titonicir mwantibus in juvenili &c aerate canitiem m o m , conversationj mansuertrdinem, vulrus gratiam, verbonrm lenitatem. m ( V P I1,6,col.864B-C).
I1 explique que Hugues mfiua d'admtttre des iuuencufiae A Marcigny de crainte de leur Iasciuitas : I Nulla ubi vel rara juvencuIrr, ne loscivient~ adhuc fervor aetr~tj, vel loco infamiam contraheret. vel inter sorores scandalum generaret, a (m I& 1 1 ,coI.868B), Intcrpdtaut msl la de la Vita de Giion ob celui-ci raconte que Hugucs fit distriiucr Ies memes portions de nourriture aws. enh t s qu'aux adultes, Hildcbtrt tempIace pueri par iuniores et dCclare que, en agissant ainsi, Hugues d t a les murmures des jeunes : Sana sane dispositio, quae praejiztam aetatern, et a mumure compescuit, et ad laborem suscepra oravit obedientiae. (Vl?" 11, IZ,co1.869A-B),
'O. YHhi 1,2,col.861A. 3'- C/HS I1,i.p-90 et VHh' VI,38,co1.883CI
Giron Hildebert
ram decumo feI .er iuucnlulir U i o Jam i u b k juventd offend2cula vir pater sanc~siimus seurg*Wa qvinque sandus inuffemsb gressibus evesetat, a annos a llCItl*ut'tate g e m a suseeptione nariviate qquicm sexaginta quinque, a reminis qudaginta ntanerobm. susceptione autem regiminfs, annos
gerenr qu&aginta w
- Bien qu'il soit impossiile de comntre les v&itabIes raisons de cette variation du
rkit, on peut imagina le scenario suivant : Gilon wmposa sur les conseils de Pons une Vira
de Hugues qui permethit de consolider le prestige, peutdtre ddjh chancelant, du nouvel abb6
de Clunp. Ce texte fit pdsente I Hildebert atin que celuici, hagiographe de renom, en
redigeit une version finale, apte I 8tre di.fhsie et digne d'etre Ccoutee. Pons, qui avait
command6 cette Vita, devait certainement esp6rer qu'Hildebert inttgrerait dans son krit
l'image trts positive du dgue d'un tout jeune abb& ddjh transmise par Gilon : la plume de
l'hagiographe donnerait ainsi un vemis d'autoritc! au discours trh int6resd du texte original.
Or, Hildebert fit tout le contraire. Dans la droite ligne de la tradition hagiographique, il
critiqua tous les Qes, mais s'aaapua plus spicialement B la folie de la jeunesse? Pons n'eut
32. Sur les problhes awcquels Pons dut faire face A partir de 1 120, cf. H.E.J. COWDREY, Two Studies in Cluniac History, 1049-1 126 m, Stzufi Gregoriani, XI (1978): 225-28, AH. BREDERO, Une controverse sur Cluny au XIIe siklc v, Revue dPHktoire Eccf&iizrtique, 76 (1981): 51-72 et Id, Cluqy et Clteata au d o ~ i i r n e si&Ie - L 'Hktoire d 'me controverse, AmsterdarnMaacsen: APA-Holla~d University Press, 1985, p.40-73. L'idde de Bredero, qu'il y avait d'un c6t6 des dforrnateurs influencb par le discours cistercien (desirant austMt6, litwgie all€g&, silence, jehcs, rctow au travail manuel ct rtjct au moins partiel des coutumes), dont Pons aurait fait et de l'aurre dcs traditiomdistes (mistance sur la couhrme), dont Maahieu d'Albano a Piem It Vdndrable, me sembte d€pourvue de tout fondemcnt Les prcuves de Bredero sont e d m e m c n t tdnues- Surtout, la Vita Hugonis de Gilon, qui exprime plus ou moins dirtctement I'iddal spirituel de Pons, ne donne aucun indicc d'une volontd de dforme : Ics thtmcs mcntionnCs ci-dessus n'y sont simplernent pas abordts. Pour cssaycr de compnndn Ie conflit qui opposa Pons P Picm Ie V€n&able, il existe tout un ensemble dc sources qui ne fit jamais mis P profit jusqu'P maintenant par les historicxu a qui est pourtant d'une grande richessc : il cst en effet fondmental de relire attentivemcnt les diverses Vitae Ccritcs pendant les annth 1120. Les divergences en* Ics textcs otiginaux a les ~ t u r e s (par Nalgod, Hildebcrt, Renaud, etc.) se dv+lcnt &re t& instructivcs. If n'est pas westion pour moi de traitcr ici de ce sujet qui m'dloigncrait beaucoup de ma th- mais Ie discours sw le pouvoir dc I'abM ct dcs oficiers clunisicns qui se dCgagcnt de ces diverses oeuvres o h probablemmt unt cl6 du probltme.
''. CeUe &don de I'6veque du Mans nc doit pas Ctomer. Approximativcment vhgt am plus t8t, il avait Ccrit dew lettres virulentes & Rcnaud de MartignC pour le dissuader dc devcnir Wque d9Angers, cat il avait moins de trcnte ans (Epiktofae, livrt n, lettres V et VI, PL 171, col.2ll-13). Ce dernier n'ecouta pas les remontrances de son coll&gue t'exhortant A se d 6 f h de sa charge ct porta ce titre de 1 102 B 1 124 (cf. 0. GUILLOT, art. a Angers, Anjou D, k U 4 , I (1980): 630). Si Hildebert pouvait tenir semblable discours alors qu'il h i t iigd d'environ 46 ans, combien plus devait-il le tenir quand il avait pres de 65 ans !
alors d'autre recows que de commander me wwelIe Viro A Hugws de Gournay qui choisit
d'dliminer la source du conflit en =jetant mute dfhnce ii la jeunesse.
Ce scCaerio a I ' a . e d ' o m une explication pour les tds nombmses U o n s
des Yirw Hugonis. Par ailleurs, il reste un factM qu'aucun chercheur ii ma connaissance n'a
pris jusqu'alors en wmpte a q@ demeure fondamental pour mon props : alors que le texte
d'Hildekrt n'est en gh&aI qu'me simple rScriture de I'oewre de GiIon, elle en Were sw
un seul point, l'image de la jeunesse. Hugues et Renaud s ' b r thmt aussi de ieur mod&le sur
ce meme th6me. Queues cpe soient les causes &elks B l'ongine de cette divergence, celle-ci
trahit en fsit la grande r6ticence des hagiographes dans leur ensemble ii adopter un discours
positif quand ils traitent de la jeunesse.
L'analyse des Vitae Hugonis ofie un bon aperqu des critiques que suscitait la
iuuentus dans le monde monastique clunisien, mais aussi des &arts possibles par rapport au
discoun dominant, D'un c6t6 comme de l'autre, les m h e s themes etaient presents :
opposition jeunesse/vieillesse et chaleur de la jeunesse. Nous avons vu que le principal
reproche formul6 contre le deuxieme ige portait sur le d6si.r qui bflait trop souvent le corps
des jeunes et les d6tournait de la voie monastique. La section suivante pomuivra 1'6tude de
la perception du corps des jeunes mais sous un tout nouvel angle, celui de la beaut&
Les saints sont souvent pr&ent& c o m e &ant beaux' ; or, la beaut6 est
habituellement associtie B la jeuness& Faut-il en conclure que les auteurs de Vies de saints
Cf. LC. POULM, L'idPol de saintette' dam 1'Apitaine carolingienne d'aprk les sources hagiographiques (750-950). (Travaux du labomtoire thistoire religieuse de I'Universitd Laval, I) Quebec: Presses de I'Universite Laval, 1975, p.48,
'. Raoul Glaber explique que Hugues, le fils de Robert le Piewc, ttait qualifie de grand (magnus), du fait de la @ce et de la IibCtalit6 de sa jeunesse (spro sug iuuenmtis elegantia ac liberafitate I., VW xi,p284) ; ainsi,
louent indirectement cet &e lotsqu'ils chantent Ies cbarmes physiques de leurs h b s ? le
&montraai qye, en *&, il auive trh raremmt qu'un jeme moine, saint ou non, soit loud
pour sa joliese ; -Us, il est possible de distingucr dam les b i t s monastiques un ideal de
beaut6 r t k m C aux hommes d'figke, distinct de celui qUi &it employ6 pour les Seculiers,
et dont la jeunesse w constituait pas un c r i t h de base. Paradoxalement, le grand Hge etait
davan-tage un atout.
11 est en effet ntcessaire d'etablir des distinctions sur les objets du discours
hagiographique quand celui-ci traite du Beau. II faut noter en premier lieu qu'il existe de
profondes divergences lorsqu'il est question d'une femme ou d'un homme et, daas ce demier
cas, lorsqu'il s'agit d'un M c ou d'un homme d ' ~ ~ l i d .
Le discours hagiographique sur la beaut6 feminine est particuISrement ambigu
puisque les saintes sont presque in6vitablement belles dam leur jeunesse, mais les puellae
incitatriw de #ch6 pewent 1'Ctre dgalement. Le corpus des vitae clunisiennes repdsente
un khantillon trop restreint - awc seulement deux descriptions de beaut6 fCminine - pour permettre de traiter seriewment du sujet ; iI donne malgr6 tout I'occasion d'bmettce
quelques hypothtses. Le comte de Boulogne, Eustache aux Grenons, fut ddsireux d9Cpouser
Ide de Lorraine, parce qu'il avait entendu parler de ses b o ~ e s moeurs et de sa beaut6
(a mores et actus atque pulchritudinem praedictae virginis Idae 9') : en introduisant ces deux
critikes c6te i wte dans son texte, l'hagiographe semble en approuver l'association5. Pass6
ces deux qualit& sont directemcnt assaciCes B son jeune age, Pour Ia suite du raisonnemcnt, il est important de souligacr quc Hugues b i t un lak Cf, aussi Ies defmitions dcs ages offertcs dans I'Annexe C, le livrc de M. GOODICH, From BiM.., 1989, p.105 ct surtout !'article de M. PASTOUREAU, 8 Les embkmes de la jeunesse - AttnIbuts a miscs en sche des jeunes dans l'image rn6diCvalc W, dam Histoire dm jeunes en Occident, vol-I: De 1 %tiquit& ti I 'e'poque moderne, dit. Giovanni Levi et Jean-Claude Schmitt, Paris: Seuil, 1996, p268-69.
'. Cette distinction avait dtjjja dtC notee par J. PAUL, dam son article 8 L'tloge des personnes et l'ideal humain au Xme sikle & a m la chmaiquc de fia Salimkne m, Le Moyen &e, 73 (1967): 403-30. le n'ai pas trow6 danr mes Yiae du Moyen Age central l'huisrance sur la noblesse en relation avec la beaut€, tant larque qu'eccl&iastique, tcmarqude par ce chcrcbeur (ibid, p.411). Par ailleurs, il ne traite absolument pas de l'idtal physique cccl&iastique.
'. VI IJ,co1.439A- 5. J- PAUL a not6 I'importance accord& ii la pi&& des femmes dans les tloges A leur Cgard et en a conclu,
ii ton selon rnoi, que fl]e comportement religieux est ddja largement feminist dam 1'Italie du Nord au XIIIe
le mariage, il n'est plus question du physique d'Ide mais uniquement de ses qualit&
modes ; il semblezait donc cpae la beaut6 soit plus specifiquement mentiom& i propos des
jeunes arm&. Odilon ne dit mot sur l'appmce de la fimnt impQatrice Adtlaide -s son
oeuvre est avant tout une @@he et non m e Vita : les questions politiques y sont
pddomhantes et les divases anecdotes sont dramahisees, non pas idCaliseeJ. Sous la plume
d'odilon, Ad6Mde n'est pas taat m e sainte qu'une grande dame6. L'autre belle jeune fille
de mon corpus est la tentatrice qui faillit fhke glisset GCraud dans le pCchC. Eile aussi devait
ttre toute jeune puisqu'elle n ' e t pas encore maritk. Selon Odon, ce qui retint surtout
l'attention du comte fut la couleur de son teint, &ment fondamental de l'esth6tique
m&ii6vale7. Cette affirmation lui permet de souligner le caractere superficiel de la b u t t afin
d'essayer de convahcre son auditoire de ne pas se hisser prendre h de telles ruses du
demon8.
Ainsi, si la beaut6 fdminine est indissaciable de la jeunesse, elle est aussi bien loude
que ddnigrk On ne peut donc pas utiliser les descriptions de belles jeunes filles comme un
indice d'une image positive de la jeunesse.
L'hagiographie clunisieme n'est pas totalement d6pourvue de portraits de saints
masculins o t ~ beaut6 et jeunesse se marient Pourtant, aucune de ces descriptions n'est donnk
pour elle-meme : cbacune tire sa raison cl'etre de circonstances particuli&res au recit. Elles
si2cle w (a L'Cloge ... b, Le by en ige, 73 (1967): 417). Cette insistance nu les qualit& morales (ou pieuses) des femmcs tdmoigne simplement dt la crainte des h o m e s qu'elks nc ternissent I'honneur et le sang de la famille par lcur comportement. Une femme pieuse risquant moins de pcendre un amant, I'Cpouse de five se doit d'iitre belle et pieuse. Cf. aussi S. FARMER, l Clerical Images of Medieval Wifes b, Speculum, 61 (1986): 5 17-43,
6. Le fait qu'il ait rttrconrrt I'imphtrice il diverscs reprises et, donc, qu'il connlit son aspea physique (qui plus wt, ctlui qu'elle wait Ia t o e fin de sa vie), ne doit pas &re nt!gligC, Ap& tout, Addlade pounait fort bien ne pas avoir Ctd une belle femme.
'. Selon Isidore, le tenne pulchritude ddsignait initiafcment une certsline qualitt rosde de la peau (cf. Edgar de BRWNE, Ihdes d'esthe'tigue m~i&&, I: L& Bake d Jiam Scot big~ne , Gentve: Slatkine, 1975 (Bruges, 1946). p.83).
'. a 0 siprotinus inteZlectu cornperisset quid sub cute latebat ! qua nimirum nihil c m k pulchrum est, nisi funis pelli- Avertit iNe mIos, sed specier per @sos cordi impreao remumit. . (VG' I, k,co l.648B).
ne pewent par co&quent &re consid&es comme l'illustration d'un tops du discom
monastiquc du ~ o y e n &e central.
La cause premik dans l'hagiographie d'un semblable portrait alliant jemesse a
beaut6 cst la lar"cit6 du saint. L'analyse du discours des hagiographes nous append que le
physique &it de grande importance pour les lai:cs9 ; or, puisqu'un saint d'un groupe don&
devait rb i r en lui la quintessence & toutes Ies qualit& de ce group, il etait normal qu'un
saint ldque fnt declit come un beau jeme homme, dam le sens la'ique du termelO.
L'analyse de quelques Vies de saints illustnra ces afkmations et offiira quelques indices sur
cette "esth6tique laique".
G&raud est un saint Mque et Odon n'oublie pas d'6voquer son aspect physique :
N m Iicet cmo nihil pro.&, iicet fallax gratiu sit puIchritudo, tamen quia libidinis argue superbiae fornes esse quibusdam solet, Zaudandum est in hoc viro quod et venustus fu2, et se nec Iibidinis coeno foedavit nec praecipitio superbie mersit Gerald= i@tw stafutae mediocris, et totus, ut dicitur, euphormis, id est bene formatus. EEt cum urtumq~odque membrum sua pufchritudo compsisset, collum tamen ita candidutum, d quasi ad n o m n vivendi decuscrtum habeba ut vix aliud turn grotiosurn vidisse te putares. Elegantiam sane co-s venustas animi decorabut- J1
9. Les parents se basaicnt en partie sur le criere du physique pour ddcider du ktur de Ieurs fils (cf. chapitre 111, &on B)- Inversemmt, ce m h e aith leur permetrait de mesurer k bien-fond6 d'une d4cision en cette mati&rc : le p&c de Hugues est finalemcnt convaincu que son fils a bicn fait d'entrcr dans les ordrcs quand il remarque il qucl point il a embclli dcpuis qu'il cst devcnu moinc (KW I,&pSl ct 1,2,co1.%61D). La beaut6 de Hugues n'cst pas d€aitc par Gilon en fonction de la courbc de son nez ni de la forme de scs yew, mais du kit que a d brillaicnt de joie a quc, surtout, le jeune hornrne avait l'air pleinement tpanoui. Sur Ie fhit quc, d o n Isidore, les yeux constituaient le plus important ClCment pour juger de la beaut6 d'un individu du fait de leur luminositt. & E de BRUYNE, h&s d'E;stM~hiqn.., 1, 1946. p.85.
lo. La ma Bwcmdi a t t e que tous Is saints layques n'&aient pas obligatobent dCcrits comme de beaux males. Malgn! tout, il nc faut pas accorder trop de poi& au tdmoignage de cettc source, compte tcnu que Bouchard n 's t pas p e t & comme un saint par son hagiographe et qu'il ne constitut pas le point focal de sa propre Vita (cE analyse de cette Vita dam 1'Annexc A).
Sur le fkit qu'un htros l w c souvent d b i t commc beau par les chroniqucurs, comme si les qualit& modes bent mdiiISSOClablcs dcs physiques, c t P. ROUSSET, s Note sur la situation du chevalier L'Cpoque rornanc a, dam Litte'rature, hhtoire, linguktique - Recueils d'dnrdes o f l i h Bermd Gagnebin, Lausannc: age d'Homme, 1973, p.192 Cf. aussi M.G. GARNER-HAUSFATER, Mentalitts Cpiques ... m, Le Moyen Age, XClII (1987): 20.
I. VG' I,xii,coL6SOC. Les mots qui ne sont pas en italique firrent corrigb sur la base du BN lat.53 I 5, fol.9 ". Cf. aussi BN IaL 15436, foI.49'-
Toutes les pteCautio11~ dont s'entoure I'auteur pour aborda la question de la beaut6 de
GQaud tboignent de la dticence (au moins thbrique) dm eccldsiastiques face ii ua tel
sujet12. Odon se justifie de s'y attader en aflirmant que l'&Ocafion de l'appatence physique
du comte lui pennet de reprocher aux nobles leur sensualit6 (libido) et leur orgueil
(-rbia)l3. Ainsi, cette partie de son dkours m s'adresse pas d e m e n t A des moines mais
egalement ib un public laque. Pour celuiei, l'auteur reprend Ies critetes de beaut6 laque,
indissociables de la fonne du corps : il parle de la stafuru et use d'expressions comme bene
firmanc~ etpulchn'hrdo rnernbr[or]~m~~. Il n'est pas fsit mention explicitement de la jeunesse
de Gkaud mais il ne s'agit certainement pas du portrait d'un vieil homme ; rien non plus
n'kvoque ici la maturite. Odon ne peut pourtant pas s'empkher de glisser des Clbments
spirituels dans ce tableau. Ainsi Gbraud n'est pas un grcmd homme, il est simplement bien
proportiom6 (a statwa medioers m) : equilibre qui rappelle la discreti0 monastique? Son
a cou delicatement blanc (a collm cmrdidullum m) serait, awc dirw de I'hagiographe, le
syrnbole de la ggularit6 de son mode de vie. Bien qu'une telle association puisse paraitre
discutable, il est du moins certain que l'adjectifcandidulus renvoie aux criteres de beaut6
Le thtrne de la jeune fille tentatrice qui n'est qu'une belle peau sur un corps immonde (cf. supra) ou celui du beau vase empli de serpents, symbolisant les oeuvres de Viiile (VO' I, 12,coI.49A), temoignent du regard t&s critique que ies h o m e s d'&$sc en g h & d ct les Clunisiens en particulier portpient P l'occasion nu la beaut& Sur cctte atthde a son origine biblique, cf, Whdydaw TATARKIEWICZ, Hbtory ofAesthetir'cs, II: Medmaf Aesthefics, La HaydParidWimmm MoutoniPWN-Polish Scientific Publishers, 1970, p.7, p.11- 12 ct p.14. I1 ne faut pourtant pas accotdcr une importance dCmesufCe l cc rcjet, mais remarquer qu'il ne constituait qu'un dcs aspects de leu discours sur ic Beau, et, ccrtainemcnt, le plus stCr60tYpC. hangemcnt, alon qu'il donne autrement un &it beaucoup plus d&ailld de l'anecdote, l'abdviateur dc la Vita Odonb a retid de sa d-ption du vase la formule deforispufchwrimus de Jean de Salcrne : il sc contcntc de dire qu'il s'agissait d'un grand vast (VQab 8,p214). Nalgod insistc en revanche sur sa beaut6 (a var grade, mira exterius pdchrihrdine vetnutatem m, V ' Fini 9,p. 136 = PL 8,co1.89A)-
13. J'ai m o d clans Ia &on p&&Iente que l'orgueil a la sensual* etaicnt surtout assacids l la jeunesse, tout comme d'aillews la b u t t "IaPque",
14. Cf. C. CAROZZI, De I'enfana i la maturii : lhdc Gap* 1 s V i a dc GCraud d'Aurillac ct d'Odon de Cluny w, clans ktud'sur la senribifitk QU kfoyen &e, Actes du l W congds national des sociNtr savantes, Lirnoges - f 977, (Section de philologic et d'histoire jusqu'l 1610,II) Paris: Bibliotheque Nationale, 1979, p. 106.
I? Jotsaud pale aussi de la stature mediocris d'Odiloa dam sa Vita (cf. *a)), tandis qu'il mentionne son stam gratu dam son ~ ~ i t a ~ h e ( c t EOI 12,p.124). Sur la prCfCrence der lam pour les granda tailles, cf. J. PAUL, L'Cloge ... m, Le Mqyen Age, 73 (1967): 408.
ecclkiastiqye dont je traiterai plus loin : il n'est donc pas etonnant qu'il soit mis en relation
avec Ies camct&stique~ monastiques de saint GCraud, e i non avec sa lacit&
Mal~cesaccentsspiritUeIsinsCrCsdansladescriptiondelabeauttdeGCraud,ceUc-
ci M Climinb de Ia deuxihe Vita. Or I'auteur de cette d d h , B la diffibnce d'Odon,
S m h les m q u e ~ la]:ques du b s : Wud &emit un clac to& dont l'aspect
physicpe ttait ignort. La M e stature du saint n'y avait plus de place, Ie cou si charmant, pas
&vantage. Il fbtt dire qu'odon raconte que cette partie du corps du saint attirait les baisers
de ses familiers (a Solebant sui colltan ejus laetantes deosculari J6), geste qui n'6tait
certahernent pas I encourager, ni meme B dvoquer, dans I'enceinte d'un monasth.
Dans 1 s Vitae Odonis comme dans la Vita Gemldi d'odon, le meme phtinomhe se
remarque : il y est f ~ t mention de la b u t 6 du saint, non pas dans un contexte monastique,
mais en liaison directe avec les id& laEques. C'est parce qu'Odon h i t devenu fort et beau
au moment de son adolescence que son @re d&i& de le faire h o m e de guerre plutdt
qu'eccl6siastique* Ainsi le portrait du be1 adolescent n'est-il pas gratuit : il ne s'agit
aucunement pour ses hagiographes de louer la beaut6 du saint en tant qu'dkment de sa
perfection mais de donner une explication satisfaisante de l'intemption de ses Ctudes
religieuses et de son envoi B la cour de Guillaume d'Aquitaine*
Cette affirmation appelle malgrk tout certaines nuances. Dans sa rnaniere de rapporter
cet evenernent, Odon atteste qu'il n'itait pas tout B fait insensible au th6me de la beaut&
peut-Etre parce qu'il etait rest6 longtemps dam le siMe, tout comme d'ailleurs son
interlocuteur, Jean de Salerne :
a Factum est autem nmr udolevissem ego, quem mod0 vetulum intueris ac turpem, strenuurn praedicabant et cottspicabilem juvenern : coepitque pater metis per incrementu temponnn me ab ecclesiasrico subtrahere ordine, et militaribus exercitiis qpplicare. d7
L'association jeunesse-beaut6 est ici mdes te , de meme que son pendant, l'association
vieillesse-laideur. Par rapport A ce premier tableau, l'abdviateur fait de la surencWre : il
s'attarde encore davantage sur la beautt5 du saint, p m e qu'il trowe un certain intdit au
sujetper se, et non pas Miquement cornme explication de la volte-face patemelle :
Facturn est post hgc, nan &levisset, intuentes parentes eius eflcatiam vuUus ~~ et oCiFgmtkm, stmttturn et conspicab#em asserebunt cum fore futurum. si miZitm*btrs studiils emdiretaw. mu
C e e lois, c'est I'aSSOciafion kut6-fm physique (obtenue g&e aux exercices militaires)
qui est tvidente. Nalgod glise pour sa part un Clement "ecclCsiastiquen dam ce portrait
lorsqu'il Cvoque la mesure des gestes d'odon (. hubitudo temprata totius coporis 3 mais
iI est aussi manifeste qu'il &prowe m e certaine complaisance h decrire la beaut6 du jeune
saint :
Ernenso pueritie spcio, cum in pleaiorem adoiescentie gratiam fonnaretw, clericurlibur studiis f i tmu clericus serviebaf* Erat in eo temperata totius corporis habitudo, statura solidior et in earn pulcritudinem foma pro$ciens, qup inter colIactmeos et co pos predkabilis haberetm Carnalis pater eius camem in eo plus di2igem.r. de spiritu minus cvans, in came iuvenis qup c a d s erant, nature ductus impetu, ccotuetw- Advertit in flio corporis eiegantiam, gatis accessum plenitudinem virium,firmamenfa lli[eIn brown d9
Dans cette dernieR description, la beaute, la forme du corps et la force physique sont de toute
Mdence Lids a la jeunesse. Les moines n'6taient pas insensibles B ces qualites et pouvaient
meme les louer chez Ieurs saints, mais rmiquement dans le cadre de la vie laique et 1 travers
un regard Mque : deux conditions qui leur permettaient d'admirer, tout en dknigrant
l'importance de l'objet admh5. Les qui lisaient ce passage de Nalgod savaient fort bien
que le p&e d'odon ktait dans son tort, qu'il await dii considCrer ces qualit& physiques de
son fils comme peu de chose en cornparaison de ses aptitudes spirituelles ; pourtant, Nalgod
- et, h travers hi, son auditoire - ne se serait pas attar& avec autant de complaisance sur
le portrait du jeune, fort et be1 Odon, s'il den avait pas reti& un certain plaisir. Parce qu'il
etait clair m a l e tout, pour les moines, que cet ideal physique etait indissociable d'une vie
Is. V C P h S,p212. 19. Y O Fini 6,p. l34=PL 5,co1.87C.
guemk, ils &finirent d'autrs cri- de beat6 pour les moines dont ils voulaient f h k des
Pour comprendre l'iddal de la beaut6 monastique masculine, il faut se toumer vers
la descn'pticm des ~ e s dlcstes, c9est4dire non d e m e n t les anges mais egalernent
les +mes qui fbent admises au Paadis, h savoir Marie, les apStres et les Clus. U est
evident qye ces divers personnages se doivent tous d ' h beaux puisqu'ils habitent le Ciel.
Or, les hagiographes clunisiens, s'ils ne pdcisent pas tout simplemeat qu'ils Merit beaux2',
'O, Il scrait int&cssant de poursuivre plus loin qu'il ne m'est donne de le faire ici l'etude du discows monastique sur Ia beaut6 Mque- Elk pcrmcttmit en cff i de micux compmdre quel regard les moines portaient sur leurs colltcmparains. Ce discours devait &re d'autant plus complexe quc Ics parents ditigcaient peut4tre leurs en- ks moins beaux vcn ~'&lk. Sous la plume des m o k , la b u t t kfqoe n'est pas obligatoircm~t mode, la di f lFhce de la bcautd monastique ; aussi peut-clle &re associte au Ma1 (commc nous I'avons ddj8 obscrvt avcc lcs femmcs), Dam la Vita Hugonh par Hugues de Goumay, celui-ci monte comment le saint fit fhir le Diable lorsqu'fl prit h parole k Autun, vcn 106249, af'h d'hblir la Paix de Dieu. Or, clans cette &e, Sfhanus est dkrit comme possCdant h amctWtique priucipale d'un bel h o m e Mque, ii savoir la statute : qu&m strdraaprtxems, fmie tmcuIennr~, multk eum setpentibus . (W iv,p.123). La beaut6 Mque pem Cgalemmt &re perddou acquke selon le bon v o d o i de Dieu, cornme en ttrnoigne I'histoire du ICprcux, autrefois riche et beau, devenu pauvre et laid, et que Hugues de Cluny gudrit miraculeusement (Wf" ~v~p.129 et F@ tV,24,co1.87!jB). GiIon ne parlait pas de beaut& dam son pmpre dcit de ces &hements ; ce fbt donc Hildebert qui ajouta cet d14nnent k l'anecdote pour en acccntuer le tragique (cC V ' I,xxx,p.76 et YFPu coI.45OD)-
". Quand saint Benoit apparut en dve Mafeul pour L'encoutager & accepter la charge d'abM de Cluny, il apparut sous I'aspect de a quihm refigionik habitu cumptus, uenustu facie decom m (VM n,2,p2 10). Le mtme abbC h d f i c i a de l'aide d'un angt, * p e r egregiu uultu r (VM ILT, l7,p274). Dans la description des derniers jovs d'Odon, il est fait mention d'un 8 vir quiabm co~tfpicobifk fonnae simul et gratiae qui vint porter au saint un message de la part de saint Martin (YO' III, l2,col.84B d YOh H ,p258). Ce dcit est probablemtnt de h plume & I'HumiIZimlu (cf. analyse dcs Yitue Odonis dam I'Anncxe A) ; il datcrait alors du w e de Hugues (I 049- 1 109)- Dans la Vita dc Ndgod, cetk description dcvient : A&t et in vrju persona conspicabifik, coele~lir gloriae praeferens candidrrturn, a (YO" 53,col. lO4B), L'ange gardicn qui veillait sur le sixieme abbt de Cluny Ctait un infm tmn elegantifinno w (W I,xxrcvii,pBO et w- V,29,col.Sf 8A). Lorsque I'&v€que Durand se manifests une troisihne fois aprts sa mort, pow annoncer que la penitence imposCe par Hugucs b sept Mrcs lui avait pennis d'etre lavt de ses pCch&, il appamt soudainement compl&emcnt transfonnC :
r Tunc redit antistis. nec iam ri;eformb ut unte, sed specie renitens uique decorus era&. ( W v.160,p.65)
Sur cctte d m c anecdote, cF. aussi V7P f,xxi,p.70, W lII,2O,co1.872-73, VFE" xxiv,p-133-34 et 'YH xxviii,p.Sl-52. L'angc qui vint rCveillcr le sacristain de Cluny du temps dc Hugues Ctait une mognae venustatk personu w (W co1.447C). Dam le &it d'unt vision qu'il f i t avant dc mourir, Hugua d M t I' En fant-Jdsus comme &ant un a elegans p e r , et divirun praeferetw veltuptafem . (mi Vn,43,co1.887C). L'hostie qu'un paysan avait p l a d dam m e ruche se transcoma infoma spetiosbsimi pueri . (DM 1,i'p.g). Le moine Gerard, qui vit un miracle similaire alors qu'il ctldbrait la messe, aperqut egalement une mulier honerrissime/orne rn et un uir angelici decoris P c W de l'autel (DM 19viii,p18). A un mourant, le personnage celeste venu defendre sa cause appamt sous les traits d'un (tfirmosus et benigmcs ut uidebatur uir m,
insistent toujours sur rune ou sur l'autre des dew caractMques Juivantes : I'impression
de puissaa@ qui se degage de ces individus et leur luminositk. Bien souvent, ces deux
t%ments sont confondus par l'usage d'adjectifs, te1 splendidrrs. A i d , dam la Vita de
C&aud, Odon raconte la vision d'un clerc de Rodez qui apequt a duo v i ~ splondidissimi
VLJ' et habitu 8 ; il s'agissaa de saint Pad et de saint MartiaP. Dans la Vita de Hugues par
Gion, celui-ci CMque la vision de saint Denis par un rnoine : il apparut comme une
rpersona qdendidbsima m2'. Le jour de 1' Ascension, pour la procession, les fibs devaient
porter quuttuor tab-] am inroginibus sancforum splendentibus *. Autrement, la 1uminosit6 est de loin la propri6t6 la plus importante. Saint Martin se
montra 8 Adhegrin, l'ami d'odon, avec une ~praeckmjbcies B*~. Hilduard, pdchantre des
Fosses, vit appadtre devant lui saint Babolein pendant son sommeil ; or, celui-ci
resplendissait comme le soleil (a sicut sol remgenr ,n). Dans son 6pitaphe pour Odilon,
Jotsaud appelle celui-ci la mmima I z a o r b i ' . Lorsque Cluny fbt envahi par m e arm6e
c61este venue cele'rer la fte de saint Paul, le sacristain vit son eglise illuminde : a comcms
tandis que les esprits mauvais dtaient des monstres d'une Iaideur insoutenable (cf, DM II,xmciii,p. 165). *. L'dvocation de la puissance seufe est assez exceptionnelle. Alon que MaSeul etait emprisomd par les
Arabes et d&espdrait de sa situation, il vit en gve un pontife romain (* [alpostolicis insignitus uesttbus romomcs mtiktes 1. (YiC1C IIIJ,pZl). Dans PW xxviiii,pS2, Hugues apparill't un whew sous les traits d'une persona m a m e seven'tati$ cum pusroraIi vr'rga L..] Cluniacemem abbatem se nominans m, mais I'abbe &.it
toujours en vie et non encore [pequ comme] un habitant du Ciel au moment de cette apparition. La Vierge Marie se montra B un jeune converti sur le point dc mourir sous I'aspcct d'une glorimksimae personae et exceIIentiwimae porestatis mufier * (VO',II,2O,coL72A). Inversement, k s accoIytes du diablc peuvent app-ttt sous la fonne de paysans hideux (cf, DMI,vii,p.22-23). 11s accupent donc un statut iaftrieur et ils sont laids.
VG' IV,v,co1,699A. z4. W W , p . 105. Hildebcrt pdfdra insister sur la puissance et parler de quaerlbm persomz venerabilis rn
( V P VI1,50,co1.891B-C). Les exemples d'ernploi du tenne "splendidm" ou de ses dtrivts peuvent ttre multipli6s. Quand un envoy6 du Ciel vint conforter l'ermite Adhegrin ct Ie rassurcr sur la valeur du mode de phitence qu'il s'imposait, il s'agissait d'un vir spldidissimrrs (YO' I,25,co1,54C). Quand GrCgoire le Grand appanrt Odon pour lui donner la permission de r&umer ses Moralfa iit Job en un stu1 volume, il apparut en cornparaison du choeur de saints qui I'avait p W C r ultra om- quiprrrecesserant eum, vuftu specieque et moribuspenpIendidus m e ornutus r ( V 0 1,2032C ; V P U 15,p.219). Cette dernike description Iaisse entendre que plus le penonnagc ctleste est grand, plus il resplendit, Quand le moine Gerard apparut un frtire aprb sa mort, son h e (animus) etait constans et son visage (uulm) splendidis (DM I,viii,p.32).
ZS. LT 7 1,p. lo@'. P. D W R mentionne en note Ies peintutts du Christ ct de la Vierge, de Pierre et de Paul. 3. VOi 1,27,coI.S5B, 27. MB 8,p.l61B. *. EO* p.123,
ltminennenbw, ppersontr deaIbatkfiIgens, vociburque duIcironis rebwnr ma. Toujours daas
la m h e VUo de Hugues par Gilon, Benoit est appe1C le soleil des ab& (sol abbatunr").
Martin, Ie bijou des plitrrs (gemmcl saeercibl~my', tandis quc W e , l'etoile de la ma, brille
avec m e grade clartt (a Vidi,.. matrem Dei, maris stellom, ~ 2 ~ u . r coruscare n)32. La
brillance des personnes habitant les Cieux s'expIique par Ieur proximite avec le Seigneur.
Ainsi qye s'excIame Rmaud de VQrlay la fin de sa Vita en prose : a lux aetema Dew ti&
luceat ornneper aevum p. Dieu est donc l u m i e , et cew qui vivent praches de lui, au
Paradis, en sont bim entendu i~npr6gnC8~ mais ils ne sont pas les seuls. En effet, un des
signes manifestes de la saint& d'un individu est sa luminosit6. comme si ddj& sur terre, il
rkfl&hissait par un ph6nomtne de miroir, la l u m i h divine.
? W coL447D-E, m. CE Won, Sermon r De sancro Berredr'cto abbute m, PL 133, coL725B. Cet auteur &me que Benoit est
comme une lampe ( ~ I C C ~ M O ) , une ttoite (stella) ct un soleil (sol). ". Le fait qu'il s'agit 18 d'une expression consade pour d&igner Martin (cf, par exernple YO ' 1,6 et
co1.46C, V P U h 3,p211) n'enltve rien 8 l'argument. 32. V H II,xv,p. 105. D'autrcs exernples peuvent Etre offerts, qui tdmoignent aussi de la lurninosite des
apparitions c&stes- Par excmple, aux dires de GiIon ct d'Hildebcn de Lavardii, le pr&e qui cdldbrait une messe afm que la naissance dc Hugues se ddmulilt sans probkme vit apparaitre dans son d i c e un MU lumineux (a species in/Pnrr'lrj supra humunum morhun mir~fice radians 8 K P I,i,p.48 et specia pueri praeferem inaestimabifm cImIatem rn YHh' I,l,caL860C). Renaud dklare simplement que k cbl&rant vit dans le cake a quasi ctliufdam injiantdiymago rn (YHt I,p39), tandis que Hugues de Goumay, trop soucieux de r h m e r la Vita* passe sous silence cct Cpisodc, Dam la version par Pierre le Vdn6rable de la vision dont Hugues beneficia un soir dt Not1 pcu avant sa mart, la multitude des angcs apparut baignant dans unc trts grande Iumi&c (DM I,xv,p.SO).
33. VJF xlv,p.60- 31. CC, par accmplc YO# II,vi,coL919D et VOip co1.932C (oi~ Dieu est appeld lumen diuinun, rn et 8 lumen
uerum a) ; plus g ~ ~ e r n c n t , rur a thhe -anent rCpdu, ff E de BRUYNE. &es en EkthJtique .., voLIII, 1946, p-17- Invef~cment, en admirant la lurninosit6 de ccrtains objcts ou individus, l 'he peut s'dlever de la Tern jusqu'au Ciel (cf Umberto ECO, AH a d Beauty in the M i . e Ages, td- H. Bredin, New Haveukondon: Yale Univ, Pnss, 1986, p.14-15, qui cite entre autres Sugcr).
3s. Le pape Benoit VIII apparut trois pcrsonnes aptts son d&&s pour dire qu'il etait en train d'cxpier scs fautes ct qu'Odilon devait prier pour Iui afin qu'il suit sauvd. Dans cctte anecdote racontee par Jotsaud, l'opposition paradis-putagoire est syrnbolistc par le couplet lumi&e-tdntbrcs : Benoft h i t videlicet non spfendore Iucis. sedpueruatan tenerelur in wnbrk rn (VO? II,xiv,co1.928B)- Apr& qu'odilon eOt entrahd tout le Chapitre de Cluny A implorcr le Ciel pour le pkhcur, Bcnoit se montra & un moinc du lieu pour dire qu'il etait enfm sauve : il avait maintenant les traits d*une p e r s o ~ f i l g i k (co1929A). Piem Darnien rencherit sur cette image, decn'mt le Pape comme &ant a q u i h pulcher, ac sere- aspecttl. ac solerrzni quorlbm nitore cons pi^ et deconrs ucfilgr'dw B (VOP coL938B). La mort d'une personne pieuse est aussi pkentde comme Ie dCpart du monde des t&n&bres (c'est-&-dire ici-bas), pour entrer dam un monde de la lumih (cf. par exemple YO3 Pra&co1.897C et I,iv,co1.900B).
Pierre Damien compare 1es actions $ W o n aux dtoiles d'un ciel serein et
-. lorJque, plus loin dam son &it, il commence A d6ain les miracks acmmplis
par le saint, il use du mQle registre symbolique :
r G.. ] co@ mnmcIIis wruscare mirucullis ; ut qui clams erat in probitate m o m cfimscCICf e t i m in ostembne sigmm ; et qui in obtutibus omniptenti's Dei erd fucenta urdclts, fieteret etimn corm hominibus IUCCMS [Joan. v]. U i e divino dkponente judicio fucrunt esf. ut qtda de ills era& pibus dictum est : Vos esth tux mundi mtth., v], primum de luce miracuIonnn exhiberet. m3'
Pour fairr l'hommage de trois moines, Hildebert dklare qu'ils ttaient des filii IuciP.
Hugues de Goumay d W t Guy, arche* de Vienne, devenu le pape Calixte II a Cluny en
1 1 19, en des termes Uushant parfaitement de la divergence en- I'ideal eccl&iastique et le
lzque : a Hic terrene nobifituttis celsitudine precellit, sed celestium nitore carismaturn
Cette luminosite des hommes piew est souvent symbolistie par la couleur blanche.
L'importance symbolique de cette couleur resort aussi bien dam la pdsentation des
personnages dlestes que dam la description des saints demeurant encore sur terre. Le sihge
qui attend saint Hugues au Ciel est un a su6sellium candidurn decenter ornatum *'O. La
multitude d'anges qui viment assister au dichs du moine Benoit avaient pour seule
caracttristique d'Etre entikment vetus de blanc4'. Jean de Saleme, puis ii leur tour
l'abdviatM et l'Hmilliimus, ss'merveillent que les membres d'Odon restkent blancs de son
vivant et, tds symboliquement, ne se noircirent pas au contact de la terre, ma&@ I'habitude
du saint de coucher directement sur le sol42. Odon ddc6d6, Jean de Saleme affirme qu'il
36. VOP c01.925B. VOIQ co1930B,
38. III, l4.coL87OA. 39, W Epkt. p- I 15. 'O. VEP XXX,~. 137. 'I.- DM I~x,p.62.
a Sed hm mirobile est. quia candor @skis corporis non esr immutatrrs a nigredine in quajacebat humi, et virzus mi animi nonjkit extemcotu a longa continua~ione jejunil'. m (YO' I,l6,colSOD et V47 a 1 3 ,p2 18). La premiere partie de cette phrase fut peutdtre inspide par la description du corps de Martin au moment de son d t c b (cf. citation offerte infiu et SuIpice Sev&e, Vie d;e saiw Mmtin, intro., texte et trad. I. Fontaine, (SC 133) Paris: ~ d . du Cerf, 1967, votI, Ep. 3,17).
monta directemat au Ciel et le fomde ainsi : resplndet cadore beatae
immortalitafi~s m? OQn lui-mhe, lonqu'il Wt les doup antienaes en l'honneur de saint
Martin, &oque les cara&&iques physiques du saint au moment du dccts et mentioxme
sa description l'image de la puissance, de la I ~ o s i t t a de la bIancheur :
qui h v b puriw, &IPdr cundidwt, came quoque momtratus est gemma - sacerdotum Glonrik~* Rom'ni~ viderunt glun'om qui e e r u n t : nmn car0 quam
cinis sempet obtexerat, ilrr mpdcnd& vt quorliiom muc~~ctionis, decus & extihda prof- 6-.] fiequibe Martini non dicmturfuneris, sed triumphi f...]. Mmtinus signiptens, fu&ore viriufuorrrr @st reuerbemt arira 6.J w
Or la blanchcur est dgdement symbole de vieillesse, du fait de la blanche chevelure
des pesonnes @&s4? Parce que la blanchem dtait signe de puretd mais probablement aussi
parce que, parmi les premiers habitants du Ciei, l'hornme du Moyen Age percevait les vingt-
quatre vieillads de 1'Apocalypse et les vieux prophttes omant le fionton des eglises, le grand
iige ttait plus en accord avec l'ideal du Beau eccldsiastique que la jeunesse. Lorsque saint
Martin apparut & Odon, il se pdsenta sous les traits d'un . vir venerabilis canitie decoratus,
stolaque splendidu indutus, super quam pallio pluviali utebarw, et episcoporum more
fimZam mcmufeebut m4. Brillance, blancheur et powoir, tous les signes d'origine celeste
sont ici amalgam&. L'ange qui veillait sur le sommeif d'Odon et le recouvrit pour qu'il ne
? VO1,III, l2,coL86A. BibLCItm. co1.263A-64A. Odon s'inspira bien entendu de la condusion de la Vita Mmtini par Sulpice
S&&ce, mais sans h recopier mot & mot : Tdatique nobb suni qui ibi&mfienmt uidhe se uularn euS tamquam uuhm angdi ; m e d m auian
ehs cundId~ fmquam nir uId&ntrrr, ita ut dicerent : w Qtieuis W m umquam cilicio rectum, qub in cineribus credm inuoIutum ?r lam enim sic uidebatw, quasi in fuiurae resurrectionis gloria et numa demutatoe camk ostenrus esset. 8 (Sulpice S v t r t , Vie de saint Miutin, (SC 133) 1967, Ep. 3'17).
Dam cecte m€me oeuvre, une d-ption dt Martin, alots qu'il est ddj& aux Cieux, thoigne de I'anciemete de ce qui pourrait s'intitulr le "Beau ccc1&iastiquen :
r [.,.I cum repnte sanctum M c a i i m episcopum uidere mihi uideor, praetextMn toga candida, uuultrr igneo, ~elf'f~bus ocut&, crhepurpurta ; u t t p itu mihi in ea kbiludihe corporb fonnuque pa notreram uitieborur [,-.I (Ibid, Ep- 2,3).
L'cmploi de la formule "personnes @&s" ne doit pas fain oublier qu'il ne s'agit ici que d'hommcs %g6, car, encore unc fois, les saintcs ne sontjamais pdscntks, B ma c o m ~ c e , comme de belles vieilks femmes.
VO1 II&oI.6 1 B. Cene description de Martin est reprise mot pour mot par I'abdviateur et I'Humillimus, cf. V@ " 29,p.233. Dam la VOu , la description est un peu diffdrente : vir personaIis. m a m a cunitie florescenr. sfda etrbm putrbre vestitus w (VO" 29,cof .97C).
vislile que le pr&e Angelus, qyi apaFut la &e, Ctait convaincu qu'il s'agissait du doyen
du lieu, le moine senex Fddus". W v m t htaX*:eul B la fin de sa vie, NaIgod dklare que
sa blanche chmltue rehiwssait son visage : aflorebat can0 jm verti'ce cuput Abbm!, et
reverentiizm d . ejur veneradz ranities amplidat C. Un p&tre, qui Ctait en& au
mo- & SaintJean d'AngCIy dors qu'il etait dc5jj8 t&s view (senim), MntnCficia d'une
vision peu avant de mourir : la persome dleste venue le tancer d'avoir oublit de confesser
une faute &it m e apersonu reuerende forme, ccmrdidi habitus, et uenerunde cuniciei m4g.
Alors que MaTed s'etait endormi, apds avoir longuement pri6 pour obtenir la guCrison d'un
cornpapon de voyage et mener ii bien me tiche fix& par I'abM Aymard, un homme
vbCrabIe de par sa blanche chevelure (a q u i h uir cunitie reuerendm m) lui apparut en rSve
pour le rassmee9°. Matthieu d'Albano aperpt quant il lui le Paradis peu avant son dbcb :
l'homme qui hi servit de guide en ce lieu etait un uir reuerendi uultrcs, multa ac uenusta
tmn capitis quarn uestium albedine decorus J1. Un paysan vit apparaitre dans son champ me
troupe dleste dont la Vierge et saint Pierre. Celui-ci avait les cheveux blancs :
cum repente mihi apparuerunt personae venerabilis cujudam dignitatis et ultra temporis hujus nostraeque conditionis homines honore et gloria dignissimi ; p e i b a t
". YOdb 49,pZS. ''. V ' IV,43,p.666C. L'auteur de la Vita Maioli aftera affkme pour sa part : [..,I jlorebat cigrteunt
Abbuti caput* senectutu maturae albicantibusflorib~~~..~ (VM col.17 8SA). 'S DM I,iiii,p.l4. Plus Ioin dans son De Mirawlh, Pierre 1e Vtndrablc d a t un autrc pr&e converti sur
le t a d Par ce portrait, il explique l a signes caractCristiqques d'un habitant du Ciel (a homo positus in caefo a). Les cheveux btancs occupcnt ici encore m e place non nCgligcable :
Im siedhabinan corpuris ehs stiIus conuertatur, solus ipe s @ c i ~ ~ i a l q i itrdicclbifur. C o p s p@pe attenuufum, facia macilenfa, capIffi ihcompti @saque canicie umuondl, uuIttls d e m b ~ ~ ~ ~ , oculi uix umquam patentes* os sine requie sacra uerba nrminanr. non P Iena set fn cdo posif~nt horninan indicabant, (DM I,mc,p.6 1)
A la diffdrmct des autm porbaits mentiom& dam cctte section, celui-ci ne semblc pas pdsenter w e "bellen perso~e. Piem le s a d parfaitcmeut ctjouak w ce paradoxt. Son objectif Ctait didactique : il voulait frapper I'imagination de son auditoirc pour le convaincrc d'imitcr ce pdtm Benoit Cet extrait thoigne ainsi du caracttrr celativement artificiel du Beau monastique : Ics moines s'dtaicnt en quelque sortc "construit" une beautt en accord avec leur idCa1 de vie- Malgd tout, certains CICments, cotnme la iuminositd et la chevelure blanche, sont tmp souvmt r6cument.s pour nc pas fitire rCelkment partic dc l'csthdtisme des hommes d'&lise.
%. VM I, lQ,p202. Cette anecdote ne se retrouve ni dam la Vita breuior ni dans celle d'odilon. Nalgod la reprend, mais pdsente le personnage dleste comme a quidmn ei reverenricle personalis apparem (VM I, 1 1 ,coL659D).
". DM II,xxi,p. 135.
Domina quae&m, cujw d t u m veloci tram-tu intueri non potui, vim d o r m rmuumndo proseaitus ; sequebclnct mtem senex n k a cmitie venerondus ... P
L'a- annorqa ik ce cultivatcur la mort prochaine de Hugues a Iui demanda d'aller
pr6venir le saint Le &it des d d e r s jom du sixihe abbt de Cluny donne lieu, chez
Gilon, A me description louangcust de son physique. Alors qu'il Ctait iig6 de 85 am, il est
Licef autem cotidiano tabesceret ihcommdo tmnm/rtinrdine mentis conseruuta, in festo rantis paIm4nrm tam speciosus p r o c d q d diuinls angel& non solurn niton habitus uerum &bm uullus datiiati? sirnilis spectaretur. mS
Un peu plus loin dans le &t, Gilon eVoque B nouveau l'aspect sublime de Hugues peu avant
sa mort :
Pmtquam lux paschafis illmit quam resurrectio solis iusticiae plus suo sole serenat. sanctus Hugo dealbutsls egreditur quasi nouitutis huius a d m i d a e testis et ntutntutnus. mS5
Cette liste d'exemples aneste que, si l'ideal de beauti pour les moines etait d'avoir
l'apparence d'un ange, celuici n'itait absolument pas pequ, comme c'est le cas aujourd'hui,
sous les traits exclusifs d'un bambin ou d'un jeune homme mais il powait tout aussi bien
11 existait des exceptions, a savoir des w o~ la beaut6 d'un moine Ctait dicrite, en
partie ou in&$plement, selon les cnt&es du "Beau laTquen. Ainsi, le portrait de MaiTeul par
VHi VII,4S7c01.888C. Dam la Vita Hugonk par Gilon, celui-ci parlait piut6t de a persome dipitate mulro preditue m7 dont une = reg& domim (sotmatendu, la Victge) a un = senior (sous-cntendu, saint Piem ; KFP II,vii,p.98). Ainsi, la puissance seule at-clle CVOQU& dans ccttt pranitrr version. Peut4tre faut- il y voir un refkt de la neon" propre au paysan ? Lorsque Hugucs de Goumay reptit cettc anecdote dam sa Yi'rr, il embellit la scine en lui donnant plus de brillant : persome premmime dignitaris m, dont une
domina spIdoris et glorr'rte i i t i m a b i k rn ct un qukkm, senior uenerandus (w d i , p . 136). Cornme h citation cidessus l'aneste, Hildebcrt ajouta pour sa part, non seulancnt la lumiht, mais aussi la blanchcur.
'? Lorsque Hugues appanrt il un catah Albero ap3s sa maf il avait llaJ dCfinitivemcnt adopt6 le visage d'un ange : ?r ~ I t u serenus angelic0 * (W II,xviiip.l07)-
97 CW Kvii,p.97, Les autrcs hagiograpbes ant cxclu ces passages, probablcment pame que, dans leur souci d'Ccoumr la Vita du trop proIixe Gilon, 1% ne choisirent de gardcr puc l a anecdotes miraculeuses. Seul HiIdebert conserve quelques traces de ccs portraits du saint, Iorsqu'il d€cIare au sujet de Hugues mourant :
herat jam vulrur' ejus quaedom fiturae portio gloriae, mi diceres alipid coilaturn de simiiitudine angefo tw~ ( V P ViI,44,co1.888B).
". VHs II,ix,p.99.
Odilon w correspond pas cxacfement au mod&le que j'ai propoSe puisque l'hagiographe
s'aaafde SIX la description da parties du corps :
vat virjmn dictus, saepe dice& saepque recoIendw, ingressu gravis, voce subJim&, ore f a d , vYiSU jtIMIItdiCS, wItu imgelicu r ,c& seremu. in omni mom gestu vel actu corporiIs honestatem praesentans. Omnium membrorum convenienh' psitione ¢&sirne comptus, omnium mortaliun mihi videbatur pulckm~mus.
MaIgrC tout, la compraison avec les ages est ici prtsente ; de plus, aucune r6ftrence n'est
faite la jeunesse, mais l'hagiographe l ake p l d t sous-entendre l'ige avauc6 du saint avec
l'emploi de i'adjectifgrmis au tout debut du portrait- Enfin, Odilon vient tout juste de
compiuer MS-eul i un astre resplendissant (astrum persplendid#.
Hildebert quant i lui dtcrit Hugues, juste apr6s son dlection a l'abbatiat, comme
titant : a ipse fonna conspiema, statwa eminenr, corporis dotes titulis virtutm curnuhvit mS8.
11 explique que le saint fbt tds app&i6 B la cow d ' H e ~ I1 entre autres pour la @ce de son
visage (gratia VI(I~SIS)~~- Mais Hildebert n'6tait pas moine : il &it 6veque et donc membre
de l'dglise stcdi&e, plus proche des laks. L'originalit6 de sa position se remarque en
confrontant son discours i celui de Gilon. En effet, la place du portrait de Hugues dam la
V ' d'Hildebert est identique B celle du portrait du saint dam la premi&re Vita : l'kveque du
Mans s'est donc inspi& sur ce point du texte du moine clunisien. Or, les dew descriptions
Merent 6norm6ment entre elles. Gilon a present6 Hugues comme &ant aformu angelicus,
moribus cornpositus, natwaZi incessu conspiam, seennoe non Mectatu sumris. On
retrouve dans ce portrait des 61ements typiquement monastiques : le rappel de l'idhl
angdique et l'absence de refkence B une statlire imposante. Hildebert a transform6 cette
description pour qu'elle coihcide avec sa propre perception du Beau, impdgnde de morale
mais tres peu monastique.
Si je n'ai pas d b l 6 daas les sources utilis6eJ pour ma Wse un portrait qui marie
jeunesse, beaut6 et @ i o n religieuse, m e teUe image se retrouve pourtant dans un
m a n d cluniden du We sikIe. Il s'agit du & d'me vision fhite par un moine de Cluny
alon qu'il &it avec ses Wres dans 1e chacm :
[...I qui uidit iuwnem decorum wldr et habaa ct uukku regi s i m b t , uirgam uureum ferenfem quem sequekdur angelus cum thuribulo ; @se autem poriubat &atant, qumn ciicwnqqueppacn& d adcu*a melorliam cun& lacthus d a b a t Deinde nmibus SinguIonmr ~ i f i c a b a ~ sfcque iIUr dabat ampkuwa et oscdum m6l
Ce tr& beau jeune homme excitant les lames de chacun des rnoines par la mdlodie de sa
cithare, puis les embrassant, &it le Christ, le mi des rois (a Quemfidsse regem regum mIIw
ignortzt v). La morale de l'anecdote est qu'il ne faut pas dormit au choeur de crainte de
manquer semblable visite. Pierre Ie V6nt5rable connaissait l'existence de cette vision
puisqu'il avait demand6 des renseignements par k i t h son propos ; pourtant, il ne l'a pas
i nc lw dam son Re Miructllis. G. Constable, qui a ddit6, ce texte semble s'en etonner
quelque pa, mais les blernents inhabituels de ce &it, oc beautti, jeunesse et sensualit6 se
mElent, expliquent probablement la decision de 1'abM.
La Vila OdiIonis rddigee par Jotsaud au debut des m k e s 1050 coastitue un parfat
ichantillon pour r6sumer ce qui a W dit prtWdemment sur la perception clunisieme de la
beaut6 des homrnes et pour mieux &valuer la place respective des divers discours tenus B ce
propos. En thCorie, les moines se devaient de ne pas accorder d'importance B la beautC
extirieure ; iis ne pawenaient pouctant pas I &re totalement insensibles au physique et, plus
encore, I la f q n dont un corps se mow& Aussi Jotsaud 6crit-il : a Et quamis, secundum
beaturn Ambrositm, in pulchritudine coporis locum virtutiis non ponamus, gratiam tamen
non excIudimw. d3 II anivait donc a w Clunisiens de se hisser guider par I'esthdtisme
6'. G. CONSTABLE, a 'The Letter from Peter of St John to Hato of Tmyes a, dam Peh.tlr Venerabiiis f f 56- 1956: Studies and Tercs Comnremorating the Eighth Centenary of hir Death, €d. G. Constable et James Kriueck, (Studia Anselmiana, 40) Roma: Herder, 1956, p.52. I1 s'agit du manuserit Paris, BN lat. 17716, fo132"-33'. Selon le recueii des Manuscrits ClbtPs, vol.m, il autait et6 cornpod aprh 1 189 (p.589). e. G. CONSTABLE, = The Letter fiom Peter. .. n, dam P e w Yenerabilk, 1956, p.48. 63,. VOS I,v,col.90 I B.
laique, oii la jeunesse, la joliesse et la stature du corps jouaient un grand r6le. Un jour o t
0dilo11 se t r o d dam une demure appar&mt A l'abbaye de Cluny, iI apequt clans un coin
renseigna pour savoir qui h i t cepuer et apprit qu'il comptait au nombre de ses serfs mais
&ait aveuglea ; le saint le fit approcher et le gu6rit. Or il s'etait i n t h s t & cet e n f i t
essentiellement parce qu'il avait un beau visage. Dam le meme ordre d'idk, et selon les
d k s de Jotsaud, dkida d'entraher Odilon dam sa suite, en premier lieu pime qu'il
avait W attin5 par son physique :
a Qui consideram in eo praesfantem eiegantia~ copor& et nobilitatem generis, magnum q u i d ! et divinunt oculir interioriibur in eo ptuevidens, totur in ejlrs mnorem ilhbitw, et vichsim inter eos ignis divinae chmitatis magis magisque accenditur.
Pourtant, cette attirance pour la f o r e du visage ou du corps ne doit pas &e surestimtk ; les
objets de tels discours et la place accordbe ii ceuxci dam les Vitoe en temoignent Lon de
la scene qui vient d'Etre &oqude, Odilon avait approximativement 27-28 am et, fait trts
important, il n'etait pas encore moine mais clerc s&culier. Par ailleurs, son portrait est
excessivement court ; il ne peut E k e considM c o m e un dchantilIon representatif de la
rhktorique monastique sur le Bead6. Pour trower un exemple de celle-ci, il faut pourmiwe
quelque peu la lecture de la Eta et attendre que le saint devienne a b g de Clmy, cYestestMire,
non plus un jeune dculier mais un moine d'un iige avand et digne d'adxniration. Juste ap&
le rkit de la nomination d'Odilon comme abM par Maieul, Jotsaud ofEe ses lecteurs un
a- VOi II,ii,c01.9 16- 17. I1 fit @ndu au saint qui intemgeait son entourage pour saw it qui 6tait I'enfant : a SeMtutIj vim10 in vesfro, domine, seniti0 annexus renew. rn Pierre Damien fait de lui en revanche le fils du viiIiclls (cf, VOP 930C). Sur cctte @isode, cf. 1- remarques dt F. ERMINIT If Pianto di Iotsaldo per la motte di Odilonc *, Srudi medievali, 1 (1928): 393. a. VO* &ii,c01-899C. P i m Darnien n'a pas consem6 cette anecdote dam sa Vita Odilonis : il fait entrer
Odilon i Cluny saw o m d'cxplication sur I t pourquoi ni le comment de cette conversion- @. L'home m&li&val pouvait fort bien 2tn sensble B la beaud "gratuitcw (a in itserfn)), comme peut l'ttre
la beaut6 d'un corps humain, mais Ia vraie beaut6 &it pour h i indissaciable de la morale (cf U. ECO, Art and BeautyT 1986, par exemple p.5 et p. 15). Outre la citation cidessous, Jotsaud o m un autre exemple de ce type de beaut6 dam sa Vita Odilonis lorsqu'il affirme au =jet d'Odilon : c Honestutik decore ifu pollebat, ut in omni ma actione huju virtufb pulchritudine, tanquam c v j ~ ( s ~ f u I g o r ~ respIenderet fumine. (YO? I,xi,col190SC).
long portrait physique et m o d du saint. le n'm rrtnlnsrrirai que la premik section, qui
traite plus ou m o b directemat du corps :
&at m e d i d in eo statura. Vvdlur ippIenus audotitd etprohioe ; mansuetis hilmis et b l e , superbis wro ef of fem, ut vik Mem- posset, terribilis. Macie vulidirs, pdlorr om&m, am&& decofof~~~~ Ocdi iuiw vduri quodam sptendore frJgCnjCC, inhrentih el tmuri e r a et adhirationi, Iacrymi;s assidhi, quia suepius
- &at virtw comptartioni;s. Retinebat e t i m iit Qsius motq gestu, incesm speck audodW&, pond- grovilodtr franqui~fiittikisque vestigrgrum Ocwstcs illius quasi q u i b gratkimcre jucundird radius, et i d l t u e delectationis eventus. Vax i2'i virilir, et &a plena decwis, ut mentes &entiurn+ non mediocriter demulceret dukedine mochrfationis* Senno illius p2enu.r suavitotis et gratiae, prout ratio causanmt se hubebat, medie temperatus ; nec modm progrediens loquendi, nec mimcspro t e m p e imprm*dirs dirserdi. NihiI h eoficatum, nihil Mectattuia ; sed
rnirabiliter reddebat eum corporis positione et ordine vitae quadrahrm ... v6' Dam ce tableau se retrouvent toutes les caract&istiques de la beaut6 eccICsiastique
&umhks p~cddemment, B savoir la luminosit6, la puissance et la blanched! Odilon avait
environ 33 ans lorsqu'il devint abW de Cluny ; comme son portrait est offert immddiatement
aprb le &it de son &don, on aurait pu s'attendre I ce qu'il nous le prisente ii cet 5ge-I&
Poutant, il den est rien. Odilon est sans ige ou, s'il faut absolument lui en associer un, ses
cheveux blancs le dCignent comme un homme 5g6.
Les etudes sur I'esthCtique m6di6vale affirment que les hommes du Moyen Age se
fondaient sur dew cri tbs pour ddfinir la beaut4 : la proportion et la lumi&re9. U. Eco
explique que I'esthCtisme bas6 sur la proportion en est un esthdtisme de quantite, tandis que
le second est un esth6tisme de qualit4 &vantage e i f i q u e a w h i t s mystiques ; iI montre
". VO? I,v,col,SO 1A-B. a. Ces diverses caractdristiques se rctrouvent tr& accentuees dam le portrait d'Odilon in st^ par Jotsaud
dam son Plmttcs (PO3 w-125-28,p.405) : .: Odilo vive, vPte, toto mihi cmrbr orbe lucidior vitro, jirlgenti clarior uuro, v u h cunspieuo, n h candente capillo. candidior cygno, mbeo formmior artroo .
*. Cf. par exemple W. TATARKIEWICZ, History of Aesthetia, ~01.11, 1970, p.30 et A. AERTSEN, a Beauty in the MiddIe Ages : A Forgotten Transcendental ? W, Medieval Philosophy & Theology, 1 (199 1) : 71 et 82.
dgdement comment ces deux e s t h h e s fiaent t6concili6s par les philosophes du Xme
sikle? Le cr&e de la proportion dtcouIait pzincipalernent de la pens& gtecQue classique
mais seretrouvaitaussidans Ie LivredelaSrrgesse, oihilcst CaitqueDieudisposadetoutes
choses sra Terre en prrnant en compte a ~~~a et numero etpondere J1 ; le second tirait
son originc de la philosophie n6o=platoniciicnne, principalernent des hits du Pseudo-
Aempagite, mais trouvait aussi un &ho dans la Biblen. Selon Ies tpoques, lles auteurs
auraient insid davantage sur I'm ou l'autre factem : ainsi, le WL sikle aurait davantage
par16 de l'harmonie et le Xm' siWe de la lumitren. L ' d y s e pdckdente laisse supposer
que l'ordre de Cluny attacha plus d'importance it ce dernier elhent ; mais il faudrait dtudier
d'autres productions clunisiennes, taut LittCraires qu'architecturales, pour psvvenir i m e
rkponse skrieusement fond&, prenant en compte 1'Cvolution qui s'inscrivit obligatoirement
au fil des sikles ; je laisserai ii d'autres le soin de mener cette ~cherchc'~.
La lecture des Vitae permet malgrti tout de formuler une hypothtse originale : il
semblerait que le discours esthetique ne changeait pas seulemcnt selon les auteurs ou les
sihles mais aussi d o n l'objet sur lequel il pottait Dam le cas d'un lac, I'auteur clunisien
m. U. ECO, Art andBecluty, 1986, p.43 et p.48. ". Sap- 11.21 ; cf, W- TATARKIEWICZ, Hkfoty ofAesrhetics, vol.II, 1970, p.7. ". Sur la conception du Beau selon Plotin, cf. W. TATARIUEWICZ, History ofAesthetr'cs, vol-I, 1970,
p.3 19sv., et selon Ie Pseudo-Denis l'ACropagite, cf, ibid, vol.II, 1970, p27sv. et U. KO, Art and Beptlzy, 1986, p. 18s~. Sur P importance de la lumikt dans la Torah, cf. Annand A B ~ ~ A S S I S , Lo lumt&e chnr b pemdkjuive, Park Bcrg Intanational, 1988 ct W. TATARKIEWICZ, Hktory ofAest&ics, vol.l.II, 1970, p.8. Le Nowenu Tesl~menl park en revanche uniquemcnt dc bcautk morale et non physique (cf. ibid, p. 12). ECO dunit en un seul chapitre sa discussion sur I'amour de la coulcur a cclle sur I'amour dc la lumi&rc par l'homme du Moycn Age, cmme s'il s'agkroit d'un d ct m h e thhne ; il a f k n e pourtant pue le premier K transmit des simples mortels aux penscurs, tandi que I t second fit surtout ddvclopp6 par Ics mystiques ct Ies philosophcs (AN curd Beau@. .., 1986, p.46).
Cf. E. de BRUYM, khr& d'esthktiqu e..., vol. IlT, 1946, p.9. Cct auteur donne plus loin dam son ounage plusieurs excmples de description de belles dam la pokie du bas Moyen Age, o l la luminositd joue un grand r6Ie (ibid, p . 1 4 ~ . ct vol.II, p.185~~). Est-il possible que les crit&res du Beau initialement r&ew€s B Dieu et & ses saints firrent ensuite adopt& pour d-e l'€m aim6 ?
". Sur l'importance du Pseudo-Denis pour k s Clunisicns, cf. t n a t autres D. IOGNA-PRAT, Agni irnmacuiati- R e c k h e s sur 1s sources hugiogruph i . relatives ti saint Muieui de Cfuw (954-994), Paris: kl. du C e 6 1988. p.13D-3 1.
Les divers hagiographes d'Odilon et Hugues Cvoquent avcc insistancc les activitb d'crnbellissement ct de construction de monastks cntreprises par Ics d e n hommes. k n'ai pas dCcCld dans ces passages une insistance particuli&e sur I'harrnonie au d€triment de la Iumith. Ainsi, lorsque Gilon dvoque les batiments de Marcigny tirig& par Hugues, il ddclare que ce dernier s necessarias~Ichre ordimit, omam fernplum decore congnro ut etiam exteriori cultu mla Dei resplenderet (VIP I,xii,p.62).
parlait surtout de la fonne du corps ; celle-ci etait quasi indissociable de l'tvocation de la
fonw et de la jeuuesse. Inver~emcnt, la vieillesse powait savir de symbole k laideur7? En
revanche, pour un individu spirituel @bitant du Ciel ou de la Ten& la l&&e constituait
le critke principal de sa beautt, prCc6daat de beaucoup en importance les proportions du
corps ct venant Wois de pair avec la puissance. L'Bge ne =trait pas en compte mais la
vieill& IxWficiait malgrt tout, cette fois-ci, de quelques atouts par rapport la jeunesse,
puisqu'elIe avait plus de chance d'&e puissante, que ses cheveux etaient blancs et que son
enveloppe charnelle paraissait aux yew des contemporains de plus en plus w e .
CONCLUSION
L'dtude de la perception et du eaitement clmisiens des jeunes &vde que les moines
portaient m e aussi grande vigilance au corps des iuuenes qu'i celui des enfants ; mais ici
s'adte la cornparaison. Tandis que le corps des petits eait l'objet de l'attention des fi2res
comme instrument d'dducation et objet potentiel de desk, le corps des jeunes btait perqu
comme un sujet actifqu'il fdait aautat que possible maitriser. Il etait en effet dangerew du
fait de ses caractCristiques intrinstques et non c o m e reflet de ce qu'y projetaient les moines
plus 5gCs L'autre WCrence entre le traitement des enfants et des jeunes est que les seconds
etaient pequs c o m e des Etres pensants, qu'il fallait convaincre par l'usage de la raison, et
non plus par Saction sur le corps'. A lire les Vitae, on a l'impression que le discours
'5. Dans la Vita Geraldi, Odon s'adnsse souvent awc lacs pour tcur reprocher lcurs vices. I1 cssaye cntre autrcs de les dCtouncr dc I'imgncric a rffnnant qu'elk entrahe une vieillesst prQlatudc (cf. YG' I, l3,coI.65 1C).
I. Nous avons vu que l a pueri Ctaient punis sur leurs corps, par le biais dcs jellnts a des coups de fouet. Les ticuerres sub c~~stodiiz semblent en revanche avoir MnCfici6 d'une mode de correction identique & celui de leun ainCa Bernard prdcise que la scule mani&rc pow la gardiens de les reprendre Ctait verbdement : = Cusroder non habent super aiios aliam drjciplim, nfii quodciamant emfortiter (Bern Ipviii,p.21 I). Un jeune fautif Ctait donc surtout corrigb par le biais de I'excommunication et du declassement. Les moines les jugeaient sufflsamment sensibles il leur rang dam la hierarchic monastique pour sou= lorsqu'ils en dtaient retranc hb.
hagiographicpe s'adresse en partie aux jeunes, pour les eduqua, leu fi&e dCnigrer leu
beautt, d a lcur sexualitt, contr6Iet les mowemeats de 1- corps ; en fhit, presque tout
ce qui caracttrisait le jeme dans la socittt Wque rn&iic!vale 6tait =jet& parce que jug6
iaacceprable par le m o w Boa le titre de ce chapi- st^ la difEicult6 &&re itmenis dans un
cadre clunisia. Cette volonte didactique des auteurs explique certainanent le caractk un
peutrop comtr& presqueartificiel, du discours eccl&hstique sur la sexuali~, m h e Mque,
et sur la beaut& A props de cette dernib, les moines n'ignoraient ni d6taient tout A fait
insensibles au "Beau IaYqueu, o& jemesse et proportions du corps jouaient un r6le central ;
pourtant, 1- t h i t s *tent am lecteurs un ideal estb6tique tout autre, fitit de 1umhosit6
et de blanchem, of^ l'ae est sans importance. L'doge du jeune et beau corps tmwe rarement
sa place dam l'hagiographie clunkienne.
Ce schema n'Ctait peut- pas qdcifique au milieu monastique. Le @re de Pdtrarque usa d'une egle assez sirnilaim pour comger ses enfants : des coups jusqu'h I'Qe de quatorze ans (ou la puberte), puis l'usage de la seuIe parole ensuite (cf. James D. FOLTS, a Senescence and Renascence : Petrarch's Thoughts on Growing Old m, Journal of Medieval and Renaasance Studies, 10 (1980): 23 1).
CHAPITRE v GLOIRE ET MISERE DU SElVEX
La vieinesse, plus que les deux autres Hges de la vie, a un statut dichotomique pour
le Clrmy du ~ o ~ e n Age central : elle symbolise B la fois la puissance et l'indigence. Elle est
ce petit vie= (uerulm) qui puait terriilernent et qu'Odon tamassa au coin d'un chemin pour
hider, mais eUe est aussi ce superbe saint Martin B la c r i n i h blanche qui apparut en r&e
ii ce m h e Odon et lui dicta sa conduite EUe occupe me partie du hut de l'dchelle sociale,
sous I'apparence de Dieu le P&re et des conseiuers des puissants (Dieu ou les seigneurs
terrestres), mak elle est aussi pdsente en sa section la plus basse, parmi ces mendiants qui
se pressent am portes du monast&e pour obtenir un quignon de pain ou ces moines trop
faibles, rel6gues ik l'hfherie.
La premik partie de ce chapitre analyse la relation unissant la vieillesse au powoir :
B travers diffkentes images rkurrentes de l'hagiographie clunisieme, il est possible
#explorer le theme mineur, mais non n6gligeable, de la vieillesse c o m e age du pouvoir.
La deuxihe montre comment les vieillards etaient frtquemment accus6s de conserver l e u
position tout en d6laissant leurs charges : une sorte de d6part A la retraite sur le plan mental
mais non physique. La d e x n i h d o n dvoque le traitement et le discours sur Ie view moine
retir6 de la vie active etlou proche de la mort. A c6t6 du portrait idyllique du saint mourant,
aim6 et choye, se profile me r&ditC beaucoup plus arn6re.
Si la bibliographic sur la vieillesse B l't5pcque mddikvale semble encore fort lacunaire,
n'ayant absolument pas l'ampleur de celle sur l'dance, elk s'est m a l e tout dguli&rement
enrichie depuis ces dix demi&es anndes. Comme pour le premier age, les questions posCes
par les chercheurs rendent avant tout aux interrogations actuelles ; je voudrais tgalement
montrer qu'elles ofient une image tr&s particue et presque exclusivement negative du
troisieme age. La majontt des themes trait& peuvent &re class& en trois grands ensembles :
l'histoire de la ghntologie, l'image de la vieillesse et la retraite. Gemntologie et g6riatrie
sont des termes d m c m e n t dans notre vocabulairr : pour ce qui est de la langue
firan- i datent nspectivemcnt de 1950 et 1915'. Mdg& tout, les mt5decins et, plus
ghblement, les auteurs du pas6 n'ont pas attendu Ie XXC SiMe pour st pencher sur les
besoins, maladies a traitements qui Merit JpCcifiques au d a n i a Qe. Quelcpes chercheurs
ont donc voulu analyser ces d i f f h t e s ~emar~ues CnoncCes au fil des s ih ld . Le =jet est
d'importance, mais il est significatif qu'une telle appmhe h s e surtout sugk des sikles
antCrieurs l'image de la dh5pitude et de la d6pendance du corps ige .
Le sujet qui a CerfaiLlement le plus intriguC les auteurs jusqu'8 ce jour ht de v6rifier
le bien-fond6 de la cmyance popdaire voulant que les personnes Sg&s etaient beaucoup
mieux trait& hier qu'aujourd'hui. L'ouvrage de Simone de Beawoir, La vieillesse, ou les
differents articles de Maria S. Haynes, &xi& d m les andes soixante pout The
Gerontologit, o m n t un bon exemple de cette tendance et de son parti pris4. Ainsi, de meme
que les historiens de l'enfance partent avec le tableau terrible tract5 par Philippe Ariks et
prouvent, sans tmp de difficultt, qu'une telle noirceur n'est pas de mise, les historiens de la
vieillwe partent d'une image d'GPin;rl et s'attachent B dunir des contre-exemples. Pour ce
faire, ils considhmt a tort que chaque remarque negative sur les mauvais vieillards qu'ils
rencontrent dam les sources s'applique B tous les homes du demier age, et ne se donnent
pas toujours la pine d'analyser le discours dam lequel ceUe-ci s'ins&re N ses prCsupposds5.
'. Dictionnaire hisrorique de b lmguefian@e, &it. AIah Rey, vol.1, Paris/MonW: Dictiomairrs Le Robert/DicoRobert, 1993, p.886 ct p.885. Gerontoiogy cst apparu en 1903 dam la langue anglaise (ibid, p.886).
'. La prerniw Ctude &importance sur cc thhe fut certainement ccllc de J.T. FREEMAN, Aging : Its History andLitwdwe, New YorldLondon: Human Sciences Prcss, 1979. Plus rkemmcnt, les deux premiers articles de rouvrage Aging d the Aged in Medieval Ewope (Cd M. Shcehan, (Papers in Mediaeval Studies, I 1) Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990) Ctaient consads B cc m&ne sujet : il s'agit de ma de L. DEMA~TRE, 8 The Care and Extension ofold Age in Mcdicval Medicine. @3-22) a 0. LEWRY,
Study of Aging in the Arts Faculty of the Universities of Paris and Oxford w (p.23-38). Pour d'autres rdferences, cE la bibliographic mr Ics bes .
Cf. Thomas R COLE, The Journqr of L+ - A Cultural History of Agi~g in America, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pxxi,
'. Simone DE BEAUVOIR, Lu vieillfesse, Paris Gallimard, 1970. s. Pour beaucoup de culnues et diverses Cpoques, le vicillard ttait pequ comme l'id6al du directeur
spirituel et du conseiller, si bien que Ies auteurs jugeaient souvent inutile d'dvoquer ce topos. Au contraire, dans Ieurs &its, il leur arrivait souvent de Ie sous-entendre pour le nuancer. Le lecteur modeme doit apprendre A
femme iig& bhCficiait d'me plus grade likrtc d'action que sa Cadette : elle pouvait par
I&-mCme &re plus puissante et donc, possiiIement, &vantage crainte et d&st6e7.
Detrxihemeat, les hommes d'&be n'applsciaient gutrt la fanmc @&, et cette pereption
p W a i t dans Icun rangs longtemps avant l'essor & la c b am sorcihs8. Le corpus trap
restreint des sources de cctte Wse ne me permet malheureusement pas d'61aborer sur ce
sujet.
La troisihe question que se po-t nombre d'historiens quant au traitement pass6
de la vieillesse conceme la retraite. Ces travaux ont montn5 qu'il existait des fonnes de
retraite bien avant l'instauration de pensions versdes am soldats ages ou handicap& de
I'Ancien R6gime? La forme la plus dpandue consistait dans I'abandon, partiel ou complet,
de ses activitk et de ses biens, I un tiers ; en &change, celui-ci devait prendre en charge la
personne && jusqul son dCck Ce tiers pouvait Ctre une institution hospitali&e ou
religieuse, un proche ou un parfat i n c o ~ u ' ~ . Le cas le plus Bquent demeurait md& tout
', Cf. tout spdcialement l'indressant article de LN. BREMMER, The Old Women of Ancient Greece m,
dam Sexual hymmez#y - Smdi'es in Amim Society, 6d. J. Blok et P. Mason, Amsterdam: J.C. Greben, 1987, p- 19 1-2 15. Pour l'dpque mediCvale, cf. par exernple El LE ROY LADURIE, Montaillou, vilfage uccitan de 1294 ci 1324, Paris: Gallimard, 1975, p.287sv. Le portrait qu'il trace de la femme &6e Montaillou ne s'explique pas uniquement par la proximitt5 de la M6ditemm& : cf. K. THOMASp Age and Authority in Early Modem England * (Raleigh Lecture on history, read I6 june 1976), Pmeeedings ofrhe Brithh Academy, 62 (1976): 35-36.
La Vita d'lde a l'gpitaphe d9AdClaYde dCnivtnt ca d t m femmes c o m e berucoup plus actives ct entreprenantcs aprts qu'clles fhcnt devtnues veuves.
g. Sur les images ndgatives dc la vieille fcmmt dan.c lcs sitcles immddiatement antfn'eurs B la chasse aux sorci ts , cutre sumr celles vChicultes par l'~glgliu, cf. J. AGRIMI et C. CRISCIANI, Savoir mddical et anthpologie rcligieuse. Lcs rcpr6sentations t t les fonctions de la vehrla (xmt-W sikle) a, Anmles ESC, 5 ( s e p t . e 1993): 1 2 8 9 ~ -
O. Cf, le chapitre IX du liwe dc J e a n - P i e GUITON? Naasance cfu vieil ld, intitulC Unt conquite du XVIIIe siWc : la retraite (Paris: Aubier, 1988, p. 1 85-2 19, surtout p. 193-208).
lo. Cd entre autres A. SAUNIER, 8 Une fin de vie : Jeanne la Grigttt l'hbpital du Saint-Esprit de Paris 1434 B, dans darrs Lesges & la v i i 1992, p269-87 ; D, ANGERS, Vieillir au XV' sikle : *rendus " a retrait& dam la dgion de Cam (1380-1500) m, Frawia, 16 (1989): 113-36 ; F. NEVEUX, * Fink ses jours B Bayeux A la fm du Moyca Age : ks conditions de vie des "rendus" dam les ttablkments d'assistance dc la villc aux XN' et X V siklcs m, dam Questions d'hktorie et rdk didectoiogie n o r n r d , Acts du 105 'Con@ national des sacidt& savantes (Caen 1980). Section de Philologie et d'biiirc jusqu'h 1610, t.2, Paris: Minist& de l'&ucation Nationale, 1984. p.151-69 ; E. CLARK, Some Aspects of Social Security in Medieval England m,
Journal of Fmily Hisrory, 7 (1982): 307-20 ; LM. BIENVENU, PaumtC, mistres et charit& en Anjou aux XIe et XIIe sikles W, Le M' Age, O. (1967): 8 ; S.R. BURSTEIN, a Care of the Aged in England : From Medieval T i e s to the End of the 16th Century B, Bulletin of the History ofMedecire, 22 (1948): 738-46.
celui du payJan laissant sa term B son fils h&itieru. Le mauvais traitement du #re, qui
powait alors s'ensuivre, a Ctt s t i m dam le dltbre fabiiau de la Houce pmrie (la
cowemre partag&)? La multiplication des actes notarit% h partir du XmC si&le permet de
suivre cette pratique depuis lots, jusqu'au XXe sitdc. Il est inutile de pdciser que, sur ce
poiat, les divergences gbgraphiqyes fment trb grandes, tout patticulihent entre le Nod
et le Sud de l'Empe : elles ne port&ent pas uni~uement sur PexiSfence ou la non-existence
de cette prasicpe, ni sur la date de la transmission des biens (soit au moment du mariage du
fils h&ier, soit beaucoup plus tad dans le temps), mais aussi sur I'ampleur du changement
de statut des parents ap& cet 6vt5nement Dam c e d e s r6gions, les personnes S g k s se
trouvhxxt reI6guh au bas de l'khelle hihnchique de la demewe f d a l e , pparfois meme
plus bas que les domestiques, dam d'autres, ils continuixent B garder la meillewe chambre,
leurs si&ges p& de la chemink et les places d'homeur table.
". Outre les articles ddjA cit& dans les notes pdcCdentes, cf. RM. SMITH, = The Manorial Court and the Elderly Tenant in Late Medieval England w, dans Lve, Death a d the Elder& in Historical Perspectiws, td M. Pelling and RM. Smith, London/New Yo& Routledge, 1991, p39-61, et Hidoire de la popula~ion jirnqaise, vol. I: Der origines b la Remitsance, par l. Dupiquier, LN. Binkn, R Btienne, C. et L. Pietri, H. Bautier, H. Dubois, A- Higounet-Nadal et C- Klapisch-Zuber, Paris: PUF, 1988, p.494-96. Pour 1'Angletetre des XVIe-XVIIC si&les, cf, les dfihnccs donndes par K. THOMAS, Age and Authority ... W, Proceedings of the Brilish A c a h y , 62 (1976): 236-37n. Pour uae *ode plus rdcente, cf. 1s di f f i i ts articles sur cc thtme publib dam Age Sbuctwing in Cornporatiue Perspective, &I. D.I. Kextzcr n KW. Shaie, Hilldale (NJ)/Hove/London: Lawrence Erlbaum Ass., 1989.
U. Cf, A. de MONTAIGLON et G. RAYNAUD, Recueil g W 4 f et compfet des fabtiata des ATIF et H'P sikcfes imprinrpls ou inhdirJ, voU, Park Librain'c des Bibliophiics, 1872, p.88-95. I! s'agit dc I'histoh du vieil homme qui accepta de lCgucr de son vivant tous ses bias Q son fib pour permettre i celui-ci de faire un tr&s bon matiage. U devint pcu par une charge intolCrable pour sa belle-fille, jusqu'i cc qu'elle convainquit son mari de le chasser dc la demeure muni d'une simple couvcrturc. LC petit-fils, qui wait CtC cherchd la dite couverturc, la coup en deux a den donna que la moitie i son grand-pke. Intcm,gC sur la raison de son geste, il dpondit qu'il gardait I'autrc moitid pour son p h , quand celui-ci serait son tour tds agC. Pour une version plus cruelle de cctw mCme anecdote (oil k grand-@re dCcWe), c t K THOMAS, Age and Autho rity... m,
Proceedings of the Britirh Acuakqy, 62 (1976): 238. Pour une version nordique oir la couverturc fit remplade par une Iugc, cf. A. PLAKANS, 8 Stepping Down in Former Ties : A Comparative Assessment of "Retirement" in Traditionnal Europe n, dam Age Structuring in Comparative Perspective, Cd. D.I. Kertzer et K.W. Shaie, Hillsdale (NJYHovdLondon: Lawrence Erlbaum Ass., 1989, p.178. Dam tous les cas de figure, tes trois gdn&atl*ons masculines sont en pdsace au moment de I'Mction du grand-+re, et le petit-fils apprend a son ptre qu'il fera de meme avec lui. En revanche, il n'est pas toujours tr& clair si l'enfant use de cette menace pour garder avec Iui son grand-ptre, ou s'il exprime navcment son cruel projet.
Le sujet de la rebah est d'uu tr& grand in- mais il est capital de garder it l'esprit
que la vieillesse des sicles pas& ne peut se dsumer B ce thQneU. NOW ne conuaissons pas
les pourcentages, mais tds ccrtainement la grande majorit6 des hommes ads d'autrefois ne
choisirent pas de fink leur existence de la so* : soit i#lt choix, soit par obligation, jmrce
qu'ils ttaient ttop pawrrs, ils continubmt l e m activitb jusqu'au seuil de la mod4. T&s
probablement, a m le grand &e, l eu mdement diminuait et c'est dans un tel contnde qu'il
faut cumprendre, pour le milieu clmhien, les nombreuses complaintes des Virre clunisimaes
con- ces vieillads s'entoumt de confort et s'adonnant i Sopus Dei avec un entrain bien
rehidi, Mid@ tout, ni ces critiques ni la pratique de la retraite ne doivent f&e perdre de
w e l'image plutgt positive de la vieillesse qui se degage de l'dtude des sources
eccl~siastiques du Moyen Age central. Pour comprendre comment les'hommes d'~glise
percevaient ii cette m e la senectus, il hut garder en mdmoire qu'ils faisaient commencer
cet age dk 50 ans : la senecfus ne designait donc pas uniquement les ann6es de ddckpitude
et d'abandon, mais aussi les andes les plus glorieuses. C'est l'ambivalence de cette image
du dernier ige que je vais essayer de dessiner en ce demier chapitre.
A. POWOXR ET PI&- : L'AVANTAGE SYMBOLIQUE DE LA VIEILLESSE
Dam son celebre owrage sur La civilisation de I 'Occident mPdiival, dam lequel il
fait des g~n&abtions un peu Mtives sur les figes de la vie, Jacques Le Goff declare a
propos de la classe des vieillards que celle-ci
13. Pour un cxemple d'ttudc ob la vicillcssc cst dtfinie en fonction dc la remite, mtme si l'auteure adrnet que les retrait& &ient rarcs au Moyen Age, d Shukmirh SHAHAR, a Who were OId in the Middk Ages ? m,
Socid Hi310ty of Medecine, 6 (1 993): 3 13-4 1. 14. Cf, le &it des dernibs a n n h de vie du marchand de Prato, Datini, que sa femme et d'autres proches
encourageaient B se retkr des affaires, pour se rapprocher de Dieu ou simplement mener une existence plus sereine, mais qui ne s'y dsolut jarnais vraiment (Iris ORIGO, The Merchant of Prato, (Bedford historical series, 16) London: Jonathan Cape, 1960 (1957), p325-4 1 (chapitre IX, "Ihe Last Yearsn).
n9[a] pas jout de 161e important dans la CMtient6 m&ii&aIe9 socitt6 de gens qui mewent jeuncs, de gucniers ct de paysans qui ne vaknt qu'h l'&poque de leur plebe force physip7 de clercs dirig6s par des Cv@ues et des papes qui, abstraction fate des scandalem adolescents du X sikk [...I sont sowent elus jeunw [...I .
au ~ o ~ e n Age, il uciste me autre voie de recherche, que je n'ai pas p&t& ci-dem du
f i t du petit nombre d'historiens qui Pont emprunttk jusqu'alod, et qui consiste &tudier
l'fige des hommes au powoir. La socidt6 rn6dZvale fbt-eIIe &lIement domink par des
hommes jeuaes ? La premi6re @me qui vient awc 16vres est oui car, c o m e pour J. Le
Goff, surgissent en memoire les &es relativement bas des rois, empereurs, seigneurs,
Mques et m h e abbes quand ils k n t nornmk Pourtant, il serait enon6 d'imaginer que
I'exercice du pouvoir se iimitait il ces seuls personnages dans 1'Europe rnciditivale.
J't5voquerai tr&s rapidement la question du gouvernement laque, avant de traiter du monde
L'ige d'un seigneur au moment de son ascension au pouvoir dipendait d'un facteur
incontr6lable et impr6visible, B savoir la disparition de son @re. De ce fait, quelques
puissants lalques acquirent lens titres et la puissance seulement dam la quamntaine3 , rnais
un bien plus grand nombre itaient encore tout jeunes lors de cet 6vdnement. Faut-il en
conclure que l'homme medi6val associait automatiquement jemesse et pouvoir ? En rMit6,
le mode de gowemement A I'Cpoque m&l%vale n'dtait pas absolutiste : tout puissant devait
pour rkgner s'appuyet sur les conseils de ses familiers. Aussi, pour viritablement savoir
quels iiges le Moyen h e associait au powair, il est ndcessain d'observer le groupe des
cowillen des seigneurs. Semblable 6tude est d'autant plus significative que, dans leur cas,
I . J. LE GOFF, La civiIisation de I 'Ucci&nt midikvaf, Paris: Arthaud, 1984 (1977), p352. J.-P. BOIS reprend ces affmations dans Histoire de la vieillesse (eue sais-je ? no 2850) Paris: PUF, 1994, p32.
2. Le rapport de Page a du pouvoir est en revanche un des principaux thtmes trajtk par les antbropologuts, cf. D.I. KERTZER, a Age Structwing in Comparative and Historical Perspective m, dans Age Structuring in Comparative Perspective, dd. D.I. Kertzer ct KW. Schaie, HillsdaIe (NJ): Erlbaum Ass., 1989, p.7.
'. Cf. par exexnple Jane Katherine BEITSCHER, The Aged in Medieval Limousin m, Proceedings of the [Fourth] A n d Meeting of the Warem Society for French HIjtory, €d, Joyce Duncan Falk, Santa Barbara (Ca): Western Society for French History, 1977, p.45-52.
le f'acteur al&oire du d&s du p&e entrait beaucoup moins en ligne de compte : on peut
donc considha qu'ils Went damntage choisis en conford6 avec I'idhl medi6val du bon
gowanant. Pour ce qui est du haut Moyen h e , m e en- sm l'iige des conseillers est
impraticable, fBute de sources, aussi bien en ce qui conceme I'identit6 des conseilIas que
leur date de x&sance4 ; aussi les que1ques recherches sur ce t h h e ont-elles jusqu'h prCsent
pod cxc~usivement sur la fin du ~ o y e n Age. Le premier A ma comaissauce ii s 9 b laace
dans me semblable etude est B e d Guenb, dans tm article intitule a L'ilge des personnes
authentiques : cew qui comptent dans la s o c i W m6di6vale sont-3s jeunes ou vieux ? 2
Apres avoir trait6 de la ddmographie et d6montd que la socidt6 m6di6vale comptait des
hommes 6gCs - qu'elle n'Wt donc pas me socittd compos6e exclusivement de jeunes - et apds avoir soulign6 la difficult6 de connaratre 1'Hge exact des individus de l'epoque,
compte tenu du d6sintMt port6 a l'iige chronologique avant le XVe si&cle, ce chercheur
&die l'iige de trois ensembles de personaages : les membres de l'ambassade de France
envoy& aup& du Pape Benoit XIII en 1395, les chevaliers d6c6db i Azincourt en 1415 et
enfin quarante historiens des Xme-XVe si6cles. I1 conclut que les hommes de confiance du
pouvoir lsque 6taient surtout des quadragCnaires6 et que ceux qui daient sur les champs de
'. B. GUEN&, a L'gge des personnes authentiques; ceux qui comptent dsns la societt mCdiCvale sont-ils jeunes ou vieux ? w, dam Praropogruphie et Gm&e & I'Etat modeme, A~ctes de la table ronde organis& par le CNRS et I'ENS de jeunes filles, Paris, 22-23 oct- 1984, &do Francoise Autrand, (Collection de 1'ENS de jeunes fills, 30) Paris: &ole Normak SupClieuce de jeuna filla, 1986, pZ5-58.
'. B. GOENEE, . L'@ d e ~ perso~~~e~... m, op.cf~, 1986, p.249-79. 6. B~isab*h MORNET constate que la nobles danois, qui enadimt au Rl'grd pour pdciper au
gowememeat du royaume, avaicnt esscntieUemcnt cntre 35 a 45 am ; mais leur maintien au pouvoir sur de longues a n n b faisait en sorte que cettc institution Ctait habituellernent cntre 1s mains des conseillers "de longue daten W. Encore plus importante est sa hmarque que les changemcnts de ttgne ne s'accompagnaient pas d'une refonte de ce groupe (8 Age et -air dims la noblesse danoisc (vcrs 1360-w~~ 1570) w, Jmtlull d s Sawartls, jam.-juin 1988, p. 1 4 3 4 ct p. 152-53).
Dans son article a La force de PPge : jeunas et vieillerse au service de l'ftat en France aux XIVe et XVe si6cIes (Comptes-redis & I 'Ac&ie des Irtscriptions et clks Beffa Lethes, 1985, p.206-23), Fran~oise AUTRAND v a t dtmontm que, m a l e la Wqucnce du lieu cornrnun sur la sup&iorit6 des view conxillers par rapport aux jeunes, les proches du mi deMient €trc dam la force de I'8geo Pourtant, clle ne mentiome que tr&s rarerncnt des quadragCnaitcs ; la grande majorit6 dcs conscillen dvoqub dtaicnt des hommcs de 50 ans et plus, et la question de la retraite ne sc posait vtaiment pour eux que lorsqu'ils dtaient devenus des septuagCnaites ct, swtout, des octog€nains.
A- HIGOUNET-NADAL remarque que Ics P6rigourdins entraient souvent t6t dans le corps consulaire, dts l'ige de la dewi&me majoritd, A savoir 25 ans. EIle conclut pourtant que @]a puissance, le rayonnement, I'action, ont dtt Ie lot de ceux qui vhrent longtemps . ; les hommes les plus influents fbrent ceux qui
bataille avaient aussi bien la vingtaine qye la chpntaine, mais que 60 ans constituait l'iige
habitue1 de !a retraite pour ce game d'activitk De telles limites correspondent ii ce que j'ai
appellt la "division Mque" dcs ages, qui cxistait l'tpoque romaine a reparut clans les
d6finitions des B p a r t k du We sitde, eatre autres dans Ies traductions des ouvrages
arabes : 40 ou 45 am marque la fin de la jeunesse (a donc, symboliqwment, l'entde de
plain-pied au pouvoir) et 60 ans, Ie Mut de la deaepitude (et donc, possi'blement, la fin des
activie) ; l'iige intermBcb'aire est appele soit l'iige moyen, soit la vieillesse. Pourtant si I'on
observe le ddrodement de l'existence dam le cas des penseurs - ici les historiens 6tudi&
par Guende -, les Limites chronoiogiques se ddplacent quelque peu :
Sauf exception, au meme iige [40 am], un intellectuel est encore en bouton. Et i'historien plus que les autres. La sagesse vient i 50 ans. Les grandes oeuvres sont le f i t de quinquag6naires, de sexagenaires, de septuagh.ires, meme d'octogdnaires. m7
On obtient diis Iors m e autre forme de division des @es oh 50 am, et w n plus 40, marque
la fin de la jeunesse8. Telle est prticis6ment la division "eccl~siastiquen des ages. Avait-elle
la moindre &lit6 en ce qui concemait la division du powoir au sein d'uw communautk ou,
plus largement, d'un ordre ?
atteignirent la soixantaine ou &vantage (pkigrreta ~ X I T et XT siikfes - hi& ak dhogrqhie hiclorique, Bordeaux: Feddration histonquc du Sud-Ouest, 1978, ~ 3 3 5 ) .
En mentionnant que le pouvoir dans l'hgleterre du XVIIe sikle etait aux mains des quadraghaires et des quinqyagdnaircs, K. THOMAS admet que cet &at dcs choses cst sirnilah cclui existant actutllement dam no= socikt, mais il souligne le g o u m qui sCpare scs d e w r b l i e : a [b]ut the great difference is that in the seventeenth century roughly halfthe population was under twenty, so that the ruling elite was selected fiom a pmportioaatcly much smaller segment m (S Age and Authority .., *, Pruceeedings of the Brirish Academy, 62 (1976): 212). '- B. L'5ge des pcrsames... m, op-cir, 1984, p.276. Cd!c variabilite de l'Pge qui cst auocid au
plein Cpanouissemcnt n'a en v M rim de tc4s enxptionnct En dtudiant les rep&entations des @es de la vie humaine au X W siMe, Alain CHARRAUD remarquait que, si le dessinateur mettait I'accent sur l*inte@tation physiologique du cycle de vie, Ie s o m e t &it attcint vcrs 40 ans ou moins, sur I'intcrprCtation sociale, SO ans, sur l'interpnitation intellectuelle (morale), aprts 50 ans (a Analysc de la repdsentations des gges de la vie humaine dam les estampes populaires W, Ethnofogiefianqaise, I (1971): 6 1). '. B. GENT% Cvoqua l'existence de as dew formcr de division des Sges dam les remarques qu'il foxmula
i la suite de la communication de F. AUTRAND, La force de I'iige ... n, Comptes-rendus de l 'Acadimie des Inscrrjltiom et des Belles Leftres, 1985, p.22 1.
Les rn&iMsks nc se sont presque jamais pod la question, s ' d t a n t trop sowent,
c o m e je L'ai deja dit dam k chapitre IT, au personnage de 1'abW. Ce choix s'expiique en
pastie par b mamp de sources. Qumd Paulette L'Hennite-Leclercq Ctudia la communad
du pried provend de la CeUe entre fe XIe a k XVF sikle, efle put constater que,
exception f~te pour le poste de prieure, les autres fonctions cent remplies sur la base du
seul cri- de l'ancieanat : par condquent, les SOMS les plus @tes les occupaient ; il
n7&ait poutant pas possible de pdciser leur Bge? La seule Ctudt & ma connaissance prenant
en compte Ie Meur de L'tige est celle d'Anne GiImouf-Bryson, ii partir des d6positions faites
entre 1307 et 13 11 ii tra.vers I'Empe, pour le p W des Templiers. 11 semblerait que I'tige
allait de pair avec le pouvou, m h e si I'inverse n76tait pas vrai : autrement dit, les hommes
Sg6s dtaient habituellement puissants mais tous les postes d'importance ne leur 6taient pas
r6sem6d0,
Si d'autre part, on s'inthzsse au discours eccldsiastique sut le rapport en= le pouvoir
et l'iige - non pas dam les sources normatives, comrne je l'ai fait au chapitre II avec les
dgles et couturniea, mais dam les autres &its de 1'~glise medi6vale -, on observe qu'il
existait dew positions diamCtralement oppos6es : certains, comme B6det1, afikn&rent que
9. Une fois en* au monasttre a professe, la nonne prend rang, comme I'expriment de facon visible les tr&s nombrcuses listcs qu'elles ont fait dresser, dam un ordre hidrarchiquc pratiquement impeccabte. Les religieuses s'dltvent cn effct I'anciennct6 jusqu'8 la dignitd de pricurc exclue I...]. Les offices semblent k pivikge de lV&, de l'cxpCtl*ence. G.] A cdtt des officiba et qui den f d pas fotccment partit, k cowil . du monast&c dont on ne sait s'il est permanent ou non, f ix ou non, iI sc m t e toujours parmi tes anciennes mais pcnnct peut4tre ii la prime de fkh sortir du rang avant son t a p s une rtligieusc qui ddsire s'cmploycr activemcnt am a£hires du monasttte et qui en a les qualitCs. rn (P. L ' W - L E C L E R C Q , Le monuchkme flminin dom ha smia l son rompr -Le monurtk de Lu GdZe @&&but mt X W siede), Paris: &I. Cujas, 1989, ~217-I 8). '9 On nc pcut que delorer le caraahe t& vague de la dponse dorm& par cette chcrchcurt, I1 semblerait
qu'elle n'ait port6 attention qu'aw 60 am et plus, h savoir 32 Mm, 7 pdtres ct 5 chevaliers : Looking at status and position within the Order assists us to know whether or not the Order valued older,
experienced members. Only one knight known or estimated to be over 59 is not apeceptor (head of a house) or higher withiin the hierarchy. One knight's testimony includes no indication of status whatever. Many older sewing brothers also served as heads of houses, ninetccn of them in fict. r (A. GILMOUR- BRY SON, a Age-Related Data fiom the Templar Trials a, dam Aging and the Aged in MediwaI Europe, td- Michael M. Sheehan, (Papers in Mediaeval Studies, 11) Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990, p.142). ". Bhde, De temporibus fiber, ed. C.W. Jones, Opera Bedoe, vol.VV3, (CCSL l2X) Turnhout: Brepols,
1980, cxvi,p.60 I.
la iuuentus Ctait I'&e le plus apte & gouvana ; d'at&esy comme Jacques de Varagine12,
dtclarkent au conmire que seuls les antiCipi et s e w m&taient d'exercer le powoir. Qu'en
Hait-il & Cluny ?
Dans cette section, j'ttudie le discom sur le lien entre le pouvoir et l'Hge dans les
Vitae, a non la distribution reelte du pouvoir B Cluny. Une telle d y s e serait en effet
impossible & mener car nous ne conaaissons pas les iges ni les andes de fonction d'un
nombre suffisant de moines clunisiens du Moyen Age central. Il existe certes un poste pour
leque1 il subsiste beaucoup d'idonnations sur ceux qui l'occuphent, 1 savoir celui de I'abb6,
mais, comme je l'ai d6jh souligd plus but, il s'agit d'un cas trb particulier, non
repr6sentatifde l'ensemble de la communaut6. A f'exception de Pierre le V&kable et des
dew ab& sur lesquels nous ne savons rien (Aymard et Hugues II), l'abbc de Cluny n'etait
jarnais un oblat du lieu, mais un ancien clerc Seculier, choisi selon des criteres qui temoignent
de son caractke d'"6trangetny B savoir ses liens politiqua dans le SieCIe et sa solide education
acquise dans me &ole urbainet3. I ne faut donc absolument pas juger de la structure
hi&rarchique clunisienne en fonction de ce sup&ie~r'~. Pour appdhender autrement le mode
*. Iacopo da Varagine, C r o ~ c a &la cittti di Genow &fle origin' al1297, intro., bad, et notes, Stefania Bertini Guidetti, Genova: EGIG, 1995, p.404. Pow d'autrcs exemples, moins tardifs, cf, la conclusion du chapitre I.
13. Tcl n'est pas, bicn entmdq le discours tenu par les hagiographcs clunisicas : ii les lii, un firm abM est toujours choisi pow son cxceptionnelle saintetC ; de plus, son choix comme htur abbC est tds tardif, ghtralcmcnt au moment de sa nominatioalCleaion, a non pas avant m€me son c a w dam la communaut~. Malgrt5 tout, la similitude de parcours des divers ab& de Cluny laisse pcu de place au doute. Par ailleurs, OdiIon montre bien comment M a u l fin r q u B Cluny &ns le but d'en devenir uttdricurcmcnt le supdricur (VW coL949B). Cct autcur oublie pourtant avoir fourni une semblable infomation lorsqu'il taconte I'tlection de Mareul un peu plus loin dam son &it I1 utl l i i alors les topoi les phs usuels de I'hagiographie : les fi&es fireat unanimes pour appuycr la proposition d'Aymard de nommct Malcul, tandis que ce dcmicr essayait vainement de refirset @id, co1.951A). Sur le "ritue! du refirs", cf. l'article, un peu trop confiant mon avis, de Y. CONGAR, a Ordinations "invitus* s o a w n de l'kg1ise antique au canon 214 m, Revue des sciences philosophr'ques et thtfologiques, SO (1966): 169-97.
Aux d i m des hagiographes de Hugucs, ccluiui n ' M pas un clcrc stculier avant d'entrer A CIuny en 1039. Pourtant, il avait pass6 quelques temps aux cat& de son oncle rnatemd et homonyme Hugues de Ch%lons, M q u e d'Auxerre, jusqu'h la mort de celui-ci, en cette m€me a d 1039 (YIF I,iii,p.SO et V p I,&coL86 1 A).
''. Sur la divergence tr&s nette entre Ies crithes dictant le choix de I'abbesse et ceux dkidant de la repartition des pouvoin au sein d'un rnonasttre Mnddictin, cf, P. L'HERMITE-LECLERCQ, Le monachisme
de dpartition du powoir aux Cchelons inf6rieurs, nous ne possddons pour I'instant aucune
source fkble, hormis les coutumiers et les Vitae1% Ces taits do-t pas un instantan6 de
la vie clunisienne mais M portrait i&aW. Wgd to* a g d k I cette am&ristiique, il est
possible de &exminer selon quels p ~ c i p e s on jugeait qu'm moine &it digne d'occuper
des positions ~ e v b . Il reste ensuite B €valuer quel group d'tige paaiculier etait priviltgit
sur la base de ces principes.
L ' M e des coutumiers dam le chapitre II a mis en valeur le r6le plus ou moins direct
jou6 par l'iige dam la hiCrarchie monastique. ThCoriquement, ce facteur n'etait pas pris en
compte lorsqu'il Wait dkider qui devait occuper quel poste ; m a l e tout, l'anciennete etait
le principal critiire d'avancement, si bien qu'il est fort probable que les moines les plus
5g& - except6 les dkdpits dont je par1erai plus tard - se retrouvaient paani les plus haut
grad&, aux cMs d'autres plus jeuns. Les etudes de Paulette L'Hermite-Leclercq et d'Anne
Gilmour-Bryson temoignent qu'une telle supposition est certainement fondde. Les Vitae
permettent d'afber cette image car il est possible de discerner en ces sources lequel de ces
deux groupes d'iige se trouvant au sommet de I'khelle Ctait pequ comme plus apte B exercer
le pouvoir. Semblable analyse donne lieu de constater que la vieillesse avait un leger
avantage par rapport A la jeunesse, et cela pour deux raisons principales. Premierement, la
pers&6rance &it peque comrne un critere fondmental pour juger de la valeur d'un moine.
Par extension, il fdlait attendre que quelqu'un ait rempli sa tiiche sur un t d s long laps de
temps, si possible sur plusieurs d h n n i e s , pour powoi af'firmer s'il etait digne d'admiration.
Comme les e r e s percevaient a w i la longdvite comrne un signe de clemence divine, ces
deux factcurs se conjuguaient pour faire en sorte qu'un vieillard avait de bien plus grandes
chances #&re louC et dcoutk qu'un jeune. Deuxiemernent, et en partie pour les raisons sus-
fiminin .-., 1989, p.217-18 : celle-ci pricurc] gendralement Clue par le chapitre - cxceptionnellcment pourvue par bulle - Ctait
de haute naissance. Le prestige aristocratique du monasth, le souci pour les religieuses de s'assurer de solides appuis aupk des grands seigneurs provenpux, peut4trc I'ambition mtme de ces filles bien nCes qui, #instinct, les porte & commander, tout se combine pour bousculer ici le rang d'anciennete. Is, Ceci n'est vrai que dam la perspective qui cst la mieme, c'est-adire I'ktude des groupes d'age. Pour
etudier le rapport entre la rdpartition du pouvoir et la noblesse des moines, par exempie, il taut absolument avoir recours aux chartes.
dites, la VieiJlesse Ctait plldois prhntke wmme I'@e de d f h c e pour ~ ~ o r d a du powoir,
mesurer la saintet6 ou &lir la v&tk A l'inversey les auteurs estimaient A i'occasion
dcessak de se j d e r loffqu'ils louaient un iuuenip.
* Les moines paeevaient la longue dude comme un factem essentiel pour juger de la
valeuf d'm individu, tout speckdement dam le cadre d'un monasttre. Mdgd la parabole
biblique des ouvriers de la vigne (Math 20.1 -l6), souvent rencontnk dans 1'Annexe C16, Ie
Wre assmi du salut etait celui qui avait filit prewe de constance sur de nombreuses amdes.
Dew raisons au mobs peuvent expliquer cette croyauce. Prernibment, les moines savaient
bien qu'une conversion pouvait Etre L'afFaire de quelques minutes : ce qui etait vraiment
difticile 1 leurs yeux etait de rester sous le fioc, pas de s'y mett~e". Dans la demi6re phrase
du prologue de sa RZgle, c'est4-dire dam l'un des moments les plus forts de cette oeuvre,
Benoit &tablit un paraU5le entre la Passion du Christ et le fait de pers6veter sous l'habit
Processu ueto conuersationis et fidei, dilatato corde inenarrabili dilectionis dulcedine mtntntur uia mandatomm Dei, ut ab ipsius numquam magisterio discedentes, in eiw docfrinarn mque ad muttem in monasteriio petseueranfes, passionibur Cl~rWper patien fiam pariic@enrur, ut et regno eiur mereamur esse consortes. ,
Semblable correspondance trahit toute I'importance attach& par les moines a la
pen6v6rance. A en croire d'ailleurs Adalbert de Voad, la peqtdtuite de la conversion du
16. Cf, cntre autres J&6me, Augustin et Isidore dans I'Annexe C. Voir aussi DMI,vii,p2, oh Pierre justifie les bienfaits d'une conversion admccu~endkrn.
17. A la toute fin de la r&gk de Ctgire d'Arles pour ks moines, donc en une section particulihement importante de son oeuvre, cet auteur tcrit :
Vestes enim secuImes deponere et religimar ahmere unitrs horae momentoposszunw; mores vero bonos iugiter retinere. vel contta male hlces vo fuptates secuIi hius, quamdiu vivimus, Christ0 udiutore Iaborare debem= qurb non qui inceperiit, sed QUI PERSEYERA YWUT USQUE IN FNEM, HIC SXL W S ERlX (S Ceusarii epicopi r e p f a monachorum, Sancti Caesarii Arelatemi3 Opera Omnia, dd- Germain Morin, Maredsous, t.11, 1942, p. 155)
Les mots en majuscule sont tin% de Matth. 1 0 3 . Benoit se base aussi sur cette citation biblique pour insister une nouvelle fois sur la nCcessit6 pour le moine de persCv€rer jusqu'g la fin (RB 7'36).
moine serait le s i p distinctifde son €tat". Deuxiemement, d o n la loi peut4tre un peu
fmstre du donnantdo~t, les moines clunisiens eonsidctaient que la joie 6teme11e devait
se mbitcr par le don d'm grand nombre d'amrCcs de sa propre vie. Un exemple de ce mode
de pens& est offirt dams le ddmonial d'entrCe ii Cluay. Les noweaux venus promettaient
de s'appliqper 8 suivle la Rhgle jusqu'l leur mort et 1'aW leur dpondait qu'ils obtiendraient
pour cela le salut €ternel :
illis @es nouveaux venus] vero obedientium se usque ad rnortem sentatwos promineenhnhh, FabW respondet : Domimcs sic in vobis quodpromittitis, perficiat, ut ad aeternam vitam pentenire meremini. r l9
Cette glorification de la pe&v&ance pemet de mieux comprendre pourquoi L'anciemet6
constitwit un c r i t k d'avancement t d s important au sein d'une communaut~ monastique :
Ie fsit qu'un individu ait vieilli sous L'habit le disignait cornme un bon moine, donc comme
une personne qui mditait d'etre promue clans la hi&archiieO. EUe explique dgalement
plusieurs t hhes hagiographiques qui, comme L'anciennetk, tendaient tous B rendre le vieux
moine plus crbdible que le jeune : je les passerai un B un en revue.
Les hagiographes se plaisent l mentiomer le grand nombre d'annges pendant
lesquelles tel individu saint a rempli me fonction d6termink. Ainsi Jean de Saleme aftirme
qu'Adhegrin mena trente andes durant une existence Crt5mitique? Gilon insiste sur le fait
que le prieur clausaal Adalmannus occupa presque quarante ans son paste? Pierre le
VCnhble souligne que presque vingt ans se sont ticod& entre la conversion de Matthieu
d'Albano et sa mort? Les auteurs clunisiens semblent particuiikement appr&ier t%oquer
la longueur du &gne de leurs abMs, bien que cette pdcision numkique n'apparaisse
vraiment qu'l partir du milieu du XIe sikle. Jotsaud et Pierre Damien mentionnent tous
Is. RB, Prol.,SO. Cf. A. de V O G ~ , RB, m. Commentaire dmrinal et spirituel, (SC 186) Pa&: a. du Cerf, 1977, p396 a ~ 3 9 4 ) .
19. Bern. IJCV,~. 16s. m- Seul un moine qui avait p 6 v M sur de nombreuses anndes avait le droit de passer fi I'etape ascetique
suivante, A savoir I'existence anachoretique (RB 1,3). 2! YO1 1,28,co1.55C. =. VHP I,iv,p.52. ". DM II,8,p. 1 10.
d e w a le second I dew reprises, pu'Odilon dirigea I'Ordre pendant 56 a@. Tous les
hagiographes de Hugues ont &oquC au mobs me fois le fhit qu'il dgna 60 ans sur Cluny?
Nalgod comge ks oublis de ses p&d&esseurs, tant pour la Vita Odonis quc pour la YIto
Maioli, et p k i s e qy'odon d&da 18 ans aprh son ordination, Mseul, 41 d.
l'exprtssion a urqw ad senectutem v. Odon de Cluny consid& que ce qui Ctait le plus
louable c h a G b u d est qu'il fit rest6 chaste usque ad senectuted? Pierre le Vkn&able
admire Turquilus, prieur de Marcigny, et Guillaume de Charlieu, prieur de Charlieu, pour
avoir poxti le joug monastique et avoir W pieux, depuis I'adolescentricrj jusqu'ii la vieillesse
(respectivement a usque ad ultimam senectutem et +re usque ad senectutem m23. La
pe&draflce du moine Gdmd dans les banes actions depuis sa prime jeunesse jusqu'l sa
presque ultime vieillesse (a a prima iuuentute ma ad iti imam usque senectutem fere m)
expliquerait, selon le neuvikme abb6 de Cluny, que le Ciel se f i t ddcid6 a Iui faire la griice
d'une vision B la fin de sa vie?
I1 existait malgrd tout un pendant nkgatifi ce type de discours pour l'homme fig6 :
on consid6rait en effet que, s'il avait choisi la voie du Mal plut6t que celle du Bien, il lui dtait
beaucoup plus malais6 de se convertir que pour un jeune. A propos de la grande ksistance
rencontr6e pa . Odon alors qu'il essayait de r6fomer un momstere, Jean de Saleme dklare
qu'il est difficile de mettre du neufdans du vieux : a Sed sicut idem Beatus Gregoriur dicit
d m m esse in mente veteri nova nterlttmi b? Il n'existait d'aUem pas de plus grave pdcheur
qu'un individu ayant persdvdd trZs longtemps dans son crime. Mdeul se gardait de fauter
pendant sa jeunesse car il savait qu'il ne pourrait se libdrer ellsuite de ses vices pendant sa
vieillesse? Pierre le Vdndrable raconte dam le DM la mort brutale d'un moine jute apds
VOi I,xiv,col9 12C et VOP co1.929A ct 9438, =. VIF II,viii,p.99, V P W,43,co1.8878, K P xxxiii,p.l39 et KW xl~i~p.60. 26. YO" S3,col. 1 O4D ct VM IV,44,co1.667B. n. VG' II,34,co1.689A-90A.
DM I,2 I ,p.63-64 et IIJ5,p. 143. ? DM I,8,pZ lo. VO' II1,7,~01.79-80. ", VM 1,5,p.188.
qu'a ait mis le feu A la grange d'une abbaye clunisienne. L'auteur expliqye ce dtcis, non pas
Prochcta est k c eius pertinatfa mull0 tempore, nec uIicuius shrdfo finiri potui~ quowque eo in malt3 inchaato, ilk qui rr#r'ngu& a m usque adfinem fortiter, congnmm tam chmb malisfinem impom1 d2
Indissociable de I'importance attach& par les moines i la longue dude est leur
discours positif sur le fait d'atteindre la vieillesse. A leurs yew, Dieu donne une longue vie
B ses bien-aim& et une mort subite et pdcoce au *herd). Deja pdsente dam la Bible,
cette image de la vieillesse comme signe de bienveillance divine dtait importante pour le
monde monastique du Moyen Age central. Quelques individus pouvaient mourir jeunes et
Etre tout de m h e pequs comme dignes de monter au Ciel, telle cette jeune me, que le
deuxibe abM de Cluny edeva en cachette B ses parents pour la fake entrer au couvent, ou
encore ce Iatro iuuenis, qui se convertit A la seule vue du sainfs ; pourtant il ne s'agit jamais
de personnages de premier plan dam les Vitae clunisiemes mais toujours de figures
secondaires. L'idk demtre ces &its est souvent qu'une vie prolong& aurait pu faire perdre
ii ces individus la chance de monter au Paradis? Il serait intdressant d'dargir une semblable
DM 1124,~. 140- ". Les sources hagiographiques clunisienncs ne contiennent qu'un nombre assez limit6 de miracles
"nCgatifsw domant lieu mort d'homme, c'est-&-dire des interventions divines oir le "mCchant" mewt pour punition dc ses fautcs ; malgd tout, il est clair que, dam I'imaginairc des moines clunisicns, les criminels dtaient habitutlkment punis par une fin brutale- A W i les torts du moine qui se dvolta contrc I'imposition du mode de vie clunisien en son monasttte entrainhcnt sa mort subite ; tous 1s hagiographes d'Odon se plurcnt i le rappeler (YO1 II,23,co1.74& VOa~0,p235 d VQ 47,coI.l02C-D). Le prieur Robert qui s'opposa au dt5veloppement du culte de Babolcin B Saint-Maur connut une fm tem%le (AB 6,p.l6 IA), etc. I1 est inutile de rasscrnblcr ici tous les cas de figure car ce Wrnc cst dCjP bim connu des chcrcheurs. Bien que ce qui est tem'ble pour Ie rnoine soit de mourir sans confcssion ni sacrement, un tel discom tend associer une mort jeune au Mal, a donc une mort un ilge avarice au Bicn-
". Pour la BbIe, cf Christian GNILKA, art Grcisenalter a, Rerrffexihnnfiir Anrike und Christentrrm, MT (1983): 1043-45 et M. GILBERT, Le grand @, vu par la Bible w, la vie spirihtelle, 147 (septsct. 1993): 478-79 ; pour la Ptres de l'&#se, cf. ibid, ~01.1061-62.
3s. VO' 1,36,co159-60 et II,2O,col.72B. 36. Telle est I'explication domde par Jean de SaIerne quand il raconte qu'Odon pria pour la mort de son
neveu encore dam les langes (YO1 II,16,col.70B). Telle fit aussi la consolation offene par Guillaume de VoIpiano i Robert le Pieux et sa femme h la mort de leur fils Hugues, en 1025 (YWxi,p284).
analyse l'awmble des Wae par les moines n o h du Moyen Age, afin de savoir
dans queue proportion ceux-ci encouraghmt (oq plut6t, ddcouragheat) les cultes port& A
des individus morts jeunes (avant 30 am). Pour les deders sikles du Moyen Age, h & 6
Vaucha a coastat6 que a u]'&ise mMc5vale n'a canonis6 aucun enfant ni m h e aucun
juvenis ; au niveau du culte local, les jeunes saints ou saintes sont en f&ble nombre, tant
demeure fort le pltjugt cl&d qui lie la grmitm monmr & la senectus
Le plaisii avec l q e l les hagiographes mentionnent L'8ge avmd du dkts de leurs
plus grands personnage9' et amoncent que tel saint &.it mod in bona senectzde ouplenur
dierum atteste qu'ils percevaient aisement la longevit6 c o m e un signe divin. Nalgod, qui
ne craint pas I'emphase, utilise les d e w formules quad il 6voque le decks de Mai:eul :
Plenzis itaque dierum et vitae gloriosus, Pater MajoIw, in senectute bonu deficiens,
dormivil in puce rJ9. Odilon diclare les miracles inutiles pour prouver la saintet6 d'un
individu ; pour timoigner de celle de Maeul, il aftirme, entre autres choses, qu'il quitta ce
monde "plein de jours" et om& de vertus? Raoul Glaber afFirme que Guillaume de Volpiano
mourut dam sa soixante-dixiiime annie41. Jotsaud ne peut s'emp6cher de souligner que la
soeur d'OdiIon, devenue abbesse, mourut centenaire : s'il mentionne ce fait dam la Vita de
son Sre, c'est qu'il y voit un heureux symbole4*. A props d'odilon, il d&ue qu'il m o m
iig6 de 87 am, information que n'oublia pas de rditirer Pierre Damien daas sa propre Vira du
". A. VAUCHEZ, La saintett! en Occident m u derniers siecler du Moyen Age d'aprPz ler prm& de canon&ation et la dmments hugiographiques, (Biblioth6ques des 4coIes fianwises d'Ath&ncs ct de Rome, 241) Rome: k o k fhnpise de Romh 1981, p.181.
'', On retrouve la meme tendance dans 1s &its des P&es du mrt, cf. J.T. WORTLEY, a Aging and the Desert Fathers : The Process Reversed m, dans Aging d the Aged in Medeval Europe, Cd. Michael M- Sheehan, (Papers in Medieval Studies, 1 1) Toronto: Pontifical fwtitute of Medieval Studies, 1990, p.66. Elle se maintient dans 1s Vitae dcs Chartrtux et des Cisterciens, cf. S. HASQUENOPH, La mort du rnoine au Moyen Age (X'-XIIC siklcr) m, CoNCikt., 53 (199 1) : 215-32.
19. V ' IV,43,667A-B, "'. VM co1.953B : 23 ne quir dlbitet de sanctitate ejw et &ria, discat ab eir pi eum visu et auditu naverunt qualiter virit,
qualiter d m i t et qua1iterpIem.s dierum, adomalu~ vhtibus ab hQC luce discesit, et cum cognmerit eum fdeiium attestatione same virhe, recte ddctlhd me&! eum procui dibio ad sanctorum omnium gloriam Chrato duce pervenkse. I, 'I, VWxiiii,p.298. ", VOj PraeJ,co1.900A.
said3. Eudes de Saint-Maw montre la sqtkioriti spirituelle de I'abbt Teuton sut ses deux
s u c c m ~ s en souligrmt qu'il swecut plus longtemps qu'eux, chacun de cnaci &ant mort
am dement ciaq ans de powo?? Hildebert adtinae qye Hugucs est mort dans la sancta
s e n e c d . Il serait facie de multiplier les exemples ; ils tdmoignent que, dam I'imagimk
clunisien, le vieillardpowrrir &re pa~u, dam ceaaiees conditions, comme un bien-aim6 de
Dieu.
Semblables dklarations - louange de la pedvbnce, Cloge des longs dgnes,
&vocation de la bonne vieillesse - sont autant &indices suggirant qu'un moine se privdant
de nombreuses a n n h de service devait pararatre plus ddible B ses M s qu'un autre moine
moins ancien. L'6tude qui va suivre, sur le discours portant spdcifiquement sur la relation
entre l'ige et le pouvoir, coafirme ce point, tout en indiquant que l'avantage des moines ads restait Limit&
11 est indCniable qu'a Cluny, des jeunes acqudraient des postes de respomabilitds ;
m a l e tout, ce pouvoir qui leu. etait accord6 pouvait Etre pequ par leu entourage comme
un powoir empruntk : il s'agissait du powoir des view diceme I un jeune pour des raisons
bien spdcifiques. Pour 6voquer la nomination de Hugues comme prieur de Cluny, Gilon
declare que, lui, le iuuenis, q u t la &he des vieillards (a Suscipit iuuenis senum negotia rM).
Hildebert reprend cette formule en la modifiant quelque peu, mais le sens reste identique :
a Srrscepir senm warn juvenis m4'.
Ce type de discours ne s'appliquait pas uniquement au th2me de la distribution des
tacbes au sein du monastke mais il etait aussi et surtout employd en relation avec la saintetC.
Or, ces dew sujets etaient t d s pmhes puisque, thbriquemenf la sup6riorit6 spirituelle etait
le premier critere a prendre en compte pour elever un moine dans la hi&archie monastique,
avant meme l'anciennet6. SpiritueUement, les vieux constituaient souvent l'aune h laquelle
les jeunes Went mesurCs. Pour donna un apequ du trk louable compartement d'Odon
apr& qu'il ait rejoint la communautd des chanoines de Saint-Martin de Tow, Jean de
Saleme d k k me p d k fois qu'il avait d- tow les vieillanis (a [vlidebutur ab
omnibus nrdils triuncuhs semnnprefre cuneos... *) et m e scconde fois qu'il avait sutpasd
ses ma'mes (8 Cwpit i~erea dl~nrmr cuneospraeire prwceptomm, et subsequentitan fieri
exemphn mu). L'Mateur ne wrwrva qu'une seuk de ces deux formdes, celle ofi le saint
est cornpar6 am senes : l'irnage devait hi sembler plus forte, mieux mettre en Cvidence la
grandeur du perso~age'~. Pierre le Vhdrable raconte que I'archev&que de Reims, Raoul le
Verd, s'6rnerveilla de la pitit6 de Matthieu d'Albaao parce qu'elle surpassait celle des
vieillards : ap& que Matthieu ait fait part h Raoul de son desk de quitter 1'~~Lise de Reims
de crainte d'avoir p8cM par sirnonie, [hlec episcopur a iuuene audiens, et innurneros sen-
ac decrepifos multa cnini deuotione eum exmperasse guudens, in lacrimas est resolutus mSo.
Ainsi, un jeune exceptiomel etait un jeune qui faisait mieux que les hommes ages, tout
c o m e nous avions not6 au chapitre III que I'enfant ideal etait partois pdsente comme un
puer-senex. La proposition implicite B I'arritre de ces images, proposition qui est beaucoup
trop sowent igaorie des chercheurs", est que les vieillards repr6sentaient la barre haute que
Ies autres Sges devaient s'efforcer d'atteindre et, si possible, de dipasser. Certes, les saints
6taient le seul vrai exempie ii imiter, mais Ies vieillards symbolisaient le cran immBdiatement
"* YO' I, 1 S,colS2A. 49, YOtab 13,p.218. 50. DM II,vi,p.lO6. Dans son Rythmus de sancto Hugone Abbate Cluniacenri, Piem le V&n&able affinne
au sujet de saint Hugues, apds qu'il fbt rentd il Cluny, qu'il &.it devenu teltement vertueux que mime les vieillarcis I'admiraicnt : Prmesm tempor& crescens virtutibar,/ ips& qpmi t mirand'ur senibus * (BiblKfum co1-4668)
Outre les exemples d&j& mentiom& dam I'introduction de ce chapitre, cf. a titre d'illustxation les remarques de J. LECLERCQ dam a Saint Bernard ct Ics jeunes m (Cofl-Cist., 30 (1968): 120-27). Dans cet article, J, Lcclercq propose un long extrait du De moribtcs et oflcio epiircopmm de Bernard de Clairvaux (PL 182,26,col.826), qu'il a traduit en 6anpis- En voici une partie signif'icative :
= nous voyons beaucoup de jeunes [iuniores] qui i'emportent en intelligence sur les vieillards [sem] : iIs se cornportent aussi bien que des anciens ; par l eu conduite meritante, ils devancent le temps : ce qui manque B leur age, ils le cornpensent par Ieur vertu, m.
J- Leclercq conclut sa longue citation en affirmant [o]n ne pouvait marquer plus de confiance dam la jeunesse (ibid, p.121) ! I1 me sernble pourtant hident que la toute premiere le~on ii tirer d'un tel passage n'est pas I'irnage positive de la jeunesse mais bien celle de la vieillesse-
inf&eur dam I'khelle de saintctc. Du fait de cette position, ils se trouvaient au-dessus des
non saints, c'est-&dire de I'&e majorit6 des moines plus jeunes.
D m le m h e ordre #id- un clunisien considtrait L'ee comme un fact^
d'importance pour &id= s'il lui Wt ou non p r h foi ii B individu, m h e s'il s'agissait
raremat de l'unique cri* pis en compd5. Ainsi, pour expli~uer pourquoi ce M le prieur
Adalmannus qui proposa Hugues comme abbe & la communautt! clunisieme, Hildebert
d6clare : a Adblrnmnus quicibon, mi religione simul et aetate q ' o r erat uuctoritus R? Gilon
explique au sujet d'un certain f%re Albero qu'il etait un a uir cmdore m o m et etate
cumpiinnrs J? Piem le VCnhble afkme qu'il aurait pu f k codiance I tel vieillard qu'il
rencontra lors d'un voyage en Espagne sur la seule base de sa matmirar etatis, de m grmMntas
morum, de ses chewwc blancs et de sa r6putationsS. La redondance des trois premiers critkes
est manifeste, si l'on tient compte du f3lit que grmitus est un terme d6signant a w i bien la
-. Cette attitude est a mettre en relation avec la pratique d'utiliser de pdf6rence de view temoins pour verifier la vtracitt des affiumations d'un individu en cour ; B. G&E va jusqu'a affirmer que Ies view h o m e s sont les a maitres du droit (m L'5ge des pemmes.., W, op-ci&, 1984, p277). Comme le remarque cet auteur, Iw cxemples sont tr&s nombreux, Cf par exemple L. BEVERLEY SMITE& R.oot5 of Age in Medieval Wales a, The Buffetin Bard of Celtr'c Studies, XXXVIU (1991): 14344, oir 15 des 18 temoins du proch 6voqu6 ont plus de 50 ans et les trois autres, Ia quarantaine, I1 s'agissait de ddmontrer que Ie jeune Roland Grufith avait be1 et bien 21 ans ; or, des thoins auraient tout aussi bien pu faire I'aKaire (cf. par exemple un autre procts du meme genre oh, cette fois-ci, on se contcnta d'intcrroger Ies bommes et Ics femmcs qui se prdsenthnt voloataircmmt, I--M. ROGER, L'enquete sur l'@e de Jean II d'Estoutcville (21-22 aodt 1397) m, Bulletin phi'lofogipe et historique @tlsqum& 1620) du Comitd des travuux hktoripes et scient~jkpes~ annPe I9 75, Paris: B bliotMque Nationale, 1977, p. 107).
User du substantifsemer en s'adrcssant h quclqu'un tquivalait h Iui domer un titre respameux. Pierre le V6nLrable dais un dc ses trait& & Pet- de Soncto Imnne (pcut4trc son sedtairc, Piem de Blois) en I'appeIant bonus et PQC@CU s- &ter etfdius P e m rn (Bib/-Cfun co1.965 ; sur I'identitd du destinataire du Contra ear quidimmt Chrism mquam se in Eumgdiis aperte Deum dimhe, 6: G. CONSTABLE, LPY, II, p334). De meme, une lettre dcstinde Piem de Poitiers etait adrcss& au a kcuksimur senex societatis nostroe prior rn (LPV I,p.3213p. 125 ; sur le destinatairc, cf. LPV D,p.l83 et p.332-33). Or, Ies auteurs au Moyen Age, en meme temps qu'ilr se rabaissaient autant que faire se pouvait, accentuaient dam leur adcase l'importance du personnage qui ils tcrivaient. L'emploi du terme senex en cette section du texte tdmoigne que ce substantif &it pequ comme une appellation laudative.
VHbi I,4,co1.862C. n. V f l Il,xvii,p.107. 55. Hic strenuitate finnosus, et secufaribtrs rebus abundanr, totam usque ad senlum fere uitam in seculo
dtait. L.. ] uidi hominem cui et efatis mafurtlas, et morum grauitas, et cunctonrnt atfesfufio, ipsaque niueu canicies,fidem inregram consfanfer prebere suadebanL W, DM I,miii,p.8 8.
premikre vieiIlesse, de 50 ii 70 d, que le comportement (escompte) des hommes de ce
grow $be . L'auteur de la Vita brator de afEme que celui-ci aimait bien le make
des m o d e s de Pavie du fait de la matwitas grauittafis suue? Nalgod, louant l'aspect de
MaTed, dklare : 8 In wltu ejw mama juctmditas, in incessu honesta gravitm
appurebat. t.? Inversement, UQ mamais vieilIard est pdsent6 comme une a n o d t 6 . Le
pr6chiin~ des Fads, qyi ne vodait pas cpe les lectiones M t e s par Eudes soient chantdes
en l'homeur de Babolein, etait un uir quidem L..] v e n e r d canicie, sed multoties in
Sanc&m Dei verba profirebut mogantiae d9.
Enfin I'iige peut aussi &re synonyme de raison et de sagesse. Le r6dacteur des
miracles de explique qu'un vieillard handicap6 (ueteranus contruc~), qui insistait
pour qu'on l'amhe aup& des reliques du saint, alors que sa famille et ses amis
d6sespdraient qu'il pet jam& guerir, avait raison de faire sa derna..de puisque la sagesse
appartient aux hommes &is (a ut in mtiquis est sopienria Hildebert affirme pour sa part
que le bon sens de Hugues d t ii mesure que son corps perdit de ses forces : Calefaciebat
eum vitgo sapentiae, quam beam senex velut David ampkxatus, nn coqore deficeret,
matwitate s e w et consilii praerogativa, sibimet eminebat. m6'
Ces divers discours sur le senex n'ont de sens que parce que l'hornme du Moyen Age
centnl n'associait que trh exceptiomellement Ie grand Qe t la sdnilitd mentale- I1 existe me
seule circonstance ob il est question assez fSquemment de la possibiit6 de perdre ses esprits,
il s'agit des demien instants : les auteurs aiment pdciser que les saints sont morts avec toute
leur raison. Pourtant la pate potentielle de celle-ci est A mettxe en relation avec l'agonie, non
le grand 5ge. Ainsi Odon pdcise que Ghud exposa ses demi5ns volontk et expira sain
#, Cf. dam le Tableau I : Augustini, Augustin" Isidorei, Alcuin, Raban Maur' et Lambert de Saint-Omer. -. V ' xx,col. l776A.
V8-f II,14,p660D. S9. MB 7,p.l6IB- @, LMM I,xiii,col,1793C. Cf. Christian GNILKA, art, 8 Greisendter n, Reallexikon fir Anfike und
Chrirrentum, Xn (1983): 105940. 61. VI,38,~01.883C. Hildekrt fait ici rCf6rence B L'etrange mdthode recommand6e au roi David par ses
sdteurs pour rkchauffer ses vieux mernbres : il lui fahi t donnir avec une jeune vierge (111 Reg. 1,1-4).
d'esprit et avec tome sa rn6moid2. En revanche, plus haut dans le &it, dois que I'auteur
bvoquait I'irnpact de la vieillesse sur le saint, il ne fit nulle mention, mike inditecte, de la
possibilitt d'un dblin de I'inteUigence. La phrase a Nimimm quiu tenitas camaIi;s newerat
emollire rigorem me& a fhit r6fhmce au maintien de son mode de vie &tique, m a l e
la perte de ses forces physiqyes, non B l'ttat de ses aptitudes intellectuelles. Dans cette
lignde, Syms trace un portrait particuIi&ement "idyllique" de l'agonie de MaSeeul :
= IIcl deo protegente, omnibus sui corpwis membnk i n t e e atque ilfibatis, preclam scilicet uiso puroque uudinc, suna memoria, sicut jkerat integer a corruptione carnis, nesciens labem niuei pudoris perwenit ad exrexrtum immortale adep- compendium. A f atribus an aliquid dderet interrogufus, respondit nihil se hubere molestie, sed omnia tranquilla ef quieta perspicere et uidere bona domini in terra uiuentium, *64
Un discours bien difftrent apparait en revanche sous la plume des deux derniers
hagiographes du saint, Nalgod et l'auteur de la Vita altera. Ceuxci deplacirent ce passage
de Syrus de tel sorte qu'il dkrivit, nonplus le d&& de Maeul, mais son ultime vieilles~e~~ :
Nalgod Vita alrera
a Licef fractior uetas viderefur in ill0 furtitdinem ntinuisse, sensus tamen corporei mira in eo integritate vigebant. Non caligavit ocuZus ejm, non auditus obsurduit, non manuurn vigor evanuit ; sed tofus integer sensu et animo, residuum vitae suae disciplinis coelestibw occupabat .
Neque siquidenr ocu20rtim eim caligauit acies, nec aurium cauernosae obsurduenmf camenrlae, nec memoria defecit, nec senrus vigor i'eus in eo refrricrf. Sicut enim vtkerat came incorrupt us, sic praestitit omnibus sensibus, vsque ad diem vltimm inuiofatus. Fatiscentis igitw corpmculli defictum non sentiebat, quam spes lucri specialis cotidie animabut & armabut. m
Ces deux textes &tent des 1120, alors que le nombre des vieillards dam I'ordre ttait
devenu une charge dsamrnent lourde pour que, quelques anukes plus tard, Pierre le
". Interim vero cunctu quae welfinerk c m a , vel remanentiurn necessitps poposchset, sono s e m et integra memoria disponit. m (VG' III,S9c01.692C) et r Cum vero quidam diceren~ quod jam discessisset, ille sensum adhuc retinens# oculos a m t , et hoc judicio nundurn se dIjcessksem rnomtravit. n (VG' IU,7,co1.694A).
VG1 IIIJroZ.,co1.689C. H. V ' III22,p.283-84. VM IV,43,p.666D et VM col. 1785A-B.
Vhbbie , d'une part, essays de limiter leur admission et, d'autre part, modifidt le rituel du
Chapitre pour ne pas trop les Mgm? La volontC de nombreux Ma de rnolait sous le f b c
clunisien et le vieillissement nature1 des innombrab1es recrues admises sous Hugues k n t
certainement B I'origine d'un accraissement du nombre des anciens dans les rangs des
fi&ed7. Pour cette raison, ies dew derniers hagiographes de avaient sous les yew
un bien plus large &entail des &verses formes de vieillesse que leur pn?decesseur Syrus,
lonque celui-ci e g e a sa Yira aux alentorns de I'an MiL On compmnd mieux alos pourquoi
ils ajouterent dans leurs portraits du dernier @e la perte possible de la raison6'. M a l e tout,
il ne faut pas p e r k de w e qu'un tel discours repdsente l'exception et non la &gle dam
l'hagiographie clunisienne : je n'ai rencontd qu'une seule autre ivocation de sdnilite
mentale, it savoir dans la Vita Hugonis par Gilon, qui est peu p& contemporaine des deux
Vitae MaiulL I1 est question d'un moine qui n'osait pas raconter me vision dont il avait
benificie de peur &Stre pris pour un delim send9 . Si le gitisme avait W pequ par les
Clunisiens des dkennies antt5rieures comme m e caract6ristique du grand gge, il est evident
qu'ils auraient pens6 souligaer son absence dam leur 6loge de saints vieillards, comme le
firent Nalgod et son contemporain pour Maieul. Or tel n'Ctait pas le cas. Moses 1- Finley s'est
kgalement etonn6 de la raretk des 6vocations de la sthilit6 mentale dam les sources
antiques70. Est-ce pace que, en ces deux epoques, l'Antiquitt5 et le Moyen Age central,
l'image du sage vieillard 6clipsait ceUe de l'homme gliteux, ou faut-il en conclure que les t&s
exceptionnels individus qui survivaient jusqu'ii un iige Ws avancd dtaient d'une
exceptiomelle robustesse, tant mentale que physique ? La dponse se trouve peutdtre dam
les dew propositions. Toujours est-il que cette perception de la vieillesse est radicalement
diff6rente de celle d'aujourd'hui, c o m e en tdmoigne la definition du Petit Robert de 1995,
66. Stat. 55,p.85 et 35,p.70. 67. Cf. KJ. CONANT, CZuny. Les dgfbes et la maison du chef d'orhe, Cambridge (Ma.)hfl4con: The
Medieval Academy of America5pr. Protat Frtrts, 1968, p. I 1 1. ". Les caractCristiques negatives de lem portraits de la vieillesse ne doivent pas etre exagt5des outre
mesure. Ces dew auteurs ont aussi ajoutt! la dm-ption initide de Syrus une louange de la blanche chevelure du saint (cf, chapitre N, section C).
*. vp IIJv,~. 104. 'O. Moses I. FlNLEY, a The Elderly in Classical Antiquity s, Ageing and Society, 414 (1 984): 406-07.
deji hroqutk au d m du premier chapitre7'. Ainsi que le remaquait TX. Hareven, le
vieillissement intellectuel (intellectual aging) n'est pas seulement un phhom6ne
physiologique mais tgalement -aln-
Cet a priori positifde quelques hagiographes envers les personnes @&s, tmt par
rapport Tautorit6 ou A la saint&, n'avait pas son pendant quaad il s'agissait de parler des
iuuenes, au contraire. Les citations pk6demment offies, oii les jeurres Ctaient cornpads
aux senes, en thoignent pour la saintete. Un autre exemple est don116 par Piem le
V&&abie, qui declare i p r o p d'un convers charcreux t&s pieux qu'il &tit a iuuenis etate,
set moribur genetosus, et u&e sand~2afeprouecIus wn. cette formule est i'exacte opposke
de celle renconMe prCctidemment, au sujet du pdchantre des Fossds : ceUe-ci disait que
I'homme &it "vieux, mais mauvais", tandis que celle-ll affirme que le chartreux etait
"'jeune, mais bod'. Inutile de souligner que cette distinction est fort significative.
L'etude des sources hagiographique atteste que l'attribution du powoir ii un individu
q W C d'adolescens ou de iuuenis ne suscitait parfois aucun commentaire, preuve qu'elle
powait ttre peque c o m e tout a fait normale et acceptable. Ainsi, Pierre le V&&able
evoque I'histoire d'un prieur iuuenis dam son De Miraculis, tan& qu'Eudes des Fossds
afinne que Bouchard rept homeurs, biens et position de conseiller auprks du roi des sa
jeunesse ; or, aucun de ces dew auteurs ne juge utile de faire de remarque, ni positive ni
negative, P ce D'autres passages tdmoignent pourtant d'une certaine m6fiance des
Clunisiens face 1 l'attribution de responsabilitis B des jeunes.
Lorsque Odon essaya de &former Fleury et que les moines du Lieu s'y oppostrent
avec violence, un jeune homme fbt pris c o m e interm6diaire. Jean de Saleme &it it son
"- Demib p4riode de la vie nonnale qui sucdde la ma- catactdride par un affiiblissement global des fonctions physiologiques et des facult& mentales et par des modificatioas atraphiques des tissus et des organes (Le Nouveuu Petit Robert, Paris/Mont&I: Dictionmires Robert/DicoRobert, 1995, ~2388) . 9 T K HAREVEN, Preface W, dans AgingdLi/e Cowse T1412sitiom - An Interdbc@Ihny Perspective,
dd- T K Hareven et KJ. Adams, New York: Guilford Prcss, 1982, pxv. n. DM II,xxviii,p. 152.
DM lIpcxiii,p. 164 et VB 1,p.S-
propos qu'il etait a itrrcents sed bonw indolis .'I. On retmuve ici encore la formule "jeune,
mais ., ". En racontant que G b u d hCrita du comte ii la mort de son pCre, Odon p k i s e :
Decentibrcs mdmrparentiblu nun dominio postestus omnis henire t , non ut solmt adoftxcenf~~, qul iirm~l#uu dominalEone sqwrbiunt. GeraIrhrs intumuit, nec incwpr~nn cord& modestim immutm't m.
Il accuse donc les udoIescentes de fib habitueIIement prewe de superbe lorsqu'ils
acquikent des respodiIit6s importantes Le deuxihe ddactew de la Yita Geraldi trouva
la remarque d'Odon sufbamment importante pour la consewer dans son oeuvre abdgCe?
aprk en avoir simplement chang6 qyelques tennes : a [...I' non, ut solent adolescentes,
inmatwa dominutione superbivit, nec humilittztem cordis dudurn conceptam demutavit. r76
Le thkne se retrouve dans la Vita Hugonis d'Hildebert, dont la particularit6 principale est
d'inoncer de nombreux lieux cornmuas. L'Mque du Mans afl'irme que Hugues iuuenis ne
ressentit aucun orgueil a la suite de sa nomination c o m e prieut de CIuny : a Juveni
siquidem expromotione non subrepsit elutio, non ordinhfervor intepuit r. I1 mentiome me
seconde fois l'absence de superbe chez Hugues, quand il ivocpe sa nomination B l'abbatiat ;
bien qu'il ne rappeIle pas sa jeunesse ii cette occasion, celle-ci etait sufEsamment connue
pour etre implicite : a Susceptis itaque pastoralibus excubiis. Dei s e w ex promotione
nullam trait insolentiam ... %
Cette accusation d'orgueil lam& contre les jeunes avait probablement pour objectif
de les convaincre de faire preuve d'un peu d'humilitk (l'inverse de l'orgueil) et d'icouter les
recommandations des (view) conseillers7! L'histoire de Roboam, que les moines
75. YO' III,8,col.8 I B. Le meme tMme est repris par l'abdviateur puis L'HumiIIimus, Y O u 32,p.237. '6. VG' I,vi,coI.645D [comgde par BN Iat. 15436, fo1.48: BN lat.53 15, fol.T, et BN lat. 1 1749, fol. 1227 ct
VGf 3,p394* ". VH ~ I,3 ,coL86tA ct V P - 1,4,co1.862D. Peut-&tm, par ccttc ~pdtition, Hildcbcrt cssayait-il de faire
indirectement la le~on B Pons dc Melgucil ? n. Cette critique con= les jcunes ne prmait pas uniquemcnt sa source dans la question de la distriiution
des pouvoirs, mais concernait aussi I ' m e . Dans un texte oh il traitc dcs moines qui quittent le monasth pour v h dans un ennitage, saint J&he sYinqui&te de l'orgueil (mperbia) que peut susciter un tel mode de vie et il associe Wcialement ce vice avec les iuuenes pratiquant l'anachodtisme. Ce texte avait encore beaucoup de succ&s au XIIe sikle ; cf, h ce propos J. LECLERCQ, Pierre le Vdn&able et I'ddmitisme clunisien I., dans Pehus Yenerabilk I 1 56-1956 - Studies a d T w commemorating the Eighth Centenary of his Death, t d . G. Constable et J. Kritzeck, Roma: Herder, 1956, p.105~~. Cette recommendation de Jer6rne rappelle celle de Benoit qui dernandait que L'Cnnite ne soit pas un individu enflammd par une ferveur novice
conmident fort bien pour la lire dgulikment dam le Liwe dm Rois (III Reg 12), illustre
parfatement ce qque les moines plus HgCs pouvaient aaindrr a essayaient d'empikher en cas
d'dection d'un tout jeune : le fils de Saiomon rejeta le conseil des anciens (senedseniores)
de son phe et basa sa politiqut sur un c o d de jeunes (a&lescentediuueenw) ; la
conclusion de I'histoire est, bien entendu, qu'il fit ainsi prewe d'une grimde betise et perdit
rapdement son powoir. La morale est qu'un jeune doit se laisser guider par les plus ages
d6jA en placem. Cene anecdote restait parfaitement &actualit& au Moyen Age, meme dans
un contexte monastique. Il s'agissait d'avoir une certaine emprise sur le nouvel 6lu :
l'accuser d'orgueil, le pire defaut pour I't!poquem, permettait de faire pression sur lui.
Ces quelques citations ont dome un aperqu du discours direct des Clunisiens sur la
teneur des Liens entre l'lge, d'une part, et le pouvoir et la saintete, d'autre part. Elles ont
confhC ce que les chapitres pnkddents avaient dejl laissd entendre, ti savoir que les moines
&&s possddaient des atouts non ndgligeables quand il s'agissait d'dvaluer la vdeur respective
des frkes. Pourtant, leur avance par rapport aux jeunes dam la distribution du powoir restait
somrne toute assez faible : en effet, les exemples qui ont W offerts ci-dessus constituent
l'integralitk des remarques trouv6es dam toutes les Vitae clunisiennes : c'est peu. Ce f ~ t
concorde bien avec ce que la lecture de la R&le de saint Benoit et des coutumiers nous avait
appris : le grand age d'un individu ne justifiait pas a Lui seul sa promotion sur 1'6chelle
hit5rarchique de la communaut6. A partir du moment oc un moine adoptait le comportement
(RB 43)- m. M h e si Pierre n'dtablit pas d ' i e m c n t de lien de cause B effet cntre la jeunesse de Pons et les erreurs
qu'il a cornmiser, il mentionnt sa jeuncs~ lors de son &don, pub Cvoque divers ddfautr de Pons qui sont tous habituellement l i b B cet h e . I1 Cvoquc sa versatilit6 (8 maifta mobilitate uel leuitate mimi w ) en le dtcrivant dabad modestc, pub mauvais abW, pub quittant son poste ct partant en Terrc Sainte, puis faisant demi-tow a detnrisant tout ; il parle de sa !id lorsqu'il le montre refisant de fake amende honorable devant le papc ; il le prbrnte enfin rcfunm ~Ccoutcr les conscils des homma saga lorsqu'il h i t au powou (= nuffis bononrm consilii3 adpiescendo *). Cf, DM II,xii,p. 1 17-20.
'O. Sur I'orgueil comme le pire pCchC pour 1- hommes du Moyen Age avant k XIF si&cIe, cf. Lester K. LITKE, Pride Goes before Avarice - Social Change and the Vices in Latin Christendom m, American Historical Review, 76/ I (1971): 1649. Sur le fait que le meme dCfaut f i t Ie vice Ie plus combattu par Odon de CIuny, cf. B. ROSENWJ3N et L.K. LITTLE, SociaI Meaning in the Monastic and Mendicant Spiritualities w, Past and Present, 63 (1974): 6.
des fitrrs Sgds a Wt p m e de gruuitus, qu'il eOt seulewnt 15 am ou bien &vantage,
il pouvait &e n o d & un poste de powoir. Dans tel contexte, ravantage des moines q~
6taient 6ges non setdement par leurs moMs mais aussi par les am& @our reprendre m e
expsion en usage aupds des hagiographes) restait mince. On ne put donc absolumcnt pas
& h e r qu'iI e x k i t un idtal ghntocratjque dam le Cltmy du ~ o ~ e n Age central, cornme
l'a fdt Keith Tomas pour TAngIeterre du XVII si&le% Mdgd tout, un certain @uilibre
devsit se f k e entre les deux gmupes d'@e desire= d'acqutrit la puissance. D'un &td, m e
esph lce de vie assez base favorisait les jeunes pour L'obtention du powoir. De l'autre, un
discours 16g&e!rnent ndgatifvis4-vis de telles attributions, une grande importance attachee
au facteur de l'anciennet6 et enfh L'idde que les vieillards devaient Etre choisis comrne
mod6la de vie permettaient a w plus 5g€s de garder une emprise certaine sur la gbkation
montante.
En conc1usion de cette premi&e section, je me propose d'avancer de nouvelles
hypoth&es sur les raisons qu'avaient les Clunisiens de se choisir de jeunes abbds pour les
diriger. ~tait-ce parce qu'ils privilkgiaient la jeunesse pat rapport i la vieuesse ? Ou ne
pourrait-on pas envisager de toutes autres explications ? Parce que les abMs devaient Etre
d'aussi haute naissance que le permettaient la renorn& et la richesse du monasttre, il &it
pref6rabIe de les prendre relativement jemesY avant qu'ils ne se voient amibuer d'autres
postes de powoir ailleurs dans 1'~glise~ un peu cornme ces jeunes filles nobles qu'on mariait
'I. K. THOMAS remarque que Ie pouvou at dam les mains dcs quadragCnaircs et des quinquagfnaires, mais que I'idtal cst celui d'une soci6td gdrontocratique : In early modem England the prevailing ideal was g e r ~ n t ~ c : the yowg were to w e and the old to rule rn (cf. Age and Authority ...w, Proceedings of the Britirh Academy, 62 (1976): 207). Le reste de I'articlc de Thomas prtsente wrc image trts sombre de la vieillesse mais il faut notcr qu'il ne ensuite prcsquc exclusivemcnt que dcs individus agds pauvrcs. B. G ~ E a auai conclu son article an la dimiiiution du pouvoir P h fin du Moyen Age en lffirmant que* si les quadraghaires Ctaknt le group qui contdlait lc pIus le pouvoir laTque, 1s hommes plus fig& dtaient m a l e tout privil&gi& dam le discours sur le pouvou car tout un chacun [savait bien] que la vieillesse eIle- mime, avant la stnilit&, est I'lge de la sagcsse ct de lyexp&icnce. Et le vieillard est, parmi les personnes authentiques, la penonne la plus authcntique, celle qui on peut Ie mieux se fier. w (a L'iige des personnes ... *, op.cit., 1 984, p.278).
aloft qu'elles dtaient encore i pine p- (m~roti;s mutan&). De plus, un jeune venu &it
certainement plus malltaMe qu'un homme d'exp&ience et les fikes pouvaient ainsi l'amener
adopter leur &&re de vim a non I'inverse. II se trouvait bien sowent d'aillem un
priew ou sous-prieau t& 4g6, dCj& sm place, qui permettait d e faire la transition en&
I'ancien gowemement et le noweau, en comeillant le nowel tlu. La passadion des powoirs
SOdon A Aymard, puis d'Aymard B hMeul, se fit sous le "dgne" du prieur Hildebrando ;
celle d'Odilon 2a Hugues se fit sous le "&pew d'Adalmannust3. Enfin, en choisissant un
jeune, Ies Clunisiens prenaient les mesures ntkessaires pour Mndficier de la stabilitt d'un
long gowemement
Nous avons observC que Ies hagiographes dtaient fie= d'insister sur la pen6v6raflce
de leurs h6ros sur Ie t 6 s long tenne et d'affirmer qu'ils avaient atteint un ige avanc6 au
moment de leur deck I1 existe pourtant un theme que peu d'entre eux oubliaient d'ajouter
lorsqu'ils traitaient des derniGres annh de leur saint, ii savoir Ie maintien exceptionnel chez
le vieillard d'une activitC inintenompue. Ce leitmotiv confirme deux sujets qui ont W
abord6s dans cette section, ii savoi le lien quelque peu privilkgie unissant la vieillesse au
pouvoir et la toute premitre importance accord& d la constance. Cette demGme -ation
se comprend aigment : dam l'imaginaire monastique du Moyen Age central, le bon moine
(mcluant le bon abbe5 etait celui dont on pouvait dire B la fin de sa vie qu'il avait dt6 capable
de se plier jour apriis jour, annde apds annCey dbcennie apds dtcennie, au meme rituel ; il
n'avait pas davantage le droit de s'en tcarter dam sa vieillesse que dam sa jeunesse. Le
premier point est peut4tre ii prime abord moins compdhensible. L'ampleur de la
Cfc YO1 ProL,colA6A, Kl8 v,co1,1767B ct surtout V M col-946-47 ct co1.949C. Cf. les notes d'Andn5 DUCHESNE sur ce personnagc dans la Bibl.Clu~~, reprises dans l'ddition de la Vita Maioli par Odifon, VW coI.94647n. Odilon insistc tout particuli&rcmcnt sur la soumission dont fit prcuve MaTeul B l'dgard d'Hildebrand et d'Ayrnard (cf, aussi FW co1.950B). Or il avait I'Cpoque 70 ans et devait certainement ddjik penser sa succession. Peut-b faut-il voir dans ces allusions une sorte de mise en garde adress€e A celui qui allait bientdt lc rempIacet.
". Cf. VHs I,iv,p.52 et les notes de H.E.J. COWDREY, VH, p.52. Pierre rnentionne aussi Bernard Gros d'UxelIes, le prieur de Cluny lorsque Pons vint ravager l'abbaye, comrne &ant un uenerabilk senex (DM II,xii,p. 120).
373 C * . mmmmtion des bagiographes con- les hommes Qg6s ne peut s'expliquer que si beaucoup
de caaci s'accordaient des E#IssE.Qoits pour contower la rigucur de la wutume. Or, pour
agir de la sorte, ils devaient ocatpet des positions assez Clevh au sein du rnomsth.
B. RETRAITE MENTALE : LA Q U ~ E DU CONFORT ET L ' A V A N ~ E EN k~
Cette section o f h l'occasion de traiter de la qualit6 des jeunes : leur vitalit& Celleci
est I'envers du dtifaut des hommes igds : leur perte de vitalitti. Cette opposition pourrait
s'exprimer sous d'autres formes : force physique par rapport B absence de force,
chale~~/rehidissemenf actionlretraite, mais aussi impatiencelpatience. Ce dernier couplet
atteste que l'bergie des jeunes n'btait pas toujours peque positivement par les auteurs
monastiques, Ioin de I&. Il est significatifque mEme lorsqu'il etait question de leur principal
atout, les iuuenes pouvaient se retrouver en butte B la critique des moines.
J'ttudierai d'abord Ies reproches exprim& contre Ie dewieme ige pour ses trop
grands emportements. L'accusation de versatilit6 qui h i t padois a w i portie contre eux'
est indissociable de cette perception du jeune comme un individu passiomel, guide par ses
Cmotions plus que par sa raison, et plus prompt, de ce fait, a changer d'avis. Bien que Vex&
d'energie des iuuenes puisse Stre aitiquC I l'occasion, l'attaque des hagiographes contre tes
vieillards se laissant aller est d'une tout autre ampleur. Celle-ci constitue le dewikme et
principal sujet de cette section.
I. Je n'ai pas relev6 d'exemple significatifde ce theme dans les Vitae clunisiennes. Cf. en revanche Pierre Damien, Ep&, l i m II,xv, reprise dam BibLCha, col.499B (au sujet d'un adolescens qui avait decidd de se faire moine mais repoussait toujours le projet : .: ipse quoque tener adolescentis animus frjcus in suo proposito nun tenerur. D)
L'importance accordk i la retenue, ainsi pue la rbave teiatk d'indulgence des
m o i w vis-B-vis de l'impulsivit6 des jeunes, transparaisJeat tout particulihent dam la
ma Oribnis de Jean de Saleme. Un point tournant de cette onme co~fespond B la cihuverte
par Bemon de la patience d'odon, bien qu'il Alt encore un iuuenis : a [iandem adnrirrms
Bemus abbas tontam in jwene patiewam m. La phrase est reprise par l'abdviateur et
I'HtlmiIIimd. Puique ce d m fi t mntre 19int&t a l'amour de Bemon pour le nouveau
venu, c'est donc qu'uue telle qualit6 Ctait jug& rare c h a les jeunes, tout en &ant t d s
recherche p les moines. Jean explique d'ailteurs B quelques reprises que L'impatience ne
doit pas guider le e r e : ce frd pour cette raison, par exemple, qu'il se retint de donner
immediatement son accord quand on lui demanda d'krire m e Vira d'odon, de meme que
ce dernier tar& h r@ondre am questions pressantes de Jean sur son passe. Parallklement a
ces encouragements I la retenue, Jean o f k au moins me anecdote temoignant qu'il n'etait
pas toujours mal vu de se Iaisser guider par ses passions, B condition, bien evidemment, que
celles-ci permettent de se rapprocher du Seigneur. Alors qu'Odon etait au senice du duc
Guillaume d' Aquitaine et qu'il souffrait (soi-disant) plus ou mobs inconsciemment de son
mode de vie, il se m61a brusquement aux chanoines de l'eglise dont il dcoutait Ie senrice de
NoB. 11 agit alors tel un impatiens juvenis :
a [... ] canonicorum dealbatw chorus adfiit ; et dum in futidibus tantae solemnitatis d iversam fieret rnodulatio vocm, veht impatiens juvenir in medio eorum prosilivi, m a cum ipsis natum regem rnundi laudare coepi. Scio e ~ i m et confieor me ihprobe feche sed tamen Davidicum illud code quodscriphon est retinens, non immerito hoc agerepraesumpsi : Laudate Dominum omws gentes, et colIau&te eum omnes populi. Statirn vero capiris me invasit nirnius dolor ... m4
Dam cet extrait, Odon (ou Jean, selon lequel des dew parle vdritablement ici) admet que
l'impatience juvCnile est condamnable, mais il l'excuse en la pnkntant cornme le detonateur
qui pennit I la maladie de se declarer et entrains, ult6rieurement. l'entree en religion. La
mtme indulgence se lit dam une autre anecdote de cette Vita. L'analyse de celle-ci permet
de donner un exemple de la manihe dont un hagiographe jouait des dges de la vie pour attirer
*. VO1 1,33,coI.S8A et V O a b 22,p226. 3. VOt Prof-, co1.44C et 1,4,co1.45C. '. YO1 I,9,~01*47C.
et attiser l'empathie du lecteur pour le saint Un iuuenis, t&s pmbablement Odon mais Jean
laisse p h Ie doute, do= en plein h e r son manteau 8 un pa-, pour dbwr i r aussit6t
qu'un tel g e e le contraignait B plotter ; il supporta vaillamment I'Cpreuve le temps des
Matiaes, puis rentra vite c h a Iui pour se rtkhauffa- Il tram alors de l'or sur son lit. La
morale de l'histoire est que le geste, bien qu'inconsidtrt, dtait saint, puisque Dieu le
dcompensa. Mal@ tout, l'hagiographe se moque doucemeat de I'attitude idfldchie du
jeune en insistant sur l'image de son corps subitement @a&. Il existe une sche similaire
dans la Vita Odonis oil Odon devenu senex o& P un malheuseux Le vetement que Jean lui
avait @t6 pour protCger sa view membres tremblants de h i d ; mais il ne fiit aucun doute
dam ce kcit qu'Odon connaissait d'avance les c o ~ e n c e s de son geste : Jean n'essaye pas
cette foisci d'amuser le lecteur avec I'impulsiviti du donneur, mais suscite son inquidtude
et sa tendresse devant L'image de ce vieillard soufbnt il cause de son aLtruisme6. Je
reviendrai dam la dernikre section de ce chapitre sur les portraits de view saints fragiles et
emouvants.
La Vita Odonis de Jean de Saleme pr6sente quelques autres portraits de iuuenes
emport& par leur Qan, tel le Iatro iuuenis qui voulait imm&iiatement entrer au monasth
et s'infligea ensuite m e phitence extremement rigoureuse7, ou cette uirgo qui desirait se
'. [Le itnrenir] vidit in atrio iprius eccIsiaepaupe'em semimdtun /were, cujw comp~rsur pemvim emit se scapdmp qu4 suprindLnu erst et usuipauperk e m transiem projsit. cons id era^^^ quodfccir, iidcirco m e w rigorb procut a se avertit. Finita itaque lade matutina totus jam rlgtdus ad suam reversus esr ce~iuIatn. Sed cum congeIizta membra voIu&set lectdo ~r&e ut calt$acemnt* libram mi super suum reperit szrarulum, ,.. * (YO' IT,4,co1.63A), La m?me anecdote se cetmuve chez Nalgod qui en accentue Ic c6t6 dramatique (VO' Fii 17,p.138 = PL 12,coLWA-B). I1 ne fait aucun doute pour lui que cc irnrenir Ctait Odon-
Sur I'impCtuositC d a jcuaes commc source de comique pour I'homme du Moyen Age, cf. Philippe h&NARD, Le rke et le sourire &as le roman courtoir en Frame m M ~ ~ E W Age (I I X W X O ) , Genkve: D m 1969, p. 149-50,
VO' II,8,col.6SC-D ct YO" 33,co1.99B-C. Cettc anecdote est Cgaiement int6ressante pour une toute autre raison : du fait du travail de ddcncnture effectuC par Nalgd Alors que Jean laissait entendm que le pauvre en question Ctait pmbablement un sorcier (a nonfirjset h o m o p u ~ m, YOt ?,8,col.66A), I'hagiographe du dCbut du XIIe siecle en a fait un envoy6 divin (a U d e illurn qur' apponrit quidam rnajusftisJe qaium hominem, verbinriIIimum mihhi corntat. 3 33,coL99C). II devait lui scmbler con& h toutes ks nomes hagiographiques habituellement en usage qu'un saint p u k e donner sa vcste et son argent un €tre malfaisant ; aussi prefers-t-i1 faire refdrence au vieux cliche martinien du saint o h t son viitement un personnage cCleste-
'. VO' 1&2O,co1.71-72 et VOmh 40,p.247-49. NaIgod ne pdcise pas qu'il s'agissait d'un iuuenis (VOn 44,coI. 10 1 D.
faire nonne8. Pourtant, ce thhe touche surtout des personnags sccondaires ; lorsque le saint
est impliqp5 e x p s h e a t , comme c'est le cas lors de l'incident du jour de NMI, une critique
d'une sanblable attitude est jmdkment o m pdvenant le lecteur pue le geste n'est pas
a imiter. Les autres Vilce clunisiennes ne prkntent en revanche pas de telles descriptions
positives de jeunes impulsifk9* Pea- est-ce simplement parce qu'elles sont davantage
ceatlees SIR les activi* du saint et of6nnt moins d'exempla didactiques que la Vita de Jean
de SalemelO, mais m e tout autre explication put &re envisagk : Odon et Jean furmt des
convertis jemes a @mbablement) volontaires au monachisme ; parce qu'ils avaient
conscience que leur impulsivit6 juv6nile &it partiellement B l'origine de leur prise d'habit,
ils firent montre d'une relative clemence face 1 cette attitude. 11s constituaient pourtant les
exceptions confirmant la r5gle dam un monde monastique habitueuement peu ouvert face
B l'affirmation juv6ile. Cette demiere explication n'est peutdtre pas il negliger quand on
remarque cpe le De Miracuf& dont le but etait egdement didactique, ne trace pas de portrait
positif de jeune fouguew.
Si ce dernier personnage n'btait pas vraiment Ie bienvenu dam la litthture
hagiographique clunisieme, le saint vieillard devait en revanche faire preuve d'une vigueur
jw6ni1eY parfois physique1' mais surtout spirituelle. La critique contre une vieillesse se
'. YO' 1,36,~0139-60 ct YO' 25,~01.95-96. Ltentr& de Hugues Clmy, par excmpk, n'est pas p d s m t comme le rCsultat d'un geste irnpulsifl mais
pIut6t c o m e la dalisation d'un &at de fait : le saint n'avait ricn f3irc dam le monde IaYq~e. La mention par Raoul Glaber de Hugues, fits de Robert le Pieux, surnomm6 le Grand par ses contemporains pour la gdce et la I l W W de sa jeuncsse (a pro sug iuuerrMir elegontiu ac l ibera l i~e m, VFV xi,p.284), est trop succincte pour constituer un contrp-exemple. Ex-on faite de cette citation et de l'anecdote du jeune ttudiant d 0 ~ a n t son manteau en h e r , I t s Clunisiens n'ont pas M du tf ihe de la gdnbrosit6 de la jeunesse ; sur son importance dans la littrrature fian@se, ccf. par aemple P. l&MRD, "Ie sui encore bacheler de jovent" (Ainreri de Narbonne, v.766) - Les reprtsentations de la jeunesse dam la littemture h @ e aux XII' et YUIIe si&cles. etude dm semibilit& et mentalit& mCdiCvala m, dans Les dges de h vie, 1992, p.184. I1 est vrai qu'une largesse sans mesure cst me des principales caract€ristiques du saint abbd clunisien ct qu'il n9€tait donc pas question d'en faire un trait juv€niIe.
I0. Je comptc Ctudier pour rnon post-doctorat Ics raisons qui pausstrent Jean dc Saleme B Ccrire sa Yira Wonis. J'exptiquerai alors pourquoi cet hagiographe o f i t autant d'exempla didactiques dam cette oeuvre.
". Horrnis les difftrcntes occurrences en rapport avec: les saints qui seront c i t k plus bas, il est question, dans le deuxihe livre de miracles consad B saint Ma$& d'un quiabm in decrepita aefate qui faisait le tour des sanctuaires dans l'espoir de guCrir de sa paralysie des pie& et des mains (a nimia contracfio pedwn & manuurn m) ; sa plus jeune f pouse trouvait wins de tels voyages parce qu'un vieux corps ne pouvait retrouver
laissant trop all= est prbmte, implicitement ou explicitement, dans la majorit6 des Vitce12.
Pour que le phhombe soit aussi h d u , iI faut Nil ait exist6 un certain ressentiment, de
la part des autoria (B l'origine des M o m des Ktae), mais peutdtre a w i parmi les
simples moines, face B m e vieillesse tmp soucieuse de son bien- et responsable de
nombreuses entorses la dgle.
- Quelques hagiographes se contentent de d e r que leur h h s r montra actif
jusqu'ii la mute fin. Raod Glaber dklare que, peu de temps avant sa mort, Guillaume s ' avh
etre encore plus assidu daos l ' o p Deil? L'hagiographe d'Ide expliqye cpe ce fht justement
I'assiduite de la sainte dans Ies veilles, les priCres, les jebes, etc., qui acct516rkent sa fin1'.
Jotsaud, peut-Stre plus daliste, montre Odilon s'eppliquant B ces activites pieuses
uniquement d m la mesure oG la maladie le lui permettaitl? Pierre Damien reprend cette
idge, mais consid6mt probablement que la pn&e ne nicessitait pas m e bonne sante, il fit
prier Odilon sans interruption : *per to tm anmafire tohis in oratione pennansit, seseque,
quantum aegritudo permisit, jejuniis ac vigilis vehementer aflixit rI6. Enfin, Pierre le
une force juv6nile (a quodimiterperquireret im veteruno corpore robw iuuenile v (LA44 II,xiv,col.l808C- E), Le vieillard eut pourtant gain de cause.
I t . le n'ai pourtant pas trouve ce theme dam la Vita Odonis de Jean de Saleme, ni dam la r6dcriture de la Vita par Nalgod. Jean trace indiscutablement le portrait d'un homme 5g6 tds actif: Odon arpente sans cesse les routes d'ltalie et de Gaule ; on le voit meme, deux ans avant sa rnort, courir entre les tombeaux des martyrs et essoufTler Ics jeuncs de sa suite (VG' I,l6,col5O-S 1). M a l e tout, Jean n'insiste pas sur ce theme a ne sembk pas voutoir glisser de critique contre les hommcs @& agissant diffdnmmcnt d'Odon. Ce sujct cst pr&ent en revanche dam la Vita de I'HumiIiimur, Iorsque celui-ci hi t , dans son &it de la &forme de Saint- Paul de Rome :
Memor vero i1Iiu.s sennonis : r Castigo corpus meum et m se~*tutem rcdigo, ne, aliis prcdicans, ipse reprobus mveniar r, corpurpropriunr ieiiiniir, vigiiiir, orationibsrr et ceteris sanctmm virtuturn operibus, tanto r'nranfitcs ~umrlo im sum.? vocolioniproximus, #&it et, ut wms olh~du, rigr'dbpaiestrk i' seniiia membra conuefIi~ rn ( VGb Hs,p.2S6).
Dans sa description de la fm d'Odon, u meme auteur evoque comment le saint sunnonta sa faiblesse (a nec reputam seniikz et praemoma membra D, VG' III, l2,coLWB = VG" F,p258) pour se rendre jusqu'l TOW. Cet hagiogtaphe &+it pendant L'abbatiat de Hugucs, c'est-B-dim entrc 1049 et 1109.
", a [darn uero in Dei opere mu@ awiduus quamJiequens (W xiiiip296). ". VI In, 1 l,coL444C : Beata igirw I& debifitatis niminmr viribus corporik, jejuniis et vigitiis orationibwque msiduis, et q u a
gerebat in animo solIicitudinib~~~fian~m et paupertun, adfinem, quasi jam proximum, Hiciter tendebat ; * IS. a [Pier totum fire annum semetipsum, in quantum infirmitas concessit, jejuniis, orationibus et vigiliir
vehenrenter @kit I. (VOi I,xiv,col-909C). 16. VOP co1.943B.
Vh6xable insiste longuement sur Sacti* incessante de Maahieu d'Albano jusqu'au seuil
de la mort ; iI s'agit en fhit du &&me principal du &it de la fin du Idgat pontifical17.
A pmnitre we, ccs diver= affirmations des hagiographes sont ddpourvues de
double-sens : le saint 4 6 , sentant la mort venk, se p d p e A I'audelil et au Jugement Dernier
en se consacrant davmtage aux activitk pieuses c o u t u m i h ~ ~ ~ . Pourtant il faut mettre ces
passages en parall&le avec d'autres qui boquent le meme comportement de la part d'un
homme iigt!, mais qui soulignent son c a r a ~ f i b e inhabituel. D'ailleurs, l'insistance t d s lourde
avec laquelle Piene d k i t cornmad Matthieu reha de s'aliter a m t la toute fin et continua
de cele3rer l'office sans intemption doit ceaainement &re comprise comme me critique
contre les vieux moines de son monast&re trop presses de se decharger de leurs t5ches
Dans la plus ancieme Vita clunisieme, celle de Ghud d'Aurillac compos6e par
Odon, celui-ci kivait dejh, dans sa description des dernieres a n n k du saint : a Miro res :
non iZZa saltem, quae veteranos cornpeke solet imbedlitus, praeter cometurn morem, ad
esum animum iIIius persuadere poterat. La phrase est reprise par l'abr&iate~r~~. Les
17. DM 11,xvi-xvii,p.127-29 : Quo toto tempore [avant son d&sJ h nullo rdro cpdclls. semper se ipo melior uirtutw profectujiebat,
et sacra s e m p studih occtlpahrr. quanto fini propinquior, t m o uimtibus exercitplior appmbrrtrrt [.-.I hersus est trmdem Phs, et per aliquot menses, uir animosus cum hac inuafetudirae fuctabatw. Nolebat Iicet egritudine cog- ua1.e lcdo dtcumbem, noleba! de Iubore sofito qukquam intumta,ere, noleba! corpori suo ucl in modico parctm Tolwabat constanter apotolice curie fabores, caw& eccltsiatliccls nunquam deerat, fmmm se subtrahut utiIitatibw nadebat Diuha obsequ& quibus ut ssrprdictum estse apuero t o m aidic~ltlerat. hqudcbcsfnquentobor Hi3 t o m more suo se rinpendebat, ut qularhrm ad iffa si eger w e nesciretw. sospes et afacer putarerw. Ora!ionts continue, ocdi assidue ii, IacrlmaF defluenfes, psalmodia urpotc CIu~iacc~lsis, toturn pene diei nod&que tempus ocmpatts. cui cor, mi linguam, mi opera cui tm&m se t o m deuouisset, mons~~abant. IZfd autem, itlud inquom, singdare mum refirgium, q u d omni fire uite sue tempore, insatiabUi desidmio frequattauera!, altarb dico sacriflclm, nuIIa ub morbk nuUa cgritudo, nuIIa debilfios, u! ucl una die, h I enn i t l f f~ r , cogere potmat- Pupbat nun morbo singulari akuotioneptihaciter, et ut & icmr dkto Miutino fegi... pro rnodo uel posse mo inuictum ab oratione spiritum non relambat. Prodkcturn est hoc eius safubre certamen. a kdendis iulii urque ad kofendas decembri3, quo toto tempore mus languore S O ~ I S uiolenter spiritui seruire cmgit, nee alicuius suasu, ab hb diuinis uel simUibus sacris operibus reuocaripotuit . In. Sur le fait que la devotion (FrSmmigAeit) est une caractCristiquc de l'ige du fait de la proximite de la
mort, cf. Christian GMLKA, art. a Greisenalter ID, ReaIZexikon@ Antike u d Christenturn, MI (1983): 1060. 19. VG ' III,ProZ.,coI.689C et VG Transitus I,p.236. Sw le fait qu'il faille lire ad esum I. et non
adhaesurn m, comme il est h i t dam l'tdition de la VG1 des Acta Sanctom et de la PL, cf. G. VENZAC,
hommes @& sont donc ~CCUS&S per Odon de changer leurs coutumes alimentairrs avec l'g%e,
par suite de lem h'b1esse. L'hagiographe leu oppose le saint vieillard, qui agit
diff-tllt : now retrowons done ici la m h e fomde stylistique Iaudative dejh
employ& B la fois pour les saints entimts, louts au dMment des autres enfhnts, et pour les
saints jeuncs, co&ntk auxautns jeunes. Il existe pourtant une diff&ence notable entre ces
trois louanges/accuSafio~~~. L'attitude des avtns vieillads, non saints, n'est pas toujours
dhigde par ce biais : il arrive que I'hagiographe &bre le saint 4g6, non pas parce qu'il f ~ t
bien a que les hommes du m h e h e font mal, mais p l a t parce qu'il accepte de souffrir et
de supporter un dur @#me de vie d o n cpe son grand ilge lui donne n o d e m e n t droit & un
certain bien&e? Ainsi, cette louange du saint vieillard ne va-t-eUe pas obligatoirement de
pair avec me violente attaque come ses pairs ; tout dCpend de I'hagiographe et de ce qu'il
a B dire sur le troisi5me 6ge.
Dans la seconde Viro du corpus consam% i un homme liifque, celle de Bouchard de
Vendeme, Eudes montre le pieux vieillard se pliant au mode de vie monastique mdgrh son
grand age et le statut qu'il wait occupk dans le sikle :
r Cumque ei [Bouchard] a fiatribus dicerefur ut quid tom nobilis vir secuIari dignfrnre prpcelsus et senecfutis jam labore fractus, se hurniliando ofligere dignatw, ille revondebat- ... f ' .
I1 n'y a donc pas ici de critique contre les hommes tlgds. Cet extrait tbmoigne plut6t que la
sociktt! m6di6vaIe s'attendait k ce qu'une personne dont le corps &it brisd par la vieillesse
b6ndficit d'une vie relativement facile. Les dew themes. l'attaque contre la paresse de
ceaains vieillards et fa reconnaissance du droit au reps de la vieuesse se retrouvent
simultan6ment dam la Vita Maioli de Syrus. On y lit aussi 1'Cloge de la vigwur juvenile :
Vie de saint GCraud, comte d'Aurillac *, Revue de la Hate-Auvergne, 43 (1972): 301n. 20. On peut ddjil notcr dam la citation ci-dessus, extraite de la Yiln Geraldi, qu'Odon n'attaque pas
diictement les vieillards, mais fait porter la fautc sur leur imbecilllit4~. Sur l'antiquitd et la grande Mquence du thtme du saint qui r e h e d'adoucir son rtgime aiimentaire bien que son grand age lui en donne le droit, cf. J.T- WORTLEY, Aging and the Desert Fath ers... s dam Aghg andhe Ageri; 1990, p.66 et I. COCHELIN,
In senectute bona : pour une typologic de la vieillesse dam l'hagiographie monastique des =Ie et XIIf si6cles a, dam Les tiges de iu vie, 1992, p. 128-29.
". VB XT,p.29.
a &itw Mdohs sene&* tempore quo soient ce!ed ren&sius uiuere, am- se labore in domini snuiuit semitutem redigere. W quasi tmc n o w accederet, ac iuuenilis ueor tn toto c o p r e fetaie- ita incredibili menris firnore diuino f m u h i n i imilstebat Copus nanque defatrgafum senb, nuuUo d o quiescere sinebat a& opur consuda
Le rtcit des demitres a n n h de lbhkul tel qu'on le trowe dam la Vita brewor, la plus
ancienne des Vitae MaioZi, ne fhhit pas partie du texte original : il s'agit Bun collage tardif
de ce mime passage pris chez Synrs. Cette oeum transmet pourtant, en me autre section,
l'id& que le noweau converti pad les stigmates du vieillissement de l 'he pour retrouver
m e energie adolescente :
multo & inmnnerabiles post se Waeul] haxit, qui relo sanctitatis accensi, igne pegectionis feluidi, abiecta inuettmrii torpork & pigrediinLF ruga, in udolescentium inruerunt fodtudine 8.
L'emploi de tames relatie & la chaleur ( a c c e ~ ~ ~ t ( ~ ~ ignis,firuz'dtls) reaforce la r6fCrence faite
a la jeunesse. A l'exception d' Odilon qui ne reprit pas ces th&mes, soit puce qu'il avait lui-
meme 70 am pass& quand il &crivit, soit parce qu'il voulait surtout faire un portrait moral
du saine4, les autres r6dacteurs de Vito Maioli adoptkent le double discours de Syrus.
L'auteur de la Yiro altera attCnua lkg6rement la critique contre la vieillesse qui se relthe en
remplapnt le "ceteri" de son predecesseur par "pleri senum" : il laissait ainsi entendre que
toutes les personnes iigies ne se laissaient pas aller B adoucir leur mode de vie? Le theme
de la vieillesse h g i l e qui a droit A un certain biendtre ou reps se retrouve egalement en
filigrane dans son texte, avec I'6vocation du CO~~~ISCU~ZCS du saint et la declaration que celui-
22- VM II122,p280-8 1 - V ' ProL,co1,1764E, Le BN lat5301,f0l-308~ pkente ado~ercentulorum, plut6t que adolescentium.
*'. Cf. ViC1" col.958A-B. 25. VM col. l784B-C :
Maiolru iplzir totius stremitatis moribus omatus, aetute prouectusD simt solitusD membrorum viribus destifuebatur, sic unimi virtutibus semper imaIescebatD & de die in diem in Dei senritio ind&ssus proficiebat. Non enim ut senum pierique suimt, ppraprcr adatis imbecilii.atem, i' aliquibus ranbe agdat : neqw curpod oblrrctanti vnquam satkfacikbat. Vigebat animus omnino iweuerberatus, vigebat armis sanctifatis munifwD miles imrictkim. Ton~tumr dl.. hucucque suo corpuscdo i'ndihetpwnar, ieiunia, vigr7im. orationespecuIiiues sibi c~ssumebat, qwre omnia choritatfi iwnditate condiebat. L..] in omni religionis oflcimitate mUes teens eraI nec in alipo a perfectioribus s41u:tis dircrepabat. [...I Fortis Agonbta ac si iuuenilibur mernbris ac vegeto corpore row vcrferet, in se solum immdericorditer dimicme videbutw, misericorditer cornpaterenu. w
ci ne fit pas preuve de rnisCricorde & l'egard de sa pmpre persome, mais seulement enven
les autres- L'hagiographe fbit ici d f i i c e B la phrase de saint Baoit alihant que l'homme
est nature1Iement enclin B &re mk5ricordieux envers les vieillards et e d i t s (a Licet ipsa
naturu ~~UIUIIU~ trahatw ad mikericordim in his aetatibus, semcm videlicet et
... p). Ndgod insiste pout sa part sut le fat que Matveul resta semblable B m e jeune
recrue au Service du Seigneur jusqye dans sa vieillesse- Ici, plus qu'ailleurs, se trowe un
kloge vdritable de la jeunesse, mais il est indirect, puisqu'il n'est pas offert pour lui-meme
mais pour critiquer la vieillesse :
Cum autem beatissitnus Puter vitae Iongioris excutsum urque ad matwam cattitiern protrm'sset, juvenili femre ef studio in sanctitate et justitia Dumino serviebat. 6.. 1 J m provectior aetm vergebat in senium :jam cum ad otium et quidem @SQ carnis debilitas hortabatur ; spiritus tamen ejus, victw aetatis, sequebatur tirocinii sui legem ; et quasi tece~ter assumptus in miitem, vitibus innovatus, in agone justitiae desudabat. Ebdem iIIi erat ordifiequentia, eadem fire diligentia jejunandi, quae et p r i m if'ius ornaverut juventu tern P
Nalgod mentiorme dans cet extrait le repos et l'inactivit6 awrquels donne droit un corps us6
par la vieillesse, mais il pecise pius loin dans son ecit que l'homme ne doit pas s'y
abandonner car il w faut pas que le Seigneur le trouve inactif lorsqu'il le rappelle B lui (a [...I ut veniens Dominus non eum remissioni vacantem et otio, sed honestis intentum
ocnrpationibus inveniret v29. Un discours similaire i celui des hagiographes de Maeul se retmuve dam la premikre
Vita Hugonis, icrite par Gilon, cependaat l'attaque contre le troisibme Hge y est plus
virulente. Aptes avoir ddclard que Hugues etait iig6 de 65 am et dgnait sur Cluny depuis 40
ans, cet auteur ajoute :
a [...I atque ut assoiet gefida senectra kaborum immemitate adducra fernentioris robur aetatis sensim subtrahebat. In id temporis cfgnea resperms lanugine corpore foris inigi&to, igne Suncti spiritus interim suauiter ardebat. Vidmus plerosque postquam ad decluum hoc perueniunt sibi @st esse Loneri, moiiioribus uti, sollicitudines posrponere, indulgere corpori et rnorem gerere genuinae debilitaii, qui uernacufm aeiatis rnoIestias emeriti more mifitis demuicentes negociir uftro
renunciant At uictor minnu floridi patri's pristiltorum memor uirtutum, ampiiora templi jbubnenta qumn fierant in CZmiaco tunc locare disposui& cometas natauae leges uin'tim bamgrediem. quodsagaci iI1Si;Stens studio mtmFce man@mit effectui 9
Dam Ie &it des dernias jom du saint, Gilon insiste de noweau sur la fideIit6 avec laquelle
celui-ci se soumit au rituel liturgique, depuis Ie CarZme jusqu'au Dimanche de Piiques, et
cela md@ son extrhe f h i b l d . Par un tel exemple, l'hagiographe accuse donc a
contrmio les hommes iigts de dblaissa Iem responsabilitts, tant par rapport au Seigneur
que vis-&+is de la communautt, et de trop s'occuper de leur bienGtre physique. MEme s'il
admet que la h i d e vieillesse s'accompagne d'une perte des forces physiques, il n'excw en
rien ce comportement des view moines. Comme je I'ai d&j& dit pdcedemment, ce
durcissement du discours clunisien vis-a-vis du troisi8me gge, q@ apparait dans les ecrits des
ann&s 1120, trowe certainement sa raison d'&e dans le nombre accru de personnes iigies
demeurant B Cluny B cette meme dpoque. Pourtant, il faut aussi prendre en compte la
particularit6 de la position de Gilon. J'ai d h o n t d au chapitre pdc6dent que celui-ci voulut
tracer dam sa Vita un portrait idyllique du jeune abb6 Hugues, probablement pour servir les
inttXts de Pons de Melgueil : pour parfaire son tableau d'une jeunesse parfaitement apte ii
diriger un monastke, il devait prisenter en contrepartie une image negative de la vieillesse.
Ses successeurs clunisiens ne le suivirent pas sur cette voie". Hugues de Goumay abandoma
compktement le tEme du troisieme ige, de meme qu'il avait delaissk celui de la jeunesse,
tandis que Renaud de V6zelay se contentait de souligner I'activitd incessante du saint jusqu'i
la toute fin, sans critiquer pour autant les hommes de cet Age3*.
? VEP U,i,p.90. "'. V . II,vii-ix,p.97-100. 3'. Hildebert, quanta lui, nta#aquc nullcmmt la vieillese, sinon pour dire qu'elle s'accompagne d'unc perte
des forces, ce qui est une dvidence. II rnontrc Ies ft&es essayant de convaincrr Hugues d'amdliorer son menu quotidien et celui-ci reftsant (W VI,3Stc01.883-84). En tenant ce discours, il confvme Ie fait quc I'@! donnait habituellement droit une mcilleurc pitance.
32. Vff xliii,p.58 : fi..] non cessabat in dies magis magisque bona opera exercere, miseticordiae srudere, estvienter pcere.
mdos vestire, sewitio dei cuncro posponere, rlgorem ordinfs sui in/luribiIi.er tenere, religionem tarn in se quam quam in subdith semper obsewe , virtufa denique omnes emulwi, amp/ectr' et obrinere et sic vocationis suae diem iugiter erpecrme. rn
Les grands abW clunisiens firent-iIs dellement preuve d'une telle constance et d'un
semblable m6pris de leur corps pendant leur vieillesse ? R n'est pas possible de dpondre ii
la question a cela reste secondaire. Ce qu'il importe de nota est que ce phhomtne d h i t
par les hagiographes clunisiens n'etait pas un topos dcpo~rvu de fondement mais p W t qu'il
se rencontrait kl et bien dans la soci&€ du ham Moyen Age : il s'y trowait en effet des
h o d qui wnsacraient la fin de leur existence un asdtisxne encore plus rigourew que
celui auquel ils s'&iient astreints jusqu'alors. Odon parle dans la Vita Geruldi d'un certain
pr&e du nom de G h u d qui s'itait fait reclus a ante vitae suae tenninm m33. Pierre kvoque
le cas du moine G h d B qui il accotda le h i t de fink sa vie dans l'ermitage clunisien
d'Aujod. Le fait est d'importance car il temoigne de 1'6ventail trik large des situations des
vieillarcis dans la soci6t6 m6dievale. Aujourd'hui, I'homme iig6 est presque toujours un
homme retrait6 : il est bien ivident que cet &at des choses influe mr notre image du
troisigme ige. Celle des Clunisiens, faite de reproches contre les vieillards soucieux de leur
confort, de d6goiit relatif pour les vieillards malades et dyadmiration pour les vieillards
"ardentsn, ne peut se comprendre sans prendre en compte la grande diversit6 de positions des
homrnes iigds.
I1 faudrait puler ici de tous les hommes, clercs ou Iaks, qui entr&ent au monasttre
pour y fink leurs jours. Je ne traiterai pourtant pas de cette question dam le cadre de ma thkse
car les Vitoe et les coutumiers ne permettent pas d'appdhender correctement ce phknomhe :
il faudrait en effet pouvou comaitre ces individus avant leur arrivk au cowent, savoir i quel
iige et pourquoi ils quitttrent le monde, B quel "prix" ils fbrent accept& dans l'abbaye et
quelle existence ils y menhrent. Malheureusement, les 6tudes abordant m6me t d s
partiellement ces questions manquent pour le haut ~ o ~ e n Age. On peut simplement supposer
qu'il existait de grandes diffknces de motivations B l'origine de ces prises d'habit tardives,
qui donnaient certainement lieu I d'importantes divergences de traitement dans le cloitre.
33. VGI II,xxx,c01.687A, Bien qu90don ait utilise le verbe recIuuai?re, iI semblerait plutdt que Ie pr&e se fiit fait ermite, puisqrt'il fit entrer G6raud en sa derneure, Cet ennitage n'btait pas depourvu de tout confort : le religieux avait en effet un serviteur B sa disposition,
34. DM I,8,p3 1.
Premibent, Ceaains individus enttaient dans me abbaye pour des raisons de pure
commodi!6, essentielIement parce qdil n ' a t pas A cette Cpoque d'institution laque pour
les recevoir dans lem derniers j o d ? De tels "convertis", ttaient-ills incorpads ih la
communad, ou bien vivaient-ils en marge de cell& comrne a sera davantage le cap B la
fin du Moym Age ? Deuxitmement, d'autres individus 6g6s cherchht en ces lie- non
seulement me relative &mitt5 mat&ielIe, mais aussi Ie salut 6teme1. Pierre le Vh6rable a
voulu mettre un fh5.n I ces en promulgant un staM qUi visait I limiter les admissions
de vieil)ards dans I'orch?. Troisikmement, il faut considtkr les en- ad mcmendum,
c'est-&dire au seuil de la mod7. EUes ne d o d e n t habituellement pas Lieu me veritable
incorporation au sein de la communautd monastique, soit parce que ces perso~nes dktkbient
imm&iiatement, ce qui devait etre le cas le plus Wquent, soit parce qu'elles quittaient
I'abbaye ap& leur g~&ison~~, soit enfin pme qu'elIes menaient UltCrieurement m e
". Cf, les dfdrences donn6es dam I'introduction de ce chap*, au suja de la retraite* Voir aussi J K BEITSCHER, The Agd., m, Proceedihgs of the Fourth] A d Meeihg of the Western Society for French Hi30t-y~ op-ci~, 1977, p.49, qui va jusqu'i aftkner que les monasteres dtaient les geriiztric houses of death de I'6poque. Quelques-uns parmi ceux qui en-t fmir lem jom au mon&re firrent p l a d en ce lieu par leurs seigneurs, en remerciement de longs senices rendus. Selon MPP. DEROUX, cette pratique serait originaire d'Orient (La o r i g m & I 'ob!af~e W i c t i n e (Zit& hbtoriipe), (faitions de la Revue MabiUon, 1) LigugC: E. Aubin, 1927, p.86). Pour des exemples tardifs, cf, John H, TILLOTSON, Pensions, Corrodies and Religious Houses: An Aspect of the Relations of Crown and Church in Early Fourteenth-Century England I., The Journaf of ReIigious Hktoty, 8 (1974): 12743.
St& 35.p.69-70. Lcs senes ne sont pas les seuls vids par ce statut, mais aussi ks infintes, wtici, stufti et, plus g€ntralement, toutes les perso~es inutiles.
? Sur la manitrt dont un Wc en& dsllccuRendum doit f&e sa profession, cf, Benr 1-p. I78 a U&L II,xxiii,col.711C. Ce type d'cntrdc a suscitC beaucoup plus d'ttudcs pour la pCriode avant le XII' siecle que les deux aums, pour lequelles nous avons des mfonnations essentiellement pour la fm du Moym Age. Cf tout particulikement Joseph H. LYNW SimoniacuI Entry into ReIigtour Lfefiom 1000 to I260 -A Socia/, Ekonomic, Legd Sm&, Colombus: Ohio State Univ. Press, 1976, p.27-36. Cet auteur a pdffd tvoquer les trois types d'cntrde mentionnk ici comme si e l k constituaient un tout. S'intCtcssant esscntiellcmmt am questions li&s I'incorparation dam un couvent, il ne s'est pas d t d sw la question du mode de vie de ces individus une fois fianchie la pork dc I'abbaye* Pour d'autru cdfknces, cf, la bbliographie sur les &cs, particulitremmt les articles de CM. FIGUERAS, J. LECLERCQ et JB. VALVEKENS ; P. ROUSSET donne aussi plusieun exemplcs d'entrces d succtu7endfllll dans son Ctude sur 8 La description du monde chevalmsgue chcr Ordcric Vitlll m, Le Moyen Age, 75 (1969): 4 3 4 ~ .
La Vita Odonk p e n t c peut$tre un cas d'cntde ad m c c y f e ~ r n oh Ie postulant se retira ap& guCrison* L'hagiographe ne mcntionne aucune prise d'habit, mais plusicurs caract&istiques des enMes ad succtarencfum se retrouvent pouxtant dam son &it Le camte Foulques d'Anjou. tdsorier de Saint-Martin de Tours, tomba gravement malade et se fit porter jusqu'au tombeau du saint- I1 fit de grands dons A la communaut6 des chanoines, mais ne retrouva 1a santk qu'aprh avoir obdi t Odon et restitud les dew vases qu'il avait autrefois volt% B I'abbaye. Jean de Saleme raconte qu'Odon essaya ensuite de convaincre le cornte
existence dam l'abbaye, mais sans grand Lien avec celle des eres. Le f ~ t transparaft
clairemetlt & la lecture de la Vita Burcmdi : tam que Bouchard fbt malade, iI demeura dans
une maison &par& de celle des fkes (a in cu11~trut10 et plijcuto a se loco monachalia
indumenta requM. et acccit m) ; a* sa gu&kon, sa dtcision &adopter le mode de vie
monastique suscita un grand &omement, preuve Nun semblable comportcment etait
inhabittd9. Piem le V h h b l e a essay6 d'encourager ies e n w s ad stlccwrendum, en
ddmontrant dam son De MiramIh que celles-ci kilitaient l'obtention du salfl. A 1'6poque
du h40yen Age central, faisait-on une distinction entre ces trob ensembles, les "retrait&", les
convertis g%& aux motivations plus ou m o b pieuses, et les momants ayant retrouvt la santi
mais d6sireux de rester sur place4' ? Il n'est pas possible de &pondre a cette question pour
I'insbnt, mais il est certain que la pdsence de ces individus i l'interieur de L'enceinte
monastique influenp le discours des hagiographes clunisiens qui critiquaient si amerement
les vieillards trop soucieux de leur confort et peu enclins B se dddier corps et time au service
liturgique.
gu&i de quiner le monde, mais ce firt en vain (VO1 1,21,53A-B). j 9 YB xi,p26-29. Lorsque Bouchard entra aux F& pour y t ini ses jours, son beau-fils, Thibaut, en etait
I'abM, Le comte saw*t donc qu'il Wntficierait en ce lieu d'un traitement de favew. *. Cf. tout particuli&remcnt DM I,vii,p22 et n , ~ ~ ~ i i , p . 8 3 ~ ~ . 'I. Ni ICS sources hagiographiques ni les couturniers ne parlent du premier graupe. En revanche, il est
souvent malaid de distinguer en* Ies convertis tardifs ct Its individus en- adsucczureendum. Dans la V i a Bmurdi, par paremple, il est hit mention de Josselin, vicamtc dc MeIun, qui prit l'habit aux Fo&, Eudes dc Saint-Maur p d n t e cct Cvhement comme s'il s'agissait d'unc conversion classique ; pourtant, du mEme souffle, il Cvoque aussi le d&& du vicomtc :
a Ipse quoquiz vicecomts cingufwn mifitippro ChrIjto deportem, in edem cmobio monachtcspostmodum at Hectus atque dr'gn~jhem sue compIens vite ibidem obiit sub die fiiiip kafendraum apriIium. (VB v,p- 1%-
Faut-il alors supposer qu'il s'agissait en &lit& d'une en* ad succurrendwn 3 Picm le VdnCrable semble voulou considtrcr ces dcux types dc conversion comme un tout, lorsqu'il en parIe dans son De MiracuI& (DM I,vii,p.22).
Lonqu'il est raconte qu'un saint parvint h convainm ses parcnts de pnndrc l'habit, faut-il parler de conversions tardives, c o m e le font toujours les hagiographcs, ou y voir plut6t des exemplcs de dCpart & la "retraiten ou d'cntrtes udsuccsvendiun ? CE pat cxemple le cas des parents d'Odon (VO',I,35,co1.58-59) : ils devaient Etrr t d s ag& lorsqu'ils quitttcent le siecle, puisqu'ils avaient eu Odon alon que sa mere avait probablement dkj8 atteint la mdnopause, et que leur fils avait maintenant plus de trente ans (age oh il entra i Baume)- Voir aussi l'histoire du ptre de Guillaume de Volpiano, qui mounrt peu aprh sa prke d'habit :
Sicque saris uccurute cum plurimis donorum exeniis drair illurn ad m a ~ e r i u m , ubi deuote uiuenr, non multo post presenrejXiofne uitam compleuit. . ( W, iii,p.260).
Le &&me du senex qui ne montre plus la m h e dew dans sa dtvotion au Seigneur
est i mettre en parallele avec celui du monde VieUhnt dont la pi& s'est rehidie. Ces
deux critiques dhulent de la m&ne penxption de la vieillesse comme un Hge qui a tendance
ii oublier sa foi pour privilcgier son confort. QueIques Yitoe clunisiennes reprirent cette
image, tr& e t e pendant le haut ~ o ~ e n Age, d'un mode qui en est presque d v 6 a sa
toute fin? ; elle pem~ettait aux auteurs de mettre en 6vidence ce qu'il y avait d'exceptio~mel
dam le pasomage dont ils allaient traiter- Il faut nota qw la majorit6 des hagiographes ne
k n t pas & cette occasion de r6fCrence directe B la vieiIlesse ; il est pourtant possible qu'ils
sous-entendaient ce Wme en ddctivant l'itat de la soci6t6. Si tel h i t le cas, ces passages
presenteraient le discom clunisien le plus virulent contre le demier gge de la vie.
Le premier hagiographe de MaTed, I'auteur de la Vita breuior, se contenta de
remarquer que le monde touchait 1 sa fin, sans f&e de comrnentaires ni positifs ni ntgatifs
sur Ie sujet : a in hoc igitzir vltimo aetatis fermino ... fl. Ses successeurs ne reprirent pas ce
t h b e dam l e m diffirentes versions de la Vita Maiuli. Dam la pr6face de sa Vita Gerddi,
Odon krivit, ap& avoir mentiom6 la saintetk de Gdmd : a Magis miramur ; puod in hac
nostra aetate, a m jam charitas pene tota refigescit, instante untichristi tempore, sunctorum
miracula cessme debeat m. I1 ne mentionne donc pas la vieillesse, mais se contenta de
refonnuler une citation biblique, a ef quonfam abundabit iniquifas refigescet caritas
mulrorum . (Mt. 24'12). L'idde du refkoidissement est pourtant intimement lide a celle du
vieillissement ; il est don difficile de savoir si Odon avait ou non la vieillesse P l'esprit
quand il inscrivit cette phrase ". Eudes de Saint-Maur usa de la meme citation 1160-
testamentah dans le prologue de la Vita Burcardi en lui associant I1 Tim. 3.12" ; il dvoqua
'=. Cf. dms I'Annexe C, les divenes dCfinitions mettant en patalltle l'histoire du monde et les ages de I'homme ; pour deux discoun t& diffints nu ce theme, voir tout spdcialement Augustin et Abtlard. '', V M co1.1763E. VG' Prae$,d64lA. L'idCe est nprix dam k deuxihDe l i m : imtmte imn tempore Antichrkti w (VG
II, 1 O,col.676C). L'abr&viattur se contenta d ' M jm succmcente iniquitate w ( V G Prol.,p392). Ce theme &ait aussi pdsent dans Ie codicillc du testament de Ghud d'Aurillac :
Mundi termino appropinquante, ruinis crebrescenfibur, jam certa signa man@stanfur, quia his advenientibus were mundus arguetur (PL 133, col.67 1 D). 45. VB Prol.,p2 : .I Ast quonium, secundum Domini dictum, habundante iniquitate et refigescente caritate, omnes qui pie
dans ce passage, non pas tant le dtclin du monde que celui de son abbaye. Tout comme
Odon, il ne fit pas & dfhnce directe h la vieillesse. C'est dam la seule Vita d'Ide de
Boulogne que se dtkouvre me violate diatribe c o n e le mode vieillissant :
a Saccub attestatione &t@turanun smcscen& etjbnrpene adfinent, w canrr eiur indicaf. cad;urils, praese~~tium quih dcrfjfdur meti&, succr(rrendum est praeterifcrrrm @?u& I'auteur fait un survol rapide de l'bistoire de I'humanitC ...I Sed
- a&uc dut dkcli'nans et pendens, jwant ill& s m t o l l l ~ meritu et orationes. Sempr i ' merita paeten'tor~ltr, quos valere putmnur postdata fideliter saecdo cadenti suppnamus. 8
Le paraU8le 6tabli par l'autnn de la Vita entre le participe prknt senescens et les trois
autres, trks ndgatifs, cadens, declinmu et pendens, trahit m e perception tds sombre du
demier he . Celleci est partiellement wdkm6e par l'aifimation de l'hagiographe, trouvde
ailleuis dans la Eta, que la sainte se montrait consolatrice envers les pemmes vieillissantes,
ce qui laisse entendre que celles-ci Ctaient ti plaindre : a Casta familimitate potentes, pia
consoIatiune senescentes, humili verbo innocentes, veneeabilis domina studebat habere 6'.
Pour compmdre l'origine d'un semblable discours, il ne faut pas se limiter au sed topos du
vieillard diminuant ses activitCs et s'adonnant avec fioideur au cuke divin, mais se tourner
vers l'image du vieillard ddckpit et rejet6 hors du choeur, a l'infirmerie. Celle-ci fera l'objet
de la troisitme et dernikre section.
C. LE CORPS DU VIEILLARD, ENTRE LA TENDRESSE ET LE ~ P R I S
Les sections pdddentes ont offat Ie portrait d'une vieillesse en relative position de
force vis-his des plus jeunes ; cette section prdsente une tout autre image de la derni6re
Ctape de l'existence. Je rn'interesserai a la perception clunisienne du moine iig6 malade.
voIunt vivere persecutionem patiuntur, jam dicto loco [l'abbaye des Fossdsj ad surnmam misetie calarnitatem decidente, ante quam penitus ad ima cornat, cogor natiwm refinquere solurn ... *. VI Prol.,coI.437C-D.
VI r,s,co1.44oc.
devenu incapable de e c i p e r au rituel liturgique. Sa faibesse l'avait ex= A I'idkmerie et
il lui falait maintenant mener m e existence en marge de la communad. Sur le plan
mat&iel, ses conditions de vie sanblent avoir W bonnes ; mais qu'en hit-il sur le plan
social ? Les hagiographes now montrent de vieux a b b Ctonnamment choyb par leur
entourage- Est-ce la manifdon d'une &Ne mkkicorde envers la maladie et le dernier Bge
ou cette attitude bit-elle insCpatable d'une position de powbir et disparaissait-elle avec
celle-ci ?
Avant de parler de la perception clunisieme des vieillards devenus trop faibles pour
participer nonnalement aux activitk de la communaute, iI faut dvoquer en quelques mots la
vieillesse mis&abIe qu'il &it possible de rencontrer I'ext6rieur du monastkre. Les
mentions en sont rares. L'image la plus saisissante se trouve sans conteste dam la Vita
Odonis de Jean de Saleme. Ce dernier raconte que le saint avait l'habitude de laisser son
cheval aux vieilles femmes et aux individus faibles qu'il rencontrait pendant ses nombreux
voyagest. Un jour, lors d'une travetsee des Alpes, il croisa un vieillard transportant un sac
rempli de pain, de gousses d'ail, d'oignons et de poireaux. 11 fit monter le vieil homme sur
son cheval et marcha B ses cM. La puauteur qui Cmanait du sac Ctait si forte, a w dires de
Jean de Saleme, que celui-ci se tint quelque temps tr6s loin de son cher abW :
In @so namque itinere vetuhs quidm et debilis praedictas Alpes nobiscum simul hmiebat- Erat autem onetatus saccuIo pleno panib= er allik, caepisque uc porris, qumtmr videlicet herbarum #ores ego minime potetam &me. S e d p h pater illico ut e m vidit, more suo stcpet equum suum sedere & i t , sibique praedictum iinrposuit feldissimum ~accutum~ Ego autem tanttim fitorem non fetens, ub ejus quem comitabm iatere retruho l o n e pedem .
La plus d m partie du voyage ayant W fianchie, Odon remonta sur son cheval mais continua
de porter le sac. Jean se rapprocha alors et l'abbe lui proposa de reprendre le chant des
psaurnes. Devant la rt5ponse du jeune homme qui ne pouvait supporter l'odeur de son
'. 8 Si autem s e w viam (ur saepius jkri solet) amm repimet aut debilem, statim de suo equo descendebor, er eum desuper sedereficiebat [..,I * (VO1 U,S,co1.63D).
chrgement, Odon s'exclama : a Heu me !pauper illud quod tibifeet, ptest comedere, rn
ejus non potes f e r e oclorem ! Pauper enim porest portare, tu cum dicis te non posse
videre ! 3 Par ce "pqer", il st plaisait faire un jeu de mots, en d&gnant aussi bien Ie
vieillard que lui-mdme. Le wntenu de ce f a m ~ t sac, la -on qu'il suscitait c h a Jean,
le fat que le vieillard se trouvait devoir empnmter h pied m e ro-he mi rude et enfin k rdle
t o t a b a t passifet silencieux que lui dome I'hagiographe d o ~ e n t un apequ de la grande
mistre du persoIlIlStge et, surtout, du go- le s6para.t de la petite troupe de cavaliers
clunisiens.
Dans la liste des miracles post mortem d'Odilon dtablie par Jotsaud, il est question
d'un vieillard aveugle originah de Touts, conduit au tombeau du saint par sa fille. Ayant
obtenu de l'eau avec laquelle les membres du saint avaient W laves, et s'en &ant hurnecte
les yeux, il chercha de la nourriture et un lieu pour passer la nuit, car, nous explique l'auteur,
il etait pauvre (a erat enim pauper B). Sa quEte fbt vaine : selon toutes probabilitds, lui et son
enfant passZrent la nuit B jeun et 8 la belle dtoile. Quand il se p e n t a le lendemain a l't5glise7
ii I'heure de la messe, il recouvra bmquement la vue. L'entendant exclamer sa joie, tous
ceux qui dtaient 1% lalcs' prCtres et clercs, accoururent ; Jotsaud p&ke qu'ils rendirent @ce
a avec le pauvre (a s i d cum puupere gratias egerunt #I3. Lorsque Bernard evoque dam son coutumier la liste des indigents B qui il fdai t venir
en aide B la porte de l'abbaye, il mentiome les persomes Sgees, mais celles-ci viennent ap&
les orphelins, les veuves, les handicap& moteurs et les aveugles :
[...I dhtw quotidie duudecim Turtue, quucrrunr unaquaeque tres Zibras appendit ; haec vero ptqillb, & viduis, cIaudis & cuecis, senibur, & aniculio, mnctisque superwnientibus sunt erugunda.
Dans une autre Iiste assez similak, les personnages iig6es h n t placees cette fois-ci avant
les handicap&. Gion hum6re l a malheureux pour qui l'abbt Hugues amassait des tresors
B c6t6 de son lit :
2. YO1 11,6,~01.64B-C. 3, VOi III,viii,coL937B-C. '. Bern. i,xiii,p. 158.
Viduas midissitna, orphanos iimpiicr depressos, pupillos debiles, crlincas anus ~ r t ~ ~ ~ a s , senex mcutuar, homines &Ioribus contractos, egros sanie declarentes, propus ahouebat. 3
La vieillesse pawre existe donc dans les sources du Moyen Age central mais elle se
rencontre trts cxceptiomellement : compte tenu du nombre wosCguent de Vitae d t u d i h
pour cette ti&e et aussi de leur ampleur, tmis cas de pauvres vieillads constituent un Wtat
t r b maigre, tout particuli&rement si l'on pense A l'insistance avec laquelle les hagiographes
dnumhimt ks acts charitables de leurs h h s . J'dtais parvenue i la m5me constatation, B la
suite de I'etude de 43 Vitae des XIIe et XIIF si*cles, pour mon mdmoire de D.E.A. Je
considhz aujourd'hui les hypothkes que j'avais fonnultks pour expliquer ce silence c o m e
beaucoup trop optimistes et erronks : je pensais qu'il fallait I'amibuer, soit au fait que les
personnes igees ne constituaient qu'un faible pourcentage des pawres, soit au fait que la
vieillesse ne s'accordait pas avec la patmet6 clans I'imaginaire m6didva16. Les quatre
mentions de pawres vieillards dam les sources clunisie~es me doment I'occasion
d'avancer une nouvelle hypoth&e, en attendant d'avoi un t5chaatillon plus significatif.
Les listes de Bemard et de Gilon sont exceptionnelles en ce qu'elles permettent
d'observer quels 6taient les groupes des pauvres les plus importants dans la perspective
clunisieme : les orphelins et les veuves viennent en premier. Peutdtre est-ce I& le reflet de
'* VH I,v,p54. 6. Cf. I. COCHELIN, 8 In senectute bona. .. I., dam Les dges de la vie, 1992, p. 13211. Sur le fait que le pauvre fit souvent pint sour Ies traits Pun home age au Moym Age, c t F. GARNIER,
Figures et comportments du pauvrc dans I'iconographie dcs XII' et Xme sitcles m, dims Horrionr marins - ftiniraires spiritueb (LW'' sieCIes), vol. I: Mentolit& et socidtds, du. H. Dubois, J.41. Hocquct et A. Vauchez, Park Publ. de la Sorbonne, 1987, p.309, M a l e tout, la vieiltesse ne symbolii pas uniquement I'indigence, loin de 18 : ainsi, dam cettc meme hde , cet auteur remarque qut a [I]a comsponndanct atre la vieillesx a la sagtsse est un lieu commun de I'iconographie rnddidvale m (ibid, p.3 17n.). Sur les pauvrcs au Moytm Age, voir entre a m Michel MOLLAT, buck sro I 'histoire dc lopau~er6: (Mayen Age-XtT sikfe), 3 voL, Paris: PubL de la Sorbome, 1974 ; mais, clans ces trois volumes, comme dam la plupart des Ctudes sur le sujet de la pauvret6 rnCdi&vale, il n'cst pcu prts rien dit sur le troisi&me age. Un article fondamental pour comprrndre k s moyens de da pasannes &$es paumr, meme s'il ne porte pas sur le Moyen Age mais I'annde f 570, est celui de M. PELLMG : 01d Age, Poverty, and Disability in Early Modem NoNvich - Work, Remarriage, and Wet Expedients R, dam Lqe, Death and the Efdedy in Historical Perspectives, t5d. M. Pelf ing et RM. Smith, Londofiw York: Routledge, 199 I, p.74-10 1.
la r u t sociale mais peutdtre faut-il y voir davantage l'influence de la Bible7. Bernard
place ensuite les handicapCs et n'acoordt cpe la troisihe position aux persannes &&s. Par
ailleuts, amme je l'ai deja souligrk, Panedote & Jesn attestc qu'il existait un go- entre
le malheureux VieiIlard a celui qui I'6voqUait, h o m e d'gglise, cultid, probablement de
b o ~ e naksance. Cet c?cart atre ces deux mondes expliqye po-i les sources meditvales
en g h k d , clunisierules en particulier, padaient habituellement des pauvres de manib
gbkique, sans entrer dam le detailt. Si jamais un auteur voulait &er sa description, il
mentionnait les vewes, les orphelins ou les handicap& mais poursuivait rarement son
~numdration au-del8 de ces trois ensembles. Les handicap& etaient importants a un autre titre
que les dew graupes pdcbdents : la source de leur malheur etait visible aux yeux de tous ;
de ce fait, ils constituaient d'excellents sujets pour les &its de miracles. L'histoire de
Jotsaud illustre ce dernier point : l'autem iasista principalement sur le statut de pauvre et
d'aveugle du rniracul6 ; son titat d'homme at5 l'intdressait peu Gilon, quant B lui, etait
surtout soucieux de soigner le tableau "expressionniste" qu'il dressait constitu6, d'une part,
de sa description de la masse hasante de nourriture et d'habits qui s'amoncelaient aux cMs
du lit du saint et, d'autre part, de son evocation de la horde de pauvres, disparate et
mis&able, venant quimander ces biens. Dans cette peinture am tons vXs, les vieilles femmes
importunes et les vieillards comb& ajoutaient une touche haute en couleur ; aussi n'est-a pas
etotonnant que I'auteur leur ait accord6 une position centrale dam sa phrase. En bref, je dirai
que les %ts du haut Moyen Age nous permettent essentiellement de discourir sur le regard
que les clercs de l ' m u e portaient sur la pauvrete, mais qu'il est malaise d'en extraire des
informations pn5cises sur l'existence des pawres cette dpoque.
'. JTai dej& abordd cette question au chapitre III, section A. '. Pour Cclaucir mon propos ii I'aide d'une cornparaison avec la situation contemporaine, je dirai que le
moine parlait du "pauvren un peu comme, aujourd'hui, beaucoup parlent de "I'Araben, du "Juif", du "Noir", etc
De m h e que, sous la plume clunisienne, le vieillard pawre disparait trop sowent
dans la masse anonyme des indigents, le vieillard "retraie" du moaastht est absorb6 et se
fond dans l'ensemble indistinct des malades. Dew types de sources fimnt principalement
utilisCs pour cette section : les chapitres des coutumie~ c o d aux malades et les
passages des Yirw &oquartt les demiers mois des saints soufEants. ~prrmi&re vue, ces dew
ensembles ne traitent pas des vieillards. Mil& tout, aucun des saints de mon corpus ne
mourut jeme ; aussi, la description de leur existence au cows de leur ultirne maladie o e - t -
elle un a- du traitement offert & un abM vieillissant ayant besoin d'attentions
particuIi&es. Dans le cas des simples moines, la grande vieillesse pouvait les contraindre a
finir leurs jours B l'infirmerie. Aussi, l'etude des chapitres consac& a m malades dam les
coutumiers donne-t-eIIe un apequ du discours clunisien sur les vieillards "retrait&".
En choisissant e x p d m e n t ces sources7 j'exclus de la discussion tous ies vieillards
encore valides, qui continu6rent leur existence monastique bien au-delii de la venue du grand
age. I1 est impossible de savoir si ceux-ci constituaient la majorit6 ou bien m e minorite
parmi les hommes iigis des communautds clunisiemes. Une constatation peut malgre tout
Ctre faite leur propos : les dew seules modifications d'importance d m leur vie que dut
entdner leur grand ige fiuent, premi&ement, de leur pennettre d'acqudrir une position de
plus en plus &levee dans l'ordo, au fur et B mesure que 17accroissement de leur anciennete
leur permettait de grimper des ticheloas de la hiearchie cornmuna~taire~ deuxiemement, de
leur ofEr une excuse porn adoucir les obligations Nnitentielles exigks par la coutume
clunisieme. En d'autres termes, l'existence d'un view moine, A moins qu'il ne fDt malade,
ne se distinguait en rien de celle des autres Mres, sinon que les annks ecouldes lui avaient
habituellement confkt un rang assez Clev6 et un mode de vie plus douillet.
La premi6re question qu'il faut se poser conceme les critkres dbcidant de l'entree
definitive ii I'infmerie. Les raisons offertes par les hagiographes pour expliquer les
d&nissions de Bemon et d' Aymard donnent des dlbments de r@onse. Ni Jean de Saleme, ni
l'abrtiviateur, ni I'HumiNimus ne firent r6Lrence h l'ige de Bernon pour expliquer sa
d6mission ; celui-ci devait po-t dh iig6 d'en.1175 ans lorsqu'il ddigea son testament
et divisa ss monasth entre Odon et son neveu Guy? L'abdviateur et l'Hiillimus se
contenthnt de rCpCta les explications o f f i initialement par Jean, sans en changer m e
a Per inud videlicet tempus exl'tr'ali lmguore coepit d e d e r e pter Bernur. Max - vicinos episcops accersivit, et ab ornni ordine se depnait : imqer etjlebili voce se ream indignumque tali miniktetio proclamabutpraefiisse. m m
Le fait est d'autant plus temarquable qye 1'HmiIlimus modifia ensuite dicalement toute
la suite du chapitre. Ainsi, ces trois auteurs expliquhent la &nission de Bernon par un
d6cli.n brusque et defhitifde ses forces ; la vieillesse &tit probablement a l'origine de ce
malaise, mais les premiers hagiographes d'Odon n'itablirent pas pour autant de lien direct
entre vieillesse et d6mission. En revanche, dam les ann& 1 120, Nalgod adopt. un discours
t d s diffknt. af t i ra que Bemon avait d6missiomd du fa premi&rement, de son grand
ige et, deuxikmement, d'une langueur fatale :
Interim Berno abbas annosa senii g r d o t e defiietzs, exitiali etiam languore correptus decubuit. Urgebatw duplici rnolestia, aegritudinis et aetatb, atque ad tollendm de rnedio vitam ejus morbu et seniurn in eodern c o p r e cornpugnubunt. Vicinos adrciscit episcopos. .. J1
Non sedement il ajouta la vieillesse et la mit en premiike place cornme cause de retraite,
mais il se permit ensuite un long dt5veloppement sur la base de la petite phrase de ses
pr6dticesseurs : a insuper etjIebili voce se reum indigmcmque tali ministerio proclamabat
praefiisse w. Il decrivit Bemon o f f i t son mea nr[pa daas les larrnes et les gthissements :
le vieil abE aurait dkI& Gtre devenu totdement indigne de la charge pastorale pour avoir
passe ses demieres a d e s dam la n6gligence et la torpeur. Or Nalgod fit subir une
transformation similaire i la Vita Maioli-
Le ddacteur anonyme de la VitP breuior Maioli ne dit rien sur la passation des
pouvoirs entre Aymard et Ma'ieul, probablement pane que, peu au courant des details de la
9. Bemon serait nC ven 850 ; il ddigea son testament en 926 et dt?cCda en 927 (cf. D. IOGNA-PRAT, Ha, V (1986): 98).
lo. VO1 1,38,co1.60 et VCFab 27,p.230. ". YO" 27,~01.96B-C.
vie du saint, il ignorait l'Cpisode12- Selon Synu, le deuxieme hagiographe, Aymard se
dkhirgea & son b&on abbatial pour quatre raisons : d'abord sa maladie, ensuite sa dcit6,
la fatigue due au grad tigc et enfin la longueur de son service.
a Cemens interea uir domini Heimardfrs b e a m M i u m uirtutum pennh ad aIta &eh& tmena crmcta &picere, d i g l o r i a m declintre, uerbispluere, mitamlis coruscate et toto cowmine de uirttite in -tern uelle proficete, at contra se infirmum, lumin~priuatum, sen& fcssum atque emcrite ntil.IIC iam ueteranum, conuocatis in ummr f atribus, hh eos compeZliwe cepit adfotr-bus [...I .I3
Dam I'extrait du sennon que fit Aymard ii cette occasion et que Syrus repmduisit dam sa
Vita, seule la &cite est mentio~de comme cause de d@art14. Dam sa Vita Muili, Odilon
n'evoque pas la vieillesse pour expliquer la d6mission d'Aymard mais uniquement la perte
des forces physiques et, surtout, celle de la Cet dpisode de la vie de MaiTeui n'existe
pas d m la Vita dtera car celle-ci est tronqu&e, pdsentant uniquement les premi&res et
d e m i b s annees du saint. Quant a Nalgod, il se distingua cette fois encore de ses
predGcesseurs, en insistant lourdement mr 1e rdle joud par la vieillesse dam la dkision
d'Ayrnard ; la &cite du vieil abb6 n'est plus mention& que de fqon t d s secondaire. A ses
dires, le r&ne d'un vieillard entraine la decadence de I'institution dont il est responsable.
De mtme que dam sa Vita Odonis, il broda longuement sur ce th5me16.
12. V U vi,co11769A-B. ". VM II.l,p.207-08. I4 VM II.2,p.208. Dans la Chnologiu des abbts de Cluny, dont Ie ddbut fit rddigC sous Hugues (cf.
Bibl-Cfua col.1621A ct E. SACKUR, Die Cimiacemer in ihrer firchfickn und al~gemeingeschichtlichen Wirkrumkeit b 6 n a Mitre & elpen JahrhmaWs, voI. I, Darmstadt: WissensehaAliche BuchgeseUschaft, 1965, p.370), la cCcit6 d7Aymard est dgalemcnt donnde comme seule explication pour sa ddmission (Bibl.Clu&, col- 16 19A-B).
Is. [...I coepit Ati tui tota vuletudine corporis et, pod sibi gravius eratp licet putienter ferretp amissione femporuIIj luminrj. Et cum jam se d occarum vergere praesciret et cognosceret se nor# posse diu tanfi coenobii tunturumque spriihralitun ovium mram gerere, [...I ( V W coL950C ; citation corrigCe sur la base du man-t Ars 162, fol.1491, Encort we fois, I t fitit qu'odilon avait 70 am lotsqu'il ddigea catc oeuvre n'cst peut-€tre pas tout B fbit Ctranger B son discours, ou plut6t son silence, sur le sujet de la vicillesx.
16. VM lT,l2,co1.659-60, Cf, Chronicon cluniizceme. BibLCfua, coL1634-35 oh il est possible de lire le mtme discours d'Ayrnard. Je ne suis pas arrivtk B dttenniner quel b i t son origine : est-ce vdritablement une retranscription fidele de paroles prononctes par Aymard, ou bien une invention de Nalgod ou d'une ticrce personnc ? Les themes de ce discours se tctrouvent de rnaniere t& &iulcor& dam la charte oficialisant la ddmission d'Aymard et I'tlection de Mareul (CLU 883), qui, elle, ntmscrit indiscutablement la pensee du vieil abbe : celui-ci explique sa ddmission du fait dc son h e ct de pcablimcs C O Q O ~ ~ ~ (e creme dt$atigafus, oflciis quoque corporis imminutus m), qui lui font craindre que la discipline de I'abbaye ne se relache par sa faute. Malgre ces points de similitude, ce texte insiste bcaucoup moins lourdement sur la vieillesse et les
Compte tenu de la transformation que Nalgod fit subir aux textes dont il s'iaspira
pour Ccrire sa YTto Odonis et sa Yita MaioIiY il semblctait que, dano les annh 1120, peut-
itre Suae aw problhes qye dut poser le dgne si court de Hugucs 11" ou simplemmt du f i t
de la prCseace d'un grand mmbre d'individus iigfs dans I'enceinte de Cluny, certains
clIlt]iSiens commendsent hconsidQer lavieillesse amme un handicap Scriew pour occuper
m e fonction de responsabii. Semblable discours est t&s MQeat de celui qui a aC analyst5
B la d o n pdc6dente : d'un dtt, on pensait que les persomes &g&s devaieat abandonner
le powoir aux plus jeunes et se retira d b qu'elIes Went devenues trop faibles pour suivre
la coutume, de l'autre, on ne remettait pas en cause la pesence de persomes ig&s am
positions de pouvoir mais on critiquait simplement leur possible manque de ferveur et leur
kventuel Iaisser-aller.
ll ne but pourtant pas SueSfimer la traasfonnation du discom clunisien vis-a-vis de
la vieillesse en ce de%ut du We siecle. Premierement, Nalgod est peut4tre un cas isold : ni
les Vitae Hugonis ni le De M i r a d s ne reprennent sa position critique. Dewciemement,
meme sow sa plume, Ie grand &e n'est jamais pdsentd cornme le seul et unique facteur
justifiant un d6part i la retraite : il existe toujoun un autre 616ment @erte de force, maladie
ou ccite) qui, couplt au grand age, eneaine la d6mission. Plus globdement, sur les deux
sikles et demi d'histoire clunisienne Ctudi6s ici, la vieillesse n'est jam& la cause unique de
d6part B la retraite, et certains auteurs ne 1'6voquent meme pas panni les raisons de dgpart
d'individus pourtant tr&s a&. Cette attitude n'est pas unique a w m o b s clunisiens :
~lisabeth Momet l'a not& par exemple dam le cas bien spkifique des ev6ques danois de la
fin du Moyen Age et Michael M. Sheehan, pour la societ6 m6di6vale dans son ensemble".
cons6quences n~~ d'un supdrie~ impotent que la Vita de Nalgod. Sur les probkmes de datation que posent ceiie charte, cf, D- IOGNA-PRAT, Agni imrnacufuri? 1988, p208n.
". Hugues de Mattigny dkC& quelqucs mois aprk son election en 1122. Son r&ne se place entrc la d6mission de Pans de Melgucil et 1'Clection de P ime le Vt?n&abk. I1 serait d'un grand intC#t d'entreptendrc une dtude ddtaillte sut Nalgod et ses h i t s pour savoir, enm autrcs? s'il ddigta sous l'abbatiat du premier ou du second Je pense qu'une analyse ds fmc dc ses dcux Vitae pourrait offiir une dponse A cette question.
'! 8. MORNET, Age a powoir dam la noblesse dpooise (vers 1360-vets 1 5'10) m. Journal dos Savants? jaw.-juin 1988, p.150 et Michael M. SHEEHAN? 8 Foreword W, dans Aging and the Aged in Medieval Ewape, td. MM. Sheehan, (Papers in Mediaeval Studies, 1 1) Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990, pxi.
EnfUq demh point important par rapport B la cessation d'activit6 des abbes, ce sujet
est trait6 par les hagiographes uniquement daas le cas de pmonnages secondaires de
l'histoire clunkienne, c o m e le k t Banon et Aymard Hed ne dhissionna pas de sa
charge d'abbt & la fin de sa vie, malgrC tout il associa Odilon au powoir en le nommant
coadjuteur un an avant sa mort, en 993 : or, ni ses hagiographes, ni m2me ceux d'odilon
n'Cvoquent cet 6ve0emedg. Le mihe phhomtne se note dans Ies Yiroe Odonis : aucun des
ddacteurs ne pdcise qu'odon s'etait d6chargd d'une partie de ses responsabiLit6s sur
Ayrnard dans ses demi6res atm&s, alors qu'il passait plus de temps en Italie qu'l CluqJO.
Ainsi, la retraite, ou &me la semi-retraite, etait p&ue comme une chose relativement
honteuse : on la cachait lorsqu'elle touchait des personnes qu'on voulait loua. Cette attitude
est fondamentale pour comprendre comment €fait pequ Ie moine contcaint d'abandonner sa
place dam la communaut6 pour entrer d&kitivement i I'hfhmerie. J'ai d6montr6 dam la
premiere section que les auteurs clunisiens pdsentaient habituellement l'homme ig6 avec
un certain respect teintd d'admiration, mais seulement s'il restait actifet fasait preuve de
pef~6veraace. Le moine retrait6 ne remplissait plus ces conditions : or nous allons voir que
sa perception et son traitement diffi5raient radicalement de ceux du vieillard encore dans le
doitre.
Dam le cas du simple moine, quels crit&res decidaient de son entde ii I ' inherie ?
Est-ce que la vieillesse pouvait constituer A elle sede me raison d s a n t e ? I1 est
malheureusement impossible de &pondre & ces questions par des &ponses pdcises. Une
chose est du moins certaine : les simples moines partaient plus t6t ih l'infirmerie que les
abbes, peu dCsireux d'abandonner leurs powoir et prestige : tandis que cew-ci pouvaient se
19. J'avais notd lc m€mc silence dans les Vitue do pdlats des XIIC-XIIIe si&cles dtudiks pour mon D.E.A., tout particuli~remcnt dam le corpus hagiographique des abbts dc la Cava (cf, I. COCHELM, a In senectute born ... W, to^ Ages cle la YL, 1992, p.124-27). Ma!@ tout, dam ce demicr ensemble, si I'on nc disait jarnais dans Ia Vie d'un saint qu'il avait diminud de son vivant ses activie et reliiche sa mainmise sur Ie pouvoir, cette information Ctait offertc dam la Vie de son successcur. Or, dans Ie cas de MaRui, elle n'est meme pas d o ~ d e dans les Vitae Odilonis (cf. V@ I,iv,co1.900B et VOP co1.928A).
'O. G. PENCO, Storia del monachesimo in ftaIia &lle origini allafine del Medio Evo, Roma: Edizioni Paoline, 196 I , p. 190-9 1.
faire porter 6un lieu P un autne quad b cent devenus trop faibles pour se dtplacet par
em-mhdl, ceux-B qui sodhient d'un ma1 similaire ttaient certainement envoy&
aussit6t njoindre les mgs des malsAes. En d'autres termes, la ddfinition du handicap
physique qui devsit s'ajoutcr h la vkilIesse pour e n m a un retrait de la vie comunautaire
devait &re tds fluctumte : cornme je le montraai plus loin, ce handicap powait n'&e qu'un
simple enlaidissement du corps ca& par la venue du grand b e . La maladie d t m d g d
tout la cause principle de d m Pour expli~uer pourquoi le view moine Gunzo (a quidmn
uetermnrr in$mus m) d t a de remplir ses fonctions dans I'abbaye de Cluny et se retrouva
I la domus infirnorum, Giin Cvoque me maladie soudaine, non sa vieillesse : a [... ] de
abbate factus cl~lll~trafi etpsalmista precipuur si non ini$mitas e m dissoluisset ad extremu
pene perductum ma. Lorsque les coutumiers detaillent les conditions Cent& dam
I'infjrmerie, ils mentioment seulement le cas des malades. Bernard affirme par exemple qu'il
fallait &re malade au point de ne plus Etre en &at de suivre le mode de vie du couvent
(a tenere Conventm m)? Ce meme auteur tvoque pourtant A diverses reprises cewc qui se
trowaient B l'infherie .pro sda senectute m24 : certains des moiws se tetiraient donc de
la vie communautaire uniquement par suite de leu. grand ige. La senectus &ant m e &tape
particuliiirement longue et les sources n'etant pas davantage explicites il faut essayer de
d6duire quand, plus exactement, ce transfert prenait place.
Tout devait dipendre de la constitution physique de chaque individu. Pourtant, en
supposaflt qu'il ne tombait pas malade, ni ne devenait un objet de rdpulsion, le view moine
devait pouvoir subsister assez longtemps dam Ies mugs de la communaut& On peut meme
imaginer que la limite de 70 ans o f f ' e par les ddfinitions des 8ges comme rnarquant l'entrk
dam I'aetas decrepitta correspondait a l'iige moyen de ce ddpart it la "retraitel'. En effet, la
2', Cf. inH a- FW IT,iSp.9O-9i. =. Bern &xxiii,p.186. Cette mCme source spCcifie qu'un rnoine n'etait r6incocpor6 h la communautC
qu'apr8s avoir dt6 jug6 apte h remplir parfaitement Ie service h la cuisine (Bern I,xxiii,p. 186). Du fait de ce demier r&glement, on peut imaginer Ie cas de vieillards, ends pour un simple malaise, mais incapables ensuite de quitter I'infmerie parce qu'ils n'avaient plus la force ndcessaire pour s'occuper de faire la cuisine pour plusieun centaincs de Mres.
24. Bern. I,xxiii,p. 188-89.
r&ie de saint Benoit et les coutumes montrent que les debiles (infirmi ou uegroh] Went
exanplb des obligations les plus &prowantes de la vie monastique, come marcher pie&
nus 10s de certain- proceSSions, rester assis dans I'Cglise les longs matins d'hiver en
attendant k lever du jour, rester debout dans le c h o ~ pendant le savice liturgique, faire le
service la cuisine, etp. La longue listc de leurs passe-droits explique vraisemblablement
l'importance du resentiment antre tous les vieillads se Iaissatlt vivre trop douillettement,
qui fbt Ctudid B la section pddente. II anivait pourtant un jour oh le vieil h o m e etait
devenu vfaiment trop fiaible pour continuer de participer aux activit6s de la communaute,
meme en Mneficiant de nombreses exemptions. Il etait dots contmint de rejoindre
l'infirmerie pour y fink ses jours.
Pour comprendre comment etaient perqus les vieux moines habitant la domus
infinnorum, il faut commencer par s'interroger sur rimage de la maladie transmise,
premi&rement, dans les Vitae et, deuxi&mement, dam les coutumiers. Le discours
hagiographique sur la souffiance physique a beaucoup 6volue depuis les actes des martyrs
jusqu'i la fin du Moyen Age. I1 serait fondamental de mener une enqu6te pouss6e sur le
sujet, en prenant en compte, non seulement la repdsentation de la doulew infligee par la
violence humaine, mais aussi la conception de la maladie. Les remarques qui suivent ne sont
pas dkfhitives mais offertes essentiellement titre d'hypoth&ses. J'6tudie ce que les
hagiographes clunisiens afkn5rent B props des maladies des saints, pour essayer d'en
dCduire leur perception des simples malades.
Aux dires de leun hagiographes, les saints clunisiens Ctaient des ch2nes solides que
rien ne pouvait ebranler, ni la pauvrete ni les hommes mawais et encore mohs la maladie.
Dam le cas d'un seul saint, et par seulement dew de ses hagiographes, il est racontd qu'il
RB 37 (senes et i@in~es ne wnt pas sournis aux rtresctes dgles du jefhe) ; RB 35,1 ( la malades ne font pas le service la cuisine) ; RB 35 J (les fariles peuvent avo^ de hide pour fake le service i la cuisine) ; LT I50,p.215 (permission de s'asseoir B I'dglise) ; LT 178,p.249 (possibilitk de recevoir le m k t m ) ; LT I85.3,~258 (avoir de I'aide pour laver sa coule ct sa tunique) ; Bern. I,xix,p. 178 et UdaL Il,xxiii,col.711 B (s'asseoir au rdfectoire sans attendre I1arriv€e dc I'abM).
tomba gra;vement malade me fois au corn de son &me26 : il s'agit de Hugues? L'objectif
de l'anecdote est de m o m la force du lien unissant les Clunisiens a w Apdtres car ce fut
en priant devant les pehtures de ceuxci que Hugucs regagna sa sane ; il n'Ctait nullement
question d'&oquer l'aspect mystique et d c i e l que pouvait prendre la soufEance. Cette
derni&e irnage n'appanrt vdritablement dans les sources hagiographiques qu'8 partir du MIc,
et &ut du WIe sikle, plus @cUiikement dans les Vitae de saintes femmes l'individu
soufFraet dwenait do= comme me hostie vivante expiant au travers de son corps m e partie
des pkh& des hommes. Dans un tel contexte, la maladie-pouvait &re perque comme
positive. Pendant le Moyen Age central, en revanche, le discours &it tout autre. Si l'on fait
exception de la maladie des demiers mois ou des demikes a d e s du saint, qui remplit un
r6le tn5s spkifique dont je discuterai plus Loin, les saints sont dkits de telle sorte dam leurs
W e qu'ils semblent ne jamis avoir W malades. La maladie est avant tout la caract~ristique
de personnages t& secondah, ces rnalheureux, hommes ou femmes, qui se present autour
des saints pour obtenir la gutrison de leurs maux. Ce parti pris est selon moi un indice de la
vision relativement ndgative de la maladie. Celle-ci est un mal dont il faut se dbbanasser le
plus rapidement possible. Le malade est habituellement en position de qu6mandeur : il est
5 J'exclus les maladies qui marquhmt l'enfance de G6raud et I'adolescence d'Odon. En effet, les mentions de celles-ci servent dam Ies Vitae une fonction rh&torique bien pnkise : expliqtler comment ces deux personnages bdndfici&rent d'une education religicuse alors qu'ils etaient destinb au monde laque.
". YHr 1,- p.8 1-82 ~t V,30,~01.878-79. POUT les Cinacieac, c t par excmpk Daniel LE BL-, Maladies ct soins du corps dam les
monast&rcs cistercicns m, dans Horitons marim, itinPraues spiritueb (P-XVIP s.), I : Menfalit& et sucihtdr, Cd Henri Dubois, Jean-Claude Hoquet et An& Vauchq Patis: Publ. de la Sorbonne, 1987, p. 179. Pour la femmes du YUII* sikle et'plus tad, CE par ucmple C. Walker BYNUM, Holy Feest a d Hob F a t - 7Ire Religious Sipflconce of F d t o Medieyd Women, Berkekyhos Angcles/London: Univ. of California Press, 1987, p246-49 et 272s~- et K, LOCHIUE, M i e r y Kempe and TrmIutiom of the Flesh, Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 199 1.
Aux d i m de scs hagiographts, Bernard de Clairvaux fut souvent ct longtemps malade au cows de son existence, J. LECLERCQ envisage la possibW que cettc image du saint souffiant n ' M en fitit qu'un moyen de rnettrc en valcur son courage (a Toward a Sociological Interpretation of the Various Saint Bernards a, dans Bernnrdtlr Mugister, Papers Presented at the nonacentenary celebration of the Birth of Saint Bernard of Clairvaux, Kalamazoo, Michigan, 10- 13 mai 1990, Cd. John R Sommcrfeldt, (Cistercian studies series, 135) Spencer m)rsaint-Nicolas-la-Citeaux: Cistercian Publication/Commentarii Cistercienses, 1992, p.29). La maladie ultime des saints clunisiens permeaait aussi B Icm bagiographes de mettre en valeur lew courage (cf. les deux sections pdc€dentes de cc chapitre, sur I'importance de la pers6vbrance et Ic refus des saints de se laher aller dans la vieillesse). Pourtant, la divergence est grande entre ces portraits clunisiens, oli Ie heros ne tombe malade qu'a la toute fin de sa vie, et les portraits cisterciens oO la maladie n'est plus tenue sous silence.
par constquent un inf&ieur qui suscite la piti& C'est avec cent image en tEte qu'il faut
U e r le discom sur les defiliers mois de la vie d'un saint et, ulttkieurement, la place faite
aux vieillards de L'infirmetie-
En &quint la maladie ultime du saint, les hagiographes cherchaient avant taut
transmettre deux messages. Ce f i t mettait premikement en valeur la grande p a s C v h c e
du heios jusqu'au seuil de la mort ; j'ai deja soulign6, dans la section prkedente,
I'importance de ce &&me pour Ies moines clunisiens. Deux2rnement, la maladie h i t peque
c o m e expiatoh : aussi, la demi8re maladie de son existence ofbit au saint la possibilitt!
d'expier tous ses pdches veniels juste avant de dispat~~l-tre. En mentiomant ses s o ~ c e s
ultimes, les auteurs powaient ensuite affinner qu'il etait mont6 au Ciel sans autre forme de
procb (si vous me passez I'expression). Cette explication de l'ultime maladie est offerte dbs
la premiire Vita clunisienne, c'est-a-dire celle de G h d &rite par Odon :
a At vero, sic& Scrbtura dicit, ut qui sandus mf, sancfifcetur adhuc, oportebaf hunc Dei hominem ante obitutn perflugellurn aspofiti Et ei sicut beato Job contigil. et Tobiue, quonimn acceptus erat tentatione probmi. Itaque per septem, et eo amplius annos, lumen ocuIotum amisit. Quos tamen itaperspicaces habebat, ut nihil caecicatis pati crederetur. Qua percussione non solurn non doluit, sed e t i m phrimum est goyisus in Domino, quod eumjlagellare dignatus sit. Quippe non nescius, quia non omnt qui/rageIIaturfltius sir, nullus tamten ostflius qui nun flogellclur [[Hbr. 12,607. Et hoc erat ei co~tsolutio, quod supernta judex mmum sumn adferiddum hmc solverit, etpeccata sine quibus hic non vivitur, in praesenti puniret. Jam itaque de misericordiu Domini seCUrZIS, confidebat quod cum ab aeterno verbere liberare dignantfr, quem in pramenti sub f7ageIIo premere dignctas sit mB
Ce long extrait nous apprend que l'ultime maladie est une obligation pour un saint, car Dieu
flagelle tous ses fils. Surtout, il temoigne qu'il existait dew sortes de soufkmce physique
dans l'esprit des Clunisiens : celle des fils de Dieu, qui etait essentiellement expiatoire, et
celle qui survenait aux "autrcs", c'est-&-dire ceux qui nY6taient pas des fils de Dieu Dans les
2? VGt III,ii,co1.690-9 1. Ce thtrne ne se retrouve pas uniquement dam les Vies de saints : le rddacteur de la Chronoiogia dde abbes de Cluny, qui Ccrivait sous Hugues (cf. supra), ucplique que la cecitt d' Ayrnard, dix ans avant sa man, Iui fit envoy& par le Seigneur pour lui pennettre d'obtenir le Salut (BMCIun, col.16 l9A).
deux cas de figurr, la maladie est ass0ci6e am p&h&s, vCniels pour les saints, plus graves
pour les a d .
Malgd tout, ce portrait relativement ntgatif doit 6tre nuand. L'insistance avec
laquelle les hagiographes parient de la grande frsgilit6 corporelle des vie= abbds, lern
emploi de termes tels senilicl membra et corptlsctlIdl, lem vocations des difficult& de
deplacement de ces grands vieillads, qui tombaient, qu'il fithit soutenir, parfois meme
portep, thoignent que la failesse du vieillard n'6tait pas obligatoirement peque cornme
quelque chose de honteux, & garda sous silence. Il faut alon pousser plus loin cette d y s e
et se demander queue etait la fonction de pareilles descriptiod3. L'hagiographe laisse
trampad- son ¬ion (de11e ou fictive, peu importe) devant le vied abbd ; il insiste aussi
sur la tendresse (n5elle ou imaginaire) avec laqueile l'entourage du saint s'occupait de lui
dam sa grande faiblesse. Je pense qu'il ewrait susciter de h sorte l'empathie de son
audience : il voulait lui transmettre ces m6mes Cmotions et ainsi l'attacher &vantage au
persoonage. Or me telle rdaction ne pouvait &re escomptee que si, dam I'imaginaire des
moines clunisiens, la vieillesse du "pee" se devait d'etre choyee par ses "fils". Ceci etait
certainement vrai tant que le vieil h o m e restait un "@re", c'est-a-dire tant qu'il se
lo. Le fait que la maladie soit le signe du p&hC est attestC par de nombreux &its de miracles dam les sources hagiographiques clunisiennes. Cf. par cxemplc l'hiioitc de la paum fiUe quc Idc dut gudrir trois fois, car apds la premib guMson, elk fauta deux fois avec un homme (V7 III, 10,co1.443C-44C).
'I. Cf. par cxempk VO1 II,8,co1.6SC, V@ IP6,p258 (= Yo IIIT12,col.84B)., WT47,coI.889C.-D Le &*me du corps qui rcste intact mal@ la viciUesse est plus rare : cf par cxemple VM III.22,p.283.
? CL par exmpk VG' III,S,co1.692B-D et II&S,coL693C ; VG Trunsi. III.p.237 ; VOd I,xiv,col9 10D. col.9 1 lC, col.9 12A et VOi Sackur p. 120 ; IITvi'ip.97 et II,xi,p.lOl. Sur I'expression biblique "baton de vieillesse" (bafilltrs seneclutb), qui est padois employ& pour designer les hommcs qui soutcnaient les v i e u ab&, cf. Daniel A. BERTRAM), "Un bgton de veillessc", & pmpos de Tobit 5 3 ct 10'4 ('Vulgate) *, Revue d 'hktoire et de philosophie mligiie, 7 111 (199 1): 33-37.
'I. Odon est Ie seul dcs auteurs clunisiens A avoir prCsent6 le dtlabrcmtnt du corps pendant la vicilksse commt le signe inversement proportionnel du d6vtIoppement de la force spirituelle : I tape exterior homo commpeblln~, cum iwerior de die in dim renovarefur (VG1 III,Pr~,c01.689D ). I1 appuya son m a t i o n de diffetents exemples ti& de Ia Bible. Lc fait qu'il ait essay& dc s t justifier ternoigne que semblable t h h e ttait peu courant Les autres hagiographes cIunisiens dMvirmt plut6t la ddcdpitude ultirne des saints pour elle-mEme, et non comme le signe d'une daIitd intdricurt, L'abrdviateur de la Vita Odonb reprit la phrase de son prddCcesseur, mais sans les exemples offerts (Tram- I,p.236) ; il n'est pas bien sfir par ailleurs qu' il ait tr&s bien compris I'id€e avancde par son pddhsseur.
de cew qui n'avaient jamais bhdfici6 d'un aussi grand powoir ?
Une anecdote con& par Piem Damien, qyi la tenait d'un fi&e clunisien, permet de
n$ondre ii la p r r m i k vestion car eIle donne un apequ de la situation du vieil abbe apds
qu'il se fiit retin5 l'infirmerie. Un soir, Ayrnard avait envoy6 des servitem demander pour
lui un fiomage au ceIl&ier. Celuici, ddbordt, non seulemeat refusa mais eut le malheur de
se plaindre de la twba abbatum, dont il ne pouvait satisfaire tous les disirs. Aymard,
profond6ment bless6 - et ici Pierre Damien fait me trb inthsante analyse psychologique
des aveugles - demanda son serviteur de l'accompagwr au Chapitre le lendemain : en ce
lieu, il exigea de Maieul qu'il lui ttmoigdt son respect et lui rendtt son titre d'abM. Maeul
obtemp6ra awit6t et Ayrnard, assis sur le sitge abbatial, chiitia I'offenseu?. Pierre offrit
cette histoire pour donner un exemplum de sainte humilit6 awc prdlats. Si le geste de Maeul
est d k i t cornme un fsit merveillew, c'est donc qu'il &it exceptiomel. En d'autres termes,
il etait tout fa t inhabitue1 qu'un a b E accept& de rendre les dnes du pouvoir a son
prddicesseur : le contraire eut &ti etonnant. Malgr6 tout, cette anecdote nous apprend
beaucoup plus. Elle montre pour commencer qu'un ancien abE vivait dam des conditions
t6s confortables : il avait un s e ~ t e u r personnel (minister sws) a sa disposition, et il powait
demander i d'autres ministri des services, c o m e de porter un message au cell6rier. Pierre
Damien laisse entendre qu'une petite pi6ce lui itait dserv6e ii l 'hfherie (a durn priuum
in infirmorurn maneret uedicula m). Enfin, il pouvait exiger subitement un fiomage dam le
courant de la joumee et Etre offusqu6 parce que sa demande n'etait pas satisifkite. Pourtant,
les conditions matdrielles n'6taient pas tout. La rCponse du celldrier temoigne que, t6t ou
tard, entre le nouvel abM en poste et l'ancien dam I'infirmerie, ce dernier perdait
14- Pierre Damien, Opu.scufum fricesr'mum tertium de bono ~ u g i o r u m et varik miraculik praeserfim B. Virginis, PL 145, co1.670B-D ; ce passage cst aussi dome dans la BibLClun comme &ant un edt de la lettre 14 du deuxieme livre des lettres de Piem (BibLClun ~01269-70). Piem Damien explique la dadion violente d'Ayrnard par sa :
a Quo senex audito0 non mediocre scandaIum pertulit, et quia lumen octllorum prorsus amkerat, dolor in ejus corde tenacius haesi~ N m quo caecus a vikibrcr vacat, eo quidquid audierito in code subtiIius versat ; et quia per exferiora quaeque non spargilur, rirteriori zefi stimufo trucu/enfius inflrrmmatur. w
progressivement tout p d g e , donc tout powoi?? Par aillem, s i Aymard eut recours B me
m&de aussi dracunienne pour se venga, c'est pbabIement qdil n'avait pas d'autres
moyens de &orsion B sa dispositio~ En effe en tant que &dent de l'infimlerie, il n'avait
plus le h i t de se redre au Chapitre. Cettt interdiction est fondamentale a j'en traiterai plus
longuement dans le cas des simples moines, car, en effct, ce qui vient d'etre not6 pour
Aymard put se gh&diser aux autres vieillads habitant I 'hhnerie : Ieras conditions ' materieIIes de vie etaient bonnes, mais leur en* en cette demeure tquivalait B m e sorte
d'exil : ils Gtaient devenus en quelque sorte des marginaux an sein meme de l'abbaye.
Je ne traiterai pas ici des soins physiques (nourriture, coucher, traitements m6dicaux)
dont bhdficiaient Ies moines de I'hfimerie. Cette question a dej& W 6tudi6e en dktail par
Gerd Zimnlemam, dam son ouvrage Ordenrleben und Lebenrstandard : cette recherche
titant bade en grande p d e sur Ies couturiers clunisiens, on y trouve un portrait assez
complet de la situation des malades dans I'abbaye bourguigno~e? Cluny semble avoir pris
un grand soin du biendtre physique de ses maladd7 Ceux-ci n'gtaient pas install& dans m e
d@endance doigntk, comme c'6tait par exemple le cas pour les moines de SaintODenis qui
Is- D. IOGNA-PRAT a dtudit! ks chartes &ligCes aptts la nomination de Mareul ct a not6 que celles-ci cornportent la signaturt muea tc d'Aymard pcndant encore trois ans aprb la -on des pouvoirs, puis elle devint de plus en plus exccptionneUe (Agni immamIdi, 1988, p.208n.).
%- Gerd ZIMUERMANN, Orcdemfeben rurd Lebensstadzd: Die Cwa corporb in dm Ordemo~chripen aks abendldndbchen Hochm&dalters, (Beitage zur Gesch- des altcn M6nchtums, 32) MIlnster: Aschendorff, 1973. Sur Ie traitement dcs mdades & Clwy, cf, aussi J. EVANS, Monustic L@ at C l u y 9f 0-1 157, s.1.: Archon Books, 1963 (193 I), p.70-72.
". I1 est spCcifi6 par cxcmple dans le LT que I t s &sirs des malades devaient tous €tre satisfaits, meme si cela ndcessitait d'achctcr certaines choses (LT 19 1 3,pJ66I3). Par ailleurs, Bernard ddclare que si un don de 10 sous ou moins &it fait 11 l'abbayc, cet argent devait Etre donne au celldrier afin qu'il en miit pour les malades (Bent. f,v,p. 145).
I1 existat pourtant une wutume qui ne semble pas avoir t t t toujoun du goat des malades, & savoir celle de leur Gire suivh coifte que coOte le sexvice liturgjquc clans I'oratoirc Saintc-Marie. Except& pour les Mrcs qui etaient inamovlibles, tous Ies autres devaicnt se rendre A la chapelle, quittc y ttre port& par les fmufi. Le ddadeur de ce passage du LT a jug6 nCcessaife de jlrstifier ce traitcmcnt. I l explique que cette pratique avait cornme avantage que certains mouraient sur place, pendant le senrice, et montaient ainsi directement au Ciel :
fngraturn nuZIi apparere debet hoc facturn, quia s e p uidimus in eodem die fiutremjinire ex hoc Iuce et ad Christum transire. etiam in @sa aecciesiu exafare spirittan- (LT 19 I. 1 ,p265*').
s'en allaient au rnonarten'dlrm, Saint-Martin3', mais d e n t sur place, dam la clb t td9 .
Po-t cette proximi* n'Wt qu'apparente. Selon les dglements, le moine malade devait
aisparaitre aux yeux de la wmmunaut6 des miem portants- La ctainte de la contagion et la
peur 1s conditions de vie B L'infinnerie ne suscitassent l'envie n'expliquent pas tout. Il
faut aussi prendre en compte la perception dgative de la maladie 6voquk cidessus. En
outre, Ies sources clunisiennes laissent padois trampmiitre la r6pulsion que pouvaient
inspirer les mdades en g h 6 d et les vieillads s o ~ t s en particulier. Hildebert raconte
que Hugues prenait un grand soin des malades et il le loue pour n'avoi pas 6prouv6 de
degotit i leur egard. Pour illustrer cette affirmation, il pparle ensuite, plus en detail, de dew
SOUS-pupes, les vieillads et Ies 16prerdO. Compte tenu de la repentation de la Epre dans
3a. La situation en cette d6pendance de'l'abbaye de Saint-Denis ne devait pas &e trop d ~ ~ b l e du temps d'odilon, puisque celui-ci s'y rctira temporairanent :
= fit propre sanchrm Dionysium monastwiolum rir honore sancti Mmtini consecratum, et vufgariter ad Pubfi'.;cam Stratom dictum : in quo vikkiicet faco~~tres, qui in praedicto suncti Dionysii moltdsterio crmsa infirmitatis vel fatigationis monere non possunt, uliipndo secerhrnt Q u a h itaque die vti sanctus fdigatus denibzs, monasteriwn &Iinans, c4t(su repustationk i l k divertit- (VO? n,viii,col-922B-C)
J'ai trow€ mention d'un autre cas de dependance monastique pour malades 6loignk de l'abbaye-mere : il s'agit de l'abbaye du Wast, dont Ctrt originaire Phagiosnphe d'lde. Selon D. HMGNER~, ce Mtiment aurait initialement servi d'infirmerie aux moines de Saint-Berth (S Notice historique et archdologique sur le prieud de saint lKche1 du Wast, ordrt de Clugny, diocbe de Boulogne m, Mgmories de Iu socie'te' des antipaires de la Morinie, IX (1854): 4-6 et Id, rn Topographic bou~omaise : les origines ct Ic nom primitif du bourg du Wast *, Bullerrit de la sociPte' ocdPmique de BouIogne-sw-Me, 4 (1 885-1890): 503-10).
La suite de I'anecdote cont6e par Jotsaud nous apprcnd que Ie monateriolum Saint-Martin abritait des cuisiniers et des hommes nsponsables du m * c c h table (injertores cibonmr). Pcut4tre s'agissait-il de serviteurs et non de Wres puisque Hugues les appclle pueri (YO? II,viii,col.922D) ? Peut4tn fircnt-ils envoy& cxceptionnellement sur place pour la venue du grand hommt, tout cornmc la noumturc quc h n t amener les procuratares de Saint-Dmis ? Lcs informations donndes par Jotsaud sont trop succinctes pour vraiment comprcndre comment fonctionnait cette dtpendance.
'4 n est fort possible en revanche que les malades de certains prk& de I'ordre aient tt& envoy& vers la grande abbayc pour y &re wig& ou y mourir (cf. LL. L ~ T R E , 8 La molt ct la commdmoration des defimts dans Ies prie* w, dam Prieurs et priwPs ri4m I 'Occident mPdiPvaI, dir. J.-L. Lemaitrc, (Hautes lhdes MCdiCvales et Modemes, 60) GenCvdParis: hoz/Champion, 1987, p. 182-83).
"'. Iotsaud a Iui aussi affixmt au sujet d'Odilon qu'il n'avait dtt dtgoQtt par aucune maladie* mais I'excmple donne nc concernait que les I@reux (VO? I,ix,coL905A-B). Odilon aurait acceptd la requ& d'un ancien clerc, devenu I€prcuq qui lui avait demand6 de lui mdrc visite A son arrivCe dsas le logis du malade, lc saint I'embrassa, puis les deux hommts diittrcnt tranquiUcmtnt, Aucun miracle n'eut lieu : il est 6vident quc, pour Jotsaud, I'attitude d'Odilon est B elk stule rniraculusc. Or, ca auteur Mvait au milieu du Me sikle. Un peu pIus d'un demi-sikle plus tar& une simple visite un Idprcux n'Ctait plus jug& admirable pour un saint GiIon raconte une histoire etrangernent similaire ii celle d'odilon, sinon qu'elle met en scbe Hugues. DifErence importante entre les deux episodes : la visite du saint fut suivie cette fois-ci par la guCrison du malade (VHp I,xxx,p.75-76).
I'baginaire mMCval", son choix est fort instnrctif quant B sa perception des vieillards
maladcs. n dtait d'ailleurs ccla-ci comme &ant des ttnS plaintifis et suintants. Mihe si
cette demike image peut &re symbolique, le portrait est saisissant :
a Porro quoscumpie vel adas vd grovbr Mecerrt aegriudo, propius jubebat ahoveri, blandits eunm sctutabrrtur mgtrstias, quibus egerent aut quid vellent oflciosi;ssime inquirem. NuUius abhombat collquiiwn, nuIIius inco1)11110du
' verebaiut. Circa sen= queralos et sante rlefluentcs compassione mtweri multiplicare benepcia, plenrrm mercedis urgere f d a t u m . fl
Enfin, iI y a cette phrase terrible du Liber tramitis, B la fin d'un chapitre consad h
l'infirmerie : il y etait e2cig6 que les handicap& et les vieillards qui deShonoraient le couvent
dispmsent compl6tement des btiments claustraux hormis I'infirmerie. Une certaine
vieillesse, come certaines difformitts, pouvait pdtre tenement repussante aux moines
qu'ils desiraient la faire disparzilntre i tout jamais de leur vw :
Cfaudi uel sena qui inhonestant conuentum out deblla sunt in ipsis ceilulis maneant, domzimt, edant atque opu~ dei audiant et quicquit eis opusfirerit ibi agant. Frater illbum cellulmum prouisor cum suis fmulis wm super eos de omnibus exerceat quae iNis opus est, ut non indigeant.
Cet extrait illustre parfaiternat ce qu'il pouvait y avoir de paradoxal dans le traitement des
vieillarcis retrait& de Cluny : ceux-ci ne manquaient probablement de rien sur le plan
matkiel, mais leur situation sociale laissait beaucoup 5 desirer. Une etude plus approfondie
de la place qu'ils leur ttaient faite dam la vie cornrnunautaire maintenant qu'ils titaient
retranchCs ii l'infirmerie conlirmera ce demier point.
Les remarques pkc6dentes font appmatre sou un nouveau jour l'insistance des
auteurs de dgles monastiques, coutumiers et Vitae sur la ndcessitt! de prendre bien soh des
mdadesu. La r6itdration Mquente de ce prkepte exprime probablement un reproche
implicite contre les rnoines sains, ayant trop tendance i se d6toumer et se ddsint6resser de
'I. La lintrature est abondante w le sujet. Cf. entre aums Frawok B~RIAC, Histoire des Ikpretat orr Moyen Age - Une socihte' d'excfus, Paris: &i. Imago, 1988, p.87-148.
''. CIJPi I,S,c01.863C. 43. LT 192,p269. ?Cf. parexernpleRB31,9, RB36, RB72,5, LT 1913,p.26611-15, VHb"xxvii,p.l35.
leurs f&es vivant ii l'infinaerie. Le fait que les malades de Cluny n'etaient pas soign6s par
lem fibs, mais par des serviteurs M q u ~ illustnnt ce point. Saint Benolt s ' a d d t
directement a w moines pour qu'ils prissent un grsnd soin dm soUff).an&? Or le Liber
tramiris nous apprend qye seul le supavisM de l'idkmerie Ctait un moine : tous les autres
individus qui y tradaient cent des fmuk? Ainsi, en quittant les rangs de la
communaut6, le vicillard pcrdait du m h e coup I'environnement social qu'il avait COMU des
ann6es durant. C o m e l'atteste la citation p&&iente du Liber tramitis, les habitants de
I'infirmerie vivaient replib sur eux-memes et leurs contacts avec leurs Bres sains etaient
(theoriquement du moins) eemement limit& : ils rnangaient, dormaient, priaient, se
d e n t stpadment de la comm~nautd~~. Du jour au lendemain, ils n'dtaient plus en rapport
quotidien avec leurs co&&es, mais avec les frmuli?'. Cette transformation radicale de leur
mode de vie et de leur entourage est le mieux i l I W par la &monie du mundafunz. Celle-
ci avait lieu 1 l'hfkmerie le meme jour que dans le cloitre, a savoir le samedi. Compte tenu
de leur &at de sante, il etait normal que les malades ne fissent rien, mais il est itonnant que
des moines du cloitre ne vinssent pas leu laver les pie& : c'ttait les serviteurs qui
". RB 36'4. &. LT 191.1,p26S1, 19 1 d,p26Sz6*, 191.3.p.2669. 19 15~267' et 19 l.7,p.26Ft6 ; Bern Ipciii,p.l85. Les
Cometudrires Antiiiiwes ne disant rien sur la questtestton, il est impossible de savoir quclle Ctait la situation au debut de I'an Mil. L'abdviatcur de la Vita Odonrj, qui &&it B unc date inddtcrmintt cntre 943 et 1109, ment io~a la pr&cnct d'un Wrc vieillant plus de tmis jours aux Cet& d'un rnoine moutant (VOah 40,p.249). Cette information €hit absente du t e a de Jean dc Saleme (YOL &2O,co1.72A-B).
". Cf. par exemple LT 19 I. 1 ,p.%MS @s malades suivent le service liturgique dans l'oratoirt Sainte- Marie) ; LT 19 I .3,p.266I9 (ils sc tasent un jour avant Ics Wrcs) ; St& 72,p. 102 (mtme h jour de Noel, Ies malades ne se mtlangent pas aux M m pour cCldbrer la messe, mais rcstcnt dam la chapclle Saintc-Marie).
S'ih Went trts soufEants et qu'ils ne pouvaicnt ni se deplacct ni &re port& jusqu'h I'oratoih, deux Mres venaicnt malgrC tout B l'infmeric pour Icur chanter l ' o p Dei (LT 191 .l,p.26S1').
". Des fitres pouvaient leur rendre visite, mais le rituel qu'ils dcvaieat suivrc dors dtait dtonnamment complcxc : il kur falIait demander la permission au primT puis cn chcmm entonner plusicurs chants a p r i h . Si le malade leur fXdt part d'une plainte quelconque, ils devaicnt vcnir la dpdtcr au priew (LT 192,p.268). On peut bicn Cvidernment se dire que de tels dglements n'btaicnt jamais suivis et n'cxistaient quc sw le parchemin. Pourtant les lois rcflttent toujows quelque peu la Mi t e qu'eIlcs cssayent de contr6ler et cetleci n'essaye pas d'endiguer 1es passages Mpents des bica portants entrc I'infmcrie et Ic cloitre, mais plut6t de ritualiser une pratique dpisodique : si Ie dglement exigeait que le prieur fit d€cang& chaque fois qu'un fikre voulait se rendre A I'infumerie, alon qu'il existait dCjA 32 lits de malades dans celle-ci (LT 142,p205), c'est que semblable visite n'dtait pas trk Mquente. Cf. aussi Bern. I,xix,p. 177 et UdaI. II.~~,co1.709C.
remplissaient ce rbled9. Tout contact avec le reste de l'abbaye n'dtait pourtant p coup&
Ainsi, des p&es choisk parmi les f%res venaient q u ~ t i d i e ~ e m ~ n t chanter I'office aux
malades dans l'oratoire Sainte-We ; mais ce qu'il fhut surtout retenir de cette intervention
des moines de I'ext&ieur de I'infimrezie est qu'il &it intadit aux malades de eCl&ter eux-
memes la messe. Il leur Ctait UlZiquement permis de lire le psautier ou de le r&iter de
mhoire : Legere arctern taut mi;ssas cmere d l i ex @sir Iiceat fucere qumiiu illicfleriint.
prueterpsalmos memoriter a~rpsaIterium si uoluen't~? Ainsi, pour tous les m o b s retrait&
qui dtaient clercs (sous-diacres, diacres ou pr&es), ce qui avait constitu6 leur occupation
principale avant leur entrie B I'infirmerie leur etait maintenant interdip. La ddchCance du
vieillad reti16 A l'infirmerie ne s'etait pourtant pas l& Il reste A traiter du point peutdtre
le plus sensible de l'amour-propre d'un moine clunisien adulte : sa place dans I'ordo.
En entrant dam I'infirmerie, le moine ne se retrouvait pas simplement en situation
de retrait vis-his du reste de la communautk. Sa situation avait en fait certaines similitudes
avec ceUe des excommuni& : l'habitant de la donrur infirnorum etait un dklasst5, tempmaire
s'il Ctait curable, d6finitif s'il 6tait incurable ou tres vieux. Les sources nornatives ne
mentionnent pas explicitement ce declassement, mais celui-ci se ddduit du rituel que
I'homme guiri devait suivre pour niintkgrer sa place dans la hikuchie communautaire : une
fois gu&i, il lui fdait non seulement faire un mea culpa en rCint6grant le Chapitre, mais
kgdement rentrer a 1'6glise d e m b les enfknts, fa premitre fois qu'il s'y rendait? Pour cewc
h qui la gudrison dtait impossible, ce dklassement Ctait donc definitif. Or, j'ai souligd dans
le chapitre I1 la grande importance attachde B la hi6rarchie dam I'ideal cluaisien. La place
d'un moine dam l'ordo etait tellement significative que punitions et dcompenses se
49, Scrbbatorum uero dierum part Uesperu habeant fmufi aquam c a l i h , ut ipsk i@mh pertes lauenf. (LT 19 1 3,p26PrT).
50. LT 191.2,p.265, s'. I1 h i t mal@ tout perrnis aux malades de se rendre B 1'Cglise principale aux heures oh Ies Wres ne s'y
trouvaient pas, mais ii la condition de ne pas manger de viande et de ne pas Ctre un de ces [cJfmdi uei senes pi inhonestant conuenfum aut debifes stint (LT 192,p268-69). Le mdade dtait autrement encourage ii ne pas rester inactif dam l'enceinte de l'infinnerie : a Interim ilfefiater qui wque ad diem sui exitus mamerit ibi et quicquid regufariter potest explet i l k (LT t 9Q.2693.
". LT 19 1 .S,p.267 et Bern I,xxiii,p. 186.
traduisaient essentiellement par un changement de position dam 17&helle socide de la
cdrnmunaut6. fitre au bas de celle-ci signifhit que vous &ez un dt, une mute Mche
recnrc ou un grand fautif qui venait B pine d'etre r6int6gr6. Ne plus avoir de position
signifiait que vow Ctia puni pour m e fiiute grave. Les malades de l'infirmerie se
retmuvaient donc dans me situation de non-powoir, identique d e des grauds *hews.
Par ailletus, amme les e a t s , la majorit6 des malades n'avaient pas voix au
Chapitre, -s B la d i f f i c e de ces demiers, ilo n'avaient m h e pas Ie &it de s'y rradna.
Cluny avait d'ailleun dsolu I'impossibilitt! dam laqueue se trouvait le malade d'exptimer
ses doldances de la meme h e r e que pour les dm&" : les plus haut grades de la
communautk7 B savoir I'abM, le prieur et le prieur claustral, devaient r6gulierement leur
rendre visite et s'inquiiter de Mat de leur h e et de leur corps, ainsi que de leurs besoins
et du traitemat que leur r6servaient Ies s e ~ t e u r s et les cell&%#. La vieillards pouvaient
donc se f k entendre, meme s'ils n'avaient plus aucun powoir ni statut,
La duretd du traitement social des malades et surtout des grands vieillards, dont
tgmoigne le Liber tramitis, s'estompa singuli&ement dam le courant de la deuxierne moitik
du XIe si5cIe, probablement sous l'intluence de l'abtx5 Hugues, mais aussi et surtout du fait
de l'acmissement de la communaut& La h n t i k , jusqu'alors t d s rigide en& le monde des
malades et celui des bien portants, ne pouvait plus endiguer le trop grand n o d m des
premiers. A lire le coutumier de Bemad, on a l'impression que les malades, et plus
". LC texte du LT est assez conk sur cctte question (ct P. DINTER, LT, p269n.)- I1 est d'abord tcrit que les malades ne peuvent s 'dter dans le cloitre pour parler aux bien portants ni participcr au Chapitre, puis il est dit un peu plus loin que la permission de fib ces deux choses &it accord& A ccrtains fhs (a Si ei a p m uisumj5wi.t s h in clovstro, liceder; etim adcqitulum atgw coifcrtionem uenite =, LT 192,p269'). Quoi qu'il en soit, ccs diverse5 activitds Ctaient formellement interdites aux a clrnrdi uel sene qui inhonestant comentm out debilks SUM m). J'6tudierai plus loin les informations contcnucs h ce pmpos dam le B e m
H. Cf. chapitre III, section B. '=. Undecumque reuertitur dommcs abbas, &bet ibi&m uenire et inquirere unumquemque quid hbeat
siue marbum mime siue corporb ualetudinem trel si aliquid necessitatrj aut neglegentie a semitoribus uel a ceI1arariispatiiurn~. (LT 19 l.Sg26713. Pierre Damien dome iadire-mmt un cxemplc de cette pratique quand il Cvoqut une visite de Hugues ii f'infirmerie, dors qu'il rtvcnait de voyage (Epbt., livre H,YCV, reproduite dans BibLCfun, coI.497C-D). II se trouvait en ce lieu un mohe sensr malade (qhter quirlhnt senex in injmotum domo, ingruuescenre totirrs corpork tumore, lunguebut a), qui f i t tr&s heureux de la venue de Hugues car il ddsirait se confesser lui,
particuli&ement les vieibds, &&rent d'itre enfenn6s dans les limites trop CtodEmtes
de l'hknerie et s'imposhnt dans les lieux o& ils avaient eu c o m e de vim avant l eu
"exilw, ri savoir l'tglise prinwe, k cloltre et le Chapitre. Lcs malack suiV8ient mainteaant
une partie des messes mine- et majcures dans la grande 6glise ; il ne leur etait pourtant
pas pcrmis de les &muter int6graIernent en ce lieu. Banard prdcise que cette limitation
s'appliqyait mun' 8 ccux qui ne soufhient que de vieillese (a et im illi qui solu senecNis
debilitate sunt in Infirmanu v), laissant ainsi entendre que ces derniers a d e n t pdfM rester
pour tout Ie service dans L'&lise de saint Pierre, plut6t que de devoir se retirer dans
I'oratoire*. Ceux-ci (a q u i p sofa senecwe sun& in Infirmmu m) Merit en outre le droit
de s'asseoir dam le cloftre le matid'. Bien que Bemard ne e c i f i e pas de quel cloitre il
s'agit, entre celui de l'infirmerie et le principal, il faut entendre ici le second. En effet,
l'auteur pscise plus loin que ceux qui 6taient I L'idbmerie a pro infirnitate vel
repmutione m, c'est-&dire tous ses habitants exceptes les vieillards, n'avaient absolument pas
le droit, quant h em, de se tmuver dam le cloitre majeur, s a d lorsqu'ils le traversaient pour
se rendre ii l'6glise ou aux ba.id8. Enfin, les vieillads Ctaient maintenant admis au Chapitre,
mSme s'ils devaient s'asseoir a cette occasion am tout demiers rangs (a novissimi omnium
sedent w)? Certainement pour limiter et contr6ler quelque peu cette "invasion" des malades
dam le monde des bien portants, un ~glement exigeait que les premiers se dCplacassent la
tete couverte et en tenant un baton* ; malgr6 tout, un sa i l avait Ct6 firanchi et les vieillards
retrait& n'dtaient plus des exil6s de la commuaaut& En s'installant B l'infirmerie, ils
perdaient, certes, la possibilitk de celdbrer la messe, leur rang dam la hidrarchie et tout
pouvoir sur leurs Sres moins anciens, mais ils gagnaient en revanche des conditions de vie
plus douces et, A en mire les dglements interdisant le rire et les discussions dans
l'infimerie6', un quotidien animt.
%. Berm T,xxiii,p. 187. Cf, awsi Berm 1,xxiii.p. 184. n. Ben. I,xxiii, p-188. ''. Bern. I,xxiii,p, 189. -. Bern. 1,xxiii.p. 189. *. Berm I,xxiii,p. 186. 6'. Bern. I,xxiii,p. I88 ; Star 19,p 57-58.
A la fin du XIe-d&ut du XD sitde, le traitement a Pirnage de la vieillesse dans
1'0d.m clunisien s u b k t d'irnportantes transformations, dolo mm9w que le nombre des
vieillards augmentait, par suite du triplement de la taille dc Izt cornmunautt, puis de son
vieillissement pgnssif. La vim moines install& dans L'infirmerie pour y finir leurs jours
b6dficiaient d'un bien meilIeur mode de vie cpe leurs prSadasmrs. M h e si, en st retirant
de la communaut& ils perdaient leur rang et leur powoir, ils powaient continuer de vim
en contact intime avec leurs eres du cloitre et n'went plus soumis i un ostracisme rigide.
ParaUtIement le regard qui etait port6 sur le grand gge se fit i l'occasion plus anatomique :
surditd9 cecite et, surtout, stidit6 mentale pouvaient maintenant Otre incluses dam les
portraits de personnes igks. Certaines voix sY6lev&ent meme des rangs des fkes pour
encourager fortement la mise B la retraite des plus view .pro sola senectute r.
CONCLUSION
L'image dichotornique de la vieillesse tranrmise par les sources clunisiemes peut
s'expliquer de diffdrentes manikes. L'gge est bien entendu un facteur fondmental: entre
un homme de 50 ans et un autre de 70 am, iI existe habituellement un kcart important quant
ii la vigueur et I la mobilitd. Ainsi l'opposition entre la senectus et l'aetas decrepita? qui
rappelle celle faite aujoud'hui, par les sociologues, entre le group des "jeunes vieux" et
celui des "vieux vieuxl', rdsume et explique en partie l'image double de la vieillesse, la
glorieuse et la misetable. Celleci se retrouve dans le monasttre, oh s'opposent, d'une part,
les moines 3g6s encore valides, qui, gtke a leur anciemet& occupent des positions
d'importance, et, d'autre part, les fieres impotents par suite de L'ige et de la maladie, qui
bent rel6gueS A I 'hfherie et perdireat ainsi leur place dans I'ordo et leur voix au Chapitre.
L'exemple des view abWs clunisiens vivant jusqu9& 80 ou 90 ans tkmoigne pourtant
que l'iige n'est pas l'unique facteur A considhr. Le pouvoir et la richesse peuvent fake en
sorte que les atteintes de la &nilit& physique n'aient g u k d'impact sus le mode de vie.
Invezsemem, la pawrrte, avec la malnutrition qui l'accompagne, put accCItFa le dklin des
forces d'un individu et fXre de celuki m pitoyable uehrhs bien avant Ia Iimite des 70 ans.
Outre 1'8ge a le statut, la perspcaive choisie par l'obsavateur est Cgalement
fondamentale ; or, eUe n'est pas assez sowent prise en compte par les chercheurs. Dans le
rnondk Mip, la force physique est essentielle, tant pour le pysan que pour le seigneur ; son
dklin fiagilise la position de I'individu au sein de son p u p e social. Aussi, la jeunesse est-
elle un bienfait et, inversement, la vieiksse un handicap. Dans le milieu monastique en
revanche, la perte de la force physique ne devient problCmatique que lorsqu'elle n6cessite
I ' d t complet de la participation active B la liturgie. Bien plus, eertaias traits habituellement
associC avec l'iige sont valoris& : un bon moine est un individu qui n'est plus la proie des
tentations physiques, qui fait prewe de gravite, qui a beaucoup d'anciennet6 et des cheveux
blancs. Ainsi, le discours sur la vieillesse change-t-il du tout au tout d o n qui observe et ce
qu'il observe : dam le Verger d'Amour du Roman de la Rose, le grand ige est objet de
degoiit, mais dam la cour des anges terrestres (ainsi que Cluny se percevait), il en va bien
autrement : la vieillesse y prend tour B tour le visage de la midre et celui de la saintete.
CONCLUSION
J'esph avoir monttC, au fil de ces chapitns, l'importance dm Qes de la vie dam
l'imaghah et le quotidien des moines du Moyen Age central. De plus, l'etude du discours
clunisien sur le cycle de vie a permis de pCn&rer ce monde de I'int&ieur, d'en miew
concevoir la structure et certains idhux. Enfin la codhntation entte le mode de vie
monastique et les ecrits bagiographiques d'une part, les dCfinitions m6di6vdes des Hges
d'autre part, a dom6 l'occasion d'expliquer ces demi&res et de comprendre comment
l'homme du Moyen Age percevait le cycle de son existence. Compte tenu de l'ampleur des
themes qui furent trait& je reprefldrai dam cette deraih section les principles hypothbes
et conclusions auxquelles je suis parvenue.
Les divisions mddidvales des ages apparaissent I premi&re we artificielles et
absconses. Pourtaat, en les observant sur l'intervalle allant du W au debut du me siecle,
on remarque qu'elles k n t presque toutes construites sur la base de quelques principes trks
simples ; une fois ceux-ci d6terrnin6s7 it devient alors possible d'expliquer pourquoi les
auteurs du Moyen Age central ddfinirent le cycle de vie comme ils le firent : ils 6taient des
hommes d ' ~ ~ l i s e et leur mani&re de dfcouper les iges est intimement lie a leur mode de vie.
La majorit6 des d6finitions pdsentent 3,4,5, ou 6 ages : la forme la plus succincte
presente lapuerilia, la imentsrs et la senechcr ; la forme &endue d o ~ e L'infmrta, lapueritiay
l'ad02escentia~ la iuuentusy la senectus et le senium. Les divisions en 4 ou 5 Qes ne font que
diviser un ou dew des trois iiges de base en dew, si bien qu'on obtient la structure suivante :
P U E R I m IUUENTUS SEiVECTUS inf ntia pueritia adolescentia iuuentus senectus senium
La principale pdcaution i prendre, pour qui se penche nu ce theme des Pges, est de ne pas
s'attarder inutilement sur les divergences de vocabulaire, entre celui choisi par les auteurs
de dtfinitions et celui des oeuvres litthhs. Ce n'est pas parce que puer et i n f a , ou
ado2esceonr a iuuenis sont habituellement synonymes dam ces denriers h i t s , qu'iI faut
~jetal'idted'uneenfbceetd'une jeunesse s ' k ~ u l a n t , chacune, eadeuxphases. De m h e ,
il ne find pas s'arrEtcr sur le fait quc le vocable senecttrs Mgne notrnalement la fin de la vie,
et senizun C v w la dscFCpitude physique. Catains auteurs de #finitions voulumnt marquer
unc M c t i o n en- dera dmces, deux jemesses et dew vieillesses ; pour ce hire, ils
puis&ent dams le bassin du vocabulake des @es, m6me si les mots qu'ils choisirent ne
cowmient pas exactement la dalit6 qu'ils leur assignaient Ils ddformaient quelque peu le
sens d'un terme courant pour pouvoir me- une appellation Wifique sur une &ape
importante du cycle de la vie.
Dam l a oeuvres littdtaires - et il n'y a pas de raison de penser que tel n'dtait pas
aussi le cas dam le langage par16 -, le puer etait Yenfaat depuis la naissance jusqu'8 la
pubertd, tandis que I'infans 6tait le tout petit 2gc5 de quelques am. Dam la majoritd des
d6finitions en revanche, l'inf~nha cowrait les annks de 0 1 7 am et lapuen'tia de 7 i 14/15
ans 11 fallat en effet nommer avec deux noms bien distincts et placer sur l'echelle des iges
en des points @cis (0,7,14/15) une M t C plus floue. Ce qu'il faut surtout retenir de cette
extreme schematisation des annties de l'enfaace est qu'il existait deux phases. L'etude des
sources hagiographiques a montd que la distinction entre la premik et la seconde conceme
le debut des etudes, avec ou sans le depart de la maison familiale. Cette coupure avait
d'autant plus de signification pour les auteurs religieux qu'elle marquait symboliquement le
debut de l'oblation et donc le commencement d'une vie tout autre. La fin de I'enfance
marquk par la puberte correspondait a l'introduction dam les rangs des adultes,
symboliquement vers 14/15 ans. Dam les monasths, i cet ige, l'oblat quittait la schola et
faisait sa profession pour se joindre aux moines adultes. La fin de la vingtaine marquait la
fin de la premih jeunesse, la seule que nous, aujourd'hui, appellerions jeunesse. Dans la vie
IaTque, I'homme etait alors bien souvent marid ; dam le monde eccldsiastique, 30 ans etait
jug6 l'fige idM pour devenir prEtre. Commen@t ensuite l'ige mWjeunesse. Pour marquer
cette cesure dads la vie, les auteurs de d&£initions qualifierent d 'adolescentiu la premikre
phase et de iuuentus la seconde, m h e si, dam Ies autres hi ts , ces deux termes Ctaient
habitueilement synonymesC Pllisque les rCdactMs de dthitions des dges dtaient pendant le
haut Moyen Age des hommes d'kghe, ils firmt s'achever la iuuentus assez tar& B 49/50
am : ils considhiient que l'homme avait alors domid les pulsions de son corps a que ce
demia cornmen@ & perdre de sa vigueur. A l'encoatre de la division des Qes de la vie de
I'epoque romaine, ils choisinnt de diviser la vieillesse en deux phases : un iige
m&/vieillesses qu'ils designkent habituelknt par le tame la senectus, et me
vieillesse/&lin, le seniunr. hare une fois, la limite cMWe de 70 am est essentiellement
symbolique : ce que les auteurs de definitions d6siraient montrer par ce decoupage est qu'il
existait une premicke vieillesse oii l'homme etait encore t&s a&, occupant souvent des
postes devk dam la hi6rmhie de sa communaut6 (lilTque ou eccl&iastique) du fait de son
expdrience, tan& que la sconde marquait la mode de la vie o t l'individu etait devenu trop
faible pour suivre ses contemporains et se retirait de son champ d'activite usuel. Dam les
monasttres (et mutatis mutmrdis dam 1'~glise s h k e ) , si l'on fat abstraction des saints
et des abb& - t&s sowent appelk de I'ext6rieur pour remplir quelques m 6 e s plus tard le
si8ge abbatial d&s qu'il deviendrait vacant, sans avoi eu a grimper un a un les echelons
internes de l'abbaye -, les simples moines devaient attendre un b e assez avand pour
dominer leurs congen&es. Puis, ap& un certain nombre d'annks, le vieux fiere devenu
incapable de remplir sa tiche quotidieme dans le service liturgique etait contraint de se
retirer B l'infirmerie. Commenqaient dors sa retraite et son demier tige. Ce schema d'une
double vieillesse, la puissante et la ddpendante, ne doit pourtant pas faire p e r k de w e que,
taut dans le monde 1- que dam le milieu monastique, cette retraite n'etait pas obligatoire,
mais le lot d'une minorit& Dans de nombreux cas, l'homme t d s Sgk se contentait de
diminuer partiellement ses activites et de f& davatltage attention A son biendtre : il pouvait
aloa devenir la cible des critiques de ses contemporains, qui lui repmhaient son manque de
vitalit&
Une telIe division du cours de l'existence humaine suscite bien Mdemment plusieurs
remarques. La caract6ristique principde du discom monastique mMi6val sur les iges est
sa polarit&. Aux enfants sont opposes les adultes, a w jeunes les vieux. La premiere
opposition est fondamentale mais elle ne se comprend vraiment qu'8 la suite de l'etude de
la seconde, Cgalement importante- II n'y a pas d'he miir pour l'homme du Moyen Age
central : la maturit6 est perque uniquement amme le comportement physique et l'attitude
mentale idhw. A m des hagiographes clmisiens n'a jarnais hu t6 des avantages et
ddsavantages de cette possible tranche d'ee, alors qu'ils sc sont volontiers appIiqu& & cet
exercice pour l'enfhce, la jeunesse d la vieillesse. Mais le meilleur indice de cette absence
de notion d'iige mQ se trowe daas les discours sur la iuuentw et la senectus. Ceux-ci se
compl&nt padititement, ils foment un tout : les d6fkuts de I'm sont les qualies de l'autre.
Dans une perspective monastique, la jeunesse a beaucoup plus de defauts que de qualitds
mais ceci n'est aussi que l 'enva de la m6daiUe du discours laique, accordant beaucoup plus
d'amait au deuxi4me Hge qu'au troisi5me. Face A cette entit6 @site mais P dew visages (le
jeunde view) qu'est l'homme adulte, l'enf'ant ap@t comme un individu incomplet Aussi
peutsn I'aimer, Ie proteger mais il n'est pas question d'accorder du poi& B ses paroles ni
5 ses ddsirs : son entiere soumission face aux adultes n'est meme pas remise en cause
lorsqu'il est un saint. T6s significativement, les quelques qualitds que lui accordent les
moines ne sant que les boas c6t& de ses d6fauts bar exemple, il ne meat pas, parce qu'il dit
tout ce qui lui passe par la ttte) ou la marque de son diveloppement inacheve (par exemple,
le petit gaqon n'iprouve pas de desk pour Ie sexe ferninin, parce que sa sexualit6 n'est pas
encore ddveloppde). Pour qu'il d e v i e ~ e un adulte, il faut le modeler de I'extbrieur, en lui
faisant imiter les gestes des adultes et en l"'imbibantn du savoir religieux. Les moines
attendaient que l'enfant devint enfin un hornme, sans faire preuve, semble-t-il, d'une trik
grande patience.
Division des iges et division hidrarchique au sein d'un moaast&e sont deux thkmes
qui s'klairent mutuellement. La communaut6 clunisienne est un monde extrEmement
hidrarchis6 : la tr& grande majorit6 des occupations quotidiennes des fk6res se ddroulent
selon l'ordo, chacun occupant une place spdcifique. L'tl6vation dam la hidrarchie
rkompense le bon moine, le d&lassement pennet de sivir contre le mauvais : ainsi, hornis
l'excommunication ou le renvoi, c'est-&-dire l'exclusion temporake ou dtifinitive de la
"famille" monastique, Ies punitions et gratifications sont faites en fonction de la hidrarchie
interne, p w e indhiable de sa grande port&. Or le mode de classement des eres est
directement inspin5 par la division mBdiMe des &es : en effa la hihrchie tripartitepueri-
i~iores-enioredpriores, M e qu'tvoquCt dam la rPgle clo saint &noit et les coutumiers,
rappefle la division tripartite des @pen'-iuuenes-series. La similihde du vocabulaire n'est
pas l'unique fhcteur de rapprochement, II y a identit6 structurelle, ce qui veut dire que le
premier ensemble a ado* la stnrtun du second ; les tapports des fibs entre eux tappeknt
singuli&ement les rapports en* les groupes d'8ges ; et enfin, les pwri du m o d r e sont
des enfants, tan& que les iuniores sont presque exclusivement des jeunes.
Cette organisation monastique sur le rndele des classes d'aes perdit po-t de son
importance au fil du XIC sikcle par suite du d6veloppement parall&le de trois phinomenes.
Premikement, une autre forme de division, bas& celle-ci, non pas sur l'anciemet6, mais sur
le statut ecclesiastique (avec les lacs s'opposant am clercs et, pami ces demiers, les p&es
se distinguant des &acres), joua un r61e grandissant dans le quotidien des Wres.
Deuxiemement, rent& massive de convertis adults et la mise par 6crit des coutumes pour
former ces demiers firent en sorte que les rapports entre les f i b s ne se conform&ent plus
au modde familial, avec les seniores/priores agissant cornme des ah& ou des peres, envers
les iuniores et les edauts : du pnkepte a seniores uenerme, iuniores diligere m, qui permettait
de fsire face B toutes Ies situations non pdvues par la dgle, les moines btaient passis B des
relations plus institutiormalisees, qu'expliquaient les dglements trk d6taiUb des coutumiers.
D'ailleurs, meme l'abbe n'dtait plus vraiment le "ptrc" de ses fils : I'abbC de Cluny h i t
devenu le "seigneur" de 1'0rdre et des prieurs dirigeaient h sa place les communaut~s. Or,
un prieur n'est pas inamoviile : iI ne prend pas le powoir a vie ; par conskpent, il peut plus
difficilement Otre identifie ib un @re1. Ceci nous amhe au troisieme facteur qui influa sur
I'organisation interne des monast&es. Le d6veloppement de l'ordre clunisien au fil du XI'
I . Les Cisterciens modifi&ent cme structure clunisicnne d'un seul wai pett paw unt constellation de communautCs, mais Ieurs abW n'&tiat pas &vantage les ptzzres famificaum dessinb par Benoit puisqu'ils pouvaient Etre ddcharg& de lcurs fomtions sur dkcision du Chapitre G & W Sur Ie d & h du pouvou abbatial au XIIe si&cIe, cf. G. CONSTABLE, The Authority of Superiors in the Religious Communities m, dam L a norion d Xmorird au Moyen-Age: Islam, Bpance, Occident, (CoIIoques intemationaux de la Napoule, 23-26 oct, 1978) Paris: PUF, 1982, p.189-210 (article repris dans Id, Monk Hermits and Cmsaders in Mediial Europe, (Variorum Reprints, 273) London: Variorum Reprints, 1988, chapitre III).
sikle entama sdrieusement la structurr M d e des abbayes en leur imposant une
fllperstructure. A M , 1'6cIatement des murs de l'abbye, I'entrCt de nombreux individus dCj&
mh, la transformation de l'image du Supcrieur et l'imposition de &dements Venus d'en
but, sont autant de tacteuff qui concoururent h miner la conception ~ ~ c t i n e du
momsthe, ih savoir m e f d e regroupant &ts, jeunes et anciens (jeunes et view), les
danik veillant patetneflement sur les deux autres groupes.
L'observation de l'organidon monastique du point de vue du discours sur I'&e m'a
en outre amen& ii dviser quelques id& toutes S t e s sur le monast&e m&Wval. J'ai ainsi
dimontd que les edimts n'avaient pas voix au Chapitre : m e telle intervention aurait W tout
5 fait contraire ii la lt5gislation monastique. Encore plus important, j'ai expiique pourquoi il
n'existait pas de noviciat a Cluny avant la deuxi5me moitie du XIe sDcle, mal@ la
recommendation de Benoit dam sa RZgle. Il faudrait v6rifier le fait pour les autres
communautis du ~ o ~ e n Age central mais il est fort probable que le cas clunisien repdsentat
la norme et non l'exception.
Pour Ies moines de l eu ordre, mais aussi pour les hommes de 19ext&ieur et pour la
podrite, les Clunisiens ont n5dig6 esentiellement deux types d ' k i t s : des coutumiers et des
Vitae. C o m e les Iignes pr6ckdentes l'attestent, les premiers font m e grande place awc
groupes d'ige, soit directement, lorsqu'ils parlent des enfants, d s iuuenes sub czcstodia et
des vieillards de I'infimerie, soit indirectement, lorsqu'ils Cvoguent les rapports iuniores-
seniores/piores. Ceci est encore plus vrai des Virae : les auteurs n'oubli&rent jam& de
parler des @es. Certains d'entre eux choisiit mCme de se distingucr de lem pnkitkesseurs
sur ce seul sujet, comme ce fut le cas pour Hildebert vis-a-vis de Gilon. Surtout, le f i t que
les auteurs clunisiens aient choisi de parler d'eux-mCmes et de leur spiritualit6 sur la base de
dcits de vie n'est pas gratuit Dans Ies Yilae, la progression du hdros au fil de son existence
est rythm6e par sa progression spirituelle mais 1'0x1 pourrait tout aussi bien dire que son
progds sur Ie chemin de la vertu est fqomd par les &ges qu'il traverse : les deux formes de
cheminement sont indissociables, ce qui rejoint parfatement ce qui vient d'etre dit sur les
principes regissant l'ilt5vation le long de l'echelle hi6rarchique. Pendant l'enfance, le saint
est deait comme un simple W t a c l e passif sur laquel agissent les parents, Dieu ou ses
-tres. Pendant la jeunesse, il est m o d h&ant, se chachaat, faisast front aux tentations
Cette progression t&s rapide s'intenompt findement et l'hagiographe f ~ t atteindte la
perfection & son h h s en m h e temps qu'il le f&t sortir de la jeunesse* Le discours sur le
rapport en= les 8ges a la saint& n'est pas d e m e n t don& aa le mode positif: la saintetd
se mesure Wement & l'aptitude d'un individu & Cvita les Ccudls de c b dcs &es. Ainsi,
pendant l'enfice, le saint ne doit pas fithe prmve de la 1 d g M des pen' ; pendant la
jeunesse, il sait dominer 1 s pulsions de son corps et le desir du jeu, ii la diffCrence de tous
ses compagnons ; dam la grande vieillesse, il ne profite pas de la diminution de ses forces
pour restreindre ses activites et hisser sa pi6t6 se refioidir. Les ages d6finissent ainsi
positivement et negativement le cadre dam lequel le saint se meut. Ceci illume encore et
toujours la place primordiale faite a m 5ges dam I'imasinairp clunisien.
Il existe un tEme que je ne m'attendais pas ii traiter outre mesure et qui est apparu
comme fondarnental au fur et i mesure qu'avanpit ma recherche, B savoir la place du corps
dam I'imaginaire monastique2. Priciskment parce qu'il devait etre nid, il &it directemeat
ou indirectement l'objet des pdoccupaons des auteurs. Le traitement des trois gges par Ies
moines clrmisiens est indissociable de leur perception du corps de chacun de ces tmis tiges.
Le seul sur lequel il h i t possible de librement discourir, que la plume monastique pouvait
dessiner P loisir, h i t celui du vieillard. Pourtant, ce choix lit&aire doit etre q l d dans son
contexte : tan& que les senilia membra du vieil abbe saint dtaient d h i t s avec tendresse par
les hagiogrsphes, les coutumiers nous apprennent que les moines seniles qui dtinaturaient le
be1 ensemble des troupes angdliques des e r e s devaient Stre relkgu6s loin du choeur, dans
l'infirmerie et & l'kglise Sainte-Marie. Le corps du jeune inquiCtait car, avec sa beautti, sa
force et, surtout, son &sir, il powait attirer le moine vers les c h e h du sikle. Les
'. Sur le fait que les historiens ont trop peu h d i 6 le corps jusqu'g maintenant, particuliiirement sa perception, son rapport avec Ies Qes et le contrde exercd sur lui par Ie pouvoir, cf. R PORTER, History of the Body a, dam New Perspectives on Hisrarical Writing, rid. P. Burke, Univ. Park (Pa): Penn State Press, 1992, p.223-25.
eglements monasti~ues insistent donc sur la nhs i t& d'exercer me tds stricte surveillance
sur le jeune pubhe pour lui apprendre A dominer sat chair. En outrr, un idCal de beaut6
d B h t de celui des hNcs, ott la jeunesse n'Ctait plus @re un atout, Ctait offkt ; enfin la
grourim (de l'esprit mais aussi a surtout des gestes) Ctait fortement carnurag&. Le corps de
l'enfant bdficiait de soins vigilants du f ~ t de sa fiagilie mais les adultes devaient
6galement le fuit pame qu'il p o d &re un objet de d* : la relative mdfiance des moines
I'egard despueri ne peut se comptendre sans tenir compte de la menace que repdsentait
le corps pd-pubh clans un monde d @ o m de femmes.
Ainsi, le discours sur le cycle de vie est indissociable de celui sur le corps, et les dew
occupent une place importante d m les h i t s clunisiens. Or l'un et l'autre h n t trop
longtemps ignonk des Specialistes du monachisme rnddi&al et, plus largement, des
historiens de I ' E ~ I ~ S ~ occidentale. J'ewre que cette thkse tkmoignera de l'inti& que
collstitue leur 6tude.
Les abfiations u t i W daas lc corps de h t h h pour dbigner les oeuvres fXquemment citks sont inscritts entre crochets, aprh le the,
AMlard, mtoria Calamitutm, texte critique et intro. par J. Monfiin, Paris: Lib. philosophique I. Vrin, 1978.
Benoit d' Aniane, Concordiu regul~rrmt, PL 103, coI.70 1 - 13 80.
&noit de Nursie, Lu Egle de Saiirf Benoit [RBI, intro., trad. et notes par A. de Vo@& texte ktabli par J. Neufiille, 2 vol., (SC 18 1-82) Paris: &. du Cerf, 1972.
Bernard de Cluny, Ordo clrmic~censik [Bern], ed. Marquard Herrgott, Vetus disciplha monastics, Paris: Osrnont, 1726, p. 134-264.
Biblia sacra itrrcta wigatam versionem, Cd. R Weber, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschafk, 1983 (3' 6d. corr.)
Bibliotheca CIrmiacensis [Bibl. Clm.], 6d. MI Marrier et A. Duchesne, Miicon: Protat, 19 1 5.
Cassien, Iiinciom ~Pnobitiques, texte, intro., trad. et notes par LC. Guy, (SC 109) Pan's: ~ d . du Cerf, 1965.
Chronologia abbatum cluniacensium, BibL Cim, col. 16 1 7-28.
Constitutiones Hirsaugremes seu Gengenbacenses, PL- 1 50, ~01.923- 1 146.
Consuetudines Chiacensiutn antipiores aim redactionibus derivotis [CAI, Cd. K. Hallinger, Collsuetudinwn s a e d i X-M-MI mommrenta, n, (CCM 712) 1983, p.3- 150.
Conruetudinesfloriocensec antiquiores [Flew], Cd. A. Davril et L. Donnat, (CCM 7/3) 1984.
Corpus glosso~iort(m latinom, 6d. G. Goeg 7 vols, Liepzig: B.G. Teubner, 1888-1923.
Coutumier clunisien de Maillezais, Cd. J. Bequet, a te coutumier clunisien de Maillezais m, R M 5 5 (1965): 3-3 1.
The Customary of the Benedictine Abbey of E ~ h a m in oxfor&hire, Cd A. Grandsen, (CCM II) Siegburg: F. Schmitt, 1963.
Eadma tie CantorMry, The L@ of St h e l m , Archbirhop of Canterbiqy. 6d. et trad. RW. Southern, Odord: CIarendon Press, 1979 (1972).
, Li'ber de sancti Anselmi similitudinibus, PL 1 59, co1.605-708.
Em& SchaIostic Co@+es, dd. WH. Stevenson, (Medieval and Modem Studies, 15) Oxford: Clarendon Press, 19 129.
Eudes de Saint-Maw-des-Fo& Vita d o m i BwcOrdi venerabilk comitrfs, VXe de Bouchord le Yinhrabfe, comte de V i , clr CorbeiC de MeZm et de Parir (P et XT si8cIes) In], Cd. C. B o w l de Ia Roocibe. (Collection de textcs pour sewir 1 l'enseigncmtllt de l'histoice) Paris : Picad, 1892, p. 1-32. - Trad. (h partk du mauscrit Paris BN U12618, qui est urn copie d'me c4pk (Paris BN lat'12614) du manuscrit le plus ancica, Paris BN 1at.3778, util*C pour 1'6dition) : M. Guizot, Coflection clar Mimobes r e l m 6 I'IT~storie de France, tome W, Paris: Librairie B r h , 1825, p.3-28.
Gauther d'oydes, Vita SAnastmii, month SMichaelis monachi, Pz 149, ~01.423-36. - Trad.: E.-A. Pigeon, Vies des saritts du d i d s e de Coutances et Avranches mec des Notions prkIiminaires et l'hbtoire des reZi@ues de chaque saint, t.II, Avranches: Imp. A Perrin, 1898, ~348-56.
Gilon de Toucy, Vita Hugonis cluniocenrir ubbatk [m, Cd. Herkrt EJ. Cowdrey, a Two Studies on Cluniac Hisbry : I. Memorials of Abbot Hugh of Cluny (1049- 1 109) n, Studi Gregoriani, XI (1978): 45-109.
Guibert de Nogent, Autobiographic, dd. et trad- E.R. Labande, Paris: Les Belles Lettres, 198 1.
Guigues la, prieur de Chartreuse, Courzunes de Chmtrewe, intro., texte, trad. et notes par un chameux, (SC 3 13) Paris: fd . du Cerf, 1984.
Guillaume de Saint-Thierry, Lettre atafiLres du Mont-Dl'eu : Iettre d 'or, texte, intro., trad. et notes par J-M. Wchanet, (SC 223) Paris: &i. du Cerf, 1975.
Gr6goire Le Grand, Dialogues, texte critique et notes A. de Vogii6, trad. P. Ant in, 3 vols, (SC 25 1, 260 et 265) Paris: b. du Cerf, 1978.
Hildebert de Lavardin, Vita sancti Hugonis ubbatis [KIP], PL 1 59, ~01.857-94.
Hildemar, Elrpositio regulae [Hifdemor], dd. R Mittem filler, Vira et regula SP. Benedicti untl curn expsitione reguIae ab Hildenmo trudita et nunc primurn typis mandata, RatisbonneNew YorKincinnati: F. Potet, 1880.
Honorius Augustodunensis, L 'EZucidarium et les Iucidaires, Cd. Y. Lefevre, Paris: de Bocwd, 1954.
Hugues de Goumay, Epirtola de vita sancti Hugonis abbath [VN"" Ep.], dd. Herbert E.I. COWDREY, a Two Studies on Cluniac History, 1046-1 126 m, Studi Gregorimi, XI (1978): 1 13- 17.
, Yiro s d i Hugonis abbatis [m, id. Herbert E.J. COWDRM, Two Studies on Cluniac History, 1046- 1 126 *, Studi Gregoriani, XI (I 978): 121-39.
H u m de Saint-Victor, Didmcdicon -Do S ' o Legendi. A Critical Tw, dd. C.H. Buttimer, (Studk in Mcdicval and Renaissance Latin, X ) Washington: The Catholic University of America Press, 1939. - Trad.: D~ccrf icon, intro., tnd. a notes par M. Lcmoinc, Paris: I%. du CerflL99 1
Hugues de Semur, Epbrola beati H ionk ~ctirnoniaIibus tr411~~bsa @ Mmciniacwn Domino semientibus w, Bibl.CIun., ~01.491-98.
H. ( j 'Hdl imus) , Kta Oclonis [Vm, Cd. MIL. Fini L'Editio minw d e b " Vitan di Oddone di Cluny c gli apporti delPHmiIZi~t~~. Tcsto critic0 e nuovi orientamenti W, L 'Ar~hi~nnario - BoIIetmo deIZa BibIiotca comnnmale di Bologna, 63-65 (19684970): 208-59.
Idung de PrJfening. Dialogus duwum monachorun, Cd. R.B.C. Huygens, Le moine idung et ses dern ouvrages : r Argwnentum super quatuor questionibw et r DiaIop duorum rnonachonmt 0, Spoleto: Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1980. - Trad.: Ctctercio~ts md C I m i ~ u : The Cmefor Citeam -A Dialogue between Two Monks : An Argument on Four Questions by i ' g of PriijZenrirg, Kaiamazoo (Mich.): Cistercian Publ, 1977, p25-141,
Initiu consuetudinnir benedictinae. Cometudines saemIi octavi et noni, 6d- K. Hallinger, (CCM I ) 1963.
Isidore de S6ville, Isidori WipaIensb epikcopi EtymoIogiarurn she originum Librim, tid. W.M. Lindsay, 2 vols, Oxford: Clarendon Press, 1957 (19 1 I). -Nouvelle Cdition et traduction : ~tymo~ogies, dd., trad. et notes M. Reydellet, Paris: Les Belles Lettres, 1984.
Jean Cluysostome, Sw la V i e GIoire et I 'Pducation des enfmts, intro., texte critique et trad. Anne- Marie Malingrey, (SC 188) Paris: &I. du Cerf. 1972.
Jean de Fnfttuaria, Tractatus de ordine vitae et m o m institutione, PL 184, co1.559-84 (introduction : PL 147, col.477-80).
Jean de Salerne, Vita sancti Odonb ubbath [VO1], PL 133, co1.43-86. - Trad.: G. SITWELL, St. Odo of CZuny. Being the L#ie of St. Odo of CZmy by John of SaZerno ond the Lfe of Sf. Gerald of AwiIlac by St. CMo, New York: Sheed & Ward, 1958, p.3-87.
Jotsaud, Epitqphim ad sepuZcmm domni Odilonis [EOil, Cd. E. Sackur, HandschriAliches aus Frankreich. I1 zu Iotsaidi Vita Odilonis ID, Neues Archiv, 15 ( 1 890): 123-26.
, PIanctus de fransiihr suncti Odilonis [PO& 6d. F. Ermini, a 11 pianto di Iotsaldo per la mode di Odilone *, Srudi MedievaZi, 2 (1928): 40 1-05.
, De Vita er uirtutibur smcri Odilonis abbatis [VOI'], PL 142, col. 897-940. - 2 chapitres manquants de cette Vita [VO$ Sackur], Cd., E. Sackur, a Handschriftliches aus Frankreich. II zu Iotsaldi Vita OdiZonis m, Neues Archiv, 15 (1890): 1 18-2 1.
Lanfianc de Cantorbe'ry, Decrefu hfianci monachb cantuariensibur transmissa [Lonfianc], ed. D, Knowies, (CCM3) 1967. - Td: Lm#am's Monastic C o ~ o o n &the Anoqymous me Iitmction of the Novices",
et trad. David Knowles, (Medieval Classics, 2) London: Thomas Nelson & Sons Ltd, 1% 1.
Liber tramitis a d Odilonis abb- [LTJ, &L P. Dintcr? (CCM 10) 1980, p.7-287.
Ndgod, Vita s ~ i Maioli abbatis [w, AS, Mai II (1680). 658-68.
, fita Wonis reformata [ V ' ou V P PL], PL 133, ~01.85-104. - Nouvelle ddition, mais partielle [V@ Finfl, par ML. FINI, a Studi sulla Vita Odonis reforrnata" di Nalgodo. 11 Wentum mutilwn del codice latino N.A. 1496 della BN di Paris ., Redconti dell;4ccademia di Scienze dell'lslituto di Bologna. C h e di scienre m o d i @ologna), 6312 (1975): 134-47.
Odilon, Epitqhim dome Adafheide mguste [m], d. Herbert Paulhart, Die Lebensbeschreibung der ffiikertir Adelheid von Abr Milo von CItmy, dans Mirteilmgen des Insfittits Jiir 6sterreichkche Geschic~orschungg Ergtingnmgsband XX 2, GdCSln: H, Blihlau, 1962, p-27-45.
, Eta beati MaioZi abbatis [KM"], PL 142, ~01.943-62.
Odon de Cluny, De vita sancti Geraldi cornitis Autiliacensis I [ V ' ] , PL 133,639-704. -Plus un &it de miracle, RB, 34-35 (1915-16): 260. - Trad.: G. Sitwell, St. Odo of Clrmy. Being the ti$e of St. Odo ofClmy by John of SaIemo and the Lije of Sf- Gerald of AuriiIac by St. Od', New York: Sheed & Ward, 1958, p.90- I 80. - Trad.: G. Venzac, a Vie de saint Ghud, comte d'Aurillac a, Revue de la Hmte-Awergne, 43 (1972): 220-322.
fie Paradefe Statutes Institutiones nostrae, Troyes. Biblioth&que MmicipIe? Ur 802. fi89r990v, intro, texte et notes par Chrysogonus Waddell, (Cistercian Liturgy series, 20) Kentucky: Gethsemany Abbey, 1987, p.9-15.
Philippe dc Novame, Des AZU tenz d 'ages d 'one (Les Quatre Ages de Z 'Homme - Trait6 moral de Philippe de Nmarre, dd. M. de Fdville, Paris: F. Didot & Cie, 1888
Pierre Darnien, Vita sancti Odifonis [VOtp], PL 144, co1.925-44.
Pierre le Vdnkable, Petri Chiacensis abbaris. De miracuiis libri duo [DM, &I. D. Bouthillier, (CC CM, 83) Turnhout: Brepols, 1988. - Trad.: Livre des merveilles de Dieu (De Mramf), trad. J.-P. Torrell et D. Bouthillier, (Pen& antique et midiivale) Parifiribourg: b. ~niversitairedd. du Cerf, 1992.
- , me Letters of Pefer tk Yenwabie [Uv, 0 , htm. et notes G. Constable, 2 vol., Cambridge (Ma): Harvard Univ, Press, 1967.
Raoul G l a k , Viadonmi WiDefrniabbath [VWJ, 66 N. Bulst, dam RodirZfi Glaber, -ro7 a. J. France, (Word Mcdievd Texts) Oxford: Clarendon Ress, 1989, p.254-99. - Trad- : ibid"
- , Iiiion'anan Libri p n p , &I. N. Bulst, J. France a P. Reynolds, (Oxford Medieval Texts) Oxford= Clarendon Press, 1989. - Trak ibid - Autre idition re'ccnte : Cronache dell'unno M2.e : S'orie, dd. G. Cavatlo et G. Orlandi, (Scrittori greci e latini) Milano: Fondazione Valla, 1989.
Recueil des chortes de I 'abbaye de CIuny [CCU], id. A. Bernard et A. Bruel, 6 vol, Paris: Imp. Nationale, 1876-1903.
lu Regle du &itre [w, intro., texte, trad. et notes A. de VogE, 2 vols, (SC 105-106) Paris: &. du Cerf, 1964,
Les Rggles des saintsp&s, texte, intro., trad. et notes par A- de Vogud, 2 vols., (CS 297-298) Paris: ~ d . du Cerf, 1982.
Renaud de V&elay7 Vira smrcti Hugonis abbaris (en prose) [m, dam VizeIiucensia E - texres rehrjrs ri I'histoire de l'ubbaye de V&elay, Cd. RJ3.C. Huyghens, (CC CM, 42. Supplementum) Turnhout Brepols, 1980, p39-60.
, Eta sancri Huganis abbotis (en vers) [m, dans Viseliacemia 17- rates relar* ci I'hisroire de I'abbaye de V M . Cd. RB.C. Huyghens, (CC CM, 42. Supplementum) Tumhout: Brepols, 1 980, p.6 1-47.
Sm Leanclto, Sm isidom, Smr FIUCIUOSO, Reglar mondsticas de la E s p h visigoda - Lar hes libros de Z' "Senrenciar", a, J. C a m p Ruiz et I. Rocca Melia, (Santos Padres Espailoles, 11) Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 1971
Sfatuts, chapitres ge'ne'raux et visites de I'ordre de CIuny, i d . G. Charvin, 6 vols., Paris: hi. de Boccard, 1965-73.
Sulpice S&&e, Yie de soinr Mrin, intm, t e e et trad. par J. Fontaine, (SC 133) Paris: &I. du Cerf, 1967.
Sym, Vita sancti Maioli B.BL 51 79 [m, Cd. D. Iogna-Prat, Agni immacuIati - Recherches sur les sources ha@iogaphiques relatives ri saint MoimI de CIuny (954494). Paris: ~ d . du Cerf, 1988, p. 163-285.
Ulrich & Cluny, AntiQuioau eollsueludmes rnonmterif CIuni'ensis [ U i . ] , PL 149, co1. 63 5-778.
Vita SBaboIeni a b b e Fmsaterr~is [YBo], Cd. P.-F. Chiffiet, Bedae prPsbyeri et Fredegmii schoI~~~fiki W I U : O ~ & Paris, I68 1, p.356-71.
Tila smcti Gerufdi cornitis Azmi'Iiacemils II [ V q , Cutd. Pmlr, vol.II, 1890, pB2-4Ol. - T r a m i ~ de la YIa anonyme dc G h u d d'Aurillac [V(3 T r 4 1 1 ~ i . J ~ Cd. V. Fumagdli, a Note sulk a Vita W d i di Oddone di Cluny v, Bdletino deU%tituto storico italimo pv il medio evo, 76 (1964): 235-40, -MaCICUIuposl mortem de la Vita anonym de GCnud d'Aurillac [Vff Bouange], Cd. G.-MtF. Bouange, Hiitoire de I'dbqye GAunik prPci!de'e de h vie de saat G i r d son fondatetcr, tome I, Paris: h. Albert Fontemoing, 1899, p370-97.
Vita smcti Hugonij par l' Anonyme II [yHn], BibLCIm., ~01.447-62.
Vita beatae Ihe [a, PL 155, co1.437-48.
Yira breziior sancti ac venerabik Maioli abbatis [ V M J, BibLCIm, col. 1 763-82.
Yilo Odonh (Cpitornt5) [ V ' ] , i d . M.-L. Fini, L'Edilio minor della a Vita di Oddone di CIuny e gii apporti del1'HlonIllimu.s. Testo critic0 e nuovi orientamenti m, L 'Archiginnmio - Bollerino deila Bibliofeca comrnunaIe di BoIogna, 63-65 (I968- 1970): 208-59.
BIBLIOGRAPHIE SUR LES AGES DE LA VIE AU MOYEN AGE
Il n'existe pas de bibliographic sur Its Pger de la vie au M o p Age ; j'ai donc jug6 utile d9indrer dam ma thLsc celle dont je me suis semi pour rrw*ller, aussi incomplh soit-elle. Pour bien compmdfc k tr'aitement et la percepttton deo ages au Moyen Agey il faudmit ajouter cette liste d'autres Ctudes, d'une part sur le b a p h t , le mariagt, le veuvage et la mort, d'autre pact sur la ddmographie, la mddecine, la transmission du patrimoine a la structure familiale. Ces dB6rents th8mes Jont Cvoqu6s ci-dessous mais occasionnellement.
ABELES, Marc et Chantal COLLARD, Cd., Age, pow& et sociitt! en A f i i q e noire. MontrcWParis: Presses de l'univ. de ~ o n t d a l h l . Karthala, 1985.
ABRAHAMSE, Dorothy, a Images of Childhood in Early Byzantine Hagiography m, p H , 6 (1979): 497-5 1 7.
Les liges de Iu vie, Actes du We colloque national de ddmographie, Strasbourg, 5-7 mai 1982.2 vol, Paris: PUF, 1983.
Les iiges de la vie mr Moyen Agey Actes du colloque du Dipt dY~tudes mCdi6vaIes de I'Univ. de Paris-Sorbome et de'IYUniv. Friedrich-WilheIm de Bonn, Provins, 16-17 mars 1990, dir. H. Dubois et M- Zink, Paris: Presses de 1'Univ. de Paris Sorbo~e, 1992,
Aging md the Ages in Medieval Europe, dd. Michael M. Sheehan, (Papers in Mediaeval Studies 1 1) Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990.
Aging and Lfe Come Transitions -An Interdisc@iinary Perspective, Cd. T.K. Hareven et K.J. Adams, New York: Guilford Press, 1982.
AGRIMI, Jole et Chiara CRISCIANT, a Savoir mddical et anthropologie religieuse. Les reprkentations et les fonctions de la vetula (XlP-XVC sikle), Annales ESC, 5 (sept.-oct. 1993): 1281-1308-
ALBN, G, 8 L'Assistenza a1l'inf;pnzia nelle c i u dell'Italia padana (seccXII-XV) m, dam Cittci e s e ~ i r i suciali neII 'M ia dei secoliX&Wy XnO convegno di studi di storia e d'arte, Pistoia, 9- 12 ottobre 1987, Pistoia: Presse la Sede del Centro, 1990, p.115-40.
ALDUC-LE BAGOUSSE, A., a Un problhe de pal6od6mographie : la mortalit6 des jeunes en Basse-Normandie au Haut Moyen Age B, dam Recueil d'ehrdes ofert en hommage b Mchel de Boiiard Annales de Normandie, 1 (1982): 3- 14.
ALEXANDRE-BIDON, Dan&, LikaCs et contraintcs dans l'bducation des jeunes enfants H la fin du Moyen Age m, dam fiber& mr ~ o y e n ige, Acts du P Festival d'Histoire de Montbrison, 1986, Montbrison, 1987, p241-52-
- , Du drapeau la : v&r au Moyen -XY s.) m, dam k vi2ement. Hhtoire. ~~~~he'oIoogie et syinhligue vatbnontorks au Mioyen&, (Cahicrs du Ldopard d'Or, 1) Piuis: Le IRopard d'Or, 1989, p. 123-68.
- ; La v o l k Appmdn i lire au Moym Age v, Annules E X , 44 (1989): 953-92-
, A tavola ! Les rudiments de I'Cducation des enfants italiens A la fin du Moyen Age et au X W sikle V, dans Chranipes i t d i m e s n022/23, Pan's: Presses Universitaires de la Sorbonne Nouvelk, 1990, p.8-34.
- , a Grandeur et renaissance du sentiment de l'enfance au Moyen Age V, dam kducations me'die'vaIes, op.cit-, 199 1, ~3463.
ALEXANDRE-BIDON, Danide et Monique CLOSSON, L 'enfmt ci I 'ombre des cathtfdraies, Lyon/Paris: Presses Univ. de LyodCNRS, 1985.
AMUNDSEN, D.W. et CJ. DIERS, The age of Menarche in Medieval England my Human Biology, 45 (1973): 363-69.
ANDERSON, Michael, Approaches to the History of the Western Family, 15004914, London: MacMillan Press, 1980.
ANGERS, Denise, a Vieillir au XV sikcle : a Rendus * et retraitds dam la region de Caen (1380- 1500) v, Frmcia, 16 (1989): 1 13-36.
ARANGLREN, I, Posiciones de Bernardo de Claraval ante la opci6n monhtica de 10s j6venes v,
Cl'sercium, 42 (1 990): 227-4 1.
ARCHAMBAULT, Paul, a The Ages of Man and the Ages of the World: A Study of Two Traditions r, Revue des e'tudes augurtiniennes, 12 (1966), p.193-228.
ARIES, Philippe, L 'enfmt et la vie fbrniide sour 1 'Ancien Re'gime, Paris: Seuil, 1973.
, Hiistoire des Popfationsfian~aises et de leras attitudes dmant la vie depuis le AKQZe siicle, Paris: Seuit, 1974.
Essais sra I 'histoire de la mort en Occident du Moyen Age ir nos jours, Paris: Seuil, 1975.
,a The Family and the City *, DaedaIw, 106 (1977): 227-35.
Arme und Reiche - Studien am der Geschichte der Geselfschoji und der Kulrur. BonisIaw Geremek 60. Gebwtstag gewidmet, Varsovie: Paristwowe Wydawnictwo nakowe, 1992.
ARNOLD, Klaus, Kind und GoselLrtlnJP in Mittelalter rad Ren&sance. Beihdge w d T a e M Geschichre der dGdbeit, Padehorn: Ferdinand Schthingh, 1980.
-, Kindheit im ~ ~ t ~ p g i s c h e n Mittelalter m, dans Ztn Soti'lgeschichte der Kindheit, dd. J. Martin ct A. Nitschkc, Miinchen: ICA. Freiburg, 1986, p.443-67.
ATKINSON, Clarissa W, lk Oldkt Vocatibn : Chrktim Motherhood m the MMie Ages, Ithaca QLY.): Come11 Univ. Press, 199 1.
AUTRAND, Franpoise, a La force de I'gge : jeunesse et vieillesse su sewice de 1'~tat en France aux XIVr et W s i k I e s V, Comptes renib de I Xcd6rnie des 1mer';Ptions er des Bell' Leftres, 1985: 206-223.
AXELSON, B, a Die Synonyme adulescens und iwenis m, in MkIanges de phiIoIogte, de litte'rature et d 'hihtoire mciennes, o f f i h J. Marouze~~~(por ses colltgues et e'lhes e'trmgers, Paris : Les Belles Lettres, 1948, p.7-17.
BACCETTT, M, a Vecchi e Giovani nella Regola di S. Benedetto m, Rivista di ascetica e mistica (Fireme), 7 (1962): 458-82.
BACHRACIE, Bernard et Jbome KROLL, a Monastic Medicine in Pre-Crusade Europe : The Care of Sick Children w, dans me MedievalMonczstery, dd. A. blackish, St, Cloud (Mi.): North Star Press of St. Cloud, 1988, p.59-63.
BAILBE, J, Le t h h e de la vieille femme dans la Wsie satirique du seizitme sitcle et du ddbut du dix-septikme sitcle v, BibliothGque d 'Humanisme et de Renaissance, XXV ( 1 964): 98- 1 19.
BALANDIER, Georges, Anthropo-Iogiques, Paris: PUF, 1985 (2' 6d.).
BAMBECK, M, Puer et puella senes bei Ambrosius von Mailand. Zur altchristlichen Vogeschichte eines literarischen T o p m, Rornunikche Forschvngen (Ftankfitrt), 84 ((1972): 257- 3 13-
Bambini santi - Rappresentazioni dell 'injanzia e modelli agiograjki, dir. A. Benvenuti Papi et E. Gianrrarelli, Torino: Rosenberg et Sellier, 199 1.
BARBERO, Alessandro, Un smto in foniglia - Vocazione religipso e resistenze sociali nell 'agiografia latinu medievole, Torino: Rosenberg & SeIlier, 199 1.
BARON, Hans, a The Year of Leonardo Bruni's Birth and Methods for Determining the Ages of Humanists Born in the Trecento V, S~~ S Y 2 (1977): 582625.
BARTLETT, R., . Symbolic Meanings of Hair in the Middle Ages m, Transactions of the Royal Historical Society, 6' sdrie, N (1 994): 43-60,
BAUMSTEIN, P., Benedictine Education : Principles of Amelm's Patronage m, American Benedicriite Review, r'ew, (1992): 3- 1 I.
BAVOW P, Enfaats trow& et orphelins du X W au XW s. P Paris v, dam Rssktmce ez ussi~tths jtlsqu? 1610, Actes du 91. Con@ national des SociCtCs Savantes, Nates - 1972, Paris: Biblioth&pc Nationale, 1979, p359-70.
B-R, P.T.W. et U. ALMAGOR, td, Age. Generation cmd Time - Some Features of East- African Age Ckgmizatrbn, Londar: C. Hunt, 1978.
BEAUVOIR, Shone de, La vieillesse, Paris: Gallimard, 1970.
BEER, Mathias, EItern Mld Kinder des spliten Mittelalters in ikren Briefen- FamiIienleben in der Sta& des SpPQtmittelaIters md detjhihen Neureit mit besonderer Beriicksichtigung NNtanbergs (I4004550), (Schriftemihe des Stadtarshivs Nflmberg, 44) Niimberg: Stadtachiv, 1990.
BEITSCHER, Jane K, "As the Twig is bent..": Children and their Parents in an Aristocratic Society *, JMH, 2 (1976): 18 1-9 1.
- ,a The Aged in Medieval Limousin m, dam Profeedigs of the /Fourth] AnnuaI Meeting of the Western Society for French History, Ld. Joyce Duncan Falk, Santa Barbara (CA): Western Society for French History, 1977,4542.
BEN-AMOS, IIana Krausmann, Adolescence and Youth in Early Modem Englund, New Haven: Yale Univ. Press, 1994.
BERICVAM, Doris Desclais, Enfmce et matemite! clms lo Iitt&we fian~aise des XIP et XIII siccles, (Coll. Essais, 8) Paris: H. Champion, 198 I .
BERLERE, Ursmer @om), a Les Oblats de saint Benoit au moyen fige v, Rb, 3 ( 1 886-87): 55-6 1 , 107- 1 1, lS6-60,209-20 et 249-55.
, holes claustrales au Moyen Age m, Bulletin de la Clase des tettres et des Sciences morales etpo2itiques de 1 Xcudimie royde de Belgiqre, 5. sCrie, 7 (192 1): 550-72.
, Le recrutement d m les monast2res b&nt!dictim aux J3T.P et X W sikles, (AcadLmie royale de Belgique, Classe des l ems et des sciences morales et politiques, vo1.18, fasc.6) Bnwlles, 1924,
BERLIOZ, Jacques, Masques et croquemitaines. A p r o p de l'expression a Faire Barb au Moyen Age m, dam Le Mode Alpin et Rhodonien. MClanges Charles Joisten, 1982, p 2 2 1-24.
- , a Le retour de l'enfance v, L 'Histoire, no 152 (1992): 10-1 1.
BERNARDI, Bemardo, I sistemi delle clussi d 'etii, Turin: Loesche, 1 984. Traduction : Age C h s System - Social Imtihrtions and Politics based on Age, (Cambridge Studies in Social Anthropology, 57) Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985.
- , 8 Age n, Dictionnaire de I'E'hnoZogie et de I'Anthropologie, dir. P. Boat6 et M. I& Paris: PUF, 1991, p31-33.
BERTHON, erk, Le sourire a m anges - Enfance et spiritualit6 au Moyen Age gt-We s.) IB,
MHi'ales, 25 (aoiit 1993): 93- 1 1 1,
BERTRAM), Ihniei A, 8 "Un Mtaa de vieillcsse", d propos de Tobit 5 3 et 10.4 (Vulgate) IB,
Revue d'hlroke et de philosophie reii@wse, 7 111 (199 1): 33-37.
BESSMERTNY, Y., La vvirion I mode et f 'hiktoire de'mographip en France ma LT-XP siPcies - Quatre lepm mr ColIgge de France, mars 1989, Par*: Les Belles Lettres, 199 1.
BEVERLEY-SMITH, Llinos, 8 Pmfs of Age in Medieval Wales r, Bullerin of the Board of Celtic Studies, 38 (1991): 13444-
BIUOT, C, = Les e-ts abandonnlF ii Chartres H la fin du Moyen Age n, ADH, 1975, p.167-86.
BLUMENFELPKOSINSKI, RENATE, Not of Woman Born: Representations of Caesarean Birth in Medieval and Renaksmce Culrwe, Ithaca (NY): Come11 Univ, Press, 1990-
BOESCH, Hans, KinderZeben m der deutschen Vergangenheit. Mit Abbildungen nach den Origrnden mu 15.-18. Jahrhundert, (Monogrqhien w daschen Kulrurgeschichte) Diisseldorfi Diederichs, 1979.
BOIS, Jean-Pierre, Hktoire de la vieillesse, (Que sais-je ?, 2850) Paris: PUF, 1994.
BOLL,, Frant. 8 Die Lebensalter : Ein Beitrag zur antiken Ethologie und nu Geschichte der Zahlen ., Neue JahrbticherjZir das klasskche Alterturn (Liepzig), XXXI (1 9 13): 89- 145. Nouvelle Cdition: dam F. BOLL, Meine Semen zur Sternkunde des Altertums, dd. Viktor Stegeman, Leipzig: Koehler & Amelang, 1950, p. 156-224.
BOLOGNE, MI, Lu narjsance interdite. Ste'n'Iite', avortement. contraception au moyen bge, Paris: 0. Orban, 1988-
BORIAS, A., Le moine et sa famille n, CoIlCist, 40 (1978): 8 1-1 10,195-217.
B~RST, Otto, AiItugsIeben in Mttelalter, Frankfbrt am Main: Insel, 1983.
BOSWELL, John, Expositio and Oblatio. The Abandonment of Children and the Ancient and Medieval Family n, Americm Historical Review (Wahington), 89 (1984): 10-33.
- , me Kindness of Strangers- fie Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissunce, New York: Pantheon Books, 1988.
BOULHOL, Pascal, a Le complexe de Melchisedech. Famille et saintetd dans I' hagiographie antique, des origines au Vl' sitcle n, Th&se pour le Doctorat, Paris IV-Sorbonne, 1 990.
BOURIN, Monique et RDbat DURAND, Kim uu viR'4ge mr yen Age. Les soZidan1h;spqsmnes du X1, au X I P sikle, Paris: McssidorK'emps actuels, 1984.
BRADLEY, Keith R, D i k c A g t k Roman Fmi& Studies rir Rowtan &cid Hitory, New York: Oxford Unk Pms, 1991.
BRISSAUD, YB, L'iafmticide la fin du Moyea b, ses motivations psychologiques a sa rZptesion m, Revue htnoriqw de h i t p a n ~ u t r et Phmger, 50 (1972): 229-56.
BRUNDAGE, J A , Impotence, Frigidity and Marital Nullity in the Decretists and the Early D e d i s t s *, Praceedings of the Seyenth Intemationaf Congress of M e d i d Crmon Law, Cambridge 23-27 jui1.1984, &I. P. Linehan, (Mononentu 1- Canonici series C, 8) Citti del Vaticano: BibL Apostolica Vaticana, 1988, p.407-23.
, Law, S a und Christian Society in Medieval Europe, Chicago: Univ. Press, 1987.
BUCKLEY, James Michael, a The Problematic Octogenarianism of John of Brienne P, Speculum, 32 (1957): 3 15-22.
BULLOUGH, Vem et Cameron CAMPBELL, a Female Longevity and Diet in the Middle Ages v,
Speculum, 55 (1 980): 3 1 7-25.
BURCHARDT GRAEFFE, htte, a The Child in Medieval English Literature fiom 1200 to 1400 *, (microfilm). Thesis (Ph-D), University of Florida, 1965.
BURROW, John-Anthony, "Young Saint, Old Devil" - Reflections on a Medieval Proverb *, Essays on Medievd Literature, OxfordMew York: Clarendon Press, 1984: 177-9 1.
, The Ages of M i : A Study in Medieval Writing md Zbught, Oxford: Oxford Univ. Press, 1986.
BURSTEIN, Sona R, Care of the Aged in England : From Medieval Times to the End of the 16th Century 8, Bulletin of the History of Medecine, 22 (1948): 738-46.
BURTON, A., a Looking forward fiom Aries ? Pictorial and Material Evidence for the History of Childhood and Family Life w, Continuity und Change, 412 (I 989): 203-29.
BYL, Simon, a Platon et Aristote ont-ils profess6 des wes contradictoires sur la vieillesse ? ., Les h d e s clossipes, XLW2 (avril 1974): 1 13-26.
CAMPBELL, Sheila, Bert HALL et David W S N E R , Cd., Health, Disease and Healing in Medieval C u b e , New York: St. Martin's Press, 1992.
CANARS, P, a Le Nouveau-n6 qui ddnonce m, AB, 84 (1 966): 309-33-
CAPUL, M, InfirmitP et hir& Les enfmtsplac& sour ZXncien RPgirrze, Toulouse: Privat, 1990.
CARMICHAEL, Ann G., a The Hcalth Status of Flomtines in tht FiCtecnth Century m, dans L& md Deuth in m k e n t Rorence, 66 M. Tctd, RG. Witt et R Goffen, Durham: Duke Univ. Press, 1989, ~28-45.
CAROZZI, C, = De I'cnfrcc i la d. hdcs d7ap& lcs vies de Umud d'Aurillac et d70don de Cluny m, dans ktudes sw la sensibilif6 au moyen ige, Actcs du l02e Congr& national des sociWs savanta. Lfmoges 1977. Philologie ct histoire jusqu'i 1610, I& Paris: Bibliothtque Nationale, 1979, p.103-16.
CARP, Teresa C., Puet senex in Roman and Medieval Thought v, OMUS US^ 39 (1980): 736-39.
CARPENTER, Jennifer, a Juette of Huy, Recluse and Mother (I 158-1228) : Children and Mothering in the Saintly Lile b, dans Power of the Wed- Shdes on Medieval Women, 6d. J. Carpenter et S.-B. MacLean, Urbandchicago: Univ. of Illinois Press, 1995.
CARRON, Roland, Enfmrt ef parent6 d m la France nPdiPvde ( F - . siMes), (Travaux d'histoire ethico-politique, XLIX) GenCve: Lib. Droz, 1989.
CARTER, John Marshall, Rape in Medieval England an Historical and SoeioIogz'cui Study, Lanhan (Md.): Univ. Press of America, 1985,
, Medieval Gumes : Sprts and Recreations in Feudai Society, New York: Greenwood Press, 1992.
CHAMBERLAIN, Alexander F., me Child and Chiidhood in Folk-thought (The Child in P rimitbe CuItwe), FoIcrofi (Pa.): Folcroft Library Ed., 1977 (1895).
CHEW, Samuel C., The Pilgrimage of Life, New Haven (Co.)lLondon: Yale Univ. Press, 1962.
CHOJNACKI, S., a Measuring Adulthood : Adolescence and Gender in Renaissance Venice my
Journal of Farnib History, 17/4 (1 992): 37 1-95.
CLARK, Elaine, cr Some Aspects of Social Security in Medieval England *, Journal of Family H'tory, 7 (1 982): 307-20.
, r The Custody of Children in English Manor Courts r, Lmu mrd History Review, 3 (1985): 333-48.
COCHELIN, Isabelle, a Y e cuer ouvrir et les iex clorren - Saintet6 et vieillesse aux MIt et X m siicles w, M h o k de recherche pdsentC en w e de I'obtention du DEA., UnivenitC de Paris IV- Sorbonne, 1989.
, a b senechrre bono : pour une typologie de la vieillesse dans I'hagiographie monastique des XIle et MIIe sikcles *, dans ~ e s Ages de fa Vie, op.cit., 1992, p. 1 19-3 8.
- , Compte nndu du livre de Michael GOODICH, From Birth to Old Age - The Humm Life CHe m M e d i d Zhwgh, 12504350 (1989), La roue hbtoripe, 576 (octdk. 1990): 47 1-73.
COFFMAN, G.R., a OId Age fiom Horace to Chaucer. Some Litefary Affinities and Adventures of an I d a v, Spectrlum, 9 (1934): 249-77.
COLEMAN, Emily R, a L'infanticide dam le h u t ~ o y e n Age ~,~nrurles BC, 29/2 (1974): 3 15-35. m i s i jour : a b t i c i d c in the early middle ages m, daas Women in Mediewl lPacety, Cd. Susan Masher S t u d , Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, I982 (1976), p.47-70.
COLLIOT, RA., a PeRpeaive sur la condiion fpmiliale de L'edbt dam la litb5rature mCdiCvale *, Se'ne'fiance, 1 (1 976): 17-33.
COLMANT, P., a Les quam 5ga de la vie (Horace, Arlpo6tiipe9 153- 175) ID, Les e'hrdes classiques, 24 (1956): 58-63.
CONGOURDEAU, M.-H., a Regards sur I'enfant nouveau-n6 a Byzance b, Revue des itudes bytmunes, LI ((1993): 16 1-76.
CONRAD, Christoph, Altwerden und Altsein in historischer Perspektive. Zur neueren Literatur *, Zeifichrwfiir SoziaIisutionsforschung d Erziehungspsychologie, 2 ( I 982): 73-90.
, Geschichte des Alterns. Lebensveddtnisse und sozialpolitische Regdierung. Zur neueren Forschung .,Zeifichr@$ir Sozi~likationsjorschcmg und Eniehungspsychoiogie, 4 (1 984): 143- 56.
CONSTABLE, Giles, introduction [sur le port de la barbe au Moyen Age], dans Apologiae Duae. Gozechini Epistola ad Wolfherum- Burchmdi. uf videtzu, Abbatis Bellevallis, Apologia de Barbis, (CC CM, LXII) Turnhout: Brepols, 1985.
, a Seniores et pueri ii Cluny aux X, XP sitcles *, dans Histoire et sociit6,III: Le moine, le clerc et Ie prince, Mdanges offerts ii Georges Duby, textes dunis par les mCdiCvistes de l'Universit6 de Provence, Aix-en-Provence: Publ. de I'Univenit6 de Provence, 1992, p. 17-24.
CORBETT, John, a The Foster Child : A Neglected Theme in Early Christian Life and Thought *, dam Traditions in Contact and Change. Selected Proceedings of the Congress of the International Association for the History of Reli'ons, dd. P. Slater et D. Wiebe, Winnipeg: Wilfiid Laurier Univ. Press, 1983, p307-21.
Corps souj5mt: ntaIcrdies et mPdcatiom, no special de Rmo (Cahiea du centre d'ttudes mMiCvales de Nice), 4 (1984).
COURCELLE, P, (I L'enfant et les sorts bibliques my Vigiliae Chrisfimae, 7 (1953): 146-250.
COURTEMANCHE, Andrde, a Lutter contre la solitude : adoption et affiliation a Manosque au XV' s. m, MPdiPvalks, 19 (1990): 3742.
COVEY, Herbat C, Old Age Portrayed by the Ages-oELife Models From the Middle Ages to the 16th Century m, TIie GerontoIo@t, 29 (1989): 692-98.
DAVIS, Robert Con, The Parental Rowumce - Reodmg God-the-Father in Eiub Western Culture, UrbaWCbicago: Univ. of Illinois Press, 1993.
Decdh in the Midde Ages, Mediaevaiia Iovaniensia, drie no. I, Studia no. IX, Louvain: Leuven Univ. Press, 1983.
DE LA GARANDERIE, P, Les obIations de minews d m 1 gg~ise depuis I 'origine b lafin du W siZcZe, Th&e de doctorat, Universitt! de Rennes, 1956.
DELORT, Robert, La vie au Mbyen Age, Paris Seuil, 1982.
DEMAITRE, L, a The Idea of Childhood and ChiIdcare in Medical Writings of the Middle Ages w,
JPN, 4 (1977): 461-90.
DEMAUSE, Lloyd, Cd., The History of Childhoot( New York: Harper & Row, 1975.
DEMOW, a Les pueri chori de Notre-Dame de Reims. Contribution a l'histoire des ckrgeons au Moyen Age v, dam Le clerc sdculer cru ~ o y e n xge, XW' Con@s de la SociCtC des Historiens Midi6vistes de I'Enseignement Supirieur (Amiens, juin 199 I), Paris: Publ. de la Sohnne, 1993.
DEROUX, M.-P, Les origines de I 'oblature bPnidctine (itude hisrorique), editions de la Revue Mabillon, 1) Ligugd: E. Aubin, 1927.
DESPLAT, Christian, L a vie, I 'amour, la mort : rites et coutumes, XVF-XV1ZI* siicIes, B iarritz: J.&D. Qitions, 1995.
DETTE, Christoph, Kinder und Jugendliche in der Adelsgesellschaft des frlihen Mittelalters w
Archiv fir Kul~urgeschichte, 76/1(1994): 1-34.
DICKSON, Gary, a La gen&se de la croisade des enfants (1212) w, BibliothPque de ~ ' ~ c o l e des Chartes, 153 (1995): 53-102.
DIDIER, LC., La question du baptsme des enfants chez saint Bernard et ses contemporains B, AnaIecfa Sacri Ordinis Cisterciensis, 9 (1 953): 19 1-20 1.
DIDRON, A., a Symbolique CMtienne: la vie humaine w, Annales mcht!ologipes, I (1 844): 244-5 1.
, a La vie humaine *, AnnaIes arch&oZugiques, XV (1 855): 4 13-24.
DIMIER, Anselme, a Mourir i Clairvaux B, ColICist., 17 (1955): 272-85.
DOVE, Mary, ?he PMect Age of Mm 'k Lge, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1986.
DUBY, Oeages, a Lcs jeunes dam la sociC(C aristoaatique dans la France du Nod-Ouest au W' sikfc w, h a l e s EX, 19 (1964): 835-46. rCimprim6 dam Hommes et sbwtwes dir ~ o y e n dge - Recweil dwmlZces, Parid La Haye: a. de lY&Il%s, 1973, p.213-25.
- , Le c M i e r W lafimme et leMtm. Le mon*me dam la Fruncefe'd~lble, Park Hachette, 198 1.
DUESBERG, H., I Le vieillatd dans l 'hcien Testament *, Ke spirituelle, 82 (1950): 237-62.
DULIN, Rachel Z., A Crown of GIory : A Biblical View of Aging, New York: Paulist Press, 198 8.
DYER, C., Standm& of Living rir the Later Mdde Ages -Social Change in England, f 2UO-ISOO, Carnbridge/New York: Cambridge Univ. Press, 1989.
l?ducations mPdiPvols : 1 'enfance. 1 I'cole. 1 'kglike en Qcciden~ (V-P si'cles), dir. I. Verger, (Histobe de I '&ucation, SO (mai 199 1)) Paris: Service d'histoire de l'&iucation de I'INRP? 199 1
EDWARDS, Glenn M., a Canonistic Determinations of the Stages of Childhood m, dam Aspectus et Agectus. Essays and Hitions in Grosseteste and Medievol htelIectuaI Lije in Honor of Richard CI Dales, Cd. G. Freibergs, (AMS Studies in the Middle Ages, 23) New York: AMS Press, 1993, p.67-75.
ducati ion. qprentissages. initiation mr Moyen Age, Actes d u premier colloque international de Montpellier en 1991 (Cahiers du CRISIMA, I), Montpellier: Univ. Paul-Valkry, 1993.
EISENSTADT, Shmuel Noah, From Generation to Generation: Age Groups and Smial Smcture, Glencoe (1lL)bndon: Free Press/Routledge, 1956.
Enfmce abandonne'e et sociPtP en Europe : X P - X F s., actes du colloque, Rome 30-3 1 janvier 1987, Roma: &ole fian@se de Rome, 1 991.
L 'Enfmt, IIe partie: Europe midihale et mderne; V partie: Le droit 6 I't?ducation, (Recueils de la sociCt6 Jean Bodin pour I'histoire comparative des Institutions, volXXXVI et XXW() Bnucelles: aitions de la Librairie encyc!opt5dique, 1976.
L ' E n f a mr Mioym &e: littiratwe et civilisation, (SGnCfiance, 9) Aix-en-Provence/Paris: Publ. du CUERMA/Champion, 1980,
Enfmt et Sociitis, no qn5cial des AD& 28 (1973).
L 'enfon~ Ia famiIIe ef la Rbolutionfi.an~aise, dir. M.-F. Uvy, Paris: 0. Orban, 1989.
ENGELS, Daniel, r The Problem of Female Infanticide in the Greco-Roman World v, Classical PhiloIogy, 75 (1980): 1 12-20,
Les entrges dmu la vie. iinitiatibns et apprentissages, We congrh de la SociCtC des histonens rn&ii&istcs dc I'Enscignement mpcn'eur public, Nancy= Presses univcrsitaircs de Nancy, 1982.
EVANS. JX, We, Women and C h i . e n m Ancient Rome, London: Routledge, 199 1.
EYBEN, Emicl, a Die Einteilung dcs measchlichen Lebens im t8mischen Altertum ., Reinnisches MieumjW PhiloIogi'e (Born)? 1 16 (1973): 15690.
, De Jonge Romein - V o ~ m de literaire bbronnen der p r i d e ca.200 v. Ch. tot ca500 n Chr., avec un &urn& en anglais, (Verhandetingen van de Koninklijke Academie vwr Wetenschappen, 8 1) Bruxelles: Paleis der AcademiGn, 1977.
, Was the Roman a Youth an Adult. socially ? m, L 'Antiqm're' cIasi@te, 50 (198 1): 328-50.
- , a What did Youth mean to the Romans ? ., JPH, 1413 (1987): 207-32.
, a The Beginning and End of Youth in Roman Antiquity r, Paedagogica Historica - International JDurnaI of the Hiitory of Education, 29 ( 1 993): 257-85.
Famille et parents dans I 'Occident mhdi&uZ, Actes du colloque de Paris (6-8 juin 1974) organisd par I'E&SS (We section), dir. Georges Duby et Jacques te Goff, (Publ. de 1'~cole Frangaise de Rome, 30) Roma: &ole Franme de Rome, 1977.
FamiZy and Inheritance : Rwal Society in Western Europe, 1200- 1800, ed. Jack Goody, i. Thirsk et E.P, Thompson, LondonMew York : Cambridge University Press, 1976.
Family History at the Crossroads : A Journal of Family History Reader, id. T. Hareven et A. Plakans, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1987.
FAULKNER, Thomas M. et Judith de Luce, &is., Old Age in Greekmd Lath Literame; New York: Ithaca, 1989.
FAVRE, Lise, La condition des eniants ihgitimes d m les pays romans au Moyen Age (ZIP-XVlt siidee), Lausame: Bibliothique historique Vaudoise, 1986.
FEDELE, Pio, Vedovanza e seconde noze ., dans matrimonio neZZa societci altomedievale, t.II, (Centro italiano di studi sull'alto mediaevo, 24) Spoleto: Presso la Sede del Centro, 1977, p-8 19- 43.
FEILZER H., Jtigend in der mitteZaZterZichen Stci;ndegeseIZschajZ Ein Beitrag m m Problem der Generutionen, W ien: Herder, 197 1.
Femmes, Mmiages-Lignages, X71*-XP si6cZes. Mihnges offerts li Georges Duby, (B ibl iothique du Moyen Age, I) Brwelles : De Boeck-Wesmael, 1992.
FEsTUGI&RE, AJ, a Lieux cornmuas littdtaircs et thdmcs de folklore dam l'hagiographie primitive. "Pus senex" v, dans Festschp Johunnes Mewaldt, Wiener Stden, 73 (1960): 13 7- 39.
FIGUERAS, Ceoarro M., Dom, Accrca del rito de la pmfesi6n monastics medieval ad succutrendum V, Lihagr'ca 2, ( M p t a et donnnenta, 10) Monttscrcat Abbayc de Montserrat, 1958, ~359-400.
FILDES V, Wet nwsiitrg. A Ifutory&m Antiw& to the Present, MordNew York: B1ackwell, 1988,
FINE, Agnb, Pamains et mmaines. Laparente'spiritueIle en Eyope, Paris: Fayard, 1990.
FINLEY, Moses I, The Elderly in Classical Antiquity m, Agerhg mrd Sociefy, 414 (1 984): 398-408.
FLORI, Jean, Qu'est-ce qu'un a Bacheler rn ? ~ t u d e historique du vocabulaire dans les chansons de Geste du ?UP sikle ? ws R u ~ m i u , 96 (1975) : 289-3 14.
, a Amour et socidtk aristocratique au We sikle : l'exemple des lais de Marie de France m, Le M'oyen Age, 98 (1 992): 1 8-34.
FOLTS, James D., Senescence and Renascence : Petrarch's Thoughts on Growing Old P, Jowmal of Mediwd md Renaissance Studies, 10 (1980): 207-37.
FONER Nancy, Ages in Conflict : a Cross-Cultural Perspective on inequality between Old ond Young, New York: Columbia Univ. Press, 1984.
FONTAINE, Jacques, OI VCrite et fktion dam la chronologie de la Vita M i i m, S M a Anselmim, 46 (1961): 189-236-
FORSYTH, Ilene H.., a Children in Early Medieval k: Ninth through Twelfth Centuries v, JPH, 4 (1976): 3 1-70.
FORTES, Meyer, Age, Generation, and Social Structure v, dans Age and Anthropological Theory, id. D.I. Kertzer et J. Keith, Ithaca: Cornell Univ, Press, 1984, p.99- 122.
FOSSIER, Robert, La socie'tP me'di&ale, (Coll. U) Pan's: A. Colin, 199 1.
Frau md spo'tmittelaIterlicher AlItag, Intemationaler Kongnss Krems an der Donau 2. bis 5. Oktober 1984, Cd. Heinrich Appelt, W ien: Ver lag der Bstemic hischen Akademie der Wissenschailen, 1986, p. 19- 10 1.
FREEMAN. Joseph T., Aging : Its History and Literature, New Yorknondon: Human Sciences Press, 1979.
FRUHOFF, W, Wts saints, c d h t s pmdiguco : I'cxpin'ence celigieuse au passage de I'enfance rage adulte v, Paedhgogicc~ K~ston'cu - Internationat J o d of the Hhtory of Educ~lion, 29
(1993): 53-76.
FROVA, Carla, Istrauiine e edtrcaziine nel mediom [ m u d de sources], Torino: a. Loessher, 1974.
FRUGOMj C, a La giovinczza di Francesco nclle fonti (testi e immagini) v, Shdi Medievali, 25 (1 984): 1 15-43.
FRY, Christine L, Toward an Anthropology of Aging 8, dans Aging rit Culnae and Society - Compmoive yiewpoin~s dStrategi'es, Cd. CL. F~ry, New York: Praeger Publ., 1980, p. 1-20.
- , a The Life Course in Context : Implications of Comparative Research *, dans Anthropology andAghzg: Comprehensive Reviaus, 6d. RL. Rubinstein, J. Keith, D. Shenk et D. Wieland, The NetherIands: Kluwer Academic Publ, 1990, p. 129-49.
GABRIEL,, Astrik, L., Ihe Educational Idem of Vincent of Bemais, Notre-Dame: Univ. of Notre Dame Press, 1962 (2' tide).
GAFFNEY, Phyllis, The Ages of Man in OId French Verse Epic and Romance *, Moden Language Review, LXXXV (1990): 570-82.
GARNIER, F, a Figures et comporternents du pauwe dam I'iconographie des We et XIIXe sikles *, dans HO~KO?#S m&s - finiraires spirrltuels (P-XVILlt si&les), vol. I: MentalitPs et sociit&s, dir. H. Dubois, LC1. Hocquet et A. Vauchez, Paris: Publ. de la Sorbonne, 1987, p.303-18.
GARNER-HAUSFATER, Marie-Gabrielle, a Les conflits de gdndration dans Ies chansons de geste du cycle de GuiIlaume d'Orange *. ThGse de Doctorat, Universitk de Paris m, 1984.
, a Mentalitts tpiques et conflits de gdniration dam Ie cycle de Guillaume d90range m, Le ~ o y e n Age, 93 (1987): I M O .
GASSEL, Ita, a Fonctions des classes d'lge dans la socidd gbbale *, Cahiers intemationaux de Socidogie, 56 (1 974): 139-57.
GASTALDELLI, Femccio, I primi vent'anni di San Bemardo: Problemi e interpretazioni *, Amdecta Cisterciensia, 43 (1987): 1 1 1-48.
GAUDEMET, Jean, Le muriage en Occident : les m e w s et lo dioit, Paris: &i. du Cerf. 1987.
GAUTIER-DALCM, J., a Connaissance dc I'ige et Cvaluation de la duke chez les habitants de quelques agglomdrations du diocese de Palencia seIon une enqutte de 1220 *, Anuurio de estudios medievaIes, 19 (1 989): 19 1-204.
GAWARD, Claude, "De Grace especial". Crime, tat et soc i a en France ci la$n du Moyen Age, 2 vofs., Paris: PubI. de la Sorbonne, 199 1.
GELIS J. et 0. REDON dir., Les miracles, miroirs des corps, Saint-Denis: Presses Univ. de Paris VIII-Vincennes, 1983.
~eo-es ~ u b y - L 'hi'zre ef I ' ~ t o i k e , dir. C. Duhamel-Amdo et G. Lobrichon, B ~ x e l l w : De Back, 1996.
GerontoIogi'e md Sonalgeschichfe, &i. C. Conrad a H.4. von Kondratowi@ Berlin: Deutsches Zentrum tiit Altcrsfiagca, 1983.
GfiELLINCK, Joseph de, 8 Iiuvenfur, grmitm, senectur b, dans S d i a mediaevalia iia honorem admadurn reverendiputris lPlrymundiJosephi Mirin, Bruges: apud Societatem editricem "De Tempelw, 1948, p39-59.
GIALLONGO, A, R bambino medievale- Edirmone ed mfma nel medioevo, (Storia e civil& 29) Bari: Dedalo, 1990.
GIANNARELLI, E, Sogni e visioni dell' infanzia nelle biografie dei santi : fia tradizione classica e innovaziane cristiana *, Aupt i i t imm, 29 (1989): 213-35.
GIL 'ADI, Avner, Concepts of Childhood and Attitudes towards Children in Medieval Islam. A Preliminary Study with Special Reference to Reactions to Infant and Child Mortality m, J o ~ n o l of the Economic and Social History of the Orient, 32 (1 989): 12 1-52.
, Childken of Islam : Concepts of Childhood in Medieval Milim Society, New York: St. Martin's Press, 1992.
GILBERT, Creighton, a When did a Man in the Renaissance Grow Old m, Sludies in the Renaissance, XIV (1967): 7-32,
GILBERT, Maurice, r Le grand Sge, vu par la Bible r, Lo vie spirifuelle, sept-oct 1993, p.477-93.
GILLIS, John R, Youth and History : Traditio~ and Chmge in European Age Relations, 1770- Present, New York: Academic Press, 1974.
GILSON, ~tienne, a Sur I'iige de la maturiti philosophique selon saint Thomas d'Aquin m, dans L 'Hontme devant Dieu - Mhlanges offerts au PGe Henri de Lubuc, v0l.n: Du Moyen jge QU
siMe des LwniZres, (Thdologie, 57) Paris: Aubier, 1964, p. 15 1-67.
Gioco e gi~tiria nell'ltrlia di c o m e , dir. Gherardo Ortaili, Treviso/Roma: Fondazione BenettonNieila, 1993.
GLASCOCK, A.P. et S.L. FEINMAN, = Social Asset or Social Burden : Treatment of the Aged In Non-Industrial Societies v, dans Dimensions : Aging, Cuhre and Health, Cd. Christine L. Fry, New York: Praeger Publ., 1981, p.133 I.
GLASSER, M, a Marriage in Medieval Hagiography n, Studies in Medieval and Renaissance History, 4 (1981): 1-34.
GNfLKA, Christian, a Altcrsklage und Ienseitssehnsucht w, JahrbwhJib. A n t i . und Christentum, 14 (1971): 5-23.
- , Retar SpiriruPlb : die t%erwinrhmg dm nutilrlichen Alterss@$ien rrls I d e a l ~ c h t ~ t l i c h e n Lebens, Cologne: P. Haastein, 1972.
GO- Hk-Wmer, Leben im Mtteldter, w m 7. bik nmr 13. Jahrhundert, Munich: CH- Beck, 1994 (St a,). Li$e k the MikWe Ages : Fron, the Seventh to the Z%irteenth Century, W. de l'all., Notre-Dame: Univ, of Notre-Dame Press, 1993.
GOLDBERG, PJ.P, Women, Work and Lfe Cycle in u Medieval Economy : Wome~ in York and Yorkrhire, cl30U-1520, Ordbrd: Clarendon PressIOxford Univ- Press, 1992.
GOLDEN, Mark, Childken und ChiIdhd m CImsicul Athens, Baltimore (Md): John Hopkins Univ. Press, 1990,
GONTHIER, Nicole, Crb de hahe et rites d'uniti- L a violence dans les villes, mm-XPrnc sigcie, Belgique: Brepols, 1992.
, DPiinquance, justice et socie'tP d m le Lyonnais me'diival de la fin du Xm s. ou dPbut du s-, Paris: ~ d . Arguments, 1993.
GOODICH, Michael, Childhood and Adolescence among the Thirteenth-Century Saints m, JPH, 1 (1973): 285-309,
, a Bartholomeus Anglicus on Child rearing m, JPH, 3/ 1 (1975): 75-84.
, Vita Perfefta : The Ideal of Sainthood in the Thirteenth Cenhny, (Monographien zur Geschichte des Mittetahers, 25) Stuttgart: Hiersemann, 1982.
, Encyclopaedic Literature: Child-Rearing in the Middle Ages m, History of Education, 12 (1983): 1-8-
, From Birth to Old Age - The Medieval mought, 12504350, LanhamMew York/London: Univ. Press of America, 1989.
, Violence and Miracie in the Fourteenth Century. Private Grief and Public Salvation, Chivago/London: Univ. of Chicago Press, 1995.
GOODY, E., Parenthood and Social Reproduction .- Fostering and Occuprtiooul Roles in West Afiica, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982.
GOODY, Jack, a The Evolution of the Family m, dans Homehold and FamiIy in P a t time, id. P. LasIett et R Well, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1972, p.103-24.
- , Aging in Nonindustrial Societies m, dans HmdbooAofAging and the Social Sciences, Cd. Robert EE. Binstock d Ethel Shams, New YO& Van Nostnad Reinhold, 1976, p. 1 17-29.
GORDON, Elcauar C., .r Chnd H a in the Middle Ages as seen in the Miracles of five English Saints, AD* 1 150- 1220 8, Buileriir of the Ribtory of Medecine, 60 (1 986): 502-22.
GOUGAUD, Iaais, a Mot& soup le fioc m, dans id. ~ o t i o n s e t ~ r ~ q u e s adtiques du moyen cigr, (Collection "Paxw, )[)CI) Park Descl& de Bmuwcr, 1925, p.129-42.
, a La moat du moine m, XW75 (1929): 281-302.
GRADOWICZ-PANCER, N i i 8 Papa, maman, I'abbC et moi : Conwrsio monnn et pathologie familiak #ap& l a sources hagiographiques du haut Moyen Age m, Le ~ o y e n Age, CWl(1996): 7-25,
GRANDSEN, Antonia, a Childhood and Youth in Mediaeval England B, Nottinghom Mediaeval Shrdes, XW ((1972): 3-19.
GREEN, Monica, a Women's Medical Practice and Health Care in Medieval Europe m, dans Working together in the Mdde Ages: Perspectives on Women 's Commtmities, no spkial de Signs. Journal of Women rit Cdture and Society, 14/2 (Hiver 1 989): 434-73.
GREILSAMMER, Myrim, t 'emers du tabtea Mariage et motemite' en FIondie midihale, Paris: A, Colin, 1990.
GRUNDMANN, Herbert, 8 Adelsbekehruogen im Hochmittelalter : Conveai und nutriti im Kloster m, dans Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Gebwbtag dargebrachr von Freunden undSchziIern, id. J, Fleckenstein et K. Schmid, FreiburgBaseVWien: Herder, 1968, p.325-45.
GU&E? Bernard, a L'iige des personnes authentiques; ceux qui comptent dam la societ6 midievale sont-ils jeunes ou vieux ? m, dans Prosopographie et GenGse de I 'Efat modeme, Actes de la table ronde organis& par le CNRS et E N S de jeunes filles, Paris, 22-23 oct 1984, Cd. Francoise Autrand, (Collection de I'ENS de jeunes filles 30) Paris: hole NormaIe Sup6rieure de jeunes filles, 1986, p.249-79.
-, Entre I gglise et I $tat. Quatre vies de prPI4sfim~ais d lafln du Moyen Age, Paris: NRF, 1987.
GUERREAU-JALABERT, Anita, 8 Sur les structures de parent6 dam I'Europe mCdiCvale m, Annales ESC, 1981, p. tO28-49.
, La disignation des relations et des groupes de parent6 en latin m6diivaI *, Archivum Latinitatis Medii Aevi, 46-47 (198187): 65- 108.
GUICHARD, P., De I'Antiquit6 au Moyen Age, famille large et farnille Ctroite m, Cahiers d 'Histoire, 1 979, p.45-60.
GUILIANO, L, Gioventir e istitunioni neMa Row antica C4ndtone grgrovanile e proemsi di socidiauzibne , h m a , 1979.
GULLIVER, P.H., art. 8 Age Diffctentiation m, fntemationul Enqdopedia of the Social Sciences, Bd. David L. Sills, vol& New Y o k The Mcmilhn Co. and Tbe Frec Press, 1968, p.157-62.
GUTTON, Jean-Piem, Nrujsmrce dir vieiIId, Paris: Aubict, 1988.
HALLISSY, M., CIean M J ~ , Tme Wives, Steadfit Widows : Chrrucer's Women unti MedievaI Codes of Conchrr:t, Wcstport (Conn.yLondon: Greenwood Press, 1993.
HANAWALT, Barbara A., 8 Childrearing Among the Lower Classes of Late Medieval England B,
J o d of Iiterddcri,Iinmy History, 81 1 (1977): 1-22.
, The Ties that Bound Peaant Fmilies in Medieval England, Oxford: Oxford Univ. Press, 1986,
, Seeking the Flesh and Blood of Manorial Families B, M, 14 (1988): 33-45.
- , a Reflections on land, kinship and life-cycle B, Peasant studies (Univ. of Utah), XV/2 (hiver 1988): 137-48.
, a Historical Descriptions and Prescriptions for Adolescence 8, Jozunal of Family Hktory, 1 7/4 (1992): 341-51.
, Growing up in MedievaI London : The Ejrperience of Childhood, New York: Oxford University Press, 1993.
HANAWALT, BA, &d, Women and Work in Preindtlstriul Europe, Bloomington: Indiana Univ. Press, p. 145-64.
HARMS, J.G., Godand the Elderly. Biblical Perspective on Aging, (Overtures to Biblical Theology, 22) Philadelphia: Fortress Press, 1987.
HARVEY, 8, Livhg and Dying in England, 1100-1540 - The Monastic Erperience, Oxfiord: Clarendon Press, 1993.
HAYNES, Maria S., a The supposedly Golden Age for the Aged in Ancient Greece (A Study of Literary Concepts of Old Age) m, me Gerontologirl, W2 (1962): 93-98.
, The Supposedly Golden Age for the Aged in Ancient Rome (A Study of Literary Concept of Old Age) v, The Gerontologirt, Wl(1963): 26-35.
HEERS, Jacques, Le cIm familial mr Moyen Age, Paris: PUF, 1974.
HEINZELMANN, M., = Studia sanctorum. ducati ion, milieu d'instruction et valeurs Cducatives dam I'hagiographie en Gaule mirovingienne 8, dam Hazit ~o~en-&e. Culture, Pducolon et
HELMHOLZ, Richard, Infinticide in the Province of Canterbury during the Fifteenth Century my Ktslory of ChiIdhmi @a~erli(, 2 (1975): 379-90,
HERLDFy, David, a Vieillir i FIotctl~~ PI Quattroccnto 8, Amtales E X , XMV (1969): 1338-1352.
, a Generation in Medieval History b, Yikrtor, 5 (1974): 347-64.
, a LZe Expectancies of Women in Medieval Society 8, dam B e M e O/ Wonrmr m the MiMe Ages, Papers of the sixth annual conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Studies, State University of Binghamton, 6-7 May 1972, 6 d Rosemarie Thee Morewedge, Albany (NY): State University of New York Press, 1975, p. 1-22.
, Family and Property in Renaissance Flomce 8, dans The M e d i d City, dd. HA. Miskimin, D. Herlihy et A.L. Udovitch, New Haven: Yale Univ. Press, 1977, p.3-24.
, a Deaths. Maniages, Births, and the Tuscan Economy (ca. 1300-1 3 50) m, dans Popuiution Pattern in the Past, 6d- RD. Lee, New York: Academic Press, 1977, p. 135-64.
, a Medieval Children 8, dam Essays on Medieval Civiiuation, dd. Bede K. Lackner et K- Roy Philip, (The Walter Prescott Webb Memorial Lectures, 12) Austin (Texas)/London: Univ. of Texas Press, 1978, p. 109-42.
, Medieval Households, Cambridge (Ma.)London: Harvard University Press, 1985.
HERLMY, David et Christiane KLAPISCH-ZUBER, k T o s c ~ et leurs families - Une h d e du "Catart0 "jlorentin de 142 7, Paris: hitions de I-EHESS, 1978.
HEWITT, M. et I. PINCHBECK, Children in English Sociep, 2 vols., London: Routledge et K. Paul, 196901973.
HIGOUNET-NADAL, Arlette, Pirigueux aux X lP et XY siZcles - ~ t u d e de diknographie historique, Bordeaux: Fkdiration historique du Sud-Ouest, 1978.
HILDEBRANDT, Maria M, me Externui School in Carolingian Sbciety, (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 1) LeidedNew York: EJ. Brill, 1992.
HINDMAN, J., a Pieter Bmgel's Children's Games, Folly and Chance I, Art met in , 198 1, p.447- 75.
HINEK Ray and Joseph M. HAWES, Growing up in America : Childien in Uisroricd Perspective, Urbana (Ill.): Univ. of Illinois Press, 1985.
Histoire de la fandle, vol.II: te choc des modemitis, dir. And& Burgui8re. C hristiane Klapisch- Zuber, Martine Segalen et F rqo i s Zonabend, Paris: Armand Colin, 1986.
Histoire de lappulationfian~aike, vol .I: Des ori@hes 6 la Rendsance, par J. Dupiquier, JN-NN Binben, R fitienne, C. et L. P i e H. Bautier, H* Dubois, A- Higounet-Nadal et C. Klapisci Zuber, Park PUF, 1988.
K i t o i r de la viepfvde, v o l E De I 'Eimpe/e'orlhfe ti la Renabsarrce, du. Philippe AriCs et Georges Duby, Paris: S a i l 1985.
Histoire aksfintnres en Occident, VOLE &e ~ i n Age, ddi CC. Klapisch-Zuber, Paris: Ploa, 1990.
Hitoire des j ~ e s en Occident, voll: De I 'Antipiti ti 1 '6-e modeme, dk. Giovanni Levi et Jean-Claude Schmitt, Paris: Seuil, 1996.
Hisroire desp2res et de Iapatemite', dire J. Delumeau et D. Roche, Paris: Larousse, 1990.
HOFMEISTER, Adolf, a Puer, itnrenk, senex. Zum VecMndnis der mittelalterlichen Altersbezeichnungen D, dam Pupsthnn taPdKhkertum. Forschungen nrrpolirischen Geschichte und GeisteskuItur des Mittelalters. P a l Kehr zum 65. Geburtstag dmgebrucht, dd. Albert Brackmann, Aden, 1973 (nied. de 1926), p.287-3 16.
HOLMES. U-T, DaiIy Living in TweMh Century, Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1962.
. .: Medieval Children r, J o m a I of Social History, 2 (I 968-69): 164-72.
HOULBROOKE, Ralph A., The English Family. 1450-1700, London/New York: Longman, 1984.
HOWELL, Trevor H., a Avicenna and the Care of the Aged r, The Geronrologikt, 12 (1972): 424-26.
HOME, George, Educational Theory and Practice in StJQugwrlire, London: Routledge & K. Paul, 1969.
HUNDERT, Gershon David, 8 Jewish Children and Childhood in Early Modem East Central Europe m, dans The Jewish Family : Metuphor and Memory, New York: Oxford Univ. Press, 1989, p.8 1-94.
HUNT, David, Parents and Children lit History - The Psychology of Family Life in Early Modern France, New YorkLondon: Basic Books, 1970.
ILLMER, Detlec Formen der Ersiehmg md WissensvemittImg im firhen Mittelalter. QueIIenstudien na Frage der Kontr'nuitdt des ubendlri;ndbchen Eniehungswesens, (MOnchener Beitdge zur MediHvistik und Renaissance-Forschung, 7) Miinchen: Arbeo-Ges, 197 1. Nouvelle Cdition: Etsiehung tmd Wksenmermitttrung imjWhen MiNealter, 1979.
L 'image dup6re d m le mythe et I'histoire, I: ~'te, Gr2ce. Ancien et Nouveatt Testaments, dir H. Tellenbach, Paris: PUF, 1983 (tid. a1 Iemande, 1976).
JAHDDA, G. ct IM. LEWIS, Acquiring Culiwe - Cross-CuI~aI Studies in Child Dewlopment, London: C m m Helm, 1988.
JANSSEN, J., 8 Quam actatcm zignificat vox quac cst "puer" v, iMhernosyne, 48-49 (1920): 10 1-02.
JAVELET, R., L'cnfhnce spirituelle au 12' s. (Surtout d'ap* Adam de Perseigne et Bermnd de Cldrvaux) D, Yie tM.&ienne, 12 (1972): 25-44 et 104-30.
JEAY, Madeleine, a De l'aute! au krceau. Rites et fonctions du mviage clans la culture populak au Moyen Age dam La culture poplaire mr moyen cige, dtudes pdsentdes au quatrihme colloque de ~~nstitut d ' h ~ d e s mCdiivales de L'UniveaitC de MonW, 2-3 avril 1977, a. Pierre Boglioni, Montnhl: L' Aurore, 1979, p.39-62.
Les je tn d lo Renoisunce, Ve Partie: J m de l'enfmce et de la jeunesse : approches hisroriques, sociologiques. iconogaphiques, etudes dunies par Philippe Ari&s et Jean-Claude Margolin, Actes du colloque international d'itudes humanistes, Tours, juillet 1980, Paris: Vrin, 1982, p.467-62 1-
JEWELL, H.M., The Bringing up of Children in Good Learning and Manners : A Survey of Secular Educational Provisions in the North of England, 1350-1 550 *, Northern Hhtorjt, 18 (1 982): 1-25,
JOLIBERT, Bernard, L 'enfmce cnr XVlT sitkfe, Paris: J. Vn'n, 198 1.
JONG, Mayke de, a Growing up in a CaroIingian Monastery : Magister HiIdemar and his Oblates *, J M , 9 (1 983): 99- 128.
, Kind en KIwser in de Vroege MddeIeeuwen: Aspecten van de Schenking van Kinderen an KIoosters in het Frankische Rijk (500-900), (Amsterdamse Historische Reeks, 8) Amsterdam: Historisch Serninarium van de Universiteit van Amsterdam, 1986.
- , In Samuel's Image : Child Oblation and the Rule of St &nedict in the Early Middle Ages B, Regulae Benedicti Studia (Annumiurn internationafe), 16 (1987): 69-79.
- , In SmueZ's Image. Child Oblation in Early Medimai West, LeidenMew YorkAWn: E.J. Brill, 1996.
NSSEN, Bernhasd, Putensck@ md Adoption i rnmen MitteIalfer. Kimsliche Vemm&chcrft als soziaie Prmis, (Verciffentlichungen des Max-Planck-Instituts fllr Geschichte, 98) G6ttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 199 1.
N'TTE, Robert, a Aging and Body Image in the 16th Century - Hermann Weinsberg's (1 5 1 8-97) perception of the Aging Body V, Europeun Hatory Quarterly, 18/3 (1988): 259-90.
KARRAS, Morgret et J. WIESEHOFER, Kindheit md Jugend in clor Antike : eine Bibliographic, Bonnr Habelt, 1981,
KELLUM, B.A., Infiraticide in England in the later Middle Ages D, JPH. 1/3 (1974): 367-88.
KERLOUEGAN, Franpis, Essai sur la misc en nounitlur ct I'Cducation dans les pays celtiques d'apds le t6moignage dcs tactcs hagiognphiques latins m, Ehrdu celtiipes, 12 (1968-1969), p.lOL-46,
KERTELGE, K, fcunesse-nouvead, &&me privil6gii dam le Nouveau Testament m, Concilium flours, Paris, Rome), 106 (1975): 95-103.
KERTZER, David L, SumTedfor Honor : hlim Infmt Abandonment and the Politics of Reproductive Control, Boston: Beacon Press, 1993.
KERTZER, David I. et Richard P. SALLER, The Frrmily in ItalyjForn Antiquity to the Present, New Haven (Conn,)/London: Yale Uaiv.Press, 199 1.
KERTZER, David I. et K. Warner SCHAIE, Cd., Age Siructzuing in Comparative Perspective, Hillsdale 0: Erlbaurn ASS., 1989.
KERTZER, David I. et Peter Laslett, Aging in the Past : Demogruphy, Society and Old Age, Berkeley: Univ. of California Press, 1995,
KETT, Joseph, Rites of Parsage- Adolescence in America, 1790 to the Present, New York: Basic Books, 1977.
KING, M.L, 7he Death of the Child Valerio Micello, Chicago: University of Chicago Press, 1994.
KIRK, G.S., Old Age and Maturity in Ancient Greece m, Eranos Yearbook- Jahrbuch- Annales (Zurich- Lieden), 197 1,40 (1973): 123-58.
KLAPISCH-ZUBER, Christiane, a Cdibat et service f6minins dans la Florence du X V sikle D,
ADtl; 1981: 289-302.
, La "mere cmelle". Maternit& veuvage et dot dans la Florence du XN ' et XV sikcles ., Annales E X , 38 (1983): 1097-1 109.
- , La mabon et le nom : Strate'gies el rilwls d m 1 M e de la Renaissance, Paris: a. EHFSS, 1990.
, Familk, religion et sexualit6 H Florence au Moyen Age m, Revue de 1 'histoire des religions, 1992, p381-92.
KLEIJWEGT, M, Ancient Yo& The Ambiguity o f Y a h andrhe Absence of Adolescence in Greco- Roman Society, (Dutch Monographs on Ancient History and Archaeology, 8) Amsterdam: LC. Gieben, 1991.
KLEIN, IE. a Adolescence, Youth and Young Adulthood : Rethinking Cumnt Conceptualizations of Life Stage a, Youth mds'iety, 2 1 (1990): 446-7 1.
KOLHER, Erich, a Seas et foncthn du t e r m "jeunesscn dans la padsie des troubadours R, dam MhIanges oferts b Red Ctotet, tJ, Cd. Piem Gatlais et Yves-Jean Riou, Poitiers: Socidtd d'&udes mCdi€vales, 1%6, p.569-83.
K&ILER, Ludwig, Hebrew Man, London: SMC Press, 1956.
KONRAD, H, &I., Det d e Mensch b der Gescliichichte, Wien: V e r b fb Gesellschaffskritik, 1982.
KOWALESKI, Maryanne, a The History of Urban Families in Medieval England *, JMH, 14 (1988): 47-63.
KRAEER, David, Images of Childhood and Adolescence in Talmudic Literature R, dam The Jewish Family : metaphor and memory, New York: Oxford Univ. Press, 1989, p.65-80.
Der k m k e Mensch in MtteIuIter und Renaissance, id. Peter Wunderli, (Studia humaniora, Dibseldorfer Studien m Mittelalter und Renaissance, 5) Diisseldorf: Droste Verlag, 1986,
KREUTZER, G, findheit und Jugend in der ahordischen Literatw, volJ: Schwangersch@, Geburt m d ' h e s t e findreit, wihstersche Beitrtige zur deutschen und nordisc hen Philologie, 21 Miinstet= Kleinheinrich, 1987.
KROLL, J 6 r o m e ~ The Concept of Childhood in the Middle Ages *, J o m a l of the History of Behavioral Sciences, 13/4 (1977): 3 84-93.
KROLL,, Jkome et Roger DE GANCK, a The Adolescence of a Thirteenth-Century Visionary Nun *, Psychologi'caZ Medecine, 16 (1 986): 745-56.
KROTZL, Chr, a Parent-Child Relations in Medieval Scandinavia according to Scandinavian Miracle Collections a, Scandinavian JoumuI of History, 14 (1989): 2 1-37.
KUEFFLER, Mathew S., a "A Wryed Existence" - Attitudes towards Children in Anglo-Saxon E n g b d *, Journal of Smial History, 2414 (199 1): 823-24 (???)
KUEHN, Thomas, Emancipation in Late Medieval Florence, New Brunswick (NI): Rutgers Univ, Press, 1982.
KUHN, Reinhard C., Corruption in Paradae : The Child in Western Literame, Hanover (NH): Brown Univ. Press, 1982.
LA FONTAINE, Jean Sybil, Cd, Sex and Age as Principles of Social Dzyerentiation, London: Academic Press, 1978.
LcAFONTAINE-DOSOGNE, Jacqueline, Iconographic cornpark du cycle de 1'Eafance de la Viergc i Byunce ct en Occident de la fin du DC au dCbut du WF w, Cahiers de Civilkation Me'didvate, 3214 (1989): 29 1-303.
- , L 'iconographic I I *e@imce 1 la Viwe clonr Z'Empiie byzantin et en Occident, 2 vol., B ~ e l l e s : AcadCmic Royak, 192 (Ze 66).
LAHAYE-GEUSPI, M., Dm @ ~ d k r Kiirder : eri, Beimrgzw Litwgie- vndSotialgeschiciciue ddes Monchrunrs im hohen Mittelalter, Aftenberg: Oros Verlag, 1 99 1.
LAIOU, Angeliki E, Wiage, omour et parent6 & Byzance ara XT-AZP sigcles, (Travaux et Mhoircs du Centre de Recherche d'Histoire et de Civilisation de Byzance, CoIl&ge de France, Monographies, 7) Par*: De Boccard, 1992.
LALLEMAM), Sumnnee, a Adoption, fosterage et alliance m, Anthroplogie et socie'tP, 1Z2 (1988): 25-40,
, Lo circuhtion des enfan& en sociM truditionnelle : prgt, don, ichmge, Paris: ~ d . de I7Harmattan, 1 993.
LAMB, Michael E, The Father's Role. Cross-Cui~taaI Perspectives, Hillsdale 0: Erlbaume Ass., 1987.
LAMIRANDE, ~rnile, a Les lges de I'hornme selon saint Ambroise v, Cahiers des Ptudes mciennes, ?UV (1982): 227-33.
, a Ages de I'homme et iges spirituels selon saint Ambroise: le commentaim du psaume 36 m,
Science et esprit, 3 5 (1 983): 2 1 1-22.
, a Enfance et dkveloppement spirituel: le comrnentaire de saint Ambroise sur saint Luc *, Science et Esprr, 35 (1983): 103-16.
MSLETT, Peter, 13e World We Have Lost- E n g h d before the Industrial Age, New York: Scniner, 1973 (2' CdJ.
, Family Li$e and Illicit Lave in Earlier Generations : Essays in Basta?-& and Historical Sociology, CambridgeMew York Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1977.
, The Wold we have lost :*her explored, New York: Scribner, 1984 (3' dd.)
, 8 The Emergence of the Third Age *, Ageing and Society, 7 (1987): 133-60.
, A Fresh Map ofL& me Emergence of the Third Age, London: MacMillan, 1995 (2 dd. corr.)
LACTRENT, S., Naitre au Moyen ige. De la conception ir ku naissunce : h grossesse et I bccouchenlenr (XTF-XP s-), Paris: Le Leopard dYOr, 1989.
LAUWERS, Michel, a La mart d lc corps dco saints : la d n e de la mort dans les Yirne du haut M O ~ C S L - A ~ ~ 8, tc Mioym Age, XClVn (1988): 2 1-50.
LE BL&VEC, Daniel, a Maladies ct soins du corps dans lcs rnoI18sferes cidmiau m, dans Horliotzs m m i ~ , i r i r i i rcS spin'tueIs (r-XWP s.), I : Mentafitks et sociitds, &i. Hmri Dubois, Jean- Claude Hoquct r An& Vauchw Paris: Publ. dc la Sorbonnc, 1987, p.171-82.
LECLEKCQ, H, att. 8 Veuvage - veuve m, Dictionnuire d %che'o/ogie Chre'tienne et de Liltrrgle, XV (1953): 3007-26-
LECLERCQ, Jean, a La veture ad s u c m e n d m d'aprts le moine Raoul v, dam Analecta Monastics- 3e se'rie, (Sfdia AmeImima, 3 7) Roma: Herder: 1955, p. I 58-68.
, rt Documents sur la mort des moines m, RM, 45 (1955): 165-80 et 46 (1956): 65-8 I.
, Deux opuscuies sur la formation des jeunes moines m, Revue d'ascPique et de mystique, 132 (I 957): 387-99.
, a Saint Bernard et les jeunes m, CollCisl., 30 (1968): 120-27.
, a Pidagogie et formation spirituelle du W au DC siMe m, dans La scuola nell 'Occidente latino dell 'alto medioevo, op-cit., 1972, p.255-90.
- , a Texts sur la vocation et la formation des moines au moyen f ge *, dans Corona Gratimm- Misce~~aneu patrhtica hisrwca et litwgica Eligio Dekkers 0.S B. Xn Lustra complenti oblata, volJI, (ImtrurnentapatriMca, XI) Sint Pietersabdij (Bmgge): Martinus Nijhoff s Gravenhage, 1975, p. 169-94.
- , r La mort d'apris la tradition monastique du moyen Sge m, Sludia Missionaliu, 3 1 (1982): 7 1 - 77.
LEGASS€, Simon, J6sus et 1'Enfmt. *Enfits 4 *peris met *simples rn d m la tradition synoptique, Paris: J- Gabalda & Cie., 1969.
LE GOFF, Jacques, La civilisation de I 'Occident midiival, Paris: Arthaud, 1984 (1 977).
LE GOFF, Jaques et Jean-Claude SCHMITT, dd., Le charivari, Actes de la table ronde organistie A Paris (25-27 aMil1977) par I'E&SS et le CNRS, Parisha HayeMew York: hi. Mouton, 198 1.
LE HORS, P.B., Age et croissance des enfanu : mdthode d'dtude et de cornparaison m, dans Ville et campagne en Europe occidentole (P-XIllr 3, Actes des cinq journdes anthropologiques de Valbonne 2 1-23 mai 1990, Cd. Luc Buchet, Paris: CNRS, 199 1, p. 103-12.
L- D, Note sull'oblazione dei fanciulli nella regola di SBenedetto m, Studr'a Rnrelmima, 18-19 (1 947): 195-225.
LE ROY LADWRIE, Emmanuel, Montaik vi&zge uccitun ck, 1294 6 1324, Paris: Gallimnrd, 1982 (&I- corr.)
LlSNE, -1c, Une source de la faamt m o ~ * q u e : ks donations il charge de pension dimentaire du MP au X sihlc 8, dam MPmgcs de phihophie et hktoire publies d I'occmion chc cinqwntemire de IP f d t k d' le- de lSffiivemitirL de Line, M&norks et huvauxpublik par des professeurs des f d t & cath01i.e~ de tilife, 32 (1927): 33-47.
, Les e'coles de la@ du Y3F si6cle ir IaBn duXW sizcle, Lille, 1940.
LETT, Didiet, 8 L'Enhce : aetm infirma, aetar Wrna n, Mt!di&ales, 15 (1988): 85-95.
- , La mhe et l'enfaat au Moyen Age n, L 'Histoire, no 152 (1992), p.6-14.
, a Les ptres du Moyen Age aimaient-ils leurs enfants ? m, L 'Histoire, no 187 (avd 1995): 46- 5 1.
, a Des nouveaux p&es au Moyen Age ? Les fonctions paternelles dans les miracles de Saint Louis V , dans Conformif& et dhimces, Colloque du CRISlMA (25-27 octobre 1993), Montpellier: Univ. Paul-VaIiry, 1995, p.223-34.
, Enfmces. dg~ises et fumilles (mileummiIieuMYIsiBcIes), Th&e de Doctorat Paris, 19%.
L'HERMITE-LECLERCQ, Paulette, a Gestes et vocabulaires du rnm-age au debut du XUe siecle dans un document hagiographique : la Vita de Christina de Markyate m, dans Maisons de Dieu et Hommes d '&lise - Floril6ge en I 'hormeur de Pierre-Roger Gatasin, saint-~tienne: Publ. de I'Univ. de saint-~tienne, 1994, 1 5 1-43.
- , Une supposition d'enfhat A la fin du W kikle en Angletern m, dans Jusice ef justiciibles - Me'fmges Henri Vidal, (Recueil de mhoires et travawr publie par la soci6t6 d'histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit fcrit, XVI) Montpellier: Facult6 de Droit, d'8conomie et de Gestion, 1994.
Liens de famille - Vivre et choisir sa pent&, no Mcial, MPdiivales, 19 (1 990): 3- 133.
ti#, Death, d t h e Elderly in mton'~aI Perspectives, td. M. Pelling et R.M. Smith, LondonMew York: Routledge, 199 1.
LIND, Levi Robert, Gabriele Zerbi: Gerontacomia: On the Cure of the Aged; and Mmcimirmus: Elegies on Old Age and Love, (Memoirs of the American Philosophical Society, 1182) Philadelphia: American Philosophical Society, 1988.
LODS, Jeanne, a Le thkme de l'enfance dans I'6popde fmfaise m, Cuhiers de Civilsation MPdiPvale, 111 (1960): 58-62.
LOFFLAAAG, E, Hdrt ihr die Kiirder lachen ? Zur A%dheit im Spiirmittelalter, Pfaffenweiler: Centaurus, 1991.
L~HMER, Cornelia, Die Welt dm Kinder im jDqjSehnten Jahrhundert, Weinhcim: Deutscher Studitn Vetlag, 1989.
LORCIN, MaridI'htrtSe, Retraibc dcs vewa ct Nks au couvent Quelques aspects de la condition fhiniie i h fm du Moytn Age m, ADH, (1975): 187-204.
8 Quand les princes n'€pousaicnt pas l a bergha ou mesalliance et classes d'ige dans Ies fabliaux my Medimo & n o , III (1976): 195-228.
, V i e et mourit en Lyonnais ti lafin du moyen rige, Paris: a. du CNRS, 198 1.
, a Vieillesse et vieillisement vus par les mCdecins du Moyen Age n, Bulletin du Centre d'Hiktoire ~conomiqve et SociaIe de iu ri@ion Iyonnaiey 4 (1983): 5-22.
- , a Le corps a ses raisons dam les fabliaux - corps ferninin, corps masculin, corps de vilain n,
Le Mioyen Age, XC (1 984): 433-53.
, M6re nature et devoir social. La mtre et l'enfant dam I'oeuvre de Christine de Pisan ., Reace historique, CCCLXXXml(1990): 29-44.
LYNCR Joseph H, The Cistercians and Underage Novices V, Gteaux, 24 (1973): 283-97.
, Simoniacaf Entry into Religious Lgeefiom 1000 to I260 -A Social, Economic and Legal Study, Columbus (Ohio): Ohio State Univ. Press, 1976.
- , Godpmnts and Kimhli, in Emly Mediewl Europe, Princeton: Princeton Univ. Press, 1986.
MAC FARLANE, Alan, M i a g e and Love in E n g h d - Modes of Reproduction, 1300-1840, OxfordMew York: Blackwell, 1986.
MAISONNEUVE, H., art. a Oblature *, Cath, IX (1982), 1474-77.
MALAMAT, A d a m , a Longevity: Biblical Concepts and Some Ancient Near Eastern Parallels ., Archivjrir Orien~orschung, 19 (1 982): 2 1 5-24,
MARCHAL, Jean, Lk %it d'oblar". Essai stct me vmiPtP de pensionnis monastiques, (Archives de la France monastique, 49) Lip&: Abbaye de Saint-Martin, 1955.
MARCUS, Ivan G., Rituafs of ChiImtood - Jewish Acculturation in Medieval Europe, New Haven/London: Yale Univ. Press, 1996.
Mmiage. DDivce, and Children in Ancient Rome, dd. B. Rawson, Canbena/Oxford: Humanities Research CenterKlarendon Press, 199 1.
MARROU, Htl, Hktoae de I'e'chrcation dims Z'htiiitd, Paris: h. du Seuil, 1971 (Te 6d.).
R m&imonrb n e k s u c i e ~ rrlontedide, 22-28 avriI1976,2 vol., (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto mediocvo, 24) Spokto: Presso de la Sode del Ccntm, 1977.
MA'ITHET, Maun, ct Enrique COESIRERAS, a n ~ e n i ~ r e s venerrae" Viiiores diligeren - Conflits tt dconciliation des ghhtions dans le monachisme ancien D, CoZZCist, 39 (1977): 3 1-68.
MEAD, Marprct, Cultwe and Commitment, a S i ofthe Goneration Gqp, Gaden cityNew York: Natural History PresJDoubleday and Co., 1970.
Medieval Fmily Rules : a Book of Essuys, 6d. Cathy Jorgensen Itnyre, New York: Garland, 1996.
MEHL, Jean-Michel, Les jem au roymme de France du XZF au XVlr sitkle, Paris: Fayard, 1990.
~&NARI), Philipp+ Le rire et le sourire dons le roman cowtois en France au Moyen Age (I 150- 1250), Genkve: Droz, 1969.
M ~ A R D , Ph. et LCh. PAYEN, U., Les chansorzs de geste du cycle de Guillowne d9Orange, volJn: Hommage Jean Frappier, Paris: Sociit6 d'~dition d'Enseignement SupCrieur, 1983.
METZ, Rend, a L'enfant dans le droit canonique. Orientation de recherches 8, dans L 'Enfant, l'Ie partie, op.cif., 1976, p. 1-96.
, to femme et 1 'enfm dms le droit cmronique mt!di&aI, (Variorum Collected Studies, 222) London: Variorum Reprints, 1985.
MILES, Margaret R, Infancy, Parenting and Nourishment in Augustine's Confessions ., Journal [of the Academyl of ReIi'bn and Psychical Research, 50 (1982): 349-64.
MILIS, Ludo, Het Kind in de Middeleewen Beschowingen over methode en ondemek 8, Tidschrijl vow Geschiedenk, 198 1, p.3 77-90.
, a Children and Youth. The Mediaeval Viewpoint m, Paedagogica Historica - Internafional Journal of the Hhtoty of Educution, 29 (1 993): 15-32,
MMOIS, Georges, La vieillesse dans la littdrature religieuse du haut moyen-ige *, Annales de Bretagne et des Pays de I 'Ouest, 4 (1 985): 3 89-40 I.
, Histoire de la vieillesse. De 1 Xntiquite' & la Renaissunce, Paris: Fayard, 1987.
MIRRER, Louise, kt., Upon my tlurbmrd's Death - Widows in the titeratwe of Medievuf Europe, Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1992.
MITTERAUER, MichaeI, Sozidgeschichte der Jugend. Fmkfbt am Main: Suhtkamp, 1986. Traduction : A of Ymh, @ad. G. Dunphy, Oxford: B. Blaclrwell, 1992.
MTTERAUER, Michael et Reinhard SIEDER, Vom Potrimhut z w Parlherscirolp : na SnYAiunvrmdeI der osferreichbchen FraniIie, MPnchea: Beck, 1977, Traduction : E~popean Fami&: Patriarchy to Partnersh@jhm the Mdde Ages to the Present, trans- Karla Oostc~enn d Manficd H8ninger, M o d : B. Blackwell, 1982.
Moines et monirrlesfbce 6 la mort, Actes du colloque de Lillc, 2, 3 et 4 oct. 1992, (Histoire m6dihrale a arch&logie, 6) LiIlJPack: CREDHIR-CAHMER, 1993.
MOLLAT, Michel, ktudes sra I%ktoire de IapuuwetP: (1Kbyen &e- AW siLcIe), 3 vol., Paris: f ubl. de la Sorbonne, 1974.
, Lospouy~es au h4oyen Jge: Etude soeiule, Paris: Hachette, 1978.
MORGAN, John H., Aging m the Religrbrcs Lge: A Comprehensive Bibliography, 1960-75, Wichita (Kans.): Institute on Ministry and the Elderly, 1977.
MORNET, Elisabeth, Age et powoir dans la noblesse danoise (vers 1360- vers 1570 v, h m a Z des smants, 1 (I 988): 1 1 9-54.
MOUNTEER, Carl A, Roman Childhood, 200 BC to AD 600 m, JPH, 14-2 (1986): 233-54.
MURRAY, Jacqueline, The Perceptions of Sexuality, Marriage and Family in Early English Pastoral Manuals m, (microform). Thesis (Ph.D), Univ. of Toronto, 1987.
MURRAY, Jacqueline et Michael M. SHEEHAN, Domestic Society in Medievol Europe: a Select Bibliogruphy, Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1990.
NARDI, Bruno, Dan& e la cuItwa medievaZe. Nuovi sag@ di filosofia dantesca, Bark Laterza, 1949 (2= id.).
NELSON, A, The Infancy of the History of Childhood : An Appraisal of Aries m, History md Theory, 19 (1980): 132-53.
&RAUDAU, LP, La jetmesse d' h littiratwe et les institutions de la Rome ripbiicame, Paris: Les Belles Lettres, 1979.
, E P ~ enfont 6 Rome, (Coll. Realia) Paris: Les Belles Let&res, 1984.
NEUGARTEN, Bernice L. a Gunhild 0. HAGESTAD, r Age and the Life Cowse b, dam Hmdbmk of Aging and the Social Sciences, Cd. Robert H. Binstock et Ethel Shams, New York: Van Nostrand Reinhold, 1976, p3S-55.
NEVEUX, F, a Finir ses joua P Bayew H la fm du Moyen Age : Ies conditions de vie des "rendus" dans Ies 6tabIissements d'assistance de la ville aux XIV' et XV siicles *, dans Questions
d'histoiie et de didectologie nornumdes, Actes du 10s' Congrh national des soci6t6s savantes (Caen 1980), Section de Philologic d d'bisto~juspu'il1610, t2, Park Ministh de l'&Iucation Nationale, 1984, p.151-69.
NICHOLAS, David, lk Domestic Lve of a Medieval City : Women, Chilitien, and the Fmiiy rir Fourreenth-Centwy Gknt, Lineola: Univ. of Nebraska Press, 1985.
OIdAge ik PreindtlsWSociety, €d. Peter N. Steams, London: Holmes and Mcyer, 1982.
OLIGER, L i i u s , De pucris obltis in orhe Minorum (cum &xtu hucusque incdito Fr. Johannis Peckam) m, Rrchivum Francbcm~l hiktori~lfltl, 8 (191 5): 339-447 et 10 (19 17): 27 1-88.
ONCLIN, W, 8 L'iige cequis pour le mariage dans la doctrine canonique mCdi6vale a, dans Proceedings of the Second International Congress of M e d i d Canon Law, Boston College, 12- 16 Aoiit 1963, id. Stephan Kuttner et J. Joseph Ryan, (Monuments Juris Canonici, Ser. C Subsidia 1) Vatican: S-Congregatio de seminariis et studiorum, 1965, p.237-49.
ONG, WJ., a Latin Language Study as a Renaissance Puberty Rite m, dam Sociology, History cmd Education, i d , P.W. Musgrave, London: Methuen, 1970, p.232-48.
ORIGO, Iris, The Merchant of Prato : Daily Lije in a Medieval Iralian City, Hannondsworth: Penguin Books, 1992 (1957).
ORLANDIS, Jo&, a Notas sobre la Oblatiopuero~nr en 10s siglos M y XI1 w, Anuarb de historia del derecho espaiiol, 3 1 (1961): 163-68.
, a La Oblaci6n de 10s nifios a 10s rnonasterios en la EspaiSa Visig6ta m, dans Esrudios sabre instituciones monasticus medievales, Cd. J. Or landis, Pamplona: Ed. Universidad de Navarra, 1971, p.53-70.
ORME, Nicolas, From Chidhood to Chivaliy: me Education of the Englbh Kings and Artsfocracy, 1066-1530, London/New York: Methuen, 1984.
, Education and Society in Medieval and Renaissance England, London: Hambledon Press, 1989.
, a Children and the Church in Medieval England n, J o d of Ecclesiustical History, 4514 (oct, 1994): 563-87.
OSSART, Reni, 8 L'oblature Enedictine m, kttre de Li'gugk, 252 (1990): 25-32.
OTIS-COUR, L., Lcs "pauvres enfants expods" B Montpellier aux XIV' et X V s. m, Annales du Midi, CV (1 993): 309-27.
OZMENT, Steven, When Fathers Ruled - Family Life in Reformation Europe, Cambridge (Ma.): Haward Univ. Press, 1983,
PAGANI, A., a L Y d di S. Rurnualdo m, Benedictrira, 3 (1 949): 127-36,
PATERSON, Linda M, L 7 ~ dam Ia l i i occitane avant 1230 m, Cahiers de Civt'ltahon Mh;dibol' 32-3 (1989): 233-46-
PATLAGEAN, Evclyne, Simctum smide, fmiIIe, CMtient6 d Bpmce 2P-M siicles, (Variorum Collected Studies, 134) Lond011= Variorum Reprints, 198 1.
PAUL, Jacques, 8 L'Cloge des pemnues a 17idQI humain au XIDe sikle d7apds la chronique de fia Sdimkne m, Ze M~ Jge, 73 (1967): 403-30.
PAULI, I, " E n f f ". "gmon: meu d m les I~ngws rommes,- essai de Iexicologie cumparke, Lund: AM?. Lindstedt, 19 19.
PAULME, Denise, 6d, Chses et ussociations d Zge en Apiipe de I'Ouat, Paris: Plon, 1971.
, art. a Classes d'ilge (Anthropologie) ., Encyclopaedia UniversaIb Corpus, V, Paris, 1989, p-959-6 1,
La Paura d e i p d neflu smietri antica e medievale, Cd. E. PelIizer et N. Zofzetti, Roma: taterza, 1983.
PEEMANS-POULET, H., Reflexions sur I'histoire de la Mdagogie m, Revue d'H'toire EccIe'simtique, 64 (1 969): 3 7-47.
PELLEGRIN, N., a Repesentation de la jeunesse dans le centre-ouest du X V au xVme siecle *, Bulletin de la Sociiti des Antiquaires de I 'Ouest et des m d e s de Poitiers, 1 5 (1 980): 4 1 1 -3 3.
, Les bacheIZeries - Organisation etjEtes de la jeunesse dans le Centre-Chest, X P - . I F s., (Mimoires de la sociCt6 des antiquaires de I'Ouest, XVI) Poitiers: SociCt6 des antiquaires de l'Ouest, 1982.
PHILIBERTY Michel, L 'hchelle des riges, Paris: Seuil, 1968.
PITTSy Tom R, The Origin and Meaning of Some St Joseph Images in Early Christian Art *, Thesis (Ph-D.), Univ. of Georgia, 1988.
PLATELLE, Hemi, a L'enfant et la vie farniliale au Moyen Age m, Millmtgs de science religieuse, 39 (1982): 67-85.
POLA FALLETTI-WLLAFALLETO, G., La juventur uttraverso i secoli, Milano]: Bocca, 1953.
POLLOCK, Linda A, The Forgotten Children : Parent-Child Relations porn 1500-1900, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
, A Lasting Relationsh@: Parents and Children over Three Centuries, Hanover-London: University Press of New England, 1987.
Poprc/otrbns cfgies ef r&&tibn grLK - Les honunes el ies sociCdk fme d ~ o r vieillissementr, Actes du Colloque Chaire Quetelct '86, Louvain-la-Neuve, 6-10 octobre 1986, dir. M, Loriaux, D. Remy, 6. Vilquin, Bnaclles: Ciaco, 1990.
POST, JB, Ages at Menarche and Menopause : Same Medieval Authorities W, Popltztion Stdiie, 25 (1971): 83-87.
POUCHELLE, Mar idkkthe , ReprCscntations du corps dam la Ugendc dock m, Ethnologic f i ~ a i s e , VI (1976): 293-308.
POULIQUEN, Sylvie, T a p s de la jemesse, temps de la folie ? Wordre juvenile dans la sociCtC des 14' et lSt siiicles m, These de Doctorat, Universie de Tours, 1987.
Le premier dge et In petite enfmce d m les campagnes de I 'Europe occidentale ou Moyen Age et h I't?poque modeme, responsables R Fossier et C. Desplat, association des joum6es internationales d'histoire de I'abbaye de Flaran, Seidemes Joumdes, 9-10 septembre 1994, actes A paraitre.
P&VOST, J.-P, Vieillir ou ne pas vieillir ? Le point de w e de 1'Ancien Testament v, ~ ~ l i s e et TCIe'ologze, 1 6 (1 985): 9-23,
QrmM, Patricia A., Better thun the Sons of Kings- Boys and Monks in the Eorly Midme Ages, (Studies in and Culture, 2) New YorklBonn/Frankfbrt am MaidParis: Peter tang, 1989.
RADDING, Charles, The Evotution of Medieval Mentalities, a Cognitive-Structural Approach v,
American HkforicaI Review, 83 (1978): 577-92.
REDON, Odile, a Le corps dans les nouvelles toscanes du XIV' sitcb *, dans Faire croire - M'aIite's de Ia dtmion et de la riception du message religieux du mIt au XtC si6cle, Rome: ~ c o l e fiantpise de Rome, 198 1, p. 147-63.
REGGIANT, Enrico, Elde e il tops della vecchiaia in the Parlement of the Three Ages v, Isliluro Lombardo, Accademia di scienze e leuere, Rendiconti - CIosse di lettere e scienze morali e storiche, 12 1 (1 987): 53-86,
Les telufions de parent6 d m Ie monde me'dihal, (Se'nPEunce n026) Aix-en-Provence: PubI. du CUERMA, 1989,
REYERSON, KL, a The Adolescent ApprenticeNorker in Medieval Montpellier b, Journal of Fami& Kcsfo~, 17/4 (1992): 353-70,
RICE&, Pierre, De I Zducution antique li l 'e'ducation chevoleresque, Paris: Flamrnarion, 1968.
, ~dzication ef Culture d m I 'Occident bmbme, W- Ym siScIe, Paris: Seuil, 1995 (Cd. revue et corrigee),
- , L'eafant dans la socittC monastique du W sikle v, dam Pierre Abe'I'd- Pierre le V&HIe: les cor~mtsphifouophi~s. litte'raires et OrtiStiques en Occident au d i m d u r n s., Acks ct rnCmoircs du colloque intctnatid tmu A L'Abbsyc de Cluny, du 2 au 9 juillet 1972, (CoUoques intemationaux da CNRS, 546) Paris: Ed du CNRS, 1975, p.689-70 1.
- , art. 8 Educazione t monaci m, L I P , III (1976), ~01.1057-65.
- , Appmdre i lire et 1 Ccrirr dam le Haut Mop Age m, BulIetm de lo Soci4te' nationale des Artliparies, 19784979, p.193-203.
- , Iiastrucfion et vie reIi@etlse d m le haut Moyen &e, London: Variorum Reprints, 198 1.
, a La vie quotidieme dans les h l e s monastiques d'ap& les colloques scolaires m, dans SOW la ~Zgle de s a t Benoit - Structwes monastipes et socie'tds en Frmce dit ~ o ~ n Age ri I h'poque modeme, Abbaye bdntklictine Sainte-Marie de Paris, 23-25 octobre 1980, Gen&ve/Paris: Librairie D~oz, 1982, p.417-26.
- , Les moines Mnidictins, maitres d'dcole VTIIt-XIe si6cles m, dans Benedictine culture 750- 2050, dd. W. Lourdaux et D. Verhelst, (MediaevaIia tovaniensia, ser.1, 11) kuven: Leuven Univ. Press, 1983, p.96-113.
, to redPcomerte de l 'enfant m4dit%ai, (Section d'histoire, B22) Li&ge: Univ. de Li*ge, s.d, 2 1p.
, a &bation et enseignement monastique dam le Haut Moyen Age w, MPdivales, 13 (1 987): 131-41.
, a Le d e de la mimoire dam I'enseignement rnkdi&al v, dans Jeur de mkrnorie, dir. B. Roy et P. Zumthor, Paris/MontrQl: VrinIPresses de I'UnivetsitC de Montdal, 1988, p.133-48.
- , Ecoles et enreignenen! dclmrr Ie ~ m t ~~n &e. W & P sihcle- milieu du AT sigcle, Paris, Picard, 1989 (2= 6d.).
RIC& Piem et Daniklle ALEXANDRE-BIDON, L 2nfrnK.e m ~ o ~ e n Age, Paris: Le Seuil, 1994.
RIEPENHOFF, J.R, Zur Frage des U r s p ~ g s der Verbindichkeit des Oblateninstitws : erir Beitrag nn Geschichte des mitteIalterIliden Bilhgswesens, Monster: F. Coppenrath, 1939.
ROGER, J.-M., L'enquite sur I'ige de Jean II d'Estouteville (21-22 aoiit 1397) m, Bulletin phiIoIogique et historique Qwqu 'ci 1610) du Cornit6 des trmaux historiques et scient~Jtiques. d e 1975, Paris: Biblioth6que Nationale, 197 7, p. 103-28.
ROSENMAYR, LCopold, Die menschlichen Lebensalter. ein Deutungsversuchen der europEschen KuIturgeschichte ., dam Die menschlichen Lebensalter: fintimiitlit und Krisen, L. Rosenmayr Cd, MiinchedZurich: Piper, 1978, p.23-79.
, a Les €tapes de la vie m, dam Continent grib - Ueillesse et vieill~sement, no spdcial de Commtmic4tions, 37 (1983): 89-104.
ROSE- Joel T, . Mediaeval Longevity the Secular Peerage, 1350-1500 m, Populution Studies, 27 (1973): 287-93.
- , Putri0rchy md Famiiiiu of Privilege m F$eenth-Centzuy Englmrd, Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 199 1.
ROSSIAUD, J, a Fratern* de jeunesse a nivcaux de culture dam les villes du Sud-Est A la fn du Moyen Age m, Cuhiers d'Histoire, 2 21 (1976): 67-1 02.
-, Prostitution, jeunese a mi& dans les villa du Sud-Est B la fin du Moyen Age m, Annales ESC, I 976, p.289-325.
, LuprostiMion rne'di&vaIe, Park Gallimard, 1988.
ROUCHE, Michel, Htrroire mondiale de l'&ucafion, t.I : Des origines ti ISIS: Enseignement et dducatlion en Frunce. des origikes ci la Renaissance, Paris: PWF, 198 1.
ROUSSEL, M.-P, a ~ t u d e sur le principe de 17anciennetC dam le monde hellenique du Ve sikle av. J.-C. & 1'6poque romaine B, Mimoires de I 'Acadhmie des Inrcrli,tions et Belles kttres, 43 (I 95 1 ): 123-227.
RUEIFEL, Hilde, Kinderleben im Marrschen Athen : Bilder aufklasische~ Varen, Mainz am Rhein: P, von Zabern, 1984.
, Dm Kind in der griechischen Kunst : von der minoisch-mykenischen Zeit bis aim Hellenhmus, Maim am Rhein: P. von Zabern, 1984.
RUSSELL, J.C, Late Medieval Population Patterns ., Speculum, 20 (1945): 157-71.
SANCHO ANDREW, J, a Ritos de la infacia y la adolescencia en el antiguo rito hispbico B, dam Psallendum - Miscelhea di studi in onore del Pro$ Jordi Pinell i Pons, dir. I. Scicolone, (Studia Anselmania, 105; Analecta liturgics, IS) Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo, 1992, p.207-45.
Smctity and Motherhood - Essuys on Holy Mothers in the Middle .4ges, dd. A.B. Mulder-Bakker, New YorWLondon: Garland Publ., 1995.
SARDtNA, P, a Immagine e realti dell'idanw-a nel Trecento siciliano m, Quaderni Medievali (Bari), 26 (1988): 45-78.
SAUNIER, Annie, La clientele de Saint-Thomas &Argenton [ h e ] entre 1450 et 152 1 : malades, "gdsineresses" et "jettCsn m, dans Mbgtmite de Lorrame et son temps. 114634521, Colloque d Wencon, 6-7 mai 1988, Sociitd historique archdologique Ome, 1989, no special, p.133-59.
SAUSSURE, Christian de, Brbe histoire des thdories de la dCrnence dnile jusqu'8 nos jours m, Ge'matoIoge et socidtd, 49 (1989): 62-69,
SCHARBERT, J, Das Alter und die Altcn in der Bibel a, Saeculan, 30 (1979): 338-54,
SCHIEFFER, k, a VHta und S8bne im Kamlingerhause m, dam BeiRdge w Geschichte des R e v Frmconan, @cihefk der Feancia, 22) Sigmaringen: Jan Thorbtcke VerIag, 1990, p. 14% 64,
SCHIMMELPFENNfG, Bernbarcl, Ex fomicatione nati: Studies on the Position of Priests' Sons fiom the Twelfi to the Fourteenth Century % Srdr'es rir Medieval andRenaissance 2 ( 0s 12) (1979): 1-50.
SCHINDLER, A, Geistliche Vilter und Hausvhr in der chtistfichen Antike m, dam Das Vaterbi'ld rin Abendand, I: Rom,fiiihes Christennnn, Mittehkr. Neuzeit, Gegewart, Cd. H. Tellenbach, Stuttgart, 1978, p.70-82.
SCHMIDT-SOMMER, Irmgard, a Benediktineroblaten zwischen Kloster und Welt *, Erbe und Aa@ag, 62 (1986): 47 1-74.
SCHMI'IT, Charles B, a Aristotle among the Physicians m, dam The Medical Renaissance of the Sixteenth Century, id. A. Wear et aZ-, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985, p. 1-1 5.
SCHMITT, Jean-Claude, a "Jeunes" et dame des chevawc de bois. Le folklore mCridional dam la litt&ature des exempla m e - M V e sikles) v, dans La Reiigrbn popuiaiie en hgziedoc duXm s i M e ir la moitii d u r n siPcle, (Les d i e m de Fanjeaux, I 1) Toulow: h. Privat, 1976, p. 12% 58,
SCHULTZ, Jmes A, Medieval Adolescence: The Claims of History and the Silence of German Narrative *, Speczilunt, 66 (1 99 1): 5 19-39.
, ffiowledge of Childhood in the German Middle Ages, 1100-1350, Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1995.
SCHUI,TZ, Margaret, a The B l d Libel : A Motif in the History of Childhood p H , 1411 (1986): 1-24.
SCHWARZ, Heinz W., Der Sch& des Kindes im Recht desmhen Mttelalters. Eine ffitersuchtmg iiber Tdtung Musbrauch. Ko"rperver2etnng Freiheitsbeeinhdchtigung, Gefdhrdung md Eigen~umsverle~g anhand von Rech~squellen des C! bir LK Jahrhunderts, (Bonner historkche Forschungen, 56). Siegburg: F. Schmitt, 1993.
Lu scuoIa neIl 'occidente lutino dell 'alto medioevo, 15-2 1 aprile 197 1,2 vol., (Settimane di studio del centn, italiano di studi sull'alto medioevo, 19) Spoleto: Presso de la Sede del Centro, 1972.
SEARS, Elizabeth, The Ages of Mmc Medieval Interpretation of the Li/e Cycle, Princeton: Princeton Univ. Press, 1986.
SEGALEN, Mattine, a Lifc-Course Pattems and Peasant Culture in France : A Reassessment V,
J i d of Fami. ITufory, 12 (1987): 213-24.
S ' & occidenfales, &I- P. h L & s et A. Mjin, (Communications, 35) Paris: Seuil, 1982,
SHAHAR, ShuIarnith, Mints, Infant Care and Attitudes toward M i c y in the Medieval Lives of Saints q JPW, 10 (1983): 28 1-309.
- , The Folaih Btate: A tjy1st0r-y of Women rir the Mdde Ages, trad. de I'hebreu C. Galai, London: Methuen, 1983.
Chifdhood in the M ' e Ages, LondonMew York; Routledge, 1990.
, a Who were Old in the Middle Ages ? n, Social History of Medecrite, 6 (1993): 3 13-4 1.
, a The Old Body in Medieval Culture n, dans Framing Medimal Bodies, id. S. Kay et M. Rubin, Manchester (NY): Manchester Univ. Press, 1994, p.160-86.
SHEEHAN, Michael M., a Theory and Practice. Marriage of the Unfree and the Poor in Medieval Society *, Mediaeval Studies, 50 (1 988): 457-87.
a The European Family and Canon Law m, Contimity md Change, 6/3 (1 99 1): 347-60.
SHEINGORN, P, "The Wise Mothern - The Image of St. Anne teaching the Virgin Mary B, Gesta, XXXII/l (1993): 69-80.
SHORTER, Edward, The Making of the M i e m Family, New York: Basic Books, 1977.
SIEBEN, Hermann Joseph, Voces - Eine Bibliographie zu Warten und Begrtgen mrr tier Putristik (291 8-1978), BerlinNew Yo& De Gruyter, 1980.
SIGAL, Pierre, a Le vocabulaire de t'enfance et de l'adolescence dans les recueils de miracles latins des XI' et Xn' s. m, dans L 'enfit, op.cit., 1980, p. l4 1-60.
, a La grossesse, I'accouchement et l'attitude envers I'enfant mort-nC a la fin du moyen-age, d'aprh les &its de miracles v, dam Actes du llOe conptb des socie'ths savuntes. M~onpelllier~ 1985. Section d'hisroire rnediivale et de philologie, vol. I: SmtP, midecine et assistance uu moyen rige, Paris: Comit6 des Travaux historiques et scientifiques, 1987, p.23-4 1.
, a Comment ~ ' ~ g l i s e a saw6 les enfants abandon& v, L 'Histoire, 16 1 (dk. 1992): 1 8-24.
SILK, J.B., a Adoption and Fosterage in Human Societies - Adaptations and Enigmas B, Cultural Anthtoplogy (Washington), 2/l (1987): 39-49.
SLUSANSKI, D., a Le vocabulaire latin des grad= aetatum 9, Revue romaine de linguistique (Bucarest), 19 (1 974): 103-2 I, 267-96,345-69,43 7-5 1,563-78.
S m Patricia, 8 Magic and the Murdered Child : Magid and Folkloric Elements in the Cults of Saints 8, Coafthnct domk B Kalamazoo en mai 199 1.
SMITH WASYLIW, Patnkia, Wwtydorn, Murder and Magic : Child S a i i and Their Cults in M e d i d Europe 8, Ph9. Dh, Binghamton Univ, 1992. A en 1996 chez Peter tang.
SMITH, P. ct G. KAHILA. Idcntificath oflnfirnticide in Archadogid Sitcs : a Case Study drom Lotc Roman-Early Byzantine Pet ids at Ashkclon IsnCl v, Journal ofArchpeIogkal Science, W6 (1992): 667-75.
SMITS, Edmd R, 8 An Uncdited Co~tcspondence between Hdlinand of Froidmont and Philp, Abbot of Val-Sainte-Matie, on Genesir 27,l and the Ages of the world 8, Endtion at God's Service, 6d. Jobn R Somme~eldt, Kalam~zoo: Cist. Publ, 1987, p.24366.
SOMMERVILLE, C-l, me Dscowry of Childhood in Puritan England, Athens: Univ. of Georgia Press, 1992.
SOT, Michel, Historiographic ipiscopale et modkle familial en Occident au [X' siecle v, Annoles E X , 33 (1978): 433-49.
SPENCER, Paul, The Riddled Course : Theories of Age and its Transformations V, dans Anthropology md the Riddle of the Sphim, &I. Paul Spencer, London: Rout ledge, 1990, p. 1-34.
SPRANDEL, Rolf, Altersschicksal md Altersmoral: die Geschichte der EimteIlungen nrm AItern nach rler pmiser Bibelexegese des 12-46. Jahrhunderts, (Monographien zu Geschichte des Mittelalters, 22) Stuttgart: A. Hiersemann, I98 1.
STEVENS, Me-A*, a Les jeux des dcoliers i 1'6poque de la Renaissance b, Riseax (Mons, Belgique), 32-34 (1978 (1979)): 53-59. pdsumb d'un mdmoire de licence, a Les jeux d'enfants
la Renaissance m, Li&ge, 1977.1
STEWART, Frank H, Fmdmentals ofAge-Groups Systems, New York: Academic Press, 1977.
STMGRE, D, 8 La question de l'enfance malheurew : son appmche hospitalihe 1 Bordeaux du Moyen Age au WC sikle 8, Bulletin de la socie'te'jFan~uoiPe d 'histoire des h6pitom, 65 (1 99 1): 20-25.
SUB-AT, J, La place de quelques paits enfaotr dam la littkature mediCvale m, dam Me'lmges de Ii~tkruture du Moyen Age auXY siicle offer~s B Jeanne Lodr p m ses col~Zgues, ses S h e s et ses amis, Paris: Collection de l'kole Normale SupCrieure de jeunes filles, 1978, p.547-57.
SWANSON, Jenny, a Childhood and Childrearing in adstatus Sermons by Later Thirteenth Century Friars m, M, 1 6 (1 990): 3 09-3 1.
TADDEI, Ilaria, F a jetmesse etpouvows : I Mbaye des n o b k e n f i de Luusunne, (Cahiem lausannois d'histoirc m&Ji6vale, 5) Lausannc: Facult6 des lettres de I'UniversiG de Lausanne, 1991.
TALBOT, A.-M- The Byzantine Family and the Monastery 8, Dtunbarton Oaks P-rs (Washington), 44 (1990): 119-29.
TELLENBACH, H., L 'image &#re d m le myrk et I 'hktoire, Paris: PUF, 1983.
Le temps cla/rm de lafin de I ' ~ n t i ~ l t ! mc Mioyen Age, P-XZP siPcIes, Colloque international du CNRS, Paris, 9-12 mars 1981, Paris: Ed. du CNRS, 1984.
Le temps et fa dw6e d m Ia litte'rahae au Moyen i g e et ir Ia Renuilrsunce, Actes du colloque organid par ie Centre de Recherche sur la littdrature du Moyen Age et de la Renaissance a IyUniv. de Reims (nov. 1984), dir. Yvonne Bellenger, Paris: Nizet, 1986.
TEVEL, J.M, e The Labourers in the Vineyard : the exegesis of Matthew 20,197 in the EarIy Church a, Vigiliae Chistianue, 46 (1992): 356-80.
THEIS, Lament, a Saints sans f a d e ? Quelques remarques sur la famille dans I t monde franc a travers 1es sources hagiographiques m, Revue historique, 255 (1976): 3-20.
THOMAS, Keith, Age and Authority in Early Modem England 8, Proceedings of the British Academy, 62 (1976): 205-48.
TILLOTSON, John H, Pensions, Corrodies and Religious Houses: An Aspect of the Relations of Crown and Church in Early Fourteenth-Century Englad ., The Journal of Religious History, 8 (1 974): 1 27-43.
TREXtER, RC., a Infanticide in Florence: New Sources and First results ., JPH, 1 0 (1973): 98- 116,
,a Ritual in Florence : Adolescence and Salvation in the Renaissance *, dans The Pursuit of Haliness in Lute Medieval andRenahmce ReIi'ony &I. Ch. Trinkhaus et HA. Oberman, Papers fiom the Univ. Michigan Comference, (Studies in Medieval and Renaissance Thought, 10) Leyden: EL Brill, 1974, p.20670.
, Naked before the Father - The Renunciutian ofFrancis ojAssisi, New York: Laqg, 198%
TlUSTRAM, Philippa, Figures of Life and Death in Medievul English Literature, New York: New York Univ. Press, 1976.
TROYANSKY, David G , Old Age in the Old Regime: Image card Erperience in Eighteenth-Century France, Ithaca: Cornell University Press, 198%
TURNER Ralph V., a Eleanor of Aquitaine and her Children : an Inquiry into Medieval Family Attachment m, Journal of Medieval History, 14 ( 1 988): 32 1-3 5.
ULBRICHT, 0, a Dcr Einstellungswandel zur Kindheit in Deutschland am Ende des Spiitmitrlalttrs (a1470 biz ca.1520) w, Zei&chri~fi;P hi;stor&che Fomchtmg, XIX (1992): 159- 87,
VALVEKENS, JB, Fratres ct sorohs "ad succurrendwn" m, AnaIecta Praemonsfrutensia, 37 (1961): 323-28.
VAN GENNEP, Arnold, M'ueI de Folkfore fian~ab contemporain, t t , 1" et 2" parties : Intr~cfioion ge'ne'role. Du berceau ri la tombe, Paris: Picard, 1943.
, Les Rites de Passage, New York: Johnson Reprint, 1969 (ddd.).
VECCIIIO, S, 8 L'immagine del puer nella letteratura esgetica del medioevo m, Quademi della Fondwrbne FeItrinelli, XXIII (1 983): 67-85.
Veuves et veuvage d m le houl Moyen dge - Table ronde orgcmisee b G6ttingen par la Mssion historiquefiunqaise en Allemape, dir. M. Parisse, Paris: Picard, 1993.
YieiIIesse et vieilihernent au Moyen Jge, (SCn6fiance, 19) Aix-en-Provence: Publ. du CUERMA, 1987.
Le vieiIZi3sentent : implications et consPQuences de 1 'a1Iongemenf de la vie humaine depuis le XVIIIL: siscle, dir. Arthur-E. Imhof, Actes de la table ronde, Paris, E&SS, 24-26 oct. 1979, Lyon: Presses Univ. de Lyon, 1982.
VTNOVSKXS, Mark, The Historian and the Life Course : Reflections on Recent Approaches to the Study of American Family Life in the Past 8, dans Lre-Span Development and Behavior, a. Paul B. Baltes, David L. Featherman et Richard M, Lerner, vo1.8, Hillsdale (NJ)/London: Erlbaum Ass. Publ., 1988, p33-59,
VOELTZEL, R, L 'enfir et son &ducation dans la Bible, Paris: Beauchesne, 1973.
WALKER, Sue Sheridan, a Widow and Ward : The Feudal Law of Child Custody in Medieval England m, dam Women in Medieval Smiety, dd. Susan Mosher Stuard, Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1976, p. 159-72.
WEIJERS, Olga id, Voeobuluire ddes icoles ef des mifhodes d'enseignement uu Moyen Jge, Actes du colloque, Rome 2 1-22 octobre 1989, Turnhout: Brepols, 1992.
WIEDEMANN, Th., Adults and Children in the Roman Empire, London: Routledge, 1989.
W I E W , W., art. Aevum m, Hktorisches Warterbuch der Philosophie (Bile), 1 (1 97 I), p.88-89.
WYe md Wid' in MedievaI Engld , &I. Sue Sheridan Walker, Ann Arbof= Univ. of Michigan, 1993-
WILSON, Adrian, a The lafirncy ofthe History of Childhood : An Appraisal ofAri&s m, Hktov und Zbeorys 19 (1980): 123-53.
WILSON, Stephen, a The Myth of Motherhood, a Myth : The Historical View of European Child- Rearing ,, Skiid mt~ry, 912 (1984): 181-98.
WOLFF, Hans Walter, Anthropofogi'e des AIkn Testaments, Munich: Kaiser, 1973. AnfhnrpoIogie de I Xncien Testament, Genhre: td. Labor et Fides, 1974.
Women ofthe Medieval World Essuys in Honor of JB Mmdy, dir, J. Kirshner & S. Wemple, Oxford: Blackwell, 1985,
WOOD, Charles T., The Doctor's Dilemna : Sin, Salvation, and the Menstrual Cycle *, SpecuZunt, 56 (198 1): 7 10-27.
ZEMAN, Frederic D, a Life's afler Years -Studies in the Medical History of Old Age, Part 7: The Medieval Period (1 096- 143 8) m, J o d of the Mount Sinai Harpifai- New York, XU (1 945): 783- 92.
ZEMON DAVIS, Nathalie, a The Reasons of Misrule : Youth Groups and Charivaris in the Sixteenth-Century France *, Past and Present, 50 (197 1): 4 1-75,
-, Ghosts, Kin and Progeny: Some Features of Family Life in Early Modern France *, DaedaIus, 1977: 87-1 14.
ZERNER-CHARDAVOME, M., a Enfants et jeunes au IXe s k l e : la dCmographie du polyptique de Marseille, 813-814 8, Provence historique, 3 112, 126 (1981): 355-84.
ZMK. Michel, a Vieillesse dam Perceval : I'ombre du temps w, dans Le nombre du temps, en hommage ri Parl Zumthor, dir. E. Baumgartner, ParidGenkve: Champion/Slatkine, 1988, p.285- 94-
BIBLIOGRAPHIE COMPLEMENTAIRE
Dam fclte bibliogmphie se rctn,went l a travaux qui n ' a ~ c a t pas leu place bas aucune des deux l i i pdc&!cntcs, mais qui ont infIucnc6 dircctcmcnt ou indircctcmcnt ma recherche. I1 sc trouve en outre quatrc Ctudes, qui abortlent k thbe d a Qcs, mais sont fondamentales pour Phistoire clunisimne : jc ics ai donc signal& sow uae fome aMg& en nnvoyant i la bibliographic pdddente. Les principaux thhncs abord& par ics artiiks et owtagcs cit& dam cette section concement Cluny, l'hagiographie mtdiCvale, les sources nornatives monastiques et, plus gdndraIemen& i '~~ l i se du Moyen Age central.
ABOU-ELHAJ, B, a The Audiences for the Medieval Cult of Saints W, Gesta, XXX (199 1): 3- 15-
A' CIuny - Congrgs scient3que en I'honnew des saints abbis Won et Odilon (9-1 1 juillet 1949). Dijon: h p r - Bemigaud et Privat, 1950.
ALBERS, Bruno, a Le plus ancien coutumier de Cluny a, Rb, 20 (1903): 174-84.
ALAMO, Mateo, e Coutumiers monastiques et religieux m, Dictionnaire de Spirituaiite', IIb, ~012454-59.
AMARGIER, Paul, a Apergus sur la mentalitt mon~ique en Provence au XIe sikle V, Annales ESC, 27-2 (1 972): 415-26.
, Un dge &or d . monachisme : Saint- Victor de Mmseille (9904 OW), Marseille: J%i. Tacussel, 1990.
ANGER, D, Le nombre des moines a Cluny r, Rb, 36 (1924): 267-71.
,a Les paCsCances clans I'ordre de Cluny V, Rb, 36 (1924): 347-50.
ANGERER, LF, Zur Problematik der Begriffe Regula-Consuetude-Obsemanz und Orden r, dam Studien d Mit teitmgen zur Geschichte ddes Benediktinerordens md seiner Zweige, 88 (1 977): 3 12-23,
, Connetdo und Reform m, dam Monastische Reformen, op.cit., 1989, p.107-16.
ARM& C. Edson, hhom and Sdptors in Roinunesque Burgun&, the New Aesthetic of Cimy El, Univ. ParkLondon: Pennsylvania State Univ. Press, 1983.
A M , C.E. et E.B. SMITH, a The Choir Screen of Cluny III W, Art Bulletin, 66 (1984): 556-73.
ARNALDI, G, Il biografo " r 0 m 8 ~ 1 ~ di Oddone di Cluny m, BuZZetiho dell ' f s i ~ o storico italimo per i Z Medio Evo e Amhivio Mwatotiano, 7 1 (1959): 19-37.
ARNAUD, Chautal, A props des rechaches rCcentes sur le pn'tur6 clunisien de la Charite-our- Loire (Nib) -NouvelIes bpdtatim archblogiques, nowcUes domCes historiques m, W, as. 6 (1995): 3 12-15.
BARLOW, Frank, The Canonization and the Early Lives of Hugh I, abbot of Cluny D, RB, 98 (1980): 297-34,
BARRY, David, Smaragdus of StMihiel and his Commentary on the Rule of St. Benedict m,
Tjunmga, 36 (mai 1989): 3-9.
Benedictine Cube 750-1050, id. W. Lourclaux et D. Verhelst, (Mediuevdia Lovaniensia, ser. I, 11) Leuven: Leuven Univ. Press, 1983.
BERL~RE, Ursmeq a Coutumim monastiques v, Rb, 23 (1906): 260-67; 25 (1908): 95; 29 (1912): 357.
, a Les coutumiers monastiques des Vm' et tXe si6cIes m, Rb, 25 (1908): 95-107.
, a te nombre des moines dans les anciens monasths B, Rb, 4 1 (1 929): 23 1-6 1 ; 42 (193 0): 3 1 - 42.
BERNARDI, P., Architecture mddiCvak et sources modernes : I'exernple de Cluny m, Bulletin monumenral, 15 113 (1993): 469-96.
BILLY, Dennis I., The "Ysengrimus" and the Cistercian-Cluniac Controversy m, The American Benedictine Review, 43 (I 992): 3 0 1-28.
BISCHKO, CJ., art Reglas monasticas m, Diccionario de hisroriu ecclesiasticu de Espan'a, 3 (1 973): 2068-69.
BLIGNY, B, L 'Eglire et les ordres reli@eux dons le royowne de Bourgogne a m et XZF sihcfe, Paris: PUF, 1960.
BONNERUE, P., B~~lents de topographie historique dans les rtgles monastiques occidentales m,
Sfudia Mon4stica, 3 7 (1995): 57-78.
BORIAS, A, Les relations du moine avec sa famille d'apes le Maitre et Saint Benoit D, Reguloe Benedicri Studia, 5 (1 976): 13-3 1.
, Quand saint Benoit modifie le vocabulaire du Maitre V, dam En rekant saint Benor'l, (Coll. Vie monastique, 23) BCgrolles-en-Mauges: Abbaye de Bellefontaine, 1990, p.59-70.
BOSWEU, John, Chriktioni& Sixid ToIimmce and Komosexudity. Guy People m Western E m p e f i r n the &ghnmgof the ch7isthn Ero to the Fourteenth Century, Chicago: Tbe Univ. of Chicago Ress, 1980. Traducbkm ~~ : Christirmbme, toldrance socide et h o m o s ~ l i t h - Les homosexuels en Europe 0cci;dentralr d a US de I ' k c M e n n e au XIT sieclo, tnd. A Tcacha Paris: Gallimard, 1985.
BOUANGE, G.-MS., Witoire de I'obbaye dXm'Ilac prtce'dCe de la vie de saw G i r d son jbnrlbteur (8944789). tJ, Paris : Lib. & ~'Ecok F m ~ k c d'Athhes a de Rome, 1899.
BOUCHARD, Constance B., Sword, Miter, and Clokter : Nobility and the Church in Bwgun& 980-1198, Ithaca 0: Cornell Univ. Press, 1987.
- , a Merovingian, Carolingian and Cluniac Monasticism : Reform and Renewal in Burgundy *, Journal of Ecclesimtical History, 4 1 (1990): 365-88.
BOUTHfLLIER, Denise, Introduction, Petri CZuniacmik abbat. De miraculis librr' duo, (CC CM 83) Tumhout: Brepofs, 1988.
BREDERO, Adriaan R, a Comment les institutions de l'ordre de Cluny se sont rapprochies de Citeaux m, dans Istituzioni monastiche e Istittuionni canonicafi in Occidente (1123-1215), Atti della settima Settirnana internazionale di studio, Mendola, 28 agosto-3 settembre 1977, (Miscellanea del centro di studi medioevali, IX) Milano: Vita e pensiero, 1980, p. 1 64-202.
, a Une controverse sur CIuny au XII' sikle m, Revue dPHistoire EccILsiastique, 76 (198 1): 48- 72.
- , a Cluny et le monachisme carolingien: continuit6 et discontinuit6 ., dans Benedictine Culrure 750-1050, op.cit., 1983, p.50-75.
, CIuny et Citema au douzihme siBcfe. L'hktoire dime controverse monastique, Amsterdam/Maarsen: Holland Univerity Press, 1985.
, La canonisation de saint Hugues et celle de ses devanciers m, dam k gouvernement d 'Hgues, op-cit., 1990, p. 149-7 1. E De heiligverklaring van abt Hugo van Cluny en die van zijn voorgangers r, T&j&cb@ voor Geschiedenis, 102 (1989): 173-881.
- , Le r6le de I'@culture dans la crise de Cluny de 1 122 v, dam Monachisnte et technologic, opcit., 1994, p. 109-22.
BROOKE, Christopher, me Monastic World. 1000-1300, Londres: Elek, 1974.
BROWN, Peter Robert Lamont, The Cults of Saints .- its Rise and Function in Latin Christianity, Chicago: Univ. of Chicago Press, 198 1. Traduction fianqaise : Le mIte des saints : son essor et sa fonction d m la chrgtienti lafine, trad. A. Rousselle, Paris: hl. du Cerf, 1984.
BULL, Uarcus, Knight& Pie& and the Luy liry~espone to the Finr C m d e , the Limousin and Gascony c97k.1130, Oxford: Clareadon Prrss, 1993,
B-, Veronicavoa, a Le graud ~ o g u e de la biblioth&p de Cluny m, dnns Le gowemement d 'Hugues, opeif., 1990, p.245-63. [cf, V, Gen]
- , Arnbmise de Milan dans la BibliothQue de Cluny B, Wptoriunr, XLVnn (1993): 127-65.
BYNUM, Carolyn W, The Spirituality of Regular Canons in the Twelfth Century : a New Approach r, Medievuiia et Humaniktica, 4 (1973): 3-24.
CANTARELLA, G.M., .: Cluny, Lione, Roma (1 1 19-1 124) v, Rb, 1980: 263-87.
, Cultura ed ecclesiologia a Cluny (sec.XII) v, Aewn, 2 (198 1): 272-93.
, i Cluniacensi e le Alpi ., diins Dal Piemonte all?Ewopa? esperienze monastiche n e h societG medievale, Relazioni e communicazioni presentate a1 XXXIV Congress0 storico su balpino storico nel millenario di SMchele della Chiusa, Torino, 27-29 maggio 1985, Turino: Deputazione Subalpha di Storia Patria, Regione Piemonte, 1988, p 2 13-27.
, Appunti su Rodolfo Glabro ., Aevm, 65 (199 1): 279-94.
, I monachi di Cluny, Tonno: G. Einaudi, 1993.
CAROZZI, C, De I'enfsna i la maturiti. ~tudes d'apr& les vies de GCraud d'Aurillac et dYOdon de Cluny v, 1979. [Cf BIBLIO. AGES]
CARTY, Carolyn M, a The Role ofGunzo's Dream in the Building of Cluny III v, dans Current Studies on CIuny, op.ci.., Gestu, XXVa/l-2 (1988): 1 13-23.
CATTANA, V, act, CIuny m, DIP, II (1975), col. 1200-04.
CAWLE'Y, M, a VocubuIa benedicina : Seniorship in the Rule of Saint Benedict v, Vox Benedictine, 1 (1 984): 1 3 4-3 9.
CHAGNY, A, a Jean I'Italien, biographe de saint Odon ., dam A Cluny..., op. tit-, 1950, p.121-29.
CHARRY, Jeanne de, art. R5gles et constitutions religieuses. 2. Les interventions de la hiirarchie m, RSp., 13 (1 988), co1.B 1-300.
CHATILLON, I., La vie des communautb de chanoines &pliers, de la fin du XIe sikle au debut du XIIIe siicle m, Ordo c m n i m (Novacella, Italia), I (1978): 104-30.
, a The Spiritual Renaissance of the End of the Eleventh Century and the Beginning of the Twelfth w, American Benedictine Review, 3613 (1985): 292-3 17.
C- J, Hibfoirc r e l i ' i e de l'&cirdent me'dibuf, Paris: Hachette, 1991.
CLEMENT, J.M., hiqzie ~AES anciennes dgies rnolu~stiques occaentafes, 2 vots, (Instmmenta Patrisb, VII A-B) SttenbruggdLa Haye: Abbaye S a i n t - P i d . Nijhoff, 1978,
CONANT, Kenneth Job, Cluny. trr igikes et la maikon mC ckf d'ordke, Cambridge (Ma,)IMbn: the Medieval Academy of Ametidmpr. Pmtat Fdres, 1968.
CONGAR, Y, a Ordinations "invitus, coactusD de 1 ' ~ ~ l i s e antique au canon 214 m, Revue des sciences phiIosophiques et fhe'oIogique~~ 50 (1 966): 169-97.
CONSTABLE, Giles, .: Pour I'histoire des coutumes de CIuny *, RM, 44 (1954): 141-5 1.
, "Famuli" et "Convers~~ at Ctuny : A Note on the Statute 24 of Peter the Venerable ., Rb, 83 (1973): 327-50.
, Monastic Legislation at Cluny in the Eleventh and Twelfth Centuries B, dans Proceedings of the Fourth International Congress ofMedieval Cmon l a w (Toronto, 21-25 Augrrst 1972)' id. S. Kuttner, (Monumenta Iuris Canonici, C.5) Cittii deI Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1976, [repris dam CIuniac Studies 1.
, a Cluniac Administration and Administrators in Twelfth Century B, dam Order and Innovation in fhe Twelfth Century. Essuys in Honour ofJoseph R Shqyer, id. W.C. Jordan, B. McNab, T.F. Ruiz, Princeton, 1976, p. 17-30 et 4 17-24. [repris dans Cluniac Studies].
, Medied Monasticism - A Select Bibliography, Toronto: Univ. of Toronto Press, 1976.
, Refigiour Life and Zhoughf (I lth-12th Centuries), London: Variorum Reprints, 1979.
, CIzmiac Studies, London: Variorum Reprints, 1980.
, Baume and Cluny in the Twelfth Century m, dans Tradition and Change : Essays in Honour ofMarjorie Chibnd, a. D. Greenway, C. Holdworth et J. Sayers, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985, p.35-61.
, m e Authority of Superiors in the Religious Communities *, dans La notion d 'mtoriti au kfoYendge: Islum, Byzunce, Occident, (Colloques intemationaux de La Napouk, 23-26 oct 1978) Paris: PUF, 1982, p. 189-2 10. wepris dam Id, Monks, Hermits and Crusaders]
, LiZmty and Free Choice in Monastic Thought and Life, specially in the Eleventh and Twelfth Century m, dam La notion & lib&& au &e: Byzonce, Occident7 Paris: Ies Bclfcs LCtthS, 1985, p.99-118.
- , a The I d d of Inner Solitude in the Twelfth Centwy m, drar Horizonr wwrihs, ithkrairiar sp&imcrS (r-XYII,P si8cIes), I: MentaIit& et sociilCs. Cd Hemi Dubuis, JeM-Claude Hocqwt a Amid Vauchez, @istoire ancienne ct mddi&ak, 20) Park Publicatr*ons de la Sorbome, 1987, p.27-34.
- , The Cehmdcs and S y m b o b of Entering Religious Life and Taking the Monastic Habit, from the Fourth to the Twelfth Century w, dans &gni e riri nella Chiesa uItomedievaIe oddentale, (Settimane di studio del Centm Italiano sull'alto medioevo, 33) Spoleto: Presso la Sede del Cenbo, 1987, p.771-834.
, Monks, Hemits arid Cmaders rir Medieval Europe, (Variorum Reprints, 273) London: Variorum Reprints, 1988.
, Entrance to Cluny in the Eleventh and Twelfth Centuries according to the Cluniac Custornaries and Stafides 8, dam Mediaevuliu ChriktianaM-MP siLcIes. Hommage ti hymonde Foreville, roumai]: hi. Universitaires, 1989, p.335-54.
, Ctuny in the Monastic World of the Tenth Centuxy 8, dans R secolo di ferro : rnito e realflrci del secolo voI.1, (Settimane di studio del Centro italiano sull'alto medioevo, 38) Spoleto : Presso la Sede del Centro, 1991, p.391-448.
8 The abbot and townsmen of Cluny in the twelfth century m, dam Church und City 1000- 1500 - Essays lit Honour of Chrbtopher Brooke, dd. D. Abulafia, M. Franklin et M. Rubin, Cam bridge: Cambridge Univ. Press, 1992, p. 1 5 1-7 1.
, a Seniores et pueri B Cluny aux Xe, XIe si~cles m, 1992. [Cf. BIBL10. AGES].
- , From Cluny to Citeaux m, dans Georges Duby - L Vcritwe et I 'Hbtoire, dir. C. Duhamel- Arnado et G. Lobrichon, (Bibliothique du Moyen Age, 6) Bnaelles: De Boeck Univ., 1996, p 3 17-22,
Cometudines monasticae, eine FestgabejBr bsius HaIIinger rn Anlmt seines 70. Gebwtstages, id. J.F. Angerer et J. Lenzenweger, (Sludia Ameimiunu, 85) Roma: Pont. Ateneo SAnselmo, 1982.
CORBET, Patrick, Les sain& ottonienr: saintete' dynustique, saintete' royole et saintete'jknrnine otnour de I 'm mil, Sigmaringen: J. Thorkcke. 1986.
COlTINEAU, D. L.-H., Re'pertoire topo-bibliographique des obbayes et priezire's, 2 vol., Miicon: impr. Protat, 1936-38,
COUSIN, Patrice, Prick d 'histoire monusfique, Paris: Bloud et Gay, 1956.
COWDREY, Herbnt EJ, Unions and Conhtemity with Cluny w, Jomai of EccZesi4~tical H'tor=y, XM (1956): 152-62.
- , The U M ~ d t h e Gregorim Reform, Oxford: Clarendon Press, 1970.
- , Two Studies in Clu- History, 1049-1 126 W , Sludi Gregoriimi, XI (1978): 1-298.
,a CIuny and Rome m, RM, n.s. 5 (1994): 258-65,
Cdttaa e SpHiurrfittri neIZa h.dmone monastica, ddi G, Penco, (Sndio Arneimanio, 103) Roma: Pont Ateneo S.Anselmo, 1990.
Current Sttrdies on CIiuy? M. W- Cahn, f J L Forsyth et W.C. Clark, no spkial de Gesta, XXVIVl-2 (1 988).
CYGLER, F, a L'ordre de Cluny et Ies "Rebelliones" au MII' sikle s Franciu, 19/1(1992): 6 1-93.
D'AMBROSIO, A., a Per una storia del regime dimentare wlla legislazione monastica dall'XI a1 ?MII secolo m, Benedictina, 33-2 (1 986): 429-49.
D'ANGELO, Mary Rose, 8 ABBA and the Father r : Imperial Theology and the Jesus Traditions n, Journal of Bibliwl Literatwe, IW4 (1992): 6 1 1-30,
DAVIES? Cyprian, a The Fmilia at Cluny in the Eleventh and Twelfth Centuries ., n h e , Louvain, 1963.
, a The conwrsus of Cluny: was he a Lay-Brother ? n, dans Benedicm - Studies in Honor of Sf. Benedict of Nwsia, (Cistercian Studies, 67) Kalamazoo (Mi.): Cistercian Publ., 1 98 1, p.99- 107.
DAWUL, Anselme, Le langage par signes chez les moines - Un catalogue de signes de I'abbaye de Fleury w, d a m SOUS la r&le de saint Beno& opeit., 1982, p.5 1-74.
, a Points de contacts en- la Vita Iohmmt Gorgiensir et les Consuetudnes FIoriacenses Antipiores *, dans L 2 b b q de Gone au F siZcIe, dtudes rhnies par M. Parisse et O.G. Oexle, Nancy Presses Univ. de Nancy, 1993, p. 183-92.
DELARUELLE, 8, a Le travail daas les *gles monastiques occidentaks du quatriime au neuviihe si2cle w. Journal de psychologie nonnole et appliqu&, 4 1 (1948): 5 1-64.
DELEHAYE, Hyppolite, SCMC~LF. Essai sw le culte des saints d m I 'AntiquilP, Bruxelles: Soci& des Bollandistes, 1927.
, Cinq le~ons sur la mkthode hagiogrqhique, BBnucIes: SocidtC des Bollandistes, 1934.
, Les Egendes hagiographipes, (Subsidia Hagiographica, 1 8a) Bnucelles: Soci6tC des Boilandistes, 1955 (4' id.).
DELISLE, LCopold, Ihvent& dw rnOntLScri&de Ia BN. Fondr de Chi , Park Librakie Champion, 1884.
DELOOC Piem, SocioIogi'e et waonirations, (Collections scientifqucs de la facult4 de dmit de I'Universit6 de Litge na30) Li&ge a la Hap: Martinus Nijxoff, 1969.
DESElf,I,& PIacide, 8 Les origines de la patemit6 spirituelle en Orient n, iatm. de I'ouvrage de W h i r Lossky ct Nicolas Arseniw, La ptemitk spiril~eIIe en h s i e cna XWP et me siPcIes, (Spiritualit6 orientale, 21) BCgrolIes: Abbaye de Bcllefontaine, 1977, p.7-26.
DEUG-SU, I, 8 Note wll'agiografia del secolo X c la santita laicaie 8, Shcdi Mediewdi, XlWl (luin 1989): 143-61.
DINTER, Peter, Zur Sprache der cluniazenser Consuetudines des 11. Jahrhunderts m, dam Comerudhnes monusticae, Erne Festgabe Air Kassius Hallinger, (Studia Amelmiha, 85) Roma: Pont. Ateneo S.AnseImo, 1982, p.175-83.
DOLBEAU, F, Anciens possesseurs des manuswits hagiographiques latins conserv6s ii la biblioth6que nationale de Paris 9, Revue d'histoire des textes, 9 (1979): 183-238.
DOLBEAU, F., M. HEWZELMANN et J.CI. POULM, Les sources hagiographiques narratives cornposdes en Gaule avant ['an mil (SHG). Inventaim, examen critique, datation r, Frmcia, 15 (1987): 701-3 1.
DONNAT, Lin, Les coutumiers du moyen ige et la R&gle de SBenoit n, Reguiae Benedicti SMia, 16 (1987 [1989]): 37-56.
, Les coutumes monastiques autour de i'an Mil m, dans Religion et culture autora de I'm MiI, dir. D- Iogna-Prat et J.-Ch. Picard, Paris: Picard, 1990, p.17-24.
, . Les coutumiers monastiques - Une nouvelle entreprise et un temtoire nouveau 9, RM, 3 (1992): 5-21.
, a Vie et couturne monastique dam la Vita de Jean de Gorze *, dam L Xbbaye de Gone au X sikcle, etudes rCunies par M- P m i et 0.0. Oexle, Nancy: Presses Univ. de Nancy, 1993, p.159- 82,
DONNAT, L. et W. WITTERS, art. a Consuetudini monastiche *, DIP, 2 (1975), co1-1692-95.
DUBOIS, Jacques, a Lt r6le du Chapitre dans k gouvemernent du monastkre 8, dam Sour la r 6 e de saint Benoit, op. cit., 1982, p.2 1-37.
, Les ordres monustiques, (C01l.a Que sais-je m, 224 1) Paris: PUF, I988 (2' i d . )
DUBOIS, Jacques et Jean-Loup L E ~ T R E , Solaces et mithodes de I 'hgiogaphie mt?diPvoe, (Colt. Histoire) Paris: ~ d . du Cerf, 1993.
DUBOIS, MarioGCrard, 8 L'accompapement spirituel dam la tradition monpJtique bier et aujourd'hui 8, ColI%iL, 5 111 (1989): 27-41.
DUBY, Gcorges, a Le budget de l'abbaye dc Cluny entre 1080 et 1155. b n o m i e domaniale et Cconomic mondtaire m, dms Hommm et strtcctwes db M i Age, Paris;/La Haye: &i. de r-ss, 1973, pm-82. [rep& des Anndes EPC, 7 (1952): 155-711.
- , Un inventaire der profits de la seigneurie clunisienne P la mort de Piem le V6ndrable n, dans Petru~ Yenerabilik, op.cit., 1956, p. 1 55-7 1.
, La smie'te' oram ef Xn si8cIe.s dmrr la r6jgiun mriconnaise, Paris: Bibl. g6nCrale de l'kole pratique des Hautes ~ t u d e s , 1988 (197 1).
- , a Lignage, noblesse et chevabrie au We siecle dam la nigion miiconnaise m, Annales ESC, 27 (1972): 803-23.
- , Le temps des ~uthe'drdes~ I'art et L soci6t6 9804420, Paris: Gallimard, 1976.
, tes trois ordres ou I'imaginaiie dufe'odalbne, Park Gallimard, 1978.
DWAL, And& art. a Regles et constitutions religieuses. 1. Vocabulaire r, DSpy 13 (1 988): 287-9 1.
L 'eremitho ih incidente nei secoliX7 e XI& Atti della seconda Settirnana internazionale di studio, Mendola, 30 agosto-6 settembre 1962,(MisceIlanea del centro di studi medioevali, 11) Milano: Vita e Pensiero, 1965.
ETAIX, Raymond, Le lectionnaice de l'office 1 Cluny m, dans Recherches augurriniennes, 11 (1976): 9 1-1 59.
~ tudes de civilisution mhdiPvoIe, LP-AP si2cles : m6lmrges offerts h E.-R Labunde, Poitien: CESCM, 1974.
L 'Europa dei secoli M e 1YIIfi.a novitfi e ~adkione: sviluppi di ma cuItwa, Atti della decima Settimana intemazionale di studio, Mendola, 25-29 agosto 1986, (Miscellanea del Centm di studi medioevali, XII) Milano: Vita e pensiero, 1989.
EVANS, Joan, Monastic Life at Clrcny 910-11 57, s. I.: Archon Books, 1963 (1 93 1).
FACCIO'ITO, Paolo, a La "Vita Geraldi" di Oddone di Cluny, un problema aperto b, Studi Medimuli, 33 (1 992): 243-63.
FARMER, Sharon, a Clerical Images of Medieval Wives b, Speculumy 6 1 (1 986): 5 1 7-43.
F E C m R J., Cluny. Adel und Yolk - Studien abet dm Verhdfnis des Klosters zu den Stciitden ( ' I 0-1 Z56), Stuttgart: Schwedtner, 1966-
FEISS, Hugh, Ciicatores: h m BeaedictofNursia to H m k of Romans m, American Benedictme him, 40/4 (1989): 346-79.
, a Art and Monasficism v, me American Benedictme Review, 42 (1991): 3 14-33,
- , Cace for the Tart : a Twelfth-Century Glossed Rule of Benedict for Notre-Dame de Saintcs a, Ammian Benedictine Review, 43/1(1992): 47-56.
FICHTENAU, H, Lebensorclbnmg des 10, J a h r W i : Studien iiber Denkart und Abktenz im er'nstigen KiwoImgerreich, S ~ t g a r t : A. Hiersemann, 1984. Trad. : Living in the cent. Mentalities andsocial orders, trad. P. Geacy, Chicago: Chicago Univ. Press, 199 1-
FINX, Maria-Luisa, a L,'editio minor della a fitam di Oddone di Cluny e gli apporti dell'Humillimus. Testo critic0 e nuovi orientamenti *, dans L 'Archigrnnmio, 63-65 (1968-1970): 132-259.
, a Studio sulla a Vita Odonis reformatu B di Nagoldo. I1 +ugmentum mutilum o, del codice latino NA 1496 della Bibliothhue Nationale 8, Rendicontidell 'Accademia discienze dell 7stituto di BoIogna CI'se di scienze morali (Bologna), 63/2 (1975): 33- 147.
Lesfoncrions des saints d m le monde occidental (2F-Xlllt s.), Actes du colloque organisi par 1'~cole Franpise de Rome a v s le concours de I'Univeait6 de Rome La Sapienza w, Rome 27- 29 octobre 1988, Rome: ~ c o l e Franptise de Rome, 1991.
FORSYTH, Ilene, a The Ganymede Capital at V6zelay m, Gesta, XV (1976): 24 1-46.
FOVIAUX, Jacques, a La immunitb ecclbiastiques (IX'-XIe sikles) m, dans L 'Eglie du R aouXle sikle, Centre d 'arche'ologie er d'histoire m&dit!vaIes (CAHMER), 3 (1 99 1): 47-67.
FRANC& John, Rodulfits Glaber and the Cluniacs my Jomul of Ecciesi4sticui Hktory, 39 (1988): 497-508.
FUMAGALLI, Vito, Note sulla " Rtu Geraldr" di Oddone di Cluny n, BuIIetino dell Tstihrto Sforico Itafimo per il Medioevo, 76 (1 964) : 2 17-40.
GARAND, Monique-CCcile, a Le scriptoriurn de Cluny, camfour d'influences au XIL siiicle : le manuscrit Paris B.N. Nouv.acq.lat. 1548 m, Journal des savunts, 1977: 257-83.
- , Copistes de Cluny au temps de saint Mayeul (948-994) m, Biblioth6que de I 'Ecole des Chartes, CXXXVI (jan.-juin 1978): 5-36.
8 Une collection personnelle de saint Odilon de Cluny et ses compliments B, Skr';Ptorium, XXMn (1979): 163-80.
- , Un manuscrit d'auteur de Raoul Glaber ? Observations codicologiques et paliographiques sur le ms- Paris, B-N., latin 109 12 n, S~riptoriurn~ XXXVII (1 983): 5-28.
-, Les plus ancims dmoins consew& des Comerudines cImiacenses d7Ulrich de Ratisborne m, dans &ire f&er~p., op.cit, 1988, p. 171-82.
GAFFER, Baudoin dc, hudm eririquar d'kgiopuphie et d'iconoIogie, (Subsidia hagiographica, 43) Bnrxellcs: Socidt6 des Bollandistes, 1967.
- , Mcntalu de I'hagiographic m6di&ale d'apds quelqucs travaux rdccnts ID, AB, 86 (1968): 391-99.
,a Hagiographie ct hiioriographit. Quelques aspects du probl&me m, dans LQ Storiogrofia alfomedi'aIe, ti& (Settimane d i studio del Centm italiano di studi sull'alto mediew, 17) Spoleto: Press0 la Sede del Centm, 1970, p. 139-66.
GAUDEMET, Jean, dir, Les tflections d m I 'Eglise Iatine des orignes au X P sEcIe, Paris: ~ d . Lanore, 1979.
GEARY, PJ, Ftaia Sacra Thefts of Relics in the Central Midde Ages, Princeton: Princeton Univ. Press, 1990 (2' dd,). Traduction firan@se : Le vol des reliqws cnr by en dge : Fwta Sacra, trad. P.-E. Daunt, Paris: Aubier, 19%.
, 8 Saints, Scholars, and Society : The Elusive Goal m, dans Smcta, Sunclu~ : Sfudies in Hagiography, dd, Sandro Sticca, Binghamtan: CEMERS, ii paraitre; repris dans Living with the Dead in the Mici'e Ages, IthadLondon: Cornell Univ. Press, 1993, p.9-29.
GERZ, V, - Le catalogue de la biblioth&que de Cluny du Xle sikle reconstituk m, Scriptorium, 4612 (1992): 256-67. [cf, V. von Biiren]
GEHRKE, Pamela, Saints and Scribes : Medieval H~giogr~pphy in its Mmurcripr Context, (California Publications in Modern Philology, 126) Berkeley: Univ. of California Press, 1993.
GIORDANENGO, Genevihve, 8 La fonction d'abb6 d'apr6s l'oeuvre de Geoffhy de Vend6me m,
Rewe d'liiitooire de I gghe de Frmce, 7 1 (1990): 1 65-84.
GOUGAUD, Louis, Anciennes coutumes cluustrales, Liguge Abbaye Saint-Martin, 1930.
Le gomementent d'Hugues de &mra ci C l q , Actes du colloque scientifique international (Cluny, septembre 1988), Cluny: Ville de Cluny et CNRS, 1990.
GRADOWICZ-PANCR, Nina, a Enfennement monastique et privation d'autonomie dans les dgles monastiques (V-We sikles) m, Rewue hisrorique, 583 (juil-sept. 1992): 3-1 8.
GREGORE, Riginald, a La communion des moines-prCtres A k messe d'aprks les coutumien monastiques rnidi6vaux J+ Sacris e d i r i , 18 (1967-68): 524-49.
-, Resecln d e b Regola di S&ncdetto nella litteratma agiogdca latina medievak m, dans Discomi e Cogemue tcmdi nek ceiebrmbni assmesiper if XYcentenurio deIIu narcitu di srm Benedetto (48&1980), wdca 11, Miscellanea cassinesc, 46) Montccassino: Pubblicazioni CassinesE, 1984, p341-48.
GREGOIRE, R et J. LECLERCQ, comptcs-rendus des v01.I et II du CCM, Shdi Medieali, 1964, p.65848.
GRIBOMONT, JI art. ah Regola. I. Vmione g e n d e fi~ologic~~stotica delk regole e costituzioni religiose. 1. AntichitA w, DP, W (1 983). d. 141 1-14.
GROSS, Angelika a Jaqueline THIBAULT-SCHAEFER, a SCmiotique de la tonsure de I'"Iiipiensn H Tristan et aux fous de Dieu R, dans Le cferc mr Mioyen lge , (SCn&ance, 37) Aix- en-Provence: Publ, du CUERMA, 1995,245-75.
GRUNDMANN, Herbe% a Adelskkehrungen im Hochmittelalter : Conversi und nutriti im Kloster m, 1968. [Cf. BIBLIO. AGES]
Hagiiaphie, cu2- ef sociPtPs (ZP-XP sihcfes), Actes du colloque organid B Nanterre et i Paris (2-5 mai 1979), Cd. E. Patlagcan et P. Rich&, Paris: Ctudes aupstiniennes, 198 1.
HALLINGER, Kassius, Gone-Kluny. Stdim N dm monmtkchen Lebensformen und Gegema"tten im HochmitteIdter, 2 vol, Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 197 1 (1950-5 1).
, a Zur geistigen Welt der Anfanp Klunys D, Deutsches Archh, X (1954): 41 7-45 Partiellement traduit dam I'article a Le climat spirituel des premiers temps de Cluny *, RM, XLVI (1 956): 1 17-40.
, Klunys Briiuche mr Zeit Hugos des Gmssen (10494 109). Prolegomena zur Neuherausgabe des Bemhard und Udalrich von Kluny r, Zeirschny der S'igny -Sttjlmg@ Rechtsgeschichte - Kbnonistische Abteilung, 45 (1959) : 99- t 40.
, art. ah Consuetude (benedictina) W, Rep.Fonf., III (1970): 623-32.
, a Clberlieferung und Steigerung im MBnchtum des 8. bis 12. Jahrhunderts m, Studia Anselmiana, 68 (1979): 1 25-87.
- , a Comencdo. Begriff, Formen, Fonchungsgeschichte, Inhalt *, dam Untersuchugen zu Mosrer mdSt@, (Ver6ffentlichungen des Max-Planck-Instituts fir Geschichte, 68) GBttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1980, p. 140-66.
HAMMET, Peter E, a Care for the Individual in the Rule of Benedict ., American Benedictine Review, 39/3 (1988): 277-86.
HASQUENOPH, Sophie, La mort du moine au Moyen Age (X'-XI'' sikle) *, CollC&r., 53 (199 1): 2 15-32,
HEAD, Thomas, Higiogrqp& rY the Cult of Saints - llie Diocose of (hlioml 800-1200, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990.
HEATH, RG, CM Impetatonr Philmophio : Imperr'uI Horuons of the C h i i C~nfiafernities~ 9Wf109, Pittsburgh (PA): The Pickwick Ress, 1976.
HEEhlE. -en, MCtOVillgh and Chling*n Hagiography. Continuity or Change in Public and Aims ? m, AB, 107 (1989): 415-28.
Can,& Dc Chrodegang i Cluny iI, cadre de vie, organisation r n ~ n ~ ~ q u e . Spkndeur monastiquc m, dam Solo Ia MgIe de smnt Benolt, op.cif., 1982, p.49 1-97.
, Les biitisseurs de Cluny r, L 'Hiistoire, no 122 (rnai 89): 86-93.
HELVETIUS, A*-M., Les mod&les de saintete dam les mondes de I'espace belge du Vm' au Xe sikle 3 dans Le monach&ne ri Bpmce, op-cit., M, 1 03 (1 993): 5 1-67.
HENRIET, Patick, a Saint Odilon devant la rnort. Sur quelques donn6es implicites du comportement celigiewr au 1 1' sYcle *, Le Moyen Age, X W 2 (1990): 227-44.
, a Le dossier hagiographique de saint Maieul de Cluny. A propos d'un oumge rCcent *, Le byee en Age, 9711 (1991): 79-81.
, La propriitd clunisienne comme ciment social (909-1 049) m, Le ~ o ~ e n ige, 9816 (1 992): 263-70.
HerrschgF tmd kfiche - Beitrdge zur Entstehung und Wirkmgsweise episkopaler und monustiwher Organkationsformen, a. F. Pcinz, (Monographien zur Geschichte des MitteIaIters, 33) Stuttgart A. Hiersemann, 1988.
HESBERT, Rend-Jean, a Les tdmoins rnanuscrits du cuke de saint Odilon B, dans 2 Cllmy, op.cit., 1950, p.5 1- 120.
Wioire des saints et de la sum fete' cbtitiemte, t,W Au temps du renouveau tbmge'lique 1054- 12 74, dir. Andk Vauchez, Paris: Hachette, 1986.
l'ges of Sainthood in Medimal Europe, dd. Renate Blumenfeld-Kosinski et Timea Szell, Ithaca et London : Cornelt Univ. Press, 1991.
HOUBEN, Hubert, a I1 monachesimo cluniacense e i monasteri nonnanni dell'Italia meridionale *, Benedictina, 39 (1992): 341-61.
HOWRLIER, Jacques, Saint Odilon abW de C I v , (BibIiothtque de la revue d'histoire eccldsiastique, fasc. 40) Louvain: Publ. Universitaires de Louvain, 1964.
HUNT, Noreen, 6d, CZuny under Saint Hugh, 1049-1 109, London: Publ. Edward Amo Id, 1 96%
- , CJuniiac Monaticim in the Cenfral M a e Ages, Hamden (Conn.): Archon Books, 197 1.
IOGNA-PICAT, Dommiquc, Continmcc et virginit6 dans la conception clunisieme de I'ordre du mondc auto- de Van Mil m, Comptes rendus de I X d t m i e d u I m m e et Belles Lettres de Pa&, 1985, p.127-46.
-, a Entre ler 1- de l'hriture a les enseignerncats du platonisme c W e n : la vie de saint dam le Cluny & I'm mil m, dans 2 si&, kcherches noweiIes. Contribution au CoIIoque Hugrres Wt 987-1987 : Lo Frmce de I'm mll, dir. P. RichC, C. Heitz et F. Heber-Suffiin, (Centre de recherche sur rantiquit6 tardivc ct le haut moyen 6ge) Nantcm: Univ. de Paris X, 1987, ~39-41.
, a D'Auxerre h Canossa en passant par Cluny *, dans Le millhaire caphrien, Journde organisdie Auxerre, le 14 avril1987, Bulletin de la Socie'te'des sciences hiktoriques et nutweles de I 'Yonne, 1 19 (1987): 49-56.
, Agni inrrnacd~. - Recherches w les sources hagiographiques relatives 6 saint Maieul de Chy (954994), Paris: a. du Ceg 1988.
, Les morts dans la comptabiIit6 cileste des CIunisiens de I'an Mil I, dans Reli'on et cufture autour de I 'an Mil, Royaume captien et Lotharingie, Actes du Colloque Hugues Capet, 987- 1987, La France de 1'An Mil (Awtene, juin 1987 ; Metz, septembre 1987), bd. D. Iogna-Prat et LC, Picard, Paris: Picard, 1990, pS5-69.
, r La croix, le moine, I'empereur : ddvotion ii la croix et thiologie politique H Cluny autour de 1'An Mil, dans I'hagiographie en GauIe jusqu'k la fin de I'tpoque mhvingienne *, dam H h i ~ ~ ~ e n - A g e - CuIlw-e, &ucation et ~arie'te'- ~ t d a oflertes 6 Pierre Rich&, dir. Michel Sot, La Garenne-Colornbe h. Europt5ennes Erame, 1990, p.449-75.
, a Hagiographie, thiologie et theocratic dans le Cluny de I'an Mil 8, dans Les functions des saints, upcit., 1991, p.241-57.
- , La geste des origines dans I'historiographie clunisie~e des XI ' et XI1 ' sikles 8, Rb, 1 02 (1992) : 135-91,
, u Panorama de I'hagiographie abbatiale clunisienne (v.940-v.1140) b, d a m Miuscrits hagiugraphiques et travail des hagiographes, 6d. M . Heiwelmann, (Beihefie der Frmcia, 24) Sigmaringen: Jan Thorkcke Verlag, 1992, p.77-118.
, Coutumes et statuts clunisiens comme sources historiques (ca 990- ca 1200) ., RM, 3 (1992): 23-48.
- , ah a Cluny m, dam Dictionnuire des lettresf;m~aises - Le Moyen Age, dir. G. Hasenohr et M. Zink, Paris: Fayard, 1992, p.3 1 1 - 16.
- , a La confection des cartulaires et l'historiographie ii Cluny (XF-W s.) m, Les cartuZaires, Actes de la table ronde organisb par 1'~cole Nationale des Chartes et le GDR 121 du CNRS
(P& 5-7 d b b r e 1991), Cd 0. Guyot jea~h, L. M o d e et M. Parisse, Paris: h o l e des Chartcs, 1993, p27-44.
- , a La W i a du Sud, 930-1 130 v, dam Hagtogrqphies - Hktoire internotionale de la kMrmtw l ' e ef vent&& a Occtdent dcs originu ri ISSO, I, Cd. G. Philippart, (Covpur christ iono~ - Hagio%raphiey I) T d o w Brcpols, 1994, p 3 1944.
IOGNA-PUT, D. ct C. SAPIN, 8 Les 6tudes clunisiennes dam tous leurs dtats - Rencontre de Cluny, 2 1-22 septembre 1993 m, RM, n.s. 5 (1994): 233-58.
L W i a nel p d i o dell 'espcaione europea del rnonachesinto clmiacense, Atti del Convegno Internnionale di storia medievale, Pescia 26-28 novembre 1981, (Pubblicazioni del centro storico benedettino italiano ; Itaiia Benedettina, VIII), Cesena: Badia di Santa Maria del Monte, 1985.
htituzioni monastiche e ktiMoni canonicalr' in Occidente (1123-ItIS), (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 7), Spoleto: Presso la Sede del Centro, 1982.
JACOBS, H, Die Cluniazenser und das Papstturn im 10. und 1 1. Jahrhundert V, Frmciu, 2 (1974), p.643-63.
JARECKI, W., Signo fquendi. Die cluniacensischen Signa-Listen, (Saecula-Sp iritaIia, IV) Baden- Baden: Koemer, 198 1.
JOCQUB, Luc, Les structures de la population claustrale dans I'ordre de Saint-Victor au XIIe sikcle. Un essai d'analyse du Liber Ordinis V, dans L 'abbaye parisienne de Saint-Victor ou M~ Age, WIe colloque d'Humanisme m6diivaI I Paris. Cd. Jean Longen, (Bibl. Victorina, I) Paridhrnhout: Brepols, 199 1, p.53-95.
KLEINBERG, M a d , Prophets in their OMI Lurid* Chicago: Univ. of Chicago Press, 1992.
KNOWLES, David, a The Reforming Decrees of Peter the Venerable m dans Petru Venerabilis, op.ci&, 1956, p.1-20.
KNOWLES, D. et D. OBOLENSKY, me Middle Ages, (The Christian Centuries, 2) London: Darton, Longman & Todd, 1969.
KOHNLE, d i n , Abt Hugo von CIuny (1049-1 log), (BeiheAe der Francia, 32) Sigmaringen: Jan Thorbecke, 1993.
LAHAYE-GEUSEN, M., Dm Opfr der Kinder, 1991. [cf. BIBLIO. AGES]
LAMMA, P., Mumenti di storiografia ~Iunic~cerrse, (Studi storici, 42-44) Roma : 1st ituto S torico Italiano per il Medioevo, 1961.
LAWRENCE, Clifford Hugh, Mediirul Monusticicnc Fonnr ofRei@ot(s Lve m Western Europe in !he M a e A g e LondodNcw York: Longman, 1989 (2= M).
LE BRAS, G, Ihstihdions ecc~Plsr'~stiques de la chPlient6 mddiwale, 2 vol, (Hiiise de l'gglise des origincs jusqu'i nos jours, 12) Paris: Bloud et Gay, 19594964.
LECLERCQ, Jean, Provetks monastiques dam Andecta monastic4 - f&re se'rie, (Shfdia AnseInr i~ 20) Rorna: Pontificum M t u t u m S.Ansclmo, 1948, p-120-23.
, 8 Cfuny firt-il cnncmi de la culture ? a, RAd, 47 (1957): 172-82.
, Nowelle dponse de I'ancien monachisme am critiques des Cistemiens m, Rb, 67 (1957): 77-94.
- , * Pout une histoire de la vie h Cluny s Rewe d 'Hhtoire Eccle'siizstique, 57 (1962): 385-408 et 783-8 12.
, a Les itudes dam les monasths du Xe au XII' si&cle *, dans Los monies y los Esrudios, IV semana de Estudios Monasticos, Poblet: Abadia de Poblet, 1963, p. 105- 18.
, a L'Ccriture sainte dans I'Hagiographie monastique du haut moyen 5ge m, dans La Bibbrb nell 'alto medioevo, (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 10) Spoleto : Presso la Sede del Centro, 1963, p. 103-28.
, a Documents sur les "tirgitifs" 8, dam Id, Analecta monastics, voI.7, (Stdia Amelmima, 54) Romx Herder, 1965.
, art. Cluniacensi m, DIP, II (1975), col. 1 198-1200.
, a La christologie clunisienne au sihle de SHugues *, S~udia Monastics, 3 1/2 (1 989): 267-78.
, a Priait-on il Cluny ? m, CollCtrt., 52 (1990): 330-42.
, L 'amout des lettres et le &sir de Die% Initiation mn auteurs monastiques du Mwen Age, Paris: hi. du Gee 1990 (3' 4.)
- 8 Mourir et sourire dam la tradition monastique m, S&ia Monasticu, 391 (1993): 55-67.
LE GOFF, Jacques, L 'imaginaire midiha1 - Essuis, Paris: NRF-Gallitnard, f 985.
- , a Le rire dam la rQ1es monastiqu du haut Moyen Age m, dam H a t Mioyen-Age - CuItwe. lhfucation et ~ m i e ' t ~ - ~ludes offwes ti Pierre Riche', dir. Michel Sot, La Garenne-Colombe: kl. EurojSennes ~rasme, 1990, p.93-103.
L E M ~ T R E , LL, L'inscription dans les n6crologes clunisiens, XIe-XIIe sikles ., dans La mort au Moyen Age, (Colloque de la socidtt! des historiens mddi6vistes de l'enseignemmt supCrieur public, 1975) Strasbourg: Librairie Istra, 1977, p. 153-67
- , Mi& h Saint-Miid. k comm4moration des nwrts et les obituaires ti Smnt-MmziaI de Limogcr d u s i c e Paris: de Boccard, 1989.
-, Les livrrs de mMeeine dans 1 s momst&es clunisicas au ~ o y e n Age d'apds les inventaires et Ics livrrs COIISCN& w, dans Monochime et techoI'2, op.cit., 199 1, p.276320.
LEMARIGNIER, Sean-Fran~is, S t r u m mb118~b~qucs et struchmo politiques dans la France de la fin du Xe et dcs d6buts du XI si&les 8, dam Il monachesho nell'uIto Mediuevo e la formmtone defla civil!& oaidcrtde, (Settimane di studio dcl Centm italiano di studi sull'alto mediava. 4) Spolcio: Rcsso la Sede del Centro, 1957, p.357-400.
, a Political and Monastic Structures in France at the End of the Tenth and the Beginning of the Elewnth Century m, in Lordshtp d Cummuni@ in Medieval Europe. Selected Readings, ed F.L. Cheyette, Huntingdon (N.Y.): RE. Krieger Publ. Company, 1975, p. 100-27.
LENTINT, Anselmo, a 11 monastero-famiglia c-one di SBenedetto a, dam Dircorsi e Confireme renuti nelle celebrazioni ccarsinesi per il XV centenario delh nascita di san Benederto (480- f98O), (Monastiea II, Miscellanea cassinese, 46) Montecassino: Pubblicazioni Cassinesi, 1984, p.277-82.
L'HERMITE-LECLERCQ, Paulette, Le monachihe firnittin dons ia socitfrt! tie son temps - Le monart61e de in Celle (XTde'but d u r n sidcIe), Paris: Cujas, 1989.
, a Roseline, Jeanne et Jeanne-Diane, trois bienheureuses chez les Villeneuve en un siecle ? Difaillances et complaisances de la mimoire, vertiges de I'imagination v, RM, nr. 4 (1993): 133- 76.
- , a Les pouvoirs de la sup6rieure au Moyen Age B, dam k s r e l i ' e s dms le cloitre ef dims le monde, Actes du dewrikrne colloque international du C.E.RC.O.R, Poitien, 1988, Saint- ~tknne: Publ. de I'Univ. Jean-Mo~et, 1994, p. 165-85.
L'HUILLIER, A, dorn, Vie de s&t Hugues, abbb de CImy 1024-1 109, Solesmes: Imprimerie Saint-Pierre, 1 888.
LIFSHITZ, Felice, Beyond Positivism and G e m : "Hagiographicdn Texts as Historical Narrative m, Viator, 25 (1994): 95-1 13.
LITTLE, Lester K, Pride Goes Before Avarice - Social Change and the Vices in Latin Christendom 8, American Historical Review, 7611 (197 1): 16-49.
- , Benedictme Moledictions : Linagt'caI Cursing in Romanestpe France, Ithaca 0: Cornell Univ. Press, 1993,
LOBRICHON, G., a L'engendrement des saints : le ddbat des savants et la revendication d'une saintett exemplaire en France du nord aux XIe et au debut du We B, dans Fonctions des saints ..., op.cit., 1991, p.143-60.
- , Gli usi della Bibbia v, clans Lo qx&k Ietterario del Mediiorvo. I Il Medioevo idino, a. G. Cavallo, C. Leonardi et E Mencstb, voL 1 : Lu prdtcnbne ckl testo, Rorna. Salemo Editrice, 1992, -42.
- , a Iks IdeaMld adliga Laienfrthnmgkeit in den Anflingen Clunys: Odos Vita des G d e n Gerald voa A m * U 8, dans Benedictine Cube 750-1050, op.cit., 1983, p.76-95.
LYNCK JH, a Hugh I of Cluny's Sponsorship of Henry N, its Context and Consequences m, SpeCtJm, LX (1985): 800-26.
MAHLER, M., art. Benoit (saint) et BdnCdictins m, DSp., t.I, ~01.1410-22.
Mmlserits irag*ogruphiques et travail des hagbgtaphes, (Beihefte der Francia, 24) Cd. Martii Heinzelmann, Sigmaringen: h Thorbecke Verlag, 1992.
MARTIMORT, A.-G, L a *&dines r, les ordinaires et les ce're'monies, (Typologie des sources du Moyen Age occidental, 56) Turnhout: Brepols, 199 1.
McGUIRE, Brian Patrick, Friendhe and Community. T%e Monastic Erperience 350-1250, (Cistercian Studies Series, 95) Kalamazoo: Cistercian Publication Inc., 1988.
MELVILLE, G., Cluny apes "Cluny". Le treizi6me siMe : un champ de recherche *, Francia, 1711 (1990): 91-124.
, Zur Funktion der Schriftlichkeit im institutionellen Gefiige mittelalterlicher Orden a,
FdkSt-, 25 (199 1): 286-3 14.
MICHAUD, Jean, Les inscriptions romanes des musees Ochier et du Farinier H Cluny *, Cahiers de Civilisation Mt!di&vaie, 3 812 (1995): 165-72.
MILIS, Ludo, a Dispute and Settlement in Medieval Coenobitical Rules n, BuiIetin de I'Imtirut Historique Beige de Rome, 60 (1990): 43-63.
- , Angelic M i and E d y Men, Monasticim and its Meaning lo Medieval Sociew, London: Boydell, 1992.
MiIZe'naire monastique du M i Saint-Michel, I: Histoire et vie monastiques, 6d. I. Laporte, (Bibl. d'histoire et d'archCologie cMtiennes, 1) Paris: Lethielleux, 1966.
R Monuchesimo neN Mo Medioevo e la fonnazione deiia civil& occidentde, (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 4) Spoleto: Presso la Sede del Centro, 1957.
Le monochisme ir gtzmce et en Occident : du WIF au K si6cle. Aspects internes et relations mec la sociPIP, Actes du colloque international organid par la Section d' Histoire de I' Universiti Libre
de Bruwlles en collaboration avec l'abbaye de Miucdsous, 14-16 mai 1992, dd. A. Diedcens, D. Misone et I.-M, S-m, Rb, 103 (1993).
Moniufime u technotog2 doP Zu sociktd ddiiwlc du X au MII' si.cZe, Actes du colloque scientifique -om& Cluny, 4-6 scptcmbre 1991, fir. C. Hctzlen et R de Vos, Cluny: h o l e Ndonafe Sup&ie~~ t d'Azts ct M&ers, 199 1.
M u ~ c k l & $ n m im 9. d l O . J&*, bd Raymund Kottjt et Hehut Maurer, (Voctriige md Forschungen, 38) Sigmaringen: Jan Thorbecke VerIag, 1989.
MORTET, Victor, Note sur la date de daction des coutumes de Cluny dites de Farfa m, dans MIZe'nmie de C Z , . Con@ d'histoire ct d'archhlogie tenu ii Cluny les 10, 1 1, 12 septembre 1910, Miicon: Protat, 1910, p.142-45.
MOULlN, LCo, La vie quotidenne des rell@eux mr Moyen Age (F - XIC siecIe), Paris: Hachette, I987 (1978).
MOUNTEER, Carl A, Guilt, Martyrdom and Monasticism ., JPH, 912 (198 1): 45-71.
Le Moyen Age et la Bible, dir. Pierre Rich6 et Guy Lobrichon, Paris: Beauchesne, 1984.
~ S S I G B R O D , A., a Zur NecrologIiberlieferung aus ciuniacensischen Kl6stem. (At Abbeys of Cluny, Moissac, Saint-Martin des Champs, Longpont-nu-Orge and Limoges) r, Rb, 98/1-2 (1988): 62-1 13.
NEBBlAI DALLA GARDIA, D., Les listes m6di6vales de lecture monastique. Contribution a la comaissance des anciennes bibliothkques monastiques s Rb, 96 (1986): 271-326.
NEISKE, Franz, a Concordances et diffdrences dam les n6crologes clunisiens. Aspects d'une andyse statistique m, Revue d'Histoire Ecclt!siustique, 68 (1982): 257-67.
, rn Der Konvent des IUosters Cluny nu Zeit des Abtes Maiolus. Die Namen der MiSnche in Urkunden und Necrologien 8, dam "VincuZum Smietatb", up.cit., 199 1, p. 1 1 8-55.
NOISETIE, Patrick, 8 Usages et repdsentations de I'espace dam la Regula Benedicti, une nouvelle approche des significations historiques de la R6gb b, dans Fibtper Intemationoler Repla Benediki'-Kongress, Regdae Benedicti Shrdiu, 14-15 (1988 pour 1985-86): 69-80.
PACAUT. Marcel, a Structures monastiques, rocidti a &ise en Occident aux Me et XIle si&cles V,
dans Rspects de la vie conventueIIe aux AT et XP sihcles, Actes du St Congds de la sociitC des histodens mCdi6vistes de I'Enseignement sup&rieur, saint-hieme, 7-8 juin 1974, Lyon: Cahiers d'histoire, 1975, p. 1 1-23.
- , a Ordre a libertt dam r ~ ~ ~ i s e . L'influence de Cluny aux XIe et MIe sikcles b, dans The End of Sf.@%, Papers from the Colloquium of the Commission internationale d'histoire eccl6siastique comparte (Durham, 198 I), id. David Loades, Edinburgh: T.M. Clark, 1984.
republit Qns Dactrinespofitiips et ~lructtrres e c c I P l s m dans I'Occident mPdi&al, &i, M. Pacaut, London: Variorum Reprints, 1985, p.155-79.
-, La formation du second &mu monastique clunisicn (v.1030- v.1080) w, dans Naissunce et fonctiomeort &s m o ~ i ~ t a e s et can&-, actes du let Colloque International du CERCOM, Saint-Eticnnt, 1618 sep. 1985, Saint-Etiennc: CERCOWUniv. Jean Monnet, 199 1, p.43-5 1.
PALAZZO, hc, Le Age cles oriees auXlF siefle, @istoire des liwes liturgiques) Paris: Beauchesne, 1993.
PARISSE, M. et O.G. OEXLE, dir., L 'abbaye de Gone arc X sikle, Nancy: Presses Univ. de Nancy, 1993,
PENCO, Gregorio, La composizione sociale delle communiti monastiche nei primi secoli I, Studia Monastics, 4 (1962): 257-8 I,
- , a Le figure bibliche del a Vir Dei 1, neIl'agiografia monastics m, Benedictina, 15 (1968): 1- 13.
, a Sul concetto de1 monastero come "scholan ., CollCist., 32 (1970): 329-33.
, Un nuovo manoscritto italiano della ReguIa Magiktri I, Benedictina, 18 (1971): 227-33.
, L'abate e la communiti nelle Regole Magr'stri e Benedicti m, dans Spiritufitri Monustica. Aspeffi e momenti, (Scritti Monastici 9) Abbazia di Praglia: Ed. Scritti Monastici, 1988, p.96- 110.
, a Senso dell'uomo e scoperta dell'individuo nel monachesimo dei secoli XI e XU ., Benedictina, 3 7 (1990): 285-3 15.
, a I secoli XI-XII : apogeo o crisi del monachesimo ? m, Benediflnu, 38 (1991): 35163.
P e w Venerabilis I156-1956: Stdies and Terts Commemorating the Eighth Centenary of his Death, 6d. G. Constable et James Kritzxk, (Studia Anselmiana, 40) Roma: Herder, 1956.
PHILIPPART, Guy, a Le saint comme pacure de Dieu, hdros dducteur et patron ternstre d'apks les hagiographes lotharingiens du Xe s. v, dam LesBnctium des saints. .., op.crS., 1991, p.123-42.
, a Hagiographes et hagiographie, hagiologes et hagiologie. Des mots et des concepts ., Higiographicur Rivista delh Societri IntmazionaIe per lo Studio del Medioevv, I (1 994): 1 - 16.
- PHILIPPEAU, H-R, Pour I'histoire de la coutume de Cluny m, RM, 44 (1 954): 14 1-5 1.
P U O w A.M., "Miitiiz Christ#?' e Cllmiacensi m, dans "MIitio Chrkti* e Crociata neisec. XI- =, Atti delh XI Scttimana in-onale di studio, Mendola, 28 ag.4 sett. 1989, (Miscellanea dcl Centtm di studi mediavaii, 13) Milano: Vita e Pensino: 1992, p.241-69.
PICASSO, G, m "Usus" e "ConsuctudincoU clrmircasi in Ierlia v, dans L'laIia nei q d r o dell'esponrione eun,peadeI~011cu:hesi1110 ~Iuniacense, Atti dcl conveguo intcrnazionale di naia medievale (Pcscia, 26-28 novembce 1981), dir. C. Violante, A. Spicciani d G. Spinelli, (Italia benedettino, 8) Ccscna: Cenm storico bcnedcttino italiano* 1985, p.297-3 1 1.
Pierre AbkIord - Pime k Vin&abie: l a cowants phiiosophiques IittPraires et &tipes en Occident au m i k t th XF s., Actes a rndmoires du calIoquc international tenu B I' Abbaye de Cluny, du 2 au 9 juillet 1972, (Colloques intemationaux du CNRS* 546) Paris: hi. du CNRS, 1975.
PIGNOT, J.-H, Histoire de I 'wdre de CIuny d e w s lafindation de I 'abbaye j q u 'ci la morf de Pierre le VPnPrabie, 3 vols, Paris : Durand, 1878.
POECK, Dietrich, Laienbegriibnisse in Cluny B, FehSt., 1 5 (1 98 1): 68- 179.
, a Cluniac Necrologies. A Status Report v, dam Mediewl Prosopography. 3 (1 982): 27-62.
, a La synopse des nicrologes clunisiens V, RM, 60 (1983): 3 15-29.
POLY, J.-P. et E. BOURNAZEL, La mutation fe'odale (X-XP skkfes), Paris: PUF, 1980.
POULIN, Joseph-Claude* L 'idM de saintete' dms i 2quitmne cdingienne d 'apr2s les sources hagiogrqhiques (750-950), (Travaux du labomtoire d'histoire religieuse de I' Universiti LavaI, 1) Laval: Presses de 17Univ. Laval, 1975,
, art, Geraldus v. Aurillac n, Lexh44, IV/6 (I 988): 1297-98.
Prieurs etpriewk d m I 'Occident mPdiivaI, Actes du Colloque organid h Paris le 12 Novembn 1984 par la 4e section du E P ~ S S et I'IRHT, dir. Jean-Lmp Lemab, (Hautes Etudes mtidi6vaIes et rnodemes, 60) Paris: Champion, 1986.
RACINET, Philippe, Les makons de Z'Ordre de Cluny mc Moyen Age : holution et permanence d 'm m i e n ordre b6nidictin au notd de Park, Bruxelles: kid. Nauwelaects, 1990.
RANFT, P., The Maintenance and Tranfinnation of Society through Eschatology in Cluniac Monasticism m, Jountol of Retigrbur History, 14/3 (1987): 246-55.
art Reclutamento *, DIP, VII (1973), ~01.1245-56.
REIMANN, Norbert, a Die Konstitutionen des Abtes Willhelm von Hirsau. Bernerkungen zur aerlieferungs- und Wirkungsgeschichte n, dans Hirsm S. Peter ond P a d 1092-199 I. vol. 2, dir. K. Schreiner (Forschungen und Berichte der Archologie des Mittelalters in Baden- Wurtemberg 1 O), Stuttgart: Kommissionsverlag, 199 1, p. 10 1-08.
ReIigron et dltrre mow de 1 ' . Mil - Royotane cc@*tien et Lotharhgte, Actes du colloque "Hugues Capet 987-1987. La France de I'm Miln, Auwm, 26 a Zl juin 1987 - Metz, 11 et 12 septanbrc 1987, h d c s dunits par D. Iogna-Pnt ct LC. Picard, Paris: Picard, 1990.
Rena&smc d R m d lir the TwIm Centmy, €d. RL, Bcnson et G. ConstabIe avec Carol Danor Lanhrm, Cambridge (Mass.): HPwd Univ. Press, 1982.
RESNICK, IM., Peter Damian and CIuny, Liturgy and Penance v, Shda L i h a g b , 18 (1988): 170-87-
- , Odo of Tournai and Peter Damian. Poverty and Crisis in the Eleventh Century a, Rb, 98 (1 988): 1 14-40.
RICHE, Denyse, a Tentatives de #forme il Cluny aux XNe et XVe sikles V, dans Maisom de Dieu et hommes d 'Eglir, FloriI&ge en I ' ~ o M ~ w de PiemRoger Gaussin, dir. & Duwton, J. Giraud et N. Boutcr, saidtienne: Univ. Jean hdomet/CERCOR, 1992, p.43-60.
RICHTER, H, Die Persbnlichkei~sd~stefIung in clmimensischen Abtmiten, Erlangen: Inaugural- Dissertation, 1972.
ROCCA, G, art. Regola *, DP, VIf (1983), 14 10-1 1.
ROMAGNOLI, Roberto, a Studi Recenti sul monachesimo cluniacense m, Quadenti MedievaIi, 29 (1 990): 236-45.
ROSENWEIN, Barbara a Rules and the Rule at the Tenth-Century CIuny 9, Studia Monastics, 19 (1977): 307-20.
, Rhinoceros bound: Cimy in the Tenth Century, Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1982.
, To be the Neighbor ofsainr Peter. The Social Meaning of CZmy 's Property, 9094069, Ithaca: Cornell Univ. Press, 1989,
ROSENWEM, Barbara H., Thomas HEAD et Sharon FARMER, 8 Monks and their Ennemies : A Comparative Approach V, Specuium, 66 (1 99 1) : 764-96.
ROSENWEIN, Barbara H. et Lester K. LITTLE, r Social Meaning in the Monastic and Mendicant Spiritualities m, Past und Present, 63 (1 974): 4-32.
ROUSSE, J , a Rdflexions sur le maim spirituel v, Lu vie spirituelle, 589- 126 (1972): 167-80.
ROUSSET, Paul, La description du monde chcvaleresque chez Orderic Vital r, t e Moyen Age, 75 (1 969): 427-44.
, a L'idCal chevaleresque dam deux viroe clunirie~es r, dam ~tudes de civiIisatiion rn&diPvale, op.cit., 1974, p.623-33.
RUDOLPH, Conrad, s Bernard of Clahaux's Aplogicr as a Description of Cluny, and the Controversy over Monastic Art m, daus Cinent Sndies on Cluny, op.cit., Gesta, 27 (1988): 125- 32
- , a The Scholarship on B e d of Clairvaux's "ApoZo~" m, Connrentarii Cirtercienses, 40 (1989): 69-1 11.
SACKUR, E, 8 Handschriftliches aus Frankreich - I. Zur Vita Odonis abbatis cluniacensis aucton 10~1llle m, Neues Archiv, 15 (1890): 105-16,
- , HandschriAIiches aus Frankreich - 11. Zu Iotsaldi Vita Odilonis und Verse auf Odilo Neues Archiv, 15 (1 890): I 17-26.
- Die Cfuniacenser in ihrer kirchlichen md allgemeingeschichtlichen Wirksamkeit bis air Mirte des elfien Juhrhunder~, 2 vol., Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965 mlle , 1 892-1 8941.
SAINT-LOUP, Aude de, a Le sourd, le diable et Ie MnkIictin m, L 'Histoire, 142 (mars 199 1): 80-82.
SALMON, Piem, C bbbt! d m la tmditioon rnonmfiquee Contribution b I'hisloire du caractgre pep6tzieI dm mpe*rietcrs religieux en Occident, (Histoice ct sociologie de l ' ~~ l i s e , 2) Paris: Sirey, 1962.
SAPIN, C., Cluny U et l'interpr&tion archiologique de son plan B, dans Religion et cuIrwe, op-cit., 1990, p.85-89.
SAYERS, Jane, Violence in Medieval Cloister m, Journal of Ecclesiastical History, 41/4 (oct. 1990): 533-42.
SCHIEFFER, R, Consuetudines rnonasticae und Reformforschung w, Deursches Archiv, 44 (1988): 161-69.
SCHIEFFER, Theodor, Notice sur les vies de saint Hugues, abbe de Cluny B, Le Moyen Age, 46 (1936): 81-103.
SCHMITT, Jean-Claude, hz raison des gestes dans 1 'Occident midi&val, Paris: Gallimard, 1990.
SC- Ph., Hhtoire de 1 'ordke de saint Benoit, 7 vol, Maredsous: ~ d . de M ~ ~ S O U S 1948-56 (2= a. corr*)
, a L'influence de saint Benoit d'Aniane dam I'histoire de l'ordre de saint Benoit *, dans I2 monuchesimo nell 'alto Medioevo, op. cit., 1 957, p A0 1 - 1 5.
SCHREINER, Klaus, a Dauer, Niedergang und Emeuerung kltisterlicher Observant im hoch- und spiitmittelalteriichen Manchtum. Krisen, Reform- und Institutionalisierungsprobleme in der Sicht und Deutung betroffener Zeitgenossen B, dam imtitutionen und Geschichfe. Theoretische Aspebe und rnirtelaIterliche Befimde, dd. G. Melville, KiilnlWeimadWein: BBhlau, 1 992, p.295-34 1.
SCHROU, Mary-AEd, Bendictiite Moniasficikm ar Rejlcted in the Wmefiid-Hildemar C O ~ Q S on the Rule, (Economics and Public Law, 478) New Yo* Columbia Univ. Press, 1941.
SEin litteras. F'orschrmgen am mitteldterlichen Geiktesleben (Festschrift B. BischofY), Cd. S. Kribncr ct M. Banhard, (Bayeriscbe Akademie der WisseascMea. Philosophi~eh-historische Klasse. Abhandlungen, Neuc Folge, 99) MBnchm: Verlag der Bayerischcn Akademie der Wissenschaftcn, 1988-
SEGL,, Peter, Zum Itinetar Abt Hug- I. von Cluny (1049-1 109) m, Deu~~hes Arclriv, xxix ((1973): 20619,
SEMMLER, Josec a Benedictus II : m a regulo - ma cometudo m, dans Benedictine culture 750- 1050, op.cit., 1983, p.1-49.
, Das Erbe der karolingischen Klostemfonn im 10. Jahrhundert m, dans Monustische Refomen, op.cit., 1989, p.29-77.
, a Reforme Wdic t ine et privikge impdrial. Les rnonasths autour de saint Benoit d9Aniane m, dims N&sance et fonctionnement des re'seattx monc~stiques et canortiam, Actes du premier colIoque du C.E.RC.OX, Saint-Etie~e, 16-18 sept. 1985. Saint-Etieme: Publ. de I'Univ. de Saint-Etienne, 199 1, p.2 1-32.
, r Le monachisme occidental du V[IP au X siecle. Formation et kformation *, dam t e monachisme h Byzance, op.cit., Rb, 103 (1993): 68-89.
SIGAL, Pierre, L 'hornme et le miracle d m la France rne'dihale W-XIT siikle), Paris: &i. du Cerf, 1985.
, = Le travail des hagiographes aux XI' et XIIe siMes: sources d'infonnation et m6thodes de rddaction m, Francia, 15 (1987): 149-82.
SITWELL, G., a. & trad., St. CMo of Cluny. Being the L$ie of St. Odo of CIuny by Jbhn of Salerno and the Life of St. Gerald of A d l a c by St. Odo, New York: Sheed & Ward, 195%.
SMITH, Julia M. H., a Review Article : Early Medieval Hagiography in the Late Twentieth Century v, Early MedievaI Europe, 1/1(1992): 69-76.
SOHN, A., Der Abbutiat Ademms von Saint-Martial tie Limoges (10634144). Ein Beitrag mr Geschichre ck?s chniacensischen Klacewerbmtdes, (Beitage zur Geschichte des alten Manchtums und des Benediktinertums, 37) MUnster-in-W.: Aschendorffkche Verlagsbuchhandlung, 1989.
Sour h dgle de saint Benoit: s~ructwes monastiques et socie'te' en Frmce du ~ o ~ e n Age 6 1 '&pope ntoderne, Colloque de I'Abbaye Mnedictine Sainte-Marie de Paris du 23-25 octobre 1980, Genkve/Paris: Drofl if is ion Champion, 1982.
SOUTHERN, Richard W, Wwem k i e t y and the Chwch in tire Mdde Ages, (Pelican History of the Church, 2) Harmondswortk Penguin Books, 1970. Traductim frangik : L ggl 'e ef b sociP6 cknr Z'&cHdort mtdihvd, tnd. J.-P. Grossein, Paris: Fhmarioa, 1987.
Spiritualit& cf..iw:ense, 12-15 odobre 1958, (Convcgni del Ccntro di Studi wlla Spiritualita medicvale, 2) Todi: Prcsso l'accademia tudestina, 1960,
STRATFORD, Kel, Lcs Mtiarcnts de I'abbaye de Cluny h I'Cpoque mCdiCvale. fitat des questions m, BulZetin monunentd, 150 (1992): 3 83-4 1 1.
Die mopse dm cluniacenstrchen Nedogg i , volk EEfeitwng tmdkgbter et v0l.E Die Sjmopse, &I. WD. Heim, J. Mehne, F. Neiske, D. Poeck, I. Wollasch, @Uinstersche Mittelaltershriften, 39) MUnchen: Wilhelm Fink, 1982.
TELLENBACH, G, Zum Wesen der Cluniacenser m, Suectllum, DC (1958): 370-78.
, Der Stun des Abtes Pontius von Cluny und seine geschichtlicbe Bedeutung B, Quellen md Forschungen aus italrenhchen Archiven und Bibliotheken, 42-43 (1 963): 13-55. [rtisumk en fran~is dans AnnaZes du Midi, 76 (1 964): 3 55-62 ]
, 11 monachesimo riformato ed i laici nei secoli XI e MI r dans I laici nella "societas christianan deisecoliX7e Xa, Atti della III Settimana di Studio della Mendola, (Miscellanea del centro di studi medioevali, m) Milano: Vita e Pensiero, 1968, p. 1 18-42.
TESKE, Wolfgang, e Bernardus und Jocerannus grossus als Miinche von Cluny - Zu den AufStiegsm5glichkeiten cluniacensischer "convers" irn 1 1. Jahrhundert r, dans Ordensstudien I : Beitrme na Geschichte der Kbnversen im Mittelalter, dd. K Elm, (Berliner historische Studien, 2) Berlin: Duncker & Humblot, 1980, p.9-24.
, taien, LaienmiInche und Laienbrilder in der Abtei Cluny. Ein Beitrag zum "Konversen- Problem" V, Friih,St., 10 (1976): 248-322 et 11 (1977): 288-339.
THOMAS, AH, Die O d t e constituties van de Dominicanem, (Biblioth&pe de la Rewe d'histoire eccI&i;astique, 42) Leuven: Bureel van de RHE, 1965.
TILL- lean-Yves, a Les moddes de saintetd du Me au XI1 s. d'apds le tgmoignage des &its hagiomphiques en ven mdtriques W, dans Smti e demoni nell'alro Medioevo, (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo, 36): Press0 la Sede del Centm, 1989, p.38 1- 406.
, a Le vocabulaire des Ccoles monastiques d'apds Ies prescriptions des consuetudines (XI =XX sikles) m, dans Vocubuloire dm dcuies et des mdthodes d 'emeignement uu Moyen ige, Actes du colloque, Rome 21-22 octobre 1989, Cd. 0. Weijers, (ktudes sur le vocabulaire intellectuel au Moyen Age, V) Tumhout: Brepols, 1992, p.60-72.
TORRELL, Jean-Picne et Denise BOUTHILLER, Pierre le Vhe'rabfe et sa vikion du monde. Sa vfe. sari oemm t 'Himme et le D b m , (Spicilegium Sacrum b v a n i ~ n s e ~ h d e s et Documents, 42) Lo- Spicilegium !5acrum Lovanitnse, 1986.
TUBA- Fdetltc C, Index B q @ m u n -A Handbook of Medieval R e l i ~ ~ Talks, (Folklore Fellows Cornu~u*~ons, no.204) Helsinki: Suomalaina Tiedeakatcmia, 1969.
Tjpologie d a smam dk M i Age uccidntal, dir. [dopdd GEMCOT, publ. par I'INlitut interfacultaire cl'hdes mCdiCvales de I'Univ. catholique de Lowain, Turnhout: Brepols, 1972 et sv.
VALOUS, Guy de, art. a Cluny V, DH%E, 13 (1956): 35-174.
Le monachisnte clunisien des orignes au XYI si6cIe- Vie intirieure des monustires et organibsrdion de 1 brdre, 2 vol., Paris: Picard, 1970 (2' &do augm.)
VAN EGEN, J, a The "Crisis of Cenobitisrnu Reconsidered : Benedictine Monasticism in the Years 1050-1 150 b, Speculzun, 61 (1986). p.269-304.
VAN UYTFANGHE, Marc, a Modiiles bibliques dans I'hagiographie my dam Le Moyen Age et la Bible, op-ci~, 1984, p.449-88.
, Stylisation biblique et condition humaine dms I'hagiographie mirovingienne (600-750), Bruxelles: AWLSK, 1987.
, a Le culte des saints et l'hagiographie face a ly&riture : 1s avatars d'une relation ambigut m, dam h t i e dernoni nell kIto medioevo occidentale, (Settimane di studio de1 Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 36) Spaleto: Presso la Sede del Centro, 1989, p. 155-202.
, a L'hagiographie : un "genre" chr6tien ou antique tardif? m, RB, 1 1 1 (1993): 135-88.
VAN'T SPLJKER, I , Als door een speciaal stempel. Trditie en vernieuwing in heligenlevem uit Noordivest-Frunk~k 1050-1150, (Middeleeuwse studies en bromen, 23) Hilversum: Verloren, 1990.
Learning by Experience : TweLAh-Century Monastic Ideas a, dam Cenfres of Learning - Learning d Locution in Pre-Modern and the Near Ew, 6d. Jan Willem Drijvers et A.A. MacDonald, Leiden/New YorldK6ln: E.J. Brill, 1995,p. 197-206.
VAUCHEZ, Andd, LQ spirituaIit6 du Moyen ige occidentale, Paris: PUF, 1975.
, Les nowelles orientations de l'histoire religieuse de la France mCdi6vaIe. I. Avant Ie Xme siecle w, dans Acfes du 10P Congrh nationaI des soci6ts savantes, Paris, 1975 - Tenhces, perspectives et mhthodes de I 'his toire mPdie'vuie, Philologie et hktoire juqu 'ri I61 0, vol .I, Paris: Bibliotheque Nationale, 1977, p.95-112.
, Lu saihteti en Occident ma: derniets siPcIes du Moyen &em dm4pr& les pro& de canonisptr~ia et lu documem hpgiographiques, Rome : Bibl. dcs Ccoles h @ e s d7Ath4nes et Ram% 1981-
, t La saint& du lac dam I'accident mddiCvat : naissanct et 6volution d'un mod& hagiographiquc (W.- ddbut Xme si&le) w, clans Slomtett! et mwfym rkau lu reIigrom m( Ihnr, W. Jacques Ibhrx, (Pmbkmts d9Hisbire du Chrisb'anismc, 19) Bnocelles: hi. de I'Univ. Libre de Bruxclles, 1989, p.57-66.
-, Lt saint rn, dam L 'honanc mBdi&ul, €d. I. Le GofI; Pack Seuil, 1989, p.345-80.
- Saints admirables et saints hitables : les foactions de l'hagiographie oat-elles chang6 awc demien si8cles du Moyen Age 8, dam Lesjonctions des saint& op-cit., 199 1, p. 161-72.
VEZIN, Jean, Une importante contribution i I'Hude du scriptorium v de Cluny i la limite des XI' et XII' sikles m, S'@torium. XM (1967): 3 12-20.
- , Un martyrologue cop% B Cluny B la fm de L'abbatiat de saint Hugues B, Himages ci Andre Boutemy, id. G, Cambier, Bmelles: Latomus, 1976, p.404-12.
VREGILLE, B. de, a Le copiste Audebaud de Cluny et la Bible de I'abM Guillaume de Dijon n. dam L 'Home dmmt Dieu - Me'langes offerts au PZre Henri de tubac, vol-II: Du Moyen Age uu si2cIe des LmiZres. (Th6ologie, 57) Paris: Aubier, 1964, p.7-15.
"VinmZum Societais". Joachim WoIIosch nan 60. Geburtstag, dir. F. Neiske, D. Poeck et M. Sandmann, Sigmaringendorf: Glock & Lutz, 199 1.
VTTOLO, G, Cava e Cluny s dam L 'ItaIia nel quadro dell 'espartsione europea del monachesimo cluniaceme, Atti del Convegno intemazionale di storia medievale (Pescia, 26-28 novembre 1981), dir. C. Violante, A. Spicciani et G. Spinelli, (Mia benedettina, 8) Cesena: Centro storico benedettino italiano, 1985, p. 199-220.
V O G ~ Adalbert de, La commm~nnd ef l bbbP d m la RSgle de saint Benoit, Paris: DescMe de Brouwer, 196 1 . - . Travail d alimentation dam les &gIes de Saint Benoit et du Maitre w, Rb. 74 (1964): 242-5 1.
- . La patem* du Christ dam la R&le de saint Benoit et la R&le du Maitre v, Vie spirituelle, 1 10 (1964): 55-67. A n reptis dam Id, Saht Benoit, so vie et sa Regle, p.111-20.
- , a "Comment les moines dormirontw. Commentaire d'un chapitre de la Wgle de saint Benoit B, Sfudia monastics. 7 (1965): 25-62.
, a Sub Regula vel Abbate. ~tudes sur la signification des 6gles monastiques anciennes ., CoIZCk!, 33 (1971): 209-4 1.
- , intn,., tnd. et notes de La &gle de saint Ben& texte Ctabli et pdsent6 par Jean Neufville, 7 vols, (SC I8 1-16) Paris &. du Caf. 1971-77.
- , PerdvCrer dam k rnonasth jusqu'l la mort. La stabilit6 chez Skno i t et autour de lui B, ColfCist, 43 (198 1): 33765.
-, lbinr Baroi&, so vie et sa rLgle : dhr&s chuhies, (Vie mo118~fi*que, 12) BCgrolles-en-Mauges: Abbaye de Bellefontaine, 198 1.
, art. 8 Regole 1- Visione g e n d e filologico-storica delle r. e costituzioni religiose. I. Antichiti 2. In Occidente a, DP, W (1983)' col. 14 14-20.
, art. a Regola. I. Viiione generale filologico-storica dclle regole e costituzioni religiose. 11. Regole cenobitiche d'occidente (sec. V-va) a, DIP, VII (1983), col. 1420-34.
, Le Mar'he, Eugrppe et saint Benoft. Reczieils d9wticIes, (Regulae Benedicti Studia, Supplementa, 17) Hildesheim: Gerstenberg, 1984.
, Les RZgles monmtiipes anciennes (400-700), (Typologie des Sources du Moyen Age occidental, 46), Tumhout: Brepols, 1985.
, De la a R&gle de saint Bade v H celle de saint Benoit v, CollCisr., 51 (1989): 298-309.
, a LXS &teres de discernement des vocations dans la tradition monastique ancienne V,
ColICkt., 5 1 (1 989): 1 09-26.
, Ce que dir saint Benoit- Une lecture de la r&gle, Btgrolles-en-Mauge: Abbaye de Bellefontaine, I99 1.
, Histoire Iitte'ruire du mouvement monustique, vol, 1, (Patrimoines du Christianisrne) Paris: ~ d . du Cerf, 199 1.
WAIHEN, Ambmse G, Silence: The Meaning ofsilence in the Rule of St* Benedict, Washington: Consortium PresdCistercian Publ., 1973.
, Manastic Visitations: Histotical Soundings m, Americun Benedictine Review, 3914 (1988): 343-7 1.
WEINSTEIN, Donald et Rudolph M. BELL, Saints and Sociew - The Two Worldr of Western Christendom, 10004 700, Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1982.
WILLMES, Peter, Der Hemscheer-r Adventus v im KToster des Friihmittelalters, (Miinstersche Mittelalterschriften, 22) Mlinchen: W. Fink, 1976.
WISCHERMAN, EM,, Grundagen einer cluniacensischen Bibliotheksgeschichte, (Miinstersche Mittelaltershriften, 62) Miinchen: W. Fink, 1988.
WOESTHUIS, Marinus M., 'Ike Origins ofhonymrrrprimtcs. Vincent of Beauvais, Helinand of Froidmoat and the Life of Saint Hugh of Cluny R, A& 105 (1987): 385-41 1.
WOLWCH, Joachim, Ref- und Adel in Butgund m, dam Iivestitwstreif und R e i c ~ ~ o s s ~ g , 66 1. Fleckenstein, (Vortrfige und Forschungen, 17) Sigmaringen: J, Thorbecke, 1973, p.282-83.
- , Zur mesten Schicht dcs cluniaccnsischen Toten~chtnisses 8, dans Geschic~schreib~g dgeistges Leben inr MttelaIter, Festschrift fUr Heinz Ldwe rum 65. Geburtstag, Cd. Karl Hauch et Hubert Mordek, K6Wein: P. B6hIau Verlag, 1978, p.247-80.
-, = Les Obituaires, thoins de la vie ctunisieme m, Cahiers de CiviIisation MidiPvaIe, 22 (1979): 139-71.
- , Parent6 noble et monachisme c6formateur. Observations sur les a conversions B ii la vie rnona~fi~que a m onzi&me et douzi6me siecles ., Revue historique, 264 (1980): 3-24,
. Wer waren die M6nche van Cluny vom 10. bis zum 12. hhunde r t ? ., dans CZio et son reg& M&mges d'hatoire, d'hkfoire de I'm et d'archebZogre offerts b Jacques Stiennon ii Z 'occarrbn de ses vingt-cinq am d'enseignement ci I 'Universit6 de Ligge, id. R Lejeune et J. Deckers, Li6ge: Pierre Mardaga, 1982, p.663-78.
- , Prosopographie et informatique : l'exemple des Clunisiens et de Ieur entourage laique m, dans lnformatique et prosopographie, Actes de la Table ronde du CNRS, Paris, 25-26 octobre 1984, Paris: &. CNRS, 1985, p.209-18.
, a Questions clis du monachisme europien avant I'an mil *, dans Saint8e'ver. MilZinaire de I'abboye, Actes du collaque international, Saint-Sdver, 25-27 mai 1985, Mont-de-Marsan: Cornit6 d'itudes sur I'histoire de I'art et de la Gascogne, 1986, p. 13-26.
, a Zur Datierung des Liber tramitis aus Farfa anhand van Pemnen und Personengruppen *, dans Person und Gemeimcircrft im Mittelalter. Festschr@jZr K i d Schmid, dd. G. Althoff, D. Geuenich, 0.G OexIe et J. Wollasch, Sigmaringen: J. Thorbecke, 1988, p.237-55.
, Refommtfnchtum und Schriftlichkeit m, F ~ k S t . , 26 (1992): 274-86.
, a Zur Datierung einiger Urkunden aus Cluny m, RM, 64 (1992): 4947.
, Zur Verschriftlichung der kI8sterIichen Lebensgewohnheiten unter Abt Hugo von Cluny *, FhihSt., 27 (1993): 3 17-49,
WOLLASCH, J, H.E. MAGER et H. DIENER, Neue Forschungen iiber CIuny und die Clmiucenser, Freiburg: Herder, 1 959.
ZIMMERMANN, Gerd, Ordendeben d Lebensstandard : Die Cura corporis in den Ordellsvorschrijlen des abendlctndhchen UochmitteZaZters, (Beitriige zur Gesch. des alten Miinchturns, 32) Miinstec Aschendorff, 1973.
ZIOLKOWSKI, J, a The t k u p d i o by Odo of Cluny. A Poetic Manifesto of Monasticism in the Tenth Century m, MrtteIIiatembches Jahrbuch, M(N-M[V (1989-90): 559-67.
Je commence par dvoqyer succinctement les sources hagiographiques des grands abbes de Cluny (Odon, meul, Odilon a Hugues) ; je ne m'attarderai g u h sur le sujet car ce dossier est d@ bien cormu gdce arrx travaw de D. 10gn~Prat le p-te ensuite m e A une les autrcs Vitae clunisi-es. En denier lieu, j'explique punpoi j'ai choisi de ne pas considcra certain= sources hagiographicps, bien qp'elles aient quelqws liens avec Cluny. Il est malais6 de dkfinir de d h e rigide ce qy'est une Vita clunisienne : j'ai voulu adopter m e d&tion assez souple me pennettant d'etudier non dement les Vies des grands abWs de Cluny mais a d ceUes d'autns personnages. Les principes de base dictant mon choix ktaient que I'auteur mt un moine kivant avant 1156 a que son r n o h appartht I l'orbite clunisienne, si possible au moment de la ddadon, autrement 101s des evtnements ivoqu6s daas la Yie. Il n'existe qu'une seule Yira dam mon corpus qui ne fid pas &rite par ua moine : il s'agit de celle d'Hugues de Cluny, &dig& par Hildebert de Lavardin, alors qu'il etait Mque du Mans. A diverses reprises dam ma t h h , je montre comment cette Vifa Were des autres oeuvres de mon corpus, particuIi&ement en ce qui concerne la hidrarchie clunisienne ; j'ai mal& tout choisi de la conserver car elle fut command& B Hildebert par Pons de Melgueil, septieme abE de Cluny.
Dans cette annexe, beaucoup de questions sont posdes : j'ai en effet adopt6 volontairement me attitude relativement critique face aux analyses ddjjii existantes sur les sources hagiographiques clunisiennes & de mettre en valeur la richesse du terrain qu'il reste P explorer. Hormis les Vitae Odonis de l'abr6viateur et I'Hmiilimus (tiditees par M.-L. Fini), la Vita MaioIi de Syrus @. Iogna-Prat), l'epitaphe d'AdtWde (H. Paulhart), la Vita Wirrelemi de Raoul Glaber (N. Bulst), les Vitae Hugonis de Gilon, de Hugues (H.E.J. Cowdrey) et de Renaud de Vezelay @.B.C. Huyghens) et les Miraculu de Pierre le VinCrable @. Bouthillier et L-P. Tomll), tous les autres kits hagiographiques clunisiens nkessitent de nowelles a t ions critiques etlou des 6tudes d6tailIh - ne se contentant pas de nhmer ce qui a W dit p&6demment - sur leur datation, leur origine et les misons qui motiverent leur a c t i o n : il s'agit de l'ewmble des fitae Geraldi, les Vitae Odonis de Jean et de Nalgod, les Vitae de meul except& celle de Synrs, les VirM Odilonis par Pierre Damien a Jotsaud, les VitM Hugonis d'Hildebert de Lavardin et de I'Anonyme II, et enfin les Vitae d'Ide de Boulogne, de Bouchard de Vendhe et de Babolein des Fosds.
LES GRANDS ABB~S CLUNTSIENS
L'article de Dominique Iogna-Prat intitul6 a Panorama de l'hagiographie abbatiale clunisienne (v.940-v. 1 140) . (dans Mmuscrits hagiographiques et travail des hagiographes, ed. M. Heinzelmann, Sigmaringen: J. norbecke Verlag, 1992, p.77-118) pdsente les dossiers hagiographiques des grands abbds de Cluny ayant En&% d'un culte, ii savou Odon (927-942). mUeul (954-994). Odilon (994-1049) et Hugues (1 049-1109). Trois articles du meme auteur o&nt des informations compl6mentaires sur le sujet. I1 s'agit de a La geste des origines dans l'historiographie clunisieme des XIe-XIIe sikcles (Rb C W 1 -2 (1 992): 1 3 5- 9 1)' la section consacree a Cluny dans l'article redig6 en collaboration avec P. Bonassie et
P t k Sigal, La GalIia du Sud, 930-1 130 m (dam Hagiographies - Histoire internationale de k Iittkratwe latrine et vemadaire een Occiderzt des orignes i ISSO, vol& dir. G. Pupart , (Copus c w a n o n a n - Hagiographies, I) Turnhout: Brepols, 1994, p.3 19-26), et les pages dsenrdes B L'a orcire de Clmy . dans I'ITtstoire cdes saints dirigk par A. Vaucha (Ha, V (1986): 98-108). Pour comaitre Pttat ectuel des recherches sm Cluny et quelques- uns des pmjets en cours, toutes disciplines confondues, on put dgalement se r 6 f b i l'article du m h e auteur, a Notes aiti~ues : les itudes clunbiemes dans tous lews &its - Rencontrc de Cluay, 21-22 septembre 1993 . (dUI. n.s. 5 (1994): 233-258).
Je me contenterai ici de rappella les dfdrences des editions des diffkentes Vitae, leun numeros dans la Bibfiothecu hgiogrophica la ti^ @HL] et leur date de ddaction. J'ajouterai quelques remarques lors de la pdsentation de chaque dossier.
ODON, deuxi&me abbC de Cluny (t942) Crtae : YO', 943 ; Vi, 943-1109 ; VOL, 1049-1109 ; YO, 1120-1130
VO' (BHL 62926296) par Jean de Salerne
- ~dit ion : Jean de Salerne, Vita sancti Odonis ubbatis, PL 133, co1.43-86.
Traduction anglaise : erard Sitwell, St. Odo of Cluny - Being the Life of St. Odo of Cluny by John of Salemo and the Life of St. Gerald of Awiflac by St. Odo, (The Makers of Christendom) LondonMew York: Sheed and Ward, 1958, p.3-87.
Cette vieille edition de la Pafrulogie pose divers probPmes. Le plus important pour mon p r o p est celui qui a 6e souleve par M.-L. Fini : selon cette cherchem, le &it de la mort d'Odon n'est pas de la plume de Jean de Saleme mais de celle du moine HumiNinrus qui &vit dam la deuxiime moitie du XP sikle, soit plus d'un sikle ap& les dvdnements. Pour ce passage, il se serait inspin5 d'un texte en vers, maintenant perdu, composd par un certain Hildebode. Selon toute vraisemblance, cet Hildebode etait l'dv6que du meme nom, qui occupa le siege t5piscopal de Chalons-~~1,-Sa6ne de 944 8i 948/4g1.
- Auteur : Jean de Saleme (ou 1'Italien ou le Romaia ou de Cluny) Jean -contra Odon en 938 B Rome et parsa beaucoup de temps a w c6tds du saint abM dans les quatre ann6es qui prtcdd&ent sa mort.
I. M.-L- FIN& a L'Ediro minor della " Vitan di Oddone di Cluny e gli appocti dell'Humillimlcs. Testo critico e nuovi onentamenti m, L 'Aichiginnasio - Bolfetino della Biblioteca communnle di Bologna, 63-65 (1968-70): 175-8 1.
- Date de &dadon : 943 Jean Cvoqye un miracle accompli le a mois d'aofit pas& (apraeterio isto menw Augusto m)
par Odon encore en vie. L'abbe de Cluny &ant d W t le 18 novembre 942, il faut donc admetke qyc ce miracIe a pris place en aoiit 942 et que Jean le transcrivit dans la VO1 avant le mois #a& suivant, soit celui de I'an 943'.
-Remaqyes: Je compte entreprendrc, dans le cadre de mon postdoctorat, m e Wition a une analyse approfoade & cette Vitc- k voudrais entre autres expliq.uerpourquoi elle fbt &rite. Ce texte est indissociabk de la Vita Gemldi, d g r k par Odon et p&t& ci4essous. Une des sections les plus intrigantes de la Vita Odonis par Jean de Salane conceme la passation des pouvoirs de Bemon P Odon. Aux dirPs de L'hagiographe, aprts que Bemon eut dkidd, quelques mois a m t sa mort, d'abandomer son powoir sur toutes ses abbayes, Odon fbt 6lu pour le remplacer. Bemon d M & ceaains moines de Baume refidrent de recomaitre Odon comme abW a celui-ci, plut6t que de les dionter, choisit de quitter l'abbaye et de se replier sur la nowelle et t ds pauvre fondation de Cluny. Les seniores du lieu le suivirent. Ceux qui restkrent sur place abjdrent bient6t leurs voew et retoumknt dam le sikle (VO1 I,38,co1.60C-D). Ce &t est d6nu6 de fondemeat. D m les faits, Bernon Egua ses abbayes de Baume et de Gigny h son neveu Guy, tandis qu'il laissait Cluny, Massay et D6ols 8 0don3.
'. VD, 11,2l,col-72. Cf, aussi E. SACKUR, Die Cluniacenrer in ihrer kirchlichen und atIgemeingeschichIichen W u h m k i t bk zur Mine des ewen Jahrhunderl~, I, Dannstadt: WisscnschaAliche Buchgesellschaft, 1965, p359 ; G. ARNALDI, II biogdo "romanow di Oddone di Cluny m, BulZettino dell 'Istihcto stotico italiano per il me& evo e Archivrb Mmtorimo, 71 (1 959): 1959, p20 et p.24 ; M.-L. FMI, a L'editio ... w, op.cit., 1968-70, p.13511, et B. ROSENWEIN, Rhinoceros Bound : CIuny in the Tenth Century, Philadelphia: Univ. o f Pennsylvania Press, 1982, p.651~
? Cf- le testament de Bernon, BibLClun co1-9-12 et PL 133, co1.853C-858A.
VOC (BHL 6297) par auteur anonyme
- m o n : M.-L. F i i a l%dirio mimr deh " fitan di Oddone di Cluny e gli apporti dell'H~~iillimrcs.
Testo critico e nuovi orientamenti r, L'Archi'lulclslb - Bolletino della Biblioteca comm1(1~1rle di BoIogm, 63-65 (1968-1970): 208-59.
Ce texte p-te une version trts aWg& de la Vita de Jean, Pourtant, quelques miracles absents de la VO1 ont W ajoutCs : Me-L. Fiai a dtmontd qu'h avaient CtC ddig& par Jean4.
- Auteur : moine cltlnisien
- Date de ddacon : entre 943 et 1109 Il est impossl%le de savoir quaad cet dpitom6 fbt d g 6 . Parce qu'il est un r6sum6 de la Vita de Jean, il est plus tardif que 943. Parce qu'il s e ~ t de base P la Vita de 1'HumilZimus qui ecrivait sous Hugues de Cluny, il f i t compose avant 1 109.
v ' @HL 6298) par auteur anonyme appel6 I'HurniIiimus
- ~dition : M.-L. Fini, a L'Editio m i ~ o r della "Vita" di Oddone di Cluny e gli apporti dell'Humiilimus.
Testo critico e nuovi orientamenti m, Ljlrchiginnasio - Bdetino della Biblioteca communale di Bologna, 63-65 ( 1 968- 1970): 208-59.
Le texte de 1'HunrilZimzu est en majeure partie identique B celui de la VP. Ce nouveau redacteur s'est content6 d'Mrer certaiaes sections ou de modifier quelques passages trh spdcifiques du texte abdge : il a ajoutd un prologue, me prdsentation de Bemon, un iloge de l'abbaye de Saint-Paul de Rome et un nouveau &it de la mort d'Odon, tandis qu'il a corrigd le rkcit de la prise de powoir du siege abbatid de Cluny par Odon.
- Auteur : moine clunisien sous l'abbatiat de Hugues (1 049- 1 109) Le nom d'Humillimus a kt6 don& & l'auteur de la troisi6me version connue de Ia Vita Odonis, car c'est avec cet adjectif qu'il se pdsente au tout debut de son oeuvre : afiater quidam humillinrus monochom mS. Puisqu'il &die son travail Hugues qu'il appelle
reverentissinus pater domnur Hugo, abbm Sancti Petri rn et a venerubilis pater m, mais aussi par le contenu mgme de la VO, il est evident que ce noweau ddacteur etait clunisien.
- Date de redaction : pendant l'abbatiat de Hugues (1049-1 109)
VQ (BHL 6299) par Ndgod
-&tian : Pour les sections de la Via pcbentes dans le plus aucien msnUSCLit de la Yilr, Paris BN nal 1496 (peu aprtS le milieu du XIP s.) : M-L. F i i a Studio sulla "Vita Odonis refomatan di Nagoldo. Iljicgmenha mutilum del
codice latino NA 14% della Bibliotheque Nationale di Parigi my dam Atti della Accdemia delle scienre deZt%tituto di Bologna - CIarse dl Scienze morali, n O69, Rendicontiy 63 (1 974-1975): 13447.
Pour les autres sections : PL 133, wl.85B-104D. Les rdfhces a citations que je fais de la V(I" proviennent, dam la mesure du possible, de l'edition de Fi ; mais parce que ce texte est incomplet et la revue qui le contient peu distributk, j'o& toujoun les nifknces correspondantes dans la PL.
Nalgod a non seulement dsum6 la VO', mais en a egalement grandement change le style, ce que n'avait pas fait 17abrCviateur ni I'HmiIlimus ; il a par ailleurs ins&& de nouvelles informafiolls.
- Auteur : Nalgod, moine clunisien L'appellation Nagold, a la place de Nalgod, se rencontre padois. M.-L. Fini a confixm6, a partir d'une etude du style, que ce Nalgod et son homonyme qui r6digea une Vita MaioLi (etudiee ci-dessous) ne formaient qu'une seule p e n o ~ e ~ . Nous ne possCdons autrement aucune information sur cet auteur et en sommes dduits aux suppositions.
- Date de Sdaction : Ies anndes 1 f 20 La diimonstration pour cette datation est faite par MPL. F i g . D. Iogna-Prat partage son point de w e et choisit de placer plus prdcisement la redaction de la VO" dam les premi&es annees de l'abbatiat de Pierre le Ventrable (1122-1156)1. Cette affirmation est tr6s probablement fond*, mais me h d e plus pow& sur le contenu de la Yira serait nCcessaire pour I'appuyer. Il faudmit la cornparer a w autres productions hagiographiques clunisiemes de ces mgmes a d e s ainsi qu'au discours tenu par Piem le Vdnhble dans ses Statuts.
6. &L, FlNI, Studio.., L, op.cit., 1974-1975, p38. '. M.-L. FMT, 8 Studio ... m, op.cit., 1974-1975, p.40. ', Cf, D- IOGNA-PRAT, La Geste..,. m, RB, 102 (1992): 183 et "Panorama" 1992, p.85-86.
MAhUL, quatribe abbC de Clmy (7994) recueil de miracfes : LICIM, tin Xe S. Vrfae : m, fin Xe s. ; W, 999-1010 ; K W 103U1033 ; W ell20 ; MCf, ell20
Pour tout le dossier de MiXeuI, il faut se d f k prineipalement A l'owrage de D. Iogna-ht, Agni inmrdm* - Recherches sur les sources hgiogrophiques relames h saint MaieuZ de Clzuzy (954-994), Paris: &L du C e 1988.
LMM(BHL 5186) par wt auteur aaonyme
- Edition : aLibri mirucz~Iolum s m i MaioIi Abbatis Cluniacensis quartim. Bibl.Clun 1787-1 8 14
- Auteurs : diffints moines de Souvigny Ce texte est camp& de deux LiVRs qui vont toujours de pair dans les inanuscrits. Puisque le style des deux o u . e s differe, on en a conclu qu'ils avaient W &dig& par deux auteurs dBi5rentsg. II est meme envisageable que chacun de ces recueils fia k i t par plusieurs individus,
- Date de nidaction : en divenes &apes, entre la fin du Xe sit5cle. jusqu'8 une date
Le premier livre fist 66s probablement acheve dam la premitre annee qui suivit la mort du saint.
(BHL 5180) par an moine anonyme
- ~dition : Vita sancti ac venerabilis Maioli, abbafis cluniacensis quarti m, Bibl.Clun, ~01.1763-82.
C o m e le deplore D. Iogna-Prat dans son M e sur les sources hagiographiques de Maleul, il n'existe pas encore d'edition critique de la Vita breuior. Il faut dire que l'importance de celle-ci du fait de sa position comme premih pike du corpus hagiographique du grand abb6 cluaisien, fht mise en Cvidence tardivement, par ce meme chercheur ; auparavant, elle &it simplement consid&& c o m e un dsumt d'autres sourceslO.
Le rdcit de la fin de Maieul ne fisait originellement pas partie de ce texte. Ce passage provient en effet de la Vita composCe par Syrus : il s'agit par consequent d'une addition postirieure ii la rhc t ion de la Vita breuior.
- Date de ddaction : peu de temps apss la mort du saint, peut4tre avant I'M 995
9. D, IOGNA-PRAT, Agni imrnactlIati 1988, pA3. IO. D- IOGNA-PRAT, Agni immac21Iati, 1988, p. 147-48.
Comrne la liste des manuscripts &abLie par D. Iogna-Rat l'a mis en Cvidence, le texte fit compos6 avant la fin du XC si&le.
--Auteur : un moinc clmisien de Pavie ou de Souvigny D. Iogna-Prat a propost! & titre d'hypothke que l'auteur de cette Vita etait o r i g h h de Pavie, car l'hagiographe semble avou bien WMU la ville? en parla I diverses reprises dam son oeuvre en des tennes trts positifb, et en codssait personnellement certaim habitants. En outre, la premik 6glist & po- le nom de Saint-M&f*eul s'y trouvait ; eIle re@ cette d a c a c e au plus tard en 99911. Cette suggestion est int&esante mais elle doit put* &re
car plusieurs indices laissent pawt que le premier dacteur des miracles de MaSeul et l'hagiographe de la Vita breuior n'btaient qu'une seule et m6me personne.
KM" (BHL 5179U) par Syrus
- ~dition : Sym, a Vim sancti Maioli B. H.L. 51 79 w, Cd. D. Iogna-Prat, Agni immaculati. Recherches sur les sowces hagiographiques relatives ci saint Maieul de Clury (954-994), Paris: ~ d . du Ce& 1988, p.163-285.
- Date de nidaction : 999-10 10
- Auteur : Syrus, moine clunisien Syrus ecrivit cette Vita a la demande d'Odilon ; il aflime avoir remanie des sources d6jh existantes (my Ep. ,p. 16365).
KIP (BHL 5182-5184) par Odilon
- ~dition : Odilon de Cluny, Vita beati MaioZi abbatis? PL 142, ~01.943-62.
- Date de r6daction : 103 1 ou 1033
- Auteur : Odilon, abb6 de Cluny
". D. IOGNA-PUT, Agni immamlati, 1988, p.27-29 et p.378. 12. L'hagiographe se nndit probablement B Pavie puisqu'il ddclare au sujet du marais que les prieres de
MaRul fircnt assdcher : a Sic imenribile elementum terrae obseruat adhuc, ut vidrlmus & uudiuhus, prueceprum Patris Maioli imperiafe. r ( V i xix,col, 177SE).
u. D. IOGNA-PUT explique que a seule la recension de BHL 5 179 a lieu d'ztre BHL 5178 est un simple abstract de la Vita de Syrus ; BHL 5177 est un montage tardif, effectuC au XIIe siecle, Saint-Martial de Lirnoges, de BHL 5 179 et 5 180. ("Panorama" 1992, p.87).
Dans la prtfacc de la Yltc, W o n explique dans queues conditions il ddigea ceIle-ci. I1 se trouvait clans le monastb de Romainm6tier Iospu'un f&e du nom de Jeaa lui demanda quel tcxte dcvait &re lu comme lectiones pour la Saint-Ma'ieul. Parce qu'il n'existait aucune oeum consac& Spccifiquement au saint pour ce g a m d'accasion, Odilon dkida d'en ddiger une (Ruef, c01.943WC). Du fhit de cate destination liturgique, la structure et le contenu de la Eta sont inhabituels. L'hagiographe parle tds peu du detoulement de l'existence de et s'attache surtout, dans le coeur du texte, d- ses vertus. En introduction et en conclusion, il phce Mabd clans une chatne de filiation (par rapport ses pr6dkesseurs sur le sitge abbatial ou par rapport & son phe charnel) : Odilon construit l'ordre de Cluny, non seulement dans le pdsent, mais aussi en remodelant le pass6 et en pdpant l'avenir. Il est s i @ d qu'il dedie son oeuvre ii sqs dew successem potentiels, Hugues et Almaanus.
MH. @HL 5181) par Nalgod
- edition : Ndgod, Eta sancti Maioli abbatis, AS, Mai II(1680), p.658-68. Ndgod critique ses pred&esseurs d&s la premi6re phrase de sa Vita (Prol., p.657B). I1 a vodu nkliger une oeuvre simple et beve, accessible i tous les lecteurs.
- Auteur : Nalgod, moine clunisien
- Date : dans les 2~l~16es 1120 Les m h e s problkmes de datation se p e n t pour la Vita refornnta Maioli de Nalgod que pour sa Vila Odonis. D. Iogna-Prat penche ici encore pour l'hypothke que cet hagiographe tcrivait sous l'abbatiat de Pierre Ie V6n&r~tbIe~~, mais le fait reste B prouver.
KIP (BHL 5185) par un auteur anonyme
- ~dition : Anonyme, Vita breuior sancti ac venerabilis Maioli abbatis, Bibl. Clun., co1.1763-82.
- Auteur : moine clunisien
- Datation : c1120 I1 faudrait confronter ce texte de la Vita Maioli i celui de Nalgod car I'un a inspird l'autre indiscutablement. La question est de savoir Iequel fut &dig6 en premier-
14, D. IOGNA-PRAT, "Panorama", 1992, p.89.
ODILON, cinquihne abb6 de Cluny (f1049) VO3, Mi et EOi, avant 1053 ; VOP, 1063
VO3 (BHL 6281), POI PHL6283f) et EOi, par Jotsaud
4ditionS : Jotsaud, De Kta et uirtutibur suncti Odilonis ubbutk, PL 142,897-940.
Plus 2 chap manQuants, Cd E. Sadnn, Handscbriffliches aus Franlarich. II m lotsddi Eta Odionis v, Neues Archiv, 1 5 (1 890): 1 18-2 1.
PIanctus de t r c m ~ ~ * ~ sancti Odilonis, FF. Ermini, a Il pianto di Iotsaldo per la morte di OdiIone m, Studi Medievaliy 2 (1928): 401-05.
, Epitaphim ad s e e m domni Odilonis [E0#], 6d. E. Sackur, a HandscbtJAliches aus Fraalrreich. II II ZotsuIdi Vita Odilonis v, Neues Archiv, 15 (1890): 123-26. La stmctme de la Eta, compos6e de trois livfes, est originale. Le premier lim est en rMtt5 une 6pitaphe (Voii I ~ , c o l 9 1 4 A et IIJroZ., 913C)15 : Jotsaud dtcrit les parents du saint, puis brosse t d s schhatiquement 17existence de celui-ci de la naissance jusqu'ii sa nomination I la tEte de Cluny. Il ddcrit ensuite les quatre qualit& principles d'Odilon : prudentkz, jusliia, fortitude et temperantia, avant de fsire un long &it de son ddces. Le deuxihe reptend en d6ail des Mnements bop rapidement ibauchs dam l'oeuvre precedente : Jotsaud explique par exemple, avec m e grande minutieY le demier voyage a Rome d'Odilon. Ce liwe est avant tout un recueil de divers miracles, tous accomplis du vivant du saint Le liwe suivant kunit les miracles post rnortem.
- Auteur : Jotsaud (1015-1053), moine clunisien16 Jotsaud se pdsente comme le nutritw d'Odilon (VOi' Prol. ,c01.897B-898A), dont il devint ensuite l'archiviste. I1 etait present am c6t& du saint pendant son demier voyage ii Rome (VO! p. 1 19). Apr& la mort d'odilon, il fbt igalement un proche de Huguesj(V0i &x&coL924D).
- Date de ddaction : avant 1053, annk de la mort de Jotsaud Selon F. Ermini, le pkanctus aurait W r6digt5 d&s 1049 ou 1050. J. Hourlier pense en revanche que la VIlo fut rWg& au retour du voyage de Jotsaud en Hongrie, donc partir de 1051~~.
Is. Sur l'importance attach& A la mort par h a u d et Odilon, cf. P. HENRIET, s Saint Odilon devant la mart. Sur quelques domdes implicites du comportement religieux au 1 I' sikle m, Le Moyen &e, XCW2 (1 990): 227-44.
16. Sur Jotsaud et pIus globalemtnt sur Odilon, cf. J. HOURLIER, Saint Odilon abbe' de Ciumy, (BibIiothQue de la revue d'hktoire eccIksiizstipe, fasc.40) Louvain: Publ. Universitaires de Louvain, 1964, p.2-3.
17. F- ERMENI, Poi, p397 et I. HOURLER, Saint Odilon, 1964, p.3.
VOF (BHL 6282) par Piem Damien
- m m : Pierre Damien, fifa sancti OdIonis, PL 144, ~01.925-44.
- Auteur : Piem Damien, ltgat pontifical II &gea m e Yiro d'odilon, B la demande de Hugues, certainement peu aprb ou pendant son scjour & Souvipy en 1063, au corn duquel iI &leva les reliques du saint. II rkma la Vfra ampode par Jotsaud a la &rganisa pour lui donner m e structlae chronologique plus classique.
- Date de rt5daction : 1063
fIUGUES DE SEMUR, sixitme abb€ de Cluny (t1109) m, ruo-in2 ; vaY, 1120-in2 ; va*, 1120-1122 ; va, 11121-~128 ; YBn
L,e dossier hagiogmphiqye d'Hugucs est fort wmplexe. La dernih mise au point - qui Iaisse encore beaucoup de questions en suspend8 - fbt E t e par k Kobnle, dam son ouvrage CO@ 5 Hugues, Abt Hugo van CIuny (1049-1109), (Beihefter der F d a , 32) Sigmaringex J. Thorbecke Verlag, 1993, p.25065. II s'oppose & la reconstruction particuliQement compliptdc qut F. Barlow a prhmde dans son article a The Canonization and the Early Lives of Hugh I, abbot ofcluny B, AB, 98 (1980): 297-334. Entre autres probl&mes que pose ce dossier, me Yiro de Hugues, ib laquelie Hildebert de Lavardin fait rifCrence dans son propre t e a , a dtt perdue, celle attribu& i un certain Ezelon ; on ne parvient m h e pas ii en deCeler des traces dans les autres VirpeL9. La question des filiations des textes entre eux est aussi difficile & 6tablir : ainsi, dans le tableau synoptique dtabli par A Kohnle, il fiudrait ajouter m e flkhe directe entre Gilon et le moine Hugues2*, une autre entre Hildebert et Remud et enfin une derni6re vers Anonyme 11, qui signalerait la provenance inconnue des anecdotes sur Pierre Damien et Guillaume le Conquirant,
VEF (BHL 4007) par Gilon
- edition : Gilon de Toucy, Vita Hugonis ~Iuniacensis abbatir, 6d Herbert EJ. Cowdrey, a Two Studies
on Cluniac History : I. Memorials of Abbot Hugh of C l a y (1049-1109) r, Sfudi Gregoriuni, XI (1 978): 45-109.
Cette Viro est extrhement bien structwie. Dans les quatre premiers chapitres du livre I, il est question de la vie de Hugues jusqu'a son election, selon l'ordre chronologique des Mnements. Des chapitres V !! XI, I'autern evoque les qualitis et la reputation du saint, particulitrement aup& de personnages puissst~lts. Dam les chapitres W-XMII, il est expliqd comment il sauva des Hmes et surtout celles de moines ; de XXIV a XXXVI, il est racont6 comment il s'accupa aussi de la guMson des corps ; de XMMI B XL, il est question de la protection divine sur Hugues ; et enfin de XLI la fin du lime I, les thtmes sont assez variis. Le liwe II traite de I'ordre de Cluny, de l'action de Hugues ii I'intCrieur de celui-ci et de la mort du saint.
- Auteur : GilonlGiiolGilles de Toucy (ou de Paris), moine clunisien Gion est nC B Toucy, pri% d'Auxerre. U fit des etudes i Paris avant de devenir moine de Cluny en 1 1 19. Outre la Kta Hugonis, il composa aussi une @p& sur la premiiire croisade
". A. KOHNLE est convaincu qu'il existait des textes Ccrits avant 1120, sur lesquels Gilon se basa (Abt Hugh von CIwy (1049-1109), (Beihcftcr der Francia, 32) Sigmaringen: J. Thorkke Verlag, 1993, p257-58).
l 9 Sur ridentit6 possible d 'h lon , cf. A. KOHNLE, Abt Hugh, 1993, p.257. '9 C t A. KOHNLE, Abt Hugh, 1993, p262.n.61.
qu'il Mvit i Paris, peut4tre en 1 1 Ig2'. En 1 120, a p h avoir canonis6 Hugues sur la base de tdmoignages o m - il re& de se d f k aux textes f i t s -, Calixte I[ entralna Gilon jusqu'g Rome et le fit cardinal-tv&pe de TusculumIZ.
- Date de -on : 1120-1 122 La VFta f i compo& entre le pdatemps 1120, au corn duquel Gilon partit pour Rome dans la suite de Callbae I& et le printernps 1122, lorsque Pons, qui avait command6 cette Vita, partit A son tour pour Rome a y abdiqua
mi (BHL 4010) par Hildebert, 6vGque du Mans
- ~dition : Hildebext de Lavardin, Vita sancti Hugonis dbatis, PL 1 59, co1.857-94.
- Auteur : HiIdebert de Lavardin, 6vSque du Mans Hildebert est un des grands auteurs du ~ o ~ e n Age lath?. Il fbt C o k e au Mans, avant d'en devenir 1'CvSque (1096-1 125). Il devint ensuite archeveque de Tours jusqu'8 sa mort, en 1133.
- Date de redaction : entre 1120 (apks Gilon) et 1122 Cette Vita ht commandtie par Pons. II donna c o m e modkles A Hildebert les textes de Gilon et du fameux Ezelon (cf YHh' Prol.,co1.858-59) Cette oeuvre est essentiellement un travail de compiIation de la tnis longue Vita de Gilon : elle n'a rien d'origind sinon qu'il s'y trouve mentionnd un episode dont Hildebert fit t6rnoi.n (m III,l9,co1.872) et des remarques personnelles, surtout des remarques nu les 5ges.
mm (BHL 40114012a) par Hugues de Goumay
- ~dition : Hugues de Goumay, Epistola de vita rHugonis Cluniacensis abbatis], ed. Herbert E.J.
Cowdrry, a TWO Studies on Cluniac History, 1046-1 126 m, Srudi Gregoriani, XI (1 978): 113-17
z', GILON DE TOUCY, De via hierosolymituna 3 Recuei. des h&toriens des crobades. Hktoriens occidentaux, V (1893): 727-800.
? Cf- A. KOHNLE, Abt Hugh, 1993, p253 et D. MISONE, art. a Gilon de Toucy m, DHGE, 20 (1984): 1402. Selon le Dictionnaim der weurs pets or lurins de i 2ntipi.d et clL Moyen ige, il n'est pas certain que le Gilon, hagiographe de Hugucs, et le Gilon, cardinal4v&que de Tusculum, firssent une seule et meme penonne (art. = Gilon n, Dictionmire. .. ,Turnhorn Brcpols, 1991, p.351).
=. Cf, Gilbert OUY et Jean-Yves TILLIElTE, art. a Hildebert de Lavardin m, Dictionnuire des letfres fian~aises - Le Mbyen ige, Paris: Fayard, 1992, p.68 1-82 et P. von MOOS, art. Hildebert de Lavardin ., DHGE, XXIV (1993): 483-84 (surtout pour la bibliographic).
, Vic'a s- Hugonis Clmiacensik abb. , ibid , p. 12 1-39.
- Date de &dadion : entre 1120 (mais ap& la rtQction du texte d'Hildebert) et 1 122
- Auteur : Hugues de Gournay, moine clunisien Comme Gilon a Hildebert, Hugues k i v i t A la demande de Pons. Il fit oeuvre originale la d i f f i de Hildebert, dans le seas OJ il employa scs pmpres mots et qu'il ajouta quelques anecdotes et r6f-ces : il prdciss, par exempIe, le nom du paysan qui vit saint Pierre et vint p&enir Hugues de sa mort prochaine (m 6 , p . lM), don que Gilon n'avait pas dorm6 ce nom (Yflr IT,vii,p.97-98)
K W en prose (BHL 4008) et W F en vers @HL 4009) par Renaud, abbe de VCzelay
- ~dition : Renaud de Vkelay, Yirre sancfi Hugonis abbatis, dans Vizeliacensia LI- texfes relatifs & I'histoire de I'obbaye de VPzeIq, ed. R.B.C. Huyghens, (CC CM, 42. Supplementum) Turnhout Brepols, 1980, p.39-60 (Vira en prose) et 61-67 (Vila en vers).
- Auteur : Renaud (TI13 I), petit-neveu de Hugues, abM de Vkzelay (1 1 16-1 1 28), ulttirieurement archeveque de Lyon (1 128-1 13 1) Renaud h i t le petit-neveu de Hugues. Tout comme Hugues de Goumay, il fit une oeuvre persomelle, dam le sens ou il ne se permit pas de recopier fexto des passages des Vitae Hugonis anttkieures et ajouta au &it des informations de son cru. Il voulait ddiger un texte succinct et facile B comprendre, d e b 6 aux minores, en opposition a w autres &its qui avaient prWd6, qu'il jugeait Ms recherchh (Vlf Prol'p.39). I1 dbclara 6crire i la demande de plusieurs f%ns (a monita m u l t o m f i a ~ m) et affirms s'ttre bas5 sur ce qu'il avait lui- meme pu obsezver ou que des hommes dignes de confiance lui avaient contd (V2T xlv,p.60). Une confrontation entre la Vita de Renaud et les autres Vitae Hugonis permettrait
certainement de mieux comprendre ce que Pons de Mergueil demandait i cew qui ddigkmt la Vita de son priddcesseur. Il serait ainsi possible d'en apprendre &vantage sur ce personaage 6nigmatique de l'histoire clunisienne.
- Date de ddaction : entre 1 12 1 et 1 128 Renaud ddbute sa Vita en prose en se p-tant cornme abbe de V&elay. Or, il le deviat en 1 1 16. Puisqu'il s'inspira tr5s probablement de l'oeuvre de Gion, il dut commencer apds 1 120. Le fenninza ante q w m at 1 128, aMee oh Renaud devint archevique de Lyon. Sa Vira en ven n'est qu'un dm116 de celle en prose ; comme les deux prdsentent ii de petits details pr6s la meme suite d'anecdotes, on peut supposer qu'elles k n t rddigees en mtme temps.
@HI, 4013) par un auteur anonyme
- Date de ddaction : dans Ie courant du XII' sikle
- Auteur : i n ~ o n n ~ Bien qu'il ne mbsiste aucune infoxmation sm ce texte, je 1% ajoute B mon corpus car, comme le remarque D. Iogna-Prat :
[o]n aurait tort de nkgliger ce texte incomplet Hypoth&se pour hypothese, rien w pxouve, en l'&t actuel du traitement du dossier hagiograpdique de saint Hugues, que les Mirada [titre d o d h cette oeuvre dam la Bibl.CZm] ne repdsentent pas la composition originelle tant recherchee. Comme lk joliment dit Frank Barlow : c'est le a joker du dossier, d4
A. Kohnle pease pour sa part que 1'Anonyme I1 se mit tardivement i l'oeuvre, malgr6 tout il note que cet hagiographe fit une sorte de collage, dunissant et recopiant textuellement les sources anciemes dont il s'inspirait? Ainsi, meme sous cet angle, on peut considker les anecdotes de ce texte comme &ant representatives des Ccrits clunisiens de la fin XIe-dibut XII' si2cle.
D. IOGNA-PRAT, "Panoraman, 1992, p. LO 1. ? A- KOHNLE, Abr Hugh, 1993, p256 et 263.
AUTRES VITAE CLUNISIENNES
G ~ U D , comte d9Aurillrrc, f909 Wac : VtP ~9251938 et V@ avant 972
Ocraua mq@t A Adlac, vers l'an 855. A la mort de son pke (879), alors qu'il etait a g i d'environ 24 ans, il hcrita de larges propri&s s'amdant sur la Haute Awa$m, le Rouergue a le Haut Quercy. Il fonda le rnonastke d9Aurillac en 894195, qui prit peu apds sa mort le nom de Saint-Gthud. I1 mourut Ie 13 octobre 909. Une diffknce fondamentale entre la Vita &rite par Odon [VG1] et la Vita abdgk [VG2] est que la seconde f ~ t de GCraud un clerc ( V G 7,p397)-
L'article de kfknce sur le dossier hagiographique de G6raud d'Aurillac est maintenant celui de k-M. Bultot-Verleysen, a Le dossier de saint Ghud d'Aurillac (Francis, 221 (1 995): 173-206). Cette auteure dome en premier lieu une bibliographic sur le sujet, puis prgsente m e I une les Mirentes versions de la Vita Geraldi, en etablissant la liste des manuscrits-
VQ ( B E 3411) par Odon de Cluny
- Auteur: Odon de Cluny
- Date de r6daction : c925-93 8
- edition: Odon de Cluny, De vita sancti Geraldi comitis Auriliacensis I, PL 133,639-704. Plus un rki t de miracle, RB, 34-35 (1 9 15-16): 260. Traduction Eranpise: G. Vensac, a Vie de saint Geraud, comte d'Aurillac ., Revue de la
Haute-Awergne, 43 (1972): 220-322. Traduction anglaise: G. SITWEU, St Odo of Cluny. Being the Life of St. Odo ofCluny
by John of Salemo and the Life of St. Gerald ofAlaillac by St Odo, New York: Sheed & Ward, 1958, p.90-180.
L'&iition de la PL est fautive sur trois points essentiels : now connaissons maintenant de meilleurs et plus anciens manuscrits ; il s'y trowe &verses emurs de transcription ; I'ordre des chapitres est quelque peu enone. Aussi A.-M. Bultot-Verleysen travaille-t-elle ii une nouvelle edition de la Vita. Elle utilise l'abdviation W (Vicaprolirior) pour dfigner celle- ci, tandis qu'elle nomme W3, un remaniement de cette oeuvre qui aurait &C fait a Cluny (peut9tre par Odon lui-mihe) et daterait d'avant 972. Ce demier texte n'a jamais W edit& et n'existe que sous la forme de f'ragments.
- Remraqucs : Odon a h i t la Yira Gerddi pour ofEr aux laks un modele de saintetk Plusieurs indices m'inciterd B pensa quc cet hagiographe visait egalernent un autn objectif, ceIui-IA beaucoup plus @is : en parIant de Ghud, il cherchait B dCfendte les in* de sa propre abkye, c'est-hake Clmy. Ua recherche postdoctorale me domera l'occasion de traiter de cette question en d m .
YO, YIUr bnuior @HL 3412-3414) par autear anonyme
- Auteur : anonyme. A*-M. Bultot-Verleysen ne pease pas qu'il h i t moim d'Aurillac. Je partage d'autant plus son avis que cet hagiographe dvite de me'ntiomer plusiem reliques de l'dglise abbatiale d'Aurillac qu'Odon avait pourtant dnumh5es dam sa Vita (ct VG1, III,3,col.691B-C et VC? Transitus III'p.236). Cette chercheure suppose plutat que le r6dacteur chit M moine de Cluny. Le fait est possible, mais &vantage d'indices sugg6rent selon moi la piste de Saint-Martial de Limoges?
- Date : le terminus ante quem de la Vita est 972 (cf. les remaques de A*-M. Bultot- Verleysen sur ce sujet)
- ~dition : Vita smcti Geraldi cornitis Auriliacensis II [BHL 34 121, Catal. Paris, vol.lI, 1 890, p.392-
401. Tr-hr~ de la Viro anonyme de G6raud d'Aurillac [V@ T m i t u s ; BHL 3412a], U. V.
Fumagalli, a Note sulla a Vita Geraldi r di Oddone di Cluny m, Bullerino dell'lsituto storico italiano per il medio em, 76 (1 964): 235-40.
Mirada post mortem de la Vita anonyme de Giraud d'Aurillac [V f f Bouange ; BHL 341 3-34141, M G.-MtF. Bouange, Histoire de l'abbaye d'AwiIIac, pre'cide'e de la vie de saint G i r d s o n f i ~ t e u r , tome I, Paris: I%. Albert Fontemoing, 1899, p.370-97.
- Remarques : la Vita breuior s'inspire directement du texte d'Odon, mais puke 6galement au texte qu'A.-M. Bultot-Verleysen intitule W. Une dtude attentive des sections de la VG1 qui fivent retranchdes de la VGL offre l'occasion de miew comprendre les objectifis de ce travail de r&riture. Il s'agissait d'alldger et de mieux stnrcturer la t&s prolixe Vita d'Odon. Malgre tout, je ne pense pas que ce qui derange& dellement l'abnhiateur fit la pdsence d'tI6ments lsques dam la vie de G b u d - en effet, certains de ceuxci firrent accent& par rapport a la VG1 : la vraie df lhnce entre les deux Vitae &side plut8t dam le message qui etait transmis awc lacs par leurs truchements. La V(i2 cherchait simplement ii faire main- mise sur un cuke populaire et d~finir en termes ntonastiques la saintete de Gdraud.
'6. P- FACCIOTTO f i t le premier & ma connaissance A dvoquer cette Cventualite (8 La "Vita Gerald?' di Oddone di Cluny, un problema aperto I, Studi MedievaIi, 33 (1992): 261).
ADELA~E, impCratrice (931-999) gpitaphe [a, BHL 63-64, rSd. c 1002, par Odilon
AdtMde fut d'abord I'Cpouse de Lothake I& mi d'Italie (947-950). A la mort de celui-ci, don qu'elle etait Q6e de 19 am, B h g e r d'Ivrk l'emprisoma pour conserver sa main- mise M l'ltalie- A* son Man, eUe dcvint en 951 la fimrme d90tton I-, mi de Germanie (936973), mi d'Italie (951-973) 6 cnfin emperem germanicpe, de 962 jusqu'ii son d& en 973. RCgente pendant quelques a ~ k s a@ la mort de son mari, elle se brouilla un temps avec son fils, l'emprrmr Oaon II. Ce fut pike A l'entremise de qu'une &conciliation prit place en 980. Ad6lalde privilegia toujours Cluny et c o d a plusieurs monasttres a l'abbaye bourguignome.
- ~dition : Odilon, E#taphium domne Adalheide mguste [MI, ed Herbert Paulhart, Die
Lebembeschreibung der Kizikerin Adelheid von Abt Odilo von Cluny, dans Mitteilmgen des imtituts fir dsterreiehische Geschi~htsforschung Ergdngzungsband XX: 2, Graz/Kiiln: H. Biihlau, 1962, p.27-45.
- Auteur : Odilon, abb6 de Cluny, qui coma pemmellement l'imp&atrice a la fin de sa vie.
- Date de ddaction : c1002.
- Remarques : Ce texte d'OdiIon est exceptiomel ii plus d'un titre : parce que, du point de vue de la forme, il se situe entre I'tpitaphe et la Vita, parce qu'il conceme une femme et enfin parce que l'auteur accorde une grande importance aux evhernents historiques et politiques2'.
n. Outre les notes de H. PAULHART qui accompagncnt son Cdition de I'U, cf. R FOLZ, Les saintes reines du Moyen Age en Occidertt (W-MIX'S.), (Sulnidia hagiographica, 76) Bmlles: SociCtC des BolIandistes, 1992, p.67-80, P. CORBET, Les s a i ~ ottoniens: saintetk &nastique, sainteti royole et saintetk fthinine outour de I 'rm mil, Sigmaringen: J. Thotbecke, 1986, p.59-72 et p.8 1-1 10, D. IOGNA-PRAT, Agni immamfizti - Recherches SM f a sources haglographigues relatives ci saint Muiml de CIuny (954-994), Paris: ~ d . du Cerf, 1988, surtout p.368-74, J.T. SCSCHULENBURG, Saints'Lives as a Source for the History of Women, 500-1 100 m, dans Medieval Women and the Sources of Medieval History, dd. Joel T. Rosenthal, Athendondon: Univ. of Georgia Press, 1990, p .B 1 et p295, A. VAUCHEZ, La sainfetP en Occident oux derniers sikfes du M- Age d bpr& lesprm& de canonbation et les documents hugiogrophiques, Rome: ~ c d e franqaise de Rome, 1988 (2'Cd.). p.429.
particuli&anent alors qu'il ddigeait la Yita WiZlem43. Il parle d'ailleurs en tames tris louangeurs de Cluny et de ses ab& Maled a Odilon dans ce texte?
33. Cf, J. FRANCE, W, pxIv- ". Cf. MYv,p.264 et p.266, Wvi,p.268, qp.280, etc. Sur les liens entre Raoul et les Clunisiens, cf. aussi
J. FRANCE, Rodulh Glaber and the Cluniacs n, Journal of Ecciesiarticai Hktoty, 39 (1988): 497-508 et E. ORTIGUES et D. IOGNA-PRAT, a Raoui Glaber et I'historiographie clunisienne 9, Sfudia Monatica, 26 ( 1 985): 537-72.
BOUCHARD, comte de VendBme (e935-1005) W u [nl, BHL 1482, r(d, 1058 par Euder des Fossb
Bouchard dut Wter vas le milieu du X SiMe du wmtc de Vend6me. Il fut Cduqut B la cour de Hugues le Grand et devint ainsi un a fidde entre les fid81es d'Hugues Capet m3?
Celui-ci hi fit @user me r ick vewe, &&etb, qui hi apporta en dot le come de Corbeil et peut4tre a w i un h i t de regard sm I'abbaye des FossCs.
- Auteur : Eudes des Fosds. Bouchard avait dtt I'avou6 de cette abbaye. En 988, il avait demand6 B Maied de vemk la dformer. Ap&s le depart du grand abbe de Cluny en 989, dew autres supt3ieurs d'origine clunisienne se succddetent B la ttte de la communautC, Teuton (989-1000) qui fit d'abord simple prim, puis ih'baa le beau-fils de Bouchard (1000-1005). L'innuence clunisienne sur le mo& a dil dkroitre par la suite, mais il est impossible de vkritablement observer Ie phinomhe. L'insistance de L'hagiographe Eudes A p a r k de Clmy permet d g r 6 tout de d i e que celui-ci se percevait c o m e appartenant ih la mouvance de la grande abbaye bourguignome.
Fait peu courant pour un auteur du XIC siecle, I'ecriture d'Eudes des Fossds est connue, car elle se retrouve sur plusieurs manuscrits originaires du monastk En premier lieu, il a appose sa signature sur le 1ectionna.h qu'il avait compldt6 (paris BN lat.3786, f01.256")~~, diclarant Stre Eudes, nutritus de Glanfeuil. Deuxi*rnement, il a ajout6 B divers actes du chartrier des Fo& l'annk d'Incamation oii ils fiuent r&Iig#'. Sur la base de cette kriture et sur la base d'autres indices, certaines oeuvres, outre la W3, lui k e n t attribuees, tout spCcialement l'office de Babdein que contient le Paris BN lat 56073g. Eudes des Foss6s n'a jamais connu personnellement Bouchard.
35. D. B A R ~ L E M Y , 8 SW les traces du comte Bouchard : dominations chiitelaincs Vend6me et en Francia vcrs l'an Mid m, clans Le r o i k France et son rayaume autour & I 'an Mil, dir, M. Parisse et XI B a d i Altet, Actes du colloquc 8 Hugucs Capet 9874987. La France de I'an Mil *, Paris-Scnlis, 22-25 juin 1987, Park Picard, 1992, p.99, S u r e personnag+ important dc I'eatoutage dc Hugues Capet, cf, aussi Id, La soci'tt! dam ie comtg de Ved6me & I'an Mil mr XlP sihcfe, Park Fayard, 1993, p.278-79, K.F- WERNER, art, = Buchardus m, M, II (1983). co1.942 a 0. GUILLOT, Le comte d'Anjou et son entourage 4~ XP sitkle, 11: Cdaiogue d'actes ef inder, Park Picard, 1972, p.33.
16. Sur c t manuscrit et sur le fait que la main cst celle d'Eudts, c t C. DE LA RONCIERE, Vie de Bouchard.,, 1892, pxxii ct 1, FAVIER, La fabrication d'un faux A Saint-Maw-des-FossCs *, BEC, 119 (1961): 235-36, MOrnLIcritr &&, IT, 1962, p.195-97, et Bibliothtque Nationale de Paris, Catafogue gidral des mormrcrits lotins, VII: (n "3776 ti 3835) Homdiaires, Paris: BibliotMque Nationale, 1988, p.92.
Cf. C. DE LA RONCIERE, Ym de Bouchatd.., 1892, pJorvii, F. SOE-E, Catalogue d a acres d'HenriP, raide France, Par&: Champion, 1907, p.40-41, I. FAVfER, La fabrication.,. m, BibliothPpe de I 'hoie des Ches, 1 19 (1961): 23 ct I. BOUSSARD, Actes myaux ct pontificawc des Xe et XP sitcles, du chartrier de Saint-Maur-des-Fo& W, Journal des Scrvunts, 1972, p.82-83 ct fig. 13, p. 1 10.
". Cf. CataLPmis, IT, p318. Dam le CataIogue, sont pub1ide.s les sections du sermon concernant fa vie historique de BaboIein @5I8-19). Le BN 5607 date du Me siMe et est originaire des Fossds (cf. DOLBEAU 1979, p210).
- Date de ddaction : 1058 L'hagiographe conclut lui-mCme son oeuvre en donnant I'm& de daction (m W , p 3 1).
- Edition : Eudes des F o e fie de Bowhardle ViEdraMe, comte cle Ved'me, de Corbeil. de Melur
et de Pa& (Xe of XIe sfeclcs), €d. C. Bourel de la Roncih, (ColIection de textes pour servir H Penseignement de l'histoire) Paris : Picard, 1892, p.1-32.
Traddon bqti# : M. Guizot, CoUedin des Mkmoires relafii b 18Histoire de F m c e , tome W, Paris: Librairie Briete, 1825, p.3-28.
- Remarques : La Yita de Bouchard n'est pas me Vie de saint P proprement parlet. ELle fut composke pour proteger Ies intsts de I'abbaye des FosSes vis4-vis du nouvel avou6, Guillaume, comte de Corbeil, qui venait #&re d6signC par le roi de France. Il est nkessaire de reprendre l'etude des relations triangulaires en- Ie moIlStSfere, le mi et l'avout, que celui-ci fut Bouchard ou Guillaume. Quelle que fiit la teneur de ces relations, il est evident que de nombreux passages de cette Vita &ent destinds a un public lalque, tout sp6cialement Hend IQ et Guillaume. Par ailleurs, pour comprendre les autres sections obscures du texte, il faut se pencher sur I'histoire interne de I'abbayea et la position instable oit se trouvait l'hagiographe.
19. Cette traduction, rrts litterale, fut faite h partir de la premih Cdition de la Vita par J. Dubreul (Suppiementm Antipifaturn &is Pmisiacae, Paris, 16 14, p.147-66), qui s'est servi du manuscrit deficient, BN lat. 12618. Malgn? tout, les differences entre les trois manuscrits, telles que mentiomtks dam I'apparat critique de I'ddition de la Roncih, sont minimes. La traduction reste donc valablc.
I1 existc une autre traduction de 1628 par %bastien ROUILLARD de Melun, avocat au Parlement (Histoire de Melun, Paris, 1628, p.639-72). Cet auteur s'est Cgdcmcnt semi dc ['edition de Dubrcul,
Sur c*te abbaye, connue aujourd'hui sous le nom de Saint-Maur-des-FoW mais qui s'appelait simplement les F o e du temps de Bouchard, cf, GaIIia Christians, W, Paris, 1744 [1970], co1.282-92, H. TRAVERS, Rcchcrchcs sur L'histoirc de I'abbaye dc Saint-Maurdcs-Fo& jusqu'h la dunion du p r i e d de saint-kloi (639-1106) m, hole der Churtes - Parfrom &s thkres, Paris: Picard, 1890, p.161-66, CO'ITINEAU, II, coL2800-02, M. BAUDOT, Histoire de l'abbaye des Fo&s dcs origines h I'm& 925 - Examen critique des sources narratives ct diplornatiquts B. bole ~aionole & Charter - Papitiom a h thhses soruemrerpar fes PIhis h lopromotion L 1925, Paris: Picad, 1925, p.13-16, P. s&oURI@, sh Babokin (saint) m, DHGE, VI (1932): 24-27, J. DAOUST, art. Saint-Maur-dcs-Fos& m, Catk, XIII (1993): 541142, et surtout B. DIRLAM, tes scufptures mhdi&aks de Saint-Muur-des-Fossh, trad. et pdparation P. GiIon, Saint-Maur: SociCtC d' Hiktok et d' Archtologic a k Vicux Saint-Maw m, L983 ct D. HAGERMANN et A. HEDWIG, Dos Polyptychon und die Noticia de Arek von Sbint-Mm-des-Fossdk Analyse und edition, (BeiheAc des Francia, 23) Sigmaringen: Jan Thorbecke Vcrlag, 1990, p3-28. Sur I'histoire du site jusqu'au haut Moyen i9g* cf. P. GILLON, Nowelle hIjtorie L Saint-M~na-&s-Foss&, I : Des origines otrr Bagmdes, [La Varenne-Saint-Hilaire]: Le Vinoc Saint-Maur, 1987. L'ouvrage de k l e GALTIER, Hirroire daparoisser de Saint-Mwdes-FossPs depuis les origines jwqu 'ci nos jotus, Paris: Champion, 1923 (reprod. 199 1) n'est pas d'un grand int6riit pour l'histoire medievale.
BABOLEIN, premier abbC d a Fossb (f670) ma [Wa], BHL 886, et WIMCUIO [MBa], BHL 887, dd. entre 1058 et 1067
Babolein Cta i t pmbablement un moine originaire d'Irhn~le'~. Il ne semble pas avoir W port6 aux aufels avant k IX sikle, mais son culte ne se dCveloppa vraiment qu'au XI %&cIe, lorsque Eudes des Fads (I'l~agiogrqhe de Bouchad) composa un office en son homeur, entre 1030 et 1058.
-Auteur : anonyme, moine des FosseS. R fbt put* un oblat du lieu (Ma 3,p. lO6C).
- edition4* : [ma] : P. m e t , ~ e h e presbyteri et ~ r e d e ~ ~ i scholastici concords, Paris, 168 1, p.356-
71, [MBa] Miracula S Baboleni abbatis Fossctemis, AS, I n , W, Pasis/Roma: Palmk7 1867,
p. 159-62.
- Date de nidaction : Les dew f i t s relatifs a Babolein furent cornpods entre 1058 (date de redaction de la Vita Burcardz] et 1067, oh eut lieu me nowelle tramlation du corps de Babolein ; certains miracles finent pourtant ajoutds peu ap*s 1088".
- Remarques : 0- le fait de donner une assise solide au culte de Babolein et de vaincre la r6sistance t k s forte de certains f%res, ces dew oewres permettent de f k I'dloge des Fo& et de d6fendre ses droits. A premike we, je n'avais gu&re de raison de les inclure dam le corpus de mes sources puisqu'elles ne font aucune place B Cluny et tentent meme, peut-, d'effacer le souvenir de la prise en main de I'abbaye par les Clunisiens, quelques quatre-vingts ans plus tiit. Mais du f;lt qu'elles ont la meme origine gbgraphique et qu'elles ont W &rites moins de dix aas a@ la Kta Bwchardi, qui eIle, est indeniablement influencde par Cluny, je ne pouvais pas les ignorer.
'I. R AIGRAIN, art. 8 Babolein (saint) W, Cah, I (1948): 1153. ". M. BAUDOT a dCtennin6 que, pour &kc sa Vita, I'autcur s'Wt bad sur : outre l'0fTice [de
Babolein], la Vita CoIumbmi de Jonas, Ies Vermr de Bobuleno abbate, la Vita RemacIi des Gem episcoprwn Leodiensium dXcrgier de Lobbes, les Gesta regum Francorurn, les Gem hgoberti, 1'Hisroria ecclesiostica Anglorum de B&de, Orose, la Pmio retractata Acuunensiiun m+m W, saas compter ses emprunts a la Vita Mmri du Pseudo-Faustus, aux MiramIa smcti Mauri d'Eudes de Glanfeuil et la Vita Bwcardi d' Eudes de Saint-Maur D (a Histoire ... m, opcit., 1925, p.8). Dans la major* des cas, l'hagiographe mentionne lui-meme ses sources,
43. Sur la date de redaction de ces deux oeuvres, cf. M. BAUDOT, Histoire ... *, op-cit., 1925, p.7-9.
IDE, comtcue de Boulogne (oo de L o m e ; t 1113) ma [WJ, BHL 4141, rW. 1130-1135, par auteur anonyme
Ide est nCe vers 1040. ElIe Ctait la fille de Wefroid le Barbu, come de Verdun (1026- 1069), duc de Haute-Lotbariagie (1044-1 047) 6 duc de Base-Lothariagie (1065-1069) ; celui-d @usa en seconde noce, en 1054. B M c e , marquise de Tosame a m&e de la cd&e Miithilde. Un des fWes de Godefbid dtait FrMdric de Lorraine, pape sous le nom d'gtienne K, depuis le 2 aosd 1057 j q ' h sa mort, le 29 man 1058. Hugues de Cluny &it I ses obtk k jour de son dtds et aurait chaw5 diverses reprks le dhon qui l'assaillaitu. Ide fut marite en 1057 h Eustache II, comte de Boulogne. Elle mourut le 13 avril 1 1 13. Elle passa ii la postdritC surtout comme m&re de Godefroid de Bouillon et de Baudoin IQ de ~erusal-~~.
- Auteur : anonyme Puisque la sainte etait e n t d au prieun5 du Wast, pr ied qu'elle avait elle-mEme remis sur pied, puisque la Vilo insiste tant sur la restauration de cette fondation et sur la lutte qui I'opposa i d'autres abbayes pour le contr6le de la ddpouille de la ~ainte~~, et enfin puisque I'hagiographe &tit prCsent lors de l'ouverture du cercuei14', il est admis par tous les chercheurs que ce demier etait moine du lieu
-Date de ridaction : 1 130-1 135
- ~dition : Vita beatae idae [VA, PL 155, ~01.43748~~.
V p iii,p.lU , V ' VII,p.S6-57, 7,coI.86SA-B et W I2,p.43. ". Sur Ide, cf, N. HUYGHEBAERT, La mtce de Godefioid de Bouillon : la comtesse Ide de Boulogne W ,
dans L a maison d'Ar&nne, 2-XP si&Ies. Act- ck jou~nkes lotharingiennes, 24-26 octobre 1980, PubIications de la Ssction hktorwe ak I'I'titut GrdDucal& Luxembourg (Luxembourg: Institut Grand- Ducal dc Luxembourg), 95 (1981): 43-63 ; Re& NIP, . Godelieve of Gistcl and Ida of Boulogne ., dans Sanctify and Motherhood - Essays on Holy Mothers in the Middle Ages, td. A.B. Mulder-Bakker, New YorKondon: Garland Publ., 1995, p209-23 ; H, PLATELLE, art, Idc m, Nouvelle Biographie Nationafe, voLII, B~xeIles: AcadCmie Royale dcs sciences, des lettrcs ct des Beaux-Arts de Belgiquc, 1990, p.233 ; G. DESPY, Godefioid de Bouillon : rnythcs d &lit& w, BuIIetin & la cfpsse &s lams et des sciences morules etpoiitigues - Acadimie royale de BeIgiqtre, 71 (juin-sept 1985): 249-75.
". D. H A I G N E ~ Topographie boulormrire : les origina ct le nom primitif du h r g du Wast w, BuIIetin de la socidh ucadkmique de Boulogne-~w-Mer, 4 (1 885- 1890): 509.
". VI IV, 13, coL446B: "hm autem, ut digmm est, fidelibur wedendurn magno pro mirocuio tes!amrrr." ". Pour les encurs d'ddition commises, voir B. dc GAIFFTER, Sainte Ide de Boulogne et I'Espagne. A
props de mliques mariales ., AB, 86 (1968): 67-82 et D. H A I G N E ~ , Topographie ... m, op.cit., 1885-1890. p.503- 10.
Le texte de D. HAIGNE* L,u vie de la Bse I& ~~~e de Boulogne, traduite du latin des BoIlandhtes, avec queipes addtiom (Boulogne: chez Berger F W , s.d. (c1850), 36p.) n'est pas une traduction de la Vita B proprement parler puisque les ajouts d'Haigner6, s'ils sont mineurs, sont malgre tout prdsents presque ;1 chaque ligne.
-Rcmarques: Ide o m le p r i d du Wa~t aw CI&ens aprb hvoir tesfaudY entre 1082 (terrnintls a quo de la mort d9Eustache 11) a 1099 (mort de 1'6veqUe G h d de Thhuanne qui aida Ide dans sun cntllcpase). L'hagiographe Cvoque d'ailleurs cette donation f~te & saint Hugues dam la Vita (VIII,7y~L442). Il est donc normal que j'm cet Ccrit pour mon corpus. L'hypoth5se de Georges Duby, selon kqyelle la Vita ht M t e pour smir Ies inWts de
la petitc-fille dlde, Mathilde, reine d7AngIeterre n'est gu&e Cette oeuvre soukve plusieurs questions ; je ne mentionnerai qye 1es principles. Pour ce qui est des 6vdnements qui prirrnt place en@ 1082 et 1099 : pourpi Ide W e beaucoup de donations A 1'gglise ap& son veuvage a pourquai offirit-elle ce pi& aux CImisiens ? Par rapport aux a n n b 1130-1 135 : il est clair que l'auteur a compost cette Yilo, moins pour faire 1'610ge de la comtesse, que pour s e e les int6fits de sa commuuautd. Quels intdts du Wast 6taient en jeu P cette epoque ?
49. G. DUBY, Le chevalier, w m m e et le pr&e - Le mcniage dans la Fmncefiodale, Paris: Hachette, I98 I, p.147 et The Matron and the MiiManied Woman : Perceptions of Maniage in Northern France c i m I 100 m, dam Social Rehiom d i d e a r - &says in Honour of RH. Hilton, €d T.H. Aston, P.R Cross, C- Dyer d J- Think, Cambridge: Cambridge UP, 1983, p.95-96.
DE AltRACIIlZJS [w, rCd 1127-1156 par Piem le V6119rabIe
- &iitionU) : Pierre le V&&able, Pem* Cl~mi'censik obbafi;s. De miracullis Iibri duo, Cd D. Bouthillier, (CC CM, 83) Tumhout: Brepols, 1988.
Traduction h p i s e : Pierre le Vhhble , t e s menteilles & Dieu, trad. J--P. Torrell a D. Bouthillier, @ride antique et m&6vale) Paris/Fribourg: 6i. UniversimCerf, 1992.
-Auteur : Pierre le V6nhble est n€ en 1092 ou 1094, dans une f d e d'Auvergne de moyenne noblesse?'. Ses parents le domerent comme oblat au monast&e clunisien de Sauxillangep alors qu'il &it ig6 de six ans. Vers 11 Wl7, B 1'3ge de 21-25 am, il fut envoy6 I V&elay, pour y remplir la charge de prieur sous l'abbatiat de Renaud de Semur, puis vers 1120, a Domhe, petit pried de douze moines en+ dont il devint le prieur. Db 1122, donc vers I'ige de 28 ou 30 ans, il etait n o m d abbe de Cluny. Il le restera jusqu'8 sa mort, le jour de NMl1156 (~62-64 am). Ses activie durant son abbatiat (reprise en main de Cluny ap& la guerre intestine avec Pons de Melgueir, intervention dans le schisme d'Anaclet, secours accord6 i Abelard, 6.) ont SUffIsmment 6t6 analysies en ddtail en d'autres ouvrages pour qu'il soit utile de les dvoquer ici.
- Date de rt5dactions : de 1 127 ii 1 156. Pierre a rassemble les anecdotes du DM de 1 127 B 1 156. II existe malgr6 tout deux temps forts de redaction : une premiere version, la collection bkve, fit redig6e entre le 6 janvier
=. D. Bouthillier a choisi c o m e tho in priviltgi6 pour son ddition le rnanuscrit de Neuch&eI [N] (Bibliotheque publique de Neuchiitel, Armoire de Fer A25, de la fm du XIIe-XUIe sikle) qu'elle avait elle- rnhe dhuver t dans Ies am& t 970 (ct D* BOUlMLLIER, Un nouvcau temoin du De rnri.~cuIk de Piem le V h h b l e : le rnanuscrit de NeuchW, Annoie & ferA25 m, MediraevdStud', XLI (1979): 524-34) ; mais elle s'm @dement bade sur les nombtcux autrts manuscn*ts prCscntant la collection brtve ou la collection longue, ou mSme dcs extraits de I'une de ccs deux versions, Pour une critique dcs choix effcctuCs par D. Bouthillier en w e de Miition, cf. Ie comptc-rmdu de son ouvrage par G. ORLANDI dans Aevwn, 6512 (1991): 36 1-68. Le compte-rendu par P.4, FRANSEN (RB, 99 (1989): 193) mentiorme diverses &f€ttnces (surtout scriptuntires) non mentionnks par D- Bouthillicr.
". Sur k fmille de P i m , c t G. CONSTABLE, The Letters of Peter the Venerable [LPVJ, II, Cambridge (Ma): Harvard UP, l%7, p.233-46, L-P. TORRELL a D. BOUTHILLER, Pierre le Vdndrable, sa virion du mo&, sa vie, son w e - Ithornme et le dihon, Louvain: Spicilegium Sacrum Lovanicnse, 1986, p. 1-104 et C. LAWRANSON-ROSAZ, L ' A w w et ses morges (Yefay,, G&mh) . du KUf cnr XP si'ecle - Lafin rfu m o d m i i e ?, Le Puy-en-Velar Les Cahicrs dc la Haute-Loire, 1987, p.148-52. Les dttaib cornus de la vie du ptrt ct de la m&rc de Piene proviennent en bonnc part de sa Lettre n053 (LPY, I, p* 153-73) b i t e sl ses trois Wres clunisiens pour Icur annonccr Ie dkts de Raingarde, leur m t m Sur cette lettn, outre les remarques de G, CONSTABLE dam LPV, II, p,133-35, c t P. LAMMA, .: La madre di Pietro it Venerabile m, Bulletino dell 'Isrhito storico itaiiano per il medb evo, 75 (1 963): 173-88.
=. Monasth fonde par la Guilhemida, cf COTTtNEAU, IT, co1.2963, plus Ies remarques Ie concernant dans C. LAURANSON-ROSAZ, L 'Auvergne.,., 1987.
". Cf. D. BOUTHILLER, DM, p.57*-117..
1 134 et le mois de mai 1 135 ; la seconde version fh cornmen& entre l'automne 1 142 et Ie mois d ' a d 1144. Elle continua #&re emichie petit & petit par 1'- de Cluny jusqu'au seuil de sa mob Pour &sum=, on peut dire que la premihe version donna le premier livre du DMet la deuxihe, le second.
-Remaqua : D. Bouthillier et LP. TomlI, les dew p d s sp6cialistes du DM, ont t& bien expliqud comment cet kit, qui ih p d & e vue ddpareille l'ensemble de l 'oem de Piem, s'iomit en vtritC padkitement dans son programme li- : h i , le DM a comme propos, en cornmun avec les tmis p~c ipaux trait& de Pierre - respectivemeat contre les Petrobdens, les Juifk a les Musulmans -, de d o r c e r lafoi vacillante de beaucoup de catholiques. Il pennet par ailleurs de souligner la grande valeur de l'ordre clunisienss, en t5voquant ses luttes victorieuses contre le Diable, en &pondant aux attaques lancees par les cisterciens et en inquit!tant les seigneurs et Mques osant remettre en cause la libertd clunisieme.
-. Cf tout spkialcmcnt leu. article, D. BOUTHILLER et L P . TORRELL, . Miraculum m, Une catdgorie fondamentale chcz Pimc Ie V&nCrablc R, m e rhontbte, 80 (1980): 357-86 ct 55966.
'? Tout un chapitre du DMa pour unique fonction dc !%ire l'apologie de Cluny (I, 9, p34-37). Ce chapitre n'existait pas dans la collection W e ; ks tratlsfonnations subies par le DM tntre I t s deux versions indiqucnt que Piem nc s'est miment inquiw dc fib l'apologie de Cluy qu'aprts I 135, lors de la dewcieme r&kion. Sur la louangc de Cluny dans le DM, cf. tout spdcialemeat LP. TORRELL et D. BOUTHILLER, Pierre le Vin&uble er so vision.., 1986, p. 1 50-54 mais a u s i 1. LECLERCQ, Pine le Vhndrable, Abbaye de Saint- Wandrille: Ed de Fontcllc, 1946, p. 13 1-34 a J.-P. Valery PATIN et J. LE GOFF, . A pmpos de la typologie des miracles dans le Liber (i& mu~Iis de Piem le VdnCrablc m, dam Pime Abdard - Pierre le VPnPIable : Ies courants philosophiques. iirthraires et artIjti~m en Occident au milieu du XTFsiCcie, Abbaye de Clun y, 2 au 9 juillet 1972, Paris: ed. du CNRS, 1975, p.l&l.
Puisque je voulais 6tdier le discours clunisien sun Ies @es, j'ai dlim.int de mon corpus les VitM qualifi6es de para-cl~siennes. par D. Iogna-Rat?. Il s'agit en effet de sources Ccrites par des hagiographes qui n'Ctaient pas clunisiens, rnais dont Ie saint fut en contact plus ou m o b direct avec Cluny. Je n'ai pas nonplus pris en compte Ies Vitae M t e s par des c1unjSiens mais dont la date de ddaction etait postekieure & 1156.
- Tel est le cas de la Vita d'Anastme (t1085/86). Celui-ci fut moine du Mont-Saint-Michel et de Cluny par intermittence, mais acquit surtout la dl&titC du fait de son existence &hitique. Son hagiographe, Gauthier, etait un clerc Seculier ; il explique, dam le prologue de la Yilr, qu'il composa celle-ci B la demande du sousdiacre Pierre, de 1'Eglise d'Oydes, et de son f k e Bernard (Prof.,#l,col.425C).
Gauthier d'Oydes, Vita SAnastmii, montis SMchaeZis momchi PHL 405, r6d. c. 1 1 151, PL 149,423-36.
Traduction h @ e : E.-A. Pigeon, Vies des saints du dioc6se de Coutances et Avranches avec des Notions prdiminaires et Chistoire des reliques de chuque saint, t.11, Avranches: Imp. A. Perrin, 1 898, p348-56.
- Le comte Simon de CrCpy (1048-1080f82) fonda un rnomstk qu'il o f i t il Cluny, Saint- Amoul de Ckpy-en-Valois ; il n'y finit pourtant pas sa vie, mais entra au monast&re Saint- Oyen (Saint-Claude), dam le Jura. C'est un moine de L'endroit qui ddigea sa Vita.
woine de Saint-Claude], Vila de Simon de Cdpy [BHL 7757, dd. ap.11091, PI. 156, 121 1-23? ASBin, VI-2, p.374-8+ AS, Sep. VIII, p.744-50.
- Je n'ai pas non plus int6gr6 la Vita &Adhegrin, le compagnon d'Odon, qui entra I Baume avec lui, puis vkut une existence Mmitique, d'aabor dam les environs de Baume puis d a m ceux de Cluny. On ne cotlll~~l~t en effa ni la date de nhction du texte, ni l'origine de I'auteur. On peut simplement noter que cet ecrit est t d s proche des passages de la Eta Odonis de Jean de Salerne evoquant Adhegrin ; il n'y a pourtant pas adequation parf'aite entre ces deux oeuvres. Il fbt toujours admis que l'hagiographe $Adhegrin s'etait bad sur le texte de Jean de Salerne, mais rien n'interdit en fait d'irnaginer que l'inverse fit vrai.
Vita Adhegrini [BEE 701, AS, juil. I (Antwerp 1 7 19), p.339-40.
- Les m h e s probl&mes de datation et &identit& de l'auteur se posent pour Ies deux Vitae de Morand (71 1 1 S), moine clunisien, qui h i t sa vie c o m e prieur d' Altkirch. Le premier hagiographe provenait du dioc&se de Bae ou se trowait le pried, puisqu'il pale de
%. Cf, D. IOGNA-PRAT, La Gaffia du Sud, 930-1 130 m, dam Hagiographies - Hirtoire internationale de la litte'rature latine et vernacuIaire en Occident des origin= d 1550, vol.1, Cd. G. Philippart, (Corpus chri3tianorzim - Hagiographie, I ) Tumhout: Brepols, 1994, p.323-26.
notre . die- et de nos . Ptinces (I, l4,p.M4B et 1.10,~-343A), mais il n'utilise pas le possessifpour p a r k de la commmmautt clunisienne - ceci pouaait p e u t a s'qliquer du fait qu'il s'agit d'un @he - et accorde fort peu d'importrmce B l'abbaye bourguignonne. Comm il afIirme qye beaucoup de temps s'est h u l € entre le dCcts du saint et le moment o& iI a g e (Prd, 2,p341D), les Bolhdbtes propo&ent de dater la nta des annBes 1165- 1 170, v m l ' m e qu'ih supposaient il tort &re celle dc la canonisation? La @on de la datation de cette oeuvre doit &re reprise cat il est possible cpe les demiers paragrapha evoquant pdcishent la canonisation du saint h t une addition tardive. Comment expliquer autrrment les plaintes de i'auteur sur l'oubli dam lequel Morand &it tomb6 (ProL, 2,pe341D) ?
Vita I du bienheureux Morand FHL 60 191 , AS, Juin (Paris l867), I, p.341-45.
La deuxi6me Vita est ind6niablement de facture clunisienne du fait de l'importance qu'elle accorde A Cluny. Puisqu'elle est un &umC remanit5 de la prktdente, elle ht &&gee bien au-delA de 1 156 ; pour cette raison, je ne I'ai pas incluse dam mon corpus de sources.
Viro II du bienheureux Morand @3HL 60201, Bibl. Clm, ~01.50 1-06.
- Je n'ai pas non plus Ctudi6 les productions hagiographiques des monast5res ayant 6t6 r6formds par Cluny, mais qui conserv&rent m e identit6 et une tradition es fortes, sur lesquelles l'iduence clunisieane n'eut que peu d'emprise. Je pense plus spdcidernent h Fleury. La production hagiographique de cette abbaye ne commenp que longtemps ap& sa reforme par Odon de Clunf8. En outre, I'analyse de son c o d e r tknoigne que l'abbaye bourpuignonne ne modifia pas en profondeur son mode de vie pour le modeler sur celui de Clunu".
9. AS, Suin (Paris, 1867), I, pdface de redition de la Vita, p.332F. On ne savait pas alors que la canonisation de Morand n'avait eu lieu qu'a Ia fur du XII' sikle.
5a. C f. T. HEAD, Hagiography and the Cult of Soints - The Diocese of Orlkans, 800- 1200, Cam bridge: Cambridge Univ. Press, 1990, pS5.
Cf. A. DAVRIL, Points de contact entre la Vita lohonntk Goniensis et les Coll~tletudines Floriucenres Anriquiores r, dam L 'abbaye de Gome ,P si&cle, dir. M. Parissc ct O.G. Oexle, Nancy: Presses Univ. de Nancy, 1993, p. 19 1-92.
Pour me d d p t i o n globale et m e mise en contexte des coutumias et statuts clunisiem, il fhut consulter l'article de D. Iogna- Coutumes et ~tahtts clunisiens c o m e sources histotiips (cu 990-cu 1200) v, RM, M. 3 (1992): 23-48. Les Comehrdiins antiquiores [a, le Libor @mi& [LTJ et ies st- de Pimc k V&&abIe [Stat.] f h n t tous Mites au cours des vingt dernik anntes ; on trowera des *tations dhiU&s de ces oeuvres dam les introductions de ces Stions f b b rrspoctivement par K K,ger , P. Dinter et G. Constable.
Consuetudines ~Iuniocemiurn antiquians [a] dd. entre 990-1015
- a t i o n : Cometudines Clmiacensium untiquiora~ cun, redactionibus derivatis, Cd. K. Hallinger,
Cometudinum sueculi X-XT-XU momnnenta, II, (CC.7/2) 1983, p.3-150. Je me suis principalement int6resstk aux textes des manuscrits B (Rome, Bibl. Vat., Barb. lat 477) et B1 (Rome, Bibl. Casananse) car ils sont les seuls Mites dam les pages de ce volume qui soient specifiquernent clunisiens.
- Date de rddaction : I1 est impossible de fixer avec certitude la date de r6daction de ces premiers coutumiers clunisiens ; on sait seulement qu'ils h n t composds entre 990 et 1015.
Liber tramitis [Ln r9d. c 1040
- &iitionl : Liber hamitis aevi Odilonis abbatis, 6d. P. Dinter, (CCM, 10) 1980, p.7-287.
- Datation : c. 1040 L'histoire de la composition du LT ou, plus exactement, I'histoire de la ddaction du manuscrit originaire de l'abbaye de Farfa, Rome Vat. lat.6808, est eemement complexe. La date de 1040 est une moyenne ; en rMit4 tout depend de la section du texte considdr&+.
I. Sur le lath assez dCpIorabb du Lr cf. P. DINTER, Zur Sprache der cluaiazenser Consuetudines des 1 1 - Jahrhundem dam C o n m e ~ i ~ rnonasrricae. eine Festgabejb Khrsius HaIIinger aus Anlars seines 70. Geburtrtages, dd. J.F. Angerer et J. Lenzenweger, (Studia Anselmiana, 85) Roma: Pont Ateneo SAnselmo, 1982, p. 175-83.
2. CC l'intmduction de P. DINTER P I'Cdition du Lr surtout p.lii-lvi, et I. WOLLASCH, Zur Datierung des Liber rromitk aus Farfa anhand von Personen und Penonengmppen m, dam Person und Gemeinrchql inr
Antiquiurns consuef~~dints cluniacedk nronaerii [Udd 1 rM. 1080-1083, par UMch de Zdl (oa de Cluny ou de Regensburg (t1093)
-Date de dbction : avant 1083, plobablement mtre 1080 et 1083 L'article ¢ de J. Wollasch, a Zm Verschrifflichung der kl8sterlichen Lebensgewohnheiten unter Abt Hugo von Cluny m, (FttihSt., 27 (1993): 3 17-49) a permis de mieux determiner Ia date de ddaction du texte d'ulrich.
- Remarques : ULrich explique dam son prologue avoir dcrit ces coutumes pour un compagnon d'enfance, Guillaume de f f i u (t lo9 1) : celui-ci dkirait &former son monasttre et voulait connatAtre le mode de vie clunisien porn s'en inspirer. Le prologue des coutumes GHirsau confirme cette explication des faits, sinon que Guillaume prtcise qu'il dut envoyer trois fois des moiws ii Cluny pour compl#er, wmger et Cmonder le texte que lui avait donut5 Ulrich. Ce dernier avoue en effet ii diverses reprises son ignorance4. Une 6tude plus dCtaill& de la vie d'Ulrich serait n6cessak pour savoir exactement oii iI a d g d ce coutumier, A Cluny ou loin de Cluny, dam le p r i e d de Ortlningen en Brisgau? Bien qu'il ait dtd un oblat de Saint- Emmeran, oh il avait rencontr6 Guillaume, Ulrich &it renw tard dam I'ordre clunisien (1 061) : ce ddtail est important pour comprendre son discours amer vis-ivis dw oblats et son ignorance de divers points de la vie clunisienne.
M~tdafter~ Fes&chr@j& Korl &bid dd. G. Althofll, D. Geuenich, 0.G Oexle et J. Wollasch, Sigmaringen: J. Thorbecke, 1988, p.237-55.
3. Au sujet des erreurs d'edition du tcxte de la PL, cf. K. HALLINGER, "Klunys" 1959, p.l06sv., M.-C. GARAND, Le scriptorim dc Clwy, camfour d'influences au XIe sitcle : I t m a n d t Paris B.N. Nouv-acq-latl548 ms Jotanal & S U V ~ ~ 1977: 257-83 et Id Les plus ancierrs tdmoins conse~ds des Cometudines cfuniisce~tses d'Ulrich de Ratisbonne r, dans Skire Iitteros. Forschungen zum mitteIafterIichen Geistesfeben (Festschrift B, BischoflF), &d, S, W ~ C T ct M, Bcmhanl, (Bayctische Akademic der Wissenschaftcn, Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungcn, Ncuc Folgc, 99) Mthchen: Verlag det Bayerischcn Akadcmic der Wssenschaftcn, 1988, p.171-82.
Une petite du texte d'Ultich a CtC traduite : cf. F.S. PAXTON, A MdimaI h t i n Death Rilupl : the Monartic Cusfomaries of Bernard und Cnrich of Cluny, Trurhrction and Commentaries, Missoula (Mont.): St Dunstan's Press, 1993.
? Cf. par exemplc Wdrrf. I,xxxii,col68OA. s. Mal@ les nombrrws h d e s sur la vie d'Ulrich, on ne sait toujours pas avcc certitude oh it se tmuvait
lorsqu'il a composC scs coutumes : cf. m o u t H. FIZHRMANN, = Ncues zur Biographie dcs tb ich von Zell (71093) m, dans Person und Gerneimchujl im Miffefalter. Festschr@@r K i d Schmid, Cd. G. AlthoflF, D. Geuenich, 0.G W e et J. Wollasch, Sigmaringen: J. Thokckc, 1988, p369-78, W. STRATMANN, Gabriel Bucelin und die Vita des Ulrich von Zell B, DissPhil, Rcgeasburg, 1988, H. OTTO, a Probleme urn Utrich von Cluny m, Afemanhches Jahbuch, 1970 (1971): 9-29 et E. HAUVILLER, UIrich von Clwy : ein biogmphische BeirragLw Geschichte der Cluniacenser im 1'. Jahrhundert, ~hengeschichtliche Studien, m/3) Monster: H. Schening, 1896.
OrQo ~Iunr'bcemsis [Bern] rid. do80 par Bernard de Cluny
- &ion6 : Bernard de Cluny, Ordo ~Itmiacesis, Cd. Marpuard Hetrgott, Vercl~ disc@Iina monustica, Paris: Osmont, 1726, p.134364.
Ce texte est me source exceptiomelle pour cormaftre la vie quotidieme des moines au Xle sitcle : il n 7 ~ s t e aucm autre coutumia pui soit & la fois aussi ancien et aussi dCtaillC. Or l'owrage d7Herrgott est non dement t c b diflicile i se procunr, mais 6galement Gutif. Cet auteur a en efEi utilis6 p~cipalement m e mpie du XWe si@le (Paris, BN lat l3877), qu'il a e d t e corrigk, mais pas dam sa totalit&, B l'aide du manuscrit Paris BN lat. 13875. Une &dition de cette oewre serait donc t ks importante? Il faudrait f& ce travail conjointement avec m e nowelle &lition du texte GUlrich, non seulement parce que des pans entiers de ces dew coutumiers sont identiques, mais aussi parce que plusieurs manusctits pdsentent me version de run (habituellernent, le texte d9Ulrich), comge sur la base d'une version de t'autre.
- Date de f ic t ion : pas avant l'autome 1078, mais Bemard y travaillait encore en 1085'. Jusqu'P tout rdcemment, plus prdcigrnent jusqu'l la publication en 1993 de I'article de
J. Wollasch dam Fru'kSt., on consid6mit qu'il existait deux versions des coutumes de Bernard : une composee avant le coutumier d'Ulricb et dont celui-ci s'inspira, uoe autre r6digke aprks, o& diffirents passages du texte d'Ulrich furent int6@s. L Wollasch a dkmontre qu'il ne se trouvait en fait qu'une seule version de l'ordo cluniacensis, kcrite a Cluny dans les annees 1080, par le moine Bemard, ii la demande de I'abM Hugues. Les manuscrits subsistants qui pdsentent des textes plus ou moins t9oign6s de la version originale proviennent d'autres monast&res o i ~ ils k n t recopik et modifids pour Ztre adapt& a w particularit6s des lieu9.
6. AU sujet des eneurs d'tdition du texte d'Herrgott, cf. K- HALLINGER, "Klunys" 1959, p-106s~. Une petite section du coutumier de Bernard fbt d6jA traduite en anglais : F.S. PAXTON, A Medievd Latin
Death Ritual, 1993. '. G. CONSTABLE tcrit cc pmpos : a A critical edition of this customary is among the prime desiderata
ofmedieval monastic studies (cf. Entrance to Cluny in the Eleventh and Twelfth Centuries according to the Cluniac Customarks and Statutes ., &us Medioevdia Chrt;rtiorrP~MIIe si4cIes- Hommage d Rqymonde Forevile, [Tournai']: tb Uuiversitains, 1989, a9, p3SO). Web Mallison avait commmd une Cdition dc ce texte pour le Corpslrr Cortpuetdinurn mo~f<l~ticOnrrn, mais n'a pu compl&cr sa &he. Des Ctudiants dc Wollasch travaillent actuellerncnt sur les manumits de cet ouvragc, tel B. Tutsch, mais aucun pour I'instant n'en a cntrepris l'ddition. '. J. WOLLASCH, Zur Verschriftlichung ... *, op.cit., 1993, p344.
Les coutumes d'Ulrich subknt ua travail similaire de decritutc dam les divers monasths qui les adopterent. Je n'ai malheureusement pas pu consulter l'article de B. TUTSCH, a Die Consueltrdines Bernhards und Ulrichs von Cluny irn Spiegel ihrer handschriftlichen fibedieferung n (FriihSt., 30 (1996)), portant sp5cifiquement sur ce theme. Se remercie pourtant ce cherchew de m'avoir quelque peu expliqu6 la teneur de son travail, au travers de divers messages &hang& sur I'internet dam le courant de l'annee 1995.
La d6montration de J. WoIlasch est tout ii f i t wnvaincante sauf sur un point important : ilexpliqutlessimilitudes~BcmardctUlrichparIe~queasdewautem se d e n t bases sur un m h e texte, aujod'hui disparu Vouiant absolumcnt que ces deurr oeuvres aient ttt composdes en pdI&le, ii a f t h e que Hugues commanda Bernard de d g e r un texte pour usage interne ct & UIrichd'en &xire un aubt pour usage exteme. Plusiem indices me portent ii mire que, en faiS B d s'est bast sur le texte d'lllrich pour Ccrirr ses coutumes. Je compte dernonhct ul&ieurement cette hypothk dans im article.
SloMo [Stat] rCd 114611147 par Piem k Vtdrable
- ~dition : Pierre le V&&able, Statuta Pefri Venerabiilis a b b e CIuniucel~s~fs IX(1146747), Cd. Oiles
Constable, dens Comehrdines Bedictime Vmae (Sbec. M?krec. m, (CCM 6) Siegburg: Cura Pontificii Athenaei Sancti Anselmi de Urbe editum, 1975, p.39-106.
- Date de ddaction : 1146147 Piem dklare lui-mhe daas la p d b avoir compos6 ce recueil de statuts vingtquatre am apds sa nomination cornme abbe : puisqu'il fbt Clu en 1122, a dcrivit donc vers 1 146/471°. La date de ddaction prkise de chaque stattat est en revanche plus difficile i ddterminer : Giles Constable rassemble les diverses informations qui existent sur cette question dans son introduction a l'ddition de 1'oewret1 et ses notes en bas de page.
- Remarques : Jusqu'ii maintenant les chercheurs se sont surtout iateressds B ivaiuer l'ampleur de l'influence cistercienw sur les Stahrts de Piem le Vh?rable : jusqu'l quel point repkentaient-ils m e dponse aux attacps des moines b l a d 2 ? Quelle que soit la rdponse, il est important de noter, dans cette tentative de rtforme amorcde par le neuvieme abbe de Cluny, la volont6 de ratiodser le mode de vie des f?hes et de gommer les ex& liturgiques, vestimentaires, alimentaims et autres. 11 est par aiUem remarquabk qw ces *glements 6manent tous d'une seule et meme source, B savoir le sup6ieut de I'ordre. Celui-ci, du haut de son pouvoir, essaye tant bien que ma1 d'imposer i ses moines des transformations dam leur mode de vie. Il affirme ne pas avoir pris seul ces dkisions13, mais il p r d tout de meme seul la parole. Les chits nonnatifs anttrieurs semblaient en revanche etre l'expression d'un consensus communautaire. Depuis le Liber tramitis jusqu'aux Statuts de Pierre, en passant par I'ordo de Bernard, il est possible d'obsemer L'accroissement graduel des interventions directes de l'abbe sur l'organisation de la vie monastique : Odilon etait peu p&nt dans le LT ; le Bern ment io~e plusieurs modifications impodes par Hugues aux facons de vivre clunisiennes ; Pierre a d6finitivement pris le devant de la &ne d m les Stat. 11 n'est pas evident que cette kvolution s'explique par un powoir accru de l'abbd sur ses fils, mais il est certain qu'elle trahit une perception difftrente de la &partition du pouvoir dkisionnel.
'O* S m , Pra&, p.39. 'I . G. CONSTABLE, Stat., p.2 1-22. 12. Cf, D. KNOWLES, The Reforming Decrees of Peter the Venerable a, dam Petrus Venerubilis 11%'-
1956: Studies and 7 ' ' Commemorating the Eighth Centenary of hik Death, Cd. G. Constable et James Kritzeck, (Studia Anselmiana, 40) Roma: Herder, 1956, p.1-20 et A.H. BREDERO, Clurry et Cite- cnr dottzi2me si6cIe. L *h&torie d *me confroverse monastique, AmsterdamMaarsen: Holland University Press, 1985.
13. Stat- Praef, p.40.
Dans cette annexe sont d o m h les r6fbnces pdcises ayant pemk d'ttablir les tableaux I et LI du chapitre I. L'ordre chronologiqye, pIut6t que I'alpWtique, a ttt! de noweau priviI€giC, din de metire en 6vidence 1'6volution des ddfinitiom au fil des sitcles ; mais la ¶tion entre les auteurs cbr&iens latins et les autres, non l a b , n'a pas W respec*. Pour ces derniers, la date de traduction des owrages et non celle de &kction a ite prise en comptel. Le discours tenu par chaque auteur lnopos de la division des @es est succintement brosst, ofhnt ainsi I'occasion & faire rm rapide survoi des diff6mts discours tenus sur le cycle de vie.
Cette liste n'est certainement pas p a 9 v e ; j'esp&e m a l e tout qw, compte tenu de sa longueur, elle wit repdsentative. Il s'agit d'une compilation des divisions rencontnh au fil de la recherche, tout spkialement & la lecture des articles de J. De Ghellinck, dat6 de 19482, de P. Archambault, de 1966, et des Livres de J.A. Burrow, E. Sears et M. Goodich, pubLi6s en 1986 pour les deux premiers et 1989 pour le demid. Dam les d f b c e s donnth en bas de page, j'indiquerai dam la mesure du possible, entre crochets, le passage de ces divers owrages oh la definition des k e s citk est analy&.
Toutes les idomations incluses dans ces travaw non pas 6t6 automatiquement reporties dam les tableaux I et II. mi, consid6rant que I'image powait avou ses impdraifs propres, je n'ai pas pris en compte les divisions des 5ges offertes par les d i ~ ~ e s (rotae) mentiods par E. Sears. Pa. ailleurs, lorsqu'un auteur donnait i deux reprises la m h e definition des Sges - constance somme toute assez exceptionnelle -, j'ai jug6 inutile de faire figurer cette r@6tition dam les tableaux, it moins de vouloi ainsi illustrer la prkpond~ance de cette dkfinition par rapport a m autres d o m h pa. le m6me auteur. Enfin, pour que les definitions puissent &re compdes entre elles, une c e d e uniformitt5 de
'. Ces auteurs non latins n'ttaient pas cwticns et I'essentiel de lew oeuvre &it de nature scientifique. Leurs travawc pouvaient malgd tout etrt connus des moines ciunisiens. Ces derniers s'int&essaknt en effet aux trait& mddicaux, au point quc ceux-ci pouvaient influcncer Ieur manitre dc v i m et que Pierre le Vtntrabte qualifia ses moines de "sectatoresphysicaen (cf, Stat- 26,p.61-63).
Pour les dates de n h c e et de mort des auteurs latins 6tudik en cette annexe, je me suis servie, en plus des Ctudes cittts en note et des dictiomaires mentiom& dans la l i i dcs abdviations ( M E , W a , etc.), du Dictionmike der auteurs grew et htim & 1 'Antiquitd d cbc by en ige, de W. Buchwdd, A. Hohlweg et 0. Prinz, trad. ct mise h jour J. D. Bergcr et f. Billen, Turnhout Brepofs, 1991.
2. J. de GHELLINCK, I . ~ , gruvitm, semxltrs n, Studio medioeyalia in honorem aclinodum reverendi patris RqymundiJosephi Mmtin, Bruges: apud societatcm editrictm "De Tempel", 1948, p39-59
'. Paul ARCHAMBAULT, 8 The Ages of Man and the Ages of the World: A Study of Two Traditions m, Revue dm dturlks augurriniennes, 12 (1966): 193-228.
'. John-Anthony BURROW, The Ages of Man= A Shdj in Medieval Wn'ting d Thought, Oxford: Oxford Univ. Press, 1986. Michael GOODICH, From Birth to Old Age - The Medieval Thought, 1250-2350, LanhamMew York/London: Univ. Press of America, 1989. Elizabeth SEARS, The Ages of Man: Medieval interpretation of the Ire cycIe? Princeton: Princeton Univ. Press, 1986.
', I1 est pr&f€rable m a l e tout de se df6rer directement a m index de ces differentes Ctudes, car certaines rdfdrences ont pu itre omises au fil de mes recherches, alors que je me concentrais davantage sur les sources proprement dites,
vocabulaire devait Etre respect& ; aussi, quelques dnumCtations des iges ne faisant absolument pas appel & la tennino1ogie habituefle ont da Stre igno&.
TertuUien s'intemge sur l'ilge de L'he lorsqu'elle Sit&gre Ie corps au moment du Jugement Dernier, tout sp6cialernent dam Ie cas d'individus morts encore enfats. Il rejette I'hypothk que celleci puke traverser les cinq 5ges de la vie alors qu'elle est ainsi siparee du corps, et m e au contraire que corps et h e se retmuvent I 1'3ge exact ou ils s'etaient quit& au seuil de la mort.
-Ambroise de Milan (f397) :
Ambroise est le seul des auteurs de cette liste pour qui il existait d6.h une etude du discours sur les iiges. Je me suis contentee d'en reprendre les conclusions.
puerii iuuenes = ephebi = addescentes = iuniores~ senes = uiri = seniores
Lorsque Ambroise parle des diffiirents 2ges de la vie en dfkrence aux dges spirituels, il distingue trois grands groupes mais n'attache g u k d'importance am noms utilisb pour designer les diffdrents membres de ces groupes. Il y a d'abord les enfants appelgs pueri puis viement indiff~remment les iuuenes, ephebi, adulescentes ou iuniores. suivis en demier par les uiri, seniores ou sene#. A p r o p de ces demi6res appellations. 8. Lamirande, I'auteur de cette dtude sur le discours ambrosien des ees, diclare :
M a l e les nombreux termes dont il [Ambroise] se sert pour ddsigner la troisikme categorie des athlktes du Christ, c'est le mot senes qui revient le plus souvent ou qui,
'. J'ai ainsi exclu du tableau I mis d&itions respectivcment de CMme, Augustin et Isidore, offertes dam le cadre de I'exdgtse de la parabole dcs travailletus de la vigne. Le premier park de ex utero marrkl a pubertatel matura aerate( iam declhmte udseniuml ultima sersectute, le second de recent- ab utero matrisl pueril imenesl uergentes in seniuml omnino decrepiti et le troisihe de a rudimentis infmtiae[ ab adolescential in iuuenuris aerate1 in senectutem declinantesl decrepiti. Cf. i.fla.
'. Tertullien, De Animo, c56, dd. C d . Waszink, Opcrq pars II, (CCSL, Il) Tumhout: Brepolr, 1954, p.864. [Sears 1986, p.8 1-82n.J. Cette division des ages avec ses tcnninaisons en "-a" est l'exacte n!plique de celle de Varron (I 16-21 av. I.-C.) telle que n?pdt& par S~MUS (IV. s. ap. JX.), cC L P . &RAUDAU. La jeunesse dam lo littffature et fes institutiom de la Rome rgpubiicaine, Paris: Les Belles L e n s , 1979, p.93.
'. mi lien LAMIRANDE, Ages de I'homrne et ages spirituels selon saint Ambroise. Le commentaire du psaume 36 n, Science et Esprit, XXW-2 (1983), p.214. Sur I'importance majeure de saint Ambroise pour Cluny et le r6le de Cluny dam la diflhion des oeuvres ambrosienncs, c f V. von B m , . Ambroise de Milan dam la BiblioWque de Cluny n, Scripurium, XLVIY2 (1993): 127-65.
en tout cas, appararat le plus char& de sens. Vir et senex sont deux termes dont L'acqtation se recouvre, en conformit6 avec les penpeaives de l 'hitute qui voit dans le vlrper/ectus celui @ a acheve sa come. .' Mais~broisenes'~pas~~SCUIe~ndediviserlavie. Dansunede ses
lettres, dat& de 387, o& il dvoquc la Cdation du mode en sept jours, il mentiome les theories d'Hippocrate a de Solon sur les @es. Il donne en premier les sept &es d'Hippoaate : fnfantia [inf-J. perilia IpuerJ dfescentia [adolescensJ iuventus [iuvenisj ViriIis aetas [vir- maturiias [veter~ntccJ senectus [senox], Il dsume ensuite la description par Solon de dix @es #me dude de sept ans cbacun : l'infmtia (0-7 ans) jusqu'a la p u s & des dents, lapueritia (7-14 am) jusqu'k la pubertC, I'addescentia (14-21 am) jusqu'i la poussde de la barbe, la iuuentm (21-28 ans) jusqu'au d6veloppement de la pefecta ziirtw puis le uirils aetas (28-35 am), apte au mariage. Aucune appellation n'est offerte pour les iges suivants mais ils sont marquds, surtout B partir de 42 ans, par la prudence et l'eloquence ; en revanche, le n e u v b e (56-63 ans) se caractirise par l'affaiblissement des forces, avec un dtclin du puler et de la sagesse (mollior lingua ac sapientia). Le dixitme (63-70 am) n'est qu'une antichambre de la mortIO. Je n'ai pas reproduit ces definitions dam le tableau I puisqu'Ambroise ne se les approprie pas mais specific bien clairement leurs origines.
Dam son De Abrahmn, alors qu'il souligne i'importance du nombre qua- (quatre ~van~iles, quatre points cardinam, etc.), il mentiome les quatre iiges de l'homme, pueritia, adolescentia? iuuentus? mafuritas. Mais, pour designer le demier Sge, il use Cgalernent du teme senectus : a [...I ferumtis etiam fiuctum fidei ab ipsa pueritia, uugeumus in adulescentia, coloremus in iuuentute, compleamus in senectute. La terminologie de ce passage s'explique par le fait qu'Ambroise compare le d6mdement de la vie de l'homme au dkveloppement d'une plante. D'autres comparaisons font du quatritme 6ge celui de la summa prudentiae et l'associent, dam l'histoire biblique, au d- de l'egypte et a l'blaboration des lois par Mo"s12. Il est a noter que cette description t 6 s positive de la maturiWvieillesse - propre A Ambroise ou, tout du m o b , qu'il n'assigne B persome en particulier - est fort differente de celle de Soion qui vient d'stre 6voqu6e. On obtient donc la Liste :
9. E. LAMIRANDE, Ages dc l'hommc ... m, op.cit, 1983, p.2 17. '9 Arnbmise, @ktI XLIV (A Horontianus), Epirtufae et acta, tI, dd. 0. Faller, Opera, pars X, (CSU 82)
Venne : HocIder/Pichlcr~empsky, 1968, p.222-23 = Ambroise, Dkcorsr'e Lettere I l / l - Leftere (1-351, Cd. 0. Faller, intro., trad. et notes Gabriele Bantcrle, (Sancti Ambrosii Episcopi Mediolancnsis Opera, 19) Milano/Roma: Biblioteca Ambrosiana/CMNuova editrice, 1988,lettre 3 1, #12, p.306-07. [De Ghcllimck 1948 p.46 et Archambault 1966 p202J.
". Arnbroise, Opa, Cd. C. Schmkl, pars I, (CSEL 32/I) PragueNienndLiepdg: Tcmpsky/Freytag, 1897, p.620 = Ambroke, De Abroham, II, 9,65, &I. C, Schenkl, intro, trad, a notes par F. Gori, (Opere csegetiche, MI) MilanoRoma: Biblioteca Ambrosiana/Cittll Nuova Editrice, 1984, p22O [Archambault 1966 p202 et Sears I986 p.21 n.571.
". Sur les liens entre les 6ges du monde et les gges de la vie chez Ambroise, cf., outre I'article de Lamirande deja citd, A. LUNEAU, L 'httoire du Sdut chez l a P2res de f gglire - La Doctrine der dges du monde, (ThCoIogie historique, 2) vol-11, Paris: Beauchesne, 1964, p.247-61.
Dam ce deuxi&me livre fontre Symmaque (un des plus cdlebres et ardents dcfefl~eurs du paganisme), Prudence dfirte la thtse selon laqueue Ie cbrisbcanisme est le pmduit d'une Rome stnile, qu'il faudrait njeter au profit des moeurs anciennes de la CitC. Le po&e demontre au contraire que les &ges succes~s de l'histoire, cornme ceux de I'homme, dont il dome dors la Liste, ont permis ii I ' h d t C de graadu et de s'amdiorer. La vieillesse, si elle n'a plus la force des Sges pnMdents, a, en revanche, davantage de sagesse et c'est sous sa ferule qu'on se toume enfin vers Dieu.
En conclusion de la Psychomachie, tandis que les Vertus triomphent des Vices, un temple est construit en L'homeur du Christ. Il symbolise L'he hmaine et sa configuration est telle que tous les @es pewent se diriger vers l'autel pour sacrifier au Seigneur : les pueri, les ephebi, les uin' et la decrepita senectaI4. A ceci pr5s que I'infantiu a W incorpode dam lapueritiia, il est fort probable que cette liste et la prkedente concordent point pour point : la chaleur ou le sang dCbocde pendant I'iige qui suit (iuuenta : ephebi), puis viement la maturite et la pldnitude (roboris aetas : uin], awquelles succkde la eoide mais pieuse vieillesse (senectw = seneeta).
Dam cette lettre adressk a H&liodore, dviique d' Altimum, pour le consoler de la mort de son neveu et probable successeur, Ndpotien, Xr6me quatifie lui-mSme et Heliodore de senes, en opposition h Ndpotien qui n'dtait qu'un iuuenis. L'auteur souligne ainsi l'injustice de cette mort, avant de l'expliquer spirituellaneat son interlocuteur. I1 mentionne les cinq iges de la vie de l'homme lorsqu'il Cvoque l'incapacitd humaine a pnndre conscience du passage du temps. I1 est a noter qu'il n'a pas de substantif pour designer L'individu ayant atteint le quatriime Age puisqu'il utilise la fonne genitive robustae uetatis.
i n f m l puer 1 iuuenis 0 rob wtae aetatis 0 senexl'
13. Prudence, Contra Symmachunr, IbJ, v.3 18-23, Carminu, 4. M.P. Cunnigham, (CCSL 126) Turnhout: Brepols, 1966, p a . [Sears 1986, p.821.
''. id, Psychamachia, v.84548, ibid, p.179. ". Jerbrne, )$itre IX (& HeIiodore, lfiogefin2bre de Ne'potien)). Lertres, vo1.I1I,4dd. et trad. I. Labouret,
Paris: Belles Lettres, 1953, p.89-9 1 = J.H.D. Scourfield, Cornling HeIiodorus: a commentary on Jerome, Lerter 60, Oxford: Clarendon Press, 1993, n.19, p.72-73.
Pour expliquer la parabole des 0\1Vtiers envoy& i la vigne (Math 20,l- 16) 16, J&me associe les cinq hems du jour, oh lepate@iimiIias sort rrcruter ses travaillem, aux cinq 5gcs de la vie. Lors de chacun de ces diff&ents &a, I'homme pew se tomer vers Dieu et se convertir. Ainsi, catainS Ie font ex utero mat&, d'autres apubertute, d'autres matura aerate, d'autns imn declill~lltte ad senfun et Ies demiers enfin ultimu senectute". Une confrontation entre cette division et la pddente est instructive : JMme a concent& I'infma et laplaeritia en un seul b e , s'ctendant jusqu'k la puberte ; cet Mnement marque le d b t de la iuuenhrs ; I'aem robrcsta et I'aetas m a constituent Wkiablement un seul et meme b e ; enfin Siige oil l'on est senex a W divid en d e w un age correspondant h un premier d&lin, l'autre reprkmtant l'ext&me fin de la vieilIesse. Je n'ai pas inclus cette Liste dans le tableau parce que sa terminologie est inhabituelle et que, au moins pour les deux premiers iges, JMme evoque les terminus a quo des divisions plut6t que celles-ci directement.
L'analyse minutieuse du vocabulaire des @es qu'emploie JMme B son propre sujet montre qu'aucun des termes Ctudies par Cavallera - savou i n f a , per , adulescens. iuuenis et senex - n'est applique uniquement A Page qui lui correspond : tous empi&tent sur les iges voisins, qu'il s'agisse de celui qui les pdcMe ou de celui qui leur succ&de. On p u t noter mal@ tout que, des termes adulescens et iutrenis, on passe directement i senex". Un tel saut contredit les divisions des Cges propsties par JMme et mentiodes cidessus, qui cornportent, toutes deux, un &e miir.
La complexit6 des dCfinitions de I'ige mik et de la vieillesse dam la classification mkdi6vale des iiges est particulitrement apparente B travers les emits d7Augustin. Dans la majorit6 des oeuvres de l'iveque d'Hippone, il existe un iige intenntidiaire entre la iuuentur et la senectzis ; pourtant, ceci n'est pas vrai pour tous ses &rits19. Un exemple du premier cas de figure est offert dans le De Genesi contra Mmrichaeos (~388-390). Augustin y distingue Mge des seniores de celui de la senectur et dome la division suivante des iges :
infantia 1 pueritia 0 adolescentia 0 iuuenrus 0 senioris aetasl senectdo
'6. SLV cette parable, cf. JM, TEVEL, 8 nie Labourers in the Vineyard : the Exegesis of Mrrlthew TO,]-7 in the Early Church -, Vigiliae Chrbtiame, 46 (1992): 356-80.
". JtMrne, Commentaire sur saint Matthieu, Iim III, c.20, Cd, tr;td, et notes E. B o ~ a r d , tII, (SC 259) Paris: ~ d . du Ce* 1979, p.86. Pour les filiations de cette interpdtation de la panbole, cE E. SEARS, me Ages of Man, 1986, p.80-88.
Is. F. CAVALLERA, Saint JWme -Sa vie er son oewre, 1' tI1, (Spicilegium Sac- Lovaniense, 2) Louvain/Paris: "Spicilegiwn sacrum Iovaniensew/Lib. Champion, 1922, p.3-12.
19. Sur Ies hbitations &Augustin il ce sujet, cf tout Wialement J. de GHELLMCK, a IuvenhLF. .. m, qui t - , 1948, p AO-44.
lo, Augustin, De Genesi contra Manichaeos, Ib.1, c.23, Obras de San Augustin, tXIV, td. B. Marth, Madrid: La Editorial catolica, 1957, p.408-2 1.
Il ktablit la meme distinction lors de son discours aux habitants &Hippone (EpistoZa C O , en 426, dors que, dCjB sgC, il p-te celui qu'il a choisi comme son successeur 1 l'@iscopat, La seule di81knce *A qdil no- l'avantaeraier Qe, lagrmtira, plut6t que la senioris a e t d l . Il &que ici le t h e de la division de la vie pour souligner le fait que chaque age vit clans I'attmte du suivaut, except& la vieillesse, c'est-&-dire L'be oh il se trouve, qyi, eUe, n'a plus rien & attendrt.
Une liste identique est dgalement domk dans deux passages du De Diuersis Quaestionibus octugiina t r i b ~ , tan& pu'Augustin &oque la venue du Seigneur lors du sixieme Bpe de I'hornme, Qyivalent au sirtihe glgc du mode a B la sirdhne heure du jo& Il explique Ace props que le dernier &ge debute A 60 am et p u t se poursuivre jusqu'h 120 am ; sa dunk est donc aussi &endue que celle des cinq premimiers @es dunis.
Dans le De Vera refigone (c390), il dome un regroupement similaire awc pr&dents, soit infmtiul pueritiau adulescential iuuentusl [aetas] senioris[ deterior uetes ac decoior et morbis subiector debili~qw2~. Dans I'Enchiridon (c421), pour 6voquer I'ensemble de l ' e w e hwnaine, il utilise les contraires (riches et pawres, nobles et non-nobles, etc.), mais a w i la liste compl5te des Sges :
infuntes! peri l adu[escentes[ iuuenes senioresl senep
Cette division est trh proche d'une autre, d o ~ e e dims le sermon 49, pour expliquer (sur le modde de J6r6mG6) la parabole des ouvriers de la vigne (Mutfh.., 20,l-16) : pueril adolescennrlil iuuenesl grauioresl decrepittin'. Entre ces deux classements des iiges, les
=I . Id, Episr. CCXIII, Epishrlae, Cd. A. Goldbachet, pars. N, (CSEL, 57) Vienne/Liepzig: Tempsky/Freytag, 19 1 1, p372-79. [De Ghcllinck 1948, p.4 1-42]
? Sur le traitement par Augustin des liens entrc les &cs du monde et tes Ages de la vie, outre les oumges de P. Archarnbault, E. Sears et JA. Burrow qui abordcnt longucment ce thhae, c f A. LUNEAU, L 'Hisroire du saht, tII, 1964, p284407. Pour m e synthbe de I'histoirc de ce thCme A travers le Moyen Age, cf. le be1 arricle de G. LOBRICHON, a.Un Moyen &, scpt 8ge du monde m, Europe, 665 (1983): 130-34.
O. Augustin, De Diuersis Quaestionibus uctugi'a rribus, c.LMII ct cLXW, td. A. Mutzcnbechcr, Opm, pars XIY2, (CCSC. 44A) Turnhout: Brcpols, 1975, p.106-07 et 137-38.
2'. Augustin, De vero refigione, c26, Cd K.D. Daur, Opera, pars W1, (CCSL 32) Turnhout: B~pols, 1962, p.217.
*, Augustin, Enchiridion ad Luwentium de Fide et spe et caritate, 27, #I 03, dd. E- Evans, Opera, ppars
xm/z, (CCSL 46) Turnhout: BrepoIs, 1969, p.105. Cet ouvrage faisait partie de la bibliothtque de Cluny au miIieu du XI' siecle et pouvait &re empmt pour une an& par un des Wns (cf. LT n,WO,p.263).
26. Cf, supra. 9 Augustin, Sermo habitus ad mensant sancti Cypriani die donrinica, Skmorres de Vetere Testurnento, Cd.
C. Lambot, Opera, pars XY1, (CCSL 4 1) Turnhout: BrepoIs, 1961, p.614. La date oit Augustin donna ce sermon n'est pas certaine, indiscutabiement un dimanche, possiblement Carthage en 418 (cf. P.-P. VERBRAKEN, ~tudes critiques srrr les sennonr authen~iques de saint Augustin* (Instmmenta paMnicq XII) Steenbmges: Abbaye S.Pierre, 1976, p.64).
modifications sont mineures : les infanfes et les pueri ne font plus qu'un seul et meme group, tan& que les seniores 6quivaIent aux grauiotes, et les senes aux decrepiti.
Dam un autre sermon sur le meme sujet, la liste #Augustin se pdsente sous me forme assez d i f f i t e , plus pmhe du modtle hibnymien : recentes a6 wen, mat&[ peril iuuenes[ uergentes in seniiml omnino decrepiti? Ici ce sont les adulescentes ou adulescenr~Zi qui ont dispanr (porn w fondre dans le gmupe des iuuenes ?).
Si l'on regroupe les divers vocables associb par Augustin aux deux Hges qui font suite B la iuuentus, on obtieat les Cquivalences suivantes :
- seniores = grariores = uergentes in senium appartenant A la grmitrar = uetas senioris - senes = decrepiti = omnino decrepiti appartenant b la senectus = deterior aetas ac decolor et morbis subiector debilisque.
Il existe pourtant, dam l'oeuvre d'Augustin, au m o k un exemple oii la fin de la vie, aprks la iuuentus, n'est pas ainsi divi& en deux ees. 11 se tmuve dam son cornmentaire du Psaume C X X W oti il cite dans l'ordre, pour evoquer le passage des ages :
infantiab pueritia 0 adolescential iuuentus 0 senecM
I1 est d'ailleurs remarquable qu'Augustin ofk , au moins dew reprises, des explications pour se justifier d'idrer la gruuitar ou l'aetm senioris dam ses classifications des 5ges'O. Dam le passage du De Genesi contra Manichaeos o~ il fait intervenir un aetas senioris, iI est evident que son objectif est be1 et bien de glisser un 6ge intermediaire :
a [...I quinta aetas, scilicet declinatio a iuventute ad senectutem, nondm senectus, sed iam non iuventus, quae senioris aetas est, quam Graeci ~ p ~ ~ ~ ~ ~ n ) ~ v o c a n t . N m senex apud eos non irp~q$o'q< sed y6pa v dicitur- rn3'
*. Augustin, Sermo LYXXYI. PL 38, chaps, #7, ~01.533. [Sears 1986, p.83). La date de ce sennon est dgalement inconnue (cf. P.-P. VERBRAKEN, hder critiip es.... 1976, p.74).
'9. Augustin, In Psafmrrm CXXVII, #IS, Enarrationes impsolmar, W. E Dekkers et J. Fraipont, Opera, pars X/3, (CCSL 40) Tumhout: Brtpols, 1956, p.1878. Cluny posst!dait au moins deux manuscrits de ce texte puisque dew eres, Raymond et Pierre, en avaient chacun une copie en main quad f i t &dig& le passage du Liber frumifik consacn! la distniution annuelle des livrcs (cf'. LT 190,p262 ct p.264).
lo. Nous venom plus loin que d'autrcs auteurs, tels Gdgoire et Isidom, cssay&ent aussi de justifier les appellations qu'ils employaicnt pow Cvoquer les demiers ages. Pour tous, I'utilisation du tame senior constituait un pmbltme. Lt bit cst dtonnaat puisque ce vocable Ctait d'usage, sinon courant, du m o b connu dans Empire comain. Ainsi, au me sitclc, l'auteur pakn Censorinus, qui rcprit, dam un ouvrage intitult De die natafi (238), Ies divcrses ddfinitions des @s en cows dam l'Antiquit6, jugea inutile d'expliquer senior en faisant dfdrence aux Gncs. It se contenta d'expliquer que ce term provenait de senescere, parce que les corps des hommes portant ce nom avaient dtjh commencer vieillir (ct Le jour natal, trad. G. Rocca-Serra, Paris: Vrin, 1980, p. 18). Lorsqu'il pdsenta la division des @es de V m n , il donna 1a liste suivante : pueritia f ( I 5 ans) adulecentia l(30 ans) iuuenta 1 (45 am) wras seniorurn 1 (60 ans) senecta (ct 1.-P. N ~ A U D A U , L a ~eunessb.., 1979, p.94).
3'. Augustin, De Genesi contm monicheos, up-cir., #3 9, p.4 10.
En revanche, daas son adyse du Psaume L m dots qu'iI chmhe il expliquer le vers a et tuque in senectm et senium (Ps-L~OC,~~), iI prtknte plutSt la gmlm come une premi&e vieillese, qu'il doit ainsi dhommer car il n'existe pas de distinction en& senecta et senium B son epoSue :
Duo ista nomina senectutis S M ~ [senecta et sen i .1 . et discernuntur a Graecis. Grauiias enim post iuuenfutem aliud nomen kbet a p d Graecos et post i p s m grmitatem uenienr dtiimo aetas aliudnomen habet ; nmr ~ t p @ o ' ~ & c i t w gtavis
- et yL'pov sentx Quia vero in fatiha Iingrca dirorum Istorum nominum dlstinctio deficit8 1 senectute ambu sunt posita, senecta et senium : scitis autem esse ducls
aetutes. m32 Dans les deux cas, les explications assez embrouillks d9Augustin illustrent la difficult6 de convaincre ses contemporains de placer un Qe interm- entre la iuuentus et la senectus (ici prise dam le sens de senium). Faut-il c o n s i d k cette nowelle &ape comme un iige miir 1 proprement parler, c'est-&-dire clairement distincte de la VieiIIesse ? Je w le pense pas. En effet, Augustin fait padois abstraction de cet 3ge et passe don directement de la iuuentus 2i la senectw ; il faut donc supposer qu'il a ins& cet 3ge dam un des dew ensembles, soit la iuuentus, soit la senectus. Or, tout indique qu'il s'agit du second. Prrmihent, Augustin appelle le plus souvent seniores les individus de ce group d9tige intermddiaire, terme qui reste tr& proche de senectus et senex par ses racines. Deuxikmement, il prdsente lui-msme, 1 L'occasion, la grauitas comme une premiere vieillesse (par exemple, dam l'extrait ci- dessus).
Ainsi, les tergiversations #Augustin dam les listes des iges traduiraient essentiellement un malaise devant l'impossibilit~ d'ivoquer deux vieillesses, une decrdpite, l'autre no4 le latin de lYAntiquit6 tardive ne distinguant pas encore entre senectus et senium. 11 ne faut pas y vou, comme nous serions trop tent& de le fake &ant dom6 notre propre division des iiges, I'apparition d'un Sge mh, nettement separ6 de 1'5ge qui lui fait suite, la vieillesse.
Du fait de l'importance de cet auteur pour les siecles suivants, quelques mots sur sa perception des iges telle que pdsent6e dam les passages ci-dessus ne sont pas superflus. Apds une petite enfance d6po-e de mdmoire, attach& & la seule satisfiaction des sens, une enfaace au cours de laquelle commence A se former le souvenir, m e adolescence o i ~ il devient possible de procrter et de devenir p h , la iuuentus est L'iige du &gne de David et donc celui qui domim les autres :
Et revera inter omnes aetates regnat juventus. et ipsa est firmum ornamenturn ornnium aetutum: et ideo bene comporctw quarto diei, quo facta sunt sideru in jirmamento coeli. Quid enim evidentius signzjkat splendorem regni, quam solis excellentia?
32. Augustin, Enarrationes inpsalmos LI-C, Ps. LXX, sermo D, #4, td. E. Dekkers et J. Fraipont, Opera, pars W2, (CCSL 39) Turnhout BrepoIs, 1956, p.962-63.
". Augustin. De Geneci c o m Manichaeos, opcit., #38, p.410.
Si Augustin souligne dam ce passage le aact&e bdant extckiewement de cet ige, il explique ailletus comment il est ausi Ia p i e des plus violents mowements de l 'he : en effet, A la c l i f f i ce des &es plus jeunes, le iuuenis connat la loi a ne put plus *her impunhent. Augustin n'attache d'aillcm *'me importance relative & cette &ape dc la vie humaine et s'intdresse beaucoup plus B cells qui la suivent Les a ~ & s apds la iuuentus, ceIles du senior, sont d'une relative tranquillite, mais les mutes demi&res sont hpp& par la dkhdauce physique. Une diff&ence majeure atiste m a l e tout par rapport aux @nodes pdcdentes : le demier 8ge correspond la venue du Christ sur Term Il est donc possible pour le uetw homo de se reg6nb par la foi et de se traasformer en n o w h o d ?
-C&aire d9Arles (t542), Sermones :
Dam un de ses sermons portant sur les noces de Cana, 1'Mque d'Arles explique le symbolisme des six outres d'eau que le Christ a transformti en vin lors de son premier miracle (Jn 51-1 0). ElIes repentent non seulement les six &es du monde (explication dbja avanctie par Augustin) mais dgalement ies six iiges de I'homme :
in/ana [ pueritial adulescentiall iuuentus~ senectus 0 decrepita a e t d 5
-Grkgoire le Grand (t604)
Dam la l ip& #Augustin, sur la base de la parable des travailleurs de la vigne embauchis ii cinq h e m W6rentes du jour par le pater$amiiias (Mattth 20,l- 1 6). Gr6goire 6voqua les cinq iges de la vie oB cows desquels Dieu peut appeler les h o m e s a se convertir :
puerifiao oduiescential iuuentuso senectusl aetas quae decrepita uel uetera dicitd6
A la suite de cette liste, Mgoire jugea utile de se justifier pour avoir mentionmi dew vieillesses :
a Unde Graeci vaide seniores, non yEpo wcy sed ap~aflud'po v~ oppellunt, ut plus quam senes esse insinuent quosprovectiures vocant. .
Les Cquivdences suivantes peuvent donc etre 6tablies entre les appellations :
Augustin, De Vera refigione, op-cit., p 2 17- 1 8 et De Diuersis Quaestionibus, opeit., p. 138. '. Cdsaire d' Arles, Sermo 169, Sermones, dd- G. Morin, tII, Operia, pars V2, (CCSL 104) Turnhout:
Brepols, 1953, p.692-93. [Burrow 1986, p.9 1-92, mais surtout Sears 1986, p-7 11- 16. Gdgoirc le Grand, Hornilia MX, #2, Homiiiue in Evangefiu, Ib.1, PL 76, col. 1 155. [Sears 1986, p.83-
841. E- SEARS souligne la tr&s grande d i f i i o n que connut ce texte de Gregoire (ibid). I1 Ctait entre autres lu Q CIuny tous Ies samedis de la septuagdsirne (cf- LTI,3S.l,p.45).
- Premitre VieilIesse = senectus : les hommes de cet h e se nomment gerontes = senes - Deuxihe vieillesse = aetas decrepita : presbuteroE= uaide seniores =prouectiotes.
Peu auparavant, Augustin s'CEait trow6 dans l amhe situation, mais ses explications avaient W tout ii fait diff&entes de celles de Mgoire. le les rappe11e ici : - Premihe vieillesse =grmdtap = aetas senioris : seniores = grmiores = uergentes in senium - Deuxihe vieillesse = seneem = dkten'or aetm ac clecolor et morbik subiector debilisque : senes = decrepiti = omnino decrepiti
Ainsi, les seniores correspondent soit aux "jeunes-vieux" (chez Augustin) soit aux "vieux-view" (chez -goire), m h e chose pour les senes, wdis que la senectus iquivaut ii la premih vieillesse (chez Grtgoh) ou B la seconde (chez Augustin). De tout cet imbroglio, il n'dmerge pour Sinstant qu'une seule certitude : le cycle de vie pr6sente deux vieillesses, dont la seconde seule est associb ii la ddcdpitude. La noweaut6 de cette double vieillesse - qui existait dCjl chez les Grecs, mais non chez les Latins - explique les h6sitations et fluctuations du vocabulaire. Ult&ieurement, celui-ci se stabilisera quelque peu, avec I'emploi de plus en plus Wquent du doublet senectus - senium ; il restera malgrc! tout toujours quelques traces de cette incertitude premi&~e, comme l'attesteront certaines dgfinitions subdquentes d'auteurs latins plus t d s . Ainsi, il est remarquabIe que, encore au IF siecle, lorsque Smaradge (c809-819), son dhve Raban Maur (7856) et Haymon d'Auxerre (t855) reprifent les paroles de Gnigoire sur la parabole des ouvriers de la vigne, iIs recopierent egalement ses explications sur les deux vieillesses".
Dam une autre de ses homilies, Mgoire explique la signification de la parabole des trois vigiles (Luc 12,3540) en associant aux trois #nodes de veille au cours de la nuit oh Ie Seigneur peut swenir les trois iges de la vie.
Avec cette definition du cycle de vie, c'est la fusion d'adulescentiu et de iuuentus que Gdgoire se sent contraint d'expliquer. Ainsi declare-toil que la seconde veille correspond il
? Smaragde, Erpositio libricomith, PL 102, co1.103 et Raban Maw, Comme~rium in Mattheurn, Ib- VI, PL 107, col- 1027 [Sears 1986, n. 14, p.1851. Haymon d'Auxtne, Homiiiae de tempore, PL 1 18, col. 137A-B (qui, ii la diffdrencc des dewc premiers, s'bloigne quelque pcu de Grtgoire dans sa description des caract&istiqucs de chaque @) [Burrow 1986, p.621. Sm Ie fait quc cttte dernitrc oeuvre cst du maitrc d'Auxene et non de son homonyrne, Mque d'Halberstadt (t851), cf. PI GLOIUEUX, Pour rcvaloriser Migne - Tables rectificatives n, MPI4nge.s de science relr'gercse, IX (1952): 57. Sur I'importance d'auteurs caro1ingiens comme Raban Maw ct Haymon d'Awcrrc pour les Clunisiens, cf, D. IOGNA-PRAT, Agni immacuIo~i - Recherches sur f a sowces hagrbgrqhiques relatives ri saint Maietri de Chny (954-994), Paris: ~ d - du Cerf, 1988, p 3 1 1.
38. Gnigoire Ic Gtand, Homelia Xm, Hamefiae in Evangelirr, PL 76, col-1125. [Sears 1986, p.88-891. Cette homtlie Ctait lue a Cluny le jour de la Ete de Gdgoire, "extimius doctor et apostolicus uir" (cf, LT I,49,p.63). Haymon d' Auxerre s'inspira Cgalement de cette horndie dam ses Homifiae de tempore, PL 1 18, co1.789B.
adolescentia vel juventus, qme actoritate sumcn eloquii unm sunt, dicente Salomone : Laetare juvenis in dolescentia tua [EccL XI,9]. .
Dans les Moralia in lob, qUi bCn&fici&ent d'un gmnd su& de li'brairie au Moyen A g e , -goire dome une nowelIe liste des bes, lorsqu'f interpdte le pro& imapin6 par Job entre le Seigneur a lui (lob 1326) :
Ces quelques lignes des Moralia o& ~ o n t expliqwks les caract&istiques de chaque ige seront reprises par Etienne de Paris k la fin du MP sikle pour expliquer la tr&s stricte surveillance qui doit etre exercde sur les moines udulescentes".
Dans les Allegoriae, I'&i!que de Seville explique, 1 la suite de JMme puis d'Augustin, la parabole des ouMiers de la vigne (Mclrth 20,146) 1 l'aide des diffirents iiges, B savoir a rudimentis infantiae, ab adolescentia, in iuuenfutis aetate, in seneclutem declinantes, de~repii"~. Cette liste est t& proche des deux pdcddentes dijg &oqu6es, mais elle fit plus probablement inspide par celle de JQ8me et non celle d'Augustin, comme l'atteste une cornparaison des trois textes. Isidore a m a l e tout insert5 de petites modifications dam Ie discours de JMme. Le "ex utero matrisn est devenu "a rudimentis infantiae", tandis que le "a pubertatef' s'est transforme en "ab adolescentia" ; ces deux premieres modifications mettent mieux en evidence les Sges au detriment des points- chamieres de la vie humaine que sont la naissance et la pubertd. La transformation suivante est plus significative : le "matura aetate" est devenu "in iuuentzitis aetate". Faut-il en conclure qu'Isidore considkre ces dew appellations comme &ant synonymes ou a-t-il pn5f6& inserer la iuuentus, jugeant inad6quat que la matwitas fasse imddiatement suite a I'adulescentia ? Je pencherais plut6t pour la dewtieme solution, compte tenu de la met6 des definitions ou la mutwitas succiide h l'adulescentiu, mais il ne s'agit lil que d'une hypothke.
J9. Le Liber rramita nous appttnd que les moines de CIuny se passaient cet ouvrage pour le lire durant l'annde, cf. LT, IT, l9O.p.262.
*. Gregoire le Grand, Morulia in lob, Librim-XMI, IbXf, c.46 (62), Cd. M. Adriaen, (CCSL 143A) Tumhout: Brepols, 1979, p.62 1.
'I. J. LECLERCQ, Textes mr la vocation et la formation des moines au moyen 6ge w, clans Corona Gmtrimm - MiscelI~eapatristica, hktoricu et Iitucrgia Efigio Dekkers O.S.B. HI Lusrra complenri oblara, vol.II, (Imtmmenta putristica, X I ) Sint Pietersabdij (Brugge): Martinus Nijhoffs Gravenhage, 1975, p. 172.
". Isidore de Sdville, Allegoriae, 178-82, PL 83, 121-22. [Sears 1986, n.10 p. 1841
Les EtymoIogiue, l'owrage le plus Cekbre d'rsidore, dont I'influence marquante se fit sentir tout au long du ~ o y e n he4', abordent B deux reprises le thtme du cycle de vie. La premi&e fois, de f q n trts sufcinte, 101s de la &finition des sitdes a des @es, l'tvhue de S6ville explique qu'il adste enhe autres @es, cem & L'homme, a il ajoute a sicut infmtia, iuuentrrs, senecchu mu- Il est poss%Ie qu'il ne f k e ici qu'tvoquer quelques iges cornme exemples - ainsi que l'emploi de Jictct k laisserait sous-entendre - et que sa liste roit inco~npI&te~~~ Le livre X, De vocabullmis, mte de dictionmire h-latin, n'explique aucune des appeuations l i b B I'@e ; il fiut attendre Ie livre sldvant, le XI, portant Specifiquement sur l'&e humain, pourtcowa m e anelyse dWllde de ceIIes-ci. Le d6coupage de I'existeace qui est alors pdsentt! diffett du p&€dent :
Isidore ajoute que I'extGme fin du demier 5ge s'intitule le senium.
Ses Differentiae ooffknt en revanche comrne liste :
Une division semblable des 6ges se trowe dans le Liber Numetorum, habitueIlement attribue a Isidore (infcYia 0 pueritia [ adulescentia~ iuuentusl senectus 0 senium)'!
Ces dernieres listesy B la diffirence de celle offerte dam les Allegoriae, soit pksentent une deuxikne vieillesse (cas le plus fniquent), soit mentioment le senium c o m e la phase extreme de la senectus. Ainsi, entre Augustin et Isidore, senium perdit sa signification de
43. Les Clunisiens poss€daient cet ouvrage dam leur bbliothtque. 11 est entre autres cite dans la liste des oeuvres p&t& aux Wres I'annCc de ddaction du tT(cf tT I,lgO,p.263).
Isidore de Sdville, Erynrologiarum she Originrun Libri XX, Ib.V, cxxxviii, 6d. W.M. Lindsay, t-I, Oxford: Clarendon Press, 191 1, s.p. Raban Maur reprendra cetre formulation (a sicuf est infontia, iurrentus, senecm m) dam son De Compwo (dd. W.M. Stevens, (CC CM44) Turnhout: Brepols, 1979, chap. xcvi De aetatibus m, p 3 19 [Scars 1986, p.63J), mais il parlera ensuite des ages du monde et ne s'expliquera pas sur Ies Bges de I'homme.
'$. Telle est, tout du mains, la position de E. SEARS ( Z k Ages of Man, 1986 p.60). Je ne suis pas totalement convaincue de la justesse de cette affirmation car ce trio ne detone & mes yeux que par l'emploi d'injhntia ih la place de l'habitucl pueritio.
*. Isidore, Etymologiurum, IbXI, c.ii. ". id, D~ferentiue, Ib.& c. 19, PL 83, co1.8 1. Sur les coatradictions entre ces deux demitres ddfmitions,
cf. De Ghellinck 1948, p.44-45 et A. HOFMEISTER, Prier, Iuuenk, Senex. Zum Verst2lndnis der rn ittelal terlichen A1 tersbezeichnungen m, clans Papstturn und Kuberum, Forschungen zur pofitischen Geschichte und Geisreskuftur des Mittefaiters. Pad K& tunt 65. Gebwstag dargebracht, dd. A. Brackmann, Dannstadt: Scientia Verlag Aalen, t 973, p.289-9 1.
". Id, Liber mmeromm, PL 83, col.185. [Sears 1986, p.22 n62 (attniution ii Isidore non certifide) et p.62- 63 n.29).
simple synonyme du tcrme senectus pour maintenant comspondre h un Bge particulier, ie denier de I'exktence humaineIP.
Si Ie sms de senim cornmenpit dCjh A se s t a b i i , il den allait pas de miime pour l'iige compris atre la iuuerrttrr d la daaCpitu&. Les divergences en@ la definition du cycle de vie des Dweeentibe et celle des Etynrologiae s rhmrts pdcishent h la difficult6 de nomrner le cinquihe 8ge : hut4 pad= de nodurn senectw, sed iim nondm izmewtcs r
(Efymologiae) ou est-il pdfCraMe d'utiliser simplement le substantif senechcs (Dif/entiae) ? Le dilemme devient @culi&ement aigu lomp'il s'agit de dormer des appellations distinctes aux individus des dew d d m gmupes d'be.
Dans les Eryllogioe, ool Ie couplet grauitcu I senium est offert, Isidore juge nkessaire de justifuer son emploi de seniores pour designer les membres du premier groupe d'tige. Il reprend alors textueuement les explications d'Augustin dam le De Genesi confra manicheus mentionntes c i - d e d , mais fitit de plus appel ii Ovide et B Terence. Ces savantes dferences temoignent de la difEcuite de convaincre les lecteurs du We siecle que senior, le comparatifde sup6rioritt de senex, IWtalement "le plus view" doive &e traduit par "moins view".
Dam les Diferentiae, Isidore opte pour un choix diffiirent En effet, meme si la senectus fa t ici directement suite la iuuenfus, il il&e 1'6tymologie des termes uir et mulier, apds ceUe de iuwnis, et avant ceUe de senex. Cette demi5re appellation, senex, est associke au demier Sge, donc, logiquement, au senim : Exbemae jm aetafilr, senes et anus voccmha m. Mais uir n'est pas pour autant li6 B la senectw ; Isidore l'associe de faqon assez obscure B 1"'iige m6diant" : a lam vero mediae aetatisproprie dimntur vir et mulier w.
Aussi bien dam le livre XI des EtymoIogiue que dans les chapitres XIX & XXI des Difjerentiae, les Listes des Sges sont accompagn6es d'une dtymologie hautemeat significative et color& des tennes 6noncb. Celle-ci est ratemeat le fait dYIsidore : l'ensemble se trouvait dej& par bribes, dans divers ecrits latins plus ancietls". Mais il s'agit de la premiere tnumiration systCmatique et globale de l'origine des appellations des ages.
Le premier ige se nomme infmtiu car le petit enfant ne sait pas park (patler = fm], ses dents n'Ctant pas encore en place? Le deuxi5me fige tient son nom de laputitas car le
". Ce glissemcnt de scns de senium est c o n h e par l'important glossah Abouus, du We-IX' s. (Corpus Glossarium Latinorum, ed, G. Gottz et G, Lowe, Licpzig, 1888- 1923, tIV, p.390)-
En gras sont les tournuces empruntCes ;Z Augustin : rn Qubta a m senior& Mest grmitur, quae est declinatlo a luuentute in senectutan ; nondum seneclutem seii iant nondum iuuentus, quia senioris adas fit, quam Graeci npeuflu'qg wcant Nam sen= apud Graecos nun presbyter, sed y@ov dicitur. (E@mologiarum, IbXI, ii),
". Sur ces Ctymologies, tout piuticulihent k discom romain confiontd aux cecherthes des philologues modemes, c t LP. &RAUDAU, to jetrnesse. .., 1979, p.97-102.
5'- Cette defmition de I'infantia serait d'origine juridique romaine : I L'incapacitk de parler dont il est question concemait chez 1 s Romaim la prononciation d a formules rituelles devant I t magistrat, (R MEW a L'enfant dam le h i t canonique medieval. Orientations de recherche n, dans t Dnfint, 11: L 'Europe mPdiPvde er maderne, (Recueils de la societt! Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, XXXM) BruxelIes:
p e r n'a toujom pas de barbe (. n e c h IanuginemfIoremque genrnmz hubens m) a w peut pas encon pmcnh (a SenmcJb aetaspueritia id estpra et n e c h odgenerrmd%m apta m). C k u n de ces deux iges a me durk d'une scale hebdomade (7 ans) du f i t de la vie simple qui y est men&. Adolescens s'explique par adultus parfiait du vexbe adoleseere) parce que ie jeune grandit d peut maintenant procder. Il dun dewc hebdomades car il beneficie par rapport A ses Ppsahssem de l'inteigence et de l'aptitude k agit (actio). Iuuenllc~ tire son origine du verb iuurrre (= aida, savir) car le jeme h o m e a pour fonction d'aida les hommes (a [... ] ad maflium praeporatw. Niam iuvme hominis est o p aliquod confeentis m). Cet flge est afirmi3sima aetahm ornniun r mais dam une perspective avant tout physiologique, comme l'indiqpent l'usage de l'adjectiffinnw et I'afbmation qui suit : a Sicat autem triginta Mectae aetatik est mrmu in hominibw, L in pecudibus ac jumenh t e~ ius rob~s1issimus. m Sa dm& est de tmis hebdomades (21 ans) car iI Mneficie justement, en plus des caract6ristiques de l'@e p&Cdent, de la pleine force physique (corpon's virtw). La senectus (comme cinqui&me ige) dure quatre hebdomades car elle poss&de, en plus des trois caract&istiques de la jeunesse pr&demment c i t h , la grmitas de l ' h e et du corps. Cette image positive de la senectm n'est pas un cas unique et la dCfinition fluctuante de ce terme va de pair avec un discours t& contrast6 sur l'age qui lui est associd.
Dans les dew ouvrages, senex Mneficie d'une dtymologie trk negative, mais qu71sidore refuse d'assumer :
r Senes autem dictos quidam putant a s e w diminutione, eo quod jam per vetustatem desipiant. N w h @ c i dicun t stultos esse homines fiigidiooris sannginis, prudentes cdidi : unde et senes, in quibus jam fiiget, et pueri, in quibus necdum calet, minus sapiunt. Inde est quod convenit sibi infawn aetas et senm : senes enim per nimiam uetatem delirant ; pueri per Iascivimn et infantiam ignorant quid agant. P
Dam les Etymolugiue, qui associent pourtant la senectus a w senes, l'image tr&s negative de ce dernier terme est contrebalancte par un portrait globalement positif du dernier ige :
a Senectus autem multa secum et bona adfert et m a h Bo~a, quia nos ab inpotentis- simis dominis liberat, vohptotibus inponit modunr. Iibidinis fiangit impetus, auget scrpientiam, dat mahuiora consilia. MaZa autern, quia senium miserrimum est debiliroe et odia Subeunt enim pirg. Georg. 3,671 morbi, tristisque senectus. Nam duo sunt, quibus minuuntw corporis vires, senectus et morbus. mn
Dam cet extrait, dont Isidore, cette fois-ci, ne refuse pas la patemite, il n'est plus question de declin mental mais uniquemeat de dklin physique et sp&ifiquement associe au senium.
~ d . de la Librairie mcyclopCdique, 1976, p. 18). Id, Elymologiamm, IbXI, i i #27. Les D~rerentiae pour leur part donnent une explication Idghrement
diffkrente : a Senes H e m quidam dictos putant. eo quad se nesciunt. et per nimiam aetarem delirent atque desipfant. U . e et Pfato : In pueris crescit sensus, in juvenibus viget, in senibus minuitur. (c-xx, coI.82).
5'. Id, Etymologimm* IbXI, c.ii, #30. [Sears 1986 p.61-621. E. SEARS souligne I'importance de ce passage pour les auteurs successifs (ibid).
En conclusion, si les premiers aes, de l'i-a B la iuuentus, ne posent g u k de probl6me de definition, les deux demiers bkficient d'une terminologie et d'une image ambigues. Les ages limites nstant h pcu de choses prh identiques dans les dew ouvrages des E~ynofogicze et des Dlrerentiae, Ie plus simple est d'admettre un pnmier @e, allant de 49-50 1 70-77 am, oil le cop ne dkline pas encore mais oa l'espit devient plus sage, appe16 gratn'Ilar ou senecrtrs, et dont les membres sont les seniores ou les uiri. Vient ensuite un d e m k &e, de deClin physique et, possii1ement aussi, de dtclin mental, ayant pour nom habituellement seniwn, pdois senecfus, et dont les rnembres s'appellent setzes.
A la suite de sa r&xiture du De lardibus Dei de Dracontius (fin Ve s.)~', faite a la demande du mi wisigoth Chindaswintha, cet 6v&pe de TolWe (646-657) apposa un court po&me ctl6bmt le septieme jour de la Crhtion. Dam ce demier, 1 ~numdra les six gges de la vie, suivis de la septieme &ape, qui est la mort :
Les adjecws simplex, moilis et grauis sont respectivement attach& aux premier, deuxieme et avant dernier age. En revanche, au sujet du quatrieme, Eughe k i t a qumta gerit virtutis opem speciosa iuventa m. E. Sears traduit de fqon erronde adulta par adult. Cet adjectif, peu utilise pendant le haut Moyen Age, est forme sur le verbe uduiesco tout cornme le terme adolescens. Selon Slusanski, il ddsigne la Hiode de la puberte, soit la transition entre la pueritia et l'adulescentia ou la iuuentzd', d6finition que corrobore parfatement I'agencement de la liste offerte cidessus.
Dans son De temporibus (~703)~ BMe reprend la cornparaison augustinienne entre les iges de la vie et les iges du monde.
infaial pueritiau adolescentiafl iuuenilis [ a e t a senectus~ decrepita a e t d '
551 Dracontius, Louanges de Dim, livres 1 et II, O e r m , 66, trad. et comm. C. Moussy et C. Camus, Paris: Les Belles Lcttres, 1985. Sur la recension d'Eughe de Tokdc, cf. cssentiellement p.106-10.
%. Eugene de Tolede, Monostichu recopitulationis septem dierum, 27-33, dam Dracontius, Cormha, Cd. Vollmer, MGH M 14, Berlin: Weidmann, 1905, p.69. [Sears 1986, p.591
57. D. SLUSANSKI, Le vocabulairc ... op.ci&, 1974, p.369. La meme signification du terme uetus aduIta h i t encore donnee par Gratien au MIe siecle, cf, R METZ, = L'enfm L.. m, dam L 'enfanf, 11, t 976, p.13.
5c. Btde, De temporibus, c.16, Cd, C.W. Jones, Opera* W3, (CCSL 123C) Tumhout: Brepols, 1980, p.600- 01.
De mSme que le Deluge a clos la premik @ode de l'histoire humaine, d'Adam 5 Not, effapnt tout demke hi, de m&w l'homme m se souvient pas de ses premi- am-. Mais dans sapueritia, il commence savok pa rk et dest justement au c o u ~ de la dewcibe p & i e de i'histoire, en* Nd a Abraham, que la langue h&rarwque prit fonne. Pendant I'adolescence, iI est possi'ble d'enfantcr ; paralltlewnt, d'Abraham naquirrnt les d i f f h t e s races qui peupletent la Tem. La &he mode de l'histo'i du mode, & David jusqu'B I'exiI il BabyIone, comspoad B l ' h des rois ; en e f f i la dipitas iuuonilis est apte ik dgner. Le cinquihe b e du monde se pmlongea jusqu'h la venue du Christ et son association avec la senectus est p t i c u l i h e n t nbgative : a ut grd senechite fessa, malh crebrioribus plebs Hebraea passatw. Le sixihe a d d e r ige co~espondait, d o n Bae, h 1'6poque ou il vivait : comme le senium, sa dude &it inconnue.
Le meme thtme est aborde dans le chapitre LXVI du De temporurn ratione (725) avec m e liste des iiges P peu pr& identique : infmtiai pueritiai iuuentusl grauis senecml decrepitu aetas. Mais d a m le chapitre XXXV du mhne owrage, Bede dtablit les correspondances entre les quatre Qes de l'homme et les quatre humem, saisons, elements et qualitds. 11 en conclut que les infmtes, chez qui domine le sang, sont a hilams laetos, misericordes, muZhnt n'dentes et Zoquentes m, les adolescentes, chez qui domine la bile rouge,
macilentos, multum tamen comedentes, ueloces, audaces, irucundos, agiles n, les transgressores, chez qui domiw la bile noire, a stabiles, graues, composites moribus, dolososque . et les senes, chez qui domine le flegme, a turdus, somnolentos. obliuiosos ..
infantes 0 adolescentes 1 transgressores 1 sene?'.
Ce quadruplet est inhabitue1 pour deux raisons : premiikement du fait du passage direct de l'infantiu a I'udolescentia, sans pueritiu, rarement absente dam les divisions des iiges, et, deuxitmement, de par l'usage du teme transgressores. On hdsite A situer ce demier entre la iuuentus et l%ge mk. Byrhtferth, commentant Bkde dam son Mmuol, se sentit contraint d'expliquer qu'il s'agissait Gindividus &ant dans la iuuentus ; en revauche, un glossateur carolingien dklara qu'on etait transgressor lorsqu'on passait de la iuuentus a la senecttlS60. Honorius Augustudonensis, qui reprit egalement le discours de B6de dans son De imagine M d i , donna pour sa part comme liste : infmtesl iuuenes~ prouectioresl senes (cf. plus bas). Du fait des adjectifs associ6s au terme transgressores par B&de - on retrouve entre autres le grauis qui &it associd dans les deux listes pdc6dentes B la senecfw -, l'explication de Byrhtferth n'est pas recevable ; il ne fat g u k de doute qu'on est ici encore confront6 au fameux probl6me de d6nomination des individus n'appartenant ni A la iuuentw, ni P la demiere vieillesse. D'autres auteurs ont utilisd des tomwes similaires, qui perrnettaient tgalement de souligner la notion de "passagew d'un iige a un autre, avec I'emploi d ' a d j d s subtantiv6s comme declinantes (cf. Augustin ci-dessus).
Rde, De temporum ratione, c.35, Cd. C.W. Jones, Opera, W2, (CCSL 123B) Turnhout: Bmpols, 1977, p.392-93. [Bumow 1986 p.2021. J.A. BURROW souligne l'influence de Pythagore dans la relation Ctablie entre les 5ges et les sauons et celle d'tiippocrate dam la relation ttablie entre les 5ges et les humeurs (ibid).
60. C' E. Sears, The Ages of Man, 1986, p.33 et n, 102 p.167.
Pour expliquer pourquoi, dans 19EvangiIe de Jean, i popos de la conversion des Samaritains, il est Specifit! que J h s aniva au puits de Jacob B la sixitme hewe (Jn 4,6), Alcuin reprend la comparahn augustinienne entre les &es de la vie a les Qes du monde. Le Christ survint au six ihe Qe, dots que le vetus homo se mourait, pour donna eJsor au novus homo. La vieillese est p-t& comme m e dCgh&escence toute ext&ieure : l'homme qui viefit est comparable & un individu portent un view vetemeat ; la lente d6gradation de cette enveloppe exttrieure est un bien puisqu'elle pennet la mise ii nu C 1'6tre &el qui est, lui, & I'image du Cdateur.
-Raban Maur, De universo sive de rerum naturis (846) :
infantiao (7 ans) pueritia[ (14 aas) uddescentia[I (28 am) iuuentusl (50 ans) a aetas senioris, id est, grauitas r 1 (70 am) senectd2
Dam cet ouvrage, Etaban Maur a repris le systtme isidorien des Etymologae et a recopit sans hesiter les contradictions de lY6vi!que, par exemple sur le bon sens vacillant etlou sup&ieur des vieillards.
Dans un autre passage du meme ouvrage, il ofEe pourtant une liste differente des iiges de la vie :
infantian pueritiau adolescentiu[ iuuenilis aetasl quasi senilis aetar 1 aetas decrepitas
11 a repris cette fois-ci I'interprdtation de B&Ie de la cornparahon a u w i e n n e entre les 3ges de la vie et les iiges du mondea.
Comme je l'ai d6ja mentiom6 pdcddemment, Raban a recopid dans son Commentmiurn in Mattheurn l'interprdtation de la parable des travailleurs de la vigne avancC par Mgoire le Grand et la division des iiges qui l'accompagnait, Puisqu'il s'agit d'une retranscription litt6raIe, sans modification, ni du contexte ni du contenu, je ne la reprends pas ici. La seule diffkence notable, par rapport aux deux divisions precGdentes, e a que l'infuntia est absente, dtant englob& dam lapueritia.
6'. Alcuin, CommenrPria in S.Joannis Evangelium, Ib.11, c.7, PL 100, co1.792. [Burrow 1986 p.841. 6z. Raban Maur, De universo sive de rerum narwii libri XMI, lb.W, c. I , PL 1 1 1, co1.179 et 185. 63, Raban Maur, ibid, lbX, c.14, PL 1 1 1, ~01.306-07. [Goodich 1989, p.60).
En clarifiant pour ses t l h m o k les points obsws de la &@e de saint Benoit, Hildemar dticlina les divers Qes du cycle de la vie :
infmtiai (7 ans) pueritial (14 ans) udolescentiu[ (28 ans) juvenhcsl (56 a) senechis1 (70 ans) decrepitas aet&
-Ms originah de Fulda (DP s.) :
infintial (7-8 ans) pueritial (14 ans) adolescential'(28 am) iuuentull (50 ans) r aetar senioris, id est, grmitas (70 ans) senecf l
11 s'agit d'une version versifde de la definition des iiges par Isidore de S6ville dam ses Etymologiae. Si dam le @me I'infmtia ne dure que 7 ans, il est en revanche inscrit dam la marge que le premier ige sYach&ve & 8 aas.
*&my d9Auerre (t908). Commenturn in Mmianum Capellam :
infantia 0 pueritia 0 adolescentia~ iuuentus
Remy mentionne les quatre points cardinaux, les quatre Clements, les quatre vertus et les quatre vices. A propos des ages de la vie humaine, l'excuse qu'il offre pour n'en nommer que quatre est peu commune : il declare en effet qu'il n'est pas nckessaire d'aller au-dell de la iuuentw puisque, ensuite, l'homme n't5volue plus, a nec ingenio nec statura corporis m. 11 spicifie po-t que u quidam quartam uetatem dicunt senectutem esse
Dans sa glose de la Consolatiophilosophiae de Bake, il donne la liste suivante des Zges :
pueritia 1 adolescentia~entus~ senecttu
Un diagramme adjacent au texte illustre le lien entre les quatre iges, les qua= saisons, etc6'.
64. HiIdemm, m i i , p.420. E SEARS, The Ages of Man, 1986, p.65 et n.46 p. 178 (Munich, Baycrische Staatsbibliothek, clm 1464 1,
fo1.329. Je n'ai pas pu consulter I t rnanuscrit pour vdrifier la transcription de Sears. 66. Remy d'Auxem, Commentum in Mbtiartwn Cpl tam, Ib.VII, 36911, td. C.E. Lutz, t I I Leiden: E.J.
Brill, 1965, p. 187 [E. Sears 1986 p.22,n.60 et 611. Rtmy d'Auxem fut le maitre d'Odon de Cluny pendant que celui-ci Ctudiait I Paris et il lui fit lire entre autres chosa Martianus Capella (cf. YO' I, 19,col.RA).
67. E. SEARS, 7Re Ages of Mm, 1986, planche n'2 (photographie d'une panic du fol. 35' du Ms cod. Pal. lat 158 I de la Bibliotheca Vaticana),
idantibl(7 ans)pueritial(14 aos) adirlescential(21 am) iuuenhcsl (de 42 jusque 70 ans) senectus
11 s'agit d'un m a n d t contenaut d i f f i t s texks mMcaux par Soranus, Galien, le Pseudo- Galien et le Pseudo-Somfl. Sur un folio (fo1.37") se d6couwe une rota divisCe entre la pueritia, l'addescetttia, la iuuentus et la senechrs69. A w d h de Sears, que je n'ai pu verifier mais que semble cornborer la description du manumit par E. Wickersheher, la liste pdce'dente des cinq gges est une addition (fol.373. Les ages y sont mentiom& accompagnds de Ieur durte et non de Ieur &e Iimite. La phrase ajoutee est la suivante : a Infmtia habet Mannos, puericia YZI, adoZescentia MI, iuventtls ter MI, senectus quater VII ..
L'iige t d s bas d'entrce en iuuenfus et en senectw, en comparaison des autres dkfinitions des @a, peut s'expliquer de deux manitres diffintes : soit du fit de IYinfIuence des trait& m6dicaw pdsents dam le manuscrit, soit, plus probable, par suite de l'oubli d'un bis dam la mention de la dude de l'adulescentia?
-Manuserit de Paris QP sikle) :
infantiin (7 ans) pueritial (14 am) adulescentia[ (28 ans) iuuentus~ (48149 ans) senectusl(70/77/80 ans) senium
Dam ce manuscrit, qui est un recueil de divers textes mddicaux, la limite de chaque 8ge est d'abord donnee (soit 7, 14'27 (sic), 48 ou 49,70 ou 80), puis il est prkise la longueur de chaque dge en pbriodes de sept ans : une pour I'infantiu, me pour la pueritia, dew pour l'adulescentia, trois pour la iuuentus et quatre pour la senecfus".
". 11 s'agit du manuscrit Chartres, Bibliothaque Municipde, ms 62. Sur ce manwrit, cf. E. WICKERSHEIMER, k munuscrits laim & m&ine du harr ~ o y e n ige ige f a bibiiotht5pe.r de France, Paris: €do du CNRS, 1966,110, p.17-21. [Sears 1986, p27 et p.47.1
69. Ibia!, planche I, p.18. "? Cet oubli cst d'autant plus probable que les autres Ccrits qui dCfinisscnt eux aussi la longueur des Sges
par le nombre d'hebdomades, s'ils en associent une seule l'infmtia et & la pueriria, en accordent deux ii l'adolescentia. Voir par exemple les Drrerentiae d'bidott de S&ille (Ib.fI, 19-2 1, PL 83, col.8 1-82) et, plus bas, le manuscrit de Paris et le Vacabularium latinurn de Papias.
'I. E. WICKERSHEIMER, Les muntll~crits, 1966, #48, p.56-57. [Sears 1986, p.471. I1 s'agit du Paris, BN, ms. Iat. 2825, fo1.80r.
A h i d e de cet owrage (bgalement connu sous l'appdation d'Encheiridon), Byrhderth, moine de Ramsey, d d t &chit les c o b c e s des clacs, tout particulierement en ce qui avait trait au cornput Pour miew transmettre son savoir, il rcdigea m e grande part du texte en vie3 anglais. Il s'agixait, selon JA. Buuow, de la l a e tentative de transmission de la thbrie des Qes en langue vernaculakavant Ie XIUe sitcle ; mais cette tentative n'eut qu'un maigre succts puisqu'il ne subsiste qu'un seul manuscrit du texte (Oxford, Bodleian Library, Ms. Ashmole 328)').
Le Rumsty Compun~~ (c1090), qui repduit trh probablement un schdma compos6 par Byrhtferth, o f k comme Qge limite pour lapueritia et i n f m a 14 am, pour l'adulescenrio 28 am, pour la iuuentus 48 am et pour la senectw 70 et 80 am7'. Le schema du seul manuscrit subsistant du Mmud ne pdcise pas les iiges limites7?
On attribue h Byrhtferth la Vita S.Ecgwini qui a pour caract6ristique, assez exceptionnelle, #&re divisde pdcidment selon les quatre iges de la vie, soit pueritia, adolescentia, iuuentus et senect~s'~.
-Lettre apocryphe dite de Luc, Manuscrit de Chiemsee (XF sikle) :
infa~ticrl (7 am) pueririlll (14 ans) udulescential (28 am) iuuentus[ (48 W) senectusl (56 am) media senectusl (70 am) senium
? Byrhtferth, M m d , &I. et trad SJ. Crawford, (Early English Text Society original series, 177) London: Oxford Univ. Press, 1966 (1929), p.204. [Burrow 1986 p. IS- 18 ; Sears 1986, p23 n.64-65 et p33-34 n. 106- 091.
n. J.A. BURROW, The Ages of Matt, 1986, p25. ". E. SEARS, The Ages of Man, 1986, planche #lo @hotographie du fol.7 , ms.17, St- John's College,
Oxford). ". Byrhtferth, Manual, op.cit., p.81. [Burrow 1986 figure no 1 ; Sears 1986 planche n09]. '". Cf Michael LAPIDGE, r Byrhtfkrth and the Vita SEcgwini 1, Mediwuf Studies, 41 (1979): 338. [Scars
1986 ~ 3 3 1 - I1 cxiste probablement d'autrcs exernples d'hagiographes ayant volontaircmmt divisd leurs oeuvres selon les iiges du cycle dc vie. LC pr€m mksionnaire anglais Willibald, qui ecrivit la Vie de Boniface, l'"apbtreU de la Germanic, entre 754 ct 768, declare avoir fhit en sorte dc traiter tous k s 5ges : a Emmerutis igitur beati viri gestis, quibtcs in infmtia et pueritiu vel adoIescentia et iuventute put e t i m in senectute f r o m a t L..] (C- TALBOT, The AngIoSmon Mksionaries in Germany Being the Lives of SS. Willibrord. Bon@ce, Stwm, Leoba and kbuin, London/Nw York: Shed and Ward, 1954,9,p.56)- Pourtant, la demiere section du chapitre I de cette thbe atteste qu'habituellement, si l'enfance (infantiu et pueritia) est bien diflirencide de la jeunesse (adukscentia et iuuenrus) par les hagiographes, la limite entre ce dernier gge et le suivant est trb indCcise.
Luc l'~van~t!liste, qu'on penstit mddecin, s'adresserait ici aux mddecins chn?tiensn.
i n f ~ h l ( 7 ans) purriral(14 am) adolescential(28 am) iuvenhlp uel uin'ksl(48 am) senior1 (70 am) senectwn
Dam I'article "aetas" de son Elementmiurn, Papias dtfinit en premier lieu les Qes de L'homme (avec la liste offerte cidessus), pub les &es spirituels, et enfin les iiges du monde. Juste avant de donner ces demiers, il rappelle les Qes de I'homme, mais pour en domer une nouvelle definition : infanfib[ pueritia I adolncentiu I iuventus I senectus, sans mentionner cette fois-ci les limites &&en. Compte tenu de I'lige oh d6butait le "senior", il faut supposer que, dans cette dernih Me, la senectus inclut le "senior" et la senecfur prgcedents.
Je n'ai rencontd nulle part ailleurs dam les sources le cornpatatif senior transform6 en substantifpour ddsigner un Qe. Il sert t d s sowent ii nommer les homes appartenant a I'avantdernitre classe d'iige, celle qui p&&de la dedpitude, mais telle n'est pas son sens dam la phrase de Papias : a Quinta [aetm] tribus itidem ebdomadibus usque ad LXX portenditur et senior dicifur declinata a iwentute in senecfutem nundum senectus.
n. Manumit originairc de Chiemsee, Munich, Bayerische Staatsbibliothek, clm 5257, fo1.26 ct 28'. Je n'ai pu like ce manuscrit mais ai tid l'idormation de E. de GHELLINCK 1948, p.4748 d de E. SEARS 1986 a.41 p. 172. Le premier se dRre P l'atiile dc F. BOLL, a Die Leknsaltcr. Ein Beitrag nu antiken Ethologic und zur Geschichte der Zahlen W, N m Jrthrbiicherjb h khsiwhe Alterturn Geschichte und deu~sche Literatw, 3 1 (1913): 108 et p.108 n3, mais il est uniquemcnt question dam cette oeuvre de 1'4tonnante vicillesse de cette division des @ts. Sears rcnvoie I'ouvrage dc G. H-, Die Eihteilungsarten a h Lebenr- wrd Weltalter bei Greichen und R6mem (WQrzbrug, 1912, p.13-14 et p.49) que je n'ai pu consulter.
n. Papias, Wementariwn - L h a A, v o t k Aeqlnu - Am@me, 6d. V. de Angelis, (T'esti e documenti per lo studio delt'AntichitA, LVW2) Milano: Cisatpino-Goliardica, 1977, p-110. [De Ghcllinck 1948, p.55-56 et Archambault 1966 p.2091. Telle cst Cgalement la listt des ages donnee dans redition du Vocubularium (autre nom donne h I'Elementarium) de 1491, consult& par De GbelIinck. Pourtant, dans celle de Venise de 1496, la liste offerte est : infantial pueritiul adulescential iiiuentzisl senecta ou g m 1 3 oetus( senectus ou senium. Je ne sais quelle est son origine puisque cette lecture n9est pas donu& dans l'apparat critique de V. de Angelis.
'9. Papias, Elementarium, 1977, p. 1 1 l .
-1ohannicius @main ibn Isbaq), Isagoge (IF siscle mais traduit en latin, peutdtre par Constantin, B la fin du XIe sitcle? :
adolescentia~ (25130 ans) iimentwl(35140 ans) senectus1(55/60 ans) senium
La vie de l'homme est compar6e ik Ia courbe d'uue f k h e en plein vol : l'homme croit physiquement jusquc 25/30 ans puis atteint un somrnet j u p 35/40 ans (aperfectum sine dimimtione viriwn copus comervans *). Jusque 55-60 am, le corps dtcline, a tamen virtu non defict r. Enfin d e n t le demier ige a in quo virhrrs u p p e t defetw mu'. J'ai place cet auteur dans la liste des auteurs non-cidtiens, bien qu'il fbt nestorien, pace qu'il appartenait indiscutablement & l ' ak du monde islamique. -
-Ali ibn al-Abbas (t994), Pantegni (traduit a la fin XIC par Constantin L'Afi.icain (tcl087)) :
pueritia (composie de l ' infda et de la pueritia uel adolescentia de 15 ans chacune)! (30 ans) iuuentusi (3 5/40 am) senectusl (45/50 ans) senium*
Un autre traducteur d'Ali ibn al-Abbas, ~tienne d7Antioche, en 1 127, modifia quelque peu Ies termes choisis pour la traduction des iiges :
pueritie etasf iuuentuso grmdiorum etas f s e n e c e
Le point de w e de cet auteur est uniquement m6dical. Il btablit les conespondances des iiges avec les humem. Par exemple, it props de l'extreme vieillesse, il admet qu'il existe ties theories contradictoires. Selon lui, ce dernier iige est cause par un ex& de secheresse: pace que le corps n'a plus #humidit& il s ' d t e de se dbvelopper. Mais Ali ibn al-Abbas ajoute en fin de chapitre que, selon certains, ce demier iige se caractt5rise au contraire par la hideur et 1'humiditC: a Dicunt tumen physicifiigidum et humidum esse
", Cf. D. JACQUART et F. MICHEAU, Lu me'decine arabe er I'occident me'di&val, Paris: Maisonneuve et Larose, 1990, p.96-107 ct F. NEWTON, Constanttine the Afiican and Monte Casino : Ncw Elements and the Text of the Isagoge n, dam Corntantine the AfFican and 'Aliibn al-2bba Af-Mami- The Pantegni and Refated T i , &I. C. Bumett ct D. Jacquart, LeidenMew YoM6ln: EL Brill, 1994, p. 1647. Vou aussi les remarques de ce dernier auteur sur la quaIit6 d'tdition de ce tcxtc, ibid, p. 1611.
'I. fohannicius, Isagoge, td Gregor Maurach, = Johannicius : lsagoge ad Techne Galieni w, Sudhofls Archiv, 62 (1978): 155- [rCE d o ~ t t par Scars 1986 p30 n.95 ; Burrow 1986 p.22-23 qui se dfere pour sa part ii I'ouvrage Articeflu, Venise, 14931.
Ali Ibn Al-Abbas, Pantegni, Theorice, Ib.1, c 2 I, aad Constantin I' Africain, Lyon, 15 15, fol4' [Sears I986 p29, n.921. Cf. M. JORDAN, me Fortune's of Constantine's Panrepi n, dam Constantine the Afican and 'AfTibn al-Xbbk Ai-MamF- Xhe Pantegni md Relaed Texts, Cd C. Burnett et D. Jaquarti Leidenmew YoW6h: EJ. Brill, 1994, p.286-302 et D. JACQUART et F. MICHEAU, Lu midecine orabe, 1990, p.103- 07.
". Ali ibn ai-Abbas, Liber regius, I, I, 2 1, trad dtienne d'htioche, Liber totius medicina necessario confiners, Lyon, 1523, s.p. [Sears 1986, p29,n.92].
corpus decreepir propter sputap~mtO1ma et ~ s i emunctorr'a: etfadiores !aaymrcrs; hec enirn apparent esse h i & . . -Ps.-BMe (fin XIe s.- debXIIC s.), De mMm. celestis terrestri'sque co~cstittrtione :
Au &ut de cette oeuvre qpi consiste en m e description d&tai.Uk de I'univers et de I ' h e humtine, l'auteur associe chacune des quatre humem aux quatre saisons, quatre &meats et quatn &es. Pour ces defiers, la liste est la suivante :
Pierre Duhem s'est &om6 du rationalisme avant-gardiste du Pseudo-B6de. I1 a f k n e que, dam ce trait6 :
les interpktations symboliques et all6goriques ont W compl&tement chassdes ; les citations de l'hiture et des Ptres ont entierement disparu. Il semble que cet auteur ait conqu l'idk, si f d l i t r e a partir du Xm' sikle, d'une science naturelle exclusivement fond& sur les domies de la raison et pleinement inddpendante de la Rt5v6lation. mu
-Anonyme anglais, Tractatus de Quaternario (debut XIIe)
Dans un manuscrit non encore l'auteur anonyme consacre sept sections du livre III am Sges de la vie. Il fait d'abord une distinction entre les mCdecins, qui divisent la vie en quatre, et les philosophes, qui la divisent en sept. Ces demiers proposent :
infantial pueritial udulescentia~ iuuentus[ senectus 1 senium a decrepitas
Chacun de ces sept iges est associk avec une des sept "planttes" qui gravitent autour de la Terre (cf. ci-dessous Ptol6mBe). Ptoldmk n'ayant pas encore &ti traduit, E. Sears s'dtome de la source d'information de l 'hnyme, compte t a u du feit qw cette association entre les iiges et les planktes, si elle etait tris dpandue dans les mondes byzantin et arabe, n'avait pas encore 6t6 transmise ii I'Occident lath.
U. Ps.-Btde, De mundi ceIestb t m q u e constitutione - A Treatike on the Uniwrse and the Sod, I, 8- 1 1, ed. et trad- C. Burnett, (Warburg Institute Survey md Texts, X) London: The Warburg Institute, 1985, p.18. [Sears 1986 p27 n.8 11.
Pierre DUHEM, Le systgme du monde - Hbtoire des doctrines cosmologiques de Platon ri Copentic, 111, Paris: Hermann, 1958 (I9 13, p.79.
'6. Anonyme anglais, Tractatus de Quaternario, Cambridge, GonvilIe et Caius College, ms.428. Les informations sur Ies iges contenues dans ce manuscrit sont reprises dans E, SEARS, The Ages ofMan, 1986, p24, p.3 1 et p.52.
La premih division par quatre dome :
E. Sears note avec justesse la codlation entre ce dbupage des &es et celui don& dam l'lsagoge, qyi venait tout juste d ' k traduit. Si effivement I'auteur du Tractatus s'est inspin5 des enits traduits de HIlrain i h Ishq, alors iI est rrmarquable quYiI ait jug6 utile de repousser I'entde de la seneem de 10 ass ! D'ailleus, iI ne fait pas sienae cette division, comme le laissent entmdn les mots qo'il emploie pour la dkrire : a s e d u m quorumdam opinionem * pour 6voquer l ' u ~ l e s c e ~ ~ puis a secundbn eosdem v pour dtfinir la iuuenttls. L'autre division en qua= ages lui sied beauwup plus. Il commence en effet sa description par a Reor enim et veritati assistere mihi videha ..
adolescenfia oupueritia~ (14 ens) iuuentusl(45/50 am) senectm[(60/65 am) senium
Ce dernier ddcoupage est beaucoup plus dam la ligde de ceux offerts par les auteurs latins prec6dents. Mais, ddcidement incertain, l'anonyme propose dam le meme Ban de changer encore cette demike division par :
Malheureusement, il d e n donne pas les iges correspondants. E. Sears a B m e que ce type d'incertitudes sur la division par quatre des iiges de la vie &ait courant et se retrouvait, entre autres, dans les textes influences par la m6decine arabe, ii partir de la fin du XIC siikle, avec Constantin l'l\fi.icain.
-Ptolkmie (IP si&le), Tetrabiblos (traduit en lath seulement en 1 138 par Platon de Tivoli) :
infmtiao (4 ans) pueritial(14 aas) udolescentiu~ (22 am) iuuentw~ (41 ans) virilis uetaro (56 am) senectusi (68 ans) senium"
Ptol6mCe fait correspondre les diff6rents iges de la vie avec les "pladtes" qui entourent la Tern, soit la lune, Mercure, Vdnus, le Soleil, Mars, Jupiter et Satume. Le Tetrabiblos semit a the earliest SUCViving account of planetary influence on the ages of man mu. L ' e h t est instable parce qu'il est domind par la lune ; il devient plus raisonnable sous Menwe. Le dksk le m h e sous VCnus mais il apprend ti contr6ler totalement ses actions et cherche le pouvoir sous le soleil. Le ddclin commence d&s I'be viril, sous l'influence de Mars. Lorsque r6gne Jupiter, le travail manuel est abandon& pour la rdflexion et les
m. Ptoldmde, @c~rii@arhrrn~ IbN, c.9, trad, Platon de Tivoli, Basileae, 155 1, p.72 [Bumow 1986 p. 198 et Sears I986 p.48-SO].
8s. E. SEARS, The Ages ofMan* 1986, p.49,
honneurst Mais aprZs 68 am, sous I'influence de Satume, le dklin devient definitif, tant sur le plan physique que mentalm.
-Honorius Augustodunensis (fll37X De Imagine M i ( d l 10)
Dam cet ou~rage, Honorius donne mmme division des Qes la liste suivante :
infantial (7 am) pueritial (14 ans) adolescentiai (21 ans) iuuentusl (50 ans) se- net-1 (70 eps) decrepitus (jusqu'h 100 am ou jusqu'8 la rnorQm
Mais il utilise dgalement les appellations :
I1 emploie ces divers termes pour ddcrire le microcosne que constitue le corps humain et montrer I'impact des quatre humeurs sur les quatre @es de la vie. I1 reprend ici pour I'essentiel le texte de Bede dam le De Tempumm Ratione. Sa perspective est donc principalement m&iicale. Dam le Sac7mnentarim, il d h i t dgalement le corps de I'homme comme un microcosme repdsentant le monde. avec la t&e symbolisant la sphk du ciel, les deux yeux, la lune et le soleil, etc. Les quatre iges qu'il h e en rapport avec les quatre saisons sont : pueritiau iuventur[ senectus0 aetas decrepie. Les deux listes peuvent
'9. En ce qui concerne le dernier ige, la traduction de Platon de Tivoli d m r e Idgecement du texte de Ptolt5mt!e. Le traducteur oublie d'6voquer le mauvais caractere du vieillad Sous sa pIume, l ' e d m e vieillesse se r h m e essentiellement ii un refioidissement des dkirs et A un ralentissement du corps : rien de tr& nCgatif d'un point de we religieux
a Hosfiigidior, cotporisque motus, grauedo delectationis, & appetitus dimimrtio, necnon & natura festina decfinatio commutmtw: hrrec autem qualitas uitam hominik mi t t rinpedimetztm & trtjtitim* mdicamque rerum sustentationem, propter suorum motuum debiIitatem imprimit.
Voici la traduction exaae, en anglais, du mtme passage dc Ptoltmk : * Now the movements both of b e a d of smI are cooled and impeded in their impukes, enjoyments, d-ires andspee4 for the ~~uturai decline msupervenes upon Ire, which has become worn down with age, &pirite4 weak, easiiy oflended, and hard to pIeare in all situations, in keeping with the sluggirhness of hk movemen&. (Tetrabiblos, dd. et trad. F.E. Robbins, Londces: William Hcinemann Ltd, 1940, p.447).
Cf. Ptol€m&e, Tetrabibla, Cd. et bad F.E. Robbias, Cambridge (Ma.)/tondon: Harvard Univ. Press/ Heinernann, 1980.
90. Honorius Augustodunensis, De imagine M u d , PL 172, Ib.D, c-75 a De aerate m, co1.156. L'ultime recension du De Imagine Mundi, qui date de 1 139, ne pkente a u m e divergence quant aux divisions des Sges et aux ages limites tels que ddfmis au Ib. II, c.78 (cf, V.1.J. FLCNT, Honorius Augustodunensis : Imago Mundi =, Archives d'Hirrore Doctrinae et Littaaire du Mqen &e, 49 (1982): 1 10).
*'. Ibid, 11, c.59 s De homine microcosmo m, PL 172, co1.154; t d flint, p.106. 1 Honorius Augustodunensis, Sacramentarium, PL 172, chap.L, coL773C. M. GOODICH amibue ce texte
il Guillaume de Conches, sans expliquer ses raisons (From Birth, 1989, p.65). Sur le fait qu'il s'agit indhiablement d'une oeuvre d'Honorius, cf. M,-0. GAWGUES, L'oeuwe d'Honorius Augustodunensis - Inventaire critique m, t h e de doctont (texte dactylographit), Institut d'gtudes MCdiCvales, Univenite de
certainement &re mises en parallble ; dans tel cas, les infmtes se trouvent dam lapueritia, les iuuenes dans la iuuenhcr, les protrectiores dans la senecm et Ies senes ciaus l'aetar decrepita.
Dans m e autre oeuvre, intitultk Gemmo Anhae, Honorius h b l i t un parallele entre les h e m canoaiales et les 8ges de la vie, et ofEe la signification spirituelle de chaque Qe. Son point de w e est tds Spscifique : il observe le rythme d'une existence au sein d'une communautt5 religied. Les Qes sont cette fois-ci encore au nombre de six :
Son discours sur les deux iiges de la vieillesse dam ce demier owrage illustre bien la perception toute diff6rente des ages que donne la perspective religieuse, P la di£Erence de la m6dicale. Apr& la iuuentus, oii il est possible de devenir diacre ou pdtre,
a [...I per Nonam, senectutem notamus, qua plerique ex clero ecclesiusticm di@tates quasi graviora vineae pondera subimw. Comenit itaque nos in hac hora Deum magnificute, qua nos voluit super plebem suam d a r e . In Vespera decrepitam ducimus ad memoriam, qua plurimi ex nobis ad rnelioris vitae conversafionem in primis venimus, qui quasi rota vita in for0 otiosi stetimus (Math.. a, durn rota vita in vanitate virinw. In hac hora decet nos Deum Iaudibus exto llere, qua nos dignatus suis hudotoribus a&ungere. mer
Apks les hornem, qui viennent avec la premih vieillesse, suit un temps de kflexion et de penitence correspondant au demier iige. II n'est alors nullement question de sknilitk.
Plus succintement, toujours dans le meme owrage, Honorius explique pourquoi trois lectiones sont faites pendant l'office de nuit I I'aide de la parabole des trois vigiles (Luc 12, 25-38), qui reprdsenteraient les trois iges de la vie :
11 reprend donc ici I'interpr6ation de Oregoire Ie Graud, mais son texte est complktement different de celui du pap.
Monl&l, 1978, p.164~. Cette autewc d&Iarc, au sujet de ce meme chapitre L du &crumentmium, qu'il s'agit de a I'exposition la plus ddtaillde et compkte des correspondances entre microcosme et macrocome que l'on puisse rencontrer dans toute son oeuvre (ibid, p. 169). Voir Cgalernent M.-0. GARRIGUES, L'oeuvre d'Uonorius Augustodunensis : inventaire critique m, Abkndlungen dw braunschweigkchen wksemch@fichen GeseIlschaf 38 (1986): 7-138 et 39 (1987): 123-228.
93. E. SEARS, The Ages of Man, 1986, p.89. 9J. Honorius Augustodunensis, Gemmu Animae, lb.U, c.LIV, PL 172, coI.633. 95. Ibid, c.L,co1.629B. [Sears 1986 p.891.
-Lambee chanoine de Saint-Omer, Liber Horirlus (dl124 121)
Lambert tvoque A divencs reprises le t h h e des 4ges de la vie dans cette oewre encyclopedique. II les associe tour I tour aux saisons ou aux 6ges du monde.
Cet auteur propose aussi la division mivante:
infntiu1 (7 am) pueritial (14 ans) adolescentia[ (28 ans) iuuentur~ (50 ans) senectusl(80 ans) decrepita96
Dam ce demier cas, il a duni la mode de la grauitm et celle de la senectw en un seul et meme 5ge a h de pouvoi 6tabli.r plus aisdment Les comspondauces entre les ages et les saisons. I1 souligne I'instabilit6 de L'enfmce, liliee h l'air et au printemps, la chaleur de l'adolescence, li& au feu et B 1'W. Pour les deux iges suivants, il est question respectivement de s i c m uutumpnus tendenr ad hyemen factus tepidus m, et de hiemps fiigr'dus tendenr ad occanm, gravis factus * tandis que le cinquihme 6ge, I'gge ddcrepit, est associe a la tene.
-Marbode, kvsque de Rennes (t1123), Liber decem capitulonn
Le cinqui&me chapitre de cet ouvrage est consad I la vieillesse, senectm. Aprh en avoir longuement soulign6 les difauts, Marbode explique dam la @etite) deuxieme moitie du passage que, d g r 6 tout, il appdcie grandement cet Qe. Il le dklare meme sup6rieur aux preddents. Revenant sur le theme des maladies qui assaillent cette periode de L'existence humaine, il remarque que chaque Qe ii ses dtfauts ; il mentiome alors l'infm, l e p e r et les iuuenes. Ce qui dome Lieu & la hste suivante des Sges :
%. Larnbert de Saint-Omer, Liber F l o r i ' (fiwsimilti), dd- Albert Derolez, Ghent, 1968, fol-20v, chapitre VI et fo1.23 [Sears 1986, p.67-691.
*. Marbode, Liber Decem CapituIorum, PL 17 I , col. 1703 = Marbode, Liber Decem Cupitufom~, Cd. W . BuIst, Heidelberg: Carl Winter Universittttsvcrfag, 1947, chap.V, p.21. [De Ghellinck 1948, p.501. J. de Gheltinck donne une Iiste diffdrente (puerosl iuuenes (Ievitus peh~fum)( gravitas senif&[ sen=, cf. ibid., p50n.), faisant ainsi d6pendre Marbode #Horace pour ce passage. En M i 6 , le premier ne distingue nullement entre la senectw et un "age mQr vieillissant" ; il affrme simplement, dam son enumdration des avantages du dernier Gge, que : . Pelhr et petdam levitas [sous-entendu "de la iuuentlcs"] g~avitate senili [sous-entendu "de la senectust~, [...I w (col. 17O3C).
Pour expliquer la vision de Itan de la Jhsalem messianique, ceinte d'un rempart dont chanme des quatn kes est gamie de trois poae~ (Apoc. 21.1243). Bnmo &o~ue Les quatre iges de l'homme car le Seigneur rrcevra les convertis de tous les aes.
-Werner, abW de Saint-Blaise en For& Noire (t1126)
Dam un sermon oh il souiigne la n k s i t t 5 d'itre toujours @i B recevoir le Seigneur, car la mort peut survenir n'importe quand, Werner evoque tous les tiges de la vie :
Expliquant dam un autre texte la parabole des oUMiers de la vigne (Mrttk 20,l-16)' il offie une Liste Idgixement diff&ente :
pueritia 0 adolescentia 1 iuuentus 0 senectw 0 decrepim ~ e t a s ' ~
La suite imm6diate de son horndie indique qu'il fait commencer l'udzdescentia B la puberte, donc vers 15 ans ; la iuuentus est synonyme de maturu aetas, alors que l'adjectifrnatunrs Ctait jusqu'alors plus sowent utilis6 pour les ages subsequents ; la senectus s'appelle Cgalement 1'aeta.s iam dec2inan.s ad senium, tandis que le seniunt bentificie de la dknomination ultima senectus.
-Rupert de Deub (t 1 129), Commentaria in Apocal'im (1 105-1 126)
A la suite de Bruno de Segni, Rupert, professeur A l'abbaye de Saint-Laurent de Li&ge puis abE de Deutz, expliqua les quatre portes de la J6rusalem messianique de Jean ( A m 21,120 13) 8 l'aide des quatre ages de l'homme :
-. Bruno de Segni, Expositio in Apoca&'"sin, PL 165, Ib.VJI, c21, co1.722. [Sears p.89-901. 99- Werner de Saint-Blake, Sermo de Adwentu Domini, PL 157, co1.733B-C et co1.734B-C. loo. Werner de Saint-Blaise, Dominica rertia in s e p t u a g a i . Deflorationes SS. Patrum, Ib.1, PL 157,
co1.844A-B. lo t ' . Rupert de Deutz, Commentaria in Apocabpsim, PL 169, IbXII, cXXI, col. 1 197. [Sears l986,n.34,
p. 1871.
-Guillaume de Conches (tc1154-1160), De Philosophia M d i (entre 1 120 a 1 130)1m :
prima aetasi iuventusl senectusl senium
Guillame de Conches analyse dam cet ouvrage les aptitudes intelIectueIIes de l'homme I chaque 6ge de la vie, en tenant compte de L'inauence des humem. Il en conclut qu'il n'est pas possible d'apprendre 101s du premier glge car le cerveau est enfumt par diverses vapeurs s'dlevant du corps ii la suite de la Gute originelle. En revanche, Mge ideal est le second, la iuuentus. Lors de la seneem, la mboire est toujours vivace mais le corps commence B dkliner. Pendant le senium, la mdmoire perd de sa puissance avec l'augmentation du flegme a l'homme devient p d . Guillaume tient un discours ii peu pr6s identique dans un autre ouvrage, le Dragmaticon ( d l 4 4 1 lSl)t03.
-Hupes de Saint-Victor (t 1 141)lM, Elucidotiones :
infantian pueritial adulescent~ iuuentus 1 uirilis aetas 1 senectus
A la suite de C6saire d' Arles, Hugues de Saint-Victor interpkte le premier miracle du Christ, la transformation de six outres d'eau en vin aux noces de Caaa (Jn 2,l-lo), cornme la sanctification par le Christ des six iges du mode et des six iiges de l'homme. Il montre que la vie n'est qu'un long apprentissage au cours duquel I'homme apprend progressivement B
Guillaume de Conches, De Philosophia Mundi, IV, 35-36, PL 172, co1.99 [Sean 1986 p27-281 ; je n'ai pas pu consulter la plus nkente edition, avec traduction allemande, par G. Maurach et H. Telle (Mtoria, 1980)- M. GOODICH soutigne les similitudes entrc ce tcxte et les Elementorum phifasophiae libri qw~tlcor (dditds dam PL 190, col.1150 et 1 178) en ce qui a trait au &&me des ages (From Birth, 1989, p.66). Le fait n'a rien d'dtonnant compte tenu qu'i1 s'agit d'un seul et &me ourmgc, mais Wit6 A partir de deux manuscrits diff6rents (cf. art, Guillaumc de Conches D, Rep. Font., V (1984): 298).
Im. Guillaume de Conches, Dragmuticon, ddite sous le titre de Dialogus de substunti~p/Irsick, Strasbourg, 1567, r&d. Frankfiut a Main: Minerva G.M.B.H., 1967, p. 31 1-12 ; une dddition est p&we tr& prochainement dans le CC CM par Italo Ronca, M. GOODICH remarque que ce soi-disant dialogue entre Guillaume et le duc de Normandie et comtc d'Anjou (Geothy V Plantagenet, duc de Nomandie de 1 144 1 150) a may be regarded as a close predecessor of such encyclopedists as Vincent of Beauvais (From Birth, 1989, p.66).
lW. Je n'ai pu tmuver A qui il Wlait attniua Ic De batik et aliis rebus, qui est Cdit6 dam la PL 177 parmi les oeuvres de Hugues. Ce demier ne doit pas en &e l'autcur puisquc cet k i t n'cst ni mentionnt! dans l'atticle du RepFont. qui lui est dCdiC (V (1984): 594-603), ni CnumCr6 dans Ie ct5pertoh des krits d'Hugues Ctabli par P. SICARD (Hugues de Saint-Victor et son dcoie, Turnhout: Bcepols, 1991, p273-78). Ce texte, qui s'inspire duectement d'Isidore, jusqu'A repreadre les explications de I'6veque de Stville sur le pourquoi de I'insertion de I'aeras senioris ct I'Ctymologie trZs negative de senes attriiuee aux pirysici, donne comme liste des dges : infanrial (7 ans) pueritiul (14 ans) adolescential (28 ans) iuuentrcsl (50 ans) vir* grmifusI (?) senecrus (Ib.111, c.6 1, PL 1 77, col. 132). Le demier ige est dtbut6 par erreur par l'auteur a 50 am.
se rappmcher de Dieu. De ce point de we, le dernier stade avant la mort est le plus accompliio?
Dans son d18bre owrage, le Didacalion (fin des annth 1 120), il traite egalement du tMme de la vieillesse'". Il mentiome des exemples de vieillards f'ameux ayant produit des chefs d'uewrc & des 4ges tds avanck Son ton est essentiellement dtfenss laissant supposer que, cians le milieu estudiantin m e n dont Z &it un des grands mAtres, un certain rnepris face i la VieiIIesse etait souvent de rigueurl"? L'autM suivant, AMhd, o f k d'ailleurs un bon exernple d'uae semblable attitude*
-AbQard (f1142), Erpositio in Hexuemeron :
infmtia! pueritial adoIescentia~ iuuentus, *id est virilis aetas 4 senectusl . senium vel decrepitas aetas dog
Abdard se base sur la metaphore augusthieme des iiges de la vie mais modifie la signification spirituelle des diffhntes &apes. Sa description des trois premiers stades de l'existence est tds dure car il montre I'Stre hurnain jusqu'i l'adolescence c o m e &ant peu diff6rent d'une Ete. Suit la iuuentus, qui est I'ipoque des prophiites et le seul age dont le portrait ne soit pas sombre. Le monde ensuite vieillit. Alors qu'AbeIard avait hitidement donne six gges, tant pour le monde que pour l'existence humaine, il escamote d m sa description dCtaill& la senectus, ce qui lui permet d'offiir un portrait t&s sombre des andes qui font mite h la iuuentw :
a Quinta aetus quasi senium rnundi defecturn prueteritorum bonorum designat, cum jam patrimchae et prophetae praeteriissent, atque unctio ad alienigenam tram$erretur, non jam pristino ria sacr~cium ceIebraretut, quod etiam Babylonica caplivitus abstulerat. In hoc quidem senio jam mundo lunguescente missus est Salvutor, qui veterem renovaref hominem, bapti.smum praedicmet : in quo quidem bcrptsmo homines veterem hominem depnentes, et no- induentes, L.. ] .Io9
'OS. Hugues de Saint-Victor, Elucidhtiones variae in scriphrrm moraliter, Mkcelhnea, lb.1, titLXXXU, PL 177, col517-18 [Sears 1986 p.78; sur cette interpdtation de la pacabole par divers auteurs avant Hugues, p.69-741. Une lecture identiquc du miracle se trouve dans les Allegoriue in Nouum Testamenrum de Hugues (PL 175, ~01.75344).
Ia6. Hugucs de Saint-Victor, Di&dicon - De Snrdio Legedi A Critical T-, dtd C.H. Buttimer, (Studies in Medieval and Renaissance Latin, X) Washington: Catholic University of America Press, 1939, livre m, chap.14, p.65-67 = Didoscalicon, intro., trad. et notes par M. Lemoinc, Paris: &. du Cerf, 1991, p.149-51.
Im. A ce pmpos, cf. R SPRANDEL, Altmschihal wdAUwsmora1: die Gerdichte d 4 Einstellungen zum Altern nach der patisw BibeIaegese a h I 2 J 6. J&huttriirts, (Monograhien zu Geschichte des Mittelalters, 22) Stuttgart A. Hiersemann, 198 1.
la. Abdlard, Epositio in Hexaemeron, PL 178, co1.772-73. [Sears 1986, p.771 IW. Pour un autre exernple du discours particulitrement negatif qu'Ab6lard tenait sur la vieillesse, cf. sa
description de son ancien maitre, Ie senex Anselme de Laon, dam ttHisroria Calamitatum (texte critique avec
Ainsi, le thhe augustinien est clairement modifid : le Christ est apparu au c o w du demier &e, non parce que l'homme Ctaa enfin pdt I le recevoir, mais parce qu'il etait trop d6ghM.
-Guillaame de Saint-Thiey (7 1 148) :
adolescencia~(25130 aas) imenftrsl(35/40 ans) senectus~(55/60 ans) senim
Guillaume 6voque les Qes dans me prspective rnddicale : il expiique Mat du corps humah awc divers stades de la vie selon la pPCpondhnce d'une des qua- humem- Son dtkoupage du cycle de la vie est identique celui de Iohannicius dtuditi p&6demrnent1i0.
&lien tie Vkelay (~1080190-cl l60/6S), Sennones (1 13 8-1 161)
Dam son sermon numhtd XVII, Julien associe le d6mon ayant attaque la fille de la Canam5eme [Mutth. 15 f lw.] au demon du midi qui se jette plus spkialement sur les a jeunes m, c'est-&dire sur les individus dont l'sge est Cgalement associd au mitan de la joumk. En effet, l'adulescentia ou iuuentus - il s'agit d'un seul et m h e 4ge car, explique Julien, Salomon a ddcld a Laetare, iuuenis, in adulescentia tua [Eccl. 1 1.91 - est 1'6ge central, prdc6d6 des deux premiers, l'infmtiu et la pueritia, et suivi des dew derniers, la senecfus et le senium,
D'autres demons attaquent Ies hommes du matin et cew du soir, mais ils semblent tous etre sp6cialis6s dam le piche de la lwure. Julien traite ensuite, pour quelques lignes, d'un theme cher aux auteurs chetiens, soit les vieillads lwcuriewc.
-Jean Beleth (mi me), Summa de ecclesiasticis oici is :
intro. par J. Monfiin, Paris: Vtin, 1978, p.68-70). 'I0. Guillaume de Saint-Thierry, De natwa corporis et a n h e , t e a et trad. Michel Lemoine, Paris: Les
Belles Lettres, 1986, c.4647, p.120-22. "I. Iulien de Vbclay, &mom, nOXW, 1.18 1-85, Cd, trad. et comm. D. Vomw, t.11, (SC 193) Paris: ~ d .
du Cerf, 1972, p.364-66. 'I2. Jean Beleth, Summa de eccIesiasricrj uflciis, c z h , dd. H. Douteil, (CC CM4 1A) Turnhout: Brepols,
1976, p.47.[Sean 1986, p.891.
A la suite de Wgoire puis d'Honorius (ct supra), Jean Bdleth, professeur B Paris, explique ies trois lectimes de Soffice de nuit par les trois Hges de la vie au cours desquels I'homme doit 6galement veiller pour ne pas &re surpris par le d€mon.
Powtant, dam un autre parsage du m b e ouvrage, Jean expliqye qu' il y a sept Hems dans le jour pour Iouer le Seigneur paras que I'homme a sept Qes et il doit se toumer vers le Seigneur au cours de chacun d'entms eun
Dam la phrase qui suit, il reprend cette liste, mais le skierne &ge devient la decrepita et le septitme a compIetoriumfinis nostre rcire *. II ne faut donc pas attacher trop d'importance a cene t d s exceptiomelle division par trois de la vieillesse.
-Manuswit d90xford associ6 avec 19icole de Laon @IF siecle) :
infantia[ (7 am) pueritiul(14 ans) adulescentia~ (28 ans) iuuentushirilis aetas 1 (56 am) senectwl l4
Dans un manuscrit de la Biblioth6que B o d l h e #Oxford (Laud. Misc. 277), melange vari6 de divers textes associc5 a l'icole d'Anselme de Laon, se trowe une description des six 5ges de la vie : l'accent est place sur les transformations physiques prenant place B chaque iige. L'homme a ses dents adultes h sept am ; la pubertC (la premi8reY c'est-&-dire celle du bas du corps, inferior pubes) commence a 14 ans ; A 28 am, mais I la suite de changements importants qui prirent place d& 21, la puberte tennine sa progression (transformation du haut du corps ou dewcii5me phase de la puberte : superius pubescit) et i'homme s ' d t e de grandir ; toute croissance prenant place ap&s 28 ans est superflue115, mais la force (uirtus) ne decline pas avant 56 ans. L'auteur conclut de cette fluctuation de la uirw que : a virilis enim etas similis est cum iwente .. Il confond donc I'iige moyen avec la iuuentus, tout comme AMlard et, probablement, Robert de Melun, mais d la diffkence de Richard de Saint- Victor,
"'. Ibid., ~28% p.55. 'I4. D.O. L O m , a Nouveaux fragments thdologiques de I'Ccole d' Ansehe de Laon - Deux manuscrits
d'Oxford m, Recherches de thioiogie amienne et mkdibde, XW (1947): 20, #452 "De dbtinctione etarum". lIS. On retrouve une id& similaire dans Ie De genwrrbne el comqtione d'Avicenne, son troisitme des huit
trait& de la Physique, traduit seulement ii la fin du ?UIXe siecle : quia senex, postquarn cessat in eo uugmentatio, impinguabitur, simt macrescit if!e qui crescit pando est in onnk augmenti w (Avicenne fatinus - Liber tertius nuturahn de generatione et corruptione, dd. critique S. Van Riet, intro. G. Verbeke, Louvain-la- Neuvekeiden: E. PeetersfEJ. Brill, 1987, chapitre WII, p.79).
-Tractatus quidam de PhUosopMa etpattibus efus (XIIC s.)
Selon I'tditeur, G. Dahan, ce texte serait d'orighe chartraiae, avec m e certaine influence victorhe, a daterait de la deuxierne moiti6 du We sf ".
Dam un premier temps, L'auteur essaye de fa& cornspondre les six ages de la vie humaine avec la thbrie des quatres humems. Il dome ainsi m e p n m i k liste a secundum quosrlmn. :
infantiu[ (7 am) pueritial (15 ens) aduiescentia[ (21 am) iuuentusl (32133 ans) uirilis uetasl(50 am) senectwl(80 ans) seniun
A la diffirence des dSnitions vues prOcedemment, Ia iuuenttls a W tronquk d'une bonne partie de sa d d e , s'intemmpant maintenant t&s t6t pour laisser place au uirilis aetus.
Dam un deuxieme temps, l'auteur dome cette meme liste mais 6courtde de teue sorte qu'elle puisse correspondre a w quatre saisons et humeurs a seamdurn alios * :
[infmtiu + pueritia] 0 [adukscentia + iuuenh~r] uirilils aetas 0 [seneclu~ + senium] ' l7 I1 se justifie de placer l'adulescentia avec la iuuentw pa. la fameuse citation de Salomon ( E d . 1 1'9) : a Laetare imenis in adolescentia tua m. Pour m e raison mcile ii cemer, le demier age est appel6 uirilis aetas tout comme le troisikme : a tettiu, id est uirilis e ta , mansit indiuisa ; quartam, id est uirilem etatem, in senectutem et decrepitam etatem. r
-Robert de Melun (f 1 167), Sententie (1 1 52- 1 1 60) :
infantilis etas1 pueritia adoiescentia 1 virilis etas! senectus~ 'himiurn vel etas decrepitas" 18.
Comme AMlard, Robert propose une nouvelle interpdtation de la cornparaison augustinieme des ages de la vie et des ages du monde, donnant lieu ii me perception trks negative de la cinquitme &ape, la senectur. Sa critique est fond& sur les theories mddicales associant le fioid et I'humiditC i la vieillesse. Sous l'influence de ces dew "qualit6s1', les hommes deviement peu enclins au Bien, mais prompts B fairr le Mal. Ce portrait est en violent contraste avec celui de la p6iode p&t!dente (uirilis aetar), au cours de laquelle culte divin et structure politique (royad) se dCvelopp6rent vigoureusement et, semblerait-il, idtidement. Le senium est simplement ddcrit c o m e la £in de l'existence, la pueritia et
'I6. G. DAHAN, 8 Une introduction il la philosophie au MIe s- : le Tractatus quidam de Philosophia et partibur eiuc a, Archives d'Hisoire Doctrinale et Lifthaire & Mqyen Age, 49 (1992). p. 155.
I". Ibid., p. 184-83. ". Robert de Melun, Sententie, voI.1, Ib.1, pars I, c.XWI, dam Oeuvres de Robert de Melun, t.III, dd.
Raymond M. Martin, Louvain: Spicilegium Sacrum Lovaniense, 1947, p202-04. [Sears 1986, p.7q.
l'dolescentia cbmme les &es au murs de~quels d t progressivement la raison, dots que l'infma est violemment critiqude amme m e pcliode dCpourvue tie raison et de parole.
Cet auteur cistercien ne mite pas I proprement parler des 6ges de la vie en un chapitre spkifique mais il6voquc ces @es tout au long de son oeuvre. Dans son livre Compendium spemli chmitutis, il dt?£i.nit la cinquanti5me arm& de la vie de l'homme comme celle de la plCnit~de~~'. L'homme est enfin en parhit contr6le de soi, il a perdu la concupiscence, il a atteint 1'Hge de la pldnitude spirituelle.
Dam la Genecrlogicr R e g m AngIorum, Aelred 6voque le f ~ t qdil ait grandi aux c6tts d ' H e ~ , fils du roi David P d'lkosse. II cite alors tous les gges de la vie habituellement mention&:
pueritia 0 adolescentia[ iuventusl aetas senilis
a Cum quo ab ips& cunabulis vin' etpuer cumpuero crevi, njus etiom adolescentiam adolescens agnovi, quem juventutis jlores pulsantem sicut pattern mum quem praecunctis mortalibus dilexi. jm senili /lore fugentem, ut Chn'sto servirem, corpore quidem, sed nunquam mente vel Mectu relitpi. J20
Le participe-pdsent "pulsanteml' dvoque la violence ma1 contrblk, caractdristique des iuuenes, opposde ii la calme puissance des senes. Autre image symbolique significative, Aelred place sa conversion lors du dernier ige.
Dam son ouvrage Quund Je'm mait douse am, il dkrit A dew reprises au moins l'attitude de la socidt6 selon les groupes d'ige, ce qui donne lieu aux dew listes suivantes : peril iuuenesl senes etparuuli[ adolescentes~ ~enioresl~~. Dam le passage o~ la premikre division est domee, Aelred parle ensuite de peri l uiri, c o m e si la somme des iuuenes et des senes dgalait le groupe des uiri?
" 9 AeIred de Rielvaux, Compendium speculiccwitatb, c.?UII, Cd. R Vander PIaetse, (CC CMI) Opera omnia, I , Turnhout: Brcpols, 197 1, p. 192-93.
Is. Aelred de Rielvaux, GeneaIogia Regum Anglorum, PL 195, co1.736. I2'. Aelred de Rielvaux, "@and J&us art douze am...", intro. et texte critique A. Hoste, trad. Joseph
Dubois, (SC 60) Paris: kd. du Ce* 1958, I,S,p.5658 et &16,p.84. k n'ai pas inscrit c a deux listes dam le tableau I car on ne peut Ctre tout A fait certain qu'elk sont compl5tes.
Stupent senes, juvenes admir~ntur, et suae runt aetatrj pueri. morum gravitate et sermbnum iUiw pondere deterrentur- [..,I Senes osculantur, cnnplectuntur juvenes, pueri obsequuntur. Et quae lacrimae a pueris, cum diutius a virk teneretur ? w (Aelred de RieIvaux, "Quand J h . ..", 1958,1,5,p.56-58).
L'auteur d k i t la pafixtion de L'univers par la voix de la Nature. Dam le passage o~ il mentiotme les @es, i &que les simiIitudes entre le d6veloppement du corps humain, le deroulement d'une journde et 1'6coulement des saisons. L'aurore et le printemps sont associk au premier be, le milieu du jour et l'ete au deubhe, les Nonnes et I'automne au troisitme, le soir et l'hiver au demier. Les dew verbes ddpendants de chaque ige sont respectivemat :
Iascivio + orior progredior + perficr'o 1 naturesco + compleo l canesco + inclino. Aiaj si la iuuentus correspond B un iige de perfiectionnernent, c'est en revanche la uirilitas qui r e p h t e le niel achkvement du dtveloppement de l'homme. Quant B la senectus, elle ea d6Wtivement I'iige du ddclin, marqub par le h i d et la blancheur. L'auteur &ant Kgerement plus prolixe pour cet ige, je retranscris ses dires :
a Aerate quoque in occidem inclinata, jam vitae vesperam senio mntiante hiemde ge1icidium senectutis, horninem suis cogit albicare pruinis.
-Richard, prieur de Saint-Victor (i 1 173), tiber exceptonurn :
infmtiaa pueritia 1 adolescentia 0 iuuentlcs[ aetm virilis 1 senectus
Richard a repns Sinterpdtation augustinieme des iiges de la vie bade sur la cornparaison avec les iiges du monde, comrne l'avait fait Hugues de Saint-Victor, son maitre. Le sixiiime iige de la vie est celui oh l'homme aspire aux choses etemelles, de m h e que le sixi8me 5ge du monde est celui de l'avknement du Christ et donc de la gtiiceIu.
-Romuald, 6viique de Saleme (t 1 18 l), Chronicon (ou De aetatibus) (~1178) :
Infantial (7 ans) pueritiai (14 ans) adolescentia0 (28 am) iuuentusl (50 senectusl (79 am) etas decrepitas'*
I*. Alain de Lille, De pfancu Naturae, dans The Angf01L4tin Satirical Poets and Epigrammatrjts of the Twelfih Century, vol.tT, €d, Thomas Wright, (Rolls Series, 59R) London: Longman & Co., 1872, prose 3, p.454. [Sears 1986, p36-37, L'infontia n'est pas dircctement mentionnde comme le premier Sge : il est simplement fait mention du p ~ t e r n p s de l'homme ; mais puisque I'auteur parlait deux phrases plus haut de l'infantia du printemps, jc me suis pennis d'utiliser cette tenninologie.
lZ4. Richard de Saint-Victor, Liber exceptionurn - Affegoriae in Novum Testamenturn, lb.1, c.11, PL 1 75, ~01.753-54 [Sears 1986 p.781.
Is. Romuald de Salerne, Chronicon, De aetatibus -, CA, Garufi* Remm italicmrn scr@tores, t.Wl, Milan: CittA di CasteIb, 1725, p.5 [De Ghellinck 1948, p.57, Archarnbault 1966, p.209 et Sears I986 p.631.
Romudd Ctablit la cornparaison augustinieme entre les ages de la vie de l'homme et celle du monde. Son texte est trb proche de ceIui de BWe.
-AViceme (980-1037), Liber C ' n i s (traduit par G&ard de Cdmone, dans le dernier quart du We sikle) :
- etas udhofeendi (ou etas ad0Iescentie)l (30 am) etas consi'stendi (ou etas pu2crirudinis)l (35/40 am) a etus mfnuendi cum v i m non ahi t t i tw * (ou etas senechrrrs)l (60 aas) a eras rnimendi cum mun~estu uirtutis debilitale * (ou eras senium) 126
La perception des gges d'Aviceme est assez proche de celles exposdes dam le Pantegni ou dam l'hagoge. 11 associe aussi la p6riode de la itiuentus au sommet d'un demi- cede et souligne que cet Q e est appele aetaspulchn'tdinnis. Le temps qui lui est assignt! est t res court, de 5 a 10 am, tan& que la vieillesse (aussi bien la senectus que le senium) commence particulikment jeune, cornpa& aux 5ges nodemen t avancds par les auteurs occidentaw. Le livre d'Avicenne, comme tout livre de medecine abordant le Wme de la vieillesse, ne met pas seulement l'accent sur la faiblesse inherente au vieillard ; il insiste aussi sur son &at de dependance loa de 1'6numiration des soins qui doivent lui Ztre administ& pour maintenir son corps en s a d n . Dam ces texts arabes, dont le point de we est avant tout medical, la description de l'&olution du corps hurnain i travers les iges n'est faite que sur le plan physique. D'ailleurs les termes utilises pour designer les 6ges sont 6vocateurs ; ils ne parlent que du corps. Les auteurs n'attachent aucun intMt au point de w e spirituel ou tout simplement mental. La description des 6ges par Avicenne eut beaucoup d' inf hence par la suite128.
Dam un autre de ses ouvrages, le De mima - traduit celui-ci a Tokde, a sans doute ap&s 1 150, par l'archidiacre Dorninique Gundisalvi ou Gundissalinus, avec la collaboration d'un savant juif, appeld Ibn Dawud . -, Aviceme &toque l'impact de l'humidit& sur I'esprit de I'homme. I1 en conclut que les enfants sont seuls douds d'une excellente memoire ; il semble cette fois-ci ne mentiomer que trois groupes &age pueri (= infaates et pueri) I iuuenes 0 senes :
a Unde pueri qucmtvl's sint h i d i , tamen firmiter retinent : animae enim eortmt non occupantur circa qune occupmtur unimae magnorum, nee movenhu- ab eo in quo stant ad aliud ; iuvenum mrtem propter calorem s u m etpropter motus sum agiles, qumnvis c o m p h ~ o sitsicca, tamen memo& eorwn nun est sicut memoria infantiurn
Is6. A v ~ c ~ M ~ , Liber Canonis, Ib.1, fen.& docm, c3, trad- de Gdrard de Cdmone, 1473 purrow 1986 p23 et Sears I986 p29-301. Sur Gerard de Crdmone, cL D. JACQUART et F. MICHEAU, La mgdecine arabc.., op-cit-, 1990, p. 147-53.
In. Avicenne, fbid* lb.1, Fen-n1, doc-III, c.l-6. I". LA. BURROW* The Ages ofMan, 1986, p23-
et puerorum ; senibus vero accidit propter humorern qui praevalet in eis non memorare ea quae vident. .I*
-Godefroid de Saint-Victor (t ap. 1 194), Minocosmus (c 1 185)
Dam cet ouvrage, qui est un commentaire allCgorique du dtbut de la GenK, Godebid souligne les comspondances classiques entre les 5ges de la vie a les ages de l'homrne :
infantial pueritial addescentia~ imentusl senectusl decreptiu aetd30
infrmsl puerl adolescensl iuuenisl uir 1 senex"'
Dam le passage dont est extraite cette liste, ~berhard essaye d'expliquer, a la mode d'Isidore, l'btymologie de chaque terme selon les caracteristiques propres de chaque iige.
infanta1 pueritial udulescentia~ iuuentus~ senectusl ~en iurn '~~
Dans sa premiere kvocation des six iiges de la vie humaine, Sicard evoque le lien entre les sept heures canoniques et les sept Hges, le septieme dquivdant B la fin de la vie. Dans sa seconde evocation, il dtablit Ie parall2le entre les sept dimanches du septuagdsime, les iiges du monde et les iiges de la vie. Sa description de la iuuentw, le quatri2me Sge, est extr6mement louangeuse puisqu'il s'agit de l'ige des Proph8tes et du dgne de David. En revanche, l'iige qui suit, la senectus, est d%te en des termes t& sombres : elle est associee B la destruction du Temple et ii l'exil ii Babylone. La description du dernier 6ge est escamotde : il correspond ii la venue du Christ sur terre.
Is9. Avicenncr latinus - Liber de anima seu sexrtrs de natwaiibus, IW, t5d. critique S, Van Riet, intro. G. Verbeke, Louvain-la-NeuvJteiden: gd. orientalistes/E JJ Brill. 1968, p. 1 et IV,iii,p.43.
130. Godefioid de Saint-Victor, Microcosmus, ed. et comm PI Delhaye, LilldGembloux: Facultds catho1iquedLib. Duculot, 195 1, p.40-41.
13'. ~berhatd de Bdthune, Graecrhw, Cd J. Wrilbel, Copus grmmaticalum Medii Aevi vol. I , Bmelles, 1 887, C. XII, v.36-49, p, 104-05,
132, Sicard de Cdmone, Mipale, PL 172, lb.W,c.iii, col. 160 et Ib.VT,c.viii, ~01.273-74. [Sears 1986, p.891
Cette section pork sur un &&me d'une importance capitale pour comprendre le monachisme cluukien, le noviciat. Si je rel@~ ce =jet en amexe et ne le traite pap dans ma t h h , c'est qu'il n'est pas directemat dCpendant du thhe des @es de la vie. Mal@ tout, je ne pew Pignorer : A Clmy, division des &es et stmctme bihhique &aient intimernent lides ; or, pour app&ender la sccondt, m e &flexion sur le mode d'entr6t dams l'abbaye bourguignome est incontournabIe.
Les sources employ& pour cette recherche sont celles p r h n t k s dans les autres annexes de cette Wse, soit les Yitae, mak surtout Ies coutumiers clunisiens. le rappelle bri&vamnt la liste de ces demiers. Les plus anciem sont les Connetdines dcpd'bres (CA), cornpods entre 990 et 1015, et dont subsistent les manuscrits B et B'. Le Liber tramit& (LZ) fbt d i g 6 en plusieurs &apes, la majeure paxtie sous le &we d'odilon (994-1049), dans les am6es 1030-1040, la demih vers 1050-1060'. Au debut des a ~ & s 1080, pendant l'abbatiat d'Hugues de Semur, Bernard de Cluny et Ulrich de Zell ecrivirwt chacun un coutumier clunisien, le premier (Ben) pour usage interne, le second (UAl*) destine a l'abbaye d'Hirsau desirruse de s'inspirer du mode de vie clunisien pour composer ses propres coutume8. On compmd encore maI quelle filiation exktait entre ces deux oeuvres, d'oi~ pmviement les nombreuses sections qu'elles ont en commun et poutquoi elles ftrent redigees presque simultan~ment. Pour expliquer ces points, j'ai propose ci-dessus, dam la pr&entation en amexe de ces deux sources, une hypothese &s dB6rente de celle avancee par WolIasch en 1993, dam son article des F&mi~eZaIterliche Studien : l'oewre de Bemard aurait W compos6e B la demande de Hugues, pour o m une version clunisieme officielle des coutumes et comger ainsi ies errem transmises par la version tds persomelle et assez libre d'Ulrich. Venant apr& Wdal., le Bera en aurait donc reproduit de nombreuses sections, mais en y incorporant des d6tails et remaniements jug& nbcessaires. Quoi qu'il en soit, l'important pour cette section est surtout d'admettre ce qui semble @ par tous, c'est- &-dire que le texte de Bernard est plus repnisentatifde la &lit6 clunisienne que ne l'est celui d' Ulrich.
Sur la base de ces divers krits, je dhoatrerai que le noviciat n'existait pas B Clmy avant l'abbatiat de Hugues de Semur (1049-1 109) ; il me faudra dots dkrire dam quelles conditions un postulant adulte &it incorpor6 dans la communautC clmisieme avant Hugues. J'ktudierai et expliquerai easuite les particularit& et divergences du noviciat institud a Cluny dam la deuxi&me rnoiti6 du XIe sikle car il W'Srait notablement de celui d6fini par Benoit dam sa regle. Mais avant d'aborder ces dBi5rents points, une ddfinition du noviciat et un rapide survol historiographique du sujet sont nkessaires.
En thiorie, le noviciat monastique est la phase initiale que doit traverser tout aspirant adulte B la vie chobitique. I1 remplit deux fonctioas : o E r au postulant la possibilitd de
I . Sur la datation extremement complexe du LT, dont les parks les plus ancie~es datent du tounxint de I'an 1000 et les plus dcentes des anndes 1050-1060, cf. l'introduction dc P. DMTER au LT, p-fii-hi.
2. 1. WOLLASCH, a Zur Verschrifilichung der klasterlichen Lebensgewohneiten unter Abt Hugo van Cluny W, FriihSt., 27 (1993): 3 17-49.
tester son aptitude ii se plier B ce noweau mode de vie @robation) et Ie former aux us et coutumes du lieu (formation)? Ceci pod, il ne h u t pas mire quc tous Ies rnonast&es du pass6 ont imp& M noviciat B lem noweIIes rrcnws, ni qye tous les noviciats ont toujours satisfait aux dew objeaifs de probation et de formation. Il se trotwe des noviciats dont la foaction principale est d9Cpmuver l'aspirant d sa pedvbuce, d'autres qui ne lui laissent auctme cbance de revenir sut sa W o n mais le foment ii sa nouveUe vie. L'etude de Cluny donne L'occasion d'observer toutes ces aIternatives,
Pour powoir afEirmer qu'il y a noviciat dans un monasth d o e je considke que certain= conditions minimales doivent &re renrplies : il hut que Ies noweaw venu~ aicnt d6jh int@r6 Ie cloitre et qu'ils soient de plus consid& comme formant un groupe distinct du reste de la cornmuaaute. Par cowdquent, ni les jours ni les semaines que les postulants passent A la porte d'une abbaye a m By &re accept& ne p e u k t constituer, B eux seuls, un noviciat Par ailleurs s i me fois en*, Is nouveaux Venus n'ont aucunement la possibilitC de repartir et mhent me vie identique, & de minimes details pds, i celle des moines de l'endroit, alors, dam ce cas non plus, on ne peut parler de noviciat J'inclus dans cette demik categorie le cas de figure 06, pendant un certain laps de temps avant la profession, la cornrnunautt observe sa demi&re recme pour la jauger, sans accorder en retour 9: celle-ci la meme libertd d'observation et de dkision : en effet, la possibilitf pour un abM de rejeter me brebis galeuse existe toujours, mSme apres la profession4 ; cette pratique ne peut donc, 5 elle sede, sewk ii ddfinir le noviciat.
Les sp6cialistes du monachisme m6dZvaI ne se sont gutre pench6s sur le sujet du noviciat, mis i part quelques articles dans Ies dictionnaires traitant de religiod et divers ouvrages sur les cMmonies de benddiction etlou profession6. Cette attitude des chercheurs
'. Cf. I. LECLERCQ, art, Noviziato W, DIP, 6 (1980): 444-45. Beaucoup d'auteurs ont consid&& que Ie noviciat consistait essentiellement en une pdriode de probation mais I'exemple clunisien, parmi d'autres, rnontre bien qu'une teile ddfmition est inacceptable.
'. D'apds la RB par exemple, un abM derneurt toujours hire de rcjetcr de la communautt5 un membte r€calcitrant ct imphitent (RB, 26,608). Dam ses Hbtoriae, Raoul Glabcr (~990-1046/47) cxplique avoir dt6 rejet6 de son monast&re suite & sa mauvaise conduite, plusieurs annW a p e avoir €16 admis comme oblat A I*&e de douze ans ; trb probablcment, pIut8t que d'&e renvoyC au sikle, il fut mutt5 vtrs une autre communaut6 et y accupa m e position infdricwe & celle qu'il occupait pdcddemment, cf, Hkto r i im Libri quinque, a. N. Bulst, I. France a P. Reynolds, (Oxfiord M e d i d Texts) Mord: Clamdon Press, 1989, V,3- 4,p2 18-21). Dam les diverses Yitue d'Hugues, il est aussi question d'un fire dc la Charit&, nCcromancien et mechanicus (manichtcn ?), qui fit chasst5 par le saint (cf. YIF I,xvii,p.67, YH' III,l6,co1.870-71 et K@" viii,p.lZS-26) ; Rcnaud de V€Aay dome une version un peu diffhnte, f k m t simplcment du moine *hew un faux pdtrq qui s'enfirya plutdt que dc se pliw 8 lit pCnitence qui lui h i t impode (W xxv,p.50).
'. Cf. art. a Noviziato D, DIP, 6 (1980): coL 44260 (article Ie plus complct sur le sujct, par J. LECLERCQ = Nella storia della spiritualit& ID, co1.442-48, et A. BOM Lcgklazione w, co1.448-60). Voir aussi 8. JOMBART, art. Novice W, D.D.Gm, VI (1957): 1024, L. KOSTER, art. a Noviziat v, Lexikun@ Theofogie und Kirche, 7 (1962): 1064, Lo-E, GHESQUIERES, art. u Noviciat *, Cath, TX (1982): 1436-37 et A. ROTHER, art. Noviziat m, kU., 6 (1993): 13 1 1-1 3 12.
6. Cf. entre autres P. HOFMEISTER, a Benediktinische Professtiten w, Studien und Mitteilungen nrr Gachichre des Benediktinemrdem und seiner Zweige, 74 (1 963): 24 1-85, Richard YEO, nie Structure and Content ofMonastic Projkssion, Rome, 1982 (Studia Ansetmiam, 83), B. THMERGE, Le rituel ckrtercien
ne doit pas bmercar elle ne fhit que reflk 1'Ctat des sources. Dans une conf&ence d o h i Toronto en fCMig 1992, je m'etomais du siIence des moines qpi, avant la deuxihe moitik du XIe si&le, n'abordent pnsque jamais la question du novicid . Si, apds la &ation de Citeaux et tout Spccialement alffk l'essor des otdns mendiants, les trait& adrrsses aux novices a lerns abondent, il n'existe en revanche aucun owrage de ce type avant la fin du XIe sikle. Je rn'ctais intenogk sur Ies raisans & ce silence, sans p e n i r vraiment B l'expliqua. L'&ude d'un onhe do~mt, Cluny, dont il subsiste de nombreux Ccrits, permetea de mieux comprendre les causes du phhombe.
Un seul article, &dig6 par GiIes Constable, est spkifiquement dedie au t h b e du noviciat i CIuny : pour l'essentiel, l'auteur tesume ce qui est dit dans les coutumiers de Bemard et Ulrich et s'etome de ce qu'il y trouve8. Il reste donc beaucoup fah. Les qxkialistes de Cluny, comme ceux d'ailleurs de tout le monachisme pr&cistercien, ont, en majorit&, considM que le noviciat se pratiquait, pdsumant que le chapitre 58 de la kgle de saint Benoit (a De disc@ha susc@iendottnn f atrum m) etait appliqudg. as constat&ent
de profmion monastique Un commentaiie hbtorique, fhe'oIogipe et Iifwgrque du rituei cktercien de profession tnonastique et dm formulaires rde bdnt!dictrrbn moine et de la code, Rome: Pontificium Athenaeum Anselrnianum, 1992 et H. LUTTERBACH, Monuchus fichu est. Die M d m k d u n g irn-hen MitteIafter, MMtInster Aschendofl, 1995.
? Isabelle COCHELIN, conference intitulk Novices and learning how to behave w, domee en fgvrier 1992 dam Ie cadre du colloque Monastic and Mendicant Lfe in the M ' e Age, organ* par le Centre for Medieval Studies of Toronto. L'absence de trait& sur le noviciat firt diverses reprises mise en evidence dans les travaux de J. LECLERCQ : Deux opuscules sw la formation des jcunes moines w (Revue d'c~sce'tique et tie mystiwe, 33 (1957): 387, o i ~ le tr&s prolixc chercheur Mnddictin ne dome aucune dference avant 1e MI' s.), Id, a Textes sur la vocation et la formation des moincs au Moym Age ,. (dam Corona Gratiarum - MkceIhea patrrjtlca, histtarictz et l i tw'ca Efigto Dekkem O.S.B. XII Lustra cornpienti oblatu, vol.1 I, (Imfrumentapafrbtica, XI) Sint Pidersabdij (Brugge): Martinus Nijioff s Gravenhage, 1975,174) et Id, art,
Noviziato m, DIP, 6 (1980): 442-48). Mais d'autres chercheurs out Cgalement souligne ce phdnomtne : G. PENCO, a Un nuovo manosctitto itahno della Regdo Magistri m, Studi et testi, Benedictina, 18 (197 1): 227- 29, Carolyn W. BYNUM, a The Spirituality of the Regular Canons in the Twelfh Century: A New Approach (Medievaiia et HumrmIjlicuT n.s. 4 (1974): 23-24) ct adin J. HOURLIER, L Zge cfc~ssique 1140-1378: les reli@kur, dans Hist0ri.e dk &oir et & imtitutions de l'kgllire en Occibt , voIX, Paris: Cujas, 1973, p 3 1-32. SeIon Penco, ce type de l i t t&ra~h se dtvtloppa avant tout dam les milieux cisterciens puis fianciscains ; mais Ie coutumier clunisien de Bernard, dont les dcstiaataircs dtaient des novices, doit aussi &re pris en compte. LecIercq associc le d&eloppcrncnt de ceae litt&amc au d t c h du nombrc d'obfats a B I'essor des cntdcs de recrues adultes dans les monast&rcs (Id, 8 Textes sw la vocation,.. m, 1975, p.169), t h h que je partage entitrement ct qut le cas dc Cluny illustrc fort bicn.
'. G. CONSTABLE, 8 Entrance to Cluny in the Eleventh and Twelfth Centuries according to the Cluniac customaries and statutes m, dam Mediamafia Chrbtibna M-XTIIe si&Ies. Hommage h Rqymonde Forevilfe, [Toumai]: eel. Universitaires, 1989, p.33544.
9. Ainsi, Guy de Valous dctivit dam sa somme sur Cluny : a La dception des novices de toutes categories n'avait pas de modifications notabIes dcpuis saint Bcnoft et la dgle clunisienne en cette matihe, telle que la rapporn UItich, cst ditcctcment cal- nrt tes pfesctl*ptions Cdi- par saint Bcnoit d'Aniane. I1 est cependant un point sur Iequd CIuny a une Idgislation qdciale, cclui de la dude du noviciat (Le monachisme ~Iunisien dm origt-nes au XV sikf, Vie int&etae dm monasr&es et organisation de I 'Orciie, I: L 'abbqye de Cluny. Les m o n a s h clunrjierts, Paris: Picard, 1970, p3 1). Sur le fait qu'une telle pkomption quant ii I'application de la RB n'Ctait pas justifih, cf. I'article de J. LECLERCQ qui d€crit l'interpdtation assez libre de la RB faite par les moines bCnCdictins du Xe au XII sikles, du fait du poids des coutumes :
simplement put le noviciat clunisien etait de plus wtnte dude que l'annk ex igk par Benoit, puisque Piare Ie V6nhble ordoma, dans ses Stahrtu, qye le temps de probation d d t un minimum d'un mois. Si la conclusion ii laquelle 1es chercheurs sont parvenus est probablement juste, soit que Ie noviciat durait ii C11my m o b d'une ann&lo, leur d6moaJtration repose en revanche sur m e mawaise inte@ta!ion du statutum de Piem. Le grand abbe de Clmy ne parlait pas ici du noviciat au sens large (formation plus probation), mais uniquement du temps de p b a t i o ~ ~ P a m que, dam le Cluny de 1146/47, celui-ci n'existait pas mdgrt I'injonction du chapitre 58 de la RB, Piem tentait de l'imposer :
6.J non dim ~nntcs* non dico dimidius, sed nec memi$, nec hebdomada, nec aliqucntdo gratia nm'n'~rumpr~batiottem dies i e a s e e . Quod quia omnino et contra rationem et contra regutae decretzun erac quae praec@tprobari spititus si ex deo sunf v i m est esse ratiombile, ut miw saltem me& novitiorum probatio comervmetw, tuli mod0 utfiocco tuntum induti, et ut alii regulariter rasi ac tonsi, absque benedictione, absqw verbi vel scn'pti alicuius professione, tam in cella novitiorum, q u a in claustro, cum ceteris ex more pertnaneant. vl'
En revanche, P i e m n'aborda pas dans ses Statuta la question de la formation des novices dam leur cella12 : ceIle-ci, telle qu'eIIe avait W definie dans le coutumier de Bernard, composC sous son pridkesseur Hugues, devait probablement lui a w e .
a Profession according to the Rule of St Benedict m, dans Rule a d Lfe : an Interdbc@Zinary Symposium, Cd. M.B. Pennington, Spencer (Ma): C k Publ., 1971, p.117-43,
'9 Je parle ici du noviciat comme temps de formation seulement, tel qu'il est ddfmi par Bernard dam son coutumier. Comme j'aurai I'occasion de le dhontrer ultericurement, UIrich propose un noviciat qui est ii la fois formation et probation, mais puisque le stalrrnun de Piem le VCnCrable, avec d'autres sotvces, atteste qu'il n'existait pas de temps de probation B CIuny au milieu du XIP sikle, il faut donc supposer, soit que lc noviciat dlUlrich tbt implant& peu de temps, soit qu'il demtwa un voeu pieux- En faisant donc abstraction du temps de probation, on remarque que le noviciat-formation clunisien €m*t d'une dude tr&s imprkise : les adverbes temporels util- par Bernard et par Ulrich sont particuli&rernent vagues. Pourtant rien ne suggtre un trh long laps de temps entre 19arriv& au monasttre ct la profession, Un extmple : Bernard dCclare que le superieur reqoit Ies postulants au Chapitre au jour qu'il a m ddcidt (a qua sibi vi&bitw die v, Benr I,xv,p. 164).
I t . Pierre le Vdn&able, Statuta Petri VenerabiZis abbatis Cluniucensis LY (I lW47) [Stat], Cd. Gilcs CONSTABLE, dans Consuetudirires Benedctime Viiae (So= M- Srrec. MY), (CCM 6) Siegburg: Cum Pontificii Athenaei Sand Anselrni de Urbe editum, 1975, #37,p.71-72.
'5 A I'exception du statut mivan?, !c 38, sur la ntceuitt pour tous l a novices des prieurb clunisiens d'aller recevoir la bhkiiction de I ' a W de Cluny avant trois am, la seule autre mention des novices dans les Stotuta se trouve dans le chapitre traitant du silence qui doit Etrc maintcnu au monasttrc : Pierre interdit ii quiconque dc p a r k en divers endroits de I'abbaye, dont la eella noyitiorum, son c l o k ct Ies officines adjxents ; sculs sont exempts de cettc mjonction 1 s novices, l eu mabe ct quelques hauts pcrsonnages (Stat. 19,p58). G. CONSTABLE conclut son analyse de ce statut en a h a n t a Each of Peter's statutes, therefore, seems to have extended the discipline of silence at Cluny to areas or occasions not specifically covered by previous rules. (Stat. p.57n.). Comment expliquer qu'il n'existait pas encore de dglement sur le silence B observer dans la celle dcs novices avant celui-ci, surtout lorsqu'on sait & quel point cette question Ctait fondamentale pour Cluny ? Pour illustrer ce demier point, il suffit de citer Ie stahlt 42 de Pierre qui dklare que, Iorsqu'une communautC est trap petite pour cntMrernent suim I'ordo, la seule dgle i laquelle il ne lui faut absolument pas d6roger est ceIle du silence (Stat. 42,p.75). Le fait que la celle des novices ne bent%ciait pas encore de dglement sur cette question est selon moi un indice de la faible anciennett de cette batisse, th&me sur IequeI je reviendrai dans cette annexe,
Supposant qpe Pierre essayait, dans ses Statuta, de fixer le temps de noviciat 5 un minimum d'un mois, A Bredem et J. LecIercq oat Cmis l'hypoth&se qu'il avait Cte diminu6 de sa longueur wrmale d'une amdc sous Ie r&gne de Hugues, ~IOIS que le nombre de recrues avait soudainement augment6 en fl&cheI3. En Wte, ce fut le contraire qui se produisit : il n'existait pas de v6ritab1e noviciat anmt Hugucs, c'est-h-dire jusqu'au milieu du XIe sikIe, mais I'arrivde continue de nombreux individus dultes ih l'abbaye bourguignomeM
13. A. BREDERO, a Pienr le VtnWle ; 1 s commencements de son abbatiat m, dam Pi= AMmd- Pierre le V M I e h cotcnmrsphilmophiQues. I~~ et ortidiips en Ocridenr au mifierr AXIIIC s&Ie, Abbaye de Cluny 2-9 juiliet 1972, I?I& du CNRS, 1975, p.108-09. lean LECLERCQ, a Ugo di Chmy m,
BS, XI1 (1969). ~01.752-56 @assage repris par R AUBERT dans l'article Hugues F de Cluny D, DHGE, XXV (1994): 209). Bredem a Lcclcrcq amcent dcs thdon'cs tout h fait difficeates pour cxpliquer la diminution du temps de noviciat sous Hugues. Pour le premier, le phtnomtat s'cxplique par l'artivde soudaine d'un nornbre trh deve d t rccnres Cluny ct la shW de Huguu, Pour le second, la cause en est la dispersion des moines clunisiens dam les nouvelles abbayes dccmment pla- dam l'otbitt de Cluny.
14. Sur la hausse tr&s net& du nombh de conversions adultcs par rapport au n o m k d'oblats dans le dernier tiers du Xl' sikle, hawse dont Mn€ficia principalement Cluny, cf. H. GRUNDMANN, r Adebbekehtungen im HochrnittelaIter. Comemi und mtriti im Kloster B, dans Adel und Kirck Gerd Tellenbach zum 65- Gebwtstag von FI+ undScWern, &LJ. Fleckenstein et K, Schmid, Freiburg/BaseVWien: Herder, 1968, p.325-45 et J. WOLLASCH, Parcntt noble et monachisme rCfarmateur. Observations sur les conversions w
h la vie monastique aux XIe et MI' sikles m, h e hrjtorique, 264 (1980): 3-6. La population claustraie de CIuny tripla en l'espace d'un demi-sikIe. D&j& sous Odilon, la communautt! etait pass& B une centaine de moines, mais, il la mort de Hugucs, ils dtaient prb de trois cents (N. HUNT, Cluny wrrlk Saint Hugh 1049- 1109, London: Edward Amofd, 1967, p.82-83). Les hagiographes de Hugues 6voquent ce fait B diverse5 reprises dam leurs Virue mais on pourrait peascr qu'il ne s'agit I& que d'un t o p . 11 existe d'autres signes plus r&Clateurs, Ulrich dvoque dam son coutwnier I'accroissement ¢ de la population claustrale et les dbavantages qui en dkoulent :
Eo tempore quo primum ad rnorwterium vent sacerdos quiprivatam mksam cantare volur'r, potuit earn interim [pendant les temps de I1krt6 de parole au cloitrcJfnire ; quad tmen mod0 ram contkit, quia multitude fiatrum acervavit ; a quibus dwn ad mamque missom oferl~r, diun par dahv & accipitw, durn in capitulo de uno pur ultero hoc et ilfud recIumaturp rhrm tanti3 in refctorio setvitur, noon minima pars expenditur diei. ipae tmen sin@ ordine nmwo salvo et ihtegro, remalbere non pssunt Propter quod hora laquendi necessario magis esf brevk (U&L ~ , c o l . 6 6 % A , rcpris par Benr &xx,p324).
Dans un autre passage, il d M t avec humour un dglrmcnt qu'il a lu dans un ancien coutumier de Cluny et qui est devenu, avcc Ie temps absolumcnt inapplicable du fait du grand nombre de fit= et d'h6tcs accourant B I'abbaye pour c6lCbnr NMl (Cfhl. I,~clvi,col.69 1). Aillews encure, il raconte que, pour le Mamhm des Wres, Ie jour de la a n e , Ics moines sont quclquefois plus de deux cents, ce qui n&essite dcs changements dam I'organisation de fa cCnfmonic (U&f. I,~cii,col.660B). I1 affirme enfin que les prof& de la congrtgation clunisicnne sont si nombrrux qu'il y a toujours des dCcts B com4moter : tanta est muftitudo itlomm qui omnes profasf sunt congregationis nostroe ut rurbsime his d@ttctis careurnus, pro quibus septem oflcia simul cum septem rn&k sunt age& m (U i l . I,vii,col.652C-D).
Une autre illustration de f'importancc du nombre des nowelles recrues dans le Cluny de Hugues est la place accordtie h la distribution de leurs effets, apds leur en* au cloftre. I1 scmblerait que tous Ics officiers du rnonastCre Mn6ficiaient de cctte manne miraculeuse constituk d'€perons, habits, chevaux, etc. (cf. Benr I,v,p.145, I,ix,p.l53, I,xii,p.l57, etc,),
Awc novices anivds directemat il la porte de I'abbaye bourguignonne, iI faut ajouter tous ceux e n W dam les prieurk de L'Ordrt mais astreints B vcnir fain leur profession B Cluny. Un tel sySteme domait lieu B une masse t& importante de recnres B former pour un nombre limit& dc moines d'ewrience, d'ou I'instauration d'un noviciat-formation, comme je le ddrnontrerai dans les Ligncs qui suivent Pour camprendre les raisons qui
contraignit l'o* ii en instaurer un ; pour a fairr, Cluny n'employa pas le chapitre 58 de la RB mais dessina son propre noviciat
Le coutumiet de Bernard iilustre perfaitemeDt tous les soins qye dcessite la pdsence de novices dans un monesttrr. Bernard abode ce Wme aussitbt apds moir dress6 le portrait des difE5rents officias du lieu Il ne lui consacre pas m o b de sept chapitns : le XV, a De novitiis quomodo recri,iCllltUI ; le XVI, a De novitiis extra monartert'um swceptis r ; le XVII, u De notitia s i gnom (@ traite d'ua sujet qUi intCrrsse tous les rnoines, le langage des signes, mais que Bernard Cvoque dam le but d'eduqucr les novices) ; le Xvm., a De Novitiik instmendis ; le WC, a De ill~trtlendo novitio w (qui, avec le prCctdent chapitre, decrit vingtquatre hews dans la vie d'un moine, pour que le novice mCmorise ses obligations fuhnes) ; le XX, a @ornodo benedic- novitii m, et enfin le LXX, a De Novilis, quomodo rec@i'tw in capitulo m (oh il explique plus en detail comment se dtroule la tonsure des lacs h L'6glise). Ces chapitres sont d'une taille wndquente : dam le livre I, c'est-&-dire celui qui traite de tous les aspects de la vie au rnonastk il I'exception de la liturgie, il s'agit du theme auquel est consacd le plus de pages. Mieux encore : I'ouvrage entiet est destine plus spkialement a w novices. Dam sa lettre d'introduction dedite au Pater gloriosissimus (l'abbe de Cluny du moment, Hugues de Semur), Bernard explique qu'il a entrepris d'ecrire le couturnier pour les novices que troublaient les controverses sur les coutmnes1? Outre la lettre dddicatoire et ces sept chapitres, les novices sont tres f%quemment mentiom& au fil du texte : ram sont les sections oii leur nom n'apparait pas au moins une fois, qu'il soit question #em, de leu celle, ou de leur Maitre.
Le noviciat occupe aussi une part importante du couhunier d'ULrich : le second des trois l ims qui composent son owrage a pour thkme a de emditione novitiomm d6 : il s'agit
pouss~rent tam de lam adultes A prendre l'habit clunisien dam la deuxieme rnoitie du XIC sikle, il faut certainement prendre en compte le succk ii pine plus tardif des Cisterciens et de la premi&re croisade. Certains t!ICments de mnse sont offcrts par M. BULL, bight& Pi' andthe Lqy Response ro the First Crusade. The Limousin a d Gmcorty c-97k.1130, Oxford: Clarcndon Press, 1993, plus spdcialement p. 1 15-54.
IS. Bern Ep.,p.134. 16. C'est tout du moins ce qu'affme tilrich dam sa pdface (U'I . , Praef:,col.640A). En dalite, seule la
moiti6 du Iivre II est d6diCe aux novices ; et encore, pas vrairncnt, puisqu'une borne part]-e de cettc section traite des m o b et nou des novices. Mais, cc qui importe pour mon props est qu'UItich, lorsqu'il expliqua le contenu de son oeuvre, ait p l d au deuxikne rang de ses priotitb, aprts I'opur Der; l'dducation des novices.
A en mire cet auteur - et il n'y a pas de raison de douter de sa parole -, cette manitre dc dkouper k texte ne fit pas son choix rnais celui de Guillaume d'Kiu qui, a p e avoir intern@ son ami d'enfance mr la liturgie de Cluny, voulut entendre parler de la drjc@Ii~ reglriurb ct, avant toute chose, de la manitre de fonncr Ics novices (m hodiernoflagr'ramus azidiie, marhe de novitih, etpmcceptk, quibus iktmrcndi sum PI MuendI, ut inter wspossint rcgnfar&er conversari D, U&l. II,Praef:,col.700C). Ce dbir de Guillaume s'explique par la structure tr&s particulitte de son monasttrc : h I'encontre de la pratiquc en cows dans la majorit6 des institutions contmrporaints, GuiIIaume r e h i t thtotiqucment les oblats en sa communautt (cf. Udaf, Epis!. nunc.,co1.637A et Comtitufiones Hi.augienses seu Gengenbacmes, PL 150, I,ii,co1.934D et ITpcii, 1069A.). Tous les nouvcaux Venus A Hirsau etaient donc des adultes : dam un tel contexte, cornme je le montrerai plus loin, une institution cornme Ie noviciat devenait me ndcessitk absolue. Les coutumes que Guillaume rddigea pour son monastere dautent d'ailleurs par le traitement des novices (cf. Constifufiones Hirsaugienses seu Gengenbacenses, PL 150, I,i,col.93Osv.).
en fait du m h e texte cpe Bernard, mais avec quelques divergences riches de signification et sllr lesque11es je mriendrail? Qu'une t d e place soit fZte au noviciat dans les oeuvres de Bernard et d'Ulrich ne doit pas etonaer : les novices du Cluny d'alors allaient fonner le Cluny de demain. Puisque le fima de l'iastitution nipsit sur ces nowelles recxues, un soin extrhement diligent devait leur &re PO&. Que ces dcux autem n'eussent que peu ou pmu abode ce Wme, voikqui eiit CtC intrigant. Or tel est le cas dans les Yitw et aoutumiers plus anciens : les novices en sont pres~ue totdement absents.
Les Vitae clunisie~es ddigtks avant le d&ut du We sikle ne parlent jamais de noviciatL8. Les &its de conversion au monachisme, d'individus IaPques ou clercs, saints ou non, sont pourtant wmbreux, mais pas m e d e fois les tem~es nouitiw ni nouitiutw ne sont utilis&, pas m e seule fois la possibilitt! n'est envisagde que les nouveaux Venus puissent faire une ptriode d'essai puis repar&k. [L parsuat m c i l e d'expliquer ce silence par une totale
". Odd II,i-xxviii,col.702-14, la. Je n'6voquerai pas ici toutes les Vitae clunisiennes, la liste serait trop fastidieuse. J'affme simplement
qu'aucune des Vitae de mon corpus composCts avant le XTP sikle ne fait alIusion au noviciat Je me contenterai ici de traitet a s par cas celles &rites depuis la fur du XI8-
- I1 n'est fait aucune mention du noviciat dans la V i a de saint Anastase (tcl085, errnite, ensuite devenu moine au Mont-Saint-Michel puis A Cluny, enfin missio~aire en Espagne), dcrite par un anonym & la fm du XIe sitcle-dCbut Mr. &lition par EPA. Pigeon, Vies akr S. db dioc&e de Coutance, LII, Avranches: Imp. Perrin, 1898, p357-64, traduction p348-56.
- I1 cst question d'un nouirius dans la Vita Odonis de Nalgod, Ccrite dam les andes 1 I20 (YO" 37,coI.IOOA). La meme anecdote, mentionnee par les Vitae plus anciennes (cclles de Jean de Saleme, de I'abdviateur et de I'Humiflimus, celle-la cornposte sous Hugues, donc dans la deui&me moitiC du XIe sikle) ne parlait pas de novices.
- 11 est question de multiples reprises de novices dam ks Yirae d'Hugues, or elks fiuent toutes rddigdes ap& 1 120, cf par exemple W 1,xiii-xiv,p.63-64, I,rw(i,p.76, m , p . 7 9 ct IJiip.89 et W xxvii,p.Sl. Pour une mison que j'ignore, Hiidebert de Lavardin a c o m d Ics anecdotes concernant des novices Cvoqudes par Gilon mais en enlevant toutes les d f h n c c s au fgit qu'iI s'agissait de novices (cE W- Ul, 13,co1.869B-C, pour le novice Maingold, et W,2l,cot873-74 pour le novice Jarenton et pour celui qui appartenait B un group de b0iS fibs).
- Plusieurs novices sont mentiom& dam le DMde Piem le Vtn6rable. Une anecdote est particuli&ement intkressante car elle illustrt la place grandissantc p r k par la celle dcs novices dans la vie des moines de Cluny, alors que cettc batissc avait dt& quasi @or& jusqu'alors. Pime ntanscrit dam son m u m une vision qu'eut Hugues de Semur, vcrs la fm de sa vie, la veille d'une Fete de la Nativitd, et qui avait dtj& tt6 mentionnee dam certaines Vitae Hugonis (ct. II,vi,p.% ct W VII,43,ca1.887B-C). Lc diable, maheureux de vou le Christ-enht se djouu de la fetc qui lui h i t pdpade B l'abbaye, I'imptora pour qu'il le kisse tenter sa chance dans les differents batiments du monasttre. II savait qu'il ne p o d ricn cntreprcndre B I'CgliK, aussi se dirigea-toil tour & tour vers k Chapitre, le dortou, p u t le dfkctoire ; ceci en vain. Pierre vouht Claborer sur la vision de Hugues et pdcisa que les novices &eut habituellaneat la t o w premikcs proies du Malin (DM I,xv,p52). 11 cormbore ce fait i l'aide des trois anecdotes suivantes, qui dtcrivent justement les mefaits tent& par les dCmons dans la ceffa des novices (DM I,xviXvixviii,p.52-56). Ainsi, sur la base d'une anecdote qui ne faisait pour sa part aucune place aux novices, P i a e a brodd une nouvelle histoire oO ceux-ci occupent un r6le de premier plan*
absence d'anecdotes, de miracles signEcatifk et de doutes pendant le noviciat de tous les nouveaux Venus Cvq& par l'bgiographie clmhienne pdXIIC sikle ; il para& plus probable que ce soit l'absence du noviciat qui soit I l'origine de ce silence.
Que racontent alors les Re de saints ap 1'- au m o b d'm individu adulte ? L'ensemble des sources le p1us riche h cet €gad est le groupe des Vitae d'odon de Cluny. Le diable b t intervenu pour empeCk le saint de se jo* B la communae de BaumeI9 ; or, pour racanta cet &pisode, ICS tadcJ dc Jean de Saleme, de l'-, de 1'HmiIlimus et de N@d ont tous dCcrit en d M les &apes suivies par Odon pour se fairr moine? Adhe* l'ami et infQidl d'Odon ii Saint-Uartin de TOUR, & a un beau jour ik Baume et s'installa 8 l'hospitium pour y M e r k mode de vie des mokes. Trts satisfjlit de ce qu'il y vit, il partit chercher Odon ; les dew hommes parvinrent peu apds au monast&e avec l'objectif d'y entrer. Pour ce faire ils s'etablirent quelque temps & l'hospitium. L'anecdote qui suit illustre que ce s6jour A la porte du momstere correspond, pour le postulant, B me p&iode de libre &flexion sur Ie bien-fond6 de sa decision. Tandis qu'Odon et Adhegrin se trouvaient en ce lieu, des moines vinrent parler au saint pour le dissuader d'entrer : ils affinnaient que Bemon &it un abM tyranniqw et cruel et qu'ils comptaient ew-mihes quitter sous peu l'abbaye par crainte d'&e damn&. Odon fbt &ran16 par ce discours et f a t abandomer son projet ; mais Adhegrin survint, d k l m que ces moines etaient des possdd6s et que cY6tait le diable qui parlait h travers eux. La l i t e soudaine du groupe confirma ses dires. Les dsistances d'Odon h n t alors vaincues et les deux hornmes en-nt i B a u d .
Une autre historiette, toujours lik B la vie d'Odon mais qui n'est offer&e que par Jean
19. Certes, cette anecdote se situe Baume et non Cluny ; mais puisque tous Ies hagiographes d'Odon chanthrent les louanges de Cluny dans leun oeuvres et fwnt preuve d'une mdconnaissance flagrante de la n?alite de Baume, puisque, en outre, les hagiographes ap& Jean corrighrent son rdcit des Mnements pour le rendre plus plausible, c'est donc que I'entrde d'Odon f5t racontee selon les nonnes clunisiennes, que celles-ci eussent ou non €tC hdritdes de Baume.
YO' tJ2-29.~01.53-56 ; VOL ct VOb 20,p.223-24 ; VOO PL 18,co1.92-93 = Fini 23,~. 142-43. 2i. Jean de Salme sptcifie qulAdhegrin se trouvait hi6rarchiquement endcssous d'Odon, puisque ctlui-ci
l'avait devanct dam la conversion A Saint-Martin de Tours. Adhegrin l'ayant ensuite prCcCdC pow entrer Baume, il devint en revanche son sup6rieur hitrarchique : * f i c l ~ r a t iife [Adhegrin] qui mteafierczt secutor, postea signanus. (cf- YO' 1,23,colS4B).
22. Dans sa Vita, Jean de Salcrne n'a pas p lad cetk anecdote au moment du k i t de l'entdc d'Odon et d' Adhegrin Baume : avant dc contcr ccllc-ci, il a tvoquC la nomination d'Odon au poste dc maitre des cnfants par Bemon, d&s son incorporation clans fa communaut6, et divers dpisodcs de la vie d'Adhcgrin (qui st fit ermite peu a p k son artivk). Lcs hagiographcs uldrieurs de la Tru d'Odoa modifitm!t I'ordrc chronologique du rkcit en plaqant I'Cpisode de la tentation avant I'entde au doitre. M.-L. FINl s'est &om& de ce que l'abdviateur d Nagold aient fhit tous deux subir la meme modification au ttxtt de base ct s'est aIors intenogk sur la possible connaissance par le second de la Y O ou de la VOb (cf, M.-L. FINI, 8 L'editio minor defla a Vita di Oddone di Cluny t gIi apporti dell'fiumillimus. Testo critic0 e nuovi orientamenti m, L 'Archigimrusio, 63-65 (1968-1970): 153). Pour ma part, je penst que cette modification trahit plutdt le caractere tout fait anachronique de cette partie de I'oeuvn de Jean : il ttait choquant pour des moines qu'il puisse ttre question de quitter un monasthre aprb qu'on y soit entk Aussi I'abdviateur ct Nagold rnodifihmt-ils I'oeuvre de Jean de telle sorte qu'Odon n'ait htsite sur sa v o d o n qu'au moment oh il Ctait encore dam l'harpitium, sans laisser aucune arnbigu'itC sur une possible hbitation apr& son incorporation,
de Saleme, confirme ce mode Cent& en religion2? L'hagiographe italien monte qu'un jour Odon enleva me jeune W e an le point d'&c maride par ses parents et qui prCf-t quitter le monde. Il l'amena A Baume a l'iastalla dans un pait oratoire, & l'ext&ieur de la cl6turr, r6servC am femmes en visite. Bern011 imposa alors comme punition h Odon, porn avoir o& agir saas lui avoir pddclemment demand6 la permission, GalIer cheque jour rencontnr la jeune vierge porn la convaiacre de se fairr moniale2'. Le Scjour dans I'onrtok de la jeune fUe 4uivaut au djour B l'ho.pin'rcm d90don : il s'agit d'un temps obligatoire de Mexion, impost! I cbsque noweau postulant, pour testa sa perstvhce, tant par lui-m&ne que par I'abbCu. Comment expliqyer autrement qu'odon, Adhegrin et la jetme fille aient dtl tous trois subii me telIe mode d'attente, ew qui avaient dtja &id€ de cpitter le monde ? Cette fonne de probation ne peut &re appel6e noviciat puisqu'elle prend place en dehors du monast&re. Je 1'6voquerai il nouveau I la toute fin de cette annexe pour d6montrer qu'eIle ne fut pas invent& par les Clunisiens mais que son usage remonte en rWitt5 tr& loin dans le temps et l'espace.
Ce que disent les Yirre clunisiennes sur ce qui advient au postulant une fois le seuil du cloitre fianchi est fort succinct : il semblerait que le noweau venu dtait le plus souvent immediatement incorpod dam la communautti pour mener derechef une existence semblable ii celle des moines du lieu. Ainsi, ap& I'6pisode de la tentation d'Odon, les trois premiers hagiographes du saint ne font aucune allusion A un quelconque noviciat Au contraire, la phrase employ& par ces trois auteurs semble indiquer que les deux homes devinrent moines aussit6t ap& leur en* au cloitre, sans p&iode d'essai ni temps de &flexion, apes leur entde au cloitre : a Pater namque Odo cum Adhegrino collega suo ad suavissimwn Christi jugurn colla submittunt. mZ6. La meme remarque peut &re faite a la lecture des Vitae
VO1 I,36,c01.59-60, Nagold se contente de raconter qu'Odon sauva la virginit6 d'une jeune femme sans offiir de details sur les &apes de son entde au monasttre (YO" 2S,co1.95-96).
24. Le nom du monast&e ou serait ensuite entde la jeune fille cst inconnu, mais il s'agit peutGtre de la proche abbaye de Chiiteau-Chdon (cf, L 'abbqve de Baume-Ies-Messieurs, €d. Ren6 Locatelli, Pierre Gresser, Roland Fietier, GCrard M o p ct Ican Courtieu, D81e: th Maquc-Maillard, 1978, p30).
? C'cst Bcnoit lui-m8mc qui avait exige ce test de petsCvCrance aux nouvcaux BItiv& (RB 58.1-2), mais il le pla@t avant la &eption du postulant au logemcnt des h&s, alors que celui-ci se trouvait encore B la porte ties lieux.
%. Cetk phrase est donnet dans la VO', immediatement aprts le *it de la fbite des moines qui essay&rent de dissuader Odon d'entrcr (VOr 29,co1.56B). La meme phrase est reprise trts cxactemcnt dam la V O et Ia VOh. La Vita dc Jean de Saleme fbt rtdigk en 943,1'dpitom& il une date incomuc, mais avant la tedaction de la VOh. Cette d e m i h fit composte sous l'abbatiat de Hugues. On aurait donc pu s'attendre, au moins dam ce demier texte, & unc 6vocation du noviciat ; or, on ne tmuve rim dc tel. Trois explications peuvent Ctre envisagb. La p m i t h ct la plus importante cst que I'HumifIimus ne s'est jamais donnC la peinc de changer de simples bouts de phrases de I'epitomb ; il s'est cantonne B fairt dcs ajouts dam I t s sections qu'i1 jugeait importantcs. Deuxitmcment, il a peut-?tre && rCdig6 ailleurs qu'h CIuny ; or la modification du noviciat prit certainement du temps s'aendte aux autres abbayes a clunisiens dont beaucoup n'avaient peut4tre pas les moyens de s ' o e une celle de novices. Troisi~memcnt, une rtgle peut &re changee mais cela ne veut pas dire pour autant que, dam les mentalit& et les faits, les changements sont aussitdt pris en compte.
La Vira de Nalgod, tcrite vers 1 120, 6voque en revanche les modifications clunisiennes faites dans la reception des nouvelles recrues. Son texte rnontrc qu'il existe be1 et bien un noviciat B Cluny en ce debut du XIIe siecle, mais celui-ci n'a qu'une fonction formative ; il ne correspond pas A un temps de dflexion ii Ia suite
Mmbli, par Synrs, Odilon et Ndgodn, et des Vitae Odionis par Jotsaud et Piem Damien2! S e u . la Yfra Maioli breuior &it exception : elle ne parIe pas de noviciat, mais dklare que M a i d fut form6 pendant plusieurs jours (upor AnJIos dies m) par Hildebraud, le priM de
duquel Ie postufant serait h i de partir. a 1ngrts.m pmxibw irnwato* ad sociiatem fiatrum regvliuiter adniliwrlrrr er, initidi profasione ~ ~ u , m wrum C~~~ - i . V i era2 Mcm h m enwitas* qvipro tempore debwant m a m i exrc wque tad @a dhcendp vriiMis bit& tkcendjse, INtituebantw cab illis* quw meritorum priuifegiis ~nlcibant et virfutnm itinera qup sepitcs ipti &vn -ant, uelut i i u pmdmtws ib iab afiis desigmri Vikbantafko mom quik tenus virerant more suo et plenm~lre ab ifI& qug borrp et ~ i l i a esse c&bmr, seniorurn imperib arcebantw. Impanrerant homims super capita sw et ideo illis eatenus ikco~ueta *at lege vivendum, T o m eis proficiebat ad meritum, totwn coope7abatw adglrntam, ut, quibus renan inoprb vliilurir compcu~~erut mmerrnan. veru et perfecra humilitas gloriam ampliiue~ * (YO" Fini 24 O,p.143 = PL 19,co1.93A).
Ce passage avait pmbablement pour objcctifde donner me v&itable lepn d'humils aux novices clunisiens : puisqu'Odon avait agi de la so* ils st dcvaknt de l'imiter, d'autant plus qu'un tel comportcment pennettait d'acqu- la gloire dleste. Le tenne nouitirrs a'apparaii pas ici mais il est utilist ailleurs dans la Eta (YO" 37,col. 1OOA) ; cf supra.
n. VM I. 1 1-12,p. 197-98 : lgitur cenobium in colfis uaff' que Ciuniucu dicitur. cui uir uite uenerabiiir Heirnardus preerat. pro
morum honestate et tibruturn studiis qpetit, ibique securrrhrm be& Benedcti regulam ab e&m uiro iam pr#ato comcersationfi habi'nun petens ut surciprefur rogmi!.
Spretis itaque omnibus terrene possession& stipendiik ob spem fittue repromiksionis. habitrim sancte conuersationk sumpsiL Sicque &inceps alien0 uixit imperio ut in d o deuimet u sancte conuersationk proposi!oO r
Odilon p b n t e un r€cit un peu difErent des dv&wments : c'est Cluny qui voulut recevoir Makul cornme moine, afin de l'avoir ensuite comme abb& Le prieur Hitdebrand s'ernpressa donc de convertir Ie saint et elui- ci entra dam la cornrnunautt5, sans qu'il ne soit alors question de @ride de noviciat. VM co1.949-50 :
a Deposito ecclesi'ticae dignitatis o+ciom spreto munabme nobilitatis supercifio. relicto saecufari et amicorum et parenttun consortiom ut Iibere parset smire vero Regi Chrkto. totum se subdidit coelesti magirterio- N~ec muitupast condicto tempore. certo die ad monasterium veniens oficiosissime suscipitur, reguiuriter infroducitur et. ut morrj est, honorabifiter el charitative tr4ctazurclnv rn
Nalgod est encore plus succinct que ces dcux auteurs sur la question de la procddure suivie pour la conversion et insiste essentiellemcnt sur raspcct mystiqyc de l'tvhemeat (YICf IlO,co1.658C). La Vita aftera (W), qui est e-mement beve, ne park simplcment pas de l'entr& de M a u l B Cluny.
=. Pierre Damicn est cxtrEmtment succinct ; en unc sculc phrase, il fait d'Odilon un clcrc de Brioude puis un moine Cluny :
a Quiprueterm dwn cldgrMdirrscuIae jam atatis atiolesceret incrementurn* priur apudsanctum Jufianum m-m fatus est cIeripncusm &id B, Moidi c o ~ ~ o r I j egregt'i se magrjterio tradidit, et in Cfuniacensi monasterr'o habiturn sanctue refigionis accepit. (VOF coI.928A).
Dans la Vim de Jotsaud, on pcut en revanche dtcdler Ics deux Ctapes dc I'enWe au monast&te avec, premi&erncnt, la dernande d'cntrer B I'intCn'eur, fotmul& de l'&eur, puis, deuxi&memtnt, la ptise d'habit. Ceae dernih drhonie marque I'incarporation immaiate du nouveau vcnu danlc la communaut6, puisqu'il se retrouve d&jA au dernicr rang des Mres et non dans le group inddpeadant des novices :
[..I c~tinibcm quai quemdcn tame repromksionk requriit inlnbtum* et veteri itenun ckpmita sarcino, monachicum suscipit indumenhrm, Jesu bone ! quam jucundiim wat tunc videre mem mundono veflere de~onsum~ de lmacro baptismatk iterum ascenctentem, cum gemellis feibus difectionis utriusque procedentem. nihil sterile seam portantem* nihilquc vemrm meditantem ! Jam sumpto habitu videres nostram ovem inter alias pinam o p e m extremam ordine [...I a (YO? I,ii,co1.899-900 ; com& B partir du manuscrit Ars 162, col. 1 1 19.
C l u e . Le cas devait ebe rare cm le grand prieur avait certainement d'autres occupations plus pressantes que celle de former ks nouveaux convertis. Une autre explication serait que l'hagiographe ait offat un a t emnt des t v h c n t s car aucun des &kctam successEs de Vita Mdoili ne r@t cette version des fats ; 4, W o n hoqya Hildebrand mais il lui fit remplir son r6le d'&lucatcllr mcmt l'incorporation du saint au rnonast&e? On retrotwe cependant me information similain dans la Yiro Odonis de Jean de Saleme, quand l'hagiographe raconte son entdc dam l'ordre c1unisien : Hildebrand, le praeposittlr de Cluny, trts certainemat le m b e homme cpi forma aussi meu131, sewit A Jean de prCcepteur ("praeceptor meus") : a ...pr aedicto viro domno HiIdebrmo regulm0bu disciplinis me [sujet = Odon] tradidt echrcanduwz v. Pour Jean, comme pour m-eul, cet apprentissage fbt une -on de quelques jours puis~ue, nonpost multo m, le jeune homme repartait pour Rome en compagnie d'odon? On ne p u t puler ici de noviciat compte tenu de la fome - tr&s persomelle, limit& dam le temps, centde sur la connaissance de la disciplina - prise par cet enseignement De plus, ces deux cas de figure semblent &re davantage des exceptions et non la dgle, entre autrPs parce qu'il n'est jamais ailleurs question dam les sources clunisiennes que le prieur oupraepsiilur d'un monastkre ait ii remplir semblable &he. Qui dots s'en chargeait ? Pour en avoit un peu plus long et surtout pour mieux comprendre par quels processus les recrues dtaient incorpods dans leur nouvelle sociCt6, il faut se toumer vers les coutwniers.
La lecture des coutumiers ne pennet pas de conclure, de maniere aussi tranchde que les Vitue, zi I'inexistence du noviciat zi Cluy avant le dgne de Hugues : les Conszietudines awiquiores n'accordent aucune place aux novices mais le Liber tramitis abode le sujet sur quelques lignd3. le demontrerai pourtant que ces passages sont trop peu substantiels pour
-. VM v,col. l767B : Nam mundani arbitrii dimittens amplam & spatiosam viam, se sub h i iugo Chisti constrimit, &
monitione, & dortatione domni ac Religimissimi Patrb Heldebranni, Ciutziacetm3 Monastwii Prior& mo~chi lb districtionis nobile magbtetium tqwtiuit Qui @sum Patrem MaioIum seam per muitos diks in Cbhti Domini seruitium emtriens, per/echrm AtWetam Der' protuii!. '". Cf- supra Ies citations offertes des a m Yirae. ". Cf- les remarques d ' h d d Duchesne ce propos, en note de la Vita Maioli d'odilon, W co1.946-47. 32. YOt, ProL,2,co1.46A ct I,4,~01.45C. Dam la Re'ge cies gwrrep&er, il cst demand6 quc le suwrieut ("rj quipraeest") cnscignt au postulant le
mode de vie de la c o m m d ; il n'est alors nullcmcnt quaion de dude d'apprentissage, mais i1 semblerait plutdt que cela se k c au moment d t l'cntdc (Les re'ges des suintspZrtx, k Trorj r4gIes de Lkrim au P sikfe* intro.* texte et trad. A. de VogOC. (SC 297) Park Ed du Cnf, 1982, W,p.lgO-g 1 et Benoit d'Anime, Concordia regutmum [Conc.Reg], Pt 103, chap.58, co1.W 1)-
33. Les tennes "pIsantesn et "inc@ientesn, qui jxuvent l'occasion €trc utilists pow designer 1es novices d'une communautf, sont totalcment absents de ccs dcux oeuvres comme l'attcstcnt lcurs index. Le terme "nouitir" est aussi ignod des CA, tout au m o d dans Ies versions Ics plus ancie~cs .
Mayke de JONG s'est egalement €tonnet du peu de place accord& aux novices dans le commentaire de la RB compose par Hildemar ven I t milieu du DC' sitcle ct en a conclu que a the majority of the new monks originated from their [the oblates'] ranks, while the adult novices were few in number (a Growing up in a Carolingian monastery : Magister Hildemar and his oblates n, J M , 9 (1983): 119). Par rapport au novice, Hildemar dvoque essentiellernent les modalit& &en& du converti adulte. Celles-ci dimrent notablement de
h e significatifk. Je degage ensuite, par la lecture conjointe de la RB et des premiers coutumiers clttnisiens, la m&de par laquelle, jusqu'au milieu du XIe sitcle, les recrues etaient incorpodes h la communazrtt clunisienne en l'absence d'un noviciat
Les novices sont CvoqueS en quehc &its du Liber tramitis. La prrmike mention, de quatrr ligaes, intervient dans la description des Mtiments du noweau Cluny, sumomm6 par les hisbrim et archcalogues Clmy II? L'autcur du L T h u m k toutes Ies wnst~~ctions du lieu, mais en utilisant deuuc modes de verbe dE&ents, I'indicatifet le subjonctif" Dam toute !a premih partie, il anploie l'indicatif porn Cvoquer les Secfiotls dtja construites. Il s'agit, bien sQr, de celles qui sont les plus vitales pour I'abbye : PCglise, le Chapitre, le dortoir, les latrines, Ie chauffoir, le dfecfoire, les deux cuisines (dguIike et Iafque), le cellier, L'oratoire Sainte-Marie, etc. En revanche, il hit usage du subjonctifdans la d e w i h e moitie de son dcit pour ddsigner les sections dont la construction etait encore I M a t de projet. La celIe des novices est mentiom& dam cette seconde Iiste (qui comprend, dam I'ordre, le palatium des lala nantis, la demeure des cordonniers et des couturiers, le cimetikre des ldics, Ies Ctables, I'habitation des serviteurs, le logement des pauvres, les b e , etc.). Elle n'existait donc pas encore au moment de la Wction du LT. A partir de cette constatation et sur la base d'autres &?men& fournis par le texte, deux remacQues pewent ttre 6nonc&. Prrmikernent, cette Mtisse n'etait pas me priorit& Elle est en eEet l'avant avant- dernier 6difice citi et les dewc suivants sont d'une importance tr&s secondaire : il s'agit de celui destind aux orfevres, bijoutitim et vittiers, et d'une autre demeure dont la finalit6 n'est pas pr6ciSee. En outre, la description de la celle est succincte et l'auteut s'est contente de reprendre presque tels quels les mots de saint Benoit. Alors que ceiui-ci avait dCc1ard : a Posteu autem sit in cella nouiciorum ubi meditenf ef manducent et dormiant m, il est Ccrit :
Et post istam positionem conshuanlur cella nouitiomm et sit angulata in quadrimodis, uidelicet prima ubi rnedite~t~ in semndu reficiantD in tertia dormiant.
celles demand& par Benoit : la probation de d e w mois sc fait I'extCrieur du monasttre, lors du service l'hospilium ; une fois cntd au cowent, le nouvcau vcnu n'a plus la possibilitt de mourner au sikle, rneme s'il demeure encore dix mois daw la cellule des novices avant sa profession (Hildemar, cocomm. du chapitre lviii, p534-38). Hildemar insiste longuement sur cc point en pccnant appui sur dcs dkisions de conciles. Plus loin dam cctte meme annext, j'aborde la question de l'anndc de probation dam Ie monast&rc, voulue par Benoit, mais rarement observk par scs succcsxurs. te tcxte d'Hildemar &it connu des Clunisiens et servait mCme l'occasion d'ouvrage de r&fdrence (cf. LT S83,p.gl).
Un coutumicr contemporain des U, cclui de Flcwy. campod entrc 1010 ct 1022 par Thierry de F l e w (ou d' Amorbach) et qui d k i t le Flcury du tomant du Xe au XIe sitcle, ne dit pas non plus mot des novices (cf. la prbentation de l'oeuvre par A. DAVREL, Consuetudines Floriacenses Antiquiores m, dam Consuetdines saeculi XXKXU mommenfa I'oductiones, (CCM VfI-1) Cd K. Hallingcr, Sieburg: F. Schmitt, 1984, p333-38 ; cf. Ic ttxte propcement dit : Ff-, p.7-60). Ce tcxtc cst inachcve mais une partie de la vie quotidiennt y est ddcrite, ainsi que tous Ies officicrs du mon&rc : il y est fait mention d'un CLCS~OS
injimtzim mais nullement d'un magists nouitiortan. Fleury fbt dfonnd par Odon en 930 ; ses coutumes ne sont donc que t d s partiellernent influenck par celles de Cluny.
Cf. N. STRATFORD, La bQtiments de I'abbayc de Cluny A l'Cpoque mCdiCvale. tat des questions m, Bullelin monumental, 150 (1 992): 3 8 % ~ .
in pmta lamha ex latere. d5 Seconde remarque : si la celle des novices n'etait pas encore construite lors de la &laction du coutumier, c'est donc que les postulants adultes, lorsqu'il s'en trowtit, a mMtaient, mangeaient et dowent w, m h g & aux almes fkes. En conclusion, h premik mention des novices dam Ie LT ne pexmct nulIcmcnt de conclute A l'existence d'un group de novices qui serait distinct de celui des Wms, au contrahe.
La deuxihe mention dcs novices dens le LT intervient dam un chapitre qui traite de la ukhonie de Mddiction, c'est-&dire de l'incorporation dtfinitive du nowaw venu I la communa&. M&ne si c e w sur le point d ' h Mnis sont ici appelb d'un nom bien spticifique, les nouitii, ce qui 1s d6marque des autres f&es, rien pourtant ne permet d'afEmer qu'b ont v&u, pendant les mois qui ont p M 6 leu incorporation B la communaut6, t6-s diffkemment des a- moines. En e f f i il est rernarquable que, dans ce chapitre, pas un mot ne soit dit du sort &sew6 aux nouveawc venus dmmt l eu noviciat?
Le tmisi6me passage du LT concernant les novices se &ume I la phrase suivante : a Nouitii durn fiatresfuerint in capitulo @si sin? in coquina rn3'. EUe prend place en un chapitre un peu "fourre-tout", intitulC a De diuersis di@nitionibus uel qualitatibur quae agi oportet in cenobiis degentibur m7 qui traite d'une multitude de choses sans rapport entre elles. Puisque, pendant les trois jours que dure leur &monie de Mnddiction, les novices doivent prendre place i l'dglise lorsque les & s sont au Chapitre, cette phrase doit concemer les novices proprement dits, c'est-&-dire les adultes nowellement incorpods dam la communaut6, avant qu'ils ne fassent tern profes~ion~~. Qu'il leur soit refuse d'der au Chapitre s'explique du fait que, en ce lieu, les Eres dglent leurs conflits et probl5mes de toutes sortes. L'envoi A la cuisine, oh il doit toujours se trouver quelques hebdomadiers en train de prdparer le repas du OW, a l'avantage d'assllrer la surveillance des nouveaw Venus pendant ce laps de temps oh les autres biitisses du clogtre sont desertees, les Wres &ant tous presents au Chapitre.
Le quatrihe et demier passage du LT6voquant les novices se dsume aussi 5 une
". RB 58.5 et LT 142,p.206. '6. La place de ce chapitre laisse songcur, I1 se trouve au tout ddbut du livrt IT, juste ap* la d-ption
dCtaill& de Cluny II et avant le chapitre c o d I'M. Meme si quelques rtgles provenples debutcnt par la question de l'entr6e au monasttrc (telles ctllcs du T'ant et de C&ak d'Arles), comme me I'a fait remarqucr il jute titre A, de Vogti6, les sources normativcs monastiques dautent habituellement Ieur d o n non liturgique en traitant de I'M ; commc c'est Ie a s par excrnple chez Benoit et chcz Bernard On pcut donc se demander si, avec le detail des bgtimcnts claustraux de Cluny, la description de la kCdiction des novices ne f i t pas unc addition tardive, de feuillets composts SCparCmmt, et P unc date qu'il rcstc ddterrnincr.
IT. Le chapitre dtbute par la phrase Ma ut @si [Novitir) erierint de cellu nouitiorum uel ante0 <quam> in cf~tr~tmfierint ... m, qui pourrait laisser supposer que les nouveaux venus ont bdndficid d'un traitemcnt partidier avant leur profession (LT 143,p207). Mais on sait que la celle n'existait pas encore au moment de la ddaction du texte, qu'elle n'dtait qu'en projet, On pcut canstater que uttc absence ne change absolumcnt rien au contenu du chapitre puisqu'il traite uniquement dc la cbdmonie dc Mnddiction. If ne faut donc pas attacher une grande signification B cette prernih phrase,
LT 154,pZ 1. 19. Le coutumier de Bernard c o n h e cette intexprdtation : il est dit que, pendant leur noviciat, les novices
doivent &re instaIl6s ii la cuisine a w heures du Chapitrc (Bern I,xv,p,165).
seule phrase. Un moine de passage, &ranger au mob, n'a le b i t de parler ni avec un iuuenis encore sous surveillance, ni avec un novice : a h ciarcstro iuuenes qui sub wtodia smt ud nouitiiflatres mnum co1ioquroqur~ h a k e debent cwn illo. ma. Il est e s t d e de smir de quek norritii il est @on ici : du fait de l'ajout du tennefiatres, on put t&s bien envisager pu'il s'agit miquement de ceux sur le point d ' h M s (cette ctdrnonie durant trois jours), ou des mtrnes, mais aprts leur profdon, alors qu'ils sont pla& sbus surveillance porn m e dude d'm B cinq ad'. Supposons malgrt tout qu'il s'agisse des novices avant, pendant et apds la profession.
Dam l'ensemble du LT, il n'est donc mentionnt, en tout et pour tout, que deux diffiknces & traitement entre Ies m o b s prof& a les novices avant l e u bQ&iiction : ces demiers n'assistent pas au Chapitre a ne pewent adtesser la parole ii un moine Ctranger. C'est trop peu pour qu'on puke drieusement pader de novi&at sous Odilon. D'autant plus qu'il parait dvident que le sujet de la formation des nouveaux venus n'int6resse ni ne pdoccupe I'auteur. La petite phrase citk cidessus (qui pdvoit que les novices, lorsque leur celle sera constmite, y mediteront, mangeroat, dormiront), bien qu'elle semble dvoquer un programme de formation, montre, du f i t r n b e qu'elle fht reprise text0 de la RB, qu'aucune reflexion n'a W mende sur le sujet ; seule exception, les Clunisiens ont pens6 qu'il serait utile d'ajouter des latrines i cette b&tisse !
Ainsi, du temps d'odilon, non seulement les occupations des nouveaux venus ne d B i e n t pas de celles des autres Wres A dew exceptions prts, mais aussi - et ce malgrb le projet de bath une celle qui leur soit dserv6e - aucune &flexion n'etait en cours sur la formation des novices. Pourquoi alors envisager la construction de cet edifice ? J'entrevois deux possibles explications. Premihanent, le Cluny II, tel que decrit dam le Liber tramitis, correspond davantage a un monaSf6re ideal qu'P m e realit futureJ2. Dans un tel tableau, place devait &re f ~ t e ii la celle des novices, puisque Benoit en avait par16 dam sa dgle et que les Clunisiens afEmaient constituer la seule congrdgation v6ritablement fid8le a cette
'O. LT 198,p279. Le titre du chapitre est Ie suivant : l Item de i l k monachis p i non habent facram profesionem in @so loco ubi &gunt. r
'I. Le chapitre sur le rituel de la MnCdiction se conclut par le paragraphe suivant (qui permet d'en savoir beaucoup plus sur le traitement des novices apds leur incorporation h la comrnunaut6, qu'il n'cn a jamais Ctt? dit sur leur traitement avant) :
Deinde In cppituflo u d I d omnibus socimturfratribus. Nam et ipsi nouitiiprimo anno non loquantur cum uIZo homine siite sua ctlstodiu nee cum ipsIj#utribtrs p i cfaustremi ant . nki cui iussum fierit. Nam et rjlse mstos sed't inter @sum et eum qui cum iflo loqui cupit. In capCuIo non pruesumuf loqui <nouitius>. nki de aIipa CC~USU intenogutus firerit usque mnum trmactum sew quinquennium- . (LT 143.~208).
N. HUNT a pens6 A tort, i la Iecture de ce passage, qu'il conccrnait les novices avant la profession et clle en a conclu que les novices sous OdiIon M m t sournis une a ~ & de noviciat m accord avec la RB (Cluny uncter Saint Hugh 10494109, London: Edward Amold, 1967, p.92). Le "deide" au dtbut du paragraphe et la phence des novices au Chapitre indiquent bien pouxtant qu'il est ici question des nouveaux venus ayant dejh fait profession, W. TESKE a soulignt L'errcur d ' i ~ ~ o n commise par N. Hunt, sans pour autant rernettre en cause la question de la dude d'une annde de noviciat (m Laien, Laienm6nche und LaienbrOder in der Abtei CIuny - Ein Beitrag zum "Konversen-Problemn I., FriikSt., 10 (1976): 286).
'*. N. STRATFORD, Les batirnents ... w, opcit., 1992, p389.
oeuvre. Deuxiknemen~ les causes qyi m t l'instauration d'un vtkitable noviciat sous Hugues (B savoir, I'a8nux & convatis adultes a la di5cult6 qui en dhulai t pour les former par "immersion") &ent peut-b dCja agisssntes sous son pFWecessM. J' Werai celles-ci en m h e temps qye j ' a d y d le discours sur Ie noviciet dans le counrmier de Banard. Mais avant d'aboder ce sujet, il hut s'intemger sur la m a n i b dont Wen t trait& les postulants ii Cluny jusqu'h l'dpquc de -on du LT.
Cornme je l'ai ddclart pCc6demment, les corzsue~ines mtiquiores n'abordent absolument pas le sujet du noviciat : jamais les tennes nouitii ni nouitiahrs n'apprrraissent en ces pages. Certes, l'existence quotidieme au monasteFe n'y est pas trait& ; seule est ivoqu8e la liturgie. Pourtant, les novices auraient pu &re mentiom& dans certain= sections de celle-ci, tout spdcialement dans les descriptions des processions qui mettaient en sckne toutes les divisions de la communaut6 claustrale. La meme constatation est valable pour le Liber tramitis. A l'exception des quatre passages d6jh analy&s, les novices ne sont cites nulle part ailleurs dam le texte, m h e lorsque les groupes de la commu1ls~ut6 abbatiale sont CnumMs simdtandment. Il est don question depueri, iuniores, seniores/priores et famuli, ou encore de pueri, conuersi, leuitae, sucerdotes et fmuli, mais jarnais de novices43. Leur absence atteste que les nouveaux Venus adultes itaient rdpartis d& leur arrivk entre ces difErents groupes et confirme ce qw laissaient supposer les Vitae : avant la deuikme moitid du XIe siecle, il n'y avait pas de noviciat vdritable P Cluny. L'etude des sources hagiographiques a pennis de constater qu'il existait une pdriode de probation pour les postulants avant que le seuil du cloitre ne soit h c h i ; l ' d y s e conjointe de la RB, des cometudines mtiquiores, du LT et des Virae va maintenant parnettre de suivre ces memes recrues B l'intdrieur du monast&e.
S'il n'y avait pas de vtkitable noviciat, quand alors prenaient place la En6diction et la profession des postulants ? 11 est diflicile de dpondre ii cette question car sut ce point encore, les coutumiers ne disent mot. Sur la base d'indices foumis par l'hagiographie, j'avancerai I'hypoWse que la profession 6tait presque sirnultange avec l'entde mais qu'il arrivait qu'elle soit retard&, non pour donner au postulant le temps de dflkhir sur le bien- fond6 de son choix, mais pour laisser au monasth l'opportunit6 de rjeter un candidat douteux. L'entde au monasth constitue me &ape fondamentale dam la vie d'un saint ; en revanche, Ies hagiographes ne xmblent jamais s'int&esser ii sa ben&iiction ni a sa profession, comme si ces dew c&monies etaient indissociables de l'entde au cloitre ou comrne si leurs c616brations w chgeaient pas grand chose ii l'existence du postulant. Ainsi, l'entree d'Odilon ii Cluny est &oqude comme suit dam la Vita de Guillaume de Volpiano (redigee c 103 1 -36) :
a Nam post patrluIum ad coenobium nominatissimm honorijice deueniens Cluniumrn ibique a sancto Maiolo est deuote wceptus atque in habitu sanctp conuersationis monachrcs ex more sacratus. mu
Une anecdote de la Vita Odonis, telk que contee par Jean de Saleme, l'abdviateur et
43, Sur I'ordo des processions detailldes dans le LT, cf. chapitre II- W, x,p280. Cf. aussi supra le cas d'Odon et #Adhegrin A Baume.
I'HmiIIimus Wdgd m&e les fhi@), o& en m c h e un exemple de l'imposition d'un temps d'attente atre I'entde au clothe a la profession La sede vue du saint qu'il avait crois6 en route dkida un jeme volcur ( b o iutlena) h se convertir. Il supplia I ' M de I'accepter imm~atement au rnomstk mais ceiuici ayant appris son ancien mdtiet lui demanda &amender auparavant ses findes (a V& etprizu mores hear wmge, etpostmdh monasticurn q p t e dilscipilaf~m B ) ~ . Certain de retomber dans Ie pCch6 si on ne I'acceptait pas sur le champ, le jeune homme convainqt findement Odon de l'stimettre. Lcs hagiopphes ont jug6 utile de qp?&er h cet endmit de lcurs &its que Ie voleur ne fbt pas fait moine d&s son incorporation ; on le surveiUa d'abord quelque temps : a Peracto itaque aliqw tempore sub regulati degenr examinutione, tandem effectus monachtrs m4?. Pour une personne de qualit&, l'exact c o n e se produisait : il etait p d f h b l e de l'accepter rapidement de crainte qu7elIe ne change& d'avis et quittiit le 'monastete. Ainsi, presque un sikle plus tar& alors que Pierre le V h b l e insistait dans ses statuts pour qu'aucun individu ne soit accept6 dans l'<)rdre clunisien sans l'accord de I ' W de Cluny (ce qui nbs i ta i t de retarder la profession B m e date indCtermink), iI admettait cornme exceptions les en* ad sucamendm et exceplis magnis et ~n'libw personis, q w e si dzzerrentur levitate fortassis animi retrocederen& nec in incepro conversionis proposiro permanere~t. m4'
Il reste maintenant I savoir comment les noweaux Venus apprenaient leur nouveau m6tier de moines en l'absence de noviciat La t d s stricte hi6rarchie monastique, telle que d6finie par Benoft, jouait un r6Ie-cE dam la formation du postulanfg. Lors de son arrivCe au monast&re, celui-ci prenait gdnMement la d e d k place, en bas des iuniores mais au- dessus despueri ; clans certains cas, si ses qualifications (et donc, trh probablement, son age) le justifiaient, il pouvait etre &lev6 I un rang sup&ieur, par decision de 1'abE. Cependant, quel que fit son echelon, le nouveau venu se trouvait au-dessous d'un certain nombre de moines : ils etaient ses senioredpriores et lui leur iunior. A b i , m e bonne partie de la population claustrale etait en droit de lui donner des ordres et de lui fgire la leqon ; le reste de la communaut6 n'ktait pas inactif pour autant puisqu'il pouvait le surveiller et denoncer ses fautes, au Chapitre ou ailleudo. De la sorte, et ii la condition que les nouvelles ncrues
'? Cf. YO" 44,col. 10 1-02. '6. Sur ce personnage, qui serait peutdtre non pas un voleur, mais simplement un noble plus soucieux que
d'autres d'accroitre ses biers, selon des mCthodes dprouvks par l a m o d , cf. H. GRUNDMANN, Adelsbekehrungen ... *, opcit-, 1968, p330sv. ". YOx I2O,col.7 ID, V O et V O 40,p248. ". Stat. 35,p.69-70. ". Cf le chapitre I& qui traite pnsquc exclusivement de la hierarchit monastique, plus spdcifiquement de
la clunisie~e. '9 A en mire Jean de Saleme, Won, arrivC vers l'@e de m t e am P Baurne, fut aucsitdt nommC magikter
des enfants du fait de sa grande culture. Il n'tn dexncura pas mains sous la surveillance tr&s pointillcue dcs Wres : lots d'un Chapitre, ceuxci I'accudrent d'avoir accompagn6 la nuit pdcCdente un enfant aux toilettes sans s'etre muni d'une chandelle (VO1 1,23,co1.54B ct 33.~01.57-58)- Guillaume de Volpiano fit aussi promu A un rang plus Clevt A son arrivee i Cluny, sur decision de I'abM, avec l'accord de tous les moines (W v,p266).
La possibilitC de jouer sur le rang accord6 au nouveau venu II son entr6e I'abbaye devait pernettre une
ne firssent pas trop nombreuses, m e multitude d'yeux a de bouches les surveillaient, tanqaient, nprenaient a supmisaient. En outrr, si le besoin s'en faisait sentir, on powait leur interdire certains espaca ou contacts plus dangerem que d'autres (le Chapitre, les &rangers, etc.). Tels Went la surveillance, le mode de punition a les interdits imps& am postulants. Mais me formation ne se duit pas i cela.
Je traitt en ddtail de l'appmhmge de la vie monastiqye au chapitre III & ma thbe ; je den paslerai donc ici que mcciactemcnt. Les premiers coutumiers clunisiens (C1 a LT) finent &dig& pour expli~lrer & d'autres comrnunaut6s ce qyi constituait l'essence & I'ordre. Leur lecture nous appxed donc cp, pour Cluny, cbanm des gestes daDs la vie du moine @as seulement les liturgiques7 m h e si m i primaient sur les autres) devait &re accompli par souci d'0bCissance7 en accord avec un &dement, que celui-ci soit extrait de la RB ou de la coutume. Tout, m h e Ies actions les plus anodines comme le coucher, devenait rituel. Dsns cette paspective, l'objectifprincipal de la formation du postulant etait d'apprendre ces gestes tels qu'ils &ent dCfinis dans les coltsuetudines? Le moyen pdconid n'6tait pas la lecture assidue de ces owrages, ce qui aurait tt6 assez vain*, mais I'imitation des autres fhkes. h i , les nouveaux Venus 6taient directement int@& dam ce ballet grandiose et parfatement orchest& que Ies Clunisiens offraent jour et nuit au Seigneur, afin que, par l'imitation et la &#tition, ils mdtrisassent le plus rapidement possible leur r6le.
Ce mode de formation, bas6 sur les deux principes de restriction/protection et imitation, &.it d6jB celui pdconist par Benoit pour Ies enfants. Son extension par les Clunisiens i tous les nouveaux Venus suggQe dew hypothks. Premikment, le groupe des
tr& grande flexibilitd et, surtout, un traitement tds diffihnt pour chacun des postulants. Je ne partage donc pas I'opinion de G. CONSTABLE quand celui-ci a f f i e que tous les postulants dtaient trait& de manitre unifonne et que ce ne firt qu'h partir des coutumiers de Bernard et Ulrich que des distinctions f k n t faites entre em (a Entrance to Cluny.,, V, op-cit., 1975, p335). Ces textes ont simplement codifid des pratiques qui existaient pddablement
sl. Une p a v e a postetiori de ce phdnomhe cst que le coutumier de Bernatd, qui d a r e peu du LT honnis qu'il est plus d&aill&, a Ies novices comme public dbign6. Les coutumiers antcrie~vs (C1 et Ll), rCdigCs B une Cpoque orl il n'y avait pas de noviciat, sont en revanche dcstinb h des comwaut& autres quc Cluny. N. HUNT avait d6jB not6 que I'apprentissage dcs novices clunisicns st &mait i la mdmorisation de gestts exterieurs : [..-I the whole emphasis of the cwtomarics is on externals and there is no evidence of the kind of concern at Cluny that is reflected in various contempotary tnatiscs conccming the training of the novices. v
(Cluny, 1967, p.95-96). Les auteuts citds en note par Hunt, Hugues dc Saint-Victor, Adam de Perscigne ct Piem de Celle, ne sont pas contemporains de Bernard et Ulrich,et le demi-sit& cnviron qui &pare ces dew groups vit des transformatiom notables dam la perception du noviciat et, surtout, dam la conception de I' intCriorhation.
S Cetk question n'est pas a W C e dam les coutumicrs anciens mais Bernard et Ulrich, qui, B la diffidrcnce de Ieurs pdddccsseurs, ont longuemcnt rtflkhi sur la fonnation du novice, ont admis I'inutilit6 de I'enseigncment par le biais de I'd& ou de la patale. Puisque la plus grande part du savoir que le novice devait acquCrir consistait en gestcs, micux valait qu'il suivit de ses proptes yew les actions des moines pour ensuite les imiter. Ainsi, les deux ddclarent : De hoc [au suja de ce qu'il faut faire & I'€glise] uutent prae$ahrr scholaris C b k i non cnrditu quanrum v k inrtnritra. ((Bern I&p. 169 et Uclbl. 1II,ii,col.7O2D). Dans un autre passage, ils Ccrivent, toujoun propos dc ce qu'il faut faire dans I'Cglise : [...I a m aIib se summittentibus se summittit ; cum aliis se levantibur, se levat# ad venias# adpreces, adorationes. a (Bern, 1,xkp. 178 et Udal. II,xxii,col,7 1OC-D).
pueri etait cons@uent : autrement, m e formation qUi se ppStait plus piciafement I l'edhce n'aurait pas Ctt privilCgi&? Deuxihement, puisque les postuIants adultes powaient se fondre dam la communaufk des frtrrs, pour &re s u r v d k par eux a agprendre en les imitant la coutume cluuisime, c'est que lna nombre Cteit d t ? Tmp de recrues, donc trop de sources d'arruff et trop d'individus ih meillet, await h s s 6 les cartes- Il n'est pas &omant que ce fut sow Hugues, alors quc Ies postulants adultcs se pressaient plus nombrmx B la porte de Cluny, que cette m~thode de formation devint caduque et que le noviciat fit son apparitions?
Le lectern n'a aucune difficult6 B connalntre le traitement r k r v 6 aux nouveIles recrues dam l'oldo cluniacensis de Banerd puisque de nombreuses pages de cet owrage leur sont directement consaa6ts. Je me contenterai ici de les dsumer- Le problkme consistera par la suite B expliquer punpoi le wviciat "bcmardien" possddait une structure a w i particulik, t d s 610ignk de celle envisagk par saint Benoit dam sa r&gle-
Ceux qui dkiraient entrer au m o m 6taient -us et install& l'hospitiufl, ppuis 1'abM venait leur rendre visite pour 6prouver leur pasCvhncet A la date qu'il avait choisie, il les intmduisait au Chapitre et les nouveaux Venus promettaient aussit6t l'obeissance jusqu'A la mort ; ils 6taient rasesn, tonslues et changeaient d'habit A paair de ce moment,
n. J'explique, dans mon chapitre III, partir de quellcs perceptions dc l'enfance ce modele Ndagogique fbt conqu Avec les coutumiers de Bernard et d'Ulrich, un processus mverse commence ii se fhkc jour, c'est-&- dire que la keption des &ts est maintenant influencb par celle dservCe aux novices : les enfants ne sont plus immt5diatement inth- dam la communaute mais doivent attendre k bon vouloir de I'abM ; ils qoivent alors la coule bhie par le supdrieur. Le m e de h ct5monie de Wn&liction a lieu lorsqu'ils atteignent q u k am-
( Puer qui ctrm CIeticafi, vel LaicaIi habitu venerit, hunc Camerariw in vestiarum ducit eodem mo& v&iendum quo quilibct Novitius praeter quodei non stamhem, sedpro stamineo camiria iinea rib?ur- Cum v&um f u d D. Abbaa capefflwn &fiocco eHjiibet aujierrr; ctlcuIIm e i ahah benedici~.. w
(Bern Iprvii,pdOO et U&L flI,viii,col.74 ID). Y. LC group dcspueri, m revanche, pouvait &re conrtquent. En e m ils Ctaient placLr tout en bas de la
hierarchic et st trouvaient donc sous la coupe de tous Ics Wres ; de plus, ils avaicnt des mahcs pow les surveiller de trb p&. Un indice suggb quc 1 s plus jeuncs dcs m c s adultes de Cluny pouvaient Wficier, e l k aussi, d'un passage ii la schok Dans la Vita de Pierre Pappacarbono (abbt de la Cava dkCdt en f 132), il est racontd comment, en& rrribfescm ii L a Cava, il voulut x perfkctiomer A Cluny a partit donc pour cette abbaye. A son urivte, l a seniores d a n a n d h t qu'il hsx un rtjour dam h schofapwrorum, mais Hugues Ie dtfendit. I1 a f f h a que l'entrcprist d'un si long voyage attestait de sa maturitt et qu'il devait &tre immddiatement rqu parmi I s moines (m De vita venerabifik abbatik Pepi, Vitae SSI Patrum Cmemhm Alpherit Leon&, Petri atque Comtabifis, Abbatum ejudem Sacri Monasterii m, Rerunt itdicarum scr@tores, 6d. LA. Muratori, vol.VI, Mediolani, 1725, ~01.217). Si I'histoire est vdridique, on p a t en conclure que la schoia servait former les recnres jug& menmlemcnt trap jcuncs ; ainsi, sa fonction n'aurait pas dt6 principalement intellcctuellc.
ss. Cf. note supra. 56. Pour tout ce qui suit, je me rt%h au chapitre XV du premier livre du Bern (I,xv,p.165-67). Mais il
arrive que d'autres sections du mtrne ouvrage confinnent ces informations. Ainsi, au sujet du passage des novices par l'hospitium, cf, I,ix,p. 155.
? Sur le fiit que cette drdmonie symbolise l'abandon de soi, c t L. TRICHET, La tonnve, Paris: ~ d . du Cerf, 1990, p.27sv., remarques de J. GAUDEMET en pdface de ce mime livm, p.9 et G. CONSTABLE,
il n'dtait plus question pour eux d'un retour B la vie &uli&d8. La pnkocite de la &monie de changement d'habit &it sur ce point significative ; dam la RB, eIle p d t place au contrairr ii la toute fin de la pcriode de noviciat, c'est-hdire 1'6chhce de l'annde de probation. Le rituel d'entde achev6, suivait ce que j'appellerai la "premi&e phase de formation des nouveawc venus".
Dts le premier jour, les recmes de Cluny passaient sow la coupe du maitre des novices ( q ~ n'avaif encore jamais CtC &@ dans les autres coutumiers) et dormaient dans la celle des novices. Ce local avait &nc finalement tW contruit ; mais aprb avoir hroqd la preparation des lits des novices en ce lieu, Bcmard jugea ntkssake de revenir sur le =jet de la celIe et sp&ifia que c'dtait bim entre ses murs, et non avec les fitrrs, que les postulants devaient dormir (a nun enim in dormitoriofiatrum jacent donec benedictionem susceperint. m). Cette pdcision trahit pmbablement le fait que cette ¶tion n'dtait ni rt5paudue d6jh dam tous les monast&es de I'ordre60, ni d'une tr& grande antiquit&.
Pendant cette premiere phase de formaton, hormis le fait qu'ils devaient normulement dormir en dehors du dortoir, les novices partageaient I peu de choses prh la
introduction de 1'Apologiae duae - Gozechini Epistoh ad Wafchenrm - Bwchardi ut videncr, Abbatb BelIevalIiS Apologia & Barb& ed. RBC. Huygcns, Turnhout: Brepols, 1985, p.60 et p.1 15-16. Chez les Germains, celui qui coupait les chcveux de l'cnfant pour la premih fois devenait ensuite une m e de @re spirituel (cf, R BARTLETT, Symbolic Meanings of Hair in the Middle Ages m, Transactions of the Royal Historicaf Society, 6e drie, N (1994): 4849) ; sur cette base, les moines considhiient peutdtre la cdrhonie de la tonsure du nouveau venu (enfants ou non) comme signc de son incorporation dam m e nouvelle farnille. Bartlett avance aussi l'hypotke que Ics cheveux courts du clerg6 occidental symbolisait peutdtre sa renonciation au sexe (ibid, p.57). Quoi qu'il en soit, cettc prcmi&rc tonsure &it hautement significative.
ss, fe reviendrai plus loin nu l'abswce d'un temps de probation dam le noviciat tel que defini par Bernard. Le Bern, n'aborde pas directement Ia question dts biens dans le &it de I ' e n ~ e au monastere mais il
Cvoque la distri'bution des cffets du novice entre les diff€rents officiers (cf. mpra). En outre, l'hagiographie ne laisse aucun doute sur la plittique de se d6Iester de toutcs ses richesses au moment de quitter le monde et non A la fm du noviciat. En voici un cxemple parmi plusicurs, celui-ci tirC de la Vita d'Odon par Jean de Saleme. Alors que les monastCm dklinaicnt par suite des invasions nomandcs,
Sub hoc Mmque temporefiater quiclbm, recedens a& hac peste, nostrum petiit monasterium, deprecam ut eum reciperemus. Cujus annuentes volmtati, prot im omnia quae acqukierat abrenuntiovit, et monastwio concessit. * (VO'JII,2,col.76D). s9. La portde symbolique de l'habit est t& grandc pour Ics momcs ; cf. par excmplc RB 58,27029, V.
HERMANS, De Novitiatu in ordinc bcnedictiao~cisterciensi a in iwt communi usque ad annwn 1335 m, Analecta 5kri Urdinis Cisterciensrj, 3 (1947): 69 et A. dc v O G ~ , Saint Benoit, sa vie et sa r2gle. &tudes chobiks, (Vie monastique, 12) B6grolles-en-Mauges: Abbaye de Btllefontaint, 198 1, p. 190-9 1. Bernard ne dome aucune pdcision sur l'habit du novice. Dans U i , on apprcnd qu'il pork Ie meme habit quc les moines de Cluny, & une exception prts, mais fondamentale : il ne pork pas la coule (cf. U&l. II,i,col-7OlC).
Dans le coutumier de hnhnc, il est prCcis& quc les postulants doivent donnu dans la celle des novices = out in donnitorio. si cenobium huiusmodi cellum nun habet (Decreta Lantami monachk cantuariensibus trunsmirsa [ b n f i a c ] , Cd. D. Knowles, (CCMIII) Siebug: F. Schmitt, 1967, 103,p.86). Cet ouvrage est fort utile pour bien comprendre celui de Bernard car il fit h i t sur la base de ce meme texte, par Lanfianc, maintenant archeviique de CantoMry, pour la communautd de moines de la cathtkhle. Sur la date de ddach'on des Dicrets, cf. J. WOLLASCH, Zur Verschriftlichung... D, FHh-St., 27 (1993): 343-44 ; le terminus ad quem de 1073174-1077 ne peut etre retenu, et il faut plut6t considerer les anndes 1086-1089.
vie quotidieme des proR$'. Sur cette base commune, B e d Qumk les exceptions. La principale, qyi b i t dCjH appliquCe du temps du LT, conceme Ie Chapitre : les novices ne pouvaient s'y mdre qu'aux temps de la ColZatio et du M i . Pendant le dhulement du Chapitre proprcment dit, ils attendaient H la cuisinea. Sur le plan liturgique, ils se mE1aient en tous points aux activitk dcs f%res DtS le premier jour, une place Spcciscpe leur avait ttt attribute au chcmr, donc avcc les autres moines, selon leur rang dans la h i k h i e (a o r d i m a MagtFfro suo in chro m). Le seul intcrdit est qu'ils ne powaient occuper un r6le de premier plan avant leur profdon, cornme firin une lectio, chanter un dpons ni entonnet me antieme. Les contacts atre les novices et le monde ext&ieur Went plus stricternent circonscrits : le novice n'avait pas le h i t de sortir du cloitre sinon pour les processions ; mais, plus significatifencore, iI ittd6fendu am moines de park d'un novice i quiwnque de I ' eeeur , le temps du noviciat et pour m e a&& ap& la En6diction. Dam une moindre mesure, les rapports entre les moines et les novices dtaient aussi Limit& puisqu'ils Weat s6par6s aux h e m de hire discussion au cloitre? La commuaaut~ des f%res devait toujours exercer me certaine surveillance sur les nouveaux Venus et denoncer leun fautes, mais en dehors du Chapitre et dam des limites bien pdcises? La grande innovation, par rapport aux autres coutumiers clunisiens et de ce qu'ils devoilaient de la formation des nouveles m e s , est qu'il etait maintenant question d'un maitre et de son enseignement ; m a l e tout, les modes ou le maitre eduquait ses pupilles dtaient peu nombreuses et servaient avant tout B occuper les novices aux heures creuses6?
61. Ap& avoir explique certaines des exceptions du traitement des novices, Bernard ajoute : a In aliis omnibus Conmfum fmentp vi&icet coquinam faciunl: ma&m akpperiblrr, sicut caeteri de thuribufo* & candelabris* quibus hac pertinet* sentiunt, (Berm I,xv,p,l65)-
62. Bernard ajoute ici une pdcision absente du LT, qui est un indice du nombre grandissant de novices Cluny : ceux-ci vont & la cuisine pendant le temps du Chapitre : nkimqorfiren't muititdo [,..I. Si vero mltlri firerint, in ceffa Nmitiomm manent, mo Magistro, non tamen ut ex toto Capi'um deserat* si necesse ficerit* inter eos docente. A la difference de I'auteur du LT, qui fit pnuve d'um emCme skheresse sur ce sujet, Bernard expliquc comment les novices doivent s'occupcr & la cuisine, pendant cctte @iode d'attentt :
[...I si quid circa i p m * ubi tunc pulmentum, & /abw guuque diQuando smt appa~itae~ focendum viderint, f~crciant* & cum ibi sumam silentiwn s e m p tenenup de imrtilibur loqut vel in alr'guo dio vagandi facultatem non habent. L..] Pertimt etim @is si Secretarb i d e eos summomwit, eligere fmmentum . (Benr I,?CV,p, 169. ". Ces rtgles d'exclusion &aicnt dCjQ appliquk envers Ics cnfmts et les jeuucs non encore mOrs (cf. sur
ce point Ies chapitrcs IlI et IV), 11 s'agkiit de &parer les h c s encore fiagiles de toute influence conuptrice, &. Pendant ks h e m s oa il etait pcrrnis de parlet librcment au cloitro, alors que les novices se trouvaicnt
dans un coin de celui-ci et dcoutaient la lqon de leur make, si vero quis de eis [dcs Wm] cfamareI vel ut in alipo meliorentw exormi vol~erit~ licet ut veniiat. &
corm Mugiriro edicut.f4ctoque cfmore quemarlinodirm Fratres in Copitdo, contimro mugentes veniam petuni, non interim sessun; donee ememabtionem promitteniibrrs Magistet- praec@iat [...I . ( B e m wv,p. l65). ". Au debut de la description de la vie dcs novices au monaothr, unc fois pa& le premier jour, une phrase
concernc l'enseignerncnt qui doit Ieur &re dispensd : a Per caeteros teminm in ma ceifa a Magisfro suo addkani ordinem suwn, horir tamen incompetentibus neqrrcrquam* niri ea die. qua veniunt, vei in crartino. a. Leur maim leur fait la lecon aux heures oix il cst permis de parler au cloitm : Post Capifufum aurem diebus quibus Fratres Ioquunlur in CIawtro, sepa'ati in qu& prte Clmtri debet Magisrer eorum sedere, ibique de ordiie docere (Bern, I,XV,p. 165).
Cette premitn phase de formation des novices prenait fin sur d6cision de I'abM, aprts un laps de temps indCtermint5. LC supcrieur demandait am postulants de vedr au Chapitre, et Y deux cas de figure se phntaimt : soit il jugeait qu'ils *ent mQs pour &re benis, soit il dkidait do contraire. Dans Ia dehe alternative, me seconde phase de formaff*on commen#t dots, trts diffhk de la premih. En c&t, m e Scparation presque totale entre les postulants et la co~nmuna& &it instit& :
[..,I ex hac bra, non jmn ut priut i* alios, id est in Comentu conwrsutionem habent ; nonr etiam a toto Convent6 C l a m d u e Magistro eis IOE4 Prioris pruesfclente, in cella sua eodem ordine# & e d e m hora, qwr Fratres refciunf, legunt. loquuntur, scribunt, & caetera pucre assoIent, dt congrnmt, exercent ; nec ~ u ,
momento mpm s~lrr, out emsine Magiistro, quipruecedat eos ; &is semper (it dictum est) sicufpriiorssfle~, aItero pst altenrm sequentibus. except0 solum pro necessitate corporis J..]. In ecclesia s e e m , in loco sibi deputato mmrent, scilicet inter chorum dt aucm 6.- ] Sciendlm praeterea, quia quemadnodum omnibus loch, ac l e d , d*drisu~ ita quoque in Copitulo per se sedent, s e w ingressum ad wunn pmtem
Dans cette deU)Li*rne &ape, le modele utilid est le syst&me de correction des adultes : exclusion de la comm~naut~~ repas pris s@&rnent, puis occupation du tout demier rang dans la hi&rarchie, en-dessous mSme des enfantsd7. Ainsi, l'dliment moteur est-il l'humiliatioa Il est fort possible que les Clunisiens esp6raietlt de la sorte briser les caractiires trop orgueillew et galvaniser les energies de tous. Face ti cette brusque exclusion, les nouveaux venus ne pouvaient aspirer qu'k &re &int6gn!s a noweau au sein de la communaut6. Cette situation durait un temps ind6termint5y jusqu'h ce que L'abM ddcidiit enfin de les h5ni.r.
Ainsi, il existait l Cluny, l 1'6poque de Bernard, deux temps de formation : le premier qui n'etait pas P proprement parler un noviciat, puisque les nouveaux venus 6taient presque enti&rement assirnil& a la communaut6, et le second qui comspondait v&itablement, hi, h un noviciat, mais selon un mod&Le assez difftrent de celui de la RB. Ce mode bipartite de formation put paraitre intrigant A prime abord mais il devient pdaitement compdhensible lorsqu'on connait la situation qui I'a prMd6. Sous Hugues, le moaast&e bowguigon Wnkficia d'un formidable essor, qui se traduisit, entre a m y par l'afnux de trk nombreuses recrues adultes, ce qui le contraignit B modifier sa m6thode de formaton. Auparavant, il avait dt6 jug6 suftisant, pour eduquer les nouveaux venus, de les int6grer directemeat P la communautd pour qu'ils en appment les &dements en imitant les f b s ; les seules
66. Bern. I,XV,p. 166, n. 6.J Signo pukato ad horant. past alias ingrediurtna Mol~~~terhrn, part afios exeunt ; quocumque ant,
vel ubi sint, e a c h omniho reverentia imi id i e i s , & tzcce&ndi ad @sm, exhibetur iffir, quae & infuntibus, ipsique eandem omnibus exhibent. . (Berm I,xv,p.166). Sur le trakrnent des Wrcs fautifs, cf. Bern I,lviii,p.252-53. Celui qui a commis une faute grave est rctranchC de la communaut& : il mange et dort sdparCment, et n'a le droit de parler & persome except6 cclui qui Ie sert et les seniores qui lui servent d'intermediaires avec I*abb& Le temps des Hems, il se timt prostern6 A la porte de I'6glise ; les novices, pour leur part, doivent rester agenouillQ p d s de la sortie tandis que les Wres quittent le lieu (Bern. I,xv,p. 166). Lorsque enfm le fautif ea pardand, ii prend la toute dernitn place dam l'ordo.
mesuns particulibs prises h leur Cgard Merit qu'ils Ctaient 6loigds de certains lieu critiques, de crainte qu'ils ne subissent de "- influencesn oe Chipitre, le monde ext&ieur, le cloitre lors des he- de libre discussi~n)~. Avec I'afIlux noweau de postulants, ce mode de f o d o n devint inad@mt : trop de nouveaux venus, donc trop de f&es ignorant le rituel et risquaet & s'induirt les uns 1 s autres en emem. PlutBt que de modifier du tout au tout le mode traditio~d dc formation, ctIui-ci fbt simplernent prolong6 par un noweau noviciat Ce dcmia, tout en &ant dessin6 sur la base des prhcipes ben&iictins de -tion de la communaut6 et r6le primordial du h i t Cgalement profondt5ment marq, par Ies techniques punitive employtks par Ies moines.
Pourquoi avoir dtfini un autre noviciat plutBt qw d'appliquer le rnod5le Mn&iictin ? Parce que celuici n'avait pas c o m e objectifpremier la forination des novices mais l e u probation. La R2gle de sainr Benoit est conpe de telle so& que le monast&re qu'eUe dtfinit est me dominici schoka senririi, oii le moine ne cesse d'apprendre et de progresser. L'ordre hi6rarchique institu6 par Benoit, mais qti carazt&ise 6galement la majorit6 des ~ g l e s monastiques anciennes, joue un file prdpondbt dans cette a formation pennanente J0 : chacun des moines, P I'exception de I'M, se muve toujours plad sous roeil vigilant des autres fi&res et soumis aux 0 t h de ses senbres. Le monastiire lui-meme &ant une &ole, un tel cadre rend superflu un noviciat-formation. Il ne faut donc pas s'etonner si le chapitre 58 de Benoit n'aborde absolument pas ce sujet mais traite essentiellement de la probation : pendant un an, le postulant doit rdfldchir si oui ou non il est prSt & se sownettre entierememeat a la RB7'. Un p a d noviciat n'etait absolument pas applicable chez fes Clunisiens : i Cluny, le temps de niflexion Ctait restreint a m quelques jours pass& A la porte du monasttre et 1 n'dtait pas question pour la reerue d'h&iter encore sur sa vocation une fois le seuil du cloitre h c h i . Aussi, lonque l'abbaye bourguignonne dut, au milieu du XI' sikcIe, instaurer un noviciat pour mieux assurer ta formation de ses recrues adultes, elle ne s'inspira que tr5s mod6rdment de la RB : elle lui emprunta l'idee de sdparer les novices du reste de la communautti en les faisant v i m dans une celle et en plaqant un maitre a leur t&e mais pour le reste, elle fixa ses propres statuts.
11 reste a savoi poquoi les Clunisiens, au moins jusqu'i Bernard, ne permirent pas Q leurs recrues de fake m e an& d'essai puis de repartir si la tentative n'avait pas W
11 n'est nulle trace de ces prhutions avant le tT et il cst docs uniquernent question du Chapitre et des 6trangen- Malgd tout, Ies nouveaux Venus pnnaicnt place dam les rangs des iuniores et, de ce fait, avaient beaucoup moins de possbilit&i de contact avec l'extdrieur que les seniores, cornrne je I'indique dam les chapitres IV et V de ma &be-
69. Le chapitre 58 de la RB indique que, pour Benoit, les novices devaient &c &pates des Wres (puisqu'ils mtditaient, mangeaient et dormaient dans Iew ulle) ct heficier des encouragements du maitre @uisque celui- ci devait etre tel qui u p m sit ad Iucrundc~s unimm, qui super eos omnino cuiose intendat- RB 58,6).
"'. CT. A. de V O G ~ La formation et l a promesses du moine chez saint Benoit m, CoNCt3t.. 53 (199 1 ) : 49.
'I. Cf. A. de V O G ~ (a La formation ... W, op.cit., 1991, p.52-57) : le coeur da promesses exigks par Benoit consiste justement dans cette somission A la dgle.
concluante. Je pornrais arguer qu'il s'agit, ici encore, d'un traasfert am nowelles recrues adults d'une fkpn d'agir (profession sans posdbilit& de se &user) habituellement aux d t s . Mais m e teUt explication ne saait pas satdbm 0 te. En effet, l'absenct d'un tempus probationis d@asse de loin le cadre du scul Cluny ou des monasttrrs dont le recrutement Ctait compos6 en grende part d'&tso II est bon d'insister sur ce phhom8ne tant une en* au mo& sans probation est diflFicilerncnt concevable pour un lecteur modeme Comme le s o u l i p I. LecIerq, dans son article sur le noviciat dans le Dbionmo degli htil~ti di Perfmbne, depuis 1'Antiquite tardive jusqu'au XTIe sikle, I'annk de probation exig& par Benoit de Nursie wnstitue me exception dans le monde monastique, et non L'inversen. La lecture de la Concordia regulcarrm ilIustre parfiment ce point
Ce texte etait d'une grande importance pour les Clunisiens. Si Won transmit & Cluny le mode de vie qu'il avait appris B Baume, ce demier rnonasttre avait W prdfond6ment influen& dam l'elaboration de sa ooutume par la rtforme m o d q u e entreprise par Benoit d'Anianen. Du temps de la Man du LT, la Concordia regularum servait encore comme livre de rkference pour fixer les coutumes a wmme Iivre de lecture individuelle pour les moines7'. Or les extraits des diverses egles rassernblk par Benoit d'Aniane pour commenter le c.58 de la RB s'unissent pour constituer m e image du mode d'entde en religion qui poss5de d'dtomantes similitudes avec celui pratiqub h Cluny jusqu'h Le th&me
? Cf, J. LECLERCQ, art. 8 Noviziato m, DP, 6 (1980): 446. La *gle de Cdsaire, tddigk entre 5 12 et 534 pour les moniales, exigeait aussi me annee de noviciat pour la novices, le temps que leur volontd soit mise A 1'Cpreuve (Scmcti Caesmi' Arelatensis Opera Omnfa, WI Germain Morin, Maredsous, LII, 1942,4,p.lO2-03 et V. DESPREZ, RZgIes monustigues d'Occi& IP- W si&Is. D 'Augustin ri FereCoI, (Vie monastique n09) BQyolles-en-Mauges: Abbaye de Bellefontaine, 1980,4,p.163).
n. Cf, YO' &22-23,coL53-54, B.H. ROSENWEIN, Rules and the "Rrrfem at Tenth-Cenfwy Cluny m, Studia Monastics, 19 (1977): 3 14-15 et A.H. BREDERO, 8 Cluny et le monachisme carolingien : continuit6 et discontinuitd w. dam Benedictine Culture 750-1050, dd. W. Lourdaux ct D. Verhelst, (Mediaevatia hvaniensia, I/XI) Louvain: Leuven Univ. Press, 1983, p.50-75. Ce demier auteur demontrr que I'affiation de lean de Saleme qu'il existait une afiiliation plus ou m o b dhecte eatre Benoit d'Aniane a Baume Ctait husse (cf. ibid, p54-58). mais l'important pour mon props est que les Clunisiens y croyaient.
". LT SS3,p.g 1 et lgO,p264. ". Bcnoit CManc, Concordh mgrJmm [Co~y:.Reg.], PL 103, col. 1259- 1302. J'iudiquerai les chapitres
de cette ddition comme dfCrrnccs, ct non les passage dcs egles ancicnncs citCts, m h e si celles-ci WnCficicnt bien souvent de nouvelles et meillcures Cditions : en effct, l'important cst ce qu'il y avait dam la Conc.Reg. et non ce qui k i t dit B l'origine dans les rtglcs. II st trouve trcnte et un chap* dans redition de la PL, mais
eeux-ci doivcnt Ctre soustraits la RB (chapitre I) et la RM(chapitrcs XXVI-XMX), cc qui laissc un total de vingt-six chapitrcs. La raison p ~ c i p a l c pour laquelle j'excIus la RMest sa complexitd. Le Mahe distiigue entn? l a eonvcrs ct l a M', mak par convers il n'entad pas cc qu'aunicnt comprk l a Clunisiens au moins jusqu'au We siklc (wit un lac qui s'est c o n v d tmp tad pour x fondre parfaittcment parmi les emores de Cluny ; cT. supra chap. n), mais plutdt un lak qui meaait dCjh une existence religieux dam le sikle (cf. A. DE V O G ~ Lu EgIe le Mahe, II, Park &I. du CQC 1964 (SC 106). p356n). Du fait de ce quiproquo, ks lecteurs medidvaux de la RMdevaient m e nu le m h e plan 1cs dew SO- d'cntrtc au monasttrc prop& par le Maitre. Dans tous les as, il est Ionguement question de la ntcessitd d'abandonner ses biens avant d'entrer au monastett (c.87 de la RM= cXXW de la Conr=RegJ. Un convers a droit une probation de deux mois au cows desquels il mene la m&ne vie quc les moines mais continue d o m u I'extCrieur du monastCre ; au bout de ces deux mok, il peut partir l ibment s'il le desire ct la communaut& peut le renvoya si elle k juge inapte (c.88 = cXXVII). Si, au contraire, le convers ddcide de rester, alon il s'unit A la communaut6 (c.89 =
principd de cate section est l'abandon de tow ses biens avmt de firanchir le seuil du doltre de telle sorte qye ce geste soit i&mi'bief6. Les coutumiexs clunisiens ne parlent pas de cette pratique mais les ntue attcstcnt de son application. La msjoritt des dgles prCsenttes par Benoit d'Aaiane pdconisent Cgalement um probation avant l'am6e au momsthen ; j'ai d&j& expIiquC qoe cette pratiqie cxistdt 8 Cluny a se maintint au m o b jusqu'au wuhnnier de Bernard. Enfin, la majorit6 Centre elks ne mentiomat, pour le postulant, ni formation, ni probation l'entden. C'est ce demier point qui importe plus plnticulihment, compte
cxxvm). I1 semblaait quc ce soit seulanent h ce moment-h quc le postulant sc ddma v4ritablement de ses biens. Lc ddcr chapitre sur le sujet (c90 = cXCRQ c o u ~ ~ ~ ~ l t ks Mcs : I'abb6 doit leur fitkc tds peur avant de les accepter ct leur expliqucr trh ciaircment Ies d'icuItts dc la nouvelle vie qu'ils ont choisie. Avant I'entde, il y a donc probation extem mais aussi distri'bution des biens. Une fois le postulant e n e , on ne h i accorde ni I'babii rcligieux ni la tonsure avant un an, S'il vcut rcpartir a p k ce laps de temps, il Ie fait avec ses anciens habits mais dele* de tous I t s biens qu'il avait donn&.
Sur l a diff4ents modes d'entrk au momsth dam l a Wes aucimnes, cfi A. DE V O G ~ a Les cr i ths de discernemcnt des vocations dam la tradition monastique aacimne w, ColfCist., 51 (1989): 109-26-
"'? Conc.Reg II (il n'est question quc des bicns que le postulant d & k offiir la commmaut6), III, IV, VII (sujet pccsque unique de u chapitre de Ia ttgle de saint Basile), lX (sujet essentiel), XN ( t h h e central), XVT, ~,xIx,xx,xra,=,xxx,=.
". COE- J& III (une rude probation est surtout rbervCc aux pauncs puisque, pour le ciche, I'abandon de ses biens constitut dtjil une pnuve de pcrSev&raace), IV, V (probation miitink de formation, puisque le postulant appmd la p r i h domiaide, Ics psaurnes puis les rtglements du rnonastbe), Vm (theme principal de ce chapitre de la dgle de saint Basile), X @e postulant doit servir pendant trois mois les h6tes du lieu), XI (la recrue se voit refher I'entde pendant six mois un an et est install& dans une cellule il I'exterieur du moms&@, XII (dix jours d'insultes puis un an avec un ancien daus m e cellule cxteme, au cows duquel il sert les hbtes), XI11 (le cowers, c'est-&-dire celui qui s'est d6j8 converti dam Ie sikle, est intemgt avant &&re accept& rnais I'm* semble quasi imrnddiatc si I s dponses sont bonnes), MV (trois jours et trois nuits), XV, XW (un senior le fonne entre-temps aux r&glements du monastk), XVIII (dix jours), XXV (pendant la probation externe, enseignement de Ia pritre dominicale et des psaumes, puis des dglemcnts du monastbre).
n. Je ne mentionnerai ici que I s chapitmi qui tdmoignent d'une position originale. Au chapitre X, on apprend que le postulant doit signer sa profession avant d'entm, c o m e le soldat qui s'enr6le. Le chapitre IV (extrait de la Rdgle de Macaire) propose un dEIai de trois jours ap& l'entde au monasttrc, A la suite duqucl le postulant p a t partir s'il y a discode ; il a perdu cntretemps toutcs ses richcsses. k chapitrc Xn, extrait de la rkgle de F~ctuewc, &?clam quc le postulant, ap& unc trh longue probation & I'extCrieur, cst confid 8 un doyen qui lVduquera Au chapitrc XV, il est dit qu'apds avou distri'tru6 tous ses bicns et avoir subi une probation exteme, le nouvcau venu cst rqu dans la communautc oh, pendant un an, il est encore mis B I'Cpreuve sous les injures des fihcs ; il n'endosse I'habit qu'apds avoir pa& victorieusement ce dernicr test. Au chapitre XVII, la meme affirmation se rctrouve : pendant un an, lc postulant ne rgoit pas i'habit en attendant que le "vieil hornme" se transforme. Au chapitre XXIII, extrait dcs lmtihrtiones dc Cassien, le postulant change de v€tements dts son en* mais scs habits dculien sont conservts trb longtemps (a si transactis muftis temporibas w), pour vCtificr que sa ferveur ne diminue pas. Le chapitre XXIV, dc meme provenance, atTirme qu'un pcu de dhMissancc trouvde en un postulant suffit pour qu'il soit dtpouilld de ses vtternents reIigieux, revdtu de ses anciens ct c W . Le passage k plus int&ssant pour mon propos, parct qu'il est 1e seul, en dehors de la RB et de la RM, qui park de la lrkrtt de dkision du postulant, prend place dam ce meme chapitrc :
Nulli autem qui de monasterio exire vuft, in pufam discedere conceditw nisi forte sicut senus captam densksimas tenebras nocte defigiat, aut certe, sicut mperiiu~ dirr'mus, cum con#tsione exuatur coram omnibufiatribus et depsita monarterii v&e peIIpha- (ConcReg., PL 103, co1.1287B = Jcan CASSIEN, imritzitions cinobitiques, C d et trad. J.-C. Guy, (SC 109) Paris; ~ d . du Cerf, 1965, IV,6.p. 128).
tenu qu'il se retmuve aussi bien dans la Concordicl regularurn'!' que dam les coutumes clunisiennes, et singularise la position prise par Benoit de Nutsie.
Ainsi, Cluny ne faisat nullaneat figure d'original en ne pennettant pas ses postulants untemps 6 probation. Mais les mentalit& Cvoluaient ct, en cette deuxihe moitid du XIc sikle, la perception du noviciat n'Wt pas partout la m€mc. Sur la dernande des p a p m mais a d de leur propre &a, Ies commumut6s monastiques h t de plus en plus nombreuses ii accorder un temps de probation & 1- novices. Cluny ne fut pas impermbble
cette n o d e tendauce, come en ttmoigne la r6daction du couhrmier d'Ulrich Lorsque Bemard &gea ses chapitres sur la dception des novices Cluny, il se
contenta de recopier pour l'essentiel le discom d'ulrich ; iI lui fallut pourtant y faire quelques corrections, petites mais trh signXcatives. Ceaaines ne touchent qu'i la fonne : ainsi, iI dpartit en dew sections distinctes la description des diverses sortes de recrues quYUlrich avait trait& en un seul bloc. D'autres modifications, celles que j'6tudiera.i ici, concement le fond. A travers e l k , se ddcowrrnt dew visions diffkntes du noviciat : I'une, celle de Bernard, que nous avons 6hadi6e prk6demment et qui correspondait au discours institutio~el clunisien, l'autre, celle d'Ulrich, plus personnelle. Pour &tuner, ce demier s'iloigna de la tradition de la Cmordia regularurn, soit une probation avant I'entde au rnonastiire suivie d'une formation par immersion au sein de la communaut6, pour se rapprocher de la definition benddictine du noviciat, qui met l'accent sur la lecture de la R&Ie et la probation ap6s I'en*. Bernard redressa le cap et e f f e les traces de ces aspirations novatrices dam sa version officielle des coutumes clunisiemes.
Dam L'Ordo Cluniacemis d'Ulrich, il n'est f ~ t nulle mention d'une probation avant
Benoit, h la diffCrence de Cassien et du M a i i , est le seul qui ne trar-te pas avec mepris le postulant ayant dtkidt de retoumer vers le sikle.
m. Bien que la Cone-Reg. tendit h promouvoir une en&e au monasttrc avec probation externe, dtipouillement total et immersion imm&iia& dam h corncnunautt, il est ironique de notcr que Benoit d'Aniane essaya au contrahe, par le biais dcs d m dcs synodes, d'imposer I'annk d t probation WnCdictint aux monast&cs de I'anpire carolingicn (cf, S)lnodiprimae taquc~granemis ac&zprwlr'miiwict, €d. J. Scmmfer, #24, p.436, Synodi primue aquisgranensis cdecreta ptrlhentica, &ICd. J. Semmlcr, #33,p.466-67, Regula sancti Benedicti abbatis anianensk she collectio cqitularis, &i. J. Semmkr, #28,p.523, dans Initia cometudinis benediczincla Cometudines s4ecilIi uctmi et noni, (CCM I) Cd. K. Wlinger, Siegburg: F. Schmit!, 1963). Pourtant, cc fbt la Conc.Reg qui survtcut I t mieux au passage du temps et connut un franc suc& dans les monastbres, non 1es ddcrets qui portCrcnt trb vite I t titre dc Regda Benedkti mianensis).
'O. Cf, R REMIGNON, 8 Le noviciat dam l'ancicn h i t W, Revue dk &oit cumonique, 4 (1954): 193. Gdgoire VII aurait &rit B Uugues de Scmur pour h i dcmaader dt rrspcctn I'm& de probation p d t e par saint Benoit (cf, N, HUNT, Clwry, 1967, p.92, qui fait rCfCtcncc A E. CASPAR, Dar Register Gregors Yll, dans MGH. EpidoIue Sdectae, IT, p.423). Lts ordrts mendiants, leur on'gine, nc proposaient pas de probation A 1eurs nouvclles m c s ct il fsllut diverses inte~cntions pontifides dans k courant du Xm' s i k k pour qdik modifient Ieurs dglements en ce dornaine (CK S. TUGWELL, a Dominican Profession in the Thirteenth Century D* Archivum Fratrum Pruedicatorum, 53 (1983): 7-10 ct K. ESSER, Orighes et objectsprimit@ de I ' o d e der Fr&a mineurs, Paris: &i. francisdnes, 1983, p.34 et n.l8,p53). Ce ne fit qu'h la suite du Concik de Trente que tous les ordres religieux k t contraints d'accordet B leurs postulants une #node de probation d'au minimum une annee (cf. E. JOMBART, art. Novice I, D.D.Can, VI (1957): 1024 et LA. GHESQU&RES, art.. Noviciat m, Corh, IX (1982): 1436).
l'entde au monast&e : le nouveau venu passe une seule nuit & l'hosptfunr, le temps d'apprendre Ie rituel qu'il lui fbudra suivre au Chapitre pour f h k sa demande d'admission (petitiu sua) ; B e m d rappde au contraire que ce djour est d'une d d e indCtednk, d w d a n t du bon vouloir de l'abbc (ou du @cur clausbal en l'absence de L'abbt), et que ce demier personnage &it venir jug= de la pcrs&&ance du noweau venu m fonction de sa condition et & son &c". Pcutitrr ne s'agit-3 lil qw Bun simple oubli de la part d'ulrich ; now observerons pourtaat ult&eurement d'autres omissions de ce m b e auteur qui, elks, ne pewent &e Ie h i t du pur bard. Le nouvcau vcnu se p16mte msllite au Chapitre et est admis dam la c o m m d ; j'&@ plus loin les divergences entre les dew rtkkteurs dam Ieur description de la drhonie de demande d'admissio~~ Aprts ceIIe-ci, UIrich traite du signe qui distingue ie novice des oblats a des pro& B savoir l'absence de coden ; ainsi, pendant tout le temps de son noviciat, le postulant est clairement dharqut! des autres C'est alors au torn de Bernard de hire me omission dam son coutumier car il n'aborde pas ce mjet, soit qu'il oublie de le &, soit qu'il @Ere davantage hsister sm ce qui rapproche les novices des autres membres de la wmmunautt, pIut6t que ce qui les distingue. Il n'est pas question dans l'U&I. de dew noviciats se succWant comme dans le Bern., cette structure clunisieme ayant peutjRt sembk inutilement l o d e I Ulrichm. II evoque en revanche dew formes possibles de noviciat selon Ie nombre de postulants : s'ils sont peu, ils sont dircctement incorpods dans la communautt (saufpour le coucher) mais s'ils sont
". U ' L II,i,col*'lO I A : = reIiqui omnes [taus les postulants except& les &res qui ont d6j8 rqu la Wn6diction et ta profession d'abbds clunisiens] non pennittuntw intrare, nk iprhp jtarp verbum sancti Benedicti* vel unam no- in hospilfo moren!ur ; prim quogue quam intraverit <sic>. instmurdi sunt quemadmodum faciaat paitionem suam ; primurn ut scimt veniam petere more nostro *.
Le texte de Bernard est temilement confirs, ce qui est typique des sections qu'il a lui-meme conques, A la diffdrence de cclles qu'il a directement cop ib d'Ulrich.
= Venientes ad conversionem & saecuIop simt & aIii srrpenientes, suscipiutttur in hospl'lio ; quorum vuluntate cognito, Fratet- quicelfoe h a r p i . Procurator m, D. A b W mULtiizt - vtd si non mer i tp ei priori, qui ordinem cfoutri tunc temwit ( d m enim potestar est ei, quiclunque sit, si Abbas, cut M i Prior defierit, quae & @si Ptiori Mojori) - qui ad tos adkns stcundum quai&afm cond&ionum & adalum, singuIomrnpcrs~an1om probat Quo fmto a Cmerario, prim quae adhujusmodi o p stnrt poratik, qua sibi vid'trur d k Frairibtcr in Cqitufo resi&ntibus & eis annuntiat, & praediclurn llrospitum susceptortm, cut lroc perliiret, qui eos quaI&er petitionem Jiacibnt, edoceat, emittens ad eas, praecipit intromitti ; qui venientes in Capitdurn petunt veniam corm eo qui Capitufum tenet (Bern. I,xv,p. 164.)
=. U&I. n,i-ii,col.70 IC-D. n. Dam I# =re& de Lanhc, qui c o p i h t Bemsrd, il n'cst Cgafernent question que d'un seul noviciat.
De plus, I'auteur insiste davantage sur ce qui distingue les novices du reste de la communautC (coule, interdiction de converser, ctc.) que sur ce qui les unit. Enfin et surtout, le temps de noviciat est un temps de probation : apes un grand nombre de jours (information inttressante puisqut ni Bernard ni Ulrich n'avaicnt prkist5 la dur& de ccttc Crape), si Ic novice d&irc rester dam la communaut6, ct s'il cst a@ par celle-ci, il demande qu'ait lieu la cddmonie de MnCdiction :
= Transact is pierisque diebais si uita eius fiatribrrr et fiatrum conuersatio ~ibiplamerit~ monendrrs est a rna@tro suo quaterms roget priorem et aIiqucas maioresfiatres, ut et ipsipro eo intercerlbnt apud abbatem pro benedictione tribuendo et profasione susc@ien& rn (Lanfianc, 1 O2,p.87).
Les Dhcrets accordent malgd tout plus de Ilkrt6 d'action aux novices que I' Udol. oh ces derniers ont un r6le essentieIlement passif ii jouer,
nombreux, ils vivent dpdment, dam la celle des novicesu. Cette pttcision d'Ulrich est extrEmement importante car elle dhontre, a posteriori, que la ¶tion des novices de la commmmautt tire son origine du tmp grand nombre de ceux-ci. Par la suite, les deux auteurs s'accordent pour dire que le temps de mviciat doit perm- aw novices d'apprrndn l'wdo cluniizcenris, c7est-Mire le ritucl des gcstes quotidicns des mobs : le langage des signes, le service liturgiqye, la discipline au dktoire, de. Aussi Wmnt-ils preillement, entre leur description du cMmonial d'entlde et celle de la bCntdiction, le dCrsil de la vie clunisieme. Ils achCvent cette seaion en dklarant : tliecpuuca, ut nzemon'ae occurertLnl de n u l a dicta stml, @bur om- m f i , sifimgpotea p r h sunt imtnrendi, qtum Collegio nostro socienha. **
La plus grande opposition entre les deux coutumiers porte sur la question de la probation ; cette divergence de vue +t particulihement clairement dam la description de la fieption des postulants au Chapitre, ii la suite de leur djour 1 l'hospitiurn. Selon Bernard, les noweaux Venus doivent promettre de se sounettre ii la dgle jusqu'i leur mort des I'instant qu7iIs ont b c h i le seuil du cloitre, c'est-&-dire avant meme leur noviciat Au Chapitre, ce premier jour, apds qu'on leur ait explique & quel point la R&gIe etait dure et difEcile et comment ils seraient chiities shrkment pour leurs nt!gligences,
fl'abbe5 rogat ut voiunt~lasuas s u p hk in praesentia Conventus aperlant ; ill$ vero obedientiam se tuque ad mo-m servaturos promittenfibus, responder : Dominus sic in vobis quod promittitis, perficiat, ut ad aetemam vitam pervenire mewmini, & Fratribus respondentibus? Amen. mu
Pour Ulrich, le noviciat e a avant tout un tempus probationis. A la diffdrence de Bernard, lorsqu'il d6crit la scene de la demande d'admission du postulant au Chapitre, il ne dit mot d'une quelconque promesse ttemelle de stabilitt. Au contraire, son emploi d'un conditio~el atteste qu'8 ses y e w le postulant etait encore libre de repgair, m6me apds qu'il ait fonnuI6 sa petitio :
CZerico et luico qui nondm ita sunt experti vitam nostram diligentin est inFimandumt ut hobetur in regtila? quam dunr et uspera necessario patianiur si ad subjectionern nostram pemnerint, quue nimitum compellit eos nuIIam potestatem
Lc texte de la PC. (W&' Il,ii,col.701D) cst ICgerement f d ; le voici, mais comge par la lecture du EN n.al.638, foLS6'ct du EN 1~18353, fol. 3 7 :
Nam quando sunt pauciores, si [ct non pas %onm] sepatoim domiunt - quia mmquam ueniunt in donnitoriwn nostnun nisi benedkti-, tmen in refitmb et in diis lmk minime sepcuanhu a nab&. Qud si tantisint ut digmrm uiihm-, twr abfalo Cppello, pro se habebunt cellum suam ubi non solum h i a n t , sed efim comedunt et iugirer mmtwnr a cmenru sep4tati. v
''- Bern. I,xix,p.179 et U"1. II,xm,col.7l2C-D. ? B e m I,xvsp. 165. Lorsque Piem le VdnCrabIe essaya de remddier dam ses statuts aux excb de l'ordre
clunisien et qu'il instaura cntre autrcs un mois de probation obligatoire avant toute promesse (verbale devant un prieur ou Ccrite devant l'abb6) du nouveau vcnu (a [.,.I unuis menrisprobutio, gratia novifios observetur, antequam volo promkae obedientiae asrtingantur. ms Stat. 37,p.71), il faisait t& certainement dfdrence A cette promesse-ci ; autrernent, le statut n'aurait pas de sens, puisque le noviciat aurait ddjA constitut une @ride de probation.
propriae voluntatis habere, sed rrd nutm alten'us per onmiupendere. mn Apds cette cMmonie, commence pow les dew auteurs la @ode de noviciat Elle s'intemmpt avec la bCn6diction (quaad ceIle-ci n'a pas Ctt dejll d o ~ k avant m h e le noviciat, pour cause de maladie, d'Cloignement d u pzieu& d'origine ou autrw mom) et la profession. Ulrich dhtroduit 8 cette occasion un wndit io~el , qui rappelle le prteCdent et ofik me d e m k fois au postulant la possibiIit6 de pa&. Cettc foisci, Bemad -pie Ulrich textuellement, mais ce dewitme conditionnel, patoe qu'il est le premier pour lui, devient sous sa plume tme f o d e stylistique vide de sens. Est-ce parce qu'il fbt jug6 mal@ tout trop dangemxx, ou est-ce une simple armr du copiste - un saut "du mtme au mOmew ("benedictionen), mais avec les "oublis" suspects du a si v et du a non .-, toujours est-iI que cette phrase fit remaniee dans certains matluscrits, dont le plus ancien qui subsiste et est originaire de Cluny. Je dome les dew textes en p d t l e * . *
Bern (BN lat. 18375) Udal.
... posteu am ei viswnfirerit, jubet eos ante se in Capiulum venire ; quibus venientibus, & veniam petentibus, postquam s u r r d n t ; ifemm quoque ut ptiusB aliquanta insinuat de austeritate disciplinae regulutis, & inter alia non tacet mefius exse uf sine bemedictione de cuetero perdurent : at @si e contra, omnem obedientiam, & stabilitatem pollicentur ; annuit tandem eos benedictione confmtwe.
Postea qumn ei vim fierit, jubel e m iterum ante se in capitulum venire. Quibus venientibus et veniam petentibus, postquam surrexen'nt, i t e m quoque ut prim aliqumta irtsinuat de ousteritate disciplinae reguulm. Et inter alia non tacet mefius ase uf sine benediciione ad saecufum redeunt, quam accepta benedictione de cuetero NON perdureng At SI @si e contra omnem obedientium et stabilitatem pollicentur, unnuit tandem eos benedictione confimare.
En tkrivant ce passage, m c h f w t directement et consciemrnent rdfhce au conditiomel
". UdaL II,i,col.70 18. k remercie k latiniste Benjamin Victor pour m'avou aid6e B comprendre le sens de cette conditiome~e. Le subjonctif prbent de " p t W doit ici 8tre compris comme dquivalent B un fitur, ce qui dome comme traduction : Combicn duns et finibles sont Is choses qu'ils supporteront s9ils se soumettent ii notre pouvoir R
u. Bern. I&p.179 (com'gC iS la Icchvc du BN k13875, f0138~-389 et U&f. II~i,col.7~2-13 (comgti la lecture du BN n.aL 638, fo1.66'et BN lat.18353,fo1.44"). Dans BN k13875, Ie "none de "nonperdurent"
a et6 grattt ; cc manwrit, qui pourtant a & comgC, n'a subi aucune autrc comction cn cette pbrasc. Le tcxte du BN laL13874 cst en revanche idcntiquc i celui d'UIrich. En effet, la phrase-clti st la suivante :
... et inter aka non tucet mefiuf esje ut s i , benedictiorse adsaecuftun &n! q m accepta betd"ctiotte de cetero non pduremt. At si @si ,.. rn (Fol.13")
Je soupqonne cette dernih version d'?m la le~on originale car Burkhardt Tutsch, qui connait parfaitement les divers manusmi& de Bernard, m'a fait savoir qu'elle &it la plus courante, II I'a en effet retrouvee dam Palermo, Biblioteca Nazionale, S. Maria Nuova, XXV F 29, fo1.199 et Paris BN lat. 13877, fol.35. Le manuscrit Arras, Bibliotheque Municipak 864, f01.18~ ofk pour sa part la phrase : Et inter cetera non tacet nrelius esse ut sine benedictione de cetero perdurment. ..
pniddent, comme en thoigne la reprise du verbe insirmare. Ainsi, son texte o f i m e dernih fois au postulant la possibilitt de retollma au sikle avant qu'il w fasse ses voew. position trts di f fh te de celle de Bemsld. La wnhntationdes discours de ces deux auteurs thoigne qu'il e x h i t dera positions di- qgnt au noviciat dam le Cluny du demier quartduXIesi&le:I'lmc@~mmvi&qPi~~~I.appren~edCS~utumes et l'autre insistant pour un noviciat de formation a de probation ; mais la p d & e h i t I'officielle, tandis qut la m n d e n'Wt que l'atprrssion d'm individu, Ulrich, desirrux d'aider un ami composer un noweau coutumier idurn.
'9. Une anecdote des Virm Hugonis faissc en!endre que certaSns novices Mneficiaicnt pcut4rc d'un temps de probation A Cluny, ce qui expiiquerait d'oik Ulrich tcaait son id& d'un tcl mode d'entde. Pourtaat le discours des bagiographes est Micile B intcrpdter ct it se p o d fort bien qu'ils parlent ici de tout autre chose. Voici I t dcit en question, tel qgc &Jig6 par Gilon :
Maingoldus qu- nouidh die sfatuto susc@&ndys b monast~io, fedio diIutionB @ecltrs prestoIpbiatur teminum ~ b a t u r , quem pmbationb causa pate sibi et sub h e r a t i~teri . . famuI'i- Hic cum rneditarenafirg~~ et suisubductionem mbito com~lot~cs ab eo d i u i t prophetic0 ore picquid apaslatici ramorb uoIuebut h ptxtore Ita &mint redienr adcor et compunr:tu expectauif pacienter diem sibi constil~turn~ (M I,xiv,p.64)
Je ne m'mtt5rrSSetai pas la version d'Hildckrt, prrisqu'it n'&ait pas moine et qu'on ne peut donc se baser sur lui pour un compte-rendu exact dm faits (ct W III, l3,coL869C). h u d de Vdalay parle de I'ennui ressenti par Maingold de devoir attendre, non pas d'entm au r n o w t k , mais de prendrc I'habit (a ....dm prestoibtionk mscQid i hobitus t& @ceretw e? @se im &liberasset nomJha morarum mafinere i'nrfciar ... a, YHC xxvii,p.S 1). II ne se sen pas non plus du tecmefiga, mais d&lare simplement que Maingold voulait s'en aller (dkcedere).
Tmis cas de figure peuvent expliquer cette anecdote. Premitrement, Maingold se trouvait ii l'extdrieur du monastere, peutdtre dans l'hospitiwn, et il s'agissai alors du temps de probation pd-noviciat usuel. Gilon affirme en effet que Maingold n'avait pas encore Cte cequ dans le mon- ct Renaud d&lare qu'il ne portait toujours pas I'habit t'appellation de novicius hi aurait €t& appliqud simplement pour marquer sa volonte de devenir moine- Le &it que le petsonuage semble &re seul, sans moine se cdt&, et que Hugues intervint par le biais d'une vision, non diredement, pournit Etre un indice d'une telle situation, Malgr6 tout, I'expression "suscipe in monusf~lult" powrait n'&c qu'une formule symbolisant, non pas l'entdc au monastere, mais I'incorporation & la cornmuaautC au moment de la pmftssion, tandb que I'cxptcssion "stlscipere hubirum" s y m b o l i i non pas le port dc I'habit mOLI8Stt*que, mais le fiit d'endosser la coule h la fin du noviciat. Dans un tel cas, Maingold avait ddjA fianchi I t s portcs du c l o k et &it be1 ct bien devcnu un novice, au scns strict du tenne. Deux intcrpdtations d e n t alors cnvisagcables. La prcmitre cst que Maingold se trouvait dam la meme situation quc le Imo iuuenrj d'odon, qui, apds avoir && admis Aans la cldnut, fbt p M quelques temps sous surveillance, avant d ' h ddfinitivcmcnt inc0cporC & la c o r n m e . Pour hi, comme pour Maingold (si I'on se fie a I'ctnploi du tennefirgu par Gilon), le dCpart du monastke n ' u t plus possible. I1 ne faudrait pas alors puler de probation : les moincs dtcidaient si oui ou non ils voulaient conserver une telle reme mais celle-ci ne puvait rcmettrt en question son choix. L'abandon du tcrmcfirga par Renaud laisse supposer une dernitre inteqr6tation : Maingold Mntficia d'un vdritable temps dc probation pendant son noviciat
A supposer que c*le daniCR explication fik la borme, une telle mrnike d'agir dewtit Ctrc exceptionnelle, en premier lieu parce que Pime le VCndrabk se plaignit peu aprts cfc l'abscnce dc toutc probation it Cluny (cf. supra), en deuxi&me lieu parcc que l'histoirc de Maingold n'est pas pdsmtte cornme I'dpreuve trts usueIIe que travers&rent des centaines ct dcs ccntaines de convertis eat& dans I'ordrt clunisicn pendant le dgnt de Hugues. Sa fonction essenticllc cst d'illustrcr Ie don prophCtique du saint ; les autres dltments sont 6vaquCs de manikre floue, comme s'ils ne concernaient g u h les lectern. Par aillcun, les autres anecdotes des Vitae Hugon& temoignent que, habituellement, l'entr& au rnonasth Ctak suivie de la prise irnmddiate de I'habit et du debut de la formation (seul fait nouveau par rapport aux Vitae plus anciennes), sans qu'il ne soit jarnais
La prrmi&e tentative clunisi- pour proposer un temps de probation a m nouvelles recnus, dont atteste le coutumier d'ulrich, 6choua. Si le coutumier de Bernard ne d s a i t pas I le demontrer, le statut 37 de Piem le VMmbll30 et sa correspondance avec Bemard de Clairva~x~~, ainsi que les d'Idung de Pdbing dam son Dialogus (c. 1 155) %nt autant d'indices qu'au milieu du We siCCle, l'abbaye bourguignome n90fEait mjom pas de tempwprobationi;s B ss postulants, sinon & qyelqyes jours. Par co&qyent, pendant les dew sikles et demi de l'histoii cludenne oti se cantome ma th&se, de 909 h 1156, le modtle dominant d'ambc en religion k Cluny consistait & int6grer imm&atement le nouveau venu dans la communaut6, apr&s seulement quelques j om de probation A la pork du moaasttte. D&s son arrivde, le postulant se voyait decrmer un rang particulier dam i'ordo, le choix duquel reposait en partie sur son h e , sinon directement, par suite du statut qu'il avait poss6d6 A I'ext6rieur : un seigneur ou un Wque w se voyaient certainement pas d6cerner le m6me rang qu'un chevalier iuuenis ou un diacre. La nowelle recrue s'inserait donc dam la structure bibchiique tripartite de la cornmunaut6 clunisienne h&t& de la RB, constitutk des groupes des pueri, des itmiores et des senioredpriores. Ce constat j d e ma decision de faire abstraction de la question du noviciat lorsque j'dndie, dam ma W s e , les trois groupes h i k h i q u e s clunisieas paralItlement aux trois groupes d'gge.
question d'un retour possible au rnonde, Dans lc &it de I'en* d t Hugues B Cluny, sa pdsentation au Chapitre cst d m cornme symbolisant son in-on ddfinitive. La phrase suivantc ptCcise qu'en pcu de temps, il apprit I'ordo (a P m o tempore, ordinis honestutem &&cenr B, V P I,iii,pJO). One autrc anecdote monte I'histoire d'un pderin qui Picm apparut B Rome ; I'ap8trc lui affbma que ces pdchts lui seraient pardonnks s'il entrait Cluny. I1 se p r k n t a donc h Hugues, lui conta son histoire a le supplia dc l'admcttre. Gilon Ccrit ensuite : Turn uero porw pirjimw cowtrnen&uwt sibi a Deo recipif et rir ouili Dominico constitutum habitat sacro i'nduit regirlmiter infomtandum. l ( V ' U,ii,p.92).
". Ct supra. L'Ctouncmcnt dc D. KNOWLES devant I t que Pierre le Vtndrable n'ait essay6 d'instaurcr qu'un tout pait mois de probation B ses novices n'a plus de raison &&re si l'on pmd en compte la du tempus probationik avant Ic XIe sitcle (8 The Reforming Decrees of Peter the Venerable B, dans P e m Venerabi'lrj I Z56I956. Studies cmd Texts commemorating the Eighth Centenary of his Death, Roma. Pontificium Institutum S.Ansclmi, 1956, p, 12).
91. Pierre le Vdndrable, & Letters ofPeer the Venerable [tPYJ, I, Cd. ct notes G. Constable, Cambridge (Ma): Hward Univ. Press, 1967, #28, p58-62 et # 1 1 1, p.282.
? Idung de Mfming, Dialogus & o m monachonmr, I,49 ct Q16 (dam R.B.C. Huygens, Le moiire Idung et ses derrr owrages : r Argmnentum s u p quatuor questionibus ef r Dialogus duo= monachorum m,
Spoleto: Centro italiano di studi sull'alto mediocvo, 1980, p.113-14 et p.128-29). Cf. aussi Jeremy 0' SULLIVAN, Ciktercians and Cluniucs. me Case for Ccte~lt~~t, Kalamazoo (Mi.): Cistercian Publ., 1977.