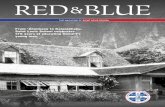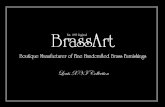Otes Et Souven Rs Inédits Eeeeeeeeeee Louis Ambrois
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Otes Et Souven Rs Inédits Eeeeeeeeeee Louis Ambrois
A V A N T - PR O PO S
Nous ne nous étendrons pas sur la nature et l e méritede ce l ivre si différen t des autres ouvrages en apparence dum êm e genre qui sont f réquents de nos jours . Nous avonstàché de lui donner un titre correspondant aux intentions del ’
auteur et a la m odeste s implicité de son langage . Que ne
pouv ons-nous'
expriœer aussi la noble d ignité qui se cachesous cette modestie ! E n remettant a son am i le Com te Frédéric S c10p is la notice sur Bardonnêche , la seule qu
’ il fit
im primer à 50 exemp laires en 1872 , l’
auteur s’
exprime en
ces term es : Cette notice n’
a d’
autre b ut que de conserver
pour la local ité certains faits et certaines dates que d’
au
tres n’
auraien t peut -être pas eu l ’ occasion et la patiencede recueil l ir . Elle serv ira comme ces livres de m énage quire sten t dans les fam i lles , où nos pères enregistraient ce
qu ’ ils croyaient pouvoir intéresser leurs enfants L e
Com te S CIO p i S lui répondait : J’
ai lu cet écrit av ec le plus
grand intérêt : c’
est beau ; c’
est fin ; c’
est complet commetout ce qui sort de v otre plume Et comme l e cbeval ier
Des Am b ro is n’
avait pas déclaré son nom en tête de sa Not ice et en avait dé fendu la réimpression , son il lustre in terloen tour lui adresse ces doux reproches : Pourquoi v oulez-v ous
priver un grand nombre de lecteurs de ce moyen exquis
— I I
d’
apprécier cette contrée si digne d etre bien connue ?…E n vérité je ne saurais vous louer de cet excès de modestie qui se transforme en coupable injustice envers vousm ême et envers l es autres . Laissez donc , je v ous prie,circuler librement votre élégante brochureNous reproduisons ci après ces deux l ettres comme la
plus bel le introduction du livre , lequel pourrait être com
paré à un recuei l de conversations d’
un homme instruit et
spirituel mais toujours v éridique jusqu ’
au scrupule . L a séré
n ité calme et impartiale du narrateur ne se dément pas un
seul instant soit que , racontant l es principaux événemen ts del a val lée de la Bo ire R ipaire au m oyen -âge , i l doi ve discourirdes faits particul iers de ses ancêtres l es anciens seigneursde Bardonnêche , soit que , rappelan t ses souv eni rs du règnede Charles Alb ert, il parle des choses qu
’ il a vues , des per
sonnages qu’ il a connus , des fai ts mémorables auxquels i l
a pris part. Il n ignorait pas les bruits erronés de toute sorten i l es appréciations injustes que l
’
on faisait courir sur son
compte . Mais, dé voué de toute son âm e au bien de son Roiet de son Pays , tranquil le dans la conscience du devoir ao
compl i et des serv ices rendus à sa patrie , confiant dans la
just ice du temps , n’
aimant pas à occuper l e public de sa
personne , il laissa tout dire, tout imprimer. Il rétablit la v ê
rité des faits sans jamais se départir de sa réserve habituel ledans ces notes que d
’
ailleurs il ne dest inai t qu’
à un pet i tnombre d ’
am is .
Ainsi on crut et on publia encore tout récemment quel es réformes proposées en 1847 a la loi communale et pro
v incia le étaient dues à l ’ av ocat Gioannetti . V oici ce qu 1 1
d it a ce propos : L ’
avocat Gioannett i , alors populaire , ava i t
été employé à la rédaction défin itive de la loi afin de pré
v en ir l e public en sa faveur. De la le bruit erroné qu’ i l
I I I
fut l ’
auteur de la loi ; et le bruit prit consistance parce
qu’ i l avait eu la patience d
’ écrire de sa main l a rédactiondern ièreL es réformes de 1847 , ajoute-t—il , comprenaient encore
l’
abolition de tous les tribunaux d ’
exception , de tous les
priv ilèges du for, moins celui du for ecclésiastique auquelle Roi n e v oulait pas toucher sans le consentement du
Cette loi était principalement l’ oeuvre du cheva
lier Des Amb ro is ; elle fut coñtres ignée par lui au lieu del ’ ê tre par l e m inistre de l a justice Avet qui se trouv aiten d issen timent sur quelque point de C ’ étaitla un
”
essai de ce qu ’ on appelait dans l e temps la monarch ie consultat ive . Il pou vait être un utile état de transition pour préparer l e passage au régime constitutionnel
auquel l ’
0 pin ion générale poussait , et que l e Roi n ’ était
pas encore décidé à accepterCependan t on affirma encore dern ièrement sur les jour
naux que Des Am b ro is vota contre la concession du statutdans le grand conseil qui fut tenu à cet effet . Les plus bien
v ei l lants ne lui reconnaissen t d ’
autre mérite que d’
avoirv oté et con tresigné cette grande charte à laquelle i l a tant
con tribué par ses conseils et par son oeuvre personnelle . O n
ne peut l ire sans la plus v ive émotion l es détails intéres
san ts qu ’ i l donne sur la séance mémorable du conseil extra
ord inaire qui fut convoqué d’
après son av is pour délibérer
sur la concession du statut et la description qu ’ i l fait de la
scène touchante de la signature du statut dans le conseil des
m inis tres qui suiv it bientôt après . Par un sentiment exquis
de délicatesse i l s’
abstient de nommer ceux qui v otèrentcontre. Le Roi , dit—i l , avec un grand calme recueil lit l es
Auto b .“pag . 9 et sui van tes .
I V
v oix en commençant par l e maréchal de L a Tour doyende l
’
Annonciade , lequel opina sans hésiter pour l a concession du statut. L es autres v otants furent presqu
’
unan imesdans le même sens L a rédaction de la proclamation
qu i annonçait le statut fut confiée à Des Amb ro is . Borel li yajouta la fameuse phrase : 1 temp i s on o matur i a case mag
giom‘
V enons a la signature du statut. C etait , dit-il ,un moment solennel . Tous les m in istres muets , émus , regardaient l e Roi signer recueilli , mais calme et serein commeA
un homme qui accompl it consciencieusement un grand deL a séance avai t été longue et pén ible . L e Roi se
leva . Alors l e v ieux comte Borel li , par un mouvementspontané , s
’
approcha, m it un genou à terre et baisa laA
A
à
A
main qu i avait signé l e statut . Chacun des m in istres baisacette ma in . C ’ était le dernier adieu à l ’ ancien ord re dechoses . L e Roi ému rel evait ses m in istres et les embrassaitavec eñ
‘
usion
Nous ne rapporterons plus ici qu’
une phrase où est em
preinte toute l a noblesse de caractère de l ’ auteur. Aprèsav oir raconté l e refus qu 11 fit en 1849 de remplacer à la
présidence du m in istère l e général de Launay ma lgré les instances du Roi V ictor Emanuel II , i l fait cette bel le réflexion : L e refus consciencieux de Des Amb ro is fut heu
reux pour l e pays , car i l amena l e choix de Maxim e
d’ Azeglio qui était l
’
homme du m oment ; Maxim e d’
Azeg l io
consolida la m onarchie ; peut —être i l l a sauva
Malheureusemen t cette partie du l ivre , a laquelle i l trava i llait quand i l mourut , et que nous avons intitulée , S ouven i r sdu R ègne de Char les Al bert, est restée fort incomplète . Ce r
( l ) Au to b .“pag . 15.
(2) Au to b *° pag. 18.
_ v _
tains morceaux ne sont que commencés ; d’
autres manquentabsolument , tels que ceux qu
’ il v oulait inti tuler : L ’
Armée et
la Mar in e , L e Clerge'
, L es Prov in ces , L es F inances , L es
R outes , L e Commerce. N ous la donnons telle qu’
elle nous est
parvenue sans rien ajouter. Néanmoins n ous l ’ avons placéela prem i ère a cause de son caractère de majeure actualitéet parcequ
’
el le contient 1’
autobiographie de l’
auteur. L a mo
nographie qui en forme le dern ier chapitre sous l e titre deRéform es Ecclésiastiques , fut certainement écrite p lusieursannées auparavant. Elle n
’
est pas san s intérêt et se rattache au règne de Charles Albert puisqu
’
elle descend jusqu ’ àl
’
an 1 848 ; elle contient m ême vers la fin des détai ls cu
rieux ma intenant tout—à—fait ignorés et qui servent a com
pléter quelques uns des chapitres précédents .
Nous av ons m is dans la deuxième partie la notice qui
porte l e titre de S use et la Va l lée de la Bo ire R ip a ire au
moyen-âge , parcequ
’
elle embrasse une plus vaste région .
La not ice sur Bardonnêche s’ étend jusqu ’
aux temps moder
nes , mais revêt un caractère plus particulier en égard au
pays restreint auquel el le se rapporte ; elle fut pour ce motif
placée dans la troisième et dern ière partie du l ivre.
V raiment ces deux dernières parties auraient pu n’
en“
for
mer qu ’
une seule sous le titre de N o tices H is tori ques sur
la Va l lée de la B o ire R ipaire, et quelques chapitres auraient
pu être m ieux coordonnés entre eux. Nous avons jugé plus a
propos de n’
apporter aucun changement aux dispositions de
l ’ auteur.
Oulx, m ai 1899.
c ron O nn nn Das Au nnoxa.
L E TTR E DU CHE V AL I E R DE S AMBR O I S
AU COMTE FR ÉDÉR I C som me
R om e l e 8 ju i l let 1872.
cher et hon oré am i ,
Je vous transmets la Notice sur Bardonnêche dont je vousa i parlé l
’
an passé . C ’
est en m ême temps un hommaged
’
am itié et une confidence ; car l’ écrit a été imprim é à un
pe ti t nombre d ’
exemplaires que j a i tous retirés , et celui-cies t le seul qui soit sorti de m es mains . Cette Notice n
’
a
d’
autre b ut que de conserver pour l a localité certains faitse t certaines dates que d
’
autres n’
auraient peut—être pas eu
l ’ occasion et la patience de recueil lir. Elle serv ira commeces l ivres de m énage qui restent dans l es fam illes , où nos
pè res enregistraient cequ’
il s croyaient pouvoir intéresserleurs enfants.
Appréciez avec indulgence ce produit de l ’ amour d ’
un
m ontagnard pour son pays ; et , en l isant ces pages , oubliezun moment que v ous êtes le prés ident de l
’
Académ ie des
sciences pour ne vous souven ir que de v otre bienv eil lanceenvers un v ieil ami
DE S Aunnoxs.
R ÉPON S E DU comme sonorxs
Turi n , 12 Ju i l l et 1872.
Je v ous suis on ne peut plus reconnaissant, mon cher et
honoré co l l ègue , de la bonté que v ous av ez eue de m’
en
voyer v otre notice sur Bardonnêche. J’
ai lu cet écrit avec le
plus grand intérêt : c’
est beau , c’
est fin ,c ’
est complet commetout ce qui sort de votre plume . Pourquoi v oulez-vous priverun grand nombre de lecteurs de ce moyen exquis d ’
appréciercette contrée s i d igne d
’ ê tre bien connue, ce seuil de la
grande porte de l’
I tal ie , consacré par ce sublime effort, sibien réussi , du gén ie ital ien ? E n v érité je ne pourrai v ouslouer de cet excès de modestie qui se trans forme en cou
pab le injustice env ers v ous—m ême et envers les autres . Laissez donc , je v ous prie , circuler l ibremen t v otre é légante brochure , qui sera , je n
’
en doute point , bientôt réimprimée al ’
avan tage du commun des lecteurs . Permettez-m o i de v ousd ire , avec toute la f ranch ise d
’
une v ieil le amitié , que sur
cela v ous avez m i lle fois tort .
Nous partons cette nuit pour nous rendre à Genève et yentreprendre l e v éritable travail judiciaire pour lequel le
tribunal a été institué . Je pense que nous en aurons pour
L e tri b unal d’
arb i tres qu i juges du fam eux procès d it de Alab am a
entre l’
Angl eterre et l es E tats U n is d‘Am érique.
_ x
assez longtemps . Je traverserai cette charmante vallée et je
saluerai cette v il le d ’ Oulx , qui s’
honore d’
avoir été v otreberceau . Si je puis vous obéir en quelque chose sur les bords
du Léman , je v ous prie de m e charger de v os commissions ,
que je serai heureux de
V otre afi'
ect i o n n é et dév oué col lègue
FnÉnfiaxc S onom a.
Le Cheval ier Des—Amb rois de N evache.
N ous abordon s ici un sujet qu ’ il nous est bien difficilede traiter à cause de notre intim ité avec le personnage don tnou s devons parler . C ’
est pourquoi nous nous bornerons a
én oncer les faits d’
après 1’
exacte vérité , en év itant touteappréciation .
François Louis Des-Am b rois de Nevache était né en 1807
d’
une fam i lle d’
ancienne noblesse , mais pauvre . S on père ,
colonel en retrai te , avait été un v ail lant officier de l ’ arm éesarde dans les guerres contre la république française. Cettefam il le avait appartenu a la noblesse dauphinoise et el le en
avait conservé l es traditions d ’
honneur , de délicatesse et de
sent im ent monarchique .
François Louis Des—Amb ro is fut destiné à la magistrature .
B ientôt après av oi r reçu l e doctorat en droit i l entra commev olon taire au bureau du procureur général du Roi et y passaau grade de substitut en 1834 . L e bureau du procureur général était alors une sorte d
’ officine où passaient presquetoutes les affaires générales de l etat ; projets de l ois , dedécrets , des contrats du gouvernement , interprétation des loiset des règlements , contentieux adm in istratif et financier ; l esaffaires les plus d isparates y étaien t tra itées . Des-Am b rois
eut occasion d ’
y étud ier une foule de ‘
matières diverses et
de s’ in itier p lus ou moins a tous les serv ices adm in istrati fs .
E n 1837 il fut chargé de réd iger les observations de la
chambre des comptes sur le projet du code pénal . E n 1839i l prit p art à la rédac tion d
’
une partie du code de procé
dure crim inel le .
Dès l’
an 1840 le Roi 1’
avait en‘
vue pour la charge deprem ier officier du m inistère de l ’ intérieur qu i devait a lorsse rendre vacante . Cette combinaison n
’
ayan t pu av oir lieu ,
il le nomma en 1841 intendan t g én éral de la d iv ision de Nice .
Ce pays était alors difficile à adm in istrer a cause de la d i
v ision des esprits qui en était venue à une certaine aigreur.
L e nouve l intendant parv int à fa i re marcher l es affaires àforce d ’ impart ial ité . Il donna une impuls ion nouvelle aux tra
vaux publics pour autan t que le permettait l’
exiguité des
moyens dispon ibles . Il eut l e bonheur de rendre possible et
d’
achem iner l ’ exécution du plus grand , du plus populaire detous , l
’
end iguement du V ar , qui é tait l e rêve des N iço is . U n
plan d’
agrandissem ent de la v ille de Nice, dont l’
utilité futm ieux sen tie p lus tard , fut approuv é nonobstan t de fortesoppos itions .
E n 1 844 Charles Albert confia au Cheval ier Des—Am b ro is
l e m in istère de l ’ intérieur duquel dépendaient alors l’
in
struction publique , l es travaux publics , l ’ agriculture et l e
comm erce .
U n des prem iers actes de son adm in istration fut de profiter de l a dém ission de l ’ é vêque Pasio , qui était p rés iden tde la réform e, c
’
est - à—d ire surintendant de l ’ instruction pub l ique , pour tâcher d
’ introduire une v ie nouvel le dans cettebranche du serv ice pub l ic . C ’
est ce qu’ i l fit en obtenant du
Roi le choix du Marquis César Alfieri .Moyennant un parfait accord de vues entre l e m in istre
et l e nouveau président , put être créée l a chaire d’ économ ie
pol itique , et se succédèrent l es am éliorations dans l ’
enseigne
m en t du droit , dan s l es écoles magistrales , l e règlemen t desécoles fém ini l es, et autres innovations ut iles .
E n m ême temps l e m in istre fav orisait l ’ établissement desasile‘
s d’
enfance et l a d iff usion de 1’
enseignement primaire .
Il encourageait cel le des écoles du soir pour l es ouvr iers .
Il combinait, avec les chambres de commerce de Turin
fer. L a muraille de la Ch ine qu i ls avaient rêvée était percéeet anéantie.
L e Roi , qui aimait à entendre tout le monde , étai t ébranlé
par tant de d issentiments . Il aimait l e progrès ; mais ayanttoujours au fond du coeur un v ague dés ir de succès m ilitaires ,i l lui répugnait de v ider l es caisses de l ’ é tat en dépensesciv iles . Il aimait le progrès ; mais i l redouta it l
’ invasion desidées contrai res à la religion , à la morale , au principe d
’
au
torité .
Par suite de tant de perplexités on s’ était borné d ’
abordà concéder à une compagn ie génoise la faculté de faire desétudes pour un chem in de fer entre Turin et Gênes . Puis ,pour calmer l es impatiences de l ’ opinion publique , on avaitpublié ve rs la fin du m inistère Gal lina, une loi. qu i approu
v ait la l igne de Turin a Gênes et d’
Al exandrie au l ac
Majeur.
Rien n’
avait été décidé n i pour ordonner l’
exécution n i
pour établi r l es moyens d’
y pourvoir.L e nouveau min istre ayant longuement réfléchi sur toutes
l es questions a résoudre , pour en v en ir à une décision pratique , obtint d u Roi la con vocation d
’
un conseil extraord i
naire présidé par S . M. , où interv iendraien t, outre les m in istresa portefeuil l e , les présidents du conseil d ’ état , l es prem iersprésidents du sénat de T urin et de l a chambre des comptes ,l e procureur généra l du Roi , le Com te Petitti conseillerd
’ état qui s’ était spécialem ent occupé de l a matière, et
quelqu ’
autre personnage ém inent.L e consei l eut l ieu l e 3 fév rier 1845 et il décida : l .
°
que
l e chem in de fer de Turin à Gênes et d’
Al exandrie au lac
Majeur serait construit sans p lus tarder ; que la constru
etion aurait l ieu aux f rais de l ’ état , lequel retiendrait l’
ex
p l o itation de la l igne ; que la compagnie gênoise seraitindemn isée pour l a dépense des études faites pas el le moyennant l a rém ission des p lans et des desseins préparés .
L es fonds de l a caisse de réserve devaient serv ir à ladépense . O n aurait av ec l e temps suppléé au surp lus par un
emprunt . Pour accélérer l es travaux , suivant une ancienne
5
idée du m inistre Gall ina, on fit ven ir pour un an un ingé
n ieur belge parcequ’
aucun des ingénieurs de l’ é tat n
’
avaitconstruit des chem ins de fer. L e gouvernement de Belgiquese prêta av ec empressement a la demande qui lui en fut
faite .
D ’
accord avec lui on chois it monsieur Mauss avantegeusement connu pour avoir d irigé l es travaux du chem ind
’
Aix— la-Chapelle dans des conditions ana logues à cel les quep résentait la pen te des Gi ov i .
A lors les études furent reprises avec activ ité sur toutel
’ étendue des lignes décrétées . O n compléta, on am éliorales projets de la compagn ie génoise. L ’
exécution comm ençapar l
’
extrém ité du côté de Gênes , puis par cel le du côté deTurin , et par l es ponts principaux sur l e Po , l e Tanaro et
l a Borm ida , ains i que par le tunnel des Giov i , enfin sur toutel a ligne. L es ponts du Tanaro et de la Borm ida étaient déjà
p resque achevés lorsque le Roi Charles Albert inaugura so
l enne l lemen t en 1 847 la construct ion de celu i du Po sousV alence , oeuvre colossale habilem ent dirigée par l
’ ingénieurV incent Rovere .
Lorsque la guerre de 1848 , absorbant les fonds dest inésà cette grande entreprise , nécessita le ralentissement et presque la suspens ion totale des travaux, ils étaient en courssur tout le tracé ; l e pont de V alence était fort av ancé ; lesautres é taient fin is ; le tunnel des Giov i était aussi fort avancé .
L es contrats é taient passés pour la fourniture des l ocomo
t iv es et autres matériaux d’
exploitation . U n grand atelierde réparation avait été établi à Gênes sous la direction demonsieur Taylor . U ne loi avait été fai te pour assurer la con
servat ion et la police de la v oie ; des règlements avaien t été
préparés pour l es d ivers serv ices avec l e concours des lum ières de monsieur Mauss , l
’
ém inent d i recteur général deschemins de fer belges , venu expressément à Turin sur l
’
in
v itat ion du gouvernem en t.T el é tait l ’ é tat des choses lorsque l e Cheval ier Des-Am
b rois dut quitter le m inistère en 1 848 Il n’
eut pas m êmela sat isfaction d ’ inaugurer un tronçon de cette voie , com
— 6
m encée par lui , qui lui avait donné tant de travai l et de
soucis .
Mauss appelé pour le chem in de Gênes avait dès son ar
rivée représenté au m in istre qu’
on pouvait prendre au sérieuxl ’ idée d ’
un chem in de fer à t rav ers l e Montcen is . Mauss
était un homme modeste , un esprit sérieux et pratique , unm écan icien très— instrui t, un ingénieur de grande expérience .
S on O pinion méritait attention et examen . O n la commun iquaà Brune l l qui en jugea ains i . O n pr ia donc Mauss de se met
tre a l ’ é tude compat ib lement avec ses autres trav aux pourv érifier soit la possibil i té d
’
un tunnel , soit cel le d ’
une v o ieferrée donnant accès au tunnel sur les deux versants des
A lpes .
E n m ême temps l’ i l lustre géologue Ange S ismonda é tait
chargé d’
examiner l a consti tu tion géologique de la chaînede m ontagnes et l a di rection et hauteur des vallées poursavoir sur quel point la percée pouvait o ffrir l e moins ded ifficultés intrinsèques et ceux où l es v allées correspondaien tde m an ière à présen ter un rapprochem ent de n iveau qui
perm i t la traversée d’
un chem in de fer .
L a loca l ité pré férable , la seule m ême où le rapprochem ent des niveaux et l ’ épaisseur moins énorme de la mon
tagne rendissent admissib le un projet de galerie fut reconnuêtre l e point des A lpes Cottiennes où l e bourg piém ontaisde Bardonnêche se trouve en face du v illage sav o isien des
Fourneaux presqu’
en face de Modane . L es données géo logi
ques faisaient supposer qu’
eu cet endroit , comme il fut avérédans la suite , la montagne était un massi f compacte de
schiste , pierre peu dure , sillonné par une seule couche dequarzite .
Mauss imagina une mach ine qu i , mue par l’
eau des tor
rents qui coulent dans les deux val lées , au rait tai l lé le schisteé v itant ainsi l ’ emplo i des m ines , lesquel les auraien t inf ectél e peu d
’
air qu ’ on pouvait injecter dan s les profondeurs dusouterrain .
L ’
expérience de la machine en proportions rédu ites fut
faite à Turin en présence du Roi sur un bloc de schiste en
7
l evé a la m ontagne m ême qui devo it être percée. Cette expé
rience ayant réuss i , e l le devo it être répé tée en grand sur
l e lieu m ême en essayant de commencer l e tunnel avec une
machine construite dans l es proportions v oulues . U ne all ocation avait été portée à cet effet dans le b udjet de l ’ étatl orsque le gouvernement étant changé , la chambre des députés rejeta l a dépense proposée .
Quelques années plus tard surgit l i dée de percer la
montagne au m oyen ord inai re des m ines , mais en employantdes procédés mécan iques n ouv eaux pour creuser en peu de
temps les trous de m ine et donnant le m ouvement à ces ma
chines_par la force de l ’ air comprimé ; l e m ême air com
primé , transm is au fond du souterrain avec une force extraord inaire , y pourrait renouveler l
’
air respirable et pousserdehors l a vapeur des m ines en m ême temps qu ’ il aurait ra
fraîch i la température où doivent trav ailler les m ineurs . E n
somme le projet Sommei ller fut trouvé :U ne comm ission m ixte d ’
adm inistrateurs et de savants ,form ée en 1857 sous la prés idence du Chevalier Des-Amb rois ,qu i av ait depuis longtemps quitté l e m in istère , fut chargéede l ’ examen du nouveau systèm e , et en fit l ’
expérience àGênes sur des blocs v enant de Bardonnêche . L es expériencesayant réussi , l e parlement, sur l a proposit ion du Com te de
Cavour et du m in istre Paléocapa , se décida à “
entreprendrel e tunnel . Il est aujourd ’
hui presqu’
achevé, et acquiert une
nouv elle importance depuis qu’
a été coupé l’
isthme de Suez .
L es travaux des chem ins de f er n’
absorbèrent pas tel lement la soll icitude de Charles Albert et de son m in i strequ ’ on laissât en oubli l es autres travaux publics . L a routede France é tait notablement abrégée et améliorée en tre SaintJean de Maurienne et Chambéry . L e pont sur l a Sesia a
V ercei l était achev é . O n reprenait avec v igueur l’
end igue
ment de l’
I sère et de l’
Arc, ce grand travail d ’
assain issement de la Sav oie qui en même temps y augmentait si grandement l e so l cul tivable .
L e Chevalier Des—Amb rois , dès son entrée au Min istère ,s
’ éta it aussi appl iqué à l’
amélioration de la législation fore
stière . U ne comm ission formée sous sa prés idence reprit etacheva un projet de loi préparé sous le ministère Pralormo .
Pour compl éter l’ oeuvre un inspecteur général fut chargé
de parcourir toutes l es régions foresti ères du royaume et
d’ étud ier sur les l ieux un plan d
’ organisation et de répartition du personnel forestier. Malheureusement le long travail ,qui é tait fort avancé déjà en 1847 , dut être interrompu et
ne put s’
achever avant que le Chev al ier Des—Amb rois sortit
du ministère.
L a partie techn ique de ce serv ice é tait trop peu connuedans le pays faute d
’
une école spéciale , et on ne pouvaitl
’
étab l ir sans préparer des professeurs . L e m in istre en voyaen Al lemagne des jeunes gens choisis parm i l es m eilleursélèves de l ’ école de botanique pour f réquenter l es m ei l leurscours théoriques et prat iques d
’
agricul ture et d’
adm in istrat ion forestière . l ls firent un cours ent ier sous le v ieux con
sei l ler Pfeil , professeur renommé qui les emmena avec luidans ses excurs ions s i ins tructives. A leur retour fut fondél ’ inst itut de la V énérie Roya le où se trouvaient réun ies l esécoles de vétérinaire, d
’
agriculture et d’
art forestier. U n
pen sionnat était annexé à l ’ ins titut afin que les jeunes gensqui y entraient y reçussent auss i une éducation adaptée àleur é tat . Chaque pro v ince du royaume devait porter sur son
b udje t la pensi on d’
un élève . O n espérai t de cette combinai son , entre autres avantages , celui de répandre peu a peu
la civ i l isation agrico le du cont inent dans l es prov inces arrié
rées et mal cultivées de la Sardaigne.
Mais l ’ institution dura peu , cons idé rée comme une intrusedans un l ieu qui , par l e passé , avait été exclus ivement oc
cupé par l ’ arti l lerie et la cavalerie . Après 1848 en pré
tendit qu ’ il était nécessai re de restituer cet endroit aux
usages m i litaires . O n trouv a aussi qu ’ il v alait m ieux de sé
parer les enseignements qui avaient été réunis et de l es porter ai l leurs . L
’
institut fut détruit . O n ne rétablit qu ’
une
école de véterinaire , et longtemps après une école forestièree n Toscane .
Il avait auss i institué des comm issions pour préparer des
9
l ois sur l a pêche maritime et la pêche fluv iale. L e temps
manqua pour l’
achèvement de ces é tudes qui avaient une
importance assez grand e pour la partie surtout qu i concernel a pêche des côtes maritim es , les côtes de la Méd iterranéeé tant dans un é tat déplorable de dé vastat ion . L
’
_état avaitautrefois possédé une école des m ines ; el le était tombéeparceciu
’
on avait manqué non seu lement d e professeurs , maisencore d
’ élèves . Il importait cependant‘
d’
avoir des ingé
n ieurs des m ines , dans l e b ut surtout d ’
exploiter l es richesses m inéra les de la Sardaigne . Des—Am b ro is prit l e partid
’
envoy er des jeunes gens étud ier à. l’ é tranger , et i l choisit
a cet effet parm i l es élè ves l es plus distingués de l’ école de
m athémat iques . Monsieur Quint in Se l la , qui parv int à une s i
haute notabi l ité comme sav ant et comme m in istre , monsieurG iordano et quelqu ’
un autre on t pu connaître ainsi tous lesprocédés pratiques de la science et rapporter dans le paysles moyens l es plus efficaces de progrès .
U ne indus trie précieuse fut implantée avec succès en S a
v oie , cel le de l’
horlogerie . Depuis longtemps les grands étab l issemen ts de Gen ève faisaient con fectionner des pi ècesd
’
horlogerie par des ouv riers savoy ards , notamment aux en
v irons de Cluses . Seulement il n’
y avai t pas des ouv riersqui fissent toutes l es pièces n i qui eussent appris a l es as
sembler. Des-Amb ro is s ’
av isa d’ in téresser le Com te Pillet-V ill ,
régent de la banque de France , sav oyard de naissance et
bienfaiteur de son pays , a chercher un homme hab ile pourétab l ir a C luses une éco le pratique d
’
horlogerie . Par l’
in
terméd iaire du Com te Théodore de Santa Rosa , alors in
tendant du Faucigny , une correspondance active fut établieavec le b on Pil let—V i l l , et on parvint , après beaucoup depeines , a fonder l ’ école , qui prospéra . L ’ industrie qu ’
ellecomplé tait prospéra av ec el le .
L e Roi avait compris lui-même depuis longtemps que lalégis lation sur l es communes avait besoin d ’
une rév ision . Ildési rait se rapprocher de l ’ organ isation lombarde . Dès la
première audience accordée au Chevalier Des-Amb ro is , i llui en avait parlé . L e m in ist re forma donc une commission
1 0
pour étudier l es ré formes dont la législation en v igueur étaitsusceptible, et i l en résulta un projet d
’ éd it qui était unerefonte complète, dont voici l es principaux traits .
Les consei l s communaux se renouvelaient par eux—m êmesen él isent les remplaçans des conseillers qui sortaient parancienneté . O n sub stitue à ce système celui de l ’ élection parles contribuables e t par l es capacités.
L e gouvernement approuvait les b udjets des communes et
pouvait à son gré changer les allocat ions . O n borna son rôleà inscrire d ’ office l es dépenses ob l igatoires .
L es communes é taient sujettes à la tute l le de la magistrature pour leurs délibérations , auxquel les devait assisterl e juge de mandement , pour leurs procès que devait autoriserle m in istère public , pour leurs contrats que l e m in is tèrepublic devait exam iner . L ’ ingérence de l ’ ordre jud iciaire ,qui était une anomal ie , mul tipl iait les formal ités et causaitdes lenteurs , fut remplacée par cel le
.de l ’ autorité adm in i
s trative , qui porte dans son action l ’ apprécia tion de l’
u til itéet la connaissance des intrigues l ocales , au l ieu de la simpleappréciation légale ; mais les assemblées furent afi
‘
ranchies
du besoin d ’
une intervent ion é trangère.
Dans l es grandes v il les le conseil communal avai t despriv il èges qui changeaient d
’
une v il le a l ’ autre. E n généra ll es conseils é taient partagés en deux classes , celle des nobleset cel le des bourgeo is . O n supprima la d istinction des classes
qui' commençai t à deveni r odieuse et on abolit tous l es pri
v i lèges .
L e projet de loi é tant achevé , l e roi hés ita a l’
admettre .
Il n ’ obtin t son approbat ion qu’
un mi lieu des ré formes de 1847 .
L ’
adm in istration des oeuv res pies était déjà ré form ée . Mais
dans l e b ut sans doute d’
assurer l’
appl ication du nouveausystème , on ava i t central isé au m inistère l e contrôle des contrats et de la comptabil ité . Des-Amb ro is crut venu le temps
de renoncer à cette centra l isation excessive . U ne foule d ’
at
trib ut ions furent dé léguées aux intendants . Ainsi tomba lan écessité de tant de rapports de ces dern iers . Leurs occu
pations furen t s imp l ifiées , celles du m in istère se trouv èren t
12
contrôlés comme les autres . Enfin sur ces éléments v int se
fonder une innov ation m ajeure qui sou leva l es acclamaüons
des uns , l es craintes et les censures des autres. Dans l e seindes conseils de d ivis ion le Roi aurait dû choisir les membresdu consei l d ’
état resté corps consul tati f . La monarchie auraitété tempérée et ren forcée a la fois par l
’
autonom ie et l’
in
fluence des communes , des prov inces et des d ivisions . L es
consei l s de ces corps moraux devenaient un théatre pourdonner de la v ie aux petits centres , aliment et sat isfactionaux ambitions loca les . L e conseil d ’ é tat ayant ses racinesdans l es corps élect ifs acquéra it plus de popularité e t pouvaitcon sti tuer une véritable garantie pour les adm in istrés . C
’
éta i t
là un essai de ce qu’
on appelait dans le temps la monarch ieconsultativ e . Il pouva it être un ut i le é tat de t ransition pour
préparer l e passage au rég ime const itutionnel , au quel l' opi
n ion géné rale poussai t et que le Roi n’ é tai t pas encore dé
cidé a accepter. Mais le temps m‘
anqua pour le met tre en
pratique . L es é vénemen ts se précipitèren t et l’
on dut passersan s trans ition à. l ’ é ta t const itutionnel . L ’
avocat Gioannett i ,a lors populaire , avait été employé à la rédaction défin i tive dela lo i afin de préven ir le public en sa fav eur. De là le bruiterroné qu
’ il fut l ’ auteur de la loi , et ce bruit prit consistanceparcequ
’
i l avait eu la patience d’ écrire de sa main la ré
dact ion dern ière .
L es ré formes de 1847 comprenaient encore l ’ abol ition detous les t rib unaux d ’
exception , de tous les priv i lèges du f or ,m oins celu i du fo r ecclésiastique , auque l l e Roi ne v ou lait
pas toucher sans l e consentem ent du Pape .
La chambre des comptes , qui ava it été jusque là le tri
bunal pri v ilégié des finances , fut trans formée en cou r su
prême du con tentieux adm inistra tif , régularisé par l e m êmeédit . Cette loi était principalement l
’ oeuvre du Cheva l ierDes—Amb ro is , el le fut con tresignée par lui au l ieu de l
’ êtrepar l e m in istre de l a justice , Avet , qui se trouvai t en di s
sen timen t sur quelque poin t de détai l . .
L a cen sure é tait dev enue ridicule et odieuse . O n créa une
comm iss ion ordinaire de censure et une comm ission d’
appe l ,
13
l ’ une et l ’ autre composées d’
hommes l ibéraux et éclairés .
Ce fut aussi une mesure critiquée comm e dangereuse, ma is
probablement inév itable et ut ile au moins comme transi tion .
Les réformes furen t accueil lies avec un enthousiasme général , dont les populations ca lmes et froides du Piémont ne
semblaient pas susceptibles . L es places et les rues de la ca
pital e étaien t l ittéralem ent encombrées d’
hommes et de femmesde toutes les classes qui acclamaient l e Roi et le gouv er
nem ent .
L e Roi partit , selon sa coutume , dans les prem iers joursde nov embre pour al ler passer ce mo is a Gènes . S on voyagefut une continuelle ovation . S on arriv ée fut un triom phe . U n
des li b é raux exaltés em b rassait ses genoux lorsqu’ i l descendit
de cheva l sous l e portique du palais .
Mais derriè re les démonstrat ion s joyeuses , le parti Mazzin ien v eillait et s
’
applaudissait de l’
agitat ion soulevée espé
rant la tourner a ses fins . U n certain nombre d’
homm esd
’ état , quelques uns m ême des m inis tres v oyaient av ec efi’
ro i
les démonstrations se multiplier quoiqu’
el les fussent pacifiqueset respectueuses . O n induisit l e Roi a env oyer un ordre aux
gouv erneurs pour sign ifier qu’ il remerciait des démon stra
t ions passées , mais qu’ il d és i rait qu
’
à. l ’ aven ir les popa lat ions reprissent leurs occupation s habituel les , et que l
’
ob ser
vance des régles ordina ires de police devait ê tre rétablie .
L e m in istre de l ’ intérieu r é tait contraire à cette publicat ion ,
dont il n ’
espérait pas un b on e ffet . I l é tait d ’
ailleurs per
suadé que l e calme rev iendrait de lui-m ême comm e i l é taitdan s la nature des choses . Mais i l eut la faiblesse de céderà l ’ O pin ion unanime de ses coll ègues et i l contres igna l
’ ordreroyal . Ce fut une erreur qui afl
‘
a ib l it le gouvernemen t . Car l esdémonstrat ions se renouvelèrent m algré la parole roya le , eton ne pouvait les empêcher parcequ
’
el les n’
avaien t rien derepréhensib le ; d
’
ai lleurs l ’ opinion généra le était en leurfaveur, et l es personnes les plus honorables y participaient .L a f rayeur augmentan t dans l es régions du pouv oir , on sen titque l
’ organ isat ion de la police adm in istrée par un inspecteurgénéral ne co rrespondait pas aux besoins de la situation . O n
14
eût v oulu que ce serv ice , devenu si essentiel , fut représentédans le consei l du Roi , auquel l
’ inspecteur général ne pouvaits iéger Quelque m inistre proposa l
’ institution d’
un m inistèrede la po l ice . Rêve] et Des—Am b ro is s
’
y opposèrent, observantqu ’
un m inistre chargé exclus ivemen t de ce serv ice ne verraitau monde que des complots et d
’
ai l leurs serait naturellementod ieux. O n conv int de partager l es attributions du m in istèrede l ’ intérieur, et , après d
’
autres combinaisons qui restèrentsan s résultat , l e Roi s
’
arrêta à cel le—ci proposée par Des-Amb ro is , qui pour cela rés igna son portefeuil le . L es attribut ionsdu m inistère de l ’ in térieur seraient réparties en trois m inistères ; l
’ in térieur proprement dit qui aurait la police et
l ’ adm in is trat ion pro v inciale et comuna_le , l ’ instruct ion pu
b l ique, et l e départemen t des travaux publics , de l’
agricul
ture et du commerce. Des—Amb ro is proposa lui—m ême pour l em in istère de l ’ intérieur le v ieux Com te de Borell i , prem ierprésident du sénat de Gênes e t comm issaire royal après dumun icipe . C ’ é tait un homme ferme et sévère , dont le choix
pouvait tranquilliser l e R oi , mais incapable de réaction . L e
Roi l ’ agréa , et Des-Amb ro is le dé term ina a accepter. Alfieri
était ind iqué pour l’ in struction publique : i l fut nommé , et l e
Roi rem it l e trois ième portefeuil le a Des—Amb roi s , en le
chargean t d’
en règler lui—m ême l es attributions et l’
organ i
sation . I l redoubla depuis lors d’
affection et de confiancepour lui , de sorte que i l ne cessa d
’ être m êlé aux affairesmajeures de toute nature .
I l en fut ainsi pour l es dé l ibérations re lat ives au statut.Dès que l
’
on sut à Turin la proclamation d’
une consti tutionà Nap les , Castagnet en in forma Des—Am b ro is . I ls v i rent l ’
ur
gence de prendre une déterm ination semb lable pour les étatsdu R o i av an t qu
’
e l le fut réclamée par les peuples . Des-Am
b ro is se porta immédiatement chez R éve l et i ls a l l èrent en
semb le proposer à Borell i de demander au Roi la con vocationd
’
un conse i l sous la présidence de S a Majesté. Alfieri de
son cô té avait fait l a même démarche auprès de Borel l i . L econseil fut tenu . L a grande ré solution fut prise et tenue se
crête. O n se réun it plusieurs fois pour combiner l es articles
_ 15 _
f ondamentaux afin de pouvoir faire une publ ication prompte .
L orsque tout fut prêt , Des—Ambrais crut con venable qu ’
une
déterm inat ion aussi grave ne fut pas prise par l e Roi sans
qu’ i l se fût entouré d ’
autres conseils , et que sa consciencef ût éclairée l e m ieux possible en m ettan t en face des m inis tres l es v ieux hommes d ’ état , certainemen t portés à facil iter les concessions . Ains i fut réun i un conseil trés-nombreuxoù siégeaien t p lusieurs chevaliers de l
’
Annonciade , les m in is tres d
’ état, les prem iers prés idents , l e Comte Gallina ancienm in istre , le Com te S clO pis présiden t de la comm ission supér ieure de censure , l e président Gromo magistrat v énéré .
Après avoir entendu l e rapport du Comte Borel li , le Roi ,avec un grand calme , recueil l it l es v oix en commençan t parl e Maréchal de La Tour doyen de l ’Annonciade, l eque l opinasans hés iter pour la concess ion du statut . L es autres v otantsfuren t presqu
’
unanimes dan s le m ême sens . L e Roi fit sen ti rque l
’ opin ion générale en fa veur d ’
un changem ent dans les
formes du gouvernement lui avait paru d’
autant°
p lus digned
’
être prise en cons idération lorsqu ’
elle é tait attestée et
appuyée par les conseils mun icipaux des deux grandes v illesde l ’ é tat , conseils où s iégeaient beaucoup d
’
hommes sages
et loyaux , cons idérables par leur position , leur caractère et
l eur expérience . O n put alors comprendre comment le Roiavait toléré et peut
—être plus que perm is que l es v illes deTurin et de Gênes , v iolant l es l im ites de leur compétencemunicipale , eussent demandé l a constitution . Il se privaitainsi du m érite précieux de l
’ initiat i ve , mais i l justifiait sa
concess ion aux yeux des conservateurs .
La proclamation qui annonçait l e statut et en faisait con
naître l es bases fut pub l iée l e 8 février 1848 ; elle avai t été
préparée la veille par les m in istres réun is chez Des—Am b raisavec l ’ adjonction de Gall ina . La rédaction avait été confiéeà Des—Ambrais , Borel l i y ajouta la fameuse phrase : i temp is ono ma tur i a case m aggior i . Dans cette m ême réun ion , sur
la propos ition de Gal l ina on délibéra d ’
ajouter, sauf l’
appro
b ation du Roi , l a d ispos ition qui portait un degrèvement de
l’
impôt sur le sel . Gal lina av ait observé que l a concess ion
16
d’
un statut était un bienfait m ieux senti par l es classes su
périeures que par l e b as peuple et que la réduction du prixdu sel aurai t fait participer les masses , surtout celles des
campagnes , a la joie de ce grand j our.
(1 ) V o ici cette cé lèb re procl ama tion m ai n ten an t oub l iée ou ign orée m êm e
dan s l e Piém o n t :
CAR L O AL B E R TOr an L A o u a z u n r m o eco.
I p opo l i , che per v o l ere d e l la D iv i n a Prov v i den za gov ern iam o da d i
ci aset te an n i con am o re d i pad re , ha n n o sem p re com preso i l n os tro afi’et to ,
s iccom e n o i cercam m o d i com p ren d ere i l o ro b i sogn i ; e fu sem p re i n ten
d im e n t o n o stro che i l p ri n ci pe e l a n az io n e fo ssero co i p iù st re tt i v i nco l i
un i t i p e l b en e d e l l a p at ri a.
D i ques ta u n i o n s og n o r p iù sa l da av em m o p ro v e b en co n so l an t i n e i
sen s i con cu i i sud d i t i n ostri acco l sero l e recen t i ri fo rm e, che i l des id eri o
d e l l a l o ro fe l ici tà ci av es co n s ig l iate per m ig l i o rare i d iv ers i ram i d i am
m i n i stm z i on e, ed i n iz iarl i a l l a d i scuss io n e d e i pub b l ici afi‘ari .
O ra p o i ch e i tem p i son o d i sp os t i a ca se m agg i o ri , ed i n m ezz o a l l e
m utaz i o n i segu i te i n I ta l ia, n o n d ub i t iam o d i dar l o ro l a p ro v a l a p iù s o
l en ne ch e per n o i s i p assa d el l a f ed e che co n serv iam o n e l l a l o ro dev oz i on e
e n e l l o ro sen n o .
Preparate n e l l a ca lm a, s i m aturan o n e i n o stri co n s ig l i l e p o l i tiche i s t i
tuz i o n i che saran n o i l com p l em en to d e l l e ri fo rm e d a n o i fat te , e v arran n o
a co n so l id arn e i l b en efiz io i n m od o con sen tan eo al l e con d i z io n i de l p aese.
Ma fi n d’
o ra ci è grato i l d ich ia rare, s iccom e co l parere d e i n os tri Mi
n i stri e d e i p ri n cipa l i co n s igl i eri d e l l a n o st ra Co ro n a . ab b i am o ri so lut o e
determ i n ato d i ad o t tare l e seguen t i b asi d i un a S tatu to f o n dam en ta l e p er
i stab i l i re n ei n o stri s ta ti un com p iu to s i s tem a d i gov ern o rap presen tat iv o .
Art.°1°eco .
L o s tatu t o fo n dam en tal e che d’
o rd i n e n o st ro v i en p reparato i n con fo r
m ita d i questa b as i , sara m esso i n v i go re i n segu i t o a l l’
at tuaz i o n e d e l
n uov o o rd i n am en to d e l l e amm in i straz i on i com un a l i .
Men t re co si p rov v ed iam o a l l e p iù a l to em ergen z e d e l l’
ord i n e p o l i t ico ,
n on v ogl i am o p iù o l tre d ifi‘eri re d i com p i ere un d e s i d eri o che da l u ngo
tem p o n u tri am o , con ridurre i l p rezz o d e l sa l e a 30 cen tes im i i l ch i l o
g ram m a fin e d a l 1 lug l i o p ro ss im o v en turo , a b en efiz i o p ri n cipa lm en te
d e l l e cl ass i p iù po v ere , p ersuas i d i trov are n e l l e p iù ag iate que l com penso
d i pub b l i ca en trata che i b i sogn i de l l o S tato ri ch i ed o n o .
Pro tegga I d d i o l‘
era n ov e l l a che s i ap re p er i n o stri p op o l i ; ed i n
tan to ch’
o ssi p ossan o far uso d e l l e m agg i o ri l i b e rtà acqu i s tat e, d i cu i son o
e saran n o d egn i , aspett i am o da l o ro la rigo rosa o sserv an za de l l e l egg i v i
gen t i , e l a im p erturb ata qu i ete tan to n ecessaria ad u l t im are l’
opera del
l’
o rd i n am en to i n tern o de l l o S tato .
Data i n To ri n o add l o tto feb b ra i o m i l l eo ttocen to quaran tot to .
CAR L O Annnnro .
_ 1 7 _
Les articles du statu t furent successivement élaborés parl es m in istres seuls . Borel li , Alfieri et Des—Amb ro is euren t lapart principale de ce travail . O n exam ina et con fronta toutesl es const itutions politiques de l
’
E urope . Mais après mûredélibération on prit pour base , d
’
après l’
av is de Des-Am
b rais , la charte f ran çaise de 1830 , comm e l’
avait fait l e Roide Naples . Aller plus loin sur la v oie des concessions auraitété affaiblir trop l e gouvernement ; rester en deçà eut été
dangereux et impol ifique , parceque c ’ était rester en arriérede ce qui avait été fait par d
’
autres princes ital iens . S’
at
tacher a un précédent comme celu i de 1830 avait l ’ avantagede sav oir précisément la portée de ce qu
’
on faisait , de trouvertoutes les interprétations fixées par la pratique , de m ettresous l es yeux du peuple une concess ion dont il pouvai t immédiatement apprécier la portée.
A m esure que le travai l avançait on l e soumettait au Roien consei l . Charles Albert s
’
arrêta sur quelques points . Ce
ne fut pas sans d ifficu lté qu’ il accepta la rédaction de l’
ar
t iole prem ier relat if à la rel igion . I l fal lut y ajouter l e mot
seule, et dire, la rel igion catho l ique est la seule rel igi on
de l’
état . A l ’ article sur la propriété i l v oulai t ajouter une
disposition pour empêcher la spoliation de l ’ égl ise. Il céda
pour ne pas donner à la propriété ecclésiastique un degréd
’ inv iolabilité au dessus de la propriété privée qui est la
base de l ’ ordre social . Ce fut lui qui voulut réduire la tu
telle de la Reine m ère aux sept prem i ères années du Roim ineur .
I l fit remarquer, avec raison , que, dans un peti t état p lacéentre deux puissants v oisins , l a tutelle du souverain m ineur
peut avoir une importance spéciale au point de vue politique ;que c
’
est une chose d ’
autant plus délicate dans notre mo
narchie O ù il est facile , pour plusieurs raisons , que la Reinem ère appartienne à l ’ une ou a l ’ autre des dynasties qui
règnent a ses côtés ; qu’
en un pareil état de choses l a tu
telle ne doit être laissée aux mains débil es d’
une femme
qu’
autant que s on en fan t a b esoin des prem iers soins ma
ternel s pour son éducation physique et morale , et qu’
elle
18
doit cesser dès que la pol itique pourrait exercer une influencesur l e moral du pet it Roi .O n dut , pour obéir au Roi , supprimer le nom de garde
n ation a le et l’
appeler communale . Ce n’ était pas dans sa
pensée un changement puéril de dénom ination ; car il y at
tachait un sens po l itique et entrev oyait vaguement une in
st itut ion loca l isée qui n’
aurait pas présenté l es m êmes dangerset aurai t pu avoir les avantages m i l itaires des anciennes m il ices du Piémont . Mais l e statut émane avec cette seule dif
férence de dénom ination de la garde. L ’ état de l ’ opin ionn
’
aurait pas perm is de promul guer une constitution où ne
figuràt pas une force qui en assurât l ’ ob servance de la partde l a Couronne aussi bien que de la part du peuple . I l n
’
êut
pas d’
ailleurs été logique de la supprim er sans y substituerd
’
autres garant ies . L es idées du Roi auraient pu être m isesa l ’ étude lorsqu ’ on fit la loi d ’ organ isat ion de l a garde na
t ionale . Mais alors l e temps m anqua ; soit que S a Majesté eûtm od ifié ses idées , soit que les circonstances ne lui aientpas perm is de l es cul tiver, l e fait est que l a loi n
’
en porteaucune trace . E l le ne fut qu ’
une cop ie de la lo i f ran çaise ,et ce fut seu lement après bien des années qu
’
on pensa a la
réform er a un point de vue m ilitaire qui se rapproche de
celui du Roi Charl es Albert .Enfin l e R o i désira donner l a garan tie constitutionnel le a
la con servat ion des ordres chevaleresques de l ’ état et de
leurs dotations , a cel le du v ieux drapeau de la maison deSavoie et de la cocarde bleue .
U n sen tim en t de convenance fit adopter san s discussionl es d ispos ition s d ictées par un légitime sen timent de dign itédynastique et d
’ orguei l national . Quelqu’
un avait cependantcherché à laisser de côté au m oins l es deux dern ières pourév iter de faire descendre l e statut à des détails non indispen sab les . S
’
i l eût été écouté ou eût év ité au Roi de se
dédire peu de temps après , comme i l dut faire en ouvrantla guerre contre l
’
Autriche , puisqu’ i l entra en Lombard ie
avec les t rois couleurs ital iennes dan s sa cocarde et dans
ses drapeaux .
— 20
L e sp eranze d’
I ta l ia , av ait fait un drapeau du mouvementen Piémont.
Pareto amena son am i le Marqu is V incent Ricci . Ces deux
personnages réun is avec Balbo se m irent à l ’ oeuvre et dél i
b érèrent de s’
adjoindre avant tout deux des anciens m in istres ,Des-Ambrais et R ével , d
’ o ffrir un portefeuil le à S c10pis et
celui de la guerre au général Franzin i . Des-Ambrais refusa
encore ; pu is voyant que l e m in istère ne se formait pas ,que l
’
émeute courait l es rues , que R ével ne voulait pas en trerau cabinet sans l ui , que le Roi était affi igé de ne pas avoiren ces moments d ifficiles l e concours des personnes sur
l’
affection desque lles i l comptait , il céda et consentit a con
server le porte feuil le non polit ique qu’ il avait tenu en dern ier
l ien , se réserv ant de sortir du m inistère dès que l es circonstances lui auraient perm is de l e fai re sans inconvénient .
Peu de temps après surv in rent l es journées fameuses de
Milan . Des-Amb ro is n’
ava it jamais poussé à l a guerre , croyantqu
’
elle aura it été désastreuse pour l e Piémont . Mais dans cem om ent O ù l
’
E urope é ta it bouleversée ,l
’
Autriche m inée au
coeur et prise au dépourvu en Lombardie , l es populationsital iennes exaltées par l e sentiment de l ’ indépendance, le Roiengagé par ses précédents , i l n
’
y avait pas a chois ir. Aussil e Roi au conseil déc lara-t—i l qu ’ il prenait sur lu i de fairel a guerre , qu
’ i l in v itait seulement l es m in istres a av iser auxm oyens d ’
exécution . L es m in istres furent unan imes à reconnaître qu ’ i l n ’
y avait pas d’
autre part i a prendre . S c10pis
improv isa l a proclamation aux peuples de l a Haute Ital ie .
Charles Albert a vant de partir pour l’
armée embrassaDes—Ambrais en lui disant : mon cher Des—Amb rois j
’
ai l e
pressen timent que nous ne nous v errons plus. U ne ballem
’
étendra sur le champ de bataille . N on , Sire , luirépondit l e m in istre , chassez ces idées sin istres . V ous v ivrezet nous chan terons l e T e Deum dans l e Dôme de Milan .
L a campagne de Lombardie occupai t toutes l es troupesde l ’ état . L e maintien de l ’ ordre dan s l es prov inces étaitabandonné à la garde nationale , récemment établie , non en
core organ isée partout , non armée sur plusieurs points . L a
21
propagande républicaine crut le m oment venu d’ opérer un
coup de main sur la Sav oie . L e gouvernement de la répu
b l ique française était partagé en deux partis . L’
un ,celu i de
L a Martine , v oulait l ’ ordre à l ’ intérieur , et au dehors l erespect des traités . L ’
autre , celui de L edru—Roll in , pré féraitl e progrès de la révolution au dedans et au dehors . Protégée , sol l icitée par ce dern ier parti , une bande d
’
env iron1200 h omm es , ouv riers pour l a plupart , l es uns f rançais , lesautres sav oyards habitan t Lyon , partirent de cette v i l le au
commencement d ’
avri l et m archèrent sur Chambéry. L ’ imagination populaire , aidée peut—être par la m auvaise fo i de
quelques meneurs , donna des proportions fantastiques a cetteinvasion quand l ’
approche en fut annoncée . C’
étaient , d isait—on ,plus de dix m i l le hommes , d
’
autres disaien t douze m i lle , résolus, féroces , arm és jusqu ’
aux den ts ; impossible de résister.
Il y eut une pan ique généra le . L e conseil de v il le réun i avecl es officiers de la garde nationale dé l ibéra de s
’
absten ir detoute rés istance . L e gouv ernemen t dépourvu de troupes suffisantes , se retira sur Aiguebelle avec l ’ in tendan t géné ral et
l es caisses publiques . L es voraces , car l es envah isseurs se
donnaient ce nom , en trèrent dans l a v ille san s coup férir,occupèrent l
’
hôtel de v ille et proclam èrent la république .
Mais en vue de la réalité le peuple comm ença à se ra
v iser . O n v it que l e nombre des envahisseurs était bien in
férieur à ce qui avait été dit , que ces prétendus v oracesétaient des hommes comme les autres , mal armés ou sans
armes , non d iscipl inés et conduits par des chef s improv isés
peu aptes au commandement. O u eut honte de subir un pareiljoug . Par un mouvement rapidement combiné , où les habitansdes faubourgs eurent une part très- v ive et ceux de la cam
pagne prêtèrent leur concours , la population surgit en armeset chassa ces dom inateurs d ’
un jour . Fugiti fs dans les cam
pagnes , i ls furen t arrêtés par l es paysans et tradu its aux
prisons de Chambéry.
Au prem ier av is de l ’ invasion ,l e gouvernement délibéra
d’
envoyer un des m inistres en Sav oie av ec p leins pouv oirs
pour encourager la résistance, faire tomber l e bruit répandu
— 22
que l e nouveau m inistère vou lût cédér la Sav oie à la France ,et ran imer le dévouemen t des populat ions envers la maisonde Savoie .
U ne pareil le m ission sans l ’ appui d’
aucune force exigeaitbeaucoup de prudence . Des—Ambrais se porta d
’
abord jusqu ’ àSaint—Jean—de—Maurienne , où il lui résu l tait , par des explorateurs envoyés a l ’ avance , que l
’
autorité restait au gouver
nement. Là il apprit b ientôt après son arriv ée que les vo
races ava ient été chassés de Chambéry . Ce fut l ’ év êquem ême qui , au m i lieu de l a nuit , v êtu en simple eccl ésiast ique ,lui apporta cette nouvelle . L ’ é vêque s
’ é tait porté secrè tem en t aux env irons de Chambé ry pour savoir ce qui se passait .
La il avait été presque témoin ocu laire des évênements de
la journée . Rassuré sur l e sort de Chambéry i l é tait rentréen toute b ête à Saint-Jean .
D ’
autre part Des—Ambrais avait su que le gouverneurétait à Aiguebel le. I l s
’
y porta ; m ais , a son arrivée , l e
gouverneur, l’ in tendant généra l et leur suite étaient déjà
repart is pour Chambéry ,où tout était rentré dans l ’ ordre .
I l ne restait donc a Des—Ambrais que de pacifier l es espritset pourvoir à. l a sécurité pour l
’
av en ir.
Par des in format ions v enues de bonne source il put se
convaincre que l’ invasion des v oraces é tait un fait isolé , et
que rien n’ é tait à craindre sur l es autres points de la f ron
t ière f rança ise. A Lyon la masse énorme des ouvriers des
ate l iers nat ionaux menaçait une nouvel le expédit ion pour dél iv rer leurs compagnons prisonn iers . Mais comme i l é taitév ident que l e fisc ne tiendrait pas sous l es v errous prèsde 1200 indiv idus , dont la p lupart avaient su1 v 1 mach inalem ent leurs chefs , i l y avait moyen d
’ év iter cette nouvel leattaque avan t m êm e qu
’
on eût le temps de fai re v en ir dest roupes pour la dé fense du pays .
E n effet , pendan t qu’ i l dem andait un ren fort accéléré de
troupes , Des—Ambrais v érifiait avec l ’ avocat fiscal généralqu
’ i l y avait l ieu à. provoquer une ordonnance de m ise en
l iberté pour plus de 800 détenus , qui en effet fu rent relâ
chés . Des mesures ayan t été prises pour que ce fait fut connu
au p lutôt parm i l es ouvriers de Lyon et pour détru ire par
des publications populaires le bruit répandu à desse in parm ieux d
’
horreurs comm ises’
contre l es voraces à Chambéry, les
O uv riers de Lyon se calm èrent et renoncèren t a se jeter den ouv eau dans les av entures d ’
une équipée qui n’
aurait p lusde but suffi sant n i de probabi l ité de succès .
Des—Ambrais fit connaître la v érité sur la conduite des
autorités et sur l e détail des évènements . L e gouverneuréloigné sans dé shonneur, un général sav o isien fut envoyé
pour le remplacer. Dans l ’ ensemble des év ènemen ts i l y avaiten imprévoyance de l a part du gouvernemen t , faib lesse de
l a part des uns , ignorance de l a part des autres , de v ivesdémonstrations de dévouem ent par des personnages qui avaientfaibl i la veil le. Des—Amb rois se hàta , a son
“
retour à Turin ,
de proposer au con seil une amn istie qui jetât un v oile sur
l e passé , qui heureusemen t frisait l e burlesque et était denature a ne pas se renouveler.
A Turin de graves complicat ions étaien t surgies . L a L om
bardie libérée du joug autrich ien ne v oulait pas s’
uni r au
Piémont sans qu’
on en v int à former une assemblée constituante pour l
’ état nouveau qui résultait de l a fusion des
deux pays . Le mandat de l a constituante aurait cependantpour base intangible la forme m onarch ique dans la m aisonde Sav oie .
O n avait essayé de détourner les Lombards de cetteexigeance qui pouvait avoir des conséquences dangereuses .
L e Marquis Albert Ricci avait été chargé d’
en trer à cet
e ffet en pou rparlers avec l es plus influents , et ce fut en v ain .
Pinel li , Des-Amb ro is et S c10pis prièrent Giobert i , qui al lait àMilan , de chercher a les dissuader par son autori té , alorsimmense . I l ne réussit pas . Que faire ? Dans un conseil réun isans la présidence du Prince de Carignan , lieutenant du Roi ,l a quest ion fut débat tue sous toutes ses faces . Tou t le con
seil , moins S c10pis , reconnut que l’
on compromettrait tout sion refusai t le vote de la Lombardie , et qu
’
en l’
acceptant on
courait moins de périls , car, si l ’ arm ée était v ictorieuse , l eR oi serait maître de la situation , et si elle é tait vaincue, il
_ 24 _
ne serait plus question n i d’
annexion , ni de constituante.
Des-Ambrais fut chargé d’ écrire au Roi au nom du conseil
pour lui soumettre l e vote et demander ses déterm inations .
L a réponse fut immédiate et conforme au vote ; elle étaitbrève ed digne de Charles Albert
L ’
annexion de l a Lombard ie ayant ainsi eu lieu , elleentraîna la convenance de constituer un m in istère nouveau ,
dans lequel eussent place quelques hommes politiques des
nouvelles prov inces. Des-Ambrais saisi t cette occasion pourquitter défin itivement l e m inistère . Il en prév int ses co l lè
gues , et sans plus en écrivit au R o i , qui était alors au quartier
général de V aleggio . Charles Albert lui répond it qu’ il ne
pouvait ins ister pour le reten ir davantage ; mais qu’ i l dési
rait qu’ i l al làt l e trouver en Lombardie pour y rester auprés
de sa personne pendant l a formation du nouveau cabinet , àl aquel le il aurait pu d
’
autant m ieux aider S a Majesté , quelui—m ême aurait été désintéressé dans la quest ion .
Il se rend it donc a V aleggio sans que sa dém ission fût
publiée. L e Roi l e reçut l es bras ouverts , et , pendant plusd
’
un mois et dem i qui s’ écoul èrent avan t la constitut ion du
m in istère , i l remplit auprès de S a Majesté les fonctions desecrétaire d ’ état dans les formes d ’
une véritable intim ité .
E n cette qual ité il contres igna la loi d ’
annexion de la
Lombardie aux états royaux , et cel le d ’
annexion de la V ê
nétie , et i l eut à. recevoir la députation de V en ise qui venait
(l ) Ma rép on se, d isai t l e R o i Magn an im e, sera aussi b rèv e q ue l a
questi on est p our m o i d’un e grav i té co l o ssa l e. V ous fû tes tém o i ns d e m a
condu ite ai n s i que R êve] pend an t tou s ces d ern i ers m o i s , v ous m e con
n a issez d epu is l ongtem p s . V ous l e sav ez d on c. Deux p o ussés m‘
on t co n
stamm en t an imé, év i ter des gran d s m a lheurs à n otre p atri e en fa i san t t out
ce qu i hum a i n em en t est p oss i b l e p our p rocurer son b onheur et sa g l o i re ;
et d on n er m a v i e s'i l l e fau t p our o b ten ir 1
’
in dépen dance i tal ien n e . V ous
1’
av ez vu ; jam ai s je n’
a i m an i fes té un regret , un chagrin . Tou te m a con
du i te fu t con stamm en t l e sacrifice de m on exi s ten ce et de tou t sen t im en t
p erson n el au b ien d e m on pay s. L a g ran de m ajo ri té d es m in i stres cro i t
que, p our l a tranqu i l l i té, l a fél ici té future de n o tre patri e, i l est con v en ab l e
que j ‘ accepte l a d em an de des Mi l an a i s ; je les est im e du p lus pro fon d d e
m on coeur, je m e rem ets à l eur av i s san s res trict ion . .
_ 25 _
fai re hommage au Roi , puis celle de la Sicile qui venaito ffrir la couronne de cette î le au Duc de Gênes , second fil s
de Charles Albert .O n ne peut se rappeler sans r ire combien ces fonct ions
se faisaient pauv rement dan s de petits v il lages d e Lombardie ,où l ’ on manquait de locaux et de m eubles , où m êm e l ’ étatde l
’
armée en face de l ’ ennem i ne permettait pas d’
employerles troupes à un apparei l m ilita ire .
L e Duc de Gênes hésitait a accepter 1’ offre des Sicil iens .
L e Roi l ’ engagea a se consulter avec Des-Amb ro is , qu’ i l
savait d isposé à l ui conseiller l’
acceptation dans l e cas où
l e m in istère en reconnût la convenance pour les intérêts de1 etat . Mais avant tout il fallait sav oir ce qu
’
en pensaientl es grandes puissances ; car l a Sicile ne pouvait être aidéepar le Piémon t , et , laissée à elle seule en face de N apleshostile et de puissances qui ; au lieu de protéger sa l iberté ,eussent elles-m êmes a son encontre des an tipathies ou des
convoitises , i l lui eût été trop d ifficile de se souten ir.
L a déroute de Custoza , qui surv int précisément l e lendemainde l ’arrivée des députés , tronqua tout comme un coup de foudre.
Duran t la batai lle de Custoza Des-Ambrais observait l esm ouvements des troupes du hau t d
’
un b el vedère de V illaf ranca av ec le général Chiodo , commandan t en chef du gén ie .
De la i ls v i rent l a marche héroïque de la d iv ision du Duc
de Sav oie , l’
actuel R o i V ictor Emanue l , qu i , la bayonnetteen avant et le ven tre contre terre , grav issait la coll ine deCustoza sous le feu battant des Autrichien s .
Des—Ambrais , quo iqu’
étranger à l ’ adm in istrat ion de la
guerre , s’
empl oy a pour improv iser dans les édifices pub licsde V illafranca des lits pour les blessés qu
’
on rapportait ducombat. C ’
était un spectacle déch irant que celui de tant deb raves , am is et ennem is , tourmentés par la douleur et ru issel ants de sang , au m i l ieu desquels circulaient l es chirurgiensqui amputaient l es bras et l es jambes , et a leur tête l e ch i
rurgien généra l les m anches retroussées , les bras ensanglan tés .
L es officiers de santé qui se trouvaient alors a V il lafranca étaient pour la plupart des jeunes gens appartenan t
— 26
au corps san itaire de Toscane . I ls étaien t remarquables parl eur zèle p lein d
’
human ité et par les bonnes man ières qui
accompagnaient leurs soins .
U n moine piémontais attaché aux ambulances , b el homme,v êtu de son f roc , é lectrisait tout l e monde par l
’
exemple desa chari té arden te.
La bataille était perdue . L e Roi ordonna que dans la
nuit on se ret irât sur Goito . Lui-m ême v oulut fermer la
marche étant à cheval à la suite des ambu lances .
Cette re traite , après un parei l désastre , était un peu dé
sordonnée et confuse . O n v i t le moment que les voituresn e pouvaient plus avancer. Des—Ambrais fut obl igé de
faire une part ie du trajet à. pied . Néanm oins i l arriva àGoito avant l e Roi et se prépara a prendre ses ordres à son
arrivée . Il y eut la un moment bien triste . Charles Albertassis à côté d ’
une table sur laquelle était posé un petit tableau de la Sainte V ierge, pâle , abattu , m ais digne . Il mesurs it toute l a grav ité de sa position . S a fo i surexcitée v oyaitdan s notre ruine un châtimen t céleste , et i l s
’
incl inait de
v an t Dieu .
L es généraux réun is à Goito sous la présidence du Roiopinèrent à l
’
unan im ité qu ’ il fal lait demander un arm istice pourav oir l e temps de remonter l e m oral des troupes et de l es
remettre sur pied , qu’
elles é taient épuisées par les fatigueset l e défaut de v ivres. Des Ambrais par ordre du Roi interv enait au conseil , en protestan t toutefois qu
’ i l se croyaitincompétent pour v oter.
O n sait que le Maréchal Hess m it à l ’ acceptation de
l ’
arm istice des conditions que l e Roi ne crut pas dev oiraccepter. L ’
armée royale se retira derrière l ’ O gl io , E l le com
m ençait a se débander. A Goito Charles Albert était revenuun mom ent a ses idées d
’
abdication , mais i l n’
y donnaaucune suite. L ’
armée continua à se retirer . L e quartier général fut porté de Goito a Crémone . Mais l es désertionsaugmen taient. S es soldats étaien t persuadés que l a guerreétait fin ie ; que l es troupes rentrer
'
aien t en Piémon t . I ls
n’
avaien t p lus de scrupules à quitter le drapeau pour re
— 28
pas dissoute . Des Ambrais avait été élu député spontanémen tpar le collège électora l de Suse lors des prem ières élect ions .
La votation avait été presqu’
unan ime en sa fav eur. I l étaitmin istre , i l ne pouvait refuser.
Il avait cependant prévu tout d’
abord combien aurait étédi fficile sa position , à lui ancien m in istre dans un parlementnouveau, qui v iendrait avec l a persuasion que tout avait étémal fait per l
’
ancien gouvernement et que l e règne de la
liberté exigeait un ensemble a neuf de personnes et de lois .
Il sentait que sa place était naturel lement marquée dans lesénat p lus conservateur et juge m oins host ile du passé . L es
m inistres nouv eaux av aient sans doute en l ’ intuition de
ces conv enances , car i l s off rirent a R ével et a Des-Am
brais des s ièges au sénat où i l paraissait aussi naturel quequelqu ’
un du m in istère prit place. Mais R ével ayant déclaréqu ’ il préférait se présenter aux élections , Des—Am b ro is fut
entraîné à refuser de même l e poste de sénateur .
Or la chambre des députés reprit ses séances en octobre1848 partagée en deux partis passionnés et an imés récipro
quement de pré ventions haineuses . L a gauche voulait la
guerre et des réformes exagérées . L a droite v oulait continuerl es négociations de paix , et , s
’
imaginant que la gauche mouvaitau social isme , repoussait toute concession . Quelle atm osphêre
pour un homme naturel lemen t impartial ! Des-Ambrais , sen
tan t eu lui -même une répugnance décidée à se lier soit av ecl
’
un soit av ec l ’ autre parti , aurait eu besoin , pour dom inerl a situation
, d’
une dextérité qui n’ était pas dans son ca
ractère et d'
une éloquence parlemen taire qui lui manqua it:Il s ’
est trouvé toute sa v ie extrêmement gêné a parler en
publ ic par une sorte d ’ émotion qu ’ i l ne put jam ais réprim erent ièremen t et qui tenait peut—être plus au physique qu
’
au
mora l . D ’
ai l leurs une autre imperfection d’ organes faisait
que la voix lui manquait bientôt au devenait aigre , enrouéeet in terrompue par la toux . I l se résigna donc a faire ce
qu ’ i l pourrait selon ses forces et sa conscience , restant indépendant et isolé , au besoin , votant dan s chaque cas commeil le croyait plus convenable dans l
’ intérêt du pays .
29
Dan s les commencements il fut b làmé par la droite qui
s’ était attendue à l e v oir entrer dans ses rangs ; mais peu a
peu on s’
hab itua a sa m an ière d ’ être . Il reçut m ême de ses
coll ègues de continuel les démonstrations de bienv eillance ,étan t ordinai rement appelé à. l a présidence des bureaux outrequ
’
i l eut celle de l a comm ission générale des b udjets et des
comptes .
Enfin lorsqu ’
eurent l ieu les élections de 1 849 , l e parti del a gauche 1
’
ayant opposé à César Balbo dans un collège deTurin , i l déclara qu
’ i l refusait , et pour ô ter toute possibil itéà l
’ élection , il protesta qu’ i l entendait ne p lus être député .
L e ministre Pine l li lui o ffrit imm éd iatement le poste de sé
nateur , qu 11 déclina par convenance . Il fut nomm é un peu
p lus tard .
Au sénat i l prit dans l es prem ières années une part trèsactive aux travaux . I l fut rapporteur du b udjet de l
’ in térieur,de la lo i de sûreté publique , de celle sur l ’ adm inistrationcentrale et de p lusieurs autres des plus importantes . Depuis1850 il présida p resque toujours la comm iss ion permanentede finances ; de 1855 a 1860 i l fut prem ier v i ce-président dusénat. Depuis l ors il s
’
agit plusieurs fois de l’
élever a la pré
si dence ; i l déclina costammen t cet honneur al léguant son
peu de voix et d’
autres infirm ités réel les . Il lui semblaitd
’
ai l leurs que ce poste gratui t exigeât une représentation et
i l avait peu de fortune .
V ictor Emanuel I l montan t sur l e trône en 1849 avaitnommé un m in istère présidé par l e général de Launay, ancienV ice—R o i de Sardaigne . L e général étant soupçonné de ten
dances réactionaires , l e Roi se v it dans la nécessité de se
séparer de lui . Il fit appeler Des—Ambrais pour le con sulterà cet égard , et , comme il déclara que sans accepter l es accusations larv ées contre de Launay i l était conv aincu que sa
présence au m inistère pouvait compromettre l e nouveau règnequi s
’
ouv rait dans les moments l es plus orageux, l e Roi luiofi
'
rit de le remplacer. Il rappela respectuesement à S a
Majesté ce qu’ i l avait d it au Roi Charles Albert en l e quit
tant a Crémone , et lui déclara que d’
ailleurs il ne croyait
30 .
pas pouvoir lui être utile en entrant au m inistère ; que l e
retour d ’
un m in istre de l ’
ancien régime donnerait toujoursl ieu aux soupçons de réaction ; que l e trône ne pouvait se
consolider qu ’
en éloignant absolum en t tout soupçon de cettenature , et qu
’ i l importait de chois ir un homme dont le nom
fût au contraire une garant ie pour l a l iberté . L e refus con
sciencieux de Des—Am b ro is fut fort heureux pour l e pays ;car i l amena l e choix de Maxime d ’
Azegl io , qui é tai t l’
hommedu moment . Maxime d ’ Azegl io consolida la m onarchie , peutêtre i l la sauva .
L es négociations du traité de paix avec 1’ Autriche trai
nèrent assez longtemps . E n dern ier lieu l e gouv ernem ent eutrichion se m ontrait disposé à conclure m oyennant une indemn ité de guerre de 75 m ill ions . L e Prince Louis Napoléon ,
président de l a république f ran çaise , s’ était intéressé officieu
sement pour la paix et pour la réduction du chi ff re . L e ComteGall ina , m in is tre à Paris , après une conversation avec mon
sieur Th iers qui avait alors une grande influence , écrivaitque peut- être au aurait pu ! obtenir une réduction u ltérieurede quelque m il l ion . L e Roi conv oqua un conseil de m inistresoù intervenait l e Duc de Gênes , av ec l
’
adjonction de L a Marmara , de Cavour , alors rédacteur du journal conservateur leR isorgimen to , et de Des
-Amb rois . Ce dern ier, appe lé à donnerson vote après l es m in istres , se prononça sans hés itation
pour la conclusion immédiate de l a paix. Il y av ait de grandsavantages m oraux et économ iques à t irer l e pays de cet étatprolongé d
’ incert itude , à rétab l ir l es rapports ordinaires en trel es deux é tats , à ren voyer dans leurs foyers tant de soldats ,pères de fam ille, ouv riers ou agricul teurs , et la réduct ion dedeux ou trois m i l lions d
’ indemnité , réduction d’
ailleurs incertaine , pour peu qu
’
elle se f it attendre aurait é té com
pen sée par la dépense e ffectiv e de l ’
entretien des troupessur p ied de g uerre pendan t l
’ intervalle . Tout l e consei l futdu m ême av is .
Des—Ambrais avait été choisi en décembre 1848 par l e
Roi Charles Albert pour rem placer , comme prés ident de sectionau conseil d ’ état , l e v ieux Com te
’
Pey retti qui avait obtenu
— 31
sa retraite ; i l ne crut pas devoi r accepter une dign ité aussiconsidérable qu i lui était déférée au m om en t où se trouvaitau pouv oir un m in istère de gauche et lorsque l e décret den om ination aurait dû être signé par Richard Sinea son am i
personnel . Il lui répugnait de pen ser qu’
en de pareilles circon stances i l recût ce que le pub l ic pourrait considérer commeune fav eur du m in istère . Il accepta
.
cependan t cette chargeen fév rier 1849 , lorsqu
’
ayant été offerte aux magistrats l esp lus ém inents , i l s l
’
eurent refusée a cause de l a ténuité dut raitement, et que l e m in istère R attazzi lu i représenta que au
fond la nom inat ion bien considérée n’ était pas une faveur
énorme envers un ancien m in istre qui avait gouv erné pendantp lus ieurs années et qui , en raison de son âge , devait encoreserv i r l ’ état .
V ers l e m ilieu de 1 850 le Maréchal de L a Tour , v icep résident du consei l d ’ état , s
’ était retiré à cause de son
grand âge et de sa presqu’
ent iére cécité . L es présidents de
section l es plus anciens avaien t aussi quitté leurs sièges et
n'
av aient pas été remplacés . Des—Ambrais fut invest i de fait ,sous l ’ apparence d
’
une régence prov isoire , de la présidenceeffectiv e du conseil . Il la con serva a travers tous les re
man iements subis par ce corps .
E n 1854 un incident parlem en tai re v int mê ler malgré lu inotre sénateur au fracas des luttes de partis . Ce fut l a di
scussion de la l oi sur l es corporat ions rel igieuses qui v int aujour en 1855 , et qui fit tant de bruit en Ital ie et en Europe
par su ite de la condamnation solennelle dont le Pape la frappa.
Le projet de loi voté par la chambre des députés et pré
senté au sénat supprimait tous l es ordres m onast iques , toutesl es autres corporat ions religieuses sauf quelques exceptionsn om inales , l es chapitres des collégiales , l es bénéfices simpleset les chapellen ies lai cales . Il en donnait l es bien s à l ’ étatqui devait en destiner l e revenu , à pensionner l es religieuxet les b énéficiers sous déduction d ’
une quote-part qui seraitdévolue au trésor public .
Ce projet déplut au sénat ; du moins fut- i l mal accue il l idans l es bureaux . Des—Ambrais fut nommé membre de l a com
— 32
m ission chargée de l’
av is préalable . La majorité de la com
m ission rejeta le projet ; l a m inorité , composée de lui et du
général Hyacinthe de Collègue, O pinait pour l’
adm ission avec
des modifications essentiel les . La majori té du sénat adm it cesystème après des d iscussions très-longues et orageuses . Maisavant qu’ i l en v int à cette v otation , les év êques siégean tau sénat avaient proposé au nom du clergé que l
’
on sub sti
tuàt au projet une lo i d ’ imposit ion extraordinaire sur les
b iens ecclés iastiques, se portant forts pour le payement dece tribut dans une somme déterm inée dont la répartition sur
l es bénéfices et autres êtres moraux ecclésiastiques aurait étélaissée aux évêques
‘
réunis. L e min istère s’ était réservé d ’
exa
m iner la proposition et la d iscussion de la loi avait été su
spendue . Mais l e parti l ibéral s’ était v ivement ému contre
l ’ intrigue qu’ i l d isait ourd ie par quelque meneur clérical .
O n parla de pressions exercées sur l a conscience du Roi etdes Reines . Il y eut des démonstrations publ iques . L e m in istère se dém it. U n cabinet nouveau fut créé sous la pres idence du général Durando ; mais i l ne put se compléter .
L ’ irritation al lait croissant dans le public . Enfin l e m inistêreCav our rentra ; il rejeta 1
’ off re des év êques et rem it sur
pied l a discussion sénatoriale . Ce fut dans cet état d ’
excitation des esprits que rev inren t sur l e tapis l es idées de Des
Ambrais , et qu ’
elles prévalurent. E n v oici l a substance et
l es motifs .
L e projet du gouvernement abolissait toutes les corporat ions sauf des exceptions rem ises au choix arbitrai re du gouv ernemen t . Des—Ambrais ôta tout arbitraire et lim ita l ’ abol itian aux ordres qui n
’ étaient appl iqués n i a la prédication ,
n i à. l ’ in struction , n i au soin des hôpitaux .
L e projet él im inait de leurs couvents l es religieux et les
rel igieuses des ordres supprimés. Des—Ambrais , restreignantl a suppression a ce que peut faire régulièrement le lo i civ ile, c
’
est—à—dire à la v ie légale du corps moral , laissait lesreligieux et les religieuses v ivre dans leurs couvents sousl
’
emp ire de l eurs règles sans se renouveler, se bornant àassurer leur existence séparée l orsqu
’
i ls ne seraient plus en
nombre suffisant pour subs ister comme couvent,san s toutefois
l es obliger par l a force a y rester.
L e projet rendant au siècle les religieux mendiants , quiperdaient ainsi la faculté de m endier, leur assignait des pension s qui formaient une charge de p lus d
’
un m i ll ion et dem i .Des—Amb ro is dans son systèm e leur conservait la faculté dem end ier, et n
’
avai t a l es pourvoir de pensions que quand il sseraient réduits en trop petit nombre pour v iv re en com
munauté .
L es chapitres des collégiales , dans le projet de Des—Am
brais, 11ӎtaient abolis qu
’
autan t qu ’ ils n’
avaient pas charged
’ âmes .
Enfin Des—Ambrais attribuait toute la succession des corpset établissemen ts sup primés à une caisse d ite ecclés ias tique,
d on t l es fonds seraient réservés à payer l es pensions desm oines et des b énéficiers privés de leurs bénéfices , et , en cas
de surplus , à amé liorer l e sort des curés pau vres , de sorteque l
’ é tat ne pouvait être accusé de tuer des corps morauxpour s
’
appr0prier leurs dépouil les . Cette caisse serait ellem ême un corps mo ral ; son adm in istrat ion serait confiée au
di recteur général de la dette publique , comme i l avait déjàcel le de la caisse des dépôts . Elle ressort irait , pour l e per
sonnel et l e con trôle , non au m in istère des finances , mais a
celui de la jus tice , et serait su rveill ée par une comm issiondont les m embres seraient élus un tiers par le Roi et un
t iers par chacune des deux chambres .
L o_Com te de Cavour saisit d ’
abord les avan tages que le
système de Des —Ambrais présentait pour faci l iter l’
adm issionde la loi qu ’ i l dépouillait de tout ce qu ’
el le avait de fiscalet de dur, et qu
’ il réduisait strictement aux l im ites de l a
compétence incontestable du pouv oir civ il , soit pour en obten iravec moindre bruit l ’
exécution , soit encore pour laissers
’ é teindre peu à peu l es ordres monastiques sans trop blesserles pos itions acquises , sans rejeter dans le m onde une foulede religieux et surtout de religieuses qui s
’
y trouveraientdéplacés , dépourvus de moyens suffisan ts pour v ivre isolésavec une honnête médiocrité ; il sentit surtout que l e projet
34
redressait une grave erreur financière du prem ier , en ce
qu ’ i l év itait aux finances la perspective non prévue d’
abordmais certaine de devoir dépenser en pensions beaucoup plusde ce qu
’
el les recevaient .L e m inistère , en m ontrant pour la forme quelque répu
gnance , accepta entièrement ce nouv eau projet .L e sénat l ’
adapta tout ent ier.
Dans l e public l es gens sensés l ’
accuei l l irent comme une
oeuvre de raison et d’ équi té , qui retranchait ce qu
’ i l y avaitde v iei lli et de superflu dans l es corporations ecclésiastiquesen conservant ce qui pouvait être utile et en observant en
v ers l es personnes l es m énagements convenables . L e p lusgrand nombre en fut satis fa it parcequ
’ il ramenai t le calmedans le pays . U n grand nombre de corporat ions , qui n
’
y
perdaien t rien , v irent sans efl‘
ro i une réforme qui les mettaità l ’
ab ri des dangers courus .
Mais l e parti clérical était outré . O n avait, selon lui ,
touché à l ’
arche sainte . L ’ état avai t disposé de ce qui appartenait à l ’ église ; i l avait v olé en gan ts jaunes ; ce n
’
en étaitpas moins v oler. L a cour de Rome , qu i d
’
abord paraissaitdésapprouv er avec modération ce qui avai t été fait sans elle ,et reconnaître qu ’
au fond on av ait procédé au sénat avecdes idées conciliantes , fin it par lancer ses censures con trel a l oi .
L a conscience publique n’
en fut guères émue . L es que
stions avaient été longtemps débattues . Chacun s’ é tait formé
une conv ic tion . L es masses m êmes étaient persuadées que legouvernement a vait usé de son droit et qu ’ il en av ait usé
honnêtement .Dans l es prem iers temps l
’
exécution de la loi sou levabeaucoup de plaintes e t de procès qui n
’
en étaient pas laconséquence nécessaire , parceque l
’
adm in istration fut quelquef ois trO p formaliste , par conséquent lente ,
t rop fiscale, m êm ech icani ère . Ces inconvénien ts furent bientôt oubliés et les
résultats v rais du système purent désormais être appréciés ;car l es ordres rel igieux frappés par la loi de 1855 ont di
sparu peu a peu en Piémont sans qu’
on s’
en soit presque
36
était lié d ’
honneur à accepter l’
aggrégation de ces peuplesà sa monarch ie.
O n dé l ibéra de chercher quelque man ière de ne pas avoirà signer un article de traité portant ce rétablissem ent , en se
f ondant sur ce qu’ à V il laf ranca le R o i avait ajouté à sa si
gnature ces m ots : p our ce qui m e con cerne .
Il se présentait aussi une autre grave d ifficulté de natured ifférente . C ’ était de fixer la quo te-part de dette publiquequi devait être mise à la charge de la Lombard ie par suitede sa séparation d
’
avec l ’
E mpire Autrichien .
L’
E mpereur N apoléon , dan s une conférence qu ’ il avaiteue à V i llafranca avec le Comte de R e ichb er , prem ier m i
n is tre d’
Autriche , avait consenti à ce que l’
on partageât ladette de l
’
E mpire Autrichien en proportion de la population .
Il en serait résulté pour la Lombard ie la charge énorme deprès de 900 m ill ions .
D ’
après l’
av is de Des—Ambrais , l e m in istère délibéra de
souten ir que la Lombard ie était un pays séparé de l’
E mp ire
Autrichien sous l e rapport financier , qu’
el le avait sa dettea part qui était cel le du Mon te L anzMrda- V én i tien , qu
’
ainsiel le ne devait prendre a sa charge aucune portion de l a detteautrichienne . L ’
emprunt forcé de 1850 é tait— il dette de l’
E m
pi re nou susceptible de partage ? I l é ta it difficile de l e sou
ten ir parcequ’
en établissant la lo i avait fixé une quote
part déterminée qui devait être a l a charge du RoyaumeLombardo—V én i tien . O n conv in t à Turin de se montrer disposé a se charger aussi de cette dette pour la part ali érente à la Lombardie , afin de mon trer qu
’
on é tait éloignéde toute chicane et pour obten i r plus facilement l
’
appui del
’
E mpereur en admettant jusqu ’ à un certain point l’ idée d ’
un
partage , cette idée qu’ i l avai t adm ise en principe dans l a
conversation improv isée a V i l lafranca .
Mais la plus forte de toutes était une difficulté prél imi
naire. C ’ était la prétention de l’
Autr iche de traiter seulemen t avec la France , laquelle successiv ement aurait traitéav ec la Sardaigne . Il resta entendu que
'
si le plénipoten
t iaire du Roi n ’ é tait pas adm is en t iers aux conférences de
Zurich sur le pied d’ égali té av ec l es autres puissances de
sorte qu ’ i l n ’
eût pas a signer l a paix, il s’
ab st iendrait de
se rendre aux conférences .
Des—Ambrais pensa que cette dern ière difficulté devaitêtre résolue à Paris , et qu ’ i l importait égalemen t d
’
exposersur les autres nos raison s à Napo léon . Il demanda donc avantt out d ’ être env oyé à Paris d ’
où i l n e se rendrait à Zurichque s i , d
’
après les réponses de l’
E mpereur , la situat ion yserait d igne d
’
un représen tant du Roi .L
’
E mpereur lui accorda a Saint Cloud un en tretien assezlong, dans lequel i l crut avoir persuadé S a Majesté que la
Sardaigne devait être représentée à Zurich d’
une m ani èreconforme à sa dignité , e t qu ’
elle devai t rester é trangère auxstipulat ions relativ es aux Duchés . I l laissa m êm e connaîtrequ ’ i l ne voulait point forcer l a v olonté des peuples et qu ’ ilcherchai t à combiner av ec l ’
Autriche le plan de transporteren Toscane et a Modène l a Duchesse de Parme qu ’ il croyait
pouvoir être agréée par l e pays , laissant Parme et Plaisances
’
uni r au Piémont .
Quant a la dette Des-Amb ro is lui fit aussi sen tir que s’
il
fal lait partager en proport ion de populat ion toute l ’ énormedette pub l ique de l
’
E mp ire Autrich ien i l en serait résulté
pour la Lombard ie une charge telle que ce pauvre paysaurait pu d ire , tout en reconnaissant ses obligations enversla France , qu
’
i l avait été forcé à payer chèrement sa
l ib er té .
Des-Ambrais crut v oir que cette dern ière observationavai t fait impression sur son auguste interlocuteur et que
l ’
ensemble de ses raisons lui paraissait plausible .
I l réclama enfin la couronne de fer comme emblème de
la Royau té Lombarde et l’
E mpereur Napoléon prom it des
’ in téresser pour en obten ir la rest i tution au trésor de Monza ,en ajoutan t toutefois qu ’ i l ne se d issimulait pas l e peu de
probabili té de succès .
Par suite d ’
entretiens qui euren t successivem ent l ieu a
Paris entre Des—Ambrais , le Comte Wa lewski m in istre desaffaires é trangères et l e Baron de Bourqueney destiné comme
- 38
prem ier pl én ipotentiai re de France , i l put partir pour Zurichav ec la certitude qu
’ il interv iendrai t aux conferénces sur le
pied d’ égalité , que cependan t la France traiterait d
’
abordavec 1’ Autriche pour l e traité de cession de la Lombardiea la France , auquel pourraien t être insérées les clauses quela Sardaigne ne pourra it accepter ; qu
’
ensuite la France sti
pulerai t un tra ité avec la Sardaigne pour la cession de la
Lombard ie laissant de côté ces m êmes clauses , et qu’
en
dern ier l ieu on ferai t en tre l es t ro is puissances un trai té depaix O ù seraient rappelées la cession et l a ré trocessi on ,
toujours sans reprodui re ces clauses malencoutreuses .
L e plénipotentiaire français , d’
accord av ec son gouvernement , prom it de s
’
approprier et de souteni r v iri lemen t notresys tème concernan t la dette .
Ainsi tous l es obstacles plus graves étaient appl an i s eu
t ièrement pour ce qui concernait la France , et pour l a p lupartse trouvaient auss i en b onne v oie de so lution pour ce qui
regardait l’
Au triche , ob l igée a lors a beaucoup de m énagem en ts env ers l
’
E m pereur des fran çais .
A Zurich on fit d’
abord en tre les trois puissances un
accord de suspension d’
armes . L es négociat ions du traitédurèrent plus de trois mois . L
’
Autriche ins istait de toutemanière sur les question s relat ives à la dette . La France et
la Sardaigne tenaient b on . L es ré su l tats furent essen t iel lementen faveur de l a Sardaigne . Cette dern ière se re fusa con
stamment a toute adhésion su r la quest ion des Duchés , et
les trois traités furent combinés de mani ère à ce qu’
elle yrestât étrangère comme el l e l
’
av ait demandé a Paris . La
France parv in t de son cô té à changer sur cette ques tionl es form es convenues a V i l lafranca . Au l ieu de süpu ler le rétab l issement des Ducs , comm e on avait fait a V i lla franca ,ou se horna à réserver leurs droits , ce qu i é loignait l
’ idéed
’ intervention des puissances s ignataires pour leur rétablissemen t . L a question de l a de tte é tai t résolue en fav eur de
l a Lombardie .
Seulemen t la couronne de fer restait à V ienne. L’
E m
pereur d’
Autriche v ou lait la conserver en tant qu ’ i l y avait
— 39
en core , disait- i l , des droits par la conservation d’
une partiedu Royaume Lombard—V én it ien , et qu ’ il lui peinait de se
dessais ir d ’
un souven ir de fam il le .
Dans l a pensée de quelques gouv ernemen ts , l es traités deZurich devaient aboutir à un congrès européen qui réglâtles affaires d ’
I tal ie . L’
E mpereur Napoléon avait m is en avant
cette idée e t obtenu l ’
assent imen t des autres cours principales . Des-Amb ro is en conséquence de sa m ission précédentefut nomm é plén ipoten tiaire du Roi V ictor Emanuel , ea: equo
avec le Com te de Cav our , s i l e Com te serait adm is , seu l en
cas contraire . L ’ op in ion publique en Italie ,surtout celle du
part i avancé , tenait beaucoup , et on le conçoit , à ce que
Cavour intervînt , parcequ’
on espérait que son énergie , son
talent , son adresse parv iendraien t à réagir con tre les pactesde V i l laf ranca . L e gouvernem en t craignait d
’ être en traînétrop loin par Cav our et engagé par lu i dans de nouv el lescomplication s ; mais i l comprenait que la présence de l
’
homme
qui personmfiait l e m ouvement ita l ien é tai t nécessaire pou rrassurer et dom iner l es esprits . L a pos i ti on de! Des—Ambraisétait énormémen t d ifficile et délicate ; i l l e sen tait parfaitement , et des am is affectionnés l e lui représentèrent ; mais i lrépond it qu
’ il y voyait avant tout un devoir à rempl ir et
qu’ i l de vait se soumettre à son sort .
Le calice dev int plus am er parceque l es autres courscombinèrent que chacune eût deux plén ipotent iaires , l
’
un
desquels fût l eur ambassadeur au m in istre résidan t à Paris .
Il fallut conférer à Des—Ambrais l a légat ion de Paris , ce quiheurtait complètement ses goûts et ses habitudes . Enfin i l sesoum it aussi a cette contrariété , et en novembre 1859 se
rendi t à son nouveau poste , chargé de préparer l es voiespour l
’
adm ission du Com te de Cavour , avec lequel il avai t eu
une longue con férence avant son départ .L es d ifficultés pour l
’
adm ission de Cavour se d issipèrentpeu
—à—
peu . Mais quand tout était prê t pour l a conv ocationdu congrès , une brochure publiée à. Paris sous le patronagesecret de l ’
E mpereur , mais où était v is ible la main du maître ,v int tout rompre . L e Pape ne pouvait plus in terven ir au
40
congrès . L'Autriche avait de fortes raisons pour s
’
en abstenir .
L e congrès tomba .
La politique de Napoléon entrait dans une nouvelle phase .
Il voya it l ’ impossibilité de pacifier l’
I tal ie sans seconder l ev oeu des peuples pour l
’
annexion au Piémont . Il proclam aitla nécessité de laisser faire, le principe de non-intervention .
Par son inspirat ion et par la force des choses Cavour étaitrentré au pouv oir ; l es houséquences qui devaient en naîtreétaient é videntes .
Déjà quelque temps auparavant , l’
E mpereur, dans une
audience particul ière accordée à Des—Ambrais , lui avait faitsenti r qu
' il consen ti rait aux annexions des Duchés , même a
celle de la Toscane si les Toscans la votaient par suffrageuniversel ; mais qu
’ i l lui fallait la Sav oie et Nice , dont l eshab i tants , disait— i l , v oulaient redevenir français . Des—Ambraisobjecta respectueusement qu
’ il avait des raisons pour croire
que S . M. 1 . était mal in formée sur ce dern ier fait . I l de
manda en outre s i S . M. pouv ait donner quelqu ’
espoir de
l ’
annexion de la V énétie ; a quai 1’ Empereur répondit : un e
chose ap rès l’
autre ; et alors i l se borna à déclarer qu’ il
aurait rapporté immédiatement à sou gouvernement la teneurde l ’
entretien dont S . M. l ’ avait hon oré .
Mais dans son rapport au Min istère , Des—Ambrais ne put
s’
empêcher de représenter combien i l aurait été grave de
céder la Savoie sans avoir la V énét ie ,nous mettan t a1ns1
dan s la position d’
avoi r les Français au Mont-Cenis et les
Autrichiens dan s le Quadrilatère . Il lu i semb lai t que notremonarchie enrichie par les annexions allait deveni r un étateunuque , et que le Roi , en cédant les front ières qui proté
geaient l e Piémon t, aurait fait comme un avare qu i eût en
tassé des trésors dans ses coffres en négl igeant d’
en tenirla c le f .Après une longue attente , il reçut , pour toute réponse à
sa dépêche , la nouvelle du retour de Cavour au poste de
prem ier m in istre .
Il devenait probable que la Savoie aurait été cédée , et
Des—Ambrais n’
aurait pas v oulu prendre part a cet acte .
D’
a illeurs l e moti f de sa m ission n’
existait plus puisque l e
congrès n’
avait plus l ieu . Il pria le nouv eau m inistre de l e
rappeler à Turin , où il manquait déjà bien l ong-temps a son
principal office , celu i de président du con sei l d ’ état .Cavour répondit en termes obligeants qu
’ il le priaitd
’
attendre encore, et qu’ i l aurait bientôt une occasion de le
rappe ler en convoquant les chambres , parceque le R o i avait1
’
in tention de l ui con férer l a prés idence du sénat. L e rappelfut cependan t accéléré par les circonstances .
Le gou vernemen t frança is désirait hâter la cession de l aSavoie et de Nice . L
’
E mpereur aimait à con férer en v oienon officielle sur l es affai res d
’
I tal ie . L’
E mpereur et l e
Prince Napoléon savaient que Des-Am b ro is était contraire àla cession de Savoie et Nice , i l s savaient auss i de lu i-m êmequ ’ il dés irait être rappelé ; on fit sentir au Com te de Cav our
que puisque Des -Ambrais pré fé rait rentrer en Piémont , il eutété bien d ’
envoyer à Paris une personne de sa confiance intime ,
quelqu ’
en fût l e grade , afin de s’
entendre plus facilem ent et plutôt sur les affaires du moment .
Le Com te de Cavour écri vit a Des—Ambrais qu 1 1 avaitl ’ intention d
’
env oy er l e Com te Arese en m ission officieuseavec obligation de s
’
entendre av ec lui Des—Ambrais ; maisqu ’
avant de le faire il désirait av oir son av is . Des-Ambraislui répond it qu
’ i l valait m ieux é v i ter cette dua l ité en le
rappelant défini t ivemen t lui-même . L a chose fut faite immé
diatement . Arese eut la m ission officieuse et Nigra fut chargéde gérer prov isoirem ent l a légat ion en qua lité de chargéd
’
affaires .
Des-Ambrais quitta l a d iplomatie pour toujours . I l ren traavec plaisir dans son v ieux fauteui l du consei l d ’ é tat .
Seulement en 1865 le souvenir de ses m issions l e fit
appeler à l a présidence du conseil du contentieux d iplomat ique , institution im itée du com ité du contentieux qui existeen France auprès du m inistère des affaires é trangères .
Ici finit l ’ autob iographie de l’
auteur . Ajoutons qu ’
en 1862 ,
à l ’ occasion du mariage de sou Altesse l e Princesse Pie de
Savoie avec le Roi de Portugal , i l fut fait cheval ier de l’
An
42
nonciade . La d ign ité de Min istre d’ État lui avait été con férée
par décret royal du 25 novembre 1859 . Enfin , dans le mais
de novembre 1874 , cédant aux instances personnel les du R o iV ictor Emanue l , i l consent it a cumuler , av ec la prés idencedu conseil d ’ é tat et celle du consei l du contentieux d iplomatique , la prés idence du Sénat qu
’ i l avait constammen t refusée jusqu ’
alo rs . L e discours mémorable qu’ i l prononça a
la séance d ’ inaugurat ion de la sess ion législat ive l e 23 no
vemb re de cette année , et que l’
on peut considérer commeson testament politique , a été tran scrit entièrement sur la
colonne de marbre qui soutient son b us te dans une sal le du
sénat . Il m ourut à Rome que lques jours après cette séance ,c ’
est-à-dire dans la nuit du 3 au 4 décembre 1874 . Cette
phrase , par laquelle il peint s i bien l ’ amiral Des Geneys ,créateur de l a m arine sarde , dan s sa Not ice sur Bardonnêche ,
semble av oir été écrite pour l ui-m ême . C ’ é tait un hommef roid , calme , parlant très peu, mais doué d
’
un grand sens ,
d’
un tact fin et d’
un nob le caractère .
( 1 ) V o ici ce d i sco u rs dan s son texte o rig i n a l ita l ien .
On o rev o l i Ca l l egh i
U na v o l o n tà su p eri o re, che son o av v ez zo ad asco l tare co n ri v eren za ed
afi’
et ta , m i ha ch iam a to a ques to s egg i a em i n en te. N essun o p iù d i m e, che
appartengo a l sen a to da u n qu arta d i seco l a , è i n gra‘
do d i app rezzare
l’
o n ore che ricev o , e tu ttav ia asso fu da m e p iù temu ta che am b i to .
Quan do p en sa a l cum u l o d i qua l i tà che rich i ed e un tan t o u fficia , e ri
v o l go l a m eu te ag l i i l l u s tri che m i p r9 ced e ttero , n o n h o che argom en t i d i
sco n farta ; o n d’
è che i n v oca co n s i ncerità d’
an im o l a hen ev o l a i n du lgen za
d i v o i tut ti .
S pera d i a tten erl a pari a l l a gran de s t im a che v i p ro fessa , a l l a dev o
z i an e afi‘
et tuasa che a v a i m i l ega . Can fida d i averl a e d i co n servarl a , p erché
cem en tata dal la com un an za d e i s en t im en t i .
T ut t i ab b i am o u n s o l o scap a, ch e è la gran dez za e l a p rosp eri tà d’
I tal i a .
T ut t i s iam a d’
acco rd a n e l com p ren d ere l a m i s s i an e augu sta d e l sen ato.
n e l sen t ira a l tam en te l a sua d ign i té. , l a sua i nd i p en den za .
Al i en i d a agn i sp i ri ta d i parte , am i am o qu e l la m od eraz i o n e ch e n on
n asce da deb o l ezza, m a è cu l ta d e l l a rag io n e e d e l la g iu st i z ia .
S i am a con serv a to ri sen za av v ersare i l p rogresso , che è l egge d e l l a p rov
v i d en z a e v i ta d e i p o po l i . Cus to d i d e l l o statu t o starem o sem pre u n i ti n el
ri sp e t ta a l l a l egge fo n d am en tal e e n e l l a fade a l la D i n ast i a g l ori o sa che s i
è im m ed es im ata ca l l a n az i on e .
44
Emanuel l “r qui lui succéda n’
ont que des fil les ; le tro is1emequi fut Charles Félix é tait aussi sans enfants , et les autres sontmorts jeunes sans avoir été mariés . Ainsi lorsqu ’
en 18 14 le
R oi V ictor Emanuel réduit jusqu ’
alors a l a possessioninsuffisante et peu sûre de l ’ île de Sardaigne , récupéra les
anciens états de sa maison , Charles Albert se trouva être l’
hé
ri tier présompt if de la couronne. L e règne de V ictor E manuel homme d ’
une b onté rare , aimant son peuple comm eun père , voulant son pays fort , prospère et indépendant, maismalheureusement peu capable et peu instruit , fut un mélangebizarre de réact ion et de progrès , de b onne et de mauvaiseadm in is tration , de justice et d
’
arbitraire .
Charles Albert était d ’
une stature s i haute que dans les
salons sa tête se voyai t au loin dominant pardessus les autres .
I l était m ince , d'
un port noble : sa figure longue et pâ le é taittoujours an imée par un regard fin et scrutateur, souvent parun sourire gracieux et légèremen t sardonique . S es man ièresétaient empreintes d
’ élégance et de dignité . I l recevait toutl e monde avec bonté , quelquefois avec une grâce séduisan te ,et d
’ ordinai re l es personnes qui obtenaient de lui une au
d ianae en revenaient sat isfaites ; car il savait trouver pourtous quelque témoignage d
’ intérêt et i l é tait diffici le de
l’
égaler dans l’
art d ’ é v i ter ou d’
adoucir une négati ve .
Dans l es rapports j ournal iers avec ses conseillers et ses
courtisans il n ’
abandonnai t jamais 1’ é tiquette qu’ il considérait
comme une nécess ité des cours , et , soit par caractère , soit
par système de gouvernement , i l u’
accorda jamais a aucund
’
eux une confiance sans b ornes . Mais a part ces réserv esdesquel les son esprit et sa bon té atténuaient la f roideur, sa
con versation é tait p lu tôt fam ilière et expans ive , souvent m ême
gaie et sem ée de m ots piquan ts et d’
anecdotes intéressan tes .
Il aimait à racon ter et i l le faisait avec agrém en t . Il avaitvu dans sa v ie bien des choses et connu beaucoup de per
saunages plus ou mo ins h istoriques . S a mémoire heureuse luireprésentait les hommes et l es faits avec une v ivaci té et unefraîcheur de coloris qui pouvaient faire env ie au conteur l e
plus brillan t .
45
Dan s sa jeunesse i l avait a imé la moquerie ; devenu Roiil se corrigea peu-à—
peu de ce penchant dangereux dans un
m onarque . Il régla alors sa v ie en toutes choses sur l es de
v a i rs de sa position . S e levant de très-grand matin i l donnaittoute sa journée au travail . Deux jours de la sem aine é taientfixés pour recevoir les rapports de ses m in istres , un troisièm e , l e jeud i , pour les réun ir en
”consei l sous sa prés idence .
Dan s l es autres jours i l recevait l es chefs de l a magistratureet de l a pol ice , et plusieurs autres hauts fonctionnaires qui
avaient ce priv ilège , ce qui l e m ettai t à m ême de connaître
par d iverses v oies le cours des affaires pub l iques et de cou
trôler les rapports m inistériels. Tous les jours i l recevait le
gouverneur de la capitale , lequel ayant touj ours cumulé av ecces fonctions la présidence du conseil d ’ état pouvait auss il
’
informer des discussions de ce corps sur les affaires m ajeures .
Enfin deux fois par semaine il donnait audience pub l ique ,et alo rs l e p lus pauv re et le plus humble de ses sujets
pouvait avoi r la sat isfaction de porter ses plain tes jusqu’ à
lui . Il retira it tous les mémoires qui lui é taien t présen tés et ,par l e moyen de son secré tai re privé , i l s
’
en faisait ré férerla substance puis il les faisait transmettre aux div ers m in istères qui devaien t au b out d
’
un certain tem ps rendre comptede leur cours . Mais l ’ a bus qu
’
on fit de cet te v oie ouverteaux pétitions en fit bientôt baisser l ’ importance , et l
’
ob l i
gat iou imposée aux Min istères n e fut p lus maintenue avecrigueur , sauf dans l es cas où le Roi faisait apposer sur le
recours une annotation spécia le .
Le Roi se considérait constamment comme un suprêmefonctionnaire dans l ’
exerc ice de son autori té et dan s l’
ac
compl issement de ses devoirs . Il ne recevait qu ’
en costumeo fficiel ( celui de général d
’
armée ) . I l d îua it dans ce costumeentouré de la fam i l le Royale et de sa cour en uni forme ou
en costume de cour . A sa table les jours de consei l s iégeaientaussi les m in istres . Presque toujours y étaien t inv ités des
fonctionnai res ém inents ou des personnages dist ingués dans
l es arts , les sciences au les lettres ou des é trangers de di
s tinct ion qui avaient ob tenu une audience .
— 46
Après le d iner l e Roi s’
entretenait avec ses commençaux
ayan t toujours quelque mot gracieux pour chacun , puis il se
reti rait dans ses appartements et bientôt après se couchait .Pendant son séjour en Toscane Charles Albert rédigea un
mémoire sur sa conduite poli tique dans l es évènem ents de
1821 . Il y représen tait que l es hommes d’ état de cette époque
et notamment l e chevalier de R ével gouverneur de Turina vaient été t el lement surpris par la révolution qu
’ ils avaientd
’
abord désespéré du salut de la m onarch ie ; mons ieur deR êval au mom ent de dé l ibérer se serait m is à pleurer. Au
m ilieu de la s tupeur et de l ’ abattem ent général l e prince deCar ignan aurait en v ain cherché à résister. Ce mémoire écriten f rançais fut d istribué aux m inistres de Charles Félix , ou
du moins à quelques uns d’
entr ’
eux. Il resta manuscrit. Durant 1 ’
enfance de ses fil s Charles Albert écriv it en françaisdes fab les pour leur instruction ; elles furent imprim ées suc
cessivement à feui l les v o lan tes . E n 1838 i l fit imprim er un
l iv re qu i est remarquable à cause de l a tendance d’
espritqu
’ i l ré vélait , et parcequ’ il est curieux d ’
en rapprocher quelques passages avec les O pinions et l es faits de ses dern iè resannées . Ce l ivre est intitulé : R éfleæian s H i s tor iques . T ur in
1 838 . Il a en tê te une estampe représentant une croix avecl es insignes de la Pass ion plantée au m i lieu de la campagne .
U n beau et jeune chevalier en costume du moyen-âge par
tan t sur son armure une casaque aux couleurs de l a maisonde Sav oie et l a cro ix de Savoie sur son bouclier est deboutau pied de la
‘
croix baissant pieusem ent son épée nue devant
elle . De l ’
autre côté son chien fidèle élève comme lui ses
regards vers l e crucifix , emblème v ivant de la fo i gardée au
Christ . Au loin on v oi t l es tours f orm idables du puissant baronqui soumet ainsi la puissance terrestre à l a l oi d iv ine , et
dans les airs apparai t rayonnan te au m i l ieu d’
une une la
Sain te V ierge qui contemple avec sat isfact ion la piété du
guerrier . A la fin de l ’ ouv rage on trouve la note suivante :cet ouvrage fut commencé dans le mois d
’ octobre de l ’ année1837 , et , a part quelques adjonctions fa ites pendant l
’
im
pression , il fut term iné l e jour des rois de cette année 1838
47
Quelques passages que nous al lons rapporter suffiront pourdonner une idée du b ut , de la substance et de la couleur del
’
ouv rage en m ême temps que du style de l ’ auguste auteur.
L ’
histoire nous prouv e par des exemples sans nombre
que l e Seigneur pun it les grands _crimes en ce mondemême ains i que l es homm es av euglés par l
’ orguei l ou pard
’
autres v ices qui croien t pouvoir d iriger les états a l’
aidede la seule science humaine ; l es esprits les plus élevés ,les plus trascendan ts nous prouven t par les malheurs , parl es chât iments qu i
.
les accab lérent la toute—puissance de
notre créateur (pageL ’
ou ne doit point s’ é tonner lorsque l ’
on v oit un gouv ernemeut crouler , être subitement ren versé quoiqu ’ il aita sa tête des hommes de m oyens et de courage : Dieu les
a aveuglés pour puni r soit le chef de l ’ état , soit ses m i
n istres ou son peuple (pageL orsqu
’
uu Roi cède à de mauvais conseils , qu’ il en
treprend quelque chose con tre les v o lontés du Seigneur,contre l ’ égl ise , qu
’ i l fait quelqu ’
acte de faiblesse , il entend
pour un m omen t les éloges des gens corrompus ou sans
principes ; mais i ls durent bien peu . De nouvelles prétentions
,de nouvel les demandes succèdent aux prem ières ; on
ne peut jamais contenter les m échan ts : s i l’
on a une fo iscédé ou ne peut plus leur rien refuser sans exci ter leurhaine , leur ind ignation ; eux—m êmes en ce m onde pun issen tl es mauvaises action s que l
’
on a fai tes à leur suggestion ;et i l ne peut en être autrement ; car si l
’
on abandonneDieu l ’
on sert alors le diable qui est certes un mauvaismaître et qui ne laisse jamais une joie parfaite a ceux quil e suiv ent ; puis v ien t en ce m onde et en l ’ autre l a justicedu Seigneur qui s
’ étend jusques sur l es descendants des
coupables . C ’
est cc—qui fait que l
’
on voit tant de fam i l less
’ é te indre , des gens de probité qui sont durement éprouvéesrecevant les chât iments att irés par les maléd ictions mé
ritées par leurs pères (pages 8 et
T out l ’ ouvrage n’
est que le développement de cette sombrepen sée , que la justice d iv ine poursuit sur l es ind iv idus , sur
*
A
À
À
Q
À
48
l es fami lles et sur les peuples , soit par des chât iments subits ,soit a l a longue et m ême a la distance de plusieurs générat ions , l a punition des crimes comm is contre les lois de l
’
éter
nel le justice et des actes contra ires à. l ’ égl ise . L ’
auteur rapporte successiv emen t à l ’
appui de son exposition beaucoupde textes des l iv res saints , et i l passe en rev ue une fouled
’
exemples de souverains et de particuliers que Dieu pun itdans leur personne , dans leur postérité ou dans leur nation .
Il passe en revue l ’ histoire des grands hérésiarques Luther ,Calv in , Zuingle , Henri V III d
’
Angleterre . L es peuples l es
plus célèbres et les plus grands souv erains , Frédéric Barberousse , Guillaume l e Conquérant , Ph ilippe le Bel , Albert 1d
’
Autriche Empereur d’
Al lemagne , Henri II Roi d'
Angle
terre , Charles V I Roi de France , Charles-Quint , FrançoisLouis XIV ,
l e Régen t de France Phil ippe d’
O rléan s , Louis XVet Louis XV I . Puis i l v ien t aux ph ilosophes m odernes , V o ltaire , Rousseau ,
d’
Alemhert , Diderot , Bayle , He l vétius , Fréret ,Mesl ier , Du laure , Hé raut-de—S échel les , le poète Alfieri ; aux
ré volutionnaires , Robespierre , Marat , Ph ilippe -Egal ité , Chaslier , Barnave , enfin à quelques simples particul iers dont lav ie lui fut connue par des rapports de justice au de policeet dont l es crimes furen t punis par la justice d iv ine de ma
n ière à r évéler l ’ intervention directe du doigt de Dieu.
III.
L a C o u r .
Quoique les princes de la maison de Savoie n’
aient jamais .
été des despotes , et qu’
au contraire i l s aient toujours a1mé à.
gouverner avec justice , a être les pères de leurs sujets de
toute classe et de tout rang, la Cour a toujours été une
grande chose dan s la monarchie de Savoie .
L a Cour proprement dite est l ’ ensemble des personnesdes deux sexes qu i sont attachées a l a personne du S ouve
rain , de sa femme et de ses en fants . C ’
est une hy érarchie plusou moins nombreuse de chambellans , m ajordomes , écuyers ,dames d
’
honneur , chev al iers d’
honneur et dames de palais .
L es moeurs féodales avaient donné beaucoup d’ éclat et d ’
im
portance a ces places que les principaux vassaux de la Canronne tenaient à honneur de rempl i r comme résumant les
lien s chevaleresques , par lesquels l e vassal étai t attaché à sonchef , liens d
’
honneur, liens m il itaires qui portaient le dev oirdu dévouemen t a toute épreuve en choses l icites et hon
nêtes , la fidéli té jusqu ’ à la mort, l e respect sans bassesse ,l
’ obéissance sans serv itude .
Dans l es prem iers siècles , ces charges de Cour étaient
presque exclusivement occupées auprès de nos souverainspar la noblesse de Savoie , soit parcequ
’
ay an t été l a prem ièrea se réuni r sous leur drapeau , elle tenai t à. conserver la posit ion acquise par des serv ices , soit aussi parceque la no
b lesse piémontaise , liv rée en général a la v ie mun icipale,av ait d ’
autres tendances et d’
autres moeurs , et peut—être
50
encore dans ces premiers temps pouvait passer pour êtrem oins dévouée .
Mais a la longue l a Cour changea de caractère ; elle ne
fut plus exclusivement guerrière et féodale ; toute la noblessede la m onarch ie y fut représentée. Alors , comme les autrescours , elle affects des m oeurs douces , m ême raffinées et en
v int à donner l e ton à la bonne société . D ’
un assemblage derudes guerriers et de nobles châtelaines a la v ie simple et
sé vère , la Cour dev int une socié té d ’ élite courbée devant lamajesté du Trône, mais faisant sentir sa supériorité a toutce qui n
’ était pas elle .
Ains i el le exerçait sur le public un prestige réel parcequ
’
el le refiétai t l a splendeur de la Royauté dans un paysessent iellement monarch ique , et parcequ
’ i l y avait en ellequelque chose de réellement distingué . Mais au fond l es
autres classes étaient secrètement blessées de ne pas êtretrai tées par elle sur le p ied de l ’ égal ité , et i l naquit un e
antipathie latente que le progrès des idées modernes allatoujours augmentan t.
E n outre de cette Cour v éritab le et permanente ou appe
l ait Cour , ici comme ai l leurs , 1’
ensemble des personnes ad
m ises aux grandes récep tions du Roi et de la Reine e t aux
fêtes données par eux dans leurs palais . Personne, hommeou femme n
’
y était admis s’
i l n’ était fi ls ou petit-fi l s de
noble . Ains i la Cour se présen tait comme une sorte de cas tequi avait l e pri vi lège d
’
approcher le Souverain , et qui formait ,au m oins en apparence , une barrière entre lui et la masse
de ses sujets . Il en résultait un surcroît d ’
env ie et de hainedans les c lasses inférieures contre la Cour et la noblesse.
Mais les Princes d e la maison de Savoie étaient trop bonspolitiques et trop bienveil lan ts env ers leurs sujets pour ne
pas sentir l e besoin de rem édier à un tel état de choses .
Dès l es temps anciens i l s avaient établi que certainescharges accessib l es à tous donnassent en voie d
’
exceptionune place a la Cour a leurs titulaires . Ainsi l e Grand Chancol ier chef suprême de l a m agistratures et des m inistères pouvait être parvenu à. son siège de la classe la p lus humble ,
a sa tab le quelqu’
une des notab il ités du pays sans distinctionde naissance. Aux fêtes qui eurent l ieu à sa Cour pour la
naissance du Prince Humbert son petit—fils , i l ordonna de
nombreuses inv itations , où l a bourgeoisie des deux sexesétait com prise. Il adm it a la Cour tous les chevaliers de
saint Maurice, ce qui voula it dire alors les hommes les plusavancés dans toutes l es carrières. Enfin à la suite de l ’
éta
b l issement du régime constitutionnel i l supprima l es chargesde Cour auprès du R o i et des Princes , leur substitua un en
tourage royal composé des d ign ita ires de l ’ état , d’
aides decam p et d
’ officiers d ’ ordonnance , ne conservant que la Courdes Reines et Princesses et un petit nombre de grands officierspour la surin tendance de sa maison mi l itai re et civi le . E n
même temps i l supprima l e privilège nobiliaire d’
adm issionaux f êtes de Cour , et l e remplaça par l e système des inv i
tatians , qui devaient embrasser toutes l es notabilités sociales.
Quoique la Cour ait été certainement dans les temps madernes une cause secrète de m écontentemen t du pays , laquellepeut avoir contribué à amener l e changement de gouvernement , i i est juste de dire , a l
’
honneur de la maison de S e
v oie , qu'
en général la Cour des temps modernes a exercépeu d
’ influence sur la m arche des affai res . Charles Al bertv eillait m ême sév èrement à ce que la Reine et les Princesne fissent aucune recommandat ion a ses m in istres .
L es Reines et la Duchesse de Savoie étaien t des modèlesde vertu , de douceur et de bien faisance. Autour d
’
elles lesmoeurs de la Cour fém in ine étaient modestes et décentes .
Elles influèrent en b ien sur cel les de l a société élégante.
L ’ éducation des filles , m ieux soignée , concourut aussi a ce
résul tat . S ’ i l continua à y avoir dans le m onde des faiblesses ,i l faut b ien dire que les femmes du m onde apprécièrent en
général beaucoup mieux la pos it ion et l es dev oirs de m èrede fam il le . La v ie l égère devenait p lus rare et n
’ était plusaffichée comme autrefois .
Sous l e règne de Charles Albert, le personnage le plussaillant de l a Cour fém in ine était l a Comtesse de R ob i lant ,
dame d’
honneur de la Reine , femme d’
un des prem iers
53
écuyers du Roi . Elle était prussienne , fil le du Com te de
V al b onrg—T hucksess , qui av ait occupé pendant de longues
ann ées l e poste de m in istre de Prusse à Turin . Charles Albert l ’ avait aim ée dans sa jeunesse et avait toujours con
sorvê pour elle de l ’ am i tié . Grande et be l le femm e , au portde princesse , aux man ières de grande dame , d
’
un espritsuffisamm ent cult ivé et aidé par un tact exercé , elle tenaitnoblem ent sa place à la Cour et dans le mande .
Parm i l es seigneurs et gentilshomm es qui composa ient l aCour, ont figuré quelques personnal ités remarquables . T el
éta it le v ieux Marquis Alfier i , grand chambellan , ancien am
b assadeur a Paris , homme rude et taciturne , mais sage con
sei l ler , excellent coeur et noble caractère ; le chevalier Césarde S aluces , grand écuyer, gouverneur des Princes Royaux ,
homme de lettres d istingué , esprit facile , orné de toute sortede connaissances , desquelles i l n
'
avait approfond i aucune,dévoué de coeur et d
’
âme à ses dev oirs , d’
une act iv ité in
fatigable , d’
une bon té et d’
une bien faisance a toute épreuve,protecteur pass ionné de la jeunesse studieuse ; l e ComteAlexandre de S aluces son f rère aîné, Grand de la Couronneet Min istre d ’
E tat , auteur de l ’
h istoire litté raire du Pié
mont ; l e Comte Provan de Collegno gentil homme de la
Chambre et contro l l eur généra l , homme sobre et austère ,mais m éd iocre, considéré comme l e candidat au m in istère du
parti u l traconservateur ; l e Marquis César Alfieri prem ierécuyer et fi l s du Grand Chambel lan , auquel nous consacrerons un article pour la part qu
’
i l on t au gouv ernement del ’ état ; le Marquis Benso de Cav our, père de celui qui fut
plus tard si i l lustre , auss i Chambel lan et V icaire de Turin ,c ’
est—à—dire che f de la police dans la cap ital e , homm e d’
espritet trés-act if , mais impopulaire ; le Marquis Léon Costa de
Beauregard , un des prem iers écuyers , gent ilhomm e sav oyardtrès-riche , grand am i des lettres et des arts , profond dans
l ’ étude de l ’
h istoire nationale au m oyen âge , b on soldat ,grand caractère et belle intel ligence ; l e Com te de Castagnetmajordome et secré taire du Roi , dont nous parlerons a part .La nob lesse au Piémont et en Savoie avait continué sous
ce règne à rechercher l es emplois m ilitaires et civ ils . CharlesAlbert pré férait les nobles pour certaines charges , lesquellesrequièrent un certain ascendant sur l es populations , commecel les d ’ intendant de prov ince au de maire de grande v ille.
Dans la pro fession m il itaire , les genti lshommes , par suite desanciens usages , occupaient presque toutes les places d
’ officiersde cavalerie.
E n revanche l es charges de magi strature étaient p lus généra lement occupées par la bourgeoisie , laquel le se l iv rait engrand nombre a l ’ étude du ‘
droit , parceque l e doctorat en
droit suffisait pour constituer une d istinction sociale qui ap
prochai t de la noblesse.
Cependant la noblesse gêno ise cont inuait a cult iver l ecommerce qui avait fait la grandeur et la puissance de Gênes .
Très—riche , mais très—économe , elle n’
avait pas abandonnéses habitudes de v ie active et laborieuse en m ême temps queplusieurs de ses membres , tels que Marcello Durazzo , Maxim ilieu Spino la , V incent Serra et d i Negro , se d istinguaientpar leur amour des sciences , des lettres et des arts .
IV .
L a capital e.
L a capitale avait ‘ reçu un notable agrand issement sousl e règne de Charles Fé l ix par la formation de l a p lace V ictorEm anuel et par l a con struct ion des hautes et vastes maisonsqu i l
’
entourent . L a brique avait été fabriquée dans l es eu
v irons et notamm en t sur la route de Moncalieri . L es boisavaient été t irés de la v allée d ’
O ulx , où commença alors l egasp illage des forêts sur des proportions énormes . Moscaavait jeté sur la Doire son magn ifique pont d
’
un seul arc.
L e règne de Charles Albert fut bien plus fécond encoreen agrand issements de Turin ; et de plus la v il le reçut toutesorte d ’
emb al l issemen ts . Ains i les nouv el les construct ions ducôté du Po s
’
étend irent sur l es deux flancs de la nouv elleplace et formèren t les deux faubourgs de Vanchig l ia et Borgo
N uovo . Ce dern ier percé de nombreuses 'rues et orné d ’ édificesélégants forme
'
presque une v i lle nouvelle ayan t sa base sur
l e Po et un développement continue l v ers l e côté opposé .
Dans ce v aste espace fut dès lors établi l ’ embarcadère du
chem in de fer de Gênes , édifice qui refait plus tard sur les
dess ins de Mazzucche l l i dev int un v éri table monument ; et enface de l ’ emb arcadère fut bâtie cette p lace superbe qui est
devenue une oasis de v erdure et de fraîcheur .
Au m il ieu du faubourg s’ éleva l ’ égl ise paroissiale de Sain t
Maxime commencée par une souscript ion qui donna env ironfrancs , term inée aux frais de la v il le et de l ’ état .
Elle coûta env iron un m illion de f rancs.
56
Pour la décoration de la place Saint Charles l e Roi ar
donna l ’ érection de la statue équestre d ’
E manuel Ph i libert,oeuvre immortelle de Marocchett i . Pour la place de l
’
Hôtel
de V ille il commissionna a Palagi le monument d’
Amèdée V I ,
l e Comte V ert, v ainqueur des Musulmans ; pour la place dela Consolation , un monument de la Sain te V ierge commencée
par le Bo lonais et non term inée . Pour l ’
ornement de la placeChâteau ,
i l fit établir la gri l le du palais roya l dessinée par
Palagi et les statues équestres des Dioscures , oeuv re de
Cacciatori . Dans l a chapelle du Saint Suai re Charles Albertfit placer les monuments en marbre blanc d
’
Amèdée V III,d
’
E manuel Phil ibert , de Charles Emanuel II , et du PrinceTh omas , oeuv res estimées de Benoit Cacciatori , de PompéeMarchesi , de Fraccaro l i de V érone et de Gaggini .
U ne société formée principalement dan s le sein de la
bourgeoisie acquit l e riche et élégant palais des MarquisSolar de! Borgo en place Saint Charles pour en former un
l ieu de réunions séra les où la socié té pût auss i donner de
grandes f êtes dans lesquelles se trouverait réun ie san s d i
stinction de classes toute l ’ élite de la popu lation . Elle ajoutaa cet effet aux splendides appartements de cet hôtel une
grande salle où euren t lieu des f êtes m agn ifiques , honoréesde la présence des Princes et des m in istres étrangers . L a
création de cette socié té appe lée Académ ie Ph i larman ique
à été pour Turin un v éri tab le progrès .
L e Roi ajoutait aux é tablissements de la capitale la création de sa gal lerie de tableaux ,
recuei l de ce qu ’ il y avaitde p lus précieux en ce genre dans l es palais de la couronne ,de quelques objets acquis par lui , et de quelques dans departicul iers , auxquels v int s
’
adjoindre la précieuse co l lectionlaissée par un v ieux prélat am ateur de tab leaux, Mon seigneurMassi , dernier rejeton et héritier des Marquis de Morano . La
gallerie avait d ’
abord é té placée dans le palais de Madame .
Deux autres collec tions non moin s importantes surgiren tdans l e palais m ême du Roi . L
’
une est celle des armes dontle noyau fut formé par l es v ie l les armures et les anciennesarmes de toute espèce trouvées dans l es palais royaux, col
57
lection pour laquel le , étant connue la sollicitude éclairée et
généreuse du Roi , affluèrent bientôt des dans rares , m agn ifi
ques ou curieux, non seulemen t de tous les pays d’
E urope,
m ais aussi des régions loin ta ines . L ’
autre collection est l a
b ib l iothèque royale , où l e bibl iothécaire , Dom in ique Prom is ,h omme de connaissances trés—v ariées et num ismate ém inent ,passionné pour les liv res et pour son pays , em ploya toute sa
v ie a mettre ensemble par un soin incessant l es restes del
’
ancienne_b ib l iothèque des R ois , l es l ivres de Charles A lbertet tou t ce qu ’ i l put ramasser de curieux en matière d
’
hi
sto ire nat ionale ,de science m ilitaire , de détails relat ifs à la
Dynastie et aux grandes maisons de l’ é tat , sans omettre l es
l ivres et les manuscrits uti les pour d’
autres branches d’
in
struc tion . L a bibl iothèque roya le est certainem ent devenueun des étab l issem ents de Turin l es plus d ignes de fixer l ’
at
ten tion des étrangers .
Ce fut sans le règne de Charles Albert que les portiquesde l a v ille , jad is pavés de cai l loux pointus et souv en t moui l léspar l
’
eau qu’
on y versait des bout iques , reçurent l e magn ifique pav é de dalles et l ’ ensemble de propreté qui en faitaujourd ’
hu i une si bel le et comm ode part ie de la v il le , un
lieu de promenade couverte peut—être un ique par son étendueet ses agréments .
Alors pour les port iques et pour toute la v i l le fut introduit l e riche éclairage au gaz duquel on jouit actuel lementau lieu des lampions a hui le qui en vérité avaient deja étéaméliorés , mais qui ne donnaien t pas une lum ière comparab le .
C ’
est encore dans la m ême période que l e système de
pavage des rues fut changé ; que l’
eau de la Doire , laquelled iv isée en ruisseaux parcourait le m ilieu des rues , fut portéedans des conduits souterrains , où elle aide a l ’ écou lem entdes immondices ; et les rues .aplaties offrirent dans leur l ongueur des bandes de dal les pour le rou lage des v O itures et
des chariots . L e systèm e des trottoirs en l arges dalles futaussi général isé a la grande sat isfact ion des piéton s , choseessentie lle à Turin où l ’
habi tude est générale dans l es deuxsexes d
’
al ler beaucoup a pied .
V .
La Hagistrature.
Sous le règne créateur d’
E manuel Philibert avaient été
institués les sénats de Chambéry pour la Savoie et de Turinpour l es prov inces de ça les Alpes , cours suprêmes de justiceim itées des parlements f ran çais . Les Ducs avaient établi en
suite un sénat a N ice ; puis en 18 15 , par suite de l ’
annexiondu Duché de Gênes aux é tats sardes , avait été créé l e sénatde Gênes pour ce Duché ; et enfin en 1838 le R o i CharlesAlbert, d iv isant le territoi re soum is au sénat de Turin , avaitimplanté un nouveau sénat siégean t à Casal .
La justice a été adm in istrée dans l es prov inces jusqu’
en
1822 par des pré fets qui exerçaient les fonctions attribuéesdepuis aux tribunaux de prem i ère instance ; ceux—ci ont étéinstitués en substitution des pré fets en 1822. Au dessous despréfets avaient été l es juges locaux. E n origine c
’ é taient desjuges de fiefs exerçant l a justice au nom des seigneurs . Maispeu
-â—
peu l es Souverains avaien t ramené à eux la juridictionet la nom ination des juges . L e gouvernem en t f ran çais avaitsupprimé toutes ces anciennes judicatures et introduit l ’
in
stitution des juges de paix. Après la restaurat ion l e gouvernement royal les avait réorgan isés sous l e t itre,
de juges demandement.
Quand on parle de magistrature pour l’ époque du règne
de Charles Albert, on parle essentiel lement du sénat. L a ma
gistrature in férieure était encore trop récen te pour avoiracquis des moeurs à el le , un caractère d istinctif et une iu
60 .
tique l ’ autorité maritale et paternel le . Quelque parent ou
am i , quelque v oisin formait toute la société de l a maison .
Seulement une fois ou deux 1 ’
année toute la fam il le se don
nait lo plaisir d’
aller à l ’
O péra où e l le se procurait une l ogoet se rendait en carrosse . E n automne à jour fixe ou se
transportait invariablement a la campagne pour y passer lasaison des vendanges . La on recevait volon tiers l es am istous l es d imanches. I ls y trouvaient pour toute la j ournéeune large et cordiale hospitalité . Hors de la ce m agistratétait tout entier a ses occupations judiciai res . L es ques tionsde droit faisaien t ses délices . I l se rappe lait ses décisionsl es plus ardues avec le m êm e plais ir qu
’
un généra l peut se
rappeler une bataille gagnée . U n homme qui v ivait ain s i ne
pouva it guères avoir une conversat ion riche et variée . Naturel lem ent la s ienne se ressentait de ses habitudes ; mais on
se tromperait si l’
on crût qu’
el le fût toujours sérieuse et
monotone . L e magistrat é tait p lutôt gai ; car il ne v ivai t pasd
’
ambi tion et sa conscience é tai t nette . Il se laissait m êmev o lontiers aller a quelque propos gai ll ard . L e jurisconsultene tue pas l
’
homme . Notre ancien magistrat , tout b on mariqu ’ il était , se permettait , d it—ou, parfois quelqu
’ échappée oùn
’
entrait peut—être pas l a poés ie , m ais non plus l e scandale .
E n po l itique n otre magist rat étai t cord ialemen t dé voué à la
m onarchie , mais i l croyait que le R oi était tenu de gouv ernersu ivant les lois , que l e droit qu
’
avaient les sénats d ’
enregi
strer l es éd its é tait chose sain te , et qu ’ i ls devaien t refuserl
’
enregis tremen t des mauvais éd its ainsi que l’
exécut ion desactes i l légaux . E n religion i l avait la fo i du charbonn ier ;mais i l é tait régal iste jusqu
’
au bout des ongles .
L a v ieil le magistrature dont nous venons de parler étaitsur son déclin lorsque Charles Albert m onta sur l e trône ;el le ne tarda pas de d isparaî tre ent iè rem ent. Par con tre leshommes de l ’ époque impé riale étaien t alors dans cette phasede la v ie où l ’ on un it l ’
expérience des affai res a la v igueurde l ’ esprit . L e magistrat de cette école avait m oin s é tud iél e droit romain et peu ou point les v ieill es décisions . S on
brév iaire était le code Napoléon qu ’ il savait presque par
coeur . Sans être fort lettré , il avait des connaissances en
dehors de la jurisprudence . Il était plus ou moins homme desociété ; en po l itique , autoritai re , inclinan t a un césarismeéc lai ré ; en mati ère religieuse , orthodoxe comm e ses predecesseurs , plus large toutefois de pensée et non m o ins at tachéaux droits régal iens .
A la tête de ces magistrats figuraient l e com te Pey rettiprésident du consei l suprême de Sardaigne et de la sectionde jus tice du conseil d ’ état , ancien prem ier présiden t de la
cour impériale de Turin , l e chevalier de Montiglio prem ierpré sident du sénat de Turin , ancien prem ier prés iden t de lacour impériale de Florence , l e président Coller procureurgénéral du Roi , puis prem ier présiden t de la chambre des
comptes et success iv emen t du sénat de Turin et de l a courde cassation et le com te Bore l l i prem ier prés ident du sénatde Gênes qui fut m in istre de l
’ intérieur à. l ’ époque où se
décida la promulgat ion du statut , puis prem ier président dela chambre des comptes .
Le prés iden t Mon tiglio fut celui d’
eux tous qu i exerça laplus l ongue et majeure influence . L a cour l ’ écoutai t commeun homme d ’
autori té ; l e m inistère suiv ait presque toujoursses av is en ce qui concerna it la magis trature . I l était devenucomme l ’ âme de ce corps . Hab ile à connaître les apt itudeset l es tendances d ’
un chacun , ingén ieux à concilier l es con
venances du serv ice av ec cel les des emp loyés , il avait su se
rendre l e centre de leurs asp iration s et s’
attirer de la partde tous un respect infin i . Doué de beaucoup d
’
esprit , de tact ,de sagaci té , il prés idait dignement mais en maître ; car i l
étai t un vé ritable maître dans sa compagn ie . R arem ent un
homme a imprimé tan t de déférence a son entourage . O n eût
d it qu’ il le dom ina it au m ora l par l a puissance de sa raison
comme i l le dom inait au physique par la hauteur de sa tai lle .
Montigl io était homme d’ état et souvent con sulté comm e tel ;
mais il était mort depuis plusieurs années lorsque les ré formespolitiques commencèrent .
E n général les v ieux magistrats tant de l’ école impériale
que de l’
ancien régime étaient plus portés à suiv re l ’ équité
— 62
que la rigueur du droit. Cette tendance l es rendait d’
autant
p lus attentif s à l ’ appréciation des faits dont i l s étaient jugestrès-sages et très habiles .
L es magistrats de l’ école m oderne avaient embrassé de
nouveaux points de vue, l a l égislation comparée , la philosophiedu droit , l es rapports nombreux de la jurisprudence avecd
’
autres bran ches du savoir , notamment avec l es principesde l ’
adm in istration et de la polit ique . Peut-être l a majeureé tendue qu
’
e lle donna à ses connaissances en d im inua quelquefo is la profondeur. Toujours est—ii que dans son ensembleelle t int d ignement sa place et que quelques uns de ses mem
bres lui donnèrent un v éritab le lustre ; tels furent S iccard iet S O l O pi3 .
Joseph S iccardi comm ença sa haute réputation commesubstitut du m inistère public au sénat de Turin . Il fut d ’
abordcrim inal iste et rédigea l es observat ions du sénat sur l e codepénal . Puis i l passa au civ i l où il se d istingua également , et
de la, en 1 840,i l dev int prem ier officier du m in istère de la
just ice. O n sait que sous le règne su ivan t , étan t garde des
sceaux , i l donna le prem ier bran le aux réformes ecclés iasti
ques eu proposant l’
abolition du priv ilège du for dont j ouissaient l es m embres du clergé , et qu
’ il fit passer cette loiaprès une d iscuss ion soutenue ou brillant orateur . Nous ne lesui vron s pas dans sa carrière ultérieure qui sort du cadre denotre travail . L es qualités l es p lus marquantes de l
’
esprit deS iccard i é taient l a connaissance réfléchie du droit , la lucid itédes idées , l
’
exactitude et la dign ité de l’
expression .
L e com te Fréderic S c10p is a eu un rôle p lus importantsous le règne de Charles Albert . Sénateur , puis avocat généra l du sénat de Turin i l avait activ em ent coopéré a la
rédaction du code civ il comme m embre de la comm ission delégis lat ion . E sprit
'
éclairé, indépendant , âme noble , généreuse ,habi tuée aux sen timen ts élev és , homme de l oi
, homme de
lettres e t homme du m onde , il eut de bonne heure dan s l e
pays une position bril lante qui l’
amena tout naturel lement às iéger dan s l e prem ier m in istère constitutionnel en qual itéde garde des sceaux. O n sait avec quel éclat il fut depuis
63
présiden t de l’
académ ie des sciences de Turin , président dusénat du royaume , et en dern ier lieu du tribunal d ’
arbitrageà Gen ève . L e Comte S c10pis avait été un des hommes d ’ étatappelés par l e R o i Charles Albert à interven ir au conseil oùl
’
on discuta l a concess ion du statut .
Du reste on pouvait remarquer dans l es sénats que l es
sections crim inel les é taient ord inairement composées moinsbien que l es civiles . Dans un temps O ù la philosoph ie du
droit pénal n’
avait pas encore pénétré dans l es lois , au con
sidérait comme chose facile la connaissance de cet te partiede l a législation , et ceux qui l
’
appl iquaient étaient regardésavec dédain par les magistrats habitués à résoudre l es que
stions ardues du droi t civ il . Cette infériorité des juges au
crim inel était d ’
autant plus regrettable que l ’
absence des
débats et la nécess ité de juger sur une procédure écriteexigeaien t de la part du tribunal d
’
autant p lus de sagacitéet de lum ières .
L a chambre des comptes était un tribunal m ixte qui
fonctionnait comme rouage de l’ ordre jud iciaire . Appel ée à
ré v iser les comptes de l’ état , el le était en m êm e temps juge
au civil et au criminel de toutes les affaires dans lesquellesse trouvaient intéressées l es finances de l ’ état ; de p lus el leavait la juridiction des eaux ,
des postes , du notariat , despoids et mesures , de la fabricat ion des monnaies , et l es
fonctions de tribunal héraldique . L a chambre avai t deuxordres de juges , ceux qui prenaient part a la d iscussion detoutes l es affaires de sa compétence , lesquels portaien t let itre de co l latérauæ, et ceux qui ne siégeaien t que pourstatuer sur l es comptes . Ces dern iers avaient place après l esautres et s
’
appela ien t maîtres aud iteurs . L es comptes ne pouvaient être référés que par eux. L es collatéraux étaien t cons idérés comme de v éritables m embres de l ’ ordre judiciaire .
Ains i faisait—ou quelquefois passer des collatéraux au sénatde Turin et des membres de ce corps a l a chambre des
comptes . L ’
expérience qu’
acquéraient l es collatéraux dans
les matières spéciales réservées à l a compétence de l a chamb re , notamment dans l
’
appl ication des lois d’ impôt et dans
— 64
l ’ appréciation des d ifficultés que soulèvent l es marchés de
fourn itures et les contrats de travaux publics , leur donnaitune grande autorité envers le barreau et envers l e public .
U n v ieil av ocat de grande réputation , qui avait t ravai llé tou tesa v ie pour l es entrepreneurs , me d isait que les seu ls m em
bres de la chambre des comptes savaient apprécier l es rusesmultiples des entrepreneurs et v oir juste dans le fond des
affaires de ce genre .
L e bureau du procureur général de la chambre des comptesjouait un grand rôle dans le gouvernement. E n même temps
qu’ i l rempl issait auprès de l a chambre l es fonctions de m i
n istère public il représentait l’ é tat comme partie et était son
procureur et son avocat dans tous les procès civ i ls que l e
gouv ernemen t avait à. souten ir. C ’ était la une grande ano
mal ie a laquelle m irent fin l es ré formes de 1847 . Elle produ isait cependan t un bien en ce que les procès ne pouvantêtre en trepris que par le procureur général , magistrat de
longue expérience et jou issant de cette indépendance que
donne une haute posit ion , l’
adm in istration ne pouvai t s’
en
gager légèrem ent dans des instances jud iciaires , et l es affai resdouteuses étaient traitées à l ’ am iab le ou m ises de côté . Maisce qui faisait la majeure occupation et l ’ importance m ajeuredu procureur général c
’ é tait le rôle qu ’ i l avait acquis peu
â-peu de conseil ler principal du gouvernem ent dans toutesorte d ’
affai res . L es m in is tres et l es chefs d ’
azienda demandaient son av is sur les projets de lois et de règlements , sur
l es projets m êm e de patentes ou décrets royaux que souven ti l é tait requis de m inuter, sur l es dou tes qui se présentaientpour l
’
applicat ion des lois ou des règlemen ts , sur l es con tratsà faire et sur toute sorte de difficultés adm inistrat ives ; ilétait dev enu , s i l
’
on peut s’
exprim er ainsi , l’ âme l égale de
l’
adm in istrat ion .
Deux hommes très-d is t ingués occupèrent successivementcette haute charge sans le règne de Charles Albert , l e président Col ler et l e président Cristian i . L e prem ier était un
ancien magistrat de l ’ époque impériale et nous en avons
parlé ail leurs . L e second appartenait à l ’ école m oderne . Il
était distingué par un caractère ferme, résolu , de toutel oyauté , par une intell igence lucide , pas des connaissancestrès—étendues et beaucoup d
’
apt itude aux affaires . L’
un et
l’
autre apportèrent dans leurs fonct ion s un esprit de léga
lité et de just ice qui ne contribua pas peu a la force du
gouv ernement.
V I .
La Bonrgeoisîe.
Plusieurs dispositions du règne de Charles Albert avaientt émoigné la cons idération du gouvernement pour l a bourgeo isie ; el les avaient rapproché cette classe de la noblesse ;el les avaient encouragé l a bourgeoisie dans l
’
ess0rt qu ’
elleprenait naturellemen t pour s
’ élever par 1’ éducation , par
l’ instruction , par l
’
accroissement de sa richesse . O n com
mença a former de vastes associations industrielles , ou donnaaux manufactures des proportions jusqu
’
alors inconnues . L es
v oyages , qui dev inrent a la mode , développèrent ces progrèsde la bourgeoisie , et e l le fut naturel lement f rappée par le
spectacle des moeurs d istinguées de l a bourgeoisie f rançaise ,de son instruction si avancée qui la faisait briller dans toutesles carrières , de l
’ importance po l itique et sociale qu ’
ell eavait acquise . C ’
est ains i qu ’
en 1848 , lorsque l es nouvellesformes in trodui tes dans le gouvernemen t appelèren t la hour
geo isie a y teni r une grande place, a y représen ter l’ élément
l e plus actif , l a bourgeoisie ne se trouva pas trop au-dessousde sa position . Si au prem ier abord elle parut peu apte au
détail des a ffaires publiques , si , par exemple , el le montraune défiance excessive envers l e gouv ernement et une par
s imon ie malentendue dans les dépenses de personnel , il fautl ui ten ir compte de l a préc ipitation avec l aquel le s
’ était faitle changem en t des institutions et a la nécessité où elle s
’
est
t rouvée de rempl ir un rôle nouveau sans y être préparée .
O n doit aussi lui ten ir compte de la fermentation qui règne
V I I .
S ciences, Lettres et Arts .
Jamais , depuis Charles Emanuel l es savan ts , les gen sde lettres et les art istes n
’
av aient été honorés et protégéspar la Cour de Turin comme i ls l e furent par Charles Albert.U n de ses prem iers actes en montant sur l e trône fut de
con férer la croix de saint Maurice , alors tenue en grandhonneur, aux quatre mem b res les plus il lustres de l ’ académ ie de Turin . Cela fit l ’ e ffet d ’
un événement , tant c’ é tai t
hors des habitudes . O n v oyait bien à Turin un savant , Plana ,qui possédait une décoration ; mais c ’ était une décorationétrangère .
U n autre acte des premiers du règne , fut la création del ’ ordre du m érite civil , destiné principalement aux écrivainset aux artistes . L e Roi agréait v olontiers l a dédicace des
l iv res ; i l acceptait avec p laisir l es objets d’
art et de scienceofferts pour les collections de l ’ état et pour l es sciences
particuli ères .
Ces depots précieux s’
enrich irent beaucoup sous son règne .
Il forma lui—même la galerie des tableaux, i l aimait à allerv isiter l es musées et a se faire rendre compte par les di
recteurs des accroissem ents et des autres améliorations .
L’
académie des beaux arts fut réorganisée par lui ; de mêmecelle d ’
agricu lture.
L ’ instruction publique fut successivement dirigée par le
Cheval ier Louis de Collegno , par l’ évêque Pasio et par le
Marqu is Alfieri , et , dans la dern ière année, par l e Chevalier
— 69
Boncompagui . Nous ne parlons pas des autres personnagesqui t inrent ce portefeuil le après Boncompagni , parcequ
’
i l s
ne firent qu ’
une apparit ion au m inistère , où i l s n’
eurent pasl e temps d
’ imprimer des traces durables .
Louis de Col legno é tait homme de talent , très-instruit,très—con sciencieux , aimant le dé veloppement des études sé
rieuses , mais t rop prévenu contre l es progrès modernes , et
trop enclin à faire dom iner dans l ’ enseignement les corporations rel igieuses . L e Comte de Pralorme , m in istre de l
’
in
térieur , qui é tait très—conservateur , m ais qui craignait devoir l ’ éducat ion pub l ique in féodée au clergé et surtoutau clergé régulier, fit tant qu ’
en 1840 i l obtint du Roi detransférer Col legno a une présidence de section du consei ld
’ état , et à lui donner pour successeur m onseigneur Pas io ,evêque d
’
Alexandrie , ancien professeur de l ’
un iversité de
Turin . Pral orme en proposant un evêque, homme grav e et
bien connu , avait voulu démontrer que s’
i l était hostile àune influence excess ive des moines , il était bien loin de vou
loir exclure le clergé d’
une ingérence just ifiée dans l a di
rection des études .
Mais Pasio , avec un fonds incontestable de b on sens et
de bonne v o lonté , avec des connaissances assez étendues et
beaucoup de pratique du monde un iversitaire , portait dansl es affaires une prudence si m éticuleuse qu ’ i l avan çait peu .
E n général on n’
en fut pas content . I l établit pourtan t en
principe l es écoles normales , et aida au rétablissement duco l l ège des prov inces , grande institut ion destinée à recevoirsous une discipline large et éclairée l es jeunes gens des prov inces qui venaient à Turin pour l es études un iversitai res .
I l aida auss i à l ’ introduc tion des asiles d ’
enfance en appe
lant à. Turin , pour donner un enseignement de pédagogie ,
l’
abbé Ferrante Aporti de Crémone , un des prem iers promoteurs de ces asiles en Italie . De la nacquirent pour Pasiodes contrariétés qui amenèrent sa retraite . Franzoni archev êque de Turin considérait les asiles d ’
enfance comme une
nouveauté imaginée par les phi lantropes sans rel igion . Il eut
pour suspect l’
abb é Aporti et lui fit interdire la célébration
_ 70 _
de la masse dans son diocèse sous prétexte qu’
il n’
avait pas
rempl i'
les fo rmal ités voulues . Pasio en fut b lessé. La querel leentre les deux évêques amusa un momen t les o isifs . L e R o i
n’
aimait pas la pétulance de l’
archevêque, mais i l craignaitson obstination et ne voulait pas s
’engager dans une querel le
avec le premier prélat du royaume. I l ne donna à Pasioaucune satisfaction réel l e. Au bout de quelque temps, Aportiretourna à Crémone avec l a croix de saint Maurice conféréesur la demande du m in istre de l ’ intérieur. Pasio se retira
pour deux ou trois mois dans son d iocèse, puis il donna sa
dém ission , qui fut acceptée.
Nous consacrons un chapitre à part a son successeur leMarquis Alfieri , san s la main duquel l ’ instruction publiquefit des pas essentiels.
Le Chevalier Charles Boncompagn i , prem ier m inistre con
stitutionnel , fut immédiat successeur d ’
Alfieri , dont i l avaitété prem ier officier ( secrétai re général ) . Boncompagn i avai tété magistrat ; il était né pour l a philosoph ie . La tournure deson esprit, d
’
ailleurs três—é levé et soutenu par le caractère leplus honorable , le rendait peu apte à la prat ique des affaires .
Il a fait dans une époque de pleins pouvoirs le décret—loi qu iinstitua les lycées nationaux, inst itut ion manquée faute d
’
hommes aptes aux fonctions qu ’
el le créait .L ’
enseignement des arts ne fut pas moins encouragé parCharles Albert . Pour en favoriser le développement i l multipl ia les commandes , non seulement dans ses états , mais danstoute l
’
I ta l ie, de tableaux , de scu lptures , de gravures . I l fut
de fait à la tête de l ’ I ta l ie par cet te mun ificence qui rayonnait sur toute la pén insule .
I l en résulta, entre autres ouv rages , plus ieurs monumentsqui décorent la v i l le de Turin , des tableaux et autres nom
breux objets d ’
art qui ornen t les palais royaux ,la magnifique
oeuvre du Marquis d ’
Azegl io sur la gal lerie de Turin en
richie de gravures de Toschi , Raimondi et autres maîtres ,quelques belles médailles de Ferraris .
Charles Alb ert sous l ’ inspiration du m inistre Gallina avaitfait ven ir Palagi à Turin et 1
’
avait attaché à son serv ice
_ 71 _
d’
une mani ère stable. L e b ut du m in istre avait été (1 1ntro
duira l e'
bon goût en fait d ’
art , et si le résu ltat ne fut pas
absolument celui qu ’ i l en attendait , néanmoin s le séjour dePalagi en Piémont eut une influence ut i le sous divers rap
ports , et plus étendue peut—être que ne l e croyait l ’ habilem inistre.
E n efi'
et Palagi , passionné jusqu’
au fanatism e pour le classique , gâta l e Palais de Turin et l e théatre royal par des
réformes où , en voulant chasser le baroque , i l substituait desportes , des chem inées , des tapisseries de sa façon aux richessculptures , aux peintures gracieuses , aux ten tures du 17
°
siècle. Il créa des d isparates qui juren t comm e l e costume deCésar avec l a perruque de Louis XIV . Mais l es dessins de
Palagi , répandus dans l e public et adaptés à la prat ique detous l es arts , généralisèrent le b on gôut . L es ébén istes surtout ,et aprés eux , les autres ouvriers en m eubles en profitérent
au grand av antage de leur industrie . Encore aujourd ’
hui on
ressent l es effets de l ’
heureuse impulsion qui fut donnée parce grand art iste .
L ’
art qui grandit le plus sous l e règne de Charles Ai
b ert fut sans nul doute la sculpture . L a peinture et l e dessinavaient eu dans l es temps antérieurs des m aîtres en Piémont.Même a une époque ancienne , l
’ école de V erce il av ait produit des chefs—d
’ oeuvre dont la v aleur artistique est d’
autan t
plus appréciée de nos jours . L a sculpture avait dorm i . Or ,sous la protection de Charles Albert , nous v oyons Marocchettiimmortaliser son nom p iémontais par la statue équestre d ’
E ma
nue l Philibert . V ela orne Turin de monuments où respire legénie ; Cacciatori env oie de Milan les splendides statues des
Dioscures qui décorent la grille du palais royal ; Alb erton ienrichit l e pays de nombreux ouv rages pleins de v ie et de
sentiment , et la v oie s’ ouv re à d
’
autres qui honorentaujourd ’
hui l ’ I tal ie.
La science du passé doit au Roi Charles A lbert la créat ion du com ité d ’
h istoire nationale qu i a publié un grandnombre de documents t irés des archives de l ’ état, des v illeset des monastères , un recuei l précieux de statuts ou règle
ments locaux de commerce du moyen—âge, et un certainnombre d ’ ouvrages ou m émoires inédits concernant l ’ histo iredu pays .
L e s iècle précédent avait produit des critiques ém inentsen matière d ’
archéologie et d’
histoire , tels que Terraneo , l e
prés ident Durandi , l e Baron V ernazza , le Comte N apione et
Ange Carena.
L ’ époque dont nous nous occupons a vu poursuivre et agran
dir l es é tudes de ces laborieux p ion iers par Cib rario , S clopis ,les deux Promis , César Balbo , Ricott i et d
’
autres , au moyendesquels a été m ise en lum ière la v éritable h istoire de la
Monarchie, de ses institut ion s , des moeurs et de l’
administra
t ion du pays , 1’
h istoire de T urin , cel le des assemblées pcpulaires , celle des petites républiques du Piém ont , celle des
légis lations ou coutumes loca les , cel le des troupes mercenaives du m oyen âge ; on v it surgir des ténèbres l es règnes
glorieux et féconds d ’ Emanuel Ph i libert , de V ictor Amédée IIet de Charles Emanuel III , le règne agité plutôt que l ouablede Char les Emanuel I ; ou connut la v érité sur le v iei l Hardouin , Marquis d
’
I vrée Roi d ’
I tal ie , sur la régence orageusede Christine de France ; on v it poindre quelque lum ièrequoiqu ’
encore faible sur les origines de la Dynastie , que leRoi et bien d
’
autres dési raient fai re descendre d’
anciensRois d ’
I ta l ie , bien qu ’
e l le soit suffisamment ital ienne par l esb iens qu ’
el le a fai ts au Piémont depuis huit siècles .
L e Com te Saul i de Ceva a publié une histoire importan tedu commerce des Gêno is en O rient .
Pierre Datta a donné un e savante histoire des Princesd
’
Acham et de Marée, branche cadette de la maison de
S av oie.
L es sciences médicales ont progressé par les travaux du
professeur R ib eri , médecin et chirurgien ém inent , du botan iste Maris et autres , et par l ’ établissemen t de l ’ académ ied e médecine .
L es sciences exactes ont été illustrées par le traité sur
la lune de l ’ astronome Plana , par les leçons lumineusesd
’
l gnace G iul io et de Bidone , dont l’ école a fourn i à. notre
— 73
temps 1 1ngénieur Sommeiller et ceux qui ont dirigé l a plu
part des grands travaux con temporains d’
I tal ie .
Le règne de Charles Albert ouvrit pour les lettres une
époque remarquab le d’ épanouissement . Disons- le , quo iqu
’
â
regret , un v oil e de pédanter ie éta it tombé sur el les . L e l atin iste Boucheron , homme d
’
une intel l igence élev ée et d’
un
caractère hors du commun ,dom inait en Roi dans l a l ittéra
ture , et son m érite , très—respec table d’
ail leurs , avait une
nuance de pédanterie qu i exerça autour de lui une influenceincontestable . Bro fferio , qui étab l it a lors un journal l e Mes
s agg iare, soutenu par sa méd isance b ardie et par cel le du
m isanthrope Gaétan De Marchi qui écrivait sous l e pseudonime de As in io R us tica , combattit à outrance cette pédan
terie , et en eut rai son . Mais l ’ école de Boucheron avaitrendu aux lettres des serv ices réels , et relevé dans la jeunessel es plus nob les instincts . Parav ia , professeur de l ittératurei talienne , appelé autrefois de V en ise par N apione , in troduis itun genre gracieux, qui se rapprochait de la manière française .
L e plus noble monumen t de la l ittérature de cette époque ,quoiqu ’ il ait été imprimé plus tard , est sans doute la tra
duction de T hucidide par Amédée Peyron , ouvrage riche de
notes et de commentaires précieux .
Après ce beau livre , je ne puis m’
ab sten ir de citer commeoeuv re remarquable dans un gen re opposé les chansons p ièmontaises de Brofi
'
erio , étincelantes d’
espri t et de v erve , oùl a facilité et l e naturel rachettent des défauts bien connus .
V III.
Le général E manuel Pas de V i l lamariua.
Emanuel Pas de V illamarina était cadet d ’
une des principal es famil les de la Sardaigne . S on oncle , général d
’
artillerie et cheval ier de l ’Annonciade, y avait exercé l es fonctionsde V ice-Roi .
Il ava it été un jeune officier dans l es dernières annéesdu siècle passé . Jol i garçon , spirituel , passionné , i l avait eu
des momen ts d ’
étourderie orageuse , au point, d it—ou, de suivreune saltimbanque et de paraître avec el le sur les tréteaux.
Plus tard i l avait épousé une noble et v ertueuse domaisel le sarde , et l es états de terreferme de la maison de Savoieétant alors au pouvoi r des Fran çais , il était resté fidèle à sonancien souverain . Mais pour amél iorer son sort de cadet etcelui de sa fam ille, il se donna â des spéculations de com
merce avec des négocian ts génois.
L a révo lut ion de 1821 l e trouva officier général . Il futappel é au m inistère de la guerre par le nouveau g ouvernem ent et ne retint pas le portefeuil le . Néanmoins le Roi CharlesFélix l e considéra toujours comme suspect de l ibéral isme et
ne lui donna aucune charge active . Au contraire CharlesAlbert, Prince de Carignan ,
lui conserva une estime part icul ière , et , monté sur le trône , il le destina à siéger au con
seil d ’ état qu ’ i l créa bientôt après . Puis i l ne tarda pas del e faire min istre de la guerre , et i l rétablit pour lui le m i
n istère spécial qui avait jadis existé pour les affaires de l ’ îlede Sardaigne.
sénat par l’
am i passionné de la Sardaigne , le général Albertde L amarmora.
V ers la fin de septembre 1847 l e général V illamarina eut
un d issentiment assez v if avec le Comte Lazzari inspecteur
général de police à pr0 pos de certaines démonstrations a lav érité peu importantes que Lazzari réprima , et que V il lamarina aurait v oulu tolérer comme inofi
'
ensives . L e Roi approuval a conduite de Lazzari . Il en surgit entre Lazzari et V illamariua une aigreur qui se prolongea . Enfin elle augmenta au
point que l e v ieux m in istre écriv it une longue lettre au Roisur l ’ imposs ibilité où il était de lutter plus longtemps avecson in férieur , et il al la jusqu
’ à o ffrir de déposer l e collierde l
’
Annonciade. L e Roi fut blessé de ce ton , et peu aprèsV i l lamarina fut m is a la retraite .
I l v écut , encore quelques années , se tenant en dehors dumonde e t des affaires. Sénateur depuis la créat ion du sénat,il in tervena it assidûment aux séances , sans prendre aucunepart aux discussions n i au trava il des bureaux , ce que d
’
ai lleurs il n ’
aurait guères pu faire étant devenu trés-sourd et
presque sans v oix . Morose, sans confiance dans le nouve lordre de choses , il s
’
égay ait parfois par des exercices de
musique, pour lesquels il fut toujours passionné .
U ne attaque d ’
apoplexie foudroyan te l’
emporta le 5 fé
v rier 1852 a l ’ âge de 75 ans .
IX.
L e Marqui s César Alfleri .
L e Marquis César Alfieri de Sostegno était né à Turinen 1799 d
’
une ancienne fam ille patricienne d’
Asti , la m êmedont une autre branche donna à l ’ I ta l ie son principal poètetragique .
L e père de César Alfieri avait été Ambassadeur du Roide Sardaigne a l a Cour de France de 1814 a 1818 . C ’ étaitun grand seigneur à man ières franches , mais nobles , un
homme d ’
excellent coeur , un caractère fier et un type d’
hon
neur , de délicatesse et de probité .
Il éleva son fils dan s la sév érité de ses principes , mais i ll
’
in itia de bonne heure au grand monde , comme i l le pou
vait facilement à Paris , non seulement par sa haute posit ion ,
mais par la grande considération dont i l jouissait .César dev int un jeune homme accompli ; la nature lui avait
donné une très—haute tail le , mais un corps bien proportionné ,une figure agréable et fine , un esprit fin et pénétrant. Il yjoignit de grandes mani ères , une instruction variée , un goûtdél icat en toutes choses .
Il étudia quelque temps l e droit , puis entra très-jeuneencore dans la carrière de la diplomatie . L es relations de
son père avec les premiers d iplomates de l’
E urope lui facil itèrent un début que ses quali tés personnelles devaient rendrebrillant . Il fut attaché à Berlin , puis secrétaire à Saint—Pétersb ourg. A l a cour de Prusse i l reçut l ’
accuei l le plus bienveillant comme neveu du Marquis de Saint Marsan , ancien
_ 78 _
ambassadeur de l ’ empire français, qui avait laissé d’
excell ents souven irs. Aussi fut—i i admis dans une sorte d
’ intim itéauprès des Princes Boyaux qui de nos jours ont occupé successivement le trône.
Il quitta la carrière d iplomatique en se mariant, et s’
etablit a Turin avec Louise Costa , de la maison i llustre des
Comte de la Trin ité , b onne, judicieuse et sainte femme.
Charles Al bert était alors Prince de Carignan , héritier
présomptif de l a couronne que portait avec une certaine fermetê et b eaucoup de nonchalance le v ieux Roi Charles Félixnon éduqué pour régner.
Charles Albert dont le R oi se méfiait , v ivait l e plus poss ib le à l ’ écart avec une petite cour, préludant a son règnefutur par l
’ étude secrète des principales amél iorations qu ’ ilaurait pu introduire. Il n ’ ignorait pas que l
’
opinion publique,lasse plus au moins d ’
un gouvernement inactif et stationnaire ,attendait beaucoup de l ui . Il voy ait quelquefois l es hommesles plus éclairés. Il n ’ était pas fâché que sa cour plus jeuneet p lus v ive fût m ise en opposition avec la cour maussade
du v ieux Roi , et ses idées de progrès avec l ’ humeur apa
thique et l es O pin ions surannées de ce Souverain .
C ’
est alors que César Alfieri fut nommé écuyer de CharlesAlbert
.Il eut été d ifficile de trouver un homme de cour
aussi bril lamment doué pour la v ie élégante d’
une maisonprincière , et en m ême temps aussi indépendant. Il s
’
affecüonna
au Prince et lui resta dévoué jusqu ’ à l a mort. Il dev in t sonconfident en beaucoup de cho ses et presque son am i. O n d it
que quelquefois l es Princes ont de v rais am is ; mais il s’
agitici de deux hommes entre lesquels ne pouvait subsister une
am it ié véri table . L’
un et l ’ autre étaien t rai l leurs , et ne sa
vaiont reten ir un mot caust ique ; l’
un et l ’ autre avaient dansl e caractère un pet it fonds de méfiance et un certain goût deréserve et de mystère. De plus Alfieri ne pouv ait pas quelquefo is s
’
empêcher d’ être cassan t, et le Prince, quoique
b on , étai t foncièrement susceptible .
Quand Charles Albert fut Roi , ses anciens écuyers dev inrent Prem iers É cuyers du R o i , et les benjam ins de sa maison .
79
Alfieri conserva son influence auprès du nouveau Monarqueet un certain degré de fam il iarité qui lui donnait au dehorsl e prestige d
’
un am i du Prince.
Il se passa néanmoins l ongtemps avant qu’ il eût une po
sition dans le gouvernement. Ce fut sans l e m in istère du
Com te de Pralorme son parent et son am i qu’ il commença
à entrer aux afi'
aires dans les fonctions gratuites de conseillerau m in istère de l ’ intérieur, sorte d ’
emploi qui n’
avait jamaisexisté et qui fut créé pour lui .
Quelque temps après i l fut nommé conseill er d ’ état. Leconseil d ’ état avait alors l ’ attribut ion importante d
’
exam inerles b udjets et les comptes rendus des m inistères ; de plus ilse trouvait alors invest i de la discussion des codes . Alfieri ybrilla par son esprit, par l
’ étendue de ses lum ières , et sur
tout par ses connaissances en stat istique et sur la législationet l ’ adm in istration des pays étrangers . Seulemen t sa v ivacité ,dont i l ne fut pas toujours maître , blessait quelquefois ses
collègues dans la discussion . Il était alors l e prem ier a re
connaître ses torts avec autan t de grâce que de noblesse.
E n 1844 le Roi à l a haute charge de président de la Ré forme des s ; c
’ é tait comme un présidentdu consei l supérieur de l ’ instruct i on publique, chargé lui
même personnellement de proposer au Souverain les choixdu personnel et les projets de règlements délibérés en conseil .Si l e Roi approuvait l es propos it ions , le prés ident en in formaitle m in istre de l ’ intérieur , auquel il appartenait de prendredéfin itivement l es ordres de S a Majesté , de lui soumettre lesdécrets , et de les con tresigner . C ’ était donc la un présiden tqui avait , jusqu
’ â un certain point , l’ importance d
’
un min istre .
I l importait d’ év iter que le Roi , qui venait de choisir
deux m inistres d ’
O pin ion m odérée , Revel et Des—Ambrais , ledern ier surtout enclin aux ré formes , v oulût donner une ga
rant ie au parti contraire en prenan t dans son sein le directeursuprême de l ’ instruction publique , ce qui aurait paralysécette branche de serv ice et affaibli l e gouvernemen t. I l étaitau contraire indispensable de dé velopper l
’
enseignement suivant l es progrès des sciences, et d
’
étendre l ’ instruction pri
— 80
maire. Le m inistre de 1 1ntérieur présenta donc au Roi uncertain nomb re de noms , tous pris parm i les conservateursmodérés , tous hommes respectables de diverses positions . Au
nombre dé ces noms , i l plaça celui du Marquis Alfieri , et leRoi l e choisit .
E n m ême temps les plus v ieux membres du conseil deréforme furent m is à la retraite , et l
’ i l lustre abbé Peyron ,
aussi b on adm inistrateur que savant orientaliste, fut appelé à.y siéger.
C ’ était un changemen t de scène . Le public fut étonné ,m ais applaudit. Alors commen ça une série de réformes qui
s’
appl iquerènt peu a peu ;
Etablissement défin itif des écoles destinées à former desenseignants
Règlement pour général iser l’ instruction des filles ;
Création d ’
une école d ’ économ ie politique ;Ré forme de 1 ’
enseignemen t du droit d ’
après les étudesd
’
une comm ission , où siégeaient des hommes spéciaux et
d’
une haute distinction de doctrine,tels que S clopis , S iccardi
et autres .
E n nov embre 1847 , époque des grandes innovat ion s dansl e gouvernement , l e conse i l de réforme et l es autres autorités supérieures qui présidaient aux é tudes furent supprim éeset l e Roi créa un m in istère de l ’ instruction publique avecun conseil supérieur pour tout l e royaum e. L e Marquis A1fieri fu t nommé m inistre . Il refusa d ’
abord parceque l e chan
gem ent avait été dé l ibéré à son insu ; mais i l fut facile de
lui démontrer qu’
on l ’ avait laissé à l ’ écart par un sentimentde dé l icatesse , et il fin it par accepterL a création du nouveau m in is tère avait en pour b ut de
rendre plus nombreux l e cabinet afin d ’
en accroître l ’ au tor ité en face de la grav i té de la situation . Mais on avaitsurtout v isé à faire entrer ainsi l e Marquis Alfieri dans l e
( 1) Tous ces changem en t s d e personn es et d e choses étai en t dus ai m i
t iat i v e du chev a l i er Des Am b ra i s a l ors m in i stre de l’i n téri eur. V . l
’auto
b i ograph i e, pages 1 1 et su i van tes
— 81
consei l officiel de l a couronne . Il le renforça en effet par sa
popularité et par l e concours précieux de sa justesse de vues
d’
autant plus nécessaire en raison de la d ifficulté des circon stances .
Duran t l e mémorable hiver de 1847 a 1 848 , lorsqu’
une
impat ience fiévreuse s’
empara des population s pour obten irl es garanties cous titutionnel l es Alfieri fut de ceux qu i v irentl e besoin de faire respecter l autorité , et en même temps
l’ impossibilité de résister bien l ongtemps au torren t de l ’ opinion , enfin l a nécess ité de pourvoir de man 1 ere a faire cesserl es tumul tes sans efi
‘
usion de sang . Puis à l ’
annonce de l a
promulgation d’
un statut politique à Naples , Alfieri fut des
prem iers à souten i r qu’
on ne pouvait pas d ifférer davantage
à faire l a m ême chose à Turin , quoiqu’
i l eut été à. désirerd
’
avoir pu m ieux préparer le pays a la v ie nouv elle qui al laits
’ ouvrir pour lui . Il prit une part activ e à la d iscussion du statut .
Ce grand acte signé , tous l es m in istres d’
un communaccord résignèrent leurs portefeui l l es afin que l e Roi pût en
disposer en faveur d ’
hommes nouveaux . Ce fut d’
après l’
av isdu Marquis Alfieri que l es che fs du mouvement qui avaitcommencé à Gênes , Pareto et Ricci , furent chargés avecCésar Balbo de composer un nouveau cabinet .
Rentré dans la v ie privée , Alfieri n’
y resta pas longtemps.
E n aôut de la m ême année 1 848 , l e Roi ayant été obl igé deconclure l ’
arm istice Salasoa et d’ évacuer la Lombard ie perdit
beaucoup de son prestige dans l’ opinion publique . L es partis
subversifs en profitèrent . L a monarchie semblait ébran l ée ;les hommes exaltés v oulaient continuer la guerre lorsqu ’ onn
’
avait que l es débris d’
une armée démoralisée et in férieureen nombre à .l
’
ennemi , lorsque l e trésor étai t épu isé et l e
crédit perdu.
Dans ces circonstances le Marquis Alfieri , surmontant sa
répugnance naturel le à embrasser une grave responsabilité ,se décida a composer avec l e Comte de R év el un cabinetconservateur , dont il fut l e président , pour essayer d
’ obten irune paix honorable par la médiation des puissances am ies , deconjurer les périls intérieurs et de sauver la couronne .
82
L o fameux abbé Gioberti , qui n’
eut pas dans ce m inistèreune place proportionnée à. son importance polit ique , fut facilemen t entraîné par le parti d
’ opposition à se tourner contrelui . Il se figura que , sous les dehors d
’
un programm e hon
nête , les chefs du m in istère cachaient des vues de réaction .
S on imagination enfanta l 'écrit intitulé I due p rogramm i ,
qui ont alors beaucoup de v ague, et en imposa au publ ic
passionné . D ’
autre part la médiation traînant en longueurd onna un nouv el aliment aux soupçon s et aux calomn ies àl ’ adresse du m inistère . L e Marquis Alfieri , craignant qu
’ i l nepût se souten ir en face du parlement qui allait s
’
assembler,donna sa démission , et fut remplacé à la présidence par legénéral Comte de Perrone . Ce furent ses ad ieux au pouvoir.
Dans l es temps successifs il fut plusieurs fois engagé à l e
reprendre, mais toujours i l refusa .
Depuis la formation du sénat i l occupait un s iège de sé
nateur . L e prem ier m in istère constitutionnel lui av ai t m êmeo ffert la présidence . Il ne l ’ accepta pas , d isant ne pouvoirêtre a la tê te d ’
un corps qui comprenait p lusieurs personnages beaucoup plus anciens d ’ âge et de serv ices , dont que lques uns avaient été ses chefs .
Il rempl it consciencieusem ent ses dev oirs de sénateurju squ ’ à sa mort , étudian t toutes l es questions , et prenantsouvent une part active et utile aux débats . S a parole , dansl es comm encements , était un peu emb arassée ; dans la suiteel le dev int nette , lucide , précise , quelquefois piquante . Jamaisil ne v isait à l ’
éloquence . Il n ’
aimait pas a faire ce qu’
on
appel le un discours . Mais ses observations éclairaient ordinairement la discussion ; il la ramenait souvent sur l a bonnev oie ; i l indiquait l es lacunes et l es difficu ltés qui n
’
avaientpas été prévues .
Nommé v ice-président , il occupa plusieurs fois en cettequal ité l e fauteui l de la présidence , et i l eut occasion d
’
y
montrer toute l a finesse de son tact , sa présence d’
esprit,sa facilité â saisir l es questions de toute nature . Il présidaitl a séance dans laquel le l e m in istère, qu
’
on appelait démo
cratique , annonça au sénat que le Roi allait entreprendre la
dev int sujet a une atonie des intestins qui l’
entraina peu a
peu au tombeau . I l mourut à Florence le 16 av ril 1869 .
Peu d’
hommes ont vécu entourés d’
une considérationaussi générale , très-peu ont été si regrettés .
X.
L e Comte de R evel .
Figurez -vous un petit homme , bien fait , à physionom iean imée , av ec un grand nez aqu i] in , des yeux v i fs , l e souriremalin ,
l es chev eux plats et gris , toujours très—propre et bien
m is . T el était l e Comte Octav e de Rêve] , un des hommes lesp lus influents du règne de Charles Albert.
Octave Thaon de Rêve] , né en 1803, était fi ls du Ma
réchal de R ével gouverneur de Turin , qui avait exercé en
1821 l es fonctions de l ieutenan t général du royaume pendantque Charles Félix ,
devenu Roi , était’
encore absent .
Parvenu très-jeune à la charge de substitut du ProcureurGénéral , pu is a celle de v ice- intendant général des finances ,naturellement act i f et d ’
un espri t lucide , i l était fermé aux
affaires lorsque le Comte Gall ina , son ancien co ll ègue , l echois it pour son prem ier officier au m inistère des finances ,charge qu
’ i l occupa jusqu’
en 1844 . A cette époque , Gal l ina ,
ayan t réuui dan s ses mains l ’
adm in istration de l ’ intérieurav ec celle des finances , Rev el dev int son prem ier officierpour l
’ intérieur . Il était aussi depuis plus ieurs années secré
taire do consei l du Roi , appelé conseil de conférence , et i l
conserva ces deux charges jusqu’ à ce qu ’
en 1844 i l futnommé m in istre des finances . Ce portefeuil le resta en tre ses
mains jusqu ’ à ce qu ’
en 1848 un cabinet m êlé de Lombardset de V én itiens fut composé par suite des annexion s . Ce ca
binet étant tombé en conséquence de l ’
arm ist ice Salasoa,Rêvai rentra au m in istère sous la prés idence du Marquis Ai
— 86
fieri , et continua jusqu’
en décembre 1848, époque à laquellei l en sortit avec la dign ité de Ministre d
’ état pour n’
y plusrentrer.
Il avait hérité de son père un dévouemen t pro fond a la
m onarchie , te lle que l’
entendaient l es hommes l es plus éclairésde l
’
ancien régime, v oulant que l e Roi respectât l es lois et
subît jurqu’
à un certain point l e contrôle de la magistrature parl e droit d ’
entérinem ent attribué aux cours souveraines , maisexcluan t toute ingérence du peuple dans l es affa ires de l
’ état .Comme son père , i l avait l es tendances aristocrat iques
tempérées par l’
esprit de justice et par un grand b on sens.
Comme lui , il portait dans les a ffaires et dans l es rapportssociaux une loyauté constante , qui n
’
excluait pas l a finesse.
Il parlait et écrivait avec beaucoup de clarté . Esprit prompt,v if , mais caustique et rail leur , défaut qui en lui augmenta
avec l ’ âge et qui lui a l iéna beaucoup de monde.
L e Roi l ’ aimait , parcequ’ i l v oyait en lui un m in istre dé
v oué et capable . E t il faut dire a sa louange que s’
i l avaitl e don de dev iner les désirs du Souverain pour l es complaireen ce qui était faisable , il eut toujours le courage de rés isternoblement aux volontés qu ’ il croyait ne pouv oir seconder . I l
fut constamment pour Charles Albert un conseil ler franc et
honnête.
Am i de l ’ économ ie , i l fut pourtant moins rétif aux dé
penses que Gallina . Il sui v it du reste l es nobles traces de
cet éminent prédécesseur en maintenan t dans son adm in i
stration l ’ ordre , la moral ité sévère et la léga l ité .
Il continua son système d ’
améliorer peu a peu les tarifsdes douanes dans l e sens le p lus favorable â la l iberté com
merciaie .
Il admit de m ême successivement des progrès de détai ldont l ’ uti l ité était démontrée dans les d iverses branches del ’ adm in istration .
Il seconda la con struction des chem ins de fer , l es dév el oppements de l ’ instruction publique . Lu i-m ême n
’ était pastrès- instruit, m ais i l l
’ était assez pour paraître honorablementdans le monde et pour goûter l es progrès de l
’
enseignem ent .
— 88
entendait s’
en prendre lorsqu 11 avança que l e m in istèreava it deux programmes , insinuatian de duplicité contre la
quelle protestait toute la v ie du Com te de R ével .Il y avait n éanmoins de te lles pré ventions contre lui , sur
tout dans la chambre des députés , que sa présence dans l e
min istère é tait pour celui-ci une cause de faiblesse , laquellecon tribua a sa chute consommée a la fin de décembre .
Rêve ! resta s imple député siégeant à la droite O ù faisaita lors ses prem ières armes le Com te de Cavour. I l s furentquelque temps un is . Puis à l ’ occasion des lois sur la juridiction ecclésiastique une scission profonde s
’ opère . R èvel et
Balbo priren t la d irection du part i qui rejetait l es innovationsfaites dans les rapports av ec l ’ égl ise san s accord préalableav ec le Pape .
U ne autre cause de dissen timent entre Cavour et R ève l
surgit a propos des ré formes en mati ère de douanes . R ével
trouvait que Cav our professait d’
une man ière trop absoluel es principes du libre échange et v ou lait les appl iquer avect rop de précipitation . Ces deux hommes dev inrent ad versairesdéclaré s . Mais Cavour avait pour lui 1
’
ascendant d ’
un ca
ractère entreprenan t , l’
attrait de l a nouv eauté , l a supérioritédes moyens parlementaires , enfin 1
’
O pin ion du plus grandnombre .
L es appréciateurs impartiaux pouvaien t trouver que dans
l a question ecclésiastique Rêve ! n ’
appréheudait pas sans raisonl es conséquences morales d ’
une lutte av ec l ’
E gl ise , mais qued
’
au tre part on ne pouvait raisonnablement se refuser a intraduire l es progrès civ ils don t le pays avait déjà joui sousl a dom ination française et que la France catholique avaitconservés , et qu
’
attendre le concours de R ome , a qui on
l ’ avait inutilem ent demandé , serait ajourner à l ’ infin i toutedéterm inat ion . L a général ité n e pouvait s
’
associer aux idéesde Rêvai lorsqu ’ il élev ait l e débat aux proportions d
’
une
question re ligieuse où fût intéressée l a conscience du ce
tho l ique .
Quant à l a discussion financière , R èvel d isait sans doutede bonnes choses ; mais en b làman t l
’
exagération de son
89
adversaire , il exagérait de son côté , et dans le débat passionne de part et d
’
autre , la balance pendait en faveur deCavour.
Rêve] , consciencieux et m odéré dans ses opin ions , n’
en
trait aucunem ent dans le parti clérical . Mais les journaux dece parti l e l ouèrent , et il en résulte qu ’
ayant été proposécomme candidat à Turin pour l a députat ion , Cavour , dans unm ouvement d ’
i rritat ion , qu’ il regrette probablement dans la
suite , fit une guerre outrée a sa candidature , et obtint qu’
à
sa p lace fût élu Bro fferio .
Plus tard le m êm e Com te de Cav our rentra d ignem enten bons rapports avec R èvel et lui offrit un siège au Sénat .
Sénateur assidu ,i l ne pri t guères part qu
’
aux discussionsde finance , dans lesquelles il fut toujours écouté avec respect ,parceque ses observations lucides , franches , pratiques étaienttoujours empreintes d
’
un esprit consciencieux , quoique parfoisdans l a forme au regrettât quel que pointe de causticité .
Quoiqu ’ i l eût désapprouv é en 1 865 l e changement de ca
pitale , i l se rendit sans hésitat ion à F lorence pour ses fonct ionsde Sénateur , et sa v oix n
’
y eut pas m oin s d’
autorité qu’
à
Turin . Cependant son physique dépérissait , i l devenait sourd ,et ses discours se ressentaient d
’
un affaiblissement moral .C
’
étaien t les signes précurseurs de sa fin qui eut l ieu à Turinl e 9 fév rier 1868 . Il tomb e frappé d
’
apopl exie au m i l ieu de
sa fam il le .
A Turin il présidait plusieurs grands établissem ents pieux .
Il avait été longtemps membre du consei l mun icipal , et partout i i laissa un souv en ir honoré .
E n 1855 le Roi V icto r Emanuel av ait o ffert a lui et àCésar Balbo de former un m in istère conserv ateur . I l avaitdécliné respectueusement , mais décidémen t cet honneur, disant avec sa noble franchise que l
’ opin ion dom inan te étaittrop contraire â ses conv intions .
XI .
Le Maréchal de R êve] .
Nous ne consacrerons pas un long article au Maréchal deR èvei parcequ
’ i l mourut dans l es premières années de ce
Règne , et dans ce court intervalle n ’
exerça pas une influencemarquée dans l e gouvernement .
L e chevalier Ignace de Rêve] , Comte de Pralungo , avaitété jadis envoyé du Roi auprès de l a république française .
Aprés le départ du Roi , i l se reti ra simple propriétaire dansson domaine de Cimena près de T urin , s
’ occupe d’
agricul
ture , è lev a av ec soin sa fam il le et vécut la dans le médiacrité et l
’ indépendance jusqu’
en 18 14 .
Au retour de la maison de Savoie il ren tre dans son graded
’ officier général , fut -‘
envoyé en 1815 comme comm issaireroya l pour prendre possession du Duché de Gênes , puis dev intsuccessivem ent v ice—Roi de Sardaigne et m inistre d ’ état , lieutenan t génèral du Royaume en 1821 , gouverneur de Turinet Marécha l .L e Roi Charles Albert ayan t créé le conseil d ’ état l ui en
confia la v ice—prés idence .
C ’ était un homme loyal , éclai ré , intègre , et très-m odéré ,un beau v eil lard , sec, droit , p lein de v igueur , à riche che
velure blanche comme neige , à physionom ie nob le et v ive .
Il avait consigné ses O pin ions pol itiques dans un liv re
publié par lui , mais très-peu répandu , où il décrivait les inconvénien ts des d iverses constitutions , et concluait pour lasupériorité de la monarchie pure accompagnée toutefois de
XII .
E tienne Gal l ina.
Etienne Gal l ina , issu d’
une fam i lle bourgeoise de Marcue
près de S av i l lano en Piémont , fut nommé m in istre des financessans l e t itre plus modeste et en apparence prov isoire de ré
gent en 1834 . Il avait al ors 35 ans .
C ’ était un b e l homme de haute tai lle et de bonnes man ières , parlan t
“ bien , d’
un maintien d igne , quelquefois dur et
cassan t .
I l avait commencé sa carrière comme v ol on tai re dans l e
bureau du Procureur Général du Roi , y était devenu sub
st itut , e t ava it acquis dans l ’ exercice de cette charge , alorsimportante, une réputat ion distinguée de talen t et d
’
in
struction , soit dan s l es mat ières de jurisprudence , soit surtouten adm in istration et en politique .
Il s’ était alors form é dan s la m agistrature P1emon taise
une pléiade de jeunes gens a instruct ion v ariée , à idées pluslarges et progressives , qu i contrastait av ec l es magistrats dela v ieil le roche , respectab les sans doute , et interprètes auss istudieux qu
’
in tègres de l a loi , mais dédaignant toute cultureétrangère à la science pure et austère du droit .
Etienne Gall ina était un des suje ts m arquants de la nou
v el le éco le , et ses études s’ étaient surtout portées v ers l
’
ad
m in istration et le contentieux adm in istratif , sans exclure la
part des lettres et des arts .
Il é tait d’
une intégrité et d’
une délicatesse extrêmes ,encl in à un système de gouvernement const itutionnel , mais
— 93
r igide conservateur du principe d’
autorité . Il v oulait dansl
’
adm in istrat ion une stricte économ ie et une d iscipline sév ère ;il aima it l e progrès , mais a pas m esurés et sûrs ; enfin il
a imait profondément son pays .
A côté de ces bonnes qual ités , i i offrait quelques défauts ,quelque chose de dur et d
’
aride dans le caractère , et une
indécision d ’
esprit , qui provenait p rincipalem ent de ce qu’
etu
d iant a fond l es quest ions i l s’
en représen tait v ivement l ecôté faible , de sorte que i l se préoccupait d
’
une foule dedifficultés qui èchappaient a d
’
autres . Ce dern ier défaut,croissant avec l ’ âge ,
lui nu isit essentie l lemen t dans la ge
s tion des affaires publiques .
T el é tait Etienne Gal lina qui tin t dans ses mains l es
finances de l ’ é tat depuis 1835 jusqu’
en 1844.
L e Roi Charles Albert l ’ avait créé Com te et avait en lui
une grande confiance .
E n 1821 Gallina avait craint que ses opin ion s l ibéra les l erendissen t suspect au gouv ernement du Roi Charles Félix .
Il avait ém igré pour quelque temps à Rome et à Naples avecson am i Charles de Perrone et quelques autres jeunes gens
qui se trouvaient dans l e m ême cas . Mais il retourna bientôt ;car personne ne pensait à l
’ inquiéter , et l e Com te de Cho lex,
qui éta it homme d’
esprit , n’
hésite pas a le destiner jeuneencore a l a charge de substitut du Procureur Général .Lorsque Charles Albert monta sur le trône en 1831 , lui
qui , comm e Prince de Carignan , s’ était in formé de ce qu ’ il
y av ait d ’
hommes d ’
av en ir dans l e pays , ne pouv ait à moinsde connaître l a réputation de Gal lina . D ’
ai lleurs Dégub ernatisson secrétaire privé , et Castagnet intendant de sa maison ,
ancien collègue de Gallina, lui avaien t fai t de justes élogesdu jeune magistrat .
Il l ’
avait d ’
abord appel é â s1eger dans que lques comm issions , dans une entr ’
autres qui devait étud ier les améliorations â introduire dans l e grand hôpital de Turin , dit de
saint Jean . L e Com te Caccia ayant été nommé m in istre des
finances , Gal lina fut attaché à son cabinet d ’
une man ière
prov isoire , puis créé prem ier officier de ce m in istère . Caccia
94
était v ieux et usé ; le poids des affaires tomba sur Gall ina.
Caccia é tant mort après une courte gestion , l e poste de mi
n istre resta quelque temps découvert, et Gal l ina en exerçal es fonctions à la grande satisfaction du Roi . Cependant leportefeuil le ne lui reste pas ; i l f ut confié au Comte de Prelorme , ancien m in istre du Roi auprés de l a Cour de V ienne ,h omme d ’
un grand sens, mais étranger aux détails de l’
adm i
n istrat ion financière. Gall ina reste son premier officier , mais
en réalité son aide tout—puissan t . Il sut se ménager dans
cette position délicate de man ière à dev en ir son confidentet son am i .
Enfin en 1834 le Comte de Pralormo passe au m in istèrede l ’ intérieur et Gall ina lui succède aux finances .
Il s ’
attache surtout a moral iser l ’ adm in istration en él i
m inant quelques rares ind iv idus qui avaient manqué de dél icatesse . Il y in troduisit l ’ esprit de légalité ; car celu i d
’ ordrey était déjà . Les finances , adm in istrées en général par des
chefs et des employés génois depuis 1 817 , étaient complètem ent ordonnées . Seulement ou se plagnait en Piémont de ce
que l’
espri t fiscal y préva lût , de ce que l ’ élément légal ,autrefois prédom inant dans l
’
admin istration piémontaise , s’
y
m ontrât en revanche trop peu .
Gal lina donna une nouve l le impulsion à la gestion des
domaines de l ’ état, surtout a celle des canaux d’ i rrigation ,
desquels i l obtin t l e double résultat d ’ étendre l es bienfaits del ’ irrigation au profit de l a richesse nationale et d
’
augmenterl es redevances en faveur du trésor .
Il am éliore graduellement les tarifs des droits sur l es
actes publics , enregistrement au insinuatian , succession , timbre,droits judiciaires .
Il m odifie successiv em en t et a plusieurs reprises l e tarifdes douanes , faisan t chaque fois un pas vers la liberté du
commerce et un accroissement de revenu pour l’ état .
Sous son m in istère , la fabrication des tabacs parv int à unrare degré de perfectionnement qui en augmente considérab lemen t 1a consommation et l
’
exportation a l ’ étranger .
L ’ institution des d irections porte plus de lum ières , d’
unité
— 96
au Roi de reconstituer séparés l es départements de 1 1ntérieuret des finances , ce qui fut fai t aussitôt .
Gallina reçut alors la croix du mérite civ i l et l a dign i ténom ina le de prés ident-chef des archives . U n s iège lui fut
conservé au conseil du Roi . Ces récompenses étaient duesaux serv ices ém inents qu ’ i l avait rendus en neu f ans de m i
n istère . Mais i l se re tira comp létem ent des affaires , et ne
reparut au Conseil que quand i l y fut inv ité en 1848 pour laconcession du statut .
S on op in ion en cette circonstance fut qu ’ on se bornât àétablir des garant ies générales de l iberté , réservant l es dé
tails de la constitut ion a un examen ultérieur et plus approfondi . Ce v ote reste isolé . Tous pensaient qu
’
en pare il le matière i l était de b onne politique de concéder tout à la foisce qui pouvait être concédé et de faire un édifice de toutespièces , afin d
’ év iter des t iraillements u ltérieurs , qui auraienttenu le gouvernement en un . continuel échec et affaibli son
autorité .
I l fut ensuite appelé à présider la comm issi on qui rédigeala l oi électorale .
Gal lina devait entrer au sénat dans l es premières nom inations ; mais i l préférait être député . Il v ou lut tenter et i léchoue . C ’
est ainsi que sa nom inat ion de sénateur eut lieu
plus tard .
Au sénat i l parle rarement, toujours avec finesse et hauteurde vues ; p lus d
’
une fois avec indécision . Cependant on lui
reproche parfois de ne pas conclure , lorsque son b ut n’
avait
pas été d’
arriver à une conclusion , mais seulement de m ettreen avant certaines observations crit iques , m ême p iquan tes et
très-graves dans la substance , qu’ i l aimait à faire passer sous
une forme nuageuse et d’
une man ière détournée .
E n 1849 l e Roi lui confie la légation de Paris . Il l ’
ac
cepta après quelque résistance , s’
y dègoûta et rev int bientôtà Turin . Ce fut la fin de sa carrière active . Il se retira alorsavec la dign ité de Ministre d
’
E tat .
Gallina ,quoique robuste avait été beaucoup affaibli par
l es cures énervantes que lui avaient imposées l es ocu l istes .
Devenu obèse , chargé d’
humeurs , presqu’
av eugle, i l se trainait avec peine . Il fit une dern ière apparition au sénat qui
avait été transféré à Florence pour prêcher l’ économ ie , cam
battre certaines m esures financières et avert ir le pays du
péril de la banqueroute .
Accablé d ’
infirm itès , il s eteign it à T urin l e 1°
d’
avri l 186 1 .
Il avait épousé , après sa sortie du m in istère , une jeune et
r iche personne appartenan t au haut commerce , femme de
mérite , qui élèvera des enfants dignes de l ui .
XIII .
L e Maréchal de l a T our.
V ictor Sellier Com te de la T our appartenait à une fa
m ille savoiarde sortie de l ’ obscurité a la fin du 17°
s ièclepar le mérite d
’
un abbé Se ll ier qui parv int aux p lus hautespos itions diplomatiques . L es Sel l ier, qui eurent alors le fief
de l e Tour et en prirent le nom ,occupèrent successivem ent
de grandes charges soit m ilitaires , soit civi les .
L e père de celui dont nous parlons commandait en chef1
’
armée royale en 1800 ,l orsqu ’
elle fut l icenciée. Au retourdu Roi en 181 4 i l fut élevé à l a dignité suprême de Maréchalde Savoie , qui n
’
avait plus été con férée depuis l a mort duMarécha l R ehb inder , c
’
est—â-dire depuis près de 80 ans .
L a fam i lle de l a T our était au plus haut point de splendeur lorsque la révolution française l a força à ém igrer deSavoie . S es biens furent confisqués . Il ne resta guères au
v ieux général que sa charge au serv ice du Roi , et commeelle lui manque encore i l fut réduit à v ivre bien pauvrement .
S on fil s s’
ev isa alors de prendre serv ice en Angleterre .
Il était jeune , d’
un esprit ouvert , aventureux comm e celuiqui n
’
a que son épée . Cette pensée d’
avoir joyeusementaffronté l ’ adversité lorsqu ’ il se jetait en avant sans autreressource que son épée l ui souriait encore dans son extrêmev ieillesse.
Doué d ’
une intelligence fine, d’
un esprit posé , d’
un calme
phi losophique , i l devait plaire aux Anglais et s’
assim iler fao llomont leurs idées et leurs moeurs . Il était parvenu au
100
i l tenait aux anciennes idées sur 1 1mportence d’
une aristocratie , l
’
utili té des majorats et des fidéicomm is , la répressionen matière rel igieuse , le maintien des anciennes lois sur les
rapports avec l ’
E gl ise .
Il préside le consei l jusqu ’
en 1850, qu ’ étant devenu
presqu’
aveugle , i l demanda à s’
en reti rer. I l avait renoncé ,depuis le commencement de 1848 , a le charge de gouverneurde Turin , qu
’
i l avait constammen t exercée avec dignité et
modération .
L e mouvement des esprits en 1847 avait effrayé l e v ieuxMaréchal . Il en v it d
’
abord l es conséquences , et , dans une
l ettre adressée au Roi , i l lu i consei l lai t l’
al ternativ e de décl arer la guerre à l
’
Autriche , ou de proclamer une con
stitut ion .
L e Marécha l , n ourri des idées anglaises , avait déjà m ontréen 1820 des dispos itions à accepter un régim e con s titutionnel ,im ité de l
’
Angleterre . Il n’ é tait donc pas étonnant que,
malgré ses tendances conservatrices , i l se p l 1at en 1847 àsuggérer un parei l système pour sauv er l a m onarchie, qu
’ ilcroyait menacée. Mais l e Roi n ’ était poin t décidé et moinsencore prê t à en treprendre une guerre contre les An trich iens , e t , d
’
autre part , conservant son av ersion au système
parlem en tai re , i l ne pensait pas qu’
i l put être contrain t de
l’
introduire . I l dut changer d' opinion peu de m ais après , et
alors le Maréchal de la Tour fut naturel lem ent appelé dansl e gran d consei l où fut décidé l e changement de gouv ernement . Par sa dign ité i l fut l e premier à v oter . S on v ote futaffirmatif sans hésitation et sans réserve .
Nomm é membre du sénat i l prit part aux prem iers actesde ce grand corps avec l a m ême aisance et la m ême séré
n ité que s’
i l y eût siégé toute sa v ie . Ce n’ était pas un
orateur ; mais quand i l parlait , tous s’
empressaient autourde lui pour recueil lir sa parol e simple , cou lan t de s ource ,portant en même temps un cachet de d ist inction , de finesse
et de loyauté , emprein te aussi d ’
un grand b on sen s , d’
une
modération inal tèrab l e et d’
un véritab lè patriotisme . S es d i
scours étaient parfois l es conseils , l es avertissements d’
un
— 101
octogénai re a ceux qui avaient m oins vécu et m oins v u. Ce
ton paternel ne déplaisa it pas parcequ’ il émanait d ’
un hommequi avait passé a travers beaucoup plus d
’
affaires et de d if
ficu l tés qu ’
aucun de ceux qui l’
ècoutaien t , et parcequ’ i l
n’ était pas accompagné d
’
aucune prétention , d’
aucune m orgue .
L a loi qui en leva au c lergé l e priv il ège du for eccl ésia
stique fut v ivemen t combattue par le v ieux Maréchal commeétant le commencemen t d 'une lutte avec le Saint Siège . Iln e fut pas moins contraire à cel le qui eb o l it l es ordres re
l igieux purem ent contemplatifs . Ces mesures alarmaien t sa
conscience et l’
effray aient en ce sens qu ’ i l l es regardaitcomme un pas dangereux vers la révolution sociale .
I l parle contre l’
expéd ition de Crimée , parceque , disait—i i ,i l fal lait présen ter les objection s que cette démarche gravesoulevait ; m ai s au fond i l ne d isconv enait pas qu ’ i l pouvaiten résulter un changemen t de pos it ion avantageux au pays .
I l s’
éteign it à Turin l e 19 janv ier 1858 âgé de 85 ans.
I l avait serv i sous six Ro i s, et occupé sans quatre l es p lus
hautes cha‘rges .
U n fait peu connu con tribue san s doute à la haute con
fiance qu ’ il conserve sous les règnes de Charles Fé l ix et de
Charles A l b ert. Avant d ’
accepter l e portefeuille des affairesétrangères en 1821 , l e Com te de l a Tour avait déclaré au
Roi que si sa pol itique portait , comm e l e bruit en avaitcouru , d
’
amener la succession au trône d ’
un Prince étrangerà la maison de Savoie , l ui La Tour , n
’
aurait pas cru que sa
conscience lu i perm i t de travail ler dans ce sens , et qu ’
en
conséquence i l n’
aurait pu dev en ir m inistre des affai resé trangères . Charles Fél ix approuve sa loyauté et l e rassure .
Charles Félix , quoiqu’ il n ’
aimât pas le Prince de Carignan ,
s’ é tait hautemen t prononcé contre toute autre candidature a
sa succession . Tout inerte et insouciant qu 1 1 était , il tenaitde ses ancêtres l ’ amour du pays et l e sentiment de l
’
indé
pendance nationale .
XIV .
L e Comte de Castagnet .
César Trabucco , cheval ier puis comte de Castagnetta , né
au commencement du siècle d ’
une fam i l le piémontaise de no
b lesse distinguée , déb u te dans la magist rature . I l é tait sub
st itut du procureur général du Roi av ec ses am is Octave deR èv el et Gal lina , lorsque Charles Al b ert , Prince de Carignan ,
l e choisit pour intendant de sa maison . Ce Prince étant dev enu Roi peu de temps après , Castagnet dev int Intendant Gènèral de la Maison Royale , puis i l succède à Dégub ernatisdans la charge délicate de secrétai re privé de sa Majesté .
Castagnet , actif , discret , honnête, ayant assez d’ instruct ion
et de capacité pour traiter toute sorte d’
affaires , sans cettehaute supériorité qui eût peut- être fait ombrage , gagna ent ié
rement la confiance du Souverain , qu i l e m êle jusqu ’ à la fin
de son règne aux secrets les plus intimes de sa cour et de
son gouvernement .
Castagnet étai t d’
une dévotion scrupu leuse et quelque peumystique , en harmon ie avec l es tendances ascétiques de
Charles Albert . I l avait pour l a personne du Roi un de ces
dév ouements qu i sont rares en tout temps et rariss im es dansl e nôtre ; attaché par sentiment et par conv iction à l e monarchie , i l s
’
associait toutefois aux aspirations du Roi a le couronne de fer, quoiqu
’ i l fal lût , pour l’
acquérir, gagner l e concours des lib éraux et faire des concess ions l ibérales . Ainsii l était un in termédiaire secret entre l e Roi et l es patriotesl ombards ; ain si en 1846, au congrès agricole réun i à Casal ,
ment i l se croyait agronome , et ses S pécu lations agricolesle m inèrent, ce qui lui attira dans sa v iei l lesse beaucoup dechagrins .
Le Comte Barb aroux .
Charles Albert avait un v éritable respect pour le Comtede Barb aroux. A sa mort . i l fit faire son portrait qu
’ il tenaitdans ses appartements .
Barb eroux était fi ls de ses oeuv res . Il avait commencé parentrer au barreau come prat icien de l ’ avocat T onso trèsestimé a cette époque comme un type de sagesse , de doc
trine et d’ intégrité . Barb eroux lui succéda dan s son étude
et dans sa réputation . Il parlait et écrivait peu , mais allaitd
’
abord au fond des quest ions av ec une sagacité et une ln
cidité d’
esprit admirables . Conciliant , honnête et con scien
cieux jusqu ’
au scrupule , ou recourait a lui comme a une
espèce d’
oracl e b ien faisaut et paterne l .L e Roi V ictor Emanuel I , voulan t organ iser la just ice à
Gênes , le t ire de son étude pour l e placer à la t ête du m i
n istère publ ic . Charles Félix l ’
en leva a la magistrature pourlui confier la légat ion de Rome , et le nomma ensuite son se
crétaire de cabinet . C ’ était une charge très-importante eu
près d’
un Roi qui passai t la majeure partie de l’
année horsde la capitale , et qui , pendant son séjour à Gênes à Chamb éry et a Nice, receva it l es rapports de ses m in istres parl ’ intermédiaire de son secrétaire de cabinet . L e Comte deBarb eroux, car l e t itre de comte lui avait été conféré ,s
’
acqui tta de ses fonctions dél icates avec tan t de prudenceque les m inistres n
’
eurent jamais qu’
à s’
en l ouer , et le Roi
de son côté lui témoigne sa satisfaction en lui con fèren ten 1830 la dignité de Ministre d
’ état.Charles Albert , parvenu au trône , s
’
empresse de créerun m in istère de la justice et d
’
y appeler le Comte Barb erouxav ec le titre de garde des sceaux . Le nouveau m in istre avaitdevant lui un travai l immense ; toute la législation a refaire
Malheureusemen t l e m anuscri t ne v a p as p lus l o i n .
108
formes cousti tutionnel les . Mons ieur de l ’ E scaréue avait ‘
a peu
près les m êmes tendances et l e m ême vague dans les idées .
C ’ était bien l ’ homme qu ’ i l lui fa l lait .
I l chois it pour son premier officier Manno , qu’ i l fit ensuite
b aron , homme d ’esprit , homme de l ettres , brillant écrivain ,
h istorien est imé de l a Sardaigne sa patrie , mais esprit peu
pratique , étranger aux dé tails d ’
admin istration et peu versédans l es é tudes adm in istrat ives .
Il s ’
assure la coopération , c omme écrivain , de l ’ av ocatGioannetti de Novare, autre homme de talen t plus brillan t
que profond . Celui-ci devait pub l ier des brochures pour éclairerl ’ O pin ion et la préparer aux réformes uti les .
Bien tôt v in t en jour le plus grand acte de ce m in istère ,l a créat ion du consei l d ’ é tat , grand corps consultat if , im itéjusqu ’ à un certain point de celui de Napo léon pr
‘
emier, composé de membres nommés par le Roi et amov ibles , appelé a
donner son a vis sur l es projets de l ois et de règlemen ts gènéraux , sur l e b udjet et l e compte rendu de chaque m in istère ,sur l es contrats à stipuler dans l
’ in térêt de l ’ état .L ’ innovation fit une impression très—favorable et très—
grande .
O n y crut voir un contrôle puissant contre le gouvernement ,un pas avancé v ers la l iberté . Aussi l e pub l ic fut— i l dou loureusement désappointé , lorsqu
’
une lo i , qui devait régler la
procédure du consei l , v in t introdui re des dispositions cen teleuses pour lui interdire toute v elléité de se donner tropd
’ indépendance .
L es choix du personne l achev èrent de dissiper l’ i llusion .
Car il s furent tous de personnages à O pin ions conservatrices ,et que lques uns l es professaient à un degré trés —marqué , outrequ ’ ils étaient am is personnels du m inistre .
L ’ insti tution é tait néanmoins un progrès considérab le et
un bienfait essent iel pour l e pays .
L’
E scarène at tache encore son nom a la création de
l ’ ordre du mérite civ il à la réforme de celui de S. Maurice ,a la création du com ite d
’
histoire nat iona le , â l’ insti tution
d’
un recuei l officiel des actes du gouv ernemen t .Il encouragea des études pour l a ré forme des oeuv res pies ,
— 109
pour l’
abolition des taxes qui l im itaient l e prix des v iv res ,e t en général pour l
’ introduct ion de la liberté commerciale .
Pendant que l e public éc lairé se réjouissait de l e v ie nou
v elle a1n 31 imprimée en pays , i l commençait à s’ inquiéter de
certains rapports entretenus par le m in istre et surtout par sa
femm e avec l es pères j ésuites , de leur int im ité avec quelquepersonnage réputé réactionnai re , des bruits qui circulaientdan s une certaine sphère sur des mystères de police . U n
fait sai llan t v int tout—â—coup augmen ter les inquié tudes .
Monsieur Dégub ernat is secrétaire particul ier du Roi , hommeâ tendances libéra les , mais m odéré , dévoué au Roi et à la manarchie , plein d
’
honneur et de probité , estimé de tous poursa haute capacité et ses v estes connaissances , inv ité par l e
Roi a se rendre en v il légiature auprès de lui a R acon is , ytrouve en arrivent l es portes fermées et reçoit l ’ av is qu ’ ila perdu sa charge . U ne intrigue parten t de haut av ait é loignédu Roi ce fidèle conseil ler . Enfin on v it avec peine un romain ,
de la fam i l le Peace , a précédents équiv oques , appelé à la têtede la police ; et l es choses furent portées en point qu
’
une
l iste de personnages suspects en politique , dressée par Peacefut présentée au Roi , lequel fut bien étonné d
’
y voir l esnom s les plus respectables de son entourage. Il envoya im
m édiatement l e Com te de la Marguer ite sign ifier a L’
E sca
rêne qu ’ il était m is a l a retraite et engagé à quitter Turinen plutôt . Pacca reçut l ’ ordre de sortir imméd ia tem ent del ’ état .
L’
E scarène , retiré à Nice av ec sa femme , y passa paisiblem ent le reste de sa v ie , jouissant de l ’
aisance que lui
procuraient les avoirs de son épouse et l es riches pensionsdon t le Roi l ’ avait grat ifiè , sans plus se mêler d
’
intrigues
polit iques . C ’ était dans la v ie priv ée un v ieillard aimable , acon versation agréable et in structive . I l mourût à l ’ âge de85 ans et v it
, d i t-on , sans en être étonné ou fâché , l’
avène
men t du régime constitut ionnel .
XV II .
Le Comte de Pral ormo.
L e Com te de Pralormo était un homme comme on en ren
con tre peu. Laid et bourru i l a réussi en diplomatie . N ’
ayant
n i des études sérieuses de théorie , n i pratique suiv ie d’
ad
m inistration ,i l a été un des m inistres l es p lus remarquables
et l es plus uti les . Avait- ii du gén ie ? non ; beaucoup d’
esprit ?non plus . Mais l a nature lui avait donné une abondance non
commune de ce qu’
on appelle l e sens commun .
O n pourrait dire qu’ i l fiairait ce qu ’ il convenait de faire .
S an b on sens lui indiquait les besoins et lui faisait pressentirl es d ifficultés poss ibles . S on tact exquis lui indiquait l es moyens d ’
y parer.
Ainsi i l date l e pays de plusieurs lois très-importantes et
très—utiles dont la pensée était excel lente , dont les détai lslaissèrent parfois à désirer, parceque les connaissances luimanquaient pour s
’ occuper des détails .
L a p lus remarquée fut la loi sur les établissement de bienfaisance et l es oeuv res pics en général . Ces êtres morauxavaient été jusques—là, sous l e double tutelle du cl ergé et dela magistrature. L a nouvelle loi sub stituait l ’
ingérence de
l ’ adm in istration a cel le de la magistrature ; el le régularisaitcette ingérence , qui devait respecter les organ isations étab l ies par l es fondateurs , mais les soummettre e un contrôlepour l a comptabil ité . L a tutelle ecclésiastique était restreinteaux mat ières de compétence ecclésiastique , sauf les cas où l esf ondateurs lui eussen t donné une majeure extension . O n avait
XV III .
Le Comte de l a Marguerite.
Clément Solar Comte de l a Marguerite a été m in istre desaffaires é trangères du Roi Charles Albert depuis 1835 jusqu
’
en
oc tobre 1847 . Il est mort m inistre d ’ état en 1 869 à l ’ âgede 76 ans .
I l n’ était poin t de la fam il le il lustre des S o lar d
’ Asti ;mais i l descendait du Com te de le Marguerite lieutenan t général qui a soutenu glorieusemen t l e siège de Turin en 1706
et qui en écriv it l’
h istoire .
Destiné d ’
abord a la magistrature i l avait été v olontaireau bureau de l ’ avocat général de Turin ; mais il s
’ occupaitde l ittérature et de poés ie et abhorrait de tout son coeurl es dossiers de procès . Il fin it par entrer dan s la diplomat ieet en parcourut la carrière jusqu
’ à la charge ém inente d’
E n
voy è et Min istre Plén ipotentiaire a l a Cour d ’
E spagne .
Lorsque l e Com te de la Tour quitta l e m in istère des af
faires étrangères , l e Roi réservait ce portefeuille en Comtede S amb uy alors m inistre à V ienne ; mais comm e ce dern ieré tait absent et ne pouvait sans inconvénien t laisser en ce
moment l e poste de V ienne , l e Com te de la Marguerite , quise trouvait al ors à Turin en congé , fut chargé de gérer
prov isoirement le m in istère.
Il développe alors ses aspirations à un aven ir plus ou
moins éloigné dan s leque l l a Couronne de fer pût être placéesur la tête de son Souv erain , et le Piémont ren forcé pût
m ieux ten i r tête a l a prépondérance autrichienne . Il plut et
resta m in istre.
1 1 3
Comme tel le Comte de la Marguerite ne pouvait pasfaire grand chose dans le sens des aspirations qui lui av aientsi b ien servi . I l se b orne à ten ir envers l ’
Autriche commeenvers les autres grandes puissances une att itude indépen
°
dante et digne .
S on m in istère fut d ’
une louable act iv ité pour établir destraités de commerce avec un grand nombre d
’ états , pour
généraliser autant que possible l’
abolition des droits d’
au
baine et autres v exations qui pesaient sur l es rapports internationaux De nouveaux consulats furent créés ; des m issionsutiles furent aidées et protégées . L es colon ies de nationauxà l ’ étranger se multiplièrent et se renforcèrent au grandavantage du pays . L e pav i llon sarde flotte sur presque toutesles m ers .
Le Marguerite porta l’
esprit d’ ordre et de détai l dans
l ’ organ isation du m in istère et des légat ions . Il fit de l e,di
piamatia une carrière ferm ée , ou presque , aux profanes , ce
qui avait de graves inconv énients , et il n ’
apprécie pas assezl es serv ices que rendaient a leur man ière un peu indépen
dante deux homm es de grand sens et de grand caractère , leComte d ’
Agl iè ministre à Londres , l e Com te de Sales em
b assadeur a Paris . Ces diplomates em inents se ret irèrentdégoûtés .
Mais ce qui marqua surtout l e m in istère du Comte de laMarguerite , ce fut son ingérence dans les a ffaires eccl ésia
stiques . Ces affaires entraient dans les attributions du Gardedes sceaux, l equel était seulement dans l e cas de recourir àl
’ interm édiaire du m in istre des affaires étrangères pour la
correspondance avec l a Cour de Rome
( 1 ) I ci fin i t l e m an uscri t. E n parcouran t l es autres b i ograph ies et d’eu
tres chap i tres ou pourra recon s tru i re par l e pen sée av ec une exact i tude
ap proxim at iv e un e p artie de ce qu i m anque à ce l l e-ci .
XIX .
Les réformes ecclésiast iques
dans l es états du R oi de S ardaigne.
Sous les faibles descendants de Charlemagne l’ influence
que ce monarque avait donnée aux évêques et aux chefsd
’ ordres monastiques dev int immense . I l s fin irent par se con
stituer en v éritables puissances , soit au spirituel , soit au
temporel .Lorsque l a maison de Sav oye commença à paraître au
nombre des souverains qui s’ élev èrent sur l es ruines du
second royaume de Bourgogne , les év êques de Genêve , de
Tarentaise et de Maurienne, souverains eux—m êmes dans leursrésidences , riches et puissants au dehors , étaient les principauxmaîtres du pays qui dev int plus tard le duché de Savoye . E n
Piémont l es év êques de Turin et d’ Asti , d
’
Aoste , d’
I vrèe et
de V erceil jouaient aussi un rôle très important , quo iqu’
è
cl ipsé par la grandeur et la richesse des Marquis de Turinet d
’
I vrèe .
Mais l es populations qui avaient d’
abord accepté et peutêtre recherché la protection et la domination des évêquesse lassèrent avec l e temps du gouvernement sacerdotal ; ellesaspirèrent peu a peu à deven ir l ibres et le mouvement
(1 ) L es Marqu i s de Turin con nus sous l e n om de Marqui s de S use
étaien t s i riches que l e dern i er (I’
eux O l deric-Maiu fro i rend i t par un seu l
acte con servé aux arch ives un m i l l ion d’arp en s de terres s i tuées en d iv ers
pay s d’
I tal ie.
O e p ri nce av ai t fai t d’
én orm es l argesses aux m onastères. L’
ab b ay e de
8. Just avai t en de l u i p lus de 15000 arpen s de b ien s—fon ds .
— 1 16
D’
autre part les Empereurs avaient peu-â—peu concédé aux
prédécesseurs de ce Prince et à lui-m ême la qualité de V i
caire de l ’ E mpire dans la plupart des pays qui composentaujourd ’
hui la Savoye et l e Piémont, ce qui leur con féraitl a juridiction suprême sur l es évêques
‘ comme princes tem
porels et était même considéré comme attribuant au duc de
Sav oye le droi t de recevoi r l es appels comme d’
abus des
jugemens prononcés par les tribunaux ecclésiastiquesAinsi l e clergé se trouvait réduit à une véritable dépen
dance envers l es ducs quoique ces dern iers continuassent aév iter toute occasion de conflit .
Dans le XV I"siècle l es f rançais conquirent sur l e Duc
Charles l e Bon l a Sav oye , puis le Piémon t et y introdui
s irent les usages et l es libertés de l ’ église Gallicane . L es
Parl emen s qu ’ ils é tablirent à Chambéry et a Turin l es ap
pl iquèrent imméd iatementL e célèbre Emanuel Phil ibert fil s et successeur de l
’
in
fortuné Duc Charles , ayant récupéré ses états par suite de
l a v ictoire qu ’ il remporte â Saint—Quentin sur les Françaiscomme général des espagnols , convertit en S én ats l es Par
lemens institués sous la dom ination étrangère et ces corpsjudiciaires conservèren t à peu près les maximes gal l icenes .
El les ne con tinuèrent cependant à être en v igueur ouver
tement et dans leur intégrité que dans l es prov inces soum isesau sénat de Sav oye .
Ainsi les décrets du conci le de Trente intitul és de reform atian e, c
’
est—â—d ire ceux étrangers au dogme , n’
ont pas
été reçus dans l e ressort du séna t de Savoye et l ’ ont étédans celui du sénat de Piém ont.
A l’
exemple de ce qui était établi en France depuis Sain tLouis , Emanue l Ph i libert assujèt it par un éd it toutes l es mainsm ortes ecclésiastiques au autres a un droit d ’
am or ti ssem en t
envers son trésor . C ’ était un impôt sur l e capital que l a
ma in morte payait lorsqu’
elle acquérait un immeuble en vue
(1 ) Mém o i res préci tés t . I , pag. 124.
(2) O n en t rouv e p l us i eu rs exem p les rem arquab l es dan s l e recuei l m a
n uscri t qu i est i n t i tu lé Pra t ique ecclés ias t ique d u S én a t d e S a voy e.
de l ’
autorisation que le Souverain lui accordait dele posséder.
Il ne fut introduit que dans le ressort du Sénat de Sav oye.
L e Duc E m . Philibert enfin , par un autre édit de 1563 , déclara l es ecclésiastiques tant sécul iers que régul iers incapablesde recuei ll ir des successions . L e Duc E m . Phil ibert avait un pouv oir immense dans le pays . O n l e considérait comme l e re
staurateur de la nationalité et i l était de plus le créateur del
’ ordre intérieur et de la bonne adm in istration . S on autorité surl es peuples était telle qu
’ il put abolir les é tats généraux sans
exciter le moindre trouble . Les mesures dont la cour de
Rome ou l e clergé de l’ état auraient peut—être fait un sujet
de plaintes sous un autre règne , ne rencon trèrent aucunobstacle sous celui-ci . Emanuel se montrait d ’
ail leurs p leind
’ égards pour le clergé . Il accep tait a S .
t Jean de Mauriennel a qual ité de chanoine de la cathédrale , prenait possessionde sa ste l le en choeur en rachat et en camail et répondaitau d iscours de réception du chapi tre qu
’
i l av ait toujoursprotégé l
’ église.
Sous son fil s , l e remuant et fougueux Charles Emanuel ,un conflit surgit avec l ’ autorité ecclésiastique au sujet del ’ impôt foncier. L e clergé de ses états prétendait cont inuerà en être exempt comme i l l
’
av ait été par le passé et commeil l ’ était généralement en Europe . L es peuples se plaignaien tamèrement de cette exemption qui faisait refluer l ’ impôt sur
l es autres terres et devenai t toujours plus onéreuse a l a
masse des contribuables a mesure que l es richesses du clergés
’
augmentaient . L e souverain crut devoi r arrêter l e mal et
fixer une époque a parti r de laquelle toute nouv elle possess ion acquise par la main morte ecclésiastique fût sujette àl
’ impôt selon l e droi t commun .
O n prit pour point de départ l’
an‘
1606
Au reste le Prince fut , comme son père , en paix avec lacour de Rome . Comme lui , d isait Contarin i ambassadeur de
( I ) L a Cour de R om e n e rat i fie cet te m esu re qu’
en 1727 en co re v ou lut
e l le év i ter d e l u i d on n er un e p lei ne sanct io n et d an s cet te p en sée, au l ieu
d e fai re remo n ter so n app rob at i o n à l'
an 1606, el le affecta de cho i s ir un e
autre date, Qu i fut cel le d e 1620, comm e on l e verra p lus l o i n .
1 18
V enise, il est fort aimé du Pape qui le cons 1dère comme l egard ien des portes de l
’
I tal ie, comme le champion du S .
t Siègeet l
’
adversaire du Pro testantisme.
E n effet la maison de Savoye avait constamment travaillédepuis un siècle soit à empêcher que l es nouve l les doctrines
passassent les Alpes , soit a ten ir circonscrite l a secte V audoisedans les V al lées de Pignero l .
Sous le règne bril lant et orageux de V ictor Amédée 11 ,
prem ier Roi de Sardaigne , commencèrent des démêlés sérieuxentre la cour de Turin et le S .
‘ Siège .
Nous n e parlerons pas\de ceux qui concernaient l e royaumede Sicile acquis par V ictor Amedèe en 17 13 . Ce pays étan tbientôt sorti de ses mains la question dont il s ’
agit n’
a p lusaucun in térêt pour l a monarch ie Sarde .
Nous ne parlerons que des débats rela tif s aux prov incesactuelles don t l e prem ier e t l e plus v i f ava it pour objet desdroits purement temporels , c
’
est—â—d ire l a souv eraineté du
territoire de S . Bènigno en Piémont .S .
‘ Bèn igno était une riche abbaye fondée au Xl°
sièclepar les marquis d
’
Iv rée. L ’
abbé é tait souverain du l ieu ,
m ais avait toujours été con sidéré comme relevant de l’
E m
pire . L a maison de Savoy e , en v ertu de son V icariat Impérial ,prétendait y exercer l es droi ts de la Suzeraineté . L es papes ,
au contraire , soutenaient que toutes fois qu ’
une église inférieure ou un é tablissement ecclésiast ique jouissait de droitssouverains il é tait censé que l e domaine suprême au Suzeraineté appartenait à l
’ égl ise de Rome .
L e pape ayant fait quelque acte de possession sur S .
t Bé
n igno , V ictor Amédée chasse ses agents . L e pape alors excom
munie les magistrats et officiers de V ictor Amédée . Celui-cidé fendit d ’
avoir égard à l’
excommunication et persiste dans sa
rés istance . Enfin Charles Emanuel III , voulant en fin ir, adm it
pour la forme les pré ten tions du S .
t Siège et conclut en 174 1avec Beno i t XIV un arrangement par lequel il fut déc laréque la maison de Sav oye exercerait à perpétuité l a p lén itudedes droi ts temporels sur l e territoire de S .
t Bènigno , maisqu
’
à cet effet el le aurait la qua l ité de V icaire du S .
t Siège .
_ 120 _
La nécessité de l ’
exèquatur pour la réception des bul leset décrets pontificaux y fut formellement reconnue en éta
b l issant quelques exceptions I l fut dit que l’
admin istrationdes bénéfices vacans laquel le avait été confiée par l e passéà la Chambre des comptes serait toujours gérée par un
ecclésiastique, et de la naqu it l’ institut ion de l ’ office qu
’
on
appel le écon oma t généra l . O n y confirm e les dispositions éteblies par la maison de Savoye à l ’ égard des impôts dûs parl es biens de l ’ église. O n y règle la faculté qu ’
avait l ’ autorité ecclés ias tique d ’ implorer a son appu i l e bras sécul ier ;ou fixe l a compétence des tribunaux ecclésiastiques, soit en
raison des matières , soit pour effet des priv il èges personnelsappartenans aux membres du clergé , enfin on déterm ine lescas dans lesquels l es malfaiteurs pouvaient se soustraire àl
’
act ion de l a justice en se réfugient dans les églises , et onétablit des règles à suivre par les autorités séculières pourobtenir leur ex tradition .
Depuis lors une paix profonde règne entre la maison deSavoye et l es souverains Pontifes .
L e progrès des temps ayant nécessité quelques dispositionsultérieures sur les matières m ixtes elles furent adoptées deconcert entre l es deux puissances .
C'
est de cette manière que l e concordat de Benoi t XIVfut successivement étendu aux nouvel les prov inces annexéesplus tard a l a monarchie Sarde C ’
est encore ainsi queClément XIV fit des add itions à l ’ instruction de Benoit XIVpour restreindre de plus en p lus l es abus du droit d ’
asilePendant que l es souverains catholiques les uns après les
autres chassaient l es jésuites de leurs états , le Roi de S ar
da igne s’
ab stenait de toute démarche contr ’
eux, et lorsquel e Pape supprime cet ordre en 1773 l e sénat de Piémon t
(l ) R esterauuo eccet tnate l a b a l l e d i p l om at i che i n m ateria d i fade, l e
ha l l e e i b rev i rego lat i v i d e l b en v iv ere e de i san t i cos tum i , l e b a l l e d e i
g iub i l ei e d’
i n du lgen z e, i b rev i del l a S acre p en i tenz ieri a e l e l ettere dal l e
sacre cm gregaz i on i d i R om a che s i scriv on o ag l i ord i n ari 0 ad a ltre per
sone per i n fo rm az io n i .
Bre f du 3 sept . 1 763, au tre du 22 sep t. 1 769.
(3) I n struct ion de Clém en t XI V du 28 jan v ier 1 790.
ayant déclaré que l e Roi avait et qu I l avai t lui seul , lal ibre dispon ibi l ité de leurs biens dev enus vacan s , i l les mit
sous la main d’
une admin istration spéciale , réservant ces
f onds a des usages pieux ou utiles à l’ instruction publique .
A la vérité , quand l e gouvernemen t autrichien supprimade sa propre autorité des couvents de moines dans le Mi
lanais pour en appliquer la dotation à des oeuvres pies et surtout a l ’ hopital de Pav ie , l e Roi de Sardaigne, requis de son
adhés ion à cette mesure à cause des biens que l es maisonsreligieuses dont il s
’
agissait possédaient snr l e territoireSarde , y acquiesça formellement sans s
’ inquiéter de l’
ab
sence du concours de Rome . Mais quand il voulut lui—m êmeabolir des étab l issemens semblables dans ses é tats il se prémun it du consentemen t du Pape .
V ictor Amédée III recourut à Rome en 1782 pour la
suppression des trois riches abbayes des Bénédictins de Citeaux, Lucedio , Casanova et Rivalba, de
'
deux autres d ’
O l iv é
tains , B rême et Précipiano et de deux maisons de V a l lom
b rosaz‘
n s , cel les de S .
‘ Pierre près de V ercei l et de S .
t Bar
thèl em i près de NovareE n 1798 ce fut par un bref du Pape , émané sur la de
mande du Roi qu ’
en t l ieu la suppression des maisonsqu
’
avaient dans ses états l es chanoines de S .
t Jean de Latran ,
l es m in is tres des ma lades et les tr in i taz‘
res chaussés
L a riche dépouille de ces ordres était m ise par le Papea la dispos ition du Roi pour s
’
en serv ir librement en usages
tempore l s .
L a Cour de Rome fit plus dans ces dern ières années de
détresse de la monarchie . Elle accorda au Roi la facultéd
‘
al iéner au profit de l’ état une quan ti té considérable de
biens ecclésiast iques , et , ce qui était à ses yeux une autre
Arch i v es de Cour.
S ous l a date du 9 fév rier.
(3) Ms‘
m‘
s tr s‘
d eg ! inf erm s‘
.
L es chano i n es d e L atran av a i en t 8 m aiso n s et éta i en t om l en ts , l esm in is tres d es m a lad es en av a ien t 3, l es t i i n i ta i res 2. Ces deux dern iers o r
dres étaien t auss i riches .
122
faveur , el le l ui perm it d imposer en général les autres propriétés de l
’ église .
L a monarchie ayant fait place a une république éphém èrepromue et dom inée par celle de France, l e nouveau gouverment supprima peu a peu tous les ordres monastiques et les
bénéfices s imples , déclarant dévolus les biens des prem iers ala nation , ceux des derniers aux fam illes qui en avaient l ejuspatronat . L es religieux furent pourvus de pensions al imen
taires . Les possesseurs des bénéfices en retirèren t l ’ usufruit .
Il ne parait pas que la cour de Rome ai t v ivement réc laméal ors contre ces mesures ni cherché d
’
en empêcher l’
exé
cution .
L e gouv ernement français , qui prit b ientôt après possess ion du Piémont , maintin t l es d ispositions faites par la
‘
répu
b l ique Piémontaise et é tend it au Piémont , de concert av ec/l ePape , le concordat fait par Napoléon en 1801 .
L ’
accord intervenu à ce sujet ne d isait rien sur l es sup
pressions opérées . I l supprimait lui-m ême plusieurs év êchéset procédait en conséquence à une nouvelle circonscriptiondes d iocèses .
Mais l ’ incorporation à la France des états Sardes de terreferm e portait avec elle des conséquences bien plus éten
dues . C ’ é tait l ’
extension à tous ces pays des libertés gall icanes , l
’
abol ition des tribunaux ecclésiastiques en mat ièretemporel le , la reconnaissance du mariage civ il , la tenue des
régistres de l etat civ i l par l’
autorité sécul ière .
E n 1814 la maison de Savoye , réduite jusqu’
alors a son
î le de Sardaigne, récupera ses é tats de terreferm e auxque l s futannexé quelques mois plus tard l e territoire de l ’ anciennerépub l ique de Gênes .
Malheureusement l e Roi V ictor Emanuel rentra dans ses
v ieilles prov inces av ec l es idées d’
une réact ion complètecontre tout ce qui s
’ é tait fait depuis son départ.Toutes l es lois émanées d urant ce long interv al le furent
ré voquées en masse. Institutions , hommes et idées , ou crut
pouvoir remettre en place , comme par l’
attouchement d’
une
baguette magique, tout ce qui existait en 1 798 . L es rap
124
de ces pères , tomba de lui-même au b out de quelquesannées
L e b on R oi V ictor Emanuel avait porté ses idées de re
staurat ion jusqu ’
au po int de recommencer en 18 17 à envoyerannuellement au Pape le cal ice d
’
or dont Charles Emanuel 111s
’
était obligé à faire hommage au S .
‘ Siège , comme v icairePonüfical , en reconnaissance de sa suzeraineté sur les terresde S .
‘ Benigno et autres.
L a cour de Rome de son côté abonda en concessions àson égard jusqu
’ à lui permettre l’
appl ication de biens ecclés iastiques pour former le douaire de son épouse la ReineMarie Thérèse d ’
Autriche .
Au reste V ictor Emanuel étend it de sa propre autoritéau duché de Gênes , en vertu d ’
un billet Royal m inuté par
une comm ission de magistrats respectables , les usages du Fiémont en mat ière ecclésiastique .
S on successeur le Roi Charles Fél ix était d 'un caractère
plus ferme et très jal oux de son autorité . Néanmoins l a
réaction religieuse fit des progrès considérables sous l e règnede ce Prince .
Essentiel lement religieux comme tous les membres de sa
fam il le , mais peu instruit , infirme et non habitué au travai ln i à la d iscussion , i l n ’ é tait pas en état d ’
approfondir toutesl es questions et de dom iner toutes l es influences .
L e parti réactionnaire forma malgré lui une associat ion ,
qu ’ on pourrait bien appeler secrète puisqu’
elle n’ était pas
av ouée au grand jour, et connue sous le nom de sociétécatho l ique .
Cette société ren fermait dans son sein des hommes sin
cères et honorables exaltés par l e fanat isme et avec eux un
b on nombre d ’
ambitieux et d’
intrigans .
L es am is éclairés de la religion considéraient cette sociétécomme dangereuse pour l
’ état et nuisible aux v rais intérêtsde l
’ église . L e v énérab le archev êque de Turin , Chiav erott i ,
L eurs autres co l l èges m archèm n t b eaucoup m i eux e t durèren t
jusqu ’ à l ’ expul s i on de l’
o rdre en 1848.
125
v ieux moine d’
une piété profonde et d’
une probité au
stère , la désapprouvait . L e Roi ne l’
aimait pas et soutenaitavec fermeté ses m in istres qu ’
elle eu t v oulu culbuter maisces dern iers , qui néanmoins en connaissaient le pouvo i r oc
culte , transigeaient avec ses exigences et abondaient env ersl e clergé .
A l ’ intérieur l e parti de la réaction et au dehors la courde Rome ne cessaient de représenter que l
’ égl ise n’ était pas
encore indemn isée des pertes qu’
el le avait soufl‘
ertes sous les
gouvernemens antérieurs . Il ne suffisait pas d’
avoir rétablil es priv i lèges du clergé et des églises , d
'
avoir rem is sur
p ied des é vêchés , des abbayes , des bénéfices et des monastères ; il fal lait , disait—on , que l e gouv ernement rendi t àl ’ église les biens que la république française avait occupéspar suite de la suppression des étab l issemens anciens , et
puisque les traités ob staien t à ce qu ’ on restituât l es biensen nature vu qu ’ ils avaien t été aliénés a des particuliersd
’
une man ière irrév ocabl e , i l fal lait au moins en payer àl ’ église l
’ équ ivalent .De pareilles prétentions n
’
ava i ent pas été soutenues dan sl es autres pays d
’
E urope . O n n’
av an çait rien de semblablecon tre la France el le-m ême qui avait opéré les suppressionset occupé les biens , ou ne l e prétendait pas m ême sous l erègne de Charles X s i malheureusemen t influencé par l es
idées réactionnaires .
L e Roi de Sardaigne aurait pu répondre qu’ il I l etait pas
responsab l e du fait d’
un gouvernement étranger qu i avaitinvadé son Royaume en l e chassant lui-m ême de ses foyers .
Que les traités de 18 14 et de 18 15 l ’ avaient m ême formellement exempté de remédier aux dommages causés par l
’
in
ras ion é trangère s i ce n’
est qu’
une somme déterm inée avaitété m ise à sa d ispos ition par l a France pour les cas d
’
in
demnité qui av aient été prévus , que d’
ail leurs aucune considération d
’ équité ne pouvait être invoquée contre lui puisqu
’
il n’
avai t aucunement profité des capitaux dont la Frances
’ était emparée.
Cam a l du l e.
— 126
O n aurai t pu donner ces raisons si simples indépendammentde la question principale si l e fait du législateur français avaitété de nature a moti ver une indemn isation , question que lesjurisconsultes contestaient fortement , qu i ls contestent eucore aujourd ’
hui et qui était en effet fortement contestable .
Mais le consei l de Charles Félix préfera céder et il céda .
Après avoir pris 1’
av is d ’
une comm iss ion m ixte sur l a sommequ ’ on pouvait assigner à titre d
’ indemn ité et sur la d istrib ution qu ’ on pouvait en proposer au S .
‘ Siège, on traita avecl e Pape sur les bases proposées lesquelles furent adoptées .
L ’
accord fut conclu par l ’ entrem ise du chev . PhilibertAvogadro de Colob ian alors second écuyer du Roi et prem ieroŒcier de la secrétairerie du Cabinet .Ce j eune homme était un m il itaire distingué qui avai t
gagné les bonnes grâces du Roi et dans sa modeste positiondevenait plus puissant que l es m inistres . Le pays s
’
étonna d e
l e v oir négociateur d’
un concordat. Rome le combla d’
honneurs et de caresses .
L a conclusion fut une bulle du 1828 par laquelle Clément XII , après av oir proclamé l e principe que tout ce qui
a appartenu à des étab l issemens ecclésiast iques reste a per
pétuité bien de l’ égl ise , établit une l iquidation de comptes
entre l ’ égl ise m ême et l e Royaume de Sardaigne, par la
quel le ce dern ier résulte déb iteur envers elle d ’
un ensemblede parties d iverses équivalant en to tal à 500 m il le francs derente , outre l
’ obligation de resti tuer certains éd ifices don ti l retenait encore la possession .
E n conséquence le Roi s ’
engageait à établir cette rentede l ivres sur l a dette publique et la bulle en réglaitl a d istribution entre l es d ivers diocèses fixant l ’ usage annuelauquel chaque portion de rente devait être perpétuellementaffectée .
L e Pape déclarait en outre qu’
il comptait que le Roi ,par un effet de sa munificence , aurait continué a pay er commepar le passé l es congrues des curés dépourvus de dotation ,
ce qui formait sur l e b udjet une al location annuel le de plusde francs .
128
l’
ancien régime , pourvu en France d ’
un poste important dansles bureaux du m inistère sous la restaurat ion ,
. enfin rentrédans sa patrie après de longues années d ’
absence avec mission d ’
inaugurer un nouveau règne , é tait naturel lement portéà introduire en Piémont les tendances re ligieuses et politiquesdes cours de Lou is XV III et de Charles X . L es intrigans du
parti réactionnaire et l es jésuites s’
émparèrent de l ’ espritde sa femme et peu à peu du sien . Quelques tentatives de
conspiration contre le gouvernement ourdies dans l ’ ombre
par la société secrète de la Giov in e I ta l ia en 1 831 et en
1833 serv irent à l’
efl‘
ray er ainsi que son maître . O n sut
profiter de tout cela et si bien manoeuv rer que dès l’
an 1 833,
c ’
est—à-d ire après deux années de règne , Charles Albert étaitdejà l iv ré à la réaction .
Mais parm i l es hommes qui entouraient le Roi , soi t commem in istres , soit comme d ignitaires de l
’ état ou de la cour ,plusieurs déploraient la politique dom inante . Am is du gou
v ernem ent absolu , mais nourris des traditions paternelles et
éclairées de la maison de Savoye , i ls croyaient que l a mo
narchie du t reposer sur l e respect des lo is et puiser sa forcedan s l ’
amour des peuples . I ls détestaien t l ’ espionn age et abhorraient la tyrann ie . Ces homm es en général étaient rel igieux ,
et ceux qu i au fond l ’ étaient moins affectaient d ’
autant plusde 1
’ être pour suiv re l a m ode du temps et pour pla ire au
souv erain ,m ais i l s n
’
aimaient pas un gouvernement de pré
tres et de moines .
L ’
E scarène avait fait créer par l e Roi un d irecteur généralde po l ice
‘
e t i l avait fait donner ce poste importan t et dan
gerou‘x a un noble Romain du nom de Pacca ,
ancien prélat ,homme nouveau pour l e Piémon t , considéré par le publiccomm e une créature de la réaction , suspect par ses anté
cédens , odieux par l’ origine de sa faveur .
Aidé par cet étranger l e parti réact ionnaire crut à proposde tenter un coup décis if . C ’ était d ’ éloigner en une foissous prétexte de tendances ultra- l ibérales tous l es hommesinfiuens dont la modération et la loyauté lui faisaient ombrage .
La l iste fatale fut dressée et présen tée au Roi ; mais on av ait
— 129
trop présumé de la faiblesse de Charles Albert. V oyantfigurer en tête l es nom s des S aluces et d
’
autres personnesdont il était sûr , i l fut stupé fait et indigné . L ’
E scarène fut
révoqué du m in istère et reçut l ’ ordre de quitter Turin ;Pacca fut chassé comme i l l e mé ritait.L es choses alors changèrent de face pour toujours . L e
m inistère de l ’ intérieur fut confié au Comte de Pralorm o,
homme modéré , loyal , d’
une probité éclairée et inflexib l e,
co ntraire aux innovation s politiques , mais zélé pour touteespèce d
’
am éliorations adm in istratives , ennem i déclaré de lacagoterie aussi bien que des empiétemens du clergé .
U n des prem iers soins de ce m in istre fut de rev end iquerau gouv ernement l
’
adm in istration supérieure des oeuv res debienfaisance dont l es év êques s
’
attribuaient la majeure part ,et dans laquel le la magistrature conservait une ingérence p lusemb arassante qu
’
utile .
Par un éd it du 24 décembre 1836 la comptabil ité de tous lesétab l issem en s de bienfaisance , sauf quelques exceptions faites
pour m ot ifs particul iers , fut soum ise au contrôle du gouver
nement par l’ interm éd iaire des intendans des prov inces . L e
min istère devait approuver leurs b udjets . Il sanctionna it aussileurs comptes après une rév ision opérée par une comm iss iondont l ’ évêque du di ocèse était l e président—né.
Les prem iers résultats du nouveau contrôle en rév élèrenttoute l ’ importance . Il résulta que l e patrimoine des oeuvresp ies formait un rev enu d
’
env i ron dix m il lions de francs,
adm in istré en général avec probité , mais pas toujours avecl ’ activ ité , la régu larité et l ’ intelligence qu ’ on aurait pudésirer.
Néanmoins la magistrature et l e clergé furent hostiles àla loi . Plusieurs évêques résistèrent autant qu ’ i ls purent àson exécution ; el le aurait probablement échoué sans 1
’
iné
b ranlab l e énergie et la rare té nacité du m inistre .
Au Comte de Pralormo , que sa brusquerie et ses ennem isfinirent par brouiller avec le Roi , succéda l e_Comte Gallinaqui continua la même politique nuancée toutefois d ’
une teinteplus libérale, puis le cheval ier Des Amb rois sous le m inistère
130
duquel s’
opérèrent les principales ré formes dans le sens
l ibéral avant le changement de gouvernement. Enfin le dern ier m in istre du pouvoir absolu qui ait tenu l e portefeuillede l ’ intérieur fut l e président Borell i ; car ce fut lui qui
contresigna la constitution de 1 848 .
Sous ces divers m inistères l es tendances l ibérales ne firent
que progresser en restant to utefois constamment dans l es l im ites d ’
un respect inv iolable pour l e trône et l ’ autel .Mais depuis le commencement du règne de Charles Albert
un nouveau m inistère ayant été créé avec l e garde des sceauxpour chef , la direction des affai res ecclésiastiques lui fut
exclusivement attribuée . L e Comte Barb aroux, ancien avocatdu barreau de Turin , puis av ocat général a Gènes , puis m in istre à Rome , puis secrétaire du cabinet de Charles Félix ,
fut pendant près de d ix ans l e m in istre de ce nouveau dé
partement où il porta un nom respecté , une probité notoire ,un grand sens , une profonde connaissance du droit , beaucoupde calm e , des vues conciliantes , mais peu d
’ énergie et quel
que tim idité dans l es rapports avec Rome .
Malgré ces faiblesses qui prêtaien t l e flanc aux entreprises de la réact ion eccl ésiastique , le part i réactiofma
‘
ire
craignait l es lum ières du v ieux m in istre et i l se réjouit à
sa m ort .Il l e craignait, mais i l trouva le moyen de 1 ev iter. Le
Roi qui avait beaucoup de respect pour lu i , qui s’
en gênait ,comme il se gênait en général des magistrats élev és , disait—i l ,dans les idées fran çaises et in fectés de préjugés gallicans ,prit pour conseiller et pour intermédiaire de fait dans l es
affaires plus délicates qui concernaient l’ église l e Com te Solar
de la Marguerite son m in istre des affaires étrangères , entiè
rement dévoué à la cour de Rome .
L e Com te de la Marguerite était entré dans le cabineten 1 834 au temps de la plus grande i nfluence de l
’
E scarène .
Il avait suiv i jusqu ’
alors la carr iè re dip lomatique et occupaiten dernier l ieu la place d
’
env oyé extraord inaire et m in istre
plénipotentiaire à Madrid .
S e trouvan t à Turin lorsque l e Comte de La T our , m i
— 1 32
saisis à l ’ encontre de la phil osoph ie moderne , et par 1’ idée
qu’
i ls ont de devoir renforcer l ’ église catholique contre l’
in
vasion des opin ions hétérodoxes en resserrant l es l iens de1
’
unité sous l ’ autorité du Pontife Romain .
Tant que dura l’ influence des jésuites il é tait dangereux de
passer pour Gall ican ou Janséniste. L ’
abbé Bessone docteurde la facul té de Droit, bibliothécaire de l
’
un iversité de Turin ,
qui avait enseigné sous l ’ empire, et ainai accepté les doctrinesgal licanes , fut persécuté et congédié de
'
sa place a la bibl iothèque. Connu de tout l e monde comme un savant plein de
bonté , respectable par son âge et par ses ser vices , aimé sin
gul ièrement par la jeunesse stud ieuse qu ’ il était toujoursempressé d
’
aider de ses lum ières et de ses conseils , il emportaavec lui les regrets de toute l
’
un iv ersité . L ’
abbé De Torri ,Sarde , homme grave et sé vère , de beaucoup de tal en t et
d’ é loquence , professeur de Théo logie a la m ême univers ité ,
suspect de ne pas aimer l es jésuites et d’
av oir des tendancesau jansén ism e , fut dénigré auprès de la cour de Rome , et
enfin privé de sa chaire , ce qui causa dan s le pays une in
dignation générale .
Tout l e règne de Charles Alb ert , mais surtout les dixprem ières années témoignent de la sujétion ou tout au moinsde la contrainte dans laquelle i l s ’ était m is env ers le clergé .
Sous lui l es év êques prirent l e pas a la cour sur l es che
v al iers de l ’Annonciade . Sous lui fut rétablie à Turin par l essoins du Com te De la Marguerite l a nonciature Pontificale ,dont les anciens Ro is s
’ é taient débarrassés comme d’
une
sujétion inopportune pour les év êques du Pays et d’
un cen tredangereux d
’
intrigues cléricales . Il prit m êm e a la chargede l ’ état une portion du traitement du Nonce. Sous lui les
évêques nationaux prirent l’
habitude d ’
al ler ‘
a Rome , et choseinsolite dans l e passé , recherchêrent ou acceptèrent a l
’
env il es charges honorifiques de l a cour du Pape .
Aucune . protection n’ était plus valide auprès du Roi que
celle des évêques et des moines .
Outre l es audiences particulières qu’ il accordait facilement
aux membres du Clergé , aux jours nombreux d ’audience pu
b l ique l’
ant ichamb re de S . M. était toujours garn ie de b onnombre d ’
ecclésiastiques et de religieux, quelquefois aussi dereligieuses .
Des moines prétendaien t- i l s av oir à se p laindre d’
une au
torité local e , i ls s’
adressaient au Roi qui le plus souv ent faisait l e possible pour les seconder . Des soeurs de charité voul aient—elles faire leur v olonté en dépit des adm in istrateursd
’
un hôpital , c’ était aussi au Roi qu
’
el les s’
adréssaient directement et la balance était disposée à pencher contre l es
adm inistrateurs .
L a nom inat ion des synd ics était concertée par l e m inistrede l ’ intérieur av ec le d irecteur général de la police qui avaitlui—m ême ses rapports avec le Roi comme fonctionnaire indépendan t ; mais le directeur de police ne donnait jamais son
av is pour l e choix d’
un syndic soit de v ille soit de campagnesans avoir consulté l ’ év êque du diocèse, et l
’ évêque consultait l e curé . Il s ’
ensuivait que les curés se considéraient commeayant entre leurs mains le sort des syndics et celui des communes , ce qui ind isposait généralemen t les populations .
I l résul ta de tout cela que l e clergé fut très influent ettrès craint. Mais que peu a peu on v int à l e haïr.
C ’
est auss i que les hommes remuan°
s qui appartenaient àce corps respectable , non conten ts d ’
user de son influence aleur profit , se rendiren t quelque fois molestes aux laïques ;c
’
est que les intrigans qui exploitaient l’ influence du cl ergé
firent serv ir a de basses fins l ’ intolérance rel igieuse , c’
est
que l’ intrigue , de la bassesse, passa à l ’ imposture la plus
révoltante .
O n v it des moines mettre obstacle à ce que l’
on continuat dans les jours de fête des travaux publics d
'
une ur
gence absolue . O n v it un m in istre respectable être dénoncéau Roi comme ayant b u dans un café , en jour de jeûne, un
bol où l ' on supposait qu’ il y eût du lait.
T oute l’
E urope fut in formée dans le temps , de l’
odieuse
manoeuvre par laquel le on enleva au m inistre de Hollande
(1 ) L e C.te de Pral orm o.
134
Heldew ier sa propre fil le pour la faire catho lique. L es fa
natiques et les spéculateurs de dévotion arrangeaient de tempsen temps quelque conversion semblable qui quelquefois finis
sait par tourner assez mal .O n avait m is en scène une malheureuse qui prétendait
avoir des rév élat ions de la feue Reine de Sardaigne MarieClot i lde de France m orte à Rome en odeur de sainteté . Le
Roi é tait filleul de Marie Clotilde. Il avait une profonde v é
nération pour sa mémoire et il croyait aux revenans et aux
esprits . C ’ était donc une chose bien importante qu’
une femme
a laquel le était apparue la feue Reine et a qui elle avaitparlé . Le sujet des ré vélat ions n
’ était pas moins intéressan t ;car il s ’
agissait du Roi lui—même . L es paroles de la reineétaient obscures ; mais el le av ait annoncé à. sa protégéequ ’
elle lui apparaîtrait encore .
E n effet la pythonisse eut de nouvelles apparitions ; maissoit que ses d irecteurs fussent plus fourbes qu
’
hab i les , soitqu ’
e l le m ême fut tr0p ignorante et trop vaine pour souten irjusqu ’
au bout l e rôle dangereux qu’
elle jouait , el le se m it
à débiter des absurd ités palpables . Ce n’ était plus seulement
Marie Clot ilde qu’
el le voyait , c’ était le S .
t Esprit en personne .
Il lui était apparu sous la forme d ’
une colombe, et s
’ étaittellement approché d
’
e l le que v oulant l e reten ir elle l ’ avaitpris par la queue. Mai s l es plumes lui é taient restées dansla main , et pour preuv e du fait el le mon trait des plumes blanches de pigeon .
A ce point l a crédul ité du Roi fit pl ace au soupçon . Ilnomma une comm ission composée de deux év êques et un an
cien magistrat , le Président Pensa alors contrôleur général ,pour lui donner son av is sur la pré tendue sainte .
L es comm issaires hommes de bonne fo i dévoilèrent hardiment l
’
imposture. L e v ieux cardinal T adini archevêque deGênes président de l a comm ission se montra hautement ind i
gué de si indignes fourberies . L a prétendue sainte fut défé
( l ) L e com te Pen sa d e Marsag l i a Prem i er p rés iden t , an ci en che f d e
l’
aud ien ce R oy al e d e S ardaign e , pu i s secon d Prés i d en t d e l a cham b re des
com p tes, homm e v i e i l e t p i eux.
136
treprise par le sénat de Turin , puis abandonnée faute de
preuves . L ’ opin ion toutefois resta tel lement contraire à l ’évèque qu
’
il se fixa a la campagne et n’ osa plus reparaître dans
sa v ille épiscopale. L e gouvernement fit des instances réité
rées auprés du Saint Siège pour obten ir qu 11 fut éloigné en
quelque man ière du d iocèse . Il ne put parv enir a aucun résul tat, et le peuple s
’
indigna de p lus en plus .
L ’
archevêque de Turin , Louis Fransoni , donnait au clergél
’
exemple des bonnes moeurs et celui de fai re beaucoup d’
au
mônes sans ostentation . Il fut cependant une des principalescauses de la réaction contre le clergé qui eut l ieu plus tard .
Fransoni issu d’
une fam il le patricienne de Gênes avait étédans sa jeunesse officier de cavalerie . E tant entré dans les
ordres il s ’
éleva bien vite dans la carrière ecclésiastique et
fut pourvu , jeune encore , de l’ évêché de Fossan .
A la mort de l’
archevêque Chiaverotti il fut chargé del ’ adm inistration du d iocèse de T urin ,
°
et Charles Albert , quidans cet interval le monta sur le trône, le nomma archev êquemalgré que la cour de Rome s
’
en m ontrât peu charmée ne
jugeant pas ce prélat assez instru it et assez pruden t pour cccuper un siège de cette importance.
E n efi‘
et Franson i connaissait peu la théologie et l e droitcanon ; il n
’
avait n i grav ité n i onction dans ses man ières . Au
contraire il se montrait caustique et aimant a plaisanter, tranchan t avec tout le monde , despotique envers ses in férieurs ,frondeur envers le gouvernement et m ême envers le pape.
Charles Albert , qui se repentit plus tard de l ’ av oir placé s i
haut, d isait de lui que c’ était un républ icain de la v ieille Cê
nes . Mais l es membres de l ’
o l igarch ie gêno ise aussi absolusque lui , mais moins orgueilleux, étaient peut—être moins ar
rogans .
Franson i était un des évêques qui voyaient de mauvaisoei l l a ‘ loi sur les oeuvres pies ; étant adm in istrateur un iqued
’
un établissement dans la v ille de Brà, il prétendit longtempsêtre exempt d
’
exécuter la loi , et , lorsque sur l ’ av is du cou
seil d ’ état , le Roi , qui tolérait d’
abord ses préten tions , futdans la nécessité de reconnaître qu
’ il ava it tort, et de l’
in
137
v itor défin itivement à éxecuter la loi , il protesta brusquementqu ’ il cédait a la force .
Sous le règne de Charles Albert les esprits s’ étaient tour
nés aux idées phi lantropiques. La mode était pour les hommesplus éclairés de s
’occuper des prisons et surtout du systèmepén itentiaire , des asiles d ’
enfance et des dépots de mendicité . Mais le part i de la réaction religieuse, que, pour employerl es termes de l ’ époque présente , nous appell erons désormaisle p arti clér ica l , afi
'
ectait d’
env isager l es tendances human itaires comme des simagrées profanes qui empiétaient sur le
domaine de l a charité chrétienne , comme des nouv eautés fut iles et dangereuses qui fin iraient par mettre la morale en
dehors de la rel igion .
O n avai t beau réunir toutes le garanties poss ibles dans1 1ntérèt religieux et procurer aux établissements le concoursde dignes ecclés iastiques ; le parti restait hostile à ces innov ations réclamées par l ’ human ité et par l e progrès des lnm ières . Il ne les faisait pas lui—m ême et ne v oulait pas qued
’
autres l es fissent .
L e Roi malgré sa dév otion extrême et sa faiblesse pourl es exagérations religieuses comprenait l e besoin du progrèset sentait la faiblesse des objections m ises en jeu . Il aimaitd
’
ailleurs la popularité et tenait à ce que son règne fut mar
qué dans l’
h istoire par des améliorations utiles. 11 se . déclara
ouvertement en faveur des pén itenciers , des dépots de mendicité et des asiles d ’
enfance .
Beaucoup de gens cessèren t de se montrer contraires àdes idées que l e maître couvrait de sa protection . Fransoni ,
f rondeur de caractère , se raidit,et ne m ontra pas plus de
ménagement dans sa conduite n i dans ses d iscours .
L ’
abbé Aporti , fondateur des asiles d’
enfance en Lombardieet des écoles de Méthode , ayant été appelé à Turin par l
’
évê
que_d’ Alexandrie alors président des un iversités et chef du
département de l’ instruction publique,-1e curé de la paroisse
où il allait d ire la messe eut ordre de Fransoni de ne pas
l’
admettre à célébrer et de lui demander ses papiers .
L ’
év êque d’
Alexandrie considéra ce procédé comme une
1 38
insulte pour lui-même . L e Roi en fut blessé , mais jugea apropos de dissimuler. L e public fut m oins indulgent .
Ainsi une foule de petits f aits amenaient a la longue lesesprits a v oir dans la puissance du clergé un joug de plusen plus pesant et moles te , et l
’ irritation se portait surtoutcontre les jésuites auxquels on attribuait toutes l es manoeuvres occultes , contre Franson i comm e le principal des évèques contrai res au progrès .
E n 1846 le Roi , a propos de ses démê lés av ec l ’
Autriche
entra iné par son désir secret de futures tentatives sur la
Lombard ie , ouv rit la v oie dangereuse des man ifestat ions populaires en prêtant les mains aux ovations de la place publiqueet aux souscriptions d
’
adresses .
De pareilles démonstrations précédèrent et suiv irent les réform es d ’ octobre 1 847 . Dans la procession des drapeaux quieut l ieu à. Gênes à la réception du Roi après l es Réformes ,une file de prê tres guidés par l e jeune abbé Doria, abbé deS .
‘ Mathieu , fit la prem ière man ifestation contre l es jésuites .
Elle inscriv it sur sa bann ière le voeu de leur chute .
C ’ était un prem ier signa l qui préludia à de tristes excès .
De démonstration en démonstrat ion l e peuple s’
échaufi‘
ant , la
police . craignit de ne plus pouvoir l e con ten ir. Les autorités
gouvernementales en avertiren t l e m in istère , et une députat ion des principaux citoyens qui , a la vérité , etait suspecte detrop pencher pour le m ouvement , v int à Turin demander queles jésuites fussent éloignés de Gênes comme incompatibl esav ec l ’ état des esprits .
L e com te Borelli m inistre de l 1n térieur , qui appréciait aujuste la position , avait déjà opiné dans l e conseil afin qu ’ on
prit des m esures avan t que l a demande en fût faite par le
peuple et qu ’ on év itât ainsi l e danger d’ être forcé à une
concession od ieuse . L es autres m in istres avaient appuyé son
(1 ) U n e fou l e im m en se de peup l e fit un e dém on strat i on à Gên es p our
comm émo rat ion d e ce que l es Autrich i en s av ai en t été chassés en 1 746. A T u
ri n un e dém o n strat i on p opu l ai re fut o rgan isée hors de l a v i l l e dès q ue l e
R o i eu t pub l ié par un art icl e su r l a Gazzet te o ffici el l e sa con du i te et ses
griefs en v ers l’Au triche dan s la ques t i on du tran s i t d es se l s.
— 140
d’
honnètes gens . Toute tentative de répression était cousidérée comme inspi rée au Roi par l e part i réactionnaire l equel en efi
'
et travaillait auprès de lui , causait de temps a autrequelque t iraillemen t dans la marche des afi
'
aires et excitait de
p lus en p lus la haine publique par ses tendances exagéréeset ses imprudences provocatrices.
La position était singul iérem ent tendue, surtout à Gênesoù le part i de Mazzini profitait de tout et agissait sans
relâche pour indispœ er l e peuple. Dans ces momens critiquesl e premier sang versé aurait pu soulev er la v ille et amener
par suite dans tout l ’ état des compl ications dont l’ issue ne
pouvait être pré vue . Ce qui se . passa à l’ étranger et surtout
a Paris just ifiait ces tri s tes appréhens ions . Quoiqu ’
i l en soitl e gouvernement habitué a des vues paternelles recula devantl ’ idée de la guerre civ i le . Il se décida à étud ier tous les
moyens de l ’ év iter et de sortir de la crise par les voies pacifiques .
Lorsque des attroupements jusqu’
alors inofi'
ensif s menacérent la sureté des jésuites de Turin et de Gênes l e conseildélibéra devant le Roi si on devait l e cas échéant faire t irersur le peuple , et le Roi désistant alors de ses continuel leshésitat ions reconnut avec ses m in istres qu
’
i l aurait été horsde propos de s
’
exposer à verser le sang des citoyens et a
al lumer la guerre civ ile pour conserver quelques établissemens monastiques lesquels auraient été un sujet continueld
’
agitation dans le pays . O n rappela en cette circostance
que parm i l es griefs faits aux j ésuites existants dans l ’ étatil y en avait de réels , tel que l
’
emploi du confessionnalexercer une sorte de police ou tout au moins a savoir deschoses étrangères aux pén itents . O n se dit que la corporationvoyant qu ’
el le était une cause de dangers si grav es pour l apaix publique aurait dû el le même se retirer. Enfin le Roidélégua l e M.is Alfieri m in istre de l ’ instruction publique pourse rendre immédiatement chez l e supérieur des j ésu ites deT urin et lui signifier que S . M. dans l ’ intérêt de l ’ état aussibien que dans celui de la Compagn ie 1
’ inv itait à quitter lepays .
L es jé suites auxquels l e Roi avait donné , a ce qu’ i l pa
rait , des espérances tout opposées , furent stupéfaits et firenten désordre l es préparatifs de leur départ . Quelques uns qui
sortirent dans les rues furent lâchement insultés par l a po
pulaos .
L e gouvernement m it sous sequestre tout ce que laissaitla Compagn ie: Peu_de temps après , l es religieuses du S acré
Coeur ,cons idérées par le pub l ic comme une afiî l iat ion des
jésuites furent obligées de même a se retirer.
Ces dames occupaient à Turin l ’ ancien bâtiment du collège des prov inces . E l les y tenaient une maison d
’ éducation
pour les fil les , qui étai t le principal et le p lus bril lant étab l issement de ce genre qu
’ il y eut dans tout l ’ état .
Il était de mode pour les bonnes maisons d’
y envoyer leursfil les . L ’ éducation était élégante , so ignée et m orale. O n lui
reprochait cependant un peu d’
exagérat ion monacale dans
l es prat iques rel igieuses , et la bourgeoisie v oyait cet établissement de mauvais oeil parcequ
’
i l aflectait des airs exclusifsd
’
aristocratie .
Des attroupements significati fs se form èrent plusieurs foisdevant la maison du Sacré Coeur et la garde nationa le , en
voy ée pour la protéger, fin it par faire sentir qu’
elle était lassede prendre ainsi les armes pour défendre une corporat ion quin
’
avait pas les sympathies . Ceux qui ont v écu dans l es tempsde révolution ne s
’
étonnen t pas qu’
un pareil langage ait ététenu et toléré et que le gouvernemen t ai t du céder
Des attroupem ents semblables _se formèren t plus souventencore devant le palais de l
’
archevêque , et l e m in istère étaitobligé chaque fois d
’
env oyer la force publique pour l es dissoudre . Elle fin it par être établie presque en permanencedans cette m ission , et commença auss i a murmurer . La po
sitiou n’ étant plus tenable , le Marquis V incent Ricci m in istre
de l ’ intérieur, compatriote de l’
archevêque , lui conseilla de
( 1 ) Ces fai ts se p assèren t au prin tem p s de 1848 av an t l’organ isat i on
régul ière de l a garde nat i ona l e . O n avai t a l ors form é dan s l a cap i tal e et à
Gênes des com pagn i es de v o l on tai res pour m ai n ten i r l’
ord re. C’
est de ces
compagn ies qu’
i l s’
agi t ici .
quitter T urin et il se reti ra à sa campagne a une lieue dela v il le.
Ayant voulu offi cier à la cathédrale le jour de Pâques , i lfut insulté en sortant de l ’ égl ise par une troupe de mauvaissujets , rentra alors et pénétrant par l es communications intérieures dans le palais Royal i l y resta jusqu
’ à ce qu ’ il putse ret irer sans danger.
Le peuple reprochait a Fransoni ses an técédents peu l ibéraux , et son avers ion déclarée aux .ré formes de 1847 , ains iqu
’
a tout progrès politique . O n prétendait qu’ i l parlait san s
aucun respect du Pape et du Roi , appelant l’
un Pi ta n on o
et l ’
autre cavo lo Al ber to . La haine publique méconnaissait sesbonnes quali tés et exagérait les mauv aises .
T el était l ’ é tat des esprits lorsqu’
en mai 1848 le gou
v ernement constitutionnel entra en fonctions et l es chambresl égislatives furent ouvertes .
Pi ta en P1em o n ta i s s ign ifie un d i n d o n e t au figu té o n d it un p i l e
p o u r d i re u n so t.
F1N DE LA PR E MIÈR E m an s .
Coup d’oeil sur l ’ histoire de l a val l ée.
L a Boire R ipaire a sa source ‘
au Mont-Genèvre et son
cours fin it dessous Turin , où elle se jette dans l e Pô . Du
Mont-Genêvre jusqu ’
a Avei l lane , el le coule entre deux chaînesde m ontagnes formant une v allée profonde . Cette v allée présente trois embranchements ; l
’
un a droite de Cesanne , arrosé par la Ribe , porte le nom de vallée de Cesanne ; l
’
autres
’ ouvrant a la gauche d’
O u lx est la vallée de Bardonnêche ,pleine de souven irs curieux ; le dern ier , que l
’
on trouv e a lagauche de Suse , est l e petit val lon de la Cén ise , autrementdit de la Novalaise , où était la célèbre abbaye de ce nom .
L a route royale de France en Italie par l e Mont—Genêvreparcourt la vallée principale dans toute sa longueur . L e che
m in de fer la remonte d ’
Avei l l ane a Oulx , et la suit l ’
em
branchement de Bardonnêche , où il perce la montagne de
Fréjus . L a route roul ière du Mont—Cen is se détache de l apremière a Suse pour grav ir par de nombreuses rampes cettemontagne fameuse .
Au centre est la v i lle de Suse . Échelonnés sur l e par
cours des routes sus-indiquées sont l es v ieux bourgs d’
Aveil
lane , Oulx , Cesanne et Bardonnêche, outre un grand nombred
’
autres bourgs ou v i llages qu i se trouvent également sur l epassage , ou bien sont situés sur les côtés de la veillée .
C ’
est l e pays dont nous allons nous occuper . Dans quelques anciens documents son ensemble est appelé V allée de
10
1 46
Suse, Va l l is S ius in a . Ayant été à plusieurs époques séparé
pol itiquement du Piémont en tout ou en partie , i l a eu ju
squ ’ à un certain point une v ie et une physionom ie a lui . Illes eut surtout pendant le moyen âge, et c
’
est pour cela quenous nous sommes at tachés à peindre son état social pendantcette période h istorique.
Mais avant tout nous croyons utile, pour éclairer notretableau , de rappeler les précédents de l
’ état de choses quenous venons de décrire , . et de résumer dans un aperçu ra
p ide l’
h istoire de la vallée .
Ce que nous savons de positif sur l es temps qui précé
dérent la dom ination romaine ne nous porte guères au delà
de l ’ époque de César .
I l conste qu ’
alors cette val lée , avec d’
autres des alpesappelées plus tard Cottiennes , étaient habitées par des peuplesou clans réun is sous l ’ autorité d ’
un Roi . L e peuple qui occupait la vallée de la Doire certainemen t en grande partie ,
et probablement en entier , était celui des S égusiens , race queles Romains considéraient comme Ligure , c
’
est—à—dire d’
une
nation que l’
on croit d ’ origine ibérique et partant asiatique .
O n sait que les Ligures étaient aux yeux des Grecs et desRomains le type des hommes forts , courageux , agiles , intell igents et rudes a la fatigue . I ls étaien t pauv res , mais fierset indépendants comme l es Basques , avec lesquels on leursuppose une parenté
L e Roi Donnus ou Don , chef de ces peuples alpins , étaitcontemporain de César . S on fil s Cottius l e fut d
’
Auguste .
Mais il parait que Donnus ne fut*
pas le prem ier Roi et qu’ il
eut m ême des prédécesseurs de son sang, car Ov ide parlantà son fil s V esta] le qualifie descendant des R ois Alp in a, Al
p in is R egions arte.
Il parait désormais établi qu’
au temps de Cottius ce petitroyaume commençait en remontant la Doire a l a hauteurd
’
Avei l lane, où deux hommes de grande autorité , Charles
(1 ) Duruy . Hi sto i re des R om ai n s, t . 1 .
148
pas croire qu’
i l s aient associé les indigènes a leur industrie ,et qu
’
elle soit restée dans le pays ?Quoiqu ’ i l en soit, les régions des Alpes , placées entre l a
v ieille civ i l isat ion de la Gaule méridionale et cel le que l es
Romains répandaient en Italie , ont dû de bonne heure subirl ’ influence de ce double courant , et certainement au tempsde Donnus et de Cottius l
’ état de ces princes ne devait plusêtre barb are.
Cottius comprit son époque. Au l ieu d ’ im iter l ’ inutile résistance que ses voisins opposaien t aux Romains et qui l es coriduisi t à la serv itude ,
il s’
att ira leur am itié en ouv rant luim ême a travers son territoire une route roul ière, celle du
Mont-Genêvre , pour l es commun icat ions entre l’
I tal ie et l a
Gaule Transalpine . Rome ne dédaigna point d’
accepter poural lié le prince sage et habi le , lequel con serv a ainsi à. sonpays une autonom ie presqu
’
ent ière , et en m ême temps lui
procura l es av antages du commerce de transit. Aussi le règne
de Cottius est -i l resté longtemps dans la mémoire de ses peu
p les comme le souv eni r d’
un âge d’ or, et au s iècle d
’
Am
m ien Marcel lin son tombeau était encore en grande véné
ration L e b el arc de Suse fut érigé par Cottius et par
l es clans de son royaume en mémoire de l ’
all iance obtenueet en honneur du puissant Empereur qui prenait sous sa protect ion l e petit Roi des Alpes .
Disons- le donc encore . L e pays où le Roi ouvrait un grandchem in roulier a travers l es m ontagnes , où l e m ême souv e
ra in é le va it un arc de marbre comme celui de Suse , l e petitroyaume que les maîtres du monde honoraient de leur al
l iance , ne pouvait pas être un pays barbare ; on a d’
ailleursd
’
autres indices du contraire . L es érud its ont attribué , non
sans raison plaus ible , au temps du v ieux Cott ius les torseshumains de sculpture exquise qui ont été trouvés sous terrea Suse , la où fut l
’
ancien palais des Rois . V estal , f rère de
(1 ) B ujn e sepu l chrum , d i t Amm i en , regu l i S egus i o n e est m oen i b n s pro
m an esque ejus ra t i o n e gem i na re l ig i o se co l un tur ; quod juxto m o
deram i n e rexerat suo s, et adjectus i n societatem rei rom an ae qu ietem gen ti
p raes t i t i t sem p i tern am .
149
ce prince , goûtait les vers d ’
O v ide et avait été jugé capablede gouverner comme président une prov ince considérable del
’
E mpire Romain .
Au v ieux Cottius succéda un autre Roi du même nom ,
l equel mourut au temps de N éron . S on état fut alors incor
poré a 1’ Empire et l ’
on créa la prov ince des Alpes Cottien n es .
La civ ilisation que l es Rois des Alpes on t laissée dans l epays ne put que grandi r sans la dom ination romaine . L a
route du Mont—Genêvre dev int une des voies l es p lus act ivesde l
’
E urope . Suse était une v ille florissante ; Oulx formaitune étape considérable de la route ; cette station s
’
appelaitad m ar tis a cause de sa proxim ité au temple de Mars . 11 yavait une Man s ia ou caserme pour l es troupes de passage etun temp l e de Mars . O n trouvait un relai a Cesanne et un
autre sur le Mont—Genêvre ( in a lp e co ttie ) , où s’
élévait un
temple b âti en p ierres taill ées et_orné de marbres , dédié ,d it—ou, a Jupiter , mais plus probablemen t aux Ma trones ou àJanus Audessous de Suse se succédaient un relai (ad duod æim um ) entre les localités actuel les de Busso l in et Borgou,
et une m an s io sur l ’ ancienne lim ite du Royaume Gott ien (adfin es , en face de l ’ emplacement actuel d ’
Av eil lane
U n écrivain , qui a profondément étudié l’
histoire des Alpescottiennes a supposé que la population de ces montagnes ,ce qui s
’
appl iquerait a la haute v allée de l a Doire , se rend itl ibre, au m oins de fait , pendant la décadence de l
’
E mpire
Romain ,lorsque les Goths envahissant l ’
I tal ie interceptèren tl es rapports de cette part ie des Alpes avec l e gouvernementcentral . Il considère comme formée par des insurgés de ces
montagnes l a troupe de Bagaudes qui en 409 barra l e passagedes
‘ Alpes à l’
armée de Scarus revenant du siège de V alence.
Enfin il croit que l e pays resta indépendant pendant quelquetemps.
L a m on tagn e a été appel ée Ma tron a . Ad scsnd i s ad jtin erB nrd iga l en se ). E l l e a auss i p orté l e n om d e Mon s jun i . O n appel l e au
jon rd’
hn i Mon t j ua n l e pic qu i es t en face de l‘hosp ice .
V oy ez Prom i s, Tori n o An tica, pag. 431 et sn iv .
Fauché Prunel l e. I n st i tut i on s Brian çonn a ises, tom . 1 pag . 197 et suiv .
— 150
N ous manquons de données précises sur les invasions dela vallée par l es barbares qui attaquèrent l ’
E mpire agon isan t. Elle dut être successivement occupée par l es Burgundeset par l es Goths. Peut—être la vallée supérieure et l
’
infé
r ieure ont-elles été quelque temps séparées .
Au sixième siècle Justinien reconqu it l ’
I tal ie et mit gar
n ison dans Suse . L es Aigles Romaines y étaient encore lors
qu’
en 57 1 l es Lombards firent i rruption dans l a val lée pourse jeter sur le Dauphiné . La garn ison s
’
enferma dans la v il leet laissa passer sous ses murs la horde dévastatrice qu ’
ellen
’
aurait pu arrêter. Cel le—ci fut défaite au delà des Alpes parle patrice Mummol . S es restes retournèrent en Ital ie , et, re
passant en vue de Suse, i l s furent battus par les impériaux
qui firent une sortie contre eux. L ’ irrupt ion ne fut doncqu ’
un fléau momentané et aucunement une occupation . Ce
pendant l es Lombards étant maîtres de l a Haute Ita l ie , lesRomains ne pouvaient conserver la possession de Suse isoléeentre deux é tats étrangers , l a Lombard ie et l e R oy aume
'
Bur
gunde , duquel l e Dauph iné faisait part ie . I l s la cédèrent probablement aGontram , monarque des Francs et Roi de Bourgogne ,
car un accord surv int entre le prince et le Roi des Lombards ,qui porta l es l im ites des Francs au b as de la vallée sus ine ,la on fut élevée la fameuse murail le flanquée de tours qu ’ onappela la Cluse, faible boulevard du Royaume de Lombard ie .
Les Francs prirent ainsi pour l im ite de leur territoire a
peu-
près la m ême ligne qui avait borné autrefois le Royaumede Cottius et probablement le souvenir de l ’ an tique dél im itation ne fut pas é tranger à l
’
adoption de la nouvelle .
Devenu maître des deux vallées de l ’ Arc et de l a Doire,le Roi Gontram eut l ’ idée malheureuse de les réun ir sous un
m ême évêque établ i par lui a Saint—Jean -de—Maurienne, et
selon toute probabil ité il fit une circonscription civ i le correspondante a l
’
ecclésiastique ; car c’ était le système d ’
a lors .
L e fait est que sous Charles Martel un seul gouverneurou féodataire v iager avait l e gouvernement des deux vall ées .
C ’ était l e fameux patrice Abbou fondateur de l’
Ab b ay e de
l a Novalaise .
152
b on devenu souverain de Briançon ; l e Comte d’ Aurate , qui
1’ était aussi de T urin , est maître de l a vallée de la Doirejusqu ’ à la cascade de Calambre au sortir d ’
E xi l les, et entreces deux états V ittb ald de Bardonnêche possède la vallée su
périeure , d’ Exilles en haut .
S i 1’
on prit à la l ettre quelques expressions employées
par l es officiers du Dauph in dans les reconnaissances de 1260 ,
il faudrait croire que la haute vallée était dev enue un vraidésert lorsque l es Sarrasins l ’eurent quittée, et que l es Com tesd
’
Al b on l a repeuplèrent en y attirant par leurs largesses denombreux immigrants . Mais ces assertions intéressées qu ’ onénonçait trois—cents ans après les événements sont bien sus
pectes d’
erreur, et péchent au moins d ’
exagération . Il n’
estpas naturel , surtout dans un pays de montagnes , qu
’
une onded
’
envahisseurs se subst itue ent ièrement à la population préexistan te . Cela est d
’
autan t moins probable pour l es Sarrasins
qui étaient peu nombreux et se répartirent sur divers pointsdes Alpes .
Nous inclinons plutôt à penser q u’
i ls se sont posés en dominateurs tenant sous le joug les indigènes , que ceux—ci avaient en partie émigré par un sentiment de f rayeur qui ne se
raisonne pas , mais que beaucoup d’
entre eux ont dû ren
trer dans l e pays quand i l s eurent vu de pouvoir l e fairesans danger , et qu
’
ainsi , après l’
expulsion des étrangers , l esl ibérateurs que leur v ictoire avait rendus maî tres du paysse t rouv èrent en face d
’
une population qui se soum it vo
l ontiers a eux parcequ’
i l s lui rendaient sa religion ,ses
moeurs et une existence m oins dure .
Les Comtes de Turin parv inrent en peu de temps à réun ir
p lusieurs Comtés sous leur domination . Mais il s attachèrenttoujours une importance spéciale a la possession de la valléede la Doire , et i l s aimaient a y résider. Placés a l ’ avan t
garde des princes italiens sur l a frontière de France , i ls prenaient l e t itre de Marquis d ’ Ital ie , se considérant comme suc
cesseurs des Comtes Carlov ingiens , il s prétendaient m ême avoirdes droits sur la haute vallée. Le dernier d
’
eux, O ldéric
Mainfro i , obtint en 1001 une investi ture de l’
E mpereur Othon
_ 153 _
où se trouvent nom inat ivement compris l es bourgs et v illagesde toute l a vallée et de ses emb ranchemenfs au -dessus de
S use , et lui—m ême céda un tiers de ses droits sur ce territoire a l ’ abbaye de S‘
. I ust lorsqu ’ i l la fonda. E n 1057 son
héritière, la célèb re Adelaide , et son mari l e Comte Odonfirent acte de souveraineté sur Oulx en confirman t a l a
congrégation naissante des chanoines d’ Oulx la donat ion
des églises locales que leur avait faite l e Seigneur du l ieu,Ponce de Bardonnêche . Mais c ’ étaient des prétent ions san s
conséquence. L es donataires dans ces temps troublés se
pourvoyaient par prudence du consentem ent de tous les prétendants possibles . De pareil les prétentions se rév é laient en
core eu 1212 dans un acte confirmati f que l e Com te de S av oie concédait à l ’ abbaye de S‘
. Iust , l orsqu’ i l éta it notoire
men t dépourvu de tout droit efi'
ecti f dans la vallée supérieure.
Mais retournons au XI siécl e .
L e gouv ernement du Marquis Mainfro i dura de l’
an 1001
a l’
an 1035 . Adelaide qui lui succéda , régna jusqu’
en 109 1 .
Ces deux règnes occupèrent a eux seuls presque tout l e siècle,le siècle qui commença la renaissance , qui prépara l es croisades , dans lequel fermentèrent l es germes des libertés com
munal es , l e siècle de Grégoire V I I qui ouv rit une nouvel leère au pontificat , où surgirent les luttes entre l e sacerdoceet l ’ empire , époque de v ie énergique , de lutte , de rénov ationsociale . Mainfroi eut l a réputation d
’
un prince magnifique et
sage . Saint Pierre Damien , son con temporain , ce cardinal i llustre et ce consei ller respecté d
’
un grand pon tife , dit delui et de son père Atalric, évêque et souverain d ’ Ast i , qu
’ ilsé taient l es plus sages princes italiens . Adelaide eut une placeencore plus grande dans l e monde . O n adm irait en elle une
énergie v iri le et l es aptitudes d’
un homme pour le gouvernement d ’
un état.Malheureusement les chron iques et l es documen ts qui nous
restent ne fournissent aucune lum ière sur l ’ adm in istrat ion deces deux souverains. O n n
’
a d’
eux que des fondations pieuses ;ainsi pour ce qui concerne la vallée de la Doire , Ma infroirétablit les moines de la N ovalaise et favorisa le développe
154
ment de l’
ab b aye de la Cluse : Adelaide °
protégea et enrichitles chanoines d ’
O ulx. Sous leur régne furent reb âties ou réparées les égl ises de Sainte Marie de Suse, de Chaumont ,d
’ Exilles et probablement aussi d’
autres .
I l s avaient sous eux des v icomtes ou l ieutenants . La val
lée de la Doire, paraît en avoi r eu deux, l’
un résidant au
château de Baratonia pour la b asse vallée, l’
autre ayant sarés idence à Suse pour la v il le et ses env irons . Des autoritéslocales sous l e titre de Gas ta ldus , tenant tout—à- la—fois du juge ,du commandant m ilitaire et de l ’ administ rateur, correspon
daient a-peu—près . à ce que furent plus tard l es châtelains.
Nous tenons du reste pour certain que soit le Prince , soitl es autorités inférieures expédiaient les affaires majeures et
surtout les jugements avec le concours ou le conseil de prudhommes , dans le sens de ce que nous voyons consacré par
les statuts émanés a l a fin du s iècle suivant, lesquels ont
év idemment confirmé d ’
anciens usages.
A la mort d ’ Adelaide son vaste hé ritage revenait de droita son petit—fil s Humbert II Comte de Savoie, mais on ignore
par quels mot ifs il ne passa les Alpes que sept ans aprèsen 1098 L ’ état régi jusques là par la main puissante de lav ielle souveraine éta it tombé en dissolution . L a v allée de Suseresta fidèle à Humbert . Ce prince ne régna deça les Alpes
que cinq ans et n’
y laissa pas de traces mémorab les ; maisses successeurs v inrenf souvent soit a Suse , soit a Avei l laùeet i l s y tinren t cour. I ls montraient avec raison de prendreun intérêt spécial pour cette v allée , moyennant laquel le i ls
avaient dans leurs mains les portes d’ Italie .
L e et le 13°
siècles furent pleins d’
actes de leur sol
l icitude et de leur bienvei llance pour ce pays . Cependant au
12°
siècle l es“
év énements pol itiques attirèrent de grands malheurs sur la val lée de Suse . L a v ille de Suse fut b ru lée en
1 174 par ordre de l’
E mpereur Frédéric Barberousse . Avei l
lane fut détruit en 1 185 par-Henri fil s de l ’
E mpereur . C’
éta
An n o quo Hum b ertus Com es ingressa s est d i t l a
Charte . du Chartarium n l ci en se qu i est datée d e 1098.
commune. Il fut plus tard déclaré formel lement que la l imiteserait le rif de Gélasse, ou ja lasse , qui passe précisément la.
L es Dauph ins avaient ob tenu en 1 155 un d iplome impé
rial qui les autorisait a battre monnaie à Cesanne. I ls n’
en
firent rien , mais le d iplome servait à consolider leur pouvoirdeçà le Mont—Genèvre . I l s b êtirent un château a Césanne et
v inrent y habiter pendant 1’
été dans l’
a ir f rais et fortifiant
du Mont Genèvre , en face de coteaux riants a 1350 m ètresau dessus du n iveau de la mer.
A Oulx i ls v oulurent aussi avoir un château lequel étaitencore habitable en 1339 .
A Exilles existait un château fort, dont l’ origine est in
connue . L es Dauphins en dev inrent maîtres et en firent uneplace de front ière. L e bourg était aussi fortifié ou du moinsce int de murs où l es gens du Dauph in faisaient le guet unisav ec un nombre proport ionné d
’
habitants .
Chaum ont appartenait , on ne sait comment , dès l e 12°
sl e
cle aux Cheval iers Hospitaliers de S . Jean de Jérusalem . L es
cheval iers se reconnurent vassaux du Dauph in qui confirmal eur possession a titre de fief par une invest iture confirmat ive
de l’
an 1235 , se réservant seulement la haute justice .
L es seigneurs de Bardonnêche , isolés dans l eur pet itev allée , furent bientôt amenés par la force des choses à °
ré
connaître l es Dauphins pour suzerains ; et dans l e 14°
sièclei ls en dev inren t l es v éritab les sujets .
Ce 14°
siècle fut une période de grandes agitations pourla v al lée de l a Doire . Au commencement de ce siècle la
v iei l le host ilité qui régnait entre l es Dauphins et les Comtesde Savoie , al imentée par une rivalité toujours croissanted
’ intérêts , était dev enue de plus en plus v ive. Elle se tra
duisait en luttes f réquentes sur la f rontière du Grésivaudan ,
laquelle par sa grande irrégularité donnait des occas ions plusfréquentes de conflits , et où chacun des deux combattan tsespérait de pouvoir marcher sur la cap itale de son adver
sai re .
Mais a l ’ époque dont nous parlons l es deux Princess
’
ob servaient mutuellement dans la val lée de l a Doire . L e
Comte de Savoie s’
y tenait sur ses gardes , et de son côté l eDauph in soupçonnait son rival de prat iquer des intell igencesdans la haute vallée et jusqu ’
au delà du Moa enêvre .
Pour se prémun ir con tre un danger qu’ il ne d issimulait
m ême pas , le Dauphin Guigues stipula en 1332 d es actesforme l s avec l a commune d
’
O ulx, avec la commune et l es
seigneurs de Bardonnêche et m ême avec la commune de N evache par lesquels toutes ces populations s
’
o b l igeaient a l e
souten ir dans la lutte contre l e Comte . L ’
acte conclu avecN evache porte exmessément que l es habitants répudient touteintelligence avec l e Prince S avoisien . L es choses en étaientla, lorsqu
’
un écart du Dauphin prov oqua une révol te de l a
haute val lée.
Gu igues , jeune homme l icencieux, ayant séduit et enl evél a fille de François de Bardonnêche, cheval ier très—considéréet aimé dans l e pays , l e père furieux se soul eva et entraîna
a sa suite ses parents et ses am is , ce qui faisait a—
peu—
prèstoute la n oblesse du B riançonnais , et avec eux une grande
partie de la populat ion .
Nous devrons donner dans un chapitre séparé l es détailsde cet événement , ainsi que les péripéties et la fin tragiquede Fran çois . I l nous suffira de d ire ici que l es révoltéss
’
étant rendus maîtres du château d’
E xil les , Fran çois de
Bardonnêche en fit hommage au Comte de Savoie , et que le
souverain savoyard ( c’ é tait l e Comte Aymon dit l e Pacifique )
après avoir accepté l’
hommage , ce qui était encourager larévolte, ne fit rien pour l a soutenir. D ’
autre part l e Dauph inGuigues mourut, l es populations révoltées se soum iren t a son
successeur en abandonnant François , qui dut se sauv er par
la fuite et fut m is au b an , puis plus tard pris et condamné àmort. Arragon de Nevache avait l ivré au Comte de Savoie un
château—fort du Grésivaudan , et ce fait , qui se liait sans douteavec la rév olte de la noblesse b riançonnaise dont Arragonfaisait partie m otiva auss i sa condamnation . Il fut décap itéavec un grand apparei l a Nevache devant son château .
Arragon éta i t d’
ai l leurs agnat de Fran ço i s d e Bardon n êche.
— 158
La mort du Dauphin Guigues avait donné lieu a une trêvequi fut suiv ie de l a paix . Humbert 11 son successeur s
’
ap
pl iqua d’
abord à des ré formes utiles . Il institua un consei lpermanent auprès de sa personne , et dans chaque b ai l lage
un conseil prov incial pour l’
examen des réclamations locales .
La haute vallée de la Doire ressortissait du b ai l lage de
Briançon . Le Dauph in voulut que l e prévôt d’ Oulx fût membre
du conse il du b ail lage . Mais la haute vallée reçut ensuite dumême prince des avantages bien plus grands .
E n 1343 les communes d ’
O u lx et de Césanne , comme plusieurs autres du Briançonnais , obtinrent de lui une charte ,l aquel le , moyennant un correspectif pécuniaire assez modique ,
leur cédai t plusieurs droits doman iaux et les exemptai t pourtoujours de tout impôt de gabel le .
L es communes de la vallée de Bardonnêche restèren tétrangères à la concession parcequ
’
el les tenaient déjà des
f ranchises au moins équivalentes de leurs arrangements avecles seigneurs l ocaux, et que d
’
ai l leurs le Dauphin n’
ava i tpas le droit de lever des impôts dans l a seigneurie de Bar
donnêche . Salbertrand, Exilles et Chaumont n’
eurent pas l eb on esprit de demander ce que l es autres obtinrent .
E n cette m ême année 1 343 l e Dauph in U mb ert ayant vumouri r son fil s uni que céda ses états a la maison de France ,s
’
en réservant toutefois la souveraineté sa v ie durant ; maisi l consenüt dès lors à donner le gouvernement des principalesp laces for tes a des personnages agréés par le Roi , lesque lsjureraien t fidélité au Roi et au Dauphin . Ains i furent n om
m ês les gouverneurs des châteaux de Bardonnêche et de
Bramafan , d’
O u lx et d’
E xi l les . E nfin en 1349 il abdiqua défin itivement en faveur de Jean Duc de Normandie, en fant de
France , après avoir fait et juré une charte qui garantissai tà perpétuité les priv il èges et f ranchises du Dauphiné .
L a charte de 1349 eut son plein effet dans la haute va l léede l a Doire . E l le fut pour m ajeure garantie transcrite sur
l es régistres du b ai l lage de Briançon a la réquête des sei
gneurs de Bardonnêche en 1 369 .
Depu is l ors l ’
histoire de la haute vallée ne présente
— 160
quel les un certain Lucius de Salb ertrand fut admis à jouirpar une concession de 1 321Mais la vallée dans son ensemble perd it beaucoup lorsque
les domaines des Princes d ’
Acaie, qui possédaient T urin et les
plus b eaux territo ires deçà les Alpes , retournèren t aux Comtesde S avoje chefs de la branche aînée de la dynast ie . Elle ne
resta qu ’
une petite prov ince de ce vaste et riche paysqu
’
on appela le Piémont .E n considérant dans son ensemb le l e résumé h istorique
que nous venons de tracer , on vo it que l ’ époque la plusmarquante du moyen âge pour la val lée de la Doire commepour bien d
’
autres pays fut celle qui embrasse le 13°
si ècleet le et la prem ière moitié du 1 4
°
est surtout la p lusv ivante ; c
’
est cette période que nous aurons principalementen vue dans la description que nous allons essayer de l ’ étatdu pays au moyen âge.
Docum en t 1 1.
11 .
État matériel de l a val l ée au moyen âge.
L es montagnes qui enserrent la v al lée étaient couv ertes ,à l
’ époque dont nous parlons , d’ épaisses forêts , très—néghgées
parceque le bois n’
ava it aucune valeur .
L es essences principales é taien t, comme aujourd ’
hui , l emelèze , l
’
arole , l e pin et le sapin dans la vallée supérieure ,ail leurs l e hêtre et l e chêne.
L ’
usage répandu a lors dans les v il lages de montagne deconstruire l es maisons en bois , et celui bien plus é tendu de
l es couv rir en planches , faisaien t que les habitants d i lapidaient
'
lee forêts de leur v oisinage et on craignait dès lors queleur destruction pût amener des ébou lements dangereux .
A Oulx en 13 14 un règlement fut fait contre l e désordredes coupes . A Chaumont en 137 1 on établit des d isposit ionsdans le m ême sens .
N éarhmo ins l es éboulemen ts furent fréquents , en plusieursl ieux les pentes se dénudèrent ; le so l se rehaussa considé
rab lement dans l e fond des val lées . A Oulx l’
exhaussement
fut en moyenne d ’
un dem i-mètre par siècleL es éb oulements , les rav ins et les désastres qui en pro
v inren t dan s les plaines ont changé en grande partie l’
aspectdes l ieux.
L e so l d e la stati on rom ain e est à 5 m ètres et dem i d ess ous l e
n iv eau actue l de la p lai ne. L e so l de 1499 es t a en v i ron un m ètre et dem i
d essous l’
actuel .
— 162
Les b ourgs et les v i llages actuels existaient déjà à l’
exce
pt ion de quelque petit hameau insignifiant ; seulement on a
l ieu de croire que certains groupes nombreux de m aisonsalpines , lesquels ne sont actuel lement habités que pendan tl ’ été
,comme le S eu dans la commune de Salbertrand , et
Montiel dans celle d ’
O ulx , fussent al ors de v éritables v illa
ges oû l’
on demeurait toute l ’ ann ée .
L es forêts qui se l iaient les unes aux autres off raientnaturellement un abri hanté par l es bê tes fauves . L es oursl es loups , l es lynx étaient fréquen ts . U ne v al lée alpine , prèsde Bussol in , s
’
appel le encore la Va l O rs iére . La tradition
populaire des montagnes conserve des h istoires d iverses deluttes entre des chasseurs et des ours . Les archives ren ferm ent plus ieurs documents concernant le droit seigneurial surl es pattes des ours tués dans l es pays , en réglant des que
stions produites par de telles chasses . Au res te la faune desm ontagnes était beaucoup plus riche qu
’
à présent . Les b ou
quetins v ivaient sur l es glaciers d’
Amb in . L es chamois , l esl ièvres et les m armottes abondaient sur l es hauteurs .
L ’ étendue des terres cult ivées é tait un peu m oindre ; cari l y eut des dé frichements dan s l es temps postérieurs . Commeà présent , et plus encore , chacun cu lt ivait pour ses propresbesoins plutôt que pour l e commerce . O n tenait ’
à avoir son
grain pour faire son pain , des l égum es , du lai t et du fromage
pour sa nourriture , du chanvre et de la laine pour t isser l esétoffes de son v êtement , du v in pour sa boisson dan s l es
pays v in icoles .
L es céréales cultiv ées alors étaient le f rom ent , l e seigle ,l
’
av oine et l ’ orge. Ce dern ier était , comme aujourd ’
hui , l e
produit principal des champs l es plus élevés. L es raves et
l es fèves étaient cult ivées en grand comme plantes al imehtaires dans quelques localités , notamment dans l es territoiresde Bardonnêche et de R ochemo l l es .
La culture de la v igne étai t a peu—
près étendue autan tqu ’
aujourd ’
hui ; elle avait m ême été portée en quelquesendroits où elle fut abandonnée a cause de l
’
âpreté du
cl imat .
vais sur le Mont —Genêvre étaient qual ifiées égl ises . Mais l esv éritab les égl ises n
’ étaient guères plus grandes que des cha
pel les , si on excepte l es églises des grands établissementsmonastiques , lesquelles avaient été construites avec plus deso in et de dépense . Celles de saint An toine de R anvers et
de saint Michel de la Cluse sont encore v isitées avec intérêt.L es égl ises paroissiales les plus spacieuses et m ieux bâtiesqui nous restent du moyen âge appartiennent a la derniéremoitié de cette période , époque de la création des paroissesrespectives . Telle est la jolie église de Savoulx, bâtie en 1451 ,
qui figure si b ien avec son clocher é lancé au m ilieu des ar
b res qui l’
entourent
Quelques égl ises ancien n es, qu i présen ten t actuel l em en t des d im en
s ions assez amp l es, o n t été agrand ies et rem an iées.
III.
La V i l l e de S use au moyen âge. S es monuments .
LA V I LLE .
Suse , la S egas ia des itinéraires romains , résidence des
Rois Cottiens , puis mun icipe romain , jouissait sous la dominat ion romaine d ’
une exis tence flo rissante parceque le peupleR oi la considérai t comme une grande étape de la route des
Gaules . Elle appartint ensuite aux Rois Goths , lesquels , suivantl a trad ition , y t inrent un palais Sous l es Rois Francs el leparaît avoir été , au moins dans les dern iers temps , la de
meure principale du gouverneur des vallées de « l’
Arc et de
l a Doire. Il est même probable que l e patrice Ab b on , ce
grand personnage si haut p lacé et s i riche que nous av onsvu posséder les deux va l lés comme fie f v iager sous CharlesMartel , fût natif de Suse , car i l avait un grand nombre de
propriétés pri vées dans les env irons et i l semble leur donnerdans son testament une attention spéc iale.
Sous les Carlov ingiens les Com tes de Turin semblentn
’
avoi r pas habité Suse. Nous manquons de données sur son
état jusqu ’
a l ’ invasion des Sarras ins , et nous ne savons même
Pa la t ium B sgum Go lkm m. Ai ns i no té dans l e T hea trum S ta iuum
B . C. S ou ad i“ .
166
pas si el le fut ou non occupée par eux, quo iqu’ i l soit très
probable qu’
i ls y aient porté la dévastat ion lorsque les moinesde la Novalaise durent abandonner , non seulement l eur monastère et sa petite val lée , mais auss i les propriétés qu
’ i lsavaien t autour de Suse , lesquelles furent perdues pour eux
a jamais .
Après l’
expuls ion des Sarrasins dans la dernière moitiédu 10
°
s iècle , l es Comtes de Turin aïeux d ’
Adelaïde tenaientsouvent leur cour a Suse, tellement qu
’
il s furent appelésMarquis de Suse et qu
’
i ls sont plus connus sous ce nom que
sous leur t itre véritabl e . Le dern ier d ’
eux, O lderic Main fro i
et Berthe son épouse, couple princier qui avai t d ’ immensesr ichesses, au point qu
’ i l vendit en un j our un m i llion d’
ar
pents de terre passaient beaucoup de temps à Suse , e tun contemporain dit que ces princes v ivaient av ec une ma
gnificence royale . La v ille dut donc refieurir. Elle ne put
que gagner encore en importance et en prospérité sous lerègne suivant , règne brillant qui dura plus d
’
un dem i-siècle ,celui de la Comtesse Adelaide dev enue si puissante que les
t itres de ses devanciers semblaient trop modestes pour el le ,et que le rigide saint Pierre Dam ien n
’
hésitait pas à la
qualifier Duchesse des Alp es Cottien n es .
L es Comtes de Sav oie ses successeurs firen t auss i de Susel eur principale résidence deçà l e Mont—Cen is où elle fut pendant que lque temps leur v ille la p lus importan te . I l s lui
donnèrent des franchises sur lesquel les nous rev iendrons, et
y établirent un hôtel des monnaies où furent f rappés l es
deniers susins (den ari i secus in i fameux au moyen âge.
L ’ Empereur Fréderic Barberousse , vaincu par les Ital iens,passan t à Suse pour retourner en Allemagne, fut attaquédans le château ou en danger de 1
’ être , et s’
évada travesti
pour sauver la v ie. Ce fait est diversement raconté par l eschron iqueurs suivant le parti ou le pays auquel i l s apparte
V en te au prêtre S igefred. H is t. Pa t. Monumen ta Char tarum.
_ 168 _
Cette nob lesse avait a sa tête les Giusti qui étaient trèsanciens , l es Bartol omei , les Barral is , fami lles influentes parleurs lumières autant que par l eurs richesses . L es Barral is
se partageaient en deux branches dont l’
une habitait en v il leet l
’
autre au faub ourg des nob les ; aussi l’
appelait-on De Burgo
pour la distinguer. C ’
est probablement à sa demeure qu’
ap
partenaient les restes assez élégants d’
architecture gothiqueexistants sur l
’
ancien emplacement du faubourg.
Cette n oblesse locale ne semble pas avo ir été d’ origine
m il itaire . N ous voyons plutôt en elle d’
anciennes fam illesd
’
hommes libres qui avaient conservé une position d istinguéeparm i leurs concitoyens et que la masse du peuple éta it ao
cou tumée a respecter parce qu’
elles avaient une pos ition indépendante , de aisance, de 1
’ éducation et l’
habitude de
traiter l es afi'
aires publiques. C ’ étaient des fam illes qui
avaient rendu des serv ices , et qui pouva ient en rendre en
core. C ’
était eu somme un patriciat mun icipal plutôt qu’
une
noblesse m ilitaire et féodale . Il est v rai qu ’
un acte de 1213
parle de m i l ites s ecus ien ses mais en examinant son en
sem b le ou peut voir qu’
i l n’
a pas pour objet la noblesse deSuse en général , et qu
’ il se rapporte aux seuls possesseursde fiefs qui l es avaient al iénés sans l ’ agrémen t du souverain .
Auss i v oyons-nous dans l es nobles dont nous parlons plusd
’ inclinat ion pour les travaux de l’ intell igence que pour en
dosser la cuirasse et empoigner la lance ou l ‘ épée .
L es f ranch ises accordées à la v ille éta ien t dues en grandepart ie a la sollicitude éclairée des principaux patriciens .
Quatre d ’
entre eux avaient obtenu en 1250 la sauv egardeen faveur des Dauphinois qui v iendraient au marché de Suse ,acte d ’
excel lente adm in istration et d’
une uti lité v itale pourl e pays .
Dans l e cours du siècle plusieurs membres de cettenob lesse dev inrent de d ignes jurisconsu l tes . L ’
un d’
eux , Hen riBartolomei , le fameux card inal d
’
O stie , un des plus grandshomm es du s iècle, jeta sur son pays un lustre impérissable .
Y av ait—il une classe moyenne entre la noblesse et l e
peuple, une bourgeoisie , dans le sens moderne de ce nom ?
169
N ous ne le croyons pas . Il peut y avoir eu quelque com
merçant , quelque chef d’ ouvriers qui s
’ élevât personnellement au dessus de la mult itude, mais qu ’
une classe existâtqui èut un rang intermédiaire , aucun document ne l ’ indique .
L es d ispositions du statut concernant l a liberté indivi
duelle, l es attributions des prudhommes , et les rapports entreconcitoyens prouvent que le peuple n
’ é tait pas av i li . L e dévouement aux nobles dont i l a fait preuve dans l es luttesdes partis démontre que la noblesse l e respectait et l e traitait b ien .
Les luttes auxquel les nous entendons faire allusion furentprincipalement v iv es dans la prem ière moitié du s iècle.
Ell es div isèrent la population ent ière en deux camps , en
sanglantèrent la v ille pendant près de trente ans, et , au d ired
’ Augustin della Ch iesa , la réduisiœ nt à l’ état l e plus pi
toy ab le .
La cause prem ière des haines atroces qui causèrent tant
de ruines n’
est pas connue ; peut-être faut—i l la chercherdans une de ces rivalités d
’ influence qui surgissent facilement dans un état social comme celui que nous venonsd
’
esquisser . L e prem ier sang versé paraît avoir été celui deRondet Al l iaudi .L es All iaudi a cette époque étaien t une des fami lles qui
tenaient le prem ier rang parm i les nobles . Benoît Al l iaud i ,jurisconsulte d istingué , avait joui d ’
un crédit spécial auprèsdu souverain et rempli que lque m ission de confiance.
Or Hugonet Bartolomei tua R oudet Al l iaudi .Quoique le meurtrier ait été condanné en 1307 au b an
nissement et a la confiscat ion de ses biens, les fils de l’
occis
v oulurent v enger sa mort. I ls attendi rent le moment propice ,attaquèrent Hugonet et le tuèrent. De la, a ce que racontedella Chiesa , suiv irent meurtres sur meurtres . L es paren ts etl es am is des deux fam il les en v inrent a une guerre ouverte .
Les aires de Jai l lons prirent parti pour les Al l iaud i , et a
leur suite se rangèren t les Barral is, une partie des Ferrandi ,les Apilet i et une fami lle qui portait le surnom ou sobriquetde Cuy day .
170
Par contre l es Giusti , l es Gioven i , l es Lomb ardi et une
autre fraction des Ferrandi se rangèrent du côté des Barto lomei.
Le peuple , comme nous avons d it , partagé en deux campsprit les armes a la suite des deux partis . Les haines de fam ille dev inrent d iscordes civ i les. Des deux côtés on étaittoujours sur le qu i
—v ive ; de temps en temps surv enaien t desmêlées furieuses . La v ille était sur l e penchant de la ru inelorsqu’
enfin l e Comte Aymon interv int. Ce prince justifia icison surnom de pacifique . Ev idemment il employa l
’ influencedu clergé de la v ille et des env irons pour amener l es deux
partis déjà affaib l is a l ’
accepter pour arbitre, et ce fut en
cette qualité , autant qu’
en celle de souverain , qu’ il ré tablit
la paix.
Pierre Maréchal , personnage de grande autorité qu 1 avaitalors le gouvernement de Suse et de la vallée , a sans douteaussi contribué par ses soins a amener cet heureux résultat.
L e Comte v int à Suse avec une suite brillante de hautsbarons et de conseil lers . Il y t int le 13 Janv ier 1334 une
séance solemnel l e dans la grande salle de son château , où ,
entouré de ces personnages ém inents et avec eux l ’ abbé deSaint Just , le prieur de Sain te Marie et celui de la Novalaise , le prévôt du Mont—Cen is et l ’ abbé de la Cluse , prélathautement rév éré , i l fit ven i r devant lui l es principaux acteursdu l ong drame qui venait de se dérouler. D
’
un côté l es
Aschieri ou aires de Jai l lons , l es Al l iaudi , plusieurs Barel is ,l es Cuy day , les Api let i et quelques Ferrand i ; de 1
’
autres l esBartolomei , les Giusti , les G ioven i , d
’
autres Ferrandi , et l esLombardi ; (tous déclarèrent consentir à. la paix et la jurèrent .
Benoît Al l iaudi meurtrier d ’
Hugonet Bartolomei fut exclusde l a paix et laissé à son sort légal . Antoine Al l iaudi con
tumax fut exilé , sau f la faculté au Comte de le rappeler,auquel cas en accédant à la paix il aurait pu en jouir . L e
Prince déclara dans l ’ acte même qu ’ i l agissait so it de sa
propre autorité soit en vertu des pouvoirs d’
arbitre choisi
par l es parties intéressées . Jean Renaud ou R egnaud secré
— 172
et les Bartolomei . Ce fut le dernier écho des v ieilles di
acordes . Mais ce que la v il le avait perdu en v ital ité et en
prospérité , elle ne le recouvre p lus ent ièrement .Le retour du Piémont à la couronne de Savo ie ( 14 18 ) en
portant les préoccupat ions du souverain sur Turin qui dev intsa capitale deçà les monts , donna l e dernier coup à l
’
an
cienne importance de Suse.
L E S MO N U ME N T S DE 80 88 .
La v ille de Suse , à proprement parler, ne présente pas
des monuments importants du moyen âge .
Te lle qu’
elle results des réparations qui suiv irent l ’ incendie de 1 174 , elle était encore cinq siècles plus tard .
C ' étai t une pe tite v il le ceinte d ’
une haute muraille cre
nelée et flanquée de tours carrées , laquelle était percée de
trois portes , ce l le de Turin o ccupant l’
emplacement actuelde l
’
arc d ’ ornement qu ’ on trouve près de la place du Sole il ,celle de France qui é tait plus haut du côté de saint François ,et enfin cel le de Sav oie , v ieille porte flanquée de tours quiexiste encore .
Hors de 1’ enceinte étaient deux faubourgs . Celui des no
bles que nous avons dejà mentionné , situé audelà du rif de
Jalasse et détruit par les eaux en 1728 , et celui qui existeencore , appelé d i za d i Dora à cause de sa position sur la
r ive de la Doire opposée à la v il le.
L a rue principale de la v il le était celle qui existe de la
porte de Turin à la porte de Savoie . Là se succédaient l ’
hô
p ital de saint Jean ou hospice des pèlerins et l es maisonsdes fam il les l es plus i llustres ; d
’
abord celle des Bartolomeiattigüe au beffroi , puis celle des Aigueblanche, des Auruce ,des s ires de Bardonnêche , des sires de Jai l lons .
E n tout cela rien de monumental . Tout près était l’
an
tique église de sainte Marie , l’ égl ise qu
’ on disait quas i ep is cop a le, l
’ égl ise m ère qui avait traversé tant de siècles ;
mais el le a di sparu et il ne nous en reste aucune description .
O n prétend qu’
elle avait été un ancien temple payen et que
des pet ites idoles ont été trouv ées dans ses souterrains .
Aujourd ’
hui des maisons de particul iers tiennent la place del
’ égl ise , et l es souterrains sont devenus des caves où i l s
conservent leur v in . Là, durant le moyen âge , furen t ense
v elis bien des personnages l es plus importants de la v il le ;la étaient entr ’
autres les sépultures des Bartolomei et no
tamment l e père du grand cardinal d ’ Ost ie . L es ménagèressans s
’
en douter foulent aux pieds la cendre de ces fierspatriciens qui ont cru trouver sous les v outes jadis sacréesun asile immortel .L ’ église de saint Just autrefois abbatiale , aujourd ’
huicathédrale, date de l
’
an 1026. C ’
est un édifice noble et sé
v ère, qui n
’
a pourtant rien de bien remarquable s i ce n’
estson clocher majestueux dom inant toute la v ille .
L ’ égl ise de sain t François attigüe au couvent des frèresm ineurs , formait une dépendance de la v ille dont elle n
’ étai tséparée que par une dis tance m in ime. Convertie aujourd ’
hui
en magasin , ou peut v oir qu ’
elle n’
a jamais été bien remarquehle par sa structure. Mais elle att irait l ’ attention par
ceque l ’ illustre et saint fondateur des Franciscains , cet ordresi populai re au moyen âge , v enu à Suse , l
’
avait fondée . lui
même avec l ’ aide de la Comtesse de SavoieL cs v éritables monuments que la Suse du moyen âge pou
vait se v anter de posséder étaient ceux qu’
elle av ait héritésde l ’ antiquité . Malheureusement i l s ne sont pas tous par
venus jusqu’
à nous .
L e principal est encore debout. C ’
est l ’
arc é lev é en
honneur d ’
Auguste par les peuples Cottiens un is à l eur Roi .La description en a été donnée par plusieurs savants et biende fois répétée. Elle est trop connue pour la reproduire ici .O n sait que ce monument de style classique est construit en
pierres équarrées de marbre blanc de Forest, lesquel les
Cette ég l ise a été de n ouveau restaurée et redonnée au cul te
en 1888 (V .
— 174
étaient liées ensemble par des agrafes de métal . I l date de
l’
an 9 avant l ’ ère chré tienne et par conséquent est , après
celui d ’
Aoste , le plus ancien des arcs qui existent de l’ époque
romaine L ’ inscription dédicatoire , énon çant les noms despeuples après celui du Roi , se l it sur le f ronton des deuxfaçades . Plus b as un bas relief représente l e sacrifice du
taureau , du bélier et du porc usité à l ’ occas ion des a l
l iances O n en infère que l’
arc é ta it destiné par Co ttius
à rappeler l’
honneur de son al l iance av ec Rome en m êm etemps que sa reconnaissance envers l ’ E mpereur qui l
’
ava ittraité en am i .
Par un singul ier efl'
et de l ’ ignorance , le moine du on
z ième siècle qui a écrit la ch ronique de la Novala ise d it
naïvement que l’
arc de Suse portait indication des pro
priétés diverses de l’
Ab b ay e de la Novalaise . I l avait pr isl es nom s de peuples pour une l iste des biens des m oines .
O n a des données pour croire qu’
i l y avait à Suse un
autre arc monumental , et peut—ê tre plus d’
un .
I l résul te en efl'
et d’
un jugement de l’
an 1 464 que
peu de temps auparavan t un gent ilhomme de Suse , Françoi sGérard Roero , avait démoli un arc de pierre taillée sem
b lab le à une porte de v i lle dans un pré donné en emphy
téose par l’
abbaye de saint Just. L e l ieu où é tait ce rested
’
une autre époque donnait son nom à la local ité qu ’ on ap
pe lait a la p orte de l’
arc
D ’
autre part l e T heatrum S tatuum C. G . S a baudiae
rapporte qu’
à l ’ entrée du faubourg de Suse appelé d i la d iDora on v oyait encore ( 1682 ) les restes d
’
un antique arc
de triomphe qu’ on d isait avoir été érigé à Jules César 50
V . Prom i s , T o rin o an t i ca, p ag. 81 et a l .
V oy ez l a d escrip t i o n pub l iée par l e p ro fesseu r Pau sero .
(3) F ab ri z i o Ma lasp i_n a. S u l l’
e tà d e l cro n is ta d e l la N ov a l esa.
Arch i v 1 1 d i S tato d i To ri n o . Ab b az ia d i S . G ius to .
(5) Ad p o rtam arcus . B o ero fu t co n dan n é à rétab l ir l’
arc en son
p rem ier état ; m a i s i l n e l e fi t pas , p arceque i l ava i t p ro b ab lem en t égaré
ou rom pu l es p ierres.
Am ste l odam i, 1682, part I , pag. 67 et 68.
176
Le savant Guillaume du Bel lay en parle comme l ’ ayantvu ; car il d it : son mausolée ou sépulchre de Cott ius ) se
v oit enco re de présent, édifice d’
ouvrage antique avecques
trois tours aux trois cantons audessus et contre les murai llesdu chaste l de Suse »
E n 1802 une excavation prat iquée à Suse, là où est
ac tuel lement la place de Savo ie , m it au jour l es torses dedeux s ta tues antiques de marbre blanc. I ls ont fait l ’
admi
rat ion des connaisseurs Aux deux torses un art iste di
stingué ajouta les parties manquantes et en forma l es deuxsta tues de guerriers qui figurent sous le portique de 1
’
U ni
vers ité de Turin . Le Com te Franchi de Pont fit sur ces torsesun mémoire remarquable, où il note que les v iei llards re
présen tés sur la cuirasse d’
un des deux torses portent l ecos tume gau lois et d
’
autre part que ces deux objets d’
artappartiennent aux temps classiques de la sculpture . Selon luil es deux statues doiven t avoir été en o rigine des ornementsde l ’ arc élévé par Cott ius à Auguste.
Nous avons quelque d ifficulté à admettre son hypothèse ,parcequ
’ il nous semble peu probable que l ’ arc ait été sur
monté de deux statues et surtout de statues de ces proport ions et de ce fini , plus faites pour être vues à hauteur
d’
homme dans un palais . Nous inclinon s plutôt à penserqu ’
e l les décoraient le palais des Rois Cottiens .
I l serait à désirer que des fou illes fussent pratiquées làoù les torses on t été trouvés. El les améneraient probablementla découverte d ’
autres obje ts antiques , peut -être m ême de
que lque in scription , et en même temps el les mettraient enlum ière s
’
i l y avait en ce l ieu un édifice monumental . L avue de Suse donnée par l e T hea trum de Gio ff redo déjà cité
place près de là un édifice qu’
i l qual ifie château des RoisGo ths … Cas trum R egum Gothorum Par sa position ou
peut reconnaître que c’
est le même qu ’ on appelait de nos
An t iqu i tés Gau l o i ses . Pari s, 1556, f o l . 54.
(2) I l s furen t po rtés à Pari s et dépo sés au m usée im péri a l , pu i s rendus
au Piém o n t après l a chu te de l’
em p i re.
177
jours le p a la is du gouvernem en t et qu i est devenu l e coll ège municipal , s i ce n
’
est qu ’ il a perdu ses créneaux et
autres formes du moyen âge . Ce chateau aura it-il été en ori
gine l e palais de Cot tius ? Quoique la chose puisse paraîtrevraisemblable nous n
’
avons absolument aucune lum ière quin ous autorise à émettre un av is quelconque à cet égard , tou tcomme nous ignorons sur que l le base Gio ffredo attr1b ue le
v ieil édifice aux Rois Goths . Ce qui est certain c ’
est qu ’ ilexistait à Suse au 12
°
et au siècle un éd ifice apparte
nant au souverain qu’
on appelait du nom antique de Pa la
tium , et qu’ i l devait être ou le château dont i l s ’
agit ici ,on un autre peu éloigné de l
’
arc , peut être même celui quel e T heatrum désigne comme palais épiscopal ; car i l n
’
y a
aucune probabilité que les év êques eussent un pa lais dansSuse où i l s n
’
ont jamais résidé et où depuis l’
an 1065 l a
jurisdiction épiscopale était exercée par l e prieur de sainteMarie sous l ’ autorité du prévôt d
’ Oulx .
I V .
Le Clergè.
Au moy en âge le clergé de la vallée de la Doire se com
posait de d ivers établ issements monastiques plus ou moinspuissants , audessous desquel s v ivaient hum b lement les curés,appelés aussi chapelains , très-pauv res , très-soum is, peu éclairés , et cons idérés en proportion .
Les principaux é tablissements qui avaient une autorité ou
exerçaient une influence dans la val lée etaient : l .
°
l’
Ab b aye
ou prév ôté de saint Laurent d ’ Oulx , congrégation de cha
noines régul iers , dont le prévôt chef d’ ordre, avait la juri
d iction épiscopale sur la vallée en général ; 2°
l e prieuréde sain te Marie de Suse, maison des mêmes chanoines régu
l iers dont le prieur, sous la suprématie du prévôt d’ Oulx,
exerçait la même jurid iction dans la partie de la vall ée quiconstituait la pléb anie de Suse ; 3
°
1’
abbaye de saint Justde Suse, maison de Bénédictins qui av ait juridiction sur
quelques paroisses de la vallée ; l a célèbre abbaye de laN ova laise ayant juridiction dans la val lée de ce nom ; 5
°
la
puissante abbaye de saint Michel de la Cluse , maison de Bênédictins qu i avait sous elle p lusieurs paroisses des env irons .
Ajoutons , en raison de leur influence dans l e pays , l’
ab
b aye ou prévôté du Mont—Cen is de laquelle dépendait aussi
quelqu ’ église, et la p recep toria des Anton ins établie àsaint Antoine de R anvers .
Jetons un coup d’ oeil rapide sur l es d iverses conditions
d’
existence de chacun de ces établissemen ts .
180
cess ions de b lancs fantômes circuler autour du lieu saint enréc i tant des prières comme font les fidèles par les rogations .
La dévotion des peuples s’
acerut d’
autant plus lorsque ,v ers l ’ an 1025 , un so i—disan t chevalier français présenta àO ldé ric Mainfro i Marquis de Suse les rel iques de saint Justen d isant qu’ il les avait trouvées sous un autel de saintLaurent.
U n prêtre d’
O ulx nommé Gerard Chev rier av ec quelquescompagnons s
’
av isa de bâtir des cel lu les auprès du sanc tuairev énéré pour y prier et le desserv ir. Il se forma ainsi une
congrégat ion à laquel le Ponce de Bardonnêche seigneur du
l ieu fi t donat ion vers l ’ an 1050 de l ’ égl ise même et de ses
dépendances , ains i que de celle de sainte Marie d’
O ulx au
jourd’
hui paroissiale. Adelai de de Suse et son mari Odon deSavoie confirméren t et ampl ièrent la donat ion en 1057 . EnfinCun ib ert é vêque de Turin donna à la congregation naissan tel
’ ins titution canon ique par une bulle de l ’
an 1065 . Cun ib ert
par un esprit éclairé de bienfaisance voulut profiter de la
société religieuse qu’
i l voyai t naître pour avoir à Oulx un
étab lissement central de secours aux v oyageurs qui suivaientl a route alors di fficile et périlleuse du Mont—Genèvre . E n
m ême temps , vu l’
importance qu’
ava it acquis l ’ égl ise de saintLaurent, il jugea à propos d
’
en faire le centre religieux detoute la vall ée de la Doire en mettant sous l ’ autori té de lacongrégation d
’ Oulx les deux pléb an ies de la val lée ; et commel e b on év êque, le quel n
’
avait sans doute jamais v isité cettepart ie de son d iocèse , se figurait qu
’ i l n ’
y eut la que de
pauv res v illages difficilement accessibles au mil ieu de m ontagnes couvertes de glace , i l décida , d
’
accord avec son cha
p itre , auss i peu soucieux que lui d’
avoir sflaire dans un payspareil , de transférer au prévôt d
’ Oulx l a juridiction épisco
pale des deux p léb anies .
L es Papes ratifièrent tout cela . La Comtesse Adelmde, quigou vernai t avec une énergie v i rile , y prêta l
’
appui de son
au torité ; mais dans les temps qui su iv iren t la mort de cettep rincesse l es intérêts f roissés réagi rent contre l
’ ordre établi .L ’ égl ise de Sainte Marie de Suse était à la tête d
’
une
— 18 1
v ille importante et de la pléb anie la p lus populeuse. Elle étaitfière de sa splendeur qui l
’
avait fait qualifier de quas i ép iscop a le dans la bul le m ême de Cun ib ert . E l le devait donc sev oir avec peine a ssujettie à l ’ égl ise d
’ Oulx. Il était aussi naturel que la populat ion de Suse et de la vallée inférieure eût
passé peu v olontiers dans la dépendance d’
un chef ecclésiastique é tabli au m ilieu des montagnes auprès d
’
un simpleb ourg. O n sait que la nature, en faisant soeurs les populat ionsdes plaines et celles des montagnes , a établi entr ’
el les desrapports nécessaires qui l es un issent pour leur bien commun .
Mais on sait aussi que dans ce ménage fraternel , ce lui quijouit d ’
une majeure aisance , d’
un so l fertile et d’
un climatplus doux , et qui hab ite en approche des centres plus con
s idérab les , est parfois tenté de se croire une certaine supériori té sur l e montagnard pauvre et gross ièrement v êtu ,
le
quel a son tour est fier de son activ ité intelligente , de sa
v igueur, de son indépendance et presque de sa pauvreté .
L ’ irritation des habitants de Suse dev int telle qu ’
un jour i l ss
’
attroupèrent , l e clergé en tête , marchèrent sur Oulx, eu
v ahirent l e monastère et chassèrent l e prévôt .N aturellement celui—ci rev int bien tôt après sur son s iège ,
mais i l ne put rétab l ir sa jurid icti on dans Suse que dans la
suite des années. Il y fut aidé puissamment par l es souverains
pontifes . Calixte I l , prince de Bourgogne, qui passa à Oulxen 1 120 pour se rendre à son couronnement à Rome et
se reposa dans le monastère , appuya sév èrement l e pré
v ôt . Néanmoins avec l e temps l a force des choses l’
emporta
sur l ’ autorité des bulles . L es pré vôts finirent par se con
tenter d ’
une suprématie de droit laissant en fait au prieurde Suse l e gouvernement de la pléb anie ; et ainsi s
’
écoula
le reste du moyen âge sans aucun autre incident marqué .
Les chanoines régul iers d’
O ulx ont prospéré pendant prèsde trois siècles , honorés à l
’
env i par les souverains et par
l es évêques , soit de la haute Ita l ie , soit de la France mérid ionale . De nombreuses églises des deux cô tés des Alpes leurfurent soum ises ; plus ieurs maisons hospital ières sur la routedu Mont—Genèvre dépendaient d
’
eux. Outre l a vallée de l a
— 182
Doire, le prévôt avai t sous sa jurisdiction celle du Cluson . I l
nommait aussi la plupart des curés du Briançonnais et per
cevai t les dîmes de tout ce b ai l lage . Deçà les Alpes i l étaitseigneur de Chaumont sous l a mouv ance du Dauphin et pas
sédait les mei lleures terres de ce territoires outre beaucoupde propriétés d iverses dans l a val lée supérieure . Ces religieuxétaient actifs , enclins à l
’ étude et à la bien faisance .
Au siècle la d iscipl ine commen ça à baisser . L e cha
pitre général de 1’
ordre , en 1342, crut nécessaire une bonne
prison pour pun ir les récal citrants .
La décadence augmen ta dans l e s iècle suivant lorsquel ’ usage s
’ introduisit de con férer en commende la charge deprévôt. Il arriva que des commendataires han taient la cour
de France aul ieu de résider dans le siège de leurs fonctions .
L e prieur de Suse richement doté v ivait aussi en prélat commel e chef de l ’ ordre.
Quelques prévôts ont joui d’
une grande considération . T e l
fut au s iècle Flocard Berard , conseiller du Dauphin Humbert 11 ; tel fut au siècle suivant Emeric d ’
Arces élu arbitrede d ifférends entre la maison de Savo ie et le Marquis de S al uces . Deux prévôts étaient rev êtus de la d ign ité de cardinal .
O n eut d it que l es curés recevaient leur institution des
prévôts comme une sorte d ’ invest iture féodale ; car i ls éta
ient tenus à la redevance d ’
un chapon ou d’
une poul e , sui
vant l ’ importance de la cure.
L’
ABBAYE DE S AI N T JU S T .
Lorsque l e Marquis O lderic Main froi crut être devenu
possesseur des rel iques de saint Just , il s’
empressa , de con
cert av ec son frère l ’ évêque U lric et avec sa femme la Com
tesse Berthe, de faire bâtir une grande égl ise pour les ré
cevo ir et d’ établi r une abbaye de bénédictins pour desserv ir
cette égl ise. L ’ église fut b âtie en 1028 ; la fondation de l’
ab
184
Charles Emmanuel 111 en stipula fo rmel lement la renoncia
tion de la part de l’
ab bé de saint Just en 1768.
D’
après ce qui précède, i l est facile de comprendre que
l’
abbaye de saint Just jouait dans le pays un rôle quelquepeu efi
‘
acé. Leur égl ise ab b atiale est la cathédrale actuelle .
Leur cloître est aujourd ’
hui le séminai re épiscopal . L’
ab bay ea été abol ie en 1778 pour créer l ’ év êché .
L’
ABBAYE DE LA N O V ALAI S E .
N ous avons parlé ai l leurs du Patrice Ab b on , un des p lushauts personnages de l
’
empi re Franc sous l e règne nom inalde Thierry , le dern ier des Rois fainéan ts.
Ab b on étant seigneur des vallées de Maurienne et de Susefonda l ’ abbaye de la Novalaise en 726 pour assurer des se
cours aux voyageurs qui passaient le Mont—Cenis et notamment pour faciliter l es commun icat ions entre ses sujets desdeux versants . Il la confia aux bénédictins et à sa mort ill
’
institua héritière de son immense fortune.
L ’
abbaye devint ainsi m aîtresse en p lein al leu de la petite vall ée de la Novalaise et propriétai re d
’
un nombreinfini de v illages et de fermes , soit dans les Alpes Cottiennes ,soit en Provence et de là remontant l e Rhône jusqu ’
au d io
cèse de Genève .
L es incurs ions des Sarrasins avaient endommagé cet énormepatrimoine du côté du l ittoral . La d ifiicul té de conserver tan tde biens dans une seule main fut cause d ’
autres pertes .
N éanmoins l ’ abbaye était encore une des plus riches et
des principales de l’
empi re lorsque Charlemagne , descendanten Italie pour son expédition contre l es Lombards , y v intréclamer l ’ hospitalité que ces grands é tablissements étaienttenus de donner dignement au souverain et à sa suite .
L e fon d ateur l a d i t étab l ie i n a l l od i o m ea.
— 185
Ici le chron iqueur de l a Novalaise nous raconte na1vement
un incident qui peint l’
époque .
Charles prolongeant son séjour pour étudier l e moyen deforcer ou tourner les Cluses Lombardes , l
’
abb é s’
av isa de
ven ir un matin se jeter à ses p ieds et lui exposer humblement que l es prov is ions du monastère é taient à la fin . A ce
d iscours le v isage serein du monarque se rembrunit . I l s ign ifiasé vèremen t à l ’ abbé qu
’ il connaissait ses droits et en tendaitl es faire respecter. Alors , di t la chronique , le saint hommese retira plein de chagrin . Puis il se m it en prière et prialongtemps , longtemps . L e lendemain on alla aux magasins dumonastère ; i ls étaient p leins de prov isions de toute espèce .
L es Carlov ingiens comblèrent l’
abbaye de priv ilèges selonl
’
usage de ces temps où le droit commun était trop peu dechose . Mais les abbés et leurs religieux s
’
en montrèrent di
gnes par les moeurs et par l’ instruct ion . La chron ique nous
apprend que leur bib liothèque en 906 contenait 600 v olumes ,nombre énorme pour ce temps
- là ; car nous savons que dansune époque bien moins ancienne et bien plus éclairée la b ib l iothèque du Roi de France Charles le sage ne possédait que900 volumes .
O n peut se fai re une idée du respect que les peuples dela vallée de Suse avaient pour l e monastère de l a Novalaisedans ce fait que nous apprend encore le v ieux chron iqueur.
Lorsque l a saison é tait venue de recuei l lir les redevancese t ofl
’
randes en nature en faveur du monastère , un chariot
partait de l ’ abbaye surmonté d’
une cloche. Il parcouraita insi tous les pays de la vallée suiv i d ’
autres chariots v ides .
L es habitants , avertis per le tintement de la cloche , accou
raient pour apporter et mettre sur l es chariots l es denréeset autres choses dues au ofl
'
ertes . Quand ces chariots é taientpleins on en ajoutait d ’
autres , et ainsi retournait au monastère un convoi tellement accru qu
’ il formait une file im
mense de v éhicules avec une prov is ion énorme de touteschoses .
Il se passa ains i deux siècles qui furent l’
âge d’
or de
l’
ab baye. Grandeur , opulence, considération concoururent à
— 186
rendre splendide cette phase de son histo ire. Tous les abb ésde cette époque laissèrent un nom rév éré. Le plus fameux
es t Eldred qui v ivait sous le règne de l’ Empereur Lothaire
La légende lui attribue plusieurs m iracles , et, entre au
tres , celui d’
avoir dorm i sous un arbre pendant 300 ans , aprèsquo i i l rentra au monastère , trouvant , comme de raison ,
tout
changé . Le portier ne le reconnaissait pas ; i l y avait un autre
abb é et d’
autres mo ines , l esquels lui firent mauvais accheil ,le prenant pour un intrus. Cependant la légende d it que pendan t ces trois siècles ses cheveux ni sa barbe n
’
avaient ni
poussé ni b lanchi .L ’ invasion des Sarrasins m it fin à l ’ abbaye en 906. Long
temps après qu’ ils furent expulsés , l e Marquis O l dericMain
f rai rétablit à la Novalaise une maison de b énéd ict ins , maisdans des conditions infiniment plus modestes, sous un s impleprieur, avec la seule possession de la val lée de la Novalaiseet de quelque propriété dans la combe de Suse.
D ’
ailleurs le nouvel établ issement ne récupéra n i l es lu
m ières, n i la réputation de saintété de l ’ ancien . S es plusb eaux jours furen t sous l ’ administration de deux prieurs distingnés , Ruffin Bartolomei au m ilieu du si ècle et V incentAschieri au m ilieu du 15
°
Comme prélat, l ’ abbé ou prieur de la Novalaise n’
avaitsous sa juridiction que les égl ises de cette pet it e v al lée ; aussiavait—i l à ce t itre peu d
’ influence dans l a val lée de Suse . I l
n’en avait guères plus en sa qual i té de seigneur féodal dont
nous parlerons ailleurs .
Il n ’
est resté du monastère de la Novalaise n i une égliseancienne, n i un cloî tre du moyen âge. O n ne peut prendreun
’ idée de ce que fut l ’ antique abbaye que par l es chron i
ques et par l es documents .
I l reste d e l u i un acte daté d e 1’
au 827.
L a d ign i té d’
ab b è n e fut rétab l ie qu’
au s iècl e. V i ncent Asch i eri
ou d e Jai l l an s , étai t p ri eur en 1 439 et en 1 447. I l fit fa i re l es sta l l es é lé
gan tes du ch oeur l esquel les figuren t actuel l em en t dan s l’
égl i se de B ar
d onn êche.
— 188
A l’
hospice la régle était peu sévère . Le religieux hospital ier y donnait satisfaction à son zèle pieux sans se soume ttreà un joug trop gênan t . Il y avait du b ien à faire et que lquechose de chevaleresque dans la singularité du séjour, et
d’
aventureux dans l ’ hospitalité à donner, dans l es secours à
porter sur la route, dans les dangers à courir.
Puis le sommet des Alpes a ses charmes comme les ondesde l
’
O céan . E n h iver le manteau de neige qui s’ é tend à des
espaces sans fin , a aussi son sublime. L es m ugissements de latourmente parlent à l
’ imagination comme ceux de la m er .
Le zéph ir de juin a les b a leines les plus pures , l es fleursde juillet ravissent par leur varié té , l eur éclat et leur parfum .
Il n ’
était pas interdi t au jeune hospita l ier de suiv re en
h iver la piste du l ièv re sur l a neige durcie , de poursuiv reav ec ses chiens, dans la b elle saison , le chamois trés—fréquenta lors , ou le bouquet in qui hantait les glaciers d
’
Amb in et
l es pics env ironnants . Il pouva it se l iv rer à l a chasse du l agopède et de la perdrix rouge , à cel le du gibier aquat iqueattiré par l e lac, et à la pèche a lors abondante .
Mais bien que l’ époque fût peu sévère sur l
’
ob servance
des règles monastiques , i l ne manqua pas de dé tracteurs pourd ire que dans ce m élange de pié té e t d
’
exercices mondains ,l es d istract ions du chasseur firent parfois oublie r l e brév iairedu chanoine , que la solitude , si elle élevait l ’ âme , laissaitaussi se renforcer le mauvais levain du v ieil Adam ,
e t que
l e désert des Alpes avait ses tentat ions comme ceux de l aThébaïde .
Le fait est que cette maison de refuge , qui paraissait perdue dans l ’ espace , au dessus de tous les soucis du monde ,fut plus d
’
une fois en butte aux censures de l ’ égl ise et m êm eaux foudres du V atican .
Tantôt c ’
est un religieux qui est excommun ié pour ses dél its probablement des faiblesses , et qui en raison de son
repen tir est absous par son supérieur au nom du SouverainPontife. Tantôt c ’
es t l e prévôt lui -même , qui au bruit des
Pro d e l ictis. E n 1433, Arch iv es d’ État de Turi n .
1 89
armes oublie son cloître , endosse l a cui rasse et suit à la
guerre le Prince d’
Achay e , se battant en brave chevalier eten digne rejeton , comme i l est , du sang illustre des Rama
gnan . L e Pape l’
excommunie , puis l’
ab sout
Plus tard un autre prévôt , est fulm iné pour des délitsnon spécifiés U n autre encore pour rénitence à payer desredevances dues au Pape U n autre encore pour ne pas
s’ être rendu au concile général ou il avait été appeléO n voit que l es prélats dans leur éloignemen t se sente.
ient quelquefois des inst incts d ’ indépendance.
L’
ABBAYE DE LA CLU S E .
O n sait que l’
abbaye de la Cluse occupait l e sommet piram ida l du mon t Pirchiri en (
5
) qui dom ine la vallée de Suse.
L ’ église , qui existe encore en son entier, est bâtie sur l e
point culm inan t de la pyram ide rocheuse . L es bâtiments del
’
abbaye , fondé s dans le roc sur l es pentes env ironnan tes ,s
’ élev aient tout autour de l ’ église . L ’
ensemble se présenta itau dehors comme une forte enceinte de hautes murail les depierre , masse imposante et sombre , semblable à un énormechâteau fort. U ne porte à pont- lev is donnait accès à des ram
pes in térieures , par lesquel les on s’
élévait au n i veau du
cloître .
L a fondation de l ’ abbaye eut lieu vers l ’ an 999 sous legouvernement du Marquis Hardouin , père d
’
O l deric Mainfrai
E n 1410. C’
éta i t Ay mo n de Bam agn an , chano in e régu l ier d’ O u lx,
él u p rév ôt d u Mo n t—Cen i s en 1398. (Arch ives d’ État de Turi n ).
E n 1425 (Arch i v es susd i tes).
(3) E n 1421 . (Arch iv es susd i tes ).E n 1442. I l s
’
ag i ssai t du Co nci l e de Bâ l e. (Archiv es susd i tes).Mon tagne de f eu .
Prov ana. D issertas io n e sopra al cun i scri ttori del m on i stero d i S .Michel e del la Chiara. Mem orie del l
’Accadem ia del l e S ci en s e d i Torino .
_ 190 _
U n baron d’
Auvergne , Hugues de Moutb o iss ier, était al léà R ome pour ob tenir l
’
ab so lution d’
un grand crime . Délivréde ce po ids , il revenait en France par la route de Suse, l ors
que la pensée lui v int de b âtir un monastère sur la cime duPirchirien , admirab le sol itude , où des hommes pieux , ayantsous leurs pieds l
’
immense val lée du Pc qui s’ étend à perte
de vue , couverte de v il les et de v i llages , et sur leur tête leciel par des Alpes , auraient été détachés du monde et facilement ab sorb és par de sub limes méd itations .
Le nouvel établissement dev int bientôt célèbre . Au boutde deux siècles il était chef d
’
une grande subdiv ision de
l’
ordre de saint Benoît. L ’
abb é de la Cluse eut alors souslui plusieurs abb ayes et plus de 150 égl ises placées en d iversdiocèses d ’
I ta l ie , de France et de Bourgogne . L es religieuxde l
’
abbaye s’
é levèrent , d it—ou , jusqu’
au nombre de centdans cette époque de splendeur . I ls avaient acquis d
’
abordune grande réputat ion par les bonnes moeurs et l
’
appl icat ionà l ’ étude .
Leur prospéri té ne fut pas pourtant sans nuages . Au ou
z ième s iècle de v ifs démêlés s’
élev èrent entr’
eux et l ’év êquede Turin, qui é tait l e b on Cun ib ert . U n abbé nouvellementé lu n
’ obt int pas de Cun ib ert la bénédict ion épiscopale et prit
possession de l’
abbaye sans avoir été béni . L a cause du refusde l ’ év êque nous es t inconnue ; mais la présomption nous paraî t être con tre le mo ine , soit parceque Cun ib ert é tait un
homme colére mais consciencieux, dont l es v ertus sacerdo
tales on t été reconnues par ses propres ennem is , soit parceque la Comtesse Adelaide , aussi pieuse qu
’
énergique , s’
ab
st int d ’ interven ir en faveur de l ’
abbé . Il y eut plus , car, lad iscorde entre l es deux prélats continuant , l e Comte Pierre ,fil s de cette princesse , en v int à l ’
extrém ité de se porter enarmes contre l e m onastère pour l e mettre à l a raison .
I l devait être assez com ique de voir 1 evêque en courroux grav issant l a montagne avec un j eune prince
’
a la tète
d’
une troupe armée pour attaquer dans son cloître l e pèreabbé non béni . Celui-ci apparemment fit semblant de se sou
mettre pour se l ibérer des sol dats du Comte Pierre . L e fait
— 192
placés qui v oulussent s’
y ret irer pour v iv re dans la solitude .
Il a vait même eu un moment le projet de fini r ses jours laen sol i taire auprés des tombeaux de ses ancêtres . Maximed
’
Azegl io a dressé et publié dans sa jeunesse l es dessin s dumonument en ruine tel qu
’
i l existait alors .
S AIN T AN T O IN E DE RAN V E R S .
Saint Antoine de R anvers était une maison de l ’ ordrereligieux et chevaleresque de saint Antoine , don t l e GrandMaître résidait à saint Antoine de V iennois .
L es cheval iers de saint Antoine avaient été institués aprèsla prem ière croisade pour soigner une de ces aflreuses ma
ladies qui furent alors importées de l’
O rient , laque l le é ta itappelée le feu de saint An toine . L es malades croyaient sent irune humeur âcre et b ru lante circuler dans leurs m embrescomme un feu dévorant et dé tacher des as les chairs , qui enefl
'
et à la longue tombaient par lambeaux.
L ’ épouvante jetée en Europe par un fléau si horrible fit
rechercher partout les chevaliers de saint Antoine . Dès l’
an
1 100 l e Com te Humbert 11 les établit à R anvers , Leurs maisons é taient en origine des hôpitaux placés sous la d irectiond
’
un ou de p lusieurs chevaliers . L e chef de la maison partait l e t itre de p récep teur .
S ur la fin du t reiz ième siècle l e Grand-Maître d ’
alors v ou
lut introduire dans l ’ o rdre la discipline ecclés iastique . Il l efit pour la maison m ère, mais il paraît que les chevaliers desautres établissements conserv èrent leur ancien éta t.
Cependant le feu de Sa int Antoine disparaissait peu à peude l
’
E urope . L es précepto ries restées sans occupat ion se con
v ertirent en une espèce de commanderies , dont jouissaientl es précepteurs , v ivant en p l eine liberté . Celui de R anv ers
avait une é tendue considérable de bonnes terres qui pouvaient lui fourn ir une large aisance. Il avait soin de l ’ église,
193
ce gracieux reste d ’
architecture gothique ; car i l paraît , parl es traces qu
’
i ls ont laissées , que ces religieux avaient dugoût. I l prêtait hommage féodal à la maison de Savoie
I l para ît qu ’
au s iècle l’
étab l issemen t éta i t ab andon né . L e Duc
E manuel Ph i l i b ert l’
ann exe à l ’
ordre d e sa i n t Maurice.
V .
Des croyances V andoi ses dans l a val l ée de l a Doire.
N ous n’
entendons pas nous occuper des origines des
croyances vaudoises , et d’
autant moins entrer dans la v ieillequest ion des rapports qu
’
el les purent avoir avec l es opi
n ions de Claude é vêque de Turin , surnomm é l’
iconoclas te .
Il nous sufli t de poser en fait que longtemps avant les iècle ces croyances existaient dans la vallée de Luzerne
et dans les pays contigus , mais que les documents connus nenous ré vèlent aucun indice de leur existence dan s la valléede la Doire dans les temps an térieurs à ce si ècle .
Ni l es prévôts d’ Oulx , qui exerçaient la juridiction épi
scopale dans presque toute l a vallée, n i l es abbés de la Novalaise , de saint Just et de la Cluse , qui l
’
ava ien t dans diverses paroisses , ne résultent avoir eu des doutes sur l ’ orthodoxie de leurs ouailles .
Mais dans la prem ière moiti é du s iècle l es inquisitours de l a fo i commencèrent à supposer que l
’
hérésie eût
pénétré dans l a val lée de Suse , soit que des V audois eussen tpassé les monts , soit que des personnes des pays inférieursde l
’
I tal ie , poursuiv ies comme appartenan t à la secte des
Patarins , ou autrement hétérodoxes , eussent cherché un asiledans cette partie des Alpes . Il ne résulte cependan t d
’
aucune
procédure faite alors par l’
inquisit ion.
E n 1384 l e domin icain Pierre Cambiano de‘
S av i l lan , in
quisiteur général en Piémont , obtint du Prince d’
Achay e un
ordre aux seigneurs de Lu‘zerne de faire arrêter p lusieurs
— 196
La tradit ion n’
accuse point de sa mort l es habitants de
la vallée de Suse ou ceux de la vallée de la Doi re . O n l'
im
puta à des héré tiques ré fugiés dans la val lée de Lanzo ,
c’
es t-à—dire aux V audo is qui avaient dû quitter l eur foyers
pour fuir la persécution provoquée par Pierre de R uflia.
Au reste on voit que dans ces temps de v iolence les
mêmes causes produisirent ai l leurs les mêmes e ffets . Dix ans
aprés le meurtre commis à Suse , l’
inquisi teur qui avait suc
cédé au dé funt , étant dans l’
église de Brichérasio , fut assai l l ipar douze hommes armés dans l
’ égl ise m ême et massacrédans le lieu saint
E n 1387 l’
inquisiteur Antoine de Septo entreprit une
poursuite en grand pour l’
extirpation de l’
hérés ie.Deux dén onciateurs furent l ’ âme du procès , un moine nat if de
Saint Raphaël prés de Turin , appe lé frère Antoine Gal osna,
et un nommé Jacques Boch de Chieri , deux scélérats fiefl'
és ,
de ces hommes sans fo i n i loi qui v ivent sur l ’ hypocrisie et
trafiquent du mensonge sans s’ inquiéter des conséquences
que leurs ca lomn ies peuvent porter.
Ce deux m isérables trouvèrent un peu partout des hérétiques à dénoncer. L es accusations principales éta ient ce l lesde croire qu’
un dragon eût créé les choses v isibles , d’
adorerl e soleil et la lune , de n ier l ’ enfer et l e purgatoire , de ne
v ou loir qu ’
une communion à leur façon et°
de ten ir des réu
n ions secrètes et nocturnes où, à la faveur de l’
obscurité ,l es femmes étaient m ises en commun .
L es in fàmes délateurs osèrent lancer de parei l les imputat ions contre l es prem iers personnages de la noblesse de
Chieri , et m ême contre les dames les p lus qualifiées de cettev ille alors si considérable .
L es V audois furent attaqués en masse et l es inquisiteursayant é tabli leur tribunal a Pignero l obt inrent qu
’
un certainnombre d
’
entr ’
eux fussent traduits là en prison . Mais le
Prince d ’
Achay e ayant fin i par leur faire senti r qu ’ il l esmettrait en liberté moyennant finance , le bureau de l ’ inqui
Con ti nuaz i on e degl i Ann al i del Baran io .
sition qui l e sut déguerpit en maugréant l’
appui trompeurde ce Prince .
Dans la val lée de la Doire l es dénonciateurs ind iquèrentcomme hérét iques l es habitants de Sauze-de—Césanne , que
les V audois considéraient au contraire comme ennem is . Ces
bons montagnards étaient sans doute plus attachés à l a con
fect ion de leurs fromages qu’
aux controverses de théologie .
I ls démon trèrent leur innocence et furent laissés en paix.
Dans les autres pays de la val lée on dénonçait çà et là
des hommes et des femmes ; c’ étaien t des habitants d ’
Av ei l
lane , de V il larfouchard , de Coazze , de Méane , de Mat tie ,de
T rana , de Giaveno , de V illar-A lmese et de la v i lle m ême deSuse, hôteliers , artisans ou simples particuliers , aucune per
sonne de d istinct ion .
I l é tait cependan t nature l que tan t de trouble jeté dans
l es foyers de gens paisib les m it 1’
alarme partout et provo
quàt à la fin une réaction v iolente . El le v int et fut terrible .
L es deux délateurs avaient eu l’
imprudence , pour appuyerleurs d ires , de déposer qu
’ i l s a vaien t v écu avec des patarinset autres sectai res , partagean t leurs erreurs , participant àleurs prat iques immorales . O n se demanda ce qu
’ étaient , ceshommes tantôt consorts et tantôt persécuteurs des héréti
ques , suivan t la convenance du m omen t. O n en v int à v oiren eux des hérétiques convaincus qui avaient abjuré de
mauvaise foi et on les considéra comme relaps D ’
accuauteurs il s dev inren t accusés ; le fanatisme des juges se tournacontre l eurs personnes et i l s subiren t , efl
’
roy ab le tal ion , la
peine atroce à laquel le i l s avaien t exposé tant d’
autres . Le
5 septembre 1388 , l’
inquis iteur Antoine de Septo proférait àTurin la fatale sentence dans l ’ église cathédrale de saint Jean .
L e frère Antoine Galosne et Jacques Bech périrent sur un
bûcherLa sentence de condamnat ion prononcée contre Galosne
et Bech a été récemment donnée au public par M. le Baron
H ou ssns con tra Ya l d snsss. Arch i v i o S to ri co I tal iano , ser. I I I , tom .
parts
Ci b rario . E conom ia po l i t ics de l Med io E v o .
198
Manuel E l le est comme un résumé des apinions étrangeset incohérentes et des rites mys té rieux imputés aux héréti
ques d ’
alors . L es condamnés avaien t été reconnus coupablesde croire et d
’
enseigner que l’
homme ne doit adorer d ’
autredieu si ce n
’
est le d ragon qui co m b at contre Dieu , est plusfort que lui et domine le monde entier ; que le d iable a créétoutes le choses v isibles , qu
’
i l est tombé du ciel et fait pén i tence sur la terre , d
’
où il doi t remonter dans sa gloire ;que les corps humains son t an imés par des démons , c
’
est-à
dire par des anges tombés du ciel pour avoir pêché , qu’
ains itoute femme enceinte porte un d iable dan s son sein et qu ’ i ln
’
y a de diables au monde que les hommes et les femm es ,
qu ’ i l n ’
y ni purgatoire ni en fer, que l es âmes de ceux dela secte qu i n
’ ont pas reçu le con s o lamm tum , c’
est—à—direl e v iatique à l eur manière , entrent dans le premier corpsvenu d
’
homme ou de brute ; que Moyse a reçu sa loi dud iable, que Jésus é tait fi ls de Joseph etc.
E n m ora le ou les d isait convaincus d ’
admettre 1 1nceste
entre fils et m ère , père et fil le , frère et soeur, et d’
avoirparticipé aux conci l iab n les obscènes et nocturnes qui réun issaient l es sectaires des deux sexes .
Que croire des faits qu’
avaient attestés les scélérats con
damnés par l’
1nquisit ion ? Des déposi tions en partie ré tractéesou reconnues sans fondement , en partie inv raisem blables,tou tes plus ou moins incohérentes , inspirent bien peu de con
fiance . Mais il n ’
est pas hors de v raisemblance que dans la
vall ée de Suse , contigue à cel le du Cluson où habita ientdes V audois et peu éloignée de la V all ouise et autres rè
gions du B riançonnais , où régnaient des croyances iden tiqueset ana logues à celles des V audois , quelqu
’
opinion hétérodoxen
’
ait glissé dans la val lée de la Doi re . Ce que nous tenons
pour certain , c’
es t qu’
en tout cas ces opinions n’
y av aientpas l a consistance d
’
une secte .
L e sieur Brunet de l ’Argent ière, qui publia en 1 750 un
U n ep iso d i o d e l la sto ria d el Pi em on te n e l seco l o XI I I . Tori n o , 1874,pag. 7l .
200
de cel les dont nous avons déjà parlé , où l e m in istre du cul teprésidan t l
’
assemb lée faisait éteindre les lum ières , et hommeset femmes s
’
accouplaient à l’
aventure dans les ténèbres .
Il ne résulte pas du reste si les réun ions eurent l ieu àBardonnêche ou si Simon Olivet l es a hantées dans un autrel ieu du Briançonna is où l es sectaires aien t été p lus nom
breux . Cette dern ière supposition nous paraî t plus probable ,parceque nous n
’
avons aucune autre trace de l ’
existence dela secte à Bardonnêche ou dans le voisinage , où il eut étéd iŒcile de la teni r cachée .
E n 1429 un homme et quatre femmes avaient été brû lésv i fs à Chaumont pour crime d
’
hérésie et de sortilège ; maisau fond i l s furent condamnés pour sortil ège , et l ’ accusat iond
’
hérésie n’ é tait qu ’
un accessoire habituel de l ’ autre .
C ’
est ainsi que nous trouv ons en 1503 deux patrimoinesf rappés de confiscation par suite de condamnation pour héréale et sorti lège, celui d
’
un Beney thon Frey let de Mél ezet ,et celui d ’
une v euve Gauteri d’
E xil les
Chorier pré tend que sur la fin du règne de Louis XIIl
’
hérésie faisa it de grands progrès dans les Alpes Dauphi
noises et spécialement dans les val lées d ’ Oulx et de Bardonnêche L ’
èvèque d’
Angoulême , inquisiteur de la fo i , fut
chargé d’
y procéder à de nouvel les recherches . O n en
v int , dit Charier, à cet te extrémité que l’
on v ou lut con
traindre les che fs de fam i lle à dé férer aux inquisiteurs leursfemmes et leurs en fants , et ceux—ci l eurs maris et leur pères .
L a peine des obstinés dans leurs erreurs fut le feu . Il y en
eut m ême pour ceux qui les quittaient. I l leur fut ordonnéde porter sur leurs habits , s
’ ils é taient jaunes , une croixblanche , s
’ ils é taient blancs , une croix Mais la
mort du Roi qui arriva le prem ier jour de janv ier de l’
an 15 14
fit une suspension à toutes choses .
L e sieur de l ’
Argen tière ajoute que l ’ év êque d’
Angou
l ême fut puissamment aidé dans sa m ission par Jean Colomb
Arch i v es d’ E tat de Turin.
Hi sto i re du Dauph i n é. Ab régé, pag . 81 .
201
de Césanne , théologien et préd icateur alors fameux et
qu ’ i ls agi ren t avec tant de succès , qu’
après avoir fait l ivrerà Gal gouverneur d
’
E xi l les quelques mutins,i l ne resta plus
aucun V audois dans le B riançonnais .
Liv rer les mut ins , c’
est-à—d ire ceux qui ne v oulaient pasabjurer, au gou verneur d
’
E xi l les, qui représentait le brassécul ier, c
’ était , suivant la prat ique des tribunaux d’
inqui
sition , les envoyer à la mort par l e suppl ice du feuOr il est dan s la nature des choses que les opin ions
qu ’ on croit dé trui re par la v iolence restent v ivantes à l ’ étatlaten t comme un ressort comprim é , ou comme une braisecouverte de cend res . A la prem ière occasion ce feu mal
é teint jette de nouv eau des étincelles .
A Chaumont en 1560 , époque où les idées de réformereligieuse fermen taient pu issamment en Dauphiné , un laïques
’
av isa de monter en chaire pour y prêcher l a ré formeA Ou lx l e ham eau de Sain t-Marc donna au culte ré formé
un m inistre qui exe rça ses fonctions avec distinct ion dans laval lée de Fenes 1re l les , et qui exerça , plus tard , auprès deL esd igu ières , une nob le influence dans le sens de la modé
rat ion et de la to lérance religieuse .
Ici nous devrions nous arrêter pour ne pas sortir des l im ites du moyen âge , mais qu ’ i l nous soit perm is d
’
ajouterun mo t sur les de rn ières v icissitudes des O pinions diss identesdans la v al lée de la Doire .
L esd iguières s’ é tant rendu maître du territoire audessus
d’ Exi l les en 1590 , puis d
’
E xi l les et de Chaumont en 1595 ,
l e cul te pro testant fut ouvertement professé par plusieursfam il les à Chaumon t , à Sa lbertrand et à Fen i ls . A Chaumon tl es ré formés essayèrent même de bât ir un temple en 1616 ,
et i ls en ava ien t obtenu 1’
autorisation du gouvernement .L ’
exaspération des catholiques parv in t cependan t à empêcher
Charier m et Co l om b au n om b re des i l lustrat i on s qu’
eut le Dauph i né
sous l e règn e d e L ou i s XI I . I l l e qua l i fie d e gran d théo l og ien . Guy Al lard
lui a co n sacré un art icl e dan s sa B ib l io thèque d u Da up h in é.
C i b rario . E co n om ia po l i t ics de l Med i o E V O .
(3) S omma i re m anuscri t du Chan o i n e T e lm on .
202
cette nouveauté . A Fen ils l’
actuel le égl ise paroissiale fut
pendan t l ongtemps partagée entre les deux cul tes
La ré vocation de l ’ édit de Nantes y m it fin . Plus ieursfamil les émigrèrent. Cel le du ministre Perron s
’
éta it réfu
giée en Hollande. 11 en restait quelques unes qui d issimu
laient leurs opin ions . Lorsqu’
en 17 13 la haute vallée fut
cédée à V ictor Amédée 11 Duc de Savoie, on rapporta à ce
Prince qu’ il y en avait encore sept fam illes à Fen ils et une
à Mo l l ières . Il donna ordre d i far l i r itirare
S om ma ire manuscri t du Chano ine Talm on .
Arch i ves d’ État de Turi n.
_ 204 _
D’
autre part la trad ition s’
est conservée à Suse qu ’
un
anc ien seigneur de Ja il lons avait obtenu du Pape le rê vacat ion d ’
une maléd ict ion qui pesai t sur les hab itants de la
v i lle . S acche tti , his to rien de Suse , rapporte un testam ent de
l’
an 156 1 , dans leque l un Com te Aschieri seigneur de Jail lansdéclare vouloir être en terré dans l ’ ég l ise de sa int Fran çoisoù es t l
’ inscription tumula ire de son ancê tre le se ign eur
Amédée de Jail lans lequel , d it—i l , est réputé a voir obtenu du
Pape , qu’ i l levât l ’ interdi t pesant sur l es S us ins E t e n
effet l’
on a trouvé dans l ’ église de saint François l e sépu l
ture d’
un Amédée de Jaillans , et i l nous res te son ép ita phede laquel le i l résu l te qu’ i l est mort le 3 des Kn len des
d’
Août 1 267 . Il es t d iffici le de douter que ce soit le m êm epersonnage don t parle le tes tamen t de 1561 . C ’
est-à-d i re quel
’
anathème , duquel on conserve la trad it ion , aurait été en térieur eu s iècle e t qu’ i l aurait été le vé avan t l ’
an 1267 .
Ces ré sulta ts afl'
a ib l issen t jusqu ’ à un certa in point le té
mo ignage de Baldessano et de l ’ é v êque B rizio , puisque cet
anathème, dont i ls ont parlé ay an t duré jusqu’
au règne duduc de Savoie Charles- le-b on , aurait cessé d
’
exis ter près detrois sièc les auparavan t .
Mais les deux témoignages se prêten t un appui réciproquequant au fait principal qui est l
’
exis tence de l ’ anathèm e .
Serait- i l donc v rai que l es S usins eussent tué deux év êques ?D ’
abord il est aujourd ’
hui bien constaté que Suse n’
a
jamais été l e s iège d’
un é vêché avant 1772.
La trad i t ion ne pourrait donc s’
appl iquer qu’
à des évê
ques de Turin ou de Maurienne , l es seu ls qui aient eu jur id ict ion dans Suse ; et comm e on n
’
a absolumen t aucun in
dice que des é vêques de Maurienne , ou un seu l d’
entre eux ,
ait péri deçà l es monts , i l s’
ensuit qu’ i l faudrait chercher
l es deux v ictimes épiscopales dans l e nombre des é vêquesde Turin .
ab so l u t i on em et v en iam i n terd ict i , in d ict i hom i n ib us S ecu s i ae ob
occi s i o n em ep i sco p o rum ejusdem l oci . ( S acche tt i , Mem o ri e d e l l a Ch i esa
d i S usa, p .
205
Or l a critique paraît avoir aussi démontré qu I l n’
estmort aucun é vêque de ce d iocèse dans la val lée de Suse
L ’ é vêque U rsucin repose en paix à Turin . O n y a trouvéde nos jours son tombeau près de la cathédrale actuel le avecune inscription sépulchra le qui ne porte aucune ind icat ion
propre a faire supposer qu’ il soit mort hors de sa résidence
e t d’
une m an ière v iolen te . I l en résulte seulement que l e
tombeau renferme sa dépouil le m ortel le et qu ’ il a term inéses jours à l ’ âge d
’
en v iron 80 ans après un épiscopat de
47 années . Il a cessé de v ivre en 609 .
I l est cependan t improbab le que la trad it ion soit privéede tout fondement , et ce fondement on le trouve avec quelqueprob abi l ité dans un fai t constaté qui concerne le m ême U rsicin .
Gon tran roi de Bourgogne , ayant annexé à ses états lava l lée de Suse jusqu ’
aux Cluses Lombardes vers l ’
an 576,
i l la soum it à la jurid iction de l ’ év êché qu 1 1 avait établi àSain t—Jean-de-Maurienne , la détachant ainsi du diocèse de
Turin dont elle a vai t fait partie jusqu’
alors .
L ’ év êque de Turin , qui était U rs icin , fut extrêmemen tblessé d ’
un pareil démembremen t de son d iocèse . Il paraîtqu ’ i l protesta et qu ’ i l se porta au m i l ieu des populat ionsqu ’ on v oulait séparer de l ui , ce qui aurait provoqué quelquemouvement ou démons trat ion de leur part. L e fait est que
Gon tran fit arrêter U rs icin et l e tint quelque temps priv éde la liberté . Ici se rat tache une autre tradition conservéeoralement dans l ’ abbaye d ’ Oulx . E l le porta it qu
’
un é vêquede Turin ava it été jad is confiné dans un manoi r solitairesitué dans la va l lée de Bardonnêche , sur le coteau qui re
garde le m id i endossas du hameau de l a Proutette f la oùl
’
on v oit l es ruines d ’
une m aison , qui toutefois ne semblepas remonter à l
’ époque d’
U rsicin .
Le Pape ( saint G régoire ? ) adressa des p lain tes amèresaux successeurs de Go n tran pour la spol iation que cet évêqueavait soufferte e t pour sa captiv i té sur la terre des Francs .
V oy ez 1’
h is to i re du d i ocè se d e Tu rin par Mey ranenio et l es n otes
du p rieur B oaio. ( B iot. Pat r. Mon . 8crip torum ) .
La tradition est al lée plus loin . Grossissant a travers un elongue suite de générations , el le a supposé qn
’
U rs icin eu t
été tué dans la vallée ou i l n’
a été que captif . N e sachan t
a qui attribuer le meurtre , el le a t rouvé naturel de le fai re
commettre par les hab itants de la val lée , et elle a dû en
inférer que pour un pareil meurt re d’
évêque la popul atio n
coupab le eut été f rappée d’
anathème . La b roderie faite sur
le premier fond de vérité s’
est accrue encore. O n avai t com
mencé par cro ire h un évêque tué ; on a fin i par en fairetuer deux au l ien d ’
un .
L ’ é vêque Brizio a cru lui-même que la trad ition se rap
portàt a U rs icin . S eulement lui , qu i croya it a un meurtre , a
adm is qu’
U rsicin avait été tué et tout ce qui s’
ensuit.Quant a la cérémonie de la malédiction et de la b éné
diction successive , e lle peut avoir été introduite l orsque l atrad i tion concernant 1’
anathème en t passé a l’ éta t de croyan ce
absolue . Elle peut aussi n ’
av oir e l le-même existé que dan s
l a trad i tion seule , car Ba ldessano éta it crédule , et l ’ é vêqu eBrizio en a parlé d
’
aprés son seul témoignage . Il es t v ra ique lui
-m ême at teste de son cru la fonction exp iatoi re qu iaurait eu lieu annuellement à sa Suse ,
et qu ’ i l en pa rl ecomme d ’
un fait contemporain ; mais une cérémon ie de ce
genre pouvait être prat iquée sans se rapporter à un m eurt ren i a d
’
autres excès comm is par la populati on , pouvan t f ortb ien av oir ou pour objet la désapprob at ion des maltraitements qu
’
U rsicin avait sub is de l a part de Gontran et de
ses agents .
208
LA rñonau ré DAN S LA vau .És svrâmavan .
La partie supérieure de la val lée en descendant jusqu ’ àExilles appartenait vers l
’
an 1000 a Wi tb a ld , le prem ierconnu de la race chevaleresque des anciens seigneurs de
Bardonnêche . O n ignore l’
o rigine de Wi tb a l d . U n act e de
son fils Ponce se rapporte à l’
o b servance de la loi rom a ine .
Mais cet ind ice par lui seul est insuffisant à é tab l ir qu’ i l fit
pro fession de v ivre sous cette loi . Ce qui paraît probable ,c
’
est que la famille eût acquis sa dom inat ion sur l e pays en
concourant expulser les Sarrasins .
Ponce de Bardonnêche agissait comme seigneur d’
O u lx
v ers l ’ an 1050, lorsqu’
i l donnait à la congrégation naissan te‘
des chanoines réguliers d’ Oulx l es deux églises du l ieu ,
sain t Laurent et sainte Marie. Il ind iquai t l es l im ites d e sa
seigneurie en donnant la la m ême congrégati on des droitsjusqu’
au r i f de Calamb re, c ’
est—à—d i re jusqu ’
aux po rtesd
’
E xilles . Au reste sa juridiction passan t les m on ts s’
éten
dait sur la val lée cont igüe de Nevache , don t une l igne deses descendants prit le nom L es seigneurs de Bardonnêche exercèrent aussi dan s l es prem iers temps des droitssur le v i l lage de Mont Genêvre et sur Césanne où i ls percevaient une port ion des revenus de l ’ ég l ise .
Mais l es Com tes d ’
Ab b on ,t ige des Dauphins , qui étaient
princes de Briançon , possédèrent ou s’
arrogèren t d ès le
l l .
°
siècle que lques droits dans les territo ires de Césanne ,
d’
O ulx et de Salbertrand , et , sans qu’
on v oie b ien comm ent,mais probablemen t par une sui te de faits habilement accom
plis , i ls se rend iren t peu a peu maîtres de cette partie de
la v al lée. I l s consol idèrent leur possess ion en obtenant parvoie ind irecte un d iplome confirmati f de l
’
E mpereur Fréderic
( l ) L e Chev al ier L ou is Des Amb ro i s d e N evach e au teu r d e cette n o
t ice fut l e d ern ier rejeton de ce tte l igne.
— 209
Barberousse , c’
est-à—dire le décret de 1 155 qui les autorisaa b at tre monnaie à Césanne . I l ne résulte aucunement qu ’ ilsse soient jamais m is en m esure d ’
y battre monnaie ; mais i l s
pouvaient dès lors se di re reconnus comme seigneurs souve
rains du l ieu . C ’ était un grand pas qui en amenait d ’
autres .
E n 1 188 il s levaient°
la tail le a Fen i ls , en 1223 il s d isposaient des m ines de la va l lée. Il n ’
y a nul doute que dès
l ors il s furent maîtres d ’ Oulx, de Salbertrand et d’
E xil les .
Les seigneurs de Bardonnêche conservèren t a peine quelquesdroits spéciaux à Césanne et a Sal bertrand . I l s restaient con
finés dans la v allée de Bardonnêche , où il s se maintinrentalors indépendants . Au 12
°
siècle l es Cheval iers hospitaliersde saint Jean de Jérusalem , étaien t devenus possesseurs deChaumont sans av oir, a ce qu ’ i l paraît , des titres plus formels que les Dauphins sur Exilles . I l s trouv èrent prudent dese consolider en se déclarant vassaux de ces Princes . E n 1232
i l s en ob t inrent une inféodat ion formelle, par l aquelle l es
Dauphins se donnèrent l ’ ai r de confirmer un vasse lage de
fait beaucoup p lus ancien . E n 1240 l es cheval iers de saint Jeanal iénèrent l e fie f de Chaumont ‘
aux prévôts d’
O ulx, qui l e
conservèrent a travers tout l e moyen âge et même jusqu ’ àl
’
abolition de la féodal ité .
Ainsi au s iècle Césanne av ec sa petite v allée, Oulxet ses dépendances , Salbertrand et Exilles étaient du domainedirect des Dauphins , sau f que lques droits de conseigneurie
tenus sous leur mouvance. Ces d roits étaient possédés a Cêsanne par la maison de Bardonnêche , puis par l es Au rus , aSalb ertrand par l es Bardonnêche , puis par Al l iaudi de Suseet ensuite par les Sapienti de la même v i lle . Bardonnêche
et sa val lée avaient encore l eurs seigneurs indépendants ;mais sur la fin du siècle quelques uns d
’
entr ’
eux commen
cèrent a se rendre vassaux des Dauphins , et l es Princes manoeuvrèrent si b ien que dans le siècle suivant i ls furent reconnue comme suzerains par tous les participants a la sei
gneurie. Enfin Chaumont était tenu en fief par le prévôt d’
O ulx.
Dans le fief de Bardonnêche l es seigneurs exerçaient lahaute just ice. I ls avaient seuls le droit de percevoir des im
210
pôts ; en un
°
mot, a part l a suzeraineté, i ls concentra ient tousles pouvo irs . A Chaumont le seigneur n
’
avait que la b asse
et la moyenne justice.
Guy Allard s'
est plu à décrire la seigneurie de Bardon
nêche'
comme étrangement morcelée en tre une foule de co
seigneurs dont il a donné l e tableau a la date de 1334 . L’
ar
t icle de Moreri sur Bardonnêche , que l’
on v oit avoir été
étud ié av ec soin sur les documents , réduit cette fanæsma
gorie aux proportions de la véri té , en d isan t que la l ignée
des prem iers seigneurs s’ éta it partagée en plus ieurs fam il les
qui , portant l es m êmes armes avec des nom s d ifféren ts , part icipaient au fief . Des noms cités par Guy Allard , ceux qu
’
on
trouve réel lement dans les hommages de la seigneurie , sont
ceux de Bardonnêche , des Am b ro is , des N evàche et des
Aigueblanche . L es autres ou ont été erronément cités , ou ne
participaient pas réel lemen t à la seigneurie.
JAIL L O N S , MÉAN E , AL T AR E T , cnàm an
D’
E N T R E naux mns , MAT T IE .
Jail lons appartenait à une fam ille i l lustre qui , outre le
nom du fie f, a porté ceux d’
Asch ieri , de R omam‘
ou De
R om a e t de De-Castel lo .
Cette fam i lle descendait des anciens seigneurs de Goy seen Sa voie , lesquels é taient du même sang: que les aires de
Chambéry , race antique professant l a l oi romaine, et probab lement nn reste de ces Gallo—Romains dont les barbaresavaient respecté la positionO n ne s
’ étonnera pas que cette fam i lle, comme plusieursautres , ait é tendu ses rameaux des deux côtés du Mont—Cenis
( l ) V o i r l es actes de d onat i on fa i ts en fav eur de l ‘ ab b ay e d e la N oval aise en 1036 e t en 1043 e t 1097, l e d ern ier co n servé aux arch iv es de Cou r
de T urin , l es au tres pub l iés par R ochaix d ans l a G lo ir e d e la N an k in .
V oy ez auss i Menab rea, O r ig ines Fdod a la , page : 885 et 386.
212
fief des Bartolomei . V ers l ’
an 1 500 il passa au noble jurisconsulte De-Rossi , probablement parceque l e fief sera tomb éen quenouil le .
Mattie , qui était du domaine des abbés de saint Just, futdonné par eux en gage aux f rères Barral is en 1369 pour
garan tie d’
un emprunt . L es Barral is ne tardèrent pas de dev enir feudataires définitifs parceque l
’
abbaye se trouva em
b arrassée a s’
acquitter. I ls restèrent seigneurs.
de Mattiejusqu ’ à l ’ extinction de la fam il le qui eut l ieu longtempsaprès la fin du moyen âge . O n v oit encore du chem in de ferl es restes de l ’
ancien château de Mattie.
3 .
CHIAN O C BU S S O L IN BR U S O L S AI N T —JE O IR E .
Chianoc appartenait depuis un temps reculé , et certainemen t depuis le 12
°
siècle , a une branche de l a maison de
Jai l lons qu’
on v oit figurer dans les actes tan tôt sous le nom
de R oman i s , tantôt sous celu i de De Cauas sa. A une date
qu ’
o n ne saurait préciser i l passa à une branche de la
maison de Bardonnêche , qui l e tin t pendant le si èclesous la mouvance du Comte de Sav oie.
L e v ieux château de Chianoc, dont il reste des murai ll es,rév è le par le système de cons truction une époque reculés .
Il doi t avoir été fondé par les prem iers seigneurs.
Bussol in o ffre aussi aux regards du voyageur l es restespittoresques d
’
un chàtèau bâti dans l e même genre et ainsiremon tant , selon toute probab ilité , a la même époque.
Casalis affi rme que l es seigneurs de Jai l lons étaient maîtresde Bussol in au temps du Marquis Mainfroi . Le fait n
’
a r iend
’ improbable et ces seigneurs pourraient av oir construit lechâteau de Bussol in comme celui de Chianoc mais nous
(1 ) L e château d e Busso l in a été dessi né. C‘
est un quarré de hautes
mura i l l es cren e lées qu i s‘
é lèv e sur un p l ateau au dessus du b ourg. O n
1‘ appe l l e Château B o rel du n om san s d oute d‘
un ancien m aître. I l y eut
un person nage d e ce n om du temps d'Ade lai de. I l apparte nai t à une fa
m i l le d e v icom tes.
213
n’
en connaissons pas les preuves. Ce que nous sav ons , c’
estque l es documents connus de nous , en commençant av ec le
siècle , nous tout v oir la seigneurie de Busso l in constamment partagée entre plusieurs conseigneurs , et que dans la
série de ceux—ci figurent l a maison de Jail lons av ec les Bartolomei , les Ferrandi , les April i etc.
, tous gentilshommesS usins , plus l es Bertrand et l es Bardonnêche…
Bruso l fut inféodé par l e comte de Savoie Thomas I .
en 1227 a Bertrand de Montmél ian châte lain de Suse pu isb aill i de la val lée, l
’
un des principaux officiers de ce princeil lustre . L ’ inv estiture lui transmettait l a plén itude de la juridiction et jusqu ’
au fodm m rega le , ou droit d ’ étape réservé au souverain , duquel on ne comprend guères l ’
exercice de la part d
’
un seigneur local dans son propre terri toire .
L es descendants du prem ier seigneur de Bruso l priren tl e nom de Bert rand pour nom de fam ille . O n trouv e parm ieux des personnages qui ont joué un rôle ém inen t , et
, eu
tr ’
autres , l’
archev êque de Tarentaise qui , au nom des étatsgénéraux présidés par lui , proclama en 1329 que la succession nu trône dans les états de Savoie était réglée par la
l oi salique .
L es Bertrands , ne tardèrent pas d’
acquérir, nous ne
savons par quels moyens , les fiefs voisins de S . Didero et de
S . Jeoire.
L a fam ille se fondit dans celle des seigneurs de Rav oire ,ou la Ravoire, qui . hab its plus en Dauphiné qu
’
en Piémontet finit par se fixer à Lyon , où el le fut connue sous l e titrede Marquis de Palais .
L e fief de Brusol passa ensuite à la fam ille piémontaisedes Grossi . Mais ceci sort de notre cadre .
L e château de Brusol existe . C ’
est là que fut signée la
paix entre la France et la Sav oie, d ite paix de Bruso l , en
1610 I l est grandement changé par l es reman iements suc
(l ) A l‘
occasion de cet te paix l e Duc de S av o ie Charle s E m anuel I
écriv ai t son fi ls l a lettre s uiv an te récemm en t trouvée dans l es arch iv es
d‘
état de Turin et que n ous reprodui sons textuel l em en t, d‘
après un f ac
— 214
cess ifs qui y furent apportés à diverses époques . O n y con
servait une petite b ib liothèque de manuscrits , en tre l esquels
le Comte N apione trouva celui des grandes chron iques de S avo ie . Malheureusement le recuei l entier a péri par l
’
ignoranced
’
un pro priétaire de l’
éd ifice .
O n vo i t des restes du v ieux château de S. Didero . O n en
vo it auss i de celui de S . Jeoire épars sur le monticule qui
portai t ce château pittoresque s’
élevant au m ilieu de la combede Suse.
I l n’
y a pas cinquante ans que l es ruines occupaient eu
core tout le sommet du monticul e . Elles se composaient de
d u “. qu i n ous fu t commun iqué par la fam i l le Ol iv ero propriétari e actuel l e
du château de B rn so l o .
F ig l uo lo m io
G ion semo i on qu i con un ma l ie." tem po d i ven te , p aré havan t i che
fnase n o t te, et m incon trai co n quest i s.‘n el en trer de l l a t op ia ( de l a
t re i l l e ) l i qua l i s o n o m o l to p iù d i que l la m i credevo m a v eram en te tutti
pe rso na d i qual ità e d i m o l to v a lore, i l de l la Dicgu i era ( l e m arécha l de
L esd igu ières ) è v ecch i ss imo e d i san i td o rob ustesa n e l‘
ha ( i l n'en a
pas ) m o l to p iù che i l Co n te D i S uents ( ou Fuen te ! ) (a ) l e cred o che n i
lun e n e l‘
al tro n on n e m angeran n o ( n e n ous m angem n t p as ) perche n on
a au den t i i o ape ro par tut to d om an i (b ) sb rigarm i d i qu i per p o i to rn arv i
av ed ere io des idero saper d e l le v o stre n o va, e d i v ostri frate l l i et so rel l e
e de l le m ie n o va d i ra questo portato re i l quale d i spas i o apos ta per ri
p o rtarc0 n e de l le v os t re, che sup l ico i l che s ian o com e d es idero che
n o n p osso n caser che b uo ne lui v i tengh i d i sua s .
‘ m an o e v i guard i p iù
che m e d i B ruso l o a l l i 22 d i apri l e 1610.
V os tro p ad re
CA. E wan .
“
(a ) Quel l e est l a p erson n e dés ignée par ce n om presqu‘i l l i si b l e f Peut
être Charles E m anuel n e n omm e pas i ci un perso nn age d e l’
en tou rage de
L esd igu i ères d o n t aucun n e po rta i t un n om sem b l ab le , m a i s l e Com te d e,
Fuen tes qu i comm an dai t l es arm ées espagn o l es en L om b ard ie. L a p résen ce
d u généra l f ran çai s , av ec l eque l i l a l l a i t tra i ter, lu i rappe l l e à l ’
espri t l e
généra l espagn o l , qu i au ss i av a i t v iv em en t recherché so n a l l ian ce , e t la
com para i son en tre l es deux chefs en nem is lu i suggère cette caust ique ré
fl ex io n que, a i l ’ un m‘
1’a utre ne le m a ngera“ p ar car : la n
’on t p as d e den ts .
Cepen dan t ces deux p erso n n ages, do n t l‘
un , L esd igm eres , ava i t a l o rs 67 an s,
e t l’
autre , Fuen tes, 50, v écuren t jusqu ’
à l’âge de 83 an s.
(6) L a p a ix av ec l a France n e fu t s ign ée que tro is jo urs ap rès sous l a
f orm e d e d eux tra i tés, d on t o n sai t q ue l‘
exécu t ion fu t em pêchée p ar la
m ort trag ique d’ Henri I V survenu e l e 14 du m o i s de m ai su ivan t. ( V ictor
O d iard Des Am b ro is
216
comte Brunon se montra animé d’
un espri t de b ien fa isanceen stipulant que les chano ines dussent é tabl ir un l it pour un
pauvre dans leur aumônerie , ce que pourtant nous rappo r
tons l’
hospice des pè lerins et autres voyageurs pauv res
( et un um lectum in hosp üio p aupm m ub i cunctis dieb us
p aup eres coüocen tur )Les v icomtes de Baratonia tenaient un train supérieur à
celui des autres seigneurs de la val lée. I l s avaient des écu
y ers et autres officiers .
Le mano ir ant ique hab ité par eux a V i llar Fouchard n’
ex i
ste plus .
V il lar Almese dev int fief des Provana v ers l e commeacement du siècl e. L es Provana , riches gentilshommes d eCarignan , éta ient gens éclairés et s
’
adonna ient aussi à la b an
que , laque lle se confondait alors avec le change des m on
naies. I ls fréquenü ient de l ongue main la vallée de Suse e t
la cour des Comtes de Savoie , auxquel s i ls s’
attachèren t de
b onne heure. Nous voyons dès l ’
an 1297 Philippe Provana
interveni r à Suse comme arbit re amical pour l e partage desb iens de la maison de Bardonnêche .
Le château de V i llar Almese , conservé en partie tel qu i l
était au moyen âge , est res té a leurs descendants .
nas mars un L’
nanars. DE LA am sn .
LA 3 . am ours , s . ams amsn , oxavnno , coazzn
L ’
abbé de la Cluse tenai t des empereurs l’ investiture de
la Cluse, S . Ambroise , V ay es , S . Antonin , Ce lles , Chiav rie et
N ovaret .
L e Com te T homas I ajouta à ces possessions le gros bourgde Giaveno en 1209 .
Dans son domaine primitif , l’
abbé ne relevait que de l'
em
pire . Mais les Comtes de Savoie, devenus v icaires impériaux,
Chart. U 1c. c. 196 et 196. Ces d eux actes son t du V icom te Hen ri etd atée de 1201 . I l s résu l ten t s tipu l és a V i l lar Fouchard sous un orm eau.
217
s’
attribuaient l’
exercice de suzeraineté , et , a la l ongue , l esabb és dev inrent leurs v éritables vassaux . Cependant en 1399l
’
abbé de Chal lant traita avec l e Duc de Savoie pour l’
ex
trad ition réciproque des criminels .
Au reste , s’
i l y ont dans l a série des abbés de l a Clusequelques personnages ém inents qui surent se faire respectersoit comme dignitaires de l
’
égl ise , soit comme seigneurs tem
porels , sous beaucoup d’
autres cette double autorité fut troppeu considérée.
E n 1297 , époque à laquelle était déjà b ien déchu l e prestige du froc monastique et de la m itre abbatiale , les fil s du
seigneur de S. Jeoire, jeunes étourd is un peu batailleurs , v oul ant faire une folie bruyante dans l e gôu t du temps , s
’
av isé
rent d ’
appeler aux armes l es v assaux de l eur père et de
marcher à. leur tête, enseignes déployées, sur l e v illage deS. Antonin qui appartenait a l ’ abbé de la‘ Cluse . Naturellement l es hab itan ts .du v i llage n_
’ éta ient point préparés à se
dé fendre ,l es agresseurs y eurent un triomphe facile . Mais
comme il leur fal lait un trophée à rapporter chez eux, il s
emmenèrent captif l e sonneur de cloches, coupable probablemen t d ’
avoir sonné l e tocs in a leur arrivée .
L ’
abbé réclama auprès du Com te de Savo ie souverain deS . Jeoire contre la v iolation de son territoire et l
’
en lève
ment de son sonneur. L e conseil du Comte condamna l esjeunes coupables a une amende . Mais ces mauvais garnements ,aul ieu de payer , all èrent chez l
’
abb é et l’
efi‘
ray èrent si fortque lui
-même pay s pour eux
6.
mars DE LA MAI S O N DE m anu , rm s , m as o acc.
La maison de Rivalta, d ite auss i de Rem o , était connueen dern ier l ieu sous l e nom d
’ Orsin i et considérée commeétan t du même sang que la fam ille h istorique d es PrincesOrsin i de Rome . Ce qui nous conste , c
’
est que leur race présente des ind ices de haute ancienneté .
Cib rarl o Discorsi sul l a finans e de l la monarchia d i 8avo ia.
218
Elle pro fessait la loi romaine ; elle tenait en al leu des
v illages considérables avec l eurs territo ires ; ell e était suze
raine des seigneurs de V il lar Almese.
Nous inclinons a croire qu’
el le était une de ces fam illesconsidérables de Gallo-Romains que l es b arb ares ont ré
spectées .
L es aires de Rival ta se tenaient en rappo rts avec les no
tables de Suse et de la vallée. I ls s’ étaient même apparentés
aux seigneurs de Bardonnêche. Leur dom ination comprenaitplusieurs territoires sur l es b ords du Sangone, et n otammentOrbassano qui leur resta ; mais nous n
’
av ons a nous occuperici que des fiefs qu
’
on peut d ire apparten ir à la va llée deSuse ou du moins à l ’ arrondissement actuel de cette v ille .
Il reste des tours assez pittoresques de leur château de
Trans . Celui de Reano a été transformé au siècle parun il lustre personnage qui l
’
acquit , par Cassien Ds lpozzo tigedes Princes de la Cisterne.
S AIN T AN T O I N E DE nm vnas. L E rms T R AN S CO R N È.
N ous avons déjà parl é de la préceptorie de Saint Antoinede R anvers considérée comme établissement religieux. N ousdevons ici la mentionner comme fief . E n efiet les précepteurs
‘
ont prêté hommage féodal a la maison de Savoie.
N on loin de cette bell e construction , au débouché desCluses Lombardes , on peut remarquer au m i lieu de la val léeun pet it monticule , sur lequel s ’ élèvent une très—
petite v illa.
carrée , et a côté de celle—ci une antique chapelle . La v il laest fraîchemen t badigeo nnée et présente des fenêtres modernes à persiennes de couleur claire ; la chapelle au contraireoffre aux yeux des v ieux murs de brique rouge , lesquels semblent menacer ruine . O r nous avons encore vu , ce qui , au
jourd ’
hui est une vi l la , être un v ieux petit château carré àmurs de b rique rouge et une comme ceux de la chapelle.
U ne s imple frise, formée par un rang de briques ouvrée s , décorait le haut des murs , circulant sous le to it. Ces deux pe
V III.
Insti tutions Command es .
Suse, ancien municipe de l’
E mpire Romain , avait eu ses
décurions et ses’
duumv irs , sa complète organisation mun ici
pa le Nous doutons même que la commune du moyen âgese ra tttache au mun icipe romain .
E n effe t l e statut de 1 197 , qui en confirme un autre établidans la prem ière moitié du s iècle , présente un caractère touta-fait germanique , fait découler de l
’
autorité du Prince toutesl es franchises de la population , et garanti t ces franchises auxhabitants sans constitua ou confirmer une organ isat ion mu
n icipale .
La dom ination des b arbares avait tronqué les traditionsdu passé , et , lorsque l e Marquis Hardouin avait pris possession du pays après l
’
expulsion des Sarrasins de la val lée, ils
’
y é tait é tabli en maître absolu.
O n est seulement porté à croire que la population avaitconservé plus ou moins ses v ieux instincts de liberté et quelquechose de cette vieille énergie gauloise q ui s
’ était man ifestéeencore aux dern iers j ours du gouvernement Romain , en ai
dant Sisinnius s résister aux Lombards ; de sorte que l es
souverains usaient envers elle des ménagements et des égards .
Ainsi l e Comte Humbert III , v oulant en 1770 donner ou
confirmer aux chano ines d ’ Oulx la possession de l’
hôpital ou
(1 ) V . Prom is S to ria.
d el l’an t ica Tori no , pag . 87. o ù est d i scu tée l
’èp0
que d e l’
érect io n de S use en m un icip e.
— 221
aumônerie de Suse , fit résul ter dans l ’ acte qu I l agissait avecl e conseil et le consentement des habitantsDu reste les moeurs german iques, dont le statut m ême est
le reflet, admettaient un grand respect pour la liberté indiv iduel le et une sorte de solidari té entre les hommes l ibres ,qui , sans être l ’ association Communale, pouvai t jusqu
’ à un
certain point y conduire. L es mêmes moeurs germaniques et
l a solidarité dont nous parlons expl iquent mieux qu ’
autrechose cette d isposition dti statut, qui veut que les injures forment l ’ objet d ’
un essai de conciliation devant l es habitantsconstitués en quelque façon comme arbitres avant de pouv oirdonner lieu a une plainte en v oie judiciaire devant les offi
ciers du Prince.
Mais il nous paraît au moins douteux qu ’
une v éritableassociation communale ait existé à l a date du statut . Ce lui—cinous représente une réunion de fam illes l iées entr
’
e ll es par
l’ identi té de position, unies par l e lien des f ranchises ob te
nues du Prince, plutôt que par ceux d’
une association for
mant corps moral .L e Comte y parle des f ran chises comme octroyées par
un acte de sa l ibre v olonté dans 1 ’
exercice de son p lein pouv oir . Je veux , d it il , faire connaître ms loi aux habi tantsdu territoire de Suse L es expressions m êm es , par lesquelles i l s ’
adresse à toute personne qui demeure dans l e
territoire , démontrent qu’
i l n’
a pas en vue une corporationde citoyens .
Le souverain s’
expl ique plus clairement encore dans lesdispositions du s tatut où“ i l dit que tout nouvel hab itantjoui ra des m êmes droits.
O n avait si bien l_’ idée que dans les statuts l ocaux il
s’
agissait d’
une communion de f ranchises et non d’
une vê
ritab le association communale, que l es souverains con féraient
Con s i l io et v o l un tate civ inm et al i orum b onornm m eorum h om innm
&cusiens ium . (Chart . U le. ch .
E go Thomas Comes et March io pmmulgare v olui omn ib us d egent ib usin S ecusiae terri tori o afi
’
ectuose justi tiam mem .
quelque fois eux—mêmes à une famil le la jouissance des franch ises de tel lieu de la vallée de Suse.
T elle fut cette s ingulière lib éral ité du Comte R ouge , quien 1386 concéda a Ph ilippe de Bulgaro l
’
usage des franchises d
’
Aveil lane p our dans : ans
T el fut un acte non moins curieux de l ’ abbé de SaintJust seigneur souverain de Mattie , lequel en 132 1 conféra laquali té d
’
habitant de Mattie a un nommé Luce de Salbortrand
E n 1 250 , la demande faite au Comte de Savoie dan s l ’ intérêt des habitants de Suse pour obtenir la sauv egarde desDauphinois , n
’
émana pas d’
une corporation communale , maisd
’
un pet it nombre de notables .
Nous tenons pour certain que dans les temps reculés i ln
’
y avait point de représentat ion permanente de la populat ion
, et que, si l’ intérêt commun des habitants exigeai t quel
que déterm inati on de leur part , les chefs de fam ille se réu
nissaient pour av iser.
Il ne nous a pas été donné de connaître à quelle époque‘
se forma un conseil permanen t et ains i l ’ organisation défin it ive de la Commune.
Quant aux origines des insti tutions communales dans la
val lée inférieure , ce que nous av ons di t d ’
Avei l lane fait assez comprendre que ce gros bourg avait des franchises octroy ées comme celles de Suse . L es autres pays courbés sous lejoug féodal n
’
ont pu parven ir que plus lentement au mêmedegré de l iberté .
Dans l a vallée supérieure les choses se passèrent un peu
autrement.Il est naturel que dans ces pays plus alpestres l
’
esprit
C ib rari o I s ti tuz ion i d e l la Mo narch ia d i S av o ia e cosa n o tab i l i .
N ous d onn o n s l e t exte de l’
acte, d oc. 2. L’
acte em p l o ie la m êm e
qual ificat io n de vo is in que n ous t ro uv o n s d ans l e S tatu t de S use . Dom in us
Ab bas… r ecep i t :’
n o ioù mm et ha b i ta torsm Ma th ia rum An d rea»: L uc“ de &al o b er tan o ; et i l ajoute : tal i m od o quod d ictus Andreas p osai t i b i m orari
i rc e t red i re sa l ve et secure et u t i com i ta ti b us e t f ranchit i i s Math iarum,
s icut a l i i hom ines et v ici n i d ict i l oci u tun tur et ut i nonouev erun t .
communes ayant chacune son adm inistrat ion a part ; puis , lest rois admin istrations se réunissaient a Bardonnêche au son
des cloches de Sainte—Marie ou des trompettes du château deBrams fan pour traiter des intérêts communs a toute la val lée .
Oulx et Césann9 , qui appartenaient au Dauph in , étaien tdéjà reconnue comme communes , et selon toute probabilité i l s1
’
étaient depuis longtemps lorsqu’
en 1343 Humbert I l leurconféra , ainsi qu
’
a d’
autres pays du Briançonnaie, une foul ede droits et de prérogatives .
E n 1319 l a commune d‘ Ou lx, U n i osrsc
‘
toa, av ai t o b tenu un e paten te
du Dauph i n pour régler certai nes ques t i on s. (Arch . comun a l es d‘ Ou lx) .
E n 1332 l e Dauphin avai t m ême daigné faire un trai té avec l a com
mune. (Fanché Prunel l e ) .
IX .
S tatuts locaux.
Par suite de la d ifférence d ’ origine et de caractère dansl es f ranchises locales , —il y avait en général dans l es communes de la haute vallée de la Doire deux classes d ’
habitants ,l es commun iers et l es forains . L es prem iers seuls étaient cons idérés comm e m embres de l ’ association communale et seulsi l s jouissaien t des droits communaux . Les forains v ivaien t enpl eine liberté sous la protection de l
’
autorité locale , mais i l sne pouvaient part iciper aux droits de la commune qu ’
aprèsav oir été aggrégés a elle par le consentement de ses
membres .
E n rappelant les origines et l es prem iers développementsdes communes nous avons déjà dû parler des statuts locaux .
Ceux de la vallée de l a Doire forment deux groupes distinctscelui de la haute et celui de la basse vallée. Nous avons en
e ffet deux types d ifiérents en présence : le statut de Bardonnêche et celui de Suse .
L e statut de Bardonnêche , comme nous l ’ av ons dit , est
établi par un pacte entre l es habitants et leur seigneur, exor
çan t, d i t—il , afiectueusement son pouvoir : afi
‘
ectuosey‘
usütz‘
am
meam .
Le f onds des dispositions n’
est pas moins d ifférent dansl es deux statuts .
Celui de Bardonnêche , quoiqu’
empreint de traces Goth iques et Burgondes , se rattache dav antage à la civil isation
1 6
romaine mieux conserv ée dans le mid i des Gaules ; celui deS use est essentiellement de couleur germanique .
A Bardonnêche l’
hom icide est pun i de mort, a Suse i l nel
’
est que d’
une amende, ce qui donne l ieu a cette dispositionexceptionnelle , et, au prem ier ab ord frappante , du statut deBardonnêche portant que l e meurtre d
’
un Susin sera pun ia Bardonnêche come le serai t a Suse celu i d ’
un Bard onneich ier .
A Suse l es voleurs de grand chemin et certains autrescriminels sont m is a la merci du Comte qu i peut a insi lespunir a son gré, et même les relacher ou les envov er a l a
mort . Le statut de Bardonnêche n’
admet aucune pe ine arbitraire .
A Suse les simples citoyens interviennent dans les affairescomme concil iateurs et juges de paix ; a Bardonnêche r iende semblable .
A Suse le Comte avait la tutele des veuves et des orphe
line, c’
est—à—dire qu il conférait les tuteles a son gré , et les
tuteurs nommés se considéraient comme gratifiés d’
une occasion de s
’
enrichir. Le s tatut de 1 197 , mettant dans la bouchedu peuple la reconnaissance de ce droit du Prince , l
’
accom
pagne d’
une réserve tristement significative . T u as , d it—i l ,
la tutel le des veuv es et des orphelins pour l es dé fendre et
non pour les dépouiller L e grand Comte Thomas ré
nonça a ce droit dangereux en 12 16.
A Bardonnêche au contraire l es tutel les étaient régléespar le droit commun .
A Suse l es ribauds , que l e statut appelle g luton es , m is
comme personnes v i les au n iveau des prost ituées , ne son t paschassés de la v ille , mais si un citoyen les frappe i l encourtune amende beaucoup plus légère que s
’
i l frappât un autrecitoyen . Puis l e ribaud ou l a prostituée qui ne se soumet pasv olontairement à amender son mé fait est pro mené nu par toutel a v il le.
i n tuo v el l e s in t.
ad defen den dum n on ad au feren dum .
228
sance entre les memb res de la commune, il y avait aussi
communauté entre la commune et les seigneurs .
E nfin deux d ispos itions ont arrêté notre attention , l’
une
dans le statut de Suse, l’
autre dans celui de Bardonnêche.
A Suse la lib erté du travail é tait proclamée dans un tempsoù généralement dans les v illes elle était restreinte par les
maîtrises. Tous les ouv riers dit le statut quel sque
soient leur art et leur nombre , pourront travailler sans
obstacleA Bardonnêche le statut punissant les délits ruraux , dé
clare néanmoins que dans un champ de raves on pourra en
manger sur place tant qu’
on voudra et en emporter jusqu’ à
trois,reste év ident d ’
une coutume antique remontant à l ’
épo
que où les raves étaient une nourriture usuelle de la pcpu
lation , souven ir touchant des moeurs de cet âge reculé quel ’ on rappelait en Savoie par le d icton latin : temp ore rap a
rum S a baudz‘
a fel tæ era t.
O perari i cujuscumque si n t ofi cu quo tquot esse p o terin t s i n e occa
s ion s operen tur.
X .
Les O euvres Pics .
Dans un pays de passage comme était l a val lée de la
Doire , f réquentée par le commerce et par l es pèlerins qu ifranchissaien t le Mont—Genêvre ou le Mont—Cen is , soit pourse rendre des d iverses parties de l
’ Europe a R ome , l e grandcen tre des pèlerinages , soit pour al ler d
’
I tal ie à Saint Jacquesde Compostel le ou a Saint Martin de Tours , la charité eut
naturellement pour b ut principal l e besoin d ’
assurer un re
fuge aux passants . Ains i nous avons vu que, dès l e temps de
Charl es Martel , fut érigée“l ’ abbaye de l a N ovalaise pour
héberger l es v oyageurs qui passaient le Mont—Cen is , et en
suite les m oines établirent un hospice sur le plateau m êmede cette montagne, hospice que Lothai re I détache en 825
pour lui donner une existence indépendanteA une époque non connue , mais peut être aussi reculés
et certainemen t fort ancienne, les puissants et riches cha
noines de Saint-Martin de Tours tenaient l ’ hospice de la
Magdeleine sur la v ieille route du Mont—Genèvre .
A Oulx dès l ’
an 1065 la congrégation qui s’
y forma de
chanoines réguliers donnait asile aux v oyageurs . L ’
evêque
Cunib ert l’
approuvs , comme nous l ’ avons dit , en vue de
cette destination human itaire : ùnm ensae v iato rum n eces
s i lati .
Muratori . An t ichi tà. I tal ian o, d issert. 37.
Au 12‘
siècle les cheval iers hospital iers de Saint Jeande Jérusa lem avaient un hospice a Chaumont et un autre
a Suse.
U n autre hospice ou lieu de refuge pour les pèlerins étaiten pleine activ ité dès l ’ an 1 158 sous la d irection des cha
noines d’
oulx auprès de l’
egl ise de Sainte Marie de SuseN ous tenons m ême pour certain qu
’ il existait auparavant , etmême depuis longtemps , parceque le document que nous possédons du 1 158 en parle comme d ’
un é tab l issement dejà an
nexé à Sainte Marie , et que d’
ail leurs les églises principales ,telle qu
’ était cette antique égl ise , quas i épiscopale, de Suse ,
cons idéraient depuis longtemps comme un devoir l ’ assistancedes pèlerins .
Enfin , à l’
extrémi té inférieure de la v al lée , la maisonhospital ière de Saint Antoine de R anvers , quoique destinée aserv ir d ’
asile pour une classe spéciale d’
infirmes , ouv rait aub eso in ses portes aux pauv res passants .
Les hospices que nous venons d ’ énumérer correspondaienta une série d ’
autres échelonnés sur la route , soit du côtédu Dauphiné , soit a travers la Savoie. L e Dauph in Humbert I Iavait étab l i l ’ hospice du Mont-Genevre ; audelà on t rouvaitcelui du Lautaret beaucoup plus ancien , desserv i par une
congrégation de frères hospital iers soum ise au prévôt d’ Oulx.
Souven t dans les documents de la vallée de . la Doire les
hospices figurent sous le nom d’
hôp itaux . Ce nom retenaitains i sa s ignification primit ive correspondant a l
’ idée d ’
hôteet d
’
hospital ité ; on se tromperait fort en croyant y v oir ce
que nous appelons aujourd ’
hui des hôpitaux , c’
est—à—dire desinfirmeries . Ces hôpitaux d
’
infirmes sont généralemen t plus
L’
aumônerie ou hosp ice d e S . Marie a été con firmée aux chan o i nes
d’ Ou lx par le Pape Ad rien IX en 1 158.
L e Com te de S av o ie Hum b ert I I I ajo u ta l a sanct i o n d e l’
au tori té ci
v i l e en 1 170. C’
est par erreur que le Pri nce a été d i t fon da teur de l‘éta
b l i ssem en t. L e m êm e ho sp ice qu i paraît s ’
ê tre l o ngtem p s restrein t à re
ce v o i r l es pè leri n s e t a i ns i av a i t cessé l’
ofi ce d’anm ôn eri e fu t conv er
en hôp i ta l a un e époque très—récen te. Ce fut par L ettres Paten tes du R o i
V ictor Amédée I I I datées du 23 octob re 1785. ( V . Cart . U lc. ch . 5 et 108 )
D’
autre part i l parait qu’
on n’
a presque jamais porté demalades locaux aux hospices . Cela était naturel dans l es
moeurs d’
autrefo is. L es fam illes l es plus pauv res auraien tcru se deshonorer en portant leurs malades hors de la maison ,
et les malades eux—mêmes auraient éprouvé une répugnance
profonde a être portée a un hospice . D ’
ailleurs les médecin séta ient rares , l es apoth icaires aussi , l es remèdes extrêmementcoûteux. O n se soigna it chez soi comme l
’
on pouvait avec
des simples . La charité envers les pauvres du l ieu éta itexercée par les aumôneries au moyen de secours a dom icil eet d
’
aumônes faites à la porte de l’ établissement.
E n général les hospices de pèlerins éta ien t en même tempsaumôneries , domus clemosynarz
‘
a . Outre les hospices don tnous avons fait m ention , i l y avait à Suse une aumônerieattachée a l ’ abbaye de Saint Just
Quo iqu’
annexées aux égl ises ou aux monastères , l es nu
môneries avaient des propriétés à el les . Celles d’
O ulx , de
Saint Just et de Sainte Marie de Suse étaient administrées
par un memb re de la congrégat ion avec l e t itre de recteur .
Il tenait un compte spécial des revenus et des dépenses del
’ oeuvre pie.
O n faisait v olontiers des legs et des donations a ces éta
b l issements pour être associé au mérite spirituel de leursaumônes . O n est même allé jusqu ’
à stipuler par con trat une
pareil le association . Ainsi , dans l’
acte cité plus haut de l’
an
1090 , le V icomte Bruno fut formellement adm is à participerau m érite des aumônes qui se feraient a l
’
aumônerie d’
O ulx
ainsi qu’
à celui des prières et autres bonnes oeuvres des
chanoines de Saint Laurent, et l e prévôt l’
a investi de cettesingulière concess ion en lui remettant un petit m orceau de
bois et un petit l ivre
E l l e est m en ti onnée dan s un acte de 1 183 s lemosy aa S an cti J us“ ,
(Chart. U l c. ch.
Cum l ign o parvn l o atque l ib el l o part em e l em os in arum et orat i o num
aiv e om n ium b en efici orum quae in praefato dec accep tab i l i a facts
fneri n t . (Chart. U l e. ch.
— 233
Il y avait en outre généralemen t dans chaque paroissel ’ inst itut ion de charité qu ’ on appelait f rairie ou con frérie duSaint—Esprit .
Les fra iries é taient des associations pieuses de secoursmutuel et de bienfaisance , nées du sent iment de la fratern itéchrétienne qui , dans les prem iers siècles de l ’ égl ise , avaitrégné avec tant de force. Il paraît qu
’
en origine les frèresfaisaien t des repas en commun , où riches et pauvres siégeaientmê lée à l a même table . Mais i l est naturel que l ’ institutiondégénéràt avec le temps, que les réun ions dev inss ent pro faneset souil lées par les désordres . Auss i l es conciles ont-i l s réprouvé de bonne heure l es agapes des frairies , et dans la
suite el les se restreigni rent à appliquer leurs revenus soit aaider les frères b eso igneux , soit a secourir d ’
autres pauv res .
Malgré leur origine religieuse , les f rairies étaient réputées ab solument laïques . O n les considéraient comme des
corps moraux ayant faculté de posséder des immeubles .
A—Oulx la frairie figurait en 1337 sur le rôle des . tailles araison des terres qu ’
elle possédait . Elle avait sa mai son dan sle haut bourg, et une rue proche du cimetière où cettemaison était s ituée , s
’
appelai t rue de la f ra tr ie. Maison et
rue ont disparu depuis longtemps . A Chaumont la maison dela frairie servait aux réun ions du conseil communal . Plusieursdélibérations concernant l es statuts y furent v otées .
O n v oit même que depuis 1’ organ isation des communes
l es conseils communaux avaient acquis , ou s’
attrib uaient une
sorte d ’
autorité sur les f rairies . Quelques dispositions du statutde Chaumont de 137 1 sont conçues dans cet esprit
Il est prob able que les f rairies recevaient beaucoup de
legs immobil iers , ce qui portait une perte de Leods ou dro itede mutation aux seigneurs ; car l e statut de Bardonnêche de1330 étab lit que cette espèce de main morte , non plus que
l es églises , ne pourrait accepter des legs semblables sans le
consentement des seigneurs . Cependant la ferv eur pour l es
frai ries semb le avoir baissé dès l e 14° siècle, puisque le même
V . l es articl es 51 , 62 et 53.
statut menace une forte amende, aussi forte que pour l’
adu l
tère, a ceux qui refusaient le rectorat de la f rairie.
Peut—être a cette époque pour Bardonnêche le nomb redes personnes a secourir était—il hors de proportion avec les
revenus de l’
oeuvre pic, de sorte que le recteur était exposéa devo ir suppléer par convenance de ses propres den iers ;peut
-être aussi conservait—on l’
usage de quelque repas dontla dépense tomb ait a sa charge.
N ous avons dit que la mission des frairies s’ é tait rédui te
en général a la distribution d’
aumônes. Mais a Suse la f ra irie ,conservan t mieux son caractère d ’
association , assumait d’
une
manière stab le l ’ entretien des frères indigents . O n en a la
preuve dans plusieurs legs faite a la frairie pour l’
entretiend
’
un con frère. L es archives d’
état contiennent de nombreuses
particules de testamenæ faits au 15°
et au 1 4°
s iècles . Il enest un sem b lable fait le 15 jui llet 1349 par Jacques Bartolomei l ’ un des principaux genti lshommes de la v ille .
Au reste 1’ existence des frairies ou con fréries du Sain tEsprit a traversé tout le moy en âge . Elle n
’
a cessé qu ’
en
17 17 , lorsque le R oi V ictor Amédée II , par un édit du 1 7
av ril 17 17 , les ab ol it dans tout l ’ état et l eur substitua les
congrégations de chari té.
La char ité de Pâques chariùxs Pascha h‘
s ) était une
oeuvre pie ay ant, à ce qu’
i l parait, la même origine que l esfrairies, mais existant à part. De même que les f rairies , el leremontait à l'usage des agapes , et son office était de per
pétuer au moins pour la grande fête de Paques la pratiqued
’
une distribut ion de pain à laquelle particips ssent , en s ignede fratern ité religieuse , tous les fidèles de la paroisse.
Dans les archives de l a commune d ’ Oulx se trouvent plusieurs extraits de testaments du moyen-âge , qui contiennentdes legs à l
’ oeuv re de l a charité de Pâques , ( chari ta ti Pasca l is , ad opus charüa tz
‘
s Pascaüs ) .Les liens qui rattachaient cette institution aux agapes se
révèlent dans l e legs fait par une femme de Sauze d’
O ulx,
Marguerite Gal ly ,l e 23 novemb re 1423 . Après av oir légué
une émine de fromen t a la charité de Pâques ( chari ta tz‘
XI .
Cul ture intel l ectuel le Industrie Com ores .
CU LT U R E I N T E LL E CT U E L L E .
L es traces l es plus anciennes de cul ture intellectuel lenous les trouvons chez le clergé . Dès l e 7
°
siècle un moineSusin , Jonas , a écrit la v ie de saint Co lomban ,
le religieuxciv il isateur, et de quelques autres chefs monastiques , et a
laissé ainsi un jalon précieux pour l ’ histoire des temps
obscurs Les moines de la Nov alaise avaient une b ibliothèque de 600 vo lumes en 906, lorsqu
’ ils furent chassés parles Sarrasins . L es chanoines réguliers d
’ Oulx, institués dan sle 1 1
°
siècle , ont aussi réun i une bibliothèque et doivent s ’
en
être occupés de b onne heure , puisqu’
un manuscrit de la L omb arde , écrit dans ce même si ècle a I v rée, leur a anciennement appartenu V ers le m ême temps on écrivait et on
copiait des manuscrits à l’
abbaye de la Cluse.
Au 13°
siècle Henri Bartolomei , qui m ourut Card inal évêque d
’
O stie, fut célébre comme prédicateur , comme théo lo
gien et comme jurisconsulte .
Mahi l l on l es a i n sérés d an s son recue i l Acta S an ctorum 0 rd im‘
s
S anct i E ma i l s“. Bas e. I I , pag. 2 et al. V en et i i s , 1733.
(2) Ce m anuscri t , con servé dan s la b i b l io thèque Am b ro i s i enn e de Mi l an ,résu l te parv enu au Card inal B orrom ée du Pri euré de S ai n te Mari e d e S use
où l’
o n sai t qu’
av ait été tran sportée la b ib l io thèque du m o n astère d’
O u lx,
et i l porte une n o te où i l est d i t p rov en an t d’
O nd a , m auv a i se traduct i on
du nom d’ Ou lx.
237
Il y ont encore dans les siècles suiy s nts quelques mem
bres du clergé renommés par leurs lum ières . Il nous suffirade citer dans le 14
°
s iècle F locard Berard Prevôt d’ Oulx ,
Ruffin Bartolomei prieur de l a . N oval s ise et Rodolphe de
Montbel abbé de la Cluse , et dans l e siècle suivant un
Aschieri prieur de l a Novalaise , Aimeric d’ Arces prév ôt
d’ Oulx et l e dom in icain Colomb de Céss nne que Chorier
appelle un grand prédicateur .
Au 13°
siècle nous v oyon s l ’ instruction répandue parm il es laïques ; elle est même portée à un degré avancé dansun certain nombre de fam il les . Henri Bartolomei , en fan t de
Suse , avait étudié l e droit à Bo logne et l ’ avait ensuite en
soigné avec éc lat, et avait pris p lace a la tête des jurisconsul tes d
’ Europe . S on splendide exemple donna une utile im
pulsion . Thomas de Jai l l ons son neveu est noté par l’
un iver
sité de Bo logne au nombre de ses élèves l es plus d istingués .
Bernard Bartolomei , un Bara l is , Palm ier Giust i et Benoit AIl iand i cultivent la jurisprudence avec succès . L e dern ierd
’
entr ’
eux figure parm i les consei llers les plus éclairés duComte de Sav oie , qui l
’
empl oie a dos négociat ions .
Dans les deux siècles suivants nous av ons encore des
hommes de loi . Tels sont , par exemple , Jouv encel des Jou
v enceaux d’ Oulx, Antoine T ho losan de Césanne , Robert de
Jail l ons et p lusieurs autres .
Dans la haute val lée l es notaires étaient gens du paysdès l e 13
°
s iècle , c’
est-à-d ire dès 1’ époque la plus éloignée
où nous trouv ions indiqués leurs noms de fam i l le . I l s appartenaient soit a la noblesse soit aux fam illes les plus distinguées parm i l es non nobles , car i l y avait dans la hautevallée une véritable bourgeoisie dans le sens moderne du
mot . O n voit par la rédaction de leurs actes qu ’ ils étaientfort instruits pour ces t emps . I l s jouissaient du reste d
’
une
grande cons idérat ion .
A Suse et dans la basse val lée il y eut en v ogue des notaires é trangers . Te ls ont été plusieurs memb res de la nob lefam ille des All evard , lesquels laissant le v i llage dauph ino is
dont i l s portaient le nom , s’ étab l irent à Chaumont et a
S use
Ave il lane, souvent hab itée par la cour de Sav oie , était un
gros b ourg très—florissant, très-an imé . Dès l’
an 1264 nousy trouvons un ingénieur mécan icien , mai tre Robino , qui yconstruiaait des machines de guerre
Les éco les existaien t dans la haute v all ée depuis un tempsimmémorial . Il s ’
y fo rmait aussi des maîtres qui al laient enseigner ailleurs . E n 1 40 1 la direction des écol es de Turi nfut confiée par la v ille a un maitre Pierre d ’
O ulx
BE AU X AR T S .
Les b eaux arts étaient peu cultiv és . O n trouv e cependan tun Rodolphe ou R odulphe Bara l is appel é en 1300 av ec Jeande Seyssel pour décorer de peintures l e château de Chamb éry , L e goût des arts n
’ était pourtant pas exc lu du pays ,témoin le b on nombre d ’
assez beaux tableaux sur bois qu ’
on
v oit encore dans l es égl ises d’
Avei l lane . L e goût des pein
tures murales é tait général dan s la haute vallée au 15°
s iècle .
L es églises de Cesanne et de Beaulard présenten t encore dest races de f resques ; l es chapelles de Jouvenceaux , de Sain tBarnabé aux S oub ras , de Sa int Sixte aux montagnes du Mélezet , de Notre Dame du Cougnet près du m ême v i llage , des
Orres au dessus de Mil laures et de‘
saint Et ienne a Ja i l l ons
ont été, et que lques unes sont encore couv ertes de pe in turesqui appartiennent a ce siècle , sauf quelque part ie p lus eu
cienne . O n y avo it représenté des sujets de rel igion ou de
moralité d ’
une man ière parfois curieuse , en y ajoutant aussiquelquefois des sentences m orales en v ieux f ran çais . Aux
Orres on avait figuré les péchés capitaux , 21 Jai l lons les
Chart . U lc. pass im . S omm a i re m anu scri t du chan o i ne T elm on .
Ci b rario . I s ti tuz i on i de l la Monarch ia d i S av o ia .
(3) Arch ives de l a v i l l e de T uri n . S on n om d e fam i l l e n’
est p as énon cé
dan s l’
acte.
et même longtemps avant, l orsque les Phéniciens qui fréquentaient le l ittoral des Gaules s
’
am uçaient dans l’ intérieur et
péné traient dans les Alpes a la recherche des m é tauxMais i l es t très-prob able que les Sarrasin s y aient tra vai lléLe fa it est que durant tout le moy en âge on avait la tra
d i tion v iv e de travaux faits et la fo i dans des travaux pos
sib les . Aussi Hugues et Ainard de Bardonnêche , donnant l aV a l freide au monastère d
’
O ulx en l’
an 1200 , se réserv èrentles m ines d ’
argent.O n ten ta encore de les louer plus tard. L es enchères
ouvertes par le chatelain d ’ Oulx restèrent désertes .
Sous le Dauphin Humbert II on crut avoir trouv é un fi lond
’
or sur le territoire d’
E xil les . U ne certaine quan tité de
m inerai fut envoy ée à Grenoble en 1336 ad facien dum au
rum , et on en resta laDans la vallée inférieure il ne résulte pas qu ’
au m oy enâge des travaux des m ines aient été entrepris , sauf un essa i
tenté en 1370 pour une m ine de fer dans le territoire de
Busso l in . E n 1299 des Floren tins étaient v enus chercher desm ines dans la combe de Suse , sans qu ’ on sache aucun résu ltat de leurs explorationsNous avons déjà dit que l es Dauphins avaient obtenu en
1 155 la faculté de battre m onnaie à Césanne . Il ne nousconste aucunem ent qu ’ ils s
’
en soient jamais serv ie, n i m êm e
qu ’ ils aient é tabli à Cesanne l es ate l iers nécessai res .
Par con tre les Com tes de Sav oie avaien t à Suse un hôte ldes monnaies où furent frappés l es den iers susins , petite
V . Th i erry , H isto i re d es Gau l o i s .
I l exi s te dan s l a v al lée supérieure un certa i n n om b re d e f am i l l e s
p ortan t le n om de Faure ou Fa ber , l equel , comm e o n sa i t, i n d iqua i t pri n
ci pal em en t un ouv ri er en m é ta l . S era i t—i l tro p tém éra i re d e co njecturerque ce n om rem o n te à un e p ro fess i o n exercée l o rs d e l
’
exp l o i tat i o n des
m in es ? Ce son t des Faures qu i hab i ten t seu l e d e t em p s im m ém o ri a l l e
ham eau d i t L es Aub erges sur l e flanc de l a m o n tag n e d e S éguret . I l y a
en co re ceci de s ingu l ier ; c’
est qu’
en généra l dan s l es fam i l les d es Faures
o n trouv e b eaucoup d’
h omm es au tei n t b asané e t aux chev eux n o i rs, b ou
clés ou crépus .
(3) V . V ab b on n ai s, Hi sto i re du Dauphin é, p reuv es, p ag . 323.
(4) Ci b rari o . I st i tn z io n i del la m onarch ie. d i S avo ia. Co sa no tab i l i .
241
monnaie d’
argent très-répandue dès l e . 12’
siècle Ces
atel iers fonctionnaient encore en 1292.
E n 1298 est constatée l ’ existence d’
un autre hôtel desMonnaies tenu dans la vallée par l e Comte de Savoie . Ilétait établi à Aveil lane et f oncti onnait encore en 1 335.
L es di recteurs de ces deux établissements desquels nousavoue pu connaître l es noms étaient des étrangersAu moyen âge , où la monnaie était rare et l es commun i
cations , difiicil es en elles—mêmes , étaient de p lus emb arraseéespar l
’
existence d ’
innombrables péages , i l était naturel quechaque pays cherchàt a se suffi re et que surtout i l en fût
ainsi dans l es val lées des Alpes. Celle de Suse avait doncdans son sein toutes les industries correspondantes à ses b e
soins . Cardeurs de laine et teil leurs de chanv re ou de l in ,
t isserands de drap et de toile, tai lleurs et tailleuses , foulonn iers , teinturiers , tanneurs , meun iers , fourn iers , teneurs de
pressoirs a huile , charpentiers ,°
menuisiers , forgerons , maréchaux—ferrants , serruriers , armuriers communs , selliers ou
b âtiers , tous ces métiers indispensables se trouvaient de côtéou d
’
autre dans l e pays.
L a basse vallée tirait de la val lée supérieure, plus richeen troupeaux, l es étoiles de laine . L es tanneurs de la hautev allée étaient spécialement habil es pour préparer l es peaux
de chamois dépouil lées de poil , d esquelles on se faisait desjustaucorps et des culottes , v êtements dont s
’
honorait un
peuple de chasseurs.
Outre l es industries déjà citées , qui étaient plus répan
dues , i l y en avait quelques unes naturellement l ocalisées
par l a qualité des matières prem ières.
Ainsi dans le territoire de Busso l in , où le buis est un
arbre si f réquent qu’ il a donné son nom au pays Buæo le
n um vient de bawue ) , était très-ancienne 1 i ndustrie de tra
L e den ier au si n val ai t l e 16° d’
un gro s tourno is. Ci b rari o ca lcu le
qu’
en 1279 i l rep résenta it l a v al eur de 14 cen t im es et 44 m i l lés imes
(2) Duran d , d irecteur à S use en 1292, éta i t d’
Av ign on . Celu i d’
Av ei l l an e
en 1298 s’
appel ai t Jacques de V aran s , n om p rob ab l emen t suisse, mai s cor
tainem en t étranger à l a v al lée de S use.
vai l ler le b ois de buis pour en faire des cuillers , des écuelleset autres peti ts meub les . Cette industrie devai t être d
’
un e
certaine importance, puisque le Comte de Savoie levait u n
impôt sur les tourneurs d’
écuelles de Busso l in
C O MME R C E .
O n sait que le commerce du moyen âge cons istait prin ci
palement dans les foires. I l en étai t ainsi dans la val léede Suse .
Nous avons ment ionné ail leurs une foire qui se tena it au
1 1°
siècle devant l ’ égl ise vénérée de sain t Laurent d ’ Oulx a
l’
occasion de la vogue qu’
y attirait la fête du sain t.La fo ire de Suse , très—fréquentée encore aujourd ’
hui , est
très-ancienne . L a date de son établissement nous échappe .
Mais nous la voyons antérieure de beaucoup au 13°
S iècle ;car en 1 212 l e Comte de Savoie donne a l ’ abbaye de sa in tJust la Loyde qu ’ i l y percevait dans un acte dont l es particularités démontrent que l
’ impôt m ême était dejà ancien .
La maison de Jai l lons possédait une quote part du droitde Loyde. Les Barral is en avaient aussi une f raction , so itqu ’ ils la tinssent des seigneurs de Jai l lons , soit qu ’ ils en
eussent obtenu la concession des Com tesOutre la foire annuelle , i l se tenait à. Suse un marché
hebdomadaire qui figure auss i dans l'
acte de 1 212 commechose qui ne fût pas nouvelle. E n effet l e statut , confirméen 1 197 , pun it et pun it sév èrement ceux qui troublent l a l ib erté du marché , appelé alors macel lum L e souv erain se
posait comme protecteur du marché et considérait commeune ofi
’
ense grave à l ’ ordre public un acte qui y portatempêchement. La Loyde du marché de Suse était pourtant à
Cib rari o. Discorso secondo sul la fin s n ze del l a m onarch i s d i S av o ia.
Arch iv es d’ E tat de Turin . Ab b az ia d i S . Giusto
(3) De fori fractura . . d e tab u l is vel m acel l o 60 l i b ras.
Le voyageur trouvait d’
autres établissements semblables ,à peine passées les Alpes , à Briançon sur l a route du Dauphiné, a Saint-Michel sur celle de Savoie ; la auss i i l se
trouvait avoir affaire avec des banquiers de l a haute Ital ieDans la v il le de Suse, par suite des tendances exclusives
que nous avons déjà notées , la vente des marchand ises au
déta il ( incis ire dit le statut ) était réservée par l e statu taux habi tants .
De même les é trangers ne pouvaient v end re des brebisn i des peaux de bêtes à laine garnies de l eur toison (avesvel p s l latos
Avec de pareilles restrictions qui aggravaient encore l es
di fficultés du commerce dans un pays d’
ai lleurs peu indust rie let peu riche , i l est naturel que la v ie commerciale se réduisî t a peu de chose pour ce qui concerne au moins l
’
in
térieur du pays .
I l y avait m ême des obstacles aux rapports commerciauxentre la val lée in férieure et la supé rieure qui appartenaitau Dauph in , cel le-ci étant séparée de l
’
autre par une l ignede frontière .
Ces difii cultés furent d im inuées en 1250 par la sauve
garde que l e Comte de Savoie accorda aux Dauphinois v e
nant s Suse dans les m ois d’
automne pour l ’ échange des
produits locaux. Mais ce décret , quoique important , ne fut
qu ’
un remède partial .Le commerce avec l ’
extérieur était moindre encore que
l ’ intérieur. L a vallée , comme nous 1’ avons d it , cherchait a
se suffi re à. elle-même ; elle n’
avait plus a faire des importations considérables , et quan t aux exportations , elle pro
duisait trop peu pour être dans le cas de v erser beaucoupau dehors .
Néanmoins on trouve dans l e statut de Suse de 1 197 un
article ,répété dans celui de 1233 , portant que l es habitan ts
de Suse sont exempts de tout péage jusqu’ à la mer de O s
A B ri an çon c’
étai en t l es n ob l es Gén o i s, à S a in t—Mich el , c’
éta ien t
l es B o rgogn i n i et l es Pel l e tts , n ob l es Astesan s.
245
labre , et qu’
en revanche tous l es Italiens jouissent de
l ’ exemption du péage à Suse , en entier pour aller , et a
moitié pour le retour .
Quel peut—être le b ut et le caractère d ’
une di sposition si
extraordinaire, si les Susi ne avaient si peu de relations com
merciales hors de leur propre commune ?N otons d ’
abord qu ’ i l s’
agit ici moins d’
une d ispositionque d
’
une déclaration . Ce n’
est pas en efi‘
et par un articlede statut local que pouvait être accordée aux Susine l ’
exemp
t ion des péages dûs aux nombreux états feudataires ou com
munes dont il fal lait alors traverser les territoires pour arriv er aux ports Calabrais . U ne pareil le franch ise ne pouvaitêtre établie que par la consentem en t de tous les possesseursdes péages ou par une autorité . supérieure a eux tous .
Elle ne peut donc figurer dans l e statut qu’
à t itre decommémoration en ce que les Susine auront tenu à fairerésulter qu ’ ils en ava ient l e droit et a engager l a protectionde leur souverain pour la conservation de ce d roit, soit qu
’ i lfût spécial a eux, soit qu ’ il leur fût commun avec d ’
autressujets du m ême Prince .
Nous ne pouvons d’
ail leurs oublier que l e péage de Susen
’
appartenait pas a la v i l le , et n’
avait jamais été mun icipal ,mais démanial , et qu ’ i l devait être te l parcequ
’ i l constituaitune v raie douane sur le transit des marchandises entre l eDauph iné et l
’
I tal ie, tout comme l e Dauph in percevait pourson compte un droit de transit dans une douane établie sur
sa propre frontière , d’
abord a Exilles , puis a Cesanne.
L e tarif de la douane de Suse était composé d’
un petitnombre de cathégories suivant la nature des marchandises .
Mais en m ême temps l es péages étaient aussi dûs par l espersonnes et par leurs montures . Il est probable qu
’ il en ait
été ainsi de celui de Suse lorsque fut concédée l ’ exempt iondont nous parlons , et que celle-ci se rapporte précisémen t au
péage dû par le voyageur, ce qui expl ique le priv il ège ré
L a f ranch i se étai t an térieure au s tatut de 1 197. L es S us i n s 1 i n v o
quen t là comm e un d ro i t acqu i s, comm e un p riv i l ège étab l i : l iber oh‘
tas
a os tra es t.
ciproque des S usins et des Italiens , car une exemption donnéeaux marchandises transportées par les Italiens aurait été s i
large et si féconde en abus qu'
elle aurait à peu-près annuléle péage .
Ce qui aide aussi a cette interprétation , c’
est que la di
sposition comprend l’
al ler et le retour, accordant une demiexemption pour ce dernier. Cela est plus naturel pour les
voyageurs que pour l es marchandises .
Quo iqu’ il en soit , nous estimons que s 11 est impossiblede considérer le privi lège comme émané d ’
un accord entreles S usins et les possesseurs des péages d
’
Ital ie , il est im
probable d’
autre part qu’ il ait été stipulé entre le Comte de
Sav oie et ces mêmes possesseurs. Comment cro ire que ce
prince à une pareille époque ait pu stipuler une conventionavec tant d ’
intéressés ? E t comment se ferait-il que , si unechose si extraordinaire eût eu lieu ,
il n ’
en fût resté de mèmoire nulle part ? La conclusion la plus plausible est donc , anotre av is , que l
’ Empereur, qui se considéra it toujours commel
’
autorité suprême placée audessus du Comte de Sav oie commedes états ital iens , ait étab l i l e priv il ège dans un intérêt général , pour faciliter l es rapports entre les populations ital iennes et les pays au delà des Alpes.
O n connaît quelque autre acte de ce genre émané des
Empereurs German iques dans le siècle même où fut rédigél e statut de Suse
C i b rari o . E conom ia po l i t ics .
— 248
tail lab les et laissaient dans l ’ ombre les famil les exemptes detail le par priv ilège , ou a cause de leur pauvreté .
A t itre de priv ilège é taient exempts l es nobles , les clercset autres ayant priv il ège de clergie , et les pauvres . Sous ce
nom , en matière de tail le ou comprenait , outre l es fam illesqui ne possédaient rien , celles qui ne possédaient pas au delàde la valeur de dix l iv res . Au moins telle était la base desrecensements que nous connaissons de la val lée de la Doi re.
Il faudrait donc pour connaître l e tota l de la populationajouter a celui des taill ables donné par l es documents , ce luides d iverses cathégories de non tail lab les et on ne peut lefaire pour la plupart des l ieux que par un calcul de prohab il ité .
I l nous reste cependant un fil pour nous conduire dans
ce labyrinthe . L a rév is ion des feux faite a Césanne en 14 1 0
porte l e nombre des familles taillables e t celui des non ta ill ab les a raison de leur pauvreté . Ces dern iers sont aux taillab les dans la proportion de 37 a 78 E n ajoutant aux 37un gradué en droit qu ’ on a exempté comme jouissant du priv i lège de clergie l e ch iffre des exempts est de 38, et faitpar conséquent le tiers du total de la populat ion .
Cette proportion constatée a Césanne , dans un pays agrico le , où la propriété a toujours été très—d iv isée , nous paraî t
pouvoir être adoptée raisonnablement pour les autres paysruraux de la vallée , et elle nous paraît aussi adm iss ible pourl es centres de v ie sociale comme Avei l lane et Suse, parceque ,s
’
i l y avait plus de richesse , celle—ci élait concentrée dan sl es fam illes principales , et a cô té d
’
el les i l devait y avoir unnombre considérable de pro létaires et de petits artisans outreune foule d ’
exempts par priv il ège de nob lesse ou de clergie .
E n procédant sur ces bases , nous al lons donner 1’ évaluat iondu nombre des habitants des principaux pays de la vallée ades époques ind iquées.
L e ch ifl’
re de 87 était com posé de toutes l es fam i l l es qu i n e po ssé
daien t p as au d el à de l a valeur de d ix l i v res Dan s ce n om b re 19 fam i l l es
c’
est—à-d i re un p eu p l us de la m o i t ié, é ta ien t tout—à—fa i t pauv res.
"vous elero‘
enh‘
ter , d i t l’
acte.
249
S use. en 1377 comptait 433 feux taillables , et ainsi a peu
près 2886 âmesAv eil l ane a la m ême époque avait 450 . feux c ’
est—à—dire3000 âmes .
Busso l in av ait 1 10 feux, soit 733 âmes .
Bardonnêche en 1472 avait 139 feux , soit 926 âmes .
Césanne en 1 410 avait 1 16 feux ( taillables et non tai llables) pour 580 âmes.
Jai l lons en 1331 avait 1 46 feux pour 973 âmes .
V i l lar fouchard avait 1 16 feux pour 763 âmes .
Ainsi dans la vall ée la commune la plus peuplée étaitAvei l l ane ; puis venait Suse . L es autres communes l ’ étaien tbeaucoup m oins .
E n jetant un coup d’ oei l comparatif aux env irons , nous
trouvons que Rivoli avait précisément 433 feux tail lable s ,comme Suse ; Turin en avait 700 ,
Lanzo , Moncal ier et Pignerol l e m ême nombre que Turin ; Chieri et S av i l ian beaucoupplus , c
’
est—à—dire 1333. Chambéry en 1387 avait 677 feuxtail lables .
Si d ’
autre part nous con frontons les chifi‘
res d’
alors avecceux de la population actuelle , nous trouv ons qu ’
en généralla vallée est a présent peu peuplée. Suse a augmenté de plusd
’
un tiers , d’
autres communes d ’
avantage , comme est l e cas
de V il larfouchard , d’
autres moins du t iers , comme plusieursde la haute vallée . Bardonnêche en 1858 , c
’
est—à—dire avantl e développement des travaux du tunnel , n
’
avait augmentéque d
’
une cinquième env ironL a d ifi
‘
érence entre l es unes et l es autres s’
explique principalement par leur situation sur la grande route ou à l
’écartet par d
’
autres circonstances p lus O n moins fav orables à un
accroissement de prospérité . Pour quelques local ités , tel les quela haute vallée de Céss nne, on doit auss i tenir comp te des ém i
grs tions temporaires ou défin itives qui sont devenues f réquentes .
433 mu l t i l ié ar 5 2185P P
p l us un t iers 72]
To ta l 2886L e recen sem en t de 1858 lui d on n e 1 144 âm es.
250
Mais dans son ensemble l’
accroissement de la populationest moindre dans la vall ée de la Doire que dans la plupartdes autres régions du Piémont . La raison nous paraî t êtreque dans ces pays l
’
industrie a créé de nouvel les sourcesde richesse et occupe beaucoup de bras , ou bien «
que l’
agriculture s pu recevoir des améliorations et des développements que la nature moins riche et la moindre étendue dusol cul tivable dans les Alpes ne permettaient pas aux popu
l ations alpines .
252
ses ém igrations temporaires pour motifs de. commerce ou
d’ industrie.
I l y a pourtant des expressions qui restent positivementdu moyen âge, ou qui 1
’
ont traversé, venant de temps beaucoup plus anciens . Nous en rapporterons ici quelques nues
en d istinguant cel les qui semblent dériver d’
une autre source.
Expressions l atines ou dérivan t de la même source que
l e latin :
Lau lac, s b b rév iation probable de lacus .
O me homme homo .
Faune femme fem ina.
V è v eau v itellius .
Pré. pré pratum .
Olme ormeau ulmus .
Frai sse frêne fraxinus.
Bioule bouleau betula,Jenèb re gen ièvre jun iperus.
Chenèb ou chanvre canapis.
L ay lait lattis .
V ie chem in v ia .
Fue feu focus.
Aïgue eau aqua .
Pan pain penis .
S oureil solei l so l .
Charôu chaleur calor .
Frey f roid f rigor .
N itoure chouette n icticorax .
Jarine poule gallina .
Jail coq gallus .
Rane grenouille rene .
Man main menus .
Courre courir currere .
You oeil oculus .
Anbre arbre arbor.
Pai lle pai l le pales .
N èb le nuage nebula.
253
L oupp loup lupus .
Chin ch ien canis .
Chat ou ciatt chat °
cattus .
Perdrl perdrix perdix.
L iaure li èvre lepus .
B itable étable stab ulum .
Aure v ent aura .
Chabre chèvre capra .
Douroù douleur dolor.
Erbe herbe herba .
Plante plante planta .
Riou ruisseau r ivus .
Expressions étrangères au latin :
Bot fils garçon .
Mand ie fille .
Banate sorte de pan ier qui sert au chargement d’
une
bête de somme .
V assiou bél ier.
V as tombeau, caveau sepulchral .S nsy de f raction de territoire , région .
B l etoun m é lèze .
l ) ai l l une faux .
E icrinchà écraser .
Amosse f raise .
V orze saule .
O ursgne noisette .
Garb ine sorte de panier que l’
on porte a dos d’
homme.
Barnage pel le a feu .
Peui l ieu é levé comme 1 i talien p aggio .
Pouy à mon tée .
Serre hauteur, monticule .
Oche entail le .
L ôdou caillou.
Mountùe peut être.
Coucs ren quelque chose.
S eicoure autrefo is .
L scb è il faut .T ache clou.
Cs rignay re amoureux d’
une jeune fill e.
V iamen bientôt.Degail là di lapider.
Doueire Doire et , en général , cours d’
eau.
Jarriou gros rat .
E icoundre cacher le n ascondere italien .
E itremh m ême sign ification .
Basl , b as ic mort , morte .
R eb s th ramasser.
Ana aller come 1 1talien andere.
Beica regarder.
Boundren beaucoup .
Quelques unes des expressions de la dern ière cathégorie
se retrouvent plus ou moins intactes dans l e piémontais et
dans d’
autres d ialectes actuels de l a haute Ital ie Il y en
a même que l’
on trouve dans l ' italien . Il y en a beaucoup ,comme cel le de b ana le, que nous apprenon s avec cert itudepar les auteurs latins être dérivées du celtique . D ’
autresencore, comm e cas et snayde sont constatées av oir appartenuau gothique Enfin da i l l et m an die se rencontrent dans l eprovençaL
V o i r l’
ovv rage de B i on del l i , p ass fm .
V oy ez l a mém o i re de Grot ius é. l a sui te de son éd i tion de Pau l
D iacre .
c Les S padonaïres , d it N orberto Rosa, ne v ont jamais pasc a pas , mais a sauts , l
’
un après l'
autre et deux a deux.
Après avoir fait deux sauts en avant , le premier spadonaïre se retourne, frappe de la lame de sa l ongue épéecelle du compagnon qui marche derrière lui , puis i l fa itde nouveau deux sauts en avant, et ensui te il se retourneencore à frapper l
’
épée de l’
autre et ainsi de suite . Quandla procession s
’
arrête les spadonai res s’
arrêtent aussi , maisdans une att itude guerrière . Car i ls t iennent l a main gauche sur le flanc, la main dro ite étendue en avant sur la
poignée de l’
épée dont la po inte s’
appuie a terre. L es fi
gares , les jeux , les sauts , l es parades , l es contors ions , l es
grimaces de cette mascarade étrange sont infinies . Tantôti ls se baissent presque jusqu
’
a terre tous les deux, ou tousles quatre, ou tous l es huit tenan t leur épée a deux mainscomme s
’
i ls voulussent la f ourb ir sur le so l ; tantôt i l s jettent leurs épées en se l es jetant et ce la a d
’
assez longuesdis tance s .
Après la procession les padonaî res se portent dans un pré ,appelé Paravi . La en présence du peuple accouru en foulei l s représen tent une révolte furieuse contre leur chef . Il sedéfend en man iant son épée avec adresse . Mais que peut—i lseul contre tous ? I l essaie de fuir ; l es rebelles le poursuiv ent , 1
’
atteignent, l’
ab b atteut à coups d' épée et l e finissent
en déchargean t sur lui des pistolets .
V ictorieux , il s se regardent entr’
eux comme pour s m
terroger sur ce qu’
i ls doivent faire ; i ls s’
approchent avec
précaution du corps du vaincu, prêtent l’ orei lle, s
’
assuren tqu
’
il ne respi re p lus , le couvrent d’
herbes et l ’ emportent.Puis i ls proclament un autre che f, lequel , v êtu d
’
hab its de
soie pourpre et coifi'
é d’
un long chapeau orné de plumesd
’
autruche noires, reçoit l es hommages de ses guerriers et
et des fleurs que lui présentent trois jolies femmes . O n lui of
fre aussi la coupe des fêtes pleine de v in pétillant et il boitjoyeusement, puis jette la coupe qui ne doit p lus serv ir àd
’
autres . Enfin , porté sur les épaules de ses preux, tenantl a main gauche a la ceinture et dans l a droite deux hal le
b ardes croisées , i l parcourt triomphaut le pays au son de la
musique et aux acc lamations du peuple2. Les Fuseaux de Bussol in . La f ête d ite du Barro se
passait a Busso l in . Elle a aussi cessé depuis peu d’
années .
Dans l’
après m id i du jour de Pâques dans l a salledes séances se réunissaient l es membres du conseil communal .A chacun d ’
eux était consigné un gros fuseau mun i aux deuxextrém ités de pointes de fer. De la au son de la musique et
suiv is de la foule du peuple ou se rendait au pré de Barro ,où l es conseil lers , t irés au sort, se partageaient en deuxcamps et , une cible étant plantée , il s lutta ient d ’
adresse al
’
atteindro avec leurs fuseaux . L es vaincus devaient un d înerà toute la joyeuse compagn ie.
La f ête des fuseaux rappel le une femme vertueuse de
Bussol in qui , tentée par un seigneur lasci f , lui enfonça dans
la poitrine un fuseau ferré exprès, et délivra ains i l e peupled
’
un tyran .
Barra est le nom d’
un habitant , ancien possesseur dupré, qui en légua par testament la propriété à la commune àl a charge que tous l es ans on y ferait l e jeu des fuseaux .
3. Les noces de Ch ianoc Lorsque le cortège des
nouveaux mariés arrive a la maison de l ’ époux , i l trouv e la
porte ferm ée. L ’ épouse f rappe trois fois ; a l a troisième la
(1 ) R egal d i d it que peu d e tem p s auparav an t i l y avai t encore des
fêtes d es spad on aïres à. J a i l l on s, à. V en aus et à. Chaum on t.
Quelque cho se du m êm e gen re a l ieu à Gênes . A Gen ova d i t G i
ro l am o B occard o i m ari nai so l evano e anco ra sog l i on o oggi di b at tere l a
m oresca, speci e d i dann p irrica accom pagn a ta dal l o el et tri zs an te suon o
del l e spad e i n s i em e percosse e da m us ica m ars ial e, i l quai s g iuoco
p resero i fort i L iguri dai S aracen i .
L e préfet L ad oucet te a con staté dan s son h i sto i re d es Hautes Al p esusage de parei l l es dan ses py rriquès dan s ce départemen t où l es L om b ard s
n'o n t jam a is dom i né. N ous croy o ns que cet usage n e v i en ne p as des L om
b ards n i des S arras in s, mai s p lutôt d es R omai n s qu i l’
héri téren t des Grecs.Ceux—ci en attrib uai en t orig ine à. Py rrus, fi l s d
’ Ach i l l e, qu i ava i t d an sé
t out arm é. Mai s l es dan ses guerrières se retrouv en t ches des peup l es sau
v ages.
O n donne en core ici une s im p le traduct ion du texte de Bogald i,
pag . 90 et 92.
( 8) Begal d i , La Dora , psg. 80 et 81 .
porte s’
ouvre et la belle-mère apparait sur le seuil avec un
air s évère ayant la cuillère a po t pendue a la ceinture ; e llecommence avec la bel le—fil le le d ialogue suivant Que v ou
l ez—vous ? E ntrer dans votre maison et vous obéir en ce
qui’
i l v ous plaira de m’ ordonner. O h ! v ous autres jeunes
fil les légères et capricieuses v ous avez bien autre chose dansla tête que l e soin d ’
un ménage . Laissez—mo i essayer et
v ous v errez. Mais ici i l s’
agit de conduire le bétail au
pâturage et de traire le lait . Et moi j ’ irai au pâturage et
je trairai le lait . De faucher les près et de travailler l eschamps . Je faucherai l es prés et je travaillerai l es champs.
De se lever la prem ière et de se coucher la dern iè re , afin
que la v ieille bel le—mère puisse se lev er l a dernière et se
coucher la prem iére . E t je ferai auss i cela . Mais vousne pourrez pas résister à tant de fatigue. Dieu et votre fil s
m’
aideront .
A ces mo ts affectueux la bel le-mère change de ton et em
brassant tendrement la jeune épouse , e l le lui di t : v iens , mafille , v iens et puisse—tu n
'
oublier jamais tes promesses . Puisel le dé tache de sa cein ture la cuillère à pot et la rem et àsa belle—fil le , laquel le dès cet instant fait l es honneurs de lamaison et inv ite toute la joyeuse compagn ie a prendre p laceau festin de noces . Dans ce festin i l est de rigueur que l esnouveaux époux mangent dans la m ême assiette, bo ivent au
m ême v erre et usent du m ême sout ient.
suppose qu’ i l venait de son parrain, et peut—être n
’
est—ce pas
émettre une conjecture trop hasardée en le co nsidérant commefil leul d ’ Henri V icomte de Barato nia, qui, a l ’ époque de sa
naissance, était le personnage le plus important de la val léede Suse , et fréquen tait la noblesse de cette v ille et des en
v irons .
L e futur Cardinal é tudia le droit a l’
un ivers ité de Bologne sous Balduin , d isciple et successeur du fameux Azon . Ilreçut ainsi la trad ition de ce grande maître , dont il devai t àson tour égaler la science et la gl oire .
E n efiet il ne tarda pas d’
enseigner lui—mémé le dro it àBo logne avec le plus grand éclat . ( Il s
’
appl ique spécialementau droit canon Puis i l passa à l
’
un ivers ité de Paris , où ilacqui t tant de réputation qu ’ on l ’ appelait la source de la
scien ce et du dro it . U n homme de grand renom , Guil laumeDurand , d it sp eculator , a été son d isciple .
Ayant accompagné en Angleterre le N once envoyé au R o i
Henri III , i l reçut de ce Prince de nombreuses marques ded istinction et de faveur qui , jointes à sa qualité d
’ étranger,lui attirèrent la jalousie et la haine des courtisans,
I l était prieur du chap itre épiscopal d’ Antibes depuis l
’
an
1239 chanoine de V ienne et archiprêtre de la mé tropoled
’ Embrun , église alors puissante et trés considérable. Peu
dant son séjour a Paris i l y avait été fait arcb idiacre de
N otre-Dame. A son retour d ’
Angleterre en 1244 il fut promuà l ’ évêché de Sisteron. Puis en 1250 il fut élevé a la d ignitéd
’
archevêque d’
E mb rum. Enfin en 1262 i l reçut la doub lenom ination de Cardinal et d ’ évêque d ’
0 stie. E n 127 1 eut l ieua V iterbe le conclave pour l
’
élection d ’
un nouveau PapeLe Cardinal Bartolomei déjà v ieux et cassé s
’
y rendit ; maisi l y tomba malade si grièvement qu
’ il dût quitter le conclave .
I l se retira d ’
abord a Orte , v i l le peu éloignée , puis , d’
aprèsle conseil des médecins, i l se fit transporter 9. Lyon , où i l
E n son t emps le siège ép iscopal d‘An ti b es fut tran sféré à Grasse et
l e t i tre de prieur fu t échangé en ce lui de prévôt. C‘
est pourquo i on le
trouve qua l i fié p révôt de Grasse.
O n y a él u Grégo i re X.
— 261
mourut le 8 des idee de novembre. I l fut inhumé dans l ’égl isedes Dom in icains , mais son tombeau fut détruit avec l ’
égliseau temps de la révolution .
L e Card ina l d ’ Ostie était consulté par l es Papes et‘
par
l es souverains a cause de sa grande réputation de savoir.
Innocent I V 1’
engagea à commenter les décrétales , ce
qu’ i l fit en jurisconsulte auss i indépendant qu
’ éclairé. SaintLouis recourait volontiers à sa sagesse , et l ’ on a supposéavec assez de probabilité que l
’
autorité moral e de cet illustre pré lat a contribué à mainten ir l e saint Roi dans sa lignede condui te env ers l ’ église , qui tout en respectant son autorité spirituelle, faisait respecter les droits du pouvoir civ ilMais sa principale gloire est d
’
avoir écrit sa somme , grandt raité de jurisprudence _et spécialement de droit canon ramenéaux principes du droit romain :L ’ influence de ce l ivre fut énorme et salutaire. L es tri
bunaux ecclésiastiques euren t une règle raisonnée: L’
autoritéen fut telle , que la somme du Card inal d ’
O stie fin it par êtregénéralement connue sous le titre de somme d
’ or, S ummaaurea . Elle fut imprimés pour l a prem ière fois à Bâle en 1537 ,puis à V en ise en 1574 , et a Lyon en 1588 et 1597
L ’ idée d ’ écrire ce traité fut san s doute inspirée à HenriBartolome i par l
’
exemple d’
Azon qui avait donné sa sommedu droit p lus spécia lement appliqué aux matières civiles .
Il en avait d ’
abord fait un prem ier manuscri t qui péritdans un incendie avant d ’ être achevé . Puis , étant archev ê
que d’ Embrun , i l se remi t pat iemment au travai l dans la so
l itude de son château de Crévoulx, où il parvint à term inerl
’
ouvrage.
Trois sommes fameuses nous sont restées de ce mém orab les iècle , s i fécond en progrès de tout genre, celle d
’
Azon
pour l e droit civ il , celle du Card inal d '
O stie pour l e droit
L ud . S au l i . Del la cond izione deg li studa n el la m onarchia d i S av oia
si no ad E man ue l e F i l i b erto .
L’
auteur légua un manuscri t de la somm e a la Chancel l erie R om ai ne
et un autre a l'U n iversi té de Paris. I l l égua l
'origi na l a l ’ U n i versi té de
Bo l ogne.
canon, et cel le de saint T homas pour la phi losophie et la
théo logie. Sans étab l ir de comparaison entre les deux pre
mières et celle du saint docteur de - 1’ Eglise pour la force
des raisonnements , la nouveauté des idées , et la hauteur desvues, i l est hors de doute que toutes les trois ont puissam
ment contribué a la civ ilisation du moyen âge.
Le Dante a donné place au Card inal d ’ Ostie dans ses versimmorte ls . I l en fait mention comme d ' un chef d ’ école qui
est a la tête des légistes
N on per l o m ondo‘
, par cu i m o s‘
afi'
an na
D i retro ad Ost ien se ed a
Le grand poète semble trouver excessive la tendance deses contemporains pour l es études du droit, lesquelles menaient a des pos itions brillantes et lucratives, tand is qu
’
i ls dél aissa ient l es méditations désintéressées de la phi losophie ah
straite, et i l fait é loge de saint Thomas qui a préféré lecu lte pur de la vérité aux applications mondaines de la science.
Mais n’
est—ce pas aussi un serv ice rendu à l ’ human ité que
celui d ’
avo ir m is a la mode 1’ étude du dro it dans un tempsoù dominait la force brutale ?La lecture de la somme d
’
or est fatigante, parceque le
texte est a tout moment entrecoupé de ci tations . E l le est di
v isée en cinq l ivres.
Le prem ier traite de la fo i catho lique , des constitutionset rescrits des Papes, des élections et de la translat ion des
E vêques , de leur renonciat ion , de l’
autorité des Archevêques ,des d ignitaires des chapitres , des v icaires aux d ivers degrésde la hiérarch ie, des gard iens ou sacristains , des égl ises et
des juges .
L ’
auteur s’
y occupe auss i des o rd inations et des cond iti ons requises pour les obten ir. Puis il passe a des mat iè resd iverses , parlant de la discipl ine h iérarchique de l ’ égl ise et
( l ) Parad iso , Can to XI I , v . 82 et 83. Taddeo é tai t un grand m édecin. L e
poëte fai sai t al l us io n aux avan tages m ondai ns qu’
on av a i t en v ue en su i
van t l es éco les de d ro i t ou de m édeci ne .
I l term ine la somme par cette expansion d’
un homme qui
a fini un lab eur pénib le et rempl i un grand devo ir, presqu’
un
devoir religieuxL icet mul ta hab uorim contraria ac me d istraxerin t alla
ardua negotia et d iversa , adjutorio tamen i l l ius in quemcamper sperav i in omn ibus sufi
‘
ul tus v im m ihi intul i , opus
quasi d isparatum et nimis difiicil e, quin imo insufiicientiao
mess impossib ile quad in ofi cio m inori excoéperam et de
mum in incend io am iseram , in major i constitutus ofiicio re
s vocav i , fidem servav i , non ego autem , sed gratin Dei mo
cum . De reliquo reposita est m ihi corona justitiae quamreddet m ihi in i l le die justus judex cui est honos , laus et
gloria par omnia saocula saecu lorum . Amen .
Outre la somme l e Card inal d ’ Ostie a laissé à la postérité l e commentaire sur les décrétal es qu
’
il avait été inv itéà écrire par le Pape Alexandre IV , comme nous l ’
avons dit
plus haut.Dans le plan de la v i lle de Suse inséré au T heatrum
S ta tutuum C. S a baud iae on voi t ind iquée une maison commeayant été cel le du Cardinal d ’ Ostie. Cet édifice existe encore :i l est dans la rue principale et se trouve attigu au beffro ide la v i l le . S a façade à grandes fenêtres gothiques conservel e cachet du moyen âge . Il ne conste par aucun document
qu’
i l ait appartenu au Cardinal ; mais i l est constaté que
c’ était une propriété de l a fam il le Bartolomei . Par une co incidence assez b izarrre cette maison , attribuée à l ’ o racle dudroit canon , fut de nos jours l
’
habitation du poète N or
b erto Rosa .
La mémoire du Card inal d ’ Ostie resta en v énération a
l’
un iversité de Bologne . Cette grande institution aima a en
registrer parm i l es noms de ses élèves les plus d ist inguéscelui d ’
un neveu du célèbre canon iste . Ce fut Th omas de
Jail lons , autrement dit de R oma ou de R oman ia, qui faisaitson droi t en 1285 T homas de Jai l lons fut chevalier, et en
( 1 ) D. T homasi nus de R oman i s nep os Ca rd i nal i s O sti ensi s. ( V . S art i et
C ardel la op
265
1 300 i l était châtelain soit gouverneur de Pignerol , résidencedu Prince d ’
Achay e, souverain du Piémont.Le Card inal d ’
O stie a été un des hommes qui ont l e p luscontrib ué à l ’ émancipat ion du pouvoir civ il . Il a posé cuvertement le principe de la séparation des deux pouv oirs et de
l eur indépendance réciproque, Il met en quest ion ; numquz‘
d
pap a m ajor est imp era tom‘
? ( ici maj or s’
en tend dans l e
sens d’
autori té supérieure ) et i l répond que non : v idetur
quad gw‘
a d isünctae sun t j uri sd ictiones quamm‘
s
un a m ajor et qu i l i bet secun dum legem suam
I l se b ête à la v érité d ’
ajouter : sed a traque tamea eccle
s ias ticas canones sequ i deb et Mais ceci se rapporte aux
mat ières spirituelles . Il tient naturel lement à bien expl iquer
que , s’
i l croit l e souverain indépendant pour le temporel , i lentend qu’
i l soit soumis a l ’ Eglise pour l e sp irituel . C’
esten ce sens qu
’ i l se demande ai l leurs ; numquz‘
d imp erator
deb et esse ob b edz‘
en s dom in o p ap ae ? et i l répond : utique,
quia sp iri tua l ia d ign iora sun t temp ora l i bus .
Du reste le grand canon iste avai t tout autre qu’
un en
gouement aveugle pour l’
autorité spirituelle. Il pose l a question délicate : an uæor p eccet m orta l i ter f rangendo votum
a bstin en tz‘
ae ad m an datum m‘
m‘
cum majom‘
p ates tat i p arere
&bea t q uam v iro ? et i l dit : respondeo : deo o b bedi i dam
in hoc v ire ob bed i i , qu ia hoc facit j uris aucton‘
tate.
L e plus souvent les hommes supérieurs subissen t l e goûtde l eur siècle comme i ls en su ivent l es modes : notre Car
dinal a semé dans son l ivre plusieurs de ces idées bizarresqui plaisaient tant a ses contemporains . Ains i i l compare auxtrois personnes de la Trinité l es trois classes sociales d ’
alors ,l e laïcat, le clergé séculier et l e régulier. L e laïcat, dit— il ,est semb lable au père par la puissance, l e clergé séculierau fi ls par la sagesse , l e régulier au Saint—Esprit par la
b onté et la grâceI l nous reste du Cardinal d ’ Ostie une lettre sur la grande
lutte entre les Guelfes et les Gib el l ins . U n évêque eut 1’
in
(1 ) S am 5 18 pag. 7 de 1‘
éd i t i on p réci tée .
S… 18, pag . 7 préci t .
266
gèna ité de lui demander par l ettre son av is sur le choix a
faire entre les deux part is . La réponse du Card inal est assezemb roui l lée. O n y voit l
’
intent ion de parler sans,rien d ire ,
et la conclusion qu’
un évêque doit être un homme de paix
I a tth ieu Paris, connu par sa faci l i té é m éd i re, et d‘
au tres ap rès
lui, on t accusé le Ca rd ina l d‘
o stie d’
étre av ide d‘
argen t et s im on iaque .
O r le seu l fa i t articulé par Pari s a été v ictorieusemen t ré futé .
D’
autre part ce qui résu l te sur l‘
état de m a i so n de n o tre prélat n e
révé la n i le d iss ipa teur, n i 1‘
avare et l o in d’
av o i r, comm e tan t d‘
amb i ti on d’
enrichir sa fami l le, i l n’
a la issé que des logs p i eux .
Fm un La mmxxùux m am .
Le V al l on de Bardonnêche .
Bardonnêche est un ancien b ourg situé dans un val londes Alpes Cott iennes formant un emb ranchemen t de la hautevallée de la Doire R ipaire a droite de la route du Montgenévre.
Le fond de ce vallon pittoresque et riant est disposé en
plan incl inê ; c’
est une vaste prai rie coupée par des files defrênes et d
’
autres arbres d ’
un beau vert. L e b ourg est a la
cime du plan incliné ; tout auteur l es flancs des montagnessont revêtus de guérets jusqu
’ à une certaine hauteur ou de
bois de d iverses essences .
A quelques toises au dessus du bourg se dressait jadis sur
un plateau le principa l manoir seigneurial , v ieux châteauayant au centre une haute tour ou donjon carré et aux an
gles des tours rondes d ’
une époque moins reculés , plus desb astions et autres ouv rages de fortification qui probablementne remontaieut pas au delà du quinzième si ècle.
E n face du b ourg et des ruines du château se présente lavue pittoresque de deux montagnes richement b oisées , quiparaissent av oir été séparées par l
’
oeuvre des hommes pourouvrir une étroite issue au vallon et un écoulement a ses
eaux . La trad ition veut en efi'
et que l a roche ait été ta i l lée,
comme el le en porte l e nom , et que dans les tema plus au
ciens le val lon format un lac.
S ur la montagne de gauche sont étagés les divers hameaux
qui forment la Commune de Mi l laures, riche et joy eux pay s
dont les moissons abondantes sont dorées par l e soleil dum id i .La montagne de dro ite peuplée de sapins et de melèzes
ofi'
re un coup d’
oeil plus sévère . La partie plus avancée formeune sorte de promonto ire surmonté des ruines de 1
’
ancienchâteau de Bramafan , qui s emb le avoir été bâti la pour garder l
’
outres du val lon.
La position de Bardonnêche au m ilieu des montagnes , àl
’
écart des grandes routes , parait en faire un cul de sac.
Mais de temps immémorial deux chem ins muletiers , qu i étaient d
’
autant plus fréquentés autrefois , l e metten t en comun ication, l
’
un par l e co l de la R 6, avec Modane et la haute
Maurienne , l’
autre par le co l de l’
Échel le (co l lem S ca le du
moyen age) avec la val lée de N evache en Briançonnais .
272
années . Ici comme a Bam el lonette i l y avait des b racel ets ab osses , d
’
un travai l qui attestait un certa in progrès de l’
art.
I l y avait aussi quelque p iéce de poterie rouge ou noire,
gross ièrement tournée et pareillement v ern is . Peut—on en in
ferer une communauté de m oeurs et une ident ité de race
entre les hab itants des tro is val lées a l ’ époque où remontent
l es sepul tures i
Bardonnêche , comme toute la vall ée d ’
O ulx, a fait partie
du Royaume des Alpes Cott iennes , aggrégat ion de tribus al
pines dont l e territo ire n’
est pas bien connu , mais qui com
prenai t certainement la Combe ou vallée de Suse , le Brian
çonnais et l’
E mb runais , et dont l e roi a l ’ époque de JulesCésar était Bonn ou Donnus , père de Cottius qui fut all ié del
’
empereur Auguste. L e dern ier roi fut un autre Cottius , quimourut au temps de N éron , l equel convertit l ’ État de ce
prince en province romaine.
Ce petit royaume gaulois , placé entre la civ i lisation greoque de Marseille et cel le de l
'
I ta l ie, devait en avo ir étépénétré de bonne heure . Doun s
'
était presque roman isé : i létait devenu Ju l ius Don nus . Co tt ius son successeur, lo ind
’
imiter l ’ inuti le et sauvage rés istance que les peuples voi
sins avaient opposée aux Romains , s’
était attiré leur amitiéen ouvrant lui—m ême a travers son terri toire une route rou
l ière pour les comun icat ions entre l ’ I tal ie et l a Gaule transal pine , la où n
’
existaient auparavant que des sentiers perchée sur l es hauteurs . Rome ne dédaigna po in t d
’
accepter
pour a ll ié ce prince sage et habi le , lequel conserv a ainsi a
son pays une autonom ie presqu’
entière et en même temps
lui procura les avantages du commerce de t ransit. Auss i l erégna de Cottius est—il resté l ongtemps dans la mémo ire deses peuples comme le souvenir d
’
un âge d’
or, et au siècled
’
Amm ien Marcellin son tomb eau était encore en grande vé
nérat ion Placé près des murs de S use, non loin du palais
Hu ius sepu1chrum r egu l i (d i t Amm ien ) 8egusion e est m oen ib n s
m an osque s i ns rat ion s gam ins rel igi on co l nn tur : quod iust o
m oderam ine rexerat suos, et adsci tus in socieù tem ro i romanao quietem
gout i praest iti t semp i tum&n
273
que l e b on roi avait habité , ce sépulchre a subsisté intactpendant plus de quinze siècles C ’
est l e vandal isme mo
derne qui l’
a détruit.L e b el arc de Suse fut érigé , dit 1 1nscription , par Cot
tius et par l es peuples cott iens : et civ itates quae cum eo
fuerun t L e Pays où le roi ouv rait un grand chem in rou
l ier à travers l es montagnes , où le m ême souverain élevaitdes arcs de marbre en honneur de ses all iés , l e petit R oy aume que les maîtres du monde honoraient de leur al liancene pouvait pas être un pays barb are . O n a b ien d ’
autres ind ices du contraire . L es érud its ont attribué , non sans raisonplausible , au temps du v ieux Cottius l es torses humain s desculpture exquise qui ont été trouv és sous terre a Suse , laoù fut l ’ ancien palais des rois . V estal , f rère de ce prince,goûtait les vers d ’ Ov ide, et avait été jugé capable de gou
verner comme président une prov ince considérable de l’
E m
pire romain .
La civ il isation que l es rois des Alpes ont laissé dans l ePays ne put que grandir sous la dom ination romaine . La routedu Montgenèv re dev int une des v oies l es plus actives de 1 ’
E u
rope. Suse était une v il le florissante . Briançon était déjà important . Oulx formait une étappe de la route . Il y avait unemans io ou caserne pour l es troupes de passage , et un temple
L e savan t Gu i l laum e Du Be l lay , qui avai t été, comm e on sa i t, l ieu
tenan t de Fran ço i s I en Piém on t, parl e du tomb eau de Co tt ius comm e
1‘
ay an t vu . S on m auso lée ou sépu l ture , d i t-i l , se v o i t en core de p résen t
éd ifiée d ’ouv rage an t ique en form e de triangl e, avecques tro i s tours aux
tro is can ton s au dessus et con tre l es murai l l es du chastel de S use An
tiqui i l s g auloi s» (Pari s fo l . 54.
Bu t an d i et d‘autres après lu i on t cru vo i r l es hab i tan ts de l a val
lée de Bardon n êche dés ignés sous l e n om de l a sss dan s l‘
in scrip t i on de
l’
arc de S use parm i l es peup les a lp in s qu i on t concouru a l’
érect io n de ce
m onumen t. I l s se fonden t sur ce que Beau lard a été (d isen t—i l s) appelé Belaudans quelque docum en t du m oyen âge. Ma i s, si l e nom fut écri t a ins i dans
un acte i so lé, je ne pu is me résoudre à fonder là dessus un e argum en ta
t i on ; car i l est po si ti f d'autre part que dan s les documen s du m oy en égo
en général l e n om de B eaul ard n‘
est pas B elau mai s Bsdular i«m ou Batn
lari«m, ou Bsular i um, traduct ion év iden te du v i eux nom pato i s Biou las, dé
rivé de b iou ls, b ou l eau, arb re fréquen t dan s l a l ocal ité et très rare dan s l e
reste de la val lée.
— 274
de Mars. S ur le Montgenèvre s’
élevait un temple b âti en
p ierres ta i l lées et orné de marb res, dédié , dit-on , a Jupiter,mais plus prob ablement aux ma tron es ou a Janus .
U n érud it , qui a profondément étudié l’
histoire des Al
pes cottiennes a supposé que la population de ces mou
tagnes se rendit libre, au mo ins de fait, pendant la décadencede 1
’ Empire romain , l orsque les Goths envah issant la hauteI tal ie interceptèrent les rapports de cette partie des Alpesav ec l e gouvernement central . I l cons idère comme formée
par des insurgés de nos montagnes cette troupe de Bagaudesqui en 409 barra l e passage des Alpes a l ’ armée de Scarusrevenant du siège de V alence. Enfin il croit que l e Paysresta indépendan t pendan t quelque temps .
Quoi qu’ il en so it, i l parait certain que nos v al lées f u
rent envahies sur la fin du cinquième siècle par l es Burgundesqui passèrent bientôt eux-mêmes sous l e sceptre des roisf rancs de la race mérov ingienne .
Les Lombards firent en 5 17 une irruption en Dauph iné
par la val lée de la Doire , qu’ ils ravagèrent ; mais il s n
’
cc
cupèrent pas l e Pays , et m ême i ls consenti rent dans la suitea ce que l es l im ites des Francs descend issent au dessous deS use jusqu’
au pied du mont Pirchirien , où i ls bâtirent pourfermer l
’
I tal ie leur fameuse murai ll e ( la Cluse) qui fut si
impuissante à arrêter Charl emagne.
Sous le ro i Gon tran la vallée de la Doire, dés Cluses lomb ardes au Montgenèvre, Bardonnêche compris , fut annexée àla Maurienne comme diocèse ecclésiastique. Probablement i len fut de même pour le gouv ernement civ il . L e fait est que
sous le dern ier des Mérov ingiens un gouverneur a v ie tenaitsous sa main l es deux pays .
Ce gouverneur ou feudataire v iager était l e patrice Abbou ,
fondateur de la célèbre et puissante abbaye de la Novalaise ,l
’
un des plus grands personnages de l’
E mpire f ranc , issuprobabl ement d
’
une ancienne fam il le gal lo-romaine établie
Fauché-Prunel l e. V oy ez ses I n s ti tut ions d ss Alp ss b re‘
ançonna isss , T. I ,
pagg. 197 et sui v .
276
avait émancipé jusqu’ à un certain point des serfs établis
sur le territoire d ’ Oulx qu i faisait alors partie de la va lléede Bardonnêche Ces serfs parvenus ainsi a un certaindegré de l iberté s
’ étaient réun is en j ura ou associationd
’
aide mutuel le . M.r Cib rario les a considérés comme un des
plus anc iens embryons de l ’ institution des communes rurales.
L a vallée dut être occupés par les Sarrasins lorsque vers
l’
an 906 i l s s’
emparèrent de la Maurienne et du Montgenè
vre . C ’
est au séjour fait par eux dans ces régions que se
rapportent l es d iverses trad itions restées dans le Pays destravaux qu
’
i l s firent ça et la, et surtout de l’
exp loitationqu ’ on leur attribue des m ines de S éguret et de celles d itesencore du S arras in en Maurienne .
L as Sarrasins furent chassés au bou t d ’
env iron un dem is ièc le sans qu ’ on sache précisément en quel le année et par
qui . Mais l’
impulsion fut donnée par le clergé ; et ce grand
fait fut certainement le résultat d ’
une levée de boucliers can
certée entre plus ieurs barons et autres gu erriers chrétiensdes deux versants des Al pes .
L e comte d ’
Aurate et de Turi n 1 8811 de race sal ique, etl e comte d ’
Al b an , dont l’ origine i l est pas connue , furent à
la tête du mouvement ; la fami lle chevaleresque qui prit plustard l e nom de Bardonnêche en fit probablement partie ; etil est permis de conjecturer que cette race vai l lants acquitainsi sa v ieille dom inat ion dans le Pays .
Les documens nous manquent sur cette dernière moi tiédu d ixième si ècle , époque où les chrétiens durent reven irpeu a peu habiter le Pays ab b andonné par l es Sarrasins , rétab l ir les églises et remettre en cul ture l es terres délaissées ;mais nous avons assez de données certa ines pour remonterl es siècles jusque v ers l ’ an 1000, et dès lors nous trouvonsBardonnêche devenu l e chef- lieu d
’
une seigneurie qui em
b rasse toute la vallée jusqu ’ à Oulx, outre l a vallée paral l è lede N evache , et qui de plus a des droits sur le pays m ême
concessi t cartu lam l ib ertat is
i n va l le Bardon isca i n l oco ub i d icitur U lces
d’
O ulx, sur celui de Salbertrand en descendant jusqu ’ à lacascade de Galamb re c ’
est a d ire jusqu ’
aux portes d’
E xi l l s s,
sur Sess ano , et m ême sur le Montgenèvre .
III.
État du Pays sans la Féodal ité.
L es possesseurs de la seigneurie de Bardonnêche étaientde fait indépendants, ne reconnaissant que la haute suprêmetie de l
’
E mpire Toutefois l es comtes de Turin se croyai snt suzerains , comme successeurs des anciens com tes établ ispar Charlemagne, dont la jurid ict ion s
’ étendait jusqu ’
au som
met des Alpes , limite légale de 1’
I tal ie D ’
autre part l e comted
’
Alb on , maître de Briançon , ne tarda pas a porter ses pré
tentions deça les Alpes où il commenca par S ssanue et Oulxplus rapprochés de son territoire incontesté .
L e prem ier que nous connaiss ions des seigneurs de Bardonnêche est Witb ald , qui était mort en 1050
Ponce , son fil s et son successeur , fit donat ion v ers l’
an
1 050 des églises de saint Laurent et de sainte Maris d ’ Oulxa la congrégation naissante qu i dev int bientôt l
’ ordre richeet considéré des chanoines réguliers d
’ Oulx. Ponce en fut
ainsi l e principa l fondateurMais , par un efl
‘
et des prétentions que nous av ons indi
quées , la fameuse Adelaide , comtesse de Turin , connus sousl e nom d
’
Adelaïde de S use , v oulut en 1057 confirmer l a
Moreri Dictionna ire, art. Bao—d onn êche, dern ière éd i t i on. U n e enqu ête
assez curi euse d e l'an 1375, qui ex is te aux Archi ves de Cour de Turin , je tte
b eaucoup de lum ière sur l'ancien ne po s i t io n de ces seign eurs .
(2) et quad hab u i t pater m en s Wi tb al dus et hom in es hab uerun t par
eum Don at ion d e Pouce ci tée ci -ap rès.
(3) Char tar ium U l cienss, charte 240 .
I b id . charte 98.
Dans la seconde moit ié du treizième s iècle les Dauphinssurent s
’
attacher des membres de la Maison de Bardonnêchepar des bienfaits et par des marques de confiance. I l en fut
ainsi de Boniface de Bardonnêche, cheval ier et homme con
s idérab le. E n 1282 l e Dauph in lui donna les d roits qu ’ i lavait, on ne sai t comment, sur la seigneurie de Nevache , etBoniface consentit a recevo ir de lui l ’ investiture de Nevacheen augmen ta tion du fief de Bardonn êche , de sorte qu
’
il
se consti tuait son vassal a double titreE n 1284 un autre conseigneur accepta de la munificence
du Dauphin l’ investiture de la bâtie de V allouise , aussi en
augmentation de fief
Enfin le Dauphin m it pied lui—même dans la seigneurieen qual ité de conseigneur en acquém nt l es droits de Canstant de Bardonnêche, puis ceux de quelques autres consorts
Ainsi en 1330 on l e vo it formellement se poser dans un
acte so lennel avec la double qual ité de suzera in (dom in usma ior) et de conseigneur p arerius ) pour confirmer l es l ib ertés que François de Bardonnêche avait accordées à la population au nom de tous les consorts.
Humbert II qui régna ensuite fit plus encore . I l jugea et
condamna comme rebelle l e même Fran çois de Bardonnêchequi avait traité avec la Maison de Savoie .
C ’ était toutefois une simple suzeraineté, et non une suze
raineté entière. Il résulte en efl'
et de l’
enquête prov oquéepar l es seigneurs en 1375 que non seulement i ls exerçaient la haute justice sans restriction , mais qu
’
aux seuls àl
’
exclusio n du Dauphin levaient la taille com itale et les eu
tres impôts , et que le Dauphin s’ était toujours borné a exi
ger as part comme p arier .
Ce fut seulement sous l es rois de France que l es seigneursde Bardonnêche tombèrent dans la condition commune aux
simples feudatai res dauphinois .
L’
orig ina l de ce documen t i néd i t est dans l es Arch ives de l‘Auteur
de cette N o t ice.
Fauché—Prunel l e, I ns ti tutions b r iançon na isss .
(3) Arch i ves de l a Commune de Bardonn êche .
Arch ives de Cour de Turin.
_ 28 1 _
La juridiction étant aliénable et div isible , se trouva au
bout d ’
un certain temps singulièremen t morcelès . E n 1 330,
époque la. la v érité où el le l e fut davantage , on comptait une
trentaine de conseigneurs , tous issus de la m ême souche et
portant l es m êmes armoiries , quo ique d iv isés en fam illes qui
pour se d istinguer avaient pris des noms difl'
èrsns C ’ étaitalors .
1’
usage au Dauphiné , comme ailleurs , que l a ligne principule de la race retint l e nom du fief l es autres portaientcelui de l ’ ancêtre qui avait commencé la l igne ou d
‘
une fra
ct ion du fief , qui était l eur dotat ion ou l eur demeure . Cha
cun des conseigneurs avait ses hommes , c’
est a d ire ses vas
saux sur lesquels i l exerçait sa juridiction . Tous en communavaien t un juge s t
,un local en v ille pour la judicature . L e
donjon du château principal était aussi commun . La étaientleur prison , le ra tier ou cachot sans porte qui avait accèspar la v oûte , et les cep s , seul instrument de torture ou de
détention dont fassent men tion les documens .
Dessous le château de Bramafan , sur l e flanc de la montagne et en vue de tout le v al lon , se dressaient l es fourchespatibulaires , triste emblème de la suprême juridiction qui ap
partenait aux seigneurs ; mais i l n e résulte pas que l es fourches aient jamais serv i L ’
enquête de 1375 , où l’
on vouluténumérer toutes les condamnat ions capitales desquelles étai tresté le souven ir, n
’
en mentionne que deux : l’
une d’
un ribaud ou v oleur vagabond qui fut pendu sur l e col de l ’Échs l le,l
’
autre auss i d ’
un ribaud qui fut condamné a être noyé dansl a rivière de Bardonnêche .
L es détails de ce dernier cas attestant la singul ière sim
pl icité des moeurs d’
alors . Guillaume de Bardonnêche , qu iétait un des principaux cheval iers de la Cour du Dauphin ,
Moreri Op . et lac. s i t t. Dan s cet articl e de Moreri on a enten du
parl er du nom b re des ind iv idus ; car ce lui des fam i l l es éta i t trés—restrein t,
comm e on peut l e v o i r par l es hommages et par d’
autres docum en s . GuyAl lard, en donnan t un n om b re con s idérab l e de n om s, a con fondu l es s im
p l es n ob l es avec les se igneurs. D‘
ai l l eurs p l usieurs des n om s qu’
i l don n e
form ent dup l icat ion ; d’
autres so n t év idemmen t estrop iés et m éconn ai ssa
b l es ; quelques un s pris d‘une autre ép oque. S a l i s te para i t fa ite de m é
m o i re et av o ir été un p rem ier jet nan revu.
poursuivi t lui—même comme conseigneur la condamnation duribaud par le juge seigneurial . Quand la sentence fut pro
noncée, il le fit trainer a la riv i ère et noyer en sa présence.
L e gouvernement des seigneurs étai t doux et paternel .L
’
un d’
eux,Ainard , statue dans son testament que , si un de
ses héritiers augmentai t les impôts , i l serait pour ce fait déchu de l
’
héritageL es impôts étaient la tail le et les tâches. La tai l le dite
com ta le ou com i ta le, étai t prob ablement appelée ainsi pourav oir été établ ie en origine par l es comtes ou gouverneurscarlov ingiens de l a Comté de Turin ; el le n
’
était pas trèsforte, et épargnait les peti tes fortunes L es nobles et l es
clercs en étaient exempts .
L e fouage éta it un impôt seigneurial qui frappait chaquefeu . Il était très l éger. I l est v rai qu'
en 1329 la populationsoulevés invoque la protect ion du Dauphin contre les sei
gneurs , qu’
el le accusait de v ouloir l’
opprimer à volontémais il parait assez clair que ce mouvement de la populati onfut exci té principalement par les intrigues des agens du Ban
phin , qui cherchaient une occasion d’
étendre l ’ autorité de
leur maître et pêcher eux—mêmes a l eur profit dans l ’ eautrouble. I ls le firent avec tant d ’
sfl'
ronterie et de maladresseque le baill i de Briançon , que les habitans avaient pris pourprotecteur , fut bientôt accusé par eux de déprédations odieu
ses , et qu ’
en 1330 i l s obt inrent formellement du souverainde ne jamais plus avoir afl
'
aire avec lui
D ’
autre part les seigneurs s’ étaient prêtés de bonne grace
à déclarer dans l ’ acte du 4 janv ier 1330 que l es deux impôts susénoncés resteraient invariabl ement fixés , la tai lle aune somme dé term inée dans l ’ acte, et la tâche au taux quis
’
y trouve établi .La tai lle était répart ie sur l es terres qu
’ on appelait dufief v i l lanen l , qui probablement avaient été considérées en
L e testam en t éta i t aux arch ives de l’
ab b ay e d'O ul a
Archi v es de Cour de Turin .
(3) Fauché-Pm nel l e I ns ti tutions ér ia n çm aisa .
I b id .
284
v icissitudes de ces sociétés primitives jusqu’
a la fin du tre izième siècle , où les trois paroisses de la val lée nous appa
raissent const ituées comme de véritables communes . E n ef
fet nous voy ons al ors la paro isse de R ochemo l las pourvo iren v rai corps de commune a la reconstruction de son égl ise .
La réforme des statuts de la chatal lanis , qui eut l ieu en 1330 ,
m it l e dernier sceau aux l ibertés et aux formes mun icipal es .
IV .
L es Châteaux forts .
Bardonnêche eut une importance au moyen âge commel ieu fortifié . Lorsque le dauphin Humbert cède ses états a laMaison royale de France , en se réservant toutefois son trône
pen dant sa v ie , le ro i pour garantie contre toute éventuel itécontraire v oulut que l e gouvernement des principales fortsrasss s fût confié à des personnages agréés par lui et qui prétasssnt serment autan t à lui qu
’
au Dauphin . Cette précautionfut alors prise pour le château de Bardonnêche et pour celuide Bramafan .
L ’
emplo i de l’
arü l l eria, qui se général ise bientôt après,dim inue notablement la valeur de ces places , et le chateaude Bramafan fin it par être démoli , d
’ ordre du roi Charles IX ,
en 1574 .
Celui de Bardonnêche avait été mun i d ’
un ravelin et
d’
autres ouv rages extérieurs . E n 1561 une colonne dehuguenots , qui venant du Frugales avait envahi la valléed
’ Oulx et brulé l ’ abbaye de saint Laurent, poursuiv is par
L a Gazette, gouverneur du Briançonnais a la tête de 1500
hommes de troupes royales , fut attaquée dans le bass in deBardonnêche où el le avait m is l e feu au bourg et occupé lechâteau . Quatrecsnts huguanots périrent dans l e combat : lesautres, pour la plupart blessés , s
’
enfuirent en d iverses directions. Cent quarante env iron se réfugièrent dans l e château
et s’
y enfermérent . La Gazette y m it l e siège et prit la place
286
d’
assaut ; mais les défenseurs se retirèrent dans le v i eux
donjon. Alors 1’ impitoyab le La Gazette , leur appliquant un e
sorte de tal ion , les fit, dit—ou, attaquer par le feu L e fa i t
est qu’
aucun n’ échappe à le mort .
U n Mém o ire l a issé par la Gal ette d i t seu lemen t qu i l s furen t t a l e
ce qui semb lera i t ind iquer qu’i ls péri ren t par l es arm es des assa i l lan s . I l
sufi t d’
a i l leurs d’
av o ir vu la con struct ion m ass iv e de l a hau te tou r d e
p ierre qu’
on appel a i t l e donjo n pour reconnaître l’improb ab i l i té qu e l a
garn ison en fermés dans ses murs ai t pu y être b ru lée.
U na b ranche s’ était établie en Faucigny au treizième siè
cle , et avait donné son nom a un v ieux château s itué au b asde la montagne de Mâle . E l le était all iée aux De la Chamb re,
aux Montmay aur et aux L ul l ins , qui pri rent parti pour el le en
1 439 dans un débat solennel et fameux contre les Campey s de
v ent le duc de Savoie La Maison de S al es s'
honorait d ’
en
descendre . Charles—Augusta de Sales dit dans son Pourp r is quela Maison de Bardonnêche était fort grands . Le treill is rouge
de ses armo iries éta it au nombre des blasons qui décoraientla grande salle du v ieux manoir de Thorens où naquit lesaint é vêque de Généve .
U ne autre branche v ers la même époque s’ était étab l ie
au Piémont au château de Ch ianoc dans la vallée de Suse ,qu’
e lle tenai t en fief de la Maison de Savoie. Elle a en outre
possédé le château fort de Givo latto , des dro its féodaux sur
Busso l in et sur saint Didero , et une maison dans SuseU ne troisième branche se transfère au château fort de
V allouise par suite de la cession que lui en fit l e Dauph inen 1284 .
E n 1333 Constant et Pierre de Bardonnêche , fils de Pouce,
cédèrent au Dauphin leur part de la seigneurie de Bardo nnêche et reçurent en échange le !fief de Paray et de Mo
nestiar dans l e pays de T rièves . L eurs descendans y fixèrant
leur résidence, et la b ranche qu’
il s formèrent, devenue eu
suits mai tresse d’
autres terres aux env irons est cel l e des
v icom tes de T rièv es qui avait un hôtel à Grenoble et qu i
s’
est parpétués j usqu’ à nos jours . A cette fam il le appar ta
nait la présidente de Bardounanchs , mentionnée avec h o n
neur dans l es L ettres de Jean—Jacques Rousseau.
August in Del la Ch iesa, qui avait là.—dessus beaucoup de
documens auj ourd ’
hui perdus , dit que les anciens seigneu rsde Bardonnêche, qu
’
. i l qual ifie v icomtes , étaient au prem ierrang dans la Cour des marquis de S use.
L e duc Am edée V I I I étai t rep résen té par l e duc L ou i s, son l i eu te
tana n t général . De S a l es ( Charl es Auguste) Pourp r i s h is tor ique.Arch iv es de Cour de Turin (Mas s i S usa et autres
_ 289 _
L a savant auteur des O rigin es féoda les dan s les Alp es
en parl e comme d’
une race i l lus tre et de feudataires de
haut p arage .
Ainard , qui v ivait en 1200 et en 1220, était un cheval iert rès-considéré . Il avait pris femme dans la Maison De la
Chambre , cette race mystérieuse des v icomtes de Mauriennequi portait les armoiries de la Maison royale de France avecune b risurs et qui était al liés de toutes parts avec des princes souverains .
Bon iface était bail li du Faucigny en 1287 . Jordan 1 etaitdu Briançonnais en 1301 , et ambassadeur du dauphin Jean .
François fut envoyé en emb asssade a la Cour de Savoiepar l e dauph in Guigues V III .
Deux frères , Pierre et Constan t, moururent glorieusementa la fameuse bataille de Poitiers où l e roi Jean tomba prisonn ier du Prince noir . Leur tombeau orné de leurs armoi »
r ies se v oyait encore au siècle passé dans la cathédral e dePoit iers .
Louis suiv it Du Guescl in dans son expédition d’
E spagne
contra Pierre l e Cruel .Enfin , dans une époque mains éloignée, Alexandra de Bar
donnêche commandait l ’ infanterie de L esdiguières a l a b a
tai l le de PontcharraMais le personnage qui laisse une trace plus marquée
dans l ’ histoi re est François , dont nous avons déjà parlé .
Fran çois était conseigneur de la baronn ie de Bardonnêchepour un seul quart , et toute fois i l figurait comme étant defait l a chef de p ariers . Aussi on 1 330 a—t
’—il concédé l es
f ranchises des habitans au nom des d ivers seigneurs , et n’
a
t’—il été désavoué de personne. Chevalier distingué et hommede sans , b on père de fam ille et b on mai tre , i l était populairedans l e Pays , et il avait la confiance du Dauphin qui lui
donna une m iss ion importan ts auprès du comte de S avo ie,son éternel r ival .Malheureusement vers la fin de l
’
an 1332, pendant que
Moreri D ictionna ire, art. Bardonnêche.
François était en ambassade a la Cour de Savoie , le dauph inGuigues eut occasion de f réquenter sa fam il le. Ce prince,élevé à la Cour du roi de France , son beau-
père , était un
beau jeune homme de 22 ans , déjà renommé pour sa b ra
voure qui 1’
avait couvert de gloire à la batail le de Cassel ,mais de complexiou amourousa et de moeurs dérégl ées . C ’
est
lui que son parent et am i Charles de Bohême prétendait avoirvu en songe sans les traits d ’
un b eau garçon que des anges
châtraient pour pun ir sa paillard ise .
Epris de la fille de Français , il la°
séduisit et l’
an lav a.
A cette nouv elle le père furieux cons idère comme rompuspar le Dauphin tous les l iens qui les unissaien t . Il se donneau comte de Savoie et lui l iv ra, dit—ou ,
l es secrets de Gui
gues . Mais la Dhauphin eut les moyens de s’
emparer de sa
personne , et le fit enfermer au château d ’
E xi ll as .
Au bout d ’
un certain temps François avait gagné un de
ses gardiens ; i l en jeta un autre dans un cul de basse fasseet parv int non seulement a être l ibre mais a se rendra me itre du château fort, don t i l fit hommage au comte de Savoie .
Puis il leva dans l e Pays 1’ étendard de la révolte .
Toute la noblesse de Briançonnais avait pris parti en sa
faveur . Tous , parents ou amis de la fam ille, i ls ressentaien ten commun l ’ injure qui lui avait été faite , et i ls entraina
iant leurs sujets a leur suite . Mais le Dauphin avait des part issus dans l es bourgs d
’
O q et de Sasaune qui apparteneisnt a sa juridiction immédiats et où il avait des châteauxd'
habitation . François de Bardonnêche, trop confiant , tombadans leurs mains et fut trans féré prisonn ier au chateau de
Pisan çon , d’ où il sut encore s
’ évader .
Revenu dans le Brian çonnais , i l le souleva presqu’
ent iè
rement ; et si en ce moment l e comte de Sav oie eût aidé au
mouvement , i l est probable que la croix de S av o ie aurait étéarborée sur la Montgenèvre , peut—être même sur les toursdu château de Briançon . L e comte ne profite pas de cetteoccasion qui lui aurait donné les clefs du Dauph iné au l ieu
i n reteriam imp inxi t
_ 292 _
s’
y refusèrent . Humbert irrité les y força , et pour punir leurrénitence i l les obligea a lui b aiser les pieds au l ieu des
mains .
Fran ç ois éta it con iumax ; i l cont inue a error on ne saitoù , m isérab le sans doute ; car sa femme était réduite pourv ivre a recevoir de m inces subsides du Dauphin m ême .
I l é tait certa inement aigri par le m alheur et par une s i
longue persécut ion lorsqu ’ on l’
errêta une dern ière fois en
1345 . C ’ é tait dans le bailliage de V ienne . O n lui fit un nou
veau procès , où on l’
accusai t d’
avoir tramé contre la v ie
du Dauphin . Cette fois i l fu t jugé par le tribunal ordinaire
( le juge de V ienne qui le condamne à m ort. Il parait quela sentence portait qu
’ i l fut pendu, genre de mort réputé iafama e t auquel il n ’
était pas d’
usage de condamner un gen
t ilhomme . La paren té et toute l a noblesse s’
en émurentcomme d ’
une atteinte à leurs priv ilèges et a leur honneur .
O n fit de fortes réclamation s auprés du souverain , qui chan
gea la pe ine en statuant que le condamné serait noyé .
Le procès avait au l ieu et le jugemen t av ait été pro
noncé au chateau de Quiris u. Français en fut tiré p ieds nus ,en chem ise . O n le parie dans une barque jusqu ’
au m ilieudu fleuve , puis on lui l ie l es mains , ou lui attache aux piedsune longue corde , et on l e jeta à l
’
eau . Après quelque tempson l
’
en retira pour s'
assurer qu’il fût m ort , et l ’ ayan t
trouvé san s mouv ement et san s v ie , des p ierres lui furentattachées au cou et aux pieds , et il fut réjeté dans la riv ière , qui lui serv it de tombeau .
Chorier , de qui nous tenons ces détails et qui parle du
procès comme l ’ ayan t lu , laisse entendre que l’
attentat con
tre la v ie du Dauphin n’ était pas prouvé et fut n ié par l
’
ac
cusé au m i l ieu des tortures ; mais qu’ i l pouva it mériter la
mort pour d’
autres crimes auxquels l ’ aurait entraîné le désespo ir . Quels pouv aient être ces crimes ? Chorier ne le d it
pas , et aucun h istorien , aucuns trad ition ne l ’ ind ique .
V I .
S tatuts l ocaux .
Le statuts de Bardonnêche, comme l es statuts communauxen général , sont des coutumes conservées d
’
abord par tra
d ition orale , puis écrites l orsqu’
aprés les prem ières creisadesla civil isation prit son essor.
Il résulte qu ’
en 1329 un mauvais sujet de la Maison deBardonnêche , nomm é Bertrand , sorte de dom Juan de v il lage,contempteur de Dieu et des hommes, vo le le manuscrit originel des Statuts pour commet tre un méfait de plus . Mais ilparait qu
’
on en conservait des cop ies ; car l’
acte confirmati f
de 1330 est censé ou reproduire tsxtuel lemsnt les art icles.
O n peut facilement comprendra par leur ensemble que de
puis longtemps l s s habitans de la vallée avaien t en plein ledroit de propriété privée, sauf seulement l a dèvo lui ion aux
seigneurs des successions ouvertes ab in tes lat lorsqu ’ il n’
y
a vait n i descendens n i frères ou soeurs pour l es recueill ir.
L es forêts et les pâturages étaient communs entre la population et les seigneurs .
Chaque paroisse formait une associat ion qui av ait dro itde régler ses intérêts .
La vallée de Bardonnêche formait alors trois seules paroisses , ce lle du chef-l ieu , cel le de R ochemo l les et cel le deBeaulard . L es habitans des trois paroisses pouvaient se réu
n ir ensemble pour traiter de leurs intérêts communs . L ’
actede 1 330 , stipulé pour toute la vallée consacre cet état de
_ 294 _
choses et lui donne une forme stable . Les paroisses y son treconnues comme de vé ritab les communes qui élisent régu
fièrement leurs administrateurs imposent les habitans pourles dépenses locales , et font des réglemens locaux. Cet te der
n ière faculté est cependant restreinte par la nécessité del'
adhés ion des se igneurs .
Les assemb lées général es des trois paroisses avaient l ieuà Bardonnêche en presence du châte lain représentant l es se igasure. Mais il n' é tait la qu
’
à t itre de contrôle , comme l afurent plus tard les châtalains au juges royaux dans l es as
semblées communales . O n se réun issait au son des clochesde sa inte Marie de Bardonnêche. E n 1336 l e dauphin Hum
bert fit ajouter que la convocation sera it auss i faite au son
des trompettes du château de Bramafan .
O n trouve dans les Statuts plusieurs d ispositions remar
quab les .
La n’
est pas admise la compos ition en den iers pour l escrimes plus graves , comme le portaient l es statuts fondéssur la législat ion b urgonde . Aussi y s st—i l-di t que , s i un ha
bitant de la seigneurie de Bardonnêche tue un habitant dela châ tellen ie de S use , il sera seulement pun i comm e l e se
rait a Suse un Susin qui tuàt un habitan t de Bardonnêche.
A Suse au pareil cas le meurtrier pouvait être quitte pourune amende , comme on l e v oit par le Statut local confirm é
par l e com te de Savoie en 1 197 et en 1223 .
L ’
adultère était pun i a Bardonnêche par une amende de
soixan te sous , et une amende égale était infligée a celui quin
’
acceptait pas le rectorat de la con frérie . Cette dern ièred isposit ion s
’
explique en ce que la corporation qu’
on appe
lait con frérie était cel le des adm in istrateurs du fonds de cha
rité . Apparemment les recteurs étaient quelquefois exposés asuppléer de leur bourse à l
’ insuffisance de la caisse .
L es dé l its ruraux étaient sév èrement réprimés ; mais on
pouvait dans un champ de rev es en manger sur place autan t
Chaque Com mun e av ai t u n Co n se i l é l ect i f, à l a tête duquel éta i en t
deux consu l s .
_ 296 _
censés avoir perdu la qual ité de sujets du prem ier et 1 etredevenus du second. Cas maisons de
'
bois étaient formées degrosses poutres de melèze superposées l es unes aux autres .
J’
en ai encore vu a R ochemo l les , il y a peu d’
années , quino ircies par l es siècles remontaieut peut—être a la date duStatut. Car une parei lle construction est d
’
une grande sol idité,
et l a qualité rèsineuse du bois en assure la durée . Seulemental le ofira une prise dangereuse aux incendies et expl ique laf réquence de ceux qui ont dévasté Bardonnêche a p lusieursépoques et qui ont enlevé à ce v ieux bourg son ancien aspect .
U n article singul ier du Statut dit que l es ribauds qui v iendront à Bardonnêche pourront être bernés impunémen t surl a place traitemen t ridicul e plus encore que
cruel , qui était peut—etre plus craint de ces vagabonds qu'
une
procédure judiciaire .
U n autre qui porte l’
empreinte des anciennes moeursob l ige l es habitans , sous peine d
’
amende , à sorti r de leursmaisons quand i ls entendent le cr ia feras , c
’
est a d ire l ’
ap
pel aux armes ou autre cri d ’
e l larme ou de ral l iement dansl es rues O n a un exemple de cet usage dans la sentencede proscription prononcée par le dauphin Humbert en 1334
con tre l ’
in fortuné François de Bardonnêche : tout sujet du
prince qui v i t passer l e proscrit devait lancer l e cr ia fera s
afin que la papulation du l ieu accourût pour se jeter sur lu i
et l e prendre ou l e tuer.
L e Statut prescrivait aussi que, si un habitant de Bardonnêche se trouv ant hors du terri toire était pris et détenu ou
dépouillé de ses av oirs , la population entière serait au dev o i rde l ’ aider a sortir de prison et à r écupérer son b ien , sau f
qu ’ il eût été arrêté pour un crime atroce. Cependant on n e
devait agir qu’
avec l ’
assentiment du châtelain .
p o ss i n t van ari
Ducanga défin i t l a cr ia foro s : cl am or exci tans ad i rruend um i n
quem Pen dan t que l a pacifique v al l ée d e Bard o n n êche éta it ob l igé e
de camm i n er des p e in es p our ren d re afi cace l e cr ia f or o s , l a v i l l e d’
I v ré e
étai t dan s l a n écessi té de fa i re u n sta tu t d e n o n cri dan do f or os f or o s
V oy ez le recue i l Monumen ta H is tor iae p a tr ice (L eger mun icip a les , I ) .
297
11 faut peut—être v oir ici les restes d ’
un ancien usage re
m ontant aux v ieilles gildes ou associations de protection mu
tuel le contre l a force brutal e, ou bien encore aux moeursde clan , que le Statut a restreint et soum is a l
’
ingérence
m odératrice de l ’ Autorité .
V I I .
S ouvenirs rel igieux et S upestition s .
La vallée de Bardonnêche est chrétienne depuis des temstrès-reculés . O n ignore cependant l
’ époque a laquel le y fu
introduit l ' é vangile .
A la chute du pagan isme la foi chrétienne a dû bien v itese répandre dans la val lée d ’ Oulx q ue parcourait une des
principales routes de l’
E mpire romain . L es nombreux indices qui restent de l
’
existence très—ancienne de m oines dansle Pays ma porte a cro ire que les religieux de L erius , fa
meux par leurs m issions apostoliques et civ i l isatrices dans
les Alpes , sont v enus dans cette vallée et y ont formé que l
que étab l issemant ; que peut—être m ême i l s ont desserv il 'église de saint Laurent d ’ Oulx , laquelle date certainementdes premiers siècles où fut publiquement pratiqué le cultechrétien . I ls seraient dans mon hypoth èse ces moines queles chroniques d isent avoir été détruits par les Lombardslorsqu ’ ils incendiérent 1 ’ église de saint Laurent en 57 1 .
U ne tradition populaire veut que saint Arey (Arr igius ) ,év êque de Gap, ait converti a l
’évangile l e pays d’
O ulx et les
env irons . S on nom est resté à un plateau du territoire d’
O ulx
près le hameau de saint Marc où l es populations s’
assam
b laient pour l’
entendre . L a tradition a certainement un fondde v érité , mais saint Arey ne peut avoir prêché que pour
abattre l ’
arianisma introduit pas la dom ination des barbares .
300
I l existe encore dans la v allée quelques v iei lles chapellescouvertes de peintures à fresque ; cel le des montagnes de
Mi l laures , où sont peints ‘ l es sept péchés capitaux , cel le de
N ôtre Dame du Cagnet , près de Mélezet , a côté de laquelleétait, d it—ou, un manoir féodal , et cel le de saint Sixt au lieudit Plan du co l , qui parait présenter des peintures de deuxépoques. Probablement l a plupart de ces fresques appart ienta la seconde moitié du quinzième s iècle , date indiquée dansun de ceux de la chapel le de saint Sixt .
L a chapelle bâtie au sommet du mont Thabo r à plus demètres au dessus du n iveau de l a mer existe depuis
plusieurs s iècles ; mais la date de son érection n’
est pas cc
nue. O n y parvient en franchissan t une ceinture de neigedurcia qui entoure le haut de la montagne : et néanmoinstous les ans depuis un temps immémorial on y va en pro
cession du Mélezet, et les populations des val lées attenantesa ce point central des Alpes s
’ y rendent avec une grande
dévo tion . L e jour de cette f ête alpine est fixé au prem ierdimanche qui su it l e 24 d
'
août .Comment se fait— il qu
’
une montagne de nos Alpes portece nom de Thabor ? Put—i l imposé jadis par les Phéniciens
qui des côtes de la Méd iterranée pénétrèrent dans l es Al pesà la recherche des mines , au bien n
’
est —i l dû qu’
à un sou
v en ir des croisades ou a la dévotion de quelque pèlerin deTerre-sainte ? L e fait est qu ’ on rencontre dans les env iron sun certain nombre de noms de mon tagnes au autres l ieux
qui semblent présenter des indices d’
origine as iatique
Te l s so n t l er n om s de Thures o u Thuras que porten t p lus i eurs d e
n o s m on tagnes, ceux d e J afi'
erb S égure t, Kato l o v i a, He b erton ou Chab e rt o n,
B rem en , G ad , R amats, B améjtœ , S iugom agum (aujou rd ’
hu i Césan ne). Peu t
ê tre auss i Pi erre Men aut, d o n t je cro i s que l e n om dérive d’
un p ierre m o
n um en ta l e ou sacrée ap pel ée Menaut ; et l a 8 6 (que l es Maurian n ai s écri
v en t R az d o n t o n a v ou l u par erreur fa i re B ouc, m a i s q ui p ourra i t déri
v er d e R oad,s ign ifian t, d i t—o u , nouŒ e en phén icien , de sorte que Co l d e l a
R 6 v oud ra i t d ire Co l du sou ffle .
V III .
Anciens U sages .
O n sait que dans l es montagnes l es v ieux usages se con
servent plus l ongtemps qu’
ai l leurs . I l s servent a nous donnerun idée des moeurs e t de l ’ esprit des générations passées .
Dans la v al lée d ’
O ulx on a continué jusqu ’ à no tre temps
à représenter des drames rel igieux. C ’ étaient des pièces en
v ieux f rançais qu ’ on al lait modern isant , lesquelles duraientordinairement trois jours . E l les m ettaient l e plus souvent en
action les tourmens et l e mort d ’
un ou plusieurs martyrs .
L e nombre des acteurs était immense . Empereurs , magistratsromains , évêques chrétiens , hommes et femmes de tous lesétats , anges et diables , âmes
'
qui allaient au ciel ou en en fer ,tout y figurait . L es diables , revêtus d
’
un sac de toile cou
v ert de l a mousse noirâtre des v ieux mel èzes , étaient horribles à. v oir . U ne Commune entière se v ouait par dévotionà donner ce spectacle . Elle abattait une portion de forêt pourconstruire le théatre, qui étai t une vaste scène en plein air
en p ied du plan incliné où l’
on d isposait une infin ité depoutres pour serv i r de siège aux spectacteurs . E n 1662 la
Commune de Salbertrand , supposant que des désastres tombéssur el le étaient une punition de ce que depuis longtemps ellene représentait plus l
’
histo ire de sain t Jean Bap tis te, dé
l ibéra de reprendre à l’
aven ir le p ieux usage, et fut formé]l ement approuv ée par l
’
Autorité ecclés iastique. Il est perm isde penser que durant ces longues représentations les audi
_ 302 _
tours s’
ennuy eient quelque fois . Pour l es distraire , on fai
sait parei tre dans l es entractes un fut au b oufl'
on , qui avaitl e priv il ège de déclamer des facéties grossières et m êmeobscènes.
U ne b oufl‘
onnerie p lus importante é tait la soi-d isant a b b ayede Ma lgouver t, sorte de con frérie de jeunes gens , qui parod iait une abbaye de moines . L ’
abbé était ordinairement un
jeune homme des prem ières famil les . L a con frérie possédaitdes propriétés et une chapel le où elle célébrait certa inesf êtes , mêlant sa parod ie burlesque a office d iv in . Au reste .
l e b ut principal de l’
association éta it de se divertir et de
faire un ou plusieurs repas en commun . E l le fut d issoute en
1679 par un décret de l ’ abbé d ’ Oulx , motiv é sur ce que ses
momeries étaient inconci l iables av ec l e respect de la rel igionL es moeurs avaient alors changé . Cs s nai ves explos ions de
gaité , que l es croy ans du moy en âge conciliaient parfaitemen tavec une fo i v ive , et qui étaient pour eux un soulagemen tmomentané au poids de la v ie , alors si tourmentés , n
’
e va
ien t plus de raison d' être dans une époque plus av ancés
O n appelait la b rute un autre spectacle étrange . À un
jour donné , toute la papulation du l ien se réun issait dan s
l ’ école communale . L e mai tre d ’ éco le pré sidait a la fonct iondans toute sa majesté . U n tré teau éta it dressé en m i l ieu d el ’ école . U n jeune garçon , l
’
un des écoliers plus âgés , arriv ait eu courant sur ce tréteau , déguisé en b rute ou p lutô ten sauvage . 1 1 était a moi tié nu ,
les épaules et l es reins couv ertes de peux grossières , la tête , l es bras et l es jambe sbarbouil lés de suis et de rouge . I l portait a la main un longbéton ou marai s a grelots , qu
’ i l agitait dans ses courses . I l
s’
adressait en mai tre d ’ école et débitait des insolences . Ce t
usage exista it encore dans mon en fance. Ainsi les v iei lles générations avaien t imaginé des moyens divers pour rire à jou rdonné des Autorités , grandes et pet i tes , et l e principe d
’
eu
toritè é tait tel lement enraciné que tout cela ne l’
èb ren la i t
O n l i t d an s l es Mim o ires de Dut i l l o t sur l a fê te des fous : I l y a .
d i t—an , à R hodes un ab b é qu’
on appel le l'
ab él d e l a N a ly oussr ne, q ui e s t
c u n reste d e la fê te des fous
IX.
Les T oms modernes L ’amiral Des Geneys .
E n 1708 V ictor Amédée duc de Savoie descendait avecune armée sur Bardonnêche par le col de la R 6. E n 1 709
toute la val lée d ’ Oulx lui prêtait hommage a S use entre les
mains du b aron de saint Rem i , son dé légué . Mais la pas
session du Pays fut longuement disputée entre lui et la
France jusqu ’
a ce qu’
en 1 7 13 elle lui fut adjugée par
le traité d 'U trecht , le m ême qui donne a Amédée l e titrede Roi. T oute la val lée fut alors annexée à la prov incede Suse.
Sous le gouvernement des rois de Sardaigne , Bardonnêchefut il lustré par l
’
am iral Des Geneys , créateur de la marinasarde.
Quoique né à Chaumont , Georges Des Geneys appartena ità la fam i lle Agnès de Bardonnêche , où son père , Jean Agn èsDas Geneys , b aron de Fen ils , tenait encore son principal dom lai la .
Georges avait plusieurs frères , qui tous su iv irent avec d istinction l a carrière des armes . L
’
un d’
eux , Mat hieu, fut
m inistre de la guerre pendant tout l e règne de Charles-Fel ix .
Il resta en fonctions sous l e roi Charles-Albert , qui lui tèmagnait une grande considération , et on peut d ire qu
’ il mourut dens l es bras de ce prince : i l était dans le cabinet du ro i
et ouv rait son portefeuille pour lui soumet tre un rapport sur
305
l ’ organ isation de l’
armée lorsqu ’ i l tomba foudroyé par une
attaque d ’
apopl exie .
Georges , né en 1761 , entra dans la marine en 1 773 et
parcourut successiv ement tous l es grades , occupant des postas m i l itaires l orsque ceux de marine manquaient , jusqu
’ àce qu
’ i l dev int général d’
arm ée en 1816 et am iral un iqueen 1826. Il fut quelque temps gouverneur de Gênes , eut la
d ignité de m inistre d’ Etat, et enfin fut décoré du col lier de
l’
Annonciade en 1836.
C ’ était un homme froid , calme , parlent très peu , maisdoué d ’
un grand sens , d’
un tact fin, et d
’
un noble caractère. Lorsque la Maison de Sav oie avait été dèpouil léa de
ses états de terreferme , il 1’
avait suiv ie dans l’
î le de S ar
daigne , au risque de perdre toute sa fortune. E n retournantav ec l e roi V ictor Emanuel l en 18 14 , i l lui consei l le de ne
pas se prêter à une réaction et de conserver pour l e m omentles lois et les fonct ionnaires de l ’
E mpire , sauf à. introduiredans la suite l es changemens de d ispositions et de pers onnesqui auraient été reconnus convenables . Mais l es conseils pass ionnés d
’
autres personnages pré valurent.Il était gouverneur à Gênes l orsqu
’
eut l ieu 1 amants de1 821 . U n groupe d
’
exal tés envah it sa demeure et s’
emparede sa personne . Il fut sauv é par l ’ intervention d
’
une foule
de bons citoyens , mais dans l e désordre un homme brutall
’
avait maltrai té cruellement . Quelques années après l e v ieilam iral v int à sav oir que cet indiv idu avait au l
’
imprudsnce
de reven ir à Gênes et qu ’ il al lait tomb er au pouvo iir de la
justice. Il le fit appeler, lui consei l le de s’
esquivsr sans
délai , et lui rem it une bourse pour subvenir au besoins del
’ év as ion .
Le nom de cette fam ille lui v ient du domaine noble desGen eys s itué au bord de la Doire , au dessous le v i llage deMi l laures . C ’ était un joli recoin composé de prés et de
champs et entouré par un bois de superbes sapins ; au fonds
’ élevait un v ieux petit manoir , espèce de château en m iniature. Aujourd'hui le manoir est remplacé par des habitationsrurales , et la majeure partie du bois a d isparu. Le domaine
était entré dans la Maison Agnès vers la moitié du dixseptième siècle : i l appartient actuel lement a des fam illes decultivateurs .
venu d’
un homme s i éclairé et si pratique , fut pris au con
s idérat ion . Le célèb re géo logue Ange S ismonda fut chargé def aire procéder sans éclat aux v érificat ions opportunes pourreconna î t re s i en quelque partie de la chaine des Alpes entrele Pi ém on t et la Sav oie la co rrespondance entre l e n iveaude s va l lées e t l ’ é tat géologique des montagnes perm ettra itle pas sage d
’
un chem in de fer au moy en d’
un percem en t .
Maus s reçut lui —même la m iss ion d' é tudier les moyens mé
can iques à employer, soit pour grav ir les pentes , soit pour
percer les mass ifs de roches dans le moindre temps possible .
Des recherches fai tes i l résu l te qu '
en tre Bardonnêche et
Modane la percée aurait abouti des deux côtés à des pentes
praticables en vo ie ferrée , et qu ’
el le aurait eu la longueurd
’
en v iron douze kilomètres ; que sur l es autres points le
ma s s i f a percer aurait été beaucoup plus épais , les accès plusd ifficiles , la route plus longue .
Quan t au percement du roc, Mauss v ou lait év iter l es
m ine s parceque le tunnel étant pratiqué a une énorm e pro
fondeur sans l’
a ide d’
aucun pui ts , l’
ai r in fecté par les m ines
y se ra it de venu insupportable . Il imagine une mach ine mue
par l’
eau , qui taillait l e roc en m inces assises qu’
on déta
cha i t en suite par l’
action de coins .
E n prem ier essai de la machine en petites proport ionsont l ieu a Turin sous l es y eux du roi et du pub l ic . Ces expé
r iences ayant réuss i , un fonds fut ’
porté au budget de 1 846et augmen té dans celui de 184 4 , avec l
’
approbation l a p lus
encouragean ts du Conseil d’
État , pour pratiquer l es expé
riences sur une échelle plus vaste et a l ’ ouverture m ême del a ga lerie projetée. Mais l ’ ingénieur ayant in troduit des mad ificat ions dans son mécan isme , l a comm ission définitive pourson exécution ne put ê tre donnée avant que l e Gouvernem ent changeât.
E n 1849 l e m inistère Galvagna v oulant reprendre cetteaffaire et reproduire au budget l
’
allocation des fonds , désireêtre éclairé par une Comm ission de savan ts , laquelle par
l ’ organe de l’ il lustre ingénieur Pierre Paléocapa, l e m ême
qui fut plus tard m in istre des travaux publics , fit un rapport
entiérement favorable . Mais la Chambre des députés ne fut
pas persuadée ; al lo écarte l’
allocation .
L e projet du percement retombe ainsi dans l ’ oubli jusqu ’ àce que les ingén ieurs Sommei ller, Grandis et Gratton i pro
posèrent un nouveau système qui employait l es m ines , maisen porforant l es trous , avec une célérité extraordinaire, parun appareil mécan ique mu par l
’
air comprimé , lequel air
injecté dans les profondeurs du tunnel aurait le force suffi
sante pour on chasser les m iasmos .
Ce.
projet rencontra encore de fortes oppos itions de l a
part d’
hommes de science. Néanmoins l e comte de Cavourl e patrona de toute son immense autorité morale , et l e Parlement l ’
adopta .
Tout l e monde sait que l’
èxécution , porfoctionnéo encore
par le gén ie inv entif de Sommeiller, correspond it entièrement aux prév isions des ingén ieurs et des géologues . Toutle monde connait l es applaud issements qu
’ i ls auront de l ’ E urope entière quand l a percée fut ouverte , l e jour de N oël 1870 .
XI .
Le Passé et l e Prosént .
Auj ourd ’
hui le Bardonnêche des anciens temps est bienchangé . Le vallon écarté où résonne la lyre des bardes , oùre te n tire l l t l es trompettes du v ieux château de B ramafan ,
sera b ien tôt ébranlé par l e s ifll ems n t des l ocomotiv es . L e
sentier pi ttoresque tournant sur l e rocher et serpentan t au
m il ieu des arb res a travers des prairies sera remplacé parune v oie ferrée des principales du m onde : là passera ,
à trev ers les Alpes , le commerce de Gênes et de V en ise , la m al lem ême des Indes .
L es v ieilles églises ont fai t place a un temple moderne .
Des châteaux du moyen âge , des manoirs féodaux flanqués
de tours austêros , habitations des guerriers d’
autre fois , i l nereste plus pierre sur p ierre . E l les on t disparu l es ant iquesmaisons de bois où v ivai t pais iblement une popu lation pacifique , mais fière et toujours prête , s
’
i l le fa llait , a prendrel es armes pour le Pays . Mais une petite v i l le est surgio avecde vastes bàtimens pour habitation d
’ ingén ieurs et d’ ouvriers ,
et l e v ieux bourg s’
est tran sformé , s’
es t refait, s’
est bad i
geonné, s’
est peuplé d’
aub ergos et de boutiques .
Le Pays a perdu sa poésie . Mais l e souŒe puissan t d’
un
grand progrès de la civ i l isation et de l ’ industrie huma ine ya versé une v ie nouvel le , et dans ces l ieux , jad is solitaires ,s
’
achè ve une des oeuv res qui honorent l’
audace et le gén iede l ’ homme.
Jan v ier, 1871 .
L ’ Ab b aye d’ oulx.
L e moy en âge , d it un historien spi rituel , a été une époquede grands crimes et de grandes peurs L ’
homme dom iné
par la pour se ré fugie dans la prière . De la le nomb re in
fini de maisons rel igieuses que l e moy en âge a vu surgir .
Ayant une fo i v ive dans l ’
effet des prières , on croyait ne
pouvoir trop les multiplier . U n monastère , où une réun ionnombreuse de religieux pût cé lébrer chaque j our beaucoupde messes , était réputé bien plus uti le qu ’
un pauv re curé ,isolé dans son égl ise paroiss iale . L ’ idéal était un choeur demoines qui , sans cesse renouvelé , priàt jour et nuit Dieu et
l es saints .
D ’
a illeurs la règle monastique était considérée comme
garantie d’
une v ie plus régul ière et comme un moy en de
perfection . Beaucoup d’ é vêques imposèren t la règle de
sain t Augustin aux chanoines de leurs cathédrales , et fav orisèron t dans leurs diocèses l a fondation de nouvel les corporat ions rel igieuses .
Mais beaucoup de fondations semblables n’ ont pas été in
spirées par l es seul es tendances d’
ascèüsms . L es sentimons
d’
humanité , de v éritable charité chrét ienne y ont souventcontribué . Dans une époque dom inée par les idées monasti
ques ou ne savait opérer les am éliorations sociales que par
S auna S u l la cond a‘
z ions d eg l i S tud i nel la Monarch ie d i S a voia s ino a l
l ’ s td d i E manus ls F i l i bsr to.
314
le moyen du clergé et surtout du clergé régulier . Ains i on
v it s’ élever des monastères pour serv ir de refuge aux v oya
geurs , pour secourir les pauv res , pour recev oir et guéri r lesmalades . O n v it même s
’ é tablir des moines avec m ission de
b âtir des pon ts , comme l’ ordre dauphinois des Pon ti/
‘
es , ou
pour combattre la lance au poing les infidè los , comme l es
chevaliers de Jérusalem .
L ’
abbay e de la N ovalaise avait été fondée en 726 par le
patrice Ab b on pour donner aide e t re fuge aux voyageurs quipassaient la Montcen is . Cel lo d
’
O ulx , créée , comme n ousl
’
avons d it , v ers le m i l ieu du onzième s iècle , dut so n ori
gine au m ême sentimen t . E l le eut charge de recevoir l esv oy ageurs qui pas saient le Montgenèv re .
La b ul le donnée en 1065 par Cun ib ert , é v êque de Turin ,
pour l’
approbation canonique de la congrégation ou ordredes chanoines régul iers d
’
O u lx, énonce ouvertemen t ce b ut
humanita ire I l faut dire cependant que ce b ut m êmeprenai t l a couleur religieuse de l
’ époque on ce que l’
o n v i
sait spécia10mon t à pro téger l es v oyages des pèlerins .
V e rs l e commencem en t du tre iz ième siècle l e v oyageur
qui venai t de France pour passer les Alpes co ttiennes trouv ai t p lus ieurs m aisons hospi ta l ièros échelonnées sur sa route .
D '
abord une maison de rel igieux affi liés à l ’ ordre d’ Oulx
l ’ hébergeai t sur l e L autars t , une autre l e recevait à Brian çon ,
puis il trouvait à Oulx un hospice attaché à l ’ abbaye , pu isun au tre à Chaumont tenu par les cheva liers de sa int Jean deJérusalem , un autre encore a Suse au prieuré de sa inte Maris ,enfin un dernier à saint Antoine de R anvers , é tabli par l escheval iers de saint Antoine . Au quatorzième siècle le dauph inHumbert I l y ajoute l
’
hospico du Mon tgenèvreL
’
hospice d’
O ulx continua à subsister tant que dure l a
congrégation religieuse. Mais dans l es dern iers temps l a ra
v iato rum imm en se n ecess i ta t i com pat ien tes Char tar ium U lci en se,
e . 24.
L e passage p ar l e Mon tcen i s éta it protégé par des ho sp ices étab l i s
en Mauri en n e, par ce lu i du Mon tcen i s fon dé par L oui s l a déb on n a i ro , et
p ar l’
ab b ay e d e l a N ova la ise .
3 16
siècl e , el le apparaissait aux populations pieuses dès l’
an 1000
avec un cortège de légendes qui frappait v ivement l es esprits .
La de sain ts hommes avaient péri massacrés par les Lom
bards . Leur mémoire avait grand i avec les siècles , et l e
récit de leur martyre avait nature llemen t acquis un éclat lêgendaire . O n parlait de nombreux m iracles qui s
’ éta ientopérés sur l es ru ines de la v iei lle église qui couvraiont les
restes des martyrs Dans l e s ilence des nuits , l orsque . l a
lum ière m élancol ique de l a luna tombait sur ces murs dé
salés , on croyait v oir des processione de blancs fantômescirculer au tour de ce l ieu sain t ; ou prétendait m ême les
entend re psalm odier des prières comme on fait dans les ro
gatiansL a dévotion des peuples fut d
’
autant plus excités l orsquev ers l
’
an 1025 un so i-disant cheval ier françois présenta à
O ldoric Main fro i marquis de S use des ossomons qu ’ i laffirme être ceux de saint Just, d isen t les avoir trouvés sousun ancien autel de l ’ égl ise de saint Lauren t couverts d
’
une
p ierre sépulcralo où était gravé le nom du saint martyr . I l
parait qu’ on fit dès l ors à l ’ égl ise l es réparations les p lus
indispensables pour pouvoir y officier en moins sur quelqu
’
autel .
U n prêtre d’
O ulx nommé Gérard , que la Ga l l ia chr i
s tian a appelle Gérard chev rier, s’
ev isa de bâti r une sorte
d’
herm i tage attigu à l’ église où il alla habiter avec deux
autres alors pour se dédier au serv ice du sa in t l ieu Il seforme ainsi le prem ier noyau d ’
une socié té rel igieuse qui ne
L’
égl i se de sai n t L aure n t étai t ap pelée p leb s m ar ty rum .
Tan ta turb a b oatorum h om iuum al b ato rum i b i hon i s apparat i n
si l en t i o n octis q uan ta s i v ide ras ox civ i ta te a l ique om n os v i vi e t fam ine
s im u l pargora, ai en t faciun t christ ica lo tom paro rogat i o n um quando par
e gun t par eccles iae, san ct orum sufl'
rag ia flagi tan toe Chron ic. N ova l icis n se
l i b . I I I , cap . 15.
J ’
em p l o ie i ci cette dénom in ati o n i noxacto p arce qu’
e l l e est con
sacrée par l’
usage p our dés igner l es marqui s de Turin , et spécial em en t l e
m arqui s Mai n f ro i .
L’
un de ces deux com pagn on s s’
appe l ai t O do l ri c, l’
autre éta i t N an
to lm o, a l o rs très—jeun e. Char tar i um U lç iense, ch . 24.
3 17
tarda pas de s’
accroître et dev int a la m ode . Ponce de Bardonnêche , qui était seigneur du pays et qui en cette qualitécroyait pouvoir d isposer des égl ises existantes dans son ter
ritoire , fi t don à l a nouv el le congrégation de l’ égl ise de saint
Laurent et de celle paroissiale de sainte Marie du bourgd
’
O ulx avec toutes leurs dépendances qui cons is taient enbiens divers ; car l
’ égl ise de saint Laurent possédait depuisdes siècles un patrimoine assez étendu en terres cultivées eten forêts sur plus ieurs poin ts de la vallée et s
’
attrib uait en
outre l es dîm es de la val lée ent ière L a donat ion fut confirmée en 1057 par la célèbre Adelaide de Suse et par son
mari le comte Odon de Savoye .
Mais la nouv el le corporation ains i formée et dotée ne
dev int une v éritab le .congrégation rel igieuse qu’
en 1065
moyennant l ’ érect ion canonique octroyée par l’
evêque Cu
n ibert .Gérard , l e v éritable in itiateur de l ’ in stitution , n
’ é tait
plus alors a sa tête. Ce n’
est pas qu’
i l eut perdu son temps ,
car il avait été appelé au s iège épiscopal de Sis teron . Maisi l avait laissé la d irection de la socié té naissante au plusaimé de ses d isciples , N an telme , un tout jeune homme qui
plaisait par ses manières s imples et modestes couvrant un
esprit dé lié . Cun ib ert dit de lui qu ’ i l avai t l a simp licitéd
’
une colombe. Or sous le gouvernement de cette co l ombeun in stitut a peine formé dev in t en peu de temps colossal . L asociété créée par Gerard , continuée par N ante lm e , fut dé
clarée congrégat ion de chanoines réguliers sous la règle de
D’
efiray an tes m aléd icti on s so n t pro férées par l e d o n ateu r co n tre
qu icon que d e sa fam i l l e ou autre ten terai t d’
attaquer l a dona t i on ou d e
t roub l er l es d on ata i res dan s l eur p o ssess ion . Qu ’
i l so i t, d i t—i l . excom mun ié
e t a nathém a t i sé ; que l a co l ére de D ieu tout pui ssan t reste sur l u i ; qu’
i l
s o i t maud i t av ec l e traître Judas et avec l es ju i fs désespérés qu i o n t reb utél e se ign eur; qu
’
i l so i t m aud it av ec Dathau et Ahi ro u que l a terre a en
g l out i s. Char ta r ium U Icim ae, ch . 240.
et decim e i s t ius v a l l i s v ad i t ad sanctum L au ren tium V oy ez l e
Char l arc‘
um , ch. 148. Cette charte, so rte d’
in v en ta i re du pat rim o in e de sai n t
L auren t, a été recon nue par p l us ieurs érud i ts comm e an térieu re à l’
i n va
si o n des S arras in s. B ua s am m ême 0p iuÔ qu’
e l le pu isse rem on ter jusqu ’
au
s ixièm e s iècl e .
— 3 18
saint Augus tin. La maison chef d’ ord re fut cel le de saint
Laurent d ’
O ulx. Cette maison ava it à sa tête un prevôt qui
gouvernait l’ ordre entier. N antelme fut institué prévôt . L es
memb res de l ’ ordre ne se d ist inguaient des s imples prêtres
que par un scapulaire blanc qu’ i ls portaient sur la soutane .
Prob ablement Cunib ert n ’ é tait jamais allé à Oulx . I l se
figurait av ec une sorte de terreur ce pays situé au m i lieude montagnes glacées I l considérai t cette vallée commeune partie sauvage et lointaine de son d iocèse , comme une
région d’
accès b ien d ifficile pour un év êque de Turin et
pour des chanoines de saint Jean . N on seulement dans sa
so l l icitude éclairée et charitable il confia aux n ouveaux re
l igieux le soin des voyageurs qui passeraient par la, mais ilse hàta de céder au prévôt d
’
O u lx la jurid iction épiscopalesur toute la val lée depuis le sommet du Mon tgenèvre jusquev ers les Cluses lombardes , comprise la v i lle de Suse et son
antique et puissante église de sainte Marie . Il y aj outa en
core toute la val lée de Prage las , dite aujourd ’
hui de Fenestre l les , compris Men tou l les .
B ien tôt après l es év êques des env iron s , no tamm en t 1’
ar
chevêque d’ Embrun , donnèren t a la congrégation d
’ Ou lx un
grand nombre d ’ égl ises paroissiales et autres de leurs d io
cèses . Ce fut de cette man ière que l e prévôt d’ Oulx acquit
le droi t de nomm er les curés dans l a plupart des paroissesdu Briançonna is et d
’
y percevoir la dîme .
Pour desserv ir l es égl ises principales et plus riches , comm esainte Marie de Suse, sainte Marie de S y nard près de Gre
noble, et plusieurs autres , il y avait des maisons de l ’ ordrecomposées d
’
un nombre proportionné de chanoines sous l a
d irection d ’
un prieur Dans les autres le prévôt nommaitun desservant, qu
’ i l choisissait parfois en tre l es m embre del ’ ordre , et plus souvent parm i les prêtres du pays .
(1 ) quon iam i n ter ge l i das i l las a l pes a l gore n i v ium et afii n ium ho rri
b i l i sub l im i tate rup ium durus et d iŒci l i s i n co l atu s et asper Char tar ium
U Icim sc, ch . 24.
(2) E n 1342, ép oque où comm en çai t déjà l a décadence de l’ Ordre, i l
com p ta i t vi ngt—hu i t ma i son s . Char ta r i um U lcc
‘
cn se, Pracf a ti o, pag. xxx .
320
la Chim a , Giaveno , saint Anton in et saint Ambroise. Pu isv ien t l ’ ab baye de l t iva l ta , qui a auss i sa juridict ion et so n
l il l pn l'l îl ll C O , et sur la grande route le riche é tablissemen t de
sa in t An to ine de R an vers , grac ieuse maison de l’ ordre re l i
gieux «le saint Antoine , don t le che f, appelé précepteur , é ta itva .
—s u l du comte de Savoy e .
Que l s furent les eff ets moraux d'une si puissante d om inat io n ti t—s moines ? E n est-il résulté pour les population s des
moeurs plus douces , une cul ture intel lectuel le, un progrès
quelco nque de c iv il isation ? O n ne pourrai t l’
aifi rmer pour la
plupart de ces étab l issemens . Mais dans la haute val lée l ’ abbay e d
’
0 ulx a certainement contribué a amener l ’ instructions i répandue qui y règne dans les classes rurales et la douceur
généra l e des moeurs .
O n a tout lieu de croire que dès l es prem iers temps deleur insti tu tion les chanoines réguliers d
’ Oulx s’
adon naient
à l ’ étude . I ls avaient une bib l iothèque d’ ouv rages ut iles à
une in s t ruction pra tique et sérieuse. U n des plus ancien s m a
nuscrits de la co l lection appe lée la L om b arde, lequel re
mon te au onzième siècl e et se trouve aujourd ’
hui a l a Bibliotheque ambrosienne de Mi lan , prov ient de cette ancienne b ib l io thèque de l
’
abbaye d ’ Oulx Elle périt en grande partiedans l ’ incendie de 1569 le res te fut au temps des guerres
postérieures t ransporté au prieuré de sainte Marie de Suseav ec d ’
autres objets précieux qu’
on voulai t sauver de l ’ ennem i , e t l es prieurs trouv èrent le moyen de ne r ien rendre
Il nous cons tc par un documen t de 1223 que l ’ abbayed
’
0m avait un portique sous lequel les rel igieux avaientfait peindre une mappemonde
( l ) V o ir la Préface de 1’
éd i ti on d on née par l e com te B aud i d e V esm e
de l a co l l ect io n L og es L ongobard orum dan s l es Mon umen ta H i s tor ia s p a tr iae.
Mém o ires du v ica i re Pnns nn a , cités dan s ceux d u chan o i ne T am ron.
(3) Mémoi res de Tam ron . C’
est d’
u n des pri eurs q ue le card i n a l F ré
déric B o rr0 m ée eu t l e m anu scri t de la L om b arde exi stan t à Mi lan , com m e
i l en résu l te par u ne an n otat ion appo sée sur l e m an uscri t m ême. V o i r l a
Préf ace p réci tée.
(4) Actum i n Iowa ub i m appam on d i est dep icts Char tar ium U Z
ca‘
m so, ch . 34 .
— 32l
C ’
est sans doute à cause de leur instruction que l es marquis de S aluces , princes éclairés , appelèrent des chanoinesd
’
0 q pour desserv ir la chapel le de leur palais .
L ’ ordre dans les prem iers temps donna l ’ exemple de labonne culture des terres . Il encouragea les défrichemens en
multipliant les emphytéoses . L es pré vôts eurent l e b on espritde faire ven ir des bergers suisses pour m ieux ut iliser les
paturages . L e dern ier prévôt importa les meil leurs cépagesde v ignobles de Bourgogne dans l es v ignes que l
’ ordre possédait dans la vallée , et ces bonnes espèces propagées dans
l e Pays contribuèrent a y porter l es v in s à la répu tation et
a la v aleur qu ’ ils ont . L a bonne admin istration de no s rel igieux l es avait m is a m ême, dès l
’
an 1200 , d’
acquérir des
m oines dissipateurs de saint Jûst de Suse l e p atr im o in e quel
’ égl ise de saint Martin de Tours avait eu auparavant sur le
territoire de Chaumont E n 1228 il s puren t par un actede patriotisme éclairé se rendre garants pour la rançon dumaréchal Auruce , alors prisonn ier du com te de Sav oye , et
débourser ensuite cette somme cons idérable que le maréchaldevenu l ibre ne se soucis pas de payer
(l ) L a p'
a tr r‘
m oi ne de sa i n t Ma r ti n étai t si tué sur l a gauche de la Do i re
en face du p l atea u où est b ât i Chaum on t ; i l se com po sa i t pri n ci pal em en t
du pl ateau d i t la Magd elgn‘
n s. L à. l e ri che et pu i ssan t chap i tre d e T ours
av ai t u ne m ai son des t in ée à héb erger ses m em b res et ses pro tégés dan s
l eu rs pè l eri n ages à R om e, av ec u n e égl i se ou chapel l e p our l eur u sage ; et
p rob ab l em en t i l s d on na ien t au ss i l’
ho sp i ta l ité aux autres pè lerin s qu i pas
sa i en t par là. L eur m ai son éta it déd iée à l a Magde le i n e, comm e p l us ieurs
au tres étab l i ssem en ts de ce gen re, parce que l a Magd e l e i n e a lav é l es
p i ed s de Jésus soui l lés par l a p ouss ière des ch em i ns. De l à san s d ou te es t
v e nu l e n om que l e p la teau p o rte en co re, et d e là auss i l a trad i t i o n qu i l
y eu t en ce l ieu u n co uv en t . De p l us l es fa i ts sus—én o n cés co n fi rm e ra ien t
autre trad i t io n que l a rou te an cien ne des Gau l es p assât su r l a gauche de
l a Do i re en face du tracé que su i t l’
actue l le, et qu’
en o rig i n e l e b o u rg de
de Chaum o n t fût co n stru i t de ce côté .
G u igues Au ruce ou Aurus ( Auruciu,s n é à Césan n e d
’
u n e fam i l l e
an ci en n e qu i av a i t d o n n é so n n om à l a fo n tain e d‘Auruce ( fan s Aurucr
‘
c‘
)sur l e t erri to ire actue l de S o l om iac, éta i t l
’
homm e l e p lus im p o rtan t de
l’
E ta t. L e dauph in Gu igues—An d ré, un d es s ouv era i n s l es p lus rem arq uab l es
qu’
a i t eu le Dauph in é, l’
av ai t i n v es t i de tou te sa co nfiance e t av a i t créé
p our lu i la charge de m arécha l , charge un ique comm e cel le d e con nétab l e
de Fran ce, à laque l l e étai t a ttaché le comm andem en t suprêm e d e ten tes
Le prévôt Flocard Berard , qui v ivait sous l e règne du
dauphin Humbert I l , avai t la réputation d’
un homme instru i tet en tendu en afi
'
aires . Le Dauphin a imait a le con sul ter .
Lorsqu’ il eut la vel léi té de créer une sorte de conseils pro
v inciaux il nomma l e prév ôt Berard prem ier membre du
Brian çonnais .
L ’
époque plus b rillante de l’ ordre d ’ Oulx s
’ étend de son
ins ti tuti on jusqu ’
au quatorzième siècle. Dès lors on v oit lad iscipline se relâcher. E n 1342 Flocard Berard assemble un
chap itre général , et la on délib ère d ’ établi r une b on n e prison
pour punir les rel igieux qui manquent à la d iscipline.
La décadence progressa rapidement dès qu ’
au quinzièmes i è cle il n
'
y eut plus de prévô ts é lectifs , mais que l e gouv ernemen t de l ’ordre fut constamment confié à des prélats comm endatai res , lesquels , nommés par le roi , se tenaien t souven t a laCour au l ieu de résider dans la maison chef d ’ordre . Enfin en 1749l e nombre des religieux é tait tel lement réduit qu
’ il se b ornaità ceux qui habitaien t le cloître d
’
O ulx et que les autres ma isonsde l ’ ordre se pouvaien t dire abandonnées . L e prévôt d
’
alors ,Jean -Baptiste d
’
O rhé de saint Innocent , proposa lui m êm e lasuppres sion de l
’ ordre , l aquelle eut l ieu de concert entre leroi Charles Emanuel 111 et l e Pape . Alors fut créé 1 ’ év êchéde Pignero l , auquel fut annexée la d ign ité de prévôt d
’ Oulxavec la juridiction sp irituel le qu i en dépendait , ains i que lesbiens de l ’ ordre et la seigneurie de Chaumon t. A Oulx futé tablie une collégiale de chanoines séculiers , a laquel le furentaffectés les b âtimens de l ’ ancienne abbaye avec une partiede ses revenus . Cette collégiale fut abol ie sous l e Gouvernement impérial . L es bàtimens et l es terres env ironnantes fu
l es fo rces m i l i tai res. L e m êm e p ri nce en m ouran t n om ma l a Dauphi n e ré
gen te dura n t l a m i n ori té d e son successeur, av ec l’
o b l igati on d e se co n
su l ter av ec_Auruce, son fidJls m arécha l . Gu igues Auruce eu t un fi l s n om m é
Ob ert, qu i l ui succéda dan s l a d ign i té de m arécha l , et u n e fil l e qu i épousaDav i d d e Cro s , gen t i lhomm e savoy ard qui tena i t du com te de S av oy e l a
charge a l o rs co n s idérab le d e châte lai n d‘Av ei l l an e . L a fam i l l e Au ruce ,
al l iée aux p ri n cipal es d e l’
an ci enn e n ob l esse d e S use, co n t i n ua à sub s i ster
a Cesann e ,où el l e ava i t d es d ro i ts d e con seign eurie , ju squ ’
au quatorz i èm e
siècl e . Aprés l a m oi t ié de ce s iècl e n ous n’
en avon s p l us aucun e t race.
324
l’
egl ise de saint Laurent ; un autre mieux éclai ré aboutissaita l
’
égl ise de saint Pierre et au ré fectoire dont l es fenêtresouv raient au m id i sur les jardins . Lors de la terrible inoadat ion de 1728 , la Doire ayant fait tout a coup irruptiondans ces jardins , surprit les chanoines au réfectoire , et i l s
s’
en fuiren t épouvantés , ayant eu à peine ,d isent leurs Mé
moires . le temps d'
emporter leurs serv iettesLes prévôts les plus no tables après F locard Berard ont été
le prévôt Bigot , homme sage et éclairé , qui donna à
la Commune de Chaumont ses statuts ruraux de 1373 , em
pre ints d’
une v éritable sagesse pratique . C ’
est lui don t lesv ieil les dents firent donner aux roches bizarres de Tou il lesl e nom qu
’
elles conservèrent pendant des siècles de Den is
d u p révôt B igo t.
Emeric d ’
Arces , d’
une fam il le i llustre de Dauphiné ,qui gouverna l
’
abbaye depuis l’
an 14 17 jusques vers l’
an
1 450 . Il fut arbitre d ’
un d ifi‘
èren t entre l e duc de Savoye et
le marquis de S aluces . C ’
est ce prélat qui fit bâti r la su
perb e digue de la Doire qui existe encore en face du b as
bourg d'
O ulx, construction fai te avec des blocs énorm es de
p ierre et remarquable pour l’ époque . Notons en passant un
incident auquel donna l ieu la constructi on de cette d igue .
L es habitans du bourg croyan t qu ’
el le jetterait l a Doirecontre leurs proprié tés s
’
opposèren t aux trav aux,mais en
vain . Les religieux poursuivaient leur oeuv re m algré toutesl es inhibitions . Alors l es habitans exaspérés recoururen t a laf orce et tirèrent sur l es ouv riers . Mais les re l igieux portérent le saint sacrement sur l e l ieu du travai l ; l a populat ioncessa de t irer ; la d igue fut achevée .
Roger de saint Lary de Bellegarde , personnage i l lustrequi , ayant quitté l 'état ecc lés iastique , dev int m arécha l deFrance et fut accusé d ’
avoir aspiré à se rendre souveraindu marquisat de S aluces don t i l était gouverneur . Il mourut ,dit —ou, empoisonné .
enfin Jean Baptiste d’
O r11e , dont j’
ai déjà parlé , issu
(1 ) Mémo ires de Tamron .
325
de la noble fam ille savoisienne des marquis de saint Innocent , connue par sa valeur chevaleresque et par son atta
cb ement séculaire a la ma ison de Sav oye. Nomm é prévôtd
’ Oulx , Jean Baptiste d’
O r l ié conserva cette d igni té pendantp lus de cinquante ans . E n 1749 il prit l ui—même sagementl ’ initiative de l ’ ab ol it ion de l ’ ordre ; lui-m ême proposa en
cette circostance et obtint l 'érection de la collégiale d’
O ulx.
E n 1 750 , secondé par l e chate lain Pierre Bernard de La
tourette , son d igne am i , il combina et obtint la création ducol lège d
’
O ulx. Évêque de Pignero l depuis 1749 , i l parv intà une extrême v ieil lesse entouré de l ’
amour et de l a véné
rat i on d e ses diocésains ; mais i l laissa surtout une m émoireb énie dans la vallée d ’ Oulx où i l avait constamment passéune partie de l
’
année . Austère pour lui-même , il était b onet aimabl e envers les autres , compatissant aux erreurs et
aux fa ib lesses , secourable pour l e malheur, paterne env ersles jeunes gens . Homme d ’
une fo i sincère , il savait prat iquerla to lérance rel igieuse comme Fènèlon , et dans un d iocèseoù v ivaien t beaucoup de d issidens i l s
’
attira le respectde tous .
Il reste encore de l eglise de sain t Laurent l e mur de
façade et une portion de mur latéral . L ’
exhaussement pro
gressif du so l a fait que ces m urs sont enterrés jusqu ’ à une
certaine hau teur et que la porte d’
entrée est presque toutesous terre La tradition es t pourtant que cette église en
origine é tait bâtie sur un emplacement élevé au dessus du
n iveau des env irons Restaurée en grand , peut - être rebâtieen 1073 , e l le é ta it encore en b on é tat en 171 4 lorsque l e
gouvernement du roi V ictor Amédée en fit faire l 'inspection .
Elle avait la forme d ’
une croix latine.
S ur la fin du onzième siècle fut construite dans 1 ’
enceinte
L es restes de égl i se d e sa in t L auren t furen t détru i ts par l e nou
v eau p ro prie ta ire en 1883.
E n creusan t l e pui ts de l a gare o u para i t av o i r t rouvé l e so l de
l’
épo que roma i n e à près d e s ix m ètres d esso us 1’
actue l . L a p o rte de
ég l ise étan t en fo n cée d’
en v i ro n deux mètres, p ouvai t être en origine à
env i ron qua tre m ètres au d essus d e l a campagn e.
326
monastère una seconde église dédiée à la sainte V ierge, àsaint Pierre et a saint Paul . Elle se trouvait du côté du
l evant . Ruinée au seizième siècle , el le fut remplacée plustard par celle qui s
'élevait en face du palais abbat ial , la
quel le tomba en 1854
Les I l ugueno ts unis aux V audois tentèrent plus ieurs foisde détrui re les égl ises et le monastère au temps des guerresde rel igion . I ls y m irent l e feu en 1562, en 1 569 et en 1574 .
La trad ition du monas tère portait que l es incend iaires avaientagi par instigation de quelques che/s d
’
0ulæ et de Cesan n e
Si ce tte accusation atroce est v raie , comment se fait- il quel es religieux eussent inspi ré de pareil les haines ? Le relâchement de la discipl ine aurait— i l amené celui des moeurs et
donné l ieu a des dérèglemens qui aient susci té l ’ indignat i ondes pères de fam i lle ? Aucun documen t, aucunne trace n
’
au
torise cette suppos ition . Ce qui est avéré c’
est que l es ré
l igieux avaient soutenu des procès con tre la popu lat ion pourl'
exemption de l’ impô t foncier ; c
’
est que , quand i l s èl evè
ren t la grande digue de la Doire malgré les oppos itionsd
’
abord légales puis v iol entes des habitans du bourg d’ Oulx,
desquelles nous avons fait m ention , ceux-ci forcés par un
moyen abusif de laisser poursui vre les travaux durent se re
tirer avec la rage dans l e coeur.
E n 1 120 Guy de Bourgogne , é lu pape sous le nom de
Cal ixte II , se rendant à Rome pour prendre possession du
t rône pontifical , passa le Montgenèv re avec une su ite brillan te et accepta l
’
hospi tal ité des chanoines régul iers d’
O ulx.
Il l es combla de faveurs et daigna m êm e béni r un autel .U n quart de siècle plus tard le pape Eugène III orga
n isait la seconde croisade . Il agissai t v ivement auprès du ro ide France et du comte Amé de Sav oye son onc le. Au printem ps de l
’
an 1 1 47 il étai t a Suse av ec l e com te Amé et yobtenait un concours pécun iaire de l ’ abbaye de sain t Just
Cet te égl i se fut reco nst ru ite e t red o n n ée au cu l te en 1886 et con sacrée
au S acré Co eu r d e Mari e ; e l l e est actue l l em en t d esserv i e p ar l es p rêtres
Ba lés ien s d e Turin auxque l s e l l e fut cédée en 1895.
(2) Mém o ires de T amron .
II .
La Gazette.
La Gazette est un nom resté légendai re dans la val l éed
’
O ulx. O n se représente celui qui l e porta it comme un typede guerrier du moyen âge , bardé de fer, avec une forced'
hercule et une valeur indomptable , ne respirant que la
guerre , terreur de l’
ennem i .T e l était en efi
‘
et la Gazette. T el i l v écut, tel il mourut.S on vé ri table nom était Jean Louis Borel . Il était né à
Oulx d ’
une famil le aisée. Mais i l parait n'av oir eu aucun
l ien de parenté avec l es Borel de Ponsonas , anciens noblesde Dauphiné , quoiqu
’ i l portàt leurs armoiries et que dans
son testament i l l es ait appelés à son héritage en cas d’
ext in
ction de sa descendance. L e surnom de L a Gazette lui v intd
’
une terre qu’ il possédait , et dev int une sorte de t itre , caron le trouve souvent qualifié s ieur ou seigneur de La Gazette,et i l ne fut presque connu que sous ce nom .
E n 1567 i l acquit l a se1gneurie de Nevache . S a granderéputation m ilitaire l e porta a une pos ition élev ée . Il m ourutcommandant général des t roupes royales dans le Briançonnais ,gouv erneur du château d
’ Exilles , gent ilhomme de la Chambredu roi , décoré du collier de saint Michel .
Dans sa jeunesse il s’ était distingué à] la batail le de Ce
r iso l es (a . 154 4 ) comm e l ieutenant d ’
une com pagn ie d’
in
fan terie . Puis i l avait fait toute la guerre d’
I ta l ie sous l e
maréchal de Brissac . Lorsque le m aréchal entrepri t l e si ègede V ignale , place du Montferrat qu i occupe le sommet d ‘
une
col line et qui était alors con s idérée comme très—forte , on
ren contra une rés istance form idable, la p lace étant bienmunie et commandée par un v ieux gouverneur d
'
une résolut ion héro ique : alors que lques capitaines , l
’
un desquels étaitL a Gazette , ofi
’
rirent au maréchal de tenter un coup hard i ,qu i éta it une escalade des murs de l a forteresse . I l s le firentaff rontan t m ille dangers , se jetèrent dans la pl ace et s
’
en
rendirent m aîtres , ains i que des d rapeaux de la garnison .
Pour récompenser cette act ion d ’ éclat , adm irée de toutel ’
armée , l e maréchal con féra à L a Gazette et aux autreschefs qui avaient conquis des drapeaux ennem is une sorte dedécorat ion décrétée tout exprès , qui consistait en un médail
lon d’ or émai llé a porter sur l a poitrine suspendu à une
chaine d ’
or. L ’ émai l portait une inscription latine indiquantl e nombre des drapeaux pris par le décoré .
C ’
est peut—être le prem ier exemple d’
une décoration destines a rémunérer des faits d ’
armes L a Gazette avaitconqu is deux drapeaux .
Par une des infinies erreurs qu ’ il a semées dans ses
écrits , Guy Allard a débi té que L a Gazette serv it d ’
abord l epart i protestant, puis le catholique. Il résulte au contrai reque dès l e commencemen t des t roubles la reine Catherine deMédicis l ’ appela auprès d
’
el le et l ui confia l a garde des
f rontières du B riançonnais . I l y lutta cons tamment contre lebaron Des Adrets puis contre Lesd iguières : et c
’
est l ui
qui de 1562 a 1590 tint constammen t levé le drapeau du
catholicism e e t empêcha les Hugueno ts de s’
emparer de
Briançon et de la vallée d ’
O ulx. De tem s a autre i l est at
taqué , et quelquefois obligé par l’
in fériori té de ses forces
Ce tte d ispos i t i on de B rissac est re latés dan s l es Mém o ires d e Bor
m qu i décri t l a décorat ion te l le qu’
on l a v o i t dan s l e p ort ra i t d e l a
Gaz e tte.L e b aro n Des Adrets v oul a i t étab l i r l a rel ig i o n réfo rm ée par l a
force des armes . V oy ez sa Proclam a t ion a ux H a b i ta n s d u Prag ela s , qu i es t
a l a su i te de cet Append ice (Documen ts , 11 . I V ).
a faire momentanément une retraite honorable dans les mursde Briançon mais toujours il reprend l
'
avantage sur l ’ ennem i
qui se reti re avec perte.
Dès l'
an 1562 nous av ons vu Bardonnêche surpris par
les I l ugn eno ts et repris par La Gazette, qui leur a l ivré un
comba t terrible. U ne autre fois i l les défait dans le plateaude sa i n t Marc au dessus d
’
O ulx. U ne autre fois encore à Cesanne . E n dern ier lieu il les chasse de saint R esteung et
prend cette pos ition qui é tait fort ifiée Il fut un tems san savoir E xi lles ; il l e prend après av oir battu et dé fait un corp sde deux m il le Huguenots venus au secours de l a place , et enreste gouverneur.
Ma is l es haines des Huguenots s’
accumulent sur sa tête .
De son cô té , aigri par l es luttes , il tourne au fanat isme , s i
répandu à cet te époque . A la m ort de Henri III , répugnan tà accepter un roi protestant , il accède au part i qui asp i raita me ttre la couronne sur la tête de Charles Emanuel 1 ducde Sa voye , fi ls de Marguerite de France. Cette circonstancedécida l a m ort de La Gazette.
Dans la nuit du 1 4 au 15 jui llet 1590 le v ieux guerrierdormai t sans défiance dans sa maison d ’ Oulx. Il avait m êmed ispen sé de se ten ir chez lui pendant la nuit une compagn iede gardes qui faisait habi tue l lement serv ice auprès de sa
personne . U ne troupe de v ingt-cinq homm es dé term inés , bienarmés et commandés par un capi taine nommé Du Pon t , futenvoy ée par L esd iguières pour le surprendre pendant son
sommei l .L a troupe passa la montagne qui sépare la v al lée d ’
O ulx
du Prage las de m an ière à ne pas être vue , et arriva v ersl e m il ieu de la nuit devan t l ’ habi tation de L a Gazette . Là.
l es assai l lans se partagèrent. L es uns m iren t un pétard a la
porte de l a maison et la firent sauter, tand is que l es au
t res se portè rent sur les derrières et pénétrèrent dans l’
en
( 1 ) O n av a i t mun i d e fo rt ificat ion s l ’
égl i se d e sa in t R esteung ( sa in tR est i tut ) p rés d e S aure d e Cesa n n e . C es fa its d i v ers so n t t irés d
’un
Mem o i re in éd i t l ai ssé par L a Ca zurr a et p o ssédé par 1’
Au teur d e cette
N otice.
832
Le cab inet où La Carotte fut tué 11 été conservé re li
gieus0ment dans le même état jusqu’
au tema de mon en fance .
C'
était une pièce ob longue et voûtée. Murs et voûte éta ientcouverts de pe intures a fresque représentant une tre i l le avec
des pampres verts . O n mon trait sur le mur des taches qu ’
on
croyai t ê tre de sang.
111 .
Légende de saint Just .
Saint Just, su ivant la légende , était un m oine attaché al ’ égl ise de saint Laurent d ’
O ulx l orsqu’
en 57 1 l es Lombardsenv ahirent la val lée et m i ren t l e feu a l ’ égl ise et au mo
nastère .
Lui et un autre moine son am i , nommé Flav ien , s'
en fui
rent a l ’ approche des barbares , et , marchant devant eux af
folés par la peur , il s parv inren t jusqu’
au sommet de la som
b re forêt de Beaulard . L â , a l’
abri de tout péril , la curiositéleur v int , et il s grimpèrent sur un arbre pour regarder du
côté du monastère. I ls v irent le b âtiment en flammes et une
épaisse fumée mêlée d’
une lueur rougeâtre s' élev er dans l es
ai rs . Mais cette lueur effroyable éclairait un spectacle m er
v eil leux . C' étaient l es âmes des m artyrs qui , entourées et
soutenues par l es anges , s’
envolaient v ers l e ciel .L es deux fugitifs eurent honte de leur peur . I l s descen
diren t de l ’ arbre , coururent au monastère , reprochèren t auxLombards l e sang versé , et furent m i s a mort , martyrs de l afo i comm e leurs frères .
Dans la grotte où le saint s’
arrêta un instant pour re
poser surgit une source d’
eau f raîche. Grotte et fontaineres tèrent en grande vénération . L a grotte s
’ étant écrouléedans la suite des s iècles , une chapelle fut bâtie a sa place .
L a chapel le auss i étant tombée, on essaya en v ain de la bâtirailleurs ou on l a croyait m ieux assise. O n dit que la bâtisse
— 334
commencée s’
écrou lait toujours . O n se-résolut enfin a l a re
construire sur l‘
ancien emplacement.L
’
arb re sur lequel grimpa saint Just subs ista jusqu ’
aux
tems modernes. C ’
était un me leze d’
une forme extraord i
naire e t partant facile a distinguer dans toute la forêt . T an
dis que le melèze a ord inairement l a forme d ’
une pyram ide ,ce lui—là se d iv isait en sept po in tes . Cet arbre avait v écu p lusde mille ans après la mort du saint, respecté par toutes l es
générations qui s’ é taient succédées dans l e pays. Mais dans
le siècle passé un habitant de la Commune s’
ev isa de l ’
abattre e t le brûler. O r des récits étranges ont circul é sur l e
sort de cet homme et de sa fam il le . S es descendan ts on t été ,d it-on , poursuiv is par une série efi
‘
ray ante de malheurs jusqu
'à ce que le dern ier périt m isérab lement.,U ne poutre
traînée par lui le renverse , passa sur son corps et l’
ècrasa .
À
h
û
h
û
h
fl
û
û
h
û
fl
û
û
.
C
temps passé . L e b onhomme se leva pour tenter de p rendrel
’
om—nu ; mais quand l’
o iseau voya it qu’ il s ’
approchait delui , i l se recula it un peu en arrière , et i l recu la tan t quele b on moine allant après lui fut hors de son abbaye et
en tra en un b ois et crev ait prendre l'oi seau ; m ais ce lu i- ci
s’
en alla sur un arbre , et commença a chanter si douceme n t que le b onhomme n
'
avait jamais ouï chose s i douce.
11 fut s i attenti f a regarder la b eauté de cet oiseau e t a
écouter l a douceur de sou chant qu’ i l en oublia toutes l es
cho s es terres tres . E t quand l’ oiseau eut tant chan té comme
i l put , i l batti t ses a iles et s’
en vola ; et le b on m oine pen saen lui-meme qu ’ i l fut env i ron 1’
heure de m id i , et se d it :
mon Dieu , je ne réci te pas aujourd ’
hu i mon office ! I l ré
garda son abbaye et ne la reconnut pas , tant elle lu i semblait être changée. Hé Dieu, d it— i l , où suis-je ? n
’
est ce pas
mon ab bay e dont je suis sorti ce matin ? I l v int â la portee t appela le portier. L e port ier v int , et quand l e b on
homme le v it il ne reconnut pas l e portier , et celu i—ci n e
reconnut pas l e moine ; et le portier l ui demanda qui il
éta i t. Je suis m oine de céans , di t le bonhomme , je v euxen trer . V ous n
’ étes pas moine de céans , di t le portier ,je ne vous a i jamais vu. Si vous êtes de céans , quandétes -v ous sorti ? Ce matin , d it le bonhomme . De
cèans , d i t le portier, il n'
est sorti personne aujourd ’
hu i .
A lo rs le b o nhomme fut tout é b ahi et d it : faites mo i parlerau portier. V ous me semb l ez , d it l e portier , un hommeho rs de s ens : ici il n
’
y a de portier que m oi , je sais bienque v ous n
’ ê tes pas moine de céan s . Je l e suis,d i t l e
mo ine . N’
est ce pas l’
abbaye de E t i l la nomma.
O ui , d i t le po rtier . Donc, répl ique l e bonhomme , je
su is m o in e de céans . Fa ites-m o i v enir 1’ abbé et le prieur ,je parlera i a eux . Adonc v in t l ’
abbé et le prieur a l a
porte , et quand i l l es v it il ne l es connut pas , n i eux lui .
Que demandez-v ous , firent- i l s au bonhomme . Je dé
maudo , d i t- i l , l’
abbé et le prieur â qui je veux parler .
Nous l e sommes , firent—i l . V ous ne l’
ê tes pas , d it l e
bonhomme , car je ne vous v is jamais . Il resta donc tout
337
ébah i , car il ne les connut pas et il ne fut pas connud
’
eux. Quel abbé , quel prieur demandez v ous , d it l’
abbé ,et qui connaissez vous cèans ? Je demande l ’ abbé et le
prieur qui s’
appelaient ains i ( et i l les nomma ) : je connaisun tel et un te l , et d
’
autres . Quand i l s ouïren t ceci,
i ls connuren t bien l es nom s qu’
i l avait indiqués . Beau
sire , tous ceux que vous demandez sont m orts , et i l y a
de cela trois cents ans : or av isez en quel lieu v ous av ez
été. Alors le bonhomme s’
aperçut d’
un grand m iracleque Dieu lui avait fait , dont il faut dédu ire que l es joiesdu parad is sont grandes qu
’ i l donnera à ses am is . Auss i l ebonhomme fut grandement émervei l lé parceque pendant
trois cents ans i l avait vu et écouté cet oiseau , et a causedu grand dési r qu
’ i l en avait , i l ne lu i semb lai t pas quel e tems fut passé s i non depuis l e mat in jusqu' à m idi , et
en trois cents ans il n ’
avait pas v ieill i et se barbe n’
avait
pas changéL e passage d
’ Eudes de Sul ly n’ énonce n i l e nom d
’
E l
drad n i celui de l a Novalaise . Qu ’ i l ai t entendu ou non parlerde notre sain t , il n
’
est pas moins v rai que la tradition, ainsique le moine R ochaix , lui appl ique le fait raconté par l ’ i llustre évêque. Quoiqu ’ i l eu soit , Sully semble av oir v ouludémontrer en forme d ’
apo logue que l es joies de l a.
v ie cé
l este ne produisent jamais n i satiété n i fatigue , et qu’ on ne
v iei l lit pas dans le paradis .
Il nous reste de saint E ldrad un documen daté de l’
an
827 , qui est la décision rendue entre lui et quelques habitans du territoire d
'
O ulx qu ’ i l réclamait comme serfs .
O n a conservé jusqu ’ à nos jours les ossemens de ce saintdans l ’ égl ise de l
’
abbaye de la Novalaise . Du moins l a croyance générale est que ce soient ses rel iques . I l s sont ren
fermés dans une châsse de bois rev ê tue de velours rouge et
mun ie de cercles en argen t ciselé . Après la suppress ion de
l’
abbaye la châsse a été rem ise par décret du Gouvernementa l ’ église paroissiale .
A
A
A
A
V .
Les E sprits et l es S orciers .
La culture intellectuel le n'
exclut pas la superstition . O n
en a m ille exemples . Ma is dans l es mon tagnes la faci l ité decroire aux choses surnaturel les est portée par l e spectacle
grand iose de la nature même .
11 n’
es t donc pas a s’ é tonner si nos pères ont cru pen
dant des siècles qu’
un esprit hab itât le sommet de Rocheme lon . O n sait qu
’ Hardouin G lab rion marquis de Turin ,de
v enu maître de la val lée de Suse et d’
O u lx par l’
expuls iondes Sarrasins , v oulut braver l ’ esprit de R ochemelon en gra
v issant la montagne avec une process ion précédée du s ignesacré de la croix. L e clergé de Suse ouv rait la marche en
chantant hymne triomphale Veæi l la R egis p rodeun t Maisquand on fut près du sommet rocheux duquel se détachenttoujours des débris , on crut être assa i l l i par des p ierresqu ’
une main inv isible lançat de la haut . Prêtres et laïques ,tous prirent peur et firen t v olte face . O n dégringola commeon put , et de l ongi ems il ne se parla p lus de ten ter une pa
rei l le ascension . Enfin en 1358 un chevalier astesan , Bon i faceRoero , rompit l e charme et étab l it sur l e R ochem elon une
chapelle en honneur de la sain te V ierge . L ’
esprit depuis l orsne donna plus signe de v ie .
Il n ’ y a pas jusqu’
à la mare appelée le lac n o ir au dessus
L es b an n ières du R o i (des cieux) s’
avan cen t
340
tence d’
avoir inv oqué l es démons de l’
en fer , d’
a v a i
par leur m in istère fabriqué des hommes à l’ image d e D i e
et tourmenté l es créatures humaines , tuant et em po i s o n
nant , commettant non un seul hom icide mais plusieu r s p a
v os maléfices . V ous avez ren ié Dieu et v iolé toutes l e s 10°
d iv ines e t humaines , et v ous êtes dev enus incorr ig ib l e sc ’
est pourquoi vous serez li és fortement a des po te au :
solides sur un bucher et v ous y serez en t iè rement d é v or é
par le feu , de sorte que vos corps retournen t à l a pou ssiere
La sentence fut cassée par le Consei l suprême du Dau
phine parceque le seigneur de Chaumont n’
avait pas l a
haute just ice ; mais l es cinq v ict imes avaient péri dan s les
flammes et leurs cendres avaien t été jetées au v en t .
Cette haute sorcellerie que l’
on pré tendait prat iquer desmeurtres et des empo isonnemens est depuis longtems oubliée ;i l lui a survécu une magie de plus b as é tage , que l
’
on cro
yait commettre des malices nuis ibles en jetant des malad ies ,quelquefois sur les hommes , l e plus souvent sur le béta i l . Cessorts jetés par une science occulte on l es détruisait par despratiques du m ême genre. O n m ettait , d i t-on , dans un pot de
terre des clous de fer, un brin d'
encens détaché du ciergepaschal , et je ne sais quel le autre chose ; on plaçait le pot
au m ilieu d ’
une chambre après av oir eu soin d’
en fermer
hermétiquement toutes l es issues . Puis on allumait du feu
sous l e pot et on attisai t la flamme jusqu’ à ce que le pot
fut en incandescence ; on traçait un cercle au tour du feu,
et pendant cette cérémonie en prononçai t certaines formulesmagiques . Enfin avec une barre ou brisait le pot et on
battait les clous en désespéré , toujours en récitant les
formules . O n se figurait qu’
en battant les cl ous on frappaitl es esprits et qu
’
on l es forçait à paraître dans la chambrea se soumettre à une volonté supérieure et a ôter le sort
(1 ) Archi v es d e Cour à T urin .
(2) i b i ign ei s fiamm is to tal i ter com b urend i i ta et tal i ter quod omn ia
corp ora v es tra in pu lv erem rev ertan tur
(3) Ce Con se i l qui dev in t l e Parl em en t de Gren ob le.
qu’
i l s avaient m is . O n dit qu’
un homme et sa femme pourlibérer leur bé tail d ’
un pré tendu sort prat iquèren t l e ritemagique et s
’
en fermèrent si bien qu’ i l s s
’
asph ixièrent . O n
l es trouva m orts à côté de leur pot brisé .
Aujourd ’
hui l a croyance aux sorciers n’
est pas encoreabsolument éteinte ; m ais il est a espérer qu
’
elle d isparaîtrabientôt . 11 est juste de di re que le clergé est loin de l
’
en
t reten ir .
V I .
L ’ Instruction et l es Arts d’autrefois .
La farce archaïque de la brute, dont nous av ons parléailleurs , démontre par sa propre antiquité combien son t au
ciennes les écoles dans la v al lée supérieure de la Doire . De
la v ient que de tema immémorial tous les homm es dan s l a
val lée sav ent li re et écrire. Aussi beaucoup d’
en t re eux ont
i ls l ’ habi tude d 'ém igrer pendant l’
h iver pour exercer dans
l es pays v oisins la profess ion de maîtres d’ école
,et cet usage
est ancien . Il y a en v iron quatrecen ts cinquan te an s que la
v ille de Turin mettait à la t ê te de son école communale un
maître Pierre d ’
O ulx, docteur en grammaire : m ag is trum
Pelrum de V lcio doctorem gram aticae
Les actes notariés qui nous resten t du moyen âge sontremarquab les par la clarté du s tyle et par la belle cal ligraphie.
L a nob lesse av ait ici comme ail leurs pour principales oc
cupations l a guerre et la chasse. Mais nous v oy ous au treizieme et au quatorzième s iècles , des gent ilshommes des principeles fam illes être en m ême tem s bril lants guerriers et
assez éclairés pour rempl ir a vec d ist inction l es fonctionsd'
ambassadeur, de bai l l i , de châ te lain ; no us en v oyons un
b on nom bre exercer l e notariat , alors en grand honneur danstout l e Dauphiné .
Sous les règnes de Henri I V ,de Louis XIII et de Louis
XIV les châtellenies d ’ Oulx et d’
E xi l les furent tenues par
des gentilshommes de la maison de Ferrus , qui tous portè
Dans les dern iers tems la val lée a eu un juriscon su l tees timé , que sa modes te philosoph ie a retenu dans ses foy ers ,quo ique son ta len t , sa doc trine , ses man ières exqu i se s , et la
nob le s se de son caractère l'
eussen t fa it d igne de parco uri rune carr iè re b ril lante . Ce fut Louis An toine de Latourre tte ,ne en 173 1 , dern ier chate lain des va l lées d '
O ulx et de Ce
sanne I l autement considé ré par le Gouv ernemen t e t co nnupersonne l lement du roi , il re fusa constamment toute promot ion ; mais le pay s l
'
entoura d’
un respect fil ia l et d’
une dé
férence pro fon de . N ous conservom de lui un portrait que legéné ra l de V aufi
'
reland fit au cray on en 1794 et sous lequeli l écriv i t ces deux v ers :
Juge in tègre, écl a iré . sen s ib l e, généreux,
L e pauvre v ien t le v o ir, e t s’
en retourn e heureux
La médecine a été constammen t représentée par quelquepers onne du pays , mais l es m édecins ont toujours é té raresparceque l es habitans , fa vorisés par un climat salu b re , éta
ien t habi tués a se soigner eux—mêmes en faisan t usage des
s imples cueill is dans leurs montagnes .
Par la m ême raison il arrivait quelquefois que personnene se
_déd iât a la pro fess ion de pharmacien .
Des fléb o tomistes et des rhabilleurs suppléaient souv en tau dé faut de chirurgiens , et il est de fait qu
’ i l y e°
u eu t de
fort habiles quoique s imples paysans .
L a charge de châte la in roy a l d e ces v al l ées éta i t un res te d es i a
st i tut io n s d u m oy en âge. E n o ri g i ne l e châtela i n roy al éta i t l e représe n tan t
l ocal d u S ouv erai n , so i t pour l e g ouv ern em en t m i l i ta i re e t ci v i l , so i t p ou r
l’
adm i n i s tra t i o n d e la jus t ice . A l’
époqu e d o n t i l s’
agi t i ci , c’
est â d i re
dan s le d ern i er s iècl e,l e châte l ai n n
’
a v a i t p lus q u e l es f o n ct io n s ju d icia i res , au to ri té d
’
i n te rv en i r aux assem b lées comm u n a l es p ou r y m a i n ten i r
l e re spect d es l o i s, ce l le de v e i l l er 1 l a v i ab i l i té d es chem in s, à la p o l ice
d es eaux e t à l a ren trée d es i m pôts roy aux, en fin la suri n ten dan ce d es
éco l es . L ou i s An to i ne de L a tourret te a ssum a l es f o n ct i o n s d e châte la i n en
1 755 et les co n serva jusqu’ à ab o l it ion de l a cha rge . N ou s av o n s cru p o u
v o i r le com p ren d re dan s cette revue de i n s truct io n d’
aut re fo i s , b ien
qu’
i l so i t m o rt dan s n o t re s iècl e, parceque sa l on gue v i e appart ien t p ri n
cipa l emen t au s iècl e passé .
345
L etude de la théo logie était beaucoup plus répandue .
L e culte a toujours été desserv i par des prêtres de la v allée ,et de plus elle a toujours fourn i des curés soit a d
’
autresparties du diocèse, soit a des d iocèses étrangers . Des en fans
du pays ont tenu une place honorable dans les ordres re
l igieux. L es h istoriens du Dauph iné o nt conserv é le souv en irdu moine Colomb de Cesanne , dom in icain , prédicateur re
nommé sur la fin du quinzièm e si ècle . Dans le sièc le dern ierl e père Des Geneys était con sidéré dans l
’ ordre des jésuites .
Il a pub l ié à Av ignon quelque brochure devenue rare. L ’
abbéPierre de Latourrette, son neveu , figura avec dist inctionparm i l es oratoriens .
L es beaux arts furent peu cultivés . Quelqu ’ échantillon
qu’
on a de bonnes peintures v ient du deh ors , ou a été faitdans l e pays par des artistes de passage , au nombre desquelsje crois que f ut Callot
L e moyen âge a fourn i des sculpteurs qui étaient, sinonde véritables artistes , du m oins des ouvriers d istingués pourl e goût . I l s ont travai l lé l e marbre du Melezet m êl é de jauneet de l ilas , don t la carrière est malheureusement abandonnée
(1 ) O n avai t l e goût des p e in tures mural es. L’
égl ise parro iss ia l e d’
O ulx
é tai t o rn ée de fri ses pe i n tes q ue l’
archi tecte Me l an o, fort i n s tru i t e n pa
re i l l e m at ière, at trib ua i t au douz ièm e s iècl e Ce l l e d e sa in t L auren t éta i t dé
co rée d e pe i n tures du m êm e gen re, qu i éta ien t au m o i n s auss i an cien n es .
N ous av o n s en occa s i o n de rap pe l er que l e clo î tre d es re l i g ieux d’
o ul x
éta i t o rn é d’
un p o rt ique où éta i t pe in te u ne m appem o n de. L es an ci ens
ap partem en s du prév ô t, qu i da n s l es d ern i ers tem s par su i te de l’
exhaus
sem en t du so l éta ien t d ev enu s d es cav es du m o nas tère, ava i en t été pe i n ts .
L a m ai s o n où m ouru t L a Gaze tte a va i t p l us ieu rs cham b res pe i n tes à fresque
Beauco up d’
ég l ises e t d e chape l les éta i en t co uv ertes d e fresques , so i t au
deho rs, com m e l’
égl i se de Cesan ne, ce l l e d e Beaul a rd , l a chape l l e de J on
v en ceaux, cel l e d es Orres au dessus de Mi l laures, ce l l es d e sa in t S ixt e t
du Cogn e t dans la parro i sse d u Mélezet , cel le de sai n t Barnab é aux S o u
b ras, ce l l e de sa i n t E t ien n e a J a i l lon s . L a p lupart d e ces p ei n tures ap .
part ien n en t au qu in z ièm e s iècl e. O n y représe n ta i t l e parad i s, peup lé de
sai n ts, l e purgato i re, adm n in i strat io n d es sacrem e n s, l es péchés cap itaux
po i n ts av ec la v erve et l a crud i té de l’
époque, d es m arty rs , le chri s t et les
apôtres , et au tres sujets re l ig ieux e t m o raux qu’
o n accom pagn a i t p arfo is
d e se n tences en v ieux fra n ç a i s. Ain s i sur la chapel le d e J a i l lon s o n pe ign i t
l es v ertus et les v ices, rep résen tés d an s un e sé rie curieuse de personn ages
m archan t en une espèce de process i on en cos tum es du tema.
— 346
depuis trois siècles. I ls en ont fait des col onnes , des porta il s ,des b én itiers . L
’
ancienne égl ise paroiss iale de Bardonnêche
était décorée d’
un portai l sculpté de ce marbre et d’
un
porche soutenu par des colonnes de la m ême mati ère . Deuxde ces colonnes après la chûte de la v iei l le égl ise ont été
employées au porche de la maison curiale: Elles sont svelteset d
’
un beau travai l .Le bén i tier en pierre de la paroisse de Bardonnêche
porte fort bien sculptées l es armoiries de la seigneurie avec
le nom de l'ouvrier , qui était de l a va l lée .
Dans le dix-septième s iècle on eut de bons scu l pteurs en
bois . Il reste d’
eux entre autres ouvrages remarquables l e
rétab le de l’ église d
’
O ulx .
Les arts u tiles ont suffi aux besoins locaux . Il y eut de
tout tem s des menuisiers capables , quelque fois exce l len s ,
des serruriers souvent hab il es , m ême des armuriers , des t is
serands pour l a laine , le l in et l e chanv re . L es hab itanss
’
hab il laient de leurs laines , réduites à serge ou drap , t issus ,foulés et tein te dans le pays .
De 1620 a 1630 une noble et bel le dame d' O ulx , Jsab eau
du Serre , femme de Laurent de Ferrus , introduis it la fa
b rication des dentelles, qu
’
el le implanta principalemen t à.
R ochemo l les en y employan t l es femmes du l ieu . Cette iadustr ie , appropriée aux longs hivers d
’
un pays de montagnes ,a survécu à sa protectrice , mais sans conserver sa prem ièrev igueur.
L ’
activ ité in tel ligente des générations passées a laissé d estables souven irs dans certains ouvrages qui atti rent l
'
atten
t ion eu raison de l ’ époque où i l s furent en trepris dans un e
v a l lée pauv re et recu lée des Alpes . T el est le cana l suspendusur l ’ arête des rochers que les seigneurs et l es habitans deJa i l lons firent con s tru ire en 1 458 pour conduire en ce l ienl es eaux d ’
un ruisseau fourn i par les glaciers du mont Am b in ,
œu vre b ard ie qui pourvoit a l ’ irrigat ion d’
un riche terr itoire , m ais si b ard ie que l es populat ions l
’ ont entourée del égendes .
Suivan t ces traditions légendaires , i l y ont dans l es au
348
qu’
un enfant lui apporta it chaque jour. O n voit encore dansles parois du tunnel l es creux prat iqués par lui dans le roc
pour y placer la pauv re lampe qui son rude labeur.
Après cinq ans d’
un travai l cont inu , i l eut, d it -on , un m o
ment où son âme faiblit . I l abandonna tout , puis l e couragel ui rev int et i l acheva .
L e marquis de Pesey d it que l e tunnel de T oui lles excitala curios i té de V auban et que le grand ingénieur estim aitqu ’ on devai t y avoir employé des tuyaux de cuir boui llipour introduire l
’
air nécessaire à l ’ ouv rierDeux époques ont été principalement m arquées par un
développemen t d’
activ ité intel lectue l le et de v ie sociale dansl a v a llée. L a prem ière embrasse le quatorzième s iècle . De la
datent l es s tatuts écrits d e Bardonnêche , de Sauze de Ce
sanne et de Chaumont ( a , 1 330 , 1366 , l es franch ises que l es habitans de la châtellenie !de Bardonnêche fi
rent garantir par leurs seigneurs , puis par le Dauph in(a . 1330 , celles qu
’
ob tinrent . du Dauph in les Communesde son domaine direct ( a . le règlement fores tierd'
O ulx ( a. l ’ établissement de l im ites entre d iversterritoires , les a l liances stipulées en tre Communes et Dan
phin (a.
Pourquoi n’
ajouterions-nous pas comme preuv e de v ie
in tellectuel le et sociale la réac tion énergique des popula tion scontre le dauphin Guigues lorsqu
'
i l attenta a l ’ honneur del a Maison de Bardonnèche ?
L‘autre époque dont nous en tendons parler embrasse la
seconde moit ié du qu inzième s iècle et la première du suivan t .
Duran t cette époque furent crées l es paroisses e t bât ie sl es églises parro issiales de Savoulx ( a. 145 1 Thures (a . 1452
Mi l laures ( a . Mélezet e t Desertes ( a. Fen i l s
(1 ) O n sa it que cet in trep i d e ouv ri er s’
appela i t Co l om b an B oméan e t
q u’
i l éta i t d es en v i ro n s d e N îm es . S on b ai l po rte que l es hab i tan s l u i co n
s tru i ro n t un e chaum ière pour son hab i ta t io n , avec u ne fo rge à l‘
ouv ert u re
du tun n el , e t qu’
i l s feron t l e déb la i des,m a tériaux . S a m a i n d
’
œuv re e s t
rét ri b uée par d es fourn i tures de v in et d e gra i n , ou tre un tan t en a rg e n t
pour chaque to ise d e p rogrès .
(a . Chateau-Beaulard (a. Bousson (a , 1503 )et Sauze d ’ Oulx ( vers le même tem s ) . Pendant la mêmepériode , outre le percement de Tou ille et l e canal de Jai l lonsdont nous av ons parlé , fut bât i l e beau porche en pierretaill ée de l
’ église de Salbertrand , et tous les principauxbourgs ou v illages furent dotés de fontaines publiques donnant en abondance de l ’ eau potabl e , avec grands bassins en
pierre pour l’
ab reuvage du bétail .
V I I .
Le Patois.
U n échan ti llon en pato is de nos vallées a été publié parM. Biondel li dans son livre s i intéressant
°
sur l es d ialectesitaliens . S o n travail démontre l a paren té qui existe entre ce
patois et beaucoup de dia lectes de la haute Italie .
Il a non moins de rapports avec le provençal , et p lusencore a v ec l es d ialectes parl és sur le versant fran çais desA lpes du m on t Thabor à Nice.
Je ne suis pas assez v ersé dans l a l inguistique pour re
chercher les sources de ce patois . Il est é v ident , à mon av is ,qu ’ il doit contenir des parties très —anciennes et qu
’ il a dû
être beaucoup alté ré par la f réquence des étrangers dan sles Communes que trav erse la route du Montgen èv re .
Je m e borne à rassembler ici quelques expressions qu isous d ivers rapports m
’
on t paru plus remarquables :
nor , garçon , fils
MAN DI E , fil le
v assxou, b él ier ,
BL E T O U N , m elèze ,
v oazs , s o u le ,
ouaaous , n o is ette,
O n ap pe l l e auss i b o t u n garç on dan s l e pato is d e Mon èt ier p rès d eB rian ç o n . L a n o vcarm ,
H is to ire d es hau tes A lp es ( 2° éd i t ion ) , p ag. 493.
E n Quey ras un garço n est appe l lé m en d ich . L an oucnr ra O p . ci l
pag. 49 1 . E n p rov en çal man dy ou maud i t s ign ifie un b erger e n fan t.
s vcounnmz, cacher , it nascon dere ,s vcous nù , caché, it . n ascosto ,
DE GAI L LA, d i lap ider ,
DE GAI LLA, d i lap id ä
Dans l e patois les pluriels fém inins se term inent en a .
L e c se prononce a la française , sau f dan s la haute v alléede Cesanne où on le prononce a l
’ ital ienne . La lettre l se
prononce comme l e r mon , de sorte que s o lei l en pato isdev ient s ourci l . L e 9 se prononce comme lej ainsi la poule ,
de ga l in c dev ient jarin e.
V III.
La Fl ore et l a l ‘aune.
Il existe entre nos mains une flore manuscri te des val léesd
’
O u lx . Elle ne porte n i date ni nom d’
auteur . Mais l ’
écri
ture est du dern ier s iècle, et d’
autre part comme elle est
rédigée d’
après la classification d’
Hauv in nous la croyonsantérieure à l ’ adaption général isée du système de Linné . L e
f rontispice présente cette intestation : Ca ta logus p lan taramin va l le V lcien s i n ascen tium . Au b as du f ron tispice on
v oit la signature du cé lébre botan iste Allions , ce qui veut
seulement dire que l e manuscrit lui a appartenu .
L a flore de nos montagnes est riche en plantes aromat iques et en bel les fleurs . O n y remarque l e genepi , la v ê
ron ique , l’
angel ique sauv age , des massifs de l avande t rèsodorante , les magnifiques v iolettes de montagne à. grandesfleurs , d
’
un parfum très fort , les saty rions de diverses espè
ces a odeur de van ille , les martagons , l es ly s , l es tul ipes ,l es anémones , les renoncules , l es gent ianes bleues , l es oei ll ets d ’
un beau rouge de chine , et une foule d 'autres plantesqui émail lent l es vallons.
L ’
abondance des fleurs parfumées expl ique la bonté ex
quise du m iel à goût de vanille ou de v iolette que l’
on ré
co lte a Champlas sur l e col de S estrières , a Désertes , a
R ochemol les . L es pâturages des val lons méridionaux du ter
ritoire de Mélezet sont tel lement peuplés de plantes aromat iquesqu ’
on y confectionne un beurre un ique pour la dél icatessede la pâte et la finesse du goût.
L es botan istes ont signalé aux env irons d ’
0 q l ’ existen ced'
une espèce de prun ier sauvage qui se trouve en Queyraset qui , é tant considéré comme particulier a quelques v a l l éesde l ’ ancien Briançonnais, a reçu d 'eux le nom de p run us
B r igan tiaca . Ce t arbre dans l e patoi local est appelé m ar
m o tier , et son fru it est connu sous l e nom de m arm ate.
C ’
est un fruit jaune , à peau l isse, ayant l a forme et la
gro sseur d’
un petit abrico t. I l v ien t à paquets te l lementnombreux que les branches surchargées p l ient et se courben t.E n approchant de la maturi té , i l prend un beau rouge du
côté du soleil et donne a l ’ arbre un aspect superbe . Cependant i l n
’
y s pas un gam in qui y touche , parceque i l est
insipide . O n uti l ise 1’ amande que renferm e le n oyau , de l a
quel le on exprime une hui le d ’
un jaune d' or, extrèmement
claire et limpide, ayant l ’ arome de l ’ amande am ère . Ceux
qui aiment ce goût l’
employ ent dans l es al im ens . Elle sertaussi en pharmacie comm e déprimant. Brulée, e l le donneune lum ière bril lante .
La v igne a été cultivée autrefois beaucoup p lus avantdans la vallée de ce qu ’
elle est aujourdhui . L es v ieux ceps
que l’
on trouve encore sur l es coteaux exposés au m idi dansl es territoires d ’
O ulx et de Savoulx témoignent qu’ i l y avait
la des v ignes lesquel les probab lement ont été abandonnées
parceque l es produits mûrissant raremen t ne compensa ient
pas les frais de culture . O n ignore l’ âge de ces v ieux ceps .
I l est pourtant hors de doute qu’
i l s sont plus que sécu la ires .
Leurs racines é tan t protégées par quelque rocher ou quelquereste de mur qui l es couv re , la plan te continue à v ivre bien
que ses pousses soient presque toujours broutées par les
an imaux.
L e noisetier se trouve a l ' état sauvage sur l es coteaux .
I l y abonde et en gros buissons qui en quelques endroitssont réun is en mass i fs cons idérables.
L es arbres f ruitiers sont cultivés de tems immém oré : le
figuier, le pêcher, l’
amandier et l e châtaignier, dan s la part ieinférieure de la vallée ; l e noyer , l e poirier et l e pomm ierpresque partout , a l ’ exception de la val lée de Cesanne ; le
pour l e mouton paisib le dans l’
ancien repai re des bêtes férocea. Car les ours étaient fréquens du tems de nos pères ,et les loups 1
’ é taient encore au commencement du s iècl e
présen t. L es documens qui nous restent du moyen âge s’
oc
cupent souven t de questions relat iv es à la chasse d e l ’ ours .
Le Dauphin et les autres seigneurs avaient chacun dans ses
terres le dro it de s’
attribuer un quartier de chaque ourstué pas les chasseurs . L ’
exercice de ce droit donna lieu a
de nombreuses quest ions en tre les habitans et l es officiersdu prince. Ceux—ci criaient a la contrebande et les habitan sde leur côté accusaient les officiers de prétent ions abus ives .
L e con trat de 1459 , qui régit l es droi ts doman iaux du roidauphin sur la Commune de Salbertrand porte une d ispos i t ionexpre s s e pour dé terminer la part du prince dans la chassede l ’ ours . Il en résulte qu
’
à ce tte époque l e droit seigneuria l é ta it partout dans la va l lée réduit à une patte et que àSalb ertrand seul l e m is tra l prétendait un quartier de sorte ,disa it la Commune, qu
’
i l ne valait pas la peine d al ler a l achasse . I l fut donc convenu que ce m istral si glou ton se
con te n terai t d ’
une patte .
L a maison qu’
hab itaient a Oulx l es seigneurs de Nevacheavait sa porte principale tapissée de têtes et de pattes d
’ ours .
N ous avons encore vu ces tê tes énorm es et séculaires quel e tems avai t dépouillées de leur poil , hideux souv en irs del a faune ancienne de nos montagnes .
L e dernier ours qui ai t hanté l a v al lée fut tué vers l ’ an1820 . C ’ étai t un ours débonnaire , é tabli dans la p inée de
Mon tfo l . B ien connu des paysans des env i ron s , il sorta itquelque fois en plein j our pour chercher sa pâture . L es pay
sans qui le rencon traient dans un sen tier s’
écartaient pourl e laisser passer, et lui sans m ême les regarder suivait tranqui l l emen t son chem in . U n jour i l adv in t que des habitansdu Gad a l lant moissonner une av oine l e trouvèren t couchéau m i l ieu de leur champ . I l s s
’
élo ignèrent efl‘
ray és , maisl
’ ours resta à sa place. Enfin sa confiance l e perd it. Car8
’ étant av isé d ’
al ler de tem s en tem s au clair de lune manger l es pommes des jardins s itués dessous l a v i l le d ’
E xi l les ,
357
i l fut guetté par l es chasseurs du l ieu qui firent feu sur lui.
Blessé , il repassa la riv ière et se retira dans l e b ois où on
l e trouva mort l e lendemain .
Quoique l e dro it de chasse fut réservé aux seigneurs ,les hab itans de la v allée de Bardonnêche on t librementchasse le chamois et l e li èv re de tems immémorial . Le s paysans é taient en usage de m ettre au sel la chair des chamoiset d
’
en faire tanner la peau pour s’
en vêt i r, Beaucoupd
’
entre eux, les chasseurs surtout , éta ient pourvus de v estes
et de culottes de peau de cham ois . La chasse continuellen
’
a pas empêché que ce gracieux anima l se soit reproduitdans le pays jusqu
’ à nos jours . O n prétend qu’ il s
’
accouple
quelquefois av ec les chèv res . C ’
es t peu t—être par suite d
’
un
pareil accouplement que , il y a quelques années , on a trouv éet tué dans l es mon tagnes de R ochem o l les un chamois en
t ièrement b lanc .
D ’
après la t radition , i l y avait autrefois des bouquetinssur l es glaciers d
’
Amb in . L e fai t est très probable ; car ilconste qu ’ i l y en avait dans les montagne peu éloignées desrégions vaudoises et du B riançonnais Ces bouq
‘
uet insétaien t de la superbe espèce qui existe encore dans la val léede CogueL es marm
‘
ottes aujourd ’
hui rares ont ahondé sur l es som
m ets gazonnés . L es habitan s des régions vois ines en faisaientl eur gib ier . Quelques fois ce lles qu
’
on prenait v ivan tes étaientconservées pendant l
’
hiv er endorm ies dans les greniers . O n
sait que la marmotte s’
endort d ’
habitude pendan t les moisd
’
h i ver comme l e blaireau et autres an imaux de l a montagne .
L es b laireaux han taient les l ieux rocailleux et déserts .
O n en trouve encore quelqu ’
un ,m ais i l s on t touj ours été
rares .
L ’
aigle impérial fait son n id dans les pics nuds et den
telés qui s’
élancen t vers le ciel . Quelquefois des jeunes gensb ard ie se sont hasardés a dén icher l es jeunes aiglons ; mais
L éo n , l’
h i s to rien des V aud o is, qu i écri va i t i l y a deux cen ts an s,
at tes te p o ur l es m o n tagn es v audo i ses .
O n l e v o i t p ar l a figure gravée dans l ‘H is to ire de L inu x.
c’
est toujours une entreprise dangereuse . U n jeune paysanavait découvert un n id d
'
aigle suspendu dans le précipicehorrible que présente v ers l e nord la cime rocheuse du Sèguret . I l se porta au dessus du précipice avec des compagnons ,et la au m oyen d
’
une corde i l se fit descendre en face dun id afin de s
’
emparer des aiglons . I l allait y porter la mainlorsque le père et la m ère qui v olaient au large l e v i rentattaquer leur n ichée . I ls fondirent sur lui à coups de b ec,
de griffes et d'
ai les , tel lement qu’ i l se v it perdu et qu ’ on
eut de l a peine a l e sauver.
L e grand duc n ichait auss i dans la v al lée , mais depui squelques années la race de ce grand oiseau de nuit sembleavoir été dé truite.
L e coq de bruyère et l e m erle à collier se perpétuen tsur la haute lisière des bois ; l e lagopède , la grande perdrixrouge et l
’
orto lan des neiges sur l es sommets dénudés . S ur
ces hauteurs habite auss i l e l iè vre blanc .
Les cornei lles v oltigent dans l es régions élev ées . L es co
racias y forment des troupes nombreuses et bruyan tes , qu iaimen t parfois a s
’
approcher de l’
homme. Gracieux oiseaux ,
au plumage d’
nu_beau noir luisant , au b ec rouge ou jaune ,à l ’ oeil v i f et inte l l igent , i l s animent le paysage de ces l ieuxdéserts où i ls semblent v iv re en maîtres .
rm DE LA m orsnämn E T DE R N IÈR E mu mu.
Docum en t N . 1
Con cord ia N ob i lium et Burgen s ium S ecusie.
I n no . dom ‘. am sn . an n a uati v i t . ejus d . 1 334 ind icione secunda
d ie 1 3°m eus is januarn , coram me n otario et test is infrascript i s , par
hoc p rese us pub l icum i n s trumeu tum tam presen t is q uam futuris
apparen t ev iden ter quad cum i n ter uob i les de Bartho lome i s , dc Ju
st is De Ferran dis de juven ib us et de L om b ardie de S ecusia ex una.
part s et de Ay l l iaudi s de Ascher iis de Barral ib us de dictis Cuy day s
ac Johan nem Ferran di de Burgo et Jaquemetum Mu let i de S ecus ia
ex parte al tera dissen sioues di scordie inim ici t ie guerre odia et ran
cure exorte et exortate fu issen t et adhuc essen t in ter partes pre
d ictas occas io n s occis iou is e t m ort is Hugonet i Bartho lomei in terfecti
ut d icitur et occis i per Ben ed ictum et An ton ium Ay l l iaudi fratres
fil ios Bo ndet i Ay l l iaudi quondam super qu ib us d i ssen t iou ib us i n i
m icut iis guerris odu s et ran curis sedaud is et pacifican dis v ir i l lu
str is et m agn ificu 9 Dom iuus Aym o Comes S ab aud ie tam per se quam
per eju s co n s i l iario s fecsr it et tractav erit cum part i bus autedictis
ip sas i nducendo v i is et remed i is opp ortun is u t in ter partes easdem
trauqu i l l i tatem in terponeret atque pacem perpetuo v al ituram . T an
dem me l i0res m ajores et proximiores p art ium predictarum et s erum
cuju s l ib et p lenam gen eralem et l ib eram po testatem dederan t p refa to
Dom ino Com iti concordiam trauqu i l litatem et pacem faciend i pro
n unciand i et arb i t rand i perpetuo val itu ram in ter partes p red ictas
p rout d ictus Dom i nus Comes nec n ou Jacom stus Ay l l iand i Mart inus
Barra l is pro se et ejue fi l ii s Phi l ipo neto et Bertran do et Leonetus
Barra l is , Bonedictus Barral is Bon ifacius Ascheri i Bertotn s et Johan
nes ejus fi l i i , Ascheretus de Jal l ione Con stan t iuus de Jaüione , Franciscus Cuy day Juven is Cuy day , Guigonetus Cuy day , V ui l l elmetn
Arch i“ d i Corte. Ci ttà d i S us a. Masson N . 1 8.
362
Bermandi , Jacometus Muset i , Johannes Ferrandi major et Johnn n e t u sBaral is ex u na parts ; e t V i l l s lmetus Bartho lome i , d ictus Cuy n a tu s ,
Card in as Bartho l om ei , Bertraudus Bartho lomei , Franci scu s Bartho
lomei , Bou ifacius fil iu s n atural is Mart in i Bartho l omai , An ton in s J u s t i ,Franciscn s Just i
,Heuricus fil ius Jacob i Just i
,S tephauu s Ju s t i .
Franciscus juv en is,Bufliuus juv en is , An ton in s de R ichardo Bartho
l omei , Beymaud iuus Ferran di, J ohauatus Ferrand i n epos ejue,Gear
gius Bartho lome i , Mart inus Bartho l om ai, Petrus Ferrandi et Gui
gouetus Lomb ard i ex parts a l tera.
Co nst itut i prop ter sa special iter que sequun tur in presen t ia pre
fat i Dom iu i Com it ia p red ict s omn ia confiten tur et asseruut esse vera
et p rou t etiam in iu strumeut is super hoc recept is d icitur con t iner i .
I dem Dom iuus Com es exam inat i s d i l igen ter u t asserit caus is e t o c
cas ion ib us d issent iouum ,d iscord iarum ,
iu im icit iarum , et guerrarnm
hujusmodi con s iderat isque m odo et qual ita te hom icid ii d iat i Hugone ti
et person arum d icti Ben ed ict i et An thonu et a l iis co n s idera nd ia
merito ex p red ict is maxime scanda l is et pericu l is que sub p retex t a
et d iscord ie hujus . mad i passen t et veris im i l i ter sperab an tur co n t in
gers et oriri . Causideraus i n super idem Dom iuus Comes quad sua
in terest hom ines suas fideles et sub di to s ton ers et hab ere in t rau
qu i l l ita t is statu pacifico et qu ieto , m atura et so l emni de l ib eratmn e
p rehab ita super‘
facto p redicta et co n t ingen t ib us ex eodem cum
mul t is am icis et con si l iari is ip s ius v ocat iaq ue omn ib us et s ingu l ia
part ib us suprad ict i et earum cujusl ib et quo s p resen tes hab ere p o tu it
e t p resen tib us p rop t er hoc eorum ip sa p ren omin at îs superius par
t ium predictarum tam ex sua jur id ica et dom iu iaa potes ts te q uam
ex p leuaria et l ib era p o testate sup er hoc special it s r a part ib us s ib i
data u t supra, prouunciav it arb itratus fu it: composu it et ord iuav it
super pred ict is omn ib us et singul ia et depen den tîb us ex eisdem
prout i n feriu s cout i netur.
I n p rim is p rouunciav i t , arb it ratus fu it composa it et ord i n av i t
pacem t rauqu il l itatem et s tatum qu ietum i nter part es p redictas e t
s ingulares personas earum et s ib i quomodo l ib et adhsroutes qui p re
sen tem pranun ciat ionem et om n ia in sa con ten ts rat ificu em ut i nfra
fes tum proximum pasch0 .
I ta tam en quad ab omu i ofl‘
en s ioue,injur ia et damuo facie nd i s
v el quomodo l ib et i n fereudi s con tra partem al t s ram in terim ab s t in ean t
pen it a s atque cessen t perpetuo va l ituram et duraturam rem is s is a
part ib u s b in o et inde omn ib us i uim iciti is od i is d issen t iouib us et ran
curis existen tib u s et que fueru nt n uque ad d iem p resen tsm occa
sions facti predict i , cont iugsut ium et emergeut ium ex aodem in ter
suas pacem securits tom b onam val an tatsm et fldow eidem An thon io
p erpetuo firm iter ob servari sub p en is p redictis ques incurran t et
so l van t n t sup ra qui et quo tien s in cont rariam p resump serit a t tem
p tare p rese n t i p rouuncia t ione e t arb itramen to u ih il om in n s perpe tu o
val i t uria ut s up ra . I tem cum Hugon e tus Ay l l iaud i fil ius n a tura l is
d ict i R o ndet i Ay l l iaud i acciai cu lpab i l is d iceb a tur f uerit par cur iam
prefat i D.n i Com it ia supra facto p red icta u t d ici tur seuten tia l i ter
ab so lu tu s et pronunciatus i ncu l pab il is et i nn ocen s ab homicid io eu
p ra d ioto , ig itur idem D.nus Comes secuudum sen ten t iam a b so lu t io
n is p red ictam p rouun t iav it et arb i tra t us fuit ip sum Hugo n etum f o re
adm it teudum et rest itucndum ad l auum p red ictum S ecusie ip sumq ue
i n presen t i p ronunciat ioue arb itram en to et con ten tis i n s i s cum ea
rat t ificaverit in cluait n om i nav i t ex n ano p ro extuua cum ra t t ificn
t io nem fecerit supradictam e t pacem t rauqui l l itatem , b ouam vo l un
tatsm et fidem e idem Hugoneto Ay l l iaudi par partem a l teram e t
s ingulares p erson as ip s ius v o l a it p recep i t prouun t iav i t et ord inav i t
firm i ter ob serv ari sub pen is p redi ct is comm it tendi s et so l v en d is
n t supra.
I tem p rouunciav it arb i trat us f uit e t ordi nav it d ictus D.n us Com es
quad nu l lus de parts d icto rum Ay l l iaudorum ,Asahoriœ um
, Barra
l ium et d ictorum Los Cuy day s par se v e l p aral ium po ss iut vel s i b i
l ics at v e l quomado l ib et e t presuma t p reb ere v el impendere aux i l ium
cous i l ium v el favo rem an t mandatum a l iquod recep tati ouem vel con
ss usum d ict is Benedicto et Autho n io vel al teri ip sorum ad ofiend eu
dum d amn orum dandum v el iujuriand um al iquem v el a l iquo s de p ar ts
a l tera d ictorum Bartho lomeo rum J us torum Ferrandorum Juvan ium
et L omb ardorum in p erson is vel reb us sub pred ict is peni s ques i ncu r
ran t e t so l van t qu i et quo t ien s in co n trarium presump seri n t a t te n
t are. Pred ict is om n i b us sup ra et in fra scrip t is u ib i lom in us firm i te r
et perpet no v a l i turis . U t au tem p ress ns arb i trrimon tum et p ran a n
cis t ia cum omn ib us que con t in en tur in ip s is firm ite r ob serv eutur e t
ad am b igu i tatem et matariam cujusl ib et d issen s ion is to l l endas idem
Dom iuus Comes expresso couseusu pren om inatorum superius v o le u
t ium et coussn tien t ium reservav it s i b i p otestatem sup er p redi c t is
om n ib us et s ingu l ia con t ings ut ib us e t dependen t ib us ex ei sdem i a
t s rp ret and i mutaud i corrigen di et declarand i quo tiescumq ne et p ro u t
s ib i v ideb i tur exped ire. I ta quad i n terpreta t io mutat io correct io e t
decl arat io quae et quandocumque d ictus Dom iuus Com es su per h i i s
duxeri t facieudas lim iter et in v io lab i l i ter a part i b us_sup rad ict i s u t
supra deb oe t ab sorvari su b p en is p red ict is comm it tend is e t so l v en d i s
m odo et forma p red ictis . V o len s et p recip isn s dictus Dominus Com es
fieri de predict is et iufrascr ipt is p lura sub eodem ten ore pub b l icare
in strumen t s pro ipsa Dom ino Com ite et qual ib ot d ictarum p art ium
et s ingu l arib us person is earn ndem qu i super hi is v o luerin t i n stru
m en tum hab ere et quad p red ict s d ictari deb es n t corrig i refici et
em endari ad in ton t iouem ip s ius et ob serv an tiam p red ictarnm parita
rum con s il io semel vel p l uries quot ien s fuerit O pportun um . Qu ib us
om n ib us suprad ict is s it iu tel l ig ib i l iter arb itrat is prouunciat is decla
rat is et recitat is ut sup ra coram tes t ib us i n fra scrip t is presen t ib us
p erso n i s part ium p red ictarnm superius n ominat is et p rop ter hoc
con s t it ut is in presen t ia prefat i D.u i Com it ia ip si‘
superius n om inat i
part ium pred ictarnm om n os et s inga l i grat is ac v o lu n tat ib us su is
spo utaneia et ex eorum cert is scien t i is omn ia et s i ngu l a sup rad icta
p ro nunciats a rb itrata decl arata et ordi nata par p refat nm D.n um Cc
m item u t supra laudaverun t rat ificav erun t et co nfirm s verun t ex
p re sso . Prom it teutes ip si p art iam pred ictarnm n om in ati superius et
eorum q u i l ihet p er juramen ta sua super can ots de i ev angel ica cor
pora l iter p red icts et sub eXpressa hy po theca et ob b l igs tion e om n ium
b o n orum suo rum presen t inm e t‘
futuraram quoruucumque pred icts
om n ia e t s ingula p ronunciata declarata compos ita et ordina ta per
dictum Dom inum Com item et supra u na cum aln s in fra scrip t is rat s
grata et firms ten ore a ttendere cum efl'
ectu et inv io lab i l iter ob ser
v aro et n un quam con t ra facers vel v ou ire in toto v el in parte nec
imp ed imen tum al iquod appon sœ tacite vel exmes se , pub b l ico v el
occul te n ec con tra v en ire v o lent i quomodo l ib et con sen t ire su b p en is
p red ict is comm i ttendis et so l vend is ut supra par il l um v e l i l lum
qui con tra p red icts presump serin t at temp ts re , Predict is om n ib us et
s ingu l i s semper et val ide duraturis et firm is man s n t ib us in ter p artes
p red ictas et s ingulares p ersonas earum u t supra ren un cian tes pre
n om i nat i superius par t iam p red ictarnm ex eorum cert is sci en t iis et
v o l un tat ib us spon tanei s in b ac facto sua juramen t i s et ob b l igs t io
n ihus an tod ict is excep t ion i do l i mal i simulat ion is et m etus pet i t ion i
et ob la t io n i l ib el l i cap ie son trascrip to p resen tis in strumen t i e t cuju
sl ib ot al ter ium semp l icis p et i t ion i s inducn s v igin t i d iorum et q ua
tuor m on s ium et omn i d il a t ioui loga li vel jud icia l i juri d icen t i com
p rom issum sub rel igious ju ris jurand i fieri non dehors rest itu t io n is
in in togrum b enoficio excep t ioui omn ium predictarnm s iv e r ite et
l egit ime no n fact0rum u t supra act iou i in factum cond it ion i s ine
causa v o l ex injusta causa ex om n i al ia juri canon ico et civ i l i par
quad con tra predicts v o l a l iqua de predictis passen t facers v el v e
u ire aut in al iquo se tueri et juri d icent i goneralem renuncia t iouem
n ou v al ore n isi pœcesserit specia1ia Acta fuerint hoc apud S ecusiam
in castro in fra s a lam cas tri pred ict i V onorab il ib us in Chri s to p a tr ib us
D.no .\o «l n l pho de Mon te b e l lo ab S .
“ Michae l is Cl us i n i D.n o Mar
t in o a b .
" Just i de S ecus ia c orab il ib us v iris D.no L a n te lmo
Gay p rio ro s .
" Petri N oval icio Francisco Prepos ito Mo n t i scen isîi
D.n o l ‘«-tro prio re majoris eccles iae b ea ts Marie d e S ecu si e , V iris
n o b i l a D. no J ohann“ D.no Co rgor0 n is D.no R eymo ndo d e B e l l o forti
D.n o \‘
n l l is J ours D.no Autho n io de Claromon to D.no B ap t is ta in
Al l »n tw t‘
s i0 D.no Potro Marescs l o i b al l ivo val l is S ecus ie D.n o Ay mons
de Cam e ra , D.no Potro de V erd o ne, D.no Francisco d e S erra v a ll e,
D.n o Pe t ra d e Mo n togo l lato m i l i t ib us . V iris dücre t is D.n i s J o an ne
de Mey r iaco d ict i D.n i Com it ia canco l lario , Gu i l lelm o de Al t o sano
jud ica v a l l is S ecus ie, Petra Berre , Andrea Bouodon n e jurisp er i t i s et
e t D.n o Po tro V i lf rod i can on ico secusiens i test ib us presen t ib u s ad
p rem ises .
E go an t em Bou ifacius de Mots auctori tate iuporia l i et D.n i Cc
m i t is S ab aud ie n o tarias pu b b l icus presen s in strumeutum p er mo
repo r tnm i n p ro toco l l i s quo ndam Joa nn is Bey naud i de Burgeta uo
tarii et secre tari i ips ius D.no Com it ia par ip sum D.num Com item
m ichi comm is sis lovari feci et in pub b l icam forman redig i e tc.
Docum en t N . 2 .
An dreas L uci i .
An no d om in i m il l es im o tercen tes im o v iges im o p r imo d ie Lune
qu in to m en s is januarn actum S ecus ie an te d omum e lemo s in erie Mo
uns tern S anct i Just i p resen t ib us tes t ib us Ph i l ippa Barra l is O o sten
t iuo de Jul i an a et Henrico Barra l is omn ib us de S ecus ia .
Nover in t un ivers i et singu i l p resen s e t pub b l icum in strum eutum
in speo turi son e tiam aud ituri q uad B ov erendus in Chr isto p eter Do
m iuu s Heuricus Dei grat is a b b as Mo nas teri i S an ct i Just i d e S ocusia
n om in e sua et dict i m onaster i i reccp it in v io iuum et hab itato rem
Math iarum Andream Lucu de S al ab ertano p resen tem et recip ien tem
Da l p rotoco l l o d i B artol om eo B run etto n otario d el l’ahaz ia di S . Gius to d i
S usa, d el l’an na 1821 .
mary nm cho se demanda par n om Porc figl de Johan Nol o d e son
Murix ho par oon trarj co l moy om Porc s i day aver prom ix cho l a
moy ama Kate l ina cm sos m ugl er. E cho in ay ses che co la moy sm a
Cha te l ins ap rox des c s i hab ia p rom ix de pyg ler am so m ar i par l a
temp s as a ir hc par zuramon t Mathee che z i ap resen t fig l d e Micho
l oth de N oua l oxa Ja sc cham autra vota ha l e s tay t a nua ucia cm l a
iossa auras de sancta Maria de 0110 1 wey ma l ac de R ius a ta co s t ta l
matrim onj coutray t emt or l or zoe em tor p red i t Math s o ha em te r
ca l l s m oy sma Katel i na.
Yade N ay par la uostr pasto ral ofi ci i zo tamquam rector h e
pasto r de la an ime specialmon t em co st l ac de rius a ta he tamquam
v ichary cm l e spiritual de la reuerend i a Kri st pari m asser la ab b a
de R iuauta 10 quai masser l a ab b a s ia py s na he m ers J urid icion
ep iscopal em co st l ao he l i autri loc cho g l i so n so thm ix vn de amy
aprsx de s i zoo de m asser la ab b a tanquam sa v icarj as ia apar ten
de cercher he juvest igor l a v erita s de co s t tal p rom ixiou d i m at ri
mo nj ha de cogns scer de la cause m atrim o n ia l em la son Ja r id ici ou .
E mps ro uoy tan t quan t l a specta a la n ostro ofli cy de la v icha ria
tan qua n t uoy aucun passa he deb iu aa en t enuest iga hc cercha l a
verita par oxam inacion de tos t imouj au co le m ey eme p rod icte p ro
m iss iou m atrimon ial fay te jn ter co lmoy sm Porc No la de a n s p art
ho jnter co la m oy en Ka teri na A.l oarda de autra part .
V i s ta l e depos icioga ha l e con fess iogn deg l i t os t imouj cho par
uoy so n s tay t d i l igeutom out eXam iuay par loor saramon t z oo d e
v ithar r iners ha d e son marj ha de sm s perchacin de r iu s a ta g l i
quag l testemonj si so n deb iu essor aprese n t a l e pred icta p rom ix iou
matrimon ial fay te in ter gl i pred ith Para he Kate l ina v is t ex iamdee
aus n t vuj l a depo s icio n he la con f es s io n de ca l l s m ey ama Kat el ina
Al oarda fay ta modiaut la sa sarament N egaut cm la sos exam inat ion
al b eatu t par sa Juramen t che zam ay a n os prom ix de douar p igl er
la p redi t Para N o l s par sa mari Auon t v is t et ismdee Alchun a l otera
l a qual n e stay ta tram is sa ho m anda par fran V al orian Fi nocha (3)I n l aquai lo tera se can to n i n efl
‘
oth J ace co l chiel moy s im f ra V a
l orian om thurin cm l a cassaa de la d icth p ren antes de u‘
o s tra part
ha de n ostra auctori ta he par uost ra com i ss ion s is d i l igent emen t
exam ina par sa saram en t he deuay n t hydèm tos tim ouj la p red it
Porc No le la quai Para ay ond che se l ez he se can ton om co la m oy
sm a l o tera s is dep ox ho co n fossa par sa sarsmon t em l a aaa exami
n acion che lauoy a prom ix de pyg1or par l a temp s a sa ir la p red icts
Kate l ina Al oarda sa tal cond ici0 n z oe em chax chal py asix a sa
parj hs asoa marj he gl i soy parsn th he am i : . Auon t otiamdee v ista
— 369
la qu itacion fay ta par cost moy om Porc qu itan t costa moy sma Kate
riua de l a prom ixiou m atrimop is l fay ta in ter l or he zo i n presen
cia de t rey stud iay t he tos tim ouj degn de fay . I nca com sa parox
p ar l a tenor de la p red icts l etora he accen t v ist tu to ay tre cosa
l eque l cm l e pred iate p rom ixiou si son stay to de voor. E surc co sta
caso Aucn t ann b on couscg l _ho matura del ib ers t iou . Juancha he
demanday g l i n om de Yhu Xy it ha de la g l orio sa vergen s Mar ia
son mari . S ey en t par trib unal in l a jessia perrochia l de san ta Maria
de r ius a ta sa costa b an aha l a qual a co s t presen t hat. n oy s i os lo
sen a par n ostr trib unal ho p ar n ostro sed ia p o stulan t heregren t la
d iet m atheo cho z i apresen t che n oy doy en n ostra sen tcucia he
n o st ra declara t ion desiay rs tion en t i le pred icta prom ixiou fay te
in ter Po rc c Kate l ina che z i apresen t ads uor sauer la m a trimoujse day ten ir in ter l or ho n o . V ude n oy d ixcn a asutent ien a e de
s iay ro n a Ju cos t m od che se souer aprex E par zo che tan t
par l e depos icioga he per le con fassiogn de cagl moy sm o Porc hc
Katel ina qua n t ociamdee p ar co l le de g l i p red ith t os t imo uj a n oy
n ohe man ifes ta caso n o ap arex secund n o s t r con segl he n o s tr aui
samen t che caste tagl p ara l le ho caste tagl p rom iss iogn d icte ho
fay te in ter gl i p red ict Para ho Kate l ina cho zascha u de l or n o
passa rechuscr he che n o passa d ir de n o de no con iungesse ma
trimo n ia lmout lun cum lau tro , Cunz o sos co ea cho costs lay paral le he
p rom iss iogn se l e son s tay to d icte he f ay te cond ician a lmen t z oe au
ta l coud icion chol p ias ix agl i paren th he am ix de luna p art ha de
l autra . N i ociamdee da pay ponden t costa tal cond icion z o in l a ter
m on de la cond icion u i da p rox u i d eusy t no sogl o souerth g nun ua
capu l a carnal par l a qua] hi ab ien derroga ala l or co nd icion . N i
et iamde in fra lauegem en t de cos ts t a l cond icion n i deuay t ny aproz
n o gl i he et iamde s tay t guuu zuram en t i n ter co sta tal p romexiou
ociamdee attendu he con s ide rs che g l i p aren t he gl i am ix de luna
p art ha de l autra i n l a auegnemen t de co sta tal co nd icio n a recussa
ha de p resen t recusse he refluem al e d icte prom iss iogn l e guagl gl i
p red i th Para ho Katel ina n on son en tegnu de attender n i de compir
se tan t aucn cho l a co nd icion n o se com p isss zoe sel n o p inx agl i
paren t ho am ix de l’
une part ha.
de l aut ra secund cho n oy aucun
p ar l a l ay canon icha. V n de per caste he autre rasouoy uel cs sogn he
cau se momen taue n oy a zo che zasahun o au tre cause l e quagl adri
t amen t ho ra souoym lmeut pascom hc deb iew mouer zascun a persona
jud icaut . N ay d ixons aoutencicna hc des iay rcus caste prom i ss iogn
fay te i n ter gl i pred it Para ho Katel ina asser gnunc ho de gnuna
val or he cuglmcy s im Porc ho Katel ina par le dicte promixiou no
24
370
ossor as troyt adoucr con tray or matrim on i l un cum l autra l ib e ra n t e
ho asojon toglc de le pred iate p rom ixiou i n ter l or day fay te z o
tar Porc ha l a pred icts Kater ina O tra de zo J ncl ina noy a l a. s u p ]
cat ion hc al a requestn de m atheo de Michel et azo chi po sso n l a p ro d
maths he Kateri na caser sp on say hal o matrimouj in ter lor sa l l em n
deu sy t l a fans de la ioss ia par paral le de p resen t par l a rect o r
cnrs de la jessia aura de rius a ta l a quel n os so thm issa a co l m o v
rector uoostaut la temp cho ndex jn tord ict n oy par la p re se n t
daocun l icout ia spousand i ipsos dam m on t cho autro imped im e n t
gl c say s in ter l or cho n oy n e sauoseu prop ter quad m a tr im o n iu
non passat adimpl eri E t s ic de presentj acta v os recip ie t ia
et vos crit ic teste s .
Docum en t N . 4 .
Proclam a tion du b aron Des Adrets ana: H ab i tan s de la ra
le'
e de Pragelas ( sans date ).
Ds ras La Box nauram aoras souvann a sarcsnun nr a u ras ,
O anos am css
un n ousams au3 LB am or Das Anas rs, s em maonn s annmu s s un L .
Cam ara au Bar, canoam. nas microns na Ps ovsacr, Lvos
au s ar Auvraaas , una s t at um un sans nas CO MPAGN I E S xsarnam:r
roux ns sanvrcs nr. Dmc,L a mesuré ar nénxvsm cr au Bar sr un L :
R ama sa nana coassavaraan nas caranxuaa ar auroarrt aa Lara
Mu ssrt s sr conm saamn A sa mtsara.
L’
ou fa it comman demen t à tous l es manan ts et hab itants des
l ieux et parro isses de Mon tou l los de quelque état et qual ité
T iré des Mémo ires mas . du chano ine T u t os .
C’es t d ire à toute la p op ul at ion de la val l ée de Pragelas , sujette al ors au
p rieuré d e Men toul l es .
Docum en t N . 5 .
Cap i tu la tim accordée p ar L esd igu ières a la va l lée d’
O u lx
( 1 1 Août
Le s ieur L es Digu ièros , con se il ler au Co n seil d etat du R o i , os
p ital ne de cen t hommes d’
arm es de ses o rdon nan ces , comm aml s u t
généra l emen t au Dauphiné sous l'
autori té de S a Majesté des gen
t i l shomm eo. cap ita ines chef s et co nducteurs des gen s de guerre qu’
i l
a p l u au d it se igneur B ai l u i comm e t t re en ce tte pro v in ce, éta n t
achem iné au b a i l l iage de Brian ço nn a is tan t pour rédu ire la v i l le et
château «le Brian çon sous son o b oxssauce, comme Dieu l u i en a fa it
la grâce , que pour réprimer l es desse in s que l e duc de S av oye b â
t it aux va l lées de S ez anne et d’
O ulx e t ramen er par l a do uceur
l es peup l es des d ites v al lées au serv ice et ob éœsauce qu’
i l s do iven t
à S a d ite Majesté,ay ant our m ai tre s An toine T oy sso ire , Jean Nav et ,
Jacques Pey ro nn et , cap itain e Cl aude Arn ou s e t Jean Al lo is,dél é
gués vers lui par les d ites v al lées , et v u l eurs requ is it ion s e t m é
mo ires , leur a accordé sou s l e b on p lai s ir d’
icel l e (9
) l es con d i tion s
su ivan tes.
Premneremon t que tou s l es co n sul s,m auan s et b ab itans d es
d ites v a l lées , assem b lés en corp s de comm unau té, jurero n t e t pro
m et tro n t de reco n naitre pan s l eu r ro i et prince légi t ime Hen ry qua
trièm e,R o i de France e t de Navarre, à présen f régn ant , et lu i rendre
à jam a is ce qu’
i l s l ui do iv en t et son t t enus comme v rais et n atu
rel s fran ça is et b on s sujets .
Pro t es teron t de n’av o ir jam ai s trempé n i adhéré à aucun es l i
guos , asso ciat io n s ou in te l l igences que le feu cap i tain e La Gazette
au au tres pourraien t avo ir ou ci—devan t tan t av ec l e duc de Main s (3)
l e duc de S av oy e , que en t res en n em is de S . M. et de son État et
Couro nn e, s in s qu’
i l s v eu l en t dem eurer ferm es comme l e dev o ir
l eur comm an de au serv ice du R o i .
Prom ettan t de s’
assemb l er en arm es et s’
appo ser de leurs v ies
et m oy en s co n tre l es dessein s des en nem is,ceux de l eur p arti ou
D'ap rès une cop ie m s . ancienn e que p os sède l
’
Auteur d e cette N otice.
d‘
iœ l l e (Maj es té )May enn e.
373
autre étranger qui v oudrai t en treprendre con tre cet te prov ince , et
p rêter serv ice et o b éissan ce à cet eff et et en tout autre q u’
i l s se
ron t commandés par mond it s iour L es Digu ières , tan t qu’
i l p l aira
à S . M. l e con tin uer en la charge; don t i l 1’
a hon oré en cet te pro
v ince, garder b ien et fidèl emen t con tre l esd it s en n em is l es passages
de l eurs va l lées , au m o in s y fai re ce qu i sera de l eur devo ir sel on
l eur p ouv o i r.
E n con sidérat ion des d i tes gardes n e sera fait e l evée en leurs
v al lées de gen s de guerre si n o n de la f ranche v o l on té des di ts
hab iton s e t san s y user de v io l ence n i con train te .
L es d its con su l s , gen s (1 eg l ise . m agistrat s, man aus et hab ito n s
d es d it es v al l ées son t m is sou s la sauv e garde et p ro tection de S . M. ,
e t l e commerce l ib re pour tou te la p ro v ince l eur est accordé .
Maud it se ign eur s’ emp l o iera v o l o n t iers en vers l e R o i p our l e
s upp l ier de l eur confirm er et m a in ten ir l eurs p riv i lèges et l ib ertés
accou tum éos .
N e sera inn ovéc aucun e cho se au fait de l a rel igion catho l ique ,
apostol ique et rom aine, n i aux o fficiers de just ice , s in s iou iron t l es
ecclésiast iques de leurs b énéfices , jurid iction , d ro i ts et routes àaux apparten an s .
N o recevron t aucun s gen s de guerre dan s l eurs v al lées si n on
que par l e comm an demen t exp rès du R o i ou de ses l ieu ton s n s
généraux.
La garn ison de la b arricade pour l e m ais de jn i l l et'
ds rn ior et
p our le présen t d’
août sera et pou r l’
aven ir l a d ite
garn ison es t cassée, s i n on que l es d it s con su l s et hab i ton s l a
v eu il l en t m ettre du co té de Chaumon t pour s’opposer aux étrangers .
T outes injures passées et survenues à cau se des p récéden s troub l esseron t oub l iées comme choses n on adv enues
,et n
’ou sera jamai s fai t
recherche , à. p eine aux con trevenan s d’
être cb ât iés comme désob éis
san s a S . M. et in f ractours du rep os pub l ic ; n otamm en t pou r ce
q u i est advenu en l’
exécut ion de feu capi tain e La Gazet te et de ce
q u i s’
est en suiv i , vu que par ses p ropres écrit s i l apport de cr ime
de l éze majes té qu’i l commet ta it con tre le R o i n o tre airs et l a
ru ine qu’
i l att ira it sur ce Pay s .
E t d’
autant que Pour.harrà et La—Pl anche qu i av aien t charge
s an s le d it La Gazette se t rouv en t fau teurs et principaux mo t ifs
l‘) O u amat ici et p l us b as des d i spos itions de détail qui n e p arais sen t p lus
a vo ir d’
in térêt.
L isez mo teurs
— 374
des menées du d it La Gazette , ayan t même iccluy Poncharrà d e p u i
son décès pris une compag n ie en la gendarmer ie du duc de S a v o v o
m aud it seigneur en v ertu de son pouvo ir et p our l‘
assuran ce d u
présen t trai té l es a b an n is de coq val lées avec commandem en t a u :
officie rs du R oi de l es sa is ir et appréhender en cas qu’
i l s y v i n s
pon t , pour en faire just ice exemp laire .
Fait à O ulx le 1 1 jour d ’août 1 590.
Les s art:sas
Par maudi t S eigm r
From
Docum en t N . 6 .
L es hab i tan s de la Parroisse de S al ber tran d de‘
l ibére nt d e
rep ren dre l’
usage imm émore‘
de rep résen ter l‘His toire de
saint Jean Baptiste leur p a tron . L’
Au tori té ecclés ias tique
app rouve et se réserve un con trôle (29 Mars
V ans ran. coacnusxos nas m amans un S u san n a roux LA auras
saarrrxoa ns LA vn: nr m aman au smaaauns cx rat aaasnus ns
N. S . J. 0 . S AI N T Jam —Barman .
Au nom de Dieu soi t am s n . L'au de grâce m i l six cen ts soixan te
doux et l e v ingtneufvième jour du mais de may à S alabcrtan dan s
Les originaux son t en l a p ossess ion d e l’
Auteur de l a N otice. O n peut vo i r
p ar ces d ocum ens comb ien l es h ab i t on s du Pay s cons i déraient comme un acte mi
ri to ire de dévot ion l a rep rés en tati on d es drames rél igieux, et com b ien usage de
ces rep résen tations éta i t ancien . S al b ertrand f ut rel ev é de s on v oeu p ar archevêque
de T urin en 1 708 ; néanm o in s l’
H istoi re de sa in t J ean Bap ti ste y fut en core repre
s en téo d ep u is l ors .
U n e R el at ion de 1 725 nous donne une idée de ces rep rés en tati ons . Le théatre,
d it—el l e, fut con struit desso us v i l l e, ay ant son aspect du co té de S al b ee (mais
à l a tro is ième journée on fit l a représentat ion dans égl ise à cause de la pluie ).
376
tire dud it sa int, à cet te cause et seu l le inten t ion ce son t au jo rd h u
assemb lés par dev ant n o taires roy aux dud it S al a b ertan s o u s s ig n <
v enerab les messire Pierre Bonnot docteur en a“ théologie p r e s t r
et curé dud it l ieu, mess ire Miche l Bouv et p ros tre et rect e u r d e
chapel les , e t tous les chefs et part icul iers de lad ite comm un a u n
les sachan ts écrire , lesquel s pour eux e t leur successeurs à l’
a d v e
n ir e t noub s l e b on p la is ir de l eurs s upérieurs tan t sp iri tu e l s q u
tempo re l s o n t de nouv eau approuvé ratt ifié et confirmé le d i t v o s
et de representer l a d ite histo ire pub l iquemen t dans deux a n s n*
p lus tot s i faire se peust , en recompeuse d e t an t d e f av eur s q u’
i l
o n t recen s a de Dieu par les mérites e t in tercess ion d e ce g l o r ie u .
sain t , n o tamm en t que pendan t l’
étab l iss emen t de la d i te estap e au
cun s in is tre ma lheur ny acciden t n‘
est arriv é dans ce l ieu so i t p
acciden t d e mo rt ou au tre, a in s i qu'i l a es te no t to ire à tou s , g ra
ces à. Dieu, et ce av ec l a p l us grande dévot ion et dans le m e i l l eu a
ordre e t condui te qu'i l sera p o ss ib le d e faire sans fa v e u n
ny excep t io n de p erson ne . E n execut io n de quoy i l a es te t ro uv é
b o n d’
estab l ir l es sep t comm is d'
en tre l es di ts part icu l ie rs q u
on t es te n ommés d imanche dern ier par l a d i te assem b lée, qu i s o n t
l es ensu re (su ivent les n oms) ; d es personn es desquel s a es t e fa i t
choix de la d ite assemb lés par la cuei l l is des vo ix,e t auxque l s e l l e
a par l e p resen t donné pouv o ir'
soub a le b on p la is ir de q ui de s su s
d’
agir n egocier et geus ra l l sm sut faire pour l'
execut ion du p rés e n t
et su i van t l e mérite du fai t ce q u‘
i l s j ugeron t faisab l e et usee s
saire , e t aux quel s lesd its part icul iers se s o n t soub m is jusques m e
sm es que , s i uug o u p lusieurs d‘
en tre l es acteurs de la di te hi
s to ire se t ro va it°
m un i du reo l l s d'un person n age du quel i l s n e
fu ssen t décl arés propres, de p ermett re qu'i l s soien t changes po ur
un au tre ou ent ieremen t deschen s i par lesd it s comm is ceta it ain s i
adv isé, sans con trad ict ion , et à pein e au con trevenan t de tren te
l iv res d'
amende, à la que l l e i l s se son t soubm is , app l iquab ls moit ié
à l'ég l ise ou reparat ion s d
’
ice l l s e t l‘
autre mo it ié aux frais de
lad ite represen ta t ion . E t iceux comm is i ncl inaus à l'accep tation de
l ad ite charge o n t prom is et juré de b ien et fidel lemeut verser au
fa ict d’
icel le av ec le p lus de s incer ité, p ro b i té , ass iduité et deschargs
l eurs co n sciences qu'il leur sera p oss ib le, sans uéau tmo ings pouvo ir
p rétendre aucun d egravent n i salaire de la charge à. eux com
m ise . E t d 'au tan t que pour le mérite et i s iet don t au present il
Mo t peu intel tig ib l e. q ui ras sem b l e à p ure
l‘) L is ez d egrév emcut
— 377
co nv iendra faire b eaucoup de despen ss s e t fra is extraordinaires, i l
a este d iet et con venu que l esd i ts comm is auron t pouv o ir de co tt izer
sur l e chascuu desd its acteurs l a somm e qu i leu r sera taxés su ivan t
l e ro l le qu’i l s en feron t, e t qu
'au regard de l
’emp runt des hab i ts
cb aseun desdits acteurs endro i t S oy tachera moy en de se pourv o ir
à. ses fraia et despens , et le cas eschs an t que que lqu'un d
‘
iceux
n’eu st le créd it ny l ed it m oyeu dud i t emp run t i l sera tenu d
’
ad
v ert ir l esdi ts comm is deux mo is au paravant l e jour q ue l a d ite
represen tat ion se f era, à. peine de pare il le am ende q ue dessu s ; et
en ca s que quelques uugs desdi ts acteurs ay en t b eso in d’
a b sèn ter
les jours qu i seron t dest inés p ou r l’
exercice de l ad ite h is to ire ,
audi t ca s i l s seron t tenus de dem ander co ngé auxdi ts comm is ou àl'u ng d
’
iceux, à. pein e , pou r chasque fo is qu
’i l s se t reuv erou t
ab seus , de cinq so l s san s excuse légit im e. Ain si que dessus est
escript , l esd its comm i s et particul iers , l e chascuu en tan t que l es
touche et co ncerne, on t p rom i s et juré av o ir l e p résen t acte et tout
l e co n tenu en icel u i p our agréab le ferme et stab l e san s y co n tre
v en ir de dro i t ny de fa ict , à. pei ne de tou s deepen s dam in téret,
sou s ob l igat ion de tou s leurs b ien s p résen t s et adv en ir , dues re
n o néiat io ns et cl au ses in terv en ues ; et quan t à la somme à laquel lelesdi ts acteurs seron t co tti sés par l esd its comm i s
,i l a este d iet que
chascuu endro i t soy pay era sa cotte dan s deux m o is après qu'i l
sera mun i du ro l lé de son perso nnage, n ous dison s dan s deux m o i s.
De quoy et tout ce que dessus i ls on t requis le presen t , fait et
p ub l ié aud it l ieu en présence des son saigués et au tres n e sacb au ts
escr ire de ce requ is .
S uiven t les signatures d u curé, du chap ela in et des p articu l iers ,
occup an t p rès de deux p ages
E t n ous n o ta ires royaux en foi soub s ign éa.
M. Dam n n ota ire.
CO S T E n otaire.
Nous Jean Al lo is docteur en a.
te théo l ogie, chan o ine et sacrista in
de la p révôté saint Lauren t d’
0q et v icaire général de rev en u
d iss ime et père en Dieu mess ire R ené de Biregue p révôt et
perpétuel commeuda tnire de l ad ite prévôté, ayan t v eu l’acte du
v eau ci devan t escrip t , avon s iceluy l oué approuvé et confirmé,et
C'es toù d ire de s on co té, à p art s o i
o rdo nné qu'
i l sera exécuté selon sa forme et teneur l'hy st o ire do n t
s’
ag it , préa lab lemen t par nous veiie, exam inée et corrigée , et a
co nd i t ion que les acteurs qui auron t été cho isis par l es comm i s en
seront trouvés capab les : de quo i nous nous réserv on s semb l ab le
m eut la con no issance afi n que l e tout se passe à. hon neur e t g l oire
de Dieu et éd ificat iou du prochain . De quoy avon s fai t l e p résen t
s igné de nos tro main et scel lé du scol de m oud it seign eur l e p révôt .
Ce neuviesme apvri l m il s ix cen t s bo i l ante tro is .
Am ora
vicaire gen era l .
Docum en t N . 7 .
L e daup hin Gu igues ratifie et homo logue les transactions stip u le'
ês
en tre les S eigneurs de B ardonnêche et les H ab i tans (1 4 J n in
I n nom ino dom in i amsn . An n o m i l lesimo tricen ts s imo triges imo
in d icione treds cima d ie quarta decima m ousis inu i i apud V l t ium
D'ap rès une cop ie an cienn e que p ossèd e 1
’
Au teur d e ce tte N otice. Co d ocu
m on t manque d ans l a p ub l ication des S tatuts de Bard on n êch e fai te p ar Faucafi
Par s eaw .
Le Dauph in fut pui s reconnu expressémen t comm e suzerain et p arier p ar l es
s eigneurs et les hab i tons de la v al l ée de Bard onn êche d ans un acte du 22 jn iu 1 332.
d on t l‘
a van t —Paus q a rap po rté l e texte et dan s l equel on l it : I l lus tris p rincep s
Guigo d al p b in us . ex v n a p arte v iri uob i l es dom in i Hugo et Francis cus de
B ard ouesch ia m i l i tes et Gui l lelm us c_h ay s s ind icus et s ind icar io n om i ue v n iuers i
tatum B eo l l arum R ocham o l larum . ex al tera. . feceruut i n ieruut et in ter se
p acto exp res s o v al l aueruut vn ioues p acte con ueu tioues con f éderat ioues et l igas que
in ferius describ uutur. Dalp b iuus v n iuers itates uob i l es et h om in es vn iuers i tatum
h aheat ten s at in grati s. et facers tanquam suce p ropri os et fid el es ip so sq ue n o
b i l es v n iuers i tates et hom ines i auare et s eq ui s e p ro s is guerram et p l aci tum ta
cers . v l tra co l l es m on ti s J sui et E sca l e d um taxat et sp ecial i ter con tra com i tem
S ab aud ie. et v icis s im p renom inat i Hugo et Fi anci scus de B ard onn esch ia sy n
d ieus et hom in es . couusuerun t p rom isernut Da lp h in o . Da lp hin um et successo
res ha b ere et ten ore tan qm dom i n u s eorum sup eri ores et con sortes p ro con
aortic et p d rcr ia qua in ha b et i n B ardon esch ia D a lp h in u s et esse fld s les fam n l ar es
n ocuon i p sum . sequ i i auare. ac fortes tot i s v iri b us f acers de p l aci to et de
guerra con tra com item S ab aud ie. ,» I nsti tnti ons Briançon naisœ , I , p ag. 579 .
n o tarios pub l ions sub auuo dom in i m il les imo t reesutos im o trices im o
d ie quarta mous is iannam et p red ictam coucord iam ad p le n um
scien tos v t assereb an t p resen te volen te et consen tien te exp resse d icto
dom ino n ostro De lp hine d icte pertes v idel icet co ndom ini p red ict i
ex parte v ua v t supra et p redict i s indici suis p rop rii s uom iuihus e t
s in d ioario uom i ne hom iuum p arocb iarum prodict s rum ex parts a l ia
super ques tio ui b ns v erton t ib n s e t v en t i lan t ib us i n ter d ictus pe rtes
super dom in ic et segnoria l oco rum spectautib us pred ict is ooudom i
n is v t as soreb ant et quamp ln rib us a l i is questiou i bus et rancu r is
que oran t in ter d ictas p artes e t b ino et inde v sque in d iem p re
sen tem t ran siger iu t pop igori n t coucordauerin t et coucordiam
feceriut i n ter se et v iciss im et in oodem m5do et forma in omn ib us
et p er omn ia v idel icet s icat f ocorn n t dom inns Franciscu s de B a r
d onn e schia ex parte vua e t p redicti sind ici hom inum parocb iarum
pred ictarnm ab parte a l ia , vt i n predicto iustrumeato facto per d i
cto s Ben ey thon um et Jo rdannm notarios de v erbo ad v erb um p l e
uaria con t ins tur Prom it toutes diot i coudom iu i v idel icet qusm l ib e t
ip so rum secundum quam ip sum tangerit vel tangere p osai t p ro
con so rt io suc l ocorum p red ictom m et dioti sind ici sub ati tn t i p rop ri o
uom ine su i et s ind icatorio nomine quo supra . v idel icet v ua p a rs
al teri ad inu icem et v ici ss im so lempn ib us s t ip u latiou ib ua hiuc in d e
i n t o ruen ien t ib us e t corporal itor ad saucta dei ouango l ia iurauer in t
n ec n ou m ih i Ben ey thouo m an rol l i et I ordan o de tb iocla n o iar i is
pu b l icis et person is pub l icis s t ipu lant ib u s et recip ien t ib u s v ice e t
uom in e omn ium e t s ingul ornm hom iuum et person arum p arocb iarum
p rod iotarum et eorum heredum et successorum in perpetunm i n
quan tum ad quem l ibot ip sorum specta t et spoetare°
p otest ac iu t e
rosse v el pertiners comun iter ve l d iuis im pred ictam coucord iam e t
cap itn la v n iuersa et s ingu la pact ionnm et counen t ionum prin i leg io
rum p rom is »ionn m ob b l igat iouum l ib ertatum coucos s icnum et afirau
cb im s n torum et omn ium al iorum concessorum sup ra [d icto rum ] a d
m odum et formam p°
red ictam et s odom m odo et s im il i forma qu ib u s
co n t iuetur in i ns trumen to p red icts conco rd io d iot i dom in i Fran ciac i
et om n ia et s ingu la sub scrip ta (3
) et in frascrip ta p erpetuo hab ere
firm s e t grato et toners et n o n coutrafacero . I n super pred ict a
dom inn s Delphinus pred ictam couco rd iam factam per d ictum d o
m i num Franciacum n oc non couco rd iam facto_m par d ictus dom i
L is ez q uil ib et
L isez quod
l3) L is ez s uprascrip ta
384
I I I . La V i l le de S use au m oy en fige. S os monumen ts
1 . La V i l le
2. Les monumen ts
L r C le rgé
L‘
Ab b aye d‘
O u lx et le prieuré de S ain t Marie de S use .
2. L ‘Ab b ay e de sain t J us t.
3. L'
Ab b ay e de la N o vala ise
4. L’Ab b ay e on Prévô té du Mon t—Cen is
. L’
Ab hay e de la C luse
6. S ain t An to ine de R an vers .
V . Des cro y an ces V aud o i ses d an s la V a l lée de l a Do ire .
V I . S i l e s S u s in s o n t été m aud i ts
V I I . L a féo d a l i té
L a féodal i té dan s la val lée supérieure
2. Ja i l l o n s,Méane, Al taret , Châ teau d ’
en tre d eux
ri fs,Matt ie .
3. Chiuaco, Busso l in ,Bruso l
,S ain t—J eo ire
4 . V i l lar Fo uchard,V i l lar Almese .
5. L es Fie fs de l ’ Ab b ay e de l a Cluse . L a Cluse ,S . An to n in , S . Am b ro ise , G iav en o , Coazze
6. Fiefa de la m a ison de R i val ta , T ran a , R ean o etc.
7. S ai n t An to ine de R an vers. L e Fief T ran scorné .
V I I I . I n s t i tu t io ns Com m un a les
S ta tu ts locaux
X . L es O euvres Pics
XI . Cu l ture in te l lectue l le, i ndustrie, commerce.
1 . Cu l ture in te l l ectuel le
2. Beaux Arts
8. I ndustrie
4. Com m erce .
XI I . L a p opu la tion
XI I I . Les p ato is.XI V . U sages d i vers
XV . Le Card in al d’ O s tie
TROISIEME PARTIE .
N O T I C E S U R B A R D O N N Ê C H E .
Le V a l l on de Bardonn êche
S ouv en irs ce l t iques L es ro is des Al pes L es B o
m a ius L es Burgundes L es'
Fran cs Charle
m agne L es Com tes de T urin O rigin es d e l a
Féod a l i té l ocal e
État du pay s sous la Féoda l i téLes Chateaux forts
208
269
V .
_ 385 _
L es seigneurs du Moyen âgeL es statuts l ocaux.
S ouven irs re l igieux et superstition s
Ancien s U sages
Les T om s m odernes L ’am ira l Des
L e percem en t des Alpes
L e Passé et le présen t
APPE NDICE .
L ’ Ab b ay e d’ O u lx
L a Cocotte
L égende de sa in t JustL égende de sain t E ldred
L es E sp ri ts et les S orciers
L ’ in struction et les Arts d ’autrefo is
L e pato i s
L a Fl ore et l a Faun e
DO CU ME NT S .
1 . Coucord ia N ob i l ium et Burgeus ium S ecusie ( 1 3 jui l let page 361
2 . Andreas L uci i
3. S en tenz a in causa m atrim on iale tra Caterina Al oarda, PietroN o l e e Mateo d i Michelet d i Nova lesa , p rouuuz iata dalV icario Ab az ial e de l l ’ Ab az ia d i S . Pietro e Andrea d i
R i va l ta e red atta i n d ialetto p iom outese 1446
Proclam ation du b aro n Des Adrets aux hab i tan s de l a V al lée
5. Cap i tu la tien accordée par Lesd iguières à l a v allée d’ O ulx
6. Les hab itan ts de l a Parro isse de S alb ertrand delib èren t dereprendre l
’usage imm ém orial de représen ter l
’ H is toire
de sain t Jean B ap tis te l eur patron . L ’autori té ecclésia
atique app rouve et se réserve un con trôle (29 Mars7. Le Dauph in Gu igues ratifie et hom o l ogue les tran saction s
stipu lées en tre les S eign eurs de Bardonnêche et les ha
de Pragelas ( san s date )
( 1 1 Août
tan ts ( 14 juin
Fm un LA T ABL E .
366
367
370
372
374
DI PR O PR IA E DIZIO N E
Ab b a G. 0 . Da Quarto al V o l turno , n otorel lo d’
un o d e i Mi l l e.
l . ° e<l is . co n agg iun te 1899 un vo l . i n - 1 6 . L . 2
Bugg i Francesco Memorie, edite da Co rrado R icci 1 898
«i ne v o lum i ia—l i i . 5
Del l a R occa ( general e) E nrico Autob iografia d i u n v e te ran o ,
rm …l i s i » r1ci o auedo t tici . V o l . I . ( 1807 - 1859 ) V o l . I I .
l a f.‘ i S econda ed iz ione 1 898 Duo v o l ] . in — 1 6
ccm ritra t t i .
Frignani Angel o La m ia pu nis ne l le carceri . Mem o rie a u t o
ln ng rafiche d i u n patrio t to romagno lo per l a prima v o l ts p u b
hl ica te in I ta l ia , e procedu te da uno s tud io sul la R es tauras ion e
p a i l l i ,'ir i6 in R omagn a e Angelo F n
‘
gnan i , d i LU IGI R a v 1
u n v o l . in - 1 6 co u r itratto . 3
Hel fert Baro n s v ou ) La cadu ta del la dom inaz io ne fran ccse n e l
I ta l ia e l a congiura m il i tare Broscian o-Mila nese n e l 1 8 14 .
'
l‘
raduz ioue co nsen ti ta dal l‘autore di L . G . Cusau i Co ufal o n ieri .
Cou un'
appoud ice d i document i 1894 un vo lume . 4
Jack La Bol ina V it torio V ecchi ) La v i ta e le ges ta d i Giu
s eppe Gari b ald i con una l et ters d i Giosuè Cardncci 1 884
un v o lum e con ritra t to e fac—s im i l i . 4 50
Minghett i Marco L a Co nv ouz io us d i S et tomb re (U n cap i to l o
d e i m ici r icord i ) Pub b l icato por cn rs del Prin cipe d i Cam
p o reale 1 899 un v o l ume in—8 . 5
Quintaval le Ferruccio U n mess d i rivo l nz ioue a Ferrara1 7 Feb b ra io 6 Marzo 1 831 ) con p refaz io no de l prof . Fran ce8 0 0 Berto l in i 1 900 un vo lume in—8. 6
U gol etti Antonio Brescia nel la r ivo l nz ioue del 1848-49
S tud i o r icerche co n u na rel az ione in ed ita del l e X g iorn ate , d o
cument i , no t iz ie b ib l iogr. ,u na cronaoa del le commemoraz ion i e
V I I I tav ol e i l lustra t ive 1899 u n v o l ume i n -8. 6
V icini Gioaoohino Giovan n i V icin i, g iurecon su l to e legis latore ,
p res iden te del gov erno del le p rov incie un ite i tal iano n e l l’ann o
1 83 1 Memorie b iografiche e storiche co u nuov i documen t i
S econda ediz io ne 1897 un vol . iu -8. 6