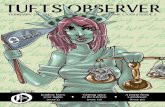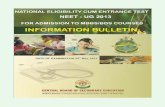Observer les mobilisations/Observing mobilizations
Transcript of Observer les mobilisations/Observing mobilizations
OBSERVER LES MOBILISATIONSRetour sur les ficelles du métier de sociologue des mouvements sociauxHélène Combes et al. De Boeck Supérieur | Politix 2011/1 - n° 93pages 7 à 27
ISSN 0295-2319
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-politix-2011-1-page-7.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Combes Hélène et al., « Observer les mobilisations » Retour sur les ficelles du métier de sociologue des mouvements
sociaux,
Politix, 2011/1 n° 93, p. 7-27. DOI : 10.3917/pox.093.0007
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour De Boeck Supérieur.
© De Boeck Supérieur. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
Dossier
Observer les mobilisations
Coordonné par Hélène Combes, Choukri Hmed, Lilian Mathieu, Johanna Siméant et Isabelle Sommier
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
Volume 24 - n° 93/2011, p. 9-27 DOI: 10.3917/pox.093.0009
Observer les mobilisations
Retour sur les ficelles du métier de sociologue des mouvements sociaux
Hélène Combes, Choukri Hmed, Lilian matHieu, Johanna siméant, Isabelle sommier
Résumé – En quoi consiste aujourd’hui la pratique du chercheur étudiant les mouvements sociaux ? Com-ment stimuler l’imagination sociologique au moment où se manifeste une triple routinisation des objets, des schèmes d’interprétation et des arts de faire méthodologiques dans ce domaine des sciences socia-les ? Il ne s’agit pas ici de céder à certaines formes de « méthodologisme » en proposant une méthode, ni a fortiori « la bonne méthode » d’étude des mobilisations, détachée des enjeux de connaissance propres à chaque recherche spécifique. Plutôt qu’un durcissement méthodologique ou la promotion d’un modèle standardisé d’approche empirique des mobilisations, l’article et le dossier appellent à un retour au prin-cipe d’unité des sciences sociales, seul moyen de ne pas se couper de pans entiers de la recherche en train de se faire et d’avoir quelque chance d’ouvrir de nouvelles questions. Penser et regarder autrement les mobilisations, c’est ce à quoi invitent donc les chercheurs réunis dans ce numéro, en suggérant en particulier de mieux prendre en compte l’inscription des mobilisations dans le temps, l’espace et l’ordre social.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
10 Observer les mobilisations
En quoi consiste aujourd’hui la pratique du chercheur étudiant les mou-vements sociaux ? Comment stimuler l’imagination sociologique au moment où se manifeste une triple routinisation des objets, des schè-
mes d’interprétation et des arts de faire méthodologiques dans ce domaine des sciences sociales ? Il ne s’agit pas ici de céder à certaines formes de « méthodo-logisme » en proposant une méthode, ni a fortiori « la bonne méthode » d’étude des mobilisations, détachée des enjeux de connaissance propres à chaque recher-che spécifique. Plutôt qu’un durcissement méthodologique ou que la promotion d’un modèle standardisé d’approche empirique des mobilisations, les textes pro-posés dans ce dossier suggèrent un retour au principe d’unité des sciences socia-les, seul moyen de ne pas se couper de pans entiers de la recherche en train de se faire et d’avoir quelque chance d’ouvrir de nouvelles questions. Penser et regarder autrement les mobilisations, c’est ce à quoi invite donc ce dossier, en suggérant en particulier de mieux prendre en compte l’inscription des mobilisations dans le temps, l’espace et l’ordre social 1.
La routinisation d’un sous-champ académique
Tout domaine d’étude spécialisé s’expose, après une période d’expansion marquée par l’inventivité méthodologique et conceptuelle, à connaître une phase de routinisation voire d’essoufflement. Il faut y voir une conséquence directe de la spécialisation : l’autonomisation d’un domaine de recherche autour d’un ensemble de travaux fondateurs ou de démarches innovantes conduit pro-gressivement à un enfermement dans un corpus de références et de débats obli-gés, qu’accompagne une certaine surdité à l’égard des discussions qui traversent les autres secteurs des sciences sociales 2. C’est là sans doute le principal péril qui guette à l’heure actuelle l’étude des mobilisations et du militantisme, à la recherche d’un second souffle après avoir connu un développement considéra-ble au cours des vingt dernières années. Les revues spécialisées constituent un bon indicateur de cette succession de dynamisation et d’assèchement de l’ima-gination sociologique. Les deux principales revues internationales, Mobilization et Social Movement Studies, ont été fondées assez récemment, respectivement en 1996 et 2002. Initialement semestrielles, elles ont toutes deux connu une accé-lération progressive de leur rythme de publication et sont aujourd’hui trimes-trielles. La consultation de leurs sommaires laisse cependant une impression de répétition, voire de ressassement. La multiplication des enquêtes ne semble guère s’accompagner d’innovations majeures, et l’application d’anciens cadres d’analyse – ressources organisationnelles, structure des opportunités politiques
1. Ce dossier s’appuie sur un séminaire mené pendant deux ans au CRPS (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), intitulé « Observer les mobilisations » et animé par les auteurs de ce texte.2. Voir, pour un autre exemple, le « second souffle » de l’analyse des politiques publiques : Hassenteufel (P.), Smith (A.), « Essoufflement ou second souffle ? L’analyse des politiques publiques “à la française” », Revue française de science politique, 52 (1), 2002.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
Hélène Combes, Choukri Hmed, Lilian matHieu, Johanna siméant, Isabelle sommier 11
93
(SOP), analyse des cadres… – à de nouveaux terrains n’ouvre bien souvent que sur leur amendement à la marge. Si la recherche française en la matière, initiale-ment moins enclavée que celle en langue anglaise, a su faire preuve d’inventivité en combinant les apports de traditions de recherche variées (ceux de la socio-logie bourdieusienne et de l’interactionnisme, notamment), elle n’en laisse pas moins percevoir, elle aussi, des indices d’une certaine baisse de dynamisme.
Les deux dimensions de cette routinisation, conceptuelle et méthodologique, sont intrinsèquement liées, car inhérentes aux choix de construction de chaque objet de recherche. Elles gagnent cependant à être appréhendées séparément. Les travaux fondateurs d’un domaine d’étude lui donnent de fait une tonalité théo-rique que les recherches suivantes tendent à reconduire sans toujours l’interro-ger. Si la publication, en 1965, de The Logic of Collective Action a indéniablement donné l’impulsion décisive à une sociologie des mouvements sociaux débarras-sée des présupposés d’irrationalisme des approches antérieures (celles du com-portement collectif ou de la frustration relative, notamment) 3, cela s’est fait au prix d’une conception étroitement utilitariste de l’action humaine, longtemps posée en implicite et que commence seulement depuis peu à contester la prise en compte des émotions (ainsi qu’en atteste l’article de Christophe Traïni dans ce numéro). Les concepts fondamentaux – tels ceux de ressources, de répertoire, de rétributions, de cadre ou encore de carrière – se trouvent de même fréquem-ment réduits, faute d’être régulièrement revisités 4, au statut de boîtes noires ou de labels identitaires d’écoles.
Le risque de routinisation méthodologique n’est pas moins prégnant. Les tra-vaux pionniers de Charles Tilly sur la morphologie de la contestation, basés sur des séries statistiques de longue durée 5, ont impulsé une tradition de recherche quantitative attentive à mesurer les variations géographiques ou temporelles de l’activité contestataire. Dans leur filiation directe, l’approche du processus poli-tique, en plein succès à partir des années 1980, s’est principalement appuyée sur la protest event analysis, comptabilisation des « épisodes protestataires » destinée à rapporter les fluctuations de la contestation aux évolutions de la structure des opportunités politiques. Le choix des données de presse comme source princi-pale 6 a fait l’objet de nombreuses critiques, sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Plus globalement, c’est la démarche comparative dans laquelle s’inscrivent la plupart des recherches menées dans cette perspective qui mériterait d’être interrogée. Bien souvent, la comparabilité entre mouvements prétendant à des objectifs similaires dans différents pays est prise comme allant de soi alors qu’un
3. Olson (M.), The Logic of Collective Action, Cambridge, Harvard University Press, 1965.4. Cf., a contrario, le réexamen du concept de répertoire récemment opéré par Michel Offerlé : « Retour critique sur les répertoires de l’action collective (XVIIIe-XXIe siècles) », Politix, 81, 2008.5. C. Tilly a évoqué les enjeux méthodologiques de certains de ces travaux dans « Décrire, mesurer et expli-quer le conflit », Revue internationale de politique comparée, 17 (2), 2010.6. Qui ne représente cependant qu’une partie de la protest event analysis.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
12 Observer les mobilisations
examen plus attentif pourrait amener à constater que des réalités fort hétérogè-nes se trouvent rassemblées sous une même dénomination 7. La multiplication des sites de comparaison expose quant à elle à perdre en profondeur d’analyse et en précision des données 8, ainsi qu’à se contenter de la mesure d’un nombre restreint de variables dont les spécificités ont été préalablement rabotées pour les rendre « comparables ».
Le développement parallèle de l’analyse des cadres contestataires s’est égale-ment accompagné d’un sensible affadissement méthodologique. De l’étude du « travail de la signification 9 » produit par les contestataires, la démarche s’est déplacée vers une banale analyse de contenu, centrée avant tout sur le repérage et la quantification des « cadres » que les mouvements mobilisent dans leurs dis-cours publics, et incapable d’intégrer les conditions contextuelles de production des énoncés qu’elle traite – un comble pour une approche issue de l’interaction-nisme symbolique et se revendiquant d’Erving Goffman 10. Les approches plus récentes en termes de « structures des opportunités discursives », qui tentent de cerner le contexte culturel global au sein duquel certains cadres revendicatifs bénéficient de plus ou moins de « résonance », présentent les mêmes limites lorsqu’elles s’appuient sur de semblables « banques de données discursives 11 ».
Pour des raisons qui tiennent sans doute autant à la formation des chercheurs et à la structuration disciplinaire qu’au financement de la recherche, les études quantitatives de grande ampleur sont moins développées en France, au profit des démarches qualitatives croisant archives documentaires, entretiens et observa-tions. Perçues comme plus économiques et d’un déploiement relativement aisé, celles-ci n’en imposent pas moins le respect d’un certain nombre de principes de méthode, dont la réflexivité sur les motivations et les conditions de l’enquête ne sont pas les moindres. Il ne suffit pas, notamment, de suivre des militants dans leurs diverses activités pour baptiser une démarche d’ethnographique. L’ample littérature anthropologique sur le sujet, souvent méconnue des politistes, répète à satiété combien il est délicat de tirer des enseignements généraux d’observa-tions ponctuelles et limitées de groupes au sein desquels l’observateur bénéficie selon les cas d’un inégal degré d’intégration. De fait, si c’est d’un recours plus
7. Au point que l’on puisse se demander si la comparaison contrôlée entre objets radicalement différents n’est pas plus fructueuse : cf. Détienne (M.), Comparer l’incomparable, Paris, Seuil, 2000.8. En témoignent notamment les inévitables approximations qui grèvent les comparaisons, basées sur des données de seconde main, sur lesquelles s’appuie la démarche de la « politique contestataire » ; cf. McAdam (D.), Tarrow (S.), Tilly (C.), Dynamics of Contention, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 et Tar-row (S.), Tilly (C.), Politique(s) du conflit, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.9. Snow (D.), « Analyse de cadres et mouvements sociaux », in Cefaï (D.), Trom (D.), Les formes de l’action collective, Paris, EHESS, 2001, p. 27.10. Cf. à ce propos les remarques critiques de Cefaï (D.), Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, Paris, La Découverte, 2007, p. 549-625.11. Cf. par exemple, en français, Giugni (M.), Passy (F.), La citoyenneté en débat. Mobilisations politiques en France et en Suisse, Paris, L’Harmattan, 2006.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
Hélène Combes, Choukri Hmed, Lilian matHieu, Johanna siméant, Isabelle sommier 13
93
accentué aux démarches ethnographiques que l’étude des mouvements peut actuellement espérer une redynamisation, c’est aussi à condition d’engager une réflexion vigilante sur les conditions de leur mise en œuvre.
Observer autrement pour penser autrement les mobilisations
Ethnographie, sensibilité aux pratiques et réflexivité caractérisent assurément des façons d’étudier les mobilisations qui évitent certaines impasses concep-tuelles ; rien ne dit cependant que des formes paresseuses de ces démarches ne soient porteuses de leurs propres routines.
Revenir aux pratiques protestataires et à l’ethnographie : nécessaire mais non suffisant ?
Cette réflexion vigilante quant aux modalités empiriques de l’investigation est d’autant plus problématique que la plupart des analystes des mouvements sociaux, particulièrement en France, ont fait leurs les principes produits par la « révolution malinowskienne » en anthropologie : il n’est plus question depuis belle lurette de se satisfaire d’une science de cabinet, de se contenter d’être un politiste ou un sociologue « assis » (comme on parle de journalistes assis). L’eth-nographie, comme méthode d’investigation et d’observation des mouvements sociaux et des pratiques protestataires, tend à faire désormais partie de ce surmoi professionnel, enseigné à ce titre dans la plupart des cursus 12. Mais il convient de nuancer ce constat. Notons d’abord que cette tendance est surtout hexagonale puisqu’outre-Atlantique, il est symptomatique qu’encore très récemment, un ouvrage intitulé Methods of Social Movement Research se borne à « vouloir mon-trer aux spécialistes qu’il existe une large palette de méthodes et de techniques disponibles, dont les forces et les faiblesses respectives doivent être évaluées lors du choix des méthodes qui s’accordent avec leur objet de recherche 13 ». Procla-mer en 2002 que l’ethnographie puisse être une méthode légitime montre sur-tout, a contrario, combien cela ne va pas de soi et informe au-delà sur l’inégale valorisation des protocoles empiriques. Remarquons ensuite que si l’injonction méthodologique à la saisie des pratiques protestataires par leur observation tend à se ritualiser et à se professionnaliser, elle ne doit cependant pas être pensée comme une alternative à la mobilisation d’outils quantitatifs : l’article de Julie Pagis dans ce dossier montre à l’inverse toute la fécondité, certes plus onéreuse pour le chercheur en termes de collecte et d’interprétation des données, de la combinaison des deux « méthodes ». Surtout, l’investigation ethnographique
12. Il est cependant regrettable que, contrairement à la sociologie, les cursus de science politique n’intè-grent pas (à quelques exceptions près) la formation pratique aux méthodes d’enquête ethnographiques. Un « module professionnel et pédagogique » proposé au XIe Congrès de l’AFSP est consacré à cette question.13. Klandermans (B.), Staggenborg (S.), eds, Methods of Social Movement Research, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002, p. XIV.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
14 Observer les mobilisations
des pratiques protestataires ne saurait être opposée à celle des registres discur-sifs et des dispositifs d’énonciation mobilisés ou produits par les entreprises de mobilisation. Il ne s’agit pas de penser pratiques et discours comme deux réalités disjointes – le discours est praxis – mais de restituer, au plus près de l’expérience des agents, les conditions sociales de possibilité et de félicité de ces pratiques, dont font aussi partie les pratiques discursives.
Ensuite, le recours à l’enquête ethnographique ne peut se concevoir comme seule garante d’une intelligibilité maximale de la mobilisation observée et, par-tant, de la scientificité de la démarche. D’une part, parce que les sciences socia-les se définissent avant tout, comme le souligne Jean-Claude Passeron, par leur recours à l’exemplification, laquelle « travaille à améliorer ses assertions présomp-tives par les contraintes empiriquement multipliées et sémantiquement conjointes auxquelles la soumet une grille conceptuelle protocolarisée de description du monde 14 ». D’autre part, et contre une définition minimaliste de l’enquête, parce que l’ethnographie ne s’entend que « comme une suite d’interactions personnel-les qui rendent possible la présence longue de l’enquêteur sur le terrain 15 ». Trois règles cumulatives conditionnent sa validité : l’interconnaissance, la réflexivité ou l’auto-analyse et la longue durée. C’est dire qu’à l’instar de l’analyse des poli-tiques publiques, la plupart des recherches qui se réclament de la sociologie des mouvements sociaux reposent sur un « impensé méthodologique 16 » : si l’entre-tien semi-directif est élevé au rang de « méthode incontournable » et systémati-que, il n’est souvent en réalité qu’une source à la fois trop peu contrôlée et trop limitée de production des données. Cet impensé peut s’interpréter comme le reflet de la préférence épistémique des chercheurs, rappelée par Javier Auyero et Matthew Mahler dans ce dossier, pour les données « codables » (codeable data) au détriment des données « embrouillées » (messy data). S’il est donc un défi pour la sociologie des mouvements sociaux telle qu’elle se pratique actuelle-ment en France, en Europe et ailleurs, c’est d’abord de renoncer aux étendards théoriques et méthodologiques de toutes sortes au profit d’une mise en œuvre plus systématique et mieux contrôlée des protocoles d’observation des mobilisa-tions. On pense, entre autres, à la notion de « carrière militante » qui, interprétée le plus souvent comme un équivalent de celle de « trajectoire 17 », ne conduit au final qu’à l’investigation par le chercheur des scènes sociales dans lesquel-les s’actualisent les pratiques militantes par le biais d’entretiens rétrospectifs, et omet de ce fait le principal apport de cette perspective, à savoir de penser dans
14. Passeron (J.-C.), Le raisonnement sociologique. Un espace non poppérien de l’argumentation, Paris, Albin Michel, 2006, p. 600, souligné par l’auteur.15. Beaud (S.), Weber (F.), Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2010, p. 274.16. Bongrand (P.), Laborier (P.), « L’entretien dans l’analyse des politiques publiques : un impensé métho-dologique ? », Revue française de science politique, 55 (1), 2005.17. Un colloque récent organisé par le GRESCO à Limoges soulève directement ces questions : « L’étude des devenirs biographiques. Techniques et concepts » (15-16 novembre 2010).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
Hélène Combes, Choukri Hmed, Lilian matHieu, Johanna siméant, Isabelle sommier 15
93
la synchronie et la diachronie « la dialectique permanente entre histoire indivi-duelle, institution et contextes 18 ».
« Retour aux sources »
Le travail sur les sources de l’observateur des mobilisations constitue d’une certaine manière un autre angle mort de la recherche. Il est en effet pour le moins paradoxal qu’un domaine des sciences sociales qui doive autant à un his-torien comme C. Tilly se soit à ce point coupé d’une réflexion approfondie sur ses sources – la routinisation du recours à la protest event analysis par données de presse n’en étant qu’un symptôme.
Les critiques portées à cette méthode sont connues 19 : risque de mesurer avant tout l’activité des médias, focalisation excessive sur la presse écrite, problèmes de comparabilité internationale… On sait aussi qu’une prise en compte de l’activité protestataire ne saurait être séparée de celle de l’activité répressive des autori-tés 20, ce qui suppose par définition d’investir les archives policières et permet de proposer une sociologie de la protestation qui marche sur ses deux jambes. Assu-rément, la protest event analysis fondée sur sources policières apparaît déjà plus convaincante 21, et c’est un enjeu central de la sociologie de la protestation que de s’orienter davantage aujourd’hui vers les archives des appareils de coercition 22 et du maintien de l’ordre 23 – quand c’est possible, et quels que soient les goûts per-sonnels de chercheurs souvent plus enclins à fréquenter « leurs » militants que les appareils qui les répriment ou les ont réprimés par le passé. D’autres risques se présentent alors, mais ils sont somme toute connus des historiens des émo-tions populaires 24 : comment éviter que les archives de la répression n’étouffent les voix des dominés et ne surdéterminent la lecture des révoltes ?
Le problème des sources de la sociologie des mouvements sociaux ren-voie plus largement à la question de l’extension de la quête documentaire : à
18. Fillieule (O.), « Carrière militante », in Fillieule (O.), Mathieu (L.), Péchu (C.), dir., Dictionnaire des mou-vements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, p. 86.19. Fillieule (O.), « On n’y voit rien. Le recours aux sources de presse pour l’analyse des mobilisations protes-tataires », in Favre (P.), Fillieule (O.), Jobard (F.), dir., L’atelier du politiste. Théories, actions, représentations, Paris, La Découverte, 2008 ; Fillieule (O.), Jimenez (M.), « The Methodology of Protest Event Analysis and the Media Politics of Reporting Environmental Protest Events », in Rootes (C.), ed., Environmental Protest in Western Europe, Oxford, Oxford University Press, 2003.20. Davenport (C.), Johnston (H.), Mueller (C.), eds, Repression and Mobilization, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2005.21. Fillieule (O.), Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Paris, Presses de Sciences Po, 1997.22. Nul doute que l’ouvrage d’Alain Dewerpe sur Charonne soit une importante contribution à la socio-logie de la protestation même et surtout si l’auteur ne revendique aucune inscription dans ce sous-champ académique. Dewerpe (A.), Charonne, 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État, Paris, Gallimard, 2006.23. Fillieule (O.), Della Porta (D.), dir., Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Paris, Presses de Sciences Po, 2006.24. Farge (A.), Le goût de l’archive, Paris, Seuil, 1997.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
16 Observer les mobilisations
constater comment la sociologie des mobilisations s’entête dans le ressassement des « faits, […] petits cubes de mosaïque, bien distincts, bien homogènes, bien polis 25 », négligeant de considérables gisements de sources pour qui saurait les questionner, on s’inspirerait volontiers de la sainte colère de Lucien Febvre sur les formes légitimes de la pratique historique 26… Est-il sûr aujourd’hui que faire de la sociologie des mouvements sociaux doive se résumer à combiner sources de presse, entretiens semi-directifs et observation plus ou moins par-ticipante, le tout éventuellement agrémenté d’un appareillage statistique ? Que l’usage du passé dans cette même sociologie doive systématiquement se faire au travers de travaux de seconde main 27 ?
En dehors même de l’archive officielle, à l’augmentation incrémentale, l’ima-gination sociologique a tout à gagner à mieux prendre en compte les supports à la fois matériels et symboliques de la protestation – ce qui contribuerait assuré-ment à ancrer l’appel à une prise en compte accrue de ses dimensions émotion-nelles et symboliques. Saisir le sens investi dans une révolte, c’est aussi traiter des graffitis 28, des tracts, aussi difficile que soit leur collecte, des chansons 29 et plus généralement des supports d’expression artistique de la contestation (sin-gulièrement en contexte autoritaire 30), et des multiples déclinaisons du rapport à l’écrit protestataire – autant de pistes pour mieux saisir la performativité de la protestation, comme s’y emploie par exemple Marie Laure Geoffray.
Un tel recours à ces sources supposerait d’ailleurs de mieux contrôler leur statut, souvent cantonné à l’illustration d’un sens décelé par ailleurs. C’est tout le propos de l’article d’Audrey Mariette présenté dans ce numéro que de donner à voir à la fois ce qui produit et structure le regard filmique et documentaire sur les militants, mais aussi ce que les savoir-faire militants peuvent apporter à la réalisation de ces sources filmiques, en tant que figurants ou informateurs privilégiés. De même, l’article de Christophe Traïni montre l’intérêt d’un travail historique de première main qui permette d’observer la formation et l’institu-tionnalisation au long cours de sensibilités (dans ce cas envers les animaux) qui pourront ce faisant être autant d’appuis à la mobilisation, permettant ainsi de dépasser les oppositions binaires entre stratégie et identité pour montrer ce que
25. Febvre (L.), Combats pour l’histoire, Paris, Armand Colin, 1953, p. 117.26. « Gardons-nous de sous-estimer la puissance persistante de ce vieux tabou : “Tu ne feras de l’histoire qu’avec des textes”. J’imagine un historien de la peinture édictant : “Peinture ? C’est quand on étend des couleurs à l’huile sur des toiles avec des pinceaux” », ibid.27. On souscrit en ce sens à l’appel d’Alain Garrigou : « Le politologue aux archives », Politix, 6, 1989.28. Braconnier (C.), « Braconnages sur terres d’État. Les inscriptions politiques séditieuses dans le Paris de l’après-Commune (1872-1885) », Genèses, 35, 1999 ; Loez (A.), « Mots et cultures de l’indiscipline : les graffitis des mutins de 1917 », Genèses, 59, 2005.29. Borowice (Y.), « La trompeuse légèreté des chansons. De l’exploitation d’une source historique en jachère : l’exemple des années 1930 », Genèses, 61, 2005.30. Geoffray (M. L.), Culture, politique et contestation à Cuba (1989-2009) : une sociologie politique des modes non conventionnels d’action collective en contexte autoritaire, thèse pour le doctorat de science politique, IEP Paris, 2010.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
Hélène Combes, Choukri Hmed, Lilian matHieu, Johanna siméant, Isabelle sommier 17
93
les savoir-faire militants comprennent de maîtrise, inégalement réflexive, des dispositifs de sensibilisation.
Sous ce double aspect du rapport aux sources et de la réflexivité militante, une attention renouvelée devrait sans doute être portée au rapport à l’écrit des participants aux mobilisations 31. Supports de mobilisation et de réflexion comme dans le cas de la littérature militante (textes de Saul Alinsky ou textes d’« organizing » aux États-Unis 32), ces documents écrits renseignent utilement sur les modalités du rapport des engagés à la compétence politique, héritée ou en voie d’acquisition, et constituent tout aussi bien un indicateur à la fois des formes de rapport à l’engagement et à l’institution militante 33. Les bibliothè-ques des militants sont ainsi de riches terrains d’investigation – comme l’est aussi la division du travail d’écriture dans les mobilisations –, ou encore des modalités plus intimes d’écriture chez les militants. Marie-Hélène Lechien, par le biais de l’étude de documents personnels de militants d’associations de soli-darité avec les immigrés, souligne combien ces sources permettent d’objectiver le « travail de reformulation constante du sens donné à l’engagement, activité à la fois cognitive et affective de déchiffrement de “l’autre” qui donne accès à une dimension peu étudiée des carrières militantes. L’écriture et l’accumulation de documents, […] photocopiés et annotés parce qu’ils venaient trancher une interrogation ou un doute, dévoilent une scène peu visible du travail militant, une sorte de “mobilisation de soi” qui contribue à la perpétuation des prati-ques de solidarité 34. » L’archive militante ou le document historique peut aussi constituer d’utiles appuis à la situation d’entretien, stimulant la mémoire des enquêtés et les amenant à produire des jugements plus armés sur des mobilisa-tions auxquelles ils ont participé 35.
Ce n’est donc pas le seul corpus des archives officielles qui ouvre un vaste champ. Et dans un tout autre registre, une réflexion accrue mériterait d’être menée sur le recours aux sources militantes disponibles sur Internet. Les cher-cheurs qui travaillent sur des mobilisations transnationales savent les limites propres à l’ethnographie multi-sites, et peuvent utilement s’appuyer sur la com-binaison de sources Internet et de celles des médias standard, comme le fait Lesley Wood en analysant 467 mobilisations locales contre le néolibéralisme lors de cinq journées d’action globale coïncidant avec des grandes réunions
31. Notamment dans la lignée des travaux de Philippe Artières. Cf. par exemple Artières (P.), Rodak (P.), « Écriture et soulèvement. Résistances graphiques pendant l’état de guerre en Pologne (13 décembre 1981-13 décembre 1985) », Genèses, 70, 2008.32. Cf. Chauvin (S.), « “Il faut défendre la communauté”. Ethnographie participante d’un “community mee-ting” de travailleurs journaliers aux États-Unis », ContreTemps, 19, 2007.33. Pudal (B.), Prendre Parti. Pour une sociologie historique du PCF, Paris, Presses de Sciences Po,1989.34. Lechien (M.-H.), « Des militants de la “cause immigrée”. Pratiques de solidarité et sens privé de l’enga-gement », Genèses, 50, 2003, p. 19.35. Pour un exemple, cf. Hmed (C.), Loger les étrangers isolés. Socio-histoire d’une institution d’État : la Sona-cotra (1956-2006), thèse de doctorat en science politique, Université Paris 1, 2006, chapitre 4.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
18 Observer les mobilisations
internationales, et en comparant quelles institutions sont plus particulièrement ciblées 36. Le recours à ce type de sources est d’autant plus utile qu’on le couple à une réflexion sur la signification sociale de l’accès militant à l’Internet : ainsi, en Afrique de l’Ouest, la présence sur le web de militants est davantage un indi-cateur de leur internationalisation que de leurs ancrages locaux, de même que la tenue régulière d’un site web est un indicateur presque infaillible de l’accès à des réseaux, soutiens et financements internationaux 37.
Le problème, assez classiquement, est donc moins celui de la légitimité ou de la dignité de certaines sources (parfois utilisées dans la dénégation par les cher-cheurs), que d’une réflexion critique accrue, et d’une attention aux nouvelles questions que ces sources permettent de poser.
Engagements ethnographiques et accès à la mobilisation
À l’instar de Laud Humphreys, le sociologue doit-il se faire « voyeur », c’est-à-dire « mobiliser l’organisation sociale de ceux qu’[il] observe 38 » ? Pour étudier les pratiques homosexuelles dans les pissotières, Humphreys assume, en effet, le rôle du voyeur : selon ses propres termes, il est « la folle qui guette », celui qui ne passe pas à l’acte mais assure la sécurité de ceux qui le font, « moyen d’être présent sans troubler l’action ». Sous quel rôle placer la relation d’enquête, a fortiori quand on observe les mobilisations par le recours à l’approche ethno-graphique ? Pour Christophe Broqua, « l’étude par l’observation participante d’un groupe qui se définit comme “activiste” confronte d’emblée le chercheur à la question des liens entre recherche scientifique et militantisme 39 ». Cette situation prend une acuité particulière pour l’ethnographe politique du fait des risques qu’elle génère : « Faire de l’ethnographie implique d’abord de s’isoler de [s]a communauté. […] Parallèlement, tu vis une sociabilité intense dans un autre espace social, car faire de l’ethnographie implique d’interagir avec les acteurs sur lesquels tu travailles. Cette extrême sociabilité et cet extrême isole-ment […] souvent te font courir le risque de te convertir […] en idéologue, en militant, en sympathisant 40. » Il reste que le retour réflexif permet de gérer cette façon de devenir, au moins partiellement, indigène, qui est moins un problème en soi que par le type d’écriture qu’elle peut générer à l’insu du chercheur, ainsi que par la perception sociale du chercheur qu’elle est susceptible d’induire.
36. Wood (L.), « Breaking the Bank & Taking to the Streets: How Protesters Target Neoliberalism », Journal of World-Systems Research, 10 (1), 2004.37. Siméant (J.), « S’engager dans l’internationalisation : trajectoires de participants africains au FSM », journée d’études Un FSM en Afrique. Nairobi 2007 - Causes africaines et extraversions militantes, 5 octobre, Paris I.38. Humphreys (L.), Le commerce des pissotières. Pratiques homosexuelles anonymes dans l’Amérique des années 1960, Paris, La Découverte, 2007 [1e éd. 1970], p. 37.39. Broqua (C.), « L’ethnographie comme engagement : enquêter en terrain militant », Genèses, 75, 2009, p. 110.40. Auyero (J.), « El oficio de la etnografía política », Iconos, 22, 2005, p. 15.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
Hélène Combes, Choukri Hmed, Lilian matHieu, Johanna siméant, Isabelle sommier 19
93
Cette triple expérience – éloignement du milieu professionnel, conversion au moins partielle aux positions des acteurs (toute enquête pouvant être analysée comme une forme de socialisation), stigmatisation potentielle 41 – est décrite avec minutie par D. Bizeul dans son récit d’enquête au sein du Front national : l’« imprégnation idéologique 42 », au fil des jours, est d’autant plus prégnante (et inconsciente) que son enquête lui vaut le rejet de nombre de ses collègues et même de son entourage amical. Dans ce cas comme ailleurs, la relation d’en-quête se construit tout autant dans l’interaction avec les enquêtés qu’avec le milieu professionnel du chercheur 43.
Quand on travaille sur des mouvements sociaux ou politiques, « trouver sa place » (et savoir l’analyser), celle de la « juste distance » dans la relation eth-nographique, constitue un enjeu d’autant plus crucial que l’injonction à l’en-gagement est explicite et permanente, et sans doute encore plus appuyée que dans d’autres aspects de la vie sociale. Dans ce cas, occuper les places succes-sivement assignées par ses enquêtés, clé d’accès à leurs formes d’intelligibilité, peut s’avérer périlleux ou contraire aux principes personnels du chercheur 44, et ce d’autant plus quand il enquête « sur l’autre politiquement répugnant 45 ». De plus, l’immersion dans les réseaux d’interconnaissance place le chercheur dans une relation complexe vis-à-vis de ses enquêtés. « Il faut alors, pour reconquérir une place de sociologue, faire le deuil d’une identité que le chercheur avait fini par endosser, parce qu’elle était à la fois congruente avec son univers et avec l’at-tente du milieu enquêté et ses prescriptions 46. » Le passage à l’écriture et surtout la publicisation des travaux mettent par surcroît en danger l’accès au terrain et, plus largement, en péril la confiance accordée par les acteurs 47. Car parfois,
41. Par les autorités, par ses proches, mais aussi par quiconque identifiera le chercheur comme un partici-pant à la mobilisation.42. Il s’est installé alors, selon ses propres mots, dans « une double vie ». Le « dé-conditionnement » lui a pris trois ans et a nécessité la rédaction de plusieurs versions de son rapport d’enquête. Bizeul (D.), « Des loyautés incompatibles. Les aspects moraux d’une immersion au sein du Front national », SociologieS, mis en ligne le 21 juin 2007, http://sociologies.revues.org/index226.html.43. Broqua (C.), « L’ethnographie comme engagement… », art. cit., p. 117.44. Marie Vannetzel, dans son travail sur les Frères musulmans, décrit les effets de paliers qu’impliquent l’acception ou la volonté de se conformer à certaines normes de ses acteurs. Vannetzel (M.), « Enquêter à la frontière du parti : jeux d’inclusion et d’exclusion d’une chercheuse chez les Frères musulmans égyptiens », Revue internationale de politique comparée, 17 (4), 2010.45. Avanza (M.), « Comment faire de l’ethnographie quand on n’aime pas ses indigènes », in Fassin (D.), Bensa (A.), dir., Les politiques de l’enquête, Paris, La Découverte, 2008. Cf. également Boumaza (M.), « L’ex-périence d’une jeune chercheuse en “milieu extrême” : une enquête au Front national », Regards sociologi-ques, 22, 2001.46. Havard-Duclos (B.), « Les coûts subjectifs de l’enquête ethnographique », SociologieS, mis en ligne le 21 juin 2007, http://sociologies.revues.org/document182.html.47. Dans sa relation aux acteurs, au-delà de son éthique personnelle et professionnelle, le chercheur est aussi dépendant d’un contexte de plus en plus codifié, aspect d’autant plus complexe à gérer dans le cadre d’un travail s’inscrivant dans l’interconnaissance. Cf. notamment : Laurens (S.), Neyrat (F.), dir., Enquêter : de quel droit ? Menaces sur l’enquête en sciences sociales, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2010.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
20 Observer les mobilisations
écrire c’est trahir 48. Daniel James n’a réussi à terminer son ouvrage singulier consacré à la trajectoire de Doña Maria, une syndicaliste argentine qu’il suit pendant plusieurs années, qu’après la mort de celle-ci 49.
L’approche ethnographique pose aussi la question de l’accès à la mobilisa-tion 50. Comment saisir le temps court de la contestation ? Dans ce numéro, Marie Laure Geoffray, à travers l’étude de deux performances artistiques, met en lumière comment les activités de collectifs artistes cubains acquièrent en acte un sens politique. Comme elle le souligne, « cette méthode doit être particuliè-rement réflexive, dans un contexte autoritaire, afin de ne pas surévaluer certai-nes contraintes, vécues comme particulièrement fortes par l’enquêteur étranger en l’absence d’une socialisation comparable à celle des enquêtés ».
Observer les mobilisations, bien souvent, nécessite aussi de dépasser la logique de la monographie d’un mouvement unique. Pour ce faire, de plus en plus de politistes optent pour une « ethnographie » de l’événement 51, souvent à travers un travail collectif. Que voit-on et que perd-on alors ? Une piste est sans doute de multiplier les regards et les points d’entrée (physique, théorique, discipli-naire) à travers des enquêtes collectives. Néanmoins, le risque latent qui guette le politiste ethnographe en entrant par l’événement et non par les réseaux de sociabilité de ceux qui y participent est bien de ne percevoir que la « façade » de la mobilisation 52. Cette façade est cependant un aspect de la performativité militante et doit être prise au sérieux comme doit l’être aussi la frontière insta-ble entre scène et coulisses. De plus, « la description est une fin en soi mais elle
48. On sait les dangers encourus par le chercheur à l’occasion de la restitution aux enquêtés de ses résultats d’enquête, particulièrement dans le cas des militants (cf., entre autres, Péchu (C.), Droit au logement. Genèse et sociologie d’une mobilisation, Paris, Dalloz, 2006). D. Bizeul et M. Avanza optent dans ce cadre pour deux positionnements différents. M. Avanza, face à un mouvement souvent ridiculisé par la presse et les travaux de sciences sociales, choisit de « le prendre au sérieux » (Avanza (M.), « Comment faire de l’ethnographie… », art. cit., p. 44) ; D. Bizeul a fait lui relire par les militants du FN tous les passages qui lui semblaient problé-matiques pour eux (« Le sociologue a-t-il des comptes à rendre ? Enquêter et publier sur le Front national », Sociétés contemporaines, 70 (2), 2008).49. Dans cet ouvrage, à travers quatre essais, il déconstruit le récit que Doña Maria lui a fait de sa trajectoire militante. James (D.) Doña María’s Story: Life History, Memory, and Political Identity, Durham, Duke Uni-versity Press, 2000.50. Nous ne revenons pas ici sur la question des difficultés particulières inhérentes à l’entrée et au maintien en terrain militant. Pour un état de la question, nous renvoyons à l’article de Aït-Aoudia (M.), Bargel (L.), Ethuin (N.), Massicard (E.), Petitfils (A.-S.), « Franchir les seuils des partis. Accès au terrain et dynamiques d’enquêtes », Revue internationale de politique comparée, 17 (4), 2010.51. À titre d’exemple, Rémi Lefebvre sur la campagne de Martine Aubry, Johanna Siméant, Marie-Emma-nuelle Pommerolle et leur équipe sur le Forum social de Nairobi, Hélène Combes et ses collègues sur les meetings au Mexique. Lefevbre (R.), « S’ouvrir les portes de la ville. Une approche ethnographique des porte-à-porte de Martine Aubry à Lille », in Lagroye (J.), Lehingue (P.), Sawicki (F.), dir., Mobilisations électorales. Le cas des élections municipales de 2001, Paris, PUF, 2005 ; Siméant (J.), Pommerolle (M.-E.), Un autre monde à Nairobi, Paris, Karthala, 2008 ; Combes (H.) « Meetings de fin de campagne au Mexique et ethnographie des milieux partisans », Politix, 85, 2009.52. Inévitable impression à la lecture descriptive et répétitive du carnet de campagne tenu par Yves Pour-cher : Votez tous pour moi, Paris, Presses de Sciences Po, 2004.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
Hélène Combes, Choukri Hmed, Lilian matHieu, Johanna siméant, Isabelle sommier 21
93
fait aussi penser autrement 53 ». Elle charrie une manière d’appréhender diffé-remment la construction de l’objet, qui n’est d’ailleurs pas forcément visible dès la première immersion mais nécessite, à l’instar de ce qui est réalisé par J. Auyero et M. Malher dans ce numéro, une « relecture ethnographique ».
Penser l’espace-temps des mobilisations
C’est dans l’inscription des mobilisations dans leur espace géographique, temporel et social, que se trouvent sans doute aujourd’hui certaines pistes empiriques particulièrement fécondes à explorer.
L’espace matériel de la mobilisation
Un truisme sociologique, rappelé par Howard Becker dans Les ficelles du métier, veut que toute action se déroule quelque part 54. Or, sans militer pour l’importation en sociologie des mouvements sociaux des paradigmes géogra-phiques les plus complexes, il faut convenir qu’à de rares exceptions près, la plupart des recherches sur les mouvements sociaux tendent à l’ignorer 55. Elles n’accordent bien souvent à l’espace matériel de la mobilisation qu’une place mineure ou au mieux décorative dans la description et donc dans l’analyse, à tel point qu’il n’est pas excessif de les qualifier de space-blind 56. L’espace de la mobilisation est pourtant un puissant levier d’intelligibilité de l’action protes-tataire : non seulement celui-ci constitue une contrainte et une ressource pour l’action des militants, des forces de l’ordre et des organisations en présence, mais il peut également représenter l’enjeu même de la mobilisation. Problé-matiser l’organisation spatiale 57 d’une action protestataire suppose donc d’être particulièrement attentif à l’espace physique au sein duquel celle-ci se réalise (la topographie du mouvement, la morphologie de la structure habitable…) ; à la distance et à la proximité sociales engendrées par la répartition, la copré-sence et la dispersion spatiale des individus et des groupes mobilisés ; enfin à la façon dont l’espace géographique lui-même est constitué en enjeu de lutte et de pouvoir entre ces mêmes individus ou groupes 58. C’est dire que « les lieux
53. Cefaï (D.), L’engagement ethnographique, Paris, Éditions de l’EHESS, 2010, p. 36.54. Becker (H.), Les ficelles du métier, Paris, La Découverte, 2002, p. 103.55. Ce constat s’applique davantage à la littérature francophone qu’à la recherche étasunienne, plus fidèle aux enseignements d’un Henri Lefebvre en la matière. On renvoie ici à Hmed (C.), « Espace géographique et mouvements sociaux », in Fillieule (O.), Mathieu (L.), Péchu (C.), dir., Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit.56. Il est significatif à cet égard que peu de manuels accordent à la dimension spatiale la place qui lui revient. Dans le cas français, cf. par exemple D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ?, op. cit.57. Et ce alors que certains parlent d’une reterritorialisation de l’action politique. Merklen (D.), Quartiers populaires, quartiers politiques, Paris, La Dispute, 2009.58. Auyero (J.), « L’espace des luttes. Topographie de l’action collective », Actes de la recherche en sciences socia-les, 160, 2005 ; Hmed (C.), « Des mouvements sociaux “sur une tête d’épingle” ? Le rôle de l’espace physique dans le processus contestataire à partir de l’exemple des mobilisations dans les foyers de travailleurs migrants », Politix, 82, 2008 ; Geoffray (M. L.), Culture, politique et contestation à Cuba (1989-2009), thèse citée.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
22 Observer les mobilisations
ne constituent pas seulement un cadre ou un décor mais bien un agent (agentic player) dans le jeu – une force dotée d’effets détectables et autonomes dans la vie sociale 59 ». Traiter l’espace comme décorum ou comme arrière-fond, ou même l’interpréter, à la manière de Pierre Bourdieu, comme un « espace social réifié » ou « physiquement objectivé 60 » reste donc insuffisant : l’organisation spatiale ne se réduit jamais à la réfraction matérielle de l’ordre social mais pro-duit des effets sui generis qu’il s’agit de mettre au jour en les observant minu-tieusement, dans toute leur concrétude. Dit autrement, les relations spatiales, i.e. contraintes spatialement, ne sont donc pas seulement l’expression des rela-tions sociales ; elles produisent au contraire, par le biais de routines géographi-quement situées, des usages et des expériences spécifiques de l’espace, lesquels contraignent et déterminent en retour l’action protestataire. Le cas des révoltes frumentaires est ici éloquent, puisque ce sont au sein même des marchés que les membres du groupe se rencontrent, s’organisent et luttent 61 ; mais l’on peut en dire tout autant des foyers d’étudiants 62, de la rue 63, de l’espace des lieux de culte 64 ou encore des bidonvilles ou des centres commerciaux : comme le mon-tre l’article de J. Auyero et M. Mahler dans ce numéro, c’est bien d’une « politi-que de l’espace » qu’il s’agit, dont le contrôle est disputé par différents groupes sociaux et organisations politiques, et qui structure en retour les formes de l’action collective protestataire. M. L. Geoffray montre quant à elle tout l’enjeu que représente l’appropriation spatiale dans un « contexte particulièrement contrôlé, balisé et normé ».
Temporalités : ethnographie des événements courts et temps de l’événement
L’attention nouvellement portée, quoique encore insuffisamment, aux dif-férentes temporalités de l’engagement et des mouvements sociaux plonge en partie ses racines dans le déplacement du regard de la question du « pourquoi », privilégiée par les analystes du comportement collectif, à celle du « comment », au cœur des interrogations des théories de la mobilisation des ressources. Il faut toutefois attendre le tournant opéré au cours des années 1980, tant en sociolo-gie qu’en histoire, pour qu’elle soit véritablement prise à bras le corps tant par l’attention au temps long de la culture que par celle portée au temps immédiat. Pour la sociologie, s’ajoute le défi méthodologique des instruments empiriques la distinguant de l’histoire et, partant, le peu d’habileté à manier les sources
59. Gieryn (T. F.), « A Space for Place in Sociology », Annual Review of Sociology, 26, 2000, p. 465.60. Bourdieu (P.), « Effets de lieu », in Bourdieu (P.), dir., La Misère du monde, Paris, Seuil, 1993, p. 160.61. Tilly (L. A.), « La révolte frumentaire, forme de conflit politique en France », Annales ESC, 27, 1972.62. Zhao (D.), « Ecologies of Social Movements: Student Mobilization during the 1989 Prodemocracy Movement in Beijing », American Journal of Sociology, 103 (6), 1998.63. Bayat (A.), Street Politics. Poor People’s Movements in Iran, New York, Columbia University Press, 1997 ; Bayat (A.), Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East, Stanford, Stanford University Press, 2010. Fillieule (O.), Tartakowsky (D.), La manifestation, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.64. Cattedra (R.), Idrissi-Janati (M.), « Espace religieux, espace de citadinité, espace de mouvement : les territoires des mosquées au Maroc », in Bennani-Chraïbi (M.), Fillieule (O.), dir., Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes, Paris, Presses de Sciences Po, 2003.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
Hélène Combes, Choukri Hmed, Lilian matHieu, Johanna siméant, Isabelle sommier 23
93
archivistiques. Le déclin des analyses d’inspiration structuraliste, mais aussi l’affirmation en France de la sociohistoire et le rapprochement des deux disci-plines, ont été un préalable de la prise en compte des différentes temporalités.
Dans le domaine strict des mouvements sociaux, cette attention au temps a bénéficié de deux injonctions : celle à la prise en compte du temps court à laquelle invitait Michel Dobry dans son analyse des échanges de coups en situa-tion de crise politique 65, ou encore William H. Sewell 66 dans sa réhabilitation de l’événement transformateur ou focal event qui précipite la crise (les deux sans exclusive) 67 ; celle du temps long des carrières militantes lancée par Olivier Fillieule dans un article séminal constitutif de l’importation de la tradition inte-ractionniste dans l’analyse de l’engagement 68. Ces appels n’ont pas exactement le même ancrage théorique (pour les plus proches, ne serait-ce qu’en termes d’inscription disciplinaire, M. Dobry se réfère pour partie à l’interactionnisme stratégique, O. Fillieule à l’interactionnisme symbolique) ; pas plus qu’ils n’in-duisent des méthodes d’analyse convergentes. Celles-ci, malgré leurs promesses, se sont parfois révélées décevantes : le suivi au plus près de l’échange des coups, des jeux d’alliances et de trahisons constitutifs de toute situation politique peut tomber parfois dans les travers à juste titre dénoncés de l’histoire événementielle, tandis que l’analyse de carrières peut se résumer, comme il a déjà été souligné, au pire, à de trop sommaires entretiens sur la trajectoire militante des acteurs et les informations sociographiques de base, et, au mieux, à des récits de vie sérieux mais trop peu nombreux ou conduits de façon trop aléatoire pour prétendre à véritable généralisation.
Plusieurs des recherches ici rassemblées offrent de ce point de vue de réelles avancées sur le plan empirique, non seulement pour leur force de proposition face aux problèmes posés par les différentes méthodes, mais surtout par leur recherche de protocoles d’enquête susceptibles de lier les diverses échelles de temporalités de l’action collective. Il en va ainsi de la contribution de Julie Pagis, sans doute une des premières à mettre en pratique l’invitation d’O. Fillieule à articuler méthodes quantitative et qualitative et, accessoirement, à répon-dre aux critiques étasuniennes quant à l’amateurisme (ou artisanat, comme si les deux étaient synonymes…) français en se pliant à la « vraie » science (i.e. quantifiable). La base de données établie est au principe de la sélection et de la
65. Dobry (M.), « Mobilisations multisectorielles et dynamiques des crises politiques : un point de vue heu-ristique », Revue française de sociologie, 24(3), 1983.66. Sewell (W. H.), « Historical Events as Transformations of Structures: Inventing Revolution at the Bas-tille », Theory and Society, 25, 1996, p. 84 ; McAdam (D.), Sewell (W. H.), « It’s About Time: Temporality in the Study of Social Movements and Revolutions », in Aminzade (R. R.) et al., Silence and Voice in the Study of Contentious Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.67. De façon assez proche de ce que proposera Timothy Tackett en histoire dans Par la volonté du peuple. Comment les députés sont devenus révolutionnaires, Paris, Albin Michel, 1997.68. Fillieule (O.), « Post-scriptum. Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel », Revue française de science politique, 51 (1-2), 2001.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
24 Observer les mobilisations
conduite d’entretiens significatifs (choisis à partir des parangons obtenus par l’objectivation statistique). Au-delà, son propos vise à articuler le temps court de l’événement « Mai 68 69 » à celui du temps long des carrières militantes : en amont, c’est-à-dire au niveau des dispositions, des socialisations primaire et secondaire ; en aval, en étudiant les conséquences biographiques de l’engage-ment, dans l’immédiat et sur le plus long terme, le tout sans succomber à l’illu-sion héroïque et rétrospective d’un « Moment 68 ».
C. Traïni s’attelle quant à lui à un autre angle mort de la plupart des études sur les mobilisations : le temps long, qu’il envisage non pas en soi mais afin de mieux penser ce que les carrières militantes doivent à leur insertion dans des configurations sociales en partie modelées par les mobilisations du passé. Il recourt d’abord à une sociogenèse des différents registres émotionnels de la cause animale et des dispositifs de sensibilisation afférents, pour montrer ensuite comment ils sont activés et finalement mobilisés par les militants dont l’histoire sociale a forgé ce qu’il appelle un tempérament, c’est-à-dire un ensemble de sensibilités, que le travail militant s’efforcera de transmuer en cause collective. Il trace ainsi une voie permettant d’éviter et un psychologisme expliquant le mili-tantisme par des propriétés supposées immuables des psychés individuelles, et un sociologisme le réduisant aux variables structurales des positions productri-ces ipso facto de dispositions.
D’autres chantiers empiriques soulèvent eux aussi la question du temps court, comme le cas des enquêtes, par sondage 70 ou enquête qualitative col-lective 71 (par exemple par guides d’observation préalablement établis), lors de grands rassemblements de protestation internationalisés (Forums sociaux, protestations contre le G8…). Ils offrent une concentration militante propice à l’objectivation statistique et à la comparaison des circuits d’accès à l’internatio-nalisation militante, et, s’ils ne permettent pas de prétendre à une ethnographie au sens strict du terme (qui dépend des liens noués au long cours avec les mili-tants étudiés), l’unité de lieu et de temps en fait des moments de cristallisation de sens et de représentation politique (dans tous les aspects du terme) particu-lièrement riches à observer.
Ordre politique, ordre social et mobilisations
Les réflexions en termes de structure des opportunités politiques ont utile-ment appelé à prendre en compte les effets que produisent les transformations de l’exercice du pouvoir, les capacités redistributrices ou coercitives de l’État, ou
69. Cf. également Gobille (B.), « L’événement 68. Pour une sociohistoire du temps court », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2, 2008.70. Della Porta (D.), Tarrow (S.), eds, Transnational Protest and Global Activism, Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 2005.71. Agrikoliansky (E.), Sommier (I.), dir., Radiographie du mouvement altermondialiste, Paris, La Dispute, 2005 ; Pommerolle (M.-E.), Siméant (J.), dir., Un autre monde…, op. cit.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
Hélène Combes, Choukri Hmed, Lilian matHieu, Johanna siméant, Isabelle sommier 25
93
encore l’accès des groupes sociaux à ce dernier. Cependant, elles ont eu comme limite de proposer des modèles caricaturaux de l’environnement politique, au point que les amendements au modèle durent intégrer la question des opportu-nités « perçues », de la « fabrication » d’opportunités par les contestataires – la sociologie du framing achevant de compenser par un excès de subjectivisme ce que le concept de SOP portait d’objectivisme 72. La question du rapport des mobilisations à l’ordre social et politique qui les englobe et qu’elles coprodui-sent n’en doit pas moins rester un terrain d’investigation – et ce faisant impli-quer des stratégies empiriques adaptées. Des questions qui semblent aller de soi dès lors que l’on travaille sur le lointain 73 disparaissent souvent quand le cher-cheur travaille chez lui. Que le lien entre ordre social, économique et politique et survenance des mobilisations ait été le plus souvent pensé sur le mode du croise-ment de macrovariables entre elles (série d’événements protestataires avec PIB, valeurs « postmatérialistes » attestées par des baromètres internationaux, capital social mesuré par des sondages ou des statistiques sur le nombre d’associations, « ouverture » et « fermeture » de l’État…) a sans doute eu de quoi décourager.
Il semble pourtant difficile de négliger les effets d’importantes transforma-tions macrosociales et culturelles sur la (non-)survenance 74 de mobilisations, même s’il importe plus encore de saisir de quelle façon précise elles jouent : ter-tiarisation et féminisation du marché du travail, trajectoires descendantes ou ascendantes de groupes sociaux, augmentation des formes de salariat précaire, effets de la mobilité résidentielle accrue, des transformations familiales 75… Il paraît aussi intenable d’ignorer certains de ces aspects que de se limiter à l’in-verse à les évoquer, ainsi qu’y invite parfois la sociologie pragmatique 76, si et seu-lement s’ils sont mobilisés dans le discours des militants eux-mêmes. Bien qu’il puisse être fécond de comprendre comment des acteurs mobilisent des schèmes critiques ou interprétatifs de description du monde – comme ceux d’« empire », de « mondialisation », de « tradition » ou de « développement des inégalités » –, le chercheur en sciences sociales n’a pas à renoncer à envisager ces aspects quand bien même le militant ne le fait pas, à l’instar de Stéphane Beaud et Michel Pialoux qui, à partir de leur ethnographie des usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard,
72. Mathieu (L.), « Rapport au politique, dimensions cognitives et perspectives pragmatiques dans l’analyse des mouvements sociaux », Revue française de science politique, 52 (1), 2002.73. Que signifie par exemple observer des « mouvements sociaux » dans un pays pauvre, comme le Mali, légalement doté d’institutions démocratiques mais dont tout l’ordre social semble traversé par la hiérarchie et l’inégalité, au point que le recours à de puissants intermédiaires apparaît comme la norme et non l’excep-tion dès lors qu’il s’agit de faire valoir des griefs ?74. Pour une étude originale d’une non-mobilisation, autrement dit des raisons pour lesquelles une popula-tion qui aurait « toutes les raisons » et les propriétés sociales de le faire ne le fait pas, cf. l’enquête ethnogra-phique de Javier Auyero et Debora Swistun : Auyero (J.), Swistun (D.) Flammable. Environmental Suffering in an Argentine Shantytown, New York, Oxford University Press, 2009.75. Sawicki (F.), Siméant (J.), « Décloisonner la sociologie de l’engagement militant. Note critique sur quel-ques tendances récentes des travaux français », Sociologie du travail, 51 (1), 2009.76. Cefaï (D.), Pourquoi se mobilise-t-on ?, op. cit.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
26 Observer les mobilisations
établissent un lien entre la crise de reproduction du groupe ouvrier, de sa mobi-lisation, et les transformations du système scolaire et du monde industriel 77. Ce dernier exemple ouvre une piste méthodologique. Si l’attention au niveau micro- ou méso-sociologique comporte inévitablement un risque de myopie, en laissant le jeu des grandes variables à une macrosociologie des vastes processus ou des cycles de protestation, il n’y a toutefois pas équivalence entre échelle de l’observation et échelle de l’interprétation. Ainsi, la monographie, unique ou combinée, permet de comprendre les transformations voire les crises de bas-sins spécifiques de militantisme ou encore de documenter le poids du capital d’autochtonie dans les mobilisations ou le lien entre sociabilités militantes et quotidiennes 78. Il s’agit, ce faisant, d’une entrée particulièrement féconde pour contrôler les corrélations, parfois abusives, entre les transformations d’un groupe social et sa plus ou moins grande propension à se mobiliser 79.
Au-delà, certaines des pistes d’observation des mobilisations les plus stimu-lantes résident sans nul doute dans le programme d’une sociologie de la (dé)légitimation qui lie ordre politique et social sans présumer que tout se joue dans le long terme, le macro et/ou les valeurs – et qui se donne les moyens de docu-menter les modalités officieuses des transactions entre scène officielle du jeu politique et arrière-cours dans lesquelles se règle le « sale boulot » politique : intimidation, actions violentes de masse… En examinant, par leur revisite ana-lytique 80 d’un terrain antérieur, le lien entre clientélisme et mobilisation dans la « zone grise » en Argentine, Javier Auyero et Matthew Mahler ne proposent pas seulement un modèle d’intelligibilité des « émeutes », mais pensent le lien entre fabrication du consentement et coproduction de l’ordre social par des mouve-ments plus ou moins contestataires. Une telle démarche est assurément compli-quée par ce qu’elle suppose d’accès empirique à l’officieux (Auyero et Mahler reconnaissent leur dette à l’égard des journalistes et des avocats comme infor-mateurs). Elle peut aboutir à faire feu empirique de tout bois. L’ethnographie au long cours peut ici être une ressource pour cet accès au caché qui n’est pas forcé-ment occulte mais non dit (et non dit au chercheur). C’est de façon plus générale la question du rapport des acteurs des mobilisations (contestataires mais aussi forces de l’ordre, spectateurs et interprètes) aux routines et à la contrainte, politi-que mais aussi sociale, qui mériterait d’être examinée davantage pour réinscrire
77. Beaud (S.), Pialoux (M.), Retour sur la condition ouvrière, Paris, Fayard, 1999.78. Retière (J.-N.), Identités ouvrières. Histoire sociale d’un fief ouvrier en Bretagne. 1909-1990, Paris, L’Har-mattan, 1994.79. Renouant, ce faisant, avec la critique par Oberschall de la théorie de la société de masse que dévelop-pait Kornhauser, ou encore avec la réfutation, par Emmanuel Pierru, du lien entre montée des extrêmes et contribution privilégiée des chômeurs à l’extrémisme. Cf. respectivement. Oberschall (A.), Social Conflicts and Social Movements, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1973 ; Pierru (E.), « La tentation nazie des chômeurs dans l’Allemagne de Weimar. Une évidence historique infondée ? », Politix, 60, 2002.80. Burawoy (M.), « Revisits: An Outline of a Theory of Reflexive Ethnography », American Sociological Review, 68 (5), 2003.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur
Hélène Combes, Choukri Hmed, Lilian matHieu, Johanna siméant, Isabelle sommier 27
93
les mobilisations dans les dynamiques ordinaires du jeu politique et social, et ne pas perpétuer par des routines de méthode une pensée qui assimile les mobilisa-tions à l’exceptionnel voire au pathologique 81.
81. Collovald (A.), Gaïti (B.), dir., La démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation politique, Paris, La Dis-pute, 2006.
Hélène Combes est chargée de recherche au CNRS depuis 2006, rattachée au Centre d’études et de recherches internationales (CERI, Sciences Po Paris). Elle travaille sur les partis et les mouvements sociaux en Améri-que latine, en particulier au Mexique. Avec Sergio Tamayo, elle coordonne un projet de recherche sur l’action manifestante à Mexico (projet ANR Palapa). Elle a enseigné dans de nombreux pays latino-américains (Mexique, Argentine, Chili, République Dominicaine) et est en charge de plusieurs séminaires de Master à Sciences Po Paris et Paris 1. Elle coordonne le Groupe d’études sur les orga-nisations et les partis politiques (GEOPP) de l’Association française de science politique (AFSP).Choukri Hmed est maître de conférences en science politique à l’Université Paris Dauphine, et chercheur à l’Institut de recher-che interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO, UMR 7170). Il est responsable du Master 2 « Études et recherches politiques et sociales » (parcours Recherche) et anime dans ce cadre le stage de terrain « Ethno-graphie de la politisation ». Il a récemment dirigé (avec Sylvain Laurens) le dossier « L’in-vention de l’immigration », Agone, 40, 2008. Ses recherches actuelles portent sur le pro-cessus protestataire dans le contexte de la crise politique tunisienne.
Lilian matHieu est directeur de recherche au CNRS (Centre Max Weber, équipe DPCS, ENS de Lyon). Il a récemment codirigé avec Olivier Fillieule et Cécile Péchu le Dictionnaire des mouvements sociaux (Presses de Sciences Po, 2009) et, avec Sandrine Lefranc, Mobilisa-tions de victimes (Presses universitaires de Rennes, 2009), et publié Les années 70, un âge d’or des luttes ? (Textuel, 2010).Johanna siméant est professeure de science politique à l’Université Paris 1 Pan-théon Sorbonne (Centre européen de socio-logie et de science politique – CESSP, UMR 8209) et membre de l’Institut Universitaire de France. Elle a récemment publié La grève de la faim (Presses de Sciences Po, 2009) et travaille aujourd’hui sur l’internationalisation des militantismes africains et la protesta-tion au Mali.Isabelle sommier est professeure de socio-logie à l’Université Paris 1 Panthéon Sor-bonne (Centre européen de sociologie et de science politique – CESSP, UMR 8209). Elle a récemment publié Penser les mouvements sociaux, en co-direction avec Olivier Fillieule et Éric Agrikoliansky, à La Découverte, col-lection Recherche, 2010.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Pol
itiqu
es d
e P
aris
-
- 19
3.54
.67.
93 -
04/
11/2
013
11h5
3. ©
De
Boe
ck S
upér
ieur
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Institut d'Etudes P
olitiques de Paris - - 193.54.67.93 - 04/11/2013 11h53. ©
De B
oeck Supérieur