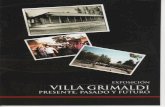MUSSI M. 1991. L'utilisation de la stéatite dans les grottes des Balzi Rossi (ou grottes de...
Transcript of MUSSI M. 1991. L'utilisation de la stéatite dans les grottes des Balzi Rossi (ou grottes de...
Margherita Mussi
L'utilisation de la stéatite dans les grottes des Balzi Rossi (ougrottes de Grimaldi)In: Gallia préhistoire. Tome 33, 1991. pp. 1-16.
Citer ce document / Cite this document :
Mussi Margherita. L'utilisation de la stéatite dans les grottes des Balzi Rossi (ou grottes de Grimaldi). In: Gallia préhistoire.Tome 33, 1991. pp. 1-16.
doi : 10.3406/galip.1991.2283
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/galip_0016-4127_1991_num_33_1_2283
AbstractSteatite is a soft, variously coloured and sometimes translucid mineral. It is found in mountainous areas,within metamorphic outcrops, and occasionally as river pebbles. Talcum powder is made by scratchingand grinding it. During the Upper Palaeolithic, it was used to make pendants and figurines. Talcumpowder was possibly used for tanning hides, but this cannot be definitely proved. Steatite items werefound in the Balzi Rossi sites, at the frontier between Italy and France, but most of them were excavatedlong ago. We discuss the place of origin and stratigraphic position of each of them, and drawcomparisons with similar artifacts found in other Italian and French sites. Working techniques, andspecially perforating techniques, became more and more complex through time. During the Gravettian-Early Epigravettian, small steatite pebbles were looked for to carve human figurines. This raw materialwas possibly more easily found at the end of the Upper Palaeolithic, after mountain deglacierisation,when people were able to explore new countries freely.
RésuméLa stéatite est une pierre tendre, de couleur variable, parfois translucide. On la trouve dans lesformations métamorphiques des massifs montagneux et, parfois, sous forme de galets dans le lit descours d'eau. Par raclage, on peut en tirer de la poudre de talc. Elle a servi, au Paléolithique supérieur, àconfectionner des pendentifs et des statuettes. Le complexe des grottes des Balzi Rossi, à la frontièreentre l'Italie et la France, trop tôt fouillé, a fourni un nombre relativement élevé de ces pièces. Leurprovenance exacte et leur position stratigraphique sont discutées. On établit des comparaisons avecd'autres exemplaires de sites italiens et français. On remarque un affinement progressif des techniquesde travail, surtout en ce qui concerne la perforation des pendentifs. Cette matière semble avoir étéparticulièrement recherchée, sous forme de galets, pour la fabrication des venus au Gravettien-Épigravettien ancien. A l'extrême fin du Paléolithique, la possibilité d'explorer les massifs montagneuxlibérés des glaces peut en avoir favorisé l'exploitation. L'emploi de la poudre de talc (par exemple dansle travail de la peau) est possible, mais non prouvé.
L'UTILISATION DE LA STEATITE DANS LES GROTTES DES BALZI ROSSI (OU GROTTES DE GRIMALDI)
par Margherita MUSSI
Résumé La steatite est une pierre tendre, de couleur variable, parfois translucide. On la trouve dans les formations
métamorphiques des massifs montagneux et, parfois, sous forme de galets dans le lit des cours d'eau. Par raclage, on peut en tirer de la poudre de talc. Elle a servi, au Paléolithique supérieur, à confectionner des pendentifs et des statuettes. Le complexe des grottes des Balzi Rossi, à la frontière entre l'Italie et la France, trop tôt fouillé, a fourni un nombre relativement élevé de ces pièces. Leur provenance exacte et leur position stratigraphique sont discutées. On établit des comparaisons avec d'autres exemplaires de sites italiens et français. On remarque un affinement progressif des techniques de travail, surtout en ce qui concerne la perforation des pendentifs. Cette matière semble avoir été particulièrement recherchée, sous forme de galets, pour la fabrication des venus au Gravettien-Épigravettien ancien. A l'extrême fin du Paléolithique, la possibilité d'explorer les massifs montagneux libérés des glaces peut en avoir favorisé l'exploitation. L'emploi de la poudre de talc (par exemple dans le travail de la peau) est possible, mais non prouvé.
Abstract Steatite is a soft, variously coloured and sometimes translucid mineral. It is found in mountainous areas, within
metamorphic outcrops, and occasionally as river pebbles. Talcum powder is made by scratching and grinding it. During the Upper Palaeolithic, it was used to make pendants and figurines. Talcum powder was possibly used for tanning hides, but this cannot be definitely proved. Steatite items were found in the Balzi Rossi sites, at the frontier between Italy and France, but most of them were excavated long ago. We discuss the place of origin and stratigraphie position of each of them, and draw comparisons with similar artifacts found in other Italian and French sites. Working techniques, and specially perforating techniques, became more and more complex through time. During the Gravettian-Early Epigravettian, small steatite pebbles were looked for to carve human figurines. This raw material was possibly more easily found at the end of the Upper Palaeolithic, after mountain deglacierisation, when people were able to explore new countries freely. Mots-clefs : grottes des Balzi Rossi, grottes de Grimaldi, Paléolithique supérieur italien, art paléolithique, parure paléolithique, venus. Key-words : Balzi Rossi caves, Grimaldi caves, Italian Upper Palaeolithic, Palaeolithic art, Palaeolithic body ornamentation, venus figurines.
Les sites paléolithiques italiens qui se trouvent fique sous plusieurs appellations : grottes de Menton, juste à la frontière de la France, sur le rivage médi- grottes de Grimaldi (terme rendu célèbre par l'impor- terranéen, sont connus dans la littérature scienti- tant ouvrage collectif faisant suite aux travaux vou-
Gallia Préhistoire, 1991, tome 33, p. 1-16.
MARGHERITA MUSSI
MER MEDITERRANEE
Fig. 1 — Les principaux sites des Balzi Rossi occupés au Paléolithique supérieur. L'astérisque indique la présence de steatite. Situation des lieux à la fin du xixe siècle d'après le relevé de E. Rivière (1887).
lus par le prince Albert Ier de Monaco) ou grottes des Balzi Rossi x. Seule cette dernière dénomination doit être retenue, les deux autres ne correspondant plus depuis longtemps à la réalité administrative ou ne s'appliquant pas aisément aux sites dégagés après l'intervention du prince de Monaco.
Les découvertes effectuées dans ces gisements dès le siècle dernier eurent une importance de tout premier plan dans les débats scientifiques de l'époque. Malheureusement, cette renommée eut aussi de nombreux inconvénients : exploités selon des méthodes qui, au mieux, correspondaient aux standards d'alors (mais qui étaient souvent en dessous de ceux-ci), les sites les plus importants du Paléolithique supérieur avaient déjà été vidés, ou même détruits par des exploitations de carrière, lorsque les techniques de fouille commencèrent à s'affiner. Très souvent, la cavité d'où provenaient les pièces archéologiques ne fut même pas notée. De ce
1. Balzi Rossi ou Baoussé-Roussé ou Baussi-Russi, c'est- à-dire les «rochers rouges» d'après un toponyme. L'orthographe Baoussé-Roussé, employée par E. Rivière et répétée par de nombreux auteurs, dérive d'une transcription erronée du toponyme d'après le dialecte local. En français, il faudrait plutôt écrire Baoussi Roussi, avec l'accent tonique sur la première syllabe. Le terme Balzi Rossi est la transposition officielle en italien.
fait, dans la littérature scientifique récente on ne trouve presque plus mention de ces gisements. Font exception les niveaux du Paléolithique moyen et inférieur qu'il a été possible d'étudier par la suite, quelques remplissages qui avaient échappé aux premières phases de recherche, et certaines découvertes particulières, telles qu'oeuvres d'art et sépultures.
La position géographique frontalière a eu, elle aussi, une influence négative. Elle contribua ultérieurement au démantèlement des collections entre l'Italie, la France et la Principauté de Monaco (mais naturellement, des séries finirent aussi, selon la coutume de l'époque, dans de nombreux autres pays européens ou extra-européens). Des questions de langue intervinrent également. Ainsi, il n'est pas toujours compris qu'un même site puisse, par exemple, aussi bien s'appeler «grotte des Enfants» que «grotta dei Fanciulli», ou que la «Barma dou Cavillou» soit aussi la «grotta del Caviglione»...
Nous avons entrepris d'examiner les documents et les collections relatives à ces gisements, dans l'espoir qu'il soit encore possible de sauver quelques bribes de l'immense quantité d'informations qu'ils recelaient. Après nous être attachée au problème des soi-disant sépultures «aurignaciennes», en fait d'âge plus tardif (Mussi, 1986a ; Mussi et al., 1989) et qui constituent maintenant une sorte de repère chrono-
LA STEATITE AUX BALZI ROSSI
logique, nous examinerons ici une série d'objets en steatite2. En effet, l'ensemble des spécimens des différents sites des Balzi Rossi constitue probablement la plus forte concentration de cette matière première connue au Paléolithique (fig. 1).
La steatite, appelée aussi «craie de Briançon», est une variété de talc, donc un phyllosilicate de magnésium hydraté plus ou moins pur (Gavinato, 1952 ; Del Caldo et al., 1973). Dans l'échelle de dureté de Mohs — élaborée pour les minéraux — le talc, avec valeur 1, est le terme le plus bas. La steatite, plus compacte, a un degré de dureté entre 2 et 3 (alors que l'ongle humain, par comparaison, a une valeur de 2,5). Selon la présence ou non d'aluminium, d'oxydes de fer, de calcium ou autres, elle peut être de couleur blanche, verdâtre, jaune, rosée, noire, etc. Dans la littérature archéologique, la steatite est parfois appelée «talcschiste» ou «schiste tal- queux» ou même «argile bleue» (cf. infra, p. 6 et 10).
La facilité avec laquelle on peut la racler, l'inciser, la perforer, n'a pas échappé aux hommes du Paléolithique supérieur qui appliquaient ces mêmes techniques à des substances d'origine organique telles que l'os, l'ivoire et la corne. Un attrait d'ordre esthétique pour cette matière colorée plus ou moins translucide a dû aussi entrer en ligne de compte, comme nous le verrons plus loin.
BREF HISTORIQUE DES RECHERCHES
Comme le remarque E. Rivière (1887), les Romains déjà, lors de la construction de la Via Aurélia, entamèrent certainement le dépôt archéologique qui s'étendait amplement devant les grottes. Dans certaines d'entre elles, de vastes fours à chaux ont été établis au xvme siècle, comme le signale H. de Saussure en 1786 (cité par Rivière, 1887). Dès la première moitié du xixe siècle, on commença à les creuser dans le but de trouver les objets anciens qui y étaient enfouis. Ainsi le prince Florestan Ier de Monaco, dont les collections sont perdues, aurait fait vider intégralement la cavité qui porte maintenant son nom (Villeneuve et al., 1906-1919). Vers 1832, S. Bonfils, alors âgé de 10 ans et qui sera plus tard conservateur du musée de Menton, commença à «gratter la terre» (Octobon, 1952).
2. Le Musée des Antiquités Nationales de Saint-Ger- main-en-Laye et le Museo preistorico-etnografîco L. Pigorini de Rome nous ont permis de reproduire la documentation photographique d'objets en steatite qui y sont conservés. Que ces institutions soient ici vivement remerciées (fig. 3, photo F. Scarpelli, coll. du Museo preistorico-etnografîco L. Pigorini ; fig. 4 et 7, photos et coll. MAN de Saint-Germain-en-Laye).
Des fouilles pseudo-scientifiques eurent lieu par la suite sous l'égide de personnes qui, attirées par le climat, séjournaient souvent à Menton en hiver : A. Grand et E. Chantre de Lyon, le suisse F. Forel, l'anglais Moggridge, le professeur Pérès de Nice, etc. En 1869, on disait déjà que «depuis longtemps les grottes avaient été tellement explorées que l'on n'y trouvait plus quoi * que ce fût» (Rivière, 1887, p. XII). Mais en 1870, les travaux pour la voie ferrée reliant l'Italie à la France révélèrent d'abondants restes archéologiques et paléontologiques qui furent bientôt un attrait pour les touristes de Menton et une source de gain pour les ouvriers. E. Rivière commença vers cette époque des recherches systématiques et bientôt officielles dans les grottes, en suivant une méthode relativement avancée : couches de 25 cm et tamisage. Malheureusement, dans les publications de cet auteur, la stratigraphie est peu évoquée. Des recherches plus poussées furent entreprises sous l'initiative du prince Albert Ier de Monaco de 1895 à 1902. Elles servirent à l'ouvrage bien connu : «Les grottes de Grimaldi» (Villeneuve et al., 1906- 1919).
Parallèlement aux chercheurs officiels, dont certains tels que L. Orsini et G.B. Rossi n'intervinrent que brièvement, d'autres creusèrent plus ou moins clandestinement dans les grottes : ainsi S. Bonfils, actif durant plus d'un demi-siècle, le carrier F. Abbo, propriétaire pendant un certain temps de quelques- unes des cavités, et L. Jullien, dont nous reparlerons.
Un nouveau cycle de recherches scientifiques eut lieu entre les deux guerres, principalement grâce à l'intérêt de A.C. Blanc et L. Cardini de l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana. Il permit la découverte d'un nouveau site, le riparo (ou abri) Mochi, qui fut fouillé de façon intermittente jusqu'en 1962.
Dans les années suivantes, l'équipe du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco, sous la direction de L. Barrai et S. Simone, reprit la fouille de la grotte du Prince, alors que l'Institut International d'Études Ligures, avec G. Vicino, s'attacha à deux nouvelles localités : le site du Casino et le riparo (ou abri) Bombrini.
INVENTAIRE DES OBJETS EN STEATITE
aurignacien
Grotte du Cavillon
Pendeloque rectangulaire
E. Rivière publia en 1887 une pendeloque de «schiste talqueux». Elle est noire, brisée à une extré-
Illustration non autorisée à la diffusion
MARGHERITA MUSST
Fig. 2 — 1, pendentif de la grotte du Cavillon (Rivière, 1887); 2, 3, objets décorés d'incisions de la Barma Grande (Graziosi, 1956; Reinach, 1898); 4-6, figurines féminines de la grotte du Prince (Piette, 1902; Breuil, 1930); 7, pendentif de l'abri Mochi (Blanc, 1954).
Sans échelle.
mité et mesure 46 mm X 14 mm X 4 mm (fig. 2, n° 1). Elle présente sur sa surface des traces de peroxyde de fer, ainsi que des stries irrégulières qui parfois s'entrecroisent. L'examen auquel cet objet, maintenant perdu, fut soumis, montre qu'il avait été travaillé avec un burin de silex qui servit à amincir la pendeloque par raclage, et à percer le trou qua- drangulaire, irrégulier, de 3 mm X 1,5 mm.
Stratigraphiquement, la découverte eut lieu à 8,75 m au-dessous du niveau originel du remplissage
et à 6 m au-dessous de la sépulture que nous estimons datée entre 25000 et 20000 BP (Mussi, 1986a ; Mussi et al., 1989). Une pointe en os à base fendue, provenant d'un niveau plus haut que la pendeloque, a été publiée par Rivière (1887, pi. IX, n° 20). Un dépôt aurignacien existait donc dans cette grotte et, la pendeloque étant à un niveau nettement plus bas que la sépulture datée du Gravettien ou de l'Épi- gravettien ancien, elle pourrait raisonnablement lui être rattachée. Mais cela reste une hypothèse.
LA STEATITE AUX BALZI ROSSI
Comparaisons En Italie, à la grotta del Fossellone (Mont Circé,
Latium), deux pendeloques de steatite du niveau aurignacien, en forme de goutte ou de croche de cerf, ont été travaillées de façon semblable (Mussi, 1988- 1989) (fig. 3a) : elles ont d'abord été façonnées par raclage avec un outil qui peut avoir été un burin et qui a laissé d'amples facettes ; puis, la surface a été modelée plus finement par un travail qui a produit des stries irrégulières ; enfin, une partie seulement, celle globuleuse, a été polie par abrasion. La perforation, tentée en creusant la surface avec un outil qui a provoqué des stries irrégulières, a échoué dans les deux cas : dans l'un, l'extrémité s'est cassée, dans l'autre, le trou commencé dans la partie la plus épaisse n'a pas été terminé. La même technique de perforation grossière a été appliquée à de vraies croches de cerf, souvent brisées à la hauteur du trou.
En France, des pendeloques en steatite de l'Au- rignacien I, d'âge compris entre 34000 et 32000 BP, sont connues en Dordogne dans les abris Castanet, Blanchard et La Souquette (White, 1989). Ici aussi, la perforation était produite par de profondes incisions, plus ou moins parallèles, qui amincissaient l'objet dans la partie voulue ; le trou était ensuite obtenu par pression ou, plus rarement, par la rotation d'un outil pointu tenu dans la main.
A l'abri Rothschild (Hérault), un petit pendentif de steatite vert clair est attribué au niveau aurignacien, alors que d'autres semblent néolithiques (Barge, 1983). La technique de fabrication de cet objet n'est pas décrite, mais les croches de cerf également présentes ont été percées par grattage et incision.
Gravettien-Épigravettien ancien
Nous emploierons ici le terme Épigravettien ancien pour désigner les industries faisant immédiatement suite au Gravettien V. En effet ce terme, communément en usage dans la littérature italienne, est assez générique pour être utile dans un contexte archéologique dont nous savons peu de chose. Toutefois, à la grotte des Enfants, un niveau défini comme appartenant à l'Arénien ancien (niveau F) a été reconnu au-dessus du Gravettien Vc (niveau G), superposé à son tour à du Gravettien IV (niveau H) (Onoratini, Da Silva, 1978). D'après Palma di Ces- nola (1979), en G il y aurait plutôt du Gravettien final et en F de l' Épigravettien ancien final. A l'abri Mochi, il y a en D du Gravettien Vc et en G de l'Épi- gravettien ancien initial remontant à 20000 BP (Palma di Cesnola, Bietti, 1983). Mais pour Onoratini
1cm 1cm
Fig. 3 — Exemples de techniques de perforation de pendentifs en steatite : a, perforation manquée, par refouillement de la surface (grotta del Fossellone, Aurignacien) ; b, perforation
réussie, par rotation (grotta Polesini, Épigravettien final).
et Da Silva (1978), ce dernier est au contraire du Proto-Arénien, donc de deux ou trois millénaires plus ancien.
Grotte des Enfants
Morceau de steatite raclé Dans le niveau H, a été recueillie «une petite
pierre bleuâtre savonneuse au toucher, un morceau de steatite couvert de stries [qui] portait un sillon comme si on avait voulu le diviser» (Villeneuve et al., 1906-1919, p. 267). Cet objet, décrit comme «raclé et rayé» (ibid., p. 266), mesure 50 mm de longueur. Cette découverte en position stratigraphique sûre fut importante, comme l'a déjà souligné L. Pales (1972) : elle confirma l'authenticité et l'antiquité des «venus de Grimaldi»3, alors connues depuis quelques années : comme nous le verrons, elles sont presque toutes en steatite.
Barm a Grande
Figurine féminine en steatite jaune
L'objet le plus célèbre de cette grotte est certainement la figurine féminine de steatite jaune, cassée, haute actuellement de 47 mm, avec une épais-
3. Nous employons le terme conventionnel de «venus» pour indiquer les statuettes féminines.
MARGHERITA MUSSI
r 2cm
-0
Fig. 4 — Figurine en steatite jaune de la Barma Grande.
seur maximum de 12 mm (fig. 4). Elle fut achetée en 1896 à L. Jullien par S. Reinach (1898) pour le Musée de Saint-Germain-en-Laye où elle est conservée depuis. D'après la documentation publiée par L. Pales (1972), elle se trouvait dans ce que Jullien appelait la «zone A» des fouilles, proche de la paroi droite ou orientale. La couche à laquelle elle appartenait était située entre 4,20 m et 4,70 m au-dessous de la surface initiale, en comprenant déjà 2 m de sédiment remanié par les recherches précédentes.
La couche concernée se trouvait à 4 m au-dessus de la première sépulture découverte en 1884 près de l'entrée de la Barma Grande. Dans le niveau sus- jacent, d'une épaisseur de 1,30 m, il y avait l'unique venus en os des Balzi Rossi, conservée elle aussi au Musée de Saint-Germain-en-Laye. Il y a donc un net décalage stratigraphique par rapport à la sépulture pour laquelle nous avons suggéré un âge de 25000 à 20000 BP (Mussi, 1986a; Mussi et al., 1989). Toutefois, il faut tenir compte du fait que, d'une part le squelette se trouvait très probablement dans une fosse assez profonde (Mussi, 1986a) et que, d'autre part, de l'avis de témoins oculaires, les couches étaient fortement inclinées de l'intérieur de la grotte vers l'extérieur (Octobon, 1952; Verneau, 1899). La localisation de la «zone A» de Jullien, où se trouvait la figurine, n'est pas connue mais on sait par Reinach (1898) que c'est une autre zone de fouille, la «zone B», qui était la plus près de l'entrée. La sépulture en question étant, elle, certainement dans cette partie de la grotte proche de l'extérieur, il y avait
ment plusieurs mètres de distance de celle-ci à la figurine, et donc une certaine dénivellation naturelle des couches archéologiques.
L'autre élément de datation de cette venus est d'ordre typologique. Malgré des critiques certainement fondées (Pales, 1972; Soffer, 1987), un âge voisin ou supérieur à 20000 BP est généralement reconnu comme acceptable pour un certain nombre de ces figurines féminines, si ce n'est pour toutes (Leroi-Gourhan, 1965; Gamble, 1982; Lumley, 1984). C'est aussi le cas des deux seules venus italiennes plus ou moins bien datées : celles, en os, de la grotta délie Veneri dans les Pouilles (Gremonesi, 1987).
Si ce raisonnement est valable, la présence d'une autre figurine féminine, en os cette fois, mais aux caractères stylistiques semblables, située plus haut dans la stratigraphie, ne peut que confirmer un âge correspondant à celui du Gravettien ou de l'Épi- gravettien ancien pour la venus de steatite jaune : elle se trouve, en effet, dans un niveau situé entre une figurine et une sépulture de cet âge.
Fragment avec incisions formant quadrillage Le niveau de la figurine jaune contenait égal
ement un «fragment d'argile bleue sculpté (quadrillé en relief) appartenant au musée de Saint-Germain» (Pales, 1972, p. 262). Il s'agit apparemment de l'objet en steatite acquis par Reinach (1898) en même temps que la statuette (fig. 2, n° 3).
Fragment de pendeloque Un «fragment de pendeloque en steatite» (Pales,
1972, p. 262), dont il ne semble plus exister de trace, a été trouvé plus haut, dans le niveau de la petite venus en os. Cette dernière est l'unique élément qui puisse quelque peu servir à en étayer la chronologie.
Grotte du Prince
La provenance stratigraphique des objets en steatite de cette cavité est la plus difficile à établir. En effet, les fouilles du prince Albert Ier ne rencontrèrent que des industries moustériennes (Villeneuve et al., 1906-1919). Celles-ci se retrouvent jusque dans le foyer supérieur A, scellé par une stalagmite (couche 8) dont la puissance dépasse 1 m par endroits. Au-dessus s'étendait la couche 9, terreuse et caillouteuse, où les fouilles furent complètement infructueuses.
Mais apparemment elles ne le furent pas pour tout le monde. En effet, les documents publiés par Pales (1972) démontrent que, de 1892 à 1895, Jullien
LA STEATITE AUX BALZI ROSSI
COUPE LONGITUDINALE DELA CROTTE DU PRINCE dressée par M.Tschirrct , sous la direction de M. M. M. BOULE et L . DE VILLENEUVE
Fig. 5 — Coupe longitudinale de la grotte du Prince (d'après Villeneuve et al., 1906-1919). Les deux profondes excavations qui traversent la couche 9 et, dans un cas, également la couche 8, sont bien visibles dans le fond. De toute évidence, il s'agit des traces
laissées par les fouilles clandestines de L. Jullien.
Fig. 6 — L'entrée de la grotte du Prince avant les fouilles du prince Albert Ier de Monaco (d'après Villeneuve et al.. 1906- 1919). Il est probable que l'accès à la grotte, encore libre dans sa partie interne, ait été malaisé pour les hommes du Paléoli
thique supérieur.
y fouilla clandestinement et avec «succès». Ces activités illicites n'échappèrent d'ailleurs pas entièrement à l'attention de l'équipe du prince de Monaco. En effet, nous apprenons par L. de Villeneuve (Villeneuve et al., 1906-1919, vol. I, p. 36) que cette grotte, qui était réputée intacte, «depuis la déclaration de M. Rivière et la vérification faite par M. Saige en 1883 [...] avait subi un commencement d'excavation témoigné par deux fosses pratiquées au fond de la chambre [...]. Elles n'ont pas outrepassé une couche de formation récente, au-dessous de laquelle s'étendait le plancher stalagmitique qui recouvrait le dépôt». La coupe longitudinale bien connue de la grotte du Prince indique clairement, dans le fond de la cavité, deux excavations irrégulières qui intéressent la couche 9 (fïg. 5). L'une d'elles, profonde d'environ 2 m, traverse en fait entièrement la stalagmite qui recouvre le Moustérien (fig. 5).
MARGHERITA MUSSI
Pig 7 — Figurines de la grotte du Prince : 1, «Polichinelle» ; 2, «Tête négroïde»; 3, «Losange»; 4, «Hermaphrodite»; 5, figurine sans autre dénomination (échelles différentes).
Par ailleurs, le concrétionnement s'étendait aussi à la «base de la couche supérieure et terminale n° 9» (ibid., vol. I, p. 95). Il était donc encore en cours de formation lorsque les sédiments de la couche 9 commencèrent à se déposer. Pour J.-C. Mis- kovsky (1974), la stalagmite correspond à l'inter- stade Wûrm II/III. Pour celle-ci, une datation au Th 230/U 238 a donné un âge de 32600 ± 3 000 BP (Fornaca-Rinaldi, Radmilli, 1968). Elle pourrait donc plutôt dater de l'interstade d'Arcy. Dans un cas comme dans l'autre, la couche 9, concrétionnée à sa base, s'est bien formée durant un laps de temps qui correspond au Paléolithique supérieur ou à une partie de celui-ci.
Le dernier point est celui de l'extension, vraisemblablement très limitée, de la zone où se trouvaient les objets du Paléolithique supérieur. Un coup d'œil à l'énorme cône contenant les niveaux du Paléolithique moyen, qui obstruait presque entièrement l'entrée de la cavité encore à la fin du siècle dernier, montre bien que, dès le Paléolithique supérieur, il ne pouvait s'agir d'une fréquentation aisée (fig. 5 et 6). Les découvertes semblant provenir du fond de la grotte, cette localisation serait, d'après Pales (1972), une sorte de «cachette» à l'écart de l'occupation principale. Cette dernière n'était d'ailleurs
apparemment pas située dans la grotte du Prince elle-même, mais plutôt dans une autre des cavités proches.
Figurines féminines (cinq au minimum) Toutes les venus des grottes de Grimaldi furent
découvertes par L. Jullien. Ce dernier, dans les lettres publiées par Breuil (1930) et Pales (1972), ne laisse aucun doute sur le fait que, hormis les deux statuettes de la Barma Grande (celle en os et celle en steatite jaune), les autres viennent de la grotte du Prince, qu'il appelle «grotte du Tunnel» ou «grotte des Statuettes». Un plan avec sa localisation fut d'ailleurs fourni. Il affirme dans une lettre adressée à Piette le 20 juin 1896 (Pales, 1972, p. 265) : «c'est dans l'été de 1895 et dans les couches les plus profondes [de mes propres fouilles] qu'on a trouvé les sculptures (et la gravure en os) dont le nombre s'élève à quinze en tout. Elles sont en pierre».
Une partie de ce lot se trouve actuellement au Musée de Saint-Germain-en-Laye. Il s'agit d'un groupe de quatre figurines acquises par E. Piette (1902), et connues comme «Polichinelle» (61 mm X 10 mm X 20 mm) (fig. 7, n° 1), «Tête négroïde» (24 mm X 24 mm X 13 mm) (fig. 2, n° 4 et fig. 7,
LA STEATITE AUX BALZI ROSSI 9
r3cm
L0
Fig. 8 — Le plus grand des deux pendentifs de steatite de Gavorrano, décoré avec des incisions formant quadrillage en
relief (Bartoli et al., 1977).
n° 2), «Losange» (63 mm X 24 mm X 17mm) (fig. 7, n° 3) et «Hermaphrodite» (52 mm X 17 mm X 11 mm) (fig. 7, n° 4). Une cinquième, sans autre dénomination, fut achetée plus tard (38 mm X 12 mm X 14 mm) (fig. 7, n° 5). Elles sont toutes en steatite verte plus ou moins translucide.
La forme originelle du petit galet ou bloc de matière première a conditionné l'obtention de la figurine désirée. Mais l'habileté technique et la capacité conceptuelle des créateurs de ces statuettes sont évidentes dans la façon dont ils ont savamment tiré parti de la pièce, au volume parfois irrégulier, qu'ils avaient à disposition. Les modalités de fabrication de ces objets n'ont pas été étudiées en détail. Toutefois, il faut mentionner l'observation de G. de Mortil- let (1898) au sujet de la figurine de la Barma Grande, dont il contestait d'ailleurs vivement l'authenticité4. Selon celui-ci, la «patine» très lisse de la statuette avait été obtenue en la tenant pendant un certain temps dans une poche. Ceci pourrait nous renseigner sur la façon de conserver ces objets.
Comparaisons D'autres figurines féminines de steatite sont
connues en Italie : la venus de Savignano, énorme dans son genre étant donné qu'elle mesure 220 mm de long et pèse plus d'une livre, et la petite venus du lac Trasimène, haute de 24 mm (Graziosi, 1924 et
4. M. Chollot (1964) présente un excellent compte rendu des discussions qui eurent lieu au sujet de l'authenticité des venus des Balzi Rossi.
1956; Palma di Cesnola, 1938). Malheureusement, elles sont privées de contexte archéologique et on ne connaît même pas précisément l'origine de la seconde.
Il y a quelques indications chronologiques pour d'autres objets de steatite. Ainsi L. Cardini (1941) mentionne la présence d'un «fragment de schiste tal- queux» à la grotta délie Arène Candide (Ligurie). Il a été trouvé entre 4,20 m et 4,30 m de profondeur, donc dans le foyer 1, avec une industrie de l'Épi- gravettien ancien, pour lequel une date 14C de 18560 ± 210 BP a récemment été publiée (Bietti, 1987a).
De nombreuses perles ou pendentifs de steatite blanche et verte sont mentionnés dans le site de plein air de Monte Longo en Toscane, pratiquement inédit mais qui semble appartenir au Gravettien final (De Borzatti von Lôwenstern, 1969; Palma di Cesnola, Bietti, 1983). Récemment, un pendentif de steatite a été signalé dans le niveau 17A de la grotta Paglicci dans les Pouilles, avec une industrie de l'Épigravet- tien ancien (IIPP, 1986). Deux dates 14C, respectivement de 19600 + 300 BP et de 17900 ± 300 BP, ont été publiées pour le niveau 17, alors que d'autres, proches de 17000 BP, sont jugées peu cohérentes par les fouilleurs (Palma di Cesnola, 1988). La chronologie de deux pendentifs de steatite couleur vert olive, trouvés lors d'un ramassage de surface à Gavorrano en Toscane, est plus difficile à établir (Bartoli et al., 1977 ; Galiberti, 1979) (fig. 8). Ils mesurent respectivement 25 înm (cassé) X 19mm X 4 mm, et 53 mm X 33 mm X 17 mm. Dans la même localité, de l'outillage lithique attribuable à différentes phases de l'Épigravettien, y compris l'Épigravettien ancien, a été trouvé. Des comparaisons ont été établies entre la décoration du plus grand des deux, composée de profonds sillons qui s'entrecoupent, et la coiffure de la «Tête négroïde» de la grotte du Prince. A Gavorrano, les objets ont été travaillés par incision, abrasion et polissage. Ensuite, ils ont été perforés selon la technique décrite par S.A. Semenov (1964) (fig. 9a). Il s'agissait de la méthode de perforation la plus simple par rotation d'un outil pointu : celle qui consiste en un mouvement alterné de la main qui tient l'outil. L'action a lieu à partir de chacune des deux faces et le résultat est un trou biconique fortement évasé, du fait du manque de stabilité de l'axe de rotation.
En France, des objets de steatite ont été trouvés dans le Massif Central dans le Protomagdalénien du Blot (Delporte, 1972), mais ils sont de conception très différente. Il s'agit d'un petit godet et d'une plaquette avec des incisions zoomorphes. Us sont tous deux munis d'un trou de suspension.
10 MARGHERITA MUSSI
Fig. 9 — Méthodes de perforation par rotation : a, perforation manuelle directe (d'après Semenov, 1964); b, perforation avec foret emmanché (d'après Semenov, 1964); c, perforation avec taraudeur à arc (d'après Malaurie, 1976). L'emploi de cette dernière méthode
au Paléolithique n'est pas démontré.
Fin du paléolithique supérieur
Abri Mochi
Pendentif Découvert dans le niveau A, avec une industrie
de l'Épigravettien final d'après Laplace (1966), du Bouverien d'après Onoratini et Da Silva (1978), il est mentionné par Blanc (1938) comme «une amulette de talcschiste vert». Nous pensons la reconnaître dans l'exemplaire qu'il illustra par la suite dans les fameuses «épreuves» de 1954, restées telles et non accompagnées d'un texte (Blanc, 1954, tav. 40, n° 24) (fig. 2, n° 7). C'est un pendentif plus ou moins ovalaire, à section piano-convexe, cassé à la hauteur du trou de suspension et doté dans la partie centrale, successivement semblerait-il, d'un second trou à section biconique. La technique de perforation paraît donc semblable à celle des exemplaires, peut-être plus anciens, de Gavorrano.
Barma Grande
Fragment travaillé Dans la coupe stratigraphique de L. Jullien
publiée par Pales (1972) figure, dans le premier
niveau de la «zone A», au-dessus de la couche de la venus en os, un «fragment sculpté d'argile bleue». Rappelons que Jullien avait décrit de la sorte l'objet en steatite vendu en même temps que la petite venus jaune. Il est tentant, mai&non prouvé, de penser que ce «fragment» appartient à une phase plutôt avancée, voire finale, du Paléolithique supérieur.
Grotte du Prince
Figurine féminine biface
Une figurine féminine de steatite vert foncé, haute de 69 mm, sculptée sur les deux faces et dite «Janus», avec une perforation au cou, se trouve actuellement au Peabody Museum de Harvard (fig. 2, n° 5). Elle a récemment été réétudiée par A. Marshack (1986). Breuil, qui la publia en premier (1930), cite à son sujet une lettre de son confrère l'abbé Dupaigne. Celui-ci, de Montréal où s'était établi Jullien auquel il s'était adressé, lui envoyait des indications sur l'origine de cet objet. Il proviendrait de la Barma Grande, et aurait été trouvé à une profondeur de 6 m. Pales (1972) conteste fort justement, nous semble-t-il, ces affirmations fournies, vingt ans après les «fouilles», par Jullien très âgé à l'époque et à la mémoire défaillante. Elles contredisent ce qu'il
LA STEATITE AUX BALZI ROSSI 11
avait exposé de façon claire et explicite en 1885, peu après la trouvaille des «quinze statuettes» de la grotte du Prince. Nous retenons donc cette dernière place d'origine comme étant la plus valable.
Après une analyse stylistique, Marshack estime que cette figurine est différente des autres et comparable à des représentations féminines de la fin du Paléolithique supérieur. Cette hypothèse de datation impliquerait alors — à la différence de tout autre reste, semble-t-il — que des venus aient été abandonnées ou entreposées à des époques très différentes, dans la même zone limitée de la grotte du Prince. Cela est assez troublant, et rend souhaitables d'autres formes de datation pour tout ce lot de statuettes.
Nous n'avons pas d'informations sur les techniques de fabrication. D'après les photographies, le travail paraît sommaire et peu précis ; la perforation du cou est largement échancrée et de forme irrégulière. Marshack remarque la présence d'un dépôt ancien rougeâtre dans les sillons entre les deux jambes. Les saillies du ventre, des seins et du visage présentent un poli qui, comme dans le cas de la venus de la Barma Grande, paraît secondaire, et plutôt dû au maniement et à l'utilisation.
Buste féminin Si un âge relativement tardif est accepté pour la
figurine «Janus», nous estimons qu'il est aussi valable pour un buste avec deux seins, d'une grandeur maximum approximative de 30 mm. Il a été sommairement illustré par Breuil en même temps que la précédente venus à laquelle il nous paraît beaucoup ressembler (fig. 2, n° 6). Depuis, cet objet a été perdu.
Comparaisons En Italie, à la grotta délie Arène Candide, le
mobilier funéraire des sépultures de la fin du Paléolithique datées entre 12000 et 11000 BP (Bietti, 1987a) comprend, dans certains cas, du «talc» (sans plus de précision) peut-être non travaillé (Cardini, 1942). Poggio délie Monache, un site de plein air de Toscane, connu par des ramassages de surface, a livré de l'industrie lithique de l'Épigravettien final et quelques fragments de steatite grise ; un seul d'entre eux a été travaillé et poli «en forme de goutte» (Coc- chi, 1951). A la grotta Polesini, près de Rome, deux pendeloques de steatite ont été recueillies et illustrées par Radmilli (1974) ; tout le remplissage semble appartenir à l'extrême fin du Paléolithique. A l'examen, elles apparaissent l'une noire, l'autre vert clair (fig. 3b) (Mussi, 1988-1989). La première, à section
piano-convexe, mesure 18 mm X 22 mm X 10 mm. Elle présente des fractures, et a été décorée par un minimum de quatre stries parallèles. La plus petite, de 15 mm X 13 mm X 5 mm, a une section lenticulaire. Elles sont toutes deux bien polies sur toute leur surface, bien que quelques petites stries irrégulières soient encore apparentes. Les trous de suspension ont été exécutés avec précision et présentent de fines stries concentriques. Dans la partie supérieure de la plus petite, ces dernières sont interrompues par d'autres transversales par rapport aux premières et qui semblent dues à la suspension. D'après S.A. Semenov (1964), des stries de perforation très régulières à l'intérieur d'un trou bien circulaire indiquent que le travail a été effectué sans déplacer l'axe de l'outil perforant. Ce résultat peut être obtenu grâce à un foret fixé à l'extrémité d'un support manœuvré entre les mains (fig. 9b) ou, avec de meilleurs résultats, avec un taraudeur à arc (fig. 9c). Dans les exemplaires de la grotta Polesini, le trou n'est pas parfaitement cylindrique mais très légèrement biconique. Il y a un palier de jonction à peine marqué qui est le résultat d'une perforation complète à partir d'une face, reprise par une autre perforation, coaxiale à la première et faite à partir de l'autre face.
Un pendentif de steatite associé à l'Épigravettien final a également été trouvé dans le riparo Sal- vini de Terracina, au sud de Rome (Bietti, 1987b).
En France aussi, on trouve des objets en steatite dans plusieurs localités distantes les unes des autres. Il s'agit principalement d'éléments de parure trouvés, dans des niveaux du Magdalénien final, à La Chaire à Calvin en Charente, au Veyrier en Haute- Savoie, à Isturitz dans les Pyrénées-Atlantiques (Bouvier, 1968).
Objets sans attribution chronologique
Barma Grande
Fragment décoré d'incisions Lors des fouilles de Bonfils fut découvert, dans
un niveau d'origine inconnu, un fragment quadran- gulaire de steatite de couleur foncée, décoré sur les deux faces par de profondes incisions qui déterminent un quadrillage en relief (fig. 2, n° 2) (Octo- bon, 1952).
Pendentif avec incisions Une pendeloque de forme allongée, couverte
d'incisions, avec un début de perforation, fut trouvée par L. Cardini (1938) dans le sédiment remanié.
12 MARGHERITA MUSSI
Grotte du Prince
«Buste» Un «buste» inédit, "perdu depuis, peut-être en
steatite, emporté par Jullien à Montréal, est mentionné par Breuil (1930) et par Pales (1972).
Autres figurines Pour arriver au total de quinze statuettes de
«pierre» dont parle Jullien dans sa lettre à Piette déjà mentionnée, il manque encore sept figurines, dont on ne sait absolument rien.
LES SOURCES DE MATIÈRE PREMIÈRE
Les gisements de talc et de steatite se trouvent dans des formations métamorphiques. Il y en a de très étendus dans les Alpes, et principalement les Alpes occidentales, ainsi que d'autres, plus limités, dans les Apennins (surtout dans les Apennins septentrionaux) et les Préapennins. Ils se situent à la périphérie des amas de pierres vertes, comme faciès particulier de ces dernières (Cavinato, 1952).
En Ligurie même, des gisements ont été exploités de façon poussée dès la préhistoire. Ainsi à Pia- naccia di Suvero, à l'autre extrémité du golfe de Gênes, un atelier de l'Age du Bronze, lié au travail de cette matière, a été identifié (Tiscornia, 1983). Les objets en steatite s'y trouvent à tous les stades de fabrication. D'autres gisements sont aussi connus actuellement près de Sestri Levante (Del Caldo et al., 1973). E. Rivière (1887), grand précurseur dans bien des secteurs, se préoccupa de rechercher quelles pouvaient être les sources exploitables de cette matière à proximité des Balzi Rossi et en reconnut la présence au col de Tende, à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau. Toutefois, nous savons aujourd'hui qu'à la fin du Wùrm cette zone était touchée par des glaciers (Cassoli, 1980, fig. 1). Il est tout à fait improbable que les hommes du Paléolithique l'aient fréquentée ; ils pouvaient plutôt avoir recueilli de petits galets de steatite dans le lit de torrents qui, comme la Roia, naissent dans ce massif montagneux et débouchent sur la côte à quelques kilomètres des grottes. La variabilité de la matière première (verte, noire, bleuâtre, jaune) et la forme sous laquelle elle a été trouvée, qui a conditionné dans certains cas l'exécution des figurines, correspondent bien à des galets tels qu'on peut les trouver dans le lit des cours d'eau.
La distance parcourue pour se procurer la steatite, par rapport à celle où l'objet fini a été perdu,
abandonné ou déposé, a varié au cours du Paléolithique supérieur. Ainsi R. White (1989), à propos de la steatite recueillie dans des niveaux aurignaciens de sites du Sud-Ouest, estime qu'elle provenait du Massif Central ou des Pyrénées, soit de plus de 100 km. Dans le cas également des pendeloques auri- gnaciennes, déjà citées, de la grotta del Fossellone au Mont Circé, une source d'origine éloignée semble probable (Mussi, 1988-1989). Par la suite, on continua à exploiter autant des sources proches (c'est le cas des sites des Balzi Rossi et de ceux de Toscane où cette matière première est assez répandue), que de plus lointaines (c'est probablement le cas à la grotta Paglicci, ou dans les localités du Latium : grotta Polesini et riparo Salvini).
RÉFLEXIONS SUR L'EMPLOI DU TALC ET DE LA STEATITE
Le talc, ou plus exactement la poudre de talc, sert actuellement dans le travail des peaux et du cuir. Il serait intéressant de contrôler si cet emploi existait déjà au Paléolithique. En effet, la connaissance de la steatite n'a probablement pas été disjointe de celle du talc : en entaillant, perçant et raclant celle-ci, on obtient «une poussière grise onctueuse au toucher» (Rivière, 1887, p. 177) qui n'a pas dû échapper à l'attention des artisans préhistoriques. Malheureusement, nous n'avons pas de preuves directes de l'usage de la poudre de talc. Notons juste quelques indices possibles, des objets informes qui pourraient éventuellement être le résultat de raclage intensif dans le but explicite de se procurer cette poudre : la pièce de steatite fortement incisée et raclée du niveau G de la grotte des Enfants, le « fragment de schiste talqueux» du foyer 1 de la grotta délie Arène Candide et, de ce même site, le «talc» trouvé dans les sépultures de la fin du Paléolithique qui contenaient aussi, de façon certaine, d'autres matières premières non travaillées, telles que limo- nite, graphite, etc. Enfin, à Poggio délie Monache il y avait des pièces de steatite non modifiée.
Dans la majorité des cas, il ne fait aucun doute que c'est bien le matériau steatite, et non la poudre, que l'on a cherché. L'usage auquel on l'a destiné est très restreint : objets de parure et figurines féminines. De ce point de vue d'ailleurs, les témoignages des Balzi Rossi se rattachent de près surtout à ceux des autres sites italiens. En France, la steatite est plus rare et parfois, comme au Blot (Haute-Loire), destinée à un emploi original.
La pertinence de l'emploi d'une substance brillante et colorée dans l'ornementation personnelle ne
LA STEATITE AUX BALZI ROSSI 13
fait aucun doute ; son utilisation pour des statuettes peut sembler plus surprenante, malgré la facilité qu'il y a à travailler cette matière particulière. Toutefois, la recherche d'une substance colorée et relativement malléable pour y tailler des figurines est en fait généralisée. Si l'on fait un bref inventaire de ces objets, en laissant de côté l'os, la corne ou l'ivoire, nous constatons qu'en Dordogne la venus de Mon- pazier est en roche complexe à base de limonite, celle de Sireuil en calcite définie comme «ambrée», celle de Tursac en calcite translucide, celle du Courbet en grès rouge, celle de Mainz-Linsenberg (Allemagne) en grès tendre gris verdâtre, celles de Petfkovice (Tchécoslovaquie) en hématite et certains exemplaires de Kostienki (URSS) en calcaire tendre (Ladier, 1987; Lumley, 1984). La recherche de steatite pour fabriquer des statuettes féminines correspondrait, en Italie, à des impératifs précis d'ordre tant esthétique que technique : si l'on exclut l'os et en l'absence d'ivoire de mammouth, il s'agissait probablement de la matière première la plus facile à se procurer à cet effet.
L'étude de ce matériel rare et particulier qu'est la steatite nous donne, pour les sites des Balzi Rossi, une série d'informations qui s'insèrent dans le cadre plus général du Paléolithique supérieur de l'Europe occidentale.
Sur le plan technique, on assiste à un affinement des méthodes, depuis les tentatives malhabiles des débuts (probablement dès l'Aurignacien, aux Balzi Rossi comme ailleurs en Italie et en France) jusqu'à la maîtrise du façonnage tridimensionnel, tel qu'il apparaît dans certaines des figurines féminines. La perforation par rotation manuelle directe est connue à la fin du Paléolithique, comme en témoigne une des rares pendeloques relativement bien datées, celle du riparo Mochi (niveau A). Cette technique était peut- être déjà employée des millénaires plus tôt dans des sites comme Gavorrano. Les techniques plus perfectionnées, telles qu'elles apparaissent dans les exemplaires de la grotta Polesini, ne se retrouvent pas aux Balzi Rossi.
A toutes les époques, c'est bien la perforation qui a été l'obstacle technique le plus difficile à surmonter. Cela se comprend aisément. Si l'on modifie une forme ou un volume en recreusant, raclant, polissant une surface, on parvient assez facilement à corriger d'éventuelles fautes ou imperfections. La perforation, au point de vue mécanique, est une action bien différente, beaucoup plus violente et difficile à contrôler. Elle est définitive et entraîne souvent des fractures, comme le montre notre inven-
Tabl. I — Répertoire des objets en steatite.
Figurines
Pendentifs
Autres
Grotte des Enfants
1
Grotte du Caoillon
1 (cassé)
Abri Mochi
1 (cassé)
Barma Grande
1
2 (1 entier + 1 cassé)
3
Grotte du Prince
8 (+ 7 dis
parues)
Italie
2
9* (5 entiers + 4 cassés)
l" ,
' auxquels s'ajoutent les «nombreux» pendentifs de Monte Longo. ** il y a en outre un nombre imprécis de fragments de «talc» à la grotta délie Arène Candide (sépultures de la fin du Paléolithique) et de morceaux de steatite non travaillée à Poggio délie Monache.
taire (tabl. I). Elle crée aussi, quand elle réussit, une zone de moindre résistance aux chocs, qui se casse plus facilement. Dans ce cas, seule une seconde perforation, lorsqu'elle est possible, permet de récupérer la pendeloque.
Du point de vue chronologique, les conditions de découverte de la plupart des objets ne sont pas satisfaisantes. Il est par exemple regrettable qu'un style de décoration très particulier, celui par quadrillage d'incisions très profondes, ne soit pas mieux daté. Nous le trouvons, probablement à l'époque du Gravettien-Épigravettien ancien, sur la «Tête négroïde» de la grotte du Prince (qui rappelle la «Dame à la Capuche» de Brassempouy et la figurine « AVN-77 n° 1 » de Avdeevo en URSS). Il existe aussi sur un des pendentifs de Gavorrano, et sur deux objets d'usage indéterminé, ainsi que sur un pendentif, tous trois de la Barma Grande (au moins un de ces éléments est d'ailleurs proche, stratigraphique- ment, d'une des venus du site) (fig. 2, nos 2-4 et fig. 8).
L'aspect géographique de la répartition des produits en steatite est intéressant. Ceux que nous trouvons aux Balzi Rossi présentent de nombreux points de contact typologiques, stylistiques et technologiques avec ceux du reste de l'Italie. Les rapports avec la France, où la steatite est plus rarement employée, sont moins évidents. Il est même tout à fait surprenant de constater que cette matière première manque totalement dans les sites de la France méditerranéenne à l'ouest du Rhône, pour lesquels un inventaire des objets d'art et de parure a été établi (Sacchi, 1984) 5. De ce point de vue, la situation
5. G. Onoratini nous a aimablement communiqué la présence d'éléments de steatite inédits dans quelques sites du Sud de la France à l'Est du Rhône.
14 MARGHERITA MUSSI
est la même que pour les sépultures des Balzi Rossi, qui trouvent de nombreux éléments de contact avec des sépultures italiennes, alors qu'en France ces témoignages font défaut (Mussi, 1986a et b ; Mussi et al., 1989). Ceci est en contraste avec d'autres aspects culturels, concrétisés par les venus comme par la présence d'outillage lithique du Gravettien à burins de Noailles, par lesquels les sites des Balzi Rossi et d'autres sites italiens se rattachent plus nettement au reste de l'Europe, du moins pendant une certaine période (Mussi, Zampetti, 1988).
Chronologiquement, il y a une certaine concentration de steatite correspondant au Gravettien-Épi- gravettien ancien. Ceci, tant aux Balzi Rossi qu'ailleurs en Italie. Nous avons montré que cette époque est généralement caractérisée, en Italie, par une nette recherche et par une production d'objets ayant une valeur esthétique et symbolique, et ayant pu servir entre autres à des contacts sur grandes distances (Mussi, 1990). Il n'est donc pas surprenant de constater, à ce moment-là, une intensification de l'emploi de la steatite qui se prête fort bien à ces usages. Cela, bien qu'il n'ait jamais été facile de se procurer cette substance peu fréquente.
Par la suite, durant la fin de l'Épigravettien ancien et durant l'Épigravettien évolué, il n'y a aucun objet en steatite raisonnablement daté, ni aux Balzi Rossi, ni ailleurs en Italie. Cette parenthèse négative s'applique d'ailleurs à toute une série de témoignages artistiques, funéraires, etc. (Mussi, 1986b; Zampetti, 1987; Mussi, Zampetti, 1988; Mussi et al., 1989). La fin du Paléolithique voit une certaine reprise de l'emploi de la steatite, un peu partout en Italie comme en France. Dans un cas comme dans l'autre ce sont surtout des objets de parure. Les sources de matière première se trouvant, par définition, dans des zones montagneuses, la fréquentation de régions nouvellement libérées des glaces, devenue possible à la fin du Wûrm, en augmentant les possibilités de recherche, pourrait ne pas être étrangère à ce phénomène.
Margherita Myssi6
6. Dipartimento di Scienze storiche, archeologiche e antropologiche dell'Antichità, Université di Roma «La Sapienza», Via Palestro 63, 00185 Rome, Italie.
BIBLIOGRAPHIE
Barge H. 1983 : Essai sur les parures du Paléolithique supérieur dans le Sud de la France, Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco, 27, p. 69-83. Bartoli G., Galiberti A., Gorini P. 1977 : Oggetti d'arte mobiliare rinvenuti nelle province di Grosseto e Pisa, Rivista di Scienze Preistoriche, XXXI, p. 193- 218. Bietti A. 1987a : Some remarks on the new radiocarbon dates from the Arène Candide Cave (Savona, Italy), Human Evolution, 2, p. 185-190. Bietti A. (sous la dir. de) 1987b : Biparo Salvini a Terracina, Roma, Quasar. Blanc A.C. 1938 : Nuovo giacimento paleolitico e mesolitico ai Balzi Rossi (Bàussi Rùssi) di Grimaldi, Bendiconti delta Beale Accademia Nationale dei Lincei, Classe di Scienze fïsiche, matematiche e naturali, série 6a, XXVIII, p. 1-7. 1954 : II Riparo Mochi ai Balzi Rossi di Grimaldi, Scavi 1938- 1949, Palaeontographia italica, L, épreuves. Blanc A.C, Segre A. G. 1953 : Excursion au Mont Circé, INQUA, Association Internationale pour l'Étude du Quaternaire, IVe Congrès International, Roma-Pisa.
Bouvier J.-M. 1968 : Godet en steatite et collier magdaléniens de la «Chaire à Calvin», Mouthiers (Charente), Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente, p. 65-72. Breuil H. 1930 : Renseignements inédits sur les circonstances de trouvaille des statuettes aurignaciennes des Baoussé Rousse, in : Atti Ia Biunione delVIslitulo Italiano di Paleontologia Umana, Firenze, p. 281-290. Cardini L. 1938 : Sulla presenza di industrie microlitiche di tipo mesolitico in due giacimenti preistorici italiani, Archivio per l'Antro- pologia e l'Etnologia, LXVIII, p. 5-11. 1941 : Ricerche paletnologiche nella Caverna délie Arène Candide, Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia, LXX, p. 1 10- 119. 1942 : Nuovi documenti sull'antichità dell'uomo in Italia : reperto umano del Paleolitico superiore nella «Grotta délie Arène Candide», Bazza e Civiltà, 3, p. 5-25. Cassoli P.F. 1980 : L'avifauna del Pleistocene superiore délie Arène Candide (Liguria), Memorie dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, III, p. 155-234. Cavinato A. 1952 : Depositi minerari, Torino, Libreria tecnica.
LA STEATITE AUX BALZI ROSSI 15
Chollot M. 1964 : Musée des Antiquités Nationales, Collection Pietle, Paris, éd. des Musées Nationaux. COCCHI P. 1951 : Nuovi giacimenti paleolitici in Toscana, Rivisla di Scienze Preistoriche, VI, p. 49-78. Cremonesi G. 1987 : Due complessi d'arte del Paleolitico superiore : la Grotta Polesini e la Grotta délie Veneri, in : Alti del 6° Conve- gno sulla Preistoria-Protostoria-Storia délia Daunia (a cura di B. Mundi e A. Gravina), 2, p. 35-46. De Borzatti von Lowenstern E. 1969 : Monte Longo, Rivisla di Scienze Preistoriche, XXIV, p. 254. Del Caldo A., Moro C, Gramaccioli CM., Boscardin M. 1973 : Guida ai minerali, Milano, Fratelli Fabbri. Delporte H. 1972 : Protomagdalénien du Blot, commune de Cerzat (Haute- Loire). Étude préliminaire, in : Congrès Préhistorique de France, xixe session, Auvergne 1969, p. 190-199. FORNACA-RlNALDI G., RaDMILLI A.M. 1968 : Datazione con il metodo Th 230/U 238 di stalagmiti contenute in depositi musteriani, Atti délia Società Toscana di Scienze Naturali, série A, LXXV, p. 639-646. Galiberti A. 1979 : Ritrovamenti d'arte mobiliare in Toscana, Rassegna di Archeologia, I, p. 108-128. Gamble C. 1982 : Interaction and alliance in Palaeolithic Society, Man, 17, p. 92-107. Graziosi P. 1924 : Su di una statuetta steatopica preistorica rinvenuta a Savignano sul Panaro in Prov. di Modena, Archivio per l'Antro- pologia e l'Elnologia, LIV, p. 165-167. 1956 : Varie dell'antica età délia pietra, Firenze, Sansoni. IIPP (ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA) 1986 : Attività del 1986, Firenze, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. Ladier E. 1987 : La «Vénus du Courbet», Rulletin de la Société Préhistorique Française, 84, 1, p. 3-4. Laplace G. 1966 : Recherches sur l'origine et l'évolution des complexes leptoli- thiques, 4e suppl. aux Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, École française de Rome. Leroi-Gourhan A. 1965 : Préhistoire de l'art occidental, Paris, éd. Mazenod, coll. L'Art et les grandes civilisations. Lumley H. de (sous la dir. de) 1984 : Art et civilisations des chasseurs de la Préhistoire, Paris, Laboratoire de Préhistoire du Musée de l'Homme, Muséum National d'Histoire Naturelle. Malaurie J. 1976 : Les derniers rois de Thulé, Paris, éd. Pion. Marshack A. 1986 : Une figurine de Grimaldi «redécouverte» : analyse et discussion, L'Anthropologie, 90, p. 807-814.
MlSKOVSKY J.-C. 1974 : Le Quaternaire du Midi méditerranéen, Études Quaternaires, 3, Marseille, Univ. de Provence. Mortillet G. de 1898 : Statuette fausse des Baoussé-Roussé, Rulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, série VI, 9, p. 146-153. Mussi M. 1986a : On the chronology of the burials found in the Grimaldi Caves, Antropologia contemporanea, 9, p. 95-104. 1986b : Italian Palaeolithic and Mesolithic Burials, Human Evolution, 1, p. 545-556. 1988-1989 : L'uso della steatite nel Paleolitico superiore italiano, Origini, XIV, p. 189-205. 1990 : Continuity and change in Italy at the Last Glacial Maximum, in : The World at 18000 RP, vol. I, High Latitudes (O. Soffer and C. Gamble eds), London, Unwin Hyman, p. 126- 147. Mussi M., Zampetti D. 1988 : Frontiera e confini nel Gravettiano e nell'Epigravet- tiano dell' Italia. Prime considerazioni, Scienze dell'Antichità, 2, p. 45-78. Mussi M., Frayer D.W., Macchiarelli R. 1989 : Les vivants et les morts. Les sépultures du Paléolithique supérieur en Italie et leur interprétation, m : People and Culture in Change, Proceedings of the 2nd Symposium on Upper Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic Populations of Europe and the Mediterranean Basin (I. Hershkovitz éd.), RAR, International Series 508, I, p. 435-458. Octobon F.-C.-E. 1952 : Contribution à l'étude des couches supérieures de la Barma-grande, Cahiers de Préhistoire et d'Archéologie, 1, p. 3-28. Onoratini G., Da Silva J. 1978 : La grotte des Enfants à Grimaldi. Les foyers supérieurs, Rulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco, 22, p. 31-71. Pales L. 1972 : Les ci-devant venus stéatopyges aurignaciennes, in : Santander Symposium, Actes du Symposium international d'Art Rupestre de l'Union Internationale des Sciences Pré- et Protohistoriques, Santander-Asturias 1970, p. 238-283. Palma di Cesnola Al. 1938 : Nuova statuetta paleolitica rinvenuta in Italia, Archivio per l'Anir&pologia e l'Etnologia, LXVIII, p. 3-7. Palma di Cesnola Ar. 1979 : La série epigravettiana della Grotta dei Fanciulli (Grimaldi) nel quadro del Paleolitico superiore ligure, Rivista di Scienze Preistoriche, XXXIV, p. 3-44. 1988 : Paglicci, Regione Puglia (Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura), Foggia. Palma di Cesnola Ar., Bietti A. 1983 : Le Gravettien et l'Épigravettien ancien en Italie, Rivista di Scienze Preisloriche, XXXVIII, p. 181-228. Piette E. 1902 : Gravures du Mas d'Azil et statuettes de Menton, Rulle- lin et Mémoires de la Société Anthropologique de Paris, série V, 3, p. 771-779. Radmilli A.M. 1974 : Gli scavi nella Grotta Polesini a Ponte Lucano di Tivoli e la più antica arte nel Lazio, Firenze, Sansoni.
16 MARGHERITA MUSSI
Reinach S. 1898 : Statuette de femme nue découverte dans une des grottes de Menton, L'Anthropologie, IX, p. 26-31. Rivière E. 1887 : De l'antiquité de l'homme dans les Alpes-Maritimes, Paris, Baillière. Sacchi D. (sous la dir. de) 1984 : L'art paléolithique de la France méditerranéenne, Catalogue d'exposition, Ville de Carcassonne. Semenov S.A. 1964 : Prehistoric Technology, London, Cory, Adams & Mac- kay. SOFFER O. 1987 : Upper Paleolithic Connubia, Réfugia, and the Archaeological Record from Eastern Europe, in : The Pleistocene Old World, Regional Perspectives (O. Soffer éd.), New York, Plenum éd., p. 333-348. TlSCORNIA I. 1983 ; Pianaccia di Suvero, un' «officina» dell'età del Bronzo
per la lavorazione della steatite, in : Preistoria delta Liguria orientale (a cura di R. Maggi), Genova, ed. R. Siri, p. 79-81. Verneau R. 1899 : Les nouvelles trouvailles de M. Abbo dans la Barma- Grande, près de Menton, L'Anthropologie, X, p. 439-452. Villeneuve L. de, Boule M., Verneau R., Cartailhac E. 1906-1919 : Les grottes de Grimaldi (Baoussé-Houssé), Monaco, Imprimerie de Monaco.
White R. 1989 : Production, complexity and standardisation in early Aurignacian bead and pendant manufacture : evolutionary implications, in : The Human Revolution : Behavioural and Biological Perspectives on the Origins of Modern Humans (C. Stringer and P. Mellars eds), Edinburgh, Edinburgh University Press, p. 366-390. Zampetti D. 1987 : L'arte zoomorfa del Paleolitico superiore in Italia, Scienze dell'Antichità, 1, p. 9-35.