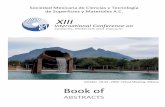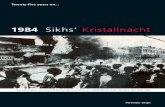Megarika XII, XIII, XIV (1984)
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Megarika XII, XIII, XIV (1984)
Arthur Muller
Megarika XII-XIVIn: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 108, livraison 1, 1984. pp. 249-266.
Résumé— XII : Les deux routes principales de Mégaride — de l'Attique à la Corinthie via les monts Céraniens et du golfe de Gorinthe auSaronique — se prolongent sans discontinuité à travers la ville de Mégare. Leur section urbaine qui apparaît dans la descriptionde Pausanias constitue aujourd'hui encore avec les deux acropoles le cadre organisateur de Mégare. — XIII : Découvertesanciennes et récentes relatives à des sanctuaires mentionnés dans la Périégèse. — XIV : Topographie reconstituée de Mégare.
περίληψη— XII : Οί δυό κύριες ρτηρίες τς Μεγαρίδας — πό τήν 'Αττική στήν Κορινθία μέσω Γερανίων καί πό τήν Κόρινθο στό Σαρωνικό —διασχίζουν χωρίς διακοπή τήν πόλη τν Μεγάρων. Μέχρι σήμερα κόμη τό τμμα πού διασχίζει τήν πόλη, ατό πού ναφαίνεται καίστήν περιγραφή το Παυσανία, ποτελε μαζί μέ τίς δυό κροπόλεις τό πολεοδομικό πλαίσιο τν Μεγάρων. —XIII : Παλαιές καί νέεςνακαλύψεις σχετικές μέ ερά πού ναφέρονται στήν « Περιήγηση ». — XIV : 'Αποκατάσταση τς τοπογραφίας τν Μεγάρων.
Citer ce document / Cite this document :
Muller Arthur. Megarika XII-XIV. In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 108, livraison 1, 1984. pp. 249-266.
doi : 10.3406/bch.1984.1856
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bch_0007-4217_1984_num_108_1_1856
MEGARIKA
XII. MÉGARE ET SON TERRITOIRE : ROUTES ET RUES
Une cité grecque se définit avant tout par son territoire, sa chôra. La connaissance de celle de Mégare est particulièrement importante en raison de son retentissement sur l'organisation de la ville1.
Le territoire de Mégare est exigu (fîg. 55). Il coïncide depuis l'époque archaïque avec une région géographique bien délimitée, l'Isthme de Mégare, dont les frontières naturelles sont claires : une chaîne de montagnes, orientée Nord-Ouest/Sud-Est, formée du Karidi, du Patéras (1131 m) et du Trikérato, sépare la Mégaride de la Béotie au Nord-Est et de l'Attique à l'Est2 ; une autre montagne, de même orientation, les Monts Géraniens (1351 m), forme vers l'Ouest la frontière avec la Corinthie3. Le territoire entre ces deux montagnes est pauvre, mal irrigué, et peu propice à l'agriculture4. Mais cette exiguïté et cette pauvreté sont compensées par une double ouverture sur la mer : au Nord-Ouest, vers le Golfe de Corinthe et, au-delà, vers la
(*) Ces notes XII-XIV achèvent la série des Megarika parue dans les livraisons précédentes du BCH depuis le tome 104 (1980). La numérotation des figures prend la suite de celle des figures des Megarika I à XI. Iro Athanassiadi a dessiné la carte fig. 55 d'après la carie administrative de Grèce au 200 000e, feuille 5 : Attique et la fig. 60 d'après le fond de carte de J. Travlos, 'Εγκυκλοπαίδεια Δομή Χ (1971), s.v. « Megara », p. 205. La fig. 56 reproduit, avec des indications supplémentaires, ArchDelt 25-11 (1970), p. 100, fig. 6 et la fig. 58, Travlos, loc. cit., p. 207. L'Institut archéologique allemand d'Athènes m'a aimablement autorisé à publier le cliché inédit de la fig. 57.
(1) La note XII reprend et développe la première partie de ma contribution à la Journée mégarienne : Megara Nisaea, Megara Hyblaea et Sélinonte organisée à Paris le 18-12-1982 par la Société française d'archéologie classique. On trouvera les réflexions sur les siècles de formation de Mégare, qui représentaient la deuxième partie de ma contribution, sous le titre « De Misée à Mégare » dans les actes de cette journée, Mél Rome 95 (1983), p. 618-628.
(2) Le tracé précis de la frontière avec l'Attique pose bien des problèmes dans le détail ; cf. par exemple U. Kahrstedt, AM 57 (1932), p. 8 sq. et S. van de Maele, Phoenix 34 (1980), p. 153-159 avec la bibliographie récente.
(3) Le versant occidental des Monts Géraniens jusqu'à Perachora et l'Isthme, longtemps possession mégarienne, est passé sous contrôle corinthien vraisemblablement dans le courant du vine siècle ; on trouvera dans R. P. Legon, Megara, the Political History of a Greek City-Slate (1981), p. 59-70, la discussion de la date de cet événement.
(4) Cf. Philippson, Griechische Landschaflen 1-3 (1952), p. 940 sq. et D. Theodoropoulos, « Stratigraphie und Tektonik des Isthmus von Megara », Erlanger geologische Abhandlungen 73 (1968).
250 ARTHUR MULLER [BCH 108
I.A.
Fig. 55. — Carte de la Mégaride antique.
Mer Ionienne ; au Sud-Est, vers le Golfe Saronique et l'Egée. Ces particularités de la Mégaride, entre deux terres et deux mers, expliquent la vocation commerçante plutôt qu'agricole de Mégare5 et l'importance qu'ont prise très tôt les voies de passage de son territoire.
L'Isthme de Mégare est en effet, presque autant que celui de Corinthe, un point de passage obligé pour le commerce maritime comme pour le commerce par voie de terre. Ceci explique l'implantation des principales agglomérations et routes. Sur chacun des golfes s'est bien sûr installé un port : celui de Pagai sur le Golfe de Corinthe6 ouvre le commerce avec la Grèce de l'Ouest ; celui de Nisée sur le Golfe
(5) R. P. Legon, op. cit., a le grand mérite de ne jamais oublier le cadre géographique particulier de la cité et les contraintes économiques qui en découlent.
(6) Ce port comporte, à partir de l'époque classique, une citadelle en arrière de la côte à laquelle elle est reliée par deux murs qui enserrent la ville basse et le port proprement dit ; sur ce site, cf. RE XVIII (1949),
1984] MEGARIKA 251
Saronique7, avec la Grèce de l'Est. Une première voie importante relie les deux ports et parcourt ainsi le territoire dans sa plus grande longueur, suivant une direction Nord-Ouest/Sud-Est. L'Isthme de Mégare est aussi le seul trait d'union entre le Péloponnèse et la' Grèce continentale : il est donc parcouru dans le sens Est-Ouest par plusieurs voies d'inégale importance8. Deux routes côtières réunissaient l'une la Corinthie à la Béotie en longeant le Golfe de Corinthe par Oinoè, Pagai et Aigo- sthènes, et l'autre la Corinthie à l'Attique en longeant le Golfe Saronique. Mais le relief rendait ces passages entre montagne et mer difficilement praticables et même parfois dangereux ; celui des Roches Scironiennes, à l'Ouest de Mégare, ne fut d'ailleurs carrossable qu'après les travaux d'Hadrien (Pausanias, I, 44, 6)9. Aussi l'axe Ouest- Est le plus important — c'était le plus sûr — fut-il longtemps la route de l'intérieur : elle reliait la Mégaride à la Corinthie en franchissant les Monts Géraniens par un col ; à Tripodiskos, sur le versant mégarien, la route se divisait en deux branches : l'une vers la Béotie en passant par Eréneia10, et l'autre vers l'Attique, qui rejoignait à Mégare la route côtière vers Eleusis. Mégare se trouve ainsi au carrefour des deux routes principales et vraisemblablement les plus anciennes de son territoire : celle qui relie ses ports et ses mers, et celle qui relie ses voisins, Corinthie et Attique.
Si les grandes lignes de la topographie de Mégare, telle qu'on peut la connaître dans son état du IIe siècle de notre ère à travers la description de Pausanias, ont été souvent décrites11, on n'a jamais insisté sur le rôle organisateur qu'avaient pu jouer, à côté du relief, les routes du territoire dans le plan de la ville (fig. 56)12. Mégare s'est établie à 2,5 km en arrière de la côte du Golfe Saronique, sur deux collines allongées d'Est en Ouest, qui reçurent les deux acropoles de la ville : l'Alkathoos à l'Ouest, haute d'un peu plus de 90 m, et la Karia à l'Est, haute d'environ 70 m (fig. 57)13.
s.v. «Pagai», col. 2284 (E. Meyer) et Sakellariou-Faraklas, Μεγαρίς, Αίγόσθενα, Έρένεια, Ancient Greek Cities XIV (1972), p. 63-66. Aigosthènes, un peu plus au Nord, disposait également d'un port; mais c'est encore celui de Panormos, à mi-chemin entre Pagai et Aigosthènes, qui offrait le meilleur mouillage ; cf. « Megarika XI », BCH 107 (1983), p. 176-179, avec la bibliographie antérieure.
(7) La région de Nisée pose des problèmes de topographie très ardus : Sakellariou-Faraklas, op. cit., p. 56-63, donnent la mise au point la plus récente. Le port se situait vraisemblablement dans la baie de Saint- Nicolas entre les hauteurs du Paliokastro à l'Ouest et de Saint-Georges à l'Est ; il était relié à Mégare par deux longs murs : les vestiges du mur occidental sont visibles entre Mégare et le Paliokastro ; cf. A. Muller, Mél Rome 95 (1983), p. 618, fig. 1.
(8) Sur ces routes qui réunissent le Péloponnèse à la Grèce continentale et leur importance respective, cf. J. Wiseman, The Land of the Ancient Corinthians, Studies in Mediterranean Archeology 50 (1978), p. 17-27, avec la bibliographie antérieure.
(9) Cf. « Megarika XI », BCH 107 (1983), p. 166 et n. 22. (10) Cf. N. G. L. Hammond, ABSA 49 (1954), p. 103-122, et « Megarika VIII », BCH 106 (1982), p. 385-
386. (11) Par exemple, et pour se limiter aux travaux récents : J. Travlos, loc. cit., p. 202-208 ; Sakellariou-
Faraklas, op. cit., p. 42-55; N. Papachatzis, Παυσανίου 'Ελλάδος Περιήγησις, Ι (1974), p. 490-508; F. Bohringer, AntCl 49 (1980), p. 5-22.
(12) On se reportera également à la figure 60, à laquelle renvoient, par anticipation, los chiffres en caractères gras dans le texte.
(13) Cette identification des acropoles, admise unanimement depuis le xixe siècle — seul Rangabé, Mémoires présentés par divers savants à Γ Académie des Inscriptions, lre série, tome 5 (1857), p. 291-292, propose l'identification inverse — a été confirmée par l'emplacement de certains vestiges : cf. infra, * Megarika XIII, p. 258 et 260, note 48.
252 ARTHUR MULLER [BCH 108
Ces deux collines allongées sont le premier élément organisateur du plan de la ville dans la mesure où elles imposent la répartition des principales zones. Elles forment un premier axe Est-Ouest et divisent la ville en une partie Nord et une partie Sud14. L'agora s'est tout naturellement développée en contrebas des deux collines, plus précisément du col qui les réunit, sur le versant Sud, le plus praticable. Le relief a ainsi suggéré la répartition harmonieuse des grandes masses au centre de la ville : les espaces sacrés sur les acropoles Est et Ouest, l'espace public sur l'agora centrale, l'habitat étant réparti pour l'essentiel entre deux zones, au Nord et au Sud des acropoles. Le tout est enfermé dans une enceinte — dont seul l'état du ive siècle nous est connu : son tracé est donné par les fouilles dans la partie Sud et reconstitué avec une grande vraisemblance dans la partie Nord15. Cette enceinte, tout entière dans la plaine, ne s'appuie sur aucune défense naturelle, si ce n'est le lit de deux torrents, au Nord-Est et au Sud-Ouest, qui ont pu servir de protection en avant des remparts16. La surface approximative de Mégare, pour une enceinte de 4,2 km de développement, est de 140 ha environ, dont le tiers est réservé aux espaces publics et sacrés.
Cette superficie était structurée par un certain nombre de rues, dont les sondages d'urgence ne suffisent pas à donner une idée précise. Mais le tracé des plus importantes d'entre elles peut se déduire avec une certaine vraisemblance à partir de plusieurs données : les contraintes du relief, la description de Pausanias, où apparaissent comme en filigrane les principaux axes, et enfin la voirie de la ville actuelle, qui a conservé par endroits le parcours des rues antiques.
Pausanias ne donne qu'un seul nom de rue : il s'agit de ΓΕύθεΐα οδός, la rue droite par laquelle il quitte l'agora pour se rendre à la Porte des Nymphes (36) et de là à Nisée (I, 44, 2) :
Έκ δε της αγοράς κατιουσιν της όδοΰ της Ευθείας καλούμενης . . . Quand on quitte l'agora par la rue appelée la rue droite...
Un autre axe de la ville se devine à travers la rupture de description entre le dernier monument signalé sur le versant Nord de la Karia (5) et le lieu-dit Rhous, au Nord de la ville (6) ; Pausanias a donc directement rejoint le Nord de la ville par une rue que mentionne explicitement Plutarque (Thésée, 27, 8) :
Δεικνύουσα δε και Μεγαρείς 'Αμαζόνων θήκην παρ' αύτοΐς επί το καλούμενον 'Ρουν βαδίζουσιν εξ αγοράς, δπου το 'Ρομβοειδές.
Les Mégariens eux aussi montrent chez eux une tombe d'Amazone, sur le chemin qui mène de l'agora à l'endroit appelé Rhous, là où se trouve le monument rhomboïde (11). Pour mener directement de l'agora au Nord de la ville, cette route devait bien sûr franchir le col des acropoles. En outre, Rhous se trouvant à la Porte de Pagai, il
(14) Elles imposent aussi le plan original de la description de Pausanias, organisée en quatre itinéraires, consacrés respectivement à l'acropole orientale, à la région Nord de la ville, à l'acropole occidentale et à la région Sud : « Megarika II1-IV », BCII 105 (1981), p. 205 et 210-211 ; cf. aussi G. Robert, Pausanias als Schrift- sleller (1909), p. 177-185.
(15) Cf. O. Alexandri, ArchDelt 22-11 (1967), p. 118 et 23-11 (1968), p. 102, ainsi que ArchAnAth 3 (1970), p. 21-29.
(16) Le lit de ces torrents a cependant pu se déplacer depuis l'Antiquité, surtout celui du ρεΰμα Tpt.- ποδίσκου au Nord-Est de la ville.
Illustration non autorisée à la diffusion
+++ Tombes
Fig. 56. — Mégare : plan de la ville moderne et tracé de l'enceinte.
ALKATHOOS KARIA
Fig. 57. — Mégare vue du Sud (cliché 1899 ; DAT Athen, Inst. Neg.).
254 ARTHUR MULLER [BCH 108
est bien évident qu'au-delà, cette rue menait au port de Mégare sur le Golfe de Corinthe.
On retrouve ainsi, avec ces deux rues, agora-Nisée et agora-Pagai, la première route de Mégaride, l'axe Nisée-Pagai, qui réunit le Golfe Saronique au Golfe de Corinthe. Cet axe subsiste même dans la ville moderne (fig. 56) : on a reconnu depuis longtemps que la rue droite doit être identifiée avec l'actuelle rue Minôa dont le tracé est rigoureusement rectiligne depuis la place des Héros, qui correspond à la limite Sud de l'agora, jusqu'à la baie de Saint-Nicolas, site du port de Nisée (fig. 57)17; la rue de Rhous correspond au prolongement Nord de la rue Minôa, soit la rue Moraïtou, qui gravit en ligne droite le versant méridional du col des acropoles et redescend en deux courbes le long du versant septentrional, plus abrupt ; elle se prolonge ensuite dans la rue Stilpônos, dont la ligne droite mène à la fontaine moderne, soit Rhous18, et au-delà à Alépochôri, soit Pagai. L'ancienneté de ce tracé est confirmée par le fait que la rue Stilpônos traverse en diagonale le réseau à peu près orthogonal des rues modernes de la partie Nord de Mégare.
Cet axe grossièrement orienté Nord-Sud qui traverse la ville, est coupé par quelques transversales d'inégale importance, dont deux au moins se devinent dans la description de Pausanias. La première réunissait les deux acropoles et coupait la rue Nord-Sud sur le col. Elle apparaît dans la Périégèse en deux tronçons qui ont la même origine au carrefour sur le col :
■ — d'une part, après l'ascension du col, jalonnée par la mention des monuments 1 à 3, Pausanias signale la montée à l'acropole orientale, la Karia : ες τήν άκρόπολιν άνελθοΰσι καλουμένην (. . .) Καρίαν (Ι, 40,6); l'accès ne devait pas être éloigné de l'actuelle rue Théagénous ;
— d'autre part, en I, 42, 1, le Périégète commence la troisième partie de sa description en mentionnant la montée à l'acropole occidentale, l'Alkathoos, à partir du col où l'a ramené son deuxième itinéraire19 : il parcourt ensuite cette acropole jusqu'à son sommet en évoquant cinq sanctuaires (14a-14e). Cet itinéraire pourrait correspondre à l'une des deux rues qui suivent la crête de l'Alkathoos, en particulier la rue Aghiou Dimitriou, jalonnée d'une demi-douzaine de chapelles et d'églises.
L'autre transversale est mentionnée explicitement par Pausanias, après qu'il a quitté l'acropole Alkathoos, vraisemblablement par le Sud-Ouest où il a signalé la tombe de Kallipolis (15) : Κατά δε τήν ες το πρυτανεΐον όδόν ... (Ι, 42, 7). Il longe donc le versant Sud de l'Alkathoos en direction de l'agora ; après le Prytanée (20), il longe, au-delà de l'intersection avec la grande rue Sud-Nord, le versant Sud de la Karia jusqu'à la Pétra Anakléthra (21)20. Ce parcours sur le versant méridional des acropoles correspond exactement à celui de l'actuelle rue Georges II, dont le tracé est continu le long des deux collines, avec de larges courbes qui épousent la configuration du terrain. Vers l'Est, cette rue se prolonge dans la route nationale menant à Athènes ; vers l'Ouest, elle continue dans la piste du col des Monts Géraniens. Autrement dit,
(17) Cette identification est déjà proposée par l'ensemble des voyageurs passés à Mégare. (18) Cf. * Megarika III », BCH 105 (1981), p. 207. (19) Cf. « Megarika IV», BCH 105 (1981), p. 211. (20) Cf. «Megarika II», BCH 104 (1980), p. 91.
1984] MEGARIKA 255
cette rue transversale correspond à un axe majeur de la ville antique : il s'agit de la section urbaine de la grande route Corinthe-Mégare-Athènes en passant par Tripo- diskos et les Monts Géraniens. Ce n'est d'ailleurs que récemment que la rue Georges II a perdu sa signification d'axe majeur de Mégare, avec la construction de la nouvelle route et de la voie ferrée le long des Roches Scironiennes, à la fin du xixe siècle : ces deux voies côtières, qui traversent la partie Sud de Mégare, ont détrôné la vieille route de l'intérieur qui avait repris ses droits, une fois dégradés les aménagements d'Hadrien dans le passage Scironien21.
Les deux rues principales de Mégare ne sont donc, en fait, que les sections urbaines de deux grandes routes de campagne, les deux voies de passage principales de la Mégaride. Leur carrefour au centre de la ville, sous les deux acropoles, constituait bien sûr un endroit privilégié pour le développement de l'agora22. Enfin, l'intersection de ces deux rues avec l'enceinte définit de façon précise l'emplacement des portes principales de la ville : porte des Nymphes (de Nisée) au Sud (36), de Pagai au Nord (6), d'Athènes à l'Est (E) et de Tripodiskos à l'Ouest (C), ces deux derniers emplacements étant assurés par la présence de nécropoles le long des routes23. « II est rare que la topographie d'un paysage se brise aux portes de la cité »24 : cette constatation faite pour plusieurs vieilles cités de la Grèce trouve donc une illustration particulièrement éloquente et durable à Mégare, où les axes du territoire se poursuivent sans discontinuité à travers la ville et en forment, avec le relief, le cadre organisateur depuis les origines jusqu'à nos jours.
Il est remarquable que l'axe Sud-Nord et les deux transversales Est-Ouest ainsi reconnues forment un embryon d'organisation urbaine régulière — on pourrait presque parler d'un quadrillage, même si ces axes ne sont ni orthogonaux ni recti- lignes. Mais il faut bien souligner le fait que cette régularité n'est pas l'effet d'une volonté planificatrice mais la résultante de deux contraintes naturelles : d'une part le relief particulier du site (deux collines formant une barrière Est-Ouest avec un passage central) et d'autre part le tracé des routes de Mégaride. Cependant, il n'est pas impossible que ce quadrillage « naturel » ait été prolongé plus ou moins sciemment. Les fouilles laissent en effet peut-être deviner l'existence d'autres rues transversales :
— au Nord-Ouest de l'acropole Karia, un sondage d'urgence a mis au jour un tronçon d'une rue importante, orientée Est-Ouest, parallèle à l'actuelle rue Mykinôn25. Il pourrait s'agir du pendant, au Nord des acropoles, de la transversale Est-Ouest qui passait au Sud de l'Alkathoos et de la Karia ;
— les fouilles sous la place des Héros (anciennement place Métaxa) en 1937,
(21) Cf. par exemple, W. Gell, Itinerary of the Morea (1817), p. 209 : « Beyond Kinetta is the Kaki Skala, anciently the Scironian Rocks, and Megara ; but the way is neglected, and travellers usually go over Geranian, by the Derveni, to Megara ».
(22) La situation est donc la même qu'à Athènes : cf. R. Martin, L'urbanisme dans la Grèce antique* (1974), p. 79. Sur les conditions de l'implantation de l'agora dans cette zone, précédemment occupée par une nécropole d'époque géométrique, cf. A. Muller, Mil Rome 95 (1983), p. 627-628.
(23) Les nécropoles de Mégare n'ont pas fait l'objet d'explorations systématiques, mais des tombes ont souvent été signalées en plusieurs endroits, surtout le long des routes quittant la ville ; O. Alexandri, ArchAn Ath 3 (1970), p. 23, n. 11 à 13, donne la bibliographie complète.
(24) M. Piérart, BCH 106 (1982), p. 143, à propos d'Argos. (25) O. Alexandri, ArchDelt 25-11 (1970), p. 117-118.
256 ARTHUR MULLER [BCH 108
ont mis au jour les vestiges de thermes romains recouvrant une stoa d'époque classique (A) devant laquelle passait une rue dallée perpendiculaire à la rue droite (fig. 58)26. Elle formait vraisemblablement la limite Sud de l'agora ;
— enfin, des travaux de voirie effectués en 1970 ont rencontré les vestiges d'une route antique au Sud de l'agora, dans la rue du 28-Octobre, à 40 m à l'Est de la place du Roi-Constantin. Sa largeur (3,70 m) invite à y reconnaître un axe important27. D'après l'orientation indiquée par les fouilleurs : Nord-Est/Sud-Ouest, elle pourrait elle aussi être perpendiculaire à la rue droite.
L'une de ces deux dernières rues — peut-être les deux — menait vraisemblablement à la porte de Corinthe au Sud-Est de la ville (D), et se prolongeait par la route côtière Mégare-Corinthe. Celle-ci, d'importance récente puisqu'elle* ne supplanta l'ancien itinéraire par Tripodiskos qu'après les travaux d'Hadrien, n'a jamais eu, dans la formation du cadre urbain de Mégare, un rôle comparable à celui des deux autres routes de la Mégaride. Mais seules des fouilles plus étendues — ou du moins la, mise en relation de sondages plus nombreux — pourraient permettre de tirer des conclusions plus assurées sur le détail de l'urbanisme de Mégare et son évolution à partir du cadre résultant des contraintes naturelles28.
XIII. Vestiges de quelques monuments
L'Olympieion (3).
Le temenos de Zeus Olympien est mentionné dans la Périégèse entre la description de l'Artémision (2) et celle de Facropole Karia (4). Il s'y trouvait un temple remarquable, qui renfermait une statue chryselephantine inachevée (Pausanias, I, 40, 4). Les vestiges du sanctuaire, encore visibles au xixe siècle, ont aujourd'hui disparu. Il s'agit d'un mur où était gravée une série de décrets dont les résolutions prévoyaient leur affichage dans l'Olympieion29. C'est dans les années 40 du siècle dernier qu'apparaissent les premières mentions de ces décrets, sans que l'on puisse décider si le mérite de leur découverte revient à L. Ross, qui en publie 4 en 1844, ou à Ph. Le Bas qui en estampe 10 le 4 sept. 1843 30 ; à partir de cette date, on découvrit d'année en année de nouvelles inscriptions jusqu'au total de 18. Le mur où elles étaient gravées a disparu mais les témoignages des épigraphistes du xixe permet de le situer. Foucart place le mur « dans la partie orientale de la ville, entre les deux collines »31, Rangabé dans la vallée qui sépare les deux collines, « et plus près de la
(26) J. Threpsiadis, PraklArchEt (1937), p. 42-52; cf. BCH 40 (1936), Chronique p. 461. (27) O. Alexandri, ArchDell 29-11 (1973-1974), p. 177. (28) Si l'on peut, selon toute vraisemblance, faire remonter le tracé des deux rues principales aux origines
de la ville (cf. Mél Borne 95 [1983], p. 626), on manque en revanche tout à fait d'indications chronologiques concernant les rues découvertes dans les diverses fouilles d'urgence.
(29) II s'agit des décrets IG VII, 1 à 14 et 3473. Les trois décrets gravés sur un bloc trouvé à Nisée, sur le Paliokastro, proviennent également de ce mur : cf. R. Heath, ABSA 19 (1913), p. 82 sq.
(30) L. Ross, Sitz. Ber. Akad. Berlin (1844), p. 156-162 ; P. Foucart, Explication des inscriptions recueillies en Grèce et Asie mineure, II : Mégaride et Péloponnèse, p. 15.
(31) Foucart, op. cit., p. 15.
Illustration non autorisée à la diffusion
1984] MEGARIKA 257
JfîJJ.·
Fig. 58. — Rue dallée au Sud de l'Agora (cliché 1937).
Fig. 59. — Mégare et Nisée vers 1675 : dessin de J. Spon.
Je* Anciennes MurmlUUr'
17
258 ARTHUR MULLER [BCH 108
colline occidentale »32 ; ce dernier détail est contredit par les autres témoignages : celui de Pittakis : « ό τοίχος οΰτος κείται δέ εν τω μεταξύ των δύω εν Μεγάροις λόφων (...) παρά τας δυτικας ύπορείας του ανατολικού λόφου33, et ceux de Velsen et de Bursian34, qui placent également le mur au pied Nord-Ouest de la colline orientale35.
Les témoignages des voyageurs permettent de se faire une idée assez précise de ce mur. La première description est celle de Rangabé36 : « J'ai copié les dix inscriptions qui précèdent à Mégares, sur un mur antique que j'y ai découvert au fond de quelques cabanes obscures et quelques écuries infectes, en partie couvertes par des immondices. La hauteur jusqu'à laquelle il est conservé atteint en quelques endroits 7 à 8 pieds [2,10 ni à 2,40 m]. Il est composé d'assises régulières d'un calcaire gris (...). Il se dirige de l'Ouest à l'Est, où, à son extrémité orientale, il tourne en angle droit vers le Nord. Les inscriptions ci-dessus, avec quelques autres entièrement illisibles, en occupent diverses pierres, qui n'ont pas plus de longueur que deux pieds et plus de largeur que un pied ». La description de Pittakis37 concorde dans ses grandes lignes avec la précédente : « Ή επιγραφή αΰτη γέγραπται επί πλίνθου λίθου ομοίου σχεδόν τω Πνυκίτη λίθω. Ή πλίνθος αΰτη κείται επί έτερων πλίνθων αϊτινες δλαι όμοΰ σχηματίζουσι τοΐχον κυκλοφέρους σχεδόν οικοδομήματος. Το ΰψος του τοίχου τούτου, όσον σώζεται είναι δέκα περίπου 'Αγγλικών ποδών »38. On ne trouve chez Bursian, qui a vu le mur au plus tard en 1855, avec la mention de nombreux blocs antiques dans le secteur, que la description de la pierre : un calcaire gris à veines blanches39.
Le mur existe encore en 1859, année où Conze découvre à proximité un nouveau bloc de ce mur : « ein grauer Marmor etwa 0.37 hoch, und 0.35 breit » avec une nouvelle inscription (IG VII, 7)40. En revanche, on ne peut savoir si Korolkow qui en 1883 à son tour rajoute une inscription à la liste (IG VII, l)41, a encore vu le mur : la nouvelle pierre n'était pas en place, et rien dans le texte de Korolkow ne permet de décider si le mur existe encore à cette date. En tout cas, il est certainement détruit dès avant 1892, date de parution du volume VII des IG : Lolling, chargé par Dittenberger de relire les inscriptions, n'en retrouve que quatre, remployées ailleurs (IG VII, 1, 5, 8, 9) tandis que huit autres ont disparu (IG VII, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14). Mais à la fin du xixe siècle, aux visiteurs érudits qui cherchaient le mur de l'Olympieion, on montrait la partie haute du mur Nord de la fontaine de Théagène, qui n'était pas encore identifiée42.
Il est cependant difficile, à partir de ces éléments, de connaître le rôle architectural de ce mur. La plupart de ceux qui l'ont vu en ont fait le mur du temenos de
(32) Rangabé, loc. cit., 286; cf. aussi Antiquités helléniques II (1855), p. 294. (33) Pittakis, ArchEph (1853), p. 805. (34) Velsen, AA (1853), p. 380; Bursian, Géographie von Griechenland (1862), I, p. 374 et n. 1. (35) Cette proximité est d'ailleurs le principal argument de l'identification de cette colline avec la Karia,
puisque immédiatement après l'Olympieion Pausanias commence la description de celle-ci (I, 40, 6). (36) Rangabé, Antiquités helléniques II (1855), p. 294. (37) Pittakis, ArchEph (1853), p. 805, n° 1327 sq. (38) Je ne m'explique pas pourquoi Pittakis, seul parmi tous les autres voyageurs, y a vu le mur d'un
édifice circulaire. C'est sur la foi de son seul témoignage que A. Kaloyeropoulou, ArchAnAth 7 (1974), p. 142, afiirme que les décrets étaient gravés sur une exèdre semi-circulaire dans l'Olympieion.
(39) Bursian, op. cit., p. 374 et note 1. (40) Conze, Philologus 14 (1859), p. 153. (41) Korolkow, AM 8 (1883), p. 183. (42) Delbruck-Volmôller, AM 25 (1900), p. 26.
1984] MEGARIKA 259
Zeus Olympien; seul Foucart43, sans doute d'après les indications de Le Bas, reprises à son tour par Dittenberger dans IG VII, en a fait le mur de soutènement de l'Olym- piéion. Cette hypothèse n'a rien d'invraisemblable ; en effet, le temenos occupait la partie la plus haute du vallon entre les deux acropoles : mais vue l'étroitesse de l'emplacement, l'aménagement d'une terrasse retenue par un mur était obligatoire pour l'édification d'un temple. La hauteur conservée du mur — un peu plus de deux mètres, à en croire Rangabé et Pittakis — surprenante peut-être s'il s'agissait d'un mur de péribole, s'expliquerait mieux ainsi. Enfin, les descriptions ne mentionnent jamais qu'un seul parement, ce qui s'explique très bien dans l'hypothèse d'un mur de terrasse.
On est mieux renseigné en revanche sur le rôle du mur en tant que lieu d'affichage des décrets et sur la façon dont on réalisait cet affichage. La face méridionale du mur — seul Foucart place les inscriptions sur la face occidentale : il s'agit sans aucun doute d'une erreur — dominait en effet l'agora, et était à proximité immédiate des bâtiments publics de la cité : elle se prêtait donc admirablement à la publicité des décrets, rôle réservé auparavant, jusque vers le milieu du me siècle avant J.-C, semble-t-il, à l'Artémision, dont la situation était absolument analogue, un peu plus au Sud. Le mur est donc comparable, pour son rôle architectural peut-être, mais sûrement pour son rôle dans la vie civique, au mur polygonal de Delphes. Une fois de plus, les indications des érudits du xixe siècle permettent de préciser la forme de l'affichage. Rangabé précise que « les inscriptions sont souvent surmontées par un petit fronton » ; selon Pittakis, ce décor fait de lignes gravées en triangle, orne chaque inscription44. C'est ainsi que l'on réalisait, à peu de frais, la gravure sur la « stèle » prévue par les décrets : α άγγράψαι δέ τόδε το δόγμα τον γραμματέα του δάμου εις στάλαν και άνθέμεν εις το Όλυμπιεΐον » (IG VII, 2, 1. 13-14).
Foucart a trouvé et estampé en 1868 des catalogues militaires (IG VII, 27, 28) et éphébiques (IG VII, 29, 30 (?), 31), datés de la période béotienne de Mégare (224- 192 avant J.-C.) et de son retour à la ligue achéenne (après 192)45. L'intitulé de l'une de ces inscriptions :
Έπί γραμματέος των συνέδρων Άλκιδάμου γυμνασιαρχοΰντος δέ εν Όλυμπιείω Ματροξένου του 'Απολλοδώρου έφηβοι οιδε ενεκρίθησαν (IG VII, 31)
permet de déduire l'existence d'un gymnase rattaché à l'Olympieion. Ce gymnase est distinct de celui que Pausanias, à la sortie de la ville, désigne par l'expression γυμνάσιον το άρχαΐον (35). Cette expression implique d'ailleurs l'opposition avec un autre gymnase, plus récent, qui ne peut être que celui mentionné dans l'inscription. Le gymnase de l'Olympieion devait être contigu au téménos de Zeus Olympien, d'où il tirait son nom. C'est ce que confirme le lieu de trouvaille des inscriptions, qui proviennent toutes de la cour du « khani » d'Épaminondas Vlakos, « situé à très petite distance des ruines du temple »46. Malheureusement, Foucart omet de préciser plus :
(43) Foucart, op. cit., n» 26, p. 15. (44) Rangabé, Antiquités helléniques II (1855), p. 294 ; Pittakis, loc. cit., p. 805. (45) Foucart, op. cit., p. 19-23, nos 34 a-34 e ; cf. M. Feyel, Polgbe et Vhisioire de la Bèolie au IIIe siècle
avant notre ère (1942), p. 41. (46) Foucart, op. cit., p. 23.
260 ARTHUR MULLER [BCH 108
mais il est probable que le gymnase se trouvait du côté Nord de l'Olympieion, puisque au Sud se trouvent l'Artémision (2) et la fontaine de Théagène (1), et à l'Est et à l'Ouest les montées vers les acropoles.
L'Asclépieion de la Karia (4e).
Bien que Pausanias ne signale pas expressément l'existence d'un sanctuaire d'Asclépios sur l'acropole Karia, celle-ci se déduit de la mention des statues d'Asclépios et d'Hygie, œuvres de Bryaxis (I, 40, 6) : en une sorte de métonymie, le mot άγαλμα évite au Périégète l'emploi de ιερόν ou de ναός47. La trouvaille fortuite, sur la colline orientale, d'un marbre représentant Asclépios a récemment confirmé l'existence d'un sanctuaire du dieu guérisseur48.
Le Dionysion de. V agora (28).
Le Dionysion mentionné dans la Periègese lors de la description de l'agora (I, 43, 5) est donné comme proche de trois autres sanctuaires, avec lesquels il forme une chaîne topographique : un Aphrodision, un sanctuaire de Tychè et un temple laissé anonyme. Malheureusement, cet ensemble d'édifices religieux ne peut être localisé avec une plus grande précision sur l'agora, car Pausanias ne donne aucune indication permettant de situer le début ou la fin de cette chaîne49. Le sanctuaire de Dionysos est signalé dans la Périégèse en raison de sa légende de fondation d'une part, et des statues qu'il abritait d'autre part : une vieille statue de bois, consacrée par le fondateur Polyidos, un Dionysos Patrôos, Satyre en marbre de Paros, œuvre de Praxitèle50; enfin, un Dionysos Dasyllios, consacré par Euchénor, fils de Polyidos. On peut selon toute vraisemblance rattacher à ce sanctuaire deux autres sculptures mises au jour dans la partie Sud de la ville.
La première a été découverte au début du siècle dernier par un voyageur anglais, W. Jones. Un autre voyageur, S. Hughes, est le seul à relater cette intéressante trouvaille51, dont il n'a plus jamais été fait mention depuis : « In his journey through the place [Mégare] a poor peasant brought for sale a marble hand, which evidently had been attached to a statue of delicate workmanship. Mr. Jones acutely conjecturing that this hand pointed out a body to which it belonged, desired the man to conduct him to the spot from whence it had been taken ; this happened to be in a little garden at the south east extremity of the town facing the saronic gulf. Here he immediately commenced an excavation with the aid of several Greeks, and at the depth of about
(47) Cf. « Megarika X », BCH 107 (1983), p. 170 et n. 48, avec des exemples de cette habitude du Périégète. (48) Renseignement que m'a aimablement communiqué A. Dragona-Latsoudi, Épimélète du Service
Archéologique, chargée de la publication de cet objet. (49) Cf. « Megarika VI », BCH 105 (1981), p. 218-219 et 222. (50) II est bien sûr impossible de préciser auquel des types de Satyre créés par Praxitèle il faut rattacher
celui de Mégare : le « Satyre au repos », le « Satyre verseur » ? Cf. Ch. Picard, Manuel de sculpture grecque, IV siècle, lre partie (1948), p. 526.
(51) S. Hughes, Travels in Sicily, Greece and Albania (1820), p. 244-245. Hughes a voyagé en Grèce en 1812-1813. La trouvaille de son ami W. Jones doit dater d'entre 1803 (date à laquelle Fauvel qui hébergea une partie du groupe reprend ses activités à Athènes) et 1812. W. Jones lui-même n'a pas, à ma connaissance, donné de relation de son voyage.
1984] MEGARIKA 261
four feet below the surface of the ground turned up an exquisite marble group, representing a youthfull Bacchus standing upright, with on arm reclining on the shoulders of a faun and the other turned gracefully over his own head, whilst a sleeping Ariadne is sculptured in fine relief upon the front of the pedestal ». W. Jones a emporté le « Bacchus » dans son tour de Morée et envoyé le Faune et la base du groupe à Fauvel, à Athènes, où il les retrouva à son retour de Morée. Fauvel fit un moulage du groupe et l'emballa pour l'expédition en Angleterre. Mais au déballage, W. Jones dut constater que la tête du « Bacchus » avait disparu52. Fauvel, dont on connaît les méthodes et l'absence de scrupules, n'était peut-être pas étranger à cette disparition. Le groupe fut restauré au British Museum53, mais je n'ai pu en trouver la trace dans les catalogues de sculpture du musée pas plus que dans ceux des collections privées de Grande-Bretagne54. La brièveté de la description interdit toute hypothèse sur l'œuvre elle-même. En revanche, le « jardin au Sud-Est » de la ville où elle a été trouvée pourrait être le site du sanctuaire de Dionysos : étant donné l'extension de Mégare au xixe siècle — la bourgade n'occupe que la colline occidentale — cette indication pourrait en tout cas correspondre au bas de l'agora.
On en est réduit pour l'instant aux mêmes hypothèses quant à la trouvaille récente d'une statue de marbre représentant Dionysos, haute de 95 cm, en excellent état de conservation, dans les ruines d'une construction antique, « vraisemblablement le temple de Dionysos, que Pausanias place dans cette région »55.
Le gymnase et la porte des Nymphes (35-36).
Le vieux gymnase de Mégare n'apparaît dans la description de Pausanias que parce qu'il sert à localiser la curieuse représentation aniconique d'Apollon Karinos (I, 44,2) :
"Εστί δε εν τω γυμνασίω τω άρχαίω πλησίον πυλών καλουμένων Νυμφάδων λίθος παρεχόμενος πυραμίδος σχήμα ου μεγάλης · τούτον 'Απόλλωνα όνομάζουσι Καρινόν.
Il y a dans l'ancien gymnase près de la porte dite des Nymphes une pierre qui a la forme d'une pyramide, pas très grande: on lui donne le nom d'Apollon Karinos56.
L'emplacement de la porte des Nymphes est connu avec une relative précision : il s'agit de l'intersection de la rue Minôa — la rue droite — avec le tracé de l'enceinte,
(52) S. Hughes, op. cit., p. 244-245. (53) S. Hughes rapporte l'avis du restaurateur chargé de l'opération : « He refers the design of the group
though not the execution, to Praxiteles » [op. cit., p. 245). (54) La seule indication qui pourrait correspondre à ce groupe est celle de Michaelis, Ancient Marbles
in Great Britain (1882), p. 510 : (collection de Marbury Hall) « N° 23 : Bacchus with a Faun : in the catalogue there is no entry of the kind. Can there have been a confusion made with N° 8 (Dionysos with a Bacchant) ? ». L'enquête demanderait néanmoins à être poursuivie.
(55) Eleflherotypia, 28.6.83. Le journaliste omet malheureusement d'indiquer plus précisément l'endroit de la trouvaille.
(56) C'est sans doute cette pyramide d'Apollon Karinos qu'il faut reconnaître sur diverses monnaies mégariennes du me siècle avant notre ère. On y voit, au revers, un obélisque orné de bandelettes, ou encadré de deux dauphins dressés ; le droit représente une tête d'Apollon. Cf. F. W. Imhof-Blumer - P. Gardner, .4. Numismatical Commentary on Pausanias (1964), p. 6, n° 7 ; SN G Denmark, Attica-Aegina, nos 477-478-479.
262 ARTHUR MULLER [BCH 108
obtenu en prolongeant la ligne donnée par les vestiges dégagés plus à l'Ouest57. C'est à cet endroit qu'ont été trouvées plusieurs inscriptions — des listes de victoires, remportées par un athlète mégarien (IG VII, 49) et les textes gravés sur la base de statues de gymnasiarques (IG VII, 97-99) — qui confirment cette localisation. Les nombreux voyageurs qui ont vu ces inscriptions omettent malheureusement de donner une description précise des ruines. Pourtant, les quelques éléments dont on dispose permettent de déduire l'existence de deux bâtiments au moins. Le premier se trouve à l'Est de la porte, et tout contre elle ; l'emplacement est assuré par la comparaison des textes de Wheler : « dans les murailles vers la mer, à main gauche de la porte »58 et de Prokesch von Osten : « wendet man sich gegen die Stadt, so bleibt das Sacellum wo Wheler mehrere Inschriften auffand, rechts »59. Il s'agit d'un petit bâtiment carré, de part et d'autre de l'entrée duquel se trouvaient deux blocs de marbre, avec les traces de scellement d'une statue, et l'inscription gravée IG VII, 49. Ce bâtiment est représenté, en plan, avec la légende « sacellum » sur le dessin de Spon (fig. 59) 60. Les inscriptions IG VII, 97, 98 et 99 se trouvent sur le même bloc de marbre, long de « 10 pieds », qui porte lui aussi les traces de pieds de statues. Cette base est souvent signalée par les voyageurs, mais jamais bien localisée par rapport à la précédente. Les quelques indications dont on dispose sont contradictoires : s'il faut identifier, ce qui est probable, le lieu marqué « inscriptions » sur le dessin de Spon avec celui où se trouvait cette base, elle se serait trouvée au Nord du bâtiment précédent ; Clarke, de même, la signale « in the front of an ancient gate leading from the city toward the sea »61. D'après Montague, la base se trouvait dans un important amas de ruines, en face du bâtiment carré, de l'autre côté de la route, c'est-à-dire à l'Ouest de la porte62. On admettra difficilement que le petit bâtiment carré était le Gymnase, comme le propose Wheler, ou un hérôon en l'honneur de quelque athlète, comme le pense Spon. Mais il faisait probablement partie d'un ensemble de bâtiments constituant le gymnase, à l'intérieur des murs, et à l'Est de la porte, plutôt qu'à l'Ouest, comme on le suggère généralement63. La plaine au Sud des acropoles offrait dans cette région toute la place nécessaire aux installations sportives.
Toutes les inscriptions trouvées à cet endroit — la liste de victoires IG VII, 49, les deux inscriptions en l'honneur de gymnasiarques IG VII, 97-99 et peut-être aussi les listes de victoires à la boxe IG VII, 47-48 — datent de l'époque romaine, alors que celles qui proviennent du gymnase de l'Olympieion (supra, p. 259) datent de la fin du ine siècle avant notre ère. Il faut donc croire que si le gymnase de la porte des Nymphes est bien l'« ancien », il n'a pas été détrôné par celui de l'Olympieion,
(57) Cf. supra, n. 15. (58) G. Wheler, Voyage deDalmalie et de Grèce et du Levant III (1689), p. 521. Cette indication est reprise
textuellement par Ch. Thompson, The travels of the late Charles Thompson, Esq. I (1752), p. 363. ^59) Prokesch von Osten, Denkwiirdigkeiten und Errinnerungen aus dem Orient II (1836), p. 353. (60) J. Spon, Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant... II (1678), dessin p. 286. (61) E. D. Clarke, Travels in various Countries of Europe, Asia and Africa VI (1810-1823), p. 767. (62) J. Montague, .1 Voyage performed by the late Earl of Sandwich, round the Mediterranean in the
Years 1738 and 1739, Written by himself... (1799), p. 78. (63) Par exemple J. Travlos, 'Εγκυκλοπαίδεια Δομή Χ (1971), «.υ. « Megara », p. 205 ; Sakellariou-
Faraklas, op. cit., fig. 27. Un sondage à cet endroit n'a rien retrouvé qui puisse confirmer cette hypothèse : cf. A. Liankouras, ArchDelt 29-11 (1973-1974), p. 80.
1984] MEGARIKA 263
puisque même au-delà de l'époque de Pausanias, on y consacrait les statues des athlètes qui avaient illustré leur patrie ou celles des gymnasiarques méritants.
La mention de la porte Sud de Mégare, celle qui menait vers le port du golfe Saronique est la seule allusion du Périégète au rempart : il ne faut pas en déduire qu'il était détruit lors de son passage, mais simplement que Pausanias n'avait rien à en dire. Spon et Wheler ont encore vu, lors de leur passage en 1676, la porte qui sert de point de repère à Pausanias64 : cela signifie donc que la muraille en ce secteur du moins, a résisté fort longtemps à l'usure du temps ; mais c'est la guerre de Venise contre l'empire Ottoman qui réduisit à peu de choses les vestiges de l'enceinte et de la porte Sud, lorsque Mégare fut détruite par les Vénitiens en 168365. Pourtant même après cette date, il devait rester des ruines assez reconnaissables de la porte, puisque Fourmont représente sur son dessin la muraille, là où elle coupait la rue droite ; c'est dans la partie Sud de son parcours, non loin de la porte, que l'on a retrouvé le plus beau tronçon de l'enceinte66.
Avant que la fontaine dite de Théagène ne fût retrouvée, au centre de la ville, les voyageurs expliquaient tous le nom de la porte des Nymphes par la proximité de ce monument, dont Pausanias nous apprend qu'il était alimenté par l'eau dite des Nymphes Sithnides (I, 40, l)67. Mais l'explication doit être différente, à moins d'imaginer que depuis la fontaine dite de Théagène d'autres conduites distribuaient l'eau dans la ville basse, jusqu'à cette porte ; seul parmi tous les voyageurs, Richard Pococke signale, au Sud de la ville, les restes d'un petit bâtiment rond, construit en gros blocs de marbre gris, qui portent quelques inscriptions grecques « très effacées »68 : il ne peut s'agir des inscriptions IG VII, 49 et 97 à 99, que le voyageur a signalées un peu plus haut dans sa description et qu'il a lues. Le nom de la porte voisine, la forme du bâtiment, rond, peuvent faire penser à un Nymphée : mais il est périlleux de déduire son existence à partir de cette seule mention.
XIV. Conclusion : topographie de Mégare
Le plan de la fig. 60, qui rassemble tous les résultats obtenus dans cette série de notes de topographie mégarienne leur servira de conclusion. A chaque monument mentionné dans la description de Pausanias a été attribué un numéro ; les quelques monuments qui n'apparaissent pas dans cette description, mais dont l'existence est certaine, sont désignés par une lettre capitale. Les monuments dont aucun vestige n'est actuellement visible — c'est-à-dire les plus nombreux — ne sont représentés sur ce plan que par leur symbole (chiffre ou lettre) ; lorsque ces symboles sont placés dans un cercle ou un cartouche, cela signifie que les monuments auxquels ils sont attribués sont localisables n'importe où dans la zone ainsi délimitée. Cette façon de représenter la topographie reconstituée de Mégare m'a semblé plus prudente que
(64) J. Spon, op. cit., II, p. 289 ; G. Wheler, op. cit., III, p. 522. Ch. Thompson, op. cit., I, p. 361, décrit la porte, qu'il a vue en 1730, dans les mêmes termes que Wheler, alors qu'elle devait être détruite : cf. n. 58.
^65) R. Chandler, Voyage en Grèce III (1806), p. 196. V66) Cf. n. 15. V67) Cf. par exemple Rangabé, loc. cit., p. 287, et planche 1-5, nos 37-38. '68) R. Pococke, .4. Description of the East and some other Countries III (1743-1745), p. 171.
264 ARTHUR MULLER [BCH 108
500
Fig. 60. — Topographie reconstituée de Mégare (légende : tableau ci-contre).
1984] MEGARIKA 265
1 Fontaine de Théagène 2 Artémision (= 19) 3 Olympieion 4a Temple de Dionysos 4b Sanctuaire d'Aphrodite 4c Oracle de la Nuit 4d Temple de Zeus Konios 4e Sanctuaire d'Asclépios 4f Megaron de Déméter 5 Monument d'Alcmène 6 Rhous 6a Autel d'Achéloos 7 Monument de Hyllos 8 Temple d'Isis 9 Temple d'Apollon et d'Artémis
10 Hérôon de Pandion 11 Tombe d'Hippolyte 12 Tombe de Térée 13a Tombe de Mégareus 13b Foyer des Dieux Prodomeis 13c Pierre à la Lyre 13d Bouleutérion 14 Acropole Alkathoos 14a Temple d'Athéna 14b Temple d'Athéna Niké 14c Temple d'Athéna Aiantis 14d Temple d'Apollon 14e Sanctuaire de Déméter 15 Tombe de Kallipolis 16 Hérôon d'Ino 17 Hérôon d'Iphigénie 18 Tombe d'Adraste 19 Artémision (= 2) 20 Prytanée 21 Petra Anaklèthra 22 Tombe des Héros des guerres médiques 23 Aisymnion 24 Hérôon d'Alkathoos et archives 25 Tombe de Pyrgo 26 Tombe d'Iphinoé 27 Tombes d'Astykrateia et Manto 28 Dionysion 29 Aphrodision 30 Sanctuaire de Tychè 31 Temple anonyme 32 Tombe de Koroibos 33 Tombe d'Orsippos
Rue droite 34 Temple d'Apollon Prostaterios 35 Vieux Gymnase 36 Porte des Nymphes 37 Sanctuaire des llithyes A Portique Sud de l'Agora Β Fontaine archaïque G Porte de Tripodiskos D Porte de Gorinthe Ε Porte d'Athènes
40, 1 Meg. V, p. 211-215. 40, 2 Meg. VI, p. 221 et VII, p. 222-225. 40,4 Meg. XIII, p. 256-259. 40, 6
Meg. X, p. 170 et XIII, p. 260. Meg. I, p. 83-89.
41, 1 41,2 Meg. III. p. 203-207.
41,3
42, 4
43,2
43, 3
43, 4
Meg. IV, p. 207-211 41, 6 i 41, 7 1 41,8 42, 1 De Nisée à Mégare, p. 623-624.
De Nisée à Alégare, p. 623.
De Nisée à Mégare, p. 627 et n. 39. De Nisée à Mégare, p. 620 (enceinte).
42, 5 42, 6
42, 7 43, 1 Meg. VI, p. 218-222.
Meg. VI-VII, p. 218-225. Meg. VI, p. 221. Meg. II, p. 89-92.
De Nisée à Mégare, p. 628.
43,5 Meg. XIII, p. 260-261. 43,6
43, 7 44, 1 44, 2 Meg. XII, p. 252-254.
Meg. XIII, p. 261-263. Meg. XIII, p. 263.
Meg. XIII, p. 255-256. Meg. V, p. 216.
Meg. XII, p. 255.
266 ARTHUR MULLER [BCII 108
celle qui consiste à représenter chaque monument par un point précis ou un rectangle69 : cette méthode implique en effet une série de choix arbitraires et fait passer notre connaissance de Mégare pour plus précise qu'elle n'est en réalité.
La légende de la figure est présentée sous forme de tableau : les deux premières colonnes mettent en rapport les symboles et les noms des monuments qu'ils représentent ; la troisième colonne donne les références au livre I de la Périégèse. La quatrième colonne enfin renvoie, s'il y a lieu, aux argumentations développées dans les Megarika10.
Un simple coup d'œil sur cette figure permet de mesurer la part d'incertitude et d'hypothèse dans notre connaissance de Mégare. Après les nombreux plans proposés par le passé71, celui-ci n'est qu'un essai de mise en forme des données dont nous disposons actuellement : puisse le progrès des recherches archéologiques le préciser et l'enrichir !
Arthur Muller.
(69) Cf. par exemple J. Travlos, loc. cit., p. 205. (70) Développement des renvois : Megarika I-II : BCH 104 (1980) ;
III-VII : BCH 105 (1981) ; VIII-IX : BCH 106 (1982) ;
X-XI : BCH 107 (1983) ; XII-XIV : BCH 108 (1984) ;
De Nisée à Mégare : MélRome 95 (1983) p. 618-628. (71) Plans de Mégare proposés jusqu'à présent :
— H. Reinganum, Das aile Megaris (1825), pi. 2.' — Rangabé, Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions, lre série, tome 5 (1857),
pi. I, fig. 5. — Ε. L. Highbarger, The History and Civilization of ancient Megara (1927), pi. I. — J. Travlos, 'Εγκυκλοπαίδεια Δομή Χ (1971), s.v. «Megara», p. 205. — Sakellariou-Faraklas, Μεγαρίς, Αίγόσθενα, Έρένεια, Ancient Greek Cities XIV (1972), fig. 27. — N. Papachatzis, Παυσανίου 'Ελλάδος Περιήγησις Ι (1974), p. 505, fig. 311. — F. Bohringer, AnlCl 49 (1980), p. 21.