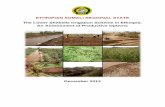Marques prosodiques de la focalisation contrastive en somali
Transcript of Marques prosodiques de la focalisation contrastive en somali
Marques prosodiques de la focalisation contrastive en somali David Le Gac
Université de Rouen – UMR 6065 Dyalang [email protected]
Abstract This paper investigates the prosodic markers of focalization and information structure in Somali, a Cushitic tonal accent language. Both traditional and more recent accounts of focalization in Somali have commonly accepted that this language uses morphological focus particles. It has been assumed, therefore, that Somali has no prosodic cues to express focalization. However, the correlation between new information and focus particles is not systematic and very little attention has been devoted to the intonation of Somali. First, this paper provides a phonetic analysis of intensity and melodic configurations in Somali and shows that, in fact, tonal accent alternations, downdrift, and intonative high and low tones express focalization and information structure. In a second part, a phonological model of the prosody of Somali is proposed. To be precise, it is suggested that Somali has two independent tonal tiers, the accentual tonal tier and the intonative tonal tier, and that the association of these tonal tiers produces the melodic patterns at the phonetic level. Furthermore, it is assumed that a low tone marks the focus and constitutes the tonal pivot of the sentence: this low tone triggers tonal accent alternations and governs the phonetic realization of the other intonative tones.
1. INTRODUCTION
Dans cet article, je propose une analyse à la fois phonétique et phonologique des marques prosodiques de la focalisation et de la structure informationnelle en somali, langue couchitique à accent tonal. L’une des caractéristiques syntaxiques du somali est l’usage obligatoire de morphèmes décrits par certains comme des marqueurs de focalisation (MF). De ce fait, on a souvent avancé que le somali ne signalait pas le focus au niveau prosodique, et cette thèse paraît motivée au regard de la prosodie d’autres langues qui emploient également des MF, comme le wolof (cf. Rialland & Robert 1991, et dans cet ouvrage). Or, la relation entre focalisation et MF en somali n’est en fait pas aussi systématique, et certains phénomènes prosodiques décrits dans la littérature remettent en cause la thèse traditionnelle.
1.1 Situation géographique et linguistique du somali
Le somali est une langue parlée par sept à huit millions de personnes sur un espace qui couvre l'ensemble de la Somalie, la partie est de l'Ethiopie, le sud de Djibouti et une partie du Kenya. Le somali fait partie de la famille couchitique, qui appartient avec quatre autres familles à la superfamille afro-asiatique anciennement dénommée chamito-sémitique (cf. figure 1). Les langues couchitiques sont parlées pour la plupart en Ethiopie et au Kenya. Au sein du couchitique, le somali fait partie de la sous-famille couchitique est, tout comme l'afar et l'oromo, cette dernière étant certainement la langue couchitique avec le plus de locuteurs.
AFRO-ASIATIQUE
Sémitique Berbère Couchitique Egyptien Tchadique
Nord Centre Est Sud
Afar Somali Oromo
Figure 1 : situation linguistique du somali
1.2 La focalisation en somali
Traditionnellement, on admet que le somali, ainsi que d'autres langues couchitiques, encode dans la structure syntaxique de la phrase l'articulation discursive ou informationnelle Topique/Focus, où le topique constitue l'information connue, et le focus l'information nouvelle (Heine & Reh 1984, Saeed 1984, 1987, 1993, 1998, Orwin 1995)1. L'encodage discursif s'exprime au moyen de morphèmes obligatoires, appelés marqueurs de focus (MF). Il en existe quatre qui se distinguent par le type et la place des éléments qu'ils focalisent :
- waa focalise le verbe ou le prédicat, - baa et ayaa sont équivalents2, et focalisent un syntagme adjacent à gauche, - waxaa3 focalise un syntagme en fin de phrase.
La fonction de waa est illustrée dans les exemples en (1). En (1)a., wiilkii « le garçon » est posé comme topique, et la question porte sur le verbe matagay « a vomi ». La seule réponse appropriée est celle avec le MF waa (cf. (1)b.). Une réponse avec les MF baa/ayaa ou waxaa qui focaliseraient le GN sujet (cf. (1)c.) est inappropriée (symbolisée par #). Saeed (1998:206) résume ainsi l'utilisation de waa : dans des phrases déclaratives où tous les groupes nominaux sont non focalisés, waa apparaît. (1) a. wiilkii ma matagay ? (Saeed 1998:204) garçon-le INT a vomi
« Est-ce que le garçon a vomi ? »
b. haa, (wiilkii) wuu matagay (Saeed id.) oui, garçon-le MF-3SM a vomi c. #haa, wiilkii baa/ayaa matagay (Saeed id.) oui, garçon-le MF a vomi
« Oui le garçon a vomi »
1 Les notions de topique et de focus (ou de thème et rhème) sont sujettes à de nombreux débats dans la littérature. Je me baserai ici sur une définition simple et traditionnelle de la structure discursive : le focus constitue l’information nouvelle, le focus contrastif réfère à la sélection exclusive et le topique renvoie à l’information connue ou donnée par le contexte. 2 On considère généralement que le choix entre baa et ayaa est d'ordre stylistique : ayaa serait plus « soigné » et utilisé dans un style plus formel. Par ailleurs, baa peut fusionner avec le syntagme qui précède : Cali (« Ali »)+baa → Calaa, tandis que cela est impossible avec ayaa. 3 Dans cet article, j’emploierai la transcription orthographique officielle du somali : « x » symbolise la fricative pharyngale sourde, « c » la fricative pharyngale sonore, et « dh » l’occlusive rétroflexe sonore, ou un [r].
Baa/ayaa et waxaa focalisent un syntagme nominal, prépositionnel ou une complétive. Ainsi, à la question (2)a., seule une réponse comportant l’un de ces trois MF est possible. Une réponse avec waa comme (2)d. est inappropriée. (2) a. Yaa la hadlay Kulmiye ? INT avec a parlé Kulmiye
« Qui a parlé avec Kulmiye ? »
b. Yoonis baa/ayaa la hadlay Kulmiye. Yoonis MF avec a parlé Kulmiye c. Waxaa la hadlay Kulmiye Yoonis MF avec a parlé Kulmiye Yoonis d. #Yoonis wuu la hadlay Kulmiye. Yoonis MF-3SM avec a parlé Kulmiye
« Yoonis/c’est Yoonis qui a parlé avec Kulmiye. Par ailleurs, l'utilisation de baa/ayaa dans une question implique une interprétation contrastive dans la réponse : (3) a. Ma Cali baa/ayaa baxay ? INT Ali MF est parti
« Est-ce Ali qui est parti ? »
b. Maya, Magan baa/ayaa baxay Non, Magan MF est parti c. Maya, waxaa baxay Magan Non, MF est parti Magan
« Non, c'est Magan qui est parti » Cependant, certaines données du somali montrent qu'il n'y a pas de relation systématique entre la manifestation formelle d'un MF et l'interprétation d'un élément précis en tant que focus discursif (information nouvelle). Ainsi, les MF baa/ayaa apparaissent quand la focalisation porte sur la phrase entière (Saeed 1998, Lecarme 1991, 1999), comme l’exemple (4) le montre : (4) a. Máxaa dhacáy ? Saeed (1998:205) INT est arrivé
« Qu'est-ce qui s'est passé ? »
b. Cali baa Faarax caayey Ali MF Farah a insulté. c. #Cali Faarax wuu caayey Ali Farah MF-3S a insulté
« Ali a insulté Farah. » On observe aussi qu'il ne peut y avoir qu'un seul MF par phrase : or, on sait qu'un énoncé peut comporter plusieurs focus, par exemple lorsqu'ils répondent à des questions du type « qui a mangé quoi ? », lesquelles n'ont pas d'équivalent en somali (Lecarme 1991, 1999). Ensuite, les MF sont exclus des propositions dépendantes, c'est-à-dire des complétives ou des relatives.
Or, il est concevable qu'un élément appartenant à une proposition dépendante puisse être focalisé d'un point de vue discursif Lecarme (1991, 1999) rappelle également que la position [GN baa/ayaa] peut être occupée par des constituants qui ne peuvent être interprétés comme le focus de la phrase : il s'agit par exemple de l'argument implicite wax « chose », vide de contenu sémantique, et qui n’est présent que pour remplir une position réclamée par le verbe. Ainsi, en (5), wax ne peut être l'information nouvelle, la focalisation proprement dite porte sur le procès, c'est-à-dire sur le fait de lire.
(5) i dhaaf, wax baan akhrinayaa (Lecarme 1991:45) 1S laisse chose MF-1S lis
« Laisse-moi, je suis en train de lire » Enfin, un constituant suivi de baa/ayaa n'est pas toujours interprété comme information nouvelle, (Lecarme 1991, 1999) : il peut aussi fonctionner comme le topique dans un contexte approprié ((6)b/c.) ou situer l'action dans l'espace et le temps (cf. (6)a. « waa baa… », exemple cité par Lecarme 1991:43) : (6) a. Waa baa waxaa belo isugu faanay Jour MF MF malfaisance se mesuraient libaax, good iyo habar lion, serpent et vieille b. Libaaxii baa hor hadlay, oo yiri :… lion-le MF d'abord parla et dit c. Habartii baa hadashay, oo tiri :… vieille-la MF parla et dit
a. « Un jour, un lion, un serpent et une vieille mesuraient leur pouvoir de nuire. » ; b. « Le lion parla le premier, et dit :… » ; c. « Puis la vieille parla, et dit :… »
Aussi, le GN ardeygan « cet étudiant » en (7) n'a-t-il pas une fonction discursive définie : il peut exprimer un focus, mais aussi un topique simple ou contrastif (« Quant à… »). Le même problème se posera pour le GN warqaddiisa final, « focalisé » par le MF waxaa. Seul le contexte permet de trancher entre ces trois interprétations pour chaque GN (Lecarme 1999). (7) Ardeygan baa wuxuu doonayaa inuu arko warqaddiisa étudiant-cet MF MF-3Sm veut que-3S voir-3Sm lettre-sa
« Cet étudiant veut voir sa lettre » Lecarme (1991:47) a résumé la situation ainsi :
« Le somali est une langue où une position syntaxique particulière [Spec, CP] est spécialement désignée pour recevoir une interprétation focus. Mais cette relation n'est en rien systématique : position Focus n'implique pas nécessairement interprétation focus. Inversement, l'interprétation focus n'est pas limitée à la position Focus. »
En somme, si la relation entre MF et interprétation focus n’est pas systématique, on peut se poser la question de savoir si la prosodie ne jouerait pas un rôle pour marquer la focalisation comme cela se passe dans beaucoup de langues. Les approches traditionnelles (Andrzejewski 1964, 1979, Saeed 1987, 1998, Orwin 1995, Hyman 1981) ont nié toute implication de la prosodie au niveau informationnel. Pourtant, certaines alternances de l’accent tonal et certains faits intonatifs suggèrent le contraire.
1.3 La prosodie du somali
1.3.1 L’accent tonal : nature et représentation
Dans son article clé, Hyman (1981) a montré que le somali était une langue à accent tonal, et non une langue à tons comme le supposaient certains travaux antérieurs (cf. entre autres, Armstrong 1934, Andrzejewski 1964, 1979). Sur le plan de la substance, l’accent tonal du somali se manifeste par un ton haut ou une montée mélodique, associé à un pic relatif d’intensité (cf. figures 2 et 3). Cependant, j’ai pu montré par ailleurs que l’intensité n’était pas perçue comme un paramètre accentuel (Le Gac 2001). Il en va de même pour la longueur segmentale, qui est phonologiquement distinctive en somali.
Time (s)0 1.27129
30
100
Figure 2 : courbes mélodiques en Hz et intensité en dB des paires minimales ínan « garçon » ~ inán « fille »
I n a n i n A n 0
500
100
200
300
400
Time (s) 0 1.27129
b b E e r b e E r
0
500
100
200
300
400
Time (s)0 1.28871
Time (s)0 1.28871
30
100
Figure 3 : courbes mélodiques en Hz et intensité en dB des paires minimales béer « foie » ~ beér « jardin » Sur le plan phonologique, depuis Hyman 1981, l’accent tonal du somali est représenté par un ton haut H associé à un accent sous-jacent, noté *. L’unité rythmique à laquelle est associé * est la more vocalique, si bien que, prosodiquement, une voyelle longue phonologique est équivalente à deux voyelles séparées par une ou deux consonnes : /VV/ = /V C(C) V/ (cf. (8)). (8) Représentation phonologique de l’accent tonal dans les paires ínan ~ inán et béer ~
beér H H H H * * * *
i nan in a n b e e r be e r
1.3.2 Les alternances de l’accent tonal
L’accent tonal du somali a ceci de remarquable qu’il présente des alternances complexes, souvent étudiées mais qui demeurent encore mal comprises de nos jours (cf. Andrzejewski 1964, 1979, Banti 1988, Hassan 1994, Hyman 1981, Morin 1991, 1995, Orwin 1995, Puglieli & Ciise 1984, Saeed 1987, 1993, 1998). La place et la présence de l’accent tonal du somali dépend de deux paramètres généraux : 1) la classe nominale (traditionnellement appelées « déclinaisons ») à laquelle appartient un nom, et 2) le contexte syntaxique. 1) Les quatre Classes Nominales (« CN »). On peut distinguer quatre CN en fonction de paramètres morphologiques (Le Gac 2001) :4
4 Le nombre de « déclinaisons » varie d’un auteur à l’autre. Tout dépend des paramètres que retiennent les auteurs dans leur classification : paramètres tonals, morphologiques, syllabiques etc. Le Gac (2001) livre une synthèse de ces différents classements.
• La CN1, constituées de noms féminins singuliers comme inán « fille », naág « femme », warqád « lettre » ou mindí « couteau »
• La CN2, regroupant des noms masculins singuliers comme ínan « garçon », nácas
« idiot », Yoónis « Yoonis » ou albáab « porte »
• La CN3, qui comporte des noms masculins singuliers suffixés en -e et des féminins singuliers en –o. Les suffixes –e/o ont une valeur agentive, instrumentale et nominalisent une proposition du type « celui qui fait, possède… » (Saeed 1998) :
(9) a. Kulmiy-é "Kulmiye" < kúlmi "faire se rencontrer"
b. bar-é "enseignant" < bár "enseigner" c. daf-ó "faucon" < daf "saisir" d. qor-tó "écrivain(f)" < qór "écrire"
• Enfin, les noms pluriels en -(C)o (Consonne+o : bahal-lo < Sg. báhal « bête(s)
sauvage(s) ») et en -aC (insertion d’un -a- et réduplication de la dernière consonne du radical : miis-as < Sg. míis « table(s) ») forment la CN4.
2) Les contextes et les alternances de l’accent tonal. Si l’on recoupe l’ensemble des informations fournies par la littérature (Andrzejewski 1964, 1979, Hyman 1981, Banti 1988, Saeed 1987, 1993, 1998, Puglieli & Ciise 1984), on peut dégager quatre contextes syntaxiques susceptibles de faire varier l’accent tonal des CN5 (Le Gac 2001, 2002, à par.) :
1. [±Focus] : le nom est focalisé ou non par un MF 2. ayaa~waxaa : type de MF qui focalise le nom 3. [±Sujet] : le nom est sujet ou non de la principale 4. [±Pause] : le nom est suivi ou non d’une pause, c'est-à-dire est en fin de phrase ou pas.
Le tableau 1 ci-dessous résume l’ensemble des alternances de l’accent tonal pour chaque CN que l’on trouve dans la littérature (cf. aussi Le Gac 2001) : Tableau 1 : variations de l’accent tonal en fonction des CN et des contextes syntaxiques
[+Focus] [-Focus]
[-Sujet] [+Sujet]
ayáa wáxaa [-Pause] [+Pause]
CN1 gabádh gabadhi
CN2 wéli weli
CN3 baré báre
báre baré baré báre
báre
CN4 bahallo bahallō bahalló
5 Il faut savoir que seuls les GN constitués d’un unique nom indéfini ou propre varient tonalement. Dans le cas d’un GN défini (N-Art, l’article est suffixé en somali) ou d’un GN modifié par un adjectif (GN Adj), un autre nom (GN1 GN2) ou une relative (GN Rel), c’est le dernier élément seulement du GN complexe (i.e.-Art, Adj, GN2 ou Rel) qui présente les alternances tonales, le GN modifié reste invariable (cf. entres autres Hyman 1981, Saeed 1987, 1993, 1998, Orwin 1995, Le Gac 2001). Cela ne remet pas en cause les analyses phonétiques et phonologiques présentées dans la suite de l’article : celles-ci ne s’appliquent finalement qu’au dernier élément du GN.
Ainsi, on voit que les CN1 et 2 présentent une opposition entre une forme inaccentuée (ou atone) en [-Focus, +Sujet] (contexte souvent nommé « Nominatif ») et une forme accentuée dans tous les autres contextes. La différence entre CN1 et CN2 concerne simplement la place de l’accent tonal : la CN1 a un accent tonal final, tandis que la CN2 manifeste un accent tonal pénultième. Tous les auteurs s’accordent sur les variations de l’accent tonal des CN1 et CN2, ce qui est d’être le cas pour les deux autres CN. L’ensemble des auteurs reconnaît également un accent tonal pénultième en [-Focus, +Sujet] pour la CN3, ce qui distingue radicalement cette classe des deux premières. Cependant, dans les autres contextes, des divergences émergent entre les auteurs. Ainsi, le contexte [+Pause] en [-Focus] est pertinent selon Banti (1988) et Saeed (1998) : l’accent tonal devient pénultième devant une pause. De même en [+Focus] : le nom focalisé par waxaa étant en fin de phrase, donc devant pause, l’accent tonal est pénultième. Mais, celui-ci reste final devant ayaa selon Banti (ibid.) et Saeed (ibid.). Pour Hyman (1981), Andrzejewski (1964, 1979) et Saeed (1993), l’accent tonal est toujours pénultième sous focus, et final en [–Focus, –Sujet]. La CN4 présente encore un autre type de problématique. Andrzejewski (1964, 1979) parle d’un ton moyen final pour cette classe, et non d’un ton haut (bahallō). Par contre, pour Hyman (1981) et Banti (1988), les noms de la CN4 présentent bien un accent tonal final mais facultatif, et ce, dans tous les contextes. Saeed (1998) argue aussi pour un accent tonal, lequel subit un abaissement (c'est-à-dire un effacement) devant pause. Enfin, selon Saeed (1993), Orwin (1995) ou Frid (1995), les noms de la CN4 seraient atones dans tous les contextes. Cet aperçu des données du somali nous amène à nous demander quelle est l’influence de la focalisation sur les alternances de l’accent tonal, notamment en CN3 et CN4. Ainsi, l’opposition forme accentuée ~ forme inaccentuée est neutralisée en [+Focus] dans les CN1 et 2 au profit de la forme intonée, ce qui paraît naturel : la focalisation se manifeste normalement par une proéminence marquée à travers les langues. En CN3, Banti (1988) et Saeed (1998) étant les seuls à mettre en avant l’influence de la pause dans le déplacement accentuel sur la voyelle pénultième, on peut légitimement douter de cette affirmation. Ne serait-ce pas plutôt la focalisation qui provoquerait un tel déplacement ? Dans ce cas, il faut expliquer pourquoi l’accent est également pénultième dans le contexte [-Focus, +Sujet], autrement dit que la neutralisation tonale se fait au profit du cas « nominatif » contrairement aux CN1 et 2 ; il est peu probable qu’il s’agisse du même processus en [-Focus] et en [+Focus]. D’autre part, si l’accent tonal reste bien final en [+Focus] devant le MF ayaa, il faudra finalement rendre compte de l’alternance accent final ~ accent final sous focus. Enfin, en ce qui concerne la CN4, il faut tout d’abord cerner la véritable nature de son ton : ton haut ou moyen ? Ensuite, les auteurs semblent avoir étudié la plupart du temps des phrases simples en isolation. Or, si le contexte syntaxique (±Sujet, ±MF etc.) est aisément maîtrisable, ce n’est pas le cas du statut informationnel des GN sans un contexte discursif approprié. Aussi, le fait que l’éventuelle proéminence de la CN4 soit facultative ne serait-il pas justement révélateur de l’influence du contexte discursif ? L’hypothèse sera donc la suivante : lorsqu’un nom de la CN4 est effectivement focalisé d’un point de vue sémantique, il porterait un accent tonal, et resterait atone dans le cas contraire.
1.3.3 Autres phénomènes prosodiques et l’intonation du somali
Je définirai l’intonation comme l'ensemble des moyens phonétiques (f0, intensité, durée) mis en œuvre pour véhiculer des signifiés supra-lexicaux, organiser et hiérarchiser l'information au niveau de l'énoncé (cf. entres autres Ladd 1996, Rossi 1999). Le somali a été décrit comme une langue sans intonation (Andrzejewski 1979, Hyman 1981, Saeed 1993, 1998). Pour étayer cette thèse, on a souvent mis en avant l’absence de montée mélodique pour marquer l’interrogation, absence due à l’usage obligatoire de particules interrogatives. De la même manière, du fait de l’emploi de MF, il n'y aurait pas en somali de patrons intonatifs marquant l'information nouvelle. Cependant, il existe au moins deux phénomènes prosodiques qui relèvent clairement de l’intonation en somali : 1) une montée mélodique en fin de groupe syntaxique, et 2) un processus d’abaissement tonal, le « downdrift ». 1) Le ton H% : selon Andrzejewski (1979) et Frid (1995), les locuteurs réalisent parfois un ton haut en fin de groupe syntaxique pour indiquer un lien sémantique avec ce qui suit. Dans l’exemple (10) ci-dessous, repris de Frid (1995), le ton haut en question est noté H%, notation courante pour indiquer un ton de frontière et que je reprendrai par la suite : (10) H* H% H* H% H* H*Bfin
[Jíirkaa]GN [waraabáha]GN [ká fiicán]GI
rat-le-baa hyène-la plus bon « Le rat est meilleur que la hyène »
Or, la localisation de H% et le fait que celui-ci contraste avec le ton bas final (« Bfin ») ne va sans rappeler le contour de « continuité » de langues comme l'italien (Rossi 1998), le français (entre autres, Di Cristo 1981, Rossi 1981, Martin 1981, Touati 1987) ou encore le grec moderne (Botinis 1989) etc, où les topiques de l’énoncé sont marqués par des montées mélodiques finales contrastant avec un ton bas en fin de phrase ou sous focus. La vérification de l'occurrence du ton H%, ainsi que sa distribution exacte sont donc cruciales. 2) Le downdrift : la conception traditionnelle selon laquelle le somali serait une langue sans intonation repose sur une définition limitée de cette dernière : l’intonation consiste en des mouvements locaux de f0 différents de ceux l’accent tonal. Or, on reconnaît à l’heure actuelle que les langues, notamment les langues à tons et à accent tonal, peuvent avoir recours à d’autres stratégies mélodiques pour véhiculer des signifiés supra-lexicaux ou hiérarchiser l’information (pour un aperçu synthétique de ces stratégies, voir notamment Hirst & Di Cristo 1998 et Ladd 1996). Le downdrift, c'est-à-dire l’abaissement itératif de tons hauts séparés par des tons bas (cf. Figure 4) en fait indiscutablement partie. H B H↓ B H↓ Figure 4 : abaissement itératif de tons hauts (H) séparés par des tons bas (B) constitutif du downdrift. Selon Frid (1995), le downdrift s'applique d’accent tonal à accent tonal automatiquement tout au long de l'énoncé. Hyman (1981) en revanche pose des frontières de groupe, notées « % » qui bloquent l'application du downdrift et s'alignent avec certains syntagmes : (11) GN % GN % VC % GN GN… (VC = “Verbal Complex” = [MF+GV])
Mais ces règles d’alignement sont générales et peuvent être violées. Hyman (1981:195) ajoute : “They are, after all, merely strategies for giving relative weight to the major categories (NP, VC) within an utterance”. En somme, tout comme pour le ton H%, il est nécessaire d’étudier le rôle de la focalisation sur le downdrift. En Japonais par exemple, une autre langue à accent tonal, l'élément focalisé porte un accent tonal proéminent non soumis au downdrift (Pierrehumbert & Beckman 1988).
1.4 Plan de l’article
Tout d’abord, je présenterai brièvement le protocole expérimental qui m’a permis de mettre en évidence les marques prosodiques de la focalisation en somali. Dans le chapitre suivant, j’exposerai les principaux résultats de l’analyse phonétique. En premier lieu, on verra que le focus est marqué par un accroissement local de l’intensité. Je montrerai ensuite que les tons H%, le downdrift et, plus globalement, l’utilisation des registres tonals permettent de hiérarchiser l’information. Mais on verra aussi que le focus en somali est marqué par un ton bas spécifique. Enfin, il sera montré que les alternances complexes de l’accent tonal dans les CN3 et 4 sont dues à la focalisation, et qu’il y a une relation évidente entre l’intonation et ces alternances. Le dernier chapitre sera consacré à la proposition d’un modèle phonologique qui rend compte des contours mélodiques de surface et de l’interaction entre l’intonation et l’accent tonal. Je montrerai que le ton bas qui marque le focus joue un rôle crucial au niveau phonologique : il constitue le pivot tonal de l’énoncé en gouvernant la réalisation des autres tons intonatifs, et en provoquant les alternances de l’accent tonal. En conclusion, je résumerai les principaux résultats et discuterai de l’application du modèle dans d’autres langues.
2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL
2.1 Corpus
Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté discursive sur les GN étudiés, j’ai utilisé le paradigme question ~ réponse. Les locuteurs devaient lire une question du type de celle donnée en (12) et répondre par l’une des deux phrases qui figurent en (13). Ainsi, y avait-il obligatoirement un GN (ici Magan) focalisé sémantiquement par ayáa ou wáxaa, et en contraste. De plus, un nom de chaque CN a été placé alternativement en position GN1 et GN2, ainsi qu’en contexte [+Focus] et [-Focus]. Notons que la position GN2, correspondant à la fin de phrase permet de tester l’impact de la pause sur l’accent tonal. Enfin, j’ai également fait varier dans chaque position la fonction [±Sujet]. (12) Maánta yáa lá hadlaý Kulmiyé ? Má baráha baa lá hadlaý ? Adv INT Prév V GN2 INT GN1 MF Prév V
Aujourd'hui qui à a parlé Kulmiye l'enseignant à a parlé « Aujourd'hui, qui a parlé à Kulmiye ? Est-ce l'enseignant qui lui a parlé ? »
(13) A. Maánta Mágan ayáa lá hadlaý Kulmiyé
Adv GN1[+Focus] MF Prév V GN2[-F]
Aujourd'hui Magan à a parlé Kulimye
B. Maánta Kulmiyé wáxaa lá hadlaý Mágan Adv GN1[-F] MF Prév V GN2[+Focus]
Aujourd'hui Kulmiye à a parlé Magan
« Aujourd'hui, c'est Magan qui a parlé à Kulmiye »
2.2 Locuteurs, enregistrements, mesures
Deux hommes (locuteurs S1 et S2) d’environs 40 ans originaires du centre et du nord de la somali ont été enregistrés. Tous deux parlent le somali standard (« Northern Somali »), qui est le dialecte de la présente étude. Ils ont fait des études universitaires, et sont plurilingues (somali + français + arabe, + anglais/suédois/italien) Les questions~réponses ont été inscrites sur des fiches individuelles et mélangées aléatoirement. Les deux locuteurs devaient lire six fois les dialogues en un seul souffle, sans pause marquée et à débit normal.6 Les mesures de f0 et d’intensité ont été prises manuellement sous chaque syllabe. Les mesures de f0 ont été converties en quarts de ton (dorénavant « qt ») sur la base du minimum de l'énoncé. Les valeurs d'intensité ont été converties en pourcentages sur la base de l'intensité moyenne de l'énoncé. Les moyennes en qt et en pourcentages des cinq dernières répétitions ont été calculées.
3. RESULTATS
3.1 L’intensité
Comme je l’ai dit en 1.3.1, l’intensité de l’accent tonal n’est pas reconnue comme un paramètre accentuel par les sujets lors de tests de perception (Le Gac 2001). Cela suggère que l’intensité constitue un paramètre non phonologique et dépendant de la f0. Au niveau intonatif, l'intensité a tendance à diminuer tout au long de l'énoncé, quelle que soit la hauteur des accents tonals. Ce phénomène est naturellement d’origine physiologique (cf. Fónagy 1979). Cependant, le focus brise cette tendance en étant marqué par un accroissement relatif de l’intensité (cf. figure 5), même en fin de phrase. Au niveau intonatif, l’intensité apparaît donc comme un paramètre indépendant de la mélodie, mais non contrôlé par le locuteur, sauf sous focus.
6 Enregistrements effectués sur un magnétophone Marantz avec microphone-cravate positionné à environ 20 cm des lèvres. Le locuteur S1 a été enregistré dans la chambre sourde du laboratoire de phonétique de l’université Paris 7, et le locuteur S2 à l’institut des langues romanes Romanska à Lund, Suède dans un bureau calme. Numérisation en 11025 Hz et 16 bits sur un ordinateur PC. Analyse à l'aide des logiciels Winpitch 1.92 de P. Martin.et PRAAT 3.9.4 de P. Boersma.
80
90
100
110
120
130In
tens
ité (
%)
Enoncés-FC 117 109 103 102 98 110
Enoncés+FS 117 125 108 106 101 102
Adv GN1 Foc Prév V GN2
Figure 5 : intensité sous chaque accent tonal dans les énoncés A (« Enoncés +FS », colonnes en pointillés, Focus suivi de ayaa) et les énoncés B (« Enoncés -FC », colonnes pleines, Focus en fin de phrase)
3.2 Les configurations mélodiques globales
Les figures 6 à 9 montrent des exemples de signal/intensité/f0 et les mesures de f0 des 5 répétitions d’un énoncé à focus final (énoncés B) et à focus non final (énoncés A) produits par le locuteur S1.
3.2.1 Enoncés B : focus final (MF waxaa)
H* H% H*
H% H* H*
H* H*
Figure 6 : signal oscillographique, intensité (dB) et f0 (Hz) montrant un énoncé avec focus final (énoncés B)7
7 Enoncé : Maánta « aujourd’hui » ; wéliga [-Focus] « homme saint-le » ; wáxaa MF ; lá « Prév-avec » ; hadlaý « a parlé » ; Mágan [+Focus] « Magan » : « Aujourd’hui, c’est Magan qui a parlé avec l’homme saint »
0
5
10
15
20
25F
0 -
quar
ts d
e to
n
weliga1 9 19 10 7 15 9 6 7 12 10 16 6 11 9 12 0
weliga2 8 21 23 9 16 9 20 11 14 6 17 5 8 5 11 0
weliga3 12 23 24 13 20 13 20 11 8 19 6 15 10 14 0
weliga4 9 21 18 12 16 8 5 10 7 17 7 9 11 15 0
weliga5 10 20 19 10 15 9 7 8 14 12 15 8 16 6 16 0
Moyenne 10 21 19 10 16 10 12 9 12 9 17 6 12 8 14 0
Ma an ta w e li ga w a xaa la ha dlay M a gan
Figure 7 : mesures de f0 en qt avec moyenne des 5 énoncés de la figure 5 Les figures 6 et 7 révèlent que l'adverbe Maánta est réalisé avec l'accent tonal le plus haut de l'énoncé par le locuteur S1. Le downdrift s’applique sur le GN1[-Focus] wéliga et le MF wáxaa, puis on observe un rehaussement tonal sur le préverbe lá. Le processus de downdrift reprend sur l'accent tonal du verbe hadlaý. Le focus final Mágan, en fin d'énoncé, se situe plus haut que le verbe (pas de downdrift), mais est situé quand même relativement bas par rapport aux autres accents tonals. Notons que chez le locuteur S1, un ton H% apparaît facultativement sur la dernière voyelle de l'adverbe, du GN1 et du verbe quand celui-ci n’a pas d’accent tonal (cf. Le Gac 2001). En ce qui concerne le locuteur S2, il se différencie essentiellement du locuteur S1 par le fait que le downdrift ne s’applique pas sur le GN1|-Focus], et aussi qu’il ne réalise jamais de tons H% (cf. Le Gac 2001).
3.2.2 Enoncés A : focus non final (MF ayaa). Comparaison.
Figure 8 : signal, intensité (dB) et f0 (Hz) montrant un énoncé avec focus non final (MF ayaa, énoncés A)
0
5
10
15
20
25
F0
- qu
arts
de
ton
Weliga1 8 15 10 8 22 7 2 5 10 7 13 6 10 8 14 0
Weliga2 9 22 18 13 20 7 21 9 13 3 15 5 9 4 7 0
Weliga3 9 20 13 10 19 8 2 3 9 5 12 4 11 3 7 0
Weliga4 10 19 20 10 21 10 17 7 13 2 13 3 9 4 8 0
Weliga5 10 22 23 8 22 7 20 10 14 2 16 3 11 5 9 0
Moyenne 9 20 17 10 21 8 12 7 12 4 14 4 10 5 9 0
Ma an ta w e li ga a ya a la had lay M a gan
Figure 9 : mesures de f0 en qt avec la moyenne des 5 énoncés de la figure 7 Comme le montrent les figures 8 et 9, l’adverbe initial maánta des énoncés A demeure à la même hauteur que celui des énoncés B. Le GN1[+Focus] wéliga se réalise à la même hauteur (locuteur S1) ou plus haut (locuteur S2) que l'adverbe maánta. Sur l’axe paradigmatique, le GN1[+Focus] est toujours plus haut que le GN1[-Focus]. De même, il y a une nette opposition de hauteur mélodique entre le GN2[-Focus] et le GN2[+Focus], celui-ci se réalisant plus haut. Par ailleurs, on remarque chez les deux locuteurs un ton bas atteignant presque la ligne de base des locuteurs (<2 qt) soit sous la dernière voyelle du GN1[+Focus] soit sous celle du MF ayáa. Ce ton bas se confond avec le ton bas final dans les énoncés à focus final. Les données montrent donc clairement que chez les deux locuteurs, le focus est marqué non seulement par l’expansion de l’espace tonal, c'est-à-dire par la non application du downdrift ou l’élévation relative du GN focalisé, mais aussi par un ton bas spécifique, que j’appellerai ton bas de focalisation ou Bfoc. Observons maintenant ce qui se passe en post-focus (Enoncés A). Les énoncés A présentent des configurations mélodiques similaires à celles des énoncés à focus final (énoncés B), cependant les premières sont réalisées plus basses que les secondes comme le montrent les figures 10 et 11 ci-dessous. Cet abaissement est particulièrement marqué chez le locuteur S2 (figure 11). En fait, on s’aperçoit que le domaine post focal, et plus précisément, que tous les éléments placés après le ton Bfoc subissent un abaissement mélodique qui se surajoute à celui provoqué par le downdrift. En somme, les données du somali montrent que le ton Bfoc partage les énoncés en deux domaines prosodiques qui contrastent sur le plan mélodique : 1) le domaine prosodique formé par le pré-focus et le focus, lesquels manifestent des accents tonals placés sur un registre haut, et 2) le domaine post-focal, dont les accents tonals sont réalisés sur un registre bas.
0
5
10
15
20
25F
0 -
quar
ts d
e to
n
Focus Final 10 20 18 10 16 10 12 9 12 9 17 6 12 8 14 0
Focus Non-f inal 9 20 19 10 21 8 12 7 12 4 14 4 10 5 9 0
Ma an ta w e li ga foc foc foc la ha dlay M a gan
Figure 10 : locuteur S1. Moyennes de f0 en qt dans les énoncés à focus final et non-final.
0
5
10
15
20
25
F0
- qu
arts
de
ton
Yoonis+FS 8 16 9 7 22 2 4 8 6 10 5 8 4 3 7
Yoonis-FC 13 23 13 13 22 12 19 16 16 20 14 17 12 19 0
Ma an ta Yo o nis a yaa l a ha dlay Kul mi ye
Figure 11 : locuteur S2. Moyennes de f0 en qt dans les énoncés à focus final (« Yoonis-FC »), et non-final (« Yoonis+FS »).
3.2.3 Le ton H% (Locuteur S1)
Nous avons vu plus haut que le locuteur S1 réalisait des tons H% sur certains constituants. Le tableau 2 donne le nombre d’occurrences de H% répertoriées dans 15 énoncés A et B. On s’aperçoit que le ton H% est possible sur l’adverbe en proportion égale dans les deux types d’énoncés (±80%), et sur le GN1 (40 et 53%). Une observation plus fine des données révèle en fait que, dans les énoncés à focus non final (énoncés A), H% apparaît sur le GN1[+Focus] uniquement lorsque Bfoc est réalisé sous ayaa (Le Gac 2001, 2002). Quand Bfoc est réalisé sous le GN1[+Focus], il bloque l’apparition de H%. En outre, toujours dans les énoncés à focus non final, on remarque que H% est rare sur le verbe, c'est-à-dire après Bfoc, contrairement aux énoncés à focus final. Autrement dit, tout indique que la distribution de H% dépend du ton Bfoc : H% peut apparaître avant Bfoc mais très rarement après Bfoc. Tableau 2 : Locuteur S1. Distribution de H% dans les énoncés à focus final (Enoncés B) et non-final (Enoncés A)
Focus final Adv GN1-F Verbe Total (/15) 12 6 9
Focus non final Adv GN1+F Verbe Total (/15) 13 8 2
3.3 Variations de l’accent tonal
Le tableau 3 résume les résultats relatifs aux alternances de l’accent tonal dans chaque CN. Ils confirment sans surprise l’opposition entre une forme inaccentuée en [-Focus, +Sujet] et une forme accentuée dans tous les autres contextes en CN1 et 2. Tableau 3 : variations de l’accent tonal des CN selon les contextes syntaxiques et discursifs
[+Focus] [-Focus]
ayáa wáxaa [-Sujet] [+Sujet]
CN1 gabádh gabadhi
CN2 wéli weli
CN3 baré báre
báre baré báre
CN4 bahalló bahallo
En ce qui concerne la CN3, les résultats confirment également l’accent tonal pénultième dans le contexte [-Focus, +Sujet]. Cependant, les données obtenues permettent de tirer au clair le rôle de la focalisation dans ces alternances. On observe en effet qu’en fin de phrase (contexte [+Pause]), l’accent tonal est toujours pénultième sous focus (énoncés B) ; en [-Focus], par contre, il reste toujours final en [-Sujet]. En d’autres termes, la pause n’a aucune influence sur la place de l’accent tonal, et c’est donc bien la focalisation qui provoque un déplacement de l’accent tonal sur la voyelle pénultième (comparez les figures 12 et 13).
Figure 12 : tracé de f0 (Hz) d’un énoncé B avec un nom de la CN3 (Kulmiye) focalisé et en fin de phrase : l’accent tonal de Kulmíye porte un accent tonal pénultième
mAn ta yoO nis ayAa lA hadlaY Kul mi yE
[+Focus] [-Focus]
0
100
200
Figure 13 : tracé de f0 (Hz) d’un énoncé A avec Kulmiye en fin de phrase. En [-Focus], l’accent tonal de Kulmiyé reste final Sous focus mais devant ayaa, la place de l’accent tonal est différente selon les locuteurs : le locuteur S1 réalise le plus souvent un accent tonal final, tandis que le locuteur S2 préfère un
accent tonal pénultième. Cependant, on observe une relation entre la place de l’accent tonal et l’emplacement du ton Bfoc : lorsque l’accent tonal de la CN3 est final, Bfoc est sur la dernière voyelle de ayaa (Figure 14), mais lorsque l’accent tonal est pénultième, alors Bfoc se réalise sur la dernière voyelle du GN[+Focus], i.e. le nom de la CN3 (Figure 15). Les données révèlent donc qu’à l’instar du contraste mélodique entre pré-focus/focus ~ post-focus, la distribution du ton H%, le ton Bfoc a une incidence directe sur l’accent tonal de la CN3 sous focalisation.
Figure 14 : locuteur S1. Tracé de f0 montrant l’accent tonal final en CN3 [+Focus] (waraabe « une hyène ») devant ayaa et emplacement de Bfoc.
mAn ta Kul mI ye ayUu lA hadlaY Yoo nis
[+Focus] [-Focus]
0
100
200
Figure 15 : locuteur S2. Tracé de f0 montrant l’accent tonal pénultième en CN3 [+Focus] (Kulmiye) devant ayaa et emplacement de Bfoc. Finalement, pour ce qui est de la CN4, les résultats confirment l’hypothèse de départ, à savoir qu’il y a une opposition entre une forme sans accent tonal en [-Focus] et une forme avec un accent tonal obligatoire en [+Focus] (Figures 16 et 17). Par ailleurs, aucun ton moyen n’a été trouvé.
Bfoc
Bfoc
Figure 16 : locuteur S1. Tracé de f0 d’un énoncé A montrant l’accent tonal final sous focus d’un nom de la CN4 (bahallo « bêtes sauvages ») 8.
Figure 17 : locuteur S1. Tracé de f0 d’un énoncé B montrant que bahallo reste atone en [-Focus] Le fait qu’un nom normalement atone devient accentué sous focus paraît naturel au regard de la phénoménologie d’autres langues : la focalisation est souvent marquée par une plus grande proéminence. Mais les données du somali nous invitent à allez plus loin. En effet, on constate un parallèle entre l’apparition d’un ton haut sous focus en CN4, d’une part, et le registre haut ainsi que la présence de tons H% sous focus dans les autres CN, d’autre part. De toute évidence, il existe un lien entre l’accent tonal de la CN4 et les phénomènes intonatifs.
3.4 Conclusion
L’analyse phonétique a donc montré qu’il existait en somali un ensemble de procédés prosodiques pour manifester la focalisation contrastive et la structure informationnelle des énoncés. Au niveau intonatif, le focus est marqué par un ton bas, le ton Bfoc. De plus, on a vu qu’il y avait un contraste mélodique entre pré-focus/focus et post-focus : le pré-focus et le focus sont réalisés sur un registre haut et présentent des tons H%, tandis que le post-focus est réalisé sur un registre bas sans apparition du ton H%. J’ai montré à cette occasion le rôle central que jouait le ton Bfoc en partageant les énoncés en deux domaines prosodiques. On a vu ensuite que la focalisation avait non seulement une influence sur les variations de l’accent tonal, mais plus encore, les données ont clairement montré qu’il y avait des relations évidentes entre l’intonation et les variations de l’accent tonal : place de l’accent tonal corrélée à celle de Bfoc en CN3, et parallélisme entre l’émergence d’un accent tonal en CN4 et registre haut/ton H%. L’objet de la partie suivante est la proposition d’un modèle phonologique de la prosodie du somali qui rend compte et unifie l’ensemble des phénomènes mis au jour dans la partie phonétique.
8 Enoncé : Maánta « aujourd’hui » bahalló [+Focus] « bêtes sauvages » ayáa MF weerári « attaquer » dooná AUX-Futur nimánka « hommes-les » : « Aujourd’hui, ce sont des bêtes sauvages qui attaqueront les hommes »
4. MODELE PHONOLOGIQUE
Le cadre général du modèle proposé ici est celui des théories phonologiques de l’intonation, lesquelles appartiennent à la phonologie autosegmentale et multilinéaire. Dans ces théories, l’intonation y est représentée par les deux seuls segments tonals haut et bas de hauteur relative (cf. Bruce 1977, Pierrehumbert 1980, Hirst 1984, Pierrehumbert & Beckman 1988, Ladd 1996).
4.1 Les deux lignes tonales
Dans les modèles standards, tons lexicaux (i.e. soit les tons lexicaux des langues strictement tonales, soit les tons liés à l’accent des langues à accent tonal) et tons intonatifs prennent place en principe sur la même ligne tonale (cf. Bruce 1977, Pierrehumbert & Beckman 1988). La phénoménologie du somali nous amène cependant à remettre en cause ce point théorique. En effet, le contraste mélodique marqué entre pré-focus/focus et post-focus chez les deux locuteurs suggère l’existence de deux niveaux tonals indépendants qui se superposent pour engendrer les accents tonals placés sur un registre haut, d’une part, et les accents tonals réalisés sur un registre bas d’autre part. Je proposerai donc les deux lignes tonales indépendantes suivantes : 1) la ligne des tons accentuels, constituée des tons hauts des accents tonals 2) et la ligne des tons intonatifs où prend place le ton Bfoc, précédé de tons hauts, et suivi de
tons bas (dorénavant Hι et Bι). Les configurations mélodiques de surface résultent alors de l’association des segments tonals de chaque ligne, ce qui permet d’expliquer simplement le contraste mélodique entre pré-focus/focus et post-focus : les accents tonals placés sur un registre haut en pré-focus/focus proviennent de l’association des tons Hι avec les tons H*, tandis que les accents tonals abaissés en post-focus découlent de l’association des tons Bι avec les tons H*. Seul le ton Bfoc ne s’associe à aucun H*, et vient se lier directement avec la dernière voyelle du GN[+Focus] ou du MF ayaa des énoncés à focus non final (cf. figure 18).
Figure 18 : les deux lignes tonales du somali, et association des tons intonatifs avec les tons H* Quant aux tons H% du locuteur S1, je propose qu’il s’agisse de l’association facultative des tons Hι en marge des topiques pré-focaux et du focus (ligne d’associations en pointillés dans la Figure 18). En outre, du fait qu’il n’y a pas de tons Hι en post-focus, ce modèle explique aussi la quasi absence de tons H% à cet endroit.
Topique Topique FOCUS Topique Topique
Ligne tonale ACCENTUELLE
Hι Ligne tonale
INTONATIVE
H*
Hι Hι Bι Bι Bfoc
H* H* H* H*
4.2 Bfoc et les deux règles orientées
Les données phonétiques des énoncés à focus non final indiquaient que le ton Bfoc partageait les énoncés en deux domaines mélodiques, ce dont la représentation figure 18 rend compte : le ton Bfoc occupe une position centrale, précédée des tons Hι et suivie des tons Bι. Cependant le statut particulier du ton Bfoc ne réside pas seulement dans sa fonction démarcative mais aussi et surtout dans le fait qu’il gouverne la réalisation des autres tons intonatifs de l’énoncé. En comparant les données du somali avec celles du français, j’ai pu montrer dans Le Gac (2001) et Le Gac (à par. b.) que les deux langues possédaient les mêmes tons intonatifs au niveau phonologique, et que les tons Hι et Bι étaient dérivés à partir de Bfoc selon deux règles syntagmatiques orientées (Figure 19) : 1) La première règle s’applique de droite à gauche et implique un processus d’inversion
tonale. Cette règle est inspirée de la théorie de Ph. Martin (1981, 1982), selon laquelle les relations syntaxiques et sémantiques se manifestent par des inversions de pente, et que Le Gac (2001) et Le Gac & Yoo (2002) ont adapté pour des tons discrets. Selon cette règle, le ton bas de focalisation (Bfoc) génère ainsi les tons hauts intonatifs situés à sa gauche.
2) La deuxième règle s’applique de gauche à droite et implique simultanément une copie et
un abaissement tonal, i.e. le downdrift. Ainsi, le ton Bfoc est-il copié et abaissé sur les topiques post-focaux, ce qui donne les tons Bι. Cette règle est également susceptible de s’appliquer en pré-focus : on a vu que le GN1[-Focus] du locuteur S1 était plus bas que l’adverbe initial maánta (cf. figures 6 et 7). Ici, le ton Hι de l’adverbe est copié et abaissé sur le GN1[-Focus] (processus représenté par la flèche en pointillés Figure 19)
Figure 19 : les deux règles orientées s’appliquant au niveau intonatif Dans ce modèle, le ton Bfoc joue donc un rôle central au niveau intonatif en pilotant la réalisation des autres tons intonatifs, et divisant de ce fait l’énoncé en deux domaines mélodiques. Mais, on va voir que le ton Bfoc joue également un rôle majeur dans les alternances de l’accent tonal.
4.3 Les alternances de l’accent tonal
Les analyses phonologiques antérieures, notamment celles de Hyman (1981), Banti (1988) et Hassan (1994) n’ont pas donné d’explications satisfaisantes aux alternances de l’accent tonal du somali. Comme je l’ai montré dans Le Gac (2001) et Le Gac (à par. a.), ces analyses sont restées descriptives, en ce sens qu’elles devaient ajouter des règles spécifiques et ad hoc pour rendre compte des variations de l’accent tonal dans les CN3 et CN4. Par exemple, selon Hyman (1981), l’absence d’accent tonal en CN1 et CN2 dans le contexte [-Focus, +Sujet] est
Topique Topique FOCUS Topique Topique
Ligne tonale ACCENTUELLE
Hι Ligne tonale
INTONATIVE
H*
Hι Hι Bι Bι Bfoc
H* H* H* H*
Inversion tonale Copie + Abaissement tonals
dû à une règle d’effacement accentuel, il s’agit donc d’un cas marqué. En CN3, par contre, l’accent tonal pénultième du sujet et du focus est non marqué, et c’est lui qui subit un déplacement sur la voyelle finale dans le contexte [-Focus, -Sujet] 9. Les problèmes rencontrés découlent du fait que ces travaux ne reconnaissent qu’un seul niveau d’analyse prosodique, le niveau accentuel, où ont lieu les seuls processus phonologiques. Le niveau tonal a été considéré comme purement phonétique et dépendant du niveau accentuel. Dans cet article, je suivrai la proposition de Hyman (1981) selon laquelle l’accent tonal est représenté par un ton haut associé à un accent sous-jacent, noté *. Cependant, contrairement à Hyman qui postule que le ton haut est un « réflexe » phonétique de l’accent sous-jacent, je propose que le ton haut soit un objet phonologique autonome, indépendant de *. Selon cette approche, accentuation et segments tonals sont gérés indépendamment, et l’accent tonal découle de règles d’association entre ces deux types d’autosegment. Les analyses phonologiques antérieures ont par ailleurs totalement négligé l’intonation, et donc son éventuel impact sur l’accent tonal. Or, l’analyse phonétique a révélé des relations évidentes entre l’accent tonal et l’intonation. Accentuation et plan tonal étant dorénavant indépendants, les tons intonatifs, notamment le ton Bfoc peuvent interagir avec les accents sous-jacents et les autres tons pour engendrer les différentes configurations de l’accent tonal.
4.3.1 Accentuation et alternances en CN1 et 2
A l’instar de Hyman (1981) et Banti (1988), je propose que les CN1 et 2 soient marquées par un seul accent sous-jacent, sur la dernière voyelle en CN1 et sur la voyelle pénultième en CN2 : (14) * *
CN1: Gab a dh CN2: Yo o nis Le ton haut accentuel s’associe ensuite de droite à gauche à la première voyelle accentuée (cf. (15)A.). En [+Focus], le ton Bfoc s’associe soit à la dernière voyelle de ayaa, soit à la dernière voyelle d’un nom de la CN2. En CN1, Bfoc reste bloqué, car la dernière voyelle est déjà occupée par H cf. (15)C. Dans le contexte [-Focus, +Sujet], où les CN1 et 2 sont atones, le ton haut est désassocié de l’accent sous-jacent (cf. (15)B.) (15) A. [-Focus, -Sujet] B. [-Focus, +Sujet] C. [+Focus]
4.3.2 Accentuation et alternances en CN3
En CN3, on a observé que l’accent tonal pouvait se trouver soit sur la voyelle finale, soit sur la voyelle pénultième. Pour rendre compte de cette alternance, je propose que les noms de la
9 Pour une critique plus détaillée des analyses phonologiques du somali, cf. Le Gac (2001, à par. a.)
Gab a dh Yo o nis
*
H Bfoc
ayaa Gab a dh Yo o n i s
*
H Bfoc
Gab a dh Yo o nis
*
H
Gab a dh Yo o nis
*
H
CN3 possèdent en fait deux accents sous-jacents, un sur chacune des deux dernières voyelles (Le Gac 2001, à par a.). En outre, ce gabarit accentuel est directement motivé par la morphologie même des noms de la CN3 : ceux-ci sont en effet des noms dérivés, composés d’un radical et d’un suffixe spécifique –e/o qui nominalise une proposition relative sous-jacente du type « celui qui fait, possède… » (Saeed 1998:132). Autrement dit, le radical et le suffixe sont marqués par un accent sous-jacent : (16) * *
Kulm i y-e La double accentuation de la CN3 permet d’expliquer simplement les processus tonals de cette classe. Comme pour les CN1 et 2, en [-Focus, -Sujet], le ton haut s’associe de droite à gauche à la première voyelle accentuée (cf. (17)A). Dans le contexte [-Focus, +Sujet], le ton haut est aussi désassocié, cependant, contrairement aux CN1 et CN2 qui ne possèdent qu’un seul *, le ton haut en CN3 peut se réassocier à la voyelle pénultième accentuée (cf. (17)B) (17) A. [-Focus, -Sujet] B. [-Focus, +Sujet]
Sous focus maintenant. Comme pour les CN1 et 2, Bfoc peut s’associer à la dernière voyelle de ayaa ((18)A). Mais Bfoc peut aussi s’associer à la dernière voyelle du nom : dans ce cas, le ton haut est désassocié par Bfoc car il peut se réassocier à la voyelle pénultième accentuée ((18)B). Ce processus n’est pas possible en CN1 car la voyelle pénultième est inaccentuée comme on l’a vu précédemment ((18)C). (18) A. B. C.
On se rend compte de l’intérêt de postuler des accents sous-jacents et des tons indépendants. Cette analyse permet en premier lieu d’unifier les processus tonals qui apparaissent en [-Focus, +Sujet] en ne posant qu’une seule règle de désassociation. Les analyses antérieures (Hyman 1981, Banti 1988, Hassan 1994) avaient recours à des règles ad hoc pour décrire la phénoménologie de la CN3. De même sous focalisation : le déplacement de l’accent tonal est dû à un seul et même objet, le ton Bfoc, et est ainsi clairement différencié du déplacement de l’accent tonal en [-Focus, +Sujet]. Les travaux antérieurs, outre l’ajout de règles spécifiques, ne distinguaient pas entre les deux types de déplacement, ce qui semblait pour le moins étrange d’un point de vue syntaxique et sémantique. Cette analyse rend compte finalement de l’étroite corrélation entre la place de Bfoc et celle de l’accent tonal mise au jour dans l’étude phonétique, et du rôle majeur que revêt Bfoc dans la prosodie du somali.
4.3.3 Accentuation et alternances en CN4
On se souvient que les noms de la CN4 sont constitués des pluriels en –(C)o et –aC. D’autre part, on a vu lors de l’analyse phonétique que ces noms n’avaient pas d’accent tonal dans le contexte [-Focus, -Sujet], c'est-à-dire là où toutes les autres CN en ont un. Je proposerai donc
G a b a dh *
H Bfoc
Kulm i y e *
H
*
Bfoc
Kulm i y e ayaa *
H
*
Bfoc
Kulm i y e *
H
* Kulm i y e
*
H
*
que le pluriel soit marqué en somali par l’absence d’accent sous-jacent. Ainsi, dans le contexte [-Focus, -Sujet], le ton haut accentuel ne peut s’associer, et n’est donc pas réalisé phonétiquement : H (19) CN4 [-Focus] : /bahallo/ → [bahallo] En [+Focus], par contre, on a observé un parallélisme entre le registre haut et le ton H% d’une part, et l’apparition d’un ton haut sur les noms de la CN4, d’autre part. Cela suggère que le ton haut qui apparaît sous focalisation est en fait un ton haut intonatif (Hι), qui vient s’associer directement à la dernière voyelle du mot : (20) CN4 [+Focus]
4.4 Tons bas phonétiques et l’intensité
Je terminerai l’analyse phonologique du somali en parlant tout d’abord du problème des tons qui n’ont pas été pris en compte dans le modèle. Les courbes de f0 ont révélé que chaque mot commençait par un ton bas. Dans Le Gac (2001), j’ai montré que la hauteur de ces tons et leur alignement avec les segments dépendaient des tons hauts, accentuels ou intonatifs. Autrement dit, tout laisse supposer que ces tons bas ne sont pas des objets phonologiques, mais simplement des tons phonétiques, bas par défaut (cf. aussi Hyman 1981, Banti 1988, Frid 1995). Le dernier point qu’il convient d’évoquer est celui de l’intensité. Comme on l’a vu en 3.1, ce paramètre n’est pas contrôlé par le locuteur sauf sous focus. Il s’agit donc d’un paramètre purement phonétique qui n’a pas sa place dans le modèle phonologique, mis à part sous focalisation : le pic d’intensité observé peut alors être représenté par un autosegment +I qui s’associe au focus.
5. CONCLUSION
Malgré l’usage de morphèmes dit de focalisation et contrairement au point de vue traditionnel, l’analyse phonétique du somali a montré que la focalisation contrastive et la structure informationnelle étaient signalées par divers moyens prosodiques : a) le focus est marqué par l’extension du registre et l’émergence d’un ton H%, b) on a observé un contraste mélodique entre pré-focus/focus et post-focus, c) un ton bas spécifique, le ton Bfoc, apparaît sous le focus et divise l’énoncé en deux domaines prosodiques, enfin d) la focalisation entraîne le déplacement de l’accent tonal en CN3 et l’apparition d’un ton haut en CN4. La proposition d’un modèle phonologique a permis de formaliser et d’unifier l’ensemble de ces phénomènes. La proposition de deux lignes tonales superposées et s’associant entre elles, la ligne tonale accentuelle et la ligne tonale intonative a permis de rendre compte du contraste de registre mélodique entre pré-focus/focus et post-focus, et de l’apparition facultative du ton H%. Mais, on a aussi vu que le ton Bfoc joue un rôle central au sein de la prosodie du somali :
Bahallo
Hι
il gouverne la réalisation de tous les autres tons intonatifs selon deux règles, et Bfoc est à l’origine du déplacement de l’accent tonal en CN3. Il est aussi indirectement la cause de l’apparition du ton haut intonatif en CN4. Cependant, certains phénomènes intonatifs du somali ne sont pas propres à cette langue. Des travaux laissent supposer l’existence d’un ton bas marquant le focus dans d’autres langues : la focalisation contrastive est marquée par une chute abrupte de f0 en français, en suédois ou en grec moderne par exemple. De même, on trouve souvent le même type de contraste « haut » ~ « bas » entre pré-focus et post-focus dans diverses langues. Le modèle proposé ne s’appliquerait donc pas seulement au somali mais aussi à d’autres langues de famille différente. C’est ce que montrent par exemple les études comparatives de Le Gac (2001, à par. b.) pour le somali et le français et Le Gac & Yoo (2002) pour le français et le grec moderne. Bibliographie ANDRZEJEWSKI, B.W. 1964. The Declensions of Somali Nouns, School of Oriental and
African Studies, London ANDRZEJEWSKI, B.W. 1979. The case system in Somali, School of Oriental and African
Studies, London ARMSTRONG, L.R. 1934. « The Phonetic Structure of Somali », in Mitteilungen des Seminars
für Orientalischen Sprachen zu Berlin 37.3, 116-161. BANTI , G. 1988. « Two Cushitic Systems: Somali and Oromo Nouns », Autosegmental
Studies on Pitch Accent, Foris Publ., 11-50 BARILLOT X. 2002. Morphologie gabaritique et information consonantique latente en Somali
et dans les langues est-couchitiques, Thèse de doctorat, Université Paris 7, Paris BARILLOT X. & PH. SÉGÉRAL. à par. "On phonological processes in the 3rd conjugation in
Somali" in D. Perrett & J. Ouhalla (eds.) Studies in Afroasiatic Grammar III, London BENDJABALLA , S. 1999. Trois figures de la structure interne des gabarits. Activités
morphologiques du niveau squelettal des représentations phonologiques en berbère, somali et bédja. Thèse de doctorat, Université Paris 7, Paris
BRUCE G. 1977. Swedish word accent in sentence perspective, Travaux de l’institut de Linguistique de Lund XII. Lund : Gleerups.
DI CRISTO A. & L. JANKOWSKI. 1999. « Prosodic Organisation and Phrasing after Focus in French », Proceedings of the XIVth International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, 1565-1568.
FONAGY I. 1979. “L’accent français: accent probabilitaire”, in Fónagy I. & P. Léon (éd.), « L’accent en français contemporain », Studia Phonetica 15, Paris, Didier, 123-233
FRID, J. 1995. Aspects of Somali Tonology, ms, Lund University, Department of Linguistics, Lund, Suède
HASSAN M.M. 1994. Aspects de la phonologie et de la morphologie du somali, Thèse de doctorat, Université de Nice-Sophia Antipolis
HEINE B. & M. REH. 1984. Grammaticalization and Reanalysis in African Languages. Hamburg, Helmut Buske.
HIRST, D. 1984. « Prosodie et structure de données en phonologie », Dell F., Hirst D. & J.R. Vergnaud (dir.), Formes sonores du langage, Hermann, Paris, 43-64
HIRST, D. 1998. « Intonation in British English », in HIRST D. & A. DI CRISTO (dir.), 56-77 HIRST D. & A. DI CRISTO (dir.). 1998. Intonation System, Cambridge University Press,
Cambridge HYMAN L. 1981. « Tonal Accent in Somali », Studies in African Linguistics vol.12 n° 2 KEENADIID, Y.C. 1976. Qaamuuska af-soomaaliga. Akademiyaha Dhaqanka. LADD D.R. 1996. Intonational Phonology, Cambridge University Press, Cambridge
LAMBERTI M. 1988. Die Nordsomali-Dialekte, Eine synchronische Beschreibung, Carl Winter Universitäts-Verlag, Heidelberg.
LAMBRECHT K. 1994. Information structure and sentence form, Cambridge University Press, Cambridge
LECARME, J. 1989. "Genitive Constructions, Noun Complement Structure and Syntactic Parameters in Somali". in Proceedings of IInd International Symposium on Cushitic and Omotic Languages, Turin.
LECARME J. 1991. « Focus en somali : syntaxe et interprétation », Linguistique africaine 7, 34-64.
LECARME J. 1992. "L’accord restrictif en somali", LOAP 5-6, pp. 133-152. Journées d’études chamito-sémitiques Paris-20,21 mars 1992.
LECARME J. 1999a. « Focus in Somali », in REBUSCHI G. & L. TULLER (dir.), The Grammar of Focus, John Benjamins, Amsterdam
LECARME J. 1999b. "Nominal Tense and Tense Theory", in Empirical Issues in Formal Syntax and Semantic 2, F. Corblin, J.M. Marandin and C. Sorin (eds), Peter Lang
LE GAC D. 2001. Structure prosodique de la focalisation : le cas du somali et du français, Thèse de doctorat, Université Paris 7, Paris, 2001
LE GAC D. 2002. « Tonals alternations and prosodic structure in Somali », actes de la conférence internationale ‘Speech prosody 2002’, avril 2002, Aix-en-Provence, France, 455-458
LE GAC D. & YOO H-Y. 2002. « Intonative Structure of Focalization in French and Greek », BEYSSADE C., BOK-BENNEMA R., DRIJKONINGEN F. & P. MONACHESI (dir.), Romance Languages and Linguistic Theory 2000, sel. papers from ‘Going Romance’, décembre 2000, Utrecht, Pays-Bas, Current Issues in Linguistic Theory n°232, John Benjamins, Amsterdam, 213-231
LE GAC D. à par. a. « Tonal alternations in Somali », in Lecarme J., Lowenstamm J. & U. Shlonsky (dir.) Research in Afro-asiatic Grammar III, sel. papers from The 5th International Conference of Afro-asiatic Linguistics, June 2000, Paris, John Benjamins, Amsterdam
LE GAC D. à par. b. « Invariants prosodiques : marques et structure de la focalisation en français et en somali », actes des IIIèmes Journées d'Etude Linguistiques, "Universaux sonores", Nantes, mars 2002, Presses Universitaires de Rennes.
LILIUS, S. 1987. Contribution à l'étude prosodique du somali, ms, Université Paris III LILIUS, S. 1988. Quelques points d'analyse du somali de Djibouti, Mémoire de DEA,
Université Paris III MARTIN PH. 1981. « Pour une théorie de l'intonation », ROSSI M., A. DI CRISTO, D. HIRST, PH.
MARTIN & Y. NISHINUMA (dir.), L'intonation, de l'acoustique à la sémantique, Klincksieck, Paris, 234-271
MARTIN PH. 1982. « Phonetic realisations of prosodic contours in French », Speech Communication n°1(3,4), 283-294
MORIN D. 1991. « Marques et relations en somali : le problème des « déclinaisons », Linguistique Africaine, n°6
MORIN D. 1995. Des paroles douces comme de la soie - Introduction aux contes dans l'aire couchitique (bedja, afar, saho, somali), Peeters, Paris
ORWIN M. 1995. Colloquial Somali, a Complete Language Course, Routledge PIERREHUMBERT J. 1980. The Phonology and Phonetics of English Intonation. PhD
dissertation, MIT, published 1988 by IULC. PIERREHUMBERT J. & M.E. BECKMAN. 1988. Japanese Tone Structure, MIT Press, Cambridge
PUGLIELLI A. & S.M. CIISE. 1984. "La flessione del nome", Aspetti Morfologici, lessicali e della focalzzazione, Studi Somali 5, MAE, Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo, Roma.
RIALLAND A. & S. ROBERT. 2001. "The intonational system of Wolof", in Linguistics 39, Issue 5. 893–939
ROSSI M. 1999. L’intonation, le système du français : description et modélisation, Ophrys, Paris
SAEED J.I. 1984. The Syntax of Focus and Topic in Somali, coll.: Cushitic language studies 3 - Hamburg : Buske Verlag
SAEED J.I. 1987. Somali Reference Grammar, Wheaton, Dunwoody Press SAEED J.I. 1993. Somali Reference Grammar, Wheaton, Dunwoody Press, 2nd edition. SAEED J.I. 1998. Somali. The London Oriental and African Library, John Benjamin, London ZORC. 1991. Somali-English Dictionary. Wheaton, Dunwoody Press.