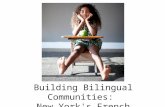L'oralité chez Catulle - doct. diss. - part 3 (French)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of L'oralité chez Catulle - doct. diss. - part 3 (French)
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
207
Bibliographie spécialisée
ANTOINE G., La coordination en français I, éditions dʼArtrey, Paris, 1958.
AXELSON B., Unpoetische Wörter. Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen
Dichtersprache, Lund 1945.
BARATIN M., DESBORDES F., Lʼanalyse linguistique dans lʼantiquité classique 1. les
théories, Klincksieck, Paris, 1981.
BENLOEW L., De lʼaccentuation dans les langues indo-européennes, Paris, 1847.
BIVILLE F., « Autonomie et dépendance phonétique dans le mot latin », BSL 85, 1, 1990,
137-159.
BROGAN T.V.F., The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton Univ.
Press, Princeton, 1993.
CHARPIN F., Lʼidée de phrase grammaticale et son expression en latin, Paris-Lille, Atelier
de reproduction des thèses, 1977.
CHEVALIER J.-C., « Quelques remarques sur un index de Calligrammes », Guillaume
Apollinaire, 1962, Revue des Lettres Modernes 69-70, Printemps 1962.
COLLART J., « Quelques observations statistiques sur les parties du discours », REL
37,1959, 215-229.
DANGEL J., « Césures et pauses syntaxiques dans lʼÉnéide », REL 61, 1984, 284-311.
— Histoire de la langue latine, PUF, Paris, 1995.
— (éd.), LE POÈTE ARCHITECTE. Arts métriques et Arts poétiques latins, BEC 24,
Peeters, Louvain-Paris-Sterling, 2001.
DE CORNULIER B., Théorie du vers. Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Seuil, Paris, 1982.
DE GROOT A.W., « Le mot phonétique et les formes littéraires du latin », REL 12, 1934,
117-139.
DESBORDES F., BARATIN M., Lʼanalyse linguistique dans lʼantiquité classique 1. les
théories, Klincksieck, Paris, 1981.
DESBORDES F., Idées romaines sur lʼécriture, Lille, 1990.
GOUVARD J.-M., Critique du vers, Champion, Paris, 2000.
GUILLEMIN A.-M., « Lʼévolution dʼun cliché poétique », REL 19, 1941, 101-113.
HELLEGOUARCʼH J., Le monosyllabe dans lʼhexamètre latin, Klincksieck, Paris,1964.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
208
— « Commentaire métrique du pème 76 de Catulle », Lʼinformation littéraire 16-17, 1964-
1965, 171-174.
HERSCHBERG-PIERROT A., Stylistique de la prose, Belin, Paris, 1993.
ISO ECHEGOYEN J.J., « La cesura en el pentametro latino clasico », Estudias
clasicas,1984, 26, 2, 98-108.
JULLIEN B., Thèses supplémentaires de métrique et de musique anciennes, de grammaire
et de littérature, Paris, Hachette, 1861.
— Lʼharmonie du langage chez les Grecs et les Romains, Paris, Hachette, 1867.
LACHERET-DUJOUR A. (avec BEAUGENDRE F.), La prosodie du français, CNRS, Paris,
1999.
LENCHANTIN DE GUBERNATIS M., Manuale di prosodia e metrica latina ad uso delle
scuole, Principato, Milano, 1934.
LOOMIS J., Studies in Catullan Verse. An Analysis of Word Types and Patterns in the
Polymetra, Leiden, 1972.
LÖSENER H., Der Rhythmus in der Rede, Linguistische und literaturwissenschaftliche
Aspekte des Sprachrhythmus, Nimeyer, Tübingen, 1999.
LUCOT R., « Ponctuation bucolique, accent et émotion dans lʼÉnéide », REL 43, 1965, 262-
274.
— « Sur lʼaccent de mot dans lʼhexamètre latin » , Pallas 16, 1969, 79-106.
LUQUE MORENO J., « Un método para el tratamiento informático de materiales latinos en
verso », Emerita 55, 1987, 15-30.
— (1994a) El distico elegiaco. Lecciones de metrica latina, Ediciones clasicas, Madrid,
1994.
MARINA SÁEZ R.-M., La métrica de los epigramas de Marcial. Esquemas rítmicos y
esquemas verbales, Institución ʻFernando el católicoʼ, Zaragoza, 1998.
MAROUZEAU J.,(1946a) Précis de stylistique française, Masson, Paris, 19462.
—(1946b) Traité de stylistique latine, Les Belles Lettres, Paris, 19462.
MESCHONNIC H., Pour la poétique, Paris, 1970.
— Écrire Hugo I-II, Paris, 1977.
— Critique du rythme. Anthropologie historique du langage, Verdier, Lagrasse, 1982.
MORIER H., Dictionnaire de poétique et de rhétorique, PUF, Paris, 19985 (1961).
NOUGARET L., Traité de métrique latine classique, Klincksieck, Paris, 1948.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
209
— « Une méthode de dépouillement destinée aux index métriques », REL 40, 136-141.
— Analyse verbale comparée du De Signis et des Bucoliques, Les Belles Lettres, Paris,
1966.
QUICHERAT L., Traité de versification latine, Paris, 18323.
SCOPPA A., Traité de poésie italienne rapportée à la poésie française, dans lequel on fait
voir la parfaite analogie entre ces deux langues et leur versification très ressemblante,
Devaux, Paris, 1803.
SOUBIRAN J., « Monosyllabes introducteurs devant la césure : Ennius, Plaute et leurs
modèles grecs », in J. Collart, Varron, grammaire antique et stylistique latine, Paris, 1978,
321-336.
— Essai sur la versification dramatique des Romains. Sénaire iambique et septénaire
trochaïque , CNRS, Paris, 1988.
SPOERRI Th., Französiche Metrik, Zürich, 1929.
TORDEUR P., « Le monosyllabe latin en fin de lʼhexamètre dactylique », Euphrosyne 17,
1989, 171-208.
TOLA E., « La négation monosyllabique en début de vers : un cas particulier, le livre II des
Tristes (II) », in DANGEL J. (éd.), LE POÈTE ARCHITECTE. Arts métriques et Arts
poétiques latins, BEC 24, Peeters, Louvain-Paris-Sterling, 2001, 121-138.
VOSSIUS I, De poematum cantu et uiribus rythmi, Oxonii, 1673.
WEIL H., BENLOEW L., Théorie générale de lʼaccentuation latine, Paris-Berlin, 1855.
WILKINSON L.P., Golden Latin Artistry, Cambridge, 1963.
YEH W.-J., « Les monosyllabes initiaux dans les distiques élégiaques latins (I), in DANGEL
J. (éd.), LE POÈTE ARCHITECTE. Arts métriques et Arts poétiques latins, BEC 24, Peeters,
Louvain-Paris-Sterling, 2001, 99-119.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
211
Le problème du monosyllabe en métrique
Nous ne prétendons pas donner ici un compte-rendu exhaustif du traitement
que la métrique réserve aux monosyllabes. Nous nous appuyons sur deux
auteurs, L. Quicherat, qui représente ce que nous appelons une « métrique
prescriptive » et J. Hellegouarcʼh qui travaille dans le domaine de la
« métrique verbale ».
Quintilien constitue une des autorités dont se réclame la métrique
prescriptive. Professeur de bon ton, il recommande (IO 9, 4, 42) de ne pas
accumuler les monosyllabes dans lʼénoncé oratoire1 — peut-être faut-il
étendre le champ de sa remarque, comme le fait J. Hellegouarcʼh (1964,
11) : « De même, plusieurs monosyllabes feront mauvais effet, parce quʼil
sʼensuit nécessairement que lʼordre des mots, ainsi rompu par de
nombreuses clausules, procède par sauts. » (trad. J. Cousin)2. Aucun
exemple nʼaccompagne cette phrase, ce qui rend lʼinterprétation malaisée.
Mais on peut noter quʼelle suit une autre recommandation (IO 9, 4, 41), qui
concerne lʼelocutio en général, enjoignant de ne pas répéter au début dʼun
mot les syllabes finales du précédent ; le contexte est donc celui dʼun
discours sur lʼeuphonie3.
1 Etiam monosyllaba, si plura sunt, male continuabuntur, quia necesse est compositio multis clausulis concisa subsultet. Nous proposons notre propre interprétation de ce témoignage au début du chapitre « Une solution : la figure rythmique du contre-accent ». 2 « Les monosyllabes aussi, lorsquʼils sont nombreux, formeront une séquence pénible, parce quʼil est alors inévitable que, par suite de la fréquence des pauses, le rythme procède par bonds. » (trad. F. Charpin). Nous reviendrons plus loin sur ce témoignage, à propos de son rapport avec la figure du contre-accent. 3 « Il faut prendre garde aussi que les dernières syllabes dʼun mot ne soient pas les mêmes que les premières du mot suivant. » (trad. J. Cousin). Quintilien, sans pitié, cite la
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
212
On entend un écho de cette recommandation esthétique chez Isaac
Vossius (1673, 37-40), quand il essaie de disqualifier la poésie française, au
profit de la poésie latine, en utilisant le critère de la fréquence des
monosyllabes. La « métrique prescriptive », qui travaille dans la perspective
des exercices scolaires — vers français, vers latins, etc. —, reprend, sans
nuance, cette prescription, toute préoccupée quʼelle est du « bon goût ».
Le Traité de versification latine de Quicherat, ouvrage de référence maintes
fois réimprimé, indique que lʼ « harmonie » du vers latin ne souffre pas les
groupes de plus de deux monosyllabes (1832, 149) : « Trop de
monosyllabes de suite donnent de la dureté au vers ». Cʼest la
recommandation de Quintilien quʼil faut deviner derrière cette assertion
péremptoire ; la dépendance à lʼégard de lʼInstitution Oratoire nʼest même
pas précisée, tant son autorité va de soi. La « dureté » ici évoquée suggère
que la poésie court, avec les monosyllabes, le risque de la cacophonie.
Pourtant, les exemples « vicieux », pour utiliser le vocabulaire du Traité de
Quicherat, sont nombreux chez les plus grands poètes.
Et dans le Traité de versification latine de Quicherat, les fins de vers
monosyllabiques sont particulièrement blâmées (1832, 147)4. La proscription
de ce type de fin de vers dépasse, dʼailleurs, le domaine de la seule
versification latine ; en dépit des différences qui peuvent exister entre le
système de la langue latine et celui de la langue française, les mêmes
Correspondance de Cicéron ainsi quʼun de ses hexamètres célèbres : Res mihi inuisae uisae sunt, Brute… O fortunatam natam me consule Romam. 4 Pour une vision plus neutre, et scientifique, de cette question du monosyllabe en fin de vers, voir P. Tordeur (1989) et J. Soubiran 1988, 396-401.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
213
prescriptions sont validées en versification française, si bien que Victor Hugo
peut revendiquer le monosyllabe final comme un geste prosodique
dʼ« antitradition » (Meschonnic,1977, 2, 30-31).
Cette répugnance métrique pour le monosyllabe nʼest dʼailleurs pas sans
rappeler les préjugés que les grammairiens expriment, à la même époque, à
lʼégard des « particules », ces mots négligeables dont le discours ne peut
cependant pas faire lʼéconomie5.
Ce qui apparaît comme « faute » dans le discours de la métrique
prescriptive est désormais appréhendé comme anomalie remarquable, dans
le cadre de la métrique verbale. Fatalement, cette discipline doit aussi
sʼappuyer sur le témoignage de Quintilien pour ce qui regarde les
monosyllabes.
Du côté dʼune métrique à visée descriptive, il faut mentionner le travail
exemplaire et monumental de Joseph Hellegouarcʼh, Le monosyllabe dans
lʼhexamètre latin (1964), qui envisage la question sous lʼangle de lʼadaptation
du lexique prosaïque au « carcan des règles métriques » (1964, 11). Lʼauteur
présente dʼabord lʼexistence des monosyllabes en poésie comme un
paradoxe quʼil sʼagit dʼexpliquer. En effet, le poète doit être « au maximum,
expressif, imagé », et « les monosyllabes sont le plus souvent des mots-
outils, totalement dépourvus de résonance et dʼexpressivité ».
5 Benloew (1847, 31) : « Lʼaccentuation de la phrase naît de lʼimportance relative des idées représentées dans les mots. Cʼest pourquoi les pronoms, les particules, les conjonctions, quelques adverbes qui nʼexpriment pas les idées mêmes, mais seulement leurs rapports, ne peuvent avoir lʼaccent tonique. La voix glisse sur eux avec plus de rapidité et les énonce avec moins dʼefforts. ». Témoignage déjà cité dans notre deuxième partie.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
214
Ce paradoxe des « unpoetische Wörter » (des « mots non-poétiques »), titre
dʼAxelson, se double dʼun problème « métrique », désigné comme un
problème de « rythme » — ce dernier terme étant utilisé au sens traditionnel,
en métrique, de « schéma prosodique » — : « la fréquence des
monosyllabes introduit un élément de trouble en ce quʼelle accroît le nombre
des intermots ». J. Hellegouarcʼh fait alors appel au témoignage de Quintilien
que nous avons cité précédemment ; ainsi, Quintilien dénoncerait « rythme
saccadé » créé par les « intermots », concept métrique dû à Jacques Perret
(ibid.). Cʼest à partir de ces deux observations fondamentales que lʼauteur va
tenter dʼexpliquer la raréfaction progressive des monosyllabes dans le
corpus diachronique quʼil a constitué.
Finalement, lʼauteur trouve « normal que le poète, dans la mesure où il veut
sʼécarter de la platitude prosaïque et donner à son œuvre un ton élevé,
rejette lʼemploi de ce type de mots » (1964, 11-12). Cela revient à dire que
les monosyllabes sont a priori comme des pièces rapportées dans le tissu
poétique. Cette affirmation, bien quʼelle soit nuancée dans le cours de lʼétude
et dans la conclusion, nous paraît ressortir à une vue esthétique encore trop
marquée par la métrique normative.
En fait, on peut se demander si la « métrique verbale » ne restreint pas trop
les perspectives pour que lʼauteur puisse aboutir à une prise en compte de la
valeur poétique des monosyllabes. En effet, si le dépouillement de la
littérature hexamétrique est impressionnant, sʼil rend possible des
conclusions sur les macro-tendances, le fait que lʼauteur choisisse le vers
décontextualisé comme cadre de lʼobservation constitue un obstacle
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
215
méthodologique majeur à une véritable appréhension rythmique de la
question du monosyllabe. Or, Joseph Hellegouarcʼh a bien cette ambition,
sinon à quoi lui servirait-il de classer les monosyllabes par catégories
grammaticales, ce qui induit une prise en compte de lʼaccentuation (1964,
18) ? Introduire la question de lʼaccentuation des lexèmes revient, à notre
avis, à sortir du cadre de la métrique pour entrer dans celui de la rythmique.
Selon nous, malgré sa vocation stylistique, Le monosyllabe dans
lʼhexamètre latin, reste prisonnier dʼune méthodologie qui ne permet pas
dʼaccéder au rythme du discours poétique, parce quʼil reste dépendant des
présupposés métriques6.
On peut donc conclure quʼil existe dans la tradition métrique un malaise par
rapport à la façon de traiter le monosyllabe. Quelles que soient son époque
et son orientation, elle doit subir lʼinfluence dʼun témoignage de Quintilien,
dont on a vu quʼil participe dʼun discours esthétique (euphonie vs.
cacophonie). On peut également se demander si la métrique nʼest pas gênée
par la problématique accentuelle qui semble toujours présente, au moins
implicitement, dès lors que lʼon évoque le statut des monosyllabes dans le
vers.
Quʼen est-il des monosyllabes dans les travaux stylistiques qui assument
une démarche dʼinterprétation globale du texte ?
6 Il est intéressant de noter que Jean-Michel Gouvard (2000, 131-202), dans le cadre de la théorie métrique de Cornulier, prend pour objet les « Proclitiques et prépositions dans lʼalexandrin du XIX° siècle ». Il retrouve ainsi les contradictions méthodologiques de la « métrique verbale », quand elle essaie de décrire le rythme, alors quʼil réfute préalablement la pertinence de lʼaccentuation pour lʼanalyse métrique du vers français (9-49).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
217
Le monosyllabe : de la stylistique à la poétique
Comme la métrique, la stylistique hérite de certains préjugés concernant les
monosyllabes. Nous avons vu que, pour un grammairien comparatiste du
début du XIX° siècle, Louis Benloew, il est naturel de reprendre les propos
dʼAristote sur les mots « asémantiques » (Poétique, 20, 1457a). La
stylistique, dans la mesure où elle procède de la grammaire et de la
linguistique, répète certaines idées issues dʼune sémantique traditionnelle,
préoccupée du seul contenu référentiel des lexèmes. Elle traite des
monosyllabes à travers la polarité entre « mots pleins » et « mots-outils »,
cʼest-à-dire plus exactement, entre mots référentiels et mots non-
référentiels7.
Grâce à lʼexemple de J. Marouzeau, qui a travaillé dans le domaine du
français comme dans celui du latin, il est possible de montrer quʼil sʼagit
dʼune doctrine diffuse, dépassant véritablement le champ spécifique de telle
ou telle langue, et dʼun héritage non-analysé des manuels de bon usage.
Ainsi, J. Marouzeau, dans son Précis de stylistique française (1946a), croit
savoir quʼil existe des « mots vides et des mots pleins » : « Certains mots
7 Cette distinction semble dʼactualité ; dans lʼarticle « mot » du dictionnaire de P. Charaudeau et D. Maingueneau (2002, 393), Fabienne Cusin-Berche écrit : « Dans une perspective sémantique, une distinction classique oppose, sur la base dʼun critère sémantique, mots pleins à mots-outils. Les premiers, ʻmême en dehors de tout emploi dans un énoncé, évoquent une réalitéʼ, alors que le sens des seconds ʻnʼévoque aucune réalité distincte dans lʼesprit des locuteursʼ (Mortureux 1997 : 11), différenciation que lʼon trouve ailleurs sous dʼautres appellations, telles que lexèmes vs grammèmes, ou unités lexicales vs unités grammaticales. »
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
218
sont vides de signification au point de nʼêtre que des outils grammaticaux ; »
(1946a, 96)8.
La catégorie des « outils grammaticaux » reste étroitement liée à celle des
monosyllabes : « En fait, le plus souvent, les mots grammaticaux sont de peu
de volume : le, je, à, du, par, et, car, quand, si, bien, plus… et passent
inaperçus dans lʼénoncé. » (1946a, 85)9. Puis revient le vieux grief lancé à
lʼencontre des mots de peu qui usurpent leur place en poésie : « Ils nous
semblent prendre une place indue quand ils sont en trop grand nombre,
particulièrement dans le vers, où, par définition, lʼespace est mesuré, donc
précieux. » (ibid.). En dépit des protestations de scientificité, on retrouve,
dans cette stylistique, le ton moralisateur des maîtres de la Restauration ; les
« vers vides » de Molière sont blâmés ; Hugo, « se permet des vers ainsi
faits », avec pour seule excuse de vouloir « exprimer lʼinsignifiance » 10.
8 « Lʼénoncé normal présente une alternance de mots insignifiants : termes de rapport et outils grammaticaux comme les conjonctions, prépositions, pronoms, termes nominaux ou verbaux exprimant des notions vagues ou banales (faire, aller, chose, affaire), et de mots vedettes qui sont comme les points saillants, les sommets de la chaîne de lʼénoncé. » 9 Voir la citation de Meillet (MSL 3, 359), reprise dans Marouzeau 1946b, 106 : « les mots autonomes de la phrase tendent dans presque toutes les langues à nʼêtre pas monosyllabiques ; seuls demeurent ou deviennent en général monosyllabiques les mots accessoires ». Cette généralisation effectuée par Meillet montre exemplairement la prégnance de certaines idées reçues. Fabienne Cusin-Berche rappelle la persistance de cette doctrine, dans P. Charaudeau et D. Maingueneau (2002, 393) : « Dans une persepctive sémantique, une distinction classique oppose, sur la base dʼun critère sémantique, mots pleins à mots-outils. ». 10 J. Marouzeau (1946, 9) : « La stylistique traditionnelle. — La stylistique est conçue dʼordinaire comme un art du style, et les manuels ou chapitres quʼon lui consacre nʼoffrent le plus souvent quʼune sorte de code du bon français, composé de préceptes et de recettes à lʼusage de qui veut bien écrire. Conception qui repose sur une définition conventionnelle du bon usage, ou se réclame dʼune esthétique a priori, ou prend arbitrairement pour critère le goût personnel. ». Les considérations de Marouzeau sur les mots de peu semblent bien ressortir à la « stylistique traditionnelle » dont il veut se détacher ; on pourrait y joindre ce qui a trait à la « cacophonie » (23-27).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
219
Dans la deuxième édition du Traité de stylistique latine (1946b), publiée la
même année, cette esthétique normative est toujours présente, avec des
exemples communs (Racine, Hugo) : « Parmi les mots brefs, le monosyllabe
possède une qualité spéciale. Dans une langue où les polysyllabes
abondent, lʼénoncé dʼun mot réduit à une brève émission de voix offre à
lʼoreille trop peu de sonorité et laisse trop peu de réflexion à lʼesprit ; le
monosyllabe risque de paraître insuffisant à contenir une idée notable.
Lʼinconvénient nʼexiste pas si le monosyllabe, comme cʼest le cas fréquent,
ne joue quʼun rôle accessoire dans lʼénoncé : mot de liaison, terme de
rapport, outil grammatical. On nʼest pas frappé de lʼabondance des
monosyllabes, tous mots accessoires, dans :
Lucil., Sat. 622 : Ego si qui sum et quo folliculo nunc sum indutus…
Il nʼy a que trois monosyllabes à sens important sur les douze qui
composent les vers cité plus haut :
Le jour nʼest pas plus pur que le fond de mon cœur.
Mais le défaut des monosyllabes apparaît si lʼon en groupe plusieurs dont
chacun est porteur dʼun sens notable. Cʼest sans doute le cas que Quintilien
a en vue quand il dit monosyllaba, si plura sunt, male continuabuntur (IX, 4,
42). Dans ce cas, lʼoreille a tendance à percevoir les monosyllabes comme
groupés, donc comme constituant des polysyllabes dépourvus de
signification. » (1946b, 104-105).
Malgré lʼingéniosité de ce raisonnement, qui, à le lire intégralement,
apparaît comme une explication cognitiviste avant la lettre, force est de
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
220
constater que J. Marouzeau fait subir une double torsion au texte de
Quintilien ; dʼune part, il postule que les monosyllabes évoqués par le
professeur de rhétorique sont des « mots pleins », dʼautre part, il tronque la
citation en supprimant un élément assez important (quia necesse est
compositio multis clausulis concisa subsultet : « parce quʼil est alors
inévitable que, par suite de la fréquence des pauses, le rythme procède par
bonds », trad. F. Charpin), et en faisant abstraction du contexte de la
remarque de cet auteur, à savoir non la prononciation du vers, mais lʼelocutio
en général.
De plus, on peut légitimement sʼinterroger sur la définition des termes du
problème ; en effet, J. Marouzeau affirme deux choses qui nous paraissent
contradictoires, au regard de lʼinterprétation de Quintilien quʼil propose :
« Dans ces phrases, lʼincompréhension résulte dʼune part de la faute quʼon
fait commettre à lʼauditeur en lʼinduisant à percevoir comme groupées des
syllabes qui appartiennent à des mots différents ; mais elle résulte aussi de
la difficulté quʼil y a pour lʼoreille et pour lʼesprit à percevoir et à fixer des
notions trop rapidement énoncées. Sʼil veut se faire comprendre, lʼauteur de
lʼénoncé doit ralentir son débit, dʼune part en prolongeant dans toute la
mesure du possible la durée des monosyllabes, enfin en prononçant avec
complaisance tous leurs éléments composants. » (1946b, 105-106)11.
En premier lieu, il évoque une prononciation groupée des monosyllabes en
série, prononciation nuisible à lʼintelligibilité ; mais, dans le même
11 Le passage continue ainsi : « Ces considérations expliquent la résistance quʼopposent les monosyllabes de sens notable aux réductions phonétiques… ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
221
mouvement, il concède que ce risque dʼinintelligibilité entraîne une
accommodation du locuteur, qui va, en quelque sorte, emphatiser ce groupe,
en utilisant le trait de durée. Ainsi, il apparaît que, selon lʼauteur, le problème
de lʼintelligibilité des groupes de monosyllabes, qui, pour lui, était la cause de
la mise en garde de Quintilien, nʼest pas effectif, mais seulement virtuel. Et il
nous paraît plus pertinent de considérer que le professeur de rhétorique
commente une prononciation effective.
Dans ce contexte, il peut paraître surprenant dʼentendre une voix
discordante, celle dʼAnne-Marie Guillemin (1941, 103-104), qui, dans
lʼintroduction à un article consacré au rôle de non, lʼadverbe de négation, en
poésie élégiaque, tient un tout autre discours : « En jetant les yeux sur un
poème élégiaque, on est dʼabord frappé du nombre de monosyllabes qui
forment le premier pied de lʼhexamètre et du sens fort quʼils présentent
presque toujours : pronoms personnels appelant le regard sur lʼun des
acteurs du drame qui se joue : me, tu, etc…; démonstratifs réclamant
énergiquement lʼattention : hic, hunc, nunc, tunc; conjonction marquant avec
insistance la liaison des strophes, leur opposition ou leur accord : at, et, sed,
nec ; exclamatifs : a ! Il semble que la voix du poète cherche à se poser par
une forte attaque du début pour accomplir plus rapidement et plus
substantiellement son bref parcours. »12
12 On peut, semble-t-il, rapprocher cette approche du lexique poétique de la conception de la diction développée par Jacques Perret (1959, 124) : « dans un débit un peu solennel où lʼon se fût efforcé de donner à chaque mot tout son poids, on comprend aisément que chacun ait dû conserver son accent » (cité dans Lucot, 1965, 269).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
222
Lʼauteur, en évoquant le « sens fort » des monosyllabes — certes, en une
collocation du vers bien précise —, brise lʼenchaînement fatal des lieux
communs. Quand elle écrit « la voix du poète cherche à se poser par une
forte attaque », cʼest bien une oralité du poème qui devient par là
concevable, car cette observation renvoie à une prise en compte du rythme.
Lʼintuition dʼun fonctionnement unitaire de ces mots brefs est également
posée. Cependant, le corps de lʼarticle est, à nos yeux, décevant, parce
quʼon nʼy trouve pas de problématisation de la question accentuelle. La
stylistique dʼAnne-Marie Guillemin reste abstraite : elle ne se donne pas les
moyens dʼapprocher la dimension orale du poème13.
Lʼidée dʼune force des « mots-outils » est exprimée par Jean Collart (1959,
227), spécifiquement à propos des conjonctions de coordination : « Nous
trouvons associées, pour lʼemploi abondant dʼun type de mot en apparence
vide de sens, la poésie et la prose dʼart. La raison en est peut-être que les
conjonctions coordonnantes ont, en fait, une grande plasticité sémantique.
Non seulement elles ont une valeur logique, mais elles glissent facilement
vers une valeur affective, parfois puissante, et, surtout, chose curieuse, les
plus banales dʼentre elles. »14. Jean Collart cite dʼailleurs deux exemples lʼun
13 Pour une reprise récente de cette problématique des monosyllabes initiaux, voir Wei-jong Yeh (2001) et Eleanora Tola (2001). Ces travaux, inspirés par Jacqueline Dangel, se situent aussi dans la perspective de J. Hellegouarcʼh, 1964. Wei-jong Yeh (2001, 108) note pertinemment la force du connecteur et, chez Properce (1, 17, 1-2), quand il est placé « au début dʼune phrase, voire à la tête de lʼélégie ». En usant de la terminologie de J. Hellegouarcʼh, il affirme alors — ce qui concorde avec les conclusions que nous tirons de nos études de cas, dans les parties qui suivent — que « le coordonnant offre toute lʼexpressivité dʼune interjection, rehausse lʼadverbe suivant, merito ». 14 Jean Collart pense ici à deux auteurs précis de son corpus, Virgile (qui emploie le plus dʼenclitiques de type –que) et Tacite (qui emploie le plus de conjonctions de coordination, en dépit de sa réputation dʼauteur asyndétique). Le passage est partiellement cité par J. Hellegouarcʼh (1964, 24) : « Les conjonctions coordonnantes ont… une plasticité
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
223
en français, lʼautre en latin (Racine, Bérénice, V, 5 ; Virgile, Énéide 2, 54-56),
qui illustrent leur goût pour et/-que, mais lʼanalyse sʼarrête là. Notons quʼen
latin, comme dans dʼautres langues, les « conjonctions coordonnantes »,
quʼévoque Jean Collart, sont assez souvent monosyllabiques, ce qui renforce
lʼassociation traditionnelle, parfois involontaire dans le discours stylistique,
des « mots-outils », et des monosyllabes. Comme Anne-Marie Guillemin
réhabilite lʼadverbe non, lʼauteur porte un regard neuf sur les conjonctions,
leur conférant une force authentique, ce qui révèle une attention au discours,
et non plus seulement à la langue15. Ce faisant, il rompt avec une tradition
qui associe la valeur poétique à la rareté, à la recherche du lexique de
registre élevé.
Ces avancées partielles sur la force potentielle des « mots-outils » dans le
discours ne participent cependant pas dʼune théorie. Chez Henri
Meschonnic, le pas théorique est franchi. Dès son Pour la poétique I (1970),
il formule en effet une doctrine qui rend compte spécifiquement du statut des
mots dans le discours poétique, en sʼopposant au privilège accordé aux
seuls mots référentiels — et parmi ceux-ci aux mots du lexique philosophique
ou théologique : « Le mot poétique nʼest pas un beau mot — ni essence ni
sémantique. Non seulement elles ont une valeur logique, mais elles glissent facilement vers une valeur affective, parfois puissante, et, surtout, chose curieuse, les plus banales dʼentre elles. ». Dans sa conclusion (299), J. Hellegouarcʼh évoque une « plus forte autonomie » des conjonctions de coordination par rapport aux autres « termes articulatoires ». En revanche, R. Lucot (1965, 265) reste prudent sur le statut des conjonctions de coordination au sein des clausules de lʼhexamètre de type si bona norint : « il est évident que la montée de la voix devait être particulièrement sensible sur lʼinterrogatif quis […] ; sur an interrogatif […] ; sur les particules exclamatives […] ; sur le démonstratif hic […] ; sur le pronom te […]. Restent et, nec, sed, plus propres par nature à glisser vers lʼatonie. » 15 Jean Collart se réclame du linguiste Gérald Antoine (1958), qui propose une perspective assez ouverte sur les prétendus « mots-outils » du français. Il renvoie aussi à un article dʼHenri Bornecque sur les conjonctions latines.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
224
idée. Cʼest un mot comme tout mot, dʼabord doublement lié, par une chaîne
horizontale au contexte proche, par une verticale aux lointains, — sa
mémoire. » (1970, 60). Il sʼinscrit aussi en faux contre une perception
purement quantitative, statistique du « mot poétique » : « Les mots poétiques
ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus de mémoire, les plus
chargés. Le mot poétique est un mot qui appartient à un système fermé
dʼoppositions et de relations, et y prend une valeur quʼil nʼa nulle part ainsi,
qui ne peut se comprendre que là : chez tel écrivain, dans telle œuvre, et par
quoi lʼœuvre, lʼécrivain, se définit. » (ibid.).
Les « mots poétiques », dans cette perspective, sont les nœuds dʼune
œuvre, autrement dits les points dʼentrée privilégiés dont lʼétude permet
dʼapprocher la subjectivation du discours que lʼauteur du poème a opérée.
Chez Hugo, Henri Meschonnic relève la valeur poétique de termes tels que
« grand », « noir » et « puisque » — des monosyllabes, si lʼon tient compte
de la plasticité prosodique de « puisque » — ; chez Apollinaire, il recense
« blanc », « abeille » ou « mais » ; chez Éluard, ce sont « réglé » et
« doublé » (1970, 61). Il sʼappuie sur les remarques que Jean-Claude
Chevalier (1962) a formulées à propos du lexique dʼApollinaire pour affirmer
quʼun « mot-outil » peut être un « mot poétique » (1970, 61 n.4).
Cʼest en ayant à lʼesprit cette théorie du « mot poétique » que nous
aborderons le rôle des monosyllabes dans lʼoralité catullienne. Nous nous
demanderons notamment sʼil est pertinent dʼétablir un lien entre « le degré
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
225
valeur »16 du mot dans lʼœuvre et son statut accentuel. Auparavant, nous
voudrions montrer quʼil nʼest pas possible dʼétudier lʼoralité catullienne en
laissant de côté la question du rôle des monosyllabes dans lʼœuvre du
Véronais. Cela implique, bien entendu, de poser certaines données
statistiques ; toutefois, il serait, à notre sens, réducteur de sʼen tenir à une
vue globalisante : il faudrait aussi trouver des instruments qui permettent
dʼévaluer lʼintensité rythmique que procurent ces mots brefs.
16 Cette expresion est tirée du glossaire qui apparaît en annexe de Meschonnic 1970, et qui est dû au travail collectif de Jean-Claude Chevalier, Claude Duchet, Françoise Kerleroux, et Henri Meschonnic. « MOT POÉTIQUE : Degré valeur d ʻun mot qui nʼapparaît que dans lʼœuvre. Tout mot peut être poétique. » (1970, 174).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
227
Catulle, poète des monosyllabes
Nous avons pu montrer dans les chapitres précédents que les
monosyllabes, en général, et, plus encore, les monosyllabes
sémantiquement non-référentiels ne jouissent pas dʼune bonne réputation
auprès des métriciens ou des stylisticiens. Or, la poésie de Catulle se
présente éminemment comme une poésie des monosyllabes, ainsi que le
rappelle J. Loomis, dans sa conclusion générale : « More needs to be done
in analyzing the types of words used to fill various positions in the line, and
particularly monosyllables, which are such a distinctive element in Catullusʼ
verse. » (1972, 141)17.
Pour nous, ce « more needs to be done », cet encouragement lancé par
Loomis à poursuivre les recherches sur les configurations verbales de la
poésie versifiée, en particulier des monosyllabes, revêt surtout une
signification méthodologique. Il ne sʼagit pas de faire plus, cʼest-à-dire de
donner plus dʼextension aux études statistiques de métrique verbale, mais de
faire différemment, et, surtout, selon dʼautres bases théoriques.
Selon lʼopinion commune, le rôle privilégié des monosyllabes dans la poésie
de cet auteur devrait entraîner une condamnation esthétique sans appel.
Comment un auteur réputé « savant » (doctus poeta), et raffiné, peut-il
composer son vers avec cette maladresse qui lui aurait valu une très
mauvaise note de vers latin, au début du XIX° siècle ? Dʼune certaine
manière, lʼaporie critique quʼentraîne le rôle des monosyllabes dans lʼœuvre 17 Dans la suite du texte, les références à cet ouvrage de Loomis renvoient directement aux pages concernées.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
228
nʼest pas sans rappeler le problème de lʼobscénité catullienne18. Sʼagit-il
encore de poésie quand prolifèrent des termes peu châtiés tels que cunnus,
culus, mentula, paedicare etc. ?
En fait, le parallèle entre le problème des monosyllabes et celui de
lʼobscénité nʼest pas entièrement satisfaisant, car sʼil est possible de réduire
le scandale causé par cette dernière en suscitant plusieurs Catulle virtuels —
un par « genre » ; le Catulle de lʼépigramme nʼest pas poli, mais celui de
lʼ « epyllion » est sublime…—, il nʼen est rien pour les monosyllabes,
problème qui prend un tour résolument transgénérique et transmétrique.
Pour étayer ce constat, il suffit, en première instance, de faire référence à la
présence insistante des monosyllabes en attaque de vers. En effet, à
plusieurs reprises, J. Loomis dans son ouvrage sur les Polymetra de Catulle,
mentionne lʼattaque monosyllabique comme une caractéristique du poète
véronais.
Lʼauteur signale que le monosyllabe occupe de préférence la syllabe
dʼattaque de lʼhendécasyllabe sapphique, chez Catulle — comme, dʼailleurs,
chez tous les auteurs qui font usage de ce mètre19. Et, à propos de
lʼhendécasyllabe phalécien, elle note que « lʼusage des monosyllabes
initiaux » est un « aspect particulier de la versification de Catulle » (47).
Lʼattaque monosyllabique représente un peu plus de 53% des choliambes —
18 Fitzgerald, 1995, 59-60 : « In the reception of Catullus, obscenity has always been an important issue. The now infamous words from the preface to Fordyceʼs commentary of 1961 […] are the last echo of centuries of embarassment, swelling frequently to outrage, at Catullan obscenity. ». 19 « A monosyllable occurs at 1 more frequently than at any other position in either the Greek or Latin poets » (25 n. 2).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
229
en combinant les monosyllabes lexicaux et prosodiques, cʼest-à-dire les
disyllabes élidés —, ce quʼelle interprète comme « un trait caractéristique de
lʼusage verbal de Catulle » (115). La proportion semble également
importante parmi les trimètres iambiques du Véronais20.
Si lʼon cumule les poèmes rédigées en hendécasyllabes phaléciens et en
distiques élégiaques, on obtient un corpus restreint qui donne une bonne
image statistique de la pratique catullienne en matière dʼattaque
monosyllabique.
En effet, lʼhendécasyllabe phalécien est la forme métrique qui sert de base
à de nombreux poèmes de Catulle, rassemblés dans la première partie du
recueil (c. 1-3, c. 5-7, c. 9-10, c. 12-16, c. 21, c. 23-24, c. 26-28, c. 32-33,
c. 35-36, c. 38, c. 40-43, c. 45-50, c. 53-58), soit au total 40 poèmes,
représentant 534 vers21. Il fait ainsi figure de forme dominante parmi les
Polymetra. Cʼest pourquoi, il nous semble que son étude procure une idée
représentative de la manière catullienne dans cette partie du recueil.
Et les distiques élégiaques (pris comme forme de type « strophique »)
jouent un rôle analogue pour le reste du recueil. Le corpus catullien composé
en distiques élégiaques correspond aux pièces 65-116, soit un total de 51
poèmes22 ; cet ensemble représente 606 vers, hexamètres et pentamètres.
20 « Twenty-two out of fifty-five trimeter lines [40%] have initial monosyllable… » (115 n. 1). 21 Dans son recensement général, Loomis (34, n.2) aboutit à un total de 113 hendécsayllabes grecs exploitables (84 autres sont trop mutilés pour être considérés) et 5 664 hendécasyllabes latins, sans compter ceux dʼépoque carolingienne. 22 Nous ne retenons pas, dans ce cas précis, les sous-divisions de la tradition textuelle ; ainsi, par exemple, le c.68 et le c.68b deviennent un seul poème dans notre décompte.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
230
Les tableaux qui suivent présentent une photographie de ce corpus
restreint, mais représentatif. On retiendra que, pour notre relevé, nous
considérons les monosyllabes prosodiques (disyllabes élidés) autant que les
monosyllabes lexicaux.
Les monosyllabes en attaque dʼhendécasyllabe phalécien Poème Formes des monosyllabes Nombres de
monosyllabes c.1 Quoi iam plus 3 (30%)
c.2 a+b Quoi et (w) cum et tam quod 6 (46,1%) c.3 Et quem nam nei sed ad qui at tam o ! 10 (55,5%) c.5 Nox da dein aut cum 5 (38,4%) c.6 Nei nam nam cur nei dic ad 7 (41,1%) c.7 Quam et aut tam quae 5 (41,6%) c.9 Vt o ! quid 3 (27,2%) c.10 Non huc iam per nec cur at ad non ut non at in hic uer(um) sed 16 (47%) c.12 Non hoc non quar(e) 9 (52,9%) c.13 Si et haec sed seu quod tot(um) 7 ( 50%)) c.14a+b Nei nam cur qui quod non quod dei quem non nam ac uos saecl(i) non 15 ( 57,6%) c.15 Vt quod non in uer(um) quem hunc quod in ut a ! 11 (57,9%) c.16 Qui quod nam qui si et non qui uos 9 (64,2%) c.21 Non aut nec atqu(e) nunc a ! nei 7 ( 53,8%) c.23 Nec uer(um) est et nec non non non aut sol(e) a hanc nec atqu(e) quod
non haec quod et 19 (70,3%)
c.24 O ! qui nec non sed aut hoc 7 (70%) c.26 Nec uer(um) o ! 3 (60%) c.27 O ! ut 2 (28,5%) c.28 Quid o ! tot(a) sed fart(i) at dent 7 (46,6%) c.32 Iub(e) (w ) et neu sed nam 5 (45,4%) c.33 O ! nam cur 3 (37,5%) c.35 Nam quae nam 3 (16,6%) c.36 Nam et ( w ) nunc quae quacqu(e) si at 7 (35%) c.38 Et quem qua 3 (37,5%) c.40 Quis an (w ) quid cum 4 (50%) c.41 non 1 (12,5%) c.42 Et quae turp(e) non aut sed quod sed 8 (33,3%) c.43 Nec nec nec ten o ! 5 (62,5%) c.45 Ni hoc at et sic huic ut hoc nunc un(o) quis (w ) 11 ( 42,3%) c.46 Iam iam ad iam iam o ! 6 (54,5%) c.47 Vos uos de 3 (42,8%) c.48 Vsqu(e) nec non sit 4 (66,6%)
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
231
c.49 quot 1 (14,2%) c.50 Vt atqu(e) ut nec sed ut at hoc ex nunc ne est 12 (57,1%) c.53 Qui di 2 (40%) c.54 Si tib(i) (w ) 2 (28,5%) c.55 T(e) in T(e) in T(e) in in quas a ! dic num si uel dum 11 (55%) c.56 O ! res 2 (28,5%) c.57 Nec un(o) non 3 (30%) c.58a+b Plus non non non non add(e) quos et 8 (53,3%) total 255 (47,75%)
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
232
Les monosyllabes en attaque du distique élégiaque (1) Poème Formes des monosyllabes Nombre de
monosyllabes c.65 Nec mens sed haec ne ut quod atqu(e) huic 9 (37,5%) c.66 Qui ut ut e qua quam non id et sed quam ut sed quis non atqu(e)
non sei capt(am) quis sed cum per quid et et hic ex qui sed lux namqu(e) nec non nunc non quam sed sed tu sed 41(43,6% )
c.67 O ! postqu(am) dic in non nec uer(um) qui ad non sed qui nos prim(um) fals(um) sed seu et quod sed cum (prép.) cui nec
tant(um) saep(e) 25 (52%) c.68a+b Quod quem nec id sed neu quae sed tu tec(um) quae haec id haec
nam hac huc quod id quod ultr(o) non nec sed nec in nam cum qui per cum hic iam is ad quo nil quod quam doct(a) quam quod si nam quaen(e) ei tec(um) quae quem nec sed ad nei quo quod sed qui nam qui nec quam sed ut aut lux quam quae ne saep(e) nec sed
quar(e) quem hoc pro ne haec huc et et a (prép.) et lux 83 (68,5%) c.69 Nol(i) non aut hunc quar(e) aut 6 (60%) c.70 Quam in 2 (50%) c.71 Si aut nam ill(am) 4 (66,6%) c.72 Sed nunc qui 3 (37,5%) c.73 Aut ut quam 3 (50%) c.74 Si hoc quod nunc 4 (66,6%) c.75 Huc atqu(e) ut nec 4 (100%) c.76 Est nec diu(um) ex nam aut quin et hoc o ! me quae non aut o ! 15 (57,6%) c.77 Frustr(a) ei uit(ae) 3 (50%) c.78 Cum (prép.) qui sed uer(um) 4 (40%) c.79 Si quam sed 3 (75%) c.80 Quid e sic ill(a) 4 (50%) c.81 qui 1 (16,6%) c.82 Aut est 2 (50%) c.83 Haec san(a) non 3 (50%) c.84 Et cum sic hoc nec cum iam 7 (58,3%) c.85 Od(i) 1 (50%) c.86 Rect(a) tot(um) mult(a) 3 (50%) c. 87 Quan(a) 1 (25%) c.88 Quid nec nam non 4 (50%) c.89 Qu(i) ut 1 (16,6%) c.90 Nam si 2 (33,3%)
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
233
Les monosyllabes en attaque du distique élégiaque (2) Poème Formes des monosyllabes Nombre de
monosyllabes c.91 Non in quod aut sed hanc et non tu culp(a) 10 (100%) c.92 De quo 2 (50%) c.93 Me nec 2 (100%) c.94 Hoc 1 (50%) c.95 Quam at et at 4 (44,4%) c.96 Si quo atqu(e) 3 (50%) c.97 Non uttr(um) nam hic est quem 6 (50%) c.98 In id si 3 (50%) c.99 Ver(um) dum nam nei non ut quam 7 (43,7% ) c.100 Flos hic cui cum 4 (50%) c.101 Vt et heu nunc atqu(e) 5 (50%) c.102 Si mequ(e) 2 (50%) c.103 Aut aut deind(e) len(o) 4 (100%) c.104 Sed 1 (25%) c.105 — 0 (0%) c.106 Cum quid 2 (100%) c.107 Si quar(e) quod quis 4 (50%) c.108 Si non lingu(a) 3 (50%) c.109 Hunc dei atqu(e) ut 4 (66,6%) c.110 Tu quod aut quae 4 (50%) c.111 Sed quam 2 (50%) c.112 — 0 (0%) c.113 — 0 (0%) c.114 — 0 (0%) c.115 Cur prat(a) usqu(e) non 4 (50%) c.116 Qui tel(a) hunc at 4 (50%) Total (606 vers)
315 (51,9%)
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
234
Si lʼon cumule les données collectées dans chaque partie de ce corpus, qui
contient, au total, 1140 vers, on obtient le résultat suivant :
Les monosyllabes en attaque de vers (1)
Hendécasyllabes
phaléciens
Distiques élégiaques Total du corpus restreint
255 (47,75%) 315 (51,9%) 570 (50%)
Les attaques monosyllabiques, on le voit, occupent une place fondamentale
dans les poèmes appartenant à ces deux formes métriques. La convergence
statistique des deux parties du corpus peut être corrélée avec le fait que lʼon
se trouve devant des textes notoirement adressés, où la stratégie
énonciative dominante est celle du « discours », au sens où celui-ci sʼoppose
à lʼ « histoire », selon Benveniste.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
235
Afin de confirmer cette interprétation, il est intéressant de comparer les
données exposées avec celles que lʼon obtient en étudiant deux poèmes à
vocation narrative23 :
Les monosyllabes en attaque de vers (2)
C. 63 (galliambes) C. 64 (hexamètres dactyliques)
8 (0,08%) 144 (35,2%)
Dans le poème dʼAttis, le nombre infime des monosyllabes dʼattaque
sʼexplique par la standardisation extrême du vers galliambique, dominé par la
réalisation prosodique wwqwqwqq 8 wwqwwwwq (Nougaret, 1948, §314 ;
Lenchantin, 1934, 56), et par les dissyllabes (Loomis, 128). La réalisation
prosodique dominante comporte une brève en attaque, ce qui réduit
considérablement la part des monosyllabes à cette place, parce que ces
derniers sont très majoritairement longs par nature, ou par position24. Lʼécart
entre les occurrences des galliambes et celles des phaléciens est énorme
(46,95%), mais il faut peut-être relativiser la portée de ce constat, à cause du
23 Nous retenons comme base les données fournies par J. Hellegouarcʼh (1964, 27, tableau 3), cependant nous les complétons. Cet auteur repère 129 monosyllabes au « longum I » ; nous leur ajoutons 15 monosyllabes prosodiques (dissyllabes élidés). Les monosyllabes présents en attaque de vers dans le c. 63 sont : quo, sed, ut, et, quod, iam, fac, at. Sur ce fait, voir Loomis (128) : « one of the first unusual features of the galliambic is the comparatively small percentage of monosyllables in general, so prominent in the rest of Catullusʼ meters. ». 24 Dans le corpus de phaléciens, seuls 6 monosyllabes dʼattaque sur 255 se réalisent comme des brèves. Le corpus de distiques ne peut être sollicité, car lʼattaque y est une longue fixe.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
236
volume proportionnellement faible du corpus galliambique (93 vers vs. 534
vers). Cependant, la répartition des rares attaques monosyllabiques est
révélatrice. La plupart dʼentre elles (6 sur 8 ;75%) interviennent dans les
parties de discours rapporté, soit dans la bouche dʼAttis, soit dans celle de
Cybèle. Seuls les connecteurs sed (63,39) et at (63,87) sont à mettre au
compte de la voix du narrateur.
Lʼécart entre hexamètres kata stichon (c.64) et phaléciens apparaît
significatif (12,55%), sans avoir la dimension radicale que lʼon a constatée
précédemment. Lʼobservation des 70 vers du monologue dʼAriane (64, 132-
201) peut contribuer à une meilleure compréhension du phénomène. En
effet, les attaques monosyllabiques représentent 33 occurrences (47,1%)
dans cette séquence de discours rapporté. Le fait important est ici la
convergence évidente entre les données du corpus de phaléciens (47,75%)
et celle du monologue dʼAriane.
De cette comparaison entre des corpus métriquement divers, nous pouvons
tirer une première série de conclusions. Lʼattaque monosyllabique est bien
un fait transmétrique, observable à des degrés significatifs dans plusieurs
corpus, mais non pas un fait indifférent à la métrique. Le cas des galliambes
en fournit un bon témoignage. La fréquence des monosyllabes en attaque de
vers semble bien liée au rapport quʼentretiennent les textes avec la parole ;
cela doit être retenu de la répartition des occurrences dans les textes
narratifs (c.63, c.64), où la fréquence nʼest pas massive. Lʼattaque
monosyllabique doit alors être considérée comme une tentative pour
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
237
représenter poétiquement la parole à lʼintérieur du système contraint quʼest le
discours versifié.
Pour compléter ce constat, on peut reprendre lʼobservation des
hendécasyllabes phaléciens et des distiques élégiaques, en prêtant attention
à ce qui se passe dans chaque poème. Dans le premier de ces ensembles,
la fréquence varie entre 12,5% (c.41) et 70,3% (c.23). La médiane statistique
(44,4%) nʼest pas très éloignée de la moyenne (47,75%). Lʼemploi de
lʼattaque monosyllabique est assez constant. Nul poème composé en vers
phalécien nʼy échappe. Dans le second, la fréquence varie entre 0% (c.112-
114) et 100% (c.75, c.91, c.103, c.106). La médiane statistique (50%) est
encore plus proche de la moyenne (51,9%).
De cette description schématique des variations à lʼintérieur de notre corpus
restreint, nous retenons un fait très significatif à nos yeux. Les occurrences
ne sont pas réparties entre les vers de façon aléatoire et constante. La
répartition obéit, au contraire — cʼest encore plus visible dans la seconde
série où les écarts peuvent être énormes— , à une stratégie, que nous
appellerons rythmique, variant dʼun poème à lʼautre.
Ainsi, il nous semble que ce phénomène de lʼattaque monosyllabique tout
en étant sensible à une structuration énonciative, correspond, en dernière
instance, à une configuration rythmique du discours versifié.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
239
Lʼénigme des séquences monosyllabiques
Catulle a usé de façon systématique et méthodique de lʼattaque
monosyllabique. Il en a fait un élément fondamental de son oralité. Pour
nous, les variations de fréquence que lʼon note de poème à poème sont
lʼindice de lʼusage véritablement rythmique que Catulle fait dʼun élément de la
composition verbale du vers.
Une étude plus poussée du fait monosyllabique en début de vers révèle des
données nouvelles, susceptibles de de corroborer le sens rythmique que
nous avons accordé à la présence massive des monosyllabes en attaque,
cʼest-à-dire situés dans la première syllabe du vers.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
240
Pour décrire ces faits, nous utiliserons la schématisation exposée par
R. Marina Sáez, à partir des pratiques de L. Nougaret et J. Luque Moreno. La
structure prosodique de lʼhendécasyllabe phalécien est traditionnellement
décrite sous la forme suivante (Loomis, 34) :
u u q w w q w q w q u
R. Marina Sáez (1998, 25) a mis au point la schématisation suivante pour
rendre compte des configurations verbales présentes dans le phalécien25 :
a b y
A B F 1 2 S t V w X Y
(K)
Dʼaprès Nougaret, le schéma prosodique traditionnel du distique est le
suivant (1948, §138-§150) :
qt qt qt qt qt qu
qt qt q qww qww u
25 Le principe générale de ce système descriptif consiste à attribuer une majuscule aux syllabes longues, une minuscule aux syllabes brèves. La variante (K) indique la substitution dʼune longue au groupe de deux brèves, notées 1 2, qui correspond au noyau du « groupe choriambique » (qwwq) de la tradition métrique.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
241
Lʼhexamètre, constituant le premier élément de la « strophe » élégiaque, est
représenté de la façon suivante, par J. Luque Moreno26 :
A B C D E F U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 z
R. Marina Sáez (1998, 25) présente ainsi la schématisation du pentamètre,
second élément de la « strophe » élégiaque :
A B C D E V W X Y Z
1 2 3 4 7 8 9 0 z
Une fois ces « outils dʼarpentage » présentés, passons à la description des
séquences de monosyllabes en attaque de vers phalécien.
26 Voir Marina Sáez, 1998, 24-25. La schématisation de Luque Moreno (1987b) modifie légèrement celle de Nougaret (1962, 1966).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
242
Il est, en effet, remarquable de constater que Catulle nʼutilise pas seulement
le monosyllabe, de façon isolée, en attaque de vers, mais quʼil forme de
véritables séquences monosyllabiques, attachées de préférence au début de
vers. À notre connaissance, ce genre de fait nʼa pas été étudié
systématiquement dans un contexte métrique donné.
Commençons par lʼhendécasyllabe phalécien.
Les groupes de monosyllabes en attaque de phalécien
schéma AB ABF ABF1
occurrences 92 39 2
Pourcentage
sur le total
des vers
17,22 % 7,3% 0,003%
Ces séquences de monosyllabes en attaque de vers représentent à elles
seules lʼessentiel (80,1%) du corpus des groupes présents dans les vers
phaléciens (166 occurrences) :
(AB) 1,5 Iam tum, c(um) ausus es unus Italorum
26,5 O uent(um) horribilem atque pestilentem !
(ABC) 35,11 Quae nunc, si mihi uera nuntiantur,
(ABF1) 3,11 Qui nunc it per iter tenebricosum27
27 Lʼaccentuation de la préposition, dans le groupe pér iter (wwq), est remarquable ; elle montre que les caractéristiques accentuelles du GP peuvent être intégrées par le poète pour
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
243
Dans le distique élégiaque, les séquences monosyllabiques jouent
également un rôle prépondérant. Examinons en premier lieu les faits dans
lʼhexamètre, en posant, au préalable, que, dʼaprès le décompte de R. Marina
Sáez (1998, 69 tabla 8a), effectué sur lʼédition Mynors, lʼattaque
monosyllabique est déjà un fait massif dans lʼhexamètre catullien (197
occurrences, 61,56%) :
(AB) 66,11 Qua rex tempestate nouo auctus hymenaeo
98,5 Si nos omnino uis omnes perdere, Vecti,
(ABC) 103,3 Aut, si te nummi delectant, desine quaeso
(ABCDE) 76,17 O dei si uestr(um) est misereri, aut si quibus umquam
Les séquences monosyllabiques en attaque dʼhexamètre
Schéma AB ABC ABCDE
Occurrences 24 18 1
Pourcentage sur
le total des vers
0,07% 0,05% 0,003%
Dans le pentamètre, où lʼattaque monosyllabique est aussi un fait
quantitativement important28, les schémas de séquences sont plus variés :
(AB) 76,12 Et deis inuitis desinis esse miser ?
former une série monosyllabique accentuellement homogène. Lʼautre occurrence du type ABF1 est issue dʼune émendation : 55,9 A ! uel te sic ipse flagitabam. 28 Selon R. Marina Sáez (1998, 120 tabla 17), on trouve 189 occurrences, à savoir une fréquence de 58,69%.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
244
76,26 O dei, reddite mi hoc pro pietate mea.
(A1) 67,26 Seu quod iners sterili semine natus erat,
(ABC) 68,34 Hoc fit, quod Romae uiuimus ; illa domus,
(A12) 66,86 Namqu(e) eg(o) ab indignis praemia nulla peto.
(ABCD) 97,2 Vtr(um) os an cul(um) olfacerem Aemilio.
(ABCDE) 110,4 Quod nec das et fers saepe, facis facinus
Les séquences monosyllabiques en attaque de pentamètre
Schéma AB A1 ABC A12 ABCD ABCDE
Occurrences 24 1 16 1 1 2
Pourcentage
sur le total
des vers
0,07% 0,003 0,05% 0,003% 0,003% 0,006%
Ces données un fois cumulées, lʼon trouve 88 occurrences de séquences
monosyllabiques en attaque de vers. Elles représentent 44,2% des
séquences monosyllabiques contenues dans les distiques élégiaques (199
occurrences). Il est donc possible de conclure, comme dans le cas des
phaléciens, que lʼattaque de vers est encore la collocation privilégiée de ce
type de configuration verbale. Cependant, les faits se révèlent nettement
moins massifs que dans la première série du corpus (hendécasyllabes). Les
séquences de monosyllabes sont mieux réparties à lʼintérieur des vers.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
245
Comment interpréter la présence non négligeable de ces groupes de
monosyllabes en une collocation où ils ne manquent pas dʼattirer lʼattention ?
Il semble bien, en tout cas, quʼelle ne relève pas dʼun défaut de la technique
de versification ; sinon, comment expliquer lʼexistence dʼun long groupe, de
type ABCDE, tel que Quod nec das et fers saepe, facis facinus (110,4) où
les échos consonantiques sont manifestement recherchés (quod-das, das-
fers, fers-facis-facinus) ?29
La question qui se pose, si lʼon admet quʼil sʼagit de configurations
délibérément introduites dans le vers, est celle du statut accentuel des unités
monosyllabiques qui composent ces séquences. Lʼinterprétation large de la
proclise latine, telle quʼelle est exposée par Weil et Benloew en 1855, nʼest
pas dʼun grand secours dans cette situation30. En effet, il nʼest pas rare que
les séquences monosyllabiques fassent intervenir plusieurs termes
« proclitiques » à la suite (6,13 Cur non tam latera ecfututa pandas ;68b,18
Qui cum de prona praeceps est ualle uolutus ; 75,3 Vt iam nec bene uelle
queat tibi, si optima fias ), et, les auteurs du Traité dʼaccentuation avouent
leur perplexité face à ces rencontres de « proclitiques »31.
29 Pour une ampleur comparable, voir 76, 17 O dei, si uestr(um) est misereri, aut si quibus umquam et 86, 3 Null(a) in tam magn(o) est corpore mica salis. Ce dernier exemple est dʼune lecture malaisée, à cause de la complexité du groupe prépositionnel à disjonction, qui met à lʼépreuve le modèle traditionnel dʼaccentuation que Quintilien nous a légué. 30 Radford (1903) défend la même interprétation maximaliste de la proclise. Voir notre partie sur les conjonctions pour plus de détails. À cette position, on peut opposer celle, exactement inverse, de L.P. Wilkinson (1963, 90) : « As to Latin of the classical period, the rule for word-accent is clear and simple : it was bound to the penultimate syllable if this was long, to the antepenultimate if the penultimate was short (e.g. domórum, but dómibus). ‡ Monosyllables were generally accented, except prepositions. » 31 « Quʼarrivait-il lorsque plusieurs particules proclitiques se trouvaient lʼune à la suite de lʼautre, comme dans cette phrase : Edixit, ut qui per urbem irent…? Étaient-elles toutes dépourvues dʼaccent ? Il est difficile de le croire, mais nous nʼavons aucun renseignement à
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
246
Tel que le posent Weil et Benloew, le problème semble insoluble, dans la
mesure où il faudrait se résoudre à « appuyer » — utilisons ici la terminologie
du XIX° siècle commençant — un mot « faible » sur un mot qui ne le serait
pas moins, ou alors à considérer des séquences de lexèmes, dont
lʼorientation sémantique est diverse, comme des groupes syntaxiques
analogues aux groupes prépositionnels. Cʼest donc là que la validité de
lʼextension du concept de proclise doit être remise en cause.
Certes, la difficulté du problème vient bien de la rareté des ressources
testimoniales latines, dʼailleurs souvent limitées par la tradition au
témoignage de Quintilien (IO 9, 4, 42), cʼest un fait indéniable.
Toutefois, nous croyons utile dʼinterroger ce défaut des textes, en nous
gardant de faire parler lʼabsence dʼune manière univoque. Deux explications,
qui ne sont pas nécessairement antithétiques se présentent à lʼesprit : 1° ou
bien les séquences de monosyllabes ne constituent pas du tout un problème
pour les grammairiens anciens, parce que la loi générale dʼaccentuation nʼy
est pas altérée, les monosyllabes non-référentiels se comportant comme
tous les lexèmes non-enclitiques ; 2° ou bien les grammairiens reculent
devant une difficulté qui se dérobe à leur grille conceptuelle, notamment
parce que les mots non-référentiels renvoient à des dimensions linguistiques
qui nʼont réellement été appréhendées, quoique de façon encore perfectible,
que dans la grammaire moderne (la phrase) et dans la linguistique
contemporaine (le discours).
ce sujet. » (1855, 57).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
247
Ce serait donc à raison que les auteurs se montreraient prudents au sujet
de lʼatonie complète des séquences de « proclitiques », car il existe des
contre-exemples pour infirmer à la fois lʼinterprétation maximaliste de la
proclise et le régime dʼaccentuation que cette dernière induit, selon Weil et
Benloew.
Il nʼest que de faire référence à certains cas rares, mais instructifs, de
récurrence lexicale en attaque de vers.
14,16 Non non hoc tibi, false, sic abibit.
62,52 Iam iam contingit summum radice flagellum;
63,73 Iam iam dolet quod egi, iam iamque paenitet.
Pour les apprécier à leur juste valeur, il faut rappeler que ces faits
rhétoriques ne relèvent pas de la simple ornementation graphique, quʼils
sont, au contraire, des témoignages de lecture et de diction. Cette diction
oratoire du texte poétique sʼinscrit bien dans la conception générale de la
lecture comme interprétation à caractère « mimétique », définie par Varron
(GRF, 236 ; Desbordes,1980, 227)32.
Ainsi, lʼemphase rhétorique suscitée par la figure dʼinsistance peut être prise
comme témoignage dʼune emphase accentuelle. J. Dangel (1984, 294) écrit
explicitement à ce sujet : « Parallèlement, pour les mots proclitiques ou à
tendance proclitique, nous avons considéré que, prenant appui sur le mot qui
les suit, ils forment avec celui-ci une seule unité phonétique, à moins quʼune
anaphore rhétorique, les détachant dans lʼénonciation, ne leur confère le
32 Voir le chapitre sur la lecture (lectio)du texte versifié dans notre première partie.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
248
statut dʼun mot de sens plein. » Cʼest ainsi quʼelle lit lʼanaphore de iam et de
et chez Virgile (Aen.1,120-121), après la césure (1983, 298)33 :
Iam ualidam Ilionei nauem, H iám fortis Achatae,
Et qua vectus Abas, P ét qua grandaevus Aletes,
De là, le phénomène de récurrence lexicale de iam et non — des
monosyllabes « proclitiques », dans lʼacception de Weil et Benloew —
permet de dégager plusieurs enseignements :
1° la récurrence suppose que ces monosyllabes « proclitiques » peuvent
être accentués en tant quʼunités lexicales ;
2° lʼemphase rhétorique et accentuelle se manifeste par une gradation de
gauche à droite ;
3° les groupes non non et iam iam comportent un élément final qui constitue
non pas un maillon faible de la séquence, mais bien un élément emphatisé
au sens accentuel, à savoir un élément de force supérieure, comme le veut
la logique rhétorique de ce genre de figure ;
4° il est possible de hausser ces exemples au statut de paradigmes
rythmiques des séquences monosyllabiques, au moins de celles qui sont
situées en collocation identique34.
33 Lʼarticle de J.Dangel étant consacré à la typologie des césures virgiliennes, dans son texte seul le mot suivant la césure est accentué. Pour des raisons techniques, nous nʼutilisons pas les conventions graphiques du texte original que nous citons (accent aigu = ictus, croix suscrite = accent de mot). 34 Notre démarche heuristique est ici proche de celle de J. Hellegouarcʼh (1964, 82) qui met sur le même plan les « rôles » (rythmiques ?) de partes orationis différentes, iam et quae, à partir de lʼanalogie structurelle de deux vers de Lucrèce (5, 316 ; 5, 378).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
249
Ces réflexions sont à comparer avec lʼanalyse que Joseph Hellegouarcʼh
propose des groupes de deux monosyllabes quʼil repère en attaque
dʼhexamètre (des groupes de type AB ou A1)35. Le métricien écrit : « Il est
rare […] que le dernier monosyllabe ne soit pas un simple mot de liaison,
introduisant le deuxième et sʼappuyant sur lui ; il est probable quʼalors le
premier se trouve mis en relief et que le deuxième sʼen trouve quelque peu
détaché ; mais lʼeffet se trouve assuré par la relative rareté du fait. » (1964,
48). Les groupes de monosyllabes en attaque de vers seraient donc destinés
à mettre en relief le monosyllabe dʼattaque, en créant un « intermot »
inattendu. Alors pourquoi ne pas écrire clairement que le « mot de liaison »
en attaque de vers reçoit une emphase au sens accentuel du terme ? On
retrouve sur ce point une des limites de la démarche stylistique de lʼauteur,
qui évoque des « effets » sans tenter de définir leur nature concrète.
Et il faut objecter que cette interprétation fait bon marché des séquences
plus longues, dont lʼexistence ne reçoit pas suffisamment de lumière dans le
livre de J. Hellegouarcʼh. Dans ces cas, les « intermots » se multiplient sans
quʼil ne soit plus possible dʼaffirmer quʼils sont là pour mettre en relief le
monosyllabe dʼattaque.
Ainsi, les hexamètres catulliens recèlent des exemples de séquences ABC
débutant par un « mot de liaison », qui ne peuvent pas tous être des
inadvertances :
35 Joseph Hellegouarcʼh semble sʼarrêter aux séquences de deux mots — quʼil réduit trop à des « clichés verbaux », négligeant les cas qui nʼy sont pas réductibles —, même sʼil fait allusion à des groupes de trois monosyllabes (1964, 61 n.3). La méthode analytique quʼil suit, à savoir lʼobservation de chaque collocation du vers, ne se prête pas bien à la mise au jour dʼune cohérence rythmique dans lʼemploi des monosyllabes.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
250
66,21 Et tu non orbum luxti deserta cubile,
68,19 Sed tot(um) hoc studium luctu fraterna mihi mors
68b,57 Quem nunc tam longe non inter nota sepulcra
68b,79 Nam nec tam carum confecto aetate parenti
68b,121 Et long(e) ant(e) omnes mihi quae me carior ipso est,
78b,1 Sed nunc id doleo, quod purae pura puellae
Ces six occurrences nous inspirent les observations suivantes :
1° Le monosyllabe final de groupe est orienté syntaxiquement vers les
disyllabe ou trisyllabe qui suit ; par exemple, lʼadverbe intensif tam porte sur
un adverbe (68b, 57 longe) et sur un adjectif (68b,79 carum) ; le cas extrême
est celui du groupe prépositionnel ánte ómnes (qwqq), où la préposition
disyllabique possède une syllabe dʼattaque renforcée, et qui devient ánt(e)
ómnes (qqq ), dans le texte catullien.
2° Le mot disyllabique ou trisyllabique qui suit reçoit un accent sur sa
syllabe dʼattaque, ce qui fait de celle-ci la dernière position accentuelle dʼune
série qui commence avec le « mot de liaison » : 66,21 lúxti (qq), 78b,1 dóleo
(wwq).
Ces remarques, conjuguées à celles que nous avons formulées à propos
des récurrences lexicales en attaque de vers, nous conduisent à poser
lʼhypothèse que les séquences de monosyllabes, ne sont ni des agrégats
fortuits ni des appendices enclitiques, destinés à mettre en relief lʼattaque de
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
251
vers, mais plutôt des configurations rythmiques délibérément constituées,
ayant en commun une dynamique orientée vers la droite.
Un examen rapide de ce qui se passe en dehors de lʼattaque de vers doit
apporter des éléments de réflexion complémentaires.
Dans lʼhendécasyllabe phaléciens, quatre types de séquences
monosyllabiques émergent significativement hors de lʼattaque de vers : St,
tV, StV et tVw36 :
(St) 16,1 Pedicabo ego uos et irrumabo.
(tV) 12,17 Vt Veraniolum me(um) et Fabullum.
(StV) 14,8 Quod si, ut suspicor, hoc nou(um) ac repertum
(tVw) 15,7 Istos, qui in platea mod(o) huc mod(o) illuc
36 Les autres séquences se répartissent comme suit :BF (1), F1 (2), F12 (1), 2S (3), XY (2), wXY (1).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
252
Les principales séquences de monosyllabes hors de lʼattaque
(phalécien)
Schéma St StV tV tVw
Occurrences 4 7 5 6
Pourcentage
sur le total
des vers
0,007% 0,1% 0,009% 0,01%
Il est intéressant de souligner que les séquences de trois monosyllabes sont
plus recherchées hors de lʼattaque de vers. Les monosyllabes
« articulatoires » (Hellegouarcʼh) étant concentrés en attaque, pour des
raisons syntaxiques, ces séquences de trois monosyllabes sont davantage
liées à lʼélision des disyllabes, comme dans le cas du v. 15,7 que nous avons
cité plus haut. Et le caractère délibéré de cette configuration apparaît bien si
lʼon relève sa récurrence, qui en fait une marque insigne de lʼoralité
catullienne :
3,9 Sed circumsiliens mod(o) huc mod(o) illuc
50,5 Ludebat numero mod(o) hoc mod(o) illoc,
Dans le distique élégiaque, la diversité combinatoire est plus importante. Il
nʼy a rien là que de naturel, si lʼon garde à lʼesprit que la plasticité prosodique
de lʼhendécasyllabe phalécien est assez limitée.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
253
À lʼintérieur de lʼhexamètre, on repère deux types de séquences dominants :
FU et YZ/z37.
(FU) 68,17 Multa satis lusi ; non est dea nescia nostri,
(YZ) 67,43 Nomine dicentem quos diximus, utpote quae mi
Les principales séquences monosyllabiques hors de lʼattaque de vers
(hexamètre)
Schéma FU YZ/z
Occurrences 13 12
Pourcentage sur le total
des vers
0,04% 0,03%
La présence dʼun nombre appréciable de séquences monosyllabiques FU
est due, vraisemblablement, à la césure penthémimère, qui sépare les
positions E et F de lʼhexamètre38. Une séquence monosyllabique de type FU
(13 occurrences), FUV (4 occurrences), ou même FUVW (1 occurrence),
joue notamment un rôle de relance du rythme, après cette articulation
37 Ce dernier type, correspondant à une séquence de deux monosyllabes en fin de vers, implique majoritairement une forme de esse, traditionnellement traitée par lʼaphérèse, à la suite de Lachmann. Systématiser cette pratique nous semble abusif, car, à notre avis, il nʼy a pas de raison, au plan rythmique,de traiter différemment 67,9 Non ita Caecilio placeam, cui tradita nunc sum et 69,7 Hunc metuunt omnes, neque mirum ; nam mala uald(e) est. La prosodie générale de Catulle incite plutôt à systématiser lʼélision, tout aussi licite métriquement. Sur les groupes de deux monosyllabes en fin dʼhexamètre, voir Hellegouarcʼh 1964, 55-62. À cette occasion, lʼauteur aurait pu sʼinterroger davantage sur les groupes de trois monosyllabes quʼil mentionne (1964, 61). 38 Voir à cet égard, la remarque de J. Hellegouarcʼh (1964, 85) : « pour les poètes latins, le milieu du 3° pied constitue du point de vue même de la structure de la phrase, un relais important. Les monosyllabes y sont traités en grande partie comme en début de vers. Ils correspondent le plus souvent à un début de phrase ou de proposition. »
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
254
essentielle du vers hexamétrique39. À titre complémentaire, nous pouvons
faire appel aux données de métrique verbale construites par R. Marina Sáez
(1998, 99 tabla 12a), laquelle constate 80 occurrences monosyllabiques
(25%) en position F de lʼhexamètre catullien40. Cʼest, par conséquent, un
véritable système de gradation rythmique qui se dessine après la césure
penthémimère, comme en attaque de vers : la même cohérence paraît à
lʼœuvre en lʼune et lʼautre collocations.
En effet, comme en attaque de vers, le monosyllabe unique est le seul fait
vraiment massif ; mais des séquences plus ou moins longues peuvent
prendre le relais, afin, croyons-nous, de créer une figure rythmique plus
marquée.
Dans le pentamètre, les séquences monosyllabiques se manifestent aussi
hors de lʼattaque de vers. Les types quantitativement importants sont DE et
CDE, cʼest-à-dire ceux qui occupent les positions situées directement avant
la « jointure » (Iso Echegoyen, 1984), communément appelée « césure »41 :
(DE) 89,4 Cognatis, quar(e) is desinat esse macer ?
(CDE) 73,6 Quam modo qui m(e) un(um) atqu(e) unic(um) amic(um)
habuit.
39 Les données concernant lʼhexamètre que nous nʼavons pas reprises dans un tableau sont les suivantes : 2C (4 ), 2CDE (1), 4DE (2), CDEF (3), CDEFU (1), DE (5), DEFU (2), EF (1), EFU (2), 6U (1), 6UV, FUV (4), FUVW (1), UV (3), vW (1), W9 (1), VW9 (1), 0Yz (1). 40 La fréquence catullienne du monosyllabe en position F est la plus élevée de toutes. Les Priapea ont cependant une valeur très proche (24,21%), et la pratique de Martial nʼest pas très différente (20,10%). Lucain en est le plus éloigné (11,70%). Cf. Marina Sáez, ibid.. 41 Les autres types hors de lʼattaque du pentamètre sont : 2C (2), CD (3), CDEV (2), DEV (1), 4E (1), V78 (2), 0Z/z (3).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
255
Les principales séquences monosyllabiques hors de lʼattaque de vers
(pentamètre)
Schéma DE CDE
Occurrences 11 8
Pourcentage sur le total
des vers
0,03% 0,02%
Les deux exemples que nous avons cités plus haut se caractérisent par un
usage spécifique de lʼélision tendant à créer prosodiquement des séquences
monosyllabiques, présentes sous dʼautres formes par ailleurs42. La place de
ces séquences appelle une remarque ; si lʼon admet, comme nous lʼavons
posé précédemment, que les séquences monosyllabiques sont orientées
vers la droite, il paraît souvent sʼagir dʼun moyen de mettre en relief lʼattaque
du second côlon du pentamètre, qui débute justement par la position V,
laquelle suit immédiatement la position E.
42 Ce fait est déjà bien illustré par lʼélision calculée de mod(o) anaphorique, à lʼintérieur du phalécien (3,9 ; 15,7 ; 50,5 ) ; élision qui crée une séquence de type tVw.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
256
La lecture accentuelle du v. 89,4 serait donc la suivante, dans notre
hypothèse :
Cognátis, quár(e) ís désinat ésse mácer ?
qqq q q qww qw wu
Cette séquence DE peut être comparée, par exemple, avec celle que lʼon
trouve au v. 66,28, où la configuration verbale est analogue, à cette variante
près que le mot dʼattaque est un choriambe (qwwq ), non plus un molosse
(qqq) :
Coniúgium, quód nón fórtior aúsit ális ?
qwwq q q qww qw wq
Au plan rythmique, cela nous frappe, quʼil y ait ou non élision ne semble pas
faire de différence. La même configuration rythmique est visée ; seuls varient
les moyens dʼy parvenir.
La séquence CDE contenue au v. 73,6 peut être, à son tour, comparée avec
celle du v. 70,243 :
Quám míhi, nón sí sé Iúppiter ípse pétat.
q ww q q q qww qw wu 43 Certaines séquences CDE ne peuvent pas être interprétées comme un groupe accentuel homogène ; ce sont celles qui contiennent une préposition (généralement, en position D). Au plan strictement rythmique, elles fonctionnent comme des séquences CD. Il en va ainsi aux vv. 71,4 ; 72,2 ; 76,8 ; 87,2. Lʼinterprétation que J. Hellegouarcʼh donne au v.76,8 (Aut facere, haec a te J dictaque factaque sunt.) nous paraît erronée ; il écrit, en effet : « le rythme garde ce même caractère heurté et dramatique, avec sa suite de 3 monosyllabes, dont le troisième est mis en relief devant la diérèse » (1964-1965, 173) ; or, le monosyllabe « mis en relief devant la diérèse » appartient en fait à un GP, accentué á te (en cohérence avec un réseau de /á/ au sein du vers ; fácere – á te – dictáque – factáque).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
257
Cʼest tout le premier côlon qui fonctionne sur un mode rythmique analogue
dans ces deux cas :
1° Lʼattaque de vers est analogue : Quam modo q ww (73,3) et Quam mihi q
ww (70,2).
2° Les élisions en série dans 73,6 sont destinées à créer prosodiquement
une séquence monosyllabique CDE, quí m(e) ún(um) átqu(e) q q q,
rythmiquement équivalente à nón sí sé q q q.
3° Les séquences CDE sont orientées vers la syllabe dʼattaque du second
côlon, laquelle est accentuée : únic(um) qw (73,6) et Iúppiter qww (70,2).
Enfin, il nʼest pas sans intérêt dʼintroduire un troisième terme dans cette
comparaison, une séquence CDEV, qui se rencontre au v. 114,244 :
Fértur, quí tót rés ín s(e) hábet egrégias,
qq q q q q ww qwwq
La position V, lʼattaque de second côlon, est occupée par une préposition
monosyllabique accentuée — cet exemple, du fait de lʼélision du second
terme du GP, apporte une confirmation décisive, au paradigme accentuel ád
te que nous avons retenu dans notre précédente partie —, laquelle est
rapprochée prosodiquement dʼun mot pyrrhique oxyton, hábet ww. Le
fonctionnement de la séquence CDEV est donc comparable à celui de la
séquence CDE, à cettte différence près que la syllabe mise en relief — en
44 Une autre séquence de même type intervient au v. 76,14 : Difficil(e) est, uer(um) hoc qua lubet efficias ;. On peut regretter que J. Hellegouarcʼh ne commente pas la dimension monosyllabique de ce vers, dans son étude stylistique du c. 76 (1964-1965, 173).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
258
lʼoccurrence lʼattaque dʼhabet en position 7 —est décalée dʼune position vers
la droite.
Au terme de ce chapitre, nous pensons avoir montré que les séquences de
monosyllabes, traditionnellement négligées, à cause, peut-être, du préjugé
dʼatonie qui affecte généralement les mots brefs, ont sans doute une grande
importance rythmique. En effet, nous avons mis au jour des systèmes
cohérents dʼorganisation sérielle dans deux grands ensembles métriques du
recueil. Cette dynamique séquentielle des monosyllabes nʼest-elle pas
justement développée par Catulle du fait de sa conception agonistique de la
parole poétique ? Rappelons quʼil désigne à lʼoccasion ses « iambes » (36,
4-5; 40, 1-2; 54, 6-7) ou ses « hendécasyllabes » (12, 10-11; 42, 1), comme
des armes, toutes prêtes à pourfendre lʼadversaire45. Ces termes ne
renvoient pas à une réalité métrique déterminée, mais correspondent à une
culture de la parole poétique, cʼest pourquoi ils valent pour la majorité des
polymetra et des poèmes composés en élégiaques.
Certains indices font soupçonner que la plupart des monosyllabes — les
prépositions étant lʼexception46 — ne sont pas traités comme des
45 Sur les sources grecques de la tradition « iambique », voir G. Nagy 1976 ; sur la manière dont Catulle sʼapproprie celle-ci, voir Wray, 2001, 175-190. 46 À titre dʼéchantillon, nous avons relevé les prépositions intervenant dans les séquences monosyllabiques en attaque de vers. Toutes ne sont pas inaccentuées, loin de là. Dans lʼhendécasyllabe phalécien (7 occurrences, soit 0,04% du corpus de séquences monosyllabiques en attaque de vers) : 10,34 Pér quam non licet esse neglegentem. ; 15,8 Ín re praetereunt sua occupati ; 15, 9 Ver(um) á te metuo tuoque pene ; 23, 18 Hanc ád munditiem adde mundiorem, ; 45, 23 Vn(o) ín Septímio fidelis Acme ; 50,17 Éx quo perspiceres meum dolorem. ; 57, 7 Vn(o) in lecticulo erudituli ambo,. Dans le distique élégiaque (16 occurrences, soit 0,16% des séquences monosyllabiques en attaque de vers ) : 66, 14 Quam dé uirgíneis gesserat exuuiis. ; 67, 35 Sed dé Postúmio et Corneli narrat amore, ; 68,36 Huc un(a) ex múltis capsula me sequitur. ; 68b, 19 Qui cum de próna praeceps est Alpe uolutus, ; 68b, 61 Ád quam tum properans fertur simul undique pubes ; 68b, 81 Qui, cúm diuítiis uix tandem inuentus auitis ; 68b, 120 Á quo sunt primo omnia nata
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
259
« proclitiques » dans le discours versifié, mais quʼils fonctionnent
accentuellement de manière homogène.
Nous formons donc lʼhypothèse que les séquences monosyllabiques
homogènes, à savoir celles qui ne comportent pas de groupe prépositionnel
compliquant la lecture accentuelle, constituent des figures rythmiques que
lʼon peut repérer dans dʼautres langues et dʼautres traditions poétiques, des
« contre-accents » et des séquences « contraccentuelles ».
bona, ; 68b,121 Et long(e) ánt(e) ómnes mihi quae me carior ipso est, ; 76, 6 Éx hoc ingrato gaudia amore tibi. ; 87, 4 Quant(a) ín amóre tuo ex parte reperta mea est. ; 91,4 Aut poss(e) a túrpi mentem inhibere probro; 91, 10 Culp(a) est, ín quacúmque est aliquid sceleris. 92, 2 Dé me: Lesbia me dispeream nisi amat. ; 98, 1 Ín te, s(i) in quémquam, dici pote, putide Vecti, 104, 4 Sed tu cum Táppone omnia monstra facis.115, 6 Vsqu(e) ád Hyperbóreos et mare ad Oceanum ?.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
261
Une solution : la figure rythmique du « contre-
accent »
Dans notre hypothèse, les séquences monosyllabiques sʼexpliquent par la
volonté de susciter dans le vers des rencontres accentuelles. Cʼest ainsi que
nous interprétons la remarque fameuse de Quintilien (IO 9, 4, 42), souvent
mentionnée au cours de cette partie47. Les traductions de Jean Cousin et
François Charpin, que nous avons citées au début de cette partie, prennent,
selon nous, trop de distance par rapport à la lettre de ce passage. Nous
proposons plutôt : « De même, sʼils sont trop nombreux, les monosyllabes
produiront une diction sans fluidité (male continuabuntur), parce
quʼobligatoirement lʼagencement verbal (compositio), découpé par de
nombreuses clausules, donne des soubresauts (subsultet). »
Avec cette référence à lʼeffet clausulaire, Quintilien insiste, selon nous, sur
lʼautonomie du mot48, qui suppose une autonomie accentuelle, et, à travers la
métaphore du verbe subsultare (« avoir des soubresauts », « sautiller »,
« faire des bonds »), sur la dynamique que dégage la juxtaposition des
monosyllabes. Cette description de la prononciation heurtée des séquences 47 Etiam monosyllaba, si plura sunt, male continuabuntur, quia necesse est compositio multis clausulis concisa subsultet. Lʼemploi du verbe subsultare recouvre apparemment une intention péjorative, de la part de Quintilien. Il évoque lʼabsence de mesure (le défaut de maîtrise) et lʼindignité sociale, comme dans un autre passage (IO 11, 3, 43) : Nam prima est observatio recte pronuntiandi aequalitas, ne sermo subsultet inparibus spatiis ac sonis, miscens longa brevibus, gravia acutis, elata summissis, et inaequalitate horum omnium sicut pedum claudicet. Secunda varietas: quod solum est pronuntiatio. Lʼhétérogénéité du discours non réglé est ici stigmatisée. Dans les pièces de Plaute, le verbe est utilisé pour désigner la manifestation corporelle (irrépressible) dʼune émotion paroxystique (Cap. 637, Cas. 324). 48 Sur lʼautonomie du mot en latin, voir, notamment, lʼarticle classique de De Groot (1934), et, plus récemment celui de F. Biville (1990), ainsi que lʼhistoire de langue latine publiée par J. Dangel (1995).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
262
monosyllabiques peut être pertinemment rapprochée de ce que certains, au
XX° siècle, nomment « contre-accent ».
Le terme de « contre-accent » désigne justement la rencontre de deux
marques accentuelles successives. Historiquement, il doit être attribué au
poéticien suisse Henri Morier. Ce dernier traduit ainsi « Doppelakzent »
(« accent couplé »), substantif que Theophil Spoerri (1929), un autre auteur
helvétique, utilise dans son traité de métrique française49.
Les pages succinctes que Spoerri (1929, 70-73) consacre à la rencontre de
deux accents dans des syllabes contiguës deviennent un article assez dense
(s. u. « contre-accent ») dans le Dictionnaire de Morier (1961, 19985). Pour
Morier (1998, 309), la rencontre contraccentuelle constitue un écart, réel,
mais rare : « Le français évite, en général, deux accents consécutifs; sʼils se
rencontrent dans la parole, il en résulte un effet dʼune violence variable, le
second accent sʼaffirmant, dans sa nature anarchique, par un surcroît
dʼintensité et par un écart mélodique. »50. Enfin, Henri Meschonnic étend
encore le champ dʼapplication du néologisme, lui accordant le statut de 49 Le prototype du « Doppelakzent » de Spoerri est à chercher dans le domaine de la métrique accentuelle du XIX° s., où il prend le nom de « schwebende Betonung » ou de « hovering accent » (« accentuation flottante »). Voir Brogan (1993, s.u. « hovering accent ») : « a term taken up by Jakob Schipper from Huemer and embraced by his students and a surprising number of otherwise sober 19th- and 20th- c. metrists (e.g. Sievers, Ten Brink, Gummere, Kaluza, Alden, La Drière, Halof, Attridge) for cases in scansion where stress seems equally disposed on to adjacent syllables… ». Ce concept est présenté comme aberration du point de vue de la métrique accentuelle, puisque celle-ci est communément conçue comme fondée sur lʼalternance accentuée/inaccentuée. Il est vrai quʼil est mal servi par lʼexpression « accentuation flottante », qui évoque un renoncement scientifique. 50 Voir aussi : « Il sʼagirait là dʼun écart stylistique par rapport à la norme : le français, en principe, a horreur du spondée. » (1961, 22). Morier utilise ici la terminologie classique qui assimile syllabe accentuée et syllabe longue, comme chez Vossius (1673, 56-57). Cette idée dʼune horreur « naturelle » de la langue française pour le « contre-accent » est relayée par Paul Garde (1968, 94-95) et Paul Verrier (Le vers français, II, 18). Meschonnic considère cette idée comme la marque dʼune esthétique de lʼeuphonie et non comme une observation empirique (1982, 245-255, n.179).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
263
notion centrale dans sa théorie du rythme (1982, 254) : « Le contre-accent,
étant la suite immédiate de deux accents, est marqué, en français, parce que
la séquence progressive, linéaire dans une langue à accent (final) de groupe,
éloigne généralement les accents lʼun de lʼautre. Sauf construction
syntaxique particulière, liés à des rapports de syntagmes monosyllabiques.
Le contre-accent est un cas marqué syntaxiquement et sémantiquement. ».
Chez Henri Meschonnic apparaît aussi la notion de « série de contre-
accents », cas de figure que nʼenvisage pas Morier, plus par préjugé
esthétique que par constat empirique.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
265
Champs dʼapplication de lʼanalyse contraccentuelle
Actuellement, le terme nʼest employé que par les auteurs qui se réclament
dʼHenri Meschonnic51. Cette situation sʼexplique si lʼon considère que la
pensée linguistique de lʼaccent communique plus facilement avec les études
littéraires dans les aires culturelles (de langues germaniques ou romanes) où
existent des « métriques accentuelles ».
En France, après lʼélan créateur suscité, au XIX° siècle, par les écrits dʼun
théoricien italien — écrivant en français — comme lʼabbé Scoppa (1803,
1811-14, 1816) qui voyait dans lʼaccent la clef universelle de toutes les
métriques — européennes et non-européennes —, il semble bien que la
dimension accentuelle soit désormais lʼapanage des approches phonétiques
expérimentales52. Lʼécole française étudiant la poésie métrique française, à
la suite de B. de Cornulier (1982), sʼen désintéresse, arguant, quʼelle nʼest
pas pertinente pour une métrique stricto sensu, dans la mesure où elle
constitue une variable discursive, et non une structuration normative.
En fait, la notion de série accentuelle, avancée par Henri Meschonnic, est
aussi étrangère au point de vue de la métrique « accentuelle » quʼà celui de
la métrique « syllabique », mais pour des raisons différentes. La théorie
syllabique française (Cornulier 1982, Gouvard 2000), par réaction contre le
scoppisme — de Quicherat à Mazaleyrat —, et par rigueur épistémologique,
51 Pour la poésie versifiée et non-versifiée, on se reportera surtout à Dessons 1991, 114-115 ; pour la prose non poétique, voir Courtois 1991, Herschberg-Pierrot 1993, 273-279. 52 Voir Lacheret-Dujour (1999), où sont bien exposés les modèles théoriques concurrents qui tentent de rendre compte des faits « suprasegmentaux » du français.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
266
ne tient pas compte des accents. Et la métrique de la poésie versifiée de
langue anglaise peine à donner un statut à des faits qui vont à lʼencontre de
ses postulats fondamentaux, à savoir lʼalternance des positions accentuées
et inaccentuées et lʼisoaccentualisme53.
Pourtant, les faits existent véritablement. La Princeton Encyclopedia of
Poetry and Poetics (= Brogan, 1993, 773), bien quʼexprimant — nous lʼavons
précédemment indiqué n.49 — son scepticisme à lʼégard de la notion,
remontant au XIX° siècle, dʼ « accentuation flottante », reconnaît, dans un
exemple de « pentamètre iambique » tiré de Milton (Paradise Lost, 2, 621), la
présence concomitante de huit accents de mots et de cinq accents métriques
(« ictus », indiqués ici par une croix souscrite) :
Ròcks, càves, làkes, fèns, bògs, dèns, and Shàdes of dèath
X X X X X
Ce sont donc ici les trois premiers « pieds » métriques qui portent une série
contraccentuelle — nous assumons cet adjectif néologique —
extraordinairement étendue. « En anglais, comme le note Henri Meschonnic
(1982, 253-254), le contre-accent joue sur la double provenance du lexique,
saxon et latin, qui privilégie le saxon, le mot court, dans une rythmique
linguistique à accent de mot fixe. ». Remarquons que, dans ce vers de
Milton, tous les mots ont un statut monosyllabique ; des lexèmes
dʼétymologie latine comme caves ou lakes, ou saxonne comme shades, ne 53 Sur lʼisoaccentualisme et ses limites, voir Brogan 1993, 6-7 (s.u. « accentual verse ») : « In definitions of all the preceding varieties [i.e. les formes répertoriées comme « accentuelles »] there has been assumption that accentual verse is isoaccentual […] Beyond typology, there is evidence to suggest that there is something more distinctive about the metrical organization of accentual verse than mere regularity of stress count. »
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
267
sont que graphiquement disyllabiques, ainsi que lʼimpose la structure
décasyllabique du mètre. Un exemple si extrême exclut toute inadvertance
poétique. La pertinence de la description métrique traditionnelle y est, bien
entendu, fortement remise en cause, à moins de prétendre que certains
monosyllabes doivent être artificiellement désaccentués.
En français, de pareils exemples sont a priori peu imaginables. Morier
(1998, 310) cite surtout de simples contre-accents fondés sur la contiguïté
dʼune finale de groupe accentuée avec un monosyllabe accentué, par
exemple chez Baudelaire (LXXIX, « Obsession ») et chez Racine (Mithridate
III, 1) :
… Ce rire amer
De lʼhomme vaincu, plein de sanglot et dʼinsultes
Ma funeste amitié pèse à tous mes amis
Toutefois, Henri Morier (1998, 312) cite aussi une véritable série
contraccentuelle sʼapprochant davantage de celle que lʼon a signalée chez
Milton ; ainsi chez Baudelaire (CXLV, « Le Coucher du Soleil romantique »):
Je me souviens ; jʼai vu tout, fleur, source, sillon
Et Henri Meschonnic (1977, 2, 30) relève chez Hugo des séries aussi
longues :
Il attendit mille ans, lʼœil fixé sur les astres
Et la méthode dʼaccentuation meschonnicienne qui combine différents
accents du français — voir le chapitre sur lʼaccentuation française dans notre
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
268
première partie — ouvre un champ plus vaste encore à lʼanalyse
contraccentuelle. Ainsi, J.-P. Courtois (cité dans Herrschberg-Pierrot 1993,
279) peut-il lire une phrase célèbre de LʼEsprit des Lois de la façon suivante :
Il y a de tels climats où le physique a une telle force que la morale nʼy
peut presque rien.
La prise en compte de lʼaccentuation « prosodique » — définie dans notre
première partie — permet de mettre au jour la série de trois contre-accents
qui fait clausule dans cette phrase.
Gérard Dessons (1991, 116-117) propose des exemples tirés de la poésie
de Clément Marot (1527), où la suraccentuation peut également se
développer sur une grande partie du vers :
Mes amours durent en tout temps
Mourir me fait quand je la vois présente
Qui est ? Et quoi ? Je ne le dirai point
Si en pensant suis trop audacieux
« Chez Clément Marot, écrit Gérard Dessons (1991, 116), par exemple, le
contre-accent manifeste lʼinscription du sujet amoureux, développant dans
lʼécriture du poème ce quʼon pourrait appeler une érotique rythmique. ».
Pour la poésie de langue allemande, on peut se référer à lʼanalyse
rythmique de lʼ« Erlkönig » (« Le roi des Aulnes » de Goethe) quʼa procurée
Hans Lösener (1999, 144-145).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
269
Le célèbre premier vers est habité par deux contre-accents (« zwei
Gegenakzente »), qui sont une manifestation rythmique de lʼinquiétante
étrangeté (« das Umheimliche »)54 :
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind ?
La deuxième strophe du poème débute par un vers où une série
contraccentuelle, dʼune longueur comparable à celle que Morier a repérée
dans « Le coucher du Soleil romantique » de Baudelaire, marque le parlé du
père :
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht
Puis, après le pronom du, inaccentué dans lʼanalyse de Hans Lösener, on
trouve un simple contre-accent qui a la particularité de faire écho au so spät
du premier vers.
54 Lʼauteur (1999, 145) commente lʼaccentuation de « Wer », le monosyllabe dʼattaque, en faisant référence au concept meschonnicien dʼaccentuation prosodique : « ʻWerʼ ist nicht nur betont (weil die Interrogativpronomen zur Klasse der betonten Einsilber gehören), sondern auch prosodisch markiert und zwar doppelt : durch die Antizipation des /v/ in ʻWindʼ und durch das /er/, das nicht nur ein Echo des Titelwortes bildet, sondern als prosodiches Thema die ganze Strophe durchzieht. ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
271
Contre-accent et langue latine
Pour la poésie de langue latine, lʼaccent a été pris en compte de deux
points de vue. Les tenants de lʼictus vocal ont cherché à lʼintégrer dans une
perspective de métrique accentuelle qui sʼignorait elle-même. Dʼautre part,
une personnalité isolée comme Bernard Jullien (1861, 1867) a tenté de bâtir
une véritable métrique accentuelle de la poésie latine classique55. Mais, en
fait, lʼun et lʼautre points de vue nʼaboutissent pas à une véritable
reconnaissance de la valeur rythmique de lʼaccent, ni, a fortiori, à une
reconnaissance du contre-accent.
Le rôle sériel de lʼaccent dans la sémantique poétique nʼa guère été
envisagé que par Robert Lucot56, dès un article de 1965 sur la ponctuation
bucolique. Lʼauteur remarque que, dans le discours rapporté de lʼÉnéide (le
« parlé »), la ponctuation bucolique suivie dʼune clausule si bona norint
renvoie à une volonté de suraccentuation, liée, pour lui, à la forte émotion
quʼexprime ce type de fin de vers : « là où la fin de vers fait ordinairement
entendre deux accents, elle en fait voisiner trois en cinq syllabes, de telle
façon que, dans le dactyle, les deux premiers se succèdent immédiatement
et que le troisième, celui du sixième longum, nʼen est séparé que par une
55 Sa doctrine, très influencée par le scoppisme, est résumée dans ce passage : « 1° Ce qui constitue le vers, cʼest véritablement une certaine symétrie dans le rhythme, dont lʼoreille soit assez frappée pour le distinguer du discours ordinaire ; 2° que cette symétriene suppose pas du tout uneégalité mathématique ; quʼelle admet au contraire des différences considérables ; 3°quʼelle devient de plus en plus rigoureuse, à mesure que les systèmes de versification se succèdent et se perfectionnent, comme nous le voyons par les vers grecs comparés aux vers latins et surtout aux vers français ; 4° quʼenfin nous pouvons apprécier lʼharmonie des vers des Grecs et des Latins en appuyant comme ils le faisaient eux-mêmes sur les syllabes accentuées, et remarquant que dans les vers de même mesure, les accents sont à très-peu près en même nombre. » (1861, 153-154). 56 Sur lʼactivité de ce latiniste, voir lʼhommage que lui rend son élève, Jean Soubiran (1989).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
272
syllabe brève. Cʼest cette succession pressée des accents toniques qui, par
lʼanimation inhabituelle quʼelle introduit dans le débit, adapte le rythme au
sens et rend sensible à lʼoreille, dans toute sa vivacité, lʼémotion que
comportent le sens de lʼénoncé et le pathétique du passage. » (1965, 268)57.
Mais cʼest quelques années plus tard, dans un article que nous avons déjà
mentionné, quʼil décrit le contre-accent sous le nom dʼ« intervalle zéro »
(1969, 100) entre deux accents.
Chez Robert Lucot, le concept de dʼ « intervalle zéro » sʼinscrit dans une
tentative pour rendre compte de la « mélodie accentuelle » (1969, 80),
comme élément du rythme. Cʼest pourquoi nous pouvons lui attribuer de
statut de précurseur de notre propre démarche.
Lucot met en œuvre ses analyses rythmiques sur des exemples tirés de
Properce. Il utilise pour la première fois la notion dʼ« intervalle zéro » pour
rendre compte du rythme du vers 1, 14 ,11 (« alors, oui, sous mon toit vient
couler le Pactole », trad. Boyancé).
La forme prosodique de cet hexamètre élégiaque est la suivante :
Tum mihi Pactoli ueniunt sub tecta liquores
q ww qqq wwq q qw wqq
Il commente ainsi ce vers (1969, 99-100) : « Lʼexpression est
grandiloquente, outrée, parce quʼelle vient dʼun cœur plein dʼamour. Ici aussi
57 Dans la conclusion de cet article (1965, 273), Lucot note déjà que la suraccentuation ne concerne pas seulement la clausule. À lʼappui de cette idée, il cite des vers de « parlé » où le pathétique est intense : En. 2,289 Héu ! fúge, náte déa, téque hís áit, éripe flámmis ; 4,314 Méne fúgis ? Pér égo hás lácrimas dextrámque túam té.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
273
le mot anapestique [ueniunt wwq] est vide de valeur poétique ; mais après
lʼévocation dʼune richesse immense (Pactoli), il introduit la ferveur du
sentiment. Cʼest le rythme qui peint la joie, en particulier la mélodie
accentuelle, dont lʼefficacité sʼaccroît ici du fait quʼelle comporte un accent de
plus que dʼordinaire. On ne peut concevoir en effet que tum ne soit pas
nettement tonique : il résume les vers 9-10 qui peignent, dans le concret,
lʼamour qui fait le bonheur de Properce. Et mihi est aussi tonique, car il
oppose Properce et son amour aux richesses décrites dans les vers 1-6.
Sans quʼon puisse dire lequel monte le plus haut, tum et mihi font voisiner
immédiatement deux accents : nous dirons quʼil y a entre eux intervalle zéro.
Ce qui apparaît propre à des énoncés fortement animés et émus, par
exemple chez Virgile : En., IV, 381 : I, sequere Italiam — ; 305 : Dissimulare
etiam sperasti — ; I, 3 : Multum ille —. Ainsi la mélodie se concentre dans le
premier hémistiche : zéro-3-2-5-2. ».
Cette analyse suppose donc que le vers prend la forme suivante :
Túm míhi Pactóli P uéniunt H sub técta liquóres
q ww qqq / wwq / qqw wqq
Ce que Lucot décrit est bien en contre-accent en attaque de vers.
Cependant, le travail de Lucot comporte un oubli, à nos yeux, important. Il
nʼexplicite pas les règles pratiques dʼaccentuation auxquels il se réfère. Ainsi,
quand il souligne que tum ne peut être que tonique, il sous-entend que le mot
peut être atone dans un cotexte différent. Et il ne soulève pas la question de
la nature de cette accentuation dépendante du cotexte.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
274
Une autre question naît de la confrontation de cet exemple comportant un
« intervalle zéro », cʼest-à-dire un contre-accent, avec dʼautres exemples où
Lucot nʼaccentue pas le monosyllabe initial (1969, 98-99), alors que
J. Hellegouarcʼh est bien près de conférer un statut emphatique aux « mots
articulatoires » situés en attaque de vers :
1, 20, 23 At cómes inuícti iúuenis procésserat últra
q ww qqq wwq qqww qw
1, 20, 39 Quae módo decérpens ténero pueríliter úngui
q ww qqq wwq wwqww qq
1, 6, 15 Vt míhi dedúcta fáciat conuicia púppi
q ww qqw wq qqww qq
Lʼanalogie des configurations verbales placées en attaque de vers ne
suggère-t-elle pas un analogie des dynamiques rythmiques mises en œuvre,
et donc, une analogie accentuelle ? En dʼautres termes, à partir de quand
est-on autorisé à généraliser ? Pour nous, cette question ne peut être évitée.
Nous y reviendrons lors de nos études de cas.
Dʼautre part, Lucot localise lʼapparition du contre-accent dans les « énoncés
fortement animés et émus ». Cette affirmation nous paraît ambiguë. Lucot
signifie-t-il par là que lʼanimation rythmique est le corollaire de la seule
émotion ? Ou coordonne-t-il deux causes autonomes de lʼapparition de notre
figure accentuelle ? Nous aurons lʼoccasion dʼillustrer les liens de la figure
contraccentuelle avec lʼaffect, dans notre étude des monosyllabes interjectifs
chez Catulle (partie 5). Mais nous pourrons aussi montrer, à propos de
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
275
pronoms ou des conjonctions, combien plus large apparaît son champ
dʼintervention.
Auparavant, nous voudrions donner une vue synoptique du fonctionnement
contraccentuel à lʼintérieur dʼun poème de Catulle, le c. 63, ce qui nous
donnera lʼoccasion dʼesquisser une typologie des occurrences de notre figure
rythmique.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
277
Le contre-accent dans le c. 63 (út Áttis Catúllus)
Pour simplifier le dépouillement, nous choisissons délibérément un poème
où les séquences de monosyllabes sont peu nombreuses, comme nous
lʼavons indiqué plus haut. Doit-on sʼattendre à une place réduite des contre-
accents ? A priori, oui.
Cette raréfaction attendue va justement nous donner la possibilité de mieux
comprendre la logique qui préside à lʼemploi des contre-accents58. De par
son extrême standardisation verbale (prédominance des disyllabes), le c. 63
se présente comme une sorte de cas-limite. Ainsi, les conclusions que nous
tirerons de son examen, vaudront a fortiori dans dʼautres contextes de
lʼœuvre.
À lʼintérieur du c. 63, qui compte 93 vers, nous avons relevé 48 occurrences
de contre-accents simples ou de séries contraccentuelles (51,6%)59. Par
comparaison, indiquons que le c.76 (distique élégiaque), réputé pour son
« animation » rythmique, totalise 33 figures contraccentuelles en seulement
24 vers. La densité rythmique du poème galliambique est donc plutôt faible.
58 Lʼarticle de Th. D. Goodell (1903), intitulé « Word-accent in Catullusʼ galliambics » nʼenvisage que la problématique de la coïncidence ictus/accent, avec une doctrine accentuelle qui nous semble dépassée. 59 63,1 ; 63,6 ; 63,11 (2) ; 63,15 (2) ; 63,17 ; 63,18 ; 63,21 ; 63,22 ; 63,23 ; 63,26 ; 63,35 ; 63,37 ; 63,39 (2) ; 63,43 ; 63,49 ; 63,50 (2) ; 63,51 ; 63,54 ; 63,55 (2) ; 63,57 ; 63,58 (2) ; 63,61 (3) ; 63,62 (2) ; 63,63 ; 63,64 ; 63,67 ; 63,68 ; 63,69 (2) ; 63,71 ; 63,72 ; 63,73 (3) ; 63,74 ; 63,78 ; 63,79 ; 63,80 ; 63,82 ; 63,84 ; 63,87 ; 63,92 ; 63,93.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
278
À présent, voyons comment les figures contraccentuelles se répartissent
entre les différentes séquences du poème. Cʼest ce que montre le tableau
suivant.
Séquence
1 (vv.1-11)
Séquence
2 (vv.12-26)
Séquence 3
(vv.27-49)
Séquence 4
(vv.50-73)
Séquence 5
(vv.74-77)
Séquence 6
(vv.78-83)
Voix du
narrateur
Voix dʼAttis Voix du
narrateur
Voix dʼAttis Voix du
narrateur
Voix de
Cybèle
3 CA 7 CA 6 CA 25 CA 1 CA 4 CA
Séquence
7 (vv.84-90)
Séquence
8 (vv.91-93)
Voix du
narrateur
Voix de
lʼauteur
2 CA 2 CA
En 4 séquences (45 vers), le narrateur se voit attribuer 12 figures
contraccentuelles. Pour un nombre un peu plus faible de vers (39), on trouve
32 figures contraccentuelles dans le discours rapporté dʼAttis. Quant aux
deux autres voix (Cybèle, lʼauteur), elles reçoivent un nombre de figures
contraccentuelles exactement proportionnel au nombre de vers qui leur est
dévolu, respectivement 4 pour 6 et 2 pour 3.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
279
En termes de rythmique contraccentuelle, une hiérarchie très nette se
dessine entre les différentes voix du poème :
1. Attis (82%). 2. Cybèle, lʼauteur (66,6%). 3. le narrateur (26,6%).
Il nous paraît maintenant important de nous intéresser à la forme de ces
figures, et à leur condition dʼapparition. Pour mémoire, notons que le
galliambe catullien prend généralement la forme suivante, avec une diérèse
qui partage le vers en deux côla, après la huitième syllabe60 :
wwqwqwqq 8 wwqwwwwq
Les types de figures contraccentuelles (CA) sont assez standardisés, dans
ce c. 63. On le verra dans le relevé qui suit, dʼoù se dégagent quelques
figures dominantes.
En attaque de vers, on trouve les types Ét córpus (CA1a), un contre-accent
simple, très courant dans le reste de la poésie catullienne, puisquʼil implique
la seule présence dʼun monosyllabe en attaque de vers, et Quó nós décet
(CA1b), un double contre-accent, qui nécessite une courte séquence
monosyllabique. Le type CA1b peut être provoqué par lʼélision qui crée
60 Sur les variations du schéma galliambique, on peut se référer à Lenchantin (1934, 126) : « La sostituzione di una lunga a due brevi o di due brevi ad una lunga e lʼuso de lʼanaclasi producono notevole varietà negli schemi del galliambo. Il primo emistichio dei vv. 5, 15, 17, 22, 26, 40, 67, 73, 77, 82, 86, il secondo emistichio dei vv. 18, 34, 83, 86, od entrambi gli emistichi dei vv. 22 e 73 condensano in usa lunga le due brevi con le quali sʼinizia il metro. I due trochei, che seguono le prime due brevi del primo emistichio, sono sostituiti da wwwqw nei vv. 23, 48, 70, da qwwww nei vv. 4, 22, 27, 30, 31, 69, 76, 78, 91, da wwwwww nel v.63. Facendo astrazione dalle due brevi iniziali del secondo emistichio, il gruppo sillabico qwwww è sostituito da qwqw nei vv. 14, 35, 73, 76 e da wwwqw nel v. 91. »
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
280
artificiellement un monosyllabe prosodique inséré en son centre (63,39 ;
63,87).
(CA1a)
63,17 Ét córpus éuirástis d Véneris ními(o) ódio;
q qw qwqq / wwq ww wwq
(?) 63,62 Quód énim génus figúr(ae) ést, d égo nón quód obíerim ?61
w wq wq wq q / ww q w wwww
63,79 Fác úti furóris íctu d rédit(um) in némora férat,
w wq wqw qq / ww qwww wq
63,82 Fác cúncta múgiénti d frémitu lóca rétonent,
q qw qwqq / wwq ww wwq
(CA1b)
63,26 Quó nós décet citátis d céleráre tripúdiis.
q q wq wqq / wwqw wwwq
63,39 Séd úb(i) óris aúrei Sól d rádiántibus óculis
w w qw qwq q / wwqww wwq
63,73 Iám iám dólet quód égi, d iám iámque paénitet.
q q wq w qq /q qw qww
61 La conjonction enim, qui se place le plus souvent en seconde position du côlon est traditionnellement traitée comme un « enclitique secondaire » en accord avec la « loi de Wackernagel ». Elle est quasiment absente du recueil de Catulle (2 occurrences : 12,8 ;63,62). Lʼenclise accentuelle attestée par les grammairiens latins pour les mots de type –que sʼapplique-t-elle ici ?
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
281
63,87 Át úb(i) húmid(a) álbicántis d lóca lítoris ádiit,
w w ww qwqq / ww qww wwu
Au milieu du premier côlon, on trouve le type Ítáqu(e) út (CA2a), un contre-
accent simple, dont il existe une variante sous forme de double contre-
accent, Ítáqu(e) út dómum (CA2b)62. Le type út némus (CA2c), un autre
contre-accent simple, qui implique une longue accentuée en position 3 du
premier côlon. Il est réalisé soit par lʼinsertion dʼun monosyllabe avant un
dissyllabe (nécessairement accentué sur sa syllabe dʼattaque), soit par une
élision (63,18 ;63,43 ; 63,55 ; 63,71). Le double contre-accent Linquénd(um)
úb(i) ésset (CA2d), qui est un hapax, apparaît comme une version plus
intense du type CA2c, rendue possible par une double élision. Un dernier
type est présent dans les alentours de lʼattaque de vers, út húic (CA2e), qui
peut également être produit par le biais dʼune élision (63,93).
(CA2a)
63,6 Ítáqu(e) út relícta sénsit d síbi mémbra siné uiro,
ww q wqw qq / ww qw wwwq
63,58 Egón(e) á mea remót(a) haéc d férar in némora dómo?
ww q wq wq q / ww qwwww wq
62 Les types CA2a et CA2b ont en commun dʼêtre produit par un accent dʼenclise et lʼélision du mot enclitique –que ou –ne.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
282
(CA2b)
63,35 Itáqu(e), út dómum Cybélles d tétigére lassúlae,
ww q wq wqq / wwqw wqq
(CA2c)
63,2 Phr´ygi(um) út némus citáto d cúpide péde tétigit,
ww q wq wqq/www ww www
63,11 Cáner(e) haéc súis adórta ést d trémebúnda comítibus.
ww q wq wq q / wwqw wwww
63,15 Séctam mé(am) éxsecútae d dúce mé míhi cómites
qq w qwqq / ww q ww wwq
63,18 Hílarát(e) érae citátis d erróribus ánimum.
wwq wq wqq / qqww wwu
63,43 Trépidánt(e) éum recépit d déa Pasíthea sínu.
wwq wq wqq / ww qwww wq
63,50 Pátri(a) ó méi creátrix, d pátri(a) ó méa génetrix,
ww q wq wqq / ww q ww wwq
63,51 Égo quám míser relínquens, d dóminos út erífugae
ww q wq wqq / wwq q wwwq
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
283
63,55 Úbin(am) aút quíbus lócis té d pósitam, pátria, réor?
ww q wq wq q / wwq www wu
63,61Míser á míser, querénd(um) ést d éti(am) átqu(e) éti(am), ánime.
ww q wq wq q / ww q ww www
63,68 Égo núnc déum minístr(a) ét d C´ybeles fámula férar?
ww q wq wq q / wwq www ww
63,71 Égo uít(am) ágam sub áltis d Phr´ygiae cólumínibus,
ww q wq wqq / wwq wwwww
63,84 Áit haéc mínax Cybélle d réligátque iúga mánu.
ww q wq wqq / wwqw ww wq
(CA2c)
63,67 Linquénd(um) úb(i) ésset órto d míhi sóle cubículum.
qq w qw qq / ww qw wwww
(CA2d)
63,74 Róseis út húic labéllis d sónitus cítus ábiit
wwq w q wqq / wwq ww wwu
63,93 Álios ág(e) íncitátos, d álios áge rábidos.
wwq w qwqq / wwq ww wwq
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
284
Peu avant la diérèse, apparaît un type de contre-accent simple, représenté
par une occurrence unique quód égi (CA3).
(CA3)
63,73 Iám iám dólet quód égi, d iám iámque paénitet.
q q wq w qq /q qw qww
Mais le fait majeur autour de la diérèse du galliambe est lʼexistence de
figures contraccentuelles à cheval sur les deux côla, fonctionnant donc
comme un véritable enjambement interne. Ces deux types contraccentuels
sont bien représentés, et semblent complémentaires lʼun de lʼautre. Cʼest
dʼabord le type uóx úbi (CA4a), un contre-accent simple qui implique les
positions jouxtant la diérèse, souvent construit sur la base dʼun monosyllabe
lexical référentiel (63,21 ; 63,22 ; 63,23 ; 63,69), mais aussi à partir dʼun
trisyllabe paroxyton élidé (63,37), ou même de monosyllabes lexicaux
traditionnellement réputés clitiques (63,57 ; 63,80 ; 63,92).
Un double contre-accent , le type adórt(a) ést d trémebúnda (CA4b), vient
compléter la figure précédente, lui ajoutant ampleur et force. Il implique
souvent une accentuation paradoxale, celle de la copule est, que certains
éditeurs traitent comme une aphérèse. Nous assumons ici un double choix.
Au plan prosodique, nous choisissons lʼélision, pour des raisons que nous
avons déjà exposées dans notre chapitre sur les séquences de
monosyllabes. Au plan accentuel, nous considérons le traitement enclitique
dʼest comme une simple hypothèse, et non comme une norme établie. Les
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
285
occurrences du type CA4b qui ne comportent pas cette difficulté nous
confortent dans ce choix rythmique. Ainsi, le double contre-accent enjambant
la diérèse est indéniable dans certains cas (63,58 ;63,64), et il nous paraît
probable que Catulle traite les formes dʼest placée avant la diérèse dans un
souci dʼanalogie rythmique.
À ces deux figures sʼajoute un hapax, au v. 63,78, le type CA4c, lui aussi
enjambant, qui comporte une série de 4 contre-accents successifs, et, à ce
titre, apparaît comme le degré superlatif des types CA4a et CA4b.
(CA4a)
63,21 Úbi c´ymbalum sónat uóx, d úbi t´ympana réboant,
ww qwq wq q / ww qww wwq
63,22 Tibícen úbi cánit Phr´yx d cúruo gráue cálamo,
qqw ww wq q / qq ww wwq
63,23 Úbi cápita Maénades uí d iáciunt éderígerae,
ww www qwq q / wwq wwwwq
63,37 Píger hís labánte languór(e) d óculos sópor óperit;
ww q wqw qq / wwq ww www
63,55 Úbin(am) aút quíbus lócis té d pósitam, pátria, réor?
ww q wq wq q / wwq www wu
63,57 Rábie féra cárens dúm d bréue témpus ánimus ést.
wwq wq wq q / ww qw www q
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
286
63,69 Égo Maénas, égo méi párs, d égo uír stérilis éro?
ww qw ww wq q / ww q www wq
63,80 Méa líbere nímis quí d fúger(e) ímperia cupit.
ww qwq wq q / ww qwww ww
63,92 Prócul á mea túos sít d fúror ómnis, éra, dómo ;
ww q wq wq q / ww qw ww wq
(CA4b)
63,11 Cáner(e) haéc súis adórt(a) ést d trémebúnda comítibus.
ww q wq wq q / wwqw wwww
63,49 Pátri(am) állocúta maést(a) ést d íta uóce misériter.
ww qwqw q q / ww ww wwwu
63,58 Egón(e) á mea remót(a) haéc d férar in némora dómo?
ww q wq wq q / ww qwwww wq
63,61Míser á míser, querénd(um) ést d éti(am) átqu(e) éti(am), ánime.
ww q wq wq q / ww q ww www
63, 62 Quód énim génus figúr(ae) ést, d égo nón quód obíerim?
w wq wq wq q / ww q w wwww
63,64 Égo g´ymnasi fúi flós, ég(o) d éram décus ólei:
ww qwq wq q w / wq ww wwq
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
287
63,68 Égo nunc deum minístr(a) ét d C´ybeles fámula férar?
ww q wq wq q / wwq www ww
(CA4c)
63,78 Áged(um), ínquit, áge férox í d fác út húnc fúror ágitet
ww qw ww wq q / w w q ww wwu
Le second côlon se caractérise par la présence de deux types
contraccentuels simples. La position qui suit immédiatement la diérèse sert
de base au type úb(i) áper (CA5a), peu représenté. La figure usuelle dans
cette partie du vers est plutôt le type mé míhi (CA5b), dont le point de départ
est la longue suivant les deux brèves initiales du schéma standardisé (/ww
qwwwwq ).
(CA5a)
63,72 Úbi cérua síluicúltrix, d úb(i) áper némoríuagus ?
ww qw qwqq / w wq wwwww
63,73 Iám iám dólet quód égi, d iám iámque paénitet.
q q wq w qq /q qw qww
(CA5b)
63,15 Séctam mé(am) éxsecútae d dúce mé míhi cómites
qq w qwqq / ww q ww wwq
63,50 Pátri(a) ó méi creátrix, d pátri(a) ó méa génetrix,
ww q wq wqq / ww q ww wwq
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
288
63,62 Quód énim génus figúr(ae) ést, d égo nón quód obíerim ?
w wq wq wq q / ww q w wwww
63,69 Égo Maénas, égo méi párs, d égo uír stérilis éro?
ww qw ww wq q / ww q www wq
Pour nous, comme pour R. Lucot (1969, 100-101)63, le contre-accent
nécessite pour base un monosyllabe accentué ou un paroxyton élidé. Dans
ce dernier cas, deux objections peuvent surgir. On a supposé que lʼaccent
puisse remonter dans le mot, lorsquʼune élision se produit. J. Soubiran
(1966, 457-480) a montré en détails lʼimprobabilité dʼun tel phénomène64. Il
ne semble pas avoir été contredit depuis (F. Cupaiuolo, 1995, 29-32).
Une autre difficulté peut être soulevée : lʼapparition du contre-accent ne
dépend-elle pas de la disparition totale de la voyelle élidée ?65 On sait que la
question de la prononciation de cette voyelle élidée a été vivement débattue.
À lʼheure actuelle, la thèse qui prévaut est celle qui a été défendue par
63 Ainsi, Lucot décèle un « intervalle zéro » dans chacun de ces deux exemples : Á méa contemptus… (Prop. 1,5,13), Díssimulár(e) étiam sperásti… (Virg., Aen. 4,305). 64 Plus récemment, J. Soubiran réaffirme ses conclusions anciennes (1988, 322) : « Nous avons montré que cette hypothèse, née du désir de faire coïncider le plus souvent possible syllabes toniques et temps marqués dans la versification iambo-trochaïque, a contre elle, non seulement le silence des grammairiens et la phonétique de lʼélision (qui nʼest pas, en latin, une élision totale), mais aussi les faits eux-mêmes, puisque, si la rétrogression systématique assure quelques coïncidences supplémentaires, […] elle provoque deux fois plus de discordances ; […] En fait, aucun argument objectif nʼappuie cette hypothèse, quʼil faut considérer comme chimérique. » 65 Cette objection nous a été proposée par Michelle Fruyt, lors de la discussion informelle qui a suivi une communication faite au Centre Ernout, à la Sorbonne, sur le thème « Le contre-accent chez Catulle » (février 1998).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
289
J. Soubiran (1966), à savoir la rémanence de ladite voyelle sous forme de
trace66.
Si cette objection est sérieuse, elle se révèle moins grave quʼil nʼy paraît. En
effet, le contre-accent est une réalité rythmique, non pas un fait phonétique.
Quand nous parlons de contre-accent, nous pensons à un rapprochement
dʼaccents, pas nécessairement à une illusoire collision dʼaccents ; à cet
égard, la formulation utilisée par Lucot (« intervalle zéro ») est malheureuse,
car elle laisse entendre quʼil nʼy aurait ni latence ni solution de continuité.
Même dans ce qui paraît continu à lʼoreille sʼinsèrent des micro-intervalles.
Nous ne recherchons pas ici lʼexacte réalité phonique, mais ce que le texte
cherche à construire. Et, à cet égard, les séries contraccentuelles que nous
avons fait apparaître dans le c. 63 nous paraissent suffisamment probantes.
En effet, si nous avons plus haut esquissé ce raisonnement en rapprochant
les séquences monosyllabiques CDE de 2 pentamètres (70,2 et 73,6), la
dernière dʼentre elles apparaissant comme une variante de la précédente,
fondée sur lʼélision67, les observations que lʼon peut pratiquer au sein dʼun
même poème, le c. 63, doté de sa cohérence propre sont encore plus
convaincantes.
66 Fabio Cupaiuolo résume lʼétat du débat (1995, 32) : « Certo, ormai, dopo lʼopera del Soubiran [=1966], la credibilità di una vera e propria ʻelisioneʼ è fortemente messa in dubbio da quasi tutti gli studiosi (ma rimane incerto e perplesso J. Hellegouarcʼh in RPh 41, 1967, 334-338. » 67 Comment expliquer une séquence dʼélisions aussi systématique que celle du v.73,6 si ce nʼest par une intention rythmique, celle de construire un équivalent prosodique de la séquence de monosyllabes lexicaux du v. 70,2, analysable, en fin de compte, comme une figure contraccentuelle ?
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
290
Un grand nombre parmi les séries que nous avons relevées montrent ce
genre dʼéquivalence rythmique. Ainsi, le type CA1b se décline en formes à
élision (63,39 ; 63,87) et formes sans élision (63,26 ;63,73). Lʼéquivalence
existe aussi pour le type CA2c, avec, par exemple, le v. 63,50 (forme non
élidée) et le v. 63,18 (forme élidée), pour le CA2d, avec le v. 63,74 (forme
non élidée) et le v. 63,93 (forme élidée)68. Lʼintention dʼanalogie rythmique
est particulièrement évidente dans le cas du type CA5a dont relève les
figures contraccentuelles de deux vers successifs : 63,72 Úbi cérua
siluicultrix, d úb(i) áper nemoriuagus ? et 63,73 Iám iám dólet quód égi, d iám
iámque paénitet.
De plus, le type CA2a, qui implique une élision, ne saurait être expliqué
sans la volonté de faire voisiner un accent dʼenclise avec un monosyllabe
(63,6 Ítáqu(e) út relícta… ; 63,58 Egón(e) á mea;), et il en va de même pour
sa variante allongée (CA2b, 63,35).
Comme on les voit, les indices ne manquent pas.
On aura remarqué que tous les types contraccentuels, ici recensés de
manière exhaustive, ne sont pas employés avec une fréquence égale. Il faut
retenir maintenant ceux qui sont assez fréquents pour acquérir une
dimension fonctionnelle au sein du poème. Au plan quantitatif, les types
CA2c (12 occurrences) et CA4a (9 occurrences) sont les plus importants ; ils
sont suivis de CA4b (7 occurrences), CA1b (4 occurrences) et CA5b (4
occurrences).
68 Cela vaut aussi pour le type CA4a où lʼon peut égaler une forme non élidée (63,23) et une forme élidée (63,37).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
291
Le type CA2c, contre-accent simple, joue dans lʼensemble du poème le rôle
de relance rythmique plutôt dévolu au monosyllabe dʼattaque dans les
poèmes composés en phaléciens et en distiques élégiaques. Il introduit une
intensité narrative de niveau faible, aux vv. 63,2 et 63,84. Il est aussi utilisé
en complément dʼautres figures contraccentuelles, par exemple au v. 63,11
(CA2c+CA4b), pour préluder rythmiquement à lʼinsertion de la parole
rapportée dʼAttis, ou comme simple appui dans les vers de parole
paroxystiques (63,55 CA2c+CA5b ; 63,61 CA2c+CA4b+CA5b).
Le CA4a, contre-accent simple enjambant la diérèse, est lié à lʼirrationnel de
la parole. Il caractérise la déraison, voire la fureur dʼAttis, à la manière dʼun
leitmotiv. Il apparaît, pour la première fois, dans trois vers successifs (63, 21-
23) de la séquence 2 (voix dʼAttis, vv.63,12-26), où il est complémentaire de
lʼanaphore dʼúbi (vv.63,21-25). Il réapparaît ensuite dans la séquence
narrative (v. 63,39) qui suit, pour dramatiser le lever du soleil, puisquʼau
réveil la folie va resurgir dans toute son horreur. Il émaille logiquement le
second discours dʼAttis (63,57-58 ; 63,69), où il est aussi relayé par le type
CA4b. Enfin, la voix de Cybèle lʼutilise, lorsquʼelle fait référence à la trahison
dʼAttis (63,80), et lʼauteur, lui-même, en fait usage, quand il supplie la déesse
de ne pas devenir lui-même un nouvel Attis (63,92).
Le type CA4b, un double contre-accent, a deux usages. Il sert, dans les
séquences narratives, à annoncer le discours rapporté dʼAttis, en offrant une
sorte de prélude à la déraison (63,11 ; 63,49). Au sein du discours rapporté,
il figure lʼhorreur paroxystique (63,58 ; 63,61-62 ; 63,64 ; 63,68).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
292
Le type CA1b, un double contre-accent, a, lui aussi, deux usages. Il sert de
clausule, dʼenvoi désespéré au discours rapporté dʼAttis (63,26 ; 63,73). Mais
le narrateur lʼutilise également pour animer le récit par un forte intensité
dramatique (63,39 le lever du soleil ; 63,87 la course du lion). Nous
interprétons cette bivalence de la figure contraccentuelle comme une
implication du narrateur, qui se voit lui-même dans Attis.
En revanche, le type CA5b, contre-accent simple, est une figure assez
univoque, parce quʼon ne la rencontre que dans le discours rapporté, dʼAttis.
Elle est un point dʼappui rythmique dans le second côlon, qui permet de
donner de lʼampleur rhétorique à la déploration.
Lʼobservation globale du poème montre que le discours rapporté est le lieu
privilégié du contre-accent, même sʼil participe sporadiquement à la
narration. Cʼest dans le discours rapporté que lʼon trouve la plus grande
variété de figures, comme si toutes les positions du vers pouvaient être
mises à contribution. Cʼest dans le discours rapporté quʼapparaisent
normalement des combinaisons de contre-accents, alors que les séquences
narratives nʼen comportent quʼun exemple (63,11). Remarquons que lʼauteur
a tenu à distinguer la parole implacable de la déesse Cybèle par une figure
contraccentuelle unique, exceptionnelle par son ampleur (CA4c, 63,78), à
laquelle il a adjoint un autre type très peu utilisé dans le poème (CA1a,
63,79 ; 63,82).
Le c.63 se présente comme un véritable exorcisme rythmique : le narrateur
participe au furor du personnage, à travers le partage de figures
contraccentuelles comme CA4b ou CA1b, tandis que lʼauteur intervient dans
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
293
la dernière séquence du poème pour marquer son identité, distincte de celle
du personnage.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
295
Conclusion
Il existe, comme nous lʼavons vu, un lien direct entre la manière dont les
philologues du XIX° siècle ont conçu la proclise latine et leur vision des
monosyllabes, issue de la contamination du point de vue grammatical
(Aristote, Poétique, 20, 1457a) et du point de vue métrique (Quintilien, IO 9,
4, 42). Selon leurs vues, les monosyllabes sont des mots « faibles »,
accentuellement et sémantiquement, ce qui entraîne la nécessité de les
éviter dans le discours — spécialement dans le discours versifié. Lʼinvention
de la proclise prend donc une dimension providentielle : elle met à la
disposition du philologue une catégorie spécifique où ranger les mots
indésirables.
Cependant, la poésie de Catulle, pour ne la considérer que comme un
exemple parmi dʼautres, oppose un démenti à cette manière de voir. Parce
que son discours versifié réserve une place difficilement négligeable aux
monosyllabes, on se trouve devant le paradoxe dʼune poétique, qui, tout en
étant pour une part célébrée comme virtuose, ne répond pas aux canons
définis par les philologues modernes en matière dʼusage lexical.
Selon nous, le paradoxe nʼest quʼapparent dès lors quʼon sʼessaie à lire le
témoignage de Quintilien dans une perspective différente, cʼest-à-dire
comme un témoignage sur la force rythmique potentielle des groupes de
monosyllabes. Nous pensons, en effet, que ceux-ci nécessitent un
ralentissement du débit et un surcroît dʼénergie articulatoire si bien quʼils se
prêtent à former les points culminants du rythme discursif.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
296
De plus, ces séquences lexicales — le mot de locution ne convient pas —
forment le point dʼachoppement de la doctrine de la proclise telle quʼelle a été
formulée par H. Weil et L. Benloew. En effet, ils reconnaissent la difficulté
que lʼon rencontre, quand on sʼavise de vouloir appliquer le système
dʼaccentuation proclitique à une série de termes réputés accentuellement
faibles.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous interprétons les séquences
monosyllabiques comme figures rythmiques quʼHenri Meschonnic nomme
contre-accents, à la suite dʼHenri Morier.
Pour nous, les monosyllabes réputés clitiques, hors les prépositions,
peuvent recevoir une emphase spécifique, qui est une accentuation de
discours : lʼanaphore rhétorique, en tant quʼindice de diction (J. Dangel),
fournit une preuve de lʼexistence de cet accent.
Lʼétude du c. 63 nous a permis de montrer la cohérence rythmique qui
organise lʼusage des monosyllabes à lʼintérieur dʼun poème donné. La
fréquence des séquences monosyllabiques, interprétées comme des
séquences « contraccentuelles », apparaît corrélée à lʼimplication du
narrateur par rapport à son sujet, ainsi quʼau degré affectif du discours
rapporté.
Les parties suivantes de notre travail nous permettront, par la multiplication
des études textuelles, de comparer le fonctionnement rythmique de partes
orationis aux statuts accentuels a priori différents.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
297
Index des auteurs et des notions
accent,208,213,221,245,248,250,262,265,266,271,273,277,281,288,290,296
accentuation,207,209,213,215,242,245,246,247,262,266,267,268,269,273,284,296
anaphore,247,291,296 Antoine,223 atone,273 Baudelaire,267,269 Benloew,213,217,245,246,247,248,29
6 Benveniste,234 Betonung,262 Biville,261 Brogan,262,266 Charpin,211,220,261 Chevalier,224,225 Cicéron,212 cliché,207 Collart,209,222,223 configuration,237,244,251,252,256 conjonction,221,280 connecteur,222 contraccentuel,275 contre-
accent,211,261,262,266,268,269,271,272,273,274,277,279,281,284,288,289,291,292
Courtois,265,268 Cousin,211,261 Cupaiuolo,288,289 Dangel,222,247,248,261,296 De Groot,261 Desbordes,247 Dessons,265,268 diction,221,247,261,296 écho,212,269 élision,252,253,255,256,257,279,281,
284,288,289,290 emphase,247,248,249,296 enclise,280,281,290 enclitique,280,281,284 enjambement,284
énonciation,247 Ernout,288 Fitzgerald,228 Fordyce,228 Garde,262 Gouvard,215,265 Guillemin,221,222,223 Hugo,208,213,218,219,224,267 ictus,248,266,271,277 Iso,254 Jullien,271 Lacheret-Dujour,265 Lenchantin,235,279 locution,296 loi de Wackernagel,280 Loomis,227,228,229,235,240 Lösener,268,269 Lucot,221,223,271,272,273,274,288,2
89 Luque,240,241 Maingueneau,217,218 Marina Sáez,240,241,243,254 Marouzeau,217,218,220 Mazaleyrat,265 Meillet,218 Meschonnic,213,223,224,225,262,263
,265,266,267,296 mètre,228,267 métrique,208,211,212,213,214,215,21
7,227,229,236,240,242,254,258,262,265,267,271,295
monosyllabe,205,207,209,211,212,213,215,217,219,228,242,249,250,254,256,267,269,274,279,281,284,288,290,291
Morier,262,263,267,269,296 mots-outils,213,217,218,222,223 Nougaret,235,240,241 oralité,222,224,239,252 parlé,269,271,272 Perret,214,221 proclise,245,246,247,295,296 proclitique,247,296 prononciation,220,261,288
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
298
prose,208,222,265 prosodia,208 Quicherat,211,212 Quintilien,211,212,213,214,215,219,2
20,221,245,246,261,295 Radford,245 récurrence,247,248,252 relief,249,250,255,256,257 rhétorique,208,220,221,247,248,292,2
96 rythme,205,208,211,214,215,220,222,
253,256,263,272,273,295 scansion,262 Scoppa,265 Soubiran,212,271,288,289
stress,262,266 Tordeur,212 vers,207,209,212,214,215,218,219,22
0,222,223,227,228,229,233,234,235,236,237,239,241,242,243,244,245,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,261,262,266,268,269,271,272,273,274,277,278,279,281,287,290,291,292
voix,213,219,221,222,223,236,278,279,291
Vossius,212,262 Wackernagel,280 Weil,245,246,247,248,296 Wilkinson,245