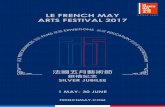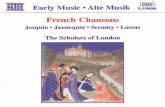Intérêt de l'adéno-amygdalectomie chez l'enfant drépanocytaire
L'oralité chez Catulle - doct. diss. - part 4 (French)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of L'oralité chez Catulle - doct. diss. - part 4 (French)
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
301
Bibliographie spécialisée
ADAM J.-M., Les textes : types prototypes. Récit, description, argumentation, explication et
dialogue, Paris, 19973.
— Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, Paris, 1999.
BARATIN M., DESBORDES F., Lʼanalyse linguistique dans lʼantiquité classique. 1. Les
théories, Paris, 1981.
BAZZANELLA C., GARCEA A., « Vincoli testuali e funzioni dei signali discorsivi in Gellio »,
Lingua e stile, 34,3,1999, 403-430.
BIVILLE F., (1996a) « Niveaux de voix et relations spatiales. Énonciation, lexique et
syntaxe », in Bammesberger A.und Heberlein F. (hrsg.), Akten des VIII. internationalen
Kolloquiums zur lateinischen Linguistik, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 1996, 125-
137.
— (1996b) « La voix signifiante », Les structures de lʼoralité en latin, C.Moussy et J.Dangel
(éds.), Paris, 1996, 147-154.
— (1996c) « Le statut linguistique des interjections en latin », in Hannah Rosén (ed.),
Aspects of Latin. Papers from the seventh International Colloquium of Latin Linguistics
(Jerusalem, 1993), Innsbruck,1996, 209-220.
— (1996d) « Ce que révèle la voix. Analyse de quelques voix romaines transmises par la
littérature latine », Bolletino di studi latini, 26,1 , 1996, 55-68.
— « Les modalités interjectives (Virgile, Énéide) », in Fruyt M. et Moussy C. (éds.), Les
modalités du latin, Lingua latina 7, Presses de lʼUniversité Paris-Sorbonne, 2002, 275-289.
CARRATELLO U., « Catullo e Giovenzo », Giornale Italiano di Filologia, 47, 1995,
— « Il carme 11 di Catullo », Giornale Italiano di Filologia, 48,1, 1996, 55-77.
CUPAIUOLO F., Studi sullʼesametro di Catullo, Napoli, 1965.
DELLA CORTE F., Personaggi Catulliani, Firenze, 19762.
DUCROT O., Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique, Paris, 19802.
— Le dire et le dit, Paris, 1984.
DUCROT O., SCHAEFFER J.-M., Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du
langage, Paris, éd. Points-Seuil, 1999.
DUPONT F., Le théâtre latin, Paris, 1988.
— Lʼinvention de la littérature. De lʼivresse grecque au livre latin, Paris, 1994.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
302
— Lʼorateur sans visage. Essai sur lʼacteur romain et son masque, Paris, 2000.
GRANAROLO J., Lʼœuvre de Catulle. Aspects religieux, éthiques et stylistiques, Paris,
1967.
HAND(IUS) F., Tursellinus seu de particulis Latinis commentarii, I-IV, Leipzig, 1829-1845,
(réimpr. 1969, Amsterdam).
HERSCHBERG-PIERROT A., Stylistique de la prose, Paris, 1993.
HOFMANN J.-B., El latin familiar, traducido y anotado por Juan Corominas, Madrid, 1958
(trad. de Lateinische Umgangssprache, Heidelberg, 19512).
HOLTZ L.,« Les parties du discours vues par les Latins », in Les classes de mots.
Traditions et perspectives, Lyon, 1994, 73-92.
LUQUE MORENO J., El dístico elegíaco. Lecciones de métrica latina, Madrid, 1994.
MAINGUENEAU D., Lʼénonciation littéraire II. Pragmatique pour le discours littéraire, Paris,
19972.
MARINA SÁEZ R.M.a, La métrica de los epigramas de Marcial. Esquemas rítmicos y
esquemas verbales, Zaragoza, 1998.
MARINONE N., Berenice da Callimaco a Catullo, Roma, 19841, 19972.
MILITERNI DELLA MORTE Paola, « La funzione della interiezione nella elegia di Tibullo e
di Properzio », Bolletino di Studi Latini, 1995, 25 (1), 35-58.
MONTEIL P., Éléments de phonétique et de morphologie du latin, Paris, 1986.
PERROTTA G., Cesare, Catullo, Orazio e altri saggi. Scritti minori I, Filologia e critica 11,
Roma, 1972.
POGGI I., Le interiezioni, Torino, 1981.
PLANTADE E., « Témoignage des grammairiens latins et pratique catullienne : sur le statut
accentuel de conjonctions telles que at, nam et sed », in Estudios de métrica latina. Jesús
Luque Moreno y Pedro Rafael Díaz y Díaz (eds.), Granada, 1999, vol.2, 781-797.
PUGLIARELLO M., « Interiectio : espressivita e norma nella teoria greco-latina », Bolletino
di studi latini 26,1, 1996, 69-81.
RADICI COLACE P., « Mittente-Messagio-Destinatario in Catullo tra autobiografia e
problematica dellʼinterpretazione », in Arighetti G. e Montanari F. (edd.), La componente
autobiografica nella poesia greca e latina : fra realtà e artificio letterario, Atti del convegno di
Pisa 16-17 maggio 1991, Pisa ,1993, 241-253.
SALVATORE A., Studi Catulliani, Napoli, 1965.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
303
SLUITER I., Ancient grammar in context : contributions to the study of ancient linguistic
thought, VU University Press, Amsterdam, 1990, 173-245.
TRABANT J., « Gehören die Interjektionen zur Sprache ? », in H.Weydt (ed.), Partikeln und
Interaktion, Tübingen, 1983, 69-81.
TRAINA A., Poeti latini (e neolatini), Bologna, 1975.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
305
Délimitation de la catégorie
Il sʼagit dʼune classe de mots qui a un statut établi depuis la grammaire
latine antique, comme lʼindique Frédérique Biville (1996c). À la suite de cet
auteur, nous distinguons les « mots interjectifs » des « énoncés interjectifs »
(1996c, 210-211). Nous ne traitons ici que du cas dʼune partie des premiers,
car ceux-ci se subdivisent en deux sous-classes (1996c, 211), les
« interjections primaires » (mots qui ne sont jamais quʼinterjectifs) et les
« interjections secondaires » (mots qui viennent dʼautres catégories
lexicales). Nous ne retenons dans notre étude que les « interjections
primaires » monosyllabiques.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
307
Les testimonia antiques sur lʼaccentuation des
interjections
Les testimonia, assez nombreux, concernant lʼaccentuation de ces partes
orationis ont été commodément rassemblés par Schöll (197-201). Les
attestations directes de la problématique accentuelle ne commencent
quʼavec lʼartigraphie. Une remarque essentielle court dʼun auteur à lʼautre : il
nʼ y pas de certus accentus qui sʼapplique à la catégorie (Diomède, Donat,
pseudo-Sergius, Cledonius, Priscien). Cela signifie que, pour ces
grammairiens, les interjections ne suivent pas de règle (Biville, 1996c, 217).
Ce qui a pour conséquence que la nature de lʼaccent (aigu, grave,
circomflexe) et sa place sont douteuses. La formulation de Diomède1 laisse
ainsi voir une certaine perplexité, et même un aveu dʼimpuissance : « On
peut respecter les accents des mots indigènes (integris dictionibus), mais
ceux des verbes étrangers et des noms barbares (tout particulièrement des
interjections) ne sont aucunement fixes. En effet, pour ces mots-ci, il nʼexiste
absolument aucune règle dʼaccentuation fixe, puisque, de lʼinforme, il serait
absurde dʼexiger une logique dans lʼaccentuation. »
Chez Donat apparaît aussi lʼexpression de « mots hors-norme » (uoces
inconditae) qui semble bien être lʼantithèse des « mots indigènes » de
1 Schöll,197, CLXVa; GLK 433,31 s. : Accentus in integris dictionibus obseruantur, in peregrinis autem uerbis et in barbaris nominibus, maxime in interiectionibus nulli certi sunt. In his enim maxime accentuum lex certa esse non potest, cum sit absurdum a turbato tenoris exigere rationem.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
308
Diomède : « Les accents des interjections ne peuvent être fixes, comme
ceux de presque tous les autres mots (aliis uocibus) hors-norme (inconditas)
que nous trouvons. »2. Nous interprétons ici uox incondita comme étant
lʼexpression de ce qui dans la langue nʼa pas été formalisé, « civilisé »,
« domestiqué » sur le modèle, par exemple, des lexèmes sujets à la flexion,
qui ressortissent, eux, aux integrae dictiones (Diomède).
Précisons que lʼinterprétation de cette expression a été très discutée ; sur
cette question, le point de vue qui nous semble le plus pertinent est celui dʼ
Ineke Sluiter (1990) et non celui de Pugliarello (1996). I. Sluiter critique les
vues de plusieurs auteurs modernes qui consiste à identifier uox incondita et
uox confusa3. Selon I. Sluiter (1990, 199-201), la notion de uox incondita est
notamment liée aux spécificités accentuelles de cette catégorie hétérogène 2 Schöll,197, CLXVc; GLK 392,2 s. : Accentus in interiectionibus certi esse non possunt, ut fere in aliis uocibus, quas inconditas inuenimus. Dosithée a la même remarque (GLK 53,5 s.). Cledonius leur fait manifestement écho (Schöll,198, CLXVg; GLK 79, 15 s.) : Accentus interiectionibus : in his interiectionibus non possunt certi accentus repperiri, quae inconditis uocibus constant, ut heu, ua. Priscien décerne un satisfecit à Donat et le glose (Schöll, 198, CLXVh; GLK 91,20 s.) : Optime tamen de accentibus earum docuit Donatus, quod non sunt certi, quippe cum et abscondita uoce, id est non plane expressa, proferantur et pro affectus commoti qualitate confunduntur in eis accentus. Apparemment, les auteurs renvoient les mots interjectifs à un langage « anarchique », cʼest-à-dire, dans la perspective varonnienne, précédant lʼintervention des impositores, les fondateurs de la langue, que sont les reges et les poetae (cf.LL V,1; V,9; VII,1). Cʼest la raison pour laquelle nous avons traduit uoces inconditas par « mots non-normés », ce qui veut notamment dire quʼils nʼont pas subi le travail de « domestication » que les grammairiens imposent au langage. Lʼexpression uox incondita désignant la forme de lʼinterjection apparaît chez Donat, dans lʼArs minor : Interiectio quid est? Pars orationis significans mentis affectum voce incondita. 3 Pour Pugliarello (1996, 76), lʼadjectif incondita est synonyme de confusa et se rattache donc à lʼopposition vox artiulata/vox confusa que lʼon trouve dans les chapitres De uoce des artigraphes (cf. Desbordes,1990, 101 ss.). Sluiter (1990, 193) confirme bien lʼopposition vox confusa/ vox articulata : « In the chapters De voce the grammarians distinguish a subgroup called vox confusa. By this term they mean disordered and inarticulate sound which cannot be written. ».I.Sluiter ne sʼaligne pourtant pas sur le point de vue de Pugliarello et Desbordes : admettant que « incondita is virtually synonymous to confusa » (1990, 193), elle ajoute cette remarque critique : « There is a tendency in modern research to equate vox incondita and vox confusa without more ado. But, as will be seen from this brief survey, in that case a contradiction is forced on the grammarians which to all appearances they themselves sought to avoid. I suggest, therefore, that the grammarians preferred to describe the interjections as uox incondita… » (1990,194).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
309
que représentent les interjections. Cet auteur nuance lʼidée que cette notion
serait due à la réflexion stoïcienne sur lʼorigine du langage (Pinborg, 1961).
Elle précise que sʼil doit y avoir une source philosophique, elle est plutôt à
chercher chez les Épicuriens, qui accordent une place aux interjections, au
contraire des Stoïciens (1990, 245).
Toutefois, si lʼensemble des auteurs antiques se rallie à cette doctrine
générale, la trace de quelques divergences de détail subsiste (Sluiter, 1990,
200-201). Et ces divergences concernent lʼaccentuation des interjections
disyllabiques4.
Cledonius (Schöll, 198, CLXVg) admet une accentuation certaine, sur la
syllabe finale (par analogie avec une possible accentuation grecque sur la
finale), pour des mots comme papaê ou attát.
Bède, citant Audax (Schöll, 199, CLXVm ; GLK VII,241,9-13), présente les
mêmes exemples.
Audax écrit explicitement, à la fin de sa Recapitulatio de accentibus (GLK
VII, 361, 9-12) : « toutes les interjections, parce que nous les avons en
commun avec la langue grecque, prennent, pour cette raison, lʼaccent sur la
syllabe finale : papae, attat, ehem ; quant aux autres, elles reçoivent, de la
même manière, lʼaccent aigu ou circonflexe sur la dernière syllabe. » :
interiectiones omnes, quia de graeco sermone mutuati sumus, ideo in
4 Cependant, I. Sluiter (1990, 200-201) relève aussi la convergence entre Clédonius et Priscien, qui affirme que les interjections interprétables peuvent être accentuées selon la règle générale : « As soon as interjections begin to resemble civilized parts of speech, they promptly start behaving like proper ones and agree with some kind of analogy. »
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
310
nouissimis syllabis fastigium capiunt, ut papae, attat, ehem; et ceterae
similiter uel acutum uel circumflexum in ultima sumunt.
Cledonius va dans le même sens quand il écrit (V, 79, 17-18) : « Sont fixes
les accents des mots qui sont analysables, comme papae, attat » : certi sunt
accentus in istis quae possunt distingui, ut papae, attat. Il oppose ces deux
interjections à heu, ua (quae inconditis uocibus constant ; 79,16-17). Cela
éclaire le sens que nous avons donné à inconditus : ces monosyllabes
interjectifs appartiennent à la « sauvagerie », à la nature non civilisée, parce
quʼils sont inanalysables.
Mais Priscien réaffirme lʼambiguïté accentuelle de papae : « Mais
lʼinterjection nʼobserve aucune règle certaine ; en effet, elle sera accentuée
dʼun aigu ou sur la syllabe finale ou sur la syllabe médiane, comme papae,
euax. »5.
Et, après lui, lʼauteur du Commentarium Einsidlense in Donatum : « Il nʼy a
pas de différence entre dire papaé, avec lʼaccent sur la finale, ou pápae,
avec lʼaccent sur la pénultième. De même pour les autres interjections. »6.
En définitive, les réserves des grammairiens latins concernant
lʼaccentuation des interjections montrent quʼils ne considèrent pas ces partes
orationis comme inaccentuées. Les options contradictoires de certains
auteurs en font foi. Ils se trouvent désemparés du fait de lʼinadéquation des
5 Schöll, 199, CLXV l; GLK 528,34 s. : Interiectio uero nullam certam regulam seruat; nam et in fine et in medio acuetur, ut papae, euax. 6 Schöll, 199, CLXVp; Ann. Helv. p.266,9 : Nihil autem differt, utrum papaé accentu in fine posito dicatur, an in paenultima pápae. Similiter in ceteris.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
311
règles générales à cette catégorie de mots, dont ils ne peuvent cependant
pas récuser lʼexistence autonome.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
313
Lʼaccentuation des interjections latines aux yeux
des modernes
La doctrine de lʼabbé Prompsault (1842, 993), qui compile une large
bibliographie, est la suivante :
« 1. Les anciens, comme nous venons de le dire dans le paragraphe
précédent, mettaient les mots barbares et les interjections en dehors des
règles de lʼaccentuation, laissant à chacun le soin de les prononcer à sa
fantaisie.
2. Alexandre de Villedieu voulait quʼon donnât lʼaccent aigu à la finale de
tous les mots barbares qui nʼétaient pas déclinés, comprenant dans ce
nombre les mots hébreux.
3. Despautère blâme cette doctrine et dit quʼil est plus convenable de
soumettre aux règles de lʼaccentuation latine les mots barbares dont
lʼaccentuation propre nʼest pas connue. Quant aux interjections, il laisse à
chacun la liberté de les accentuer à son gré. Je ne partage pas entièrement
son avis sur ce dernier point, bien que ce soit celui des anciens [lʼitalique est
de nous].
4. Les interjections monosyllabiques devaient avoir nécessairement lʼaccent
aigu ou lʼaccent circonflexe, selon quʼelles étaient ou naturellement brèves
ou naturellement longues, et, dans tous les cas, elles ne pouvaient jamais
recevoir lʼaccent grave.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
314
5. Les interjections disyllabiques devaient prendre lʼaccent sur la première
ou sur la dernière syllabe, selon la nature du sentiment quʼelles exprimaient.
6. Pour le reste, je pense comme Despautère, quʼil faut conserver aux mots
barbares leur accentuation propre, si on la connaît, et, dans le cas où on ne
la connaîtrait pas, les soumettre aux lois de lʼaccentuation latine. »
Tout en respectant, dans lʼensemble, les prescriptions des grammairiens
antiques, lʼabbé Prompsault introduit lʼidée moderne dʼun accent non pas
anarchique (point 3), mais affectif (point 5), et dont la place dépendrait du
sentiment exprimé. Pour lui, il nʼest donc nullement question de faire des
interjections des mots atones.
Weil et Benloew nʼapportent rien au débat, parce quʼils se retranchent
derrière les aveux dʼimpuissance des grammairiens anciens (1855, 58) :
« Reste une dernière espèce de particules, les interjections. On dit quʼelles
nʼavaient pas dʼaccent fixe; des cris et des exclamations ne se soumettent à
aucune règle : Quum sit absurdum a turbato tenoris exigere rationem [n.2,
Diom., p.428. Prisc., p.1025, 1300]. »7
Il ne semble pas que cette catégorie grammaticale soit considérée, au XXe
siècle, comme atone, ou relevant dʼune quelconque cliticité. J.
Hellegouarcʼh, par exemple, classe les interjections parmi les « termes
autonomes » (1964,19). Si les témoignages antiques nʼont guère fait lʼobjet
dʼévaluation, cʼest que, sans doute, cette catégorie ne sʼest pas trouvée au
7 Toutefois, lʼabbé Viot, qui écrit un ouvrage de vulgarisation dans le sillage de ces auteurs, associe les interjections à des partes considérées comme proclitiques : « Les proclitiques sont ou des prépositions, ou des adverbes, ou des conjonctions, ou des interjections, ou des adjectifs relatifs. » (1857, 15).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
315
centre des enjeux reconnus par la grammaire historique. Parmi les rares
auteurs du XXe siècle à risquer une doctrine explicite, quoique confuse, il faut
mentionner Mariano Bassols de Climent, qui suit de près les testimonia. Cet
auteur affirme, en surévaluant un peu la position de Cledonius, que les
interjections relèvent généralement de lʼoxytonie, mais, aussitôt après, se
référant implicitement à Priscien, il admet les déplacements dʼaccent et
conclut que la « liberté » accentuelle dont elles font preuve est due à leur
« nature emphatique »8.
Dans son récent article, F.Biville (1996c, 217) propose ce que nous
recevons comme une interprétation linguistique du flottement phonétique des
interjections : « Manifestation de la subjectivité du locuteur, leur volume
sonore est laissé à lʼappréciation de ce dernier, qui peut leur donner diverses
inflexions et modulations, correspondant aux divers types dʼémotions et,
jouant sur la durée dʼémission et la force dʼexpiration, une forme plus ou
moins emphatique, proportionnelle à lʼintensité des émotions. ». Cet auteur
montre ainsi que la perplexité des grammairiens latins est due, non pas à
lʼirrémédiable irrationalité des faits donnés, mais bien à une lacune théorique
qui les empêche de voir le fonctionnement de la catégorie.
Ce ne sont pas les testimonia qui influencent le jugement des modernes
dans ce sens; comme on lʼa vu, ils ne sauraient être allégués. Le guide, ici,
est lʼintuition que la fonction linguistique de tels mots est intimement liée à
8 Mariano Bassols de Climent, Fonetica Latina, Madrid, 19928, 45 : « Las interjecciones tampoco, por lo regular, se atienen a la regla general de acentuación. Generalmente son oxítonas; así, attát, papáe, pero a veces puede el acento afectar a las otras sílabas; así, áttat, pápae. En realidad las interjecciones, dada su índole enfática, muestran gran libertad respecto a la posición del acento. »
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
316
leur rayonnement phonique dans le discours. Leur présence nʼest
normalement justifiable quʼen situation nettement illocutoire.
Les sources anciennes ne mettent pas en doute le caractère accentué des
interjections primaires. Et les auteurs modernes, se fondant sur leur fonction
linguistique, nʼont pas de raison de le récuser, bien au contraire. Il est
probable que les polémiques antiques tiennent à deux facteurs : dʼune part, à
la confusion entre interjections primaires et secondaires, dʼautre part, à la
concurrence entre accentuation originelle (dans le cas de dissyllabes grecs
oxytons) et interprétation latine.
Mais on peut aussi se demander si, au delà de ces deux causes, la
polémique et lʼincertitude qui entourent les interjections disyllabiques, ou
polysyllabiques, nʼont pas une source plus profonde, qui dépasserait le seul
problème de la polarité accentuelle grec/latin. Les interjections, en général,
et les disyllabiques, en particulier, ne seraient-elles pas lʼindice dʼune
accentuation qui nʼa été théorisée ni par les auteurs grecs ni par les auteurs
latins ?9
En effet, quant à lʼaccentuation des dissyllabes que nous avons vus
apparaître comme exemples dans la discussion, une possibilité demeure
inenvisagée, à savoir que les différentes options des grammairiens soient
toutes également pertinentes, parce que toutes également partielles. En
dʼautres termes, on pourrait également penser que ce qui trouble les
grammairiens est la présence dʼune accentuation « affective », cʼest-à-dire
9 Voir la conclusion de notre deuxième partie, et Marouzeau (1955) pour lʼidée dʼun « accent dʼexpressivité » en latin.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
317
dʼun accent de discours qui porterait sur toutes les syllabes du mot interjectif.
Ainsi, on dirait, dans le discours réel, non pápae ni papaê, mais bien pápaê.
Et, de la sorte, sʼexpliquerait la conscience quʼont les grammairiens anciens
dʼune catégorie marginale au point de vue accentuel, car composée de
uoces inconditae, de mots « sauvages », irréductibles, en tant que tels, à la
règle générale dʼaccentuation.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
321
La voix dʼAttis
63,50
Les trois occurrences dʼinterjections primaires du c.63 (63,50 bis; 63,61) ont
la particularité dʼêtre localisées dans le deuxième passage de discours
rapporté du poème (63,50-73), cʼest-à-dire que leur énonciateur est Attis,
personnage mythique. Ce personnage se trouve dans une situation
dʼarrachement par rapport au monde qui lʼa vu naître et grandir, du fait de sa
nouvelle identité sexuelle, brusquement matérialisée dans le poème par
lʼaccord du participe au féminin (63,11adorta)10.
Ce passage, maintes fois cité, maintes fois commenté, peut être caractérisé
comme un long lamento du personnage, contrastant avec le premier
passage de discours rapporté (Syndikus,1990,89-90). Le texte de ces deux
vers où apparaissent les interjections est assez sûr et lʼon peut donc
commenter celles-ci comme lʼouvrage même de Catulle et non comme des
reconstructions plus ou moins conjecturelles11 .
10 Le changement de genre, attesté dans les mss, a été quelquefois considéré comme une fantaisie de copistes. Pour H.Bardon, qui suit en cela O.Weinreich (Mélanges Cumont I, 481-483), il sʼagit bien « dʼun effort très conscient de Catulle pour exprimer lʼambiguïté physique dʼAttis émasculé et les troubles psychiques causés par la castration » (1970, 128 n.1). 11 Notons, malgré tout, une correction graphique qui concerne le début du vers 61: lʼinterjection a été refaite par un humaniste (Italus ?), et ainsi conservée depuis, alors que les mss. G et R donnaient la leçon ah et O la leçon ha (Bardon,1970,128). F.Biville (1993, 214) : « Quant aux interjections primaires, leur signifiant est parfois mal fixé : la plus primitive des interjections, a(h), se rencontre sous quatre formes : a, ah, ha, aha. ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
322
Dans le vers 50, lʼinterjection o est présente deux fois 12. Mais de quel o
sʼagit-il exactement ? Car beaucoup de dictionnaires possèdent deux
entrées, avec deux graphies différentes, lʼune pour lʼemploi « absolu » de o,
lʼautre pour son emploi syntagmatique13.
Comme le Gaffiot, lʼOxford Latin Dictionary distingue lʼemploi « absolu » de
lʼinterjection en utilisant la graphie oh; cette distinction graphique semble
reposer sur lʼanalogie avec la différenciation accentuelle des deux emplois
(syntagmatique et absolu) qui existe en grec. Déjà, certains grammairiens
anciens comme Audax (cf. Cledonius, GLK V.78.27-79.5), ont noté les
différents emplois de o, sans pour autant en faire une question de graphie
(GLK VII.356.18-357.1) : «Si lʼon prononce o avec un état dʼâme donné,
cʼest-à-dire avec emphase, ce sera une interjection, par exemple, “O toi la
seule image qui me reste de mon Astyanax !”. Mais si lʼon prononce o suivi
dʼun accusatif, ce sera un adverbe exclamatif, ainsi “O triste condition !” et “O
guerre éminemment redoutable !”. Et, en effet, si lʼon prononce o sans
emphase, ce sera un pronom ou un article précédant le vocatif, ainsi “o iste”,
“o ille”. »14
12 Lʼinterjection o apparaît dans deux fragments de poèmes latins en mètre galliambique (Loomis, 1972,124) : Ades, inquit o Cybebe, fera montium dea,/ades et sonante typano quate flexibile caput. (Mécène); O qui chelyn canoram plectro regis Italo… (incertus). 13 Nous pensons, pour notre part, comme F. Biville (2002, 282 n.6), quʼil sʼagit bien de deux emplois du même mot. 14 O, si cum animi adfectu proferatur, hoc est per suspirationem, erit interiectio, ut puta “O mihi sola mei super Astyanactis imago” [En. III,489]. Si uero o ad accusatiuum casum proferatur, erit aduerbium exclamantis, ut “o condicionem miseram” et “o bellum magnopere pertimescendum”.Nam si o simpliciter proferatur, erit pronomen uel articulus uocatiui casus, ut “o iste”, “o ille”.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
323
La spécificité des emplois syntagmatiques de o nʼempêche pas certains
grammairiens dʼen rester à la définition canonique de lʼinterjection comme
expression dʼaffect ; ce faisant, ils prêtent à celle-ci une valeur qui ressortit
plutôt au syntagme lui-même : « et on ne peut attribuer à ce terme une
signification unique, parce que ses emplois interjectifs varient; en effet on
peut lire un o de douleur, comme “Oh ! si Jupiter me rendait mes années
écoulées“, et un o de colère comme “O trompeurs !”, etc. »15
Lʼinterjection, ici, nʼest pas employée de façon autonome ; elle appartient à
un syntagme exclamatif dont elle constitue lʼattaque : o mei creatrix / o mea
genetrix. Or, syntaxiquement, lʼinterjection nʼest pas nécessaire : le cas
vocatif est suffisant pour exprimer la modalité exclamative (Ernout/Thomas,
19532, §18-19). Même si parfois lʼadjonction de lʼinterjection permet de
surmonter lʼambiguïté vocatif/nominatif, ce ne peut pas être ici son efficacité
première, parce que la narration (63,49) désigne au préalable lʼallocutaire
dʼAttis (Patriam allocuta est).
Cependant, si elle nʼest pas la marque syntaxique de lʼexclamation, les
marques casuelles prenant en charge ce rôle, lʼinterjection fonctionne un peu
comme un modalisateur de lʼexclamation. Selon nous, elle a pour effet de
faire entrer lʼexclamation dans un registre rituel, soit social soit religieux.
Ainsi la valeur phatique de lʼinterjection signale une démarche particulière de
lʼénonciateur : il fait ici la démarche dʼentrer en contact, ce qui le met dans
15 et haec pars non potest proprium nomen unius cuiusque significationis tenere, eo quod uariae interiectiones sunt : nam o dolentis legitur ut : ʻo mihi praeteritos referat si Iuppiter annos,ʼ [En. 8,560] et irascentis, ut ʻo callidos hominesʼ et similia. (Servius, GLK IV, 443, 23-27)
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
324
une situation de demandeur, et, implicitement, signifie que lʼallocutaire est
situé à un niveau plus élevé, dans une relation de parole qui sʼengage sur
une mode inégalitaire. Dans le cas dʼAttis, il ne sʼagit pas dʼun simple salut,
mais plutôt dʼune parole qui sʼinscrit dans le champ religieux de la
supplication16. Lʼinvocation de la patrie peut en effet supposer un syntagme
exclamatif commençant par lʼinterjection : o Troia, o patria, o Pergamum, o
Priame periisti senex (Plt., Bacch . 933) ; o pater, o patria, o Priami domus
(Enn., Scaen. 92). Mais, dans le vers de Catulle, ce nʼest justement pas le
mot patria qui est inséré à lʼintérieur du syntagme débutant par lʼinterjection,
mais une glose de ce mot qui insiste sur lʼaspect maternel de lʼallocutaire
(creatrix, genetrix).
La narration construit dès le vers 49 le type de voix qui va être celui dʼAttis.
On nous dit alors quʼil va sʼagir dʼune vox maesta 17 (« une voix endeuillée »).
Lʼeffet même de lʼénonciation est caractérisé par lʼadverbe modalisant
allocuta est, cʼest-à-dire miseriter. Compte tenu de la redondance de ces
informations, on peut dire avec vraisemblance que lʼauteur crée lʼattente dʼun
syntagme exclamatif du type o patria, attesté, comme on lʼa vu, dans la
16 Le premier discours rapporté dʼAttis sʼinscrit explicitement dans le registre du chanté, avec lʼaccompagnement du tambourin (63, 8-11; 63,27). Le verbe alloqui , utilisé pour caractériser le deuxième discours rapporté ne suppose pas, au contraire, de voix chantée, mais nʼexclut pas, compte tenu du contexte de supplication, une cantillation de type rituelle. Notons que les moyens métriques et rhétoriques mis en œuvre ne diffèrent que par une concentration plus grande dans le deuxième passage. 17 Les vers (63,48-49) introduisant le deuxième discours rapporté dʼAttis sont ainsi traduits par Henri Bardon (1970,128) : « là, fixant les mers désertes, yeux en pleurs, elle sʼadressa ainsi à sa patrie, dʼune voix douloureuse, pitoyablement ». Pour nous, lʼadjectif maestus nʼindique pas ici une simple douleur psychique, comme le supposent H.Bardon dans la traduction citée ou A.Ernout qui parle dʼun « voix attristée » (1964,83), mais il tend plutôt vers une valeur plus sociale, plus rituelle que nous rendons par « endeuillé(e) », car cʼest bien du deuil de soi-même, dʼune ancienne vie et dʼune autre identité sexuelle, quʼil va être question dans le discours rapporté.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
325
tragédie. Or lʼauteur fait preuve ici dʼune grande habileté ; en effet, il réalise
bien ce programme, mais dans le désordre, introduisant un décalage ; il va
même sʼefforcer de convaincre le lecteur-auditeur quʼil a affaire à un texte de
pathétique maximal.
Si la présence de lʼinterjection est préparée par la caractérisation de
lʼénonciation, rattachant le deuxième discours dʼAttis aux grands airs
tragiques, par quel biais le programme pathétique va-t-il être réalisé ?
Lʼénonciateur Attis cherche à établir un contact avec lʼallocutaire Patria, dans
le but de retrouver une partie de lui-même. Or le contact verbal est loin dʼaller
de soi : cʼest ce que veut marquer la segmentation du vers 50 en quatre
syntagmes exclamatifs. Ce vers commence par un syntagme minimal dont le
composant unique (patria), est élidé ; nous constatons donc une première
exclamation brute, inachevée, qui précède une exclamation, elle, très
ritualisée du fait de lʼadjonction du monosyllabe interjectif. Lʼitération de
lʼexclamation est elle-même signifiante de lʼéloignement extrême de
lʼallocutaire ; elle figure la possibilité de lʼéchec du contact verbal18.
18 Cʼest sans doute ainsi que lʼon peut justifier la note lapidaire de Kroll (1929,19592, 136) : « Die doppelte Anrede an das Vaterland verstärkt das Ethos. »
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
326
Lʼhabileté de Catulle consiste ici à utiliser lʼinterjection, non pas
prioritairement pour introduire lʼexclamation, qui va en effet de soi à cause de
la narrativisation de la parole, mais bien pour segmenter le côlon en deux
syntagmes exclamatifs, syntagmes paradoxalement cousus par la rythmique
de lʼélision :
Patri(a) o mei creatrix, d patri(a) o mea genetrix,19
ww q wq wqq/ ww q ww wwq
La tension rythme-syntaxe est organisée par un ordre inhabituel des mots.
Et, si grâce à sa valeur phatique, lʼinterjection a pour effet de focaliser le mot
suivant, il est intéressant de noter que cʼest la marque de première personne
(pronom mei / adjectif mea) qui est mise en valeur, et non le susbstantif.
Ainsi, cʼest la relation de lʼénonciateur et de lʼallocutaire qui fonde le
pathétique du discours ; à travers lʼallocution (« Anrede ») à la patrie, cʼest
bien à une figure éloignée, révolue, de lui-même que sʼadresse Attis.
Apparaît ici la scission interne à lʼhistoire dʼAttis que représente
lʼautocastration. Il est fort probable que Catulle nʼa pas voulu manquer de
jouer avec la voix de la notha mulier (63,27, « la femme hybride »), la voix de
castrat dʼAttis, comme dans lʼart lyrique du XVIII° siècle, se prête à des
acrobaties virtuoses. Rendre compte de ces jeux de voix suppose de
19 Le vers galliambique nʼa pas à proprement parler de césure. Toutefois un seul schéma prosodique constitue 75 % des occurrences et cette standardisation des réalisations prosodiques a pour conséquence de créer lʼattente de deux côla isosyllabiques (8/8), même si lʼon doit parfois placer la diérèse à la septième ou à la neuvième syllabe. Voir Loomis,125-127.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
327
considérer les figures accentuelles, car lʼaccent latin classique a très
probablement deux aspects, la tonalité (montée vocale vers lʼaigu) et
lʼintensité (articulation plus marquée de la syllabe).
La lecture accentuelle du vers nous paraît être la suivante :
Pátri(a) ó méi creátrix, / pátri(a) ó méa génetrix,
1 2 1 2
Selon nous, lʼinterjection monosyllabique est utilisée pour créer un contre-
accent au milieu de chaque côlon. Lʼélision permet de réduire lʼespace entre
les deux premiers accents du côlon et donc de figurer un débit rapide,
préparant la montée contraccentuelle. Notre hypothèse, ici, veut que cette
montée contraccentuelle soit la figuration du cri dʼAttis.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
328
63,61
La seconde interjection primaire du passage nʼintervient que quelques vers
après (63,61). De forme monosyllabique, comme la précédente, elle succède
à une série dʼinterrogations qui ont été caractérisées comme « affectives »
par Jean Granarolo (1967, 357-58).
Miser a! miser, querend(um) est d eti(am) atqu(e) eti(am), anime20
ww q wq wq q/ ww q ww www
Lʼinterjection a, dans sa simplicité morphologique, est, en quelque sorte,
lʼarchétype de la catégorie grammaticale introduite par les grammairiens
latins21. Ici, elle correspond parfaitement à leur doctrine fondamentale, car
elle exprime manifestement unadfectus ou motus animi. Les grammairiens lui
prêtent essentiellement lʼexpression de la colère (ira) ou de la douleur (dolor,
luctus).
Quel est dans le cas du v. 63,61 lʼaffect véhiculé ? Comme lʼindique F.Biville
(1993, 213), « La plupart des interjections sont, à lʼécrit, polysémiques. Si
lʼinterjection signale le caractère subjectif et affectif de lʼénoncé dans lequel
elle apparaît, cʼest bien souvent dans le contexte, verbal et situationnel, quʼil
faut chercher la nature du sentiment exprimé. »
20 Quelques rares éditeurs écrivent querendumst, préférant lʼaphérèse de est à lʼélision. Dans cette position du galliambe, le monosyllabe est pourtant tout à fait concevable. 21 Sur les nuances à apporter à cette idée dʼinnovation latine, voir L.Holtz (1994, 88-89).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
329
Lʼinterjection est insérée dans un énoncé exclamatif, encadrée par deux
adjectifs (vocatif/nominatif) qui renseignent à ce sujet : il y a là déploration du
sort de quelquʼun. En outre, le texte catullien donne un élément encore plus
explicite, à la suite de lʼénoncé exclamatif. Lʼemploi du verbe queri à la suite
de lʼinterjection amène à définir lʼénoncé miser a ! miser comme une querela
(lamentation). Cette glose de lʼénoncé exclamatif émane en réalité de
lʼénonciateur Attis lui-même, et fait écho à la caractérisation de la voix dʼAttis
émanant du narrateur (63, 49 maesta uoce). Ainsi, comme pour le vers
63,50, tous les éléments sont fournis au lecteur-auditeur pour décrypter
lʼinterjection et lever son ambiguïté, toute relative dʼailleurs22.
Quel est lʼénonciateur de lʼinterjection ? La place de lʼénoncé miser a miser,
en début de galliambe, suppose plutôt que lʼénonciateur soit toujours le
même, à savoir Attis, cela pour des raisons de cohésion textuelle. La
morphologie de lʼadjectif au nominatif/vocatif donne un indice sur lʼidentité de
lʼallocutaire qui permet, par déduction, dʼidentifier lʼénonciateur, et donc de
confirmer cette première analyse. En tant quʼadjectif masculin, miser ne peut
plus référer à Attis, du moins à lʼAttis corporel, que Catulle désigne très tôt
dans le texte comme un sujet féminin. Mais le texte offre une solution qui est
de considérer quʼanime, vocatif masculin, est détaché de lʼénoncé qui nous
occupe, par hyperbate. Dans ce cas, il faut comprendre que lʼallocutaire est 22 Il en va bien sûr autrement dans le texte de théâtre qui est censé reproduire le parlé. Les traits intonatifs de la voix de lʼacteur, ainsi que le contexte scénique, apportent des informations suffisant à lʼidentification de lʼaffect. Ceci a pour conséquence immédiate de permettre des énoncés réduits à lʼinterjection même : _ Dic isti _ Ah ! _Quid est ? Ecquid lubet ? (Plt.Cur 130-31). Mais lʼénoncé réduit à lʼinterjection est rare, la plupart du temps celle-ci est placée en tête de réplique : _ Perii et tu periisti. _ A, perii ? quid ita ? (Plt.Cas.633). Dʼautre part, quand lʼinterjection a est liée à un énoncé exclamatif (Ah ! me miserum, Tér. Ad. 309;329), lʼadjectif miser nʼest pas nécessaire à son interprétation, comme dans 63,61.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
330
lʼanimus et que lʼénonciateur est lʼAttis de chair, ce qui permet de gloser
lʼénoncé exclamatif sous la forme suivante : Miser a miser anime mi !
Lʼinterjection a est souvent accompagnée, hors texte dramatique, de
lʼadjectif miser, qui permet dʼinterpréter facilement le type dʼaffect quʼelle
véhicule. Ainsi dans Priap. 2,34, on trouve bien le redoublement, ou
réduplication, de lʼadjectif (a miser miser), mais le mot interjectif se trouve en
début dʼénoncé, comme cʼest aussi le cas lorsque lʼadjectif nʼest pas
redoublé (Virg.,Georg. 4,527 A miseram Eurydicen ! ; Tib. 1,9,3; Mart.7,65,3
A miser et demens ! ; Hor., Carm.1,27,18), comme cʼest enfin le cas dans le
texte dramatique où lʼinterjection est en début de réplique23.
La diversité des schémas métriques impliqués dans ces exemples permet
de justifier lʼhypothèse selon laquelle lʼénoncé a + miser serait un tour
emprunté tel quel au parlé24. Par rapport à celui-ci, lʼénoncé de Catulle se
distingue donc par lʼordre des termes; on nʼy voit pas une simple
réduplication, mais une épanalepse, au sens de Lausberg (1960, §616),
cʼest-à-dire lʼinsertion dʼun deuxième terme au milieu de la réduplication25. La
23 Dans lʼexemple cité dʼHorace, le poète, après avoir sollicité une confidence amoureuse, réagit spontanément : Quicquid habes, age, / depone tutis auribus. (intervention implicite de lʼinterlocuteur) A ! miser, /. Ces derniers mots seraient à interpréter, en termes de théâtre, comme un début de réplique. Lʼisolement en fin de vers de cet énoncé apparaît aussi comme lʼindice de son autonomie dans le parlé quotidien. 24 Lʼénoncé a + miser est parallèle à un autre tour me + miserum. Lʼimpossibilité dʼutiliser a + miserum , si elle était établie, signifierait une spécialisation énonciative de ces deux tours. Dʼautre part, il nʼest pas inintéressant dʼimaginer que le volume verbal et lʼaccentuation de ces énoncés a pu jouer un rôle dans leur fortune. 25 Lʼinsertion de lʼinterjection a dans une réduplication exclamative se retrouve chez Sénèque (Troi.1013 Semper a ! semper dolor est malignus) et Juvénal (14,45 P procul a procul inde puellae). Le phénomène peut être déjà observé, chez Virgile, avec lʼinterjection o : P procul o procul este profani (Aen. 6,258).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
331
place particulière de lʼinterjection en 63,61 doit donc être interprétée comme
un écart par rapport au parlé quʼil sʼagit de expliquer et dʼinterpréter.
Cette disposition particulière de lʼinterjection a sans doute une visée
paronomastique, comme lʼa fait remarquer F.Biville26. Manifestement, Catulle
a pour but de suggérer mísera (www) à travers míser á (wwq), même si
lʼidentité phonique ne peut être totalement réalisée. Dʼailleurs, lʼénoncé míser
á míser nʼest autrement attesté que dans un autre vers de Catulle où
lʼambiguïté sexuelle est encore présente (61,138-140) : Nunc tuum cinerarius
// Tondet os. Miser, a ! miser // Concubine, nuces da. (« Maintenant le
barbier va tondre ta tête. Pauvre, ah, pauvre mignon ! donne les noix. »,
Ernout, 74). Catulle sʼadresse alors au concubinus du jeune marié, qui va
changer de statut. Ce nʼest pas le seul argument que lʼon puisse invoquer
dans ce sens.
En effet, au plan rhétorique, lʼhyperbate, qui scinde lʼénoncé miser a
miser… anime en deux, est non seulement une figure de mots bien propre à
signifier la dualité sexuelle dʼAttis, mais elle a aussi pour conséquence de
suggérer une lecture spontanée de miser a miser comme énoncé complet,
et donc de favoriser la référence à lʼénoncé misera miser, qui, lui, explicite
morphologiquement lʼambiguïté du personnage.
Ce nouvel énoncé suggéré par paronomase implique de poser à nouveau la
question de lʼénonciateur. Car la nature paradoxale de lʼénoncé, joignant la 26 « Quant au v.61 : miser a(h) miser… (anime), si la tradition manuscrite, la métrique et lʼanalyse grammaticale invitent indubitablement à lʼinterpréter comme un ensemble de deux masculins séparés par une interjection en isotopie sémantique avec les deux adjectifs, on ne peut cependant sʼempêcher dʼévoquer la possibilité dʼune superposition phonique du féminin misera (www). » (Rapport de lʼagrégation de grammaire, 1997).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
332
référence à une réalité présente à celle dʼune réalité défunte, rend peu
probable quʼAttis puisse le prononcer au vocatif, en sʼadressant à lui-même.
Ce serait une audace difficilement concevable, dépassant les codes
rhétoriques en vigueur. De plus, on attendrait plutôt pour exprimer
lʼautodéploration un énoncé comme me miserum. Mais Catulle a eu soin de
laisser la possibilité dʼune autre interprétation : lʼinjonction impersonnelle
querend(um) est, sʼadresse autant à Attis lui-même quʼà lʼanimus, bien que
les traducteurs interprètent souvent le texte en restituant un tibi qui serait
implicite27.
La construction impersonnelle de lʼénoncé permet ainsi deux lectures du
vers :
1° une lecture logique et « monophonique » où Attis, lʼénonciateur de
lʼénoncé de début de vers, invite à son animus à se plaindre avec lui : Miser
a miser ! querendum est, etiam atque etiam, anime.
2° une lecture paronomastique et « polyphonique » où Attis invite lʼanimus,
instance transcendant la dualité féminin/masculin, à énoncer la déploration
sous la forme de lʼénoncé paradoxal que nous avons vu :« Misera, miser ! »
querendum est, etiam atque etiam, anime.
27 La traduction dʼHenri Bardon : « Malheureux, ah!, malheureux, gémis encore et toujours, mon âme ! » (1970, 128). A.Ernout (1964, 83) : « Malheureux ! ah, malheureux ! plains-toi et plains-toi encore, ô mon cœur ! ». M.von Albrecht (1995, 91) : « Weh, armes Herz, immer wieder mußt du klagen ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
333
Aucun vers du poème ne compte autant dʼélisions28. Bien sûr, on peut
interpréter cela comme la traduction du débit rapide caractérisant ici la
cantillation dʼAttis. Toutefois, lʼaspect prosodico-accentuel du discours doit
également être pris en compte. On constate alors que les trois élisions du
deuxième côlon ont pour effet de créer un parallélisme rythmique des deux
débuts de côlon 29 :
Míser á! míser… / éti(am) átqu(e) éti(am)…
ww q wq / ww q ww
Lʼattention est de ce fait attirée sur lʼécho sonore (/a/ long accentué) qui
existe entre les deux syllabes centrales. Lʼinterjection monosyllabique et la
conjonction disyllabique élidée sont toutes deux le point de départ dʼun
groupe contraccentuel qui relance la dynamique de chaque énoncé :
Míser á! míser… / éti(am) átqu(e) éti(am)…
1 0 1 2 0 1 0 1 2 0
Lʼélément central commun de ces deux groupes étant le /a/ long accentué,
lʼitération dʼune séquence prosodico-accentuelle identique apparaît comme la
réalisation de ce que dit le signifié du second côlon (« encore et toujours »).
28 On trouve deux élisions dans les parties narratives et dans les parties de discours rapporté (vers 63, 12 ; 63, 20 ; 63, 47 ; 63, 49 ; 63, 50 ; 63,56 ; 63,58 ; 63, 63 ; 63,67 ; 63, 70 ; 63, 85 ; 63, 87). 29 Cette lecture implique que lʼon considère lʼélision presque totale de la finale dans la diction.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
335
La voix dʼAriane
Dans le c.64, Catulle insère le discours rapporté dʼAriane et celui des
Parques. Ces deux instances énonciatrices émettent des interjections qui
sont, à une exception près, les mêmes que celles quʼAttis prononçaient; au
total, elles représentent quatre occurrences.
64,135
En 64,135, lʼinterjection a, dont lʼoccurrence nʼest pas contestée, pose les
mêmes problèmes de graphie que ceux que nous avons rencontrés en
63,61 : lʼapparat dʼHenri Bardon (1970,143) comporte les informations
suivantes : « a edd. : ah X m2, ad, m, ha O ».
Il sʼagit de la première apparition de lʼinterjection a dans un long passage
dont on connaît lʼimmense fortune. La fille de Minos y poursuit Thésée de sa
plainte vindicative (64,132-237). Syndikus lui consacre dix pages dans son
commentaire synthétique (1990,151-161 : « Ariadnes Klage »), étudiant
lʼintertextualité grecque30. En ressort lʼidée dʼune Ariane catullienne
beaucoup plus violente que ses avatars de la littérature hellénistique.
30 Lʼattention de la poésie aux voix féminines est un trait alexandrin, même si la poésie tragique avait largement tracé la voie : « Der Blick in das Herz einer liebenden Frau war eines der neuen Themen der Hellenistichen Dichtung. » (1990,151). Syndikus compare les motifs du texte catullien avec ceux de certaines œuvres grecques, notamment celle de Nonnos (152-154). La comparaison de lʼAriane de Nonnos (Dionysiaca 47,320- 418) et de
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
336
La source fondamentale, selon Syndikus (154, n.228), de cette Ariane
pugnace et vindicative serait plutôt la Médée dʼEuripide (465-519), il ajoute
aussi, à la suite de Klingner, Apollonios de Rhodes (Argonautiques, 4, 355-
390; cf. H.Hross, Die Klagen der verlassenen Heroiden in der lateinischen
Dichtung, Diss. München, 1958).
Catulle aurait encore accentué le pathétique par rapport à Euripide :
« Gelegentlich geht Catull sogar über Euripidesʼ Formulierungen und
Pathosmotive hinaus und verstärkt durch verwandtes in der Art dieser Rede
den pathetischen Ton. » (156).
Le fait quʼune interjection comme a intervienne dès le quatrième vers du
discours rapporté (64,135) nʼest pas sans incidence sur la perception
générale du ton prêté au passage. Dʼailleurs, cette interjection est précédée
dʼune vigoureuse apostrophe lancée à Thésée.
Lʼinterjection nʼest pas employée de façon autonome, comme elle peut lʼêtre
au théâtre. La configuration du vers 64,135 doit être examinée :
Immemor a ! T deuota Tr domum H periuria portas ?
qww q / qqw / wq / qqww qu
Comme on peut le voir, lʼhexamètre est divisé en quatre côla, par des
césures trihémimhère, trochaïque troisième et hephthémimère (triple a de
Nougaret) ; les mots sont placés en fonction de leur attaque. Dans le premier
celle de Catulle laisse apparaître des caractères fort différents : « Aber beim Vergleich mit der Partie bei Nonnos wird auch sehr deutlich, daß Catull seiner Ariadneklage einen anderen Charakter gegeben hat. Bei Nonnos hat die Klage einen sehr weichen Klang. Ariadne läßt sich von Selbstmitleid und vagen Hoffnungen überwältigen. Immer nennt sie den treulosen Geliebten mit Kose- und Liebesworten. » (154).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
337
côlon, le phonème d’attaque est vocalique ; dans le deuxième, il est
consonantique (/d/), dans le troisième et dans le quatrième, il est encore
consonantique (/d/, /p/). Lʼinterjection fait donc partie dʼun groupe métrique
avec lʼadjectif au vocatif. Ce groupe métrique doit être rapproché du premier
côlon du vers 131 par lequel commence le discours dʼAriane31 :
Sicine me…
qww q /
En début de vers, la configuration mot dactyle + monosyllabe long (qww + q)
est rare dans le discours dʼAriane. On ne la retrouve que dans un contexte
de désespoir où la récurrence lexicale est très présente.
Les vers 64,186-87 sont la clausule dʼun mouvement caractérisé par
lʼinterrogation (64,177 Nam quo me referam ? ) : Nulla fugae ratio nulla spes;
omnia muta / Omnia sunt desert(a), ostentant omnia letum. En fait, lʼanalogie
entre 64,135 et 64,187 va plus loin, car ce sont les trois premiers mots qui
sont prosodiquement semblables (avec cette nuance que le troisième est
élidé dans 64,187); la séquence est la suivante : mot dactyle + monosyllabe
long + mot bacchée (qqw). Autres occurrences de la configuration mot
dactyle + monosyllabe long : 64,150 (mot choriambique élidé); 64,157;
64,174; 64,176 (mot péon élidé).
31 On peut se demander si lʼanalogie des mots dʼattaque concerne aussi lʼaccentuation. Où placer, en effet, lʼaccent de Sicine ? On retrouve dans ce terme lʼenclitique -ne, ce qui conduirait à une accentuation anomale : Sicíne . Lʼaccentuation normale Sícine semble pourtant beaucoup plus probable, dʼune part parce que lʼon a affaire à un lexème ancien, qui nʼest plus scindable en deux éléments * sici et -ne, dʼautre part, parce que lʼanalogie prosodique des débuts de vers est suffisamment flagrante pour que lʼon crédite le poète dʼune intention dʼanalogie plus étendue encore, cʼest-à-dire accentuelle.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
338
La rareté de ce type de groupe métrique (côlon) est utilisée afin dʼencadrer
les quatre premiers vers du discours dʼAriane, qui ont un rôle dʼexposition du
thème32 : ces quatre premiers vers forment dʼailleurs un mouvement
dʼinterrogation rhétorique à tonalité particulièrement « affective » (Granarolo,
1967, 352). En rapprochant Immemor a ! de Sicine me, on peut déceler
lʼinclusion du pronom de première personne dans lʼadjectif axiologique
immemor. Ce dernier peut alors être reçu non avec sa valeur sémantique
obvie, mais comme une construction verbale où le préfixe de négation im-
est associé à une forme du pronom de personne 1 (me). Dans ce cas, on
pourrait, à lʼextrême limite, considérer quʼune lecture irrationnelle se produit,
conforme à la logique furieuse de lʼénonciatrice, qui mène à comprendre
lʼadjectif immemor comme « qui nie la réalité ou lʼidentité de lʼénonciateur ».
La prosodie de 64,135, comme on lʼa vu, autorise à lire le premier côlon en
tant quʼénoncé autonome. Lʼétude de cet énoncé révèle en effet une
organisation rythmique particulière :
Il sʼagit dʼun énoncé de structure choriambique, fermé par deux syllabes
accentuées, dont les syllabes internes sont organisées par un écho
consonantique. Sa cohésion et son autonomie sont donc très fortes.
32 Les vers centraux de ce groupe (64,134-35) ont une attaque similaire : mot dactyle + mot molosse (qww + qqq).
/í/ /m/ /m/ /á/
q w w q
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
339
Lʼénoncé ainsi formé, par anastrophe de lʼinterjection, réorganise lʼordre
prosaïque des éléments lexicaux, qui voudrait que lʼinterjection constitue
lʼattaque de lʼénoncé de manière à focaliser le mot suivant, comme cʼest le
cas dans a miser !. On attendrait alors un énoncé *á ímmemor, qui,
apparemment, nʼexiste pas pour plusieurs raisons. Dʼabord, au plan
métrique, cet énoncé fictif, de structure ionique (qqww) ne pourrait pas
occuper les deux premiers pieds de lʼhexamètre, et ne trouverait pas sa
place dans la clausule normale du même schéma métrique, ces deux
positions étant celles où lʼon attend le plus lʼinterjection.
De plus, le hiatus existant entre les deux lexèmes en ferait, malgré le
contre-accent en attaque, un énoncé peu efficace dans le parlé33.
Enfin, la probabilité de rencontrer le composé immemor hors du langage
cultivé est assez faible, ce qui distingue cet adjectif de miser, mot commun à
des socio-lexiques très divers, et de structure prosodique commode.
Ainsi divers facteurs concordent pour faire des termes recouvrant le premier
côlon un énoncé doté dʼune autonomie, une incise à lʼintérieur du
mouvement interrogatif de la phrase. On peut dʼailleurs remarquer que Virgile
utilise la même configuration dans Georg. 4,491, où le narrateur manifeste
de la compassion pour Orphée : Immemor heu ! T uictusqu(e) animi respexit.
Ibi omnis. Mais dans ce cas, la valeur dʼimmemor nʼest pas celle de 64,135.
33 Citons pourtant trois cas de hiatus après interjection de structure vocalique, provenant tous du Corpus Tibullianum : O ego c(um) adspicerem dominam, quam fortiter illic (2,3,5); O ego ne possim tales sentire dolores, (2,4,7); Sulpicia introduit une variante en utilisant lʼinterjection a : A ego non aliter tristes euincere morbos / Optarim… (4,11,3-4).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
340
Le premier côlon est isolé de façon que le glissement énonciatif soit bien mis
en valeur.
À lʼintérieur de cet énoncé-incise, les deux éléments lexicaux sont liés lʼun à
lʼautre par des procédés rythmiques. Cette solidarité rythmique des lexèmes,
appartenant à des classes différentes, nous semble de nature à suggérer un
lien sémantique entre eux.
Avant dʼaborder cette question de sémantique poétique, étudions
séparément les deux composants de lʼénoncé isolé en début de vers.
Lʼadjectif immemor est un des termes récurrents de c.64 où il qualifie
toujours Thésée ou la mens de Thésée34. En 64,135, il est utilisé à la suite
de lʼadjectif perfidus qui est vraiment le terme propre à qualifier le héros
(déchu), avec une valeur proche de celui-ci, cʼest-à-dire « oublieux de sa
parole »35.
Mais ici ce terme est choisi pour relayer perfidus, parce quʼil permet de
jouer sur deux valeurs, celle que nous avons citée, qui introduit une axiologie
religieuse, et celle de « sans mémoire », qui nʼest pas a priori porteuse
dʼinfamie. Ce jeu sur les deux valeurs est très important parce que cʼest à
travers lui que se manifeste lʼefficacité de la parole dʼAriane. Thésée
« oublie » (valeur non axiologique) les recommandations de son père, parce
34 La chaîne des occurrences est la suivante : 64, 58 (immemor…iuuenis) - 64, 123 (immemori pectore) -64, 135 (immemor) - 64, 248 (mente immemori). Trois formes casuelles du singulier sont donc exploitées, le nominatif, le vocatif et lʼablatif en -i. Encore les deux premières dʼentre elles sont-elles prosodiquement identiques. 35 Les deux adjectifs sont enocre associés dans un autre passage du recueil (c.30). Catulle sʼy adresse à Alfenus en utilisant des adjectifs au vocatif : immemor-false-dure-perfide (30,1-3). J.Granarolo (1967, 355) a montré la convergence rhétorique de c.30 avec les v.132-38 de c.64.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
341
quʼAriane, lʼayant stigmatisé comme « oublieux de sa parole », a remis sa
vengeance dans les mains des Euménides, qui sont chargées de rétablir la
justice de façon égale. Lʼusage du même signifiant pour dire les deux actes
de Thésée est donc fondamental.
Lʼinterjection est attendue, parce que le poète a, de longue main, indiqué la
tonalité du discours rapporté. Il prodigue une profusion de signes qui font
dʼAriane un personnage chez qui coexistent le luctus et la colère vindicative.
Le réveil coïncide pour Ariane, comme, dʼailleurs, pour Attis avec la prise de
conscience de son malheur.
Normalement, dans la logique de la tragédie, la première étape rhétorique
de son discours devrait être lʼautodéploration, convertie peu à peu en désir
de vengeance (dolor).
Cette phase est passée sous silence par Catulle, qui fait de lʼhéroïne un
personnage immédiatement en proie au furor (64,124 illam… furentem);
divers termes manifestent cet aspect sauvage de la vocalité : les sons
coulent dʼeux-mêmes (64,125 fudisse) du fond de la poitrine (64,125 imo…e
pectore). Cela distingue Ariane dʼAttis, dont la parole est directement
ritualisée, et sʼinscrit plutôt dans le dolor, mais aussi des héroïnes tragiques,
êtres corporels et vocaux dont le discours ne souffre pas lʼellipse. Lorsquʼil
introduit le discours rapporté dans le poème, Catulle utilise un verbe différent
pour narrativiser la prise de parole (64,130 dixisse), il indique aussi quʼil
sʼagit non pas dʼun discours autonome, mais de la fin dʼune séquence (64,
130 extremis… querelis).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
342
De là, on peut imaginer que la partie implicite du discours dʼAriane
correspondait bien à lʼautodéploration. Il prend également soin de donner
des indications sur lʼaspect non-verbal de cette parole : les pleurs qui
inondent son visage (64,131 udo… ore), les sanglots glacés quʼelle émet
(64,131 frigidulos singultus); ce sont apparemment des reliquats de sa
souffrance, qui marquent que lʼhéroïne a quitté le stade du hurlement.
Lʼadjectif frigidulos fait penser à ce que nous appelons la « colère froide », et,
par là, à une mise en œuvre « furieuse » (au sens scénique) de la
vengeance.
À cet égard, elle est très proche dʼune héroïne tragique comme Médée en
qui le dolor engendre le furor : « Ce malheur absolu de Médée qui frappe
Médée est déjà la négation dʼelle-même. Elle ne peut donc absolument pas
se résigner à lʼévénement sans sʼengloutir dans le néant. Il lui faut
combattre. Cet état de malheur actif, les Romains lʼappellent dolor (le terme
latin de dolor signifiant à la fois la souffrance et le besoin de mettre un terme
à cette souffrance par un acte de vengeance). » (F. Dupont, 1988, 54).
Le furor est à la fois lʼétape suivante et la conséquence de cet « état de
malheur actif » : « il désigne lʼétat de tout homme qui ne se conduit pas de
façon humaine […] Le furor ne relève pas de la passion, quʼil faudrait alors
opposer à la raison. […] le furieux utilise la raison et même la ruse; il est
maître de lui. » (F. Dupont,1988, 52).
Malgré lʼaffliction qui est la sienne, manifestée par lʼadjectif maestam
(64,130), et par des notations sur lʼaspect non-verbal de sa parole, Ariane
est posée en personnage pugnace. Elle demande des comptes à Thésée :
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
343
Le début du discours rapporté nʼest pas le début de la querela dʼAriane, mais
sa phase conclusive. Comme dans le début de la plainte dʼAttis que nous
avons étudiée, le discours est tout dʼabord centré sur lʼétablissement du
contact avec un allocutaire, mais ici, le contact ne passe pas par la médiation
de lʼinterjection o, qui suggèrerait une situation de demande de la part de
lʼénonciatrice. Le vocatif seul, dans un contexte interrogatif, la reprise
anaphorique de lʼadjectif axiologique perfidus imposent le projet dʼemblée
agonistique de lʼénonciatrice : Sicine me patriis auectam, perfid(e) ab aris, /
Perfide, deserto liquist(i) in litore, Theseu ? (64,132-33).
Sa parole vindicative nʼest pas sans effet, puisque Catulle présente la mort
dʼÉgée (64,241-45) comme la conséquence directe du recours aux
Euménides (64,192-201) et à Jupiter (64,171-76).
Cela fait donc que rien ne vient lever lʼambiguïté de lʼinterjection. Celle-ci
évoque en même temps la souffrance et la colère, les deux affects principaux
qui lui sont attachés selon les grammairiens.
Et cʼest sans doute pour que le lecteur ait le temps de saisir tout le
complexe dʼaffects qui se cache derrière ce monosyllabe que Catulle le place
en fin de côlon. Il y acquiert une résonance prolongée, dʼautant que la
syllabe dʼattaque du côlon suivant nʼest pas accentuée.
La solidarité rythmique des éléments de lʼénoncé crée un lien sémantique
entre eux qui peut être explicité de la manière suivante : « Puisque tu mʼas
été déloyal, je dis “ a ! “. ». Il existe bien, à lʼétat implicite, un rapport causal
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
344
entre les deux termes. On peut aller plus loin dans lʼinterprétation en tenant
compte des deux affects véhiculés par lʼinterjection. Ainsi, on peut arriver à :
1° « Tu mʼas été déloyal, donc je crie ma souffrance. »
2° « Tu mʼas été déloyal, donc je te maudis. »
Grâce à cette double potentialité de lʼinterjection, lʼénoncé-incise apparaît
comme une condensation programmatique du discours tout entier. Il montre
la réversibilité de la souffrance extrême, qui peut devenir malédiction.
Dʼautant que le reste du vers est structuré par des échos consonantiques
sous accent, ce qui teinte dʼironie menaçante lʼinterrogation rhétorique
quʼAriane adresse à Thésée.
De plus, la parole de lʼhéroïne apparaît comme dotée de la caution du
narrateur, car elle reprend avec un léger glissement paronomastique le début
du vers 64,58 : Immemor at iuuenis fugiens… Occurrence de la conjonction
at que nous étudions dans notre partie sur les conjonctions.
64,178
La seconde occurrence de lʼinterjection a (64,178) dans le discours rapporté
dʼAriane est contestée par certains éditeurs : lʼinterjection, qui correspond à
la vulgate, nʼest pas retenue par tous. En effet, Mynors, à la suite de Muret,
opère une correction qui fait passer le monosyllabe dʼune classe
grammaticale à lʼautre, imprimant at au lieu de a. Mynors doit avoir une forte
raison de suivre Muret, car il indique bien dans son apparat que la graphie a
correspond au Veronensis deperditus. Il sʼagirait donc, dans sa perspective,
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
345
dʼune erreur ancienne, transmise aux apographes et subapographes.
Toutefois Kroll (ad uers.) retient cette interjection, en disant que Catulle
lʼaime beaucoup, ce qui est un peu exagéré, si lʼon considère le nombre
finalement peu élévé dʼoccurrences dans le recueil. Il faut noter que
contrairement à ce qui se passe pour les occurrences de 63,61 et 64,135,
lʼaccord des manuscrits les plus anciens est total à propos de la graphie a de
lʼinterjection.
À notre sens, ce problème dʼecdotique mérite ici discussion, car il permet de
mieux cerner le fonctionnement de lʼinterjection, dans son rapport avec
dʼautres éléments du système de lʼœuvre.
Exposons rapidement les données du problème. Le texte de Lafaye, qui
nous sert de base de travail, est le suivant pour les vers 64,178-79 :
Idaeosne petam montes ? a ! gurgite lato // Discernens ponti truculentum ubi
diuidit aequor ? Son apparat critique ne permet pas de restituer lʼhistoire
philologique de ces vers. En revanche, la consultation de lʼédition Bardon
(1970) et de celle de Mynors (1958) apportent plusieurs informations
importantes. Dʼune part, le texte de Lafaye est directement issu des
manuscrits. Dʼautre part, il existe une tradition dʼéditeurs ne se satisfaisant
pas de la leçon des manuscrits. Cette tradition remonte aux éditions de deux
humanistes, Trincavelli (1535) et Muret (1554). Le premier dʼentre eux
supprime la conjonction ubi dans le v.179 (Bardon, 1970, 145), le second
corrige lʼinterjection du v.178 en une conjonction at (ibid.)36. Le texte de
36 Dans ce contexte, la correction de lʼinterjection, purement graphique (ah), opérée par Guarino (1521) nʼest pas du même intérêt.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
346
Mynors hérite de cette double modification, tandis que Bardon ne retient que
la première, conservant ainsi lʼinterjection. Selon Fordyce (19732, 300), qui
justifie le choix de Mynors, la leçon de V, cʼest-à-dire de lʼarchétype des plus
anciens manuscrits (Veronensis deperditus) ne donne pas de sens
satisfaisant (« no satisfactory sense »). Étrangement, ce texte insensé reste
celui de la vulgate.
Bien entendu, cʼest la correction de Muret qui est pour nous la plus
stimulante intellectuellement, même si, on peut le deviner, elle se conçoit
dans la perspective de la première, cʼest-à-dire dans un mouvement de
compensation syntaxique, où la suppression dʼune conjonction doit entraîner
lʼapparition dʼune « partie du discours » équivalente. Fordyce (ibid.) étaye le
choix de la conjonction at, dʼun autre point de vue, en disant quʼelle
« introduit souvent lʼobjection que le locuteur se fait lui-même » (« often
introduces the speakerʼs own objection »). Mais si Muret a eu lʼidée de cette
correction, nʼest-ce pas que le texte des manuscrits, reflétant celui de
Catulle37, la lui suggérait ?
Notre étude a pour but de montrer que la leçon des mss. est la plus riche,
parce quʼelle inclut en fait la référence à la lecture de Muret et Mynors.
Les deux vers corrigés appartiennent à une séquence relativement longue
qui est une délibération sur le thème « Que faire dans une situation
désespérée ? ». Cette séquence suit directement la prière à Jupiter (64,171-
37 Lʼinterjection est notamment une leçon du ms. O qui a toutes les chances dʼêtre le reflet fidèle du Veronensis deperditus parce quʼil a été copié, selon les termes de Fordyce (xxvii), « by an ignorant but conscientious scribe who had the virtue of trying to copy faithfully what he did not understand ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
347
176 : « Si seulement rien de tout cela nʼavait eu lieu ! »). Elle sʼétend du
v.177 au v.191, sʼouvrant par un groupe de trois monosyllabes longs (Nam
quo me referam : « Où donc me réfugier ? ») procédé rythmique que lʼon
trouve déjà dans le texte dʼEnnius, comme le note J.Granarolo (1967,337)38.
Elle correspond à un monologue tragique ; cʼest une parole adressée à soi-
même, bien que lʼhéroïne ait pris soin dʼalerter précédemment Jupiter, afin
dʼen faire un témoin, plutôt quʼun véritable allocutaire. Le recours désespéré
aux Euménides est introduit, immédiatement après, par la conjonction quare
(64,192), qui indique que cet acte de parole vient en conséquence de toute la
délibération.
Suivons pour lʼinstant le texte de Mynors, et voyons quelle est sa logique :
Idaeosne petam montes ? at gurgite lato // discernens ponti truculentum
diuidit aequor. (« Faut-il que je gagne les montagnes de lʼIda ? Mais
lʼétendue agitée de la mer mʼen sépare, mʼen coupe par son large gouffre. »).
Comme lʼa précisé Fordyce, la conjonction introduirait ici une objection faite à
soi-même. Ce qui signifie que les v.178-79 comportent deux unités
phrastiques. La première est une interrogative dont le verbe est au subjonctif
délibératif. La deuxième est assertive, introduite par la conjonction at, qui
suppose un mouvement argumentatif39. Cette lecture est à la fois
38 Le vers 177 a pour modèle un vers de la Medea exul (Klotz frg.272 = Vahl. 276) : Quo nunc me uortam ? quod iter incipiam ingredi ? Ennius sʼinspire lui-même directement dʼEuripide (Médée, 502) . 39 Il sʼagit dʼat « marqueur dʼopposition » (Orlandini,1994,164) : « Ce connecteur enchaîne avec le contexte précédent (p), auquel lʼénoncé “ at q ” sʼoppose. Le connecteur signale une rupture dans lʼorientation argumentative; le mouvement discursif réalisé par lʼénoncé q possède en effet une orientation contraire à celle de lʼénoncé p . Le connecteur at est partie prenante dans le processus dʼargumentation, quʼil renforce. ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
348
syntaxiquement acceptable et métriquement correcte. Toutefois, lʼexamen du
cotexte apporte plusieurs objections.
Tout dʼabord, il se trouve que Catulle nʼutilise quʼune fois cette conjonction
dans cette partie de lʼhexamètre et que ce nʼest pas dans un contexte
interrogatif40. Dʼautre part, lʼhypothèse dʼune objection faite à soi-même est
peu probable, parce quʼon se trouve dans une séquence délibérative
extrêmement formelle. Du vers 177 au vers 183, Catulle semble sʼêtre
imposé lʼinterrogation rhétorique comme contrainte dʼécriture. Lʼunité
syntaxique du passage est la phrase interrogative. Cʼest pourquoi la
suppression dʼubi et son remplacement par at sont dommageables.
Pour Ariane, aucune issue au malheur nʼest sérieusement envisageable. Il
nʼest pas fortuit, dans ces conditions, que le début de la séquence
dʼinterrogations comporte la marque de lʼinanité dʼune pareille délibération.
En effet, pour J.Granarolo (1967,336), la fin du vers 177 signifie la négation
de lʼespoir. On pourrait traduire Quali spe perdita nitor ? par « Perdue, avec
quel espoir puis-je tenir ? »41. Cette phrase est à lire rythmiquement comme
suit :
P quáli H spé pérdita nítor ?
/qq/q qww qw
40 Sensibus ereptis P mens excidit ! at t(e) ego certe (66,25). La place la plus fréquente de cette conjonction est lʼattaque dʼhexamètre. Dans le discours dʼAriane, on en compte deux exemples (64,139; 64,160). 41 G. Sabbah suggère la traduction « Sur quelle sorte dʼespoir est-ce que je mʼappuie, étant perdue ? »
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
349
Le pathétique y est extrêmement travaillé, car lʼadjectif interrogatif est
détaché du nom spe par la césure, Catulle figurant un doute de
lʼénonciatrice, caractéristique de la délibération authentique, alors que le
dernier côlon réfute toute issue heureuse. La récurrence de / pe / et le
contre-accent lient les deux mots centraux en sorte quʼils forment un
oxymore.
Cʼest donc ici que nous retrouvons le texte de la vulgate dont nous étions
parti. Au contraire de la conjonction at, lʼinterjection a est suceptible dʼêtre
utilisée comme incise, et donc de ne pas mettre en danger la structure
syntaxique de la phrase. Ainsi, sa présence ne gêne en rien le mouvement
séquentiel dʼinterrogations rhétoriques42.
De plus, comme on lʼa vu notamment à propos de 64, 135, lʼinterjection doit
être interprétée en fonction du co-texte, qui précise quel affect est à lʼœuvre.
Dans cette perspective, il apparaît que lʼun des rôles du dernier côlon de 64,
177 est bien dʼindiquer une tonalité affective, à savoir le désespoir. Et cette
indication, paradoxale dans une délibération rationnelle, nous semble avoir
pour but de préparer lʼinsertion de lʼinterjection a. On se trouve devant une
situation de dolor tragique, conduisant au furor (64, 192-201), lʼinterjection
pourrait donc être univoque, mais ce nʼest pas tout à fait le cas.
42 Comme le président du jury, Guy Sabbah, nous le fait justement remarquer, notre raisonnement pourrait être ici complété et éclairé par une comparaison avec la rhétorique des plaintes dans les Héroïdes dʼOvide.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
350
On peut en effet lire :
Idaeósne pétam P móntes H á ! B gúrgite láto
qqqw wq / qq / q/qww qq
Discérnens pónti P truculént(um) úbi B díuidit aéquor ?
qqq qq / wwq ww / qww qw
La position de lʼinterjection est extrêmement importante43, car elle
commande une mise en réseau :
1°/ Comme les deux derniers côla de 177 et 178 sont verbalement et
prosodiquement superposables, les monosyllabes spe et a sont mis en
valeur en tant que termes antithétiques.
2°/ Lʼinterjection se trouve placée à la charnière du deuxième et du
troisième côlon. Elle est métriquement détachée du mot montes, le but que
lʼénonciatrice cherche désespérément à atteindre. De lʼautre côté, elle est bel
et bien rattachée au mot gurgite, lʼobstacle concret, mais aussi la métaphore
de la perte dʼAriane. Ainsi, lʼinterjection est utilisée pour figurer le corps de
lʼénonciatrice elle-même. Ce corps penche bien évidemment du côté de la
perte; cʼest ce que figure le contre-accent orienté vers la syllabe initiale de
gurgite.
Deux interprétations de lʼaffect se présentent en conséquence. Si lʼon
considère le rapport du monosyllabe à montes, le regret dû à lʼarrachement
43 Les effets particulièrement riches que provoquent cette position du monosyllabe expliquent partiellement la position étrange de la conjonction ubi, qui pourrait fort bien, en termes prosodiques, occuper la place de lʼinterjection, comme le voudrait lʼordre prosaïque des mots.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
351
est plausible. Si lʼon considère ce qui suit a, cʼest lʼeffroi désespéré qui
sʼimpose.
3°/ Un autre lien du réseau reste à expliciter. Lʼinterjection á entre en
résonance avec lʼadjectif láto, dʼabord sur le plan phonique et accentuel,
ensuite parce quʼelle focalise habituellement un adjectif qui la suit
directement (a miser, a demens…). On a vu, à propos de 64, 135, quel effet
de sens Catulle pouvait tirer de lʼinversion de cette structure attendue. En
fait, lʼeffet de ce lien nʼest sensible que quelques vers plus tard. Catulle met
en attente la paronomase de deux mots-clausules lato (64, 178) et letum (64,
187), sémantiquement intéressante.
Pour conclure, ajoutons que lʼinterjection a, dans le texte catullien, a aussi la
possibilité de mobiliser la référence à la conjonction at, comme le montre le
rapprochement des débuts de vers Immemor at (64,58) et Immemor a ! (64,
135). En 64, 178, elle peut ainsi suggérer lʼopposition binaire entre les deux
premiers côla et le dernier, suggérer une organisation syntaxique, sans que
dʼautres éléments du réseau soient laissés de côté.
Par sa polyvalence, lʼinterjection lʼemporte poétiquement sur la conjonction.
Les corrections humanistes nous semblent refléter le désir de rendre le texte
univoque, de le ramener à une seule de ses potentialités poétiques.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
352
64,196
En 64,196, une troisième et dernière interjection est mise dans la bouche
dʼAriane. Il sʼagit de uae (cf. grec ouai ) qui fonctionne souvent sur un mode
quasi prépositionnel, étant suivi dʼun régime au datif, comme dans le fameux
uae uictis de Tite-Live 5,49,9, ou même dʼun accusatif : Dabitur pol
supplicium mihi de tergo uostro — Vae te ! (Plt.As. 481) ;Vae me, puto,
concacaui me! (Sen. Apoc. 4,3). Ce fonctionnement syntaxique de uae est
dʼailleurs à rapprocher de celui dʼheus (Biville, 1996c, 210), mais aussi de
celui dʼei (Biville,1996c, 209 ;TLL s.u.).
Pour Fordyce (19732,303), lʼoccurrence catullienne qui nous intéresse
représente un cas dʼemploi absolu de lʼinterjection (« used absolutely »). Il
étaye sa remarque dʼune série de références poétiques, tirées directement
de lʼOxford Latin Dictionary : Mantua uae T miserae P nimium uicina
Cremonae (Vir. Buc. 9,28); Huic ego uae T demens P narrabam flumin(um)
amores (Ov.Am. 3,6,101)44. Dans ces deux hexamètres, lʼinterjection est
placée au deuxième longum, cʼest-à-dire avant la césure trihémimère. Fait
44 On trouve encore une occurrence de cet « emploi absolu » dans un tout autre contexte métrique, selon lʼOLD : Cum te Lydia, Telephi / ceruicem roseam, cerea Telephi / laudas bracchia, uae, meum / feruens difficili bile tumet iecur. (Hor.,Carm.1,13,1-4). Le vers 3 où apparaît lʼinterjection suit le schéma du glyconique, mètre utilisé par Catulle dans c.61. Même si lʼon nʼa pas coutume de parler de césure dans un vers dʼune pareille longueur, remarquons que lʼinterjection est placée dans la partie clausulaire que Catulle utilise quelquefois pour insérer, en rejet, un nouveau mouvement phrastique : Commodi capere; at potest (61,63); Terra finibus; at queat (61,73). Exemples comparables en 61,68; 61,212; 61,214; 61,232. Le rapprochement le plus intéressant que cet exemple horatien puisse suggérer est bien sûr le vers 61,139, où lʼinterjection occupe la même place : Tondet os. Miser, a ! miser.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
353
dʼautant plus notable, que lʼoccurrence de uae présente la même
particularité, en 64,196. On se rappelle aussi que lʼinterjection a (64,135),
postposée par rapport à lʼadjectif immemor, occupait déjà cette position.
Même sʼil est hasardeux de fonder une analyse générale sur trois exemples,
la coïncidence dʼun type dʼemploi de lʼinterjection et dʼune position dans
lʼhexamètre a sans doute de quoi stimuler la réflexion.
Vae, en emploi « absolu », cʼest-à-dire autonome, se distingue assez mal
dʼautres interjections réputées exprimer la douleur et la peine, comme heu et
a. Dʼailleurs, Dosithée (GLK 4.424.6-8) associe uae et heu quand il parle de
lʼexpression de la douleur45. Et il nʼest pas étonnant de retrouver, dans le
cotexte immédiat de uae, les adjectifs miser et demens qui accompagnent
souvent les interjections concurrentes.
Mais revenons au texte de Catulle. Si lʼon observe uae comme la dernière
manifestion interjective du discours de lʼhéroïne, il faut noter que chacune
des trois occurrences intervient dans une phase discursive orientée de
manière différente :
1° lʼinterjection a (64,135) paraît dans une séquence adressée à Thésée.
2° lʼinterjection a (64,178) paraît dans une séquence autoadressée.
3° lʼinterjection uae (64,196) paraît dans une séquence adressée aux
Euménides.
45 Pour uae exprimant la tristesse, par opposition à uah qui exprime la joie, voir lʼanalyse du pseudo-Sergius (GLK IV 489.10-17) chez F. Biville (1996, 213).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
354
Cette dernière séquence recouvre les vv.192-201, autrement dit, constitue
la partie conclusive du discours dʼAriane. Même si les traducteurs en langue
française segmentent cette séquence en deux ou trois unités phrastiques,
elle peut, malgré tout, être lue comme un seul mouvement phrastique,
structuré par des termes de relance comme les pronoms relatifs en attaque
de vers (Quas, 64,196; Quae, 64,198), qui représentent des échos
phoniques partiels de la conjonction quare, utilisée en début de séquence
(64,192) : « Aussi, vous qui dʼune peine vengeresse châtiez les fautes des
hommes, Euménides, dont le front couronné dʼune chevelure vipérine
exprime les colères qui sʼexhalent de votre cœur, accourez, accourez vite,
écoutez les plaintes que dans mon malheur, hélas ! la passion, lʼégarement
dʼune fureur aveugle arrachent du plus profond de mes moelles. Et sʼil est
vrai quʼelles jaillissent sincères du fond de mon cœur, ne souffrez pas que
mon deuil reste impuni, mais faites, ô déesses, que, par le même oubli qui
causa mon abandon, Thésée soit funeste à son tour et à lui-même et aux
siens. » (Ernout, 92)46.
Dʼemblée, avec la conjonction citée, cette séquence finale, adressée à un
groupe dʼallocutaires, prend un tour argumentatif. Sa structure la met du côté
de la période rhétorique. Elle se réfère ainsi à la tradition oratoire qui attribue
à cette séquence du discours, la péroraison, un ethos particulier.
46 « Vous donc qui châtiez de peine vengeresse les actions de hommes, Euménides, vous dont la chevelure de serpents, couronne de votre front, darde les colères quʼexhalent vos poitrines, ici ! ici ! pressez-vous, écoutez mes plaintes, ces plaintes que le malheur, hélas !, me contraint à proférer du fond des moëlles, — sans recours, toute feu, aveugle de fureur insensée. Puisquʼelles ne naissent que trop vraies des profondeurs de ma poitrine, ne permettez pas que notre détresse soit pour rien ; mais quʼen ayant le cœur de mʼabandonner à cette solitude, Thésée, de ce même cœur, endeuille et lui-même et les siens. » (Bardon, 1970, 146).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
355
Lʼinterjection sʼinscrit dans cette période en tant quʼélément dʼune stratégie
argumentative que lʼon peut définir comme une rhétorique et une rythmique
de lʼauthenticité. Le pathétique est également présent dans cette péroraison,
mais essentiellement comme rémanence du reste du discours, et
particulièrement de la séquence de « monologue » (64,177-191) où se
trouvait insérée lʼinterjection a.
En réalité, lʼélément nouveau est bien la façon dont Ariane se présente
comme suppliante authentique, car sa vengeance est à deux conditions : elle
doit attirer lʼattention des divinités, et les Euménides doivent être persuadées
dʼavoir affaire à un malheur dʼune ampleur suffisante, en même temps que
parfaitement authentique.
La procédure phatique utilisée par Ariane reprend les éléments essentiels
du genre discursif quʼest lʼinvocation, mais avec quelques altérations. Lʼordre
normal Nom de la divinité + Phrase Relative, comme chez Accius
(Phoenissae, W 585-86 : Sol qui micantem candido curru atque equis /
flammam citatis feruido ardore explicas), est transgressé47.
47 Sur cet aspect du « style sacré archaïque » (J. Dangel), voir J.Dangel (1996,86 n.11) et A. Traina (1970,192).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
356
Lʼinvocation commence, en effet, par un groupe participial (64, 192) qui met
en valeur la caractéristique essentielle des divinités aux yeux dʼAriane, leur
compétence vindicative, grâce à un couplage des syllabes dʼattaque :
uírum P multántes uíndice
wq / qqq qww
Cʼest seulement au vers suivant (64,193) que le nom divin est détaché en
début de vers, puis déterminé par une phrase relative, selon la coutume :
Euménides T quíbus anguíno H rédimíta capíllo…
qwwq / ww qqq / wwqw wqq
Dans ce vers, les seules syllabes initiales susceptibles de recevoir un
accent sont les attaques des côla 2 et 3. Lʼaccentuation nʼa pas ici de visée
dynamique, mais véhicule plutôt quelque chose de didactique et de pesant.
Le vers suivant (64,194), sur lequel se poursuit pourtant la relative, rompt
ce lent mouvement explicatif de façon brutale :
Fróns éxpirántis P praepórtat péctoris íras
qq qqq / qqq qww qq
R P R PR P R P R R
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
357
Le v. 64,194 débute par un contre-accent dont la valeur est essentiellement
dynamique; ce qui crée un contraste très net avec lʼattaque du vers
précédent48. Bien quʼun mot molosse occupe encore la position centrale, le
mouvement rythmique diffère profondément, parce que le vers est saturé
dʼéchos consonantiques en /r/ et en /p/. Répartis dans les deux côla, les
deux séries consonantiques sont pourtant hiérarchisées : le /r/ est dominant,
puisque sous accent, dans le premier côlon; il en va de même pour /p/ dans
le second côlon. Cette saturation systématique et organisée du vers par des
échos consonantiques, procédé éminemment ennien, constitue un
primitivisme formel suggérant lʼanimation croissante de lʼénonciatrice. Cʼest
lʼoralité du furor qui perce ici.
La visée phatique culmine dans le vers 64,195. Elle est, cette fois-ci, autant
manifestée par la syntaxe injonctive (impératifs aduentate et audite) que par
la dynamique du rythme :
Húc húc áduentáte Tr méas H audíte querélas,
q q qqqw / wq/ qqw wqq
Au plan rythmique, lʼattaque de 64,195 apparaît comme plus forte que celle
du vers précédent : la séquence contraccentuelle est allongée dʼune syllabe.
La faiblesse quʼaurait le mot épitrite (qqqw) aduentate sʼil était uniquement
paroxyton justifie lʼaccent secondaire sur la syllabe dʼattaque.
48 Lʼarticulation emphatique de la syllabe dʼattaque (= accent secondaire) dʼexpirantis , mot dispondaïque, est induite par lʼantéposition du monosyllabe « de sens plein ». Cette lecture contraccentuelle du début nous semble possible, quoique non nécessaire, car elle anticipe lʼattaque du vers 64,195 (Húc húc).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
358
De plus, le premier côlon se caractérise par le couplage des phonèmes
vocaliques sous accent : /ú/- /ú/ - /á/ - /á/. Les Euménides doivent venir sans
délai; lʼénonciatrice balise leur chemin jusquʼà elle : lʼadjectif de première
personne, meas, détaché du nom, est mis en valeur entre deux césures.
Enfin, audíte est focalisé par le jeu des échos vocaliques sous accent, car
lʼinsertion du phonème /í/ à lʼintérieur du couple /é/ -/é/ forme contraste avec
la structure dʼéchos du premier côlon. Comme nous lʼavons déjà signalé, la
visée phatique qui caractérise les vers que nous venons dʼétudier est à
mettre en rapport avec lʼoralité du personnage en proie au furor. Or, cʼest
cette oralité elle-même qui prend valeur argumentative : lʼoralité du furor est
la preuve de lʼauthenticité du dolor. Et cʼest dans ce dispositif discursif que
sʼintègre lʼinterjection uae, intervenant au vers 64,196 : Quas ego uae misera
extremis proferre medullis.
En première analyse, nous pouvons remarquer que cette interjection est
utilisée comme langage du corps, comme élément de pathétique mimant la
spontanéité. En cela, elle correspond parfaitement à la définition donnée à
cette partie du discours en sémantique énonciative : « Pour nous, une
interjection se reconnaît à deux propriétés complémentaires. Lʼune, négative,
est quʼelle ne se présente pas comme destinée à fournir une information à
lʼauditeur — bien quʼelle puisse en apporter une et que lʼintention non avouée
de lʼénonciateur puisse être de lʼapporter. Lʼautre, positive, est quʼelle se
présente comme arrachée au locuteur par la situation, cʼest-à-dire comme
une espèce de cri. » (Ducrot et alii, 1980,133). Elle donne lʼautorité de
lʼauthenticité absolue à la requête dʼAriane. On pourrait dʼailleurs lui
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
359
substituer dans ce rôle a , heu, interjections de sens approchant, employées
dans des contextes comparables, et lʼon obtiendrait encore la même
traduction : « …ces plaintes que je suis, hélas !, moi la malheureuse, obligée
dʼextirper du plus profond de mon être… ».
De plus, cet effet authentifiant de lʼinterjection, qui fonctionne alors en
isotopie avec dʼautres traits dʼoralité que nous avons décelés dans le reste
de la séquence, se double dʼune particularité du discours de lʼhéroïne, son
aspect métalinguistique. En même temps quʼelle déploie les traits formels du
discours furieux, Ariane les « décode » systématiquement : elle est
« contrainte » (64,197 Cogor) dʼ« extraire < des plaintes> du plus profond de
ses moelles » (64,196 proferre extremis medullis), elle se définit au travers
les mots stéréotypés du dolor ((64,196 misera, 64,197 inops) et du furor,
terme quʼelle utilise dʼailleurs à son propos (64,197 ardens, « enflammée »,
caeca amenti furore , « aveuglée par une déraisonnable révolte ») ; un peu
plus loin, elle fait remarquer que ses plaintes sont véridiques (64,198 uerae),
naissant « du plus profond de sa poitrine (64,198 ab imo pectore). On
retrouve là des termes qui étaient employés par le narrateur lui-même pour
caractériser la parole et la voix de lʼhéroïne et justifier lʼinsertion dʼune
interjection dès le début du discours rapporté (64,124-131).
Bien sûr, la redondance tautologique est un aspect connu de la copia
pathétique. Cependant, le métalangage ainsi développé a un autre effet qui
participe de la stratégie argumentative visant à convaincre de lʼauthenticité
du propos. Pour efficace que soit lʼinterjection dans cette opération, il ne faut
pas sous-estimer lʼusure qui peut lʼaffecter. Sa commodité dʼemploi la rend
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
360
très attrayante pour qui veut feindre à bon compte (O. Ducrot, J.-
M. Schaeffer, 1999, 733 : « Les Oh!, Ah!, Aïe!, Hélas!… du français, et les
mots de même fonction, mais souvent différents matériellement, que lʼon
trouve dans la plupart des langues, servent également à authentifier la parole
: en les prononçant, on se donne lʼair de ne pas pouvoir faire autrement que
de les prononcer (dʼoù leur particulière utilité pour les menteurs). »).
Ainsi, le décodage métalinguistique vient désamorcer la défiance envers
lʼinterjection qui pourrait naître chez les allocutaires : en mettant à nu le
projet qui anime son discours, Ariane se donne un allié supplémentaire : la
transparence.
Nous avons mis en évidence la fonction première de cette interjection au
sein de la séquence discursive, mais il nous reste à voir ce qui motive le
choix de uae parmi le lot dʼinterjections comparables que nous avons
mentionnées.
Dans cette perspective, il est également nécessaire dʼétudier, au plan
rythmique, le vers 64,19649 :
Quás égo uaé ! T míser(a) extrémis H proférre medúllis
q ww q / ww qqq / qqw wqq
Le choix de lʼinterjection uae ne sʼexplique pas seulement par la volonté
dʼintroduire une variation conclusive dans la série des interjections
prononcées par Ariane. Il permet aussi une micro-figure rythmique qui 49 Lʼaccentuation du pronom relatif quas (64,196), sʼexplique, parce quʼil sʼintègre dans un réseau : Quare (64,192) - querelas (64,195) - Cogor - caeca (64,197) - Quae -quoniam (64,198).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
361
sʼinscrit dans le mouvement argumentatif que nous avons repéré à un niveau
plus large dans la séquence.
Le vers 64,196 est divisible en trois côla et uae apparaît à la fin du premier
dʼentre eux, de la même façon que lʼinterjection a en dernière position du
vers 64,135. Dans cet exemple-ci, la structure interne du côlon était
renforcée par les échos consonantiques en /m/. En 64,196, on observe un
jeu rythmico-phonique de finalité sémantique comparable, mais de forme
différente.
En effet, il sʼagit encore de justifier la présence de lʼinterjection par un lien
de causalité qui la rattache au reste du côlon. Ce lien passe dʼabord par le
contre-accent qui établit une solidarité dynamique entre Quás et égo , en
mettant en valeur deux phonèmes vocaliques. Lʼinterjection est présentée
comme conséquence du rapprochement des deux mots précédents, parce
quʼelle est phoniquement engendrée par les phonèmes vocaliques sous-
accent /á/ long et /é/ bref. Précisons quʼau plan phonologique lʼarticulation de
uae comme sonante + diphtongue est possible dans un idiolecte précieux et
littéraire50. On peut même retrouver trace de lʼappendice labio-vélaire du
pronom relatif dans la sonante du monosyllabe interjectif.
Ainsi, lʼénonciatrice signifie que le référent de Quas, cʼest-à-dire les
« plaintes » (64,195 querelas), est indissociable de son identité (ego), et que
50 On débat à propos de la date de la monophtongaison, en latin standard. Intervient-elle au II° siècle avant ou après J.-C. ? Toujours est-il que la diphtongue reste longtemps possible dans lʼidiolecte littéraire, au moins jusque chez Pétrone (merci à F. Biville pour ce renseignement). Pour Audax, bien plus tard, lʼhomophonie de lʼenclitique -ue et de lʼinterjection uae est acquise : si non cum commotione animi pronuntiatur, erit coniunctio, ut ʻPariusue lapisʼ; si uero uae cum commotione animi proferatur, erit interiectio, ut ʻuae misero mihiʼ. (GLK VII.350.26- 27).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
362
lʼénonciation de lʼinterjection uae (« hélas ! », « malheur ! »), loin dʼêtre
gratuite, est la conséquence dʼune nécessité fatale qui veut quʼelle, Ariane,
soit attachée à son malheur.
Toutefois, si dans le cas de 64,135, lʼautonomie syntaxique de lʼinterjection
a ne fait aucun doute, on peut dire que la situation est moins simple pour uae
en 64,196, ce qui va nous amener à nuancer le point de vue de Fordyce,
citée au début de cette étude, qui voyait dans notre occurrence catullienne
un « emploi absolu ».
Certes, le texte, au plan visuel, ne permet pas de voir de lien syntaxique
entre lʼinterjection et lʼadjectif au nominatif (64,196 misera) qui la suit
directement, dans la mesure où la construction quasi prépositionnelle de uae
entraîne un accord du régime à lʼaccusatif, ou, plus fréquemment, au datif51.
Mais il faut tenir compte de deux éléments du rythme qui ne sont pas
décelables visuellement : le contre-accent qui lie lʼinterjection à la syllabe
initiale de lʼadjectif et lʼélision prosodique de la marque flexionnelle -a.
Si la césure trihémimère, qui sépare les deux premiers côla du vers 64,196,
a pour fonction de souligner le caractère dʼénoncé-incise de lʼinterjection
monosyllabique, en accord avec la lecture syntaxique du vers , il faut bien
reconnaître que le contre-accent introduit une tension par rapport à cette
césure et quʼil suggère (ce terme est important) une autre lecture où
lʼinterjection nʼest plus autonome, mais dotée dʼun régime. Ainsi, à cause de
lʼeffet de substitution vocalique créé par lʼélision, introduisant un rappel 51 Lʼadjectif misera doit se lire syntaxiquement comme une apposition à ego, au même titre que les autres adjectifs accumulés au vers suivant (64,197), inops, ardens, caeca dont il a déjà été question plus haut.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
363
paronomastique de la désinence de datif féminin à travers le /e/ long initial
dʼextremis, on peut encore interpréter le début de lʼhexamètre de la manière
suivante : Quás égo / uaé míserae…
Bien sûr, nous touchons ici le domaine de lʼallusif, le domaine de la
« préciosité » poétique, mais cette deuxième lecture du fonctionnement
rythmico-phonique de lʼinterjection, nous permet de mettre en évidence
pourquoi Catulle nʼa pas écrit uae miserae mihi, énoncé banal en poésie
dramatique (avec, si nécessaire, un autre des mots différent), admissible en
prosodie dactylique. Vae est bien utilisée de façon autonome (« absolue »
selon les termes de Fordyce) à une place du côlon qui permet une lecture
sémantique très riche, pourtant sa place et son insertion dans le rythme
suggèrent aussi un autre emploi de lʼinterjection que nous avons appelé
« quasi prépositionnel ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
365
La voix des Parques
64,323
O decus eximium magnis uirtutibus augens,
Emathiae tutamen, Opis carissime nato, (64,323-24)52
« O toi dont les grandes vertus accroissent la noblesse, défense de
lʼÉmathie, si cher au fils dʼOps… » (Bardon,1970,154).
Cʼest sur ce mode élogieux que commence le discours des Parques
(64,323-64,381). Ce discours a la particularité dʼêtre prononcé non pas par
un énonciateur unique, mais par une voix collective et unanime, que le poète
a caractérisée par avance. Pour ce faire, il a recouru à certaines expressions
métalinguistiques qui sʼappliquaient déjà au discours dʼAriane, avec,
toutefois, quelques traits distinctifs.
Ainsi, cette voix collective des Parques est qualifiée de clarisona (64,320
« sonore et distincte »), le verbe fundere est utilisé à la place de dicere
(64,321 fuderunt, « elles répandirent »); ces traits caractérisaient déjà la
parole dʼAriane. Ce qui distingue la parole des Parques de celle de lʼhéroïne
crétoise, cʼest, bien entendu, lʼabsence de marques pathétiques inscrites
dans la voix et le corps énonciateur, mais aussi son aspect formel et
52 Le vers 64,323 ne présente pas de difficultés ecdotiques particulières, mais le texte de 64,324 a subi plusieurs métamorphoses. Les mss. anciens segmentent mal les mots de ce dernier vers. La reconstruction et la ponctuation (très vraisemblables) adoptées par les plus récentes éditions (y compris le dernier tirage de Lafaye revu par Simone Viarre) sont dues à Housman. Voir Fordyce, 1973, 318.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
366
solennel, signifié par lʼexpression diuino carmine (64,321). Sʼil apparaît que
cette voix, forte et vigoureuse émane de corps présentés, en revanche,
comme débiles (64,305 infirmo quatientes corpora motu; 64,307 corpus
tremulum), cela manifeste lʼessence divine de la parole énoncée.
Ce qui nʼapparaît pas nettement dans cette préparation du discours
rapporté, cʼest lʼidentité explicite du destinataire. Le discours des Parques
sʼadresse implicitement à Pélée, dont ce sont les noces, mais nulle part les
futurs époux ne sont décrits. Leur position au sein de lʼespace du palais reste
mystérieuse, alors que le poète signale avec précision le ballet des invités;
les humains se retirant (64, 267-268) pour laisser la place aux divinités qui
sʼassoient (64, 303-304).
La première fonction que remplit ici lʼinterjection53 o est celle dʼembrayeur,
dʼoù sa place normale en attaque dʼhexamètre; elle marque le début du
discours des Parques et lʼancre dans une situation dʼénonciation dont on a
vu quʼelle nʼest pas entièrement explicitée par le poète, qui focalise les
énonciatrices, non lʼallocutaire. La situation veut que le discours débute par
lʼéloge du maître des lieux. Cʼest pourquoi il nʼest même pas nommé.
Le début du discours rapporté coïncide avec un syntagme vocatif
recouvrant le vers 64, 323. La désignation métonymique de Pélée (decus,
« honneur ») y est mise en valeur par le contre-accent créé par la contiguïté
de lʼinterjection54. Ainsi, lʼon a rythmiquement, lʼéquivalent de O tu (qq) ou
53 Pour les nuances que lʼemploi de ce terme doit susciter dans le cas de o, voir notre étude de 63, 50. 54 Même attaque dʼhexamètre dans la translation dʼHomère réalisée par Cicéron (Fin. 5, 49) : O decus Argolicum P quin puppim B flectis, Ulixes, / auribus ut (T) nostros P possis H
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
367
bien O Peleu (qqq), mais des formes comme eximium ou augens nʼidentifient
pas de manière déterminante le cas vocatif. Il faut attendre le vers 64,324,
avec carissime pour que ce cas soit clairement marqué. Alors interviennent
des formes qui manifestent la deuxième personne, lʼimpératif Accipe et le
pronom personnel tibi (64,325).
Lʼabsence de désignation obvie de lʼallocutaire en début de discours, les
périphrases diplomatiques référant à Pélée montrent bien que lʼauditoire est
trié55, quʼil est tout acquis ou quʼil se censure en raison de la solennité en
cours. En effet, aussi bien les futurs époux que les invités divins sont censés
comprendre de qui parlent les Parques en évoquant lʼEmathiae tutamen,
Opis carissime nato (ce vers ayant pour fonction de montrer le statut
privilégié de lʼallocutaire, dans le monde humain et dans le monde divin
symétriquement).
agnoscere cantus ?. Le premier côlon est prosodiquement superposable à celui de Catulle. La voix est ici celle des Sirènes qui cherchent à attirer lʼattention dʼUlysse. 55 Les fâcheux potentiels, Phébus et sa soeur Diane, sont restés chez eux (64,299-302).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
368
Cʼest bien la gloire du maître de maison qui est visée par la parole des
Parques. Cette parole collective, pour atteindre son but, doit donc éviter
lʼécueil de la confusion, du brouhaha, de lʼobscurité prophétique. Aussi le
poète a-t-il insisté sur son intensité (clarisona uoce), et fait en sorte que la
colométrie découpe lʼéloge de façon fragmentée, mettant notamment en
relief des dissyllabes emblématiques (magnis, Opis) de la gloire de Pélée :
Ó décus éximium P mágnis H uirtútibus aúgens,
q ww qwwq /qq / qqww qq
Emáthiae T tutámen, Tr Ópis H caríssime náto,
qwwq /qqw /wq /qqww qq
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
369
La voix de la Boucle
Le poème 66, translation dʼun poème de Callimaque, représente le discours
dʼune boucle de cheveux56. Nous avons affaire à une prosopopée au cours
de laquelle se rencontrent trois interjections (66,39; 66,85; 66,87),
textuellement sûres.
66,39
La première dʼentre elle (66,39, o) intervient dans une séquence de
discours directement adressé à Bérénice (66,37-42). Elle introduit le
syntagme vocatif ó regína (qqqw). La Boucle de cheveux, personnifiée par
son accès soudain à la parole, interpelle la reine Bérénice. Nous avons
affaire à un dispositif rhétorique dont la familiarité risque de nous masquer
les enjeux véritables. Élucider le rôle de lʼinterjection et du syntagme quʼelle
inaugure, cʼest essayer de mettre au jour certains implicites de cet artifice
rhétorique, et dʼabord définir le masque ou le visage (deux traductions
possibles du grec prosôpon) qui se manifeste dans cette parole.
Au début du poème, la Boucle assume le rôle dʼune messagère, dʼune
narratrice qui conte sa métamorphose à la première personne. Très 56 Les papyri nous ont révélé une partie du texte de Callimaque (Pfeiffer, Callimachus, vol.1 frg.110). Malheureusement, nous ne possédons pas le texte grec correspondant aux trois vers comportant des interjections primaires. Anne Videau (1997) propose un commentaire littéraire de ce poème ainsi que la plus récente traduction en langue française.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
370
rapidement, en fait dès quʼelle sʼest présentée, identifiée en tant
quʼénonciatrice, elle interrompt son récit pour se livrer à des réflexions sur la
psychologie des jeunes mariées57. Cʼest alors une séquence discursive
(66,15-18) sans destinataire affiché où lʼénonciatrice se pose en experte
psychologue, à travers lʼemploi du présent de vérité générale : « Vénus est-
elle donc odieuse aux nouvelles épousées ? Ou plutôt ne veulent-elles pas
gâter la joie de leurs parents par les fausses larmes quʼelles versent en
abondance avant de franchir le seuil de la chambre nuptiale ? Non — me
protègent les dieux !— leurs gémissement ne sont pas sincères. » (Ernout,
1964,102)58. Le dernier vers de cette séquence (66,18 Nón íta mé díui J
uéra gémunt iúuerint. ) mêle assertion généralisante et énoncé en « fonction
interjective » (à ce propos voir Biville,1996c, 210 et Pompeius GLK V 281.11-
12), de sorte que lʼon a lʼimpression dʼune parole tendant vers lʼoralité
populaire59.
La Boucle prétend ainsi découvrir au lecteur la vérité des noces de la reine.
Et son nouveau statut stellaire lui permet de généraliser à partir de cette
expérience de témoin terrestre. Mais la truculence primesautière de la
Boucle croît encore par la suite. Elle a, semble-t-il, beaucoup à dire et profite 57 Voir Hollis (1992) sur le rituel nuptial. 58 J.Granarolo commente ce passage, ainsi que deux autres du même poème (66,21-22; 66,31-32), en ces termes : « Le plokamos (c.LXVI) présente un système dʼinterrogations couplées antithétiques, difficiles à cataloguer, mais que nous nʼestimons pas contre-indiqué de rattacher à lʼinterrogatio rhetorica, vu que le 1er membre équivaut à une négation, et le 2e à une affirmation à peine déguisée… » (1967, 345). 59 À lui seul, ce vers mériterait un commentaire plus étendu, ne serait-ce que pour expliquer la remarque lucide que Fordyce formule à son propos (1973,331 « hyperbate très osé »). Lʼobscurité syntaxique est-elle ici un symptôme de lʼoralité débridée de lʼénonciatrice ou une maladresse du traducteur Catulle ? Plus loin, lʼénonciatrice fait deux fois usage (66,30 et 66, 48) en attaque de vers, de Iúpiter, pris comme « interjection secondaire » (cf. Salvatore, 1965, 274).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
371
du poème pour dire son fait à Bérénice. Lʼénonciatrice passe, sans transition,
du récit sans destinataire marqué au discours orienté vers une personne
précise (66,19-22) : « De cela, la reine mʼa instruite par les nombreuses
plaintes que lui arracha le départ de son jeune mari pour de farouches
combats. Mais peut-être ne pleurais-tu pas lʼabandon de ton lit où tu restais
veuve, mais la séparation dʼavec un frère chéri ? » (Ernout, 1964, 102).
Lorsque sʼopère le passage à un plan énonciatif nouveau, on peut remarquer
que la rythmique évolue aussi. Un groupe de trois monosyllabes,
caractéristique de lʼoralité dialogale, occupe le début de lʼhexamètre (66,21) :
Át tú nón (T) órbum P lúxti H desérta cubíle,60
q q q qq/qq /qqw wqw
Le premier côlon, avec sa longue série contraccentuelle, a quelque chose
dʼune apostrophe grandiloquente, qui, nous semble-t-il, crée un effet
humoristique. Fordyce (1973, 332) lʼinterprète comme une expression
ironique, ou bien indignée, visant Bérénice, mais le caractère disproportionné
de la rythmique met tout autant en valeur la parrhèsia naïve de la Boucle. On
remarque aussi que le parfait de lugere, placé entre les césures, est une
forme syncopée (luxisti > luxti), ce qui renforce la dimension orale du vers.
60 La vulgate comporte un Et initial, leçon du ms O. Deux autres mss majeurs, G et R, comportent en fait la leçon At (cf. Mynors). La leçon de la vulgate sʼexplique par un souci de uariatio de la part des éditeurs, dans la mesure où lʼon a Sed au début du vers suivant. Même sʼil est difficile dʼapporter un argument décisif en faveur de lʼune ou de lʼautre variante textuelle (sans tenir compte ici des corrections parfois proposées, cf. Marinone, 1984,136-140), il nous semble que la rupture introduite par le passage de la narration à lʼinterpellation est propre à justifier lʼusage du connecteur at, souvent employé en rupture énonciative et en attaque dʼadresse. Cʼest dʼailleurs la leçon retenue par un commentateur pertinent de la poétique catullienne, A.Salvatore (1965, 270).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
372
De sa position céleste, la Boucle prend plaisir à désigner la vérité des
sentiments de Bérénice, sans y mettre un tact exagéré.
Lʼénonciatrice se pose en témoin importun, faisant alterner interrogatives et
exclamatives. Lʼexemple des vers 66,24-26 est révélateur à cet égard :
« Quelle inquiétude emplissait alors ta poitrine, égarant tes sens et ton
esprit ! Et pourtant, depuis le temps où tu étais toute petite, je connaissais ta
grande âme ! » (Ernout, 1964,103).
Vt tíbi túnc tóto J péctore sollícitae
qww q qq/qww qwwq
Sénsibus eréptis P méns éxcidit ! B át t(e) égo cérte
qww qqq /q qww/ q ww qq
Cognór(am) a párua J uírgine magnánimam.
qq qqq/ qww qwww
La faconde de la Boucle y est traduite en termes rythmiques :
1° Le premier côlon de 66,24 (pentamètre) est saturé par les échos en /t/
qui accompagnent deux contre-accents successifs (Vt tibi / tunc toto ; même
configuration prosodico-rythmique au début des vers 66,18-19); ces échos
sont moins marqués, parce quʼoccupant des syllabes inaccentuées, mais
toujours présents dans le second côlon61.
61 Pour A.Salvatore, lʼallitération présente au vers 66, 24 (« il significato espressivo della lungha serie delle t ») participe bien du « linguaggio intimo di Catullo », quoique lʼon ait affaire à une traduction (1965, 271).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
373
2° Dans le vers 66,25, deux termes appartenant au même champ lexical
sont rapprochés de manière redondante (Sensibus…mens). La vivacité orale
de lʼénonciatrice est aussi représentée à travers lʼattaque contraccentuelle
des deux derniers côla : on assiste donc dʼun vers à lʼautre à un déplacement
de lʼemphase orale, qui fait rebondir le rythme du discours. Et la ponctuation
bucolique, au dernier côlon, permet dʼinsérer un rejet.
3° La vivacité orale est caractérisée par un autre procédé dans le vers
66,26. Catulle introduit une succession dʼéchos consonantiques où syllabes
accentuée et inaccentuée alternent, de façon à produire une effet de relais
rythmique : 66,25 cérte - 66,26 Cognór(am) / párua - uírgine / uírgine -
magnánimam.
À notre avis, la parole de la Boucle, récemment promue à une destinée
céleste, correspond à celle dʼune servante (cf. 66,75 a dominae uertice),
brusquement libérée de ses inhibitions, et qui se laisse naïvement griser par
lʼexpression de ses émotions.
Par rapport à cette parrhèsia quelque peu envahissante, et naïve, la
séquence dans laquelle sʼintègre le syntagme vocatif o regina apporte une
évolution, une rupture de ton (66,37-42) : « Cʼest à regret, ô reine, que jʼai
quitté ton front, oui, à regret; jʼen fais serment par toi, par ta tête, et que soit
justement châtié quiconque lʼaurait invoquée par un faux serment ! Mais qui
prétendrait pouvoir rivaliser avec le fer ? » (Ernout,1964,103).
Notons que le syntagme vocatif nʼest pas placé au début de la séquence
dont Bérénice est lʼallocutaire (66,21); il nʼa donc pas de fonction de contact,
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
374
comme dans les salutations de théâtre. Il doit être compris comme une
rupture dans le paradigme de la personne 2. Jusquʼau vers 66,39,
lʼallocutaire nʼapparaît quʼà travers le jeu des pronoms personnels et de la
morphologie verbale, et le substantif regina, utilisé dans la narration en tant
que nominatif (66,19), nʼest pas repris par lʼénonciatrice dans son adresse à
Bérénice. Mais cʼest au moment où son récit la conduit à sa réalité présente
(66, 37-38 ego… dossoluo) que lʼénonciatrice se rend soudainement compte
quʼelle est séparée de son allocutaire. Le syntagme vocatif, qui rend à
Bérénice, son titre marque le passage à une distance nouvelle entre
interlocutrices sʼinscrivant dans un dispositif pathétique.
La Boucle laisse à présent éclater son émotion, quittant sa pose stellaire62 :
Inuít(a), ó T regína, Tr túo H de uértice céssi,
qq q/qqw /wq/ qqww qq
Inuít(a), adiúro J téque tuúmque cáput
qq qqq/ qw wqw wu
Dígna férat T quód sí P quis inániter ádiurárit ;
qw wq/q q/ w wqww qqqu
Séd quí sí férro J póstulet ésse párem ?
q q q qq/qww qw ww
62 Commentaire de Salvatore : « il tono diviene più caldo » (1965, 278). Pour cet auteur, on trouve dans un tel passage des « attegiamenti espressivi » qui sont tout aussi caratéristiques des nugae et des épigrammes.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
375
La naïveté de lʼénonciatrice se manifeste dans son apologie. Dégageant sa
responsabilité par lʼanaphore pathétique de lʼadjectif Inuit(a), elle accuse
indirectement la reine de leur séparation. Il y a de la maladresse dans cette
déclaration de fidélité. Les traits dʼoralité du discours de la Boucle sont
encore présents (le serment accompagné dʼéchos en /t/, le lieu commun
fortement rythmé clôturant la séquence).
Lʼexamen détaillé du vers 66,39, en comparaison avec Verg. En. 6,460
Inuitus, T regina, tuo H de litore cessi 63 , permet de complexifier lʼanalyse de
la particule o que nous avons jusquʼà présent défini comme attaque dʼun
syntagme vocatif. La présence dʼo est nécessaire des points de vue
prosodique et syntaxique : il sʼagit dʼéviter grâce à lʼélision une séquence
amétrique (Inuita regina, qqwqqw) et de rendre impossible une interprétation
de regina comme nominatif. Mais cette nécessité permet aussi dʼexploiter la
double potentialité dʼo. En effet, ce monosyllabe, focalisé par le contre-
accent dû à lʼélision, peut être encore interprété comme interjection
autonome, et non seulement comme « particule vocative » (TLL), à cause de
sa position par rapport à la césure trihémimère. Dans ce cas, il sʼagirait dʼune
réaction de trouble exprimée par lʼénonciatrice (la Boucle-servante) sous
lʼeffet dʼun reproche implicite dʼinfidélité.
En définitive, on peut dire que le rythme du début de vers, caractérisé par
la tension du contre-accent et de la césure trihémimère, concourt à un effet
63 À propos de lʼintertextualité entre ce passage catullien et Virgile, voir deux contributions récentes : Lyne, R.O.A.M., « Vergil's Aeneid: Subversion by Intertextuality. Catullus 66.39-40 and Other Examples », G&R, 41.2,1994, 187; Griffith, R. Drew, « Catullus' Coma Berenices and Aeneas' Farewell to Dido », TAPhA ,125,1995,47-59.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
376
dʼambiguïté et quʼil rend légitime la lecture du monosyllabe o autant comme
interjection (au sens restreint) en emploi autonome que comme « particule
vocative » (lecture syntagmatique).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
377
Les deux dernières interjections monosyllabiques prononcées par la Boucle
de Bérénice se trouvent dans un passage (66, 79-88), dont lʼunité est
signalée par A.Salvatore (1965, 278-279) et que H.-P. Syndikus (1990, 224)
nʼétudie pas comme tel64 : « Et vous maintenant, quʼunit le flambeau nuptial
au jour tant souhaité, ne livrez pas vos corps à vos ardents époux, ne rejetez
pas le voile pour découvrir vos seins, avant que lʼonyx 65 nʼait répandu pour
moi dʼaimables libations, ou du moins votre onyx, ô vous qui observez la loi
conjugale dans votre chaste lit. Mais celle qui sʼest livrée à lʼimpie adultère,
ah ! pour celle-là, que ses mauvais présents se perdent, absorbés par la
poussière. Je ne demande aux femmes indignes aucun hommage. Tâchez
plutôt, ô jeunes épouses, que toujours la concorde, que toujours un amour
sans relâche habitent vos demeures. » (Ernout, 1964,104-105).
La Boucle, interrompant son récit plaintif, sʼadresse à un nouvel allocutaire,
collectif cette fois. Ce qui est marqué par deux monosyllabes en attaque
dʼhexamètre (66,79 Núnc uós) qui forment un contre-accent propre à signifier
le début de séquence et à stimuler lʼattention des jeunes mariées, vers
lesquelles est orienté le discours. Ce procédé rythmique à double visée,
64 Le commentateur met en lumière le rapport de ce passage avec la religion alexandrine : « Die Locke spricht in Vers 79 die Bräute direkt an und bittet sie, diesen Brauch zu vollziehen. Die Betonung der Keuschheit der Bräute scheint wesentlich und für den ganzen Kult der Arsinoe-Aphrodite typisch gewesen zu sein… ». 65 Lʼénonciatrice se pose en divinité, et, à ce titre, demande aux épouses dʼaccomplir un geste rituel avant de faire lʼamour avec leurs époux, en lʼoccurrence de verser une libation de parfum en son honneur, car le mot onyx, repris en épanalepse aux vers 66,82-83, signifie métonymiquement « fiole à parfum ». Pour ce sens dʼonyx, Fordyce (1973, 339-340) donne les références suivantes : Plin. N.H. 36,60; Prop.2,13,30; Hor. Carm.4,12,17. Syndikus (1990, 224 n.115) en ajoute : Prop. 3,10,22; Mart. 3,94,1; 11,49,6. Les récipients à parfums sont taillés dans du marbre jaune.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
378
démarcation et contact, nʼest pas nouveau dans le poème, puisquʼil est déjà
mis en œuvre lors de lʼadresse à Bérénice (66,21Át tú nón, leçon des mss G
et R que nous avons retenue).
On peut sʼinterroger sur la valeur du connecteur Nunc dans ce cotexte. Est-
il uniquement utilisé pour sa valeur temporelle, comme le suggère la
présence de quondam (66, 77) deux vers auparavant ? Cʼest en tout cas
lʼidée défendue par A. Traina (1975, 150), et reprise par G. Marinone : ce
connecteur servirait à opposer le présent malheureux au passé heureux,
cʼest-à-dire au temps où la Boucle se trouvait unie à Bérénice66.
Toutefois, si lʼon admet cette interprétation, qui semble plausible, il nʼest pas
exclu dʼaffecter au connecteur Nunc, en début de vers, une valeur
supplémentaire, liée à une nouvelle rupture énonciative, ce qui le rapproche
du connecteur at. Le connecteur sert à focaliser le nouvel allocutaire signalé
par le pronom qui le suit (uos). Ainsi, on peut le créditer dʼune double
fonction :
1° le contraste par rapport à lʼépoque repérée par quondam.
2° le marquage dʼune nouvelle séquence discursive, envisagée
sémantiquement comme une conséquence de ce que vient dʼénoncer la
Boucle. Dans ce cas, le connecteur marque un tournant dans le temps du
discours67.
66 Marinone (1984, 253) : « nunc. Ora, nellʼattuale condizione, in contrasto con il “passato felice della chioma sul capo di Berenice” (Traina, 1972 = 1975,150) che è stato sottolineato supra v.77 con quondam… ». 67 Cette occurrence de nunc nous paraît ici combiner deux valeurs de lʼadverbe définies par Hand (1845, IV, 341) : a. « In rerum expositione per nunc oratio transgreditur ad aliam
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
379
66,85
Si la Boucle sʼadresse aux femmes mariées (et non aux seules jeunes
épouses) dans leur ensemble, elle nʼen établit pas moins une distinction à
lʼintérieur de ce groupe dʼallocutaires. Sont exclues du culte les femmes
impures parce quʼadultères (66, 84-86) :
Séd quaé s(e) impúro J dédit adúlterio,
q q qqq/qw wqwwq
Íllius á ! T mála dóna léuis H bíbat írrita púluis;
qww q/ww qw wq / ww qww qu
Námqu(e) ég(o) ab indígnis J praémia núlla péto.
q w wqqq /qww qw wq
Cette restriction sʼouvre par un couple de monosyllabes (abstraction faite du
se élidé) qui nous semble suivre le paradigme de lʼattaque de séquence
(66,79). Le pronom relatif quae (nominatif singulier) paraît avoir une force
accentuelle comparable à celle du pronom personnel uos. Par analogie avec
lʼexemple de 66,79, nous interprétons le groupe comme un contre-accent,
malgré les doutes que lʼon peut légitimement conserver quant à
lʼaccentuation des conjonctions (Plantade, 1999c) et des pronoms relatifs
(Schöll, 66-67). Il nʼy a pas, proprement parler, de changement dʼallocutaire,
rem : quod etiam per nam fit. Additur uero saepe. »; b.« Cum imperatiuo et cum coniunctiuo adhortationis nunc componitur, ut rerum status, in quo iussum nitatur, appareat : nec raro cum quodam sarcasmo. ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
380
mais un tournant énonciatif qui consiste en un passage à la personne 3. La
Boucle ne sʼadresse pas à la femme adultère pour la maudire, mais formule
une invective qui la dispense dʼun contact porteur de souillure.
Dans le vers 66,85, lʼoralité de lʼinvective ne se manifeste pas cette fois
sous forme dʼéchos consonantiques, mais par une particularité
dʼaccentuation : tous les mots y sont accentués sur la syllabe dʼattaque,
aussi bien les nombreux disyllabes68, pour lesquels cʼest un fait quasiment
mécanique, que les trisyllabes, de forme dactylique (Illius, irrita). Ceci a pour
effet de créer une diction très stéréotypée qui rappelle lʼarticulation dʼun
énonciateur en proie à une colère intense et froide. À défaut dʼéchos
consonantiques, on trouve en revanche un couple de phonèmes vocaliques,
/ i / et / a / dont les occurrences marquées, accentuées, encadrent le vers
(premier et dernier côlon).
À lʼintérieur de ce dispositif dʼinvective, lʼinterjection a (66,85) joue un rôle
important. Compte tenu des multiples émendations quʼa connues ce vers, il
nʼest pas inutile de rappeler que sa présence dans le texte nʼest pas
douteuse : « Essa, tràdita amala [i.e. sans segmentation de lʼinterj. et de
lʼadj. suivant] ma già staccata nella grafia in parecchi codici recenziori (ad es.
i Vaticani Chisianus, Palatinus, Lat. 1608, e lʼAmbrosianus H 46) fu
tralasciata in tutti gli incunabuli e nelle cinquencentine anteriori a Stat. 1566,
che presentano come testo illius mala dona leuis bibat irrita puluis… »
68 Lʼordre des disyllabes a été changeant, avant de se stabiliser dans les éditions récentes. Lʼordre que retiennent celles-ci (dona leuis bibat) correspond à la correction de la tradition manuscrite, amétrique (leuis bibat dona : wqwqqw), effectuée dans lʼeditio princeps (Venise,1472). Pour un aperçu des émendations plus radicales, voir Marinone (1984, 260).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
381
(Marinone, 1984, 260). Lʼeditio princeps (1472) proposait de lui substituer
lʼinterjection o, arguant quʼa ne correspond pas au contexte imprécatif69.
Cette correction paraît superflue, car lʼinterjection contenue dans la tradition
manuscrite convient au contraire très bien à ce contexte. Sa polyvalence est
dʼailleurs relevée par le TLL (« uarios affectus animi exprimit, dolorem,
luctum, aegritudinem, indignationem… »), comme par J.B. Hofmann qui
explique que le seul trait commun à ses différents emplois est de manifester
un fort investissement affectif (1958, §21, 25 : « AH… recorre toda un amplia
gama de impresiones cuya base común consiste en una fuerte descarga
afectiva »). Lʼinterjection a se prête donc bien à lʼexpression de lʼindignation
et de la colère furieuse, ainsi que nous lʼavons vu à propos dʼAriane.
Notons quʼelle apparaît à la même position métrique que lorsque la fille de
Minos sʼadresse à Thésée fuyant (64,135). Mais lʼanalogie nʼest pas
uniquement métrique. En fait, on retrouve les mêmes voyelles accentuées
dans ces deux attaques de vers (Ímmemor á / Íllius á).
Cette configuration rythmique semble à associer aux particularités de la voix
féminine telles quʼelles sont représentées dans la culture romaine
(Biville,1996d, 59)70. Les auteurs latins la caractérisent comme aiguë, ce qui
implique toute une gamme de jugements, le plus souvent réprobateurs. Il
nʼest pas fortuit que les deux côla que nous rapprochons, et qui, tous deux,
correspondent à lʼexpression de lʼindignation féminine, se présentent comme
69 « Sed ea tamen interiectio [i.e. a !] commiserantis magis, quam imprecantis, esse solet; mutandum sit in o, quod sit optantis » (citation de Marinone, 1984, 261). 70 F.Biville cite les témoignages suivants : Rhet.Her.3,22; Plt.,Poen.32-33; Virg.,Aen.4,667.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
382
des modulations partant de la voyelle au timbre le plus aigu, cʼest-à-dire
[ i ]71.
Toutefois, le parallèle entre les vers 64,135 et 66, 85 sʼarrête là, parce que
dans ce dernier lʼinterjection monosyllabique est suivie dʼun disyllabe,
accentué sur la syllabe dʼattaque (mala), non plus dʼun trisyllabe paroxyton.
Ce qui produit une situation contraccentuelle. Ainsi, en 64,135, lʼinterjection
apparaissait surtout comme lʼélément clausulaire du premier côlon, alors que
le contre-accent dans 66,85 crée une dynamique de tension par rapport à la
césure trihémimère. Lʼinterjection est dʼautant plus orientée vers le deuxième
côlon que le disyllabe qui la suit est saturé dʼéchos vocaliques en / a /. Pour
nous résumer, nous disons que :
1° lʼinterjection occupe une place métrique (avant la trihémimère) qui la met
en valeur en tant quʼincise.
2° rythmiquement, elle est rattachée à lʼattaque du côlon suivant (groupe á
mála).
Ces deux faits ne sont pas exclusifs lʼun de lʼautre, mais concourent en fait
à la dramatisation du vers. La césure est utlisée comme lieu de reprise du
souffle, ce qui permet de donner une emphase encore plus grande à
lʼattaque du deuxième côlon. Avec ses phonèmes vocaliques accentués (/ i /
et / a /), le premier côlon fournit la base des modulations exploitées dans
lʼensemble du vers (par exemple, bibat, irrita).
71 Cf. P.Monteil (1986, 44).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
383
Enfin, lʼinterjection a apparaît comme un point de jonction entre lʼoralité
féminine de la douleur ou de lʼindignation (variante de celle-ci) et celle de la
malédiction. En tant que « signification de la douleur », et grâce à sa position
métrique dʼincise, elle clôt le premier côlon qui est le lieu de lʼindignation
paroxystique (ululatus), comme le suggèrent les timbres vocaliques très
contrastés qui composent le mot Illius (passage du plus aigu, / i /, au plus
grave, / u /). Mais du point de vue rythmique (contre-accent, échos en / a /),
cʼest bien elle qui lance la dynamique des deux derniers côla, dont on a vu
quʼelle est fortement typée au plan accentuel.
66,87
Le vers 66, 87, qui contient une autre interjection72, allie des éléments
venus des vers 66, 84 et 66, 85. Ce nʼest pas un hasard, dans la mesure où
les vers 66, 87-88 véhiculent un vœu positif, au contraire des précédents.
Séd mágis, ó T núptae, P sémper H concórdia uóstras
q ww q/ qq /qq / qqww qq
Sémper ámor sédes J íncolat assíduus.
qw wq qq/ qww qwww
La conjontion Sed, en attaque dʼhexamètre (66, 87), prépare le changement
énonciatif (passage de la personne 3 à la personne 2). Elle est aussi le
72 Pas de problème textuel à signaler à cet égard.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
384
premier élément dʼun contre-accent (Séd mágis)73. Un indice de
lʼaccentuation de cette conjonction peut être découvert dans le réseau
dʼéchos consonantiques où les syllabes contenant / s / portent lʼaccent
(sémper - Sémper - sédes - assíduus). La configuration accentuelle du
premier côlon de 66, 87 est la même que celle du début de 66, 84, en dépit
du fait que lʼon ait affaire, respectivement, à un hexamètre et à un
pentamètre.
Dʼautre part, la « particule vocative » o qui occupe la même position
métrique que lʼinterjection a (66, 85), est elle-aussi intégrée dans un groupe
contraccentuel, parce quʼelle est suivie du disyllabe nuptae. Le groupe o
nuptae répond donc, avec une force rythmique égale au groupe a mala . Il
permet de faire apparaître en gloire lʼallocutaire collectif qui nʼétait désigné,
au début de la séquence, que par une tournure périphrastique générale
(66,79 uos optato quas iunxit lumine taeda). Le groupe doit être dès lors
compris avec une valeur restrictive : « ô vous, véritables épouses ».
73 Cette expression, comme le note Fordyce (1973, 340), signifie « mais en revanche » (« but instead »). Elle est encore utilisée au vers 73, 4.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
387
La voix du passant
67,1
Le poème 67 présente un dialogue fictif entre un passant et une porte
(ianua)74. Il contient une seule interjection monosyllabique qui est placée à
lʼattaque du premier vers (67, 1). Son énonciateur est le passant curieux75 ,
qui commence ainsi une séquence de salutation (67,1-6), adressée à un
allocutaire peu ordinaire : « — O toi, chère au tendre époux, chère au père,
salut ! et que Jupiter comble tous tes désirs, porte qui, dit-on, servis de bon
gré Balbus autrefois, quand le vieillard occupait lui-même le logis, et quʼon
accuse dʼavoir au contraire servi de mauvais gré le fils depuis que, le vieillard
une fois enterré, tu es en puissance de mari. » (Ernout,1964,106).
74 Le poème, en raison de son aspect licencieux, nʼest pas commenté par Fordyce. Pour Bardon, il sʼagit des « commérages de Brescia, sous la forme, assez habituelle à la poésie alexandrine, dʼun dialogue avec la porte. » (1970,172 n.1). De lʼétude approfondie que Syndikus (1990, 226-228) consacre à lʼintertextualité de c.67, il ressort que ce poème entretient des liens avec diverses traditions (dont celle dʼAlexandrie) sans pour autant se rattacher de manière précise à lʼune dʼelles (« Ein solches Gespräch zwischen einem toten Ding und einem Auskunft erheischenden Vorübergehenden ist in der antiken Literatur keine ganz unübliche Gesprächssituation. »). Cf. A.P. 7, 64 (anonyme); 7, 470 (Méléagre) ; 7, 524 (Callimaque); Call. fr.114 Pfeiffer; Alc. fr. 374 Lobel-Page; Plt. Curc.147-154; Tib. 1, 2; Prop.1,16. 75 Beaucoup dʼéditeurs identifient spontanément le passant au poète lui-même, à cause du contexte cisalpin des faits évoqués par la porte, mais en toute rigueur il faut en rester à ce que propose le texte (Perrotta, 1972, 158 s.; Syndikus,1990, 232).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
388
Lʼinterjection o est en fait, sans conteste, une « particule vocative » qui
constitue le début dʼun syntagme dont le dernier élément est rejeté en
attaque du vers 67,3 :
O dulci iocunda uiro, iocunda parenti,
Salue, teque bona Jupiter auctet ope,
Ianua, quam Balbo dicunt seruisse benigne…
Comme souvent, la particule vocative o est utilisée comme attaque de
syntagme à valeur nettement méliorative, ce qui en fait non un simple
embrayeur, mais aussi le signal dʼune stratégie discursive de lʼénonciateur, à
savoir lʼéloge. On a déjà repéré un fonctionnement analogue de lʼinterjection
dans le discours rapporté des Parques, commençant par une adresse à
Thésée (64, 323-324). À ce propos, Kroll (1929, 213 n.1) insiste sur le fait
que lʼon a affaire, en 67, 1, à une épithète stéréotypée, qui construit le rôle
idéal de la porte, et ne sʼapplique pas avec la même pertinence à lʼallocutaire
du passant. Ainsi, la porte, de façon générale, doit être chère au cœur de
lʼhomme qui, en tant que mari exerce une surveillance sur sa femme, et en
tant que père sur sa fille.
Que le substantif Ianua (le nom de lʼallocutaire au vocatif) soit détaché du
reste du syntagme nʼest pas indifférent. Une ambiguïté est ainsi ménagée.
La seule marque apparente de lʼallocutaire au vers 67,1 est la terminaison du
vocatif féminin. Le lecteur peut donc brièvement formuler lʼhypothèse que le
discours sʼadresse à une femme mariée respectable, et bien vue de la gent
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
389
masculine. Le substantif Ianua, mis en relief, vient plaisamment démentir
cette hypothèse. On peut dire que lʼeffet dʼattente créé par lʼénonciateur trahit
une légère ironie de lʼéloge. En effet, si lʼénonciateur multiplie les signes
dʼune salutation formelle, en adjoignant au syntagme vocatif une interjection
secondaire (67,2 salue) et un souhait de prospérité76 suffisamment
stéréotypé pour appartenir à la catégorie des énoncés pro interiectione
(Pompeius, GLK V,281,11-12 : elocutio omnis pro interiectione est), cela
peut encore être interprété comme un signe de duplicité. Il sʼagit bien de
flatter lʼallocutaire pour gagner sa confiance et le faire parler (Syndikus,1990,
232, « Zunächst will der Ankömmling die Tür sichtlich freundlich stimmen, um
sie gesprächig zu machen. »; cf. Perrotta,1972, 163), mais il faut préciser
deux choses.
Dʼune part, la copia des salutations est nécessaire dans la logique
discursive de lʼénonciateur, parce quʼil va mettre en cause lʼallocutaire en se
faisant lʼécho des bruits médisants qui lʼaccusent (66, 5 Quamque ferunt
rursus nato seruisse maligne). La salutation, en tant que captatio
beneuolentiae, doit être assez crédible pour que la porte ne se referme pas
sur elle-même, si lʼon ose dire, et, de ce fait, pour compenser
symboliquement cette mise en cause. Dʼautre part, il faut remarquer que le
76 Kroll (213, 2) fait remarquer quʼauctet est une forme archaïque, qui se susbstitue à augeat pour des raisons métriques. Il renvoie à une citation de Plaute (Capt.768, Iuppiter supreme seruas me measque auges opes) et indique que son équivalent prosaïque serait ita te Iuppiter auctet (références à vérifier). On peut préciser que la « tournure prosaïque » quʼil propose contient tout aussi bien lʼarchaïsme auctet, ce qui corrobore lʼinterprétation de cet énoncé comme interjection. Syndikus (1990, 232 n.27) cite une autre occurrence (Ov.F.1, 612 s.).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
390
passant sʼadresse aussi à un deuxième allocutaire, le lecteur, qui, lui, est
capable de décrypter la duplicté de son discours.
Ó dúlci T iocúnda Tr uíro, H iocúnda parénti,
qqq/qqw/wq/qqwwqq
Sálue, téque bóna J Júpiter aúctet ópe,
qqqwwq/qwwqwww
Iánua, quám (T) Bálbo P dícunt H seruísse benígne
qww q qq /qq / qqw wqq
Au plan rythmique, le vers 67,1 débute par un contre-accent (Ó dúlci)
constituant une attaque forte en accord avec la fonction dʼembrayeur de la
particule vocative. Il se divise en quatre côla qui créent un effet de
modulation rythmique du fait que lʼaccentuation des attaques de mot alterne
(côlon 1, Ó dúlci ; côlon 3, uíro) avec lʼaccentuation des syllabes pénultièmes
(côlon 2, iocúnda ; côlon 4, iocúnda parénti). Cette modulation correspond
aux inflexions dʼune voix enjôleuse (blanda uox). Lʼanaphore de lʼadjectif
iocunda à lʼhephthémimère induit aussi une lecture comparée des deux
segments débutant de la même façon. Comparaison que nous rendons
lisible dans un tableau.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
391
côlon 2 + côlon 3 côlon 4
iocunda + uiro iocunda parenti
qqw + wq qqw wqq
La comparaison des segments, constitués des mêmes éléments
syntaxiques, fait ressortir leur dissymétrie syllabique et prosodique (sans
parler du déplacement accentuel). En effet, le deuxième est composé dʼune
syllabe longue supplémentaire. Ce déséquilibre au profit du segment
clausulaire (côlon 4) sʼinscrit aussi dans lʼoralité de lʼéloge.
Ce qui frappe, en revanche, dans le pentamètre qui suit (67,2), cʼest la
disposition des accents sur les attaques de mots. Apparemment, après la
séduction des modulations accentuelles, cʼest une autre démarche vis-à-vis
de lʼallocutaire qui est choisie. Lʼénonciateur construit son autorité par le
recours à des éléments ritualisés de la conversation; la configuration
accentuelle est archaïsante, ce qui instaure une relation dialogique fondée
sur les valeurs traditionnelles, dont celle de fides. Le nom Júpiter est mis en
valeur après la jointure du pentamètre. Le choix de lʼarchaïsme aúctet
permet un écho sonore avec téque. Et la clausule du vers joue sur un
parallélisme approximatif, celui de deux disyllabes qui ont presque le même
matériel vocalique (aúctet, qw / ópe, ww).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
393
De la voix de lʼami à celle du frère
68,20
Lʼinterjection o apparaît au vers 68,20, cʼest-à-dire dans un poème destiné
à un personnage dont le nom change selon les éditeurs77. Elle est située
dans une séquence autodiégétique, délimitée par Syndikus (1990, 244-245).
Tempore quo primum uestis mihi tradita pura est,
Iocundum cum aetas florida uer ageret,
Multa satis lusi; non est dea nescia nostri,
Quae dulcem curis miscet amaritiem;
Sed totum hoc studium luctu fraterna mihi mors
Abstulit.78 O misero frater adempte mihi,
Tu mea tu moriens fregisti commoda, frater,
Tecum una tota est nostra sepulta domus,
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,
77 Pas de difficulté textuelle à signaler pour ce qui concerne lʼinterjection. Notons seulement que lʼédition de Baehrens (Bardon,1970,177) corrige o en ei, par analogie avec 68b,92. Le destinataire (Bardon,1970,176-177), nommé au v.68,11, sʼappelle Allius (Schöll, Schuster, Perrotta, Bardon), ou Manlius (Lafaye), ou Manius (Lachmann, Kroll, Mynors)… Nous nʼinsistons pas davantage sur cette question, à propos de laquelle on trouvera une synthèse dans Syndikus (1990, 251-252). 78 Traduction des vers 68,15-20 : « Au temps où pour la première fois je revêtis la toge blanche, quand mon âge en sa fleur vivait son joyeux printemps, jʼai joué bien souvent à ces jeux : elle nʼest pas sans nous connaître, la déesse qui mêle à nos peines une douce amertume. Mais tous ces plaisirs, le deuil où mʼa jeté la mort de mon frère me les a ravis. » (Ernout,1964,108).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
394
Quae tuus in uita dulcis alebat amor.
Cuius ego interitu tota de mente fugaui
Haec studia atque omnes delicias animi (68,15-26).
Cette séquence narrative est annoncée par lʼimpératif Accipe (68,13).
Lʼénonciateur lui assigne un but précis, convaincre lʼallocutaire, que nous
nommerons Allius, quʼil ne peut répondre à sa demande en lui envoyant des
poèmes ayant ses amours pour thème. Cette dimension argumentative du
récit est soulignée par lʼintervention de Quare au début du vers 68,27.
Tempore79, ablatif de date, est placé en attaque de vers (68,15) de façon à
mettre en évidence le changement de plan énonciatif. Dans cette lignée, il
est fait usage du parfait (verbes soulignés) ainsi que du cum historicum
(68,16). La dimension autobiographique se manifeste à travers la personne 1
du verbe ludere (68,17) et les occurrences de déictiques (68,15 mihi ; 68,17
nostri ; 68,19 mihi ; 68, 25 ego ).
À lʼintérieur de cette séquence, lʼinterjection o, prise comme « particule
vocative », parce quʼelle se rattache à un syntagme au vocatif (frater
adempte) introduit une subdivision. Elle ouvre en effet une sous-séquence de
discours rapporté où un personnage, qui nʼest autre que le narrateur,
sʼadresse à son frère, selon un programme pathétique annoncé par le mot
luctu (68,19). La personne 2 ne se réfère donc plus à lʼallocutaire nommé
Allius (68,2 mittis), qui est le destinataire du poème. Lʼaspect abrupt du
changement énonciatif rappelle la façon dont la Boucle fait de Bérénice une
79 Lʼordre prosaïque serait, bien entendu, Quo tempore. Pour ce début dʼhexamètre, Kroll (1929, 222) renvoie à Lucr. 5, 917, en précisant « vielleicht ennianisch ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
395
personne 3 dans son propre récit autobiographique, puis, soudainement,
sʼadresse à elle (66,19-22), à cette différence près que le frater Catulli
nʼapparaît même pas comme personnage véritable du récit, mais que seul un
adjectif (68,19 fraterna mors) se réfère à lui, au vers précédant lʼallocution.
La particularité de cette sous-séquence de discours rapporté est quʼelle est
très intégrée à la séquence narrative, par des procédés de cohésion textuelle
intéressants :
1° Lʼinterjection monosyllabique apparaît en une position médiane du
premier côlon de 68,2080, alors quʼelle habituellement placée en attaque de
vers. Elle joue ainsi son rôle de démarcatif dʼembrayeur, mais dans une
continuité renforcée avec la narration.
2° Le temps dominant (à une exception près) est ici encore le parfait, à la
personne 2 ou 3 (voir infra les verbes doublement soulignés). Ces
occurrences du parfait ne sont plus repérées par rapport au marqueur initial
de la séquence narrative (Tempore), mais par rapport au nunc de
lʼénonciateur de la lettre, qui prétend effacer le décalage épistolaire, car
lʼimparfait du style épistolaire formel est remplacé par le présent
dʼénonciation (68, 2 mittis ; 68, 9 est ; 68, 9 dicis).
Ce dispositif troublant permet à lʼauteur du poème de se dissimuler derrière
un personnage et de tirer, en même temps, le plus grand pathétique de la
voix figurée rythmiquement dans le discours rapporté. Nous allons aborder
maintenant le passage autobiographique proprement dit.
80 Dans le schéma de typologie verbale proposé par J. Luque Moreno (1994a, 92), le monosyllabe O correspond à la position C du pentamètre.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
396
« Mais tous ces plaisirs, le deuil où mʼa jeté la mort de mon frère me les a
ravis. O frère qui me fus enlevé pour mon malheur, tu as, oui, tu as, ô mon
frère, en mourant, brisé mes bonheurs; avec toi notre maison tout entière est
entrée au tombeau, avec toi ont péri toutes les joies que pendant ta vie
entretenait en nous ta si douce affection. »81 (Ernout,1964,108-109).
Séd tót(um) hóc T stúdium P lúctu H fratérna míhi mórs
q q q /wwq /qq/ qqw wq q
Ábstulit. Ó mísero J fráter adémpte míhi,
qww q wwq/ qw wqw wu
Tú méa tú T móriens P fregísti B cómmoda, fráter,
q ww q/wwq / qqq/ qwwqu
Téc(um) úna tót(a) ést J nóstra sepúlta dómus,
q qq q q/ qw wqw ww
Ómnia téc(um) úna P periérunt gaúdia nóstra,
qww q qq/ wwqq qww qw
Quaé túus in uíta J dúlcis alébat ámor.
q ww qqq/qw wqw ww
81 A. Ernout, dans sa traduction, interprète à tort les vers 68, 25-26 comme fonctionnant sur le même mode énonciatif que 68, 20-24, et les intègre au discours rapporté. En réalité, le relatif « de liaison » Cuius marque le passage à la personne 3 pour la référence au frater. Le verbe fugaui indique que lʼon est revenu au mode narratif des vers 68,15-20 (cf. lusi). Cette erreur est évitée dans la traduction de G. Lafaye (1923, 76).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
397
Le discours rapporté est anticipé dans la narration (68,19) par le mot luctu,
mis en valeur entre les césures penthémimère et hephthémimère. La
contextualisation métalinguistique de la prise de parole est ainsi réduite à ce
programme minimal. Lʼénonciateur du discours rapporté nʼa pas le visage
mouillé de larmes comme Ariane; mais ce manque est compensé par lʼoralité
pathétique que la narration prend déjà en charge, avec un jeu dʼéchos
consonantiques (/t/ et /m/), toujours au vers 68,19, et une clausule
dʼhexamètre singulière par sa configuration verbale82, créant les conditions
dʼun contre-accent enjambant (Plantade, 1999c, 796) comme par sa
construction phonique (échos en /m/)83.
Le discours rapporté débute par un contre-accent (Ó mísero) qui lance
rythmiquement la sous-séquence, en la constituant en fait dʼoralité.
Lʼhyperbate sépare lʼinterjection o des vocables portant la marque du vocatif
(frater…adempte) ; cʼest la première syllabe de lʼadjectif au datif qui se
trouve focalisée en tant que sommet du contre-accent. Sʼélabore un tissage
des vocables au vocatif (référence au frère mort) et de la chaîne lexicale
mise en réseau sous le signe de la subjectivité de lʼénonciateur à travers les
échos phoniques (misero - mihi - mors).
Il est également intéressant dʼobserver que cette configuration verbale
constituant lʼattaque de la sous-séquence (monosyllabe interjectif + adjectif 82 Rosa Marina Sáez (1998, 138) repère 10 clausules de type W9-0X-Z (notation de L.Nougaret, reprise par J. Luque Moreno) dans les hexamètres élégiaques de lʼœuvre de Catulle, soit 3,12% de lʼensemble, contre 42,5% pour le type condere gentem. 83 Rappelons le commentaire de Fordyce (1973, 346) au sujet des vers 19 et suivants : « The ending of l.19 in a stressed monosyllable and the break after the first foot in l.20 convey the shock of sudden sorrow and the repetitions fraterna - frater - frater and tu - tecum - tecum - tuus are pathetically eloquent. ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
398
au datif) était annoncée, au point de vue prosodique, dans le vers clausulaire
de la première séquence (68,1-14) du texte : N(e) amplius a misero P dona
beata petas). Celui-ci jouait dʼailleurs sur lʼhomonymie de la préposition
proclitique avec une interjection accentuée, fréquemment placée, comme on
lʼa vu, avant une forme de lʼadjectif miser. Mais il y a davantage à dire. La
configuration accentuelle du deuxième côlon est celle-là même qui est
utilisée à la manière dʼun refrain dans tout le discours rapporté (68,20 ;
68,22 ; 68,24). Comme le schéma prosodique du deuxième côlon dʼun
pentamètre quasi fixe, cette constante accentuelle est obtenue par un jeu
verbal qui consiste à aligner un mot trochée (qw), un mot amphibraque (wqw)
et un mot pyrrhique (ww).
En fait, il sʼagit de la configuration verbale la plus courante pour cette partie
du pentamètre catullien. Selon les statistiques de Marina Sáez (1998,176,
tableau 27), elle se retrouve dans 14,9% de lʼensemble des pentamètres84.
Toutefois, on ne trouve pas trace de cette configuration avant le vers 68,14,
et, surtout, elle nʼest pas utilisée dans la partie narrative (68,15-20 ; 68,25-
26) de la séquence de récit autobiographique que nous avons délimitée.
Si lʼon observe une régularité totale des fins de pentamètre dans le discours
rapporté, une standardisation est encore à lʼœuvre après la césure
penhémimère des deux hexamètres de la sous-séquence. Les mots qui
suivent directement la césure penthémimère sont paroxytons, quʼil sʼagisse
du molosse fregísti ou de lʼ ionique mineur periérunt(wwqq). De plus, les
84 Utilisant la notation de J. Luque Moreno, lʼauteur note cette configuration verbale sous la forme de la séquence V7-8X9-0Z. On en trouve 48 occurrences dans le corpus.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
399
clausules sont construites à lʼidentique, selon le type condere gentem (68,21
cómmoda fráter ; 68,23 gaúdia nóstra).
Les débuts de vers obéissent à une logique différente. Ce sont les
rencontres de syllabes accentuées, autrement dit les figures
contraccentuelles qui y sont recherchées. Autrement dit, ces débuts de vers
forment un rythme de la véhémence. Notons, par exemple, les deux contre-
accents du vers 68,21, qui sʼappuient sur une récurrence à la fois lexicale et
consonantique, et dont le second est puissamment dramatisé par la tension
de la césure trihémimère : Tú méa tú Tmóriens… Notons aussi les contre-
accents créés de façon systématique par la présence des élisions : 68, 22
Téc(um) úna tót(a) ést85 ; 68, 23 Ómnia téc(um) úna.
Lʼoralité du luctus est obtenue par un travail spécifique correspondant à
chaque grande partie du vers. Avant la césure penthémimère ou la jointure,
cʼest la violence phatique qui sʼexprime, pour couvrir la distance qui sépare le
mort de lʼénonciateur, dans la dernière partie du vers, le rythme est syncopé,
parce quʼil fait alterner les attaques de mot accentuées et les paroxytons, qui
figurent une baisse de la voix.
85 La forme monosyllabique dʼesse est ici une partie de la forme composée du parfait passif (sepulta est), mais, compte tenu de sa place par rapport au participe, habituellement le premier élément en prose, il nous semble raisonnable de penser quʼelle est emphatique. Cʼest pourquoi nous ne retenons pas la prosodie de certains éditeurs (dont Kroll), totast, et préférons le monosyllabe ante iuncturam.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
400
68, 92-93
Lʼinterjection ei nʼest employée, de façon certaine, quʼà deux reprises dans
le liber Catulli, et cela dans deux vers contigus (68, 92-93)86. Elle a donné
naissance à un verbe délocutif, eiulare (Biville,1996c, 219). Le TLL lui
attribue la gamme dʼaffects suivante : « interiectio ei uarios affectus animi
consternati, dolorem et lamentationem, timorem et terrorem, indignationem
stuporemque significat. ». Pour Hofmann (1958, §12, 17), qui nʼentre pas
dans ces détails, elle est essentiellement propre à exprimer la douleur
actuelle ou escomptée. Elle possède davantage dʼautonomie que uae (Plt.
Amph.321 : ei, numquam obolui )87, mais on la trouve le plus souvent comme
attaque de syntagme au datif (ei mihi ou ei misero mihi).
Les deux occurrences qui nous intéressent interviennent dans une
séquence de déploration du frère mort (Syndikus, 1990, 259 : « Die Verse
91-100 sind darauf der Klage um den Bruder gewidmet. ») qui sʼinscrit dans
un mouvement plus large, consacré à Laodamie et à Troie.
Intéressons-nous dʼabord à ce qui précède la déploration du frère (68, 87-
92) : « Alors en effet, par le rapt dʼHélène, Troie avait commencé de soulever
contre elle les grands chefs Argiens, Troie (ô sacrilège !) tombeau commun
de lʼAsie et de lʼEurope, Troie où furent réduits en cendres avant lʼheure tous
86 Pas de problème textuel à signaler, hormis que les mss. portent souvent la graphie hei (68, 92 : G, R, O; 68,93 : G, R, O). 87 Plt. Most. 542 ei, quam timeo miser ! ; Most. 739 — ei ! —quid est ? — me miserum, occidi!
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
401
les héros et tous les héroïsmes, Troie qui causa aussi le trépas lamentable
de mon frère. » (Ernout,1964,111).
Nám t(um) Hélenae T ráptu P primóres Árgiuórum
q wwq / qq/qqq qqqq
Coéperat ad sése J Tróia ciére uíros,
qww qqq/ qw wqw wq
Tróia (néfas) T commúne Tr sepúlcr(um) HÁsi(ae) Eúropaéque,
qw wq/ qqw / wq ww qqqw
Tróia uír(um) ét uirtút(um) J ómni(um) acérba cínis
qw w q qq / qw wqw wq
Quaén(e) étiam T nóstro P létum H míserábile frátri
q wwq/ qq /qq /wwqww qq
Áttulit.
qww
Au lieu dʼêtre une simple exposition de lʼarrière-plan du mythe de Laodamie
(la guerre de Troie), ce passage préalable à la déploration fraternelle elle-
même permet au narrateur de se démasquer et de laisser progressivement
apparaître lʼénonciateur autobiographique quʼil est potentiellement. Ainsi, le
connecteur Nam, qui délimite la séquence explicative, est suivi dʼun verbe à
valeur dʼimparfait (68, 88 coeperat : second plan), mais son sujet, Troia (68,
89), va être repris à travers une série de trois appositions à caractère
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
402
nettement axiologique. La première dʼentre elles acquiert cette dimension
grâce à lʼinsertion dʼun dissyllabe interjectif (nefas !) qui fonctionne comme
un adjectif péjoratif, les deux autres exploitent pour ce faire le procédé de la
reformulation métaphorique, faisant appel au lexique funèbre (68, 89
commune sepulcrum ; 68, 90 acerba cinis). Ce nʼest déjà plus la voix du
simple narrateur qui intervient ici, dʼautant que se joint à la subjectivité du
jugement la modalité exclamative, impliquée par lʼanaphore de Troia en
attaque de vers, ou le tour emphatique familier des vers 68, 91-92
(Quaene…attulit !), auquel il ne faut dʼailleurs pas accorder trop de crédit,
dans la mesure où le début du vers 68,91 est dû à une émendation de
lʼhumaniste hollandais Heinsius (XVII°)88.
La tension vers une oralité subjective se manifeste de façon foisonnante
dans la dimension métrico-rythmique du passage. Au plan purement
métrique, le vers démarcatif (68, 87), un hexamètre, est doté dʼune clausule
spondaïque à travers le quadrissyllabe Árgiuórum, et il en est de même de
lʼhexamètre suivant (68,89), avec Eúropaéque. Or, ce type de clausule,
avant cette occurrence, nʼest présent quʼune fois dans le c.68, de surcroît
dans un vers qui contient une itération anaphorique (61,65 Iam prece
Pollucis, iam Castoris implorata,). Cet aspect est complété par le retour dʼune
même configuration prosodico-verbale en fin de pentamètre, déjà utilisée en
88 Fordyce (354) ne dénie pas toute valeur interrogative à ce colloquialism que lʼon trouve chez Horace (Sat.1,10,21 o seri studiorum, quine putetis / difficile et mirum Rhodio quod Pitholeonti / contigit ?) et conclut : « the relative clause appears to be given emphasis by being put interrogatively ». Pour J.Granarolo (1967,338), -ne est ici « dépourvu de toute acception proprement interrogative », il « joue un rôle mi-explicatif mi-assévératif qui se retouve chez Horace, Sat., I, X, 21 (avec le subjonctif, il est vrai) et relève, lui aussi, dʼune langue assez familière, prouvant que le mélange des tons et des niveaux stylistiques peut sʼétendre à lʼélégie. ». Autres références sur cette question : Granarolo, 1967, 338 n.1 et 2.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
403
série dans la déploration du frère contenue par le début du poème (voir notre
étude dʼo au vers 68,20). Les pentamètres 68,88, 68,90 (série se
prolongeant au delà de ce passage) contiennent la configuration mot
trochée (qw) - mot amphibraque (wqw) - mot pyrrhique (ww).
Il y a donc une subjectivation de la prosodie elle-même, transformée en
« forme-sens » (Meschonnic) de lʼénonciation autobiographique. Au plan
rythmique, remarquons que lʼattaque de la séquence est marquée par un
contre-accent (Nám t(um) Hélenae) provoqué par une élision, procédé qui
est un des faits rythmiques majeurs du passage. Lʼautre fait rythmique
majeur, débutant lui aussi au vers 68,87, serait le jeu avec les échos en / r /:
le mot ráptu est mis en valeur entre les césures trihémimère et
penhémimère, et sa syllabe accentuée trouve un écho renversé dans la
syllabe dʼattaque du mot clausulaire, Árgiuórum, portant un accent
secondaire.
Le bilan rythmique pour le reste du passage (68,88-91) est le suivant :
1° On trouve deux élisions dans le vers 68,89. La première dʼentre elles
crée un contre-accent annulant la césure hephthémimère (sepúlcr(um) H
Ási(ae)). On trouve trois élisions dans le vers 68,90. La première dʼentre
elles aboutit à un effet contraccentuel (uír(um) ét), la deuxième, fait rare,
aboutit à un contre-accent en annulant la jointure du pentamètre (uirtút(um) J
ómni(um)). Ces faits, qui interviennent dans des énoncés exclamatifs, sont à
interpréter comme des manifestations dʼune oralité de la colère véhémente.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
404
2° Le réseau dʼéchos le plus important est celui qui concerne le phonème / r
/. Son extension est assez large, puisquʼil permet de constituer une série
lexicale contenant : 68, 87 raptu, primores, Argiuorum ; 68, 88 Coeperat,
Troia, ciere, uiros ; 68, 89 Troia sepulcrum, Europaeque ; 68, 90 Troia,
uirum, uirtutum, acerba ; 68, 91nostro, miserabile, fratri. Lʼaccentuation des
syllabes en / r / est un critère qui permet de former une liste restreinte, plus
facile à interpréter : ráptu - Árgiuórum - Tróia - Tróia - Tróia - (acérba) -
míserábile - frátri. Ainsi, le poète établit une interdépendance sémantique de
ces termes, et légitime le glissement quʼil est en train dʼopérer entre le récit
mythologique et le discours autobiographique.
De la sorte, lʼoccurrence des interjections aux vers 68, 92-93, est préparée
et justifiée, au travers dʼun processus de subjectivation de lʼénoncé, qui
mobilise de multiples ressources linguistiques (axiologie, modalité, prosodie,
élision, échos phoniques, rythme accentuel). Le mot Tróia, converti en
emblème du mot mórs (présent au vers 68,19, cʼest-à-dire juste avant
lʼoccurrence de lʼinterjection o), évoque alors de façon évidente le mot frátri.
Examinons maintenant la séquence (68,92-100) inaugurée par lʼinterjection
ei, en position C du pentamètre, selon la formalisation de J. Luque Moreno
(1994, 92 n.375), cʼest-à-dire au troisième demi-pied : « Las! quel malheur
pour moi, ô mon frère, de tʼavoir perdu ! quel malheur pour toi, ô mon frère,
dʼavoir perdu lʼaimable lumière du jour ! Avec toi notre maison tout entière est
entrée dans la tombe, avec toi ont péri toutes les joies que, durant ta vie,
entretenait en nous une affection si douce. Et maintenant te voilà au loin,
reposant non parmi les tombes familières et les cendres de tes proches,
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
405
mais enseveli dans la sinistre Troie, dans la Troie maudite, dans une terre
étrangère qui détient tes restes aux extrémités du monde. » (Ernout, 111).
Cette séquence de déploration fait, bien entendu, écho à celle des vers
68,19-26, que nous avons étudiée, et dans laquelle se trouve déjà un
monosyllabe interjectif (68, 20 o). Les vers 68,93-94 apparaissent comme
une réécriture de 64,20-21. Ainsi, 68, 20 et 68, 93 sont tous deux des
pentamètres commençant par des formes dactyliques, en lʼoccurrence des
verbes au parfait de sémantisme antonymique (Abstulit / Attulit ); les deux
occurrences dʼei occupent chacune une position où lʼon trouve déjà un
monosyllabe, interjectif ou non. De plus, certains vers des deux séquences
parallèles sont identiques (68, 22-24 = 68, 94-96) 89.
Devant quel emploi de lʼinterjection se trouve-t-on ? Lʼemploi autonome est
vraisemblablement à exclure du fait de la présence dʼun mot dont la marque
désinentielle peut être interprétée (à juste titre) comme un datif :
… Eí mísero J fráter adémpte míhi !
q wwq /qw wqw ww
Eí mísero T frátri P iocúndum lúmen adémptum !
q wwq /qq/ qqq qw wqq
89 Ce remploi est dʼailleurs utilisé par Syndikus (1990,253-254) comme un argument en faveur de lʼunité du c.68 (épître dédicatoire) et du c.68b (élégie) : « Man kann durchaus einen Sinn darin sehen, daß der Dichter die zentralen Verse seiner Elegie in der Einleitungsepistel vorwegnimmt: Wenn sie der Leser vorher kennengelernt hat und so weiß, aus welchen Lebensumständen heraus Catull das Gedicht geschrieben hat, wird die Wiederkehr des Motivs in dem dem Freund und der eigenen Liebe gewidmeten Gedicht verständlicher. ». Plus généralement, cet auteur réfute point par point (1990,251-254), de façon convaincante, les arguments internes allégués par les tenants de la séparation des deux passages.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
406
En revanche, le fait de repérer un emploi « syntagmatique » de lʼinterjection
ne clôt pas lʼenquête. Il sʼagit ensuite de déterminer quels sont les éléments
de ces syntagmes. On a vu que lʼemploi syntagmatique de lʼinterjection se
traduit par des formules du type ei mihi ( la plus fréquemment documentée
chez les poètes dramatiques ou les élégiaques) ou ei misero mihi (Ter.
Haut. 234; Plt. Cas. 848, Plt. Aul. 200). Pour Kroll (1929, 232), il paraît
évident que lʼon a affaire, pour le vers 68, 92, à la seconde de ces formules,
mais il remarque que sa construction nʼest pas habituelle (« ungewöhnliche
Konstruktion »), pensant probablement à lʼhyperbate, bizarrerie quʼil justifie
par la recherche dʼun parallélisme avec le vers 68, 20 (o misero frater
adempte mihi). Dans ce dernier vers, le syntagme au datif, dépend
uniquement dʼadempte. Mais la situation se complexifie dans le cas du vers
68, 92. Et il ne semble pas, comme lʼa pensé Kroll, que lʼon puisse réduire le
vers à une seule lecture syntaxique. En effet, Catulle paraît avoir recherché
lʼambiguïté :
1° Compte tenu du fait que le vers précédent (68, 91) se termine par fratri
et que ei misero forme un groupe contraccentuel avant la jointure, le lecteur
peut très bien considérer que le référent implicite de lʼadjectif misero est le
frère de lʼénonciateur. Dans cette hypothèse le datif mihi dépend seul
dʼadempte.
2° Une autre hypothèse, plus spontanée, se présente, qui reprend lʼanalyse
de Kroll : la jointure provoque chez le lecteur un effet dʼattente, rendu
possible par la fréquence de la formule ei misero mihi, et il interprète mihi
comme dépendant concomitamment dʼei et dʼadempte.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
407
À notre sens, les deux lectures ont été voulues par lʼauteur.
Dans le cas du vers 68, 93, où Eí mísero se trouve en attaque dʼhexamètre,
Kroll fait appel, sans lʼexpliciter, à un raisonnement analogue à celui que
nous venons dʼutiliser pour la première hypothèse de lecture de 68, 92 :
« Die Anaphora verlangt, daß in V.93 ei misero (mihi) verstanden und nicht
misero mit fratri verbunden wird; fratri - adempte steht, wie schon die
Wiederholung des Verbums zeigt, mit frater adempte parallel. ». Le référent
implicite du groupe Eí mísero serait donc mihi, placé à la fin du vers
précédent, et alors fratri dépendrait exclusivement dʼademptum. Cette lecture
nous paraît possible, car le groupe est délimité par la césure trihémimère.
Toutefois, on peut lire cette césure comme la création dʼun effet dʼattente,
introduisant cette fois une variation sur la formule usuelle, et, ici, le substantif
fratri, pris entre la trhihémimère et la penthémimère est lu comme dépendant
concomitamment dʼei et dʼademptum.
Lʼambiguïté syntaxique nʼest pas gratuite : ce que recherche Catulle cʼest un
moyen dʼexprimer lʼindissolubilité du lien fraternel par delà la mort. Qui est le
plus à plaindre ? Celui qui reste ou celui qui part ? Si le vers 68,92 envisage
la mort du frère comme une perte ressentie par lʼénonciateur, on a vu que
lʼautonomie du groupe contraccentuel permet une autre interprétation. La
réciproque est vraie, lorsque le vers 68, 93 insiste sur la perte ressentie par
le frère, arraché à la lumière joyeuse.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
409
La voix du narrateur
64, 22-23
Dans le c.64, plusieurs interjections sont à mettre au compte de la voix du
narrateur, et non plus de personnages mythiques. Il en va ainsi de
lʼinterjection o, qui est présente dans deux vers consécutifs (64,22-23)90.
Lʼinterjection, en attaque du vers 64, 22, sert dʼembrayeur à une séquence
(64, 22-30) où le narrateur sʼadresse aux personnages de la « matière »
héroïque, et particulièrement à Pélée, dont les noces doivent être contées
dans le poème : « O vous qui êtes nés dans des siècles trop heureux, salut,
héros, race des dieux ! O digne descendance de vos mères, salut encore !
…91 Cʼest vous, oui, cʼest vous que je ne cesserai dʼinvoquer dans mes
chants, et toi plus que tous les autres, toi que combla une heureuse union, ô
colonne de la Thessalie, Pélée, à qui Jupiter en personne, oui, le père des
dieux lui-même a cédé ses amours. Nʼest-ce pas toi que la fille de Nérée,
Thétis, la toute belle, a tenu dans ses bras ? Nʼest-ce pas à toi que Thétys
voulut bien accorder sa petite fille, Thétys et lʼOcéan qui dans ses flots
embrasse la terre entière ? » (Ernout, 1964, 85-86).
90 Pas de soupçon quant au texte. La Scholia Veronensis ad Verg. Aen., reprise par Keil (94, 11) apporte un témoignage sur 64,23 qui confirme lʼitération de lʼinterjection o que proposent les mss. Fordyce (281) : « The manuscripts have the meaningless o bona mater : the quotation in the Verona scholia on Aen. V 80 corrects the last word to matrum and adds half of the following line. ». 91 Les points de suspension correspondent ici à la lacune qui se trouve dans le vers traditionnellement numéroté 68,23b.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
410
À lʼintérieur de cette séquence, le narrateur se désigne explicitement par
lʼemploi du pronom de personne 1 (64, 24 ego), et ses allocutaires mythiques
sont désignés par les pronoms de personne 2, lʼensemble des héros dʼabord
(64, 24 Vos…uos), puis Pélée (64, 25 Teque; 64, 28-29 Tene).
Lʼinterjection o joue bien un rôle démarcatif, par rapport à la séquence
narrative qui précède (64,1-21), marquée par la personne 3, lʼemploi du
parfait et des indices temporels du type de quondam (64,1) ou de lʼablatif de
date luce (64,16)92. Toutefois son occurrence nʼest pas inattendue pour le
lecteur, car les trois derniers vers (64,19-21) de la séquence narrative
supposent une intervention de la subjectivité du narrateur : lʼanaphore du
groupe constitué par lʼadverbe Tum et le substantif Thetis (au nominatif ou
au datif) fait sortir la narration de la neutralité de lʼannale; elle crée une
focalisation sur le personnage de la divinité féminine, qui constitue un
hommage enthousiaste à son endroit.
La continuité entre les vers 64,19-21 et le vers 64, 22 est renforcée par la
rythmique des attaques, qui sont contraccentuelles : Túm Thétidis / Túm
Thétis / Túm Thétidi / Ó nímis.
Lʼinterjection o est employée non comme forme autonome, mais bien
comme début de syntagme au vocatif, cʼest-à-dire que lʼon a bien affaire ici à
ce que le TLL désigne comme une « particule vocative ». Dans un ordre
prosaïque, ce syntagme pourrait avoir la forme suivante : O Heroes, nimis
optato tempore saeclorum nati. Il convient donc de remarquer la place
92 La métonymie lux pour dies se retrouve aussi au vers 64,325 (laeta luce).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
411
marquée quʼoccupe le substantif Heróes (molosse paroxyton) dans le texte
catullien. En rejet, il libère la position contiguë à lʼinterjection, quʼil occuperait
probablement, de sorte quʼun dissyllabe portant lʼaccent sur la syllabe
dʼattaque puisse se substituer à lui :
Ó nÍmis optáto P saeclórum B témpore náti
q ww qqq/ qqq / qww qq
Heróes, T saluéte, Tr déum H géns, ó bóna mátrum93
qqq / qqw /wq / q q ww qu
Progénies, T saluét(e) íterum […]
qwwq / qq wwq
En cela, lʼadresse aux héros se rapproche de lʼadresse à la porte, du c.67,
où le nom vocatif de lʼallocutaire est rejeté en attaque du troisième vers, alors
que le début de la séquence discursive est occupé par un groupe
contraccentuel : Ó dúlci T iocúnda Tr uíro, H iocúnda parénti, /Sálue, téque
bóna JJúpiter aúctet ópe, / Iánua…(67,1-3). On peut noter deux autres traits
communs à ces adresses de salutation. Dʼune part, elles comportent
lʼinterjection secondaire salue / saluete. De lʼautre, le deuxième vers de la
séquence discursive inaugurée par lʼinterjection est construit avec le même
système de césures, dénommé « triple a » par L.Nougaret (1948,§§79-80),
93 Le texte du vers que nous adoptons varie sur un mot de celui de la vulgate. Nous préférons gens à genus (ww) que portent les mss. G, R, et O. Le texte que propose la Scholia Veronensis ad Verg. Aen. 5,80 (citée par Mynors) est le suivant : …saluete deum gens o bona matrum progenies saluete iter… Or, il nous semble que les éditeurs (hormis Madvig) font preuve dʼinjustice en rejetant la leçon gens (métriquement acceptable) alors quʼils adoptent matrum, qui corrige avantageusement les mss., et le début de 64,23b.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
412
cʼest-à-dire la combinaison des césures trihémimère, trochaïque troisième et
hephthémimère.
Lʼapostrophe élogieuse que constitue la micro-séquence 64,22-23b nous
semble animée par une dynamique rythmique croissante. Le premier vers se
caractérise par la lisibilité de sa structure, divisé quʼil est en deux côla par sa
césure penthémimère, et, de plus, doté dʼune clausule banale du type
condere gentem. On y trouve un souci dʼéquilibre verbal, les deux molosses
du vers étant répartis entre les deux côla (optato/saeclorum). Sa
configuration accentuelle, si lʼon fait abstraction du contre-accent en attaque
de vers, compose des échos consonantiques embrassés (/ n / - / t / - / t / - / n
/) dont lʼordonnancement résonne comme un appel plein de digne solennité :
Ó NÍmis opTáto P saeclórum Témpore Náti .
Mais Catulle rompt ce bel équilibre dans le vers 64, 23. Celui-ci, comme
nous lʼavons déjà noté, est doté dʼun système de trois césures. Le
déséquilibre sʼétend dʼabord à la métrique verbale les deux trisyllabes
paroxytons du vers (Heróes, saluéte) forment les deux premiers côla. À partir
de la césure trochaïque troisième, les mots portent lʼaccent sur la syllabe
dʼattaque. Et surtout le dernier côlon a une dynamique contraccentuelle
remarquable, que produit la clausule de type si bona norint introduite par la
récurrence de lʼinterjection o en position W de lʼhexamètre, cʼest-à-dire au
premier demi-pied de la dipodie finale.
Ici lʼon peut voir deux interprétations rythmiques, selon que lʼon suit le texte
de la vulgate, ou celui que nous avons retenu. Le texte de la vulgate
présente lʼhypothèse minimale, où le côlon final, délimité par une ponctuation
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
413
bucolique (Cupaiuolo, 1965, 59), contient un seul contre-accent, mettant en
valeur la syllabe dʼattaque de lʼadjectif mélioratif : H génus B ó bóna mátrum.
Dans lʼhypothèse maximale qui est la nôtre, fondée sur une variante
textuelle, nous nous trouvons devant une série de deux contre-accents qui
donne une dynamique un peu différente au côlon final : Tr déum H géns, ó
bóna mátrum. Dans ce cas, la relance du rythme a lieu dès lʼattaque de
côlon, ce qui a pour conséquence de lier la fin du syntagme deum gens à ce
qui apparaît, en raison du placement habituel de lʼinterjection o, comme un
début dʼénoncé. Cette configuration rythmique, opérant un rapprochement
syncopé, par annulation de la pause, de la fin dʼun énoncé exclamatif au
début du suivant, nous paraît suggérer lʼenthousiasme de lʼénonciateur.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
414
64,71
Au vers 64, 71, apparaît lʼinterjection a, que les manuscrits proposent
généralement avec la graphie ah 94. Le texte des manuscrits est dʼautant
plus sûr quʼil est confirmé par le témoignage de Nonius (134 L, s.u.
externauit). Ce monosyllabe interjectif est inséré dans une longue séquence
(64, 52-75), traditionnellement désignée comme une ekphrasis, en dʼautres
termes comme la description dʼune scène figurée sur un objet dʼart95. Cette
scène représente Ariane scrutant la mer, sur laquelle sʼéloigne, à coups de
rames, Thésée, lʼamant oublieux.
Puisque lʼon ne se trouve pas devant une séquence de discours direct, où,
normalement, le statut énonciatif de lʼinterjection est clairement indiqué par
une description du motus animi du personnage, il sʼagit, au préalable,
dʼétudier certains aspects saillants de lʼekphrasis catullienne.
Dʼabord, il sʼagit dʼune description animée par lʼusage dʼune série de verbes
au présent historique (64, 53 tuetur ; 64,55 credit ; 64, 56 cernat ; 64, 58
pellit ; 64, 60 prospicit ; 64, 61 prospicit ; 64, 63 fluctuat) dont le sujet est
94 On trouve ici une divergence de lʼapparat de Lafaye avec ceux de Mynors et Bardon. Selon ces deux derniers éditeurs, le ms O contient la leçon ha, et non ah, comme lʼindique Lafaye. 95 Ce procédé remonte à la description homérique du bouclier dʼAchille (Il.18,478 ss.). Il est repris notamment, à lʼépoque hellénistique, par Appolonios de Rhodes (1, 721-767), et Théocrite (1, 29-55); cf. Fordyce, 273.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
415
Ariane, à une exception près (64, 58). En fait, la dimension essentiellement
descriptive est ici reconnaissable au fait quʼil nʼy a pas de véritable linéarité
temporelle organisée par des connecteurs, et que, bon nombre de ces
verbes étant isotopes (liés au sème « regarder »), lʼensemble du passage
apparaît comme lʼamplification rhétorique de ses deux premiers vers (64, 52-
53 Namque fluentisono prospectans litore Diae / Thesea cedentem celeri
cum classe tuetur); lʼénoncé iuuenis fugiens uada remis (64, 58) renvoyant,
de son côté, au syntagme Thesea cedentem (64, 53).
Lʼactivité du narrateur semblerait, si lʼon sʼen tenait à cela, limitée à
lʼorganisation du travail analytique impliqué par lʼamplification (la « procédure
dʼaspectualisation » inhérente au prototype descriptif, selon J.-M. Adam,
1997, 89-91). Mais il intervient encore autrement.
Il prête à Ariane des motus animi : la révolte (64, 54 « agitant en son cœur
des fureurs indomptées »), ainsi que la stupeur (64, 55 « Elle ne croit pas
encore avoir vu ce quʼelle a vu »). Acte qui suppose une interprétation de la
scène figurée dépassant le simple constat objectif.
De plus, il est engagé dans une démarche de commentaire, qui se traduit
par lʼusage dʼune comparaison, ut effigies bacchantis (64,61 « comme
lʼimage dʼune bacchante »), dʼun système métaphorique reformulant
lʼexpression du motus animi agitant le personnage dʼAriane, et magnis
curarum fluctuat undis (64,62 « elle tangue au gré des grandes eaux de ses
craintes »). Mais surtout, comment interpréter lʼinterjection dissyllabique
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
416
eheu96 , qui constitue le dernier pied de lʼhexamètre 64,61 ? Définie par le
TLL comme une « interiectio lamentantis », elle renvoie à la question « Qui
donc se lamente en lʼoccurrence ? ».
Dans ce cotexte, et à cause de sa position au centre de lʼépanalepse
prospicit eheu prospicit, on a tendance à la considérer comme une
intervention discursive directe du narrateur. Celui-ci prend fait et cause pour
lʼhéroïne, en jugeant son état « misérable » (au sens latin du terme) : « Et de
loin sur lʼalgue, la fille de Minos , telle la statue de pierre dʼun bacchante, le
regarde de ses tristes yeux, hélas !, elle le regarde » (Ernout,87). Que
lʼinterjection soit mise au compte du narrateur est dʼautant plus probable que
le dissyllabe spondaïque eheu (64,61) trouve un écho obvie dans le nom du
héros Thésée, au vocatif, placé un peu plus loin (64,69 Theseu), en une
position métrique rigoureusement identique (le dernier pied, i.e. en termes de
métrique verbale, YZ). Cette paronomase est intéressante à plus dʼun titre.
Dʼabord, elle permet de rattacher le dissyllabe interjectif à un énoncé où
lʼénonciateur (ego = narrateur) et son allocutaire (tu = Thésée) sont
absolument définis. Ce qui renforce lʼhypothèse selon laquelle lʼinterjection
dissyllabique est bien émise par le narrateur. Ensuite, elle autorise une
hypothèse forte sur lʼaccentuation dʼeheu ; dans la mesure où lʼaccentuation
96 Ce dissyllabe interjectif, qui appartient maintenant à la vulgate du texte, est dû à une correction faite par Bergk à partir de la leçon manuscrite heue. Elle est hautement probable, comme nous le verrons dans le cours de cette étude. Pour Fordyce (286), « the pathetic repetition makes Bergkʼs eheu certain ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
417
de la dipodie finale de lʼhexamètre est notoirement standardisée97 (les
exceptions étant générées par lʼintrusion de monosyllabes en clausule), on
peut inférer éheu à partir de Théseu98.
Toutefois, si cette première interjection de la séquence est principalement à
mettre au compte du narrateur, cela ne signifie pas quʼil en soit le seul
énonciateur possible. Ainsi, on peut également expliquer lʼoccurrence de cet
embrayeur, par la proximité du syntagme maestis ocellis (64,60 « ses tedres
yeux en deuil »), décrivant le regard dʼAriane tout en donnant une information
sur son affectus ou motus animi. Car cʼest précisément de cette façon que le
poète procède lorsquʼil veut introduire une interjection dans une séquence de
discours rapporté (cf. études de 63,50 ou de 64,135). Eheu se présente donc
comme un cas de polyphonie, où le narrateur se fait le porte-parole dʼun
affect, qui appartient dʼabord à un personnage, mais quʼil finit par partager.
De même que le personnage dʼAriane devient psychologiquement semblable
aux flots quʼelle voit, par lʼentremise dʼune métaphore que nous avons
évoquée, le narrateur est contaminé par lʼaffect du personnage qui se trouve
au premier plan de son tableau fictif.
Les observations rythmiques viennent corroborer ce qui a été écrit
précédemment à propos de lʼimplication du narrateur. La description est
soutenue, animée par une oralité rythmique très perceptible. Les
phénomènes de récurrence lexicale (Évrard-Gillis, 1976) comme 97 Sur la coïncidence, dans lʼhexamètre, de lʼaccent de mot et des temps marqués (les premiers demi-pieds) de la dipodie finale comme moyen de constituer lʼidentité du mètre, voir Iso Echegoyen (1981-82) et sa reprise chez Marina Sáez (1998,137). 98 Mais on verra que cette inférence ne clôt pas la question et quʼil est possible de former une hypothèse plus hardie sur lʼaccentuation de ces termes paronomastiques.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
418
lʼépanalepse des vers 64,61-62, ou lʼanaphore de Non (64,63-65), qui la suit
immédiatement, constituent autant dʼindices de lʼimplication de lʼénonciateur.
Au plan prosodico-accentuel, certains passages se présentent comme de
véritables morceaux de bravoure rythmiques. Nous en sélectionnons deux
dʼentre les plus remarquables.
Voyons les vers 64,55-57 : « Elle ne peut encore en croire ses yeux, elle
qui, à peine réveillée dʼun sommeil trompeur, se voit, la malheureuse,
abandonnée sur le sable du désert. » (Ernout, 87).
Nécd(um) étiam T sése P quaé uísit B uísere crédit
q wwq/qq /q qq /qww qw
Út póte falláci P quaé túm (H ) prím(um) éxcita sómno
q ww qqq/q q q qww qq
Desért(am) in (T) sóla P míseram H sé cérnat haréna.
qq qqq/ wwq / q qw wqq
Observons, sans souci dʼexhaustivité, que la longue série de contre-accents
(quaé túm prím(um) éxcita), présente dans le deuxième côlon du vers 64,
56, a deux fonctions, au moins :
1° Elle mime la violence ressentie par lʼhéroïne au réveil.
2° Elle rompt lʼunité rythmique de la dipodie clausulaire en excluant le mot
spondaïque finale (sómno), de sorte que celui est apparaît comme le relais
dʼune série distincte, cʼest-à-dire le groupe lexical créé par les échos du
phonème / s /, sous accent ou non : 64, 55 sése - (uísit) - (uísere) - 64, 56
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
419
sómno 64, 57 Desért(am) - sóla - (míseram) - sé. Cette série opère, au plan
sémantique, un rapprochement pathétique et solennel entre lʼidentité de
lʼhéroïne et sa situation misérable. On voit dʼailleurs à lʼœuvre ce même
procédé, quand, dans le discours rapporté, Ariane dresse un bilan sinistre de
ses ressources face à lʼadversité.
Le deuxième exemple que nous prenons est constitué par les vers 64,68-
70 : « Mais alors, insoucieuse du sort et de sa mitre et de son vêtement que
baignait la vague, cʼest à toi, Thésée, que tout son cœur, toute son âme,
toute sa pensée demeuraient éperdument suspendus » (Ernout, 87).
Séd néque túm (T) mítrae P néque túm (H) flúitántis amíctus
q ww q qq / ww q wwqw wqq
Ílla uícem T cúrans P tót(o) ex H té péctore, Théseu,
qw wq /qq /q q / qqww qq
Tót(o) ánimo T tóta P pendébat pérdita ménte.
q wwq/ qq/qqq qww qw
Ici, pas de longue série contraccentuelle, mais de simples contre-accents,
surtout concentrés dans le premier vers (64, 68 Séd néque… túm mítrae…
túm flúitántis), utilisés notamment de façon à dramatiser lʼapparition dʼun
allocutaire, Thésée, au vers suivant. Comme dans le cas dʼeheu, lʼon a
affaire à une allocution polyphonique en dernière analyse, même si cʼest bien
au départ le narrateur qui interpelle le héros, le présentant comme coupable
du furor dʼAriane. Insistons sur les contre-accents des deux derniers vers. Au
vers 64, 69, lʼattaque du dernier côlon est renforcée par le contre-accent quʼy
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
420
crée lʼinsertion dʼun pronom personnel monosyllabique au milieu dʼun
syntagme prépositionnel (ex H té péctore); ce quii a pour but de mettre en
valeur le nom du héros, détaché de lʼensemble clausulaire, mais cette fois,
contrairement à ce qui se produit au vers 64,56 (…sómno), le mot
spondaïque final (Théseu) est intégré à une chaîne dʼéchos consonantiques
qui passe et par le contre-accent antécédent, et par le suivant (64,70 Tót(o)
ánimo). Cette série en / t / sʼinterprète sémantiquement comme un lien de
causalité entre la présence de Thésée et la colère furieuse dʼAriane : 64,68
túm - (mítrae) - túm - flúitántis - (amictus) - 64,69 tót(o) - té - (pectore) -
Théseu - 64,70 tót(o) - tóta - (pendebat) - (perdita) - (mente).
Ces multiples apparitions du narrateur dans une séquence dont la visée est
fondamentalement descriptive permettent de préparer lʼoccurrence de
lʼinterjection monosyllabique a en attaque de vers (64, 71). Cette position est
significative, car elle implique une fonction démarcative au plan de
lʼorganisation du texte. Ainsi, la parole du narrateur est alors clairement
assumée comme telle, et non plus justifiée par une situation polyphonique , à
la manière dont serait présentée une interjection inaugurant un discours
direct rapporté (64, 71-75) :
Á ! míser(a) assíduis P quám lúctibus éxternáuit
q ww qwwq / q qww qqqq
Spinósas T Érycína Tr sérens H in péctore cúras
qqq / wwqw /wq/ qqww qq
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
421
Ílla témpestáte Tr férox H qu(o) ex témpore Théseus
qq qqqw /wq / qqww qq
Egréssus T cúruis P é litóribus Piráei
qqq / qq/ qqwwq qqq
Áttigit iniústi P régis H Cort´ynia témpla.
qww qqq/ qq/qqww qw
Rythmiquement, lʼinterjection est liée, comme souvent (cf.TLL), à lʼadjectif
miser, par le moyen dʼun contre-accent (Á ! míser(a)). Fordyce (288)
rapproche cette occurrence de celle que lʼon trouve dans un fragment de
Calvus (frg. 9 M A uirgo infelix, herbis pasceris amaris). La véhémence du
narrateur se manifeste, dans le vers 64,71, par le renforcement
contraccentuel des attaques de côla, et le fait que les échos vocaliques
accentués de lʼinterjection occupent les positions-clefs de lʼhexamètre.
La déploration focalisée du malheur dʼAriane sʼaccompagne alors dʼune
reprise du nom du héros (64,73), précédée dʼun adjectif épithète, mis en
valeur entre les césures trochaÏque troisième et hephthémimère, qui a une
évidente valeur axiologique, ferox99.
Enfin, lʼinterjection en attaque de vers fonctionne comme un connecteur
capable dʼassurer une transition textuelle entre la visée descriptive de
99 Certains traducteurs (Lafaye, Ernout) semblent sous-estimer la valeur péjorative de cet adjectif, quand ils le rendent par le mot « fier ». Bardon (138) propose « farouche », qui paraît déjà plus adéquat.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
422
lʼekphrasis et la narration proprement dite, parce quʼelle permet de lancer
lʼanalepse narrative (64,73 Illa tempestate) qui reprend le début du mythe.
64,94
On trouve lʼinterjection monosyllabique heu au vers 64,94 ,dont le texte est
absolument sûr, cʼest-à-dire dans une longue séquence narrative (64,76-
115). Après avoir décrit, sous forme dʼekphrasis, Ariane contemplant son
amant en fuite, le poète revient à leur rencontre en Crète. Il narre le « coup
de foudre » du point de vue de lʼhéroïne, puis interrompt la narration par une
prise de parole du narrateur : « Oh! cœur cruel qui sans pitié exaspères les
passions, enfant divin, qui aux douleurs humaines mêles les joies, et toi,
reine de Golgos, reine des frondaisons dʼIdalie, de quelles ondes avez-vous
assailli la fille à lʼâme de braise, qui pour le blond étranger souvent soupirait !
Comme elle éprouva de craintes en son cœur défaillant ! Comme elle devint,
souvent, plus blême quʼor brillant, quand, désireux dʼaffronter le monstre
cruel, Thésée allait à la mort, ou aux références de la gloire ! » (64,9-102,
trad. Bardon, 1970,140).
Lʼinterjection Heu occupe la position dʼattaque de lʼhexamètre, de la même
façon quʼA au vers 64,71. Elle joue donc le même rôle démarcatif,
introduisant une série dʼexclamations.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
423
Le narrateur prend toujours le parti de lʼhéroïne, victime des fureurs de
lʼamour :
Heú míser(e) exágitans P immíti B córde furóres,
q ww qwwq /qqq /qw wqq
Sáncte púer T cúris P hóminum quí gaúdia mísces…
qw wq /qq / wwq q qww qq
Lʼinterjection est le point dʼappui dʼun contre-accent de transition textuelle
dont le deuxième élément nʼest autre que lʼadverbe misere (dérivé de
lʼadjectif miser). Il y a donc là une très nette référence intra-textuelle,
notamment au vers 64,71.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
425
La voix « iambique » de Catulle
Les interjections peuvent se trouver également dans des poèmes adressés
à des personnages que lʼon suppose historiques, même si la prosopographie
nʼest que rarement probante. Nous étudions ici deux occurrences de
lʼinterjection a (15,17 ; 21,11) apparaissant dans le cadre de poèmes qui
appartiennent au cycle dʼAurelius et Furius (c.11, c.15, c.16, c.21, c.23, c.26),
auquel se rattachent dʼune certaine manière les quatre textes adressés à
Iuuentius (c.24, c.48, c.81 et c.99). Ces deux occurrences, précisons-le, nʼont
pal le même statut philologique, puisque la première, au vers 15,17, est tirée
directement des sources manuscrites (Bardon, 55), mais sous les graphies
ah (X), ou bien ha (O), tandis que la seconde est issue dʼune émendation de
Scaliger (1577) qui a été finalement adoptée par la vulgate.
Les poèmes 15 et 21 prennent la forme dʼune adresse du locuteur (le poète
G.Valerius Catullus) à un allocutaire, Aurelius, sur lequel aucune information
externe au recueil ne nous est parvenue, et dont on peut seulement
conjecturer quʼil venait dʼune famille romaine honorable (Syndikus,1984,
239). Toutefois, ce qui nous intéresse ici, plutôt que de cerner le portrait
historique dʼAurelius, cʼest bien de définir, ne serait-ce quʼen termes
schématiques, le type de communication institué par les poèmes de Catulle.
Et ce nʼest que dans cette perspective que peuvent être analysées les
occurrences interjectives.
Uhlrich von Wilamowitz-Moellendorff (cité par Carratello,1996, 56 n.6) a vu
en lui un membre du milieu qui gravitait autour de Lesbia. Quoiquʼil en soit,
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
426
lʼon peut déduire des cc.11,16 et 21, quelques traits objectifs qui dessinent
un portrait minimal du personnage. Dʼabord, il sʼagit dʼun jeune homme
appartenant à la génération de Catulle, ce quʼimplique lʼexpression comites
Catulli (11, 1) par laquelle le poète désigne le couple dʼAurelius et Furius,
quelle que soit lʼironie quʼelle comporte vraisemblablement (Syndikus,
1984,125 ; Carratello,1996, 55-59). Ensuite, ce jeune homme a
connaissance des textes de Catulle, et son jugement, à lʼégard des vers
comme du poète (16,3-4 Qui me ex uersiculis meis putastis, quod sunt
molliculi, parum pudicum : « Parce que mes vers sont un peu dévergondés,
vous avez jugé que je manque de pudeur ! », Bardon, 54) ne doit pas être
dénué dʼautorité dans son milieu, puisque lʼauteur prend la peine de lʼen
punir, dans un texte extrêmement violent.
On peut donc décrire Aurelius comme un jeune homme éduqué, lettré, peut-
être même teinté de philosophie, de vertu et dʼascétisme : cʼest du moins une
interprétation possible de lʼexpression pater esuritionum (21,1) dont Catulle
veut le flétrir100. Et cʼest sans doute parce quʼil a affaire un individu qui se
targue, à tort ou à raison, dʼune certaine formation intellectuelle, que le poète
fait appel à un appareil argumentatif de visée caricaturale (15,6 et 15,9 Non
dico…Verum; 16,10 Non dico…sed ;16,4 quod = « parce que »; 16,5 Nam;
16,8 Si).
100 Cette possibilité nʼest pas du tout envisagée par Syndikus (1984,151-154) dans son étude du c.21, mais il nous semble possible de rattacher « das Motiv des Hungerleiderei » à un topos de la polémique anti-ascétique. Le fait quʼAurelius soit accusé de vouloir enseigner la faim (21,11 puer et sitire discet) au puer circonvenu nous apparaît comme un indice dans ce sens. Lʼéducation pédérastique se profile ici comme référence culturelle.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
427
La relation « historique » entre Catulle et Aurelius nous semble
pertinemment définie par Della Corte (19762,180, cité par Carratallo,1996,59)
en termes de « rivalità ». Deux griefs sont évoqués par Catulle envers son
allocutaire :
1° Aurelius prétend séduire le puer delicatus de Catulle (Iuuentius ou
quelque autre).
2° Aurelius associe la mollitia des vers du poète à son ethos personnel.
Mais pour Catulle, il semble bien que ces deux griefs se rapportent en fait à
une faute unique, celle de lui dénier les attributs masculins, qui sont
constitutifs de son identité. En effet, le thème central des cc.15 et 21 est
lʼattitude dʼAurelius à lʼégard dʼun puer delicatus (peut-être Iuuentius) que
Catulle désigne comme lʼobjet de son amour (15,1; 21,4 meos amores).
Dans les deux textes, se rencontrent des termes obscènes, qui caractérisent
comme une agression le comportement sexuel dʼAurelius (15, 9 tuoque pene
: « ta queue »; 21,4 pedicare : « enculer »). Le parallèle lexical peut être très
net : 15,16 Vt nostrum insidiis caput lacessas; 21,7 nam insidias mihi
instruentem (« à tʼen prendre perfidement à notre tête », « car machinant
des perfidies contre moi »).
La menace sexuelle qui guette le puer est donc convertie en une menace
dirigée contre lʼidentité même de Catulle, ou bien, si lʼon se réfère au c.16,
adressé à Furius et Aurelius, contre la composante masculine de lʼidentité
(16,13 male me marem putatis : « vous ne me prenez pas pour un vrai
mâle »). Le mot caput, employé au vers 15 ,16 résume ces différents aspects
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
428
par la richesse de ses valeurs métaphoriques : caput est lʼessence du sujet
(cʼest ainsi que le lisent la plupart des traducteurs), mais ce peut être aussi,
dans le discours amoureux, lʼobjet de lʼamour (si lʼon veut, Iuuentius), à partir
de lʼidée de « partie précieuse du corps » , lʼéquivalent dʼoculi ou dʼocelli,
sans oublier le sens trivial de « tête du sexe masculin » (TLL, s.u.). Ces
diverses valeurs du mot signifient bien lʼimportance de lʼenjeu, du point de
vue de Catulle.
Catulle, contre cette menace, recourt à lʼarme poétique, se plaçant sous le
patronage dʼune double tradition, comme lʼa bien montré J.Granarolo (1967,
232-246), celle de la lyrique éolienne et celle de la justice populaire italique
(flagitatio). Il revendique la vocation agonistique du poème, quand il désigne
ses vers sous le nom dʼiambes (36, 4-5; 40, 1-2; 54, 6-7) ou
dʼhendécasyllabes (12, 10-11; 42, 1).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
429
15,17
Lʼinterjection a (15,17) participe des deux aspects fondamentaux de ce
texte, pris comme poème vindicatif. Elle est intégrée à la raillerie (ironique ou
non) et à la rythmique des attaques de vers. Mais, avant de la mettre en
perspective à lʼaide de quelques exemples, procédons à lʼanalyse de son
fonctionnement dans le cotexte direct.
Lʼinterjection apparaît dans la partie conclusive (15,14-19) du poème : « Si
ta folie et ton égarement furieux te poussent, canaille, à lʼénorme faute de
tʼen prendre en douce à ma figure, ah alors je te plains et tu risques gros ; on
tʼécartera les jambes ; par la porte béante galoperont les raiforts et les
mulets. » (Bardon,54).
Elle est employée dans une configuration qui apparaît comme une variante
de la locution exclamative bien connue, a me miserum (q+q+www), marque
presque rituelle de lʼexpression de la souffrance. Toutefois, les modifications
que subit cette dernière ne sont pas dénuées dʼintérêt :
Á túm té míserum (6) malíque fáti !101
q q q wwq/ wqw qq
101 Le vers phalécien ne comporte pas de césure proprement dite. On parle alors dʼintermot, placé, suivant les cas, après la cinquième, la sixième ou septième syllabe (Marina Sáez, 1998, 225).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
430
Qu(em) attráctis pédibus (6) paténte pórta
qqq wwq / wqw qq
Percúrrent ráphaníque (7) múgilésque.
qqq wwqw /qwqw
Dʼabord, lʼinterjection nʼest contiguë ni au pronom ni à lʼadjectif; ensuite le
pronom personnel impliqué correspond à la personne 2, fait inhabituel si lʼon
se réfère aux occurrences du TLL ou à celles du recueil catullien que nous
étudions ailleurs. Le fait plus remarquable, à notre sens, est quʼelle soit
placée en attaque dʼun groupe de monosyllabes où lʼécho consonantique du
/ t / joue un rôle emphatique. Nous avons donc là une série de contre-
accents qui contribue à la focalisation de lʼattaque de míserum. Au second
plan, mentionnons aussi lʼécho vocalique de lʼinterjection que lʼon retrouve
dans le mot clausulaire du vers phalécien (fáti), alors constitué en énoncé
fermé, et presque « oraculaire ».
Ainsi lʼapparition de lʼinterjection en attaque du vers a clairement pour effet
dʼinaugurer un côlon placé sous le signe dʼune dynamique croissante,
manifestation dʼintensité rythmique qui évoque la jouissance aiguë de
lʼénonciateur, à lʼidée de ce qui attend lʼallocutaire quand il subira le
châtiment des adultères102 (15,18-19).
102 Évoquant les réactions vindicatives des maris trompés, Juvénal envisage trois cas de figures; parmi eux, le dernier correspond à la menace brandie par Catulle : …necat hic ferro, secat ille cruentis / uerberibus, quosdam moechos et mugilis intrat. (Sat.10,316-317). Syndikus (1984,142) cite les attestations en contexte athénien de la raphanidosis : Ar.Nub. 1083; A.P. 9,520. G.Damschen (1999,174), avec quelque précaution, sʼappuie sur lʼarticle « adultery » de lʼOxford Classical Dictionnary pour affirmer que ce châtiment existait dans la Rome républicaine : « Die ursprünglich grieschiche Strafe diente ebenso im republikanischen Rom als Sanktion für das adulterium, wenn auch unser Wissen über das
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
431
« Parler de façon ironique, cela revient, pour un locuteur L, à présenter
lʼénonciation comme exprimant la position dʼun énonciateur E, position dont
on sait par ailleurs que le locuteur L nʼen prend pas la responsabilité et, bien
plus, quʼil la tient pour absurde. Tout en étant donné comme le responsable
de lʼénonciation, L nʼest pas assimilé à E, origine du point de vue exprimé
dans lʼénonciation. » (Ducrot, 1984, 211). Lʼexclamation a tum te miserum
est à mettre au compte de lʼénonciateur Catulle, puisque lʼallocutaire y
apparaît sous la forme dʼun pronom de personne 2. Ce nʼest pas un cas de
discours indirect libre. Pourtant il est notoire que le locuteur Catulle, dont on
a vu quʼil nʼa pas de bienveillance particulière à lʼégard dʼAurelius, ne peut
endosser une commisération que la série contraccentuelle rend hyperbolique
(élément de distanciation). Il apparaît donc que lʼexclamation proférée au
vers 15,17 a une dimension ironique très nette.
Ajoutons que si rien ne prépare de la part de lʼénonciateur une exclamation
de souffrance, lʼapparition du monosyllabe interjectif est cependant préparée
par plusieurs phénomènes. Dʼabord par un fait paronomastique assez subtil
qui suppose une véritable intention poétique.
Dans la partie centrale du poème, Catulle démasque lʼhypocrisie dʼAurelius :
« garde-moi chastement cet enfant à lʼabri — je ne dis pas du public : nous
ne redoutons pas ceux qui circulent sur le boulevard, ils vont ici, ils vont là,
occupés à leurs affaires ; mais cʼest toi que je crains avec ta verge… »
(Bardon, 54). En disant « je ne dis pas du public » (15, 6 Nón díco a público),
Eherecht der republikanischen Zeit durch die von Augustus im Jahre 18 v. Chr. (Suet. Aug.34) verfügte lex Iulia de adulteriis stark beeinträchtig ist. ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
432
ironiquement, il fait comme sʼil répondait à une offre de lʼallocutaire affirmant
quʼil protégerait le puer contre la foule impudique, ce qui, par parenthèse,
conforte lʼhypothèse que nous avons formulée quant aux prétentions
dʼAurelius à la vertu. Alors vient le vers 15, 9 par lequel lʼattaque frontale est
lancée :
Vér(um) á te métuo i6) tuóque péne
q qq wwq /wqw qw
La place du syntagme prépositionnel á te paraît choisie pour quʼapparaisse
un contre-accent en attaque de vers, constituant un parallélisme rythmique
avec lʼattaque de 15,6 (Nón díco ). Dans ce cas, nous avons appliqué
strictement la règle, issue du témoignage de Quintilien, qui veut que le
syntagme prépositionnel soit traité comme un « mot phonétique ». Règle
apparemment conforme aux indices tirés des clausules dʼhendécasyllabes
phaléciens (où la place de lʼaccent, comme dans la dipodie finale de
lʼhexamètre, est standardisée) : ád me (10,31) et á te (50,20). Comme le plus
souvent les prépositions sont dénuées dʼaccent, nous voyons, dans
lʼaccentuation de la préposition a, lʼintention claire de créer une paronomase
avec lʼattaque du groupe exclamatif inauguré par lʼinterjection á. Ce qui est
par là souligné, cʼest le renversement ironique de la menace dont Aurelius
est lʼagent, en une menace quʼil subit désormais. Manière subtile pour
lʼénonciateur de placer lʼallocutaire devant un enchaînement fatal.
Mais ce nʼest pas le seul élément qui amène lʼinsertion de lʼinterjection. En
réalité, tout le poème est rythmiquement orienté vers ce sommet émotionnel.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
433
H.P. Syndikus (1984,140-142) a bien mis en valeur la rupture de ton qui se
produit à lʼintérieur du c.15 : le texte sʼengage selon le code discursif de la
lettre de recommandation tel que lʼon peut le découvrir dans la
correspondance de Cicéron (Ad fam. 13), avec une tournure dʼusage
(Commendo tibi… Aureli), puis lʼobscénité du vers 15,9 bouscule la règle du
genre.
À notre sens, la valeur offensive de lʼhendécasyllabe se traduit dans ce
poème par un travail spécifique du rythme des attaques de vers. En effet, le
ton de la correspondance urbaine est représenté par le type dʼattaque
encadrant le texte (15,1-2 Comméndo, Auréli ; 15,18-19 Qu(em) attráctis,
Percúrrent), cʼest-à-dire le mot molosse (qqq) qui est un paroxyton. La
véhémence de lʼénonciateur se manifeste par différents degrés dʼattaque de
vers : la simple accentuation de la syllabe dʼattaque de vers (15,7 Ístos ;
15,8 Ín re ; 15,12 Quántum), le contre-accent (15,4 Nón díco ; Vér(um) á ;
15,16 Út nóstrum), la série de deux contre-accents (15,13 Húnc ún(um)
éxcipio), et surtout la série de trois contre-accents, qui devient la marque du
harcèlement que lʼénonciateur inflige à lʼallocutaire (15,3 Út sí quícqu(am)
ánimo ; 15,11 Quém tú quá lúbet ; 15,14 Quód sí té mála ; 15,17 Á túm té
míserum).
On voit, à lʼexamen de ce dernier réseau, que lʼinterjection du vers 15,17 est
amenée par ce travail du rythme à lʼintérieur des bien nommées attaques de
vers. Travail qui constitue ce quʼon pourrait appeler une oralité de
lʼintimidation. Dans ce système, le triple contre-accent inauguré par le
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
434
monosyllabe interjectif se présente comme un sommet, aussitôt suivi par une
baisse conclusive de lʼintensité rythmique.
21,11
Cʼest ici que la comparaison avec lʼinterjection proposée par Scaliger pour
le vers 21,11 (hendécasyllabe phalécien) a son intérêt. Plusieurs éléments
internes plaident en faveur de cette émendation :
1° Lʼinterjection pallie une déficience des textes manuscrits, qui sont
amétriques.
2° Lʼitération de mé proposée par les mss. O, G et R constitue
manifestement une incise exclamative. Il est donc très plausible que cette
incise débute par une interjection (sur lʼhistoire des émendations diverses,
voir lʼapparat de Bardon, 59).
3° Lʼinterjection, comme signification de douleur, est amenée par le verbe
doleo au vers précédent.
4° La lecture rythmique de 21,10-11 montre quʼil y a probablement un projet
dʼéquivalence des attaques de ces deux vers :
Núnc íps(um) íd dóleo, (6) quód ésuríre,
q q q wwq/ w qwqw
Á ! mé mé púer (5) ét sítire díscet.
q q q ww/q wqw qw
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
435
Dans ces deux vers, lʼon trouve en effet, une attaque composée dʼune série
de trois contre-accents, exactement de la même façon que dans le vers
15,17.
Finalement, le dernier argument validant le choix de Scaliger provient de la
comparaison de la fin des cc. 15 et 21, qui participent, comme on lʼa vu du
même projet vindicatif. Lʼinterjection a, au vers 21,11, a la même place dans
le poème 21 que celle quʼelle occupe dans le poème 15, autrement dit, elle
inaugure le dernier sommet rythmique, avant un fléchissement conclusif
composé de deux hendécasyllabes, qui fait appel à une oralité plus
« rationnelle ».
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
437
Conclusion
Nous avons montré, au début de cette partie, que les monosyllabes
interjectifs sont accentués. Cela nʼa rien de nouveau ou de surprenant, car
toute la tradition incite à conclure ainsi. Ce qui lʼest davantage, à notre sens,
cʼest la réflexion que nous introduisons au sujet du type dʼaccentuation dont il
sʼagit.
Notre hypothèse se fonde, avant tout, sur les doutes que les grammairiens
anciens formulent quant à leur capacité à rendre compte de lʼaccentuation de
ces mots, qui ne sont pas sentis comme relevant du système spécifique de
la langue latine. Le problème de lʼaccentuation des disyllabes interjectifs ne
tient pas seulement à la concurrence des systèmes dʼaccentuation grec et
latin : derrière cette manière de formuler la problématique, on peut déceler
lʼallusion à une accentuation qui nʼobéirait pas rigoureusement au système
de lʼune ou lʼautre langue, mais correspondrait à une option de discours.
Cʼest de cette manière que nous comprenons lʼinsistance des grammairiens
sur la non-fixité de lʼaccent (accentus incertus), et sur le caractère « hors-
norme », « sauvage » des interjections (uoces inconditae).
Bien que nous ne puissions définir strictement la nature phonique de cette
accentuation — est-elle analogue à celle de lʼaccent de mot, ou sʼen
distingue-t-elle radicalement ? —, nous pensons pouvoir affirmer quʼil sʼagit
dʼune manifestation de « lʼaccent dʼexpressivité » postulé par J. Marouzeau.
En ce sens, les monosyllabes interjectifs nous fournissent un modèle à partir
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
438
duquel il serait possible de penser dʼautres accentuations anomales,
notamment celles des monosyllabes de statut douteux.
Mais, on peut, en tout état de cause, se fonder sur le caractère accentué
des interjections monosyllabiques pour étudier lʼinteraction du rythme et du
sens.
Nos études de cas proposent une exploration de ce phénomène. Les
données qui suivent ont pour objet de les situer au sein du corpus global des
interjections catulliennes.
Les interjections primaires monosyllabiques se répartissent de la façon
suivante dans le recueil catullien103 :
a(h) en (h)ei heu io o uae total
9+1 1+1 3 2+4 33 63 2 119
Ces interjections primaires monosyllabiques sont, peu ou prou, les mêmes
que celles que lʼon rencontre chez des poètes élégiaques comme Tibulle et
Properce104.
103 Les occurrences textuellement discutables sont indiquées en italiques. Les trisyllabes interjectifs, peu nombreux, sont représentés par euohe (64, 256 (2)), agite (61, 38 ; 63,12 ; 64, 372). Les disyllabes comportent des interjections secondaires, comme age (61, 26 ; 63, 78 ; 63, 81) ou nefas (68,89), ou même une interjection primaire, comme eheu (30,6 ; 64, 61). 104 Nous synthétisons, pour cette comparaison, les données éparses présentées par Paola Militerni della Morte (1995, 38-39).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
439
a(h) en (h)ei heu io o uae
Catulle 9+1 1+1 3 2+4 33 63 2
Tibulle 3 0 2 11 3 11 0
Properce 24 0 3 14 0 28 1
Lʼéventail lexical est à peine plus large que celui des deux élégiaques : il
utilise lʼinterjection en quʼaucun des deux autres auteurs ne reprend.
On note pourtant des différences en termes quantitatifs, même si, dans le
cas de lexèmes rares comme (h)ei et uae, lʼécart est négligeable. Ainsi, on
repère la présence massive de lʼinterjection io, qui est due à la répétition
dʼune formule limitée à un seul poème (c.61).
Mais le fait le plus significatif, à cet égard, est lʼusage constant, à travers
tout le recueil, de lʼinterjection o, dans des proportions que ne connaissent
pas les deux élégiaques. Lʼécart a comme cause déterminante la présence
de cette interjection dans deux formules récurrentes (c. 61, c. 62), à la
manière de ce quʼon remarque pour io, dans le c. 61.
Le tableau qui suit présente, sur deux pages, lʼensemble des occurrences et
celles que nous avons étudiées en détails. Précisons que le choix de ces
dernières a reposé sur les exigences suivantes :
1. étudier en priorité les interjections les plus représentées dans le
discours versifié, à savoir a(h) et o.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
440
2. former un échantillon des « voix », ou instances énonciatives
repérables dans le texte, et rechercher, dans leur discours, la cohérence
de lʼusage interjectif.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
441
a(h) (occurrences) a(h) (études de cas)
10 8
15, 17 ; 21, 11 ; 60, 5 ; 61, 139 ; 63, 61 ;
64, 71 ; 64, 135 ; 64, 178 ; 66, 85
15, 17 ; 21, 11 ; 63,61 ; 64, 71 ; 64, 135 ;
64, 178 ; 66, 85
en (occurrences) en (études de cas)
2 0
56, 11 ; 61, 156
(h)ei (occurrences) (h)ei (études de cas)
3 2
68, 92 ; 68, 93 ; 77,4 68, 92 ; 68, 93
heu (occurrences) heu (études de cas)
6 1
64,61 ;64, 94 ; 77, 5 (2) ; 77, 6 (2); 101,6 64,61
io (occurrences) io (études de cas)
33 0
61, 124 (2) ; 61, 125 ; 61, 144 (2) ; 61,
145 ; 61, 149 (2) ; 61, 150 ; 61, 154 (2) ;
61, 155 ; 61, 159 (2); 61, 160 ; 61, 164 (2);
61, 165 ; 61, 169 (2); 61, 170 ; 61, 174 (2);
61, 175 ; 61, 179 (2); 61, 180 ; 61, 184 (2) ;
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
442
61, 185 ; 61, 189 (2) ; 61, 190
o (occurrences) o (études de cas)
63 9
1, 9 ; 3, 1 ; 3,16 (2) ; 9, 5 ; 9, 10 ;17, 1 ;
24, 1 ; 26, 5 ; 28, 9 ; 29, 23 ; 31, 7 ; 31, 12 ;
31, 13 ; 33,1 ; 34, 5 ; 36, 11 ; 42, 13 ; 43,
8 ; 44, 1 ; 46, 9 ; 56, 1 ; 61, 1 ; 61, 4 ; 61,
5 ; 61, 39 ; 61, 40 ; 61, 49 ; 61, 50 ; 61, 59 ;
61, 60 ; 61, 111 ; 61, 121 ; 62, 5 (2) ; 62,
10 (2) ; 62, 19 (2) ; 62, 25 (2) ; 62, 31 (2) ;
62, 38 (2) ; 62, 48 (2) ; 62, 67 (2) ; 63, 50
(2) ; 64, 22 ; 64, 23 ; 64, 323 ; 66, 39 ; 66,
87 ; 67, 1 ; 68, 20 ; 76, 17 ; 76, 26 ; 88, 5 ;
107, 6
63, 50 (2); 64, 22 ; 64,23 ; 64,323 ; 66,
39 ; 66, 87 ; 67, 1 ; 68, 20
uae (occurrences) uae (études de cas)
2 1
8, 15 ; 64, 196 64, 196
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
443
À propos des interjections virgiliennes, F. Biville (2002, 280) observe que
« lʼinterjection, élément spécifique du discours, comporte une fonction
dʼattaque : elle est utilisée pour mettre en place et structurer les situations
dʼéchange verbal. » En dʼautres termes, disons que lʼinterjection peut jouer
un rôle de démarcation du discours.
Elle peut servir à caractériser dʼemblée le texte comme un échange verbal :
cʼest le cas dans le c. 67, où lʼénonciateur se présente en tant que passant
anonyme sʼadressant à une porte (67, 1 o)105.
On sʼattend aussi à voir fonctionner ce procédé dans le système du poème
narratif, pour établir une démarcation entre les niveaux énonciatifs de
lʼhistoire et du discours106. Lʼinterjection permet dʼintroduire le discours direct
mis au compte des personnages. Dans le poème dʼAttis (c. 63), les
interjections primaires monosyllabiques ne jouent pas réellement ce rôle. La
première prise de parole dʼAttis est délimitée par une interjection secondaire,
de type disyllabique (au plan prosodique) : 63, 12 Ágit(e) ww107. Et lʼitération
de lʼinterjection o, qui se trouve dans le premier vers de la seconde prise de
parole dʼAttis (63, 50), est utilisée de manière beaucoup plus complexe.
Cette spécificité du c. 63 montre que lʼemploi de lʼinterjection monosyllabique
105 Lʼinterjection o, en tant que « particule vocative » (TLL) ou « marqueur dʼadresse » (Biville, 2002) semble, chez Catulle, spécialisée dans cette fonction :; 17, 1 ; 24, 1 ; 33, 1 ; 44, 1 ; 56, 1. Dans deux cas, Catulle prend de la distance par rapport à ce procédé, en ne plaçant pas lʼinterjection en attaque de vers : 3, 1 ; 61, 1. 106 F. Biville (2002, 280) donne en exemple le v. 5, 672 de lʼÉnéide : En ego uester Ascanius, « Cʼest moi, votre Ascagne ». 107 Même procédé pour introduire la parole de Cybèle : 63, 78 Áged(um) ww.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
444
comme élément démarcatif renvoie, en dernière instance, à un problème de
rythme, à une caractérisation rythmique de la voix du personnage : comme
nous lʼavons montré dans notre troisième partie, lʼoralité du c. 63 repose
notamment sur une raréfaction des attaques contraccentuelles, et lʼinsertion
dʼune interjection monosyllabique en attaque de vers a très souvent pour
conséquence une figure contraccentuelle.
En revanche, le c. 64, comporte un exemple dʼune démarcation réalisée par
une interjection monosyllabique. La voix collective des Parques sʼadresse à
Pélée à travers un contre-accent dʼattaque (64, 323 Ó décus), ce qui
sʼaccorde au respect dû à lʼhôte royal, ainsi quʼà la solennité de lʼacte de
parole oraculaire qui sʼannonce108. Le discours dʼAriane, au contraire, de
même que celui dʼÉgée, ne sʼouvre pas ainsi.
Plus intéressants encore sont les cas où lʼinterjection, comme embrayeur,
sert à insérer la parole du narrateur dans le cadre du récit. Nous avons
étudié précisément lʼun de ces exemples (64,22 Ó nímis), qui présente une
analogie rythmique avec lʼattaque du discours de Parques109. Le narrateur
sʼadresse alors aux héros de lʼunivers mythologique. Mais lʼinterjection peut
véhiculer aussi un jugement, ce qui signifie que le narrateur nʼadopte pas
une attitude neutre vis-à-vis de lʼaction et de ses protagonistes. Quand
Catulle insère lʼinterjection á (64, 71 á míser(a)), cʼest pour manifester très
explicitement quʼil prend le parti dʼAriane. « Il peut aussi arriver, mais plus
108 Le même usage démarcatif peut être observé quand Catulle passe de la narration à lʼinteraction verbale (64, 22 Ó nímis). 109 Autres monosyllabes interjectifs mis au compte du narrateur dans le c. 64 : 64, 23 o ; 64, 71 a ; 64, 94 heu.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
445
rarement, quʼau cours de son récit le poète lui-même fasse brièvement et
subtilement entendre sa voix par lʼinsertion dʼun élément interjectif, et quʼil
participe ainsi aux événements évoqués… » (Biville, 2002, 280). Cette
remarque vaut pour Catulle autant que pour Virgile110.
Chez Catulle, ce procédé est systématisé, lorsquʼil est question dʼAriane.
Ainsi, le début de lʼekphrasis marque une concentration de ces interventions
du narrateur, à travers des interjections monosyllabiques (64, 71 a ; 64, 94
heu), mais aussi une interjection disyllabique (64, 61 eheu). La mise en
relation de ces trois occurrences permet une observation qui nʼest pas sans
intérêt. Si chacune dʼentre elles relève de la voix du narrateur, il faut rappeler
que lʼinterjection eheu peut également être analysée en termes de
polyphonie (voix du narrateur/voix dʼAriane)111. Cʼest à partir de cette base
polyphonique que Catulle constitue lʼintervention de sa voix ; autrement dit,
lʼusage de lʼinterjection tend, de la polyphonie, vers une monophonie
exprimant clairement le parti pris du narrateur.
À cette progression sont liées des données de position et des données
rythmiques. Éheu — ou, peut-être, Éheû ? —, ambigu, polyphonique est
placé dans le spondée final de lʼhexamètre. En revanche, les interjections
monosyllabiques monophoniques apparaissent en attaque dʼhexamètre, 110. Aen. 8, 688 : sequiturque — nefas — Aegyptia coniunx (Biville, 2002, 276) ; Aen. 12, 452-453 miseris heu praescia longe / Horrescunt corda agricolis, dabit ille ruinas : « les malheureux laboureurs, hélas, lʼont vu venir de loin, et sont remplis dʼeffroi » (Biville, 2002, 280). 111 Ce fait polyphonique est évoqué lors de lʼanalyse de lʼinterjection a (64, 71). Il est approfondi dans notre sixième partie, pour appuyer notre analyse des connecteurs en contexte narratif (64, 58 at ; 64, 68 sed). Lʼexemple virgilien, que nous citons dans la note précédente (Aen. 12, 452-453), pourrait aussi relever dʼune analyse polyphonique : heu peut être mis au compte du narrateur, mais aussi des paysans eux-mêmes, horrescunt corda pouvant être interprété comme discours narrativisé.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
446
constituant de ce fait un contre-accent de type A1, lié à la narration (64, 71 Á
mísera ; 64, 94 Heú mísere)112.
Ce fonctionnement de lʼinterjection comme embrayeur permettant dʼinsérer
le discours rapporté et les interventions affectives ou axiologique du
narrateur est cependant loin dʼépuiser la richesse de ses usages.
Nos études ont porté sur deux autres aspects des interjections catulliennes,
leur ambiguïté et leur mode dʼinsertion — les deux problématiques étant
dʼailleurs étroitement liées.
Lʼambiguïté se déploie sur deux dimensions, la première sémantique, la
seconde énonciative. Lʼambiguïté sémantique, ou polysémie des interjections
correspond à leur possibilité de véhiculer un spectre dʼaffects plus ou moins
large (F. Biville, 1993, 213). Le texte poétique sʼefforce normalement de
réduire ce spectre en proposant une représentation descriptive de la voix, du
langage corporel ou même en décodant par avance lʼaffect signifié113. Chez
Catulle la caractérisation de la voix dʼun personnage nʼexclut pas
nécessairement quʼune certaine polysémie subsiste : ainsi dolor et furor se
combinent dans le discours dʼAriane (64, 135). De plus, dans un texte où
lʼencadrement narratif est inexistant, comme le c. 66, Catulle exploite la
polysémie de lʼinterjection o (66, 39 affect de regret/interpellation).
112 Sur la prédominance dans le c. 64, de ce type de contre-accent à fonction de relance narrative, voir notre analyse des occurrences de connecteurs at (64, 58) et sed (64, 68). 113 « Tout en possédant un signifié propre, qui peut être ambigu, les interjections sont modalisées par les indications lexicales de nature vocale et émotionnelle qui précèdent ou suivent les prises de parole. » (Biville, 2002, 281). F. Biville le montre spécialement à partir des occurrences dʼheu dans lʼÉnéide (2002, 282).
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
447
Lʼambiguïté énonciative, cʼest-à-dire de polyphonie des interjections, est
encore plus intéressante. Lʼekphrasis du c. 64 en fournit lʼexemple, avec le
a ! du v. 64, 71, que nous avons étudié en détail (cf. 64, 61 eheu). Sʼétablit
alors une fusion des points de vue du narrateur et de lʼhéroïne Ariane.
Quant au mode dʼinsertion des interjections, deux axes se dégagent.
Dʼabord, lʼencadrement narratif du discours rapporté en construisant lʼethos
du personnage fait ou non attendre le recours à lʼélément interjectif. Nous
avons déjà signalé lʼmportance que cela revêt dans le cas dʼAriane ; cʼest
également vrai dans le c. 63. Toutefois, il demeure de nombreuses situations
où ce « guidage » lexical ne peut pas se déployer. Sʼil lʼon part du principe
que lʼon doit nécesairement préparer et justifier lʼinsertion dʼun élément
« sauvage » du langage comme lʼinterjection, comment le poète sʼy prend-il
lorsquʼil veut construire des contre-points dans le discours dʼun personnage
ou dans le sien ?
À notre avis, cʼest là quʼintervient le rôle de lʼoralité du cotexte. Cʼest à
travers des variations dʼintensité rythmique procurées par les contre-accents
que le poète signale une tension affective aboutissant à lʼemploi de
lʼinterjection (15, 17 ; 21, 11 ; 64, 178, 64, 196 ; 66, 39, 68, 20 ;68, 92-93).
Cette oralité rythmique peut dʼailleurs se cumuler au dispositif lexical (63,
50). Dans cette mesure, on conçoit que lʼapparition de lʼinterjection soit liée à
un travail sur les autres monosyllabes, en particulier sur les connecteurs
susceptibles marquer lʼorganisation textuelle, notamment sur le plan de la
rupture et de la cohésion.
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
448
Les fonctions énonciatives et textuelles des interjections que nous étudions
font apparaître de nombreux points communs avec ce type de connecteurs.
Cʼest particulièrement flagrant quand se pose un problème dʼétablissement
du texte comme au v. 64, 178, où les éditeurs hésitent entre a ! et at. Ne
pourrait-on pas, à partir de là développer lʼhypothèse dʼune analogie
dʼaccentuation entre ces connecteurs monosyllabiques et les interjections,
surtout si lʼon suppose, comme nous lʼavons fait, que ces dernières ne
portent pas, à parler rigoureusement, un accent de mot, mais une
accentuation de discours ? Cʼest lʼhypothèse que nous mettrons à lʼépreuve
dans notre partie sur les connecteurs. Mais le même raisonnement peut être
tenu à propos des pronoms personnels, comme nous le verrons dans la
partie suivante.
Enfin, il convient de noter que lʼaccentuation — quelle que soit sa forme —
des interjections monosyllabiques nous a permis de valider lʼexistence de la
figure contraccentuelle en latin. En témoigne — pour ne prendre quʼun
exemple très fréquent, chez Catulle et chez dʼautres auteurs — la
prolifération des groupes monosyllabe interjectif+disyllabe, du type á míser !
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
449
Index des auteurs et des notions
accent,307,309,310,313,314,315,316,317,327,337,344,356,357,358,361,384,397,403,411,412,417,418,432,437,448
accentuation,307,309,310,313,314,316,330,337,356,360,379,380,384,390,404,416,417,432,433,437,448
accentus,307,308,310,437 Adam,415 Albrecht,332 anaphore,375,390,402,410,418 atone,314 Bardon,321,324,332,335,345,354,365,
387,393,414,421,422,425,426,429,431,434
Benloew,314 Betonung,377 Biville,305,307,315,321,322,328,331,
352,353,361,370,381,400,443,445,446
Carratello,426 Cicéron,366,433 configuration,336,337,339,372,381,38
4,391,397,398,402,412,413,429 conjonction,333,344,345,346,347,348,
349,350,351,354,384 connecteur,347,371,378,401,421 contraccentuel,333,384,403,406,407,4
11,421 contre-
accent,327,339,349,350,357,361,362,366,375,377,379,382,383,384,390,397,403,412,413,419,421,423,432,433,444,446
Cupaiuolo,413 Damschen,430 Dangel,301,355 Desbordes,308 diction,333,380 Ducrot,358,360,431 Dupont,342 écho,308,329,333,338,391,403,405,41
6,430 élision,326,327,328,333,362,363,375,
403,404 emphase,322,373,382
enclitique,337,361 énonciation,302,324,325,362,366,395,
403,431 Ernout,323,324,331,332,354,370,371,
372,373,377,387,393,396,401,405,409,416,418,419,421
fastigium,310 focalisation,410,430 Fordyce,346,347,352,362,363,365,370
,371,377,384,387,397,402,409,414,416,421
Granarolo,328,338,340,347,348,370,402,428
Hand,378 Hofmann,381,400 Holtz,328 ironie,344,389,426 Iso,417 Kroll,325,345,388,389,393,394,399,4
06,407 Lafaye,345,365,393,396,414,421 locution,429 Loomis,322,326 Luque,302,395,397,398,404 Madvig,411 Marina Sáez,397,398,417,429 Marinone,371,378,380,381 Marouzeau,316,437 Meschonnic,403 mètre,322,352,417 métrique,331,337,338,339,352,381,38
2,383,384,402,412,416 Militerni della Morte,438 monosyllabe,325,328,337,343,344,35
0,357,361,375,376,395,397,399,405,414,431,434,448
motus animi,328,414,415,417 Nougaret,336,397,411 oralité,301,357,358,359,370,371,375,3
80,383,391,397,399,402,403,417,433,435,444,447
Orlandini,347 parlé,329,330,339 Pinborg,309 polyphonie,417,445,447 proclitique,398
Emmanuel Plantade, Lʼoralité chez Catulle
450
Prompsault,313,314 prose,302,399 Pugliarello,308 Quintilien,432 récurrence,337,349,399,412,417 relief,368,389 rhétorique,331,338,340,341,344,348,3
54,369,415 rythme,357,362,363,373,375,399,404,
413,433,438,444 Salvatore,370,371,372,374,377 Schöll,307,308,309,310,379,393 Sluiter,308,309 Syndikus,321,335,336,377,387,389,39
3,400,405,425,426,430,433 traduction,324,332,333,359,369,372,3
96 Traina,355,378
vers,321,322,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,336,337,338,340,344,345,346,347,348,350,351,352,354,356,357,358,360,361,362,365,366,367,369,370,371,372,373,374,375,377,378,380,381,382,383,384,387,388,390,391,393,394,395,396,397,398,399,400,402,403,404,405,406,407,409,410,411,412,414,415,418,419,420,421,422,423,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,443,445
Viarre,365 Videau,369 Viot,314 voix,301,321,324,326,329,335,359,36
5,367,369,381,387,390,393,395,399,402,409,425,440,444,445,446
Weil,314