L'influence de la Physiologie du goût de Brillat-Savarin sur les physiologies balzaciennes
Transcript of L'influence de la Physiologie du goût de Brillat-Savarin sur les physiologies balzaciennes
2
Légende de l’illustration de couverture : Farcy Alphonse, affiche en
couverture de La Physiologie du goût par Brillat-Savarin illustrée par Bertall,
Litographie Prodhomme imprimeur, 1847, BNF ENTDN-1(FARCY,Alphonse)-FT6,
disponible sur : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39837567z
3
Université de Nantes
UFR de Lettres et langages
Master « Lettres et philosophie : littérature française et comparée »
De l’influence de la Physiologie du goût de M. Brillat Savarin
sur les physiologies balzaciennes
Mémoire présenté par Pierre-Marie BONNAUD
en vue de l’obtention du diplôme de Master 1
sous la direction de Monsieur Paul-André CLAUDEL.
Année Universitaire 2012-2013, session de juin 2013.
4
Remerciements Je tiens à remercier en premier lieu Monsieur Paul-André Claudel, Maître de conférence à l’Université de Nantes et directeur de ce mémoire, pour son aide, son humour rassérénant et ses précieux conseils quant à la rédaction de ce travail de recherche. Je tiens à remercier mon ami Monsieur Pierre Maréchaux, Professeur à l’Université de Nantes de m’avoir inspiré ce mémoire et de m’avoir soutenu durant cette année. Je remercie Madame François Rubellin, Professeure à l’Université de Nantes dont les conseils méthodologiques avisés ont permis de rendre ce mémoire lisible. Enfin je remercie Monsieur Frédéric Le Blay, Maitre de conférence à l’Université de Nantes de m’avoir fait découvrir le trop méconnu François Broussais.
5
Goethe et Brillat-Savarin : ces deux noms, rapprochés, font énigme. Certes, Werther ne dédaignait pas de se faire cuire des petits pois au beurre, dans sa retraite de Walheim ; mais le voit-on s’intéresser aux vertus aphrodisiaques de la truffe et aux éclairs de désir qui traversent le visage des belles gourmandes ? C’est que le dix-neuvième siècle commence son double voyage, positiviste et romantique (et peut-être ceci à cause de cela). Autour de 1825, année où paraît la Physiologie du goût, se noue une double postulation de l’Histoire, ou tout au moins de l’idéologie dont il n’est pas sûr que nous soyons sortis : d’une part une sorte de réhabilitation des joies terrestres, un sensualisme, lié au sens progressiste de l’Histoire, et d’autre part une explosion grandiose du mal de vivre, liée, elle, à toute une culture nouvelle du symbole. L’humanité occidentale établit ainsi un double répertoire de ses conquêtes, de ses valeurs : d’un côté les découvertes chimiques (garantes d’un essor de l’industrie et d’une transformation sociale) et de l’autre une très grande aventure symbolique : 1825, l’année de Brillat-Savarin, n’est-elle pas aussi l’année où Schubert compose son quatuor de la Jeune Fille et la Mort ? Brillat-Savarin, qui nous apprend la concomitance des plaisirs sensuels, nous représente aussi, indirectement, comme il convient à un bon témoin, l’importance, encore sous-évaluée, des cultures et des histoires composées.
Roland Barthes, Lecture de Brillat-Savarin.
7
Introduction : sélection d’un corpus et considérations générales sur le genre de la physiologie ........................................................................................................................ 9
1. Le discours pseudo-‐scientifique chez M. de Balzac et M. Brillat-‐ Savarin: justification et ironie ................................................................................................... 25 1.1. La justification d’un propos ........................................................................................ 25 1.1.1. La mimèsis scientifique ........................................................................................................ 25 1.1.2. L’ effet de science .................................................................................................................... 27
1.2. L’ironie méditative ........................................................................................................ 31 1.2.1. Le comique rassurant de l’« effet de science » et l’imitatio doxique ................ 31 1.2.2. Observation et jeu de miroir : humour voyeuriste, l’illusion petite-‐bourgeoise de la différence ............................................................................................................ 32
1.3. Continuité de M. Brillat-‐Savarin chez M. de Balzac ............................................ 34 1.3.1. Le patronage savarin ............................................................................................................. 34 1.3.2. Axiomes, aphorismes et néologismes : illusion de sérieux et volonté théorisante ............................................................................................................................................. 36
2. Poétique et style chez M. de Balzac et M. Brillat-‐Savarin : l’écriture de la mondanité, la mondanité de l’écriture .................................................................. 40 2.1. La question du corps ..................................................................................................... 40 2.1.1. Le discours sensible, processus de mobilisation totale ......................................... 40 2.1.2. L’omniprésence de la gastronomie ................................................................................. 43
2.2. La vie parisienne et aristocratique .......................................................................... 45 2.2.1. Paris : capitale du savoir ...................................................................................................... 45 2.2.2. Le mythe de de la vie parisienne ...................................................................................... 47
2.3. « L’esprit du chiffon » ................................................................................................... 49 2.3.1. L’ « expression de la pensée comme le style » ........................................................... 49 2.3.2. Une « bathmologie » .............................................................................................................. 52
3. La question historique chez M. de Balzac et M. Brillat-‐Savarin : chronique, critique et philosophie .......................................................................... 56 3.1. La chronique journalistique des événements ...................................................... 56 3.1.1. La réécriture des codes du discours journalistique ................................................. 56
3.2. La critique politique et législative contemporaine ............................................ 61 3.2.1. La (dé)nomination ou son absence comme attaque ad nominem ..................... 61 3.2.2. Féminisme et misogynie ...................................................................................................... 64
3.3. La volonté d’un discours d’historien ....................................................................... 67 3.3.1. La mode des restaurateurs ................................................................................................. 67 3.3.2. Un panorama historique subjectivé ............................................................................... 70
4. Physiologie et anthropologie chez Balzac et Brillat-‐Savarin : sociologie et peinture des mœurs d’un temps ......................................................................... 74 4.1. L’étude sociale et anthropologique ......................................................................... 74 4.1.1. Le voyage comme étude des peuples, des villes et des mœurs .......................... 74 4.1.2. L’usage de la langue étrangère comme nuance de la pensée .............................. 76
4.2. La description analytique des moeurs ................................................................... 79 4.2.1. « Paris sera toujours Paris » ............................................................................................... 79 4.2.2. L’exemple type comme individualité négativée ........................................................ 80
4.3. La peinture scientifique des relations entre individus ..................................... 83 4.3.1. Une étude partiale néantisante ........................................................................................ 83
8
4.3.2. Messieurs Brillat-‐Savarin et Balzac disciples avant l’heure d’Auguste Comte ? ..................................................................................................................................................................... 86
Conclusion : l’influence multiple d’un auteur original .............................................. 89 BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................... 95 ANNEXES .............................................................................................................................................. 109 Mise en bouche en guise d’avant-‐propos. .............................................................................. 110 Menu. ...................................................................................................................................................... 110
10
Le choix d’un corpus : une réflexion évolutive En août 1838, à Paris, l’éditeur Gervais Charpentier, que d’aucuns qualifient
de « père du livre de poche »1, publie dans un format compact le célèbre ouvrage (à
l’époque du moins) de Jean Anthelme Brillat-Savarin intitulé Physiologie du goût, ou
Méditations de gastronomie transcendante paru pour la première fois en 1825 chez
Sautelet. Cette publication est suivie par la Physiologie du Mariage d’un certain
Honoré de Balzac dont l’éditeur avait acheté, le 31 août de la même année, à Henri
Delloye et Victor Lecou – les propriétaires des Œuvres complètes de Balzac – le
« droit d’imprimer dans le format in dix-huit cinq mille exemplaires avec passe
simple »2. Monsieur Charpentier voit dans cet ouvrage un pendant à la Physiologie
du goût. Selon Pierre-Georges Castex3 le succès fut au rendez-vous. L’éditeur
envisagea dès octobre une seconde édition pour l’ouvrage de M. Brillat-Savarin. Il
commande à M. de Balzac une « préface »4. Le 11 mai 1839, la Bibliographie de
France annonce la seconde édition Charpentier de la Physiologie du goût, la préface
est signée du baron Richerand5. Cependant, il est indiqué dans l’édition que le texte
du gastronome est suivi « du Traité des excitants modernes, par M. de Balzac ».
L’autonomie du texte est visible, il n’a pas été pensé comme « préface » mais plutôt
comme un complément aux lacunes de l’ouvrage du gourmet. L’auteur n’hésite
d’ailleurs pas à nous signaler explicitement ce caractère lacunaire de l’ouvrage du
gourmet : « Il est inouï que Brillat-Savarin […] ait oublié le chapitre du tabac. »6.
Cependant, si la correspondance balzacienne démontre la volonté de l’auteur
de se détacher du texte de Brillat-Savarin, l’œuvre de Balzac depuis 1825 est aussi la
1 Il proposait une collection d’in-18 à 3 F 50 le volume selon l’article de Jean-Yves Mollier, « l’édition en Europe avant 1850. Balzac et la propriété littéraire internationale », L’Année balzacienne, 1992, p. 157-173. 2 Honoré de Balzac, Correspondance, tome III, Roger Pierrot, Garnier, Paris, 1964, p. 428. 2 Honoré de Balzac, Correspondance, tome III, Roger Pierrot, Garnier, Paris, 1964, p. 428. 3 Pierre-Georges Castex, « Balzac et Brillat-Savarin. Sur une préface à la “Physiologie du goût” [sic] », l’Année balzacienne, 1979, p. 7. 4 « Je reconnais avoir reçu de Monsieur Charpentier la somme de cinq cent francs pour prix d’un préface à la Physiologie du goût, dont je lui cède à perpétuité le droit pour être mise en tête de la dite Physiologie, ne me réservant que celui de la mettre dans des œuvres complètes. Paris, 30 octobre 1838, de Balzac. Le manuscrit sera remis sous dix jours, de Balzac. » op. cit. Corr. p. 450. 5 Dont nous avons reproduit le texte en annexe III 6 Honoré de Balzac, Physiologie du goût, éd. Charpentier de 1839, Appendice, Traité des excitants modernes.
11
preuve flagrante de l’influence du gastronome sur le dandy aux gants jaunes7 et
particulièrement sur l’abondante production physiologique de ce dernier. C’est
justement sur cette influence que nous avons choisi de faire porter notre étude. En
effet, s’il nous avait paru évident que M. de Balzac était influencé par M. Brillat-
Savarin – l’admirait même, le mot n’est pas trop fort 8 – notre étude portait
initialement sur l’influence de La Physiologie du goût sur le corpus dit des Études
analytiques d’Honoré de Balzac. Nous avons choisi de délaisser ce corpus, composé
des Physiologie du Mariage (1829) ; Petites misères de la vie conjugale (1846) ;
Traité de la vie élégante (1839) ; Théorie de la démarche (1833) et Traité des
excitants modernes (1839) (les trois derniers formant ce que l’on appelle la
Pathologie de la vie sociale), au profit d’un autre, moins traité9 et moins académique
à notre goût : celui que nous nommerons des Physiologies balzaciennes.
Définition du corpus
Le corpus que nous nous autorisons pour des raisons pratiques à nommer
corpus des Physiologies balzaciennes se compose donc de textes qui ont pour
caractéristiques communes d’êtres écrits par Honoré de Balzac et dont les titres
comportent tous au moins le substantif « physiologie ». Il s’agira donc de nous
pencher sur les physiologies10 : du Mariage (publiée en décembre 1829 daté 1830
chez Levavasseur & Urbain Canel) ; de la Toilette I. De la cravate, considérée en
elle-même et dans ses rapports avec la société et les individus (parue le 3 juin 1830
dans le journal La Silhouette) ; de la Toilette II. Des Habits rembourrés (parue le 15
juillet 1830 dans le journal La Silhouette) ; Gastronomique I. Introduction (parue le
15 août 1830 dans le journal La Silhouette) ; Gastronomique II. Le Mangeur et le
7 Dont il faisait une consommation abondante : « Ma chère mère, mets dans le paquet de Belley une demi-douzaine de gants, jaunes. » écrit-il à sa mère le 18 septembre 1832. Corr. op. cit. t. II, p. 124. 8 Nous en voulons pour preuve l’élogieuse notice de Brillat-Savarin que rédige Balzac pour la Biographie universelle ancienne et moderne de Michaud. Cette dernière est reproduite dans son intégralité en annexe II 9 Nous pensons ici à l’ouvrage collectif du Groupe International de Recherches Balzaciennes (GIRB) réalisé sous la direction de Mesdames Claire Barel-Moisan et Christèle Couleau et édité chez Christian Pirot en 2009 dans la collection « Balzac » et qui s’intitule Balzac, l’aventure analytique. 10 Nous prions par avance notre tolérant lecteur de nous pardonner ce rébarbatif mais néanmoins nécessaire catalogue.
12
glouton (parue le 14 octobre 1830 dans le journal La Silhouette) ; des Positions
(parue le 21 juillet 1831 dans le journal La Caricature) ; de l’Adjoint (parue le 11
août 1831 dans le journal La Caricature) ; du Cigare (parue le 10 novembre 1831
dans le journal La Caricature) ; de l’Employé (publiée le 21 août 1841 chez Aubert
et annoncé par la Presse le 26 août) ; du Rentier de Paris (publiée le 4 septembre
1841 chez Martinon) et enfin l’Histoire et physiologie des boulevards de Paris
(publiée en 1845 dans l’ouvrage collectif Le Diable à Paris).
Ce choix nous a paru à la fois pertinent et intéressant car il nous permettait de
nous pencher à la fois sur des textes rares (certains n’étant plus édités) et sur un
aspect méconnu de l’écriture balzacienne. Enfin, si nous parvenons à satisfaire notre
indulgent lecteur, nous espérons qu’il pourra y découvrir quelques éclaircissements
ou connaissances quant à la genèse de la Comédie Humaine et quant au style
balzacien lui-même.
Précisions relatives aux journaux du corpus
Comme notre attentif lecteur a pu le remarquer plus haut, certains des textes
de notre corpus sont parus dans des journaux et s’apparentent donc, par définition, à
des articles. C’est pour cette raison qu’il nous apparaît intéressant de digresser un
instant, avant d’entrer dans le vif du sujet, sur les périodiques dans lesquels sont
parus certaines de nos physiologies et ce afin qu’un lecteur novice puisse apprécier
pleinement certaines nuances sinon nécessaires du moins utiles à une dégustation
optimale de notre étude.
La Silhouette est un journal hebdomadaire illustré, sous titré album
lithographique : Beaux-arts, dessins, mœurs, théâtres, caricatures. Il est en kiosques
à Paris du 24 décembre 1829 au 2 janvier 1831 et a pour visée principale de
« fronder les nouveaux ridicules ». Satirique, le journal publie de multiples
physiologies. Elle moque l’aristocratie dans les lithographies Marquise de Philipon,
et écorne une certaine forme de dandysme très parisien dans Longchamps et les
Fashionables11. Tous y passent et la province n’est pas épargnée avec « ses ridicules,
11 Martine Contensou, Balzac et Philipon associés. Grands fabricants de caricatures en tous genre, Paris, Association Paris-Musées, 2001, p. 27-29.
13
ses manies, sa fatuité, sa bigoterie, et son inquisition tracassière »12. Aux alentours de
la révolution de Juillet, la satire prend une tournure de plus en plus politique à
mesure que La Silhouette s’attaque à « Monsieur de Polignac [qui] vient de faire
l’impossible, et [que] cependant on ne croit capable de rien»13 et dresse contre son
« ministère antipathique » un véritable réquisitoire.
La Caricature est aussi un hebdomadaire satirique et illustré. Elle paraît la
première fois le 4 novembre 1830 sous le titre La Caricature morale, religieuse,
littéraire et scénique. Associé avec Philipon à la création du journal, Honoré de
Balzac en rédige le prospectus et y donne sous divers pseudonymes une trentaine
d'articles jusqu'en février 1831 (dont Petites Misères de la vie conjugale en 1830).
En 1832, le journal change de nom et devient La Caricature politique, morale,
littéraire et scénique. La Caricature lutte contre le pouvoir de Louis-Philippe Ier.
Changeant encore de nom, l’hebdomadaire devient La Lithographie mensuelle d’août
1832 à 1834. Après l’attentat de Fieschi et la promulgation des lois de septembre
1835 La Caricature cesse provisoirement de paraître. En 1842 le satirique modifie sa
ligne éditoriale et devient La caricature, revue satirique des modes, des théâtres, de
la musique, des tribunaux et de la littérature : études de mœurs et satire sociale
remplacent les satires politiques. En 1843 elle se fond avec Le Charivari14.
L’atténuation d’une « gêne technique » : le choix des physiologies
Le choix de définir notre corpus relativement à la présence ou non dans le
titre d’un substantif précis nous permet d’éliminer d’emblée le problème de la
fameuse « gêne technique à l’égard des fragments »15. En effet, moins inachevées
12 La Silhouette, tome I, 3e livre, p.17. 13 La Silhouette, tome II, 10e livre, p. 80. 14 Pour davantage d’informations sur le thème de la presse de cette époque nous invitons le lecteur curieux à consulter (après sa lecture de notre étude) l’ouvrage de Charles Ledré, La presse à l'assaut de la monarchie, 1815-1848, Paris, Armand Colin, 1960. 15 Expression attribuée au titre d’un essai sur La Bruyère de Pascal Quignard et reprise à dessein par Joëlle Gleize dans son article extrait des actes du colloque Balzac l’aventure analytique dirigé par Claire Barel-Moisan et Christèle Couleau et intitulé « Pathologie de la vie sociale : une gêne technique à l’égard des fragments ». A propos de ce choix Mme. Gleize explique dans la note 1 qu’il s’agit d’un « anachronisme délibéré, [et que sa] lecture de Balzac ne [prétend] pas s’abstraire du contexte épistémologie, culturel et littéraire dans lequel elle est faite aujourd’hui. »
14
que les Études analytiques16 du même auteur (et qui contiennent la Pathologie de la
vie sociale dont Mme. Gleize traite), les Physiologies balzaciennes ont de plus une
parenté évidente avec l’ouvrage de Brillat-Savarin : elles portent toutes dans leurs
titres le même substantif.
Si les miscellanées des Études analytiques étaient morcelées, souvent
incomplètes et inégalement achevées17, les ouvrages qui composent le corpus de nos
Physiologies balzaciennes sont eux, majoritairement, sinon terminés dans leur
intégralité du moins autonomes (il s’agit souvent d’articles). Néanmoins, les
Physiologies balzaciennes ont ceci en commun avec les Études analytiques qu’elles
sont, à l’exception de la Physiologie du mariage, de forme brèves. Moins connues
que les Études, les Physiologies, sont, tout comme les premières, les témoins
privilégiés de l’écriture aphoristique, des énoncés gnomiques, des axiomes et des
anecdotes lesquels sont autant d’arguments scientifiques pour justifier de l’influence
de M. Brillat-Savarin sur M. de Balzac.
Partant du principe qu’une visibilité évidente en masque une autre plus
profonde nous avons par conséquent choisi de nous pencher sur ces textes plus ou
moins oubliés et de révéler une autre influence du gastronome aimé de Barthes sur le
peintre de la vie sociale que fut Balzac. Cependant, la porosité de l’œuvre
balzacienne et l’omniprésence intertextuelle nous imposent, afin de mieux considérer
le sujet dans son ensemble, de faire régulièrement référence au corpus académique
de ce que l’on appelle les Études analytiques. Nous espérons que notre aimable
lecteur ne nous en tiendra pas rigueur.
Définir le genre de la physiologie L’écueil principal de notre étude réside dans son intitulé même : qu’est
précisement le genre de la physiologie ? Alors que l’étymologie du substantif renvoie
16 À des fins de simplification et d’esthétique rédactionnelle nous entendrons par Études analytiques les : Théorie de la démarche, Traité de la vie élégante, Petites misères de la vie conjugale, Traité des excitants modernes et nous en exclurons les : Physiologie du mariage et Physiologie de la toilette que nous regrouperons sous le titre de Physiologies balzaciennes. 17 Pierre-Georges Castex dans sa « Notice » en parle comme d’ouvrages qui « font mince figure » au sommet de la Comédie humaine. Études analytiques, t. XI de La Comédie humaine, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiaide », p. 1715.
15
au latin physiologia, au grec φὑσιολογἱα , « étude de la nature », lui-même composé
à partir de φύσις / phusis, « nature », et λόγος / logos, « discours, traité » ; que M.
de Balzac nous propose la définition suivante dans sa Physiologie de l’employé :
« Physiologie, expression qui veut dire : discours sur la nature de quelque chose »18 ;
le dictionnaire de l’Académie française nous propose, lui, l’acception suivante :
« Type d’étude qui s’attachait à décrire le fonctionnement d’un groupe social, d’un
type humain, d’une institution, etc., et qui fut particulièrement en vogue au début du
XIXe siècle. » Le même dictionnaire signale aussi « Par métonymie : ouvrage
présentant, parfois sur un mode plaisant19, ce type d’étude. »20. Cette dernière
acception nous conduit alors vers l’excellent article de Paul Aron qui nous explique
que :
les physiologies veulent dresser le tableau de la vie sociale contemporaine. [qu’]
Elles définissent des “types” qui tiennent de la satire traditionnelle des ridicules d'un personnage ou d'un caractère, mais qui découvrent progressivement que l'individu peut être identifié par sa condition sociale21.
La Physiologie des physiologies en 1841 nous propose une nouvelle
acception du terme :
Physiologie, ce mot se compose de deux mots grecs dont la signification est
désormais celle-ci : Volume in-18, composé de 124 pages et d’un nombre illimité de vignettes, de cul-de-lampe, de sottises et de bavardage (logos) à l’usage des gens niais de leur nature (phusis).
Bien qu’assez restrictive, cette description a néanmoins le mérite de proposer
une vision synchronique de notre sujet tout en mettant, tant par son propos que par
l’ouvrage duquel elle est tirée, en lumière la mode des physiologies au XIXe siècle. 18 Honoré de Balzac, Physiologie de l’employé, Anne-Marie Baron, Mayenne, Le Castor Astral, 1994, p. 39. 19 « La veine spécifiquement comique des physiologies est bien entendu liée à la popularité croissante du vaudeville et des comédies de mœurs auprès du public du début du XIXe siècle au même titre qu’à la vitalité de journaux satiriques comme La Silhouette, La Caricature et Le Charivari – effectivement, Charles Philipon, cerveau qui animait ces trois journaux et rédacteur influent à la Maison Aubert est peut-être responsable plus que n’importe qui d’autre de l’élaboration du succès des physiologies dans les années 40. », Sieburth Richard, « Une idéologie du lisible : le phénomène des Physiologies » dans Romantisme, 1985, n°47, Le livre et ses lectures, p. 40. 20 Dictionnaire de l’Académie française, Neuvième édition, Tome 3 (Maquereau à Quotité), Paris, Imprimerie nationale/Fayard, 2011. 21 Paul Aron, « Le pasticheur pastiché ou Janin, Balzac et Reybaud », Histoires littéraires no1, 2000, p. 72-76.
16
La mode des physiologies au XIXe siècle
L’évolution des techniques d’impression et de fabrication du papier ont rendu
plus aisée la réalisation et la commercialisation des ouvrages illustrés, lesquels
n’étaient pas sans rappeler les très populaires dioramas et panoramas de l’époque22.
Ces recueils peignant le lieu urbain et son fonctionnement répondaient à la volonté
du lectorat d’appréhender son espace social en développement23.
Les physiologies n’étaient alors qu’une sous-espèce de ce que Walter
Benjamin nomme « littérature panoramique »24. Mais si les luxueuses anthologies
comme Le Diable à Paris, Paris et les parisiens étaient réservées aux confortables
bibliothèques des salons aristocrates, les physiologies, elles, se destinaient à un
acheteur plus modeste. En effet, les physiologies, en sus de leur format standardisé,
que nous avons signalé précédemment (lequel permettait de les présenter comme une
série, une collection et de les distribuer plus facilement), se caractérisaient par un
prix de vente d’un franc contre trois francs cinquante minimum pour un autre livre.
La mode des physiologies, dans les années 1840, semble donc inhérente à la
visée consumériste du genre : rapidement produit, commercialisé, consommé et jeté.
Littérature alimentaire, s’il en est, pour ceux qui la pratiquent, tout l’intérêt des
physiologies réside dans la présence de mutliples références (pour la plupart
humoristiques) aux actualités de l’époque et ceci dans le but de provoquer le rire, de
dénoncer, de critiquer, une politique, une attitude, de moquer un ministre, un notable
( attitude particulièrement palpable dans La Physiologie du rentier de Paris25). Or de
ces multiples convocations événementielles l’ouvrage tombe inévitablement en une
22 C.f. Patrice Thompson, « Essai d’analyse des conditions de spectacle dans Panorama et le Diorama », Romantisme, no 35, 1982. 23 Rappelons pour mémoire que les travaux d’Haussmann relatifs à la modernisation d’un Paris insalubre et médiéval eurent lieu de 1853 à 1870, cette transformation ne concerne donc pas directement notre étude. Cependant, il est tout à fait raisonnable de penser un mouvement d’exigence précédent l’action gouvernementale. 24 Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Payot, 1982, p. 55. 25 Parut sous le titre de Monographie du rentier en 1841 dans le troisième tome de l’ouvrage collectif, Les Français peint par eux-mêmes, publié par Léon Curmer et édité la même année sous ce titre chez Martinon et accompagné d’un texte d’Arnould Frémy (Le Rentier de province).
17
rapide désuétude. C’est ce caractère temporaire qui donne naissance à ce que Richard
Sieburth définit comme l’un des « premiers exemples du livre instantané »26.
Cependant la satire contenue dans les physiologies, cet humour de distraction
qui ne dépasse jamais les limites de l’innocuité (Harmlosigkeit) en fond un genre
terriblement petit bourgeois, « virtuellement dépourvu de pénétration sociale »27.
La physiologie : une manifestation du « déclin de l’aura »28
Dans son ouvrage Die kleine Geschichte der Fotografie, Walter Benjamin
développe le concept d’aura qu’il définit comme « un tissage étrange d’espace et de
temps : l’unique apparition d’un lointain, si proche soit-elle29. »30. Dans son essai
L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique il ajoute :
La valeur unique en son genre de l'œuvre d'art « authentique » trouve son
fondement dans le rituel où elle eut sa valeur d'usage première et originaire31. […] L’aura est liée à l’unicité (Einzigkeit) de l’œuvre d’art, laquelle fonde son authenticité (Echtheit) : « ici et maintenant » (hier und jetzt) de l’œuvre32.
C’est grâce à cette thèse qu’il induit celle dite du « déclin de l’aura » (Verfall
der Aura). Pour Benjamin, la reproduction, à l’âge moderne de l’œuvre d’art (qu’elle
soit littéraire ou artistique peu importe), entraîne la perte de l’unicité des œuvres, et
par conséquence de leur aura. La reproduction provoque, selon lui, la perte du lien de
l’humanité à une temporalité et à une signification dont l’œuvre, est à la fois le
transport et l’héritage. Ce qui se tarit, en d’autres termes, c’est « l’authenticité33 ».
26 Op. cit., « Une idéologie du lisible : le phénomène des Physiologies », p. 43. 27 Ibid., p. 45. 28 Walter Benjamin, Maurice de Gandillac, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » in L’homme, le langage et la culture, Paris, Gonthier, « Médiations » 1974, p. 117. 29 Walter Benjamin, Petite histoire de la photographie , Allia, 2012, p. 28. Nous nous mettons ici volontairement en porte-à-faux avec la traduction de Maurice de Gandillac qui voudrait que le ce soit le loitain et non l’apparition qui soit proche. 30 « Ein sonderbares Gespinst von Raum und Zeit : die einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. » 31 « Der einzigartige Wert des “echten” Kunstwerks hat seine Fundierung im Ritual, in dem es seinen originären und ersten Gebrauchswert hatte. » 32 Walter Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », Œuvres III, Paris, Gallimard, « Folio Essai », 2000, p. 70. 33 « Ce qui fait l’authenticité d’une chose est tout ce qu’elle contient de transmissible de par son origine, de sa durée matérielle à son pouvoir de témoignage historique. Comme cette valeur de témoignage repose sur sa durée matérielle, dans le cas de la reproduction, où le premier élément – la durée matérielle – échappe aux hommes, le second – le témoignage historique de la chose – se trouve
18
Les physiologies – anthologies illustrées faisant partie de collections qui
visent à classer répertorier, analyser et maîtriser toutes les catégories sociales
(humaines ou non-humaines) de la scène urbaine – peuvent donc être considérées
selon Richard Sieburth : […] comme une manifestation de ce que Benjamin nomme le “déclin de l’aura”,
en ce qu’elles sont des reproductions ou des copies, à plusieurs sens du terme. En premier lieu en tant que marchandises produits en vue d’une consommation de masse, leur valeur commerciale se situe évidemment dans le fait qu’on peut les reproduire à bon marché et dans la simple quantité d’exemplaires vendus […] Mais les physiologies étaient des copies dans un autre sens, dans la mesure où elles prétendaient être des représentations précises (quoique satirique des types sociaux contemporains, elles fonctionnaient comme des versions tardives du speculum consutudinis, c’est-à-dire qu’elle fournissaient (en image et en texte à la fois une reproduction de modèles familiers tirés de la vie moderne, destinés à rendre le champ entier de la diversité visible, plus lisible, plus accessible à leurs lecteurs34.
A ces considérations il est évident, pour celui qui connaît quelque peu ce type
de publications, que s’ajoute l’imitation qu’elles font chacune l’une de l’autre tout en
revendiquant l’aura du statut d’original ce que Benjamin définit dans son ouvrage,
L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, comme l’un des
paradoxes de l’âge de la reproduction mécanique. Chaque volume de physiologie se
veut particulier, unique et cependant tous sont, virtuellement les mêmes, enfermés au
format in-32 et servant le mythe de la vie parisienne.
L’héritage de Buffon, de Broussais et de Lavater chez Brillat et Balzac : la physiologie et la physiognomonie
Si par notre étude nous souhaitons nous attacher à prouver l’existence d’une
influence entre la physiologie de M. Brillat-Savarin et celles de M. de Balzac, il
serait malhonnête de notre part de ne pas rappeler l’héritage naturaliste,
physiognomique, physiologique et phrénologique dans lequel s’inscrivent nos
auteurs. En effet, le gourmet comme le dandy se présentent tous deux comme des
disciples de Buffon, Broussais et Lavater.
également ébranlé. Rien de plus assurément, mais ce qui est ainsi ébranlé, c’est l’autorité de la chose, son poids traditionnel. Tous ces caractères se résument dans la notion d’aura, et on pourrait dire : à l’époque de la reproductibilité technique, ce qui dépérit dans l’œuvre d’art, c’est son aura. », Walter Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », Œuvres III, op.cit. p. 73. 34 Richard Sieburth, « Une idéologie du lisible. Le phénomène des “Physiologies” », Romantisme, 1985, p. 12-13.
19
L’influence de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, mathématicien,
biologiste, naturaliste et philosophe, de son œuvre complète et plus particulièrement
de son Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du
Roy est peut-être la plus perceptible, la plus explicite dans les textes de nos deux
écrivains. Ainsi M. Brillat-Savarin fait-il preuve de la plus précise des connaissances
tant de l’homme que de l’œuvre quand il écrit : « Il me reste quelque chose à dire sur
mon style, car le style est tout l’homme, dit Buffon »35 – qu’il présente d’ailleurs
quelques lignes plus bas comme un de ses auteurs favoris qu’il sait « par cœur »36 –
et qu’il ajoute plus loin « Voltaire et Buffon prenaient beaucoup de café ; peut-être
devaient-ils à cet usage, le premier, la clarté admirable qu'on observe dans ses
oeuvres le second, l'harmonie enthousiastique qu'on trouve dans son style »37. Chez
M. de Balzac l’influence est-elle principalement perceptible dans la Physiologie du
Mariage de notre corpus. Ainsi, l’auteur convoque-t-il Buffon à plusieurs reprises :
pour citer l’homo duplex38 du Discours sur la nature des animaux39 ou pour se placer
comme l’applicateur de sa physiologie aux hommes, « Ah !... Buffon a
supérieurement décrit les animaux, mais le bipède nommé mari... (Comme c’est
agréable à entendre quand on est marié !) »40.
35 Jean Anthelme Brillat-Savarin, Physiologie du gout ou Méditation de Gastronomie transcendante; ouvrage théorique, historique, et à l'ordre du jour, dedié aux gastronomes Parisiens par un professeur membre de plusieurs societes savantes. Illustrée par Bertall ; précédée d'une notice biographique par Alp. Karr ; dessins à part du texte , gravés sur acier par Ch. Geoffroy, gravures sur bois , intercalées dans le texte par Midderigh, Préface, Gabriel de Gonet, Paris, 1848, p. XXI. 36 Ibid. 37 Ibid. p. 86. 38 Laquelle expression est citée à la Méditation XXVI de la Physiologie du mariage :
De même qu'il se rencontre des âmes tendres et délicates en des corps d'une rudesse minérale, de même il existe des âmes de bronze enveloppées de corps souples et capricieux, dont l'élégance attire l'amitié d'autrui, dont la grâce sollicite des caresses ; mais si vous flattez l'homme extérieur de la main, homo duplex, pour nous servir d'une expression de Buffon, ne tarde pas à se remuer, et ses anguleux contours vous déchirent.
Honoré de Balzac, Physiologie du mariage ou Méditations de philosophe éclectique sur le
bonheur et le malheur conjugal, Pierre-Georges Castex, Arlette Michel, René Guise, in La Comédie Humaine t. XI, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, p. 1161. 39 Notion à propos de laquelle Pierre-Georges Castex (ibid.) précise : « Pour Buffon l’homo duplex est l’homme intérieur, ainsi nommé parce qu’il est double, “compos” de deux principes différent par leur nature et contraires par leur action. Ces deux principes sont le principe spirituel et le principe animal. » Buffon, Discours sur la nature des animaux, in Corpus général des philosophes français, Auteurs modernes, t. XL, Paris, PUF, 1954, p. 337. 40 Op. cit. Physiologie du mariage, p. 930. Notons que cette idée est aussi présente dans l’Avant-Propos de la Comédie humaine, «le plus grand magasin de documents que nous ayons sur la nature
20
L’influence de François Broussais, fondateur de la médecine physiologique
est moins explicite que celle de Buffon chez les auteurs de notre corpus. Ainsi, si
Balzac, adepte de la physiognomonie41, écrit : « Broussais sera votre idole »42, c’est
davantage la méthode à l’origine de l’identité du physiologique et du pathologique –
selon laquelle les maladies consistent en des irritations organiques que l’on soigne
par la prescription d’antiphlogistiques – qui influença Auguste Comte et que
François Vatin présente comme terreau des sciences sociales43 que leur auteur que
l’on perçoit dans les physiologies du fondateur du réalisme. Méthode que l’on
perçoit aussi chez l’auteur de la Physiologie du goût qui lorsqu’il explique : « nous
n’avons examiné le goût que sous le rapport de sa constitution physique ; et à
quelque détails anatomiques près, que peu de personnes regretteront, nous nous
sommes tenus au niveau de la science »44 n’est pas sans rappeler une phrase de la
leçon 3 des Cours de Phrénologie de Broussais qui disait : « l'anatomie et la
physiologie du cerveau peuvent seules fournir des notions rationnelles sur
l'entendement humain »45.
L’influence de Johann Kaspar Lavater, théologien suisse et de langue
allemande est principalement perceptible chez nos deux auteurs via le célèbre traité :
L’Art de connaître les hommes par la physionomie du premier. M. Brillat-Savarin y
fait d’ailleurs référence à sa vingt-deuxième Méditation et signale à propos de
humaine », dans lequel Balzac, qui se propose de composer l’histoire naturelle de l’homme, justifie sa démarche : « Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l'ensemble de la zoologie, n'y avait-il pas une œuvre de ce genre à faire pour la Société ? » 41 Nous renvoyons ici notre aimable lecteur au passionnant article d’Hélène Spengler (p. 69) : « Système et mises en scène de l’énergie dans le récit romantique selon Stendhal et Balzac. Massimilla Doni et ses intertextes stendhaliens » publié dans les actes du colloques Stendhal, Balzac, Dumas, un récit romantique ? Sous la direction de mesdames Lise Dumasy, Chantal, Massol, Marie-Rose Corredor et édité en 2006 aux Presses Universitaires du Mirail dans la collection « essais de littératures Cribles ». 42 Op. cit., Physiologie du Mariage, p. 1026. 43 François Vatin, Trois essais sur la genèse de la pensée sociologique : Politique, épistémologie et cosmologie, Paris, La Découverte, 2004. 44 Op. cit. Physiologie du goût, p. 22. 45 François Broussais, Cours de Phrénologie, leçon 3, Paris, Baillière, 1836, p.75. Pour plus d’informations sur Broussais c.f. Frédéric Le Blay, « Des tempéraments à l’idiosyncrasie : évolution et permanence d’une définition physiologique de l’individu. », in V. Barras, B. Maire et A.-F. Morand, Mélanges, crases, tempéraments. La chimie du vivant dans la médecine et la biologie anciennes. Actes du colloque international, Universités de Lausanne et de Genève, 6-8 mai 2004, Bibliothèque d'Histoire de la Médecine et de la Santé, Editions BHMS, Lausanne (à paraître).
21
l’extase post-mortem d’une jeune fille que : « Lavater en fait mention dans son Traité
de la physionomie ». Chez M. de Balzac la référence va au-delà d’une simple
mention et on peut lire dans sa Physiologie du mariage une véritable admiration pour
l’ouvrage de cet homme : « La Physiognomonie de Lavater a créé un véritable
science. Elle a pris place enfin parmi les connaissances humaines »46.
M. de Balzac comme son auguste maître (et peut-être même davantage que
lui) s’inscrivent donc tous deux dans cette longue tradition qui se pensait science et
qui voulait qu’on puisse déduire le caractère d’un individu au simple regard de son
physique et plus particulièrement sur les traits de son visage : la physiognomonie,
dont Lavater dit qu’elle est (…) la science, la connaissance du rapport qui lie l’extérieur à l’intérieur, la
surface visible à ce qu’elle couvre d’invisible. Dans une acception étroite, on entend par physionomie l’air, les traits du visage, et par physiognomonie la connaissance des traits du visage et de leur signification.
Cette physiognomonie permit, en cherchant les causes dans l'objet du
jugement et non dans le jugement subjectif, le développement du lombrosianisme
relatif à l’homme criminel et par la suite du racisme scientifique, grande passion du
nazisme.
Balzac et Brillat-Savarin : une interaction historique
Au-delà de notre sujet à proprement parler, les rencontres entre M. de Balzac
et M. Brillat-Savarin sont habituelles : en 1835, la rédaction de la notice sur Brillat-
Savarin de la Biographie universelle de Michaud échoit à M. de Balzac. En 1838,
pour la réédition de la Physiologie du goût, M. Charpentier demande à M. de Balzac
une préface laquelle deviendra le Traité des excitants modernes placé en appendice.
Dans son remarquable article, « Balzac et Brillat-Savarin. Sur une préface de la
Physiologie du goût »47, Pierre-Georges Castex nous signale d’ailleurs à ce propos
que l’auteur semblait avoir œuvré sur une première version inachevée. Ces huit
46 Op. cit. Physiologie du mariage, p. 1044. 47 Pierre-Georges Castex, « Balzac et Brillat-Savarin. Sur une préface de la Physiologie du goût », Année Balzacienne, 1979.
22
pages manuscrites furent réunies sous le titre Sur Brillat-Savarin et de l'alimentation
dans la génération48 et semblent développer les aphorismes savarins.
De plus, M. de Balzac a certainement eu, grâce à ses relations avec l’éditeur
de M. Brillat-Savarin, Philibert Auguste Sautelet, une copie ou le manuscrit de la
Physiologie du goût avant sa parution. En effet, M. de Balzac entretenait de bonne
relation avec M. Sautelet dont il était le condisciple au collège Vendôme ainsi que
nous le rappelle le professeur Alan B. Spitzer dans son article49 :
An even more ubiquitous individual whose brief existence can be traced out along
the ramifications of the generational network was Auguste Sautelet, suicide at the age of thirty but preserved in the amber of Balzac and Stendhal scholarship50. Sautelet had come up from the provinces where he had been a condisciple of Balzac at the collège of Vendôme, studied at the collège Charlemagne with Balzac and Michelet then took his degree in law and plunged into the militant world of the youth of the schools.
Mais la preuve la plus flagrante de la très probable possession de l’ouvrage de
M. Brillat-Savarin par Honoré de Balzac avant la parution officielle de celui-ci, en
décembre 1825, réside selon nous dans l’association de M. de Balzac avec M.
Sautelet à la fonction d’éditeur ainsi que nous l’indique l’enregistrement, par la
Bibliothèque de France (B.F.), le 29 juillet 1826, de deux livraisons d’ouvrages dont
la page de titre indique Œuvres complètes de La Fontaine ornées de trente vignettes
dessinées par Devéria et gravées par Thompson et signale Sautelet comme éditeur.
Or, si jusqu’ici nous convenons que la preuve n’est pas faite, au verso du faux titre
on peut lire : « H. Balzac éditeur-propriétaire, rue des Marais-S-Germain, No17 » et
la couverture porte les noms et les adresses de Balzac et de Sautelet. On peut alors
penser à une participation financière d’Honoré de Balzac auprès de Sautelet. 48 Honoré de Balzac, Sur Brillat-Savarin et de l'alimentation dans la génération, manuscrit autographe incomplet. Ms Lov. A 166 / Fol. 21-29. Collection Spoelberch de Lovenjoul. Dont nous avons reproduit le fac-similé en annexe I 49 Alan B. Spitzer, « A Generation as a Social Network », dans Histoire & Mesure, 1987 volume II, n°3-4, p. 19-39. 50 See, e.g., Barbéris, Balzac et le Mal du siècle, I :329 ; Henri Martineau, Petit Dictionnaire stendhalien (Paris, 1948), 434-39. For contemporary descriptions of Sautelet and the testimony on his personal connections, see especially the obituary by Armand Carrel, « Un Mort Volontaire », Revue de Paris (June 1830), 205-16 ; « Obsèques de M. Sautelet », Le National, 16 mai 1830 ; Sainte-Beuve, Portraits Contemporains (Paris, 1891), I :178-83 ; Pierre Leroux, Réfutation de l’éclectisme (Paris 1839), 79 ; Charles de Rémusat, Mémoires de ma vie, présentés et annotés par Charles H. Pouthas (Paris, 1958-67), 2 :282-83 ; Delécluze, Souvenirs, 274-275. [Nous reproduisons ici la note 14 de l’article de M. Spitzer dans son exhaustivité et en respectant la typographie séléctionnée par son auteur].
23
Participation qui en sus d’un nom et d’une adresse au verso d’un faux titre permit
certainement à l’auteur de la Physiologie du mariage d’ébaucher cette dernière avant
que ne sortit le livre dont il se revendiqua l’inspiré.
Enfin, en novembre 1829, M. de Balzac lui-même dans une lettre à
Levavasseur se compare à Brillat-Savarin lorsqu’il écrit à propos de la Physiologie
du mariage :
Je voulais faire une plaisanterie et vous m’êtes venu demander, un matin, de faire
en trois mois ce que Brillat-Savarin avait mis dix ans à faire. Il ne parlait que de godailleries et moi je parle de ce qu’il y a de plus sérieux en France. Il avait un sujet neuf et moi le sujet le plus usé51.
Les physiologies balzaciennes semblent donc à la fois réceptacle des
influences savarines et point de relance de cette même pensée. La question qui se
pose désormais est celle de la démonstration de cette intuition.
51 Honoré de Balzac, Correspondance, Paris, Calmann Lévy, 1877, p. 91.
25
1. Le discours pseudo-scientifique chez M. de Balzac et M.
Brillat- Savarin: justification et ironie
1.1. La justification d’un propos
1.1.1. La mimèsis scientifique Comme nous l’avons signalé dans notre introduction, les physiologies
fonctionnent généralement comme des reproduction de modèles familiers de la vie
moderne. Elles sont en d’autres termes destinées à rendre le champ tout entier de la
diversité plus visible, plus lisible, en bref, plus accessible à ses lecteurs. Cette
prétendue mimèsis des mœurs communes est toutefois entièrement subordonnée à la
réécriture des codes du discours scientifique.
Balzac, se situant dans la continuité de Brillat-Savarin, allie expérience et
discours à travers ce que Karlheinz Stierle appelle une « présence d’esprit
ironique »52 . Il met à profit, tout comme l’auteur de la Physiologie du goût avant lui,
le charme de la physiologie pour articuler l’acquis quotidien. Chez nos deux auteurs,
le lecteur peut observer une écriture novatrice qui cherche à se rapprocher du
discours scientifique. Dans La Physiologie du goût par exemple Brillat-Savarin
endosse le costume d’un « Professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et
savantes » 53 et affirme son admiration pour les sciences naturelles dès sa Préface :
Je suis surtout médecin-amateur ; c'est chez moi presque une manie, et je compte
parmi mes plus beaux jours celui où, entré par la porte des professeurs et avec eux à la thèse de concours du docteur Cloquet, j'eus le plaisir d'entendre un murmure de curiosité parcourir l'amphithéâtre, chaque élève demandant à son voisin quel pouvait être le puissant professeur étranger qui honorait l'assemblée par sa présence54.
Nos auteurs s’improvisent pédagogues et vont même jusqu’à le revendiquer
explicitement comme Balzac qui dans la Physiologie du mariage se surnomme « le
Professeur ». Il justifie ainsi l’emploi du ton doctoral qui lui permet de soutenir 52 Karlheinz Stierle, Jean Starobinski, La Capitale des signes, Paris et son discours, Maison des Sciences de l'Homme, 2001, p. 196. 53 En effet le titre complet de son ouvrage est rappelons le : Physiologie du Goût, ou Méditations de Gastronomie Transcendante ; ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux Gastronomes parisiens, par un Professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. 54 Op. cit., Physiologie du goût, p. 34.
26
l’aphorisme LXI de son « Traité de politique maritale » (Méditation X) qui suit
l’emploi dudit substantif : Le professeur vous défend ici très expressément l'usage de la cravache si vous
voulez parvenir à ménager votre gentille Andalouse .
LXI Qu' un homme batte sa maîtresse ... c' est une blessure ; mais sa femme ! ... c' est
un suicide55.
Le dandy et le gourmet donnent à leurs œuvres un dessein davantage
didactique que ludique. Le divertissement, lui, semble comme induit, et ce presque
malgré l’auteur, par la visée pédagogique. Ou c’est du moins ce que l’on cherche à
nous faire croire. En d’autres termes, à la finalité première, esthétique, formelle, ou
du moins réglementée, nos textes opposent ce nonobstant une fonction
d’enseignement scientifique.
Or, nos physiologies fussent-elles revendiquées comme des transcriptions de
savoirs scientifiques, leur style : journalistique, anecdotique ou romancé ne peut
induire qu’une représentation se donnant comme mimèsis. La didactique pseudo-
médicale qui les compose ne peut être acceptée que grâce à la plus exacte et la plus
fidèle peinture sociale et sociétale56. En d’autres termes si le style semble objectif
pour ne pas dire scientifique alors le fond, dans l’esprit du lecteur, suit.
Toujours pour se faire scientifique, la représentation pourra se faire
monographie, étude de personnage, de caractère, d’un sujet précis et limité qui
pourra se réduire à la simple lecture d’un tableau scientifique. C’est ainsi que, dans
sa Physiologie de l’employé, M. de Balzac divise les employés en différents groupes
tels que les « météores » 57 et les « moteurs » 58 de la bureaucratie ou les « rouages » 59
de la machine administrative et qu’une fois cette opération effectuée il divise ces
mêmes groupes en sous-groupes plus précis qui peuvent donner lieu à des tableaux
aussi précis et détaillés que celui-ci :
55 Op. cit., Physiologie du mariage, p. 1011. 56 A l’adjectif « sociétal » nous attribuons une dimension structurelle. 57 « Les employés ne les aperçoivent que comme les astronomes aperçoivent les comètes. », Honoré de Balzac, Physiologie de l’employé, Anne-Marie Baron, Mayenne, Le Castor Astral, 1994, p. 51. 58 Ibid, p. 85. 59 Ibid., p. 51.
27
Tableau III64 : Les « moteurs » 65 de la bureaucratie.
Néanmoins, la mimèsis scientifique inhérente à ce projet taxinomique
implique que le code des sciences naturelles autorise une appréhension imitative du
réel et suppose de plus que le travail didactique s’intègre dans une reproduction. Or,
cette implication est loin d’être évidente. L’humour, conséquence malheureuse d’une
adaptation de la technique scientifique au sujet humain, créé davantage un effet de
science qu’un véritable discours scientifique.
1.1.2. L’ effet de science L’usage ironique langagier tout comme la convocation des méthodes de
Linné ou de Buffon dessert la visée didactique pure – à laquelle aurait pu mener
sinon le naturalisme du moins le réalisme descriptif de nos auteurs – au profit de la
création de ce qu’Alain Buisine décrit comme « la volonté de créer un “effet de
science” pour démarquer l’“effet de réel” de Barthes »66. Le corollaire humoristique
de cet effet de science se situe dans l’évident déséquilibre entre la technicité
scientifique alambiquée de la peinture et la banalité extrême de l’espèce sociale ou
du sujet représenté. M. de Balzac excelle d’ailleurs à la réalisation de ce genre 60 Ibid, p. 88. 61 Ibid, p. 92. 62 Ibid, p. 95-96. 63 Ibid, p. 100. 64 Cf. annexe VI pour davantage de tableaux. 65 Ibid, p. 85. 66 Alain Buisine, « Sociomimesis : Physiologie du petit-bourgeois. » in Romantisme, 1977, no17-18, p. 88.
Chef de Bureau Chef de division Garçon de bureau Retraité « Dans les bureaux le chef est ou chien ou bon enfant : (…) Le chien est dur, exigeant, tracassier, méticuleux. (…) Le bon enfant est calme, indulgent, complaisant sans se laisser duper, il jouit d’une bonne santé. »60
« Ils sont donc l’âme des ministères et gouvernent les ministres. Le nerf, l’existence, la gloire du chef de division c’est le Rapport. » 61
« Véritable pilier des ministères, expert des coutumes bureaucratiques (…) serviteurs sans maître (…) ce garçon qui n’est jamais célibataire est le philosophe des administrations. »62
« La mortalité sur les employés retraités est effrayante. »63
28
d’exercice : sa description de « l’adjoint, machine essentiellement complétive, placée
à côté de l’objet créé, dont elle est la doublure sans en faire partie, qu’elle aide quand
elle marche à sa suite, qu’elle compromet quand elle va devant. »67 est chargé, on le
voit bien, d’une certaine universalité en sus, d’une truculente ironie. Selon nous, M.
Brillat-Savarin, plus âgé que M. de Balzac au moment de l’écriture, est aussi plus
sérieux, car probablement plus habité par son sujet, que son auguste héritier. Ainsi
décrit-il, mi-figue mi-raisin, en développant plus que de raison, la technique de
consommation de l’ortolan : Prenez par le bec un petit oiseau bien gras, saupoudrez-le d’un peu de sel et de
poivre ; enfoncez-le adroitement dans votre bouche, sans le toucher des lèvres ni des dents, tranchez tout près de vos doigts et mâchez vivement. Il en résulte un suc asse abondant pour envelopper tout l’organe et dans cette mastication, vous goûterez un plaisir inconnu du vulgaire68.
Cependant ajoutons, à la décharge du gastronome, qu’il est assez difficile
d’être drôle dans la peinture d’une recette de cuisine sans sombrer dans le ridicule.
Or même si la Physiologie du goût n’est dénuée d’un certain humour, il ne s’agit
certainement pas de son but premier.
Les portraits de nos physiologies, leurs descriptions ne peuvent en aucun cas
– lorsque leur discours de science revient à n’être qu’une mathésis burlesquement
soumise à la réécriture – être appréhendés comme représentation réaliste. « La
Science naturelle, en d’autres termes, n’est pas revendiquée pour sa méthode mais
simplement pour le code qu’elle fournit à l’écrivain » 69 . Le jeu sémiotique, plus
flagrant chez M. de Balzac (plus assumé peut-être) que chez M. Brillat-Savarin, avec
la classification sociale, anthropologique ou les évocations historiques est si
clairement allégué qu’il rejette dans les tenebrae exteriores toute relation mimétique
que les œuvres physiologiques pourraient avoir avec l’objet réel de leur étude.
Remarquons la même volonté de création dans l’emploi abondant et récurrent
de termes latins. Écrire en citant Horace dans le texte : « Odi profanum vulgus et
67 Honoré de Balzac, « Physiologie de l’adjoint », in Œuvres complètes de H. de Balzac. Tome XXI, Œuvres diverses. Troisième partie, Physionomies et esquisses parisiennes. Quatrième partie, Croquis et fantaisies, Paris, Michel Lévy frères, 1872, p. 551. 68 Op. cit., Physiologie du goût, p. 93. 69 Op. cit., « Une Idéologie du lisible : le phénomène des Physiologies », p. 45.
29
arceo »70 chez M. Brillat-Savarin ou reprendre le « quos aequus amavit Jupiter »71 de
l’Énéide72 chez M. de Balzac, plutôt que de noter : « je hais le vulgaire profane et je
l'écarte » ou de « que Jupiter a aimé » c’est attribuer à l’écrit une marque de
scientificité – en la fixant ou non dans une tradition – bien plus que lui donner une
valeur scientifique véritable. La volonté de faire connaître fonde ce divertissement
qu’est la physiologie, mais ce n’est qu’en créant une forme attrayante via l’illusion
70 M. Brillat-Savarin reprend ici le vers I de l’ode I du livre III d’Horace. Ce chant (ωδή) composé par le poète à un âge avancé est, comme un grand nombre des odes du Livre III, « plus remplies de preceptes & de moralitez : car c’eft le langage le plus ordinaire de la vieilleffe [sic] », André Dacier, « Remarques sur l’ode I du Livre Troisième »,, Œuvres d’Horace, tome III, Paris, Denys Thierry et Claude Barbin,1691, p. 10. Ainsi quand M. Brillat-Savarin écrit :
Prenez par le bec un petit oiseau bien gras, saupoudrez-le d'un peu de sel, ôtez-en le gésier, enfoncez-le adroitement dans votre bouche, mordez et tranchez tout près de vos doigts et mâchez vivement : il en résultera un suc assez abondant pour envelopper tout l'organe, et vous goûterez un plaisir inconnu au vulgaire :
Odi profanum vulgus et arceo.
Op. cit. Physiologie du goût, p. 93. Il se présente à la fois comme un viel homme et comme un homme sage. Il est celui que l’on doit écouter, comme Horace il écrit pour l’éclairé et méprise le jugement du peuple. 71 Citation en contexte :
Au premier rang, enfin, se placent ces hommes forts et solides par eux-mêmes, qui sentent et
comprennent la cravate, qui la comprennent dans ce qu'elle a d'essentiel et d'intime, avec cette énergie d'intelligence, cette puissance de génie, départies à ces mortels privilégiés quos aequus amavit Jupiter. Ceux-là n'ont ni maîtres ni modèles, ils trouvent en eux de grandes, de nobles ressources ; ils n'écoutent qu'eux-mêmes, ils sont véritablement créateurs.
Balzac Honoré de, Physiologie de toilette. De la cravate, considérée en elle-même et dans ses rapports avec la société et les individus, Mayenne, Castor Astral, 1992, p. 68. 72 Cette citation du vers 129 du livre VI de l’Énéide de Virgile évoque descente de Thésée et d’Hercule aux enfers :
Facilis descensus Averni ; Noctes atque dies patet atri janua Ditis : Sed revocare gradum, superasque evadere ad auras, Hoc opus, hic labor est. Pauci quos æquus amavit Jupiter, aut ardens evexit ad æthera virtus, Dis geniti potuère.
Or, pour reprendre les très justes réflexions Philippe-Jean Bitaubé, membre de l’institut de la Légion d’honneur, dans ses « Remarques sur la descente d’Ulysse aux enfers » dans le tome III des Œuvres d’Homères parut à Paris en 1819 chez Ledoux et Tenré : « Le côté allégorique [du motif de la descente aux enfers] n’est pas difficile à saisir. Un homme sage doit (…) être prêt (…) à descendre aux enfers pour découvrir la vérité. (…) ». Le clin d’œil balzacien résidant dans le choix du latin est clair : ceux qui comprennent réellement la cravate sont comme descendus aux Enfers et, tels des héros antiques de l’élégance, en sont revenus avec la lumière de la vérité inhérent à ce bout de tissu.
30
scientifique, en l’occurrence le latin, que l’on pourra faire avaler « la pilule
didactique »73 au lecteur.
De plus le latin s’inscrit dans le cadre de la visée didactique mis en lumière
précédemment. En effet, au XIXe siècle, l’enseignement de la lingua latina est
privilégié tant dans l’enseignement que dans la communication scientifique. On parle
même d’un néo-latin qui naîtrait avec l’imprimerie et marquerait une période de
transition pour se concentrer, par la suite, dans les milieux linguistiques, littéraires et
scientifiques de l’époque sur laquelle porte notre étude. C’est une des raisons pour
que moins d’un siècle plus tard sa disparition (ou du moins son cantonnement aux
seuls domaines de la cladistique et de la systématique) ne soit pas sans causer
quelques regrets à certains ainsi que nous le signalent Louis Couturat et Léopold
Leau dans leur préface à l’Histoire universelle de la langue : « Les savants regrettent
souvent le temps où le latin était la langue scientifique unique et ils sont ainsi amenés
à rêver la résurrection du latin comme langue internationale »74 et nous aimons à
penser que ce n’est pas le Vatican qui nous contredira.
Nos physiologies sont donc chargées d’une volonté didactique et usent des
techniques propres au discours scientifique. Cependant, cette pédagogie se voit
parasitée par l’humour, corollaire malheureux d’une adaptation du naturel au social,
de l’objectif au subjectif. Le genre de la physiologie est davantage empli d’un effet
de science, d’une mimèsis divertissante que d’une véritable portée savante.
Néanmoins, cette réécriture ironique des codes théoriques conduit davantage le
lecteur vers la méditation légère au sourire charmant que vers la parodie grossière au
rire gras.
73 Nous empruntons l’expression et l’idée à l’article d’Alain Buisne, « Un cas limite de la description : L’énumération. L’exemple de Vingt mille lieues sous les mers » in La Description, Textes réunis par Philippe Bonnefis et Pierre Reboul, Lille, Presses Universitaire de Lille, 1981, p.88. 74 Louis Couturat, Léopold Leau, préface à l’Histoire de la langue universelle : Beigebunden ist : Les nouvelles langues internationales. Mit e. bibliograph. Nachtrag von Reinhard Haupenthal, Hildesheim, Georg Olm, 1903, p. X.
31
1.2. L’ironie méditative
1.2.1. Le comique rassurant de l’« effet de science » et l’imitatio
doxique Malgré l’impression de parodie et de dévalorisation taxinomique qui émane
de nos physiologies, nous sommes en droit d’affirmer que l’ironie perceptible n’est
en rien subversive. En effet, loin de faire du discours scientifique un discours
grotesque pour ne pas dire carnavalesque, les physiologies balzaciennes tout comme
la Physiologie du goût réalisent simplement un écho parasite des énoncés
théoriques : le discours (logos) d’un Buffon ou d’un Cuvier permet au social d’être
appréhendé d’une manière rassérénante et naturelle (phusis), par opposition avec la
loi (nomos) assénée, comme la répétition automatique d’un lieu commun ou cliché75.
En incluant à leurs physiologies des anecdotes, en les notant dans un style
parfois proche de celui du romancier, du journaliste, nos auteurs assouplissent la
brutalité rébarbative du texte scientifique. Les lois, aphoristiques, parsèment les
ouvrages du dandy et du gastronome et ne s’imposent pas comme celles du code ou
de la thèse. Le texte est avant tout littéraire et se doit d’être léger pour ne pas lasser
en étant prétentieux. Les chapitres invitent par leur titre à la Méditation. Plutôt que
par la violence c’est par la redondance que s’imposera la pensée de l’auteur. C’est en
se répétant sur des tons différents que l’idée germera dans l’esprit du lecteur fertilisé
par l’humour.
Notons enfin que si les physiologies se prétendent mimèsis des mœurs
communes cette imitation n’est pas celle de la vie contemporaine mais plutôt
l’immense fond du déja-écrit et du déjà-lu. Entre d’autres termes la doxa et le
comique naît de cet imitatio doxique en cela que chaque physiologie diffère de
l’autre tout en regardant son sujet à travers la même loupe et en le diffusant dans le
même format76, en étant donc potentiellement identique. Il s’agit avant tout de flatter
75 c.f. Ruth Amossy, Elisheva Rosen, Les Discours du cliché, Paris, Sedes, 1982. 76 Supra. « Définir le genre de la physiologie », p. 5.
32
le lecteur, de le conforter dans ses idées, la physiologie doit se faire charmante avant
d’être convaincante. Elle est le miroir du « Narcisse Bourgeois »77.
1.2.2. Observation et jeu de miroir : humour voyeuriste, l’illusion petite-bourgeoise de la différence
Chez nos deux auteurs on remarque la même nécessité de justifier leur
démarche : « Il manquait un guide, une boussole aux pèlerins mariés… cet ouvrage
est destiné à leur en servir 78 ». Le charme de la physiologie réside dans un
narcissisme fondamental du lecteur. Il se pense observateur et s’admire en tant que
tel. Or ce charme peut-être aisément qualifié d’autoréflexif puisqu’il naît non
seulement de la jouissance du regardant mais aussi de celle du regardé : la page est le
miroir d’un lecteur complice d’un auteur séducteur qui bavarde en ami au fil de sa
narration. Ainsi M. de Balzac d’interpeller son lecteur, tel un promeneur parisien
discutant avec un autre promeneur parisien : « Regardez bien l’entrée de la rue
Grange-Batelière, bordée à chaque encoignure d’édifice sans grandeur ni caractère,
au milieu de tant de splendeurs !79 » et de lui demander : Croiriez-vous que l’une de ces maisons soit celle du Jockey-Club ? ne trouvez-
vous pas étrange dque ses membres, aussi riches qu’élégants, n’aient pas eu la pensée nationale de lutter avec les clubs de Londres, dont la magnificence dépasse celle des rois ?80
M. Brillat-Savarin lui aussi fait du charme à son lecteur en lui offrant des
friandises. Il écrit :
J'ai dit que le plaisir de la table, tel que je l'ai caractérisé, était susceptible d'une
assez longue durée; je vais le prouver en donnant la relation véridique et circonstanciée du plus long repas que j'aie fait en ma vie c'est un bonbon que je mets dans la bouche du lecteur, pour le récompenser de la complaisance qu'il a de me lire avec plaisir81.
Le choix du terme « complaisance » est intéressant car ce substantif féminin
s’il signifie selon le Dictionnaire de l’Académie française : « Disposition, caractère
77 Maguèye Touré, Le Sens de la sottise chez Flaubert, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 190. 78 Op. cit. Physiologie du mariage, p. 919. 79 Honoré de Balzac, Histoire et Physiologie des Boulevards de Paris, Roger Caillois, Honoré de Balzac, A Paris !, éditions Complexe, collection « Le regard littéraire », 1993, p. 52 80 Ibid. 81 Op. cit., Physiologie du goût, p. 193-194.
33
qui porte à s'accommoder au sentiment, au goût d'autrui pour lui plaire », une autre
entrée signale la locution « avec complaisance » en donnant l’acception : « avec un
sentiment de plaisir mêlé de vanité ». Il est alors tout à fait probable que M. Brillat-
Savarin ait choisi ce terme à dessein : si le lecteur est indulgent c’est parce qu’il se
retrouve dans le texte du gastronome et qu’il en tire une certaine vanité.
Mais l’acte d’observation peut aussi être l’acte voyeuriste, dissimulé et c’est
cette assurance d’une observation sans conséquence, sans risque d’être remarqué qui
fonde le dispositif rassérénant de l’ironie, de la satire de nos ouvrages (et du genre
dans son ensemble). Alain Buisine dans son article en parle comme de la forme
caractéristique de l’aliénation petite bourgeoise : ne pas se reconnaître soi-même
comme autre : Plus qu’une quelconque curiosité ethnologique fortuitement prélevée parmi une
foule d’autres dans la faune de la socialité, le petit-bourgeois est par définition une curiosité en tant que telle. L’exhiber relève moins d’un choix que d’une nécessité. Car le social ne se saurait se faire spectacle sans la monstration du petit-bourgeois. Plus qu’un des éléments du tableau, il est d’abord ce qui rend possible le tableau. Quand la socialité accède à la représentation, quand elle se regarde, elle prend la forme typique du petit-bourgeois, elle est inéluctablement petite-bourgeoise. Cette sorte de classe bâtarde constitue le lieu même de la socialité pour autant qu’elle la rend descriptible : petit bourgeois infiniment décrit, jamais suffisament décrit puisque condition sine qua non du représentable, indispensable opérateur de la représentation, révélateur de la socialité au sens le plus technique82.
Le lecteur petit-bourgeois se moque, riche de la flatterie illusoire de sa non
appartenance à la caricature dépeinte par son semblable à l’intérieur du texte. Il se
met ainsi dans une position de supériorité sans être, pour autant, ciblé par le ridicule
déployé.
Légères et caressantes, nos physiologies convoquent la pensée doxique et se
changent en miroir séducteur du lisant petit-bourgeois. Confronté à la caricature
celui-ci est rasséréné : le moqué du livre aux traits grossier ne lui ressemble pas, il lui
est donc supérieur. Cette réflexion est valable chez nos deux auteurs. Néanmoins si
M. de Balzac se place comme l’imitateur du style pseudo-scientifique de M. Brillat-
82 Alain Buisine, « Sociomimesis : Physiologie du petit-bourgeois. » dans Romantisme, 1977, no17-18, p. 45.
34
Savarin, le dandy aux gants jaunes ne plagie pas celui qui l’inspire. Il est un auteur
original, un continuateur du gourmet.
1.3. Continuité de M. Brillat-Savarin chez M. de Balzac
1.3.1. Le patronage savarin L’influence du gourmet auteur de la Physiologie du goût sur l’auteur futur de
la Comédie Humaine est particulièrement flagrante dans la Physiologie du mariage,
ouvrage balzacien de notre corpus le plus abouti sinon le plus long (près de quatre
cent pages en édition de poche). Afin de ne point lasser, nous nous concentrerons
donc sur ce seul texte. Dans la rédaction de cette partie de notre travail de recherche,
il nous est, en effet, apparu comme amplement suffisant pour présenter un catalogue
complet des différentes convocations de M. Brillat-Savarin par M. de Balzac.
Néanmoins, il ne s’agira pas de présenter ici une rébarbative et répétitive liste
exhaustive mais plutôt de proposer des illustrations savoureuses précisement
sélectionnées. Ce choix nous permettra de mettre en exergue les mécanismes
balzaciens d’hommages et de références. Ces mécanismes, que nous tâcherons
d’interpréter, sont valables pour l’ensemble de notre corpus.
Les références du dandy au gastronome sont de deux ordres : continuité et
contradiction. Suivant l’un des deux à chaque fois, M. de Balzac va ensuite choisir
de citer l’ouvrage savarin ou de convoquer son auteur. C’est ainsi que, dès
l’Introduction à la Physiologie du mariage 83 , l’écrivain cite la Préface de la
Physiologie du goût après en avoir présenté l’auteur :
C’est un des malheurs les plus grands qui puissent arriver à un ouvrage, et l’auteur
ne se l’est pas dissimulé. Il a donc disposé les rudiments de cette longue étude de manière à ménager des haltes au lecteur. Ce système a été consacré par un écrivain qui faisait sur le goût un travail assez semblable à celui dont il s’occupait sur le mariage, et auquel il se permettra d’emprunter quelques paroles pour exprimer une pensée qui leur est commune. Ce sera une sorte d’hommage rendu à son devancier dont la mort a suivi de si près le succès.
83 Ouvrage dont le titre lui-même est choisi par imitation de la Physiologie du goût de M. Brillat-Savarin.
35
« Quand j’écris et parle de moi au singulier, cela suppose une confabulation avec le lecteur; il peut examiner, discuter, douter, et même rire ; mais, quand je m’arme du redoutable NOUS, je professe, il faut se soumettre »84 .
Ce faisant, Honoré de Balzac place cet ouvrage tout entier sous le patronnage
de Jean-Anthelme Brillat-Savarin. Cette Physiologie du mariage, succès d’édition,
est un hommage à son inspirateur85.
Mais l’inspiration peut aussi être parfois moins explicite. Ainsi, à un niveau
plus formel, les titres de Méditation qui parcourent la physiologie balzacienne sont
directement inspirés des intitulés de chapitres de la physiologie savarine. Il fait aussi
indirectement référence aux idées qui jalonnent l’ouvrage inspirateur telle que la
lutte contre le fléau qui menace le sujet physiologique. Ainsi M. Brillat-Savarin lutte-
t-il, en sa Méditation XXI, contre l’obésité, « cet état de congestion graisseuse où,
sans que l'individu soit malade, les membres augmentent peu à peu en volume, et
perdent leur forme et leur harmonie primitives »86. Cette maladie consécutive à une
ingestion trop importante de nourriture est l’épée de Damoclès du gourmet tout
comme l’est, pour le marié, le fait d’être cocufié ou pour reprendre les termes de M.
de Balzac – qui s’y oppose avec véhémence dans toute sa troisième partie intitulée
assez explicitement De La Guerre civile – « minautorisé »87. Honoré de Balzac est
l’héritier de Jean-Anthelme Brillat-Savarin et il le clame. Ce patronage se trouve à la
fois dans la forme et dans le fond de notre corpus balzacien. La construction quelque
peu pontifiante ainsi que la présence de néologismes en sont une preuve
supplémentaire.
84 Op. cit. Physiologie du mariage, p. 912. 85 À propos de l’Introduction Pierre-Georges Castex observe dans les notes de l’édition Pléiade que :
L'intérêt de l'énumération des titres – dont on ne trouve pas exactement les concordances dans la production de l’époque - au début de l'introduction qui se termine par une citation de la physiologie du goût, et de montrer que la physiologie du mariage tient autant au code, arts et autres ouvrages du même style qu’au savant travail de Brillat-Savarin.
86 Op. cit. Physiologie du goût, p. 210. 87 « Aux yeux de toute femme, même de sa femme légitime, plus un homme est passioné dans cette circonstance, plus on le trouve bouffon. Il est odieux quand il ordonne, il est minautorisé s’il abuse de sa puissance. », op. cit., Physiologie du mariage, p. 1070.
36
1.3.2. Axiomes, aphorismes et néologismes : illusion de sérieux et volonté théorisante
Tout comme M. Brillat-Savarin, M. de Balzac a fait des dissimilitudes de son
cocktail de discours un agent constituant son effet. En d’autres termes, la variété des
tons, des styles et des techniques employés est une composante essentielle, inhérente
même, au genre physiologique tel que le rédigent les deux auteurs de notre corpus.
Ainsi, lorsque Brillat-Savarin présente, dans une apicale volonté théorisante, une
« théorie de la friture »88, en lieu et place de sa septième Méditation, Balzac propose,
lui, une « théorie du lit »89 comme dix-septième Méditation.
Aphorismes et axiomes côtoient méditations et réflexions philosophiques
dans un but clair : paraître homme de science, faire de son œuvre un écrit sérieux, un
enseignement. Or, pour se faire professeur, il faut être érudit ou du moins le paraître
et les termes bien employés de « prolégomènes »90 – que le Dictionnaire de
l’Académie définit comme : « longue et ample préface qu'on met à la tête d'un livre,
pour donner les notions nécessaires à l'intelligence des matières qui y sont traitées »
– d’« Aphorismes » 91 semblent aider à créer l’illusion. L’usage du terme
« aphorisme », que le Dictionnaire de l’Académie définit comme : « sentence ou
maxime énoncée en peu de mots », plutôt que du terme axiome que le même
dictionnaire définit comme : « vérité évidente par elle-même ; proposition générale,
reçue et établie dans une science » est intéressant. En effet, grâce à ce choix, l’auteur
vide l’énoncé autonome de son évidence universelle et indépendante pour le faire
devenir principe de conduite, de maxima propositio. Contenu dans le substantif de
« Méditation »92 qui remplace le classique « Chapitre », l’aphorisme devient fruit
autosuffisant, assertif voire péremptoire de la production intellectuelle de l’auteur
devenu penseur puisqu’énonciateur de vérité. Ce dernier quitte alors le domaine des
sciences via la rhétorique pour se poser en philosophe.
88 Op. Cit., Physiologie du goût, p. 125. 89 Honoré de Balzac, Physiologie du mariage, La Comédie Humaine, t. XI, Études philosophiques, Études analytiques, Arlette Michel, René Guise, Paris, Gallimard, « Pléiade », 1980, p. 1060. 90 Op. Cit., Physiologie du goût, p. IX. 91 L’intitulé parsème les ouvrages de notre corpus. 92 Ibid.
37
Que ce soit dans la physiologie savarine ou dans les physiologies
balzaciennes le message est clair : les ouvrages que vous consultez sont détenteurs
d’un savoir universel à la fois découvert et médité. En d’autres termes, grâce à leur
observation de la nature / phúsis (φύσις), nos auteurs mettent leur intelligence /
phrónêsis (φρόνησις) et leur langage / rhêtorikê tekhnê (ῥητορικὴ τέχνη) au
service de leur lectorat afin de lui proposer un ouvrage de connaissance concernant à
la fois la création / poíêsis (ποίησις), le savoir / epistêmê (ἐπιστήμη) et l’action /
prâxis (πρᾶξις). Ils sont les penseurs par excellence en cela qu’ils maîtrisent
chacune des divisions de la philosophie aristotélicienne et se placent ainsi tous deux
comme héritiers de l’art classique.
S’ils maîtrisent l’aspect du scientifique de la parole / lógos (λόγος), ils leur
faut maîtriser, pour être complet, son aspect linguistique. Or, quoi de mieux qu’un
néologisme pour prendre possession de la langue / glỗssa – glỗtta (γλῶσσα –
γλῶττα). Il apparaît en effet logique que M. de Balzac comme M. Brillat-Savarin ne
pourront traduire leurs pensées novatrices que grâce à des créations littéraires pures.
Ainsi le verbe « anecdoter »93 comme le substantif « gynomètre »94 semblant désigner
une invention instrumentale balzacienne pour mesure la femme sont autant de
réponse aux néologismes savarins tels que le substantif de « convivialité » 95
désignant : le plaisir de vivre ensemble, de chercher des équilibres nécessaires à établir une
bonne communication, un échange sincèrement amical autour d'une table. La convivialité correspond au processus par lequel on développe et assume son rôle de convive, ceci s'associant toujours au partage alimentaire, se superposant à la commensalité96.
Dans sa préface le gastronome revendique son appartenance au « parti des
néologues »97 ce qui n’a pas échappé à M. de Balzac qui le signale et lui rend
93 « La matière était si grave qu’il a constamment essayé de l’anecdoter, puisqu’aujourd’hui les anecdotes sont le passe-port de toute morale et l’anti-narcotique de tous les livres. », op. cit. Physiologie du mariage, p. 912. 94 « Ce mystérieux gynomètre », Ibid., p. 1077. 95 Op. cit., Physiologie du goût, p. 127, 278, 282. 96 Jean-Pierre Corbeau, « De la table aux tablettes » in L’imaginaire de la Table, Jean-Jacques Boutaud, L'Harmattan, « Communication et Civilisation », 2004. 97 Op. cit., Physiologie du goût, p. XXII, Préface.
38
hommage en 1835 dans la notice sur Brillat-Savarin de la Biographie universelle
ancienne moderne : Brillat est très souvent néologue, et ceux qui partagent ce goût lui doivent non
moins de remerciement que les gastronomes : il a plaidé leur cause avec esprit dans sa préface ; il a semé partout son livre d’heureux exemples non moins appétissants que hasardeux.
De remercier à s’inspirer il n’y a qu’un pas et M. de Balzac semble l’avoir
franchi avec audace. Enfin, l’emploi du néologisme relève selon Roland
Barthes d’une attitude fétichiste et gourmande : Le néologisme (ou le mot très rare) abonde chez Brillat-Savarin ; il en use sans
frein, et chacun de ses mots inattendus (irrorateur, garrutilé, esculent, gulturation, soporeux, comessation, etc.) est la trace d’un plaisir profond qui renvoie aux plaisirs de la langue : Brillat-Savarin désire les mots, comme il désire des truffes, une omelette au thon, une matelote ; comme tout néologue, il a un rapport fétichiste au mot seul, cerné par sa singularité même. Et comme ces mots fétichisés restent pris dans une syntaxe très pure, qui restitue au plaisir néologique le cadre d’un art classique, fait de contraintes, de protocoles, on peut dire que la langue de Brillat-Savarin est à la lettre gourmande : gourmande des mots qu’elle manie et des mets auxquels elle se réfère ; fusion ou ambiguïté, dont Brillat-Savarin fait lui-même état lorsqu’il évoque avec sympathie ces gourmands dont on reconnaît la passion et la compétence à la seule façon – gourmande – dont ils prononcent le mot « bon »98.
On le voit, chez M. Brillat-Savarin comme chez M. de Balzac l’audace
stylistique, l’insolence de la lettre est toujours profondément liée sinon au sujet du
moins au caractère de l’auteur, à sa personnalité. C’est parce que M. Brillat-Savarin
est un gourmet qu’il est un néologue nous dit M. Barthes. C’est parce que c’est un
dandy, et parce qu’il est influencé par M. Brillat-Savarin, que M. de Balzac embrasse
ce parti.
98 Roland Barthes, Lecture de Brillat-Savarin dans Brillat-Savarin, Physiologie du goût. Première édition mise en ordre et annotée. Avec une lecture de Roland Barthes, Paris, Hermann, « savoir : lettres », 2005, p. 18-19.
40
2. Poétique et style chez M. de Balzac et M. Brillat-Savarin :
l’écriture de la mondanité, la mondanité de l’écriture
2.1. La question du corps
2.1.1. Le discours sensible, processus de mobilisation totale Chez nos deux auteurs, nous sommes face à un discours sensible. Il semble
logique qu’afin de discourir des habitudes de leurs contemporains, ou de sensations
relatives à la vie en société, M. Brillat-Savarin comme M. de Balzac se doivent de
mobiliser leurs facultés perceptives. Il s’agira alors pour nos deux écrivains de faire
preuve d’une synesthésie moins métaphorique que réelle99.
La synesthésie gourmande que l’on devine prépondérante chez M. Brillat-
Savarin n’est en revanche, dans l’incomplète Physiologie gastronomique de M. de
Balzac, qu’à peine abordée. Celle-ci n’offre en effet qu’un bien maigre ensemble
dans lequel la seule synesthésie présente consiste en sa négation par le type
physiognomonique du glouton : À table, jamais il ne lève les yeux, il dévore de l’œil comme de la bouche ; il ne
desserre les dents que pour manger ; jamais un propos facétieux, ce sel de tous les bons dîners, même des mauvais ; rien ne sort de sa bouche, tout y entre ! jamais un coup d’œil à sa jolie voisin ; jamais la plus légère attention, la moindre prévenance ; il la coudoie parfois, parce qu’il lui faut ses aises, et que fort souvent l’on est l’un sur l’autre à table100.
Ni le goût, ni la parole ne sont mobilisés dans un acte qui les nécessiterait
pourtant. Mais, même lorsque M. de Balzac vient à dépeindre un individu que jamais
M. Brillat-Savarin n’aurait admis à sa table, on peut voir un clin d’œil à l’œuvre du
gastronome en l’anecdote de la Méditation XI : J'étais un jour bien commodément placé à table à côté de la jolie madame M… d,
et je me réjouissais intérieurement d'un si bon lot, quand, se tournant tout à coup vers moi : « A votre santé ! » me dit-elle. Je commençai de suite une phrase d'actions de grâces ; mais je n'achevai pas ; car la coquette se portant vers son voisin de gauche : « Trinquons !... » Ils
99 « La synesthésie n’a pas la signification d’une métaphore. Quand Rimbaud écrit le sonnet des voyelles ou quand Proust fait allusion à la sonorité mordorée du nom de Brabant, ils se situent l’un et l’autre dans le registre poétique. La synesthésie a tous les caractères d’une perception réelle. », Jean Cambier, Patrick Verstichel, Le Cerveau réconcilié : précis de neurobiologie cognitive, Masson, « Mass », Paris, 1998, p. 98 100 Honoré de Balzac, Physiologie gastronomique, Jean-Jacques Brochier, Mayenne, 1992, p. 87.
41
trinquèrent, et cette brusque transition me parut une perfidie, qui me fit au coeur une blessure que bien des années n'ont pas encore guérie101.
Ici en effet, c’est M. Brillat-Savarin qui se trouve blessé dans son orgueil de
gentilhomme par la brusquerie et la grossièreté d’une femme. M. de Balzac aura
alors simplement repris et inversé le schéma.
M. Brillat-Savarin décrit l’action des sens et leur dialogue dans ses premières
Méditations. Selon le gastronome, la synesthésie s’opère autour d’un sens principal :
le goût. Or comme le signale Gérard Danou : Le goût isolé manquerait d’ironie, il n’aurait ni arrière-goût ni avant-goût. Il serait
sans désir. Le goût est perverti par les autres sens, qui lui donnent une caisse de résonance, une amplitude corporelle. Tous s’entrelacent en une danse de synesthésies. L’odorat goûte le mets fumant qui caresse les narines. L’oreille goûte les sons et fait saliver (Pavlov). Le regard dévore l’objet désiré de son œil tactile (haptique), il le caresse, le saisit pour le dévorer, pour le détruire. La saveur résonnante met en jeu l’émotion, l’interférence des sens. Elle est intraduisible en mots, pur domaine de l’expérience corporelle. C’est une perception immédiate par le dedans, en deçà de l’activité linguistique102.
En complément du goût, qui « a pour but la conservation de l’individu »103 le
gourmet en ajoute un, le « génésique »104 qui a pour but « la conservation de
l’espèce »105. Si la synesthésie savarine figurant l’appétit contextualisé, semble placée
sous le patronage suprême du goût c’est parce que la jouissance gustative relève de la
cénesthésie, d’un corps total. Selon Roland Barthes, cette cénesthésie, sensation
globale de notre corps interne, « c’est le bien-être qui suit les bons repas »106.
Cependant s’étonne le critique : Lorsqu'il veut saisir les effets voluptueux de la nourriture, c’est sur le corps
adverse qu’il va les chercher ; ces effets sont en quelque sorte des signes, pris dans une interlocution : on déchiffre le plaisir de l’autre ; parfois même, s’il s’agit d’une femme, on l’épie, on le surprend comme si l’on avait affaire à un petit rapt érotique107.
Ce rapt est tout à fait perceptible dans la peinture de la gourmande, extrait qui
suit directement notre citation savarine précédente. Dans ce passage M. Brillat-
101 Op. cit., Physiologie du goût, p. 126-127. 102 Gérard Danou, Le Corps souffrant. Littérature et médecine, Champ Vallon, « L’Or d’Atalante », Seyssel, 1994, p. 87. 103 Op. cit., Physiologie du goût, p. 2 104 Ibid. 105 Ibid. 106 Op. cit., Lecture de B.S., p. 10. 107 Ibid.
42
Savarin décrit ce qu’il nomme « la radiance de l’extase »108 qui donne aux yeux du
beau sexe « plus de brillant »109, « aux muscles plus de soutient »110, « à la peau plus
de fraîcheur »111 et Roland Barthes d’en parler comme d’une illumination interne.
Cette cénesthésie, on la retrouve dans nos physiologies balzaciennes : moins
analysée que chez son prédécesseur, ce saisissement interne est tout de même
perceptible dans la Physiologie de la toilette étreignant M. le prince de R…. L’auteur
en parle alors comme d’une chaleur d’âme : M. le prince de R…, aujourd’hui archevêque et cardinal, fut longtemps la gloire de
la cravate. Vous ne l’eussiez pas vu défaire, essayer, recommencer à plusieurs reprises le nœud d’une même cravate. Il mettait dans cette partie de la toilete une ampleur, un grandiose qu’un petit esprit ne saurait comprendre. Vingt cravates étaient préparées devant lui ; il en prenait une, la mettait à son cou et la nouait d'une main sûre qui ne connaissait pas l'hésitation. Le noeud lui déplaisait-il, il jetait la première cravate, en prenait une autre. Quelquefois, il en essayait jusqu'à dix, quinze, avant d'être satisfait de son oeuvre ; car la cravate, expression de la pensée comme le style, est souvent rebelle comme lui. Mais, quand il était parvenu à reproduire dans sa cravate ce type sans pareil qu'il avait dans l'esprit, on admirait, on s'extasiait. Son âme était passée dans le tissu léger, et s'y manifestait tout entière. On y voyait cette aisance, cette liberté d'esprit, sans laquelle il n'est pas d'originalité, et surtout cette chaleur d'âme, ce feu brûlant qui se développa plus tard en zèle religieux, et devint une vocation au cardinalat112.
Notons ici la même attitude relevée par Roland Barthes chez le gastronome, à
savoir la recherche de cénesthésie dans la contemplation du corps adverse. Plus
admirative qu’érotique, cette scène nous permet d’affirmer que la gastronomie qui
trouble tant M. Brillat-Savarin trouve son écho dans l’élégance qui semble bien
passionner à même mesure M. de Balzac. Néanmoins il serait faux de penser que la
gastronomie qui possède le sujet savarin n’est pas présente dans nos physiologies
balzaciennes. L’art de se nourrir est même omniprésent dans l’ensemble de notre
corpus.
108 Op. cit., Physiologie du goût, p. 149. 109 Ibid. p. 127. 110 Ibid. 111 Ibid. 112 Honoré de Balzac, Physiologie de la toilette, La Comédie Humaine, Compiègne, 2012, p. 73.
43
2.1.2. L’omniprésence de la gastronomie Quand il ne traite pas spécifiquement de gastronomie, M. de Balzac se
présente tout de même comme disciple de M. Brillat-Savarin. C’est ainsi qu’il
explique dans la Physiologie du mariage que « Flâner est une science, c’est la
gastronomie de l’œil »113. Ce à quoi il ajoute quelques pages plus loin en référence
directe au gastronome auteur de la Physiologie du goût : « Notre civilisation actuelle
a prouvé que le goût était une science, et qu’il n’appartenait qu’à certains êtres
privilégies de savoir boire et manger. Le plaisir, considéré comme un art, attend son
physiologiste. »114. Cette fonction de physiologiste du plaisir élévé au rang d’art, il va
lui même l’occuper lorsqu’il écrit dans sa Physiologie du cigare : Le cigare est une source de jouissances toutes personnelles et internes. Comme les
liqueurs, le tabac en poudre, l’opium, il ne procure d’agrément qu’à celui qui en use et éloigne les autres. (…) il suffit de fumer un cigare pendant quelques instants, d’en avaler quelques gorgées, et aussitôt, comme par enchantement, la tête se débrouille, l’esprit s’éclaircit, un émotion tumultueuse vient remplacer l’insouciance des sens et un pouvoir inconnu ranime toutes les facultés auparavant assoupies. C’est-à-dire que la fumée, qui produit le même effet que les vapeurs du vin, commence à opérer, et c’est le moment de cesser, sous peine de ressentir bientôt les inconvénients de l’ivresse.
Pour continuer à éprouver le bienfait de cette espèce de remède, il faut en user rarement, et toujours avec modération ; car, autrement, chaque nouvel essai lui faisant perdre un degré de son intensité, il finirait par dégénérer en habitude, et par ne plus produire les mêmes résultats115.
Cette influence savarine de ce que nous nommerons science gastronomique,
celle qui fait de M. de Balzac un chef d’orchestre tabacologique, est encore plus
flagrante dans l’édition pré-originale de sa Physiologie du mariage. En effet, on peut
y voir, comme dans la Physiologie du goût, des prescriptions médicales
gastronomiques. Ainsi, à l’exemple de M. Brillat-Savarin qui dans le cadre d’un
régime préservatif de l’obésité conseillait : Buvez, chaque été, trente bouteilles d’eau de Seltz, Un très grand verre le matin,
deux avant le déjeuner et autant en vous couchant. Ayez, à l’ordinaire, des vins blancs, légers et acidulés, comme ceux d’Anjou. Fuyez la bière comme la peste : demandez souvent radis, des artichauts à la poivrade, des asperges, du céleri, des cardons. Parmi les viandes, préférez le veau et la volaille ; du pain, ne mangez que la croûte ; dans les cas douteux, laissez-vous guider par un docteur qui adopte mes principes ; et quel que soit le
113 Op. cit., Physiologie du mariage, p. 930. 114 Ibid., p. 66. 115 Honoré de Balzac, Œuvres complètes. Édition définitive, tome XX, Œuvres diverses, Paris, Michel Lévy frères, 1870, p. 549.
44
moment où vous aurez commencé à les suivre, vous serez avant peu frais, jolis, lestes, bien portants et propres à tout116.
M. de Balzac, paraphrasant un ouvrage de Laurence Sterne117 paru en 1760,
cite une lettre de Gauthier de Sandy à son frère Tobie traitant de la manière de se
conduire avec les femmes : Avicenne est d’avis que l’on se frotte ensuite avec de l’extrait d'ellébore, après les
évacuations et purgations convenables, et je penserais assez comme lui. Mais surtout ne mange que peu, ou point de bouc ni de cerf ; et abstiens-toi soigneusement, c’est-à-dire, autant que tu le pourras, de paons, de grues, de foulques, de plongeons, et de poules d’eau.
Pour ta boisson, je n’ai pas besoin de te dire que ce doit être une infusion de verveine et d’herbe hanéa, de laquelle Elien rapporte des effets surprenants. Mais si ton estomac en souffrait, tu devrais en discontinuer l’usage, et vivre de concombres, de melons, de pourpier et de laitue.118
D’aucuns pourraient arguer qu’il ne s’agit là que d’une coïncidence
cependant, le choix spécifique de cette lettre avec cette prescription de régime
semble selon nous indiquer une référence précise à M. Brillat-Savarin. Le choix de
l’ouvrage cité relève aussi d’après nous d’un clin d’œil à M. Schopenhauer avec qui
M. de Balzac partageait l’admiration du livre de M. Sterne119/120 ainsi que : [L’]idée d’une substance universelle, homogène et continue [qui] était le
patrimoine de toute la philosophie empirique et théorique, et [dont] Huygen comme Newton ont besoin (…) pour combiner leurs postulats du monde physique en un système mécanique (…) La substance absolue que Balzac et Schopenhauer appellent Volonté, est la même que Maxwell et Thompson réhabilitent comme substrat final de l’existence (…) sorte d’Etre Absolu en une ontologie cosmique rigoureusement scientifique. On l’appelle éther premier jusqu’à ce qu’Einstein le déclare inutile et remplace ce concept par un autre, celui
116 Jean Anthelme Brillat-Savarin, Physiologie du goût, Jean-François Revel, Paris, Flammarion, « Champs », 1982, p. 230. 117 Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman in Works of Laurence Sterne in one volume with a life of the author written by himself, Philadelphie, Grigg & Elliot, 1834. 118 “Avicenna, after this, is for having the part anointed with the syrup of hellebore, using proper evacuations and purges—and I believe rightly. But thou must eat little or no goat's flesh, nor red deer—nor even foal's flesh by any means; and carefully abstain—that is, as much as thou canst, from peacocks, cranes, coots, didappers, and water-hens—As for thy drink—I need not tell thee, it must be the infusion of Vervain and the herb Hanea, of which Aelian relates such effects—but if thy stomach palls with it—discontinue it from time to time, taking cucumbers, melons, purslane, water-lillies, woodbine, and lettice, in the stead of them.”, Ibid, p. 250. 119 Peter Jan de Voogd, John Neubauer dans leur ouvrage The reception of Laurence Sterne in Europe, Londres, Continuum, 2004, p. 80, font d’ailleurs référence à cette admiration que l’on trouve p. 469 du Die Krone der Gattung de Shopenhauer : « For Schopenhauer, in equally laudatory vein in the Parerga und Paralipomena (1851), Tristam Shandy is to be grouped rather with Don Quixote, La nouvelle Héloïse and Wilhelm Meister as “crowning the novelistic form”. ». 120 C.f. Geneviève Delattre, Les opinions littéraires de Balzac, Paris, PUF, 1961, p. 169-173.
45
de champ qui lui est équivalent, mais avec un sens beaucoup plus neutre et dépourvu de ses propriétés antérieures121.
Enfin la présence de cette prescription dans l’édition pré-originale de la
Physiologie du mariage conforte notre hypothèse selon laquelle M. de Balzac avait
eu accès à l’ouvrage de M. Brillat-Savarin avant sa parution officielle grâce à ses
connaissances avec l’éditeur de ce dernier, M. Sautelet qu’il avait eu comme
condisciple au collège de Vendôme puis au collège Charlemagne en compagnie de
M. Michelet122.
Nos physiologies déploient une stylistique savoureuse qui semble déguster
chaque sensation. De plus lorsqu’elle est relative à l’art de se nourrir, l’expérience
semble nourrir le texte comme elle nourrit ceux qui l’écrivent. Mais la gastronomie
ne prend tout son sens que lorsque, tel le pâté, elle s’encroûte d’une aura mythique.
Celle de Paris, capitale du savoir où s’ébattent nos auteurs.
2.2. La vie parisienne et aristocratique
2.2.1. Paris : capitale du savoir Que ce soit M. Brillat-Savarin se présentant comme un « puissant professeur
étranger »123 dans sa Préface puis signalant qu’« on a fait à Paris, pour les enfants et
les oiseaux (…) des pâtisseries où le gluten domine, parce qu'une partie de la fécule a
été soustraite au moyen de l'eau »124, ou M. de Balzac dans Histoire et physiologie
des Boulevards de Paris comparant les boulevards parisiens au « Grand Canal à
Venise »125 et les changeant en « poëme [sic] où elle [la capitale] s’exprime, où elle
se résume, où elle est plus particulièrement elle-même »126, nos deux auteurs se
situent précisement à
121 Estrada Ezequiel Martinez, « Philosophie et Métaphysique de Balzac », in Hommage à Balzac, Paris, Mercure de France, 1950, p. 223-224. 122 Alan Spitzer, « A Generation as a Social Network » dans Histoire & Mesure, 1987 volume 2, no3-4, Varia, p. 19-39. 123 Ibid., p. XX. 124 Op. cit., Physiologie du goût, p. 46. 125 Op. cit., Histoire et physiologie des Boulevards de Paris, p. 39. 126 Ibid.
46
( …) Paris, capitale du savoir, où à pu naître à présent une nouvelle littérature de l’expérience du quotidien, à la fois située hors des institutions du savoir et pourtant tournée vers ces institutions127.
Cette capitale, c’est celle qui leur permet de soutenir le discours scientifique
qu’ils professent tout en en restant relativement détachés. En d’autres termes, grâce à
l’aura de leur environnement nos deux auteurs peuvent transformer des constatations
nées d’expériences ou d’observations personnelles en des considérations, explicites
ou implicites, sinon scientifiques du moins générales et théoriques. Les déductions
qu’opérent nos physiologistes naissent alors davantage de données empiriques que
d’un réel processus de science pure comme ils semblent le revendiquer. Ainsi M. de
Balzac constate dans sa Physiologie de l’adjoint que « la nature est incomplète » et
se justifie en affirmant : Une preuve évidente de cette imperfection première, c’est l’état toujours incomplet
de ses imitations. Exemple : l’adjoint, machine essentiellement complétive, placée à côté de l’objet créé, dont elle est la doublure sans en faire partie, qu’elle aide quand marche à sa suite, qu’elle comprend quand elle va devant.
Qui dit adjoint dans la vaste étendue du sens, et non dans la conception rétrécie du mot, comprend cette immense variété d’emplois diminués de leur importance par cette seule particule de sous, – de lieutenant, – d’aide – d’adjoint, qui précède ces mots catégoriques de chef, – général, – major, – maire128.
On perçoit bien ici la volonté aphoristique d’un propos chargé d’universalité.
Lorsqu’il parle de la « vaste étendue du sens »129 M. de Balzac se place comme un
scientifique définissant son champ d’étude. Cependant cette définition est réalisée de
façon artificielle et arbitraire130 dans le seul but d’accroître l’aura d’autorité que lui
donnent ses références ultérieures à la vie parisienne et aux événements historiques
relatifs à « la constitution définitive de l’Empire »131 ou au « drapeau blanc que le
duc d’Angoulême planta à Bordeaux »132. En effet, élargie à un vaste champ et
formulée a fortiori par un détenteur du savoir (car parisien) – peu importe que ce
savoir ne soit pas de même nature que celui qu’il justifie – une théorie n’en devient
127 Op. cit., La Capitale des signes : Paris et son discours, p. 196-197. 128 Honoré de Balzac, « Physiologie de l’Adjoint », La Caricature, 11 août 1831. 129 Ibid. 130 Son seul critère de séléction est en effet linguistique (le nôtre aussi mais nous ne nous prétendons pas physiologistes). 131 Op. cit., « Physiologie de l’Adjoint ». 132 Ibid.
47
que plus forte et l’idée qu’elle charrie ne s’en trouve que mieux assise. Mais cette
idée de justification du discours théorique sinon scientifique par l’environnement est
un ouroboros / uroborus (οὐροϐóρος) car chez M. de Balzac comme chez M.
Brillat-Savarin, « le discours théorique est entremêlé (…) d’histoires, d’exemples et
d’anecdotes qui sont derechef comme les germes de formes narratives traitant de la
ville »133.
Enfin, il nous paraît intéressant d’ajouter qu’en constatant l’imperfection de
la nature, Honoré de Balzac développe la même idée que M. Brillat-Savarin lequel
note : « c’est par le feu que l’homme à dompté la nature »134, « De droit divin,
l’homme est le roi de la nature, et tout ce que la terre produit a été créé pour lui »135.
Idée selon laquelle l’homme parfait la nature et lui est bien supérieur. Cette idée,
assez chrétienne par ailleurs, est à la source des physiologies : il s’agit de présenter
voire de démontrer les améliorations qu’apporte l’homme à l’ordre naturel. Or quoi
de mieux que Paris, sa modernité et sa diversité mythique pour faire la preuve de
l’apport bénéfique de l’homme sur son environnement ?
2.2.2. Le mythe de de la vie parisienne Ce Paris que nous présentent nos deux auteurs est le lieu d’expériences
déambulatoires. Ainsi M. Brillat-Savarin de se féliciter dans sa Préface du surprenant
état des rues parisiennes : « (…) les rues (chose rare), ne présentaient ni boue ni
poussière » 136 et M. de Balzac de traiter des « Omnibus137 à l’aide desquels la plupart
des Rentiers se transportent d’un point à un autre de l’atmosphère parisienne, au-delà
133 Ibid., p. 197. 134 Op. cit., Physiologie du goût, p. 254. 135 Ibid., p. 85. 136 Ibid., p. 124. 137 Rappelons pour mémoire que le premier omnibus, ce véhicule à traction hippomobile inspiré des diligences et assurant un service de transport public en circulant à des horaires déterminés sur des lignes fixe (distinct donc des fiacres apparentables à des taxis), est apparu à Nantes en 1826 grâce l’imagination d’Étienne Bureau et à la mise en place du service par Stanislas Baudry. Le service très vite payant est géré par l’entreprise de transport urbain baptisée « La Dame Blanche » qu s’inspire du succès de l’opéra-comique de Boëldieu. Herodote.net
48
de laquelle il ne vivent pas »138. Ce lieu expérience qui se confond avec le monde de
l’animation bourgeoise journalière suscite, grâce à l’intérêt soutenu et détaillé, que
lui portent nos auteurs une véritable galerie de la vie parisienne qu’explicitent peut-
être davantage les physiologies balzaciennes que la Physiologie du goût. Cette
galerie qu’elle soit claire ou sous-entendue dans les descriptions données semble
toujours au service d’un mythe chrétien tel que celui mis en lumière par Roland
Barthes :
Ce mythe fonctionne en deux temps : on affirme d’abord la différence des
morphologies humaines, on surenchérit sur l’exotisme, on manifeste les infinies variations de l’espèce, la diversité des peaux, des crânes et des usages, on babélise à plaisir l’image du monde. Puis, de ce pluralisme, on tire magiquement une unité : l’homme naît, travaille, rit et meurt partout de la même façon ; et s’il subsiste encore dans ces actes quelque particularité ethnique, on laisse du moins entendre qu’il y a au fond de chacun d’eux une « nature » identique, que leur diversité n’est que formelle et ne dément pas l’existence d’une matrice commune. Ceci revient évidemment à postuler une essence humaine, et voilà Dieu réintroduit dans notre Exposition : la diversité des hommes affiche sa puissance, sa richesse ; l’unité de leurs gestes démontre sa volonté139.
Ainsi, dans la Physiologie du goût, M. Brillat-Savarin effectue un catalogue
des « gourmands par état » 140 dans lequel il réduit les financiers, les médecins, les
gens de lettres, les dévots, les chevaliers et les abbés à des individus ayant « une
finesse d'organes, ou une tenue d'attention » 141, pourvus « des houpes nerveuses
destinées à inhaler et apprécier les saveurs » 142 et les oppose à ceux qui ne les
possèdent pas ou qui « ne mangent que pour se remplir » 143.
Comment ne pas voir alors l’amplification de cette idée que réalise M. de
Balzac dans sa Physiologie de l’employé. Amplification concernant la diversité du
catalogue salarial dont on s’aperçoit vite qu’il ne charrie qu’une unité bien illusoire.
En effet, la classe d’hommes que l’auteur décrit n’a rien d’autre en commun que sa
138 Honoré de Balzac, Arnould Frémy, Physiologie du rentier de Paris et de province, Paris, Martinon, 1841, p. 7. Il nous paraît utile de préciser que si les deux ouvrages ont été rassemblé, ils n’ont en aucun cas été écrit à quatre mains. Chaque ouvrage et le fruit propre du travail de son auteur. 139 Roland Barthes, « La grand famille des hommes », Mythologies, Paris, Seuil, « Essais », 1957. 140 Op. Cit., Physiologie du goût, p. 154. 141 Ibid, p. 150. 142 Ibid, p. 150. 143 Ibid, p. 150.
49
situation professionnelle : il s’agit d’employés. De ce substantif, l’écrivain donne la
large acception suivante : « un homme qui écrit, assis dans un bureau. »144.
La généreuse définition de ce terme par notre auteur implique par
conséquence que certains individus comme les animaux d’Orwell soient plus égaux
que d’autres. En effet, en signalant dans son deuxième axiome qu’« au-dessus de
vingt mille francs d’appointements, il n’y a plus d’employés »145 M. de Balzac sous-
entend une division hiérarchique inhérente à des différences salariales. Ainsi, M. de
Balzac de classer les employés de sa Physiologie selon trois types146 : « les météores
de la bureaucratie »147 ; « les rouages de la machine administrative »148 et « les
moteurs de la bureaucratie »149 et de conforter la théorie de Roland Barthes.
Paris permet à nos physiologies de se teinter d’un sérieux scientifique. Elle
est la ville de la modernité preuve de l’importance du savoir et de l’homme sur le
monde. Elle est la ville de la diversité et de l’animation. Elle permet l’observation
d’un panel représentatif et justifie l’établissement d’une classification simplifiante.
Mais Paris est aussi la ville de la mode, de l’élégance où s’exprime une pensée qui
s’habille, se pare et où tout et tout le monde se trouve jugé, hiérarchisé.
2.3. « L’esprit du chiffon150 »
2.3.1. L’ « expression de la pensée comme le style151 » Le concept de collection inhérent au système classificatoire opéré par nos
auteurs dans leurs physiologies est partagé par l’univers de la mode. Ce concept est
particulièrement flagrant dans la Physiologie de la toilette de M. de Balzac en cela
144 Honoré de Balzac, Physiologie de l’employé, Anne-Marie Baron, Mayenne, Le Castor Astral, p. 19. 145 Ibid., p. 20. 146 Que nous avons résumé en tableaux dans nos annexes p. 4-7. 147 Op. cit., Physiologie de l’employé, p. 51. 148 Ibid., p. 51. 149 Ibid., p. 85. 150 « Aussi n’est-ce pas tant le chiffon en lui-même que l’esprit du chiffon qu’il faut saisir. », Honoré de Balzac, Traité de la vie élégante, Dijon-Quetigny, Rivages poche, « Petite Bibliothèque », 2012, p. 99. 151 Balzac Honoré de, Physiologie de la toilette, Jean-Jacques Brochier, Mayenne, Le Castor Astral, 1992, p.70.
50
qu’il regroupe tant la taxinomie que l’élégance. Ainsi l’auteur classe-t-il les porteurs
de cravate – signe extérieur de distinction sociale dont il justifie l’utilisation et
l’importance en ces termes : Enfin les français devinrent tous égaux dans leurs droits, et aussi dans leur toilette,
et la différence dans l’étoffe ou la coupe des habits ne distingua plus les conditions. Comment alors se reconnaître au milieu de cette uniformité ? Par quel signe extérieur distinguer le rang de chaque individu ? Dès lors était réservée à la cravate une destinée nouvelle : de ce jour, elle est née à la vie publique, elle a acquis une importance sociale ; car elle fut appelée à rétablir les nuance entièrement effacées dans la toilette, elle devint le critérium auquel on reconnaîtrait l’homme comme il faut et l’homme sans éducation152.
– selon différents groupes composés par leurs rapports au bout de tissu sacralisé.
Ainsi selon le dandy aux gants jaunes : Considérés sous le rapport de la cravate, les hommes se divisent naturellement en
trois grandes catégories. D'abord, pour commencer par celle qui mérite le moins notre attention, se présente
cette classe nombreuse d'hommes qui portent la cravate sans la sentir, ni la comprendre, qui, chaque matin, tournent un morceau d'étoffe autour de leur cou, comme on fait d'une corde ; puis, tout le jour se promènent, mangent, vaquent à leurs affaires, et le soir, se couchent et s'endorment sans scrupule, sans remords, parfaitement satisfaits d'eux-mêmes, comme si leur cravate eût été mise le mieux du monde. (…)
Au-dessus d'eux, immédiatement, viennent ceux qui entrevoient ce qu'il y a de bien dans la cravate et ce qu'on peut en faire, mais qui, n'en pouvant tirer aucun parti par eux-mêmes, sont réduits à copier autrui. Esprits étroits, stériles, sans imagination, sans une seule idée à eux, ils étudient chaque jour le noeud qu'ils reproduiront le lendemain. (…)
Au premier rang, enfin, se placent ces hommes forts et solides par eux-mêmes, qui sentent et comprennent la cravate, qui la comprennent dans ce qu'elle a d'essentiel et d'intime, avec cette énergie d'intelligence, cette puissance de génie, départies à ces mortels privilégiés quos aequus amavit Jupiter. Ceux-là n'ont ni maîtres ni modèles, ils trouvent en eux de grandes, de nobles ressources ; ils n'écoutent qu'eux-mêmes, ils sont véritablement créateurs153.
Via une taxinomie arbitraire et personnelle se présentant comme vérité
scientifique, aphorique, M. de Balzac opère une hiérarchisation par le style des
hommes censés être libres et égaux en droit suite à la Révolution. Or, ce que l’auteur
sous-entend par cette hiérarchisation n’est pas tellement une classification
d’individus définis par leur manière de porter une cravate qu’une classification
d’individus définis par leur rapport à celle-ci et à l’élégance en général. La
classification de l’auteur concerne donc la classe sociale. Ce nous propose M. de
Balzac n’est rien d’autre que la réalisation d’un jugement aphoristiquement travesti
152 Op. cit., Physiologie de la toilette, p. 69. 153 Ibid., p. 71-72.
51
et uniquement fondé sur la manière de s’accessoiriser, sur l’apparence comme
illustration de l’esprit de l’accessoirisant et par là de son degré de respectabilité.
« Paraître c’est être » semble nous dire l’écrivain et celui qui paraît ne peut
décemment pas fréquenter celui qui paraît moins car le style, l’élégance, la recherche
vestimentaire est la marque du style, de l’élégance, de la recherche spirituelle.
Ce système que Roland Barthes signale comme étant « un ordre dont on fait
le désordre » 154 qui « multiplie les signifiés d’un même signifiant et les signifiants
d’un même signifié » 155 à la fois « imprévisible et systématique, régulier et inconnu,
aléatoire et structuré, [qui] conjoint fantastiquement l’intelligible sans lequel les
hommes ne pourraient vivre et l’imprévisibilité du mythe de la vie » 156 est d’autant
plus arbitraire qu’il varie suivant les saisons et les porteurs. Il est la marque purement
subjective qui se détache et forme l’essentiel autonome, le classificatoire
indépendantisé, de nos physiologies. Il est celui qui joint chez nos auteurs et leurs
lecteurs le désir de communauté et le désir d’isolement, ce que Jean Stoetzel nomme
« l’aventure sans risque » 157 . En d’autres termes, si M. de Balzac ou M. Brillat-
Savarin – qui déplore dans son ouvrage l’oubli de la gourmandise sociale qui réunit l'élégance athénienne, le luxe romain et la
délicatesse française, qui dispose avec sagacité, fait exécuter savamment, savoure avec énergie, et juge avec profondeur qualité précieuse, qui pourrait bien être une vertu, et qui est du moins bien certainement la source de nos plus pures jouissances.158
et pour qui le met varie selon la classe social de l’individu159 auquel il est proposé car
son goût, au même titre que sa toilette, est modelé sinon par la culture du moins par
ses moyens. – traitent de la pensée comme le style, et que cela implique l’inverse, ce
n’est pas seulement parce qu’ils le pensent mais aussi parce que la perte des trois
classes monarchiques a provoqué une perte de repères chez les individus. Perte que
la physiologie dans une moindre mesure et presque cyniquement permet de soulager
154 Roland Barthes, Système de la mode, Évreux, Point, 1983, p. 302. 155 Ibid. 156 Ibid. 157 Jean Stoetzel, Psychologie sociale, Paris, Flammarion, 1978, p. 247. 158 Op. cit., Physiologie du goût, p. 120. 159 Il suffit pour cela de se pencher sur les différents menus des dîners qu’il décrit et qui sont relatifs aux moyens l’hôte.
52
à défaut de la combler. Les réflexions de M. de Balzac portées sur l’élégance lui
permettent d’analyser les formes de vie de la société post-révolutionnaire comme M.
Brillat-Savarin le fît avant lui au travers du mets. Cette hiérarchisation opéré par des
auteurs issus des classes supérieures de la société est non seulement le symbole du
peu de considération qu’ils ont pour les classes inférieures mais aussi l’application à
l’humain du discours qu’ils font du goût.
2.3.2. Une « bathmologie » 160 L’entreprise taxinomique de nos auteurs lorsqu’ils traitent plus
particulièrement de la question du goût est soumise, pour permettre une meilleure
lisibilité, à un échelonnement des phénomènes que Roland Barthes néologise comme
la bathmologie et qu’il définit ainsi : « la bathmologie, ce serait le champ des
discours soumis à un jeu de degrés » 161. En d’autres termes, lorsqu’elle concerne le
champ de la dégustation ou plus généralement le traitement d’une sensation étapée,
progressive ou simplement décalée, la classification, le découpage narratif,
qu’opèrent nos auteurs conduit à une meilleure appréhension spatio-temporelle du
sujet ou de l’objet traité. Selon Roland Barthes, c’est dans la signification postérieure
qu’induit la bathmologie, « dans ce recul du sens que naît la littérature »162.
Le goût est plus particulièrement concerné par cette remarque car « il connaît
et pratique des appréhensions multiples et successives : des entrées, des retours, des
chevauchements, tout un contrepoint de la sensation »163. Ainsi lorsque M. Brillat-
Savarin déduit de son observation du docteur Corvisart le théorème selon lequel « Le
vin de Champagne qui est excitant dans ses premiers effets (ab initio), est stupéfiant
dans ceux qui suivent (in recessu) ; ce qui est au surplus un effet notoire du gaz
carbonique qu’il contient »164, il nous propose un échelonnement grossier mais qui
160 Brillat-Savarin, Physiologie du goût, première édition mise en ordre et annotée, Avec une lecture de Roland Barthes, Paris, Hermann, « Savoir : Lettres », 2002, p. 7. 161 Ibid. 162 Ibid. 163 Ibid. 164 Op. cit., Physiologie du goût, p. 139.
53
illustre bien cette temporalité. Lorsqu’il s’attarde sur la dégustation d’une pêche c’est
pour la peindre en trois étapes précises :
Celui qui mange une pêche, par exemple, est d'abord frappé agréablement par
l'odeur qui en émane il la met dans sa bouché, et éprouve une sensation de. fraîcheur et d'acidité qui l'engage à continuer; mais ce n'est qu'au moment où il avale et que la bouchée passe sous la fosse nasale que le parfum lui est révélé, ce qui complète la sensation que doit causer une pèche. Enfin ce n'est que lorsqu'il a avalé que, jugeant ce qu'il vient d'éprouver, il se dit à lui-même : « Voilà qui est délicieux ! »165.
Ces trois étapes, le gastronome les théorise comme autant de sensations qu’il nomme
directes, complètes et réfléchies et qu’il définit en ces termes : La sensation directe est ce premier aperçu qui nait du travail immédiat des organes
de la bouche, pendant que le corps appréciable se trouve encore sur la langue antérieure. La sensation complète est celle qui se compose de ce premier aperçu et de
l'impression qui nait quand l'aliment abandonne cette première position, passe dans l’arrière-bouche, et frappe tout l'organe par son goût et par son parfum.
Enfin la sensation réfléchie est le jugement que porte l'âme sur les impressions qui lui sont transmises par l'organe166.
Cette décomposition qui permet la mise en exergue du développement de la
description de M. Brillat-Savarin et qui entraîne une temporalisation induisant une
peinture langagière fidèle de la subtilité gustative n’est pas étrangère à M. de Balzac
lorsqu’il peint par exemple les effets du cigare : La tête se débrouille, l’esprit s’éclaircit, une émotion tumultueuse vient remplacer
l’insouciance des sens, et un pouvoir inconnu ranime toutes les facultés auparavant assoupies. C’est-à-dire que la fumée, qui produit le même effet que les vapeurs du vin, commence à opérer, et c’est le moment de cesser, sous peine de ressentir bientôt les inconvénients de l’ivresse.
Bien que la description balzacienne s’approche davantage, en simplicité, de la
description savarine des effets du vin de Champagne, elle provoque néanmoins ce
que Roland Barthes appelle la « soumission de la sensation gustative au temps »167.
Cette temporalisation permet à l’auteur qui l’utilise, et à plus forte raison au
physiologiste dont l’entreprise est intrinsèquement classificatoire, de décrire les
subtilités du goût comme s’il s’agissait de réminiscences nées d’expériences
165 Ibid., p. 16. 166 Ibid., p. 16. 167 Op. cit., lecture de Roland Barthes, p. 8.
54
personnelles. Ces réminiscences sont, de prime abord, subjectives mais l’auteur leur
confère, grâce à un ton didactique, une valeur et un aspect objectif.
56
3. La question historique chez M. de Balzac et M. Brillat-
Savarin : chronique, critique et philosophie
3.1. La chronique journalistique des événements
3.1.1. La réécriture dées codes du discours journalistique La prétendue mimèsis (μίμησις) des mœurs communes que nous avons mise
en lumière précédemment, et sur laquelle nos auteurs appuient leur autorité écrivante
est subordonnée à la réécriture des codes du discours journalistique de lisibilité168,
d’information et d’accroche. Nos auteurs usent de ces principes pour plusieurs
raisons : ils n’écrivent pas d’œuvres romanesques, leurs ouvrages se veulent
didactiques, scientifiques mais ne sont au final qu’une « philosophie du rien »169. Ils
sont donc, semblablement au journaliste, contraints de séduire, d’accrocher pour
informer. Cette réécriture est d’abord formelle via les structures fragmentantes
d’aphorismes et de Méditations qui permettent l’interruption de la lecture et donc le
confort intellectuel tout en s’apparentant à la clarté, à la précision et à la concision
journalistiques170 ; via les illustrations qui jalonnent l’œuvre (mais n’étant pas du fait
de l’auteur nous ne nous y attarderons pas) et enfin via le titre composé à la manière
d’un article : un titre court suivi (pour les physiologies du goût et du mariage) de ce
qui peut s’apparenter à un chapô (respectivement Méditations de Gastronomie
Transcendante ; ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux
Gastronomes parisiens, par un Professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires
et savantes et Méditations de philosophie éclectique, sur le bonheur et le malheur
conjugal, publiées par un jeune célibataire).
Remarquons aussi que le plan de construction de nos physiologies est plus
proche de ce que Christian Sauvage appelle « le plan en pyramide inversée »171 que
168 Réécriture à propos de laquelle Benoît Grevissedistingue lisibilité matérielle et lisibilité intellectuelle. Benoît Grevisse, Écritures journalistiques. Stratégies rédactionnelles, multimédia et journalisme narratif, De Bœck, « Info com, licence, master, doctorat », Bruxelles, 2008, p. 19. 169 Op. cit., Lecture de Roland Barthes, p. 7. 170 Maggy de Coster, Le Journalisme expliqué aux non-initiés, l’Harmattan, Paris, 2007, p. 17. 171 « Le plan n’est pas en deux ou trois parties, comme l’apprennent les professeurs de l’enseignement secondaire ou supérieur, mais en “pyramide inversée”, du plus important vers le moins important,
57
du plan littéraire ou scientifique en deux ou trois parties. Le gastronome débute en
effet son ouvrage par une méditation sur les sens pour le terminer par une poésie et le
dandy (dans sa Physiologie du mariage) commence par traiter des individus que
concerne son écrit pour finir sur un conte oriental. Mais ce remaniement du code de
presse est aussi lié fondamentalement au genre de la physiologie. Il s’apparente à une
réécriture journalistique d’un ton léger : on y trouve des anecdotes et de l’humour.
Cet humour est perceptible à travers ce qu’Alain Buisne nomme le « cruel travail de
typisation » 172 du petit-bourgeois. En effet, cette classe, dénommée ultérieurement
suite aux observations de M. de Balzac dans la Comédie Humaine, est à l’époque de
nos auteurs la cible privilégiée des attaques humoristiques des écrivains et des
journalistes. Satirique, acide, cet humour facile et facilitant la caricature parcourt nos
physiologies et sous-tend aussi la ligne éditoriale de certains journaux de l’époque.
Ce lien, Richard Sieburth l’explique en ces termes : La veine spécifiquement comique des physiologies est bien entendu liée à (…) la
vitalité de journaux satiriques comme La Silhouette, La Caricature et Le Charivari – effectivement, Charles Philipon, cerveau qui animait ces trois journaux et rédacteur influent à la Maison Aubert (…) s’empara d’un titre dont la viabilité commerciale avait déjà été prouvée par la Physiologie du goût de Brillat-Savarin (1826) et la Physiologie du mariage de Balzac (publié en 1830 mais conçue dès 1824-1825). Il semble que Balzac ait à l’origine pensé intituler son ouvrage Code marital ou l’Art de rendre sa femme fidèle – titre qui faisait allusion à une série de livres élaborée par son collègue journaliste Horace Raisson et connue comme Les Codes littéraires dont la popularité fut telle que Raisson publia une série de suites (…) Ces différents Codes et Art de offraient un ensemble à la fois descriptif et prescriptif, parodique et didactique. On trouve le même ton dans les physiologies, l’accent est mis de la même façon sur la codification des coutumes contemporaines en un système de formules et de conventions aussi rigoureux que celui qui régit toute langue ou tout système sémiotique (…) Comme beaucoup de livres à la substance humoristique de cette période, ces Codes étaient la création de ce milieu de journalistes et d’écrivains à gages nouvellement apparu et évoqué par Balzac dans Illusions perdues, et les physiologies des années 40 ont de semblables liens avec la presse et particulièrement avec les éditeurs, écrivains et artistes associés aux journaux satiriques illustrés. La Silhouette publia une Galerie physiologique dès 1830 et son successeur, La Caricature, offrait régulièrement des vignettes satiriques physiologiques (…)173.
On le voit, de la même façon que l’article journalistique est lié pour des
raisons éditoriales et financières au genre de la physiologie, la physiologie lui est liée
en cela qu’elle lui inspire Codes et Art de. Si l’on observe, principalement chez paragraphe après paragraphe [dans notre cas : Méditation après Méditation] ». Christian Sauvage d’après Maggy Coster, Ibid. 172 Op. cit., « Sociomimesis : physiologie du petit-bourgeois », p. 45. 173 Op. cit., Une idéologie du lisible : le phénomène des Physiologies, p. 40-41.
58
Honoré de Balzac, une réécriture des codes du discours journalistique c’est en
premier lieu parce ses physiologies des positions, de la toilette, gastronomique, de
l’adjoint et du cigare sont parues dans les journaux que cite Richard Sieburth et dont
M. de Balzac était un contributeur régulier174. Or pour écrire un article de journal il
est nécessaire de s’adapter et de viser un public, le plus large possible, ainsi qu’un
format : les physiologies balzaciennes sont alors raccourcies, voire fragmentées et les
peintures descriptives qu’elles font sont simplifiées, certainement afin de favoriser la
caricature.
Si la réécriture des codes journalistiques est davantage flagrante dans les
physiologies balzaciennes ultérieures à la Physiologie du mariage, leur emploi est
cependant inhérent au succès de celle-ci et au succès de la Physiologie du goût. En
effet, l’adaptation au format périodique du genre n’aurait pu avoir lieu sans la mode
que lancèrent ces deux physiologies à succès. Ajoutons que ce succès est en grande
partie due à la légèreté du ton qu’apporte l’anecdote.
3.1.2. L’anecdote et le flâneur : segmentation autonome d’un univers polysémique
Nous avons remarqué que l’espèce décrite dans la physiologie, qu’elle soit
rentière, employée ou gastronome est définie par sa juxtaposition à d’autres
spécimens d’un même type. Il est dès lors évident que les physiologies balzacienne
ou savarine tendent vers le catalogue expansé du sujet. Souvent, il est opéré à
l’intérieur même de ce catalogue composant notre physiologie une hiérarchisation
permettant une progression dans la lecture. Cette promenade textuelle est bien
souvent fragmentée, ne serait-ce qu’en apparence (la présence illustrative abondante
accroit d’ailleurs cet effet). Brillat-Savarin s’y exerce d’ailleurs avec brio lorsqu’il
digresse longuement sur l’obtention qu’il a fait d’un parfum : Il y a quelques années que les journaux nous annoncèrent la découverte d'un
nouveau parfum, celui de l'hémérocallis, plante bulbeuse qui a effectivement une odeur fort agréable, ressemblant assez à celle du jasmin.
174 Nombre de ses physiologies paraissent d’ailleurs dans des journaux satiriques.
59
Je suis fort curieux et passablement musard, et ces deux causes combinées me poussèrent jusqu'au faubourg Saint-Germain, où je devais trouver le parfum, charme des narines, comme disent les Turcs.
Là je reçus l'accueil dû à un amateur, et on tira pour moi du tabernacle d'une pharmacie très bien garnie une petite boîte bien enveloppée, et paraissant contenir deux onces de la précieuse cristallisation : politesse que je reconnus par le délaissement de trois francs, suivant les règles de compensation dont M. Azaïs agrandit chaque jour la sphère et les principes.
Un étourdi aurait sur-le-champ déployé, ouvert, flairé et dégusté. Un professeur agit différemment je pensai qu'en pareil cas le retirement était indiqué; je me rendis donc chez moi au pas officiel et bientôt calé dans mon sofa je me préparai à éprouver une sensation nouvelle.
Je tirai de ma poche la boite odorante, et la débarrassai des langes dans lesquels elle était encore enveloppée c'étaient trois imprimés différents, tous relatifs à l'hémérocallis, à son histoire naturelle, à sa culture, à sa fleur, et aux jouissances distinguées qu'on pouvait tirer de son parfum, soit qu'il fût concentré dans des pastilles, soit qu'il fût mélé à des préparations d'office, soit enfin qu'il parût sur nos tables dissous dans des liqueurs alcooliques ou mêlé à des crèmes glacées. Je lus attentivement les trois imprimés accessoires (…)
J'ouvris donc, avec due révérence, la boîte que je supposais pleine de pastilles. Mais, ô surprise! ô douleur ! j'y trouvai, en premier ordre, un second exemplaire des trois imprimés que je venais de dévorer, et, seulement comme accessoires, environ deux douzaines de ces trochisques dont la conquête m'avait fait faire le voyage du noble faubourg.
Avant tout, je dégustai; et je dois rendre hommage à la vérité en disant que je trouvai ces pastilles fort agréables ; mais je n'en regrettai que plus fort que, contre l'apparence extérieure, elles fussent en si petit nombre, et véritablement plus j'y pensais, plus je me croyais mystifié.
Je me levai donc avec l'intention de reporter la boîte à son auteur, dût-il en retenir le prix ; mais à ce mouvement, une glace me montra mes cheveux gris je me moquai de ma vivacité, et me rassis, rancune tenante: on voit qu'elle a duré longtemps.
(…) C'est encore une anecdote qu'il faut que mes lecteurs connaissent. Je suis
aujourd'hui (17 juin 1825) en train de conter. Dieu veuille que ce ne soit pas une calamité publique. 175
Davantage encore chez M. de Balzac que chez M. Brillat-Savarin, le discours
conceptuel scientifique (ou pseudo-scientifique) est emmêlé d’anecdotes digressives,
d’exemples, pour ne pas dire de divagations classificatoires lesquelles sont autant
d’embryons de formes narratives avortées. Honoré de Balzac en justifie l’usage
ainsi : Mais l’auteur n’a pas la sotte prétention d’avoir toujours réussi à faire des
plaisanteries de bon goût ; seulement il a compté sur la diversité des esprits, pour recevoir autant de blâme que d’approbation. La matière était si grave qu’il a constamment essayé de l’anecdoter, puisqu’aujourd’hui les anecdotes sont le passe-port de toute morale et l’anti-narcotique de tous les livres. Dans celui-ci, où tout est analyse et observation, la fatigue chez le lecteur et le Moi chez l’auteur étaient inévitables. C’est un des malheurs les plus grands qui puissent arriver à un ouvrage, et l’auteur ne se l’est pas dissimulé. Il a donc
175 Op. cit., Physiologie du goût, p. 43-44.
60
disposé les rudiments de cette longue étude de manière à ménager des haltes au lecteur. Ce système a été consacré par un écrivain qui faisait sur le goût un travail assez semblable à celui dont il s’occupait sur le mariage, et auquel il se permettra d’emprunter quelques paroles pour exprimer une pensée qui leur est commune. Ce sera une sorte d’hommage rendu à son devancier dont la mort a suivi de si près le succès.176
L’anecdote n’est alors qu’une preuve de la dislocation sémantique (du moins
visuellement), elle-même indiquant alors le choix fait par nos auteurs de privilégier
l’organisation élémentaire. Elle est l’indice, la trace que dans les œuvres de notre
étude les types sociaux sont retirés du développement de l’histoire, la description est
segmentée, autonomisée, détachée du récit dans lequel elle se trouve, et même plus
encore, qui lui donne naissance.
Afin d’introduire ces anecdotes dans le récit, de fragmenter ces descriptions,
nos deux auteurs tendent à introduire un personnage que nous définirons d’après
Walter Benjamin comme flâneur177. Comme le personnage de Chamfort chez Honoré
de Balzac178, ce flâneur est un collectionneur179. Il est l’expression incarnée de la
méthode physiologique : cet homme « produit peu, mais il amasse beaucoup »180 il
est d’ailleurs à l’âge « où tout se classe et s’ordonne dans le cerveau de l’homme »181
(pour ne pas dire l’âge où l’homme est pris de tendance taxinomique). En d’autres 176 Op. cit, Physiologie du mariage, p. 912. 177 Walter Benjamin en parle comme de celui qui découvre un monde opposé à la nature sauvage que découvrait le promeneur du XVIIIe siècle. Le flâneur s’épanouit dans la masse métropolitaine, « ce dernier voit la ville se scinder en deux pôles dialectiques. Elle s’ouvre à lui comme paysage et elle l’enferme comme chambre » pour le philosophe allemand, le flâneur est celui qui au travers de son regard physiognomonique et par extension phsyiologique réifie la ville au rang de champ d’observation soumis à son talent de « déchiffrer sur les visages la profession, l’origine et le caractère » en percevant les traces du caché, du privé, de l’intime. Les deux citations de ce paragraphe sont tirées de Walter Benjamin, Paris, Capitale du XIXe siècle – Le Livre des passages, Paris, éditions du Cerf, 1989, p. 435, 447. 178 Ce personnage qui recueille l’anecdote est tout à fait apparentable à celui que Walter Benjamin décrit comme l’héritier du promeneur du XVIIIe siècle. M. de Balzac l’introduit ainsi :
On dit à la duchesse de Chaulnes, dont l'état donnait de grandes inquiétudes : - M. le duc de Chaulnes voudrait vous revoir. - Est-il là?... - Oui. - Qu'il attende!... il entrera avec les sacrements.
Cette anecdote minotaurique a été recueillie par Chamfort, mais elle devait se trouver ici comme type.
Op. cit., Physiologie du mariage, p. 1177. 179 Terme dont on note une première occurrence dans la Correspondance de Balzac (p. 538) en 1828 et qui supplantera peu à peu le terme de « curieux » (c.f. Le Trésor de la langue française). 180 Auguste de Lacroix, « Le flâneur » dans Les Français peint par eux-mêmes, encyclopédie morale du XIXe siècle, t. III, Paris, Curmer, 1841, p. 68. 181 Ibid.
61
termes, le flâneur s’improvise spécialiste du tout, et donc du rien, à la manière de
MM. de Balzac et Brillat-Savarin qui, s’ils ont des prétentions de couturier,
gastronome ou médecin, n’apportent au final que des réflexions superficielles
lesquelles ne donnent rien d’autre au propos que l’apparence de l’érudition.
Le personnage du flâneur, ce porteur d’anecdotes qui construisent tant la
Physiologie du goût que les physiologies balzaciennes, n’est rien d’autre qu’un
signifiant parfaitement adapté à son signifié. Autrement dit, il est la métaphore de
l’observateur physiologiste voire plus généralement du littérateur182 : botanisant la
foule « tout est pour lui un texte d’observation »183.
Nos physiologies sont donc des textes qui, soumis aux contraintes
journalistiques, se fragmentent. Les Méditations sont rédigées pour être autonomes.
Tout doit divertir le lecteur : la forme comme le fond. C’est en cela que l’anecdote et
le flâneur, son rapporteur, prennent tout leur sens : elle est la pause intellectuel dans
le récit, elle charrie l’amusement. Grâce à cette interruption l’auteur ne lasse pas et
peut mieux critiquer la société de son époque.
3.2. La critique politique et législative contemporaine
3.2.1. La (dé)nomination ou son absence comme attaque ad
nominem « La nomination témoigne du travail scientifique de l’identification :
reconnaître, c’est faire œuvre de naturaliste » 184 écrit Alain Buisne dans son article
relatif à l’énumération. La nomination précise, qu’elle soit ou non un néologisme,
qu’opère nos auteurs dans leurs classifications relève donc encore de l’« effet de
science » qui permet à Buisne de se démarquer de l’« effet de réel » barthien. Ce
182 « La flânerie est le caractère distinctif du véritable homme de lettres Le talent n’existe, dans l’espèce que comme conséquence ; l’instinct de la flânerie est cause première. C’est le cas de dire avec une légère variante : littérateurs parce que flâneurs ». Ibid. 183 Auguste d’Aldeguier, « Le flâneur à Paris » dans Paris ou le Livre des Cent-et-Un, t. V, Francfort, Sigismond Schmerber, 1832, p. 101. 184 Op.cit. « Un cas limite de la description : L’énumération. L’exemple de Vingt mille lieues sous les mers », p.88.
62
n’est pas la nomination des substantifs qui nous intéresse dans cette partie mais
plutôt la nomination voire même la dénomination de la personne. Afin de distinguer
nomination de dénomination nous reprendrons la définition qu’en fait Paul Siblot,
par opposition à la théorie de MM. Blanche et Benveniste185 pour qui les deux termes
étaient synonymes, et que Benoît Louyest résume dans son article : Un certain nombre d’articles s’appuient sur l’analyse discursive que propose Paul
Siblot (professeur à Montpellier III)186. Ce dernier rappelle justement en introduction sa conception de la nomination comme désignation verbale. Pour résumer, Siblot part des éléments de la langue qui servent de passerelle (d’ « embrayage », dirait Jakobson) entre le langage et le réel, et qui font apparaître le rapport du locuteur à l’objet désigné : ce sont les « déictiques » (désignatifs). En disant par exemple ce livre-là (que je montre), je manifeste une relation sujet > objet. La deixis — ensemble des références au lieu et au moment de l’énonciation ainsi qu’aux interlocuteurs — englobe tout à la fois l’indication gestuelle et la désignation verbale.
La nomination (acte de nommer) relève d’une deixis verbale dans la mesure où elle consiste à désigner, à montrer un objet ; elle implique une mise en relation du locuteur au référent. Au contraire, les dictionnaires fournissent des termes lexicaux isolés, extraits des discours où ils étaient actualisés, et considérés désormais « dans l’artefact d’une autarcie métalinguistique » (P. Siblot, p. 34) : ces termes deviennent alors des dénominations en langue. Méthodologiquement, Siblot propose de revenir à la dynamique de la désignation verbale en envisageant la nomination dans son contexte de production. Ce principe vaut en particulier pour le nom, en raison des propriétés qui en font le prototype des catégories lexicales.
L’opposition linguistique entre nomination et dénomination repose donc sur la différenciation entre d’une part un acte verbal aboutissant à l’acte de nommer, et d’autre part un état figé et régulé des unités lexicales, séparées du lieu où elles sont produites187.
Nommer est donc un acte qui suppose une relation entre locuteur et référent
par opposition à dénommer qui le fige et le sépare de son lieu de production. Dans le
cas des personnes de nos physiologies, les auteurs oscillent entre dénomination et
nomination mais non sans raison. Lorsque le M. Brillat-Savarin nomme des docteurs
par leurs noms au début de sa Biographie c’est pour les honorer et à travers eux
rendre hommage au docteur Richerand qu’il a introduit dans le Dialogue qui précède
sous la dénomination théâtrale de L’AMI :
185 Claire Blanche et Emile Benveniste, « La dénomination dans le français parlé : une interprétation pour les répétitions et les hésitations », Recherches sur le français parlé n° 6, Aix-en-Provence, 1984, p. 123-157. 186 Paul Siblot, « Nomination et production de sens : le praxème », Langages n° 127, Paris, 1997 p. 38-55. 187 Benoît Louyest, « Une linguistique “réaliste” » – à propos du recueil L'acte de nommer. Une dynamique entre langue et discours, Georgeta Cislara, Olivia Guérin, Katia Morin, Emilie Née, Thierry Pagnier, Marie Veniard, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2007 – Acta Fabula, Novembre-Décembre 2007, URL : http://www.fabula.org/revue/document3590.php
63
En m’occupant de lui, j’ai remonté jusqu’à ceux qui l’ont précédé, et je me suis
aperçu avec orgueil que l’arrondissement de Belley, au département de l’Ain, ma patrie, était depuis longtemps en possession de donner à la capitale du monde des médecins de haute distinction ; et je n’ai pas résisté à la tentation de leur élever un modeste monument dans une courte notice188.
L’utilisation de la dénomination plutôt que du nom réel du docteur Richerand
par le gastronome dans son dialogue présenté sous forme théâtrale s’explique très
certainement par la péjoration qu’il y a à être simplement dénommé : le nom propre
détaché se désémantise et perd de son élégance. De plus, pour des raisons
stylistiques, le gastronome eut sans doute été forcé d’écrire Richerand sans le titre de
docteur ce qui nuisait à l’image du bon docteur comme à celle de l’auteur car à forte
connotation populaire.
Lorsqu’il use de ce procédé dans sa Physiologie des positions189, M. de
Balzac, lui, le subvertit : il nous présente un dialogue entre La Duchesse de
Valbreuil, La Comtesse et La Femme du banquier. Pour chacune d’entre-elles il
juxtapose le nombre d’amants. Or, l’observation est faite que moins la femme a
d’amants et moins elle est nominalement indépendante : avec ses trois amants, La
Duchesse de Valbreuil dispose d’un titre et d’un nom ; avec ses deux amants, La
Comtesse ne dispose plus que d’un titre tandis que La Femme du banquier, qui n’en
a qu’un, est dépossédée d’une personnalité propre pour n’être définit que par sa
fonction sociale de femme de…. On peut alors parler de désémantisation nominale
ou nominalisée.
Cependant, lorsqu’ils nomment un homme politique nos auteurs y adjoignent
davantage une critique qu’un hommage. La nomination précise de l’homme politique
ne s’oppose pas à notre déduction précédente en cela que le politicien est une figure
publique et qu’en le nommant pour le critiquer c’est moins sa personne que son
action qui est critiquée. Ainsi lorsque M. de Balzac fait référence à Louis XV dans sa
Physiologie du rentier c’est pour le critiquer par la bouche de ce dernier : « Louis xv,
un égoïste, homme d’esprit néanmoins, roi dissolu, vous connaissez son Parc-aux-
188 Op. cit. Physiologie du goût, p. XV. 189 Op. cit., Physiologie des positions, p. 543.
64
Cerfs ? »190. C’est en quelque sorte une dénomination objectivante qui est opérée : le
politique, réduit à son action, à ses réalisations, à sa politique est dépossédé de sa
personnalité véritable et ramené à sa caricature pour être moqué sinon attaqué. Mais
l’attaque n’est pas seulement personnelle, l’individu n’est pas l’unique victime du
discours dénonciateur de nos auteurs. Le sujet de société peut en faire parfois les
frais. Ainsi, le gastronome comme le dandy prennent-ils position sur la question de la
condition féminine.
3.2.2. Féminisme et misogynie
La juxtaposition de ces deux termes antinomiques dans notre intitulé peut
surprendre. Néanmoins ladite présentation se justifie par l’attitude trouble de nos
auteurs au sujet de la femme. Chez M. Brillat-Savarin la femme est un plaisir pour
les yeux, le corps adverse et opposé sur lequel on constate les voluptueux plaisirs
qu’apportent l’acte de se nourrir. Le gastronome écrit d’ailleurs dans une
constatation presque érotique que :
Rien n'est plus agréable à voir qu'une jolie gourmande sous les armes sa serviette
est avantageusement mise ; une de ses mains est posée sur la table ; l'autre voiture à sa bouche de petits morceaux élégamment coupés, ou l'aile de perdrix qu'il faut mordre ; ses yeux sont brillants, ses lèvres vernissées, sa conversation agréable, tous ses mouvements gracieux elle ne manque pas de ce grain de coquetterie que les femmes mettent à tout. Avec tant d'avantages, elle est irrésistible et Caton-le-Censeur lui-même se laisserait émouvoir.191
Epiée, la femme est victime d’une sorte de rapt érotique lorsqu’elle est
surprise à manger. Celle dont « la beauté consiste surtout dans la rondeur des formes
et la courbure gracieuse des lignes »192 est détentrice, chez M. Brillat-Savarin, d’une
sensualité, que Roland Barthes appelle la « luisance » et qu’il définit ainsi. la physionomie s'épanouit, le coloris s'élève, les yeux brillent, cependant que le
cerveau se rafraîchit et qu'une douce chaleur pénètre tout le corps. La luisance est évidemment un attribut érotique : elle renvoie à l'état d'une matière à la fois incendiée et mouillée, le désir donnant au corps son éclair, l'extase sa radiance (le mot est de B.S) et le plaisir sa lubrification. Le corps du gourmand est ainsi vu comme une peinture doucement radieuse, illuminée de l'intérieur. Ce sublime comporte cependant un grain subtil de trivialité; on perçoit très bien ce supplément inattendu dans le tableau de la belle
190 Op. cit., Physiologie du rentier, p. 30. 191 Op. cit., Physiologie du goût, p. 126. 192 Ibid., p. 234.
65
gourmande ("Une jolie gourmande sous les armes" dit B.S) : elle a les yeux brillants, les lèvres vernissées, et elle mord dans l'aile de perdrix; sous l'hédonisme aimable, qui est le genre obligé des descriptions de convivialité, il faut lire alors dans la luisance un autre indice : celui de l'agression carnassière, dont la femme , paradoxalement , est ici porteuse; la femme ne dévore pas la nourriture, elle mord, et cette morsure irradie; peut être dans cet éclair assez brutal, faut-il percevoir une pensée anthropologique: par à coups le désir revient à son origine et se renverse en besoin, la gourmandise en appétit (...). L'étrange est que dans le tableau excessivement civilisé que B.S. donne continûment des usages gastronomiques, la note stridente de la Nature - de notre fonds naturel - est donnée par la femme. (…) Mythologiquement la nourriture est affaire d'hommes; la femme n'y prend part qu'à titre de cuisinière ou de servante; elle est celle qui prépare ou sert, mais ne mange pas. D'une note légère B.S subvertit deux tabous: celui d'une femme pure de toute activité digestive, et celui d'une gastronomie qui serait de pure réplétion : il met la nourriture dans la Femme, et dans la Femme l'appétit (les appétits).
En d’autres termes, ce qui peut sembler à une objectivation misogyne de la
femme à son corps mangeant au premier abord relève en réalité d’un féminisme
sauvage. La femme est détentrice de sexualité mais cela en fait moins sa faiblesse
que sa force : c’est elle qui consomme, elle qui choisit quand se livrer au plaisir. La
femme savarine ne subit pas l’homme mais lui rappelle au contraire que sans elle il
n’est rien.
M. de Balzac quant à lui interdit, juste après sa Dédicace, l’accès à sa
Physiologie du mariage aux femmes :
La femme qui, sur le titre de ce livre, serait tentée de l'ouvrir, peut s'en dispenser, elle l'a déjà lu sans le savoir. Un homme, quelque malicieux qu'il puisse être, ne dira jamais des femmes autant de bien ni autant de mal qu'elles en pensent elles-mêmes. Si, malgré cet avis, une femme persistait à lire l'ouvrage, la délicatesse devra lui imposer la loi de ne pas médire de l'auteur, du moment où, se privant des approbations qui flattent le plus les artistes, il a en quelque sorte gravé sur le frontispice de son livre la prudente inscription mise sur la porte de quelques établissements : Les dames n'entrent pas ici.193
Néanmoins, loin d’être aussi sexiste qu’il y paraît, cet avertissement s’adresse
aux femmes qui voudraient se fier au titre de l’ouvrage sans en connaître le résumé et
non à la femme avertie : celle que Balzac estime et qu’il définit comme « la
créature investie du sacerdoce de la pensée par une éducation privilégiée, et chez qui
l’oisiveté a développé la puissance de l’imagination »194. De plus, l’Avertissement
n’est pas destiné à protéger une femme par trop fragile des idées grossières de
l’auteur mais à protéger l’auteur des médisances féminines. On le voit, même s’il ne
193 Op. cit., Physiologie du mariage, Avertissement. 194 Ibid. p. 924.
66
s’agit pas d’un féminisme d’avant-garde, la misogynie balzacienne est davantage
destinée à moquer le misogyne qu’à moquer la femme.
Une lecture approfondie de ladite physiologie tendra d’ailleurs à prouver, et
ce même au plus récalcitrant des lecteurs, que si Balzac prend la voix du misogyne
ainsi qu’il l’indique dans ses deuxième et troisième parties qu’il intitule des MOYENS
DE DEFENSE A L’INTERIEUR ET A L’EXTERIEUR et DE LA GUERRE CIVILE c’est pour
mieux moquer la solidarité générique – qui plus est en des termes martiaux sous
entendant la figure du vieux militaire aux cornes immenses – qu’imposeraient les
convenances. Arlette Michel dans son Introduction à Physiologie du mariage pour
l’édition de la « Bibliothèque de La Pléiade » note d’ailleurs que : L’œuvre propose les bases d’une thérapeutique : le mariage peut subir des
« perfectionnement qui sauveront les femmes d’une union souvent désastreuse. Le féminisme balzacien s’emploie ici avec générosité. Mais pour réformer le mariage il faut que les maris et les femmes soient amendables, s’il ne le sont pas reste à composer pour les médiocres (deuxième et troisième partie) – le livre du mépris et de la dérision à décrire la guerre des sexes : c’est le versant misogyne de l’ouvrage. – le mariage semble pouvoir susciter des vues contradictoires195.
En conclusion, elle ajoute :
La sociologie que nous venons d’examiner, postule des valeurs, et puisqu’il s’agit
de mariage, un féminisme. Balzac affirme en effet qu’une société vaut ce que valent les mœurs des femmes. Or les mœurs se sont régis par le plaisir des hommes. Balzac dénonce une société où la femme n’est que l’objet du désir. Le féminisme balzacien est d’abord critique. Balzac fait dans une physiologie d’apparence satirique pour les femmes une reconnaissance implicite de la médiocrité masculine. L’esprit positif est d’abord critique pour se montrer plus efficacement constructif. Une éducation libre de la jeune fille selon Balzac, l’armerait contre « l’amour du premier venu » (page 973). (…) Notre auteur n’est ni un homme de gauche, ni un immobile conservateur : il croit qu’une médiation est à chercher entre le pragmatisme bourgeois et l’esprit aristocratique, son sens des fidélités, son exigence d’absolu, son féminisme fonde l’ordre social sur la confiance placé dans la femme. 196
Balzac traite des manières pour l’époux de se garder de l’amant, il dépeint les
techniques, les moyens de défenses anti-minautorisation mais semble oublier de dire
que lui même n’est pas marié et que, dandysme balzacien oblige, courtiser la femme
mariée ou non n’est sinon un devoir du moins un droit.
195 Ibid., Introduction d’Arlette Michelle, p. 879. 196 Ibid.
67
Nos deux auteurs perçoivent les bouleversements sociaux et politiques
profonds qui traversent leur époque. Modernistes, ils choisissent d’embrasser
l’égalitarisme générique en puissance et de critiquer les actes politiques
réactionnaires se faisant par-là historiens engagés du début du XIXe siècle. Mais cette
attrait pour le discours historique n’est pas seulement le symbole d’un choix
militant : il est un moyen de se poser en scientifique.
3.3. La volonté d’un discours d’historien
3.3.1. La mode des restaurateurs On observe chez MM. Brillat-Savarin et Balzac la peinture d’un lieu
fréquenté à l’époque : le restaurant. Cette description qui forme la Méditation XXVIII
se compose chez le gastronome d’une définition simple et austère ; d’un historique
que l’auteur nomme « établissement »197 et dans lequel il explique que le restaurateur
est simplement celui qui, en « homme de tête »198, jugea qu’une cause active ne pouvait reste sans effet ; que le même besoin se
reproduisant chaque jour vers les mêmes heures, les consommateurs viendraient en foule là où ils seraient certains que ce besoin serait agréablement satisfait (…) ; qu’on ne regarderait pas à une légère augmentation de paiement quand on aurait été bien promptement et proprement servi.199
Cet historique est plus proche de la déduction logique que du véritable
discours d’historien. L’auteur évacue les données précises pour énumérer les
avantages du restaurant puis s’attarde sur l’« Examen du salon »200 . Cet Examen
consiste davantage en un tableau subjectif de la clientèle du restaurant qu’en une
description objective de l’agencement mobilier ou décoratif du lieu. Dans cette partie
M. Brillat-Savarin nous propose un tableau de situations dans lequel il aligne
arbitrairement les caricatures. Cette peinture, qui n’apporte rien à la Méditation et se
trouve située entre l’écriture des « Avantages » et celle des « Inconvénients », relève
moins de la digression anecdotique que de l’« effet de réel » théorisé par Roland
197 Op. cit. Physiologie du goût, p. 285. 198 Ibid. 199 Ibid. 200 Ibid, p. 287.
68
Barthes. En d’autres termes, il faut voir dans le tableau précis des clients d’un
restaurateur le désir savarin d’une analyse qui se veut exhaustive (et de quelle valeur pourrait bien être une méthode
qui ne rendrait pas compte de l’intégralité de son objet c’est-à-dire, en l’occurrence, de toute la surface du tissu narratif ?), en cherchant à atteindre pour leur assigner une place dans la structure, le détail absolu.201
En d’autres termes, l’auteur de la Physiologie du goût nous décrit les clients
du restaurant dans le seul but de nous offrir l’analyse la plus pure possible. Il nous
prouve ainsi tant la qualité de sa méthode que celle de son texte. À la suite de cette
description de la clientèle se placent les « Inconvénients ». Puis, dans une partie qu’il
nomme « Émulation », l’auteur justifie son propos en marquant les apports utiles du
restaurant à la gastronomie et donc à la science qu’il professe : « Nous avons dit que
l’établissement des restaurateurs avait été d’une grande importance pour
l’établissement de la science »202. Le gourmet semble le rappeler ici, nous sommes
avant tout dans un ouvrage qui se prétend scientifique et quelque soit le passage de
cet ouvrage, il ne peut servir que ce but.
Enfin, M. Brillat-Savarin de s’attarder sur le cas particulier en indiquant une
sélection de « restaurateurs à prix fixe »203 et remarquables à travers l’Histoire
contemporaine. Il s’attarde sur l’un des premiers, sinon le premier, Beauvillier, et
achève sa Méditation sur ce que nous pourrions associer à une mise en pratique
puisqu’elle concerne la question du « gastronome chez le restaurateur »204. Or il y a
là toute raison de croire que le gastronome expérimentant les délices de l’abondance
variée d’un restaurant n’est autre que notre auteur lui-même. Cet ultime composé de
la Méditation XXVIII nous indique la volonté qu’ont nos auteurs de s’inscrire dans
leur temps et dans l’Histoire. En effet, si M. Brillat-Savarin s’attarde tant sur la
restauration c’est parce qu’elle est très à la mode à son époque : artistes, gourmets et
mondains s’y pressent. Cependant, ne s’inscrire que dans la tendance actuelle ne
semble pas suffisant au gastronome qui choisit de s’inscrire aussi, en scientifique,
dans l’Histoire de celle-ci afin d’en prouver la valeur et le sérieux. En déjeunant au 201 Roland Barthes, « l’effet de réel », Communications, vol. 11, no 11, 1968, p. 85. 202 Op. cit., Physiologie du goût, p. 290. 203 Ibid., p. 290-291. 204 Ibid., p. 293.
69
restaurant, M. Brillat-Savarin fait peut-être acte de gourmet mais il fait surtout acte
de physiologiste.
Honoré de Balzac quant à lui a pour satisfaire son appétit gargantuesque malgré ses éternels soucis financiers,
(…) recours à un stratagème astucieux : il cite le café, le restaurant dans ses ouvrages. C’est ainsi qu’il fait souper au Rocher de Cancale, restaurant qu’il affectionne, beaucoup de ses héros : il y conduit Lucien de Rubempré, Rastignac, Mme de Maufrigneuse… En contrepartie, le patron du lieu y invite gracieusement le créateur de La Comédie humaine.205
Cette technique originale semble aussi présente dans les physiologies du
dandy aux gants jaunes. Ainsi en sus de certaines références relatives à la
fréquentation des restaurants dans son Histoire et Physiologie des boulevards de
Paris : « Le Boulevard a faim vers midi, on y déjeune, les boursiers arrivent »206 ; on
peut y lire des références explicites à des établissements : Là fut Frascati, dont le nom fut religieusement conservé par un café, rival de celui
dit du Cardinal, qui lui fait face. (…) Sur la garantie d’un bail de dix-neuf ans qui oblige à un loyer de cinquante mille, un tailleur construit cette espèce de phalanstère colyséen, et il y gagnera, dit-on ; un million ; tandis que dix ans auparavant, la maison du café Cardinal, dont le rez-de-chaussée rapporte aujourd’hui quarante mille francs, fut vendue pour la somme de deux cent mille francs !... Buisson et Janisset, le café Cardinal et la Petite Jeannette (combien de déjeuner, d’affaires, de bijoux, de fortunes, en peu de mots !) forment la tête de la rue Richelieu.207
Au premier abord, l’impression est donnée que Balzac ne cherche pas à faire
de ses physiologies un acte pérenne. Pour lui, il semble seulement falloir s’inscrire
dans le présent car le genre physiologique ne vieillit pas : il meurt avec le périodique
dans lequel il paraît et propose les peintures d’une société à un instant T. Cependant
inscrire cette peinture dans un fond historique ou dans une géographie précise relève
moins d’un discours journalistique que d’un discours historien. Elle donne en effet
un caractère durable à un écrit dont l’éphémérité est consécutive du genre. Face à
une peinture, la plus objective possible, dénuée de jugement de valeur, le lecteur ne
peut que se demander s’il n’y a pas alors la volonté d’une transmission. Conscient de
la futilité de leurs écrits ou du moins de leur caractères actuels, nos deux auteurs font
discours d’historiens et s’assurent ainsi une relative éternité. Néanmoins cette
205 Gérard Letailleur, Histoire insolite des cafés parisiens, Paris, Perrin, 2011, p. 73. 206 Op. cit., Histoire et physiologie des Boulevards de Paris, p. 43. 207 Ibid., p. 44
70
Histoire est toujours soumise au sujet de la physiologie. En d’autres termes, nos
auteurs ne réalisent qu’un panorama historique subjectivé.
3.3.2. Un panorama historique subjectivé
Chez nos deux auteurs l’idée est donc d’user d’Histoire pour justifier du
sérieux de leurs physiologies et ainsi se garantir une certaine pérennité. Mais, M.
Brillat-Savarin comme M. de Balzac se servent aussi de cette science humaine
comme d’un supplément à la science naturelle que développent les ouvrages de notre
corpus. Le gastronome propose alors une « histoire philosophique de la cuisine » en
guise de Méditation XXVII et peint un panorama géographique et historique de la
cuisine. Autrement dit, le gourmet nous entraîne dans un voyage spatio-temporel
subjectivé à son sujet où il démontre empiriquement que la cuisine Est le plus ancien des arts ; car Adam naquit à jeun, et le nouveau-né, à peine entré
dans ce monde, pousse des cris qui ne se calment que sur le sein de sa nourrice. [que] C’est aussi de tous les arts celui qui nous a rendu le service le plus important
pour la vie civile ; car ce sont les besoins de la cusine qui nous ont appris à appliquer le feu, et c’est par le feu que l’homme à dompté la nature.208
M. Brillat-Savarin justifie de l’importance du sujet qu’il traite en le présentant
tant comme l’écho que comme le moteur de toute civilisation humaine. Puis, il
poursuit en soutenant qu’un grand degré d’art culinaire, que le raffinement de celui-
ci sous-tend un grand degré civilisationnel, une société savante, de progrès. Il circule
ainsi dans les grandes civilisations qui ont fait l’Histoire et fait de la cuisine tant le
symbole de l’éducation, qu’un art et qu’une science susceptibles d’inspirer les
savants : Les savants s'empressèrent à l'envi d'écrire sur un art qui procurait de si douces
jouissances. Platon, Athénée et plusieurs autres nous ont conservé leurs noms. Mais hélas leurs ouvrages sont perdus et s'il faut surtout en regretter quelqu'un, ce doit être la Gastronomie d'Achestrade, qui fut l'ami d'un des fils de Périctès.
« Ce grand écrivain, dit Théotime, avait parcouru les terres et les mers pour connaître par lui-même ce qu'elles produisent de meilleur. Il s'instruisait dans ses voyages, non des mœurs des peuples, puisqu'il est impossible de les changer; mais il entrait dans les laboratoires où se préparent les délices de la table, et il n'eut de commerce qu'avec les hommes utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor de science, et ne contient un vers qui ne soit un précepte. »209
208 Op. cit., Physiologie du goût, p. 254. 209 Ibid., p. 263.
71
L’auteur se place alors dans le sillage de ces auteurs antiques puisque lui-
même écrit sur la cuisine. Il est un voyageur et un connaisseur que la cuisine mène.
Comme Achestrade il vise sciences et préceptes. Il est un héritier du savoir des
premiers temps. Il est, au même-titre que ceux qui l’ont précédé, en dissertant sur la
gastronomie, le professeur de ses successeurs. M. Brillat-Savarin se place comme le
voyant, l’homme capable d’appréhender un thème de manière universelle et
atemporelle. Le gastronome se fait autorité, démiurge du goût, omnipotent culinaire :
personne ne semble pouvoir le contredire sur le sujet qu’il traite puisqu’il
l’appréhende dans son ensemble, il est l’autorité professante, le détenteur de vérité.
M. de Balzac, dans une moindre mesure, fait preuve d’une volonté similaire
en intitulant un chapitre de sa Physiologie de l’employé « Histoire philosophique et
transcendante des employés »210. Mais la volonté d’un discours historiquement
englobant est moins flagrante que dans l’Epilogue qui sert de Méditation IX à la
Physiologie du Mariage. Dans cette Méditation l’auteur justifie son mouvement
comme permettant de compléter la constatation faite précédemment et selon laquelle
tout mariage aboutit à une crise en cherchant « à établir par une courte péroraison les
causes politiques de cette infirmité sociale »211. Honoré de Balzac part de l’idée que Le système de lois et de mœurs qui régit aujourd'hui les femmes et le mariage en
France est le fruit d'anciennes croyances et de traditions qui ne sont plus en rapport avec les principes éternels de raison et de justice développés par la grande révolution de 1789.
Trois grandes commotions ont agité la France : la conquête des Romains, le christianisme et l'invasion des Francs. Chaque événement a laissé de profondes empreintes sur le sol, dans les lois, dans les mœurs et dans l'esprit de la Nation.212
La question chez l’auteur de la Physiologie du Mariage est moins de se faire
démiurge de son sujet que de proposer une démonstration de cause à conséquence. Il
s’agit alors de se présenter comme scientifique total car mobilisant le langage
historique pour apporter une exhaustivité et une clarté maximale à son thème.
M. de Balzac comme M. Brillat-Savarin ont compris que chacun des sujets
qu’ils traitent respectivement : le mariage et la nourriture sont apparentables à ce que
210 Op. cit., Physiologie de l’employé, p. 29. 211 Op. cit., Physiologie du mariage, p. 999. 212 Ibid., p. 1000-1001.
72
la rhétorique antique nomme un topos (τόπος). Aux auteurs de s’en servir alors pour
convoquer toutes les sciences, qu’elles soient sociales ou naturelles. L’ouvrage du
gastronome comme celui du dandy « tend à l’encyclopédie, même s’il ne fait qu’en
esquisser le geste »213.
213 Op. cit., Lecture de Brillat-Savarin, p. 32.
74
4. Physiologie et anthropologie chez Balzac et Brillat-Savarin :
sociologie et peinture des mœurs d’un temps
4.1. L’étude sociale et anthropologique
4.1.1. Le voyage comme étude des peuples, des villes et des mœurs Qu’elle se fasse dans les propos hors texte – comme avec l’épigraphe de la
Physiologie du mariage extraite du Supplément au Voyage de Bougainville214 ou in
texto lorsque M. de Balzac peint son étonnement de voir à Mexico que les danseurs fumaient changeant alternativement leur cigare de main avec autant
de grâce et d’agilité, pour enlacer la taille de leurs danseuses, et [que] celles-ci, emportées par l’ardeur de la danse, enivrées par l’odeur du tabac et le bruit des instruments, s’abandonnaient avec complaisance et semblaient savourer avec volupté les épaisses bouffées que lançaient leur cavaliers215.
– l’observation reste la même : le voyage est omniprésent dans les
physiologies balzaciennes comme dans celle de M. Brillat-Savarin qui a entre autre
« voyagé en Hollande avec un riche commerçant de Dantzick qui tenait, depuis
cinquante ans, la première maison de détail en eaux-de-vie »216.
Le voyage tel qu’il est présenté par nos auteurs est moins un cheminement
vers l’Ailleurs, à la découverte de civilisations nouvelles, qu’une recherche de l’Ici
dans un autre pays. Ils font des mondanités en pays étranger comme ils en font à
Paris. De plus, les coutumes du pays en question tel que l’Angleterre ou l’Amérique
se distinguent peu des coutumes françaises. Cependant le voyage en tant que
déplacement physique ne semble pas nécessaire pour traiter d’un pays. Nous doutons
en effet que le gastronome possède la pratique de ce qu’il théorise lorsque sur un ton
professoral il explique :
214 Épigraphe de la Méditation I : « Nous parlerons contre les lois insensées jusqu'à ce qu'on les réforme, et en attendant nous nous y soumettrons aveuglément ». Op. cit., Physiologie du mariage, p. 915. 215 Op. cit., Physiologie du cigare, p. 550. 216 Op. cit., Physiologie du goût, p. 380.
75
Le cacaoyer est indigène de l'Amérique méridionale on le trouve également dans les îles et sur le continent mais on convient maintenant que les arbres qui donnent le meilleur fruit sont ceux qui croissent sur les bords du Maracaibo, dans les vallées de Caracas et dans la riche province de Sokomusco. L'amande y est plus grosse, le sucre moins acerbe et l'arôme plus exalté. Depuis que ces pays sont devenus plus accessibles, la comparaison a pu se faire tous les jours, et les palais exercés ne s'y trompent plus. Les dames espagnoles du nouveau monde aiment le chocolat jusqu'à la fureur, au point que, non contentes d'en prendre plusieurs fois par jour, elles s'en font quelquefois apporter à l'église217.
Un ton livresque pour un savoir qui l’est tout autant. M. Brillat-Savarin n’a
certainement pas l’expérience de ce qu’il décrit mais qu’importe, sa connaissance
semble exhaustive et son ethnologie n’avoir aucune frontière. Peu importe l’endroit
« la prise de nourriture est en tous lieux et en tous temps un acte social. On mange à
plusieurs, telle est la loi universelle » 218 et le voyage se fait alors symbole
d’universalité. Pour Brillat-Savarin, la collectivié gastronomique est essentiellement mondaine, et
la figure rituelle en est la conversation. La table est en quelque sorte le lieu géométrique de tous les sujets d’entretien ; c’est comme si le plaisir alimentaire les vivifiait, les faisait renaître ; la célébration d’un aliment est laïcisée sous la forme d’un mode nouveau de réunion (et de participation) : le conviviat219.
Pour M. de Balzac l’idée est identique même s’il précise que si l’universalité
réside dans le conviviat alors peu importe le pays tant que la mondanité est présente.
Selon lui, la civilisation s’établira quelque soit le lieu tant qu’elle est associée à l’art
gastronomique : Un morceau de pain bis et une cruchée d’eau font raison de la faim de tous les
hommes ; mais notre civilisation a créé la gastronomie. (…) Eh ! bien, n’y a-t-il pas de quoi faire frémir tous les maris s’ils viennent à penser
que l’homme est tellement possédé du besoin inné de changer ses mets, qu’en quelque pays sauvage où les voyageurs aient abordé, ils ont trouvé des boissons spiritueuses et des ragoûts ?220
L’auteur nous explique qu’il est inhérent à la psychologie individus lorsqu’ils
sont en communauté – l’auteur parle en effet de « voyageurs » au pluriel – de
rechercher dans la complexion artificielle du mets la trace de la civilisation. En
d’autres termes, et cela vaut pour nos deux auteurs, c’est moins le pays dans lequel
217 Op. cit., Physiologie du goût, p. 90. 218 Op. cit., Lecture de Roland Barthes, p. 29 219 Ibid. 220 Op. cit., Physiologie du mariage, p. 941.
76
on se trouve (qu’il soit ou non sauvage) que la civilisation qu’on lui apporte, par la
présence d’une communauté d’hommes civilisée et réunie en un conviviat autour
d’une célébration gastronomique, d’une consommation participative artificialisée,
qui compte. Le voyage, souvent livresque mais livré comme réel, est moins symbole
d’un Ailleurs que d’un Ici universalisé par la gastronomie. C’est cet art qui permettra
aux hommes d’atteindre la civilisation où qu’ils soient. Il paraît alors logique que si
la gastronomie est de tout les pays elle emprunte à toutes les langues. C’est pour cela
que nos auteurs usent de la langue étrangère pour nuancer leur pensée.
4.1.2. L’usage de la langue étrangère comme nuance de la pensée Si la latinisation d’expressions permet de « donner au texte la marque de la
scientificité bien plus que lui conférer une véritable valeur scientifique. [Si] Nommer
en latin, c’est “faire scientifique” comme l’on dit “faire vrai” »221 alors l’utilisation
abondante de mots anglo-saxons ou plus généralement de langues étrangères par nos
auteurs reviendra à « faire exploration »222. Aussi n’est-il pas surprenant de trouver
des termes comme « le verbe anglais to sip »223 ou encore des expressions comme
« horse laugh »224 chez M. Brillat-Savarin – qui a résidé en Angleterre et en
Amérique du Nord 225 et connaît « plus ou moins, cinq langues vivantes »226 –
lorsqu’il traite de discussion avec des anglo-saxons ou de termes intraduisibles en
français. Il n’est alors pas non plus étonnant de rencontrer certains usages de la
langue de Shakespeare chez M. de Balzac. Ils peuvent être, comme chez le
gastronome, destinés à rendre compte fidèlement d’une citation épigraphe comme
« to be or not to be »227 ou à reconnaître la paternité d’une expression comme honey
moon, qu’il traduit directement, a contrario de son inspirateur, et présente ainsi :
221 Op. cit., La Description, Textes réunis par Philippe Bonnefis et Pierre Reboul, p. 88. 222 Ibid. 223 Op. cit., Physiologie du goût, p. XXII. 224 Ibid., p. 330. 225 Germaine de Villeneuve et Joseph Dulaud, Antelme Brillat-Savarin : 1755-1826, Georges Nicolas, Ambérieu-en-Bugey, Arc-en-ciel, 1952, p. 45 226 Op. cit., Physiologie du goût, p. XXI. 227 Op. cit., Physiologie du mariage, p. 1009.
77
Cette expression, Lune de Miel, est un anglicisme qui passera dans toutes les langues, tant elle dépeint avec grâce la nuptiale saison, si fugitive, pendant laquelle la vie n’est que douceur est ravissement ; elle restera comme restent les illusions et les erreurs, car elle est le plus odieux de tous les mensonges. Si elle se présente comme une nymphe couronnée de fleurs fraîches, caressante comme une sirène, c’est qu’elle est le malheur même [sic] ; et le malheur arrive, la plupart du temps, en folâtrant228.
Néanmoins, en n’offrant à ses lecteurs que l’immédiate traduction de
l’expression anglaise, M. de Balzac se présente en traducteur et, en analysant le
caractère versatile de l’anglicisme, se peint en linguiste, capable de produire un
énoncé à la fois poétique et théorique sur une donnée lexicale que sa connaissance lui
permet de traduire. En cela M. Brillat-Savarin est peut-être moins prétentieux, car
s’il ajoute parfois la traduction entre parenthèse d’un susbtantif anglais en français ou
inversement, il ne se permet pas de jouer avec des traductions d’expressions
lexicalisées.
L’usage de la langue étrangère contribue à pallier la pauvreté de la langue
française selon M. Brillat-Savarin : Je suis intimement persuadé que la langue française, dont je me sers, est
comparativement pauvre. Que faire en cet état? Emprunter ou voler. Je fais l'un et l'autre, parce que ces emprunts ne sont pas sujets à restitution, et que le vol de mots n'est pas puni par le Code pénal. (…)
Je m'attends bien que les sévères vont crier à Bossuet, à Fénélon, à Racine, à Boileau, à Pascal, et autres du siècle de Louis XIV il me semble les entendre faire un vacarme épouvantable.
A quoi je réponds posément que je suis loin de disconvenir du mérite de ces auteurs, tant nommés que sous-entendus; mais que suit-il de là?. Rien, si ce n'est qu'ayant bien fait avec un instrument ingrat, ils auraient incomparablement mieux fait avec un instrument supérieur. (…)
Les peuples du Nord, et surtout les Anglais, ont sur nous, à cet égard, un immense avantage le génie n'y est jamais gêné par l'expression il crée ou emprunte, Aussi, dans tous les sujets qui admettent la profondeur et l'énergie, nos traducteurs ne font-ils que des copies pàles et décolorées229.
En reconnaissant une certaine péremption linguistique le gastronome se fait
moderne, il use de tous les mots que sa connaissance des langues met à sa
disposition. M. Brillat-Savarin se fait linguiste comme il se fait gastronome, il est
gourmand de la langue qu’elle soit française ou étrangère, de ses curiosités, de ses
expressions ou de son patois. Il appréhende le langage avec la même méticulosité
qu’il appréhende la cuisine. Il goûte la langue étrangère comme on goûte le met 228 Ibid., p. 980. 229 Op. cit., Physiologie du goût, p. XXI-XXII
78
exotique et se repaît de sa vocalité. Cependant si M. de Balzac se sert lui aussi de la
langue étrangère pour pallier les défauts du français, il la déguste quelque peu moins
bien que son analyse de l’expression Lune de miel reste tout à fait savoureuse.
Mais emprunter références, citations, expressions et substantifs à la langue
étrangère en opérant, ou non, une traduction c’est aussi rendre hommage à l’Autre en
préservant la pureté de son idiome ou en en reconnaissant au moins la provenance.
Le mot (dans son acception la plus large) en langue étrangère est celui du voyage, de
la rencontre, de la translation spatiale. Dans le cadre de la citation il rend compte des
qualités d’éruditions de son rapporteur. C’est dans l’usage de la langue de l’Autre
que l’auteur se présente comme revendiquant la diversité tant des genres que des
formes, d’un certain humanisme dans son observation, d’une certaine universalité du
propos physiologique. L’emprunt linguistique est aussi culturel que ce soit dans la
citation pure que dans la restitution de l’expression traduite. Mais qu’il soit imitation,
transposition, citation ou transformation, l’emprunt linguistico-culturel correspond à
la reconnaissance de l’alter et de la nécessité de co-existence entre les Nations230.
Nos physiologies se veulent universelles et convoquent en ce but les thèmes
du voyage, de l’anthropologie. La civilisation est en tout lieu portée par la
gastronomie laquelle unit les hommes par delà les mers. Or il est illogique de traiter
d’une science transcendante sans user d’autres langues. La convocation linguistico-
culturelle est nécessaire afin de mettre en exergue l’unité des hommes dans leur
diversité et de donner, comme à la mayonnaise, un peu de liant au texte. Néanmoins,
l’exotisme n’est pas le but premier de nos auteurs et les physiologies sont avant tout
des entreprises classificatoires caricaturales profondément parisiennes.
230 C.f. au sujet des emprunts l’article de Marie Miranda, « Sonnet et plurilinguisme au siècle d’Or espagnol », in Langues et identités culturelles dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles, Nancy, 2003.
79
4.2. La description analytique des moeurs
4.2.1. « Paris sera toujours Paris » 231 Paris prend une place importante chez nos deux auteurs mais au-delà des
motifs, déjà signalés, de capitale du savoir ou de ville mythique barthienne, c’est le
réseau des connexions, la connaissance des relations qui régissent la vie dans une
société particulière que charrie la convocation de ce thème de la grande ville. C’est
dans l’anonymat de la ville que l’individu peut disparaître. C’est dans cette cité que
l’autre devient vecteur du signe, de la « grimace sociale de convention» 232 .
C’est le bourgeois, souvent petit d’ailleurs, et ses angoisses que décrit M. de
Balzac, c’est le notable et son vernis qu’expose M. Brillat-Savarin. Ainsi lorsque le
gastronome nous peint en ces termes ceux qu’il aime recevoir et chez qui il aime être
reçu : Les prédestinés de la gourmandise sont en général d'une stature moyenne ; ils ont
le visage rond ou carré, les yeux brillants, le front petit, le nez court, tes lèvres charnues et le menton arrondi. Les femmes sont potelées, plus jolies que belles, et visant un peu à l'obésité.
Celles qui sont principalement friandes ont les traits plus fins l'air plus délicat, sont plus mignones, et se distinguent surtout par un coup de langué qui leur est particulier.
C'est sous cet extérieur qu'il faut chercher les convives les plus aimables : ils acceptent tout ce qu'on leur offre, mangent lentement, et savourent avec réflexion. Ils ne se hâtent point de s'éloigner des lieux où ils ont reçu une hospitalité distinguée ; et on les a pour la soirée, parce qu'ils connaissent tous les jeux et passe-temps qui sont les accessoires ordinaires d'une réunion gastronomique233.
le dandy aux gants jaunes semble lui répondre en nous expliquant que
Le timbre de la voix, le maintien, la gêne, un sourire, le silence même, la
tristesse, les prévenances à votre égard, tout est indice, et tout doit être étudié d’un regard, sans effort. Vous devez cacher la découverte la plus désagréable sous l’aisance et le langage abondant d’un homme de salon. (…) Le plus léger mouvement des lèvres, la plus imperceptible contraction des narines, les dégradations insensibles de l’œil, l’altération de la voix, et ces nuages indéfinissables qui enveloppent les traits, ou ces flammes qui les illuminent, tout est langage pour vous234.
231 Ainsi que l’aurait dit Maurice Chevalier. 232 Op. Cit., La Physiologie du mariage, p. 1047. 233 Op. cit. Physiologie du goût, p. 133. 234 Op. cit., Physiologie du Mariage, p. 1054.
80
C’est une analyse phénoménologique où point le signe secret et le langage
furtif que peignent nos deux auteurs : une analyse des relations sociales, et de leurs
interconnexions.
Mais plus encore, les ouvrages sur lesquels porte notre étude transforment
l’univers parisien, espace principal de déroulement narratif, en un monde d’« objet-
signes » 235 humains lesquels se définissent moins dans leurs rapports sociaux, moins
par leurs vies sociales, que par leur différence relativement aux autres sujets de la
physiologie : soit l’on est la femme maigre qui « désire engraisser »236 car ayant « les
yeux morts, les lèvres pâles et que la combinaison de [nos] traits indique l’inénergie,
la faiblesse, quelque chose qui ressemble à la souffrance »237 soit l’on est la « jolie
gourmande sous les armes »238 dont les « yeux sont brillants »239 et les « lèvres
vernissées »240 chez M. Brillat-Savarin ; soit l’on est « le glouton [qui] est beaucoup
plus qu’un animal ; [qui] est beaucoup moins qu’un homme »241 dans Physiologie
gastronomique soit l’on est « le mangeur » qui s’il « ne mange pas pour vivre (…) ne
vit pas non plus pour manger » 242 . En d’autres termes Paris, lorsqu’il est
physiologique (physiologisé même) via une physiologie de ses composantes
humaines, est vidé de son mystère par une codification textualisante omniprésente.
Moins que l’homme, c’est le signe qui compte dans nos physiologies. L’homme n’est
plus que le porteur conscient ou inconscient d’un ensemble de caractéristiques qui
mène à sa caricature. Chez nos auteurs l’individu s’efface au profit de l’exemple.
4.2.2. L’exemple type comme individualité négativée
Nous avons précédemment mis en lumière la classification qu’opèrent nos
deux auteurs en soumettant l’univers de leurs observations à un jeu de degrès afin
235 « L’objet devenu signe ne prend plus son sens dans la relation concrète entre deux personnes, il prend son sens dans la relation différentielle à d’autres signes. », Jean Baudrillard, Pour Une Critique de l’économie politique du signe, Gallimard, 1972, p. 64. 236 Op. cit. Physiologie du goût, p. 235. 237 Ibid. 238 Ibid., p. 126 239 Ibid. 240 Ibid. 241 Op. cit., Physiologie gastronomique, p. 86. 242 Ibid., p. 88.
81
d’appréhender un espace-temps problématique. Néanmoins, il est un inconvénient
intrinsèque à cette situation : l’univers social est changé en une structure absolument
prévisible où l’autre, s’il pose problème, socialement parlant, s’il n’entre pas dans la
case, est effacé. L’auteur de la physiologie supprime les indices, les marques qui
spécifient l’altérité sociale, suppression qui semble opérée par une méthode de
systématicité absolue de ces marques caractéristiques : vêtement, nourriture, allure,
profession, poids… tout semble encadré par une grammaire précise qui provoque la
disparition d’un corps social « tellement réifié en stéréotypes qu’il s’évanouit tout à
fait dans la pure profusion onomastique de sa symptomatologie » 243 .
Cette négation stéréotypée est davantage marquée chez M. de Balzac que
chez M. Brillat-Savarin. En effet, l’auteur de la Physiologie du goût se trouve moins
tenu à des contraintes formelles que son héritier. En écrivant dans des périodiques,
qui plus est à une époque où la physiologie est très pratiquée, Honoré de Balzac est
lié par les règles inhérentes du genre : il doit aller à l’essentiel et donc se restreindre
ce dont il est bien conscient : « deux numéros de La Silhouette ne suffiraient pas à
mes développements, si je voulais analyser toutes mes observations »244. Or quoi de
mieux pour donner un maximum d’informations et paraître renseigné que la
taxinomie pure ? Néantiser l’altérité garantit à l’auteur de la Physiologie de
l’employé de faire le panorama le plus complet du sujet en un minimum de pages et
tant pis pour le détail. Ce découpage grossier se traduit chez l’auteur par des
indications d’une volonté de développement : « peut-être un jour traiterons-nous ex
professo de cette réforme »245 . Les physiologies balzaciennes ont beau être inspirées,
en celle du goût, d’une physiologie qui épuise son sujet, elles sont tenues par des
impératifs éditoriaux, réduites à vendre en gros (exception faite du mariage).
Enfin cette disparité s’explique par l’adhésion du disciple du gourmet, à la
différence de M. Brillat-Savarin, à la physiognomonie lavaterienne et la phrénologie
gallienne. Pour lui
243 Op. cit., « Une idéologie du lisible : le phénomène des Physiologies », p. 51. 244 Op. cit., Physiologie gastronomique, p. 82. 245 Op. cit., Physiologie de la toilette, p. 71.
82
La Physiognomonie de Lavater a créé une véritable science. Elle a pris place enfin parmi les connaissances humaines. Si, d’abord, quelques doutes, quelques plaisanteries accueillirent l’apparition de ce livre, depuis, le célèbre docteur Gall est venu, par sa belle théorie du crâne, compléter le système du Suisse, et donner de la solidité à ses fines et lumineuses observations. Les gens d’esprit , les diplomates, les femmes, tous ceux qui sont les rares et fervents disciples de ces deux hommes célèbres, ont souvent eu l’occasion de remarquer bien d’autres signes évidents auxquels on reconnaît la pensée humaine. Les habitudes du corps, l’écriture, le son de la voix, les manières ont plus d’une fois éclairé la femme qui aime, le diplomate qui trompe, l’administrateur habile ou le souverain obligés de démêler d’un coup d' oeil l’amour, la trahison ou le mérite inconnus246.
Ces deux pseudo-sciences qui dérivèrent comme on le sait sont portées par la
figure déjà traitée du flâneur247. Il est celui qui, investit de la connaissance des
théories nouvelles relatives à l’apparence physique d’un individu et aux formes d’un
crâne comme reflets d’une personnalité, se mèle à l’auteur et fusionne avec lui dans
une analytique que Walter Benjamin observe :
Le flâneur fait figure d’éclaireur sur le marché. En cette qualité il est en même
temps l’explorateur de la foule. La foule fait naître en l’homme qui s’y abandonne une sorte d’ivresse qui s’accompagne d’illusions très particulières, de sorte qu’il se flatte, en voyant le passant emporté dans la foule, de l’avoir, d’après son extérieur, classé, reconnu dans tous les replis de son âme. Les physiologies contemporaines abondent en documents sur cette singulière conception. L’œuvre de Balzac en fournit d’excellents [et a fortiori les Physiologies balzaciennes]. Les caractères typiques reconnus parmi les passants tombent à tel point sous les sens que l’on ne saurait s’étonner de la curiosité incitée à se saisir au-delà d’eux de la singularité spéciale du sujet. Mais le cauchemar qui correspond à la perspicacité illusoire du physiognomiste dont nous avons parlé, c’est de voir ces traits distinctifs, particuliers au sujet, se révéler à leur tour n’être autre chose que les éléments constituants d’un type nouveau ; de sorte qu’en fin de compte l’individualité la mieux définie se trouverait être tel exemplaire d’un type. C’est là que se manifeste au cœur de la flânerie une fantasmagorie angoissante. (…) L’individu qui est ainsi présenté dans sa multiplication comme toujous le même témoigne de l’angoisse du citadin à ne plus pouvoir, malgré la mise en œuvre de ses singularités les plus excentriques, rompre le cercle magique du type. (…) Mais le nouveau que toute sa vie il a guetté n’est pas fait d’une autre matière que cette fantasmagorie du « toujours le même »248.
C’est très certainement là que réside le fait le plus dommageable de nos
physiologies : la célébration ironico-satirique de la diversité de la vie parisienne de
l’époque provoque son inscription dans un spectacle, une quasi-exhibition, où chacun
aura l’air de l’autre249 dans sa case.
246 Op. cit. Physiologie du mariage, p. 1044 247 Supra, p. 56. 248 Op.cit., Paris, capitale du xixe siècle – Le Livre des passages, p. 33. 249 « Hélas ! hélas ! Maudites soient les physiologies ! Savez-vous ce qui arrivera par elles, avant peu ? Les hommes, se voyant ainsi daguérreotypés corps et âme, sans pouvoir se défendre, feront
83
Nos physiologies opèrent une entreprise taxonomique. Elles doivent donc
réduire les individus étudiés à un ensemble de signe qui fait sens conformément aux
doctrines pseudo-scientifique de Lavater et de Gall. Une fois opérée, cette négation
individuelle favorisant des exemples types formés d’un ensemble plus ou moins
conscient d’actes et de caractéristiques physiques permet la classification. Or cette
classification est profondément partiale. Elle néantise en effet, un ensemble de
classes sociales au profit d’un ensemble jugé digne par nos auteurs. En agissant ainsi
nos auteurs se font les précurseurs d’une certaine forme de sociologie.
4.3. La peinture scientifique des relations entre individus
4.3.1. Une étude partiale néantisante250 Le parisianisme, qu’il soit inhérent à la réécriture du code journalistique ou
lié à une forme de mondanité taxinomique, semble être exclusif d’une autre pensée
géographique. En effet, chez M. de Balzac comme chez M. Brillat-Savarin, lorsque
la province est évoquée, c’est pour être immédiatement sinon déconsidérée comme
lieu d’habitat envisageable du moins réduite à une zone de vie qui ne peut être que
temporaire. Ainsi, M. Brillat-Savarin, fidèle à lui-même, réduit-il la province à un
lieu de bonne chère comme lorsque s’arrêtant à « l’auberge du petit bourg ou village
de Mont-sous-Vaudrey » 251 il dîne avec des « messieurs de justice » 252 d’une
« fricassée de poulets de haute facture, telle qu'on n'en trouve qu'en province, et si
richement dotée de truffes qu'il y en avait assez pour retremper le vieux Tithon »253.
Pour M. de Balzac, cette même province est une menace que fait le mari à sa femme
trop dépensière, menace du même acabit qu’une retraite monastique :
comme les hommes qui veulent arrêter les regards de la foule, ils tireront leurs rideaux. (…) Vous vous frotterez les yeux, Messieurs les physiologistes, et vous ne découvrirez partout que le même type à dessiner. » Physiologie des physiologies, Paris, Desloges, 1841, p. 66, 68. 250 Selon l’acception de Foulques Saint-Jean : « Considérer ou négliger comme s'il n'était pas, éliminer de son monde intentionnel. » lequel s’inspire de la pensée sartrienne évoquée dans L’Être et le Néant, Paris, Gallimard, 1943, p. 59 : « L'Être par qui le Néant arrive dans le monde doit néantiser le Néant dans son Être et même ainsi, il courrait encore le risque d'établir le Néant comme un transcendant au coeur même de l'immanence, s'il ne néantisait le Néant dans son être à propos de son être. ». 251 Op. cit., Physiologie du goût, p. 392. 252 Ibid., p. 393. 253 Ibid., p. 394.
84
Pour acheter la croix de diamants, il faudrait prendre mille écus sur nos capitaux;
or, une fois cette voie ouverte, ma petite belle, il n'y aurait pas de raison pour ne pas quitter ce Paris que tu aimes tant ; nous ne tarderions pas à être obligés d'aller en province rétablir notre fortune compromise. Les enfants et la dépense croîtront assez! Allons, sois sage254.
La province est donc soit le lieu de passage, occasion de rencontre et de
dégustation éphémère entre voyageurs ; soit le lieu d’enfermement à ciel ouvert,
punition conjugale. Mais davantage encore, on trouve au cœur même de cette
stratégie fondamentale d’exclusion, de ce parisianisme passionné, une seconde
exclusion, double cette fois et relative aux classes sociales. En effet, l’aristocratie
tout comme le prolétariat (et a fortiori les classes marginales255) n’existent pas. C’est
d’ailleurs cette même constation qui fait dire à Richard Sieburth que
Le monde social décrit dans les physiologies est ainsi un univers à la fois plein et
vide – plein dans la mesure où il évoque un panorama illusoire de la diversité humaine, mais vide dans la mesure où cette profusion de description urbaines, fondée comme elle l’est sur l’exclusion systématique de ce qui n’est pas bourgeois, de l’Autre, ne fait guère plus que répeter, dans différentes versions, la récurrence du Même256.
Chez M. de Balzac nous sommes prévenus qu’il s’agit d’une circonscription
nécessaire à la bonne marche de l’expérimentation sociale dans laquelle s’inscrit
l’auteur et, qui plus est, d’une évidence : Ici nous ne stipulons que pour les oisifs, pour ceux qui ont le temps et l'esprit
d'aimer, pour les riches qui ont acheté la propriété des passions, pour les intelligences qui ont conquis le monopole des chimères. Anathème sur tout ce qui ne vit pas de la pensée! Disons raca et même racaille de qui n'est pas ardent, jeune, beau et passionné257.
Chez M. Brillat-Savarin elle semble plus implicite et les indices de la
présence et de la nécessité d’une telle exclusion pour une meilleure intelligibilité
globale du projet sont rares. Quand il traite de la question du peuple c’est pour
s’interroger sur le traitement politico-gastronomique qui est réservé à certains : Est-ce que nos pauvres pêcheurs des côtes de Normandie ne se réjouissent pas à
l'avance de manger un homard ou des crevettes cuits dans l'eau dela mer, quand ils peuvent
254 Op. cit., Physiologie du mariage, p. 1011. 255 Ou lumpenproletariat chez Marx. C.f. Hal Draper, « The concept of the “lumpenproletariat”, in Marx and Engels », Économies et sociétés, t. 6, no 15, décembre 1971, p. 2285-2312. 256 Op. cit., « Une idéologie du lisible : le phénomène des Physiologies », p. 48. 257 Op. cit., Physiologie du mariage, p. 924.
85
éviter les regards de la douane car le fisc défend de puiser de l'eau à la mer, et l'Océan est gardé par toute une armée d'hommes vêtus de vert qui vous ferait rejeter à la mer une cruche d'eau que vous auriez subrepticement puisée cela épargnerait aux pauvres gens d'acheter du sel, et le sel est un impôt258.
Néanmoins, c’est davantage l’absence du traitement, par le gastronome, de la
condition prolétarienne qui règne mais moins par mépris que par logique
démonstrative. En effet, si M. Brillat-Savarin traite principalement des gastronomes,
des gourmets, des gourmands par état qu’il classe au nombre de quatre : « les
financiers les médecins, les gens de lettres et les dévots »259, l’homme de plus petite
condition est tout de même considéré dans ses « Éprouvettes gastronomiques »260 où
le gastronome associe une série de mets relativement à la classe sociale, les moyens
financiers, du sujet. Ainsi le budget s’échelonne-t-il de « 5000 Francs
(médiocrité) »261 à « 30000 Fr. et plus (Richesse) »262. Or comme le remarque Roland
Barthes : Dans cette sociologie culinaire, toute pudique qu’elle soit, le social pur est
cependant présent : là, précisément, où il manque au discours. C’est dans ce qu’il ne dit pas (dans ce qu’il occulte) que Brillat-Savarin pointe le plus sûrement la condition sociale, dans sa nudité : et ce qui est refoulé, impitoyablement, c’est la nourriture populaire [et avec elle son consommateur]263.
Plus moderne que celui qu’il inspire par la prise en compte d’un facteur de
sociabilité, M. Brillat-Savarin ne s’empêche pas, néanmoins, de néantiser l’individu
qui n’entre pas dans sa fourchette arbitraire de revenu présumé. En opérant une
classification relative à des classes sociales aisées, nos auteurs opèrent donc une
séléction entre les individus. Il semble inutile de traiter d’individus ou de
groupement d’individus qui ne rentrent pas dans le schéma. La physiologie est une
classification qui, comme le travail sociologique, doit être circonscrite.
258 Op. cit., Physiologie du goût, p. XX. 259 Ibid., p. 137. 260 Ibid., p. 151. 261 Ibid. 262 Ibid. 263 Op. cit., Lecture de Brillat-Savarin, p. 31
86
4.3.2. Messieurs Brillat-Savarin et Balzac disciples avant l’heure d’Auguste Comte ?
C’est un fait : à travers le genre de la physiologie puis au travers des courants
réalistes et naturalistes, la littérature du XIXe siècle emprunte volontiers aux sciences
humaines naissantes que sont la sociologie, l’ethnologie et l’anthropologie, leur
mode de réflexion fondé sur l’analyse observatoire du physique individuel. Nos deux
auteurs sont d’ailleurs parmi les premiers à user du lexique médical et scientifique
dans une « imitation sérieuse, flamboyante et poussée »264 dont l’ingénieux écart
avec la « vraie » science tend à faire sourire leurs lecteurs. Un sourire qui s’atténue
lorsque ce lecteur constate, suite à sa lecture de la Politique Positive d’Auguste
Comte que l’ouvrage qu’il tient entre les mains est plus qu’une simple caricature :
une « sociologie amusante »265, indice « de la transformation d’un monde »266. Par le seul titre de « physiologie » : Balzac emprunte aux ancêtres de la sociologie,
les idéologues, qui se présentent comme les héritiers du matérialisme analytique du XVIIIe siècle. Ce sont les philosophes, Destutt de Tracy et Cabanis en particulier, qui sont ici relayées par les spécialistes de la chose sociale que son Fourier, Saint-Simon et ses disciples. Cabanis, en écrivant son Traité des rapports du moral et du physique de l’homme, posait l’idée que les « sciences morales » pourraient n’être plus qu’une « branche de l’histoire naturelle » (troisième édition Caille et Ravier, 1815, Préface, p. XV). Dans sa théorie des quatre mouvements, Fourier préconise d’établir une science exacte des faits sociaux « classés, avec détails d’ordre, genre, espèce, variété » (Leipzig – Lyon, 1808. Discours préliminaire.). La Mémoire de la science de l’homme de Saint-Simon contient un véritable discours de la méthode ; la « physiologie sociale » sera une science « positive », appliquant les préceptes de « la méthode adoptée pour les autres sciences physiques » 267.
Ce qu’Arlette Michel observe chez M. de Balzac, Roland Barthes (qui signale
d’ailleurs qu’on retrouve toujours Fourier près de l’auteur de la Physiologie du goût)
l’observe, lui, chez M. Brillat-Savarin à propos du traitement des classes sociales
chez le gastronome : On a vu que dans le jeu (ou l’expérience) des éprouvettes gastronomiques, Brillat-
Savarin liai la différence des goûts à la différence des revenus. L’originalité n’est pas de reconnaître des classes d’argent (médiocrité, aisance, richesse), c’est de concevoir que le goût lui-même (c’est-à-dire la culture) est socialisé : s’il y a affinité entre les œufs à la neige et un revenu modeste, ce n’est pas seulement parce que ce mets est peu dispendieux,
264 Ramon Fernandez, Balzac ou l’envers de la création romanesque, Paris, Grasset, 1980, chap. III, II. 265 Jean-Yves Tadié, La Création littéraire au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, « Histoire littéraire. Lettres sup. », 2011, II, 3, I. 266 Ibid. 267 Op. cit., Introduction d’Arlette Michel, p. 879.
87
c’est aussi, semble-t-il, en raison d’un formation sociale du goût, dont les valeurs s’établissent, non point dans l’absolu, mais dans un champ déterminé. C’est donc toujours par le relais de la culture – et non par ce lui des besoins – que Brillat-Savarin socialise la nourriture. Ainsi, lorsqu’il passe des revenus aux classes professionnelles (à ce qu’on appelait les « états » ou les « conditions »), établissant que les grands gourmands de la société sont principalement les financiers, les médecins, les gens de lettres et les dévots, ce qu’il considère, c’est un certain profil d’habitudes, bref une psychologie sociale : le goût gastronomique semble à ses yeux lié par privilège, soit à une positivisme de la profession (financiers, médecins), soit à une aptitude particulière à déplacer, à sublimer ou intimiser la jouissance (gens de lettres, dévots)268.
En professant une pédagogie, une didactique, apte à réunir les hommes dans
une réalisation commune, Jean Anthelme Brillat-Savarin et Honoré de Balzac à sa
suite font acte sociologique : leur démonstration dont la « superficialité apparente
(…) est nettement assumée comme un outil rhétorique »269 est novatrice en cela
qu’elle est chargée d’une portée critique et politique laquelle est née d’une nouvelle
considération de l’homme comme objet d’étude. En même temps que « l’énonciateur
du savoir se donne une double fonction pédagogique, en passant d’un discours
initiatique à un discours disciplinaire »270 le texte se charge d’une valeur illocutoire.
Ce faisant, ce qui passait pour une instructive Méditation se trouve en réalité être une
pédagogie illustrée par l’histoire moderne de l’individu.
268 Op. cit., Lecture de Brillat-Savarin, p. 30-31. 269 Éric Bordas, « Instruire la femme quand on est un homme : Balzac, La Physiologie du mariage », in L’Éducation des femmes en Europe et en Amérique du Nord de la Renaissance à 1848, dir. Guyonne Leduc, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 476. 270 Catherine Nesci, La Femme, mode d’emploi. Balzac, de la Physiologie du mariage à La Comédie humaine, Lexington, KY : French Forum Publishers, 1992, p. 61.
90
Le disciple d’un homme, l’enfant d’une époque
Influencé, inspiré par M. Brillat-Savarin, M. de Balzac l’est donc
certainement du moins en ce qui concerne notre corpus. Néanmoins, l’auteur de la
Physiologie du goût comme celui de la Physiologie du mariage, de la toilette,
gastronomique, des positions, de l’adjoint, du cigare et de l’employé s’appuient sur
des opportunités fournies par une époque qui donne, elle-même, l’impression « d’un
tourbillon où tout s’inspire » 271 .
De plus, comme le fait justement remarquer M. Benjamin, le genre de la
physiologie est tout entier fondé sur la répétition, sur la remise à neuf ou du moins
sur la réactualisation du cliché. Qu’elles soient de M. Brillat-Savarin, de M. de
Balzac, de M. Guenot-Lecointe272 ou de n’importe quel autre auteur participant à
cette tendance, toutes les physiologies usent du discours d’opinions courantes, du
probable / verisimilis273 (ἔνδοξον) aristotelicien274. Or ce discours est fondé sur la
répétition et sur la différence, on peut donc aisément admettre une faible marge de
nouveauté dans quelque physiologie que ce soit et par voie de conséquence une
certaine porosité, sinon une certaine inspiration, entre les sujets et les techniques
d’écriture.
L’invitation au voyage : les adresses balzaciennes et savarines à d’éventuels continuateurs
M. Brillat-Savarin, conscient de l’étendue de son sujet et de l’impossibilité
pour lui d’en traiter l’intégralité au risque de s’égarer, s’amuse à semer sa
Physiologie du goût de legs. Ainsi, à sa réflexion
271 Pascale Hellégouarc’h, « L’ironie au service d’une Méditation sur le goût » dans Balzac L’aventure analytique, Joué-Les-Tours, Christian Pirot, 2009, p. 144. 272 Dont la Physiologie du gant réinterprète certains « Aphorismes du professeur » de la Physiologie du goût. 273 Ou probabilis ainsi que le traduit Cicéron, Marta Spranzi Zuber, « Rhétorique, dialectique et probabilité au XVIe siècle », Revue de Synthèse, vol. 122, no 2-4, 2001, p. 297-317 274 « Sont probables les opinions qui sont reçues par tous les hommes, ou par la plupart d’entre eux, ou par les sages, et parmi ces derniers, soit par tous, soit par la plupart, soit enfin par les plus notables et les plus illustres », Aristote, Topiques, Paris, Tricot, 1990, p. 16.
91
Si j'avais eu assez de temps j'aurais fait un choix raisonné de poésies gastronomiques depuis les Grecs et les Latins jusqu'à nos jours, et je l'aurais divisé par époques historiques, pour montrer l'alliance intime qui a toujours existé entre l'art de bien dire et l'art de bien manger.
Ce que je n'ai pas fait. un autre le fera. (…)275
il adjoint une note qui résume les sujets qu’il laisse à d’éventuels
successeurs : « Voilà, si je ne me trompe, le troisième ouvrage que je délègue aux
travailleurs : 1o Monographie de l'Obésité ; 2o Traité théorique et pratique des Haltes
de chasse ; 3o Recueil chronologique de Poésies gastronomiques »276. M. de Balzac
n’en aura cure et choisira à la manière du gastronome de léguer dans sa Physiologie
du mariage un ensemble d’idées rédactionnelles. Idées dont il fait le compte lors de
sa « théorie du lit » : Cet extrait peut servir à résoudre les difficultés qui se rencontrent dans la théorie
du lit relativement à sa construction. Mais l'auteur de ce livre trouve que l'association anglaise a donné trop
d'importance à cette question préjudicielle. II existe peut-être autant de bonnes raisons pour être Rossiniste que pour être
Solidiste en fait de couchette, et l'auteur avoue qu'il est au-dessous ou au-dessus de lui de trancher cette difficulté. Il pense avec Laurent Sterne qu'il est honteux à la civilisation européenne d'avoir si peu d'observations physiologiques sur la Callipédie, et il renonce à donner les résultats de ses Méditations à ce sujet, parce qu'ils seraient difficiles à formuler en langage de prude, qu'ils seraient peu compris ou mal interprétés. Ce dédain laissera une éternelle lacune en cet endroit de son livre; mais il aura la douce satisfaction de léguer un quatrième ouvrage au siècle suivant qu'il enrichit ainsi de tout ce qu'il ne fait pas, magnificence négative dont il donne l'exemple à plus d'un imitateur277.
Cette volonté d’inspirer les générations suivantes en leur laissant des thèmes
à traiter relève moins d’un pur altruisme que d’un calcul tant organisationnel
qu’intéressé. En effet, se pencher sur un sujet aussi vaste que le mariage ou le goût
relève du défi au bon sens s’il l’on cherche l’exhaustivité. On ne peut épuiser une
idée telle qu’au bout du travail d’une vie. Afin d’en garantir l’exécution la moins
rébarbative et la plus qualitative dans un ensemble donné sélectionner est nécessaire.
Or, via la sélection, certains sujets se trouvent exclus. Ce que font alors nos auteurs
n’est pas tant de donner une inspiration à d’éventuels lecteurs que de se garantir une
postérité au travers de leurs rebuts.
275 Op. cit., Physiologie du goût, p. 398. 276 Ibid. 277 Op. cit., Physiologie du mariage, p. 1064.
92
La passion poétique du collectionneur Mue par une volonté d’éternité nos auteurs sont aussi les collectionneurs
passionnés de l’individu et du genre humain. En créant l’illusion du différent, de la
nouveauté, via la multiplication signifiant/signifié ou a contrario signifié/signifiant
l’auteur de physiologie se fait collectionneur d’homme en ce sens que « l’objet n’est
plus spécifié par sa fonction, il est qualifié par le sujet : mais alors tous les objets
s’équivalent dans la possession. » 278, « le goût de la collection étant une sorte de jeu
passionnel » 279 . [Or] seule une organisation plus ou moins complexe d’objets renvoyant les uns
aux autres constitue chaque objet en une abstraction suffisante pour qu’il puisse être récupéré [écrit en l’occurrence] par le sujet (…) Cette organisation, c’est la collection [et la taxinomiesavarine ou balzacienne n’est rien d’autre qu’une expression de celle-ci] (…) c’est là où triomphe cette entreprise passionnée de possession, là où la prose quotidienne des objets devient poésie, discours inconscient et triomphal280.
Nos physiologistes s’improvisent gardiens d’une connaissance intime, celle
de la chose, du mets, du vêtement ou de l’individu et de sa fonction, connaissance
qu’ils enclosent dans leurs collections, leurs œuvres, leurs entreprises classificatoires.
Il s’agit, par l’art de la nuance, de retrouver la différence parmi le même, une
différence davantage réservée à celui qui collectionne, qui possède : l’écrivain-
observateur qu’à celui qui le lit.
Un auteur original Malgré l’influence de M. Brillat-Savarin et l’inscription dans un genre très
codifié, certaines particularités d’écriture restent propres (ou du moins jamais
employées avant lui) à l’auteur futur de la Comédie Humaine. Ainsi Karlheinz Stierle
nous signale très justement que
parmi les discours épistémologiques de référence, il s’en trouve un chez Balzac
qui n’apparaît pas chez Brillat-Savarin : celui de la théorie des signes de l’expression humaine, tel que l’a développé Lavater en particulier. C’est chez Balzac que physiologie et physiognomie s’allient pour la première fois étroitement281.
278 Jean Baudrillard, Le Système des objets, Paris, Gallimard, « Tel », 2006, p. 120. 279 Maurice Rheims, La Vie étrange des objets : histoire de la curiosité, Paris, Plon, 1959, p. 30 280 Op. cit, Le système des objets, p.121. 281 Op. cit. Paris, Capitale des signes, p. 197.
93
La science chez M. de Balzac trouve une autre position que chez M. Brillat-
Savarin : alors que le gastronome présentait sa physiologie comme un ouvrage
scientifique, littéraire car écrit, le dandy aux gants jaunes pose la littérature comme sœur de la science. À l’image de la science, elle tend à la
connaissance, à la prise de possession du réel. Elle emprunte à la science, et elle vulgarise. Témoignage de sciences humaines ou sociales la Physiologie du Mariage [et chacune des physiologies balzaciennes] met au point une doctrine de la connaissance et de l’expression littéraire de la réalité sociale282.
Néanmoins, si M. de Balzac renouvelle le genre initié par M. Brillat-Savarin,
il reste dans la lignée de cette élégance géniale du « livre charmant dont chaque
chapitre est une petite merveille, un diamant [et] qui donna les préceptes et l’exemple
du goût » 283. Et, contrairement aux successeurs qui se croyant meilleurs veulent
recréer le maître en l’effaçant, innover en ne conservant de l’inventeur que le seul
titre de Physiologie, Honoré de Balzac s’inscrit dans le sillage virtuose de son
inspirateur et fait de ses physiologies tant un hommage que les prémisses de son
œuvre future.
282 Op. cit., Introduction d’Arlette Michel, p. 879. 283 Op. cit., Physiologie des Physiologies, p. 92.
95
BIBLIOGRAPHIE
Corpus :
• Jean Anthelme Brillat-Savarin :
-‐ Brillat-Savarin Jean Anthelme, Physiologie du Goût, ou Méditations
de Gastronomie Transcendante ; ouvrage théorique, historique et à l'ordre
du jour, dédié aux Gastronomes parisiens, par un Professeur, membre de
plusieurs sociétés littéraires et savantes., Paris, Auguste Sautelet, 1826, t. I, t.
II, Z-44091 et Z-44092,
disponibles sur http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30161657n ; http://catal
ogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30161657n .
-‐ Brillat-Savarin Jean Anthelme, Physiologie du Goût, ou Méditations
de Gastronomie Transcendante ; ouvrage théorique, historique et à l'ordre
du jour, dédié aux Gastronomes parisiens, par un Professeur, membre de
plusieurs sociétés littéraires et savantes, illustrée par Bertall, précédée d'une
notice biographique par Alphonse Karr, Paris, Gérard de Gonet, 1848, BNF
Z-44113 disponible sur http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30161672j.
-‐ Brillat-Savarin Jean Anthelme, Physiologie du Goût première édition
mise en ordre et annotée avec une lecture de Roland Barthes, Paris, Herman,
coll. « Savoir : lettres », 1975.
-‐ Brillat-Savarin Jean Anthelme, Physiologie du Goût, Jean-François
Revel, Champs Flammarion, Paris, 1982.
96
• Honoré de Balzac :
-‐ Physiologie du mariage ou Méditations de philosophe éclectique sur
le bonheur et le malheur conjugal, Pierre-Georges Castex, Arlette Michel,
René Guise, in La Comédie Humaine t. XI, Paris, Gallimard, « Bibliothèque
de la Pléiade », 1980.
-‐ Balzac Honoré de, Physiologie du mariage, Samuel Silvestre de Sacy,
Gallimard éd., coll. Folio, 1971.
-‐ Balzac Honoré de, Physiologie du mariage préoriginale, Bardèche
Maurice, Librairie Daloz, 1940.
-‐ Balzac Honoré de, Physiologie gastronomique : I. Introduction. II. Le
Mangeur et le Glouton., Brochier Jean-Jacques, Bègles, Le Castor Astral,
1992.
-‐ Balzac Honoré de, Physiologie des positions, Œuvres complètes, Éd.
Définitive, t. XX, Œuvres diverses, Paris, Michel Levy frères, 1870.
-‐ Balzac Honoré de, Physiologie du cigare, Œuvres complètes, Éd.
Définitive, t. XX, Œuvres diverses, Paris, Michel Levy frères, 1870.
-‐ Balzac Honoré de, Physiologie de l’employé, Œuvres illustrées de
Balzac, 200 dessins par MM. Tony Johannot, Staal, Bertali, E. Lampsonius,
H. Monnier, Daumier, Meissonier, ETC., Paris, Marescq et compagnie, 1852.
-‐ Balzac Honoré de, « Physiologie de l’adjoint », La Caricature
politique, morale, littéraire et scénique, Paris, 11 août 1831.
97
-‐ Balzac Honoré de, Histoire et physiologie des boulevards de Paris, in
Honoré de Balzac, A Paris!, Roger Caillois, Paris, Complexe, collection « Le
regard littéraire », 1993.
-‐ Balzac Honoré de, Frémy Arnould, Physiologie du rentier de Paris et
Province, Paris, P. Martinon, 1841, manuscrit BNF RES-16-Li6-177,
disponible sur : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32128912n.
-‐ Balzac Honoré de, Physiologie de la toilette : I. De la cravate
considérée en elle-même et dans ses rapports avec la société et les individus.
II. Des habits rembourrés., Brochier Jean-Jacques, Bègles, Le Castor Astral,
1992.
-‐ Balzac Honoré de, Correspondance, tome III, Roger Pierrot, Garnier,
Paris, 1964.
-‐ Balzac Honoré de, Physiologie du goût, éd. Charpentier de 1839,
Appendice, Traité des excitants modernes.
-‐ La Silhouette, tome I, 3e livre.
-‐ La Silhouette, tome II, 10e livre.
-‐ Balzac Honoré de, Physiologie de l’employé, Anne-Marie Baron,
Mayenne, Le Castor Astral, 1994.
-‐ Honoré de Balzac, Sur Brillat-Savarin et de l'alimentation dans la
génération, manuscrit autographe incomplet. Ms Lov. A 166 / Fol. 21-29.
Collection Spoelberch de Lovenjoul.
-‐ Balzac Honoré de, Traité de la vie élégante, Dijon-Quetigny, Rivages
poche, « Petite Bibliothèque », 2012,
98
• Autres auteurs :
-‐ Dictionnaire de l’Académie française, Neuvième édition, Tome 3
(Maquereau à Quotité), Paris, Imprimerie nationale/Fayard, 2011.
-‐ Buffon, Discours sur la nature des animaux, in Corpus général des
philosophes français, Auteurs modernes, t. XL, Paris, PUF, 1954.
-‐ Broussais François, Cours de Phrénologie, leçon 3, Paris, Baillière, 1836.
-‐ Sterne Laurence, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman
in Works of Laurence Sterne in one volume with a life of the author
written by himself, Philadelphie, Grigg & Elliot, 1834.
-‐ Lacroix Auguste de, « Le flâneur » dans Les Français peint par eux-
mêmes, encyclopédie morale du XIXe siècle, t. III, Paris, Curmer, 1841.
-‐ Sartre Jean-Paul, L’Être et le Néant, Paris, Gallimard, 1943.
-‐ Physiologie des physiologies, Paris, Desloges, 1841.
Études critiques :
• Sur les sciences pures ou sociales :
-‐ Amossy Ruth, Rosen Elisheva, Les Discours du cliché, Paris, Sedes, 1982.
-‐ Barthes Roland, Système de la mode, Évreux, Point, 1983, p. 302.
99
-‐ Baudrillard Jean, Pour Une Critique de l’économie politique du signe,
Gallimard, 1972.
-‐ Blanche Claire et Benveniste Emile, « La dénomination dans le français parlé
: une interprétation pour les répétitions et les hésitations », Recherches sur le
français parlé n° 6, Aix-en-Provence, 1984.
-‐ Bordas Éric, « Instruire la femme quand on est un homme : Balzac, La
Physiologie du mariage », in L’Éducation des femmes en Europe et en
Amérique du Nord de la Renaissance à 1848, dir. Guyonne Leduc, Paris,
L’Harmattan, 1997.
-‐ Buisne Alain, « Un cas limite de la description : L’énumération. L’exemple
de Vingt mille lieues sous les mers » dans La Description, Textes réunis par
Philippe Bonnefis et Pierre Reboul, Lille, Presses Universitaire de Lille,
1981.
-‐ Cambier Jean, Verstichel Patrick, Le Cerveau réconcilié : précis de
neurobiologie cognitive, Masson, « Mass », Paris, 1998,
-‐ Corbeau Jean-Pierre, « De la table aux tablettes » in L’imaginaire de la
Table, Jean-Jacques Boutaud, L'Harmattan, « Communication et
Civilisation », 2004.
-‐ Coster Maggy de, Le Journalisme expliqué aux non-initiés, l’Harmattan,
Paris, 2007.
-‐ Couturat Louis, Leau Léopold, préface à l’Histoire de la langue universelle :
Beigebunden ist : Les nouvelles langues internationales. Mit e. bibliograph.
Nachtrag von Reinhard Haupenthal, Hildesheim, Georg Olm, 1903.
100
-‐ Danou Gérard, Le Corps souffrant. Littérature et médecine, Champ Vallon,
« L’Or d’Atalante », Seyssel, 1994.
-‐ Draper Hal, « The concept of the “lumpenproletariat”, in Marx and Engels »,
Économies et sociétés, t. 6, no 15, décembre 1971.
-‐ Grevisse Benoît, Écritures journalistiques. Stratégies rédactionnelles,
multimédia et journalisme narratif, De Bœck, « Info com, licence, master,
doctorat », Bruxelles, 2008.
-‐ Jan de Voogd Peter, John Neubauer dans leur ouvrage The reception of
Laurence Sterne in Europe, Londres, Continuum, 2004.
-‐ Louyest Benoît, « Une linguistique “réaliste” » – à propos du recueil L'acte de nommer. Une dynamique entre langue et discours, Georgeta Cislara, Olivia Guérin, Katia Morin, Emilie Née, Thierry Pagnier, Marie Veniard, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2007 – Acta Fabula, Novembre-Décembre 2007, URL : http://www.fabula.org/revue/document3590.php.
-‐
-‐ Marie Miranda, « Sonnet et plurilinguisme au siècle d’Or espagnol », in Langues et identités culturelles dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles, Nancy, 2003.
-‐ Catherine Nesci, La Femme, mode d’emploi. Balzac, de la Physiologie du
mariage à La Comédie humaine, Lexington, KY : French Forum Publishers, 1992.
-‐ Siblot Paul, « Nomination et production de sens : le praxème », Langages
n° 127, Paris, 1997.
-‐ Spitzer Alan B., « A Generation as a Social Network », dans Histoire &
Mesure, 1987 volume II, n°3-4.
-‐ Stoetzel Jean, Psychologie sociale, Paris, Flammarion, 1978.
101
-‐ Vatin François, Trois essais sur la genèse de la pensée sociologique :
Politique, épistémologie et cosmologie, Paris, La Découverte, 2004.
-‐ Zuber Marta Spranzi, « Rhétorique, dialectique et probabilité au XVIe siècle »,
Revue de Synthèse, vol. 122, no 2-4, 2001.
• Sur le genre de la physiologie et ses composantes :
-‐ Aristote, Topiques, Paris, Tricot, 1990.
-‐ Aldeguier Auguste d’, « Le flâneur à Paris » dans Paris ou le Livre
des Cent-et-Un, t. V, Francfort, Sigismond Schmerber, 1832.
-‐ Barberis Pierre, Balzac et le mal du siècle. Contribution à une
physiologie du monde moderne, Genève, 1970, Slatkine reprints, 2002.
-‐ Barbéris Pierre, Balzac et le mal du siècle, contribution à une
physiologie du monde moderne, t.I : une expérience de l'absurde, aliénations
et prises de consscience 1799-1829 ; t.II : De la prise de conscience à
l'expression 1830-1833, Gallimard, 1970.
-‐ Barthes Roland, « La grand famille des hommes », Mythologies, Paris,
Seuil, « Essais », 1957.
-‐ Barthes Roland, « l’effet de réel », Communications, vol. 11, no 11,
1968.
102
-‐ Baudrillard Jean, Le Système des objets, Paris, Gallimard, « Tel »,
2006.
-‐ Benjamin Walter, Charles Baudelaire, Payot, 1982.
-‐ Benjamin Walter, Paris, Capitale du XIXe siècle – Le Livre des
passages, Paris, éditions du Cerf, 1989.
-‐ Benjamin Walter, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité
technique », Œuvres III, Paris, Gallimard, « Folio Essai », 2000, p. 70.
-‐ Benjamin Walter, Petite histoire de la photographie, Allia, 2012.
-‐ Letailleur Gérard, Histoire insolite des cafés parisiens, Paris, Perrin,
2011
-‐ Preiss Nathalie, « Les physiologies au XIXe siècle et la mode. De la
poésie comique à la critique », L’Année balzacienne, no22, 1984.
-‐ Preiss Nathalie, Les « Physiologies » en France au XIXe siècle. Étude
historique, littéraire et stylistique, Mont-de-Marsan, éd. Inter-universitaires,
1999.
-‐ Rheims Maurice, La Vie étrange des objets : histoire de la curiosité,
Paris, Plon, 1959
-‐ Sieburth Richard, « une idéologie du lisible : le phénomène des
Physiologies », Romantisme 47, 1985.
103
-‐ Tadié Jean-Yves, La Création littéraire au XIXe siècle, Paris, Armand
Colin, « Histoire littéraire. Lettres sup. », 2011.
-‐ Thompson Patrice, « Essai d’analyse des conditions de spectacle dans
Panorama et le Diorama », Romantisme, no 35, 1982.
• Sur Balzac et ses physiologies :
-‐ Aron Paul, « Le pasticheur pastiché ou Janin, Balzac et Reybaud »,
Histoires littéraires no1, 2000.
-‐ Barel-Moisan Claire et Couleau Christèle (dir.), Balzac l’aventure
analytique, Christian Pirot éd., 2009.
-‐ Baron Anne-Marie, « L’auto-ironie avant la Comédie humaine : de la
Correspondance à la Physiologie du mariage » dans Ironies balzaciennes,
Christian Pirot (dir.) Saint-Cyr-Sur-Loire, Eric Bordas éd., Balzac coll., 2003.
-‐ Basset Nathalie, « La Physiologie du mariage est-elle une
physiologie ? », L'Année balzacienne, no 24, 1986.
-‐ Bonnet-Roy Dr Flavien, Balzac, les médecins, la médecine et la
science, Les Horizons de France, 1944.
-‐ Castex Pierre-Georges, « Notice », Études analytiques, t. XI de La
Comédie humaine, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiaide », 1980.
-‐ Cesari Paul, Étude critique des passions dans l’oeuvre de Balzac,
Presses modernes, 1938.
104
-‐ Contensou Martine, Balzac et Philipon associés. Grands fabricants de
caricatures en tous genre, Paris, Association Paris-Musées, 2001.
-‐ Delattre Geneviève, Les opinions littéraires de Balzac, Paris, PUF,
1961.
-‐ Diaz José -Luis, « Avoir de l’esprit », L’Année balzacienne, no 43,
2005.
-‐ Évrard Franck, « Bottes et feintes balzaciennes », Littératures, 1991,
n° 24.
-‐ Ezequiel Martinez Estrada, « Philosophie et Métaphysique de
Balzac », in Hommage à Balzac, Paris, Mercure de France, 1950.
-‐ Fernandez Ramon, Balzac ou l’envers de la création romanesque,
Paris, Grasset, 1980.
-‐ Fizaine Jean-Claude, « Ironie et fiction dans l'œuvre de Balzac », dans
Balzac, l'invention du roman, Claude Duchet et Jacques Neefs éds., Paris,
Belfond, 1982.
-‐ Goblot Jean-Jacques, « Un compte rendu oublié de la Physiologie du
mariage », L’Année balzacienne, 1975, no 15.
-‐ Ledré Charles, La presse à l'assaut de la monarchie, 1815-1848,
Paris, Armand Colin, 1960.
105
-‐ Lauster Martina, Sketches of the Nineteenth Century: European
Journalism and Its Physiologies, 1830-50, New-York, Palgrave Macmillan,
2007.
-‐ Mollier Jean-Yves, « l’édition en Europe avant 1850. Balzac et la
propriété littéraire internationale », L’Année balzacienne, 1992.
-‐ Mouchard Claude, « Volonté de style », dans Balzac et le style, Paris,
Sedes, « Collection du bicentenaire », 1998.
-‐ Muhlstein Anka, Garçon, un cent d'huîtres ! : Balzac et la table, Odile
Jacob, coll. Histoire et document, octobre 2010.
-‐ Nesci Catherine, « mimèsis ou auto-référence : les apories des Études
analytiques » dans Balzac, Œuvres complètes. Le « Moment » de La
Comédie humaine, presses universitaires de Vincennes, 1993.
-‐ Preston Ethel, Recherches sur la technique de Balzac, Presses
françaises, 1926.
-‐ Rivers Christopher, Face Value: Physiognomical Thought and the
Legible Body in Marivaux, Lavater, Balzac, Gautier, and Zola, University of
Wisconsin Press, december 1994.
-‐ Saïdah Jean-Pierre, Dandysme social et dandysme littéraire à
l’époque de Balzac, thèse d’État, univ. de Bordeaux III, 1990.
-‐ Stevenson N.W., Paris dans la Comédie humaine, Librairie Georges
Courville, 1938.
106
-‐ Stierle Karlheinz, La Capitale des signes. Paris et son discours, Paris,
éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2001.
-‐ Tolley Bruce, « Balzac anecdotier. De l’Album historique et
anecdotique (1827) à La Comédie Humaine », L’Année balzacienne, no6,
1967.
-‐ Ygaunin Jean, Paris à l’époque de Balzac et dans « La Comédie
humaine », la ville et la société, A.-G. Nizet, 1992.
• Sur Brillat-Savarin et la physiologie du goût :
-‐ Colomb François de, « Brillat-Savarin lexicologue et… cosmonaute.
», Défense de la langue française, no 35, décembre 1966.
-‐ Delatour François, « Brillat Savarin », Historia : La savoureuse
histoire de la France gourmande, A table… les français !, Hors Série no 42,
10 juillet 1975.
-‐ Fortassier Rose, « Sur Brillat-Savarin et de l’alimentation dans la
génération » L’Année balzacienne, no 7, 1968.
-‐ Michel, Pierre, « Gastronomie ou Barbarie. Autour de la Physiologie
du goût et de la Maison rustique des Dames », dans Ecritures du repas,
Fragments d'un discours gastronomique, Becker, Karin / Leplatre, Olivier
(dir.), 2007.
-‐ Roudaut Jean, « Anthelme Brillat-Savarin : Mythologie
gastronomique. Manger pour rêver.» La Nouvelle Revue Française.
Novembre 1981, no 346.
107
-‐ Sipe Daniel, « Social Gastronomy: Fourier and Brillat-Savarin »
French Cultural Studies, August 2009.
-‐ Stiénon Valérie, «Fictions de l’universalité du savoir dans la
Physiologie du goût de Brillat-Savarin.» Signes, Discours et Sociétés [en
ligne], 1. Interculturalité et intercommunication, 21 mai 2008. Disponible sur
Internet : http://www.revue-signes.info/document.php?id=201. ISSN 1308-
-‐ 8378.
-‐ Teulon Fabrice, « Le Voluptueux et le gourmand: Économie de la
jouissance chez La Mettrie et Brillat-Savarin. » Symposium, vol. 52, no3,
1998.
-‐ Trenard Louis, « Un idéologue méconnu : Brillat-Savarin » dans
L'Héritage des lumières : Volney et les idéologues, Angers, Presses de
l'université, 1988.
-‐ « Le Centenaire de Brillat-Savarin », Chronique des lettres françaises,
4e année, no 20, mars-avril 1926.
• Sur la relation entre Brillat-Savarin et Balzac :
-‐ Castex Pierre-Georges, « Balzac et Brillat-Savarin. Sur une préface à
la Physiologie du goût », L’Année balzacienne, no19, 1979.
-‐ Dubois, Philippe, « Savarin/Balzac : du goût des excitants sur
l'écriture moderne », Nineteenth-Century French Studies, t. XXXIII, no 1-2,
2004 Fall-2005 Winter.





















































































































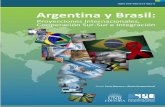




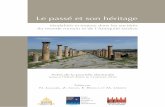

![Diseño del Sur [Español] (2013)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6325a6be7fd2bfd0cb0392af/diseno-del-sur-espanol-2013.jpg)




