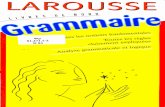L'évolution des manuels de grammaire de 1960 à 2000
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
Transcript of L'évolution des manuels de grammaire de 1960 à 2000
71e congrès de l’ACFAS tenu à Rimouski du 19 au 23 mai 2003, dans la session
« didactique » L’évolution des
manuels de grammaire de 1960-
2000Monique Lebrun
département de linguistique et didactique des langues;
Priscilla Boyer étudiante à la MA
UQÀM
La place de la grammaire dans les programmes:
le département de l’Instruction publique et le programme de 19591. Le contexte socio-politique (révolution tranquille, Rapport Parent, MEQ)2. Les contenus grammaticaux du programme- Le but principal de ce programme est d’amener l’élève à parler et à écrire correctement.-La norme du français correct reste le français de France.-L’accent mis sur la grammaire et l’orthographe est très important.-On distingue grammaire normative et grammaire raisonnée, cette dernière comprenant l’analyse des mots et des propositions.-Des apprentissages particuliers touchent la phraséologie et la stylique.
La place de la grammaire dans les programmes:
les programmes cadres de 19691. Le contexte socio-politique (rapport Gendron de 1968, loi 63 de 1969).2. Les contenus grammaticaux du programme-La langue est perçue comme un instrument au service de la communication, de la culture et de la pensée.-La langue parlée et écrite de l’élève est imparfaite: il faut la corriger.-Il faut insister sur l’oral-L’apprentissage de la langue doit se faire de façon globale, et non en dissociant ses éléments constitutifs.3. L’accueil fait à ces programmes-Le livre noir de l’AQPF (1970)-Les articles de Lysiane Gagnon (1975)
La place de la grammaire dans les programmes:
les programmes de 1979 (primaire) et 1980 (secondaire)1. Le contexte socio-politique (cf loi 101 de 1977; rapports du CLF de 1987; Plan d’action du MEQ de 1988)2. Les contenus grammaticaux des programmes-L’apprentissage de la grammaire lors de pratiques d’écriture.-La distinction entre « pratiques », « objectivation de la pratique » et « acquisition de connaissances ».-L’apparition du discursif au secondaire: les différents types de textes, auxquels on doit lier certains apprentissages grammaticaux.-L’accent mis sur l’orthographe grammaticale au primaire.-Une sensibilisation à la variation et aux registres de langue, pour la première fois dans des programmes de français.
La place de la grammaire dans les programmes: les programmes de 1979 (primaire) et 1980 (secondaire) suite.3. L’accueil fait à ces programmes-La suspicion de certains quant au changement de position des programmes et à la grammaire « implicite » au primaire (Mareuil).-Mauvaise compréhension du processus d’apprentissage en trois étapes qui laisse croire en la mise de côté des « connaissances ».-Travail fondateur de Milot: explications répétées sur l a méthode inductive, sur la nécessité de partir des lacunes des élèves, sur des propositions concernant l’apprentissage de l’orthographe.-Enquête de l’Université de Montréal: la grammaire s’enseigne encore !
La place de la grammaire dans les programmes: les programmes de 1994 (secondaire) et 1995 (primaire)
1. Le contexte socio-politique (États généraux sur l’éducation, multiplication des politiques évaluatives sur la langue à tous les niveaux)2. Les contenus grammaticaux des programmes-L’apprentissage systématique de la syntaxe et de la grammaire du texte.-L’impact des grammaires scientifiques de type « renouvelé ».-L’insistance sur la méthode inductive.-Le recours aux « manipulations » (opérations linguistiques).-Le changement terminologique (métalangage).-Un apprentissage systématique du lexique.3. L’accueil fait à ces programmes-Une commotion chez les enseignants; un ajustement chez les formateurs.-Le rôle de relais de la revue Québec français dans l’explication des positions ministérielles.
La place de la grammaire dans les programmes:
l’évolution depuis 1999
1. Opération de refonte de tous les programmes : le Programme des programmes.2. Le français: à la fois compétence disciplinaire et compétence transversale.3. Un flou relatif concernant les positions ministérielles sur les apprentissages grammaticaux.
Graphique 1: Ventilation de l’objectif « connaissance de la
langue » par période
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%
prioritaire 63,60% 71,40% 80% 80%non mentionné 36,30% 28,60% 6,70% 20%secondaire 6,70%sans mention 6,70%
avant 1972
1973-1981
1982-1993
après 1994
Graphique 2: Filiation théorique des auteurs, pour
chaque période
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%
2e période 42,90% 57,20% 0%3e période 53,30% 40% 6,70%4e période 10% 30% 60%
Tradition- nelleHybride Rénovée
Graphique 3: Présentation du mot à la phrase ou de la phrase
au mot, par période
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Mot-phrase 81,80% 14,30% 33,30% 10%phrase-mot 9,10% 57,10% 33,30% 80%ordre alpha 0% 0% 20% 0%particularités9% 29% 13,30% 10%
avant 1972
1973-1981
1982-1993
après 1994
Graphique 4: Utilisation du concept « Phrase de base », par
période
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
P de base 0% 57,10%26,70% 80% 37,20%pas de P debase
100% 42,90%73,30% 20% 62,80%
avant 1972
1973-1981
1982-1993
après 1994
sur 43 grammaire
Graphique 5: Désignation des catégories grammaticales, par
période
0
0,1
0,20,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
classe 14,30% 26,70% 70%nature 27,30% 42,90% 40% 10%catégorie 18,20% 28,60% 26,70% 20%espèce 54,50% 85,70% 6,70% 0%aucun 9,10% 14,30% 26,70% 0%
avant 1972 1973-1981 1982-1993 après 1994
Graphique 6: Utilisation des termes « complément circonstanciel » et
« complément de phrase », par période
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
circonstanciel100% 71,40% 93,30% 30%de phrase 0,00% 14,30% 33% 90%aucun 0,00% 14,30% 6,70% 0%
avant 1972
1973-1981
1982-1993
après 1994
Graphique 7: Utilisation de la méthode inductive, par période
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
guide d'obs. 57,10% 33,30% 40%manipulations 9,10% 42,90% 33,30% 90%découverte 57,10% 10%exemple/texte 18,20% 14,30% 13,30% 30%exercices/texte18,20% 6,70%méta./intég. 7%
avant 1972
1973-1981
1982-1993
après 1994
Graphique 8: Prise en compte des exceptions, par période
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Sur 43grammaires
48,80%
avant 1972 63,60%1973-1981 42,90%1982-1993 53,30%après 1994 30%
exceptions
Graphique 9: Place de l’orthographe lexicale, par
période
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Chapitre 45,50% 42,90% 73,30% 80%Annexe 9,10% 20,00% 10,00%Aucun 45,50% 57,10% 6,70% 10%
avant 1972 1973-1981 1982-1993 après
1994
Conclusion En conclusion, on peut dire que le manuel est sensible
- à l’évolution de la linguistique elle-même (la notion de grammaire de phrase, la notion de complément circonstanciel);
- à celle de la psychopédagogie (méthode inductive et réflexion sur l’apprenant);
- à celle de l’idéologie (fragilité de la norme québécoise et crainte d’aborder le français parlé)
























![[Claire Miquel] Grammaire en dialogues Niveau in(Book Za org)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63160bee5cba183dbf0847b9/claire-miquel-grammaire-en-dialogues-niveau-inbook-za-org.jpg)