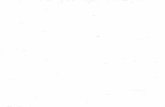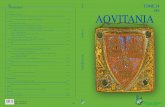L'obituaire du chapitre de Saint-Materne à la cathédrale Saint ...
L'église Saint-Lubin de châteaudun
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'église Saint-Lubin de châteaudun
Bernard Robreau
L'église Saint-Lubin de Châteaudun (Eure-et-Loir) / The churchof Saint-Lubin at ChâteaudunIn: Revue archéologique du Centre de la France. Tome 23, fascicule 1, 1984. pp. 99-124.
RésuméEtude historique et archéologique de l'évolution du plus vieil édifice chrétien intra-muros de Châteaudun, avec discussion desproblèmes chronologiques qu'il soulève. Après une phase de développement qui semble durer du VIe au XIe siècle, le déclins'amorce progressivement à la suite de l'aménagement du château médiéval, immédiatement au nord du site étudié. La fonctionfunéraire apparaît tardivement au XIVe siècle et se poursuit jusqu'au XVIIIe siècle.
AbstractHistorical and archaeological study of the first intra-muros Christian building at Châteaudun and discussion of the chronology.After a phase of development (6th-llth cent.), the church declines from the date of construction of the medieval castle, north of thesite. The church is later used for funeral purposes (14th-18th cent.).
Citer ce document / Cite this document :
Robreau Bernard. L'église Saint-Lubin de Châteaudun (Eure-et-Loir) / The church of Saint-Lubin at Châteaudun. In: Revuearchéologique du Centre de la France. Tome 23, fascicule 1, 1984. pp. 99-124.
doi : 10.3406/racf.1984.2402
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/racf_0220-6617_1984_num_23_1_2402
Revue Archéologique du Centre de la France, Tome 23, vol. 1, 1984.
Bernard ROBREAIT
L'église Saint-Lubin de Châteaudun
THE CHURCH OF SAINT-LUBIN IN CHÂTEAUDUN.
Mots-clefs : Architecture religieuse, Châteaudun, Eglise, Sépultures médiévales, Sépultures modernes.
Key-words : Religious architecture, Châteaudun, Church, Medieval burial, Modem burial.
Résumé : Etude historique et archéologique de l'évolution du plus vieil édifice chrétien intra-muros de Châteaudun, avec discussion des problèmes chronologiques qu'il soulève. Après une phase de développement qui semble durer du VIe au XIe siècle, le déclin s'amorce progressivement à la suite de l'aménagement du château médiéval, immédiatement au nord du site étudié. La fonction funéraire apparaît tardivement au XIVe siècle et se poursuit jusqu'au XVIIIe siècle.
Abstract : Historical and archaeological study of the first intra-muros Christian building at Châteaudun and discussion of the chronology. After a phase of development (6th-llth cent.), the church declines from the date of construction of the medieval castle, north of the site. The church is later used for funeral purposes (14th-18th cent.).
* 70 rue T. Divi - 28000 CHATEAUDUN.
100 R.A.C.F. 23, 1, 1984.
Fig. 1 : Croquis de localisation : A. Escarpements actuels ; B. : Castrum du Haut Moyen-Age (tracé probable) ; C. : Enceinte urbaine élargie (XIIIe siècle) ; D. : Clôture des faubourgs médiévaux et modernes ; E. : Fossés du château (fin Xe ou début XIe siècle) ; F. : Edifice religieux environné d'un cimetière mérovingien ; G. : Saint-Lubin ; H. : Autre établissement religieux médiéval ; I. : Principaux axes de la voierie antique et médiévale.
Fig. 2 : Plan d'ensemble : A. : Gallo-Romain ; B. : Edifice primitif ; C. : Edifice carolingien (IXe siècle ?) ; D. : Abside profonde (Xe) ; E. : Edifice à appareil en épi (vers l'an 1000) ; F. : Parties romanes (fin XIe ou début XIIe) ; G. : Milieu XVe ; H. : Milieu XVIe ; I. : Trous de poteau ; J. : Fenêtre associée à l'appareil en épi ; K. : Fenêtre gothique. 1. : Fouille 1980 ; 2. : Fouille 1981 ; 3. : Fouille 1983. 001 à 028 : ouvertures mentionnées dans le texte. Les portes murées n'ont pas été figurées sur le plan et leur référence, indiquée à hauteur de leur emplacement, est alors soulignée.
R.A.C.F. 23, 1, 1984. 101
L'église Saint-Lubin de Châteaudun, vendue comme bien national à la Révolution, et aujourd'hui partiellement ruinée, semble la plus ancienne de la ville intra-muros. Trois années de recherche consacrées à cet édifice nous autorisent à tenter cette première et toute provisoire synthèse1.
1. LES DONNEES HISTORIQUES.
Dès la fin du XIXe siècle, un érudit chartrain, l. merlet (1863) avait reconnu l'ancienneté de l'édifice. Selon la vie de saint Aventin (acta sanctorum, 4 février), récemment revalorisée par une étude (blanchart-lemee 1981) concernant un autre site mentionné par cette source hagiographique tardive, il aurait été bâti de ses propres deniers par le saint évêque qui l'aurait alors dédié à saint Etienne. Celui-ci restera, en effet, le second patron de l'église jusqu'à la Révolution. Elle aurait pu avoir dès cette époque - la fin du Ve siècle ou le début du VIe siècle - un rang episcopal puisqu'Aventin a signé comme évêque de Dun au concile d'Orléans de 511. Les actes sont cependant moins crédibles lorsqu'ils en font l'évangélisateur de sa ville.
Quoiqu'il en soit, l'édifice a bien dû avoir temporairement ce rang episcopal sous le règne de Sigebert puisque Grégoire de Tours nous rapporte qu'un prêtre de Châteaudun nommé Pro- mothe en obtint de devenir évêque de sa ville. Il est d'ailleurs possible que le changement de dédicace de l'édifice - dont le prétexte fut le miracle réalisé dans la paroisse par Lubin, abbé de Brou, puis évêque de Chartres au milieu du VIe siècle - ait été destiné à effacer les traces de cette volonté d'autonomie locale. Les dédicaces à saint Lubin semblent, en effet, au terme de l'étude que nous leur avons consacrée2, très anciennes dans leur majorité. Des arguments variés (témoignages archéologiques, attestations historiques, contamination de la vie de saint Lubin et de diverses traditions liées à des édifices consacrés à ce saint, par des éléments mythologiques païens...) invitent à faire remonter son culte très tôt après sa mort. 1. La présente étude remplace la courte note publiée dans le Bull, de la Soc. Arch, d Eure-et-Loir, 1981, 3e trimestre, p. 31-36, rédigée à partir des seules informations de la campagne de fouilles 1980 et dont quelques données sont à reprendre. 2. Rapport de fouilles 1981 , annexe n° 4, 20 pages dactylographiées. Consultable à la Bibliothèque Municipale de Châteaudun. Certains éléments de l'étude sont là aussi dépassés.
L'église serait restée le seul édifice intra- muros de Châteaudun jusqu'au IXe siècle au moins (merlet et jarry 1896, xiii). Vers 1071, Guillaume gouet la donnera à Saint-Père de Chartres, qui y installera un prieuré. Il est possible qu'il s'agisse, ici, de la régularisation d'une usurpation déjà ancienne3. En tout cas, elle semble s'accompagner d'un certain déclin de l'édifice. Sous l'impulsion comtale, c'est La Madeleine, bâtie hors les murs, qui deviendra dorénavant le principal pôle religieux de Châteaudun. Saint-Lubin devra désormais se cantonner dans le rôle d'une paroisse riche mais de faible population, puisque correspondant assez exactement à un quartier - au sens étymologique - de la ville forte. L'incendie de 1723 aura pour conséquence d'amorcer une dégradation du contenu social de la paroisse qui débouchera sur sa suppression lors de la Révolution. Devenu atelier d'armements, puis habitation avec jardin et écurie, il n'avait plus en 1980 qu'une fonction de dépotoir et de poulailler. Le rachat des ruines par la municipalité va dorénavant poser le problème de leur remise en valeur.
2. UNE HISTOIRE COMPLEXE DONT TEMOIGNENT LES FLUCTUATIONS DU PLAN.
La valeur de ce dossier historique semble confirmée par les témoignages archéologiques, notamment les multiples vicissitudes que le plan de l'édifice a connues.
Dans son premier état, l'édifice devait s'ordonner en fonction d'un module rectangulaire dont nous avons pu retrouver partiellement les murs sud et est lors de la campagne de fouilles 1981. Le mur sud a été dégagé sur environ 5 m de longueur à la base du mur sud de la nef 3. Le donateur, futur possesseur des cinq baronnies du Perche Gouet, s'y présente comme possesseur de l'honneur des Alluyes. Nous savons, par ailleurs, que FULBERT de Chartres avait eu dans les premières années du XIe siècle des démêlés avec le seigneur de ce lieu qui abritait un certain ARNULPHE casatus de l'église de Chartres et sans doute seigneur d'Yèvre le Châtel. Or GUILLAUME donne avec l'église le lieu qui la jouxte nommé « les cours d'ArnouIt » ainsi qu'un chevalier. Il précise aussi - ce qui n'est peut-être pas qu'une clause de style - qu'il donne l'église pour le salut de son âme et de celle de ses ancêtres. De plus, ce texte, qui semble avoir été rédigé peu de temps avant la mort de sa mère - sans doute en 1071 selon CUISSARD, Bull, de la Soc. Dunoise, Tome 7, p. 295 -, suit de peu son approbation de la restitution à Saint-Père des restes de l'ancien monastère de Brou.
102 R.A.C.F. 23, 1, 1984.
actuelle, tandis que le mur oriental a été rencontré perpendiculairement au précédent à hauteur du net décrochement séparant aujourd'hui le chœur de la nef. Ce premier édifice a peut-être été assez anciennement agrandi par l'adjonction d'une abside semi-circulaire peu profonde qui n'a pu encore faire l'objet de recherches mais dont plusieurs indices suggèrent la possibilité (disposition et altimétrie d'un pavement de brique entrevu au-dessus du mur oriental arasé lors de la fouille 1981 ; amorce de cette abside probable visible sur une trentaine de centimètres à la base du mur sud actuel du chœur, immédiatement à l'est du décrochement signalé plus haut, côté externe de l'édifice).
Un second état certain a été exhumé en 1980. Il s'agit d'un segment d'une abside plus profonde correspondant à un chœur un peu moins long mais plus large d'au moins 3 m par rapport à l'actuel. Cet édifice a été postérieurement réduit pas la construction d'un mur droit, retrouvé seulement en fondation et barrant cette abside à sa base ainsi que par la mise en place du mur nord actuel de la nef et probablement de la partie occidentale du mur nord du chœur (aujourd'hui non observable).
Dans une étape ultérieure, le chœur va être à nouveau approfondi par une abside demi-circulaire qui lui donnera ses dimensions actuelles. Il ne restera plus, pour compléter le plan général, qu'à ajouter deux éléments ; l'allongement de la nef vers l'ouest d'environ 4 m4 et l'implantation d'un clocher latéral et d'un porche aujourd'hui disparus mais connus par une description du XVIIIe siècle5 et attestés par l'examen de l'élévation sud de la nef.
3. L'EDIFICE PRIMITIF.
Il nous est très mal connu car rien n'a subsisté au-dessus du niveau du sol actuel. Toutes nos connaissances proviennent donc de la seule campagne de fouilles 1981. Elle nous a permis
4. Sans doute au XVIe siècle, si l'on en croit un marché passé en 1547 (MERLET 1886) qui présente cependant quelques difficultés au niveau des dimensions mentionnées (« troys toises de dedans en dedans »). 5. Manuscrit de P.D. BOISGANIER, Archives Départementales, Chartres, série G, supp. 757, dont la partie consacrée à la description de l'église et de son mobilier a été publiée (JUSSELIN 1963).
d'ébaucher quelques idées sur le plan, et nous a appporté quelques lueurs sur les procédés de construction, la durée d'utilisation et l'aménagement intérieur.
Les vestiges de murs dégagés possèdent environ 1 m de commandement dont le tiers supérieur seulement semble se rapporter à la partie originellement en élévation. Les murs est et sud paraissent assez dissemblables, bien que relevant peut-être de la même campagne de travaux. Les différences d'aspect doivent être liées aux problèmes de pente qui ont nécessité l'établissement d'une fondation d'un type différent pour le mur méridional. A l'est, la fondation - construite avant celle du mur sud - se réduit à une tranchée peu profonde creusée dans des remblais de terre noire contenant des tessons gallo-romains. Son fond avait été tapissé d'une sorte de hérisson de pierres incluant également quelques fragments de briques ou de tuiles. Au-dessus, dès la troisième assise, nous avons pu observer un parement relativement soigné avec des blocs soigneusement taillés en tête, aux arêtes généralement assez vives et assemblés assez parfaitement pour que le battage du mortier ne l'ait pas toujours fait refluer aux têtes de joints montants. Certains joints donnent ainsi l'impression d'être vifs. Cependant, l'hétérogénéité des dimensions, de la nature géologique et de la forme des blocs employés, ainsi que les variations d'épaisseur des joints laissent soupçonner le réemploi des blocs les mieux taillés et ajustés. En raison d'une pente plus forte en direction de l'ouest, le mur sud a nécessité l'établissement d'une fondation d'un type différent, à redans avec des assises obliques. L'horizontalité a été rétablie par l'amincissement progressif des lits vers l'est. Pour ce faire, on a employé des moellons de plus en plus minces, parfois faits d'une craie plus tendre que le calcaire de Beauce massif qui constitue l'essentiel de la fondation, puis la brique et même un fragment de tuile. Au-dessus, débutent trois assises horizontales qui correspondent à la partie inférieure de l'élévation de l'église primitive. Nous sommes ici en présence d'un petit appareil moellonné, grossièrement équarri, enfermant un blocage de moellons (avec une forte proportion de silex à la base de la fondation où l'implantation d'une sépulture nous a permis d'entrevoir le mur en coupe) noyé dans un bain de mortier.
Au niveau de la première assise régularisée, nous avons observé les témoins des sols les plus
R.A.C.F. 23, 1, 1984. 103
Fig. 3 : Détail de l'appareil du mur est de l'édifice primitif (mire : 50 cm).
Fig. 4 : Angle sud-est de l'édifice primitif : opposition des deux types de fondation (mire : 50 cm).
Fig. 5 : Emploi de la brique pour amincir les assises de fondation du mur sud de l'édifice primitif (mire : 50 cm).
anciens. Ceux-ci semblent témoigner d'une longue période d'utilisation de l'édifice. Ils consistent en des couches de mortier jaune pulvérulent séparées par de fines couches noirâtres parfois d'aspect cendreux et pouvant correspondre à plusieurs recharges sur le témoin le mieux préservé, mais il en a vraisemblablement existé bien davantage car les sépultures tardives n'ont laissé subsister que des témoins de médiocre étendue toujours entamés dans leur partie sommitale.
La partie orientale de l'édifice semble avoir été légèrement surélevée d'environ 15 cm (fig. 26). L'existence de deux trous de poteaux non contemporains atteste l'entretien ou la réfection d'une structure de bois sur le flanc sud de cette plate-forme à environ 1 m du mur méridional. Le sol semble avoir été revêtu de carreaux de brique - de plus de 20 cm de côté - dès le premier état, puisque la moitié d'un exemplaire a été recueilli en place au-dessus du mur d'un édifice précédent arasé. Ce mode de pavage continuait d'exister lorsque le mur est du premier état a été arasé. Des.éléments comparables ont en effet été observés à son sommet.
4. LES VESTIGES CAROLINGIENS.
Le mur sud de l'église a conservé en élévation des vestiges présentant des caractères archaïques qui incitent à les rapporter aux temps préromans. C'est notamment le cas d'une porte ancienne en plein cintre, située à l'extrémité orientale de la nef, 2,75 m environ avant le décrochement marquant le début du chœur. Pour plus de commodité, nous lui atribuons ici la référence 001. Sa largeur est de 1,20 m ; sa hauteur maximale sous voûte de 2,19 m au-dessus de l'horizontale réglée - du côté intérieur - par l'installation de briques à une cote identique sous chacun des piédroits.
En 1982, nous avons pu dégager le cintre de cette porte, aujourd'hui murée, des enduits récents qui en dissimulaient le côté extérieur. Nous avons alors pu lire une intéressante composition architecturale, presque intégralement restituable en dépit des injures que le temps lui avait fait subir. Les claveaux en craie tendre sont assez épais (14-17 cm à l'extrados, 11-12 cm environ à l'intrados) et d'une taille assez soigneuse. Leur longueur semblait être de 32 cm si
104 R.A.C.F. 23, 1, 1984.
l'on en juge par le seul exemplaire qui nous soit parvenu intact. Ils étaient liés par des joints de couleur crème, assez fins (1 cm) et extradossés par un cordon de briques de 4 cm d'épaisseur. Celui-ci était doublé à une distance de 19 cm par un second cordon de briques de 3 cm d'épaisseur disposé de manière parallèle en demi-cercle. Les deux cordons déterminaient un registre rempli par un appareil géométrique décoratif constitué de pierres cubiques d'environ 11 cm d'arête disposées sur la pointe. Les piédroits ont été endommagés par des reprises postérieures et ils sont partiellement enterrés. Ils laissent cependant entrevoir la présence de blocs de grès rous- sard de forme allongée disposés symétriquement - à la même cote -. Ils incorporent également des pierres de calcaire de Beauce assez bien taillées en tête, ainsi qu'au moins un bloc assez conséquent d'un calcaire à lamellibranches (24 x 30 cm), le tout lié par un mortier blanc de compression à joints assez épais. Au-dessus de cette porte, règne un petit appareil moellonné taillé en tête dont les assises sont soigneusement réglées. Enfin, 1 m environ au-dessus.de l'intrados se trouve une arase constituée de deux rangs de briques disposées en liaison (de 4 cm d'épaisseur pour l'assise inférieure et 3 cm pour la supérieure) que l'on peut suivre sur 1,30 m de longueur.
Du côté intérieur, les mêmes éléments se retrouvent au sein des piédroits : blocs allongés de roussard, blocs de calcaire à lamellibranches de module plus conséquent (25 x 30 cm ou plus)... mais aussi faiblement conservées sur environ 70 cm de longueur, les amorces de deux arases de brique distantes d'un peu plus de 30 cm. Par contre, le cintre a été profondément remanié postérieurement et nous ne pouvons proposer qu'avec d'extrêmes réserves, vu la faiblesse du fragment conservé, la restitution probable d'un cordon demi-circulaire de briques extradossant originellement le cintre.
Au niveau stratigraphique, il semble avoir existé un état intermédiaire entre ces vestiges carolingiens et l'édifice primitif. J'ai pu en effet observer : - d'une part, l'existence, au-dessus du mur sud arasé de l'édifice primitif, d'un replat sur lequel deux couches successives de mortier jaune séparées par une couche grise cendreuse ont été étendues. Ces couches de mortier se relient à des enduits jaunes qui recouvrent la base du mur au-dessus du replat mais en-dessous des piédroits de 001 dont l'installation
ble avoir nécessité des reprises à l'enduit rose sur les précédents. Un seuil moulé par l'enduit jaune s'ouvre sous 001, très légèrement désaxé par rapport aux piédroits. - D'autre part, l'établissement d'un nouveau sol en mortier rose lissé, se reliant aux reprises d'enduit mural rose semble correspondre à l'installation de 001. En effet, on voit l'enduit rose s'appuyer sur la base des piédroits alors que le seuil a été obstrué jusqu'à la hauteur des briques réglant leur stricte horizontalité.
On pourrait donc émettre l'hypothèse que les vestiges carolingiens sont contemporains de l'édifice à abside large et que l'état intermédiaire correspond à la phase d'agrandissement de l'édifice primitif par une abside peu profonde que nous avons indiquée plus haut comme probable. Cependant, d'autres observations s'opposent à cette manière de voir. Des considérations altimétriques d'abord, mais aussi l'existence au niveau du sol extérieur actuel d'une arase de briques que l'on peut suivre sur 50 cm à la hauteur du décrochement chœur-nef et sous le piédroit ouest de 002, là où l'abside probable semble s'amorcer. Cela nous entraîne plutôt à proposer l'hypothèse que les vestiges carolingiens correspondent à cette abside peu profonde et l'état intermédiaire à un édifice de même plan que le primitif. Cette hypothèse a aussi pour elle diverses autres observations sur la répartition des enduits et sur les remaniements nécessités par l'établissement d'un nouveau sol au-dessus de l'ancien mur oriental arasé de la nef primitive. De toutes manières, le problème ne pourra être véritablement résolu avant l'exécution d'une fouille prolongeant celle de 1981 à l'est ; et pour l'instant notre connaissance de cet état intermédiaire se limite à peu de choses : un bloc (30 x 30 cm) réutilisé dans l'état carolingien et présentant des traces de peinture rouge malheureusement peu lisibles qui devait primitivement se situer à l'angle supérieur d'une porte de forme rectangulaire et qui nous atteste que cet état intermédiaire devait posséder une décoration peinte.
5. REPARATION ET EXTENSION DE L'EDIFICE CAROLINGIEN.
L'hypothèse émise ci-dessus nous entraîne à admettre une histoire relativement complexe
PORTE 001
FACE INTERNE FACE EXTERNE
■— "OQ-
, 4 D
////« A rrn b — c Effl D
.1m
Fig. 6 : Porte 001 et mur sud de la nef : A. : Replat marquant le niveau d'arasement de l'édifice primitif ; B. : Enduit jaune moulant le seuil lors du premier état de la porte 001 ; C. : Brique ; D. : Eléments en grès roussard. 1. : Sol plusieurs fois rechargé de l'édifice primitif ; 2. : Sols intermédiaires ; 3. : Sol carolingien en mortier rose lissé ; 4. : Niveau du sol en 1979.
F'9- 7 : Porte 002 : originellement voûtée en plein cintre, elle a fait l'objet d'une tentative visant à la retailler pour lui donner une forme rectangulaire.
106 R.A.C.F. 23, 1, 1984.
pour l'église carolingienne. L'examen des vestiges en élévation et les découvertes de la campagne 1980 nous amènent en effet à constater d'importants travaux de réparation et d'agrandissement de cet édifice.
Les travaux de réparation concernent notamment la porte 001 dont le cintre a été presque entièrement repris du côté intérieur et a subi d'importantes consolidations du côté extérieur. En décrivant6 la face interne de 001 en 1981, j'avais émis l'hypothèse que la majeure partie du cintre puisse avoir été refaite postérieurement et appartienne à une phase de construction plus récente que les piédroits, qui aurait pu être contemporaine de l'érection de la porte 002 sise à l'entrée du chœur, côté sud. Je me fondais alors sur : - la présence de joints similaires assez épais (2 à
3 cm), en mortier rose, présents aux piédroits et au cintre de 002, mais seulement employés pour les deux-tiers supérieurs du cintre de 001.
- la présence de claveaux de craie de dimensions et de forme voisines dans les deux cintres, à la seule exception des deux premiers claveaux occidentaux de 001 qui étaient de forme trapézoïdale et liés par un mortier gris.
- l'utilisation de la brique (une dans les piédroits de 002, deux utilisées comme claveaux aux cintres de 001) avec notamment dans ce dernier cas, la présence d'un bloc curieux. Il associe, dans une position proche de la clef de voûte, une brique assez longue (36 cm) et un claveau de grès roussard plus court (27,5 cm) liés par un joint que sa couleur crème et sa faible épaisseur (inférieure à 1 cm) rendaient unique au sein de ce cintre. La liaison avec les deux claveaux voisins se faisait à joint vif, exclusivement par le jeu des pressions latérales. Le tout suggérait l'idée d'un bloc appartenant à un arc détruit et qui aurait été réemployé dans une réparation sommaire et sans doute hâtive.
Les deux arcs présentent cependant quelques différences, notamment dans la présence de claveaux en roussard disposés sans réelle symétrie, mais selon un certain rythme cependant, uniquement dans 001. L'extradossage de 002 paraît également plus soigné (avec l'existence d'un large joint de mortier rose venant régulariser l'extrados) que celui de 001 (extradossage en escalier assez grossier avec des bourrages de mortier rose et gris). Ces faits ne contredisaient 6. Rapport de la deuxième campagne de fouilles, paragraphe 411.
pas obligatoirement l'hypothèse émise, surtout si l'on admet que la réparation de 001 a été accomplie rapidement en première urgence, alors que 002 a été exécutée quelques mois ou années plus tard dans le cadre d'un agrandissement programmé de l'édifice. Depuis 1982, il ne subsiste plus de doute possible puisque le dégagement de la face externe de 001 a montré que les claveaux du cintre primitif avaient été endommagés et que ledit cintre avait dû subir d'importantes réparations effectuées au moyen de claveaux de craie, utilisés de concert avec quelques briques. L'analyse statistique semble même démontrer que les claveaux utilisés pour la réparation des deux faces de 001 et la construction de 002 durent souvent provenir du réemploi de claveaux comparables à ceux de l'arc primitif de 001, retaillés et sans doute fréquemment divisés en deux. En effet, la longueur des claveaux de l'arc primitif semble légèrement supérieure (30 à 32 cm contre 26 à 29 cm) et leur épaisseur semble en moyenne double (11 à 16 cm à l'intrados contre 5 à 8,5 cm ; 14 à 19 cm à l'extrados, contre 6,5 à 11 cm).
D'autres traces de réparations sont probablement attestées au mur sud de la nef, côté interne, par une reprise en appareil grossièrement cubique de faible module lié par un mortier blanc de compression très pulvérulent.
Cette reprise a recoupé les arases de brique précédemment décrites à la base du piédroit ouest de 001. Du côté externe, toute la partie comprise entre les portes 001 et 006 (par où l'on entre aujourd'hui depuis la ruelle Saint-Lubin) ne laisse plus de trace d'arasés. On y trouve au voisinage de 001 un petit appareil assez soigneusement taillé, de module cubique (11 cm d'arête) assez régulier, en calcaire de Beauce. Il est difficile de juger de son association ou non avec les arases de brique, en raison des réparations apportées à 001. On peut noter que quelques éléments cubiques ont été utilisés (ou réutilisés ?) pour remplacer une brique (Fig. 6). Mais de tels éléments entraient déjà dans l'appareillage du piédroit interne oriental qui ne semble pas avoir été remanié. C'est un appareil un peu comparable, bien qu'apparemment moins soigné, que l'on observe à l'est de 002 du côté intérieur. Mais le piédroit oriental de 002 ayant disparu, il est difficile pour l'instant de démêler l'histoire de ce segment de mur et de se prononcer sur l'appartenance de 002, soit à l'édifice à appareil en épi, soit à une campagne antérieure d'agrandissement de l'édifice.
R.A.C.F. 23, 1, 1984. 107
DO
Fig. 8 : Abside profonde arasée : A. : Mortier jaune pulvérulent ; B. : Terre noire incluant quelques fragments de charbon de bois ; C. : Traces de mortier beige indiquant la présence du mur 1059 avant sa destruction par les tombes postérieures ; D. : Brique ; E. : Terre noire incluant des tessons gallo- romains ; F. : Sol naturel (argile à silex). 1. : Niveau de régularisation des deux assises inférieures débordantes de la fondation ; 2. : Replat indiquant le début de l'élévation ; 3. : Bloc appartenant au mur 1059.
Ces travaux d'extension de l'édifice ont été mis en évidence par la découverte, en 1980, des vestiges d'une abside profonde, dont le diamètre à l'ouverture semble de l'ordre de 10 à 11 m. Il est possible que cette largeur soit héritée de l'édifice primitif. Le mur exhumé est épais de 1,10 m à son niveau d'arasement et d'environ 1,80 m à la base de la fondation. Il était constitué de deux parements en petit appareil moel- lonné7 incorporant des éléments variés : des pierres de petit appareil assez soigneusement taillées selon un module cubique d'environ 10 cm d'arête, démaigries en queue, généralement en calcaire de Beauce ; des silex et d'autres moellons mal taillés utilisés surtout dans les parties invisibles ; quelques éléments de forme allongée ne dépassant jamais le module 10 x 20 cm et généralement en calcaire tendre. Il faut faire une place à part à un élément de réemploi de 8 x 12 cm, soigneusement taillé et orné d'une moulure de 2 cm de large à la base, qui peut peut-être provenir d'une corniche. Ces éléments étaient maintenus par un blocage interne de mortier gris, brassé avec un sable non criblé et étendu par assises successives d'environ 10 cm de hauteur incluant de gros moellons bourrus. Episodiquement, le battage avait pu faire refluer le mortier jusqu'aux têtes des moellons, mais il n'existe pas de véritable joint montant égalisé. La fondation présente un léger fruit et repose sur deux assises plus larges, implantées directement sur le sol naturel. Environ 0,60 m au-dessus de ces deux assises, un léger replat de 7 à 8 cm s'esquisse. Vers l'ouest du sondage de 1980 et en raison de la pente qui s'accélère, la fondation devient plus profonde et l'on y observe l'emploi à plusieurs reprises, sans doute à fin de réglage de l'horizontalité, de briques et d'éléments fins de calcaire tendre. On a particulièrement remarqué cet emploi pour l'assise délimitant le replat, ce qui constitue un argument supplémentaire pour localiser à ce niveau le sol contemporain de la construction8. L'altimétrie autorise à relier ce niveau à celui identifié sous la référence 2026 durant la campagne 1981. Ce
Fig. 9 : Mur 1059 : vue de la base de la fondation très perturbée par les tombes médiévales et modernes (mire : 50 cm).
7. Je reprends, pour la description des appareils, l'essentiel des catégories explicitées par G. PLAT, 1939, Chap. 1. 8. Ayant repris en 1982 l'étude de ces vestiges, j'ai pu corriger quelques erreurs, dues à l'emploi d'un matériel insuffisamment précis, et qui étaient contenues dans le relevé primitif. J'ai donc pu vérifier que ce replat était quasi horizontal et non en légère pente comme le suggérait le relevé de 1980. De même, en ravivant la coupe du témoin conservé dans l'angle sud-ouest du sondage, j'ai pu mettre en évidence sur ce replat, l'existence d'une couche noire contenant quelques traces de charbon de bois qui était sûrement antérieure à la construction de l'édifice à appareil en épi.
108 R.A.C.F. 23, 1, 1984.
dernier semblait correspondre, dans le chœur, au sol contemporain de la construction de 002 et dans la nef, à un exhaussement très net du sol (30 cm). Celui-ci était cependant plus limité que celui intervenu dans le chœur (environ 45 cm), ce qui, joint à la différence de niveau préalable et au désir probable des constructeurs de garder simultanément en activité les deux portes 001 et 002, les a contraints à l'établissement d'une pente assez forte (une dénivellation d'environ 45 cm rachetée en 2,50 m) à l'extrémité orientale de la nef. Il n'a pas été observé à cet endroit de dispositif pouvant faire songer à l'établissement de marches (Fig. 26).
6. L'EDIFICE A APPAREIL EN EPI.
L'édifice à abside profonde ne semble pas être resté longtemps en activité. Il n'a pas été retrouvé de témoin d'un sol qui puisse lui être associé, mais seulement la petite couche noire signalée à la note 8. Celle-ci constitue sans doute la trace d'un événement fortuit, ayant nécessité l'interruption du chantier9. Il est même probable que cet édifice n'a jamais été terminé et que, suite à cette interruption, on ait remanié les projets primitifs et construit le mur droit 1059 qui ferme l'abside à l'est. Ayant été profondément entamé par des sépultures postérieures, il n'a pu être retrouvé qu'en fondation, sur une hauteur de 0,40 m au maximum. Large de 1,80 m cette fondation était formée de moellons bourrus d'assez forte taille (jusqu'à 40 x 60 cm) enfermant un blocage de moellons plus petits liés par un mortier beige dont on a aussi observé les traces plus haut, sur le mur de l'abside. Un bloc, qui devait se situer originellement en élévation, s'est trouvé conservé à la valeur de la petite corniche marquant le début de l'élévation de l'abside précédente. C'est sous ce bloc que nous avons pu observer la petite couche noire.
L'installation de ce mur droit semble avoir correspondu à un rétrécissement de l'édifice qui trouve alors la largeur qu'il a conservée jusqu'à aujourd'hui : 7,50 m dans la nef, 6,75 m dans le chœur. Ce dernier devait alors posséder une longueur d'environ 7,30 m et avoir une forme presque carrée.
Des vestiges assez conséquents de cette église subsistent en élévation, notamment toute la partie supérieure du mur sud de la nef. Ils consistent d'abord en un chaînage d'angle ouest de blocs de module varié, mais fréquemment de grand appareil allongé (dimension maximale 0,35 m x 1,30 m). Les joints étendus à la truelle sont épais (de 1,7 cm à 4 cm ; le plus fréquemment de 2 à 3 cm); et en mortier de tuileaux rose. Au-delà débute un mur à appareil en épi, à mortier gris mis en place par compression, percé à intervalles réguliers (environ 2,65 m, soit 9 pieds romains) de trois fenêtres d'environ 88 cm (soit 3 pieds romains) dont l'appui se situe à environ 5 m au-dessus du sol contemporain. L'ensemble (3 fenêtres de 3 pieds séparées par 4 intervalles de 9 pieds) donnait une longueur de 45 pieds à la nef - du côté intérieur -. Nous sommes donc en présence d'un plan soigneusement établi, témoignant d'une véritable campagne de reconstruction de l'édifice10. Deux de ces petites fenêtres ont été bouchées postérieurement, mais la dernière, qui est aussi la mieux conservée en élévation, nous montre un ébrasement intérieur marqué (l'appui est environ 45 cm au-dessus de l'allège). Les montants sont constitués de pierres taillées de module varié, mais toujours faible et de forme allongée (hauteur 4 à 12 cm, longueur descendant rarement au-dessous de 20 cm), disposées sans symétrie et appareillées avec un mortier rose de tuileaux, à joints épais (rarement inférieurs à 3 cm, mais pouvant atteindre le double). Cette fenêtre, comme les deux autres, a vu sa partie supérieure arasée après la vente de l'édifice comme bien national. Nous ignorons donc si sa partie supérieure était cintrée - comme il semble probable -. En tout cas, au niveau d'arasement, soit 0,90 m au-dessus de l'appui, nous n'observons encore aucun départ de cintre. La fouille 1983 a permis de constater l'emploi du même type d'appareil allongé au piédroit de la porte centrale de la façade. De plus, un enduit de mortier rose parfaitement lissé a été ici appliqué sur le tableau du piédroit. Côté extérieur, les principales observations effectuées semblent indiquer que des parties antérieures assez conséquentes semblent avoir été conservées en soubassement de cette élévation sud. L'exhaussement du terrain au cours des siècles ne permet cependant pas d'en avoir la certitude. Outre la porte 001 et son environnement immé-
9. On peut songer à un incendie, en rapport ou non avec d'éventuels combats autour des remparts, tout proches, de la ville.
10. Les dimensions mentionnées témoignent d'un choix mathématique et esthétique, mais peut-être aussi symbolique : on remarque notamment l'importance du chiffre 3 : 45 = 5x3x3 = (4 x 3) x3 (intervalles) + 1x3x3 (fenêtres).
R.A.C.F. 23, 1, 1984. 109
138.31
1m.
13&3I f
Fig. 10 : Edifice à appareil en épi : chaînage d'angle sud- ouest. A. : Mortier de tuileau rose ; B. : Brique ; C. : Reprises postérieures à mortier jaune.
50cm
diat qui sont sûrement plus anciens, on peut se demander s'il n'en va pas de même pour la base du chaînage ouest. Celle-ci présente en effet des caractères qui la rappprochent des vestiges carolingiens en grande partie enterrés qui subsistent à hauteur du décrochement de la nef et du chœur, côté externe, entre les portes 001 et 002 : pierres calcaires paraissant plus friables, de hauteur d'assises plus faible, liées par un mortier d'un rose un peu plus pâle et d'épaisseur plus régulière. La plus basse des assises observables sans fouille montre même l'emploi jusqu'à 1,60 m de l'angle du chaînage de pierres cubiques de 11 cm d'arête. Il conviendrait de dégager la base de ce chaînage afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une assise exceptionnelle, car il faut avouer que l'homogéité ne semble pas la qualité dominante dudit chaînage ! La façade de cette église à appareil en épi semble avoir été détruite au XVIe siècle11 lorsque la nef a été agrandie de 4 m environ vers l'ouest. Cependant son emplacement est parfaitement restituable puisqu'un chaînage comparable est observable au sein du mur nord de la nef. Ce dernier, dont la base est cachée par d'importants remblais qui ne laissent apercevoir que l'extrémité supérieure du cintre de la porte 004 entièrement visible sur le plan de belleforest a vu sa partie supérieure presqu'entièrement reprise, sans doute à l'époque où l'on a mis en place les fenêtres gothiques qui la percent aujourd'hui. Cette reprise a néanmoins laissé subsister l'intégralité du chaînage en grand appareil allongé à mortier rose comme son symétrique du mur sud. Quelques pierres disposées en épi et liées à mortier gris témoignent sans ambiguïté de l'existence préalable d'un mur à appareil en épi contemporain du chaînage, - la reconstruction s'étant faite en employant un mortier jaune -. Il est difficile de juger de l'ampleur de cette reconstruction du côté extérieur, puisque de forts remblais, apportés depuis le début du XVIIe siècle, en dissimulent la base. Elle semble cependant avoir été
Fig. 11 : Fenêtre 021 associée à l'appareil en épi (face interne du mur sud de la nef) : A. : Mortier de tuileau rose ; B. : Brique.
11. Le plan de BELLEFOREST, publié en 1575, nous présente un pignon triangulaire percé de deux petites fenêtres cintrées. Il ne fait pas de doute qu'il s'agit bien de la façade antérieure à l'actuelle. La position d'une porte 004, représentée entre les deux fenêtres du mur nord de la nef, ne laisse aucune place à l'incertitude. Il faut donc penser que le plan s'appuie sur des données un peu antérieures, sinon cela compliquerait encore le problème posé à la note 4. Pour tout simplifier, le portail flamboyant qui orne la façade actuelle doit dater probablement du milieu du XVe siècle. Il aurait donc été conçu pour la façade antérieure, et déplacé lors de l'agrandissement de l'édifice. Cette hypothèse qui peut d'ailleurs s'appuyer sur le fait que cette ouverture, aujourd'hui murée par le béton, ne possède pas la même forme côté interne et côté externe, a été confirmée par la fouille 1983.
110 R.A.C.F. 23, 1, 1984.
plus importante du côté interne où le parement semble avoir été refait jusqu'au niveau du sol actuel et ne laisse subsister aucune trace de l'ouverture 004. Le nouveau parement est assez hétérogène, tant du point de vue de la hauteur des assises que des blocs utilisés de dimensions peu régulières, parmi lesquels on distingue de nombreux éléments de réemploi (quelques blocs de grès roussard, mais aussi et surtout d'assez nombreux éléments de calcaire à la taille très soigneuse, pouvant provenir de l'édifice préroman et réutilisés comme simples moellons). A l'autre extrémité du mur nord de la nef, au décrochement la séparant du chœur, il subsiste un contrefort rectangulaire de 0,45 x 0,60 m monté en moyen appareil à joints roses. La partie inférieure enterrée sous les épais remblais, déjà mentionnés, ne permet guère d'apprécier sa hauteur. De toute façon, la partie supérieure semble avoir été détruite. La face est de ce contrefort est chaînée avec ce qui semble le départ d'un « mur-pignon », en appareil allongé lié à joints roses, qui forme le court décrochement sur lequel vient s'appuyer le mur nord du chœur. Il n'est pas assuré que celui-ci soit chaîné avec ce « mur-pignon ». Il n'est pas sûr non plus que ce mur appartienne à la même campagne de travaux que celle qui a édifié les parties à appareil en épi. Il est vrai qu'il est peu visible. Sa base est dissimulée par les remblais et son sommet a été arasé, selon un niveau horizontal correspondant à l'allège des fenêtres du chœur et donc probablement lors de la construction de ces ouvertures au milieu du XVe siècle. Du côté intérieur, la plus grande partie en est cachée par une construction parasite érigée au XIXe siècle. Ce qui rete observable montre des dispositions en épi assez nettes dans les parties hautes, un peu en dessous du niveau d'arasement.
Le sondage de 1980 a permis d'observer, dans son angle sud-ouest, un médiocre témoin d'un sol indubitablement associé à 1059. Il se situait à une altitude supérieure d'environ 15 cm à celle du replat signalé dans la description de l'abside profonde. Le sol du chœur paraît donc avoir été, alors, légèrement exhaussé. Nous avons, par contre, toutes les raisons de penser que le sol de la nef a gardé le même niveau.
Fig. 12-: Edifice à appareil en épi : chaînage d'angle nord- ouest. Ajdroite, maçonnerie du XVIe siècle ; à gauche reprise du XVe siècle.
i \ i
Fig. 13 : Terre cuite moulée ( h = 7,5 cm, L = 13 cm) trouvée avec quelques autres fragments dans un dépotoir postérieur à la désaffectation de l'édifice. Ce fragment daterait, selon Jean Chapelot, soit de l'époque gallo-romaine, soit plus pro
bablement, en fonction du contexte de la découverte, du XVII* siècle.
R.A.C.F. 23, 1, 1984. Ill
7. L'EDIFICE ROMAN.
De l'époque romane date un approfondissement assez sensible du chœur dont il subsiste d'importants vestiges. Ceux-ci se composent de deux segments de mur rectilignes d'un peu plus de 5 m de longueur, terminés par une abside demi-circulaire d'environ 6,65 m de diamètre, et laissent une impression d'archaïsme qui incite à ne pas trop les rajeunir12. On peut, en effet, observer au sein d'une maçonnerie de compression en appareil moellonné l'insertion de plusieurs chaînages en blocs de craie soigneusement taillés (dimensions 35 x 24 cm) qui contribuent à armer la structure de l'abside. A la base du mur rectiligne sud, l'on distingue deux arcades en plein cintre, reposant sur une pierre géminée servant de départ d'arc commun. Ces arcades paraissent avoir primitivement abrité des niches larges de 0,80 m et d'une hauteur maximale probable de 1,66 m. Celle de gauche a été recoupée par une ouverture plus récente (007). Par contre, celle de droite, aujourd'hui murée, possède toujours un piédroit ouest en blocs de craie (dimensions 30 x 17 cm) liés par des joints épais (1 à 3 cm) alors que les cintres semblent assemblés à joints vifs. Quelques 0,90 m plus à l'ouest, se trouve la porte murée 003 de 0,75 m de large par une hauteur d'environ 2,10 m. Seul, le piédroit ouest en grand appareil de craie est visible du côté interne. Environ 1,5 m plus à l'ouest, on reconnaît aisément le raccord avec les parties antérieures de l'édifice. Celles-ci sont en effet construites à mortier gris, alors que le parement intérieur du mur roman est lié avec un mortier jaune, incluant un sable ferrugineux assez grossier. Ce parement possède par ailleurs des assises de hauteur supérieure à celle des assises des parties antérieures. Le plein cintre de 003 est aussi observable du côté extérieur. Cette ouverture semble avoir été condamnée par suite de l'érection postérieure d'un contrefort à redans, en grand appareil, qui empêche d'apercevoir son piédroit oriental. Le piédroit ouest n'est pas observable non plus, à moins qu'il ne corresponde aux restes un peu saillants d'une structure en moyen appareil que j'interprète - de manière peu satisfaisante, peut-être - comme des vestiges de contrefort13. Pour tout clarifier, la base de 12. L'on pourrait également envisager l'hypothèse du recours à des maçons de second ordre, travaillant selon des techniques dépassées, mais cela cadrerait mal avec la qualité des propriétaires d'alors : les moines de Saint-Père de Chartres. 13. La largeur de cette structure (0,96 m) est sensiblement voisine de celle du contrefort postérieur (0,92 m), mais elle ne semble pas dépasser la hauteur du cintre de 003.
l'édifice a été ici épaissie d'environ 0,10 m par l'application sur une hauteur d'environ 2 m d'une maçonnerie assez hétéroclite, débutant 1,70 m à l'est de ces vestiges de contrefort et s'étendant jusqu'à 007. L'existence d'un mur de soutènement retenant d'importants remblais empêche d'observer la base de l'abside, mais on peut observer au-dessus de 007 quelques blocs d'un chaînage interne de cette abside, dont la partie inférieure a été supprimée par le percement de cette ouverture. Du côté nord, des enduits récents dissimulent l'essentiel du mur roman visible depuis l'intérieur. On peut juste entrevoir quelques blocs de grand appareil indiquant la présence de chaînages internes ou de piédroits. Les quelques observations que nous avons pu effectuer semblent montrer la présence d'un dispositif à arcades symétriques de celui du côté sud. Quelques traces rouges indiquaient les traces d'un décor peint sur les claveaux d'une arcade. Le parement extérieur, caché par d'épais remblais, laisse apercevoir quelques dispositions en épi, mais sans la régularité de l'appareil décrit au mur sud de la nef. Les contreforts externes du chœur laissent apercevoir des blocs chaînés de grand appareil non saillants leur paraissant antérieurs, mais nous savons par un texte de 1700 (merlet 1885, 32) que « m. maul- duit, gager, a fait enduire de ciment le dehors du chœur du côté du collège et refaire le bas de deux piliers ». Cet approfondissement du chœur ne semble guère avoir bouleversé le niveau du sol dans l'église. Le niveau du sol du nouveau chœur se situait 6 cm au-dessus de l'ancien et il semble que celui de la nef soit resté inchangé. Il semblerait par contre que la porte 006 aurait été alors ouverte dans le mur sud à appareil en épi. Son cintre, endommagé après la désaffectation de l'église, présente en effet de grandes analogies avec l'architecture du chœur, alors que l'appareil en épi a été profondément perturbé tout autour.
8. LES DERNIERES TRANSFORMATIONS.
Les murs de Saint-Lubin constituent un énorme puzzle où l'on peut déchiffrer les multiples traces d'une histoire intense qui ne s'arrête pas à l'époque romane. Aux siècles suivants, le bâtiment continue à vivre, et si nous n'avons rien d'important à reporter aux XIIIe et XIVe siècles, les XVe et XVIe siècles ont été marqués
0
Est
/ / /' Niche actuelle
1 , ..,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
1m E
Fn
a A ÎB3 B
35 80NG
a 34 80
J
— « E
^Porte 003
Ouest
II Ip^ffiT?? Il — 1^ *
Fig. 14 : Chœur roman : arcades sud et porte 003. A. : Brique ; B. : Grès roussard utilisé en remploi ; C. : Niveau du sol roman ; D. : Partie restituée (ayant été détruite lors de l'ouverture de la porte 007) ; E. : Limite des parties romanes.
Fig. 16 : Poterie à fonction acoustique encastrée dans le mur au-dessus de la fenêtre gothique 028 (milieu XVe).
\ ,,-\
t %.
Fig. 15 : Fenêtre gothique 025.
Fig. 17 : Portail principal flamboyant (façade ouest) du milieu du XVe siècle. D'abord plaqué sur la façade à appareil en épi, il a été déplacé au milieu du XVIe siècle, lors de l'agrandissement de l'édifice vers l'ouest.
R.A.C.F. 23, 1, 1984. 113
chacun par une campagne de travaux relativement conséquents14.
La première s'est surtout attachée à laisser pénétrer la lumière dans l'église15 en y perçant de larges croisées : cinq, disposées dans le chœur de manière symétrique, trois dans la nef. Il est vrai que l'édifice devait être alors assez médiocrement éclairé par des ouvertures du type de celles que nous avons décrites associées à l'appareil en épi. Cette campagne doit sans doute être datée du milieu du XVe siècle, des marchés concernant des fenêtres d'un type semblable ayant été passés à Chartres vers cette date16. De plus, L. merlet (1863) nous apprend que les verrières dataient des XVe et XVIe siècles. L'une d'elles portait l'écu de la famille d'Orléans. Le portail principal de style flamboyant17, dont un parallèle très proche existe à l'église de Jallans, doit également relever de cette campagne. Il en va -de même du clocher latéral, construit dans l'alignement du pignon ouest d'alors. Son implantation explique que le mur sud de la nef ait bénéficié d'une relative protection lors de cette campagne de travaux. On a en effet renoncé18 à y ouvrir des croisées comme dans le reste de l'édifice. On s'est contenté d'une seule fenêtre un peu plus basse, immédiatement en avant du décrochement séparant la nef et le chœur et on a dû maintenir en activité une ou deux des trois petites fenêtres préexistantes, la troisième ayant été aveuglée par la construction du clocher. Celui-ci était flanqué de quatre contreforts. Deux d'entre eux qui avaient été chaînés avec le mur sud de la nef y ont laissé, même
14. Le contexte local explique assez bien cette chronologie : après les épreuves de la guerre de cent ans, la ville se relève lentement et va connaître une brève apogée économique au cours du XVIe siècle. 15. La nécessité d'agrandir l'église n'a jamais dû être très pressante, la paroisse étant petite et ne paraissant guère avoir varié en population. Le pouillé de la deuxième moitié du XIIIe siècle lui accorde 72 « parrochiani », c'est-à-dire probablement chefs de famille selon A. CHEDEVILLE (1973) ce qui correspond assez sensiblement aux 82 maisons existant sur la paroisse à la veille de la révolution. 16. Renseignement obligeamment communiqué par M. Marcel COUTURIER. 17. Les deux culs-de-lampe qui ornent ce portail sont aujourd'hui très effacés. Selon M. ACKERMANN, l'un d'eux représentait un moine. 18. On peut se demander si cette renonciation n'a pas été aussi liée à des déconvenues survenues lors du percement des croisées du mur nord de la nef. En effet, alors que les murs du chœur ont été arasés régulièrement et à une hauteur sensiblement plus élevée, le mur nord de la nef a vu ses parements refaits à des hauteurs différentes selon les deux côtés. Côté interne, le parement a été reconstruit très bas, sans doute jusqu'à hauteur du sol puisque la porte 004 y a été totalement oblitérée.
après leur démolition, des témoignages de leur existence sous la forme de « fantômes » de moellons blancs liés à mortier jaune résultant du rebouchage des saignées des blocs chaînés.
Une seconde campagne de travaux a été entreprise au milieu du siècle suivant. Elle a consisté en un modeste allongement de la nef d'environ 4,10 m, ce qui a laissé le clocher légèrement en retrait et a nécessité l'abattage de la façade principale dont le portail a été transporté au nouveau pignon. Au milieu de ce dernier, juste au- dessus du portail, se trouvait une croisée signalée par boisgasnier et visible sur une gravure de nesle représentant la façade ouest du château de Châteaudun et exécutée vers 1750 (jusselin 1938, p. 322-24).
Signalons enfin la percée de deux portes (007 et 008) identiques par leur forme ogivale, leurs dimensions (1,34 m de large) et leur appareillage. L'une d'elles (008) a recoupé l'unique fenêtre gothique du mur sud de la nef.
L'une de ces deux campagnes de travaux a conduit à un exhaussement du sol de la nef d'environ 20 cm. Le sol du chœur ne semble pas avoir changé de niveau à cette' occasion. Le niveau du sol de toute l'église a enfin été surélevé une dernière fois au cours du XVIIIe siècle, après que l'on eut abandonné la pratique de l'inhumation à l'intérieur de l'édifice.
9. LES SEPULTURES.
Des éléments en connexion appartenant à 44 sépultures différentes19 ont été relevés, ce qui est relativement considérable pour une superficie fouillée d'environ 25 m2, soit environ le dixième de l'édifice. La densité des sépultures est d'autant plus impressionnante que le volume des ossements recueillis dans les remplissages paraît très supérieur à ce qu'exigeraient les seuls recoupements observés. Les remplissages étaient le plus souvent coalescents et formaient
19. 55 sépultures ont pour l'instant été dégagées en 1983 dans la partie occidentale de la nef (30 m2) qui a englobé au XVIe siècle une partie de l'ancien cimetière. Ceci porte à 99 le total des sépultures relevées. Sur ce chiffre, quatre avaient été creusées primitivement dans le cimetière extérieur, antérieurement au milieu du XVIe siècle.
Fig. 24 Fig. 25 Echelles graduées en cm.
Fig. 22
Fig. 18 : Pots à encens 21 (A), 1 (B), 22 (C) provenant d'une fosse réoccupée ultérieurement par la sépulture 6 R DIEHL (1984) publie un pot quasi-identique à ces vases, qu'il date très exactement entre 1528 et 1538, et qui proviendrait d'un atelier de Saint- Pierre le Potier près de Laval. Fig. 19 Fig. 20 Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25
Pot à encens (V2) et fragments attribuables au même ensemble.
Pots à encens 18 (A) et 19 (B) représentatifs d'un ensemble provenant d'une fosse réoccupée par la sépulture 44. Pots à encens de la sépulture 37 : V6 (C), V9 (B ), V12 (A), V13 (D), V14 (E), V15 (F). Pot à encens (V4). Pot à encens (V3). Pot à encens (V27).
R.A.C.F. 23, 1, 1984. 115
une couche homogène20 riche en os21 et en épingles de suaires, dépassant fréquemment le mètre d'épaisseur. De ce fait, et sauf pour les sépultures les plus profondes, il a été rarement possible de distinguer les bords de fosses.
La plupart des sépultures ont été faites en cercueil. Les inhumés reposaient sur le dos, la tête regardant vers l'est. Il n'y a que deux exceptions dont nous reparlerons plus bas. La position des bras est plus variable : la plupart avaient les deux mains reposant parallèlement sur la poitrine, mais on a observé quelques cas où une des deux mains est allongée le long du corps, l'autre reposant sur la poitrine ; enfin, il existait une sépulture où les deux mains avaient été croisées sur la poitrine.
Les inhumations d'enfants semblent avoir été rares dans le chœur et la partie orientale de la nef où aucune n'a été relevée en connexion. Les remplissages ont cependant livré quelques ossements qui indiquent qu'il a dû exister quelques cas isolés. Par contre la fouille 1983 a montré qu'elles étaient nombreuses (14 enfants en bas âge dont un inhumé au-dessus du bras de sa mère et trois adolescents) au voisinage des fonts baptismaux. Dans l'angle nord-ouest de la nef, où les fonts ont été installés postérieurement à l'agrandissement de l'édifice au milieu du XVIe siècle, quatre tombes antérieures à leur établissement sont des sépultures d'adultes, alors que sur les neuf tombes postérieures, quatre appartenaient à des enfants en bas-âge et deux à des adolescents.
Six ou sept22 de ces inhumations comportaient des vases funéraires, mais dans tous les cas, les sépultures avaient été perturbées par des recoupements de fosses postérieures. Il n'y a qu'un seul cas (S37) où nous sommes absolument certains d'avoir retrouvé le squelette primitivement associé aux vases. Nous allons examiner successivement les divers cas observés en insistant sur les quelques éléments relevés concernant la
20. Cette couche de remplissage avait réduit les traces de la plupart des sols anciens à de maigres témoins de très faible extension et même « digéré » sur un mètre de hauteur un mur de fondation de près de deux mètres de large ! 21. Les fossoyeurs semblent avoir procédé, lors de l'exercice de leurs fonctions, à un certain nombre de regroupements d'ossements au-dessus des cercueils. Nous avons observé plu- seurs de ces amoncellements qui paraissaient intentionnels, notamment au-dessus de S12 et surtout de S2 où trois crânes en assez bon état de conservation avaient été regroupés. 22. Nous avons un doute en ce qui concerne les deux vases apparemment associés à la sépulture 14. Cf. plus loin.
répartition des vases dans la sépulture et les indices chronologiques : - le vase VI a été retrouvé intact, le col en bas
avec les charbons ayant servi à brûler l'encens éparpillés à proximité immédiate. La fosse, sur le bord de laquelle il se trouvait, a été postérieurement réoccupée selon un axe légèrement différent, mais il ne fait aucun doute que le vase était disposé le long du cercueil à proximité des pieds. Il s'agit d'un vase de petite taille de forme circulaire, avec une anse se détachant de la lèvre pour venir s'appuyer sur la base de la panse. Le diamètre de celle-ci est identique à la hauteur totale du vase (7,7 cm). Il est de couleur noire avec des cannelures sur la panse. De nombreux tessons de vases du même type et de dimensions similaires (diamètre de la panse variant entre 7,7 et 8,2 cm) ont été recueillis au fond de la fosse et ont pu être recollés avec des tessons provenant des remplissages permettant d'affirmer qu'il y avait au moins cinq vases dans la sépulture concernée. Aucun de ces vases n'avait la panse percée. Stratigraphiquement, VI est antérieur à S3, elle-même antérieure à S2 qui semble pouvoir être exactement datée de 1614. Il s'agissait en effet d'une sépulture anormalement orientée la tête regardant vers l'ouest, ce qui doit signaler, conformément à des rites encore observés lors des offices funèbres des membres du clergé, une sépulture de prêtre. Une rapide recherche d'archives nous a permis de retrouver l'identité probable de l'inhumé, « Leonard frontault, prebstre, vivant curé de St. Lubin de Châteaudun,... le trentième jour d'aoust 1614, le corps duquel a été ensépulturé devant l'autel » (merlet 1885, 28).
- V2 a été retrouvé lui aussi isolé et quasi entier. Seule l'anse manque mais on est sûr qu'elle partait de la lèvre pour se rattacher à la base de la panse. Les dimensions sont un peu supérieures à celles de VI (diamètre de la panse : 8,8 cm ; hauteur : 9,2 cm) et le col présente une forme différente. Les flancs sont percés de trois orifices. Là encore, les tessons des remplissages ont permis de reconstituer plusieurs autres vases (trois ou quatre) du même type et de dimensions analogues. Tous avaient les flancs percés. V2 paraît provenir comme VI de la fosse la plus ancienne discernée dans son secteur.
- La sépulture 44 est une inhumation sans vases, mais qui a réoccupé une fosse qui avait précédemment accueilli une sépulture avec vases. Ceux-ci ont été recueillis cassés en multiples
116 R.A.C.F. 23, 1, 1984.
tessons, souvent retrouvés plaqués contre les bords de fosse. Leur remontage a permis de reconstituer presque intégralement quatre vases (V16 à 19). L'ensemble semble en avoir comporté au moins un cinquième, puisque un demi-fond excédentaire a été retrouvé. Comme pour les autres, il s'agissait d'un vase d'assez grandes dimensions (diamètre du fond : environ 7,5 cm ; les dimensions des quatre autres variant de 7,8 à 8,9 cm pour une hauteur et un diamètre à la panse compris entre 14 et 16,5 cm), de teinte beige en surface mais avec une âme grise. Les quatre vases reconstitués possédaient une anse reliant la lèvre au renflement de la panse, avec une trace de doigt très visible au point d'application de l'anse sur la panse. Ils avaient tous subi quelques ennuis de cuisson se traduisant par des taches rouge-orange sur la panse et des traces noires ou brunâtres, notamment pour ces dernières, à la naissance du col. Tous avaient également les flancs percés de cinq ou six orifices. La répartition des tessons au moment de la découverte laissait penser que deux vases se trouvaient originellement de chaque côté du cercueil, probablement à hauteur des jambes. Le remontage des vases a confirmé cette hypothèse. Stratigraphiquement, S44 était la plus profonde des sépultures découvertes jusqu'en 1981. De nombreux tessons appartenant à des vases du même type ont été retrouvés en 1983 dans des couches antérieures au milieu du XVIe siècle. S37 est la plus « riche » des sépultures relevées. C'est la seule dont le cercueil ait livré, outre des clous, de larges cornières de métal oxydé. La fosse renfermait au moins onze vases (V5 à 15), peut-être plus si l'on songe que son extrémité orientale a été recoupée par une fosse demi-circulaire tardive. Tous étaient du même type : couleur beige ou brune, dimensions voisines (diamètre du fond : 5 à 6,2 cm ; de la panse : 8,6 à 10,3 cm ; hauteur : 8,5 à 10,2 cm) ; anse démarrant à mi-col pour venir se rattacher à la partie inférieure de la panse. Là encore, les vases présentaient des malfaçons : traces de coup de feu, mauvais tournage (la hauteur de V15 varie de 9 à 9,4 cm...). Le corps reposait de manière très anormale sur le ventre, légèrement de côté, avec le bras droit nettement décollé du corps et déjeté en arrière avec le coude plaqué contre la paroi du cercueil. Il semble que, involontairement ou non, le cercueil ait connu un accident pendant sa descente. Il serait sans doute
Fig. 21 : Plan de deux fosses funéraires ayant livré des pots à encens : A. : Contours des fosses ; B. : Cercueils ; C. : Cornières ; D. : Zones de concentration des tessons (les vases quasi-intacts ou à défaut les fonds ont été représentés exactement) ; E. : Principaux rattachements notés au remontage ; F. : Recoupement de S37 par une fosse-dépotoir postérieure à la désaffectation de l'édifice.
R.A.C.F. 23, 1, 1984. 117
osé de voir ici la traduction sournoise d'antagonismes sociaux. Il est cependant curieux que cet accident ait affecté la plus « luxueuse » des sépultures découvertes. Les vases s'y répartis- saient en deux ensembles déposés à deux moments distincts. Huit vases avaient été placés dans la fosse préalablement à la descente du corps et ils ont été recueillis plus ou moins fragmentés par la chute du cercueil. Trois autres ont été déposés postérieurement à l'accident au-dessus du cercueil à hauteur de la tête. Ils ont été retrouvés intacts, l'un d'entre eux, V6, cassé sur place (sans doute par le poids des terres). Comme les huit autres, aucun n'avait les flancs percés. S37 peut également être classée stratigraphiquement comme une sépulture parmi les plus anciennes.
- Un dernier groupe de sépultures, toutes implantées le long du mur sud de la nef, immédiatement en avant du décrochement qui la sépare du chœur, nous a permis les observations stratigraphiques les plus intéressantes. Il s'agit de quatre sépultures superposées : S13 (132,35 m NGF), S14 (132,24 m), S29 (132,09 m) et S36 (132,05 m). Au pied de S14, effectuée en cercueil, nous avons trouvé les fragments de deux vases très différents d'aspect. V3 a été retrouvé cassé en six tessons qui ont permis d'en reconstituer la moitié. Il est de couleur brune tirant vers l'orange à l'extérieur, blanche ou légèrement grise à l'intérieur et présente les traces d'un coup de feu. De minuscules gouttes de glaçure verte sont présentes sur la panse (éclaboussures lors de la fabrication ?). Les parois sont épaisses et les flancs non percés. Au contraire, V4, quasi entier (puisque seule l'anse n'a pu être retrouvée), mais cassé sur place, présente des caractères bien différents : couleur (orange, tant du côté interne qu'externe, mais avec une âme noire) et forme (un peu plus haut et ventru, il présente un fond de diamètre plus faible et un renflement bien plus prononcé à la partie supérieure de la panse) ; parois minces ; panse percée de trois orifices... L'anse disparue partait probablement de la lèvre. J'avais d'abord envisagé que la fragmentation de V3 et V4 provienne de l'implantation de S13 (qui a d'ailleurs délogé le tibia droit de S14) et que les deux vases puissent être associés à S14. Mais la présence de tessons et de charbons de bois le long du squelette ainsi que la dissemblance profonde des deux vases (qui s'oppose à l'ensemble des autres sépultures à vases qui ont toujours livré des poteries proches dans
leurs formes et surtout dans le fait que leurs flancs soient ou non percés), m'entraînent à penser qu'au moins un des deux vases représente une sépulture distincte et antérieure à S14. Un seul fait certain subsiste : les deux vases devaient être originellement placés à l'extrémité orientale de la fosse. S36 a livré des fragments d'au moins trois vases obligatoirement antérieurs à V3 et V4, de forme identique assez proche de celle des vases de S37, mais de couleur rouge-orange clair. Là encore, il est difficile d'être certain que les vases ont bien été brisés lors de l'implantation de S29 et qu'il ne s'agit pas de la réoccupation d'une fosse antérieure. En tout cas, l'intercalation de S29, effectuée en pleine terre, entre S14 et S36, nous assure qu'à une certaine époque l'inhumation avec vases funéraires n'était pas systématique. Elle était peut-être même en liaison avec un certain rang social, si l'on tient compte du fait que les sépultures associées à des vases (S37) ou susceptibles de l'être (S14, S36) semblent avoir été faites en cercueil.
La datation de ces sépultures laisse donc la place à une assez grande incertitude que l'on peut tenter de réduire par le raisonnement. Notons d'abord que l'ensevelissement avec vases funéraires est une coutume attestée à Château- dun au début du XVe siècle. L'abbé marquis (1887) a en effet attiré l'attention, dès 1887, sur le testament de colin d'autheuil, bourgeois de Châteaudun, qui lègue en 1412 « aux pauvres qui porteront le poz à l'encens autour de son corps, le jour de son obit », à chacun dix deniers tournois. Le contexte semble montrer que cette pratique s'inscrit normalement dans le déroulement des rites et des coutumes que l'on observe lors de la mort d'un des bourgeois de la ville (divers dons aux pauvres, cire pour le luminaire, messes, lecture du psautier la veille sont également prévus par le testament). On voit ici une certaine connotation sociale s'exercer puisque les vases sont portés par des pauvres. Peut-être est- ce la même logique qui veut que la plupart des pots recueillis souffrent de défaut de cuisson ? Ne fallait-il pas se présenter auprès de Dieu avec une âme de pauvre23 ? Mais à quand remonte cette coutume ? Nous disposons de deux types d'indices. D'abord ceux de la stratigraphie qui nous montre que les inhumations à vases parais- 23. On peut encore trouver un lointain écho de cette idéologie dans le sermon « sur l'éminente dignité des pauvres » de BOSSUET, où il affirme que les grands de ce monde n'entreront en paradis que sur la recommandation d'un pauvre.
118 R.A.C.F. 23, 1, 1984.
sent parmi les plus anciennes et qu'elles n'ont pas été pratiquées avant l'établissement de l'antépénultième niveau d'occupation de l'église, c'est-à-dire postérieurement à la construction des parties à appareil en épi et même probablement après celle du chœur roman. Le matériel découvert dans les sépultures et les remplissages fournit une deuxième série d'indices. Outre les multiples clous de cercueil, épingles de suaire et quelques éléments de parure, il consiste surtout en tessons de pots à encens. Parmi eux, on peut signaler quelques tessons (assez rares) de céramique rouge de « l'Orléanais » qui est attribuable aux XIIIe-XIVe siècles, mais aussi l'existence de glaçures vertes appliquées uniquement sur des rebords, côté interne. J'insisterai peu, ici, sur les comparaisons de formes, sinon pour signaler l'existence du type 4 défini par j. nicourt pour Vienne-en-Val (1973, 85-100) et d'un type trouvé à Vendôme par c. leymarios (1980, p. 43-49) qui l'attribue (lui- même par comparaison !) aux XIVe-XVe siècles. d. orssaud auteur d'une thèse inédite sur les vases funéraires médiévaux (Université de Paris I) a bien voulu examiner nos vases. Elle les attribue, par comparaison typologique, essentiellement au XVe siècle. Ceux livrés par la fosse réoccupée par S44 remonteraient seuls à la seconde moitié du XIVe siècle. Le matériel monétaire n'a jamais été retrouvé associé à une sépulture, mais toujours dans les remplissages. Il va essentiellement du début du XIVe siècle au milieu du XVIIe siècle24.
En résumé, il paraît vraisemblable que la pratique de l'inhumation avec vases a été utilisée à Saint-Lubin aux XIVe-XVe siècles, et apparemment sans être automatiquement la règle. Il semble aussi qu'au XVIIe siècle, ce type d'inhumation ne se pratique plus. La fouille de la partie de l'église agrandie au milieu du XVIe siècle a permis de montrer que le milieu du XVIe siècle semblait constituer un terminus pour cette pratique. Quant à la fin des inhumations (avec ou sans vase) dans l'édifice, elle semble se placer vers la fin du XVIIIe siècle25.
24. Identifications de M. DHENIN, conservateur au cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale. 25. L. MERLET (1885) nous apprend qu'en 1762 P.D. BOIS- GANIER, curé de Saint-Lubin, a été inhumé dans l'église. Jusqu'en mai 1788 des inhumations auront lieu dans le cimetière. L'examen des registres paroissiaux indique la date de 1776 pour la dernière inhumation dans l'église.
10. LES PROBLEMES CHRONOLOGIQUES.
Parvenus au terme de notre analyse, nous essaierons de conclure en proposant un schéma chronologique provisoire de l'édifice étudié. Les grandes lignes de la chronologie relative du site peuvent être résumées en dix phases :
Phase I : implantation d'un premier bâtiment encore mal connu notamment au niveau de sa fonction dont il n'est pas assuré qu'elle fût déjà religieuse. Phase II : édifice primitif arasé au niveau des premières assises. Phase III : édifice « carolingien » probablement pourvu d'une abside peu profonde et dont il subsiste quelques vestiges peu étendus en élévation. Phase IV : importantes réparations et construction sans doute inachevée d'une abside plus large et plus profonde. Phase V : rétrécissement de l'édifice par un mur transverse barrant l'abside précédente à son ouverture et définissant un nouveau chœur proche d'un module carré. Les parties hautes de la nef sont reconstruites, ainsi que l'intégralité de la façade ouest. Phase VI : approfondissement du chœur précédant le début de l'utilisation funéraire de l'édifice. Phase VII : importante campagne de reconstruction des parties hautes (fenêtres gothiques). Phase VIII : agrandissement de la nef vers l'ouest par des maçonneries de mauvaise qualité traduisant bien un certain déclin de l'édifice au sein de la hiérarchie religieuse locale. Phase IX : désaffectation de l'édifice dont le clocher est abattu. Après avoir été un temps transformé en atelier d'armement, il est rendu à des usages privés : jardin dans la nef, maison d'habitation, puis grange et écurie dans le chœur. Phase X : usage de terrain de « jeux » puis de dépotoir.
Le passage à une datation absolue est beaucoup plus délicat, car l'utilisation funéraire a fait disparaître l'essentiel des couches antérieures et le matériel recueilli n'éclaire que la première et les dernières phases. Il nous assure cependant que le bâtiment de la phase I a été implanté au sein de remblais contenant de nombreux tessons de céramique gallo-romaine (commune et sigillée) qui ont aussi été retrouvés dans des couches postérieures - par exemple le remblai des tranchées de fondation de l'édifice primitif qui a
R.A.C.F. 23, 1, 1984. 119
Ouest Est
("""" Mur oriental de /■ l'édifice primitif
132.31 NGF .<"■"■" I 'fr
Mur gallo-romain
131,31
^W1 == IZÔ2A mnmR LTUC LZZ3D [EZIE
Jm
EZ3H [ZZ3 I rzzz J
Fig. 26 : Coupe stratigraphique est-ouest dans l'angle nord- ouest de la nef : A. : Remblais tardifs ; B. : Mortier jaune ; C. : Mortier blanc ; D. : Remblai de mortier rose ; E. : Béton gris ; F. : Couche constituée par les remplissages coalescents des sépultures médiévales et modernes ; G. : Brique ou tuile ; H. : Argile (probalement, éléments de torchis effondré) ; I. : Terre noire incluant de nombreux vestiges de destruction ; J. : Remblai de terre noire riche en tessons gallo-romains et en cailloutis de silex ayant subi l'action du feu ; K. : Remplissage des trous de poteaux. L'élévation du mur gallo-romain indiquée en tireté a été complétée à partir d'une deuxième coupe observée à environ un mètre de distance.
Fig. 27 : Vue de la stratigraphie à l'aplomb du mur oriental de l'édifice primitif (détail de la Fig. 26) : tranchée de fondation scellée par un débordement de mortier blanc et surmontée d'une couche de destruction (mire : 50 cm).
120 R.A.C.F. 23, 1, 1984.
aussi livré des fragments d'enduits peints26. Les documents historiques nous apparaissent
donc comme les principales bases de datation absolue et il convient de les utiliser au mieux, notamment en les couplant avec l'étude des particularités architecturales. Les phases VII à X ne posant pas de problème majeur, elles ont déjà été discutées plus haut et nous n'y reviendrons pas. Les problèmes débutent réellement avec les phases V et VI pour lesquelles nous disposons du texte important de 1071. Il est assez logique que cette donation à Saint-Père de Chartres ait été suivie d'une campagne de reconstruction, quoique l'on nous dise que l'édifice « a été construit de façon convenable depuis un temps ancien »27, ce qui peut laisser penser que sa reconstruction n'est pas urgente. L'édifice dont il est ici question ne peut être que celui de la phase IV ou V, car l'appareil en épi est peu fréquent pour un. édifice religieux après la fin du XIe. En nous fondant surtout sur le fait que l'approfondissement du chœur paraît assez bien concorder avec une donation à des réguliers, nous inclinerions à penser que l'état roman est l'œuvre des moines de Saint-Père et que l'édifice donné en 1071 était celui à appareil en épi. La technique des chaînages armant une abside en maçonnerie de compression se retrouve dans les parties de Saint- Jean de Châteaudun assez vraisemblablement attribuables au XIIe siècle. Par contre, les arca- tures et les piédroits de 003 paraissent plus frustres, ce qui ne veut peut-être pas dire plus anciens si l'on tient compte de l'importance moindre du chantier et de l'absence de chapiteaux sculptés. En partant de l'idée que l'extension du chœur n'a peut-être pas suivi immédiatement la donation, puisque l'édifice donné était en bon état, il me paraît plausible d'avancer une datation du dernier quart du XIe siècle ou du premier quart du XIIe pour cette partie de l'église. Un argument supplémentaire peut être tiré du texte de 1071 dans la mesure où il mentionne la donation d'un lieu voisin nommé « les Cours d'ARNOULT ». Il est plus que probable que le prieuré et le cimetière du Bas Moyen-Age 26. Selon un renseignement oral de C. ALLAG aux journées archéologiques du Centre en 1981, ces enduits sont datables de « n'importe quand, du Ier au IIIe siècle »... La sigillée provient d'ateliers de Gaule du centre (Lezoux notamment) et couvre la période allant du début du Ier siècle à la fin du IIe. Quelques trouvailles monétaires toujours retrouvées dans les remplissages de sépultures attestent une occupation gallo- romaine et gauloise du site (un bronze carnute de la période de l'indépendance, un potin à la tête diabolique des Turones, deux as à l'autel de Lyon de Tibère, une monnaie de Titus...). 27. Quae ecclesia, a prisco tempore, intra vallum Castriduni decenter constructa videtur, atque a patribus nostris, jure here- ditario, possessa est.
ont été installés à leur emplacement. Les documents du XVIIIe siècle (registres paroissiaux et manuscrit de boisganier) permettent de situer ce prieuré qui donne sur la rue Saint-Lubin à l'angle de la ruelle qui menait à la porte 006 et au cimetière. Il est donc assez logique de lier 006 et l'appareil roman avec cette installation du prieuré qui devait donner au XIIe siècle par l'arrière sur les portes 001 et 002, alors que les paroissiens devaient entrer par le bas de la nef en montant la ruelle Saint-Lubin (Fig. 28).
Cette attribution oblige à reculer la construction des parties à appareil en épi au moins à la première moitié du XIe siècle. On peut en effet supposer que l'expression « un temps ancien » s'applique seulement à la possession et à la situation de l'église, mais on peut supposer que si une reconstruction très récente avait eu lieu, le texte la signalerait. L'association de l'appareil en épi avec des fenêtres haut perchées et à ébrasement intérieur en petit appareil allongé ne paraît pas s'y opposer. La disposition régulière de ces fenêtres rappelle un parti adopté à la nef de Cra- vant et daté des environs de 1050 par Ch. lelong, mais la facture de l'ensemble me paraît moins soignée et pour tout dire moins évoluée qu'à Cravant. Aussi nous semble-t-il possible de mettre en concordance les phases III à V avec les quelques données connues de l'histoire dunoise de la fin du haut Moyen-Age. Celle-ci paraît se résumer à une série de désastres : 878 : prise de Châteaudun par le comte du Maine ; 911 : mise à sac par les Vikings qui incendient la ville, suivie, vraisemblablement guère avant la deuxième moitié du Xe siècle, d'un relèvement de la ville sous l'impulsion de la dynastie des Thibault, comtes de Tours, Blois, Chartres et Châteaudun ; 994 : nouvelle prise de la ville par foulques nerra qui aurait alors détruit les murailles de Châteaudun. Cette succession de malheurs cadre assez bien avec ce que nous montre l'histoire de l'édifice carolingien : réparations sommaires, tentative d'extension avortée, puis rétrécissement de l'église s'accompagnant de la construction des parties à appareil en épi. Ce rétrécissement pourrait être mis en parallèle avec l'aménagement des fossés du château, immédiatement au nord de l'église. Traditionnellement attribuée à Thibault le tricheur28, la construction de la « Tour » des comtes29 dans l'angle de
28. Ou plus exactement au second des deux personnages que l'on s'accorde à reconnaître sous ce nom. 29. Le château n'est jamais nommé castelllum ou castrum, termes qui paraissent réservés à l'enceinte urbaine, mais turris
R.A.C.F. 23, 1, 1984. 121
Fig. 28 : Environnement de l'église Saint-Lubin au milieu du XVIIIe siècle : A : Eglise Saint-Lubin (a. clocher, b. porte 001, c. porte 002, d. porte 006). B : Cimetière. C : Château (a. donjon du XIIe siècle, b. vieux château antérieur au XVe siècle, c. fossés). D : Collège. E : Terrain cédé par le comte en 1615 pour construire une allée permettant de conduire les enfants du collège à l'église Saint- Lubin. F : Presbytère. G : Maison du sonneur-sacriste. Ancienne maison du curé avant le XVIIe siècle. H : Logis du prieuré (le prieur ne réside plus au XVIIIe siècle). I : Jardin du Sieur Foucault, autrefois jardin des prieurs. J à 0 : Maisons progressivement regroupées par la famille Foucault au cours du XVIIIe siècle. P et Q : Maisons tenues à bail à rente de la fabrique de Saint-Lubin. R : Murs de ville. S : Porte d'Abas. Sources : Plan levé en 1723 par l'ingénieur HARDOUIN.
Registres paroissiaux de Saint-Lubin. Manuscrit de P.D. BOISGANIER, A.D. Eure-et-Loir, G. Supp. 757. M. COUTURIER 1968 - Recherches sur les structures sociales de Châteaudun, 1524-1789, Publication commune de la Société Dunoise et de la Société Archéologique d'Eure-et-Loir 24-2, 253-272. L. MERLET (1886).
122 R.A.C.F. 23, 1, 1984.
l'ancienne enceinte urbaine la plus favorable à la défense pourrait tout aussi bien être l'œuvre d'EUDES après le désastre de 994 dont l'église Saint-Lubin a dû beaucoup souffrir étant donné sa position auprès des plus anciens remparts de la ville30. On pourrait donc admettre le schéma suivant : - construction au IXe siècle (phase III) d'un édi
fice que les éléments architecturaux désignent comme carolingien : arases de brique ou d'éléments allongés de grès roussard31, cordons de brique préfigurant les cordons de pierre romans, parti décoratif jouant sur les surfaces et non sur les volumes. Il paraît cependant difficile de préciser si cet état est antérieur aux événements de 878.
- réparations sommaires et hâtives après l'épisode viking, précédant une campagne de reconstruction (phase IV), après que la famille des Thibault eut mis la main sur la ville.
- cette campagne de construction ayant été interrompue par l'arrivée de foulques nerra, on aurait révisé le plan des constructions en liaison avec de nouvelles préoccupations stratégiques. La campagne 1983 a montré que, très peu de temps après la construction de la façade à appareil en épi, un remblai assez conséquent a été mis en place devant cette façade, expliquant ainsi l'exhaussement enregistré plus haut du sol de l'église. La composition de cette couche de remblai paraît indiquer qu'elle
ou palatium, et ce aussi bien au XIe qu'aux XIIe ou XIIIe siècles. 30. Rien n'interdit de penser que les chaînages d'angle en grand appareil de la façade de l'édifice à appareil en épi ne puissent être constitués de blocs récupérés lors du démantèlement de FOULQUES NERRA... mais rien n'y autorise non plus. Il semble cependant que ce soient les parties de l'édifice les plus proches du rempart qui aient été systématiquement reconstruites. 31. L'emploi du roussard comme élément décoratif a des origines anciennes dans la région puisqu'on le voit au rempart du Bas-Empire au Mans. A Cloyes, des sarcophages mérovingiens en roussard ont été découverts au XIXe siècle dans le cimetière de Saint-Lubin. Mais il est aussi fréquent de le découvrir encore à l'époque romane où l'on joue encore souvent sur l'opposition roussard-calcaire dans le Maine et le Perche.
résulte de l'épandage des produits du creusement des fossés du château, qui se situent à quelques mètres au nord. C'est au sein de ce remblai que le cimetière médiéval (attesté dès 1212) a été implanté32. Les parties à appareil en épi auraient pu être construites dans le premier quart du XIe siècle ; quelques textes cités par a chedeville (1973), montrent que les campagnes autour de Châteaudun sont en reconstruction dans la première décennie du XIe siècle sous la direction de marmoutier33, la grande abbaye tourangelle très liée à la famille des comtes de Châteaudun-Blois. Les seigneurs d'Alluyes alors possesseurs de l'édifice sont parmi les plus importants vassaux autochtones du comte et ont pu jouer un rôle dans le relèvement de la ville.
Quant à l'édifice primitif, nous ne pouvons que le reporter de manière imprécise aux temps mérovingiens. Le fait que nous ayons cru y déceler les traces d'une reconstruction intermédiaire et le détail de la stratigraphie montrant plusieurs recharges du sol permettent d'escompter une durée d'utilisation assez longue qui concorde assez bien avec les données de la tradition en faisant remonter les origines à la fin du Ve siècle ou au début du VIe. Les différentes couches noires entre les recharges évoquent également les incendies de la ville au VIe siècle, rapportés par GREGOIRE DE TOURS. 32. Peut-être faut-il mettre en liaison l'implantation de ce cimetière intra-muros avec l'installation du prieuré consécutif à la donation de 1071. 33. Dès 995, le comte fait à Marmoutier un don important : celui de son domaine de Chemars au pied de la ville-forte. Le fait est d'autant plus remarquable qu'il semble s'agir du principal bien détenu par le comte dans une région où il était peu possessionné de manière directe. Il est plus que probable qu'il y a ici un lien évident avec les dévastations de l'année précédente.
Les dessins au trait sont de l'auteur, sauf la Fig. 2 qui est de P. CROSSONNEAU. Les photos sont de Ph. DUREUIL, sauf les photos 3, 4, 5, 9 et 27 qui sont de l'auteur.
R.A.C.F. 23, 1, 1984. 123
BIBLIOGRAPHIE
BAIX 1931 Baix F. — Aventin (3) in BAUDRILLART A., DE MEYER A. et VAN CAUWEN- BERGH E., Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique, 5, col. 1025.
BELLEFOREST 1575 Belleforest F. — Cosmographie Universelle, Paris.
BLANCHART-LEMEE 1981 Blanchart-Lemée M. — La villa à mosaïques de Mienne-Marboué, Gallia 39, 63-83.
BORDAS 1884 Bordas J. (Abbé) — Histoire Sommaire du Dunois, 1, 31-32 et 62-68 ; 2, 294, Château- dun.
CHEDEVILLE 1973 Chédeville A. — Chartres et ses campagnes, XIe-XHIe siècles, Paris.
CUISSARD 1892 Cuissard C. — Les seigneurs d'Alluyes, Bull, de la Soc. Dunoise, Archéol., Hist., Sciences et Arts, 7, 285-330.
DIEHL 1984 Diehl R. — Les tombes du Port Ringeard à Entrammes (Mayenne), La Mayenne, 6, 107-134.
GREGOIRE DE TOURS Grégoire de Tours. — Histoire des Francs, VII, 17.
JUSSELIN 1938 Jusselin M. — Deux vues du château de Châteaudun, Bull, de la Soc. Dunoise, 17, 322- 324.
JUSSELIN 1963 Jusselin M. — Manuscrit inédit de l'abbé Pierre-Denis Boisganier (1691-1762), Bull, de la Soc. Archéol. d'Eure-et-Loir, Documents, 9, 1-40.
LEYMARIOS 1980 Leymarios C. — Vendôme, La Chapelle du Calvaire, Sauvetage Archéologique sur des sépultures médiévales, Bull, de la Soc. Archéol. Scient, et Litt. du Vendômois, 43-49.
MARQUIS 1887 Marquis J. (Abbé). — Un testament à Châteaudun en 1412, Bull, de la Soc. Dunoise, S, 354-5.
MERLET 1863 Merlet L. — Notice sur l'église Saint-Lubin de Châteaudun, Bull, de la Soc. Archéol. d'Eure-et-Loir, Mémoires, 4, 180-9.
MERLET 1885 Merlet L. — Inventaire sommaire des archives municipales de Châteaudun, Châteaudun.
MERLET 1886 Merlet L. — Registres et minutes des notaires du Comté de Dunois, Chartres.
MERLET et JARRY 1896 Merlet L. et Jarry L. — Cartulaire de l'abbaye de La Madeleine de Châteaudun, Châteaudun.
M G H Monumenta Germaniae Historica — Auctores Antiquiores, IV, 2, 73-82, Berlin (Vita San Leobini BHL 4847).
124 R.A.C.F. 23, 1, 1984.
NICOURT 1973 Nicourt J. — Préliminaires d'une étude de la céramique médiévale à Vienne en Val, Bull, de la Soc. Archéol. et Hist, de l'Orléanais, 5, 85-108.
PONCELET 1905 Poncelet A. — Les saints de Micy, Analecta Bollandiana, 24, 1-31.
THIERCELIN 1913 Thiercelin (Abbé). — Vie de saint Aventin (453-528) évêque de Châteaudun, Bull, de la Soc. Dunoise, 13, 135-213.