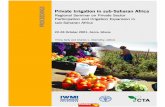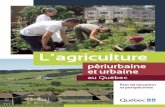Sécurité alimentaire et urbanisation; enjeux pour l'agriculture intra et péri-urbaine
LE TOURNANT DE L'AGRICULTURE ROUMAINE INTRODUCTION
Transcript of LE TOURNANT DE L'AGRICULTURE ROUMAINE INTRODUCTION
LE TOURNANT DE L’AGRICULTURE ROUMAINE
INTRODUCTION
A. ctuellement, telle qu'évolue la PAC, on va vers une industrialisation
qui ne laisse plus de place aux paysans". Voilà comment Geneviève
Savigny, de la Coordination européenne Via Campesina, analyse la
Politique Agricole Commune, le mercredi 19 septembre 2012 à
Bruxelles. Ce jour-là, plus de 200 personnes, agriculteurs et membres
d’associations paysannes ou environnementales, manifestaient devant les
institutions européennes de Bruxelles pour manifester en faveur d’une autre
politique agricole en Europe alors que commençait le cycle de négociations d’une
nouvelle réforme de la PAC.
En effet, la dernière réforme de la PAC date de 2003 et beaucoup tentent de peser
sur les négociations entre la Commission Européenne, le Conseil des Ministres et
pour la première fois, le Parlement Européen. Il faut dire que les enjeux, qu’ils
soient financiers, économiques, sociaux ou environnementaux, sont énormes. Les
tensions entre les différents groupes politiques et institutions chargés de conclure
un accord sont visibles. Un retard est d’ailleurs annoncé puisque l’on sait déjà que
la réforme prévue pour 2014 ne rentrera pas en vigueur avant 2015.
La nécessité de réformer en profondeur la PAC s’impose aux yeux de beaucoup à
cause des nombreuses critiques qui la décrivent comme injuste ou inefficace. Mais
aussi parce que l’Union Européenne a connu depuis 2003 un changement
gigantesque qui a altéré totalement la nature et la dimension de sa question
agricole : les élargissements de 2004, avec dix nouveaux pays dont certains très
agricoles, et de 2007, avec la Bulgarie et surtout la Roumanie.
B.
La Roumanie est un cas à part en Europe avec plus de trois millions
d’exploitations (soit 32% des exploitations de l’U.E.), de deux millions
d’agriculteurs (soit près de 30% de la population du pays) et plus de treize millions
d’hectares utilisés pour l’agriculture qui pèse près de huit pourcents de son PIB.
"A
On comprend dès lors que les enjeux de la Politique Agricole Commune et de
l’économie agricole en général prennent dans ce pays un tout autre sens, un tout
autre poids.
Mais encore plus que sa dimension importante, c’est la structure particulière de
l’agriculture roumaine qui fait d’elle une exception dans le paysage européen. Plus
des deux tiers des exploitations présentes en Roumanie font moins de deux
hectares : une part énorme de l’agriculture repose donc sur la « petite
paysannerie ».
Or, cet état de fait donne lui aussi une autre envergure aux questions agricoles
européennes et aux critiques faites à la PAC. 80% des aides directes vont à 20%
des exploitations dans l’U.E. En Roumanie, la distribution des subventions est
encore plus inéquitable – et même la pire- de l’U.E avec 0,7% des exploitations
recevant 51% des aides. L’agriculture européenne semble se diriger vers une
structure bipolaire. En Roumanie, les exploitations de taille moyenne (entre deux
et 50 ha.) sont celles qui disparaissent le plus (moins 28%), tandis que les
exploitations de grande taille (de 50 à 10 000 ha.) augmentent et que les petites,
bien qu’en constante diminution, résistent encore, en se repliant sur elles-mêmes.
L’Union Européenne vogue-t-elle vers une « agriculture sans paysans » ? En
Roumanie le nombre de personnes travaillant dans le secteur agricole a diminué
de moitié en dix ans, dans un contexte de chômage urbain endémique et à un
rythme d’ailleurs deux fois plus élevé que la baisse du nombre d’exploitations.
Tout ceci montre l’importance et la portée de la problématique rurale et agricole en
Roumanie et illustre bien son caractère à la fois particulier et représentatif
d’enjeux européens, voire mondiaux, en tout cas terriblement actuels.
C.
Mais comment cela se passe-t-il réellement dans les campagnes roumaines ?
Comment ont évolué ces campagnes depuis 2004 et les premiers programmes
européens de « restructuration » agricole ?
Autrement dit, quel est le prix d’une transition entre une agriculture traditionnelle
paysanne et une agriculture industrielle en concurrence avec le reste de l’Europe
et du monde ? Quel est le rôle que joue la PAC dans cette transition ? Ce sont le
sujet et l’angle que nous avons choisis pour notre mémoire médiatique.
Mais avant de partir en reportage sur le terrain, il convient de dresser l’état des
lieux de l’agriculture roumaine, mais aussi européenne, et bien sûr mondiale car il
est impossible de comprendre la partie sans avoir connaissance des mécanismes
qui régissent le tout. C’est l’objet de cet État de la question.
D.
Pourquoi l’agriculture roumaine tend-t-elle vers une structure « duale », où les très
petites exploitations côtoient les très grandes ? Quel est le coût en termes
d’emploi de cette transformation ? Quel impact sur l’activité et le développement
rural ? Qui profitent de ces changements et qui en pâtit ? Quelles politiques
publiques soutiennent (ou contrecarrent) ces évolutions ? Dans quel but ? Cette
transformation est-elle inévitable ?
Autant de questions de première importance auxquelles nous tenterons de
répondre. Avant cela, il nous faut déterminer quels sont les questions que nous
n’allons pas nous poser.
En effet, l’agriculture et ses évolutions est un sujet passionnant parce qu’il touche
énormément de domaines: l’économie, l’histoire, la géographie, la politique, la
finance, l’agronomie, l’écologie, etc. Cependant dans le cadre de notre mémoire
de fin d’étude il convient de circonscrire notre sujet si l’on veut avoir une chance
de pouvoir dire vraiment quelque chose, le temps d’un reportage. Nous écarterons
donc toutes les problématiques liées à : la souveraineté alimentaire, les problèmes
environnementaux, la politique foncière et (à propos de la Roumanie) la transition
postcommuniste. Ce sont là des thèmes également très intéressants mais nous
avons choisi d’axer notre questionnement sur l’emploi et le développement rural,
deux matières souvent oubliées lorsque les médias parlent d’agriculture.
Évidemment, ces différents thèmes sont tous liés à la question qui nous occupe et
il est possible qu’ils apparaissent en toile de fond à certains moments de cet État
de la question.
E.
Tout au long de ce travail nous allons donc nous attarder à décrire la situation
actuelle de l’agriculture en Roumanie et à expliquer les mécanismes qui la
structurent. Pour cela, nous nous baserons sur un cheminement logique qui va du
général au particulier. Ou plus concrètement : du monde à la campagne roumaine.
Nous commencerons par réfléchir à l’agriculture en tant que marché global :
comment ce marché s’est progressivement libéralisé pour accompagner la
« mondialisation », quels traités et institutions en définissent les contours et le
fonctionnement, que représente ce marché en termes d’échanges, quels rapports
de forces sont à l’oeuvre pour déterminer l’avenir de ce marché et quels sont les
enjeux économiques, géopolitiques et humains de la compétition mondiale dans
ce domaine.
Nous concentrerons ensuite notre regard sur l’Union Européenne en analysant
bien entendu son indissociable instrument de gestion de l’agriculture : la Politique
Agricole Commune. Nous verrons comment celle-ci fut créée, et comment ses
buts et ses finalités ont évolué au fur et à mesure de ses différentes réformes.
Nous analyserons d’où vient son financement et comment se compose son
budget, pour nous intéresser ensuite à son organisation et aux mécanismes qui la
font fonctionner. Nous pointerons ses limites, ses effets collatéraux et ses
manquements (parfois envers ses propres engagements). Enfin nous terminerons
en décrivant le processus de réforme en cours, son fonctionnement et ses enjeux.
Mais connaître la PAC n’est pas encore connaître l’agriculture européenne. Nous
examinerons donc la situation de celle-ci, ou plutôt de celles-ci puisque nous
verrons l’état à la fois de l’agriculture paysanne et de l’agriculture industrielle sur le
vieux continent. La place qu’y occupe la paysannerie actuellement et les
évolutions profondes qu’elle a consenties pour s’adapter à la nouvelle donne
européenne et mondiale.
Il sera alors temps d’explorer la question roumaine. En abordant tout d’abord les
chiffres qui décrivent l’état actuel de l’agriculture roumaine, avant d’exposer les
différentes évolutions qu’elle a connues sous l’influence de l’Union Européenne,
avant 2007 dans un premier temps puis après son adhésion, et pour finir en
posant quelques pistes de réflexion quant à son avenir.
F.
Cet état de la question s’appuie sur de nombreux documents : ouvrages et articles
scientifiques, études institutionnelles, articles de presse, statistiques, etc. issus de
nos recherches. Il se base également sur des rencontres qui nous ont permis de
mettre un pied d’une manière plus « vivante » dans le gigantesque dossier
agricole. Deux entretiens ont été particulièrement riches en enseignement et sont
repris à certains moments de ce travail : tout d’abord la longue entrevue que nous
avons eue avec Gérard Choplin, animateur de la coordination paysanne
européenne Via Campesina, ensuite l’interview que nous avons réalisée de
l’eurodéputé et membre de la commission agricole, Marc Tarabella.
1. L’AGRICULTURE DANS LA MONDIALISATION1
La mondialisation, qui commence au milieu des années septante dans sa forme
moderne mais qui peut aussi se voir comme la suite d’un phénomène plus ancien,
a énormément accru les exportations de marchandises entre les différentes
parties du monde mais aussi les échanges de technologies, d’informations, de
services, etc. La mondialisation est aussi une nouvelle organisation géopolitique et
économique du monde où la hiérarchie des nations qui prévalait jusque-là est
bouleversée et où l’interdépendance des pays s’accroît. De cette économie
« globalisée », naît une nouvelle forme d’organisation des entreprises et des
institutions, notamment via la création de très grandes firmes internationales qui
s’adaptent à la nouvelle donne mondiale.
Cette nouvelle configuration n’a pas épargné l’agriculture même si, on le verra,
celle-ci a été et reste un cas à part au sein du phénomène de mondialisation des
économies. En analysant les caractéristiques de l’agriculture comme marché
mondial, il faut bien garder à l’esprit le statut particulier qu’elle occupe dans les
économies et les échanges internationaux. C’est une activité qui répond à un
besoin essentiel : nourrir les hommes. Et à ce titre un secteur dont la maitrise, au
niveau de la production et des échanges, est perçue comme essentielle par
beaucoup d’acteurs : états ou entreprises.
Cette maitrise passe en partie par l’élaboration de politiques agricoles par les
états. Ce point reviendra donc à plusieurs occasions dans notre analyse. Un autre
élément essentiel pour comprendre la complexité du secteur agricole est de savoir
qu’il est une partie du système alimentaire mondial, et donc est lié aux questions
de l’agroalimentaire et aux spécificités de ce secteur.
Comprendre l’importance et la particularité de la question agricole dans
l’économie mondiale amène aussi à un constat que Thierry Pouch énonce ainsi
dans son livre La guerre des terres : « La question agricole participe de la
fragmentation du monde » (2010, p.12). Nous verrons donc comment la question
1 �
Ce chapitre s’inspire essentiellement de l’ouvrage intitulé « La guerre des terres » de Thierry
Pouch, économiste et responsable du service études économiques de l’Assemblée permanente des
Chambres d’Agriculture en France, et du chapitre cinq de l’étude sur le système alimentaire mondial
réalisée par Jean-Louis Rastoin et Gérard Ghersi, « Internationalisation, mondialisation et
globalisation ». Lorsque d’autres sources sont utilisées en complément de ces ouvrages, elles sont
précisées en fin de paragraphe.
agricole se déploie au sein des relations internationales et des grandes
discussions commerciales multilatérales qui sont toujours en cours aujourd’hui.
1.1 Taille du marché agricole mondial
Que représente le marché agricole dans l’économie mondiale ? Les données les
plus récentes proviennent de l’OMC. Elles indiquent, en 2007, un montant
d’exportation de 215 milliards pour les MPA (Matières Premières Agricoles).
D’un point de vue plus large, c’est moins de 20% des 1 128 milliards de dollars
d’exportations de PAPF (Produits Agricoles et Produits Forestiers), à peine plus
par rapport aux 913 milliards de PA (Produits Alimentaires), dont à peu près 600
milliards sont des PAT (Produits Alimentaires Transformés).
Pour se faire une idée plus précise, entre 2004 et 2006, quinze marchés
internationaux de produits alimentaires avoisinaient ou dépassaient dix milliards
de dollars en moyenne. Le premier d’entre eux, avec près de 27 milliards, était
constitué de préparations (sauces, condiments et plats cuisinés). Dans cette liste
ne figurent que trois « commodités » (ou matières premières agricoles) : blé, soja,
maïs. Tous les autres produits sont issus de l’industrie agroalimentaire.
Six marchés dépassent aujourd’hui chacun un milliard de dollars alors qu’ils
étaient à des niveaux infimes auparavant : les exportations mondiales de porcs
approchent aujourd’hui sept milliards de dollars (contre 110 millions au milieu des
années 1980, soit un coefficient multiplicateur de plus de 60). Les aliments pour
animaux familiers atteignent 5,8 milliards (aussi multiple de 60), les farines pour
l’élevage sont à 3,3 milliards de dollars (70 millions en 1985), preuve du passage
à un élevage intensif à base d’aliments industriels. Les trois autres marchés
milliardaires relèvent de l’alimentation humaine sophistiquée (les crèmes glacées,
les pâtes pour boulangerie-pâtisserie et les yaourts).
On voit donc le déclin du poids relatif des produits agricoles par rapport aux
produits alimentaires et produits alimentaires transformés. Tous ceux-ci ne
représentant plus qu’une part infime des échanges internationaux : à peine six
pourcents des exportations mondiales de marchandises en 2007 (contre 46% en
1950).
1.2 Tendances des marchés agricoles et alimentaires
On l’a vu, le commerce de PAPF régresse au sein des exportations mondiales. On
peut constater aussi que les points perdus par les produits primaires sont gagnés
par les produits manufacturés, on estime à 67% en 2007 la proportion de PAT
dans l’ensemble des PA, contre 44% en 1984. La structure du commerce
alimentaire international a été profondément modifiée dans les 20 dernières
années : aux produits bruts se sont substitués les produits élaborés, nous
sommes bel et bien rentrés dans « l’âge agro-industriel ».
La régression des PAPF dans les exportations totales de marchandises ne signifie
pas pour autant que ces produits chutent en valeur absolue. Bien au contraire, ils
connaissent une croissance continue avec un accroissement annuel moyen
d’environ quatre pourcents depuis 1950 (avec une baisse autour des deux
pourcent pendant les années septante et quatre-vingt). Au sein des PAPF, la
progression des produits alimentaires est beaucoup plus rapide que celle des
matières premières non comestibles.
Autre phénomène : l’intensification des échanges intra-branches, c'est-à-dire au
sein de chaque catégorie de produits (par exemple les préparations à base sucre
ou celles à base de viandes). Ce qui souligne à la fois la diversification du secteur
et l’importance des grandes firmes internationales, celles-ci procédant à des
échanges entre leurs différentes branches réparties dans le monde, avant d’arriver
à un produit final.
Les exportations de produits agricoles et alimentaires (PAA), sur la longue
période, augmentent comme pour l’ensemble des marchandises, plus rapidement
que la production. On peut donc en déduire que la part du système alimentaire
ouverte sur l’international est en augmentation.
Évolution des exportations mondiales de produits agricoles et alimentaires.
(OMC, 2008 cité par Rastoin et Ghersi, 2010)
1.3 Ouverture internationale de l’agriculture
En 2005-2006, la moyenne mondiale du ratio exports agricoles/PIBA (PIB
Agricole) s’établissait à 56%, mais avec des écarts considérables entre les pays
du monde.
Certains petits pays à hauts revenus, avec une faible population et une
infrastructure logistique très performante (comme la Belgique par exemple) ont un
ratio qui dépasse 100%, grâce à la valeur ajoutée des produits transformés. Les
grandes puissances agricoles à forte population se situent à un niveau
intermédiaire avec un ratio entre 50 et 100% (comme les Etats-Unis ou le Brésil).
Suivent ensuite les pays très peuplés (comme la Chine) et les pays en voie de
développement à forte population et/ou infrastructure logistique défaillante
(Angola, Bangladesh, Tunisie, etc.)
Quant au ratio exports agricoles/ exports totales, il est très nettement inférieur
dans les pays riches et industrialisés (sauf exceptions : Australie, Nouvelle-
Zélande, Danemark) par rapport aux pays pauvres qui ont fréquemment un taux
élevé (plus de 50 %). Cette dépendance de la balance commerciale pour la
production agricole, dominée souvent par un ou deux produits à peine, indique
une forte vulnérabilité économique pour ces pays.
En ce qui concerne les produits, la moyenne d’exportation s’établit à onze
pourcents du total et ce chiffre n’a augmenté que de deux pourcents en 20 ans.
Mais là encore il existe de très grandes différences : par exemple 84% de la
production mondiale de kiwis est destinée à l’exportation, alors que seulement
trois pourcents des pommes de terres produites dans le monde sont exportées.
1.4 Structure du marché agricole mondial
Une première caractéristique importante des échanges internationaux de produits
agricoles et alimentaires est la forte polarisation de ce commerce: en 2007, 67%
des échanges mondiaux (exportations et importations) étaient réalisés par les
blocs de la « Quadriade » (Union européenne, ALENA, Mercosur et Chine), avec
un poids considérable des échanges « intra-régionaux », c'est-à-dire à l’intérieur
des zones régionales de libre échange existantes. Ainsi, le commerce entre les 27
pays de l’Union européenne représente plus du tiers des exportations mondiales
de PAPF.
Mais les cartes sont en train d’être redistribuées. Les gagnants sont
principalement les grands pays émergents, dont la part dans le commerce agricole
mondiale augmente fortement, mais aussi quelques petits pays comme le Liban,
le Sénégal, le Mozambique ou la Tunisie.
D’après les statistiques de la FAO, le top dix des plus gros exportateurs agricoles
est (dans l’ordre) : Etats-Unis, Pays-Bas, France, Allemagne, Brésil, Belgique-
Luxembourg, Italie, Espagne, Canada et Australie (classement sur 40 ans).
Cependant, si on adopte un point de vue plus géopolitique et que l’on considère
l’Union européenne comme un seul pays, en éliminant les échanges intra-
communautaires (qui représentent 78% des exportations agricoles totales de l’UE
en 2007), on fait alors apparaître le poids croissant des pays émergents.
Le top dix des exportateurs de produits agricoles et alimentaires.
((OMC, 2008 cité par Rastoin et Ghersi, 2010)
La liste est quasiment la même si on se concentre sur les produits alimentaires
transformés, avec quelques changements de places dans le classement mais cela
prouve que tous les grands exportateurs se sont engagés dans la voie de
l’agroalimentaire.
Un phénomène très important pour comprendre la structure du marché agricole et
alimentaire mondial est que dans la liste des dix premiers importateurs mondiaux
de produits agricoles et alimentaires figurent quasiment les mêmes pays que dans
celle des exportateurs. A l’exception notable du Japon présent ici (troisième
importateur mondial) et de l’Australie, absente. La plupart des pays connaissent
une progression de leurs importations allant de trois à cinq pourcents par an
(depuis au moins dix ans), ce qui est supérieur à la croissance des marchés
intérieurs et indique donc une hausse des besoins plus rapide que celle de la
production. L’U.E. des 27 est de loin le premier marché agricole et alimentaire
mondial, avec 46% des importations mondiales (douze pourcents si l’on exclut les
échanges intra-communautaires), un chiffre qui a doublé par rapport à l’année
2000. Les pays émergents quant à eux ne réalisent que seize pourcents des
importations mondiales, ce qui représente à peine 38% des dépenses du top dix.
Le top dix des importateurs de produits agricoles et alimentaires, 2007.
(OMC, 2008 cité par Rastoin et Ghersi, 2010)
Pour comprendre qui sont les véritables gagnants et perdants en termes de
commerce agricole il faut donc regarder la balance commerciale des différents
pays dans ce domaine. Le Brésil arrive ici clairement en tête, les Etats-Unis ne se
trouvant pas sur la liste parce que leur balance commerciale agricole est
relativement équilibrée bien que légèrement déficitaire.
Soldes commerciaux agricoles positifs et négatifs les plus élevés.
(OMC, 2008 cité par Rastoin et Ghersi, 2010)
1.4.1 Principaux flux de produits agricoles et alimentaires
Si l’on tente d’établir la carte des échanges agricoles et alimentaires, les flux de
produits dessinent à la surface de la planète des liens économiques denses, mais
inégaux. L’essentiel du commerce agricole et alimentaire mondial reste cantonné,
pour l’essentiel, à quelques « autoroutes » (maritimes, terrestres et aériennes) qui
relient des grandes puissances entre elles et laissent des miettes aux autres pays.
Le monde du commerce agricole est multipolaire : trois zones, Europe, Amérique
du Nord et Asie assurent 81% des exportations et 84% des importations totales.
Une seconde caractéristique lourde des échanges est la prépondérance des
échanges intra-zones : 81% pour l’Europe (effet « Union européenne »), 42% pour
l’Amérique du Nord (effet « ALENA ») et 56% pour l’Asie (dans ce cas, il n’y a pas
de zone de libre-échange, mais des relations d’affaires très actives). Ce qui
montre aussi la très grande efficacité des unions économiques pour stimuler les
échanges commerciaux.
Matrice du commerce international des produits agricoles et alimentaires,
2007.
(OMC, 2008 cité par Rastoin et Ghersi, 2010)
En fait, en éliminant les flux internes aux unions douanières existantes dans le
monde, le panorama change totalement : le marché international des produits
agricoles est divisé par deux (580 milliards de dollars au lieu de 1121), l’Asie
passe au premier rang avec 210 milliards, suivie de l’Amérique latine, de
l’Amérique du Nord et de l’Europe avec environ 100 milliards pour chaque sous-
continent. En réalité, le marché que l’on peut réellement qualifier d’international ne
représente qu’une très faible partie de la production mondiale. Il joue pourtant un
rôle pilote pour l’établissement des prix.
Si l’on s’intéresse aux changements à l’œuvre dans la structure des échanges, on
remarque que les marchés qui grandissent le plus sont l’ex-URSS, puis l’Afrique, il
s’agit toutefois de marchés de taille réduite (50 et 43 milliards de dollars). C’est
l’Amérique latine qui a tiré le plus grand profit de ces deux marchés émergents. La
CEI (Communauté des Etats Indépendants) et le Moyen-Orient ont également
réalisé une belle percée en Afrique. Les autres zones (du tableau ci-dessous)
enregistrent des progressions plus petites, mais qui sont cependant proches d’un
doublement en 7 ans, et ceci sur des flux économiques beaucoup plus importants.
Évolution du commerce international de produits agricoles entre 2000 et
2007 (en %)
(OMC, 2009 cité par Rastoin et Ghersi, 2010)
1.4.2 Rôle de la demande mondiale et son évolution
Une autre lecture que l’on peut avoir du marché international agricole est qu’il y a
deux catégories de clients : d’un côté, ceux qui sont en demande de produits de
base pour l’alimentation humaine, cela concerne les pays en voie de
développement et certains gros pays émergents ; et ceux qui ont besoin de
produits pour l’alimentation animale, comme l’U.E ou des pays émergents
déficitaires tels que la Chine et la Russie. Dans les deux cas, la demande gonfle
et est concentré sur un petit nombre de produits végétaux : blé, riz, maïs, soja. Or,
si le prix des matières premières en général croît à cause de l’élévation de la
demande mondiale, poussée par les pays émergents, les matières premières
agricoles ne font pas exception.
Le marché, déjà fortement sous pression, a été de plus déséquilibré par une
nouvelle utilisation des matières premières agricoles : les agrocarburants. Rien
qu’aux Etats-Unis, qui appliquent une politique stimulante pour ce secteur, la
consommation et avec elle la production de ce type de produit a doublé entre
2005 et 2007. Cette concurrence entre food et fuel dans un contexte de
raréfaction des terres et de l’eau, en plus du plafonnement des rendements de
l’agriculture productiviste, accentue les frictions économiques et financières autour
des produits agricoles.
« La rareté est de retour » (Pouch, 2010, p.130) et ces deux phénomènes
(augmentation de la demande mondiale et pression des agrocarburants) sont les
raisons de base qui ont mené à la hausse des prix des matières premières
agricoles et donc à la crise alimentaire de 2007-2008 et aux fameuses « émeutes
de la faim ». A cela il faut rajouter également la hausse des coûts de production et
de commercialisation des aliments, due en grande partie à l’augmentation du prix
du pétrole (qui a un impact sur le prix des engrais et autres intrants, des
emballages et des transports) mais aussi et surtout le rôle de la spéculation
financière.
1.4.3 Rôle des marchés à termes et de la spéculation financière
Le principe des marchés à terme et donc de la spéculation financière existe
depuis très longtemps (il a en fait quasiment suivi l’invention de la monnaie) et
permet historiquement de fluidifier un marché aussi risqué que celui de
l’agriculture. En assumant le risque de fluctuation des prix et en faisant le lien avec
des clients qui sinon n’auraient pas rencontré l’offre du producteur, le spéculateur
joue un rôle économique clé et même (du moins en théorie) stabilisateur pour le
marché. « L’histoire montre comment les producteurs ont réussi à transférer les
risques sur les négociants et comment ces derniers stabilisent les prix en
spéculant. » (Facchini, 2006)
Ceci étant, dans la réalité on observe parfois des divergences importantes entre
les marchés à terme et les marchés physiques qui peuvent aller jusqu’à de
véritables effets d’emballement. Or, les grandes bourses de commerce jouent un
rôle fondamental dans la fixation des prix mondiaux et ont un impact considérable
sur l’économie agricole de tous les pays. En 2007-2008, il aura suffi qu’une petite
partie des spéculateurs se détournent du gigantesque marché des subprimes,
alors en plein éclatement, pour venir inonder le marché des produits agricoles et
déclencher une forte hausse des prix de ceux-ci.
1.4.4 Rôle des multinationales dans le secteur de l’agroalimentaire et
de l’agrofourniture
Si on veut approcher la nature actuelle du marché mondial agricole, il est
impossible de faire l’impasse sur le rôle structurel que jouent les multinationales
de l’alimentaire dans celui-ci. Si l’agriculture reste un secteur très atomisé, le
système alimentaire mondial est lui dominé par une quarantaine de très grandes
firmes internationales. Celles-ci se sont constituées par un processus de « fusions
et acquisitions », qu’on retrouve dans tous les secteurs et qui est une
caractéristique de la mondialisation. Elles proviennent de la croissance externe de
firmes occidentales puisqu’on constate notamment qu’en 2006, plus de 90% des
730 milliards de dollars investis dans le système alimentaire mondial venaient de
pays à hauts revenus. Cependant, de nouvelles multinationales se forment dans
des pays comme la Chine, l’Inde, l’Argentine ou le Brésil et pourraient bien
modifier le jeu agroalimentaire mondial.
C’est clairement en amont du système alimentaire que la concentration est la plus
élevée, c'est-à-dire dans le secteur de l’agrofourniture qui produit les semences,
les engrais chimiques, les substances phyto et zoosanitaires et le matériel
agricole. Or ce secteur conditionne étroitement la configuration de l’agriculture et
une telle concentration de puissants groupes chimiques et mécaniques influe
forcément sur le modèle d’affaire adopté.
Au niveau de l’agriculture même, on peut observer aussi une nette tendance à la
concentration, bien que comme on l’a dit celle-ci est très loin d’être aussi avancée
que dans les secteurs en amont ou en aval. Portée à l’origine exclusivement par
des firmes agroalimentaires, comme dans le cas des fruits tropicaux avec Del
Monte ou United Fruits, cette concentration dans l’agriculture est aujourd’hui aussi
financée par des capitaux en provenance d’autres secteurs, attirés par la hausse
des prix alimentaires. Ainsi se développe dans le monde entier l’ « agribusiness »,
la production industrialisée à grande échelle, dont les résultats en termes de
volumes et de marge sont indéniables mais qui posent d’énormes problèmes
sociaux (pauvreté, exclusion) et environnementaux. Parmi les investisseurs de ce
type d’agriculture on trouve notamment des fonds souverains de pays cherchant à
sécuriser leur approvisionnement alimentaire en achetant des terres ailleurs : c’est
le phénomène de l’ « accaparement des terres ».
L’industrialisation du système alimentaire a généré des produits qui s’apparentent
aux biens de grande consommation et les matières premières agricoles sont
devenues des marchandises comme les autres. Cependant, leurs spécificités
légitiment toujours des traitements spécifiques de la part des états et des
instances internationales. C’est pourquoi nombre de pays connaissent des
politiques agricoles actives, avec intervention de l’Etat, et que les échanges de
produits agricoles sont une source de préoccupation majeure de tous les
gouvernements. Ce qui complique donc la tâche des grandes négociations
commerciales multilatérales dès que l’on commence à parler d’agriculture.
1.5 Les discussions sur le commerce agricole international
La question agricole fait bien évidemment partie des grandes négociations
internationales sur le commerce et si le poids des produits agricoles et
alimentaires est sur le déclin, voire marginal aujourd’hui, dans les échanges
mondiaux de marchandises, « ils n’en revêtent pas moins une importance décisive
dans les relations internationales » (Pouch, 2010, p.11).
Le dossier Agricole a toujours constitué la pierre d’achoppement des grandes
négociations commerciales internationales : déjà en 1982, alors que l’idée d’un
nouveau grand cycle de négociation (qui allait devenir « l’Uruguay Round »)
commençait à prendre forme, la réunion des ministres du commerce, alors dans le
cadre du GATT (voir plus bas), avait achoppé sur l’agriculture. Les négociations à
l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) sont d’ailleurs bloquées depuis
2001 principalement à cause de l’épineux dossier agricole qui rend impossible la
conclusion du Cycle de Doha (Organisation Mondiale du Commerce).
Pour rappel, l’OMC a été fondé à la suite de l’accord de Marrakech signé par 124
pays en 1994. Son avènement constitue une rupture dans les négociations sur le
commerce international car cette nouvelle institution intergouvernementale vient
prendre place aux côtés du FMI, de la banque mondiale ou des Nations Unies
pour succéder à une « simple » instance de dialogue qui prévalait jusque-là : le
GATT (General Agreement on Tarifs and Trade). Ce dernier, créé en 1947 à
Genève est composé de sept « cycles » dont le dernier, « l’Uruguay Round »
conclu en décembre 1993, allait donner lieu à la création de l’OMC. Le GATT avait
comme but principal l’abaissement des droits de douane et la réduction des
restrictions quantitatives et qualitatives pour le commerce international. De ce
point de vue c’est un succès puisque les droits de douane sur les produits
manufacturés sont passés de 40% en moyenne en 1947 à moins de quatre
pourcents en 1994 et que de nombreuses règles de « bonne conduite » ont été
fixées pour les « barrières non-tarifaires » telles que les subventions ou les
protections des marchés publics.
1.5.1 Le dossier agricole au sein de l’OMC
Comme nous l’avons mentionné, le sujet de l’agriculture (et celui, lié, des
industries agroalimentaires) peine encore à être intégrés aux grands accords de
l’OMC.
En fait le dossier agricole a bénéficié d’un régime d’exception au sein des
négociations internationales pendant très longtemps, la déclaration de Tokyo en
1979 soulignait encore le caractère spécifique de l’agriculture malgré l’apparition
des premières tensions autour de la PAC européenne, venant surtout des Etats-
Unis.
Les Etats-Unis justement ont été les premiers, dès 1933 et le New Deal, à
légitimer l’interventionnisme dans le secteur agricole pour le protéger des fortes
fluctuations de prix et pour le soutenir dans sa recherche de parts de marché au
niveau mondial. Et si les choses ont beaucoup évolué depuis, jamais les Etats-
Unis n’ont remis en question l’idée même d’une politique agricole (en tout cas
américaine) forte.
C’est à partir des années quatre-vingt, que la thèse comme quoi toute politique
agricole produit des distorsions de concurrence et est donc néfaste pour
l’économie mondiale commence à gagner du terrain. Le libéralisme économique
domine alors largement le climat intellectuel et l’accession de Ronald Reagan à la
présidence des Etats-Unis vient accentuer cette tendance.
Mais c’est surtout la confrontation ouverte en matière de politique agricole entre
les Etats-Unis et l’Union Européenne à la même époque qui amèneront les Etats-
Unis à s’engager sur le terrain du libéralisme dans ce domaine. Pour eux, la PAC
européenne est alors la cause de leurs pertes de parts de marché dans le secteur
agricole et son démantèlement est une priorité de l’administration Reagan. Les
Européens firent front pour protéger la Politique Agricole Commune qui leur avait
si bien réussi et se déclarèrent prêts à négocier uniquement si l’aide alimentaire
américaine, qui est une sorte de soutien indirect aux agriculteurs, était aussi mise
dans la balance. Finalement, l’Union Européenne, parce qu’elle ne veut pas
assumer seule l’échec des négociations, adoptera en mai 1992 une réforme
d’envergure de la PAC qui faisait la part belle aux exigences américaines et était
taillée sur mesure pour permettre un accord au GATT (Guyomard et Mahé, 1995).
En novembre 1992, alors qu’aucun accord international d’envergure n’avait jamais
été conclu sur ce sujet, les États-Unis et la Communauté Européenne d’alors
surmontèrent donc la plupart de leurs divergences concernant l’agriculture en
concluant ce qui était officieusement dénommé l’Accord de Blair House. Celui-ci
allait ouvrir la voie à un accord global sur l’agriculture et donc à la conclusion du
Cycle de l’Uruguay, commencé en 1986.
L’Accord Agricole, qui fait partie de l’accord général du Cycle de l’Uruguay de
1993, a conduit indéniablement à la limitation des subventions à l’exportation et à
la réduction des soutiens publics ayant un effet direct sur la production, comme
annoncé. Cependant, en matière d’accès au marché, il n’a pas entraîné de réelle
ouverture des frontières dans la plupart des pays développés car ceux-ci ont
utilisé au mieux les dispositions techniques de l’Accord (qu’ils avaient négocié)
pour maintenir une protection élevée sur les principaux produits agroalimentaires.
Les pays riches n’ont donc pas joué franc-jeu dans leur appel à plus de libéralisme
et ont fait primer leurs intérêts commerciaux immédiats. (Bureau, 2002).
Depuis 2001 et le programme de Doha (du nom de la capitale du Qatar où a eu
lieu la quatrième conférence interministérielle dans le cadre des négociations de
l’OMC), les principes libéraux ont gagné du terrain par rapport à « l’exception
agricole » mais l’agriculture reste un sujet à part et très sensible qui bloque le
processus de négociation de l’OMC.
En effet, le cycle de Doha se terminera par un échec surtout à cause de la
question agricole, sur laquelle portaient l’essentiel des tractations. Elle est ainsi au
centre des négociations commerciales internationales car aucun accord n’est
possible tant qu’elle n’est pas réglée. Or plusieurs groupes, aux intérêts
divergents, s’affrontent sur ce dossier. Ils sont résumés dans le tableau ci-
dessous, avec leurs objectifs. A noter que les différents groupes se superposent
parfois, certains pays rejoignant les positions de un ou plusieurs groupes en
fonction de leur situation géopolitique. Pour être totalement complet il faudrait
sans doute aussi ajouter un groupe : le « G-1 », composé des seuls Etats-Unis qui
ont un leadership et une tendance hégémonique particuliers à l’OMC.
Les coalitions de pays les plus actives à l’OMC.
(Rastoin et Ghersi, 2010)
L’objectif de Doha, repris par Hong Kong en 2005, était l’amélioration de l’accès
au marché, la réduction des soutiens internes à l’agriculture et la suppression des
aides à l’exportation. En somme, l’approfondissement des objectifs de l’Accord
Agricole, au nom de la réduction des distorsions venant perturber le
fonctionnement de la loi de l’offre et de la demande.
Son échec est essentiellement dû au fait que la plupart des pays n’avaient rien à
gagner à suivre la logique de l’OMC dans le domaine de l’agriculture : depuis 1993
et l’Accord Agricole, les pays riches se sont contentés de sauver certaines formes
d’aides, qu’ils pouvaient se permettre, en même temps qu’ils en interdisaient
d’autres pour légitimer l’abaissement des droits de douane, seule protection de
beaucoup de pays en voie de développement. « Le cycle de Doha est un cycle
dans lequel les pays développés tentent de forcer l’entrée des marchés des pays
en voie de développement, en particulier dans le domaine de l’agriculture »
(Choplin, Strickener et Trouvé, 2009).
La FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l'agriculture) a
déclaré en août 2006 que « l’effondrement des négociations commerciales
internationales du cycle de Doha [était] essentiellement dû à une tentative des
pays riches, des corporations et des puissants lobbies de s’accaparer des
avantages sur les marchés agricoles », regrettant en outre que les négociations se
soient focalisées sur « le commerce libre, plutôt que sur le commerce équitable ».
La FAO ajoute que « le cycle de Doha était sans grand intérêt pour les pays les
moins avancés, qui n’ont pratiquement rien obtenu lors des précédentes
négociations commerciales sur l’agriculture de l’OMC. Si la réduction des
subventions et des droits de douane agricoles par les pays développés se fait
dans l’intérêt des pays en développement, elle doit être appliquée dans un cadre
qui accroît les revenus de leurs petits agriculteurs et améliore leur sécurité
alimentaire » (FAO, 2006)
Il convient néanmoins de préciser cette fracture pays riches/ pays pauvres, où les
premiers cherchent à flouer les seconds en prônant le libéralisme sans l’appliquer
vraiment à eux-mêmes. Il faut rajouter au tableau tous ceux qui s’opposent à l’idée
même de politiques agricoles et revendiquent une libéralisation totale du secteur :
ce sont les pays du groupe de Cairns (voir tableau précédent), Brésil en tête. On
remarque d’ailleurs la présence de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande dans ce
groupe, preuve que les conflits entre pays développés existent aussi. De la même
façon l’Inde a toujours défendu l’exception agricole et s’est opposé
vigoureusement en 2008 à une libéralisation du secteur agricole mondial ce qui
montre bien qu’entre « géants émergents » les conflits sont possibles également.
1.5.2 Etat de la protection et du soutien à l’agriculture dans le monde
Tout ceci fait que le niveau de protection de l’agriculture et des industries
agroalimentaires reste élevé dans la plupart des pays du monde. En 2001, le taux
moyen mondial des taxes appliquées à l’importation était de 20 % dans le secteur
agricole contre 4,6 % dans l’industrie et les mines. De plus, en l’absence d’un
accord global, Il y a un traitement différencié des pays en fonction de
considérations économiques et géopolitiques. Les tarifs varient aussi fortement
selon les produits. L’U.E. par exemple applique des taux réduits pour l’Afrique
alors que les pays développés du groupe de Cairns subissent de lourdes taxes.
De la même manière, le blé ne subit pratiquement aucun droit de douane au sein
de l’U.E, alors que le riz, les produits laitiers, les viandes et le sucre sont
lourdement taxés.
Si l’agriculture reste un secteur très protégé, elle reste aussi un secteur très aidé,
particulièrement dans les pays développés. Les soutiens à l’agriculture
comprennent les interventions sur les prix agricoles et les subventions à la
production, mais aussi, d’une façon plus large, les services aux agriculteurs tels
que la recherche, la formation, les contrôles de qualité, la promotion des produits,
etc., financés sur fonds publics et les transferts du consommateur qui résultent de
la différence de prix entre le marché intérieur et le marché international.
L’agrégation de ces trois sortes d’aides, directes ou indirectes, donne des
montants colossaux : 372 milliards de dollars en 2006 pour les pays de l’OCDE
qui concentrent la majorité des transferts publics vers l’agriculture mondiale. On
comprend directement que les marchés agricoles ne fonctionnent absolument pas
dans des conditions de concurrence pure et parfaite.
La composition des subventions est variable selon les pays et reflète des
politiques agricoles et des conditions économiques différentes. Pour stimuler la
production agricole, il est par exemple possible d’apporter des aides au prix à la
ferme (solution privilégiée par l’U.E ou le Japon) ou bien à l’achat d’intrants (Etats-
Unis, Australie, Mexique,…).
Pour apprécier différemment l’intensité des soutiens que par des montants
globaux, on peut établir des indicateurs qui ramènent les aides totales au nombre
d’agriculteurs ou à l’emploi agricole, aux superficies cultivées ou encore au PIB.
Le poids sur le PIB des transferts vers l’agriculture est à la fois modeste (1 % en
moyenne pour l’ensemble des pays de l’OCDE) et considérable, car la moyenne
de la contribution de l’agriculture au PIB est pour ces pays de l’ordre de 3 %. Les
aides par emploi agricole se situent à près de 13 000 dollars, avec une fourchette
allant de 2 000 dollars pour la Turquie à près de 45 000 pour les États-Unis. Les
soutiens à l’hectare sont également dans une proportion de 1 à près de 40 entre
ces deux pays. On voit bien que, ici encore, les chiffres obtenus sont très variables
de pays en pays et reflètent des situations mais aussi des moyens difficilement
comparables. Ils permettent aussi de relativiser certaines idées préconçues : on
découvre par exemple que, par emploi agricole, les États-Unis sont de loin les
plus interventionnistes.
La négociation agricole à l’OMC ne porte que sur les soutiens directs à
l’agriculture (pas les services publiques ni les transferts du consommateur comme
expliqué plus haut, qui ne représentent que 29% des montants donnés). On
remarque que ceux-ci sont très concentrés sur l’Union européenne, les États-Unis
et le Japon qui représentent à eux trois 77 % des aides totales à l’agriculture. Si
on analyse l’évolution de ces soutiens sur les dix dernières années on constate
une stagnation ou une augmentation pour la plupart des pays (avec des
exceptions notables, comme le Japon), ce qui nous ramène encore une fois au
constat de l’échec des négociations de Doha concernant l’agriculture.
Les différentes sortes d’aides à l’agriculture sont réparties par l’OMC selon trois
catégories : une « boîte verte » qui comprend les subventions autorisées, une
boîte orange qui contient celles qui sont tolérées mais doivent être réduites ou ne
pas dépasser un certain seuil et une boîte bleue qui concerne les subventions
liées aux programmes de limitation de la production, qui sont également
plafonnées.
Ce classement a été instauré par l’Accord Agricole de 1994 et continue à
réglementer les formes de soutiens à l’agriculture, en raison des échecs
successifs des négociations ultérieures. Le programme de Doha implique la
réduction significative du niveau de remplissage des trois boîtes, en étant
bienveillant sur la boîte bleue et en épargnant la boîte verte.
Ainsi, les pays industrialisés ne vont « avoir de cesse de déplacer le maximum de
leur budget agricole dans la boîte verte de l’OMC en réformant un à un les
secteurs de production sur le même modèle : remplacement des soutiens aux prix
par des aides directes, puis découplage de celles-ci de la production. » (Choplin et
al., 2009). De cette manière l’U.E. peut continuer à légitimer sa PAC tandis que les
Etats-Unis ne doivent aucunement justifier l’aide alimentaire qu’ils accordent à leur
population et qui représentait 64 milliards de dollars en 2010 et concernait un
américain sur sept. (MOMAGRI, 2013)
2. LA PAC
2.1 Qu’est ce que la PAC en bref?
La PAC est la Politique Agricole Commune de
l’Union Européenne. Elle est la plus ancienne
des Politiques Communes. Elle est mise en
œuvre par la Direction Générale « Agriculture
et développement rural » de la Commission
européenne. Elle est aujourd’hui composée
de deux piliers : le premier, de base, qui vise le soutien des marchés et gère les
prix agricoles et le second, dit du développement rural. Encore aujourd’hui, elle
reste l’une des plus importantes dans l’Union Européenne et représente la plus
grosse dépense de l’Union. Pour la période 2007-2013, elle rassemblait 42,5% du
budget, ce qui représente 55,5 milliards d’euros sur les 129,1 milliards d'euros du
budget total de l’Union (Union Européenne, 2012).
2.2 Historique
2.2.1 La naissance de la PAC
L’idée d’une Politique Agricole Commune est née pendant la seconde guerre
mondiale, en 1943. A cette époque-là, l’Europe est alors réellement en retard par
rapport à ses besoins de production. En effet, elle est déficitaire au niveau de sa
production agricole : peu de sucre, de lait, de céréale et de viande bovine. Dans
son discours du 9 mai 1950, Robert Schuman2 appelle à la création d’une
communauté européenne. Six états répondent à cet appel : la France,
l’Allemagne, l’Italie et le Benelux. L’idée de cette politique commune est donc
d’atteindre, par cette union solidaire et en modernisant l’agriculture, une meilleure
productivité en Europe (Burny, 2010).
Après la seconde guerre mondiale, on a simplifié à outrance les systèmes de
culture pour créer des boulevards de l’alimentation. On a valorisé toutes les
plantes qui fournissaient le plus à l’hectare. La plante la plus riche en énergie,
c’est le maïs. Celle qui fournit le plus de protéines à l’hectare ? Le soja. Pour les
calories ? Le palme est imbattable. Une bonne dose d’engrais, de pesticides et
d’herbicides par-dessus, et la boucle était bouclée, le cercle vicieux installé.
(Saporta, 2010, p.115)
Lors du traité de Rome, le 25 mars 1957, la Communauté Economique
Européenne (CEE) est fondée. C’est là que va naître réellement la Politique
Agricole Commune européenne. On passe de la simple idée à la réalisation. Pour
seulement six pays, la communauté se confrontait déjà à bien des difficultés dans
l’élaboration d’une réelle politique agricole commune. Les cultures ne sont pas les
mêmes entre ces pays et les conditions climatiques ou encore les systèmes
sociaux sont très différents (Burny, 2010).
C’est à la conférence de Stresa en Italie, en juillet 1958, que les bases de la PAC
seront précisées. Et le 1er août 1962 elle entrera véritablement en vigueur.
2 �
Considéré comme l’un des « pères fondateurs » de l’Europe (1886-1963).
2.2.2 Les différentes réformes
La PAC a connu de nombreuses réformes depuis sa création. Nous allons
brièvement les énoncer en les mettant en lien avec leurs contextes respectifs.
Nous nous arrêterons plus en longueur sur les plus importantes.
Au sortir des années 1960, les objectifs productivistes de la Politique Agricole
Commune sont atteints et même dépassés. La PAC est alors victime de son
succès : les exploitations agricoles européennes sont en surproduction et l’Europe
est confrontée à des excédents énormes qu’elle doit stocker. Au niveau des
quantités de lait : en 1973 l’U.E avait déjà atteint l’autosuffisance et en 1983, elle
se retrouvait avec un million de tonnes de beurre et 700. 000 litres de lait en trop.
Plus tard, ce sera le secteur céréalier qui réalisera des surplus importants. Tout
cela entraine un coup budgétaire important puisque l’U.E. paie à l’époque des
subventions aux exportations pour écouler tous ces excédents sur le marché
international (Choplin, 2013).
Des mesures vont alors être mises en place afin de tenter d’aligner la production
sur les besoins du marché. C’est en 1984 qu’ont lieu les premières modifications.
Des mesures d'encadrement des dépenses semblent alors nécessaires. L’Union
va donc mettre en place des quotas laitiers et des dispositions de maîtrise des
marchés des céréales et du vin. En 1988, des nouvelles propositions seront faites
car les dernières démarches entreprises n’ont pas permis d’améliorer la situation.
Fin des années quatre-vingt, on avait entre autres atteint 10 millions de tonnes de
céréales en trop (Union Européenne, 2012).
Gérard Choplin, Alexandra Strickner, Aurélie Trouvé dans Souveraineté
alimentaire. Que faire ? :
Il fallait maitriser le productivisme, cesser de nuire à l’environnement et stopper le
dumping (que nous définissions comme l’exportation à un prix inférieur au coût
de production moyen du pays – hors subventions). Bien que les causes de la
crise aient été explicitées, que les solutions aient été proposées, l’Europe
politique ne va pas s’en sortir par le haut.
Au début des années 1990, nous sommes encore face à 25 tonnes de céréales
en trop et 900 000 tonnes de viande bovine. Seuls les quotas laitiers ont été
respectés.
C’est en 1992 qu’on peut réellement parler de la première réforme3. Elle vise
essentiellement à mieux recadrer la PAC dans le marché. L’Europe cherche alors
à diminuer son poids budgétaire en baissant les prix garantis. En effet, L’U.E.
garantissait un certain prix, bien au-dessus du prix mondial, aux agriculteurs pour
leur production. Cette baisse des prix va être compensée par des paiements
directs (premier pilier de la PAC) aux producteurs qui sont non plus en
concordance avec leur production mais proportionnels à la taille de leurs
exploitations. En échange de cette aide, les agriculteurs doivent garantir une
période de gel de la production. Face à une crise de la surproduction, le gel est la
meilleure solution qui ait été avancée par l’U.E. Cela permet de mieux maitriser la
production, de réduire les stocks et de renforcer la compétitivité (Direction de
l’information légale et administrative, 2013).
Cette réforme visait donc à résoudre des problèmes internes mais pas
uniquement. Il était nécessaire pour l’Europe de se conformer aux règles
internationales4. La PAC passe d’un soutien des marchés à un soutien aux
producteurs, puisque le soutien des prix est remplacé par des aides directes aux
agriculteurs (Direction de l’information légale et administrative, 2013).
Mais en 1995 de nouvelles contraintes arrivent comme l’élargissement de l’Union
Européenne aux Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO). Un processus
d’élargissement qui est surtout lié au potentiel de production agricole substantiel
que les PECO ajouteraient à l’Union grâce au caractère sensible de l’agriculture et
à la taille relative du secteur agricole dans ces pays (Union Europénne, 2012).
C’est en 1999 que le second pilier de la PAC va voir le jour. Celui-ci vise le
développement rural et représente aujourd’hui 20% du budget de la PAC. Il appuie
en fait surtout la modernisation et la restructuration agricole et très peu le
développement ou le maintien de l’activité dans les régions rurales (Choplin et al.,
2009).
3 �
Appelée aussi la réforme Mac Sharry, selon le nom du Commissaire à l’agriculture de
l’époque.
4 �
Rappelons que l’Organisation Mondiale du Commerce a été instauré 2 ans plus tard, en avril
1994.
Tandis que la PAC continue allègrement à vider le monde rural de son tissu de
paysans, on fait croire à l’opinion que le second pilier et ses mesures vont régler
les problèmes (Choplin et al., 2009).
C’est en 2003, lors d’une révision à mi-parcours, que la commission imposera un
découplage important des paiements directs du premier pilier malgré l’opposition
de la plupart des états européens. L’OMC ne peut en effet plus accepter le modèle
productiviste de la vieille PAC et l’énorme dumping5 qui l’accompagnait. Les
Européens ont donc cherché un moyen de faire du dumping en agriculture mais
en respectant les règles conclues avec les autres : on découple les aides de la
production et on diminue les aides à l’exportation. Le problème est qu’il n’y a donc
plus besoin de produire pour bénéficier des aides.
Pour vendre ce nouvel instrument aux agriculteurs et à l’opinion publique, on a
fait croire à tort que le découplage serait bon pour l’environnement et qu’il
supprimerait l’effet distorsif sur les marchés puisque les paiements ne dépendent
plus ni du type, de l’acte de production. Son effet pervers est de délégitimer les
paiements aux yeux du contribuable, qui ne voit pas pourquoi il devrait payer
quelqu’un qui peut ne pas produire (Choplin et al., 2009).
Le budget a été établi pour la période de 2004 à 2013, en distinguant les anciens
états membres et les nouveaux. C’est là que va être instauré la progressivité des
aides. En effet, les nouveaux membres ne vont pas directement accéder aux
mêmes aides que les quinze premiers (Burny, 2010).
La réforme de 2008 constitue essentiellement en un « bilan de santé » et à une
consolidation de la réforme de 2003.
2.2.3 L’élargissement
Avec seulement six pays dans les années soixante, l’Europe peinait déjà à mettre
au point une politique agricole commune entre ses membres. En 2004, elle ouvre
ses portes à dix nouveaux pays6 et en 20077 à encore deux autres. C’est donc
face à 27 agricultures distinctes qu’elle doit se confronter aujourd’hui.
5 �
Puisqu’on se retrouve dans un modèle avec de la surproduction et des aides à l’exportation,
l’Union Européenne faisait descendre un maximum les prix pour gagner plus en vendant plus.
6 �
Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie
et Slovénie.
Dix états en plus, cela veut dire quatre millions d’agriculteurs supplémentaires.
Cela promet de nouveaux débouchés mais surtout une concurrence beaucoup
plus accrue. Des pays très agricoles comme la Pologne et la Roumanie vont
notamment entrer en jeu. Ces deux pays possédaient un grand nombre de petites
et moyennes exploitations paysannes. Les adhésions de la Pologne et la
Roumanie ont marqué un virage pour les institutions européennes et nationales
parce qu’elles signifient que la transition vers une économie de marché est
considérée comme terminée dans ces pays (Darrot, Von Hirschhausen, 2011).
L’élargissement a contribué à une augmentation de 40% de la surface agricole
utilisée (SAU), de 40% la production céréalière, de 23% celle de lait et de
quatorze pourcents celle de la viande bovine de l’Union Européenne. Le budget
de la PAC a de son côté augmenté de 20%.
Un projet de modernisation des agricultures des futurs états membres, géré à la
fois par les gouvernements nationaux et l’Union Européenne, avait été mis en
place avant leur adhésion.
Afin que les futurs membres puissent un minimum se mettre à niveau, un
instrument agricole de préadhésion appelé SAPARD8 a donc été instauré par l’UE.
Ainsi, 1,33 milliard d’euro leur ont été accordés dès les quatre années
précédentes 2003. On atteint même la somme de 2,2 milliards si l’on ajoute les
sommes octroyées pour l’intégration de la Bulgarie et la Roumanie. Les résultats
obtenus sont bons puisque la production a été relancée dans tous ces pays mais
pour que la PAC puisse fonctionner totalement dans ces nouveaux états
membres, les millions de travailleurs qui s’y trouvent doivent encore apprendre à
mettre en pratique le droit communautaire (aGter et du secteur études, 2012).
7 �
Bulgarie et Roumanie.
8 �
SAPARD est un cadre d’aide communautaire à l’agriculture et au développement rural
durable destiné aux pays candidats d’Europe centrale et orientale durant le processus de préadhésion
pour la période 2000-2006. Il vise à résoudre les problèmes d’adaptation à long terme du secteur
agricole et des zones rurales. Il constitue un soutien financier à la mise en œuvre de l’acquis
communautaire en matière de politique agricole commune et de politiques connexes (Europa.eu).
Comme dit plus haut, la décision a été prise de leur octroyer les aides de manière
graduelle. La Roumanie recevait, en 2007, 25% des aides. Après quoi, elles ont
augmenté de cinq à dix pourcents chaque année de manière à ce qu’elles arrivent
en 2016 au même montant que les autres. Pendant cette période, les
gouvernements nationaux sont autorisés à ajouter des aides complémentaires. On
appelle ces aides des « top-ups »9 et celles-ci peuvent aller jusqu’à un certain
seuil qui est déterminé par l’Union européen (aGter et du secteur études, 2012)
(Renard, 2010).
2.3 Différence de traitement dans le premier pilier
L’aide uniforme à l’hectare tue l’agriculture et enrichit les propriétaires qui sont
déjà riches. Il faut aller à l’encontre de l’RPUS parce que ce n’est pas aider
l’agriculture mais c’est aider les propriétaires (Tarabella, 2013).
Les aides directes dans l’Europe des quinze, les aides du premier pilier, sont
appelées Régime de Payement Unique (RPU). On peut obtenir l’aide en
présentant un hectare éligible et en respectant une série de 18 normes qui
couvrent des domaines comme la sûreté alimentaire, le bien-être animal, etc.
(Renard, 2010).
Ces aides sont donc des payements directs à l’hectare mais avec des dispositions
spéciales. Ce RPU va en effet prendre différente forme. Les états membres ont la
possibilité de choisir entre trois modèles différents (Knight, 2010).
Le premier est le modèle historique. Le calcul est fait par exploitation. On le fait
sur base du montant que celle-ci a reçu pendant une période de référence
historique et par rapport au nombre d'hectares exploités au cours de cette même
période. Sur cette référence, l’exploitation reçoit les aides actuelles. C’est le
modèle notamment choisi par les régions belges.
La seconde possibilité est le modèle régional. On fait le calcul d’une enveloppe
globale sur le territoire du pays, également sur base des montants reçus lors de la
période de référence. Et on divise cette enveloppe globale par le nombre
d’hectare de la superficie agricole utilisée. On arrive donc à un montant uniforme
9 �
En Roumanie, ces aides sont appelées « plan national pour le développement rural »
(PNDR)
par hectare, au sein d’une zone géographique définie. Ce modèle est notamment
appliqué au Danemark.
Le troisième est le modèle hybride. Les états qui l’utilisent peuvent appliquer des
systèmes de calcul différents selon les régions de leur territoire ou calculer les
payements en se fondant à la fois sur une approche historique et sur un taux
forfaitaire. Ces systèmes peuvent finalement également varier au cours du temps.
Ce type de modèle est appliqué en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni,
etc. (Renard, 2010).
On comprend donc que c’est sur une base historique qu’on a établi les sommes
versées aux états membres. C’est pourtant ici que les nouveaux états membres
vont se retrouver face à un « problème » puisque leur enveloppe historique est
évidemment vide (Renard, 2010).
Pour les pays rentrés dans l’Union après 2003, ce système d’aide est remplacé
par le régime de paiement unique à la surface (RPUS), beaucoup plus simple. Un
hectare représente simplement une somme.
Le système de paiement des aides appliqué dans le cas de la Roumanie est le
régime de paiement unique à la surface (RPUS). Le seuil minimum pour les
aides a été décidé par le gouvernement roumain. Le plafond se situe à un
hectare, les parcelles détenues ne pouvant pas être inférieures à 0,3 ha ou à 0,1
ha pour les vignes et les arbres fruitiers. En imposant ces limites presque trois
millions d’exploitations ont été exclues, les aides concernant seulement 9,5
millions hectares de la SAU totale de 13,298 millions hectares. Selon les chiffres
du ministère de l’agriculture roumain, en 2011, un nombre de 1,088 millions de
bénéficiaires ont reçu 130,82 €/ha (dont 50,46 de complément national). Malgré
le fait d’être largement contesté pour son effet sur l’accroissement des inégalités,
le RPUS a été adopté car il est considéré plus facile à mettre en place dans le
pays où les démarches administratives et la gestion des aides posent encore des
problèmes. Ce système favorise néanmoins la polarisation de l’agriculture,
augmentant les écarts entre les petites et les grandes structures au niveau
national (aGter et du secteur études, 2012).
Si les modèles sur base historique figent les inégalités héritées du passé où les
gains étaient encore liés à la production, ces RPUS favorisent les grands
propriétaires et accentuent le dualisme de l’agriculture des pays qui les utilisent.
De plus, dans ce système simplifié, si l’aide augmente, les loyers et le coût de la
terre vont augmenter également. On n’achète pas seulement une terre, on achète
les subventions qui vont avec (Tarabella, 2013).
Seul la Slovénie et Malte avaient choisi de se confronter aux difficultés des RPU
dès le départ. En 2010, tous les pays rentrés en 2004 sont également passés à
cette formule. Aujourd’hui il n’y a plus que la Roumanie et la Bulgarie qui
bénéficient encore de ce type d’aides (Knight, 2010).
2.4 Buts et principes de la PAC
La Politique Agricole Commune de l’Europe a été élaborée, rappelons-le, dans
une période de carence alimentaire. On peut dégager cinq objectifs majeurs à la
PAC qui sont toujours d’actualité aujourd’hui.
1. Assurer la productivité et la compétitivité de l’agriculture européenne. Cet
objectif est purement économique et peut bien sûr être contesté, au niveau de
l’écologie notamment. Il reste aujourd’hui un objectif essentiel. Le but principal de
la PAC est d’améliorer l’utilisation des facteurs de production et de la main œuvre
afin de faire rentrer la production agricole dans une économie de marché.
2. Améliorer le revenu agricole. Il y a en effet des disparités à deux niveaux.
Tout d’abord au niveau externe (donc par rapport aux autres domaines) et ensuite
au niveau interne (les gros agriculteurs par rapport aux petits paysans).
3. Stabiliser les marchés : Rendre les prix moins volatile par rapport aux
conditions climatiques, etc.
4. Garantir les approvisionnements : Pour réaliser cet objectif, la PAC garantit
l’augmentation de la production intérieure et l’ouverture des frontières aux
importations.
5. Garantir des prix raisonnables aux consommateurs
A la conférence de Stresa, en juillet 1958, se sont dessiné quatre grands
principes directeurs (Burny, 2010) :
1. Marchés et prix unifiés : dès le départ on va unifier les marchés, les produits
peuvent circuler en toute liberté dans les pays de l’Union (Choplin et al., 2009).
2. Préférence communautaire : des taxes à l’importation vont être décidées sur
un certain nombre de produit afin de favoriser le marché intérieur (Choplin et al.,
2009). C’est le principe qui est le moins mis en œuvre. (Burny, 2010).
3. Parité et productivité : la productivité a été stimulée pour que les agriculteurs
puissent produire à moindre coût grâce à un soutien des prix agricoles. Les
revenus agricoles devaient atteindre donc progressivement ceux des autres
secteurs (Choplin et al., 2009).
4. Solidarité financière : les dépenses en matière agricoles ont été financée à
partir d’un budget commun qui ne correspondait forcement pas à la redistribution
qui en sera faite. En 1984, ce principe sera battu en brèche par de Margaret
Thatcher, exigeant de recevoir autant que sa contribution. Quand elle donnait une
livre au budget européen, elle voulait recevoir une livre en retour (Burny, 2010).
2.5 Les outils de la PAC
L’Union Européenne a en main des grands instruments afin d’atteindre les
objectifs de sa politique commune. Dans les marchés libres, les prix vont dans
tous les sens, on a donc décidés de définir plusieurs outils qui permettent de les
réguler :
1 Prix d’intervention : si le prix du marché européen descend en dessous
d’un « prix garanti », l’Union achète alors sur le marché. Elle stocke, exporte,
donne aux plus démunis ou alors détruit les surplus (Choplin et al., 2009).
2 Prix indicatif : est un prix plafond qui permet d’assurer un certain revenu
aux agriculteurs. C’est un prix indicatif, celui que la Communauté souhaite voir
obtenir par les producteurs agricoles compte tenu du niveau de production espéré.
3 Taxes à l’importation (ou le prix de seuil) : on peut forcement acheter
moins cher ailleurs, c’est pourquoi l’UE protège son marché en imposant des
taxes à l’importation (Burny, 2010).
4 Aides à l’exportation afin de combler, s’il existe, l’écart entre les prix
d’intervention et les prix mondiaux (Burny, 2010).
La PAC a également en sa possession des mesures structurelles qui lui
permettent d’éliminer les petites exploitations qu’elle évalue comme « non-viable »
ainsi que d’autres pour agrandir et moderniser les plus grandes afin d’abaisser
leurs coûts de production (Choplin et al., 2009).
Les dépenses en matière d’agriculture sont garanties par deux fonds différents
(compris dans le budget européen) :
le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Il finance le premier
pilier, c’est-à-dire les paiements directs aux agriculteurs et les mesures destinées
à réguler les marchés agricoles.
le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
C’est lui qui finance les programmes de développement rural des États membres
(Union Européenne, 2012).
2.6 Budget et bénéficiaire
Pour rappel, la PAC est composée de deux piliers. Le premier se focalise sur la
production, le soutien des marchés et les payements directs aux agriculteurs.
Le deuxième est la partie de la PAC qui se concentre sur le développement rural à
travers la modernisation des économies rurales, la diversification, etc. (Knight,
2010).
Avant toute chose, il est également bon de préciser que l’agriculture est le seul
secteur entièrement financé par le budget européen. Les dépenses nationales
sont censées être entièrement remplacée par la PAC.
La PAC est la plus grosse dépense de l’Europe. Elle représentait, en 2012, 40,8%
du budget. En regardant le tableau ci-dessous, on comprend que 77% des aides
de la PAC sont destinées au premier pilier. Le deuxième pilier, qui doit
subventionner le maintien de la vie rurale, est en certain point une illusion. Nous
l’avions déjà compris dans le point traitant de RPU et des RPUS (du premier pilier,
beaucoup plus important donc), la PAC actuelle favorise largement les gros
exploitants. Il faut également souligner que pour ce deuxième pilier, les actions
sont cofinancées par l’Europe et l'État membre. Nous verrons plus tard, avec le
cas de la Roumanie, pourquoi il a tant de mal à se mettre en place et à réaliser.
CE: crédits d'engagement - CP: crédits de paiement (Union
Européenne,2013)
La répartition des aides reflète « le poids respectif » des agricultures de chacun
des Etats membres. La France, dont l'agriculture représente 20% de l'agriculture
européenne, reçoit ainsi 20% du budget de la PAC. Cette tendance a été
renforcée lorsque l’on est passé à un système de paiement unique à l’hectare. La
critique que l’on peut dresser est que puisque les aides sont désormais
découplées de la production, les sommes d’argent perçue ne sont pas toujours
justifiables. Prenons l’exemple du Royaume-Uni. La reine d’Angleterre, l’un des
plus grandes fortunes du monde, bénéficiait en 2008 d’environ 530.000 euros pour
son domaine privé autour du château de Sandringha.
Le tableau des répartitions détaillées du budget de la PAC pour l’année 2009
montre également combien le développement rural est désavantagé. Il est
également important de noter la différence entre promesse et payement.
L’entièreté des aides directes et des interventions sur les marchés agricoles
annoncées ont été versée alors que seulement les trois-quarts des aides pour le
développement rural ont été distribuées.
(eur-lex.europa.eu,2009)
Nous l’avons également déjà souligné plus haut mais les différences notoires
entre les différentes agricultures sont également à prendre en compte dans la
distribution de ce budget. Le tableau si dessous nous laisse entrevoir cette
différence en comparant assez simplement l’agriculture roumaine à celle du
Royaume-Uni.
On constate qu’en Roumanie, en Pologne ou en Bulgarie, les aides accordées
pour la modernisation de l’agriculture sont bien plus importantes que dans les
autres pays d’Europe.
2.7 Les institutions impliquées et leurs rôles dans la réforme de la PAC
La commission européenne est responsable de la bonne gestion de la PAC et
contrôle son application. C’est le commissaire européen de l’agriculture,
actuellement Dacian Ciolos, et son équipe qui propose des modifications et
réformes des politiques agricoles. La DG de l'Agriculture et du Développement
Rural compte environ 1000 fonctionnaires. Elle est dirigée par José Manuel Silva
Rodiguez et est responsable de la mise en œuvre de la politique agricole (Union
Europénne, 2013).
Lorsqu’une réforme est proposée par le commissaire européen, la commission de
l’agriculture du parlement européen va pouvoir proposer des amendements sur
ces propositions. Après cela, ils vont être votés en séance plénière par tout le
parlement.
Le conseil des ministres de l’agriculture, comportant les différents ministres de
l’agriculture des pays membres, travaille sur base des textes acceptés ou rejetés
par le parlement. Les ministres doivent atteindre un consensus. Après quoi, il y
aura une renégociation entre les trois parties (commission, parlement et conseil
des ministres) jusqu’à qu’un texte unique soit approuvé par tous.
2.8 Limites de la PAC
L'Europe souhaite produire une agriculture compétitive d'une part mais désire
également soutenir les plus petites exploitations d'autre part. Qu'en est-il
réellement ?
Dans les textes européens, on note le projet de restructurer l'agriculture vers de
plus grandes exploitations dans une recherche de compétitivité maximale mais
également une volonté de soutien aux plus petites exploitations qui ne sauraient
pas s'adapter aux normes du marché.
Ces aides octroyées par la PAC sont-elles équitablement réparties entre ces deux
catégories ? L’étude réalisée par Catherine Darrot et Béatrice Von Hirshhausen en
2011 permet de comprendre dans quel sens vont les dispositions européennes
concernant la restructuration de l’agriculture des futurs membres. L’analyse porte
sur les textes définissant les efforts de préadhésion de la Pologne et de la
Roumanie et sur leurs effets réels. Le cas de la Pologne est intéressant car celui-
ci a lieu plusieurs années avant celui de la Roumanie. Les chercheurs ont donc pu
observer les effets des textes sur une plus longue période.
1) L'exemple de la Pologne
En Pologne l'axe 1 « modernisation » du second pilier de la PAC prévoit :
-l'aide à la modernisation des exploitations
-l'aide au départ en préretraite
-l'aide aux jeunes agriculteurs
L'axe 2 « soutien à la durabilité des zones rurales » du second pilier prévoit :
-l'aide à la diversification des activités
-les aides agro-environnementales
L'axe 1 a pour objectif le développement et la compétitivité des exploitations. L'axe
2 vise à soutenir les petites exploitations.
Mais ces subventions sont-elles efficacement réparties ?
Pour avoir droit à l'aide à la modernisation du second pilier, « il faut être capable
d'avancer le montant des investissements pour en bénéficier, l'Union Européenne
ne remboursant que 18 mois plus tard ». (p.77)
Conséquence : seules les exploitations déjà grandes et riches peuvent accéder à
cette aide à la modernisation. Le plus grand nombre de demandes de subsides
provient donc d'exploitations de tailles importantes qui peuvent se permettre
d'avancer l'argent.
De façon encore plus étonnante, les aides agro-environnementales destinées aux
petites cultures sont principalement octroyées aux grandes exploitations. Ces
aides ne vont donc pas « aux régions ou la main-d’œuvre agricole est la plus
élevée par hectare, autrement dit aux régions ou l'agriculture assure la plus forte
fonction sociale et est identifiée comme bénéfique pour l’environnement ». (p.78)
C'est également vrai pour les aides à la diversification des activités rurales dont la
destination est prévue à l'origine pour les petites exploitations dans les zones ou le
chômage rural est important. Ces aides sont « mieux captées dans les régions de
grandes exploitations, sans lien effectif avec le taux de chômage rural ». (p. 78-79)
Force est donc de constater que les aides allouées par la PAC vont aux
exploitations qui n'en ont pas pleinement l'utilité.
2) L'exemple de la Roumanie
En Roumanie les demandes d'aides directes du premier pilier de la PAC
proviennent essentiellement des régions où l’implantation des grandes
exploitations est la plus forte. Dans les régions ou la petite paysannerie est
fortement présente, les demandes sont rares. Comment expliquer cela ?
La PAC ne prend pas en compte les micro-exploitations de moins d’un hectare car
« elle considère que les plus petites exploitations sont vouées à une disparition
prochaine. Aucun dispositif d'aide ne leur est donc destiné ». (p.81)
Cette limitation fixée à 1 ha, exclut des aides 49,5% du total des exploitations et
cinq pourcents des terres. Et même si la parcelle correspond aux critères de
subventions, « le montage d'un dossier de demande, l'ouverture d'un compte
bancaire constituent pour bon nombre de familles paysannes un obstacle réel ».
(p.81)
Pour les aides agro-environnementales du second pilier (destinées à la base aux
petites exploitations), le critère de taille entre également en compte. Ainsi, les
subventions accordées vont quasiment toujours au même type d'exploitation. Cela
a pour effet de creuser toujours plus l'écart entre les structures agricoles.
2.9 Réforme de la PAC 2014-2020
C'est en octobre 2011 que sont lancées les premières discussions pour la PAC
2014-2020 entre la Commission Européenne, le Parlement Européen et le Conseil
des 27 Ministres de l'agriculture sous propositions de règlements de la
Commission. (Chambre Agriculture Normandie, 2013).
Le processus de réforme suit un calendrier précis :
Octobre 2011 : Publication par la commission de ses propositions de règlements
PAC.
Février 2013 : Décision du Conseil des Chefs D'Etat sur le cadre budgétaire 2014-
2020.
Mars 2013 : Avis du Parlement sur les propositions de règlements.
Mars 2013 : Avis du conseil des 27 Ministres de L'Agriculture sur les propositions
de règlements.
Avril-Juin 2013 : Négociations (« Trilogue ») entre les trois parties prenantes de la
décision.
Juin 2013 : (prévisionnel) Adoption de la PAC après 2013 par codécision du
Conseil des 27 Ministres et du Parlement Européen Validation par le parlement
Européen du cadre budgétaire 2014-2020.
2014 : (prévisionnel) Début d'application de la PAC réformée. (Chambre
Agriculture Normandie, 2013)
Les discussions de cette réforme se déroulent en parallèle avec les négociations
budgétaires de l'Union Européenne pour la prochaine période financière de 2014-
2020. En effet, pour pouvoir faire une réforme budgétaire de la PAC, il faut tout
d’abord savoir quel sera le montant du budget européen total et la part que la PAC
continuera d’avoir au sein de celui-ci. (Knops, 2012, p.2)
Les chefs d'Etats des 27 pays de l'Union Européenne se sont mis d'accord, le 8
février 2013, sur le budget à allouer à la nouvelle PAC : 362,9 milliards d'euros sur
la période 2014-2020 (un tiers du budget total européen) soit une réduction de
3,22% par rapport à la proposition de la Commission et une réduction de treize
pourcents par rapport au budget de la PAC 2007-2013. (Sopinska, 2013)
L’arrêté budgétaire du Conseil des Chefs d'Etats et les discussions qui ont eu le
13 mars au Parlement et le 19 mars 2013 au sein du Conseil des Ministres
permettent de mettre en lumière les accords conclus. (Chambre Agriculture
Normandie, 2013)
Voici quelques-uns des principaux accords (Chambre Agriculture Normandie,
2013) :
Dans le cadre budgétaire 2014-2020 de la PAC, « les crédits du premier
pilier baisseront de cinq pourcents environ par rapport à 2013. Les crédits
européens du second pilier (développement rural) 2014-2020 sont en baisse de
plus de huit pourcents. Le Parlement Européen espère modifier à la marge cet
accord avant la fin juin.
La structure de la PAC ne change pas. C'est à dire le mécanisme des deux
piliers de la PAC.
Les aides octroyées par le premier pilier sont mieux réparties entre les
différents états. « Les pays dont les aides par hectare du premier n'atteignent pas
90% de la moyenne européenne réduisent d'un tiers cet écart de 2015 à 2020. 12
pays verraient leurs aides progresser au premier rang desquels les Pays Baltes, la
Roumanie, la Bulgarie et la Pologne ».
Plafonnement des aides par exploitation. « Un plafond à 300 000 euros par
exploitation et par an serait instauré, avec une retenue progressive entre 150 000
et 300 000 euros ».
Mise en place de cinq pourcents de surfaces agricoles d’intérêt écologique
au lieu des sept pourcents proposés par la Commission.
Revendications de quelques pays pour la PAC 2014-2020 :
L'Allemagne, plus gros contributeur du budget européen, souhaite une PAC
forgée sur l'économie. Selon Angela Merkel, la PAC « doit se résoudre à faire
des économies de fonctionnement ». La proposition d'Herman Van Rompuy
de réduire fortement le budget de la PAC à hauteur de 25 milliards d'euros
semble être pour la Chancelière un bon projet. (L'est-éclair, 2013)
La France opte pour une tout autre position. Etant le plus grand bénéficiaire
des aides de la PAC, François Hollande souhaite une PAC dont le budget
reste important. Pour le président français, la PAC doit avoir « le budget le
plus élevé possible (...). La PAC doit avoir une dimension économique de
soutien des productions et des prix et donc renforcer les mécanismes
d'intervention.» (Le Monde.fr avec AFP, 2013)
La Roumanie est comme la France, désireuse d'avoir un budget important
pour la PAC 2014-2020. Le ministre roumain des Affaires européennes,
Léonard Orban, pense « qu'il est essentiel pour nous que l'on assure des
allocations substantielles pour la politique de cohésion et la politique agricole
commune. » (Ambassade de France en Roumanie, 2011)
2.9.1 Critiques de cette réforme (Knops, 2012)
De nombreuses personnes du monde civil et politique auraient espérer voir une
réforme plus juste vis à vis de l'environnement mais également voir une PAC qui
tienne d'avantage compte des petites exploitants face aux grandes entreprises
agricoles. Cette réforme est donc une déception.
« Ecolo s'est exprimé pour dénoncer les différents renoncements de la
Commission qui traduisait clairement une volonté de maintenir la PAC dans une
logique de compétitivité internationale désastreuse ». (p.8)
Thérèse Snoy, dans une note présentée au Bureau Politique le 20 septembre
2010, mettait en garde : « si rien ne change, les paysans vont continuer à
disparaitre et les ressources naturelles à se dégrader ». (p.8)
En 2012, José Bové, député au parlement Européen, s'offusque lui aussi de cette
réforme. « On croit rêver (...). Personne n'a demandé le renforcement de la
compétitivité des entreprises de l'agroalimentaire, personne n'a réclamé le
développement des biotechnologies pour lutter contre la faim dans le monde et
personne n'a revendiqué la mise en place d'une agriculture duale avec les agri-
managers d'un côté et les petits paysans aux fermes chancelantes de l'autre ».
(p.3)
Il semble très clair que la PAC, conservant son système architectural actuel
composé de deux piliers « ne remet aucunement en question le cadre néo-libéral
imposé par l'OMC, un facteur qui conditionne toute prise de décision en matière
de politique agricole ». (p.8)
Selon un Communiqué de Presse du groupe des Verts/ALE, en octobre 2011, «
Aujourd’hui, ce sont toujours les plus grosses exploitations agricoles qui
bénéficient le plus des aides de la PAC, mettant les petites exploitations agricoles
sous pression. Sur les 14 millions d'agriculteurs en Europe, 10 millions ne
touchent pas ou peu d'aides ». (p.9)
La nouvelle réforme de la PAC 2014-2020 prévoit un plafonnement des aides à
300 000 euros. Cette instauration de plafonnement était une revendication des
agriculteurs les plus modestes, elle pourrait donc être vue comme une bonne
nouvelle. Cependant ce montant est excessif pour les défenseurs d'une PAC plus
équitable car il est « bien trop élevé et n'aura pas l'effet escompté, à savoir, la
redistribution de paiements des plus privilégiés vers ceux qui en ont le plus
besoin. De plus, la commission ne prévoit pas de mécanismes qui empêcheraient
les cibles de cette mesure d'entreprendre des démarches juridiques pour
fragmenter leurs exploitations, et ainsi éviter les effets du plafonnement ». (p.12)
2.9.2 Rôle des lobbys, qui est gagnant ? (de Lacour, 2013)
Pour la première fois dans une réforme de la PAC, le Parlement Européen est co-
décisionnaire avec la Commission. Cela donne un autre pouvoir au parlement. Du
coup, les eurodéputés ont été visés par les différents lobbys, agro-alimentaires ou
ONG environnementales.
Pour donner un exemple de ces actions, la WWF a envoyé 40 000 mails, une
Good Food March a été organisée devant le parlement Européen... Les
organisations de la société civile ont ainsi souhaité attirer fortement l'attention des
députés européens.
Cependant, les différents lobbys ne travaillent pas tous avec les mêmes moyens
techniques et logistiques. Pour donner un exemple, la Copa - Cogeca, lobby agro-
alimentaire, compte 120 salariés permanents à Bruxelles alors que la plupart des
ONG environnementales ne font appel qu'a des bénévoles. Les forces d'actions et
d'influence ne sont donc pas les mêmes.
3. EVOLUTION DE L’AGRICULTURE EN EUROPE
3.1 Mutations de l’emploi agricole en Europe
On observe une tendance lourde dans le secteur agricole : plus un pays est
technologiquement avancé, plus son développement économique est élevé et plus
l’emploi dans le secteur agricole est menacé.
L’ouverture quasiment complète des frontières avec l’UE des 15, à partir de
2004, a encouragé l’émigration temporaire ou définitive de nombreux actifs
agricoles. Mais les petites exploitations n’ont pas forcément disparu et
constituent parfois un « refuge » face à la crise économique actuelle, comme en
Pologne (Bazin, 2011).
Ces dernières années, la diminution de la main-d’œuvre agricole, n’a pas touché
tous les pays de la même manière. Par exemple, l’emploi agricole reste plus
important dans le Sud de l’Europe (Eurostat, 2013). « Des études ont montré
qu’entre 1995 et 2000, en Bulgarie et surtout en Roumanie, l’activité agricole a
progressé, éloignant même ces deux pays de la structure d’emploi de l’UE »
(Bazin, 2011). En ce qui concerne l’Estonie, la Hongrie et la Pologne, leur
production agricole a progressé de plus de 80% depuis 2005, grâce à la forte
réduction des effectifs agricoles et l’augmentation des grosses exploitations
industrielles (FAO, 2012). Malgré une production agricole qui progresse, on
constate que, globalement, en Europe, l’emploi agricole décroît depuis la Politique
agricole commune entreprise en 1992 (Eurostat, 2013).
3.2 Evolution du nombre d’exploitations dans les pays de l’Union
européenne
En 2007, les PECO1010 concentraient 57% des exploitations agricoles de l’UE des
27. Le nombre d’exploitations dans l’ensemble des PECO10 a diminué en
moyenne de 8,3% entre 2003 et 2007, suivant la même courbe décroissante que
dans l’UE des quinze. Ce qui est interpellant c’est que parallèlement à cela, la
basse de la main d’œuvre agricole dans les PECO10 est beaucoup plus rapide
que la baisse du nombre d’exploitations, ce qui n’est pas le cas dans l’UE des
10 �
Les PECO : pays d’Europe Centrale et Orientale. PECO10 : Hors Bulgarie et Roumanie
(Bazin, 2011).
quinze. « Ceci indique une évolution rapide des systèmes de production –
substitution du travail par du capital dans les plus grandes exploitations (…) –
ainsi que le départ temporaire ou définitif des travailleurs en surplus et mal
rémunérés dans les petites exploitations familiales » (Bazin, 2011).
On constate donc que la baisse du nombre d’exploitations et l’accroissement de
leur taille signifie immanquablement une diminution de la main d’œuvre agricole.
3.3 Transition agraire11 : l’adaptation des Nouveaux Etats membres
(NEM) de l’UE
« L’élargissement de l’UE à dix pays d’Europe centrale et orientale y a
profondément transformé les conditions sociales, économiques et politiques du
développement agricole et rural » (Pouliquen, 2011).
Impulsés par la poursuite d’une forte croissance globale et par l’accès aux aides
de la PAC, la reprise agricole et les gains de productivité ont globalement évité le
bouleversement, a priori très redouté de part et d’autre, des équilibres Est-Ouest
des productions et échanges agricoles mutuels. Mais les écarts de productivité
restent substantiels et l’extrême dualisme structurel hérité de l’ère communiste
reste marqué. D’un côté en effet, les grandes et très grandes exploitations
sociétaires et individuelles, issues de l’ancien secteur socialisé, sont très
renforcées par les aides communautaires, de l’autre une partie notable des
minifundia de subsistance a trouvé des voies multifonctionnelles de résistance.
Toutefois, dans la plupart des NEM, les exploitations « moyennes » ont conquis
ou maintenu (notamment en Pologne) une place significative, mais le plus
souvent sans accéder au modèle « professionnel » ouest européen (Pouliquen,
2011).
Les réformes menées en Europe centrale et orientale n’ont pas fonctionné tel que
souhaité. Premièrement, le processus de redistribution ou de restitution des
parcelles, à l’œuvre après la Seconde Guerre Mondiale, a participé à la
fragmentation de la propriété. Deuxièmement, les marchés fonciers sous-
développés n’ont pas permis un regroupement de la propriété. Troisièmement, la
création de droits de propriété et le démantèlement des fermes collectives et
11 �
« Historiquement, la transition agraire correspond au passage de structures de production
petites, peu productives dégageant un surplus limité à des structures plus grandes, plus productives
pour la terre et le travail en mobilisant du capital et dégageant des surplus commercialisés
importants » (Benoit-Cattin, 2007).
étatiques durant la période post-collectiviste n’ont pas facilité la création
d’exploitations de taille moyenne comme prévu.
D’un point de vue économique, il était attendu que les petites exploitations, en
dessous de la taille critique nécessaire aux économies d’échelle, et les très
grandes exploitations, souffrant de coûts de transaction élevés et de
déséconomies d’échelle, disparaissent au profit d’exploitations individuelles de
taille moyenne comme dans les pays occidentaux (Pouliquen, 2011).
Finalement, la transition a donné lieu à un secteur agricole dual dans la plupart de
ces pays où énormément de petites exploitations coexistent avec des exploitations
de taille moyenne, ainsi qu’avec de très grandes fermes, peu nombreuses mais
utilisant la majeure partie des terres agricoles (Pouliquen, 2011).
Malgré cette bipolarité de l’agriculture en Europe, « la persistance des petites
exploitations de semi-subsistance et des grandes structures employant des
centaines d’employés (…) a sans doute permis d’éviter un désastre social pendant
la (…) période de transition économique, en garantissant un niveau de vie à des
millions de personnes dans les zones rurales » (Pouliquen, 2011).
Lors des négociations d’adhésion, la Commission européenne a,
exceptionnellement, permis aux Etats entrant d’apporter à leurs agriculteurs des
aides complémentaires à celles de la PAC car l’agriculture dans ces pays
constituait un secteur primordial et « elle pesait également lourd dans le budget
européen (45%) en raison des subventions aux agriculteurs » (Pouliquen, 2011).
L’adhésion signifiait donc, pour ces pays, recevoir une part du gâteau constitué
par ces subventions agricoles généreuses, alors que pour la Commission et pour
les anciens États membres, l’élargissement impliquait une augmentation de la
part budgétaire de l’agriculture, et donc une plus grande contribution de certains
pays (comme la France et l’Allemagne) au budget européen (Pouliquen, 2011).
L’intégration de douze nouveaux membres dans l’UE entre 2004 et 2007 a
profondément modifié la structure de l’agriculture européenne. La surface agricole
utilisée a augmenté de 38% et l’emploi agricole a plus que doublé (Bazin, 2011).
3.4 Compétitivité de l’agriculture européenne : bilan
Une des priorités universelles du marché mondial est d’assurer les bases d’une
concurrence loyale. Or, dans l’agriculture, actuellement, cette concurrence sur les
marchés est foncièrement déloyale. Chaque pays opère avec ses propres règles
et chacun d’eux voudrait être le maitre du jeu. Le problème c’est qu’aucun n’arrive
à se mettre d’accord en termes de fiscalité, droits des travailleurs, salaires,
protection sociale, etc.
« Certains pays acceptent de financer des politiques environnementales, d’autres
détruisent leur environnement à long terme pour produire intensivement. Certains
font du dumping monétaire, d’autres ont des monnaies surévaluées. Certains
soutiennent leurs agricultures pauvres, d’autres la maintiennent dans la pauvreté
comme avantage comparatif » (Griffon, 2011).
La globalisation et la libéralisation des marchés n’ont fait qu’accroître les
déséquilibres. La combinaison guerre des coûts et absence de règles douanières
de compensation ne fait qu’aggraver de jour en jour la vie de la plupart des
agriculteurs européens (Griffon, 2011).
Au sein de l’espace européen s’est développée une forte concurrence qui peut
menacer les agricultures de certaines régions. Au moins deux tendances
s’opposent : la spécialisation des agricultures en fonction de leurs avantages
compétitifs (les porcs au Danemark, le blé dans le Bassin parisien, l’arboriculture
dans les pays du Sud…) et la vision – plus alternative – d’agricultures localement
diversifiées et ancrées dans leur territoire de manière, notamment, à bien
s’intégrer dans l’économie locale, à conserver les emplois et protéger les
paysages comme un capital pour le futur. La concurrence est avivée par le fait
que les pays membres n’ont pas les mêmes règles sociales (travailleurs payés
sous le Smic en Allemagne) ni fiscales et que les subventions ne sont pas
réparties selon les mêmes critères (Griffon, 2011).
Si les nouvelles règles de la PAC n’évoluent pas rapidement, des crises locales
surgiront pour tel ou tel produit peu compétitif. La crise dans la filière porcine en
Grande-Bretagne en témoigne déjà (Griffon, 2011).
4. LE CAS ROUMAIN
4.1 Description et statistiques
4.1.1 Première approche de la Roumanie
En Roumanie, les sols et le climat permettent une production agricole efficiente.
En effet, le pays profite d’une large gamme de sols cultivables et fertiles : vallées
fluviales, bassins transylvains, sols semi-arides de la Dobroudja méridionale, etc.
De plus, la superficie de terres de labour couvre plus du tiers (38,2% en 2009
selon Eurostat) de la superficie totale du pays, c’est à dire 238 391 km2.
Ce sont principalement les cultures céréalières (maïs, blé, houblon, avoine) et
l’élevage qui font la renommée de l’agriculture roumaine. À cela il faut également
ajouter la viticulture, l’arboriculture et le maraîchage (Velcea, 1967).
En termes de production au sein des PECO, la Roumanie se situe en deuxième
position, juste après la Pologne. Cependant la production des agriculteurs
roumains varie fortement d’année en année car utilisant moins d’engrais et de
pesticides et travaillant avec des techniques moins performantes, leur production
est plus sensible aux conditions climatiques12 (OCDE, 2000).
« Avec 36% de l’emploi national et une contribution au PIB de seize pourcents en
1998, l’agriculture occupe une place plus importante en Roumanie que dans
n’importe quel autre pays d’Europe centrale et orientale, à l’exception de l’Albanie.
Par contre, la Roumanie a très peu développé les autres secteurs de son
économie » (OCDE, 2000).
Dans son étude « Transmission patrimoniale et relations intergénérationnelles en
Roumanie », Fiona Gaborean fait le constat d’un pays dont l’économie reste,
encore actuellement, très agraire. Pour appuyer son propos, elle se base sur une
enquête du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (2005) qui montrait que
45,1% de la population habitaient la campagne et que quatre millions de ménages
subvenaient à leurs besoins grâce à une agriculture de subsistance.
Actuellement, le secteur agricole roumain présente deux caractéristiques
générales : d’une part, il comporte une forte masse de petites et moyennes
exploitations familiales qualifiables de « paysannes », et d’autre part, depuis son
entrée dans l’UE, il fait l’objet d’un projet de modernisation de ses structures
d’exploitation avec le support des aides de la PAC13 (Darrot et Von Hirschhausen,
2011).
12 �
Avant la construction de digues, chaque inondation des cultures par le Danube affectait la
production.
13 �
Ces deux caractéristiques peuvent être transposées au secteur agricole polonais (Darrot,
2011).
4.1.2 Quelques chiffres évolutifs (FAO, 2012)
Population économiquement active dans le secteur agricole (en milliers) :
3680 (1980) 2603 (1990) 1739 (2000) 868 (2010)
Part de l’agriculture dans la population économiquement active totale (%) :
35 (1980) 24 (1990) 15 (2000) 9 (2010)
Montant annuel moyen des flux d’IDE14 destinés à l’agriculture :
56 millions $ (2005-2006) 159 millions $ (2007-2008)
Dépenses publiques : part de l’agriculture dans le montant total des
dépenses publiques (%) :
3,4 (2000) 4,9 (2007)
14 �
IDE pour Investissements Directs Etrangers : « Les IDE constituent la catégorie
d’investissements internationaux qu’une entité résidente d’une économie (l’investisseur direct)
effectue dans le but d’acquérir un intérêt durable dans une entreprise résidente d’une autre économie
» (Eurostat, 2013).
4.1.3 Tableau comparatif des statistiques du secteur agricole en
Roumanie et en Belgique (Eurostat, 2013)
Roumanie
(237 500 km2)
Belgique
(30 528 km2)
Population active agricole 28% (2012) 1% (2010)
Part du PIB agricole dans
le PIB total
7,9% (2011) 6,6% (2004)
Production de céréales en
milliers de tonnes
14 874 (2009) 0,7% (2011)
Production de viande en
milliers de tonnes
779 (2004) 1821 (2003)
Terres arables (%
superficie émergée)
38,2% (2009) 27,7% (2009)
Terres arables (hectares
par personne)
0,41 (2009) 0,08 (2007)
4.1.4 Typologie des exploitations agricoles roumaines (Villemin, Andreff
et Montaigne, 2011)
- Exploitations de subsistance : 76,3% (2002)
- Exploitations de semi-subsistance : 21,1% (2002)
- Exploitations familiales commerciales : 2,1% (2002)
- Sociétés commerciales privées : 0,2% (2002)
Cinq ans plus tard, en 2007, 64% des exploitations roumaines produisaient
toujours uniquement pour leur propre production.
4.1.5 Tableau évolutif des parts de la surface exploitée par les
exploitations agricoles selon leur taille en Roumanie 15 (Bignebat et
Latruffe, 2011)
1994-1995 2007
Exploitations de moins de 5 ha 45% 90%
Exploitations entre 5 et 50 ha
(exclus)
10%
Exploitations entre 5 et 100 ha
(exclus)
10%
Exploitations de 50 ha ou plus 0,4%
Exploitations de 100 ha ou plus 45%
On constate qu’entre la chute du système collectiviste et l’entrée du pays dans
l’Union européenne, la Roumanie a gagné énormément de petites exploitations et,
parallèlement, le nombre de grosses exploitations a fortement diminué.
Actuellement, 93% des fermes roumaines ont une surface de moins de cinq
hectares, mais elles ne représentent que 30% de la surface agricole totale.
Environ 200 fermes ont une surface supérieure à 2000 hectares. Et 2,7 millions de
Roumains travaillent dans l’agriculture, soit 28% de la population active (Bran,
2012).
Exploitations
individuelles
Exploitations de
personne morale ou
en groupement
1990 (période de transition) 12%
2007 (entrée de la Roumanie 100% 0,5%
15 �
Les cases vides signifient que les données n’ont pas été trouvées pour ce type d’exploitation
dans l’UE)
4.1.6 L’écologie en Roumanie
« On avait déjà foutu en l'air l'Europe de l'Ouest, et maintenant on va détruire toute
l'agriculture roumaine » (Wagenhofer, 2005).
D’un côté, on a une Roumanie qui est face à des défis environnementaux
importants dû à la période communiste après laquelle les grandes fermes
collectives ont laissé des terres usées dont les sols avait été surexploités. Sur 16
millions d’hectares de terres agricoles, 12 millions ont été touchées par des
facteurs tels que l’érosion, les inondations, etc.
Mais d’un autre côté, ce n’est pas aussi catastrophique que dans les pays qui
pratiquent l’agriculture industrielle depuis des décennies. De plus, les paysans ont
l’habitude d’utiliser moins de pesticides, ce qui à pour bénéfice de préserver les
sols.
En Europe occidentale, on laisse les terres en jachère cinq à six ans alors qu’en
Roumanie une à deux années suffisent. Avec son entrée dans l’ « orbite
occidentale », le pays va être amené à traiter les sols exactement de la même
manière que dans les pays d’Europe de l’Ouest (Knight, 2010, pp.27-28).
4.2 Evolution de la culture paysanne roumaine : avant 2007
4.2.1 Fin de la domination ottomane et avènement du Vieux Royaume
En 1856, suite au traité de Paris qui symbolise la libération du peuple de l’emprise
ottomane, la Roumanie originelle se compose de deux principautés : la Valachie et
la Moldavie.
Dans son étude sur les réformes agraire en Europe centrale et orientale (2001),
Christian Giordano explique : « Après la conquête de son indépendance en 1877,
la Roumanie a dû affronter de puissants propriétaires terriens « autochtones » à
caractère féodal ou « patrimonialiste » – la noblesse et les boyards16 – qui, outre
16 �
Boyard : noble de haut rang dans les pays slaves, particulièrement en Russie (Xe-XVIII
e s.)
ainsi qu’en Moldavie, en Valachie et en Transylvanie. (Larousse, 2013)
leurs privilèges politiques, possédaient des fortunes économiques considérables
».
Depuis ses tout débuts, la Roumanie n’a cessé d’accumuler les réformes agraires.
Celles-ci ont fortement participé à la modernisation du pays. La première de ces
grandes réformes remonte à la période suivant la naissance du Vieux Royaume.
Elle porte sur l’expropriation de la propriété ecclésiastique et donc la
sécularisation de terres possédées, principalement, par des boyards. Avant d’être
promulguée, cette loi a été l’objet d’âpres débats dans la classe politique. Une fois
son entrée en vigueur en 1865, elle a permis à de nombreux paysans de gagner
leur liberté et aux familles de s’approprier les hectares qu’elles cultivaient déjà
(Giordano, 2001).
Henry L. Roberts mentionne que, malgré cette première réforme en faveur des
paysans, « les boyards conservèrent un tiers des terres, les meilleures et se virent
généreusement indemnisés par l’ État » (1969).
Les effets de la réforme agraire s’annulèrent rapidement, et ce pour les raisons
suivantes : premièrement trop peu de terres étaient attribuées à un trop grand
nombre de demandeurs, même si beaucoup de paysans étaient exclus de la
distribution et continuaient à travailler dans les latifundia17 des boyards ;
deuxièmement, la croissance démographique engendra, dans les campagnes,
une surpopulation dévastatrice ; troisièmement, les pratiques héréditaires
fondées sur la division en parts égales pulvérisèrent gravement la propriété. (…)
Les propriétaires se virent victimes d’un processus d’endettement rapide et
croissant qui les obligea (…) à solliciter des crédits aux intérêts exorbitants
auprès des boyards, des grands fermiers ou des usuriers. Une autre stratégie
consistait à restituer les terres aux anciens patrons et/ou à retourner travailler
dans les latifundia à des conditions presque équivalentes à celles d’autrefois
(Giordano, 2001).
David Mitrany explique qu’au début du XXème siècle, la société et l’économie des
campagnes roumaines fonctionnaient sous les modes du servage féodal et du
17 �
Latifundia : grand domaine agricole exploité extensivement et de façon archaïque (Larousse,
2013).
capitalisme réunis. Cette situation de détresse paysanne engendra des
soulèvements périodiques18.
4.2.2 La Grande Roumanie19 et l’entre-deux guerres
A la fin de la Première Guerre mondiale, une nouvelle réforme agraire se met en
place. Son but était avant tout de résoudre le vieux problème de la terre. Christian
Giordano explique : « La loi prévoyait que la propriété foncière ne pouvait
dépasser 100 hectares, les terres excédentaires dûment ôtées aux latifundistes
avec compensation par l’Etat devant, contre remboursement, être redistribuées en
lots de cinq à huit hectares » (2001). Cette seconde réforme a permis aux
paysans de récupérer une partie des terres des boyards.
Après la victoire des Alliés en 1918, la superficie de la Roumanie a doublé. Le
pays acquiert la Transylvanie, le Banat, la Bucovinie et la Bessarabie. Suite à cela,
la population roumaine a explosé, elle a augmenté de 70%. La nouvelle Grande
Roumanie devient à ce moment-là « un État hétéroclite, d’un point de vue tant
socioéconomique qu’ethnique » (Giordano, 2001).
Cette remarquable diversité contraignit le gouvernement de Bucarest à prendre
des mesures spécifiques pour chacune des régions. Dans ce cadre
socioéconomique, ethnique et législatif très complexe, les données officielles de
1921 disent qu’au total ce sont 6 millions d’hectares qui furent expropriés, dont 4
millions furent distribués à 1,4 million de paysans ; les 2 millions restants
demeurèrent aux mains de l’État ou furent assignés aux communes (Giordano,
2001).
Mais cette grande réforme ne rendit pas la Roumanie plus moderne qu’elle ne
l’était. « L’agriculture, avant la Seconde Guerre mondiale, ne réussit jamais
vraiment à décoller, et le niveau de vie dans les campagnes resta l’un des plus
bas d’Europe » (Giordano, 2001). En 1930, 6700 latifundistes détenaient encore
18 �
La grande révolte paysanne de 1907 traduisait le mécontentement des paysans vis-à-vis de
l’injustice de la propriété terrienne, aux mains de grands propriétaires. Elle peut être considérée
comme le point de départ de la nouvelle réforme agraire annoncée par le roi Ferdinand aux troupes
roumaines en pleine Première Guerre mondiale. (Roberts, 1969)
19 �
La Grande Roumanie (1920-1940) : le terme s’oppose à celui de Vieux Royaume. Il marque
le rattachement au pays de la Transylvanie, de la Bucovine, de la Bessarabie et d’une partie du Banat
roumain. (Larousse, 2013)
24% des terres tandis que 2,5 millions de paysans n’en possédaient que 28%. La
surpopulation de l’époque due à l’agrandissement du territoire d’après-guerre
provoqua une parcellisation excessive du sol (Giordano, 2001).
David Mittrany rend compte des inégalités créées par cette nouvelle loi dans les
régions gagnées après la Première Guerre mondiale, et en particulier en
Transylvanie. En effet, les minorités présentes dans ces régions ne pouvaient pas
bénéficier de cette réforme agraire car « les territoires acquis devaient être
attribués en premier lieu aux anciens combattants et aux veuves de guerre, qui,
évidemment, relevaient à tous égards de la nation roumaine » (Mitrany, 1930).
La réforme agraire, après la Première Guerre mondiale, avantageait la population
roumaine, paysanne pour une large part, tandis qu’elle défavorisait la population
magyare, vu que les Hongrois représentaient toujours la quasi-totalité des
latifundistes de Transylvanie qui auraient dû être expropriés, abstraction faite de
leur nationalité. (…) Le seul fait d’appartenir à la «nation ennemie », (…) pouvait
être à la base d’une discrimination dans la distribution de la terre. (…) Même si
en Transylvanie on ne peut parler de véritable persécution ethnique envers les
groupes minoritaires, il est indéniable que la réforme agraire incarne un
nationalisme en quête d’un idéal de « roumanisation territoriale et culturelle»
dans toute la région (Giordano, 2001).
Finalement, au lieu de moderniser les campagnes roumaines et de réduire le
retard de la Roumanie vis-à-vis des autres pays d’Europe occidentale, cette
seconde réforme est devenue un sujet particulièrement sensible entre les
différentes communautés. Les intérêts des grands propriétaires, en majorité
hongrois, se heurtaient continuellement à ceux des paysans, en majorité
roumains.
4.2.3 La période communiste
Dès 1949, le Parti Communiste au pouvoir en Roumanie a mis en œuvre « la
collectivisation » en organisant l’administration collective du cheptel, des terres et
des machines agricoles. (Ancuta, Ardelean, Arba et Darques, 2008).
Concrètement, les communistes adoptent des mesures d’expropriation avec
l’obligation pour les paysans de quitter leurs villages et leurs biens sans préavis,
en ayant parfois recours à l’agression physique et au chantage (accès des
enfants à l’éducation conditionné par l’entrée des parents dans la CAP20). Les
20 �
Coopérative Agricole de Production, Cooperativa Agricola de Productie : structures collectives
paysans roumains se transforment en travailleurs agricoles, propriétaires de leur
maison et d’une parcelle de 250 m2 maximum. Les familles les plus jeunes,
privées de ressources, émigrent et alimentent en main-d’œuvre les industries
dispersées sur tout le territoire national par le régime centralisé. (…) La vie
communautaire se dilue. Mis à part quelques localités choisies pour accueillir des
«centres agro-industriels», où étaient délocalisées quelques succursales
d’entreprises et où quelques blocs étaient construits pour signifier l’instauration
d’une vie meilleure, les investissements étaient généralement nuls ou très limités.
Les villages ont stagné. Réduit à sa seule fonction agricole et soumis aux
décisions prises par des autorités extérieures, l’espace rural a perdu son mode
de fonctionnement autorégulateur pour devenir un contenant (Ancuta, Ardelean,
Arba et Darques, 2008).
La seconde collectivisation a débuté en 1956. Tout comme la première, il s’agissait
d’exproprier la paysannerie sans pour autant nationaliser la terre. Durant toute la
période communiste la production et la gestion des fermes relevaient donc du
gouvernement. Ce qui a fait perdre au droit de propriété ses dimensions
historiques populaires fondamentales : usus, fructus, abusus21. « L’ordre
collectiviste agraire fondé sur l’appropriation sociale des moyens de production et
l’organisation collective du travail s’est substitué à l’idéal agrarien du paysan
propriétaire » (Maurel, 2011).
En 1973, 95% des terres cultivables appartiennent au secteur socialiste, 75% aux
coopératives agricoles de production (CAP) et 17% aux entreprises agricoles
d’Etat (IAS). (Eurostat)
En Roumanie, le monde rural a subi de plein fouet les politiques de privatisation
foncière car 90% de la terre a été collectivisée dans les années 50. (…) 10
millions d’hectares de terrains agricoles sont devenus propriété des coopératives
socialistes. La collectivisation a entrainé des transformations sociales
importantes : l’exode rural, les migrations journalières et hebdomadaires entre
ville et campagne, l’apparition du phénomène de « navetteurs » travaillant
alternativement à l’usine et aux champs des coopératives (Gaborean, 2011).
soumises à un régime de planification. Chaque coopérative se voit imposer des objectifs annuels mais
reste libre de les atteindre par les moyens qui lui conviennent. (Roger, 2002)
21 �
L’usus, le fructus et l’abusus : le droit d’user, de percevoir et de disposer (Larousse 2013).
« La figure du propriétaire a disparu de l’agriculture collectivisée tandis que s’est
affirmé le pouvoir des gestionnaires. Le caractère impersonnel de la propriété
collective a modifié les rapports à la terre et au travail, entraînant la
déresponsabilisation des travailleurs » (Maurel, 2011).
Néanmoins, Ion Velcea, docteur en géographie, faisait remarquer en parlant de la
Roumanie que la valorisation de certains terrains et la réduction des superficies
forestières isolées sous l’ère communiste avait contribuée à l’accroissement des
superficies agricoles du pays (Velcea, 1967).
A la fin des années 1980, l’économie roumaine était au bord de l’effondrement et
la population était profondément traumatisée par le régime autoritaire de
Ceausescu (OCDE, 2000).
4.2.4 La chute du système collectiviste
La chute du régime de Ceausescu (1989) marque un tournant dans tous les
secteurs de l’économie roumaine et particulièrement dans le secteur agricole.
Face à la pression paysanne, la Roumanie a dû engager la reprivatisation de ses
terres. Les gouvernements de l’ère postcommuniste ont donc mené plusieurs
réformes22 dans le but, notamment, d’améliorer les conditions de vie de la
population et, in fine, de regagner la confiance du peuple.
Au début des années 1990, le mot d’ordre du secteur agricole était la privatisation
de la propriété foncière qui était jusqu’alors collective ou étatique. Il s’agissait de
développer des exploitations individuelles plus efficaces que les formes collectives
de production.
Dans son article « Un village roumain face à la propriété privée », Florina
Gaborean parle d’un « retour paysan au passé » pour décrire le processus de
décollectivisation de l’agriculture (Pouliquen, 2011).
Il est intéressant de noter que la Roumanie constitue le seul pays d’Europe
centrale et orientale à avoir vu sa population agricole augmenter durant les
années 1990 du fait de ce « retour » massif dans les campagnes (Bazin, 2011).
22 �
En 1991, la loi sur le Fond foncier organisait la dissolution des coopératives agricoles. A la
place, des sociétés agricoles sont nées sous l’initiative de ménages ayant décidé de regrouper leurs
parcelles pour former une exploitation commune.
En 1996, le gouvernement fraichement élu d’Emil Constantinescu vote une série
de nouvelles lois : libéralisation des prix et du régime des changes, réduction des
droits sur les importations, élimination des subventions, démantèlement progressif
du contrôle du crédit dans le secteur agricole et promotion de l’investissement
étranger. Mais malgré toutes ces mesures, le déficit du commerce extérieur
roumain s’est aggravé et le chômage a nettement augmenté. De nombreuses
fermes roumaines, gérées par l’Etat autrefois, ont été abandonnées après la chute
de la dictature communiste. C’est ce qui a poussé le FMI en 1999 à conclure un
accord avec le pays pour redresser son économie. (Amblard et Colin, 2006 ;
OCDE, 2000).
Le journaliste Mirel Bran explique qu’après la chute du communisme, les pays
d’Europe de l’Est sont devenus très attractifs. Nombre d’exploitants agricoles
étrangers y ont vu des opportunités d’installation (Bran, 2012).
Comme le constate Marie-Claude Maurel à propos des agricultures d’Europe
centrale « En moins d’un demi-siècle, elles ont traversé trois ruptures majeures :
réformes agraires, collectivisation, décollectivisation » (2011, p. 2).
4.3 Evolution de la culture paysanne roumaine : après 2007
4.3.1 Production
On note en Roumanie un important déséquilibre entre la production animale et
la production végétale. La production de céréales et d’oléagineux23 représentait
à elle seule 67% de la production agricole en 2010.
La culture de céréales représentait 65% des terres arables. Elle s’élevait à 14 874
milliers de tonnes en 2009. En 2010, le rendement en céréales était de 3 331
kg/ha (Statistiques-mondiales, 2013).
La surface utilisée pour la culture du blé était de 2,15 Mha de blé, de 2,08 Mha
de maïs et 0,51 Mha d’orge. Les oléagineux utilisaient 18% des terres avec 0,53
Mha de colza, 0,79 Mha de tournesol et de 0,06 Mha de soja. La Roumanie
comptait en 2009 181 000 ha de vignes et la production de vin a été de 6,7
millions d’hl (Ambassade de France en Roumanie, 2011).
23 �
Plante cultivée pour ses graines ou ses fruits riches en lipides dont on extrait des huiles
alimentaires et dont on utilise les résidus de l'extraction dans l'alimentation du bétail (soja, colza,
tournesol, arachide, etc.) (Larousse, 2012).
En ce qui concerne l’élevage, la volaille constitue de loin la production principale.
En 2010, la Roumanie a élevé 80,8 millions de volaille dont 55% étaient des
poules pondeuses. Le cheptel porcin quant à lui s’élevait à 5,4 millions de bêtes
dont 1,7 dans des unités industrielles, l’ovin et le caprin comptait chacun 9,6
millions d’animaux. Deux millions de bovins étaient également élevés uniquement
pour une production laitière.
La production de bovins de races à viande n’est pas une priorité, du fait de la
préférence des consommateurs roumains pour la viande de porc et de volaille. La
production de lait, après une phase d’expansion jusqu’en 2006 avec 64,6 Mhl, est
en déclin avec 56,3 Mhl produits en 2009, et 49,1 Mhl produits en 2010. À 85%
composée de lait de vache, la production est autoconsommée à hauteur de 17%,
20% sont livrés aux laiteries, quinze pourcents sont vendus directement, et 42%
sont transformés en fromages. Les productions de viande porcine et de poulet ne
répondent pas en volume aux besoins des consommateurs et, en conséquence, la
Roumanie a recours à des importations en partie en provenance de l’UE. Les
animaux (bovins et ovins) vivants sont majoritairement exportés vers la Bulgarie,
l’Italie, la Grèce et le Moyen-Orient. La Roumanie manque d’une solide filière de
production bovine pour répondre aux exigences de la grande distribution
(Ambassade de France en Roumanie, 2011).
On peut préciser également que parmi les douze pays entrés dans l’UE après
2004, la Roumanie est le deuxième producteur agricole (après la Pologne)
(Darrot, Von Hirschhausen, Ghib, 2011).
4.3.2 Adhésion à l’Union Européenne : sous quelles conditions
Avant d’entamer ce point, rappelons que la Roumanie a subi 50 ans de production
collective et est entrée, à peine 18 ans après la chute du dictateur communiste
Nicolae Ceausescu, dans l’Union Européenne.
En 2003, en vue de sa prochaine adhésion dans l’Union, la Roumanie a entamé
un plan de modernisation du secteur agricole grâce à des subventions (SAPARD).
Aujourd’hui, les agriculteurs roumains perçoivent toujours des aides dans un but
de modernisation via le PNDR, programme national de développement rural et le
FEADR, fonds européen agricole pour le développement rural (Record, 2011).
Le Programme national de développement rural pour la période 2007-2013, vise
seulement neuf pourcents des fermes (soit seize pourcents de la surface
cultivées) – vraisemblablement à cause d’un manque d’information – et vu les
conditions imposées, seulement un quart des fermes peuvent postuler (Knight,
2010).
D’un point de vue européen, ce PNDR finance des top-ups : de l’argent en plus
des RPUS (premier pilier) que les nouveaux membres sont autorisés à verser à
leurs agriculteurs. Une partie de ces top-ups vient du second pilier mais la majorité
de l’argent vient du budget national. L’Europe autorise la Roumanie à
subventionner les fermes à partir de 0,3 hectares, mais celle-ci a choisi d’opter
pour un hectare. Cela lui revient à une centaine d’euros par hectare, qu’elle a déjà
des difficultés à payer. 2,6 millions de ménages sont donc exclus des payements
directs, soit la moitié de la population agricole (Knight, 2010).
Les nouveaux membres ne bénéficient pas directement des mêmes aides que les
autres pays européens. La Roumanie recevait en 2007 25% de la somme des
aides de la PAC. Le pourcentage augmentait de 5% par année jusqu’en 2010 puis
de 10% jusqu’en 2016 pour atteindre le même niveau que les autres pays (aGter,
2012).
Afin de favoriser l’intégration dans l’Union Européenne, des lois sont également
entrées en vigueur.
La loi 247 (2005) qui est une réforme de la propriété visant à fluidifier le
marché et à amener un regroupement des terres.
Elle abolit le plafond maximal de 200 hectares et le droit de préemption prévu par
la loi du fermage. Elle ouvre la possibilité de louer des terres à des personnes
physiques et à des entreprises étrangères. Elle assouplit également l’obligation
de réaliser le cadastre. Celui-ci n’est plus obligatoire au moment des ventes qui
ont pour objectif le regroupement des parcelles et pour les bénéficiaires du
programme «Rente Viagère » (aGter, 2012).
Cela constitue un réel feu vert de la part de la Roumanie à l’agriculture industrielle.
La loi 71 (2011) qui est, en réalité, une annulation de la loi du fermage.
Celle-ci garantissait des contrats de location de minimum 5 ans. Le bail pouvait
être payé soit en produits, soit en argent (la référence étant le blé). Elle assurait
également le droit de préemption pour le locataire en cas de vente. Cette loi
ouvrait la location des terres uniquement aux citoyens roumains.
Le fermage est donc dès lors ouvert à des personnes et entreprises étrangères.
Cela explique le flux d’investisseurs et d’agriculteurs étrangers venus s’installer en
Roumanie (aGter, 2012).
Pour l’Union Européenne, accepter de s’étendre à l’Est voulait forcément dire :
une complexification du débat sur la programmation de la PAC. Elle doit
notamment prendre en compte l’hétérogénéité de la Roumanie et préparer un
nouveau budget (aGter, 2012).
L’émergence du modèle ouest-européen « d’exploitation familiale
professionnelle » intensive et de taille moyenne, a été beaucoup plus lente et
difficile que ce qui avait été prévu et souhaité. Ceci malgré l’important budget et
les outils ad hoc du deuxième pilier de la PAC (Pouliquen, 2011).
4.3.3 Conséquence sur l’agriculture roumaine
« Si on veut sortir d’une agriculture de subsistance et que les zones rurales
deviennent des zones de développement économique, il ne faut pas uniquement
laisser la place à des énormes exploitations agricoles, même si elles seront
immanquablement présentes. Il faut qu’à côté de cela, il y ait un autre modèle qui
fasse vivre les paysans dans les campagnes. Et il faut des fonds publiques pour
cela » (Tarabella, 2013).
La Roumanie est aujourd’hui profondément affectée par les décisions prises par
l’Union. Ce que l’Europe occidentale a en tête quand elle dit vouloir préserver
l’agriculture familiale n’a rien à voir avec la réalité du terrain à l’Est. « La PAC n’a
jamais été créée pour pouvoir supporter le poids de la petite agriculture
roumaine » (Choplin, 2013).
Aujourd’hui, même si la Roumanie s’est ouverte au marché mondial, ce sont les
mêmes problèmes qui existaient pendant la période communiste qui touchent les
agriculteurs. Or, ces problèmes affectent principalement les petits paysans. La
raison principale en est que la Roumanie n’a jamais vraiment eu le temps de
développer un véritable modèle agricole. Leur quotidien n’est que lutte pour
s’adapter au nouvel environnement (Knight, 2010).
Toujours lié à cette période postcommuniste, l’administration est lente et reste très
bureaucratique. Quantité d’actions du gouvernement roumain ne font que diminuer
la confiance que les paysans lui accordent. Pour exemple, certains subsides ont
été payés seulement en mai 2010 alors que le gouvernement les avait promis
pour début 2009 (Knight, 2010).
Pour accéder aux aides européennes, il y a une véritable tendance à
l’élargissement des structures.
En 2010, il y avait quinze pourcents de moins d’exploitation qu’en 2003 mais
seulement cinq pourcents de moins de la surface agricole utilisée (SAU) (aGter,
2012).
Le gouvernement semble donc s’être détourné des soucis des petits exploitants
pour se conformer au modèle de la rentabilisation européenne. Puisque ce qui
freine le développement des grandes exploitations en Roumanie, c’est la
parcellisation excessive des terres24, le ministère de l’agriculture travaille sur un
projet de rachat des petites parcelles pour pouvoir constituer des plus grandes
surfaces (Lepetitjournal, 2011).
Ces idées productivistes de la PAC, du gouvernement roumain et celles qui sont
prônées par certains économistes vont totalement à l’encontre de la préservation
de la paysannerie. Valeriu Tabara, l’ancien ministre roumain de l’agriculture,
affirmait en 2011 qu’il était important de réunir ces petits territoires afin qu’ils
puissent être exploité au mieux (Lepetitjournal, 2011).
Mais à qui profite réellement ce rassemblement ?
Aujourd’hui, même si l’Europe et le gouvernement roumain tente de la recadrer
dans le modèle capitaliste, l’agriculture roumaine n’a pas réussi à faire réellement
émerger un modèle. De plus, elle reste toujours fortement influencée par des
facteurs conjoncturels (aGter, 2012).
Plus de 85% des Roumains qui pratiquent une agriculture de subsistance n’ont
aucun plan de commercialisation et le gouvernement ne fait rien pour les aider
(Knight, 2010 pp.23).
On peut également mettre en avant des chiffres significatifs. Depuis son entrée
dans l’Union, la part de la population agricole âgée entre 15 et 24 ans est passée
de 52,5% en 2002 à 41,4% en 2008 (Knight, 2010 pp.23).
Si le deuxième pilier, comme nous allons le voir, offre des aides aux jeunes qui
démarrent, le manque d’information empêche ceux-ci de profiter et cet abandon
du gouvernement vis de l’agriculture familiale ne les pousse pas dans cette voie.
24 �
Le communisme a également sa part de responsabilité puisqu’il a laissé d’énormes
domaines qui profitent directement des subventions de la PAC (17%).
4.3.3.1 Comment les piliers favorisent les grosses fermes
Le premier pilier, qui s’occupe des aides directes, favorise les grandes surfaces
puisque nous sommes dans un système de paiement simplifié à l’hectare.
Le deuxième pilier, plus important en Roumanie25, s’adresse normalement d’autres
catégories de fermiers. Pourtant, nous sommes confrontés dans ce domaine à un
réel problème de mise en place de structures plus indépendantes. Il n’y a aucun
lien entre les petits agriculteurs et les centres de décision. Ceux-ci n’ont aucun
accès à l’information. S’ils sont en mesure d’accéder à des aides, ils n’en sont la
plupart du temps pas du tout informés. Le deuxième pilier n’est manifestement pas
conçu pour les paysans roumains (aGter, 2012).
Les paysans roumains ont toujours eu d’énormes difficultés à accéder à des
crédits. Aujourd’hui, c’est pire que jamais. Les possibilités de développement
agricole sont maintenant aux mains des étrangers. Ils arrivent avec des prêts
accordés par les banques de leurs pays respectifs et peuvent ainsi plus facilement
développer leurs activités. Une autre preuve des failles du deuxième pilier (et
également une preuve que la Roumanie n’était peut-être pas prête, au moins du
point de vue de l’agriculture, à s’ouvrir à l’Union), c’est qu’il nécessite 50% de
financement garantis à partir des banques des pays. Le manque d’établissement
de crédit en Roumanie le met donc largement en péril ! (Knight, 2010).
En 2008, 0.2% des fermes ont reçu 30% de l’argent des subsides et si on inclut
les fermes entre 100 et 500 hectares, soit 0.9% des fermes, on monte carrément
à 51% des subsides de la PAC pour la Roumanie. Il faut bien sûr aussi prendre
en compte le fait que seulement 30% des fermes roumaines pourraient recevoir
ces subsides. Et surtout, pour comprendre à quel point la majorité du « pactole »
est destinée aux industriels, de toutes les fermes qui reçoivent de l’argent en
Roumanie, 80% obtiennent à peine entre 98 et 490 euros ! La PAC soutient donc
un système qui existait déjà et le fait perdurer en l’amplifiant. Cette remarque est
généralisable à toute l’Europe mais la répartition des subsides n’y est pas aussi
contrastée qu’en Roumanie. En Europe occidentale, 50% des bénéficiaires
reçoivent 3% des subsides totaux (Knight, 2010).
25 �
Il représentait plus de 70% du budget de la PAC pour la Roumanie en 2009 ( DG Agri, 2009)
Il y a une réelle incapacité du gouvernement à administrer les fonds et à mettre en
œuvre la politique. Comment les agriculteurs pourraient-ils juger une PAC qui n’a
pas vraiment été mise en action ?
4.3.3.2 Mais où est la jeunesse ?
En plus d’avoir une agriculture très duale, la Roumanie a pour caractéristique
majeure la vieillesse de ses agriculteurs. Il y a en effet une très faible implication
des jeunes dans ce domaine. Beaucoup de retraités, par contre, y démarrent des
activités agricoles. Cela constitue pour eux un complément de revenus. Seize
pourcents des agriculteurs ont plus de 65 ans et 20% ont entre 55 et 64 ans. Le
problème majeur c’est que l’agriculture ne garantit pas un revenu stable pour ses
jeunes. La Roumanie est un pays très sensible aux évènements conjoncturels. En
2002, les jeunes entre 15 et 24 ans constituaient 52,5% de la population rurale. En
2008, on tombait à seulement 41,4% alors que le nombre de personnes âgées,
entre 55 et 64 ans, augmentait de quasiment 3%.Pourtant, le deuxième pilier de la
PAC accorde des aides à la jeunesse qui souhaite démarrer une exploitation
agricole. Le plus souvent les jeunes ne sont pas au courant de cette possibilité et
s’ils le sont et que la ferme leur a été léguée (sur le papier), c’est la plupart du
temps les ainés qui s’occupent toujours de la ferme et touchent les aides (Knight,
2010, p.23).
4.3.3.3 Changement des habitudes alimentaires
La Roumanie européanisée est confrontée à un autre problème : le changement
des habitudes alimentaires. Le pays est totalement dépendant de l’étranger pour
obtenir des produits finis. En 2005, elle exportait 59% de ses produits agricoles et
importait 68% de produits agro-alimentaires finis! Il faudrait donc soit que la
Roumanie commence elle-même à transformer ses produits soit qu’elle revienne à
des habitudes alimentaires plus « brute » et « locale ». En 2009, la Roumanie était
le 5ème plus gros producteur européen et pourtant importait toujours pour 3,7
milliards de produits agro-alimentaires (Knight, 2010, p.26).
Marc Tarabella, député européen réagit à ce sujet en soulignant : « Si tout va aux
grands groupes étrangers, je crains pour la paysannerie. Les Roumains devraient
développer une industrie agro-alimentaire ou un artisanat de transformation de
ses produits. Les Roumains pourraient valoriser et vendre leur produit. »
4.3.4 Développement de l’agriculture industrielle
(…) les donneurs d’ordres des agriculteurs, les façonniers de la terre, ce sont
désormais les industriels. Ils vont jusqu’à imposer les variétés qui leur
conviennent. Le libre arbitre de l’agriculteur dans tout cela ? Il n’existe plus. Le
paysan n’est plus qu’un technicien, lourdement endetté, à la solde des
industriels, avec lesquels il se doit d’être lié puisque ces derniers s’engagent à lui
acheter une partie importante de sa récolte chaque année (Saporta, 2010,
p.149).
Avant toute chose, il serait bon de préciser que la production destinée à
l’autoconsommation en Roumanie n’est pas qu’ « alimentaire», elle est un réel
moyen de consolider le tissu social et familial. Si cette production de subsistance
ne représente en rien un levier commercial, c’est aussi une manière de s’assurer
de la qualité de la nourriture qu’on mange.
Nous l’avons déjà vu plus tôt mais il est bon de le répéter puisque cela constitue
l’élément essentiel de notre reportage : l’agriculture roumaine est très duale. D’un
côté, il y a de très petites exploitations et de l’autre, des structures de productions
de plus en plus importantes. Cette confrontation est l’héritage de la collectivisation
et des politiques appliquées depuis la chute du Mur.
Aujourd’hui, ce sont particulièrement d’énormes exploitations de céréales et
d’oléagineux qui se développent en Roumanie.
Cette évolution de la taille des exploitations reflète les pensées d’Isabelle
Saporta : « Les petits agriculteurs disparaissent au profit de ceux qui sont
capables de payer des appareils énormes et des mises aux normes drastiques »
(Saporta, 2010, p.151).
Aujourd’hui, plus de la moitié des exploitations sont en dessous d’un hectare et
pourtant, elles occupent ensembles seulement 5% de la surface agricole utilisée
(SAU) (aGter, 2012).
Par contre, 48,8% de la surface agricole utilisée (SAU) est occupée par des
exploitations supérieures à cent hectares et par seulement 0,35% des
exploitations. (aGter, 2012).
Alain Pouliquen, agronome, économiste et directeur de l'Institut national de la
recherche agronomique (INRA), répondait en mars 2011 à une interview pour
agrobioscience.org :
Je pense ici à ce qui s’est passé notamment en République tchèque et en
Hongrie. Ces nouvelles grandes exploitations ont eu tendance à délaisser les
secteurs de l’élevage et des cultures maraîchères et fruitières pour se spécialiser
en cultures de céréales et oléagineux. D’un côté, ces dernières sont plus
rentables que les exploitations sociétaires d’origine, restées partiellement fidèles
à l’ancienne polyculture-élevage, mais de l’autre, elles génèrent beaucoup moins
d’emplois par hectare. Cette tendance a été renforcée par l’accès aux aides de la
PAC, en particulier le système du paiement unique à l’hectare. Ces aides ont
certes accéléré la nécessaire recapitalisation de ces grandes exploitations, donc
leurs gains de productivité. Mais, au-delà de certaines surfaces éligibles, non
seulement elles alimentent des rentes improductives, mais elles soutiennent des
spécialisations défavorables à l’emploi comme à la valeur ajoutée agricole.
« Le secteur évolue comme cela. A partir du moment où il y a des gains de
productivités, il y aura nécessairement moins de paysans dans les zones
rurales », explique quant à lui Marc Tarabella, eurodéputé en charge de
l’agriculture. « La perte d’emploi dans l’agriculture est inéluctable. Il n’y aura plus
30% de paysans de Roumanie en 2025, c’est certain. Mais il faut valoriser la
production roumaine et créer de l’emploi dans les zones rurales », ajoute-t-il avec
ferveur.
Cette entrée dans l’Union Européenne constitue une véritable invitation au
business agricole et surtout une opportunité pour les multinationales étrangères à
venir s’installer dans les milieux ruraux roumains. Cela va causer une véritable
destruction du mode de vie et de la culture roumaine.
« Il y aura d’office des grands groupes étrangers. Le mouvement est déjà
enclenché, ils ont déjà commencé à acheter des terres. Aux mains de qui sera
l’agriculture roumaine ? De celles des petits paysans ou des grosses sociétés
étrangères ? » questionne le député européen.
Le gouvernement sait pertinemment qu’une grosse partie des subsides de la
Politique Agricole Commune va aux industries. Il pousse d’ailleurs lui-même vers
la sortie les petits fermiers en se souciant peu de leur futur.
Dans le documentaire Roumanie : éleveurs porcins à terre, on est confronté aux
conséquences pour les paysans de l’arrivée de grands groupes étrangers sur le
territoire roumain. En 2004, Smithfield, un géant de l’industrie porcine est arrivé et
a bouleversé complètement le paysage agricole roumain. Après s’être implanté au
Mexique et en Pologne, cette industrie américaine a décidé de venir importer ses
méthodes industrielles en Roumanie. En 2008, à peine quatre ans plus tard, neuf
éleveurs locaux sur dix avaient déjà cessé toute activité. Si certains éleveurs se
battent pour survivre, ils se retrouvent souvent condamnés à une économie de
subsistance quasi-illégale puisqu’ils ont bien du mal à se mettre aux normes
sanitaires européennes. Dans le cadre de la PAC, Smithfield, le leader sur le
marché français de la charcuterie, a perçu 823 000 euros entre 2008 et 2011
(Camus, 2013).
Patrick Marcolini, docteur en philosophie et chercheur, écrit en 2007, dans sa
Lettre d’un Français aux Roumains qu’on empêche de traire leurs vaches à la
main :
Interdiction pour les paysans roumains de vendre leur lait trait à la main. Pour
toutes celles et ceux qui comptent vendre leur production laitière, ce règlement
de l’Union européenne signifie l’achat obligatoire de machines à traire ; c’est-à-
dire la disparition, à court ou moyen terme, de tous les paysans pauvres, qui ne
pourront pas assumer le coût de cet équipement et de son entretien. De
plus, l’application de ce règlement européen représentera un pas supplémentaire
vers l’alignement de la Roumanie sur les normes de la modernité qui prévalent à
l’Ouest.
Le résultat : de grandes exploitations mécanisées et spécialisées. Alors qu’une
ferme fournissait localement non seulement du lait, mais aussi du beurre, du
fromage et de la crème fraîche (sans compter les légumes, les œufs et la
viande), ces usines agricoles que seront désormais devenues les fermes ne
produiront plus que du lait, en abondance et revendu à des firmes qui se
chargeront de le transformer en une multitude de produits dérivés.
Cette mesure, qui interdit la traite manuelle des vaches, doit être replacée dans
le cadre plus général de l’industrialisation de l’agriculture, avec ses
conséquences sur le milieu naturel et sur le plan humain. Cette industrialisation
entraîne en effet l’appauvrissement des terres par leur exploitation intensive,
l’empoisonnement de l’eau, la disparition des espèces animales et végétales
considérées comme non exploitables ou non rentables, et enfin la transformation
ravageuse des paysages et des conditions climatiques, contribuant ainsi à créer
ces catastrophes que l’on présente abusivement comme « naturelles » :
tempêtes, sécheresses, inondations, dérèglement du cycle des saisons, etc. Sur
le plan humain, l’industrialisation de l’agriculture ne suppose rien moins que
l’éradication programmée de la civilisation paysanne. Elle suppose en effet la
ruine de milliers de paysan-ne-s, réduit-e-s à la misère, incapables de
moderniser leur exploitation et de vivre de la vente de leur propre production sur
le marché moderne. Elle suppose un exode rural massif, l’individualisation des
rapports sociaux et la dissolution des liens de parenté. Elle suppose la
désertification des campagnes…
Méfiez-vous de cette fascination pour l’Europe, de la fierté d’être Européen-ne-s
qui cache mal cette « volonté anxieuse de s’uniformiser » que Pasolini reprochait
aux Italiens de son temps, fraîchement convertis à l’idéologie européenne et à la
société de consommation.
4.3.5 Afflux d’agriculteurs étrangers en Roumanie
La Roumanie représente un véritable petit paradis sur terre pour les agriculteurs
étrangers. « Pour faire ce que j’ai fait en Roumanie en trois ans, il m’aurait fallu
trois générations en France » a déclaré Maxime Laurent, un agriculteur français
de 22 ans au journal La Croix (Mercier, 2012).
Le site internet, lepetitjournal.com rapporte les propos d’un jeune fermier suisse
venu s’installer en Roumanie : « En Suisse, un hectare de terre peut coûter
jusqu'à 80.000 euros, alors qu'ici, en Roumanie, nous avons acheté l'hectare entre
2.000 et 3.000 euros. En Suisse, tout est déjà fait, il n’y a plus de place pour les
jeunes. Ici, nous avons la possibilité de construire quelque chose en partant de
zéro ».
Le site internet rapporte également les propos d’un italien venu créer une
entreprise de fourrage agricole il y dix ans à Timisoara : « Beaucoup
d’investisseurs ont eu accès aux programmes des fonds européens. Cela leur a
permis d’acheter de nombreuses machines agricoles et de construire des silos où
sont entreposées leurs céréales. La production est ensuite exportée dans toute
l’Europe ».
Grâce aux fermiers venus d’Europe occidentale, la Roumanie a connu une
croissance de onze pourcents en 2011 (Bran, 2012b).
Actuellement pourtant, seules des sociétés enregistrées en Roumanie ont le droit
d’acquérir des terrains agricoles. Les chiffres montrent une toute autre réalité
puisque 800. 000 hectares sur neuf millions de terres cultivables étaient détenus
par des investisseurs étrangers en 2012. Cela représente quasiment neuf
pourcents. Ces derniers passent simplement par l’intermédiaire de société
roumaine. D’ici 2014, les choses pourraient encore se faire plus facilement et
s’accélérer, puisqu’à son entrée dans l’Union en 2007, la Roumanie s’est engagée
à ouvrir son marché foncier d’ici 2014 (Albert, 2012).
Mieux encore, en 2014, la Roumanie sera encore plus attirante car il y aura une
répartition plus égalitaire des subventions à l’hectare (entre les « nouveaux pays »
de l’Union et les plus anciens)26.
Certaines régions comme le Banat voyaient déjà en 2011 plus de 80% de ses
terrains agricoles entre les mains d’étrangers (lepetitjournal, 2011).
Les autorités aimeraient pourtant reprendre la situation en main en diminuant les
possibilités d’achat des territoires par les étrangers. Le ministre de l’agriculture,
Daniel Constantin, a parfaitement conscience du manque de capitaux des
agriculteurs roumains face à leurs compatriotes européens. Il voudrait imposer un
plafond de superficie afin de protéger les agriculteurs roumains (Belga, 2012).
En mars 2013, le gouvernement dévoilait une partie de cette nouvelle loi en
expliquant qu’il souhaitait imposer comme condition que les acheteurs soient eux-
mêmes agriculteurs afin de protéger les agriculteurs locaux (lepetitjournal, 2013).
D’autant plus que plus de 90% des achats en Roumanie se font uniquement dans
un but spéculatif (aGter, 2012).
Pourtant, même si depuis quelques années, les Roumains commencent à vendre,
la location reste tout de même entre les mains des habitants du pays. Ceux-ci
gardent un très fort attachement à la terre car elle est une valeur sûre. Assez
« amusant » puisque pour une fois, ce sont donc les petits qui louent aux grands.
Mais si les Roumains acceptent tout de même de vendre à des investisseurs
étrangers c’est qu’ils sont prêts à mettre le prix fort (en tout cas du point de vue
des Roumains). Que ça soit pour louer ou vendre, ils préfèrent traiter avec des
étrangers qu’ils estiment beaucoup plus sûrs que les paysans de leur propre pays.
Les contrats avec les sociétés étrangères sont plus fiables. Cela ne fait que
favoriser encore une fois la gestion de grande surface par un nombre de
personnes de plus en plus petit (aGter, 2012).
Nous pourrions conclure ce point en rappelant que pour les étrangers, la
Roumanie constitue donc un territoire doublement rentable. Premièrement, lors
de l’achat de terres qui se fait à des prix bien plus bas qu’en Europe occidentale.
26 �
Voire RPU et RPUS plus haut dans le texte
Deuxièmement, par le simple fait que la plupart de ces investisseurs ont accès
aux subsides européens qui leur permettent d’acheter des machines agricoles.
Certains sites internet comme « 3D conseil », se sont même lancé dans la
consultance pour les entrepreneurs agricoles qui voudraient aller s’installer en
Roumanie.
4.4 Avenir de l'agriculture en Roumanie
Comme vu dans les points précédents, la PAC 2014-2020 restera dans la lignée
de celle de 2007-2013, c'est à dire la volonté de développement d'une agriculture
industrielle dans une logique de compétitivité maximale au détriment des plus
petits exploitants.
La volonté de la Roumanie est d'aller vers « une diminution progressive et
acceptable du nombre d'actifs agricoles » (Ghib, 2009b, p.37).
Au mois d'avril 2012, le prix du lopin de terre en Roumanie s’élevait à 2000 euros
l'hectare en moyenne. Un prix défiant toute concurrence en Europe. Ainsi de
nombreux agriculteurs étrangers achetèrent en masse ces terres bon marché à
condition de créer une société dans le pays. A partir de 2014, la nouvelle PAC
supprimerait cette obligation. Ainsi, n'importe quel citoyen européen pourra
acheter directement des terres. Il y a donc fort à parier que les prix par hectares
augmenteront (Bran 2012).
4.4.1 La Roumanie nouveau grenier de l'Europe ?
L'Europe est actuellement dépendante de l'Amérique de Sud pour ses
approvisionnements en céréales. Dans un contexte de crise mondiale, 2013 sera
une année très importante car il pourrait se jouer une lutte pour les matières
premières agricoles. Cela pourrait être une opportunité pour la Roumanie qui a «
le potentiel de produire une proportion importante de la demande européenne en
produits agricoles » et pourrait donc ne plus être dépendante d'un autre continent
(Presseurop).
4.4.2 Une agriculture de subsistance pour les plus petits exploitants
« Capitalisme rime souvent avec appauvrissement et creusement du fossé entre
riches et pauvres » (Barthou, 2008, p.101).
Dans un marché où la logique de la compétitivité prime, les petits exploitants
agricoles sont laissés pour compte. Les possibilités de reconversion ne sont pas
évidentes. La mobilité professionnelle des personnes du rural vers l'urbain « serait
toujours entravée par le prix du logement, des transports, de l'accès à l'information
et de l'accès à la formation » (Ghib, 2009, p.37).
Dans ce contexte, les agriculteurs qui ne peuvent s'adapter aux normes du
marché ont développé des mécanismes de survie (Barthou, 2008, 105).
En Roumanie, l'économie de « débrouille » est très facilement observable. Les
activités de subsistance sont un rempart pour de nombreuses familles afin de se
nourrir en évitant de recourir au marché. Ce type d'activité permet « à de
nombreuses familles roumaines de résister aux difficultés et surtout de manger à
leur faim. » (Barthou, 2008, p.106)
« En Roumanie, dans le Programme National de Développement Rural (PNDR),
les exploitations dont la valeur économique est inférieur à 2 UDE (unité de mesure
de l'activité économique égale à 1200 euros de marge brute standard) sont
classées dans la catégorie des exploitations de subsistance. Elles représentent
environ 45% de la superficie agricole utilisée et 91% (3,8 millions) du nombre total
des exploitations. » (Page, 2010, p.74)
L'activité d'une agriculture de subsistance est souvent couplée avec un travail à
temps partiel.
Les exploitations de subsistance sont confrontées à de nombreux problèmes
(Page, 2010, p.78) :
« absence de débouchés pour leurs produits, qui est notamment le résultat
du faible coût des importations et des règles strictes concernant la vente
informelle de la production des petits exploitants ».
« difficultés d'accès aux mesures de soutien destinées à accroitre la
compétitivité et la diversification ».
« les règles d'hygiène ont porté préjudice aux petits exploitants locaux en
imposant des normes irréalistes ».
« les migrations économiques ont entraîné un manque de main d'œuvre
saisonnière dans les villages ».
« la diversification des revenus est sous-développée du fait du manque
d'opportunités ».
L'Europe désire des exploitations toujours plus grandes et compétitives.
Seulement, ces petites exploitations, contrairement aux grandes, sont «
importantes dans l'approvisionnement de toute une série de biens publics vitaux,
disposant d'une grande valeur économique. Qualité de l'eau, prévention des
inondations, résistance aux effets des changements climatiques, sécurité de l'eau
et alimentaire. » (Page, 2010, p.86)
Les petites exploitations roumaines peuvent donner à la Roumanie une image
régionale « proche de la nature » (Page, 2010, p.76)
Les zones rurales de Roumanie offrent des paysages uniques. La conservation
des traditions peut être bénéfique pour le tourisme. Seulement, « le manque de
centres d'informations locaux capables de promouvoir le tourisme au niveau local
fait obstacle à ce développement. » (Page, 2010, p.78)
CONCLUSION
Des changements profonds sont à l’œuvre dans les campagnes roumaines et
ceux-ci s’accélèrent avec le temps. Le dualisme de l’agriculture, hérité de la
période difficile de transition post-communiste, a été renforcé par le système de
paiement de la Politique Agricole Commune dès 2004 et par les premières aides
de pré-adhésion. La catégorie des très grandes exploitations s’est fortement
développée. Des sociétés roumaines se sont constituées sur le terreau des
anciennes fermes collectives et ont su attirer des capitaux étrangers pour se
moderniser à outrance tandis que d’autres groupes étrangers se sont implantés
par l’achat ou la location de terres, modifiant considérablement le paysage
agricole roumain. Dans ce contexte, la petite paysannerie roumaine a prouvé
qu’elle avait une forte faculté de résistance. Attachée à sa terre, elle se replie sur-
elle-même pour continuer à exister. Elle s’enfonce alors un peu plus dans une
agriculture de subsistance qui l’exclut totalement, et pour longtemps, du marché,
des aides et de tout espoir de modernisation.
La Roumanie vit donc bien sa transition entre une agriculture traditionnelle et une
agriculture industrielle dans un pays ouvert à la concurrence européenne et
mondiale. Mais quel est le prix d’une telle transition, dans l’Europe d’aujourd’hui ?
Des millions d’exploitations disparaissent, laissant leurs paysans grossir les rangs
des chômeurs dans les villes. Avec leur départ, le tissu social des campagnes se
désagrège. Ceux qui restent, et ils sont encore très nombreux, restent cantonnés
à une agriculture de subsistance et à une précarité qui empêchent un véritable
développement rural. A côté d’eux, se développe l’agribusiness, la production
agricole industrialisée à très grande échelle, qui n’est ni génératrice d’emploi
agricole, ni d’autres activités, réduisant ainsi les campagnes à n’être que
d’immenses monocultures. C’est de plus un modèle porteur de problèmes
environnementaux importants.
La restructuration de l’agriculture roumaine est inévitable. Et qui dit modernisation,
dit forcément pertes d’emplois. Cependant, il n’existe pas qu’une seule manière
d’opérer ces changements et ils pourraient donc être radicalement différents. Les
transformations en cours sont déterminées à la fois par la Politique Agricole
Commune, et ses différentes réformes, et par les règles du commerce
international. Le système de répartition des aides de la PAC, que ce soit les
paiements directs ou l’aide au développement rural, privilégie les plus grandes
exploitations, jugées comme les seules viables sur le marché. Les négociations
internationales sur le commerce ont accru l’ouverture de l’agriculture et donc la
concurrence mondiale et ont contraint l’Europe à réformer la PAC de manière à la
faire accepter par ses partenaires à l’OMC. De plus, le modèle agro-industriel
domine largement le système alimentaire mondial et, en amont de l’agriculture, les
sociétés d’agrofourniture imposent leurs vues. Les industriels définissent donc
l’avenir de l’agriculture, et la Roumanie ne fait pas exception.
En effet, la situation de l’agriculture roumaine est façonnée par des rapports de
force. Et ceux-ci penchent clairement en faveur des grandes exploitations. Avec
des résultats en termes de production et d’économies d’échelle indéniables et
soutenues par les industriels du secteur, elles peuvent se présenter aux autorités
européennes distributrices d’aides comme les plus méritantes et défendre un
système de répartition en leur faveur. Ainsi, ces exploitations sont triplement
gagnantes : elles produisent à moindre coût, achètent ou louent des terrains à des
prix bien moins élevés que dans le reste de l’Europe et reçoivent des subventions
de l’Union Européenne. Face à tout cela, les plus petites exploitations ne peuvent
qu’adopter une stratégie de survie. Elles sont pourtant celles qui répondent le plus
aux attentes de l’Union Européenne en matière d’emploi, de développement rural
ou de respect de l’environnement.
La deuxième moitié de l’année 2013 et l’année 2014 s’annoncent comme des
moments clés pour l’agriculture roumaine. Les négociations de réforme de la PAC
vont se poursuivre entre le parlement européen, la Commission et le Conseil. La
Roumanie devrait recevoir le même montant d’aide à l’hectare que les pays
d’Europe de l’Ouest ; le marché foncier roumain sera bientôt totalement libéralisé
et le nouveau directeur général de l’OMC (le Brésilien Roberto Azevedo, issu du
pays à la pointe de la lutte pour la libéralisation totale de l’agriculture mondiale) a
annoncé vouloir relancer les négociations commerciales internationales, y compris
concernant l’agriculture évidemment. Si l’agriculture roumaine se trouve bel et
bien à un nouveau tournant, il semble que celui-ci tourne une fois de plus dans la
mauvaise direction.
Glossaire
DG de l’Agriculture et du Développement Rural: Il est placé sous sur l’autorité
de Dacian Ciolos, le commissaire européen à l’agriculture. Il compte 1000
employés. Son directeur général est José Manuel Silva Rodriguez.
FEOGA : Fonds européen d’orientation et de garantie agricoles. Il finançait le
soutien des marchés et la section "Orientation" le développement rural. Il n’existe
plus depuis 2007.
FEAGA : Fonds européen agricole de garantie (remplace le FEOGA)
(financement du premier pilier)
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural (remplace le
FEOGA) (financement du deuxième pilier)
PNDR : Plan national pour le développement rural. L’union européenne accepte
que les gouvernements nationaux ajoute de l’argent au SAPARD. Ce sont des top-
ups.
RPU (SFP) : Régime de Paiement Unique. Ce sont des aides découplées de la
production. Ce système consiste en des aides par hectare mais avec des
dispositions spéciales, il comporte trois variantes en fonction des pays : modèle
historique, régional ou hybride.
RPUS (SAPS) : Régime de Paiement Unique à la Surface. C’est le modèle
simplifié du RPU pour les nouveaux arrivants. C’est-à-dire une aide par hectare.
SAPARD : Instrument agricole de préadhésion ; un cadre d'aide communautaire à
l'agriculture et au développement rural durable destiné aux pays candidats
d'Europe centrale et orientale (PECO) durant le processus de préadhésion pour la
période 2000 - 2006. Il vise à résoudre les problèmes d'adaptation à long terme du
secteur agricole et des zones rurales. Il constitue un soutien financier à la mise en
œuvre de l'acquis communautaire en matière de politique agricole commune et de
politiques connexes. (Europa.eu, 2007)
Bibliographie
Albert, C. avec Belga (2012, 15 octobre). La Roumanie veut limiter l'achat de terres
agricoles par des étrangers. Consulté le 1er avril 2013 du site http://www.7sur7.be/ :
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1517586/2012/10/15/La
-Roumanie-veut-limiter-l-achat-de-terres-agricoles-par-des-etrangers.dhtml.
aGter, secteur études de l’ASP (2012). Quelle évolution des structures agraires
2012 en Roumanie ? Récupéré le 4 avril du site http://www.agter.asso.fr/ :
http://www.agter.asso.fr/article930_fr.html.
Ambassade de France en Roumanie. Service économique de Bucarest (2011,
septembre). Panorama de l’agriculture et de l’agro-alimentaire en Roumanie.
Trésor direction générale. Récupéré le 4 avril du site
https://www.tresor.economie.gouv.fr/ :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/328803.
Amblard, L. et Colin, J.P. (2006, mai-juin). Dimension organisationnelle et
pratiques contractuelles foncières. Les sociétés agricoles en Roumanie. Economie
Rurale, n°293. Mis en ligne le 5 juin 2008, consulté le 1er avril 2013 du site
http://economierurale.revues.org/ : http://economierurale.revues.org/794.
Ancuta, C., Ardelean, F., Arba, A. et Darques, R. (2008, mai-juin). L’impact des
politiques européennes sur l’espace rural roumain : le cas des financements
SAPARD. Méditerranée, n°110. Mis en ligne le 1er janvier 2010, consulté le 2 avril
2013 du site http://mediterranee.revues.org/ : http://mediterranee.revues.org/541
Barthou, E. (2008). « L'économie de survie » ou comment s'adapter à l'essor du
capitalisme en Roumanie. Récupéré le 2 avril du site
http://www.cairn.info : http://www.cairn.info/revue-autrepart-2008-4-page-101.htm
Bazin, G. et Bourdeau-Lepage, L. (2011, mai). L’agriculture dans les pays
d’Europe centrale et orientale. Continuité et adaptation. Economie Rurale, n°325-
326 (pp.10-24).
Benoit-Cattin, M. (2007). L’agriculture familiale et son développement durable.
Economie rurale, n°300 (pp. 120-123).
Bignebat, C. et Latruffe, L. (2011, septembre-décembre). Vingt ans de réformes
foncières en Europe centrale et orientale. Bilan et perspectives. Economie Rurale,
n°325-326. Mis en ligne le 17 octobre 2013, consulté le 2 avril 2013 du site
http://economierurale.revues.org/ :
http://economierurale.revues.org/index3225.html.
Bran, M. (2012, 30 avril). Des terres fertiles en opportunités. Presseurop. Consulté
le 21 avril du site http://www.presseurop.eu/fr :
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/1886771-des-terres-fertiles-en-
opportunites.
Bran, M. (2012, décembre). La Roumanie, nouvel eldorado à l’Est. Dans Les
Nouveaux paysans. Le Monde (Hors-série), pp. 42-43.
Bureau, J-C. (2002) La baisse de la protection douanière dans l’Uruguay Round :
le cas de l’agriculture dans l’Union Européenne, au Canada et aux Etats-Unis.
Economie et prévision. N°154. pp. 107-122.
Burny, P. (2010). Des origines à la réforme de 2003. Récupéré le 4 avril 2013 du
site http://www.academieroyale.be :
http://www.academieroyale.be/cgi?usr=8ac4cauqcc&lg=fr&pag=1026&tab=146&re
c=11100&frm=385&par=secorig1561&par2=-1&id=6105&flux=31610720#detail.
Camus, M.-P. (2013). Les dessous de la mondialisation. Roumanie : éleveurs
porcins à terre. Visionné le 4 avril du site http://www.publicsenat.fr/ :
http://www.publicsenat.fr/emissions/les-dessous-de-la-mondialisation/roumanie-
eleveurs-porcins-a-terre/124813.
Chambre Agriculture Normandie. (2013, mars). PAC après 2013 : les grandes
lignes connues, avant les derniers ajustements. Récupéré le 1er avril du site
http://www.normandie.chambagri.fr/default.asp :
http://www.normandie.chambagri.fr/pac_2014_reglement.asp.
Choplin, G. (29 mars 2013). Interview personnelle, Bruxelles.
Choplin, G., Strickner, A., Trouvé, A. (2009, mai). Souveraineté alimentaire. Que
fait l’Europe ? Pour une nouvelle politique agricole et alimentaire européenne
(pp.7-75). Edition Syllepse.
Cour des comptes européenne (2011). Rapport spécial n° 5 Régime de paiement
unique (RPU) : questions à examiner en vue d’améliorer la bonne gestion
financière. Récupéré le 4 avril 2013 de http://bookshop.europa.eu :
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/8096820.PDF.
Darrot, C., Von Hirschhausen B. et avec la collaboration de Ghib, M.L. (2011,
septembre-décembre). PAC et transition agricole en Pologne et Roumanie : les
nouveaux termes du processus. Economie Rurale, n°325-326. Mis en ligne le 17
octobre 2013, consulté le 4 avril 2013 du site http://economierurale.revues.org :
http://economierurale.revues.org/index3257.html.
De Ravignan, A. (2008, mars). 50 ans de PAC, pourquoi l’Europe verte ne
fonctionne plus. Alternatives internationales. n°38. pp.30-33.
Direction de l’information légale et administrative (2013, février). Qu’est-ce que la
politique agricole commune ? Consulté le 15 mars 2013 du site http://www.vie-
publique.fr : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-
europeenne/action/politiques-communautaires/qu-est-ce-que-politique-agricole-
commune-pac.html.
Eurostat (2013, mise à jour 31 mars). Base de données de la Commission
Européenne. Données récupérées le 31 mars 2013 du site :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/introduction.
Facchini, F. (2006). Des effets de la libéralisation des marchés agricoles.
Economie Rurale. n°292. pp.68-78.
FAO (2006). Le cycle de Doha a besoin d’une nouvelle orientation. Rome :
Organisations des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
FAO (2012). La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. Rome :
Organisations des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
Gaborean, F. (2011, janvier). Transmission patrimoniale et relations
intergénérationnelles en Roumanie. Recherches familiales, n°8 (pp. 19-29).
Récupéré du site www.cairn.info : www.cairn.info/revue-recherches-familiales-
2011-1-page-19.htm.
Giordano, C. (2001, mars-avril). Réformes agraires et tensions ethniques en
Europe centrale et orientale. Etudes rurales, n°159-160 (pp. 205-228). Editions
EHESS. Récupéré du site www.cairn.info : www.cairn.info/revue-etudes-rurales-
2001-3-page-205.htm.
Griffon, M. (2011). Préparer l’agriculture aux défis de 2050. Projet, n°321 (pp. 37-
44). Récupéré du site www.cairn.info : doi 10.3917/pro.321.0037
Guyomard, H. et Mahé L-P. (1995). Le GATT et la nouvelle politique agricole
commune : une réforme inachevé. Revue Economique. Volume 46. n°3. pp. 657-
666.
Ghib, M.-L. (2009). Quelle politique agricole pour les exploitations de subsistance
et semi-susistance en Roumanie ?
Ghib, M.-L. (2009, mai-juin). Retraite et agriculture en Roumanie. Une indemnité
viagère aux objectifs ambigus. Économie rurale, n°311. Mis en ligne le 5 mai 2011.
Récupéré du site http://economierurale.revues.org :
http://economierurale.revues.org/2305.
Knight, D. (2010, octobre).Romania and the common agricultural policy. The future
of small scale farming in Europe. Récupéré le 3 février 2013 du site
http://www.ecoruralis.ro :
http://www.ecoruralis.ro/storage/files/Documente/ReportCAP.pdf.
Knops, L. (2012, mai). Reforme de la PAC 2013 : regard critique sur les
propositions de la commission. Récupéré le 3 mars 2013 du site
http://www.etopia.be :
http://www.etopia.be/IMG/pdf/20120518_Reforme_PAC_LK.pdf.
Lacour, G. de. (2013, 18 mars) Quelle influence des lobbies dans la tentative de
réforme de la PAC ? Récupéré le 3 avril du site http://www.novethic.fr :
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,environnement,agriculture,quelle_influenc
e_lobbies_dans_tentative_reforme_pac,139418.jsp.
L'Est-Eclair. (2013, 3 avril). 80 % des paiements à 20 % des bénéficiaires.
Récupéré le 5 avril 2013 du site http://www.lest-eclair.fr : http://www.lest-
eclair.fr/article/agriculture/80-des-paiements-a-20-des-
b%C3%A9n%C3%A9ficiaires.
Le Monde.fr avec AFP. (2012, 24 février). Hollande : réformer la PAC mais garder
un budget "le plus élevé possible". Récupéré le 4 avril 2013 du site
http://www.lemonde.fr : http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-
2012/article/2012/02/24/hollande-veut-garder-un-budget-le-plus-eleve-possible-
pour-la-.
Lepetitjournal (2013, 13 mars). Pour que les propriétaires terriens étrangers soient
des agriculteurs. Consulté le 1er avril 2013 du site http://www.lepetitjournal.com :
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/economie/144085-agriculture-pour-que-les-
proprietaires-terriens-etrangers-soient-des-agriculteurs.
Marcolini, P. (2007). Lettre d’un Français aux Roumains qu’on empêche de traire
leurs vaches à la main. Consulté le 14 novembre du site
http://offensive.samizdat.net/ : http://offensive.samizdat.net/spip.php?article407.
Martin, C., Spendlingwimmer, F. (2009).Farm Structure Survey in Romania 2007.
European Communities. Récupéré le 4 avril 2013 du site
http://ec.europa.eu/eurostat/ :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Farm_structure_in
_Romania.
Maurel, M.C. (2011). Retour sur les réformes agraires au XXème siècle en Europe
centrale. Dans Paul Gradvohl (dir.), L’Europe médiane au XXe siècle. Fractures,
décompositions – recompositions – surcompositions (pp. 67-86). Prague :
CEFRES.
Mercier, J. (2011, 25 mai). La terre roumaine, un paradis pour les étrangers.
Récupéré le 4 avril de http://www.lepetitjournal.com :
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/economie/79253-agriculture--la-terre-
roumaine-un-paradis-pour-les-etrangers.html.
Mercier, J. (2012, 23 février). L’est de l’Europe attire les jeunes agriculteurs qui ne
parviennent pas à s’installer en France. La Croix. Récupéré le 21 avril du site
http://www.la-croix.com : http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/L-est-de-l-
Europe-attire-les-jeunes-agriculteurs-qui-ne-parviennent-pas-a-s-installer-en-
France-_NP_-2012-02-23-771543.
Mitrany, D. (1930). Land and peasant in Rumania. New-York : Greenwood Press,
Gale University Press.
MOMAGRI. Aux Etats-Unis, le programme d’aide alimentaire, durement frappé,
alors que le chômage reste élevé. Récupéré le 17 avril 2013 du site
http://www.momagri.org : http://www.momagri.org/FR/temoignages/Aux-Etats-
Unis-le-programme-d-aide-alimentaire-durement-frappe-alors-que-le-chomage-
reste-eleve_979.html
OCDE. (2000, 26 octobre). Examen des politiques agricoles de l’OCDE :
Roumanie 2000. Editions OCDE.
OMC. Comprendre l’OMC : Le cycle d’Uruguay. Récupéré le 12 mars 2013 du site
http://www.wto.org : http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact5_f.htm
Page, N . (octobre, 2010). L’agriculture de semi-subsistance en Europe: concepts
et questions clés. Réseau européen de développement rural. Annexe 3. Etude de
cas : le rôle des exploitations de subsistance dans la fourniture de biens publics
en Roumanie. Récupéré le 1er avril du site http://enrd.ec.europa.eu :
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=85CECAA2-BAF8-
02E2-CF22-0DE82F0A6708
Pouch, T. (2010). La guerre des terres. Paris : Choiseul Editions.
Pouliquen, A. (2008, mars). Europe centrale et orientale : bilan positif, lendemains
incertains. Alternatives Internationales. n°38. pp34-36.
Pouliquen, A. (2011, septembre-décembre). Vingt ans de transitions agricoles et
rurales à l’Est. Quels enseignements ? Economie Rurale, n°325-326. Mis en ligne
le 17 octobre 2013. Consulté le 1er avril 2013 du site
http://economierurale.revues.org :
http://economierurale.revues.org/index3212.html
Pouliquen, A. (2011, mars). Réforme de la PAC de 2013 : les nouveaux visages d’
lagriculture des pays de l’est. Consulté le 4 avril du site
agrobioscience.org : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3021
Rastoin, J-L., Ghersi, G. (2010) Internationalisation, mondialisation, globalisation.
Dans Le système alimentaire mondial. (pp. 265-405). Editions Quae.
Collection Synthèses.
Record, S. (2011, 6 janvier). Investir en Roumanie : l’agriculture. Récupéré le 4
avril du site http://fr.viadeo.com :
http://fr.viadeo.com/fr/groups/detaildiscussion/?containerId=002zy9mp0vnmy8h&fo
rumId=0021hikmn2vjpv0p&action=messageDetail&messageId=0021usybknbo2n2
q
Renard, J. (2010). De la réforme de 2003 à aujourd'hui. Récupéré le 4 avril 2013
du site http://www.academieroyale.be :
http://www.academieroyale.be/cgi?usr=8ac4cauqcc&lg=fr&pag=1026&tab=146&re
c=11100&frm=385&par=secorig1561&par2=-1&id=6105&flux=31610720#detail
Roberts, H.L. (1969). Rumania. Political problems of an agrarian state. New
Haven : Archon Books, Yale University Press.
Roger, A. (2002, février). Relations agraires et relations de pouvoir dans la
Roumanie communiste : les coopératives agricoles de production comme terrain
d’affrontement politique. Revue d’histoire moderne et contemporaine, n°49-2
(pp.24-53).
Saporta, I. (2010). Le livre noir de l’agriculture. Comment on assassine nos
paysans, notre santé et l’environnement. Paris : Fayard.
Schwarz, H. (2010, 14 décembre). Réforme de la PAC : les gagnants et les
perdants. Récupéré le 4 avril du site http://www.eurosduvillage.eu :
http://www.eurosduvillage.eu/Reforme-de-la-PAC-qui-l-aura-dans,4388.html
Sopinska, J. (2013, 8 février). Le budget de la PAC amputé de 13% par rapport à
2007-2013. Europolitique. Récupéré le 2 avril du site
http://www.europolitique.info : http://www.europolitique.info/politiques-
sectorielles/le-budget-de-la-pac-amput-de-13-par-rapport-2007-2013-art348072-
10.html
Stan, S. (2005). L’agriculture roumaine en mutation. La construction sociale du
marché. Dans Marie-Claude Maurel (dir.), Revues d’études comparatives Est-
Ouest, vol. 36, n°4 (pp. 209-212). Editions EHESS, CERCEC.
Statistiques-mondiales (2013, mise à jour 20 juillet). Union Européenne. Consulté
le 21 juillet 2013 du site http://www.statistiques-mondiales.com/index.html :
http://www.statistiques-mondiales.com/roumanie.htm
Tarabella, M. (2013, 10 avril). Interview personnelle, Bruxelles.
Thoyer, S. (2012). La réforme de la PAC en 2013. Les enjeux négociés. Cours
4.Récupéré le 3 mars du site http://www.supagro.fr :
http://www.supagro.fr/capeye/public/reperes_pac/cours/UE6-cours4-
reforme2013.pdf
Union Européenne (2013, mise à jour 31 mars). Base de données de la
Commission Européenne. Récupéré le 31 mars 2013 du site
http://epp.eurostat.ec.europa.eu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/port
al/agriculture/introduction
Union Européenne (2013, mise à jour 12 février). Agriculture et développement
rural. Récupérées le 4 avril 2013 du site
http://ec.europa.eu : http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm
Villemin, V., Andreff, W. et Montaigne E. (2011, septembre-décembre). La
marginalisation des minifundia. Le cas vitivinicole roumain face aux politiques
publiques. Economie rurale, n°325-326. Mis en ligne le 14 février 2012. Consulté
le 3 avril 2013 du site http://economierurale.revues.org :
http://economierurale.revues.org/index3290.html
Velcea, I. (1967). Les transformations de l’utilisation agricole du sol en Roumanie.
Dans Méditerranée, vol. 8, n°8-4 (pp. 269-282). Presses Universitaires de
Provence.
Wagenhofer E. (2006). We feed the world. Autriche. 96 min.
Table des matières
Le tournant de l’agriculture roumaine ....................................................................................................2
INTRODUCTION ........................................................................................................................................2
Définitions ................................................................................................................................................3
1. L’AGRICULTURE DANS LA MONDIALISATION .........................................................................................3
1.1Taille du marché agricole mondial ...................................................................................................4
1.2Tendances des marchés agricoles et alimentaires ..........................................................................4
1.3Ouverture internationale de l’agriculture .......................................................................................4
1.4Structure du marché agricole mondial ............................................................................................5
1.4.1 Principaux flux de produits agricoles et alimentaires..............................................................6
1.4.2 Rôle de la demande mondiale et son évolution ......................................................................7
1.4.3 Rôle des marchés à termes et de la spéculation financière ....................................................7
1.4.4 Rôle des multinationales dans le secteur de l’agroalimentaire et de l’agrofourniture ...........7
1.5Les discussions sur le commerce agricole international .................................................................7
1.5.1 Le dossier agricole au sein de l’OMC .......................................................................................8
1.5.2 Etat de la protection et du soutien à l’agriculture dans le monde ..........................................8
2. LA PAC ..................................................................................................................................................9
2.1 Qu’est ce que la PAC en bref? .........................................................................................................9
2.2 Historique .......................................................................................................................................9
2.2.1 La naissance de la PAC .............................................................................................................9
2.2.2 Les différentes réformes .........................................................................................................9
2.2.3 L’élargissement .................................................................................................................... 10
2.2 Différence de traitement dans le premier pilier .......................................................................... 10
2.4 Buts et principes de la PAC ......................................................................................................... 11
2.5 Les outils de la PAC ...................................................................................................................... 12
2.6 Budget et bénéficiaire ................................................................................................................ 12
2.7 Les institutions impliquées et leurs rôles dans la réforme de la PAC .......................................... 13
2.8 Limites de la PAC .......................................................................................................................... 14
2.9 Réforme de la PAC 2014-2020 ..................................................................................................... 15
2.9.1 Critiques de cette réforme (Knops, 2012) ............................................................................ 16
2.9.2 Rôle des lobbys, qui est gagnant ? (de Lacour, 2013) ........................................................... 16
3. EVOLUTION DE L’AGRICULTURE EN EUROPE ..................................................................................... 17
3.1 Mutations de l’emploi agricole en Europe .................................................................................. 17
3.2 Evolution du nombre d’exploitations dans les pays de l’Union européenne .............................. 17
3.3 Transition agraire : l’adaptation des Nouveaux Etats membres (NEM) de l’UE .......................... 17
3.4 Compétitivité de l’agriculture européenne : bilan ...................................................................... 18
4. LE CAS ROUMAIN ............................................................................................................................... 18
4.1 Description et statistiques .......................................................................................................... 18
4.1.1 Première approche de la Roumanie ..................................................................................... 18
4.1.4 Typologie des exploitations agricoles roumaines (Villemin, Andress et Montaigne, 2011) . 20
4.2 Evolution de la culture paysanne roumaine : avant 2007 .......................................................... 21
4.2.1 Fin de la domination ottomane et avènement du Vieux Royaume ...................................... 21
4.2.2 La Grande Roumanie et l’entre-deux guerres ...................................................................... 21
4.2.3 La période communiste ........................................................................................................ 22
4.2.4 La chute du système collectiviste ......................................................................................... 22
4.3 Evolution de la culture paysanne roumaine : après 2007 ........................................................... 23
4.3.1 Production ........................................................................................................................... 23
4.3.2 Adhésion à l’Union Européenne : sous quelles conditions .................................................. 23
4.3.3 Conséquence sur l’agriculture roumaine .............................................................................. 24
4.3.4 Développement de l’agriculture industrielle ........................................................................ 25
4.3.5 Afflux d’agriculteurs étrangers en Roumanie ....................................................................... 26
4.4 Avenir de l'agriculture en Roumanie ........................................................................................... 27
4.4.1 La Roumanie nouveau grenier de l'Europe ? ........................................................................ 27
4.4.2 Une agriculture de subsistance pour les plus petits exploitants .......................................... 27
CONCLUSION ........................................................................................................................................ 28
Glossaire ................................................................................................................................................ 28
Bibliographie ......................................................................................................................................... 29




















































































![« Un tournant métaphysique ? Sur Bruno Latour, Enquête sur les Modes d’Existence » Critique, Novembre 2012, n°786. Pp. 916-932. [EPREUVES NON CORRIGEES]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631985a577252cbc1a0ebc28/-un-tournant-metaphysique-sur-bruno-latour-enquete-sur-les-modes-dexistence.jpg)