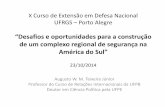Catalogue des livres provenant des collections d'Eugene Piot ...
Le téléphérique du Complexo do Alemão un projet d’image urbaine ou d’amélioration des...
-
Upload
graduateinstitute -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Le téléphérique du Complexo do Alemão un projet d’image urbaine ou d’amélioration des...
Le téléphérique du Complexo do Alemão un projet d’image urbaine ou d’amélioration des conditions de vie des habitants ?
Sophie LANGEL Catarina MASTELLARO
Bea VARNAI
1
I. Introduction Les bidonvilles à Rio et les politiques d’aménagement du territoire Dès le milieu du XIXe siècle, des améliorations de la qualité de vie comme l'abolition de l'esclavage, l’exode rural et le début du processus de développement industriel a attiré dans le pays des nombreux travailleurs et plus particulièrement à Rio de Janeiro, à l’époque capitale du Brésil. Les logements de fortune des travailleurs se situaient principalement vers le centre ville où traditionnellement sous forme de « cortiços », logements insalubres partagés par plusieurs familles. Le maire commença la persécution de ce type de logement par des expulsions forcées des familles et leur accorda la permission de construire des maisons sur les collines (« morros »), entamant le processus de construction des premières «favelas» (bidonvilles). Selon la définition adoptée dès 1950 par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE) basée sur la notion de légalité un bidonville (favela) est « un ensemble constitué par un minimum de 51 habitations occupant ou ayant occupé jusqu’à une récemment un terrain public ou privé, disposées en général de manière désordonnée et dense et dépourvues le plus souvent de services publics essentiels ». Dans cette perspective, selon les données officielles du recensement de 2010 (CENSO 2010) recueillis par l'IBGE, il y existe 763 bidonvilles dans la ville de Rio, ce qui représente environ 22% de la population de la ville ou l'équivalent de 1.443.773 habitants. A partir de 1985, les expulsions forcées menées par le gouvernement laissent place à des nouvelles mesures d’aménagement du territoire prenant cette foisci en considération les nouvelles formes d’habitat non conventionnelles qui s’apparentent à des favelas. Néanmoins, ce n’est qu’à partir de 1994 que le gouvernement de Rio lance le programme FavelaBairro visant à urbaniser ces zones et proclamant le droit à l’urbanisation aux habitants des bidonvilles. En 2007, les financements pour les projets de réaménagement des bidonvilles augmentent, notamment par la mise au point d’un nouvel outil du gouvernement fédéral: le Programme d'Accélération de Croissance (PAC). Le PAC vise à promouvoir l'accélération de la croissance économique dans le pays, à augmenter les opportunités d'emploi ainsi qu’à améliorer les conditions de vie de la population par le développement de l'infrastructure du pays. Dans le Complexo do Alemão, le PAC a permis l’investissement d’environ 269 millions de dollars depuis avril 2008 pour des projets de mobilité dont notamment le téléphérique du Complexo do Alemao, projet d’environ 80 millions de dollars inauguré en juin 2011, mais aussi pour des projets de logements et d’amélioration des conditions de vie dans le bidonville (Brasil, 2011).
2
Notre étude de cas : le Complexo do Alemão
Le Complexo do Alemão (Wikipedia) Situé au nord de la ville de Rio, le Complexo do Alemão fut considéré comme la région la plus violente de la ville pendant plusieurs années, car elle hébergeait le « siège » de la principale association criminelle du pays, le Comando Vermelho. En 2000 presque un tiers des résidents du Complexo vivaient en dessous du seuil de pauvreté et le bidonville présentait l’IDH (Indice de Développement Humain) le plus bas de la ville (Uol, 2010). Le nom du Morro do Alemão, qui baptise l'ensemble du Complexo, se réfère à l'ancien propriétaire, le polonais Leonard Kaczmarkiewicz. Le fermier a hérité de son surnom pendant les années 1920, quand – réfugié de la Première Guerre Mondiale il arriva à la Serra da Misericórdia et acheta cette propriété qui correspond aujourd’hui au bidonville du Relicário. Avec l'ouverture de l'Avenida Brésil en 1946 et la transformation progressive de la région en pôle industriel, les travailleurs et les émigrés du nord du pays s’installent sur le site. En 1951, le « faux allemand » vend sa ferme qui va être immédiatement occupée par les employés de la Société Algodoeira Fernandes, industrie de coton proche de la propriété. L’expansion de l’occupation dans les communautés de Joaquim de Queiroz et Nova Brasilia dans les années 1950 a été suivie par l’occupation du Morro das Palmeiras et du Morro da Baiana à la fin des années 1970 et au début des années 1980.
Localisation de Rio de Janeiro et du Complexo do Alemão
(à partir d’OpenStreetMap)
3
Actuellement, le Complexo do Alemão est composé de 15 communautés: Itararé, Joaquim de Queiróz, Mourão Filho, Nova Brasília, Morro das Palmeiras, Parque Alvorada, Relicário, Rua 1 pela Ademas, Vila Matinha, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana, Estrada do Itararé, Morro do Alemão e Armando Sodré. La population totale du Complexe est estimée à un peu plus de 60.000 habitants (plus de 18.000 foyers) sur 296 hectares. Depuis Juillet 2011, le Complexo dispose aussi d’un nouvel atout, une nouvelle attraction touristique: le téléphérique, inspiré par le célèbre “Métrocable” de Medellin, en Colombie. Questions de recherche et plan de travail Ce travail vise à porter un regard critique sur le téléphérique du Complexo do Alemao, exalté comme un moyen de transport innovant avec un potentiel inclusif pour les populations défavorisées des bidonvilles installées dans des zones peu accessibles des grandes métropoles urbaines. De nombreux téléphériques déjà existants en Amérique du Sud ont certainement influencé le choix du téléphérique comme projet de mobilité pour le Complexo do Alemao, premier projet de ce type réalisé au Brésil. Dans notre travail, il nous a semblé important de chercher à saisir l’impact de telles infrastructures dans un lieu comme le Complexo do Alemao car non seulement elles s’inscrivent dans des projets urbains plus larges mais il est très probable que de nombreux autres téléphériques voient le jour en Amérique Latine et ailleurs. En effet, la ville de Santos, dans l’Etat de Sao Paulo, planifie la construction d’un téléphérique d’une plus grande envergure que celui du Complexo do Alemao dont la construction débutera en 2015 (Esse, 2013). Néanmoins, le succès des téléphériques comme nouveau moyen de transport urbain semble être contesté dans d’autres contextes: Dans le bidonville Rocinha à Rio, un projet de téléphérique a été contesté et bloqué par ses habitants en 2013 (Real, 2013). Face au discours qui accompagne le téléphérique du Complexo do Alemao et qui le situe dans un contexte plus large de transformation sociale pour les habitants des quartiers défavorisés, nous allons aborder la question de l’impact d’une telle intervention urbaine dans la vie des habitants et des bidonvilles: qui bénéficie vraiment du téléphérique? Quel est son impact sur la vie quotidienne des résidents? Les promesses d’aménagement et de services urbains faites dans le contexte de la construction du téléphérique ontelles été réalisées? Quel rôle ont joué les habitants dans l’élaboration et l’exécution du projet? En résumé, le téléphérique du Complexo do Alemao, constituetil un projet d’image urbain ou d’une véritable amélioration des conditions de vie et d’inclusion sociale de ses habitants ? Afin de répondre à cette question, nous allons dans un premier temps étudier la mobilité urbaine en tant que vecteur d’inclusion socioéconomique des populations concernées. Dans une deuxième partie, nous aborderons la question de reprise du pouvoir et de contrôle spatial par l’Etat sur des lieux traditionnellement abandonnés par les autorités publiques. Finalement, nous nous intéresserons à l’aspect de la “marchandisation” et de “marketing urbain”, exercés au nom du téléphérique ainsi que leur impact sur la vie des résidents du Complexo do Alemao.
4
II. Le téléphérique, un projet d’inclusion socioéconomique par la mobilité La mobilité, facteur clé d’inclusion sociale et économique et sa signification dans le Complexo
Implantation de la station terminus du téléphérique en rapport aux infrastructures primaires de la ville (à partir d’OpenStreetMap
Les téléphériques sont traditionnellement associés au déplacement pour des fins touristiques et ont marqué le paysage urbain depuis longtemps: A Rio de Janeiro, le téléphérique du Pain de Sucre constitue une des attractions touristiques majeures depuis sa construction en 1912. Depuis une dizaine d’année, les téléphériques ont été « découverts » comme moyen de transport urbain en commençant par Medellín (Colombie) en 2006, Skikda et Tiemcen (Algérie) en 2008, Caracas (Venezuela) en 2010, La Paz (Bolivie) en 2014, etc. Rio a reçu son premier téléphérique destiné au déplacement quotidien en 2011 et un autre projet a été réalisé en 2013 dans le Morro da Providência, toujours à Rio. Selon Steven Dale, le fondateur du Gondola Project « Cable cars are viable in both developed and developing cities and are most effective in solving transport problems with clear topographical, or manmade physical challenges.” (Cities Today, 2013:21). Un tel engouement pour les téléphériques dans la sphère urbaine s’explique d’une part par leur capacité à connecter des lieux peu accessibles et d’autre part par leur efficacité énergétique ainsi que le fait qu’ils constituent un moyen de transport sûr et fiable tout en ne produisant que très peu de nuisances environnementales et sonores (Silva et al., 2011:1033f), ceci en dépit de leur caractère visuel esthétique.
5
Le téléphérique du Complexo do Alemao s’étend sur 3,5 km et six stations et compte avec 152 cabines d’une contenance de 8 personnes chacune. Le téléphérique a une capacité totale de 30.000 passagers par jour (Supervia, pers. comm.). Il permet de joindre les deux stations Bonsucesso et Palmeiras, situées aux extrémités du système, en environ 16 minutes. Le téléphérique est connecté au système de transport public et routier par la station Bonsucesso où se trouve également une station du métro, située à environ 50 minutes du centre ville de Rio et de la zone sud, grands bassins d’emplois pour les habitants des zones périphériques de la ville Le téléphérique du Complexo do Alemao est promu comme une contribution importante à la mobilité des habitants du bidonville. De nombreuses études mettent en lumière l’effet de la mobilité sur les revenus et la qualité de vie des individus, d’une telle façon que, selon Davila et Brand (2012:18), la mobilité et ses conséquences constituent un nouveau paradigme pour les sciences sociales. Par ailleurs, Gomide (2003:8) démontre qu’un service de transport collectif accessible, efficient et de qualité permettant aux habitants de se déplacer au sein de tout l’espace urbain permet de faciliter l’accès aux services publics de base et d’augmenter les opportunités de travail des plus pauvres. Par conséquence, il considère le transport collectif comme un instrument important dans la lutte contre la pauvreté urbaine et la promotion de l’inclusion sociale (ibid.) Afin de parvenir à cette conclusion, Gomide (2003:11f) montre qu’à Sao Paulo, 8% des revenus familiaux sont dirigés vers le transport urbain constituant ainsi les dépenses les plus importantes dans les services publics pour les familles de revenus bas. De plus, il montre que le coût des transports publics agit comme facteur limitant aux opportunités de travail (ibid.). Ces constats semblent pertinents dans le cas du Complexo do Alemao, d’autant plus que la plupart des résidents travaillent à l’extérieur du bidonville. On peut supposer que la possibilité d’accéder à d’autres zones de la ville de façon rapide et efficace constituerait un avantage considérable pour eux. Le téléphérique vise à améliorer cet aspect et a donc potentiellement un impact positif sur le temps de déplacement des habitants non seulement vers les zones de travail, de services publics ou de lieux de loisir, souvent situés hors des bidonvilles. Grâce aux cartes cidessous on peut apprécier les gains en temps de déplacement pour de différents trajets au sein du Complexo do Alemao qui sont souvent considérables (bien qu’il faille souligner que ces cartes ne prennent pas compte des passages informels qui peuvent réduire le temps de déplacement à pied). Néanmoins, les horaires d’ouverture du téléphérique (6h 21h pour les jours ouvrables et 8h20h pendant le weekend) sont susceptibles de limiter l’usage du téléphérique car les personnes travaillant en ville doivent souvent partir bien avant l’heure d’ouverture et rentrent trop tard au Complexo pour pouvoir bénéficier du service du téléphérique.
6
Il est évident que le facteur temps n’est pas le seul à jouer un rôle décisif dans la vie des habitants du Complexo. L’accessibilité financière du téléphérique est tout aussi importante. Ainsi, la municipalité de Rio de Janeiro concède deux voyages gratuits par jour (allerretour) aux personnes ayant plus de 65 ans, aux handicapés, aux étudiants de l’école publique ainsi qu’à tout résident du Complexo do Alemao. Tout voyage complémentaire coûte 1 BRL (0,37 USD); le même prix est payé par les abonnés au réseau urbain (pour tout autre passager, un voyage coûte 5BRL (1,85 USD). Afin d’avoir accès à ces bénéfices, les résidents doivent s’inscrire auprès d’une agence implantée dans la station Bonsucesso et présenter une preuve de résidence (une carte résidentielle, facture d’électricité, d’eau ou autre). Bien que l’enregistrement pour bénéficier de ces gratuités ne semble pas être une procédure compliquée, seul 2700 habitants se sont enregistrés selon Supervia, l’entreprise responsable pour le fonctionnement et la maintenance du téléphérique (Supervia, pers. comm.). Toujours selon Supervia, environ 12 000 personnes utilisent le téléphérique par jour (jours ouvrables) dont 70% sont des résidents du Complexo do Alemao. Ces nombres sont toujours loin de la pleine capacité du téléphérique (30 000 personnes / jour), mais montre une augmentation considérable par rapport aux dernières années, notamment en ce qui concerne la proportion de résidents parmi les usagers. En 2012 seul 11% des usagers du service étaient des résidents (Segundo, 2012a). Néanmoins, le téléphérique semble être bien moins utilisé par les habitants du Complexo do Alemao que ce que le discours autour de sa construction laissait supposer. Minon (2011:21) recense l'avis de certains habitants affirmant que bien que le téléphérique constitue un moyen de transport intéressant pour ceux qui habitent en haut des collines (soit près des stations), les autres n’ont pas changé leurs modes de déplacement et utilisent toujours des modes de transport alternatifs. En effet, il convient de souligner que les favelas, généralement dépourvues d’un réseau de transport public, ont développé un réseau informel de transport, efficace et flexible, opérant généralement avec le soutien de politiques et de trafiquants de drogue (Davila et Brand, 2012:187). Dans le Complexo, ce réseau est constitué par les coopératives de minibus et les mototaxis (ibid.). Selon le résident Walace Fortunato , ces réseaux sont 1
toujours en fonctionnement, même après la construction du téléphérique. Le téléphérique, un projet d’ ”urbanisme social” Malgré les bénéfices associés à l’amélioration de la mobilité urbaine, mentionnée cidessus, cette dernière ne constitue pas une solutionmiracle à la pauvreté urbaine et l’exclusion sociale. Dans les mots de Brand et Avila (2011:648): "While there is ample evidence to demonstrate that, in general terms, the lack of mobility is an integral part of the condition of disadvantage and deprivation (...), it is far from clear that the opposite is true: that marginally improved mobility options for the poor lead directly and inexorably to social improvement. (...) Although mobility is a generalised characteristic and requirement of contemporary society, how mobility options operate and are inserted into economic and social routines, and the positive outcomes it produces, depend on the specific conditions of any given community or social group."
1 Walace Fortunato, résident du Complexo do Alemão, acteur et assistant de production théâtrale par facebook est une connaissance avec lequel nous avons pu nous entretenir via les réseaux sociaux.
8
Les auteurs rappellent ici l’importance du contexte dans lequel s’insère un système de transport visant à faciliter l’accès des résidents à l’espace urbain, ainsi que l’importance de politiques sociales complémentaires. En effet, le projet du téléphérique va audelà d’un investissement dans l’infrastructure urbaine et se veut un projet de transformation sociale. La grande attention médiatique portée au téléphérique confirme ces impressions. Ainsi, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, convoquée à l’inauguration du téléphérique, déclara que « [le Brésil est] en train de vivre […] un véritable miracle social” (Brasil, 2011).
Le maire de Rio, Eduardo Paes, le gouverneur de Rio, Sérgio Cabral, et la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, lors de
l’inauguration du téléphérique du Complexo do Alemão (Folha, 2011)
Non seulement la présidente, mais aussi d’autres parties prenantes du projet tiennent un discours similaires: le gouvernement de Rio déclare sur son site que « [L]e téléphérique constitue une référence touristique et de logistique de Rio de Janeiro et contribue à l’insertion et transformation sociale dans les (quinze) communautés du Complexo do Alemao (SETRANS, 2015). Et dans une vidéo promotionnelle de l’entreprise Supervia, on peut apprendre que « le téléphérique constitue un moyen d’inclusion pour les habitants du Complexo et contribue au développement du commerce local » (SETRANS, 2015). Mais quel est ce miracle social qui fait du téléphérique du Complexo do Alemao plus qu’un simple projet d’infrastructure urbaine? Derrière cette argumentation, nous pouvons identifier plusieurs présupposés théoriques: Premièrement, l’hypothèse qu’un service de transport accessible, efficient et de qualité peut augmenter considérablement la disponibilité de revenus et de temps pour les plus pauvres, faciliter l’accès aux services sociaux (tels que la santé, l’éducation, la formation et le temps libre) et les opportunités de travail (voir section précédente). La mobilité constitue un vecteur de transformation sociale: la possibilité de descendre le “morro”, la colline ou la favela, entraîne l’opportunité d’ une ascension sociale. Deuxièmement, une intervention publique d’une telle envergure montre symboliquement que l'État est non seulement de nouveau présent dans les espaces traditionnellement oubliés par le pouvoir public, mais aussi que l’État n’hésite pas à mettre à disposition des services publics de la même, voire d’une meilleure, qualité aux habitants des bidonvilles que pour les autres résidents de la ville. Par conséquent, à travers la mobilité, les résidents accèdent à la pleine citoyenneté, constituent des parts entiers de la société et rompent avec le stigma social associé à leurs origines. En effet, le projet du téléphérique n’a jamais constitué un simple projet d’infrastructure car il a toujours été accompagné par des transformations complémentaires telles que des équipements sociaux, les
9
investissements dans des activités culturelles, du logement et le développement d’activités locales génératrices de revenus.
Equipements sociaux : de nombreux équipements sociaux accompagnent le projet technique et sont implantés dans la proximité immédiate des six stations. Voici une liste exhaustive des équipements sociaux (Krassner, 2013):
Station Equipements
Bonsucesso point Rio Card (enregistrement des habitants)
Adeus agence bancaire et ATM
Baiana point d’orientation urbaine et sociale de la préfecture ; ATM
Alemao / KIBON centre de référence de la Jeunesse (centre de formation) ; service INSS (sécurité sociale), Centre de référence social (CRAS centre social) ; bureau de poste
Itararé / NATURA intégration avec la communauté Poesi ; Collège journaliste Tim Lopes de l’état ; salles FIRJAN (Fédération des Industries de l’Etat de Rio de Janeiro) qui offre des cours gratuits pour les habitants
Palmeiras espace destiné à l’installation d’un centre culturel, auditoire, bibliothèque, etc.
Emplacement des équipements et services publics dans le Complexo ( à partir d’OpenStreetMap)
10
Investissements culturels : A la suite de l’inauguration du téléphérique en 2011, des ONG locales ont développé le programme « stations culturelles » soutenu par l’entreprise Supervia depuis 2013. Le programme offre un vaste agenda culturel, non seulement pour les habitants mais aussi pour les touristes: des expositions, spectacles, concerts, ateliers, etc. animés par les habitants et des artistes locaux. Le programme est organisé tous les samedis dans les différentes stations et attire jusqu’à 500 personnes par jour (Carioquissimo, 2014). Le développement de l’emploi local : Selon le gouvernement local, le téléphérique gère actuellement 250 emplois dont 160 de façon directe et 110 indirecte . Toujours selon cette même source, 60 pour cent des fonctionnaires sont des habitants 2
du Complexo do Alemão (Setrans, 2015). De plus, environ 3500 travailleurs ont été employés lors de la construction du téléphérique, dont la « plupart était des habitants du Complexo » (Davila et Brand, 2012:191). Bien que des études spécifiques au Complexo ne soient pas disponibles, Brand et Davila (ibid.: 95) montrent que le métrocable de Medellín a un impact positif sur l’économie locale et de proximité ayant ellemême un effet bénéfique sur les indicateurs socioéconomiques à moyen et long terme. On peut supposer, que la construction du téléphérique ait des effets similaires sur le Complexo. L’intégration symbolique: Bien que, comme nous l’avons vu précédemment, les effets et l’efficacité du téléphérique en termes de mobilité peuvent être mis en question, le téléphérique est supposé amener un bénéfice symbolique. Selon Davila et Brand (2011: 658), dans le cas de Medellín: “the highly visible insfrastructures and the aesthetic experience they [the cable cars] afford to both residents and visitors create a feeling of inclusion and integration into the ‘modern’ city, help develop local pride and promote individual selfesteem”. En conclusion, le téléphérique s’inscrit dans une série de projets visant à développer “l’urbanisme social”. Cette notion, apparue en parallèle à la construction du premier téléphérique de ce type à Medellín, est associée à un ensemble de projets urbanistiques dirigés vers les secteurs populaires de la ville et nécessitant des investissements importants. Cependant, l’urbanisme social fut conceptualisé bien avant, en 1952, par Karl Brunner, urbaniste d’origine autrichienne qui a eut une influence décisive dans la planification de Santiago de Chile, Bogotá et Panamá dans les années 1930 et 1940, ainsi que sur le développement de la Vienne d’aprèsguerre (Hofer,1996). Il reste à s’interroger, néanmoins, sur le véritable impact de l’urbanisme social. Contribuetil vraiment à la transformation de la réalité sociale et donc à la réduction de l’inégalité et de la pauvreté au sein d’une ville, ou constituetil un instrument de constitution de l’image urbaine et de contrôle sur des territoires délaissés par le pouvoir public (Brand et Davila, 2011, 657)?
2 Les chiffres que nous donnons sont repris du site du gouvernement, malgré leur inexactitude.
11
III. Le téléphérique et la stratégie de contrôle spatial de la ville La reprise du contrôle public sur un “nonlieu” : le processus de « pacification» à Rio Comme mentionné précédemment, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, les bidonvilles sont devenus les principaux centres du trafic de drogue à Rio de Janeiro et des zones violentes. Des milices et d’autres groupes armés illégaux ont bénéficié de «l’invisibilité» des bidonvilles pour développer leurs activités criminelles, mais aussi pour offrir des services d'intérêt public aux habitants, en adoptant le rôle du pouvoir public. Ce n’est que dans les années 1990, que le gouvernement municipal de la ville de Rio a commencé à mettre en place des mesures afin d’urbaniser les favelas en fournissant des infrastructures de base relatant du service public tel que l'eau, l'assainissement, la collecte des ordures et l'éclairage de rue entre autres. Néanmoins, le fait que ces zones soient toujours contrôlées par des milices ainsi que d’autres forces armées compromettait fortement le bon déroulement des interventions projetées. D’une part, le dialogue entre le gouvernement et la population étaient contraint par la menace des milices et la pression exercée sur les communautés. D’autre part, le gouvernement s’est vu forcé d'établir un dialogue avec les trafiquants de drogue afin de rendre possible le projet et d’entamer les différentes étapes de construction (Simpson, 2013). Dans ce contexte, en 2008, le Secrétariat de la sécurité publique de Rio de Janeiro a commencé à mettre en œuvre les Unités de Police Pacificatrice (UPPs). A travers ce programme, le gouvernement déploie des unités de police communautaires dans les bidonvilles dominées par le trafic de drogue avec l'aide de l'Armée (la police militaire) avec pour but de récupérer les territoires contrôlés par les trafiquants de drogues et les milices, de capturer les dirigeants et ainsi réaffirmer la présence de l'État dans les bidonvilles. Actuellement, il y existe 38 UPPs à Rio, mais la population est fortement divisée sur son efficacité et il existe de nombreux rapports d'abus de pouvoir des agents travaillant dans ces unités. En outre, les UPPs sont critiquées parce que les policiers contrôlent plusieurs aspects de la vie quotidienne dans les bidonvilles, comme la réalisation des fêtes connues comme « bailes funks » sorte de bals très populaires, exerçant un certain contrôle social sur la vie privée des habitants. Nous avons interrogé Walace Fortunato, un résident du Complexo, sur son opinion concernant les UPPs. Il répond: “Je pense que les UPPs ont collaboré pour mettre fin à certaines pratiques criminelles existantes dans le bidonville, comme l’exhibition d ‘armes qui étaient faites par certains habitants. Néanmoins, le problème est que certains policiers respectent la loi lorsque d’autres vont créer leur propre loi… » Bien que l’opinion publique soit mitigée concernant les UPPs, il faut admettre que cette police des favelas est effectivement en train de changer certains paradigmes, soit par l'expulsion de trafiquants de drogue des territoires qu'ils ont contrôlés pendant des décennies, soit en formant de policiers récemment embauchés, s’attaquant ainsi à la corruption policière généralisée. Néanmoins, il convient de souligner que le processus de pacification et avant tout d’un ordre symbolique car les autorités publiques souhaitent montrer leur capacité à sécuriser la ville et semblent vouloir redorer l’image de
12
Rio sur la scène internationale en reprenant le contrôle sur l’intégralité du territoire de la ville. Selon Veena Das et Deborah Poole (2004:13), l'Etat se doit de contrôler aussi les territoires en marge, comme les bidonvilles, car "margins are a necessary entailment of the state, much as the exception is a necessary component of the rule”. Contrôler les marges signifie donc pouvoir contrôler l'ensemble de la ville et l'État de Rio a besoin de montrer sa capacité à sécuriser la ville, notamment dans le contexte des grands événements internationaux qui y ont lieu. Pour ainsi faire, le gouvernement a décidé, en 2010, de mettre en place l’UPP Social, maintenant connu sous le nom de Rio + Social . Le programme Rio + 3
Social vise à contribuer à la consolidation du processus de paix et à la promotion de la citoyenneté locale, promouvoir le développement urbain, social et économique et collaborer à la pleine intégration des pacifiés au reste de la ville. A titre d’exemple, Rio + Social organise des forums publics avec les habitants des bidonvilles afin d'identifier les besoins spécifiques de chaque territoire. La pacification, le téléphérique et la stratégie de contrôle spatial En ce qui concerne le Complexo do Alemão, sa reprise par les forces de sécurité a eu lieu fin novembre 2010 et a nécessité 1200 agents de police, 400 policiers civils, 300 policiers fédéraux et 800 soldats de l’Armée (UPP, 2015). Cette mission a constitué la plus grande offensive contre le trafic de drogue à Rio. Quatre UPPs sont actuellement implantées dans le Complexo do Alemão et depuis leur installation en 2012 plusieurs membres de groupes armés, de milices et d’organisations criminelles liées au trafic de drogue ont été arrêtés. Bien que la présence des UPPs dans les favelas soit l’amorce d’un processus de pacification et donc de diminution de la violence, les échanges de tirs qui sont encore fréquents (environ 2 fois par semaine) sont pour les habitants du Complexo do Alemão une menace bien réelle qui a aussi un impact sur le bon fonctionnement du téléphérique, fermé à cause des échanges de tirs la dernière fois le 10 novembre 2014 (Extra, 2014). D’un point de vue urbanistique, la construction des stations du téléphérique a nécessité le réaménagement des alentours pour permettre l’installation des équipements sociaux et des UPPs, ainsi que l’élargissement des rues alentours des équipements pour faciliter l’accès aux stations. Selon Jáuregui (Urbana, 2013) l’architecte responsable des projets de téléphérique à Medellin et au Complexo do Alemão, la conception du projet de téléphérique a commencé avec une étude de la demande existante (ce qui a permis la conception du système et le nombre de stations requises) et de la topographie du site. Ainsi, l'emplacement des stations au sommet des collines était cruciale non seulement au niveau de la logistique, mais aussi, et surtout, pour des raisons de sécurité (par exemple, pour assurer la bonne maintenance des câbles). De plus, le gouvernement a installé les UPPs en 2012 en proximité des stations: deux UPPs se trouvent dans les stations Itararé et Palmeiras et deux autres ont été implantées entre les stations Adeus/Baiana et Alemão, une fois le téléphérique construit. L’emplacement des UPPs sur les sommets donne au gouvernement la possibilité de contrôler l’ensemble du Complexo, puisqu’il permet une meilleure visibilité de la région (Rio, 2012).
3 Comme la population se méfiait de tout projet commençant avec l'acronyme "UPP", le gouvernement a décidé de renommer le projet.
13
Implantation stratégique des stations du téléphériques sur les point culminant du Complexo do Alemão (http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoestecnicas/30/imagens/img01.jpg)
Position des stations du téléphériques et les UPPs en relation avec la topographie du site
(à partir d’OpenStreetMap et Google Maps et le site http://www.riomaissocial.org)
Il est important de noter que le projet du téléphérique du Complexo do Alemão est inspiré du téléphérique installé à Medellín, une ville avec les mêmes caractéristiques que celle du Complexo en ce qui concerne sa topographie mais aussi par rapport au combat contre le trafic de drogues. Comme montrent les enquêtes faites par Minon (2011:17), les habitants du Complexo n’ont jamais considéré le téléphérique comme prioritaire dans le programme PAC Alemao, d’autant plus que sa construction a consommé 32 pour cent du budget à disposition pour le développement du Complexo, ce qui laisse supposer la prévalence des intérêts de sécurité et de contrôle social sur les besoins quotidiens et réels des résidents. Ainsi, au delà de constituer un moyen de transport pour les résidents du Complexo, le téléphérique adopte une fonction stratégique de contrôle spatial du bidonville, étroitement liée à la pacification de la région et l’implantation des UPP, sans laquelle une telle intervention urbaine n’aurait pas pu être réalisée. Le téléphérique démontre symboliquement la présence de l ‘Etat dans le bidonville; une présence qui est affirmée dans la pratique par les quatre UPP implantées dans la zone.
C’est dans ce contexte que nous pouvons mentionner le travail de Yves Pedrazzini qui traite de l'existence d'un "urbanisme de la peur", ou encore d'un "urbanisme sécuritaire". Selon l'auteur,
14
«l’urbanisme contemporain est en majeure partie une activité de police, comme celui d’Haussmann au 19ème siècle à Paris qui visait à permettre un meilleur contrôle des espaces publics (grandes avenues contre ruelles moyenâgeuses et pour faire passer les canons). Aujourd’hui, l’urbanisme est sécuritaire et l’architecture dissuasive ou militaire.» (Pedrazzini, 2009:6)
IV. Le téléphérique, un projet de «marketing urbain»
L’insertion de la favela dans les politiques néolibérales de « marketing urbain »
Les projets urbains menés et financés par le PAC et d’autres programmes gouvernementaux sont souvent critiqués pour leur tendance à être intentionnellement visibles, spécialement dans les communautés. Ces critiques soutiennent que les projets ne répondent pas intrinsèquement aux besoins des habitants, mais aux demandes d’un “marketing urbain” qui vise à augmenter la compétitivité internationale de la ville et à attirer des investissements et du tourisme. HernandezGarcia (2013:45) défini le marketing urbain de la façon suivante:
“City branding is understood as the means both for achieving competitive advantage in order to increase inward investment and tourism, and also for achieving community development, reinforcing local identity and identification of the citizens with their city and activating all social forces to avoid social exclusion and unrest.” En effet, le téléphérique du Complexo démontre une volonté de la ville de Rio d’améliorer son image de ville internationale, d’autant plus que le projet a été mené parallèlement à la grande attention portée à la ville dans le contexte de la Coupe duMonde (2014) et les Jeux Olympiques (2016). Il constitue par conséquent un projet de grande visibilité; marquant non seulement le paysage urbain pour toute personne arrivant à l’aéroport international mais figure aussi parmi les attractions incontournables de la ville et attire de nombreux touristes. Tripadvisor conseille l’expérience de la visite du Complexo:
Awesome bird's eye views of Rio's largeset favelas. Many Cariocas may be mortified if you tell them of your plans to visit Complexo do Alemao but with the heavy UPP police presence around the stations it is possibly safer than Lapa. The cable car costs just R1,00 and you get some amazing (and totally safe) views of several of Rio's largest favelas. The views stretch almost endlessly into the mountains and it almost feels like spying as you cruise above people flying kites and cooling off on rooftop pools. The cable car is actually public transport so open to anyone and everyone, however the stations were heavily policed and the only concern should be for people with a big fear of heights as the cable car takes off. It's fun though. (Tripadvisor, 2015).
Ainsi, le téléphérique s’inscrit dans la tendance d’exploiter le potentiel touristique des bidonvilles. Ce nouveau modèle de “slum tourism” s’est largement établi à Rio, notamment dans la Zone Sud, la plus touristique de la ville où se trouvent les bidonvilles les plus emblématiques. Selon FreireMedeiros (2014), cette pratique s’inscrit dans une marchandisation de la pauvreté, où la pauvreté devient un spectacle accessible pour tous et les favelas un objet de consommation. Le téléphérique constitue un véhicule important dans cette démarche, car il rend la favela accessible et ouvre une nouvelle perspective sur les bidonvilles et la ville de Rio, observable par les touristes d’une distance confortable
15
et sécurisante. Deux points d’observation promouvant l’usage touristique du téléphérique sont installés à côté des stations du téléphérique depuis lesquels on peut observer quelquesuns des attractions touristiques les plus emblématiques de Rio, entre autre, le pain de sucre. Ainsi, toujours selon FreireMedeiros (2014) «[...] les téléphériques offrent de nouveaux modes de gouvernance de la pauvreté urbaine en même temps qu’il porte la promesse de levier marketing de ces villes du tiersmonde» (FreireMedeiros, 2014, 06:20). Dans le même sens, Brand (2012,14) soutient qu’en effet, dans le cas duMétrocable de Medellín, l’effet esthétique des projets d’urbanisme social est bien plus important que son impact matériel dans la vie des personnes concernées. Le déplacement des habitants et l'augmentation du loyer Il est important de noter que la mise en œuvre d'un système de transport par câble a l'avantage de ne pas nécessiter de grandes démolitions pour l'expansion des rues qui serait nécessaire avec un système de métro, par exemple, réduisant ainsi le nombre de foyers déplacés. Cependant, comme Minon (2011) l’indique, le processus de déménagement des habitants reste une des actions les plus contestées du PAC au Complexo do Alemão. Selon les données du gouvernement (Jurberg, 2015), 2 352 familles ont été déplacées au cours des travaux de construction des stations et plusieurs alternatives leurs ont été proposées, comme l'achat avec le consentement du gouvernement (737 familles), des indemnités (655 familles) ou le loyer temporaire pendant que les unités de logement social sont construites (300 familles). En outre, le gouvernement a construit 728 unités de logement social au Complexo do Alemão. Pour éviter le caractère arbitraire de ces déplacements, le gouvernement a constitué un Comité de Suivi composé par des représentants des habitants provenant des Associations de Quartier. Mais cette situation n’a pas été bien vue par les ONGs du Complexo et par plusieurs habitants puisque les représentants des Associations de Quartier ont eu tendance à privilégier leur connaissances au cours du processus d'indications (Minon, 2011), d’autant plus que ces associations ont souvent été contrôlées par les milices et les trafiquants de drogue. Le logement social et la vente des appartements : Dans le budget du projet de téléphérique (PAC) il est prévu que 2 à 3 pour cent du montant soit utilisé pour ce qu'on appelle le travail social, comprenant le recensement de la population et son «implication» dans le projet (signifiant surtout un gain d’information sur la population), ainsi que la régularisation foncière. L'objectif de la régularisation foncière est d’assurer que chaque famille devienne légalement détentrice du terrain et du bien sur lequel elle est installée. Dans le cas du Complexo do Alemão, la régularisation foncière a coûté environ 3 millions de dollars dont 18.000 familles ont bénéficié (Jurberg, 2015). Néanmoins, la régularisation foncière peut avoir différents impacts sur les acteurs de la ville, comme l’observe Harvey (2008, 36). Dans cette perspective, Harvey porte aussi un regard critique sur les projets urbains de Rio qui accordent le droit à la propriété privée aux habitants des bidonvilles, notamment par l’intermédiaire des logements sociaux. Selon lui,
“What of the seemingly progressive proposal to award privateproperty rights to squatter populations, providing them with assets that will permit them to leave poverty behind? Such a scheme is now being mooted for Rio’s favelas, for example. The problem is that the poor, beset with income insecurity and frequent financial difficulties, can easily be persuaded to trade in that asset for a relatively low cash payment. (Harvey, 2008, 36)”.
16
En effet, cette situation peut être observée à Rio, et le Complexo do Alemão n’en constitue pas une exception. De nombreux habitants déplacés vers les logements sociaux ont mis en vente leurs appartements un peu plus d’un an après de les avoir reçus (Segundo, 2012b) Selon les habitants, la principale raison à ces ventes est la hausse des prix fonciers, conséquence notamment de la pacification mais aussi de la construction du téléphérique et d’autres projets de réaménagement urbain, ainsi que les factures à payer (l’électricité, l’eau et des frais mensuels de maintenance, le “condominio”). En effet, la flambée des prix du foncier qui touche l’ensemble de la ville, a mené à une forte spéculation immobilière avec une augmentation des loyers de plus de 16 pour cent en moyenne en 2011 (Bech et Laffon 2012:2). Au Complexo do Alemão, le prix du loyer a même doublé pendant cette période selon l'Association du Secteur Immobilier, SECOVIRJ (R7, 2011). Ceci entraîne, comme mentionné auparavant, le départ de nombreux habitants qui sont souvent poussés vers la périphérie de la ville. De plus, le processus est intensifié par l'arrivée des "nouveaux habitants" comme les étrangers qui sont attirés par le coté diffèrent /exotique du bidonville, par son emplacement dans la ville, ou par les prix de loyer inférieurs à la moyenne de la ville, et entament un processus de gentrification des zones concernées. Dans le cas du Complexo do Alemao, il convient de nuancer cet aspect de par le fait que le bidonville est situé au Nord de la ville dans une zone moins touristique et centrale, et donc moins encline à ce type de processus. La participation des habitants dans la conception du projet: Bien qu' une partie du budget du projet du téléphérique soit attribuée à l’information des résidents sur le projet et à leur intégration en tant que main d’oeuvre au cours de la phase de construction, plusieurs chercheurs (Nery et Flaeschen 2010 , Davila et Brand 2012) ont indiqué que les secteurs les plus organisés du Complexo do Alemão n'étaient pas suffisamment informés sur les détails de l'ensemble du projet, ce qui a conduit à des retards dans les travaux à cause des manifestations organisées par les résidents. En outre, certaines ONGs ont rédigé un document exigeant un meilleure accès aux informations lors des prochaines interventions du gouvernement et regrettant que beaucoup de leurs demandes n’aient pas été satisfaites par le projet du téléphérique (Brasil, 2013). V. Conclusion La construction du téléphérique du Complexo do Alemao s’inscrit dans une série de politiques publiques urbaines lancée aux trois niveaux politiques (l’État fédéral, les États fédérés et les municipalités) au Brésil qui visent à combattre la pauvreté et à promouvoir le développement urbain par la croissance économique. Ces politiques se concentrent notamment dans le secteur des infrastructures urbaines, requérant des investissements importants, car la mobilité est considérée comme un outil pour combattre la pauvreté urbaine et l’exclusion sociospatiale présente dans certaines zones des ville, notamment les bidonvilles ou favelas qui, par leur topographie et morphologie urbaine, sont difficilement accessibles.
17
Le téléphérique du Complexo do Alemao constitue l’exemple d’un projet de mobilité urbaine relevant d’un nouveau paradigme urbanistique, réaffirmé lors de la construction du Métrocable à Medellín, où l’urbanisme se veut le vecteur d’une transformation sociale: l’urbanisme social. Nous avons pu faire plusieurs constats tout au long de ce travail:
Bien qu’il existe une série d’évidences sur l’importance de la mobilité urbaine pour l’inclusion sociale, il ne va pas de soi que l’implantation d’une infrastructure urbaine pour des zones défavorisées aura un effet positif sur les indicateurs sociaux de cette région. Un accompagnement social à longterme reste indispensable afin de garantir des impacts socioéconomiques durables. D’importantes mesures dans ce sens ont été incorporées au projet du téléphérique, notamment la construction et le maintien des équipements sociaux implantés à proximité des stations.
Il convient de souligner que des projets urbains de grande envergure et maquillant la réalité d’une zone, constitue aussi toujours une affirmation du pouvoir politique et de la présence de l’État dans la région concernée. La pacification du Complexo do Alemao et l’implantation des quatre UPPs sur le territoire étaient non seulement indispensables dans la réalisation du projet du téléphérique mais montre également la reprise de pouvoir de l’État sur le territoire qui peut se transformer en moyens d’oppression et de contrôle social.
Bien que le discours des politiques, des entreprises concessionnaires et de la plupart des médias mettent l’accent sur les bénéfices en termes de mobilité et de gain de citoyenneté pour les résidents du Complexo do Alemao, le téléphérique constitue à la fois une source de revenu et un levier de marketing pour la ville de Rio. Cette situation peut mettre en question la validité du projet en tant que projet social, toujours quand les intérêts économiques de certains l’emportent sur les bénéfices et les besoins des habitants. Ceci est d’autant plus valable dans une ville comme Rio qui accueille plusieurs mégaévènements internationaux en peu de temps et se voit transformée à une grande vitesse afin de satisfaire les besoins du grand capital et des investisseurs. Les grands projets d’aménagement dont le téléphérique n’en constitue qu’un exemple parmi de nombreux autres, risquent de porter un bénéfices exclusifs pour les secteurs plus favorisés et de forcer les populations défavorisées encore plus loin vers la périphérie de la ville et à la marge de la société.
Finalement, le constat sur la difficulté d’une évaluation objective du téléphérique du Complexo do Alemao s’impose. Elle est dû au manque d’études micro sur le sujet et la difficulté de mesurer l’impact symbolique et diffus d’une telle intervention urbaine sur les bidonvilles du Complexo.
En conclusion, ce travail a cherché à établir quelques pistes de réflexion sur la situation dans lequel s’inscrit le téléphérique du Complexo do Alemão et d’insister sur la nécessité d’adopter une vision d’ensemble afin de pouvoir juger l’impact socioéconomique du téléphérique. Le travail soulève plus de questions qu’il ne donne de réponses; néanmoins, nous considérons qu’il est important de se poser ces questions car probablement de plus en plus de villes verront émerger des telles infrastructures comme nouveau moyen de transport urbain. L’analyse critique et complète des expériences de cette forme de mobilité est indispensable pour l’optimisation de futurs projets aux bénéfices des populations concernées.
18
VI. Bibliographie : Batista, Carlos (2010). Da criminalização do funk à militarização do espaço da pobreza. Dissertation <http://www.anf.org.br/dacriminalizacaodofunkamilitarizacaodoespacodapobreza/#.VJ14fsDA> (consulté le 6 janvier 2015). Bech, Victoire et Laffon, Sarah (2012). La politique de Rio à l’épreuve des favelas. Club du millénaire. <http://clubdumillenaire.fr/2012/12/lapolitiquederioalepreuvedesfavelas/> (consulté le 6 janvier 2015). Brand, Peter (2012). Governing inequality in the South through the Barcelona model: ‘social urbanism’ in Medellín, Colombia. Interrogating Urban Crisis: Governance, Contestation, Critique, 911 September, De Montfort University. Brand, Peter et Dávila, Julio (2011). Mobility innovation at the urban margins. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, 15:6, 647661 Brasil, Governo Federal do (2011). Teleférico do Alemão é um símbolo do PAC, diz presidenta Dilma. <http://blog.planalto.gov.br/otelefericodoalemaoeumsimbolodopacdizpresidentadilma/>, 7/09/2011 (consulté le 6 janvier 2015). Brasil, Jornal do (2013). Rocinha e Alemão pretendem processar Estado por causa de Teleférico. <http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/09/29/rocinhaealemaopretendemprocessarestadoporcausadeteleferico/> , 29/09/2013 (consulté le 6 janvier 2015). Carioquissimo (2014). Teleférico do Alemão História e Curiosidades. <http://www.carioquissimo.com.br/telefericodoalemaohistoriaecuriosidades/>, 01/10/2014 (consulté le 6 janvier 2015). Cavalieri, Fernando (2010). Favelas na cidade do Rio de Janeiro: o quadro populacional com base no Censo 2010. <http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download%5C3190_FavelasnacidadedoRiodeJaneiro_Censo_2010.PDF> (consulté le 6 janvier 2015). CENSO 2010. <http://censo2010.ibge.gov.br/> (consulté le 6 janvier 2015). Cities Today (2013). The search for alternative transport solutions. 27/03/2013. Cortes Neri, Marcelo (2011). UPPs e a economia de Rocinha e do Alemão: Do choque de ordem ao de progresso. Rio de Janeiro FGV, CPS.
19
Couto, Patricia et Rodrigues, Ruth (2012) : A gramática da moradia na favela do complexo do Alemão. <http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/131003_favelas_rio_gramaticadamoradia.pdf> (consulté le 6 janvier 2015). Das, Veena and Poole, Deborah. (2004). Anthropology in the Margins of the State. School of American Research Press. Davila, Julio et Brand, Peter (2012). Movilidad urbana y pobreza. Development Planning Unit, UCL / Universidad Nacional de Colombia. Esse, Engenharia Cosultiva (2013). Obras do teleférico de Santos começam em 2015. <http://esseconsultoria.com/telefericosantos/>, 28/11/2013 (consulté le 6 janvier 2015). Extra (2014). Tiroteio interrompe teleférico do Alemão. <http://extra.globo.com/casosdepolicia/tiroteiointerrompetelefericodoalemao14519769.html>, 10/11/2014 (consulté le 6 janvier 2015). Ferreira, Alvaro (2009). Favelas no Rio de Janeiro: nascimento, expansão, remoção e, agora, exclusão através de muros. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XIV, nº 828, 25 de juin 2009. Folha (2011). Dilma participa da inauguração de teleférico no morro do Alemão. <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/07/940289dilmaparticipadainauguracaodetelefericonomorrodoalemao.shtml>, 07/07/2011 (consulté le 6 janvier 2015). FreireMedeiros, Bianca (2014). La pauvreté vue du ciel. Forum Vies Mobiles. <http://fr.forumviesmobiles.org/video/2014/01/20/pauvretevueciel2099>, 20/01/2014 (consulté le 6 janvier 2015). Gomide, Alexandre de Avila (2003). Transporte urbano e inclusão social : elementos para políticas públicas. IPEA, Brasília, julho de 2003. Harvey, David (2008). The right to the city. New Left Review 53, SeptemberOctober 2008 HernandezGarcia, Jaime (2013). Slum tourism, city branding and social urbanism: the case of Medellin, Colombia. Journal of Place Management and Development, Vol. 6 Iss 1 pp. 43 – 51 HernandezGarcia, Jaime (2013a). Slum Tourism and City Branding in Medellin. <http://blog.inpolis.com/2013/01/28/guestarticleslumtourismandcitybrandinginmedellin/> (consulté le 6 janvier 2015).
20
Hofer, (1996). Planeación metropolitana de la posguerra en Viena. Revista de Arquitectura No 8. Universidad de Chile: 2227. Jurberg, Ruth (2015). Trabalho técnicosocial na urbanização de favelas. Seminário Brasileiro de Efetividade na Promoçãoda saúde. <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/palestras/seminario_efetividade_promocao/urbanizacao_favelas_PAC.pdf> (consulté le 6 janvier 2015). Krassner, Anne (2013).Where do Political Will and Community Needs Meet? Dissecting the case of the Aerial Cable Cars in Rio de Janeiro, Brazil. MA thesis. Minon, Ricardo Moreira (2011). O programa de aceleração do crescimento (PAC) no Complexo do Alemão: um campo de disputas. <http://de.scribd.com/doc/86604470/OPACnoComplexodoAlemao> (consulté le 6 janvier 2015). Nery, Marina et Flaeschen, Marcelo (2010). O IPEA sobe o morro. <http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1298:reportagensmaterias&Itemid=39> (consulté le 6 janvier 2015). Pedrazzini, Yves (2009). Violences urbaines, violence de l’urbanisation et urbanisme de la peur: dialectique destructive de l’environnement construit. Article pour le colloque international «Le territoire dans tous ses états » . Mexico, 3 novembre 2009 – 25'300 signes. R7 (2011). Preço de casas no Complexo do Alemão dobra seis meses após ocupação. <http://noticias.r7.com/riodejaneiro/noticias/precodecasasnocomplexodoalemaodobraseismesesaposocupacao20110529.html>, 29/05/2011 (consulté le 6 janvier 2015). Real, Mundo (2013). A critical look at cable cars from experts and allies, with Rocinha’s PAC Planning Process in the Spotlight. <http://mundoreal.org/criticallookatcablecarsfromexpertsrocinhasinspotlight>, 20/07/2013 (consulté le 6 janvier 2015). Rio, Agência (2012). Primeiras UPPs do Complexo do Alemão começam a ser instaladas. <http://www.agenciario.com/materia.asp?cod=102639&NomeEdi=POLICIA#.VJ6wRsDA>, 17/04/2014 (consulté le 6 janvier 2015). Rivadulla, María José et Bocarejo, Diana (2014). Beautifying the slum: cable car fetishism in Cazucá, Colombia. International Journal of Urban and Regional Research Volume 38, Issue 6, pages 2025–2041, November 2014 Segundo, Ultimo (2012a). Construído por R$ 210 mi, teleférico do Alemão custa R$ 6,70 ao Rio por viagem.
21
<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/construidoporr210mitelefericodoalemaocustar670aorio/n1597668033588.html>, 08/03/2012 (consulté le 6 janvier 2015). Segundo, Ultimo (2012b). Vendese apartamento do PAC no Complexo do Alemão por R$ 25 mil. <http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/vendeseapartamentodopacnocomplexodoalemaoporr25mil/n1597579836738.html>, 20/01/2012 (consulté le 6 janvier 2015). SETRANS (2015). Teleférico do Alemão. <http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?articleid=1400288>, (consulté le 6 janvier 2015). Silva, Daniel; Silva, Severino; Rudolph, Andreas et Rudolph, Katharina (2011). Sistema de transporte por cabo uma alternativa auxiliar inovadora para o trânsito urbano. Comunicação técnica 139. Pages 10321041 Simpson, Mariana Dias. (2013). Urbanising favelas, overlooking people: Regressive housing policies in Rio de Janeiro’s progressive slum upgrading initiatives. Bartlett Publication, ISSN 14743280. Tripadvisor (2015). Rio de Janeiro: Complexo do Alemão. <http://www.tripadvisor.com/Travelg303506c190974/RioDeJaneiro:Brazil:Complexo.Do.Alemao.html> (consulté le 6 janvier 2015). Uol (2010). Veja o raio x do Complexo do Alemão, região mais pobre e uma das mais violentas do Rio. <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2010/11/26/vejaoraioxdocomplexodoalemaoregiaomaispobreeumadasmaisviolentasdorio.htm>, 26/11/2010 (consulté le 6 janvier 2015). UPP(2015). Histórico da UPP do Complexo do Alemão. <http://www.upprj.com/index.php/historico> (consulté le 6 janvier 2015). Urbana, Infraestrutura (2013). Santos, Vitória e Florianópolis planejam implantar transporte de massa por teleférico. Conheça o projeto de referência para as cidades: o teleférico do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. <http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoestecnicas/30/artigo2942782.aspx>, Septembre 2013 (consulté le 6 janvier 2015).
22