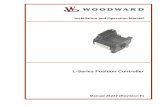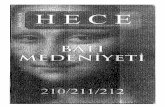LE REJET DE LA POSITION « CONCILIATRICE» DANS LES ÉCLAIRCISSEMENTS DE BAYLE
Transcript of LE REJET DE LA POSITION « CONCILIATRICE» DANS LES ÉCLAIRCISSEMENTS DE BAYLE
/
Les «Eclaircissements» de Pierre Bayle
Édition des «Éclaircissements» du Dictionnaire historique et critique
et études recueillies par Hubert Bost et Antony McKenna
HONORÉ CHAMPION PARIS
J
346 ÜIANNI PAGANINI
Le constat du manque de « point fixe » dans les discours théologiques, lorsqu' il s'agit des déterminations du concept de Dieu, est sans doute 1 ' un des legs majeurs que l 'auteur du Dictionnaire a transmis aux générations successives, y compris la redécouverte kantienne des antinomies qui minent, dans la dialectique transcendantale, toute tentative de théologie
• philosophique.
Gianni PAGANINI
Université du Piémont Oriental
LE REJET DE LA POSITION « CONCILIATRICE» DANS LES ÉCLAIRCISSEMENTS DE BAYLE
Au xvii• siècle, 1 'explication la plus influente du rapport entre la philosophie et la théologie chez les philosophes est ce que j 'appellerai la position << conciliatrice » . Selon cette position, alors que les vérités de la révélation précèdent celles de la philosophie rationnelle, la philosophie peut toutefois s'accommoder des vérités révélées parce que les vérités révélées se placent au-dessus de la raison, et non contre elle. La position conciliatrice n'est pas une nouveauté du xvn• siècle ; il y a plusieurs antécédents hist01iques de cette position, y compris Clément d 'Alexandrie et saint Thomas. Sa portée est pourtant si considérable au début de 1 'époque moderne que 1 'on peut dire que les géants de la philosophie tels que Descartes, Malebranche, et Leibniz 1 'ont tous assumée sous une forme ou sous une autre, et il ne serait pas exagéré de dire qu'elle était plus ou moins considérée comme équivalente à l '01thodoxie théologique- ou bien à 1 'orthodoxie catholique, disons -, de sorte que ceux qui la rejetaient étaient considérés comme théologiquement douteux.
Mon hypothèse de travail est que Bayle rejette cette position conciliatrice, et qu'ilia rejette parce qu'elle ne parvient pas à rendre suffisamment compte de la profondeur de la tension entre la raison - considérée comme une faculté épistémique qui gouverne les relations logiques entre les vérités, ainsi qu'une source de la vélité elle-même - et la foi ou la révélation. Ma thèse est que la singularité de Bayle se trouve dans sa façon de rejeter cette position conciliatrice. Selon Bayle, ce qu' il faut respecter avant tout, c'est 1 'existence d 'un vrai décalage entre les mystères chrétiens et les données et l 'opération de la raison ; certes, la phrase célèbre de Bayle est qu' « il faut nécessairement opter entre la philosophie et l'Evangile' » . Et Bayle insiste à maintes reprises sur le fait que la conséquence à tirer de cette position est que la raison doit se soumettre à une autorité beaucoup plus puissante qu'elle : l'autorité indépendante de la foi.
1 Éclaircissement sur les Pyrrhoniens, p. 644.
348 KRISTEN IRWIN
Si donc les mystères ont cette autorité indépendante de la foi et si, comme le souligne Bayle, les mystères sont réellement incompatibles avec la raison, alors, en effet, les mystères ne doivent pas se soumettre à la raison. Mais la cohérence de cet argument dépend d 'un fait essentiel : 1 'autorité revendiquée pour les mystères. D'où vient cette autorité ? est-
• elle fiable ? comment le savoir ? Un trajet possible pour résoudre cette énigme, que je n'aurai pas assez de temps d'explorer ici, se trouve dans les mots de Bayle à propos de la conscience. La conscience a pour lui une autorité qui surpasse toutes les autres sources de connaissance ; on ne peut que la suivre, comme une obligation absolue et sans condition, et le fait d'être obligé de la suivre n'a aucun rapport avec la raison. Cet « élan de conscience » outrepasse toute pulsion externe, et il me semble que pour Bayle, la conscience fonctionne comme justification de sa croyance dans les mystères.
II y a, néanmoins chez Bayle un indéniable respect à 1 'égard de la raison, et 1 'on ne peut manquer de constater que, la plupart du temps, Bayle parle avec la voix de la raison- c'est-à-dire qu 'il n'hésite pas à employer un ton très philosophique, très précis, même très argumentatif. Il analyse des fautes logiques dans les arguments de ses adversaires et construit des réponses extraordinairement sophistiquées aux objections. Le projet de cette intervention est donc de faire entendre plus vigoureusement le désaccord de ces deux voix qui coexistent chez Bayle : celle de la raison et celle de la foi. Les Éclaircissements nous donnent un exemple concentré de ces deux voix, et je voudrais ici explorer le désaccord entre elles dans ce texte.
Ces deux voix parlent en même temps dans les deux Éclaircissements centraux qui traitent des articles de Bayle sur les manichéens, et sur les pyrrhoniens. C'est pourquoi ils seront le champ de notre investigation. Je voudrais montrer, à travers une lecture de ces Éclaircissements, que la position réfléchie de Bayle aboutit au fait que la foi et la raison ne peuvent jamais se battre équitablement. La foi ne gagnera jamais, car elle se bat sur un champ de bataille qui est déjà contrôlé par la raison. Il y a deux aspects de ce combat qui marchent ensemble contre la foi . L 'un est que la raison peut soulever les objections contre la foi , mais la foi ne peut en faire autant. La foi peut seulement revendiquer et affirmer ses propres propositions, mais elle n 'est capable ni de formuler des objections philosophiques contre la raison- même pas les objections primafacie -, ni de se défendre philosophiquement. Cela montre une asymétrie entre la raison et la foi : considérée exclusivement au niveau rationnel, la foi est handicapée et donc ne peut jamais gagner un combat dialectique.
LE REJET DE LA POSITION «CONCILIATRICE» 349
L'autre raison en défaveur de la foi est que, par définition, elle ne peut répondre aux objections soulevées par la raison à cause d'une différence d'ordre ontologique. La raison appartient à 1 'ordre naturel ; elle domine et éclaire dans ce domaine, mais elle ne peut rien faire- elle n'a aucun pouvoir - dans le domaine surnaturel. La foi, par contre, appartient à 1 'ordre surnaturel ; elle est incapable de fournir des réponses aux objections parce qu'il y a une incommensurabilité absolue entre ses propositions et celles de la raison. Cette incommensurabilité se révèle sur le plan des objets de croyance. Les objets de croyance pour la raison sont évidents, tandis que les objets de croyance pour la foi sont, selon Bayle, « inévidents » . Examinons donc 1 'asymétrie du combat et 1 'incommensurabilité entre la raison et la foi, et voyons-en les conséquences pour la position de Bayle sur la relation entre la raison et la foi.
L 'asymétrie du combat
Une description des règles dialectiques dans le combat de la raison et la foi se trouve dans le passage suivant de 1 'Éclaircissement sur les Manichéens :
Toute dispute philosophique suppose que les parties contestantes conviennent de certaines définitions, et qu'elles admettent les regles du syllogisme et les marques à quoi l'on connoit les mauvais raisonnemens. Après cela, tout consiste à examiner si une these est conforme médiatement ou immédiatement aux principes dont on est convenu, si les prémisses d'une preuve sont véritables, si la conséquence est bien tirée. [ ... ] On remporte la victoire, ou en montrant que le sujet de la dispute n'a aucune liaison avec les principes dont on étoit convenu, ou en réduisant à 1 'absurde le défel)deur. [ .. . ]Le but de cette espece de disputes est d'éclaircir les obscuritez et de parvenir à l'évidence; et de là vient que 1 'on juge que pendant le cours du procès la victoire se déclare plus ou moins pour le soutenant ou pour l'opposant, selon qu'il y a ou plus ou moins de clarté dans les propositions de 1 'un que dans les propositions de l'autre : et enfin l'on est d'avis qu'elle se déclare pleinement contre celui dont les réponses sont telles qu 'on n'y comprend rien, et qui avoue qu 'elles sont incompréhensibles. On le condamne dès-là par les regles de l'adjudication de la victoire [ ... f
Bayle rappelle ici les critères d'une dispute philosophique : le contexte est typiquement dialectique, dans la mesure où la dispute a pour . but
2 Éclaircissement sur les Manichéens, p. 630.
350 KRISTEN IRWIN
« d'éclaircir les obscuritez et de parvenir à 1 'évidence», d'aniver à un espèce de consensus atteint par la démarche dialectique. Mais les « parties contestantes » doivent être d'accord sur les présupposés du débat ; sinon aucun accord ne serait envisageable. Et le présupposé fondamental d 'un~ dispute philosophique est q ue la victoire n'est pas possible pour la Partie qui fournit les réponses « incompréhensibles », c 'est-à-dire « inévidentes ». On verra plus tard que les mystères chrétiens sont caractérisés par leurs objets « inévidents » ; donc, il paraît que les mystères sont exclus de la possibilité même d 'une victoire dans une dispute philosophique, par définition. L 'asymétrie du combat est déjà présente dans les présupposés du débat.
Un autre passage qui évoque le même point, mais plus métaphoriquement, est le texte qui se trouve au-dessus du passage préalablement cité :
[Certains] s'irritent et[ ... ] s'indignent quand ils voient que l'on avoue que tous les articles de la foi chrétienne, soutenus et combattus par les armes de la seule philosophie, ne sortent pas heureusement du combat ; qu'il y en a quelques-uns qui plient, et qui sont contraints de se retirer dans les forteresses de l'Ecriture, et de demander qu'à l'avenir ils aient la permission de s'anner d'une autre maniere, faute de quoi ils refuseront de rentrer en lice.
Ceux qui se fâchent de se voir ainsi inquietez dans la possession de l ' image d'un plein triomphe craignent d'ailleurs qu'en avouant une sorte d' infériorité. on n'expose la religion à une défaite totale, ou que pour le moins on n'affaiblisse notablement sa certitude et que l'on n'avance les affaires des ennemis de l'Evangile. [ ... ]
Bien loin que ce soit le propre de ces véritez de s'accorder avec la philosophie, il est au contraire de leur essence de ne se pas ajuster avec ses regles (2).
(En note marginale (2) : Restreignez ceci aux véritez evangeliques qui contiennent des mysteres ; car il faut avouer que les préceptes de la morale de Jesus-Christ se peuvent facilement concilier avec la lumiere naturelle. l3
Ce passage montre qu'avec les seules armes de la philosophie, la foi ne peut pas se défendre. La foi ne peut que se retirer sous 1 'autorité de la révélation - les mystères chrétiens - faute d 'avoir la possibilité de se défendre autrement. Et à la fin du passage se trouve une explication pourquoi les armes philosophiques ne marchent jamais pour la foi : il s'agit en fait, pour « ces véritez » - c'est-à-dire les vérités mystérieuse~ de la foi - de se conformer aux règles philosophiques du combat, a
3 Éclaircissement sur les Manichéens, p. 630.
LE REJET DE LA POSITION « CONCILIATRICE » 351
rebours de leur essence propre. Autrement dit, elles sont constitutivement incapables d 'engager la raison sur son propre terrain.
Bayle insiste encore sur 1 'inégalité du combat entre la raison et la foi cians un autre passage tiré de l'Éclairci ssement sur les Manichéens :
Voici en quoi different la foi d'un chrétien et la science du philosophe : cette foi produit une certitude achevée, mais son objet demeure toûjours inévident : la science au contraire produit tout ensemble l 'évidence de l'objet et la pleine certi tude de la persuasion. Si donc un chrétien entreprenait de soutenir contre un philosophe le mystere de la Trinité, il opposerait à des objections évidentes un objet inévident. Ne serait-ce point se battre les yeux bandez et les mains liées, et avoir pour antagoniste un homme qui se peut servir de toutes ses facultez ? Que si Je chrétien pouvait résoudre toutes les objections du philosophe sans se servir que des principes de la Iumiere naturelle, il ne seroit pas vrai, comme 1 'assûre saint Paul , que nous cheminons par foi et non point par vue. La science, et non pas la foi divine, serait le partage du cbrétien4•
L'image de ce passage est très instructive : la foi a « les yeux bandez et les mains liées », tandis que la raison peut se servir « de toutes ses facultez ». On voit aisément comment la raison pourrait réduire un « mystere chrétien » à 1 'absurdité ; prenons la Trinité comme exemple. La raison pose l'objection que trois personnes ne peuvent pas être de la même essence divine, que trois personnes ne peuvent pas composer un seul dieu. Mais la foi, sans recours à la « lu.miere naturelle », n'a aucune réponse, sauf une simple affirmation contradictoire de la doctrine mystérieuse de la Trinité. Se pose également le problème de 1 'évidence : la raison- ici « la science » - produit l ' évidence de l'objet ainsi que la certitude de la persuasion. Que pourrait offrir la foi ? rien qu'un objet « inévident », mais avec une certitude « achevée ». Le degré de certitude paraît être le même ; le trait distinctif est la clarté de l'objet de croyance. Mais cette divergence n'a pas de connotation négative ici ; au contraire, Utiliser les « principes de la lum.iere naturelle » pour répondre aux objections serait contraire à 1 'idée de la foi exprimée par la théologie même. << Cheminer par vue » revient à cheminer par la lumière naturelle, tandis que la foi représente un chemin qui n'est illuminé que par la lumière surnaturelle, un chemin qui n 'est jamais nature llement évident.
4 Éclaircissement sur les Manichéens, p. 63 1.
352 KR!STEN IRWIN
L'incommensurabilité de la fo i et la raison
Nous venons de voir que l'asymétrie entre la foi et la raison a pour conséquence qu'elles ne peuvent pas s'affronter équitablement ; cependant, le texte laisse entendre que Bayle va au-delà d'une simple lutte. En fait, il paraît que, pour lui , il y a une différence constitutive et qualitative entre les ordres ontologiques de la raison et la foi . Ce point se trouve dans le passage suivant dans 1 'Éclaircissement sur les Manichéens :
Les mysteres de l'Evangile, étant d'un ordre surnaturel, ne peuvent point et ne doivent point être assujettis aux regles de la lumiere naturelle. Ils ne sont pas fai ts pour être à l'épreuve des disputes philosophiques : leur grandeur, leur sublimité, ne leur permet pas de la subir. Il seroit contre la nature des choses qu'ils sortissent victorieux d'un tel combat : leur caractere essentiel est d'être un objet de foi, et non pas un objet de science. Ils ne seroient plus des mysteres si la raison en pouvait résoudre toutes les difficultez ; et ainsi au lieu de trouver étrange que quelqu'un avoue que la philosophie peut les attaquer, mais non pas repousser 1 'attaque, on devrait se scandaliser si quelqu'un disoit le contraire (3).
[En note marginale (3) : Notez qu'on ne veut pas condamner ceux qui s'efforcent de concilier ces mysteres avec la philosophie ; leurs motifs peuvent être bons, et leur travail avec la bénédiction de Dieu peut quelquefois être utile. ]5
Comme nous avons déjà vu ci-dessus, les « mystères de 1 'Evangile » ne peuvent pas - et ce qui est plus fort, ne doivent pas - être assujettis aux « regles de la lumiere naturelle » ; ils sont trop « sublimes » pour être considérés d'une telle manière. Je prends 1 'expression « lumiere naturelle » ici comme un synonyme de « la raison », ce qui correspond approximativement à l'usage de cette phrase chez Descartes et les autres rationalistes. Quand Bayle affirme qu' « il seroit contre la nature des choses » que les mystères 1 'emportent sur la raison, il parle selon les règles du combat qui sont- comme on 1 'a vu- effectivement celles de la raison. Dire qu'il est « contre la nature de choses » que les mystères de 1 'Evangile soient victorieux dans un combat avec la raison, puis dire qu' ils ne doivent pas être assujettis aux règles de la raison, revient à dire que ces mystères ont une présomption de supériorité normative, c'est-àdire qu'il y a quelque chose hors de l 'ordre naturel qui les recommande.
5 Éclaircissement sur les Manichéens, p. 631.
LE REJET DE LA POSITION « CONCILIATRICE » 353
Avec tous ces outils, il faut donc retourner maintenant à la fameuse déclaration de Bayle selon laquelle « il faut nécessairement opter entre la philosophie et l'Evangile » . Voyons le contexte de cette déclaration de plus près:
Un véritable fidele, un chrétien, qui a bien connu le génie de sa religion, ne s 'attend pas à la voir conforme aux aphorismes du Lycée, ni capable de réfuter par les seules forces de la raison les difficultez de la raison. Il sait bien que les choses naturelles ne sont point proportionnées aux surnaturelles, et que si l'on demandait à un philosophe de mettre au niveau et dans une parfaite convenance les mysteres de 1 'Evangile et les axiômes des aristotéliciens, on exigerait de lui ce que la nature des choses ne souffre point. Il faut nécessairement opter entre la philosophie et 1 'Evangile : si vous ne voulez rien croire que ce qui est évident et conforme aux notions communes, prenez la philosophie et quittez le christianisme ; si vous voulez croire les mysteres incompréhensibles de la religion, prenez le christianisme et quittez la philosophie; car de posséder ensemble l'évidence et l'incompréhensibilité, c'est ce qul ne se peut, la combinaison de ces deux choses n'est guere plus impossible que la combinaison des commoditez de la figure quarrée et de la figure ronde. U faut opter nécessairement [ ... ]6
L'interprétation la plus fréquente de ce passage est qu'il y a un choix absolu à faire entre la philosophie et 1 'Évangile. Cette interprétation pourtant est ambiguë : en replaçant ce passage dans son contexte, on peut en percevoir le sens véritable : la profondeur de la tension « entre la philosophie et 1 'Evangile » se trouve dans la disproportionnalité des choses naturelles et des choses surnaturelles. L'ordre naturel - la « nature ?es choses » - ne touche point les choses surnaturelles. Le détail le plus Important du contexte de ce passage est cependa:rrt que cette dichotomie se trouve au niveau des « choses », c'est-à-dire des choses particulières. Bien que la grande rhétorique soit très nette à la fin du passage, le c?ntexte nous donne les outils pour mettre à jour un sens plus précis. Au mveau des choses particulières, les propositions individuelles, il faut bien opter « entre la philosophie et l'Evangile », c'est-à-dire décider si une proposition appartient à l 'ordre naturel ou à l'ordre surnaturel. Chaque proposition fait partie soit de 1 'ordre naturel, soit de 1 'ordre surnaturel · il serait incohérent qu'une proposition puisse appartenir aux deu~ domaines à la fois. Chaque proposition est donc ou un objet de la foi, ou un objet de la philosophie. Mais cette vérité ne touche point la question
6 Éclaircissement sur les Pyrrhoniens, p. 644.
354 KRISTEN IRWIN
de la coexistence de la philosophie et 1 'Evangile. Évidemment ce n'est pas u~1e contradiction de etire qu ' il y a deux ordres d'existence, et Bayle a déjà d1t que les deux o rdres sont qualitativement différents. S' il y a en effet une différence fondamentale entre ces deux domaines, cela ôte la pression d ' un conflit direct entre les deux : le choix entre la philosophie et l'Evangile s'opère toujours au niveau des propositio ns individuelles, et j amais au niveau des domaines .
Cette analyse est soutenue par une explication du reste du passage en employant cette distinction « propositionnelle ». Après avoir donné le choix entre« la philosophie et le christianisme >>, Bayle li vre la rai son de cette dichotomie: « car de posséder ensemble l 'évidence e t l'incompréhensibilité, c'est ce qui ne se peut ». Le mot crucial ici est « ensembl e » ; il justifie notre interprétation « propositionnelle » du choix. Certes, il est impossible d'avoir une proposition qui est à la fois évidente et incompréhensible ; il est impossible « de posséder ensembl e 1 'évidence et l 'incompréhensibilité » dans la même proposition. Mais cela ne dit ri en sur la question de l'affirmation de plusieurs propositions différentes, dont quelques-unes ont des objets évidents, et d'autres ont des objets « inévidents ». Pareillement, une telle interprétation peut être soutenue en examinant l 'analogie des fi gu res carrée et ronde. Bayle dit que la combinaison de 1 'évidence et de l'incompréhensibilité est comme la combinaison des corrunodités d' une figure carrée et d'une figure ronde. Ce qui est notable ici est qu'il recourt à une métaphore avec des objets particuliers ; ce n'est pas une question de domaines généraux, mais une contradiction du fait de « commodités » particulières qui sont mutuellement exclusives. Ainsi, les commodités d'une proposition évidente ne peuvent point être combinées avec les commodités d ' une proposition « inévidente ». Quand Bayle pose qu '« il faut nécessairement opter entre la philosophie et 1 'Evangile », cela veut donc dire que 1 'on ne peut pas affirmer une proposition avec les critères et méthodes de la philosophie et la certitude de la foi en même temps ; le choix dépend du statut des objets de la proposition. Si la proposition concerne des objets « inévidents », el le n'appattient pas à l'ordre naturel, et donc ne peut pas être éval uée par la phllosophie. Mais cela n ' implique pas que la phi losophie et 1 'Évangile ne peuvent pas coexister dans leurs propres domai nes.
Conclusion
Il y a deux conséquences principales à tirer de tout cela. La première est que, même si le domaine de la raison se limite à l'ordre naturel, cela signifie néanmoins que, pour Bayle, la raison joue un rôle important. Elle
LE REJ ET DE LA POSITION « CONCILIATRICE» 355
est la sow·ce essentielle de toute notre connaissance de 1 'ordre naturel, la capacité uniquement apte à comprendre la « nature des choses». Et cela n'est pas négligeable ! Les vérités morales font partie de la « nature des choses », et peuvent donc être comprises par la raison. Cette position permet l'affirmation cé~èbre de Bayle soulignant que les athées peuvent être moraux. Dans les Eclaircissements, Bayle ne rejette point la raison et il ne dit pas que la raison n 'est pas fiable ; au contraire, il a un~ conception de la raison qui lui donne tout le pouvoir possible dans son propre domaine. La voix de la raison chez Bayle n'est pas simplement utile en tant qu 'outil logique, elle s'avère aussi un moyen puissant pour acquérir des connaissances naturelles.
La deuxième conséquence est que le domaine des mystères sumaturels est qualitati vement différent de celui de la raison. Cela n ' implique pas qu'il n'y ait pas des éléments de la révélation qui fassent pa1tie de la « nature des choses», de l 'ordre naturel , et donc du domaine de la raison comme les vé1ités morales par exemple. Mais les vérités centrales d~ l'Évangile- les « mystères » - appartiem1ent au domaine surnaturel. Et même si Bayle parle toujours avec la voix de la raison, cette voix est restreinte par l ' auto1ité de la voix de la foi, d 'où viennent les mystères. Ce qui est paradoxal chez Bayle, c'est que ces deux voix ne peuvent pas se parler- Bayle utilise la voix de la raison, mais il fait entendre la voix de la foi dans un autre registre tout au long de ses textes. Le décalaoe entre ces deux voix implique que Bayle ne voit pas de moyen pour l~s concilier ; la séparation est profonde et insurmontable. Ce qui reste est la coexistence inquiète de deux ordres ontologiques, et en fin de compte la voix de la foi parle plus fortement- quoique moins fréquemment - que celle de la raison.
Que faire donc avec cette coexistence inquiète ? Comment négocier une interprétation qui explique 1 'impmtance de la· méthode philosophique des textes bayliens tout en respectant la place centrale des vérités de la foi ? Toute interprétation aura des éléments controversés, mais je constate que, pour être plausible, une interprétation doit rendre compte de la tension entre la raison et la foi d'une manière qui soit en cohérence à la fois avec l'esprit et avec la lettre de Bayle. Cela implique que les interprétations qui privilégient le rationali sme de Bayle en rendant obscures ou équi voques ses professions de foi creusent l 'unicité et l 'originali té de sa position . Il est facile d 'être un fidèle, et guère moins facile d 'être un incroyant, mai s être un philosophe fidèle qui insiste sur le décalaoe entre la foi et la
• 0
ratson ? Voi là la sin gularité, et donc la valeur, de la position baylienne. D'un autre côté, toute interprétation qui insiste sur le fidéisme absolu de Bayle sans reconnaître sa fixation s ur les apories philosophiques au cœur
356 KRISTEN IRWIN
de la foi rabaisse la facilité analytique que Bayle démontre tout au long de son œuvre ; effectivement, les textes hors Dictionnaire nous révèlent un esprit essentiellement interrogateur, même hétérodoxe dans son doute.
Une interprétation qui utiliserait la conscience comme la justificati on pour 1 'autorité des mystères de la foi parviendrait aux deux desiderata ci _ dessus. Bien sûr, elle pourrait expliquer pourquoi Bayle privilégie certaines propositions qui font pattie du noyau del 'orthodoxie chrétienne . mais elle pourrait aussi justifier la position de Bayle sur la question de 1 ~ tolérance religieuse, ainsi que sa prédilection pom 1 'analyse philosophique. Il faudrait une étude textuelle beaucoup plus exhaustive pour démontrer que cette position est fidèle à 1 'œuvre de Bayle, mais j'espère avoir donné le début d'une esquisse d'une telle interprétation.
Kristen lRW!r-i Université de Californie à San Diego
LES OBSCÉNITÉS DE LA PHILOSOPHIE : ÉCLAIRCISSEMENTS SUR LES« ÉCLAIRCISSEMENTS»*
Peut-on dire quelque chose de nouveau à propos des Eclaircissements de Bayle ? La confiance et la prévoyance des organisatems de ce colloque nous encouragent à penser que oui. Les faits sont bien connus, en définitive grâce au mérite de P. Des Maizeaux, puis de J.B. Kan et de E. Labrousse. La récente biographie de H. Bost relit avec attention les données disponibles, et on doit se renvoyer à celle-ci aussi afin d'éviter d'inutiles répétitions1
• II me semble cependant qu 'une mise au point peut se révéler opportune. La procédure entamée par le consistoire wallon de Rotterdam à l 'encontre du DHC suivit de quelques années l 'affaire de l'Avis aux réfugiés, et doit être considérée comme une nouvelle manifestation de 1 'hostilité de Jurieu et d 'autres pasteurs de son cercle. Face à cette nouvelle poursuite, Bayle maintient une attitude d 'extrême prudence, associant une grande disponibilité formelle à une fermeté substantielle. Il reste franchement incompréhensible que E. Labrousse ait pu écrire que Bayle démontra dans cette histoire une « soumission respectueuse [ ... ] envers le tribunal spirituel qui lui avait demandé des explications » ou une « scrupuleuse docilité envers les autorités légitimes dans laquelle il voyait Je ciment de la société »2
• Il est difficile d ' imaginer que les pasteurs calvinistes aient eu la même impression. Bayle contesta depuis le début la compétence du consistoire vis-'à-vis d'un livre à caractère historique comme le Dictionnaire. Il est vrai qu' il manifesta une
• Cette recherche a été soutenue par le MIUR- Ministero deli' Istruzione Università e Ricerca PRIU 2006 - Projet de recherche « Comunicare la scienza : testi , strumenti e immagini nell 'età maderna e contemporanea ».
1 Cf. P. Des Maizeaux, Vie de Monsieur Bayle, in DHC, 1740, I, p. XYII-CXn ; J.B. Kan, Bayle et Jurieu, « Bulletin de la Commission de l'Histoire des Églises Wallonnes »,
IV, 1890, p. 139-202 ; E. Labrousse, Pierre Bayle, t. I : Du pays de Foix à la cité La Haye, M. Nijhoff, 1963, p. 246-253 ; H. Bost, Pierre Bayle, Paris, Fayard,
p. 429-462. Cf. désormais H. Bost et A. McKenna (ed.), « L'Affaire Bayle ». La entre Pierre Bayle et Pierre Jurieu devam le consistoire de l'Église wallonne de
~Oliterd'am. Saint-Etienne, Insti tut Claude Longeon, 2006. 2 E. Labrousse, Pierre Bayle, t. I, cit. , p. 250-251 .