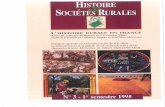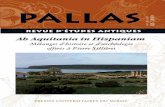Le plus ancien document des Archives Municipales de Fougères : un don de 1259 à la Maison Dieu...
-
Upload
univ-brest -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Le plus ancien document des Archives Municipales de Fougères : un don de 1259 à la Maison Dieu...
75
Le plus ancien document des Archives Municipales de Fougères
Un don de 1259 à la Maison Dieu vidimé en 1308
par Julien BACHELIER
Les archives municipales de la ville de Fougères possèdent un acte remontant au tout début du XIV e siècle, classé sous la cote I.I. 6/1-1 et, sur la pochette cartonnée dans laquelle il repose, il est fait mention d’une redevance due à la chapelle du château de Fougères.
Pour diverses raisons, ce document nous intéressait et lorsque nous avons entrepris sa traduction il nous ait apparu que le titre de la pochette n’avait pas de rapport avec le contenu de la notice. S’il est bien ques-tion d’une redevance, il n’y a aucune mention d’un château et encore moins d’une chapelle. Une lecture erronée de certains mots a conduit à cette erreur.
Dès lors il nous est apparu intéressant d’en proposer une présen-tation ainsi qu’une explication, ne serait-ce que pour faire connaître aux Fougerais le contenu de cette archive la plus ancienne de la ville. Disons-le tout de suite, faute de temps il ne nous a pas été possible de fournir ici une transcription et une traduction qui suivent au mot près le texte (1). Le vidimus, bien que soigneusement conservé, a subi les assauts
76
du temps qui empêchent la lecture de certains passages. Rappelons aussi que les actes de cette époque sont rédigés en latin, ce qui ne constitue toutefois pas l’obstacle le plus difficile. Chaque scribe a son écriture et ses abréviations, dont certaines n’ont pu être déchiffrées. De plus le parchemin est légèrement abîmé en quelques endroits et certaines lignes restent difficiles à lire car le document a dû être plié.
Le court article qui suit propose d’abord une description de l’acte, puis après avoir tenter une transcription des principaux passages avec les limites dont nous venons de parler, nous expliquerons le document et le remplacerons dans son contexte, car bien que le vidimus soit daté de 1308, l’essentiel du texte remonte au milieu du XIIIe siècle.
Description du vidimus
L’acte en question est un petit parchemin de 21,5 centimètres sur 21, comptant 25 lignes, l’écriture est relativement dense, les lettres bien que petites restent lisibles, les abréviations peuvent parfois gêner la compré-hension. Si XPI pose peu de problème (ligne 4, dernier mot : Christi), d’autres demeurent plus énigmatiques et n’ont pu être déchiffrées. La graphie correspond bien au XIVe siècle.
La taille du document, qui peut sembler modeste de prime abord, coïncide avec d’autres textes de la même époque conservés, par exemple aux archives départementales d’Ille-et-Vilaine de Rennes. Le parchemin coûte cher ce qui explique la taille de l’acte. Ni son contenu (un don et une redevance modestes), ni l’origine sociale des donateurs (seigneurs certes, mais de second rang) ne pouvaient justifier d’utiliser davantage de peau.
Un vidimus est une copie certifiée d’un acte plus ancien. Vidimus signifie en latin « nous avons vu... », sous-entendu : « nous avons vu l’acte à authentifier ». Or ici on peut constater que le copiste a travaillé vite, trop parfois... Ainsi à la ligne 8, le mot est raturé et ce n’est pas le seul exemple.
Dans son ensemble, le document est bien conservé pour un acte datant de plus de 700 ans. Le temps et les hommes ont néanmoins abîmé cer-tains passages. La partie supérieure compte quelques tâches rougeâtres, qui font penser à de la rouille (lignes 7 ou 9), si elles gênent la lecture, elles n’empêchent pas de transcrire le texte si on veut bien prendre son temps. À l’inverse dans la partie inférieure, on trouve d’autres marques
77
posant de sérieuses difficultés. Ainsi, aux lignes 15-16, des traces d’humi-dité ont fait disparaître une partie du texte. Et aux lignes 15, 17 et 19, le parchemin est troué en quelques points, notamment dans la partie droite.
Enfin, l’acte était scellé. Il reste aujourd’hui une bandelette, fine, d’une douzaine de centimètres de long, attachée au bas du parchemin et sur laquelle devait se trouver le sceau du prêtre de la Maison Dieu certi-fiant l’authenticité de l’acte.
figure n° 1. Le vidimus de 1308 (Archives Municipales de Fougères, I.I. 6/1-1, cliché J. Bachelier, 2009)
Analyse de dons faits à la Maison Dieu de Fougères au Châtellier
L’acte se compose de deux parties bien distinctes, mais emboî-tées. Les premières et les dernières lignes enserrent un acte de 1259, l’ensemble ayant été rédigé en 1308. C’est le texte du XIIIe siècle qui
78
constitue le cœur de la donation. Les lignes qui suivent reprennent l’es-sentiel du document.
« À tous ceux qui liront et entendront cette présente lettre, Guillaume Radier, prêtre de la Maison Dieu Saint-Nicolas de Fougères (Guillelmus Radier presbiter domo dei Sancti Nicholai Filgeriensis) salut dans le Seigneur. Sachez que nous avons vu et examiné l’acte dont la teneur suit (2) et avons apposé notre sceau pour le certifier authentique.
À tous les fidèles du Christ présents qui verront ou entendront cette présente lettre, Pierre Hoyte, bourgeois de Fougères, alors admi-nistrateur de la Maison Dieu de Fougères (Petrus Hoyte burgensis Filgeriis alloquens domo dei Filgerii), salut dans le Seigneur. Sachez que Robert de Vieuville (Robertus de veti villa) s’est rendu à la cour de la Maison Dieu de Fougères pour passer un accord, il a hérité et a possédé en paix et paisiblement un clos au lieu-dit Lessart et quatre jugères (3) de terre au niveau de Loisance, situés dans la paroisse du Châtellier (in parrochiam de Castellarum) dans un fief de la Maison Dieu de Fougères. Lui et ses héritiers possédaient en paix quatre livres et demi de monnaie courante. Tuallort et Jeanne, son épouse, avaient vendu au dit Robert ce champ avec les obligations afférentes dans la paroisse du Châtellier selon les us et coutumes bretonnes (4) (in parrochiam de Castellarum usus et consuetudines britannie). Le même Robert a donné et concédé ledit clos et lesdites quatre jugères de terre à la Maison Dieu de Fougères avec l’accord de Henri Trohon et Pierre Pange, Robert et ses héritiers ont donné en paix ce qu’ils possédaient sur ces biens. Robert et ses héritiers percevaient 5 sous de monnaie courante lors de la Nativité de la sainte Marie (5). Lesdits Henri, Pierre et leurs héritiers ont fait un don pour l’entretien d’un luminaire (6) en mémoire de Robert et de ses héritiers dans l’église du Châtellier (in ecclesiam de Castellarum).
Robert et ses héritiers confirment leurs dons à maison Dieu de Fougères
Pierre Hoyte appose, en tant qu’administrateur, le sceau de la Maison Dieu. Acte passé en 1259.
Le vidime est scellé en février 1308 (7) en présence d’Étienne Gualais, Guillaume de Roella, Robert du Plessis, Hamelin, seigneur de Trecendo, Étienne Rilez et de nombreuses autres personnes. »
79
Un (petit) éclairage sur Fougères et ses environs
Ce document a peu servi aux historiens locaux, on trouve une rapide mention dans les recherches de Léon Maupillé (8) et de Christian Le Bouteiller (9), mais l’acte n’est pas véritablement exploité.
Nous allons d’abord commenter l’acte enchâssé, le plus ancien. Nous évoquerons le donateur et sa famille, puis les dons qu’ils font. Ceci nous permettra de revenir et d’expliquer pourquoi le titre de la pochette des archives est fautif. Puis nous reviendrons sur le rôle et la place des bour-geois de Fougères, ainsi que sur le lien avec l’hôpital.
La famille de Vieuville, seigneur du Châtellier
Le document de 1259 est avant tout un acte de donation. Robert de Vieuville (veti villa) cède des biens fonciers et une rente à la Maison Dieu de Fougères. Il est possible d’identifier ce donateur, d’abord à partir de son nom, mais aussi grâce à ses dons et surtout leur localisation.
Robert possède des biens en la paroisse du Châtellier (in parrochia de Castellarum), or il existe toujours un lieu-dit Vieuville en cette commune. Le texte parle de Loisance qui s’écoule au cœur de cette dernière, ce qui renforce la localisation (voir carte de localisation).
Robert apparaît aussi dans un autre document. En 1258, Jean, doyen de Fougères, fait savoir que Robert de Vieuville, écuyer (armiger), confirme le don de Guillaume de Vieuville, chevalier (miles), fait à l’ab-baye de Savigny, et qui consiste en une rente de 5 sous sur la Haie Joué (lieu-dit Le Joué, voir carte de localisation) située en la paroisse de Saint-Germain-en-Coglès (10).
En l’espace d’une année, Robert effectue deux dons. Il confirme d’abord à la prestigieuse abbaye de Savigny, fondée vers 1112-1113 par Raoul Ier de Fougères, une rente annuelle. Le texte précise qu’il n’est qu’écuyer, un chevalier en devenir, peut-être est-il alors un jeune homme (11) qui vient d’arriver à la tête d’une seigneurie. Cette confirmation serait pour lui un moyen de se lier avec le monde des moines, ceux qui vont lui assurer son salut dans l’au-delà. Savigny a peut-être sollicité l’écuyer pour s’assurer de cette rente. Puis l’année suivante, en 1259, Robert, seul, fait un don. Il a certes l’accord de ses proches, mais il n’in-tervient pas pour confirmer, cette fois il agit, comme un chef de famille, de lignée. Il est tout à fait envisageable que Robert vient de prendre la tête de la seigneurie en cette fin de la décennie 1250. Il entre d’abord en relation avec Savigny, puis avec la Maison Dieu de Fougères. Dans
80
le premier cas ce sont les moines qui lui garantissent son salut ; dans le second, il donne à l’hôpital, aux pauvres qu’il accueille et qui, par leurs prières, assureront à Robert son salut. N’oublions pas que les pauvres sont l’image du Christ, Daniel Le Blévec souligne qu’ils « demeurent, et demeureront avant tout, des intercesseurs privilégiés entre Dieu et les hommes, l’image du Christ ici-bas. C’est à ce titre qu’on doit les secourir (12). » Dans les deux cas, on devine la préoccupation religieuse.
Quant à la famille de Robert, elle semble n’apparaître que tardive-ment dans la documentation, toutefois la situation paraît plus compliqué quand on replace cette lignée dans la région où elle vit. En 1258, Robert fait lui-même allusion à Guillaume, mais on ignore le lien de parenté, s’il y en a un. Tout au plus sait-on, par ailleurs, que Guillaume était un oncle de Guerrehes, chevalier (miles) de Poilley (13). La famille seigneuriale du Châtellier est connue depuis le milieu du XIe siècle, mais les liens de parenté figurent rarement dans les actes. Voici ceux que nous avons pu croiser dans les textes médiévaux :
- Hamelin du Châtellier, simple témoin en 1050, lors de la dona-tion par l’évêque de Rennes, Main, des églises de Poilley et de Villamée à l’abbaye du Mont-Saint-Michel (14).
- puis au tournant de l’an 1100, Bothard du Châtellier est men-tionné à plusieurs reprises. D’abord lors du don de l’église de Lécousse à l’abbaye de Pontlevoy, vers 1080-1090, il donne son accord car il possédait cette église en fief (15). Il était aussi pré-sent lors de la donation de la chapelle Sainte-Marie de Fougères à Marmoutier (16). Au tout début du XIIe siècle, il figurait dans la suite de Raoul Ier, lorsque ce dernier fit un don à l’abbaye de Marmoutier dans le comté de Mortain (17). Enfin, il est cité parmi les premiers témoins lors de la fondation de l’abbaye de Savigny, vers 1113 et dans plusieurs actes qui posèrent les bases du monastère jusque vers 1120 (18).
- Henri apparaît comme témoin à deux reprises lors de dons à l’abbaye de Savigny en 1151, puis à nouveau en 1155 (19).
- en 1173, lors de la révolte de Raoul II de Fougères contre Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre (20), Guillaume du Châtellier est capturé dans la tour de Dol parmi les derniers chevaliers qui com-battaient (21). On le retrouve parmi les chevaliers qui accom-pagnent Raoul II au Mont-Saint-Michel en 1188 (22). Peut-être est-ce à nouveau lui que nous voyons au début du XIIIe siècle en tant que simple témoin dans un acte relatif à l’abbaye de Savigny (23) ?
81
- en 1219, Geoffroy est cité en tant que témoin dans un acte de donation en faveur de Savigny (24). Simple miles (chevalier), il ne réapparaît plus après.
- dans le même acte que le précédent, est aussi mentionné Henri, cité à la suite de Geoffroy, mais on ignore s’il y avait un lien de parenté. En 1229, Henri avec l’accord de son épouse, Pétronille, et son fils aîné, Guillaume, donna à Savigny des prés au lieu-dit La Ramée, au Châtellier, ainsi que sa seigneurie sur une terre achetée à Guillaume Joe, qu’il faut peut-être mettre en relation avec les toponymes de Joué en Saint-Germain-en-Coglès. Il renonça à ses droits sur deux étangs à proximité (25). En 1236, Henri confirma le don de La Ramée (26). Les différents actes semblent indiquer que Savigny se construit ici un petit domaine.
- en 1237, Clémence du Châtellier, veuve d’Étienne de Terra Gasta, miles, a donné la moitié du fief de Guillaume Pezein de La Mériennais, en Saint-Germain-en-Coglès (voir carte de loca-lisation), qui rapportera aux moines 8 sous de Tours et 4 deniers annuellement.
- en 1250, Guillaume du Châtellier, miles, fils d’Henri, probable-ment le même que celui-ci plus haut, confirma les dons de son père et y ajouta le don de droits sur les terres déjà cédées. En retour Savigny s’engagea à prier pour son âme (27).
Certes Robert n’a pas pour nom le Châtellier, toutefois des liens doivent exister entre ces deux groupes familiaux et on devine surtout l’ancienneté et la fréquence des relations entre les seigneurs du Châtellier et l’abbaye de Savigny. Les Vieuville seraient une modeste famille sei-gneuriale probablement d’un rang inférieur aux Châtellier, peut-être même en sont-ils des vassaux. Mais on peut envisager une autre hypo-thèse : les Châtellier et les Vieuville formeraient le même groupe fami-lial. L’onomastique apporte quelques éléments de réponse. Le prénom Robert est classique au milieu du XIIIe siècle, il apparaît difficile de l’utiliser comme argument de filiation. Par contre, on relèvera qu’en 1258 Robert confirme un don de Guillaume de Vieuville, miles, fait à l’abbaye de Savigny, or en 1250, un dénommé Guillaume du Châtellier, miles, donne à cette même abbaye une rente annuelle de 40 sous de Tours, que ses prévôts du Châtellier et de Saint-Germain-en-Coglès verseront aux moines sur les terres que vilains et travailleurs agricoles ou cen-siers, tenaient de lui. Si cela n’arrive pas à temps, les moines pourront se servir sur les biens du seigneur et en son manoir du Châtellier (28). Ce dernier ne serait-il pas l’actuel château de Vieuville ? Les concordances
82
de lieux (paroisses du Châtellier et de Saint-Germain-en-Coglès), de temps (décennie 1250) et les ressemblances onomastiques (Guillaume) et sociale (miles) fournissent suffisamment d’indices pour imaginer que les Vieuville et les Châtellier forment un seul et même groupe familial. Robert serait l’héritier de Guillaume. Il aurait adopté un nouveau nom de famille (29), peut-être parce qu’à la même époque il décida d’aban-donner le bourg du Châtellier et de s’installer au lieu-dit Vieuville. Le château actuel remonterait au 17e siècle (30) et le cadastre napoléonien du début du 19e siècle montre un parcellaire totalement reconfiguré à la même période, avec de vastes parcelles rectangulaires. Il n’existe donc plus de trace du manoir de la seconde moitié du 13e siècle. La famille du Châtellier possédait suffisamment de biens pour en céder une partie à des établissements religieux.
figure n° 2. Carte de repérage (communes du Châtellier et Saint-Germain-en-Coglès)
Les dons
Revenons à l’acte de donation de Robert de Vieuville, que cèda-t-il à la Maison Dieu ? De manière classique son legs a une double nature. Il offre tout d’abord une moitié de champ avec une maison, puis quatre jugères de terre. Nous sommes face à une petite exploitation sur laquelle doit vivre une famille d’agriculteurs. Les hôpitaux ont besoin de ces exploitations pour être ravitailler (31).
Mais le don comporte aussi une part en argent, là aussi c’est tout à fait classique. Cette exploitation rapportait annuellement 5 sous à Robert
83
de Vieuville, dorénavant ils iront aux pauvres. Cette somme relative-ment modeste se retrouve fréquemment au cours du Moyen Âge. Nous pouvons comparer avec le seul hôpital de Haute-Bretagne ayant laissé des archives, celui de Vitré. Ainsi Hervé d’Erbrée et Hamelin Lohin donnent une rente de 5 sous sur une terre en Erbrée à l’hôpital Saint-Nicolas (32). Mais l’essentiel des dons porte sur des valeurs moindres : quelques deniers, deux ou trois sous, seuls les plus fortunés peuvent se permettre des dons onéreux, comme André III de Vitré qui lègue dans son testament à ce même hôpital, une rente de 14 livres à prendre au bourg du Pertre (33). La somme léguée par Robert de Vieuville reste modeste, mais rappelons son appartenance à la strate inférieure de la noblesse.
Sa famille intervient pour donner son accord au don, fait classique pour l’époque. C’est une garantie prise par l’institution hospitalière contre des héritiers qui auraient tendance à contester les legs de leurs aïeuls (34). Mais cette famille intervient aussi directement en demandant l’entretien d’un luminaire dans l’église du Châtellier pour rappeler la mémoire de Robert. Catherine Vincent l’a récemment montré, le luminaire constitue un moyen pour affirmer son statut social, mais aussi pour garantir la perpétuation de son souvenir au-delà du trépas (35).
L’étude de la nature des dons a pu montrer qu’ils étaient des plus clas-siques pour l’époque ; on les retrouve ailleurs, comme le souligne Annie Saunier : « les moyens financiers des établissements hospitaliers pour entretenir le personnel, les bâtiments, le matériel et rendre les meilleurs services à leurs hôtes, proviennent en grande partie des terres et rentes données à la fondation et au cours des années (36). » Celle de leur locali-sation remet en cause le titre de la pochette des archives municipales. En effet, on peut tout d’abord noter qu’il paraît pour le moins curieux qu’un seigneur fasse un don à la chapelle du château de Fougères, rattachée au milieu du XIIe à l’abbaye de Rillé (37). Si Robert avait voulu faire un don à la chapelle il serait passé par l’abbaye. De plus, depuis le milieu du XIIIe siècle, la chapelle Sainte-Marie est devenue un prieuré dépendant de Rillé, le texte n’en parle plus en tant que capella mais priouré (38).
Les toponymes qui figurent dans l’acte montre bien que nous sommes dans la région du Châtellier (voir carte de localisation). Robert donne une pièce de terre près de Loisance et surtout le champ s’appelle Lessart. Or il existe toujours un lieu-dit de cette forme (L’Essart) au pied du Châtellier, sur la colline séparant le bourg de Saint-Germain-en-Coglès de celui du Châtellier. Un problème subsiste car il est bien précisé dans le vidimus que ces lieux se trouvent en la paroisse du Châtellier, or aujourd’hui ils se
84
situent en Saint-Germain. Y aurait-il eu un changement de limite parois-siale ? Est-ce une erreur du copiste de 1259 ou bien de celui de 1308 ?
Ainsi deux autres documents de la même époque parlent de la paroisse du Châtellier. En 1222, l’évêque de Rennes, Pierre de Fougères, fait connaître l’accord conclu au sujet du transport des dîmes de pailles et de chaumes de la paroisse. Le recteur et le vicaire du Châtellier seront chargés de les transporter dans un grenier particulier, en retour l’abbaye Saint-Melaine de Rennes leur versera une rente annuelle de 10 sous, payable lors de la fête de saint Luc l’Évangéliste (39). Un siècle plus tard, la paroisse est une nouvelle fois citée, en 1320, l’évêque de Rennes, Alain III de Châteaugiron, confirme l’arrangement conclu entre le recteur de l’église Notre-Dame du Châtellier (ecclesie Beate Marie de Castellario), maître Guillaume Beaufrère, et l’abbaye Saint-Melaine, qui revendique les deux tiers des dîmes de ladite église. Le recteur ver-sera aux moines 14 mines de bons grains de la dîme de la paroisse, soit 8 mines de seigle, 2 mines d’avoine grosse, 4 mines d’avoine menue à la mesure de Fougères, tous les ans lors de l’octave de Noël au presbytère du Châtellier ou, en cas de retard, à Fougères dans les huit jours suivant la réclamation (40). Ces deux textes – et leurs allusions aux dîmes – laissent penser qu’au moment où Robert de Vieuville fait son don, au milieu du XIIIe siècle, la paroisse du Châtellier est délimitée.
Il en va de même pour celle de Saint-Germain, plusieurs documents la citent à partir du milieu du XIIe siècle. Dès 1142, une bulle pancarte du pape Innocent II énumère l’église de Saint-Germain parmi les biens de l’abbaye Saint-Florent de Saumur, elle semble liée à celle de Saint-Brice-en-Coglès (41). Au cours de la décennie 1160, l’abbé de Saint-Florent et Hamelin Bérenger se mettent d’accord sur les revenus, obla-tions et dîmes liés à l’église de Saint-Germain (42), même si le différent s’éternise (43). Au milieu du XIIIe siècle, la paroisse apparaît comme un territoire de référence. Ainsi, en 1237, Clémence du Châtellier donne à Savigny la moitié du fief de Guillaume Pezein de la Merianeie, située dans la paroisse (in parrochia) de Saint-Germain (44) et, en 1258, Robert confirme le don de Guillaume de Vieuville d’une rente de 5 sous sur la haie de Joué située in parrochia de Saint-Germain-en-Coglès (45).
On constate donc que les deux paroisses du Châtellier et de Saint-Germain semblent posséder leur propre territoire paroissial. L’erreur de localisation ne s’explique pas, peut-être le scribe a-t-il confondu la paroisse d’origine de Robert de Vieuville avec celle où il a fait des dons ? Ou bien n’y a-t-il pas d’erreur... En effet, de plus en plus on s’aperçoit
85
que les limites paroissiales que l’on imaginait anciennes, parfois consti-tuées dès l’époque carolingienne, voire mérovingienne, ne seraient fixées que tardivement (46), soit au XIIe siècle pour les points de friction et au XIIIe siècle, voire plus tard pour les zones faiblement peuplées (47). La colline entre Le Châtellier et Saint-Germain-en-Coglès a pu changer de ressort paroissial entre le milieu du XIIIe siècle et la constitution des communes actuelles, en partie (mais en partie seulement) héritières des paroisses médiévales.
Si on recherche d’autres paroisses avec les mêmes caractéristiques toponymiques, on trouve seulement celle du Coglès où existe un lieu-dit Les Essarts, dominant Loisance, mais le texte précise bien que nous sommes dans le secteur du Châtellier (48). De plus, les seigneurs de cette paroisse ont fait de multiples dons à Savigny sur l’autre versant de Loisance, ainsi on retrouve aujourd’hui encore les toponymes de Le Joué ou La Mériennais qui rappellent les dons respectifs d’Henri du Châtellier et de Clémence (voir carte de localisation). La zone semble mise en valeur : prés, moulins, étangs.... Par générosité, les seigneurs
figure n° 3. Le lieu-dit L’Essart (Saint-Germain-en-Coglès) d’après le cadastre de 1833
86
en font profiter les nécessiteux. Enfin les rares documents évoquant les Vieuville les situent dans les communes du Châtellier et de Saint-Germain-en-Coglès, et on connaît quelques uns de leurs successeurs pour les XIV-XVIe siècles (49).
Comment expliquer l’erreur figurant sur la pochette des archives municipales, parlant d’une « redevance due à la chapelle du château de Fougères » ? Il est fort probable que Castellarum ait été pris pour castrum ou castellum, termes désignant le château, mais nous ignorons comment on a pu y lire une référence à la chapelle et à Fougères, les seules fois où le nom de la ville est évoqué c’est en relation avec la Maison Dieu.
La Maison Dieu : hôpital de la ville et du pays de Fougères
Robert de Vieuville fait donc un don à la Maison Dieu de Fougères, également connue sous le nom d’hôpital Saint-Nicolas (50). Ce saint est fréquemment invoqué pour aider les malheureux, particulièrement dans le milieu hospitalier (51). Henri Bourde de La Rogerie pensait qu’il exis-tait un lien avec les croisades (52), mais Saint-Nicolas est cité dès 1092, avant la première croisade (1096). Plus récemment Karlheinz Blaschke a avancé l’hypothèse selon laquelle « Saint-Nicolas peut être attribué aux habitats de marchands, lors de la phase initiale du développement urbain (53). » Ceci pourrait correspondre au cas de Fougères, mais on peut aussi tout simplement souligner que le culte de Nicolas devient très populaire au cours du XIe siècle, les marchands de Bari allant même, en 1087, jusqu’à voler ses reliques à Myre (actuelle Turquie) afin de capter une part de sa sainteté et attirer dans leur ville les pèlerins...
L’hôpital Saint-Nicolas se situe à l’extrémité du Bourg Neuf (54), face à Saint-Léonard, le long d’une rue, à l’endroit qui constituait alors l’une des entrées de Fougères. Situation idéale pour accueillir les pauvres, les malades et les pèlerins (55). Quelques rares documents permettent de se faire une idée des personnes qui ont pu y être hospitalisées.
Les livres des miracles sont l’une des seules sources qui évoque les différents types de maladies médiévales. Pour la région il existe deux recueils de miracles, l’un rédigé au Mont-Saint-Michel, l’autre à Savigny. Ces deux sanctuaires accueillent des personnes susceptibles d’être passées d’abord à l’hôpital, mais la médecine terrestre se révélant inefficace, elles se sont tournées vers la médecine céleste. Ainsi, en 1146, arrive au Mont-Saint-Michel « un homme de la région de Fougères, nommé André, qui était victime, non seulement dans son corps, mais également dans tous ses membres, d’une gêne et d’une difformité telles, que les doigts de ses
87
mains et les articulations de ses pieds étaient affreusement recroquevillés si bien qu’il ne pouvait plus du tout manier ni tenir quoi que ce soit (56). » Il se rend au Mont, s’appuyant sur deux bâtons, arrivé dans l’église, il s’écroule dans d’atroces cris de souffrance provoquant la terreur autour de lui. Il se confesse, ses articulations craquent, l’homme guérit et « rentre chez lui sain et sauf, louant Dieu et saint Michel. » Perclus de douleurs, en partie paralysé, André souffrait de la goutte arthritique (57). Venant de la région de Fougères, il a pu espéré être soigné à l’hôpital Saint-Nicolas, mais ce dernier n’est pas attesté à la date de 1146. Pour revenir à la mala-die d’André, Pierre-André Sigal souligne que les paralysies apparaissent très fréquemment dans les livres de Miracles, preuve que les hôpitaux ne parviennent pas vraiment à guérir ce type de souffrance. Saint-Nicolas, s’il était fondé, a aussi pu accueillir André comme simple pèlerin se rendant au Mont, ses douleurs l’empêchait de se déplacer normalement, le trajet a dû être long et pénible, fait d’haltes dans des établissements d’accueil, comme les différentes maladreries que l’on peut retrouver dans la toponymie en Poilley, au Ferré puis en Saint-James (58).
De son côté, Savigny a fourni quantité de miracles, près de 385 (59), dont une petite vingtaine concerne au milieu du XIIIe siècle la région de Fougères. Ce livre des Miracles a été rédigé vers 1244 et sur les 17 faits se rapportant à la région fougeraise, on trouve sept femmes et dix hommes (60), les âges sont rarement mentionnés (61), à l’exception de la fille de Nicolas du Ferré, âgé d’à peu près 4 ans. Toutes les caté-gories sociales sont concernées depuis l’écuyer insolent au charpentier malchanceux, en passant par la noble dame (62). La présentation qui suit tend à montrer quelles pouvaient être les raisons (63) qui condui-saient à l’hôpital. Il y a tout d’abord les accidentés, comme Henri de la Crèche, fils de Gautier, charpentier (faber lignarius), il construisait une maison dans le bourg de La Bazouges-du-Désert pour Jean de la Bazouges. Cette maison avait été élevée par une grande part des hommes de la villa. Pour faire la toiture, Hervé monta en haut de l’échelle, quand il s’apprêta à poser le pied sur le sommet du bâtiment, celui-ci s’écroula et Hervé chuta lourdement sur le visage. Tous craignirent pour sa vie, il fut transporté comme mort (64). Le texte publié s’arrête là, mais il y a fort à parier que les saints de Savigny lui ont porté secours. Viennent ensuite ceux qui tombent subitement malades, comme Eremburgis de La Bazouges-du-Désert, fille de Michel Gilles, l’hagiographe rentre alors rarement dans les détails (65). Suit la cohorte de ceux qui souffrent de fortes fièvres, Mathilde, veuve de Pierre Rouaut, s’était même confes-sée et avait reçu le viatique des mains d’un des Frères Mineurs. Son
88
fils Hasculf Rouaut, miles, avait prié les saints, qui la ramenèrent à la vie (66). La fille de Nicolas du Ferré, âgée d’à peu près quatre ans, souf-frit pendant quinze jours d’une très forte fièvre et d’une dysenterie, la faute à un manque d’hygiène probablement (67). Son père la conduisit de préférence auprès des saints plutôt que des médecins (68). Le meunier de Louvigné-du-Désert souffrait quant à lui de paludisme, le lieu de son activité explique très probablement son cas, les moulins sont très souvent accompagnés d’un étang (69). On retrouve des problèmes de goutte arth-ritique pour Ermengarde Tison, de Saint-Marc-sur-Couesnon, qui depuis 15 ans souffrait d’une paralysie des articulations, des reins, des jambes et des pieds (70). Enfin, plus anecdotique, mais qui montre la confiance toute relative que les gens de l’époque avaient pour le milieu hospita-lier, Isabelle, domina de Fougères, avait une arête de poisson coincée en travers de la gorge, il faut l’intervention des saints de Savigny pour la sauver (71).
À côté de ces malades qui ont été déçus par la Maison Dieu de Fougères ou qui ont préféré l’éviter, Saint-Nicolas a aussi dû accueillir des pèlerins. Les Miracles des saints de Savigny montrent à plusieurs reprises des habitants du pays de Vitré qui se rendent sur le tombeau de saint Vital, gageons qu’ils ont fait une halte à Fougères (72).
Pour revenir à l’hôpital, on peut rappeler que Saint-Nicolas appa-raît pour la première fois dans la documentation en tant qu’église en 1092 (73). Mais en 1143, elle semble rétrogradée au rang de simple chapelle (74), puis un siècle plus tard, en 1243, il est question d’une aumônerie (75). Un texte de la même époque souligne que l’aumônerie accueillait des pauvres et était desservie par des clercs (76), l’abbaye de Pontlevoy intervint pour sortir l’établissement de ses difficultés car le document souligne que l’aumônerie avait été détruite au temps des guerres et que les seigneurs de Fougères s’étaient engagés à la recons-truire (77), mais n’avaient pas respecté leur engagement. De quand datent ces destructions ? On pense d’abord aux célèbres épisodes des années 1166-1173 (78), mais il serait étonnant que Fougères n’ait pas eu d’hôpital ou de lieu d’assistance entre ces années troublées et le milieu du XIIIe siècle. Guillaume le Breton évoque très brièvement la prise de Fougères au début de l’année 1203 (79), peut-être y a-t-il eu des destruc-tions à ce moment-là ?
L’hôpital, qui accueille pauvres, malades, vieux et pèlerins, doit être en partie reconstruit au milieu du XIIIe siècle. Pontlevoy prend l’initiative à partir de 1243, et Robert de Vieuville – comme d’autres probablement,
89
mais nous avons perdu la trace de leur intervention – soutient cette (re-)fondation. Le bâtiment changea alors de nom, d’aumônerie il devint Maison Dieu et on note que dès le milieu du XIIIe siècle les bourgeois ont pris en charge sa gestion et sa direction.
Quelques documents du XIXe siècle, une lithographie du début du siècle et des photographies des années 1860, nous montrent la chapelle de l’hôpital (voir annexes (80)). Si Léon Maupillé (81) puis Christian Le Bouteiller (82) affirmaient que la façade remontait en partie au XIIe siècle et se rattachait donc à l’art roman, à la lecture des documents nous pen-sons que l’hôpital Saint-Nicolas date plutôt du milieu du XIIIe siècle. Certes la partie inférieure de la chapelle ressemble à l’art roman, mais la baie de la partie supérieure correspond au gothique qui se diffuse alors. Il n’est pas impossible, non plus, que les destructions n’aient été que partielles ou bien qu’au cours des années 1240, on ait décidé d’ajouter un étage à Saint-Nicolas. Ces images, peu nombreuses, montrent l’hôpital et plus particulièrement sa chapelle, cette dernière tenait d’ailleurs un rôle important car les personnes accueillies au sein de la Maison Dieu se devaient de « suivre le culte chrétien (83) », mais aussi de prier pour les fondateurs et les donateurs.
À l’origine, le fondateur devait être un seigneur de Fougères, on ignore quand fut édifié ce premier hôpital. L’historiographie locale donne le beau rôle à Raoul II (84), ce n’est pas impossible, d’autant plus que la grande période d’édification des hôtels-Dieu correspond aux XIIe et XIIIe siècles (85) et est due généralement à des initiatives seigneuriales, du moins au Nord de la France. Mais on peut aussi penser à Henri qui a eu la volonté de fonder l’abbaye Saint-Pierre de Rillé. D’autres villes de Haute-Bretagne ont eu des hôpitaux un peu plus tôt, le plus ancien (86)est celui de Dinan, dont l’existence remonte à la fin du XIe siècle (87), suivent ceux de Redon (88) cité en 1133 ou bien celui de Vitré au tour-nant de 1200 (89). On est alors en plein dans la « floraison » hospitalière selon le mot de Michel Mollat (90). L’hôpital de Vitré est qualifié de Maison Dieu (91) dès 1210, à Fougères il faut attendre sa reconstruction au milieu du XIIIe siècle. Mais si les seigneurs ont donné l’élan fondateur, le relai est pris par les moines de Pontlevoy, puis les petits seigneurs et les bourgeois de Fougères.
À partir de 1259, seigneurs et moines semblent moins présents, on rappellera qu’alors le seigneur de Fougères était Hugues XII de Lusignan (92), la seigneurie de son beau-père, Raoul III, ne formait qu’une partie de ses nombreux domaines. Face à l’absence d’initiative
90
seigneuriale, les bourgeois prennent la direction de l’hôpital. Avec un léger retard, on retrouve à Fougères ce qui a pu être observé ailleurs. Certaines études montrent que dès le XIIe siècle, l’élite urbaine prend en main la gestion des aumôneries et des léproseries (93) ; à Fougères le mouvement est plus tardif, mais en ce milieu du XIIIe siècle, on trouve Pierre Hoyte, bourgeois de Fougères, comme administrateur, c’est-à-dire une sorte de gestionnaire de l’hôpital, devant probablement rendre des comptes aux fondateurs de la Maison Dieu.
Les bourgeois de Fougères au chevet de l’hôpital ?
À l’origine, les bourgeois sont les habitants des bourgs, plus ou moins des quartiers, fondés les uns après les autres, possédant des statuts dif-férents et appartenant à des seigneurs différents. Fougères possède au moins cinq bourgs (94), chronologiquement le plus ancien – probablement contemporain de l’installation des seigneurs, vers 1040 – doit être celui du Bourg Vieil, actuelle rue de la Pinterie, cité seulement en 1163 (95). À peu près au même moment se développent le Bourg Chevrel (96) et celui du Marchix (97), qui peinent à croître dans le méandre (98) du Nançon au pied du château. À la fin du XIe siècle, apparaît le Bourg Neuf (99), actuelle rue Nationale. Ce dernier et le Bourg Vieil appartiennent au seigneur de Fougères, tandis que ceux du Marchix et Chevrel relèvent du prieuré de la Sainte-Trinité, dépendance de l’abbaye tourangelle de Marmoutier. Enfin au cours de la première moitié du XIIe siècle, mais la documentation fait alors défaut, l’abbaye de Pontlevoy fonde le bourg de Rillé qu’elle donne aux chanoines de Sainte-Marie quand ils décident de fonder l’abbaye Saint-Pierre de Rillé (100).
Quant aux bourgeois – au XIe siècle le mot désigne seulement les habitants des bourgs, le mot (101) n’a pas encore sa connotation actuelle –, ils apparaissent très peu au XIIe siècle. Le premier, Guillaume, est un simple témoin vers 1110-1120 (102), mais c’est le premier bourgeois à apparaître individuellement, auparavant les textes parlaient plus volon-tiers des bourgeois de manière colllective. Le fait que Guillaume soit cité seul montre probablement une certaine ascension sociale. Si Pierre de Bolande est qualifié de bourgeois de Fougères en 1260 (103), la mention de Pierre Hoyte, dans la donation de Robert de Vieuville (1259), qui l’intitule bourgeois de Fougères, en ferait le premier à porter un tel qua-lificatif (104). Le changement a son importance, car aux XIe-XIIe siècles on est bourgeois de tel ou tel bourg, puis s’amorce une évolution au cours du XIIIe siècle, on peut alors se dire bourgeois de Fougères. La ville n’est plus un assemblage de bourgs mais bel et bien un ensemble urbain,
91
du moins c’est ainsi que le vivent ses habitants, d’ailleurs Fougères est qualifiée de ville en 1200 (105).
Ces bourgeois prennent donc progressivement en main l’hôpital dès le milieu du XIIe siècle et un long texte les présente en train de défendre leurs prérogatives face à Marie d’Espagne, agissant au nom de son fils, mineur, Charles, comte d’Alençon et seigneur de Fougères, à propos du patronage de la Maison Dieu et de la léproserie. Sont réunis plus de 150 bourgeois, qui constituent « la plus grant et la plus saine partie des bourgeois et habitans de la dite ville de Fougières » ; ils s’entendent avec Marie d’Espagne pour nommer à tour de rôle le responsable de la Maison Dieu qui doit être un habitant de la ville, car « telle personne née du dit lieu devra miex amer que un estranger le profit du lieu (106) ». Comme dans d’autres régions, mais avec un peu de retard, les bourgeois de Fougères, des laïcs, gèrent l’administration hospitalière (107).
Conclusion
Cette petite étude a permis, nous l’espérons, de faire connaître le plus ancien document conservé aux archives municipales de Fougères et aussi de corriger l’erreur figurant sur la pochette le protégeant. Le vidimus date de 1308 et il copie un document plus ancien de 1259 où Robert de Vieuville, seigneur du Châtellier, et descendant du lignage du même nom, donne à la Maison Dieu de Fougères alors en reconstruction, un champ et une rente dans une partie de la paroisse de Saint-Germain-en-Coglès qui est alors mise en valeur depuis au moins un demi-siècle.
Enfin, reste à s’interroger sur la raison qui a motivé la rédaction de ce vidimus. Il est fréquent que l’on réécrive des actes importants lors d’un changement de seigneur. Nous avons vu qu’en 1347, plus de 150 bourgeois se manifestent auprès de Charles, comte d’Alençon, car il vient d’hériter de la ville de Fougères (108). En 1308, on se trouve dans le même cas de figure, puisque la seigneurie passe à Yolande de Lusignan (109), Guillaume Radier, prêtre de la Maison Dieu, tient à ce que les droits de l’établissement dont il est chargé soient respectés et pour cela il fait rédiger un vidimus.
92
figure n° 4. La chapelle de l’hôpital Saint-Nicolas. Photographie des années 1865-1867 (coll. L. Tual). Les arcs en plein cintre du rez-de-chaussée laissent imaginer que cet étage est d’époque romane (XIIe siècle ?), par contre l’étage supérieur, avec la baie, fait davantage référence au gothique. Cette photographie suggère au moins deux temps dans la réalisation des travaux. Puisque le premier niveau est constitué de pierres taillées, alors qu’au dessus on distingue un appareil de pierres plus modeste (seconde moitié du XIIIe – première moitié du XIVe siècle).
figure n° 5. La Chapelle de l’hôpital Saint-Nicolas. Photographie des années 1865-1867 (coll. L. Tual). Sur cette photographie, au premier niveau, la porte avec son arc en plein cintre (roman tardif), est entourée sur chaque côté de deux arcatures murées romanes. Les deux baies les plus proches de la porte sont géminées et plus larges que celles qui sont à l’extérieur. Au-dessus le fronton triangulaire, une fenêtre ogivale (XIVe siècle), divisée en trois ogives.
93
figure n° 6. La Chapelle de l’hôpital Saint-Nicolas. Photographie des années 1865-1867 (coll. L. Tual).L’édifice est ici particulièrement en mauvais état. Il pourrait ici s’agir de la grande arcade ogivale, décrite par Guillotin de Corson (Pouillé, t. III, p. 283), qui devait faire communiquer la chapelle avec un cloître, dont on devine quelques arcs sur la figure n° 4.
figure n° 7. L’église Saint-Léonard et la chapelle Saint-Nicolas, gravure de la pre-mière moitié du XIXe siècle (coll. P. Bachelier). Bien que plus anciennes, la chapelle Saint-Nicolas fait ici pâle figure face à la masse de l’église Saint-Léonard. On devine sur cette gravure les éléments romans et gothiques des photographies précédentes.
94
Notes
(1) Dans le cadre de nos recherches, nous avons privilégiés les aspects socio-économiques.(2) On retrouve ici un type de formule inspiré du royaume de France, on peut ici rappeler que la seigneurie de Fougères n’est plus tenue par un membre issu de la lignée originelle. Mais elle relève de la famille de Lusignan, une grande famille de l’Occident médiéval. Voir LE BOUTEILLER Christian, Notes sur l’histoire de la ville et du pays de Fougères, rééd. Culture et Civilisation, Bruxelles, 1976, 4 tomes, pour l’histoire de la ville au XIIIe siècle voir les volumes 2 et 3.(3) Mesure de terre, approximativement un quart d’hectare, soit dans le cas présent l’équivalent d’un hectare.(4) Allusion à une ancienne vente du champ par Tuallort et son épouse à Robert de Vieuville.(5) Le 8 septembre.(6) Probablement à comprendre comme une bougie.(7) Traditionnellement la date retenue était 1302, mais à la lecture du document nous optons pour 1308.(8) MAUPILLÉ Léon, « Notices historiques et archéologiques sur les paroisses du canton de Saint-Brice », dans Bulletin et Mémoires de la Société Archéo-logique d’Ille-et-Vilaine, 1879, t. 13, p. 221-318, ici p. 261-262.(9) LE BOUTEILLER Christian, Notes sur l’histoire de la ville et du pays de Fougères, op. cit., t. 3, p. 19 et p. 30.(10) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F553 (fonds La Borderie, copies d’actes de l’abbaye de Savigny concernant le pays de Fougères ou don-nées par les seigneurs de Fougères).(11) Mais il existe de vieux écuyers... Les deux dons que faits Robert de Vieu-ville peuvent aussi s’envisager comme le souci d’un homme vieillissant qui s’inquiète pour son salut et multiplie donc les intercesseurs. Toutefois on optera pour un jeune homme, car, comme le souligne Florian Mazel, lors d’un change-ment de seigneur, le nouveau cherche à renouer les liens avec les établissements privilégiés de la famille, voir : MAZEL Florian, La noblesse et l’Église en Pro-vence, fin Xe – début XIVe siècle. L’exemple des familles d’Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, CTHS, 2008 (1e éd. 2002), part. p. 367.(12) LE BLÉVEC Daniel, La part du pauvre. L’assistance dans les pays du Bas-Rhône du XII e siècle au milieu du XV e siècle, Paris, École française de Rome, Collection de l’École Française de Rome, n° 265, 2 vol., 2000, p. 65-66.(13) BRAND’HONNEUR Michel, Manoirs et châteaux dans le comté de Rennes. Habitat à motte et société chevaleresque (XI e–XII e siècles), Rennes, PUR, 2001, p. 283.(14) Cartulaire du Mont-Saint-Michel. Fac-similé du manuscrit 210 de la Biblio-thèque municipale d’Avranches, éd. par Les Amis du Mont-Saint-Michel, 2005, fol. 58 v° - 60 r°.(15) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F558 (fonds La Borderie, copies d’actes du prieuré de Marmoutier à Igné, près de Fougères).
95
(16) « Actes de l’abbaye de Marmoutier concernant le prieuré de la Trinité de Fougères, XIe-XIIe siècles : édition et traduction », éd. par MAZEL Florian et LE HUËROU Armelle, dans Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, t. 103, n° 3, 2006, p. 137-165, ici p. 144-148.(17) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 6H16 (original).(18) Bozardus de Castellerio dans MOOLENBROEK Jaap (van), Vital l’Ermite, prédicateur itinérant fondateur de l’abbaye normande de Savigny, numéro spé-cial de la Revue de l’Avranchin et du pays de Granville, t. 68, mars 1991, actes n° 2, 3, 11, 12.(19) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F553 (fonds La Borderie, copies d’actes de l’abbaye de Savigny concernant le pays de Fougères ou don-nées par les seigneurs de Fougères).(20) BACHELIER Julien, « Fougères brûle-t-elle ? Les années 1166-1173 et les sources », dans Le Pays de Fougères, juin 2007, n° 145, p. 4-8.(21) Roger de HODEVEN (ou HOWDEN), Chronica, dans Rerum Britannica-rum medii aevi scriptores, or Chronicles and memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages, éd. par W. Stubbs, Londres, Longmans, Green and Co, 1869, vol. 2, p. 51-53, ici p. 52.(22) Cartulaire du Mont-Saint-Michel..., op. cit., fol. 125v°-126r°.(23) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F553 (fonds La Borderie, copies d’actes de l’abbaye de Savigny concernant le pays de Fougères ou don-nées par les seigneurs de Fougères).(24) ibid.(25) ibid. (26) ibid. (27) ibid.(28) ibid. : super omnibus terris et possessionibus quas villani et agricole homines seu etiam censarii hodie tenent de me in tota terra Filgeriarum (...) manerio meo de Chasteler.(29) Sur la désignation des chevaliers au Moyen Âge en Haute-Bretagne, voire : BRAND’HONNEUR Michel, Manoirs et châteaux dans le comté de Rennes..., op. cit., p. 160-168, part. p. 165-166, où l’auteur souligne que « la stabilisation du nom de lieu est dans l’ensemble assez tardive. »(30) BANÉAT Paul, Le département d’Ille-et-Vilaine. Histoire-Archéologie-Monuments, Paris, 1973, (1e éd. 1927), 4 tomes, ici t. 1, p. 380-381.(31) Voir les remarques de SAINT-DENIS Alain, « Hôtel-Dieu et Société, XIIe-XIIIe siècle », dans Bulletin du Centre d’Histoire économique et sociale de la région Lyonnaise, Lyon, n° 3-4, 1986, p. 21-41, p. 26.(32) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F927, 44 (fonds La Borderie, copies d’actes de l’hôpital Saint-Nicolas de Vitré).(33) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F927, 10 (fonds La Borderie, copies d’actes de l’hôpital Saint-Nicolas de Vitré).(34) Voir pour un exemple local la famille Pinel en Saint-Sauveur-des-Landes dans BACHELIER Julien, « Saint-Sauveur-des-Landes. Histoire, habitats et
96
société aux Xe-XIVe siècles », dans Bulletin et Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Fougères, t. 47, 2009.(35) VINCENT Catherine, Fiat Lux. Lumière et luminaires dans la vie religieuse du XIII e siècle au début du XVI e siècle, Paris, Cerf, 2004, part. chap. IX.(36) SAUNIER Annie, « Le pauvre malade » dans le cadre hospitalier médiéval. France du Nord, vers 1300-1500, éd. Arguments, 1993, p. 40-41.(37) Les débuts du XIIe siècle demeurent mal connus faute de documents, voir l’étude détaillée de MAZEL F., « Seigneurs, moines et chanoines : pou-voir local et enjeux ecclésiaux à Fougères à l’époque grégorienne (milieu du XIe – milieu du XIIe siècle) », dans Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, t. 113, 2006, n° 3, p. 105-135. Les desservants de la petite chapelle Sainte-Marie du château deviennent les chanoines de l’abbaye Saint-Pierre de Rillé au milieu du XIIe siècle, voir pour une brève présentation : BACHELIER Julien, « L’abbaye de Rillé. La fondation de l’abbaye Saint-Pierre de Rillé en 1143 », dans GALLAIS Jean-Paul (dir.), Élévation. Patrimoine des hauteurs. Pays de Fougères et de Vitré, 2009, p. 27-31, particulièrement p. 27-28.(38) Le cartulaire de la seigneurie de la Fougères connu sous le nom de cartu-laire d’Alençon, éd. par AUBERGÉ Jacques, Rennes, Oberthur, 1913, acte n° 14.(39) super tractu, paleis et straminibus decimarum eosdem abbatem et conven-tum in parrochia Castellarii dans Cartulaire de Saint-Melaine, acte n° 291. Nous remercions Monique Chauvin et Chantal Reydellet de nous avoir cédé une copie de l’édition du cartulaire qu’elles préparent. La saint Luc Évangéliste a lieu le 18 octobre.(40) Cartulaire de Saint-Melaine, acte n° 129.(41) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F516 (copies d’actes de l’ab-baye de Saint-Florent de Saumur).(42) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F519 (copies d’actes de l’ab-baye Saint-Florent de Saumur, prieurés bretons).(43) ibid.(44) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F553 (copies d’actes de l’ab-baye de Savigny concernant le pays de Fougères ou données par les seigneurs de Fougères)(45) ibid. (46) PICHOT Daniel, « Paroisses, limites et territoire villageois de l’Ouest (XIe – XIIIe siècle) », dans Mélanges en l’honneur de Monique Bourin, 2010. Nous remercions D. Pichot de nous avoir donné lecture de son article avant sa parution.(47) LUNVEN Anne, « Les actes de délimitation paroissiale dans les diocèses de Rennes, Dol et Saint-Malo (XIe – XIIIe siècle) », dans Le rôle des fron-tières dans la formation des territoires médiévaux, Actes des journées d’étude de Nantes, Paris et Poitiers 2009-2010, Pagès, Lleida, à paraître. Nous remercions A. Lunven de nous avoir donné lecture de son article avant sa parution.(48) Il n’existe qu’une dizaine de toponymes ayant la forme Essart ou Lessart en Ille-et-Vilaine.(49) MAUPILLÉ Léon, « Notices historiques et archéologiques sur les paroisses du canton de Saint-Brice », art. cit. p. 262-264.
97
(50) Les lignes qui suivent reprennent en partie BACHELIER Julien, « À l’ombre des clochers. Naissance et développement des églises et paroisses de Fougères du XIe au XIIIe siècle », dans Bulletin et Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Fougères, t. 44, 2006, p. 5-75, ici p. 25 et suiv. Sur l’hôpital jusqu’à sa destruction en 1865, on pourra consulter : DUVINAGE A., « La Maison-Dieu Saint-Nicolas », dans Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de l’arrondissement de Fougères, t. 33, 1995, p. 65-78.(51) DUVAL Michel, « En Bretagne : recherches sur la formation des paroisses entre l’Ille et la Vilaine. XIe-XVIe siècles », dans L’encadrement des fidèles au Moyen Âge et jusqu’au concile de Trente, Paris, actes du 109e congrès national des sociétés savantes, 1984. On peut néanmoins nuancer ce point de vue à la lec-ture de Daniel Le Blévec qui montre pour le Midi de la France que saint Nicolas n’est pas aussi fréquent que certains l’avaient avancé, voir LE BLÉVEC Daniel, La part du pauvre..., op. cit., p. 806-807.(52) BOURDE DE LA ROGERIE Henri, « Les fondations de villes et de bourgs en Bretagne du XIe au XIIIe siècle », dans Bulletins et Mémoires de la Société Historique et Archéologique de Bretagne (MSHAB), t. 9, 1928, p. 69-106, p. 76, note 9.(53) BLASCHKE Karlheinz, « La naissance des villes médiévales en Europe, au nord des Alpes : nouveaux résultats et méthodes de recherche », dans Mondes de l’ouest et villes du monde. Regards sur les sociétés médiévales. Mélanges en l’honneur d’André Chédeville, Rennes, PUR et SHAB, 1998, p. 671-681.(54) ecclesiam sancti Nicolai sitam in capite burgi dans « Documents inédits sur l’histoire de Bretagne. Charte du prieuré de la Sainte-Trinité de Fougères », éd. par LA BORDERIE Arthur (de), dans Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique d’Ille-et-Vilaine, t. 2, 1863, p. 150-234, ici p. 191-192.(55) LE BLÉVEC Daniel, « Problèmes de topographie hospitalière dans le Midi de la France », dans TOUATI François-Olivier (dir.), Archéologie et architec-ture hospitalières de l’Antiquité tardive à l’aube des temps modernes, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2004, p. 295-303.(56) ex Fulgeriensi pago quidam homo, nomine Andreas, subito in istam introivit ecclesiam, tanta non solum corporis sed et membrorum omnium mul-tatus incommoditate et deformitate ut intus horrifice retortis manuum digitis pedumque articulis adeo ut aliquid adtrectare vel tenere nullatenus posset dans BOUET Pierre et DESBORDES Olivier, Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IX e-XII e siècle), Manuscrits d’Avranches – Textes fondateurs du Mont Saint-Michel – I, Presses Universitaires de Caen, Caen, p. 149-200 (traduction des auteurs.(57) SIGAL Pierre-André, « Comment on concevait et on traitait la paralysie en Occident dans le Haut Moyen Âge », dans Revue d’histoire des Sciences, 1971, n° 24-3, p. 193-211, part. p. 200.(58) La distance entre Fougères et le Mont dépasse légèrement les 50 km. De la Maison Dieu de Fougères à Poilley, il y a une quinzaine de kilomètres, entre Poilley et Le Ferré, à peine 4 km, on retrouve la même distance entre
98
Le Ferré et Saint-James. Puis la dernière étape, entre Saint-James et le Mont couvre plus de 20 km.(59) SAUVAGE Hippolyte, Le Livre des Miracles des saints de Savigny, Leroy, Mortain, 1899, à compléter par des extraits publiés dans Liber de Miraculis Sanctorum Savigniacensium dans Recueil des Historiens des Gaules et de la France, publ. par de Wailly, Delisles et Jourdain, 1894, t. 23, p. 587-605. Pour une rapide analyse de ce Livre des Miracles, voir BACHELIER Julien, « Miracles et miraculés au milieu du XIIIe siècle d’après le Livre des Saints de l’abbaye de Savigny », dans Revue de l’Avranchin et du pays de Granville, à paraître (premier trimestre 2011).(60) Sur l’ensemble des 385 miracles, il est fait mention de 89 femmes, soit 24 %, mais le texte compte de nombreuses lacunes.(61) On note que les enfants sont concernés par près du quart des interventions divines, 43 enfants âgés de un an à 22 et 49 « fils de... » ou « fille de... ». Soit près de 92 mentions.(62) Le Livre des Miracles présentent quelques lacunes, la condition sociale apparaît dans une cinquantaine de mentions : dix religieux (quatre moines, un convers, un abbé, cinq clercs, mais un seul parmi eux est diacre, deux prêtres et un prieur), 22 membres de la noblesse (homme ou femme et à divers degrés de la chevalerie, depuis l’armiger au miles), sept bourgeois (quatre cives et trois burgenses), cinq mentions d’activité professionnelle (un marchand, trois arti-sans et deux famuli) et un seul paysan clairement attesté (rusticus) alors que les miracles devaient les concerner au premier chef.(63) On ne peut ici rentrer dans le détail des données et des analyses, mais le Livre des Miracles de Savigny montre des exemples de dysenteries, Mal des Ardents (ignis sacer), eczéma et érysipèle (feu de saint Laurent), tuberculose, mal de saint Éloi, mal caduc (épilepsie), différentes paralysies (arthritique, scia-tique...), paludisme. À côté de ces maladies, il y a les accidents, des pertes des sens (parole et vue surtout), chutes et noyades. Enfin des cas plus anecdotiques, comme ce blasphémateur qui refuse de croire au miracle et dont le fils tombe malade ou cette femme qui se fait dérober toutes ses richesses (pierres pré-cieuses, argent...).(64) Liber de Miraculis Sanctorum Savigniacensium..., op. cit., p. 592.(65) Liber de Miraculis Sanctorum Savigniacensium..., op. cit., p. 593.(66) Liber de Miraculis Sanctorum Savigniacensium..., op. cit., p. 598.(67) Liber de Miraculis Sanctorum Savigniacensium..., op. cit., p. 597.(68) Il n’existe pas d’exemples pour le pays de Fougères, mais sur les 385 miracles de Savigny, quatre évoquent clairement l’intervention – forcément – inefficace de médecins, et un cas montre qu’une mère, noble, préfère confier son fils aux soins des saints plutôt qu’à la médecine terrestre.(69) febre quartana dans Liber de Miraculis Sanctorum Savigniacensium..., op. cit., p. 595.(70) Liber de Miraculis Sanctorum Savigniacensium..., op. cit., p. 594. (71) Liber de Miraculis Sanctorum Savigniacensium..., op. cit., p. 605.(72) Liber de Miraculis Sanctorum Savigniacensium..., op. cit., p. 596
99
(73) Voir note plus haut.(74) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F558 (fonds La Borderie, copies d’actes du prieuré de Marmoutier à Igné, près de Fougères).(75) Le cartulaire de la seigneurie de la Fougères..., op. cit., n° 9, le texte parle d’eleemosinaria et plus loin domus.(76) Ecclesia Sancti Leonardi de Filgeriarum, cujus jus patronatus habuimus ab antiquo, elemosinarie Filgerarium ad majorem sustentionem pauperum et clericorum ibi Deo desservientium uniatur dans Le cartulaire de la seigneurie de la Fougères..., op. cit., n° 4, p. 83-85.(77) quod eadem domus guerrarum tempore fuerat omnio destructa ipsamque dicti domini reparaturos sepe sponderent dans Le cartulaire de la seigneurie de la Fougères..., n° 4, p. 83-85.(78) BACHELIER Julien, « Fougères brûle-t-elle ?... », art. cit. et id. « Réseau vassalique et réseau de peuplement : une même géographie féodale ? L’exemple du Fougerais (v. 1160-1180) ». On peut ici rapidement souligner que les tensions entre les rois d’Angleterre et ceux de France ont été l’occasion de passages, notamment dans la région de Fougères, de troupes de chevaliers, soldats et mer-cenaires entre les années 1160 et les années 1200. (79) Guillaume le BRETON, Vie de Philippe Auguste, dans Collection de mémoires relatifs à l’histoire de France, Vie de Philippe Auguste par Rigord. Vie de Philippe Auguste par Guillaume le Breton. Vie de Louis VIII…, publ. par Guizot, Paris, J.-L.-J. Brières, 1825, vol. 11, p. 226.(80) M. de La Garenne a aussi fourni un dessin de la cheminée de cet hôpital, publié par CAUMONT Arcisse (de), Abécédaire ou rudiments d’archéologie, Paris, Derache, Didron et Dentu, Caen, Hardel et Rouen, Le Brument, 1853 (ici : 1859, 3e éd.), p. 39, l’auteur la date du XIIe siècle.(81) MAUPILLÉ Léon et BERTIN A.médée Notice historique et statistiques de la ville de Fougères, Bruxelles, éd. Cultures et civilisations, 1978 (rééd.), p. 161.(82) LE BOUTEILLER Christian, Notes sur l’histoire de la ville et du pays de Fougères, op. cit., t. 2, p. 271.(83) SAUNIER Annie, « Le pauvre malade »..., op. cit., p. 96.(84) BACHELIER Julien, « Raoul II fut-il un grand seigneur ? », dans Le Pays de Fougères, novembre 2007, n° 146, p. 3-7 et janvier 2008, n° 147, p. 3-7.(85) SAUNIER Annie, « Le pauvre malade »..., op. cit., p. 4.(86) Pour la période qui nous concerne ici, les XIe –XIIIe siècles ; car il a pu exister des lieux d’assistance (xenodochium) au cours du haut Moyen Âge. Un xenodochium est un hôpital, une maison d’accueil pour les étrangers, les pèle-rins, les pauvres, les malades, ayant le statut d’un établissement religieux et placé sous le contrôle de l’évêque. Ainsi, la Vie ancienne de saint Judicaël, roi de Domnonée, nous montre l’évêque d’Alet, Maëlmon (vers 650), fonder le monas-tère de Lan-Maëlmon, et il y aurait aussi adjoint un lieu d’assistante à Talredau, « qui in Talredau apud xenodochium Maelmonis. », Texte dans : GUILLOTIN DE CORSON Amédée, Pouillé historique de l’archevêché de Rennes, Paris-Rennes, 1880-1884, 6 tomes, citation : t. 3, p. 353. Sur la localisation du lieu, voir TANGUY Bernard, « Les pagi médiévaux », dans Société archéologique
100
du Finistère, t. 130, 2001, p. 371-396, ici p. 386, le xenodochium de Mael-mon ou Lanmaelmon correspondrait à Saint-M’Hervon, et non Saint-Malon, le texte parle de pèlerins qui se rendent à Rome, en passant par Avranches. Une autre vita évoque des xenodochia, mais sans précision, celle de saint Méen, où saint Judicaël, qui aurait vécu dans la première moitié du VIIe siècle, joue un rôle important dans la reconstruction et la dotation des monastères en Bretagne : « Multaque monasteria et xenodochia, auxiliante Domino, in Britannia Minore patria sua construere mandavit et dirupta antiquis temporibus in pristinum et meliorum statum reedificare jussit. » Voir vita de saint Méen, éd. POULAIN C., Vie de saint Méen, abbé et confesseur : Ms. B.N. Lat. 9889 « Obituaire de saint Méen », mémoire de maîtrise, Rennes-II, 1995, p. 22-23.(87) GESLIN de BOURGOGNE Jules-Henri et BARTHÉLEMY Anatole (de), Anciens Évêchés de Bretagne. Histoire et Monuments, Paris – Saint-Brieuc, 1855-1879, notamment t. IV, diocèse de Saint-Brieuc, p. 398, n° 10, acte de 1124 qui évoque une maison hôpital dans le cimetière de Dinan, donnée par Cana, épouse d’Olivier de Dinan.(88) Cartulaire de l’abbaye de Redon en Bretagne, éd. par de COURSON Aurélien, Paris, 1863, Collection de documents inédits sur l’Histoire de France, appendix, acte n° 74.(89) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F927, 1 et 3 (fonds La Borde-rie, copies d’actes de l’hôpital Saint-Nicolas de Vitré).(90) MOLLAT Michel, « Floraison des fondations hospitalières, XIIe–XIIIe siècles », dans IMBERT J. (dir.), Histoire des hôpitaux en France, Privat, Toulouse, 1982, p. 32-66.(91) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F927, 15 (fonds La Borderie, copies d’actes de l’hôpital Saint-Nicolas de Vitré).(92) LE BOUTEILLER Christian, Notes sur l’histoire de la ville et du pays de Fougères..., op. cit., t. 3, p. 7 et suiv.(93) BARTHÉLEMY Dominique, La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au XIV e siècle, Fayard, 1993, p. 768-769.(94) BACHELIER Julien, « Des bourgs à la ville. Esquisse de Fougères du XIe au XIIIe siècle », dans Le Pays de Fougères, n° 141, juin 2006, p. 3-8 et n° 142, octobre 2006, p. 3-8.(95) MORICE Pierre-Hyacinthe (dom), Mémoires pour servir de preuves à l’his-toire civile et ecclésiastique de Bretagne tirés des archives de cette province, de celles de France et d’Angleterre, des recueils de plusieurs scavants antiquaires, éd. par dom MORICE, Paris, 1742-1746, 3 tomes, col. 650-653.(96) « Documents inédits sur l’histoire de Bretagne. Charte du prieuré de la Sainte-Trinité de Fougères », éd. par LA BORDERIE Arthur (de), art. cit., p. 194-195(97) ibid., p. 186-187.(98) Le mot Chevrel renverrait à une volonté de mise en valeur, d’assèchement des marécages qui ceinturent le château. Marchix signifie clairement marais. Les moines de Marmoutier n’ont pas reçu les plus belles terres...
101
(99) Il ne porte pas encore ce nom mais c’est de lui dont il est question dans « Documents inédits sur l’histoire de Bretagne. Charte du prieuré de la Sainte-Trinité de Fougères », éd. par LA BORDERIE Arthur (de), art. cit., p. 191-192.(100) Texte publié dans MORICE Pierre-Hyacinthe (dom), Mémoires pour servir de preuves..., op. cit., col. 606-607, traduit et présenté dans BACHELIER Julien, « L’abbaye de Rillé... », art. cit. p. 29.(101) Sur les bourgs et les bourgeois, voir les travaux de MIYAMATSU Hironori, Bourgs et bourgeois dans l’Ouest de la France (XI e-XIII e siècles), thèse, Rennes 2, dact., 2 vol.(102) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 6H16 (original), acte publié MORICE Pierre-Hyacinthe (dom), Mémoires pour servir de preuves..., op. cit., col. 423-424 et « Actes de l’abbaye de Marmoutier concernant le prieuré de la Trinité de Fougères... », art. cit., p. 161-165.(103) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1F553, ce bourgeois possède un sceau (copies d’actes de l’abbaye de Savigny concernant le pays de Fougères ou données par les seigneurs de Fougères). (104) Un document inédit, conservé au château de la Haye de Saint-Hilaire permettrait toutefois d’avancer légèrement cette date, nous préparons actuelle-ment l’édition de cet acte, voir : BACHELIER Julien, « Un acte inédit de 1253 conservé au château de la Haye de Saint-Hilaire », dans Bulletin et Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Fougères, à paraître en 2012.(105) BERTRAND de BROUSSILLON Arthur (éd.), La maison de Laval (1020-1605), étude historique accompagnée du cartulaire de Laval et de Vitré, 5 vol., Paris, 1895-1903, acte n° 3209.(106) Le cartulaire de la seigneurie de la Fougères..., op. cit., acte n° 64.(107) LE BLÉVEC Daniel, La part du pauvre..., op. cit., p. 647.(108) LE BOUTEILLER Christian, Notes sur l’histoire de la ville et du pays de Fougères..., op. cit., t. 3, p. 68 et suivantes.(109) ibid., t. 3, p. 33 et suivantes.