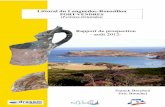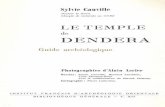La prospection archéologique dans le méthodes et résultats Cherbourg"'
-
Upload
univ-alger2 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La prospection archéologique dans le méthodes et résultats Cherbourg"'
Fig. 1
>Département de
la Manche : localisation
des sites mentionnés
dans le texte
(DAO O. Laurent/Inrap).
La prospection archéologique dans le méthodes et résultats
• FERMANVILLg
Cherbourg"'
PAR CAROLINE DUCLOS, LAURENCE JEANNE, NICOLAS NAVARRE, KARINE CHANSON, LUDOVIC LE GAILLARD ET LAURENT PAEZ-REZENDE AVEC LA COLLABORATION D'OLIVIER LAURENT
• MONTAIGU
riALOGNES
Reprenant le flambeau de Charles de Gerville (1769-1853), après plusieurs décennies de léthargie sur la période antique, des passionnés d'archéologie ont relancé une dynamique de détection du patrimoine archéologique dans le nord du Cotentin. Des tâtonnements de 1999 à la première campagne de sondages programmés de l'été 2002, menée en collaboration avec des archéologues de l'Inrap et avec le soutien du ministère de la Culture et du Conseil général du département de la Manche, diverses méthodes de prospection ont été expérimentées, permettant un renouvellement des connaissances sur ce secteur.
La prospection est une démarche de l'archéo-logie souvent peu valorisée mais pourtant à la base de la plupart des travaux de fouille pro-grammée et prise en compte par le service ré-gional de l'Archéologie dans l'instruction des dossiers d'urbanisme. Ainsi, la majorité des sites préhistoriques et historiques ayant fait l'objet d'une recherche archéologique dans le département de la Manche n'est pas le résultat de découvertes fortuites mais celui d'investi-gations méthodiques. Les campagnes de prospection sont pourtant délicates à mettre en place dans une région où le paysage bocager, dominé par des herbages et jalonné par des zones boisées ou des landes, n'est pas des plus propices à la détection des sites archéologiques. Ce dernier constat a mo-tivé une réflexion autour d'un cadre méthodo-logique adapté à la découverte des indices d'oc-cupations anthropiques préhistoriques et his-toriques dans ce type d'espace géographique (encadré A).
De la prospection-inventaire à la prospection thématique En 1999, débute une prospection archéolo-gique dans le nord du Cotentin, prospection aérienne avec vérification au sol essentielle-ment, suivant l'exemple des vols fructueux menés depuis une trentaine d'années dans plu-
sieurs régions de France. Le but est de complé-ter l'inventaire archéologique des communes, en liaison avec la cellule de la Carte archéolo-gique régionale du service régional de l'Ar-chéologie de Basse-Normandie, et de tester la méthode de prospection dans ces paysages do-minés par un bocage peu remembré. Cette opé-ration marque une pause en 2001, donnant un bilan mitigé : si la lecture des sites est souvent claire, elle reste la plupart du temps limitée aux parcelles cultivées, et l'inventaire ne progresse véritablement que par la prospection pédestre et les contacts pris à cette occasion. Parallèlement, une prospection thématique est
entreprise dès 2000 sur le site probable d'une ag-
o Archéopages n10 • Juillet 2003
Cherbourg
nord Cotentin 0 Le nord Cotentin aperçu du « bout du monde »
PAR MARIE DERREUMAUX
e « bout du monde »,
c'est ainsi que les Bas-
Normands, entre autres,
nommaient il n'y a pas
si longtemps encore le
Cotentin et sa capitale
emblématique Cherbourg.
Cette presqu'7e, bande de
terre large de 40 km entourée
par la Manche, est située entre
le Bassin parisien et le massif
Armoricain. Sa façade
orientale, laissant dans
ses deux tiers sud une large
place aux grandes plages
de sables, est tournée vers
l'embouchure de la Seine et
les petits estuaires de la côte
du Calvados ; la frange nord et
le littoral ouest sont nettement
plus découpés et présentent
une alternance de plages et de falaises, l'une faisant
face aux îles Britanniques
et l'autre s'ouvrant sur l'océan
Atlantique. Le paysage tumultueux
du tiers nord de la presqu'île
est le résultat de son entière
appartenance au massif
Armoricain ; partout on y rencontre les trois grandes
formations géologiques :
les schistes, les granites
et les roches cimentées (grès,
poudingues, conglomérats
triasiques). La topographie
de l'intérieur des terres s'en
ressent tout autant, avec un
relief aussi mouvementé que les profils côtiers. De Carentan
à Cherbourg comme de Saint-
Vaast-la-Hougue à Jobourg
se succèdent lignes de crêtes
et petites vallées où s'écoulent
nombre de cours d'eau qui,
à l'est et au centre-nord,
alimentent la Saire et la
Divette, principaux fleuves du
secteur, tandis qu'à l'ouest, ils
filent directement vers la mer.
Cette configuration hydrographique est une des
données intervenant dans la
scission du nord Cotentin en
deux • Pays » : le Val de Saire
pour la moitié est et la Hague
pour la moitié ouest. Une telle distinction est une
réalité morphologique, puisque
le Val de Saire, grâce à ses deux fleuves, possède des
espaces plus ouverts, surtout
dans les vallées, alors que
la Hague apparaît plus repliée
à l'intérieur de ses hautes
falaises. Le paysage est tout
aussi marqué entre ces deux
microrégions, la Hague, battue
par les vents froids venant
de l'Océan, développe de nombreuses landes
ou maquis et les terres
agricoles sont en majorité
à usage de prairies où
n'engraissent guère que des
moutons. Le Val de Saire
est à l'inverse abrité de
ces vents et la proximité
du Gulf Stream lui procure
un climat plus doux, atouts qui favorisent la culture
céréalière, le maraîchage
et l'élevage bovin.
Le couvert forestier
se développe à quelques kilomètres en retrait du littoral
et n'est aujourd'hui constitué
que de lambeaux disséminés
des anciennes forêts royales,
seigneuriales ou ecclésiastiques, qui couvraient
encore au début du xvi0 s. les
quatre cinquièmes du Cotentin
(d'après l'analyse du Journal
du sire de Gouberville).
proximité du site de Montaigu-
la-Brisette, le bois de
Barnavast est un bon exemple
de cet état de fait.
Mais le paysage qui domine cette presqu'île reste le
bocage, juxtaposition de
parcelles d'un hectare en
moyenne, closes de haies et
souvent dévolues à l'élevage.
Cette image des vertes prairies
de l'ouest de la France reflète
cependant une construction
parcellaire récente, très
éloignée des plans relevés aux
)(vie et xve s. Depuis la fin des années 50, les techniques
agricoles nécessitent des
remembrements qui modifient
le paysage bocager : ils sont
cependant très limités dans
cette partie de l'Ouest, et les
parcelles cultivées restent peu
nombreuses dans le Cotentin.
glomération secondaire antique, à Montaigu-la-Brisette. l'année suivante, c'est le site de Portbail, contemporain du premier, qui fait l'objet du même travail. Ces deux opérations participent d'une même réflexion méthodologique, initiée en 1998 sur le site antique d'Alauna (Valognes), visant à synthétiser les données disponibles sur de vastes sites présumés urbains (cf. infra). Enfin, ces opérations de prospection condui-sent en 2002 à deux recherches qui affinent et complètent les résultats des trois premières an-nées, à Fermanville et à Montaigu-la-Brisette.
Sur le premier de ces sites, une prospection pé-destre systématique des parcelles cultivées a permis d'étendre considérablement nos connaissances des occupations préhistoriques dans ce secteur (fig. 2). À Montaigu, la pour-suite des recherches a précisé notre perception d'un ensemble flou, juxtaposition de décou-vertes anciennes au sein d'un concept obscur de bourgade antique, issu de l'archéologie du xixe s. La démarche adoptée se place dans le prolongement de la méthode mise en oeuvre en 2000, et constitue une approche globale du
Juillet 2003 • Archéopages n°10
't4e
`'Mr4/00111MOV i rad,
-0
1500 m
APRES
%tee, ♦ er-
L_ (7)
MB Artefacts du Paléolithique
11111 Artefacts du Mésolithique
MI Artefacts du Néolithique Autres périodes
MI Artefacts de la protohistoire sens large
Fig. 2
Fermanville.
Évolution des résultats
de la prospection
centrée sur les
occupations
préhistoriques
(DAO L. Jeanne/GRAC).
site, considéré aujourd'hui comme une agglo-mération secondaire du Haut-Empire (fig. 3). Celle-ci a fait l'objet d'une campagne de son-dages l'an passé, porteuse de premiers résul-tats stratigraphiques, chronologiques et struc-turels fiables sur ce site.
Une convergence des techniques de prospection Que les recherches concernent des indices de toutes périodes, les difficultés d'approches inhé-rentes au contexte environnemental obligent à
développer des techniques peu utilisées et à adapter celles qui ont fait la preuve de leur ef-ficacité en d'autres lieux. Les programmes de recherche qui interviennent ensuite (sondages et fouilles programmées) servent alors aux pros-pecteurs à tester la validité de ce faisceau de techniques de prospections complémentaires. La convergence des moyens que l'on se donne et les réglages qui leur sont constamment ap-portés permettent d'optimiser la collecte et l'ana-lyse de données archéologiques sur un secteur déterminé.
Archéopages n°10 • Juillet 2003
0 200 m 1 Km
1 217 975
1 216 975
Hamea Touraine
. 1 215 975
Superficie estimée du site à l'issue de la première année de prospection thématique : les tiretés correspondent aux zones qui sont mentionnés des vestiges antiques dans la bibliographie. Le fanum représente l'unique bâtiment gallo-romain identifié.
1 214 975
S
1 217 975
1 216 975
1 215 975
1 214 975
s
N
Superficie estimée du site à l'issue de la deuxième année de prospection thématique : l'approfondissement des recherches permet d'être plus précis quant à la localisation et la nature du site. À côté d'un noyau d'occupation dense, correspondant sans doute à l'agglomération secondaire, trois sites indépendants se dessinent, dont un probable atelier de tuiliers.
Fig. 3
ic7ritaigu-la-Brisette.
Évolution des résultats
de la prospection
sur le site antique
(DAO O. Laurent,
L. Le Gaillard/Inrap).
Juillet 2003 • Archéopages n°10 •
La prospection aérienne : le point de vue d'un pilote
PAR PIERRE DUBOST*
es vols programmés pour
effectuer une observation
aérienne nécessitent de
réunir impérativement
plusieurs conditions :
- un avion adapté ;
- une météo favorable ;
- un briefing détaillé des sites à
survoler;
- une bonne forme physique de
l'équipage.
À l'évidence l'avion utilisé ne
peut sortir du domaine autorisé
par le constructeur aussi bien
pour le nombre de passagers
que pour la masse totale
admise au décollage. Des
Robin DR 400, 108 cv, 120 cv
et 160 cv ont tour à tour permis
d'effectuer ces vols de
prospection. Ces avions
présentent l'avantage de voler à
des vitesses relativement
faibles en toute sécurité
(140 km/h) pour faciliter les
prises de vues, sachant que la
vitesse de croisière normale est
proche de 200 km/h. Ces
avions à ailes basses donnent une excellente visibilité grâce à
un cockpit constitué d'une
verrière entièrement
translucide. Seul défaut,
l'emplacement de l'aile basse
implique d'incliner l'avion
fortement pour faire une prise
de vue correcte. Ce type de vol dont les
trajectoires sont rarement en
lignes droites n'est pas
confortable pour un équipage
occasionnel (ce qui n'est plus le
cas). Les virages consécutifs
d'un bord sur l'autre, plus ou
moins serrés, plus moins
inclinés, créent des sensations
assez désagréables à
l'équipage, ce qui implique un
pilotage souple tout en
surveillant régulièrement le
comportement de l'équipage.
Au moment de la prise de vue,
l'avion est incliné à plus de 45°
pour obtenir un cliché presque
vertical et pour limiter certains
effets de reflets dus à la
verrière. Des passages
circulaires successifs
s'imposent parfois pour se
positionner correctement en
hauteur et selon le meilleur
angle d'éclairage.
Les conditions
météorologiques sont
essentielles pour mener à bien
ces prospections. Un beau
temps apparent au sol est
parfois décevant en vol. Malgré
un ciel dégagé, on voit très
fréquemment que la visibilité en
vol est dégradée donnant
l'impression d'un
environnement embrumé, la
luminosité naturelle produit un
effet de brillance rendant
quasiment impossible des
prises de vues de qualité. Le
vent turbulent est à éviter :
c'est d'une part impressionnant
pour l'équipage et d'autre part
les prises de vues relèvent de
l'exploit. Le choix de l'heure et
la position du soleil doivent être
pris en compte en fonction
des sites à survoler. La hauteur
des survols doit rester
réglementaire, une hauteur
de 1 000 pieds (300 m) - voire
supérieure tout en réduisant la
puissance pour éviter les
nuisances sonores au sol - est
en permanence respectée.
Avant chaque départ un briefing complet est de rigueur
pour définir exactement le
circuit et pour optimiser le vol.
Les points particuliers à
observer sont parfaitement
répertoriés sur une carte au
1/25 000, ce qui est
particulièrement difficile à gérer
en avion. Pour donner une idée
de la difficulté, à la vitesse
normale de l'avion chaque
minute de vol représente
un déplacement de 12 cm sur
ce type de carte. Une bonne
connaissance de la cartographie
locale, la localisation
de toutes les communes
des zones à survoler,
l'orientation intuitive
sont des atouts indispensables
pour le pilote. Il faut savoir
que l'égarement est la hantise
de la plupart des pilotes
peu expérimentés.
En vol, un navigateur en place
arrière observe et essaie
de suivre le déplacement
de l'avion afin de positionner
des sites susceptibles
d'intérêt sur sa carte IGN.
Le pilote profane et la prospection aérienne Bien connaître sa région est un
point essentiel pour être
suffisamment disponible dans
le pilotage et accorder un peu
d'attention à tout ce qui entre dans certains critères dignes
d'intérêt à observer. La curiosité pour des vieilles
pierres, l'aspect culturel, le
côté « découverte » sont autant
d'éléments qui invitent à
prendre part à l'action. Le
pilote n'a pas en général trop
l'esprit disponible pour
observer des taches dans les
champs, des formes
géométriques - à peine
perceptibles qui plus est -
visibles un jour et invisibles un
autre jour. Le pilotage demande
beaucoup d'attention et ne
tolère pas trop la distraction. La
sécurité du vol est une
obligation permanente.
Ce type de vol apporte une
nouvelle vision de notre région.
Le contact avec des
passionnés de cette activité
bien documentés donne l'envie
de participer concrètement à
ces prospections. Le regard sur
le sol, vu d'en haut, prend une
autre dimension. Ce qui
paraissait un banal panorama
« défilant » aérien se transforme
parfois en « lecture » du sol
complètement différente. Un alignement de chemins, de
routes et traces rectilignes
laissent tout de suite penser
peut-être à une ancienne voie
romaine. Des formes
rectangulaires à demi
apparentes dans des parcelles
cultivées sont à coup sûr des
traces d'anciennes constructions sans pour cela
remonter à l'Antiquité. Sachant
aussi que la Seconde Guerre mondiale a aussi laissé des
stigmates considérables dans
notre bocage, des ruines
ensevelies, des champs
d'aviation...
En conclusion, le pilote n'est
pas déçu de cette expérience,
qui apporte un plus à sa petite
culture archéologique, et
apprécie le formidable travail
de synthèse que réalise
l'équipe de bénévoles associée
à des professionnels dont le
compte rendu est de qualité.
*pilote à l'aérodrome
de Cherbourg-Maupertus
Montaigu-la-Brisette. Bâtiment (antique ?) révélé par un déficit de pousse (cliché L. Jeanne/GRAC).
Archéopages n°10 • Juillet 2003
Fig. 4
Saussemesnil. Ferme
indigène romanisée ;
à l'enclos « indigène »,
au centre,
pourrait succéder
une occupation
gallo-romaine, dont
un bâtiment est visible
en bas du cliché (cliché
L. Jeanne/GRAC).
La prospection aérienne est la première technique utilisée dans le nord Cotentin au cours de nos opérations (encadré B). Dans cet espace, la va-riété et l'alternance du couvert végétal ou la densité d'urbanisation, associées au maillage étroit du parcellaire actuel, n'offrent souvent qu'une image diffuse et partielle des structures archéologiques. Les occupations variées qui ja-lonnent l'histoire de l'humanité ne répondent pas de la même manière à la détection visuelle. À cela s'ajoutent les conditions climatiques cumulées sur de longues périodes qui favori-sent ou non la transparence des sites. D'où la nécessité plus qu'ailleurs de passages répétés et échelonnés sur plusieurs saisons et années pour compléter les données. Reste malgré tout que certaines implantations humaines demeu-reront toujours inabordables par ce procédé d'investigation. l'étude comparée entreprise pour le nord Cotentin confirme ces contingences. La photo-graphie d'une probable ferme indigène roma-nisée découverte sur la commune de Sausse-mesnil (fig. 4), à quelques kilomètres du site antique de Montaigu-la-Brisette, offre une vi-sion disloquée de l'établissement. Cette image incomplète, amplifiée par la fugacité de certains indices, nous a obligés à un survol fréquent de la zone. En revanche, les repérages sur Mon-taigu-la-Brisette ont montré les limites de l'achar-nement puisque la qualité de l'information sur les mêmes indices n'a pas varié d'une année sur l'autre. Sur le site antique de Portbail, c'est le taux d'urbanisation, même lâche à l'emplace-ment des vestiges, qui masque ou perturbe la détection parce qu'il morcelle l'espace de pros-pection et détourne l'attention pendant le vol : notre vue se focalise sur les éléments concrets que sont les constructions contemporaines, en opposition aux anciennes qui n'apparaissent toujours qu'en filigrane. Techniquement, quand l'environnement est pro-pice, les reconnaissances à basse altitude sont les plus efficaces. Mais l'incertitude demeure, et une vérification au sol est indispensable à la construction des hypothèses structurelles et chronologiques.
La prospection de surface est donc indissociable des survols. Le secteur étudié, commune ou zone plus restreinte, doit intégralement être cou-vert par les observations pédestres afin de poser un filtre supplémentaire dans la prise en compte ou, au contraire, le rejet des anomalies. Chaque parcelle doit bénéficier des mêmes exigences de
recherche. Les investigations planimétriques sont très riches en enseignements archéolo-giques, notamment en terme de répartition spa-tiale des occupations. Cependant, cette ap-proche n'est pas sans soulever quelques pro-blèmes d'ordre méthodologique. Laccessibilité à la documentation est conditionnée par la na-ture du sol et la profondeur du labour. Même si les exigences de ramassage sont identiques, les terrains prospectés ne peuvent pas bénéfi-cier des mêmes facilités d'accès à l'information. D'autre part, le matériel collecté en surface des labours est déconnecté de son contexte strati-graphique et fonctionnel. Si le mobilier histo-rique, assez caractéristique, peut souvent être rattaché à une période relativement précise, le matériel lithique notamment postpaléolithique, parfois assez atypique dans notre département, peut rester sans attribution chronoculturelle précise. En revanche, pour ces indices d'occupation, la prospection pédestre est une alternative à son invisibilité en altitude, comme ce fut le cas à Fermanville. Pour certains sites, une cohésion chronologique de l'ensemble peut être apportée par la collecte de mobilier en surface des labours. Les tessons de céramique, le plus souvent fragmentés et al-térés, constituent néanmoins nos premiers mar-queurs chronologiques. Ainsi, l'abondant mo-bilier collecté à Montaigu-la-Brisette, dominé par une céramique en assez bon état, fait ap-paraître une forte proportion d'indices inscrits dans une fourchette chronologique allant de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. au début me s. Cette datation a d'ailleurs été confirmée par les résultats des premiers sondages archéologiques
Juillet 2003 • Archéopages n°10
Q
Montaigu-la-Brisette.
Aménagements de
briques, tuiles et pierres
dans le lit d'un cours
d'eau, partiellement
démantelés lors d'un
curage. Ces
aménagements ont fait
l'objet d'un sondage en
2003 qui a confirmé la
structuration et la
chronologie de cette
découverte fortuite,
issue de la propection
pédestre (cliché
L. Jeanne/GRAC).
Fig. 5
(fig. 5). Les récoltes de mobilier sur l'occupa-tion antique de Portbail — qui n'a pas encore fait l'objet de recherches plus approfondies — sont plus imprécises bien que numériquement com-parables.
L'enquête orale apporte également une meilleure connaissance des zones temporairement ou dé-finitivement inaccessibles à la prospection. Ces derniers secteurs concernent notamment les prairies ou les zones partiellement ou totale-ment détruites par des aménagements. Cette
approche est très utile dans les secteurs de forte urbanisation, tel que Portbail, où elle suppléait souvent à la prospection de surface devenue impossible dans ce contexte. Seule l'enquête orale, soumise au regard plus ou moins sub-jectif du déclarant, serait encline à livrer des informations permettant de mieux comprendre un site plus ou moins détruit. C'est en tout cas un des moyens que nous avons utilisés pour déterminer les limites de l'occupation antique de Portbail/Gouet, majoritairement scellée sous les constructions contemporaines. Notons qu'ici la tradition orale place sur le plateau une ville haute, et en contrebas, idéalement placée pour les échanges maritimes, une ville basse ; les données de la carte archéologique ou des prospections convergent dans ce sens. D'autre part, l'enquête orale permet d'appré-hender les traditions locales susceptibles de li-vrer des informations archéologiques. Ces tra-ditions, qui véhiculent régulièrement des faits qui prêtent à sourire, témoignent parfois de fondements crédibles pouvant aiguiller l'ar-chéologue dans sa recherche. Une tradition an-crée à Montaigu-la-Brisette depuis des siècles situe précisément au hameau Dorey un village romain qui aurait porté le nom de Venise. En souvenir de cette ancienne occupation, une route traversant le site a été baptisée « rue de Venise ». Le bon sens nous contraint bien évi-demment à mettre de côté l'aspect poétique de la référence à la ville italienne et à envisager une explication étymologique : « Venise »
Fig. 6
Montaigu-la-Brisette.
Fût de colonne
découvert fortuitement
pendant les labours.
La communication
de cet objet, sorti il y a
plusieurs années et
mis au rebut depuis
lors, est le résultat
de l'enquête orale
menée depuis trois
ans sur le site. Le lieu
de sa découverte
confirme la localisation
du • noyau urbain »
de l'agglomération
antique (cliché
L. Jeanne/GRAC).
Archéopages n°10 •
e L'analyse des données et leur prise en compte dans la gestion du patrimoine
PAR DOMINIQUE CLIQUET'
es prospections conduites dans
le nord Cotentin ont permis de
tester de nouvelles méthodes
d'investigations, jusqu'alors peu,
voire pas, usitées en Basse-
Normandie. Ces prospections se
sont organisées autour de
plusieurs thématiques, induites soit
par des interrogations soit par des
« vides » d'occupations humaines
dans certains espaces.
La finalité de ce travail était, en
premier lieu, de documenter la carte
archéologique dans des espaces
peu propices aux découvertes
fortuites et aux opérations
d'archéologie préventive (espaces
ruraux, faible urbanisation, faible
développement économique,
absence de développement du
réseau routier et surtout
environnement bocager).
En effet, ces zones, en principe peu
propices aux découvertes, peuvent
avoir été le théâtre d'un intense
peuplement depuis la Préhistoire
ancienne, comme l'attestent les
investigations menées dans le Pays
d'Ouche qui couvre les
départements de l'Orne et de l'Eure.
Néanmoins, la documentation
apparaît très déséquilibrée de part et
d'autre de la limite administrative des
deux départements. Les sites se
révèlent nombreux dans l'Eure, en
raison d'une tradition de recherche
qui remonte au xixe s., à la différence
de ce qui s'observe dans l'Orne,
alors que les conditions
environnementales sont les mêmes.
Tous ces éléments laissaient
supposer un important patrimoine
non attesté et a fortiori non avéré.
Deux axes principaux
d'investigations ont été privilégiés.
Le premier s'oriente vers la
recherche d'occupations
protohistoriques et historiques par le
biais des prospections aériennes,
pédestres, des recherches
bibliographiques et des enquêtes
orales. Ces investigations ont mis en
évidence des structures bâties
inédites, par photographies
aériennes et observation de la
microtopographie, tant en contexte
d'herbage qu'en milieu boisé.
Les vérifications au sol ont permis de
préciser le contexte chronologique
de certaines occupations,
notamment avec l'observation
systématique des excavations et la
« fouille » des taupinières.
Ces travaux ont motivé la conduite
de sondages sur le site gallo-romain
de Montaigu-la-Brisette, visant à
préciser la nature des vestiges, leur
état de conservation et la profondeur
d'apparition des structures et des
sols, puis à tenter une cartographie
de l'ensemble de l'espace par
sondages manuels pratiqués à la
tarière.
Cette méthode, longue et
harassante, permet de circonscrire
les zones de grande densité de
vestiges, de préciser l'existence
d'anomalies, telle la présence de
matériaux durs probablement issus
de constructions...
Cette approche multiple a précisé
« l'empâtement » de l'agglomération
antique de Montaigu-la-Brisette et
induit d'autres questions,
notamment la place occupée par
cette ville « secondaire », à 7 km de
Valognes (Alauna), dans la gestion
du territoire des Unelles. Le second
axe consistait à préciser la nature
des occupations pré et
protohistoriques sur la commune
littorale de Fermanville dans le Val de
Saire. De nombreux vestiges
archéologiques sont répertoriés sur
la façade maritime de la commune,
toutes périodes confondues.
La problématique consistait à tenter
une prospection systématique sur
l'ensemble des espaces accessibles
de la commune, puis de préciser la
nature du contexte sédimentaire des
éventuelles occupations par une
cartographie des sondages manuels
pratiqués à la tarière sur l'ensemble
des parcelles.
Cette analyse a permis d'effectuer
un parallèle avec les sites trouvés en
stratigraphie en micro falaise et,
fréquemment, d'expliquer la
présence ou l'absence de vestiges
de périodes déterminées dans des
secteurs bien circonscrits, en
fonction de la nature des sédiments,
de leur épaisseur, voire de leur
quasi-absence.
Ces deux opérations de prospection
se sont révélées très riches
d'enseignement non seulement pour
les démarches mises en oeuvre, mais
encore pour la connaissance des
peuplements de l'occupation de
l'espace et des potentialités des
sites comme Montaigu-la-Brisette et
Portbail ; enfin, en révélant des
occupations pré et protohistoriques
à l'intérieur des terres de la
commune de Fermanville. Ces
investigations contribuent à affiner
notre connaissance du patrimoine
enfoui et documentent la carte
archéologique du département de la
Manche. Elles permettent de
procéder à des opérations de fouilles
programmées et participent à
l'élaboration des dossiers
d'archéologie préventive. De ce fait,
ces prospections méritent d'être
reconduites et développées dans
tous les espaces peu accessibles :
bocages, zones fortement
urbanisées, terres où le « droit du sol »
peut être une entrave aux
investigations lourdes.
*Conservateur du patrimoine au service
régional de l'Archéologie
de Basse-Normandie
Juillet 2003 • Archéopages n°10 co
pourrait provenir de la légendaire sainte Venice ou sainte Véronique, patronne des lingères et des laveuses, dont la première mention date du ve s. Si cette tradition ne remonte pas à l'Anti-quité, elle pourrait en revanche révéler la pré-sence d'une chapelle disparue, ou, plus ordi-nairement, d'un lavoir. Si certaines idées per-pétuées sont inutilisables, d'autres ne sont donc peut-être pas sans fondement. L'enquête orale nécessite une présence impor-tante sur le terrain où se créent des liens entre archéologues et habitants, propriétaires ou exploitants agricoles. Souvent, c'est un véritable réseau d'informations qui se forme. Ainsi, une grande partie des données nouvelles collectées en 2002 sur Montaigu-la-Brisette ont-elles cette origine : mentions de découvertes fortuites (fig. 6), prêts de céramique ou d'autres vestiges, sont autant d'éléments qui affinent notre connaissance, mais qui n'auraient pas été connus sans la présence presque hebdomadaire de bénévoles sur le terrain.
Les sources bibliographiques mentionnant des sites archéologiques abondent dans les bases de données informatisées. La somme de don-nées exploitables concernant la mise en évi-dence de sites antiques dans le Cotentin ap-partient à une documentation des xvme et xixe s. essentiellement issue des travaux menés par Ch. de Gerville. Cet antiquaire a développé une méthodologie relativement novatrice intégrant
un relevé sur fond cadastral des concentrations de débris romains. Ces plans compilent les ré-sultats de prospections et de découvertes for-tuites signalées par des particuliers. Il semble-rait toutefois que certaines de ces informations aient été exploitées sans avoir fait l'objet de vé-rifications scientifiques. Économie de recher-ches qui perdure dans certains écrits contem-porains. Dans ce contexte, le retour aux sources est pri-mordial et doit systématiquement s'accompa-gner d'une vérification de terrain. Véritable clé de voûte des prospections thématiques menées sur Montaigu-la-Brisette, Valognes ou Portbail, l'inventaire bibliographique est cautionné par une véritable approche critique. Une fois véri-fiée et validée, la documentation peut bénéficier de l'apport des découvertes qu'elle a su fédérer. À noter toutefois que cette dialectique essen-tielle entre l'étude de la bibliographie ancienne et l'intervention de terrain est plus délicate à mettre en place dans le cadre des recherches en Préhistoire, où les monuments mégalithiques sont bien souvent les seuls vestiges mention-nés dans les documentations antérieures aux xvme et me s. Si cette méthode a été peu effi-cace dans la découverte d'occupations préhis-toriques sur la commune de Fermanville, elle a permis dans le secteur de Montaigu-la-Bri-sette la redécouverte d'une inscription antique utilisée en remploi dans une chapelle médié-vale (fig. 7).
Fig. 7
Teurthéville-Bocage/
Prieuré de Barnavast.
Bloc portant une
inscription (VL[...]AC),
réemployé dans une
chapelle médiévale
(cliché L. Jeanne/GRAC).
Archéopages n°10 • Juillet 2003
Fig. 8
Résultat
de la prospection
électrique sur le site
d'Alauna (Valognes).
Sur la voirie antique,
dont les bandes de
circulation sont
électriquement très
résistantes, s'appuient
les fondations
de bâtiments,
sans doute en partie
recouverts de couches
de destruction.
À l'écart de ces
zones résistantes
apparaissent de larges
secteurs non bâtis,
révélés par la grande
conductivité du sous-
sol (DAO Terra Nova).
149
tal
00111
0
t90
110
150
150
110
109
110
173
To
50
Les relevés microtopographiques, s'ils ne révèlent pas de données nouvelles, permettent au moins de mettre en évidence des faits quelquefois à la limite de la perception visuelle. Linterpréta-tion en reste cependant délicate, et dans tous les cas dépendante de l'utilisation de la parcelle relevée. Seuls des secteurs intacts ou présup-posés tels — des forêts ou des landes actuelles ou récemment disparues — sont susceptibles de révéler des microreliefs anciens. Ce qui pré-serve le sol ne nous est pourtant pas toujours favorable, puisque le couvert forestier ne per-met de faire des relevés qu'en hiver. Ainsi en est-il d'un probable atelier de tuiliers antique connu par l'enquête orale aux abords du site de Montaigu, dans le bois de Barnavast. Il se signale par de forts reliefs, constitués en partie par des tuiles et des briques surcuites et déformées, mais aucun relevé n'a pu en être fait jusqu'à présent.
La prospection géophysique a été expérimentée à ce jour sur le seul site d'Alauna (Valognes). Menée par la société Terra Nova, elle a fait appel
aux techniques électriques et magnétiques, partiellement superposées. L'objet de ce pre-mier test était méthodologique et archéolo-gique : il s'agissait en premier lieu, et sur une surface limitée à 2 ha, d'en mesurer la perti-nence par rapport au couvert sédimentaire pré-sent au-dessus des couches archéologiques, puis de comparer l'efficacité des deux tech-niques ; et, enfin, sur un plan strictement ar-chéologique, de vérifier des hypothèses concer-nant la trame viaire du site et les substructions antiques. La technique magnétique se révélant peu adaptée à la détection de ces dernières, l'utili-sation de la prospection électrique seule s'est imposée (fig. 8). Limage obtenue est tout à fait lisible. D'un point de vue archéologique par contre, les résultats se sont montrés très miti-gés : la trame viaire, dont deux voies orthogo-nales sont connues par la photographie aérienne, ne semble pas se densifier davantage ; la vue des fondations est plus floue et induit certainement une longue évolution du bâti antique et la pré-sence d'importantes couches de destruction.
Juillet 2003 • Archéopages n°10
À la suite de cette expérience, la multiplication des prospections géophysiques sur des surfaces limitées peut être considérée comme une al-ternative satisfaisante entre la prospection et les sondages. Nous avons vu en premier lieu les limites des méthodes prospectives en mi-lieu bocager, qui livrent peu de données quant à la structure du site : seules les grandes voies peuvent éventuellement être mises en évidence, et il n'a jamais été possible de produire une image nette de substructions à Portbail, Mon-taigu ou Alauna par ces techniques. Par ailleurs, il est évident que les sondages ou les fouilles ne peuvent s'étendre à l'ensemble d'un site aussi vaste. Au contraire, la prospec-tion électrique révèle, au sens photographique du terme, le réseau viaire et les substructions, sans pour autant nécessiter une fouille longue et destructrice. C'est aujourd'hui le meilleur compromis entre les exigences des archéo-logues, scientifiques et patrimoniales, et celles des propriétaires et des exploitants.
Les sondages à la tarière manuelle achèvent l'énu-mération et la critique des méthodes de pros-pection. Précisons que si leur utilisation sur les sites préhistoriques est relativement courante et féconde, elle l'est beaucoup moins sur les oc-cupations antiques. Pourtant l'expérience menée cette année sur Montaigu prouve que cette technique, laborieuse et limitée en terme qualitatif pour apprécier les aspects structurels et chronologiques, reste pertinente dans la dé-tection des éventuels niveaux d'occupation. Elle permet aisément d'apprécier la profondeur des vestiges antiques et la nature des couches sous-jacentes par échantillonnage. Les premiers résultats obtenus contribuent à mieux connaître l'extension du site, sans pour autant en préci-ser la forme ni la manière dont les espaces ont été aménagés par l'homme. La fiabilité des ré-sultats issus des campagnes à la tarière demande à être validée par l'intermédiaire de sondages ar-chéologiques en même temps qu'elle les oriente. Cette technique permet en outre d'éviter le re-cours aux sondages mécaniques destructeurs et parfois choquants pour les populations locales, en particulier dans des zones stériles.
La convergence de toutes ces techniques d'in-vestigation permet indéniablement l'apport d'une somme très importante de données. Il faut dans un deuxième temps synthétiser cette masse d'informations, qui doit comprendre en outre le dépouillement de la bibliographie et
de l'iconographie. C'est l'objet de la base de travail mise en place pour les sites d'Alauna, Montaigu et Portbail.
Vers une approche globale des sites Une prospection seule ne peut rendre compte de l'état des connaissances d'un site. Il importe d'intégrer à la réflexion archéologique l'en-semble des données, collectées dès la fin du xvne s. à Alauna, et le plus souvent à partir du xnce s., jusqu'aux opérations de fouille récentes. En outre, de nombreuses sources iconogra-phiques méritent également d'être jointes à une documentation conçue comme la base des tra-vaux à venir. Soumise à des soucis de fiabilité, afin d'élimi-ner les interprétations et les erreurs nées des écrits postérieurs, et d'exhaustivité, cette base de travail revêt une forme détaillée et synthé-tique. Elle comprend en effet un fonds docu-mentaire et son inventaire, ainsi que des syn-thèses bibliographiques (chronologie des fouilles, index des découvertes) et cartogra-phiques (plans de répartition des mobiliers et plans compilatoires, sur fond cadastral actuel). Le but est de disposer en permanence de trois moyens d'accès à la même information : le do-cument original, sa critique et sa traduction graphique sur le plan compilatoire. Ce dernier utilise les possibilités du logiciel Adobe Illus-trator : chaque type de données fait l'objet d'un calque, qu'il est possible d'afficher ou de mas-quer. Cet ensemble de données, portées sur un unique plan général, vise à permettre une ap-proche globale du site. Globalité archéologique bien entendu, mais également géographique ou historique, aux sens les plus larges. La réunion sur un seul plan de toutes ces informations, toujours accessibles sous deux autres formes, permet de les com-parer et de les croiser. À la différence des bases de données informatisées, cette procédure de compilation repose sur une visualisation per-manente des données et, surtout, sur leur spa-tialisation.
Des résultats substantiels Les campagnes de prospection dans le Cotentin, comme dans d'autres départements, ont pour objectif de créer une base préalable au travail de sondage et de fouille, ainsi qu'une première approche dans la gestion du patrimoine. La démarche développée, astreignante et la-borieuse, est l'une des plus adaptées à la re-
C/)
C.)
C. W
DC
o Archéopages n'IO • Juillet 2003
w
C—)
w
CC
Archéologie préventive sur un terrain de prospection : le cas d'Alauna (Valognes)
e projet de
construction d'une
écurie à proximité de
la ferme du Bas-
Castelet, à Valognes
(Manche), a donné
lieu à un diagnostic
archéologique en 2002, sur
une surface de 400 m2. Plus
que son emprise, c'est
évidemment le voisinage
archéologique du projet qui a
motivé cette intervention. La
connaissance de ce contexte
est le fruit des recherches
menées au début des années 1990 par T Lepert, et en 1998
et 1999 par L. Le Gaillard et
N. Navarre.
L'écurie occupera le flanc d'un
large talweg qui s'étend du
coeur du site vers le nord.
Immédiatement à l'ouest et au
sud sont connues deux zones
de bâti antique. A 100 m vers
l'ouest, un ensemble de
substructions gallo-romaines a
été relevé et rapidement sondé en 1981. Ces murs affleurent
sous la terrasse et le potager du Bas-Castelet. Au sud du
talweg, à 200 m du sondage,
la zone de bâti antique est
parfaitement identifiée grâce à
la prospection électrique
menée en 1999. Deux rues
orthonormées sont bordées de
constructions : la lisibilité de
ces vestiges indique des
remaniements du bâti durant la
période gallo-romaine et un
bouleversement probable des
couches supérieures du site.
Enfin, il se peut qu'un sondage
effectué vers 1850 ait touché
le secteur est du talweg : des
substructions légères y ont été
découvertes, se rapportant à
un ou deux petits bâtiments
antiques.
Le récolement de toutes les
informations concernant le site
antique, initié en 1990 et mené
à bien en 1998, a permis la
définition d'un périmètre
englobant 35 ha : il correspond à une extension
maximale. Ce périmètre est
bien inférieur aux terrains
préservés de l'urbanisation par
le POS de 1981, élaboré à
l'époque avec l'aide des
archéologues de la
circonscription des Antiquités historiques. On ne peut donc
prétendre que ces recherches récentes concourent à la
protection du site. Elles
guident cependant
l'archéologue qui intervient à
Valognes dans le cadre d'un
diagnostic, en mettant à sa
disposition l'ensemble des
données, brutes et analysées,
et une cartographie précise
des découvertes. Outil
précieux certainement,
appréciable du moins,
puisqu'il s'agit ici d'aborder
une ville antique.
Contrairement aux attentes, le
sondage effectué près du Bas-
Castelet n'a révélé ni voirie ni
substruction. Sous un épais
niveau de remblais contenant
des moellons, des tuiles et de
la céramique gallo-romaine,
une vingtaine de fosses et de
tronçons de fossés ont été
repérés. Il semble que le
talweg n'ait été occupé que
par des jardins et des
constructions légères, puis
remblayé après la destruction
de bâtiments voisins.
Sur un site comme celui
d'Alauna, probable ville
antique protégée par les prés
et les haies, très peu exploré,
la connaissance archéologique est le fruit d'aller et retour
entre des opérations d'archéologie préventive et la
recherche programmée. Les
données alimentent une même
base de travail, une même
histoire.
cherche de sites archéologiques en contexte bo-cager et participe pleinement à une meilleure connaissance de l'occupation humaine depuis la Préhistoire. Une telle méthode permet d'étof-fer de manière substantielle les indices enre-gistrés sur le secteur prospecté et surtout de développer une stratégie patrimoniale adaptée, dans un souci de préservation des sites avérés ou potentiels. Les résultats obtenus dans un es-pace géographique difficile laissent présumer l'impact qu'aurait une telle méthode dans un
contexte plus propice à la détection des sites archéologiques.
Caroline Duclos, Laurence Jeanne Groupe de recherches archéologiques du Cotentin (GRAC) Mairie, avenue de Couville, 50460 Querqueville
Karine Chanson, Ludovic Le Gaillard, Laurent Paez-Rezende, Olivier Laurent Inrap, boulevard de l'Europe, 14540 Bourguébus
Juillet 2003 • Archéopages n°10 ce